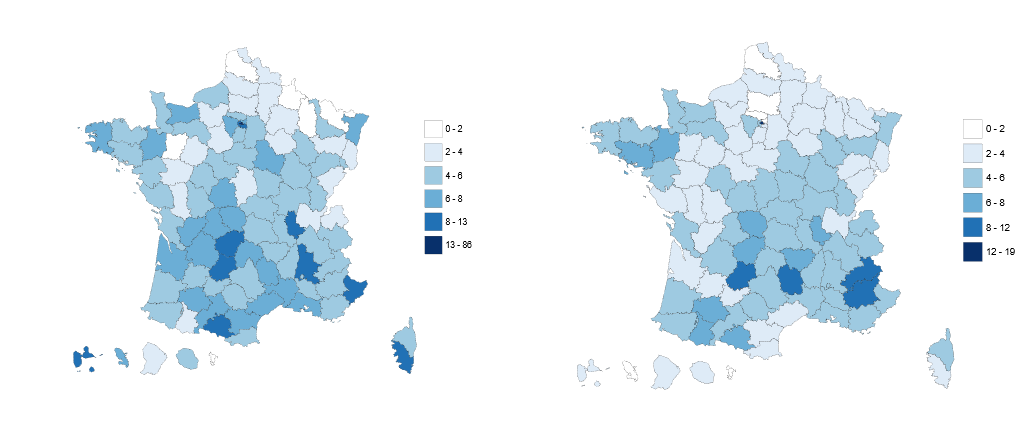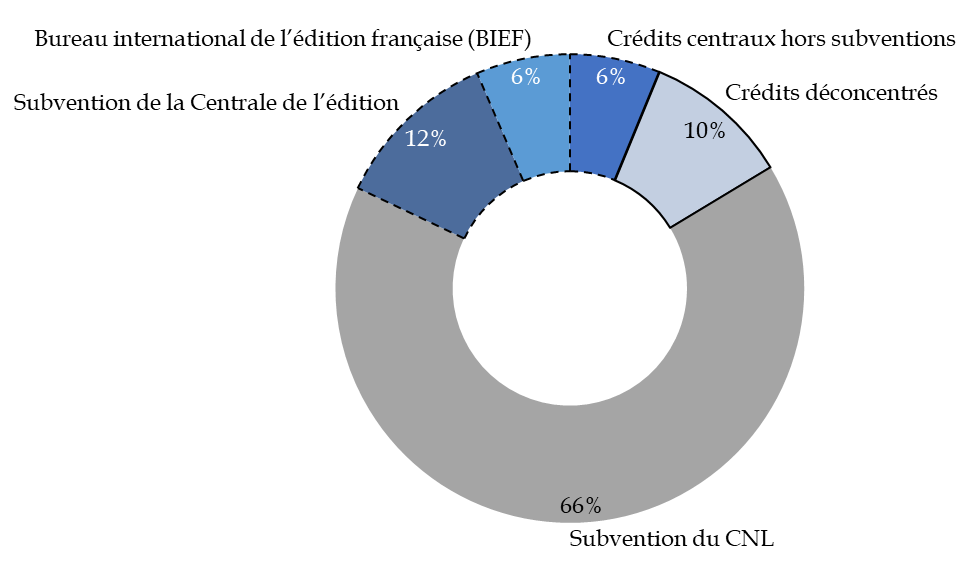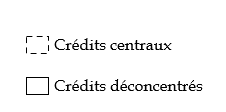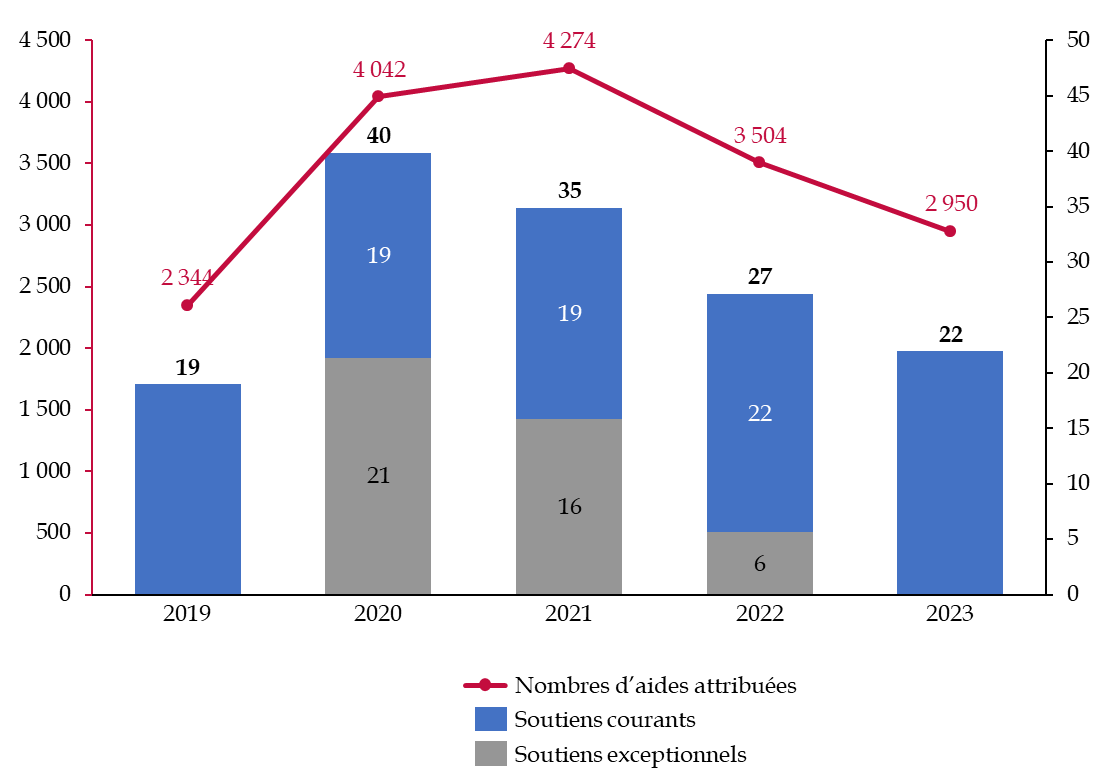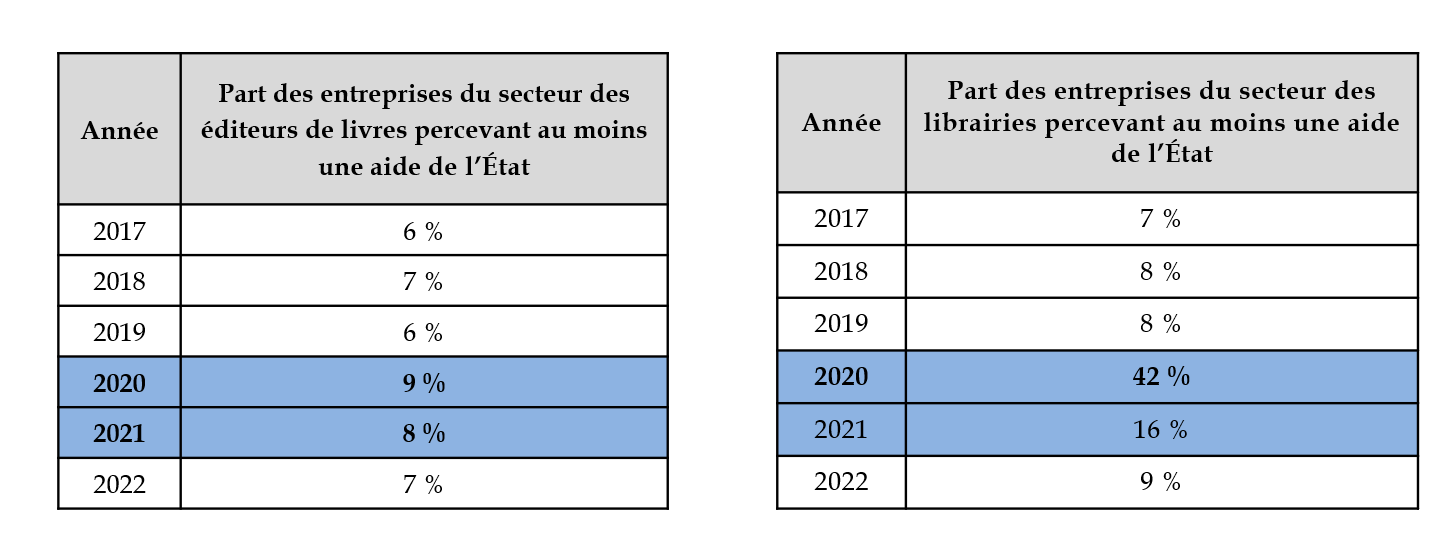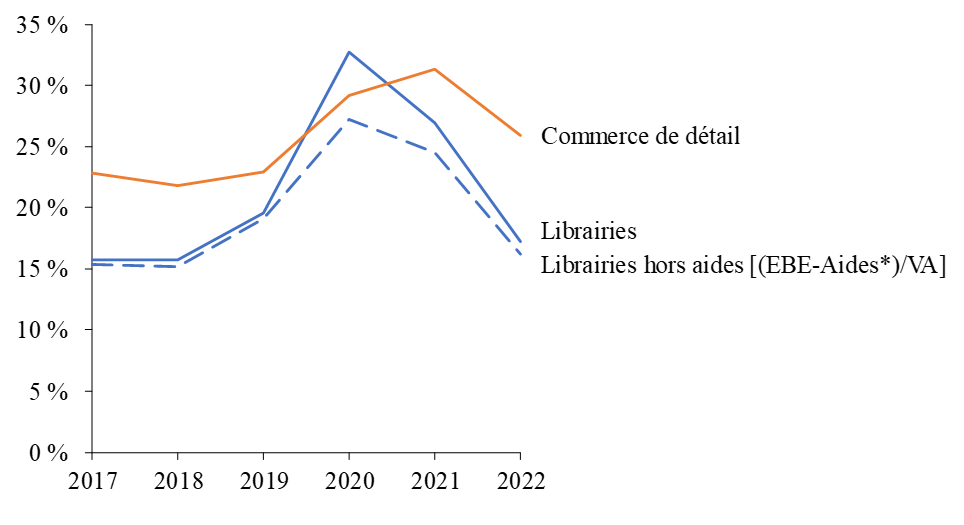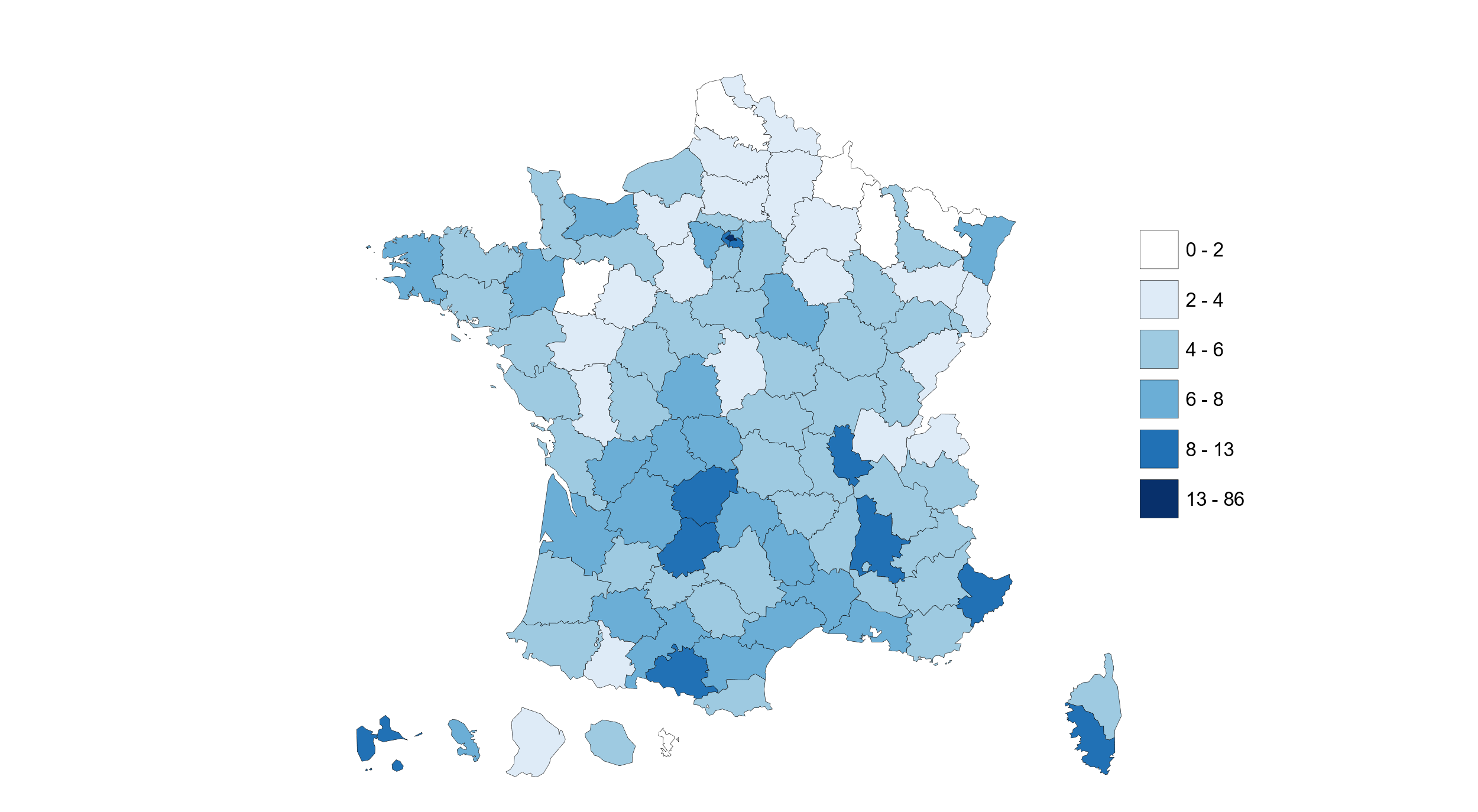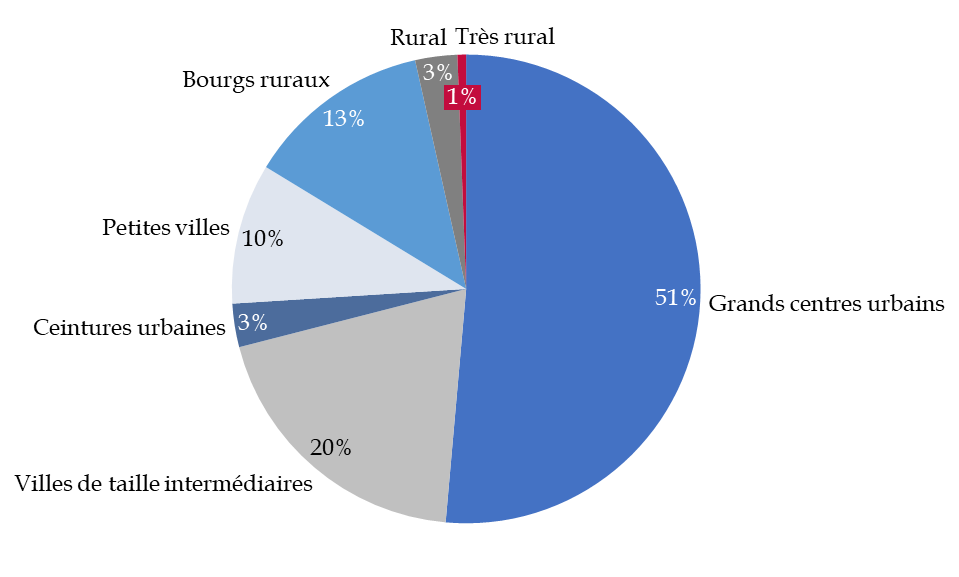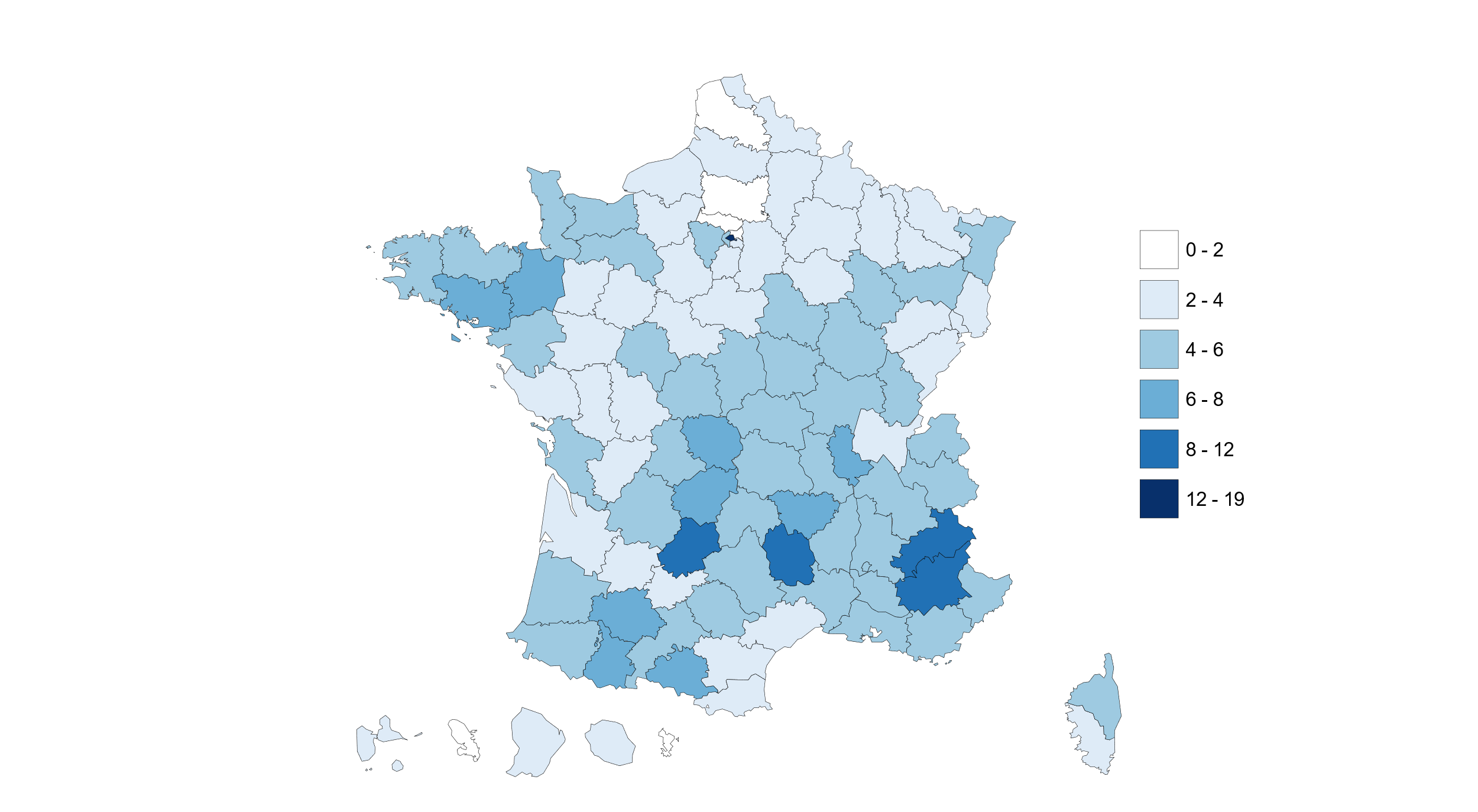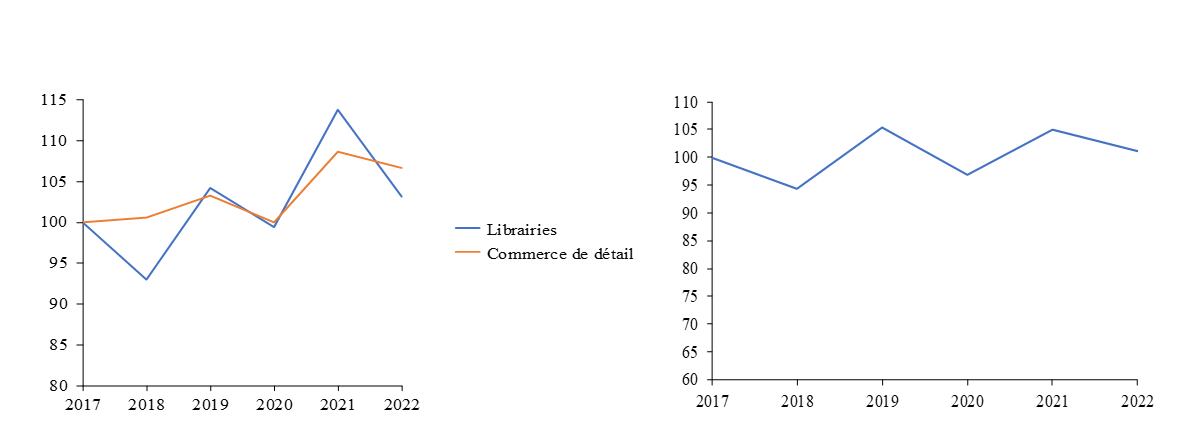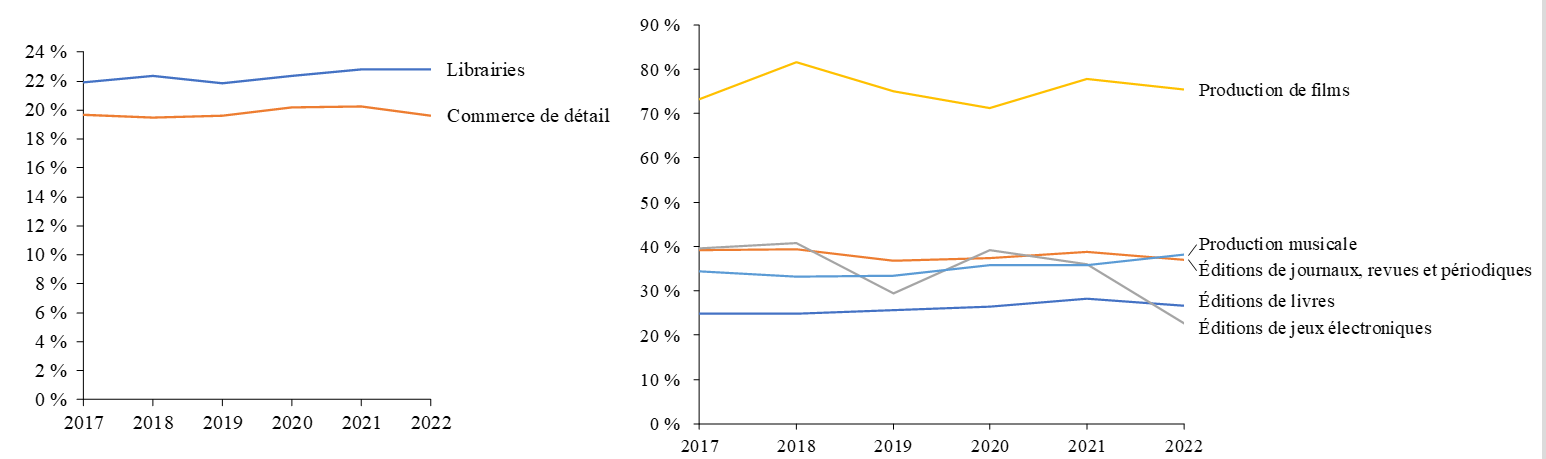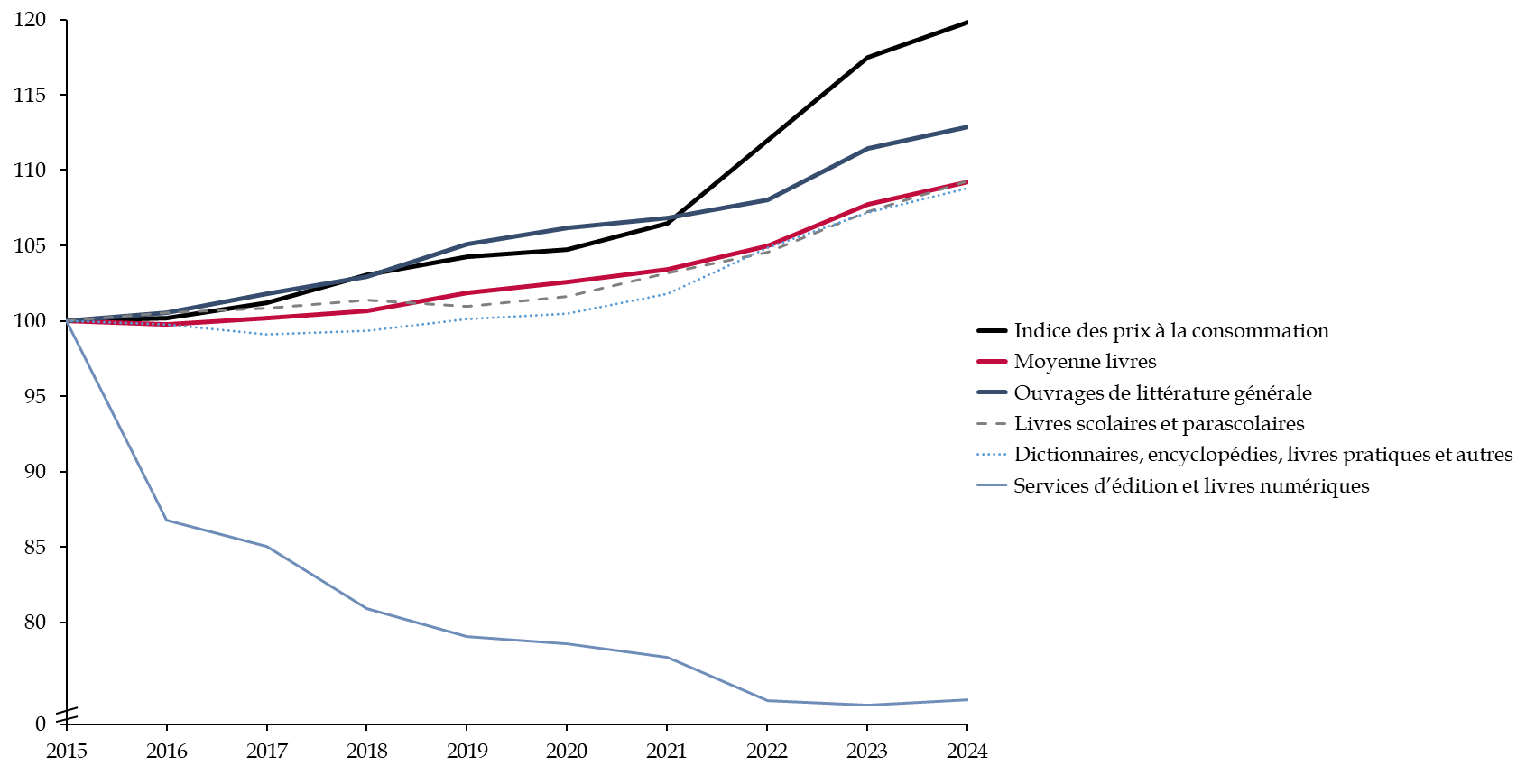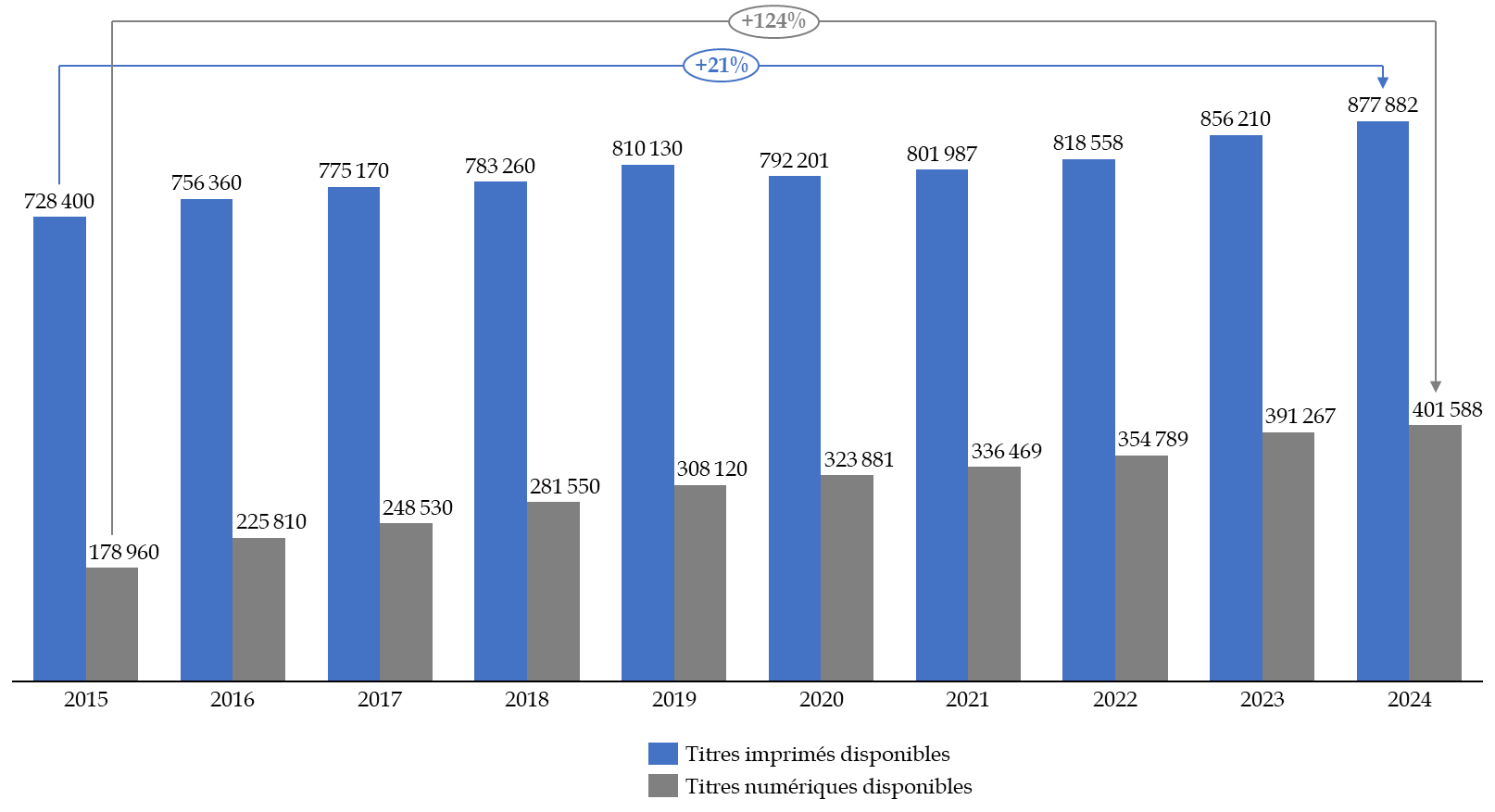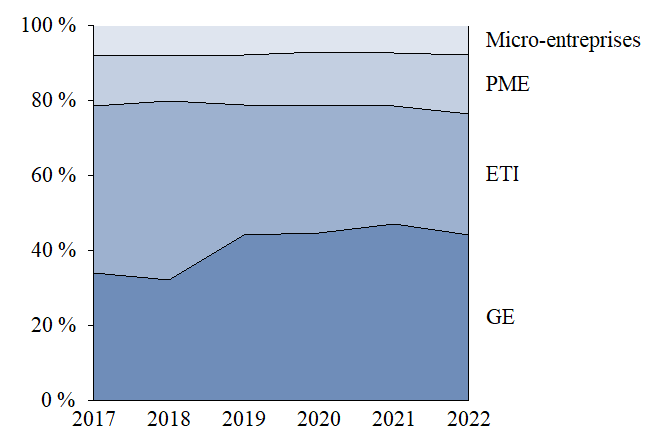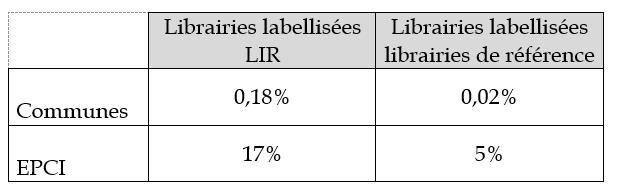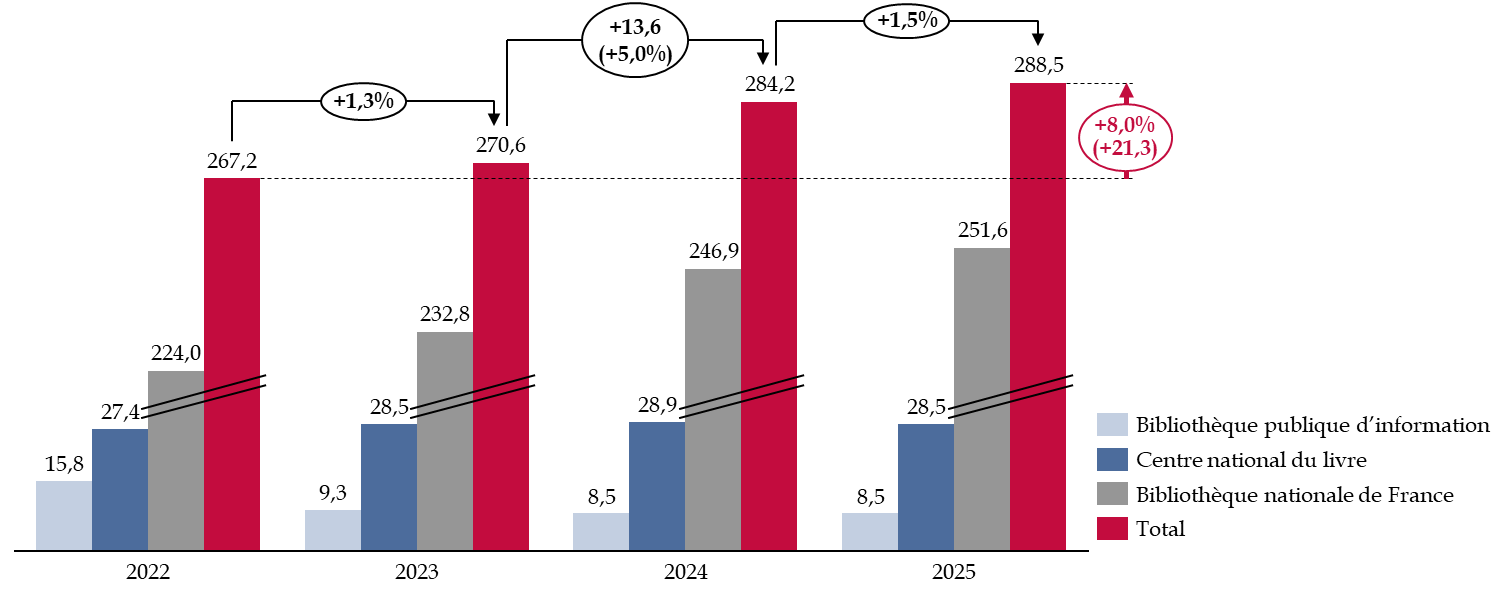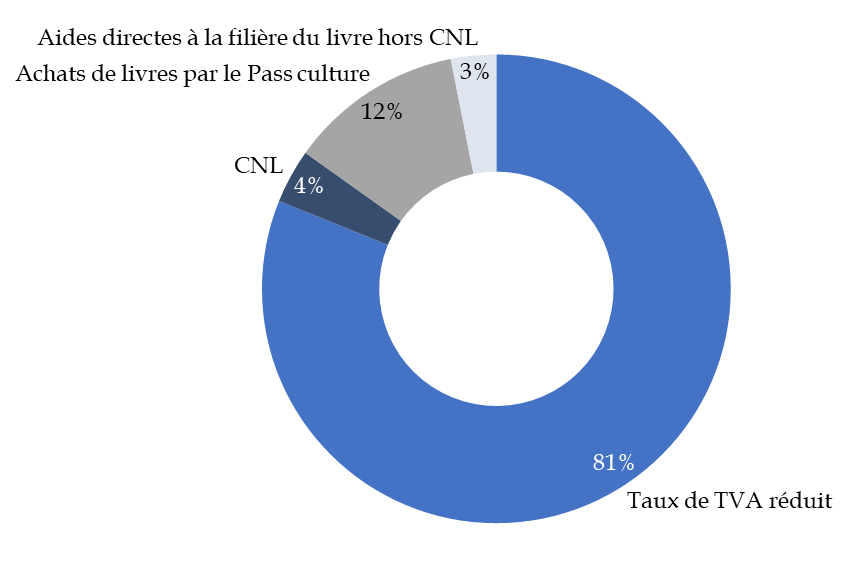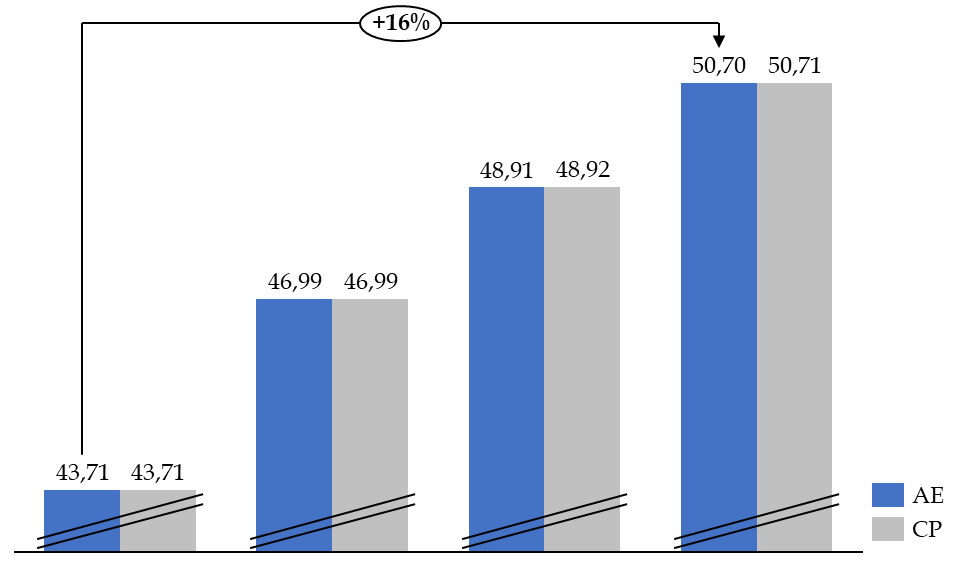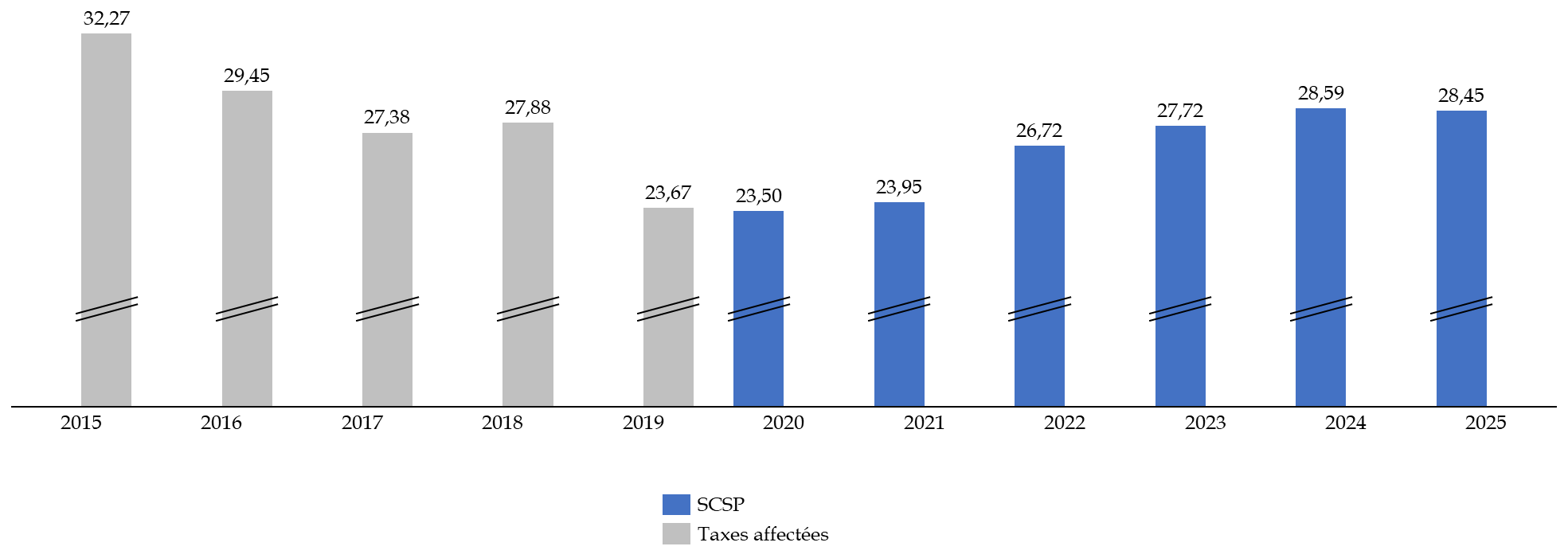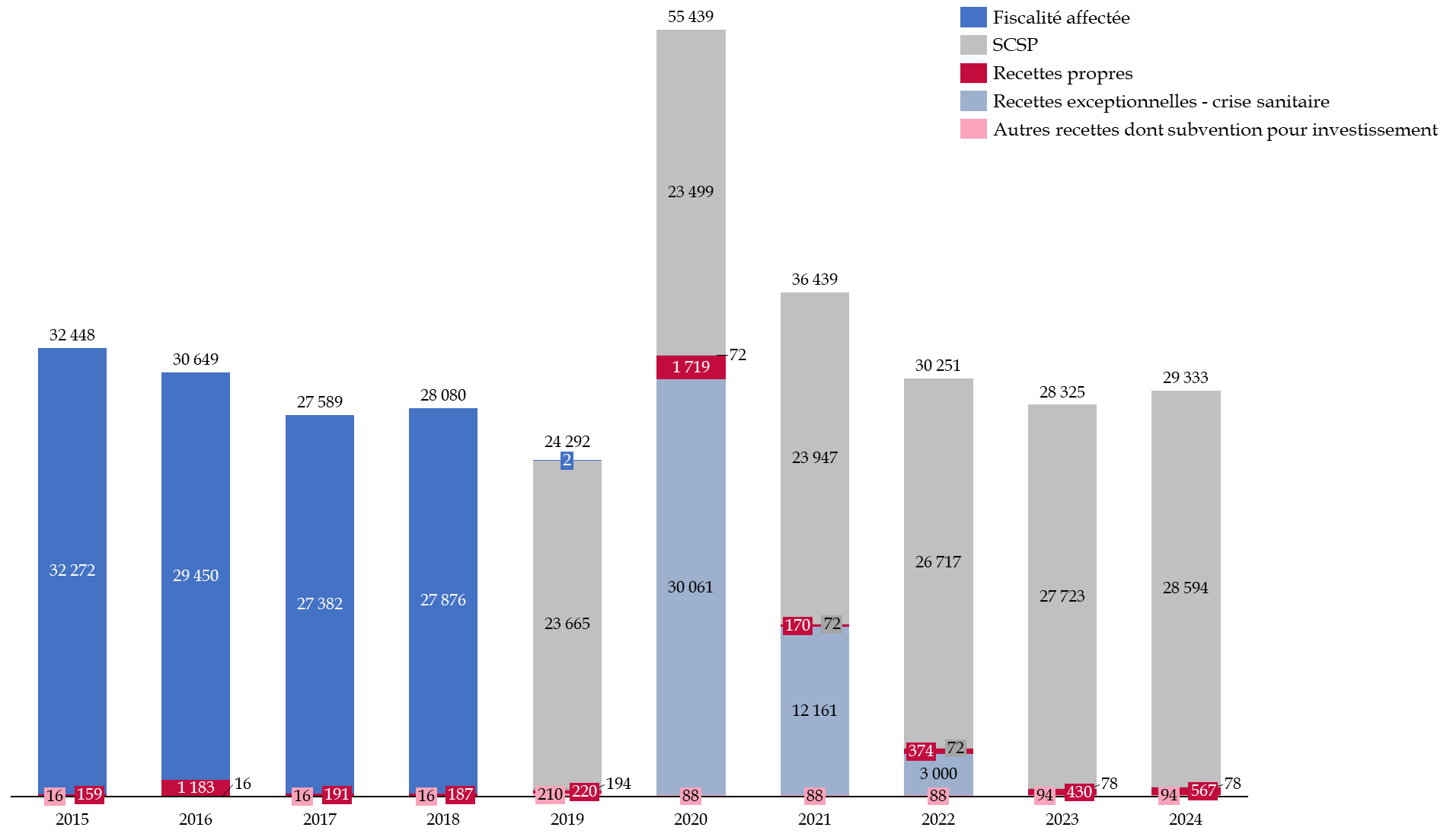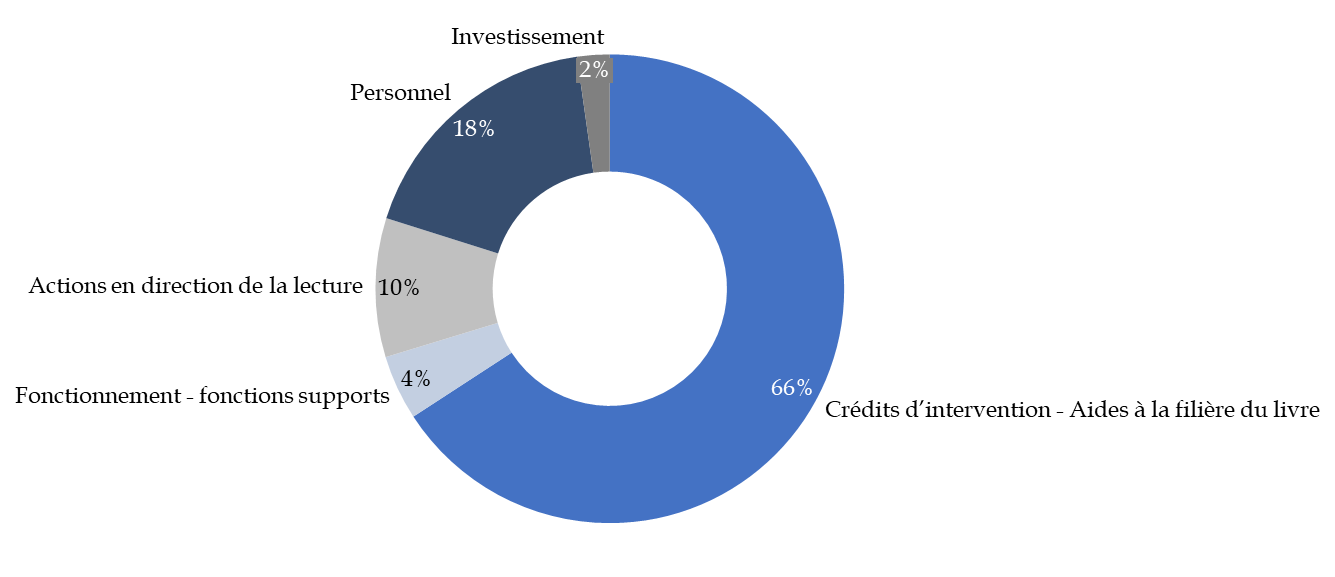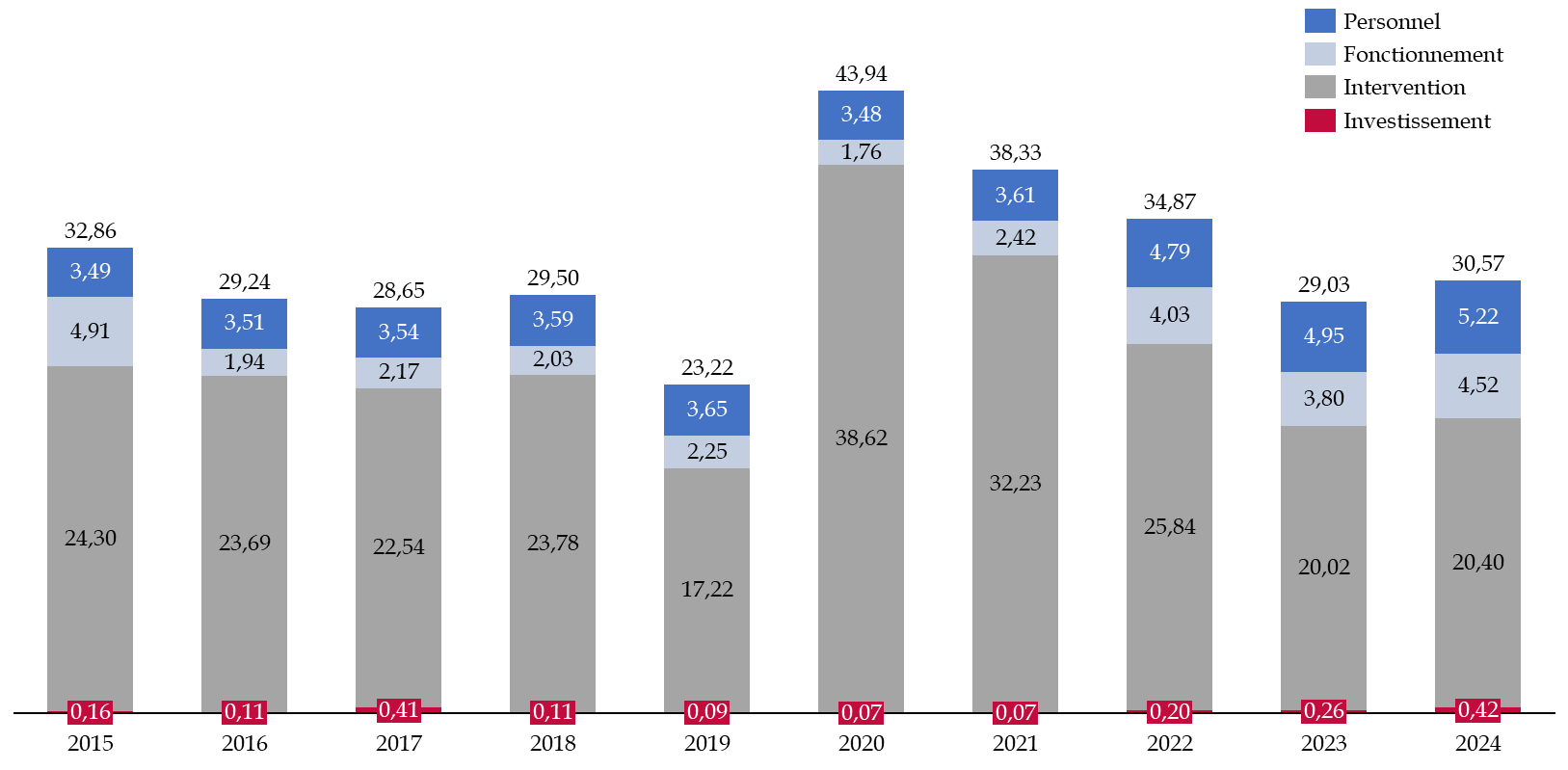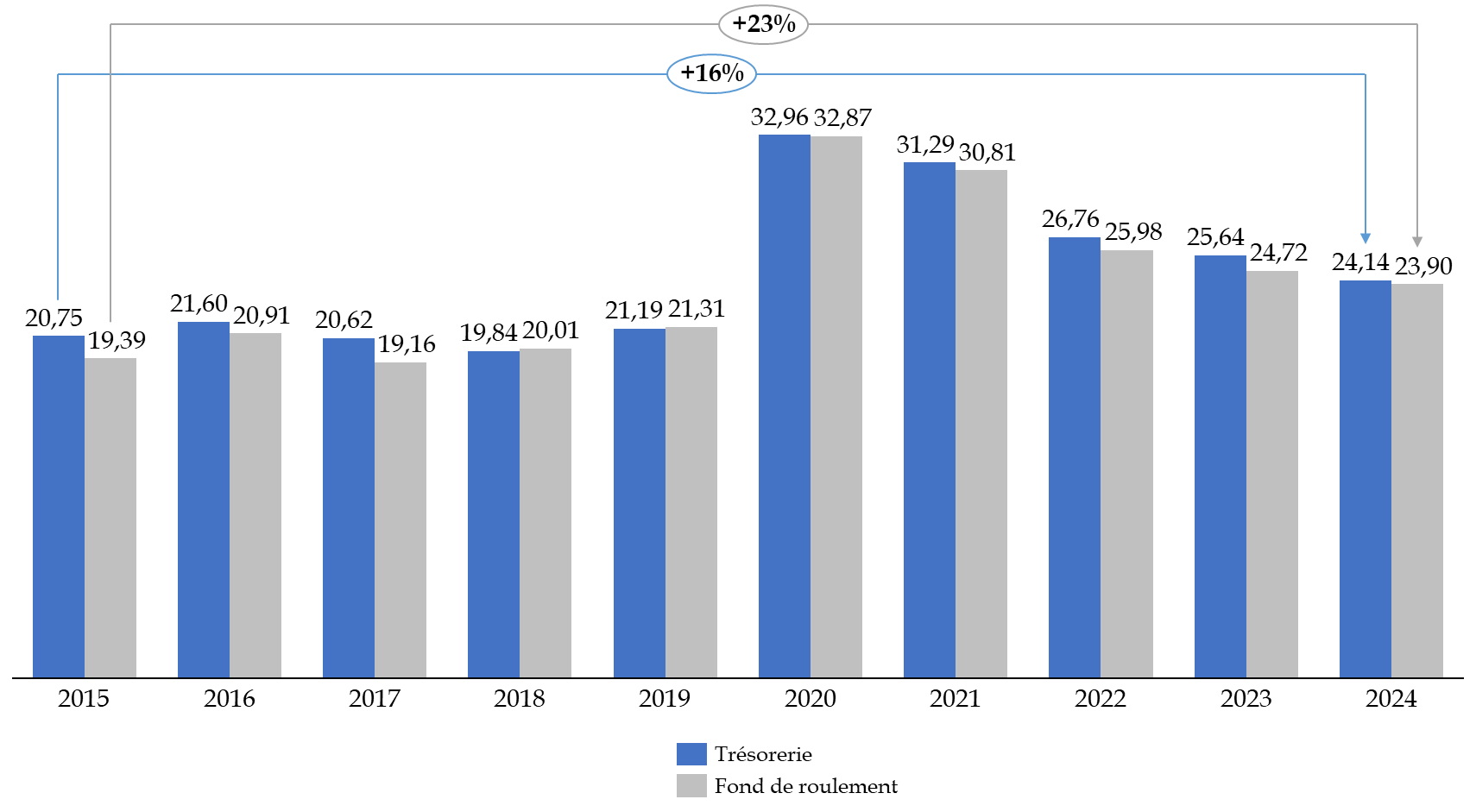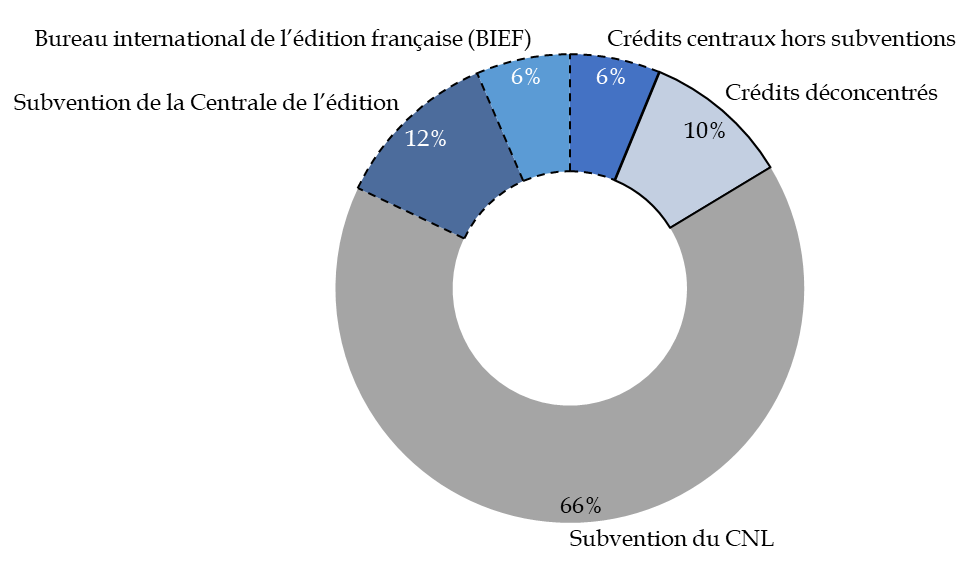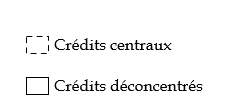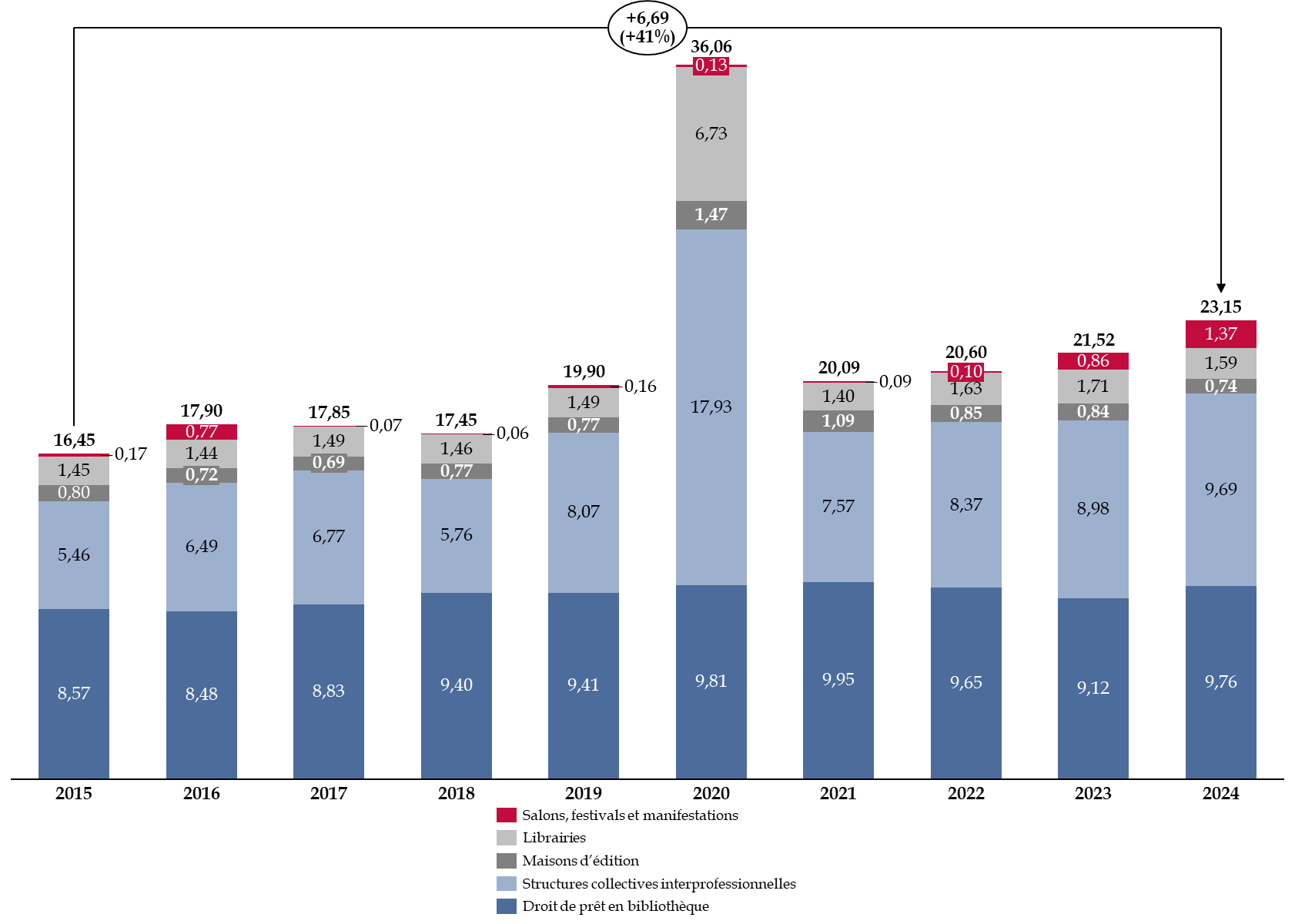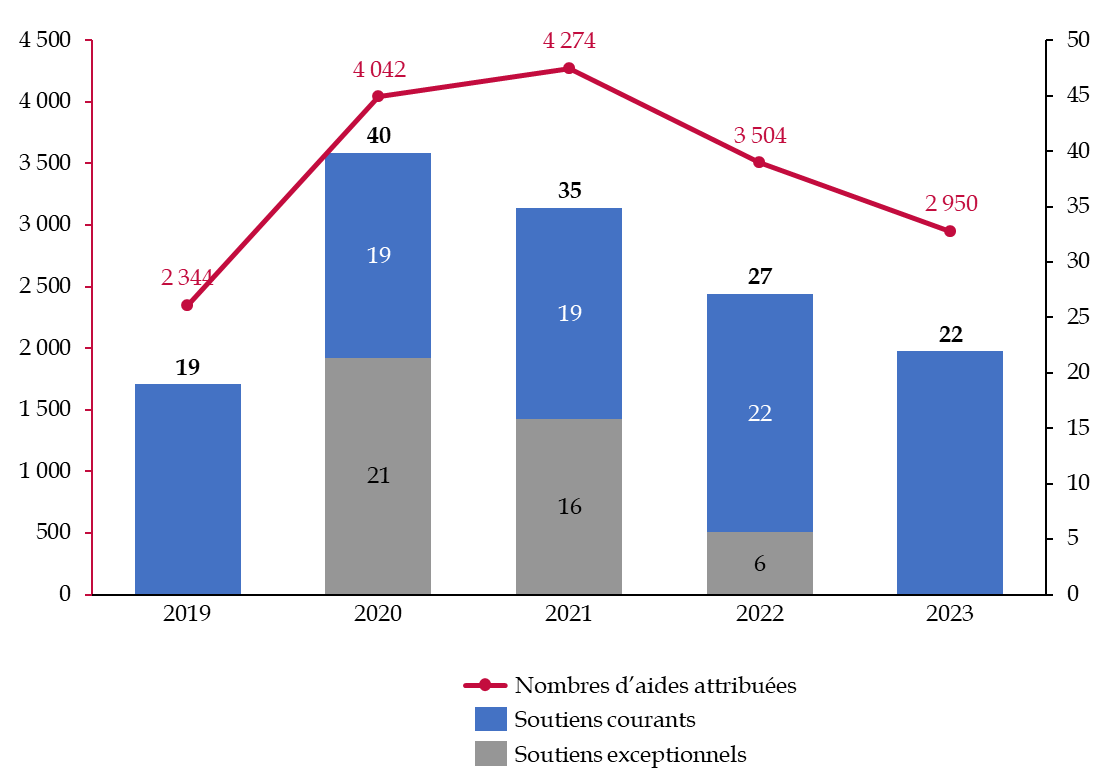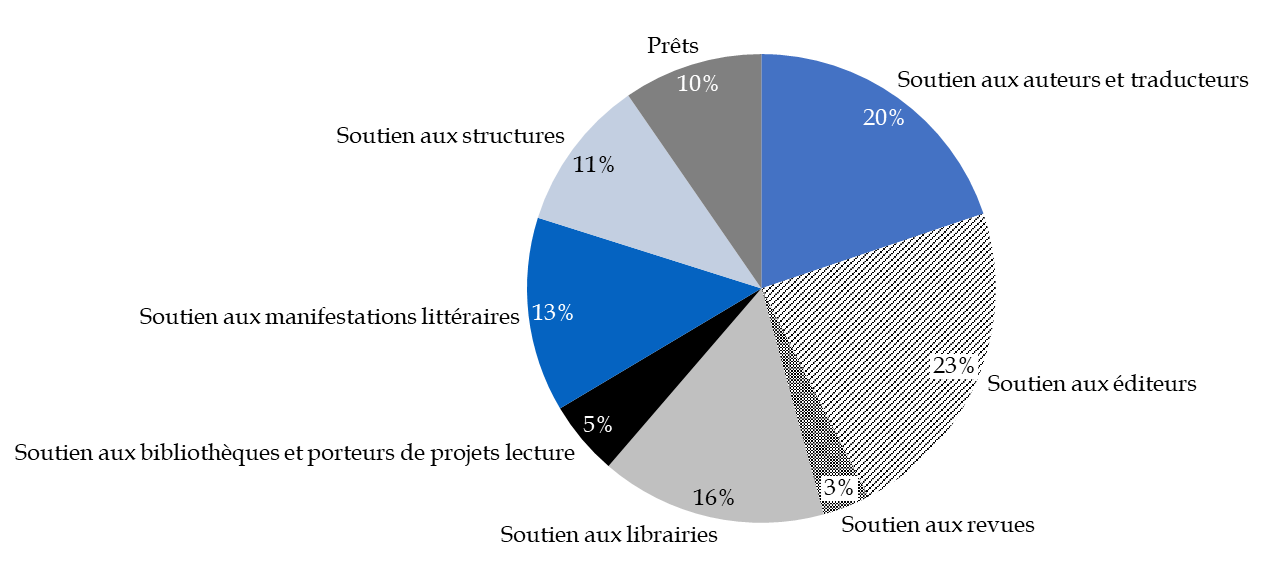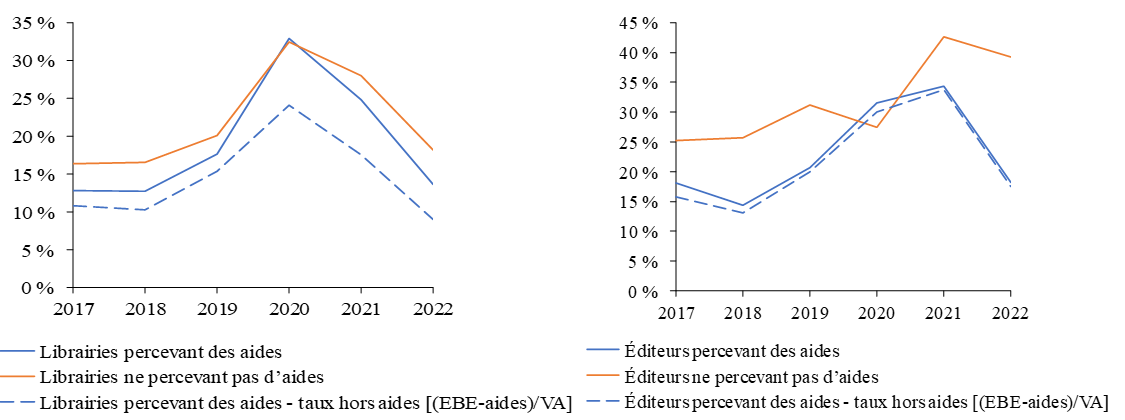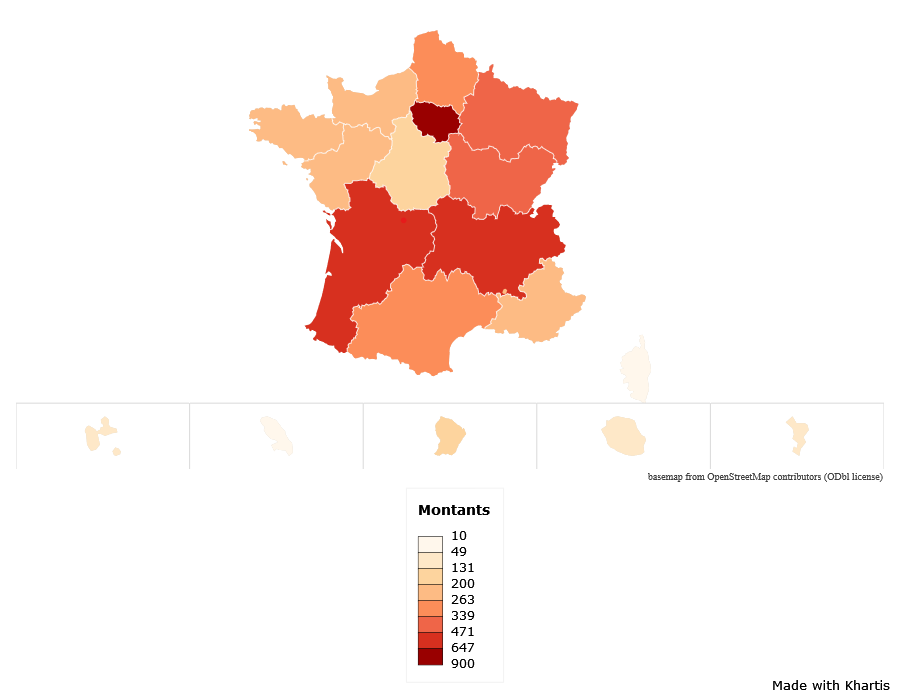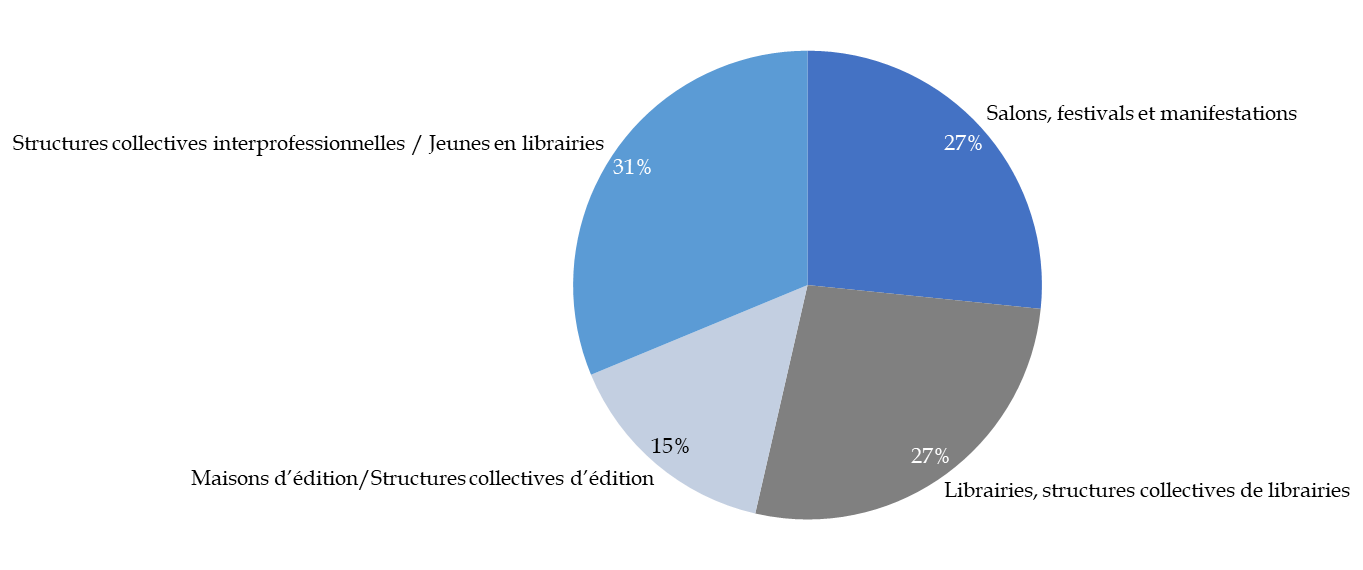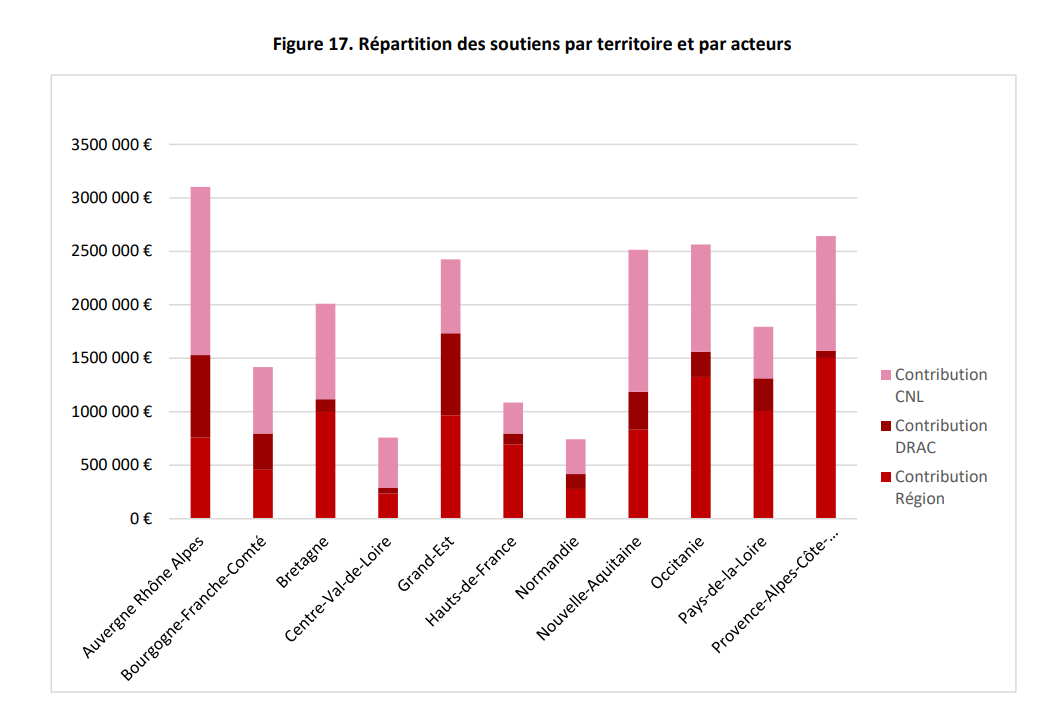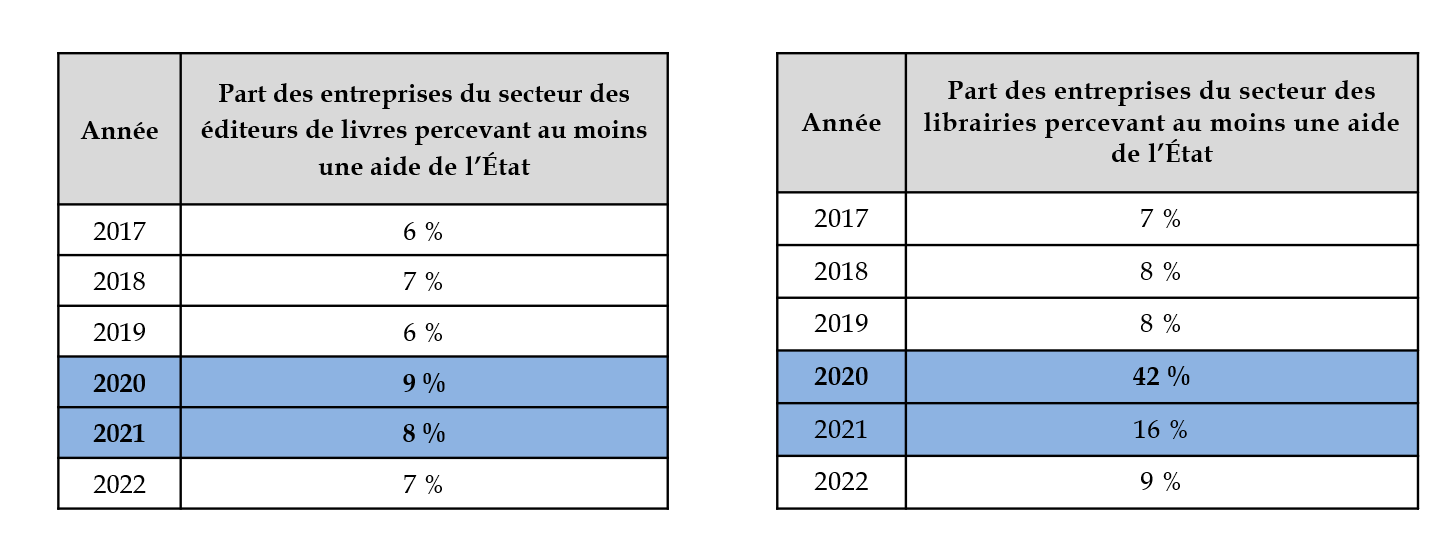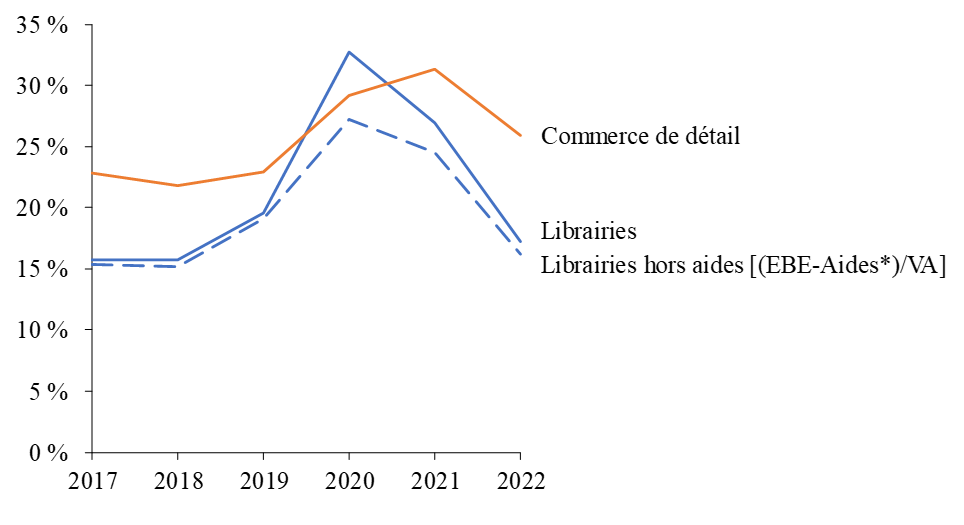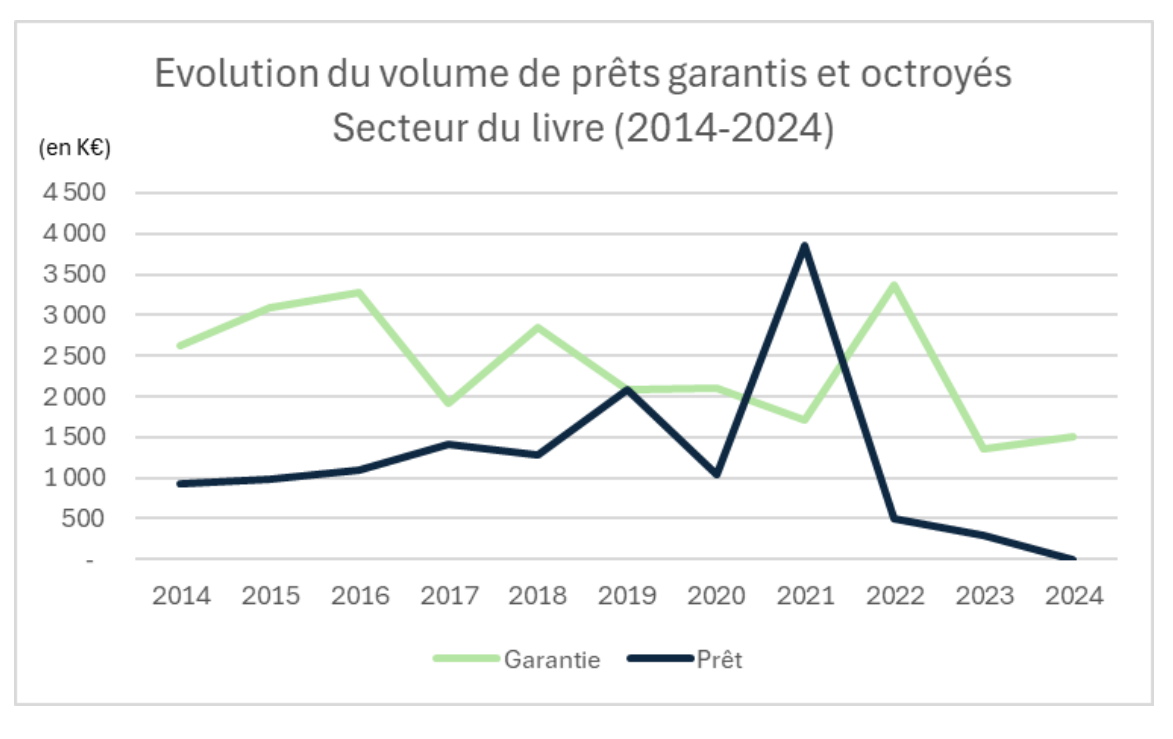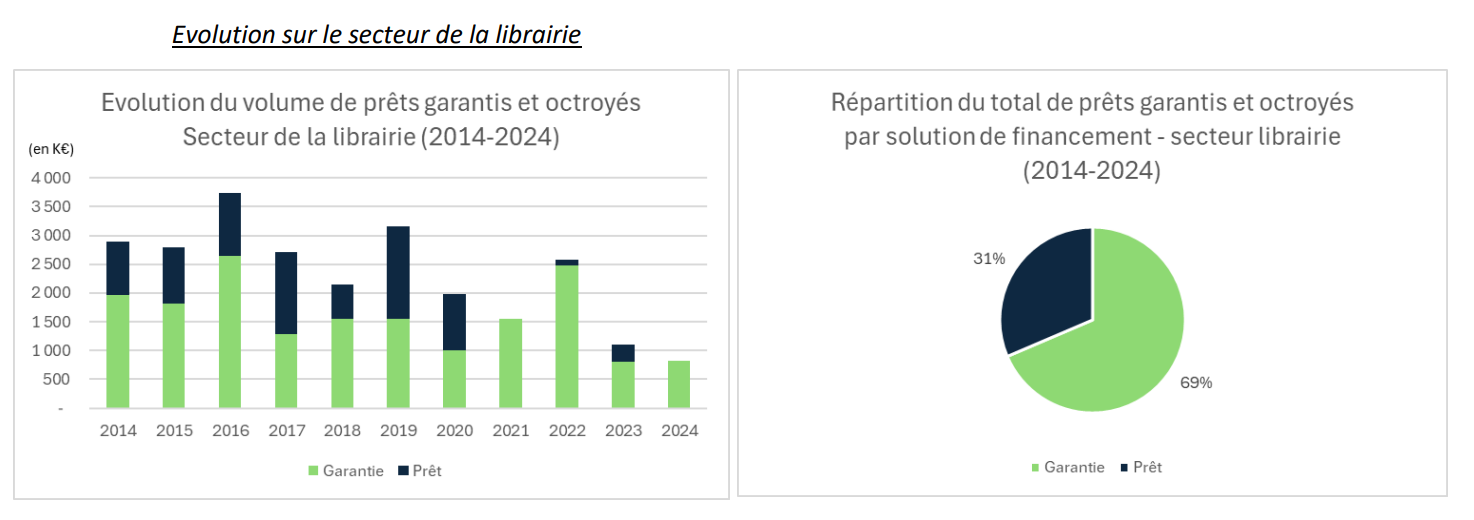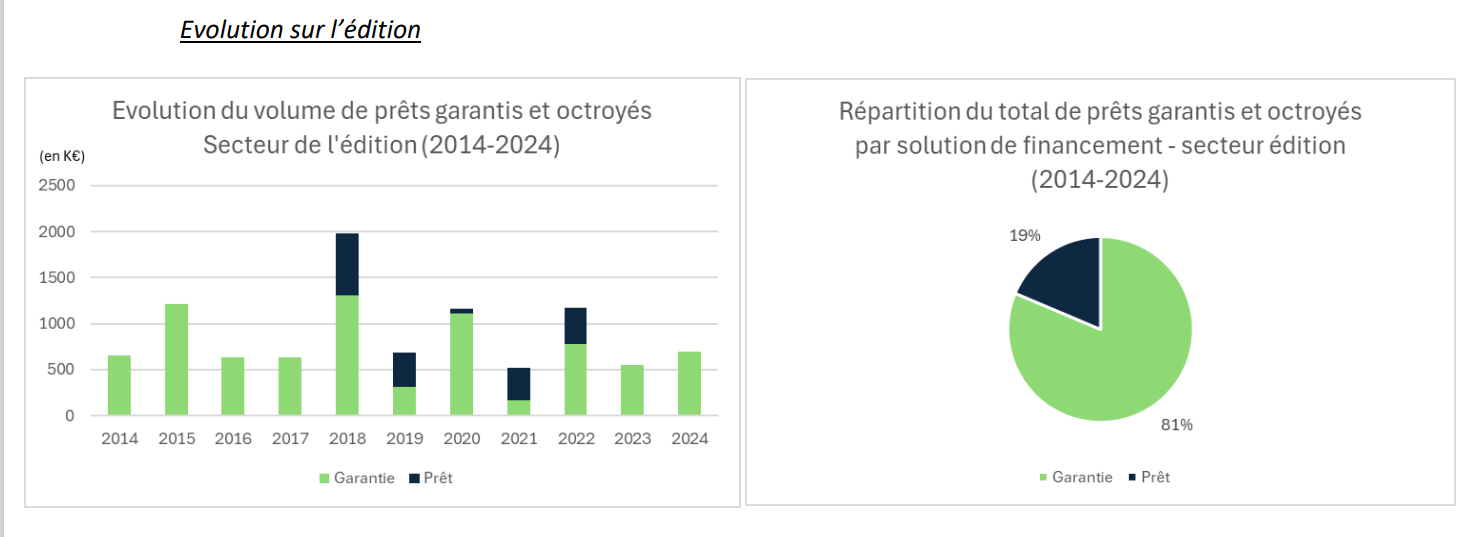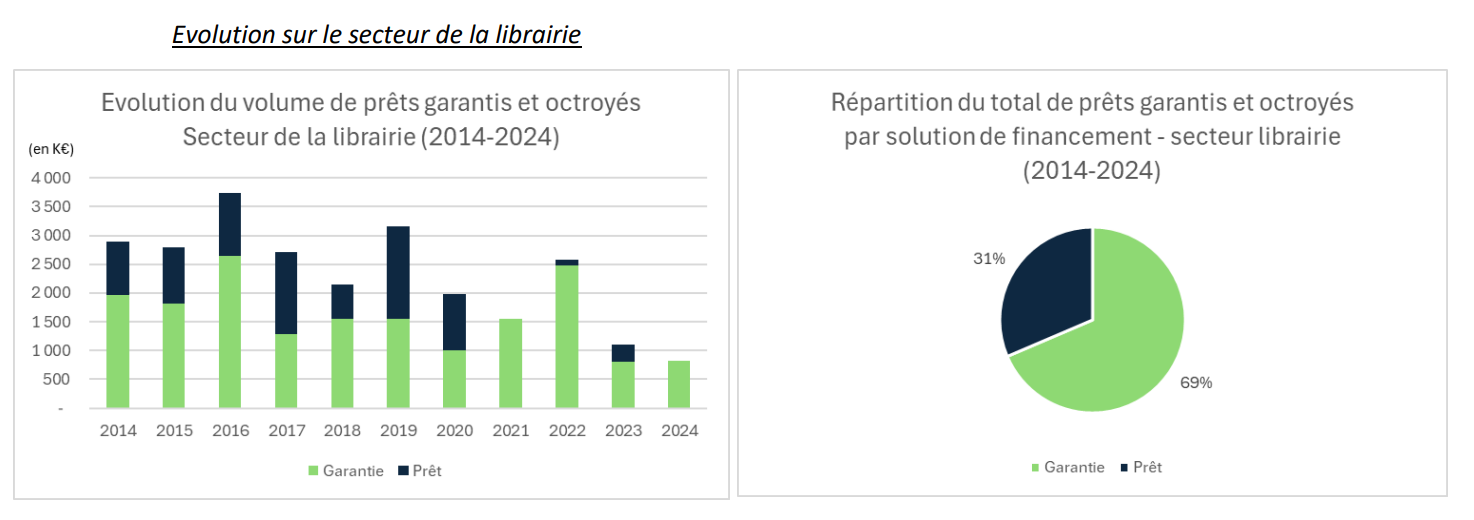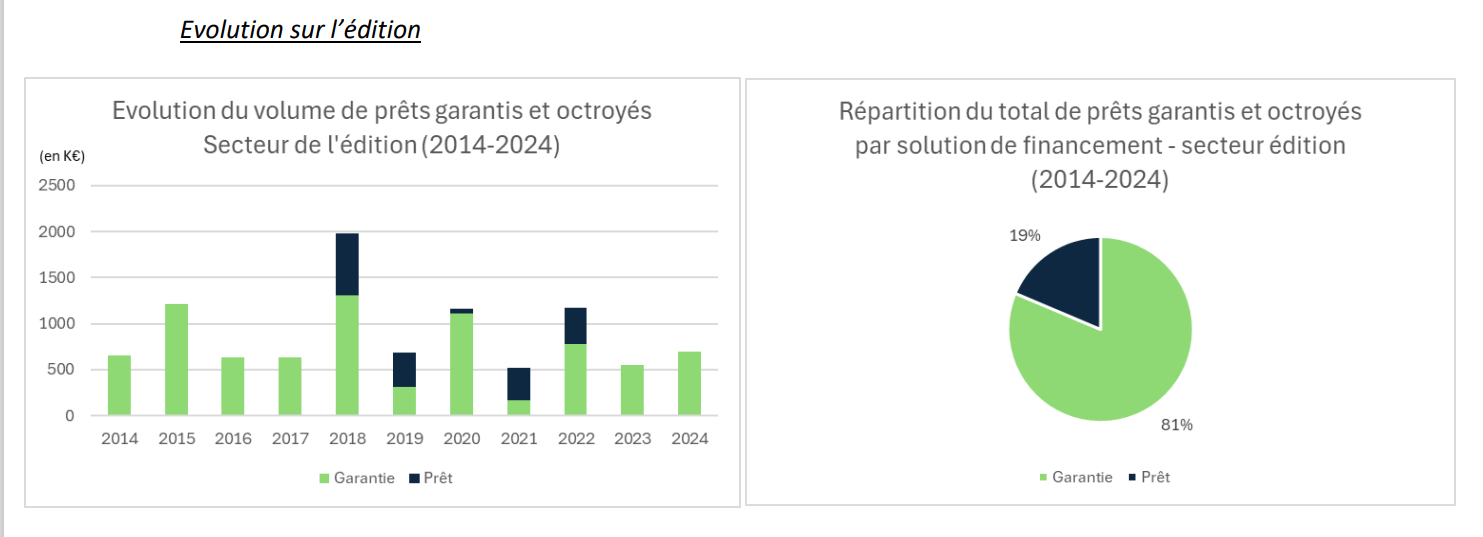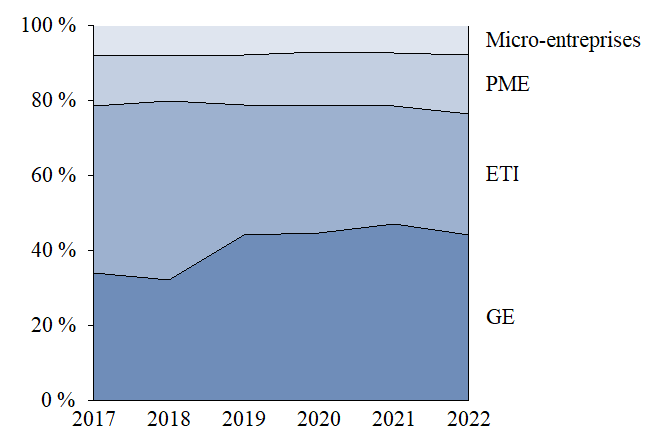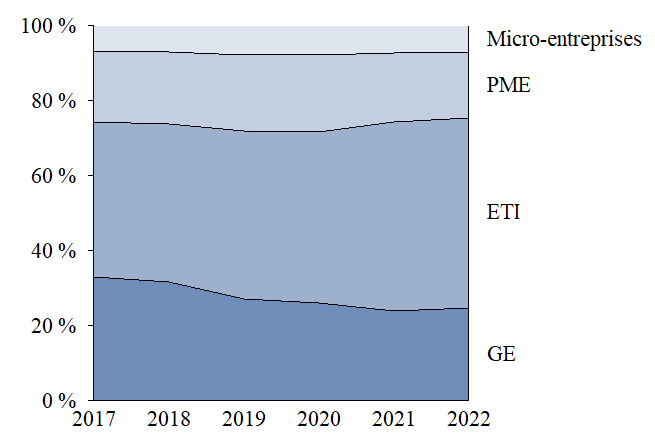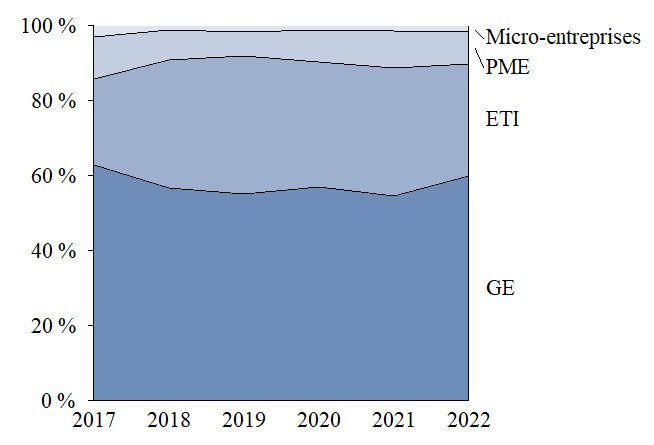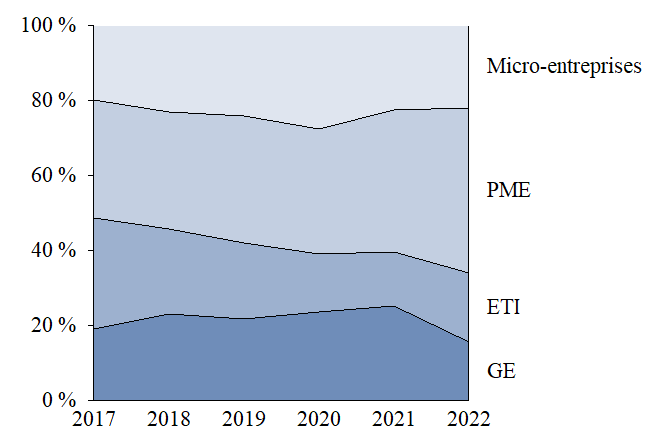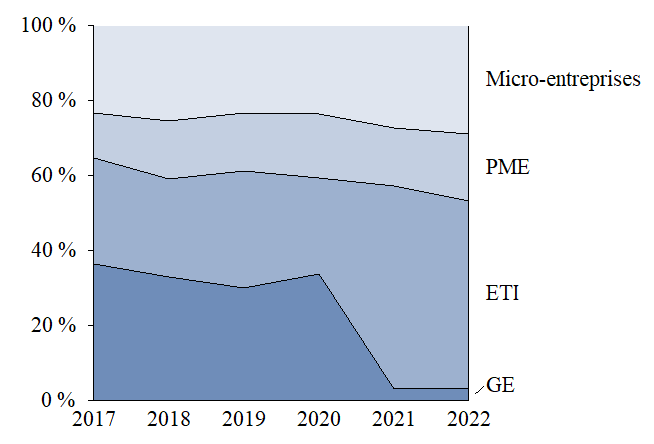- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- PREMIÈRE PARTIE
LA PLACE DE L'ÉTAT DANS L'ORGANISATION
DE LA FILIÈRE DU LIVRE
- I. ÉTAT DES LIEUX GÉNÉRAL DE LA
CHAÎNE DU LIVRE
- A. LA FILIÈRE DU LIVRE EST IMPLANTÉE
SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES, EN PARTICULIER RURAUX ET TRÈS
RURAUX
- B. À L'EXCEPTION DE LA PÉRIODE DE LA
CRISE SANITAIRE, DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES QUI SONT RESTÉS
STABLES AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES
- C. LA CHAÎNE DU LIVRE EST CONFRONTÉE
À COURT ET MOYEN TERMES À DES ENJEUX MULTIPLES
- A. LA FILIÈRE DU LIVRE EST IMPLANTÉE
SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES, EN PARTICULIER RURAUX ET TRÈS
RURAUX
- II. UN PILOTAGE SATISFAISANT DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE DU LIVRE, QUI RELÈVE EN GRANDE PARTIE D'UNE POLITIQUE
DE PROXIMITÉ
- III. LES MOYENS DE L'ÉTAT POUR LE LIVRE
DÉPASSENT LE SEUL SOUTIEN À L'ÉCONOMIE DU LIVRE
- A. LE SOUTIEN HISTORIQUE DE L'ÉTAT À
LA FILIÈRE DU LIVRE PASSE POUR L'ESSENTIEL PAR LA RÉGULATION
- B. LE SOUTIEN À LA FILIÈRE NE
REPRÉSENTE QU'UNE FAIBLE PART DES MOYENS CONSACRÉS PAR
L'ÉTAT AU LIVRE ET À LA LECTURE
- A. LE SOUTIEN HISTORIQUE DE L'ÉTAT À
LA FILIÈRE DU LIVRE PASSE POUR L'ESSENTIEL PAR LA RÉGULATION
- I. ÉTAT DES LIEUX GÉNÉRAL DE LA
CHAÎNE DU LIVRE
- DEUXIÈME PARTIE
À REBOURS DES AUTRES INDUSTRIES CULTURELLES, UNE FILIÈRE QUI REPOSE PEU
SUR LE SOUTIEN BUDGÉTAIRE DE L'ÉTAT
- I. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU
LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS
- A. LE CNL VERSE ENVIRON 22 MILLIONS D'EUROS
D'AIDES DIRECTES À L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE
- B. LES AIDES DIRECTES DES DRAC EN ARTICULATION
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : UN EFFET LEVIER IMPORTANT
MAIS DES MONTANTS RÉDUITS
- C. LE RÔLE ACTIF DE L'ÉTAT PENDANT LA
CRISE SANITAIRE POSE LA QUESTION DE L'APRÈS
- 1. Un doublement des aides accordées par le
CNL pendant la crise sanitaire qui a principalement
bénéficié aux librairies
- 2. L'impact économique des aides de
l'État à la filière du livre pendant la crise
sanitaire : une sur-rentabilité temporaire des librairies
- 3. Comment tourner la page de la crise
sanitaire ?
- 1. Un doublement des aides accordées par le
CNL pendant la crise sanitaire qui a principalement
bénéficié aux librairies
- A. LE CNL VERSE ENVIRON 22 MILLIONS D'EUROS
D'AIDES DIRECTES À L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE
- II. DE MULTIPLES SOUTIENS INDIRECTS PRIS EN CHARGE
PAR L'ÉTAT OU PAR DES OPÉRATEURS PRIVÉS FINANCÉS
PAR DES FONDS PUBLICS
- A. LES AUTRES AIDES À LA FILIÈRE DU
LIVRE : UN ENSEMBLE DE DISPOSITIFS DONT LE COÛT EST TRÈS
LARGEMENT SUPÉRIEUR À CELUI DES AIDES DIRECTES
- 1. Une prise en charge par l'État d'une
partie de l'assurance vieillesse des artistes auteurs dont le coût est en
hausse constante et qui doit être réévaluée
- 2. Les prêts à taux zéro
accordés par le CNL, un dispositif spécifique qui ne semble pas
justifié
- 3. Le taux réduit de taxe sur la valeur
ajoutée : un manque à gagner pour l'État de
600 millions d'euros dont la moitié bénéficie au
dernier décile de revenus
- 4. Le Pass Culture, un impact fondamental sur la
filière du livre : vers l'explosion d'une
« bulle » Pass culture dans les librairies ?
- 1. Une prise en charge par l'État d'une
partie de l'assurance vieillesse des artistes auteurs dont le coût est en
hausse constante et qui doit être réévaluée
- B. LES AIDES TRANSITANT PAR DES ORGANISMES
PRIVÉS FINANCÉS PAR DES FONDS PUBLICS
- A. LES AUTRES AIDES À LA FILIÈRE DU
LIVRE : UN ENSEMBLE DE DISPOSITIFS DONT LE COÛT EST TRÈS
LARGEMENT SUPÉRIEUR À CELUI DES AIDES DIRECTES
- III. UN SOUTIEN GLOBAL SANS COMMUNE MESURE AVEC
CELUI APPORTÉ PAR L'ÉTAT AUX INDUSTRIES CULTURELLES
- I. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU
LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
- ANNEXES
N° 812
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur la politique de l'État en faveur de la filière du livre,
Par M. Jean-Raymond HUGONET,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
I. LE SOUTIEN À LA FILIÈRE DU LIVRE : UNE POLITIQUE DE PROXIMITÉ CENTRÉE SUR LES ENTREPRISES INDÉPENDANTES
Le montant total consacré par l'État au livre et à la lecture s'élevait en 2024 à 1,1 milliard d'euros, dont 600 millions d'euros de pertes de recettes liées au taux réduit à 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la vente de livre. Les bibliothèques représentent ensuite le premier poste de dépense, de sorte que la politique économique du livre proprement dite s'élève en 2024 à 50,7 millions d'euros, soit seulement 6,8 % des crédits consacrés au livre et à la lecture.
Montants consacrés par l'État au soutien au livre et à la lecture en 2024
(en millions d'euros et en %)
|
Dépense budgétaire ou incidence fiscale |
Montant |
Proportion du soutien total accordé par l'État |
|
|
Mission Médias, livre et industries culturelles Programme 334 |
Bibliothèque nationale de France |
243,0 |
22,07 % |
|
Politique économique du livre |
50,7 |
6,85 % |
|
|
Dont Centre national du livre |
28,5 |
2,52 % |
|
|
Développement de la lecture et des collections |
23,7 |
2,15 % |
|
|
Dont Bibliothèque publique d'information |
10,1 |
0,92 % |
|
|
Total |
317,4 |
28,83 % |
|
|
Mission Culture |
Achats de livres sur les crédits du Pass Culture (part individuelle) |
89 |
8,09 % |
|
Compensation partielle par l'État d'exonération de cotisation d'assurance vieillesse pour les artistes auteurs |
nc1(*) |
nc |
|
|
Mission relations avec les collectivités territoriales |
Concours particulier relatif aux bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) |
94,4 |
8,58 % |
|
Taux réduit de TVA sur le livre |
600 |
54,51 % |
|
|
Total |
1 100,8 |
100,00 % |
|
|
Total soutien économique à la filière du livre |
740 |
67,22 % |
|
|
Total dépenses budgétaires |
500,8 |
45,5 % |
|
|
Total dépenses budgétaires - soutien économique à la filière du livre |
139,7 |
12,69% |
|
Source : commission des finances
1. Un marché fragile confronté à de nombreux enjeux, mais dont la rentabilité reste stable
Le marché du livre est actuellement confronté à un effet de ciseaux entre, d'une part, la baisse structurelle du nombre de lecteurs, et d'autre part, une production de livres toujours plus abondante : Le nombre de livres non numériques disponibles a augmenté de 21 % en dix ans, alors même que le lectorat s'effondre.
|
Nombre d'éditeurs en 2025 |
Nombre de librairies en 2025 |
Source : Sénat d'après les données transmises par le Ministère de la Culture
2. Un pilotage de la politique économique qui ne relève que marginalement de l'administration centrale
Le suivi économique de la filière n'est effectué que par 10 agents en administration centrale. Celle-ci ne déploie aujourd'hui aucune activité de guichet et exerce une activité de contrôle et de régulation. L'administration déconcentrée a un rôle de répartition des aides (4,8 millions d'euros pour l'ensemble des directions régionales des affaires culturelles), en complémentarité avec les collectivités territoriales. Le pilotage économique et l'attribution des aides directes à la filière relèvent pour l'essentiel du centre national du livre (CNL).
Répartition des crédits de la politique économique du livre
(en %)
Source : commission des finances d'après les données du ministère de la culture
II. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS
Le centre national du livre est le principal acteur à intervenir directement auprès des entreprises de la chaîne du livre. Les aides du CNL prennent la forme de 28 dispositifs, qui bénéficient à l'ensemble des professionnels de la chaîne du livre. Près de 3 000 aides ont été attribuées en 2023 par le CNL, pour un montant total de 22 millions d'euros. Les modalités d'attribution des aides du CNL sont perfectibles mais globalement satisfaisantes.
Aides directes totales attribuées par le CNL
(en millions d'euros et en nombre d'aides)
Source : commission des finances d'après le CNL. Les aides figurent sur l'échelle de gauche
Si, en nombre d'aides, les librairies ne représentent que 16 % des aides accordées, les aides aux librairies sont en moyenne d'un montant deux fois supérieur aux aides aux auteurs et aux éditeurs.
1. Un ciblage des aides sur les librairies et les éditeurs les moins rentables
Les librairies qui perçoivent des aides sont, en moyenne, structurellement moins rentables que les autres, ce qui semble indiquer que les aides sont bien ciblées sur les commerces les plus en difficulté. S'agissant des éditeurs, les aides versées par le CNL ont un impact plus faible que pour les librairies : les montants sont globalement plus faibles et se répartissent sur un marché plus étendu que celui des librairies.
Évolution de la proportion d'entreprises de
la filière du livre
recevant des aides de l'État
(en %)
Source : Sénat, d'après base de données FARE et Ministère de la Culture. Pour les librairies, les ETI et GE sont exclues
2. Comment tourner la page de la crise sanitaire ? Une sur-rentabilité temporaire des librairies en 2020
Les acteurs de la filière du livre ont pu, pour la plupart, bénéficier des dispositifs généraux d'aides aux entreprises mis en place dès le début de la crise sanitaire. S'y sont ajoutées des aides spécifiques au secteur du livre : le montant total des aides accordées par le CNL a doublé en 2020 par rapport à 2019. Au total, entre 2020 et 2022, 43 millions d'euros d'aides exceptionnelles auront été accordées à la filière du livre par le CNL.
Les mécanismes d'aide à la filière ont été mis en place, comme pour l'ensemble des secteurs, dans la précipitation et dans une période de grande crainte de la filière du livre sur les perspectives. Or les résultats de la filière ont été nettement meilleurs qu'anticipés, de sorte qu'une part non négligeable des fonds d'urgence n'ont pas été consommés et ont été redéployés. L'année 2020 est une année de très forte hausse du taux de marge pour les librairies, leur permettant même d'obtenir un taux de marge moyen plus élevé que pour le reste du commerce de détail. Les aides d'urgence de l'État ont donc entraîné une sur-rentabilité temporaire des librairies, avec un retour à la normale rapide dès 2021.
Impact des aides versées par l'État sur le taux de marge des librairies
(en %)
Source : Sénat, d'après la base de données FARE et le ministère de la Culture. Les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises sont exclues
III. AU-DELÀ DES AIDES BUDGÉTAIRES, UN APPUI MULTIFORME DE L'ÉTAT AU LIVRE
1. Le taux réduit de TVA : un manque à gagner pour l'État de 600 millions d'euros dont la moitié bénéficie au dernier décile de revenus
La vente et la location de livres bénéficient d'un taux réduit de TVA à 5,5 %. La dernière évaluation faite par la direction de la législation fiscale chiffrait son coût autour de 600 millions d'euros par an. Comme pour de nombreux taux réduits de TVA, le taux de 5,5 % applicable au livre ne constitue pas un instrument pertinent en termes de redistribution. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires considère dans un rapport de 20222(*) que le décile de population le plus riche achète des livres à hauteur de 294 millions d'euros par an, contre 84 millions d'euros pour le premier décile.
Ni le ministère de la culture ni celui des comptes publics ne suivent précisément ce taux réduit de TVA, dès lors que celui-ci n'est pas considéré comme une dépense fiscale. Au vu du coût de ce dispositif, qui est sans commune mesure avec les soutiens directs à la filière du livre, il est impératif de disposer d'une analyse plus fine.
2. Le Pass Culture, un impact fondamental sur la filière du livre
Le livre est, depuis la création du Pass culture en 2019, le produit le plus consommé. Au total, 28 millions de livres ont ainsi été achetés à travers le Pass culture, soit 359 millions d'euros cumulés depuis 2019.
Les achats de livres par le Pass culture représentaient 89 millions d'euros en 2024, soit près de trois fois le montant des aides directes du CNL à la filière du livre. L'impact économique du Pass culture sur la filière du livre peut donc s'apparenter à une aide d'État massive : le Pass culture a représenté 2,6 % des livres achetés en 2023, mais cette part peut représenter jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires de certaines librairies indépendantes.
3. Les aides transitant par des organismes privés financés par des fonds publics
Plusieurs structures aident les entreprises du secteur du livre, généralement plus fragiles économiquement, à accéder au financement bancaire. L'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), « banque des industries culturelles » détenue pour moitié par l'État, a garanti et octroyé pour la seule filière du livre un total de 39,3 millions d'euros en faveur de 411 bénéficiaires sur la période 2014-2024.
Par ailleurs, le CNL et le ministère versent un certain nombre de subventions à des structures et associations représentatives du secteur, qui peuvent à leur tour redistribuer une part de ces financements sous forme d'aides.
IV. UN SOUTIEN GLOBAL SANS COMMUNE MESURE AVEC CELUI APPORTÉ PAR L'ÉTAT À D'AUTRES INDUSTRIES CULTURELLES
Le livre représente le premier secteur en termes de chiffres d'affaires parmi les industries culturelles. Il est pourtant de très loin le secteur le moins directement aidé.
Si les aides du CNL représentent entre 1 % et 2 % du chiffre d'affaires de l'édition et de la librairie indépendantes, elles ne représentent que 0,23 % du chiffre d'affaires total du secteur du livre.
Ce taux d'intervention est très largement inférieur à celui des autres industries culturelles : il est de 0,8 % pour le secteur du spectacle vivant et jusqu'à 15,1 % pour les secteurs soutenus par le Centre national du cinéma, dont le budget est sans commune mesure avec les moyens des autres opérateurs.
Poids des dépenses fiscales dans le secteur
des industries culturelles
par rapport à leur chiffre d'affaires en
2024
(en millions d'euros et en %)
|
Secteur |
Dispositif |
Coût des dépenses fiscales |
Part de la dépense fiscale par rapport au chiffre d'affaires du secteur |
|
Presse |
Taux réduit de TVA applicable aux publications de presse |
57 |
0,5 % |
|
Audiovisuel |
Taux réduit de TVA applicable aux services de télévisions |
150 |
13 % |
|
Cinéma |
Crédits d'impôts « cinéma » |
621 |
35 % |
|
Jeux vidéo |
Crédit d'impôt « jeux vidéo » |
66 |
2 % |
|
Spectacle vivant |
Taux réduits de TVA pour le spectacle vivant |
360 |
5 % |
|
Crédit d'impôt « spectacle vivant » |
42 |
||
|
Livre |
Taux réduit de TVA sur l'achat et la location de livre |
600 |
6 % |
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires et les données du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS)
Même si les aides directes sont complétées par un ensemble de dispositifs, et si le soutien de l'État est multidimensionnel, le livre apparaît comme un secteur relativement indépendant des financements publics.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : poursuivre le déploiement des contrats de filière tripartites dans les régions non encore signataires, en particulier dans les outre-mer (Directions régionales des affaires culturelles -DRAC, Centre national du livre - CNL, régions)
Recommandation n° 2 : introduire dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens du CNL un objectif de développement des ressources propres de l'établissement (ministère de la culture, CNL)
Recommandation n° 3 : évaluer le coût de traitement des aides du CNL et relever le montant minimal d'aides, actuellement fixé à 500 euros pour la plupart des aides et non revalorisé depuis 2018, afin de limiter le saupoudrage des moyens (CNL)
Recommandation n°4 : renforcer la conditionnalité des aides du CNL pour en faire davantage des instruments de politique publique face aux grands enjeux de la filière du livre (CNL)
Recommandation n° 5 : formaliser une doctrine d'intervention de l'administration déconcentrée commune à toutes les DRAC (ministère de la culture)
Recommandation n° 6 : mettre fin à l'octroi de prêts par le CNL, notamment en communiquant davantage sur le rôle de l'institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), et ainsi recentrer le rôle de soutien économique du CNL sur l'octroi de subventions complémentaires, constituant une garantie de financement des projets (CNL, IFCIC)
Recommandation n° 7 : évaluer davantage le coût et l'impact du taux réduit à 5,5 % sur le livre, notamment en termes de redistribution et d'incitation à la lecture, et suivre le dispositif au sein du tome 2 de l'évaluations des voies et moyens en annexe des projets de loi de finances (ministère des comptes publics)
Recommandation n° 8 : transférer au CNL le financement de l'ensemble des structures professionnelles subventionnées, afin de rendre plus lisible la répartition des compétences entre tutelle et opérateur (ministère de la culture)
PREMIÈRE PARTIE
LA
PLACE DE L'ÉTAT DANS L'ORGANISATION
DE LA FILIÈRE DU LIVRE
I. ÉTAT DES LIEUX GÉNÉRAL DE LA CHAÎNE DU LIVRE
Le présent rapport porte sur les différents outils permettant à l'État de soutenir la filière du livre. Par conséquent, il apparaît utile, avant de rentrer dans le détail des moyens d'action de l'État et de l'évaluation des dispositifs mis en place, de dresser un panorama général du secteur.
A. LA FILIÈRE DU LIVRE EST IMPLANTÉE SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES, EN PARTICULIER RURAUX ET TRÈS RURAUX
Il est difficile de disposer d'un décompte solide du nombre d'éditeurs : l'édition française se caractérise par l'existence de très nombreux acteurs indépendants aux dimensions variables. Les données transmises par le ministère de la culture permettent de considérer qu'il existe en 2022 plus de 8 000 structures éditoriales, dont 4 000 pour lesquelles l'édition constitue l'activité principale et 1 000 dont l'activité est significative sur le plan économique3(*). Ceux-ci sont répartis sur le territoire. Toutefois, rapporté au chiffre d'affaires réalisé, le marché de l'édition apparaît comme un secteur assez concentré dans certaines régions, en particulier en Île-de-France.
Nombre d'éditeurs pour 100 000 habitants en 2025
Source : Sénat d'après les données transmises par le Ministère de la Culture
Plus de 3 000 librairies sont réparties sur le territoire, avec un nombre élevé de librairies par habitant à Paris, ainsi que dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de Lozère et du Lot. Si la moitié des librairies sont situées dans un grand centre urbain, 30 % des librairies sont implantées dans des petites villes ou des milieux ruraux ou très ruraux.
Implantation de librairie par type de territoire en 2024
(en %)
Source : commission des finances d'après les chiffres de l'observatoire de l'économie du livre
S'agissant des créations de librairies, le ministère note qu'à la suite de la crise sanitaire, les librairies généralistes ont continué à s'implanter dans des communes de moins de 15 000 habitants (plus de 3 créations de librairies sur 5), pour partie périurbaines, mais majoritairement isolées, et même de moins de 5 000 habitants (3 créations sur 10).
Ainsi, plus de 270 communes sont nouvellement dotées d'une librairie créée au cours des quatre dernières années. Les communes de plus de 100 000 habitants totalisent un cinquième des créations, avec une proportion de librairies spécialisées logiquement bien plus importante que la moyenne nationale (45 %).
Nombre de librairies pour 100 000 habitants en 2025
Source : Sénat d'après les données transmises par le Ministère de la Culture
L'analyse du secteur de la vente de livres est cependant bien plus large que les seules librairies. D'après le ministère de la culture, les librairies ne représentaient en 2024 que 27 % des achats de livres, contre 30 % pour les grandes surfaces spécialisées dans les industries culturelles. Il faut noter que la proportion d'achats en librairie est en hausse au cours des dernières années, l'achat de livres en ligne représentant une proportion stable au cours des dix dernières années.
Évolution des canaux de vente de livres
(en %)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Grandes surfaces spécialisées |
22,0% |
24,0% |
24,5% |
25,3% |
25,6% |
26,9% |
28,6% |
27,9% |
27,7% |
28,4% |
29,9% |
|
Librairies |
22,0% |
22,0% |
22,1% |
21,9% |
21,8% |
22,2% |
22,5% |
23,4% |
22,9% |
23,7% |
26,8% |
|
Internet |
18,5% |
19,0% |
19,5% |
20,3% |
20,8% |
20,9% |
21,9% |
20,0% |
21,9% |
22,2% |
19,9% |
|
Grandes surfaces non spécialisées |
19,5% |
19,5% |
19,2% |
19,2% |
19,4% |
18,5% |
16,7% |
18,3% |
18,7% |
18,1% |
17,9% |
|
Autres |
3,5% |
3,5% |
3,8% |
3,8% |
3,9% |
4,1% |
4,6% |
4,7% |
5,4% |
5,4% |
4,5% |
|
Courtage, club |
14,5% |
12,0% |
10,8% |
9,4% |
8,6% |
7,3% |
5,7% |
5,7% |
3,2% |
2,2% |
1,0% |
Source : ministère de la culture
B. À L'EXCEPTION DE LA PÉRIODE DE LA CRISE SANITAIRE, DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES QUI SONT RESTÉS STABLES AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES
L'analyse des données économiques des entreprises de la chaîne du livre (la méthodologie de calcul figurant en annexe 1 du présent rapport) bat en brèche une vision défaitiste de l'évolution de la filière, mais n'incite pas pour autant à l'optimisme à moyen et long termes. Les données révèlent en effet, d'une part l'absence d'effondrement de la filière depuis 2017, d'autre part la fin très rapide, dès 2022, de la « bulle » de la chaîne du livre consécutive à la crise sanitaire.
D'après le Centre national du livre, le chiffre d'affaires global de la vente au détail de livres s'élève à 4 milliards d'euros par an, dont 500 à 600 millions d'euros pour l'export de livres. Pour les seules librairies indépendantes, les analyses du Sénat permettent de conclure à un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros en 20224(*).
Évolution du chiffre d'affaires par secteur d'activité
(en base 100 en 2017)
Librairies Édition
Source : Sénat, d'après la base de données FARE. Les ETI et GE sont exclues pour les librairies.
Le secteur des librairies représente un marché relativement volatile, avec un niveau en 2022 proche de 2017. Si le secteur du commerce de détail a un chiffre d'affaires orienté tendanciellement à la hausse au cours des années 2017 - 2022, l'année 2020 montre un recul pour les librairies comme pour le commerce de détail. On constate un rebond important en 2021, particulièrement marqué pour les librairies, mais dont l'effet a été très limité dans le temps. Dès 2022, le secteur de la librairie est redevenu moins dynamique que l'ensemble des commerces de détail.
Contrairement au secteur des librairies, le chiffre d'affaires du secteur de l'édition est resté assez stable aux cours de la crise sanitaire. Le niveau en 2022 est proche du niveau de 2017.
Le Centre national du livre a évoqué lors de son audition un taux de marge des librairies de 2 %. Ces données sont cohérentes avec celles ressortant des analyses du présent rapport, mais cet indicateur, qui rapporte le résultat sur le chiffre d'affaires, ne permet cependant pas de comparer de façon fiable différents secteurs, contrairement au taux de valeur ajoutée.
Taux de valeur ajoutée par secteur d'activité
(en %)
Librairies Edition et autres industries culturelles
Ce graphique présente l'évolution du ratio valeur ajoutée / chiffre d'affaires.
Source : Sénat, d'après base de données FARE. Les ETI et GE sont exclues pour les librairies.
Le taux de valeur ajoutée des librairies est assez stable au fil des années, autour de 22 %. Même sans marge de manoeuvre sur le prix du livre, les librairies parviennent tout de même à obtenir un taux de valeur ajoutée légèrement plus élevé que le commerce de détail dans son ensemble.
Le taux de marge est quant à lui structurellement plus faible pour les librairies que pour le commerce de détail dans son ensemble. Cela s'explique notamment par un poids des salaires plus élevés pour les librairies que pour le reste du commerce de détail : les salaires représentent, en moyenne entre 2017 et 2022, 62 % de la valeur ajoutée des librairies, contre 55 % pour le commerce de détail. Ainsi, si les librairies génèrent plus de valeur ajoutée que le commerce de détail, le poids des effectifs rogne davantage sur la marge finale réalisée.
Le taux de valeur ajoutée du secteur des éditeurs de livres est structurellement plus bas que pour les autres industries culturelles et reste stable autour de 25 % au fil des années. Cela peut s'expliquer par une plus forte dépendance des éditeurs aux prestataires externes (auteurs à rémunérer, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs), là où les entreprises de production de films, par exemple, réalisent davantage le travail de création de valeur en interne.
Le taux de marge des éditeurs est relativement faible comparé aux autres industries culturelles. Il est toutefois plus élevé que celui des éditeurs de journaux et a une dynamique plutôt haussière, là où le taux de marge des éditeurs de journaux est plutôt orienté à la baisse.
S'agissant du prix du livre, celui-ci a évolué nettement en deçà de l'inflation au cours de la dernière décennie. Les ouvrages de littérature générale sont ceux pour lesquels les prix ont été orientés davantage à la hausse.
Évolution du prix du livre par rapport à l'inflation
(base 100 en 2015)
Source : commission des finances d'après les chiffres du ministère de la culture
C. LA CHAÎNE DU LIVRE EST CONFRONTÉE À COURT ET MOYEN TERMES À DES ENJEUX MULTIPLES
Tout d'abord, le marché du livre est actuellement confronté à un effet de ciseaux entre, d'une part, la baisse structurelle du nombre de lecteurs, et d'autre part, une production de livres toujours plus abondante.
S'agissant du premier aspect, les conclusions du dernier baromètre de la lecture5(*) publié par le Centre national du livre ont été largement reprises. Globalement, la part des Français se déclarant spontanément lecteurs et lectrices diminue dans toutes les catégories socio-professionnelles et pour la quasi-totalité des tranches d'âge ; mais aussi et surtout les lecteurs réguliers (- 5 points), dont le niveau est au plus bas depuis 2015. Le ministère de la culture souligne un phénomène de « captation de l'attention par les écrans numériques », massif à partir de 2010.
Concernant le second aspect, le marché approche la saturation du fait d'une sur-publication de titres. Il existe aujourd'hui plus de 877 000 références d'ouvrages accessibles en version papier, et près de la moitié accessibles en livres numériques. Le nombre de livres physiques disponibles a augmenté de 21 % en dix ans, alors même que, comme indiqué précédemment, le lectorat s'effondre.
Évolution du nombre de titres disponibles
(en nombre de titres et en %)
Source : commission des finances d'après les chiffres du ministère de la culture
La vente de livres d'occasion constitue le seul secteur dynamique du marché, qui ne bénéficie qu'à la dernière étape de la chaîne du livre (d'où les discussions en cours sur le partage de la valeur de la vente du livre d'occasion. Ce sujet ne faisant pas l'objet du présent rapport, le rapporteur spécial ne se prononcera pas sur ces échanges).
À l'opposé des librairies dans la chaîne du livre, les évolutions technologiques, et en particulier l'intelligence artificielle, pourraient avoir un impact très fort pour les auteurs, l'activité de traduction d'ouvrages ayant déjà été fortement transformée au cours des dernières années.
Le secteur éditorial fait quant à lui l'objet d'enjeux spécifiques du fait de sa concentration croissante. D'après le Centre national du livre, les deux premiers groupes d'édition totalisent environ 35 % des ventes de livres et les 12 premiers éditeurs, près de 80 %.6(*)
Part du chiffre d'affaires de l'édition de
livre réalisé par les entreprises
selon la taille de leur
groupe d'appartenance
(en %)
Source : Sénat, d'après la base de données FARE
II. UN PILOTAGE SATISFAISANT DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU LIVRE, QUI RELÈVE EN GRANDE PARTIE D'UNE POLITIQUE DE PROXIMITÉ
A. LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE, INTERLOCUTEUR RECONNU PAR L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE DU LIVRE
L'action du ministère de la culture en faveur du livre repose au niveau national en grande partie sur le Centre national du livre (CNL), qui, à l'image du Centre national du cinéma, a été créé après-guerre7(*). La Caisse nationale des lettres visait alors uniquement à soutenir l'édition et la réédition d'oeuvres littéraires. Ses missions se sont progressivement élargies (la caisse nationale devient ainsi le Centre national des lettres en 1973) en parallèle du développement de ses moyens, notamment par l'affectation de taxes sectorielles. Le Centre national des lettres prend le nom de Centre national du livre en 1993. La dernière évolution significative des missions du CNL remonte à 2018, qui a conduit à un recentrement du CNL sur le soutien économique à la filière du livre et le transfert à d'autres acteurs de certaines missions sans rapport (financement de la numérisation patrimoniale de la bibliothèque nationale de France par exemple).
Si la création du CNL est ancienne, sa séparation avec le ministère de la culture est en revanche assez tardive. Jusqu'en 2010, le Centre national du livre était dirigé par le directeur du livre et de la lecture au sein du ministère chargé de la culture. Cette confusion entre l'opérateur et l'administration (alors que le CNC est sa propre administration et ne dépend plus de l'administration du ministère de la culture) a été fortement critiquée. Ainsi, un rapport de l'inspection générale des affaires culturelles et de l'inspection des finances8(*) de 2007 soulignait que « la mission observe que la responsabilité de la Direction du livre et de la lecture et du Centre national du livre est exercée par la même personne, ce qui ne correspond pas aux principes souhaitables de gouvernance qui distinguent plus nettement les missions de stratège et de régulateur d'un côté, d'opérateur public chargé de la mise en oeuvre des politiques de l'autre ». La séparation a donc été renforcée en 2010, de sorte que le ministère de la culture n'exerce aujourd'hui sur le CNL qu'une tutelle classique, comparable à celle exercée sur le Centre national de la musique ou les grandes bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale de France notamment).
Aujourd'hui, cet établissement public administratif (EPA) a pour missions d'encourager la création, l'édition, la diffusion et la promotion d'ouvrages. Il assure la mise en place de nombreux dispositifs d'aide aux acteurs de la chaîne du livre.
Le CNL a fait l'objet de différentes évolutions au cours de la dernière décennie : réforme de sa gouvernance en 2014, transformation des aides à plusieurs reprises, dématérialisation des aides en 2018... Il assure également depuis 2009 la labellisation des libraires françaises ou à l'agrément des librairies francophones à l'étranger (cf. infra).
Dans son dernier rapport (non publié) sur le CNL9(*), la Cour des comptes soulignait que « l'établissement est aussi un lieu d'échanges entre tous les professionnels du livre, ce qui lui confère une place particulière au coeur du secteur ». De fait, il ressort des auditions du rapporteur spécial que le CNL est également une enceinte de concertation entre les différents acteurs de la filière du livre (auteurs et traducteurs, éditeurs et libraires en premier lieu), alors que des enjeux de partage de la valeur, historiquement prégnants, sont réactivés par les enjeux actuels (baisse du nombre de lecteurs, croissance du marché des livres d'occasion, essor du livre numérique, développement de l'intelligence artificielle, etc.).
B. UNE POLITIQUE FORTEMENT DÉCONCENTRÉE
1. Un service de taille restreinte en administration centrale qui n'a aucun rôle direct dans le soutien économique à la filière du livre
La tutelle de la politique du livre est assurée au ministère par le service du livre et de la lecture au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
La taille du service du livre et de la lecture est désormais restreinte. Le ministère indique ainsi que le suivi économique de la filière n'est suivi que par 10 agents. Le département de l'économie du livre a pour mission d'élaborer, de coordonner et d'évaluer l'action du ministère de la culture pour l'ensemble des questions économiques, juridiques et sociales intéressant la création, l'édition, la distribution et la promotion du livre en France et à l'étranger.
L'administration centrale ne déploie aujourd'hui aucune activité de guichet en soutien à des projets portés par des acteurs de l'économie du livre. Elle exerce essentiellement une activité de contrôle et de régulation. Le département de l'économie du livre est divisé entre trois bureaux : le bureau de la création et de la diffusion ; le bureau de la régulation et des technologies ; l'observatoire de l'économie du livre, dont le rôle est d'assurer un suivi de la santé économique de la filière.
Certains intervenants entendus par le rapporteur spécial ont pu regretter la perte de poids de l'administration centrale sur le livre depuis 20 ans, vécue comme une invisibilisation progressive de la politique du livre au sein du ministère de la culture. S'il est vrai que, comparativement aux autres industries culturelles, le service du livre et de la lecture est plus réduit, sa diminution sur le temps long est en grande partie liée à la montée en puissance du CNL. D'autre part, il est vrai que peu de ministres de la culture au cours des dernières années ont fait de la lecture une des priorités de leurs ministère, de sorte que la relative attrition du service du livre et de la lecture est également liée à un portage politique souvent limité.
En revanche, la politique du livre est très peu interministérielle, alors que les enjeux sont transversaux. Par exemple, il n'existe pas de dialogue interministériel à haut niveau en administration centrale entre le ministère de la culture et celui de l'éducation nationale, alors même que la part collective du Pass culture comporte de nombreuses actions sur le livre et la lecture.
2. Un rôle essentiel de l'administration déconcentrée
La politique économique du livre a outre un caractère fortement déconcentré. Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) sont les interlocuteurs de premier niveau de la filière. Contrairement à l'administration centrales, elles ont non seulement un rôle d'expertise, mais également d'attribution de subventions.
Le ministère met ainsi en avant le rôle des 33 conseillers livre et lecture répartis dans 17 DRAC. Ils sont entre 1 à 4 par régions, selon la taille de celle-ci et l'importance que la DRAC accorde à la politique du livre. Ces conseillers ont cependant un rôle bien plus large que le soutien à l'économie du livre, et sont compétents sur l'ensemble des sujets liés au livre (économie du livre mais aussi bibliothèques, patrimoine et archives, développement de la lecture, etc.).
S'agissant de l'articulation entre le CNL et les DRAC, elle a pu faire l'objet de critiques par le passé, le ministère soulignant que « les champs d'intervention des DRAC en direction de l'économie du livre recoupent donc en partie ceux du CNL ». Aujourd'hui, la plupart des acteurs entendus par le rapporteur spécial qualifient de fluides les relations entre l'opérateur et l'administration déconcentrée.
S'agissant des aides, comme cela sera décrit plus bas, les règlements des aides sont conçus pour éviter les doubles subventions entre le CNL et les DRAC. La répartition s'effectue le plus souvent selon la taille des projets : les projets concernant les librairies dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 000 euros relèvent des DRAC, les autres du CNL. De même, les festivals à rayonnement national sont essentiellement soutenus par le CNL, les autres étant soutenus par les DRAC. La Drac rend également au CNL des avis sur les demandes de soutien qui lui sont adressées par les professionnels de la région.
Cette organisation a déjà été approuvée par une mission de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires culturelles, qui soulignait en 2017 que « la politique publique en faveur du livre articule l'action des régions, celle du CNL et celle des DRAC en organisant une complémentarité, davantage qu'un cumul, entre les différents dispositifs d'aide »10(*).
C. UN PILOTAGE STRUCTURÉ PAR LE BIAIS DES CONTRATS DE FILIÈRE, PERMETTANT UNE ASSOCIATION INDISPENSABLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La politique économique du livre est non seulement très déconcentrée, mais également très décentralisée. Dans le cadre de leur compétence en matière de développement économique, les régions sont les principales interlocutrices des DRAC en soutien de la filière du livre. Les départements n'ont quant à eux pas de compétence en matière de politique économique du livre (bien que pouvant intervenir localement et indirectement par le biais de l'approvisionnement des bibliothèques départementales). Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont depuis 202111(*) la possibilité de soutenir les librairies par des subventions, mais ces interventions demeurent très limitées en volume. Les communes ne peuvent par ailleurs pas accorder d'aides à la création de librairies.
Un outil de soutien des communes aux
librairies :
les marchés publics d'achats de livres
Les marchés publics pour les ventes de livres aux bibliothèques représentent en moyenne 10 % du chiffre d'affaires des librairies. Les communes peuvent appliquer la dispense de procédures pour les marchés publics de livres inférieurs à 90 000 euros. Ce seuil correspond aux achats moyens annuels de livres non scolaires d'une bibliothèque d'un territoire de 70 000 habitants. Comme précisé dans l'article R. 2122-9 du code de la commande publique, le choix de recourir à la dispense de publicité et de mise en concurrence est motivé par « l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création »
Cette mesure découle du constat que le critère du prix, habituellement déterminant pour l'attribution des marchés publics, est quasiment inopérant dans le cas des marchés publics de livres non scolaires. En effet, depuis la loi du 18 juin 2003, les rabais sur les achats de livres non scolaires par les collectivités sont plafonnés à 9 % et la quasi-totalité des fournisseurs proposent ce rabais maximal.
La dispense de procédure, bien que prévue par le code de la commande publique, n'est pas toujours connue ni appliquée par les collectivités.
Source : commission des finances
La politique du livre se caractérise, en dépit de la multiplicité des acteurs et de l'enchevêtrement de compétences, par une coordination approfondie entre les différents acteurs, par le biais de deux outils principaux : les contrats de filière économique d'une part, et les structures régionales pour le livre d'autre part.
1. Les contrats de filière, un outil garantissant la complémentarité des interventions des différents échelons
Concernant le premier aspect, des contrats de filière tripartites, s'inspirant du cinéma, réunissant initialement les DRAC et les régions, puis le CNL après 2014, ont progressivement été déployés depuis le début des années 2010.
Ces contrats de filière pour l'économie du livre, conclus pour une durée de 3 ans entre la région, la DRAC et le CNL, définissent des orientations stratégiques communes. Ils ont également vocation à mutualiser les moyens publics accordés à l'économie du livre au travers d'une convention d'application financière annuelle. Les contrats de filière fonctionnent en effet sur le principe d'un co-financement entre l'État et les collectivités.
Les contrats de filière permettent notamment de limiter les doublons en matière d'invention économique. Ils permettent également de compléter l'action du CNL en axant le soutien des DRAC et des régions sur des librairies et des éditeurs inéligibles aux dispositifs nationaux du CNL. À ce titre, ils constituent des outils précieux pour la lisibilité de l'action publique et permettent d'éviter des interventions dispersées entre l'État et les collectivités. Ces contrats de filière constituent un exemple de coordination qui, s'il n'est pas unique dans le domaine des industries culturelles, est néanmoins à saluer.
Ces contrats couvrent aujourd'hui une majeure partie des régions. La politique territoriale du CNL pour la période 2022-2024 avait pour objectif d'étendre la politique de contractualisation du CNL à l'ensemble des régions métropolitaines, et d'étudier un dispositif ad hoc pour l'Outre-Mer. Cet objectif n'est pas encore tenu à l'heure actuelle, malgré des progrès. On dénombre aujourd'hui 11 contrats de filière, mais les régions Île-de-France et Pays de la Loire ne sont toujours pas dotées de contrats régionaux, même si des discussions sont en cours avec cette dernière. En outre-mer, dans lesquels les enjeux de la chaîne du livre, par exemple d'implantation de librairies, peuvent être très spécifiques, seule l'Île de la Réunion est dotée d'un contrat.
Recommandation n° 1 : poursuivre le déploiement des contrats de filière tripartites dans les régions non encore signataires, en particulier dans les outre-mer.
2. Un instrument ad hoc pour la politique du livre : les structures régionales pour le livre
Les contrats de filière sont mis en oeuvre par les structures régionales pour le livre (SRL). Celles-ci sont pour la plupart toutefois bien antérieures, et répondaient lors de leur création à un objectif de développement de la coopération décentralisée. Ces structures rassemblent, outre les financeurs publics, tous les acteurs de la chaîne du livre (soit plus de 30 000 acteurs au total).
Elles sont financées quasi-paritairement par l'État et par les collectivités : 50 % des financements proviennent des collectivités (dont 46 % des régions), 43 % de l'État et 7 % de la filière elle-même. Les structures régionales pour le livre rassemblent au total 135 équivalents temps plein (ETP).
S'agissant de l'État, ces financements ne s'ajoutent pas à ceux des DRAC : les financements déconcentrés de l'État sont le plus souvent affectés aux structures régionales pour le livre.
Selon les régions, les structures régionales pour le livre prennent la forme d'associations ou d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC). Dans le cadre des contrats de filière, les structures régionales pour le livre ont un rôle de pré-instruction des dossiers de demandes d'aides, les financeurs intervenant ensuite dans un second temps.
Les structures régionales pour le livre sont historiquement davantage liées à la librairie et à l'édition, dans une optique d'aménagement du territoire. Afin de répartir les efforts sur l'ensemble de la chaîne du livre, les nouveaux contrats de filière incitent les structures régionales pour le livre à soutenir davantage les auteurs.
Carte des structures régionales pour le livre
Source : fédération interrégionale du livre et de la lecture
La particularité de la région Île-de-France est de ne pas avoir de structure régionale pour le livre. Alors que la région francilienne concentre un grand nombre des acteurs de la chaîne du livre, le Centre national du livre ainsi que les différents acteurs entendus soulignent les difficultés qui résultent de cette absence de structure régionale, complexifiant l'articulation de l'État et de la collectivité.
Financement des structures régionales pour le livre en 2023
(en %)
|
Structure régionale |
Part de financement État |
Part de financement Région |
|
Auvergne-Rhône Alpes livre et lecture |
54 |
38 |
|
Agence livre et lecture Bourgogne Franche-Comté |
49 |
40 |
|
Livre et lecture en Bretagne |
42 |
42 |
|
Agence régionale pour le livre et l'image Centre Val de Loire |
nc |
nc |
|
Interbibly (Grand Est) |
51 |
18 |
|
Agence régionale livre et lecture Hauts-de-France |
42 |
46 |
|
Agence régionale livre et lecture Mayotte |
33 |
0 |
|
Normandie livre et lecture |
33 |
50 |
|
Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine |
25 |
71 |
|
Occitanie livre et lecture |
31 |
46 |
|
Mobilis Pays de la Loire |
27 |
46 |
|
Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur |
25 |
45 |
|
La Réunion des livres |
49 |
15 |
|
Maison du livre de la Nouvelle Calédonie |
22 |
54 |
Source : commission des finances d'après le CNL
La politique économique du livre fait intervenir de nombreux acteurs. Cependant, la structuration ancienne de la filière, ainsi qu'un pilotage qui repose essentiellement sur le CNL et sur l'administration déconcentrée, fluidifient les relations entre les différents échelons. Nombre de recommandations figurant dans les rapports des inspections ou du Sénat du début des années 2010 ont été mises en oeuvre entre temps.
S'il reste des aspects perfectibles, s'agissant de la coordination interministérielle ou de la contractualisation avec l'ensemble des territoires, le rapporteur spécial considère que la gouvernance de la politique du livre a pour vertu d'assurer une complémentarité des actions à destination de la chaîne du livre, ce qui doit être salué.
III. LES MOYENS DE L'ÉTAT POUR LE LIVRE DÉPASSENT LE SEUL SOUTIEN À L'ÉCONOMIE DU LIVRE
A. LE SOUTIEN HISTORIQUE DE L'ÉTAT À LA FILIÈRE DU LIVRE PASSE POUR L'ESSENTIEL PAR LA RÉGULATION
1. Une action essentielle du ministère de la culture en matière de régulation du marché du livre
La politique publique du livre repose sur quatre piliers principaux :
- des mesures de régulation par le biais du droit de la propriété littéraire et artistique et du prix unique du livre ;
- un soutien aux bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale de France - BNF, bibliothèque publique d'information - BPI et bibliothèques locales) ;
- une fiscalité spécifique par l'application d'un taux réduit de TVA12(*) ;
- un soutien économique direct à la chaîne du livre, notamment par le biais du CNL.
Le présent rapport est consacré pour l'essentiel aux deux derniers aspects. Pour autant, il apparaît nécessaire pour mémoire de revenir brièvement sur les autres interventions de l'État.
Le rôle de l'administration centrale du ministère de la Culture est en effet essentiellement dédié à la construction du cadre législatif et réglementaire.
L'exemple le plus emblématique de l'intervention du ministère en matière de régulation du secteur est la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, qui a acté le principe du prix unique du livre. Le prix unique est désormais un instrument consensuel, les dérogations étant réduites au fil du temps (le dernier exemple en date étant l'interdiction faite aux plateformes de vente en ligne de contourner le prix unique en jouant sur le coût des frais de livraison13(*)).
L'autre volet principal de régulation du secteur est celui de la régulation par le droit d'auteur, le ministère intervenant par exemple sur des sujets tels que la gestion collective du droit de prêt en bibliothèques ou encore la mise en place d'une règlementation propre aux contrats d'édition.
La régulation reste, 45 ans après la loi sur le prix unique du livre, l'instrument privilégié d'intervention de l'État sur la filière du livre. À rebours de l'idée qui ferait du financement l'alpha et l'oméga de l'action de l'État en soutien à une filière économique, l'action régulatrice de l'État est particulièrement structurante : le prix unique est un outil garantissant l'égal accès à tous au livre et favorise également le maintien d'un réseau dense de librairies de proximité.
2. Une politique de labellisation axée sur le soutien aux librairies indépendantes gérée par le CNL pour le ministère
Autre instrument de la politique économique du livre, la labellisation des librairies a des conséquences sur l'attribution d'aides publiques, mais a des objectifs plus larges.
Les librairies peuvent bénéficier de l'un ou l'autre des deux labels attribués par le ministère : le label « librairie indépendante de référence » (LIR) ou « librairie de référence » (LR) pour des librairies de groupe. S'y ajoute un troisième label pour les librairies à l'étranger, qui peuvent bénéficier d'un agrément comme « librairie francophone de référence » (LFR).
Peuvent bénéficier de ces labels des libraires menant une politique de valorisation de la diversité éditoriale et de la création. Les établissements doivent remplir plusieurs conditions : avoir une activité principale de librairie en réalisant a minima 50 % du chiffre d'affaires au travers de livres ; disposer d'un catalogue d'ouvrages variés ; proposer toute l'année une animation culturelle dont la régularité et la qualité sont jugées suffisantes par la commission compétente au regard notamment de la diversité des actions et de l'importance des publics touchés.
Ces labels sont attribués pour 3 ans par le ou la ministre de la culture mais sont gérés par le CNL, qui instruit depuis 2009 les demandes de labellisation pour le compte de son ministère de tutelle. D'après le CNL, plus de 500 librairies sont actuellement labellisées, dont environ un cinquième en Île-de-France.
Les avantages du label LIR sont multiples : reconnaissance du public ; conditions commerciales favorables de la part des fournisseurs ; possibilité de bénéficier d'une aide à la valorisation des fonds accordée par le CNL ; possibilité de bénéficier d'une exonération de contribution foncière des entreprises si la collectivité a délibéré en ce sens.
Les exonérations de contribution foncière des entreprises pour les librairies
La loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 a posé le principe d'un label de librairie indépendante de référence, ouvrant la possibilité aux collectivités locales d'exonérer de taxe professionnelle (TP) les librairies labellisées librairies indépendantes de référence (LIR) répondant aux conditions de l'article 1464 I du code général des impôts. Elle a depuis été remplacée au 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale (CET).
Depuis la loi de finances pour 2018, les librairies labellisées librairies de référence peuvent également en bénéficier, sous réserve d'une décision étendue des collectivités territoriales.
Dans la plupart des cas, la compétence « livre » a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En 2024, 17 % des EPCI avaient mis en place cette exonération pour les librairies labellisées LIR, et 5 % des EPCI avaient étendu l'exonération aux librairies de référence.
Proportion d'EPCI et de communes ayant mis en
place une exonération
de CET en 2024
(en %)
Source : commission des finances
Source : commission des finances d'après le ministère de la culture
B. LE SOUTIEN À LA FILIÈRE NE REPRÉSENTE QU'UNE FAIBLE PART DES MOYENS CONSACRÉS PAR L'ÉTAT AU LIVRE ET À LA LECTURE
1. Les moyens budgétaires consacrés par l'État s'élèvent à 500 millions d'euros, dont la majorité n'est pas consacrée à l'économie du livre
Le montant total consacré par l'État au livre et à la lecture s'élevait en 2024 à 1,1 milliard d'euros. Ce volume élevé doit être analysé avec précaution : les deux-tiers de ce montant ne recouvrent en réalité pas une dépense budgétaire mais une perte de recettes pour l'État. La dépense budgétaire de l'État en faveur du livre et de la lecture représente 500 millions d'euros. Ces montants restent inférieurs au 1,7 milliard consacré par les collectivités à la politique de la lecture publique.
Le volet budgétaire de l'action de l'État en faveur du livre repose en grande partie par l'action 01 - Livre et lecture du programme 334 « Livre et industries culturelles » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Celle-ci s'élevait en exécution 2024 à 310 millions d'euros en AE et 317,4 millions d'euros en CP. Le reste de la dépense budgétaire découle pour une part de transferts de l'État aux collectivités territoriales (concours pour les bibliothèques locales sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ») et d'autre part du Pass culture, dont une grande partie subventionne l'achats de livres (pour un montant de 89 millions d'euros en 2024).
L'ensemble de ces 500 millions d'euros ne finance pas le soutien à l'économie du livre. La politique économique du livre proprement dite est financée par la sous-action 04 du programme 334, qui s'élève en 2024 à 50,7 millions d'euros, soit seulement 6,8 % des crédits consacrés au livre et à la lecture.
Montants consacrés par l'État au soutien au livre et à la lecture en 2024
(en millions d'euros et en %)
|
Dépense budgétaire ou incidence fiscale |
Montant |
Proportion du soutien total accordé par l'État |
|
|
Mission Médias, livre et industries culturelles Programme 334 - Action 01 livre et lecture |
Bibliothèque nationale de France |
243,0 |
22,07 % |
|
Politique économique du livre |
50,7 |
6,85 % |
|
|
dont Centre national du livre |
28,5 |
2,52 % |
|
|
Développement de la lecture et des collections |
23,7 |
2,15 % |
|
|
dont Bibliothèque publique d'information |
10,1 |
0,92 % |
|
|
Total |
317,4 |
28,83 % |
|
|
Mission Culture |
Achats de livres sur les crédits du Pass Culture (part individuelle) |
89 |
8,09 % |
|
Compensation partielle par l'État d'exonération de cotisation d'assurance vieillesse pour les artistes auteurs |
nc14(*) |
||
|
Mission relations avec les collectivités territoriales |
Concours particulier relatif aux bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) |
94,4 |
8,58 % |
|
Taux réduit de TVA sur le livre |
600 |
54,51 % |
|
|
Total |
1 100,8 |
100,00 % |
|
|
Total hors lecture publique et archives |
740 |
67,22 % |
|
|
Total dépenses budgétaires |
500,8 |
45,5 % |
|
|
Total dépenses budgétaires hors lecture publique et archives |
139,7 |
12,69% |
|
Source : commission des finances
La très grande majorité des crédits budgétaires est donc consacrée à la politique de la lecture publique, essentiellement de soutien aux bibliothèques. Environ 260 millions d'euros sur les 317 millions d'euros du programme 334 consacrés au livre financent les grandes bibliothèques publiques (bibliothèque nationale de France - BnF et bibliothèque publique d'information - BPI). La dotation de la BnF est ainsi 10 fois supérieure à celle du Centre national du livre.
Évolution des crédits dédiés aux opérateurs du programme 334 « Livre et lecture »
(en millions d'euros)
Source : commission des finances
Les crédits de l'action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles », ces derniers ont augmenté de 15 % en AE et 21 % en CP entre 2020 et 2025. Là encore, une grande part de cette dynamique est imputable au soutien aux bibliothèques. Les crédits dédiés à la seule BnF sont en forte hausse au cours des dernières années du fait d'un besoin de gros investissements (+ 28 millions d'euros entre 2022 et 2025).
2. Des crédits dédiés au soutien économique à la filière du livre limités à 50 millions d'euros en 2024
a) Une relative stabilité des crédits dédiés à l'économie du livre depuis 2021
Le taux réduit de TVA pour le livre a un coût estimé à 600 millions d'euros en 2025 par le ministère des comptes publics. Cela représente 80 % du soutien direct de l'État à l'économie du livre. Les crédits de la mission « Médias et industries culturelles » représentent 7 % du soutien de l'État à la filière, soit une proportion inférieure au poids des crédits de la mission « Culture » (12 %).
Ventilation des dépenses fiscales et budgétaires consacrées à la politique économique du livre
(en %)
Source : commission des finances
Les crédits dédiés à l'économie du livre proprement dite s'élèvent en 2024 à 50,7 millions d'euros, soit une progression de 7 millions d'euros (+15 %) entre 2021 et 2024.
Évolution de la sous-action Économie du livre
(en millions d'euros)
Source : commission des finances
Hors inflation, sur la période 2021-2024, les crédits dédiés à l'économie du livre n'augmentent que de 3,1 %.
Évolution de la sous-action Économie du livre en euros constants
(en millions d'euros)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Montant en valeur |
43,71 |
46,99 |
48,91 |
50,70 |
|
Évolution en valeur (en euros courants) |
|
7,50% |
4,10% |
3,70% |
|
Évolution en volume (en euros constants) |
|
2,00% |
-0,70% |
1,80% |
|
Montant en euros 2025 |
49,85 |
50,87 |
50,51 |
51,41 |
Source : commission des finances
L'évolution à plus long terme des crédits budgétaires en faveur de la filière du livre depuis 2015 est difficile, du fait de forts changements de périmètre ; et en premier lieu la budgétisation des ressources du CNL en 2019 après la suppression des taxes affectées qu'il percevait antérieurement. En outre, l'évolution pluriannuelle est marquée par un fort soutien à la filière du livre dans le cadre des plans d'urgence et de relance pendant la crise sanitaire, thématique qui sera développée plus bas.
b) La situation financière du Centre national du livre : des recettes publiques en légère hausse et des dépenses maîtrisées, mais une trésorerie à un niveau particulièrement élevé
Le financement du CNL a été entièrement modifié en 2019. Auparavant, la quasi-totalité de ses ressources provenait du produit de deux taxes affectées : la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie et celle sur les appareils de reprographie et d'impression. Le rendement de ces deux taxes était en diminution, notamment du fait du caractère partiellement obsolète de la seconde (27 % entre 2015 et 2019). Dans le cadre plus large de volonté du ministère de l'économie et des finances de réduire les taxes affectées dont le montant était faible, leur suppression a été actée en loi de finances pour 201915(*).
Depuis le 1er janvier 2019, le financement du CNL a donc été budgétisé : l'opérateur perçoit désormais une subvention pour charges de service public (SCSP) sur le programme 334 « Livre et industries culturelles » de la mission » Médias, livre et industries culturelles ». Cette SCSP représentait 28,45 millions d'euros en 2025.
Le montant de la SCSP reste inférieur à celui des taxes affectées pendant la décennie 2010, là encore pour des raisons de périmètre : le montant de fiscalité affectée comprenait les subventions versées par le CNL destinées à la Bibliothèque nationale de France (BnF), au Bureau international de l'édition française (BIEF), et à la Maison des écrivains et de la littérature (MEL).
La dotation pour charges de service public du Centre national du livre a augmenté de 4,5 millions d'euros depuis 2020 (+21 %). Une part de cette augmentation en 2023 et 2024 est liée à la compensation de la hausse de l'inflation et de la revalorisation des personnels. Une autre part de cette hausse a été consacrée à des actions liées à l'année de la lecture « grande cause nationale » en 2022.
Elle a en revanche légèrement diminué entre 2024 et 2025 (de 440 000 euros), dans un contexte de contraction de la dépense publique.
Évolution des crédits accordés au CNL
(en millions d'euros en AE=CP)
Source : commission des finances d'après les données du CNL
En 2024, la SCSP représentait 96 % des recettes du CNL. Pour autant, les recettes de l'établissement ont été diversifiées pendant la crise sanitaire, en particulier grâce aux versements de crédits exceptionnels (+ 30,1 millions d'euros en 2020 ; + 12,2 millions d'euros en 2021 et + 3 millions d'euros en 2022, cf. infra).
Évolution et ventilation des recettes du CNL
(en millions d'euros en AE=CP)
Source : commission des finances d'après les données du CNL
Le CNL voit ses recettes propres augmenter, mais celles-ci restent très réduites (2 % de recettes propres seulement en 2024). Elles sont aujourd'hui essentiellement constituées par le remboursement des prêts consentis par le CNL, des masterclass d'auteurs, financés la part collective du Pass culture et de l'organisation des manifestations nationales portées par le CNL. Comme pour nombre d'opérateurs du ministère de la culture, le développement des ressources propres doit représenter un axe d'amélioration au cours des prochaines années.
Il est d'ailleurs notable que le contrat d'objectifs et de performance du CNL pour 2022-2026 ne comporte pas d'indicateur dédié à la diversification de ses recettes16(*). Le seul indicateur de l'axe 4 du COP - adapter la gouvernance du CNL aux nouveaux enjeux concerne la réduction des dépenses de personnel. Le prochain COP doit être l'occasion pour la tutelle d'encourager le CNL à développer ses ressources propres en mettant en place un indicateur spécifique.
Recommandation n°2 : introduire dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens du CNL un objectif de développement des ressources propres de l'établissement
Deux-tiers des crédits versés au CNL par le ministère de la culture sont directement reversés à la filière du livre par des aides directes. Les dépenses de personnel constituent le deuxième poste de dépense (5,6 millions d'euros). Les frais de fonctionnement du CNL s'élèvent à 1,4 million d'euros.
Ventilation des dépenses du CNL en 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les données du CNL
Les dépenses du CNL sont globalement maîtrisées : elles ont diminué de 7 % au cours des dix dernières années et s'élèvent en 2024 à 30,6 millions d'euros.
Les dépenses de personnel sont celles qui ont davantage augmenté en proportion, de 3,5 millions d'euros en 2015 à 5,7 millions d'euros en 2024. La croissance de la masse salariale n'est pas liée à des recrutements (diminution d'un ETPT depuis 2015, le plafond d'emplois du CNL étant stable à 65 ETPT depuis 2019). Une part de cette augmentation découle du transfert en 2022 de la gestion des agents fonctionnaires (14 ETPT) sur le budget du CNL, qui a entraîné une hausse des dépenses d'environ 0,9 million d'euros. Les hausses successives du point d'indice en 2022 et 2023 se sont traduites par une progression de 5 % des dépenses de personnel.
Évolution des dépenses du CNL
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les données du CNL
S'agissant de l'évolution des indicateurs financiers du CNL, la trésorerie et le fonds de roulement ont augmenté légèrement entre 2015 à 2019, (+ 2 % en 4 ans pour la trésorerie ; + 9 % pour le fonds de roulement). La crise sanitaire a entraîné un gonflement de l'une comme de l'autre sous le double effet de la hausse de recettes grâce aux abondements prévus dans le cadre des plans d'urgence et de relance et du décalage entre ces recettes et les dépenses correspondantes. En conséquence, en 2020, la trésorerie du CNL a augmenté de 55 % et le fonds de roulement de 54 %.
Les niveaux du fonds de roulement et de la trésorerie se sont relativement normalisés au cours des années suivantes, à la fois grâce au décaissement progressif des dépenses liées à la crise sanitaire et à des prélèvements ciblés sur le fonds de roulement. L'année de la lecture - grande cause nationale en 2022 a été financée par un prélèvement sur le fonds de roulement du CNL à hauteur de 1,5 million d'euros en 2022, prolongée en 2023 à hauteur de 500 000 euros et en 2024 de 400 000 euros. Des prélèvements sur le fonds de roulement ont également été mis en oeuvre pour financer des travaux de rénovation énergétique et le plan de soutien pour la transition écologique des acteurs de la chaine du livre (pour un montant de 400 000 euros par an).
Le fonds de roulement comme la trésorerie restent néanmoins aujourd'hui à un niveau largement supérieur à celui d'avant crise (+ 24 % par rapport à 2015), et au montant élevé, représentant près d'une année de budget. En conséquence, le CNL devrait mobiliser davantage son fonds de roulement afin de financer ses dépenses, dans un contexte de baisse potentielle des recettes publiques.
Évolution de la trésorerie et du fonds de roulement du CNL
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les données du CNL
c) Les crédits du ministère
Les crédits de la sous-action « Politique économique du livre » s'élevaient en 2024 à 50,7 millions d'euros, dont les deux-tiers couvrent la SCSP du Centre national du livre. Le ministère disposait donc en 2024 de 22 millions d'euros, dont un tiers de crédits déconcentrés.
Répartition des crédits de la politique économique du livre
(en %)
Source : commission des finances d'après les données du ministère de la culture
Les crédits centraux s'élèvent en 2024 à 10,5 millions d'euros, essentiellement consacrés au financement de deux organismes, la Centrale de l'édition et le bureau international de l'édition française (BIEF). La première, qui a reçu 5 millions d'euros du ministère en 2024, est un groupement d'intérêt économique chargé à la fois de favoriser l'exportation à l'étranger des livres en langue française et de permettre l'application dans les territoires ultramarins de la loi de 1981 sur le prix du livre. Le second, recevant 2,8 millions d'euros en 2024, est chargé de faciliter et d'encourager les exportations et les échanges de droits à l'international. Le ministère verse également des subventions aux associations représentatives des auteurs, des éditeurs et des libraires (cf. infra).
S'ajoutent aux crédits centraux les montants versés par le ministère de la culture au titre du droit de prêt en bibliothèque, soit 9,8 millions d'euros en 2024. Ces derniers évoluent relativement peu selon les années (9,1 millions d'euros en 2023, 9,7 millions d'euros en 2022).
Le droit de prêt en bibliothèque et les régimes de retraites des auteurs
Le droit de prêt en bibliothèque constitue l'un des principaux dispositifs de l'action en faveur de l'économie du livre.
La loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a mis en place une rémunération des auteurs et des éditeurs pour le prêt de leurs livres en bibliothèques. Cette rémunération est financée par l'État, sur la base d'un forfait par lecteur inscrit, et par les bibliothèques de prêt, sous la forme d'un versement de 6 % du prix des livres achetés par ces dernières.
Ce dispositif permet également le financement d'un régime de retraite complémentaire au profit des écrivains et traducteurs, ainsi qu'aux illustrateurs de livres depuis le 1er janvier 201017(*).
Ce dispositif complémentaire s'ajoute aux compensations versées par l'État au titre de la prise en charge partielle des cotisations au régime général de l'Assurance retraite pour les artistes auteurs (cf. infra).
Source : ministère de la culture
Les crédits déconcentrés représentent un tiers des montants accordés à la lecture et à l'économie du livre directement par le ministère de la culture. Toutefois, les crédits déconcentrés spécifiquement en faveur de la filière économique du livre sont d'un montant réduit, soit 4,8 millions d'euros en 2024.
Ce niveau correspond pour autant à un doublement par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire (2,2 millions d'euros en moyenne sur la période 2015-2019). Une partie de cette hausse découle de financements de manifestations littéraires et du dispositif Jeunes en librairie (pour un total de + 1,3 million d'euros en 2023 et + 600 000 euros en 2024).
S'agissant de la destination des financements du ministère, ils contribuent pour l'essentiel au financement des librairies et dans une moindre mesure de l'édition et des manifestations littéraires. Une analyse plus précise des aides attribuées par les DRAC figure en deuxième partie du présent rapport.
Évolution des crédits de la
sous-action 4 du programme 334 - hors subvention
du Centre national du
livre
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les données du ministère de la culture
DEUXIÈME
PARTIE
À REBOURS DES AUTRES INDUSTRIES CULTURELLES, UNE
FILIÈRE QUI REPOSE PEU
SUR LE SOUTIEN BUDGÉTAIRE DE
L'ÉTAT
I. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS
A. LE CNL VERSE ENVIRON 22 MILLIONS D'EUROS D'AIDES DIRECTES À L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE
1. Un rôle central du Centre national du livre dans la distribution des aides à la filière du livre
a) Le CNL attribue plus d'une vingtaine d'aides pour des montants restreints
Le Centre national du livre est le principal acteur à intervenir directement auprès des entreprises de la chaîne du livre. Les aides du CNL concernent autant les aides à l'investissement qu'au fonctionnement. Elles prennent différentes formes :
- aides aux entreprises : prêts sans intérêts ou subventions pour l'accompagnement de projets de création, de reprise ou de développement ;
- aides aux actions qualitatives : prêts sans intérêts ou subventions pour le soutien aux actions d'animation culturelle, à l'élargissement ou à la création de fonds thématiques ;
- subventions en faveur des librairies francophones à l'étranger ;
- accompagnement de projets interprofessionnels.
Les aides du CNL prennent la forme de 28 dispositifs, qui bénéficient à l'ensemble des professionnels de la chaîne du livre.
Présentation des dispositifs d'aides directes du CNL
|
Cible |
Dispositif |
|
Soutien aux auteurs et traducteurs |
Bourses auteurs et illustrateurs : écriture |
|
Bourses auteurs et illustrateurs : résidences |
|
|
Bourses traducteurs : bourses de traduction |
|
|
Bourses traducteurs : bourses de séjour aux traducteurs |
|
|
Bourse Cioran |
|
|
Allocations annuelles aux auteurs |
|
|
Soutien aux éditeurs |
Publication |
|
Traduction (vers le français) |
|
|
Traduction (depuis le français) |
|
|
Développement numérique : livre audio |
|
|
Développement numérique : publications numériques |
|
|
Développement numérique : services numériques |
|
|
Promotion auteurs et publications |
|
|
Soutien aux revues |
Revues : fonctionnement |
|
Revues : numérisation |
|
|
Soutien aux librairies |
Conventions territoriales |
|
Subventions économiques |
|
|
Valorisation des fonds |
|
|
Librairies francophones à l'étranger |
|
|
Soutien aux bibliothèques et porteurs de projets lecture |
Aide au développement de la lecture |
|
Soutien aux manifestations littéraires |
Manifestations littéraires en région |
|
Partir en livre |
|
|
Printemps des poètes |
|
|
Soutien aux structures |
Accompagnement ou valorisation du secteur du livre |
|
Prêts économiques |
Prêts économiques aux éditeurs |
|
Prêts économiques aux librairies |
Source : commission des finances
S'agissant des domaines bénéficiant des financements, les livres jeunesse, les romans et la bande dessinée représentent à eux seuls plus de la moitié des aides. Les champs « histoire, sciences humaines et sociales, philosophie », « arts » et « poésie, théâtre » sont davantage aidés que ce qu'ils représentent au sein du chiffre d'affaires de l'édition française. À l'inverse, le CNL aide moins les domaines « bande dessinée » et « jeunesse » que ce qu'ils représentent au sein du chiffre d'affaires de l'édition française18(*).
Près de 3 000 aides ont été attribuées en 2023 par le CNL, pour un montant total de 22 millions d'euros.
Aides directes totales attribuées par le CNL
(en millions d'euros et en nombre d'aides)
Source : commission des finances d'après le CNL
Le CNL soutient toutes les étapes de la chaîne du livre : ainsi, 20 % des aides accordées vont aux auteurs, 23 % aux éditeurs et 16 % aux librairies.
Ventilation par dispositifs des aides versées par le CNL en 2023
(en %)
Source : commission des finances d'après le CNL
Le montant moyen global pour l'ensemble des aides attribuées en 2023 est de 7 500 euros. On note cependant d'importantes variations selon l'échelon cible dans la chaîne du livre. Ainsi, si en nombre d'aides les librairies ne représentent que 16 % des aides accordées, les aides vers celles-ci sont en moyenne d'un montant deux fois supérieur aux aides aux auteurs et aux éditeurs.
Montant moyen des aides attribuées par le CNL en 2023
(en euros)
|
Nombre d'aides attribuées par le CNL |
Montant total |
Montant moyen |
|
|
Auteurs et traducteurs |
830 |
4 590 000 |
5 530,1 |
|
Éditeurs |
1131 |
5 080 000 |
4 491,6 |
|
Librairies |
449 |
5 740 000 |
12 784,0 |
|
Manifestations littéraires |
357 |
3 170 000 |
8 879,6 |
|
Valorisation du livre |
43 |
2 550 000 |
59 302,3 |
Source : commission des finances d'après les données du CNL
b) Un ciblage des aides sur les entreprises les moins rentables
Face à aux montants moyens des aides accordées par le CNL, il est possible de s'interroger sur un risque de saupoudrage. Sans l'écarter, l'analyse des données va dans le sens d'un ciblage des aides du CNL sur les entreprises les plus fragiles.
Évolution du taux de marge du secteur des
librairies et des éditeurs
selon les aides CNL et DRAC
perçues
(en %)
Taux de marge : Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée
Source : Sénat, d'après base de données FARE et Ministère de la Culture. Les ETI et GE sont exclues pour les librairies.
Les librairies qui perçoivent des aides sont, en moyenne, structurellement moins rentables que les autres, ce qui semble indiquer que les aides sont bien ciblées sur les commerces les plus en difficulté.
Hors crise sanitaire, les aides CNL et DRAC leur permettent de gagner entre 2 et 5 points de marge, et donc de se rapprocher du niveau de rentabilité des autres librairies. Malgré cela, leur taux de marge est resté inférieur au taux de marge de celles ne percevant pas d'aides. En 2020 et dans une moindre mesure 2021, les aides ont ciblé nettement plus d'entreprises, et ont tout de même été orientées, en moyenne, vers celles ayant un taux de marge plus faible.
S'agissant des éditeurs, les aides versées par le CNL ont un impact plus faible que pour les librairies : les montants sont globalement plus faibles et se répartissent sur un marché plus étendu que celui des librairies.
La répartition entre le CNL et les DRAC implique que le CNL soutienne des projets et des entreprises de plus grande taille que les DRAC. Pour autant, le COP 2022-2026 contient deux indicateurs destinés à encourager les plus petits acteurs de la chaîne du livre.
Le premier est le taux de subventions du CNL attribuées à des petites et moyennes maisons d'éditions : il était de 57 % en 2022 et de 79 % en 2023. Le second est la proportion de librairies bénéficiant d'aides du CNL et localisées dans des communes de moins de 30 000 habitants : cette proportion est stable entre 2021 et 2023, entre 43 % et 46 %.
Une évaluation globale des aides du CNL implique également de tenir compte de l'effet levier des aides du CNL par le biais des contrats de filière : le ministère indique ainsi que sur la base d'un abondement d'un euro du CNL pour un euro de la région, les contributions financières du CNL varient de 100 000 euros à 25 000 euros par an selon les régions. Il importe également de tenir compte de l'interdépendance des différents acteurs de la chaîne du livre : ainsi, les aides aux librairies bénéficient indirectement aux auteurs et aux éditeurs, et vice-versa.
2. Des modalités d'attribution des aides perfectibles mais globalement satisfaisantes
a) L'attribution des aides par le CNL, un processus lourd pour des montants faibles
Il n'existe aucune aide automatique attribuée par le CNL, celui-ci ne versant que des aides sélectives.
Les aides du CNL ne sont pour la plupart d'entre elles pas territorialisées : les aides à la publication ou les bourses d'auteurs sont par exemple attribués uniquement sur des considérations esthétiques ou selon des critères formels ayant trait aux oeuvres soutenues. La localisation des projets soutenus n'entre donc pas en ligne de compte. En revanche, le CNL indique « intégrer des critères territoriaux pour toutes les aides nationales comportant une problématique d'aménagement culturel du territoire et de relation aux publics », tels que les aides aux librairies (à l'exception des labels), les aides aux manifestations littéraires ou les résidences d'auteur. Le CNL sollicite alors les conseillers des DRAC.
Le CNL indique néanmoins que, sur ses crédits, 40 % ont aidé les librairies dans des communes de moins de 15 000 habitants. 60 % des librairies aidées le sont dans des communes de moins de 15 000 habitants et 75 % dans des communes de moins de 25 000 habitants.
Les demandes d'aides sont examinées en commissions thématiques (15 commissions artistiques selon les genres littéraires) ; en comités (uniquement pour les prêts aux éditeurs ou aux librairies, afin de respecter le secret des affaires) ; en collège des présidents (pour les subventions aux structures professionnelles ou les demandes n'entrant pas dans le champ de compétences des commissions thématiques ou des comités) et enfin en conseil d'administrations (pour les subventions dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 euros). La liste des commissions et comités figure en annexe 4 du présent rapport. Les dossiers présentés aux commissions et comités sont instruits et portés par les 3 délégations du CNL : la délégation à la diffusion et à la lecture, la délégation à la création et la délégation à la communication et aux événements littéraires.
La décision d'octroi de l'aide relève cependant uniquement de la présidente du CNL, sur la base de l'avis collégial émis en amont, qui n'est que consultatif.
Le taux de sélectivité des projets apparaît dans l'ensemble correct, à l'exception des 43 projets relevant de l'objectif de valorisation du livre, pour lesquels la quasi-totalité des projets ayant demandé une aide en ont bénéficié.
Taux de sélectivité des aides attribuées par le CNL
(en % et en nombre de bénéficiaires)
|
Nombre de demandes examinées en commission |
Nombre de bénéficiaires |
Taux de sélectivité |
|
|
Auteurs et traducteurs |
1307 |
765 |
58,5% |
|
Éditeurs |
1672 |
374 |
22,4% |
|
Librairies |
523 |
352 |
67,3% |
|
Manifestations littéraires |
484 |
329 |
68,0% |
|
Valorisation du livre |
43 |
42 |
97,7% |
Source : commission des finances d'après les données du CNL
La comitologie du CNL apparaît assez lourde : chacune des commissions est composée de 8 à 20 membres experts nommés pour 3 ans sur décision de la présidente de l'établissement, auxquelles s'ajoutent des expertises complémentaires de lecteurs et de rapporteurs externes qui examinent en détail les projet soumis à l'avis des commissions.
Les comités du CNL sont composés de certains agents du CNL, des ministères concernés et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Le comité Allocations annuelles aux auteurs, auquel participe un assistant social, est composé de quatre présidents de commission. Le collège des présidents est quant à lui composé de tous les présidents des commissions du CNL.
Depuis 2018, il existe un montant minimal de subvention, d'après la Cour des comptes pour « éviter que les coûts de traitement de l'aide ne dépassent son montant ». Ce seuil, fixé à 500 euros pour la plupart des dispositifs, reste extrêmement bas. Par exception, il est cependant de 4 000 euros pour la subvention d'aide à l'investissement des librairies et 3 000 euros pour l'aide à la mise en valeur des fonds. Le montant plancher n'a en outre pas évolué depuis 2018.
Lors des auditions, plusieurs intervenants ont souligné la charge administrative découlant de la demande d'aide, pour des montants qui demeurent extrêmement réduits. Il semble donc impératif, dans un objectif de simplification tant pour les demandeurs que pour le CNL, de relever ce plancher pour toutes les aides pour lesquelles il est fixé depuis 2018 à 500 euros.
Plus largement, la Cour des comptes soulignait dans son rapport sur le CNL en 2022 précédemment mentionné que les coûts de traitement des aides « n'ont pas été calculés ni de manière générale ni pour des dispositifs donnés ». Le rapporteur spécial considère que le CNL doit mettre en place une méthodologie de calculs des coûts de traitement des aides, sans laquelle il n'est pas possible de mener une réelle évaluation de l'efficience des aides.
Recommandation n° 3 : évaluer le coût de traitement des aides du CNL et relever le montant minimal d'aides, actuellement fixé à 500 euros pour la plupart des aides et non revalorisé depuis 2018, afin de limiter le saupoudrage des moyens (CNL)
b) Un processus constant d'amélioration de l'attribution des aides mais qui demeure en cours
La principale avancée en matière de simplification mise en place au cours des dernières années est la numérisation des demandes d'aides en 2018. Plus largement, à la suite du rapport de la Cour des comptes et de la crise sanitaire, le CNL s'est engagé en 2022 dans un chantier de simplification de ses dispositifs et de ses procédures.
Il faut également noter que le nombre de dispositifs d'aide est en diminution au cours des dernières années, afin de fusionner plusieurs d'entre elles. Le règlement des aides du CNL de juin 2024 définit ainsi 28 aides, contre 38 avant 2015.
Dispositifs du CNL évaluées au cours de la dernière décennie
Le Centre national du livre (CNL) s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d'évaluation de ses dispositifs. Le CNL conduit une réflexion méthodologique axée sur l'analyse de critères évaluatifs standards, portant notamment sur la pertinence, la cohérence, l'efficacité, et l'efficience des dispositifs qu'il met en oeuvre. Sur la base de cette méthodologie, déployée à compter de 2016, l'établissement a ainsi évalué une grande partie de ses dispositifs :
- les subventions pour la mise en valeur des fonds et de la création éditoriale en librairie (2016- 2017). Désormais uniquement accessible aux établissements labellisés LIR ou LR par le ministère de la culture, cette subvention est recentrée sur l'engagement et l'investissement des libraires ;
- les bourses aux auteurs et illustrateurs (2018-2019), les subventions pour la publication d'ouvrages (2018-2019), les subventions pour la traduction d'ouvrages étrangers en français (2018-2019). Ces aides ont été assouplies et revalorisées, ainsi que les critères recentrés sur la qualité des projets ;
- les subventions en faveur des revues (2020-2021) ;
- les subventions en faveur du développement numérique (2020-2021) ;
- les conventions territoriales (2020-2021) ;
- les aides économiques aux éditeurs (2021) ;
- les subventions aux manifestations littéraires (2021-2022). L'évaluation a donné lieu à la création d'une aide destinée aux manifestations de petite taille, jusqu'alors inéligibles aux subventions du CNL, mais affichant des objectifs intéressants en matière de maillage territorial, de proposition artistique et littéraire, ou de travail avec les publics ;
- les subventions aux porteurs de projets pour le développement de la lecture des publics spécifiques (2022-2023),
- les subventions à la création ou au développement du livre audio (2022-2023),
- les subventions aux maisons d'édition pour la promotion des auteurs et publications (2023-2024). Depuis 2020, 8 dispositifs ont ainsi été évalués, et ont donné lieu à 8 changements de règlements afin de mettre en oeuvre les recommandations issues des évaluations.
La Cour des comptes, dans son rapport sur le CNL de 2022, recommande d'accélérer le processus d'évaluation : « Au regard des enjeux qu'elles recouvrent, la Cour considère que le CNL ne saurait se satisfaire de prévoir l'achèvement de ces évaluations d'ici une dizaine d'année et estime indispensable d'en accélérer le rythme ».
Source : commission des finances d'après le CNL
Ces évaluations ont mené à quelques réformes au cours des dernières années (assouplissement des délais de carence entre deux résidences d'auteurs ; fusion de l'aide à la publication et de l'aide aux grands projets, modification de l'aide à la promotion, etc). Une amélioration suggérée à plusieurs reprises lors des auditions concerne les subventions à la valorisation des fonds en librairie. L'aide à la valorisation des fonds est réservée aux librairies bénéficiant du label LIR, les deux demandes (de labellisation et d'aide) étant instruites par le CNL, pour les mêmes librairies mais sur la base de critères différents.
Le CNL considère que les réformes déjà mises en place ont permis d'améliorer le fonctionnement de l'établissement : « ces simplifications ont permis une optimisation en termes d'organisation interne du travail », qui a permis d'absorber les nouvelles missions du CNL « à plafond d'emploi constant ».
La Cour des comptes reprenait la suggestion du ministère de création d'une cellule interne de contrôle de gestion et d'évaluation, « qui pourrait notamment coordonner des évaluations plus régulières sur les dispositifs de moindre importance et diffuser une culture de l'évaluation au CNL ». Le rapporteur spécial rejoint la Cour des comptes sur ce point : il est nécessaire que le CNL dispose d'outils internes permettant de mettre en oeuvre des évaluations en continu.
Les auditions ont mis en avant plusieurs pistes d'amélioration portant sur le renforcement de conditions sociales et environnementales dans l'attribution des aides. Ainsi, les auteurs réclament la mise en place d'une conditionnalité des aides aux éditeurs sur le respect de « bonnes pratiques » dans les contrats d'édition (existence d'un minimum garanti versé aux auteurs, pourcentage de rémunération...). Des discussions semblent être en cours sur ce point.
Plus largement, les aides du CNL doivent être davantage des instruments permettant au régulateur d'intervenir face aux grands enjeux de la filière du livre : concentration dans le secteur de l'édition ; développement de l'intelligence artificielle dans l'écriture et la traduction ; répartition territoriale des librairies, etc.
Recommandation n°4 : renforcer la conditionnalité des aides du CNL pour en faire davantage des instruments de politique publique face aux grands enjeux de la filière du livre (CNL)
B. LES AIDES DIRECTES DES DRAC EN ARTICULATION AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : UN EFFET LEVIER IMPORTANT MAIS DES MONTANTS RÉDUITS
1. Des montants octroyés par les DRAC très modestes
Si le CNL est le principal levier d'aide à la filière du livre, les DRAC accordent également une part des subventions. Toutefois, si les montants d'aide du CNL sont relativement conséquents, ceux des DRAC sont plus que modestes : les montants totaux distribués par chaque DRAC sont inférieurs au million d'euros. Ainsi, la région Île-de-France mise à part, qui accorde 900 000 euros de subventions en 2024, aucune région n'accordait au total plus de 550 000 euros. On observe en outre de fortes variations selon les DRAC.
Variation selon les régions des montants
distribués par les DRAC
à la filière du livre en 2024
(en euros)
Source : commission des finances d'après les données du ministère
Les montants accordés par les DRAC évoluent fortement à la hausse (+ 120 % entre 2019 et 2024). Cependant, outre la faiblesse des montants malgré cette dynamique, on observe là encore des évolutions très différentes selon les régions : + 51 % pour la DRAC Nouvelle-Aquitaine contre + 168 % pour la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Évolution du montant total des subventions accordées par les DRAC
(en euros et en %)
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Variation |
|
Auvergne Rhône-Alpes |
200 303 |
403 227 |
312 713 |
303 200 |
400 800 |
537 350 |
168,3 % |
|
Bourgogne F.-Comté |
207 017 |
310 918 |
210 117 |
216 897 |
318 762 |
358 262 |
73,1 % |
|
Bretagne |
80 000 |
147 800 |
80 000 |
80 000 |
152 000 |
200 000 |
150,0 % |
|
Centre Val de Loire |
21 000 |
46 000 |
67 085 |
21 000 |
96 500 |
150 866 |
618,4 % |
|
Corse |
6 000 |
10 000 |
|||||
|
Grand-Est |
200 759 |
364 863 |
201 975 |
217 450 |
355 138 |
414 850 |
106,6 % |
|
Guadeloupe |
21 892 |
32 038 |
27 434 |
31 692 |
51 626 |
57 758 |
163,8 % |
|
Guyane |
64 257 |
113 517 |
46 304 |
65 300 |
100 663 |
159 623 |
148,4 % |
|
Hauts de France |
125 902 |
226 960 |
143 847 |
100 602 |
219 921 |
270 568 |
114,9 % |
|
Ile-De-France |
326 332 |
506 661 |
351 600 |
362 600 |
433 867 |
939 185 |
187,8 % |
|
La Réunion |
30 000 |
376 000 |
20 000 |
35 000 |
95 000 |
110 000 |
266,7 % |
|
Martinique |
21 019 |
92 444 |
52 444 |
44 944 |
104 444 |
25 624 |
21,9 % |
|
Mayotte |
29 000 |
20 000 |
28 254 |
53 500 |
|||
|
Normandie |
130 700 |
241 500 |
129 827 |
145 316 |
195 931 |
241 899 |
85,1 % |
|
Nouvelle Calédonie |
9 465 |
||||||
|
Nouvelle-Aquitaine |
342 683 |
612 950 |
368 566 |
371 276 |
477 280 |
518 451 |
51,3 % |
|
Occitanie |
180 000 |
240 603 |
193 014 |
187 782 |
293 014 |
328 014 |
82,2 % |
|
PACA |
112 944 |
230 800 |
105 000 |
81 687 |
172 658 |
202 500 |
79,3 % |
|
Pays-De-La-Loire |
118 568 |
159 489 |
124 391 |
124 393 |
222 986 |
255 270 |
115,3 % |
|
Polynésie |
4 000 |
||||||
|
Total |
2 183 376 |
4 138 770 |
2 434 317 |
2 409 139 |
3 734 309 |
4 833 720 |
121,4 % |
Source : commission des finances d'après les données du ministère
S'agissant de la destination des financements des DRAC à la filière du livre, elles financent essentiellement la vie littéraire, puis les maisons d'édition et les librairies, là où le CNL intervient plus directement sur les librairies. Les DRAC n'interviennent cependant pas pour tous les échelons de la chaîne du livre : elles n'apportent pas d'aides à la publication pour les projets éditoriaux ni de bourses de création pour les auteurs.
Répartition par action des subventions accordées par les DRAC en 2024
(en %)
Source : commission des finances d'après les données du ministère
2. Un important effet levier de l'action du CNL et des DRAC sur les financements des collectivités
Le ministère, entendu par le rapporteur spécial, indique ne pas mener d'évaluation systématique des aides accordées par les DRAC, notamment faute de moyens humains. Il indique donc se concentrer pour l'instant sur l'évaluation des dispositifs nouvellement créés.
Les crédits versés par l'administration déconcentrée sont principalement déployés dans le cadre des contrats de filière État-régions. La doctrine d'intervention n'est cependant pas unifiée : certaines DRAC versent les crédits à la Région ou à la structure régionale du livre, quand d'autres attribuent directement les subventions aux porteurs de projets.
Recommandation n° 5 : formaliser une doctrine d'intervention de l'administration déconcentrée commune à toutes les DRAC (ministère de la culture)
Grâce aux contrats de filière, les aides des DRAC sont complémentaires de celles du CNL. Le CNL ne co-finance pas de dispositif intégré à un contrat de filière qui serait le même qu'un dispositif déjà porté par le CNL au niveau national. En revanche, il arrive aux DRAC de le faire en l'absence de conventions territoriales.
Le CNL a initié la réalisation de diagnostics territoriaux permettant de synthétiser l'effet levier des contrats de filière. Les contrats de filière reposent sur la logique de cofinancement des projets, et la synthèse du CNL permet de déterminer que l'État (CNL et DRAC) verse 56 % des aides économiques à la filière du livre, les régions en versant 44 %.
Répartition des soutiens à la
filière du livre par acteurs
et par région en
2022
(en euros)
Source : synthèse des diagnostics territoriaux, CNL
C. LE RÔLE ACTIF DE L'ÉTAT PENDANT LA CRISE SANITAIRE POSE LA QUESTION DE L'APRÈS
1. Un doublement des aides accordées par le CNL pendant la crise sanitaire qui a principalement bénéficié aux librairies
Les acteurs de la filière du livre ont pu pour la plupart bénéficier des dispositifs généraux d'aides aux entreprises mis en place dès le début de la crise sanitaire : chômage partiel, décalage des délais de paiement des échéances sociales et fiscales, fonds de solidarité19(*), prêts garantis par l'État, etc.
La filière du livre a également bénéficié de dispositifs spécifiques, déployés en trois temps :
- un plan d'urgence dès le printemps 2020 ;
- un plan de soutien jusqu'en 2021 pour atténuer les effets de la crise sanitaire et accompagner la reprise d'activité ;
- un plan de relance dans un troisième temps pour stimuler l'activité économique en 2021-2022.
La réalisation de ces trois phases a été confiée au CNL. Elles se sont traduites par une hausse rapide des interventions du CNL.
Aides accordées par le CNL entre 2020 et 2021
(en millions d'euros et en nombre de bénéficiaires)
|
Période de mise en oeuvre |
Aide |
Montant total |
Nombre de bénéficiaires |
|
Plan d'urgence |
Aide aux auteurs (gérée par la Société des gens de lettres) |
1 |
677 |
|
Petites maisons d'édition |
0,5 |
138 |
|
|
Manifestations littéraires |
1,1 |
54 |
|
|
Librairies françaises à l'étranger |
0,5 |
78 |
|
|
Plans de soutien et de relance |
Aide exceptionnelle aux librairies |
25 |
1904 |
|
Fonds de modernisation des librairies |
13,3 |
||
|
Librairies françaises à l'étranger |
0,9 |
106 |
|
|
Fonds de soutien aux maisons d'édition |
5 |
70 |
|
|
Aide aux auteurs |
1,9 |
480 |
|
|
Dispositif Jeunes en librairies |
2,1 |
692 librairies (44 803 élèves) |
Source : commission des finances d'après les réponses du ministère
Le montant total des aides accordées par le CNL a doublé en 2020 par rapport à 2019. Au total, entre 2020 et 2022, 43 millions d'euros d'aides exceptionnelles auront été accordées à la filière du livre par le CNL.
Afin de permettre au CNL de verser ces aides exceptionnelles, certains règlements ont en outre été prolongés ou adaptés :
- le plafond des aides en librairie a été relevé à deux reprises, jusqu'à 40 000 euros en juin 2021, puis à 150 000 euros en novembre 2021 ;
- la durée de validité des bourses de résidence et des bourses de séjour aux traducteurs du français vers les langues étrangères obtenues en 2020 a été prolongée ;
- les subventions aux festivals littéraires reportés ont été maintenues dès mars 2020.
Les fonds d'aides aux librairies pendant la crise sanitaire
Le fonds d'aide exceptionnelle aux librairies
Ce fonds de 25 millions d'euros confié au CNL a été mobilisé entre le 2nd semestre 2020 et le 1er semestre 2021, en deux temps. Il était initialement destiné à compenser les coûts fixes assumées par les librairies pendant le 1er confinement. À l'automne 2020, 1 267 librairies en avaient bénéficié pour un total de 15,2 millions d'euros.
Le montant total des pertes étant largement inférieur au montant du fonds, il restait un reliquat de 10 millions d'euros, dont une partie a financé le remboursement des frais d'expédition des librairies pour les livraisons de livres neufs pendant le deuxième confinement. 637 librairies ont obtenu un remboursement, pour un total de 3,1 millions d'euros environ.
Le syndicat de la librairie française, entendu par le rapporteur spécial, souligne le caractère « massif » et le « mécanisme simple d'utilisation pour les libraires » du dispositif.
Le fonds de soutien à la modernisation des librairies
En 2021, un deuxième fonds à destination des librairies a eu pour objectif d'accompagner les projets de modernisation des magasins (travaux, informatique, etc.), des outils de gestion ou encore de la vente à distance des librairies. Dès 2020, 6 millions d'euros ont été votés par la 3e loi de finances rectificative20(*). Ce montant a été doublé en LFI pour 2021 au titre du plan France Relance.
Le fonds de modernisation a également bénéficié d'un redéploiement de crédits non utilisés sur le dispositif Jeunes en librairies à hauteur d'1,3 million d'euros. Il a d'abord permis d'accompagner les projets de modernisation des magasins (travaux, informatique, etc.) et les outils de gestion (1er volet) entre 2020 et début 2022, puis la vente à distance des librairies (2nd volet) en 2022. D'après le syndicat de la librairie française, ces dispositifs ont été « bien ciblés et ont porté leurs fruits », en particulier sur le développement de sites internet de librairies.
Source : commission des finances d'après le ministère de la Culture
Conséquence de cette accumulation de dispositifs ciblés sur les librairies, le taux d'entreprises du secteur des librairies qui perçoivent au moins une aide des DRAC ou du CNL est monté à 42 % en 2020, contre 7 % à 9 % en période normale. Si le soutien de l'État à l'édition a également augmenté pendant la crise, il est loin d'avoir bondi dans les mêmes proportions : on ne compte en 2020 que 9 % des éditeurs ayant reçu une aide spécifique du CNL, soit seulement deux à trois points de plus qu'en temps normal.
Évolution de la proportion d'entreprises de
la filière du livre
recevant des aides du CNL ou des
DRAC
(en %)
Source : Sénat, d'après la base de données FARE et le Ministère de la Culture. Pour les librairies, les ETI et GE sont exclues
2. L'impact économique des aides de l'État à la filière du livre pendant la crise sanitaire : une sur-rentabilité temporaire des librairies
Il ressort des auditions menées par le rapporteur spécial que la filière du livre a conscience d'avoir été largement soutenue pendant la crise sanitaire. Les librairies en particulier indiquent que « sans ces aides, de très nombreuses librairies auraient été contraintes à la fermeture, le faible niveau de leur trésorerie ne leur permettant pas de financer leurs charges fixes en l'absence de chiffre d'affaires au-delà de quatre à cinq semaines »21(*).
Les mécanismes d'aide à la filière ont été mis en place, comme pour l'ensemble des secteurs, dans la précipitation et dans une période de grande crainte sur les perspectives. Or les résultats de la filière ont été nettement meilleurs qu'anticipés, de sorte qu'une part non négligeable des fonds d'urgence n'ont pas été consommés et ont été redéployés.
Impact des aides versées par l'État
(CNL et DRAC)
sur le taux de marge des librairies
(en %)
Source : Sénat, d'après la base de données FARE et le Ministère de la Culture. Les ETI et GE sont exclues.
L'analyse des données économiques des librairies révèle que les années de la crise sanitaire (2020 et 2021) sont marquées par une hausse importante du taux de marge des librairies. En particulier, elles ont obtenu en 2020 un taux de marge moyen plus élevé que pour le reste du commerce de détail.
Il est à noter que même sans les aides CNL et DRAC, le taux de marge des librairies aurait augmenté en 2020, ce qui peut s'expliquer d'une part par les autres aides perçues, non spécifiques au secteur du livre, et d'autre part par une hausse temporaire des achats de livres.
En conséquence, sur ce secteur comme sur beaucoup d'autres, le déblocage massif d'argent en 2020 n'aurait sans doute pas été indispensable pour beaucoup de librairies, aboutissant à une sur-rentabilité temporaire de ces commerces grâce aux aides d'urgence.
3. Comment tourner la page de la crise sanitaire ?
Comme présenté plus haut, la crise sanitaire a en réalité été une période plutôt positive pour le commerce de livres, sous un double impact d'accroissement conjoncturel de la lecture et des dispositifs d'aides.
Comme pour grand nombre de politiques publiques, se pose donc encore la question de la sortie complète du régime de crise. Depuis 2023, le montant total d'aides accordé se normalise du fait de l'extinction des dispositifs d'urgence. Néanmoins, le niveau des aides distribuées par le CNL est resté supérieur à celui d'avant crise (+ 3 millions d'euros).
Le dispositif Jeunes en librairies est l'exemple d'un dispositif de crise, initialement créé pour encourager les jeunes à se rendre dans des librairies, qui a ensuite été pérennisé.
Le dispositif Jeunes en librairie
Il s'agit d'une opération à destination des collégiens, lycéens, apprentis, etc... pour les sensibiliser à la chaîne du livre, en particulier au métier de libraire, tout en soutenant la demande de livres face à la crise. Antérieurement déployée sous forme expérimentale dans les Hauts de France, en Nouvelle Aquitaine et à Mayotte.
Cette action vise à sensibiliser le jeune public à l'économie du livre, à la production éditoriale et au rôle joué par la librairie indépendante. Le dispositif repose sur un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture.
Pendant la crise, il a été décidé de généraliser le dispositif dans l'ensemble des régions grâce à des crédits « relance ». Le plan de relance prévoyait une dotation initiale de 7 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros pour 2021 (dont 1,33 million d'euros non consommé) et 3,5 millions d'euros pour 2022.
À la suite de la crise sanitaire, le dispositif a été pérennisé et son financement budgétisé à hauteur de 2 millions d'euros par an. Sa mise en place est assurée par les DRAC en lien avec les structures régionales du livre.
Source : commission des finances d'après le ministère de la culture
Se posent en outre des questions liées au remboursement des prêts perçus par les libraires pendant la crise sanitaire, qui doivent être remboursés maintenant alors que les achats de livres diminuent. Plusieurs acteurs entendus par le rapporteur spécial ont émis des craintes sur des difficultés de remboursement des prêts garantis par l'État (PGE). Bien que cet enjeu ne soit pas propre aux librairies, le ministère a indiqué mener actuellement un travail d'évaluation sur ce sujet en lien avec la direction générale du Trésor. Le ministère a en outre indiqué réfléchir à remobiliser un dispositif d'avances remboursables auprès de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (cf. infra) afin de permettre aux librairies d'étaler le remboursement des PGE.
II. DE MULTIPLES SOUTIENS INDIRECTS PRIS EN CHARGE PAR L'ÉTAT OU PAR DES OPÉRATEURS PRIVÉS FINANCÉS PAR DES FONDS PUBLICS
A. LES AUTRES AIDES À LA FILIÈRE DU LIVRE : UN ENSEMBLE DE DISPOSITIFS DONT LE COÛT EST TRÈS LARGEMENT SUPÉRIEUR À CELUI DES AIDES DIRECTES
1. Une prise en charge par l'État d'une partie de l'assurance vieillesse des artistes auteurs dont le coût est en hausse constante et qui doit être réévaluée
Les artistes-auteurs sont rattachés à un régime social particulier mais affiliés au régime général de la sécurité sociale. Ils s'acquittent à ce titre des prélèvements sociaux équivalent à ceux dues par les salariés du régime général.
Le régime social des artistes-auteurs repose d'une part, sur une participation des diffuseurs et exploitants d'oeuvres d'art et sur un dispositif d'exonération spécifique en faveur des artistes-auteurs, d'autre part. Afin de diminuer le manque à gagner qui en résulte pour l'Assurance vieillesse, l'État prend à sa charge depuis 2020 une fraction de la part des cotisations vieillesse de l'ensemble des artistes-auteurs.
Il finance la totalité de la cotisation à l'assurance vieillesse déplafonnée (0,40 % des revenus) et une fraction égale à 0,75 % de la cotisation à l'assurance vieillesse plafonnée précomptée (6,90 % pour la partie des revenus en droits d'auteur), ainsi ramenée à 6,15 %. Cette participation prend la forme d'une compensation du ministère de la culture à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
Cette mesure s'inscrivait dans la volonté de soutenir le pouvoir d'achat des artistes-auteurs face à l'augmentation de la CSG décidée le 1er janvier 2018 pour l'ensemble du régime général. Les artistes-auteurs n'étant pas affiliés à l'assurance-chômage, cette mesure s'est traduite par une hausse de leur taux global de cotisation et, en conséquence, par une baisse de pouvoir d'achat de 0,95 % de leurs revenus artistiques. Une première solution de soutien se traduisant par des aides ciblées avait été adoptée par décret en 201822(*) et 201923(*). Ce dispositif transitoire a par la suite été pérennisé à partir du 1er janvier 2020, à travers une prise en charge par l'État d'une fraction des cotisations d'assurance vieillesse à la charge des auteurs et autrices.
Ce dispositif cible l'ensemble des artistes-auteurs tels que définis à l'article L. 382-1 du code de la Sécurité sociale. Il ne concerne donc pas uniquement les auteurs de livres.
Depuis son entrée en vigueur, ce dispositif connaît une hausse continue tant de ses effectifs que de son coût annuel. En 2020, le coût annuel était de 17,78 millions d'euros pour un effectif de 222 718 artistes-auteurs. En 2023, il bénéficiait à 389 790 artistes-auteurs, pour un coût annuel s'élevant à 24,27 millions d'euros. Pour 2024, l'estimation du coût annuel était en hausse de 6,5 millions d'euros par rapport à 2023, soit une progression équivalente à celle de la période 2020-2023.
En conséquence, malgré une progression du coût total du dispositif de 6,5 millions d'euros en trois ans, la hausse du nombre de bénéficiaires est allée de pair avec la diminution du coût unitaire. Ce dernier est passé de 80 euros par bénéficiaire en 2020 à 62 euros en 2023.
Des critiques récurrentes à l'encontre du régime spécifique des artistes auteurs
Le régime d'assurance retraite des artistes auteurs a fait l'objet d'une récente analyse de la Cour des comptes24(*), qui soulignait des distorsions selon le revenu des auteurs au détriment de ceux aux revenus les plus modestes, alors que près de 60 % des artistes-auteurs perçoivent un revenu annuel inférieur à 1 054 euros. Seulement 3 000 artistes-auteurs ont touché un revenu supérieur à 101 472 euros.
En outre, les artistes-auteurs, affiliés au régime général de la sécurité sociale, bénéficient d'exonération de certaines cotisations patronales et s'acquittent des prélèvements sociaux équivalents à ceux dus par les salariés du régime général. Cette configuration entraîne un manque à gagner important pour la Sécurité sociale. Une mission commune de l'IGAS-IGF (25(*)) a souligné la nécessité d'ajuster ce calcul de l'assiette des cotisations pour mieux refléter les réalités économiques et les spécificités du secteur.
Enfin, le financement du régime social des artistes-auteurs repose sur une contribution spécifique des diffuseurs et exploitants d'oeuvres d'art, ces derniers ne pouvant être assimilés à des employeurs relevant du régime général. Ainsi, ils n'acquittent pas les mêmes cotisations que les employeurs du régime général, avec un taux réduit de 1 % et 0,10 % pour la formation professionnelle. Depuis 1976, le caractère spécifique des artistes-auteurs et de leurs diffuseurs et exploitants fait peser le financement de la protection sociale des artistes-auteurs sur l'ensemble des cotisants au régime général.
Le coût total de l'absence de cotisation patronale pour les artistes auteurs est en effet de 571 millions d'euros en 2022 d'après le projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale de l'année 2024.
Source : commission des finances d'après
La Cour des comptes met en avant dans le rapport précité « l'indispensable restructuration de la gestion de la retraite des artistes-auteurs ». Elle indique notamment que, « dans le respect des principes de solidarité et d'équité du régime général, le taux de cotisation vieillesse sur les revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale pourrait être relevé au-delà du niveau pris en charge par l'État ». Une telle évolution devrait entraîner une modification de la prise en charge par l'État d'une part des exonérations.
2. Les prêts à taux zéro accordés par le CNL, un dispositif spécifique qui ne semble pas justifié
Le CNL accorde des prêts aux éditeurs depuis 1992 et aux librairies depuis 1993, qui constituent une aide complémentaire aux subventions grâce à des conditions avantageuses : taux zéro, absence de garantie, période de franchise, échéanciers longs.
Le règlement des aides du CNL prévoit que toute subvention au titre de l'aide à l'investissement des librairies d'un montant supérieur à 15 000 euros est obligatoirement assortie d'un prêt. En cas d'obtention simultanée d'un prêt et d'une subvention, le montant minimal du prêt est au moins égal à celui de la subvention. Le CNL indique dans ses réponses au rapporteur spécial que cette proportion est généralement plus proche de deux tiers de subventions pour un tiers d'investissement.
La Cour des comptes était relativement sceptique dans son rapport de 2022 précédemment mentionné sur les prêts du CNL. En effet, le nombre et le montant de prêts avait continuellement diminué au cours de la décennie 2010 : « le volume des prêts octroyés a décru de manière quasi continue sans que cela résulte d'une sélectivité accrue : 6 par an de 2015 à 2017, 3 en 2018, 5 en 2019 et 2 en 2020. Le montant moyen a été de 26 600 euros en 2019 et 18 000 euros en 2020, comparé à 78 333 euros en 2016 ».
La dynamique s'est cependant inversée après la crise sanitaire, du fait notamment d'une forte hausse de créations de librairies. Il n'en reste pas moins que le volume de prêts reste réduit (2,3 millions d'euros en 2024 pour 67 projets, pourtant un maximum historique, soit un montant moyen de 33 000 euros). Le taux de sinistralité est faible : sur les 5 dernières années, les pertes enregistrées représentent 1,34 % du montant total de prêts engagés sur la même période.
Prêts accordés par le CNL aux librairies et aux éditeurs
(en euros et en %)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Montants de prêts engagés |
955 000 |
1 422 000 |
1 669 000 |
2 163 000 |
2 251 000 |
|
Nombre total de prêts accordés |
34 |
49 |
68 |
58 |
67 |
|
Perte |
15 000 |
32 441 |
0 |
42 900 |
23 000 |
|
Part de perte |
1,57 % |
2,28 % |
0,00 % |
1,98 % |
1,02 % |
Source : CNL
La Cour des comptes notait que les prêts économiques étaient « toujours source d'interrogations ». Elle soulignait que la cible de l'indicateur d'impact des prêts à taux zéro dans le COP précédent du CNL n'avait jamais été atteinte. Or le COP 2022-2026 ne comporte plus aucun indicateur relatif aux prêts.
Le CNL défend le principe de ses prêts, qu'il justifie par sa connaissance du secteur. Il faut cependant noter que l'octroi de prêts par l'opérateur culturel chargé des subventions est une anomalie : ni le Centre national du cinéma, ni le Centre national de la musique n'octroient de prêts, tous deux s'en remettant à l'IFCIC. Le CNL indique que « les autres acteurs se positionnent et/ou conditionnent souvent leur intervention en fonction, et dès l'amont, du possible soutien et de la décision du CNL ».
D'après le CNL, les autres acteurs susceptibles d'intervenir et de consolider un projet sont complémentaires des aides de l'établissement. Rien n'oblige cependant à ce que le soutien du CNL prenne la forme d'un prêt complémentaire. Par ailleurs, le prêt au développement des maisons d'édition n'est pas cumulable avec l'obtention d'un prêt auprès de l'IFCIC : l'argument de l'effet levier du prêt du CNL sur d'autres investisseurs est donc moins pertinent.
On voit mal l'utilité de coupler toute subvention à l'investissement aux librairies d'un montant supérieur à 15 000 euros à un prêt, comme le prévoit le règlement des aides du CNL. Un conditionnement des dossiers à modèle de financement solide et un plafonnement des aides du CNL aurait le même effet.
La Cour des comptes appelait en 2022 à une évaluation très rapide du dispositif, ce qui était déjà le cas dans son précédent rapport. Or, cette évaluation qui devait avoir lieu en 2023 n'a visiblement pas été mise en place. Le rapporteur spécial appelle donc le CNL à supprimer l'octroi de prêt et à recentrer son action sur l'octroi de subventions, qui constituent son coeur de métier et qui permettent tout autant d'affirmer la qualité professionnelle du projet soutenu.
Recommandation n° 6 : mettre fin à l'octroi de prêts par le CNL, notamment en communiquant davantage sur le rôle de l'institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), et ainsi recentrer le rôle de soutien économique du CNL sur l'octroi de subventions complémentaires, constituant une garantie de financement des projets (CNL, IFCIC)
3. Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée : un manque à gagner pour l'État de 600 millions d'euros dont la moitié bénéficie au dernier décile de revenus
Le 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la vente et la location de livres bénéficient d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 %. La cession de droit d'auteurs est taxée à hauteur de 10 % (article 279 du CGI). Ces taux sont aménagés en Corse et dans les territoires ultra-marins.
Présentation des taux de TVA applicables au livre
|
Opération |
France métropolitaine |
Corse |
Outre-mer |
|
Vente et location de livres |
5,5 % |
2,1 % |
2,1 % |
|
Cessions des droits d'auteurs et les droits portant sur les livres |
10 % |
10 % |
2,1 % |
Source : commission des finances
La doctrine fiscale définit ainsi le livre : il s'agit d'un « ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement ou de la diffusion de la pensée et de la culture »26(*).
Depuis la loi de finances pour 202027(*), les livres numériques et audio bénéficient également du taux réduit, dès lors que peuvent en bénéficier les livres « sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement ».
La dernière évaluation faite par la direction de la législation fiscale chiffrait le coût du taux réduit à 5,5 % sur la vente et la livraison de livre autour de 600 millions d'euros par an. Cette estimation était de 500 millions d'euros dans le rapport du Sénat de 201028(*). La direction de la législation fiscale indique que le taux réduit sur les droits d'auteurs, est probablement très faible car il concerne des situations où la TVA est normalement intégralement déductible.
Comme pour de nombreux taux réduits de TVA, le taux de 5,5 % applicable au livre ne constitue pas un instrument pertinent en termes de justice fiscale. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoire considère dans un rapport de 202229(*) que les dépenses d'achat de livres représentent la même proportion (1 %) des dépenses des ménages les moins aisés et des ménages les plus riches. Cependant, le décile de population le plus riche achète des livres à hauteur de 294 millions d'euros par an, contre 84 millions d'euros pour le premier décile.
Ni le ministère de la culture ni celui des comptes publics ne suivent précisément le taux réduit de TVA, dès lors que celui-ci n'est pas considéré comme une dépense fiscale : l'absence de qualification comme dépense fiscale implique que le coût du dispositif pour les finances publiques n'est pas calculé ni son impact évalué.
La qualification de dépense fiscale est pourtant loin d'être formalisée. Le CPO le critiquait déjà en 2022 : « alors que les taux réduits sur l'audiovisuel public et les livres ne sont pas considérés comme des dépenses fiscales, ceux sur l'accès aux salles de cinéma, aux musées, aux expositions ou aux réunions sportives et ceux relatifs aux publications de presse le sont. Pour autant, l'ensemble de ces mesures combinent un double objectif de soutien au secteur culturel et d'accès facilité à la culture. Dès lors, la qualification ou non de dépense fiscale peut apparaître arbitraire dans la présentation de ces taux et superfétatoire comme critère pour déterminer la précision de leur suivi ».
Or, « le suivi des objectifs des mesures de TVA, du nombre de leurs bénéficiaires (voire de leur répartition par décile), de leur coût pour les finances publiques, des résultats de leur évaluation au travers d'un tableau de suivi actualisé chaque année, permettrait d'estimer leur efficacité et leur efficience »30(*).
Le rapporteur spécial considère qu'au vu du coût de ce dispositif, qui est sans commune mesure avec les soutiens directs à la filière du livre, il est impératif de disposer d'une analyse plus fine. Celle-ci doit porter à la fois sur l'évolution dans le temps du coût de la dépense fiscale, le nombre de bénéficiaires, leurs revenus et l'impact éventuel sur l'incitation à la lecture. Afin d'être accessibles au Parlement comme aux citoyens, ces données devraient figurer, au même titre que d'autres taux réduits de TVA dans le secteur culturel, dans le Tome 2 de l'annexe des voies et moyens au projet de loi de finances de l'année.
Outre que les catégories sociales les plus favorisées bénéficient plus largement du taux réduit à 5,5 % sur le livre, il faut également avoir à l'esprit que, comme indiqué en première partie, le coût moyen d'un livre a évolué largement en-deçà de l'inflation au cours des dernières années.
Recommandation n 7 : évaluer davantage le coût et l'impact du taux réduit à 5,5 % sur le livre, notamment en termes de redistribution et d'incitation à la lecture, et suivre le dispositif au sein du tome 2 de l'évaluations des voies et moyens en annexe des projets de loi de finances (ministère des comptes publics)
4. Le Pass Culture, un impact fondamental sur la filière du livre : vers l'explosion d'une « bulle » Pass culture dans les librairies ?
Le livre est, depuis la création du Pass culture en 2019, le produit le plus consommé sur la plateforme d'achats. Depuis 2019, 28 millions de livres ont été achetés à travers le Pass culture. Le montant cumulé d'achats de livres financés par le Pass culture s'élève à 359 millions d'euros depuis 201931(*).
Bien que cette proportion se réduise, le livre reste actuellement majoritaire parmi les achats du Pass culture, soit 58 % des achats en 2024 (contre 82 % la première année du Pass culture). Il faut d'ailleurs noter un rééquilibrage au sein du Pass culture. Si les mangas représentaient près de 40 % des achats de livres dans le pass Culture au 3ème trimestre 2021, ils ne représentent début 2024 plus que 20 %.
Les achats de livres par le Pass culture représentaient en 2024 89 millions d'euros, soit près de trois fois le montant des aides directes du CNL à la filière du livre. L'impact économique du Pass culture sur la filière du livre peut donc s'apparenter à une aide d'État massive : le Pass culture a représenté 2,6 % des livres achetés en 2023, mais cette part peut représenter jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires de certaines librairies indépendantes. Les librairies indépendantes représentent 33 % des achats de livres avec le Pass culture.
En conséquence, si le Pass culture a été présenté en audition comme « une très bonne chose pour la filière du livre », d'autres craignent avec la réduction des crédits progressive du Pass culture l'explosion d'une « bulle d'achats ».
La réforme mise en place par décret en février 202532(*) concentre l'essentiel du dispositif sur les jeunes âgés de 18 ans et plus. Désormais, les jeunes de 15 à 16 ans sont exclus du dispositif, alors que les jeunes de 18 ans bénéficient toujours de 150 euros, toujours sans condition de ressources. Or, 82 % des dépenses d'achats de livres en 2024 ont été effectués par des jeunes de 18 ans et plus. La réforme devrait donc avoir des conséquences minimes.
Il faut cependant rappeler que le Pass culture n'a jamais eu vocation à subventionner les industries culturelles. Par conséquent, alors que les critiques à l'encontre du dispositif s'accumulent et que la Cour des comptes33(*) comme l'inspection générale des affaires culturelles34(*) soulignent le faible impact du Pass culture en termes d'accès à la culture des moins favorisés, le subventionnement indirect à la filière du livre ne saurait constituer un argument en faveur du maintien de la part individuelle du Pass culture.
Par ailleurs, la part collective du Pass culture finance également des actions pour le livre. La SAS Pass culture indique ainsi que 17 millions d'euros cumulés depuis la création de la part collective y ont été consacrés. Le Pass culture a financé en 2024 1 300 interventions d'auteurs en établissement.
Nombre de masterclass d'auteurs en
établissement financées
par la part collective du Pass
culture
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
470 |
1 030 |
1 300 |
Source : commission des finances d'après le COP du CNL
B. LES AIDES TRANSITANT PAR DES ORGANISMES PRIVÉS FINANCÉS PAR DES FONDS PUBLICS
1. L'IFCIC et l'ADELC, des outils méconnus du grand public contribuant à garantir à la filière du livre un accès au financement bancaire
a) Le fonds de soutien à la transmission et la reprise des commerces de librairie
L'association pour le développement de la création de librairie de création (ADELC) est une association créée par des éditeurs ayant vocation à soutenir les librairies indépendantes. L'ADELC bénéficie notamment de financements publics par le biais d'une subvention versée par le CNL.
Montants accordés par le CNL à l'ADELC
(en milliers d'euros)
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
228 |
216 |
200 |
190 |
190 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Source : CNL
L'ADELC gère depuis 2008 le fonds de soutien à la transmission et la reprise des commerces de librairie. Ce fonds permet à l'association d'intervenir essentiellement sous forme d'apport en compte courant d'associé remboursable. L'ADELC prend une participation au capital de librairies d'environ 5 %, remboursables habituellement sur 6 ans après 2 ans de franchise.
L'ADLEC contribue aux projets ayant trait à la transmission et la création de librairies, au développement et la rénovation de la surface de vente, aux déménagements, et enfin à la restructuration de fonds propres (capitaux) ou de fonds de roulement (trésorerie).
De façon extrêmement marginale, l'ADELC peut également distribuer des subventions. Elle accompagne aussi les librairies aidées sur les questions liées à leur gestion et à l'exercice de leur métier. Il ressort des auditions du rapporteur spécial que les aides de l'ADELC sont considérées comme un soutien déterminant à la transmission de librairies, l'ADELC étant bien identifiée par les libraires.
b) L'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles
L'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) est une société anonyme détenue à 50,5 % par des établissements bancaires et à 49,5 % par l'État (30 % de l'IFCIC étant détenu par Bpifrance).
La mission de l'IFCIC est de permettre l'accès au crédit des entreprises de l'ensemble des secteurs culturels et créatifs relevant du champ du ministère de la culture, dans des secteurs qui ont des difficultés structurellement plus importantes d'accès au secteur bancaire. L'IFCIC intervient sous forme de garantie de crédit auprès des banques ou de prêts à moyen ou long terme.
En dehors du cinéma, qui représente le gros de l'activité de l'IFCIC, le livre est le 2e secteur accompagné par l'IFCIC après le spectacle vivant. La filière du livre représente 19 % des prêts garantis et octroyés au 31 décembre 2024, soit de près de 200 bénéficiaires à date.
L'IFCIC intervient exclusivement sur les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises de la filière du livre. Les montants des prêts sont moins élevés que dans les autres secteurs (le montant d'encours moyen des prêts garantis et octroyés sur le secteur du livre s'élève à 64 000 euros en 2024, contre 202 000 euros en moyenne pour l'ensemble des secteurs culturels). En conséquence, le livre ne représente par contre que 6 % des montants de prêts et garantie (11,0 millions d'euros). L'IFCIC indique qu'un prêt en librairie a une maturité d'environ trois à quatre ans, contre 10 à 15 ans pour un prêt dans d'autres industries culturelles.
Sur la période 2014-2024, pour la seule filière du livre, l'IFCIC a garanti et octroyé un total de 39,3 millions d'euros en faveur de 411 bénéficiaires, soit une moyenne de près de 4,0 millions d'euros par an. L'octroi de garanties représente deux-tiers des montants, l'activité de prêt étant plus tardive (ouverture à l'ensemble de la filière livre en 2017 seulement).
Le volume des prêts est donc historiquement inférieur à celui des garanties, à l'exception de la crise sanitaire.
Évolution du volume de prêts garantis et octroyés par l'IFCIC au secteur du livre
(en milliers d'euros)
Source : IFCIC
S'agissant de la répartition entre la librairie et l'édition, la librairie représente la majorité des entreprises accompagnées par l'IFCIC (65 % des montants, soit 25,4 millions d'euros). Il faut cependant reconnaître que cela ne représente qu'un petit nombre d'entreprises (311 librairies en dix ans). Plusieurs raisons expliquent ce constat. D'une part, l'IFCIC demeure moins identifié par les libraires que l'ADELC. D'autre part, l'action de l'IFCIC et celle de l'ADELC étant complémentaires, l'IFCIC a vocation à intervenir sur les plus gros projets.
Depuis 2017, l'IFCIC a octroyé et garanti près de 10,0 millions d'euros de prêts en faveur de 91 maisons d'édition. Ces prêts ont principalement soutenu des renforcements de fonds de roulement Le nombre restreint de maisons d'édition soutenues s'explique par une ouverture de l'activité de prêt plus tardive que pour les librairies et par la concentration du secteur de l'édition. Les opérateurs de l'édition ont en règle générale moins besoin d'intermédiation pour accéder à des financements bancaires classiques.
Évolution du volume de prêts octroyés et prêts garantis
(en milliers d'euros)
Librairies Édition
Source : IFCIC
Les prêts représentent en outre une plus grande part des accompagnements de l'IFCIC pour les librairies.
Répartition entre prêts octroyés et prêts garantis sur la période 2014-2024
(en %)
Librairies Édition
Source : IFCIC
L'IFCIC agit en complémentarité avec le CNL, dont l'avis est sollicité sur les demandes en garantie et d'intervention en prêt. La sinistralité pour la filière du livre est très faible : le montant de pertes cumulées sur la période 2014-2024 s'élève à seulement 500 000 euros, ce qui représente un taux de défaillance inférieur à 2 % du volume de prêts garantis et octroyés. L'IFCIC souligne en outre que près de la moitié des défaillances sont intervenues entre 2019 et 2020.
Il faut souligner que l'IFCIC est avant tout un organisme bancaire, avec une lecture prudentielle des dossiers, qui n'a pas une connaissance aussi fine du secteur que le CNL et l'ADELC. Toutefois, dans la mesure où, comme indiqué plus haut, l'activité de prêt du CNL n'apparaît pas pleinement justifiée, l'IFCIC pourrait être amenée à prendre le relais. Cela suppose d'accroître la connaissance du secteur sur les possibilités ouvertes par l'IFCIC, alors qu'il ressort des auditions que l'IFCIC n'est pas toujours bien identifié par la filière, en particulier par les éditeurs.
L'accompagnement du secteur du livre par l'IFCIC devrait en outre se renforcer mécaniquement au cours des prochains mois, dans la mesure où les tensions actuelles sur la trésorerie des librairies accroissent leurs besoins de financement. L'IFCIC a déjà indiqué au rapporteur spécial participer à des travaux avec le syndicat national de la librairie « afin d'évoquer les pistes de mesures structurelles pouvant être mises en oeuvre par ces librairies pour regagner des points de marges nécessaires au correct remboursement » des dettes des librairies, afin de limiter les cas de défaillances.
2. Le soutien aux professionnels du secteur du livre, une répartition confuse entre le CNL et le ministère
Parmi les aides aux structures, le CNL et le ministère versent un certain nombre de subventions à des structures et associations représentatives du secteur, qui peuvent à leur tour redistribuer une part de ces financements sous forme d'aides.
Certaines de ces associations assurent pour le compte du ministère ou du CNL des missions d'intérêt général. Ainsi, la société des gens de lettres (SGDL) assure par convention avec le CNL diverses actions d'accompagnement social et juridique des auteurs.
La société des gens de lettres
La Société des Gens de Lettres est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1892.
Son budget annuel s'élève à 1,6 million d'euros, dont 10 % de subvention du CNL. Ces financements sont accordés au titre des missions d'intérêt général de la SGDL : défense du droit d'auteur ; conseil juridique et assistance sociale aux auteurs en difficulté ; organisation de formations professionnelles à destination des auteurs. Sur la subvention du CNL, 25.000 euros sont chaque année affectés au budget de la commission d'aide sociale aux auteurs en difficulté.
La SGDL a également géré le dispositif d'urgence aux auteurs en difficulté pendant la crise sanitaire. Le CNL justifiait cette délégation par la connaissance des auteurs de la SGDL. Il peut toutefois être interrogé.
La SGDL occupe également un bâtiment public, l'Hôtel de Massa, mis à la disposition de la société dans le cadre d'un bail emphytéotique depuis 1927. La SGDL tire environ 150 000 euros par an de ressources de l'occupation du bâtiment, affectée à son entretien et à sa rénovation. Un compte rendu annuel de gestion est produit et adressé à la DRFIP et à la DRAC Ile-de-France, qui justifie de l'ensemble des dépenses engagées au titre de l'entretien du bâtiment et des recettes tirées de son exploitation. Si les recettes dépassent les dépenses, le solde est reversé chaque année à la DGFIP.
Le bail emphytéotique arrivant à échéance en 2026, la SGDL a sollicité la reconduction anticipée de son titre d'occupation afin de disposer d'une visibilité avant d'engager ces travaux. L'État a donc proposé à la SGDL une convention de gestion d'une durée de 50 ans.
Source : commission des finances d'après la SGDL
Ces financements sont loin d'être négligeables rapportés aux ressources globales des structures subventionnées. Ainsi, la subvention de l'État au syndicat de la librairie française représente un quart de ses ressources.
Montants versés par l'État aux
principales associations représentatives
du secteur en
2023-2024
(en euros)
|
Acteurs |
Association |
Montant |
|
Auteurs |
Société des gens de lettres |
160 000 |
|
Ligue des auteurs professionnels |
20 000 |
|
|
Éditeurs |
Syndicat national de l'édition |
150 000 |
|
Librairies |
Syndicat de la librairie française |
215 000 |
Source : commission des finances
La Cour des comptes soulignait dans son rapport de 2022 que la distinction entre les structures soutenues par le CNL et celles soutenues par le ministère n'était pas très claire. La Cour des comptes recommandait en 2022 de transférer au CNL le financement des associations professionnelles d'auteurs, qui, à l'exception de la SGDL, était assurée par le ministère. En effet, au-delà des auteurs, le ministère continue à financer :
- la Centrale de l'édition, groupement d'intérêt économique chargé à la fois de favoriser l'exportation à l'étranger des livres en langue française ;
- le Syndicat de la librairie française ;
- le Bureau international de l'édition française (BIEF) qui est chargé de faciliter et d'encourager les exportations et les échanges de droits pour l'édition française.
Le CNL finance les autres structures. Les raisons de cette distinction ne sont pas explicites, d'autant que le BIEF était financé par le CNL avant 2019.
Recommandation n° 8 : transférer au CNL le financement de l'ensemble des structures professionnelles subventionnées afin de rendre plus lisible la répartition des compétences entre tutelle et opérateur (ministère de la culture)
III. UN SOUTIEN GLOBAL SANS COMMUNE MESURE AVEC CELUI APPORTÉ PAR L'ÉTAT AUX INDUSTRIES CULTURELLES
Le livre représente le premier secteur en termes de chiffres d'affaires parmi les industries culturelles. Il est pourtant de très loin le secteur le moins directement aidé. Si les aides du CNL représentent entre 1 % et 2 % du chiffre d'affaires de l'édition et de la librairie indépendantes, elles ne représentent que 0,21 % du chiffre d'affaires total du secteur du livre.
Ce taux d'intervention est très largement inférieur à celui des autres industries culturelles : il est de 3,3% pour la musique et jusqu'à 15,6 % pour les secteurs soutenus par le CNC (cinéma et jeux vidéo), dont le budget est sans commune mesure avec les moyens des autres opérateurs.
Intervention directe des opérateurs du
ministère dans le secteur
des industries culturelles
(en millions d'euros)
|
Secteurs soutenus |
Mode de financement |
Chiffre d'affaires du secteur en 2023 |
Aides accordées au secteur en 2023 |
Part des interventions directes par rapport au chiffre d'affaires du secteur |
|
|
Centre national du cinéma et de l'image animées |
Cinéma et jeux vidéo |
Taxes affectées |
4 522,2 |
708 |
15,66 % |
|
Centre national de la musique |
Musique |
Taxes affectées et SCSP |
1 566,3 |
60 |
3,83 % |
|
Centre national du livre |
Livre |
SCSP |
10 271,6 |
22 |
0,21 % |
Source : commission des finances d'après les données du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS), Chiffres Clés 2024 de la culture et de la communication
Une décorrélation entre le chiffre d'affaires des différents secteurs et le poids de la dépense fiscale peut être observée : le taux réduit de TVA sur le livre représente environ 6 % du chiffre d'affaires du secteur, soit une proportion à peu près équivalente aux dépenses fiscales en faveur du spectacle vivant. En revanche, la dépense fiscale représente un poids nettement plus important pour le secteur du cinéma, soit 35 %, les quatre crédits d'impôt du CNC s'élevant en 2024 à 621 millions d'euros.
Poids des dépenses fiscales dans le secteur
des industries culturelles
par rapport à leur chiffre d'affaires en
2024
(en millions d'euros)
|
Secteur |
Dispositif |
Coût des dépenses fiscales |
Part de la dépense fiscale par rapport au chiffre d'affaires du secteur |
|
Presse |
Taux réduit de TVA applicable aux publications de presse |
57 |
0,5 % |
|
Audiovisuel |
Taux réduit de TVA applicable aux services de télévisions |
150 |
13 % |
|
Cinéma |
Crédits d'impôts « cinéma » |
621 |
35 % |
|
Jeux vidéo |
Crédit d'impôt « jeux vidéo » |
66 |
2 % |
|
Spectacle vivant |
Taux réduits de TVA pour le spectacle vivant |
360 |
5 % |
|
Crédit d'impôt « spectacle vivant » |
42 |
||
|
Livre |
Taux réduit de TVA sur l'achat et la location de livre |
600 |
6 % |
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires et les données du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS)
En tout état de cause, le livre apparaît comme un secteur relativement indépendant des financements publics, même si les aides directes sont complétées par l'ensemble des dispositifs décrits plus haut dans le présent rapport.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 2 juillet 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur spécial, sur la politique de l'État en faveur de la filière du livre.
M. Claude Raynal, président. - Nous allons entendre une communication de M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » et du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » sur la politique de l'État en faveur de la filière du livre.
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur spécial. - Lors de nos réunions, nous avons davantage l'habitude de citer des rapports administratifs plutôt que des romans. Je vous propose ce matin de concilier les deux, en vous présentant le résultat de mes travaux sur les interventions de l'État en faveur de la filière du livre. Plus précisément, ce contrôle budgétaire porte sur la politique économique du livre, par conséquent, sur les aides de l'État accordées aux auteurs, aux éditeurs et aux libraires.
Pour commencer, je donnerai quelques éléments de contexte sur la vente de livres en France. La politique de soutien à la filière du livre comporte une dimension relevant de l'aménagement du territoire. Si la moitié des 3 000 librairies indépendantes en France sont situées dans un grand centre urbain, 30 % d'entre elles sont implantées dans des petites villes ou des milieux ruraux, voire très ruraux. En outre, les modes de consommation évoluent : en 2024, les achats de livres étaient effectués pour 27 % d'entre eux dans les librairies, contre 30 % dans de grandes surfaces spécialisées dans les produits culturels et 20 % en ligne.
Le secteur du livre a connu une sorte de bulle économique immédiatement après la crise sanitaire : plus de 270 communes disposent ainsi d'une nouvelle librairie, créée au cours des quatre dernières années. Toutefois, les indicateurs financiers révèlent que cette euphorie économique a été de courte durée : après une envolée en 2020 et 2021, le chiffre d'affaires du secteur de la librairie est redevenu moins dynamique que celui de l'ensemble des commerces de détail dès 2022. Le taux de marge des librairies est, quant à lui, structurellement plus faible que celui de l'ensemble des commerces. Pour ce qui concerne les éditeurs de livres, leur taux de valeur ajoutée est également plus bas que celui des autres industries culturelles.
J'en viens à la politique du livre proprement dite. En premier lieu, il faut garder à l'esprit que l'action de l'État en faveur de la filière du livre passe, pour l'essentiel, par la régulation normative du secteur. Le prix unique du livre, instrument qui fait désormais consensus, constitue le premier axe de soutien de l'État. En second lieu, la politique de l'État est essentiellement orientée vers le développement de la lecture publique, par conséquent vers les bibliothèques. La Bibliothèque nationale de France bénéficie, à elle seule, de 245 millions d'euros. Ces crédits complètent l'action des collectivités territoriales à destination des bibliothèques, qui s'élève à environ 1,7 milliard d'euros.
Par conséquent, le soutien de l'État à la filière du livre ne représente qu'un effort financier assez réduit, à l'exception du taux réduit de TVA.
Le taux de TVA de 5,5 %, qui s'applique à l'achat de livres, est, en effet, le premier instrument de soutien direct de l'État à la filière. Son coût pour les finances publiques s'élève à quelque 600 millions d'euros de moindres recettes par an. Les dépenses d'achat de livres représentent la même proportion - 1 % environ - des dépenses des ménages les moins aisés et des plus riches. Toutefois, le décile de population le plus riche achète des livres à hauteur de 294 millions d'euros par an, contre 84 millions d'euros pour le premier décile.
Par ailleurs, ce taux réduit de TVA n'est pas considéré comme une dépense fiscale, contrairement à d'autres taux réduits applicables aux industries culturelles. Son coût ainsi que ses bénéficiaires sont, en conséquence, très peu suivis par le ministère de la culture comme par Bercy. Au regard du coût de ce dispositif, qui est sans commune mesure avec celui des soutiens directs à la filière du livre, il est impératif de disposer d'une analyse plus fine.
En dehors du taux réduit de TVA, la filière du livre est en réalité peu subventionnée. En 2024, les aides directes versées par le Centre national du livre (CNL) ne représentaient que 22 millions d'euros et celles qui sont versées par les directions régionales des affaires culturelles (Drac) 4,8 millions d'euros.
Le CNL est l'opérateur de l'État pour la politique économique du livre. Son budget de 28 millions d'euros est consacré aux deux tiers à l'intervention directe auprès du secteur. Le CNL soutient tous les maillons de la chaîne du livre : ainsi, 20 % des 3 000 aides accordées sont versées aux auteurs, 23 % aux éditeurs et 16 % aux librairies. Le montant des aides à destination des librairies est, en moyenne, deux fois supérieur à celui des aides accordées aux auteurs et aux éditeurs.
Au regard de la faiblesse du montant moyen des aides accordées par le CNL, il est possible de s'interroger sur un risque de saupoudrage des aides. Sans l'écarter, l'analyse des données va plutôt dans le sens d'un ciblage pertinent. Tout d'abord, les librairies percevant des aides sont, en moyenne, structurellement moins rentables que les autres ; les aides sont donc dirigées vers les librairies les plus en difficulté. Ensuite, près de la moitié des aides aux librairies sont attribuées à des commerces situés dans des communes de moins de 30 000 habitants. Enfin, 79 % des aides aux éditeurs sont versées à de petites et moyennes maisons d'édition.
Le processus d'attribution des aides du CNL, quoique transparent, est très lourd. Je formule plusieurs recommandations pour les simplifier. Il me paraît, en particulier, nécessaire de supprimer la possibilité, pour le CNL, d'accorder des prêts. En effet, le volume des prêts reste réduit - 2,3 millions d'euros en 2024 pour 67 projets - et d'autres acteurs dont c'est le coeur de métier existent ; le rôle du CNL devrait ainsi être recentré sur l'attribution de subventions.
Quant aux aides des Drac à la filière du livre, celles-ci sont d'un montant très modeste, selon les critères de la commission des finances pour laquelle l'unité de compte est bien souvent le milliard d'euros. En 2024, la région d'Île-de-France mise à part, aucune région n'accordait plus de 550 000 euros d'aides. Ces dernières sont le plus souvent fléchées vers les structures régionales du livre, institutions qui réunissent les Drac, le CNL et les régions.
Je souhaite revenir brièvement sur la période de la crise sanitaire. Comme pour nombre de secteurs économiques, l'État a réagi en débloquant, dans l'urgence, des montants de crédits importants. Au total, entre 2020 et 2022, 43 millions d'euros d'aides exceptionnelles ont été accordés par le CNL à la filière du livre. La proportion de librairies percevant au moins une aide des Drac ou du CNL a progressé jusqu'à 42 % en 2020, contre 7 % à 9 % en temps normal. Or les achats de livres ont paradoxalement augmenté pendant cette période. Par conséquent, une part non négligeable des fonds d'urgence n'ont pas été consommés et ont été redéployés. En outre, une surrentabilité des librairies a été constatée en 2020, leur permettant même d'obtenir un taux de marge moyen plus élevé que celui réalisé par le reste du commerce de détail. Dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres, le déblocage massif d'argent n'aurait sans doute pas été indispensable en 2020 pour nombre de librairies.
Enfin, au-delà des aides directes, un certain nombre de dispositifs bénéficient au secteur du livre ; c'est notamment le cas du pass Culture. En 2024, les achats de livres par ce biais ont représenté 89 millions d'euros, soit trois fois le montant des aides directes du CNL. L'impact économique du pass Culture sur la filière du livre peut donc s'apparenter à celui d'une aide d'État massive. Pourtant, rappelons-le, celui-ci n'a jamais eu vocation à subventionner les industries culturelles.
Pour terminer, je souhaite partager quelques éléments de comparaison entre la filière du livre et les autres industries culturelles. Ainsi, pour ce qui concerne les financements publics, il est frappant de constater que le secteur du livre est un « bon élève » par rapport à d'autres secteurs sur-subventionnés.
Premier secteur au sein des industries culturelles en termes de chiffres d'affaires, il est pourtant - et de très loin - celui qui est le moins directement aidé. En effet, les aides du CNL ne représentent que 0,23 % du chiffre d'affaires total du secteur, un niveau très largement inférieur à celui des autres industries culturelles, soit 3,3 % pour la musique et jusqu'à 15 % pour les secteurs soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), dont le budget est sans commune mesure avec les moyens des autres opérateurs.
L'écart est encore plus frappant pour ce qui concerne le rapport entre la dépense fiscale, définie au sens large en y incluant l'ensemble des taux réduits de TVA, et la valeur ajoutée totale du secteur. La dépense fiscale représente 6 % de la valeur ajoutée du secteur du livre, mais jusqu'à 35 % de celle du secteur du cinéma !
Ma principale conclusion est que le secteur du livre est relativement indépendant des financements publics ; les autres industries culturelles gagneraient à s'en inspirer. Nul doute que nous en débattrons lors du prochain projet de loi de finances (PLF).
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Quelques éléments sont contre-intuitifs. Ainsi, dans des départements à dominante rurale, la proportion de librairies par habitant est plus élevée que celui de départements plus peuplés et dotés de plus grandes villes ; il s'agit peut-être de départements bénéficiant d'aides plus importantes. Il serait intéressant d'approfondir ces données pour sortir des idées reçues.
En liaison avec la commission de la culture, il serait aussi utile d'analyser l'évolution du lectorat ; il me semble d'ailleurs que le livre numérique plafonne. Le nombre de salons littéraires organisés dans de nombreuses villes et communes, ainsi que la renaissance et le déploiement des bibliothèques soutenus par les politiques départementales vont à l'encontre de l'idée assez communément répandue selon laquelle nous assistons à la fin du livre, qui serait une industrie dont l'avenir s'assombrit. Jean-Raymond Hugonet pourrait, peut-être, nous donner quelques informations sur ces sujets.
Je retiens de cette présentation que la filière du livre est, certes, aidée, mais bien moins que d'autres, alors qu'elle participe au creuset culturel de notre pays. Nous devrions en tirer des enseignements pour ce qui concerne les facteurs favorisant sa vitalité et pour continuer de faciliter l'accès à la lecture dans nos territoires. On pourrait penser, à tort, que ce sujet est très restreint. Je souscris aux recommandations du rapport de Jean-Raymond Hugonet.
M. Arnaud Bazin. - Selon le rapporteur spécial, en termes de dépenses fiscales, le taux réduit de TVA coûterait plus cher pour le dernier décile de revenus que pour le premier décile. J'espère qu'il ne propose pas une TVA différentielle selon le revenu fiscal de référence ! L'argument peut d'ailleurs être retourné, puisque le dernier décile paie davantage de TVA, en valeur absolue, que le premier décile.
Pour ce qui concerne le livre numérique, quelle taxation lui est appliquée ? La diffusion de cette pratique de lecture plafonne-t-elle ou, au contraire, devient-elle plus fréquente ? Quels en sont les effets sur les maisons d'édition ? Quels sont les besoins en matière d'aides ?
Mme Christine Lavarde. - Le rapporteur spécial fait des propositions pour mieux articuler les actions de l'administration centrale, de l'administration déconcentrée et du CNL en matière de politique de soutien à la lecture.
En effet, ces trois acteurs ont été mobilisés dans le cadre du plan de relance. On aurait pu se demander pourquoi l'administration centrale a été chargée d'encourager les jeunes à venir dans les librairies et non pas les services déconcentrés...
Au-delà de cet exemple, pensez-vous que l'organisation de la politique de soutien au livre est optimale ?
M. Claude Raynal, président. - Ce rapport est dense. Mais j'ai du mal à identifier la recommandation principale. Faut-il supprimer les prêts accordés par le CNL ? Lorsqu'il s'agit de 2 millions d'euros, cela ne me semble pas une question majeure.
Votre analyse est plutôt positive : les actions menées par l'État, les régions et les communes semblent traiter la question correctement.
À mes yeux, les librairies qui ont été en grande difficulté se sont relevées grâce à un changement de pratiques, au travers de présentations d'auteurs ou de services de petite restauration qui en font des lieux de vie intéressants, vivants et attirants.
Le secteur du livre n'est pas tout à fait à l'équilibre, mais n'en est pas loin. J'ai donc l'impression que votre appréciation est positive et, sauf si vous me dites le contraire, qu'aucune modification marquante n'est à apporter.
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur spécial - Nous voyons souvent, dans cette commission, le chaos budgétaire et le manque de contrôle. Or, dans ce domaine qui réclame peu de subventions, l'argent public est bien utilisé. C'est plutôt satisfaisant. Les quelques actions qui auront lieu, sur la base de mes recommandations, interviendront donc le cas échéant à la marge.
Il ne s'agit pas de supprimer les prêts, mais de faire en sorte qu'ils ne soient pas accordés par le CNL. Ce dernier se concentrerait sur les subventions, qui sont toujours un sujet délicat - pourquoi tel auteur plutôt que tel autre ? Les prêts seraient, quant à eux, laissés à des structures plus habilitées à les octroyer et qui assurent d'ailleurs déjà cette mission.
Cette filière est effectivement dynamique et agile. Devant l'adversité, même si les aides publiques ont pu profiter à certains au-delà de leurs espérances en raison d'un manque de contrôle de l'État, elle a su se modifier pour offrir d'autres services. Nous l'avons tous vu dans les librairies de nos communes.
Monsieur le rapporteur général, les auditions ont montré que la politique du livre était presque un exemple de décentralisation. Avec les contrats de filière, l'État et les régions se coordonnent, localement, avec des professionnels passionnés, pour viser la plus grande efficacité possible. Cela devrait servir d'exemple pour d'autres thématiques.
La politique du livre est une action majeure dans nos territoires. Qui n'a pas son salon littéraire, son salon du livre jeune, ou autre ? Les bibliothèques évoluent aussi, comme les librairies. Elles deviennent de plus en plus des lieux de vie, parfois avec les moyens du bord. Ce n'est pas forcément dans les grandes communes que l'on trouve les initiatives les plus originales. De plus, la bibliothèque est un endroit de convergence intergénérationnelle. Patrimoine historique majeur, elle est aussi un creuset culturel. Cette réalité est vécue dans tous les territoires, urbains comme très ruraux.
Concernant la TVA, je faisais un constat sur les différences de consommation selon les déciles de revenus. En outre, il faut avoir à l'esprit que les plus riches ne se tournent pas forcément vers le même genre de livre que les moins aisés. Aucune offre de TVA différentielle n'est à l'étude.
J'en viens à la taxation du numérique. La production de titres numériques a crû de 124 % en dix ans. Certes, elle partait de très bas. Le nombre de livres numériques représente environ la moitié du stock de livres physiques. Les ventes en ligne de livres sont stables, comprises entre 18 % et 20 % depuis dix ans. La TVA appliquée au livre numérique est, comme pour le livre physique, à 5,5 %.
Madame Lavarde, ce qui ressort du rapport est plutôt positif, mais il y a certainement des améliorations à apporter, notamment en matière d'organisation.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'économie du livre est la première économie culturelle, en chiffre d'affaires. Cependant, pour éviter un effet de saupoudrage, des progrès pourraient être effectués. Il reste néanmoins que les sommes d'argent public consacrées à cette politique, quoiqu'importantes, forment en réalité l'épaisseur du trait par rapport à ce que l'on voit dans d'autres domaines.
Nous veillerons à parfaire l'organisation. J'espère que ce rapport constituera une contribution intéressante à cet égard.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial et autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Service du livre et de la lecture - Ministère de la culture
- M. Nicolas GEORGES, directeur du livre et de la lecture, chef du service ;
- M. Rémi GIMAZANE, chef du département de l'économie du livre au ministère de la culture.
Table-ronde des représentants des directions régionales des affaires culturelles
DRAC des Hauts de France
- Mme Christel DUCHEMANN, conseillère au livre et à la lecture ;
- Mme Séverine BOULLAY, conseillère au livre et à la lecture.
DRAC Occitanie
- M. Frédéric BOURDIN, directeur des pôles Création et Action culturelle et territoriale ;
- Mme Fleur BOUILLANNE, conseillère livre ;
- M. Henry GAY, conseiller livre.
DRAC Ile-de France
- Mme Carole SPADA, directrice régionale adjointe ;
- M. Nicolas ROBERT, chef du service régional Populations, accompagnement, coopération et territoires ;
- Mme Sylvie BONNEL, conseillère au livre et à la lecture.
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
- Mme Jacqueline BROLL, directrice du pôle Création, médias, industries culturelles, action culturelle et territoriale ;
- Mme Anne-Marie BOYER, conseillère au livre et à la lecture ;
- Mme Axelle REDON, conseillère au livre et à la lecture ;
- M. Nicolas DOUEZ conseiller au livre et à la lecture.
SAS Pass Culture
- Mme Laurence TISON-VUILLAUME, présidente ;
- Mme Morgane LE POUL, cheffe de cabinet et responsable des relations extérieures.
Syndicat de la librairie française (SLF)
- M. Guillaume HUSSON, délégué général.
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL)
- M. François ANNYCKE, co-président, directeur de l'agence régionale du livre et de la lecture (AR2L) des Hauts-de-France ;
- Mme Sophie NOËL, co-présidente, directrice de Normandie Livre & Lecture ;
- Mme Marion CLAMENS, co-présidente, directrice de l'agence Livre et Lecture de Bourgogne-Franche-Comté.
Société des gens de lettres
- M. Patrice LOCMANT, directeur général ;
- M. Christophe HARDY, président.
Ligue des auteurs professionnels
- Mme Liza Pamela LANDREVIE, conseillère ;
- Mme Elodie TORRENTE, conseillère.
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
- M. Hubert TILLIET, directeur des affaires juridiques.
Syndicat national de l'édition (SNE)
- M. Renaud LEFEBVRE, directeur général ;
- Mme Marion GLÉNAT, vice-président ;
- M. Alban CERISIER, membre du bureau ;
- Mme Sabine WESPIESER, éditrice, membre du conseil d'administration du Centre national du livre ;
- Mme Delphine BURGAUD, consultante en affaires publiques à Image Sept.
Centre national du livre
- Mme Régine HATCHONDO, présidente ;
- M. Pascal PERRAULT, directeur général ;
- Mme Marlena MATHON, secrétaire générale.
Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC)
- M. Karim MOUTTALIB, directeur général ;
- M. Sébastien SAUNIER, directeur des crédits aux entreprises culturelles et créatives.
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Poursuivre le déploiement des contrats de filière tripartites dans les régions non encore signataires, en particulier dans les outre-mer |
DRAC, CNL, régions |
2026 |
Contrats de filière |
|
2 |
Introduire après 2026 dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens du CNL un objectif de développement des ressources propres de l'établissement |
CNL |
2026 |
Contrat d'objectifs et de performance du CNL |
|
3 |
Évaluer le coût de traitement des aides du CNL et relever le montant minimal d'aides, actuellement fixé à 500 euros pour la plupart des aides et non revalorisé depuis 2018 afin de limiter le saupoudrage des moyens |
CNL |
2025 |
Règlement des aides du CNL |
|
4 |
Renforcer la conditionnalité des aides du CNL pour en faire davantage des instruments de politique publique face aux grands enjeux de la filière du livre |
CNL |
2025 |
Règlement des aides du CNL |
|
5 |
Formaliser une doctrine d'intervention de l'administration déconcentrée commune à toutes les DRAC |
Service du livre et de la lecture, DRAC |
2025 |
Circulaire |
|
6 |
Mettre fin à l'octroi de prêts par le CNL, notamment en communiquant davantage sur le rôle de l'institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), en recentrant le rôle de soutien économique du CNL sur l'octroi de subventions complémentaires, constituant une garantie de financement des projets |
CNL, IFCIC |
2025 |
Règlement des aides du CNL et tous supports |
|
7 |
Évaluer davantage le coût et l'impact du taux réduit à 5,5 % sur le livre, notamment en termes de redistribution et d'incitation à la lecture, et suivre le dispositif au sein du tome 2 de l'évaluations des voies et moyens en annexe des projets de loi de finances |
Ministère des comptes publics |
2025 |
Projet de loi de finances pour 2026 |
|
8 |
Transférer au CNL le financement de l'ensemble des structures professionnelles subventionnées afin de rendre plus lisible la répartition des compétences entre tutelle et opérateur |
Service du livre et de la lecture, CNM |
2025 |
Projet de loi de finances pour 2026 |
ANNEXES
ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DU TRAITEMENT DE DONNÉES
La plupart des analyses figurant dans le présent rapport sont réalisées à partir d'une extraction de la base de données FARE, produite par l'INSEE et la DGFIP. Elle exclut les micro-entrepreneurs. Les secteurs d'activité sont constitués à partir des codes APE (Activité Principale Exercée) suivants : 47.61Z (Commerce de détail de livres en magasin spécialisé), ensemble des codes APE de la division 47 (Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles), 58.11Z (Édition de livres), 58.13Z (Éditions de journaux), 58.14Z (Éditions de revues et périodiques), 58.21Z (Éditions de jeux électroniques), 59.11C (Production de films pour le cinéma), 59.20Z (Enregistrement sonore et édition musicale).
Le code APE affecté à l'entreprise dépend de l'activité principale de cette entreprise. Ainsi, une réserve doit être faite sur les résultats ci-dessous : par exemple, les entreprises qui vendent des livres comme activité secondaire ne sont pas comptabilisés comme librairies. Et inversement, des entreprises dont l'activité principale est la vente de livres mais qui ont également une activité autre seront intégralement considérées comme contribuant au marché d'activité des librairies.
Dans le but d'approcher le secteur des librairies indépendantes, les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et les Grandes Entreprises (GE) ont été exclues du périmètre pour le secteur des librairies, ainsi que pour le secteur du commerce de détail, afin de rendre possibles les comparaisons.
Ces analyses sont réalisées en unités légales (UL) et non en entreprises.
Les montants d'aides CNL et DRAC perçues par les librairies et les maisons d'édition ont été transmis par le Ministère de la Culture.
Les deux cartes sont réalisées à partir des bases de données des libraires et des maisons d'édition transmises par le Ministère de la Culture.
ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION DANS DIFFÉRENTES INDUSTRIES CULTURELLES
Part du chiffre d'affaires du secteur
d'activité réalisé par les entreprises
selon la taille
de leur groupe d'appartenance
Éditions de livres
Éditions de journaux, revues et périodiques
Éditions de jeux électroniques
Production de films
Production de musique
Source : Sénat, d'après base de données FARE
Grandes entreprises (GE) : entreprises ayant au moins 5 000 salariés, ou qui ont moins de 5 000 salariés mais plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 milliards d'euros de total de bilan.
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) : entreprises qui ont entre 250 et 4 999 salariés, et soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI.
Petites et moyennes entreprises (PME) : entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.
Microentreprises (MIC) : entreprises occupant moins de 10 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.
Le secteur de l'édition de livres apparaît comme un secteur assez concentré sur des entreprises de taille importante : en 2022, 44 % du chiffre d'affaires du secteur est réalisé par des entreprises qui appartiennent à des Grandes Entreprises (GE). Seul le marché de l'édition de jeux électroniques est davantage détenu par des grands groupes. Si l'année 2019 a marqué une hausse de la part des GE dans le secteur de l'édition, cette part est depuis assez stable.
En 2022, 32 % du CA du secteur de l'édition est réalisé par des entreprises appartenant à des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Ainsi, près de 75 % du marché de l'édition de livres est réalisé par des entreprises appartenant à des groupes ETI ou GE, soit de plus de 250 salariés (ou de plus de 50 millions d'euros de CA et 43 millions d'euros de total de bilan).
A l'inverse, les secteurs de la production de films et de la production musicale sont davantage diversifiés, avec notamment une très faible part des GE dans le secteur de la musique depuis 2021, ou encore une part importante des PME dans le secteur du cinéma.
ANNEXE 3 : INDICATEURS DU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2022-2026 DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Axe 1 - Favoriser la diversité de la création en accompagnant l'ensemble des acteurs de la chaine du livre |
Indicateur 1 : Montant des subventions versées aux petites et moyennes maisons d'édition pour l'aide à la promotion des auteurs et à des publications, parmi le montant total des aides versées au titre de cette aide |
Cible |
48% |
50% |
52% |
54% |
55% |
||
|
Réalisé |
47% |
57% |
79% |
||||||
|
Indicateur 2 : Nombre de librairies soutenues dans les communes de moins de 30 000 habitants |
Cible |
45% |
47% |
47% |
50% |
50% |
|||
|
Réalisé |
43% |
46% |
44% |
||||||
|
Indicateur 3 : Nombre de régions couvertes par une convention territoriale |
Cible |
9 |
12 |
14 |
14 |
15 |
|||
|
Réalisé |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
Axe 2 - Renforcer la place des auteurs et de la littérature dans la vie des Français |
Indicateur 5 : Nombre d'auteurs intervenant dans les manifestations littéraires soutenues par le CNL |
Cible |
5 900 |
6 400 |
6 450 |
6 500 |
6 550 |
||
|
Réalisé |
5 870 |
7 109 |
7 066 |
||||||
|
Indicateur 6 : Nombre de résidences d'auteurs référencées sur la plateforme et de masterclasses réalisées dans le cadre du Pass culture |
Sous indicateur 6.1 : Nombre de résidences d'auteurs référencées sur la plateforme |
Cible |
50 |
80 |
120 |
150 |
200 |
||
|
Réalisé |
42 |
54 |
|||||||
|
Sous-indicateur 6.2 : Nombre de masterclasses réalisées dans le cadre du Pass culture |
Cible |
400 |
600 |
800 |
1200 |
1300 |
|||
|
Réalisé |
471 |
1031 |
|||||||
|
Indicateur 7 : Audience des auteurs francophones |
Cible |
15% |
16% |
18% |
19% |
20% |
|||
|
Réalisé |
14% |
15% |
13,5% |
||||||
|
Axe 3 - Développer le goût des livres et de la lecture auprès du plus grand nombre |
Indicateur 8 : Nombre de personnes touchées par les dispositifs d'actions en faveur des jeunes publics et des publics empêchés |
Sous-indicateur 8.1 : nombre d'enfants concernés en temps scolaire et hors temps scolaire (hors manifestations nationales) |
Cible |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
6 000 |
|
|
Réalisé |
540 |
5 380 |
8 525 |
||||||
|
Sous-indicateur 8.2 : nombre de personnes touchées par les actions menées par les associations |
Cible |
18 000 |
37 000 |
38 000 |
39 000 |
40 000 |
|||
|
Réalisé |
36 159 |
103 212 |
|||||||
|
Sous-indicateur 8.3 : nombre de personnes touchées par les actions menées par les bibliothèques |
Cible |
7 000 |
8 000 |
9 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Réalisé |
8 222 |
67 335 |
|||||||
|
Indicateur 9 : Nombre d'évènements réalisés par manifestation littéraire |
Sous-indicateur 9.1 : Nombre de structures et d'événements référencés participant aux manifestations nationales de Partir en Livre (PEL) |
Cible (structure) |
1 400 |
1 425 |
1 450 |
1 475 |
1 500 |
||
|
Réalisé (structures) |
1 825 |
1 558 |
1 677 |
||||||
|
Cible (évènements) |
4 200 |
4 300 |
4 400 |
4 500 |
4 600 |
||||
|
Réalisé (évènements) |
4 000 |
4 701 |
5 818 |
||||||
|
Sous-indicateur 9.2 : Nombre de structures et d'événements référencés participant aux manifestations nationales des Nuits de la lecture (NDL) |
Cible (structure) |
2 522 |
2 550 |
2 575 |
2 600 |
2 625 |
|||
|
Réalisé (structures) |
1 142 |
2 522 |
3 959 |
||||||
|
Cible (évènements) |
5 371 |
5 400 |
5 500 |
5 600 |
5 700 |
||||
|
Réalisé (évènements) |
2 076 |
5 371 |
7 995 |
||||||
|
Indicateur 10 : Nombre d'abonnés aux comptes du Centre national du livre sur les réseaux sociaux |
Sous-indicateur 10.1 : Nombre d'abonnés sur Twitter |
Cible |
22 000 |
23 000 |
24 000 |
25 000 |
26 000 |
||
|
Réalisé |
21 000 |
22 048 |
23 249 |
||||||
|
Sous-indicateur 10.2 : Nombre d'abonnés sur Instagram |
Cible |
8 500 |
9 000 |
9 500 |
10 000 |
10 500 |
|||
|
Réalisé |
7 800 |
11 245 |
18 432 |
||||||
|
Sous-indicateur 10.3 : Nombre d'abonnés sur LinkedIn |
Cible |
19 000 |
20 500 |
22 000 |
23 500 |
25 000 |
|||
|
Réalisé |
17 500 |
21 177 |
29 750 |
||||||
|
Sous-indicateur 10.4 : Nombre d'abonnés sur Facebook |
Cible |
19 000 |
19 500 |
20 000 |
20 500 |
21 000 |
|||
|
Réalisé |
20 000 |
19 000 |
24 300 |
||||||
|
Axe 4 - Adapter la gouvernance du CNL aux nouveaux enjeux |
Indicateur 11 : Optimisation de la gestion des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement |
Sous-indicateur 11.1 : Taux de participation d'agents aux formations collectives organisés par le CNL |
Cible |
90% |
91% |
91% |
92% |
92% |
|
|
Réalisé |
88% |
90% |
91% |
||||||
|
Sous-indicateur 11.2 : Taux d'évolution des charges de fonctionnement de la fonction support |
Réalisé |
1 032 657 |
1 879 680 |
1 256 557 |
|||||
|
Taux d'évolution |
+82% |
-33% |
|||||||
ANNEXE 4 : COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DES AIDES DU CNL
|
Commission |
Cible |
Aide |
|
Comité d'aides économiques aux maisons d'édition et de librairie |
Editeurs indépendants français |
Aides aux éditeurs pour la promotion des auteurs et des publications (hors revues) |
|
Label LIR/LR |
Librairies |
Labellisation de librairies pour trois ans reconnaissant, valorisant et soutenant l'engagement et le travail qualitatif des libraires |
|
VAL - Valorisation des fonds et de la création éditoriale en librairie |
Librairies labellisées LIR et LR |
Aide visant à soutenir les librairies ayant un assortiment de livres neufs diversifiés et de qualité dans un local attractif et en ligne |
|
Economie numérique |
Editeurs indépendants français |
Aide à la création et au développement
du livre audio |
|
Comité Résidences d'auteurs à l'Ecole |
Auteurs |
Bourses de résidence |
|
Comité Résidences d'auteurs en centres de loisirs et colonies de vacances |
Auteurs |
Bourses de résidence |
|
Comité d'aides économiques aux maisons d'édition et de librairies |
Librairies |
Aides à l'investissement aux librairies (prêts et subventions) |
|
Commission Vie littéraire |
Manifestations littéraires soutenues sur le territoire national |
Aide à la réalisation de manifestations nationales visant à soutenir les festivals qui associent tous les acteurs de la chaîne du livre en vue de proposer un contenu littéraire de qualité à destination d'un large public |
|
Commission Partir en livre |
Manifestations littéraires soutenues dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre |
Aide à la réalisation de manifestations visant à soutenir les manifestations qui associent tous les acteurs de la chaîne du livre en vue de proposer un contenu littéraire de qualité à destination du jeune public |
|
Commission Printemps des poètes |
Manifestations littéraires soutenues dans le cadre de la manifestation nationale Printemps des poètes |
Aide à la réalisation de manifestations visant à soutenir les manifestations qui associent tous les acteurs de la chaîne du livre en vue de proposer un contenu littéraire de qualité à destination du grand public |
|
Philosophie |
Projets d'ouvrages ou de revues relevant du domaine de la Philosophie, psychanalyse et histoire et sciences des religions. |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Poésie |
Projets d'ouvrages de textes poétiques, de revues et d'essais sur la poésie, francophones ou traduits. |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Roman |
Projets d'ouvrages ou de revues relevant du genre romanesque (romans, nouvelles et récits) |
bourses d'écriture et aides bisannuelles aux revues |
|
Histoire et Sciences humaines et sociales |
Protes d'ouvrages et de revues relevant du domaine de l'Histoire et des sciences humaines et sociales (géographie, anthropologie, économie, Ethnographie...) |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Théâtre |
Projets d'ouvrages de pièces de théâtre, de revues et d'essais sur le théâtre, francophones ou traduits. |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Comité Cioran |
Projet d'essai de facture libre, d'ordre philosophique et/ou littéraire, dans l'esprit de Cioran. |
Bourse d'écriture décernée chaque année à un essayiste francophone, -créée grâce au legs de Simone Boué sur les droits d'auteur de l'oeuvre d'Emil Cioran, essayiste dont elle fut la compagne. |
|
Comité des allocations annuelles aux auteurs |
Dispositif social clos depuis 2010 et n'examinant depuis chaque année que les dossiers des auteurs inscrits avant cette date (5 auteurs concernés en 2024) |
bourse sociale annuelle visant à pallier aux difficultés chroniques liés au grand âge ou à la maladie d'auteurs de plus de 65 ans et dont l'oeuvre a incontestablement contribué au rayonnement de la littérature d'expression française. |
|
Développement de la lecture auprès de publics spécifiques |
Associations et bibliothèques poreturs de projets de développement de la lecture auprès des publics spécifiques |
Aide au développement de la lecture auprès de publics spécifiques |
|
Diffusion du livre français à l'international |
|
Aides aux Librairies francophones à l'étranger + aides aux maisons d'édition francophones à l'étranger |
|
Arts |
Projets d'ouvrages et de revues relevant du domaine de l'Histoire générale de l'art (à l'exception du champ contemporain qui relève de la compétence du Centre national des arts plastiques) et plus particulièrement aux domaines de la peinture, de la sculpture, de l'archéologie, du cinéma, de la musicologie et de l'histoire de la musique, de la philosophie de l'art et de la photographie. |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Bande dessinée |
Projets d'ouvrages de création ou d'essais relevant de la bande dessinée, francophones ou traduites des langues étrangères vers le français |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Extraduction littérature |
Projets de traduction du français vers les langues étrangères d'ouvrages français de littérature (fiction et essais) |
aides à la traduction d'ouvrages francophones vers les langues étrangères (extraduction) et bourse de séjour en France pour les traducteurs du français vers les langues étrangères |
|
Extraduction Histoire et Sciences humaines |
Projets de traduction du français vers les langues étrangères d'ouvrages français de Non fiction |
aides à la traduction d'ouvrages francophones vers les langues étrangères (extraduction) et bourses de séjour en France pour les traducteurs du français vers les langues étrangères |
|
Littérature jeunesse Jeunesse |
Projets d'ouvrages dédiées à la jeunesse (roman, album, bande dessinée, poésie, théâtre, documentaire...) |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Littératures Etrangères |
Projets d'ouvrages relevant du roman étranger traduit en français et d'essais sur la littérature étrangère |
aides à la publication et aides à la traduction d'ouvrages étrangers vers le français, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture pour les auteurs non francophones et de traduction. |
|
Histoire et critique littéraires |
Projets d'ouvrages et de revues relevant du domaine de la critique littéraire, littérature classique, histoire littéraire. |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
|
Sciences de la Vie et de la Matière |
Projets d'ouvrages ou de revues relevant du domaine de la littérature scientifique et des problématiques environnementales. |
aides à la publication et aides à la traduction, aides bisannuelles aux revues, bourses d'écriture et de traduction. |
* 1 Le coût total de la compensation partielle par l'État d'exonération de cotisation d'assurance vieillesse pour les artistes auteurs s'élevait à 21 millions d'euros sur la mission « Culture » en loi de finances initiale pour 2025. Toutefois, les documents budgétaires ne permettent pas de retracer la part de ces compensations qui est liée à des exonérations d'auteurs de livres et non d'autres oeuvres intellectuelles.
* 2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique, CPO, décembre 2022.
* 3 La méthodologie de calcul figure en annexe 1.
* 4 Hors entreprises de taille intermédiaires (ETI) et grandes entreprises (GE).
* 5 Baromètre Les Français et la lecture Résultats 2025, Centre national du livre.
* 6 Une analyse comparative de la concentration des industries culturelles figure en annexe.
* 7 Loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une caisse nationale des lettres.
* 8 Mission d'audit de modernisation - rapport sur la chaîne du livre, Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires culturelles, juillet 2007.
* 9 Relevé d'observations définitives sur le Centre national du livre, Exercices 2015 à 2020, Cour des comptes, décembre 2021.
* 10 Évaluation de politique publique Le soutien à l'économie du livre et du cinéma en régions, Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires culturelles, février 2017.
* 11 Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs.
* 12 Article 278-0 bis, A, 3° du code général des impôts.
* 13 Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs.
* 14 Le coût total de la compensation partielle par l'État d'exonération de cotisation d'assurance vieillesse pour les artistes auteurs s'élevait à 21 millions d'euros sur la mission Culture en LFI pour 2025. Toutefois, les documents budgétaires ne permettent pas de retracer quelle part de ces compensations est liée à des exonérations d'auteurs de livres et non d'autres oeuvres intellectuelles (musique, oeuvres audiovisuelles, etc.).
* 15 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
* 16 La liste des indicateurs du COP 2022-2026 du CNL et de leur atteinte figure en annexe du présent rapport.
* 17 Article 45 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
* 18 La bande dessinée représente 11,4 % des aides CNL en valeur, contre 24,9 % du chiffre d'affaires de l'édition. Le CNL rappelle que près de 30 % du chiffre d'affaires de l'édition française est généré par des secteurs non aidés par le CNL (enseignement et scolaire, dictionnaires et encyclopédies, cartes et atlas, livres pratiques...).
* 19 Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
* 20 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 21 Réponses du syndicat de la librairie française au rapporteur spécial.
* (22) Décret n° 2018-356 du 15 mai 2018 instituant une mesure de soutien au pouvoir d'achat des artistes-auteurs pour l'année 2018.
* (23) Décret n° 2019-422 du 7 mai 2019 instituant des mesures de soutien au pouvoir d'achat des artistes-auteurs.
* (24) Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2025, Cour des comptes, mai 2025.
* (25) IGAS-IGF, mai 2015, Revues de dépenses, Les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques.
* 26 BOI-TVA-LIQ-30-10-40.
* 27 Article 35 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 28 Rapport d'information fait par M. Yann Gaillard au nom de la commission des finances sur la politique du livre face au défi du numérique, février 2010.
* 29 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique, CPO, décembre 2022.
* 30 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique, CPO, décembre 2022.
* 31 Audition de la présidente de la SAS Pass culture.
* 32 Décret n° 2025-195 du 27 février 2025 relatif au « pass Culture ».
* 33 Premier bilan du pass Culture, Cour des comptes, 17 décembre 2024.
* 34 Les impacts de la part individuelle du Pass Culture, IGAC 2024 - N° 2024-15.