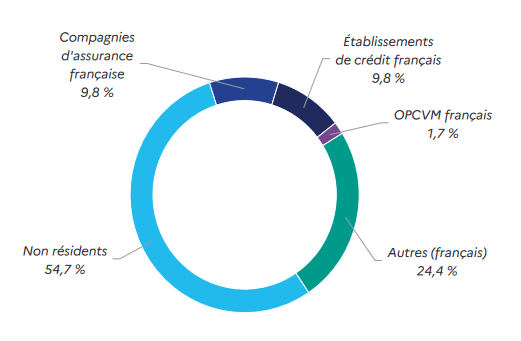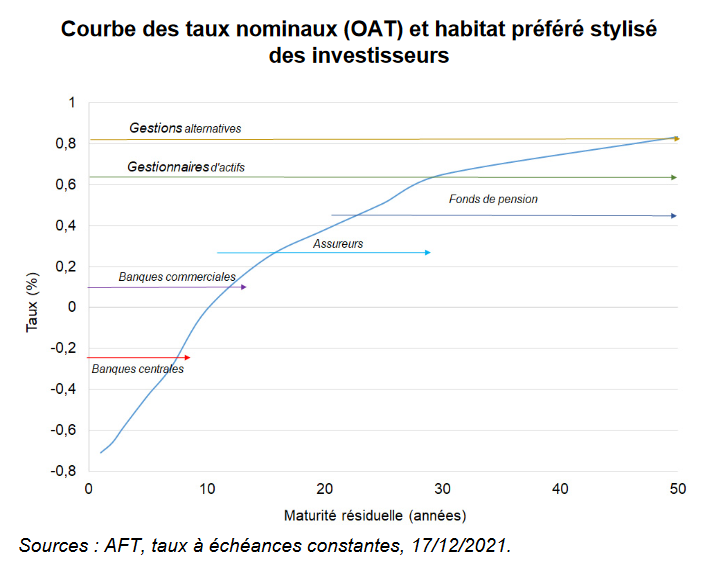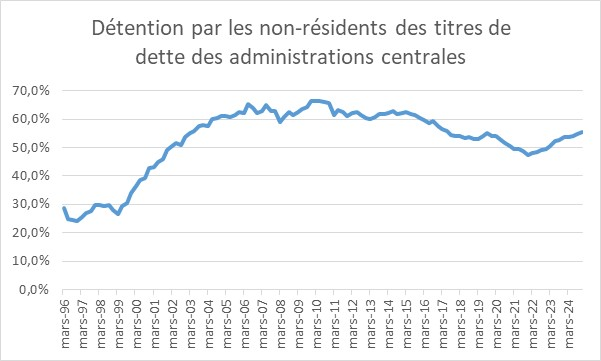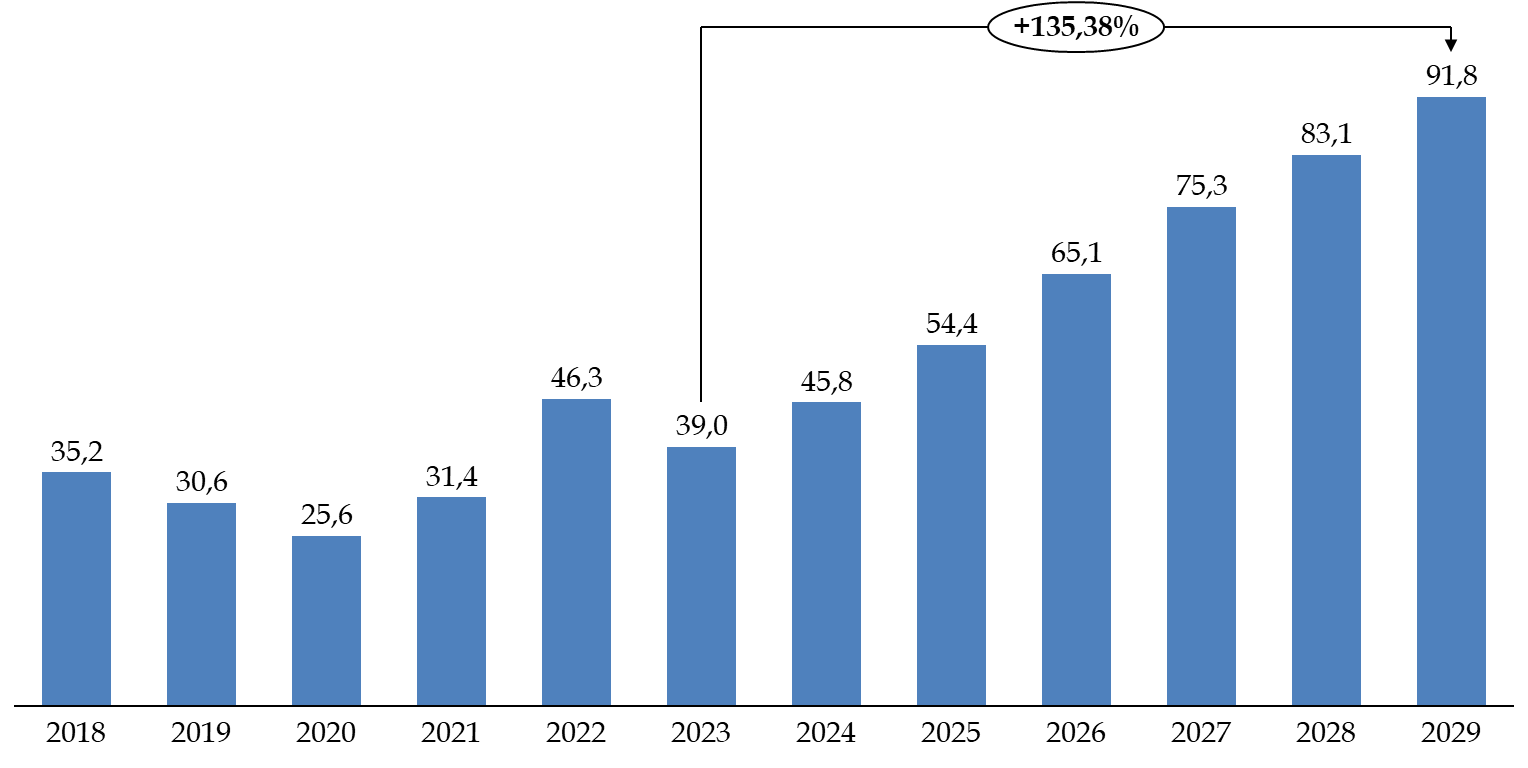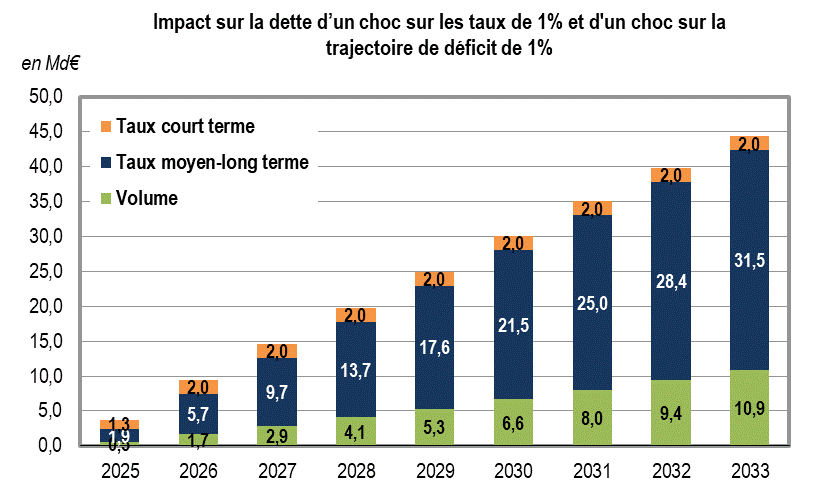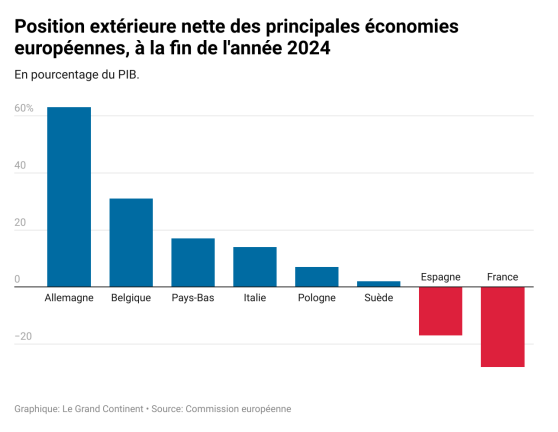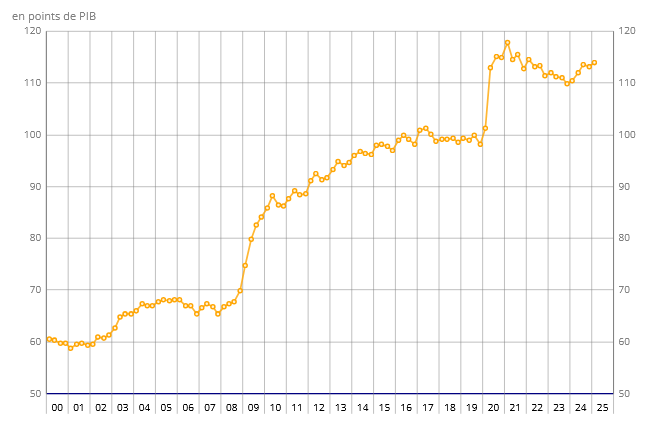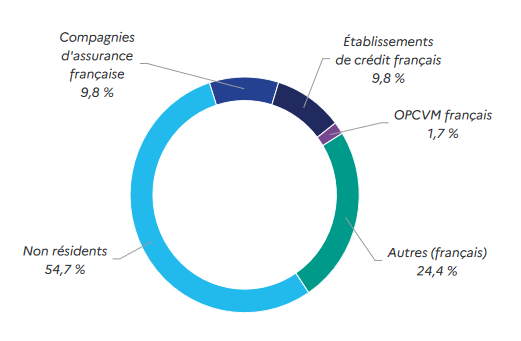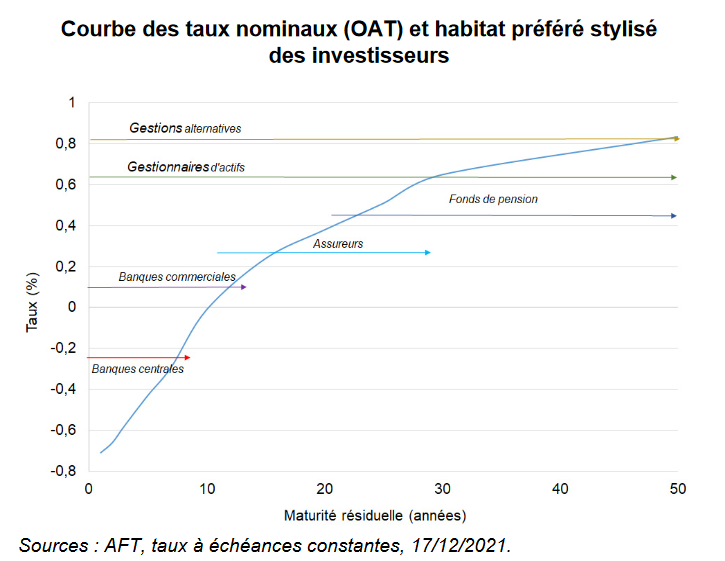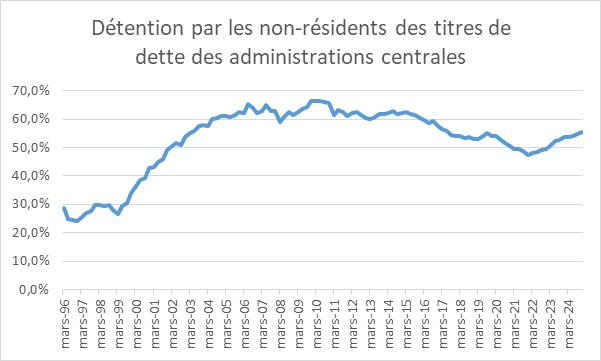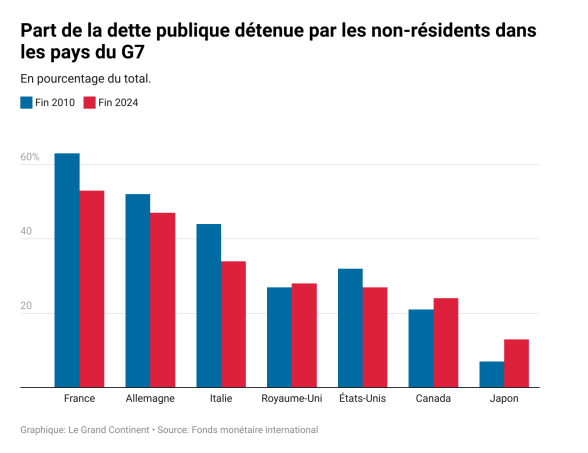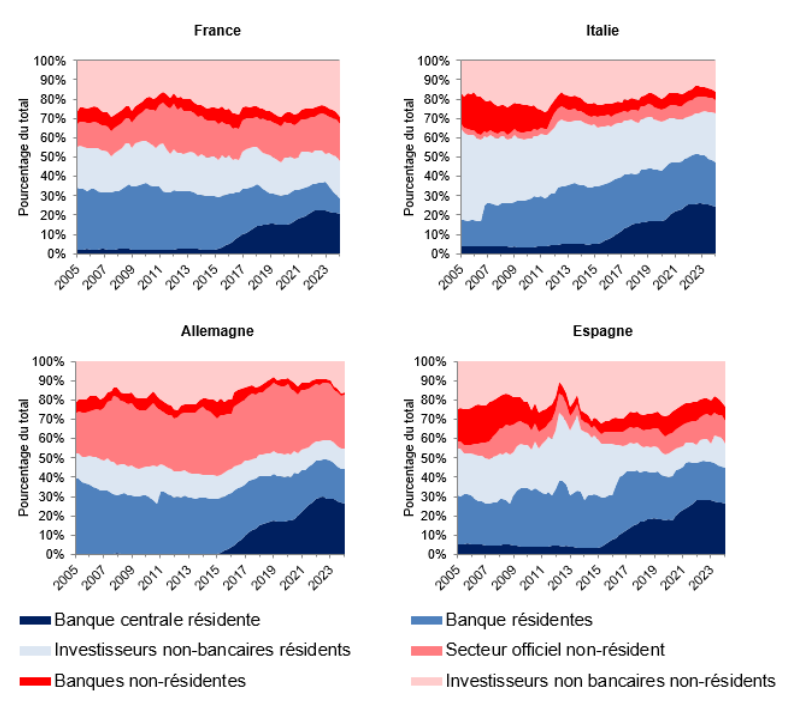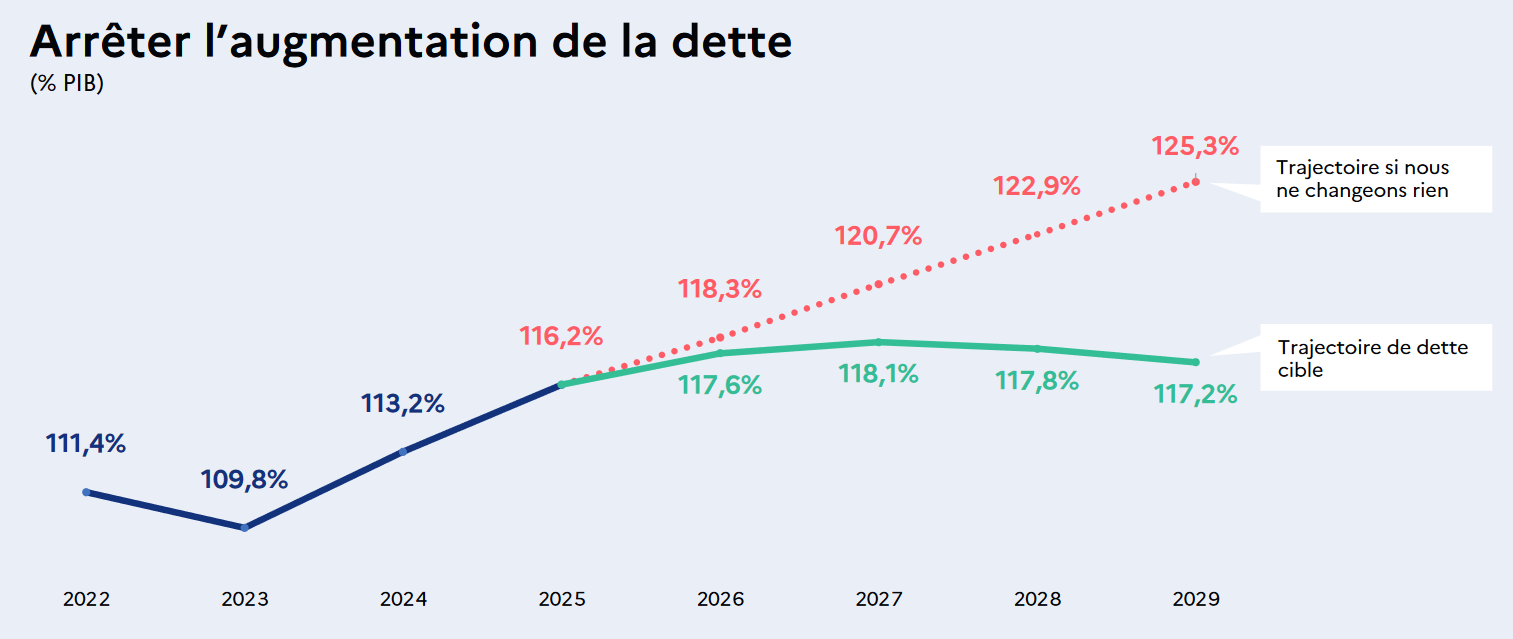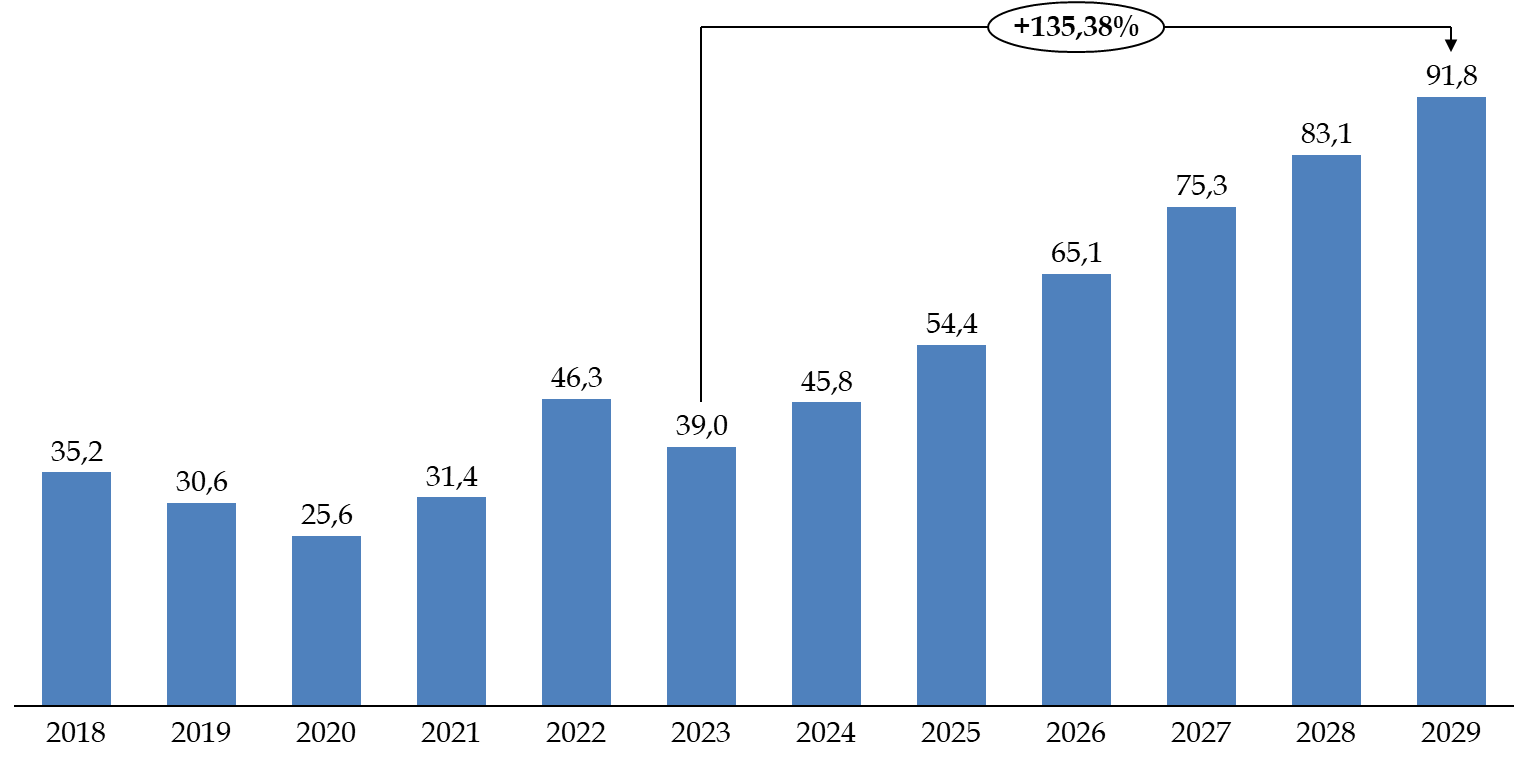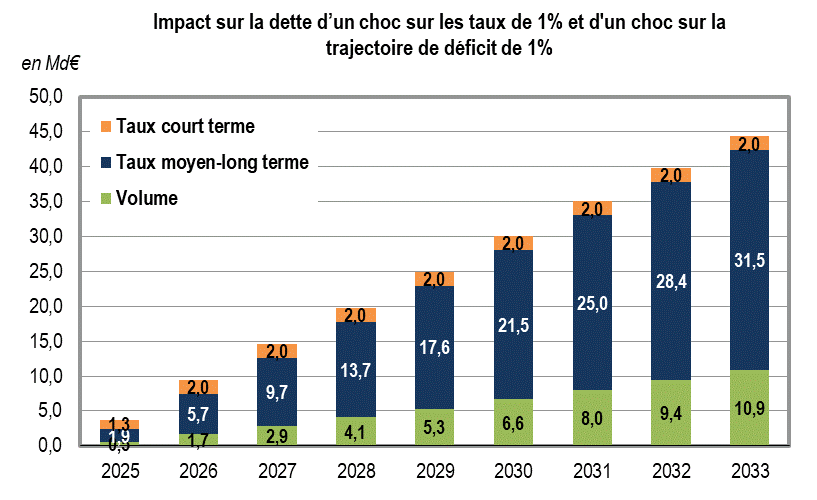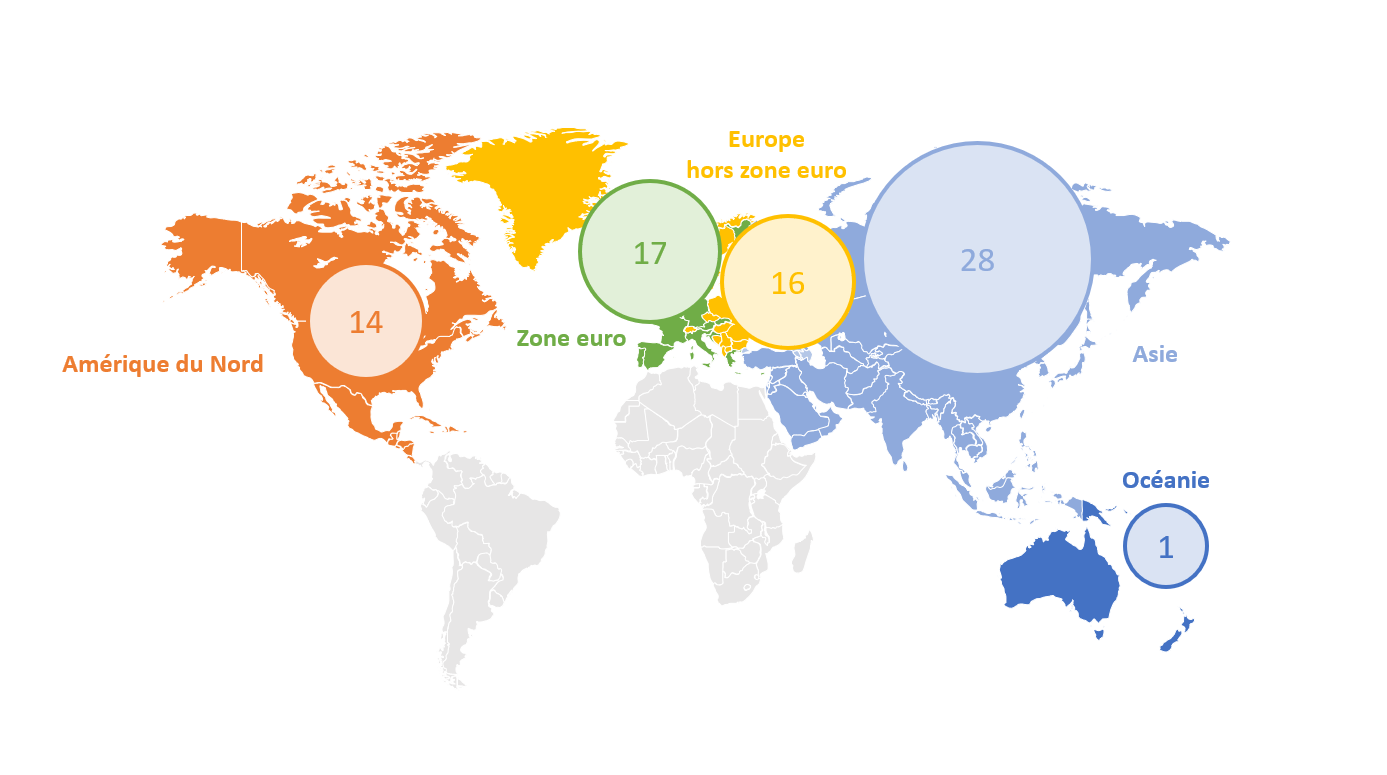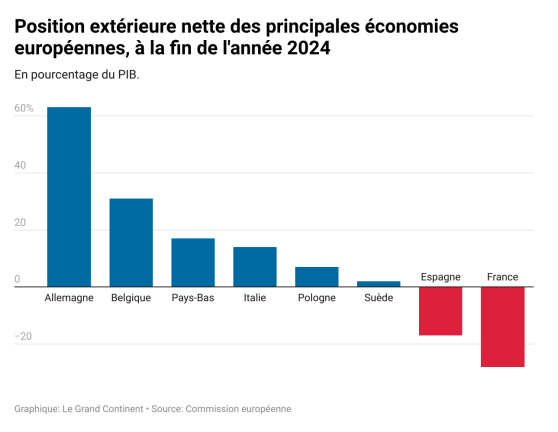- L'ESSENTIEL
- LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR
SPÉCIAL
- I. LA STRUCTURE DE DÉTENTION DE LA DETTE DE
LA FRANCE SE DISTINGUE PAR UNE FORTE DIVERSIFICATION DES INVESTISSEURS, REFLET
DE LA CONFIANCE DANS LA SIGNATURE DE L'ÉTAT
- A. UNE BASE D'INVESTISSEURS DIVERSIFIÉE, TANT
EN TERMES DE TYPE D'ACTEURS FINANCIERS QU'AU REGARD DE LEUR ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE
- 1. La dette française est détenue par
des acteurs financiers variés, poursuivant des stratégies et des
horizons d'investissements spécifiques
- 2. La structure de détention de la dette de
la France a connu une internationalisation croissante au cours des
dernières décennies, avec un taux de détention par des
investisseurs non-résidents relativement élevé en
comparaison d'autres États développés
- 1. La dette française est détenue par
des acteurs financiers variés, poursuivant des stratégies et des
horizons d'investissements spécifiques
- B. CETTE DIVERSIFICATION REFLÈTE
L'ATTRACTIVITÉ DE LA DETTE FRANÇAISE POUR LES INVESTISSEURS
INTERNATIONAUX ET EST VALORISÉE PAR L'AGENCE FRANCE TRÉSOR DANS
LE CADRE DE SA STRATÉGIE DE GESTION DE LA DETTE
- A. UNE BASE D'INVESTISSEURS DIVERSIFIÉE, TANT
EN TERMES DE TYPE D'ACTEURS FINANCIERS QU'AU REGARD DE LEUR ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE
- II. DANS UN CONTEXTE DE TENSIONS CROISSANTES
CONCERNANT LA TRAJECTOIRE DE LA DETTE PUBLIQUE, LA DIVERSIFICATION DE SA
STRUCTURE DE DÉTENTION DOIT ÊTRE POURSUIVIE, SANS DRAMATISER LES
ENJEUX DE SOUVERAINETÉ ET DE RÉSILIENCE FINANCIÈRES
ASSOCIÉS
- A. ALORS QUE LA MAÎTRISE DE LA TRAJECTOIRE
D'ENDETTEMENT DE LA FRANCE REPRÉSENTE UN IMPÉRATIF DE
SOUVERAINETÉ ABSOLU, IMPOSER DE NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIÈRE
DE DÉTENTION SERAIT CONTRE-PRODUCTIF
- 1. La souveraineté financière repose
essentiellement sur la maîtrise de la trajectoire d'endettement et sur la
réduction du poids de la charge d'intérêts
- 2. De nouvelles contraintes adoptées de
manière unilatérale en matière d'identification ou
d'origine géographique des investisseurs affecteraient
l'attractivité de la dette française et aboutiraient à une
augmentation de son coût pour les finances publiques
- 1. La souveraineté financière repose
essentiellement sur la maîtrise de la trajectoire d'endettement et sur la
réduction du poids de la charge d'intérêts
- B. LES ENJEUX DE SOUVERAINETÉ ET DE
RÉSILIENCE FINANCIÈRES ASSOCIÉS À LA
DÉTENTION DE LA DETTE PUBLIQUE NE DOIVENT NI ÊTRE
DRAMATISÉS, NI CONDUIRE À PORTER PRÉJUDICE AU FINANCEMENT
PRIVÉ ET À LA STABILITÉ FINANCIÈRE
- 1. L'orientation de l'épargne domestique
vers la détention de la dette publique répond à une
finalité davantage politique qu'économique et doit être
réservée à des investissements stratégiques
clairement déterminés
- 2. Plus globalement, le poids des investisseurs
non-résidents dans le financement de l'économie française
constitue un défi majeur, qui ne peut être traité par des
mesures ponctuelles mais qui renvoie à la problématique de la
compétitivité industrielle
- 1. L'orientation de l'épargne domestique
vers la détention de la dette publique répond à une
finalité davantage politique qu'économique et doit être
réservée à des investissements stratégiques
clairement déterminés
- A. ALORS QUE LA MAÎTRISE DE LA TRAJECTOIRE
D'ENDETTEMENT DE LA FRANCE REPRÉSENTE UN IMPÉRATIF DE
SOUVERAINETÉ ABSOLU, IMPOSER DE NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIÈRE
DE DÉTENTION SERAIT CONTRE-PRODUCTIF
- I. LA STRUCTURE DE DÉTENTION DE LA DETTE DE
LA FRANCE SE DISTINGUE PAR UNE FORTE DIVERSIFICATION DES INVESTISSEURS, REFLET
DE LA CONFIANCE DANS LA SIGNATURE DE L'ÉTAT
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 902
SÉNAT
2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur les enjeux associés à la structure de détention de la dette de l'État,
Par M. Albéric de MONTGOLFIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
La commission des finances a examiné, le mercredi 24 septembre 2025, le rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'État », sur les enjeux associés à la structure de détention de la dette de l'État.
I. LA STRUCTURE DE DÉTENTION DE LA DETTE DE LA FRANCE SE DISTINGUE PAR UNE FORTE DIVERSIFICATION DES INVESTISSEURS, REFLET DE LA CONFIANCE DANS LA SIGNATURE DE L'ETAT
A. UNE BASE D'INVESTISSEURS DIVERSIFIÉE, TANT EN TERMES DE TYPES D'ACTEURS FINANCIERS QU'AU REGARD DE LEUR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Les titres de dette de l'État, qui se composent de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF) pour les titres de court terme et d'obligations assimilables du Trésor (OAT) pour les titres de moyen-long terme, sont des titres de créance négociables qui s'échangent librement sur les marchés financiers. Si l'État n'est donc pas en mesure de connaître à tout instant les investisseurs dans sa dette, il peut néanmoins s'appuyer sur deux enquêtes récurrentes, une première menée par la Banque de France et une seconde par le Fonds monétaire international (FMI). Au regard des volumes et des flux en jeu, seule cette approche permet « une cohérence et une permanence des méthodes suffisantes pour éclairer le débat public »1(*).
Suivant cette méthode, plusieurs types d'acteurs financiers peuvent être identifiés au sein de la structure de détention de la dette de la France.
Détention des titres de la dette
négociable de l'État
par groupe de porteurs au premier
trimestre 2025
(structure en pourcentage exprimée en valeur de marché)
Note : les OPCVM désignent les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Source : Agence France Trésor, d'après la Banque de France
Courbe des taux nominaux (OAT) et types de
placement recherchés
par les différentes catégories
d'investisseurs
(taux en pourcentage, maturités résiduelles en années)
Note : les taux présentés dans ce graphique correspondent aux taux à échéances constantes au 17 décembre 2021.
Source : Direction générale du Trésor, « La stratégie d'émission de la dette souveraine française », Trésor Eco n° 297, janvier 2022
La détention de la dette des administrations centrales par des investisseurs non-résidents a fortement augmenté au cours de la décennie 2000-2010. En 1996, les non-résidents détenaient 28,7 % de cette dette et la proportion est restée à peu près stable jusqu'à mi-1998 (29,5 %). Cette part a ensuite augmenté régulièrement jusqu'à un pic de 66,4 % fin 2009, avant de connaître une baisse à partir de 2015 sous l'effet du programme d'achat de titres publics des banques centrales de l'Eurosystème, pour atteindre un creux à 47,5 % fin 2021. Depuis cette date, la fin du programme d'achat et, au contraire, la vente de titres à travers la politique de resserrement monétaire ont conduit à ce que la détention par les non-résidents réaugmente progressivement jusqu'à près de 56 % aujourd'hui.
Détention par les non-résidents des titres de dette des administrations centrales
(en pourcentage du total)
Source : Banque de France, comptes nationaux financiers
B. CETTE DIVERSIFICATION REFLÈTE L'ATTRACTIVITÉ DE LA DETTE FRANÇAISE POUR LES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX ET EST VALORISÉE PAR L'AGENCE FRANCE TRÉSOR DANS LE CADRE DE SA STRATÉGIE DE GESTION DE LA DETTE
Comme le souligne l'Agence France Trésor, la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette française procède de l'attractivité de la signature de la France : « la part des investisseurs étrangers dans la détention de la dette allemande et française est à peu près identique. Le fait que cette part augmente est un indicateur d'attractivité de la dette française (...) C'est plutôt à mettre au crédit de la qualité de cette dette »2(*).
« L'internationalisation du placement de la dette est un facteur d'élargissement de la demande, et donc de baisse du taux à l'émission » (Agence France Trésor)3(*)
Pour les investisseurs comme pour les emprunteurs, la diversification est un principe fondamental de gestion du risque. Pour l'État, cela signifie « attirer des investisseurs étrangers, ce qui permet d'élargir la base de financement et de ne pas dépendre uniquement des investisseurs nationaux »4(*). Par ailleurs, il apparait que la part d'investisseurs étrangers dans les obligations souveraines est positivement corrélée avec la note souveraine du pays.
II. DANS UN CONTEXTE DE TENSIONS CROISSANTES CONCERNANT LA TRAJECTOIRE DE LA DETTE PUBLIQUE, LA DIVERSIFICATION DE LA STRUCTURE DE DÉTENTION DOIT ÊTRE POURSUIVIE
A. ALORS QUE LA MAÎTRISE DE LA TRAJECTOIRE D'ENDETTEMENT DE LA FRANCE REPRÉSENTE UN IMPÉRATIF DE SOUVERAINETÉ ABSOLU, IMPOSER DE NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIÈRE DE DÉTENTION SERAIT CONTRE-PRODUCTIF
La souveraineté financière est avant tout reliée au niveau d'endettement, qui détermine notamment le poids budgétaire de la charge d'intérêt. Par ailleurs, en se tournant vers le panel d'investisseurs le plus large et diversifié possible, la France minimise à la fois le coût et la volatilité des conditions de financement de sa dette. Dès lors, « la meilleure stratégie est donc de ne pas dépendre d'une catégorie d'investisseurs en particulier, quelle qu'elle soit »5(*).
En l'état actuel du droit français, l'article L. 228-2 du code de commerce prévoit la faculté, pour toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances négociables « autre que les personnes morales de droit public », d'identifier nominativement les porteurs des titres concernés. Alors que l'application d'un tel dispositif à la gestion de la dette de l'État pourrait paraître de prime abord une piste séduisante, cette solution revêt en pratique des limites techniques et économiques majeures :
- d'une part, la structure de détention des titres à travers des intermédiaires multiples ne permet pas d'identifier systématiquement les investisseurs finaux ;
- d'autre part, en l'absence de coordination à l'échelle internationale, notamment dans le cadre de l'Union européenne (UE), un tel dispositif singulariserait la France au sein des émetteurs souverains, portant atteinte à l'attractivité de sa dette et risquant d'en renchérir le coût.
Comme le souligne l'Agence France Trésor, toute déclaration hostile envers la détention étrangère de la dette française pourrait miner la confiance des acteurs non-résidents, entraînant l'attrition de la base d'investisseurs de la France et in fine, une hausse du coût de la dette qui devra être supporté par le contribuable.
À cet égard, le rapporteur rappelle les perspectives particulièrement alarmantes concernant l'augmentation attendue de la charge de la dette de l'État, qui devrait doubler d'ici la fin de la décennie, pour atteindre la barre de 100 milliards d'euros. Dans ce contexte de tensions accrues sur les finances publiques, et alors que le financement du déficit dépend fortement de l'attractivité de la dette française sur les marchés obligataires, il importe effectivement de s'abstenir de toute initiative malencontreuse qui affecterait la confiance des investisseurs, notamment non-résidents.
Trajectoire prévisionnelle
d'évolution de la charge de la dette de l'État
entre
2018 et 2029 (en comptabilité générale)
(en milliards d'euros)
Note : les données indiquées pour les années 2025 à 2029 sont des prévisions.
Source : commission des finances, d'après le rapport sur la dette des administrations publiques annexé au projet de loi de finances pour 2025 et les réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur spécial
Impact sur la charge de la dette d'un choc sur les
taux de 1 %
et d'un choc sur la trajectoire de déficit de
1 %
(en milliards d'euros)
Note : le choc sur la trajectoire de déficit correspond à une augmentation du déficit de 1 % du PIB par rapport au déficit prévisionnel. Pour les estimations indiquées dans le présent graphique, l'AFT a procédé par hypothèses conventionnelles. Il est ainsi fait l'hypothèse d'un choc sur le niveau du déficit (effet volume) sans impact sur le niveau des taux d'intérêt (effet taux, décomposé entre taux court terme et taux moyen-long terme).
Source : réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur
B. LES ENJEUX DE SOUVERAINETÉ ET DE RÉSILIENCE FINANCIÈRES ASSOCIÉS À LA DÉTENTION DE LA DETTE PUBLIQUE NE DOIVENT NI ÊTRE DRAMATISÉS, NI CONDUIRE À PORTER PRÉJUDICE AU FINANCEMENT PRIVÉ ET À LA STABILITÉ FINANCIÈRE
Selon une idée communément admise, alors que les investisseurs internationaux adopteraient une gestion plus pragmatique, rationnelle de leurs placements et investissements selon leurs besoins, stratégies et contraintes, les investisseurs résidents auraient une perception subjective du risque souverain national, perception qualifiée dans la littérature économique et financière de « biais domestique ».
Cependant, divers évènements, à l'image de la crise des gilts britanniques en 2022 consécutive à l'annonce du « mini-budget » par le gouvernement dirigé par Liz Truss, amènent à penser qu'un tel biais domestique est faible, et que les investisseurs nationaux sont soumis aux mêmes besoins, stratégies et contraintes que les investisseurs internationaux.
Pour autant, la mobilisation de l'épargne domestique dans le cadre d'un programme de financement orienté vers des investissements stratégiques prioritaires peut tout à fait se concevoir, mais pour des masses financières plus limitées, afin de créer « une dynamique de solidarité nationale visible, dans une logique de « financement référendaire » »6(*).
Plus globalement, le faible recours à l'épargne domestique pour le financement de la dette publique constitue, d'un point de vue économique, plutôt une opportunité. Ainsi, une réorientation de l'épargne vers la dette publique pourrait être compensée, sur les marchés d'actifs privés (notamment actions et obligations), par une augmentation de la détention de ces actifs par des non-résidents, ce qui présenterait autant, voire davantage, de difficultés au plan de la souveraineté économique, dans la mesure où la détention d'actifs tels que des actions offre plus de droits (et plus de pouvoir de marché) que celle de titres de dette publique liquides.
De manière plus fondamentale, le poids des investisseurs non-résidents dans le financement de l'économie française constitue un défi majeur, qui ne peut être traité par des mesures ponctuelles mais qui renvoie à la problématique de la compétitivité industrielle, laquelle se traduit par une position extérieure nette vis-à-vis du reste du monde largement négative. Ainsi que le souligne François Écalle dans une note récente, « du fait de l'accumulation [des] déficits de nos échanges extérieurs, nos passifs vis-à-vis du reste du monde sont supérieurs à nos actifs. La position extérieure nette de la France vis-à-vis du reste du monde (actifs moins passifs) est négative (- 28 % du PIB) alors que celle des principaux pays de l'Union européenne est souvent positive (+ 63 % du PIB pour l'Allemagne et + 14 % pour l'Italie). » 7(*)
Position extérieure nette des principales
économies européennes,
à la fin de l'année
2024
(en pourcentage du PIB)
Source : François ECALLE, « Qui détient la dette française ? Anatomie d'un risque géopolitique », Le Grand Continent, septembre 2025, d'après la Commission européenne
LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
Recommandation n° 1 : Poursuivre les initiatives destinées à favoriser la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État (Agence France Trésor).
Recommandation n° 2 : Valoriser, dans le cadre de la sélection et de l'évaluation des banques spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), la contribution de celles-ci à la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État (Direction générale du Trésor, Agence France Trésor).
Recommandation n° 3 : Explorer l'opportunité d'étendre la diversification de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État à de nouvelles zones (Direction générale du Trésor, Agence France Trésor).
Recommandation n° 4 : Réserver les actions de mobilisation de l'épargne des résidents, telles que celles du type « grand emprunt national », à des programmes de financement spécifiques, fléchés vers des investissements publics stratégiques précisément définis (Direction générale du Trésor, Agence France Trésor).
I. LA STRUCTURE DE DÉTENTION DE LA DETTE DE LA FRANCE SE DISTINGUE PAR UNE FORTE DIVERSIFICATION DES INVESTISSEURS, REFLET DE LA CONFIANCE DANS LA SIGNATURE DE L'ÉTAT
A. UNE BASE D'INVESTISSEURS DIVERSIFIÉE, TANT EN TERMES DE TYPE D'ACTEURS FINANCIERS QU'AU REGARD DE LEUR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
1. La dette française est détenue par des acteurs financiers variés, poursuivant des stratégies et des horizons d'investissements spécifiques
Au premier trimestre 20258(*), la dette publique de la France s'établissait à 3 345,4 milliards d'euros, soit 113,9 % du produit intérieur brut (PIB). Sur ce total, la dette des administrations centrales (État et organismes divers d'administration centrale) représentait 2 793,1 milliards d'euros, soit 83,5 % de l'ensemble de la dette française. La dette des administrations publiques locales (collectivités territoriales et leurs établissements publics) s'élevait à 262,5 milliards d'euros, soit 7,8 % de l'ensemble de la dette, et celle des administrations de sécurité sociale atteignait 289,9 milliards d'euros, soit 8,6 %. À elle seule, la dette de l'État représentait 2 723,4 milliards d'euros, correspondant à 81,4 % du total de la dette française.
Évolution de la dette publique de la France depuis 2000
(en points de PIB)
Source : Insee, Informations rapides, n° 163, 25 juin 2025
Les titres de dette de l'État, qui se composent de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF) pour les titres de court terme (maturité inférieure à 1 an) et d'obligations assimilables du Trésor (OAT) pour les titres de moyen-long terme (maturité supérieure à 1 an), sont des titres de créance négociables qui s'échangent librement sur les marchés financiers. Si l'État n'est donc pas en mesure de connaître à tout instant les investisseurs dans sa dette, il peut néanmoins s'appuyer sur deux enquêtes récurrentes, une première menée par la Banque de France et une seconde par le Fonds monétaire international (FMI), pour obtenir des renseignements sur la typologie des investisseurs.
Ainsi que le souligne l'Agence France Trésor (AFT), « il n'existe pas de méthode permettant (...) d'identifier en temps réel et avec précision l'exposition de la dette française vis-à-vis d'un investisseur individuel »9(*). La connaissance de l'exposition de la dette de l'État vis-à-vis d'un type d'investisseurs ou d'une origine géographique repose avant tout sur un travail statistique structuré, à partir des enquêtes de la Banque de France et du FMI.
Ce travail de construction statistique s'appuie sur un processus complexe de réconciliation entre intermédiaires (dépositaires centraux, conservateurs) et est enrichie par des données fiscales. Selon l'appréciation de l'AFT, partagée par la majorité des acteurs financiers interrogés par le rapporteur, seule cette approche permet « une cohérence et une permanence des méthodes suffisantes pour éclairer le débat public »10(*). En effet, les volumes et les flux en jeu sont d'une ampleur telle qu'un suivi autre que statistique serait particulièrement imprécis.
À cet égard, une étude de la Banque de France met en évidence les incertitudes associées à l'estimation de la détention de la dette par des investisseurs non-résidents dans le cas de chaînes de conservation complexes, lorsque cette mesure est réalisée par le prisme du pays émetteur (approche par « engagements », notamment suivie par le Trésor américain) et non par le prisme du pays détenteur (approche par « avoirs »)11(*).
Ainsi, pour l'AFT, « ces travaux doivent rester des travaux statistiques, car ils nécessitent un important exercice de réconciliation entre les données issues des émetteurs et celles provenant des créanciers, en raison de la complexité des chaînes de détention et des circuits financiers »12(*).
Les sources des données sur la typologie des investisseurs
L'enquête de la Banque de France s'appuie sur PROTIDE, une collecte trimestrielle de données déclaratives des teneurs de comptes conservateurs. Cette collecte « vise à mesurer la détention par les agents économiques », résidents ou non-résidents, « des titres inscrits en compte chez les établissements déclarants », émis par des résidents ou non-résidents. La collecte PROTIDE est en valeur de marché. Si le champ de cette collecte dépasse celui de la seule dette négociable de l'État, la Banque de France transmet à l'Agence France Trésor les taux de détention par les résidents de la dette négociable de l'État (globale et par instruments) ainsi que la décomposition des positions résidentes par catégorie d'acteurs : assurances, établissements de crédit, organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et autres.
L'intérêt de ce jeu de données est qu'il porte sur la dette de l'État seule et qu'il est actualisé trimestriellement. Il ne permet cependant aucune ventilation par zone géographique principale, encore moins par pays.
L'enquête trimestrielle du FMI, publiée deux fois par an, s'appuie sur la « Sovereign Debt Investor Base for Advanced Economies ». Cette base de données fournit des estimations sur les types d'investisseurs de la dette des administrations publiques de 24 économies avancées. Le champ de cette enquête conduit à publier des données plus larges que celles transmises par la Banque de France à l'AFT. Notamment, les crédits bancaires sont cumulés aux titres obligataires et le champ inclut tous les autres sous-secteurs des administrations publiques (collectivités locales, administrations de sécurité sociale). Toutes les données sont soit en valeur nominale, soit corrigées des variations de valorisation, le cas échéant, afin d'éliminer les réévaluations de prix. Tous les avoirs intra-gouvernementaux sont déduits. La base d'investisseurs est regroupée en six catégories : banque centrale nationale, banques nationales, non-banques nationales, secteur officiel étranger, banques étrangères et non-banques étrangères.
L'intérêt de ce jeu de données est qu'il permet une ventilation par zone géographique des investisseurs. Néanmoins, cumulant tous les émetteurs publics français, il ne permet pas d'en tirer une statistique pour le seul État. À noter enfin que les investisseurs sont ainsi ventilés selon leur zone d'implantation géographique, et que ce ne sont donc pas les « États » ou les « fonds souverains » de cette zone qui détiennent nécessairement la dette française, mais n'importe quel investisseur qui y est implanté.
Source : Rapport sur la dette des administrations publiques annexé au projet de loi de finances pour 2025
Dans ce contexte, les statistiques issues des enquêtes de la Banque de France et du FMI permettent d'identifier plusieurs types d'acteurs financiers au sein de la structure de détention de la dette de la France.
Détention des titres de la dette
négociable de l'État
par groupe de porteurs au premier
trimestre 2025
(structure en pourcentage exprimée en valeur de marché)
Note : les OPCVM désignent les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Source : Agence France Trésor, d'après la Banque de France
En premier lieu, l'Eurosystème - et plus spécifiquement la Banque de France et la Banque centrale européenne (BCE) -, représentant l'essentiel de la catégorie « Autres (français) », détient des OAT d'une maturité d'au plus 30 ans, dans le cadre des programmes d'achats13(*) pour la mise en oeuvre de la politique monétaire. L'Eurosystème détiendrait près d'un quart des OAT à ce titre. Depuis janvier 2025, il n'y a plus de réinvestissement des sommes lors de l'échéance des titres, si bien que la dette détenue par l'Eurosystème dans le cadre de la politique monétaire se réduit graduellement (et donc a fortiori la part dans la dette totale).
En deuxième lieu, les banques centrales et fonds souverains des États étrangers sont susceptibles de détenir des BTF et des OAT dans le cadre de la gestion de leurs réserves de change, pour la partie libellée en euro. Selon les dernières données du FMI, ces avoirs représenteraient près d'un cinquième de la dette. La maturité des titres détenus dépend de la politique propre à chaque institution. Il est cependant probable qu'une large partie des encours porte sur des titres de maturité inférieure ou égale à 10 ans.
En troisième lieu, les investisseurs institutionnels comprennent différents acteurs :
- d'une part, les fonds de pension gèrent les avoirs adossés aux passifs de retraite dans les systèmes reposant sur la capitalisation. Ils sont en général dans une logique d'adossement actif-passif qui en fait les investisseurs prédominants sur le segment long terme (15-20 ans et au-delà). La part de capitalisation dans le système de retraite français est marginale. En revanche, les fonds de pension d'Europe du Nord, y compris des Pays-Bas, sont de taille plus significative ;
- d'autre part, les assureurs, y compris l'assurance vie, constituent une autre catégorie d'investisseurs guidés par des nécessité d'adossement actif-passif, avec toutefois un horizon un peu plus court. Selon les données de la Banque de France, les assureurs français détenaient fin 2024 près de 10 % de la dette de l'État ; selon les données de la BCE, les assureurs et fonds de pension européens, pris globalement (acteurs français inclus), détiendraient près de 20 %. Les investissements des assureurs vie (fonds en euros) se concentrent sur les maturités 5-15 ans ;
- enfin, les trésoreries de banques, et plus largement les « asset liability management » (ALM) de banques, détiennent des titres d'État dans le cadre de la gestion de leurs coussins de liquidité. Le plus souvent, la rémunération à taux fixe des titres est échangée contre une rémunération à taux variable. Par ailleurs les banques françaises collectrices de l'épargne réglementée - livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire - adossent pour partie ces ressources à des titres d'État, en particulier des OAT indexées sur l'inflation pour couvrir l'exposition à l'inflation découlant de la formule du taux de rémunération de ces ressources. Les banques françaises détiennent 10 % de la dette de l'État à fin 2024 selon les données de la Banque de France ; la part de détention des banques de la zone euro, prise globalement (incluant les banques françaises), serait proche de 15 %.
Investisseurs spécialisés, les gestionnaires d'actifs gèrent des portefeuilles, parfois pour le compte d'assureurs, de fonds de pension, de fonds souverains ou de banques centrales. Cette catégorie d'acteurs est active sur tous les segments de la courbe des taux.
Les gestions alternatives représentent la dernière catégorie de taille détenant de la dette française. Les stratégies mises en oeuvre sont diverses et n'en font pas un groupe homogène.
Courbe des taux nominaux (OAT) et types de
placement recherchés
par les différentes catégories
d'investisseurs
(taux en pourcentage, maturités résiduelles en années)
Note : les taux présentés dans ce graphique correspondent aux taux à échéances constantes au 17 décembre 2021.
Source : Direction générale du Trésor, « La stratégie d'émission de la dette souveraine française », Trésor Eco n° 297, janvier 2022
Typologie des investisseurs et part de détention dans la dette négociable de l'État
(part en pourcentage au 1er trimestre 2025)
|
Part |
Stratégie d'investissement |
|
|
Investisseurs non-résidents |
54,7 % |
|
|
Banques centrales étrangères |
Environ 10 % |
Réserves de change, stratégie de diversification, recherche de titres sûrs et liquides |
|
Fonds souverains étrangers |
Environ 10 % |
Allocation stratégique à long terme, diversification géographique et monétaire |
|
Autres institutions financières étrangères |
Environ 30% |
Recherche de rendement, arbitrages de taux et de courbe, gestion active de portefeuilles |
|
Investisseurs résidents |
45,3 % |
|
|
Compagnies d'assurance françaises |
9,8 % |
Allocation dans l'assurance-vie, investissements à long terme pour couvrir les passifs |
|
Établissements de crédit français |
9,8 % |
Détention directe ou pour le compte de clients, opérations de trésorerie |
|
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français |
1,7 % |
Gestion collective, optimisation de portefeuilles à court et moyen terme |
|
Autres français (dont la Banque de France pour le compte de la BCE) |
24,4 % |
Politique monétaire |
Source : commission des finances, d'après les réponses du cabinet de conseil souverain Global Sovereign Advisory au questionnaire du rapporteur, l'Agence France Trésor, J.P. Morgan, la Banque de France et le Fonds monétaire international
2. La structure de détention de la dette de la France a connu une internationalisation croissante au cours des dernières décennies, avec un taux de détention par des investisseurs non-résidents relativement élevé en comparaison d'autres États développés
D'après les données de la Banque de France, la détention de la dette des administrations centrales par des investisseurs non-résidents a fortement augmenté au cours de la décennie 2000-2010.
En 1996, les non-résidents détenaient 28,7 % de cette dette et la proportion reste à peu près stable jusqu'à mi-1998 (29,5 %). La part des non-résidents augmente ensuite régulièrement jusqu'à un pic de 66,4 % fin 2009.
Sur le début des années 2010, cette proportion reste sur un plateau avant de baisser à partir de 2015 sous l'effet du programme d'achat de titres publics des banques centrales de l'Eurosystème. La part des non-résidents redescend ainsi jusqu'à un creux à 47,5 % fin 2021.
Depuis cette date, la fin du programme d'achat et, au contraire, la vente de titres à travers la politique de resserrement monétaire des banques centrales de l'Eurosystème ont conduit à ce que la proportion détenue par les non-résidents ré-augmente progressivement jusqu'à près de 56 %.
Détention par les non-résidents des titres de dette des administrations centrales
(en pourcentage du total)
Source : Banque de France, comptes nationaux financiers
Avec 52 % de détention par des investisseurs non-résidents, la dette publique française (toutes administrations publiques) demeure aujourd'hui particulièrement ouverte aux investisseurs internationaux, en comparaison d'autres États développés. Tous titres confondus, la part des investisseurs non-résidents dans la dette des grands émetteurs de la zone euro s'élève ainsi à 28 % pour l'Italie, 43 % pour l'Espagne et 45 % pour l'Allemagne14(*).
Part de la dette publique détenue par les non-résidents dans les pays du G7
(en pourcentage du total)
Source : François ECALLE, « Qui détient la dette française ? Anatomie d'un risque géopolitique », Le Grand Continent, septembre 2025, d'après le Fonds monétaire international
La part de détention des investisseurs non-résidents varie selon le type de titres de dette concernés, avec une proportion prédominante pour les titres de court terme (BTF) et une part minime pour les titres indexés sur l'inflation française (OATi) ou européenne (OAT€i).
Détention des titres de la dette
négociable de l'État par type de titre
au 1er
trimestre 2025
(en pourcentage du total de l'encours de titre concerné)
|
Résidents |
Non-résidents |
|
|
OAT |
47,6 % |
52,4 % |
|
OAT€i |
67,6 % |
32,4 % |
|
OATi |
85,5 % |
14,5 % |
|
BTF |
18,7 % |
81,3 % |
Note : les OAT désignent les obligations assimilables du Trésor ; les OAT€i et OATi représentent, respectivement, les obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation en zone euro et celles indexées sur l'inflation française ; les BTF correspondent aux bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté.
Source : Agence France Trésor, d'après la Banque de France
D'après le rapport sur la dette des administrations publiques annexé au projet de loi de finances pour 2025, la diversification de la répartition de la dette publique française, et sa stabilité dans le temps, constituent « un atout pour la France car elles permettent de diminuer le risque de refinancement et de minimiser les taux d'intérêt, via une concurrence accrue entre les investisseurs ».
Néanmoins, la demande des investisseurs internationaux peut être plus volatile et sensible à tout changement conjoncturel ou de perception du risque sur le rendement escompté. En conséquence, la participation des acteurs étrangers sur les marchés obligataires souverains apporte aussi des « défis aux gouvernements, qui doivent être gérés d'une manière à optimiser les gains et à réduire les coûts associés à la sensibilité de leur demande aux différents facteurs » (niveau du taux de rendement, stabilité du taux de change, liquidité de la dette sur le marché secondaire, note souveraine).
Dans ce contexte, l'émetteur souverain a intérêt à constituer « une base d'investisseurs diversifiée afin de contrebalancer le risque intrinsèquement lié à chaque type d'investisseur, ce qui est le cas en France »15(*).
Évolution de la répartition de la
dette publique de certains pays européens
par groupe de
porteurs
(en pourcentage du total)
Note : données arrêtées au quatrième trimestre 2023.
Source : Rapport sur la dette des administrations publiques annexé au projet de loi de finances pour 2025, d'après le Fonds monétaire international, Sovereign Debt Investor Base for Advanced Economies
D'après l'AFT, « la diversification géographique de la base d'investisseurs est aussi importante que la diversification par typologie »16(*). Elle permet à l'État émetteur de poursuivre trois objectifs :
- d'une part, de réduire significativement ses coûts de financement en élargissant la demande adressée à ses titres obligataires ;
- de modérer les effets d'éviction sur l'investissement privé, renforçant ainsi la résilience des recettes fiscales ;
- de limiter les boucles de rétroaction entre la soutenabilité de la dette et la stabilité du secteur financier national.
Opportunités et risques associés à l'origine géographique des investisseurs
Investisseurs résidents
L'absence du risque de change et la possibilité pour l'État de favoriser l'investissement dans ses propres titres via la réglementation ou la fiscalité expliquent souvent l'importance d'une base d'investisseurs nationale. Toutefois, la participation des investisseurs résidents comporte aussi des limites : l'épargne nationale disponible, si elle est très orientée vers les titres souverains, peut provoquer des effets d'éviction, alors qu'une trop forte concentration sur les investisseurs résidents, notamment les banques, accroît le risque de dépendance mutuelle entre le souverain et le système financier national (« nexus souverain bancaire »). En cas de ralentissement économique propre à la France, les ménages auraient moins de capacité ou d'appétit pour acheter des titres de dette, précisément au moment où l'État aurait besoin d'emprunter davantage pour soutenir l'économie.
Investisseurs de la zone euro non-résidents en France
Les investisseurs de la zone euro non-résidents constituent une source précieuse de financement pour la France. Leur appartenance à la même zone monétaire élimine le risque de change, ce qui facilite l'intégration des marchés obligataires au niveau de la zone et renforce la liquidité des titres souverains français. Leur participation permet de réduire significativement les effets d'éviction. Elle offre également la possibilité de baisser le coût de financement.
Investisseurs européens hors zone euro
Les investisseurs européens situés en dehors de la zone euro représentent une source complémentaire de financement externe pour l'État. Bien qu'en dehors de la zone monétaire, ces acteurs opèrent dans un environnement réglementaire, juridique et institutionnel relativement proche (Suède, Norvège, Royaume-Uni, etc.), ce qui favorise leur accès aux marchés de la dette souveraine française. Leur participation contribue à accroître la profondeur et la diversification de la base d'investisseurs, en particulier dans les compartiments à long terme ou dans les instruments spécifiques (indexés, verts, etc.). Leur comportement est également influencé par des facteurs macro-financiers globaux, par la politique monétaire conduite au sein de leur économie et par l'évolution des différentiels de taux entre devises. Pour ces investisseurs, la détention de titres de dette française vise à répondre aux besoins de réserves de change (cas des banques centrales des pays concernés) ainsi qu'à un besoin de diversification (cas des épargnants de ces pays).
Investisseurs hors Europe
La participation de ces investisseurs sur le marché de la dette souveraine française permet notamment d'améliorer la visibilité de la signature de la France à l'international. La demande en provenance de ces investisseurs contribue à l'augmentation de la demande globale et donc à une négociation des titres de dette à des prix plus élevés (soit des taux d'intérêt plus faible). Leur comportement est plus sensible à l'évolution des conditions macro-financières à l'international, aux politiques monétaires étrangères (notamment celles menées de part et d'autre de l'Atlantique) et aux notations souveraines. L'absence en France de dette émise dans une devise étrangère réduit l'exposition de l'État au principal risque associé à ce type d'investisseurs.
Source : commission des finances d'après les réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur
B. CETTE DIVERSIFICATION REFLÈTE L'ATTRACTIVITÉ DE LA DETTE FRANÇAISE POUR LES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX ET EST VALORISÉE PAR L'AGENCE FRANCE TRÉSOR DANS LE CADRE DE SA STRATÉGIE DE GESTION DE LA DETTE
1. Le caractère diversifié de la base d'investisseurs s'explique par l'attractivité de la signature française
Comme le souligne l'Agence France Trésor, la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette française procède de l'attractivité de la signature de la France.
Auditionné par la commission des finances du Sénat, le directeur général de l'AFT, Antoine Deruennes, a ainsi relevé que la croissance récente de la part des investisseurs non-résidents dans la structure de détention de la dette souveraine française correspondait notamment à une évolution mécanique, résultant de la réduction du bilan de l'Eurosystème, et que cette tendance était révélatrice de la confiance continue des investisseurs : « La part des investisseurs étrangers dans la détention de la dette allemande et française est à peu près identique. Le fait que cette part augmente est un indicateur d'attractivité de la dette française, puisque les investisseurs, partout dans le monde, continuent d'investir dans la dette française. C'est plutôt à mettre au crédit de la qualité de cette dette »17(*).
Au-delà de l'origine géographique des investisseurs, l'AFT valorise également la diversité des types d'acteurs concernés : « Hors investisseurs étrangers, on voit une certaine diversité des investisseurs : les banques, notamment pour répondre à la réglementation bancaire, mais également les assureurs, les fonds monétaires ou non monétaires. Cette diversité participe à la résilience, puisque cela veut dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes comportements en cas de turbulence »18(*).
2. La structure de détention actuelle de la dette de la France est globalement considérée comme équilibrée et cohérente avec la stratégie de financement de l'État
La mission de l'AFT étant d'émettre au moindre coût et au moindre risque pour le contribuable, « l'internationalisation du placement de la dette est un facteur d'élargissement de la demande, et donc de baisse du taux à l'émission »19(*).
En France, les particuliers détiennent déjà indirectement des OAT, à travers par exemple leurs livrets réglementés ou leurs assurances-vie en fonds euro, qui sont largement investis en dette d'État. Ces supports de placement présentent par ailleurs l'avantage d'être garantis en capital à tout instant et d'être parfaitement liquides, ce qui correspond aux préférences des ménages.
En dehors de ces supports, les particuliers peuvent d'ores et déjà investir directement dans des obligations d'État, sur le marché secondaire. Leur participation est marginale, premier signe que ces produits sont peu intéressants, tels quels, pour les ménages. Des OAT dédiées aux particuliers ont existé par le passé et n'ont pas rencontré le succès escompté, leur volume diminuant peu à peu. Le programme d'émission correspondant a été arrêté en 2005.
Pour réunir une demande suffisante, un placement de dette directement auprès des particuliers devrait donc être rendu attractif en s'appuyant soit sur la fiscalité, soit sur une forme de garantie en capital à tout instant, soit sur un taux bonifié, à l'image de la pratique du Trésor italien. Ce faisant, un tel placement de dette se ferait à un coût nécessairement plus important pour les finances publiques, alors que l'alourdissement attendu de la charge d'intérêts, dans un contexte monétaire désormais durablement défavorable, apparaît déjà considérable à l'horizon 2030.
Pour les investisseurs comme pour les emprunteurs, la diversification est bénéfique. Que ce soit pour les ménages, les institutions financières ou l'État, la diversification est un principe fondamental de gestion du risque. Pour l'État, cela signifie « attirer des investisseurs étrangers, ce qui permet d'élargir la base de financement et de ne pas dépendre uniquement des investisseurs nationaux »20(*). Par ailleurs, il apparait que la part d'investisseurs étrangers dans les obligations souveraines est positivement corrélée avec la note souveraine du pays concerné. De surcroît, augmenter la détention domestique ne serait pas cohérent avec la politique d'orientation de l'épargne mise en avant par les autorités françaises et européennes (voir infra).
De même, concernant le circuit du Trésor, système de financement alternatif mis en oeuvre par la France jusqu'aux années 1980, il faut rappeler le contexte dans lequel ce circuit est né, à savoir celui de la Seconde Guerre mondiale et de l'Occupation, ou même celui dans lequel il s'est développé, à savoir celui de la Libération et de la Reconstruction. Pendant la guerre, l'indemnité d'occupation représentait un montant supérieur à celui du budget de l'État de Vichy. Après-guerre, l'inflation s'élevait à plus de 50 % (entre 1944 et 1948), les besoins d'investissement pour la reconstruction étaient massifs.
Le circuit du Trésor, un système de
financement de la dette publique
placé sous le signe de la
contrainte
Déployé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le circuit du Trésor imposait aux institutions bancaires et aux épargnants de déposer leur trésorerie sur le compte du Trésor à la Banque de France, permettant à l'État de disposer de ressources de très court terme.
Ce circuit avait été complété, à partir de 1948, par la souscription forcée de bons du Trésor par le système bancaire, via le système des planchers, exigeant des banques qu'elles détiennent dans leur portefeuille une proportion conséquente de titres de dette dont les taux étaient déterminés par les pouvoirs publics en fonction de l'évaluation de la demande potentielle et en concertation avec la Banque de France.
Le mode de financement actuel, reposant sur l'appel aux marchés de capitaux (par adjudications ou syndications), découle de la mise en marché progressive de la dette publique à partir de la fin des années 1960, puis plus franchement dans les années 1980, avec la création d'un véritable marché obligataire remplaçant le crédit bancaire.
Source : commission des finances, d'après Benjamin LEMOINE, L'ordre de la dette, 2016
Comme le relève l'Agence France Trésor, « ces besoins d'investissement, couplés à une pénurie des capitaux engendrée par la guerre et la faiblesse du marché financier de l'époque, ont justifié l'existence du circuit »21(*). Cela a contribué à « l'émergence d'un État-banquier, collectant la grande partie des liquidités de l'économie pour financer des investissements de long terme, avec des effets d'éviction pour le secteur privé, supportables dès lors que l'État fixait les priorités de la reconstruction »22(*).
Les dysfonctionnements et limites associés au circuit du Trésor ont cependant amené à son abandon progressif :
- d'une part, il suscitait des tensions inflationnistes fortes, en ce qu'il était équivalent à un financement monétaire ;
- d'autre part, il était caractéristique d'une époque enserrée dans les contraintes : la prédation (pendant l'Occupation), puis la pénurie de capitaux et une lente modernisation du système financier et fiscal (la taxe sur la valeur ajoutée, très réactive à l'activité, n'a été généralisée que dans les années 1960).
Par ailleurs, la banque centrale, dont l'indépendance a été consacrée au plan juridique et assortie de garanties fortes, a désormais la charge de la politique monétaire, en lieu et place de « l'État-banquier » de l'après-guerre. Ainsi, un fonctionnement analogue au circuit du Trésor n'aurait aujourd'hui « pas de justification, car l'État est en mesure de lever des ressources fiscales et des emprunts de long terme à moindre coût dans de bonnes conditions de sécurité »23(*).
II. DANS UN CONTEXTE DE TENSIONS CROISSANTES CONCERNANT LA TRAJECTOIRE DE LA DETTE PUBLIQUE, LA DIVERSIFICATION DE SA STRUCTURE DE DÉTENTION DOIT ÊTRE POURSUIVIE, SANS DRAMATISER LES ENJEUX DE SOUVERAINETÉ ET DE RÉSILIENCE FINANCIÈRES ASSOCIÉS
A. ALORS QUE LA MAÎTRISE DE LA TRAJECTOIRE D'ENDETTEMENT DE LA FRANCE REPRÉSENTE UN IMPÉRATIF DE SOUVERAINETÉ ABSOLU, IMPOSER DE NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIÈRE DE DÉTENTION SERAIT CONTRE-PRODUCTIF
1. La souveraineté financière repose essentiellement sur la maîtrise de la trajectoire d'endettement et sur la réduction du poids de la charge d'intérêts
Ainsi que le souligne l'Agence France Trésor, lorsqu'il est question de la dette publique, la souveraineté est avant tout reliée au niveau d'endettement. Par ailleurs, en se tournant vers le panel d'investisseurs le plus large et diversifié possible, la France minimise à la fois le coût et la volatilité des conditions de financement de sa dette. Dès lors, « la meilleure stratégie est donc de ne pas dépendre d'une catégorie d'investisseurs en particulier, quelle qu'elle soit »24(*).
Trajectoire prévisionnelle d'évolution de la dette publique
(en pourcentage du PIB)
Source : présentation du Premier ministre François Bayrou du 15 juillet 2025, d'après le rapport d'avancement annuel pour l'année 2025 pour la trajectoire cible, la Direction générale du Trésor pour la trajectoire à politique inchangée. Chiffres 2025 conventionnels
Comme le relève l'Agence France Trésor25(*), toute déclaration hostile envers la détention étrangère de la dette française pourrait miner la confiance des acteurs non-résidents, entraînant l'attrition de la base d'investisseurs de la France et, in fine, une hausse du coût de la dette qui devra être supporté par le contribuable.
À ce propos, le rapporteur rappelle les perspectives particulièrement alarmantes concernant l'augmentation attendue de la charge de la dette de l'État, qui devrait doubler d'ici la fin de la décennie, pour atteindre la barre de 100 milliards d'euros. Eu égard à ces tensions accrues sur les finances publiques, et alors que le financement du déficit dépend fortement de l'attractivité de la dette française sur les marchés obligataires, il importe effectivement de s'abstenir de toute initiative malencontreuse qui affecterait la confiance des investisseurs, notamment non-résidents.
Trajectoire prévisionnelle
d'évolution de la charge de la dette de l'État
entre
2018 et 2029 (en comptabilité générale)
(en milliards d'euros)
Note : les données indiquées pour les années 2025 à 2029 sont des prévisions.
Source : commission des finances, d'après le rapport sur la dette des administrations publiques annexé au projet de loi de finances pour 2025 et les réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur spécial
Impact sur la charge de la dette d'un choc sur les
taux de 1 %
et d'un choc sur la trajectoire de déficit
de 1 %
(en milliards d'euros)
Note : le choc sur la trajectoire de déficit correspond à une augmentation du déficit de 1 % du PIB par rapport au déficit prévisionnel. Pour les estimations indiquées dans le présent graphique, l'AFT a procédé par hypothèses conventionnelles. Il est ainsi fait l'hypothèse d'un choc sur le niveau du déficit (effet volume) sans impact sur le niveau des taux d'intérêt (effet taux, décomposé entre taux court terme et taux moyen-long terme).
Source : réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur
Dans le contexte des tensions commerciales suscitées par les annonces de nouveaux droits de douane par l'administration américaine, plusieurs observateurs ont évoqué la possibilité pour certains États, en particulier asiatiques, d'utiliser l'instrument de la détention de la dette publique comme moyen de pression voire de coercition économique26(*).
Comme le note l'AFT, « les tensions autour des marchés obligataires surgissent souvent lorsque la confiance s'érode »27(*). Les rumeurs d'utilisation de la détention de la dette comme moyen de pression sur les Etats-Unis ont ainsi émergé dans un contexte géo-économique particulier, après que l'administration américaine a augmenté unilatéralement et de façon arbitraire les droits de douane contre la quasi-totalité des pays du monde. Or il n'y a aucune raison de penser que la France puisse prendre une décision comparable à l'encontre de ses partenaires commerciaux - ne serait-ce que parce que la politique commerciale relève de la compétence de l'Union européenne.
De surcroît, les achats de titres de dette française par les investisseurs étrangers sont motivés par la confiance de ces derniers dans la capacité de l'État à rembourser sa dette. Cette marque de confiance est bâtie sur la solidité des institutions françaises, la qualité de crédit de la France et son engagement à honorer ses contrats vis-à-vis de ses créanciers.
Le caractère peu probable d'une utilisation de la détention de la dette publique comme moyen de pression géopolitique
Un épisode de vente brutale d'obligations souveraines à des fins de pression géopolitique nécessiterait la conjonction de plusieurs conditions :
1. le ou les pays qui en seraient les auteurs doivent pouvoir disposer de ces actifs de réserve en dollar (respectivement en euro) sans porter préjudice à leur économie (et notamment à leur taux de change) ;
2. ces pays doivent être en mesure de coordonner les différents acteurs économiques nationaux qui détiennent ces actifs (banques commerciales, banque centrale, fonds souverain, fonds de pension, assureurs, investisseurs institutionnels, etc.) de sorte que les montants mobilisés constituent une part significative de la dette publique totale du pays visé ;
3. ils doivent être en capacité d'assumer la perte induite par le mouvement de marché significatif qui serait créé et dont ils seraient les premiers perdants (vendant leurs titres à décote). Selon l'économiste Larry Summers, un « équilibre de la terreur financière » empêcherait ainsi la vente brutale de bons du Trésor américain par la Chine, en ce que cette décision nuirait à la fois aux États-Unis et à la Chine ;
4. l'émetteur visé doit être dans une situation de fragilité structurelle de sorte que ne s'exprime aucune demande de substitution, alors même que les titres de dette concernés atteignent des prix inférieurs aux anticipations ;
5. enfin, les pays à l'initiative de la vente doivent pouvoir trouver un actif sûr et extrêmement liquide de substitution pour réallouer les montants très significatifs mobilisés à un coût contrôlé.
Source : commission des finances d'après les réponses de la banque Lazard au questionnaire du rapporteur
Comme le souligne la banque Lazard, la condition relative à la coordination des différents acteurs économiques nationaux « renvoie essentiellement vers la Chine »28(*), or celle-ci déclare une détention de dette française (dette souveraine et privée) par ses acteurs économiques résidents de seulement 17 milliards de dollars à mai 2025, ce qui constitue un montant très faible, de l'ordre de grandeur des ventes mensuelles de la BCE. De surcroît, la France bénéficie de la crédibilité de la BCE et des mécanismes mis en place par cette dernière pour faire face à une crise temporaire (notamment le programme TPI - « Transmission Protection Instrument »).
Dans une récente étude publiée en juin 202529(*), portant sur la détention des dettes publiques des pays de la zone euro par des non-résidents de la zone, la BCE s'est interrogée sur les risques de déstabilisation par des pays qui ne seraient pas « géopolitiquement alignés avec l'Occident », plus particulièrement depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie en février 2022.
Relevant que le taux de détention des dettes publiques des pays de la zone euro par des non-résidents de la zone s'élevait en moyenne à environ 23 % au quatrième trimestre 2024, la BCE observe que la proportion détenue par des non-résidents originaires de pays « non alignés » représentait environ 7 % et que cette part avait légèrement diminué depuis 2022, avec une baisse de 5 %, sans que cette évolution soit statistiquement significative au regard des mouvements observés antérieurement.
Suivant cette analyse, les risques géopolitiques associés à la détention de la dette publique par des non-résidents (notamment des non-résidents de la zone euro) demeurent ainsi en pratique limités.
2. De nouvelles contraintes adoptées de manière unilatérale en matière d'identification ou d'origine géographique des investisseurs affecteraient l'attractivité de la dette française et aboutiraient à une augmentation de son coût pour les finances publiques
En l'état actuel du droit français, l'article L. 228-2 du code de commerce prévoit la faculté, pour toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances négociables « autre que les personnes morales de droit public », d'identifier nominativement les porteurs des titres concernés. Alors que l'application d'un tel dispositif à la gestion de la dette de l'État pourrait paraître de prime abord une piste séduisante pour suivre plus finement la détention de la dette publique30(*), cette solution revêt en pratique des limites techniques et économiques majeures :
- d'une part, la structure de détention des titres à travers des intermédiaires multiples ne permet pas d'identifier systématiquement les investisseurs finaux ;
- d'autre part, en l'absence de coordination à l'échelle internationale, notamment dans le cadre de l'Union européenne (UE), un tel dispositif singulariserait la France au sein des émetteurs souverains, portant atteinte à l'attractivité de sa dette et risquant d'en renchérir le coût. Comme le précise l'AFT, « certains investisseurs, notamment institutionnels et banques centrales, pourraient se détourner des titres français en raison d'atteintes à la confidentialité ».
De fait, la confidentialité des opérations peut revêtir, de manière légitime, une importance particulière pour des investisseurs spécifiques, tels que les banques centrales dans le cadre de la gestion de leurs réserves de changes. Dans l'hypothèse d'une application unilatérale par la France d'un système d'identification des détenteurs de titres de dette publique, ces investisseurs pourraient préférer d'autres émetteurs de la zone euro pour leurs réserves en euro. En effet, un certain nombre d'États membres de l'UE n'ont pas transposé la directive SRD II (pour « Shareholders Rights Directive II »)31(*) - qui constitue le fondement en droit européen de l'article L. 228-2 du code de commerce français - pour tous les instruments financiers, mais uniquement pour les actions de sociétés32(*).
Par ailleurs, selon les informations transmises par Euroclear France33(*), les motifs de mise en oeuvre de la procédure d'identification des porteurs de titres de dette pour le compte d'émetteurs privés correspondent à deux cas principaux, dont la pertinence apparaît limitée pour un émetteur de dette souveraine :
- d'une part, dans le cas d'opérations de gestion d'engagements (« liability management »), telles que la modification des termes et conditions d'obligations avec rachat ou échange, pour lesquelles le consentement des porteurs de titres est généralement nécessaire ;
- d'autre part, dans le cas d'opérations de marketing, notamment de préparation de présentations investisseurs (« roadshows »).
Ainsi, la poursuite du suivi statistique de la détention de la dette de l'État constitue pour les acteurs concernés (notamment l'AFT et les banques spécialistes en valeurs du Trésor - SVT) la solution la plus adéquate pour s'assurer du caractère équilibré de la structure de détention.
Plus fondamentalement, les volumes en jeu sont tels qu'ils empêchent un ou plusieurs investisseurs de déstabiliser le marché par des mouvements brusques. À ce titre, la première protection pour la résilience de la gestion de la dette de la France réside dans la diversification de la base de détenteurs, protection qu'il importe de consolider.
Recommandation n° 1 : Poursuivre les initiatives destinées à favoriser la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État (Agence France Trésor).
En particulier, dans le cadre des relations de l'AFT avec les banques SVT, interlocuteurs privilégiés de l'agence pour sa politique d'émission et de gestion de la dette, il conviendrait de valoriser spécifiquement la contribution de ces établissements à la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs.
Recommandation n° 2 : Valoriser, dans le cadre de la sélection et de l'évaluation des banques spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), la contribution de celles-ci à la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État (Direction générale du Trésor, Agence France Trésor).
En complément, l'extension de la base des détenteurs de titres de dette de l'État à de nouvelles zones géographiques, disposant d'une épargne abondante, pourrait, le cas échéant, être envisagée. Si l'origine géographique des investisseurs dans la dette de la France semble aujourd'hui se concentrer sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est, d'autres régions pourraient faire l'objet d'initiatives déterminées en vue d'améliorer la connaissance et l'attractivité de la signature française.
En effet, les données relatives aux présentations investisseurs réalisées par l'AFT suggèrent une part prédominante d'acteurs originaires des principales zones de pays développés. A l'inverse, certaines régions, présentant des potentiels de financement importants, semblent peu explorées34(*).
Origine géographique des investisseurs
rencontrés par l'AFT
dans le cadre de présentations
dédiées, sur l'année 2024
(en unité)
Source : commission des finances, d'après les réponses de l'AFT au questionnaire du rapporteur
Recommandation n° 3 : Explorer l'opportunité d'étendre la diversification de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État à de nouvelles zones (Direction générale du Trésor, Agence France Trésor).
B. LES ENJEUX DE SOUVERAINETÉ ET DE RÉSILIENCE FINANCIÈRES ASSOCIÉS À LA DÉTENTION DE LA DETTE PUBLIQUE NE DOIVENT NI ÊTRE DRAMATISÉS, NI CONDUIRE À PORTER PRÉJUDICE AU FINANCEMENT PRIVÉ ET À LA STABILITÉ FINANCIÈRE
1. L'orientation de l'épargne domestique vers la détention de la dette publique répond à une finalité davantage politique qu'économique et doit être réservée à des investissements stratégiques clairement déterminés
Selon une idée communément admise, alors que les investisseurs internationaux adopteraient une gestion plus pragmatique, rationnelle, de leurs placements et investissements, selon leurs besoins, stratégies et contraintes, les investisseurs résidents auraient une perception subjective du risque souverain national, perception qualifiée dans la littérature économique et financière de « biais domestique ».
Le biais domestique en matière de choix d'investissements
Certains épargnants préfèrent les placements dans leur propre pays parce qu'ils en ont l'habitude, qu'ils en connaissent mieux les fondamentaux et parce que ces placements leur permettent d'éviter des coûts de transaction.
Ce « biais domestique » subsiste dans tous les pays bien qu'il soit affaibli par l'ouverture internationale des marchés de capitaux -- notamment dans la zone euro du fait de la disparition du risque de change. Il tient pour partie au comportement d'acteurs de petite taille, en particulier les ménages, lorsqu'ils investissent directement ou donnent des instructions à leurs gestionnaires de portefeuille. Les décisions d'investissement des grandes entreprises sont probablement moins déterminées par ce biais domestique.
Source : commission des finances d'après François ECALLE, « Qui détient la dette française ? Anatomie d'un risque géopolitique », Le Grand Continent, septembre 2025
Cependant, divers évènements amènent à penser qu'un tel biais domestique est globalement faible, et que les investisseurs nationaux sont soumis aux mêmes besoins, stratégies et contraintes que les investisseurs internationaux.
L'absence de protection associée à un financement domestique pour la gestion de la dette publique : l'exemple de la crise des gilts britanniques en 2022
Le « mini-budget » annoncé le 23 septembre 2022 par le gouvernement dirigé par Liz Truss a déclenché des tensions sur le marché des obligations d'État (« gilts ») britanniques qui se sont transmises aux fonds de pension utilisant des stratégies dites « liability-driven investment » (LDI).
Les stratégies d'investissement LDI permettent aux fonds de pension d'aligner leurs actifs avec leurs engagements futurs. Ces stratégies se concentrent sur la gestion des risques associés aux engagements plutôt que sur les rendements des actifs. Les fonds LDI utilisent des obligations à long terme (notamment celles indexées sur l'inflation) pour couvrir ces risques. Une part importante des fonds de pension à prestations définies investissent dans des produits LDI.
Après la chute des prix des gilts résultant des annonces budgétaires non financées du gouvernement de Liz Truss, les fonds de pension concernés ont dû rapidement trouver des liquidités pour répondre aux exigences de la réglementation en vigueur en matière d'appels de marge. De nombreux fonds ont rencontré des difficultés à réunir ces liquidités en temps voulu, forçant la vente de titres à perte et exacerbant la chute des prix des gilts.
Source : commission des finances d'après les réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur
S'agissant des exemples japonais et italien, les services du ministère de l'économie et des finances ont souligné le caractère davantage subi que choisi du haut niveau de détention de la dette publique de ces pays par des investisseurs résidents.
Les facteurs explicatifs du niveau élevé de détention des dettes publiques japonaise et italienne par des investisseurs résidents
La dette publique japonaise
Près de 90% de la dette publique japonaise est détenue par des institutions financières domestiques, dont la Banque centrale du Japon (Bank of Japan). Cette part élevée est avant tout le résultat d'une situation économique très particulière :
- une politique monétaire ultra-accommodante se traduisant par des taux d'intérêt extrêmement bas, voire négatifs, et un assouplissement quantitatif reposant sur l'achat d'obligations d'Etat, impliquant ainsi la baisse de leurs taux de rendement. Ces achats de titres de dette par la Bank of Japan, qualifiés de « monétisation », font augmenter mécaniquement la part des résidents détenant la dette publique japonaise, en particulier la part de la banque centrale (environ 600 000 milliards de yens sur un total de la dette publique de 1 100 000 milliards de yens) ;
- ces rendements historiquement très bas combinés à un coût de couverture contre le risque de change très élevé, en raison de la forte volatilité du yen face au dollar et à l'euro, ont significativement pesé sur l'attractivité des obligations souveraines japonaises auprès des investisseurs internationaux, qui se sont ainsi détournés de ces titres.
La dette publique italienne
La dette publique italienne est détenue à environ 70 % par des investisseurs domestiques. Cette proportion s'explique essentiellement par deux facteurs :
- d'une part, la dégradation depuis 2012 de la signature italienne sur les marchés de capitaux internationaux. En effet, la part de la dette italienne détenue par des résidents a nettement progressé en 2012, atteignant en moyenne 63 % sur l'année (après 55 % en 2011), résultat d'une défiance envers la signature italienne. Depuis, la part des résidents reste à un niveau élevé. En réponse, le Trésor italien a conçu des instruments spécifiquement destinés aux ménages : lancement en mars 2012 du BTP Italia (obligation d'une maturité comprise entre 4 ans et 5 ans, indexée sur l'inflation nationale), puis en 2020 du BTP Futura (maturité de 10 ans) et en juin 2023 du BTP Valore (maturité de 4 ans) ;
- d'autre part, l'absence en Italie d'instruments d'épargne compétitifs et à disposition des ménages. En France, les instruments d'épargne destinés aux ménages similaires aux titres obligataires proposés par les États sont uniques dans leurs genres en zone euro. Le produit d'épargne italien qui se rapproche le plus du Livret A français est le Libretto di risparmio postale. À l'image de son équivalent français, les dépôts sur ce livret postal sont garantis par l'État italien et servent notamment à financer des investissements publics. Ses intérêts sont cependant fiscalisés, ce qui limite son attractivité.
Source : commission des finances d'après les réponses de la Direction générale du Trésor et de la banque Citigroup aux questionnaires du rapporteur
À cet égard, Dorothée Rouzet, cheffe économiste de la Direction générale du Trésor, observe que, depuis 2024, la hausse du crédit de l'Italie (absolu et relatif) et la baisse de son écart de taux (spread) avec l'Allemagne se sont accompagnées d'une internationalisation accrue de sa dette publique. Ainsi, la part des investisseurs non-résidents a progressé de 4 points entre octobre 2022 et mars 2025, ce qui confirme que la proportion élevée d'investisseurs résidents résulte d'« une situation subie et non d'un choix stratégique »35(*). De même, la banque Lazard estime que cette évolution illustre « les limites de la capacité d'absorption des acteurs résidents (et notamment des particuliers) »36(*).
De fait, les structures de détention des dettes publiques japonaise et italienne, marquées par une proportion prédominante d'investisseurs résidents, présentent des limites importantes :
- en premier lieu, des niveaux d'endettement public qui demeurent très élevés. Ainsi que le relève la banque Citigroup à propos du Japon, « bien que les taux d'intérêt soient maintenus à un niveau bas, la dette élevée et les besoins de financement futurs pourraient exercer une pression à la hausse sur les taux, ce qui pourrait rendre le remboursement de la dette plus coûteux »37(*) ;
- en deuxième lieu, un contexte macroéconomique très spécifique dans le cas japonais, avec une déflation durable qui a conduit la banque centrale à acheter des titres de dette publique à des fins d'assouplissement monétaire (et non directement en soutien aux déficits publics). À cet égard, la banque Lazard note que « le retour de tensions inflationnistes, inédites dans les trois dernières décennies, au Japon pourrait induire une diminution de la politique de Quantitative Easing [assouplissement quantitatif] menée par la Bank of Japan et démontre les limites d'un recours massif à cet instrument pour l'absorption des titres de dette publique »38(*) ;
- en troisième lieu, une absence de protection absolue contre la volatilité. Ainsi, les récentes tensions sur les titres obligataires japonais de long terme se sont traduites par une augmentation du rendement des obligations à 40 ans, de 2,7 % au 1er avril 2025, à un niveau record, de 3,7 % le 21 mai, avant de se stabiliser autour de 3,1 % à compter du 28 mai. De même, en Italie, le recours accru aux ménages expose l'État à une irrégularité de la demande, dans la mesure où ce type d'investisseurs est très sensible au niveau des taux de rendement et dispose de volumes limités à placer39(*) ;
- en quatrième lieu, un coût élevé pour les finances publiques, du fait des avantages - notamment fiscaux - accordés aux titres destinés aux investisseurs particuliers. Dans le cas italien, en plus de l'indexation sur l'inflation nationale, le souscripteur bénéficie d'une absence de commissions ou de frais prélevés sur les achats effectués pendant les jours de placement ainsi que d'une fiscalité préférentielle sur les revenus du capital de 12,5 % et de l'exonération des droits de succession. Par ailleurs, le BTP Valore offre une prime finale supplémentaire (« prime de fidélité ») aux particuliers qui l'achètent pendant la période de placement et le conservent jusqu'à l'échéance (cette prime varie d'une émission à l'autre, allant de 0,5 % à 0,8 % du montant nominal acheté). Comme le relève la banque Lazard40(*), ces dispositions spécifiques n'ont ainsi « pas particulièrement permis de diminuer [le] coût » de la dette publique, tout en faisant porter à l'État italien le risque d'inflation ;
- en cinquième et dernier lieu, des effets négatifs sur l'investissement productif privé (cas du Japon) et sur la stabilité financière. Ainsi, pour la banque Citigroup, la forte détention de la dette publique par des banques domestiques en Italie (22 %), et dans une moindre mesure en Espagne (19 %)41(*), est « de nature à pouvoir engendrer des risques supplémentaires pour [la] stabilité financière »42(*), à travers une boucle (« nexus ») entre risque souverain et risque bancaire.
Pour autant, la mobilisation de l'épargne domestique dans le cadre d'un programme de financement orienté vers des investissements stratégiques prioritaires peut tout à fait se concevoir, mais pour des masses financières plus limitées.
Ainsi que le souligne le cabinet de conseil souverain Global Sovereign Advisory, l'intérêt d'un « grand emprunt national » est de « capter directement les ressources des citoyens et des entreprises nationales, créant une dynamique de solidarité nationale visible, dans une logique de "financement référendaire" »43(*).
Par ce mode de financement, il s'agit pour les pouvoirs publics d'envoyer un « signal de confiance » dans le cas où cette forme d'appel public à l'épargne serait rapidement souscrite. Néanmoins, il existe également un risque de signal très négatif dans le cas où ce « grand emprunt national » ne réaliserait pas une bonne performance, faisant apparaître de la défiance.
Recommandation n° 4 : Réserver les actions de mobilisation de l'épargne des résidents, telles que celles du type « grand emprunt national », à des programmes de financement spécifiques, fléchés vers des investissements publics stratégiques précisément définis (Direction générale du Trésor, Agence France Trésor).
2. Plus globalement, le poids des investisseurs non-résidents dans le financement de l'économie française constitue un défi majeur, qui ne peut être traité par des mesures ponctuelles mais qui renvoie à la problématique de la compétitivité industrielle
Comme l'ont relevé la majorité des acteurs interrogés par le rapporteur, le faible recours à l'épargne domestique constitue, d'un point de vue économique, plutôt une opportunité. Ainsi que le souligne la banque Lazard, l'épargne domestique est « plus disponible pour le financement de l'économie réelle hors secteur public (marché action, marché obligataire privé, etc.) »44(*).
De fait, une réorientation de l'épargne vers la dette publique pourrait être compensée, sur les marchés d'actifs privés (notamment les actions et obligations d'entreprises), par une augmentation de la détention de ces actifs par des non-résidents.
Or un tel accroissement de la détention d'actifs privés par des non-résidents présenterait autant, voire davantage, de difficultés au plan de la souveraineté économique, dans la mesure où la détention d'actifs tels que des actions offre plus de droits - et plus de pouvoir de marché - que celle de titres de dette publique liquides.
À cet égard, la banque Barclays met en avant le caractère contradictoire du signal qui serait envoyé dans l'hypothèse d'une mobilisation massive de l'épargne domestique vers la dette publique : « inciter les ménages français à acheter plus de dette française couterait beaucoup plus cher à l'État que le système d'adjudication et aurait évidemment des effets d'éviction (Livret A, Assurance Vie) mais aussi sur les marchés actions alors qu'au même moment les rapports Dragui, Letta, Noyer insistent sur le fait que nous manquons en France et en Europe d'investisseurs actions de long terme et que les starts up doivent se tourner vers les Etats-Unis. »45(*)
Plus fondamentalement, dans une récente note, François Écalle rappelle l'importance de restaurer la compétitivité de l'économie française afin de réduire la dépendance globale de celle-ci à l'égard des investisseurs non-résidents, laquelle se traduit par une position extérieure nette vis-à-vis du reste du monde largement négative : « si les incitations financières et fiscales ou les contraintes réglementaires peuvent modifier significativement la répartition de l'épargne des ménages entre les placements possibles, elles ont peu d'impact sur son montant global. (...) Du fait de l'accumulation [des] déficits de nos échanges extérieurs, nos passifs vis-à-vis du reste du monde sont supérieurs à nos actifs. La position extérieure nette de la France vis-à-vis du reste du monde (actifs moins passifs) est négative (- 28 % du PIB) alors que celle des principaux pays de l'Union européenne est souvent positive (+ 63 % du PIB pour l'Allemagne et + 14 % pour l'Italie). » 46(*)
Dès lors, « la France étant globalement dépendante des financements extérieurs, rendre l'État moins dépendant des non-résidents en rendant les entreprises plus dépendantes de ceux-ci n'aurait pas beaucoup d'intérêt. La priorité est de rééquilibrer nos échanges extérieurs en renforçant la compétitivité des entreprises françaises. »47(*)
Position extérieure nette des principales
économies européennes,
à la fin de l'année
2024
(en pourcentage du PIB)
Source : François ECALLE, « Qui détient la dette française ? Anatomie d'un risque géopolitique », Le Grand Continent, septembre 2025, d'après la Commission européenne
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 24 septembre 2025 sous la présidence de M. Pascal Savoldelli, vice-président, la commission a entendu une communication de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial, sur les enjeux associés à la structure de détention de la dette de l'État.
M. Pascal Savoldelli, président. - Nous entendons la communication de notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'État », sur la structure de détention de la dette de l'État.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial. - Pendant des années, la question de la dette n'intéressait personne. Lorsque j'occupais les fonctions de rapporteur général de la commission des finances, je disais toujours que nous n'étions pas à l'abri d'un accident, à l'instar d'un choc pétrolier, d'un krach boursier - je n'avais pas prévu la crise sanitaire. Nous avons connu une période délirante avant la covid : nous empruntions à taux zéro, voire à taux négatif. Bruno Le Maire, qui donnait des leçons dans la presse, nous expliquait que nous étions des imbéciles de ne pas nous endetter, puisque plus on le faisait, moins le coût pour les finances publiques était important. Paradoxalement, la charge de la dette diminuait alors que l'on s'endettait davantage. Aujourd'hui, la fête est finie : la dette occupe une place importante dans le débat public.
En tant que rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'État », j'ai souhaité mener cette année un contrôle budgétaire sur les enjeux associés à la structure de détention de la dette de l'État : en clair, qui détient la dette ? Le sujet suscite de vives discussions dans les sphères politiques et économiques, notamment sur le poids des investisseurs internationaux.
Le rapport que je vous présente aujourd'hui résulte d'échanges approfondis avec des interlocuteurs représentant les différents acteurs de la gestion de la dette publique et des marchés financiers : les services du ministère de l'économie et des finances - en particulier l'Agence France Trésor (AFT) -, la Banque de France, des banques-conseils et des banques spécialistes en valeurs du Trésor, chargées de placer la dette française. De même, mes travaux m'ont conduit à auditionner, dans une perspective internationale et comparée, des institutions étrangères, à savoir la Banque d'Angleterre, le Debt Management Office britannique et l'International Capital Market Association.
Je commencerai par une présentation générale de la structure de détention de la dette de la France, avant de mettre en évidence les principaux enjeux soulevés par le mode de financement de notre endettement.
À cet égard, je tiens à clarifier un point de méthode, car il est difficile de savoir qui détient la dette française : les titres de dette de l'État sont des titres de créances négociables qui s'échangent librement sur les marchés financiers. L'AFT se charge de l'émission primaire : par construction, nous savons donc qui achète les titres émis par l'Agence. Mais ceux-ci peuvent ensuite être échangés sur le marché secondaire : dès lors, l'État n'est pas en mesure de connaître à tout instant les investisseurs dans sa dette. Néanmoins, il peut s'appuyer sur deux enquêtes statistiques récurrentes, menées respectivement par la Banque de France et par le Fonds monétaire international (FMI).
Suivant cette approche, plusieurs types d'acteurs financiers peuvent être identifiés au sein de la structure de détention de la dette de la France. Ainsi, selon les données de la Banque de France, au premier trimestre 2025, cette dernière se décomposait entre : des investisseurs non-résidents - comprenant pour moitié des investisseurs de la zone euro et pour moitié des investisseurs hors zone euro -, pour 54,7 % ; des compagnies d'assurance françaises, pour 9,8 % ; des établissements de crédit français, également pour 9,8 % ; des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français, pour 1,7 % ; enfin, d'autres investisseurs français, essentiellement la Banque de France pour le compte de la Banque centrale européenne (BCE), pour 24,4 %.
De fait, la détention de la dette publique par des investisseurs non-résidents a fortement augmenté au cours de la décennie 2000-2010.
Entre 1996 et mi-1998, les non-résidents détenaient moins de 30 % de la dette des administrations centrales. Cette part a ensuite augmenté régulièrement jusqu'à un pic de 66,4 % en 2009, avant de connaître une baisse à partir de 2015 sous l'effet du programme d'achat de titres publics de l'Eurosystème, pour atteindre un creux à 47,5 % fin 2021. Depuis lors, la détention par les non-résidents augmente de nouveau progressivement pour atteindre 56 % aujourd'hui.
Est-ce bon ou mauvais signe ? Mes interlocuteurs me l'ont tous confirmé : la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette française reflète l'attractivité de la signature de la France. Notre pays est le premier émetteur de titres de dette de la zone euro. Il représente également le premier marché pour la dette secondaire ; or les investisseurs institutionnels sont heureux de pouvoir revendre leurs titres.
Attirer des investisseurs étrangers permet d'élargir la base de financement, de ne pas dépendre uniquement des investisseurs nationaux et, plus concrètement, de baisser les taux à l'émission et par conséquent la charge d'intérêt de la dette.
De fait, si la souveraineté financière repose avant tout sur la maîtrise de la trajectoire d'endettement, la meilleure stratégie pour la gestion de la dette publique consiste à ne pas dépendre d'une catégorie d'investisseurs en particulier, quelle qu'elle soit.
Dans ce contexte, imposer de nouvelles contraintes en matière de détention de la dette serait largement contre-productif.
Ainsi, alors que l'application d'un dispositif d'identification des détenteurs de titres pour la gestion de la dette de l'État pourrait paraître une piste intéressante de prime abord, cette solution revêt en pratique des limites techniques et économiques rédhibitoires. D'une part, la structure de détention des titres au travers d'intermédiaires multiples ne permet pas d'identifier systématiquement les investisseurs finaux. D'autre part, en l'absence de coordination à l'échelle internationale, notamment dans le cadre européen, un tel dispositif singulariserait la France au sein des émetteurs souverains, portant atteinte à l'attractivité de sa dette et risquant d'en renchérir le coût.
Plus généralement, l'Agence France Trésor indique qu'il convient d'éviter toute déclaration hostile à l'égard des investisseurs étrangers, à l'heure de l'hypersensibilité des taux : avec 3 400 milliards d'euros de dette, une évolution des taux de 0,1 % représente une charge supplémentaire à terme de 3,4 milliards d'euros. Toute augmentation du spread a des conséquences rapides : voilà 15 jours, notre pays a subi une hausse de 0,2 % des taux auxquels il emprunte, soit un coût à terme d'un peu moins de 7 milliards d'euros. La confiance des acteurs non-résidents est primordiale : la réduction de la base d'investisseurs se traduirait par une augmentation du coût de la dette.
À ce titre, je tiens à rappeler les perspectives particulièrement dégradées concernant la trajectoire prévisionnelle de la charge de la dette de l'État.
En 2019, avant la crise sanitaire, la charge de la dette représentait environ 30 milliards d'euros, à comparer aux recettes nettes de l'État après dégrèvements, qui s'élèvent à 300 milliards d'euros. Or elle devrait doubler d'ici à la fin de la décennie et franchirait la barre des 100 milliards d'euros : le tiers de nos recettes fiscales y serait affecté, si la tendance actuelle se poursuit.
Dans ce contexte, nous devons tenir compte de l'hypersensibilité des investisseurs. Qu'un ministre de l'économie et des finances soutienne que notre pays sera mis sous tutelle du FMI - alors même que la majorité à laquelle il appartient a contribué à aggraver la dette - est irresponsable. Il est impératif de s'abstenir de toute initiative malencontreuse qui affecterait la confiance des investisseurs, notamment non-résidents.
Le cas échéant, pourrions-nous nous tourner vers les investisseurs nationaux ? Contrairement à une idée communément admise, ces derniers sont globalement soumis aux mêmes besoins, stratégies et contraintes que les investisseurs internationaux ; ils sont aussi sensibles au risque souverain national. Ainsi de la dette du Royaume-Uni, détenue essentiellement par des acteurs domestiques. Durant l'automne 2022, l'annonce du « mini-budget » par le gouvernement de Liz Truss avait provoqué une crise : les taux d'emprunt avaient atteint des niveaux très élevés. Ceux de l'Italie se sont élevés jusqu'à 7 % : impossible d'emprunter à de tels sommets.
Plusieurs interlocuteurs bancaires nous ont indiqué qu'avec de tels niveaux d'endettement, comme la France en connaît actuellement, une étincelle est susceptible de provoquer une hausse des taux. Une action concertée de fonds spéculatifs me semble peu probable, au vu des montants nécessaires pour attaquer la France. En revanche, des déclarations malencontreuses, des erreurs stratégiques, sont susceptibles de conduire au même scénario que celui qui s'est déroulé au Royaume-Uni.
Plus globalement, le faible recours à l'épargne domestique constitue plutôt une circonstance opportune d'un point de vue économique. Le niveau de l'épargne disponible en France est important. Celle-ci pourrait-elle être utilisée pour financer la dette publique ? Sans doute, mais prenons garde à ne pas favoriser l'érosion des ressources financières des entreprises. Un grand emprunt national est envisageable, à condition que celui-ci soit limité en volume. En outre, il faudrait offrir des perspectives aux Français acceptant de prêter de l'argent à l'État : seul un emprunt destiné à des investissements publics stratégiques clairement identifiés serait envisageable.
Aussi, dans le cadre restreint de la gestion de la dette publique, il importe de poursuivre les initiatives destinées à favoriser la diversification de la typologie et de l'origine des investisseurs en dette de l'État. Quant aux actions de mobilisation de l'épargne des résidents, telles que celles du type « grand emprunt national », il convient de les réserver à des programmes de financement spécifiques, fléchés vers des investissements publics stratégiques précisément définis.
Dans un contexte de tensions croissantes concernant la trajectoire de la dette publique, la diversification de la base des détenteurs constitue assurément une protection importante, mais non absolue. Notre situation dégradée en matière de finances publiques est désormais scrutée avec attention par nos créanciers. Seule la maîtrise de notre endettement nous permettra de garantir notre souveraineté financière.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Jusqu'au début des années 2000, les investisseurs nationaux possédaient deux tiers de notre dette, contre moins de la moitié aujourd'hui. Serait-il possible de définir une stratégie préférentielle afin de favoriser la part des investisseurs nationaux ? Serait-ce pertinent ?
Nous faisons face à un double problème : l'instabilité gouvernementale et le poids exponentiel de la charge de la dette, qui pourrait s'élever à plus de 100 milliards d'euros par an en 2029, soit près d'un doublement par rapport à aujourd'hui. C'est très préoccupant.
Quelles conclusions doit-on en tirer, notamment à l'approche de l'examen du prochain projet de loi de finances (PLF) ? Nous devons dire la vérité aux Français et présenter des solutions pour améliorer les choses, sans pour autant les plonger dans l'inquiétude. Monsieur le rapporteur spécial, avez-vous des propositions à formuler en la matière ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial. - Permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur la question de l'origine géographique des détenteurs de la dette et sur le débat entre dette domestique et dette internationale.
La forte diversification des investisseurs détenant des titres de notre dette nous a permis de nous financer à moindre coût durant des années, et ce en vertu d'une loi fort simple à comprendre, celle de l'offre et de la demande. À l'inverse, je ne suis pas certain que nous obtiendrions les mêmes résultats si nous avions une dette 100 % souveraine : l'exemple britannique prouve que nous nous financerions probablement à un coût plus élevé.
L'exemple du Royaume-Uni depuis 2022 montre également que l'augmentation de la part des résidents dans la détention de la dette ne constituerait pas une garantie ou une protection contre le risque de crise de notre dette souveraine...
Quoi qu'il en soit, je souscris aux propos de Jean-François Husson : l'enjeu est avant tout celui de la confiance envers notre capacité à régler, à terme, plus de 100 milliards d'euros d'intérêts chaque année. Il s'agit donc d'un enjeu de soutenabilité budgétaire. Pour rendre la charge de notre dette soutenable, il faut prioritairement que l'État fasse davantage d'efforts : rappelons que 81,4 % de notre endettement public correspond à la dette de l'État, qui résulte essentiellement de l'accumulation des déficits primaires de celui-ci.
M. Pascal Savoldelli, président. - Au 31 août 2025, la durée de vie moyenne de la dette négociable s'élevait à huit ans et cent soixante-dix-huit jours. Il s'agit là de l'une des clés de la soutenabilité de notre dette : plus cette durée sera longue, plus la France sera protégée contre la hausse des taux d'intérêt.
Comment faire en sorte d'allonger la durée de vie de notre dette publique ?
M. Michel Canévet. - Je remercie le rapporteur spécial pour son éclairage. Je suis particulièrement intéressé par sa recommandation n° 3, par laquelle il nous invite à étendre la diversification de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État à de nouvelles zones.
Ces dernières semaines, on a entendu de nombreux responsables politiques affirmer qu'en définitive notre pays pouvait continuer à s'endetter, notamment dès lors que notre dette serait acquise dans des proportions plus importantes par des investisseurs nationaux, à l'image de la situation du Japon. Qu'en pense le rapporteur spécial ? L'enjeu est-il vraiment aujourd'hui de faire en sorte de réorienter la détention de notre dette publique vers des acteurs nationaux ?
Par ailleurs, la trajectoire prévisionnelle d'évolution de la charge des intérêts de la dette de l'État me semble particulièrement préoccupante - il est tout de même question de près de 100 milliards d'euros en 2029 ! Qu'en serait-il si cette trajectoire n'était pas respectée ? Le risque existe-t-il que les économies budgétaires prévues soient moins élevées que celles qui sont envisagées, affectant la trajectoire de la dette et donc celle de la charge d'intérêts ?
M. Vincent Delahaye. - Je remercie le rapporteur spécial de s'intéresser à un sujet sur lequel la transparence n'est, hélas, pas suffisamment de mise. Il serait souhaitable que nous en sachions davantage sur les détenteurs de notre dette : on en sait finalement très peu sur l'identité des non-résidents détenteurs de titres de la dette française.
On nous oppose aujourd'hui qu'il ne serait pas possible de connaître à un instant t l'origine de ces investisseurs, en raison des fluctuations permanentes des flux financiers. Ne serait-il pas envisageable que, par la loi, nous obligions le Gouvernement à établir un état des lieux annuel des détenteurs de notre dette ?
Mme Nathalie Goulet. - J'ai eu l'honneur et le privilège d'exercer, trois années durant, la fonction de rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'État ». Aussi, je peux vous assurer que je m'interroge moi aussi sur l'identité des détenteurs de la dette française.
À contre-courant de l'enthousiasme général qui a accompagné durant des années le constat du faible niveau des taux d'intérêt, notre commission a toujours mis en garde contre une possible remontée de ceux-ci : la catastrophe est là, un constat qui pose avec d'autant plus d'acuité la question de l'identité des investisseurs non-résidents. À mon époque, on m'avait opposé le secret fiscal, voire le secret-défense. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'obtenir enfin des réponses à la fois au titre de la transparence et au nom de notre souveraineté.
M. Thierry Cozic. - La charge d'intérêts s'élève actuellement à près de 60 milliards d'euros, soit presque l'équivalent du budget du ministère de l'éducation nationale. Plus de la moitié de la dette française est par ailleurs détenue par des non-résidents : quelles sont les options pour réduire la dépendance de la France vis-à-vis de nos créanciers étrangers ?
Dans un contexte géopolitique difficile, l'identité de nos créanciers me semble être une question d'intérêt général. Serait-il envisageable de publier régulièrement des données plus détaillées sur la répartition géographique et sectorielle des détenteurs de notre dette ?
Enfin, n'est-il pas temps de discuter d'une restructuration partielle de cette dette, comme un certain nombre d'États l'ont déjà fait, ou d'envisager un audit citoyen qui permettrait de distinguer la part légitime de la dette de sa part illégitime, c'est-à-dire de celle qu'a contractée l'État pour servir des intérêts privés, et non ceux de nos concitoyens ?
M. Pierre Barros. - Le financement de l'État n'a pas toujours dépendu des marchés financiers. Pendant des décennies, la France a disposé d'un système original, celui du circuit du Trésor, qui reposait sur trois piliers : la centralisation des dépôts des banques et des entreprises publiques sur un compte unique des dépôts à vue du Trésor ; l'obligation pour les établissements de crédit de détenir une part de leurs ressources en bons du Trésor ; enfin, des taux fixés administrativement.
Ce modèle, qui a disparu dans les années 1980, permettait à l'État de se financer de manière autonome et à faible coût : près de 80 % des financements de l'État étaient couverts par ce circuit domestique.
Aujourd'hui, il existe des pistes, non pas d'un retour à ce système, mais d'un éloignement vis-à-vis d'une trop importante financiarisation de notre dette via les marchés obligataires.
Nous soutenons pour notre part la création d'un pôle bancaire public, seul susceptible de garantir à l'État un financement stable et maîtrisé. Le débat, qui a eu lieu ici même à plusieurs reprises, n'est pas épuisé, et ce d'autant moins que le montant de la charge de la dette continue de s'envoler.
Doit-on continuer à considérer que notre souveraineté budgétaire se joue désormais uniquement sur les marchés financiers ou est-il imaginable que l'État puisse disposer de solutions lui apportant davantage d'autonomie ?
Mme Florence Blatrix Contat. - Monsieur le rapporteur spécial, je tiens à vous remercier pour cette présentation détaillée.
Ma première question porte sur la détention de notre dette par des investisseurs non-résidents : pensez-vous que celle-ci soit à son pic ou estimez-vous que cette part d'environ 55 % de créanciers étrangers puisse encore augmenter dans les cinq ans à venir ?
Autre question : en France, on débat beaucoup en ce moment de la dette publique, et on parle nettement moins de dette privée, certainement parce que, dans notre pays, les dépenses d'éducation sont prises en charge par l'État, et que la santé et la protection sociale y sont mutualisées. Existe-t-il, selon vous, une corrélation entre le niveau de la dette publique et celui de la dette privée ? L'épargne privée, qui n'a jamais été aussi élevée en France, ne devrait-elle pas être davantage mise à contribution pour financer nos investissements publics ? La recommandation n° 4 prévoit la possibilité de mettre en oeuvre des actions de mobilisation de l'épargne des résidents dans certaines circonstances, pour financer des investissements publics stratégiques précisément définis : à quel niveau devrait-on fixer cet effort et de quel montant pourrait être un éventuel grand emprunt national ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial. - Comme l'évoquait Pascal Savoldelli, nous observons effectivement un allongement de la durée de vie moyenne de notre dette, laquelle s'élève à environ huit ans aujourd'hui contre six ans il y encore peu. Est-ce pour autant une bonne nouvelle ? Allonger davantage la maturité moyenne de notre dette serait-il une solution ? Je ne le pense pas : aujourd'hui, le Royaume-Uni emprunte à des taux plus élevés que la France, alors même que la maturité de sa dette est plus importante. Il n'y a pas de solution miracle : si nous allongeons notre dette, nous paierons plus cher.
Michel Canévet a cité un exemple intéressant, celui de la dette japonaise. Or la situation du Japon n'est pas comparable à la nôtre : l'endettement public y est certes très élevé, mais il est essentiellement d'origine domestique ; de plus, ce pays a le yen et fonctionne en circuit fermé, ce qui n'est pas le cas de la France dont l'exposition internationale, via l'Eurosystème, est sans commune mesure.
Plusieurs d'entre vous m'ont demandé quelles étaient les options envisageables pour réduire notre dépendance vis-à-vis des créanciers étrangers, en évoquant notamment les possibilités offertes par le niveau très élevé de l'épargne nationale, de l'ordre de 6 000 milliards d'euros, la possible hausse de la part des résidents parmi les détenteurs de titres, ou encore l'éventualité d'un grand emprunt.
Selon moi, le fort taux d'épargne que l'on constate dans notre pays ne représente absolument pas une piste crédible pour prévenir une possible crise de la dette. En effet, une réorientation de l'épargne nationale vers la dette publique pourrait être compensée par une détention accrue des actifs privés - actions ou obligations d'entreprises - par des investisseurs non-résidents, ce qui d'un point de vue de souveraineté économique poserait autant, si ce n'est plus, de difficultés. Ce qui importe en matière de gestion de la dette publique, c'est que la charge de la dette continue d'être soutenable. Or, comme le souligne l'Agence France Trésor, l'internationalisation du placement de la dette est un facteur d'élargissement de la demande et donc de baisse du taux à l'émission.
À la question du niveau souhaitable d'un grand emprunt national, je répondrai indirectement en rappelant que, d'ici à deux ans, notre besoin de financement annuel sera considérable, puisqu'il pourrait atteindre entre 350 milliards et 400 milliards d'euros, entre le financement du déficit - qui sera notamment alourdi par l'augmentation du niveau de la charge d'intérêts - et le refinancement de la dette arrivant à échéance. Le sujet d'un grand emprunt national n'est pas tabou, mais d'une part le volume nécessairement limité d'un tel emprunt ne saurait suffire pour financer notre besoin de financement annuel, et d'autre part il conviendrait d'orienter cet éventuel emprunt vers des investissements publics stratégiques, afin de créer une dynamique de solidarité nationale visible qui serait tournée vers le financement des priorités du futur. Autrement, dans le contexte de défiance actuelle concernant l'état de nos finances publiques, je doute fortement que nos concitoyens prennent le risque d'investir leur épargne pour simplement financer nos déficits chroniques.
S'agissant de l'identité des détenteurs de la dette de l'État, la difficulté qu'il y a à la connaître précisément tient à ce qu'une large part des titres s'échangent sur le marché secondaire, qui est beaucoup moins traçable que ne l'est le marché primaire.
Voici quelques éléments de réponse figurant dans le rapport, à partir des enquêtes statistiques de la Banque de France et du FMI : parmi les 54,7 % d'investisseurs non-résidents, on estime à environ 20 % la part des banques centrales et des fonds souverains étrangers et à 30 % la part des autres institutions financières, comme les gestionnaires d'actifs et les fonds de pension. Pour ce qui est des 45,3 % d'investisseurs nationaux, on distingue les compagnies d'assurance françaises, pour 9,8 %, les établissements de crédit français, également pour 9,8 %, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français, pour 1,7 % et, enfin, d'autres investisseurs français, essentiellement la Banque de France pour le compte de la BCE, pour 24,4 %.
J'ai rappelé l'importance de notre besoin de financement annuel, qui ne saurait être résolu en opposant détention de la dette par des investisseurs français et détention de la dette par des investisseurs non-résidents : compte tenu de ce besoin récurrent, nous sommes obligés de faire appel au marché international. L'exemple britannique montre que le caractère domestique de la dette ne permet pas forcément d'en réduire le coût.
Par ailleurs, nous pourrions débattre du financement de nos déficits par d'autres modes, tels qu'un grand emprunt national. Cependant, comme je l'ai déjà dit, il conviendrait alors d'y associer des perspectives pour les Français, telles que le renouvellement d'infrastructures routières ou ferroviaires. S'il ne s'agit que de remplir le grand puits de la dette, je ne suis en effet pas convaincu qu'ils souscriraient, sauf à recréer un emprunt obligatoire, c'est-à-dire un impôt, à l'instar de l'emprunt sécheresse.
Le circuit du Trésor, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était un système de financement de la dette publique fonctionnant par la contrainte. En effet, il imposait aux institutions de déposer leur trésorerie auprès de la Banque de France, avec des émissions forcées de bons du Trésor.
Ce système de souscription forcée a été remplacé par un appel croissant au marché à partir de la fin des années 1960 et, dans les années 1980, par la création d'un véritable marché obligataire. Ainsi, pendant des années, la France a payé sa dette à des taux anormalement bas, parfois égaux à zéro. Or, aujourd'hui, les montants comme les taux sont élevés.
M. Vincent Delahaye. - Ne devrions-nous pas légiférer afin de connaître annuellement l'état de la détention de la dette française ? Quant aux détails sur le marché secondaire, ne pourrions-nous pas interroger les établissements porteurs ?
M. Thierry Cozic. - Quid de la restructuration ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial. - Sur le marché secondaire, rien n'oblige, par exemple, les fonds souverains de la Norvège ou de Singapour à répondre à une telle demande. Le rapport précise que les motifs de mise en oeuvre de la procédure d'identification existante pour les porteurs de titres de dette d'émetteurs privés - essentiellement les obligations d'entreprises - correspondent à deux cas principaux, dont la pertinence apparaît limitée pour un émetteur souverain : d'une part, des opérations de gestion d'engagements, telles que la modification des termes et conditions d'obligations avec rachat ou échange, pour lesquelles le consentement des porteurs de titres est généralement nécessaire ; d'autre part, des opérations de marketing, notamment de préparation de présentations investisseurs.
En outre, la dette est négociable : par exemple, un fonds de pension de policiers du Texas qui consent à déclarer sa détention de dette française pourrait très bien ne plus en posséder la semaine suivante... Ainsi, ce qui est faisable sur le marché primaire de la dette est bien plus complexe pour le marché secondaire.
Quant à la restructuration, de quoi parlons-nous ? Les pays ayant fait l'objet d'une restructuration ont été mis sous tutelle, avec des mesures en recettes - lutte contre l'évasion fiscale, hausse de la TVA, etc. - et en dépenses - arrêt des subventions sur les produits alimentaires - parfois assez violentes. Il existe également des mesures de restructuration comme les abandons et les allongements, mais nous n'en sommes pas là.
Ainsi, si un pays comme la France demandait à être restructuré, je ne suis pas certain que les taux resteraient bas... Je considère donc que les propos des ministres chargés des finances et des comptes publics sont parfois irresponsables, car ils suscitent une augmentation des taux. Je rappelle que 0,1 % de 3 400 milliards d'euros représente tout de même 3,4 milliards d'euros : la charge de la dette peut donc augmenter très vite. Avant de demander une restructuration, il convient de considérer l'hypersensibilité de notre endettement, très élevé, à toute hausse de taux.
J'ai conscience de l'aspect technique du rapport et des limites de l'exercice. L'ambition n'est autre que de mieux connaître les opportunités, les contraintes et les risques associés aux différents types de détenteurs de notre dette.
M. Pascal Savoldelli, président. - Nous devons voter sur quatre recommandations.
La première, prudente, vise à poursuivre la diversification de la typologie des investisseurs et de leur origine géographique. Quant à la dernière, elle me semble intéressante, même si, malheureusement pour M. le rapporteur spécial, elle est plutôt keynésienne... Il est intéressant de mobiliser l'épargne des résidents sur des programmes spécifiques de financement. Pour ma part, je voterai le rapport.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial et autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Agence France Trésor
- M. Antoine DERUENNES, directeur général ;
- M. Mathieu MARCEAU, chef du bureau de la trésorerie de l'État.
Direction générale du Trésor
- Mme Dorothée ROUZET, cheffe économiste.
Euroclear
- M. Geert DESMEDT, directeur général ;
- M. Cédric BAYART, directeur des opérations ;
- M. Thomas BRIAN, chargé de mission auprès du directeur des opérations.
Lazard Frères
- M. Pierre CAILLETEAU, associé-gérant ;
- M. Thomas LAMBERT, associé-gérant.
Centerview Partners
- M. Matthieu PIGASSE, associé-gérant.
Service économique régional de Londres
- M. Pierre CHABROL, ministre-conseiller pour les affaires économique et chef du service économique régional ;
- M. Alexandre GENY, attaché financier ;
- M. Hugo BRISEBARD, attaché macroéconomie ;
- Mme Zoé HEDOUIN, chargée de mission.
International Capital Market Association (ICMA)
- M. Bryan PASCOE, Chief Executive Officer ;
- Mme Nina SUHAIB-WOLF, Director, Market Practice and Regulatory Policy ;
- M. Simone BRUNO, Associate Director, Fintech and Digitalisation ;
- M. Jean-Luc LAMARQUE, ICMA Chairman et Managing Director, Global Co-Head of Primary, Crédit Agricole CIB.
Banque d'Angleterre
- M. Nathanaël BENJAMIN, Executive Director, Financial Stability and Risk, membre du Financial Policy Committee ;
- Mme Pelagia NEOCLEOUS, Senior Policy Manager, Financial Stability, Strategy and Risk ;
- M. Philippe LINTERN, Head of Foreign Exchange Division.
Debt Management Office
- Mme Jessica PULAY, Chief Executive Officer.
*
* *
- Contributions écrites -
Banque de France
Barclays
Citigroup
Crédit Agricole CIB
HSBC
J.P. Morgan
Société Générale
Global Sovereign Advisory
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Poursuivre les initiatives destinées à favoriser la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État |
Agence France Trésor |
À compter de l'année 2026 |
Types de titres de dette émis, organisation de présentations investisseurs |
|
2 |
Valoriser, dans le cadre de la sélection et de l'évaluation des banques spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), la contribution de celles-ci à la diversification de la typologie et de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État |
Direction générale du Trésor, Agence France Trésor |
À compter de l'année 2026 |
Classement annuel des banques SVT, procédure de sélection pluriannuelle des banques SVT |
|
3 |
Explorer l'opportunité d'étendre la diversification de l'origine géographique des investisseurs en dette de l'État à de nouvelles zones |
Direction générale du Trésor, Agence France Trésor |
À compter de l'année 2026 |
Dialogue avec les banques SVT |
|
4 |
Réserver les actions de mobilisation de l'épargne des résidents, telles que celles du type « grand emprunt national », à des programmes de financement spécifiques, fléchés vers des investissements publics stratégiques précisément définis |
Direction générale du Trésor, Agence France Trésor |
À compter de l'année 2026 |
Projets de lois de finances |
* 1 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 2 Commission des finances du Sénat, Audition sur le thème « Solutions hors marché, grand emprunt national : des modes de financement à envisager pour notre dette publique ? », 19 février 2025.
* 3 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 4 Commission des finances du Sénat, Audition sur le thème « Solutions hors marché, grand emprunt national : des modes de financement à envisager pour notre dette publique ? », 19 février 2025.
* 5 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 6 Réponses du cabinet de conseil souverain Global Sovereign Advisory au questionnaire du rapporteur.
* 7 François Écalle, « Qui détient la dette française ? Anatomie d'un risque géopolitique », Le Grand Continent, septembre 2025.
* 8 Insee, Informations rapides, n° 163, 25 juin 2025.
* 9 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 10 Ibid.
* 11 Fabrice BIDAUD, Banque de France, Bloc-notes Eco, « Les Français ont-ils si massivement investi en obligations américaines depuis 2023 ? », Billet de blog 401, avril 2025.
* 12 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 13 Asset Purchase Programme (APP) et Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).
* 14 Rapport sur la dette des administrations publiques annexé au projet de loi de finances pour 2025.
* 15 Rapport sur la dette des administrations publiques annexé au projet de loi de finances pour 2025.
* 16 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 17 Commission des finances du Sénat, Audition sur le thème « Solutions hors marché, grand emprunt national : des modes de financement à envisager pour notre dette publique ? », 19 février 2025.
* 18 Ibid.
* 19 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 20 Ibid.
* 21 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 22 Ibid.
* 23 Ibid.
* 24 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 25 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 26 Voir notamment Éric ALBERT, Marc ANGRAND, « La dette américaine, arme de négociation contre Donald Trump pour le reste du monde », Le Monde, 10 mai 2025 ; Chelsey DULANEY, « China's Financial Weapons : U.S. Treasurys, the Yuan », The Wall Street Journal, 10 avril 2025.
* 27 Réponses de l'Agence France Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 28 Réponses de la banque Lazard au questionnaire du rapporteur.
* 29 Roland BECK, Vlad BURIAN, Georgios GEORGIADIS, Peter MCQUADE, « Geopolitics and foreign holdings of euro area government debt », Banque centrale européenne, juin 2025.
* 30 Voir notamment le rapport d'information n° 2686 de M. Kévin MAUVIEUX, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sur la détention de la dette de l'État par des résidents étrangers, mai 2024. Le rapporteur de la commission des finances du Sénat avait également envisagé l'opportunité d'une telle piste dans son précédent rapport de contrôle, sans aborder cependant les conditions de mise en oeuvre juridiques et opérationnelles : rapport d'information n° 719 (2023-2024) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances du Sénat, sur les facteurs explicatifs des perspectives d'évolution différentes en matière de charge de la dette entre la France et les principaux États européens, juillet 2024.
* 31 Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.
* 32 Réponses d'Euroclear France au questionnaire du rapporteur.
* 33 Ibid.
* 34 À l'image du Moyen-Orient. Voir l'exemple, certes pour des volumes financiers qui demeurent limités, des émissions, par le Trésor britannique, d'obligations souveraines conformes aux règles de la finance islamique (« sukuks souverains ») : Les Échos, du 2 avril 2021, « Que sont les « sukuk », des bons du Trésor britannique conformes aux règles islamiques ? »
* 35 Réponses de la Direction générale du Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 36 Réponses de la banque Lazard au questionnaire du rapporteur.
* 37 Réponses de la banque Citigroup au questionnaire du rapporteur.
* 38 Réponses de la banque Lazard au questionnaire du rapporteur.
* 39 Réponses de la Direction générale du Trésor au questionnaire du rapporteur.
* 40 Réponses de la banque Lazard au questionnaire du rapporteur.
* 41 Contre 14 % en Allemagne et en France.
* 42 Réponses de la banque Citigroup au questionnaire du rapporteur.
* 43 Réponses du cabinet de conseil souverain Global Sovereign Advisory au questionnaire du rapporteur.
* 44 Réponses de la banque Lazard au questionnaire du rapporteur.
* 45 Réponses de la banque Barclays au questionnaire du rapporteur.
* 46 François ECALLE, « Qui détient la dette française ? Anatomie d'un risque géopolitique », Le Grand Continent, septembre 2025.
* 47 Ibid.