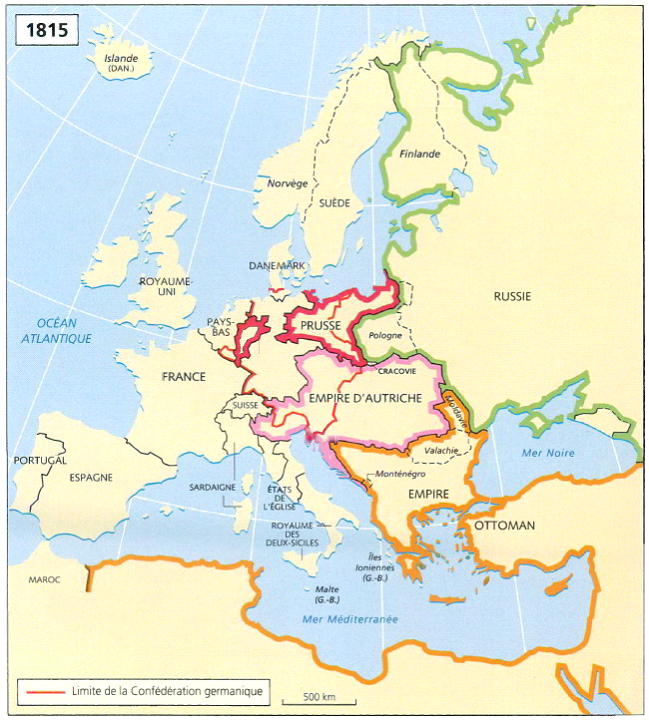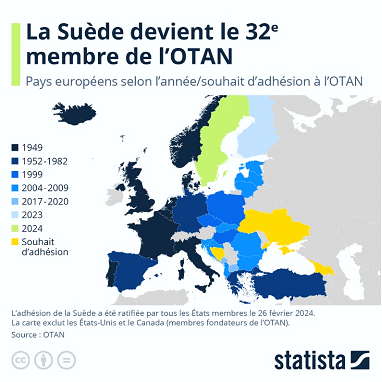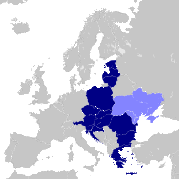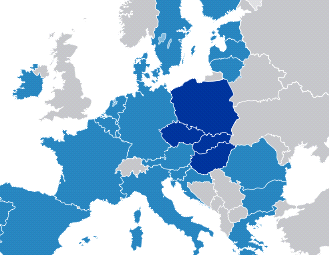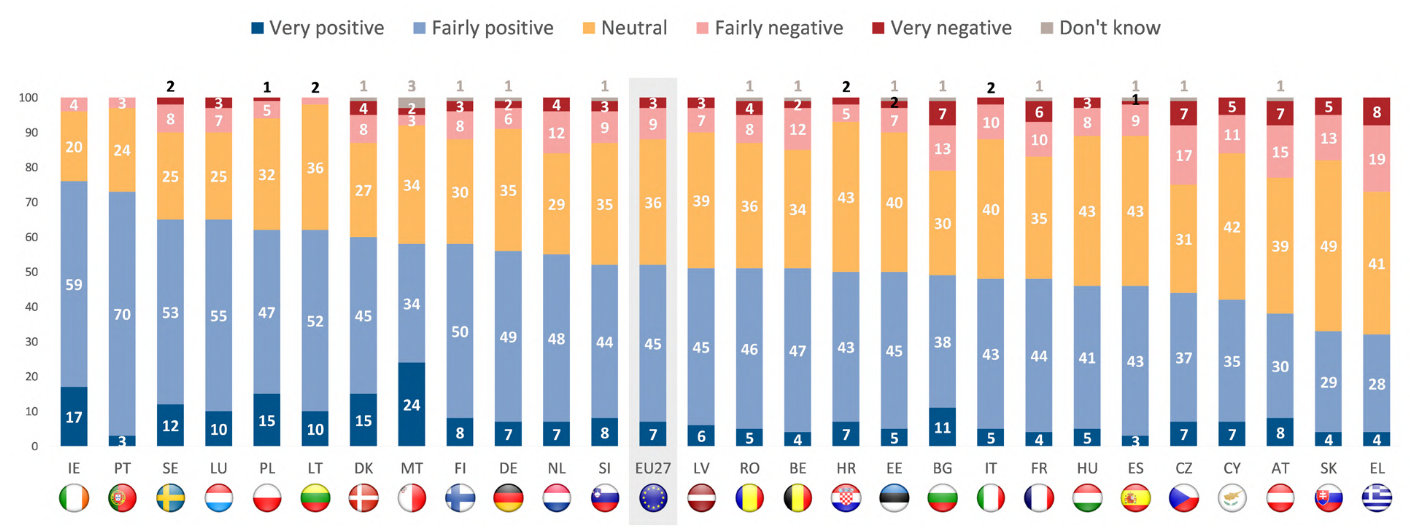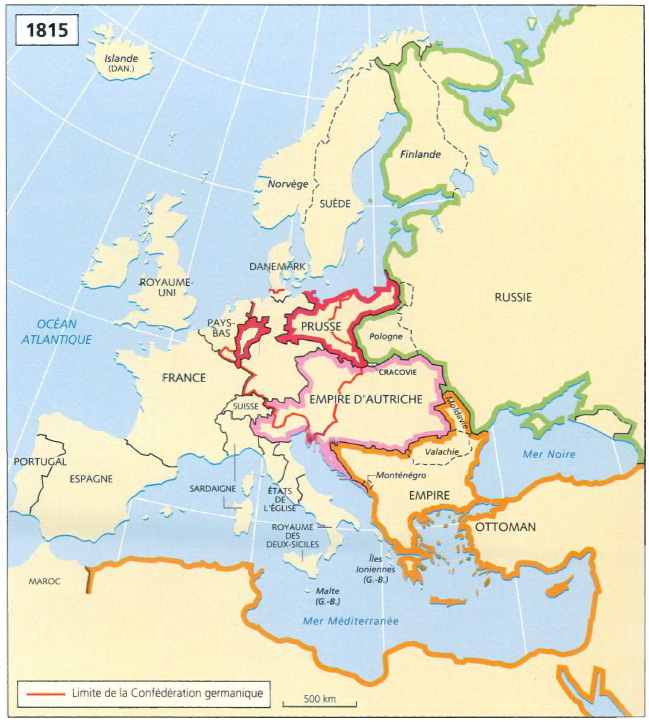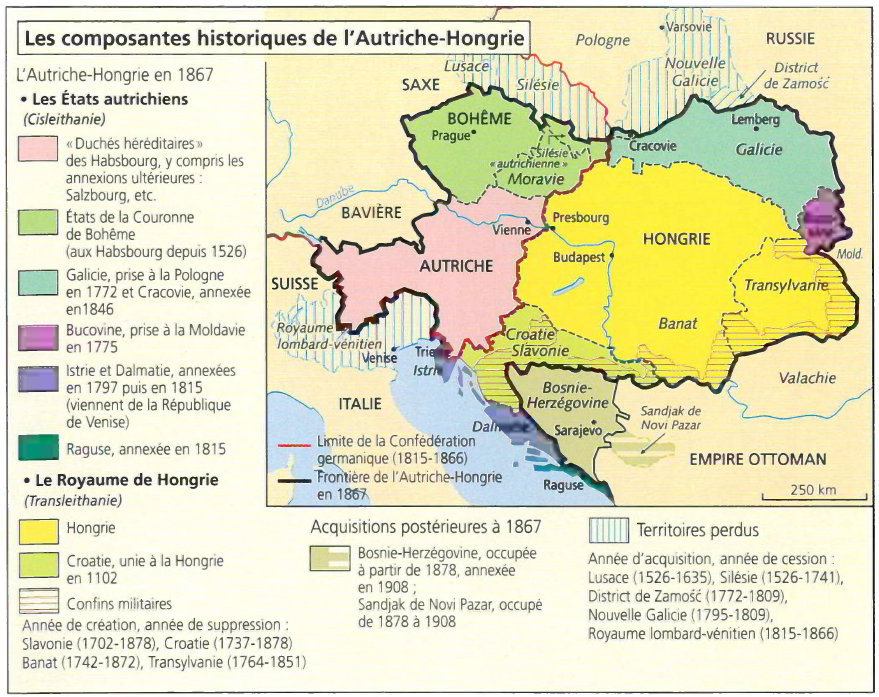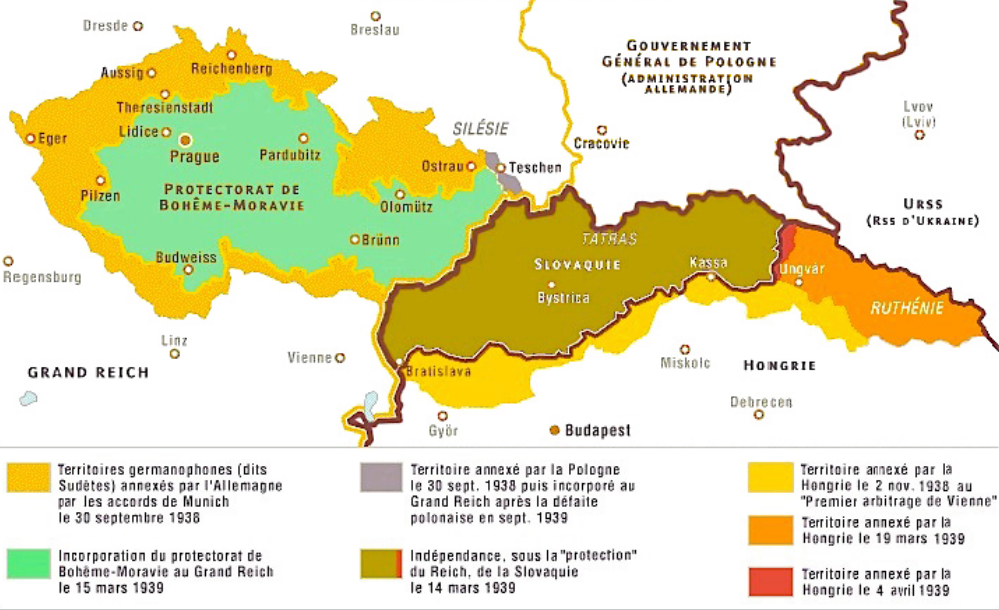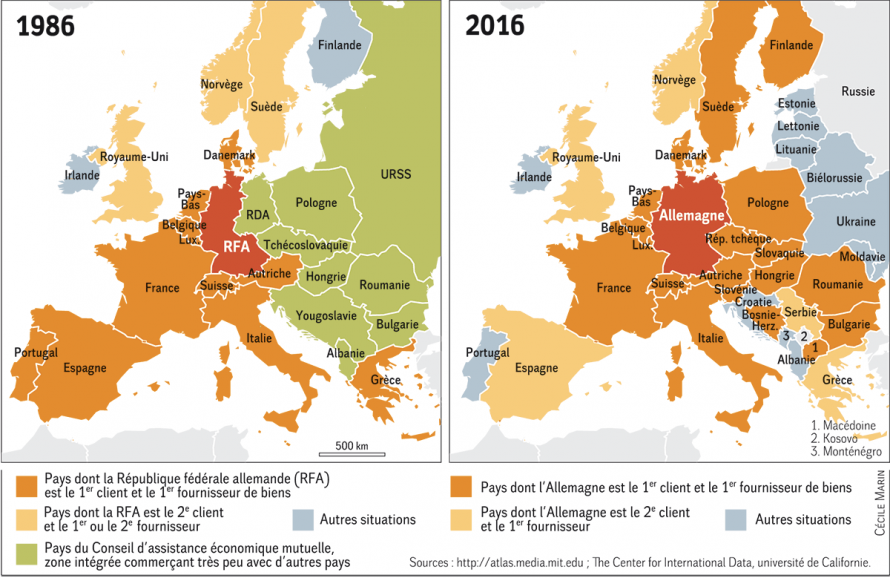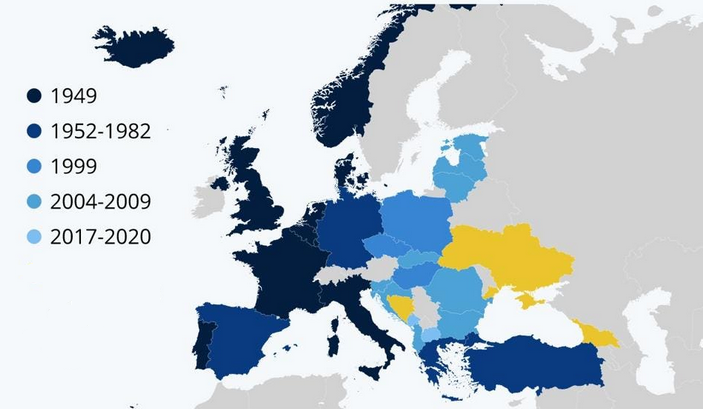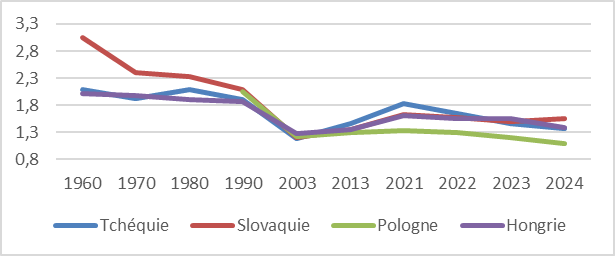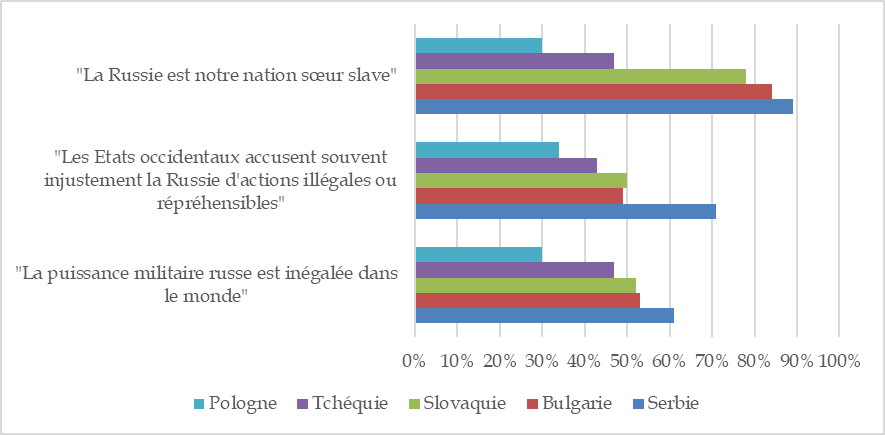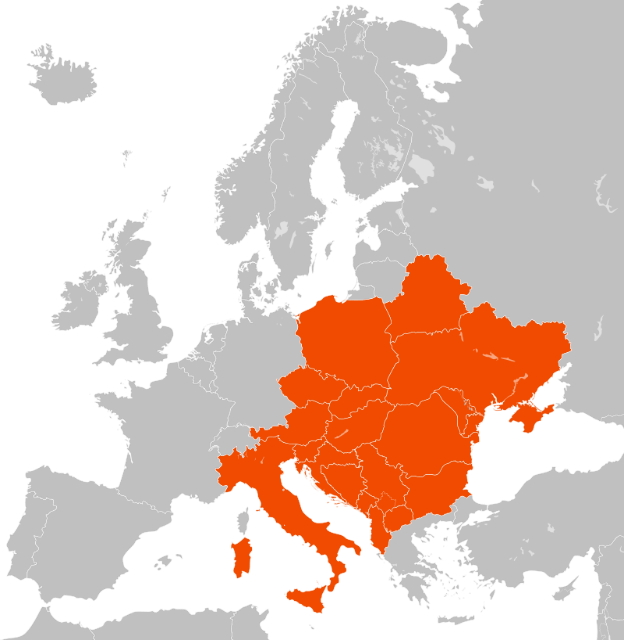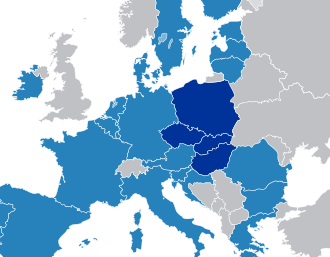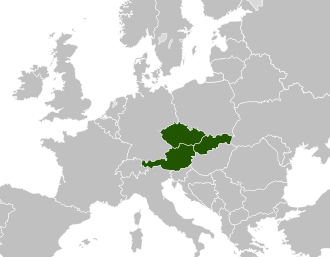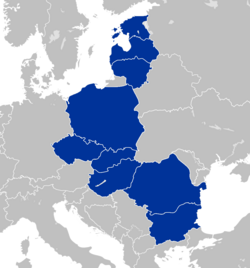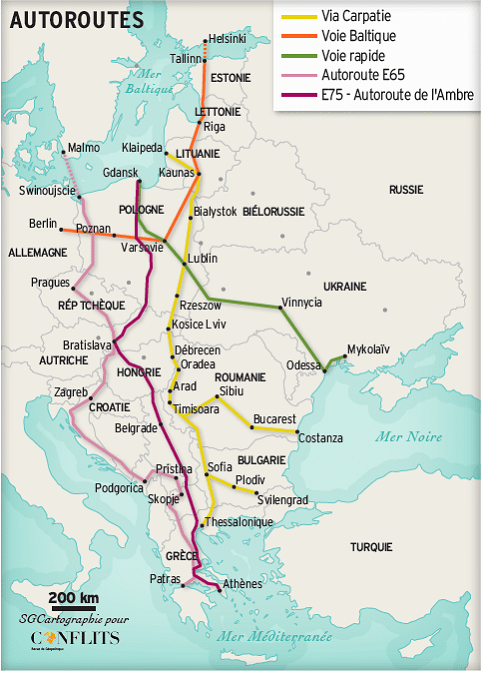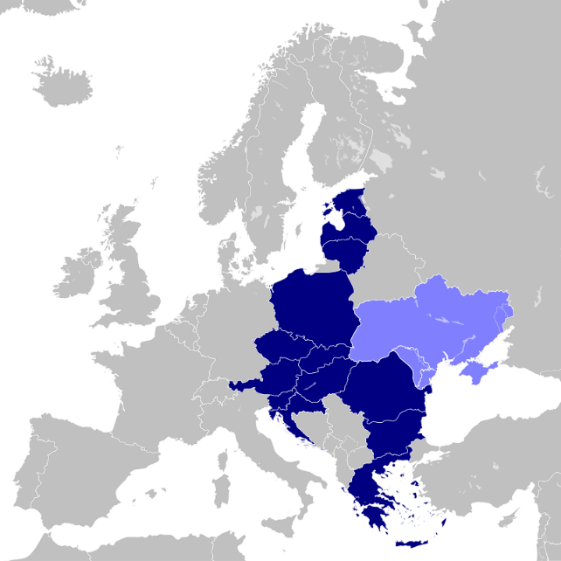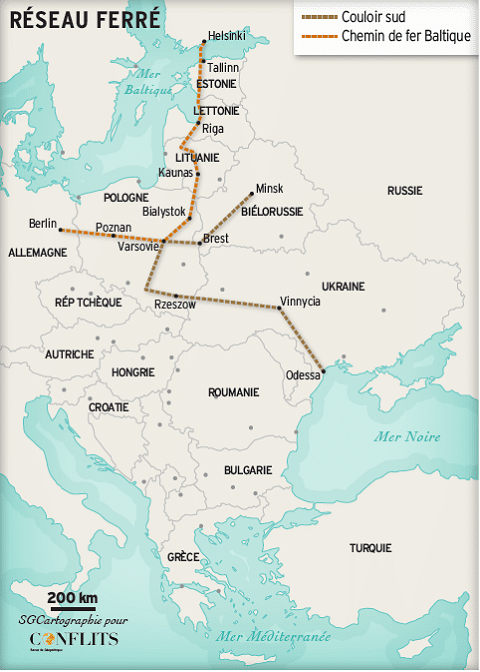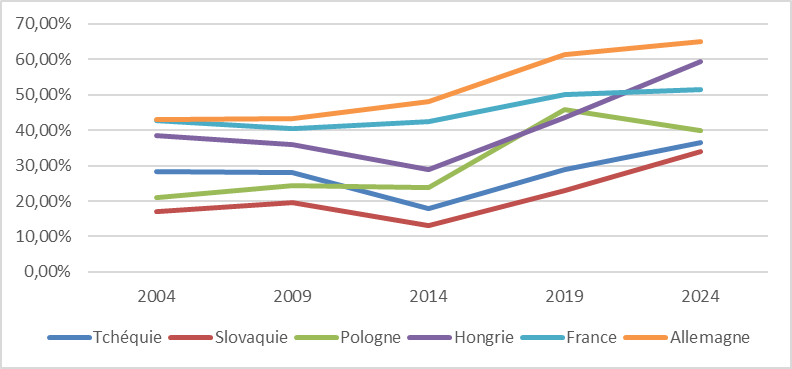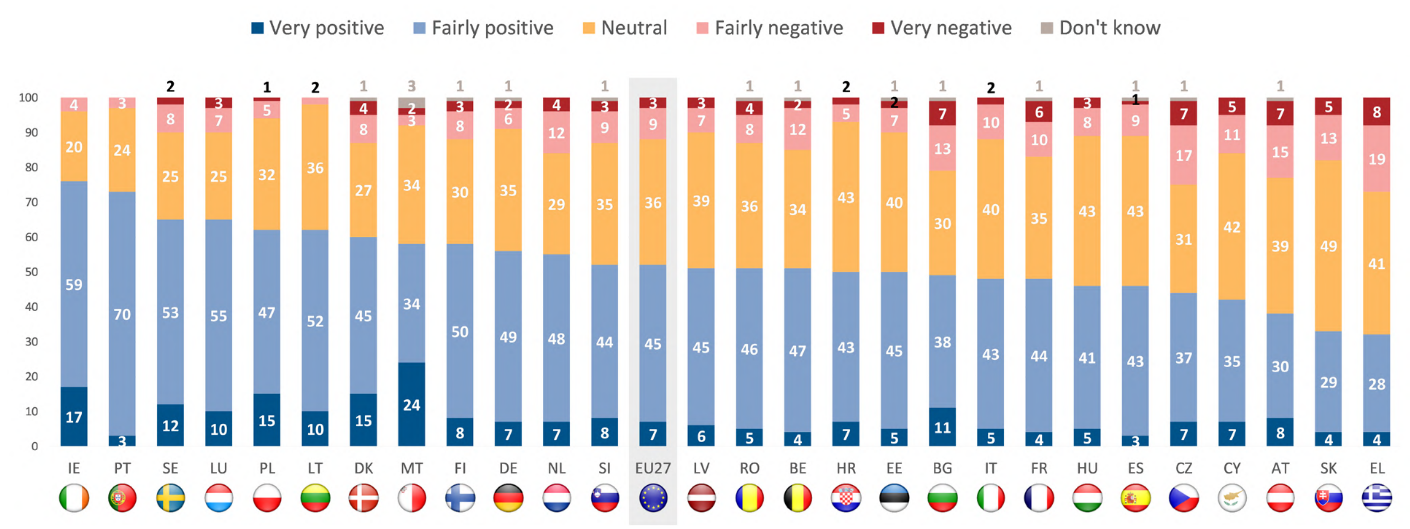- L'ESSENTIEL
- I. UNE GÉOPOLITIQUE RESTÉE
SPÉCIFIQUE EN DÉPIT DE L'UNIFICATION DU CONTINENT
- II. UNE GÉOPOLITIQUE FORCÉMENT
AMBIVALENTE, QUI REND LA CONVERGENCE DES VUES TOUJOURS PLUS
DÉLICATE
- I. UNE GÉOPOLITIQUE RESTÉE
SPÉCIFIQUE EN DÉPIT DE L'UNIFICATION DU CONTINENT
- AVANT PROPOS
- I. TCHÉQUIE ET SLOVAQUIE, ÉCHANTILLON
D'UNE EUROPE REDEVENUE CENTRALE
- II. DES DOCTRINES STRATÉGIQUES
FORCÉMENT AMBIVALENTES, QUI RENDENT LA CONVERGENCE DES VUES TOUJOURS
PLUS DÉLICATE
- I. TCHÉQUIE ET SLOVAQUIE, ÉCHANTILLON
D'UNE EUROPE REDEVENUE CENTRALE
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 14
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur les enjeux stratégiques européens vus depuis les « petits États » d'Europe centrale,
Par M. Thierry MEIGNEN et Mme Nicole DURANTON,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : M. Cédric Perrin, président ; MM. Pascal Allizard, Olivier Cadic, Mmes Hélène Conway-Mouret, Catherine Dumas, Michelle Gréaume, MM. André Guiol, Jean-Baptiste Lemoyne, Claude Malhuret, Akli Mellouli, Philippe Paul, Rachid Temal, vice-présidents ; M. François Bonneau, Mme Vivette Lopez, MM. Hugues Saury, Jean-Marc Vayssouze-Faure, secrétaires ; MM. Étienne Blanc, Gilbert Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Christian Cambon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Édouard Courtial, Jérôme Darras, Mme Nicole Duranton, MM. Philippe Folliot, Guillaume Gontard, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Ludovic Haye, Loïc Hervé, Alain Houpert, Patrice Joly, Mmes Gisèle Jourda, Mireille Jouve, MM. Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Ronan Le Gleut, Didier Marie, Thierry Meignen, Jean-Jacques Panunzi, Mme Évelyne Perrot, MM. Stéphane Ravier, Jean-Luc Ruelle, Bruno Sido, Mickaël Vallet, Robert Wienie Xowie.
L'ESSENTIEL
I. UNE GÉOPOLITIQUE RESTÉE SPÉCIFIQUE EN DÉPIT DE L'UNIFICATION DU CONTINENT
A. DES TERRITOIRES HISTORIQUEMENT OBJET DES RIVALITÉS DES PUISSANCES GERMANIQUES ET RUSSE
1. L'Europe centrale, champ clos et carrefour des rivalités de puissances
L'Europe centrale est une zone dont la complexité ethnique et la position centrale, au point de rencontre des rivalités des puissances germaniques, russe et, pour quelques siècles, turque, a longtemps rendu quasiment impossible la construction d'États-nations sur le modèle de l'Europe de l'ouest.
Au XIIIe siècle, entre le Saint empire romain germanique dont la frontière orientale se stabilise, et les principautés russes soumises à la Horde d'or, ne subsistent que les principautés polonaises et le royaume de Hongrie. À partir de 1385, l'union de la Pologne et de la Lituanie engendre l'un des Etats les plus puissants d'Europe. La Hongrie - dont les Slovaques font partie - atteint son âge d'or dans la seconde moitié du XVe siècle.
À partir du XVIe siècle, l'Europe centrale a aussi été, et pendant trois siècles et demi, le rempart de l'Europe contre la pression ottomane. La défaite des Hongrois face aux Turcs en 1526 pousse à un rapprochement avec les Habsbourg. La rivalité grandit au siècle suivant entre puissances autrichienne, prussienne et russe, qui culmine à la fin du XVIIIe dans les partages d'une Pologne affaiblie.
En 1815, quatre puissances se partagent l'Europe centrale - le royaume de Prusse, l'empire d'Autriche, l'empire ottoman et l'empire russe. Les peuples par eux soumis sont confinés dans le cadre de l'Europe centrale, véritable champ clos.
Les États des Habsbourg, qualifiés à compter de 1804 d'empire d'Autriche - dénomination héritière de l'Ostmark, littéralement la marche orientale de l'empire des Germains - sont entre-temps devenus majoritairement composés de peuples non germaniques. L'éveil des nationalités au cours du XIXe siècle, et en particulier l'unité italienne, puis l'unité allemande, ébranle l'édifice.
L'Europe en 1815
Le compromis trouvé en 1867 ne divise l'empire qu'en deux ensembles pour donner naissance à la double monarchie austro-hongroise. La Bohême, ancêtre de la Tchéquie, relève alors à la partie autrichienne, et l'actuelle Slovaquie de la Hongrie. Le nationalisme tchèque hésite alors entre l'idée slave et une solution autrichienne plus décentralisée.
Divisions de l'Europe selon des critères culturels d'après le comité permanent des noms géographiques allemands (2007)
Le père de la Tchéquie moderne, Tomas Masaryk, défendra plus tard la création d'États-nations souverains
susceptibles de faire obstacle aux projets pangermanistes - dans lesquels il voit l'origine principale de la Grande guerre. Les grandes puissances, elles, pensent toujours l'Europe centrale comme objet, comme en témoignent les projets allemands de Mitteleuropa, plus ou moins libéraux et plus ou moins décentralisés. Cette notion inspire encore, outre-Rhin, des représentations courantes des différents sous-ensembles culturels européens.
De cette histoire mouvementée, de bons auteurs centre-européens ont tiré des conclusions pénétrantes sur la culture politique de l'Europe centrale et orientale : l'absence de cadre national et étatique propre, d'une capitale, d'une cohésion politique et économique, d'une élite sociale homogène, aurait rendu l'acclimatation du libéralisme politique plus difficile et produit un style politique spécifique, distincte de celle de l'Europe de l'ouest. Selon l'historien hongrois Istvan Bibo, sa caractéristique principale est, historiquement, la peur pour l'existence de la communauté : « un pouvoir d'État étranger, sans racines dans le pays, se présentant tantôt sous une forme civilisée, tantôt sous celle d'un oppresseur, a pesé à un moment ou à un autre, sur la vie de tous. [...] La non-coïncidence des frontières historiques et ethniques ne tarda pas à dresser ces pays les uns contre les autres [...] Dynasties puis nations ont lutté en permanence pour l'âme de chaque sujet » (Istvan Bibo).
2. Au XXe siècle, une souveraineté encore sous contrôle
Après la Première guerre mondiale, l'Europe centrale est conçue comme un rempart contre l'expansionnisme allemand. Les « petites nations » se constituent enfin en États par la rencontre des efforts des élites nationales pour l'autodétermination et des projets franco-anglo-américains de réorganisation de l'Europe. L'Autriche-Hongrie est démembrée par la volonté de Clemenceau, Lloyd George et Wilson, certes au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes - dixième des « Quatorze points » - mais aussi dans l'objectif de priver l'Allemagne d'un allié naturel.
La France soutient en particulier les efforts d'autodétermination des élites tchécoslovaques, en abritant le conseil national tchécoslovaque dès 1916, en étant le premier État à le reconnaître comme organe suprême du gouvernement tchécoslovaque, le 30 juin 1918, et après avoir fourni un soutien décisif au plan militaire. La création par décret, en décembre 1917, d'une « armée autonome » placée sous la « direction politique » du conseil national tchécoslovaque mais « reconnaissant au point de vue militaire l'autorité supérieure du haut commandement français » fait en quelque sorte précéder l'État tchécoslovaque de son armée. Par la suite, le premier chef d'état-major de la jeune république, en mai 1919, n'est autre que le chef de la mission militaire française, le général Maurice Pellé.
Cette création va de pair avec la constitution d'alliances de revers, avec les États de la « Petite entente », Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Roumanie, mais aussi avec la Pologne. Cette politique est toutefois un échec : les différends ethnico-frontaliers et politiques entre les jeunes nations sont sous-estimés et, dans les années 1920 et 1930 se multiplient les différends centre-européens : guerre polono-tchécoslovaque, polono-soviétique, accord germano-polonais, remilitarisation de la Rhénanie, Munich enfin.
Après la seconde guerre mondiale, l'Europe centrale est à nouveau conçue comme rempart, soviétique cette fois-ci, dressé contre la domination américaine. Les massacres de la guerre et les déplacements de populations ont clarifié certains problèmes de frontières, mais la Tchécoslovaquie est immédiatement un enjeu prioritaire de la rivalité entre les deux « Grands ». Après avoir soutenu l'établissement d'une zone soviétique d'influence ouverte dans ce pays libéré par l'Armée rouge, les Etats-Unis font de la Tchécoslovaquie, à compter du Coup de Prague de février 1948, le laboratoire des politiques de déstabilisation du bloc soviétique. Suivront quarante ans de glaciation soviétique des « démocraties populaires », et la répression sanglante par l'armée rouge des velléités d'autonomisation - ainsi à Budapest en 1956, ou à Prague en 1968.
L'idée d'Europe centrale comme objet culturel et géopolitique renaît à cette période. La cause des « nations captives » devient un thème de politique intérieure américaine, et les intellectuels exilés à l'Ouest ravivent le mythe de la Mitteleuropa. Milan Kundera, dans son article paru en 1983 « L'Occident kidnappé », en donne une expression brillante, paradoxale et pessimiste, qui fait de l'Europe centrale le condensé malheureux de la culture européenne.
« Qu'est-ce que l'Europe centrale ? La zone incertaine de petites nations entre la Russie et l'Allemagne. La petite nation est celle qui peut disparaître, et qui le sait » (Milan Kundera)
À la chute du Mur, qui avait été fragilisé d'abord en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie, les relations se sont renforcées très rapidement avec l'Allemagne. Avant même la libéralisation des flux de capitaux, le régime du perfectionnement passif, facilité par le droit européen en 1986, permet en moins d'une décennie d'intégrer un vaste pan des économies d'Europe centrale voisins de l'Allemagne dans ses chaînes de valeur. Puis dans la décennie 1990, les flux d'investissements directs à l'étrangers allemands vers les pays d'Europe de l'Est explosent ; au début des années 2000, l'Allemagne réalise à elle seule plus du tiers des IDE effectués en Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et Pologne.
La France, qui a participé à la création du programme Phare d'aide aux pays d'Europe centrale et orientale et de la BERD, et a contribué au rapprochement germano-polonais au sein du triangle de Weimar, est toutefois moins présente que son voisin dans cette partie du continent.
B. UNE « UNIFICATION DE L'EUROPE » EN TROMPE-L'oeIL
1. Une unification subordonnée à la protection de l'Otan
La « réunification » de l'Europe n'eut rien de naturel ou de linéaire puisque la première conséquence du dégel du glacis soviétique a été non l'union spontanée de peuples à nouveau libres mais la reprise du processus de décomposition de l'Autriche-Hongrie par la séparation des Tchèques et des Slovaques, effective au 31 décembre 1992.
Élargissement de l'Otan en Europe centrale
La deuxième conséquence de la liberté recouvrée fut la recherche d'un protecteur extérieur autre que soviétique, et donc, faute de défense proprement européenne, l'élargissement de l'Otan. Annoncé publiquement dans son principe par le président Clinton en janvier 1994 en dépit des inquiétudes russes, il concerne la Pologne, la Hongrie et la République tchèque en 1999, puis la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en juin 2004, la Croatie et l'Albanie en 2009, le Monténégro en 2017, et la Macédoine du nord en 2020. Chaque intégration dans l'Otan précédant celle dans l'Union européenne, l'Europe de la défense fut ainsi retardée.
L'élargissement à l'Europe centrale de l'Union européenne a pris plus de temps, notamment du fait des craintes françaises que le centre de gravité de l'Union ne se déplace loin de Paris ou Bonn. Elle fut néanmoins décidée en décembre 2002, et effective en mai 2004. La critique essuyée en Europe par l'opposition franco-allemande à la guerre américaine en Irak fut une première illustration du fossé séparant les conceptions stratégiques ouest et centre-européennes. Ce fossé fut aussi creusé par l'opportun appui américain à la « nouvelle Europe », selon des conceptions stratégiques assez classiques - théorisées par Zbigniew Brzezinski par exemple - qui font de l'Europe la « tête de pont » de la puissance américaine à la condition que le continent soit unifié - à l'exclusion impérative de la Russie - grâce à la domination allemande sur son espace central, elle-même rendue possible par la protection américaine.
2. Une intégration contrariée par l'« épuisement du cycle libéral »
Si le bilan de l'élargissement a été considéré jusqu'à la fin des années 2000 comme plutôt positif sur le plan institutionnel et macroéconomique, les partis polonais, tchèque, slovaque et slovène à l'origine de l'intégration de l'Union n'en ont récolté aucun bénéfice puisqu'ils ont immédiatement perdu les élections. Seul le Fidesz hongrois de Viktor Orban a survécu, mais au prix de sa transformation d'un parti libéral en un parti populiste illibéral.
Ce courant politique devenu plus significatif au cours des années 2010 est souvent ramené à deux caractéristiques : une forme de populisme, c'est-à-dire la légitimation par le renchérissement patriotique et le dépassement des clivages partisans, qui conduit des partis attrape-tout à mêler, selon des dosages variables : antiélitisme, conservatisme sociétal, critique de la supranationalité, nouveau roman national ; et une hostilité à certaines formes garantissant l'État de droit, et la promotion d'une volonté collective moins intermédiée, qui vaut à la Pologne et à la Hongrie des contentieux avec les institutions européennes tenant à la compatibilité de certains dispositifs législatifs aux valeurs de l'Union - en matière d'indépendance des médias ou de la justice, par exemple. Outre le Fidesz hongrois, le parti Droit et justice en Pologne, le SMER-SD en Slovaquie, le parti AUR en Roumanie ou, dans une moindre mesure le parti ANO en République tchèque, sont fréquemment versés dans cette catégorie.
Ce phénomène n'est pas sans explications. D'abord, la chute des taux de fécondité et l'exode de la population jeune et instruite vers l'Europe de l'ouest, certes moindre que redouté et plus fort à l'est qu'au centre de l'Europe, est un motif de peur pour l'existence de la nation qui s'ajoute à celui hérité de l'Histoire. Ensuite, l'intégration européenne s'est accompagnée d'une difficulté à s'affirmer face aux « Grands » en Europe, et le sentiment d'être à nouveau relégué dans une forme de périphérie, au moment où les périls - terrorisme, menaces hybrides, réaffirmation de la Russie - croissaient de nouveau, n'a pas toujours été injustifié.
Enfin, les effets matériels de l'intégration européenne ont alimenté une puissante critique du consensus libéral de l'Union. La dépendance des économies centre-européenne, dans des proportions variables, aux exportations, aux investissements étrangers, aux financements de banques étrangères, aux transferts issus des migrations, ou encore aux fonds structurels européens n'est pas toujours bien vécue. L'efficacité des solutions proposées par les illibéraux pour remédier à ces modèles de « capitalistes dépendants » se discute ; reste que le report sine die par la République tchèque, la Pologne et la Hongrie d'intégrer la zone euro peut être compris comme le refus d'une perte de contrôle économique supplémentaire.
La domination du capital allemand dans l'économie tchèque lui vaut encore aujourd'hui le surnom de « 17e Land »
Au carrefour de ces explications, la crise migratoire du milieu des années 2010 a été un puissant catalyseur des mouvements nationaux-populistes en Europe centrale. Terres d'émigration depuis le XIXe siècle - une tendance prolongée par l'intégration économique du continent -, et ayant traversé de douloureuses phases de nettoyages ethniques pendant et après la seconde guerre mondiale, ces pays vivent très mal les soubresauts migratoires et la prétention de Bruxelles à imposer un modèle libéral et multiculturel insoucieux des préoccupations nationales.
II. UNE GÉOPOLITIQUE FORCÉMENT AMBIVALENTE, QUI REND LA CONVERGENCE DES VUES TOUJOURS PLUS DÉLICATE
A. QUELLE INTÉGRATION EUROPÉENNE À L'HEURE DU RETOUR DES MENACES ?
1. Le monde vu d'Europe centrale : des tiraillements contraires
Le maintien d'un lien transatlantique fort et fonctionnel demeure l'une des priorités cardinales de la politique extérieure et de défense des États d'Europe centrale. Le maintien d'une présence stratégique américaine en Europe est vu comme une garantie pour la sécurité nationale autant que comme un facteur d'équilibre régional, « une échappatoire au dilemme historique de l'entre-deux géopolitique Allemagne-Russie » (David Cadier). Il est en outre puissamment porté par l'adhésion des élites politiques de la région au modèle économique et social des Etats-Unis, ainsi que par leur socialisation professionnelle, dans les années 1980 et 1990, auprès des élites stratégiques américaines.
Cet atlantisme peut être plus ou moins dogmatique ou pragmatique, selon les pays. Il se traduit en tout cas très largement par l'adhésion à la communauté des utilisateurs de matériel militaire américain. La Slovaquie a acheté un lot de 14 chasseurs F-16 en 2018, dont elle a reçu les deux premiers en juillet 2024 ; la Pologne a commandé 32 chasseurs F-35 en janvier 2020 et envisage l'acquisition d'appareils F-15 EX pour remplacer ses MiG-29 ; la République tchèque s'est décidée en janvier 2024 pour l'achat de 24 avions F-35, afin de remplacer sa flotte de Gripen suédois.
La guerre en Ukraine a en outre fait bénéficier la Hongrie et la Slovaquie du renforcement de la présence de l'Otan sur leur territoire. La Hongrie abrite 800 militaires, et la Slovaquie pourrait héberger jusqu'à 2 100 soldats des groupements tactiques multinationaux créés en 2016 et renforcés depuis 2022. La Slovaquie dispose en outre d'une batterie de défense anti-aérienne Patriot, et la République tchèque, la Pologne et la Hongrie contribuent à la protection de son espace aérien. La Tchéquie contribue à plusieurs groupements tactiques en Slovaquie, Lettonie et en Lituanie.
Dans ces conditions, les notions d'autonomie stratégique et de souveraineté européennes en matière de défense font historiquement office de tabous. En Tchéquie, les prises de parole officielles les plus récentes témoignent certes d'une inflexion : le Premier ministre Fiala a ainsi dit poursuivre l'objectif d'une Europe forte, tandis que le président Pavel a appelé l'Europe à « tenir sur ses propres jambes » et à renforcer le « pilier européen de l'Otan ». Reste que tous ont endossé l'objectif de 5 % du PIB consacré à ce poste fixé par la nouvelle administration américaine, et adopté au sommet de l'Otan de La Haye, en juin 2025 - même si le Premier ministre slovaque Robert Fico l'a qualifié d'« absurde » et a de nouveau brandi l'hypothèse d'une neutralité de son pays.
Les attitudes des pays d'Europe centrale à l'égard de la Russie, et par voie de conséquence de l'Ukraine, sont plus hétérogènes. Pour Varsovie réconciliée depuis trente-cinq ans avec Berlin, la Russie est l'ennemi historique, l'Autre contre lequel s'est construite l'identité nationale, et c'est un moteur puissant d'un atlantisme antérieur déjà aux menaces russes en Ukraine. L'hostilité à la Russie est également très forte à Prague, qui plaide pour une politique de sanction très ferme à son égard. Budapest oscille entre solidarité avec les sanctions européennes et opportunisme économique puisque, enclavé, le pays dépend des hydrocarbures russes acheminés par voie terrestre à hauteur de 95 % pour le gaz et 77 % pour le pétrole. Bratislava s'est démarquée depuis vingt ans comme la moins hostile à Moscou, pour les mêmes raisons pragmatiques que la Hongrie, mais aussi en raison de la sympathie dont jouit la Russie au sein d'une population dont l'identité nationale s'est davantage appuyée sur le panslavisme au XIXe siècle. Le Premier ministre Fico s'est ainsi rendu à Moscou le 22 décembre 2024, et le 9 mai 2025 pour la célébration des 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie.
Mais les positions des centre-européens à l'égard de l'Ukraine sont devenues plus complexes. Pologne et Tchéquie en sont restées les soutiens les plus déterminés en lui fournissant une aide significative et en accueillant un très grand nombre de réfugiés, mais les opinions publiques font à présent connaître leur lassitude : elles s'agacent désormais de l'accueil des réfugiés en Tchéquie, et s'inquiètent, en Pologne, des conséquences économiques d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union. Karol Nawrocki, nouveau président polonais depuis juin dernier, s'est fait le porte-parole de ces craintes et adopte une position de fermeté dans les contentieux mémoriels avec l'Ukraine - tel le massacre des Polonais de Volhynie par l'armée insurrectionnelle ukrainienne pendant la Seconde guerre.
Les vues stratégiques des Centre-européens en Asie sont également hétérogènes. Pologne et Tchéquie suivent une politique d'ouverture à l'égard de la Chine, mais la concrétisation des opportunités économiques des nouvelles routes de la soie se fait attendre, et l'étroitesse de la coopération dépend en partie de l'état de leur relation transatlantique. Hongrie et Slovaquie sont plus ouverts à la coopération avec la Chine, et avec davantage de succès. Tchéquie et Hongrie se distinguent encore par la solidité de leur soutien à Israël.
2. L'Europe vue du centre : une géométrie variable
L'unification politique de l'Europe a paradoxalement révélé les nuances de géographie mentale dans cette partie du continent.
Groupe de Visegrad
Groupe des Neuf de Bucarest
Les premiers projets de coopération régionale rendus possible par la décomposition du bloc de l'Est ont d'abord épousé les frontières de l'ancien empire des Habsbourg. L'initiative centre-européenne a ainsi d'abord regroupé l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Yougoslavie, et s'est beaucoup élargie, depuis, jusqu'à la Biélorussie. À Prague, en 1991, l'appel du président Vaclav Havel à combler le vide laissé en Europe par la disparition de l'Autriche-Hongrie a pris la forme du groupe de Visegrad, qui regroupe Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et Pologne. Enceinte de concertation préalable à l'élargissement de l'Otan et de l'Union, ce groupe est aussi devenu un pôle de contestation du libéralisme européen. La Slovaquie et la République tchèque font également partie, avec l'Autriche, du format Slavkov, également appelé format Austerlitz ou S3, initié par la République tchèque en 2015, afin de compléter le précédent. Le groupe des Neuf de Bucarest, ou « B9 », est formé en novembre 2015, après l'annexion de la Crimée, à l'initiative du président roumain Klaus Iohannis et du président polonais Andrzej Duda afin de renforcer la coopération entre ces pays en matière de sécurité extérieure dans le cadre d'une menace accrue de la Russie.
Initiative des trois mers
La variante d'origine polonaise de la coopération régionale est encore plus vaste et recouvre tout l'espace compris entre l'Allemagne et la Russie. L'initiative des trois mers, créée en 2016, a pour objectif d'opérer une meilleure jonction économique entre les mers Baltique, Adriatique et Noire, ouverte aux capitaux américains et chinois, tout en évitant de désigner trop explicitement Moscou comme adversaire. La filiation est cependant évidente avec le rêve d'Intermarium du maréchal Pisudski, premier chef d'État de la Pologne moderne, ressuscitant la République des deux nations polono-lituanienne et fondé sur une doctrine - le « prométhéisme » - de l'affaiblissement de la Russie.
Ces enceintes sont plus ou moins actives, les divergences politiques entre les gouvernements de leurs membres ayant par exemple ralenti la coopération au sein du groupe de Visegrad.
La perception de l'Union européenne est elle aussi à géométrie variable. Si les élites tchèques sont très largement attachées à l'Union, la Tchéquie est historiquement un des pays membres dont l'opinion publique est la plus eurosceptique. La participation des électeurs tchèques aux élections européennes est traditionnellement très faible, en-dessous de 30 %, sauf aux dernières élections, où elle a atteint 36 %. La Slovaquie montre un attachement à l'Union fluctuant au gré des crises successives - crise de la dette, crise migratoire, covid. Le référendum sur l'adhésion à l'Union avait été remporté à une majorité de plus de 92 %, mais avec la participation d'un électeur sur deux. La Slovaquie est désormais fréquemment dernière dans les eurobaromètres mesurant l'image de l'Union dans la population.
Perception de l'Union européenne selon l'Eurobaromètre du printemps 2025
Les divergences de conceptions du projet européen entre la France et les États centraux ne doivent pas être sous-estimées. La Tchéquie, pays le plus industriel d'Europe en part de richesse nationale, et la Slovaquie, dont l'industrie automobile pèse pour 10 % du PIB et près de la moitié des exportations, sont libre-échangistes et favorables à l'accord avec le Mercosur. En Hongrie, Viktor Orban défend depuis quelques années une conception de l'Europe comme projet économique débarrassé d'ambitions politiques propres, et une théorie de la connectivité pour son pays, dont il défend le caractère de pont entre l'Europe et l'Asie, conception qui inspire aussi le Premier ministre slovaque. Le 26 septembre, le Parlement slovaque a même voté une révision constitutionnelle réaffirmant la primauté sur les engagements internationaux du pays de ses lois relatives à l'identité nationale, qui recouvrent notamment « les questions culturelles et éthiques fondamentales relatives à la protection de la vie et de la dignité humaine, de la vie privée et familiale, du mariage, de la parentalité et de la famille, de la moralité publique, de l'état civil, de la culture et de la langue [...] ».
B. RESSERRER NOTRE COOPÉRATION À TOUS LES NIVEAUX
1. L'avenir incertain des populismes centre-européens
L'avenir des forces politiques centre-européennes eurocritiques n'est pas facile à prédire. Le Fidesz hongrois n'est certes pas favori pour les élections de 2026. Il pourrait perdre le pouvoir au profit du parti Respect et Liberté de Péter Magyar. En Slovaquie, la dynamique populaire du parti SMER-SD de Robert Fico, qui gouverne depuis 2023 avec le parti Hlas et les ultranationalistes du parti national slovaque, est devenue moins favorable.
Il existe pourtant une dynamique régionale en leur faveur. En septembre 2024, le FPÖ autrichien, hostile au soutien à l'Ukraine, est devenu la première force politique du pays, mais n'a pu former de gouvernement. En janvier 2025, Zoran Milanovic, hostile à l'élargissement de l'Otan et partisan de bonnes relations avec la Russie, est devenu le nouveau président croate. En juin 2025, les électeurs polonais ont élu président le candidat nationaliste et eurocritique Karol Nawrocki, hostile à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En Roumanie, la victoire du populiste pro-russe Calin Georgescu a été empêchée de justesse fin 2024.
Certains déterminants matériels de la progression des forces populistes ne devraient pas disparaître. Le ralentissement économique allemand lié au renchérissement du prix de l'énergie, aux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump et à la concurrence chinoise conjuguent leurs effets déstabilisants sur un tissu productif très dépendant des exportations d'automobiles. Le groupe de Visegrad pourrait rester une force de contestation.
2. Pour une politique française plus équilibrée dans la région
La France est souvent soupçonnée de défendre l'autonomie européenne à son profit et de manquer de considération à l'égard de ses alliés. Les Tchèques lui reprochent ainsi de ne les avoir pas consultés avant l'extinction de la mission Barkhane, à la fin 2022, et regrettent qu'elle n'ait pas participé à la principale initiative militaire tchèque d'achat de munitions à destination de l'Ukraine. Le format Weimar+ pourrait être plus volontiers étendu aux pays d'Europe centrale, désireux de prendre part aux réflexions stratégiques européennes.
Les relations bilatérales, en particulier sur les questions militaires, pourraient en outre être approfondies nonobstant les désalignements idéologiques des gouvernements, qui s'inscrivent par hypothèse dans une temporalité plus courte. Les menaces de sanctions financières européennes brandies par le chancelier Merz contre les gouvernements hongrois et slovaques ne sont pas forcément la bonne méthode pour renforcer le consensus en Europe.
La France pourrait encore approfondir sa visibilité et la défense de ses intérêts dans les enceintes régionales de coopération. Outre son rôle clé dans la défense du flanc est de l'Otan, elle pourrait s'impliquer davantage dans les enceintes politiques d'Europe centrale, comme elle le fait dans les organisations de coopérations nordiques et baltiques.
Enfin, peut-être la convergence des vues stratégiques pourrait-elle être suscitée dans un nouveau format. La Communauté politique européenne, lancée par le président Macron à Prague en 2022 en écho aux Assises de la Confédération européenne organisées, à Prague également, par le président Mitterrand en 1991, pourrait en être le premier creuset.
AVANT PROPOS
Comme le disait le ministre des affaires étrangères de la Tchécoslovaquie Jan Masaryk après la Seconde guerre, être un pont entre l'Est et l'Ouest n'est pas aisé car, « en temps de paix, c'est un lieu d'embouteillage et, en temps de guerre, c'est la première chose que l'on fait sauter »1(*).
Cet inconfort de l'Europe centrale semble avoir trouvé à s'illustrer de nouveau en juin 2025 lorsque les dirigeants respectifs de ce qui formait jusqu'en 1992 un État unitaire ont pris publiquement des positions opposées sur l'objectif de consacrer 5 % de leur PIB aux dépenses de défense : si le Président tchèque Petr Pavel - ancien président du comité militaire de l'Otan -, y a souscrit sans réserve, le plus russophile Premier ministre slovaque n'a pas manqué d'en désapprouver le principe jusqu'à soulever même l'hypothèse d'une « neutralité » de son pays.
Tchéquie et Slovaquie forment un bon échantillon de « cette Europe qu'on dit centrale »2(*), et qui a été un sismographe de première importance tout au long de l'histoire européenne moderne et contemporaine : le coup d'envoi de la guerre de Trente ans, dont l'issue a consacré les États modernes selon les plans des traités de Westphalie de 1648, a été donné à Prague en 1618 ; le Saint Empire romain germanique a pris fin en 1805 dans le palais primatial de Bratislava, alors Presbourg, après la bataille d'Austerlitz - aujourd'hui Slavkov, en Moravie ; le deuxième Reich a commencé de naître à Sadowa, à cent kilomètres de Prague, en 1866 ; le dépeçage de la Tchécoslovaquie a été le premier front de la seconde guerre mondiale ouvert en Europe occidentale et le pays a été un des objets principaux de la rivalité des deux Grands dans les premières années de la guerre froide ; c'est à Prague enfin que le président Mitterrand tenta de renouveler l'architecture de coopération en Europe pour « abolir la distance physique et psychologique créée par un demi-siècle de séparation ».
L'élargissement de l'Union européenne, qui devait refermer cette brèche, n'a pas effacé l'hétérogénéité des positions - en matière de commerce, d'industrie, de défense, de conceptions stratégiques même -, laquelle devient chaque jour plus préjudiciable lorsque la guerre en Ukraine et la politique du second mandat de Donald Trump exigeraient une forme d'autonomie continentale. En se rendant à Prague et à Bratislava en juillet 2025, la mission a tenté de mieux comprendre les trajectoires de ces deux sociétés, les vues de leurs représentants, et les perspectives de coopération avec ces deux États, sans s'interdire d'élargir la réflexion à la situation de leurs voisins, notamment hongrois et polonais.
I. TCHÉQUIE ET SLOVAQUIE, ÉCHANTILLON D'UNE EUROPE REDEVENUE CENTRALE
La situation contemporaine de la République tchèque et de la Slovaquie illustre bien ce paradoxe : l'intégration des anciennes démocraties populaires dans l'Union européenne, où beaucoup d'entre elles ont vu l'« unification de l'Europe », a révélé l'hétérogénéité du continent, laquelle doit beaucoup à la fragilité des constructions politiques de son espace central.
A. DES TERRITOIRES LONGTEMPS OBJET DES RIVALITÉS DES PUISSANCES GERMANIQUES ET RUSSE
L'Europe centrale est une région dont la complexité ethnique a longtemps rendu quasiment impossible la construction d'États-nations sur le modèle de l'Europe de l'ouest. Comme l'écrivait le philosophe et premier président tchécoslovaque Tomá Masaryk, « politiquement et ethnographiquement, l'Europe est organisée d'une façon bizarre. Pour bien comprendre l'Europe [...] il est extrêmement important de se rendre compte de la singulière zone de petites nations qui occupent les territoires situés entre l'Est et l'Ouest, surtout entre les Allemands et les Russes »3(*).
1. L'Europe centrale, carrefour des rivalités de puissances
a) Carrefour des ambitions concurrentes, essentiellement germaniques, russes et turques
Les peuples d'Europe centrale sont essentiellement d'origine slave, hongroise, latine et bulgare. Une ligne imaginaire reliant la base orientale de l'actuel Danemark à l'actuelle ville de Trieste a longtemps séparé, approximativement, les Germains de l'empire Carolingiens des Slaves. Entre le VIIIe et le XIVe siècle, les migrations allemandes vers l'est laissent toutefois derrière elles, au bout de plusieurs siècles au cours desquels la frontière du Saint-Empire se déplace aussi vers l'est, des situations contrastées : dans certaines régions, les peuples slaves ont été germanisés ; ailleurs, ils ont gardé leur identité - ainsi des Tchèques et des Slovènes. Tous ont été progressivement christianisés, entre le VIIe et le XIVe siècle, selon un mouvement allant de l'ouest et du sud vers le nord.
Au XIIIe siècle se stabilisent les frontières orientales du Saint-Empire romain germanique, héritier de l'empire ottonien fondé en 962 à la suite de l'empire carolingien. L'invasion mongole, qui ruine Kiev en 1240, saccage l'Europe orientale jusqu'à la Valachie et laisse derrière elle un État, la Horde d'or, qui impose un tribut à toutes les principautés russes jusqu'à la Galicie. Entre les deux, subsistent le royaume de Hongrie, qui inclut l'actuelle Croatie, et les principautés polonaises.
L'Europe vers 1250
Source : Jean et André Sellier, 2014.
À partir de 1385, l'union de la Pologne et de la Lituanie a engendré l'un des États les plus vastes et les plus puissants d'Europe, qui vainc même en 1410 les chevaliers teutoniques à Tannenberg - Grunwald pour les Polonais, haut lieu de la mémoire nationale de l'époque romantique à nos jours4(*), et qui a nourri aussi le revanchisme allemand dans la première moitié du XXe siècle. Cette « République des Deux Nations » perfectionnée par l'Union de Lublin de 1569 atteint alors bientôt son expansion territoriale maximale. La Hongrie atteint, elle, son âge d'or sous Mathias Corvin (1458-1490).
L'Europe vers 1500
Source : Jean et André Sellier, 2014.
À partir du XVIe siècle, l'Europe centrale a aussi été, et pendant trois siècles et demi, le rempart de l'Europe contre la pression ottomane, qui soumet le royaume de Hongrie à Mohács en août 1526. En décembre cette année-là, Ferdinand de Habsbourg, élu roi de Bohême deux mois plus tôt, est également élu roi de Hongrie, ce qui pose les fondations de l'union personnelle austro-hongroise. La Hongrie, progressivement éclatée entre une province ottomane, une Hongrie royale conservée par les Habsbourg, et une Transylvanie plus ou moins autonome selon les époques, ne récupèrera ses territoires qu'à l'orée du XVIIIe siècle, après l'échec du siège turc de Vienne en 1683. Le reflux turc des Balkans deviendra plus significatif avec les premiers règlements russo-prussiens de la question balkanique en 1878.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles s'affermit en effet la rivalité des puissances autrichienne, prussienne et russe. Celle-ci culmine dans les partages de la Pologne. Pour apaiser les tensions russo-autrichiennes, le roi de Prusse suggère un premier partage en 1772. Russie et Prusse opèrent un deuxième partage en 1793. L'échec de l'insurrection de Tadeusz Kosciusko de mars 1794 aboutit à un troisième partage tripartite, qui réduit la Pologne à rien, en octobre 1795. Après l'intermède napoléonien, qui recrée un grand-duché de Varsovie aux dépens de l'Autriche et de la Prusse, la Russie accroît sa part du gâteau polonais à l'issue du Congrès de Vienne de 1815.
« En 1815, quatre puissances se partageaient l'Europe centrale - le royaume de Prusse, l'empire d'Autriche, l'empire ottoman et l'empire russe - de sorte qu'aucun peuple d'Europe centrale n'était indépendant. Chacune de ces puissances disposait d'une ouverture sur l'extérieur. Les peuples soumis, en revanche, se trouvaient confinés dans le cadre de l'Europe centrale, véritable champ clos » 5(*).
L'Europe en 1815
Source : Jean et André Sellier, 2014.
Les États des Habsbourg, qualifiés à compter de 1804 d'empire d'Autriche - dénomination héritière de l'Ostmark de l'époque d'Othon 1er qui désigne littéralement la marche orientale de l'empire des Germains - sont entre-temps devenus majoritairement composés de peuples non germaniques : Hongrois, Slovènes, Tchèques, Slovaques, Serbes, Croates, Roumains, Juifs, Italiens. L'éveil des nationalités au cours du XIXe siècle, et en particulier l'unité italienne à compter de 1859, puis l'unité allemande à partir de 1866, ébranle un édifice dont la stabilité tient encore beaucoup au caractère autocratique du régime.
Le compromis finalement trouvé en 1867 partage l'empire en deux entités : la Transleithanie, qui rassemblent les pays de la couronne de Saint-Etienne, n'est autre que le royaume de Hongrie reconstitué, et la très hétérogène Cisleithanie, composée des « royaumes et pays représentés à la Diète d'Empire », comprend les duchés héréditaires des Habsbourg, les États de la Couronne de Bohême, la Galicie, la Bucovine, l'Istrie et la Dalmatie, et Raguse.
Composantes historiques de l'Autriche-Hongrie
Source : Jean et André Sellier, 2014.
Tchèques et Slovaques avant le compromis de 1867
Le sort respectif des Tchèques et des Slovaques illustre bien la complexité de la construction historique des « petites nations » d'Europe centrale.
La Bohême, intégrée dès le Xe siècle à l'Empire romain d'Othon le Grand avait été élevée en 1158 à la dignité de royaume par Frédéric Barberousse et son prince fait électeur du roi de Germanie. L'apogée du royaume est atteint sous Charles IV, dans la seconde moitié du XIVe siècle, qui fait de Prague une capitale de l'Empire, codifie le système d'élection de l'Empereur et fonde l'université de Prague. Le particularisme tchèque s'exprime, contre la grande aristocratie et la hiérarchie ecclésiastique allemande, dans le mouvement hussite, celui des partisans de Jan Huss, précurseur de Luther, au début du XVe siècle. La Bohême devient possession des Habsbourg en 1526.
La Slovaquie, en revanche, a été conquise par le royaume de Hongrie au Xe siècle. Elle perdit alors toute indépendance et jusqu'à son nom pour s'appeler Haute Hongrie. Le destin de ses habitants de se distingua de celui des Hongrois qu'en 1526 lorsque celle-ci devint vassale du sultan : les montagnes slovaques permirent à ses habitants d'échapper à sa domination effective.
L'ancien royaume de Hongrie ne fut repris aux Turcs par les Habsbourg qu'en 1699 par le traité de Karlowitz, et conservé en 1718 aux termes du traité de Passarowitz, mais les Habsbourg n'y régnaient pas en tant qu'empereurs mais en tant que rois de Hongrie. La Slovaquie n'appartenant pas à la même monarchie que la Bohême, elle ne partageait ni ses lois ni ses moeurs. Le patriotisme slovaque grandit à partir des années 1830.
L'accord entre l'Autriche et la Hongrie, qui se fait au détriment des petites nations, est une terrible déception pour beaucoup d'entre elles, à commencer par la tchèque. La première réponse à la « question tchèque », formulée par Jan Kollar (1793-1852), avait cherché le salut dans l'idée slave, conçue comme contrepoids à l'influence allemande. Frantiek Palacký (1798-1876) en défendait une seconde, qui pariait sur la fédéralisation accrue de l'Autriche-Hongrie. Le désenchantement de l'après-1867 rapprochera Palacký d'une forme de réalisme à l'égard de la Russie. Plus tard, Tomá Masaryk plaidera auprès de l'Entente et des Etats-Unis pour une autre voie, celle de la création d'États-nations souverains susceptibles de faire obstacle aux projets pangermanistes misant sur un « axe Berlin-Bagdad », qu'il estime être une cause essentielle de la première guerre mondiale6(*).
L'émergence des nationalités ne met en effet pas fin à l'idée que l'Europe centrale reste un objet géopolitique soumis aux rivalités des grandes puissances qui l'entourent. Tandis que la Russie cherche depuis le XVIIIe siècle à affirmer son rôle européen, la pensée politique et économique allemande jongle avec l'idée d'un super-État centre-européen sous domination allemande7(*). Friedrich List, économiste libéral et théoricien du protectionnisme, écrivait déjà en 1842 que « l'Allemagne possède, avec les pays du bas Danube et de la Mer noire, un hinterland analogue à celui dont disposent les Etats-Unis avec le Far-West »8(*).
La solution bismarckienne vers l'unité ayant exclu l'Autriche, c'est largement en son sein que se poursuivra la réflexion sur l'idée supranationale au service des minorités. Il est à cet égard intéressant d'observer que beaucoup des idées en vigueur dans l'Europe du XXIe siècle puisent dans celles de von Mises, Schumpeter, Popper ou Hayek, nés aux quatre coins de l'empire et ayant passé leur exil à méditer sur la chute de la monarchie autrichienne, les moyens de maintenir une « société ouverte » préservée de la puissance publique, et la nécessité pour ce faire de dissocier l'économie de la politique dans un ensemble fédéral9(*).
Mais en Allemagne, les conceptions d'une Mitteleuropa bâtie à son avantage ne disparurent pas non plus. En octobre 1915, le député Friedrich Naumann publie un livre qui rencontra un exceptionnel succès de librairie puisque 100 000 exemplaires en furent vendus en six mois, et qui n'est que l'expression alors la plus populaire d'un projet caressé par de nombreux courants politiques.
Friedrich Naumann et l'idée de Mitteleuropa
« Moderniste et nationaliste, Naumann acceptait les conditions créées par le capitalisme moderne. Soucieux de concurrencer les thèses socialistes [...] il réclamait un « Empire social », attentif au bien des milieux populaires. [...] Sa Mitteleuropa est imprégnée d'une idéologie darwiniste [...] De toute évidence, le peuple allemand est en ce début de XXe siècle sur une ligne ascendante. [...] On pourrait définir Friedrich Neumann comme un « impérialiste libéral ». [...]
Des arguments économiques justifiaient à ses yeux la création d'une [association économique] entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. A ces arguments s'ajoutaient le projet d'affirmer une grande puissance centre-européenne contre les Etats-Unis, l'URSS, les Empires britanniques et français. C'est un point commun à la plupart des auteurs mitteleuropäisch : l'exclusion de l'Angleterre et de la France, rejetés vers une « Europe occidentale », tandis que l'Allemagne se réserve le centre et l'est de l'Europe comme une chasse gardée. La nécessaire cohésion géopolitique obligeait les Allemands à « penser à l'autrichienne » le problème des nationalités dans l'espace danubien, mais il était clair aux yeux de Naumann que l'Allemagne devait jouer le rôle moteur [...]
Naumann pensait cette « fédération » mitteleuropéenne sur le modèle de la formation de l'unité du Reich bismarckien et ce mélange contradictoire de fédéralisme et d'impérialisme (limité, cette fois, à l'espace centre-européen) devait susciter autant de méfiance que d'enthousiasme parmi ses contemporains. Pour la gauche sociale-démocrate, le projet naumannien ne représentait qu'une atténuation des visées expansionnistes du haut commandement militaire. Pour les nationalistes tchèques et hongrois, la perspective d'un renforcement des structures « supranationales » contrôlées par l'Allemagne et l'Autriche était inacceptable. Quant aux pangermanistes, ils considéraient le projet de Naumann comme excessivement modeste. [...]
Ce « pli géopolitique » remonte au débat de la fin du XVIIIe siècle et de l'époque de la Révolution française, sur la question des « frontières naturelles ». Au départ, il s'agit d'un curieux « complexe d'infériorité » des géographes allemands qui cherchent à déterminer les frontières de leur nation. [...] L'Empire bismarckien ne met pas fin au débat géopolitique, bien au contraire : les frontières du nouveau Reich ne résultent, elles non plus, d'aucune évidente logique géographique. Les premiers géographes à faire la théorie de la Mitteleuropa voient en celle-ci l'ensemble « naturel » cohérent dans lequel serait inséré le Reich allemand. [...] Au fil des années et des publications de la géopolitique allemande, les frontières est du continent imaginaire appelé Mitteleuropa ont tendance à se boursoufler. Albrecht Penck, qui préférait parler d'Europe intermédiaire, incluait l'Ukraine, le « grenier à blé » de l'Europe centrale... L'exemple le plus célèbre est celui de Friedrich Ratzel [...], auteur d'un classique du genre appelé tout simplement Lebensraum. [...]
La première grande rencontre entre la géopolitique et la politique tout court eut lieu en 1914 avec la discussion sur les buts de guerre allemands, dont Friedrich Naumann fut le plus retentissant orateur [...] On ne peut que citer les analyses de Fritz Fischer, qui mettent en évidence l'expansionnisme impérialiste allemand comme l'une des causes majeures de la première guerre mondiale. Mais cet impérialisme se donnait une justification : l'Allemagne se présentait comme un pays « menacé », au premier chef par la Russie (et bientôt l'URSS), attaquant dans un mouvement de légitime défense. [...] On trouve chez Carl Schmitt, dans un texte de 1932, la formule frappante : « Nous vivons en Mitteleuropa sous l'oeil des Russes » ».
Source : Jacques Le Rider, La Mitteleuropa, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1994, chapitre 7.
La notion de Mitteleuropa n'est certainement pas confinée à l'histoire des idées puisque c'est encore le référentiel suggéré par le comité permanent des noms géographiques allemands depuis le milieu des années 2000. Les travaux de cet organisme scientifique indépendant, composé de scientifiques et de praticiens de la topographie, de la cartographie, de la géographie et de la linguistique allemands, autrichiens et suisses, publiés à la demande du ministère fédéral allemand des affaires étrangères puis des institutions européennes, ont tâché d'identifier les frontières culturelles internes de l'Europe. Sur la base, prioritairement, des zones de peuplement historique des Allemands et de diffusion de l'allemand comme langue de communication et d'éducation, ils circonscrivent une Europe centrale qui va, du Nord au Sud, des pays baltes au nord-est de l'Italie et à la Croatie, et d'Ouest en Est de la Lorraine à la Galicie ukrainienne10(*).
Divisions de l'Europe selon des critères culturels et géographiques d'après le comité permanent des noms géographiques allemands (2007)
Source : Ständigen Ausschuss für Geographische Namen (StAGN)
b) L'Europe centrale, une autre Europe ?
De bons auteurs, centre-européens eux-mêmes, ont cru pouvoir déceler dans cette histoire longue, qui peut se laisser ramener à l'histoire d'une difficulté à se constituer en États-nations, l'origine d'une culture politique particulière.
Prenant appui sur la période habsbourgeoise, l'historien hongrois Istvan Bibó note à la sortie de la Seconde guerre que « ces nations ne disposaient pas de certaines données élémentaires, banales chez les nations occidentales, comme l'existence d'un cadre national et étatique propre, d'une capitale, d'une cohésion politique et économique, d'une élite sociale homogène, etc. [...] Ainsi s'explique le trait le plus caractéristique de l'attitude psychique, du déséquilibre politique des peuples d'Europe centrale et orientale : la peur pour l'existence de la communauté. Un pouvoir d'État étranger, sans racines dans le pays, se présentant tantôt sous une forme civilisée, tantôt sous celle d'un oppresseur, a pesé à un moment ou à un autre, sur la vie de tous. Empereurs, tsars et sultans privaient ces pays de leurs meilleurs sujets, soit en offrant des possibilités de carrière aux plus talentueux, soit en envoyant en prison et à l'échafaud les plus irréductibles d'entre eux. La non-coïncidence des frontières historiques et ethniques ne tarda pas à dresser ces pays les uns contre les autres [...] Dynasties puis nations ont lutté en permanence pour l'âme de chaque sujet »11(*).
Bibó en tire des conclusions à caractère général sur le style politique des États d'Europe centrale et orientale, brutales dans leur formulation mais qu'il n'est pas inutile de conserver à l'esprit avant d'aborder la période contemporaine : « On admet généralement que l'Europe centrale et orientale, plus exactement le territoire s'étendant à l'est du Rhin, entre la France et la Russie, est caractérisé par l'état arriéré de la culture politique. Les rapports sociaux y sont antidémocratiques, les méthodes politiques brutales ; les nationalismes mesquins, étroits et violents, le pouvoir politique y est concentré entre les mains d'aristocrates, grands propriétaires terriens dont ces pays sont incapables de se débarrasser par leurs propres forces »12(*).
Cet état de fait a largement pour cause la peur pour la survie de la communauté, qui entretient une forme de fragilité du débat public, où dominent une classe spécifique d'intellectuels et un style que l'on qualifierait désormais de populiste : « dans ces régions prolifèrent les philosophies politiques les plus confuses, les mensonges politiques les plus gossiers [...] Mais [...] les demi-vérités des philosophies confuses n'ont prise que sur des individus et des communautés qui veulent bien y croire, car ils entretiennent leurs illusions, flattent leurs vains espoirs, perpétuent leurs fausses conceptions et assouvissent leurs passions [...] Les larges masses populaire ayant à l'égard de l'idée nationale une attitude assez passive, l'intelligentsia nationale déployait d'immenses efforts pour « apprendre » au peuple la « leçon » du nationalisme [...] Cette évolution a sécrété un type de politicien caractéristique de ces pays, celui du faux réaliste [...] Il en résulte aussi une certaine prééminence, par rapport à l'ouest, des souverains, aristocrates ou militaires, sur les juristes ou administrateurs, et d'autre part l'intelligentsia dite nationale se voit investie d'une mission spéciale. La culture, dans ces pays, revêt une importance politique exceptionnelle [...] mais ce qu'il en résulte, ce n'est pas l'épanouissement mais la politisation des activités culturelles »13(*).
À la suite de Bibó, et de Fernand Braudel, un autre historien hongrois, Jeno Szucs, a tenté de styliser les étapes de la construction historique de ce qu'il appelle « les trois Europe ». Selon lui, celle du centre se distingue par l'état des structures sociales - « en Hongrie, un homme sur vingt ou vingt-cinq était noble à la fin du Moyen-Âge tandis qu'en France un homme sur cent l'était ; à la même époque un homme sur quarante ou cinquante était citoyen libre en Hongrie alors qu'il y en avait un sur dix en France » - mais aussi par les rapports entre l'État et la société - « la cause de la communauté n'a pas eu comme à l'ouest partie liée avec la cause de la liberté », en sorte, que progressivement, « l'appropriation du pays par la communauté nationale ne s'accompagnait pas de la libération de l'individu »14(*).
Quoi qu'il en fut au juste, les procédures intentées par les institutions européennes contre la Pologne ou la Hongrie, qui seront décrites plus bas, la place de certains États centre-européens dans les classements relatifs au niveau de corruption, ou encore certaines politiques - hongroises notamment - relatives aux minorités nationales situées dans les pays voisins, trouvent peut-être un début d'explication dans cette plus difficile acclimatation du libéralisme politique, faute du terreau économique et social adéquat en temps utile, à l'est d'une ligne qui passe quelque part à la frontière orientale de l'Allemagne.
2. Au XXe siècle, une souveraineté encore sous contrôle
a) L'Europe centrale, rempart contre l'expansionnisme allemand
À la suite de la Première Guerre mondiale, l'« Europe centrale » perd sa signification puisque les « petites nations » se constituent enfin en États par la rencontre des efforts des élites nationales pour l'autodétermination et des projets franco-anglo-américains de réorganisation de l'Europe. Comme le souligne l'historien d'origine hongroise Henry Bogdan, « ce ne sont pas les peuples qui ont décidé de leur propre destin. C'est à Paris, à Londres, à Rome que leur sort a été réglé par les Grandes puissances en fonction de leurs intérêts politiques et économiques avec la complicité de certains de leurs chefs politiques ». « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui avait servi à légitimer aux yeux des populations la guerre que menait l'Entente, fut appliqué d'une façon singulièrement arbitraire »15(*).
Repoussée par Poincaré et le président Wilson en première intention, la destruction de l'Autriche-Hongrie fut finalement décidée sous l'impulsion de Clemenceau, Lloyd George et Wilson, qui pensaient ainsi priver l'Allemagne d'un allié naturel. Clemenceau invoqua à son soutien les principes démocratiques, en effet reconnus en janvier 1918 par le dixième des Quatorze points du président Wilson énoncés en janvier 1918 : « aux peuples d'Autriche-Hongrie, dont nous désirons voir sauvegarder et assurer la place parmi les nations, devra être accordée au plus tôt la possibilité d'un développement autonome ».
La France soutenait en particulier les efforts d'autodétermination des élites tchécoslovaques. Le conseil national tchécoslovaque avait en effet été créé en 1916 au 18 rue Bonaparte, à Paris, et avait élu Tomá Masaryk à sa tête. Son activité est alors intensément soutenue par des universitaires et des intellectuels comme Ernest Denis, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'Europe centrale, ou Louise Weiss, et le dessin des frontières dut beaucoup, à Versailles, au travail du géographe Emmanuel de Martonne. La France est le premier État à reconnaître le conseil national comme organe suprême du gouvernement tchécoslovaque, le 30 juin 1918, avant la proclamation officielle de l'indépendance du pays, le 28 octobre. Tomá Masaryk est élu président de la république lors de la première réunion de l'Assemblée nationale provisoire, le 14 novembre.
Le soutien français est également décisif au plan militaire. Masaryk avait été l'artisan de la création des légions tchécoslovaques, formées en Russie puis en France d'anciens prisonniers retournés par l'Entente contre l'Autriche-Hongrie. Le décret du 16 décembre 1917 pris par le président Poincaré fait en quelque sorte précéder l'existence de l'État tchécoslovaque par celle de son armée puisqu'il crée une « armée autonome » placée sous la « direction politique » du conseil national tchécoslovaque mais « reconnaissant au point de vue militaire l'autorité supérieure du haut commandement français ».
Cette coopération militaire est plus fructueuse encore après la guerre. L'armistice signée le 13 novembre 1918 entre les puissances alliées et la Hongrie n'ayant pas réglé la question de la délimitation des frontières, Edvard Bene demande en décembre l'envoi d'une mission d'organisation de l'armée du jeune État, qui est approuvé en janvier 1919 par Paris. Le chef de la mission militaire française à Prague, le général Maurice Pellé, devient chef d'état-major général de l'armée tchécoslovaque en mai 1919 et permet au pays de défendre ses nouveaux acquis dans le conflit qui éclate en avril avec la république des conseils de Hongrie de Bela Kun. La mission a pu constater sur place la vigueur du souvenir, dans la mémoire tchèque, du soutien français apporté à l'époque à la jeune nation.
Décret du 16 décembre 1917, publié au Journal officiel du 19 décembre, créant une armée tchéco-slovaque
Sur le rapport de MM. George Clemenceau, président du Conseil et ministre de la guerre, et Stephen Pichon, ministre des affaires étrangères :
« La France a toujours soutenu de tout son pouvoir les revendications nationales des Tchèques et des Slovaques. Le nombre de volontaires de ces nationalités, qui sont venus se ranger sous le drapeau français au moment de la déclaration de guerre, est important ; les vides produits dans leurs rangs prouvent, sans conteste, l'ardeur avec laquelle ils ont lutté contre nos ennemis. Certains gouvernements alliés, et en particulier le gouvernement provisoire russe, n'ont pas hésité à autoriser l'engagement sur notre front d'unités constituées au moyen d'éléments tchéco-slovaques échappés à l'oppression de l'adversaire. Il est juste de donner à ces nationalités les moyens de défendre sous leur drapeau, côte à côte avec nous, la cause du droit et de la liberté des peuples, et il sera conforme aux traditions françaises de concourir à l'organisation d'une armée tchéco-slovaque autonome. [...] »
Art. 1er. Les Tchéco-Slovaques, organisés en armée autonome et reconnaissant au point de vue militaire l'autorité supérieure du haut commandement français, combattront sous leur propre drapeau contre les empires centraux.
Art. 2. -- Cette armée nationale est placée au point de vue politique sous la direction du conseil national des pays tchèques et slovaques, dont le siège central se trouve à Paris.
Art. 3. - La mise sur pied de l'armée tchéco-slovaque, ainsi que son fonctionnement ultérieur, sont assurés par le Gouvernement français.
Art. 4. -- Les dispositions en vigueur dans l'armée française concernant l'organisation, la hiérarchie, l'administration et la justice militaire sont applicables à l'armée tchéco-slovaque.
Art. 5. - L'armée tchéco-slovaque autonome se recrute : 1° Parmi les Tchéco-Slovaques servant actuellement dans l'armée française ; 2° Parmi les Tchéco-slovaques d'autres provenances admis à passer dans l'armée tchéco-slovaque ou à contracter un engagement volontaire, pour la durée de la guerre, au titre de cette armée. [...]
Toujours est-il que cette union politique est artificielle, et placée dès son origine au service des intérêts stratégiques français. Artificielle, car Tchèques et Slovaques, même réunis sous la couronne autrichienne, avaient toujours vécus séparés. Il y avait certes communauté de destin, mais elle n'était évidente que pour le souverain et ses ministres, pas pour ses peuples16(*). La Tchéquie était en outre industrialisée et largement athée, tandis que la Slovaquie était rurale et profondément catholique.
Surtout, les populations n'avaient pas été consultées, or la Tchécoslovaquie comptait alors 40 % de minorités nationales, par ailleurs non représentées à l'Assemblée provisoire. L'ancien royaume de Bohême comptait deux tiers de Tchèques et un tiers d'Allemands, et la Slovaquie de nombreux Hongrois. Les Allemands de Bohême tentèrent en 1919 de faire sécession, sans succès, Bene invoquant à Versailles l'unité historique de la Bohême. Quant à la partie orientale du pays, « Bene réclama le territoire beaucoup plus étendu que le domaine géographique occupé par les Slovaques [...] pour des raisons à la fois économiques - il fallait que le nouvel État accède au Danube - et stratégiques - le maréchal Foch estimait que le Danube était une frontière facilement défendable »17(*). Le traité de Trianon avait en outre prévu un statut d'autonomie pour la Ruthénie subcarpatique peuplée de Ruthènes, mais rien ne fut fait en ce sens avant 1938.
La Pologne, objet du huitième des Quatorze points de Wilson et autre grand bénéficiaire des traités signés à Versailles et à Saint-Germain-en-Laye, présente les mêmes faiblesses. Ressuscitée dans un territoire plus vaste que la Pologne actuelle, mais moins grand que la république des Deux Nations, elle est multinationale et sa frontière à l'Est n'est pas fixée. La France lui apporte son soutien dans la guerre qu'elle déclenche contre l'URSS en avril 1920 - les officiers français comptent notamment dans leurs rangs le capitaine de Gaulle -, et à l'issue de laquelle elle s'agrandit très au-delà de la ligne proposée par Lord Curzon en décembre 1919. La France noue ensuite avec elle une alliance militaire en février 1921.
La stratégie française va de pair avec la création d'un réseau d'alliances à l'Est. Paris supervise la création de la « petite entente », alliance diplomatique et militaire signée en août 1920 et regroupant la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Cette première alliance est renforcée par la signature d'accords bilatéraux entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie en avril 1921, ente la Roumanie et la Yougoslavie en juin 1921, et entre la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie en août 1922, puis par des garanties accordées officiellement par la France à la Tchécoslovaquie en octobre 1925, à la Roumanie en juin 1926 et à la Yougoslavie en novembre 1927.
Le bilan de cette stratégie est toutefois décevant, notamment car la complexité des antagonismes entre ces nouveaux États, ainsi qu'entre eux et leurs voisins, est sous-estimée. Le contrôle de la ville de Teschen fait l'objet de la courte guerre polono-tchécoslovaque, sous les yeux des Alliés, en janvier 1919 ; les Tchécoslovaques freinent le transit d'armes en direction de la Pologne lors de la guerre polono-soviétique de 1919-1920 ; Prague et Varsovie se désolidarisent de Poincaré lors de l'occupation de la Ruhr en 1923 ; en 1933, alors que l'Allemagne s'est retirée de la conférence sur le désarmement, le Pacte à Quatre amorce l'abandon par Paris des principes de Versailles et provoque la conclusion de l'accord germano-polonais de janvier 1934, lequel fait ensuite échouer le projet de pacte oriental, ou « Locarno de l'est », pourtant soutenu par la Tchécoslovaquie ; en 1935, cette dernière s'allie comme la France à l'URSS, poussant la Pologne plus près de l'Allemagne ; en 1936 la remilitarisation de la Rhénanie détruit ce qui restait de stratégie française de soutien aux alliés de l'est ; en 1938 enfin, à Munich, la Pologne profita du dépeçage de la Tchécoslovaquie en récupérant la région de Teschen.
Quant à la Hongrie, isolée par la défaite des empires centraux puis par celle, à l'extérieur et à l'intérieur, de la république des conseils, elle n'eut d'autre choix que d'accepter le « diktat » de Trianon le 4 juin 1920, qui prive le pays de deux tiers de son territoire, de son accès à la mer, et d'une partie de sa population magyarophone, et dont les effets sont encore perceptibles de nos jours dans la mémoire nationale et dans la vie politique du pays.
La politique française de l'entre-deux-guerres à l'égard de l'Europe centrale évite difficilement la critique, qui dépasse d'ailleurs celle de l'attitude franco-britannique à Munich. Du point de vue de la mise en oeuvre de la stratégie fixée, la France a certainement manqué de fermeté, de discernement et d'effort de compréhension de ses partenaires, mais sa responsabilité propre dans l'échec du système est peut-être moindre qu'on ne pense souvent18(*). Elle n'avait, surtout, pas les moyens financiers, économiques, militaires de ses ambitions, et ne pouvait donc pas être un protecteur suffisamment efficace, même si l'état-major et les missions de défense prenaient très à coeur les engagements de sécurité de la France dans la région. Les partenaires étaient tout simplement trop divisés entre eux : à l'égard de l'Allemagne, de l'URSS, de la sécurité collective, de la Hongrie, de la Petite Entente elle-même. La garantie de sécurité offerte par la France était notoirement dépourvue de portée juridique et opérationnelle suffisante.
L'historien hongrois Istvan Bibo rejoignait cette analyse dès la fin de la guerre : « on sait avec quel cynisme le national-socialisme et le fascisme ont précipité l'Europe dans la catastrophe. Mais il n'est pas moins vrai qu'entre 1918 et 1933 d'importantes tentatives de réconciliation entre la France et l'Allemagne ont échoué à cause du veto de la Petite Entente, ce qui représentait en même temps une véritable perversion de l'idée régionale qui, pourtant, avait suscité beaucoup d'espoirs. Autre fait significatif : en 1938, au moment de la tragédie tchécoslovaque, la Pologne et la Hongrie, pourtant menacées par l'invasion allemande, ont été incapables de faire le moindre geste de solidarité à l'égard de leur voisin malheureux »19(*).
Mais cette politique a été durement jugée d'un point de vue stratégique également. Jacques Bainville est sans doute le premier des commentateurs de la paix de Versailles à y voir un cadeau fait à l'Allemagne dans la création de petits États influençables dans son pourtour. D'autres spécialistes contemporains de l'Europe centrale jugent négativement la destruction de l'Autriche-Hongrie, contrepoids naturels à l'Allemagne, la recomposition arbitraire de ses morceaux dans des ensembles mal conçus, et le maintien de frontières irréalistes, tous facteurs qui ont conduit, selon une ligne plus ou moins droite, à la domination allemande, à la tyrannie russe, puis à la prédominance américaine sur l'ensemble de l'Europe20(*).
Le politologue d'origine tchèque Jacques Rupnik, dialoguant avec l'historien d'origine hongroise François Fejtö, convenait en 2009 du caractère tragique de l'histoire de l'Europe centrale dans la première moitié du siècle dernier : « En tant qu'Européen, je partage le deuil de la disparition d'une Europe centrale comme pôle distinct de l'Occident et de la Russie ». « Rétrospectivement, je pense que cette Europe centrale d'États indépendants naquit dans une situation d'anomalie, c'est-à-dire dans une situation de vide géopolitique créé par la défaite des deux grands pôles qu'étaient la Russie révolutionnaire et l'Allemagne. Pendant quelques années, les puissances occidentales purent garantir l'existence de ces États-nations, mais, dès que la France, essentiellement, et la Grande-Bretagne cessèrent de porter un intérêt soutenu à ces pays, ils ne furent plus en mesure de garantir seuls leur indépendance »21(*).
Évolution territoriale de la Tchécoslovaquie à la fin des années 1930
Source : wikipedia.
Les accords de Munich du 30 septembre 1938, donc, préludent à la domination nazie de l'Europe centrale. Début octobre, Bene fuit le pays ; Mgr Tiso proclame l'autonomie de la Slovaquie et lui fait emprunter la voie du fascisme ; en mars 1939, le successeur de Bene consent à l'incorporation du « protectorat de Bohême-Moravie » au Reich allemand, et Tiso proclame l'indépendance de la Slovaquie sous la protection du Reich. La Pologne subit un quatrième partage en septembre, tandis que la Hongrie, qui s'est agrandie de la Ruthénie subcarpatique au détriment de la Slovaquie et du nord de la Transylvanie au détriment de la Roumanie, est entraînée dans la guerre contre l'URSS aux côtés du Reich.
L'Europe sous domination allemande en 1942
Source : Jean et André Sellier, 2014.
b) L'Europe centrale, rempart soviétique contre la puissance américaine
Après la victoire sur le nazisme, l'Europe centrale - et surtout, en son sein, la Tchécoslovaquie - fut à nouveau instrumentalisée en formant le principal objet de la rivalité entre les puissances américaine et soviétique22(*).
Alors que l'Europe centrale était pour les Américains une « terra incognita », ils considèrent au printemps 1944 que Tchécoslovaquie libérée du nazisme par l'armée rouge sera le véritable test de la capacité du système soviétique à coexister avec un système non soviétique. Les Etats-Unis soutiennent alors d'abord l'établissement d'une sphère d'influence soviétique ouverte - plutôt qu'exclusive - en Europe, qui leur semble alors propice à de bonnes relations avec Staline comme à la défense de leurs propres intérêts dans ces pays. Le fameux « accord des pourcentages » d'octobre 1944 entre Staline et Churchill n'invalide pas cette lecture de l'immédiat après-guerre : il ne porte que sur la Yougoslavie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Grèce et ne vise qu'à circonscrire la domination soviétique dans des proportions acceptables23(*).
Si la Tchécoslovaquie s'est toujours considérée comme occidentale, l'attitude des élites et de la population à l'égard de la Russie restait alors plutôt positive. L'américanophilie tchèque est certes massive dès le milieu du XXe siècle, en raison de la diaspora présente aux Etats-Unis - l'américano-tchèque Anton J. Cermak occupa la mairie de Chicago au début des années 1930 - de l'américanophilie des élites nationales - Masaryk était marié à une Américaine et s'est inspiré de la Déclaration de 1776 pour rédiger celle de son pays - et de l'attraction de la culture populaire américaine. Mais la méfiance des pères fondateurs de la Tchécoslovaquie se dirige alors encore davantage vers l'Allemagne que vers la Russie. Masaryk s'est opposé à toute intervention dans la guerre civile russe et a signé un accord d'assistance mutuelle soviéto-tchécoslovaque en 1935 ; Bene a imité Masaryk en signant un traité d'alliance avec l'URSS en 1943, Staline ayant été le premier à reconnaître son gouvernement en exil en juillet 1941 et à affirmer que la Tchécoslovaquie devait être rétablie comme État souverain.
La fin du modèle tchécoslovaque a lieu entre l'automne 1946 et février 1948. Les Etats-Unis prennent ombrage en 1947 de gestes jugés prosoviétiques des dirigeants tchécoslovaques et suspendent leur aide à Prague ; puis le plan Marshall vise explicitement à détacher, par la puissance économique américaine, les pays d'Europe centrale de l'URSS. À partir du Coup de Prague, en février 1948, les Etats-Unis mènent une politique offensive visant à mettre un terme à la domination soviétique en Europe centrale. À partir de juin 1950, le containment prend la tournure souhaitée par Paul Nitze, dont la doctrine l'emporte sur celle de George Kennan au sein du département d'État, visant à faire reculer hors d'Europe la puissance soviétique.
La Tchécoslovaquie devient à cette date le laboratoire des politiques que l'on dirait désormais hybrides, faites d'ingérence et de déstabilisation par tous moyens, d'abord américaines, puis soviétiques. Le « plan pour une guerre psychologique » américain de juillet 1950 donne ainsi lieu à la création de structures spécialisées, d'instruments de conquêtes des esprits tel Radio Free Europe ou encore les formations du Collège de l'Europe libre offertes aux jeunes réfugiés, et plus de 250 millions de tracts sont lancés sur toute l'Europe centrale en quelques années. Ces initiatives suscitent une intense contre-propagande soviétique antiaméricaine. « L'accusation la plus comique concerna l'envoi supposé en Tchécoslovaquie d'insectes nuisibles, notamment des doryphores de pommes de terre »24(*).
Suivront quarante ans de glaciation soviétique. L'URSS « considère en effet depuis octobre 1917 et surtout depuis l'agression allemande du 22 juin 1941 qu'elle se trouve sous la menace permanente des États capitalistes occidentaux. Il en résulte pour elle la nécessité impérieuse d'assurer sa sécurité le long de ses frontières occidentales »25(*) et donc de préserver le glacis de protection constitué grâce au pacte de Varsovie. L'URSS vise par ailleurs à « étendre à l'ensemble du monde et en premier lieu aux pays qui font partie de sa « zone de sécurité » le système politico-économique qu'elle s'est donné en 1917 »26(*). Les insurrections de Budapest en 1956, ou de Prague en 1968, seront durement réprimées par l'armée rouge.
Pendant la guerre froide, la France est alors quasiment absente des négociations relatives à l'Europe centrale et orientale, qui sont traitées par les deux nouveaux « Grands ». De Gaulle lance la « détente, entente, coopération » avec l'est en 1964, après le sentiment d'échec ressenti lors de la ratification par le Bundestag du traité de l'Élysée, que les députés allemands font précéder d'un préambule affaiblissant sa portée. L'Ostpolitik de Willy Brandt normalise les relations entre la RFA et les pays de l'Est également, mais la France y joue plus un rôle de témoin que d'acteur. La France se rapproche certes de la Pologne de Geremek et de la Roumanie de Ceaucescu dans la seconde moitié des années 1970, mais les résultats sont mitigés. La présence de la RFA dans la région, indépendamment de la nature des régimes, augmente, jusqu'en Albanie27(*). Le sommet franco-soviétique de Varsovie de mai 1980 reste sans suite.
Cette période voit ainsi renaître l'idée d'Europe centrale comme objet géopolitique. La cause des « nations captives » devient un thème de politique intérieure américaine dans la mobilisation de la société civile contre l'ennemi soviétique, sous Truman puis, surtout, sous Eisenhower, et sous l'impulsion du secrétaire d'État John Foster Dulles. La notion de Mitteleuropa reparut aussi dans le monde intellectuel à l'Ouest, d'abord sous la plume d'universitaires, tel Claudio Magris, dont la thèse sur la continuité du « mythe habsbourgeois » dans la littérature est publiée en 1963.
« L'ordre sanctionné par le pacte de Varsovie et par le Comecon transforme en réalité la hantise des peuples centre-européens depuis l'époque de Pierre le Grand : l'extension de l'Empire russe jusqu'aux pays slaves occidentaux et à l'est de l'Allemagne. Après cette seconde mort, l'idée d'Europe centrale était prête à renaître. Comme en 1848, le modèle germanique de Mitteleuropa allait être réhabilité par des intellectuels des pays slaves du Centre-Est. L'idée d'Europe centrale fut un mythe qui donnait courage aux exilés parisiens ou new-yorkais des tyrannies communistes, et aux intellectuels dissidents qui pouvaient se risquer à le formuler, un mythe vivant tant que se maintenait l'empire néo-stalinien »28(*).
L'article du romancier Milan Kundera, « l'Occident kidnappé », publié en 1983, est l'illustration la plus connue en France du retour de cet objet géopolitique, dont la consistance est toutefois contestée par l'auteur, qui affirme en quelque sorte l'occidentalité du Centre, au moins sur le plan culturel. La fortune contemporaine de ce texte subtil, réédité séparément par les éditions Gallimard en 2021, traduit dans de nombreuses langues et rapidement épuisé, a cependant quelque chose de paradoxal. Convoqué à présent, semble-t-il, pour attester de la prescience des petites nations centre-européennes, dont la défiance à l'égard de leur voisin russe s'appuie sur de compréhensibles motifs historiques, et des motifs prétendument naturels, l'article recèle pourtant une critique assez profonde de l'Europe que ces pays rejoindront vingt ans plus tard.
Milan Kundera - l'Occident kidnappé (novembre 1983, extraits)
« En 1956, au mois de septembre, le directeur de l'agence de presse de Hongrie, quelques minutes avant que son bureau fût écrasé par l'artillerie, envoya par télex dans le monde entier un message désespéré sur l'offensive russe, déclenchée le matin contre Budapest. La dépêche finit par ces mots : « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. » Que voulait dire cette phrase ? [...] Qu'est-ce que l'Europe pour un Hongrois, un Tchèque, un Polonais ? [...]
L'Europe géographique (celle qui va de l'Atlantique à l'Oural) fut toujours divisée en deux moitiés qui évoluaient séparément : l'une liée à l'ancienne Rome et à l'Église catholique (signe particulier : alphabet latin) ; l'autre ancrée dans Byzance et dans l'Église orthodoxe (signe particulier : alphabet cyrillique). Après 1945, la frontière entre ces deux Europes se déplaça de quelques centaines de kilomètres vers l'Ouest, et quelques nations qui s'étaient toujours considérées comme occidentales se réveillèrent un beau jour et constatèrent qu'elles se trouvaient à l'Est. Par suite, se sont formées après la guerre trois situations fondamentales en Europe : celle de l'Europe occidentale, celle de l'Europe orientale et celle, la plus compliquée, de cette partie de l'Europe située géographiquement au Centre, culturellement à l'Ouest et politiquement à l'Est. [...]
C'est à la frontière orientale de l'Occident que, mieux qu'ailleurs, on perçoit la Russie comme un Anti-Occident ; elle apparaît non seulement comme une des puissances européennes parmi d'autres mais comme une civilisation particulière, comme une autre civilisation. [...] C'est pourquoi l'Europe que j'appelle centrale ressent le changement de son destin après 1945 non seulement comme une catastrophe politique mais comme la mise en question de sa civilisation. Le sens profond de leur résistance, c'est la défense de leur identité ; ou, autrement dit : c'est la défense de leur occidentalité. [...]
Comment expliquer que cette face du drame soit restée quasi invisible ? [...] Les Polonais, les Tchèques, les Hongrois avaient eu une histoire mouvementée, fragmentée, et une tradition d'État moins forte et moins continue que celle des grands peuples européens. Coincées d'un côté par les Allemands, de l'autre côté par les Russes, ces nations, dans la lutte pour leur survie et pour leur langue, épuisèrent trop de forces. [...] L'Empire autrichien tenait une grande occasion de créer en Europe centrale un État fort. Hélas, les Autrichiens étaient divisés entre le nationalisme arrogant de la grande Allemagne et leur propre mission centre-européenne. [...] Et, pour tout dire, je vois enfin la faute de l'Europe centrale dans ce que j'appellerai l'« idéologie du monde slave ». [...]
Est-ce donc la faute de l'Europe centrale si l'Occident ne s'est même pas aperçu de sa disparition ? Pas entièrement. Au commencement de notre siècle, elle devint, malgré sa faiblesse politique, un grand centre de culture, peut-être le plus grand. [...] Car l'Europe centrale n'est pas un État, mais une culture ou un destin. [...] Ce qui définit et détermine l'ensemble centre-européen ne peut donc pas être les frontières politiques (qui sont inauthentiques, toujours imposées par des invasions, des conquêtes et des occupations) mais les grandes situations communes qui rassemblent des peuples, et les regroupent toujours différemment, dans des frontières imaginaires et toujours changeantes, à l'intérieur desquelles subsistent la même mémoire, la même expérience [...]
Aucune partie du monde n'a été aussi profondément marquée par le génie juif. Étrangers partout et partout chez eux, élevés au-dessus des querelles nationales, les Juifs étaient au xxe siècle le principal élément cosmopolite et intégrateur de l'Europe centrale, son ciment intellectuel, condensation de son esprit, créateur de son unité spirituelle. [...] c'est dans son destin que le sort centre-européen me semble se concentrer, se refléter, trouver son image symbolique. Qu'est-ce que l'Europe centrale ? La zone incertaine de petites nations entre la Russie et l'Allemagne. Je souligne les mots : petite nation. En effet, que sont-ils, les Juifs, sinon une petite nation, la petite nation par excellence ? [...] Mais qu'est-ce que la petite nation ? Je vous propose ma définition : la petite nation est celle dont l'existence peut être à n'importe quel moment mise en question, qui peut disparaître, et qui le sait. [...]
Voilà pourquoi dans cette région de petites nations qui « n'ont pas encore péri », la vulnérabilité de l'Europe, de toute l'Europe, fut visible plus clairement et plus tôt qu'ailleurs. [...] En ce sens-là, le destin de l'Europe centrale apparaît comme l'anticipation du destin européen en général, et sa culture prend d'emblée une énorme actualité. Il suffit de lire les plus grands romans centre-européens : dans Les Somnambules, de Broch, l'Histoire apparaît comme un processus de la dégradation des valeurs ; L'Homme sans qualités, de Musil, dépeint une société euphorique, qui ne sait pas que demain elle va disparaître ; dans Le Brave Soldat Chveik, de Hasek, la simulation de l'idiotie est la dernière possibilité de garder sa liberté ; les visions romanesques de Kafka nous parlent du monde sans mémoire, du monde après le temps historique. Toute la grande création centre-européenne, de notre siècle jusqu'à nos jours, pourrait être comprise comme une longue méditation sur la fin possible de l'humanité européenne. [...]
La disparition du foyer culturel centre-européen fut certainement un des plus grands événements du siècle pour toute la civilisation occidentale. [...] comment est-il possible qu'il soit resté inaperçu et innommé ? Ma réponse est simple : [...] parce que l'Europe ne ressent plus son unité comme unité culturelle. [...] Or, il me semble que dans notre siècle un autre changement arrive, aussi important que celui qui sépare l'époque médiévale des Temps modernes. De même que Dieu céda, jadis, sa place à la culture, la culture à son tour cède aujourd'hui la place. [...]
Mais à quoi et à qui ? Quel est le domaine où se réaliseront des valeurs suprêmes susceptibles d'unir l'Europe ? Les exploits techniques ? Le marché ? Les médias ? (Le grand poète sera-t-il remplacé par le grand journaliste ?) Ou bien la politique ? Mais laquelle ? [...] Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je crois seulement savoir que la culture a cédé sa place. [...]
En ce sens je voudrais souligner une circonstance significative : les révoltes centre-européennes n'étaient pas soutenues [...] par les médias. Elles étaient préparées, mises en oeuvre, réalisées par des romans, par la poésie, par le théâtre, par le cinéma, par l'historiographie, par des revues littéraires, par des spectacles comiques populaires, par des discussions philosophiques, c'est-à-dire par la culture. [...] C'est pourquoi, quand les Russes occupèrent la Tchécoslovaquie, la première conséquence en fut la destruction totale de la culture tchèque en tant que telle. [...] Si en France ou en Angleterre toutes les revues disparaissaient, personne ne s'en apercevrait, même pas leur éditeur. À Paris, même dans le milieu tout à fait cultivé, on discute pendant les dîners des émissions de télévision et non pas des revues. Car la culture a déjà cédé sa place. [...]
Par son système politique, l'Europe centrale est l'Est ; par son histoire culturelle, elle est Occident. Mais puisque l'Europe est en train de perdre le sens de sa propre identité culturelle, elle ne voit dans l'Europe centrale que son régime politique ; autrement dit : elle ne voit dans l'Europe centrale que l'Europe de l'Est. L'Europe centrale doit donc s'opposer non seulement à la force pesante de son grand voisin, mais aussi à la force immatérielle du temps qui, irréparablement, laisse derrière lui l'époque de la culture. [...]
Sa vraie tragédie n'est donc pas la Russie, mais l'Europe. L'Europe, cette Europe qui, pour le directeur de l'agence de presse de Hongrie, représentait une telle valeur qu'il était prêt à mourir pour elle, et qu'il mourut. Derrière le rideau de fer, il ne se doutait pas que les temps ont changé et qu'en Europe l'Europe n'est plus ressentie comme valeur. Il ne se doutait pas que la phrase qu'il envoya par télex au-delà des frontières de son plat pays avait l'air désuète et ne serait jamais comprise ».
La chute du Mur a d'abord eu lieu en Europe centrale. « Les gouvernements polonais et hongrois qui, dès 1988, avaient enclenché le processus de réformes radicales, ont inconsciemment ou non, été les véritables promoteurs de ce vent de révolte qui a soufflé à l'Est à partir de l'été 1989 »29(*). En république tchèque en revanche, ce sont les manifestations populaires qui sont à l'origine du recul du pouvoir aligné sur Moscou.
La France n'est pas restée inactive dans le soutien à la transition. Elle est ainsi à l'origine du programme Phare qui permet à la Communauté européenne d'accorder des aides non-remboursables à onze pays d'Europe centrale et orientale - l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie -, puis de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, créée le 29 mai 1990. Après le maigre bilan de la première conférence sur le pacte de stabilité en Europe de mai 1994, la France et l'Allemagne accueillent encore la Pologne dans le format original du « triangle de Weimar », créé lors de la rencontre des ministres des affaires étrangères français, allemand et polonais à Weimar en 1991, format qui fait bénéficier la relation germano-polonaise de l'expérience de réconciliation franco-allemande.
Mais c'est avec l'Allemagne que les relations sont dès cette période plus immédiatement renforcées au plan économique. Avant même la libéralisation des flux de capitaux, le régime du perfectionnement passif, facilité par le droit européen en 198630(*), permet en moins d'une décennie d'intégrer un vaste pan des économies d'Europe centrale voisins de l'Allemagne dans ses chaînes de valeur. « En 1996, les sociétés rhénanes réimportent vingt-sept fois plus (en valeur) de produits perfectionnés en Pologne, République tchèque, Hongrie ou Slovaquie que les entreprises françaises »31(*).
Puis, « de 1991 à 1999, les flux d'investissements directs à l'étrangers allemands vers les pays d'Europe de l'Est sont multipliés par vingt-trois. Au début des années 2000, l'Allemagne réalise à elle seule plus du tiers des IDE effectués dans les pays du groupe de Visegrád et étend son emprise capitalistique en Slovénie, Croatie et Roumanie »32(*). Le travail y est moins onéreux et la menace de délocalisations dans son voisinage immédiat sert à modérer les hausses de salaire en Allemagne même.
Extension de la puissance commerciale allemande en Europe centrale
Source : Cécile Marin, Le Monde diplomatique, op. cit., 2018.
Dès cette époque apparaît la nécessité d'« une véritable politique française à l'Est afin que les peuples concernés n'attribuent pas tous les mérites à nos amis, alliés et néanmoins concurrents d'outre-Rhin qui oeuvrent dans ce sens avec efficacité »33(*).
B. UNE « UNIFICATION DE L'EUROPE » EN TROMPE-L'oeIL
Comme l'observait Jacques Rupnik en 2017, « l'intégration dans l'Union européenne en 2004 a été célébrée comme une unification de l'Europe, avant que l'on découvre qu'elle était divisée et que l'intégration européenne elle-même était menacée »34(*).
1. Une unification subordonnée à la protection de l'Otan
La « réunification »35(*) de l'Europe n'eut rien de naturel ou de linéaire. La première conséquence du dégel du glacis soviétique a d'ailleurs été non l'union spontanée de peuples à nouveau libres mais la reprise du processus de décomposition de l'Autriche-Hongrie par la séparation des Tchèques et des Slovaques. Les troupes soviétiques ayant achevé leur retrait du pays, les composantes tchèque et slovaque du pays décidèrent de se séparer au cours de l'année 1992, à l'unanimité des partis. Aucune force ne s'opposant à la séparation de peuples qui ne voulaient plus vivre ensemble, la séparation fut effective le 31 décembre 1992 à minuit.
La deuxième conséquence de la liberté recouvrée fut, pour les Centre-européens, la recherche d'un protecteur extérieur autre que soviétique et donc, faute de défense proprement européenne, l'élargissement de l'Otan. Le groupe de Visegrád est créé en février 1991 afin de coordonner les efforts de réintégration occidentale. Le sommet de l'Otan de Rome de novembre 1991 invite les ministres des pays d'Europe centrale et orientale à joindre leurs efforts pour renforcer le partenariat avec l'Organisation. Le président Clinton enfin, après avoir tenté de ménager les souhaits d'intégration des jeunes démocraties et les craintes russes à ce sujet en lançant la solution intermédiaire d'un Partenariat pour la paix, annonce en janvier 1994 que l'Otan s'élargira bel et bien. Quelques commentateurs de l'époque, et quelques historiens depuis, ont souligné le rôle important dans cette décision des diasporas polonaise, tchèque et hongroise aux Etats-Unis, concentrée dans les swing states du nord du pays36(*).
Le dossier est promptement pris en charge par la secrétaire d'État d'origine tchèque Madeleine Albright début 1997. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque, officiellement invitées en juillet 1997, adhèrent donc à l'Otan en mars 1999 au grand dam des autorités russes, Boris Eltsine ayant bruyamment exprimé son inquiétude en décembre 1994. Elles sont suivies par la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, invités en mars 1999 et devenus officiellement membres en juin 2004. Suivront, en Europe centrale et orientale, la Croatie et l'Albanie en 2009, le Monténégro en 2017, et la Macédoine du nord en 2020.
Que l'intégration des États centraux dans l'espace euro-atlantique ait été jugée nécessaire au service des intérêts américains, on n'en doutera pas en lisant les doctrines stratégiques américaines les plus classiques. Pour Zbigniew Brzezinski par exemple, l'élargissement de l'Union européenne, de l'Otan et le leadership allemand sur l'Europe centrale grâce à la protection américaine font système : « si le processus d'unification et d'élargissement de l'Europe devait s'arrêter, de bonnes raisons incitent à penser qu'une version plus nationaliste du concept d' « ordre » européen apparaîtrait alors en Allemagne, au détriment peut-être de la stabilité du continent [...] l'Allemagne n'exercerait plus seulement une prépondérance économique sur la Mitteleuropa, mais aussi une primauté politique explicite [...] L'Europe cesserait alors d'être la tête de pont de la puissance américaine et le tremplin pour l'expansion en Eurasie du système démocratique mondial »37(*). Le système de Brzezinski suppose encore une Russie privée des moyens de préserver son empire eurasien - le maintien de l'Ukraine dans son giron étant le principal d'entre eux - et imagine en conséquence, au soutien d'une Europe formant la tête de pont de la puissance américaine, une « colonne vertébrale géostratégique »38(*) franco-germano-polono-ukrainienne. Faire de l'Europe un « partenaire global » des Etats-Unis est une conception alors répandue, conçue de manière plus ou moins entreprenante39(*).
Les difficultés anticipées de la transition n'ont pas poussé les Européens à la précipitation dans l'élargissement de l'Union. Dans son allocution du Nouvel An 1989, le président Mitterrand proposait d'abord la création, sur la base des Accords d'Helsinki, d'« une organisation commune et permanente d'échanges, de paix et de sécurité ». Le président Vaclav Havel s'y opposa, de crainte de retarder l'accession des pays d'Europe centrale à l'Union comme membres de plein droit, et de distancier l'Europe des Etats-Unis.
L'élargissement de l'Otan en Europe
En France, la crainte que le centre de gravité de l'Union ne se déplace loin de Paris, Bonn ou Berlin n'est pas dissimulée40(*). Cet attentisme persiste sous le mandat de Jacques Chirac, et le peu d'enthousiasme de la classe politique dans son ensemble, qui voit dans l'élargissement une regrettable primauté du libre-échange sur l'approfondissement politique, ou qui privilégie des projets politiques méditerranéens, se retrouve dans les études d'opinion : un Eurobaromètre d'avril-mai 2001 révèle que seuls 35 % des Français interrogés approuvent l'élargissement à l'Est, tandis que 47 % y sont opposés - contre respectivement 43 % pour et 35 % contre dans le reste de l'Union.
La crainte du déséquilibrage des conceptions géopolitiques de l'Union du fait de son élargissement trouve d'ailleurs immédiatement à s'illustrer. Deux semaines après le sommet de Copenhague de décembre 2002, où fut prise la décision d'intégrer dix nouveaux membres à l'Union européenne, la Pologne fit connaître son choix, pour sa flotte de chasseurs, de F-16 américains plutôt que de Mirage français. Puis, le 17 février 2003, le président Chirac s'en prenait aux pays « qui ont perdu une bonne occasion de se taire » en choisissant de signer la « lettre des huit » appelant à se ranger derrière les Etats-Unis dans la guerre en Irak - dont la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie -, ainsi qu'aux dix pays de l'Europe ex-communiste du « groupe de Vilnius », qui avaient fait de même. L'antériorité de l'adhésion à l'Otan servit dès alors à amenuiser les ambitions d'une politique de défense proprement européenne.
L'élargissement de l'Union a finalement lieu le 1er mai 2004, avec l'entrée de dix nouveaux membres, lesquels sont restés depuis de fervents soutiens à la poursuite de l'élargissement - toujours précédé par une adhésion à l'Otan - afin de consolider leur appartenance à l'ensemble et de transmettre à d'autres la responsabilité de garder les marches de l'Union. Les pays d'Europe centrale « ont eu tendance à projeter sur eux l'image de leur propre identité historique d'« Occident kidnappé ». La principale politique de l'Union européenne à l'égard de la région, le Partenariat oriental, fut avant tout conçue et inspirée par la Pologne, et lancée sous la présidence tchèque en 2009 »41(*).
Le jugement porté sur le bilan de l'élargissement est resté généralement positif dans un premier temps, tant sur le plan politique et institutionnel que sur le plan macroéconomique. Les pays d'Europe centrale et orientale ont en effet connu une croissance relativement forte, et leur niveau de vie, qui ne représentait que 15 % de la moyenne de l'Union en 1993, atteint 35 % en 2008, tandis que le chômage y recule de façon sensible, notamment en Pologne. En juillet 2006, le politologue Jacques Rupnik pouvait ainsi écrire que « jamais dans leur histoire moderne les peuples d'Europe centrale n'ont connu une telle avancée de la démocratie, une telle prospérité et un environnement géopolitique aussi favorable à leur sécurité. La Russie est depuis près de deux décennies affaiblie et ne peut directement peser sur leurs destins, l'Allemagne est intégrée au monde des démocraties occidentales, enfin l'Union européenne fournit à l'Europe du Centre-Est un point d'ancrage et un levier modernisateur sans équivalent »42(*).
2. L'intégration contrariée : « l'épuisement du cycle libéral »43(*)
La première fausse note dans l'hymne à la réunification du continent fut émise au sein des partis proeuropéens des nouveaux membres eux-mêmes. Les gouvernements polonais, tchèque, slovaque et slovène ont en effet chuté immédiatement pour céder la place à des mouvements plus ou moins populistes et eurocritiques. « En Pologne, ce fut ROAD, coalition issue de Solidarité, puis l'Union de la liberté de Geremek ; en République tchèque, le Mouvement civique (issu du Forum civique) échoua aux portes du Parlement avec 4,9 % des voix aux élections de juin 1992 ; en Hongrie, c'est l'Alliance des démocrates libres (SDSz), parti libéral fondé par Janos Kis qui, après sa participation au gouvernement avec les socialistes dans les années 1990, s'est lentement éteint »44(*).
Les taux de participation à leurs premières élections européennes, en 2004, n'ont pas dépassé les 28 % atteints en République tchèque. Réunis à Prague en juin 2005, les pays du groupe de Visegrád ont convergé vers un « euroscepticisme soft », symptôme, selon Jacques Rupnik, d'une forme de décompression après les efforts exigés par l'entrée dans l'Union. Le seul parti libéral fondé par d'anciens dissidents et ayant réussi à s'implanter durablement est le Fidesz de Viktor Orbán, mais au prix de sa transformation en une forme désormais exemplaire d'illibéralisme centre-européen.
Ce courant politique devenu plus significatif après la crise de 2008, au cours des années 2010, est souvent ramené à deux grandes caractéristiques. D'une part, une hostilité à certaines formes garantissant l'État de droit, et la promotion d'une volonté collective moins filtrée. L'ennemi est, selon la formule de Jaroslaw Kaczynski, l'« impossibilisme légal »45(*). Le parti Fidesz de Viktor Orban en Hongrie en a été le précurseur, qui a mis en cause la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et des médias, avant de servir de modèle à la Pologne après la victoire du parti Droit et Justice en 2015. L'autre grande caractéristique de l'illibéralisme centre-européen est la légitimation par le renchérissement patriotique et le dépassement des clivages partisans, qui conduit ces partis attrape-tout à mêler, selon des dosages variables, critique des élites, traditionalisme, localisme, conservatisme sociétal, critique de la supranationalité, promotion d'un nouveau roman national plus ou moins révisionniste. Sont souvent versés dans cette catégorie le parti Droit et Justice, ou PiS, polonais, le parti SMER-SD de Robert Fico en Slovaquie, l'Union démocratique croate en Croatie, le parti AUR en Roumanie, ou encore, dans une moindre mesure, le parti ANO en République tchèque.
La première explication du succès de l'illibéralisme centre-européen tient à l'émergence d'une nouvelle peur pour l'existence de la nation. Au-delà de l'héritage historique, un tel sentiment s'appuie sur une réalité démographique : les taux de fécondité étaient compris entre 2,27 et 2,43 enfants par femme en Pologne, en Hongrie et en Tchécoslovaquie dans les années 1980 ; ils sont tombés en 2011 à 1,43 en République tchèque, 1,33 en Pologne et 1,25 en Hongrie, et ne se sont redressés depuis que faiblement et temporairement. À cela s'ajoute un exode de la population jeune et instruite, certes moins massif au centre qu'à l'est de l'Europe, mais qui a contribué à la diminution nette de la population hongroise ou polonaise totale, et qui ne peut ne pas alimenter d'angoisses identitaires.
Taux de fécondité en Europe centrale
Source : Eurostat ; pour 2024 : offices statistiques nationaux respectifs.
Une deuxième catégorie d'explications est d'ordre géopolitique. L'intégration de l'Union aurait été synonyme « d'une difficulté à s'affirmer face aux « grands », donnant le sentiment de ne pas être « traités à leur juste valeur » et de se retrouver une nouvelle fois relégués à la périphérie de l'Europe, position dont ils ont cherché à sortir depuis le XIXe siècle »46(*). Ce sentiment nourrit l'atlantisme, les Américains ayant été les plus prompts à rechercher le soutien de ce que Donald Rumsfeld appelait la « nouvelle Europe » quand l'ancienne lui refusait son soutien en Irak, et alimente une certaine défiance à l'égard des États membres occidentaux longtemps plus soucieux de subordonner la politique de voisinage de l'Union à la relation euro-russe, quand leur expérience historique commandait de faire l'inverse. Depuis 2014, l'expansionnisme de la Russie, les tensions internationales et l'accroissement des menaces hybrides ont sans doute beaucoup fait encore pour les mouvements qui se font fort de mieux protéger la communauté nationale.
Les procédures européennes à l'encontre de la Hongrie et de la Pologne pour méconnaissance de l'État de droit
• Les procédures politiques
En janvier 2016, la Commission européenne a mis en oeuvre pour la première fois son nouveau cadre pour l'État de droit à vocation précontentieuse à l'encontre de la Pologne, consistant à solliciter un dialogue sur la réforme de la justice et la loi concernant la radio et la télévision publiques. Puis, faute de progrès, elle a adopté plusieurs recommandations, en juillet et décembre 2016, et en juillet 2017.
Le Parlement européen, pour sa part, a adopté des résolutions en avril 2016, septembre 2016 et novembre 2017 sur la législation relative à la criminalisation des enseignements sur la sexualité aux mineurs, les discours discriminatoires à l'égard des personnes LGBTI, et la législation restreignant le droit à l'avortement.
Outre ces procédures précontentieuses a également été emprunté le terrain de l'article 7 du TUE. Selon son volet préventif (article 7 § 1), la Commission, le Parlement européen ou un tiers des États membres peut inviter le Conseil, statuant à la majorité des 4/5 et après approbation du Parlement européen, à constater l'existence d'un « risque clair de violation grave » de l'État de droit. Le volet répressif (article 7 § 2) ne peut être déclenché qu'en cas de constatation de « l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2 », par décision unanime du Conseil européen, à l'exception de l'État visé. Le Conseil peut alors décider, à la majorité qualifiée, de suspendre certains droits de l'État.
Le 20 décembre 2017, la Commission a proposé au Conseil, sur le fondement de l'article 7 § 1 du TUE, de constater l'existence d'un risque clair de violation grave par la Pologne de l'État de droit constitué par les réformes du système judiciaire polonais. À l'issue d'une série de sept résolutions votées entre 2011 et 2017 sur la législation hongroise sur les médias, la révision de la Constitution, l'indépendance de la justice, le statut de la banque nationale, ou encore la législation électorale, le Parlement européen a déclenché la procédure de l'article 7 § 1 TUE contre la Hongrie le 12 septembre 2018. Le Conseil n'a statué dans aucun de ces cas.
• Les procédures budgétaires
Le règlement 2020/2092 du 16 décembre 2020 a précisé la décision du Conseil européen des 17-21 juillet 2020 en soumettant l'exécution du budget de l'Union et du plan de relance au respect de l'État de droit et des valeurs de l'Union. Cette procédure a été déclenchée pour la première fois par la Commission européenne à l'encontre de la Hongrie le 27 avril 2022, trois semaines après la réélection de Viktor Orbán. En décembre 2022, le Conseil a gelé 6,3 milliards d'euros et finalement privé Budapest d'environ 1 milliard d'euros de crédits budgétaires en 2024. Budapest n'a par ailleurs touché qu'une petite partie du plan de relance.
• Les procédures d'infraction face à la justice européenne
La Commission a également ouvert des procédures d'infraction contre la Hongrie et la Pologne pour « atteintes aux valeurs fondamentales de l'Union européenne » le 15 juillet 2021, et un procès s'est ouvert devant la Cour de justice de l'UE le 19 novembre 2024. La Commission a lancé une autre procédure d'infraction contre la Hongrie le 7 février 2024, et saisi la CJUE le 3 octobre 2024, pour contester la conformité au droit européen de la loi hongroise qui instaure une autorité de surveillance visant à prévenir les « interférences étrangères » dans le processus électoral.
Les effets matériels de l'élargissement sont une autre catégorie d'explications à la divergence des attitudes à l'égard du consensus libéral de l'Union. Certains économistes ont proposé d'appliquer aux économies des pays d'Europe centrale et orientale la notion de « capitalismes dépendants »47(*). Celle-ci désigne la tendance à dépendre, dans des proportions variables - certes plus élevées à l'est qu'au centre - des exportations, des investissements étrangers - la domination du capital allemand dans l'économie tchèque lui vaut encore aujourd'hui le surnom de « 17e Land allemand » -, des financements de banques étrangères, des transferts issus des migrations, ou encore des fonds structurels européens. Ce pli de l'économie, pris de plus ou moins bon gré dès la décennie 1990, contraint souvent les gouvernements à surenchérir dans les politiques d'attractivité par le levier fiscal ou l'assouplissement du marché du travail. La crise de 2008 a certes freiné certaines de ces tendances, mais a aussi aggravé les dépendances institutionnelles de certains États, contraints de faire appel au FMI - la Hongrie, ainsi -, et a donc apporté du carburant à la critique des ingérences étrangères.
Les illibéraux appellent en réponse à prioriser l'accumulation de capital domestique, à chercher de nouvelles sources de croissance internes, ou encore à un retour de l'État plus protecteur, politiques qui voisinent avec le conservatisme sociétal. En mars 2006, Jarosaw Kaczyñski s'en prenait déjà au « lumpenlibéralisme » provoquant les pires « pathologies sociales » comme la criminalité, la corruption et le relâchement moral. De même, Viktor Orban vante l'illibéralisme par opposition au système « qui se solde toujours par la victoire du plus fort sur le plus faible », et promeut avec « l'idéologie nationale-chrétienne »48(*) une responsabilité première envers sa communauté de proximité, qui inspire en partie des politiques natalistes et de préférence nationale.
Il n'est en tout cas pas anodin que la majorité des États du groupe de Visegrád - la Pologne, la Hongrie et la République tchèque - ait reporté sine die la perspective de leur adhésion à la zone euro afin de ne pas amoindrir encore leur souveraineté économique. Le président tchèque Petr Pavel a tenté, sans succès, de relancer le débat en 2024. Les inquiétudes des citoyens tchèques mesurées par les sondages sont autant économiques que politiques : 60 % des sondés craignent une hausse des prix, 45 % redoutent une perte de contrôle de la politique économique nationale et 57 % une érosion de l'identité nationale.
Au carrefour de ces explications, la crise migratoire du milieu des années 2010 a été un puissant catalyseur des mouvements national-populistes en Europe centrale. Terres d'émigration depuis le XIXe siècle, tendance prolongée par l'intégration, et ayant traversé une douloureuse phase d'épuration pendant et après la seconde guerre mondiale, ces pays vivent très mal les soubresauts migratoires et la prétention de Bruxelles à imposer un modèle libéral et multiculturel considéré comme insoucieux des préoccupations nationales. Aux discours universalisants de la chancelière allemande Angela Merkel ont ainsi répondu ceux de Viktor Orban en défense de la civilisation européenne.
Il est vrai que ces tendances ne sont nullement propres au centre de l'Europe49(*). Il reste que l'histoire particulière de l'espace centre-européen rend ses peuples plus sensibles aux mutations contemporaines de l'économie et de la société, jusqu'à faire dire par exemple à Viktor Orban que « les élites européennes, les décideurs politiques, les personnes qui dirigent les médias s'imaginent que le développement de l'humanité passe par la liquidation de nos identités, qu'il n'est pas moderne d'être Polonais, Tchèque ou Hongrois, qu'il n'est pas moderne d'être chrétien. Une nouvelle identité est apparue à la place, celle d'Européen... Les Britanniques ont dit “non”. Ils ont voulu rester Britanniques. [...] L'identité européenne n'existe pas, il y a des Polonais et des Hongrois »50(*).
II. DES DOCTRINES STRATÉGIQUES FORCÉMENT AMBIVALENTES, QUI RENDENT LA CONVERGENCE DES VUES TOUJOURS PLUS DÉLICATE
Les États d'Europe centrale sont replacés depuis l'agression russe de l'Ukraine et le retour au pouvoir de Donald Trump dans un certain inconfort que traduisent leurs divergences de vues, lesquelles ne facilitent pas la promotion par la France d'un consensus européen au service de ses intérêts.
A. LA RECHERCHE D'UNITÉ POLITIQUE À L'HEURE DU RETOUR DES MENACES
L'hétérogénéité des vues stratégiques en Europe centrale, qui s'explique largement par l'histoire et les caractéristiques géographiques propres de chaque État, complique assurément la recherche d'unité politique en Europe.
1. Le monde vu d'Europe centrale : des tiraillements contraires
a) Entre protection américaine et autonomie stratégique européenne
« Le maintien d'un lien transatlantique fort et fonctionnel demeure l'une des priorités cardinales de la politique extérieure des États d'Europe centrale »51(*). D'une part car le maintien d'une présence stratégique américaine en Europe est vu comme une garantie pour la sécurité nationale autant que comme un facteur d'équilibre régional, « une échappatoire au dilemme historique de l'entre-deux géopolitique Allemagne-Russie », d'autre part en raison de l'adhésion des élites politiques de la région au modèle économique et social des Etats-Unis.
Le politologue David Cadier y ajoute un facteur sociologique : « à l'heure où ces pays cherchaient à rétablir leur identité européenne et à s'ancrer institutionnellement à l'ouest, la voie vers la Communauté économique européenne (CEE) leur fut barrée par plusieurs capitales (dont Paris), quand Washington leur ouvrait les portes de l'Alliance atlantique. De fait, la période des années 1980 et 1990 a été déterminante dans la socialisation des élites de politique étrangère centre-européennes à une grille atlantiste : les anciens dissidents reçurent l'appui moral et financier des organismes américains de soutien à la démocratisation et les élites stratégiques travaillèrent alors en étroite collaboration avec des conseillers politiques et militaires dépêchés par Washington »52(*).
Ce motif admet toutefois des variations, illustrées par exemple par les cas tchèque et polonais, que David Cadier appelle respectivement l'atlantisme normatif et l'atlantisme stratégique. L'atlantisme tchèque est devenu plus marqué dans les élites politiques après 2004. « Ce courant fut à l'origine de la participation de la République tchèque au plan de troisième site du bouclier antimissile américain, plan conçu par l'administration Bush et qui prévoyait l'installation d'une station radar en Bohème et de dix missiles intercepteurs en Pologne. Contrairement à cette dernière, le gouvernement tchèque n'exigea quasiment rien en retour de son implication dans un projet auquel l'opinion publique était pourtant très largement opposée »53(*). L'annulation du projet par le président Obama en septembre 2009 et sa politique de reset avec la Russie ont été mal vécue à Prague, ce qui a motivé la rédaction, en juillet 2009, de la « lettre ouverte fracassante »54(*) cosignée par d'autres responsables centre et est-européens, dont d'anciens présidents polonais et lituaniens, regrettant que « les pays d'Europe centrale et orientale ne se trouvent plus au coeur de la politique étrangère américaine »55(*).
Aujourd'hui, la Tchéquie joue un rôle important dans la présence avancée rehaussée de l'Otan. Elle est à la tête d'un groupement tactique basé en Slovaquie et contribue à plusieurs groupements tactiques stationnés en Lettonie et en Lituanie. Elle a également déployé plusieurs chasseurs Gripen en Lituanie dans le cadre de la mission de police du ciel de l'OTAN. Enfin, la République tchèque participe à la mission KFOR au Kosovo et à la mission de formation de l'Alliance en Irak.
L'atlantisme polonais semble à David Cadier plus stratégique. Déçue d'être peu payée de ses efforts en termes de contrats en Irak ou de facilités d'obtention de visas, la Pologne se serait orientée au milieu des années 2000 vers une attitude plus transactionnelle à l'égard de Washington et plus utilitariste d'une manière générale. En témoigne la demande de contreparties au projet de bouclier antimissiles si fortes que les négociations demeurèrent longtemps gelées, et le renforcement de sa position au sein de l'Union européenne par anticipation du retrait progressif américain du continent.
L'atlantisme hongrois ou slovaque peuvent encore emprunter à diverses justifications : idéologiques, lorsque l'invocation des valeurs traditionnelles et chrétiennes, ou le réalisme géopolitique, convergent avec la critique du libéralisme européen ; ou économiques, lorsque la dépendance commerciale au marché automobile américain - dans le cas slovaque notamment - doit nécessairement pousser à la conciliation.
La politique d'acquisition de matériel de défense témoigne partout de cette priorité accordée à l'allié américain. La Slovaquie a signé en 2018 un contrat pour l'achat de 14 appareils F-16, dont elle a reçu les deux premiers en juillet 2024. La Pologne a commandé 32 chasseurs F-35 en janvier 2020 et envisage de compléter ses forces aériennes par l'acquisition d'appareils F-15 EX pour remplacer ses MiG-29. La République tchèque a à son tour signé un contrat majeur avec les Etats-Unis en janvier 2024 pour l'achat de 24 avions F-35, afin de remplacer sa flotte de Gripen suédois.
La guerre en Ukraine a en outre fait bénéficier la Hongrie et la Slovaquie du renforcement de la présence de l'Otan sur leur territoire. La Hongrie abrite 800 militaires, et la Slovaquie pourrait héberger jusqu'à 2100 soldats des groupements tactiques multinationaux créés en 2016 et renforcés depuis 2022. La Slovaquie dispose en outre d'une batterie de défense anti-aérienne Patriot, et la République tchèque, la Pologne et la Hongrie contribuent à la protection de son espace aérien.
Par voie de conséquence, les notions d'autonomie stratégique et de souveraineté européennes en matière de défense font historiquement office de tabous, surtout en République tchèque, ainsi que la mission a pu le constater sur place. Même si le pays s'est engagé dans l'Europe de la défense en s'associant à certains dispositifs - coopération structurée permanente, fonds européen de défense, mission EUTM Mali, dont elle a assuré le commandement au second semestre 2022 -, l'idée du remplacement de la protection américaine par une défense proprement européenne reste un repoussoir absolu.
Certains propos exprimés par les responsables tchèques depuis le retour au pouvoir de Donald Trump témoignent certes d'une inflexion : le Premier ministre Fiala a ainsi décrit la « fin » d'un ordre international, et a indiqué que l'objectif premier était désormais une Europe forte, tandis que le président Pavel, ancien président du comité militaire de l'Otan, a appelé l'Europe à « tenir sur ses propres jambes » et à renforcer le « pilier européen de l'Otan ». Il est cependant trop tôt pour avancer que la politique du président Trump aura un impact significatif sur les orientations stratégiques du pays.
La nouvelle administration américaine n'a fait pour l'heure que pousser les centre-européens à confirmer leurs engagements à dépenser plus pour la défense, puisque tous ont endossé l'objectif de 5 % du PIB consacré à ce poste fixé par la nouvelle administration américaine, et adopté au sommet de l'Otan de La Haye, en juin 2025. Le président tchèque Petr Pavel a fortement soutenu cet objectif ; si le Premier ministre slovaque Robert Fico l'a qualifié d'« absurde » et a de nouveau brandi l'hypothèse d'une neutralité slovaque56(*), le président Peter Pellegrini, issu du parti HLAS-SD créé par scission d'avec le SMER-SD, a signé la déclaration finale du sommet. La préoccupation des dirigeants tchèques ou slovaques face aux changements de position des États-Unis ne les empêche pas de maintenir le dialogue, tout en estimant que l'Union doit faire preuve d'initiative.
b) Entre Europe et Russie
Les attitudes des pays du groupe de Visegrád à l'égard de la Russie sont plus hétérogènes, et il peut s'avérer périlleux de les interpréter sans un minimum de recul historique. Selon un sondage de 2021 de l'institut slovaque Globsec, la majorité des centre-européens - 56 % - ne se sentaient alors pas menacés par la Russie ; seuls 25 % en moyenne en étaient convaincus, soit une proportion deux fois inférieure à celle... des Américains. Dans le détail, si 20 % des Polonais seulement considéraient que la Russie n'est pas une menace pour leur pays, cette proportion était de 57 % pour les Tchèques, 61 % pour les Slovaques, et 65 % pour les Hongrois57(*).
• L'hostilité à la Russie trouve son expression la plus forte en Pologne et en République tchèque. Dans la première, « la Russie incarne pour Varsovie l'ennemi historique (participation au démembrement du pays au XVIIIe siècle, répression des révoltes nationalistes du XIXe siècle, décapitation des élites à Katyn au XXe siècle, etc.), voire une altérité ontologique contre laquelle s'est construite l'identité nationale »58(*). David Cadier notait déjà en 2012 que « c'est avant tout le courant atlantiste de l'élite de politique étrangère qui a porté cette rhétorique : insister sur la continuité de la menace (russe) permet de légitimer la continuité des garanties (américaines) pour s'en protéger. En somme, peut-être plus encore que l'alliance avec Washington est vue comme un moyen de se préserver de la menace russe, c'est la menace russe qui est vue comme un moyen de préserver l'alliance avec Washington [...] L'ancien Premier ministre Mirek Topolanek avait par exemple brandi la menace russe pour tenter de susciter l'adhésion au projet de bouclier antimissile, ou même au traité de Lisbonne »59(*). Aussi la guerre en Ukraine apparaît-elle comme un atout politique dans le sens où elle soutient l'idée d'une supériorité morale, l'ancienneté des avertissements polonais valant argument d'autorité sur l'aveuglement prétendu des États membres fondateurs de l'Union, en particulier la France et l'Allemagne60(*).
La relation tchéco-russe est très mauvaise depuis 2022. Elle s'était déjà dégradée avec l'explosion, en 2014, d'un dépôt de munitions attribuée aux services secrets russes, et les expulsions de 18 diplomates décidées en conséquence en avril 2021. La guerre en Ukraine a soudé quasiment toute la classe politique tchèque, la conduisant à appeler à des sanctions très fermes vis-à-vis de la Russie. Le gouvernement a en outre fait de la lutte contre la désinformation russe une priorité, ce qui a conduit à la fermeture du site d'information basé à Prague Voice of Europe en mars 2024.
• L'attitude hongroise envers la Russie oscille entre solidarité avec les sanctions européennes et opportunisme économique. Viktor Orban, naguère l'un des leaders du mouvement antisoviétique dans les années 1990, développe désormais une forme de multi-alignement guidé par la priorité donnée à la défense des intérêts nationaux. Quatre capitales sont selon lui clés pour servir cet objectif : Berlin pour l'influence économique, Moscou pour les ressources énergétiques, Pékin pour le commerce et Ankara pour les migrations. Le Premier ministre Orban s'est rendu à Moscou en février 2022 et juillet 2024 et a rencontré le président Poutine à Pékin en octobre 2023.
En tant que pays enclavé, la Hongrie cherche prioritairement à obtenir des exemptions aux sanctions énergétiques imposées par l'Union et les États-Unis. Si les pays voisins, dont la République tchèque ou l'Autriche, détournent progressivement leurs raffineries du pétrole russe, la Hongrie, qui dépend de la Russie pour environ 95 % de ses besoins en gaz en 2020 et environ 77 % de ses besoins en pétrole en 2023, prolonge l'oléoduc de Droujba jusqu'à Ni, en Serbie.
• La Slovaquie s'est démarquée depuis vingt ans comme l'État le moins hostile à Moscou. Vladimír Meèiar, entre 1993 et 1998, cultiva une relation privilégiée avec la Russie, notamment dans le domaine économique ; Mikulá Dzurinda, entre 1998 et 2006, privilégia au contraire les orientations euro-atlantistes du pays ; Robert Fico, entre 2006 et 2010, afficha à son tour une certaine proximité avec la Russie, dans le domaine énergétique mais aussi sur certains dossiers internationaux - bouclier antimissile, indépendance du Kosovo, conflit en Ossétie, etc.61(*) Lors du conflit russo-géorgien de l'été 2008, Bratislava s'est opposée aux sanctions contre Moscou que Prague et Varsovie défendaient.
La Russie jouit en effet en Slovaquie d'une forme de sympathie historique en raison du rôle de l'identité panslave dans la formation de la nation slovaque contre le pangermanisme et le panmagyarisme au XIXe siècle, et de la libération de l'actuelle Slovaquie par l'armée soviétique en 1945. Un tiers des Slovaques perçoivent désormais la Russie comme l'un des deux partenaires stratégiques majeurs de leur pays62(*), ce qui est vrai à tout le moins sur le plan énergétique puisque celui-ci dépend de la Russie à 98 % pour le gaz, 84 % pour le pétrole et dépend de Rosatom pour la fourniture de combustible. Les Slovaques étaient, en 2020, 78 % à voir dans la Russie une nation soeur slave, un score proche des records atteints dans les pays majoritairement orthodoxes comme la Serbie ou la Bulgarie.
Mesure de l'adhésion de la population à certaines expressions de proximité à la Russie selon l'institut slovaque Globsec
Source : commission, d'après Globsec Trends 2020.
Le nouveau gouvernement de Robert Fico constitué en octobre 2023 a renforcé cette orientation. Les visites du Premier ministre à Moscou le 22 décembre 2024, relative aux enjeux énergétiques, et le 9 mai 2025, pour la célébration des 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, ne sont pas passées inaperçues en Europe. Si l'enseignement de la langue russe s'est effondré après l'agression de l'Ukraine en 2022, l'ambassade de Russie à Bratislava joue un rôle particulièrement actif dans la société slovaque en finançant des associations culturelles, multipliant les événements cultivant la mémoire historique et alimentant un réseau d'influence.
Les positions des Centre-européens à l'égard de l'Ukraine sont ainsi devenues plus complexes. Pologne et Tchéquie en sont restés les soutiens les plus déterminés. L'Ukraine fait partie du paysage familier des Polonais, dont la souveraineté s'étendait sur la plus grande partie du pays à l'époque de la République des Deux Nations - Lviv, Lemberg sous domination autrichienne, était redevenue la Lwów polonaise entre les deux guerres. La Pologne a consenti, en proportion de la richesse nationale, un soutien matériel à l'Ukraine parmi les plus importants en Europe et a accueilli près de trois millions de réfugiés, et soutenait jusqu'à l'été 2025 l'adhésion de l'Ukraine à l'Union : « Les élites stratégiques polonaises voient de longue date en une Ukraine démocratique et libre de l'influence russe une condition sine qua non de la sécurité, voire de l'existence, de leur État »63(*).
La Tchéquie s'est également affirmée comme l'un des premiers soutiens de l'Ukraine, les élites politico-militaires convoquant fréquemment les précédents de 1938 et 1968 pour rappeler que la République tchèque pourrait avoir à faire face à une menace russe si l'Ukraine tombait. La République tchèque a fourni à Kiev des matériels majeurs et accueilli plus de 500 000 réfugiés ukrainiens. Plus de 365 000 y résident avec un visa de protection temporaire, soit près de 4% de la population. Depuis 2022, le gouvernement tchèque soutient en priorité une accélération du processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie.
Les relations entre Budapest et Kiev ont commencé à se dégrader lorsque l'Ukraine a réduit les droits des minorités nationales - l'usage des langues minoritaires dans l'éducation et la vie publique - dans le but de lutter contre l'influence russe, affectant ainsi ceux des Hongrois de Transcarpatie, qui ont maintenu des liens étroits avec la Hongrie. Dénonçant un Occident qui « cède à la psychose de la guerre »64(*), le gouvernement Orbán maintient son souhait de rester en-dehors du conflit et refuse la fourniture et le transit d'armes sur son sol, et appelle à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix immédiats. La Hongrie a consenti dans la douleur, en décembre 2023, à travers une abstention constructive, à l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union pour l'Ukraine et la Moldavie, et accepté à reculons l'octroi de la « Facilité Ukraine » de 50 milliards d'euros en février 2024.
La Slovaquie a figuré parmi les premiers soutiens politique, militaire et humanitaire de l'Ukraine au début de la guerre, mais le pays a opéré un tournant avec le retour au pouvoir de Robert Fico en 2023. Si le gouvernement slovaque affirme sa solidarité de principe avec l'Ukraine, il a néanmoins décidé de la suspension de son aide militaire à l'Ukraine et a durci récemment le ton en menaçant de bloquer le 18ème paquet de sanctions contre la Russie en raison des retombées qu'aurait le plan présenté par la Commission visant à se passer d'énergie en provenance de Russie. La Slovaquie a par ailleurs indiqué qu'elle refusait toute participation à une éventuelle opération de maintien de la paix. Tout comme la Hongrie, elle s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, mais à la différence de Viktor Orbán, Robert Fico soutient un élargissement de l'Union sur des bases méritocratiques, incluant l'Ukraine.
La réceptivité de l'opinion slovaque à l'expression des intérêts russes en fait désormais un terrain d'action privilégié des opérations de propagande de Moscou. D'après les responsables politiques rencontrés sur place, la forte émigration de Slovaques jeunes, urbains et diplômés, et la grande dispersion, en zone rurale, de la population restée au pays facilite la propagation de la désinformation pro-russe, qui transite massivement par les réseaux sociaux. Sur Facebook, réseau social le plus utilisé dans le pays, les followers de l'ambassade de Russie sont trois fois plus nombreux que ceux des ambassades française, allemande et américaine réunis.
Même parmi les peuples les plus hostiles à la Russie toutefois, progresse un sentiment grandissant de « fatigue de la guerre », qui accroît l'écart de perception entre les gouvernants et les gouvernés. Les Slovaques ont certes toujours été les plus rétifs à la perspective d'une escalade des tensions, un sondage de septembre 2022 indiquant même que les Slovaques déclarant explicitement vouloir « plutôt » ou « certainement » la victoire de l'Ukraine dans la guerre ne dépassait pas 47 %65(*). Mais selon un sondage effectué par le Centre pour l'étude de l'opinion publique en avril 2024, même les Tchèques pensent à présent en majorité que leur pays a accueilli plus de réfugiés ukrainiens qu'il n'est en mesure de le faire, tandis que le nouveau président polonais Karol Nawrocki a pu affirmer en juin dernier que, si « nous devons soutenir l'Ukraine » dans son conflit avec la Russie, « l'Ukraine doit comprendre que d'autres pays, notamment la Pologne, la Hongrie et d'autres pays européens, ont également leurs propres intérêts »66(*) et s'est dit hostile à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union. Selon un sondage de l'institut Ibris, réalisé en juin, les Polonais sont désormais majoritairement défavorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE : ils ne sont plus que 35 % à soutenir le processus contre 85 % en 2022, en raison des craintes des conséquences économiques de l'intégration de l'Ukraine, des difficultés culturelles liées à l'accueil d'un million de réfugiés et des questions mémorielles, tous facteurs déterminants dans la progression des voix des candidats nationalistes en 2025.
c) Au-delà de la relation transatlantique : entre Europe et Asie
La Pologne a été le premier pays d'Europe centrale à nouer un partenariat stratégique avec la Chine, en 2011, lequel a été suivi de la constitution d'un comité intergouvernemental et de rencontres et de visites de haut niveau fréquentes. C'est à Varsovie qu'a été créé, en 2012, le format « 16+1 », initiative du ministère chinois des Affaires étrangères visant à promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale - dont le nombre de membres a fluctué jusqu'à le ramener à « 14+1 »67(*). La Pologne a officiellement rejoint le projet des nouvelles routes de la soie en novembre 2015, et signé un partenariat stratégique avec Pékin en juin 2016. La lente concrétisation des projets en Pologne, et l'attitude des administrations Trump à l'égard de la Chine ont toutefois ralenti la coopération sino-polonaise. En septembre 2025 ainsi, le ministre des affaires étrangères Radosaw Sikorski a tâché de plaider la menace russe auprès de son homologue chinois pour justifier la fermeture de la frontière polono-biélorusse, qui entraîne la rupture d'un couloir terrestre importante de la nouvelle route de la soie.
La République tchèque poursuit à l'égard de la Chine une politique en dents de scie. La page pro-chinoise de la présidence Zeman, entre 2013 et 2023, motivée par la volonté d'attirer des investissements jamais concrétisés, a été tournée par le gouvernement Fiala depuis 2021 et la présidence Pavel depuis 2023. Prague a ainsi exclu des entreprises chinoises des appels d'offres pour les réseaux 5G, puis pour la centrale nucléaire de Dukovany en avril 2021, le ministre des affaires étrangères Jan Lipavský a désavoué le format « 14+1 » en mai 2023, le gouvernement a accusé la Chine d'une campagne cybernétique malveillante... Prague développe, simultanément, des relations économiques fortes avec Taïwan. La Chine reste néanmoins le deuxième partenaire commercial de la République tchèque, dont l'industrie est fortement dépendante de Pékin pour les matières premières, et le caractère très intégrée à l'économie allemande de l'industrie tchèque plaide pour éviter une approche trop conflictuelle - d'où l'abstention tchèque en octobre 2024 sur l'imposition des droits de douane aux véhicules électriques chinois.
La politique de ces États à l'égard de la Chine semble en partie dépendante de la politique américaine. « Les mots du président Macron sur la Chine et le danger de voir l'Europe « prise dans des crises qui ne sont pas les siennes » par « suivisme des États-Unis » avaient causé au moins autant de remous en Europe centrale que certaines de ses déclarations sur la Russie. Beaucoup dans la région considèrent que le nécessaire soutien de Washington face à une menace russe renouvelée implique d'adhérer au maximum à ses priorités sur la Chine, et ils rejettent plus profondément tout ce qui pourrait s'apparenter à une mise à distance symbolique des États-Unis des affaires européennes ou, a fortiori, à une dévaluation de l'Otan »68(*).
La Slovaquie est disposée à cultiver de bonnes relations avec la Chine et suivre la voie de la Hongrie en pratiquant une politique étrangère à « 360 degrés ». La Chine et la Slovaquie ont célébré les 75 ans de leurs relations diplomatiques à l'occasion d'une visite du Premier ministre Fico à Pékin en octobre 2024. Bratislava plaide en faveur d'un dialogue ouvert, franc et non conflictuel avec Pékin et s'oppose à toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, Taïwan comprise. Les deux pays se sont accordés sur l'élévation de leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique. Au plan économique, la Slovaquie s'apprête à accueillir, d'ici 2026-2027, un vaste projet d'usine de production de batteries cofinancé par deux industriels chinois et slovaque, que Robert Fico a qualifié de « plus grand projet de l'histoire de la Slovaquie », et une usine automobile Volvo/GEELY est en projet à l'est du pays.
La Hongrie est le pays d'Europe le plus ouvert à la diversification de ses partenariats à l'Est, notamment avec la Chine. Le ministre des Affaires étrangères Szijjártó consacre ainsi une part importante de son activité à la diplomatie économique, notamment avec les pays asiatiques. Un partenariat renforcé, dit de « toute saison », a été conclu lors de la dernière visite de Xi Jinping à Budapest en mai 2024. Un accord de sécurité permettant des patrouilles conjointes de policiers hongrois et chinois en Hongrie a été signé en février 2024, et les autorités hongroises continuent d'attirer les investissements chinois, notamment dans le secteur automobile. Selon la BERD, la Hongrie est devenue le premier bénéficiaire d'investissements directs chinois en Europe, attirant 44 % des presque 12 milliards d'euros que la Chine destinait au continent en 202369(*). Le commerce bilatéral reste cependant nettement déficitaire pour la Hongrie, tandis que la Chine est devenue le cinquième partenaire commercial de Budapest depuis 2020.
d) Politique à l'égard d'Israël
L'importance du soutien à l'État d'Israël dans la politique étrangère des États centre-européens est une autre caractéristique remarquable. La politique de la République tchèque, en particulier, appelle des développements particuliers, tant « la force de l'engagement pro-israélien tchèque et le consensus des élites politiques du pays pour soutenir fermement Israël sont désormais devenus un phénomène unique en Europe, voire dans le monde entier »70(*).
Cette « relation spéciale », « historique » ou « stratégique » est un lieu commun du débat public national, qui la fait remonter à l'immédiat après-seconde guerre mondiale. À l'époque, la Tchécoslovaquie a en effet servi d'intermédiaire au soutien soviétique aux rares forces politiques de la région susceptibles d'être réceptives à l'idéologie communiste, à savoir les travaillistes juifs de la Palestine mandataire. C'est ainsi que la Tchécoslovaquie a fourni un représentant à la commission de l'ONU chargée d'établir un plan pour l'après-mandat britannique à l'automne 1947, puis le matériel militaire utilisé pour soutenir la guerre de 1948. Le rapide alignement de Ben Gourion sur le bloc de l'Ouest interrompit les relations entre les deux pays dès l'année suivante71(*).
Depuis 1989, le soutien à Israël fait partie du legs doctrinal du président Vaclav Havel, qui a rétabli les relations avec l'État hébreu et s'est opposé aux campagnes de boycott à l'égard du pays. Les politologues tchèques contemporains l'expliquent par l'attachement des intellectuels tchèques pour la grande tradition juive pragoise, la mémoire des combats contre l'antisémitisme du président Masaryk, l'amalgame plus ou moins explicite entre la vie du ghetto et celle des dissidents à l'ère soviétique, ou encore l'attachement aux valeurs démocratiques comme rempart à l'autoritarisme du monde arabe. Ces motifs n'expliquent toutefois pas le parallélisme entre la radicalisation des gouvernements israéliens et les manifestations de soutien tchèques, et il faut alors convenir, faute d'explications entièrement satisfaisantes, que les doctrines américaines justifiant le soutien à Israël ont trouvé à Prague un relais puissant72(*).
Ce soutien est devenu quasiment inconditionnel après l'attaque du 7 octobre 2023. La ministre de la défense Jana Èernochová a menacé de quitter l'ONU après l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale appelant à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, et le débat sur le déplacement de l'ambassade tchèque à Jérusalem, qui préexistait à 2023, a été réactualisé en pleine guerre des douze jours avec l'Iran. Le soutien des responsables politiques tchèques à Israël approche aujourd'hui l'unanimité, et les rares voix discordantes au sein des partis d'opposition se font plus discrètes lorsqu'elles s'approchent des sphères décisionnelles - telle celle du ministre des affaires étrangères Jan Lipavský, naguère critique et qui fut le premier ministre étranger à se rendre en Israël après l'attaque du 7 octobre.
Si, selon certaines études d'opinion, la population tchèque affiche une des plus grandes proportions de soutien à Israël, certains politologues ont toutefois apporté quelques nuances à ce tableau. Une étude récente fait observer que la proportion d'indécis et de partisans d'une responsabilité partagée et d'une solution à deux États est majoritaire, et bien supérieure à ce qu'elle est, par exemple, aux Etats-Unis, attestant d'un décalage non négligeable avec les positions des élites politiques du pays73(*).
La Hongrie elle aussi soutient sans réserve l'État hébreu. Les visites et rencontres de haut niveau entre les dirigeants des deux pays sont fréquentes et Budapest appuie dans les enceintes internationales le droit d'Israël à se défendre ainsi que sa lutte contre le Hamas. Viktor Orban a annoncé en avril 2025 se retirer du statut de la Cour pénale internationale afin que la Hongrie ne soit plus tenue de respecter ses obligations à l'occasion de la visite sur son sol du premier ministre israélien, visé par un mandat d'arrêt de la Cour de La Haye. Ce soutien procède d'accointances idéologiques, d'une nécessité tactique pour conserver une proximité avec Washington, et de l'acceptation des membres du groupe de Visegrád de se faire la porte d'entrée de l'influence israélienne auprès des pays membres de l'Union européenne74(*).
2. L'Europe vue du centre : une géométrie variable
a) Une perception de l'Europe à géométrie variable
La chute de l'Union soviétique et l'unification apparente de l'Europe ont paradoxalement révélé les nuances de géographie mentale existant dans cette partie du continent.
L'idée d'une coopération politique des nations d'Europe centrale sur une base autonome est vieille d'un siècle au moins. En 1918 déjà, des représentants tchèques - dont Masaryk lui-même -, polonais, lituaniens, ukrainiens et yougoslaves lançaient un appel en faveur d'une « Union démocratique d'Europe centrale ». L'Autrichien Julius Meinl a lancé au début des années 1920 l'idée d'un « Mouvement pacifiste centre-européen », qui donna naissance à un Congrès économique centre-européen à Vienne en 1925. Le Hongrois Elemér Hantos a envisagé le programme d'une fédération danubienne excluant l'Allemagne, mais réunissant Autriche, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Roumanie, et fut l'initiateur des Mitteleuropainstitute de Vienne, Brno et Budapest, projets alors dirigés contre un rapprochement austro-allemand.
C'est pourtant à partir des contours de l'ancien empire des Habsbourg que se dessinent, à la chute du Mur, les projets de coopération des nations qui s'en sont affranchies.
• Le ministre des Affaires étrangères italien Gianni De Michelis avait proposé, dès 1988, une association de pays, la Quadrangolare, regroupant l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Yougoslavie. Élargi dans les années 1990-1991 à la Tchécoslovaquie pour devenir la Pentagonale, puis à la Pologne, ce forum de coopération économique est à présent connu sous le nom d'Initiative centre-européenne, créée officiellement à la tombée du Mur de Berlin et présentée désormais comme la plus ancienne association sous-régionale européenne. Son élargissement s'est poursuivi jusqu'à nos jours à la Biélorussie, l'Ukraine, et dans les Balkans. Ses membres font progresser leur coopération, par exemple en matière sanitaire. Son siège est à Trieste, ancienne porte de l'empire austro-hongrois sur la mer - où, d'ailleurs, la Hongrie vient d'acheter un terrain destiné à abriter son propre port en eau profonde et un centre logistique intermodal, opérationnels d'ici 2028.
Contours de l'Initiative centre-européenne
• Le président tchèque Vaclav Havel appelait en 1990 à « combler le grand vide politique qui est apparu en Europe centrale après l'effondrement de l'empire des Habsbourg avec quelque chose qui soit authentiquement significatif »75(*). Le « groupe de Visegrád » en a été l'expression, qui regroupe depuis 1991 la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Son nom fait référence à la coalition anti-Habsbourg constituée à Visegrád en 1335 par la Bohême, la Pologne et la Hongrie. Devenu ensuite une enceinte de concertation en amont des grandes échéances européennes, et de coordination de ses membres sur certaines questions internationales, admettant des réunions délocalisées ou des invités - Israël ou le Maroc, ainsi -, le V4 s'est par après transformé, dans les années 2010, en pôle de contestation au sein de l'Union. Prudence sur l'euro, réticences sur le climat, opposition à la politique migratoire notamment en 2015, ont ainsi fait partie des positions arrêtées en opposition aux pays d'Europe de l'Ouest. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le V4 est néanmoins très divisé, le gouvernement hongrois, puis le slovaque, s'attirant l'hostilité des autres en raison de leur attitude complaisante avec la Russie, et fonctionne aujourd'hui au ralenti sur la base de coopérations sur des sujets techniques en matière de défense, d'énergie, ou d'infrastructures.
États membres du groupe de Visegrád
• La Slovaquie et la République tchèque font également partie, avec l'Autriche, du format Slavkov, également appelé format Austerlitz ou S3, initié par la République tchèque en 2015. Le vice-ministre tchèque Drulak précise alors que ce format vise à compléter les activités du groupe de Visegrád. Alors que les relations bilatérales entre la République tchèque et la Slovaquie sont assez dégradées depuis le retour au pouvoir de Robert Fico, le format Slavkov fonctionne, comme le V4, au ralenti.
États membres du format de Slavkov, ou d'Austerlitz
• Le groupe des Neuf de Bucarest, ou « B9 », est formé en novembre 2015 à l'initiative du président roumain Klaus Iohannis et du président polonais Andrzej Duda afin d'augmenter la coopération entre ces pays en matière de sécurité extérieure dans le cadre d'une menace accrue de la Russie, un an après l'annexion de la Crimée. À partir de 2022, ses réunions, en présence de la présidente de la Commission européenne ou du secrétaire général de l'Otan, ont conduit ses membres à plaider puissamment pour le renforcement de la présence militaire sur le flanc est de l'Alliance.
États membres des Neuf de Bucarest, ou B9
• La variante d'origine polonaise de la coopération régionale est encore plus vaste et recouvre tout l'espace compris entre l'Allemagne et la Russie. L'initiative des trois mers, créée en 2016 après le débat suscité par un rapport copublié par l'Atlantic Council, alors dirigé par l'ancien commandant suprême des forces alliées en Europe James L. Jones, et le lobby énergétique centre-européen CEEP76(*), a pour objectif d'opérer une meilleure jonction économique entre les mers Baltique, Adriatique et Noire, ouvrant les bras aux capitaux américains et chinois, tout en évitant de désigner trop explicitement Moscou comme adversaire.
La filiation est pourtant évidente avec le projet d'Intermarium du maréchal Pisudski, premier chef d'État de la Pologne moderne, ressuscitant la République des deux nations lituano-polonaise qui, à son extension maximale à la fin du XVIe siècle, embrassait l'est du continent de la Baltique à la Mer noire. Comme l'observent Marlène Laruelle et Ellen Rivera, auteurs d'une étude hébergée sur le site de l'Ifri77(*), le renouveau de cette idée ne sert désormais pas seulement une construction géopolitique tournée contre la Russie, mais forme une pièce d'un ensemble conceptuel plus vaste inspiré par les idées conservatrices ou d'extrême-droite et porté par l'atmosphère illibérale de l'heure.
Contours de l'initiative des trois mers et projets d'infrastructures associés
Source : revue Conflits n° 51, août 2024.
Le concept d'Intermarium - d'après Marlène Laruelle et Ellen Rivera (2019)
Premier Intermarium : quelle Europe centrale après les empires ? La proposition originelle est celle de Józef Pisudski, qui envisage une fédération d'États suffisamment forts pour contrer l'Allemagne et l'URSS. Les accords de Varsovie de mars 1922 liant Finlande, Pologne, Estonie et Lituanie en sont la traduction la plus aboutie mais le refus de leur ratification par le Parlement finlandais la fit échouer. Ce projet va de pair avec celui de la Ligue prométhéenne, réseau de coopération semi-clandestin visant à lutter contre l'URSS inspiré de la « doctrine prométhéenne » de Pisudski, consistant à soutenir les minorités nationales de la puissance soviétique - au premier rang desquels les nationalistes ukrainiens - pour la faire s'effondrer. Le soutien français et britannique à ces projets n'ayant pas suffi, le colonel Beck, Premier ministre polonais à partir de 1932, se rapprocha de l'Allemagne nazie.
Intermarium 2 : l'unité de l'Europe centrale entre la collaboration avec les Nazis et le soutien des Alliés. Le projet d'Intermarium fut repris par le Club fédéral de l'Europe centrale, plateforme de militants anticommunistes et de fédéralistes est-européens créée en 1940, animée en particulier par l'officier tchèque Lev Prchala. Son activité fut reprise par la CIA au début de la guerre froide.
Intermarium 3 : l'Europe centrale comme front anti-communiste. L'organisation la plus connue au soutien de ce projet fut le Bloc des nations antibolcheviques, qui rassembla des émigrés issus des peuples non-russes de l'URSS et du bloc de l'Est, en particulier les anciens membres des organisations paramilitaires de nationalistes ukrainiens, oustachis, ou de la garde de fer roumaine. Cette organisation rejoint en 1966 la ligue anticommuniste mondiale.
Intermarium 4 : l'Europe centrale comme « nouvelle Europe » proaméricaine. À la fin des années 2000, le concept d'Intermarium renaît sous la plume d'auteurs inspirés de Halford Mackinder et de Zbigniew Brzezinski, cherchant à éviter une balkanisation de l'Europe centrale dont profiterait la Russie. L'influent think tank américain Stratfor - parmi d'autres - promeut une notion dans laquelle son directeur d'origine hongroise, Georges Friedman, voit en outre la promesse d'une puissance économique européenne à l'image des Etats-Unis. Ce concept sert à justifier l'extension de l'Otan à l'est, et son succès culmine dans le sommet de l'Otan de Varsovie de juillet 2016, où est inauguré le système de défense antimissile et précisée la doctrine de dissuasion à l'égard de la Russie.
Intermarium 5 : l'unité de l'Europe centrale par la coopération économique régionale. En Pologne en particulier, et dans la renaissance culturelle de la diaspora réunie autour de Jerzy Giedroyæ et de la revue Kultura à Maisons-Laffitte, progresse l'idée d'une nouvelle stratégie polonaise à l'est, dépourvue de revanchisme ou d'ambitions territoriales. Si la « doctrine Giedroyæ » est originellement dépourvue d'hostilité à l'égard de la Russie, sa reprise au service de l'élargissement du bloc euro-atlantique ne l'a pas toujours été. Cette doctrine a en partie inspiré le programme du parti PiS, l'activisme polonais au sein du groupe de Visegrád et l'élaboration du Partenariat oriental. L'Initiative des trois mers en découle logiquement.
Intermarium 6 : l'Europe centrale rêvée par l'extrême-droite ukrainienne. La réhabilitation de l'organisation des nationalistes ukrainiens depuis 2004 et 2014 a réhabilité le concept d'Intermarium au service des projets de confédération paneuropéenne de diverses formations ultranationalistes et groupes paramilitaires.
Le projet d'Initiative des trois mers, ou Intermarium, n'est pas sans contradictions, qui tiennent notamment aux sentiments pro-russes qui animent certains de ses États membres, tels que la Hongrie et la Slovaquie, et sa compatibilité avec la direction politique qui peut être exercée au sein de l'Union européenne n'est pas évidente : le soutien apporté par le président Trump à l'Initiative des trois mers en 2017 et l'atlantisme des États centraux marginalisent toujours plus l'axe Paris-Berlin, sans parler des projets français d'autonomie stratégique européenne.
b) Une perception de l'Union européenne à géométrie variable
Si une grande partie de la classe politique, de la société civile, des ONG ou du secteur académique reste aujourd'hui très favorable et attachée à l'Union, la Tchéquie est historiquement un des pays dont l'opinion publique est la plus eurosceptique. Seuls 29% des Tchèques ont une image positive de l'Union. Sentiment compréhensible pour un État ayant si peu exercé sa si récente souveraineté, l'euroscepticisme tchèque a été incarné par l'ancien président Václav Klaus, qui avait retardé la signature du traité de Lisbonne, refusé le drapeau européen sur le château de Prague, et qui se demandait : « Allons-nous dissoudre notre souveraineté et notre identité dans l'Europe comme un morceau de sucre dans une tasse de café ? »78(*).
Outre l'attachement à la souveraineté du pays et la puissance de l'atlantisme tchèque, peut aussi entrer en ligne de compte pour l'expliquer la prédominance dans le paysage politique d'un parti conservateur (ODS) historiquement proche des conservateurs britanniques, dont ils se sentent par ailleurs orphelins depuis le Brexit. La participation des électeurs centre-européens aux élections européennes est traditionnellement très faible, en-dessous de 40%, mais elle a progressé lors des deux derniers scrutins - et, dans le cas hongrois, en faveur certes du candidat pro-européen.
Taux de participation aux élections européennes
La Slovaquie montre un attachement à l'Union fluctuant au gré des crises successives - crise de la dette, crise migratoire, covid. Lors du référendum de 2003 sur l'adhésion à l'Union, les Slovaques ont voté « oui » à 92,46 %, un taux largement supérieur aux sondages de l'époque et à celui des autres pays candidats où des référendums avaient été organisés. Selon l'institut Globsec, 75 % des Slovaques sont favorables au maintien de leur pays dans l'Union79(*) mais, selon le dernier Eurobaromètre du printemps 2025, à la question de savoir si l'appartenance de son pays à l'Union est une bonne ou une mauvaise chose, la Slovaquie affiche le niveau de réponse positive le plus faible en Europe, et les autres opinions publiques d'Europe centrale - à l'exception de la polonaise, légèrement au-dessus de la moyenne - ne brillent pas par leur europhilie.
Eurobaromètre printemps 2025 : « l'UE a-t-elle pour vous une image très positive, plutôt positive, neutre, plutôt négative ou très négative ? »
Source : Eurobaromètre printemps 2025.
La dernière manifestation d'hostilité à la supranationalité européenne a été le vote par le Conseil national slovaque, le 26 septembre 2025, d'une révision de la Constitution visant à visant à faire obstacle à certaines revendications des courants progressistes sur le plan sociétal - notamment l'interdiction de la gestation pour autrui et la reconnaissance de deux sexes biologiques - mais, surtout, réaffirmant la supériorité du droit national en la matière. L'article 7 de la Constitution slovaque, relatif aux engagements internationaux du pays, est en effet complété par un alinéa disposant que :
« La République slovaque préserve sa souveraineté, notamment dans les questions d'identité nationale - les questions culturelles et éthiques fondamentales relatives à la protection de la vie et de la dignité humaine, de la vie privée et familiale, du mariage, de la parentalité et de la famille, de la moralité publique, de l'état civil, de la culture et de la langue, ainsi que des décisions relatives à des questions connexes dans les domaines de la santé, des sciences, de l'éducation, de la formation, de l'état civil et de la succession. »
« Aucune disposition de la présente Constitution et des lois constitutionnelles ne peut être interprétée comme un consentement de la République slovaque à transférer l'exercice d'une partie de ses droits dans les domaines qui constituent l'identité nationale. »
La position slovaque à l'égard des orientations politiques prises à Bruxelles est toutefois fragile. La force d'opposition du gouvernement Fico est limitée par la situation budgétaire du pays, placé en procédure pour déficit excessif depuis juillet 2024, et par l'efficacité des pressions de la Commission européenne sur les projets de réforme en cours : les menaces de déclencher le mécanisme de conditionnalité liée à l'État de droit si les intérêts financiers de l'Union n'étaient pas mieux protégés dans la législation slovaque80(*), et si la loi relative aux ONG n'était pas assouplie81(*), ont finalement atteint leur but. Robert Fico n'a encore jamais mis à exécution sa menace de veto d'une décision du Conseil européen.
En Hongrie, Viktor Orban défend une politique européenne alternative, qu'il appelle réaliste. Conscient du poids relatif de la Hongrie en Europe, il se défend de vouloir jouer le moindre rôle européen et prétend seulement défendre ses intérêts nationaux. Il soutient l'accession à l'Union européenne des pays des Balkans occidentaux - et notamment de la Serbie, mais s'oppose aux orientations de politique étrangère de l'Union et à toute évolution dans le sens d'un plus grand fédéralisme. Ses vues géopolitiques ont été par exemple exposées dans son discours du 27 juillet 2024, tenu à la 33ème université d'été libre de Bálványos, communément appelée le festival Tusványos.
Discours de Viktor Orban du 27 juillet 2024 (extraits)
« Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est en réalité un changement de système mondial. Et c'est un processus qui vient d'Asie. [...] [Ce processus est] presque imparable et irréversible. [...] Le président Trump s'efforce de trouver une réponse américaine à cette situation. En fait, la tentative de Donald Trump est probablement la dernière chance pour les États-Unis de conserver leur suprématie mondiale. [...] Quelle est la réponse européenne au changement du système mondial ?
Nous avons deux options. La première est ce que nous appelons le « musée à ciel ouvert ». C'est ce que nous avons aujourd'hui. [...] L'Europe, absorbée par les États-Unis, restera dans un rôle de sous-développement. [...]
La deuxième option, annoncée par le président Macron, est l'autonomie stratégique. [...] Il est possible de recréer la capacité de l'Europe à attirer des capitaux, et il est possible de faire revenir des capitaux d'Amérique. Il est possible de réaliser de grands développements d'infrastructures, notamment en Europe centrale - le TGV Budapest-Bucarest et le TGV Varsovie-Budapest, pour ne citer que ceux dans lesquels nous sommes impliqués. Nous avons besoin d'une alliance militaire européenne avec une industrie de défense européenne forte, de la recherche et de l'innovation. L'Europe a besoin d'une autosuffisance énergétique, ce qui ne sera pas possible sans l'énergie nucléaire. Et après la guerre, nous avons besoin d'une nouvelle réconciliation avec la Russie.
Cela signifie que l'Union européenne doit renoncer à ses ambitions en tant que projet politique, se renforcer en tant que projet économique et se construire en tant que projet de défense.
Dans les deux cas - musée à ciel ouvert ou compétition - il faudra se préparer à ce que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, car nous, Européens, n'avons pas assez d'argent pour cela.
L'Ukraine redeviendra un État tampon. Si elle a de la chance, cela s'accompagnera de garanties de sécurité internationale, qui seront inscrites dans un accord entre les États-Unis et la Russie, auquel nous, Européens, pourrons peut-être participer. L'expérience polonaise échouera, car ils n'ont pas les ressources nécessaires : ils devront retourner en Europe centrale et dans le V4. Attendons donc le retour des frères et soeurs polonais.
En résumé, je peux donc dire que les conditions sont réunies pour une politique nationale indépendante à l'égard de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. [...]
L'essence de la grande stratégie de la Hongrie est donc la connectivité. Cela signifie que nous ne nous laisserons pas enfermer dans l'un des deux hémisphères émergents de l'économie mondiale. L'économie mondiale ne sera pas exclusivement occidentale ou orientale. Nous devons être présents dans les deux, à l'Ouest et à l'Est.
Cela aura des conséquences. La première. Nous ne nous impliquerons pas dans la guerre contre l'Est. [...] Le deuxième chapitre de la grande stratégie concerne les fondements spirituels. Au coeur de cette stratégie se trouve la défense de la souveraineté [...]
Le troisième chapitre identifie le corps de la grande stratégie : la société hongroise dont nous parlons. [...] La première condition pour cela est de stopper le déclin démographique. [...] Il faut contrôler l'afflux de ceux qui viennent d'Europe occidentale et qui veulent vivre dans un pays national chrétien. [...]
Enfin, il y a l'élément crucial de la souveraineté. C'est l'essence même de la protection de la souveraineté, qui est la protection de la spécificité nationale [...] »
B. RESSERRER NOTRE COOPÉRATION À TOUS LES NIVEAUX
1. L'évolution incertaine de la politique centre-européenne
L'avenir des forces politiques centre-européennes eurocritiques, illibérales ou populistes n'est pas facile à prédire. Le Fidesz hongrois n'est certes pas favori pour les élections hongroises de 2026. Il pourrait perdre le pouvoir au profit du parti Respect et Liberté fondé par le dissident du Fidesz Péter Magyar. En Slovaquie, la dynamique populaire du parti SMER-SD de Robert Fico, qui gouverne depuis 2023 avec le parti Hlas et les ultranationalistes du parti national slovaque, est devenue moins favorable, sa popularité ayant été dépassée depuis la fin 2024 par celle des libéraux du parti Slovaquie progressiste.
Il existe pourtant une dynamique régionale en leur faveur. En septembre 2024 en Autriche, le parti d'extrême-droite FPÖ, hostile au soutien à l'Ukraine, a progressé de treize points pour devenir pour la première fois dans l'histoire du pays la première force politique avec 29 % des suffrages, avant d'être rejeté dans l'opposition faute de pouvoir composer un gouvernement. Son chef Herbert Kickl est à l'origine de la formation au Parlement européen d'une fraction commune avec le Fidesz hongrois et le Smer-SD slovaque en juin 2024, les Patriotes pour l'Europe. En janvier 2025, la Croatie a élu président Zoran Milanovic, qui s'était dit très hostile à l'élargissement de l'Otan à la Finlande, à la Suède et à l'Ukraine, et plaide pour le maintien de bonnes relations avec la Russie. En juin 2025, les électeurs polonais ont préféré élire président le candidat nationaliste et eurocritique, Karol Nawrocki, hostile à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, plutôt que le candidat libéral Rafa Trzaskowski. La situation en Roumanie, où la victoire du populiste pro-russe Calin Georgescu a été empêchée de justesse fin 2024, avant que le libéral pro-européen Nicu?or Dan ne l'emporte en mai 2025 sur son remplaçant George Simion, mériterait des développements particuliers.
En République tchèque, le mouvement ANO de l'ancien Premier ministre Andrej Babi, désormais affilié aux Patriotes pour l'Europe, a remporté les élections législatives des 3-4 octobre 2025. L'incident de janvier 2023 semble ne pas avoir entamé sa popularité : à la question de savoir s'il enverrait des soldats pour défendre une Pologne attaquée, il avait répondu par la négative, semblant ne pas se sentir lié par l'article 5 du traité de l'Atlantique nord, avant d'être contraint de rétropédaler. Son mouvement devra toutefois composer avec d'autres forces politiques, notamment le parti des Automobilistes et le parti Liberté et Démocratie directe, tous deux rangés très à droite de l'échiquier politique tchèque et très critiques de l'Union européenne.
Certains grands déterminants matériels de la progression des forces populistes et contestant l'ordre libéral européen, bien qu'ils ne soient pas les seuls à orienter les préférences électorales, ne devraient pas disparaître. L'horizon économique de la zone, en particulier, n'est pas très dégagé. Si les fondamentaux ne sont pas catastrophiques - la croissance est faible mais positive et même encourageante en Pologne à près de 3 %, le chômage est partout contenu -, la dynamique créée par le refus de l'énergie russe et les tarifs douaniers américains est préoccupante. L'inquiétude pour l'appareil productif et les capacités d'export est grande en République tchèque et en Slovaquie ; les projets de gigafactory de batteries de voiture ne se sont pas concrétisés - Volkswagen a finalement renoncé à son projet de Plzen ; l'inflation reste forte en Roumanie, Hongrie, Pologne, Slovaquie et, en République tchèque, les salaires réels ont diminué de 5 % par rapport à 2019. En toute hypothèse, le ralentissement de l'économie allemande, qui a à peine progressé depuis 2019, obscurcit les perspectives pour toute la région.
En Slovaquie, dont l'économie est très déformée par l'industrie automobile, et qui produit essentiellement des véhicules thermiques, le choc provoqué par la politique du président des Etats-Unis s'ajoute en outre à la crise du secteur liée à la concurrence des véhicules électriques chinois. La banque centrale slovaque a calculé différents scénarios, dans lesquels les conséquences des tarifs américains pourraient entraîner une perte qui irait jusqu'à trois points de PIB au total, d'ici à 2027.
Il est certes douteux que les forces politiques populistes aient les solutions aux problèmes économiques de leur pays. Le gouvernement Fico ne semble pas avoir trouvé le moyen de diversifier l'économie slovaque, d'investir pour remédier au mauvais état des infrastructures, et les dépenses publiques d'intervention à l'attention de la population rurale ou âgée creusent le déficit et appellent des hausses de prélèvements obligatoires - l'impôt sur les sociétés est passé de 21 % à 24 %, la TVA de 20 % à 23 %. En Hongrie, l'insistance à renforcer les politiques d'attractivité n'apporte pour l'heure pas de solution à la dépendance à l'étranger de son appareil productif.
Quoi qu'il en soit, des temps plus difficiles pourraient n'être pas propices à des bouleversements stratégiques choisis. La priorité absolue donnée à la relation transatlantique devrait perdurer, et prédominer sur une forme de préférence européenne, même si une telle position n'empêche pas de soutenir les initiatives pour une défense mieux coordonnée en Europe, ou de réorienter certaines coopérations régionales. La Pologne, par exemple, mise davantage sur le triangle de Weimar, ainsi que sur le groupe des pays baltes et nordiques, avec lesquels elle poursuit des efforts d'achats de matériel communs - missiles à courte portée de conception polonaise, mines antipersonnel depuis leur sortie de la convention d'Ottawa en mars 2025 -, de conception d'un mur de drones. En 2024, le Premier ministre Tusk avait d'ailleurs été pour la première fois l'invité spécial du groupe Nordic-Baltic Cooperation, ou NB8, signe que « Varsovie considère désormais ses voisins de la mer Baltique comme ses partenaires les plus proches et mène régulièrement des consultations avec eux, notamment avant les Conseils européens »82(*).
Le politologue Georges Mink envisage la fin de l'alliance de Visegrád par épuisement de la logique d'entraide sur une base géographique et de l'histoire commune du soviétisme, qui ferait resurgir les égoïsmes nationaux, et par l'émergence d'un « nationalisme anti-européen indulgent pour le nationalisme impérial grand-russien »83(*), mais cette interprétation n'est pas entièrement convaincante. La russophilie des nationaux-populistes est très variable et diversement motivée ; les illibéraux de Visegrád sont moins anti-européens qu'eurocritiques, le recouvrement récent de leur souveraineté les rendant moins désireux de quitter l'Union qu'ombrageux face aux tendances fédéralisantes ; enfin, Karol Nawrocki et Andrej Babi ont, en toute hypothèse, dit publiquement leur souhait de relancer la coopération au sein du groupe de Visegrád. Selon les possibilités de coalition tchèque et la nature de la cohabitation entre le nouveau chef de l'État polonais et son gouvernement, une redéfinition des équilibres en Europe centrale et le renforcement d'un noyau populiste construit autour du V4 ne sont donc pas à exclure.
2. Pour une politique française d'équilibre dans la région
La France doit d'abord continuer à investir dans les relations bilatérales avec les États de la région. Sur le plan politique, la France est souvent soupçonnée de défendre l'autonomie européenne à son profit et de manquer de solidarité ou simplement de considération à l'égard de ses alliés. Les Tchèques gardent ainsi un mauvais souvenir de la fin de l'opération Barkhane, à laquelle ils s'étaient joints début 2020, car le gouvernement français a manqué de les consulter avant l'extinction de la mission, à la fin 2022. La timidité du soutien français à l'initiative tchèque pour l'achat d'obus a été, pour eux, un autre motif de déception.
Pour remédier au sentiment d'être déconsidérés par les puissances européennes de plus grande taille alors que, depuis janvier 2025, le cadre de l'Union européenne et la concertation entre Européens prennent une nouvelle dimension, les pays d'Europe centrale expriment le souhait d'être associés au plus près aux réflexions collectives, et un nouvel intérêt semble se faire jour pour la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Le format Weimar+ qui, en février 2025, a joint aux trois membres historiques l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et plusieurs dirigeants européens, pourrait être un format d'association plus régulier des États centraux aux réflexions stratégiques en cours.
L'initiative tchèque d'achat d'obus à destination de l'Ukraine
L'initiative tchèque en matière de munitions est un effort de coordination lancé par Prague au début de l'année 2024 afin de garantir la livraison d'obus d'artillerie de gros calibre à l'Ukraine. Dans ce cadre, le gouvernement tchèque met en commun les fonds provenant des pays européens et du Canada afin que les entreprises tchèques puissent s'approvisionner en munitions à l'échelle mondiale, y compris dans des pays situés hors de l'Union européenne et de l'Otan avec lesquels le pays entretient des relations de confiance. En contrepartie, les fabricants tchèques de matériel de défense perçoivent quelques pour cent des revenus générés par les contrats, ce qui augmente leur chiffre d'affaires.
Au total, cette initiative a permis de livrer 1,5 million d'obus d'artillerie en 2024, financés principalement par des pays autres que la République tchèque. En 2025, le président tchèque Petr Pavel a estimé que les livraisons pourraient atteindre 1,8 million. Cela représente la majeure partie du soutien total de l'Europe en matière de munitions à l'Ukraine, dont les soldats tirent 15 000 coups par jour. Selon le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, les fabricants européens devraient produire 2 millions d'obus d'artillerie cette année, qui ne seront pas tous destinés à l'effort de guerre.
Ce mécanisme efficace et pragmatique a permis de combler rapidement certaines lacunes de l'Ukraine en matière de munitions, et a renforcé le rôle de Prague en tant que facilitateur clé du soutien européen à la défense. Malgré les critiques selon lesquelles l'initiative manque de transparence, pratique parfois des prix excessifs pour les munitions et retarde les livraisons, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'elle « fonctionne à merveille ». Une vingtaine d'États ont participé ou indiqué leur souhait de participer au financement de cette initiative, mais la liste est difficile à établir avec précision.
Notre coopération peut également progresser dans le domaine militaire. La République tchèque, par exemple, est demandeuse d'une vraie réciprocité en matière d'armement. Le meilleur exemple de coopération réussie est constitué par le contrat, signé en 2019, relatif à l'achat de 62 blindés Titus du groupe français Nexter, montés sur un châssis fabriqué par le tchèque Tatra, qui a entraîné la commande de 24 véhicules supplémentaires en 2025. La République tchèque a également commandé 62 canons Caesar dans le cadre d'un contrat qui fait une large part - 40 % - à l'industrie locale, qui sont en cours d'adaptation aux demandes de l'acheteur. L'industrie de l'armement tchèque entretient des liens forts avec l'industrie et les forces armées ukrainiennes, via l'université de défense de Brno et les bureaux d'études militaires, et bénéficie ainsi de retours d'expérience directs du conflit en cours.
La relation économique entre la France et la Tchéquie pourrait être resserrée - les infrastructures ferroviaires et routières, par exemple, appellent dans un avenir proche d'importants investissements - mais, dans les domaines les plus sensibles, certains choix semblent certes prédéterminés par les préférences stratégiques du pays. Le 4 juin 2025, la République tchèque a signé avec le coréen KHNP un contrat de 16 milliards d'euros pour la fourniture de deux réacteurs nucléaires sur le site de Dukovany. Les recours intentés par EDF, candidat malheureux, devant la justice tchèque et devant la Commission européenne sont désormais épuisés. La technologie utilisée par KHNP provenant en partie de Westinghouse, les deux entreprises ont finalement signé un accord selon lequel Westinghouse laisserait le marché tchèque aux Coréens dans le cadre d'une forme de partage des marchés mondiaux84(*).
La France et la République tchèque ont signé un partenariat stratégique en 2008, qui se décline en plans d'action quadriennaux. La dernière feuille de route a été signée le 5 mars 2024 par le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre tchèque Petr Fiala pour la période 2024-2028. Le plan d'action porte notamment sur les questions internationales, européennes, énergétiques, de transports, culturelles, éducatives, linguistiques et scientifiques. La feuille de route souligne l'importance du renforcement de la coopération bilatérale en matière de lutte contre la menace russe et en faveur du soutien à l'Ukraine.
Avec la Slovaquie, un plan de coopération militaire franco-slovaque a été signé le 27 juillet 2021. La Slovaquie ayant envoyé en Ukraine ses systèmes S300, des opportunités pourraient être à saisir en matière de défense anti-aérienne, mais aussi de fabrication de munitions. Un projet de base logistique aéroterrestre non permanente est toujours en cours d'étude côté France : l'armée de l'air et de l'espace se base sur le concept Agile Combat Employment et l'armée de Terre poursuit son évaluation du besoin selon les plans régionaux de l'Otan. Un détachement d'un régiment français participe régulièrement en Slovaquie à l'exercice OTAN « Toxic Valley », seul exercice OTAN organisé en Europe où s'exercent des unités spécialisées dans la gestion du risque NRBC.
Sur le plan politique, le plan d'action du Partenariat stratégique avec la Slovaquie, signé en 2008, a été renouvelé en 2023 pour la période 2023-2027, qui couvre tous les domaines de la relation bilatérale. Alors que la présidence de Zuzana Èaputová a constitué une période riche en visites bilatérales, avec comme point d'orgue le déplacement du Président de la République à Bratislava le 31 mai 2023, les relations ont été plus distantes après le retour au pouvoir de Robert Fico en octobre 2023.
Ce dernier constat invite à formuler l'hypothèse que conditionner nos relations à une forme de proximité idéologique est, en première analyse, inopportun. D'abord car les changements de pied consécutifs à une alternance politique peuvent être rapides, surtout dans cette zone, alors que les relations économiques, les coopérations militaires, ou les rapprochements culturels s'inscrivent dans un temps plus long que celui des élections parlementaires et des coalitions gouvernementales. En outre, dans le cas particulier de la coopération des industries de défense, dans un contexte où tous les États réarment et obtiennent des facilités de financement de l'Union européenne, aucun marché européen ne devrait être réputé exclu a priori, même lorsque nos compétiteurs ont déjà pris une avance significative en influence politique et en capacités d'investissement. Enfin car le populisme centre-européen n'est pas sans motifs, qu'il vaut mieux chercher à comprendre avant d'en combattre, éventuellement, les effets politiques.
La nouvelle coalition au pouvoir à Berlin semble disposée à se montrer plus ferme à l'égard de certains dirigeants centre-européens puisque, lors d'une conférence sur l'Europe le 21 juin dernier, le chancelier Merz a évoqué la possibilité « d'entrer en confrontation si nécessaire » avec la Hongrie et la Slovaquie si ces dernières persistaient à bloquer les décisions pour l'ensemble de l'Union, ce qui pourrait traduire un intérêt de l'Allemagne pour un renforcement de la conditionnalité financière. Une telle approche ne semble pas, de prime abord, de nature à renforcer les sentiments pro-européens, ni le souhait d'intégration fédérale, des populations d'Europe centrale tentées par l'illibéralisme.
La France gagnerait à investir quoi qu'il en soit dans les relations bilatérales, même si notre pays n'est pas instinctivement dans le paysage mental des Tchèques, des Slovaques ou des Hongrois. Dans ses voeux aux agents diplomatiques en janvier 2023, la ministre Catherine Colonna avait mis en avant le besoin de renforcer l'analyse politique dans plusieurs zones prioritaires, au premier rang desquelles l'Europe centrale et orientale. Cette ambition s'est matérialisée par la création d'ETP supplémentaires, en centrale, mais aussi dans les chancelleries, qui ont cependant profité d'abord à Tallinn, Riga et Vilnius au cours des dernières années, hormis la création d'un poste de n°4 à Budapest à partir de septembre 2025. La coopération décentralisée serait une autre piste d'approfondissement de nos relations avec ces pays.
La France devrait en outre accroître sa visibilité dans les enceintes régionales de coopération. Elle est certes déjà un acteur de premier plan dans le dispositif de défense du flanc est de l'Otan. Depuis 2022, la France est engagée en Roumanie en tant que nation cadre, où la force « Aigle », qui a vocation à monter en cas de besoin au niveau d'une brigade, constitue le plus important déploiement français à l'étranger avec, en moyenne, près de 2000 militaires. Ce cadre de coopération de défense a été renforcé par la signature, le 9 mai 2025, du traité de coopération et d'amitié renforcées avec la Pologne, dit « traité de Nancy », qui contient un important volet en matière de défense, une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression, la promotion d'une industrie de défense européenne, l'approfondissement du dialogue stratégique franco-polonais.
Mais des progrès peuvent être faits dans les enceintes de dialogue politique. En tant que membre de l'Union européenne, elle est, par exemple, déjà observatrice du Conseil des États de la mer baltique, et les ministres Benjamin Haddad et Jean-Noël Barrot ont été invités à participe à la dernière réunion du forum des pays nordiques et scandinaves, dit « NB8 ». La participation de la France aux enceintes de discussion centre et est-européennes ne se justifierait pas moins, compte tenu des enjeux stratégiques du moment.
L'attitude à l'égard des pays du V4 appelle encore quelque prudence à l'aune du tour pris par les négociations relatives au règlement de la question ukrainienne, et compte tenu de la dépendance des politiques extérieures centre-européennes à la politique étrangère américaine. Donald Trump, cherchant à normaliser rapidement la relation avec Moscou, a mis l'accent sur la relance des liens économiques, répété que l'Ukraine n'était pas sa priorité et semble disposé à laisser les Européens seuls face à leurs responsabilités, notamment celle de se réarmer auprès des Etats-Unis. Tel était pour partie l'objet de l'accord conclu avec la présidente de la Commission européenne le 27 juillet 2025.
À partir de ces prémices, l'ancien ambassadeur Jean de Gliniasty a récemment esquissé pour l'Ifri plusieurs scénarios85(*). « Si Poutine continue à éluder les propositions de Trump et poursuit avec succès son offensive, un durcissement des relations russo-américaines est probable », et « l'Europe pourrait alors être à nouveau au diapason américain, et une véritable guerre froide s'instaurerait pour longtemps ». Les incitations à développer l'autonomie européenne en matière de défense pourraient en être allégées du fait du réalignement des positions américaines sur la défense du continent.
« Si Trump, en l'absence de résultat rapide, se désengage du conflit sans renoncer à la normalisation économique avec Moscou, l'Europe sera devant un choix difficile : s'incliner ou continuer à soutenir toute seule l'Ukraine [...] Le risque d'affrontement ne peut pas être totalement exclu ». « Si Poutine finit par accepter les offres de Trump et renonce à établir sa tutelle sur l'ensemble de l'Ukraine, l'Europe devra se prononcer sur un accord bancal faisant la part belle aux intérêts russes, et les contradictions entre Européens seront exacerbées ». Certains se rallieront à l'initiative américaine, dont probablement les Hongrois ; d'autres - parmi lesquels sans doute les Polonais - maintiendront une position hostile à la Russie ; « la France sera devant un choix difficile : demeurer à la tête de la Coalition des volontaires soutenant l'Ukraine ou préparer une normalisation que les Russes lui feront payer au prix fort ». Enfin, « En cas de succès de Trump, les Européens se rallieront tôt ou tard à un accord russo-ukraino-américain, et la course à la normalisation sera relancée. Alors se posera la question d'une « nouvelle architecture de sécurité » en Europe ».
Ces différents scénarios appellent donc à une forme de prudence à l'égard des positions centre-européennes. Leurs élites, ainsi que la mission a pu s'en rendre compte à Prague et à Bratislava, ne sont à ce stade pas convaincues de la possibilité d'un retrait américain substantiel du continent européen et font toujours primer la relation transatlantique sur la recherche d'autonomie européenne. Aussi la position prise par le président de la République à Bratislava le 31 mai 2023, à l'occasion du forum Globsec, appelle-t-elle un examen nuancé. Le président Macron avait alors concédé, en référence au mot d'humeur de Jacques Chirac au moment de la crise irakienne, que Paris avait « parfois perdu des occasions d'écouter » les pays d'Europe centrale, et semblé se rapprocher des pays qui sont de longue date qualifiés de « faucons » à l'égard de la Russie - Pologne, République tchèque - en acceptant de bâtir la défense européenne contre elle86(*).
Les appels du président Macron à bâtir une nouvelle « architecture de sécurité européenne » avaient suscité les critiques des mêmes. L'idée est pourtant intéressante, qui fait volontairement écho à celle du président Mitterrand. Le 31 décembre 1989, lors des voeux de fin d'année, celui-ci avait appelé à la constitution d'une « Confédération européenne au vrai sens du terme qui associera tous les États de notre continent dans une organisation commune et permanente d'échanges, de paix et de sécurité ». Lq'idée était, selon les mots de son conseiller d'alors Jean Musitelli, de « dépasser Yalta sans ressusciter les nationalismes », et sans recours aux « instruments issus de l'ordre ancien, que ce soit l'OTAN comme le souhaitaient les Américains, ou la CSCE comme le suggéraient les Allemands »87(*). Après le sommet de la CSCE de novembre 1990 au cours duquel fut adoptée la « Charte de Paris pour une nouvelle Europe » eurent ainsi lieu les Assises de la Confédération européenne, les 13 et 14 juin 1991, au coeur de l'Europe centrale, à Prague.
Le projet échoua finalement en raison de la priorité donnée à la réunification allemande, de l'impatience des anciennes démocraties populaires à entrer dans la Communauté européenne, de leur réticence à la présence soviétique, du rappel par Vaclav Havel qu'on pouvait « difficilement imaginer ce projet sans le concours des États-Unis et du Canada », puis car il fut éclipsé par les guerres yougoslaves, l'effondrement de l'URSS et les projets de traité de Maastricht. « Mitterrand n'eut que le tort d'avoir raison trop tôt. Sa clairvoyance se heurta à la conjonction du conservatisme (celui des Américains, prioritairement attachés au maintien de leur influence en Europe) et de l'impatience (celle des pays d'Europe de l'Est, pressés de monter dans le train communautaire) »88(*).
La Communauté politique européenne voulue par le président Macron, dont la première réunion de préfiguration s'est aussi tenue à Prague, le 6 octobre 2022, est une intéressante reprise de l'idée de son prédécesseur. Comme en 1991, il s'agit pour la France de « ne pas perdre la main dans un contexte de basculement stratégique »89(*). Reste à préciser son format et son objet. Le géographe Michel Foucher, associé naguère au projet mitterrandien et commentateur de la CPE, cite à ce sujet un propos de Vaclav Havel : « La Russie ne sait pas vraiment où elle commence, ni où elle finit. Dans l'Histoire, la Russie s'est étendue et rétractée. La plupart des conflits trouvent leur origine dans des querelles de frontières et dans la conquête ou la perte de territoire. Le jour où nous conviendrons dans le calme où termine l'Union européenne et où commence la Fédération russe, la moitié de la tension entre les deux disparaîtra »90(*). L'atteinte de cet objectif supposera, le moment venu, de concilier les préoccupations stratégiques de chaque membre et d'accorder à celles des États d'Europe centrale une exacte considération.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 8 octobre 2025, sous la présidence de M. Cédric Perrin, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport d'information de Mme Nicole Duranton et M. Thierry Meignen, rapporteurs : « Une Europe redevenue centrale ».
M. Cédric Perrin, président. - Nous examinons le rapport d'information de Nicole Duranton et Thierry Meignen sur la mission en République tchèque et en Slovaquie.
Mme Nicole Duranton, rapporteur. - Les élections du week-end dernier en Tchéquie ont, sans surprise, consacré la victoire du parti ANO d'Andrej Babi. Si celui-ci représente une version plutôt adoucie des populismes centre-européens et devra former une coalition pour gouverner, le balancier semble reparti en faveur du groupe de Visegrád, enceinte de coopération formée par la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie qui a longtemps été synonyme de critique du consensus européen et le reste sur le plan du soutien à l'Ukraine.
Le Bureau de notre commission a donc bien fait de créer la mission d'information qui nous a conduits en Tchéquie et en Slovaquie, deux pays formant un bon échantillon de cette Europe centrale qui constitue la charnière entre l'Europe de l'Ouest et le monde slave - nous aborderons également un peu la Hongrie et la Pologne.
Cette Europe est à la fois voisine - Prague est plus proche de Paris que Berlin - et relativement peu évocatrice. Tomá Masaryk, philosophe et premier président de la République tchécoslovaque, n'est certes pas inconnu en France, mais qui l'a lu ? Et qui saurait dire à quoi associer Svatopluk Ier, dont l'impressionnante statue équestre domine Bratislava depuis l'entrée du château ?
Sans doute un bref rappel historique est-il donc nécessaire pour fixer cette idée simple : l'Europe centrale n'est pas l'Europe de l'Ouest ; leurs sociétés, leurs cultures politiques, leurs intérêts stratégiques diffèrent.
L'Europe centrale est historiquement la zone de rivalité des puissances germanique, russe et, pendant quelques siècles, turque. Les frontières en ont été continuellement affectées. Résultat : la correspondance entre conscience nationale et autonomie politique dans les limites que nous connaissons est très récente. La Bohême est certes un royaume depuis le XIIe siècle et a une très brillante histoire, mais elle fut incluse dans le Saint-Empire romain germanique, puis l'Empire d'Autriche. Quant aux Slovaques, ils n'ont longtemps été qu'une composante du royaume de Hongrie. Entre le XVIe et le début du XXe siècles, seule la Pologne a été indépendante, mais de façon très discontinue.
Au XIXe siècle, le réveil des nationalités conduit les Habsbourg à consentir le compromis de 1867, qui crée la double monarchie austro-hongroise : une déception pour beaucoup, car une forme d'autonomie est rendue à la Hongrie, incluant l'actuelle Slovaquie, alors que les Tchèques restent fondus parmi les autres possessions héréditaires des Habsbourg.
L'indépendance acquise après la Grande Guerre est encore insatisfaisante, pas seulement pour les Hongrois, vaincus et humiliés par le traité de Trianon. D'une part, elle est, pour la Tchécoslovaquie par exemple, la création des vainqueurs, qui découpent les pièces de l'Autriche-Hongrie de manière assez artificielle et sans consulter les populations. D'autre part, cette politique est motivée, en France surtout, par des conceptions stratégiques visant à se protéger de l'Allemagne, en la privant de son allié autrichien et en constituant un réseau d'alliances de revers ; l'échec de cette politique est connu.
Pensée d'abord comme un rempart contre l'Allemagne, l'indépendance des petites nations centrales est encore instrumentalisée, après la Seconde Guerre mondiale, par l'Union soviétique pour servir de rempart contre l'Occident capitaliste. En ont résulté quarante ans de glaciation et la répression dans le sang des velléités d'autonomie en Hongrie et Tchécoslovaquie.
L'idée d'Europe centrale comme objet géopolitique renaît ainsi pendant la Guerre froide, d'abord dans son expression littéraire. La plus connue en France est due à Milan Kundera, qui écrit en 1983 L'Occident kidnappé pour s'alarmer que l'Europe centrale, épicentre de la culture européenne, étouffe sous l'oreiller soviétique sans que l'Europe libre l'entende crier.
La chute du Mur et de l'URSS est donc l'histoire d'une liberté retrouvée. Le premier usage qu'en ont fait Tchèques et Slovaques a été de modifier de nouveau les frontières en se séparant, fin 1992, puisqu'ils n'avaient jamais souhaité vivre ensemble.
Tous ont rapidement rejoint l'Otan, par désir pressant de trouver un protecteur qui ne pouvait alors pas être l'Europe, faute de politique de défense commune, et à l'invitation non moins pressante du président Clinton et de sa secrétaire d'État d'origine tchèque, Madeleine Albright. Tous ont ensuite rejoint l'Union européenne en 2004. Jusqu'à la crise de 2008 environ, le bilan institutionnel, politique et économique de l'intégration euro-atlantique était jugé plutôt bon. Mais on ne comprend pas la trajectoire politique de ces pays jusqu'à nos jours sans prêter attention au revers de la médaille.
L'intégration européenne n'a pas permis aux petits États centraux de s'affirmer face aux grands États membres. La France, en particulier, n'était pas pressée de voir le centre de gravité de l'Union se déplacer loin de Paris et Bonn. Les nouveaux membres ont longtemps eu le sentiment d'être à nouveau relégués dans une forme de périphérie et que leurs préoccupations de voisinage étaient subordonnées à la relation de l'Union avec Moscou.
Ensuite, la « peur pour l'existence de la Nation », qui caractérise la psychologie centre-européenne, a été réveillée par de sérieux problèmes démographiques. La chute des taux de fécondité et l'exode de la population jeune et instruite vers l'Europe de l'Ouest, certes moindre au centre qu'à l'est, alimentent forcément des angoisses identitaires, dont découle en partie l'obsession de certains leaders, comme Viktor Orbán, pour la natalité.
Enfin, les effets matériels de l'intégration européenne ont alimenté une puissante critique du consensus libéral de l'Union. Les économies des pays d'Europe centrale et orientale sont souvent qualifiées de « capitalismes dépendants », car elles sont dépendantes, dans des proportions variables, aux exportations, aux investissements étrangers, aux financements des banques étrangères, aux transferts issus des migrations ou encore aux fonds structurels européens.
L'intégration des économies tchèque, slovaque, polonaise et hongroise aux chaînes de valeur allemandes, en particulier, a commencé dès la fin des années 1980 ; de nos jours, la Tchéquie est parfois appelée « le dix-septième Land ». La chute du Mur a été l'occasion pour l'Allemagne de réaliser le vieux rêve de la Mitteleuropa, formulé de manière plus ou moins fédérale - ou dominatrice - du milieu du XIXe au début du XXe siècle. Dans ces conditions, le report de la décision par la République tchèque, la Pologne et la Hongrie d'intégrer la zone euro peut être compris comme le refus d'une perte de contrôle économique supplémentaire.
Au carrefour de ces explications, la crise migratoire du milieu des années 2010 a été un puissant catalyseur des mouvements nationaux-populistes en Europe centrale. Terres d'émigration depuis le XIXe siècle et ayant traversé de douloureux nettoyages ethniques pendant et après la Seconde Guerre mondiale, ces pays vivent très mal les prétentions de Bruxelles à imposer un modèle libéral et multiculturel insoucieux des préoccupations nationales.
Dans ces conditions, la progression de forces politiques contestataires du consensus européen s'explique assez bien. On ramène souvent ces forces à deux grandes caractéristiques : une forme de populisme, c'est-à-dire la légitimation par le renchérissement patriotique ou le dépassement des clivages partisans ; et une hostilité à certaines formes garantissant l'État de droit. On y range le Fidesz hongrois de Viktor Orbán, Droit et Justice (PIS) en Pologne, le SMER-SD de Robert Fico en Slovaquie ou encore AUR en Roumanie. Le parti ANO d'Andrej Babis en est une version tempérée, mais celui-ci envisage de rétablir la coopération avec ses homologues hongrois et slovaque.
Bref, l'Europe centrale et orientale n'est pas l'Europe occidentale. De bons historiens centre-européens l'ont montré : les conditions de construction d'États-nations y ont été plus difficiles à réunir, le libéralisme politique et la philosophie de la démocratie y ont été introduits plus tardivement. Les procédures de sanction relatives au respect de l'État de droit ou les niveaux de corruption en témoignent encore.
Quid des conceptions stratégiques ? Dans tous ces États, le maintien d'un lien transatlantique fort demeure l'une des priorités cardinales de la politique extérieure et de défense. La présence américaine en Europe est vue comme une garantie pour la sécurité nationale autant qu'un facteur d'équilibre régional - autrement dit, une manière d'échapper au dilemme historique entre Allemagne et Russie. Il est puissamment porté par l'adhésion des élites politiques au modèle américain, qui a tiré la transition dans les années 1990.
Il ne s'agit pas que d'une demande unilatérale de protection : ces pays sont aussi une pièce importante de l'échiquier européen du point de vue des États-Unis. Ces derniers considèrent qu'une Europe centrale pacifiée par une Allemagne dominante économiquement, mais réconciliée avec ses voisins, car ayant délégué sa défense aux États-Unis, réunit les conditions de promotion des intérêts américains contre leurs principaux adversaires du continent eurasiatique.
Tous sont impliqués dans l'Otan. La Pologne abrite 10 000 soldats américains et une base antimissiles des États-Unis. Hongrie et Slovaquie accueillent des groupements tactiques multinationaux. La Tchéquie joue un rôle important dans la présence avancée de l'Otan en Slovaquie. Tchéquie, Slovaquie et Pologne se sont portées acquéreurs de F-16 ou F-35.
Dès lors, pour les Centre-européens, les notions d'autonomie stratégique et de souveraineté européenne en matière de défense sont impensables, voire comiques. Nos discussions à Prague avec le numéro deux du ministère de la défense n'ont laissé aucun doute à ce sujet. Il n'en résulte pas que les instruments européens ne les intéressent pas, au contraire ; mais ceux-ci ne dicteront jamais une préférence européenne de principe.
Tous les pays d'Europe centrale ont repris à leur compte l'objectif de 5 % du PIB consacré à la défense, fixé par la nouvelle administration américaine et adopté au sommet de La Haye en juin dernier. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, l'a toutefois qualifié d'absurde et a de nouveau brandi l'hypothèse d'une neutralité de son pays, mais sa position semble relativement isolée et le président slovaque a signé la déclaration finale du sommet.
M. Thierry Meignen, rapporteur. - J'en viens aux différentes conceptions des finalités de l'ensemble euro-atlantique - c'est là où les choses se compliquent.
Les attitudes des pays d'Europe centrale à l'égard de la Russie et, par voie de conséquence, de l'Ukraine en guerre sont hétérogènes. Pour Varsovie réconciliée depuis trente-cinq ans avec Berlin, la Russie est l'ennemi historique ; c'est un sentiment qui préexistait aux menaces russes en Ukraine et nourrit l'atlantisme pragmatique du pays. L'hostilité à la Russie est également très forte à Prague : le gouvernement Fiala plaidait pour une politique de sanction très ferme. La Hongrie oscille entre solidarité avec les sanctions européennes et opportunisme économique, puisque, enclavé, le pays dépend des hydrocarbures russes acheminés par voie terrestre à hauteur de 95 % pour le gaz et 77 % pour le pétrole.
Bratislava, enfin, s'est démarquée depuis vingt ans comme la moins hostile à l'égard de Moscou, pour les mêmes raisons pragmatiques que la Hongrie, mais aussi en raison de la sympathie dont jouit la Russie au sein d'une population dont l'identité nationale s'est davantage appuyée, au XIXe siècle, sur le panslavisme contre les idéologies pangermaniste et panmagyare. Le Premier ministre Fico s'est ainsi rendu deux fois à Moscou depuis un an.
Pour cette raison, la Slovaquie est souvent considérée comme le cheval de Troie des intérêts russes en Europe. L'émigration de la population jeune et diplômée des villes déséquilibre en effet les perceptions des Slovaques restés dans le pays et les réseaux sociaux sont un canal efficace de propagation de l'influence russe, mais la russophilie slovaque préexistait à internet.
Les positions des Centre-européens à l'égard de l'Ukraine sont devenues plus complexes encore. Tous lui ont fourni de l'aide. En dépit de la russophilie de Robert Fico, la Slovaquie poursuit son aide à Kiev. Le président du Parlement slovaque, Richard Rai, originaire de Koice, à l'est du pays, nous a bien expliqué les solidarités ukraino-slovaques au niveau décentralisé dans l'extrême ouest de l'Ukraine, qui fut slovaque dans l'entre-deux-guerres, et la crainte de son pays d'un scénario de type Tchernobyl, préjudiciable à toute la région.
Pologne et Tchéquie sont restées les soutiens les plus déterminés de l'Ukraine et ont accueilli de très nombreux réfugiés. Leurs opinions publiques affichent cependant une certaine lassitude : en Tchéquie, elles s'agacent de l'accueil des réfugiés et, en Pologne, elles s'inquiètent des conséquences économiques d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union. Karol Nawrocki, nouveau président polonais, s'est fait le porte-parole de ces craintes et adopte une position de fermeté dans les contentieux mémoriels avec l'Ukraine, tel le massacre des Polonais de Volhynie par l'armée insurrectionnelle ukrainienne pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'hétérogénéité des vues stratégiques des Centre-européens se retrouve à l'égard de la Chine. Pologne et Tchéquie suivent une politique d'ouverture à l'égard de ce pays, mais sa concrétisation se fait attendre et dépend beaucoup de la relation transatlantique. Hongrie et Slovaquie y sont plus ouvertes, avec davantage de succès.
Par ailleurs, Tchéquie et Hongrie se distinguent par la solidité de leur soutien à Israël.
Et l'Europe dans tout cela ? D'abord, l'Union européenne est loin d'épuiser les géographies mentales de la zone. Le fantôme de l'Autriche-Hongrie plane toujours sur l'Europe centrale, puisque Václav Havel appelait, en 1991, à combler le vide laissé par sa disparition ; le groupe de Visegrád a été la première réponse à cet appel. Le format de Slavkov, l'initiative centre-européenne, le groupe des Neuf de Bucarest ou encore l'initiative des trois mers, d'origine polonaise et très soutenue par le président Trump à sa création en 2016, constituent d'autres cadres de coopération en Europe centrale, plus ou moins actifs selon les alignements politiques de leurs membres et aux attributions plus ou moins larges. Ils témoignent que, dans cette partie du continent aussi, les États ont la politique de leur géographie.
La perception de l'Union européenne elle-même est à géométrie variable. Si les élites tchèques y sont très largement attachées, l'opinion publique du pays est historiquement l'une des plus eurosceptiques ; la participation aux élections européennes est traditionnellement très faible, en dessous de 30 %, sauf aux dernières élections, où elle a culminé à 36 %. Les Slovaques sont ceux qui ont la plus mauvaise image de l'Union.
La dernière expression de l'euroscepticisme slovaque est le vote, il y a dix jours, d'une révision constitutionnelle faisant primer la législation du pays sur toute autre norme en matière d'identité nationale, cette notion étant comprise très largement, mais visant d'abord les questions de parentalité, de famille, d'état civil et de moralité publique. Cette réforme a été vivement dénoncée par les défenseurs des droits des minorités. Au-delà du sujet de fond, elle manifeste surtout un souverainisme que l'histoire du pays rend assez facile à comprendre et qu'on retrouve aussi en Tchéquie.
Les points de divergence entre intérêts français et centre-européens sont donc nombreux. La Tchéquie, pays le plus industriel d'Europe en part de richesse nationale, et la Slovaquie, dont l'industrie automobile pèse 10 % du PIB et près de la moitié des exportations, dépendent des États-Unis pour leur commerce et leur défense et les élites politiques et militaires de ces pays en sont très proches. Nos diplomates veulent croire que la position tchèque est en voie de rééquilibrage, car le Premier ministre Fiala a dit poursuivre l'objectif d'une Europe forte, tandis que le président Pavel a appelé l'Europe à « tenir sur ses propres jambes » et à renforcer le « pilier européen de l'Otan » - cela reste à voir.
Ces questions stratégiques en emportent peut-être d'autres : en juin dernier, la République tchèque a écarté la candidature d'EDF pour la construction de deux centrales nucléaires, confiée au sud-coréen KHNP, dont la proximité avec l'américain Westinghouse est apparue ensuite. Très intégrés dans les chaînes de valeur allemandes, peu agricoles, ces États ont soutenu l'accord avec le Mercosur.
La stratégie de soutien à l'Ukraine trouve dans cette zone ses limites. Viktor Orbán dénonce depuis plus d'un an ce qu'il appelle la « psychose de guerre » européenne et théorise un tout autre projet politique : pour l'Europe, un projet économique débarrassé d'ambitions politiques propres ; pour son pays, ce qu'il appelle la « connectivité », au carrefour des mondes européen, russe, turc et est-asiatique. Robert Fico suit une ligne proche.
L'idée d'une autonomie stratégique européenne trouve peu d'échos dans cette zone. Dans le traité que la France a signé avec la Pologne le 9 mai dernier, le terme de souveraineté n'est ainsi associé qu'à l'énergie, l'agriculture et la technologie. Le texte mentionne certes la notion d'autonomie stratégique, mais au paragraphe sur la politique commerciale de l'Union - et c'était avant l'accord conclu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen le 28 juillet dernier...
L'avenir des forces politiques euro-critiques et russo-complaisantes n'est pas facile à prédire. L'image dans les sondages de Viktor Orbán et Robert Fico a nettement pâli, mais la dynamique est plus large. En septembre 2024, le FPÖ autrichien, hostile au soutien à l'Ukraine, s'il n'a pas réussi à former un gouvernement, est devenu la première force politique du pays. En janvier dernier, Zoran Milanoviæ, hostile à l'élargissement de l'Otan et partisan de bonnes relations avec la Russie, a accédé à la présidence croate. En juin, les électeurs polonais ont élu à la présidence le candidat nationaliste et euro-critique Karol Nawrocki, hostile à l'adhésion de l'Ukraine. Enfin, il faudrait revenir un jour sur la situation roumaine.
L'inscription d'Andrej Babi dans ce mouvement n'est pas évidente. Souvent qualifié de populiste, il pourrait mettre fin à l'initiative tchèque pour l'achat d'obus et se montre plus réservé à l'égard du soutien à l'Ukraine. Mais tous nos interlocuteurs sur place nous ont garanti que son arrivée au pouvoir ne changerait pas grand-chose aux grands déterminants de la politique étrangère et de défense tchèque.
Certains grands déterminants matériels de la progression des forces populistes ne devraient pas disparaître de sitôt. Le ralentissement économique allemand lié au renchérissement de l'énergie, aux tarifs douaniers américains et à la concurrence chinoise déstabilise un tissu productif très dépendant des exportations d'automobiles. Le groupe de Visegrád pourrait ainsi rester une force de contestation en Europe. Le facteur économique n'est certes pas le seul qui compte, comme le montre la Pologne, plutôt bien portante.
En toute hypothèse, la France pourrait resserrer ses relations bilatérales avec ses voisins centraux, en tâchant de les comprendre et sans forcément souhaiter qu'ils lui ressemblent.
À cela, tous les moyens sont bons. Nous avons constaté que le souvenir de l'aide apportée par la France à la création de l'État tchécoslovaque est là-bas toujours vif. De fait, notre pays a été le premier à reconnaître, en juin 1918, l'autorité du Conseil national tchécoslovaque, établi à Paris dès 1916 ; le président Poincaré a autorisé la création sur le sol français de l'armée tchécoslovaque avant la naissance de cet État ; le premier chef d'état-major de l'armée nationale a été le général français Maurice Pellé. La mémoire de ces liens historiques est, chez nous, assez faible. Par ailleurs, les jumelages dans cette partie de l'Europe sont probablement insuffisants.
Sur le plan politique, la France est souvent soupçonnée de défendre l'autonomie européenne à son profit et de manquer de considération à l'égard de ses alliés. Les Tchèques nous reprochent ainsi de ne pas les avoir consultés avant l'extinction de la mission Barkhane, à laquelle ils participaient, et de ne pas avoir contribué à leur initiative d'achat de munitions à destination de l'Ukraine. La Tchéquie est désireuse de participer aux discussions stratégiques européennes : le format Weimar+ pourrait être plus volontiers étendu.
Nous nous interrogeons sur l'attitude à adopter à l'égard des populismes centre-européens. Au fond, les désalignements idéologiques entre États membres ne devraient pas empêcher de développer des liens bilatéraux sur le plan économique ou militaire, lesquels se situent dans un temps plus long que celui des alternances politiques. Le chancelier Merz a récemment redoublé de menaces contre les gouvernements hongrois et slovaque en matière de conditionnalité financière : il est douteux que ce soit une bonne méthode pour renforcer le consensus en Europe et le soutien à une intégration plus poussée parmi ces peuples ombrageux lorsque leur souveraineté est menacée, pour des raisons historiquement compréhensibles.
La France pourrait approfondir encore sa visibilité et la défense de ses intérêts dans les enceintes régionales de coopération. Outre son rôle clé dans la défense du flanc est de l'Otan, elle pourrait tenter de s'impliquer davantage dans les enceintes politiques d'Europe centrale, comme elle le fait en tant qu'observatrice dans les organisations de coopération nordiques et baltiques.
Enfin, si l'Union européenne suscite des sentiments aussi mêlés, peut-être la convergence des vues stratégiques pourrait-elle être suscitée dans un nouveau format. La Communauté politique européenne, lancée par le président Macron à Prague en 2022 en écho aux assises de la Confédération européenne organisées, à Prague également, par le président Mitterrand en 1991, pourrait en être le creuset.
M. Mickaël Vallet. - Expliquer que l'Europe centrale réapparaît comme objet géopolitique, notamment dans son expression littéraire, en mentionnant Milan Kundera et L'Occident kidnappé me paraît un contresens. Kundera a, au contraire, défendu l'idée suivante : nous sommes Européens, point. La notion d'Europe centrale et orientale était, pour lui, une façon de détacher ces peuples de ce qu'il considérait comme leur culture profonde, en tout cas pour les intellectuels, et, partant, d'en faire des satellites d'une autre grande culture européenne. Je suggère donc de reformuler ce passage.
Dans un de ses premiers romans en français, Kundera imagine un ancien dissident se rendre compte, lors d'un colloque international, que le petit accent, caractéristique de la culture tchèque, manque sur son nom dans le badge qu'on lui remet... C'est donc à la fois un détail et un enjeu important.
M. Thierry Meignen, rapporteur. - Dans le rapport, nous consacrons deux pages à cet article de Milan Kundera. Ce passage reflétera la nuance que vous soulignez.
M. Cédric Perrin, président. - Comment la France est-elle perçue dans ces deux pays ?
M. Thierry Meignen, rapporteur. - Ils sont très tournés vers l'Allemagne, notamment sur le plan économique. Un certain nombre de jeunes y poursuivent d'ailleurs leurs études. La France est perçue comme une puissance un peu lointaine. Nos jumelages sont peu nombreux, de même que nos liens économiques. C'est comme si la France n'existait pas vraiment pour eux... Un gros travail est donc à mener pour renforcer notre coopération économique ; il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue.
Mme Nicole Duranton, rapporteur. - Nous avons observé à cet égard une vraie attente que la France s'implique davantage en matière économique et de défense.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 10 juin 2025 :
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, direction de l'Union européenne :
- M. Martial Adam, chef de la mission Europe centre-orientale et balte
- M. David Guillaud, rédacteur République Tchèque
- M. Cyprien Bilbault, rédacteur à la mission Europe centre-orientale et balte
Lundi 30 juin et mardi 1er juillet 2025 :
Déplacement à Prague, République Tchèque
- M. Matus Halas, chercheur à l'Institut des relations internationales
- M. Pavel Fischer, président de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat
- M. Jan Jire, directeur général de la politique de défense et de la stratégie
- M. Lubor Koudelka, vice-ministre de la Défense pour les acquisitions
- M. Eduard Hulicius, vice-ministre des affaires étrangères
- M. Jiri Hynek, président de l'association des industries d'armement AOBP
- Visite de l'Agence Européenne pour le Programme Spatial EUSPA
Mercredi 2 et jeudi 3 juillet 2025 :
Déplacement à Bratislava, en Slovaquie :
- M. Ivan tefunko, député PS et président du groupe d'amitié franco-slovaque du Conseil national
- Général Pavel Macko, président du parti politique ODS
- M. Jaroslav Nad, ancien ministre de la défense et président du parti politique Demokrati
- M. Vladimír nidl, journaliste de Denník N
- M. Richard Rasi, président du Conseil national
- Mme Kristína Korbelova, directrice du Département des relations extérieures et du protocole
- M. Daniel Plesko, chef du service des relations extérieures et de la coopération interparlementaire
- Mme Federica Mangiameli, defense and security senior programme manager de Globsec
- M. Tomá Nagy, senior research fellow for nuclear, space, and missile defense, defence & security stream de Globsec
- M. Igor Melicher, secrétaire d'État au ministère de la Défense
- Général Daniel Zmeko, chef d'état-major des Armées
- M. Vladimír imonak, secrétaire d'État au ministère de l'Économie de la République slovaque
* 1 Jan Masaryk, Ani opona, ani most... (Ni rideau ni pont), Prague, Vladimir Zikes, 1947, cité par Justine Faure, L'ami américain. La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplomatie américaine, Paris, Tallandier, 2004.
* 2 Catherine Horel, Cette Europe qu'on dit centrale, Paris, Beauchesne, 2009.
* 3 Tomas Masaryk, La Nouvelle Europe, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 55.
* 4 Voir par exemple Henryk Sienkiewicz, Les chevaliers teutoniques, dont la version originale a paru en roman-feuilleton entre 1897 et 1899, et la première version française en 1901 sous le titre Les chevaliers de la croix ; voir encore Sylvain Gougenheim, Tannenberg - 15 juillet 1410, Paris, Tallandier, 2012.
* 5 Jean et André Sellier, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris, La Découverte, 2014, p. 8.
* 6 Voir Tomas Masaryk, La Nouvelle Europe, Paris, L'Harmattan, 2002.
* 7 Voir notamment Jacques Droz, L'Europe centrale, évolution historique de l'idée de Mitteleuropa, Paris, Payot, 1960.
* 8 Cité par Jacques Droz, op. cit.
* 9 Voir notamment Quinn Slobodian, Les globalistes, Paris, Seuil, 2022, chapitre 4.
* 10 Voir Peter Jordan, « Großgliederung Europas nach kulturräumlichen Kriterien », in Europa Regional 13.2025, 2025, pp. 162-173.
* 11 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, p. 156.
* 12 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, p. 153
* 13 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, pp. 162-163. Sur l'origine et le rôle de l'intelligentsia dans les pays d'Europe centrale, surtout en République tchèque et en Slovaque, voir Bernard Michel, La mémoire de Prague, Paris, Perrin, 1986.
* 14 Jeno Szucs, Les trois Europe, Paris, L'Harmattan, 1985, pp. 66 et suivantes.
* 15 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'Est, Paris, Perrin, 2008, p. 292.
* 16 Voir Pierre Béhar, Vestiges d'empires, Paris, éditions Desjonquères, 1999.
* 17 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'Est, Paris, Perrin, 2008, p. 288.
* 18 Voir, ainsi que sa préface par Georges-Henri Soutou, Isabelle Davion, Mon voisin, cet ennemi - La politique de sécurité française face aux relations polono-tchécoslovaques entre 1919 et 1939, Bruxelles, Peter Lang, 2009.
* 19 Istvan Bibó, Misère des petits États d'Europe de l'Est, Paris, Albin Michel, 1993, p. 176.
* 20 Voir par exemple : Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1920 ; François Fejtö, Requiem pour un empire défunt, Paris, Lieu Commun, 1988 ; Pierre Béhar, L'Autriche-Hongrie, idée d'avenir, Paris, éditions Desjonquères, 1991 et, du même auteur, Vestiges d'empires, Paris, éditions Desjonquères, 1999 ; dans un autre registre, Stefan Zweig, Le monde d'hier, souvenirs d'un Européen, Paris, Le Livre de poche, pp. 466-467 ; voir encore l'entretien croisé entre Jacques Rupnik et François Fejtö, « Requiem pour un empire défunt » dans Esprit 2009/10, pp. 18-30.
* 21 François Fejtö et Jacques Rupnik, « Requiem pour un empire défunt », dans Esprit, 2009/10, pp. 18-30.
* 22 Les développements qui suivent s'inspirent de Justine Faure, L'ami américain. La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplomatie américaine, Paris, Tallandier, 2004.
* 23 Selon l'historien Bruno Arcidiacono, cité par Justice Faure, op. cit., pp. 56-57.
* 24 Justine Faure, L'ami américain. La Tchécoslovaquie, enjeu de la diplomatie américaine, Paris, Tallandier, 2004, pp. 276-281.
* 25 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'est, Paris, Perrin, 1991, p. 416.
* 26 Henry Bogdan, Histoire des pays de l'est, Paris, Perrin, 1991, p. 416.
* 27 Voir notamment Jean-Christophe Romer et Thomas Schreiber, « La France et l'Europe centrale », dans Politique étrangère 60/4, 1995, pp. 917-925.
* 28 Jacques le Rider, La Mitteleuropa, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1994.
* 29 Henry Bogdan, op. cit., p. 630.
* 30 Règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard.
* 31 Pierre Rimbert, « Le Saint Empire économique allemand » dans Le Monde diplomatique, février 2018.
* 32 Pierre Rimbert, op. cit.
* 33 Jean-Christophe Romer et Thomas Schreiber, « La France trop discrète à l'Est », dans Le Monde du 5 janvier 1996.
* 34 Jacques Rupnik, traduit de l'anglais par Lalo, A. « La démocratie illibérale en Europe centrale » dans Esprit 2017/6, pp. 69-85.
* 35 Vaclav Havel, entretien avec Jacques Rupnik, dans Politique internationale, n° 98, hiver 2002-2003, p. 21.
* 36 Voir notamment Thomas Friedman, « Bye bye Nato », dans Foreign Affairs, le 14 avril 1997 ; James Goldgeier, Not whether but when : the US decision to enlarge Nato, Brookings institution press, 1999 ; Kimberly Marten, « Reconsidering NATO expansion: a counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s », in European Journal of International Security, 2018 3(2), pp. 135-161 ; Serhii Plokhy and M. E. Sarotte, « The Shoals of Ukraine Where American Illusions and Great-Power Politics Collide » in Foreign Affairs, le 22 novembre 2019.
* 37 Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier, Paris, Bayard, 1997, p. 106.
* 38 Zbigniew Brzezinski, op. cit., p. 118.
* 39 Voir par exemple Ronald D. Asmus, « L'élargissement de l'OTAN : passé, présent, futur » dans Politique étrangère n° 2002/2, pp. 353-376 ; du même auteur, « L'Amérique, l'Allemagne et la nouvelle logique de réforme de l'Alliance », dans Politique étrangère n°1997/3, pp. 247-261.
* 40 Voir Stanislaw Perzymies, « La France et l'Europe centrale », dans l'Annuaire français des relations internationales 2009/X, 2009.
* 41 David Cadier, « France et Europe centrale : vers la convergence ? » dans Esprit, Juin 2024/6, pp. 10-14.
* 42 Jacques Rupnik, « La crise de l'Union européenne vue d'Europe centrale » dans Esprit, 2006/7, 121-137.
* 43 Jacques Rupnik, « La démocratie illibérale en Europe centrale » dans Esprit 2017/6, pp. 69-85.
* 44 Jacques Rupnik, « La crise du libéralisme en Europe centrale » dans Commentaire, n° 160(4), pp. 797-806.
* 45 Cité par Didier Mineur, « Qu'est-ce que la démocratie illibérale ? » dans Cités n° 79(3), pp. 105-117.
* 46 Roman Krakovsky, « Les démocraties illibérales en Europe centrale », dans Études, Avril 2019, pp. 9-22.
* 47 Voir notamment Éric Magnin, « La grande transformation des pays d'Europe centrale et orientale : tous les chemins (r)évolutionnaires mènent-ils au capitalisme dépendant ? », Les Dossiers du CERI, 2016 ; Violaine Delteil, « Capitalismes dépendants » d'Europe centrale et orientale : pièges de la dépendance externe et instrumentalisations domestiques », dans Revue de la régulation n° 24, second semestre, automne 2018.
* 48 Cité par Roman Krakovsky, op. cit.
* 49 Jacques Rupnik, traduit de l'anglais par Lalo, A. « La démocratie illibérale en Europe centrale » dans Esprit 2017/6, pp. 69-85.
* 50 Viktor Orban, cité par Olivier Bault, dans Jacques Rupnik, « La crise du libéralisme en Europe centrale », op. cit.
* 51 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.
* 52 David Cadier, op. cit.
* 53 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.
* 54 « Diner d'adieu à Prague » dans Le Monde du 8 avril 2010.
* 55 Op. cit.
* 56 « Nous sommes un pays pacifique. La neutralité est peut-être plus appropriée pour notre peuple », a déclaré Robert Fico dans une interview à RTVS le 25 juin 2025.
* 57 Globsec, « The image of Russia in Central & Eastern Europe and the Western Balkans », avril 2021.
* 58 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.
* 59 David Cadier, op. cit.
* 60 Voir « L'Europe penche à l'est, quelles conséquences pour l'Allemagne et la France », table ronde organisée par la Maison Heinrich Heine le 16 mars 2023, avec David Cadier, Jacques Rupnik, Daniel Hegedüs, modérée par David Capitant, notamment les propos des deux premiers.
* 61 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.
* 62 Globsec Trends 2025.
* 63 David Cadier, « France et Europe centrale : vers la convergence ? » dans Esprit, Juin 2024/6, pp. 10-14.
* 64 Entretien avec Dániel Bohár sur la chaîne Youtube Patrióta, le 26 mai 2024.
* 65 Globsec, « New poll: Slovaks want Ukraine to win the war, not Russia », 5 octobre 2022.
* 66 Karol Nawrocki, entretien donné au journal hongrois Mandiner le 7 juin dernier.
* 67 Ses membres sont à l'origine l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie ; la Grèce l'a rejoint en 2019 ; les trois pays baltes en sont sortis en 2021 (la Lituanie) et en 2022.
* 68 David Cadier, « France et Europe centrale : vers la convergence ? » dans Esprit, Juin 2024/6, pp. 10-14.
* 69 BERD, Transition report 2024-2025.
* 70 Jakub Záhora et Jan Daniel, « Czech Foreign Policy towards Israel, Gaza and Palestine: An Introduction » in Czech Journal of International Relations, 60(2), 2025, pp. 105-117.
* 71 Voir Eva Taterová, « Czechoslovak Support for the Founding of Israel in the Late 1940s: the Myth of Everlasting Friendship? » dans le Czech journal of international relations 60(2), 2025, pp. 119-130.
* 72 Voir Marek Èejka, « Václav Havel's Zionism? The Role of New Political Elites in the Transformation of Czech Policies Towards the Israeli-Palestinian Conflict after the Fall of Communism » in Czech Journal of International Relations, 60(2), pp. 133-144.
* 73 Tereza Plítilová, « Reassessing the Czech Public Attitudes towards Israel and the Israel-Palestinian Conflict », in Czech Journal of International Relations 60(2), 2025, pp. 165-178 ; voir aussi Irena Kalhousová, Sarah Komasová, Tereza Plítilová, Marek Vranka, « Elite-Public Gaps in Attitudes towards Israel and the Israeli-Palestinian Conflict: New Evidence from a Survey of Czech Parliamentarians and Citizens », in East European Politics vol. 41 n° 1, 2025, pp. 142-15.
* 74 Voir « Israël courtise les frondeurs de l'Union européenne » dans Le Monde du 16 février 2019.
* 75 Cité par Jacques Rupnik, « L'Europe centrale, objet retrouvé » dans Esprit n° 2022/9, pp. 26-30.
* 76 Atlantic Council, « Completing Europe--From the North-South Corridor to Energy, Transportation, and Telecommunications Union », 21 novembre 2014.
* 77 Marlène Laruelle et Ellen Rivera, « Imagined Geographies of Central and Eastern Europe: The Concept of Intermarium », IERES occasional papers, mars 2019.
* 78 « Que des kebab, un sentiment de désespoir », discours du président Vaclav Klaus devant l'AfD, Lidové Noviny, 14 mars 2016, cité par Jacques Rupnik, op. cit.
* 79 GLOBSEC Trends 2025.
* 80 Voir par exemple « EU prosecutor's office concerned by Slovakia slashing jail terms for corruption » sur Euractiv, le 6 décembre 2023.
* 81 Voir par exemple « Slovakia adopts Russian-style law targeting NGOs » sur Politico, le 17 avril 2025.
* 82 Amélie Zima, « Pays baltes et Pologne : un renouveau de la coopération régionale ? » dans Ramses 2026, Paris, Dunod, 2025, p. 257.
* 83 Georges Mink, « Europe centrale : mutations et divisions » dans Ramses 2026, Paris, Dunod, 2025, p. 107.
* 84 Voir « KHNP et Westinghouse pourraient créer une entreprise commune pour cibler le marché mondial de l'énergie nucléaire » dans The Korean Herald, le 21 août 2025.
* 85 Voir Jean de Gliniasty, « L'Europe, la Russie et la guerre d'Ukraine », dans Ramses 2026, Paris, Dunod, 2025, pp. 98-103.
* 86 Voir David Cadier, « France et Europe centrale : vers la convergence ? » dans Esprit, Juin 2024/6, pp. 10-14.
* 87 Jean Musitelli, « François Mitterrand, architecte de la Grande Europe : le projet de Confédération européenne (1990-1991) » dans Revue internationale et stratégique, n°82, 2011/2, pp. 18-28. Voir aussi Frédéric Bozo, Mitterrand, la fin de la guerre froide et l'unification allemande, Paris, Odile Jacob, 2005, chapitre 7.
* 88 Jean Musitelli, art. précité.
* 89 Michel Foucher, « A Prague, de l'échec confédéral à la Communauté politique européenne », sur Le Grand continent, le 30 septembre 2022.
* 90 Vaclav Havel, dans le Monde du 25 février 2005, cité par Michel Foucher, art. précité.