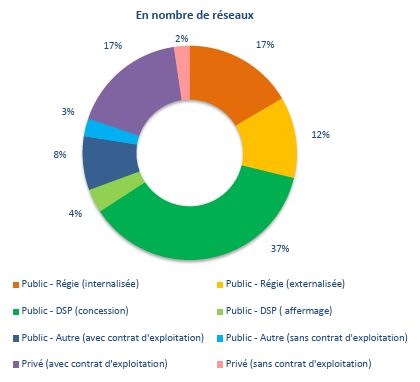ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
NOR : ECOM2524721L/Bleue-1
7 novembre 2025
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 32
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 40
TITRE IER - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS ET MARCHÉS DE CAPITAUX 57
Article 1er - Correction de la transposition de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (« directive sur le crédit immobilier ») 57
Article 2 - Place des titres subordonnés non-éligibles à la constitution de fonds propres dans la hiérarchie des créanciers en liquidation 68
Article 3 - Correction de la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits 79
Article 4 - Dispositions d'adaptation au règlement 2024/790 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers 88
Article 5 - Habilitation à transposer par ordonnance la révision de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et à adapter le droit national des véhicules de titrisation au cadre posé par le règlement titrisation 99
Article 6 - Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance en vue d'assurer la transposition des directives du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'accès aux marchés cotés 115
Articles 7 - Correction des dispositions de transposition de la directive 2019/878/UE dite « CRD5 ». 125
Article 8 - Transposition de la directive (UE) 2024/2994 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale 137
Article 9 - Modalités d'omission des informations commercialement sensibles dans les informations de durabilité publiées en application de la CSRD 148
TITRE II - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 155
Article 10 - Prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme 155
Article 11 - Transposition de la directive « AMLD6 » concernant la transparence des bénéficiaires effectifs 163
TITRE III - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE MARCHÉ INTÉRIEUR, DE CONSOMMATION ET DE CONCURRENCE 177
Article 12 - Règlement (UE) 2024/1028 relatif à la collecte et au partage des données relatives aux services de location de logements à court terme 177
Articles 13, 14 et 15 - Mesures nationales d'adaptation du cadre européen de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur 190
Article 16 - Plateforme nationale des aides d'Etat valant registre national des aides de minimis 201
Article 17 - Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes 215
Article 18 - Mise en conformité avec la directive 2019/2161 relative à la protection des consommateurs 225
Article 19 - Sécurité générale des produits 237
Article 20 et 21 - Transposition de la directive 2024/825 en faveur de la transition verte 249
Article 22 - Achèvement de la transposition de la directive 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire 265
Article 23 - Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels 278
TITRE IV - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ, DE SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE NUMÉRIQUE 301
Articles 24 - Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle 301
Article 25 - Désignation de l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement (UE) 2023/2854 et pouvoirs d'enquête et de sanction 308
Article 26, 27 et 28 - Modifications sémantiques du code de commerce en cohérence avec le Data Act 318
Article 29 - Modification de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique 330
Articles 25 bis et 30 - Extension et application outre-mer du règlement européen sur les données 339
Article 31 -Mise en conformité de dispositions du code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques 349
Article 32 - Dispositions spécifiques d'adaptation au règlement (UE) 2024/2847 relatif à la cyber-résilience 362
Article 33 - Créer le cadre procédural permettant d'assurer l'effectivité des règlements relatifs aux systèmes d'information de l'Union européenne en matière de contrôles d'identité, de droit au séjour et aux frontières 375
Article 34 - Mise en conformité des dispositions du code de procédure pénale relatif aux conditions d'utilisation de la visioconférence ou de toute autre technologie de communication à distance en matière pénale avec le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 399
Article 35 - Mesures d'adaptation du droit national au règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique 408
TITRE V - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE 430
Article 36 -Transposition du règlement 2024/1747 portant sur l'organisation du marché de l'électricité 430
Article 37 -Transposition de la directive 2024/1711portant sur l'organisation du marché de l'électricité 440
Article 38 - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1789 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène et transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène 449
Articles 39 - Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Créations des zones d'accélération renforcée pour les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau 463
Article 40 - Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 472
Article 41 - Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Bioénergies 479
Article 42 - Introduction de l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone dans les Carburants 519
Article 43 - Règlement pour une industrie à zéro émission nette 539
Article 44 - Cadre de sanctions applicables aux violations du règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie 551
Article 45- Transposition de la directive 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments 559
TITRE VI - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'INDUSTRIE, D'ENVIRONNEMENT ET D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 608
Article 46 - Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l`environnement - ajout des infrastructures aéroportuaires 608
Article 47 - Mise en cohérence du code de l'environnement avec la directive 2008/98/CE relative aux déchets et la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement 616
Article 48 - Dispositions relatives aux emballages et aux déchets d'emballages et aux filières de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et professionnels 627
Article 49 - Dispositions relatives aux transferts transfrontaliers de déchets 643
Article 50 - Adaptation du droit français au règlement 2024/1781 sur l'écoconception pour des produits durables 655
Article 51 - Directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage 671
Article 52 - Police environnementale des élevages 688
Article 53 - Stratégie pour le milieu marin 697
TITRE VII - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORT ET D'INFRASTRUCTURES 707
Article 54 - Déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs 707
Article 55 - Vérification des antécédents et habilitation de personnels intervenant dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile 717
Article 56 - Compétences de l'Autorité de régulation des transports en matière de qualité de service 728
Article 57 - Ciel unique européen 741
Article 58 - Mesures relatives à la modulation en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone 749
Article 59 (1°) - Définition du Guichet unique maritime et portuaire 756
Article 59 (2°) - Mise en place, obligations relatives au guichet unique maritime et portuaire et mode de financement 767
Article 60 - Obligations relatives au dépôt des déchets 782
Article 61 - Sanctions à l'encontre de l'autorité portuaire et du déclarant 790
Article 62 - Non-application du guichet unique maritime et portuaire à Saint-Pierre-et-Miquelon 800
TITRE VIII - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE PRODUITS TECHNIQUES 807
Article 63 - Mesures d'adaptation du cadre européen applicable à la conception et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle 807
Article 64 - Mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive 2005/36/CE 818
Article 65 - Convention du travail maritime 827
Article 66 - Organisation du temps de travail des gens de mer 835
Article 67 - Extension du principe de l'extraterritorialité des sanctions aux règles relatives aux tachygraphes (paragraphes I et II) et possibilité d'immobilisation de véhicules de transport routier de marchandises lors d'infractions aux règles relatives aux transports de cabotage (paragraphe III) 844
TITRE IX - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'AGRICULTURE, D'ALIMENTATION ET DE PÊCHE 850
Article 68 - Mesures d'adaptation du code rural et de la pêche maritime au règlement (UE) 2024/1143 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles 850
Article 69 - Modification du code de la propriété intellectuelle pour mettre en cohérence la durée des certificats nationaux d'obtention végétale 865
Article 70 - Contrôle des pêches 873
Article 1er - Tableau de transposition d'une directive 2014/17/UE du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/ce et 2013/36/UE et le règlement (UE) 1093/2010 888
Article 2 - Tableau de transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dite « BRRD 2 » et modifiant la directive BRRD 896
Article 3 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits 902
Article 4 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II Review) 910
Article 7 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres 972
Article 8 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/2994 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale 1002
Article 9 - Tableau de transposition d'une directive de l'Union européenne : Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises 1022
Article 11 - Tableau de transposition de la directive 2024/1640 Anti-blanchiment de capitaux et Financement du terrorisme 1026
Article 13 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/2749 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur 1050
Article 15 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/2749 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques 1073
Article 18 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/2161 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE 1078
Articles 20 et 21 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/825 du parlement européen et du conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyale et grâce à une meilleure information 1092
Article 22 - Tableau de transposition de la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire 1121
Article 37 - Tableau de transposition de la Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union 1126
Article 38 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE 1179
Article 39 - Tableau de transposition de la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 1393
Article 40 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 1423
Article 41 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; ainsi que de mesures de transposition complémentaires de la directive (UE) 2018/2001 relatives aux bioénergies 1427
Article 42 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil 1460
Article 45 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) 1472
Article 46 - Tableau de transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement 1516
Article 47 - Tableau de transposition de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, et de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement 1518
Article 51 - Tableau de transposition de la directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles 1532
Article 53 - Tableau de transposition de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin 1544
Article 58 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures 1551
Article 64 - Tableau de transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 1555
Article 65 - Tableau de transposition de la Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) 1561
Article 66 - Tableau de transposition de la directive 1999/63/CE du conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer et de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 1575
INTRODUCTION GÉNÉRALE
La présente étude d'impact accompagne le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne.
Dans un avis motivé en date du 12 février 2025, la Commission européenne a indiqué qu'elle estimait qu'était incorrecte la transposition des articles 32 et 34 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel en ce qui concerne les obligations relatives au régime de liberté d'établissement et de libre prestation de services des intermédiaires de crédit et à la surveillance des intermédiaires de crédit. L'article 1er corrige ces dispositions.
Tenant compte de questions et objections de la Commission européenne et d'autorités européennes intervenues à la fin de l'année 2024, relativement à l'actuelle transposition française de l'article 48, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (« directive BRRD »), introduit par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (« directive BRRD2 »), l'article 2 vise à préciser le rang, en cas de liquidation judiciaire, d'une catégorie résiduelle d'engagements subordonnés des établissements du secteur bancaire (notamment les titres participatifs et prêts participatifs) qui ne peuvent plus être reconnus comme instruments de fonds propres prudentiels au sens du règlement n° 575/2013 du 26 juin 2013 (« règlement CRR »).
L'article 3 vise à transposer en droit français, au bénéfice des sociétés de financement, l'exclusion prévue par la directive (UE) 2021/2167 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, pour les prêteurs qui ne sont pas des établissements de crédit mais sont néanmoins surveillés par une autorité nationale conformément aux articles 20 de la directive 2008/48/CE ou à l'article 35 de la directive 2014/17/UE. Il permettra ainsi aux sociétés de financement, régulées et supervisées par l'ACPR, de ne pas avoir à supporter les coûts administratifs et financiers d'un double agrément lorsqu'elles exercent des activités de gestion de crédits non performants.
L'article 4 s'inscrit dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (dite « MiFID II »). Cette directive fait partie du paquet législatif adopté en 2024 visant à renforcer la transparence, l'équité et l'efficacité des marchés européens, en articulation avec le règlement (UE) 2024/791 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 (dit « MiFIR »).
L'article 5 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive dite « AIFM 2 », en matière d'outils de gestion de la liquidité pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d'investissement alternatifs (FIA), et d'encadrement de l'activité d'octroi de prêts par les FIA, ainsi qu'à tirer les conséquences de cette directive dans le droit national s'agissant de l'octroi de prêts, notamment en matière de monopole bancaire. Il habilite également à adapter le droit national des organismes de titrisation à la directive dite « AIFM » et au règlement « titrisation ».
L'article 6 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paquet « Listing act » comprenant un règlement et deux directives, l'ensemble visant principalement à faciliter l'accès aux marchés cotés des sociétés européennes et à favoriser la diversification des modes de financement des PME et ETI en allégeant les obligations d'information et en modernisant l'organisation des offres au public.
L'article 7 vise à introduire dans le code monétaire et financier les modifications convenues avec la Commission européenne pour assurer la pleine conformité de la directive CRD5. Ces modifications procèdent d'abord en la correction d'erreurs matérielles. Elles introduisent également une prise en compte des effets particuliers que des mesures de surveillance d'une compagnie financière holding mixte pourraient avoir sur le conglomérat financier détenu par cette compagnie. Elles introduisent une obligation pour l'ACPR, dans le cadre de la surveillance commune conduite par plusieurs autorités compétentes d'un groupe d'établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, ou pour une de ces entités seulement au sein d'un groupe, de saisir l'Autorité bancaire européenne (ABE) en cas de désaccord avec une autre autorité compétente, en particulier au sujet de l'octroi de l'agrément à une compagnie financière holding / holding mixte établie en France et en-dehors de France. Les dispositions de cet article offrent également à l'ACPR une nouvelle possibilité de s'écarter sensiblement de la décision de l'ABE sur le fondement d'une décision motivée.
Ces modifications sont de nature principalement technique et ne se traduiront pas par des changements substantiels des exigences réglementaires ou de la pratique de la supervision.
L'article 8 vise à transposer la directive (UE) 2024/2994 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale. Ce faisant elle contribue à réduire la dépendance excessive des acteurs financiers européens vis-à-vis des contreparties centrales de pays tiers, notamment britanniques, qui continuent de traiter une part substantielle des transactions libellées en euros depuis le Brexit.
L'article 9 corrige une disposition qui prévoit des modalités spécifiques de dépôt du rapport de certification des informations en matière de durabilité au greffe du tribunal de commerce. De telles modalités n'ayant pas été prévues par la directive relative à l'information de durabilité des entreprises dite « CSRD », l'article 9 les supprime.
L'article 10 habilite le Gouvernement à transposer en droit national les dispositions du sixième paquet législatif européen anti-blanchiment du 31 mai 2024, qui renforce et harmonise le cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il habilite également le Gouvernement à procéder aux mises en cohérences du cadre juridique national rendues nécessaires par l'entrée en application en juillet 2027 de ce nouveau dispositif européen et à clarifier l'ensemble du dispositif.
L'article 11 met en conformité le droit national avec les dispositions de la directive européenne n° 2024/1640 du 31 mai 2024 (dite sixième directive anti-blanchiment) relatives à la transparence des bénéficiaires effectifs, qui doivent être transposées avant juillet 2026, contrairement au reste du sixième paquet législatif européen anti-blanchiment dont le délai de transposition est fixé à juillet 2027. Il créé ainsi un nouvel article L. 561-46-3 au sein du code monétaire et financier permettant au bénéficiaire effectif, lorsque cela est rendu nécessaire pour la protection de sa personne, de demander une restriction de la diffusion des informations le concernant figurant au sein du registre centralisé des bénéficiaires effectifs des sociétés. Il transpose également ces dispositions, ainsi que celles plus largement relatives aux modalités d'accès aux données des bénéficiaires effectifs, au registre des trusts et fiducies en modifiant l'article L. 167 du livre des procédures fiscales.
Le secteur de la location de logements de courte durée connaît une régulation croissante, portée à la fois par le droit national et par le droit européen. Après l'adoption en 2024 de deux lois renforçant le contrôle des meublés de tourisme et instituant un dispositif de centralisation des données, le règlement (UE) 2024/1028 instaure un cadre harmonisé de collecte et de partage des informations entre plateformes, autorités locales et États membres.
L'article 12 vise à parachever l'adaptation du droit français à ces nouvelles obligations, en prévoyant l'adoption par ordonnance des mesures techniques nécessaires à la mise en oeuvre du règlement, afin de garantir la cohérence, la fiabilité et l'efficacité du dispositif de régulation.
L'article 13 vise à prévoir les mesures nationales d'adaptation du code de l'environnement pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/2748 et de la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur, lorsqu'un ou plusieurs actes d'exécution de la Commission européenne visent des produits relevant du périmètre spécifique des produits et équipements à risques. Le présent article vise également à compléter le dispositif de sanctions en vigueur au regard des nouvelles dispositions introduites.
L'article 14 vise à transposer, par l'ajout d'un nouvel article dans le code du travail, les dispositions de la directive (UE) 2024/2749.
L'article 15 vise à transposer l'article 9 de la directive 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur. Il instaure des procédures d'urgence en matière de mise sur le marché d'équipements radioélectriques, et confie à l'Agence nationale des fréquences la possibilité de délivrer dans certaines conditions des autorisations de mise sur le marché.
La réglementation européenne demande à ce que les éléments essentiels d'une aide de minimis octroyée à une entreprise soit désormais publiée dans un registre central librement consultable par le public. Ce registre doit contenir des informations sur le montant de l'aide et l'identité de l'entreprise bénéficiaire de façon à ce que toutes les autorités (administrations de l'État, collectivités territoriales et leurs opérateurs) qui octroient une aide puissent s'assurer au préalable que le montant cumulé des aides de minimis ne dépasse pas le plafond fixé par la réglementation (300 000 euros pour le cas général, 750 000 euros pour les services d'intérêt économique général, 50 000 euros pour le secteur agricole).
La règlementation permet de choisir entre constituer un registre au niveau national ou utiliser l'outil développé par l'Union européenne. L'article 16 du projet de loi vise à ce que le choix des autorités françaises de constituer un registre national via la plateforme des aides d'État et de rendre obligatoire son alimentation par les autorités d'octroi soit applicable également aux collectivités territoriales pour les aides qu'elles octroient. L'obligation européenne de constituer un registre s'applique aux aides de minimis générales et aux services d'intérêt économique général à partir du 1er janvier 2026 et au secteur de l'agriculture à partir du 1er janvier 2027. Cet article étend aussi l'obligation de constituer un registre aux aides de minimis du secteur de la pêche afin de bénéficier du plafond plus élevé permis par la réglementation européenne (40 000 au lieu de 30 000 euros en l'absence de registre).
L'article 17 adapte la loi de 1951 au règlement (UE) 2024/3018 - lequel impose aux États membres de garantir l'accès effectif des instituts de statistique aux données détenues par des acteurs privés pour des finalités de statistiques européennes.
L'article 18 du présent projet de loi vise à rendre totalement conforme le droit national avec la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs (dite directive « Omnibus ») modifiant les directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE à la suite de l'EU PILOT adressée par la Commission européenne aux autorités françaises le 15 février 2024 et concernant les conditions de transposition de cette directive en droit national. Sont également corrigées par cet article des sous-transpositions passées de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales des entreprises à l'égard des consommateurs.
Conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, les Etats-membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution adéquats. Dans ce cadre, la France doit se doter du pouvoir nécessaire afin d'émettre des injonctions, tel que décrit aux paragraphes 4 et 5 de l'article 22 du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (ou « RSGP »), entré en vigueur en décembre 2024, tel est l'objet de l'article 19. Cette injonction permettra d'imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne (ou « marketplaces ») de retirer les contenus spécifiques faisant référence à une offre de produits dangereux, d'en rendre l'accès impossible ou d'afficher un avertissement explicite, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de réception de l'injonction. Ces injonctions peuvent en outre exiger de la place de marché qu'elle retire de son interface en ligne, pour une période déterminée, l'ensemble des contenus identiques se rapportant à l'offre du produit dangereux. Les principes généraux de ce mécanisme dit de « notification et action » (ou « notice and takedown ») ont été établis dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Service Act), dont le RSGP constitue une lex specialis pour ce qui concerne les obligations des fournisseurs de place de marché en ligne. Ces injonctions doivent dès lors être émises conformément aux conditions minimales énoncées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 auquel renvoie le paragraphe 4 du RGSP.
Les articles 20 et 21 contiennent les mesures législatives nécessaires à la transposition en droit interne de la directive 2024/825 du 28 février 2024 en faveur de la transition verte. Elles visent, d'une part, à permettre au consommateur d'adopter des comportements d'achats plus durables en lui garantissant une meilleure information sur la durabilité et la réparabilité des biens et, d'autre part, à le protéger contre des pratiques commerciales reposant sur des allégations environnementales trompeuses tendant à l'écoblanchiment (greenwashing), nuisibles à la transition écologique de l'économie.
L'article 22 vise à améliorer le dispositif de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire et à parachever la transposition de la directive 2019/633. D'une part, il modifie l'article L. 443-5 du code de commerce pour ménager les cas dans lesquels une annulation dans un délai supérieur à 30 jours serait considérée comme une trop brève échéance - dans le cadre de l'interdiction pour l'acheteur d'annuler les commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à brève échéance. Il maintient qu'un délai inférieur ou égal à 30 jours est toujours considéré, sauf exceptions limitativement énumérées, comme une trop brève échéance. D'autre part, il crée un nouvel article L. 443-9 dans le code de commerce. Tout d'abord, celui-ci dispose qu'un acheteur ne peut demander la participation du fournisseur aux coûts liés aux remises sur ses produits dans le cadre d'opérations promotionnelles et aux coûts liés à la publicité que si les conditions sont convenues préalablement en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté. Enfin, il prévoit l'interdiction pour l'acheteur de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de fourniture.
L'article 23 vise à adapter en droit national les dispositions du Règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Depuis de nombreuses années, la protection des indications géographiques est établie au niveau de l'Union pour les vins et les boissons spiritueuses ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris les vins aromatisés. Le législateur européen a pris conscience de la nécessité de se pencher désormais sur la protection des produits industriels et artisanaux.
Il était donc opportun d'accorder une protection au niveau de l'Union des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union existant, tout en assurant une certaine harmonisation européenne.
L'article 24 amorce la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle - IA). L'objectif du règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles harmonisées pour garantir que les systèmes d'IA respectent un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux. Le règlement prévoit, pour le suivi des obligations qu'il impose aux systèmes d'IA et à leurs opérateurs, la mise en place d'autorités compétentes au niveau national, les Etats membres déterminant le régime des sanctions et autres mesures d'exécution applicables aux violations de ce même règlement.
L'article 25 désigne l'autorité nationale de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données).
Il précise les pouvoirs d'enquête et de sanction dont cette autorité dispose pour veiller à la bonne application de ce règlement. L'Arcep apparaît comme l'autorité la plus légitime pour assurer la mise en oeuvre cohérente de ce règlement, par sa capacité à répondre aux attentes des entreprises en matière d'expertise technique et sa connaissance des enjeux commerciaux liés aux données, dans des conditions d'indépendance et de fonctionnement reconnues. Cet article précise également les conditions d'application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (« règlement sur les données ») aux territoires d'outre-mer, au regard de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales d'outre-mer.
Cet article renvoie également à un décret d'application précisant les conditions et modalités de la certification des entités en tant qu'organe de règlement des litiges, sous le contrôle de l'Arcep, autorité compétente désignée
L'article 26 entend assurer la conformité sémantique de l'article L.442-12 du code de commerce, créé par l'article 26 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données.
En effet, afin d'éviter toute difficulté résultant de l'emploi de termes différents pour appréhender une réalité similaire, cet article modifie donc l'appellation de « services d'informatique en nuage » à l'article L.442-12 du code de commerce en la remplaçant par le terme « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », ainsi que toutes les occurrences « d'informatique en nuage » par « de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ». Cet alignement des termes ne modifie toutefois pas la définition elle-même des services d'informatique en nuage (appelés services de traitement de données dans le règlement européen pour appréhender possiblement les futures évolutions technologiques), laquelle avait déjà été alignée autant que faire se peut dans le cadre des débats parlementaires sur la loi n° 2024-449 précitée.
L'article 27, dans le même esprit de simplification rédactionnelle et d'alignement sémantique que l'article précédent, modifie les articles L.32, L32-4, L.36-6 et L.36-11 du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques tels que modifiés par la loi SREN afin de remplacer les termes « d'informatique en nuage » par les termes « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».
L'article 28 entend supprimer de l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, à compter du 12 janvier 2027, la référence suivante « au second alinéa du III de l'article 30 » qui sera devenue obsolète en raison de l'abrogation de cet article à cette date, en vertu de l'article 64 IV de la loi SREN (dite « Sunset clause »). Cette suppression s'inscrit dans une démarche de simplification et de clarification du droit applicable, assurant l'articulation entre le règlement européen (d'application directe) et les dispositions de la loi SREN relatives aux services d'informatique en nuage, et prenant en compte les modifications apportées à l'article 30 de la loi de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique par le présent projet de loi.
L'article 28 prévoit également l'ajout, à l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, d'une précision quant à la possibilité pour l'Arcep, désignée comme autorité compétente chargée de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 à l'exception du chapitre VII, de prononcer, en formation restreinte, des sanctions dans les conditions prévues par l'article 35-1 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, créé par l'article 25 du présent projet de loi
L'article 29 introduit quant à lui des modifications sémantiques - notamment en ce qui concerne les termes de « services d'informatique en nuage » - des réagencements et des abrogations ciblées dans le titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée », et par corollaire l'article 64 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN). Ces modifications visent à garantir, autant que faire se peut, la cohérence normative et l'articulation entre les différents textes, et ainsi permettre l'application directe du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 en prévenant les risques de conflits de termes et de normes, y compris dans le temps.
Outre l'objectif de renforcer l'équité et la confiance sur le marché de l'informatique en nuage, la loi SREN avait également pour objectif d'anticiper au mieux l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, en permettant à l'Arcep de commencer à engager les travaux nécessaires à la mise en oeuvre concrète de certaines obligations prévues par ce règlement, en lien avec les acteurs concernés et de manière cohérence et constructive avec les instances européennes. L'entrée en application du règlement en septembre 2025, ainsi que le calendrier d'adoption de la loi SREN, imposent une révision a minima des dispositions prises par le biais de cette dernière pour anticiper l'application du règlement et prévenir tout chevauchement normatif entre les niveaux national et européen. Cette simplification vise ainsi à assurer, pour l'ensemble des acteurs et parties prenantes, la cohérence du cadre juridique et son efficacité.
L'article 30 de la même manière, précise les conditions d'application en outre-mer du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données). Bien que des dispositions permettant l'application de ce règlement ont été introduites dans le cadre de la loi SREN, les conditions de son application en outre-mer n'avaient pas été incluses dans l'ordonnance du 13 novembre 2024 portant extension et adaptation en outre-mer des dispositions de la loi précitée, au regard de la complexité de l'articulation des textes et de la nécessité de traiter cette question de manière globale et cohérente. Le présent projet de loi traite donc de cette question de manière complémentaire au règlement sur les données.
L'article 31 met en conformité le code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques. Il vise ainsi à promouvoir la lisibilité du régime juridique pertinent, en éliminant les contradictions entre les dispositions françaises et les dispositions européennes obligatoires. Il met en oeuvre également le choix du gouvernement français d'activer certaines options permises par le règlement, notamment une entrée en vigueur différée pour les petites communes.
L'article 32 vise l'adaptation des mesures nationales au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement Européen et du Conseil. L'objectif de ce règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme pour les exigences essentielles de cybersécurité pour la mise sur le marché de l'Union de produits comportant des éléments numériques. Le règlement prévoit pour le suivi des exigences qu'il impose aux produits comportant des éléments numériques et à leurs opérateurs, la mise en place d'autorités compétentes au niveau national. Le présent article vise à permettre à l'Agence nationale des fréquences, ainsi désignée par le législateur comme autorité chargée du contrôle du respect des prescriptions du règlement, de mener à bien ces nouvelles missions. Par ailleurs, le règlement prévoit des obligations de notification qui disposent d'un équivalent en droit national à l'article L. 2321-4-1 du code la défense. Cet article tend donc à abroger cette disposition de droit national.
L'article 33 modifie les modalités du contrôle d'identité prévues au code de procédure pénale et les modalités du contrôle du droit au séjour et du contrôle aux frontières prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en tirant les conséquences des règlements européens en matière de systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Il prévoit la possibilité de collecter des données biométriques (empreintes digitales et/ou photographies), en vue de permettre la consultation par la biométrie du système d'information des visas (VIS), du système entrée-sortie (EES), du répertoire commun des identités (CIR) et du système d'information Schengen (SIS) en cas de concordance alphanumérique entre l'identité déclarée et un signalement enregistré dans ce système contenant des données biométriques.
L'article 34 tire les conséquences de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire. Ces dispositions prévoient notamment, dans le cadre d'audiences ou d'auditions expressément visées, qu'en cas de recours à la visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière pénale, le consentement de la personne entendue soit recueilli. Il exige également que les titulaires de l'autorité parentale ou un adulte approprié soient rapidement informés en cas d'usage de tels moyens de communication à l'égard d'un mineur.
L'article 35 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (le « règlement 2024/900 »).
Ce règlement a pour objectif de soutenir le débat politique ouvert et équitable, et garantir le plein respect des droits fondamentaux pour la diffusion de publicité à caractère politique ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Pour cela, il vise à garantir que les citoyens européens puissent faire des choix éclairés lors des élections en leur permettant de reconnaître plus facilement les publicités à caractère politique et les aidant à comprendre leurs bénéficiaires et les financeurs de ces publicités, et si ces citoyens ont fait l'objet d'un ciblage particulier lorsqu'ils ont été exposés à de telles publicités. Le règlement 2024/900 s'appuie sur le droit de l'Union existant, en particulier le règlement général n° 2016/679 sur la protection des données (RGPD) et le règlement n° 2022/2065 sur les services numériques (RSN).
Le présent article désigne les autorités compétentes en charge de la supervision du respect des obligations prévues par le règlement 2024/900, à savoir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (ARCOM) - également désignée point de contact pour la France au niveau de l'Union - et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il organise les modalités de coopération et de coordination entre ces deux autorités et détermine le régime de sanctions applicables aux acteurs visés.
Pour ce faire, le présent article complète la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complète divers articles de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL), complète le code électoral et abroge l'article L.163-1 dudit code, en tirant les conséquences rédactionnelles de cette abrogation.
L'article 36 vient transposer les modifications et créations d'articles apportées par le règlement (UE) 2024/1747 visent à améliorer le fonctionnement des marchés de gros du marché organisé européens et français de l'électricité. Il prévoit l'évaluation des besoins de flexibilités du système électrique français pour une période couvrant au moins les 5 à 10 prochaines années, définit les sources de flexibilité, prévoit que la France définira un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilité non-fossiles et rend possible la mise en oeuvre d'un régime d'aide à la flexibilité non fossile lorsque le développement des sources de flexibilités est insuffisant pour atteindre les objectifs indicatifs précédemment définis. Il élargit la notion actuelle d'« effacement » à celle de « flexibilité de la consommation d'électricité » du règlement (UE) 2024/1747, tout en conservant une définition et un cadre idoine pour les effacements de la consommation tel qu'actuellement prévu à l' article L. 271-1 du code de l'énergie. Il renforce les pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en ce qui concerne, d'une part, les échanges transfrontaliers, et, d'autre part, également la surveillance, la transparence et la liquidité des marchés de gros. Il permet par ailleurs de faire bénéficier aux installations nucléaires d'un contrat pour différence (CfD). Il précise les missions des gestionnaires de réseaux de distribution et de transport quant aux informations qu'ils doivent fournir aux utilisateurs du réseau afin d'assurer un accès efficace aux réseaux. Enfin, cet article complète les compétences de la CRE quant à la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
L'article 37 vient transposer les modifications et créations d'articles apportées par la directive (UE) 2024/1711 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union. Il prévoit que les consommateurs aient accès à un large choix d'offre de fourniture notamment des contrats à prix fixe et à durée déterminée et que les fournisseurs soient soumis à des obligations prudentielles afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre le risque de défaillance des fournisseurs. Il vient également renforcer la protection des consommateurs contre les interruptions de fourniture. Il adapte également en conséquence le code de l'énergie pour renforcer les dispositions transposant la directive 2019/944 concernant les droits contractuels des consommateurs, notamment en matière d'information sur la manière dont le prix est déterminé, sur les conditions de renouvellement de leur contrat ou les conséquences de résiliation d'un contrat. Il vient préciser également l'articulation entre l'autoconsommation et l'activité des opérateurs de bornes de recharge afin d'assurer la mise en oeuvre des modifications introduites par la directive (UE) 2024/1711 à l'article 33 de la directive (UE) 2019/944.
L'article 38 vise, d'une part, à accueillir les modifications législatives nécessaires pour que le droit législatif national soit cohérent avec le régime européen instauré par le règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène modifiant les règlements (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) 715/2009 (refonte).
L'article 38 vise, d'autre part, à transposer la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE.
Ces deux textes introduisent des variations mineures dans le cadre existant pour le marché intérieur du gaz naturel, notamment pour prendre en compte les gaz renouvelables et bas-carbone, et mettent en place un cadre, inspiré de celui du gaz naturel, pour l'hydrogène. Concernant l'hydrogène, il s'agit ainsi par exemple de la désignation d'un régulateur national indépendant, la certification des gestionnaires de réseaux d'hydrogène devant appliquer une séparation d'activités ainsi que d'autres points sensés donner de la visibilité pour les porteurs de projets avec la mise en place rapide d'un cadre complet. Le cadre développé pour l'hydrogène appelle de nombreuses nouvelles dispositions en droit français, souvent inspirées de celles déjà en place dans le code de l'énergie pour le gaz naturel ou l'électricité.
L'article 39 créé des zones d'accélération renforcée pour les projets d'énergie renouvelable et les infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration d'énergies renouvelables dans le système électrique qui seront définies au sein des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ces zones sont définies dans des plans soumis à évaluation environnementale. Les projets d'énergies renouvelables et d'infrastructure de réseau implantés dans ces zones pourront bénéficier d'une exemption d'évaluation environnementale.
S'agissant de l'article 40, la Directive de REDIII renforce les exigences de transparence et d'accessibilité en matière de gestion des données énergétiques afin de soutenir la transition vers un système électrique durable. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis impose aux gestionnaires de réseaux de transport et si les données sont disponibles, aux gestionnaires de réseaux de distribution, de mettre à disposition, sous format numérique et si possible en temps réel, des données relatives à la part d'électricité renouvelable, aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'au potentiel de flexibilité de la consommation. La transposition de cette disposition permettra ainsi d'améliorer la gestion et l'accessibilité des données pour l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité.
L'article 41 du projet de loi transpose les dispositions liées aux bioénergies de la troisième version de la Directive énergies renouvelables (2023/2413). Par rapport à la précédente directive, les critères de durabilité pour l'usage de bioénergies sont renforcés, tant d'un point de vue quantitatif (rehaussement de seuils) que qualitatif (exigences de gestion durable forestière plus importantes). Enfin, le texte introduit le principe d'utilisation en cascade de la biomasse.
L'article 42 vise à aligner le droit national avec les objectifs européens de décarbonation des transports définis par la directive sur les énergies renouvelables 2023/2413. La rédaction actuelle de l'article L. 641-6 du code de l'énergie prévoit que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport soit au moins égale à 15 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports en 2030. Pour l'atteinte de cet objectif, trois vecteurs distincts y contribuent aujourd'hui :
· la Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Energies Renouvelables dans les Transports (TIRUERT), définie à l'article 266 quindecies du code des douanes et révisée annuellement en loi de finances, qui s'applique au secteur routier. Elle offre une visibilité limitée à un voire deux ans aux producteurs de carburants alternatifs et ne permet donc pas le déclenchement d'investissements suffisants dans des capacités de production supplémentaires, nécessaires à une décarbonation souveraine ;
· le règlement 2023/2405 relatif à l'utilisation de carburants durables dans l'aviation, qui garantit à lui seul la décarbonation du secteur aérien ;
· le règlement 2023/1805 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, qui s'applique seulement aux navires de plus de 5000 unités.
Or, la directive 2023/2413 fixe un objectif de réduction de l'intensité carbone de 14,5% en 2030, et s'applique à l'ensemble du secteur des transports. Il convient dès lors de fixer cet objectif au niveau national en définissant une trajectoire afin de donner aux filières de production la visibilité dont elles ont besoin. Dans cet objectif de visibilité, la trajectoire est étendue à 2035. Cet article remplace la Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Energies Renouvelables dans les Transports par l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone des Carburants (IRICC), qui s'applique aux secteurs routier, fluvial et maritime, en cohérence avec les règlements européens sectoriels. Cet article soutient en outre les efforts d'électrification nationale en permettant aux opérateurs de bornes de recharges de générer des certificats, achetés par des metteurs à la consommation de carburants pour contribuer à leurs objectifs. Afin d'assurer une contribution équitable des filières (routier, maritime, fluvial, etc.) aux efforts de décarbonation, sans pénaliser de vecteurs énergétiques et sans rupture majeure qui aurait des conséquences potentiellement lourdes sur les acteurs économiques, des objectifs spécifiques d'incorporation d'énergies renouvelables et une intégration progressive des filières doivent être établies. Ces objectifs et modalités d'application sont renvoyés à un décret en Conseil d'Etat ainsi qu'à un arrêté. Leur adoption fera l'objet de consultations obligatoires dédiées.
Les dispositions du I de l'article 21 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesure en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » organise la transparence des données géologiques du sous-sol pour une meilleure connaissance afin d'accélérer les projets de stockage de CO2, technologie s'inscrivant dans la décarbonation de notre économie. L'article 43 met en conformité les dispositions du code minier avec celles du règlement européen. La réduction des durées de confidentialité des données géologiques permettra d'accélérer tous les projets miniers d'exploration dont la géothermie.
L'article 44 vise à déterminer le régime de sanctions applicable aux violations du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments, dite DPEB, a été adoptée le 24 avril 2024, et vient mettre à jour la précédente directive relative à la performance énergétique des bâtiments. Ses exigences doivent être transposées dans le droit français d'ici au 29 mai 2029. Certaines de ces exigences nécessitent des dispositions législatives, qui sont l'objet de cet article 45.
Ainsi, le 1° du A du I de l'article 45 vise à inscrire dans le droit français la notion de rénovation importante d'un bâtiment, fixée à l'article 2 de la directive et sous-jacente à diverses obligations en rénovation (délivrance d'un diagnostic de performance énergétique, déploiement de bornes de recharge ou de panneaux solaires, etc.)
L'article 14 de la directive renforce les obligations concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) et le stationnement des vélos dans les bâtiments. Des dispositions existent déjà dans la loi française à ce sujet, via la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), et doivent donc faire l'objet d'une mise en cohérence avec les exigences européennes. C'est l'objet des dispositions du 2° à 9° du A du I.
Le B du I de l'article 45 vient introduire l'obligation de délivrance d'un diagnostic de performance énergétique suite à une rénovation importante ou lors du renouvellement d'un bail locatif, en transposition de l'article 20 de la directive.
L'article 10 de la directive prévoit l'obligation d'installation d'un dispositif de production d'énergie solaire en toiture de bâtiments. Sa transposition nécessite de modifier les articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui imposent aux bâtiments neufs, rénovés lourdement ou certains bâtiments existants, d'installer en toiture un dispositif de production d'énergie renouvelable ou de végétalisation. En effet, bien que l'article 10 de la DPEB et les articles 171-4 et 171-5 du CCH aient des objectifs et exigences similaires, les dates d'entrée en vigueur, les typologies de bâtiment soumis à l'obligation et les modalités de respect des obligations ne sont pas les mêmes. C'est l'objet des 1° et 2° du C du I de l'article 45, ainsi que du IV de celui-ci.
Par ailleurs, la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments a substitué à l'obligation de produire une stratégie de rénovation à long terme l'obligation de produire un plan national de rénovation des bâtiments. En conséquence, les dispositions du II de l'article 45 viennent actualiser la mention de la stratégie de rénovation à long terme.
Enfin, la directive actualisée étend aux systèmes de ventilation des bâtiments équipés de systèmes techniques d'une puissance utile nominale supérieure ou égale à 70 kW l'obligation d'inspection actuellement applicable au chauffage et à la climatisation. C'est l'objet des dispositions au III de l'article 45.
L'objet de l'article 46 est la modification du cadre légal initialement défini pour transposer la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. La modification de l'article L. 572-2 du code de l'environnement permettra de consolider le cadre juridique des cartes stratégiques de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement du secteur aérien. Cet ajustement législatif a été recommandé par le Conseil d'Etat en 2023 dans sa note sur le projet de décret relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires.
L'article 47 vise à se conformer à l'avis motivé de la Commission européenne sur la transposition de la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets. Le présent article vise à se conformer strictement aux termes employés dans le texte européen.
Il est également proposé de profiter de ces modifications pour dé-surtransposer le champ de certaines filières à responsabilité élargie du producteur (pour se conformer au cadre européen de la directive 2019/904) et adapter les dispositions relatives à la communication des données relatives aux filières REP auprès de l'ADEME.
L'article 48 modifie divers articles du code des titres I et IV du code de l'environnement afin de tirer les conséquences du règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. Ce règlement réforme le cadre législatif et réglementaire relatif aux emballages et déchets d'emballage.
Ce règlement a notamment pour objectif de réduire la quantité d'emballages mis sur le marché ainsi que la quantité de déchets d'emballages produits (en particulier via le développement du réemploi), et d'augmenter la qualité du recyclage et le contenu en matière recyclée des emballages.
Il s'applique à tous les emballages, qu'ils soient ménagers ou professionnels. En remplaçant la directive n° 94/62/CE du même nom, le nouveau règlement définit un cadre harmonisé pour la mise sur le marché des emballages afin d'éviter les distorsions du marché et les obstacles à la libre circulation des emballages au sein de l'UE.
Cet article a donc pour finalité principale d'harmoniser les dispositions législatives nationales avec les exigences énoncées dans le règlement, lequel, en vertu de son caractère directement applicable, s'impose aux États membres sans nécessiter de mesures de transposition supplémentaires.
De nouvelles dispositions concernant les emballages en plastique sont également introduites par le règlement, et certaines d'entre elles modifient la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qu'il y a donc lieu de transposer dans le droit français.
L'article 49 modifie divers articles du titre IV du code de l'environnement relatifs aux transferts transfrontaliers de déchets. Les changements portent principalement sur la mise à jour des références des textes réglementaires, la modification de définitions et l'usage d'un téléservice pour soumettre et échanger les documents relatifs aux demandes de transferts transfrontaliers de déchets puisque le règlement (UE) 2024/117 prévoit la dématérialisation des procédures relatives aux transferts transfrontaliers de déchets à compter du 21 mai 2026.
L'article 50 vise à permettre la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.
Il prévoit des dispositions permettant d'habiliter les corps de contrôle adéquats afin de procéder à la recherche et à la constatation d'infractions et de manquements au règlement, en adaptant le code de l'environnement, le code de la consommation et le code de la route.
D'autres dispositions apportent des modifications du code de l'environnement pour l'adapter aux nouvelles dispositions du règlement d'application directe en matière d'interdiction de destruction des invendus.
L'article 51 vise à transposer la directive 2010/75/UE, relative aux émissions industrielles, dite « IED ». Cette directive constitue un pilier de la législation environnementale de l'Union européenne ; elle encadre les émissions polluantes issues des installations industrielles à fort impact environnemental. Cette directive a fait l'objet d'une révision, adoptée en 2024.
Plusieurs dispositions de rang législatif sont proposées par cet article pour répondre aux nouvelles exigences de la directive. Elles visent à élargir le champ de la directive à de nouvelles activités, notamment aux travaux miniers, à ajuster le régime de sanctions administratives applicables, à étendre le champ de la consultation du public en cas d'actualisation des conditions d'autorisation de l'exploitation et à adapter le nom de la directive dans le code de l'environnement et le code de l'énergie.
L'article 52 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi permettant la création d'une police spéciale adaptée aux spécificités de l'élevage d'animaux.
Cette habilitation doit contribuer à mettre en oeuvre, pour la partie concernant les élevages, la transposition de la directive relative aux émissions industrielles (IED).
Ce nouveau régime contribuera plus largement à simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l'Union européenne et à l'international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d'autorisation, notamment concernant la consultation du public, à la spécificité des élevages et permettra la mise en oeuvre de procédures administratives appropriées pour des élevages de plus petite taille, non soumis à la directive IED ou à la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (dite EIE).
L'article 53 permettra de procéder à l'ajustement de deux dispositions transposant, dans le code de l'environnement, la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) :
- Modification de l'article L.219-10 du code de l'environnement pour y introduire la possibilité d'un "réexamen" (conformément à l'article 17 de la DCSMM) préalable à la mise à jour d'un volet du plan d'action pour le milieu marin. Cette modification doit permettre de ne pas imposer de mise à jour systématique tous les 6 ans si le contenu des documents concernés ne nécessitait pas d'actualisation au regard des enjeux qu'ils recouvrent.
- Modification des articles L.219-11 et L.123-19 du code de l'environnement de manière à aligner sur le droit commun les modalités de consultation « aval » du public prévues pour les plans d'action pour le milieu marin. Cette modification doit permettre de réduire la durée de la consultation du public de 3 mois à 30 jours minimum, cette durée de 3 mois n'étant pas exigée par la DCSMM.
L'article 54 tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
L'article 2 du règlement (UE) 2023/1804 comporte 72 définitions en lien avec les carburants alternatifs, dont la recharge pour véhicules électriques. En particulier, la 48ième définition du règlement correspond à celle du « point de recharge », unique définition sur la recharge à l'article L. 353-1 du code de l`énergie. Il est proposé, par souci de cohérence, de supprimer l'article L. 353-1 du code précité. Par ailleurs, les éventuelles autres définitions nécessaires à la règlementation pourront être introduites dans la partie règlementaire du code de l'énergie.
Conformément à l'article 20 du règlement, les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement doivent mettre à disposition, en open data sur le Point d'Accès National ( https://transport.data.gouv.fr), certaines données statiques (données immuables du point de recharge telles que la localisation géographique, la puissance, le type de connecteur, etc.) et dynamiques (statut opérationnel, disponibilité, prix) concernant les infrastructures qu'ils exploitent. Parmi ces données figurent : les coordonnées du propriétaire et de l'exploitant de la station de recharge ou de la station de ravitaillement, les horaires d'ouverture, le prix ad hoc (soit le prix à l'acte sans carte d'abonnement, à l'instar du prix affiché avec une pompe de carburant conventionnel), le statut opérationnel ou encore la disponibilité de l'infrastructure en temps réel.
Il est proposé d'habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à contrôler la loyauté des données mises à disposition par les exploitants de points de recharge et ravitaillement sur l'interface numérique établie par l'Etat comme prévu par le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
L'article 55 vise à modifier l' article L. 6342-3 du code des transports, relatif aux habilitations aéroportuaires délivrées par les préfets, afin d'aligner la liste des personnes devant être titulaires de cette habilitation sur celle des personnes pour lesquelles la réglementation européenne en matière de sûreté de l'aviation civile, récemment modifiée, exige la tenue d'une enquête administrative préalable à l'exercice de leurs fonctions. Il vise également à déterminer la liste des personnes soumises à cette habilitation parmi celles pour lesquelles la réglementation européenne laisse à aux autorités nationales la possibilité de déterminer si une enquête administrative doit ou non être menée.
Il a également pour objectif d'étendre aux îles Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les effets de l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Cette disposition abroge la procédure d'agrément du préfet et du procureur de la République qui était mentionnée à l'article L. 6342-4 du code des transports. Cette abrogation résultait du renforcement de la réglementation européenne en matière de vérification des antécédents dont l'adaptation en droit national est inscrite à l'article L. 6342-3 du code des transports.
L'article 56 vise à compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expressément parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars interurbains librement organisés. Cela est nécessaire à l'exercice de ses missions et contribue à une meilleure prise en compte des besoins des usagers des services de transport.
En effet, pour le secteur ferroviaire, la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen comporte dans ses considérants et articles des éléments sur la qualité de service qui justifient certaines pratiques de l'ART en ce domaine, mais qui n'ont pas été dûment pris en compte en droit national lors de sa transposition.
S'agissant de l'article 57, le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen abroge le règlement (CE) n°550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Ce nouveau règlement prend notamment en compte la publication du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, pour remédier aux chevauchements qui existaient depuis.
Ces modifications à l'échelle européenne appellent une modification des références règlementaires qui permettent de définir, dans le code des transports et le code de l'aviation civile, le périmètre de certaines mesures législatives nationales.
L'article 58 vise à ouvrir la possibilité de déroger à l'obligation de moduler les tarifs de péage, applicables aux poids-lourds empruntant les réseaux routiers concernés (les autoroutes et ouvrages d'art soumis à péage), selon les classes CO2 dès lors que l'obligation de prendre en compte les émissions de CO2 dans la tarification du carburant serait remplie du fait du système européen d'échange de quotas d'émission étendu au secteur du transport routier, système dit ETS2. Cet article ouvre également la possibilité de déroger à l'obligation de modulation des tarifs de péage en fonction des classes d'émissions EURO lorsque le péage comprend déjà une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique.
Les articles 59, 60, 61 et 62 sont relatifs au règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE qui introduit un système de guichet unique maritime européen (EMSWe) simplifiant et unifiant les obligations déclaratives des navires qui entrent, sortent et séjournent dans les ports de l' Union européenne. Le système national actuellement applicable est un guichet unique portuaire national, dont les composants ne correspondent plus aux actes juridiques de l'Union. Ainsi, l'article 51 de la loi a pour objet de modifier les dispositions législatives, relatives à ce guichet, figurant dans le code des transports afin d'adapter ces règles aux exigences européennes.
L'article 63, dans le cadre de l'adaptation du droit interne à la réglementation européenne, vise à compléter l'article L. 4311-1 du code du travail afin d'y mentionner expressément l'application du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 relatif aux machines. Ce nouveau règlement, qui se substitue à la directive 2006/42/CE, entrera en application en janvier 2027.
Il introduit également le nouveau règlement (UE) 2024/1689 relatif à l'intelligence artificielle (IA), et plus particulièrement aux systèmes d'IA à haut risque susceptibles d'être intégrés à des équipements de travail ou à des moyens de protection individuelle. (L'article 6 de ce règlement qui prévoit l'articulation des dispositions relatives aux systèmes d'IA à haut risque avec les législations sectorielles sera applicable à partir du 2 août 2027).
Pour une meilleure lisibilité et par souci d'harmonisation des dispositions du code du travail, cet article est également complété par la référence à deux règlements déjà en application :
- le règlement (UE) 167/2013 dit “tracteurs” (les tracteurs sont des équipements de travail) et
- le règlement de 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI)
Cet article apporte également des clarifications sur plusieurs points relatifs à l'application du règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et sur le régime de sanctions pouvant être appliquées aux opérateurs économiques dans ce cadre.
L'article 64 du projet de loi vise à restreindre les cas où la vérification préalable des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne est exigée, s'agissant des responsables d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente ou de location, de transit, et de présentation au public de spécimens vivants de la faune française et étrangère. Cette restriction vise à répondre à une mise en demeure de la Commission européenne portant sur la transposition de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
S'agissant de l'article 65, en conformité avec la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, telle que modifié par la directive 2009/13/CE, le texte confirme la gratuité des visites médicales d'aptitude à la navigation pour les gens de mer et précise quels sont les médecins dûment qualifiés pour les délivrer, pour mieux faire application du droit européen. En effet, le code des transports impose actuellement une prise en charge financière par l'Etat qui n'est pas prévue par la directive européenne. Cette simplification sera notamment favorable à l'activité de certains secteurs maritimes très concurrentiels comme le yachting.
L'article 66 a pour objet d'adapter pour son application aux gens de mer les dispositions du code du travail relatives au nombre de jours de congés payés acquis en cas d'arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie non professionnelle (art. L. 3141-5-1 du code du travail).
Aux fins de conformité avec le droit européen, le nombre de congés payés pour les arrêts de travail d'origine non professionnelle concernant les gens de mer travaillant à bord des navires autre que de pêche, relevant de la directive 1999/63, est fixé à 2,5 jours par calendaires par mois et à 30 jours calendaires par an. Pour les gens de mer travaillant à bord des navires de pêche, relevant de la directive 2003/88, le nombre de jour de congés payés est de 2,4 jours calendaires par mois et de 28 jours calendaires par an.
L'article 67 vise à transcrire dans la législation pénale nationale le principe de l'extraterritorialité des infractions aux règles relatives aux tachygraphes. Ainsi, à l'occasion d'un contrôle sur le territoire français, les autorités de contrôle nationales pourront sanctionner une entreprise et/ou un conducteur pour une infraction commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers (et non déjà sanctionnée).
Il vise également à rétablir la possibilité d'immobiliser un véhicule de transport routier de marchandises en infraction aux règles relatives aux conditions de réalisation des transports de cabotage, possibilité supprimée par erreur par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021.
L'article 68 vise à adapter le code rural et de la pêche maritime (CRPM) à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, dit « règlement IG ».
Il prévoit :
- L'adaptation des dispositions relatives au champ d'application et à la procédure de reconnaissance et de modification des appellations d'origine, des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, afin d'assurer leur cohérence avec le droit de l'Union européenne.
- La reconnaissance des organismes de défense et de gestion reconnus en vue de la défense et de la gestion d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en tant que groupements de producteurs reconnus au sens du règlement susmentionné. Les groupements de producteurs reconnus, institués par ce règlement, visent en effet à instaurer au niveau de l'Union un système inspiré de celui des organismes de défense et de gestion français.
L'article 69 aligne la durée des certificats d'obtention végétale délivrés au niveau national sur celle des certificats délivrés au niveau communautaire, le règlement (UE) 2021/1873 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 ayant augmenté la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, afin de tenir compte des difficultés techniques liées à la sélection de ces espèces.
Le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 20231(*) relatif à la politique de contrôle des pêches au sein de l'Union européenne établit un nouveau cadre juridique commun en matière de contrôle des pêches au sein de l'Union européenne. Son adaptation en droit interne nécessite de modifier les dispositions du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
L'article 70 du projet de loi prévoit ainsi de modifier :
- l'article L. 942-1 du CRPM en vue d'élargir le nombre d'agents habilités à constater les manquements à la réglementation européenne relative à la pêche et à prendre des mesures conservatoires lors du constat de ces manquements ;
- les articles L. 943-1 et L. 943-8 du CRPM pour élargir les mesures conservatoires pouvant être prises par les agents chargés de constater et rechercher les infractions ainsi que par l'autorité compétente ;
- l'article L. 945-4 du CRPM afin de préciser les infractions applicables en cas de manquements à la réglementation relative à la pêche ;
- l'article L. 945-5 du CRPM pour préciser les peines complémentaires applicables aux personnes coupables d'une infraction à la réglementation européenne ;
- l'article L. 946-1 du CRPM afin de supprimer un renvoi par décret en Conseil d'Etat qui n'apparaît plus pertinent ;
- les articles L. 951-9 et L. 951-10 du CRPM pour adapter la procédure contentieuse applicable en Guyane par le juge des libertés et lui permettre d'ordonner la destruction en mer des embarcations qui ont servi à commettre des infractions, lorsque ni le propriétaire de l'embarcation ni une personne ayant des droits sur elle ne sont connus, et qu'il n'est pas possible de procéder à la destruction à terre dans un lieu situé à proximité.
Il habilite enfin le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l'effectivité de la politique de contrôle des pêches, d'une part en appliquant la procédure d'amende forfaitaire à certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime et d'autre part en instituant un régime de transaction pénale pour certains délits.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
|
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
|
1er |
Correction de la transposition de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (« directive sur le crédit immobilier ») |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) |
Sans objet. |
|
2 |
Place des titres subordonnés non-éligibles à la constitution de fonds propres dans la hiérarchie des créanciers en liquidation |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Fédération bancaire française (FBF) Association française des sociétés de financement (ASF) |
|
3 |
Correction de la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits. |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Fédération bancaire française (FBF) |
|
4 |
Dispositions d'adaptation au règlement 2024/790 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers |
Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière (CCLRF) |
Autorité des marchés financiers |
|
5 |
Habilitation à transposer par ordonnance la révision de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et à adapter le droit national des véhicules de titrisation au cadre posé par le règlement titrisation |
Sans objet. |
Consultations des principales fédérations d'acteurs concernés de la place financière (Association française de la gestion financière, France Invest, Association française des sociétés de placement immobilier, Paris Europlace, France Post Marché, etc.) |
|
6 |
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance en vue d'assurer la transposition des directives du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'accès aux marchés cotés |
Sans objet. |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers (AMF), consultation de place |
|
7 |
Correction des dispositions de transposition de la directive 2019/878/UE dite « CRD5 » |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Fédération bancaire française (FBF) Association française des Sociétés de financement (ASF) |
|
8 |
Transposition de la directive 2024/2994/ UE modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et 2019/2034/UE en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale |
Comité consultatif de législation et de réglementation financières (CCLRF) |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Autorité des marchés financiers (AMF) Consultation de place organisée par la direction générale du trésor avec LCH SA, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, ainsi que les associations professionnelles (Fédération Bancaire Française, Association française des Marchés FInanciers, France Post-Marché). |
|
9 |
Modalités d'omission des informations commercialement sensibles dans les informations de durabilité publiées en application de la CSRD |
Sans objet. |
Association française des entreprises privées (AFEP) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Autorité des marchés financiers Haute autorité de l'audit |
|
10 |
Prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme |
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
11 |
Transposition de la directive « AMLD6 » concernant la transparence des bénéficiaires effectifs |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
12 |
Règlement (UE) 2024/1028 relatif à la collecte et au partage des données relatives aux services de location de logements à court terme |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
13,14 et 15 |
Mesures nationales d'adaptation du cadre européen de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur |
Conseil d'orientation des conditions de travail Consultation publique au titre du code des postes et communications Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse Commission supérieure du numérique et des postes |
Sans objet. |
|
16 |
Plateforme nationale des aides d'État valant registre national des aides de minimis |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
17 |
Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
18 |
Mise en conformité avec la directive (UE) 2019/2161 relative à la protection des consommateurs |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
19 |
Sécurité générale des produits |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
20 et 21 |
Transposition de la directive 2024/825 en faveur de la transition verte |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
22 |
Achèvement de la transposition de la directive 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
23 |
Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels |
Sans objet. |
Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales (FFIGIA) Comité français d'accréditation (COFRAC) |
|
24 |
Dispositions spécifiques d'adaptation au règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
25 |
Désignation de l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement (UE) 2023/2854 et pouvoirs d'enquête et de sanction |
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) |
Sans objet. |
|
26 |
Modification de la définition de service
d'informatique en nuage à l'article |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
27 |
Modification du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques |
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) |
Sans objet. |
|
28 |
Modification du titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques |
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) |
Sans objet. |
|
29 |
Modification de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique |
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) |
Sans objet. |
|
25 bis et 30 |
Extension et application outre-mer du règlement européen sur les données |
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) |
Sans objet. |
|
31 |
Mise en conformité de dispositions du code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques |
Consultation publique au titre du code des postes et communications électroniques Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse Commission supérieure du numérique et des postes Conseil national d'évaluation des normes |
Sans objet. |
|
32 |
Dispositions spécifiques d'adaptation au règlement (UE) 2024/2847 relatif à la cyber-résilience |
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) |
Sans objet. |
|
33 |
Créer le cadre procédural permettant d'assurer l'effectivité des règlements européens relatifs aux systèmes d'information de l'Union européenne en matière de contrôles d'identité, de droit au séjour et aux frontières |
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
34 |
Mise en conformité des dispositions du code de procédure pénale relatif aux conditions d'utilisation de la visioconférence ou de toute autre technologie de communication à distance en matière pénale avec le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
35 |
Mesures d'adaptation du droit national au règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique |
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) |
|
36 |
Transposition du règlement 2024/1747 portant sur l'organisation du marché de l'électricité |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
37 |
Transposition de la directive 2024/1711 portant sur l'organisation du marché de l'électricité |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
38 |
Mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1789 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène et transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
39 |
Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables -Créations des zones d'accélération renforcée pour les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
40 |
Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
41 |
Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Bioénergies |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
42 |
Introduction de l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone des Carburants |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Consultation publique du 12 mai au 10 juin 2025. |
|
43 |
Règlement pour une industrie à zéro émission nette |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
44 |
Cadre de sanctions applicable aux violations du règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
45 |
Transposition de la directive 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) Conseil National de l'Habitat (CNH) |
Sans objet. |
|
46 |
Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l`environnement - ajout des infrastructures aéroportuaires |
Sans objet |
Sans objet |
|
47 |
Mise en cohérence du code de l'environnement avec la directive 2008/98/CE relative aux déchets et la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Conseil national de l'économie circulaire (CNEC) |
|
48 |
Dispositions relatives aux emballages et déchets d'emballage et aux filières de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et professionnels |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Conseil national de l'économie circulaire (CNEC) |
|
49 |
Dispositions relatives aux transferts transfrontaliers de déchets |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Conseil national de l'économie circulaire (CNEC) |
|
50 |
Adaptation du droit français pour la mise en oeuvre du règlement 2024/1781 relatif à l'écoconception pour des produits durables |
Sans objet. |
Consultation du Conseil national de l'économie circulaire (CNEC) pour les dispositions relatives aux invendus non-alimentaires |
|
51 |
Directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
52 |
Police environnementale des élevages |
Mission interministérielle de l'eau |
Sans objet. |
|
53 |
Stratégie pour le milieu marin |
Conseil national de la mer et des littoraux Mission interministérielle de l'eau |
Sans objet. |
|
54 |
Déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
55 |
Vérification des antécédents et habilitation de personnels intervenant dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
56 |
Compétences de l'Autorité de régulation des transports en matière de qualité de service |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Autorité de régulation des transports (ART) |
|
57 |
Ciel unique européen |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
58 |
Mesures relatives à la modulation en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
59 (1°) |
Définition du Guichet unique maritime et portuaire |
Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
59 (2°) |
Mise en place, obligations relatives au guichet unique maritime et portuaire et mode de financement |
Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
60 |
Obligations relatives au dépôt des déchets |
Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
61 |
Sanction à l'encontre de l'autorité portuaire et des déclarants |
Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
62 |
Non-application du guichet unique maritime et portuaire à Saint-Pierre-et-Miquelon |
Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
|
63 |
Mesures d'adaptation du cadre européen applicable à la conception et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle |
Conseil d'orientation des conditions de travail. |
Sans objet. |
|
64 |
Mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive 2005/36/CE |
Sans objet |
Sans objet |
|
65 |
Convention du travail maritime |
Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCMEFP) |
Sans objet. |
|
66 |
Organisation du temps de travail des gens de mer |
Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCMEFP) |
Sans objet. |
|
67 |
Extension du principe de l'extraterritorialité des sanctions aux règles relatives aux tachygraphes (paragraphes I et II) et possibilité d'immobilisation de véhicules de transport routier de marchandises lors d'infractions aux règles relatives aux transports de cabotage (paragraphe III) |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
68 |
Mesures d'adaptation du code rural et de la pêche maritime au règlement (UE) 2024/1143 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles |
Conseil territorial de Saint-Barthélemy |
Sans objet |
|
69 |
Modification du code de la propriété intellectuelle pour mettre en cohérence la durée des certificats nationaux d'obtention végétale |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
70 |
Contrôle des pêches |
Assemblée de Guyane Mission interministérielle de l'eau |
Sans objet. |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
|
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
|
1er |
Correction de la transposition de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (« directive sur le crédit immobilier ») |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique (Direction générale du Trésor) |
|
2 |
Place des titres subordonnés non-éligibles à la constitution de fonds propres dans la hiérarchie des créanciers en liquidation |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
3 |
Correction de la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
4 |
Dispositions d'adaptation au règlement 2024/790 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers |
Décret simple |
DG Trésor |
|
5 |
Habilitation à transposer par ordonnance la révision de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et à adapter le droit national des véhicules de titrisation au cadre posé par le règlement titrisation |
Ordonnance |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale du Trésor |
|
6 |
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance en vue d'assurer la transposition des directives du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'accès aux marchés cotés |
Ordonnance |
Direction générale du Trésor |
|
7 |
Correction des dispositions de transposition de la directive 2019/878/UE dite « CRD5 » |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
8 |
Transposition de la directive 2024/2994/ UE modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et 2019/2034/UE en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
9 |
Modalités d'omission des informations commercialement sensibles dans les informations de durabilité publiées en application de la CSRD |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
10 |
Prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme |
Ordonnance |
Ministère de l'Economie et des Finances Direction générale du Trésor
|
|
11 |
Transposition de la directive « AMLD6 » concernant la transparence des bénéficiaires effectifs |
Décrets en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Economie et des Finances Direction générale du Trésor (DGT) |
|
12 |
Règlement (UE) 2024/1028 relatif à la collecte et au partage des données relatives aux services de location de logements à court terme |
Ordonnance |
Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale des Entreprises |
|
13, 14 et 15 |
Mesures nationales d'adaptation du cadre européen de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur |
Décrets en Conseil d'Etat |
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles Direction générale du travail (DGT) Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale des entreprises (DGE) |
|
16 |
Plateforme nationale des aides d'État valant registre national des aides de minimis |
Décret simple |
Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale des Entreprises (DGE) |
|
17 |
Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes |
Décret simple |
Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique Direction de l'Insee |
|
18 |
Mise en conformité avec la directive (UE) 2019/2161 relative à la protection des consommateurs |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
19 |
Sécurité générale des produits |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
20 et 21 |
Transposition de la directive 2024/825 en faveur de la transition verte |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Economie et des Finances et Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) |
|
22 |
Achèvement de la transposition de la directive 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
23 |
Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels |
Décret en Conseil d'Etat. |
Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle Direction Générale des Entreprises (DGE) |
|
24 |
Dispositions spécifiques d'adaptation au règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
25 |
Désignation de l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement (UE) 2023/2854 et pouvoirs d'enquête et de sanction |
Décret simple. |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale des Entreprises |
|
26 |
Modification de la définition de service
d'informatique en nuage à l'article |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
27 |
Modification du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
28 |
Modification du titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
29 |
Modification de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
25 bis et 30 |
Extension et application outre-mer du règlement européen sur les données |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
31 |
Mise en conformité de dispositions du code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale des entreprises (DGE) |
|
32 |
Dispositions spécifiques d'adaptation au règlement (UE) 2024/2847 relatif à la cyber-résilience |
Décret en Conseil d'Etat |
Services du Premier ministre Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Agence nationale de sécurité des systèmes d'information Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale des entreprises |
|
33 |
Créer le cadre procédural permettant d'assurer l'effectivité des règlements européens relatifs aux systèmes d'information de l'Union européenne en matière de contrôles d'identité, de droit au séjour et aux frontières. |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
34 |
Mise en conformité des dispositions du code de procédure pénale relatif aux conditions d'utilisation de la visioconférence ou de toute autre technologie de communication à distance en matière pénale avec le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 |
Sans objet |
Sans objet |
|
35 |
Mesures d'adaptation du droit national au règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la Culture Direction générale des médias et des industries culturelles |
|
36 |
Transposition du règlement 2024/1747 portant sur l'organisation du marché de l'électricité |
Décrets en Conseil d'Etat Décret simple Arrêté |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) |
|
37 |
Transposition de la directive 2024/1711 portant sur l'organisation du marché de l'électricité |
Décrets en Conseil d'Etat Décrets simples Arrêtés |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) |
|
38 |
Mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1789 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène et Transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) |
|
39 |
Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables -Créations des zones d'accélération renforcée pour les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau |
Décrets en Conseil d'Etat |
Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) |
|
40 |
Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
41 |
Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Bioénergies |
Décret en Conseil d'Etat Arrêtés |
Direction générale de l'énergie et du climat |
|
42 |
Introduction de l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone des Carburants |
Décret en Conseil d'Etat Arrêtés |
Ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique Ministère chargé de l'industrie et de l'énergie Direction générale des douanes et des droits indirects et Direction générale de l'énergie et du climat |
|
43 |
Règlement pour une industrie à zéro émission nette |
Décret simple |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) |
|
44 |
Cadre de sanctions applicable aux violations du règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
45 |
Transposition de la directive 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments |
Décrets en Conseil d'État Arrêtés |
Ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Ministère de l'industrie et de l'énergie Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) |
|
46 |
Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l`environnement - ajout des infrastructures aéroportuaires |
Sans objet |
Sans objet |
|
47 |
Mise en cohérence du code de l'environnement avec la directive 2008/98/CE relative aux déchets et la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement |
Arrêté ministériel |
Direction générale de la prévention des risques (DGPR) |
|
48 |
Dispositions relatives aux emballages et déchets d'emballage et aux filières de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et professionnels |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale de la prévention des risques (DGPR) |
|
49 |
Dispositions relatives aux transferts transfrontaliers de déchets |
Décret en Conseil d'Etat |
Direction générale de la prévention des risques (DGPR) |
|
50 |
Adaptation du droit français pour la mise en oeuvre du règlement 2024/1781 relatif à l'écoconception pour des produits durables |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
51 |
Directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage |
Décret en Conseil d'Etat |
Direction générale de prévention des risques (DGPR) |
|
52 |
Police environnementale des élevages |
Ordonnance |
Direction Générale de la Prévention des Risques |
|
53 |
Stratégie pour le milieu marin |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
54 |
Déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
55 |
Vérification des antécédents et habilitation de personnels intervenant dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
56 |
Compétences de l'Autorité de régulation des transports en matière de qualité de service |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
57 |
Ciel unique européen |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
58 |
Mesures relatives à la modulation en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone |
Sans objet. |
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités |
|
59 (1°) |
Définition du Guichet unique maritime et portuaire |
Décret en Conseil d'Etat |
Direction Générale Des Affaires Maritimes, De La Pêche Et De L'Aquaculture |
|
59 (2°) |
Mise en place, obligations relatives au guichet unique maritime et portuaire et mode de financement |
Arrêtés |
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) Ministère chargé des transports Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) |
|
60 |
Obligations relatives au dépôt des déchets |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) |
|
61 |
Sanction à l'encontre de l'autorité portuaire et des déclarants |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) |
|
62 |
Non-application du guichet unique maritime et portuaire à Saint-Pierre-et-Miquelon |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
63 |
Mesures d'adaptation du cadre européen applicable à la conception et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
64 |
Mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive 2005/36/CE |
Sans objet |
Sans objet. |
|
65 |
Convention du travail maritime |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction Générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) |
|
66 |
Organisation du temps de travail des gens de mer |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
67 |
Extension du principe de l'extraterritorialité des sanctions aux règles relatives aux tachygraphes (paragraphes I et II) et possibilité d'immobilisation de véhicules de transport routier de marchandises lors d'infractions aux règles relatives aux transports de cabotage (paragraphe III) |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
68 |
Mesures d'adaptation du code rural et de la pêche maritime au règlement (UE) 2024/1143 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles |
Sans objet |
Sans objet |
|
69 |
Modification du code de la propriété intellectuelle pour mettre en cohérence la durée des certificats nationaux d'obtention végétale |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
70 |
Contrôle des pêches |
Ordonnance |
Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) |
TABLEAU D'INDICATEURS
|
Indicateur |
Objectif et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
|
Nombre d'autorisations de mise sur le marché délivrées en période d'activation du mode d'urgence |
Suivi par la Direction générale de la prévention des risques ( DGPR) |
100 % des produits respectant les exigences essentielles de sécurité |
Ces autorisations ne pourront être délivrées qu'en période d'activation du mode d'urgence par la Commission européenne |
Article 13 II de l'article 13 créant une Section 1 bis « Procédures d'urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise |
|
Nombre d'autorisations de mise sur le marché délivrées en période d'activation du mode d'urgence |
Suivi par l'ANFR |
100 % des produits respectant les exigences essentielles de sécurité |
Ces autorisations ne pourront être délivrées qu'en période d'activation du mode d'urgence par la Commission européenne |
Article 15 III de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques |
|
Nombre annuel d'études mobilisant des données transmises par des organismes privés |
Comptabilisation annuelle des études publiées suite à une demande formelle adressées par les services statistiques aux organismes privés, sur le fondement du nouvel article 3 bis Administration en charge de la collecte des données et/ou du suivi de l'indicateur : Insee |
Progression annuelle, atteignant 2 études par an en moyenne d'ici 5 ans |
5 ans |
Article 17 Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes Adaptation du cadre national pour permettre la transmission de données nécessaires à la production de statistiques européennes. |
|
Nombre annuel de demandes de transmission adressées aux organismes privés |
Comptabilisation annuelle des demandes formelles adressées par les services statistiques aux organismes privés, sur le fondement du nouvel article 3 bis Administration en charge de la collecte des données et/ou du suivi de l'indicateur : Insee |
Progression annuelle, atteignant 1 demande par an en moyenne d'ici 5 ans |
5 ans |
Article 17 Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes Adaptation du cadre national pour permettre la transmission de données nécessaires à la production de statistiques européennes. |
|
Taux de demandes aboutissant sans mise en demeure |
Proportion des demandes satisfaites volontairement (accord express) par rapport au total des demandes formulées Administration en charge de la collecte des données et/ou du suivi de l'indicateur : Insee |
Maintien d'un taux supérieur à 95 % |
5 ans |
Article 17 Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes Concertation préalable systématique prévue par la loi |
|
Nombre de sanctions administratives prononcées |
Nombre de sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article 3 bis sur les nouveaux cas Administration en charge de la collecte des données et/ou du suivi de l'indicateur : Insee |
Faible recours : moins de 1 sanction par an sur les 5 ans |
5 ans |
Article 17 Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes Application des sanctions existantes à l'ensemble des cas couverts |
|
Nombre de retraits d'annonces de produits dangereux vendus en ligne effectivement effectuées par les places de marché en ligne à la demande des autorités |
Evaluer l'impact de ce nouveau pouvoir d'injonction dont le règlement UE 2023/988 a doté les autorités européennes de surveillance du marché |
Objectif tendanciel : Augmentation progressive du nombre d'annonces retirées par les places de marché en ligne, étant donné les taux de non-conformité et dangerosité très importants identifiés aujourd'hui sur ces acteurs de la vente en ligne |
3 à 5 ans |
Article 19 Création d'une habilitation pour les agents de la CCRF d'émettre des injonctions de retrait des produits dangereux à l'encontre des places de marché en ligne |
|
Nombre d'Indications Géographiques enregistrées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions d'adaptation du Règlement 2023/2411 |
L'indicateur reflète l'impact de la création du système européen d'indication géographiques pour les produits artisanaux et industriels (INPI) |
En valeur : 50 Observation de l'évolution du nombre d'IG enregistrées |
25 ans |
Article 23 Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels |
|
Nombre de manquements au règlement UE 2023/2411 constatés depuis l'entrée en vigueur |
L'indicateur reflète l'évolution des manquements à la protection des indications géographiques des produits artisanaux et industriels, en passant d'un système de protection national à européen (DGCCRF) |
En valeur Observation de l'évolution du nombre de manquements constatés |
3 à 5 ans |
Article 23 Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels |
|
Nombre de contrôles effectués |
Suivi du nombre de contrôles effectués par l'ANFR au titre du règlement L'ANFR recueillera les données et assurera le suivi de l'indicateur |
Entre 20 et 50 |
3 ans |
Article 32 Adaptation au règlement (UE) 2024/2847 (création de nouveaux contrôles et catégories de produits réglementés) |
|
Nombre de contrôles aboutissant à un constat de non-conformité |
Suivi du nombre de cas non conformes constatés par l'ANFR au titre du règlement L'ANFR recueillera les données et assurera le suivi de l'indicateur |
50% des équipements contrôlés |
3 ans |
Article 32 Adaptation au règlement (UE) 2024/2847 (création de nouveaux pouvoirs de sanctions en cas de non-conformité aux obligations du règlement) |
|
Nombre d'injonctions émises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en tant qu'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique |
Mesurer le nombre d'injonctions prononcées par l'ARCOM visant à mettre fin à tout manquement au règlement (UE) 2024/900 par les services qu'elle supervise |
Constater le degré de mise en oeuvre du texte par les acteurs visés et une éventuelle tendance haussière, mesurer la montée en charge pour l'administration concernée et l'adéquation avec les moyens alloués Pas d'objectif en valeur de l'indicateur |
Chaque année, à partir de 2026 |
Article 35 L'article 20-9 (création) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confère à l'ARCOM une mission de supervision du respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/900 applicables aux services de publicité à caractère politique. L'article 8-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) est également modifié pour prévoir que l'ARCOM assure aussi cette mission vis-à-vis des services intermédiaires au sens de cette loi. Dans ce cadre, elle peut notamment prononcer des injonctions de mise en conformité ou pour contraindre un service à adopter des mesures correctives. |
|
Nombre de sanctions prononcées par l'ARCOM en application du règlement (UE) 2024/900 |
Mesurer le nombre de sanctions prononcées par l'ARCOM et évaluer la bonne application du règlement |
Constater le degré de mise en oeuvre du texte par les acteurs visés et une éventuelle tendance haussière, mesurer la montée en charge pour l'administration concernée et l'adéquation avec les moyens alloués Pas d'objectif en valeur de l'indicateur |
Chaque année, à partir de 2026 |
Article 35 L'article 20-10 (création) de la loi du 30 septembre 1986 et l'article 9-1 de la LCEN (modifié) prévoient que, dans le cadre des missions de supervision mentionnées supra, l'ARCOM peut prononcer des sanctions pécuniaires qui ne peuvent excéder 6 % du revenu annuel du prestataire de services de publicité à caractère politique concerné, ou 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial au cours de l'exercice précédent. |
|
Nombre d'injonctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en application du règlement (UE) 2024/900 |
Mesurer le nombre d'injonctions prononcées par la CNIL et évaluer la bonne application du règlement |
Constater le degré de mise en oeuvre du texte par les acteurs visés et une éventuelle tendance haussière, mesurer la montée en charge pour l'administration concernée et l'adéquation avec les moyens alloués Pas d'objectif en valeur de l'indicateur |
Chaque année, à partir de 2026 |
Article 35 L'article 124-12 (création) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL) confère à la CNIL une mission de supervision du respect des obligations prévues par règlement (UE) 2024/900 applicables aux responsables de traitement de données à caractère personnel et à leurs sous-traitants. Dans ce cadre, elle peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la LIL, y compris prononcer des injonctions de mise en conformité. |
|
Nombre de sanctions prononcées par la CNIL en application du règlement (UE) 2024/900 |
Mesurer le nombre de sanctions prononcées par la CNIL et évaluer la bonne application du règlement |
Constater le degré de mise en oeuvre du texte par les acteurs visés et une éventuelle tendance haussière, mesurer la montée en charge pour l'administration concernée et l'adéquation avec les moyens alloués Pas d'objectif en valeur de l'indicateur |
Chaque année, à partir de 2026 |
Article 35 Comme indiqué supra, la CNIL peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la LIL, y compris prononcer des sanctions. |
|
Nombre d'injonctions prononcées par l'autorité judiciaire en application du règlement (UE) 2024/900 |
Mesurer le nombre d'injonctions prononcées par l'autorité judiciaire et évaluer la bonne application du règlement |
Constater le degré de mise en oeuvre du texte par les acteurs visés et une éventuelle tendance haussière, mesurer la montée en charge pour l'autorité judiciaire et l'adéquation avec les moyens alloués Pas d'objectif en valeur de l'indicateur |
Chaque année, à partir de 2026 |
Article 35 L'article 20-10 (création) de la loi du 30 septembre 1986 et l'article 9-1 de la LCEN (modifié) prévoient que, dans le cadre des missions de supervision mentionnées supra, l'ARCOM peut saisir l'autorité judiciaire afin qu'elle prononce une injonction (mise en conformité, mesures correctives ou provisoires, selon le cas) |
|
Extension de l'horizon temporel du marché |
Développer un marché de moyen (4-5 ans) et long terme (au moins jusqu'à 10 ans) pour permettre aux acteurs de mieux se couvrir |
Hausse des transactions à ces échéances |
5 ans |
Article 36 Transposition du règlement 2024/1747 portant sur l'organisation du marché de l'électricité Article L. 131-6 du code de l'énergie |
|
Réduction d'intensité carbone du secteur des transports en 2030 |
L'indicateur vise à mesurer l'atteinte de l'objectif général fixé par la directive 2023/2413 en 2030. La DGEC est chargée du suivi de l'indicateur et de la récolte des données. |
14,5% |
2030 |
Article 42 Introduction de l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone dans les Carburants |
|
Nombre d'IRVE ouverts au public |
Nombre d'IRVE ouvertes au public dans les parcs de stationnement de bâtiments |
Augmentation |
2027 et 2029 |
Article 45 - 2° à 9° du A du I Développer les infrastructures de mobilités durables |
|
Nombre d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos |
Nombre d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parcs de stationnement de bâtiments |
Augmentation |
5 ans |
Article 45 - 2° à 9° du A du I Développer les infrastructures de mobilités durables |
|
Nombre d'inspections réalisées/an (=70 kW) |
Extraction des données des rapports reçus sur la base nationale. |
Montée en charge jusqu'à 100 % des systèmes éligibles en fin de période transitoire. |
De 2026 à 2029 pour la puissance combinée des systèmes > 290 kW et de 2026 à 2031 pour la puissance combinée >70kW et < 290kW puis respectivement tous les 3 ans et tous les 5 ans |
Article 45 - III Mise en place des inspections des systèmes de ventilation |
|
Taux de transmission des rapports d'inspection à la base nationale |
Nombre de rapports obtenus par rapport au nombre attendu |
95 % à partir de 2028 |
2028 |
Article 45 - III Mise en place des inspections des systèmes de ventilation |
|
Part des bâtiments éligibles équipés d'un BACS |
Rapprochement avec le suivi du décret BACS (tertiaire) |
Progression conforme au décret BACS d'ici 01/01/2027 |
2027 |
Article 45 - III Mise en place des inspections des systèmes de ventilation |
|
Publication annuelle d'états des lieux sur la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars interurbains librement organisés |
L'objectif est de vérifier le respect par l'Autorité de régulation des transports de l'obligation de publier au moins une fois par an un état des lieux sur la qualité des services de transport ferroviaire et par autocars interurbains librement organisés, ce qui implique le suivi de la qualité du service délivré aux usagers et la consultation des parties prenantes. Les sous-directions des services ferroviaires (DTFFP/SF) et des transports routiers (DMR/TR), au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) sont les structures en charge de cette vérification. |
100% ou plus Calcul : |
Publication au plus tard en septembre 2026 Puis tous |
1° et 4° de l'article 56 Cf. dernière phrase du nouvel article L. 1262-7 du code des transports créé au 1° et article L. 3111-23 du même code tel que modifié au 4° |
|
Taux des ports qui satisfont aux nouvelles dispositions |
L'indicateur vise à vérifier la mise en oeuvre effective du règlement Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture |
100 % |
2 ans |
Article 59 (2°) Obligations de l'Autorité portuaire de
compléter les étapes de la procédure d'escale dans le
guichet unique maritime et portuaire (GUMP). |
|
Nombre d'infractions aux nouvelles dispositions |
L'indicateur vise à évaluer le nombre de situation non conformes par rapports aux obligations déclaratives Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture |
<80 (pour environ 80 000 escales par an) soit un ratio de non-conformité des escales de 0,1% |
Annuel |
Article 61 Une sanction administrative, avec mise en demeure
préalable, à l'encontre des Autorités portuaires qui ne se
conformeraient pas à leurs obligations relatives au GUMP. |
|
Nombre de demande de reconnaissance de qualifications professionnels pour un responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques non dangereuses |
S'assurer qu'aucune reconnaissance de qualifications professionnelles n'est demandée pour ces professions (information provenant de la Direction de l'Eau et de la Biodiversité, transmise à la Direction générale des Entreprises) |
0 |
2029 |
Article 64 Mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive 2005/36/CE |
|
Nombre de demande de reconnaissance de qualifications professionnels pour un responsable d'établissement de vente ou de location d'animaux d'espèces non domestiques non dangereuses |
S'assurer qu'aucune reconnaissance de qualifications professionnelles n'est demandée pour ces professions (information provenant de la Direction de l'Eau et de la Biodiversité, transmise à la Direction générale des Entreprises) |
0 |
2029 |
Article 64 Mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive 2005/36/CE |
|
Nombre de demande de reconnaissance de qualifications professionnels pour un responsable d'établissement de transit d'animaux d'espèces non domestiques non dangereuses |
S'assurer qu'aucune reconnaissance de qualifications professionnelles n'est demandée pour cette profession (information provenant de la Direction de l'Eau et de la Biodiversité, transmise à la Direction générale des Entreprises) |
0 |
2029 |
Article 64 Mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive 2005/36/CE |
TITRE IER - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Article 1er - Correction de la transposition de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (« directive sur le crédit immobilier »)
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le présent article corrige des dispositions en matière de crédit immobilier à la suite d'un avis motivé de la Commission européenne en date du 12 février 2025 pour transposition incorrecte de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. La Commission a considéré qu'en ne transposant pas correctement ses obligations relatives au régime de liberté d'établissement et de libre prestation de services des intermédiaires de crédit, à la surveillance des intermédiaires de crédit et à la structure de rémunération, la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, 32 et 34 de la directive. La France a déjà corrigé le défaut de transposition de l'article 7 dans l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation. L'article 1er vise à corriger les défauts de transposition des deux autres articles de la directive.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Par ailleurs, la liberté contractuelle comprend la protection des contrats légalement formés, laquelle fait l'objet d'une protection constitutionnelle sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ( DC n° 98-401 du 10 juin 1998), ultérieurement complétée par l'article 16 du même texte ( DC n° 2002-465 du 13 janv. 2003). Le libre choix du contractant fait également l'objet d'une protection. Dans une décision du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a estimé qu'une loi qui incitait les entreprises pharmaceutiques à conclure des accords avec le comité économique des produits de santé ne portait pas une atteinte contraire à la Constitution à la liberté contractuelle « qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ».
La protection constitutionnelle des libertés, telles que la liberté contractuelle, n'empêche toutefois pas le législateur d'y apporter des limitations « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », à la condition « qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » ( DC n° 2012-660 du 17 janv. 2013).
Le législateur intervient pour réglementer le libre choix du contractant ou du contenu du contrat, souvent pour restituer à la partie faible la liberté que le déséquilibre initial des forces rendait illusoire. S'agissant du droit de la consommation, le législateur peut poursuivre un objectif d'intérêt général de protection des consommateurs ( décision n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019). Ce droit spécial protège le consommateur, présumé en situation d'infériorité face au professionnel proposant les biens et services qu'il convoite ou lui sont indispensables. Il rééquilibre la relation entre entreprises et consommateurs finaux, et reconnaît au consommateur des droits qui tempèrent les principes civilistes de liberté contractuelle et de force obligatoire du contrat.
Par ailleurs, l'article 38 de la Constitution prévoit que : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La protection des consommateurs dans l'Union européenne se fonde sur les articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Dans une économie européenne intégrée - le marché unique, les consommateurs doivent pouvoir acheter des biens et des services dans n'importe quel pays de l'Union en ayant l'assurance que leurs droits seront respectés en cas de problème. Lorsqu'il existe des obstacles (ou qu'il est vraisemblable que de tels obstacles vont apparaître dans le futur) en raison de mesures prises (ou en cours d'élaboration) par les États membres à l'égard d'un produit (ou d'une catégorie de produits) qui ne seraient pas de nature à assurer un niveau de protection suffisant, l'article 114 TFUE habilite le législateur de l'Union à intervenir en arrêtant les mesures appropriées dans le respect :
- du paragraphe 3 de cet article (impératif d'assurer un niveau élevé de protection en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et du consommateur) ;
- des principes juridiques mentionnés dans le TFUE ou dégagés par la jurisprudence de la CJUE, notamment du principe de proportionnalité.
Bien qu'aux origines de la construction européenne le consommateur n'ait pas été pris en compte dans les politiques de l'Union, au sommet de Paris de 1972 les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé pour la première fois leur volonté de mettre en place une politique en faveur des consommateurs. La Commission européenne a alors présenté un programme d'action visant à assurer la garantie des droits qui constituent, encore aujourd'hui, les fondements de la législation de l'Union : le droit à la protection de la santé et de la sécurité ; le droit à la protection des intérêts économiques ; le droit à la réparation des dommages ; le droit à l'information et à l'éducation ; le droit à la représentation.
Le traité de Maastricht a depuis lors fait de la protection des consommateurs une politique à part entière avec ce qui est aujourd'hui l'article 169 du TFUE, qui stipule en son paragraphe 1 que « afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts ».
S'agissant plus particulièrement de la protection des intérêts économiques des consommateurs, le colégislateur européen a adopté plusieurs textes. Depuis le 13 juin 2014, la directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/UE) remplace des directives antérieures relatives aux contrats négociés en-dehors d'un établissement commercial, à la vente de biens et garanties ainsi qu'aux clauses abusives dans les contrats, renforçant les droits des consommateurs. Pour ce faire, elle a instauré des règles en matière de communication d'informations, de droit de rétractation et de dispositions contractuelles. La directive n°2023/2673 du 22 novembre 2023 relative aux contrats de crédit conclus à distance, en mettant à jour la précédente directive de 2002, complète ce dispositif.
La directive 2005/29/CE porte sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que les activités trompeuses et la contrainte. La directive 2006/114/CE encadre la publicité trompeuse et la publicité comparative. Des révisions de cette directive ont été proposées afin d'en combler les lacunes. Elles se sont concrétisées par la directive (UE) 2019/2161, qui modernise et renforce les règles de protection des consommateurs.
Enfin, en matière de contrats de crédit, la directive 2014/17/UE (précitée) établit des lignes directrices concernant les contrats de crédit aux consommateurs liés à un bien immobilier résidentiel. Elle vise à créer un marché du crédit immobilier unifié au profit des consommateurs et impose aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit des exigences professionnelles élevées. De nombreuses dispositions transposées, qui offrent un haut niveau de protection au consommateur, sont communes avec le crédit à la consommation.
La protection des consommateurs est source d'une importante jurisprudence européenne. Sur les clauses abusives notamment, le juge européen, qui considère que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, a énoncé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle ( CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08)2(*).
La CJUE porte une attention particulière, en matière de contrats de crédit à la consommation, au respect par le prêteur de son obligation d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur ( CJUE, 5 mars 2020, n° C-679/18), notamment du fait qu'elle est destinée à prévenir le surendettement et à créer un marché intérieur performant en matière de crédit. S'agissant des informations précontractuelles, enfin, avec l' arrêt Radlinger du 21 avril 2016 (C-377/14), la CJUE impose au juge national d'examiner d'office le respect par le prêteur de l'obligation d'information prévue par la directive n°2008/48 car « les informations préalables et concomitantes à la conclusion d'un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion, sont pour un consommateur d'une importance fondamentale [...] c'est notamment sur la base de ces informations que ce dernier décide s'il souhaite se lier par les conditions rédigées par le professionnel ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission européenne considère que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 32 et 34 de la directive sur le crédit immobilier :
- en ne transposant pas correctement l'article 32 de la directive sur le crédit immobilier en ce qui concerne les intermédiaires de crédit d'autres États membres, afin de veiller à ce qu'ils puissent offrir leurs services en France, indépendamment de toute vérification ou de tout enregistrement par les autorités françaises, dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'autorité française des informations de l'État membre d'origine ;
- en ne transposant pas correctement l'article 34 de la directive sur le crédit immobilier, afin de veiller à ce que la surveillance par les autorités françaises des intermédiaires de crédit entrants qui fournissent leurs services en France par l'intermédiaire d'une succursale ou au titre de la libre circulation des services soit limitée, conformément à l'article 34 de la directive sur le crédit immobilier.
La Commission européenne a adressé aux autorités françaises, par courrier du 12 février 2025, un avis motivé sur le fondement de l'article 258, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif du présent article est de mettre le droit national en conformité avec la directive européenne précitée.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les dispositions actuelles n'étant pas pleinement conformes à la directive et l'obligation de transposition des directives européennes étant une exigence constitutionnelle, la seule option envisagée a été de procéder à leurs corrections.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article L. 519-3-2 relatif à l'obligation d'immatriculation des intermédiaires de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services est modifié sur plusieurs points :
- Le premier alinéa est modifié dans le but de simplifier le renvoi au code des assurances. Cette mesure rédactionnelle améliore la lisibilité de l'article.
- Le second alinéa est modifié pour supprimer le terme de « formalités » que la Commission européenne considère comme non défini et ambiguë. Les établissements de crédits ayant recours à un intermédiaire de crédits devront s'assurer que l'organisme qui gère le registre a bien reçu de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine la notification que cet intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France.
L' article L. 519-9 du code monétaire et financier relatif à la liberté d'établissement ou de libre de prestation de services en France, des intermédiaires de crédit immatriculés dans un autre État membre de l'Union européenne est modifié sur plusieurs points :
Le premier alinéa est complété pour préciser que les intermédiaires de crédit agréés dans d'autres États membres peuvent offrir leurs services en France, en régime de libre établissement ou de libre prestation de services, dans un délai d'un mois après la date à laquelle il a été informé par l'autorité de son État membre d'origine de ce que la notification a été faite à l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).
Le deuxième est supprimé : les intermédiaires de crédit passeportés en France ne seront plus soumis par le droit français à l'obligation de souscription à une assurance en responsabilité civile professionnelle, cette règle relevant de la seule responsabilité des autorités compétentes de l'État membre d'origine.
- Le troisième alinéa est modifié : il est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les obligations auxquelles sont soumis les intermédiaires de crédits d'autres Etats membres proposant des services en France en matière de connaissances et de compétences. Comme le ii du paragraphe 3 de l'article 9 le prévoit le décret devra distinguer selon que l'intermédiaire exercera sous le régime de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.
Enfin, trois alinéas sont ajoutés à l'article L. 519-9 pour limiter strictement les obligations que le droit français fait peser sur les intermédiaires de crédit exerçant en France sous le régime de la liberté d'établissement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 519-3-2 du code monétaire et financier sont modifiés. Le premier alinéa l'article L. 519-9 du même code est complété. Son deuxième alinéa est supprimé et son troisième alinéa est modifié. Le présent article prévoit également l'ajout de trois alinéas à l'article L. 519-9 précité.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article permet de répondre à l'avis motivé adressé à la France par la Commission européenne au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison d'une transposition incorrecte des articles 32 et 34 de la directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
En 2023 et 2024, l'ORIAS comptabilise 31 intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'UE qui exerce sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, qui se répartissent comme suit :
Belgique : 16
Pays-Bas : 7
Autriche : 2
Irlande : 2
Allemagne : 1
Espagne : 1
Luxembourg : 1
Portugal : 1
Il est possible que les modifications apportées se traduisent par un nombre plus important d'intermédiaires de crédits passeportés exerçant en France.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Lors du traitement d'une notification d'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne, la procédure sera simplifiée car l'ORIAS n'aura pas à vérifier que l'intermédiaire dispose d'une assurance en responsabilité civile professionnelle.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), saisi en application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, a été consulté le 31 juillet 2025 et a rendu un avis favorable (2025-34).
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le lendemain du jour de leur publication au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements, régions et collectivités uniques régis par l'article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. ». La matière bancaire et financière n'en fait pas partie.
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. La matière bancaire et financière n'en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse d'applicabilité.
L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis-et-Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis-et-Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis-et-Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Cependant, le second alinéa de l'article L. 519-3-2 et les articles L. 519-7 à L. 519-10 du code monétaire et financier ne sont pas étendus car ils portent sur la liberté d'établissement et la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE car les collectivités du Pacifique n'appartiennent pas à l'UE et sont considérés par la Commission européenne comme des pays et territoires d'outre-mer liés à ladite Commission par une décision d'association 2013/755/UE du 25 novembre 2013 du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer»). En effet, seul le premier alinéa de l'article L. 519-3-2 est applicable dans les collectivités précitées. Celui-ci étant modifié par l'article 1er, les tableaux lifou aux I des articles L. 773-15, L. 774-15 et L. 775-14 seront actualisés en conséquence.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les exigences en matière de connaissance et de compétence qui s'imposeront aux intermédiaires de crédit exerçant en France sous le régime de la liberté d'établissement et de la libre prestation de service.
Article 2 - Place des titres subordonnés non-éligibles à la constitution de fonds propres dans la hiérarchie des créanciers en liquidation
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2019 (dite « BRRD2 ») a modifié l'article 48 paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (dite « BRRD »).
Tel que modifié par la directive BRRD2, l'article 48 paragraphe 7 de la BRRD impose aux Etats membres que leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité des établissements de crédit (phase de liquidation) prévoient que tous les détenteurs de titres et créances éligibles en tant que fonds propres par le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, dit « règlement CRR », régissant l'éligibilité des titres aux fonds propres, sont remboursés après les détenteurs de tout titre ou créance qui ne serait pas éligible en tant que fonds propres au moment de la liquidation. Autrement dit, les détenteurs de titres et créances éligibles en tant que fonds propres ont un rang de priorité inférieur aux détenteurs de titres et créances non éligibles au jour de la liquidation et ce quand bien même ces derniers auraient été éligibles avant la liquidation.
Cette exigence est également précisée dans la communication de la Commission relative à l'interprétation de certaines dispositions juridiques de la directive BRRD23(*) :« si un instrument n'est plus un élément de fonds propres éligible, la législation nationale en matière d'insolvabilité doit garantir qu'il ne puisse pas être de rang égal ou inférieur à des éléments de fonds propres ».
Or, certains titres et créances, notamment les titres et les prêts dits participatifs4(*), étaient, avant la modification du règlement CRR, éligibles aux fonds propres. Cette éligibilité en tant que fonds propres emportait des conséquences sur le rang dans la hiérarchie des créanciers de ces créances et titres participatifs. Ainsi, dans la législation nationale régissant la hiérarchie des créanciers, ces titres et créances participatifs étaient même subordonnés de dernier rang, c'est-à-dire qu'en cas de liquidation de l'institution, leurs détenteurs n'étaient remboursés qu'après le remboursement de tous les autres.
Aux termes de la directive BRRD telle que modifiée par la directive BRRD2 en 2019, les créances et titres participatifs (ainsi que tous les titres et créances devenus inéligibles aux fonds propres) auraient donc dû voir leur rang dans la hiérarchie des créanciers modifié dans la législation nationale pour que ce rang soit désormais senior par rapport à celui des fonds propres. Ainsi, en cas de liquidation, leurs détenteurs auraient dû être remboursés avant les détenteurs des titres éligibles aux fonds propres. Toutefois, en France, la législation nationale en vigueur se contente d'encadrer la hiérarchie des créanciers par des grands principes mais la hiérarchie précise des titres et engagements est définie par voie contractuelle lors de leur émission. Or, dans certaines réglementations contractuelles, le rang de certains titres subordonnés éligibles aux fonds propres (par exemple des titres dits « AT1, T2 ») sont définis par rapport au rang des titres ou prêts participatifs, qui font office de « référence » dans certaines réglementations contractuelles. Ainsi, une modification par la loi du rang de ces titres et prêts participatifs lors de la transposition de la directive BRRD2 aurait pu avoir de lourdes conséquences pour la réglementation contractuelle, modifiant le rang de l'ensemble des titres subordonnés qualifiés de fonds propres dont le rang, à leur émission, avait été défini par rapport aux titres et prêts participatifs.
Lorsque la France a transposé l'article 48 paragraphe 7 de BRRD au 5° du I de l' article L. 613-30-3 du code monétaire et financier, elle a donc introduit une disposition visant à préserver le rang des titres et prêts participatifs lorsque ceux-ci avaient été émis avant 2020 (disposition ci-après dénommée la « clause du grand-père »).
Les échanges avec la Commission européenne et d'autres autorités européennes ont fait apparaître la nécessité d'une modification de la transposition française sur ce point. En outre, indépendamment dudit point, il était nécessaire d'une part, d'harmoniser la rédaction de deux articles et d'autre part, de corriger une erreur matérielle dans le code monétaire et financier.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle »5(*). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles §3).
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Aux termes de l' article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il est nécessaire de transposer en droit français les dispositions des directives.
La directive BRRD2 impose aux Etats membres de modifier le rang des titres et instruments non-éligibles aux fonds propres dans la hiérarchie des créanciers présentes dans leurs procédures nationales d'insolvabilité (article 48 paragraphe 7 de BRRD).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La directive BRRD2 devait être transposée au plus tard le 28 décembre 2020. Sauf enjeu de conformité ciblé faisant l'objet d'un dialogue bilatéral avec la Commission européenne, les autres Etats membres ont introduit dans leur droit national, depuis cette date, les dispositions faisant l'objet des corrections prévues par le présent article.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de légiférer provient ici tout d'abord de l'obligation constitutionnelle de transposition en droit interne d'une directive imposée par l'article 88-1 de la Constitution qui dispose que « [l]a République participe à l'Union européenne ». Cette obligation a d'ailleurs été rappelée par le Conseil constitutionnel dans le considérant 7 de sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 : « Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution [...] ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ».
Les révisions prévues par le présent article sont issues des conclusions des analyses juridiques conjointes de la Commission européenne et des autorités françaises. En cas d'inaction des autorités françaises pour introduire ces révisions en droit national et de maintien à long terme des enjeux de conformité identifiés par les autorités européennes, les autorités françaises s'exposeraient à un recours en manquement initié par la Commission européenne auprès de la Cour de justice de l'Union européenne en application de l' article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise principalement à assurer la bonne transposition de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2019 (dite « BRRD2 ») qui impose aux Etats membres que leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité (phase de liquidation) prévoient que tous les détenteurs de titres et créances éligibles en tant que fonds propres par le règlement CRR aient un rang de priorité inférieur à celui de tout titre ou toute créance qui ne serait pas éligible en tant que fonds propres au moment de la liquidation. Des dispositions de clarification sont également introduites afin d'expliciter l'application du nouveau 5° de l'article L. 630-30-3 du code monétaire et financier aux contrats en cours.
Le présent article vise enfin à répercuter à l'article L. 313-30-3 du code monétaire et financier une modification rédactionnelle apportée par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole à l'article L. 613-34 du même code et à corriger une erreur de renvoi à l'article L. 613-38 du même code.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Sur le fond, il n'apparait pas possible de maintenir une disposition législative ne correspondant pas aux besoins de transposition d'une directive.
Dans la mesure où il s'agit de corriger une transposition, aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Après échange avec la Commission européenne, la France a décidé de supprimer la « clause du grand-père » précédemment introduite, tout en clarifiant les modalités d'application de cette suppression aux contrats en cours.
Ainsi, premièrement, les modifications apportées au 5° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier précisent que les titres et prêts participatifs sont inclus dans la catégorie des « créances subordonnées ».
Deuxièmement, elles suppriment la « clause du grand-père » qui permettait notamment à des titres et prêts participatifs de conserver leur ancien rang (pré-BRRD2) dans la hiérarchie des créanciers lorsqu'ils avaient été émis avant 2020 (date de la transposition de la directive BRRD2). Le texte précise désormais que les détenteurs de titres ou créances subordonnés qui ne sont pas retenus comme instruments de fonds propres doivent être remboursés avant (senior) les créanciers de titres retenus comme instruments de fonds propres (plus junior), cette règle primant sur toute disposition contraire. Les modifications ajoutent également que la règle transposant l'article 48(7) de la directive BRRD prime sur toute stipulation contractuelle prévoyant une hiérarchie de rang subordonné.
Troisièmement, une disposition de coordination ajoute que la modification du rang d'une créance subordonnée, en particulier des titres et prêts participatifs, consécutive à l'application des dispositions de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier tel que modifié, n'affecte pas l'ordre, tel qu'il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles.
Enfin, l'article permet également d'apporter deux corrections supplémentaires :
- Il corrige la désignation, au 1° du I bis de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier, des catégories d'entreprises d'investissement auxquelles s'applique la hiérarchie des créanciers prévue par la directive BRRD :
§ La modification permet de rectifier l'actuel désalignement rédactionnel entre cette disposition et l'article L. 613-34 du même code, qui définit le périmètre d'application de la transposition française de la directive BRRD. Le point 2° du I de cet article vise les catégories d'entreprises d'investissement qui relèvent du régime de résolution bancaire du code monétaire et financier.
§ L'article 10 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 avait modifié la formulation relative au périmètre d'entreprises d'investissement couvertes par cet article L. 613-34 du code monétaire et financier, en omettant d'appliquer la même modification à l'article L. 613-30-3 du même code. Après cette modification, l'article L. 613-34 désigne les entreprises d'investissement couvertes par la résolution bancaire en énumérant les autorisations d'activités et habilitations concernées, conformément à la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 (« directive IFD »).
§ Ces articles L. 613-30-3 et L. 613-34 du code monétaire et financier ont vocation à s'appliquer au même périmètre d'entreprises d'investissement : celles visées au point 3 du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive BRRD, auxquelles le législateur français a choisi en 2015 d'ajouter toute entreprise d'investissement habilitée à fournir le service de tenue de compte-conservation d'instruments financiers. La correction est purement rédactionnelle et poursuit l'objectif de cohérence et de lisibilité du régime français de résolution bancaire.
- L'article L. 618-38 du code monétaire et financier est modifié pour corriger une erreur de renvoi signalée par la Commission européenne. Comme relevé par les services de la Commission, le III de l'article L. 511-41-3 du même code, auquel fait référence l'article L. 613-38, IV, 3ème al., ne concerne pas la prérogative visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE (« Pillar 2 Guidance »), que mentionne l'article 10, paragraphe 6, quatrième alinéa de la BRRD, mais certains pouvoirs de supervision visés aux points g), h) et l) de l'article 104 de la directive 2013/36/UE. Il s'agit donc ici d'une erreur de renvoi puisque la disposition visant l'exigence de l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE a été transposée non au III mais au II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article opère les modifications suivantes au sein du code monétaire et financier :
- Il modifie et complète l'article L. 613-30-3 ;
- Il modifie l'article L. 613-38 ;
- Au livre VII, il modifie le tableau du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 (compteur Lifou).
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article vise à assurer la bonne transposition de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2019 (dite « BRRD2 ») qui impose aux Etats membres que leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité prévoient que tous les détenteurs de titres et créances éligibles en tant que fonds propres par le règlement CRR aient un rang de priorité inférieur à celui de tout titre ou toute créance qui ne serait pas éligible en tant que fonds propres au moment de la liquidation.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le présent article, qui corrige l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier, sera dépourvu d'effet notable sur les institutions bancaires.
En effet, la documentation contractuelle des instruments subordonnés des établissements bancaires français s'appuie fréquemment sur les rangs subordonnés des titres participatifs et prêts participatifs (ci-après TP et PP) pour définir d'autres rangs subordonnés. Ces autres rangs sont contractuellement définis soit comme plus subordonnés (junior) que les TP et PP, soit comme moins subordonnés (senior) que les TP et PP.
C'est notamment le cas de la plupart des instruments de dette AT1 et T2 émis par les groupes bancaires français pour satisfaire leurs exigences prudentielles.
La modification de rang qu'imposera la nouvelle transposition à certains TP et PP n'entrainera pas de modification du rang d'autres instruments, par le jeu de ces références au rang des TP et PP.
Pour écarter tout risque d'une application « dynamique » de ces clauses de rang, susceptible de bouleverser indument la hiérarchie des créanciers subordonnés, les dispositions présentées rappellent que lorsque les titres et prêts participatifs sont utilisés comme une référence extérieure pour la définition du rang d'autres instruments, les rangs des TP et PP devraient être considérés comme « statiques », sans les modifications de rang susceptibles d'affecter les TP et PP disqualifiés comme fonds propres, par l'effet de la nouvelle transposition.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le présent article, qui corrige l'article L. 613-30-3, I, 5° du code monétaire et financier, sera dépourvu d'effets notables sur les services administratifs, y compris pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans la mesure où la France considérait déjà ces dispositions applicables aux titres et prêts dans les faits, en cas de liquidation d'un établissement (qui ne s'est pas produite sur la période) et a simplement introduit une « clause du grand-père ».
Les échanges avec la Commission européenne ont permis de mieux comprendre ses attentes et de clarifier cette intention initiale par une rédaction plus conforme à la directive BRRD2.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'article, en renforçant la conformité des dispositions de droit français transposant les exigences du cadre européen en matière de gestion des crises bancaires (liquidation et résolution), contribuera à la protection des consommateurs dans leur relation commerciale avec les établissements de crédit et les sociétés de financement et à la stabilité financière.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a été consulté a rendu un avis favorable le 12 septembre 2025.
Les présentes dispositions ont en outre été soumises, pour information et sur une base informelle, aux services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Fédération bancaire française et à l'Association française des sociétés de financement.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le lendemain du jour de leur publication au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.
Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article s'appliqueront de plein droit sans aucune adaptation ni aucune consultation.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).
Les dispositions en droit bancaire et financier s'appliquent de plein droit dans ces trois collectivités. Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.
L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis-et-Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis-et-Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis-et-Futuna prennent des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Pour tenir compte des modifications opérées au livre VII du code monétaire et financier, les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 du même code sont modifiés pour mettre à jour les lignes des tableaux compteurs Lifou, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat du 7 janvier 2016.
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions du présent article ne requièrent aucune mesure d'application.
Article 3 - Correction de la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits a été transposée en droit français par l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 et le décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023. Elle s'applique à deux catégories d'acteurs :
- les acheteurs de crédits, qui se livrent au rachat de contrats de prêts non-performants (PNP) ou des droits associés à un tel contrat ;
- les gestionnaires de crédits, qui peuvent se voir charger de l'exécution des droits et obligations et des éventuelles procédures de recouvrement au titre d'un contrat de PNP pour le compte d'un acheteur de crédits, lorsque ce dernier n'a pas la capacité ou la volonté de gérer lui-même la créance.
L'une des principales mesures introduites par cette directive concerne l'obligation, pour les gestionnaires de crédit, d'obtenir un agrément auprès de l'ACPR pour exercer en France (ou d'une autorité d'un autre Etat membre dans le cas d'un gestionnaire de crédits dont le pays d'accueil n'est pas la France). La directive prévoyait toutefois une exemption à cette obligation pour les établissements de crédit qui se livrent à de la gestion de crédits dans le cadre de leurs activités normales de recouvrement de dette. Cette exemption, qui a été transposée en droit français, est justifiée au considérant 23 de ladite directive par le fait que ces établissements sont déjà règlementés et surveillés au sein de l'Union européenne et qu'une nouvelle obligation entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d'agrément et de conformité.
La directive répond au constat que, au sein de l'Union européenne, la bonne gestion par les établissements de crédit de leurs stocks de PNP se heurte aujourd'hui à l'absence d'un marché secondaire européen suffisamment concurrentiel et profond pour permettre aux établissements de crédit de céder une partie de leurs stocks dans des conditions de prix satisfaisantes. Elle poursuit donc un l'objectif d'harmonisation qui passe notamment par l'obligation faite aux gestionnaires de crédits, d'obtenir un agrément auprès de l'ACPR pour exercer en France (ou d'une autorité d'un autre Etat membre dans le cas d'un gestionnaire de crédits dont le pays d'accueil n'est pas la France).
En son article 2 (iii du a) du paragraphe 5), la directive prévoit plusieurs exemptions à son application et donc à l'obligation d'obtention d'un agrément pour exercer l'activité de gestion de crédits. Notamment, n'y sont pas soumis les prêteurs autres que les établissements de crédit soumis au contrôle de l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l'article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu'ils exercent des activités dans cet État membre. Cette exemption, qui n'a pas été transposée en droit français, est justifiée au considérant 23 par le fait que ces établissements sont déjà règlementés et surveillés au sein de l'Union européenne et qu'une nouvelle obligation entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d'agrément et de conformité.
En droit français, cette catégorie d'acteur correspond aux sociétés de financement (SF) qui sont définies à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier comme les personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédits dans les conditions et limites définies par leur agrément.
Ces SF sont agréées par l'ACPR et placées sous sa surveillance. En effet, les dispositions de la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit (« CRD ») prévoyant notamment les exigences en matière d'agrément, de solvabilité, de gouvernance et de contrôle interne, ont été étendues aux SF dans le cadre de la transposition de cette directive dans le code monétaire et financier. Les dispositions prudentielles applicables aux SF sont par ailleurs définies dans l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement, tel que modifié, qui leur rend applicable l'ensemble des exigences du règlement 575/2013/UE relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (« CRR ») et des règlements et décisions de la Commission européenne adoptés en application du règlement CRR et de la directive CRD, sous réserve de certaines adaptations visant à tenir compte des spécificités des SF. Conformément à l'article 11 de cet arrêté, « les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les sociétés de financement sont réputées comparables en termes de solidité à celles qui s'appliquent aux établissements ».
À ce titre, les SF sont des prêteurs mentionnés au iii du a du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2021/2167/UE, et elles sont couvertes par l'exemption lorsqu'elles exercent des activités de gestion de crédits pour compte d'autrui.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ».
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits harmonise les règles applicables aux activités d'achat et de gestion de PNP, et crée ainsi un passeport européen permettant aux acteurs concernés de conduire ces activités sur une base transfrontière. Simultanément, la directive fixe des mesures de protection des emprunteurs dont la créance est transférée vers un acheteur de crédits. Ces mesures, qui s'insèrent dans le corpus de règles de protection des consommateurs de produits financiers auxquels sont déjà assujettis les prêteurs (en particulier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE), reposent sur le principe du maintien systématique d'un même niveau de protection avant et après le transfert de la créance et d'un coût de l'opération nul pour le débiteur. Par ailleurs, la directive définit les modalités d'agrément et de surveillance de acheteurs et gestionnaires de crédits, qui seront menées dans chaque Etat membre par une autorité nationale désignée : l'ACPR dans le cas de la France.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Les Etats membres avaient jusqu'au 29 décembre 2023 pour transposer la directive dans leur droit national. S'agissant du traitement des sociétés de financement dans l'application de cette directive, il n'existe pas d'élément de droit comparé dans la mesure où cette catégorie d'entités n'existe qu'en droit français.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le projet d'article vise à transposer en droit français , au bénéfice des sociétés de financement, l'exemption prévue par la directive (UE) 2021/2167 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, pour les prêteurs autres que les établissements de crédit soumis au contrôle de l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l'article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu'ils exercent des activités dans cet État membre.
Ces mesures viennent modifier des dispositions qui conditionnent ou non une activité à l'obtention d'un agrément. S'agissant d'encadrer la liberté d'entreprendre, ces dispositions sont de nature législative. Il est donc nécessaire de légiférer pour prendre ces mesures. Il est également nécessaire de modifier certaines dispositions de nature législative pour les coordonner avec les nouvelles activités des SF en tant que gestionnaire de crédits.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article vise à compléter l'application en droit français de la directive (UE) 2021/2167 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits en transposant une exemption au bénéfice des sociétés de financement afin de leur permettre d'exercer l'activité de gestionnaire de crédits sans avoir à disposer d'un agrément supplémentaire.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
En l'état actuel du droit, la transposition en droit français de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits est incomplète, dans la mesure où elle n'intègre pas l'exclusion prévue à son article 2(5)(a)(iii) pour les prêteurs non bancaires soumis à supervision nationale.
Le maintien du droit en l'état aurait conduit à laisser perdurer cette erreur de transposition et la distorsion qui en résulte entre établissements de crédit et sociétés de financement, contraire à la directive comme à l'objectif d'égalité de traitement entre acteurs soumis à des exigences prudentielles comparables. Cette option n'a donc pas été retenue.
La mesure proposée vise donc à corriger cette omission, en précisant que les sociétés de financement qui gèrent leurs propres crédits, y compris ceux qu'elles ont achetés, sont dispensées d'agrément en tant que gestionnaires de crédits
Concernant le dispositif envisagé pour le rééquilibrage visé, une disposition législative ne peut être modifiée que par une mesure de même niveau normatif. Ainsi, aucune autre option que le recours à la loi n'a été envisagée ici.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif consiste à ajouter dans les dispositions du code monétaire et financier relatives aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (chapitre XI du titre IV du livre V) la mention des SF, aux côtés de celles des établissements de crédit, afin de transposer l'exemption prévue par la directive pour leur permettre d'exercer les activités de gestion de crédits sans agrément.
Il s'agit donc d'élargir le champ d'intervention des sociétés de financement en complétant l'article L. 515-1 du code monétaire et financier et, corrélativement, de les dispenser à l'article L. 54-11-3 du même code d'obtenir un agrément lorsqu'elles exercent l'activité de gestion de crédits pour le compte d'acheteurs de crédits ou pour gérer leurs propres crédits lorsqu'elles s'en sont portées acquéreuses.
Des mesures de coordination sont également prévues aux articles L. 54-11-10, L.54-11-27, L. 54-11-28 et L. 54-11-29 du code monétaire et financier afin d'assurer la cohérence du dispositif et de lever toute ambiguïté sur l'application l'exemption.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les articles L. 515-1, L. 54-11-3, L. 54-11-10, L. 54-11-27 à L. 54-11-29 du code monétaire et financier seront modifiés. En outre, les compteurs Lifou prévus au tableau du I des articles L. 773-10, L. 774-10, L. 775-9, L. 773-40-1, L774-40-1 et L. 775-34-1 sont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les modifications proposées transposent l'exemption prévue pour les prêteurs qui ne sont pas des établissements de crédit en application du iii) du a) de l'article 2.5 : « De plus, les créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit mais qui sont néanmoins surveillés par une autorité compétente d'un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activités de gestion de crédits pour des crédits accordés à des consommateurs dans le cadre de leurs activités normales, ne sont pas couverts par la présente directive lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits dans cet État membre. ».
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure a un impact limité et de nature favorable pour les sociétés de financement. Elle clarifie leur régime en confirmant qu'elles ne sont pas tenues d'obtenir un agrément en tant que gestionnaires de crédits lorsqu'elles exercent des activités de gestion de crédits. Cette précision évite les surcoûts administratifs et financiers qui auraient pu résulter d'une procédure d'agrément supplémentaire
4.2.3. Impacts budgétaires
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure a un effet positif pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en allégeant la charge d'instruction des demandes d'agrément de gestionnaires de crédits présentées par des sociétés déjà supervisées pour leurs activités de prêt.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a été consulté a rendu un avis favorable le 12 septembre 2025.
Les dispositions de l'article ont en outre été soumises pour information et sur base informelle aux services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Fédération bancaire française et à l'Association française des sociétés de financement.
Les dispositions de l'article ont en outre été soumises pour information et sur base informelle aux services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Association française des sociétés de financement.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions de l'article du présent projet de loi entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi dans le Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.
Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
- Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
- A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).
Les dispositions en droit bancaire et financier s'appliquent de plein droit dans ces trois collectivités. Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.
L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Pour tenir compte des modifications opérées au livre V, les articles L. 773-10, L. 774-10, L. 775-9, L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 du code monétaire et financier sont modifiés mettant à jour les lignes des tableaux compteurs Lifou, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat du 7 janvier 2016.
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions de l'article ne requièrent aucune mesure d'application.
Article 4 - Dispositions d'adaptation au règlement 2024/790 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 4 s'inscrit dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (dite « MiFID II »). Cette directive fait partie du paquet législatif adopté en 2024 visant à renforcer la transparence, l'équité et l'efficacité des marchés européens, en articulation avec le règlement (UE) 2024/791 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 (dit « MiFIR »).
Elle répond à la nécessité de corriger certaines limites du cadre adopté en 2014, notamment la fragmentation de l'accès aux données de marché, les risques liés à certaines pratiques de rémunération comme le paiement pour les flux d'ordres, ou encore les insuffisances du régime applicable aux dérivés sur matières premières. L'objectif est de favoriser un accès centralisé et en temps quasi réel aux données de marché, de renforcer la protection des investisseurs et de soutenir la compétitivité des marchés de capitaux de l'Union Européenne.
Précisément, la révision de MiFID II poursuit plusieurs objectifs :
- Clarifier et recentrer le périmètre de MiFID II, en supprimant certaines dispositions relatives aux systèmes multilatéraux de négociation (SMN)6(*), désormais transférées dans le règlement MiFIR, afin de mieux distinguer ce qui relève du droit national et du droit directement applicable ;
- Renforcer les obligations de transparence imposées aux plateformes de négociation7(*) en cas de fluctuations anormales ou de perturbation des marchés, notamment via des obligations nouvelles de publication ;
- Moderniser les exigences de publication des positions agrégées sur contrats financiers8(*), en introduisant une dissociation entre contrats d'option9(*) et autres instruments ;
- Adapter le régime des exemptions d'agrément pour certaines entités non financières qui accèdent aux plateformes à des fins de gestion de liquidité ou de couverture, en sécurisant juridiquement leur statut ;
- Préciser les obligations minimales d'activité des plateformes de négociation, en imposant à toutes (marchés réglementés, SMN, Systèmes organisés de négociation - SON10(*)) de disposer d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs.
La directive appelle, pour certaines de ses dispositions, une transposition législative dans le code monétaire et financier. Cette transposition s'effectue sans aller au-delà de ce que la directive impose, sauf ajustements rédactionnels nécessaires à sa correcte mise en oeuvre. Les modifications suivantes du droit national sont ainsi proposées :
- L'article L. 420-1 est modifié pour tirer les conséquences du retrait, par la directive 2024/790, du paragraphe 7 de l'article 1er de MiFID II relatif aux systèmes multilatéraux de négociation (SMN), désormais régis par MiFIR. Dans un objectif de lisibilité de la norme, la définition de SMN est maintenue au sein du code monétaire et financier, avec l'ajout d'un renvoi vers le règlement MiFIR. Le renvoi au droit interne applicable est clarifié.
- L'article L. 420-3 est complété pour permettre la suspension ou la limitation des négociations en cas de situations d'urgence ou de volatilité excessive, imposer des obligations de transparence sur les paramètres techniques, et prévoir une intervention de l'AMF en cas de défaillance d'un gestionnaire de plateforme.
- L'article L. 420-8 est modifié pour permettre aux marchés réglementés de caler leur pas de cotation sur celui d'un marché pertinent situé dans un pays tiers pour certaines actions définies par décret.
- L'article L. 420-9 est enrichi pour imposer aux plateformes de négociation de se conformer aux normes de qualité des données prévues par MiFIR.
- Les articles L. 420-14 et L. 420-16 sont modifiés pour mettre à jour la terminologie (remplacement d'« instruments dérivés » par « contrats financiers »), intégrer les quotas d'émission dans le périmètre de la gestion des positions, et introduire l'obligation de publier un rapport hebdomadaire distinct sur les options.
- Les articles L. 421-11, L. 424-2 et L. 425-2 sont complétés pour imposer aux marchés réglementés, SMN et SON de disposer d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun pouvant interagir avec les autres sur la formation des prix.
- Certains alinéas des articles L. 424-1 et L. 425-1 devenus sans objet sont supprimés.
- L'article L. 531-2 est modifié pour refléter les nouvelles conditions d'exemption d'agrément applicables aux entités non financières accédant à une plateforme de négociation dans un but de gestion de liquidité ou de réduction des risques.
- Les articles L. 533-9, L. 533-18-2, L. 533-19 et L. 533-32 sont ajustés pour clarifier les obligations de transparence sur le lieu d'exécution, les conditions de fonctionnement des internalisateurs systématiques11(*), et la cohérence avec les exigences de MiFIR.
- Les articles L. 533-18-1 et L. 533-33 sont abrogés car devenus obsolètes.
Ces ajustements permettent d'assurer la conformité du droit français avec la directive 2024/790, tout en maintenant la cohérence du code monétaire et financier avec les autres composantes du cadre réglementaire européen des marchés financiers.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article n'est en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le présent article s'inscrit dans le cadre du droit de l'Union européenne applicable aux marchés financiers, en particulier la directive 2014/65/UE (MiFID II) modifiée par la directive (UE) 2024/790, et le règlement (UE) n° 600/2014 (MiFIR) modifié par le règlement (UE) 2024/791.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Nous ne disposons pas à ce stade d'éléments d'information pertinents s'agissant des options retenues par d'autres Etats membres européens dans le cadre de leurs éventuels travaux d'adaptation de leur droit national réalisés suite à l'entrée en vigueur de la revue de MiFID.
Certaines dispositions de la directive (UE) 2024/790 modifiant la directive 2014/65/UE (MiFID II) laissent une marge d'appréciation aux États membres, notamment en ce qui concerne les exemptions applicables à certaines entités non financières ainsi que les exigences relatives au nombre minimal de membres actifs sur les plateformes de négociation.
Par ailleurs, certains États membres peuvent être amenés à procéder à des ajustements de leur droit national pour en assurer la cohérence avec le nouveau cadre issu du règlement MiFIR.
1. Exemptions pour les entités non financières
L'article 2, paragraphe 1, point d), ii), de MiFID II, tel que modifié, prévoit une exemption d'agrément pour les entités non financières membres ou participantes d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, lorsque les transactions exécutées sont liées à la gestion de la liquidité ou à la couverture des risques commerciaux.
La France transpose cette disposition en reprenant le libellé de la directive. Aux Pays-Bas, cette exemption est également prévue dans le cadre du régime national applicable aux entités non financières dans la loi sur la supervision financière (Wet op het financieel toezicht), sans ajout de conditions supplémentaires.
2. Seuil de trois membres ou utilisateurs actifs sur les plateformes
La directive prévoit que les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (SMN) et les systèmes organisés de négociation (SON) doivent disposer d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs.
Cette disposition est transposée dans le droit national sans modification. En Allemagne, cette exigence a donné lieu à des interrogations quant à sa mise en oeuvre effective. Certaines plateformes, telles que Tradegate, sont structurées autour d'un seul intervenant dominant, ce qui peut limiter l'effectivité de la règle. Dans ce contexte, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a signalé, dans plusieurs communications, les risques associés à une absence de concurrence effective sur certaines plateformes de négociation, en lien avec cette exigence de membres actifs. L'application de cette disposition par les autorités de supervision nationales reste donc un point de vigilance.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifie la directive 2014/65/UE (MiFID II) en plusieurs points nécessitant une transposition en droit interne. Conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une directive lie les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Plusieurs dispositions du code monétaire et financier (CMF) doivent être modifiées afin de mettre le droit national en conformité avec les nouvelles obligations résultant de cette directive.
La transposition par voie législative est nécessaire dans la mesure où ces évolutions portent sur des dispositions de niveau législatif figurant dans le CMF.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article a pour objet de transposer les ajustements apportés à la directive 2014/65/UE (MiFID II) par la directive (UE) 2024/790, dans le but d'améliorer le fonctionnement, la transparence et l'intégrité des marchés financiers de l'Union européenne.
Les objectifs poursuivis par cette transposition sont les suivants :
· Renforcer la transparence des marchés, en facilitant l'accès aux données de négociation pour l'ensemble des acteurs de marché, notamment via la clarification des obligations des plateformes en cas de perturbation ou de volatilité excessive ;
· Améliorer l'organisation et la résilience des marchés de négociation, en imposant des exigences minimales d'activité aux plateformes (au moins trois membres actifs), afin de garantir une formation des prix plus robuste et plus concurrentielle ;
· Sécuriser l'accès des entités non financières aux plateformes, en précisant les conditions d'exemption d'agrément lorsqu'elles interviennent à des fins de gestion de liquidité ou de couverture des risques commerciaux ;
· Adapter le cadre de surveillance des positions sur contrats financiers, en introduisant une dissociation entre options et autres instruments, et en intégrant les quotas d'émission au périmètre de contrôle ;
· Assurer une meilleure articulation entre droit national et droit européen, notamment en distinguant clairement les dispositions désormais régies par le règlement MiFIR, d'application directe, de celles relevant du champ législatif national.
Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre plus large de l'Union des marchés de capitaux (CMU), en soutenant l'attractivité, la compétitivité et l'intégrité des marchés financiers européens. La transposition nationale veille à garantir la cohérence et la lisibilité du code monétaire et financier.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La transposition de la directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE (MiFID II) est obligatoire. Aucune autre option n'était donc envisageable.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La transposition est réalisée par voie législative, par modification du code monétaire et financier. Cette transposition reprend exactement les termes de la directive lorsque cela est possible, en veillant à assurer la cohérence d'ensemble du droit national.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les modifications proposées ont pour objet de mettre le droit national en conformité avec les dispositions de la directive (UE) 2024/790. Le présent article modifie ou abroge les articles suivants du code monétaire et financier : L. 420-1, L. 420-3, L. 420-8, L. 420-9, L. 420-14, L. 420-16, L. 420-17, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-2, L. 425-1, L. 425-2, L. 531-2, L. 533-9, L. 533-18-1 (abrogé), L. 533-18-2, L. 533-19, L. 533-32, L. 533-33 (abrogé). Il modifie également le livre VII du même code pour adapter les dispositions relatives à l'outre-mer (voir le détail dans la rubrique application dans l'espace).
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article assure la transposition en droit national de la directive (UE) 2024/790 du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE (MiFID II).
Elle vise à intégrer dans le code monétaire et financier les ajustements introduits au niveau européen, notamment en matière de gouvernance des plateformes de négociation, de transparence, de surveillance des positions et de conditions d'exemption pour certaines entités.
La transposition respecte les délais fixés par la directive. Elle ne soulève pas de difficulté d'articulation avec le droit international et est conforme aux engagements européens de la France.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
En contribuant à une meilleure transparence des marchés financiers, à une formation plus efficace des prix et à un accès facilité aux données de négociation, le présent article participe à renforcer l'attractivité et la compétitivité des marchés européens. Ces évolutions sont de nature à encourager l'investissement, tant national qu'international, et à soutenir le financement de l'économie réelle, avec des effets positifs attendus sur la croissance à moyen terme.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les ajustements apportés par la directive (UE) 2024/790 visent principalement les plateformes de négociation et les entreprises d'investissement. Ils portent sur des éléments ciblés de transparence, de gouvernance et d'organisation des marchés, tels que les exigences de qualité des données, les règles de suspension des négociations en cas de volatilité excessive, ou encore les conditions d'accès aux exemptions pour certaines entités non financières. Ces évolutions n'introduisent pas de nouvelle catégorie d'obligations structurelles, mais précisent ou renforcent des dispositifs existants issus de la directive MiFID II, avec lesquels les acteurs concernés sont déjà familiarisés. Les entités principalement concernées sont des établissements régulés - notamment des plateformes de négociation, des internalisateurs systématiques et des entreprises d'investissement - disposant des ressources organisationnelles et techniques leur permettant d'intégrer ces ajustements dans leurs procédures internes sans surcoût significatif.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'impact est limité. La mise en oeuvre des nouvelles obligations relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui les intègre dans ses missions de supervision existantes, sans charge significative nouvelle.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Le présent article ne crée ni ne modifie de conditions d'accès ou d'exercice des professions réglementées du secteur financier. La directive (UE) 2018/958 ne trouve donc pas à s'appliquer.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La méthode de transposition retenue n'aura aucun impact direct sur les particuliers. Toutefois, en contribuant à un meilleur fonctionnement des marchés financiers et à une supervision renforcée, la réforme participe indirectement à la protection des investisseurs.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, en application de l'article L. 614-2 du Code monétaire et financier, a été consulté par écrit le 3 juillet 2025, il a rendu un avis favorable le 10 juillet 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
La directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 fixe une date limite de transposition au 29 septembre 2025.
Les dispositions prévues dans le présent projet de loi entreront en vigueur à compter de la promulgation de la loi. Aucune période transitoire n'est prévue, compte tenu du caractère ciblé des mesures et de leur objet essentiellement technique et d'alignement avec le droit de l'Union.
5.2.2. Application dans l'espace
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.
Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
- Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
- A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).
Les dispositions en droit bancaire et financier s'appliquent de plein droit dans ces trois collectivités. Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.
L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Pour tenir compte des modifications opérées au livre IV du code monétaire et financier, les articles L. 762-3, L. 763-3, L. 764-3, L. 762-6, L. 763-6 et L. 764-6 du même code sont modifiés mettant à jour les lignes des tableaux compteurs Lifou, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat du 7 janvier 2016. De même, les tableaux compteurs Lifou des articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22, L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 sont actualisés.
5.2.3. Textes d'application
Un décret simple sera pris pour application de cet article.
Article 5 - Habilitation à transposer par ordonnance la révision de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et à adapter le droit national des véhicules de titrisation au cadre posé par le règlement titrisation
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
(1) Cet article vise en premier lieu à permettre la transposition en droit national de la directive « AIFM 2 »12(*) publiée le 15 mars 2024.
La directive « AIFM »13(*) adoptée en 2011 visait à :
- mettre en place une approche cohérente en matière de surveillance des risques que les activités des fonds d'investissement alternatifs14(*) (ci-après « FIA ») peuvent générer.
- assurer une protection aux investisseurs, en obligeant les gestionnaires de FIA à gérer efficacement les risques et à garantir une transparence adéquate des activités des FIA dont ils assurent la gestion.
- faciliter l'intégration des FIA sur le marché de l'UE : un agrément unique est délivré par les autorités de surveillance des pays d'origine du FIA, leur permettant de gérer des FIA dans toute l'Union européenne et de les commercialiser auprès d'investisseurs professionnels.
En 2021, conformément à l'article 69 de la directive AIFM, la Commission a réexaminé l'application et le champ d'application de directive et a conclu que les objectifs de cette dernière ont, pour la plupart, été atteints.
La Commission a néanmoins estimé, à l'issue de ce réexamen que, dans un objectif d'amélioration de la protection des investisseurs et de renforcement de l'intégration du marché des FIA, la directive pouvait faire l'objet de modifications ciblées.
Les objectifs principaux de cette revue étaient :
- d'harmoniser les règles applicables aux gestionnaires de FIA qui octroient des prêts ;
- de prévoir des standards minimaux harmonisés de recours aux outils de gestion de la liquidité ;
- de clarifier les normes applicables aux délégataires15(*) de fonctions ou de services essentiels pour les gestionnaires ;
- d'améliorer l'accès transfrontalier entre Etats membres aux services de dépositaires16(*).
Après plus d'un an de négociations au Conseil, au cours desquelles la France a joué un rôle pro-actif, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne début 2022, le texte final a abouti à un compromis, moins ambitieux que la proposition initiale, mais qui préservait les demandes françaises sur un certain nombre de points, notamment s'agissant des activités accessoires susceptibles d'être exercées par les fonds. Les mesures visant à assurer une plus grande transparence des pratiques de délégation ont en revanche été vivement contestées par un certain nombre d'Etats membres, tandis que l'approche prescriptive portée par la France en matière d'outils de gestion de la liquidité a été remise en cause par les tenants d'une approche plus flexible. Un accord politique est finalement intervenu en juillet 2023, sous présidence espagnole.
La directive « AIFM 2 » modernise donc la directive « AIFM » sur les différents points mentionnés supra.
La Commission a également estimé qu'un certain nombre des problématiques identifiées se posaient aussi pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières17(*) (ci-après OPCVM). La directive « AIFM 2 » modernise donc également, sur des points précis, la directive « OPCVM »18(*), qui définit les règles applicables aux OPCVM.
Le texte adopté prévoit ainsi :
- en matière de FIA qui octroient des prêts, un renforcement du cadre :
- s'agissant des FIA octroyant des prêts19(*) (fonds dont la stratégie principale est d'octroyer des prêts ou dont la valeur notionnelle20(*) représente au moins 50 % de la valeur actuelle nette du fonds) :
§ obligation pour ces fonds d'être fermés21(*), sauf s'ils démontrent que leur système de gestion de la liquidité est assez robuste ;
§ obligation d'avoir une limite du niveau de levier22(*) (175 % de la valeur nette d'inventaire pour les fonds ouverts, 300 % pour les fonds fermés) ;
§ dispense d'application des règles pour les fonds qui n'octroient que des prêts d'actionnaires, tant que ces prêts n'excèdent pas 150 % du capital du fonds ;
- s'agissant de l'octroi de prêts par les FIA :
§ limite d'investissement par entité fixée à 20% du capital du fonds pour certaines entités (entreprise financière, organismes de placement collectif) ;
§ interdiction d'octroyer des prêts à la société de gestion, au dépositaire, aux délégataires ou aux entités du même groupe ;
§ exigence de 5% de rétention du risque23(*) pour tout prêt émis et revendu ;
§ interdiction du modèle consistant à originer des créances pour les distribuer ;
§ possibilité faite aux États membres d'interdire au niveau national l'octroi des prêts à des consommateurs ;
- en matière d'outils de gestion de la liquidité :
§ obligation pour les gérants de choisir au moins deux outils de gestion de la liquidité parmi une liste de neuf outils figurant en annexe de la directive (suspension et plafonnement des rachats, extension des périodes de préavis, frais de rachats, ajustement de la valeur liquidative, régime du double prix, droits d'entrée en de sortie ajustables, cantonnements d'actifs, rachats en nature - pour les seuls investisseurs professionnels) ;
§ système de reporting auprès des autorités nationales prévu lorsque les gérants activent ou désactivent les outils de gestion de la liquidité préalablement sélectionnés par le gérant ;
- en matière de délégation :
§ obligation de fournir des informations plus précises sur l'ensemble des délégations (intra et extra-européennes) lors de l'autorisation ainsi qu'un reporting régulier des acteurs sur les montants et les pourcentages d'actifs sous gestion délégués, ainsi que la liste des activités des fonctions de gestion de portefeuille et de risques effectivement déléguées ;
§ rapport de l'ESMA (European Securities and Markets Authority - Autorité Européenne des Marchés Financiers) à la Commission européenne sur les pratiques de marchés en matière de délégation ;
- en matière de dépositaires : possibilité de recours par un fonds à un dépositaire dans un État membre autre que celui où il est établi, à condition que le marché national de la conservation d'actifs soit inférieur à 50 Mds € ;
- en matière de substance minimale : exigence que l'activité du gestionnaire soit assurée par au moins deux personnes résidant dans l'Union européenne qui sont, soit salariées à temps plein par le gestionnaire du fonds, soit membres exécutifs ou membres du conseil d'administration à plein temps de ce dernier ;
- en matière d'activités accessoires : autorisation explicite de nouvelles activités annexes, telles que l'administration d'indices ou la gestion de crédits, et toute activité déjà exercée par le gestionnaire, à condition que tout conflit d'intérêts éventuel créé par l'exercice de cette fonction ou activité au service d'autres parties soit géré de manière appropriée, permettant notamment de consolider la position française autorisant l'exercice par les sociétés de gestion de ces activités, pratique qui avait fait l'objet de contestations au niveau de l'ESMA ces dernières années ;
- en matière de commercialisation avec passeport des fonds d'épargne salariale : bénéfice du passeport distribution24(*), sous la condition qu'ils soient investis de manière prédominante dans les actions de l'entreprise qui les met à disposition de ses salariés, et avec la précision que ces fonds doivent être accessibles à tous les employés du groupe, qu'ils soient dans des filiales et ou des succursales (permettant de sécuriser la distribution des FCPE français aux employés des groupes français localisés dans d'autres Etats membres) ;
- en matière de reporting : développement d'un système de reporting intégré qui doit combiner les reportings envoyés aux autorités des marchés ainsi qu'aux banques nationales (dont le reporting sur les titres en portefeuille) et de supprimer les éventuels doublons qui existeraient.
La directive « AIFM 2 » reproduit également dans la directive « OPCVM » les mêmes dispositions en matière de délégation, d'outils de gestion de la liquidité, de substance minimale, d'activités accessoires et de reporting, s'agissant des OPCVM.
La directive « AIFM 2 » s'inscrit donc dans l'approfondissement du marché intérieur européen des FIA et des OPCVM (FIA octroyant des prêts, délégation, dépositaires, substance minimale), le renforcement de la résilience du secteur financier face aux crises (FIA octroyant des prêts, outils de gestion de la liquidité), l'amélioration de la transparence (délégation, reporting) et la sécurisation de certaines pratiques des gestionnaires d'actifs (activités accessoires, commercialisation avec passeport des fonds d'épargne salariale).
Les dispositions de cette directive devant être transposées d'ici à avril 2026, des adaptations doivent donc être conduites dans notre droit national.
Par ailleurs, dès lors que la directive « AIFM 2 » crée un régime harmonisé, au niveau européen, pour l'octroi de prêts par les FIA, il est nécessaire d'en tirer les conséquences en adaptant le champ de la dérogation au monopole bancaire sur le territoire français (qui, en l'état, est réservée à une liste limitative de fonds de droit national et de fonds européens labellisés « ELTIF » - European Long-Term Investment Funds), et en élargissant le champ des bénéficiaires auxquels ces FIA peuvent octroyer des prêts.
(2) L'article prévoit également une habilitation à procéder par ordonnance pour adapter le code monétaire et financier à la directive « AIFM » et au règlement « titrisation »25(*), afin notamment de faciliter la réalisation d'opérations de titrisation.
La titrisation est un mécanisme qui permet à un originateur (une banque généralement) de transformer des prêts (comme des crédits immobiliers ou des prêts automobiles) en titres financiers qu'elle peut vendre à des investisseurs institutionnels. La titrisation permet aux banques de libérer leur capital, de manière à pouvoir financer davantage de projets en accordant de nouveaux prêts, y compris aux petites et moyennes entreprises.
Le règlement « titrisation » définit le cadre général applicable à l'émission d'actifs titrisés dans l'Union européenne, et notamment les règles que doivent respecter les entités impliquées dans une opération de titrisation (prêteur initial, sponsor, organe de gestion, entité de titrisation et investisseur). En particulier, il définit la notion d'« entités de titrisation » (véhicule détenant les créances dans le cadre de l'opération) au niveau européen, et exclut de la définition de la « titrisation », au sens européen, les véhicules ne présentant pas de tranchage du risque26(*) au passif. Il ajoute un important corpus de règles de diligence raisonnable (due diligence investisseurs) et de transparence destinées à améliorer l'information des investisseurs, la maîtrise des risques (réduction de la dépendance aux agences de notation, interdiction de la re-titrisation) ainsi que la traçabilité des opérations. Ce régime prévoit également un régime de supervision.
En France, les entités de titrisation sont constituées sous forme d'« organismes de titrisation »27(*), qui sont des FIA « par nature » (dans la mesure où il sont listés explicitement par le code monétaire et financier28(*)). Ils présentent toutefois un régime ad hoc, le régime des FIA transposé par le code monétaire et financier ne leur étant, en majorité, pas applicable29(*). Cette spécificité résulte du choix fait par la France, lors de la transposition de la directive « AIFM », d'intégrer les organismes de titrisation au régime AIFM en qualifiant de « FIA par nature », tout en prévoyant un régime spécifique pour ces organismes. La qualification des entités réalisant des opérations de titrisation n'était toutefois pas impérative, la directive « AIFM » excluant explicitement les structures de titrisation ad hoc de son champ.
Ce point n'a pas été modifié à l'occasion de l'adoption du règlement « titrisation » en 2017, qui pose pourtant des critères spécifiques applicables aux entités engagées dans des opérations de titrisation en matière de transparence, destinées à améliorer l'information des investisseurs, de maîtrise des risques, de traçabilité des opérations et de supervision.
Certains éléments du régime des organismes de titrisation au niveau national, notamment relatifs au rôle des contrôles exercés par les dépositaires dans le cadre des opérations, paraissent par ailleurs désormais inadaptés, le règlement européen ayant largement harmonisé les diligences devant être réalisées en la matière.
L'habilitation permettrait notamment de modifier le cadre national pour limiter l'application aux véhicules français de titrisation d'exigences additionnelles qui dépasseraient celles posées par le règlement « titrisation ».
?Ces modifications accompagneraient la relance au niveau européen du marché de la titrisation, devenue une priorité dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux, avec le soutien du régulateur européen de marché (Autorité Européenne des Marchés Financiers) et des régulateurs nationaux (Autorité des marchés financiers et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution30(*)). Elle a fait l'objet de recommandations récentes dans les rapports publiés par Christian Noyer31(*), Enrico Letta32(*) et Mario Draghi33(*).
Adéquatement réglementé, un marché dynamique de la titrisation peut en effet contribuer à libérer des capacités de financement bancaire et attirer des investisseurs institutionnels, contribuant ainsi au financement des transitions écologique et numérique. Contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni ou à d'autres régions qui ont su relancer cet outil, le marché européen de la titrisation n'a jamais retrouvé les niveaux pré-crise de 2008, privant l'UE d'un levier de financement efficace, réduisant la compétitivité de ses banques et limitant sa capacité à mobiliser des ressources pour soutenir l'économie.
Une partie de cette situation est liée au cadre mis en place après la crise financière. Si certains garde-fous de ce cadre doivent être conservés (interdiction de la re-titrisation, interdiction de la titrisation sans rétention, supervision des agences de notation), un consensus émerge sur la nécessité de faire évoluer certains paramètres, sans compromettre la stabilité financière.
En termes de calendrier, la Commission européenne a publié le 17 juin 2025 un paquet « titrisation »34(*), incluant notamment une révision du règlement « titrisation » (comme annoncé par la Commission européenne dans sa communication sur l'Union de l'épargne et de l'investissement)35(*), avec pour objectif de simplifier les exigences prudentielles et réglementaires, tout en maintenant des garde-fous solides et une transparence adéquate pour garantir la sécurité du système financier.??
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Aux termes de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il est également nécessaire de transposer en droit français les dispositions de la directive « AIFM 2 ».
L'habilitation à légiférer par ordonnance s'inscrit dans le régime prévu à l'article 38 de la Constitution.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
(1) L'article prévoit une habilitation à transposer par ordonnance la directive « AIFM 2 », qui modifie deux directives :
- la directive « AIFM » : directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 ;
- la directive « OPCVM » : directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Une transposition fidèle des dispositions est prévue sur les différents sujets traités par la directive.
En matière d'octroi de prêts par les FIA, la directive crée un régime harmonisé, au niveau européen, pour l'octroi de prêts par de tels fonds. Des adaptations dépassant la stricte transposition pourraient donc s'avérer nécessaires dans le droit national, notamment pour étendre les exemptions au monopole bancaire applicables à de tels fonds (qui, en l'état, réserve la dérogation au monopole bancaire sur le territoire français à une liste limitative de fonds de droit national et de fonds européens labellisés « ELTIF » - European Long-Term Investment Funds), ainsi que pour élargir les bénéficiaires des prêts octroyés par des FIA.
Au demeurant, l'habilitation permettrait d'apporter certains ajustements rédactionnels aux dispositions issues de la transposition des directives « AIFM » et « OPCVM ».
(2) L'article prévoit également une habilitation à adapter les dispositions nationales en matière d'entités de titrisation. L'objectif est d'adapter le régime juridique des véhicules de droit français utilisés pour conduire des opérations de titrisation, pour que leur utilisation n'emporte pas d'obligation plus élevée que celles exigées pour les entités de titrisation définies par le règlement « titrisation » (règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012), et en particulier pour ne pas leur appliquer d'exigences supplémentaires résultant de la qualification en tant que FIA au sens de la directive « AIFM ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le paquet législatif a été publié au Journal Officiel de l'Union européenne au mois de mars 2024 et les travaux de transposition sont encore en cours au niveau des États membres.
S'agissant des entités de titrisation, les éléments de droit comparé indiquent que la plupart des autres Etats membres de l'Union européenne (en particulier le Luxembourg) n'ont pas retenu le choix de la qualification en tant que FIA des véhicules utilisés dans le cadre des opérations de titrisation.
Au demeurant, les diligences complémentaires qui résultent du cadre national applicable aux véhicules utilisés dans le cadre des opérations de titrisation sont plus élevées que celles d'autres pays européens, où elles se limitent le plus souvent à celles exigées au titre du règlement « titrisation ».
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
(1) La directive « AIFM 2 » procède à un certain nombre de modifications dans les directives « AIFM » et « OPCVM », qui nécessitent une transposition, notamment par adaptation des dispositions de droit national prises pour la transposition de ces deux directives.
En particulier, les dispositions de la directive « AIFM 2 » relatives à un certain nombre de sujets nécessitent des mesures de niveau législatif, dans la mesure où elles modifient des dispositions elles-mêmes de nature législative :
- Octroi de prêts par les FIA ;
- Outils de gestion de la liquidité ;
- Activités accessoires ;
- Reporting ;
- Dépositaires ;
- Substance minimale ;
- Pouvoirs de l'autorité de supervision.
L'article 3 de la directive « AIFM 2 » dispose que la transposition doit intervenir au plus tard le 16 avril 2026 pour l'ensemble des dispositions de la directive, à l'exception des dispositions relatives au reporting, qui doivent être transposées avant le 16 avril 2027.
Un véhicule législatif est donc requis pour procéder à la transposition de ces dispositions.
Par ailleurs, les dispositions régissant le monopole bancaire et définissant les bénéficiaires des prêts étant de niveau législatif, un véhicule législatif est nécessaire pour les modifier.
(2) Le règlement titrisation est d'application directe et ne nécessite pas en tant que tel de mesure de transposition. Toutefois, le dispositif actuel a démontré des difficultés à structurer des opérations de titrisation par l'intermédiaire de véhicules de droit français (organismes de titrisation).
Dans les faits, les retours des acteurs de la place financière (banques et dépositaires) font état d'une utilisation des organismes de titrisation de droit français pour les seules opérations domestiques, et d'une faible attractivité du régime, voire quasiment nulle, pour les opérations internationales, au profit de véhicules de droit étranger, luxembourgeois et irlandais notamment. Le modèle français des organismes de titrisation (FIA par nature n'appliquant pas le régime des FIA) est par ailleurs source d'incompréhensions chez les investisseurs internationaux.
Dans un contexte de relance au niveau européen du marché de la titrisation, l'adaptation du cadre national pour permettre de faciliter la structuration d'opérations par ces véhicules de droit national paraît donc nécessaire.
Ces modifications sont relatives aux règles législatives applicables aux organismes de titrisation. En particulier, la qualification des organismes de titrisation en tant que FIA relève du niveau législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'habilitation doit permettre de procéder à la transposition des dispositions de la directive « AIFM 2 », qui doit contribuer à l'approfondissement du marché intérieur européen des FIA et des OPCVM, améliorer la résilience et la transparence de ces fonds et, in fine, accroître les capacités de financement de l'économie. Elle doit également permettre de tirer les conséquences de la création par la directive « AIFM 2 » d'un régime harmonisé, au niveau européen, pour l'octroi de prêts par les FIA, pour revoir certaines dispositions nationales qui constituent, dans les faits, un frein à l'octroi de prêts sur le territoire français par ces entités, notamment les règles nationales en matière de monopole bancaire et certaines règles sur les bénéficiaires de prêts octroyés par ces entités.
Elle doit également permettre de faciliter la structuration d'opérations de titrisation par l'intermédiaire de véhicules de droit français, notamment en réduisant le coût associé à de telles opérations et, ainsi, d'une part, accroître la participation sur ce marché, notamment pour des plus petits acteurs ou pour des opérations de plus petite taille et, d'autre part, renforcer la compétitivité de la place de Paris comme place de domiciliation pour ces opérations.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La première option envisagée aurait consisté à introduire directement dans le projet de loi les modifications nécessaires pour procéder à la transposition de la directive « AIFM 2 », ainsi que les modifications du droit national nécessaires pour l'adapter au règlement « titrisation » et faciliter la réalisation d'opérations de titrisation. Elle aurait également permis de renforcer immédiatement la compétitivité des organismes de titrisation de droit national.
Cette option se serait toutefois heurtée à plusieurs contraintes de calendrier :
- en premier lieu, les dispositions, que ce soit pour la transposition de la directive « AIFM 2 » ou pour l'adaptation du régime national des véhicules de titrisation au règlement « titrisation », présentent un haut niveau de technicité et un volume conséquent, qui nécessiteront des échanges nourris avec des acteurs de la place financière (notamment les fédérations représentatives des sociétés de gestion (Association française de la gestion financière, France Invest, Association française des sociétés de placement immobilier) et des dépositaires (France Post Marché) en amont de leur présentation, pour garantir qu'elles répondent bien à l'ensemble des besoins identifiés. Une consultation élargie sur les dispositions de transposition de la directive « AIFM 2 », notamment auprès des fédérations représentatives des organismes de gestion collective, ne pourront être entamées qu'ultérieurement. Ce temps pourra également être mis à profit pour approfondir la comparaison avec les autres Etats membres en matière de transposition de la directive, pour objectiver l'enjeu de compétitivité ;
- en deuxième lieu, les adaptations du droit national des entités de titrisation au règlement « titrisation » devront intégrer la révision à venir de ce règlement, suite à la présentation du texte législatif par la Commission européenne le 17 juin 2025, qui devrait intégrer notamment une simplification des exigences de transparence applicables aux opérations de titrisation, et pourraient donc emporter la nécessité d'adaptation additionnelles ;
- en troisième lieu, un groupe de travail du Haut comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP), consacré à la transposition de la directive « AIFM 2 » s'est réuni à compter du mois d'octobre 2024, pour travailler plus spécifiquement sur les sujets de transposition liés à l'octroi de prêts par les FIA, aux outils de gestion de la liquidité, et aux activités accessoires. Son rapport final doit être présenté juillet 2025, et ses propositions constitueront un élément important pris en compte dans le cadre de la transposition.
L'option de l'ordonnance adoptée dans le délai de transposition présente donc l'avantage de permettre une transposition avant l'échéance du délai d'avril 2026, tout en évitant de reporter la prise de ces mesures techniques et impératives à un prochain vecteur législatif.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La voie d'une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance a donc été retenue. Deux raisons justifient ce choix :
- Une contrainte de calendrier : comme indiqué plus haut, plusieurs éléments sont en attente de finalisation avant d'être en mesure de proposer des dispositions législatives stabilisées ;
- Une contrainte technique : les mesures envisagées dans le cadre de cette habilitation sont de nature technique, puisqu'elles consistent en des adaptations des règles applicables aux différentes catégories d'OPCVM et de FIA de droit français, notamment les organismes de titrisation. Elles présentent en outre un volume conséquent.
A cet égard, il est notable que les dernières réformes législatives importantes intervenues dans le domaine des FIA sont également passées par une habilitation à légiférer par ordonnance (l'article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II a habilité le Gouvernement à prendre l'ordonnance du 4 octobre 2017 créant les organismes de financement spécialisés et l'article 40 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, qui a habilité le Gouvernement à prendre l'ordonnance du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs ), de même que la transposition initiale de la directive « AIFM » (l'article 18 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement a habilité le Gouvernement à prendre l'ordonnance du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
Sur les différents points, une transposition fidèle des dispositions de la directive étant néanmoins prévue, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts suivants :
- S'agissant du marché des FIA dans l'Union européenne, ce dernier représentait 6 800 Md € fin 2022 et environ un tiers du secteur des fonds de l'UE. Néanmoins, l'harmonisation du cadre applicable aux FIA est susceptible de développer encore davantage ce secteur.
- En matière d'octroi de prêts par les FIA, les considérants de la directive mentionnent que le marché des FIA de l'Union fournit plus de 250 milliards d'euros aux entreprises de l'Union dans le domaine de la dette privée, et les investisseurs de l'Union sont responsables de 30 % du capital mondial alloué à l'ensemble du secteur. Un cadre européen clarifié en matière d'octroi de prêts par les FIA pourrait favoriser le développement de la dette privée en France, en offrant davantage de sécurité juridique et de reconnaissance mutuelle au niveau européen.
- Les dispositions de transposition de la directive en matière d'outils de gestion de la liquidité, de reporting, de substance minimale et de délégation sont de nature à renforcer la résilience des OPCVM et des FIA et, ainsi, de préserver le marché intérieur des FIA.
- Les dispositions en matière de passeportage des fonds d'épargne salariale et d'activités accessoires seront par ailleurs de nature à sécuriser la pratique des gestionnaires français en la matière.
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Concernant l'habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de douze mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.
Le délai demandé (12 mois) doit permettre au Gouvernement de permettre la conclusion des travaux en lien avec les acteurs de la place financière relatifs à la transposition et permettre de conduire les consultations multiples des acteurs et des travaux d'instruction approfondis aux niveaux de la direction générale du Trésor et de l'AMF.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
6. APPLICATION DANS L'ESPACE
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit.
Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3 ». La matière bancaire et financière n'en fait pas partie.
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1 ». La matière bancaire et financière n'en fait pas partie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse d'applicabilité.
L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57- 811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
L'article d'habilitation prévoit donc la possibilité d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie français et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises par ordonnance, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités. Il ouvre également la possibilité de prévoir les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités qui sont des pays et territoires d'outre-mer où le droit européen ne s'applique pas.
Article 6 - Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance en vue d'assurer la transposition des directives du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'accès aux marchés cotés
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La facilitation de l'accès aux marchés cotés et la diversification des modes de financement des PME et ETI ont été identifiées comme deux priorités de la stratégie d'approfondissement de l'Union des marchés de capitaux de la Commission européenne. Le développement insuffisant des marchés d'actions européens par rapport aux autres économies avancées est pour partie attribuable au coût généré par la lourdeur des exigences d'information imposées par les règles européenne de cotation36(*), la fragmentation dans la mise en oeuvre des règles de cotation au niveau des États membres et l'inadéquation croissante des règles actuelles à certaines pratiques nouvelles (émergence d'offres transfrontalières au public ou de nouveaux modes d'accès à la cotation, etc.).
C'est dans ce contexte que le plan d'action de la Commission européenne sur l'Union des marchés de capitaux, publiée en septembre 2020, intégrait une réforme des règles de cotation. Des travaux techniques ont été conduits par un groupe d'experts qui a présenté en mai 2021 un rapport ayant largement inspiré la proposition législative dite Listing Act.
Le Listing Act vise ainsi à réduire les obligations d'information lors des introductions en bourse et des augmentations de capital (règlement Prospectus) et à moderniser l'organisation des offres au public. En particulier, il prévoit :
- L'harmonisation des formats et du contenu des prospectus37(*) (nombre de pages, ordre et contenu des sections, normes linguistiques, etc.) afin d'en faciliter la préparation - ces différents éléments devant être précisés dans des normes techniques de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) ;
- La suppression de l'obligation de produire un prospectus pour les augmentations de capital d'un montant inférieur à 30 % du capital sur douze mois ainsi que pour toute opération secondaire d'une société cotée depuis plus de 18 mois sur un même marché ;
- L'encadrement strict des procédures d'examen des prospectus par les autorités de marché (délai d'approbation, justification des demandes à l'émetteur...) ;
- La modernisation des procédures d'offre de titres au public, notamment par la réduction de la durée de ces opérations, de six à trois jours.
En outre, le Listing Act vient alléger certaines des obligations d'information continue imposées aux sociétés cotées dans le cadre du règlement sur les abus de marché (règlement 596/2014 du 16 avril 20114 dit règlement « MAR »). Ces règles pouvaient représenter un coût important pour les émetteurs car elles nécessitaient de contrôler de façon étroite la circulation, au sein de la société, des informations privilégiées ainsi que leur processus de publication, en lien avec les autorités de marché. Le Listing Act restreint sensiblement le champ des situations devant conduire à une communication immédiate au marché ; en effet, les étapes intermédiaires des procédures en plusieurs étapes (telles que les fusion-acquisition, brevet, etc.) ne devront plus faire l'objet d'une information du marché. Il refond aussi les dispositions régissant le différé de publication d'une information privilégiée de façon à donner une sécurité juridique plus forte aux émetteurs qui souhaitent y recourir - le caractère imprécis de ces dispositions l'y autorisant difficilement aujourd'hui.
Le Listing Act autorise également les introductions en bourse avec des actions dites à droits de vote multiples, permettant aux sociétés d'accéder aux marchés cotés tout en conservant un régime de gouvernance proche du marché non-coté, et renforçant ainsi l'attractivité de la cote.
Enfin, le Listing Act introduit une évolution de la facturation de la recherche financière, afin de renforcer la couverture des PME par les analystes.
Le présent article vise à transposer les deux directives du Listing Act.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, Loi relative à la protection des données personnelles §3).
Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu'ils visent à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce que leur objectif est d'amender les modalités techniques de collecte d'informations qui font déjà l'objet d'obligations de transmission aux autorités compétentes.
L'habilitation à légiférer par ordonnance s'inscrit enfin dans le régime prévu à l'article 38 de la Constitution.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Aux termes de l' article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il est également nécessaire de transposer en droit français les dispositions des deux directives du paquet législatif Listing Act.
Cet article a donc pour objet la transposition deux directives :
- La directive (UE) 2024/2810 du 23 octobre 2024 du Parlement européen et du Conseil sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l'admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation ;
- La directive 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 visant à rendre les marchés publics des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux.
Il a également pour objectif d'assurer la mise en cohérence du droit national avec les dispositions du règlement 2024/2809 visant à rendre les marchés des capitaux plus attrayants pour les entreprises de l'UE et faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux.
La directive (UE) 2024/2811 modifie la directive 2014/65/UE dite MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) qui vise à améliorer la transparence des marchés financiers, à renforcer la protection des investisseurs et à harmoniser la réglementation des services d'investissement au sein de l'UE. Elle abroge en outre la directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs.
Par ailleurs, le règlement (UE) 2024/2809, modifie les règlements suivants :
- Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE
- Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dit MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation).
Une transposition fidèle des dispositions des deux directives est prévue sur les différents sujets traités par la directive.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet - le paquet législatif a été publié au Journal Officiel de l'Union européenne au mois d'octobre 2024 et les autres États membres débutent, à l'instar de la France, les travaux de transposition.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La transposition des directives 2024/2810 et 2024/2811 doit intervenir au plus tard le 5 juin 2026.
Les dispositions des deux directives précitées nécessitent des mesures de niveau législatif, dans la mesure où elles modifient des dispositions elles-mêmes de nature législative, telles que la modification des modalités de calcul du seuil déclenchant l'obligation de publier un prospectus d'offre au public, l'assouplissement des règles relatives au régime linguistique des prospectus et des résumés de prospectus ou la modification des modalités de traitement de la recherche financière.
Un véhicule législatif est donc requis pour procéder à la transposition de ces dispositions.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'habilitation doit permettre de procéder à la transposition des dispositions des deux directives précitées :
- La directive (UE) 2024/2810 du 23 octobre 2024 du Parlement européen et du Conseil sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l'admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation
La directive a pour objet principal d'autoriser les sociétés enregistrées dans l'Union européenne à s'introduire en bourse avec des actions à droits de vote multiples, c'est-à-dire des titres de capital offrant plusieurs actions par droit de vote. Cette possibilité relève actuellement des régimes nationaux de droit des sociétés et seule une minorité d'États membres autorisent les sociétés cotées à se doter de ce type de structure actionnariale. Cette évolution vise à prendre en compte le fait que le recours aux actions à droits de vote multiples lors de l'introduction en bourse était devenu un choix de gouvernance fréquent (aux Etats-Unis, environ 45 % des sociétés ayant réalisé leur introduction en bourse en 2021 avaient choisi de s'en doter). Les actions à droits de vote multiples offrent la souplesse de gouvernance recherchée par un nombre croissant de sociétés innovantes, en atténuant les conséquences de la dilution au capital du dirigeant (ou actionnaire principal) provoquée par l'augmentation de capital accompagnant l'introduction en bourse et en préservant son influence sur la stratégie de la société en dépit de la réduction de sa participation au capital. Le dirigeant est ainsi largement immunisé contre les conséquences d'une variation excessive du cours de bourse et/ou du choix de ne pas verser de dividendes. Cet avantage est particulièrement recherché pour les sociétés innovantes dont les cycles de développement s'étendent sur des périodes relativement longues (par exemple, dans le secteur pharmaceutique) et/ou exerçant dans des secteurs dans lesquelles les premières années d'activités correspondent à une période de fort investissement et donc de non rentabilité (notamment dans le secteur technologique). Les dirigeants de sociétés dotées d'actions à droits de vote multiples conservent, a minima au cours des premières années de cotation, un mode de gouvernance similaire à celui pratiqué avant la cotation. La faculté de se doter de droits de vote multiples vise ainsi à :
1. encourager la cotation de sociétés qui aurait préféré poursuivre la croissance en-dehors du marché boursier, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité d'acheter des actions dans des entreprises qui, autrement, ne leur auraient peut-être pas été accessibles ;
2. permettre aux actionnaires de contrôle (qui détiennent de tels titres), aux administrateurs et aux dirigeants de se concentrer sur le succès et la rentabilité à long terme de la société ;
3. protéger les actionnaires des prises de contrôle hostile (par voie d'offre publique d'achat - OPA) et leur permettre de participer à la souveraineté économique de la France alors que le marché français se caractérise par une forte base actionnariale étrangère.
- La directive 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 visant à rendre les marchés publics des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux
La proposition de directive amende de façon ciblée la directive 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers (dite MiFID II) et abroge la directive 2001/34/CE (dite Cote officielle) dont une partie des dispositions sont obsolètes. Les dispositions pertinentes sont renvoyées dans la directive MiFID II.
Les amendements à la directive MiFID II visent
à assouplir les contraintes pesant sur le financement et la diffusion de
la recherche financière. La directive MiFID II impose aux entreprises
d'investissement de (i) soit séparer les paiements qu'elles
reçoivent en tant que commissions de courtage des
rémunérations qu'elles reçoivent pour la recherche en
investissements (règles de dissociation de la recherche), (ii) soit
financer la recherche en investissements sur leurs ressources propres. Cette
séparation a eu pour conséquence de diminuer très
significativement les activités de recherche en investissements sur les
PME.
Afin de revitaliser le marché de la recherche en
investissements et de garantir une couverture suffisante de la recherche par
les entreprises, en particulier les entreprises à faible et à
moyenne capitalisation, il est apparu nécessaire d'adapter les
règles de dissociation de la recherche afin d'offrir aux entreprises
d'investissement une plus grande souplesse dans la manière dont elles
choisissent d'organiser les paiements pour les services d'exécution et
la recherche. La première modification consiste à revenir sur
l'interdiction faite aux prestataires de service d'investissement de facturer
le coût de la recherche avec le coût d'exécution d'une
transaction, sous réserve que l'analyse concerne une
société dont la capitalisation boursière est
inférieure à 10M€. Pour la recherche financée par les
émetteurs, dite sponsorisée, le texte crée une nouvelle
exemption qui permet de ne pas être soumis à la qualification de
documentation commerciale dès lors qu'un code de conduite aura
été défini au niveau de la place financière, revue
tous les deux ans. Par ailleurs, la directive Cote officielle est
abrogée, une partie des concepts et des dispositions étant
devenus obsolètes à mesure que d'autres textes sectoriels ont
progressivement étoffé le corpus réglementaire
européen. Les rares dispositions toujours pertinentes, qui concernent la
capitalisation minimale lors de l'introduction en bourse et le flottant
minimum, sont conservés et transférés dans la directive
MiFID II.
- Le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifie les règlements « Prospectus » (2017/1129), « Abus de marché » (MAR) (596/2014) et « Marchés d'Instruments Financiers » (MiFIR) (600/2014)
Le règlement vient assouplir l'obligation de publier un prospectus, lequel ne s'appliquera plus aux offres au public relatives aux valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation à condition que :
1. elles représentent moins de 30% du nombre de valeurs mobilières existantes sur une période de 12 mois ;
2. l'émetteur ne fasse pas l'objet d'une procédure de restructuration ou d'insolvabilité ;
3. un document résumé soit déposé auprès de l'autorité compétente (mais non soumis à l'approbation de celle-ci).
Il crée en outre une nouvelle exemption pour les offres au public et les admissions aux négociations de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation pendant une période continue d'au moins 18 mois précédant l'offre ou l'admission aux négociations des nouveaux titres, à condition que :
1. elles ne soient pas émises dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, d'une fusion ou d'une scission ;
2. l'émetteur ne fasse pas l'objet d'une procédure de restructuration ou d'insolvabilité ;
3. un document résumé soit déposé auprès de l'autorité compétente.
L'exemption à l'obligation de publier un prospectus pour les « petites offres » est également élargie : ne concernant actuellement que les offres d'un montant maximum de 8M€ sur une période de 12 mois, ce montant est augmenté à 12M€ (étant précisé que les Etats membres pourront choisir de baisser ce seuil à 5M€).
- Les modifications apportées au règlement « MAR » sont plus ciblées
La principale modification vise à exempter les sociétés émettrices de l'obligation de publication immédiate des informations privilégiées relatives « aux étapes intermédiaires d'un processus en plusieurs étapes » (tels que les processus de fusions acquisitions). Seuls les circonstances finales ou l'événement final doivent être divulgués, dès que possible après qu'ils se sont produits.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La première option envisagée consistait à introduire dans le projet de loi l'ensemble des modifications législatives nécessaires à la transposition des deux directives, ainsi que les modifications du droit national nécessaires pour l'adapter au règlement associé.
Cette option s'accommode difficilement du haut niveau de technicité des dispositions, de la nécessité d'assurer la cohérence de la transposition avec les dispositions issues de la récente loi dite Attractivité du 14 juin 2024 et des nombreuses consultations de place qui devront être tenues.
La deuxième option envisagée prend la forme d'une transposition par voie d'ordonnance, qui permettra de conduire les travaux techniques et de consultations, tout en respectant le délai de transposition fixé au 5 juin 2024. C'est cette option qui a été retenue.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La voie d'une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance a été retenue. Trois raisons principales expliquent ce choix :
- L'importance d'assurer la cohérence des choix des transpositions de la directive (UE) 2024/2810 avec les dispositions de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, qui a déjà introduit, avant l'adoption du Listing Act, la possibilité, pour certaines sociétés, d'émettre des actions de préférence à droits de vote multiples lors de leur première admission à la cote.
- La nécessité de procéder à des arbitrages de nature technique sur certaines dispositions pour lesquelles le Listing Act laisse une certaine latitude aux Etats membres, et en particulier : i) le niveau du rehaussement du seuil d'offre au public déclenchant l'obligation de publier un prospectus d'offre au public ; ii) le régime linguistique relatif au prospectus et au résumé du prospectus ; iii) les modalités de calcul dans le code monétaire et financier du seuil d'offre au public.
- La nécessité de conduire des consultations multiples avec les différentes fédérations professionnelles de la place de Paris et d'associer très étroitement l'Autorité des marchés financiers, en sa qualité de superviseur, aux travaux de transposition.
L'option de l'ordonnance, laquelle serait adoptée dans le délai de transposition, présente donc l'avantage de permettre une transposition avant l'échéance de juin 2026, en permettant de conduire les travaux techniques et les consultations nécessaires.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'évaluation des conséquences attendues de la mise en oeuvre du portail du Listing act sont renseignées dans l'analyse d'impact accompagnant la proposition législative de la Commission européenne.
Par ailleurs, l'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation. Néanmoins, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts suivants :
- L'harmonisation minimale du régime d'actions à votes multiples devrait renforcer l'attractivité de l'admission à la négociation. Les créateurs d'entreprises et les entreprises familiales pourront demander à être admis à la négociation dans n'importe quel État membre, tout en conservant un contrôle renforcé sur leur entreprise grâce à l'utilisation d'actions à votes multiples, ce qui devrait les inciter à la cotation ;
- L'introduction de prospectus plus courts, combinée à un examen simplifié par les autorités nationales de supervision, contribueront à lever les obstacles réglementaires et à réduire les coûts relatifs aux introductions en bourse. En outre, une procédure d'examen et d'approbation plus efficace doit se traduire par un processus d'admission à la négociation plus rapide.
Le paquet Listing Act devrait permettre aux émetteurs, PME incluses, d'économiser chaque année un montant estimé à 167 millions d'euros38(*) - montant correspondant à la réduction associée de production de documentation réglementaire.
Les autorités nationales de supervision devraient également bénéficier d'un allègement de leur charge de travail, grâce à des exigences plus simples et mieux définies, qui faciliteront l'exercice efficace de leurs missions de surveillance.
Les investisseurs devraient, quant à eux, bénéficier des modifications réglementaires envisagées, car l'information sur les entreprises (au moment de l'admission à la négociation et par la suite) sera plus courte, plus rapide et plus facile à consulter.
In fine, le paquet Listing Act contribuera à améliorer l'intégration, la profondeur et la liquidité des marchés des capitaux de l'Union.
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Concernant l'habilitation donné au Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de 6 mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.
Ce délai de 6 mois doit permettre au Gouvernement d'assurer la conclusion des travaux de place relatifs à la transposition, de procéder aux arbitrages nécessaires et permettre de conduire les consultations multiples des acteurs et des travaux d'instruction approfondis aux niveaux de la direction générale du Trésor et de l'AMF.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Articles 7 - Correction des dispositions de transposition de la directive 2019/878/UE dite « CRD5 ».
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les graves perturbations économiques et financières observées à partir de 2008 ont conduit le Comité de Bâle à harmoniser et renforcer les standards internationaux en matière d'exigences prudentielles et de surveillance des banques d'une nouvelle révision en 2010 des accords de Bâle, dite « Bâle III ». Ces évolutions ont été intégrées dans l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) par l'adoption de plusieurs « paquets législatifs » bancaires européens, dont fait partie la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, dite « CRD5 » , encadrant notamment les conditions d'accès au marché, la gouvernance et le dispositif de gestion des risques des banques.
L'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière a introduit en droit français les révisions de nature législative nécessaires à la transposition de la directive CRD5.
Par échange de courriers conduit entre les mois d'avril 2024 et juin 2025, la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés de capitaux de la Commission européenne et les autorités françaises ont conjointement identifié plusieurs dispositions introduites par l'ordonnance susmentionnée soulevant des questions de conformité avec les exigences de la directive CRD5, et nécessitant de ce fait des corrections dans les transpositions qui avaient précédemment été réalisées. Le présent article vise donc à introduire dans le code monétaire et financier les modifications convenues avec la Commission européenne pour assurer la pleine conformité des dispositions concernées.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle »39(*).
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive 2013/36/UE, dite CRD4, harmonise les règles et les délais applicables aux autorisations relatives à l'agrément des établissements de crédit, à leur extension et leur retrait, au contrôle des prises de participations au capital des établissements de crédit et, plus largement, à la supervision prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Elle a été complétée par la directive CRD5, en particulier en ce qui concerne les exigences prudentielles en matière de rémunération, de gouvernance et de conservation de fonds propres, ainsi que des modalités de surveillance sur base consolidée des groupes d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et des compagnies financières holding.
Ces directives constituent un corpus normatif qualifié de « paquet bancaire européen », avec le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012, dit « CRR » (pour « Capital Requirements Regulation ») qui a été modifié par les règlements (UE) 2019/876 et 2024/1623, dits « CRR2 » et « CRR3 ». Ce paquet législatif permet d'harmoniser la réglementation prudentielle bancaire au niveau de l'Union européenne.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La directive CRD5 devait être transposée au plus tard le 28 décembre 2020. Sauf enjeu de conformité ciblé traité par un dialogue bilatéral avec la Commission européen, les autres Etats membres ont introduit depuis ces dates dans leur droit national les dispositions faisant l'objet des corrections prévues au présent article.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de légiférer provient ici tout d'abord de l'obligation constitutionnelle de transposition en droit interne d'une directive imposée par l'article 88-1 de la Constitution qui dispose que « [l]a République participe à l'Union européenne ». Cette obligation a d'ailleurs été rappelée par le Conseil constitutionnel dans le considérant 7 de sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 : « Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution [...] ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ».
Or, les dispositions qui sont modifiées sont de nature législative. Il n'y a donc d'autre choix que de prendre une loi pour se conformer au droit de l'Union européenne.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à lever les enjeux identifiés conjointement par la Commission européenne et les autorités françaises dans le cadre du contrôle de conformité opéré pour la transposition de la directive CRD5.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Seules les modifications présentement envisagées permettent de mettre en conformité notre droit avec les dispositions impératives de la directive CRD V.
En outre, une disposition législative ne peut être modifiée que par une mesure de même niveau normatif. Ainsi, aucune autre option que le recours à la loi n'a été envisagée ici.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Les révisions sur lesquelles les autorités françaises et la Commission européenne se sont accordées dans le but d'assurer la mise en conformité des dispositions de droit français transposant la directive CRD5 sont apparues limitées dans leur ampleur et dans leur matérialité. Celles-ci sont de nature principalement technique et ne se traduiront pas par des changements substantiels des exigences réglementaires ou de la pratique de la supervision.
Premièrement, le 1° du présent article corrige certaines dispositions du VI de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier, transposant les paragraphes 2, 2 bis et 12 l'article 131 de la directive CRD5, qui ont été en partie indument supprimées par l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE, dite « IFD » (pour « Investment Firms Directive »). Cette suppression résulte d'une erreur d'écriture de l'ordonnance. Ainsi, il convient de réintroduire les spécifications de CRD5, lesquelles concernent la méthodologie de recensement des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) sur base consolidée40(*) (en particulier, la liste des indicateurs utilisés pour mesurer l'importance systémique41(*)) ainsi que les exigences de publication par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des établissements recensés. Pour contexte, conformément à l'article 131 de CRD5, l'ACPR actualise, au travers d'une décision de son collège de supervision, et publie sur son site internet42(*) chaque année la liste des EISm sur la base d'une méthodologie d'identification harmonisée par le règlement délégué (EU) n° 1222/2014 de la Commission européenne43(*). Ces exigences de la directive reprennent le cadre défini par le Comité de Bâle en matière d'identification des banques d'importance systémique mondiale et la réintroduction de ces dispositions assurera ainsi également le plein alignement entre l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier et les standards internationaux.
Toutefois, le deuxième alinéa introduit à l'article L. 511-41-1-A au 1° du présent article est légèrement reformulé par rapport aux dispositions qui ont été supprimées par l'ordonnance n° 2021-796 précitée. Ce deuxième alinéa précise que - en plus de la méthodologie de droit commun consistant à mesurer les activités transfrontières d'un établissement en y incluant les activités au sein des autres Etats membres de l'UE et des pays tiers -, l'ACPR peut décider de recourir à une méthode de calcul dérogatoire consistant à ne pas retenir les activités d'un établissement au sein de l'Union bancaire comme des activités transfrontières. Les établissements assujettis au Mécanisme de supervision unique sont dans ce cas considérés comme opérant dans une juridiction unique. Les ajustements rédactionnels apportés à cet alinéa par rapport à sa version antérieure à 2021 visent à simplifier sa formulation et à renforcer son intelligibilité.
Deuxièmement, le 2° du présent article corrige l'article L. 517-16 du code monétaire et financier, lequel n'avait pas transposé la spécification existante dans la partie introductive du paragraphe 6 de l'article 21 bis de la directive CRD5 selon laquelle les mesures de surveillance qui concernent une compagnie financière holding mixte qui ne respecte plus les exigences liées à son agrément doivent prendre en compte les effets particuliers qu'elles pourraient avoir sur le conglomérat financier détenu par ladite compagnie.
Troisièmement, le 3° du présent article corrige le IV de l'article L. 613-20-4 du code monétaire et financier, lequel prévoit seulement à ce jour que l'ACPR, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, doit se conformer à la décision de l'ABE dans le contexte d'un désaccord entre autorités de surveillance pour adopter une décision commune en matière de surveillance sur base consolidée des groupes d'établissement de crédit et de société de financement. Or, le 4e alinéa du paragraphe 3 de l'article 113 de la directive CRD5 offre la possibilité à toutes autorités de surveillance (donc y compris l'ACPR) de s'écarter sensiblement de la décision de l'ABE sur le fondement d'une décision motivée. Cette correction apporte ainsi davantage de latitude à l'ACPR dans sa décision d'appliquer ou non la délibération rendue par l'ABE.
Quatrièmement, le 4° du présent article corrige l'article L. 613-20-6-1 du code monétaire et financier, lequel permet à ce jour à l'ACPR de saisir, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe d'établissement de crédit ou de société de financement, l'Autorité bancaire européenne (ABE), en cas de désaccord avec une autre autorité compétente au sujet de l'octroi de l'agrément à une compagnie financière holding ou à une compagnie financière holding mixte établie en-dehors de France. Cette correction se justifie dans la mesure où le paragraphe 8 de l'article 21 bis de la directive CRD5 fait de cette saisine de l'ABE une obligation (« saisit » dans la sémantique de la CRD5) pour l'autorité de surveillance sur base consolidée et non pas une possibilité (« peut saisir » dans la sémantique de l'actuel article L. 613-20-6-1 du code monétaire et financier). Ces révisions précisent également - par l'introduction du terme « alors » impliquant nécessairement un séquençage des actions du superviseur dans le temps - que l'ACPR doit s'abstenir de prendre une décision commune avec une autre autorité compétente lors de la période de saisine de l'ABE comme le précise le paragraphe 8 de l'article 21 bis de la directive.
Cinquièmement, le 5° du présent article corrige l'article L. 613-21-4 du code monétaire et financier pour les mêmes motifs que les révisions introduites à l'article L. 613-20-4. Alors que l'article L. 613-20-4 couvre le cas où l'ACPR est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe d'établissement de crédit ou de société de financement, les dispositions de l'article L. 613-21-4 couvrent le cas où l'ACPR est l'autorité de surveillance compétente pour un établissement du groupe sans être l'autorité de surveillance sur base consolidée. Dans les deux cas, en cas de désaccord avec une autre autorité compétente pour adopter une décision commune en matière de surveillance sur base consolidée conduisant à une saisine de l'ABE, le 4e alinéa du paragraphe 3 de l'article 113 de la directive CRD5 fait de cette saisine de l'ABE une obligation offre la possibilité à toutes les autorités de surveillance de s'écarter sensiblement de la décision de l'ABE sur le fondement d'une décision motivée.
Sixièmement, le 6° du présent article corrige l'article L. 613-21-6-1 du code monétaire et financier pour les mêmes motifs que les révisions introduites à l'article L. 613-20-6-1. Alors que l'article L. 613-20-6-1 couvre le cas où l'ACPR est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe d'établissement de crédit ou de société de financement, les dispositions de l'article L. 613-21-6-1 couvrent le cas où la compagnie financière holding est établie en France et où l'ACPR est son autorité de surveillance. Dans les deux cas, en cas de désaccord avec une autre autorité compétente au sujet de l'octroi de l'agrément à une compagnie financière holding ou à une compagnie financière holding mixte, le paragraphe 8 de l'article 21 bis de la directive CRD5 fait de cette saisine de l'ABE une obligation.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les articles L. 511-41-1-A, L. 517-16, L. 613-20-4, L. 613-20-6-1, L. 613-21-4 et L. 613-21-6-1 du code monétaire et financier sont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les présentes dispositions permettent d'assurer la pleine conformité du droit français aux paragraphes 6 et 8 de l'article 21 bis, au paragraphe 3 de l'article 113 et aux paragraphes 2, 2 bis et 12 de l'article 131 de la directive CRD5. Cette mise en conformité est assurée par la correction de lacunes identifiées avec la Commission européenne des transpositions de ces directives qui avaient été respectivement conduites en 2014 et en 2020.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les révisions du code monétaire et financier introduites le présent article assureront la pleine conformité du droit français aux exigences et objectifs de la directive CRD5 en matière de stabilité financière et de protection des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le 1° corrigeant le VI de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier sera dépourvu d'effets notables sur les entreprises, y compris les établissements d'importance systémique mondiale, dans la mesure où ces révisions viennent simplement réintroduire des dispositions en partie indument supprimées par l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 transposant la directive (UE) 2019/2034, dite « IFD ». En pratique, cette erreur de plume n'avait pas modifié les modalités d'identification des établissements d'importance systémique mondiale, si bien que la correction opérée se restreindra à une remise en conformité du droit sans ajustement opérationnel.
Le 2° corrigeant l'article L. 517-16 du code monétaire et financier garantira que les mesures conservatoires dont fait l'objet une compagnie financière holding mixte qui ne respecte plus les exigences liées à son agrément doivent prendre en compte les effets particuliers sur le conglomérat financier détenu par ladite compagnie. Dans la mesure où l'ACPR prend déjà ces effets en compte, au regard de leur importance prudentielle et du caractère intégré de la supervision conduite par l'ACPR (couvrant à la fois les banques et les compagnies d'assurance), cette révision correspond à une mise en conformité du droit sans effet opérationnel de nature à impacter les entreprises concernées.
Les 3° et 5° corrigeant les articles L. 613-20-4 et L. 613-21-4 du code monétaire et financier apporteront davantage de latitude à l'ACPR dans son application de la décision rendue par l'ABE dans le contexte d'un désaccord entre autorités de surveillance pour adopter une décision commune en matière de surveillance sur base consolidée des groupes d'établissement de crédit et de société de financement. En pratique, les déviations significatives de l'ACPR à l'égard des décisions de l'ABE devraient être limitées et les entreprises disposeront des motifs mis en avant par l'ACPR pour justifier cette déviation.
Les 4° et 6° corrigeant les articles L. 613-20-6-1 et L. 613-21-6-1 du code monétaire et financier contraindront l'ACPR à saisir l'ABE en cas de désaccord avec une autre autorité de surveillance sur l'octroi d'un agrément à une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie en-dehors de la France. Les entreprises concernées devraient anticiper un rallongement minime des délais liés à la production de la décision commune les concernant - par rapport aux cas, précédant la présente modification, où l'ACPR n'aurait pas saisi l'ABE.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le 1° corrigeant le VI de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier aura peu d'effets sur l'activité de l'ACPR. Les dispositions réintroduites en droit français ont été en partie indument supprimées par l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 transposant la directive dite « IFD » (pour « Investment Firms Directive »). Malgré le fait que les dispositions des paragraphes 2, 2 bis et 12 l'article 131 de la directive CRD4 et complétés par CRD5 avaient été indûment retirées du droit français, l'ACPR continuait néanmoins de se conformer à ces exigences de la directive. Leur réintroduction vise ainsi principalement à rétablir la pleine conformité juridique des dispositions françaises mais ne se traduira pas par un ajustement des pratiques de supervision.
Le 2° corrigeant l'article L. 517-16 du code monétaire et financier aura peu d'effets sur l'activité de l'ACPR. Les dispositions initialement introduites en droit français n'avaient pas pleinement transposé la partie introductive du paragraphe 6 de l'article 21 bis de la directive CRD5 selon laquelle les mesures de surveillance dont fait l'objet une compagnie financière holding mixte qui ne respecte plus les exigences liées à son agrément doivent prendre en compte les effets particuliers sur le conglomérat financier détenu par ladite compagnie financière holding mixte. Néanmoins, dans la pratique de sa supervision, l'ACPR en tant qu'autorité intégrée surveillant à la fois les établissements bancaires et les compagnies d'assurance prendrait en considération les effets mentionnés sur les conglomérats financiers dans le scénario d'une compagnie financière holding mixte en situation d'infraction.
Les 3° et 5° corrigeant les articles L. 613-20-4 et L. 613-21-4 du code monétaire et financier apporteront davantage de latitude à l'ACPR dans son application de la décision rendue par l'ABE dans le contexte d'un désaccord entre autorités de surveillance pour adopter une décision commune en matière de surveillance sur base consolidée des groupes d'établissement de crédit et de société de financement. En pratique, les déviations significatives de l'ACPR à l'égard des décisions de l'ABE devraient être limitées.
Les 4° et 6° corrigeant les articles L. 613-20-6-1 et L. 613-21-6-1 du code monétaire et financier contraindront l'ACPR à saisir l'ABE en cas de désaccord avec une autre autorité de surveillance sur l'octroi d'un agrément à une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie en-dehors de la France.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cet article renforce la conformité des dispositions de droit français aux exigences du cadre européen en matière de surveillance prudentielle bancaire. Il contribue ainsi à la protection des consommateurs dans leur relation avec les établissements de crédit et les sociétés de financement et à la stabilité financière.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a été consulté par procédure écrite du 1er aout au 12 septembre 2025.
Les dispositions ont en outre été soumises pour information et sur base informelle aux services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Fédération bancaire française et à l'Association française des sociétés de financement.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Corrigeant des dispositions de transpositions de directives déjà applicables, le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.
Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
- Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
- A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).
Les dispositions en droit bancaire et financier s'appliquent de plein droit dans ces trois collectivités. Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.
L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna adopte des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Pour tenir compte des modifications opérées au livre V, les articles L. 773-5, L. 774-5, et L. 775-5, du code monétaire et financier sont modifiés mettant à jour les lignes des tableaux compteurs Lifou, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat du 7 janvier 2016.
En revanche, les articles L. 517-16 (compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes), L. 613-20-6-1 (ACPR saisie par les compagnies financières holding mixtes) et L. 613-21-4 (surveillance sur base consolidée par l'ACPR et le collège de réviseurs), ne sont pas applicables dans les collectivités du Pacifique.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite aucune mesure d'application.
Article 8 - Transposition de la directive (UE) 2024/2994 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le paysage financier français se caractérise par la présence d'établissements bancaires d'importance systémique qui occupent une place prépondérante sur les marchés de produits dérivés. Ces établissements, au premier rang desquels figurent les entreprises BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE, recourent massivement aux services de contreparties centrales (CCP)44(*) pour sécuriser leurs transactions sur ces produits, conformément aux obligations introduites par le règlement n° 648/2012/UE du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (dit règlement « EMIR ») EMIR depuis 2012.
Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la compensation de ces transactions se trouve très fortement concentrées dans des chambres de compensation (CCP) hors de l'Union. Les CCP britanniques, en particulier l'entreprise LCH Ltd, occupent en effet une position dominante dans la compensation des produits dérivés libellés en euros et en dollars. Fin 2020, l'ESMA (European Securities and Markets Authority, l'équivalent de l'Autorité des marchés financiers - AMF - au niveau européen) estimait que l'entreprise LCH Ltd assurait à elle seule plus de 90 % de la compensation des produits dérivés de taux d'intérêt négociés de gré à gré, dont 80 % du volume des produits libellés en euros. La dépendance aux services de compensation britanniques pour les produits dérivés n'est donc pas une spécificité francaise, ou européenne, mais reflète la place historique des acteurs britanniques, consolidée par des économies d'échelle difficilement réplicables et qui rendent difficile la migration de la compensation vers d'autres infrastructures.
Cette dépendance à des acteurs non européens, donc non soumis au cadre réglementaire de l'Union stricto sensu, et répondant uniquement aux autorités de pays tiers en cas de crise, crée une vulnérabilité potentielle, justifiant l'imposition d'un cadre de gestion de risque spécifique aux acteurs européens.
Face à ce constat, l'Union européenne a adopté fin 2024 une révision du règlement EMIR45(*), avec le Règlement (UE) 2024/298746(*) (dit « EMIR 3 ») du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024. Les mesures prévues par ce texte vise à réduire progressivement la dépendance des établissements européens aux CCP de pays tiers systémiques, tout en préservant la stabilité financière et la compétitivité des acteurs européens. Parmi les principales dispositions du règlement figurent :
- L'introduction d'une obligation de compensation actif (« active account ») auprès d'une chambre de compensation établie dans l'UE pour certaines classes de produits dérivés (notamment les dérivés de taux en euro) ;
- Le renforcement des pouvoirs de supervision de l'ESMA vis-à-vis des chambres de compensation d'importance systémique établies dans des pays tiers (Tier 2 CCP) ;
- Des exigences accrues en matière de gestion du risque de concentration, imposées aux entités européennes et à leurs autorités nationales compétentes, en particulier s'agissant de l'exposition à des CCP de pays tiers systémiques.
La directive (UE) 2024/2994 prévoit quant à elle des ajustements ciblés de plusieurs directives sectorielles (CRD IV47(*), IFS48(*) et UCITS49(*)) afin d'intégrer les exigences de gestion des risques de concentration dans les obligations prudentielles applicables aux entités financières couvertes par ces textes.
Les grandes banques françaises, qui figurent parmi les principaux utilisateurs européens des services de LCH Ltd, seront particulièrement concernées par ces nouvelles obligations. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et les autres établissements systémiques devront adapter leurs pratiques de gestion des risques et potentiellement réorienter une partie de leurs flux de compensation vers des infrastructures européennes, notamment Eurex Clearing, en Allemagne.
La présente disposition est prise pour transposition de la directive 2024/2994/UE.
Elle introduit d'abord une modification de l'article L. 511-41-1-B qui traite de la gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement. Cet article, issu de la transposition de la directive CRD50(*) (en anglais : Capital Requirements Directive ou directive sur les fonds propres règlementaires), établit déjà les principes généraux de surveillance des risques par l'organe de direction. La réforme y insère un nouvel alinéa spécifiquement dédié aux risques découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d'importance systémique substantielle. Cette insertion après le sixième alinéa permet de maintenir la cohérence de l'article tout en ajoutant une obligation ciblée. Cette formulation reprend la terminologie du règlement EMIR 3, par souci de cohérence entre les exigences européennes et nationales.
Deux autres modifications portent sur les articles L. 511-55 pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, et L. 533-29 pour les entreprises d'investissement. L'objectif est d'intégrer le risque de concentration sur les CCP dans l'énumération des risques devant faire l'objet d'une surveillance spécifique. La référence explicite aux conditions fixées à l'article 7 bis du règlement EMIR, relatif à l'obligation de compte actif, vise à s'assurer que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement prennent en compte dans leur dispositif de surveillance l'ensemble des exigences du règlement en la matière, notamment l'obligation de détenir des comptes opérationnels auprès de CCP européennes et d'y compenser un volume représentatif de transactions pour les établissements dépassant les seuils fixés.
Cette symétrie entre les obligations des établissements de crédit, des sociétés de financement et celles des entreprises d'investissement garantit le maintien des conditions de concurrence entre tous les acteurs du marché.
La modification portée à l'article L. 533-29-1 vise à imposer aux entreprises d'investissement de mettre en place des stratégies, politiques, processus et systèmes solides pour détecter, mesurer, gérer et suivre « les causes et effet significatifs des risques de concentration résultant de l'exposition aux contreparties centrales ». Il est également prévu que le conseil d'administration ou l'organe de surveillance mettent en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables. L'ACPR se voit confier une mission d'évaluation et de suivi de l'évolution des pratiques des entreprises d'investissement en matière de gestion de ces risques.
Enfin, la modification de l'article L. 612-33, confère à l'autorité des pouvoirs d'intervention face aux risques de concentration excessive. L'Autorité peut enjoindre aux établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement de réduire leurs expositions à une CCP donnée ou d'ajuster la répartition de ces expositions entre différents comptes de compensation, conformément à l'article 7 bis d'EMIR.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En application, de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il est nécessaire de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2024/2994.
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
Au regard de la liberté d'entreprendre - principe à valeur constitutionnelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, « Loi de nationalisation ») - la transposition impose plusieurs contraintes aux établissements financiers : (i) la mise en place de plans spécifiques et d'objectifs quantifiables de gestion des risques de concentration ; (ii) la possibilité, sur instruction de l'ACPR, de devoir réduire certaines expositions ou réaligner des positions ; et (iii) une obligation indirecte, issue du règlement EMIR, de diversifier leurs relations avec les chambres de compensation.
Ces atteintes à la liberté d'entreprendre, qui n'est ni générale ni absolue selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, ne paraissent toutefois ni injustifiées, au regard de l'intérêt général que constitue la stabilité financière, ni disproportionnées, n'étant pas prévu une interdiction stricte de recourir à des CCP de pays tiers pour les établissements français.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Il n'existe pas de convention internationale relative aux sujets couverts par la directive (UE) 2024/2994.
L'articulation des nouvelles dispositions avec le droit européen ne soulève pas de difficultés particulières. La directive s'inscrit dans la continuité du règlement EMIR et de ses modifications successives. Pour les établissements significatifs supervisés directement par la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du mécanisme de supervision unique, la répartition des compétences entre l'ACPR et la BCE sera assurée par le règlement MSU51(*), prévenant tout risque de doublon.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Nous ne disposons pas d'information sur les travaux de transpositions des autres membres de l'Union Européenne.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'intervention du législateur est nécessaire car les dispositions de la directive à transposer en droit national modifient des articles de nature législative du code monétaire et financier. En effet, les nouvelles obligations de gouvernance, les pouvoirs de supervisions conférés à l'ACPR et les modifications des exigences prudentielles touchent au domaine de la loi tel que défini par l'article 34 de la Constitution. Il n'est donc pas possible de procéder à cette transposition par une autre voie notamment réglementaire.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif principal consiste à mettre en cohérence le code monétaire et financier avec les dispositions des directives 2009/65/CE (UCITS), 2013/36/UE (CRD IV) et 2019/2034/UE (IFS), telles que modifiées par la directive 2024/2994/UE.
Il s'agit principalement d'introduire dans le code monétaire et financier :
- Un renforcement de la gouvernance des risques au sein des établissements financiers. Les organes de direction des établissements de crédit et des entreprises d'investissement devront établir des plans spécifiques et des objectifs quantifiables pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d'importance systémique substantielle.
- Un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'autorité pourra notamment, lorsqu'elle estime qu'il existe un risque de concentration excessif, exiger des établissements qu'ils réduisent leurs expositions ou qu'ils réalignent leurs positions entre différents comptes de compensation.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Ces dispositions constituent une pure transposition de la directive. Il n'y a pas d'autre option que de les prévoir.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Comme indiqué ci-dessus, dès lors que le droit de l'Union européenne s'impose, il n'y a d'autre option que de prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 7 implique la modification de cinq articles du code monétaire et financier : L. 511-41-1-B, L. 511-55, L. 533-29, L. 533-29-1, L. 612-33 et le livre VII pour les dispositions outre-mer. Ces modifications s'intègrent dans l'architecture existante du code sans nécessiter de refonte structurelle. Aucune abrogation n'est nécessaire, les nouvelles dispositions venant compléter les obligations existantes sans s'y substituer.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La transposition doit permettre de mettre en conformité le droit national en conformité avec la directive 2024/2994.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les bénéfices économiques de la réforme se manifesteront principalement à moyen et long terme. La réduction de la dépendance à une infrastructure unique diminuera notamment le risque systémique en renforçant la résilience des établissements financiers.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La réforme entraînera une augmentation des coûts de mise en conformité des établissements financiers, mais ceux-ci devraient rester limités. Ils concernent surtout l'adaptation de la gouvernance, la gestion des risques et le renforcement du reporting, sans nécessiter d'investissements technologiques majeurs. Les coûts récurrents devraient rester faibles, liés principalement au suivi des dispositifs.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers assumeront leurs nouvelles compétences à moyens constants.
L'ACPR intégrera le suivi des risques de concentration sur les CCP dans le cadre du contrôle prudentiel existant, sans nécessiter de procédures spécifiques. Les équipes de supervision disposent déjà des compétences nécessaires pour évaluer ces risques, ayant développé une expertise sur les questions de compensation centrale depuis l'entrée en vigueur d'EMIR.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La Direction générale du Trésor a organisé une large consultation de place pour recueillir les observations des participants de marché. Cette consultation a réuni les principaux acteurs concernés, notamment les grandes banques françaises (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole), LCH SA et les associations professionnelles (FPM, AMAFI, FBF).
La Fédération bancaire française (FBF) a formulé plusieurs demandes de modification afin d'éviter toute surtransposition des exigences du règlement EMIR 3. Dans leur ensemble, ces demandes ont été écartées car elles n'étaient pas conformes aux dispositions d'EMIR 3.
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières a formé un avis 2025-42 le 25 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La directive ayant été adoptée le 27 novembre 2024 et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 4 décembre 2024, elle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, le 24 décembre. Les États membres disposent d'un délai de dix-huit mois pour transposer ses dispositions dans leur droit national, ce qui fixe l'échéance au 25 juin 2026.
Les dispositions législatives entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Cette entrée en vigueur immédiate se justifie par la nécessité de respecter le délai de transposition fixé par la directive.
5.2.2. Application dans l'espace
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.
Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
- Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
- A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).
Les dispositions en droit bancaire et financier s'appliquent de plein droit dans ces trois collectivités. Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.
L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.
Pour tenir compte des modifications opérées au livre V, les articles L. 773-5, L. 774-5, L. 775-5, L. 773-6, L. 774-6, L. 775-6, L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 du code monétaire et financier sont modifiés mettant à jour les lignes des tableaux compteurs Lifou, conformément à la recommandation du Conseil d'Etat du 7 janvier 2016. De même, pour intégrer les modifications opérées au livre V, les tableaux compteurs Lifou des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 sont mis à jour.
5.2.3. Textes d'application
Aucun texte d'application spécifique n'est exigé par la transposition.
Toutefois, l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement (hors sociétés de gestion), pourrait faire l'objet de modifications, en particulier ses articles 8 et 13, afin de tenir éventuellement compte des précisions introduites par les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du Règlement (UE) 2024/2987 et de la Directive (UE) 2024/2994, si leur contenu se révélait particulièrement technique.
Article 9 - Modalités d'omission des informations commercialement sensibles dans les informations de durabilité publiées en application de la CSRD
1. ETAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Pour transposer les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE telle qu'amendée par la directive 2022/2464/UE (dite directive CSRD), le législateur a introduit les articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce obligeant respectivement les grandes entreprises et les sociétés consolidantes d'un grand groupe, au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du même code à publier des informations en matière de durabilité. Une occultation des informations de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société est autorisée.
L'article L. 232-23 du code de commerce prévoit que lorsqu'elles y sont soumises, les sociétés par actions déposent au greffe du tribunal notamment le rapport de certification des informations en matière de durabilité.
Les dispositions relatives à l'omission d'informations commercialement sensibles dans les informations de durabilité figurant dans le rapport de gestion, en application de la directive relative à la publication d'information en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », ont été modifiées par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Dans la rédaction issue de cette loi, l'article L. 232-23 code de commerce dispose que les sociétés par action soumises à la publication d'un rapport de durabilité au titre de la directive CSRD peuvent omettre du rapport de durabilité, déposé au greffe du tribunal de commerce, des informations de nature à nuire gravement à leur position commerciale à la condition que ces informations fassent l'objet d'un dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les articles L. 232-21 (pour les sociétés en nom collectif) et L. 232-22 (pour les sociétés à responsabilité limitée) du même code n'ont pas été modifiés alors qu'eux aussi prévoient le dépôt au greffe du rapport de certification des informations en matière de durabilité.
L'ajout de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ne concerne que les sociétés par actions alors que les obligations de publication des informations en matière de durabilité s'appliquent à d'autres formes de société. Par ailleurs, le domaine de l'occultation prévue par la nouvelle phrase ne concorde pas avec le domaine de l'occultation prévu aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce. Enfin, le dépôt des informations occultées auprès de l'AMF ne relève pas des fonctions de cette dernière laquelle n'a, jusqu'alors, pas eu de compétence en ce qui concerne les entreprises non cotées.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive CSRD, prévoit des modalités d'exemption de publication de certaines informations commercialement sensibles.
Les articles 19bis et 29bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, telle qu'amendée par la CSRD, disposent que : « Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les dispositions qui présentent une incohérence avec le cadre de publicité en matière d'informations de durabilité sont de niveau législatif. Il est donc nécessaire de recourir à la loi pour la supprimer.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à rétablir la cohérence de traitement en matière de publicité des informations de durabilité entre les différentes formes de société et à retirer tout rôle à l'AMF dans le processus d'omission des informations en matière de durabilité.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Outre sa suppression, il a été envisagé de :
- conserver la dernière phrase de l'article L. 232-23 du code de commerce ;
- de répliquer cette phrase au sien des articles L. 232-21 (pour les sociétés en nom collectif) et L. 232-22 (pour les sociétés à responsabilité limitée) du même code.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Par cohérence avec les règles d'omission prévue aux articles L. 233-28-4 et L. 232-6-3 du code de commerce et par fidélité aux termes de la directive CSRD, il a finalement été décidé de supprimer la dernière phrase de l'article L. 232-23 du même code afin de mettre un terme à une différence de traitement entre différentes formes de société et à l'intervention de l'AMF dans le processus d'omission des informations en matière de durabilité, celle-ci n'était pas prévue dans la directive.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition modifie l'article L. 232-23 du code de commerce relatif aux dépôts obligatoires au greffe des sociétés par actions. Elle restitue l'état du droit tel qu'issu de la transposition de la directive CSRD par l' ordonnance du 6 décembre 2023 n°2023-1142.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente disposition renforce l'alignement du droit interne avec le droit européen.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La présente disposition simplifie les procédures de publication / omission des informations de durabilité en supprimant toute distinction selon la forme de la société.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La présente disposition supprime une mission confiée à l'AMF qui aurait constitué une nouvelle charge sur ses services.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les modalités d'omission des informations commercialement sensibles ont fait l'objet de plusieurs consultations non obligatoires auprès des fédérations professionnelles (Association française des entreprises privées ; Mouvement des entreprises de France) ainsi que de la Haute autorité de l'audit et l'autorité des marchés financiers (AMF).
Ces dernières ne se sont pas opposées à cette mesure.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition s'applique selon le droit commun, c'est-à-dire le lendemain de la publication de la loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.
Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :
- Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.
L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »
L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.
- A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).
Les dispositions en matière commerciale s'appliquent de plein droit dans ces trois collectivités. Dès lors, pour ces collectivités, les dispositions du présent article ne contiennent aucune adaptation et n'impliquent aucune consultation.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
L'Etat n'est compétent en matière commerciale que dans les îles Wallis et Futuna.
Le droit commercial relève de la compétence des collectivités d'outre-mer :
- En Nouvelle-Calédonie, par l'application combinée des dispositions du III-4° de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, de l'article 26 et du 10° de l'article 99 de cette même loi organique ;
- En Polynésie française, où l'article 13 de la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 précise que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat. Ces domaines de compétence de l'Etat sont listés à l'article 14 de cette même loi organique, qui ne mentionne pas le droit commercial.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'article 40 du décret modifié n° 57-811 du 22 juillet 1957 précité prévoit que l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Cet article ne mentionne pas d'items se rapportant au droit commercial.
Il convient de prévoir une mention expresse d'application de l'article 232-23 à cette collectivité à l'article L. 950-1 du code de commerce. S'agissant de simples grilles de lecture, aucune consultation de ce territoire n'est à envisager.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
TITRE II - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Article 10 - Prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 30 mai 2024 le sixième paquet législatif européen de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Dans la continuité des cinq directives successives anti-blanchiment52(*), le paquet comprend :
- Le « règlement unique » de l'Union européenne en matière de LBC/FT, dit AMLR53(*) ;
- La sixième directive anti-blanchiment, dite AMLD654(*) ;
- Le règlement instituant l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Authority for Anti-Money Laundering, ou AMLA), dit AMLAR55(*).
Le paquet renforce l'harmonisation des dispositifs nationaux LBC/FT, notamment, par ce règlement unique, en uniformisant une partie importante des dispositions précédemment laissées à l'appréciation des Etats membres par voie de directive. Cette nouvelle législation européenne est motivée par le constat, d'une part, de la permanence d'un phénomène essentiellement transfrontalier de blanchiment des produits financiers d'activités illicites, et d'autre part, de la nécessaire jonction entre LBC/FT et mise en conformité de ces dispositifs avec les exigences d'un marché unique intégré, au regard des incidences de ces réglementations sur la vie économique.
Le dispositif LBC/FT comprend un volet préventif et un volet répressif. Si la coopération policière et judiciaire au niveau européen est consacrée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)56(*), l'organisation judiciaire et la répression pénale sont très largement du ressort des Etats membres. Les normes européennes concernent donc principalement le volet préventif, articulé autour d'obligations de vigilance et de déclaration de différents acteurs économiques susceptibles d'être confrontés à des schémas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces obligations LBC/FT permettent par la suite d'enrichir le volet répressif au niveau national. En effet, les déclarations occasionnées nourrissent notamment le travail de TRACFIN, la cellule de renseignement financier française, puis, le cas échéant, celui des autorités judiciaires. Le présent cadre européen approfondit en outre les dispositifs de coopération entre les Etats membres.
Le règlement AMLR précise et uniformise la définition du périmètre des entités tenues par ces obligations LBC/FT, ainsi que les obligations elles-mêmes (e.g. définition des procédures internes devant être mises en place pour l'évaluation du risque de blanchiment au sein d'une société, ou des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle).
La directive AMLD6 précise ensuite certains éléments relatifs à la mise en oeuvre de ces obligations et, plus généralement, relatifs à l'architecture des institutions chargées de la mise en oeuvre de la règlementation LBC/FT au sein des Etats membres.
Le règlement AMLAR institue l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), chargée de s'assurer au niveau européen d'une application cohérente de ces textes, et dotée de pouvoirs spécifiques de supervision, directe ou indirecte, des entités assujetties aux obligations LBC/FT.
A été associée à ce paquet la directive (UE) n° 2024/165457(*), adoptée spécifiquement pour compléter la directive (UE) n° 2024/1640 s'agissant des accès au mécanisme d'interconnexion des registres centralisés des comptes bancaires.
L'obligation de tenue d'un registre centralisé des comptes bancaires a été instaurée par la cinquième directive anti-blanchiment ( directive (UE) n° 2018/843) modifiant la quatrième directive ( directive (UE) n° 2015/849). Cette directive n'ouvrait l'accès à ce registre qu'à un nombre restreint d'administrations, dont notamment les cellules de renseignement financier (CRF) nationales. La directive n° 2019/1153 a complété ce dispositif en permettant aux Etats membres d'ouvrir l'accès à ce registre aux autorités chargées de la prévention ou de la détection d'infractions pénales ou des enquêtes et poursuites en la matière.
La sixième directive anti-blanchiment ajoute un mécanisme d'interconnexion des registres centralisés des comptes bancaires des différents Etats membres. La directive n° 2024/1654 vient donc modifier la directive n° 2019/1153 afin de préciser que les autorités chargées de la prévention et la détection des infractions pénales, ou des enquêtes et poursuites en la matière, ayant accès aux registres nationaux des comptes bancaires, ont également accès à ce mécanisme d'interconnexion.
Ce paquet législatif européen doit être intégré au droit national d'ici le 10 juillet 2027. Par exception, certaines dispositions connaissent une entrée en application différée :
- Certaines dispositions de la directive 2024/1640 relatives à la tenue des registres centraux de bénéficiaires effectifs doivent être transposées d'ici le 10 juillet 2026 ;
- Les dispositions de la directive 2024/1640 relatives à la tenue d'un registre centralisé concernant les biens immobiliers, d'ici le 10 juillet 2029 ;
- Certains nouveaux assujettissements introduits par le règlement AMLR sont applicables à partir du 10 juillet 2029.
Au-delà de l'intégration de la substance des normes européennes, l'entrée en vigueur d'un règlement d'application directe dans un domaine jusqu'ici régi par des directives transposées en droit national nécessitera une clarification de la législation applicable.
Les dispositions relatives aux modalités de consultation des registres des bénéficiaires effectifs, adoptées pour mettre le droit européen en conformité avec une décision du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne58(*), ont d'ores et déjà été transposées par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne59(*) en ce qui concerne les sociétés.
Le présent article habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, toute mesure nécessaire pour assurer la transposition du paquet européen et la mise en cohérence et clarification du dispositif national avec ce dernier, d'ici juillet 2027.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (CC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économique numérique, n° 2994-96 DC). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (CC, 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, n° 2018-765 DC).
Les articles du code monétaire et financier qu'il s'agira de mettre en cohérence avec le paquet européen se rapportent à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public (CC, 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, n° 2021-822 DC).
La liberté d'entreprendre est un principe à valeur constitutionnelle (CC, 16 janvier 1982, Nationalisations, n° 81-132 DC). A l'aune de ce principe et de l'objectif de valeur constitutionnelle précité, le Conseil constitutionnel est notamment susceptible de contrôler la proportionnalité de dispositions posant des obligations déclaratives publiques d'acteurs économiques (CC, 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, n° 2016-741 DC)60(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les directives n° 2024/1640 et 2024/1654 doivent être intégrée au droit national d'ici juillet 2027. Les dispositions des règlements n° 2024/1624 et n° 2024/1620 seront d'application directe, sans nécessiter d'acte de transposition formel, en juillet 2027. Il conviendra cependant de procéder aux adaptations du droit national nécessaire à la bonne application de ces règlements.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Les dispositifs LBC/FT européen et national appliquent notamment les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), structure intergouvernementale instituée en 1989 et spécialisée en la matière. Le GAFI fonctionne selon un système de cycles d'évaluations mutuelles des différents dispositifs nationaux au regard des quarante recommandations. Ces évaluations offrent de nombreux éléments de comparaison sur les déclinaisons nationales de chacune des recommandations GAFI. Il peut être noté que le dispositif français a été jugé particulièrement robuste à l'occasion de sa dernière évaluation en 2022.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La transposition et l'adaptation au paquet européen supposent modifications, créations et suppressions (pour renvoi au règlement unique) de normes de niveau législatif principalement contenues au sein du code monétaire et financier (CMF).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Ces dispositions visent la mise en conformité du dispositif national LBC/FT avec le sixième paquet législatif européen, en habilitant le Gouvernement à transposer les directives n° 2024/1640 et n° 2024/1654 et à assurer la cohérence du dispositif national avec les règlements n° 2024/1624 et n° 2024/1620, en prenant, à cette occasion, toutes les mesures de coordination et clarification nécessaires.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il a été envisagé :
- Une habilitation n'offrant la possibilité que de la transposition des deux directives et d'une adaptation du droit national à l'entrée en vigueur des règlements pour éviter de potentiels conflits de normes.
- Une habilitation plus large, offrant la possibilité d'une mise en cohérence globale d'un dispositif marqué par une forte technicité, notamment au regard des évolutions législatives récentes en la matière.
L'arbitrage du périmètre retenu pour l'habilitation s'est attaché à éviter toute surtransposition. Il a cependant pris en compte l'impératif de rendre le dispositif cohérent dans son ensemble, y compris avec les branches de la législation nationale plus indirectement impactées par l'entrée en vigueur du sixième paquet anti-blanchiment, ainsi qu'avec les évolutions législatives récentes relatives à la LBC/FT intervenues en-dehors du cadre européen.
A titre d'exemple, le législateur national a récemment décidé d'assujettir les loueurs de véhicules de transport, en plus des vendeurs61(*). Le règlement n° 2024/1624 prévoit seulement un assujettissement des vendeurs de ces véhicules de transport, mais précise l'ensemble des conséquences à tirer d'un assujettissement, y compris si un Etat membre fait usage de la faculté de prévoir un périmètre d'assujettissement plus large. Il sera donc nécessaire, pour assurer la cohérence et donc l'efficacité du dispositif global, de prévoir des dispositions spécifiques supplémentaires concernant les loueurs de véhicules de transport - par exemple, désigner une autorité de supervision et une autorité de sanction les concernant.
En outre, certaines incohérences du dispositif de LBC/FT, issues de réformes antérieures, ont été identifiées dans le code monétaire et financier. Il apparait dès lors souhaitable d'inclure leur correction dans le périmètre de l'habilitation.
Pour l'ensemble de ces raisons, le choix a été fait d'une habilitation permettant une mise en cohérence globale du dispositif.
3.2. DISPOSITIF RETENU
En considération des raisons exposées ci-dessus, le présent article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures permettant de :
- transposer la directive n° 2024/1640, dite sixième directive anti-blanchiment, et la directive n° 2024/1654 relative à la tenue d'un registre central des comptes bancaires (intimement liée au paquet européen) et en tirer les conséquences en termes d'adaptation du droit national ;
- adapter le dispositif national aux règlements n° 2024/1624 et n° 2024/1620, correspondant respectivement au règlement unique anti-blanchiment et au règlement instituant l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux ;
- modifier et simplifier les dispositions du code monétaire et financier afin de garantir leur lisibilité et leur cohérence à la suite de la transposition des directives n° 2024/1640 et n° 2024/1654 et de l'adaptation aux règlements n° 2024/1624 et n° 2024/1620, celles-ci étant susceptibles de modifier en profondeur son architecture ;
- apporter des modifications aux dispositions existantes du code monétaire et financier rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux de transpositions, afin d'assurer la cohérence entre les différentes définitions des crypto-actifs y figurant, de clarifier la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel en ce qui concerne la supervision des prestataires de services sur crypto-actifs, de clarifier le régime de sanctions applicable aux opérateurs de vente volontaire, et de désigner l'autorité en charge de la supervision et le régime de sanction applicable aux professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation. Néanmoins, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts ci-dessous présentés.
Le paquet européen poursuit un objectif de lutte contre la délinquance financière. Lutter contre les schémas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme participe directement à la lutte contre les infractions sous-jacentes associées.
Ces mesures participent à l'objectif de lutte contre la délinquance financière à travers des dispositifs de transparence économique, qui peuvent avoir un effet sur la compétitivité des acteurs économiques européens. Toutefois, une grande partie de ces obligations existe déjà, et le nouveau paquet européen a également pour effet de les harmoniser. L'effet global est donc difficile à mesurer, mais ne sera en tout état de cause pas majeur au niveau macroéconomique.
S'agissant de la transposition future du reste de la directive n° 2024/1640, par anticipation, il peut être fait état d'impacts sur les entreprises du fait d'une évolution du régime des obligations LBC/FT reposant sur certaines entités. Le domaine d'application de ces obligations correspond aux entités aujourd'hui listées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Ce périmètre a été récemment modifié par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. La transposition du paquet européen pourra impliquer un ajustement du périmètre d'assujettissement aux obligations LBC/FT, ce qui représentera un impact direct, mais difficilement mesurable, sur les entreprises concernées.
Plus généralement, en ce qui concerne les obligations LBC/FT reposant sur ces entités, qui comprennent par ailleurs des professions réglementées, certaines sont renforcées par le règlement n° 2024/1624 et la directive n° 2024/1640, à l'instar des mesures de contrôle et les procédures internes dans les groupes de société. Toutefois, la majorité des entités était déjà assujettie aux obligations de LBC/FT, et leurs charges ne devraient dès lors pas être significativement alourdies.
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Concernant l'habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de dix-huit mois est nécessaire.
En effet, les adaptations de la législation nationale rendues nécessaires par ces textes européens sont particulièrement techniques et vont couvrir de nombreux domaines entrant dans le champ de compétences de nombreuses administrations différentes. En outre, l'entrée en vigueur d'un règlement européen, d'application directe, dans un domaine jusqu'alors couvert par des directives adaptées en droit national, entraînera nécessairement la disparition de pans importants de ce dernier.
Afin de garantir la lisibilité de ces dispositions, et notamment la bonne articulation entre d'une part les domaines continuant d'être régis par des directives et donc de faire l'objet de dispositions nationales, et d'autre part ceux étant désormais régis par des règlements européens, une refonte en profondeur de la partie du code monétaire et financier relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourra donc s'avérer nécessaire.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 11 - Transposition de la directive « AMLD6 » concernant la transparence des bénéficiaires effectifs
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 30 mai 2024 le sixième paquet européen de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Dans la continuité des cinq directives successives anti-blanchiment62(*), le paquet comprend :
- Le règlement 2024/1624, « règlement unique » de l'Union européenne en matière de LBC/FT, dit AMLR63(*) ;
- La directive 2024/1640, sixième directive anti-blanchiment, dite AMLD664(*) ;
- Le règlement 2024/1620 instituant l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Authority for Anti-Money Laundering, ou AMLA), dit AMLAR65(*).
Les dispositions des articles 11 à 15 de la directive 2024/1640, relatifs à la transparence des bénéficiaires effectifs, doivent être transposées d'ici le 10 juillet 2026, à la différence de l'ensemble du paquet européen, qui doit être intégré au droit national d'ici le 10 juillet 2027.
Le règlement 2024/1624 définit les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques comme étant les personnes physiques, qui détiennent directement ou indirectement une participation au capital de la société ou qui contrôlent directement ou indirectement la société ou toute autre entité juridique, par une participation au capital ou par d'autres moyens. Les articles 11 à 15 de la directive 2024/1640 fixent les règles relatives à la tenue du registre des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et à ses modalités d'accès. En effet, le cadre européen concilie les impératifs de transparence financière et de protection de la vie privée en imposant la création de ce registre tout en en réservant l'accès à certaines entités limitativement énumérées ou pouvant démontrer un intérêt légitime à y accéder, et en permettant aux bénéficiaires effectifs, lorsque cela est rendu nécessaire pour leur protection, de restreindre davantage encore la diffusion des informations les concernant. En outre, il peut être noté que ces registres des bénéficiaires effectifs seront interconnectés au niveau européen.
En droit national, ces bénéficiaires effectifs sont renseignés, selon le cas : (i) dans le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés, tenu par les greffes des tribunaux de commerce ; (ii) dans le registre des trusts et fiducies, tenu par l'administration fiscale ; ou (iii) dans les registres dédiés aux associations et autres organismes à but non lucratifs (dont notamment les fondations), tenus par le ministère de l'Intérieur. Les dispositions relatives à cette dernière catégorie devant être modifiées dans le cadre de la transposition sont uniquement de niveau réglementaire.
- S'agissant du registre des bénéficiaires effectifs prévu pour les sociétés
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE)66(*) a permis la mise en conformité de la France avec une décision du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne67(*) en modifiant le droit national de sorte à satisfaire les exigences des articles 11 à 13 concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés. S'agissant de ces derniers, il ne reste donc à transposer d'ici le 10 juillet 2026 que les dispositions de l'article 15, qui introduit des limitations au droit d'accès au registre à des fins de protection de certaines populations vulnérables.
En ce qui concerne le cadre national applicable à la tenue du registre des bénéficiaires effectifs, en application des précédentes directives anti-blanchiment, les articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) disposent que les sociétés déclarent les informations relatives aux bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme unique (guichet unique électronique des formalités d'entreprises), à l'occasion de leur immatriculation. Ces informations sont ensuite inscrites au répertoire national des entreprises.
S'agissant des sociétés commerciales, les greffiers des tribunaux de commerce, en leur qualité de teneurs de registre, s'assurent de la validité des informations transmises et prennent en charge les signalements, par les entités assujetties aux obligations LBC/FT, de divergences entre les informations en leur possession et celles contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs. L'absence de déclaration des bénéficiaires effectifs, ou le caractère erroné de la déclaration, font l'objet de diverses sanctions, y compris pénales ( art. L. 574-5 du code monétaire et financier).
- S'agissant des registres des trusts et des fiducies
L'administration fiscale est responsable de la tenue des registres des trusts et des fiducies conformément au décret n°2010-219 du 2 mars 2010 pour le registre des fiducies et à l' article 368 de l'annexe II au code général des impôts pour le registre des trusts modifié par le décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.
La directive n°2015/849 du 20 mai 2015 dite « AMLD4 » puis la directive n°2018/843 du 30 mai 2018 dite « AMLD5 » ont conduit à compléter le cadre juridique applicable aux registres des trusts et des fiducies en prévoyant notamment, d'une part, l'enrichissement des données relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts et fiducies, et d'autre part, l'ouverture des registres à de nouvelles autorités et personnes agissant en matière de LBC/FT.
Ces évolutions ont été transposées en droit interne par l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 s'agissant d'AMLD4 et l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 s'agissant d'AMLD5.
En l'état du droit actuel, conformément aux dispositions de l' article L. 167 du livre des procédures fiscales (LPF), qui permet la consultation de ces registres par dérogation au secret fiscal en matière de LBC/FT, il convient de distinguer trois niveaux d'accès :
- Le premier niveau, figurant au I de l'article L. 167 du LPF, permet l'accès des autorités compétentes à l'intégralité des données contenues dans les registres des trusts et des fiducies (RDTF) ;
- Le deuxième niveau, qui figure au premier alinéa du II de l'article L. 167 du LPF, permet aux personnes assujetties à la LBC/FT mentionnées à l'article L. 561-2 du CMF de consulter le registre sur demande. Elles ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies ;
- Le troisième niveau qui figure au deuxième alinéa du II de l'article L. 167 du LPF permet aux personnes qui justifient d'un intérêt légitime et les personnes qui demandent des informations sur un trust/une fiducie qui détient une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un État tiers d'effectuer une demande de consultation.
Contrairement au cas du registre des bénéficiaires effectifs des sociétés, les articles 11 à 15 de la directive dite AMLD6 doivent encore être transposés au registre des trusts et fiducies.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (CC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économique numérique, n° 2994-96 DC).
Le dispositif proposé se rapporte à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public (CC, 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, n° 2021-822 DC et CC, 21 octobre 2016, Mme. Helen S. [Registre public des trusts], n°2016-591 QPC).
Les dispositions présentes ajoutent des garanties supplémentaires à un régime d'accès au registre des bénéficiaires effectifs déjà révisé pour une mise en conformité avec le respect du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel68(*). A titre plus secondaire, si le dispositif implique un traitement plus favorable de populations vulnérables, il peut être noté que le Conseil constitutionnel apprécie le respect du principe d'égalité devant la loi visée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'aune des différences de situation.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le cadre conventionnel européen offre aussi une protection des droits précités au travers de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (voir notamment les articles 7 et 8). La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue un objectif d'intérêt général susceptible de justifier des ingérences dans ces droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, aff. C 817/19).
La liberté d'établissement est un principe cardinal de la construction européenne, garantie au sein des textes fondateurs de l'Union.
La directive n° 2024/1640 apporte, par rapport à la cinquième directive anti-blanchiment, une réforme des modalités d'accès aux registres des bénéficiaires effectifs ainsi qu'un dispositif d'exemption pour endiguer une utilisation abusive de ces droits d'accès.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Les dispositifs LBC/FT européen et national appliquent notamment les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), structure intergouvernementale instituée en 1989 et spécialisée en la matière. Le GAFI fonctionne selon un système de cycles d'évaluations mutuelles des différents dispositifs nationaux au regard des quarante recommandations. Ces évaluations offrent de nombreux éléments de comparaison sur les déclinaisons nationales de chacune des recommandations GAFI, dont, les recommandations 24 et 25 spécifiquement relatives à la transparence des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Il peut être noté que le dispositif français a été jugé particulièrement robuste à l'occasion de sa dernière évaluation en 2022.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 78 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 prévoit que les articles 11, 12, 13 et 15 doivent être transposés avant le 10 juillet 2026, notamment pour les dispositions relatives à l'accès aux registres des trusts et des fiducies.
L'article 15 de la directive prévoit des exemptions au régime d'accès au registre des bénéficiaires effectifs. Les modalités d'accès aux registres figurent aux articles L. 561-46 et suivants du code monétaire et financier. La dérogation prévue par la directive concernant les mineurs, les personnes autrement frappées d'incapacité, et les personnes exposées à un risque disproportionné n'existe pas en droit national. Prévoir une telle dérogation à des dispositions de niveau législatif suppose un vecteur de même valeur juridique. Par ailleurs, ce dispositif dérogatoire, dont bénéficieraient des publics en situation de vulnérabilité, procède en une conciliation entre l'objectif à valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des libertés fondamentales.
S'agissant des registres des trusts et des fiducies, l'article L. 167 du LPF nécessite d'être modifié dès lors qu'il ne prévoit pas, en l'état actuel de sa rédaction, l'ensemble des éléments relatifs à l'accès aux registres qu'impose la directive dite AMLD6.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 167 du LPF :
- ne garantit pas l'accessibilité à l'ensemble des autorités compétentes visées par la directive ;
- bien qu'il prévoie l'accès aux registres pour les personnes démontrant un intérêt légitime à le faire, ne précise pas les cas où ces personnes sont présumées avoir un tel intérêt légitime à cette consultation, ni ne mentionne les informations consultables par ces personnes ;
- ne prévoit pas les restrictions d'accès aux registres dans le cas où leur consultation est susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à des risques disproportionnés ;
- ne prévoit pas que l'administration fiscale conserve l'historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Ces dispositions visent la mise en conformité du dispositif national LBC/FT avec le sixième paquet législatif européen.
S'agissant des articles 11 et 12 de la directive (UE) 2024/1640, l'objectif de la transposition est d'actualiser la liste des autorités nationales et européennes compétentes dans la LBC/FT et de leur permettre un accès direct et sans restriction aux informations concernant les bénéficiaires effectifs (Agence française anticorruption, agents habilités de la direction générale du Trésor chargés de la mise en oeuvre des sanctions internationales, parquet européen, office européen de lutte anti-fraude, Europol, Eurojust).
L'accès à ces registres sera autorisé sur demande aux personnes justifiant d'un intérêt légitime dans la LBC/FT, et notamment aux personnes présumées avoir un tel intérêt, le cas échéant selon des modalités différenciées (journalistes, chercheurs, organismes à but non-lucratifs, etc.). Cela permettra de garantir un plus grand accès aux informations tout en maintenant le secret fiscal lorsque des conditions particulières l'exigent.
Enfin, la transposition de l'article 15 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 permet de garantir que le dispositif de transparence des bénéficiaires effectifs n'emporte pas de conséquences indésirables en exposant certaines personnes à un risque injustifié. En particulier, il s'agit de prévoir la possibilité pour un bénéficiaire effectif de demander, en cas de circonstances exceptionnelles, à ce que ces données personnelles ne soient pas accessibles aux personnes démontrant un intérêt légitime, si cet accès exposait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné pour sa sécurité. En cas d'octroi d'une telle dérogation, les données du bénéficiaires effectifs restent accessibles aux autorités compétentes.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
- Sur la nécessité de transposer les articles 11, 12, 13 et 15 de la directive s'agissant de l'accès aux registres des trusts et fiducies
La principale option envisagée a été d'amender l'article L. 167 du livre des procédures fiscales afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la 6ème directive anti-blanchiment portant sur le registre des bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies contenues aux articles 11, 12, 13 et 15.
- Sur la transposition de l'article 15 de la directive s'agissant des bénéficiaires effectifs des sociétés
Une première série d'options envisagées reposait principalement sur des divergences d'interprétation du texte de la directive. Au sujet des mineurs et personnes autrement frappées d'incapacités, trois options ont été envisagées :
- Une exemption systématique de la communication des informations, sans condition de demande au teneur de registre ;
- Une exemption systématique, sur condition de demande au teneur de registre et de vérification de la situation de minorité ou d'incapacité par ce dernier ;
- Une exemption sur demande au teneur de registre, avec pondération du risque auquel le mineur ou le majeur incapable seraient exposés si les informations demeuraient accessibles aux personnes démontrant d'un intérêt légitime.
Une exemption systématique sans condition de demande a été écartée, puisque représentant un risque de contournement du dispositif LBC/FT trop important, et s'écartant du texte de la directive. S'agissant de la troisième option, celle-ci semblait également s'éloigner du texte européen qui prévoit une approche au cas par cas exclusivement s'agissant des situations d'exposition à un risque disproportionné, et elle semblait offrir une protection trop ténue de ces personnes vulnérables.
Une seconde série d'options concernait la traduction, en droit national, de la situation de personne majeure frappée d'incapacité au sens de la directive, qui constitue l'une des conditions possibles pour bénéficier de l'exemption au principe de transparence des bénéficiaires effectifs. Deux options ont été envisagées :
- N'inclure dans le droit national qu'une référence générale à l'état d'incapacité de la personne, l'existence d'une telle incapacité devant être appréciée au cas par cas lors de la demande ;
- Inclure dans le droit national une liste précise des situations juridiques entraînant une incapacité justifiant l'octroi de l'exemption.
Afin d'éviter de faire reposer la charge de l'analyse sur l'organisme en charge de l'examen des demandes de dérogation, et pour prévenir toute insécurité juridique, l'option retenue a été de lister précisément les mesures de protection entraînant une incapacité juridique justifiant l'octroi de la dérogation.
Une problématique spécifique s'est enfin posée sur le traitement des demandes de dérogations concernant les sociétés. En effet, les données des bénéficiaires effectifs des sociétés se trouvent accessibles en deux endroits distincts car inscrites au registre du commerce et des sociétés (tenu par les greffiers des tribunaux de commerce via Infogreffe) et au répertoire national des entreprises (tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, INPI). Il a été envisagé soit de confier le traitement des demandes de dérogation aux deux teneurs de registre (INPI et greffiers des tribunaux de commerce), soit de ne le confier qu'à l'INPI, soit de ne le confier qu'aux greffiers des tribunaux de commerce. Il a été choisi un traitement des demandes par les greffiers des tribunaux de commerce, après un enregistrement auprès de l'INPI, afin d'assurer une cohérence avec le régime applicable au traitement des déclarations de divergence (art. L. 561-47-1 CMF). La décision des greffiers des tribunaux de commerce d'accorder ou non la dérogation est ensuite systématiquement répercutée tant auprès du registre du commerce et des sociétés que du répertoire national des entreprises, pour assurer la cohérence du registre des bénéficiaires effectifs. Ce schéma a en outre l'intérêt de reposer sur une architecture informatique existante, puisqu'elle emprunterait les canaux en place dans le cadre du guichet unique des formalités d'entreprises.
3.2. DISPOSITIF RETENU
- Sur la nécessité de transposer les articles de la directive s'agissant de l'accès aux registres des trusts et fiducies
L'article 15 de la directive implique la création d'une exception aux règles d'accès aux registres des bénéficiaires effectifs et limite de ce fait la portée même de l'article L. 167 du LPF. Par cohérence entre les registres des bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies et celui des sociétés, il a été renvoyé autant que possible aux dispositions du CMF relatives au registre des sociétés.
- Sur la transposition de l'article 15 s'agissant des bénéficiaires effectifs des sociétés
Le mécanisme comprend donc deux types de dérogation :
- un octroi systématique de dérogation pour les mineurs et majeurs bénéficiant des mesures de protection listées (car entraînant une incapacité juridique) après formulation d'une demande, selon le cas, par le représentant légal du mineur, ou par le majeur protégé ou la personne chargée de la mesure de protection ;
- un octroi sur examen des circonstances exceptionnelles et d'existence d'un risque disproportionné du fait de l'accès des informations par les entités assujetties aux obligations LBC/FT ou aux personnes justifiant d'un intérêt légitime.
L`examen des demandes et l'octroi des dérogations relèveront des greffiers des tribunaux de commerce.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
S'agissant de la transposition de l'article 15, il est proposé d'introduire un nouvel article L. 561-46-3 au sein du code monétaire et financier, à la suite des articles relatifs aux modalités d'accès au registre des bénéficiaires effectifs.
S'agissant des registres des trusts et des fiducies, la mesure proposée nécessite de modifier l'article L. 167 du livre des procédures fiscales en répliquant les dispositions prévues au code monétaire et financier s'agissant des sociétés, à la fois en termes de conditions d'accès aux données des bénéficiaires effectifs que de restriction à la communication des données sur demande d'un bénéficiaire effectif.
En outre, le présent article modifie les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 du code de commerce.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les présentes dispositions transposent une partie de la directive n° 2024/1640 devant entrer en application d'ici le 10 juillet 2026 (à la différence du reste du paquet, qui entrera en vigueur au 10 juillet 2027).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les entreprises déjà assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ne seront pas impactées par les présentes dispositions, à l'exception des greffiers des tribunaux de commerce qui se voient confier l'examen des demandes par les bénéficiaires effectifs de dérogation à la communication de leurs données.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'INPI, établissement public administratif rattaché au ministère chargé de l'Economie, enregistrera les demandes de dérogation formulées sur le fondement du nouvel article L. 561-46-3 du code monétaire et financier, via le guichet unique des formalités d'entreprises.
La direction générale des finances publiques (DGFIP) aura à traiter les demandes de dérogations en ce qui concerne le registre des trusts et fiducies, au même titre que les greffiers de tribunal de commerce pour les registres des sociétés.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'article 15 de la directive tel qu'actuellement intégré au droit national tient compte de potentielles conséquences indésirables du dispositif LBC/FT, en considérant que les informations accessibles au titre de l'objectif de transparence de la vie économique (participant à la lutte contre le blanchiment) puissent être utilisées à des fins détournées. Le dispositif participe ainsi à accroître la protection de certaines personnes.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
L'article 15 de la directive 2024/1640 prévoit une exemption en matière de droit d'accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les mineurs. Dès lors qu'ils en formulent la demande auprès du teneur de registre, les informations les concernant en leur qualité de bénéficiaires effectifs ne pourront être communiquées aux personnes disposant d'un accès au registre. Cette disposition garantit une plus ample protection des mineurs face à des utilisations à des fins détournées des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les personnes physiques bénéficiaire effectif d'une entité juridique bénéficieront d'une garantie supplémentaire par l'article 15 AMLD6 sous la forme d'un droit à l'exemption de la communication de leurs informations via le registre des bénéficiaires effectifs si cette communication les expose à un risque disproportionné de faire l'objet d'une infraction d'atteinte à la personne.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été conduite. En particulier, les collectivités ultramarines du Pacifique n'ont pas à être consultées pour ces modifications.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le 10 juillet 2026.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions s'appliqueront de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution en application du principe dit « d'identité législative » (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de leurs statuts respectifs (la matière bancaire et financière ne fait pas partie des matières exclues de l'applicabilité de plein droit, en application, respectivement, des articles LO. 6213-1, LO. 6313-1 et LO.6413-1 du code général des collectivités territoriales).
En application des articles 74 et 77 de la Constitution et du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse d'applicabilité.
L'Etat est compétent dans la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :
- En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.
- En Polynésie française, cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité. L'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
- Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; (ii) le décret n° 57- 811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne les domaines bancaires et financiers.
Les dispositions de l'article L. 561-46-3 du code monétaire et financier s'appliquent donc de plein droit en Nouvelle-Calédonie (art. L. 773-42) et en Polynésie française (art. L. 774-42), mais par mention expresse à Wallis-et-Futuna (L. 775-36).
L'Etat n'est compétent en matière commerciale que dans les îles Wallis et Futuna. Le droit commercial relève de la compétence des collectivités d'outre-mer :
- En Nouvelle-Calédonie, par l'application combinée des dispositions du III-4° de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, de l'article 26 et du 10° de l'article 99 de cette même loi organique ;
- En Polynésie française, où l'article 13 de la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 précise que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat. Ces domaines de compétence de l'Etat sont listés à l'article 14 de cette même loi organique, qui ne mentionne pas le droit commercial.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'article 40 du décret modifié n° 57-811 du 22 juillet 1957 précité prévoit que l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Cet article ne mentionne pas d'items se rapportant au droit commercial.
Il convient de prévoir une mention expresse d'application des articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 à cette collectivité à l'article L. 950-1 du code de commerce.
S'agissant de simples grilles de lecture, aucune consultation des collectivités ultramarines du Pacifique n'est à envisager pour ces modifications.
5.2.3. Textes d'application
L`article L. 561-46-3 du code monétaire et financier relatif au mécanisme dérogatoire à la transparence des bénéficiaires effectifs sera notamment précisé par voie réglementaire :
- s'agissant de la définition des circonstances exceptionnelles ;
- s'agissant de la possibilité pour le teneur de registre de s'adresser à son administration de tutelle pour avis à l'occasion de l'examen d'une demande de dérogation ;
- s'agissant des délais d'examen de la demande et de durée de validité de la dérogation.
L'article L. 167 du livre des procédures fiscales sera également précisé par voie réglementaire :
- s'agissant des modalités d'accès aux données des bénéficiaires effectifs des trusts et fiducies, des présomptions propres à la démonstration d'un intérêt légitime, et de l'encadrement d'un tel accès ;
- s'agissant du délai de conservation de l'historique de consultation. ;
- s'agissant des mêmes éléments relatifs au mécanisme dérogatoire à la transparence des bénéficiaires effectifs, en cohérence avec l'article L. 561-46-3 du code monétaire et financier.
TITRE III - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE MARCHÉ INTÉRIEUR, DE CONSOMMATION ET DE CONCURRENCE
Article 12 - Règlement (UE) 2024/1028 relatif à la collecte et au partage des données relatives aux services de location de logements à court terme
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Depuis une décennie, l'encadrement des meublés de tourisme en France s'est progressivement étoffé afin de répondre aux tensions provoquées par leur essor dans les zones dites « tendues », c'est-à-dire les communes caractérisées par un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, telles que définies par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Face à ces enjeux, plusieurs lois ont structuré un cadre juridique visant à mieux réguler cette activité et à préserver l'équilibre du marché du logement.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a posé les premiers jalons de cette régulation en autorisant les communes à soumettre la transformation d'un local d'habitation en meublé de tourisme à une autorisation préalable de changement d'usage ( article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation - CCH). Ce dispositif, applicable dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les zones tendues, permet aux municipalités de limiter l'essor des locations de courte durée au détriment du logement pérenne.
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a complété ce cadre en imposant aux plateformes de location de fournir une information claire aux loueurs sur leurs obligations légales ( article L. 324-2-1 du code du tourisme), et en offrant aux communes la possibilité de mettre en place une procédure d'enregistrement préalable des meublés de tourisme ( article L. 324-1-1, III, du code du tourisme).
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) a renforcé ces dispositifs, en permettant aux communes ayant instauré l'enregistrement de demander aux intermédiaires de location de meublés la transmission d'un état récapitulatif du nombre de nuitées de location par logement ( article L. 324-2-1 du code du tourisme, modifié par l'article 145 de la loi ELAN). Elle a également posé les bases d'un contrôle du respect du plafond de 120 jours de location par an pour les résidences principales, plafond déjà fixé antérieurement par la loi ALUR ( article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme). Par ailleurs, afin de renforcer l'effectivité de ces obligations, la loi ELAN a introduit un régime d'amendes civiles : en cas de location sans enregistrement, une amende pouvant atteindre 5 000 euros est prévue et, en cas de dépassement du plafond de 120 jours, une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros par logement peut être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande de la commune compétente ( article L. 324-1-1, V, du code du tourisme).
Par la suite, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité (dite loi « engagement et proximité ») a permis aux communes soumises au régime de changement d'usage de soumettre à autorisation la transformation de locaux commerciaux en meublés de tourisme ( article L. 324-1-1, IV bis, du code de tourisme).
Malgré ces évolutions législatives, de nombreuses difficultés opérationnelles persistaient et limitaient l'efficacité du contrôle de la location des meublés de tourisme. Les collectivités territoriales devaient gérer des données éparses, souvent incomplètes ou peu fiables, transmises par une multitude d'acteurs. Cette situation compliquait l'identification d'un même logement proposé sur plusieurs plateformes et rendait le suivi du respect du plafond de 120 jours de location très difficile à assurer. L'absence d'un système automatisé et harmonisé accroissait les coûts de traitement pour les services municipaux et freinait la modernisation des procédures. Sans données consolidées et fiables, les élus locaux manquaient d'éléments solides pour adapter leurs politiques de logement et de tourisme.
Les opérateurs numériques rencontraient eux aussi des obstacles : il leur était parfois difficile d'identifier quelles communes étaient habilitées à demander des informations, et ils devaient traiter manuellement des demandes hétérogènes, ce qui alourdissait leurs démarches. Ils soulignaient également les limites en matière de fiabilité des informations déclarées par les loueurs. Si l'extension progressive du nombre de collectivités utilisant les dispositifs législatifs précités était constatée, elle restait difficile à mesurer en l'absence d'une liste officielle. Dans ce contexte, la croissance continue du nombre d'annonces de meublés de tourisme dans les grandes villes augmentait encore le besoin d'outils plus performants pour réguler efficacement cette activité.
Face à ces limites du dispositif de transmission des données, une expérimentation a été menée par la direction générale des entreprises (DGE) entre février et septembre 2022. Ce dispositif expérimental, dénommé « API meublés », a consisté à développer et à tester une plateforme pour faciliter les échanges de données entre opérateurs numériques de location de meublés de tourisme (ou « intermédiaires de location de meublés ») et communes, et à faciliter leur exploitation. Ce projet avait plus particulièrement pour objectifs l'harmonisation et la simplification des échanges entre communes et intermédiaires de location, la numérisation et l'automatisation des échanges pour accélérer et faciliter la mise à disposition de l'information ainsi que la mutualisation de l'effort de correction et de réconciliation des données pour les communes.
Le bilan de l'expérimentation, produit à la clôture du dispositif en septembre 2022, s'est révélé positif. Il a permis de mieux mettre en évidence les besoins et les attentes des différents acteurs de ce dispositif de transmission de données. Le bilan réalisé a surtout montré qu'une plateforme de centralisation des données pouvait répondre tant aux besoins des communes que des intermédiaires de location de meublés de tourisme, qui ont sollicité une pérennisation du dispositif.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (dite loi SREN). Son article 43 crée une base juridique pour la transmission de données fiabilisées par les opérateurs numériques vers les collectivités territoriales. Il modifie à cet effet le II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme en prévoyant qu'un organisme public unique met à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui le demandent et qui ont mis en oeuvre une procédure d'enregistrement des meublés les données d'activité de ces hébergements qui doivent être transmises par les intermédiaires de location de meublés (IDM). Cet organisme doit par ailleurs informer la commune concernée lorsqu'un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué pour une même année civile plus de cent vingt jours. Il met enfin les données qu'il gère à la disposition du public sous une forme agrégée.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale complète en dernier lieu le dispositif existant de régulation du secteur des locations de meublés de tourisme.
Son article 1 prévoit ainsi la généralisation à l'ensemble du territoire national de l'enregistrement des meublés de tourisme, auprès d'un téléservice national qui sera opéré par l'organisme public unique devant déjà être chargé de centraliser les données d'activité des meublés de tourisme en vertu de l'article 43 de la loi SREN.
Cet article renforce également les conditions de l'enregistrement en prévoyant notamment que le loueur devra apporter, le cas échéant, la preuve que le bien loué constitue sa résidence principale au moment de la déclaration, à laquelle il devra procéder en personne. La déclaration devra en outre être renouvelée à l'expiration d'un délai précisé par décret. Par ailleurs, un décret fixera, d'une part, les informations et pièces exigées pour l'enregistrement et, d'autre part, celles qui peuvent être jointes à la déclaration afin de permettre notamment le contrôle par la commune du respect des règles de sécurité contre les risques d'incendie ou de l'interdiction de sous-louer un logement social.
Enfin, l'article 1 autorise le maire à suspendre la validité des numéros de déclaration des meublés quand les loueurs fournissent des informations incorrectes, incomplètes ou frauduleuses à l'occasion de l'enregistrement de leur bien ou lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité.
Il est prévu une entrée en vigueur des dispositions de l'article 1 à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026, ce qui correspond à la date d'entrée en application du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, règlement dit « Short term rentals » (STR) - voir ci-après.
A l'article 4 de la loi, figure une disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et permettant aux communes d'abaisser, par une délibération motivée, le nombre maximal de 120 jours de location autorisé pour les résidences principales, dans la limite inférieure de 90 jours. Cet article comporte également des mesures relatives à des sanctions, avec notamment le remplacement de l'amende civile sanctionnant le défaut d'enregistrement par une amende administrative et la création d'amendes administratives pour obtention frauduleuse d'un numéro d'enregistrement ou usage d'un faux numéro. Il prévoit enfin, depuis la publication de la loi, un élargissement du régime d'autorisation préalable à la location des locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme à tous les locaux à usage autre que d'habitation.
Au-delà de ces évolutions nationales, la régulation des meublés de tourisme s'inscrit désormais dans un cadre européen avec l'adoption en 2024 du règlement sur la collecte et le partage des données concernant les locations de courte durée (règlement STR précité). Cet acte répond aux problématiques identifiées par la Commission européenne de manque de fiabilité des données disponibles et de fragmentation des réglementations nationales dans ce domaine. L'objectif de ce règlement est l'harmonisation des exigences en matière d'enregistrement des locations de courte durée et la rationalisation du partage des données entre plateformes numériques de location et les autorités publiques nationales compétentes (voir infra 1.3.).
Dans ce contexte, le présent article vise à achever l'édifice juridique encadrant la location de logements de courte durée par la transposition des dispositions du règlement STR encore absentes en droit national.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 16 de la loi ALUR a complété le code de la construction et de l'habitation par l'introduction du régime d'autorisation préalable de changement d'usage à destination de la location de meublés de courte durée, de la mise en place d'un régime d'autorisation temporaire pour ce type de location, ainsi que de la possibilité pour les « communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts » et les communes tierces de mettre en place ce système d'autorisation préalable par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou par une délibération municipale.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de ces dispositions pour statuer sur la contrainte excessive et disproportionnée qu'elles auraient pu représenter au regard des motifs d'intérêt général poursuivis, ainsi que sur l'atteinte à la liberté contractuelle. Par une décision du 20 mars 201469(*), le juge constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article 16 de la loi ALUR n'étaient entachées d'aucune inintelligibilité et ne méconnaissaient aucune autre exigence constitutionnelle aux motifs qu'elles répondaient à l'objectif poursuivi. Elles ont donc été déclarées conformes à la Constitution.
Par un arrêt du 5 juillet 201870(*), la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevant l'atteinte au droit de propriété causée par l'amende encourue en cas de non-respect de l'obligation de changement d'usage d'un local d'habitation proposé à la location de courte durée. Le juge a retenu que l'amende encourue constituait une sanction ayant le caractère de punition, en lien direct avec le non-respect sanctionné et ne paraissait pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la² location dans certaines zones déterminées. Ce régime de sanctions ne portait donc pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Comme il a été vu précédemment, la loi ELAN a introduit, en son article 145, la possibilité pour les communes dotées d'un régime d'autorisation préalable de changement d'usage d'instaurer une procédure d'enregistrement des meublés de tourisme. Si le Conseil constitutionnel a été saisi pour statuer sur la conformité à la Constitution de certains des articles de cette loi, il ne s'est pas prononcé explicitement sur ces dispositions71(*).
Enfin, le Conseil d'État a été saisi en cassation de deux QPC concernant les dispositions du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, relatives à la faculté pour les communes de soumettre à autorisation la location de locaux commerciaux comme meublés de tourisme. Dans une décision du 31 décembre 202472(*), le juge administratif a considéré que les griefs soulevés ne présentaient pas un caractère sérieux, car les dispositions litigieuses poursuivaient un objectif d'intérêt général sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel., ce qui dénote de la solidité du cadre constitutionnel dans lequel s'inscrivent les présentes dispositions.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Au niveau de l'Union européenne, l'activité des plateformes de location de courte durée est qualifiée de service de la société de l'information73(*) au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 201574(*) et se voit donc appliquer le corpus régissant de tels services, en particulier la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 200075(*) sur le commerce électronique. Cette directive a en particulier consacré le principe selon lequel les opérateurs de ces services ne font l'objet d'une réglementation (liée à l'accès et à l'exercice de ces services) que dans le pays de l'Union européenne (UE) où ils ont leur siège statutaire - et non dans le pays où sont situés les serveurs, courriers électroniques et boîtes postales qu'ils utilisent. Elle prévoit par ailleurs que les État membres ne peuvent restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre que pour des motifs tenant à l'ordre public, à la protection de la santé publique, à la sécurité publique ou à la protection des consommateurs. Ce corpus a été complété en 2022 par le règlement sur les services numériques (Digital Service Act - DSA)76(*) et par celui sur les marchés numériques (Digital Market Act - DMA)77(*). Ainsi, les opérateurs de plateformes de locations de courte durée se voient appliquer les règles relatives à la lutte contre les contenus illicites ainsi qu'à l'absence d'obligation générale de surveillance prévues par le règlement sur les services numériques. Le règlement sur les marchés numériques met quant à lui en place des outils de régulation pour créer une concurrence loyale entre les acteurs du numérique.
S'agissant de l'activité de location de meublés, le juge européen a confirmé qu'elle relevait elle-même du champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur78(*). Il a par ailleurs jugé que la réglementation nationale était bien conforme à cette directive en considérant que la soumission de certaines activités de location de courte durée à un régime d'autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers était particulièrement marquée était justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l'objectif poursuivi79(*).
Par ailleurs, le règlement général sur la protection des données (RGPD)80(*) s'applique à la collecte, au traitement et au partage des données à caractère personnel détenues par les plateformes et communiquées aux autorités qui ont à en connaître.
Comme indiqué précédemment, le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement STR) entrera en application le 20 mai 2026.
Ce texte instaure un dispositif juridique harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, qui vise à garantir une transparence accrue sur le marché de la location de courte durée, en facilitant la coopération entre plateformes et autorités locales et en permettant aux États membres de disposer d'un cadre commun pour surveiller et encadrer ce secteur.
Le texte s'applique aux hôtes (personnes physiques ou morales) proposant des logements meublés à la location pour de courtes périodes, ainsi qu'aux opérateurs numériques intermédiaires qui publient ces offres. Il fixe en particulier des règles communes pour l'enregistrement auprès des pouvoirs publics des biens faisant l'objet de locations saisonnières, qui se voient attribuer un numéro d'enregistrement unique. Les autorités compétentes sont habilitées à suspendre ce numéro d'enregistrement en cas de manquement identifié, voire à le désactiver si le loueur ne rectifie pas sa situation après injonction. Les numéros d'enregistrement doivent par ailleurs figurer dans un registre public et facilement accessible.
L'acte européen instaure en outre une obligation, pour le recueil et la transmission des données d'activité des meublés de tourisme, de mise en place d'un point d'entrée numérique unique (PENU) au niveau de chaque Etat membre. C'est par l'intermédiaire de ce PENU que les opérateurs numériques sont ainsi tenus de transmettre aux autorités qui le demandent des informations précises telles que l'adresse de l'hébergement, le nombre de nuitées réservées et le nombre de personnes hébergées, l'envoi de ces données d'activité s'effectuant selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, en fonction de la taille des opérateurs concernés.
Le règlement STR impose également la mise à disposition du public de certaines informations par l'intermédiaire du PENU. Sont ainsi publiées et régulièrement tenues à jour les listes concernant les zones dans lesquelles une procédure d'enregistrement s'applique ainsi que celles qui portent sur les zones dans lesquelles les autorités compétentes ont demandé les données d'activité aux plateformes numériques. Le règlement organise par ailleurs la transmission des données afférentes aux hébergements concernés aux autorités chargées d'élaborer le cadre réglementaire de la fourniture des services de location de logements de courte durée ainsi qu'aux instituts statistiques. Enfin, son article 12 habilite la Commission européenne à adopter des actes d'exécution établissant des spécifications techniques et des procédures communes en matière de points d'entrée numériques uniques, d'échange de données et de structure des numéros d'enregistrement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Au sein de l'Union européenne, vingt-trois Etats membres81(*) disposaient à la fin de l'année 2022 d'une réglementation encadrant la location de meublés de tourisme par des procédures d'enregistrement ou des demandes de transmission d'informations entre autorités compétentes et plateformes numériques. Une telle législation était par ailleurs en cours de préparation dans un Etat (la Roumanie).
Certains Etats membres disposent d'une législation encadrant les locations de meublés de tourisme plus souple que la réglementation nationale française, notamment en matière d'obligations pour les loueurs. Par exemple, le Danemark n'impose pas de procédure d'enregistrement mais exige une transmission d'informations par les plateformes aux autorités fiscales.
D'autres Etats membres ont mis en place un système d'enregistrement abouti, à l'image de la législation française. En Espagne, la réglementation touristique relevant de la compétence de l'Etat et des régions autonomes, plusieurs normes existent, variant selon les zones géographiques et les besoins locaux. Au niveau national, la limitation ou l'interdiction des locations saisonnières au sein des immeubles d'habitation ainsi que la modification de la répartition des frais de copropriété peuvent se faire sans l'unanimité de la copropriété82(*). La location de meublés de tourisme nécessite l'obtention d'une licence touristique locale. L'établissement doit être inscrit auprès de la communauté autonome concernée, qui met en place une procédure qui lui est propre. Des textes réglementaires différents déterminent les démarches obligatoires pour les loueurs. Sans la licence touristique, l'activité de location n'est pas reconnue comme légale et elle est sanctionnée par une amende administrative ; il n'est par ailleurs pas possible d'être référencé sur les plateformes numériques. En complément de la législation nationale, les municipalités peuvent adopter des programmes d'urbanisme propres à leur territoire. Ainsi, des villes comme Madrid ou Valence ont instauré des systèmes de compensation restrictifs (tels que l'obligation de louer en rez-de-chaussée ou l'interdiction de laisser en libre accès le logement) ainsi que des zones d'application délimitées pour la location touristique83(*). A Barcelone, les plateformes doivent informer les loueurs des obligations locales et vérifier l'existence et l'affichage des numéros d'enregistrement conformément aux listes qu'elles tiennent.
En Belgique, les régions et communautés réglementent les locations de meublés de tourisme (dont la définition française d'un logement à l'usage exclusif du locataire correspond au terme de « résidence de tourisme » dans le droit local). La location de meublés de tourisme est soumise à déclaration préalable auprès de la ville, avec l'attribution d'un numéro d'enregistrement devant être affiché pour pouvoir exercer cette activité. La transmission d'informations par les plateformes dépend quant à elle des réglementations locales. A titre d'exemple, la région de Bruxelles réglemente l'hébergement touristique et impose aux loueurs de meublés de tourisme une déclaration préalable, un enregistrement et l'attribution d'un numéro avant toute publication d'annonce, sous peine d'amendes administratives84(*).
A l'inverse, l'Italie a introduit l'enregistrement des meublés de tourisme de manière uniforme sur son territoire, afin d'obtenir un suivi régulier de l'activité des loueurs via une base de données centralisée.
Le gouvernement irlandais a publié en avril 2025 un projet de loi sur la location de courte durée et le tourisme visant à créer un registre des locations de courte durée d'ici mai 2026. Ce registre sera géré par l'Autorité nationale de développement du tourisme (Fáilte Ireland) et fournira une vue d'ensemble du parc d'hébergements touristiques enregistrés dans l'État. Les hébergeurs proposant ce type d'hébergement pour des durées allant jusqu'à 21 nuits seront tenus de s'enregistrer auprès de Fáilte Ireland et de détenir un numéro d'enregistrement valide, qui devra être affiché lors de la publication de l'annonce. Le projet de loi prévoit également l'introduction d'une procédure de sanction en cas de manquement des plateformes de location de courte durée en ligne à leurs obligations au titre du règlement européen. L'État pourra ainsi imposer des sanctions financières importantes, pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires, pour faire respecter le règlement si nécessaire.
Seuls trois Etats membres ne mettraient en oeuvre en 2025 aucune législation encadrant la location des meublés de tourisme, soit l'Estonie, la Finlande et la Suède.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Comme cela a été développé au 1 de la présente étude d'impact, le corpus juridique régissant l'activité de location de meublés de tourisme a fait l'objet de plusieurs évolutions en 2024, à travers le règlement STR du 11 avril 2024, la loi SREN du 21 mai 2024, et la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme. Le droit national en vigueur jusqu'alors a ainsi subi de profondes modifications législatives et plusieurs mesures réglementaires d'application sont toujours attendues pour permettre une pleine mise en oeuvre de ces évolutions présentant généralement des entrées en vigueur différées85(*). La spécificité de cette situation tient à ce que les diverses évolutions sont concomitantes et ont trait aux mêmes aspects de la réglementation nationale, à savoir la régulation des meublés de tourisme (ou location de logements de courte durée).
L'adaptation du droit national au règlement européen a déjà été engagée. Ainsi l'article 43 de la loi SREN crée un dispositif de centralisation des données devant être transmises aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents par les intermédiaires de location de meublés de tourisme, dispositif qui correspond au PENU européen. L'article 1 de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme, qui doit entrer en vigueur au plus tard le 20 mai 2026, renforce les conditions de l'enregistrement des meublés de tourisme dans le respect des prescriptions de l'acte européen, tout en généralisant cet enregistrement à l'ensemble du territoire et en le confiant à un téléservice national unique. Il précise par ailleurs les contrôles que les communes sont autorisées à mener sur les déclarations effectuées par les loueurs à l'occasion de la demande des numéros d'enregistrement.
Il reste néanmoins un certain nombre de dispositions techniques à prendre pour assurer la pleine conformité de la législation française au texte européen. En effet, ni les dispositions de l'article 43 de la loi SREN, ni celles de l'article 1 de la loi du 19 novembre 2024 ne permettent de satisfaire complètement à cet objectif. Les premières ont ainsi été conçues à un moment où le texte européen n'était pas encore totalement stabilisé tandis que les secondes portaient essentiellement sur le dispositif d'enregistrement des meublés de tourisme et n'avaient pas donc vocation à permettre d'aligner le droit national avec la réglementation européenne sur des sujets autres que cet enregistrement et couverts par le règlement européen.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Dans le prolongement des évolutions normatives en matière de régulation des meublés de tourisme, le projet d'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance a pour objet d'achever l'adaptation du droit national aux nouvelles obligations du règlement STR entrant en application au mois de mai 2026. Ces adaptations devraient permettre d'introduire dans le corpus législatif national diverses mesures absentes de la législation actuelle.
Il s'agirait en particulier de dispositions concernant les vérifications que les opérateurs numériques sont tenus de mettre en oeuvre à l'égard des biens des loueurs auxquels ils fournissent leurs services d'intermédiation, conformément aux articles 7 et 8 du règlement européen. Les évolutions envisagées permettront également d'assurer une pleine conformité entre le dispositif national de centralisation des données d'activité des meublés de tourisme régi par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme et le point d'entrée numérique unique dont la création et les fonctionnalités sont prévues par l'article 10 du texte européen. Elles viseront ensuite à préciser les modalités de transmission des données aux différentes entités habilitées à en connaître en vertu de l'article 12 du règlement européen, en particulier les instituts statistiques.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le recours à des instruments de droit souple, sous la forme de chartes ou d'engagements pris par les acteurs concernés, ne saurait être pertinent alors qu'il s'agit d'intervenir sur le corpus juridique existant afin d'aligner sur les dispositions du règlement STR la législation française en matière de régulation des meublés de tourisme. De même, l'adaptation induite par l'entrée en application du règlement européen ne pourrait reposer sur le fondement de conventions conclues entre les autorités compétentes et les intermédiaires de location de meublés, à l'instar du dispositif juridique qui avait permis de mener en 2022 l'expérimentation mentionnée supra. En effet, le dispositif expérimental n'avait pas vocation à modifier la régulation de ces hébergements prévue par le code du tourisme mais visait seulement à éprouver la pertinence d'une centralisation des transmissions d'informations. Or, l'objectif de mise en conformité du droit national avec l'acte européen ne saurait être tributaire de la volonté des acteurs en cause et ne peut être atteint que par une intervention normative et, plus précisément, dans un premier temps, par la prise des mesures législatives requises pour cette mise en conformité.
Cette modification de la législation pouvait emprunter deux formes : l'inscription des dispositions législatives directement dans le présent projet de loi ou l'intégration, au sein dudit projet, d'une habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Si les principales dispositions du droit français devant être alignées avec les obligations européennes à venir ont déjà pu été identifiées, il n'est pas possible à ce stade de définir avec certitude les dispositions à prendre par ordonnance. En effet, le parachèvement de cette définition est suspendu à l'aboutissement de plusieurs travaux en cours, notamment des travaux européens menés au sein de différents groupes techniques en vue de définir les principales caractéristiques attendues du point d'entrée numérique unique prévu par le règlement européen.
3.2. DISPOSITIF RETENU
En conséquence, il est proposé de recourir à une disposition habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre les mesures d'adaptation de la législation rendues nécessaires par l'application du règlement STR. Les dispositions de la future ordonnance visent à assurer la cohérence des dispositifs de droit interne avec le règlement STR, il ne s'agit pas d'une surtransposition.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
Les différents impacts - sociaux, économiques et financiers, sur les services administratifs, sur les collectivités territoriales, etc. - seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées.
S'agissant de l'impact sur l'ordre juridique interne, il peut d'ores et déjà être précisé que l'ordonnance devrait essentiellement modifier les articles de la section première intitulée « Meublés de tourisme » (articles L. 324-1 à L. 324-2-1) du chapitre 4 du titre II du livre III de la partie législative du code du tourisme.
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Concernant l'habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation court de six mois est prévu compte tenu du caractère circonscrit des dispositions techniques à prendre ainsi que de la date d'entrée en application du règlement STR, fixée au 20 mai 2026.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Articles 13, 14 et 15 - Mesures nationales d'adaptation du cadre européen de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le règlement (UE) 2024/2747 du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil vise à résoudre les problèmes de libre circulation au sein du marché intérieur et de pénuries de biens, en cas de crise (pandémie, catastrophe naturelle, conflit géopolitique). Cet instrument d'urgence pour le marché intérieur est destiné à s'appliquer aux biens et services non-médicaux. Il établit des dispositions applicables selon trois modes pour une action graduée en cas de menace de perturbation du marché intérieur :
- un mode de préparation (mode de contingence) : pendant lequel les États membres et la Commission doivent s'efforcer de mettre en place des réseaux de communication, de former le personnel et d'effectuer des tests de résistance ;
- un mode d'alerte : en présence d'une menace de crise, les Etats membres et la Commission doivent identifier les biens concernés par la crise ainsi que leurs producteurs, les stocks existants et les capacités de production ;
- un mode d'urgence : en cas de crise généralisée, la Commission peut (i) demander des informations aux entreprises, (ii) organiser des appels d'offres au nom des États membres ou en collaboration avec eux, et (iii) proposer aux entreprises des dérogations de responsabilité afin qu'elles donnent la priorité aux commandes de la Commission, au détriment de leurs autres obligations contractuelles.
Ce règlement est complété par la directive (UE) 2024/2749 et le règlement (UE) 2024/2748 qui modifient respectivement dix directives sectorielles existantes et six règlements sectoriels existants couvrant des produits susceptibles d'être concernés par une situation de crise.
L'objectif est d'intégrer, dans le cadre de ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), les procédures d'urgence applicables à l'évaluation de la conformité des produits, à la présomption de conformité, à l'adoption de spécifications communes et à la surveillance du marché telles que définies dans les textes précités pour certains secteurs.
Ces procédures prévoient notamment :
- la priorisation des évaluations de conformité réalisées par les organismes notifiés, au bénéfice des produits reconnus comme biens nécessaires en cas de crise ;
- la possibilité, pour un État membre, d'autoriser, sur son territoire, la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise sans évaluation préalable par un organisme notifié, sous réserve du respect des exigences essentielles de sécurité.
Ces dispositions ne s'appliquent que si la Commission européenne a adopté auparavant un acte d'exécution pour activer les procédures d'urgence recensant spécifiquement les biens nécessaires en cas de crise, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2024/2747.
La présente étude d'impact examine les modalités et les impacts de l'adaptation de la directive (UE) 2024/2749 et du règlement (UE) 2024/2748 en droit national.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En application de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les directives adoptées au niveau des instances de l'UE doivent faire l'objet d'une transposition par les Etats membres afin qu'elles aient force de loi dans lesdits États.
Conformément à l'article 288 du TFUE, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. Les mesures nationales doivent ainsi permettre d'atteindre les objectifs définis par la directive selon les modalités propres qu'elles définissent.
La protection des personnes face aux produits dangereux relève également du champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment l'article 2 (droit à la vie) et l'article 8 (respect de la vie privée et familiale). Elle implique des obligations positives de l'État en matière de sécurité. Toute procédure dérogatoire, bien que justifiée par une situation d'urgence, doit donc veiller à ne pas porter une atteinte à ces droits fondamentaux. L'encadrement législatif et réglementaire, les conditions strictes de délivrance et les contrôles a posteriori dans le cadre de la surveillance de marché constituent à ce titre des garanties indispensables.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de légiférer découle, d'une part, de l'obligation de transposer la directive (UE) 2024/2749 dans le droit national, conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette directive impose aux États membres de prévoir des procédures spécifiques en cas de crise affectant le fonctionnement du marché intérieur.
D'autre part, il est nécessaire de légiférer afin de mettre en oeuvre les deux règlements suivants : le règlement (UE) 2024/2747 (cadre général) et le règlement (UE) 2024/2748 (lié aux règlements sectoriels) et notamment :
- dans le périmètre spécifique des produits et équipements à risques relevant du chapitre VII du titre V du livre V du Code de l'environnement, il s'agit d'adapter les dispositions pour les secteurs suivants afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en produits à risques, tout en préservant un niveau élevé de sécurité
§ les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (directive 2014/34/UE) ;
§ les appareils à gaz (règlement 2016/426) ;
§ les équipements sous pression transportables (directive 2010/35/UE) ;
§ les équipements sous pression (directive 2014/68/UE) ;
§ les récipients à pression simples (directive 2014/29/UE) ;
- en ce qui concerne les machines et produits connexes, il convient de modifier le code du travail ;
- dans le périmètre spécifique des équipements radioélectriques, il s'agit de la transposition de l'article 9 de la directive 2024/2749 du 9 octobre 2024.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est de permettre une réaction rapide et coordonnée face à des situations exceptionnelles perturbant l'approvisionnement en produits critiques. Il s'agit notamment :
- d'assurer la continuité de la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise, sous conditions strictes de sécurité ;
- de garantir une surveillance du marché renforcée, même en cas d'activation du mode d'urgence par la Commission ;
- de prévenir les ruptures d'approvisionnement en facilitant l'évaluation de conformité par des procédures prioritaires ;
- de permettre une mutualisation des décisions entre États membres grâce aux actes d'exécution de la Commission.
Cette adaptation du droit national s'inscrit dans un objectif plus large de résilience du marché intérieur, en assurant une cohérence entre les instruments juridiques européens et les dispositifs nationaux, tout en évitant toute surtransposition.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
S'agissant d'une démarche d'adaptation d'une directive européenne et d'un règlement il est nécessaire de procéder aux adaptations législatives induites par ce texte.
S'agissant des articles 13 et 14, aucune autre option n'a été envisagée.
S'agissant de l'article 15, qui vise à transposer l'article 9 de la directive 2024/2749 qui modifie la directive 2014/53 et qui insère un nouvel article 43 quater prévoyant la possibilité de mettre sur le marché à titre dérogatoire un équipement radioélectrique n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de la conformité par un organisme notifié, deux options ont été envisagées pour la transposition de cette disposition :
- Option A
La procédure d'évaluation de conformité d'un équipement radioélectrique européenne prévue par la directive 2014/53 dite « RED » telle que transposée à l'article L. 34-9 du code des postes et communications électroniques dispose que cette évaluation peut incomber à un organisme notifié. Pour déroger à ce principe de niveau législatif et donner, dans des conditions déterminées, compétence dont elle ne dispose pas à droit constant à l'Agence nationale des fréquences pour délivrer une autorisation de mise sur le marché d'un équipement radioélectrique n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme notifié, il apparait nécessaire de compléter l'article L. 34-9 du code des postes et communications électroniques.
- Option B
Il a été également examiné la possibilité de considérer que l'article 43 quater se borne à instituer une procédure dégradée des procédures d'évaluation qui sont déjà prévues au titre de la directive 2014/53 et transposées à l'article L. 34-9, auquel cas il ne s'agirait pas d'une procédure nouvelle mais simplement d'une version allégée des procédures déjà existantes.
Le II de l'article L. 34-9, du code des postes et des communications électroniques dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité, les conditions de mise sur le marché, ainsi que la procédure d'évaluation de conformité86(*). Ainsi, la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché en cas d'activation du mode d'urgence serait comprise comme une condition de mise sur le marché d'un équipement dispensé de l'évaluation de conformité et pourrait être entièrement prévue dans la partie règlementaire, sans nécessiter d'assise législative nouvelle.
L'établissement public administratif Agence nationale des fréquences étant déjà créé, rien ne parait s'opposer à ce que par voie réglementaire, une compétence spécifique lui soit confiée par le ministre qui assure sa tutelle, c'est-à-dire le ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d'une procédure d'urgence dans le domaine de la mise sur le marché d'équipements radioélectriques.
3.2. DISPOSITIF RETENU
S'agissant de l'article 13, la transposition retenue repose sur une adaptation législative ciblée du chapitre VII du titre V du livre V du Code de l'environnement :
- Modification de l'article L. 557-2 du code de l'environnement : ajout d'un renvoi aux définitions du règlement (UE) 2024/2747 ;
- Création d'une section 1 bis « Procédures d'urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise après l'article L. 557-8-1 du code de l'environnement : mise en place de procédures d'urgence applicables à la mise sur le marché de produits à risques, comprenant :
§ la priorisation par les organismes habilités des demandes d'évaluation de conformité des produits reconnus comme biens nécessaires en cas de crise ;
§ la possibilité, d'autoriser la mise sur le marché de produits non encore évalués, dès lors que leur conformité aux exigences essentielles de sécurité est démontrée.
- Modification de l'article L. 557-58 du code de l'environnement : introduction de sanctions spécifiques en cas de manquement aux nouvelles procédures d'évaluation prévues par la section 1 bis.
Un décret en Conseil d'État viendra en complément préciser les modalités de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Cette option garantit une transposition stricte, conforme et opposable, tout en évitant toute surtransposition inutile.
S'agissant de l'article 14, l'objectif de transposer la directive avant la fin de l'année 2025, afin de permettre son application dès 2026, impose une action rapide. Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) constitue le premier véhicule législatif disponible. Il est, par ailleurs, particulièrement adapté dès lors qu'il s'agit de la transposition d'une directive.
S'agissant de l'article 15, l'approche adoptée retient la nécessité d'introduire au niveau législatif une modification du code des postes et des communications électroniques (CPCE) afin de confier à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) la possibilité de délivrer des autorisations de mise sur le marché lorsque les conditions prévues par la directive 2024/2749 sont réunies. Cette approche a été privilégiée car, d'une part, le recours à une assise législative semble apporter une plus grande sécurité juridique dans un domaine où le respect des exigences essentielles permet de préserver l'intérêt général s'attachant notamment à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques et, d'autre part, l'ensemble des compétences de l'ANFR étant déterminées au niveau législatif, par parallélisme, le niveau législatif apparaissait naturel pour confier une nouvelle mission.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les modifications proposées dans l'article 13 permettront de maintenir la cohérence entre le droit français et le droit européen. Cet article modifie les articles L. 557-2 et L. 557-58 du code de l'environnement et crée une section 1 bis « Procédures d'urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise » après l'article L. 557-8-1 comprenant les articles L. 557-8-2 à L. 557-8-5 du code de l'environnement.
L'article 14 crée, après l'article L. 4314-2 du code du travail, un chapitre V intitulé « Procédure d'urgence d'autorisation de mise sur le marché applicable aux machines et produits connexes » qui introduit un nouvel article L. 4315-1.
L'article 15 modifie l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La modification prévue vise à assurer la pleine conformité du droit français aux règlements (UE) 2024/2747 et (UE) 2024/2748 et à la directive (UE) 2024/2749.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mise en oeuvre des procédures d'urgence prévues par la directive (UE) 2024/2749 ne devrait pas engendrer d'effet significatif sur les grands équilibres macroéconomiques (PIB, emploi, balance commerciale). En revanche, ces dispositions permettront de renforcer la résilience structurelle du tissu industriel européen et national face aux chocs exogènes (sanitaires, géopolitiques, climatiques).
En sécurisant la disponibilité et la mise sur le marché rapide de produits critiques en cas de crise (équipements sous pression, dispositifs ATEX87(*)...), le dispositif contribue à la continuité des chaînes d'approvisionnement industrielles et énergétiques, évitant ainsi des interruptions aux conséquences économiques potentiellement lourdes.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'ensemble des mesures prévues apporte des avantages économiques aux entreprises, en particulier en cas d'urgence, grâce à une meilleure réponse à la crise au niveau de l'UE, ce qui réduira les obstacles à la libre circulation et améliorera la disponibilité des produits concernés par la crise. Ces mesures n'engendrent aucun coût supplémentaire pour les entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'ensemble des mesures prévues n'engendre aucun impact budgétaire.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les dispositions issues des règlements (UE) 2024/2747 et (UE) 2024/2748 et de la directive (UE) 2024/2749 n'ont pas d'incidence directe sur les compétences, les missions ou les ressources des collectivités territoriales. La mise en oeuvre des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, la présomption de conformité et la surveillance du marché relève exclusivement de l'État, à travers ses services déconcentrés (par exemple les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement - DREAL pour les produits à risques visés à l'article 13). Aucun transfert de charges, ni de responsabilités, n'est envisagé à destination des collectivités locales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les mesures prévues entraîneront des coûts modérés pour les services administratifs, principalement liés à la participation à des instances de coordination. Ces coûts sont estimés par la Commission européenne, dans le rapport d'analyse d'impact relatif au règlement (UE) 2024/2748 et à la directive (UE) 2024/2749, publié en septembre 2022, à environ 0,5 à 1,5 ETP par an et par État membre88(*).
S'agissant de biens essentiels en cas de crise, sur un champ restreint du point de vue technique, il n'est pas attendu un très grand nombre de telles demandes d'autorisations.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Le dispositif vise à garantir la continuité d'approvisionnement en biens critiques en situation d'urgence, ce qui contribue indirectement à la protection de la population et à la résilience du tissu économique. Il renforce la capacité de réponse de l'État face aux crises, au bénéfice global de la société. Aucun effet social négatif direct n'est identifié.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Le texte n'a pas d'effet différencié ou spécifique sur les personnes en situation de handicap. Aucune restriction d'accès ni conséquence particulière sur leurs droits ou leur situation n'est identifiée.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Le projet de loi est neutre en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il ne crée ni avantage ni désavantage selon le genre.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Aucun impact direct spécifique sur les jeunes n'est identifié. Toutefois, le renforcement de la résilience industrielle et du marché intérieur peut contribuer à la préservation de l'emploi et des perspectives économiques à moyen terme.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Le texte ne modifie ni le périmètre ni les conditions d'exercice des professions réglementées. Aucun impact particulier n'est à signaler à ce stade.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le texte ne crée ni d'obligations nouvelles ni de restrictions spécifiques pour les particuliers. Il n'a pas d'effet direct sur leurs droits, leurs démarches administratives ou leur quotidien. Aucune charge nouvelle ne leur est imposée.
Le texte préserve le respect des exigences essentielles de sécurité. Il maintient ainsi la sécurité des personnes utilisatrices des biens concernés par ces dispositions dérogatoires.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le texte est neutre sur le plan environnemental. Il n'entraîne ni d'atteinte à l'environnement ni d'amélioration mesurable directe.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation n'a été menée à ce stade pour l'article 13.
S'agissant de l'article 14, le Conseil d'orientation des conditions de travail a été consulté et a rendu un avis le 21 juillet 2025. Les organisations syndicales ont pris acte du texte, et certaines organisations patronales ont émis un avis négatif (relatif toutefois à certaines dispositions de l'article 71 et non de l'article 14)
S'agissant de l'article 15, plusieurs consultations ont été menées
- En application du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, une consultation publique du 28 juillet au 7 septembre 2025 a été effectuée ;
- En application de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a été saisie pour consultation le 8 juillet 2025. Dans son avis n°2025-1765 du 4 septembre 2025, l'ARCEP prend acte des modifications envisagées qui n'appellent pas de remarques particulières ;
- En application des articles L. 125 et D. 576 du code des postes et des communications électroniques, la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) a été saisie pour consultation le 8 juillet 2025. Dans un avis n°2025-07 du 18 septembre 2025, la CSNP a émis un avis favorable aux mesures envisagées.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les présentes dispositions de transposition entreront en vigueur à la date fixée par la directive, soit le 30 mai 2026. En outre, les dispositions prévues à l'article 14 seront abrogées le 20 janvier 2027.
5.2.2. Application dans l'espace
Les mesures s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. S'agissant de l'article 15, les dispositions de l'article L. 34-9 du CPCE ne sont pas applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquelles s'applique un régime d'autorisation d'importations en vertu de la répartition spécifique des compétences entre l'Etat et ces collectivités ultramarines. Cette répartition résulte des lois organiques n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Par ailleurs, en tant que pays et territoires d'outre-mer (article 355 du TFUE), le droit de l'Union européenne ne s'applique pas à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5.2.3. Textes d'application
S'agissant de l'article 13, un décret en Conseil d'État viendra en complément préciser les modalités de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.
S'agissant, de l'article 14 portant sur les modifications du code du travail, un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de cet article.
S'agissant de l'article 15 portant sur la modification du code des postes et des communications électroniques, un décret en Conseil d'Etat complétera la transposition de la directive 2024/2749.
Article 16 - Plateforme nationale des aides d'Etat valant registre national des aides de minimis
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Chaque année, les autorités publiques versent aux entreprises 20 milliards d'euros d'aides qui ne relèvent pas de mesures générales placées par nature hors du champ de contrôle européen des aides publiques à l'économie (i.e. de mesures s'appliquant à tous types d'entreprises et à tous secteurs d'activité sur tout le territoire). Au contraire, chacune de ces aides vise à soutenir des secteurs économiques, des catégories d'entreprises ou des territoires spécifiques. Le caractère sélectif de ces aides les rend susceptibles d'affecter la concurrence et les échanges entre États membres de l'Union européenne ; c'est pour cela qu'elles sont encadrées par des textes de droit communautaire. Certaines aides, dites aides de minimis89(*), sont présumées ne pas affecter les échanges du fait de leur faible montant. Elles sont néanmoins encadrées par le droit communautaire afin d'assurer l'effectivité de cette présomption.
Les règlements européens relatifs aux aides de minimis général (2023/2831 du 13 décembre 2023) et spécifiques aux services d'intérêt économique général (2023/2832 du 13 décembre 2023, ci-après SIEG) et au secteur de l'agriculture (2024/3118 du 10 décembre 2024) prévoient en effet dans leurs articles 6 respectifs l'obligation pour chaque État membre de constituer un registre des aides de minimis, à partir du 1er janvier 2026 pour les aides des secteurs général et Service d'intérêt économique général (SIEG), et à partir du 1er janvier 2027 pour les aides du secteur agriculture. Cette obligation vient en contrepartie d'une rehausse des plafonds réglementaires respectifs90(*), lesquels sont imposés à toute entreprise unique (groupe) sur une période glissante de 36 mois.
Le secteur de la pêche et de l'aquaculture (règlement n° 717/2014 modifié par le règlement n° 2023/2391 du 4 octobre 2023) est soumis à cette obligation seulement si l'État membre décide d'élever le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique à hauteur de 40 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux, au lieu du seuil en vigueur de 30 000 euros. Le projet d'article institue l'obligation de renseigner le registre national, ce qui emporte en contrepartie le rehaussement du plafond d'octroi de ces aides à 40 000 euros qui est l'objectif.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les règlements européens précités fixent une obligation de publication des aides de minimis et imposent à chaque Etat membre de déterminer un registre unique pour l'ensemble de ses autorités d'octroi : soit la création d'un registre central national, soit l'utilisation du registre européen qui sera mis en place par la Commission européenne à partir du 1er janvier 2026.
Il appartient à chaque Etat membre de choisir entre registre national ou européen selon ses procédures de droit interne. Si pour la France le registre national peut être imposé comme registre unique aux autorités d'octroi de l'Etat par décret, une loi est en revanche nécessaire pour rendre ce registre national obligatoire aux collectivités en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution.
En effet, l'article en projet institue une nouvelle obligation pour les collectivités territoriales, qui consiste à enregistrer chaque aide de minimis octroyée sur la plateforme nationale des aides d'État. Ceci ressortit à la compétence du législateur compte tenu de l'article 34 de la Constitution, selon lequel la loi détermine les « principes fondamentaux » de « la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Dès lors, toute obligation nouvelle imposée aux collectivités territoriales doit être définie par la loi, car elle touche aux principes fondamentaux de leur administration91(*).
Ainsi, il est à tout moment loisible au législateur « d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ». Sans préjudice du fait que le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoie que « les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus », « le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration » (Conseil constitutionnel, décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, cons. 22 à 24).
Le législateur peut ainsi imposer aux collectivités l'utilisation du registre national des aides de minimis dès lors que cette mesure est nécessaire pour définir les modalités de mise en oeuvre d'une obligation européenne de transparence.
Enfin, le secteur de l'aquaculture et de la pêche n'est pas directement concerné par l'obligation de constituer un registre, mais son application volontaire permettrait de rehausser, de 30 à 40 000 €, le plafond des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux conformément aux dispositions du règlement (2023/2391) du 4 octobre 2023. Il est donc proposé de saisir cette opportunité de soutien à nos entreprises soumises à une forte concurrence intra comme extra-européenne, ce qui implique de lever le secret fiscal pour les aides de minimis relevant de ce secteur (cf ci-après 2.1 §5).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article en projet définir les modalités de mise en oeuvre en droit national des règlements de l'Union européenne précités (v. 1.1), lesquels ont été adoptés en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En effet, si l'obligation de transparence des aides de minimis à partir du 1er janvier 2026 (pour les aides de minimis générales et SIEG) et à partir du 1er janvier 2027 (pour les aides de minimis agricoles) est d'application directe, ses modalités de mise en oeuvre doivent être définies en droit interne dès lors que les règlements européens laissent une marge de manoeuvre aux Etat membres.
L'Etat doit ainsi définir en droit interne le registre qu'il imposera à l'ensemble de ses autorités d'octroi comme registre central des aides de minimis. A cet effet, l'Etat fait usage de l'potion qui lui est offerte par les règlements européens, c'est à dire le choix entre un registre national ou le registre européen.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
D'autres États membres de l'Union européenne sont déjà dotés d'un outil comparable à la plateforme des aides d'État : l'Italie depuis 2018, l'Espagne depuis 2013. Les registres respectifs sont déployés sur un site internet qui permet la libre consultation de toutes les aides reçues par chaque entreprise italienne ou espagnole.
Des États membres comme la Pologne et la Roumanie, qui ont rejoint l'Union européenne plus tardivement ont également mis en place des registres d'aides afin de pouvoir bénéficier des programmes européens.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'effet direct en droit interne des règlements européens précités n'obère pas la nécessité de légiférer pour acter la mise en oeuvre du registre national des aides d'État en France.
La nécessité de légiférer ressort, d'une part de l'obligation pour l'Etat de mettre en place un registre unique des aides de minimis en optant soit pour un registre national soit pour le registre européen, d'autre part d'imposer l'utilisation de ce registre national à l'ensemble des autorités d'octroi, y compris les collectivités territoriales.
Pour les collectivités territoriales, l'obligation d'utiliser la plateforme nationale aides d'État requiert une disposition législative particulière, compte tenu du principe de libre administration de ces dernières. L'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 attribue en effet au législateur la compétence pour adopter des normes en matière de « libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
Or, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle maximum de la nécessité et de la proportionnalité sur les restrictions apportées à la libre administration (Conseil constitutionnel, 20 janvier 1984, n° 83-168 DC). À ce titre, la nécessité et la proportionnalité des restrictions apportées à la libre administration des collectivités en ce qui concerne la participation à la plateforme s'apprécient au regard de l'obligation pour l'Etat de définir les modalités de mise en oeuvre par l'ensemble des autorités d'octroi, y compris celles des collectivités territoriales, des obligations européennes de publications des aides de minimis.
Enfin, ainsi que précisé au 1.2, il est proposé d'étendre volontairement au secteur de l'aquaculture et de la pêche l'obligation de renseigner le registre national ce qui permet de réhausser, de 30 à 40 000 €, le plafond des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux conformément aux dispositions du règlement (2023/2391) du 4 octobre 2023. Ce choix national permis mais non prescrit par les règlements européens implique de lever par la loi le secret fiscal pour les aides de minimis relevant de ce secteur (réductions et exonérations de taxes ou crédit d'impôts pour les entreprises du secteur de la pêche). En effet le renseignement de ces aides dans un registre implique que des informations issues des déclarations à l'administration fiscale soient rendues publiques : ces informations (le montant du crédit ou de la réduction d'impôt et l'identité de l'entreprise bénéficiaire) sont, comme pour toutes les aides fiscales aux entreprises, normalement couvertes par le secret fiscal tel qu'il est précisé dans les articles L103 à L112 B du livre des procédures fiscales. Ce secret est levé d'office par application directe des règlements européens s'agissant des domaines où le registre est prescrit mais doit l'être par la loi nationale s'agissant des aides à l'aquaculture et la pêche.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'obligation pour les collectivités territoriales d'enregistrer les données d'aides de minimis sur la plateforme des aides d'État permettra non seulement de satisfaire une obligation de transparence imposée par le droit européen, mais aussi, avec les données issues de la même obligation pour les services de l'État et leurs opérateurs, de constituer une base de données nationale d'aides de minimis exhaustive. Ce registre va ainsi permettre d'améliorer la connaissance de l'ensemble des aides octroyées, tout en sécurisant leur versement par les autorités d'octroi au cas par cas, grâce à la vérification systématisée du respect des plafonds d'octroi.
Cette base permettra également d'alléger la charge des entreprises qui doivent actuellement déclarer à chaque nouvelle demande la liste des aides précédemment perçues.
Les bénéfices pour les autorités d'octroi seront :
- Une aide à la décision au moment d'octroyer une nouvelle aide : celle-ci portera sur les aspects réglementaires, pour la vérification des plafonds d'octroi, mais aussi sur les aspects d'opportunité et de ciblage de l'aide publique ;
- Une meilleure visualisation et connaissance des aides versées aux entreprises ; à titre d'exemple il n'existe pas actuellement de tableaux de bord sur les aides versées à un secteur d'activité, une filière, une catégorie d'entreprise ou un territoire donné. Cette information n'est actuellement pas disponible car les données ne sont pas centralisées dans un outil dédié.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Pour la constitution d'un registre des aides de minimis, chaque État membre doit choisir entre un système d'information de la Commission européenne ou un outil national. Les travaux et échanges interministériels préliminaires, ainsi que le recueil de l'avis des associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs groupements, ont conduit à retenir la plateforme nationale des aides d'État comme outil devant constituer le registre de minimis, au motif notamment qu'un outil national devrait, par rapport à la plateforme présentée par la Commission européenne, présenter des avantages, notamment en termes de sécurisation juridique des aides octroyées. En effet, seul l'outil national permettra une vue consolidée par « entreprise unique ». Le projet de plateforme nationale présente également des avantages en termes d'ergonomie et de réduction de la charge administrative, selon l'expérience comparative menée avec plusieurs autorités d'octroi de l'État ou de collectivités territoriales.
Pour l'alimentation du registre des aides de minimis, l'option alternative à la loi consistant à prendre uniquement des mesures incitatives pour amener les autorités d'octroi à participer serait contraire aux règlements européens qui imposent à chaque Etat membre de choisir un registre unique pour l'ensemble de ses autorités d'octroi. Une telle option donnerait lieu à un risque de procédure en manquement à l'encontre de la France.
En outre, cette option présenterait le risque fort que l'objectif d'exhaustivité de cette base ne soit pas atteint. Or, c'est le caractère exhaustif du registre qui permettra d'alléger les entreprises de la déclaration des aides perçues, et qui contribuera à renforcer la sécurité juridique des décisions d'octroi par les autorités publiques. Seule l'exhaustivité permettra d'apporter in fine à ces dernières un bénéfice supérieur à l'effort initial requis de renseigner le registre pour les aides qu'elles octroient.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue pour la constitution d'un registre des aides de minimis est donc celle d'un outil national, la plateforme nationale des aides d'État, dont l'alimentation par les collectivités territoriales est rendue obligatoire par la loi. Pour les autres autorités qui octroient des aides de minimis (administrations, opérateurs) l'obligation d'alimentation de la plateforme sera précisée par décret.
Il est proposé d'étendre l'obligation d'un registre de minimis public au secteur de la pêche et de l'aquaculture, afin de bénéficier du rehaussement de 30 à 40 000 €, du plafond des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux conformément aux dispositions du règlement (2023/2391) du 4 octobre 2023. Cette opportunité de soutien à nos entreprises, soumises à une forte concurrence intra comme extra-européenne, impose de lever le secret fiscal pour les aides relevant de ce secteur (pour les aides de minimis des autres secteurs, la levée du secret fiscal découle de l'obligation imposée par la réglementation européenne).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article porte création d'un nouvel article L. 1511-1-3 au sein du code général des collectivités territoriales.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions prévues par la présente loi permettent de répondre aux nouveaux règlements européens sur les aides de minimis publiés en octobre et décembre 2023 (général, pêche et SIEG) et en décembre 2024 (agriculture), qui renforcent les règles de transparence en introduisant un système de registre obligatoire des aides de minimis. Les règlements sont applicables à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030. L'obligation relative à l'instauration d'un registre central entrera en vigueur, quant à elle, au 1er janvier 2026 pour les secteurs général, spécifique aux SIEG et de la pêche, et au 1er janvier 2027 pour le secteur spécifique à l'agriculture
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les aides de minimis constituent une dépense importante pour les finances publiques et leur bonne allocation est un enjeu majeur, surtout dans une période de fortes contraintes budgétaires. La mise en place d'un registre des aides de minimis permet de diminuer les redondances entre les différents dispositifs des administrations centrales, des opérateurs et des collectivités territoriales, et de renforcer la sécurité juridique des décisions d'octroi grâce à la vérification systématisée du respect des plafonds d'octroi. La fiabilité accrue des données sur les aides déjà versées apportée par le registre, devrait a contrario optimiser le potentiel d'aide « jusqu'au plafond » en sécurisant la prise de décision des autorités d'octroi qui pouvaient, par prudence, renoncer dans le doute à une aide légitime et justifiée car proche mais inférieure au plafond.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La constitution d'un registre des aides de minimis a pour objectif d'alléger les entreprises de la charge consistant à fournir, lors du dépôt d'une demande d'aide, la liste des aides déjà perçues.
La mise en place d'un registre des aides permet donc d'inverser la charge de la preuve sur la compatibilité de la nouvelle aide demandée avec les aides déjà reçues : c'est l'autorité qui octroie l'aide qui doit s'assurer en consultant le registre que l'entreprise est bien éligible à une nouvelle aide. Réaliser une demande d'aide entraîne des frais administratifs souvent plus importants pour les plus petites entreprises92(*). Ces frais s'apparentent de plus à un coût fixe dont le montant ne dépend pas vraiment du montant d'aide espéré93(*) : on constate un non recours aux aides plus important pour les entreprises petites, jeunes ou qui ne sont pas intégrées dans des groupes. La mise en place d'un registre des aides permettra prioritairement de simplifier les demandes d'aide de ces catégories d'entreprises.
Une étude94(*) du ministère de la Recherche publiée par l'Insee permet d'illustrer le problème des difficultés d'accès aux aides pour certaines catégories d'entreprise. Les entreprises qui ont des dépenses de Recherche et développement (R&D) mais qui ne demandent pas à bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR) sont significativement plus petites que les entreprises bénéficiaires95(*), elles sont aussi plus souvent indépendantes. Par ailleurs, elles bénéficient moins souvent d'autres aides directes à la R&D et se trouvent d'autant plus pénalisées par rapport à leurs concurrentes. Si le taux de recours au CIR a fortement progressé96(*) (+20 points) avec les réformes du CIR de 2004 et 2008 qui ont permis d'augmenter fortement le taux d'aide, le non-recours reste toujours conséquent97(*).
La grande variété des aides possibles tend à renforcer cette barrière à l'entrée pour les entreprises qui ne possèdent pas en interne les compétences juridiques et comptables adéquates. En particulier, le montant des aides fiscales (crédit d'impôt ou exonérations de taxe) et des aides sociales (allègement des charges sociales) est particulièrement complexe à mesurer car cela demande de simuler le niveau de ces prélèvements en l'absence d'aide et cette information n'est en général pas transmise à l'entreprise. Les entreprises voient par exemple l'impôt payé, mais sans connaitre le montant de crédit d'impôt octroyé. Pour le mesurer, elles doivent être en capacité de calculer l'impôt qu'elles auraient dû payer en l'absence de crédit d'impôt. La mise en place d'un registre alimenté par les administrations compétentes permettra ainsi aux entreprises de connaître exactement le montant exact des aides déjà reçues.
La difficulté à mesurer les aides fiscales et sociales concerne plus particulièrement les aides de minimis. On dénombre ainsi au moins 55 mesures fiscales différentes qui sont des aides de minimis et elles concernent plusieurs impôts (l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés, la contribution foncière des entreprises, les droits de mutation, la taxe pour les frais de chambre de commerce et de chambre de métiers, l'avantage fiscal crédit-bail, le CIR-collection, l'impôt sur la fortune immobilière, la taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales et la taxe foncière sur les propriétés bâties)98(*).
Plus généralement, la liste des aides de minimis publiée sur le site Europe en France comporte pas moins de 98 mesures. Souvent la nature de minimis de ces aides n'est pas connue des entreprises alors qu'elles doivent en faire la comptabilité exacte au moment de demander une nouvelle aide. Partant de ce constat et ayant pour objectif de simplifier les tâches administratives des entreprises99(*), la Commission européenne a modifié la réglementation encadrant les aides de minimis en rendant obligatoire l'utilisation d'un registre public. Simplifier le recours aux aides de minimis est un enjeu important car ces aides sont particulièrement adaptées pour construire des dispositifs de réponse à des crises : leur montant est certes limité mais elles permettent de financer tous les types de dépenses (comme exemples récents d'aide de minimis, on peut citer les aides auprès d'entreprises de Mayotte pour la sécheresse et pour répondre aux conséquences des blocus, ou encore l'aide aux entreprises suite aux inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais).
Le caractère public des registres mis en place à partir du 1er janvier 2026 implique a minima que le montant total des aides de minimis reçu par chaque entreprise française soit rendu public100(*).
Par ailleurs la mise en place de registre public pour les aides de minimis du secteur de la pêche permettra d'augmenter leur plafond, et ainsi de répondre plus facilement à des situations d'urgence. En effet, la réglementation européenne incite les État membres à mettre en place des registres pour ces aides aussi : le plafond des aides de minimis pêche peut-être relevé de 30 000 à 40 000 euros si un registre est mis en place.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le coût du développement de la plateforme nationale des aides d'État est évalué à cinq-cent mille euros par an. Il est pris en charge sur le budget du ministère de l'économie et des finances (direction générale des entreprises). De même, ce ministère prendra à sa charge les coûts ultérieurs de maintenance, y compris évolutive, de la plateforme.
Aucun coût ne sera mis à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements.
L'accès au registre sera libre et gratuit, que ce soit pour les entreprises bénéficiaires ou pour les citoyens intéressés.
La mise en place d'un registre permet de réduire le risque de dépassement opportuniste ou involontaire des plafonds fixés par la réglementation. C'est un objectif majeur de la mise en place d'un registre car ce risque de dépassement est triplement préjudiciable :
- A l'efficience de la politique publique, qui, à enveloppe constante, prive des entreprises légitimement éligibles à hauteur des aides indues perçues au-delà du plafond par d'autres entreprises,
- A l'entreprise qui dépasse les plafonds car en cas de contrôle, elle est tenue de rembourser les aides indument perçues,
- A la réputation de l'ensemble des entreprises aidées et à la politique publique elle-même.
La mesure exhaustive de ce risque est malaisée faute de registre national. Toutefois, il peut être approché dans le cas des aides à la recherche et développement. Une étude de la DGE sur les aides à la R&D suggère que le risque est non nul y compris dans ce domaine bien maitrisé par l'État. En effet, la grande variété des dispositifs de soutien à la R&D génère des taux d'aide cumulés (tableau 1) qui laissent voir des dépassements de l'aide pour au moins 10 % des entreprises moyennes et des microentreprises qui ont été sondées (dernière colonne du tableau). En effet sur la période étudiée, l'aide maximum était fixée à 50 % de la recherche industrielle et 25 % du développement expérimental pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 65 % et 30 % pour les entreprises moyennes et à 70 % et 45 % pour les microentreprises101(*).
Tableau 1 : Distribution des taux d'aide à la R&D cumulé par catégorie d'entreprise
|
Catégorie d'entreprise |
Caractéristiques de la distribution des taux d'aide pour chaque catégorie d'entreprise |
||||
|
Premier quartile |
Médiane |
Moyenne |
Troisième quartile |
Dernier décile |
|
|
Grande entreprise et ETI |
1 % |
4 % |
15 % |
14 % |
41 % |
|
Moyenne entreprise |
6 % |
15 % |
35 % |
41 % |
88 % |
|
Petite entreprise |
13 % |
29 % |
55 % |
52 % |
97 % |
Champ : entreprises interrogées par l'enquête R&D en 2017, qui ont déclarés avoir des dépenses de R&D et qui ont reçu cette année au moins une aide directe pour financer leurs dépenses de R&D.
Note : le taux d'aide cumulé est le rapport entre le total des aides d'État reçues au cours d'une année pour financer des activités de R&D et les dépenses de R&D.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le choix de la Plateforme des aides d'État, plutôt que l'outil européen pour constituer le registre d'aides de minimis est sans impact pour les collectivités territoriales qui ne participeront pas au financement de l'outil.
A moyen terme, ce choix devrait s'avérer bénéfique dans une perspective d'extension de l'usage de cet outil à l'ensemble des aides d'État, ce qui en ferait un support efficace et sûr pour le pilotage stratégique par ces collectivités, singulièrement les régions, ainsi que la simplification drastique de certaines de leurs obligations déclaratives à la Commission européenne (automatisation via la plateforme nationale de la publication des aides octroyées les plus importantes, l'exercice de « transparence », et de la réalisation du rapport annuel sur les aides versées prévu à l'article L. 1511-1 du CGCT). Les collectivités pourraient notamment, à terme choisi, privilégier le recours à la Plateforme des aides d'État pour remplir ces obligations102(*).
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les règlements européens des aides de minimis disposent que les données d'aides de minimis doivent être rendues publiques et accessibles sur internet ; ils précisent toutefois que les personnes physiques bénéficiaires des aides peuvent être pseudo-anonymisées103(*).
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les principales associations d'élus des collectivités territoriales et de leurs groupements ont été consultées préalablement à la réunion interministérielle du 23 janvier 2025, dont l'objet était le choix entre le recours à un outil européen et un outil national pour constituer le registre de minimis.
Aucun avis défavorable au recours à la Plateforme aides d'État n'a été émis.
Une nouvelle consultation de ces associations d'élus a été menée en amont de la saisine du Conseil national d'évaluation des normes en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel a émis un avis favorable sur le projet de texte le 02 octobre 2025
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La date d'entrée en vigueur de l'obligation est le 1er janvier 2026 pour les aides relevant des règlements de minimis général, spécifiques aux services d'intérêt économique général et relevant de l'aquaculture et de la pêche, et le 1er janvier 2027 pour les aides relevant du secteur de l'agriculture, conformément aux règlements européens en vigueur sur les aides de minimis.
5.2.2. Application dans l'espace
Le texte s'applique aux collectivités situées en France métropolitaine et dans les 6 régions ultrapériphériques (RUP). Les RUP recouvrent les 5 collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) et la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. La réglementation des aides d'Etat ne s'applique pas en revanche aux autres collectivités ultramarines (Pays et territoires d'outre-mer - PTOM).
5.2.3. Textes d'application
La liste exhaustive des éléments à renseigner, le format des champs de données, la fréquence de transmission ainsi que les différentes modalités de versement dans la plateforme seront précisées dans un décret d'application pris par le ministre de l'économie et des finances.
Article 17 - Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques permet au ministre chargé de l'Economie, après avis du Conseil national de l'information statistique (CNIS), d'imposer à des personnes morales de droit privé la transmission de données extraites de leurs bases au bénéfice du service statistique public.
Toutefois, ce dispositif est actuellement limité aux seuls cas où les données sont collectées dans le cadre d'enquêtes rendues obligatoires en application de l'article 1er bis de la même loi. Cette condition restreint donc l'utilisation de cette procédure de transmission de données aux situations déjà encadrées par un dispositif d'enquête (e.g. données nécessaires au calcul de l'indice des prix à la consommation, collectées auprès des grandes enseignes de distribution), à l'exclusion de cas où l'exploitation de données existantes pourrait éviter de mobiliser un tel dispositif (par exemple, l'utilisation de données des opérateurs de téléphonie mobile pour la mesure de l'activité touristique, ou bien encore, toujours dans le domaine du tourisme, l'utilisation des données des plates-formes de locations, les indicateurs touristiques étant dans le champ de la statistique européenne).
Dans ce contexte, le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes, et plus particulièrement de son article 17 quater, paragraphe 5, impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour assurer l'exécution effective des demandes adressées par les instituts nationaux de statistique aux entités privées, en vue de la production de statistiques européennes. La présente disposition vise à adapter ce règlement en droit national.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (cf. décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (cf. décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018).
En outre, la présente disposition prévoit des sanctions administratives, lesquelles s'inscrivent dans le respect des principes constitutionnels issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment le principe de légalité des peines (article 8), qui implique que toute sanction ayant un caractère punitif doit être prévue par la loi. Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, que les sanctions administratives doivent respecter les garanties applicables en matière de droit répressif, notamment lorsqu'elles visent à sanctionner un manquement à une obligation légale.
Le présent dispositif n'introduit pas de nouveau régime de sanction, mais élargit le champ d'application d'un mécanisme existant, déjà encadré juridiquement, et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel a-t-il jugé, dans sa décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989) : « Considérant que l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La modification envisagée vise à assurer la conformité du droit national à une norme contraignante issue du droit de l'Union européenne. Il s'agit du règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (précité), modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0223-20241226), et plus particulièrement de son article 17 quater, paragraphe 5.
Ce texte impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour assurer l'exécution effective des demandes adressées par les instituts nationaux de statistique aux entités privées, en vue de la production de statistiques européennes.
Le règlement, ayant effet direct et s'imposant aux États membres en vertu de l'article 288 du TFUE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12016E288), constitue une norme supérieure à la loi au sens de l'article 55 de la Constitution. Le droit national doit donc être adapté pour garantir son application effective.
En-dehors du cadre européen, aucune convention internationale ou bilatérale ne fait obstacle à la présente évolution.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Plusieurs pays européens disposent de législations spécifiques encadrant l'accès aux données privées à des fins statistiques.
On peut notamment citer :
- L'Allemagne, avec la Bundesstatistikgesetz (loi fédérale sur la statistique) ;
- Les Pays-Bas, dont le Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) est régi par la Loi sur les statistiques des Pays-Bas ;
- La Suède, avec la Loi sur les statistiques officielles encadrant l'accès aux données et la confidentialité ;
- L'Italie, qui dispose d'une loi sur la statistique publique (Decreto Legislativo n. 322/1989).
Ces dispositifs visent, dans des configurations variables, à garantir aux autorités statistiques un accès sécurisé aux données détenues par les acteurs privés, dans le respect des droits fondamentaux et de la protection des données personnelles.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La modification législative est rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/3018 du 27 novembre 2024, qui modifie le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes. Ce texte impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour garantir l'accès effectif des instituts nationaux de statistique (INS) aux données détenues par des entités privées, dans un but exclusif de production de statistiques européennes (article 17 quater, paragraphe 5).
En l'état du droit national, cet accès n'est possible que dans un cas limité : lorsque les données privées peuvent se substituer à des données issues d'une enquête statistique rendue obligatoire, conformément au I de l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (précitée). Cette condition de substitution constitue une restriction qui ne permet pas de satisfaire pleinement aux exigences du règlement européen, notamment dans les situations où l'exploitation de données existantes serait nécessaire à défaut de pouvoir mettre en oeuvre une enquête.
Par ailleurs, pour assurer l'exécution effective des demandes d'accès couvertes par le règlement, il convient que le régime de sanctions administratives prévu au II de l'article 3 bis puisse s'appliquer à l'ensemble des cas relevant désormais du périmètre européen, ce que ne permet pas la rédaction actuelle.
Ces évolutions ne peuvent être introduites ni par voie réglementaire, ni par interprétation jurisprudentielle, dès lors qu'elles impliquent une redéfinition du champ d'application d'un pouvoir de contrainte. Une intervention législative est donc indispensable pour assurer la pleine conformité du droit national aux obligations européennes.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La modification législative proposée vise, en premier lieu, à adapter le droit français aux nouvelles exigences européennes en matière d'accès aux données privées à des fins statistiques, telles que définies par le règlement (UE) 2024/3018.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La rédaction du paragraphe 5 de l'article 17 quater du règlement (UE) 2024/3018 laisse une certaine latitude aux États membres quant à la forme que doivent prendre les "mesures appropriées" destinées à garantir l'accès des instituts nationaux de statistique aux données détenues par les entités privées.
Une première option aurait pu consister à prévoir des mécanismes d'incitation non contraignants, reposant sur la coopération volontaire des détenteurs de données privées. De tels mécanismes auraient pu prendre la forme d'accords de partenariat, de dispositifs d'accompagnement ou de reconnaissance (labellisation, charte, dispositifs financiers conditionnels, etc.). Toutefois, cette option présentait des limites sérieuses :
- d'une part, le règlement européen, dans son paragraphe 6, prévoit que la Commission (Eurostat) puisse, en dernier ressort, recourir à des sanctions sous forme d'amendes administratives pouvant atteindre 50 000 euros ;
- d'autre part, le droit national, dans sa rédaction actuelle de l'article 3 bis de la loi de 1951, prévoit déjà un régime de sanctions administratives en cas de refus de transmission.
Par ailleurs, l'article 3 bis de la loi de 1951 intègre un dispositif procédural spécifique, prévoyant une concertation préalable avec les entités concernées et une étude de faisabilité et d'opportunité. Cette exigence constitue une garantie suffisante que les échanges puissent s'engager d'abord sur une base volontaire, avant toute procédure formelle ou sanction.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Dans ce contexte, l'option retenue consiste à faire évoluer à droit constant le champ d'application de l'article 3 bis, pour y inclure les situations couvertes par le règlement (UE) 2024/3018, relatives au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Cette évolution permet de rendre pleinement effectif le régime de sanctions administratives déjà prévu par le droit national, sans création d'un dispositif nouveau.
Cette option présente l'avantage d'offrir un équilibre acceptable entre contrainte légale et logique de coopération, puisque le mécanisme de concertation préalable continue à s'appliquer avant toute mesure contraignante.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le premier alinéa du I de l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 est remplacé par de nouvelles dispositions afin d'élargir le champ d'application du droit reconnu au ministre chargé de l'Economie de demander la transmission de données à caractère non personnel détenues par des personnes morales de droit privé au bénéfice des services producteurs d'informations statistiques.
Jusqu'à présent, ce droit était limité aux situations dans lesquelles les données sollicitées se substituaient à des données issues d'une enquête statistique obligatoire. Désormais, il pourra être exercé lorsque le recours aux données privées est justifié pour les besoins de statistiques européennes.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La réforme proposée vise à mettre en oeuvre une obligation explicite issue du droit de l'Union européenne, énoncée à l'article 17 quater, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/3018, qui modifie le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes. Cette disposition impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour assurer l'exécution effective des demandes d'accès formulées par les instituts nationaux de statistique (INS) aux données détenues par des entités privées.
Les sanctions prévues par le II de l'article 3 bis de la loi de 1951 (amendes administratives) sont cohérentes, dans leur nature et leur montant, avec celles que peut prononcer la Commission européenne en application du paragraphe 7 de l'article 17 quater du règlement précité. Il en résulte une continuité d'approche entre le droit national et le droit de l'Union, tant en termes de garanties que de proportionnalité des mesures.
Conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le règlement est d'application directe dans les États membres et prévaut sur toute disposition législative nationale incompatible. La présente réforme a donc pour objet de lever l'obstacle que constitue la limitation actuelle du champ d'application de l'article 3 bis, en assurant ainsi la pleine effectivité de la norme européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'élargissement du champ d'application de l'article 3 bis de la loi de 1951 pourrait avoir un impact ponctuel sur certaines entreprises ou organismes privés amenés à transmettre des données à des fins statistiques.
Toutefois, ces impacts restent limités : le dispositif reste encadré par une procédure de concertation préalable, assortie d'une étude de faisabilité, ce qui permet d'anticiper les contraintes éventuelles liées à la transmission des données et d'ajuster les demandes en fonction des capacités des opérateurs concernés.
En outre, le règlement (UE) 2024/3018, en son article 17ter, paragraphe 5, prévoit que les entités privées concernées peuvent bénéficier d'une compensation limitée pour couvrir les coûts directement liés au traitement technique des données, sans inclure un remboursement général. Il revient à chaque État membre d'organiser cette prise en charge dans le respect de ce cadre. Cette disposition offre une base pour intégrer, dans des conditions maîtrisées, un mécanisme de compensation en cas de traitement technique substantiel exigé.
Par ailleurs, en facilitant l'accès direct à des bases de données déjà constituées, cette réforme peut contribuer à maîtriser la charge statistique globale pesant sur les entreprises et les ménages pour la production de statistiques européennes. Les données transmises dans ce cadre pourront, dans certains cas, se substituer à des enquêtes spécifiques, évitant ainsi la multiplication des sollicitations et allégeant les obligations déclaratives des opérateurs.
4.2.3. Impacts budgétaires
La modification de l'article 3 bis n'emporte pas de charge budgétaire directe nouvelle pour l'administration, dans la mesure où le mécanisme d'obligation de transmission de données par les entités privées existe déjà et que le service statistique public dispose des structures opérationnelles pour le mettre en oeuvre.
Toutefois, dans certains cas, notamment lorsque les données demandées supposent un traitement technique spécifique, une compensation limitée pourra être envisagée, conformément au paragraphe 5 de l'article 17ter du règlement (UE) 2024/3018, qui autorise la prise en charge des seuls coûts directement liés à l'extraction ou à la préparation technique des données à transférer.
Ces coûts sont par nature circonscrits et contrôlables, et devraient pouvoir être absorbés, selon les cas, par les moyens de fonctionnement existants ou des réaffectations internes. Le mécanisme de concertation prévu par la loi permet également de les anticiper en amont.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La modification de l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 n'entraîne pas de changement structurel dans l'organisation ou le fonctionnement des services administratifs concernés, à savoir les services composant le service statistique public.
Le mécanisme d'obligation de transmission de données par les entités privées est déjà en place, encadré par des procédures éprouvées incluant la concertation préalable, l'avis du Conseil national de l'information statistique (Cnis) et, le cas échéant, l'activation de sanctions administratives.
La modification proposée consiste à étendre le champ des situations dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé, sans modifier sa logique, ni ses modalités de mise en oeuvre.
En conséquence, l'impact sur les effectifs et les charges de travail des services concernés peut être considéré comme neutre, les structures actuelles étant en capacité d'absorber les sollicitations supplémentaires éventuelles, dans le cadre de leurs missions habituelles.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La réforme proposée vise à améliorer la capacité des services statistiques publics à accéder à des données détenues par des entités privées, dans des conditions encadrées et strictement limitées à la production de statistiques officielles.
Elle est de nature à renforcer la qualité, l'actualité et la réactivité des statistiques produites, notamment pour les statistiques européennes dans des domaines où les sources administratives ou les enquêtes traditionnelles présentent des limites (par exemple, consommation, mobilité, tourisme). L'élargissement de l'accès aux données privées permet ainsi d'améliorer la couverture statistique de certains phénomènes économiques et sociaux, y compris à des échelles territoriales fines ou dans des champs émergents (numérique, consommation en ligne, mobilité, etc.).
Par ailleurs, en permettant une réduction du recours aux enquêtes auprès des ménages ou des entreprises, cette évolution peut contribuer à alléger la charge statistique pesant sur les répondants, en limitant la sollicitation directe du public ou des acteurs économiques. Le recours à des données déjà collectées dans d'autres contextes permet ainsi une utilisation plus efficiente des ressources d'information disponibles, sans augmenter la pression statistique sur les individus.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Pas d'impacts spécifiques si ce n'est potentiellement une réduction de la charge résultant des enquêtes statistiques (voir 4.5.1 plus haut).
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française, sous réserve de la publication du décret d'application prévu à l'article 3 bis de la loi du 7 juin 1951.
Le mécanisme de concertation préalable prévu par cet article et maintenu dans sa rédaction modifiée permet d'assurer une transition opérationnelle souple, en offrant au service statistique public et aux organismes concernés un temps de dialogue et d'adaptation pour organiser la transmission des données dans des conditions satisfaisantes.
Ce mécanisme garantit que l'évolution du champ d'application pourra s'appliquer de manière progressive et maîtrisée, sans rupture dans les pratiques existantes.
5.2.2. Application dans l'espace
La disposition s'applique sur l'ensemble du territoire relevant de la compétence législative nationale dans le champ couvert par le droit de l'Union européenne (France métropolitaine et collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution).
5.2.3. Textes d'application
Le décret n° 2017-463 du 31 mars 2017, pris pour l'application de l'article 3 bis de la loi du 7 juin 1951, devra être adapté pour intégrer le nouveau fondement européen de l'accès aux données, tel que défini par les articles 17 ter et 17 quater du règlement (UE) 2024/3018.
Article 18 - Mise en conformité avec la directive 2019/2161 relative à la protection des consommateurs
1. ÉTAT DES LIEUX
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 114 et 169 du TFUE) et la charte des droits fondamentaux (article 38) exigent un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'Union. La législation de l'Union en matière de protection des consommateurs contribue également au bon fonctionnement du marché unique. Elle vise à assurer que les relations entre entreprises et consommateurs sont loyales et transparentes et, en définitive, contribuent au bien-être des consommateurs européens et à l'économie de l'UE.
A la suite d'un bilan de qualité et d'une évaluation de la législation européenne relative à la protection des consommateurs, la Commission européenne a entrepris de modifier certaines dispositions de protection du consommateur dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique consultable).
Ainsi, la directive (UE) 2019/2161 pour une meilleure application et une modernisation des règles de l'union en matière de protection des consommateurs, adoptée le 27 novembre 2019, modifie les directives 98/6/CE, 2005/29/CE, 2011/83/UE et 93/13/CEE aux fins de renforcer l'application des dispositions de protection des consommateurs face au risque croissant d'infractions à l'échelle européenne.
Outre l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions transfrontières de grande ampleur, la directive prévoit de garantir une plus grande transparence pour les consommateurs sur les places de marchés, d'étendre la protection des consommateurs aux contrats de services numériques pour lesquels le consommateur ne paie pas de prix et fournit des données à caractère personnel, d'interdire certaines pratiques commerciales nouvelles, de définir les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent avoir recours à des annonces de réductions de prix ou encore de permettre aux Etats membres d'encadrer certaines pratiques commerciales mises en oeuvre dans le cadre de visites non sollicitées au domicile du consommateur ou d'excursions à fins de vente de biens ou de services.
Ces modifications, qui concernent principalement les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE, ont été réalisées en tenant compte de leur nécessaire articulation avec les dispositions des directives 2019/770/UE et 2019/771/UE du 20 mai 2019 et du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.
Cette directive a été transposée par l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs et le décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l' article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
En outre, une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel prescrit la proportionnalité des sanctions administratives ( Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986). Les présentes dispositions respectent cette exigence.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En application de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les directives adoptées au niveau des instances de l'UE doivent faire l'objet d'une transposition par les Etats membres afin qu'elles aient force de loi dans lesdits États.
Conformément à l'article 288 du TFUE, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. Les mesures nationales doivent ainsi permettre d'atteindre les objectifs définis par la directive selon les modalités propres qu'elles définissent.
Une fois adoptées les mesures nationales doivent être communiquées à la Commission européenne. En cas de défaut de transposition, la Commission peut engager une procédure d'infraction contre l'Etat concerné auprès de la Cour de justice de l'UE. A cet égard, la Commission a ouvert une procédure dite « EU Pilot » pour vérifier la conformité de la transposition de la directive (UE) 2019/2161 faite par l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs. A l'issue de cet examen, ses services ont identifié des non-conformités au droit européen (sous transposition ou surtransposition) que le présent article vient corriger.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La directive (UE) n°2019/2161 dite « Omnibus » a été transposée par tous les Etats membres.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
A la suite de l'exercice EU PILOT, lancé le 15 février 2024 et consistant à la vérification par les services de la Commission européenne de la conformité de la transposition des dispositions de la directive 2019/2161/UE, les autorités françaises se sont engagées à modifier le droit national pour le mettre en conformité avec le droit européen (note des autorités françaises (NAF) du 24 juin 2024). Dans ce cadre, le présent article modifie certaines dispositions législatives du code de la consommation, ce qui nécessite un véhicule législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à mettre en conformité le droit national avec la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil. Il s'agit de clôturer la procédure EU PILOT ouverte par la Commission européenne qui a identifié quelques dispositions sous-transposées et une disposition surtransposée.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu consiste en l'adoption des mesures législatives de mise en conformité avec l'article 6 bis de la directive 98/6/CE sur l'indication des prix, des articles 8(4) et 24(4) de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs et de l'article 13(4) de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.
Ces mesures de mise en conformité avec le droit européen seront les suivantes :
- S'agissant de la transposition de l'article 6 bis de la directive 98/6/CE sur les annonces de réduction de prix
Les dispositions de l' article L. 112-1-1 du code de la consommation qui encadrent les annonces de réduction de prix, s'appliquent à toute annonce de réduction de prix relative à la vente de biens et à la fourniture de services, y compris numériques ou encore de contenus numériques.
En effet, tout en respectant ses obligations de transposition de l'article 6 bis de la directive 98/6/CE pour la vente de biens, les autorités françaises ont choisi d'appliquer ces règles au-delà du domaine coordonné par cette directive pour des raisons de sécurité juridique et de lisibilité du droit, considérant qu'il est très insatisfaisant de soumettre les produits et les services à deux régimes juridiques distincts en ce qui concerne les annonces de réduction de prix.
Néanmoins, les annonces de réduction de prix, en général, constituent des pratiques commerciales au sens de l'article 2.d de la directive 2005/29/CE.
Dès lors, comme le soulignent les services de la Commission européenne, en l'absence de règles prévues par le droit de l'Union européenne (UE) pour l'encadrement des annonces de réduction de prix propres aux services, y compris numériques ou à la fourniture de contenus numériques, ce sont les dispositions de la directive 2005/29/CE qui s'appliquent.
La directive 2005/29/CE est dite d'harmonisation maximale et interdit aux Etats membres, selon une jurisprudence constante de la CJUE, de maintenir ou d'adopter des dispositions divergentes pour le domaine qu'elle coordonne, même dans le but d'assurer une meilleure protection des intérêts économiques des consommateurs.
En conséquence, les autorités françaises prennent acte de la non-conformité de l'article L. 112-1-1 du code de la consommation au droit de l'UE et plus précisément aux dispositions de la directive 2005/29/CE, en ce qu'il s'applique non seulement aux biens mais aussi à la fourniture de services, y compris numériques ou encore de contenus numériques.
Le premier alinéa de l'article L. 112-1-1 du code de la consommation sera ainsi rédigé : « Art. L. 112-1 - I. - Toute annonce d'une réduction de prix portant sur la vente d'un bien indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix. / [Le reste sans changement] »
- S'agissant de la transposition de l'exigence d'un montant maximal d'au moins 2 millions d'euros pour l'amende infligée à un professionnel lorsque l'absence d'information sur son chiffre d'affaires annuel ne permet pas de porter l'amende jusqu'à 4% de celui-ci, pour sanctionner les infractions aux articles 6, 7, 8 et 9 de la directive 2005/29/CE, y compris son annexe I et aux dispositions de la directive 2011/83/UE :
En cas de pratique commerciale trompeuse, l' article L. 132-2 du code de la consommation prévoit une sanction pénale de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour une personne physique. En outre, une loi104(*) récente a renforcé la sanction « lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. » Dans cette hypothèse, en effet, « les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ». Ces quantums doivent en outre être appréciés à la lumière d'une autre disposition du droit national puisque l'article 131-38 du code pénal, prévoit que l'amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple du montant de l'amende prévu pour les personnes physiques.
Enfin, outre le pourcentage du chiffre d'affaires, le montant de l'amende visée à l'article L. 132-2 du code de la consommation peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit de pratique commerciale trompeuse. Ce taux est porté à 80 % dans les cas de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations environnementales. Dans l'hypothèse d'une infraction de grande ampleur ou d'une infraction de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, cette disposition trouverait à s'appliquer dans la mesure où les dépenses engagées pour réaliser la pratique dans plusieurs Etats membres seraient très certainement d'un montant significatif. Dans ces conditions, le montant de l'amende peut atteindre et dépasser les 2 millions d'euros même en cas d'absence de données relatives au chiffre d'affaires. Toutefois, afin d'assurer la stricte transposition de cette exigence en droit national, il est nécessaire de préciser expressément la sanction lorsque le chiffre d'affaires annuel n'est pas connu, en cas de pratiques commerciales trompeuses constatées dans le cadre d'actions coordonnées engagées sur le fondement de l'article 21 du règlement 2017/2394/UE et constitutives d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'UE
L'article L. 132-2 du code de la consommation sera ainsi complété par l'alinéa suivant : « Dans les conditions fixées par l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, en cas d' infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne et à défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. » ;
Après le deuxième alinéa de L'article L.132-11 du code de la consommation, il sera ainsi inséré l'alinéa suivant : « Dans les conditions fixées par l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, en cas d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne et à défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. »
- En ce qui concerne les sanctions encourues en cas de violation des dispositions de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs :
Les articles L. 242-7-2 et L. 242-14-1 du code de la consommation prévoient la possibilité de porter à 4% du chiffre d'affaires le montant des amendes prévues par les articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-10 à L. 242-13 du code de la consommation qui sanctionnent en droit national les manquements aux dispositions transposant la directive 2011/83/UE. Ces sanctions sont constituées d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale. Il convient d'articuler ces dispositions relatives aux sanctions avec l'article L. 522-7 du code de la consommation qui précise que : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ». Ainsi et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ( décision n° 2021-984 QPC, 25 mars 2022), une même sanction administrative peut être infligée autant de fois qu'il y a eu de pratiques constitutives de manquements à une même règlementation.
Ainsi, dans le respect du principe de proportionnalité105(*), il est possible de cumuler les amendes administratives prononcées et d'aggraver le régime des sanctions applicables en cas de manquements. Or, dans l'hypothèse d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, ces manquements seront nécessairement multiples ce qui permettra ainsi d'atteindre, voire de dépasser le seuil de 2 millions d'euros.
Toutefois, afin d'assurer la stricte transposition de la directive en droit national, il est nécessaire de modifier les articles L. 242-7-2 et L. 242-14-1 du code de la consommation, afin de prévoir un montant d'amende conforme aux exigences européennes, en l'absence d'information sur le chiffre d'affaires annuel, lorsque des manquements aux dispositions de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs sont constatés dans le cadre d'actions coordonnées engagées sur le fondement de l'article 21 du règlement 2017/2394/UE et constitutives d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'UE.
L'article L. 242-7-2 du code de la consommation sera ainsi complété par la phrase suivante : « A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. » ;
L'article L. 242-14-1 du code de la consommation sera ainsi complété par la phrase suivante : « A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. » ;
- Sur les informations à fournir avant la conclusion du contrat conclu à distance :
L'article L. 221-12 du code de la consommation transposant l'article 8.4 de la directive 2011/83/UE prévoit que : « Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. ».
La précision apportée par la directive (UE) 2019/2161, selon laquelle le formulaire de rétractation n'est pas exigé au titre des informations précontractuelles obligatoires à fournir au consommateur par la technique de communication à distance utilisée imposant des contraintes d'espace ou de temps ou au moyen de celle-ci, mais qu'il doit être fourni sous une forme adaptée, n'a pas été ajoutée à l' article L. 221-12 du code de la consommation qui ne renvoie qu'à la transmission au consommateur d'une information sur l'existence du droit de rétractation, mais dans les conditions prévues par l' article L. 221-5 de ce code, lequel prévoit la fourniture du formulaire type de rétractation.
Dès lors, il semble en effet nécessaire que cette précision soit reprise à l' article L. 221-12 du code de la consommation.
L'article L. 221-12 du code de la consommation sera ainsi rédigé : « Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation, à l'exclusion du formulaire type de rétractation. / Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article, y compris le formulaire type de rétractation, par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. »
Par ailleurs, l'article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation sont également modifiés pour corriger des sous transpositions passées de la directive 2005/29/CE afin d'avoir une transcription plus fidèle de la directive. Il s'agit notamment d'intégrer le critère lié à la décision commerciale dans le délit de pratique commerciale trompeuse par action et par omission. L' article L. 512-15 est également modifié pour corriger une sous transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Il s'agit d'alléger la démonstration du délit en considérant des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées ne sont pas apportées par le professionnel ou sont jugées insuffisantes, conformément à l'article 12 de la directive 2005/29/CE.
Enfin, le présent article adapte de la rédaction de l'article L. 512-22-1 du code de la consommation à la modification de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) par l'article 48 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique en application de l'article 89 du règlement (UE) 2022/2065.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les mesures envisagées modifient les articles L.112-1-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 132-2, L. 132-11, L. 221-12, L. 242-7-2, L. 242-14-1, L. 512-15 et L. 512-22-1 du code de la consommation.
Il est précisé que les articles L. 121-2 et L. 121-3 sont modifiés parallèlement par les articles 18 et 20 du présent projet de loi. Ces modifications poursuivent des objectifs distincts : la mise en conformité du droit national à la suite d'une procédure EU pilot conduite par les services de la Commission sur la transposition de la directive (UE) 2019/2161 d'une part et la transposition de la directive (UE) 2024/825 d'autre part.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article vise à mettre en conformité le droit national avec la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil. Il s'agit de clôturer la procédure EU PILOT ouverte par la Commission européenne qui a identifié quelques dispositions sous-transposées et une disposition surtransposée.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les dispositions de cet article ne sont pas de nature à produire d'impacts économiques.
En matière de pratiques commerciales déloyales, la définition de nouvelles pratiques commerciales trompeuses, la précision de certaines informations substantielles ainsi que l'instauration d'un régime de sanctions dans l'hypothèse d'infractions transfrontières ne sont pas de nature à créer des charges nouvelles sur les acteurs économiques.
S'agissant des aménagements du droit induits par les modifications de la directive sur les droits des consommateurs qui définit largement les conditions d'information du consommateur et de formation des contrats conclus à distance ou hors établissement, la transposition complète les obligations d'information et prévoit que les contrats portant sur des produits vendus sur saisie ou par autorité de justice sont exclus du champ d'application de ces règles. Concernant particulièrement les obligations d'information incombant aux opérateurs de places de marché, il est à noter que le code de la consommation les prévoit d'ores et déjà et qu'elles n'induisent donc aucune charge nouvelle. Quant au régime de sanctions applicables en cas d'infractions transfrontières, il ne crée aucune charge nouvelle sur les acteurs économiques.
S'agissant de l'encadrement des annonces de réduction de prix, ces dispositions visent à assurer la transparence de telles communications commerciales en explicitant les seules conditions de forme à même de garantir que ces pratiques commerciales ne soient pas déloyales. A cet égard, la modification apportée qui consiste à limiter l'encadrement des annonces de réduction de prix qui porte uniquement sur les biens (ce qui exclut celles portant sur les services) n'a pas d'incidence au fond puisque les professionnels restent tenus d'observer les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses sur le caractère promotionnel du prix des biens ou des services.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Conformément aux objectifs de la directive, le renforcement des dispositions de protection des consommateurs vise à encourager davantage les entreprises à respecter leurs obligations d'information et à les dissuader de mettre en oeuvre des pratiques commerciales déloyales ou d'utiliser des clauses abusives dans leurs contrats.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les mesures proposées auront un faible impact dans la mesure où la charge de travail induite par le contrôle du respect des règles en matière de protection du consommateur ne devrait pas évoluer.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les dispositions de l'article 18 du projet de loi viennent compléter la transposition en droit national de la directive 2019/2161 (dite « Omnibus ») et ont pour objet de renforcer l'effectivité des règles de protection des consommateurs, notamment, contre les pratiques commerciales trompeuses mais également de garantir un niveau de sanction dissuasif pour lutter plus efficacement contre les infractions transfrontières commisses sur le territoire de l'UE.
Elles contribuent, ainsi, à accroître la confiance des consommateurs dans le marché intérieur.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'ordonnance ne crée pas véritablement de nouveaux droits au bénéfice du consommateur, elle vise en revanche à inciter davantage les entreprises à respecter la réglementation par l'instauration d'un régime de sanction plus dissuasif. Par conséquent, les consommateurs devraient être mieux informés et moins exposés à certaines pratiques commerciales.
Le renforcement du dispositif de protection des consommateurs devrait conduire à une meilleure information des consommateurs et l'établissement d'une moindre défiance vis-à-vis de certaines pratiques commerciales des professionnels.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions des présents articles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Elles s'appliquent également à Saint-Martin qui est assujetti au droit européen.
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions du présent article ne nécessitent aucun texte d'application.
Article 19 - Sécurité générale des produits
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En matière de sécurité comme de conformité, de nombreux produits font l'objet d'une réglementation spécifique, qui prévoit en général la prise en compte des principaux risques. Il peut s'agir d'une réglementation trouvant sa source dans le droit communautaire (règlement européen directement applicable ou directive transposée dans le code de la consommation, ou dans un autre code) ou d'une réglementation d'initiative nationale.
Les produits non réglementés sont soumis à l'obligation générale de sécurité (ci-après OGS). En outre, pour les produits réglementés, l'OGS pourra également trouver à s'appliquer dans certains cas, comme un « filet de sécurité » - dès lors qu'un risque ne serait pas couvert. L'articulation entre l'OGS et les textes communautaires sectoriels est précisée par le règlement UE 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (ci-après RSGP), qui a abrogé la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits qui posait les mêmes principes. Dès lors, tous les produits non-alimentaires destinés aux consommateurs sont soumis à l'OGS telle que prévue par le RSGP pour autant qu'il n'existe pas, dans le cadre de réglementations européennes, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et couvrant bien tous les risques pour les consommateurs.
Conformément à cette réglementation, les opérateurs économiques, tels que définis à l'article L.421-1 du code de la consommation, sont soumis à des obligations générales conformément aux dispositions du RSGP. Ces dispositions générales sont généralement complétées par des dispositions plus précises dans les textes sectoriels pour les produits harmonisés ou dans le RSGP pour les produits soumis à l'OGS. Ces obligations générales au titre du RSGP concernent notamment l'évaluation des risques préalable à la mise sur le marché, la documentation technique et les informations de traçabilité des produits que les fabricants et importateurs doivent fournir ainsi que les mesures correctives à prendre en cas de produit signalé pour non-conformité ou dangerosité.
Certaines dispositions du RSGP ont toutefois vocation à s'appliquer à l'intégralité des produits, y compris ceux déjà soumis à une législation d'harmonisation. Cela est notamment le cas pour les fournisseurs de place de marché en ligne (plus couramment appelés « marketplace »). Il s'agit notamment :
- Des mesures de retrait et/ou rappel des produits dangereux : en cas de rappel de produits pour des raisons de sécurité ou afin de garantir l'utilisation sûre d'un produit, les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne doivent notifier ces informations aux consommateurs concernés sans retard injustifié et leur proposer le choix entre au moins deux recours parmi la réparation, le remplacement ou le remboursement adéquat du produit (art. 35, 36 et 37, RSGP).
- De l'information du consommateur vis-à-vis des produits vendus en ligne : les opérateurs économiques ont l'obligation de fournir aux consommateurs, de manière claire et visible, les informations relatives à l'offre de produit en ligne (identification du produit et du fabricant, ou de la « personne responsable » en cas de fabriquant établi dans un pays-tiers, avertissement ou information de sécurité lorsque nécessaire, etc.) (art. 19, RSGP)
- Du signalement obligatoire des accidents liés à la sécurité des produits : le fabricant a une obligation de signalement des accident causés par un produit aux autorités compétentes de l'Etat membre où l'accident s'est produit, par l'intermédiaire du point d'accès Safety Business Gateway. Les importateurs ou distributeurs doivent informer sans retard injustifié le fabricant s'ils ont connaissance d'un accident causé par un produit qu'ils ont mis sur le marché (art. 20, RSGP).
En matière de commerce en ligne plus spécifiquement, les obligations de fournisseurs de services numériques tels que des « places de marché » en ligne hébergeant les offres de vendeurs tiers, sont encadrées par la loi sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN)106(*), par le Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (dit règlement sur les services numériques ou « DSA » ci-après) et par le RSGP (son article 22 notamment).
Selon les termes du DSA (art. 31), les fournisseurs de places de marché en ligne veillent à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée d'une manière permettant aux vendeurs de respecter leurs obligations en matière d'informations précontractuelles, de conformité et d'informations sur la sécurité des produits (identification des produits, éléments relatifs à l'étiquetage et au marquage en matière de sécurité et de conformité des produits). En outre, ces fournisseurs doivent déployer « tous leurs efforts » pour déterminer si ces professionnels ont communiqué les informations sur les produits avant de les autoriser à les proposer sur leur place de marché. Pour les offres déjà publiées, ils doivent « s'efforcer, dans la mesure du raisonnable, de vérifier de manière aléatoire, dans une base de données en ligne ou une interface en ligne officielle, librement accessible et lisible par une machine, si les produits ou services proposés ont été recensés comme étant illégaux ». Concrètement, avec les technologies actuelles, les places de marché devraient être en capacité de supprimer grâce à des mécanismes automatisés les annonces correspondant à des produits déjà identifiés comme dangereux sur la base européenne « Safety Gate ».
La réglementation prévoit par ailleurs toujours des dérogations en matière de responsabilité lorsque le prestataire n'a pas eu connaissance d'informations ou d'activités illégales fournies ou initiées par des tiers utilisant son réseau. Ainsi, n'étant pas assimilés aux distributeurs, les fournisseurs de places de marché n'ont pour seule obligation que celle d'agir « promptement » pour retirer les informations ou en rendant leur accès impossible dès qu'ils ont connaissance du caractère illégal des éléments qu'ils publient sur leur site pour le compte d'un tiers. Cette procédure, dite de « notification et action », permet concrètement d'obtenir d'une place de marché Internet le traitement des cas individuels de produits non-conformes et/ou dangereux, y compris en prévenant la réapparition de cette référence précise sur la plateforme. En tant que lex specialis du DSA, le RSGP précise ainsi en son article 22 que les fournisseurs de places de marché en ligne disposent d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'injonction afin de prendre les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises par l'autorité de surveillance émettrice. Si un produit a été signalé comme illégal à une place de marché, il est également possible de lui demander de mettre en place des mesures de retrait, veille ou de surveillance permettant d'éviter la réapparition de cette même référence (contenu identique) sur sa plateforme. Pour être applicable aux contenus identiques, l'injonction doit déterminer une période d'application finie dans le temps et ne pas obliger la place de marché à procéder à une évaluation indépendante de ces contenus. Afin de permettre d'entrer en contact facilement avec les places de marchés, celles-ci doivent mettre à disposition des consommateurs ainsi que des autorités de surveillance du marché un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, en ce qui concerne les questions de sécurité des produits.
Ces dispositions ont déjà fait l'objet d'adaptation dans le cadre de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Elle a été complétée par le décret n° 2024-1171 du 6 décembre 2024 portant mesures d'adaptation du code de la consommation à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité des produits. Celui-ci a notamment introduit un nouvel article R. 412-43-2 permettant de constater que certaines dispositions du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, et portant des obligations spécifiques pour les professionnels (articles 2, 3, 9 à 16, 18 à 20, 22, 28, 35, 36 et 37) constituent des mesures d'exécution de l' article L. 412-1 du code de la consommation relatif à la conformité et la sécurité des produits, de manière à ce que tout manquement entre dans le dispositif de sanction.
Cependant, les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 relatifs à la procédure de « notification et action » nécessitent des mesures d'adaptation supplémentaires pour pouvoir habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à émettre ces nouvelles injonctions. Certaines mesures de toilettage du code de la consommation sont par ailleurs nécessaires afin de supprimer les références à des articles abrogés et les remplacer par des références aux articles du règlement UE 2023/988.
Au-delà de la mise en conformité avec le droit européen, se doter de ce pouvoir d'injonction relatif au retrait de produits dangereux apparaît d'autant plus nécessaire face à l'essor du commerce en ligne. En effet, les ventes en ligne ont dépassé 175 Md€ en France en 2024, en hausse de 9,6 % sur un an selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). En 2023, selon la FEVAD, la part du e-commerce représente 10% du commerce de détail. L'essor du commerce en ligne et les principales places de marché opérant en France et au sein de l'Union européenne représentent donc un enjeu majeur pour notre économie. Pour la DGCCRF, laquelle cherche à assurer le même niveau de protection des consommateurs en ligne et hors-ligne, il est impératif de se doter des outils juridiques adaptés afin de contrôler ces acteurs et conformément aux évolutions du cadre réglementaire européen (en l'occurrence le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ). Cela apparaît d'autant plus indispensable que les enquêtes menées par la DGCCRF depuis plusieurs années sur les principales plateformes de vente en ligne montrent des niveaux d'anomalie largement supérieurs à ce que l'on peut trouver en magasin physique (dangerosité ou non-conformités). Ce constat soulève dès lors des enjeux en matière de protection des consommateurs mais également de concurrence déloyale pour les entreprises européennes respectueuses des règles du marché intérieur (level playing field). Ainsi, en enjoignant à ces places de marché de retirer non seulement le produit dangereux signalé mais également les produits identiques, il s'agit là d'un vrai progrès par rapport au régime existant dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (règlement qui, pour sa part, ne peut concerner que les plateformes établies en France, conformément au principe du pays d'origine issu de la directive 2000/31 dites « e-commerce »).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3). La transposition ou l'adaptation doivent permettre la mise en oeuvre effective des règles européennes.
Le Conseil constitutionnel peut être amené à examiner les obligations légales imposées aux sociétés à l'aune de la liberté d'entreprendre qui procède de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le Conseil constitutionnel a confirmé, qu'elle comprend deux objets, à savoir : « non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité » (cons. n° 7)107(*). Il a notamment jugé que ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre la loi qui crée une obligation déclarative pour certaines sociétés dans le but de transmettre à l'administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, comptables et fiscaux de leur activité108(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La liberté d'entreprendre est garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet article protège la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge sur son fondement que la liberté d'entreprendre ne constitue pas une prérogative absolue mais peut être soumise à un large éventail d'interventions de la puissance publique susceptibles d'établir, dans l'intérêt général, des limitations à l'exercice de l'activité économique.
Les règles européennes en matière de surveillance du marché sont notamment définies de manière transversale par le règlement UE 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et la conformité des produits. Celui-ci définit des obligations pour les acteurs économiques mais également les pouvoirs des Etat-membres en ces matières et leurs obligations de coopération européenne. En matière de sécurité des produits plus spécifiquement, c'est dorénavant le règlement UE 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) qui s'applique, en remplacement de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. Celui-ci établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. Il pose le principe-clé selon lequel les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs. Dans la continuité du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Service Act) dont il constitue une lex specialis eut égard les obligations à l'égard des fournisseurs de places de marché en ligne, le RSGP impose de nouvelles obligations à ces derniers (obligation de conception de l'interface, coopération avec les autorités, information des consommateurs, retrait des produits dangereux signalés, etc.).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, les Etats-membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution adéquats. Dans ce cadre, la France doit se doter du pouvoir nécessaire afin d'émettre des injonctions, tel que décrit aux paragraphes 4 et 5 de l'article 22 du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (ci-après « RSGP »). Cette injonction permettra d'imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne (« marketplaces ») de retirer les contenus spécifiques faisant référence à une offre de produits dangereux dans un délai de deux jours ouvrables à compter de réception de l'injonction. Il est par ailleurs précisé que ces injonctions peuvent exiger de la place de marché qu'elle retire de son interface en ligne, pour une période déterminée, l'ensemble des contenus identiques se rapportant à l'offre du produit dangereux. Les principes généraux de ce mécanisme dit de « notification et action » (ou « notice and takedown ») ont été établis dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Service Act). Ces injonctions doivent dès lors être émises conformément aux conditions minimales énoncées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 auquel renvoie le paragraphe 4 du RGSP.
Doter les agents habilités de ce pouvoir d'injonction au sein du code de la consommation est dès lors essentiel à plusieurs égards.
D'un point de vue strictement juridique, il s'agit en premier lieu de se mettre en conformité avec le droit européen et les dispositions du règlement (UE) 2023/988 (RSGP) nécessitant adaptation dans le droit national. Ainsi, l'article 22 du RSGP impose aux Etat-membres de « conférer à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire » d'émettre cette injonction, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Par ailleurs, l'article 44 du règlement (UE) 2023/988 (RSGP) précise que les Etat-membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations du règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions conformément au droit national. Conformément au même article 44, la Commission devra avoir été informée de ces mesures additionnelles d'adaptation du droit national109(*).
Plus fondamentalement, en matière de surveillance du marché, ces modifications permettront de mieux responsabiliser les fournisseurs de places de marché en ligne, dans un contexte marqué par l'augmentation rapide des flux de produits en provenance de pays-tiers par l'intermédiaire de ces plateformes. Le pouvoir d'exiger des plateformes qu'elles retirent non seulement le produit litigieux signalé mais également les contenus identiques s'y référant permettra en effet une action consolidée à l'encontre d'un produit dangereux et d'éviter ses réapparitions, phénomène auquel les services d'enquête de la CCRF sont aujourd'hui régulièrement confrontés.
Certaines mesures de toilettage du code de la consommation sont par ailleurs nécessaires afin de supprimer les références à des articles abrogés et les remplacer par des références aux articles du règlement UE 2023/988.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette habilitation permettra aux agents de la CCRF d'émettre des injonctions de retraits des offres en ligne de produits dangereux et d'ainsi assurer une protection égale du consommateur que celui-ci achète en ligne ou en magasin physique. L'enjeu réside dans notre capacité à responsabiliser de la sorte les plateformes de vente en ligne au regard des produits circulant par leur intermédiaire. Ce nouveau pouvoir d'injonction a deux apports principaux :
- Il impose aux plateformes un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'injonction pour retirer les produits dangereux, ce qui n'est pas le cas pour les contenus dits « illicites » au sens du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Service Act), qui n'impose pas délai de traitement ;
- Il impose aux plateformes de retirer les contenus identiques au produit litigieux signalés afin que celui-ci soit définitivement retirer de la vente en ligne dans l'attente d'une mise en conformité.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée, l'adaptation du règlement UE 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits en droit interne étant obligatoire. L'emplacement choisi dans le code de la consommation est le seul possible afin d'être dûment intégré dans le champ de compétence et d'habilitation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est créé un article L. 521-18-1 afin d'habiliter les agents de la CCRF à mettre en oeuvre l'injonction décrite aux paragraphes 4 et 5 de l'article 22 du règlement UE 2023/988. Ce pouvoir permet d'enjoindre un fournisseur de place de marché en ligne à retirer un contenu relatif à un produit dangereux de son interface en ligne, d'en rendre l'accès impossible ou d'afficher un avertissement explicite. Le délai de traitement de l'injonction est de 48 heures ouvrées à compter de réception de l'injonction transmise par les autorités. L'article précise que la mise en oeuvre précise de cette injonction doit se faire selon les conditions et modalités définies dans ces mêmes paragraphes 4 et 5.
L'article L.521-12 est modifié pour intégrer la définition de l'obligation générale de sécurité telle que définie par le règlement UE 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, en lieu de l'article L.421-3 modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
L'article L.521-14 est modifié afin d'intégrer la référence au paragraphe 7 de l'article 9 du règlement UE 2023/988 relatif aux obligations des fabricants de produits soumis à l'obligation générale de sécurité d'accompagner leurs produits d'instructions et d'informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs.
L'article L.521-18 est modifié afin d'intégrer le règlement UE 2023/988. Il est ainsi précisé que lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit au présent article, il est réputé ne pas satisfaire à l'obligation générale de sécurité, en lieu de la référence à l'article L. 421-3.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le dispositif retenu créé un article dans le code de la consommation et en modifie trois autres.
- Il créé un article L. 521-18-1 ;
- Il modifie l'article L.521-12 ;
- Il modifie l'article L.521-14 ;
- Il modifie l'article L.521-18.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
S'agissant d'une mesure d'adaptation du droit national à un règlement européen, il est par définition en cohérence avec le droit européen en vigueur. Conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché, il est convenu que les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire d'émettre des injonctions, en l'occurrence de retrait d'offres en ligne de produits dangereux.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L'impact macroéconomique de l'habilitation créée pour les agents de la CCRF et des mesures d'adaptation de notre droit national est en tant que tel faible car peu dimensionnant prises isolément.
Cette nouvelle injonction s'inscrit en effet dans le cadre en cours de construction depuis plusieurs années de la régulation du commerce en ligne qui, dans son ensemble, vise à assurer la même protection du consommateur pour ses achats en ligne et en magasin physique. Prise dans son entièreté, cette régulation du commerce en ligne peut avoir des impacts macroéconomiques sur le niveau de la consommation sur ces plateformes ainsi que sur les entreprises européennes parfois concurrencées de façon déloyale par des fabricants hors Union européenne, qui sont souvent moins-disant dans le respect des normes européennes (en matière de sécurité des produits, d'impact environnemental, etc.).
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'injonction de retrait des produits dangereux vendus en ligne, compte tenu du nombre extrêmement élevé d'offres de produits mis en ligne par les places de marché, n'est pas susceptible en tant que tel d'impacter le modèle économique de ces dernières. Elle vise avant tout à les responsabiliser et à protéger le consommateur et l'empêcher de se procurer des produits qui pourraient le mettre en danger. L'injonction demeurant proportionnée et ciblée sur une référence précise de produits, la volumétrie relative de produits impactée demeure ainsi soutenable pour les plateformes.
Les entreprises européennes pourront être impactées positivement par un contrôle accru des produits dangereux vendus en ligne afin de limiter la concurrence déloyale vis-à-vis de produits en provenance de pays-tiers qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences et respect de normes de sécurité. Cette injonction permet en effet d'assurer que les opérateurs économiques vendant leurs produits en ligne soient soumis à un niveau d'exigence réhaussé en matière de sécurité des produits.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Ce nouveau pouvoir d'habilitation s'inscrivant dans le champ de compétence actuel des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il ne nécessite pas d'augmenter les moyens humains des corps de contrôle. Celui-ci renforce leur pouvoir et capacité d'action vis-à-vis d'acteurs émergents, les fournisseurs de place de marché en ligne, mais ne génère pas de transformations majeures nécessitant une augmentation des moyens humains en tant que tel. Des temps de formation seront nécessaires pour familiariser les enquêteurs et les agents d'administration centrale face à ce nouveau pouvoir d'injonction.
Il est toutefois à noter que ce nouveau pouvoir s'inscrit de manière générale dans l'accroissement des besoins de régulation du commerce en ligne qui, pour sa part, nécessite un renforcement des effectifs et des moyens budgétaires supplémentaires pour augmenter le nombre d'analyses de sécurité de produits prélevés en ligne.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Cette mesure visant à assurer un niveau de protection du consommateur renforcé lors de leurs achats en ligne, celle-ci ne peut leur être que bénéfique. En effet, l'objectif in fine, en responsabilisant davantage les fournisseurs de place de marché en ligne, est de réduire le nombre de produits dangereux vendus sur ces plateformes qui représentent des parts de marché significatives et qui se sont inscrites durablement dans les nouvelles habitudes d'achat des consommateurs français.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'a été conduite et aucune consultation facultative n'a été menée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions modifiant le code de la consommation s'appliqueront dans toutes les régions et départements d'Outre-mer.
Pour les collectivités de l'article 74, le livre IV du code de la consommation ne prévoit pas de dispositions relatives à l'Outre-mer. Les dispositions ne seront donc pas applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.
En revanche, conformément aux dispositions des articles LO6413-1, LO6213-1 et LO6313-1 du Code général des collectivités territoriales, les dispositions s'appliqueront de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la répression des fraudes ne faisant pas partie des matières de la compétence de ces collectivités.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucun texte d'application.
Article 20 et 21 - Transposition de la directive 2024/825 en faveur de la transition verte
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 114 et 169 du TFUE) et la charte des droits fondamentaux (article 38) exigent un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'Union. La législation de l'Union en matière de protection des consommateurs contribue également au bon fonctionnement du marché unique. Elle vise à faire en sorte que les relations entre entreprises et consommateurs soient loyales et transparentes et, en définitive, contribuent au bien-être des consommateurs européens et à l'économie de l'UE.
Dans cette logique, la directive (UE) 2024/825 vise à renforcer les droits des consommateurs en modifiant deux directives qui protègent les intérêts de ces derniers au niveau de l'Union : la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Plus précisément, l'objectif de cette directive est de contribuer à une économie européenne circulaire, propre et verte en permettant aux consommateurs de prendre des décisions d'achat en connaissance de cause et, partant, de contribuer à une consommation plus durable. La directive vise également les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les détournent de choix de consommation durables. En outre, elle garantit une application plus efficace et plus cohérente des règles de l'UE en matière de protection des consommateurs.
L'adoption de ce texte repose sur plusieurs constats préoccupants. Dans une étude réalisée en 2020 sur 150 allégations environnementales110(*) la Commission européenne a révélé que 53,3 % d'entre elles étaient vagues, trompeuses ou infondées concernant les caractéristiques environnementales des produits et que 40 % d'entre elles n'étaient pas du tout étayées. Cette même étude a également recensé plus de 230 labels environnementaux sur le marché européen, qu'ils soient publics ou privés, et constaté que la moitié d'entre eux étaient accordés sans que les vérifications adéquates soient effectuées. Par ailleurs, à l'heure actuelle, seuls 35 % des labels de durabilité exigent la présentation de données spécifiques prouvant la conformité avec les exigences en matière d'étiquetage.
La directive s'inscrit dans le nouveau cadre plus large du nouvel « Agenda du consommateur 2025-2030 » et du plan d'action pour une économie circulaire proposé dans le prolongement du Pacte vert pour l'Europe. Le principe selon lequel il faut donner aux consommateurs les moyens d'agir et leur permettre de profiter de réductions de coûts est l'un des fondements du cadre d'action pour des produits durables. Il convient à cette fin d'améliorer la participation des consommateurs à l'économie circulaire, notamment en fournissant à ces derniers, avant qu'ils ne contractent, de meilleures informations sur la durabilité et la réparabilité de certains produits, et en renforçant la protection de ces consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales qui empêchent les achats durables, telles que :
§ Les pratiques d'écoblanchiment, à savoir l'utilisation d'allégations environnementales disproportionnées, fausses ou ne pouvant être justifiées et donc considérées comme trompeuses (e.g. allégations relatives à la neutralité carbone, à l'écoconception des produits ou à un impact environnemental réduit) ;
§ Les pratiques d'obsolescence précoce (entraînant des défaillances prématurées des biens) ;
§ L'utilisation de labels de durabilité et d'outils d'information non-fiables et non transparents (e.g. des labels monocritères et internes à une société).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En application de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les directives adoptées au niveau des instances de l'UE doivent faire l'objet d'une transposition par les Etats membres afin qu'elles aient force de loi dans lesdits États.
Conformément à l'article 288 du TFUE la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. Les mesures nationales doivent ainsi permettre d'atteindre les objectifs définis par la directive selon les modalités propres qu'elles définissent.
Une fois adoptées les mesures nationales doivent être communiquées à la Commission européenne. En cas de défaut de transposition, la Commission peut engager une procédure d'infraction contre l'Etat concerné auprès de la Cour de justice de l'UE.
C'est dans ce cadre que la présente disposition législative vise à permettre la mise en oeuvre dans le droit français de la directive (UE) 2024/825 qui a pour principal objectif de renforcer les droits des consommateurs en modifiant deux directives qui protègent les intérêts de ces derniers au niveau de l'Union : la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La France faisait figure de précurseur en matière de lutte contre l'écoblanchiment, notamment avec l'adoption de la loi AGEC en 2020 et Climat et Résilience en 2021, laquelle avait introduit des obligations spécifiques et des sanctions renforcées pour encadrer les allégations environnementales. Ce cadre national allait, sur certains points, au-delà des exigences alors posées par le droit européen, ce qui est permis lorsque les dispositions ont pour objectif la protection de l'environnement notamment.
Toutefois, la transposition dans les droits nationaux de la directive (UE) 2024/825 permettra une harmonisation des législations au niveau de l'Union européenne, imposant des règles communes en matière de transparence et de fiabilité des informations délivrées aux consommateurs. Cette convergence devrait permettre, à l'échelle européenne, une meilleure protection des consommateurs et la garantie d'une concurrence plus équitable entre opérateurs économiques.
A ce jour, aucun élément concernant la transposition par les autres Etats membres de la directive (UE) 2024/825 n'est disponible dans la mesure où l'échéance de transposition est fixée au 27 mars 2026.
Au niveau européen, quelques décisions emblématiques111(*), rendues récemment dans plusieurs États membres de l'Union européenne, traduisent cependant une prise de conscience accrue, tant du côté des juridictions que de la société civile. Ces différentes affaires, bien qu'hétérogènes dans leurs conclusions et leurs effets, dessinent les premiers contours d'une jurisprudence européenne en matière d'allégations environnementales trompeuses traduisant la montée progressive d'une réponse judiciaire à ce phénomène.
Ces décisions récentes, bien que disparates et encore limitées en nombre au regard du volume des allégations trompeuses112(*), traduisent une volonté croissante des juridictions européennes de se saisir des enjeux liés à l'écoblanchiment. Elles montrent que les autorités administratives et les juges nationaux commencent à intégrer les spécificités des allégations environnementales dans leur analyse juridique. Néanmoins, cette jurisprudence demeure encore parcellaire et inégalement partagée selon les États membres, soulignant la nécessité d'adopter une législation spécifique aux allégations environnementales.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
A la suite de l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/825, le droit interne doit être modifié pour être conforme au droit européen. La modification à opérer pour assurer la conformité au droit européen est de niveau législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article 20 vise à mettre en conformité le droit national avec la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil. L'essentiel de la transposition sera opéré au sein du code de la consommation et de façon plus marginale au sein du code de l'environnement (article 1).
Ces nouvelles dispositions permettront à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent le consommateur en erreur et l'empêchent de faire des choix de consommation durable, en particulier les pratiques liées à l'obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses, aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ou aux labels de développement durable non transparents et non crédibles.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La transposition de la directive 2024/825 dans le code de la consommation par les mesures législatives prévues par l'article 20 du présent projet de loi est la seule option de transposition qui a été envisagée, dans la mesure où cette directive modifie d'autres directives (2005/29/CE et 2011/83/UE) précédemment transposées dans ce code.
Par ailleurs, afin de satisfaire à l'exigence d'un transposition conforme, l'article 21 du projet de loi aménage les dispositions du code de l'environnement :
§ En supprimant les dispositions de ce code relatives à l'interdiction des allégations portant sur la neutralité carbone d'un produit ou d'un service, couverte, désormais, par la prohibition, dans le code de la consommation, de pratiques commerciales ayant cet objet et considérées comme trompeuses en toutes circonstances ;
§ En complétant les dispositions du code de l'environnement interdisant les allégations environnementales globalisantes par un renvoi aux dispositions du code de la consommation les considérant comme des pratiques commerciales trompeuses dès lors que l'excellente performance environnementale reconnue du produit ou de l'emballage, en rapport avec l'allégation, n'est pas démontrée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Seule une modification de la loi permet d'intégrer les nouvelles dispositions prévues par la directive 2024/825, dans la mesure où celle-ci modifie des dispositions de deux directives déjà transposées en droit français par la voie législative.
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
L'article L. 121-2 du code de la consommation est modifié pour préciser d'une part que les caractéristiques environnementales ou sociales, les aspects liés à la circularité (tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité) sont des éléments sur lesquels peut être fondée une pratique commerciale trompeuse sur les caractéristiques essentielles du bien.
D'autre part, une nouvelle pratique commerciale est ajoutée pour encadrer les allégations environnementales futures de type « neutralité carbone en 2050 » ou encore « X% de réduction de gaz à effet de serre en 2030 ». Désormais, le droit européen exige que le professionnel mette en place une procédure pour justifier ces allégations. Ainsi, une pratique commerciale pourra être reconnue trompeuse en présence d'« une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l'affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ; » sur la base d'une évaluation au cas par cas de l'altération potentielle du comportement économique du consommateur.
Enfin, une dernière pratique commerciale est ajoutée et pourra être reconnue trompeuse sur la base d'une évaluation au cas par cas de l'altération potentielle du comportement économique du consommateur lorsqu'elle « attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d'une entreprise sans que cela soit pertinent, ni ne résulte d'une caractéristique propre à ce produit ou à l'activité de cette entreprise. »
L'article L. 121-3 du code de la consommation est également modifié pour ajouter deux pratiques commerciales trompeuse par omission, qui consiste à omettre, dissimuler ou fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur qui l'empêche de prendre une décision d'achat éclairée : « Lorsqu'un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d'information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s'y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l'objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour.».
L'article L. 121-4 du même code est modifié pour ajouter 12 pratiques présumées trompeuses en toutes circonstances et donc interdites, celles qui sont ajoutées à l'annexe 1 de la directive 2005/29/CE modifiée par la directive (UE) 2024/825. Pour ces pratiques, il n'est pas nécessaire de démontrer l'altération du comportement économique du consommateur. Il s'agit de :
« 2° bis De présenter un label de développement durable qui n'est fondé ni sur un système de certification au sens de l'article L. 434-1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ; »
« 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale du bien ou du service concerné, ou lorsque cette dernière est démontrée, est sans lien avec celle-ci. L'excellente performance environnementale est reconnue conformément à l'une au moins des normes suivantes : [...] »
Sur le label de développement durable
Par ailleurs, afin de transposer la définition du label de développement durable, il convient de créer un chapitre IV intitulé « Label de développement durable » au sein du titre III du livre IV du code de la consommation. Ce nouvel encadrement des labels de développement durable implique l'intervention de tiers indépendants, afin de garantir la fiabilité du processus de labellisation et la conformité des produits aux critères du label. Ainsi, la directive fixe des obligations de moyens mais ne traite pas du contenu du label en tant que tel.
En conséquence, elle définit des garanties procédurales comme le caractère public et non-discriminatoire du cahier des charges, l'existence d'une procédure de retrait du label en cas de non-respect des critères et la vérification par un organisme tiers. Malgré son nom, ce nouveau dispositif est différent de la certification de conformité encadrée par les articles L. 433-3 et suivants du code de la consommation, car le tiers qui vérifie le respect des critères n'est pas obligatoirement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Il doit toutefois présenter des garanties d'indépendance et de compétence vis-à-vis du professionnel qui sollicite le label de développement durable et le propriétaire de ce label.
Sur les informations précontractuelles
Plusieurs modifications sont apportées aux articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. D'une part, sur le fond, les éléments nouveaux ajoutés par la directive 2024/825 sont intégrés. Il s'agit de :
§ La référence expresse à la garantie commerciale de durabilité. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d'exécution de la Commission pris en application de l'article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiée par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024
§ l'information sur la durée de la fourniture des mises à jour pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques ;
§ l'indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l'Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation.
D'autre part, sur la forme, il est procédé à un alignement de l'article L. 221-5 sur l'article L. 111-1 afin que les obligations d'informations précontractuelles soient dans une grande mesure symétrique (vente physique ou vente à distance) à l'instar du droit européen (articles 5 et 6 de la directive 2011/83).
L'exercice de transposition implique la nécessité d'abroger l'article L.111-6 du code de la consommation (information sur la durée de fourniture de la mise à jour). Cet article, issu de la loi n°2021-1755 relative à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique (dite « Loi Chaize »), impose aux producteurs de biens intégrant des éléments numériques une obligation d'information. Ceux-ci doivent indiquer au vendeur professionnel la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles qu'ils fournissent restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur est ensuite tenu de transmettre cette information au consommateur. L'article 2 de la directive 2024/825 n'impose pas directement cette obligation aux producteurs. Elle prévoit seulement que le vendeur professionnel informe le consommateur de la durée minimale pendant laquelle des mises à jour logicielles seront fournies pour les biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques ou des services numériques, mais uniquement si ces informations lui ont été communiquées par le producteur ou le fournisseur. Il apparaît donc nécessaire d'harmoniser l'obligation d'information prévue par le droit français avec celle prévue par la directive 2024/825 en abrogeant l'article L. 111-6 du code de la consommation.
L'article L. 221-14 du code de la consommation est également modifié pour tenir compte des modifications de l'article 8 de la directive (UE) 2011/83 s'agissant de l'obligation, pesant sur le professionnel pour les contrats conclus par voie électronique, de rappeler au consommateur les éléments essentiels du contrat avant qu'il ne passe sa commande. A cet égard, il est ajouté « Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité s'appliquant à l'ensemble du bien et d'une durée de plus de deux ans et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° de l'article L. 221-5, que le bien bénéficie d'une telle garantie, la durée de celle-ci et l'existence de la garantie légale de conformité. ».
D'autres modifications de mise en cohérence sont opérées au sein du code de la consommation (L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-3-1, L. 132-2, L. 217-23).
Sur les dispositions modifiant le code de l'environnement
Au niveau national, l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement issu de l'article 13 de la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020, dite loi « AGEC » dispose : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions "biodégradable", "respectueux de l'environnement" ou toute autre mention équivalente ». Le guide relatif aux allégations environnementales du Conseil national de la consommation a précisé une liste (non exhaustive) de mentions équivalentes. Le législateur a ainsi entendu proscrire de telles allégations environnementales pouvant présenter, en l'état de la technique, un caractère trompeur ou ambigu pour le consommateur susceptible de susciter la confusion sur le geste de tri ou l'incidence du produit sur l'environnement.
Au niveau européen, la directive (UE) 2024/825 présentement transposée vise, d'une part, à permettre au consommateur d'adopter des comportements d'achats plus durables en lui garantissant une meilleure information sur la durabilité et la réparabilité des biens et, d'autre part, à le protéger contre des pratiques commerciales reposant sur des allégations environnementales trompeuses tendant à l'écoblanchiment, nuisibles à la transition écologique de l'économie. A cet égard, la directive ajoute notamment douze nouvelles pratiques à l'annexe I de la directive 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales. Il s'agit d'une liste noire de pratiques présumées trompeuses en toutes circonstances et donc interdites per se.
Ainsi, alors que le droit européen autorise ces mentions dès lors qu'elles sont justifiées par la satisfaction d'exigences précises (labellisation de type I reconnue ou équivalence, pour autant que cette labellisation soit en lien direct avec l'allégation concernée), le droit national prévoit quant à lui leur interdiction absolue.
Par conséquent, pour se conformer au droit européen, il convient de modifier le quatrième alinéa de l'article L. 541-9 du code de l'environnement. En effet, même si la finalité initiale ayant motivée cette disposition dans la loi AGEC était liée à la protection de l'environnement et à la prévention et à la gestion des déchets, l'introduction dans l'annexe I de la directive 2005/29/CE d'un 4 bis complétant la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances et visant la pratique ayant pour objet de « Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation » a pour conséquence de faire basculer la question de l'interdiction des allégations génériques déloyales dans le champ de la protection des intérêts économiques des consommateurs puisque la directive 2005/29/CE ne vise qu'à la préservation de ce type d'intérêt. Aussi, la mesure proposée prend en compte l'évolution du droit européen, elle maintient l'interdiction en assurant l'articulation avec le code de la consommation. Elle rend plus visible l'apport de la directive qui encadre strictement ces allégations sur tous types de support et pas seulement sur les produits et les emballages. Ainsi, seuls les produits qui présentent une excellente performance environnementales reconnue peuvent en bénéficier et sous réserve que l'allégation soit en lien avec celle-ci, sous peine de constituer une pratique commerciale trompeuse, délit qui est puni en application de l'article L. 132-2 du code de la consommation, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Cet article sera modifié pour que l'aggravation du taux concerne toutes les pratiques commerciales trompeuses en matière d'allégations environnementales.
Par ailleurs, les contrôles de ces allégations environnementales génériques par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront désormais fondés sur le seul code de la consommation (suppression des habilitations et sanction de l'interdiction issue du code de l'environnement).
Par ailleurs, l'article L. 229-68 du code de l'environnement, issu de la loi Climat et résilience de 2021, interdit les allégations de neutralité carbone à condition de fournir au public certaines informations113(*). Ainsi, moins qu'une interdiction en tant que telle c'est davantage une obligation de transparence puisque ces allégations demeurent autorisées sous conditions. Ce dispositif vise à garantir une information complète du public sur les allégations de neutralité carbone, à favoriser les engagements des annonceurs tout en luttant contre l'écoblanchiment. Son non-respect expose le professionnel à une peine d'amende. Cette réglementation, suivie par la DGEC et applicable depuis le 1er janvier 2023, a conduit l'administration à avoir des échanges avec plusieurs entreprises, suite ou non à un signalement, qui ont permis d'aboutir à la suppression ou à la mise en conformité de certaines allégations de neutralité mais aucune sanction n'a été donnée.
La directive (UE) 2024/825 adoptée postérieurement à la loi Climat et résilience prévoit d'ajouter à la liste noire des pratiques commerciales présumées trompeuses en toutes circonstances et donc interdites, figurant à l'annexe 1 de la directive 2005/29 le fait pour un professionnel de : « Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre ». Cette interdiction induira un changement notable dans les pratiques des annonceurs et marque un pas en avant significatif dans la lutte contre l'écoblanchiment. En effet, il ne serait plus possible pour une entreprise de faire un lien dans ses allégations entre un usage de crédits carbone et l'impact en termes de gaz à effet de serre de ses produits ou de ses services114(*).
En conséquence, la transposition de cette pratique interdite au sein de l'article L.121-4 du code de la consommation emporte la nécessité d'abroger l'encadrement prévu au sein de la section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Article 20 : Les mesures envisagées modifient l'article liminaire du code de la consommation ainsi que les articles L.111-1, L. 111-6, L. 121-2, L.121-3, L.121-4, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-3-1, L. 132-2, L. 217-23, L. 221-5, et L. 221-14 du code de la consommation.
Il est précisé que les articles L. 121-2 et L. 121-3 sont modifiés parallèlement par l'article 18 du présent projet de loi. Ces modifications poursuivent des objectifs distincts : la mise en conformité du droit national à la suite d'une procédure EU pilot conduite par les services de la Commission sur la transposition de la directive (UE) 2019/2161 d'une part et la transposition de la directive (UE) 2024/825 d'autre part.
Les mesures envisagées créent par ailleurs, au sein du titre III du livre IV du code de la Consommation un chapitre IV intitulé « label de développement durable », contenant un nouvel article L. 434-1.
Article 21 : Les articles L. 541-9-1, L. 541-9-4-1 et L. 511-7 du code de l'environnement sont modifiés. La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est abrogé.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente mesure vise une mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure obligera les entreprises à faire preuve d'une rigueur et d'une transparence accrues dans la communication sur leurs performances environnementales ou celles de leurs produits. Pour mémoire, toute allégation environnementale devra être fondée sur des données objectives, vérifiables et facilement accessibles. Cela impliquera pour certaines entreprises, une révision de leur stratégie de communication et de marketing, afin d'assurer leur conformité avec les nouvelles exigences réglementaires.
S'agissant des allégations portant sur des performances environnementales futures, la directive impose des engagements concrets assortis d'objectifs mesurables et d'un mécanisme de suivi indépendant. Cela engendrera des coûts supplémentaires pour les entreprises, liés à l'évaluation, à la vérification des engagements et à la mise à disposition publique des résultats.
Par ailleurs, la directive prévoit l'instauration d'un nouveau cadre pour les labels de développement durable. L'article 1er de la directive (UE) 2024/825 qui modifie la directive 2005/29/CE prévoit un nouvel encadrement de la procédure d'attribution et de retrait des labels de développement durable définis comme : « tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l'Union ou du droit national ». Ainsi, l'étiquette énergie prévue par le Règlement (UE) 2017/1369 ou encore l'indice de durabilité prévu par l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement ne sont pas considérés comme des labels de développement durable.
Désormais, il sera interdit aux professionnels d'afficher un label de développement durable s'il n'est pas fondé sur un système de certification respectant les exigences115(*) fixées par la directive ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques.
Ce nouvel encadrement des labels de développement durable implique l'intervention de tiers indépendants, afin de garantir la fiabilité du processus de labellisation et la conformité des produits aux critères du label. Ainsi, la directive fixe des obligations de moyens mais ne traite pas du contenu du label en tant que tel. En conséquence, elle définit des garanties procédurales comme le caractère public et non discriminatoire du cahier des charges, l'existence d'une procédure de retrait du label en cas de non-respect des critères et la vérification par un organisme tiers. Malgré son nom, ce nouveau dispositif est différent de la certification de conformité encadrée par les articles L. 433-3 et suivants du code de la consommation, car le tiers qui vérifie le respect des critères n'est pas obligatoirement accrédité par le COFRAC. Il doit toutefois présenter des garanties d'indépendance et de compétence vis-à-vis du professionnel qui sollicite le label de développement durable et le propriétaire de ce label.
De nombreux labels privés existants ne répondent pas encore à ces exigences, ce qui impliquera des modifications en profondeur. Leur mise en conformité impliquera des coûts pour les entités qui souhaiteront bénéficier de ces labels (notamment le recours obligatoire à un tiers indépendant, bien qu'il renforce la fiabilité du processus, constitue un facteur d'augmentation des coûts) ce qui pourrait dissuader certains acteurs de s'engager dans une telle démarche. Ces exigences risquent de pénaliser davantage les petites structures, notamment les associations, dans la mesure où la directive ne prévoit pas de traitement différencié selon la taille des entités concernées.
Toutefois, la mise en oeuvre de ce dispositif permettra de lutter plus efficacement contre les pratiques d'écoblanchiment fondées sur l'usage abusif de labels environnementaux dépourvus de contrôle ou de crédibilité, source de distorsions de concurrence entre, d'une part, les entreprises réellement engagées dans une démarche de protection de l'environnement qui soumettent tout ou partie de leurs activités aux exigences d'un label environnemental fiable et, d'autre part, celles qui se contentent de formuler des allégations environnementales sans modifier concrètement leurs pratiques.
En contrepartie, ce nouveau schéma renforcera le rôle des tiers indépendants, qui deviendront des acteurs clés du processus de labellisation et verront leurs activités économiques croître de manière significative.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'encadrement des labels de développement durable ne s'applique pas aux labels mis en place par des autorités publiques. Ces dispositions sont donc sans effet sur les collectivités territoriales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La transposition de la directive (UE) 2024/825 aura un impact positif sur les autorités de contrôle chargées de la protection des consommateurs, en facilitant leur action contre les pratiques commerciales trompeuses (PCT) liées aux allégations environnementales.
En intégrant explicitement certaines pratiques de greenwashing, d'obsolescence programmée ou d'utilisation de labels non fiables dans la « liste noire » des pratiques commerciales présumées trompeuses en toutes circonstances et donc interdites, la directive fournit aux agents de la DGCCRF un cadre juridique renforcé et plus facilement mobilisable (puisqu'il ne sera plus nécessaire de démontrer l'altération du comportement économique du consommateur), ce qui simplifiera la qualification des pratiques et la mise en oeuvre des sanctions.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure a un impact sur la société puisqu'elle a pour objectif de promouvoir une consommation plus durable. Le ciblage spécifique des pratiques d'écoblanchiment et l'usage abusif de labels environnementaux non vérifiés, montre une volonté claire du législateur de rétablir la confiance des consommateurs dans les messages écologiques véhiculés par les entreprises. En contraignant les entreprises à fonder leurs allégations environnementales sur des engagements concrets, mesurables et vérifiables, la mesure incite à un changement structurel des stratégies marketing et industrielles. Elle érige la lutte contre les abus environnementaux en priorité politique, renforçant le rôle des consommateurs comme acteurs de la transition verte.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure aura un impact positif sur les particuliers consommateurs, dès lors qu'elle a pour objet d'introduire dans le droit de l'Union en matière de consommation des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et donne aux consommateurs davantage d'informations leur permettant de faire des choix de consommation durables.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure vise à rendre l'information aux consommateurs plus fiable en matière environnementale, leur permettant de faire des choix éclairés et plus durables. Elle permet également d'éviter une distorsion de concurrence en favorisant la promotion de biens ou de services, et de manière générale de pratiques plus vertueuses. Ainsi, indirectement, la mesure s'inscrit dans le cadre de la transition écologique et plus particulièrement du développement durable.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été menée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entreront en vigueur le 27 septembre 2026, conformément à l'article 4 de la directive (UE) 2024/825. Il est à noter qu'aucune disposition transitoire n'est prévue par la directive pour la mise en conformité des labels existants.
5.2.2. Application dans l'espace
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions des présents articles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Elles s'appliquent également à Saint-Martin qui est assujetti au droit européen.
5.2.3. Textes d'application
Un décret pris en Conseil d'Etat sera nécessaire pour compléter la transposition de la directive (UE) 2024/825 s'agissant des dispositions relatives à l'information des consommateurs (modification de la directive (UE) 2011/83).
Par ailleurs, certaines dispositions réglementaires du code de l'environnement devront être abrogées.
Article 22 - Achèvement de la transposition de la directive 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le droit des pratiques restrictives de concurrence a pour objet d'assurer l'équilibre et la loyauté des relations commerciales.
Depuis près de 40 ans, le législateur français et la jurisprudence ont affiné ces dispositions et ont permis la mise en place, au sein du titre IV du livre IV du code de commerce, d'un corpus législatif visant à garantir des relations commerciales équilibrées et loyales entre les acteurs économiques.
Les dispositions prises en droit français pour assurer la transposition de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (ci-après, directive « PCD ») sont donc venues enrichir un cadre juridique déjà très développé. C'est la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière qui a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de cette directive. L' ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire a ensuite été publiée le 30 juin 2021.
Depuis l'adoption de cette ordonnance, le cadre légal a été complété par :
- la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs : la loi rend obligatoire la conclusion de contrats écrits et pluriannuels lors de la vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur, sauf exception. La loi rend non-négociable, entre les industriels et leurs acheteurs professionnels (sauf grossistes), la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles. Les contrats entre fournisseurs et distributeurs doivent contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l'évolution du coût des matières premières agricoles. Une clause générale de renégociation des prix est créée et sera activable en fonction de l'évolution des coûts comme l'énergie, le transport ou les emballages. Les pénalités logistiques infligées par les distributeurs aux fournisseurs sont strictement encadrées.
- la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (dite Egalim 3) : la loi précise le cadre dans lequel s'inscrivent les cocontractants lorsque la négociation annuelle échoue, augmente la sanction à l'encontre des acteurs ne respectant pas la date butoir du 1er mars pour la signature des contrats entre fournisseurs et distributeurs, elle soumet au droit et aux tribunaux français les contrats négociés entre les fournisseurs et les enseignes de la grande distribution via les centrales d'achat basées à l'étranger, elle renforce l'encadrement des pénalités logistiques.
- la loi n°2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : prolongation jusqu'au 15 avril 2028 du relèvement de 10 % du seuil de revente à perte, dont le périmètre est expressément étendu aux produits vendus sous marque de distributeur (MDD), ainsi que celle de l'encadrement des promotions destinées aux consommateurs à tous les produits de grande consommation, à 34 % de leur valeur pour les produits alimentaires et à 40 % de leur valeur pour les produits de la droguerie-parfumerie-hygiène. Les promotions sont également encadrées en volume à hauteur de 25% sur tous les PGC, la mesure ayant également été prolongée par la loi du 14 avril 2025 jusqu'en. La loi renforce également les sanctions applicables en cas d'infraction à l'interdiction de revente à perte ou de non-respect de l'obligation pour les distributeurs de communiquer à l'administration la part du surplus de marge généré par la majoration du SRP qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs (jusqu'à 0,4 % du chiffre d'affaires des distributeurs).
Garant de la protection de l'ordre public économique, le ministre de chargé de l'Economie dispose du pouvoir de saisir le juge judiciaire pour voir condamner un acteur économique qui ne respecte pas ces règles de transparence et de loyauté. Ainsi, le ministre peut intervenir dans ces relations commerciales et assigner devant les juridictions civiles de tels acteurs économiques aux fins de demander au juge qu'il sanctionne les pratiques commerciales déloyales. Les amendes civiles pouvant être prononcées par le juge peuvent atteindre 5 millions d'euros, le triple des sommes indument perçues ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est, quant à elle, dotée de pouvoirs de sanction. Les sanctions administratives qu'elle peut prononcer sont principalement encourues en cas de non-respect de certaines dispositions régissant le formalisme obligatoire des contrats.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé à cinq reprises sur la conformité du droit national des pratiques commerciales restrictives de concurrence à la Constitution (décisions QPC 2010-85, 2011-126, 2016-542, 2018-749 et 2022-1011). Il en résulte une jurisprudence bien établie dont il ressort qu'« il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ». Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions de lutte contre les pratiques commerciales déloyales sont fondées sur un impératif d'ordre public économique et visent à maintenir un équilibre dans les relations commerciales. La liberté d'entreprendre peut alors être limitée au regard de ce fondement.
La proportionnalité des sanctions prévues par le présent article ne soulève pas de difficultés particulières. En effet, pour ce qui est de l'interdiction d'annulation de commande de produits alimentaires périssables à brève échéance, elle préexistait, n'est pas modifiée et reste donc fixée à 375.000 euros. Or il s'agit d'un montant identique à celui des amendes frappant de nombreux manquements passibles de sanctions administratives dans le titre IV du livre IV du code de commerce (ex : article L. 441-6 pour certains manquements au formalisme contractuel obligatoire entre fournisseurs et distributeurs et article L. 441-9 pour les manquements aux règles de facturation). Le formalisme auquel la participation du fournisseur aux coûts liés aux remises sur ses produits dans le cadre d'actions promotionnelles et aux coûts liés à la publicité doit être conforme est assorti d'une amende administrative du même montant, soit 375.000 euros. Il en est de même pour l'interdiction pour l'acheteur de modifier unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture. Ces amendes ne sauraient donc être regardées comme étant disproportionnées.
En outre, aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
D'après l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les institutions peuvent prendre des directives pour exercer les compétences de l'Union. C'est un acte de droit dérivé fixant un objectif à atteindre aux Etats membres tout en leur laissant une liberté de choix quant à la forme et aux méthodes pour y parvenir.
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de confirmer la conformité à la Convention européenne des droits de l'Homme de l'action judiciaire du ministre en matière de pratiques restrictives de concurrence, ainsi que des sanctions qu'il peut demander au juge judiciaire de mettre en oeuvre, notamment dans sa décision récente du 1er octobre 2019 (CEDH, 1er octobre 2019, Req. 37858/14, Carrefour France c/ France).
Les institutions européennes ont également déjà confirmé la conformité du droit national des pratiques restrictives de concurrence au droit communautaire. D'une part, le règlement CE n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence réserve la possibilité aux Etats-membres de mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise, à l'instar du droit français des pratiques restrictives. D'autre part, dans son arrêt du 24 novembre 1993, « Keck et Mithouard » (affaires jointes C-267/91 et C-268/91), la CJCE a affirmé que la législation française interdisant de façon générale la revente à perte (article L. 442-5 du code de commerce) ne constituait pas un obstacle à la libre circulation des marchandises.
Ainsi, les dispositions de la directive en droit national ont été intégrées dans un ensemble législatif respectueux du cadre conventionnel.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire s'est inscrite dans la continuité des réflexions menées par les institutions européennes sur la nécessité de proposer des règles communes relatives aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises.
La France a été attentive à deux points majeurs au cours de la négociation de cette directive : le principe d'une harmonisation minimale, préservant les acquis importants du droit national, et la compétence des autorités nationales pour poursuivre les auteurs de pratiques commerciales déloyales, garantissant que chaque Etat-membre conserve l'opportunité des poursuites.
Le choix d'une directive d'harmonisation minimale a toujours été fortement défendu par la France. En effet, un tel niveau d'harmonisation doit permettre à la France de s'assurer que les fournisseurs conservent le bénéfice d'un haut niveau de protection sur le marché français, particulièrement marqué par un fort déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des produits de grande consommation, notamment alimentaires.
Les choix retenus dans cette directive, qu'il s'agisse de la liste des pratiques interdites (comme les paiements tardifs, les annulations de commande à brève échéance ou encore les modifications unilatérales ou rétroactives des contrats) ou de l'application de ces règles par des autorités de contrôle amenées à coopérer entre elles, constituent un standard minimal de protection des entreprises implantées au sein de l'Union européenne.
Le texte a également retenu une solution très protectrice pour les fournisseurs concernant la détermination de l'autorité compétente pour traiter les plaintes, notamment dans le cas de pratiques transfrontalières.
Cette question de l'autorité compétente a constitué un point juridique fondamental. En effet, pour la France, le choix de l'autorité compétente pour sanctionner des pratiques déloyales ne devait pas dépendre du lieu d'implantation de l'acheteur, qui est parfois établi dans un pays où il n'a aucune activité de distribution. Si la directive avait retenu le principe selon lequel l'autorité compétente est celle du lieu de résidence de l'acheteur, cela aurait obligé les fournisseurs français à saisir une autorité de contrôle d'un autre pays (notamment ne parlant pas leur langue) afin de demander l'arrêt des pratiques déloyales menées par un acheteur (centrale d'achat par exemple) implanté à l'étranger).
Dans cette optique, le choix défendu par la France lors des négociations, qui a finalement été retenu, désignant l'autorité de contrôle compétente comme celle qui reçoit la plainte du fournisseur, semble être la solution la plus pertinente pour protéger les fournisseurs. La pertinence de cette règle sera par ailleurs assurée grâce au principe de coopération qui amènera les autorités compétentes à échanger et à travailler ensemble face à des cas de pratiques transfrontalières.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le titre IV du livre IV du code de commerce encadre les relations commerciales et vise à assurer leur transparence, loyauté et équilibre.
Dans ce cadre, le ministre peut intervenir en tant que garant de l'ordre public économique notamment lorsque :
- un acteur économique a obtenu de son partenaire contractuel un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné par rapport à la contrepartie consentie (article L. 442-1 I 1° du code de commerce).
- un acteur économique a soumis ou tenté de soumettre son partenaire contractuel à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 I 2° du code de commerce).
Cette notion de déséquilibre significatif introduite en 2008 dans la réglementation française est fondamentale et a donné lieu à une jurisprudence abondante et riche116(*) sur les comportements constituant ou non une telle pratique illicite. La notion de soumission ou de tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties a ainsi vocation à sanctionner toute clause ou pratique abusive, injustifiée et non réciproque, imposée à une partie en position de soumission et sans marge réelle de négociation.
Compte-tenu de cette législation sur la régulation des relations commerciales et de la jurisprudence qui l'accompagne, les autorités françaises ont considéré que la plupart des pratiques commerciales déloyales prohibées par la directive 2019/633 étaient déjà largement interdites en droit français.
Dans le cadre de la transposition de la directive 2019/633, qui est un texte d'harmonisation minimale, les autorités françaises ont légitimement souhaité maintenir le niveau de protection élevé en matière de pratiques commerciales déloyales qu'offre le droit français. Elles ont ainsi estimé que plusieurs pratiques commerciales prohibées par la directive étaient d'ores-et-déjà couvertes par ce droit national. Les autres pratiques commerciales prohibées par la directive qu'elles ont estimé ne pas pouvoir être appréhendées par le droit national préexistant ont fait l'objet d'une transposition expresse dans l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
C'est la raison pour laquelle la transposition de la directive 2019/633 ne s'est pas traduite en France par un ajout à l'identique des dispositions de la directive, mais par une incorporation de la directive au droit existant.
Cependant, la Commission européenne estime que certaines dispositions prévues dans la directive 2019/633 n'ont pas fait l'objet d'une transposition satisfaisante en droit français. Elle a ainsi initié le 13 janvier 2023 une procédure dite « EU PILOT » pour violation éventuelle de la directive sur les pratiques commerciales déloyales à l'encontre des autorités françaises. Ces dernières ont adressé une note des autorités françaises à la Commission le 6 juin 2023 pour défendre la conformité à la directive PCD des mesures de transposition prises en droit français. La Commission a répondu aux autorités françaises le 7 mai 2024 en réitérant ses doutes sur la bonne transposition en droit français de certaines prescriptions de la directive et en indiquant que sur d'autres points, elle jugeait les éléments de réponse des autorités françaises satisfaisants. Par NAF du 9 décembre 2024, les autorités français ont réitéré leurs arguments précédemment invoqués.
Cependant, afin d'éviter l'engagement d'une procédure d'infraction à l'encontre de la France, les autorités françaises ont concédé à la Commission qu'il semblait nécessaire de modifier le droit français en reprenant une rédaction conforme à la directive afin de couvrir les situations dans lesquelles un délai d'annulation de commande supérieur à 30 jours pour des produits alimentaires périssables pourrait être considéré comme une annulation à trop brève échéance, alors que le droit français actuel prévoit que seules les annulations de commande dans un délai inférieur à 30 jours constituent des annulations réalisées à trop brève échéance.
Il est aussi nécessaire de prévoir un nouvel article dans le code de commerce comportant certaines dispositions concernant le formalisme contractuel encadrant les actions promotionnelles et les services de publicité dont le paiement est demandé au fournisseur par l'acheteur et étendant l'application de ce formalisme à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi qu'à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires. Il correspond à des pratiques dites grises de la directive, qui ne sont licites que sous réserve d'avoir été expressément stipulées par les parties dans le contrat régissant leurs relations, dans des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté. Cet article portera également interdiction de la modification unilatérale d'un contrat, dans le cadre de la vente de produits agricoles et agroalimentaires, cette interdiction relevant d'une clause noire (interdiction per se) prévue par la directive précitée. En droit français, une telle modification unilatérale tombe sous le coup de l'interdiction de la soumission à un déséquilibre significatif. Cependant, la nécessité de prouver le critère de la soumission pour pouvoir mettre en oeuvre cette disposition a conduit la Commission à considérer que cette pratique n'était donc pas interdite en toutes circonstances en droit français alors qu'il s'agit d'une pratique noire dans la directive.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Comme indiqué supra, l'objectif de ces dispositions législatives visent à achever en droit français la transposition de la directive PCD dès lors que malgré l'adoption de l'ordonnance du 30 juin 2021 précitée, la Commission a considéré que cette transposition n'était pas totalement conforme aux prescriptions de la directive. Ainsi, sans remettre en cause l'objectif poursuivi par la première transposition, à savoir celui de maintenir un dispositif réglementaire simplifié, compréhensible par les opérateurs et protecteur, en ajoutant uniquement les pratiques visées par la directive qui n'étaient pas déjà couvertes par le droit français relatif aux pratiques commerciales restrictives, il convient de compléter le droit national actuel avec plusieurs dispositions de nature à répondre aux préoccupations formulées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure « EU PILOT » précitée.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Lors de la transposition de la directive 2019/633 le gouvernement a privilégié la voie d'une habilitation à transposer les dispositions de la directive par ordonnance.
Ce choix était justifié par :
- le faible impact de la transposition de la directive en droit national du fait du niveau déjà élevé de protection offert par le droit français,
- la nécessité de maintenir une architecture cohérente des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce qui viennent d'être refondues,
- la volonté de coordonner ses dispositions avec les adaptations rendues nécessaires par le règlement « platform to business » visant à garantir la transparence et la loyauté des relations commerciales dans le secteur de l'intermédiation en ligne.
Cependant, il est proposé de réaliser les travaux complémentaires de transposition de la directive dans le cadre du présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, sans habilitation à transposer par ordonnance. Ce choix est justifié par le nombre très limité de dispositions complémentaires à introduire.
Une autre option envisagée aurait consisté à résister auprès de la Commission en continuant de défendre la conformité à la directive PCD et le caractère suffisant des dispositions prises dans l'ordonnance du 30 juin 2021 aux fins de transposition de ce texte. Cependant, une telle option aurait fait courir aux autorités françaises un risque de contentieux élevé au regard de l'ouverture probable d'une procédure en manquement formelle par la Commission.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue permet au Gouvernement de répondre dès l'entrée en vigueur du présent projet de loi aux préoccupations de la Commission européenne dans le cadre de la procédure EU PILOT précitée, conformément aux engagements pris par les autorités françaises dans la NAF du 9 décembre 2024 citée supra.
Il est prévu de procéder en conséquence à la transposition expresse en droit français de la disposition de la directive interdisant la modification unilatérale d'un contrat. Cette nouvelle interdiction s'appliquerait aux seuls contrats portant sur des produits agricoles et agroalimentaires correspondant au champ d'application de la directive.
Il est également prévu de modifier le droit national applicable :
- en étendant le champ d'application de certaines dispositions régissant le formalisme contractuel encadrant les opérations promotionnelles et les services de publicité à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires couverts par la directive ainsi qu'à toute relation commerciale entre un fournisseur de ces produits et son acheteur (et non aux seules relations avec un distributeur) ;
- en ajoutant certaines dispositions concernant le formalisme contractuel encadrant les opérations promotionnelles et les services de publicité, relatives à la précision des modalités de paiement demandée par l'acheteur et à l'estimation des coûts de ces actions et services ;
- en prévoyant le cas théorique dans lequel une annulation de commande de produits périssables dans un délai supérieur à 30 jours doive être considérée comme effectuée à trop brève échéance.
Ces différentes dispositions seront ajoutées au code de commerce et les obligations et interdictions qu'elles prévoient seront toutes passibles de sanctions administratives en cas de non-respect.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les présentes dispositions visent à modifier la première phrase de l'article L. 443-5 du code de commerce, à abroger la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 443-2, et à créer un nouvel article L. 443-9.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Dans une démarche de mise en conformité avec le droit européen, la présente transposition permet de répondre aux préoccupations formulées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure EU PILOT initiée en mars 2023 pour violation éventuelle par la France de son obligation de transposition de la directive 2019/633.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
S'agissant des impacts macroéconomiques, la transposition de la directive devrait participer au rééquilibrage des relations commerciales, en particulier en faveur des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires de plus petite taille, fortement vulnérables au pouvoir de marchés de la grande distribution.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les impacts sur les entreprises sont mineurs étant donné que les dispositions ainsi transposées ne modifient qu'à la marge le dispositif actuellement applicable et s'y intègrent en garantissant un meilleur équilibre et une meilleure loyauté des relations commerciales entre opérateurs économiques.
La disposition relative à l'interdiction d'annulation de commande à brève échéance ne devrait pas impacter les pratiques des entreprises puisqu'actuellement, les commandes de produits périssables sont quasi-systématiquement passées moins de 30 jours avant la date prévue pour leur livraison.
En revanche, l'élargissement, que ce soit pour les produits ou pour les opérateurs couverts, du champ d'application de certaines dispositions de formalisme du code de commerce créera une contrainte supplémentaire pesant sur les entreprises qui n'étaient pas soumises au dispositif actuel. Ce dernier n'est en effet applicable qu'aux relations entre fournisseurs et distributeurs alors que la directive prescrit un formalisme auquel tout acheteur de produits agricoles et alimentaires est soumis dans ses relations avec son vendeur professionnel.
4.2.3. Impacts budgétaires
La France disposant déjà d'un réseau d'enquêteurs au sein de la DGCCRF en charge du contrôle des pratiques commerciales déloyales interentreprises (brigades des relations interentreprises au sein des DR(I)EETS117(*), soit 122 ETP consacrés à cette tâche) et d'un bureau spécialisé en administration centrale (bureau 3C chargé du commerce et des relations commerciales), le parachèvement de la transposition de la directive n'engendrera aucune dépense publique additionnelle.
Les sommes correspondantes aux amendes administratives qui seront, le cas échéant, prononcées par les DR(I)EETS en cas de non-respect des nouvelles dispositions prévues par le présent article, viendront abonder le budget de l'Etat et seront recouvrées par la Direction des créances spéciales du Trésor.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions transposées auront un impact limité sur les services centraux et déconcentrés de l'Etat. Il s'agira seulement de contrôler le respect de ces nouvelles dispositions par les opérateurs qui y sont soumis.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du territoire national de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions ne requièrent pas de textes d'application.
Article 23 - Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le système français actuel de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA) est issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il donne une place prépondérante à l'organisme de défense et de gestion (ODG) qui peut seul présenter la demande d'homologation du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Aux termes de l'article L. 721-3 du code de propriété intellectuelle (CPI), la décision d'homologation est prise après :
- La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
- La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
- La consultation de diverses personnes (les collectivités territoriales concernées ; les groupements professionnels intéressés ; dans certains cas spécifiques, le directeur de l'INAO, les associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du Code de la consommation).
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique et, par voie de conséquence, enregistrement de l'IGPIA.
Le Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels modifie cette approche en se basant sur un processus d'enregistrement d'une demande d'indication géographique (IG) se déroulant en deux temps et à deux niveaux : une phase nationale et une phase européenne.
La demande devra être déposée auprès d'une autorité nationale compétente, et comporter, outre le cahier des charges (qui contient notamment le plan de contrôle), un document unique et des documents d'accompagnement. En lieu et place de l'enquête publique et de la consultation, le règlement prévoit une procédure nationale d'opposition ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime et établi ou résidant en France avec des motifs d'opposition définis limitativement par le règlement.
Après l'examen de la demande d'enregistrement et l'évaluation du résultat de la procédure d'opposition, si l'autorité compétente constate que les exigences du règlement sont satisfaites, elle prendra une décision favorable et déposera la demande d'enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui à son tour l'examinera (cette phase est dite « à l'échelle de l'Union ») et prendra la décision d'enregistrement. Le règlement innove également en ce qui concerne l'annulation des enregistrements en prévoyant la mise en place d'une procédure administrative en annulation inconnue du système actuel, ouverte aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime ainsi qu'à l'autorité nationale.
Concernant le contrôle du respect du cahier des charges, le règlement apporte deux modifications au système actuel : suppression de l'intervention des organismes d'inspection et désignation d'une autorité compétente en charge de la réalisation de ces contrôles pouvant déléguer cette tâche à des organismes de certification, à charge pour ces derniers de lui communiquer les résultats.
Enfin, conformément à l'article L. 431-2 du code de la consommation, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) sont aujourd'hui déjà habilités à rechercher et constater l'utilisation frauduleuse des indications géographiques protégées nationales sur le marché, sans être concernés par les étapes en amont de leur reconnaissance ou de leur gestion. Dans le cadre de ce nouveau règlement, la DGCCRF maintiendra son rôle de surveillance de l'utilisation des indications géographiques en l'étendant à celles reconnues au niveau européen, en réaction notamment à des plaintes ou signalement de fraudes.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans une décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par l'article 2 de la Déclaration de 1789 », a énoncé que « les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux [...] parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle ».
Véritables droits de propriété intellectuelle mais de nature collective, les indications géographiques sont garanties par la constitution et régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
L'article 88-1 de la constitution du 4 octobre 1958 prévoit que : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
L'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que « Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre (...) »
Bien qu'il s'agisse d'un règlement européen, qui s'impose directement à la France sans qu'il soit nécessaire de le transposer en droit français, le Règlement appelle à plusieurs reprises des précisions à apporter par le droit national des Etats membres, soit pour le compléter, soit pour choisir entre différentes options.
Les présentes dispositions d'adaptation nationales ont pour objectif d'organiser l'application du règlement (UE) 2023/2411 dans le système national préexistant de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Ø Au niveau international
Les indications géographiques sont reconnues au niveau international comme un type particulier de droit de propriété intellectuelle et plusieurs conventions internationales consacrent des dispositions à leur protection. Historiquement plutôt orientées sur la lutte contre les fausses indications de provenance et la protection des produits vinicoles, ces conventions ont, au fil du temps, étendu leur champ d'application.
C'est tout d'abord la Convention de l'Union de Paris (CUP) signée le 10 mai 1883, convention générale relative à la propriété industrielle qui s'est intéressée à ce sujet mais de manière très superficielle. Elle a été complétée par deux arrangements spécifiques aux indications géographiques, l'Arrangement de Madrid signé le 14 avril 1891, principalement consacré à la répression par des mesures douanières des indications de provenance fausses ou fallacieuses, et l'Arrangement de Lisbonne signé le 31 octobre 1958. Ce dernier instrument, qui était à l'origine uniquement consacré aux appellations d'origine, a connu le 20 mai 2015 une révision au moyen de l'acte de Genève permettant de l'étendre à tous types d'indications géographiques et de produits. La France a signé et ratifié ces instruments, aux côtés de l'Union européenne.
Il convient de noter que, en vertu du transfert de compétence des Etats membres à l'Union, celle-ci est désormais exclusivement compétente pour conclure des accords commerciaux, dans le cadre des politiques commerciales et agricoles communes, y compris les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle ( article 207 du TFUE). Le TFUE permet toutefois, dans son article 351, le maintien des engagements des Etats qui sont antérieurs au transfert de compétences dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les traités européens.
La France, comme six autres Etats membres, a été autorisée à ratifier cet instrument afin de conserver l'antériorité et la continuité de la protection des appellations d'origine qui étaient enregistrées sous l'Arrangement de Lisbonne.
L' article L. 614-25 du code de la propriété intellectuelle issu du transfert de l'ancien article L. 614-31 par l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 dispose que : « les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, des dispositions de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ». Quoique contenue dans le livre VI relatif aux brevets, cette disposition est considérée comme étant d'interprétation large et applicable à l'ensemble des droits de propriété industrielle visés par la CUP. En tout état de cause, l'application de la CUP aux ressortissants français résulte de l'application de l'article 55 de la constitution qui pose le principe de la supériorité des traités internationaux sur la loi nationale (CA Paris, 24 juin 1993).
L'accord relatif aux aspects des droits de la propriété intellectuelle (ADPIC) signé le 15 avril 1994 aborde le sujet des indications géographiques parmi les droits de propriété intellectuelle protégés notamment en son article 23 qui précise qu': « Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » et pour lesquels il fixe des standards minimaux de protection. Il s'agit d'une convention multilatérale qui compte près de 164 membres dont les 27 États membres de l'UE ainsi que l'Union elle-même. Si cet accord impose aux États d'assurer une protection minimale, il n'est pas directement applicable aux particuliers et invocable par eux (CJCE, 14 déc. 2000, aff. C-300/80, Dior). En revanche aussi bien les dispositions nationales que les dispositions européennes en matière de propriété intellectuelle, comprenant ainsi les règlements européens relatifs aux indications géographiques, doivent être interprétés et appliqués, dans la mesure du possible, à la lumière de l'accord sur les ADPIC (CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, Anheuser-Busch).
Ø Au niveau européen
Le système européen de protection des indications géographiques est établi depuis de nombreuses années, mais pour des produits autres que les produits industriels et artisanaux :
- pour les vins ( règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013) ;
- pour les boissons spiritueuses ( règlement (UE) n° 2019/787 du 17 avril 2019) ;
- pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ( règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012).
Ce système a été récemment révisé par le Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les Règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012. Ce Règlement est entré en application le 13 mai 2024.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Seize États membres disposent de systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. La plupart diffèrent toutefois sensiblement de celui prévu par le règlement et de celui qui est issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (instaurant les IGPIA) :
- Si dans la plupart de ces Etats, l'autorité compétente en charge de l'enregistrement de l'IG est l'office national chargé de la propriété intellectuelle, en Belgique et en Allemagne, cette fonction est dévolue à un juge ou à une autorité administrative (ministère ou autorité régionale) ;
- L'identité de l'autorité en charge du contrôle du respect du cahier des charges varie, des contrôles internes peuvent être aussi bien réalisés par des comités de producteur (par exemple, pour l'IG dentelle d'halas en Hongrie) que des conseils techniques créés par une municipalité (dans le cas de l'IG dentelle d'Idrijia en Slovénie) ;
- On peut relever une certaine diversité dans la nature des demandeurs pouvant solliciter une protection : un organisme collectif, un gouvernement, une autorité locale présentant un lien avec le territoire concerné par l'IG, une association de personnes morales ou physiques, une commune, des collectivités locales voire les autorités de l'Etat ;
- De nombreuses réglementations nationales ne prévoient pas d'opposition dans le cadre de la procédure d'enregistrement permettant aux tiers intéressés de donner leur avis sur la demande de protection. C'est le cas par exemple en Belgique, Tchéquie, Estonie, Hongrie et Slovaquie ;
- Concernant le lieu de production, dans certains pays (par exemple Croatie, Tchéquie, Hongrie, Estonie), la production, la transformation ou la préparation du produit doit avoir lieu dans la zone géographique définie. D'autres législations (par exemple la Slovénie, la Slovaquie) ne prévoient aucune règle spécifique concernant le fait que certaines étapes de production doivent avoir lieu dans la zone géographique concernée ;
- Dans la plupart des pays, les IG sont protégées pour une durée indéterminée, dans la mesure où les exigences de protection restent à satisfaire. En Belgique et en Roumanie, les IG ne sont accordées que pour une période de protection de 10 ans, celles-ci doivent être renouvelées pour rester valide ;
- Il existe peu de registres nationaux inventoriant les différentes IG protégées au niveau national ;
- Concernant les contrôles des producteurs, ceux-ci peuvent se faire dans un format allégé avec un contrôle des locaux possible uniquement avant la demande d'agrément. Par exemple, le comité disciplinaire en charge de la céramique de Faenza en Italie peut demander des informations, visiter les installations de production avec l'accord du propriétaire, visiter les magasins, zones de production et établissements ouverts au public. Celui en charge de l'IG dentelle d'Idrijia en Slovénie ne s'assure de la qualité de la dentelle concernée que lors du processus d'enregistrement de l'IG mais pas après ;
- Après la mise sur le marché, seul le comité en charge de l'IG dentelle d'Idrijia réalise un contrôle du respect du cahier des charges par les acteurs du marché de la dentelle, les autres législations ne prévoient pas de dispositions spécifiques et ce travail est en réalité assuré par les producteurs eux-mêmes de manière informelle ;
- La durée moyenne de la procédure d'enregistrement d'une IG varie considérablement d'un Etat membre à l'autre avec un minimum de 2 mois pour la Lituanie et un maximum de 12 mois en Tchéquie ;
- Des taxes de dépôt sont demandées dans certains Etats membres (Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Irlande et Italie) mais pas dans d'autres (Slovaquie et Slovénie), et certains Etats connaissent des taxes supplémentaires comme des droits d'usage (Tchéquie) ou d'enregistrement (Pologne).
Vue générale sur les modalités nationales de protection des IGPIA en Europe
|
Etats membres |
Loi sur les IG spécifique protégeant tout type de produits artisanaux et industriels |
Loi spécifique ou décret protégeant certains secteur ou type de produits industriels et artisanaux |
Marque nationale de certification visant à certifier l'origine géographique d'un produit |
Nombre d'enregi-strements |
Effectif |
Taxe de dépôt |
Durée moyenne en mois d'enregi-strement |
|
France |
X |
X (anciens dispositifs, reconnaissance judiciaire ou par décret ) |
24 |
1 |
350 |
8 |
|
|
Autriche |
|||||||
|
Belgique |
X |
||||||
|
Bulgarie |
X |
13 |
7 |
110 |
6 |
||
|
Chypre |
|||||||
|
Croatie |
X |
3 |
40 |
10 |
|||
|
Tchéquie |
X |
62 |
3 |
158 |
6-12 |
||
|
Danemark |
|||||||
|
Estonie |
X |
||||||
|
Finlande |
|||||||
|
Allemagne |
X |
1 |
|||||
|
Grèce |
|||||||
|
Hongrie |
X |
10 |
2 |
292 |
3-4 |
||
|
Irlande |
X |
1 |
1 |
177 |
N/A |
||
|
Italie |
X |
X |
22 |
N/A |
337 |
6 |
|
|
Lettonie |
X |
X |
0 |
N/A |
150 |
5,5 |
|
|
Lituanie |
X |
0 |
0 |
240 |
2 |
||
|
Luxembourg |
|||||||
|
Malte |
|||||||
|
Pays-Bas |
|||||||
|
Pologne |
X |
X |
0 |
N/A |
64 + 215 |
N/A |
|
|
Portugal |
X |
X |
27 |
3 |
127 |
4 |
|
|
Roumanie |
X |
0 |
0 |
400 |
8 |
||
|
Slovaquie |
X |
2 |
N/A |
0 |
N/A |
||
|
Slovénie |
X |
2 |
N/A |
0 |
N/A |
||
|
Espagne |
X |
30 |
N/A |
197+253 |
10 |
||
|
Suède |
X |
N/A |
200 |
3,8 |
Source : tableau issu de l'étude d'impact de la commission sur la protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux en date du 13/04/2022, page 118 (le montant des taxes de dépôt a été arrondi à l'euro inferieur)
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Bien qu'il soit déjà entré en vigueur (le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 16 novembre 2023), le Règlement 2023/2411 ne sera applicable qu'à compter du 1er décembre 2025. Comme indiqué précédemment au point 1.2., s'il est d'application directe et ne nécessite pas à proprement parler de mesures de transposition, de très nombreux articles appellent des dispositions nationales afin de détailler les différentes exigences, conditions de forme et procédures prévues par le règlement (2.1.1), ou délèguent aux Etats membres le pouvoir d'intégrer ou non en droit national des options proposées par le règlement (2.1.2).
Nécessité de légiférer 1 : pour compléter le règlement
Le règlement laisse une certaine marge de manoeuvre aux Etats membres dans leur ordre juridique interne afin de rendre effectives les dispositions de celui-ci.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, peut être cité en premier lieu l'article 12 qui impose la désignation de l'autorité compétente chargée de la phase au niveau national de la procédure d'enregistrement des IGPIA, des modifications du cahier des charges et de l'annulation de l'enregistrement. L'autorité française compétente est l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Outre la désignation de l'INPI en tant qu'autorité nationale compétente, le règlement autorise les Etats membres à exiger que le cahier des charges comporte des éléments supplémentaires à ceux déjà prévus par le règlement, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l'Union et le droit national (article 9). Un Etat membre peut également exiger que les documents accompagnants la demande (article 11) comprennent toute autre information jugée appropriée.
Le règlement prévoit également que les Etats membres établissent les modalités détaillées applicables à la procédure d'opposition. Ainsi, si le règlement impose l'existence de cette procédure et énumère les motifs d'opposition, il revient au Législateur français d'en prévoir les modalités (recevabilité, délais, coût, etc.). Au vu de l'absence de précisions relatives à la procédure d'annulation dans le règlement, il convient également de prévoir les modalités détaillées de cette procédure.
Plus largement, l'article 17 intitulé « efficacité des procédures » prévoit que pour l'examen de la demande d'enregistrement, pour la procédure nationale d'opposition et pour la prise de décision sur la phase au niveau national, les Etats membres doivent prévoir « des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale de la procédure, sont rendues publiques ». Cette rédaction laisse une importante marge de manoeuvre aux Etats membres dans la mise en place de toutes les procédures de la phase nationale.
Enfin, l'article 61 laisse aux Etats membres le soin de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du règlement et les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. L'habilitation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera complétée par décret en Conseil d'Etat afin d'intégrer les manquements au règlement au sein du dispositif de sanctions.
Nécessité de légiférer 2 : pour prendre position sur les options offertes par le règlement
En raison des difficultés à harmoniser totalement le régime de protection des IGPIA dans l'Union européenne, le Règlement (UE) 2023/2411 prévoit différentes options que les Etats membres peuvent retenir ou non.
Parmi les options proposées, peuvent être citées la possibilité d'instaurer une protection nationale temporaire (article 18) entre la date de décision positive prise par l'autorité nationale compétente au niveau national et la date de décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement prise par l'EUIPO, et la possibilité de déroger totalement à la phase nationale et désigner l'EUIPO en lieu et place de l'autorité nationale d'examen (articles 19 et 20) en vue d'un « enregistrement direct ».
Le règlement pose également le principe d'un contrôle du respect du cahier des charges au moyen d'une auto-déclaration du producteur soumise à la vérification de l'autorité compétente. Il autorise toutefois les Etats membres à déroger à ce mécanisme en permettant que ces contrôles soient effectués par une ou plusieurs autorités compétentes ou par un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif des dispositions d'adaptation nationales est d'organiser l'application du Règlement 2023/2411 dans le système national préexistant de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et d'apporter les précisions nécessitées par ledit règlement. En effet bien qu'il s'agisse d'un règlement européen, qui s'impose directement à la France sans qu'il ne soit nécessaire de le transposer en droit français, il appelle à plusieurs reprises des précisions à apporter par le droit national des Etats membres.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune option n'est envisageable sans l'intervention d'une loi, dans la mesure où l'application du Règlement 2023/2411 nécessite :
- de prendre des dispositions nationales afin de détailler les différentes exigences, conditions de forme et procédures prévues par le règlement,
- de pouvoir intégrer en droit national certaines des options proposées par le règlement,
- de supprimer du code de la propriété intellectuelle, les dispositions actuelles issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui sont en contradiction avec celles du Règlement 2023/2411.
Toutefois, le règlement offre aux Etats membres différentes options, permettant :
- de déroger à l'obligation de mettre en place une phase nationale pour la procédure d'enregistrement en permettant de déposer les demandes d'enregistrement directement devant l'EUIPO (article 7 paragraphe 2) ;
- à une autorité locale ou régionale de présenter une demande d'enregistrement (article 8 paragraphe 4) ;
- de prévoir que le cahier des charges comprend des exigences propres à l'Etat membre à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l'Union (article 9 paragraphe 1) ;
- de prévoir que les documents accompagnant la demande d'enregistrement peuvent comprendre toute information jugée appropriée par l'Etat membre (article 11 paragraphe 1 d) ;
- de mettre en place une protection nationale temporaire à une IG à compter de son dépôt auprès de l'EUIPO (article 18 paragraphe 1) ;
- de prévoir que des organismes publics, et d'autres parties prenantes telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs peuvent également participer aux travaux d'un groupement de producteur (article 45 paragraphe 1) ;
- aux autorités compétentes, de déléguer leurs missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques (articles 52 et 55) ;
- de prévoir que la vérification du respect du cahier des charges d'une IGPIA peut être effectuée au moyen d'une auto-déclaration du producteur (article 51 paragraphe 1).
3.2. DISPOSITIF RETENU
Au regard des options possibles précitées, le choix est fait de mettre en place une phase nationale pour la procédure d'enregistrement en désignant l'INPI en tant qu'autorité compétente.
Concernant le contrôle du respect du cahier des charges par les opérateurs, l'INPI sera désigné comme autorité compétente et délèguera cette mission aux organismes de certification.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les dispositions envisagées ont un impact sur les livres IV (organisation administrative et professionnelle) et VII (marques de produits ou de services et autre signes distinctifs) du code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi que sur le code de la consommation.
Concernant le livre IV du code de la consommation :
L'article 70 du Règlement (UE) 2023/2411 prévoit que les régimes de protections nationales des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels cesseront d'exister avant décembre 2026. Cela requiert l'abrogation du régime des appellations d'origine artisanales ou industrielles reconnues par voie judiciaire et l'adaptation des articles du code de la consommation qui y sont consacrés. Les dispositions concernées sont les articles L. 431-4, L. 431-6, L.431-7, L. 453-2 et L. 455-2 en vigueur du code de la consommation.
Concernant le livre IV du CPI :
Le Règlement 2023/2411 prévoit notamment la mise en place d'une procédure administrative en nullité de l'enregistrement (article 12 paragraphe 1) ainsi qu'une phase nationale relative à l'enregistrement de l'indication géographique.
Il est donc nécessaire d'ajouter les décisions rendues à l'occasion des demandes d'enregistrement, de modification du cahier des charges et des demandes en annulation aux missions de l'INPI prévues à l'article L. 411-1 et à la liste des décisions rendues par le directeur général de l'INPI de l'article L. 411-4. Il convient également de prévoir que l'INPI est l'autorité compétente pour la vérification de la conformité du produit au cahier des charges..
Concernant le livre VII du CPI :
- L'article L. 721-1 est modifié.
- Le règlement apporte des définitions claires aux notions de « produits industriels et artisanaux » (article 4) et « d'indication géographique » (article 9), il est ainsi nécessaire de supprimer les définitions correspondantes présentes à l'article L. 721-2 et de prévoir un renvoi au règlement. Le règlement met par ailleurs en place une procédure d'enregistrement des demandes d'indications géographiques qui diffère sensiblement de la procédure connue du droit français notamment centrée sur l'homologation du cahier des charges. Un examen en deux temps sera désormais pratiqué (phase nationale / phase à l'échelle de l'Union). L'article L. 721-2 est modifié pour refléter notamment ces modifications ;
- Le règlement prévoit que la demande d'enregistrement doit être déposée auprès d'une autorité nationale et qu'en lieu et place de l'enquête publique et de la consultation réalisée actuellement, une procédure nationale d'opposition doit être mise en place. L'article L. 721-3 est donc modifié pour refléter ces changements dans la procédure d'enregistrement et vient préciser que c'est le directeur général de l'INPI qui procèdera à l'examen des demandes.
- L'actuel article L. 721-4 doit être modifié afin de préciser que lors de l'examen de la demande d'enregistrement, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle s'assure de la représentativité des producteurs au sein du groupement pour le produit concerné, et que la décision favorable à l'enregistrement emporte reconnaissance du groupement de producteurs qui a fait la demande d'enregistrement comme organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique.
- Les modifications apportées à l'article L. 721-5 visent à préciser les missions cruciales du groupement de producteurs (ancien organisme de défense et de gestion) et à indiquer que dans le cas où celui-ci ne les exercerait pas, et après une mise en demeure par l'INPI restée infructueuse, l'Institut peut engager une procédure d'annulation de l'enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d'utiliser l'indication géographique enregistrée.
- L'article L. 721-6 doit être modifié pour prévoir qu'un producteur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il a obtenu une certification délivrée par un organisme de certification. Il précise également que l'INPI tient à jour la liste des producteurs certifiés.
- L'article L. 721-7 doit être amendé afin de créer une procédure d'annulation de l'enregistrement d'une indication géographique conformément à l'article 32 du Règlement ;
- L'article L. 721-8 est amendé afin de prévoir que les indications géographiques enregistrées sont protégées contre les atteintes définies à l'article 40 du Règlement ;
- L'article L. 721-9 doit être modifié pour préciser que l'INPI délègue le contrôle de la conformité du produit au cahier des charges à des organismes de certification accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°39/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation couvrant la certification considérée.
. Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien et de l'extension de la certification et peuvent, après avoir permis aux producteurs de produire des observations, prononcer le refus, la réduction, la suspension ou le retrait de la certification. En cas de suspension ou de retrait de la certification d'un producteur, l'Institut national de la propriété industrielle le retire de la liste des producteurs certifiés.
- L'article L. 721-9-1 est créé afin de prévoir des cas de réduction de redevances perçues à l'occasion d'une opposition à l'enregistrement d'une indication géographique notamment lorsque l'assujetti au paiement de ladite redevance est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise ;
- L'article L. 721-10 prévoit un décret en Conseil d'Etat et l'article L. 722-1 est modifié.
Concernant le livre VIII du CPI (dispositions relatives à l'outre-mer) :
L'article L. 811-1-1 est modifié pour prendre en compte les dispositions des présents articles dans les îles Wallis et Futuna.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Ø Articulation avec le droit européen
Bien qu'il s'agisse d'un règlement européen, qui s'impose directement à la France sans qu'il soit nécessaire de le transposer en droit français, les dispositions d'adaptation nationales ont pour objectif d'organiser l'application du Règlement (UE) 2023/2411 dans le système national préexistant de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Ø Articulation avec le droit international
Afin que l'Union puisse exercer pleinement sa compétence exclusive en ce qui concerne sa politique commerciale commune, et puisse pleinement respecter ses engagements au titre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé « accord sur les ADPIC »), elle a, le 26 novembre 2019, conformément à la décision (UE) 2019/1754 du Conseil, adhéré à l'acte de Genève, qui est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L'acte de Genève offre un moyen d'obtenir la protection d'indications géographiques, quelle que soit la nature des produits auxquels elles s'appliquent, et couvre par conséquent les produits artisanaux et industriels. Assurer dans l'ensemble de l'Union une reconnaissance et une protection uniformes des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une priorité de l'Union afin de respecter pleinement ses obligations internationales. En ce sens, le règlement modifie le Règlement 2019/1753 relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques, afin d'intégrer les indications géographiques industrielles et artisanales dans le champ de compétence de l'Union et de lui confier l'administration de celles-ci dans le cadre de l'acte de Genève. La décision (UE) 2019/1754 précitée a également été modifiée en ce sens par la décision (UE) 2023/1051 du Conseil.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
En renforçant la valorisation de l'origine des produits manufacturés à l'échelle européenne et non plus simplement nationale, cette mesure permet aux producteurs de bénéficier d'une protection des produits porteurs d'une indication géographique dans toute l'Union européenne.
De la même manière que pour les IG agricoles, une protection au niveau européen des IGPIA permettra aux producteurs concernés d'exporter leurs produits sans subir une concurrence déloyale de producteurs qui feraient usage d'un signe identique ou similaire sur le marché concerné.
Enfin, cette protection élargie permettra d'éclairer les consommateurs de tous les Etats membres sur l'origine des produits manufacturés et améliore ainsi l'information qui leur est donnée. Cela peut également conduire à améliorer leur sensibilisation à l'authenticité des produits et partant à les inciter à en acheter davantage.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Depuis 2015, et l'entrée en vigueur du dispositif national actuel, 24 indications géographiques artisanales ont été homologuées par l'INPI.
Elles bénéficient à près de 150 entreprises, représentant 3500 emplois, et un chiffre d'affaires annuel total de 350 millions d'euros. Celles-ci recouvrent des secteurs d'activité très variés, allant des arts de la table (porcelaine de Limoges, poteries d'Alsace et coutellerie de Laguiole), aux textiles (dentelles de Calais-Caudry, linge basque, tapis et tapisseries d'Aubusson, charentaises), mais aussi l'ébénisterie (siège de Liffol), la joaillerie (grenat de Perpignan), et les matériaux de construction naturels (10 indications géographiques de pierres naturelles).
Aujourd'hui, le profil des entreprises intervenant dans le domaine des produits artisanaux et industriels est assez varié. En Europe, une grande majorité (80%) des fabricants sont des micros et petites entreprises. Les groupes constitués pour la plupart de petits ou de micro-producteurs (moins de 50 salariés) sont assez communs pour toutes les catégories de produits.
En France, les plus grandes entreprises sont des PME de taille importante comme Bernardaud avec l'IG Porcelaine de Limoges, alors que les plus petites comptent une ou deux personnes, comme dans le cas de l'IG Grenat de Perpignan.
Il existe également un cas, exceptionnel, d'indication géographique ne bénéficiant qu'à un seul producteur, celui-ci étant le dernier à avoir maintenu une production entièrement locale, la botte camarguaise.
S'il est difficile d'obtenir des données chiffrées consolidées de la part des entreprises, des retombées largement positives ont cependant été rapportées par celles-ci.
Il convient toutefois de préciser que les bénéfices retirés de l'usage d'une indication géographique dépendent de nombreuses variables, propres à chaque filière.
Quelques exemples et retombées importantes pour les entreprises peuvent néanmoins être rapportées :
- Le cas de la Porcelaine de Limoges : la filière regroupait 27 entreprises, employant 850 salariés, et un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros, avant sa reconnaissance, en 2017. L'association gestionnaire atteste que l'indication géographique fédère aujourd'hui 34 entreprises, protège 1200 emplois locaux, et que le chiffre d'affaires global atteint désormais aujourd'hui 100 millions d'euros.
- L'étendue de la réputation initiale du produit (nationale ou régionale) : une notoriété locale peut devenir nationale grâce à la délivrance d'une indication géographique, comme dans le cas du grenat de Perpignan. Le syndicat professionnel a reconnu que l'indication géographique avait permis d'augmenter les volumes de production de 50 % dans les mois qui ont suivi sa reconnaissance, cette augmentation s'étant stabilisée dans le temps à 30 % depuis cinq ans.
- La reconnaissance de l'IG permet de lutter contre les produits contrefaits. Il pourra être cité, à titre d'exemple, le cas de la porcelaine de Limoges : l'indication géographique lui a permis de déposer une demande d'intervention douanière auprès des Douanes françaises, procédure qui a facilité les échanges entre les agents des Douanes et le titulaire des droits. Deux saisies de containers de produits contrefaisants ont été rendues possibles grâce à ce dispositif. Certaines filières de pierres naturelles, notamment la pierre de Bourgogne, ont également pu faire cesser près d'une centaine d'usurpations de leur indication géographique, notamment sur les sites de vente en ligne, avec de simples mises en demeure pré-contentieuses. Seules deux actions sur cent ont finalement abouti à des actions judiciaires, qui se sont soldées par de lourdes condamnations au profit du titulaire de l'indication géographique118(*).
L'entrée en application du règlement aura un impact économique positif pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) en renforçant leur compétitivité, et une incidence globalement favorable sur l'emploi, le développement économique et le tourisme dans les régions rurales et moins développées. En outre, la protection des IGPIA au niveau européen facilitera l'accès aux marchés des pays tiers au moyen d'accords commerciaux avec l'Union et permettra aux indications géographiques de déployer tout leur potentiel pour les produits artisanaux et industriels.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'INPI étant exclusivement financé par les redevances payées par les déposants pour le dépôt et le maintien de leurs titres de propriété industrielle, sans subvention de l'État, les investissements nécessaires à la mise en place des nouvelles procédures prévues par le règlement seront intégralement pris en charge par le budget de l'établissement.
Il convient de souligner que le montant des redevances perçues par l'INPI doit être adopté par arrêté.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les IGPIA présentent des effets positifs pour les collectivités territoriales à différents niveaux :
- Sur l'emploi : les IGPIA sont une juste récompense pour les producteurs, en ce qu'elles peuvent permettre de sécuriser des débouchés commerciaux à leurs produits et augmenter leurs revenus ;
- Sur le tourisme : les IGPIA sont un atout important pour les territoires en ce qu'elles promeuvent l'identité régionale et valorisent le patrimoine local ;
- Sur la protection du savoir-faire local : les IGPIA permettront d'empêcher l'utilisation des dénominations protégées ou de dénominations similaires par des opérateurs qui ne sont pas originaire de la région d'origine et/ou ne respectent pas le cahier des charges.
Concernant l'attractivité des territoires concernés, plusieurs collectivités territoriales citent les IG homologués sur leur territoire soit au titre d'une mise en avant des savoir-faire locaux soit au titre des sites touristiques à visiter :
- La région Nouvelle-Aquitaine, dans un article119(*) « l'art et les matières : les savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine », fait mention des IG porcelaine de Limoges, tapisserie et tapis d'Aubusson, charentaises de Charentes-Périgord, linge basque et pierre d'Arudy ;
- Le site des offices de tourisme de la région Auvergne met en avant la visite d'une carrière d'argile dans le cadre de l'IG Argile du Velay120(*) ;
- Certaines dispositions du Règlement ont enfin un impact direct sur les entités locales ou régionales de l'Etat membre d'origine du groupement de producteur demandeur :
§ Celles-ci peuvent apporter une assistance à la préparation de la demande d'enregistrement et à la procédure qui y est liée (article 8.3) ;
§ Elles peuvent déposer elles même une demande si jamais elles sont désignées par l'Etat membre (article 8.4).
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les deux principales étapes de la phase nationale relatives à l'enregistrement d'une indication géographique pour les produits industriels et artisanaux, prévue par le règlement 2023/2411, s'inscrivent dans la continuité de la procédure d'homologation actuelle au niveau national, mise en place par l'INPI en application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Par ailleurs, le nombre de demandes d'enregistrement devrait rester à un niveau similaire à celui actuellement observé. Aussi, l'instruction des futures demandes d'enregistrement d'indications géographiques ne modifiera pas drastiquement la charge de travail pour l'INPI. Cette charge reposera sur l'équipe intervenant actuellement.
L'ajout d'une procédure administrative en nullité de l'enregistrement (article 12 paragraphe 1) mobilisera en revanche des ressources supplémentaires, en fonction du nombre de demandes d'annulation qui seront formulées (1 à 2 ETP dégagés par réallocation interne et sans modification du plafond d'emploi de l'INPI).
Les systèmes informatiques de l'INPI seront également adaptés en conséquence.
De plus, l'INPI participera au conseil consultatif relatif aux indications géographiques artisanales et industrielles instauré par l'article 35 du règlement 2023/2411 pour échanger sur les questions relatives aux indications géographiques. Cette participation contribuera à mettre en avant l'expertise développée en matière d'indications géographiques par la France depuis la promulgation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation vis-à-vis de ses homologues européens et contribuera à renforcer la coopération déjà existante entre l'INPI et l'EUIPO en matière de marques et dessins et modèles.
4.4.1. Impacts sur la société
La protection uniforme, dans toute l'Union, des droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques peut encourager la production de produits de qualité, contribuer à lutter contre la contrefaçon, assurer une offre large de produits de qualité aux consommateurs et contribuer à la création d'emplois de qualité et durables, y compris dans les régions rurales et moins développées, ce qui contribuerait à contrer les tendances au dépeuplement. En particulier, compte tenu du potentiel d'une telle protection pour ce qui est de contribuer à la création d'emplois durables et hautement qualifiés dans les régions rurales et moins développées.
4.4.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.4.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Les femmes représentent une part importante des salariés employés dans certains types d'artisanat de produits comme la dentelle, la broderie, la tapisserie, le verre, la céramique/poterie ainsi que les produits en laine.
A titre d'exemple, il y a aujourd'hui environ 700 travailleurs, pour la plupart des dentellières à Koniaków (Pologne) et la production de chaussures à Elche en Espagne emploie plus de 9 000 travailleurs à temps plein, dont 41 à 60 % de femmes.
En outre, les femmes ont également un rôle majeur dans la préservation du patrimoine culturel grâce à l'artisanat. En revanche, les hommes sont plus représentés dans les métiers techniques. Par exemple, la filière Pierre de Bourgogne est composée de 16 entreprises. Cela représente environ 500 emplois à temps plein. 2 entreprises sur les 27 qui composent l'Association Pierre de Bourgogne sont dirigées par des femmes mais seulement 20 % des travailleurs sont des femmes.
4.4.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.4.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Globalement, on peut considérer que le nombre de produits fabriqués qui sont sous IGPIA est relativement limité au regard de la somme globale de produits manufacturés.
De plus, un produit sous IGPIA est généralement un bien plus durable par rapport aux alternatives relevant de la production de masse, le plus souvent moins chères mais plus susceptibles d'être produites hors l'UE (ce qui induit un impact du transport réduit).
Enfin le consommateur qui exprime une préférence pour les produits couverts par une IGPIA sera vraisemblablement une personne respectueuse de l'environnement et on peut s'attendre à ce que les producteurs de produits sous IGPIA partagent cette préoccupation et mettent en avant cette vertu environnementale.
Pour toutes ces raisons, l'impact environnemental - aussi minime soit-il - est probablement positif. Un tel impact positif est également attendu par près de 60 % des répondants aux consultations publiques menées par la Commission européenne en amont de l'adoption du règlement.
On peut également citer l'exemple de l'IG Pierre de Bourgogne pour laquelle le développement durable est depuis toujours une valeur ajoutée du secteur et non des moindres. 100 % naturelle, 100 % minérale, la pierre se produit en circuit court (proximité géographique des ateliers et des carrières), avec une faible consommation énergétique, aucune cuisson, ni transformation, ni traitement chimique nocif.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Pas de consultation obligatoire. Une consultation facultative de la Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales (FFIGIA) et du Comité français d'accréditation (COFRAC) a été réalisée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Comme indiqué au point 2.1, bien qu'il soit déjà entré en vigueur (le vingtième jour suivant celui de sa publication au JOUE, soit le 16 novembre 2023), le Règlement 2023/2411 ne sera applicable qu'à compter du 1er décembre 2025. Les demandes d'homologation du cahier des charges déposées avant cette date demeureront donc examinées conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Le règlement précise néanmoins que les systèmes de protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux dont relève la loi précitée cesseront d'exister le 2 décembre 2026.
Les dispositions créées par le présent projet de loi s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République
Entre le 1er décembre 2025 et le 2 décembre 2026, la France notifiera à la Commission européenne et à l'EUIPO les IGPIA déjà enregistrées conformément au droit français actuel afin qu'elles soient enregistrées et protégées au niveau de l'Union.
Par ailleurs, des dispositions temporaires ont été prévues afin d'une part de prévoir que les indications géographiques ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article 70 alinéa 2 du règlement sont protégées au niveau national jusqu'à la décision devenue définitive de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne, et d'autre part que les demandes d'homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement au 1er décembre 2025 sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.
5.2.2. Application dans l'espace
Le Règlement, de par sa nature de texte européen, voit son application territoriale varier suivant les territoires concernés par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Il ressort d'une lecture combinée du TUE (article 52) et du TFUE (article 349 et 355) que ces deux textes et leurs droits dérivés (et donc le Règlement) s'appliquent automatiquement à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin.
Pour les PTOM (la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy) il en va différemment. Ces territoires relèvent du régime spécial d'association précisé dans la décision d'association du 5 octobre 2021 qui prévoit dans son considérant 10 que le TFUE et le droit dérivé adopté sur la base de celui-ci ne s'y appliquent pas automatiquement, à l'exception d'un certain nombre de dispositions qui prévoient expressément leur application. Tel n'est pas le cas du présent règlement.
Il conviendra donc de prévoir des mesures spécifiques permettant l'application du règlement dans ces territoires, mesures relevant suivant le PTOM concerné soit de la compétence du législateur français (auquel cas, le livre VIII de la partie législative du code de la propriété intellectuelle devra en déterminer les modalités d'application) soit des autorités locales.
Il est donc précisé que les dispositions d'adaptation nationales prises en vertu du Règlement seront applicables dans les îles Wallis et Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Le présent projet de loi sera complété par la création ou la modification de dispositions règlementaires, portées par un ou plusieurs décrets d'application.
Un décret en conseil d'Etat viendra notamment préciser :
- les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'enregistrement d'une indication géographique et notamment la nature des documents à fournir lors du dépôt ;
- les modalités de mise en oeuvre de la procédure de modification du cahier des charges ;
- les modalités de mis en oeuvre de la procédure d'opposition ;
- les modalités de mise en oeuvre de la procédure en annulation.
TITRE IV - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ, DE SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE NUMÉRIQUE
Articles 24 - Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle
1. ÉTAT DES LIEUX
Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles uniformes pour la mise en service, la mise sur le marché ou l'utilisation des systèmes d'IA. Il exclut notamment les systèmes d'IA utilisés à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité exerçant ces activités.
Les dispositions du règlement visent à réguler les usages des systèmes d'IA en privilégiant une approche basée sur le risque, et catégorisant dès lors ces systèmes selon leur impact potentiel, de risque minimal à inacceptable :
i) les systèmes dont l'usage présente un risque inacceptable car contraire aux valeurs de l'Union et qui sont par conséquent interdits ;
ii) les systèmes dont l'usage présente un risque élevé pour la sécurité, la santé et les droits fondamentaux et qui font donc l'objet d'un encadrement particulier pour leur mise en service, mise sur le marché ou leur utilisation ;
iii) les systèmes dont l'usage présente un risque nécessitant une transparence accrue du fait de leur interaction avec des personnes physiques ;
iv) les systèmes dont l'usage ne présente qu'un risque minimal, voire nul, et qui ne font l'objet d'aucun encadrement spécifique au titre du règlement.
L'adoption de mesures législatives ou, dans certains cas, l'adaptation de mesures législatives existantes, est nécessaire pour transcrire en droit interne certaines obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1689 s'agissant de :
i) la mise en place ou le fonctionnement d'autorités compétentes au niveau national afin d'assurer, d'une part, la notification des organismes d'évaluation de la conformité des systèmes d'IA dits à haut risque concernés préalablement à leur mise sur le marché ou mise en service sur le territoire de l'Union et, d'autre part, le contrôle des systèmes d'IA couverts par le texte postérieurement à cette mise sur le marché ou mise en service. A ce titre, les Etats membres sont libres de structurer leur gouvernance nationale, sous réserve qu'ils désignent au moins une autorité notifiante et une autorité de surveillance du marché (1er paragraphe de l'article 70), le règlement (UE) 2024/1689 donnant par ailleurs un certain nombre de préconisations sur quelles devraient être ces autorités (article 74).
ii) la détermination du régime des sanctions et autres mesures d'exécution applicables aux violations de ce même règlement, en tenant notamment compte des dispositions de l'article 99 du règlement.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765 DC, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les dispositions de l'article 24 se limitent à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/1689 s'agissant d'une référence au règlement. Les dispositions prévues par le règlement (UE) 2024/1689 s'inscrivent en complément de règlementations sectorielles existantes au niveau conventionnel encadrant le développement, la mise sur le marché et l'utilisation de certains produits ainsi que de règlementations transverses concernant l'utilisation de données à l'instar du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Les travaux d'adaptation nécessaires à la bonne mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1689 au sein des Etats-membres sont toujours en cours.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le règlement (UE) 2024/1689 prévoit, pour le suivi des obligations qu'il impose aux systèmes d'IA, des exigences de conformité.
Certaines des dispositions qui doivent être adoptées ou le cas échéant modifiées pour mettre en oeuvre les articles 28, 70, 74 et 99 du règlement (UE) 2024/1689 étant de nature législative, il est par conséquent nécessaire de légiférer.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Aux fins de la mise en oeuvre des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, l'article 24 permet l'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les dispositions étant commandées par une norme supérieure issue du droit de l'Union européenne et l'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA étant de nature législative, aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article 24 vise à intégrer un titre V bis dédié aux systèmes d'IA au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) afin de centraliser les dispositions générales du règlement (UE) 2024/1689 auxquelles pourront se référer les textes sectoriels.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Il est créé un titre V bis dédié aux systèmes d'intelligence artificielle composé d'un article 55-1 au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions de l'article 24 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/1689 afin de permettre l'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA. Elles s'inscrivent en complément de règlementations sectorielles existantes ainsi que de règlementations transverses concernant l'utilisation de données à l'instar du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
En raison de son large champ d'application et de son approche horizontale par le risque, le règlement (UE) 2024/1689 devrait avoir un impact important sur l'ensemble des entreprises, ainsi que sur les entités publiques qui développent des solutions d'intelligence artificielle ou les adoptent, dès lors que celles-ci comportent un risque pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux Les effets sur les fournisseurs (qui développent ou font développer un système d'IA et le mettent sur le marché ou le mettent en service sous leur propre nom ou leur propre marque, à titre onéreux ou gratuit) et déployeurs (qui utilisent sous leur propre autorité un système d'IA, sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d'une activité personnelle à caractère non professionnel) de systèmes d'IA, qu'ils soient des entreprises ou des entités publiques, sont plus directement liés à l'entrée en application du règlement (UE) 2024/1689 lui-même qu'aux mesures d'adaptation du droit national prévues dans le présent projet de loi. S'agissant du mécanisme de gouvernance nationale, les mesures de mise en cohérence se limitent l'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA.
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le règlement (UE) 2024/1689 encadre la mise sur le marché ou en service et l'utilisation de briques technologiques qui ne faisaient jusqu'à présent pas l'objet d'une règlementation spécifique, dans une multitude de secteurs ou d'usages, par les acteurs privés comme publics. L'article 24 se borne à l'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA. Il aura donc un impact modéré.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les entreprises devront se conformer au règlement (UE) 2024/1689 lorsqu'elles fournissent ou déploient des solutions d'IA qui tombent dans son champ d'application. Cette mise en conformité aura nécessairement un coût (financier mais aussi humain, en termes de temps, de ressources, renfort d'expertise, etc.) et pourrait être source d'incertitudes. Son ampleur dépendra de la mise en oeuvre du règlement par les autorités compétentes. Seule une mise en oeuvre équilibrée et harmonisée permettra le développement et l'adoption des outils d'IA par les entreprises françaises.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA n'a pas d'impact budgétaire.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA n'a pas d'impact sur les collectivités territoriales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA n'a pas d'impact sur les services administratifs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
L'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA n'a pas d'impact social.
4.5.1. Impacts sur la société
Cf. supra.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Cf. supra.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Cf. supra.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Cf. supra.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA n'a pas d'impact sur les particuliers.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L'identification du cadre applicable en France s'agissant des systèmes d'IA n'a pas d'impact environnemental.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté le 2 octobre 2025 et a émis un avis favorable.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements, régions et collectivités uniques d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution ainsi que les collectivités de l'Atlantique de l'article 74 que sont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions ne prévoient pas de texte d'application.
Article 25 - Désignation de l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement (UE) 2023/2854 et pouvoirs d'enquête et de sanction
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le règlement (UE) 2023/2854 sur les données (« Data Act »), adopté en 2023, entrera en application le 12 septembre 2025.
Ayant pour objectif de faciliter la circulation des données entre les entreprises, les consommateurs et certains organismes du secteur public, ce règlement se caractérise par la technicité des droits et obligations des producteurs et utilisateurs de données, et des fournisseurs de services de traitement des données. Il comporte des dispositions relatives :
(i) au partage de données dans les relations entre entreprises et dans les relations entreprises-consommateurs ;
(ii) à l'accès de la puissance publique aux données du secteur privé dans des circonstances exceptionnelles ;
(iii) au régime de transfert de données non personnelles détenues par les fournisseurs de services de traitement de données (informatique en nuage) à des autorités non-européennes.
D'application directe et de nature transversale, ce règlement laisse aux Etats membres le soin de :
(i) désigner la ou les autorités compétentes chargées de sa mise en oeuvre au regard des critères précisés en son article 37121(*) ;
(ii) déterminer le régime de sanctions applicable pour veiller à la bonne application des différentes parties du règlement.
L'efficacité de la mise en oeuvre du règlement précité par les autorités compétentes désignées par les Etats membres repose sur :
(i) la connaissance fine des enjeux commerciaux liés au partage des données, tels que ceux liés à la protection du secret des affaires ou réputationnels, sans préjudice des compétentes existantes des autorités sectorielles, et notamment de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de données à caractère personnel ;
(ii) la capacité à régler les différends techniques et financiers induits par la complexité des activités numériques en prenant en compte les enjeux économiques et contraintes des différents acteurs dans le domaine des données.
Pour autant, une vigilance accrue quant à la lisibilité du corpus juridique relatif au numérique pour l'ensemble des acteurs apparaît nécessaire, au regard de la multiplication des textes européens au cours des dernières années. Ainsi, le présent article vise à mettre en place, au niveau national, une gouvernance claire et efficace pour l'ensemble des acteurs et parties prenantes, sans pour autant complexifier le droit national existant et assurant l'application directe des règlements européens.
Déjà désignée autorité nationale compétente pour la régulation de la fourniture des services d'informatique en nuage et d'intermédiation des données au titre des dispositions des articles 29, 30 et 36 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique et du règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) apparaît comme l'autorité la plus légitime pour assurer la mise en oeuvre cohérente du Data act (précité), par sa capacité à répondre aux attentes des entreprises en matière d'expertise technique et sa connaissance des enjeux commerciaux liés aux données, dans des conditions d'indépendance et de fonctionnement reconnues et conformes aux conditions posées par le règlement européen. La compétence de l'Arcep devra néanmoins souffrir d'une exception : chapitre VII du règlement, dont les enjeux engagent les autorités de l'Etat en matière d'entraide judiciaire et administrative, de sécurité nationale et de loi de blocage.
Par souci de simplification administrative et de lisibilité pour l'ensemble des acteurs concernés, les pouvoirs d'enquête et de sanction confiés à l'Arcep s'inscrivent dans le cadre des procédures existantes prévues notamment par les articles L. 32-4, L. 32-5, L.36-8 et L.36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui apparaissent suffisantes et compatibles avec le règlement européen d'application directe.
Les dispositions d'adaptation du droit national parachèvent ainsi le cadre de gouvernance en matière d'économie de la donnée initié au niveau européen par le règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance européenne des données, qui encadre les modalités de partage de données pour les administrations, les entreprises et les particuliers au moyen de trois dispositifs, régulés chacun par une autorité compétente désignée par les Etats membres :
- accompagnement des administrations dans leurs décisions d'autoriser ou de refuser l'accès aux données protégées122(*) qu'elles détiennent. En application de l'article 7 du règlement, cet accompagnement est assuré en France par la direction interministérielle du numérique (DINUM), désignée à cette fin par le décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019123(*) modifié relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique ;
- encadrement juridique de pratiques commerciales liées au marché de la donnée par la création de la notion de « services d'intermédiations de données », opérés par des organismes tenus à des obligations de neutralité, de transparence et d'intégrité. En France, en application de l'article 13 du règlement, l'Arcep a été désignée comme l'autorité compétente en matière de services d'intermédiation de données en vertu de l'article 36 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (loi dite SREN)124(*) ;
- création du statut juridique des « organisations altruistes » en matière de données. En France, en application de l'article 23 du règlement, les dispositions de l'article 57 de la loi SREN désignent la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en tant qu'autorité compétente. Ces dispositions comportent des mesures d'adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et renvoient à un décret en Conseil d'Etat125(*) pour l'encadrement de la procédure d'enregistrement au registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues126(*).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (cf. décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (cf. décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 impose aux États membres de désigner des autorités compétentes pour veiller à son application, sans préjudice des compétences nationales déjà existantes. Le présent article vise à assurer la cohérence du droit national avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le Data Act comporte des dispositions relatives :
(i) au partage de données dans les relations entre entreprises et dans les relations entreprises-consommateurs ;
(ii) à l'accès de la puissance publique aux données du secteur privé dans des circonstances exceptionnelles ;
(iii) au régime de transfert de données non personnelles détenues par les fournisseurs de services de traitement de données (informatique en nuage) à des autorités non-européennes.
D'application directe et de nature transversale, ce règlement laisse aux Etats membres le soin de :
(i) désigner la ou les autorités compétentes chargées de sa mise en oeuvre au regard des critères précisés en son article 37127 ;
(ii) déterminer le régime de sanctions applicable pour veiller à la bonne application des différentes parties du règlement.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif des dispositions du présent article est de désigner l'Arcep comme autorité nationale compétente pour veiller à la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/2854 sur les données (Data act) et sanctionner le cas échéant les violations de ce règlement (à l'exception de son chapitre VII) en la dotant des pouvoirs nécessaires pour y parvenir et en assurant la cohérence de ces dispositions avec les procédures déjà exercées par l'Arcep.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Compte tenu de sa capacité à répondre aux attentes des entreprises en matière d'expertise technique et sa connaissance des enjeux commerciaux liés aux données, dans des conditions d'indépendance et de fonctionnement reconnues, ainsi que de son rôle déjà avéré dans le cadre de l'intermédiation des données et de la régulation de la fourniture de services d'informatique en nuage, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) apparaît comme l'autorité la plus légitime et la plus à même d'assurer la mise en oeuvre cohérente du règlement sur les données et de son articulation avec les autres domaines complémentaires relatifs aux données dans lesquels elle exerce déjà ses missions, à l'exception du chapitre VII relatif à l'accès international illicite aux donnes à caractère non-personnel et au transfert international illicite de ces données par les autorités publiques.
Ainsi :
- Par souci de simplification administrative et de lisibilité par l'écosystème de la donnée, les pouvoirs d'enquête et de sanction afférents confiés à l'Arcep s'inscrivent dans le cadre des procédures existantes prévues notamment par les articles L. 32-4, L. 32-5, L.36-8 et L.36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui apparaissent suffisantes et compatibles avec le règlement européen d'application directe.
- S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE) 2023/2854 relatives au règlement des litiges (article 10) dans le cadre du partage de données générées par des produits connectés (internet des objets, dit « IoT ») ou de la fourniture de services de traitement de données (informatique en nuage, dit « cloud »), le présent article prend la mesure des droits conférés par le règlement, qui n'exige pas la désignation d'une entité particulière par les Etats membres mais la certification d'entités à leur demande. Cette exigence procédurale semble donc imposer la mise en place d'une procédure de certification préalable par les Etats membres. Le présent article renvoie dès lors à un décret d'application les conditions et modalités de la procédure de certification que les entités - publiques ou privées - qui le souhaiteront pourront mobiliser en application de l'article 10 précité pour obtenir leur certification en tant qu'organe de règlement des litiges, sous le contrôle de l'Arcep, autorité compétente désignée.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les dispositions du présent article confient de nouvelles compétences à l'Arcep.
Dans un souci d'accessibilité de la norme et pour favoriser le regroupement des dispositions applicables en matière numérique - à défaut de pouvoir les intégrer immédiatement dans le code des postes et des communications électroniques, les dispositions du présent article sont intégrées dans un article 35-1 au sein du titre III de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dans un chapitre IV bis intitulé « Dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 (règlement sur les données) ».
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions de cet article assurent la mise en conformité du droit national avec les articles 10 et 37 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023.
Elles chargent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de l'application et de l'exécution dudit règlement à l'exception de son chapitre VII.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La Commission européenne a produit une étude127(*) qui aborde en détail les impacts, notamment macroéconomiques, du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, qui vise à assurer une meilleure répartition de la valeur issue de la circulation et de l'utilisation des données pour les acteurs concernés. A ce titre, il entend créer les conditions d'un meilleur équilibre concurrentiel sur le marché des données et encourager la recherche et l'innovation, sous la supervision des autorités compétentes désignées par les Etats membres, à l'instar de l'Arcep en France.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les impacts sur les entreprises découlent directement du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023.
Compte tenu de la technicité des droits et obligations qu'il établit, l'efficacité de sa mise en oeuvre repose sur :
- la connaissance fine des enjeux commerciaux liés au partage des données, tels que ceux liés à la protection du secret des affaires ou réputationnels, sans préjudice des compétentes existantes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de données à caractère personnel ;
- la capacité à régler les différends techniques et financiers induits par la complexité des activités numériques, en prenant en compte les enjeux et contraintes des acteurs économiques investis dans l'économie de la donnée.
4.2.3. Impacts budgétaires
Aucun impact budgétaire direct n'est identifié. Néanmoins, un impact budgétaire indirect est envisageable. Cette désignation appellera en effet des contrôles par les services de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse, qui nécessiteront des moyens (notamment humains) spécifiques pour l'autorité.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions du présent article ne créent pas de nouvelle structure administrative. Les nouvelles missions confiées à l'Arcep engendreront une charge administrative supplémentaire.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La Commission européenne a produit une étude128(*) qui aborde en détail les impacts, notamment sociaux, du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, sur les relations129(*) entre acteurs concernés. En prévoyant la désignation d'autorités compétentes nationales, le règlement entend améliorer les conditions d'accès aux données, par la rationalisation des procédures afférentes130(*).
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La Commission européenne a produit une étude 131(*) qui aborde en détail les impacts, notamment environnementaux, du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023. En prévoyant la désignation d'autorités compétentes nationales, le règlement entend améliorer les conditions d'accès aux données132(*) pour répondre aux défis environnementaux, en rationalisant les procédures afférentes sous la supervision desdites autorités.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La consultation de l'Arcep est obligatoire aux termes de l'article L.36-5 du code des postes et des communications électroniques. Elle a été saisie par voie de procédure écrite le 10 juillet 2025 et a rendu un avis le 4 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
- Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
- Application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
La présente disposition s'appliquera à ces trois collectivités en application de l'article 35-2 du présent article (cf voir brique d'étude d'impact relative à l'article 25 bis).
- Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
La présente disposition ne s'appliquera pas à ces trois collectivités.
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'article 10 du règlement (UE) 2023/2854 verront leurs modalités d'application définies par un décret simple.
Article 26, 27 et 28 - Modifications sémantiques du code de commerce en cohérence avec le Data Act
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
26 - Modification de l'article L442-12 du code de commerce
L'article 26 modifie la définition de « services d'informatique en nuage » à l'article L.442-12 du code de commerce en remplaçant le terme de « services d'informatique en nuage » par « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », ainsi que toutes les occurrences « d'informatique en nuage » par « de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».
Cet article entend ainsi assurer la conformité sémantique de l'article L.442-12 du code de commerce, et par corollaire la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données. En effet, la loi SREN, au travers de son article 26, a contribué à l'ajout de l'article L.442-12 au code de commerce. Ce dernier pose le cadre définitionnel sur lequel s'appuie les dispositions du titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée » de la loi SREN, dont une partie a été prise pour anticiper et fluidifier l'application du règlement mentionné, et ainsi préparer tant l'autorité compétente que l'écosystème visé à l'arrivée de ce nouveau cadre réglementaire. Se faisant, la modification du socle définitionnel de l'article L.442-12 ne relève que de la pure modification de forme et n'introduit aucune modification de fond.
27 - Modification du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques
L'article 27 modifie les articles L.32, L32-4, L.36-6 et L.36-11 du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques pour remplacer les termes « d'informatique en nuage » par la formule « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».
Cet article vise à adapter la terminologie utilisée dans le code des postes et des communications électroniques en ce qui concerne les services de traitement de données, désignés aujourd'hui par le terme de services d'informatique en nuage, au regard des termes du règlement précité tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne. La substitution des termes opérée par cet article vise uniquement à assurer l'alignement sémantique du droit français sur le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données. Cette disposition n'entend pas modifier le fond des dispositions modifiées.
28 - Modification du titre II du Livre III du code des postes et des communications électroniques
Cet article entend procéder à une actualisation ciblée de l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, au regard de la nécessaire articulation entre le règlement européen, d'application directe, et les dispositions de la loi SREN relatives aux services d'informatique en nuage, afin de prendre en compte également les modifications apportées à l'article 30 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique par le présent projet de loi.
Le présent article entend ainsi supprimer à l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, à compter du 12 janvier 2027, la référence suivante « au second alinéa du III de l'article 30 et » qui sera devenues obsolète en raison de l'abrogation de cet article à cette date, en vertu de l'article 64 IV de la loi SREN (dite « Sunset clause »). Cette suppression s'inscrit dans une démarche de simplification et de clarification du droit applicable.
Cet article prévoit également l'ajout, à l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, d'une référence à l'article 35-1 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, créé par l'article 25 du présent projet de loi afin de préciser que la formation restreinte de l' autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), désignée comme autorité compétente chargée de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 à l'exception du chapitre VII, peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par ledit article.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (cf. décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (cf. décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018).
Concernant l'article 26 spécifiquement, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles relatives à la détermination des crimes et délits, à la procédure pénale, à la fiscalité, et, plus largement, aux principes fondamentaux régissant les obligations civiles et commerciales. Le cadre définitionnel posé à l'article L.442-12 du code de commerce entre dans ce champ. De surcroît, la modification ici opérée consiste en un ajustement de cohérence sémantique, visant à harmoniser le droit interne avec un texte européen d'application directe, ici le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023. Dès lors, la modification proposée par l'article 26 du présent projet de loi relève bien du pouvoir d'adaptation du législateur, en application de l'article 34 de la Constitution.
Concernant l'article 28, la modification prévue à l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques relève pleinement du domaine de la loi. Conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient en effet au législateur la compétence de fixer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, à la répression des infractions, ainsi qu'à la compétence des autorités administratives indépendantes.
Enfin, en précisant les modalités de sanction applicables par l'Arcep en matière de traitement de données, et en supprimant des références devenues obsolètes dans l'article L.130, l'article 28 assure la cohérence normative et la clarté du droit, deux principes à valeur constitutionnelle consacrés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (cf. décisions n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 et n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les présents articles visent à assurer la cohérence du droit national avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023. En procédant à des modifications sémantiques du droit national, en confirmant la compétence de la formation restreinte de l'Arcep et en précisant les mécanismes de sanction applicables, le Gouvernement et le législateur français entendent permettre l'application complète du règlement mentionné, en évitant tout risque d'interprétation divergente par les juridictions nationales et européennes ainsi que toute difficulté d'application pratique pour les acteurs économiques et les autorités de régulation.
1.4. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les dispositions du présent article ne consistent pas en une surtransposition mais en une harmonisation des termes. En effet, l'article 26 de la loi SREN qui a donné la création de l'article L.442-12 du code du commerce n'est pas un article anticipé du Data Act. Il n'y a donc aucune raison de l'abroger. Néanmoins, il y a besoin de modifier la base définitionnelle de l'article car sert de base définitionnelle pour tous les autres articles qui suivent en lien avec le cloud (éléments mis précédemment)
26 - Modification de l'article L442-12 du code de commerce
La modification proposée à l'article L.442-12 du code de commerce est rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
La loi SREN a anticipé une partie des exigences posées par ce règlement et introduit pour ce faire, en son article 26, une définition des « services d'informatique en nuage ». Toutefois, le terme utilisé ne correspond plus à la terminologie retenue par le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023. Afin de prévenir toute difficulté d'interprétation à compter de la date d'application directe du règlement au 12 septembre 2025 et de garantir le principe de sécurité juridique, il est apparu nécessaire de modifier le cadre définitionnel de l'article L.442-12 pour l'aligner strictement sur celle du règlement européen.
Une divergence de terminologies pourrait en effet entraîner des incertitudes juridiques pour les opérateurs économiques concernés, et compromettre les objectifs sous-tendus par le règlement.
27 - Modification du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques
La modification proposée à l'article L.442-12 du code de commerce est rendue nécessaire par l'entrée en application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, d'application directe.
La loi SREN a défini en droit national le terme de « services d'informatique en nuage », alors que le règlement (UE) 2023/2854 n'emploie jamais ce terme, tout en le définissant de la même manière, au profit de la notion de « services de traitement de données ».
Compte tenu de l'application directe du règlement sur les données à partir du 12 septembre 2025, il apparaît dès lors nécessaire d'éviter toute divergence sémantique de nature à susciter une incompréhension des acteurs concernés et par là-même une incertitude juridique, afin d'assurer une parfaite articulation entre les règles de droit interne et le cadre juridique européen.
28 - Modification du titre II du Livre III du code des postes et des communications électroniques
La loi SREN, notamment en son article 30, avait prévu des dispositions transitoires pour encadrer l'action de l'Arcep en matière de services de traitement de données (« service d'informatique en nuage » avant modifications induites par le présent projet de loi). Or, certaines de ces dispositions, notamment le second alinéa du III de l'article 30, seront abrogées à compter du 12 janvier 2027 en raison de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2024, conformément à la temporalité prévue par l'article 29 et à l'article 64 de la loi précitée.
Le maintien de références à des dispositions législatives devenues obsolètes poserait ainsi un problème de lisibilité et de sécurité juridique. Il est donc nécessaire de mettre à jour l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, à cette même échéance, afin d'en garantir la cohérence et la lisibilité.
Outre un réagencement marginal du cadre réglementaire interne, cet article prévoit également l'ajout, à l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, précise que l'Arcep peut prononcer des sanctions sur le fondement du présent article. Cette précision apparaît indispensable en vue d'éviter toute carence normative pouvant entraver la bonne application des règles européennes.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif principal de la modification induite par les articles 26, 27 et 28 est d'éviter toute difficulté d'interprétation en assurant la cohérence sémantique entre le droit national existant tel que résultant de la loi SREN et le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, afin de permettre la bonne articulation du droit de l'Union et du droit national.
Ces articles entendent également éviter les divergences d'interprétation qui pourraient naître entre autorités nationales, juridictions ou opérateurs économiques sur le périmètre des obligations applicables, à la suite de l'application directe du règlement à partir du 12 septembre 2025. A cette fin elles participent de l'effort de simplification normative engagé par le Gouvernement.
L'article 28 vise en outre à clarifier le cadre juridique applicable à compter du 12 janvier 2027, en supprimant toute référence à des dispositions devenues obsolètes, comme le second alinéa du III de l'article 30 de la loi SREN. Il garantit ainsi la cohérence et la lisibilité du code des postes et des communications électroniques dans la perspective de l'entrée en vigueur complète du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
Il cherche, ensuite, à renforcer la lisibilité et la sécurité juridique du cadre de régulation nationale pour l'application du règlement (UE) 2023/2854. Il précise que les sanctions prononcées par l'Arcep, en tant qu'autorité compétences chargée veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 à l'exception du chapitre VII, devront respecter les modalités définies par les présentes dispositions.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Parmi les options envisagées pour les articles 26, 27 et 28 consistaient en un maintien en l'état du droit commun actuel, notamment sans substituer des termes par la terminologie issue du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 en vigueur. Cette solution n'a pas été retenue car elle semblait contribuer à créer une insécurité juridique et à augmenter le manque de lisibilité du cadre législatif français en matière de régulation des services d'informatique en nuage, pour les acteurs économiques comme pour les régulateurs. Une telle option aurait également pu susciter des divergences d'interprétation des obligations prévues par le règlement mentionné quant à leur champ d'application.
3.2. DISPOSITIF RETENU
26 - Modification de l'article L442-12 du code de commerce
L'option retenue vise à substituer les occurrences de « services d'informatique en nuage » et « d'informatique en nuage » respectivement par « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » et « de services de traitement de données au sens du règlement (UE 2023/2854 du 13 décembre 2023 », afin de garantir la cohérence sémantique du droit national avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, dans une logique de bonne articulation entre les différents textes. Cette solution permet également d'éviter les divergences d'interprétation qui pourraient naître entre autorités nationales, juridictions ou opérateurs économiques sur le périmètre des obligations applicables, mais aussi renforcer la sécurité juridique et la lisibilité du cadre législatif français pour faciliter l'application directe du Règlement.
27 - Modification du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques
L'option retenue vise à substituer les occurrences de « d'informatique en nuage » par « de traitement de données au sens du règlement (UE 2023/2854 du 13 décembre 2023 », afin de garantir la cohérence sémantique du droit national avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, dans une logique de bonne articulation entre les différents textes. Cette option permet également d'éviter les divergences d'interprétation qui pourraient naître entre autorités nationales, juridictions ou opérateurs économiques sur le périmètre des obligations applicables, mais aussi renforcer la sécurité juridique et la lisibilité du cadre législatif français pour faciliter l'application directe du Règlement.
28 - Modification du titre II du Livre III du code des postes et des communications électroniques
L'option retenue consiste en une double actualisation ciblée de l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques à savoir :
(i) une suppression, à compter du 12 janvier 2027, de la référence au second alinéa du III de l'article 30 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, appelé à être abrogé à cette date par l'article 38 du présent projet de loi ;
(ii) l'ajout d'un référence explicite à l'article 35-1 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, créé par l'article 25 du présent projet de loi, précisant que la formation restreinte de l'ARCEP peut prononcer des sanctions administratives dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/2854 à l'exclusion du chapitre VII, selon les modalités prévues par cet article.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
26 - Modification de l'article L. 442-12 du code de commerce
L'impact de la modification, proposée par l'article 26 du présent projet de loi, de l'article L.442-12 du code de commerce est essentiellement de nature sémantique, sans incidence sur le fond des dispositions ainsi modifiées. Cette intervention législative vise à assurer l'alignement sémantique du droit interne sur le droit de l'Union européenne, en remplaçant les mots « services d'informatique en nuage » et « d'informatique en nuage » respectivement par les formules « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » et « de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».
L'article L.442-12, introduit par l'article 26 de la loi SREN, avait été conçu pour anticiper partiellement les exigences du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, en posant un cadre national préparatoire à l'application du règlement mentionné. Toutefois, la terminologie utilisée ne correspond pas à celle retenue dans le texte final du règlement publié.
27 - Modification du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques
L'impact de la modification, proposée par l'article 27 du présent projet de loi, aux articles L.32, L.32-4, L.36-6 et L.36-11 du titre Ier du Livre II du code des postes et des communications électroniques est principalement de nature sémantique, sans incidence sur le fond des définitions existantes.
Cette intervention législative vise à assurer l'alignement du droit interne avec le droit de l'Union européenne, en remplaçant les mots « d'informatique en nuage » par la formule « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ». Elle n'a ainsi aucun impact sur le régime juridique applicable aux acteurs économiques ou aux autorités administratives concernées, ici l'Arcep. Les missions, les pouvoirs de régulation, les procédures et les obligations demeurent inchangés.
28 - Modification du titre II du Livre III du code des postes et des communications électroniques
Le présent article apporte deux ajustements ciblés à l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, sans modifier le fonctionnement général du dispositif de régulation existant.
Il supprime tout d'abord une référence obsolète. En effet, la suppression, à compter du 12 janvier 2027, de la référence au « second alinéa du III de l'article 30 et » de la loi SREN permet d'éviter le maintien dans la loi d'une mention devenue obsolète.
Il ajoute ensuite une référence explicite à l'article 35-1 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, créé par l'article 25 du présent projet de loi. afin de préciser que la formation restreinte de l'Arcep pourra prononcer des sanctions pour les manquements aux dispositions du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, à l'exclusion du chapitre VII, sur la base de cet article.
L'ensemble du dispositif vise à adapter l'ordre juridique interne à l'échéance du 12 janvier 2027, dans une logique de d'articulation du droit européen et de simplification. Aucune norme nouvelle de fond n'est introduite, et aucun droit ou obligation existant n'est modifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article s'inscrit dans une logique d'adaptation du droit national avec le droit de l'Union européenne, en particulier avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées pour l'équité de l'accès aux données et de leur utilisation.
Concernant l'article 26, le règlement impose une définition uniforme des « services de traitement de données ».
Concernant l'article 27, le règlement donne une définition des « services de traitement de données », bien que défini au fond comme des services d'informatique en nuage au sens du droit national.
Afin de garantir une lecture cohérente des dispositions du code de commerce et des articles de la loi SREN qui s'appuient sur cette définition, il est nécessaire d'ajuster la terminologie nationale pour la faire correspondre à celle utilisée par le règlement européen.
Concernant l'article 28, en ajoutant la référence à l'article 35-1 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, créé par l'article 25 du présent projet de loi, à l'article L.130 du code des postes et des communications électroniques, la France se conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/2854 qui impose aux Etats membre de mettre en place des mécanismes de contrôle et de sanctions appropriés.
Ces modifications ne créent pas de norme nouvelle de fond, mais vise à assurer la lisibilité, la cohérence et l'efficacité juridique du droit interne vis-à-vis d'un texte européen applicable directement. Elle facilite la mise en oeuvre uniforme du règlement sur le territoire national, en évitant que subsistent dans le droit français des formulations susceptibles d'induire une interprétation divergente ou plus étroite que celle prévue par le droit de l'Union.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Concernant l'article 26, aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été conduite.
Concernant l'article 27, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a été saisie le 10 juillet 2025 et a rendu son avis le 04 septembre 2025.
Concernant l'article 28, l'autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (Arcep) a été saisie le 10 juillet 2025 et a rendu son avis le 04 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
La présente disposition s'appliquera à ces trois collectivités.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
La présente disposition ne s'appliquera pas à ces trois collectivités.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions ne requièrent pas de texte d'application.
Article 29 - Modification de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le présent article introduit des modifications sémantiques, notamment en ce qui concerne les termes de « services d'informatique en nuage », des réagencements et des abrogations ciblées dans le titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée », et par corollaire l'article 64 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), afin de garantir une cohérence normative et assurer une bonne application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
Outre l'objectif de renforcer l'équité et la confiance sur le marché de l'informatique en nuage, la loi SREN avait pour objectif d'anticiper au mieux l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 en permettant à l'Autorité de régulation des communication, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de commencer à engager les travaux nécessaires à la mise en oeuvre concrète de certaines obligations prévues par le règlement, en lien avec l'écosystème et de manière cohérente et constructive avec les instances européennes.
L'entrée en vigueur du règlement impose désormais un ajustement marginal des termes employés par les dispositions de la loi SREN prises pour anticiper l'application du règlement mentionné en matière de services d'informatique en nuage, afin de prévenir tout chevauchement de normes entre le niveau national et européen. Le présent article entend ainsi uniquement clarifier les dispositions nationales de la loi SREN, dans un souci de cohérence juridique, tout en assurant un cadre plus lisible pour les acteurs économiques et autorités compétentes.
Le présent article prévoit tout d'abord une mise en cohérence terminologique. En effet, il prévoit le remplacement systématique, dans les chapitres I, II et IV du titre III de la loi SREN les termes de « services d'informatique en nuage » par « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », dans un souci de cohérence avec la terminologie européenne. Cette harmonisation concerne les intitulés de chapitres, le contenu des articles 27 à 30, 33 et 35, ainsi que tous les renvois associés.
Cet article prévoit ensuite plusieurs suppressions et abrogations de dispositions de la loi SREN, notamment aux articles 27, 28, 29, 30, 33 et 64, devenues redondantes avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
Enfin, le présent article procède à une renumérotation au sein des articles 27, 30 et 33 de la loi SREN afin de tenir compte des nombreuses abrogations partielles ou totales de paragraphes. Cette réorganisation est indispensable pour garantir la lisibilité de ces articles après suppression de certains alinéas. Elle s'accompagne d'une mise à jour des renvois internes, notamment dans les articles 30 et 35, afin de supprimer les références devenues inexactes ou inopérantes. Par ailleurs, certaines mentions rédactionnelles ou structurelles ont également été supprimées lorsqu'elles apparaissent désormais incohérentes du fait des évolutions apportées à l'architecture du titre III. L'ensemble de ces ajustements vise à assurer la cohérence formelle du texte et à préserver son intelligibilité après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (cf. décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (cf. décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018).
Par ailleurs, les modifications prévues par le présent article relève pleinement du domaine de la loi. Conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient en effet au législateur la compétence de fixer les règles relatives aux droits civiques, aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ainsi qu'aux principes fondamentaux du droit des obligations civiles et commerciales. La révision des dispositions du titre III de la loi SREN relève de cette compétence, dans la mesure où elle touche à la régulation de l'économie de la donnée et à l'encadrement de la puissance publique, ici l'Arcep, dans l'application d'un règlement européen.
Par ailleurs, les modifications proposées répondent aux exigences constitutionnelles de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (cf. décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999). En supprimant des dispositions nationales devenues obsolètes ou redondantes avec le droit européen directement applicable, le présent article permet d'éviter les confusions juridiques et les doublons normatifs.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Cet article vise à assure la cohérence du droit national avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023. En modifiant et/ou abrogeant les articles 27 à 30 et 64 de la loi SREN, l'administrateur et le législateur français entendent permettre l'application complète du règlement mentionné, en évitant tout risque d'interprétation divergente par les juridictions nationales et européennes ainsi que toute difficulté d'application pratique pour les acteurs économiques et les autorités de régulation. Cet article permet également de répondre au principe de primauté du droit européen.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Outre l'objectif de renforcer l'équité et la confiance sur le marché de l'informatique en nuage, la loi SREN avait notamment pour objectif d'anticiper au mieux l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 en permettant à l'Arcep de commencer à engager les travaux nécessaires à la mise en oeuvre concrète de certaines obligations prévues par le règlement (UE) 2023/285 du 13 décembre 2023, en lien avec l'écosystème et de manière cohérence et constructive avec les instances européennes. L'entrée en application du règlement désormais imminente impose néanmoins désormais une révision des dispositions de la loi SREN, uniquement celles prises pour anticiper l'application du règlement mentionné, pour prévenir tout chevauchement réglementaire entre le niveau national et européen. Cet article du présent projet de loi entend ainsi uniquement clarifier les dispositions nationales de la loi SREN, dans un souci de cohérence et d'efficacité juridique, tout en assurant un cadre plus prévisible et lisible pour les acteurs économiques.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cet article a pour objectif de garantir une bonne articulation entre la loi SREN et le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, afin d'assurer une cohérence claire entre le droit national et européen. Il vise aussi à harmoniser la terminologie juridique utilisée en droit national avec celle du règlement mentionné, afin de prévenir toute ambiguïté dans l'interprétation des textes. De plus, il prévoit la suppression des dispositions obsolètes ou redondantes, qui ne sont plus nécessaires en raison des obligations européennes directement applicables.
Dans une logique de simplification, cet article cherche à rendre plus claire et lisible la structure juridique du titre III de la loi SREN, afin de mieux s'adapter au cadre de régulation européenne. Il a également pour but de renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques en leur offrant un cadre stable et prévisible d'ici les échéances du 12 septembre 2025 et du 12 janvier 2027.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée que celle retenue.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue repose sur une adaptation législative ciblée du titre III de la loi SREN, conçue pour assurer une articulation fluide avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023. Elle vise en premier lieu à aligner la terminologie nationale sur celle du droit européen, en substituant à l'expression « services d'informatique en nuage » celle de « services de traitement de données » telle que définie par le règlement. Elle prévoit également des abrogations échelonnées dans le temps, synchronisées avec le calendrier d'application du règlement mentionné.
Cette révision s'accompagne d'une restructuration purement formelle du texte, incluant la renumérotation des dispositions modifiées, la suppression des formulations devenues inadaptées, ainsi que la correction des renvois internes affectés par les abrogations.
Par cette approche, le législateur garantit à la fois la clarté et la stabilité de l'ordre juridique interne, la lisibilité des obligations applicables pour les acteurs économiques, et à l'Arcep de poursuivre son action de régulation dans un environnement juridique clarifié et stabilisé.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Cet article a pour effet principal de restructurer sur le plan formel uniquement le titre III de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN), qui avait notamment pour objectif d'anticiper au mieux l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 en permettant à l'Arcep de commencer à engager les travaux nécessaires à la mise en oeuvre concrète de certaines obligations prévues au titre III de la loi SREN. En pratique, cette modification se traduit par différents impacts sur l'ordre juridique interne, tel que modifié par la loi précitée.
Tout d'abord, le présent article procède à la suppression et/ou abrogation d'un ensemble de dispositions aux articles 27 à 30, 33 et 64 de la loi SREN, de manière à s'articuler correctement avec les dispositions applicables directement du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
- Les paragraphes III, IV et VII de l'article 27, relatifs aux frais de changement de fournisseur et aux obligations d'information, sont abrogés au 12 septembre 2025 pour éviter toute redondance avec les articles 25, 29 et 34 du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
- Les paragraphes II, V et VIII de l'article 27, relatifs aux frais de transfert de données et aux exceptions prévues pour les services d'informatique en nuage conçus sur mesure ou pour à des fins d'essais et/ou d'évaluation, sont abrogés à partir du 12 janvier 2027, conformément à l'application directe du paragraphe 1 de l'article 29 et de l'article 31 du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2024.
- Les articles 28 et 29, relatifs à l'interopérabilité et à la portabilité, sont supprimés en cohérence avec les articles 30 et 35 du règlement.
- Les paragraphes I à III de l'article 30, relatifs aux modalités de contrôle de l'Arcep uniquement désormais pour l'article 27, sont abrogés au 12 janvier 2027, date à laquelle l'article 29 du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 interdira directement tous frais de changement de fournisseur dans le cadre d'un changement de fournisseur.
- Le paragraphe I de l'article 33 de la loi SREN, relatif aux obligations d'information incombant aux fournisseurs de services de traitement de données, est abrogé à partir du 12 septembre 2025, conformément à l'application directe de l'article 28 du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
- Le paragraphe IV de l'article 64 (« Les articles 27 à 30 et le I de l'article 33 de la présente loi ne s'appliquent que jusqu'au 12 janvier 2027 ») est abrogé en raison de l'abrogation et suppressions précédentes.
Ces abrogations ont pour effet de supprimer les redondances en droit national, de prévenir les conflits de normes entre les niveaux national et européen, et de garantir la lisibilité des normes de droit interne.
Les présentes dispositions entrainent également une restructuration purement formelle de plusieurs articles (27, 30, 33), afin de maintenir une numérotation cohérente et actualiser les références internes. Cela concerne notamment :
- La requalification des mentions numériques (cf. le « V » devient « III », le « VI » devient « IV », etc.), pour correspondre aux paragraphes encore en vigueur.
- La suppression de la mention « IV. - » à l'article 30, devenue sans objet après abrogation des parties précédentes.
- La mise à jour, à l'article 35, de la liste des articles visés (cf. « les articles 27 à 30 et l'article 33 » devient « les articles 30 et 33 »).
Il s'agit dès lors d'un travail légistique de consolidation, qui ne modifie pas le fond du droit mais assure la lisibilité, la cohérence et la stabilité des textes résultant des débats parlementaires.
Enfin, en ajustant le périmètre d'application des dispositions nationales à la temporalité d'entrée en vigueur règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, le présent article clarifie les prérogatives de l'Arcep, en maintenant temporairement certaines dispositions nationales (telles que le II de l'article 27 de la loi SREN) jusqu'à leur substitution par les règles posées par le Règlement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Cet article s'inscrit dans une logique d'alignement marginal du droit national avec le droit de l'Union européenne, en particulier avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.
En effet, le maintien dans le droit national de dispositions législatives traitant des mêmes obligations que celles fixées par le règlement mentionné - notamment en matière de frais de changement de fournisseur, de frais de transfert de données, de transparence contractuelle, d'interopérabilité, etc. - ferait peser un risque juridique important, en particulier en cas de contradiction ou de divergence d'interprétation. Cet article répond donc à l'exigence de cohérence normative en supprimant, à échéances coordonnées avec le calendrier d'entrée en vigueur du Règlement, les dispositions de la loi SREN devenues redondantes. Ces modifications ne créent pas de norme nouvelle de fond, mais vise à assurer la lisibilité, la cohérence et l'efficacité du droit interne tel que résultant des discussions parlementaires vis-à-vis du texte européen, applicable directement. Il garantit ainsi l'effectivité du règlement européen, conformément au principe de primauté du droit de l'Union européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les modifications introduites le présent article impliquent une mise à jour des textes réglementaires d'application. En particulier, les arrêtés et décrets pris pour l'application des articles de la loi SREN concernés devront être adaptés afin de garantir leur cohérence avec la nouvelle rédaction législative.
Ces ajustements n'emportent pas de conséquences organisationnelles lourdes pour les services administratifs. Ils nécessiteront toutefois une mobilisation ponctuelle des administrations compétentes pour procéder à la révision des actes réglementaires concernés et en assurer la publication.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (Arcep) a été saisie le 10 juillet 2025 et a rendu son avis le 04 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
- Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
- Application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
La présente disposition s'appliquera à ces trois collectivités.
- Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
La présente disposition ne s'appliquera pas à ces trois collectivités.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Articles 25 bis et 30 - Extension et application outre-mer du règlement européen sur les données
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 25 étend expressément l'application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement européen sur les données) aux territoires des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, outre son application de plein droit au territoire de Saint-Martin.
Les dispositions du Code général des collectivités territoriales précisent la nature des compétences de l'Etat et des collectivités d'outre-mer. Plus précisément, les articles LO6211-1 à LO6271-8 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy ; les articles LO6311-1 à LO6380-1 à Saint-Martin, et LO6411-1 à 6475-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon.Les dispositions du règlement européen concernant les attributions dévolues à la Commission européenne ou autres instances ou organes européens ne sont toutefois pas applicables à ces territoires d'outre-mer.
L'article 30 étend expressément l'application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant les règles harmonisées portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) aux territoires des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, outre son application de plein droit au territoire de Saint-Martin.
Les dispositions du règlement européen concernant les attributions dévolues à la Commission européenne ou autres instances ou organes européens ne sont toutefois pas applicables à ces territoires d'outre-mer.
Le choix de limiter l'application directe de ces deux règlements à ces collectivités d'outre-mer et de ne pas l'étendre aux collectivités du Pacifique de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, est motivé par l'absence de compétence de l'État dans les matières nouvelles traitées par ce règlement européen. Par souci de cohérence dans l'application des dispositions du règlement, il a été fait le choix de ne pas l'appliquer au territoire de Wallis-et-Futuna.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3) ;
Les articles 74 et 77 de la Constitution définissent le statut régissant les collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier.
Les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ont, en vertu de l'article 74 de la Constitution, « un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République », ce statut étant défini par une loi organique.
Dans les ces trois collectivités, le régime
de spécialité législative institué par l'article 74
dont elles relèvent a été inversé par les lois
organiques au bénéfice d'un régime d'identité
législative dans la limite des compétences normatives propres de
ces collectivités.
Dans le cadre de l'application du droit
dérivé de l'Union Européenne dans ces trois
collectivités, elles peuvent relever de deux catégories
distinctes en droit de l'Union européenne : les régions
ultrapériphériques (RUP), d'une part, et les pays et territoires
d'outre-mer (PTOM), d'autre part.
- Saint-Martin (SXM) est une RUP dans laquelle l'ensemble du droit de l'Union Européenne est applicable de plein droit (article 355 § 2 du TFUE ; CJCE 10 octobre 1978, Hansen, aff. 148/77 ; Conseil d'Etat, section des finances, avis n° 402.975 du 8 juillet 2021).
- Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM) et Saint-Barthélemy (SXB) sont des PTOM qui relèvent du régime spécial d'association à l'Union européenne (articles 198 à 204 du TFUE), le droit de l'Union européenne ne leur étant en principe pas applicable.
Au surplus, il convient de regarder SXB et SPM comme des collectivités relevant d'un régime distinct des autres PTOM dès lors qu'elles sont, sauf exception, régies par le principe d'identité législative. Si bien que lorsque le législateur adopte des dispositions d'adaptation du droit national aux règlements UE, ces dispositions s'appliquent à SXB et à SPM y compris en ce qu'elles font référence à des règlements UE (Décision CC n°2018-765 DC du 12 juin 2018 ; Conseil d'Etat, avis du 13 octobre 2020, section des finances, n°401046).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 25 vise à rendre applicable le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, d'application directe.
L'article 30 vise à rendre applicable le règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022, d'application directe.
En raison de leur situation particulière, les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont toutefois régies par les articles 198 à 204 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) concernant les pays et territoires d'outre-mer, tandis que celle de Saint-Martin, région ultrapériphérique, est régie par l'article 349 dudit Traité.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La disposition proposée apparaît nécessaire pour assurer la cohérence de l'application des règlements (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 et 2022/868 du 30 mai 2022 sur l'ensemble du territoire de la République, lorsque son application est compatible avec les textes en vigueur et la réalité économique du territoire concerné.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif principal d'assurer une application cohérente sur le territoire de la République, tout en prenant en compte la nouveauté des sujets traités par les règlements européens (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 et 2022/868 du 30 mai 2022, ainsi que les réalités pratiques et techniques que son application suppose au préalable en termes d'infrastructures ou d'organisation économique notamment. La cohérence des choix faits concernant le règlement européen sur les données s'impose également.
Concernant l'article 25, l'option retenue permet également à l'autorité compétente désignée (Arcep) de continuer à travailler sur les territoires d'outre-mer pour lesquelles elle est déjà compétente, à moyens constants et sans besoin de modifier le champ territorial de ses compétences au regard de celles qui lui ont déjà été attribuées par les textes en vigueur.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le choix de limiter l'application directe de ces deux règlements à ces collectivités d'outre-mer et de ne pas l'étendre aux collectivités du Pacifique de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, est motivé par l'absence de compétence de l'État dans les matières nouvelles traitées par ce règlement européen. Par souci de cohérence dans l'application des dispositions du règlement, il a été fait le choix de ne pas l'appliquer au territoire de Wallis-et-Futuna.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue vise à étendre l'application des règlements européens (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 et (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, outre celle de Saint-Martin où il sera d'application de plein droit.
Le règlement sur les données adopte une approche centrée sur le droit de la consommation et la protection des consommateurs, comme le rappelle son article 1er point 9, qui précise que « Le présent règlement complète le droit de l'Union qui vise à promouvoir les intérêts des consommateurs et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et à protéger leur santé, leur sécurité et leurs intérêts économiques (...) ».
L'Arcep apparaît comme l'autorité la plus légitime pour assurer la mise en oeuvre cohérente de ce règlement, par sa capacité à répondre aux attentes des entreprises en matière d'expertise technique et sa connaissance des enjeux commerciaux liés aux données, dans des conditions d'indépendance et de fonctionnement reconnues.
Ainsi :
- Par souci de simplification administrative et de lisibilité par l'écosystème de la donnée, les pouvoirs d'enquête et de sanction afférents confiés à l'Arcep s'inscrivent dans le cadre des procédures existantes prévues notamment par les articles L. 32-4, L. 32-5, L.36-8 et L.36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui apparaissent suffisantes et compatibles avec le règlement européen d'application directe.
- S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE) 2023/2854 relatives au règlement des litiges (article 10) dans le cadre du partage de données générées par des produits connectés (internet des objets, dit « IoT ») ou de la fourniture de services de traitement de données (informatique en nuage, dit « cloud »), l'article 35-1 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, créé par l'article 34 du présent projet de loi, prend la mesure des droits conférés par le règlement, qui n'exige pas la désignation d'une entité particulière par les Etats membres mais la certification d'entités à leur demande. Cette exigence procédurale semble donc imposer la mise en place d'une procédure de certification préalable par les Etats membres. L'article 35-1 de la loi précitée, tel que créé par l'article 25 du présent projet de loi, renvoie dès lors à un décret d'application les conditions et modalités de la procédure de certification que les entités - publiques ou privées - qui le souhaiteront pourront mobiliser en application de l'article 10 précité pour obtenir leur certification en tant qu'organe de règlement des litiges, sous le contrôle de l'Arcep, autorité compétente désignée.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 25 étend expressément l'application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement européen sur les données) aux territoires des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, outre son application de plein droit au territoire de Saint-Martin.
L'article 30 étend expressément l'application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant les règles harmonisées portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) aux territoires des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, outre son application de plein droit au territoire de Saint-Martin.
Les dispositions des deux règlements européens précités relatives aux attributions dévolues à la Commission européennes ou autres instances ou organes européens ne sont toutefois pas applicables à ces territoires d'outre-mer.
Dans un souci d'accessibilité de la norme et pour favoriser le regroupement des dispositions applicables en matière numérique - à défaut de pouvoir les intégrer immédiatement dans le code des postes et des communications électroniques :
- les dispositions de l'article 25 sont intégrées dans un article 35-2 au sein du titre III de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dans un chapitre IV bis intitulé « Dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 (règlement sur les données) ».
- les dispositions de l'article 30 sont intégrées dans un article 39-1 au sein du chapitre V du titre III de la loi précitée.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Cette modification ne crée pas de règle nouvelle de fond. Il permet de rendre directement applicable les règlements européens (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 et 2022/868 du 30 mai 2022 à certaines collectivités d'outre-mer.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 vise à assurer une meilleure répartition de la valeur issue de l'utilisation des données. A ce titre, il entend créer les conditions d'un meilleur équilibre concurrentiel sur le marché des données et encourager la recherche et l'innovation.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les impacts sur les entreprises découlent directement du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023.
Compte tenu de la technicité des droits et obligations qu'il établit, l'efficacité de sa mise en oeuvre repose :
(i) sur la connaissance fine des enjeux commerciaux liés au partage des données, tels que ceux liés à la protection du secret des affaires ou réputationnels, sans préjudice des compétentes existantes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de données à caractère personnel ;
(ii) sur la capacité à régler les différends techniques et financiers induits par la complexité des activités numériques, en prenant en compte les enjeux et contraintes des acteurs économiques investis dans l'économie de la donnée.
4.2.3. Impacts budgétaires
Aucun impact budgétaire direct n'est identifié. Néanmoins, un impact budgétaire indirect est envisageable. Cette désignation appellera en effet des contrôles par les services de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse, qui nécessiteront des moyens (notamment humains) spécifiques pour l'autorité.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions du présent article ne créent pas de nouvelle structure administrative. Les nouvelles missions confiées à l'Arcep engendreront une charge administrative supplémentaire.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La Commission européenne a produit deux études133(*) qui abordent en détail les impacts, notamment sociaux, du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023.
Ainsi, en prévoyant la désignation d'autorités compétentes nationales pour veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre, ces deux règlements entendent améliorer les conditions de partage et d'accès aux données pour les acteurs concernés (entreprises, consommateurs, organismes publics, particuliers) par la rationalisation des procédures afférentes 134(*).
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
En prévoyant la désignation d'autorités compétentes nationales pour veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre auprès des acteurs concernés (entreprises, consommateurs, organismes publics, particuliers) le règlement européen sur les données et le règlement européen sur la gouvernance des données entendent améliorer les conditions de partage et d'accès aux données, par la rationalisation des procédures afférentes135(*). Le règlement européen sur la gouvernance des données, en particulier, instaure un dispositif de partage de données à caractère personnel intitulé « altruisme des données », supervisé, en France, par la CNIL136(*).
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
En prévoyant la désignation d'autorités compétentes nationales, les règlements précités entendent améliorer les conditions d'accès aux données137(*) pour répondre aux défis environnementaux, par la rationalisation des procédures afférentes sous la supervision de desdites autorités.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (Arcep) a été saisie le 10 juillet 2025 et a rendu son avis le 4 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
- Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
- Application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les deux règlements européens s'appliqueront à ces trois collectivités.
- Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
Les deux règlements européens ne s'appliqueront pas à ces trois collectivités.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions ne nécessitent pas de texte d'application.
Article 31 -Mise en conformité de dispositions du code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le déploiement de réseaux de communications électroniques fixes et mobiles dans l'Union européenne exige des investissements significatifs.
A cet égard, historiquement, les coûts de déploiement ont été, pour la plupart, imputables aux trois facteurs suivants :
- des déficiences dans le processus de déploiement liée à l'utilisation des infrastructures passives existantes (telles que les gaines, conduites, trous de visite, boîtiers, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis) ;
- des goulets d'étranglement relatifs à la coordination des travaux de génie civil et à la lourdeur des procédures administratives de délivrance des autorisations d'urbanisme ;
- des obstacles au déploiement des réseaux à l'intérieur d'immeubles.
C'est dans ce contexte que, il y a dix ans, soucieux de faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit (à savoir, ceux pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s),138(*) les Etats membres et le Parlement européen ont adopté la directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (la « directive 2014/61 »). Ce texte, transposé en droit français par l' ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016, a prévu entre autres les obligations suivantes :
- une obligation pour les opérateurs de réseau (eau, transport, électricité, télécoms...) de faire droit à toute demande raisonnable d'accès à leurs infrastructures passives, faite par une entreprise souhaitant déployer des éléments de réseau de communications électroniques à haut débit ;
- une obligation pour les opérateurs de réseau (eau, transport, électricité, télécoms...) effectuant des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, de faire droit à toute demande raisonnable de coordination faite par une entreprise souhaitant déployer des éléments de réseau CE à haut débit ;
- afin de faciliter les demandes d'accès, une obligation pour les opérateurs de réseau (eau, transport, électricité, télécoms...) de mettre à disposition certaines informations relatives à leurs infrastructures passives et à leurs projet de travaux de génie civil ;
- une obligation pour les autorités compétentes de délivrer ou de refuser les autorisations d'urbanisme relatives à des éléments de réseau CE à haut débit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète ;
- une obligation pour les propriétaires d'immeubles de les équiper d'une infrastructure passive intérieure adaptée au haut débit.
La Commission européenne ayant jugé insatisfaisants les résultats de la directive 2014/61, le 12 mai 2024 a été publié le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (le « règlement 2024/1309 »). Ce texte, qui a abrogé la directive 2014/61, va plus loin que la directive à plusieurs égards :
- LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LES OBLIGATIONS D'ACCÈS ET DE MISE À DISPOSITION D'INFORMATIONS : Alors que la directive visait surtout les opérateurs de réseau (eau, transport, électricité, télécoms...), le règlement crée des obligations d'accès et de transparence également pour les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures passives (toits de mairies, lampadaires d'éclairage public...) ;
- LA MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS : Un point d'information unique consiste en un répertoire électronique d'informations, dans lequel les informations peuvent être mises à disposition et les demandes introduites en ligne à l'aide d'outils numériques, tels que des pages internet, et des applications et des plateformes numériques. La directive exigeait la mise en place d'un tel point uniquement pour les informations relatives aux projets de travaux de génie civil. Le règlement étend la mise en place d'un point d'information unique aux informations relatives aux infrastructures passives ;
- LA NATURE DES INFORMATIONS MISES À DISPOSITION : La directive exigeait la mise à disposition d'informations sur l'emplacement des infrastructures physiques et des travaux de génie civil ; le règlement exige en plus que ces informations soient géoréférencées ;
- LE DÉLAI POUR METTRE À DISPOSITION LES INFORMATIONS : En ce qui concerne les demandes d'information relatives aux infrastructures physiques, la directive prévoyait un délai de réponse de deux mois. Le règlement a réduit ce délai à seulement 10 jours.
- LES CONSÉQUENCES DE L'ABSENCE D'UNE DÉCISION D'URBANISME : Le règlement introduit la notion d'approbation tacite, en prévoyant qu'en l'absence de décision de l'autorité compétente dans le délai de 4 mois, l'autorisation est réputée accordée. Il convient de préciser que le système d'approbation ne s'applique pas aux droits de passage.
Enfin, l'article 17 du règlement 2024/1309 comporte un sujet distinct : le prix de détail des communications passées depuis un téléphone fixe ou mobile, depuis son pays d'origine vers tout autre pays de l'Union européenne. Cet article, qui modifie le règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015, ne nécessite pas d'adaptation du droit français.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3). La transposition ou l'adaptation doivent permettre la mise en oeuvre effective des règles européennes.
Aucune des modifications envisagées ne semble en contrariété avec une règle ou norme de valeur constitutionnelle.
Il n'existe pas de jurisprudence pertinente du Conseil constitutionnel.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le secteur des communications électroniques est soumis à une régulation économique qui a fait partie d'un mouvement de libéralisation des marchés à l'initiative des autorités européennes. Depuis 1990, plusieurs « paquets » télécom ont créé un cadre réglementaire harmonisé au sein de l'Union européenne pour la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques. En ce sens, une régulation du secteur a été mis en place entre le ministre chargé des postes et des communications électriques ainsi qu'un régulateur indépendant qu'est l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le cadre réglementaire des communications électroniques a fait l'objet d'une refonte dans le cadre de l'adoption de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, par laquelle de nouveaux acteurs sont entrés dans le champ de la régulation et de nouvelles priorités ont été données comme le déploiement de réseaux de nouvelle génération tels que l'accès à la 5G et à la fibre optique ainsi que la mutualisation des infrastructures afin d'accélérer leur déploiement au sein des Etats membres de l'Union européenne.
Dans la perspective de faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit tout en réduisant les coûts liés à ce déploiement, la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit a introduit un ensemble de mesures harmonisées pour répondre aux progrès réalisés dans le domaine des technologies numériques et pour répondre aux besoins croissants et futurs des entreprises et des citoyens européens nécessitant un accès à des réseaux qui ont une capacité plus élevée. Cette directive est abrogée par le règlement 2024/1309 qui justifie la mise en conformité de certaines dispositions du code des postes et communications électroniques (CPCE) afférentes au déploiement des réseaux de communications électroniques.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Pour se conformer au règlement 2024/1309, la majorité, si ce n'est l'ensemble des Etats-membres, devront adapter leur droit aux nouvelles exigences posées par ce texte.
Toutefois, le règlement 2024/1309 n'est entré en vigueur que le 11 mai 2024 et ne sera applicable, en fonction des dispositions concernées, qu'à partir du 12 novembre 2025,139(*) du 12 février 2026,140(*) du 12 mai 2026,141(*) et (au plus tard) du 12 mai 2027.142(*)
A ce stade, il n'y a pas d'éléments permettant de faire un état des lieux comparé de la mise en oeuvre du règlement dans les Etats membres de l'Union européenne. A titre d'exemple, il n'y a pas d'informations disponibles sur le point de savoir si les autres Etats membres vont :
- sur la forme : modifier leurs dispositions nationales, mises en place lors de la transposition de la directive 2014/61, ou les supprimer, pour s'appuyer uniquement sur le règlement, qui est d'application directe ;
- sur le fond : activer certaines options permises par le règlement, par exemple la possibilité de restreindre le recours qui peut être fait à un motif de refus d'accès prévu à l'article 3.5(f) du règlement, et en retardant - pour les municipalités de moins de 3 500 habitants - l'applicabilité des obligations d'information prévues à l'article 4 du règlement
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les modifications proposées sont du niveau législatif (modifications de dispositions législatives existantes) et relèvent de la compétence de la loi conformément à l'article 34 de la Constitution.
Le règlement 2024/1309 venant abroger une directive ayant fait l'objet d'une transposition en 2016 dans le code des postes et communications électroniques et complétant ou modifiant les principes et obligations initiés par cette directive, il apparait nécessaire de légiférer pour adapter certaines dispositions du droit national aux évolutions imposées par le règlement afin d'assurer lisibilité et sécurité juridique. A titre d'exemple, en matière de demandes d'accès à des infrastructures passives, alors que l'article L. 34-8-2-1 du CPCE permet un refus dans les deux mois suivant la demande, l'article 3.7 du règlement 2024/1309 ne prévoit qu'un délai d'un seul mois. Sauf à aligner le texte français sur le texte européen, certains acteurs pourraient avoir des difficultés à identifier facilement la disposition applicable (le règlement) et écarter la disposition nationale continuant de figurer dans le code des postes et communications électroniques.
De plus, le règlement permet une flexibilité dans la mise en oeuvre de certaines de ses dispositions. Il revient aux Etats membres souhaitant mettre en oeuvre la flexibilité permise de prendre les dispositions nationales adéquates. En France, la mise en oeuvre de cette flexibilité requiert des dispositions législatives
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif des mesures envisagées est d'assurer la conformité du droit français avec le règlement 2024/1309 portant sur le déploiement des réseaux de communications électroniques et de faire usage de la flexibilité octroyée aux Etats membres s'agissant de la mise en oeuvre de certaines options offertes telles que le report d'un an pour l'applicabilité des obligations d'information prévues à l'article 4 du règlement par les communes de moins de 3 500 habitants.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La transposition de la directive 2014/61 est intervenue par voie législative ce qui implique de recourir à la loi pour modifier les dispositions qui sont en contradiction avec le règlement de 2024/1309.
La diffusion de documents explicatifs quant à la primauté du règlement sur le droit national serait insatisfaisante au regard d'une part du maintien dans des textes nationaux de dispositions incohérentes avec le droit européen et d'autre part, porterait atteinte aux principes de sécurité et lisibilité juridiques.
Les règlements étant d'application directe, une option législative aurait été de supprimer la totalité des dispositions législatives nationales ayant résulté de la transposition de la directive 2014/61.
Une telle approche aurait toutefois eu de nombreux inconvénients.
Par exemple, le règlement 2024/1309 impose des obligations non seulement aux opérateurs télécoms mais également aux collectivités territoriales (y compris les plus petites) et aux propriétaires de bâtiments. Ces acteurs ne sauraient pas forcément aller chercher le détail de leurs obligations au-delà du code national qui leur est habituellement applicable.
Par ailleurs, le vocabulaire du règlement 2024/1309 pourrait facilement prêter à confusion en France. En effet, lors de la transposition de la directive 2014/61, il a été décidé de « françiser » certaines notions clés du texte européen, en appelant par exemple les fournisseurs d'accès des « gestionnaires d'infrastructures d'accueil » (terme français) plutôt que des « opérateurs de réseau » (terme européen). S'appuyer uniquement sur le règlement ne ferait ainsi que fragiliser la lisibilité des règles applicables.
Une deuxième solution aurait été de « transposer » le texte du règlement en droit national, en prenant le soin de bien adapter le vocabulaire au contexte français. Cela permettrait, comme la première solution, d'éviter aux administrés d'avoir à parcourir deux textes pour connaître leurs droits et obligations. Toutefois, cette approche aurait eu, elle aussi, certains inconvénients. Surtout, il est recommandé en légistique de ne pas réécrire en droit national un règlement.
3.2 DISPOSITIF RETENU
L'approche retenue est celle consistant :
- d'une part, à adapter les dispositions nationales existantes, en les modifiant, lorsqu'elles contredisent le règlement 2024/1309, et en les complétant lorsqu'il leur manque des éléments importants prévus au règlement 2024/1309 ;
- d'autre part, à activer les options souhaitées :
- le gouvernement fera application de la possibilité offerte par le règlement de différer - pour les communes de moins de 3 500 habitants - l'applicabilité des obligations d'information prévues à l'article 4 du règlement ;
- le gouvernement fera également application de la possibilité offerte par le règlement de de restreindre le recours qui peut être fait à un motif de refus d'accès prévu à l'article 3.5(f) du règlement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les modifications concernent les titres Ier (chapitre II, section 4) et II (chapitre III, section 1) du livre II du CPCE.
Les articles L. 32, L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2, L. 34-8-4, L. 36-8, L. 49 et L. 50 sont modifiés. L'article L. 1425-1du code général des collectivités territoriales est également modifié.
Les principales modifications envisagées sont listées dans le tableau ci-après :
|
Article GIA |
Article CPCE |
Sujet |
Modification |
|
2 |
L. 32 |
Définitions |
Modification de la définition d'« infrastructure d'accueil » pour englober les immeubles et le mobilier urbain des personnes publiques ; modification de la définition de « gestionnaire d'infrastructure d'accueil » pour mieux englober les personnes publiques. |
|
3 |
L. 34-8-2-1 |
Accès aux infrastructures d'accueil |
L'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil d'accorder un accès aux infrastructures d'accueil existe déjà dans le CPCE. Les mesures envisagées visent toutefois : une modification des éléments devant être pris en compte lors de la détermination des conditions d'accès ; une modification des motifs de refus d'accès ; une réduction du délai pour communiquer une réponse à la demande d'accès ; la non-applicabilité de l'obligation d'accès dans certains cas précisés. |
|
4 |
L. 34-8-2-2 |
Accès aux informations sur les infrastructures d'accueil |
L'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil de communiquer des informations relatives aux infrastructures d'accueil existe déjà dans le CPCE. Les mesures envisagées visent toutefois : ajout d'une disposition permettant la mise en place d'un « point d'information unique » par le biais duquel ces informations pourront être demandées de manière dématérialisée ; précision sur le fait que les informations communiquées en retour devront être désormais « géoréférencées » ; réduction du délai de communication des informations ; non-applicabilité de l'obligation d'information dans certains cas précisés. |
|
5 |
L. 49 II |
Accès aux travaux d'installation d'infrastructures d'accueil |
L'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil, en tant que « maîtres d'ouvrage », d'accueillir les opérateurs lors de travaux, existe déjà dans le CPCE. Les mesures envisagées visent toutefois : correction de vocabulaire ; ajout d'un motif de refus supplémentaire relatif aux infrastructures critiques. |
|
6 |
L. 49 I |
Accès aux informations sur les travaux d'installation d'infrastructures d'accueil |
L'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil, en tant que « maîtres d'ouvrage », de communiquer des informations sur les travaux, par le biais d'un point d'information unique, existe déjà dans le CPCE. Les mesures envisagées visent toutefois : modification de la nature des informations devant être fournies ; précision sur la possibilité de proroger le délai de réponse. |
|
13 |
L. 36-8 |
Compétences de l'Arcep |
Augmentation du nombre de différends pour lesquels l'Arcep peut être saisie, en cas d'échec de négociations. |
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les modifications proposées du code des postes et des communications électroniques s'inscrivent dans la continuité du cadre réglementaire européen et sont cohérentes avec les normes européennes pertinentes (règlement 2024/1309, directive 2018/1972, telles que transposées en droit français).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Tout impact macroéconomique serait la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Tout impact sur les entreprises serait la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.2.3. Impacts budgétaires
Tout impact budgétaire serait la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'impact sur les collectivités territoriales sera la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées, à l'exception près tenant du fait que le Gouvernement fera application de la possibilité offerte par le règlement de retarder - pour les communes de moins de 3 500 habitants - l'applicabilité des obligations d'information prévues à l'article 4 du règlement. Ce choix, favorable aux collectivités concernées, leur offrira une année supplémentaire pour se conformer aux obligations imposées par le règlement concernant l'accès aux informations à délivrer au titre de cet accès dans certains délais.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Tout impact sur les services administratifs (par exemple, un élargissement des compétences de l'Autorité de régulation des communication électroniques, des postes et de la distribution de la presse serait la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Tout impact éventuel sur la société serait la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.5.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Tout impact éventuel sur les particuliers serait la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L'impact environnemental serait la conséquence du règlement 2024/1309 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées. Il s'agit d'un impact positif, dans la mesure où le règlement permet aux exploitants de réseaux de communications électroniques d'utiliser des infrastructures existantes, la création de nouvelles infrastructures générant une pollution en termes d'émissions de gaz à effet de serre et étant susceptible de créer une pollution visuelle (dans le cas des infrastructures aériennes). L'étude d'impact de la Commission européenne a ainsi relevé un impact environnemental fort positif, avec notamment une réduction des émissions à effet de serre de 13,72% pour le déploiement des seuls réseaux fixes143(*).
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Conformément aux dispositions de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, le public a été consulté sur le projet de texte législatif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit sa consultation pour les projets de loi relatifs au secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a été consultée le 23 juin 2025 et a émis un avis le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions des articles L. 125 et D. 576 du code des postes et des communications électroniques, la Commission supérieure du numérique et des postes a été consultée le 23 juin 2025 et a émis un avis le 3 octobre 2025.
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes a été consulté à titre obligatoire le 02 octobre 2025 et a émis un avis défavorable.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La plupart des dispositions du présent article entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Les obligations relatives à la mise à disposition d'informations géoréférencées :
- sur l'emplacement des infrastructures passives (cf les VI, VII et VIII du présent article) entreront en vigueur le 12 mai 2026, pour les communes d'au moins 3 500 habitants et au plus tard le 12 mai 2027, pour les communes de moins de 3 500 habitants.
- sur l'emplacement des travaux de génie civil (cf le XII du présent article) entreront en vigueur le 12 mai 2026.
5.2.2. Application dans l'espace
Le règlement 2024/1309 est applicable de plein droit en France métropolitaine.
En vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les dispositions des traités sont applicables dans les régions ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin) définies à l'article 349 du TFUE.
Par conséquent, les collectivités de l'article 73 de la Constitution, ainsi que Saint-Martin, sont incluses dans le territoire d'application du règlement 2024/1309.
En vertu de l'article 355 du TFUE, les pays et territoires d'outre-mer définis à l'article 198 et dont la liste figure à l'annexe II de ce traité (i.e. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy) font l'objet d'un régime spécial d'association.
Le règlement (UE) 2024/1309 ne fait pas référence expresse aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Par conséquent, à part Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, qui bénéficient du principe de l'identité législative, les collectivités de l'article 74 de la Constitution, ayant le statut de PTOM, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les TAAF sont exclues du territoire d'application du règlement 2024/1309.
Conséquence : Application des modifications du CPCE envisagées
Les modifications du CPCE envisagées sont applicables de plein droit :
- en France métropolitaine ;
- dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) ;
- à Saint-Martin ;
- à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy où la loi sera applicable en vertu du principe de l'identité législative.144(*)
Au vu de leur exclusion du territoire d'application du règlement 2024/1309, sont exclues de la réforme législative envisagée la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.
Informations supplémentaires : Application des dispositions transposant la directive 2014/61
Comme mentionné plus haut, la directive 2014/61/UE, que le règlement 2024/61 abroge et remplace, a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016, laquelle n'a pas été rendue applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité, soit parce que celles-ci étaient compétentes en matière de communications électroniques (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française), soit il s'est agi d'un choix d'opportunité (Wallis-et-Futuna, TAAF).
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour l'application du présent article.
Article 32 - Dispositions spécifiques d'adaptation au règlement (UE) 2024/2847 relatif à la cyber-résilience
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En droit national, différentes règles s'imposent aux fabricants des produits comportant des éléments numériques afin d'assurer la cybersécurité de ces produits. En particulier, lorsqu'ils sont éditeurs de logiciels, ces fabricants sont actuellement soumis à l'obligation, prévue à l'article L. 2321-4-1 du code de la défense, de notification à l'ANSSI des vulnérabilités significatives et des incidents susceptibles d'affecter significativement leurs produits.
Parallèlement, a été adopté au niveau européen le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 (règlement sur la cyberrésilience), qui a pour objectif d'augmenter la cybersécurité des produits numériques, réduire les cyber-incidents et leurs coûts, harmoniser les règles de sécurité pour éviter les divergences nationales, améliorer la réputation et les revenus des entreprises, et renforcer la protection de la vie privée et des données sensibles. Ce règlement impose aux fabricants de prendre en compte la cybersécurité tout au long du cycle de vie des produits et de réduire leurs vulnérabilités. Il permet également aux utilisateurs de considérer la cybersécurité des produits lors de leur sélection, en améliorant la transparence sur les risques et l'assistance des fabricants.
Le texte fixe ainsi :
- les règles relatives à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques afin de garantir leur cybersécurité ;
- les exigences essentielles et des obligations de cybersécurité applicables aux fabricants et le cas échéant aux opérateurs économiques relatives :
§ à la conception, au développement et à la production de ces produits ;
§ aux processus de gestion des vulnérabilités mis en place pour garantir la cybersécurité de ces produits pendant la période d'utilisation prévue pour ceux-ci ;
§ des processus d'évaluation de conformité ;
- les règles relatives à la surveillance de marché et au contrôle de l'application des obligations du texte ;
- la détermination du régime des sanctions et autres mesures d'exécution applicables aux violations de ce même règlement, en tenant notamment compte des dispositions de l'article 64 du règlement.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel déduit de l'article 88-1 de la Constitution que l'adaptation du droit interne à un règlement de l'Union européenne résulte d'une exigence constitutionnelle (décision DC n° 2018-765 du 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, considérant 3).
Sur le fond, dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article n'entre en contradiction avec aucune norme de valeur constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel peut être amené à examiner les obligations légales imposées aux sociétés à l'aune de la liberté d'entreprendre qui procède de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le Conseil constitutionnel a confirmé, qu'elle comprend deux objets, à savoir : « non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité » (cons. n° 7)145(*). Il a notamment jugé que ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre la loi qui crée une obligation déclarative pour certaines sociétés dans le but de transmettre à l'administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, comptables et fiscaux de leur activité146(*).
En outre, conformément au principe de légalité des délits et des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) aux termes duquel « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » les éléments constitutifs de l'infraction ou du manquement concerné doivent être définis de façon précise et complète et la sanction doit être prévue par un texte. Par ailleurs, conformément à cet article, « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Appliqué pour la première fois à des sanctions administratives par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 87- 237 DC du 30 décembre 1987 rendue à propos d'amendes fiscales, le principe de proportionnalité implique que la sanction infligée soit adaptée, au vu des circonstances propres à chaque espèce, à la gravité du manquement.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Cet article s'inscrit dans le cadre de l'adaptation du droit national au règlement (UE) 2024/2847 s'agissant de la structuration d'une gouvernance nationale permettant sa bonne application.
La liberté d'entreprendre est garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet article protège la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre147(*). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge sur son fondement que la liberté d'entreprise ne constitue pas une prérogative absolue mais peut être soumise à un large éventail d'interventions de la puissance publique susceptibles d'établir, dans l'intérêt général, des limitations à l'exercice de l'activité économique.
Le texte s'inscrit dans le cadre d'harmonisation maximale c'est-à-dire que les Etats membres ne pourront pas (excepté pour certaines exceptions prévues dans le texte) édicter des règles nationales plus strictes que le règlement « CRA ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Certaines des dispositions qui doivent être adoptées pour mettre en oeuvre règlement (UE) 2024/2847 étant de nature législative, il est par conséquent nécessaire de légiférer pour modifier notamment le code des postes et des communications électroniques et abroger l'article L. 2321-4-1 du code de la défense.
En effet, le règlement introduit un dispositif de surveillance de marché assuré, pour la France, par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui peut imposer des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du marché et au rappel du produit ou des amendes (au maximum de 10 millions d'euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel mondial du fabricant). L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) aura un rôle de soutien technique auprès de l'ANFR tant dans la définition de la stratégie de surveillance que dans les contrôles menés par les laboratoires accrédités auxquels a recours l'ANFR.
S'agissant plus particulièrement de l'abrogation de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense, cet article ne peut pas être maintenu en l'état car il prévoit des exigences contraires et supplémentaires au règlement. En effet, il voit son dispositif affecté par le règlement « CRA » en particulier sur les principaux points suivants :
- Périmètre organique : le règlement « CRA » assujettit les fabricants, incluant parfois importateurs et distributeurs tandis que l'article L. 2321-4-1 du code de la défense assujettit les éditeurs fournissant des produits en France ou à des entreprises françaises (siège social ou contrôlées) ;
- Périmètre matériel : le règlement « CRA » vise les vulnérabilités activement exploitées et incidents graves mais également de manière facultative toute vulnérabilité, cybermenace ou incident susceptible d'affecter un produit comportant des éléments numériques (PCEN) alors que l'article L. 2321-4-1 du code de la défense couvre les vulnérabilités significatives et les incidents susceptible d'affecter significativement la sécurité des systèmes d'information des produits ;
- Destinataire de la notification : le règlement « CRA » prévoit l'envoi de la notification au CSIRT coordonnateur de l'Etat membre dans lequel le fabriquant à son établissement principal via la plateforme ENISA, alors que l'article L. 2321-4-1 du code de la défense prévoit l'envoi de la notification à l'ANSSI ;
- Délais de procédure : les délais de notification et gestion des incidents peuvent différer.
Les fabricants, dont les éditeurs soumis à l'article L. 2321-4-1 du code de la défense, demeurent, en application du règlement, soumis à des obligations de communication des vulnérabilités et incidents et de divulgation coordonnée de celles-ci afin de protéger les utilisateurs.
En effet, le règlement prévoit deux principaux types d'obligations relatives à la gestion des vulnérabilités et incidents pour les fabricants :
- L'obligation de respecter des exigences relatives aux processus de gestion des vulnérabilités (exploitées ou non) à mettre en place afin de garantir la cybersécurité des produits qui comprennent des procédures et politiques de divulgation coordonnée des vulnérabilités et leur correction lorsque c'est possible (article 13 en particulier 13.8 et II de l'annexe I du règlement : gestion et correction sans retard, mise à jour de sécurité, tests réguliers, publication des mises à jour, communication etc) ;
- L'obligation pour le fabricant de notifier toute vulnérabilité activement exploitée ou incident grave contenu dans le produit comportant des éléments numériques dont il prend connaissance simultanément au CSIRT désigné comme coordinateur national et à l'ENISA (article 14 du règlement).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Aux fins de la mise en oeuvre des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, cet article permet :
- la création ou le cas échéant la modification des dispositions applicables aux autorités compétentes pour la mise en oeuvre du règlement au niveau national afin de prévoir ces nouvelles compétences et d'en préciser le périmètre ;
- la précision des mesures, y compris des amendes administratives et de leurs plafonds, que ces autorités peuvent ordonner ;
- de rendre applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna ainsi que, sans qu'il soit besoin de le prévoir explicitement, à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, ces dispositions avec les adaptations nécessaires.
S'agissant plus spécifiquement de l'article visant à abroger l'article L. 2321-4-1 du code de la défense, il s'agit de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur prochaine du règlement (UE) et en particulier de ses articles 13, 14 et de son chapitre V.
Ces articles fixent en particulier des obligations en matière de communication de vulnérabilités contenues dans des produits qui sont susceptibles d'être notamment des logiciels qui ne sont pas compatibles avec le maintien de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense. Créé par l'article 66 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense - dite « LPM 2024-2030 » - cet article a en effet prévu une obligation d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) applicable aux éditeurs de logiciels constatant des vulnérabilités significatives sur leurs produits. Le règlement « CRA » étant d'harmonisation maximale, il est inenvisageable de laisser coexister deux obligations d'information de l'ANSSI concurrentes. Poursuivant en outre un but de clarification et de simplification du droit applicable, il est donc proposé d'abroger l'article L. 2321-4-1 du code de la défense, les seules obligations résultant du règlement « CRA » ayant désormais vocation à s'appliquer.
L'article L. 2321-4-1 du code de la défense vise actuellement à contraindre les éditeurs de logiciels victimes d'un incident informatique sur leur système d'information susceptible d'affecter un de leurs produits, ou ayant une vulnérabilité significative sur un produit à le notifier à l'ANSSI et à en informer leurs utilisateurs. Cette mesure permet de garantir l'information des usagers afin qu'ils mettent en oeuvre des mesures de remédiation adaptées.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les dispositions dont l'insertion est prévue à l'article L. 43 du CPCE étant commandées par une norme supérieure issue du droit de l'Union européenne et certaines des dispositions à modifier pour garantir sa mise en oeuvre étant de nature législative, aucune autre option n'a été envisagée.
S'agissant de l'impact sur l'article L. 2321-4-1 du code de la défense, trois options ont été envisagées :
- l'abrogation de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense ;
- le maintien de cet article pour le périmètre exclu du champ d'application du règlement. Cette option a été écartée car le champ d'application très large du texte européen rendait le maintien de la disposition du code de la défense sans intérêt voire inopérante ;
- le maintien du texte national pour permettre à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de notifier aux éditeurs des vulnérabilités non corrigées, non connues de l'éditeur et non exploitées afin de lui demander la mise en place d'un plan de sécurisation et de communication aux utilisateurs. A défaut d'action suffisante de l'éditeur, cette option aurait permis à l'agence de notifier la vulnérabilité aux utilisateurs ou dans certains cas la publier. Le risque de non-conformité avec les articles 13 et 14 du règlement 2024/2847 étant trop important, cette option a été écartée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Cet article vise à modifier les dispositions spécifiques applicables aux autorités compétentes afin d'intégrer les compétences nouvelles ou élargies prévues pour la mise en oeuvre du règlement. A cet égard, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) est désignée comme autorité de surveillance du marché et investie de missions nouvelles.
A ce titre, l'ANFR veillera au respect des obligations découlant du règlement 2024/2847 en procédant au contrôle documentaire et technique d'équipements qu'elle prélèvera. Lorsqu'elle constatera une non-conformité, l'ANFR pourra mettre la personne responsable en demeure de se conformer avec ses obligations dans un délai qu'elle détermine. Conformément à la procédure prévue au paragraphe 5 de l'article 54 du règlement 2024/2847, en l'absence de mesures permettant de mettre fin à la non-conformité, l'ANFR pourra adopter toutes les mesures provisoires148(*) appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit comportant des éléments numériques sur le marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel.
S'agissant de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense, l'option retenue est l'abrogation de l'article. Le règlement 2024/2847 - notamment ses articles 13 et 14 - s'appliquera directement en lieu et place de cette disposition.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Sont modifiés :
- l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et des mesures règlementaires d'application devront être prévues.
- l'article L. 2321-4-1 du code de la défense qui est abrogé, ses décrets d'application ayant vocation à l'être également.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions de cet article visent à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/2847 afin de permettre la mise en place ou le fonctionnement des autorités compétentes que la France doit désigner au niveau national et mettre le droit national en conformité.
L'articulation prévue par le texte, avec le règlement n°2019/881 du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et le règlement n°2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle doit permettre d'éviter les chevauchements de textes ayant un objet connexe et la multiplication d'exigences et processus d'évaluation pour un même produit.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le texte pourrait générer la création d'emplois pour la mise en oeuvre des nouvelles obligations. Cet impact résulterait néanmoins du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
S'agissant des dispositions insérées dans le code des postes et des communications électroniques, tout impact sur les entreprises serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
L'abrogation de la disposition du code de la défense n'a en soi pas d'impact direct pour les entreprises qui devront se conformer aux obligations comparables du règlement de l'Union européenne. Les éditeurs auront une charge administrative et de prise en compte contractuelle susceptible d'être plus importante avec l'application du nouveau texte européen car il s'applique à un périmètre matériel et territorial plus large et tout au long du cycle de vie du produit. Toutefois, les économies permises par l'arrivée du texte européen pourraient compenser cet impact :
- l'absence de sécurisation de vulnérabilités exploitées ou de remédiation d'incident grave, engendrerait inévitablement un coût important pour les utilisateurs ayant subi un préjudice et susceptibles de réclamer réparation ;
- le coût en termes d'image serait potentiellement très significatif pour les éditeurs, surtout en cas de dissimulation de la vulnérabilité ou de l'incident ayant privé les utilisateurs de la possibilité d'en limiter les effets ;
- l'approche harmonisée devrait permettre aux entreprises des gains de productivité et des économies liées à une simplification du cadre règlementaire de l'Union. Elle devrait aussi être un vecteur favorable à la circulation des produits sécurisés dans le marché intérieur et avec des pays tiers.
Il est possible par ailleurs que le texte bénéficie au marché des opérateurs tiers accompagnant la mise en conformité si les opérateurs économiques n'internalisent pas sa mise en oeuvre.
La particularité des petites et moyennes entreprises est déjà prise en compte dans le cadre du texte européen.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/2847 implique la mise en place d'un schéma de gouvernance nationale avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) comme autorité notifiante et CSIRT désigné comme coordinateur et l'Agence nationale des fréquences (ANFR) comme autorité de surveillance du marché, investies de missions nouvelles ou élargies. Ces autorités devront renforcer leur expertise technique afin de pouvoir mener à bien ces missions, ce qui nécessitera des recrutements de personnel à la hauteur des ambitions qui seront retenues en matière de volume de contrôles.
La mise en oeuvre du règlement induit un enjeu organisationnel et de coopération entre les structures affectées par le texte. La mise en oeuvre du règlement nécessitera de mobiliser des ressources dans un secteur déjà en tension pour ses ressources humaines et dont la montée en compétence nécessite des délais liés à la technicité des exigences. Cela pourrait engendrer des retards de mise en oeuvre en pratique.
La mobilisation de l'ANSSI dans un souci d'accompagnement de l'ANFR, autorité de surveillance du marché désignée dans ces fonctions nouvelles est également prévue.
L'abrogation de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense à la faveur du règlement européen « CRA » devrait avoir un impact notamment budgétaire pour l'ANSSI dont le centre de réponse à incidents (cert-fr) devra gérer un nombre plus important de notifications de vulnérabilités et incidents.
Le suivi des actes secondaires et de normalisation pour la mise en oeuvre du règlement induira un coût supplémentaire pour l'ANSSI également.
La sensibilisation et l'accompagnement des opérateurs économiques comme le soutien renforcé des PME auront également un impact budgétaire pour l'ANSSI.
Le champ d'application complexe du règlement, la multitude d'actes délégués et d'exécution, comme l'articulation avec d'autres règlements de l'Union (règlement n°2019/881 précité et règlement n°2024/1689 sur l'intelligence artificielle) pourraient complexifier la mise en oeuvre du texte. La mise en oeuvre cohérente des textes va nécessiter l'accompagnement de l'écosystème, en particulier les plus petits acteurs.
En outre, le fruit des amendes prévues par le présent article viendra abonder le budget de l'Etat.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A l'exception de l'extension de l'application du règlement (UE) 2024/2847 de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie, l'impact sur les collectivités territoriales sera la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mise en oeuvre du règlement comporte un enjeu organisationnel et de coopération entre les structures impactées par le texte. La mise en oeuvre du règlement nécessitera de mobiliser des ressources dans un secteur déjà en tension pour ses ressources humaines et dont la montée en compétence nécessite des délais liés à la technicité des exigences. Cela pourrait engendrer des retards de mise en oeuvre en pratique.
Son champ d'application complexe, la multitude d'actes délégués et d'exécution, comme l'articulation avec d'autres règlements de l'Union (règlement n° 2019/881 et règlement n° 2024/1689) pourraient complexifier la mise en oeuvre du texte. La mise en oeuvre cohérente des textes va nécessiter l'accompagnement de l'écosystème, en particulier les plus petits acteurs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Tout impact éventuel sur les personnes en situation de handicap serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
L'abrogation de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense en faveur du règlement « CRA » permettra de renforcer encore plus la sécurité des produits et ainsi prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité ou à la sûreté, à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel en raison d'un élargissement du champ des éditeurs et produits concernés.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet. Tout impact éventuel sur les personnes en situation de handicap serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet. Tout impact éventuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet. Tout impact éventuel sur la jeunesse serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet. Tout impact éventuel sur les professions réglementées serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Tout impact éventuel sur les particuliers serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
Le règlement européen a pour but de créer des conditions permettant aux utilisateurs de prendre en considération la cybersécurité lorsqu'ils sélectionnent et utilisent des produits comportant des éléments numériques. Il améliore par exemple la transparence concernant la période d'assistance, pouvant inclure la gestion de vulnérabilités et incidents dans des logiciels d'éditeurs, pour les produits mis à disposition sur le marché.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet. L'essentiel de l'impact environnemental serait la conséquence du règlement 2024/2847 - qui est d'application directe - et non des dispositions législatives envisagées.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a été consultée et a rendu un avis n° 2025-1765 le 4 septembre 2025.
En application des articles L. 125 et D. 576 du code des postes et des communications électroniques, la Commission supérieure du numérique et des postes a été consultée et a rendu un avis n° 2025-09 le 29 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Toutefois, son application est échelonnée entre le 11 juin 2026 (1° et 2° du II) et la date butoir du 11 décembre 2027 (3° du II).
Il est prévu de rendre la disposition visant l'abrogation de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense effective à compter du 12 septembre 2026, les obligations de signalement concernant les vulnérabilités activement exploitées et les incidents graves ayant des répercussions sur la sécurité des PCEN prévues par le règlement « CRA » entrant en vigueur au 11 septembre 2026.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article étend l'application du règlement (UE) 2024/2847 à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie, afin d'y rendre applicables les mesures de retrait ou de rappel prises par l'ANFR.
En tout état de cause, conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'abrogation de l'article L.2321-4-1 du code de la défense a un impact pour les éditeurs de logiciels français et étrangers qui fournissent un produit à des utilisateurs sur l'ensemble du territoire de la République, y compris à des sociétés ayant leur siège social en France ou à des sociétés contrôlées par elles, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Toutefois la portée de l'abrogation est à tempérer car le règlement européen touche tous les produits mis sur le marché européen avec potentiellement une portée extraterritoriale également pour des produits fournis par des fabricants non UE et mis sur le marché de l'Union européenne.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions prévoient la publication de décrets en Conseil d'Etat.
De plus, les conditions d'application du dispositif national de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense ont été définies par décret en Conseil d'Etat : ces dispositions réglementaires doivent par conséquent être abrogés conformément à l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 33 - Créer le cadre procédural permettant d'assurer l'effectivité des règlements relatifs aux systèmes d'information de l'Union européenne en matière de contrôles d'identité, de droit au séjour et aux frontières
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Ø Cadre européen
Afin d'améliorer la coopération européenne en matière judiciaire, renforcer la sécurité intérieure et lutter contre l'immigration irrégulière, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont décidé, sur proposition de la Commission européenne, de la refonte des systèmes d'information européens existants, de la création de nouveaux systèmes d'information et de leur interopérabilité.
Ont ainsi été décidées :
- la refonte de systèmes d'information européens existants : le système d'information Schengen (SIS), le système d'information sur les visas (VIS) et le système de gestion des demandeurs d'asile (Eurodac) ;
- la création de nouveaux systèmes d'information : le système d'entrée/de sortie (EES), le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système européen d'information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) ;
- l'interopérabilité des systèmes d'information européens ainsi refondus ou crées, grâce à plusieurs composantes : un portail de recherche européen, un service de correspondance biométrique partagé, un répertoire commun des données d'identité (CIR) et un détecteur d'identités multiples.
Le système d'information Schengen (SIS)
Initialement prévu par la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, le système d'information Schengen (SIS) est le principal outil européen en matière de contrôle aux frontières et de coopération policière et judiciaire. Il a fait l'objet d'une première évolution par le biais de la décision 2007/533/JAI du Conseil et du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Une deuxième révision est intervenue le 28 novembre 2018, par l'adoption de trois règlements européens, constituant le « paquet SIS RECAST »149(*), élargissant notamment le périmètre du SIS à de nouvelles catégories de signalements de personnes et d'objets et à de nouvelles fonctionnalités opérationnelles telle sa consultation à partir de données biométriques. Le SIS refondu a été mis en service le 7 mars 2023.
Le droit de l'Union européenne impose désormais, si la consultation alphanumérique du SIS met en évidence que la personne fait l'objet d'un signalement et que ce signalement contient des photographies ou empreintes digitales, que ces données soient notamment utilisées pour confirmer l'identité de la personne. Cette obligation ne distingue pas selon les cadres de contrôle (contrôle d'identité judiciaire, administratif, contrôle aux frontières ou contrôle du droit de circulation et de séjour).
|
Le système d'entrée/sortie (EES) Le système EES prévu par le règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 mettra fin à l'apposition manuelle d'un cachet dans les passeports des ressortissants de pays tiers et permettra de contrôler électroniquement les entrées, les sorties, les refus d'entrées et les durées de séjour des citoyens de pays non-membres de l'Union européenne, franchissant les frontières extérieures de l'espace Schengen pour un court séjour. La mise en service d'EES le 12 octobre 2025 doit permettre aux forces de sécurité intérieure de consulter ce système par la biométrie afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers ont légalement franchi les frontières du territoire et s'ils respectent leur durée de séjour autorisée. |
|
Le système d'information des visas (VIS) Ce système prévu par le règlement (UE) 767/2008 du 9 juillet 2008 est utilisé pour l'examen des demandes de visas de court séjour et des décisions de refus, de prorogation, d'annulation ou de retrait de visa, ainsi que pour les vérifications des visas et les vérifications et identifications des demandeurs et des détenteurs de visa. Sa version refondue par le règlement (UE) 2021/1134 du 7 juillet 2021, qui complète le dispositif migratoire européen par l'intégration des visas long-séjour et des titres de séjour, doit entrer en service en 2027 au plus tôt. Le règlement prévoit l'utilisation par les services français de la biométrie afin de vérifier si une personne étrangère dispose d'un visa de court séjour, et à terme, d'un visa de long séjour ainsi que d'un titre de séjour. |
|
Le répertoire commun des identités (CIR) Le module d'interopérabilité CIR créé par les règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 relatifs à l'interopérabilité des systèmes d'information de l'Union européenne dans le domaine de la Justice et des affaires intérieures, doit entrer en service en même temps qu'ECRIS TCN au début de l'année 2026. Il a comme objectif de créer à terme un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l'EES, VIS, ETIAS, Eurodac et ECRIS-TCN afin de faciliter l'identification des ressortissants de pays tiers. Les autorités concernées des Etats membres pourront consulter ce répertoire en mobilité (contrôle d'identité ou du droit au séjour) ou au service (en enquête judiciaire) pour identifier des personnes, dans des conditions fixées par le règlement et le droit national. |
Les règlements européens qui régissent ces systèmes d'information, déjà mis en service ou en cours de développement, prévoient notamment un recours plus systématique à l'interrogation des fichiers par la biométrie (empreintes dactyloscopiques et/ou image faciale), afin de fiabiliser l'identification ou la vérification de l'identité de la personne contrôlée tout en préservant sa liberté de circulation en minimisant la durée des contrôles ou des vérifications :
- pour vérifier l'identité d'un ressortissant de pays tiers, vérifier ou contrôler son droit d'entrée ou de séjour ou pour l'identifier, les autorités habilitées doivent pouvoir être en mesure de collecter, après une recherche alphanumérique dans l'EES, les empreintes digitales et photographies des personnes concernées aux fins de consultation de EES, conformément aux articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226.
- pour vérifier l'authenticité d'un visa, l'identité de son titulaire et le droit au séjour de ce dernier ou l'identifier, les autorités habilitées doivent pouvoir être en mesure de consulter le VIS avec les empreintes digitales, conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) 2008/767.
- pour confirmer l'identité d'une personne localisée à la suite d'une recherche alphanumérique dans le SIS, dans le cadre d'un contrôle d'identité, d'un contrôle aux frontières ou d'un contrôle du droit de circulation et de séjour, les autorités habilitées doivent utiliser sa biométrie lorsque le signalement en contient, conformément aux articles 33§1 du règlement (UE) 2018/1861 et article 43§1 du règlement (UE) 2018/1862.
- pour identifier les personnes dans le cadre d'un contrôle du droit de circulation, de séjour et d'un contrôle aux frontières, les autorités compétentes peuvent consulter par la biométrie le CIR conformément aux articles 20 du règlement (UE) 2019/817 et du règlement (UE) 2019/818.
Dans ses conclusions du 9 juin 2022, le Conseil de l'Union européenne a pris acte de la volonté exprimée par les Etats membres d'une mise en oeuvre ambitieuse des règlements européens et les a invités à examiner si leur droit national était bien compatible avec ces derniers150(*). Pour le recueil de données biométriques, et notamment des empreintes digitales, le Conseil s'est prononcé pour l'utilisation de dispositifs mobiles si ceux-ci sont disponibles, afin de pouvoir sans délai procéder aux vérifications prescrites par les règlements et retenir la personne concernée le moins longtemps possible :
« Le Conseil de l'Union européenne
[...]
26. ESTIME qu'il est souhaitable que ces interrogations biométriques soient effectuées le plus rapidement possible pour assurer que l'utilisateur final puisse accomplir efficacement ses missions, tout en préservant un équilibre satisfaisant entre les objectifs visés par le règlement et la protection des droits et libertés fondamentaux ;
27. RAPPELLE que les agents des États membres chargés de la sécurité publique et de la lutte contre l'immigration illégale sont encouragés à procéder à une interrogation biométrique du SIS aux fins susmentionnées ;
28. CONSIDÈRE qu'en pareils cas, il est souhaitable que cette recherche biométrique soit effectuée sur place et sans délai, à l'aide de dispositifs mobiles pertinents, si ces derniers sont disponibles ».
Si le droit européen constitue déjà une base suffisante pour le recueil d'empreintes en vue de consulter certains systèmes (VIS et EES) aux frontières extérieures de l'UE et s'il existe déjà, en droit français, des possibilités de recueil biométrique et d'interrogation des fichiers européens, les règlements prévoient des cas nouveaux et des facultés à activer dans les cadres procéduraux français.
Ainsi, le recueil de la biométrie en vue de la confirmation d'une identité déclarée faisant l'objet d'une concordance positive à la suite d'une recherche alphanumérique dans le système SIS n'a pas d'équivalent dans le droit français, tandis que la Commission a indiqué au Gouvernement que les règlements SIS ne constituaient pas en eux-mêmes la base légale de recueil des empreintes. Le règlement relatif aux composants de l'interopérabilité, renvoie quant à lui aux Etats-membres le soin de prendre les mesures nationales d'adaptation pour l'accès au CIR aux fins d'identification par les services de police.
Ø Cadre national
Le relevé des empreintes digitales et des photographies aux fins de procéder à l'identification d'une personne ou de confirmer son identité est déjà prévu en droit national dans certains cas, tant en matière pénale qu'en matière de police des étrangers et de contrôle des frontières. Cadre national en matière pénale
En procédure pénale, le relevé des empreintes digitales et des photographies est possible, d'une part, en cas de vérification d'identité.
L'article 78-3 du code de procédure pénale prévoit ainsi « la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé ». D'autre part, dans le cadre d'une enquête, le recueil de ces données est possible en vertu de l'article 55-1 du même code, qui prévoit que : « L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers ».Dans les deux cas, le fait de refuser de se soumettre aux prélèvements constitue une infraction pénale punie d'une peine d'emprisonnement (trois mois pour les vérifications d'identité de 78-3, un an pour les relevés signalétiques des suspects de 55-1).L'article 55-1 prévoit ainsi la possibilité, sous de strictes conditions, de relever par la contrainte les données biométriques d'une personne « lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts ».
La loi pénale n'entre pas dans le détail du traitement des données ainsi collectées, lequel est régi par le pouvoir réglementaire. Elle ne traite que des cas où de telles données peuvent être recueillies et des sanctions afférentes aux refus de recueil de ces données.
Le cadre juridique en vigueur ne prévoit pas la possibilité de procéder à la prise d'empreintes et de photographies pour confirmer l'identité d'une personne après qu'une concordance positive soit apparue à la consultation du système d'information Schengen. De plus, il ne couvre pas le cas général des contrôles d'identité ( article 78-2 du code de procédure pénale), hors d'un cadre d'enquête.
Cadre national en matière de contrôle aux frontières et de droit au séjour
Les personnes entrantes et sortant de l'espace Schengen sont soumises à des contrôles aux frontières à des fins sécuritaires et migratoires. Les étrangers se trouvant sur le territoire national peuvent faire l'objet de contrôles relatifs à la validité de leur droit de circulation ou de séjour.
Contrôles aux frontières
En droit européen, les vérifications aux frontières extérieures sont régies par le chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (code frontières Schengen).En droit national, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit, dans le chapitre « Contrôles aux frontières » ( articles L. 331-1 à L. 331-3), les conditions dans lesquelles sont contrôlés les documents de voyage et les titres de séjour lors du passage de la frontière et renvoie aux conditions prévues au chapitre II du titre II du code frontières Schengen. Les articles L. 142-1 à L.142-5 du CESEDA encadrent les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux étrangers. Ces dispositions garantissent la protection des droits des personnes concernées et visent à organiser la collecte et l'utilisation de ces données par les autorités compétentes.
Pour les contrôles à la frontière de première ligne des ressortissants de pays tiers (contrôle aux frontières aux aubettes, conformément aux dispositions de l'article 8 du code frontières Schengen), les garde-frontières consultent de manière automatisée et par des données alphanumériques certains fichiers européens, nationaux et internationaux : fichier des personnes recherchées, base de données d'Interpol des documents de voyage perdus et volés (STLD) et des documents de voyage associés aux notices (TDAWN), SIS, Visabio et VIS en cas de recherche négative dans Visabio. La vérification par l'empreinte dans Visabio ou le VIS est mise en oeuvre pour les porteurs de visas. Visabio est une base française contenant l'ensemble des visas délivrés par la France, pour la métropole et l'outre-mer. Le VIS héberge quant à lui l'intégralité des visas court séjour délivrés par tous les Etats membres de l'Union européenne.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux points de passage autorisés en cas de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures conformément à l'article 32 du code frontières Schengen.
Contrôles sur le territoire national
Aux termes de l'article L. 812-1 du CESEDA, « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France ».
L'article L. 812-2 précise que « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel considère que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, objectif de valeur constitutionnelle151(*).Il fait en outre découler le respect de la vie privée de l'article 2 de la Constitution : « Le principe du respect de la vie privée est garanti par la Constitution, en déclinaison de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, étant entendu que pour apprécier ce respect, le Conseil constitutionnel contrôle la proportionnalité entre le motif d'intérêt général justifiant la collecte de données et la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée152(*). »
Il considère également que les relevés signalétiques sont des moyens acceptables lorsqu'est poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions153(*).
De plus, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 55-1 du code de procédure pénale relatifs aux prélèvements externes (prise d'empreinte digitale, palmaire, ou photographie) effectués à l'occasion d'une procédure pénale, en considérant notamment au regard des principes de la dignité de la personne humaine, d'inviolabilité du corps humain et de la liberté individuelle que le « "prélèvement externe" fait référence à un prélèvement n'impliquant aucune intervention corporelle interne ; qu'il ne comporte (..) donc aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des intéressés »154(*).Dans une décision de 1997155(*), le Conseil constitutionnel a considéré « qu'il revient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels, compte tenu de l'intérêt public qu'il s'assigne, les mesures applicables à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'en prévoyant le relevé et la mémorisation des empreintes digitales des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour après l'expiration d'un délai de trois mois depuis leur entrée sur le territoire français, ou sont en situation irrégulière sur le territoire ou sont visés par une mesure d'éloignement de ce dernier, et la possibilité d'un traitement automatisé de ces informations conformément aux garanties prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il n'a pas, par ces mesures de police administrative, porté d'atteinte excessive à la liberté individuelle de nature à méconnaître la Constitution. ».
Enfin, depuis sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel juge de manière constante, en ce qui concerne la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel, que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».
La création d'un traitement de données à caractère personnel ne nécessite plus aujourd'hui, en principe, de dispositions législatives particulières, sous réserve que le traitement respecte les exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi n° 78-18 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le droit de l'Union européenne impose désormais, si la consultation alphanumérique du SIS met en évidence que la personne fait l'objet d'un signalement et que ce signalement contient des photographies ou empreintes digitales, que ces données soient utilisées pour confirmer l'identité de la personne. Cette obligation ne précise pas les cadres de contrôle (contrôle d'identité judiciaire, administratif, passage de frontière ou contrôle du droit au séjour).
Le droit de l'Union impose également l'utilisation des empreintes digitales s'il n'est pas possible d'identifier autrement une personne.
Règlements (UE) 2018/1861 et 2018/1862 relatifs au SIS modifiés
Art. 33 du règlement 2018/1861. - « 1. Lorsque des photographies, des images faciales et des données dactyloscopiques sont disponibles dans un signalement dans le SIS, ces photographies, images faciales et données dactyloscopiques sont utilisées pour confirmer l'identité d'une personne qui a été localisée à la suite d'une recherche alphanumérique effectuée dans le SIS.
2. Les données dactyloscopiques peuvent, dans tous les cas, faire l'objet de recherches pour identifier une personne. Toutefois, les données dactyloscopiques font l'objet de recherches pour identifier une personne lorsque l'identité de la personne ne peut pas être établie par d'autres moyens. À cette fin, le SIS central contient un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales (AFIS). » Art. 43 du règlement 2018/1862. - « 1. Lorsque des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils ADN sont disponibles dans un signalement dans le SIS, ces photographies, images faciales, données dactyloscopiques et profils ADN sont utilisés pour confirmer l'identité d'une personne qui a été localisée à la suite d'une recherche alphanumérique effectuée dans le SIS.
2. Les données dactyloscopiques peuvent, dans tous les cas, faire l'objet de recherches pour identifier une personne. Toutefois, les données dactyloscopiques font l'objet de recherches pour identifier une personne lorsque l'identité de la personne ne peut pas être établie par d'autres moyens. À cette fin, le SIS central contient un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales (AFIS). »
Règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 relatifs à l'interopérabilité : la consultation du répertoire commun des identités (CIR) pour les données biométriques
Les articles 20 de ces règlements prévoient une faculté pour les Etats membres de procéder au recueil des données biométriques en vue de consulter le CIR pour permettre d'identifier certaines personnes, suivant les cas prévus par ces articles (points 1 et 2).
Art. 20. - « 1. Les interrogations du CIR sont effectuées par un service de police conformément aux paragraphes 2 et 5 uniquement dans les circonstances suivantes: a) lorsqu'un service de police n'est pas en mesure d'identifier une personne en raison de l'absence d'un document de voyage ou d'un autre document crédible prouvant l'identité de cette personne; b) lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par une personne; c) lorsqu'un doute subsiste quant à l'authenticité du document de voyage ou d'un autre document crédible fourni par une personne; d) lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité du titulaire d'un document de voyage ou d'un autre document crédible; ou e) lorsqu'une personne n'est pas en mesure ou refuse de coopérer. Ces interrogations ne peuvent viser des mineurs de moins de 12 ans, à moins que ce ne soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Lorsqu'une des circonstances énumérées au paragraphe 1 se produit et qu'un service de police y a été habilité par les mesures législatives nationales visées au paragraphe 5, elle peut, uniquement aux fins de l'identification d'une personne, interroger le CIR à l'aide des données biométriques de cette personne relevées en direct lors d'un contrôle d'identité, à condition que la procédure ait été initiée en présence de ladite personne.
3. Lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, le service de police a accès en consultation aux données visées à l'article 18, paragraphe 1. Lorsque les données biométriques de la personne ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec ces données échoue, cette dernière est introduite à l'aide des données d'identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, ou à l'aide des données d'identité fournies par cette personne.
4. Lorsqu'un service de police y a été habilité par des mesures législatives nationales visées au paragraphe 6, il peut, en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste, et uniquement aux fins d'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés, interroger le CIR à l'aide des données biométriques de ces personnes. [...]
5. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 adoptent des mesures législatives nationales. [...] »
La consultation d'EES par la biométrie est ouverte par le règlement européen (UE) 2017/2226 aux forces de sécurité au-delà des seuls garde-frontières dans deux cas :
- à titre subsidiaire et de façon facultative, pour permettre aux autorités chargées de l'immigration des États membres de vérifier l'identité du ressortissant de pays tiers, ou de contrôler ou vérifier si les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies. La consultation du fichier ne peut ici intervenir qu'en cas de hit alphanumérique. Dès lors, les autorités chargées du contrôle migratoire sont autorisées à comparer les images faciales ou vérifier les empreintes (article 26) ;
- les autorités frontalières ou les autorités chargées de l'immigration sont autorisées à effectuer, de manière facultative, des recherches à l'aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l'image faciale, aux seules fins d'identifier tout ressortissant de pays tiers susceptible d'avoir été enregistré précédemment dans l'EES sous une identité différente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire des États membres (article 27).
Art. 26. - « 1. Afin de vérifier l'identité du ressortissant de pays tiers, ou de contrôler ou vérifier si les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies, ou les deux, les autorités chargées de l'immigration des États membres sont autorisées à effectuer des recherches à l'aide des données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 17, paragraphe 1, point a). Si la recherche montre que l'EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités chargées de l'immigration peuvent: a) comparer l'image faciale du ressortissant de pays tiers prise en direct avec celle visée à l'article 16, paragraphe 1, point d), et à l'article 17, paragraphe 1, point b), du présent règlement; ou b) vérifier les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa par consultation de l'EES et des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa par consultation du VIS, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 767/2008.
2. Si la recherche effectuée à l'aide des données visées au paragraphe 1 montre que l'EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités chargées de l'immigration sont autorisées à consulter la calculatrice automatique, les données du dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers, ainsi que la ou les fiches d'entrée/de sortie et toute fiche de refus d'entrée rattachées à ce dossier individuel. 3. Si la recherche effectuée à l'aide des données visées au paragraphe 1 du présent article montre que l'EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, lorsqu'une vérification portant sur celui-ci ne donne pas de résultat ou en cas de doute quant à l'identité du ressortissant de pays tiers, les autorités chargées de l'immigration ont accès aux données aux fins d'identification conformément à l'article 27. »
Art. 27. - « 1. Les autorités frontalières ou les autorités chargées de l'immigration sont autorisées à effectuer des recherches à l'aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l'image faciale, aux seules fins d'identifier tout ressortissant de pays tiers susceptible d'avoir été enregistré précédemment dans l'EES sous une identité différente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire des États membres. Si la recherche effectuée à l'aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l'image faciale montre que l'EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, un accès aux données du VIS aux fins d'identification est assuré conformément à l'article 20 du règlement (CE) n o 767/2008. [...]
2. Si la recherche effectuée à l'aide des données mentionnées au paragraphe 1 montre que l'EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données du dossier individuel ainsi que les fiches d'entrée/de sortie et les fiches de refus d'entrée qui y sont rattachée. »
Règlement (UE) 767/2008 relatif au VIS
Les articles 19 et 20 du règlement 767/2008 prévoient la consultation du VIS à partir des empreintes digitales dans deux cadres :
- de façon obligatoire, pour les seuls besoins de vérifier l'identité du titulaire du visa et/ou l'authenticité du visa et/ou si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies (article 19) ;
- à titre subsidiaire mais de façon obligatoire, pour identifier toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres (article 20).
Art. 19. - « 1. Dans le seul but de vérifier l'identité du titulaire du visa et/ou l'authenticité du visa et/ou si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, les autorités compétentes chargées de contrôler si ces conditions sont remplies sur le territoire des États membres effectuent des recherches à l'aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou du numéro de la vignette visa. Pour les titulaires de visas dont les empreintes digitales sont inutilisables, la recherche s'effectue uniquement à l'aide du numéro de la vignette visa.
2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande, ainsi que du ou des dossier(s) de demande lié(s) conformément à l'article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1: a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l'article 9, paragraphes 2 et 4; b) les photographies; c) les données saisies visées aux articles 10, 13 et 14 concernant le(s) visa(s) délivré(s), annulé(s) ou retiré(s) ou dont la durée de validité a été prorogée ou réduite.
3. En cas d'échec de la vérification concernant le titulaire du visa ou le visa, ou de doute quant à l'identité du titulaire du visa, l'authenticité du visa et/ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes est autorisé à consulter les données, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2.
Art. 20. - 1. Les autorités chargées de contrôler aux points de passage des frontières extérieures conformément au code frontières Schengen ou sur le territoire des États membres si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales de la personne uniquement aux fins de l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent être utilisées ou en cas d'échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l'aide des données visées à l'article 6, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l'article 9, paragraphe 4, point b).
2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et de(s) dossier(s) de demande lié(s), conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et uniquement aux fins visées au paragraphe 1: a) le numéro de la demande, les informations relatives au statut du visa et l'autorité à laquelle la demande a été présentée; b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l'article 9, paragraphe 4; c) les photographies; d) les données saisies, visées aux articles 10 à 14, concernant tout visa délivré, refusé, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée ou réduite, ou concernant des demandes dont l'examen a été interrompu. 3. Lorsque la personne est titulaire d'un visa, les autorités compétentes consultent le VIS dans un premier temps conformément à l'article 18 ou à l'article 19. »
Enfin, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, connu sous le nom de règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (direction dite « police-justice »), encadrent strictement le traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne. Ces textes affirment que la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données constitue un droit fondamental, tout en garantissant la libre circulation de ces données entre États membres. Les dispositions du présent article ont été prises dans le respect du cadre européen relatif à la protection des données, d'autant plus que les recommandations de la CNIL, garante du respect de cette règlementation, ont été prises en compte.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
L'ensemble des autres Etats membres ont déclaré pouvoir consulter par la biométrie les systèmes d'information européens conformément aux règlements précités.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le relevé des empreintes digitales et des photographies et les cadres dans lesquels ces données peuvent être relevées par les forces de l'ordre relèvent du domaine de la loi.
Ø Contrôles à la frontière
Le droit européen couvre de manière certaine le relevé de l'empreinte pour consulter VIS et EES.
Toutefois, la Commission européenne a signalé que si les règlements SIS autorisent la consultation en cas de concordance alphanumérique, ils ne permettent pas la collecte de la biométrie. Le droit européen demande également une mesure nationale pour permettre l'identification par la biométrie dans le CIR.
Ø Contrôle d'identité
Les contrôles et vérification d'identité dans un cadre judiciaire ou administratif sont prévus au code de procédure pénale par le chapitre « Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité » comme rappelé au point 1.1.1 ci-dessus.
Cependant, aucune de ces dispositions ne permet de procéder au relevé des empreintes digitales et des photographies pour confirmer l'identité de la personne lorsque son identité est signalée dans le système d'information Schengen (SIS). Il est donc nécessaire de légiférer pour se conformer aux règlements européens. De plus, l'article 78-3 prévoit le recueil des empreintes qu'en dernier recours, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier par un autre moyen une personne, et dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification d'identité après l'autorisation du procureur de la République.
Or, il paraît nécessaire de permettre aux agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale de procéder à un relevé d'empreintes et à la prise de photographies lorsque l'identité d'une personne apparaît comme déjà enregistrée dans le SIS, dans le cadre d'un contrôle d'identité, sur la base de l'identité déclarée, afin de fiabiliser cette dernière dans le propre intérêt de la personne, en dehors de la procédure privative de liberté de retenue pour vérification d'identité.
Par exemple, en matière de sécurité publique, si dans le cadre d'un contrôle d'identité, les données alphanumériques d'un individu font l'objet d'une concordance dans le système d'information Schengen signalant par exemple que cet individu est recherché à des fins d'arrestation, le relevé d'empreintes permettra de s'assurer de manière certaine de son identité et en conséquence, de fiabiliser la conduite à tenir, sans mise en oeuvre d'une procédure privative de liberté.
Il faut noter que, concernant l'identité des personnes signalées dans le SIS, les règlements européens n'exigent seulement que l'introduction d'un nom et d'une date de naissance, ce qui renforce le risque d'homonymie sans recours à la biométrie.
Ø Contrôle du droit au séjour
Pour les ressortissants étrangers, les contrôles s'effectuent lors du passage de frontière (article L. 331-2 du CESEDA) et sur le territoire national (article L. 812-1 du CESEDA). Sur le territoire national, ces contrôles ne peuvent être effectués que « si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ».
Les fichiers AGDREF, VISABIO ou le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) peuvent être consultés à partir de recueil biométrique, conformément à l'article L. 142-2 du CESEDA :
« En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Toutefois, ces dispositions du droit national s'appliquent d'une part seulement pour l'identification d'un étranger non documenté ; d'autre part, faisant expressément référence aux « traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur », il existe une incertitude sur la possibilité de consulter à droit constant les fichiers mis en oeuvre uniquement par l'Union européenne.
La prise d'empreintes ou de photographies aux fins du contrôle du droit de circulation et de séjour n'est prévue que dans le cadre de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, conformément à l'article L. 813-10 du CESEDA :
« Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. »
Il existe donc un écart substantiel entre, d'une part, l'état du droit national, et, d'autre part, l'obligation de consultation biométrique des fichiers européens ou encore l'obligation de prévoir la possibilité pour les forces de sécurité intérieure de procéder à cette même consultation biométrique prévue dans les règlements rappelés au point 1.3 ci-dessus.
Le droit national doit être adapté pour permettre cette consultation biométrique dans le cadre d'un contrôle du droit au séjour, sans recours systématique à une retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, plus attentatoire aux libertés individuelles et représentant une charge importante pour les forces de sécurité intérieure.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La disposition proposée permet :
- d'une part, en cas de concordance alphanumérique lors d'un contrôle d'identité, de procéder au relevé les empreintes digitales et à la prise de la photographie de la personne contrôlée afin de confirmer son identité et sa correspondance avec la personne figurant dans le signalement SIS ;
- d'autre part, de relevé les empreintes digitales et prendre la photographie aux fins de consultation du VIS, d'EES, du CIR et du SIS (pour ce dernier seulement , hit alphanumérique), dans le cadre du contrôle du droit de circulation et de séjour ;
- de relevé les empreintes digitales et prendre la photographie aux fins de consultation du SIS (après hit alphanumérique) et du CIR dans le cadre des contrôles aux frontières.
Les données biométriques ne sont pas collectées pour être mémorisées, mais recueillies à des fins de comparaison en temps réel avec les données biométriques contenues dans les systèmes d'information européens.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
L'absence d'adaptation du droit national continuerait d'empêcher le recueil des empreintes digitales et de la biométrie en contradiction avec le droit européen applicable. Cette option a donc été écartée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La modification du code de procédure pénale prévoit, dans le cadre du contrôle d'identité, la collecte des empreintes digitales et des photographies en vue de permettre la consultation du SIS après concordance alphanumérique entre l'identité déclarée et un signalement contenant des données biométriques.
Plusieurs modifications du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont présentées.
Ces modifications visent à prévoir le relevé des empreintes pour la consultation biométrique du SIS et du CIR dans le cadre des contrôles aux frontières.
Dans le cadre du contrôle du droit de circulation et de séjour, il est prévu le relevé des empreintes pour la consultation biométrique du CIR, d'EES et du VIS et du SIS (en cas, pour ce dernier, de concordance alphanumérique entre l'identité déclarée et un signalement contenant des données biométriques).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les dispositions proposées modifient le code de procédure pénale et le CESEDA.
Dans le code de procédure pénale, il est ainsi créé un nouvel article 78-2-2-1.
Dans le CESEDA, une section distincte « Systèmes d'information de l'Union européenne » et un article L. 142-6 et un article L. 142-7 nouveaux comprenant des références précises aux articles des règlements applicables en matière de contrôle aux frontières et de contrôle du droit de circulation et de séjour sont créés. L'article L. 821-2 du CESEDA est modifié afin de prévoir une extension de la peine de refus de se soumettre aux prélèvements biométriques, pour les nouveaux fichiers prévus par l'article 142-6 ainsi créé.
Les articles L. 151-2, L. 152-2, L. 152-1, L. 152-3, L. 153-1, L. 153-2, L. 154-1, L. 154-2, L. 155-1, L. 155-2, L. 156-1, L. 156-2, L. 831-2, L. 832-1, L. 832-2, L. 833-1, L. 833-2, L. 834-1, L. 834-2, L. 835-1, L. 835-2, L. 836-1 et L. 836-2 du CESEDA, relatifs à l'outre-mer sont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La disposition législative donne son effet utile aux articles des règlements européens adoptés dans le domaine de la Justice et des affaires intérieures cités au point 1.3 et est conforme au règlement général sur la protection des données.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Aucun impact économique et financier n'est envisagé, les capteurs permettant le relevé des données biométriques, y compris en mobilité étant en cours de déploiement au sein des forces de sécurité intérieure.
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
La possibilité de procéder aux vérifications du droit de circulation ou de séjour dès le contrôle prévu à l'article L. 812-1 du CESEDA permettra d'éviter certaines mesures de placement en retenue prévu aux articles L. 813-1 et suivants du même code, qui impliquent des frais (escortes, intervention des forces de sécurité intérieure, intervention de l'autorité judiciaire, assistance médicale, etc.).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les moyens de confirmation de l'identité des personnes et de contrôle du droit au séjour par les agents de la police et de la gendarmerie nationales seront renforcés par la capacité de relever leurs empreintes et/ou leur image faciale.
Une identification facilitée participe à améliorer la politique de l'éloignement et donc à faciliter le travail des services de préfecture et de la police aux frontières pour caractériser la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour d'une part, et l'obtention des laissez-passer consulaires auprès des Etats d'origine d'autre part, si l'intéressé doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Sur le territoire, la prise d'empreintes et de photographie lors du contrôle permettra la consultation immédiate des systèmes d'information européens, sans qu'il soit systématiquement nécessaire de placer les personnes contrôlées en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, évitant ainsi de mobiliser les forces de sécurité intérieure et l'autorité judiciaire. La mesure envisagée permettra de fiabiliser l'identité de la personne et facilitera ainsi la mise en oeuvre des conduites à tenir156(*) prévues dans les signalements insérés dans le SIS par les personnels de la gendarmerie et de la police nationales lors des contrôles d'identité, tout en préservant la liberté de circulation des personnes homonymes de personnes recherchées ou victimes d'usurpation d'identité.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les personnes faisant l'objet d'une vérification ou d'un contrôle d'identité ou du droit de circulation ou de séjour par la police ou la gendarmerie nationales pourront se voir demander leurs empreintes digitales et/ou leur photographie, dans les cadres procéduraux et pour les finalités précisées par le code de procédure pénale et le CESEDA.
Sur le territoire, la prise d'empreintes et de photographie lors du contrôle lors d'un hit alphanumérique permettra la consultation immédiate des systèmes d'information européens, sans qu'il soit systématiquement nécessaire de placer les personnes contrôlées en retenue pour vérification d'identité ou du droit de circulation ou de séjour. Cette absence de placement en rétention permettra une meilleure préservation de la liberté de circulation des personnes coopératives lors d'un contrôle.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La consultation de la CNIL est requise sur le fondement du 4° du I de l'article 8 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu duquel elle se prononce sur « tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. »
La modification proposée du code de procédure pénale et de modification du CESEDA ont fait l'objet d'une saisine de la CNIL en juin 2024 (délibération n°2024-049 du 20 juin 2024). Les modifications proposées tiennent dûment compte des observations de la CNIL. Ainsi, dans le cadre de la consultation du SIS, le projet a été modifié d'une part afin de supprimer toute mention à la procédure de vérification d'identité, au regard des dispositions déjà existantes en droit national (article 78-3 du code de procédure pénale précité). D'autre part, les dispositions ont été précisées afin de mentionner explicitement que la consultation ne se fera qu'à la suite d'un hit alphanumérique lors du contrôle aux frontières et du droit au séjour. S'agissant du CIR, les finalités de consultation ont été mentionnées.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions sont applicables dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire national.
Il est proposé une extension dans les outre-mer, sous réserve de certaines adaptations. En effet, les dispositions concernant la réglementation relative au système d'information Schengen et la règlementation relative au système d'entrée/sortie de l'espace Schengen n'ont pas vocation à s'appliquer dans les collectivités ultramarines, ces dernières n'appartenant pas à l'espace Schengen. L'accord de Schengen ne s'applique que « sur le territoire européen de la République Française », c'est-à-dire sur le territoire métropolitain, conformément à l'article 138 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Il convient de rappeler que le code de procédure pénale s'applique de la manière suivante :
- Application de plein droit au territoire métropolitain et, sous réserve des adaptations prévues, aux collectivités de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion), ainsi qu'à Saint Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Application aux autres collectivités de l'article 74 de la Constitution (îles Wallis et Futuna, Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve d'une mention expresse et des adaptations prévues ;
Les dispositions du I du présent article du projet de loi s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du I du présent article du projet de loi s'appliquent, sur mention expresse dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La mise à jour de cette mention expresse est prévue par le VII de l'article 29 du présent projet de loi.
Il convient de rappeler que le CESEDA s'applique de la manière suivante :
- Application de plein droit au territoire métropolitain et, sous réserve des adaptations prévues, aux collectivités de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion), ainsi qu'à une collectivité de l'article 74 (Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
- Application aux autres collectivités de l'article 74 de la Constitution (Saint Barthélemy, Saint-Martin, îles Wallis et Futuna, Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve d'une mention expresse et des adaptations prévues ;
Les dispositions du II du présent article du projet de loi s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions relatives au système d'information Schengen et de la règlementation relative au système d'entrée/sortie de l'espace Schengen et sous réserve des adaptations prévues (6° et au 11° du II du présent article).
Les dispositions du II du présent article du projet de loi s'appliquent, sur mention expresse, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Le présent article du projet de loi procède en conséquence à la mise à jour des compteurs prévus dans le CESEDA conformément à la jurisprudence Lifou du Conseil d'Etat et étend explicitement les dispositions à ces collectivités (3°, 4°, 5° et 10° du II du présent article), à l'exception des dispositions relatives au système d'information Schengen et de la règlementation relative au système d'entrée/sortie de l'espace Schengen et sous réserve des adaptations prévues (7°, 8°, 9° et 11° du II du présent article).
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions ne nécessitent aucun texte d'application.
Article 34 - Mise en conformité des dispositions du code de procédure pénale relatif aux conditions d'utilisation de la visioconférence ou de toute autre technologie de communication à distance en matière pénale avec le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 706-71 du code de procédure pénale (CPP) représente la disposition socle s'agissant du recours à la visioconférence en matière pénale, précisant les conditions dans lesquelles le recours à la visioconférence se tient.
Les hypothèses d'interdiction du recours à la visioconférence sont d'ores et déjà très limitées et concernent, essentiellement, les situations suivantes :
- La comparution de l'accusé devant la cour d'assises ;
- L'interrogatoire de première comparution et le placement en détention provisoire lorsque le prévenu n'est pas détenu pour une autre cause.
Dans un certain nombre de cas où il est prévu, le recours à la visioconférence est cependant conditionné à l'accord de la personne mise en cause ou des parties civiles :
- Débat contradictoire pour placement en détention provisoire si la personne est détenue pour autre cause (sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public, d'évasion ou de sa particulière dangerosité)
- Débat contradictoire pour la prolongation de détention provisoire (sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public, d'évasion, ou de sa particulière dangerosité)
- Audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la CHINS ou la juridiction de jugement (sauf si l'extraction paraît devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l'ordre public, d'évasion ou de sa particulière dangerosité).
- Comparution devant le tribunal correctionnel (accord nécessaire du procureur et de l'ensemble des parties)
- Comparution devant la chambre des appels correctionnels (accord nécessaire du procureur et de l'ensemble des parties)
- Comparution devant le PR et le JLD de la juridiction saisie du dossier sur mandat d'amener ou d'arrêt.
Enfin, il existe des dispositions spécifiques aux JIRS dont le ressort s'étend en outre-mer (art. 706-79-2 du CPP) : la visioconférence est possible concernant les personnes se trouvant sur le ressort d'une cour d'appel ultramarine, autre que celui où siège la JIRS (Paris ou Fort-de-France) pour l'interrogatoire de première comparution ainsi que le débat relatif au placement en détention provisoire.
L'article 6 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire, définit les conditions d'utilisation de la visioconférence et d'une autre technologie de communication à distance en matière pénale pour les procédures au titre des actes juridiques spécifiquement visés.
Les modifications à opérer vise donc à assurer la conformité au droit européen en précisant dans le droit national que, pour l'utilisation de la visioconférence, d'une part, le consentement de la personne entendue est requis et, d'autre part, que les titulaires de l'autorité parentale sont informés quand tels moyens sont utilisés à l'égard de mineurs.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur le recours à la visioconférence.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 supprimant la possibilité offerte au détenu de refuser la visioconférence en cas de débat de prolongation de la détention provisoire, soulignant « l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétente. » ( Cons. Const. 21 mars 2019, n°2019-778 DC §234). De même, il a été censuré les dispositions de l'article 706-71 permettant qu'en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire puisse être privée pendant un an de la faculté de comparaître physiquement devant le juge de la détention ( Cons. Const. 20 sept. 2019 n°2019-802 QPC).
Plus récemment, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 prévoyant, lorsqu'une personne détenue est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, que sa comparution devant une juridiction d'instruction ainsi que les audiences relatives à son placement en détention provisoire, à la prolongation de cette mesure et au contentieux de la détention provisoire s'effectuent par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sans que le consentement de cette dernière soit nécessaire (Cons. Const. 12 juin 2025, n°2025-885 DC). Cette mesure étant de nature à priver la personne détenue de comparaitre physiquement devant un juge pendant toute la durée de sa détention provisoire, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé qu'« eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction compétente », les dispositions contestées étaient contraires à la Constitution.
Ainsi, si la décision par laquelle la juridiction « ordonne le recours à la visioconférence relève de son appréciation souveraine, une telle faculté, qui ne concerne qu'un nombre limité de cas [doit procéder] d'un équilibre suffisant entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnel de bonne administration de la justice. » ( Crim. 15 juillet 2021, n°21-80-587).
En outre, aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le cadre conventionnel relatif à la visioconférence est le suivant :
- Art. 9 du deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale qui prévoit que les États parties peuvent organiser l'audition de témoins, d'experts ou de personnes poursuivies par vidéoconférence lorsque leur présence physique n'est pas possible ou souhaitable. Cette audition doit respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment en matière de procédure équitable et de représentation juridique ;
- Art. 24 de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne qui permet à l'autorité d'émission de solliciter une audition par vidéoconférence d'un suspect ou d'une personne poursuivie, lorsque leur présence physique dans l'État d'exécution n'est pas possible ou souhaitable. L'État d'exécution doit veiller à ce que l'audition respecte les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment en matière de procédure équitable et de représentation juridique.
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable, encadre strictement le recours à la visioconférence en procédure pénale, en imposant que ce mode de comparution ne compromette ni les droits de la défense, ni l'égalité des armes, ni la publicité des débats, et que la personne concernée puisse interagir efficacement avec son avocat et la juridiction.
Par ailleurs, et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) se sont prononcées quant à l'utilisation de la visioconférence en matière pénale.
Ainsi, « si la participation de l'accusé aux débats par visioconférence n'est pas, en soi, contraire à la Convention, il appartient à la Cour de s'assurer que son application dans chaque cas d'espère poursuit un but légitime et que ses modalités de déroulement sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense, tels qu'établis par l'article de la Convention » ce à quoi elle procède en examinant concrètement que « l'intéressé a eu la possibilité d'exercer les droits et facultés inhérents à la notion de procès équitable. » ( CEDH 5 oct. 2006, Marcello Viola c/ Italie req. N°45196/04 §67 et §76).
De même, la CJUE a jugé, à propos de l'article 8 de la directive (UE) 2016-343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre de procédures pénales, que celui-ci doit être interprété « en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un prévenu puisse, à sa demande expresse, participer aux audiences de son procès par visioconférence, le droit à un procès équitable devant, par ailleurs, être garanti (§33) ( CJUE, 4 juillet 2024, aff. C-760/22).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il apparait nécessaire de mettre les dispositions du code de procédure pénale en conformité avec les dispositions du règlement susvisé, s'agissant du recueil préalable du consentement de la personne entendue, ou de l'information de ses représentants légaux si elle est mineure, via un moyen de visioconférence, dans certains cadres procéduraux spécifiquement visés.
Or, s'agissant du droit national applicable, et notamment des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans tous les contentieux ne touchant pas à la liberté, l'accord de la personne au recours à un moyen de visioconférence n'a pas nécessairement à être recherché par l'autorité judiciaire.
De même, il n'est pas prévu, dans les hypothèses où il est fait usage de la visioconférence ou d'un autre moyen de télécommunication à l'égard d'un mineur que les titulaires de l'autorité parentale de ce dernier soient informés.
Une modification par voie législative s'impose s'agissant de dispositions, de ce même niveau, relevant du domaine de l'article 34 de la Constitution.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est d'assurer la conformité du droit interne à l'article 6 du règlement 2023/2844 s'agissant du consentement requis auprès de la personne entendue pour l'usage de la visioconférence ou d'une autre technologie de communication à distance en matière pénale pour les procédures au titre des actes juridiques spécifiquement visés et de l'information des représentants légaux ou d'un adulte approprié lorsqu'un mineur est concerné.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Plusieurs options ont été envisagées. D'abord, il a été évoqué la possibilité de modifier l'article 706-71 du code de procédure pénale afin de préciser, pour chacune des procédures visées par le règlement, que le consentement de la personne entendue est requis. Toutefois, compte tenu des nombreuses références aux textes européens que cela impliquait, la lisibilité aurait été réduite et ce d'autant que l'article 706-71 est un article socle en matière de vidéoconférence et déjà très fortement fourni.
Il aurait également pu être envisagé d'ajouter un alinéa à l'article 706-71 pour indiquer expressément qu'en matière d'entraide pénale, il convient de recueillir le consentement de la personne entendue pour recourir à un moyen de visioconférence. Toutefois, une telle évolution aurait dépassé le cadre de la mise en conformité, le règlement (UE) 2023/2844 ne posant cette exigence que pour certains actes limitativement définis. Pour les mêmes raisons, il n'a pas été envisagé de modifier les dispositions générales applicables en matière d'entraide pénale européenne et internationale et notamment les articles 694-5 et 694-48 du code de procédure pénale.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La solution retenue consiste à modifier les articles référents des procédures et actes juridiques visés par le règlement et qui spécifiquement concernent l'usage de la visioconférence, par référence à l'article 706-71. Dans les hypothèses où aucune référence à l'article 706-71 ne serait déjà prévue, ce qui est le cas notamment s'agissant de la procédure de protection, il est proposé de procéder à un renvoi à l'article en précisant que le consentement est requis.
Ainsi, il convient de modifier les articles suivants afin qu'ils soient conformes au règlement susmentionné :
- L'article 695-44 du code de procédure pénale relatif au mandat européen et à l'audition de la personne recherchée ;
- L'article 728-17 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance mutuelle des exécutions des condamnations ;
- L'article 764-22 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance de jugement et de probation devant le juge d'application des peines ;
- L'article 764-30 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance de jugement et de probation devant le président de la chambre de l'application des peines ;
- L'article 696-70 du code de procédure pénale en matière de contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention ;
- L'article 696-80 du code de procédure pénale en matière de contrôle judiciaire devant la chambre de l'instruction ;
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Il est procédé à la modification des
dispositions du code procédure pénale suivantes :
articles 695-44, 728-17, 764-22, 764-30, 696-70, 696-80, et 804.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article permet de mettre le code de procédure pénale en conformité avec l'article 6 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le présent article n'a pas d'impact pour les services judiciaires qui disposent déjà du matériel nécessaire. En outre, le recueil du consentement n'a pas de coût.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Dans les hypothèses concernées par les nouvelles dispositions, les services devront recueillir le consentement de la personne entendue par un moyen audiovisuel. Cette nouvelle obligation est sans conséquences sur l'organisation des services, un tel recueil préalable étant déjà imposé dans d'autres cas procéduraux.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les présentes mesures renforcent la garantie des droits, notamment de la défense.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'impact de ces modifications sera relatif, en ce que le droit pour une personne entendue de s'opposer à l'utilisation d'un moyen de visioconférence est déjà reconnu dans plusieurs hypothèses. Les présentes mesures renforcent la garantie des droits, notamment de la défense.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national grâce à la mise à jour du compteur LIFOU de l'article 804 du code de procédure pénale, qui applique expressément les dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucun texte d'application.
Article 35 - Mesures d'adaptation du droit national au règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le présent article procède à l'adaptation du droit national au règlement 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Ce règlement fait partie du plan d'action pour la démocratie européenne présenté par la Commission européenne dans sa communication du 3 décembre 2020.
Ce règlement vise à répondre aux préoccupations des autorités et des citoyens liées aux risques de manipulation de l'opinion ainsi qu'aux ingérences étrangères à l'approche d'élections, notamment à la suite de l' « affaire Cambridge Analytica »157(*) lors de la campagne pour la présidentielle américaine en 2016, révélée en 2018. Dans son plan d'action pour la démocratie, la Commission soulignait également la difficulté constatée à appliquer à l'environnement en ligne les règles traditionnelles liées aux campagnes politiques.
Le règlement 2024/900 établit des règles harmonisées en matière de transparence et de ciblage de la publicité à caractère politique, et ce, quel que soit son vecteur de diffusion, en ligne et hors ligne. Ces règles concernent aussi bien toute publicité conçue par ou pour le compte d'un acteur politique que celle susceptible et conçue dans le but d'influencer les résultats d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire. Sont cependant exclus du règlement les messages des sources officielles strictement limités à l'organisation et aux modalités de la participation à une élection, les informations officielles non destinées à influencer les électeurs, et la présentation des candidats expressément encadrée par le législateur garantissant une égalité de traitement des candidats.
Les obligations du règlement 2024/900 n'affectent pas le contenu de la publicité à caractère politique ni d'autres aspects de la publicité à caractère politique, tels que le déroulement des campagnes politiques, régies par les règles nationales. Les opinions politiques et autres contenus rédactionnels exprimés, quel qu'en soit le support, sous une responsabilité éditoriale ne sont pas considérés comme de la publicité à caractère politique, à moins qu'un paiement spécifique ou une autre rémunération ne soit prévu pour, ou en lien avec, leur élaboration ou diffusion.
Les points clés du règlement 2024/900 sont les suivants :
- la publicité à caractère politique doit être clairement identifiée comme telle et inclure des informations sur les personnes qui l'ont payée, l'élection, le référendum, le processus législatif ou réglementaire auquel elle est liée et l'utilisation éventuelle de techniques de ciblage ou de diffusion de la publicité ;
- des informations supplémentaires fournissant un contexte plus large pour la publicité à caractère politique, telles que des informations sur les montants agrégés ou leur origine, sont fournies dans l'avis de transparence qui doit être inclus dans chaque publicité à caractère politique ou être facilement récupérable ;
- le ciblage ou la diffusion de la publicité à caractère politique en ligne n'est autorisé que dans des conditions strictes :
o les données doivent être collectées auprès de la personne concernée ;
o les données ne peuvent être utilisées que si la personne concernée a donné son consentement explicite séparément pour leur utilisation à des fins de publicité à caractère politique ;
o les données à caractère personnel des mineurs ne peuvent pas être utilisées ;
o les catégories particulières de données à caractère personnel, comme les données révélant l'origine raciale ou ethnique ou les opinions politiques, ne peuvent pas être utilisées à des fins de profilage ;
o l'utilisation de données à caractère personnel d'une personne concernée dont l'âge supposé est inférieur de moins d'un an à l'âge du droit de vote établi par les règles nationales est interdite ;
- toutes les publicités en ligne seront disponibles dans un répertoire européen accessible en ligne ;
- une interdiction est imposée à la publicité à caractère politique provenant de parraineurs extérieurs à l'UE au cours des trois mois précédant une élection ou un référendum.
L'impact du présent article sur le droit français est relativement limité dans la mesure où la plupart des dispositions du règlement sont directement applicables par les parraineurs, les prestataires de services de publicité à caractère politique et les responsables de traitement de données à caractère personnel et leurs sous-traitants, au titre du règlement 2024/900. Par ailleurs, la publicité politique étant prohibée pour les services audiovisuels en France, est principalement concernée la publicité politique diffusée sur les plateformes en ligne et par les services de presse.
Les Etats membres doivent désigner les autorités compétentes pour le contrôle du respect du règlement 2024/900 au niveau national, prévoir les modalités de coopération et de coordination entre ces autorités et déterminer le régime de sanctions applicables aux acteurs visés. C'est l'objet du présent article. Il complète la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complète divers articles de la LCEN et de la LIL, complète le code électoral et abroge l'article L. 163-1 du code électoral et en tire les conséquences rédactionnelles.
Entré en vigueur en avril 2024, le règlement 2024/900 s'appliquera entièrement dans l'Union européenne à partir du 10 octobre 2025.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
Tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent ainsi d'une exigence constitutionnelle.
Le présent article a pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions du règlement 2024/900. L'impact des obligations prévues par ce dernier sur l'exercice du droit à la vie privée, sur la liberté d'expression ou encore sur la liberté d'entreprendre, découle directement du règlement européen.
Les sanctions prévues par le règlement 2024/900 en cas de manquements ne peuvent excéder 6 % du revenu, du budget annuel ou du chiffre d'affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas. Lorsqu'une sanction est prononcée, l'autorité compétente doit prendre de nombreux éléments en compte pour assurer la proportionnalité de la sanction, y compris :
- la nature, la gravité, la récurrence et la durée de la violation et son caractère délibéré ou négligent ;
- toute mesure prise pour atténuer le dommage éventuellement subi ;
- le degré de coopération avec l'autorité compétente ;
- toute circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ;
- la taille et la capacité économique de l'entité sanctionnée, le cas échéant.
Certains manquements sont considérés comme particulièrement graves lorsqu'ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d'élections et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises.
Le règlement 2024/900 accorde, sur quelques points, une marge de manoeuvre aux Etats membres. Il leur revient notamment de :
- désigner les autorités compétentes pour le contrôle au niveau national du respect des obligations de ce règlement, en précisant leurs pouvoirs de supervision et d'exécution ;
- prévoir les modalités de coopération et de coordination entre ces autorités ainsi désignées ;
- préciser le régime de sanctions applicables aux acteurs visés par le règlement.
Le règlement 2024/900 précise en outre qu'afin de soutenir le respect des libertés et droits fondamentaux, de l'état de droit, des principes démocratiques et de la confiance du public dans le contrôle de la publicité à caractère politique, il est nécessaire que les autorités compétentes désignées soient impartiales, structurellement indépendantes des interventions extérieures ou des pressions politiques et qu'elles soient dotées des pouvoirs nécessaires pour contrôler et prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du règlement, en particulier de ses exigences en matière de marquage et de transparence. Il précise également que l'exercice, par les autorités compétentes, des pouvoirs que leur confère le règlement devrait être soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l'Union et au droit des États membres, y compris des recours juridictionnels effectifs et une procédure régulière.
Ces garanties sont prévues par les textes organisant les compétences et pouvoirs des autorités respectivement désignées pour la supervision des obligations applicables aux prestataires de services de publicité à caractère politique et aux responsables de traitement de données à caractère personnel ou, le cas échéant, par les dispositions nouvellement créées.
Les dispositions envisagées prévoient les adaptations nécessaires du droit national au règlement 2024/900 ne présentent pas de risque de contrariété avec une règle ou norme de valeur constitutionnelle.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'organisation des élections dans l'Union européenne est largement régulée au niveau des Etats membres, y compris concernant la publicité et les communications politiques.
Le règlement 2024/900 doit néanmoins être envisagé en lien avec plusieurs normes européennes : les règles relatives à la protection des données personnelles, principalement le RGPD, le cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union et dans le contexte des élections européennes, le règlement électoral européen de 1976 ainsi que le règlement sur le statut et le financement des partis européens. Le règlement 2024/900 complète également le RSN, qui prévoit certaines obligations de transparence pour les services en ligne.
Par ailleurs, le Conseil de l'Europe a adopté en 1999 une recommandation sur les mesures concernant la couverture médiatique des campagnes électorales. Cette recommandation appelle les Etats à adopter un cadre réglementaire permettant d'assurer une couverture des campagnes électorales équitable, équilibrée et impartiale, contribuant à des élections libres et démocratiques.
La recommandation couvre à titre principal la radiodiffusion mais également les organes de presse écrite détenus par les pouvoirs publics. La recommandation n'omet d'ailleurs pas de rappeler que le cadre réglementaire en matière de couverture des campagnes électorales ne doit pas interférer avec l'indépendance éditoriale des médias. Les éditeurs de presse, en particulier, doivent pouvoir exprimer une préférence politique.
Concernant les radiodiffuseurs, le Conseil de l'Europe recommande que les cadres de régulation nationaux favorisent et facilitent l'expression pluraliste des courants d'opinion. Ces cadres de régulation devraient également prévoir l'obligation de couvrir les campagnes électorales de manière équitable, équilibrée et impartiale à travers l'ensemble des services de programmes des radiodiffuseurs, privés comme publics.
La recommandation précise aussi que, lorsque la publicité politique payante est autorisée, les Etats membres doivent veiller à ce que tous les candidats et partis politiques soient traités de manière « égale et non discriminatoire ». Par exemple, l'ensemble des candidats et partis politiques doivent pouvoir acheter des espaces publicitaires dans des conditions ainsi qu'à des tarifs similaires. La recommandation souligne également l'importance d'une identification claire de la publicité politique. Une version révisée de la recommandation a été adopté en 2007 afin d'étendre son champ aux services de médias audiovisuels non-linéaires et à la presse en ligne158(*).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Avant l'adoption du règlement 2024/900, il n'existait pas d'approche harmonisée au niveau européen concernant la régulation de la publicité politique. Selon un rapport de septembre 2020 du Conseil de l'Europe, le traitement de la publicité politique s'avérait jusque-là disparate d'un Etat membre à l'autre : certains pays la réglementent peu tandis que d'autres ne l'autorisent qu'en période « pré-électorale » (Italie, Allemagne) ou l'interdisent pour des périodes plus longues voire complètement sur certains médias (France, Belgique, Portugal, Irlande).
Le rapport 2024 du « Media pluralism monitor » indique que, de manière générale, la publicité politique est largement réglementée concernant sa diffusion sur des médias traditionnels, en particulier sur les médias audiovisuels. En revanche, la publicité politique en ligne apparait, avant l'adoption du règlement 2024/900, très peu réglementée par les Etats membres, la plupart des législations étant cantonnées aux médias traditionnels. Cette absence de cadre réglementaire concernant la publicité politique en ligne entraine, selon le rapport, une augmentation des risques en matière de représentation équitable des différents acteurs et points de vue politiques.
Dans son chapitre consacré à l'Allemagne, le rapport indique qu'il existe une interdiction générale de la publicité politique à la radio. En outre, les publicités électorales ne peuvent être diffusées à la télévision que dans les six semaines précédant une élection dans des conditions strictes, tandis qu'il n'existe aucune restriction concernant la publicité politique sur les réseaux sociaux. Il n'existe pas non plus de labellisation claire de la publicité politique ou de règles de transparence spécifiques.
En Espagne, le cadre réglementaire ne fixe pas de limite à la publicité politique en ligne et n'oblige pas les partis politiques à rendre compte de leurs dépenses publicitaires. En outre, il n'existe aucune restriction aux pratiques de collecte de données personnelles, ce qui permet l'utilisation de technique de microciblage.
Au Danemark, plusieurs lois définissent des obligations en matière de transparence de financement de la vie politique. La loi sur la comptabilité des partis (Partiregnskabsloven) ainsi que celle sur le soutien aux partis politiques (Partistøtteloven) obligent les partis ainsi que les candidats à déclarer leurs dépenses de campagne, y compris en ligne. La loi sur la publicité (Markedsføringsloven) impose, en outre, que les publicités (y compris politiques) soient clairement identifiables et interdit de contacter des individus sans leur consentement à des fins publicitaires. L'utilisation de techniques de microciblage est considérée comme une violation de cette loi. La publicité politique en ligne relève de la loi sur la publicité tandis que la publicité politique diffusée sur la radio et la télévision relève d'une loi spécifique à ces médias.
En Lituanie, la diffusion de publicité politique a été interdite en 2021 sur les médias de service public. Il n'existe pas de réglementation spécifique aux plateformes ou aux médias en ligne concernant la diffusion de publicité politique en ligne en période électorale, qui sont donc soumis aux mêmes exigences que les autres médias aux termes du code électoral de la République de Lituanie. Le code prévoit notamment une obligation générale de garantir l'égalité des chances et la transparence de la publicité politique. Chaque candidat doit déclarer à la Commission électorale centrale ses comptes sur les réseaux sociaux via lesquels il a l'intention de diffuser de la publicité politique sponsorisée, ainsi que les personnes autorisées à gérer la diffusion de la publicité sur ces comptes. Toutes les données relatives aux publicités politiques dans l'ensemble des médias (nationaux, régionaux, locaux) et plateformes en ligne, réseaux sociaux, sont accessibles au public sur le site internet de la Commission électorale centrale.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La loi est commandée par une norme supérieure, le règlement 2024/900.
Le présent article adapte le droit national au règlement 2024/900, qui est d'application directe. Le règlement charge néanmoins les Etats membres de désigner des autorités nationales compétentes pour la supervision des obligations qu'il prévoit et de déterminer le régime de sanctions applicables aux manquements par les acteurs concernés.
En conséquence, les adaptations nécessaires du droit national visent donc à :
- désigner les autorités compétentes pour le contrôle au niveau national du respect des obligations de ce règlement, en précisant leurs pouvoirs de supervision, d'exécution ;
- prévoir les modalités de coopération et de coordination entre ces autorités ainsi désignées ;
- préciser le régime de sanctions applicables aux acteurs visés par le règlement.
Ces désignations entrainent des adaptations des textes qui organisent aujourd'hui les pouvoirs des autorités concernées, à savoir :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique pour l'ARCOM ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour la CNIL.
Il est en outre nécessaire d'adapter certaines dispositions du droit national au règlement 2024/900, qui est d'harmonisation maximale. En particulier, l'article L. 163-1 du code électoral est désormais couvert et étendu dans sa portée par le règlement. En effet, l'article 11 du nouveau règlement 2024/900 vise un champ plus large d'acteurs (les éditeurs de publicité à caractère politique) que ceux visés par l'article L.163-1, limités aux « très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne », au sens du RSN. Or, les éditeurs de publicité à caractère politique incluent notamment ces « très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne », comme le notait d'ailleurs le Conseil d'Etat en 2024 lors de l'examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. De plus, l'obligation de transmission d'informations prévue par ce même article 11 du règlement est permanente, alors que l'article L.163-1 la limite à la seule période des trois mois précédant les élections. En outre, l'article 13 du règlement 2024/900, qui vise spécifiquement les « très grandes plateformes » et les « très grands moteurs de recherche en ligne », renforce leurs obligations concernant le contenu des informations de publicité politique à prévoir dans le registre prévu à l'article 39 du RSN. Cette disposition s'avère donc plus précise que celle prévue au L.163-1 du code électoral, qui se limitait à l'obligation d'informations prévues par ce registre au sens de l'article 39 du RSN. Pour ces raisons, l'article L.163-1 du code électoral doit être abrogé et d'autres dispositions doivent être adaptées pour tirer les conséquences rédactionnelles de cette abrogation.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à adapter le droit national aux dispositions du règlement 2024/900.
Il désigne les autorités compétentes chargées de la supervision du respect des obligations prévues par le règlement, organise les modalités de coopération et de coordination entre lesdites autorités et détermine le régime de sanctions applicables aux acteurs visés par le règlement.
L'objectif est d'assurer la bonne mise en oeuvre des obligations prévues par le règlement 2024/900 sur le territoire national. Ainsi, il est nécessaire de désigner les autorités nationales compétentes pertinentes pour superviser les différentes obligations prévues par le règlement et les différentes catégories d'acteurs couverts, selon une répartition claire des responsabilités entre les différentes entités concernées, organiser une coopération efficace entre autorités, et prévoir des sanctions effectives.
Un second objectif consiste à aligner le droit national avec le règlement 2024/900, d'harmonisation maximale. En effet, les États membres doivent s'abstenir de maintenir dans leurs législations nationales des dispositions sur la transparence de la publicité à caractère politique qui s'écartent de celles établies par le règlement 2024/900, en particulier des dispositions plus ou moins strictes prévoyant des niveaux de transparence différents dans le domaine de la publicité à caractère politique.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les options envisageables concernent principalement le choix des autorités nationales compétentes à désigner pour la supervision des obligations prévues par le règlement 2024/900, suivant les types d'obligations et d'acteurs visés.
S'agissant des obligations des fournisseurs de services intermédiaires (mentionnés au paragraphe 3 de l'article 22), le règlement indique que les autorités compétentes désignées en application du RSN peuvent être l'une des autorités compétentes pour superviser le respect des obligations qui incombent à ces acteurs. L'article 7 de la LCEN désigne l'ARCOM, la DGCCRF et la CNIL en tant qu'autorités compétentes pour la supervision du RSN, et l'ARCOM en tant que coordinateur pour les services numériques pour la France. L'ARCOM étant chargée de la supervision des obligations de transparence publicitaire prévues par le RSN, les options DGCCRF et CNIL ont été écartées s'agissant de cette compétence.
S'agissant des obligations des prestataires de services de publicité à caractère politique, qui ne sont pas des fournisseurs de services intermédiaires au sens du RSN - par exemple les agences de publicité, les éditeurs de presse ou de services de médias audiovisuels, les créateurs de contenus, ou encore les services de technique publicitaire -, le règlement 2024/900 laisse toute latitude aux Etats membres pour la désignation des autorités compétentes, étant entendu qu'elles doivent jouir d'une indépendance structurelle totale à l'égard du secteur et à l'égard de toute intervention extérieure ou pression politique. Le règlement mentionne que les autorités compétentes peuvent être différentes de celles chargées du RGPD ou du RSN et peuvent être les mêmes que les autorités compétentes au titre de la directive Services de médias audiovisuels.
Il a d'abord été envisagé de procéder à une répartition sectorielle de la supervision de ces acteurs, en tentant d'affecter une autorité compétente suivant le secteur d'activité considéré. Toutefois, après analyse, une telle répartition n'est pas apparue pertinente dans la mesure où plusieurs catégories d'acteurs visés ne font pas l'objet d'une régulation spécifique par des autorités établies (agences de publicité, éditeurs de presse notamment) et que la création d'entités ad hoc ne paraissait ni optimale ni même pertinente. Une multiplication des autorités compétentes aurait en outre vraisemblablement entraîné une complexification notable de la supervision du règlement. Cette option a donc été écartée au profit d'une répartition plus unifiée des compétences.
Demeure le cas de la supervision des obligations des « parraineurs », définis par l'article 3 du règlement comme « la personne physique ou morale à la demande de laquelle ou pour le compte de laquelle une annonce publicitaire à caractère politique est élaborée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée ». Il s'agit donc de personnalités politiques ou de partis politiques, etc.
Les obligations qui incombent aux parraineurs sont précisées aux articles 7 et 10 du règlement, et consistent pour l'essentiel à déclarer de bonne foi leur statut de parraineur et informer les prestataires de services de publicité à caractère politique des annonces publicitaires à caractère politique qu'ils élaborent ou dont ils sont l'objet, en garantissant en permanence la complétude et l'exactitude des informations qu'ils fournissent, et répondant aux demandes qu'ils leur sont faites par les prestataires de services de publicité à caractère politique. Plusieurs hypothèses ont été envisagées : confier la supervision à l'ARCOM, à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ou à la CNCCFP.
Après échanges avec la HATVP, celle-ci a été écartée dans la mesure où les missions de supervision des parraineurs, tournées vers le champ politique et électoral, sont en réalité assez éloignées voire sans lien avec les missions de la Haute autorité, qui visent plutôt les représentants d'intérêts et non les responsables publics susceptibles de faire l'objet de démarches de leur part. La Haute autorité ne dispose par ailleurs pas des contacts du public visé ici par le règlement.
Concernant l'ARCOM, il y a une certaine logique à chercher à étendre ses missions à la supervision des parraineurs puisqu'il est proposé par le présent projet de loi qu'elle soit chargée de la supervision de l'ensemble des prestataires de services de publicité à caractère politique. Cela étant, les missions de l'ARCOM concernent jusqu'à présent la régulation des médias audiovisuels et des plateformes en ligne, et non directement les personnalités ou les partis politiques. Par exemple, le décompte des temps de parole en période d'élections est une mission de contrôle des médias, pas des partis politiques. L'ARCOM demeure toutefois une candidate possible à la supervision des parraineurs.
Enfin, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été approchée, mais n'a pas souhaité se voir confier une telle mission de supervision des parraineurs, qu'elle a jugé trop éloignée de ses missions actuelles et incompatible avec ses moyens. En revanche, la CNCCFP a souhaité pouvoir être rendue destinataire des informations utiles et des rapports périodiques permettant la veille de la publicité politique pendant les campagnes électorales françaises afin d'en tirer les conséquences en matière de respect des règles de financement.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Certaines compétences sont déjà fléchées par le règlement 2024/900. En effet, au paragraphe 1 de son article 22, le règlement précise que l'autorité compétente pour superviser le respect des obligations en matière de techniques de ciblage et de diffusion de publicités à caractère politique (chapitre III du règlement) est l'autorité nationale compétente au titre du RGPD. Par conséquent, la CNIL est désignée compétente sur le champ de ce chapitre III.
Dans la mesure où la Commission européenne dispose d'une compétence exclusive pour superviser et faire respecter des obligations applicables aux très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne au titre du RSN, la Commission supervisera le respect par ces acteurs de leurs obligations concernant le répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne prévues par le règlement 2024/900. Aucune disposition de droit national n'est nécessaire sur ce point.
L'ARCOM étant chargée de la supervision des obligations de transparence publicitaire prévues par le RSN, il est cohérent qu'elle soit également désignée autorité compétente pour superviser les fournisseurs de services intermédiaires, au sens de la LCEN, pour l'application du règlement 2024/900. C'était également le souhait des services de l'Autorité. Il est donc proposé que l'ARCOM soit l'autorité compétente pour assurer la supervision du respect des obligations auxquelles sont assujettis les fournisseurs de services intermédiaires.
Concernant les prestataires de services de publicité à caractère politique mentionnés au paragraphe 4 de l'article 22 du règlement, il a finalement été décidé de confier à l'ARCOM la supervision de l'ensemble de ces acteurs, notamment en raison de ses compétences déjà établies sur certains de ces services (en particulier les services de médias audiovisuels) et afin de simplifier la mise en oeuvre du texte.
Il en est de même pour la supervision des parraineurs, confiée à l'ARCOM, qui après réflexion, a acté que cette nouvelle attribution constituerait le schéma le plus naturel et, surtout, le plus opérant, dans la mesure où l'Autorité est désignée pour la supervision des autres maillons de la chaine (exception faite des dispositions revenant à la CNIL selon les termes mêmes du règlement). A défaut, une fragmentation de la supervision aurait risqué de porter atteinte à son efficience et partant, à celle de la mise en oeuvre du règlement.
Un découpage des missions de l'ARCOM suivant les vecteurs législatifs en fonction des acteurs est rendu nécessaire compte tenu, d'une part, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui précise les missions de l'ARCOM dans le champ audiovisuel et dans certains cas sur la communication au public en ligne (interfaces des télévisions connectées et plateformes en ligne notamment) et de la LCEN qui définit le champ d'action de l'autorité concernant les services intermédiaires. Cette supervision emporte des modifications des deux lois précitées, détaillées en partie 4.1.1.
Il est également précisé que la CNCCFP, en tant qu'autorité chargée de l'audit et du contrôle des partis politiques, est rendue destinataire des rapports périodiques sur les services de publicité à caractère politique au sens de l'article 14 du règlement 2024/900.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée pour tirer les conséquences de la désignation de l'ARCOM en tant qu'autorité compétente pour la supervision des prestataires de services de publicité à caractère politique, en application du paragraphe 4 de l'article 22 du règlement 2024/900. Sont créés :
- un article 20-9, consistant :
o en son I, à inscrire dans le droit national les définitions de « prestataire de services de publicité à caractère politique » et de « parraineur » prévues par le règlement en renvoyant à celles-ci, et préciser l'ensemble des élections pour lesquelles s'inscrivent ces nouvelles obligations ;
o en son II, à désigner l'ARCOM compétente au titre de la supervision des obligations applicables aux prestataires de services de publicité à caractère politique (autres que fournisseurs de services intermédiaires prévues dans la LCEN, c'est-à-dire par exemple, les services de médias, les créateurs de contenus ou les services de techniques publicitaires) et aux parraineurs et prévoir que l'ARCOM est chargée de tenir à jour le registre des représentants légaux de ces services pour la France ;
o en son III, à préciser les nouveaux pouvoirs d'enquête et de sanctions de l'ARCOM dans le cadre de ses nouvelles prérogatives ;
o en son IV, V et VI, à préciser les règles procédurales des agents habilités et assermentés dans le cadre d'inspections sur site, de saisine et restitution des documents ;
o en son VII, à prévoir des dispositions spécifiques à la mise en oeuvre des pouvoirs d'exécution de l'ARCOM afin de s'assurer du respect du secret des sources ;
- un article 20-10, consistant :
o en son I, à préciser le régime et la procédure de sanctions pouvant être prononcées par l'ARCOM ;
o en son II, à déterminer le montant maximal des sanctions et des astreintes pouvant être prononcées par l'ARCOM ;
o En son III, à préciser les modalités de publication des injonctions et sanctions prononcées par l'ARCOM ;
- un article 20-11 qui précise :
o en son I, les modalités de coopération entre les autorités nationales compétentes, à savoir l'ARCOM et la CNIL. Une coopération étroite et une assistance mutuelle sont attendues entre ces autorités aux fins de la bonne application du règlement, notamment via l'échange d'informations et les consultations mutuelles ; les modalités de mise en oeuvre doivent être précisées par voie de conventions entre ces autorités ;
o en son II, que l'ARCOM est l'autorité désignée point de contact pour la France au niveau de l'Union, aux fins du bon suivi du règlement.
Afin que les dispositions citées précédemment soient rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la mention expresse d'application présente à l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est actualisée. Par ailleurs, deux nouveaux alinéas sont insérés afin d'adapter les références au tribunal judiciaire à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et au règlement 2024/900 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En outre, le présent article modifie la LCEN pour tirer les conséquences de la désignation de l'ARCOM en tant qu'autorité compétente pour la supervision des fournisseurs de services intermédiaires, en application du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement 2024/900 :
- l'article 8-1 est complété afin d'étendre les missions de l'ARCOM vis-à-vis des fournisseurs de services intermédiaires, consistant à superviser leurs obligations de transparence et de diligence raisonnables prévues par les articles 7 à 17 et 21 du règlement ;
- l'article 9-2 est complété, afin d'adapter le régime de sanctions pécuniaires de l'ARCOM à l'encontre des fournisseurs de services intermédiaires au titre du règlement 2024/900 ;
- l'article 57 est modifié et complété pour rendre les dispositions énoncées précédemment applicables dans les collectivités du Pacifique et pour prévoir les dispositions nécessaires à l'application du règlement 2024/900 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent article modifie également la LIL, en complétant les articles 8, 16, et 20 pour préciser que la CNIL l'autorité compétente au sens du paragraphe 1er de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 et en insérant un nouveau titre IV Quinquies, précisant les modalités de supervision du respect par les responsables de traitement et des sous-traitants qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées à l'article 18 du règlement. Les articles 125 et 126 de la LIL sont modifiés pour rendre les dispositions citées précédemment applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et pour prévoir l'application du règlement 2024/900 dans les pays et territoires d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises).
Le présent article insère un nouvel alinéa au sein de l'article L. 52-1 du code électoral afin de préciser que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rendue destinataire des rapports périodiques des fournisseurs de services de publicité à caractère politique comportant les informations prévues à l'article 14, paragraphe 1, du règlement 2024/900. L'article L. 163-1 du code électoral est abrogé et tire les conséquences rédactionnelles sur ce même code à ses articles L. 112, L. 306 et L. 558-46. Les compteurs Lifou présents aux articles L. 388, L. 395 et L. 439 sont actualisés afin de rendre les dispositions énoncées précédemment applicables dans les collectivités du Pacifique. En outre, l'article L. 388 est modifié et les articles L. 477-1 A et L. 531-1 sont créés pour prévoir les dispositions nécessaires à l'application du règlement 2024/900 dans les pays et territoires d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie). Par ailleurs, le 10° du IV du présent article insère, au sein de la présente loi, une mention expresse d'application afin de rendre les modifications opérées par le 5° du IV de ce même article applicables dans les collectivités du Pacifique.
Enfin, le présent article modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. L'article 14-2 est modifié pour tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L. 163-1 du code électoral et le compteur Lifou présent à l'article 26 est actualisé afin de rendre les dispositions citées précédemment applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article adapte le droit national au règlement 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.
L'articulation entre les règles prévues par le règlement 2024/900 et celles du droit de l'Union européenne est précisée à l'article 2 du règlement. En particulier, il s'entend sans préjudice des règles établies notamment par :
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;
- la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») ;
- la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») ;
- le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ;
- le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (RSN).
A noter que le règlement 2024/900 complète le RSN s'agissant des obligations de transparence et de marquage des publicités s'appliquant à certains prestataires de service de publicité à caractère politique qui sont des fournisseurs de services intermédiaires au sens du RSN.
Par ailleurs, certaines dispositions du RGPD s'appliquent aux activités couvertes par les articles 18 et 19 du règlement (mutatis mutandis pour certaines).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Puisqu'il s'agit dans cet article de mesures d'adaptation du droit national au règlement 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, les effets sur les entreprises sont plus directement liés à l'entrée en application du règlement lui-même. Les prestataires de services de publicité à caractère politique seront soumis à des obligations nouvelles, déjà rappelées. Ces obligations ne devraient nullement affecter la compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis des autres Etats membres de l'Union, puisqu'elles proviennent d'un règlement européen et que ce dernier s'applique à toute publicité à caractère politique lorsque celle-ci est diffusée dans l'Union, qu'elle est portée dans le domaine public dans un ou plusieurs États membres ou qu'elle s'adresse à des citoyens de l'Union, indépendamment du lieu d'établissement du prestataire de services de publicité à caractère politique ou du lieu de résidence ou d'établissement du parraineur, et quels que soient les moyens utilisés.
A noter que certaines obligations prévues par le règlement sont allégées pour les micros, petites et moyennes entreprises.
En matière de sanctions auxquelles les entreprises sont exposées, il convient de relever que celles-ci sont plafonnées (6 % du revenu, du budget annuel ou du chiffre d'affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas) et qu'elles seront proportionnées notamment à la nature, la gravité, la récurrence et la durée de la violation et son caractère délibéré ou négligent, ainsi qu'à la taille et la capacité économique de l'entité sanctionnée.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le présent article élargit le champ de compétence de l'ARCOM et suscite une activité supplémentaire pour l'autorité administrative indépendante. Quelques ETP supplémentaires au sein de l'ARCOM pourraient s'avérer nécessaires.
Les sanctions pécuniaires prononcées par l'ARCOM sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Cet article confère aux autorités nationales compétentes - l'ARCOM et la CNIL, des pouvoirs spécifiques en application du règlement 2024/900.
S'agissant des nouvelles missions de supervision confiées à l'ARCOM, le règlement 2024/900 prévoit plusieurs étapes lors desquelles d'éventuelles non-conformités pourront être relevées par les acteurs concernés, le public ou les autorités compétentes. Dès l'étape de la transmission d'informations relatives aux publicités politiques par les parraineurs à leurs prestataires de services de publicité politique (ex. services de technologies publicitaires), ces derniers devraient « considérer qu'une déclaration ou une information est manifestement erronée si cela ressort du contenu de l'annonce publicitaire, de l'identité du parraineur ou du contexte dans lequel le service concerné est fourni, sans autre vérification ou recherche de faits » (considérant 45 du règlement 2024/900) et les prestataires sont ainsi tenus de demander une correction des informations (article 7, §4 du règlement).
Ensuite, les prestataires transmettent les informations aux éditeurs (réseaux sociaux, créateurs de contenus, services de médias, etc.) qui affichent la publicité politique, présentent ces informations au public (articles 11 et 12 du règlement) et les renseignent dans le répertoire européen des annonces (articles 13 du règlement). Les prestataires doivent corriger ou compléter les informations s'ils se rendent compte qu'elles sont fausses ou incomplètes, et les éditeurs doivent eux déployer tous leurs efforts s'ils s'en rendent aussi compte, y compris en contactant le prestataire ou directement le parraineur.
Les éditeurs doivent également permettre à toute personne de leur signaler si une annonce publicitaire à caractère politique donnée qu'ils ont publiée ne respecte pas le règlement (article 15 du règlement). Le traitement de ces signalements par les éditeurs doit être diligent et, dans le mois précédant une élection, être réalisé dans un délai de 48 heures. Les éditeurs peuvent prendre des mesures pour corriger les informations ou, si nécessaire, retirer la publicité et en informer les parraineurs et prestataires concernés.
Si les manquements ne sont pas corrigés durant ces étapes, dans le cadre de ses missions de contrôle, l'ARCOM pourra déclencher ses pouvoirs d'exécution à la suite de réclamations émises par toute personne auprès de l'ARCOM en application de l'article 24 du règlement, à la demande d'autorités compétentes d'autres Etats membres dans le cadre de la coopération transfrontière (article 23 du règlement) ou encore spontanément sur la base de ses propres constatations (article 22 du règlement). Si une réclamation concerne une autre autorité compétente, l'ARCOM devra lui transmettre.
Les nouveaux pouvoirs confiés à aux autorités compétentes pourraient impliquer une augmentation de leur charge administrative. Ces autorités devront avoir la capacité de suivre la correcte exécution des obligations prévues par le règlement 2024/900, applicable à une très grande diversité d'acteurs (cf. 3.1 supra), et devront être dotées de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur incombent en vertu du règlement, y compris les ressources techniques, financières et humaines suffisantes.
Il est toutefois difficile de chiffrer d'ores et déjà l'ensemble des coûts engendrés par ces nouvelles missions, en l'absence de données précises sur les ressources humaines et les dépenses opérationnelles qu'elles pourraient impliquer. L'ampleur de ces ressources dépendra des volumes de publicités à caractère politique en cause sur les différents supports, et du taux d'infractions à la réglementation. Une telle supervision ne devrait mobiliser en 2026 que quelques « équivalents temps plein » sur l'année, possiblement mutualisés dans le cadre d'autres missions connexes. Au fil des mois, l'ARCOM sera en mesure de mieux appréhender les moyens propres devant être déployés sur cette activité.
L'impact du présent article sur les services de la CNIL devait être limité dans la mesure où celle-ci effectue déjà des contrôles en matière de ciblage publicitaire, sujet qu'elle maîtrise par ailleurs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Cet article vise à adapter le droit national au règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, qui a pour objectif de garantir que la diffusion de publicité à caractère politique respecte pleinement les droits fondamentaux. Il permet en particulier de renforcer la traçabilité et la transparence des publicités politiques afin notamment de limiter les tentatives de manipulation de l'information, ou d'influences étrangères, susceptibles de troubler le bon déroulé des élections. Ce texte a été élaboré en raison de préoccupations quant à la manipulation de l'opinion et aux ingérences étrangères dans le cadre d'élections, notamment à la suite de l'affaire Cambridge Analytica révélée en 2018 et dans la perspective des élections européennes de juin 2024.
Il s'agira donc de contribuer à garantir une mise en oeuvre pleine, cohérente et effective du règlement par les autorités nationales compétentes. Elle présente, à ce titre, un intérêt démocratique substantiel.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Non spécifique. Voir 4.6 « Impact sur les particuliers ».
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le règlement vise à assurer une information plus transparente des citoyens de l'Union européenne sur la publicité à caractère politique et sur les techniques de ciblage et de diffusion de cette publicité. L'objectif est de s'assurer que leurs droits fondamentaux sont respectés et qu'ils soient en mesure de faire des choix éclairés, notamment dans le cadre des élections, en leur permettant :
- de reconnaître plus facilement les publicités à caractère politique auxquelles ils sont exposés ;
- d'identifier les personnes qui sont à l'origine de ces publicités et les élections qu'elles concernent ;
- de savoir s'ils ont fait l'objet d'un ciblage particulier lorsqu'ils sont exposés à une telle publicité.
L'étude d'impact de la Commission européenne sur le règlement 2024/900 indique qu'aucun impact environnemental n'est prévu.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a été consultée en application de l'article 9 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et a rendu un avis n° 2025-4 le 1er octobre 2025.
La Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) a été consultée en application de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information aux fichiers et aux libertés, et a rendu sa délibération n° 2025-084 portant avis le 25 septembre 2025.
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a été saisie à titre facultatif et n'a pas rendu d'avis.
A noter enfin qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la consultation des collectivités ultramarines n'est pas requise
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, et au plus tôt le 10 octobre 2025, date d'entrée en application du règlement 2024/900.
5.2.2. Application dans l'espace
Le dispositif s'applique de plein droit en France métropolitaine et dans collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), régies par le principe de l'identité législative ainsi que dans celles qui, relevant de l'article 74 de la Constitution, sont régies, en la matière, par le principe d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Le droit de l'Union européenne n'est pas applicable dans les pays et territoires d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises). Or, le présent article mentionne et renvoie aux dispositions du règlement 2024/900, dont il prévoit l'adaptation. Dès lors, pour que ces dispositions soient applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, il est nécessaire d'insérer une grille de lecture où les références au règlement 2024/900 sont remplacées par celles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.
L'article 108 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est donc modifié par le présent article pour prévoir l'application des modifications opérées à ladite loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent article modifie l'article 57 de la LCEN pour que les modifications apportées à cette loi soient rendues applicables dans les collectivités du Pacifique et qu'une nouvelle grille de lecture précisant que, pour l'application de la LCEN à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement 2024/900 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement, soit insérée.
Le présent article modifie également les articles 125 et 126 de la LIL afin que les modifications apportées à cette loi soient rendues applicables dans les collectivités du Pacifique et dans les Terres australes et antarctiques françaises et que, pour l'application de la LIL à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au règlement 2024/900 soient remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole, en vertu de ce même règlement.
Le présent article modifie les articles L. 388, L. 395 et L. 439 du code électoral et crée les articles L. 477-1 A et L. 531-1 pour prévoir l'application des modifications apportées par la présente loi au code électoral et les dispositions nécessaires à l'application du règlement 2024/900 dans les pays et territoires d'outre-mer.
Enfin, le présent article modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. L'article 14-2 est modifié pour tirer les conséquences de l'abrogation de L. 163-1 du code électoral et l'article 26 est modifié pour mettre à jour la disposition d'application à l'outre-mer.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat est prévu pour préciser les modalités d'application de l'article 20-9 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, créé par le présent article du projet de loi.
TITRE V - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
Article 36 -Transposition du règlement 2024/1747 portant sur l'organisation du marché de l'électricité
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En 2024, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté une réforme du marché européen de l'électricité comprenant la révision du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (dit « règlement EMD »), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (dite « directive EMD »), du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie et du règlement (UE) 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (dit règlement « REMIT »). S'agissant du règlement EMD, il avait donné lieu à des mesures d'adaptation par ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Les mesures d'adaptation portaient notamment sur les missions de la Commission de régulation de l'énergie et sur les mesures relatives à la sécurité d'approvisionnement.
Le marché intérieur de l'électricité a pour finalité, en organisant des marchés de l'électricité concurrentiels transfrontaliers, d'offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finals de l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques, d'assurer la compétitivité des prix, d'envoyer de bons signaux d'investissement et d'offrir des niveaux de service plus élevés et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la transition énergétique.
La crise des prix de l'énergie survenue en 2022-2023 a démontré les limites du cadre du marché européen de l'électricité. Cette réforme vise à faire émerger des signaux de long terme permettant à l'ensemble des acteurs de se couvrir très en amont de la livraison ; à renforcer la protection des consommateurs et à développer la flexibilité des systèmes électriques européens selon les besoins évalués par chaque État membre. Les sources de flexibilité désignent ici toute action d'un producteur, consommateur ou stockeur, visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites.
Après avoir constaté l'absence de notification de la France, la Commission a conclu, en mars 2025, que les dispositions de la directive (UE) 2024/1711 n'étaient pas encore transposées. Une procédure d'infraction a été lancée par la Commission et notifiée aux autorités françaises le 26 mars 2025. Il en est de même pour 20 autres Etats membres.
Les dispositions intégrées dans cet article du présent projet de loi ont pour but de transposer les dispositions du règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité dans l'Union dit « règlement EMD ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La transposition des dispositions intégrées dans le projet de loi relève du domaine de la loi en ce qu'elles apportent des modifications à des normes de niveau législatif codifiées dans la partie législative du code de l'énergie et du code de la consommation.
Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu'ils visent à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce qu'elles ne font que préciser des dispositions du code de l'énergie existantes ou compléter des dispositifs déjà existants.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union impose un ensemble de définitions et de dispositions qui doivent être explicitement transposées par les Etats membres.
Le règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union s'applique aux Etats membres. Le code de l'énergie doit ainsi être révisé pour assurer sa conformité avec ce règlement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il ressort des engagements internationaux de la France, et notamment de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que le règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
L'entrée en vigueur de ce règlement le 16 juillet 2024 introduit des changements qui rendent nécessaires des modifications de nature législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est d'adapter les dispositions législatives afin de mettre le droit français en conformité avec le règlement « EMD ».
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Au regard du droit européen et de la nature des modifications apportées par le règlement « EMD », qui impactent notamment les dispositions en matière de flexibilité, de missions de la CRE ou de contrats pour différence il a été jugé qu'il n'existait aucune autre option possible que de mettre en conformité le code de l'énergie par un véhicule législatif, accompagné lorsque cela est pertinent d'une déclinaison au niveau réglementaire.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de modifier certaines dispositions du code de l'énergie ainsi que d'y introduire de nouvelles dispositions Ces dispositions recouvrent notamment les points suivants :
· Mise à jour du cadre juridique de la valorisation de la flexibilité de la consommation d'électricité des consommateurs finals (modifications des articles L. 271-1 à 3 ainsi qu'articles L. 321-15-1 du code de l'énergie) ;
· Création d'un nouveau rapport du gestionnaire du réseau public de transport sur l'évaluation des besoins de flexibilités du système électrique français, incluant un rapport de la Commission de régulation de l'énergie sur les barrières au développement des flexibilités (création article L. 321-6-5) ;
· Création d'une définition des sources de flexibilité du système électrique (article L. 354-1) ;
· Création d'un cadre pour fixer un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilités non-fossiles (article L. 354-2) ;
· Renforcement des missions de la Commission de régulation de l'énergie afin d'assurer le bon fonctionnement du marché de l'électricité de gros et de détails (modifications aux articles L. 131-2 et L. 336-1 et création articles L. 131-6). Le dispositif retenu répond également aux besoins d'évolution de ces missions nécessaires à la bonne exécution de la nouvelle régulation économique du parc électronucléaire historique ;
· Mise en place des dispositions en matière de contrats pour différence pour les centrales électronucléaires (article L. 313-3).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article vient modifier les articles suivants du code de l'énergie : Articles L.121-8-1, L. 131-2, L.134-1, L.134-3, L. 134-25, L.134-1, L.271-1, L.271-2, L.271-3, L.321-6, L. 321-6-1, L.321-12, L.321-15-1, L.322-8, L. 322-11, L. 336-1, L. 341-3, L.316-6.
Le présent article modifie en outre le titre VII du livre II du code de l'énergie intitulé « L'effacement de consommation d'électricité ».
Ce même article vient créer de nouveaux articles dans le code de l'énergie : Articles L. 131-6, L. 313-3, L. 321-6-5.
Le présent article créé également un chapitre IV à la fin du titre V du livre III intitulé « Les flexibilités du système électrique » avec trois articles : L.354-1, L.354-2 et L.354-3. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie est ainsi renommée : « Versement décarboné universel ».
Le présent article abroge les articles L.271-4, L.352-1-1 et L.121-8-2.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées doivent permettre de mettre en conformité le code de l'énergie avec le règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Cet article n'emporte pas d'effets macroéconomiques direct. Cependant :
- il permettra d'améliorer le fonctionnement des marchés de gros de l'électricité ;
- les dispositions relatives au développement des flexibilités non fossiles concourent, en combinaison à l'électrification des usages à la limiter la consommation de pétrole et de gaz en France et à la réduction du déficit commercial correspondant. Réseau de transport d'électricité (RTE) chiffrait dans son bilan prévisionnel 2023 ces économies à environ 190 milliards d'euros de dépenses consacrées aux énergies fossiles en moins d'ici 2035, alors que les coûts de déploiement associés aux flexibilités pourraient rester dans le même temps limité.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les dispositions ouvrant la possibilité de faire un contrat pour différence (CfD)159(*) sur une installation nucléaire permettra d'apporter, à la demande des exploitants, un soutien pour les nouveaux investissements dans le parc nucléaire en France.
S'agissant des dispositions relatives au développement de la flexibilité décarbonée : ce développement devrait permettre aux entreprises disposant de leviers de flexibilité sur leur consommation, de mieux maîtriser leurs coûts énergétiques en s'adaptant plus efficacement aux signaux de marché. Certaines entreprises industrielles utilisent déjà des moyens de flexibilités tels que l'effacement de consommation rémunéré sur les marchés ou le stockage par exemple. Le développement de la flexibilité permettra d'encourager l'innovation des entreprises en proposant des systèmes intelligents ou automatisés aux consommateurs d'électricité, tels que les bâtiments.
4.2.3. Impacts budgétaires
Cet article a un impact budgétaire.
Lorsque les investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale le justifient, le ministre chargé de l'énergie peut conclure, avec les exploitants des installations nucléaires de base produisant de l'électricité qui en font demande, un contrat d'achat offrant un complément de rémunération pour l'électricité produite par ces installations.
Lorsque le développement des sources de flexibilités est insuffisant pour atteindre les objectifs pris en application de l'article L.354-2 : il prévoit la faculté pour le ministre chargé de l'énergie de procéder à une procédure de mise à concurrence pour concourir au développement des sources de flexibilités. Les charges engendrées sont inclues dans les charges de service public de l'énergie.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le développement de la flexibilité décarbonée devrait permettre aux collectivités territoriales qui souscrivent à des services de flexibilités, en tant que consommatrices d'électricité, de mieux maîtriser leurs coûts énergétiques grâce à une gestion plus efficace de leur consommation selon les signaux de marché se traduisant par une opportunité de réduction de leur facture énergétique.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Cet article octroie de nouvelles missions et pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie en lien avec ses missions et pouvoirs existants et de manière neutre budgétairement :
- Rédaction par la Commission de régulation de l'énergie d'un rapport tous les deux ans sur l'évaluation des obstacles à la flexibilité sur le marché de l'électricité et approbation du rapport de RTE sur les besoins en flexibilités du système électrique (article L. 321-6-5) ;
- Possibilité pour la Commission de régulation de l'énergie d'organiser un appel d'offre pour désigner un facilitateur de marché en cas de liquidité insuffisante du marché de gros de l'électricité français. Si l'appel d'offre est infructueux, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité en France de remplir le rôle de facilitateur de liquidité (article L. 131-6) ;
- Fixation de la fréquence de publication par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques de ses estimations de production annuelles de son parc électronucléaire (article L. 336-1).
Cet article précise des missions et pouvoirs déjà conférés à la Commission de régulation de l'énergie en application du règlement (UE) 2024/1747 liées à son obligation de garantir le respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité pour les gestionnaires de réseaux et les opérateurs désignés du marché de l'électricité au sens dudit règlement.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cet article permettra de protéger l'ensemble des consommateurs d'électricité en imposant aux fournisseurs d'électricité de répercuter les recettes éventuellement générées par les mécanisme de soutien aux capacités de production d'électricité renouvelable et nucléaire et d'expliciter ces montants sur les factures, Le mécanisme de redistribution via le versement décarboné universel profitera à l'ensemble des consommateurs d'électricité et leur permettra de bénéficier d'une part de la compétitivité du parc électrique décarboné.
Par ailleurs, les dispositions demandant à la Commission de régulation de l'énergie de s'assurer qu'EDF propose des offres fixées dans des conditions semblables à celles accessibles aux fournisseurs alternatifs améliorera le fonctionnement du marché de détail.
La faculté pour la Commission de régulation de l'énergie de prendre des mesures visant à développer le marché de moyen terme permettra le cas échéant à l'ensemble des consommateurs de se couvrir plus en amont de la livraison, ce qui améliorera la prévisibilité et la stabilité de leurs factures.
Enfin, le développement de la flexibilité décarbonée devrait permettre aux particuliers qui souscrivent à des services de flexibilités, en tant que consommatrices d'électricité, de mieux maîtriser leurs coûts énergétiques grâce à une gestion plus efficace de leur consommation selon les signaux de marché se traduisant par une opportunité de réduction de leur facture énergétique.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cet article emporte des impacts environnementaux positifs, en faveur de la transition énergétique de la France.
En permettant d'apporter un soutien public aux exploitants nucléaires en cas de besoin pour lancer leurs investissements en France, le présent article permettra d'atteindre les objectifs énergétiques de la France et d'avoir accès à une électricité pilotable et décarbonée.
En permettant aux consommateurs de bénéficier de la compétitivité des parcs nucléaire et renouvelable et en instaurant un mécanisme de protection contre les crises des prix de l'énergie, les dispositions envisagées conduiront à faciliter l'électrification des usages, nécessaire à la transition énergétique.
Le développement des flexibilités non fossiles (flexibilité de la consommation d'électricité, stockage, etc.) a un effet globalement positif sur l'environnement. En adaptant la demande à la production d'électricité, les flexibilités réduisent le recours aux moyens de production thermiques fossiles lors des pics de consommation. Elles contribuent ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique et contribuent ainsi à l'atténuation au changement climatique. Le stockage et les moyens de pilotage permettent également de contribuer au lissage de l'intermittence des énergies renouvelables sans recourir à des solutions carbonées.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire le 2 octobre 2025 et a émis un avis favorable.
Aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les présents articles s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Néanmoins, les articles L. 121-8-1, L. 121-8-2 et L. 271-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi, restent applicables, jusqu'à leurs termes, aux contrats issus des appels d'offres effacement pluriannuels (AOE) et flexibilités décarbonées (AOFD) dont la date limite de réponse est antérieure à la présente loi.
5.2.2. Application dans l'espace
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions des présents articles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Elles s'appliquent également à Saint-Martin qui est assujetti au droit communautaire.
5.2.3. Textes d'application
Trois décrets en Conseil d'Etat, deux décrets simples et un arrêté devront être pris pour mettre en cohérence la partie réglementaire du code de l'énergie avec ces modifications législatives.
Article 37 -Transposition de la directive 2024/1711portant sur l'organisation du marché de l'électricité
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En 2024, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté une réforme du marché européen de l'électricité comprenant la révision du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (dit « règlement EMD »), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (dite « directive EMD ») et du règlement (UE) 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (dit règlement « REMIT »).
S'agissant de la directive EMD, elle avait donné lieu à des mesures de transposition par ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Ces mesures de transposition ont été complétées par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Les mesures de transposition portaient notamment sur les missions de la Commission de régulation de l'énergie, sur l'information et la protection des consommateurs, sur la mise en place d'offres à tarification dynamique, sur le développement de l'agrégation et sur la possibilité d'appels d'offres groupés pour le changement de fournisseur. La réforme de la directive EMD introduite en 2024 vise notamment à renforcer les signaux de prix de long terme et la protection des consommateurs (cf. infra).
Le marché intérieur de l'électricité a pour finalité, en organisant des marchés de l'électricité concurrentiels transfrontaliers, d'offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finals de l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques, d'assurer la compétitivité des prix, d'envoyer de bons signaux d'investissement et d'offrir des niveaux de service plus élevés et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la transition énergétique.
La crise des prix de l'énergie survenue à l'hiver 2022-2023 a démontré les limites du cadre du marché européen de l'électricité. Cette réforme vise à faire émerger des signaux de prix de long terme permettant à l'ensemble des acteurs de se couvrir très en amont de la livraison (c'est-à-dire la possibilité pour les acteurs d'acheter des volumes d'électricité pour une livraison dans plusieurs années), à renforcer l'information et la protection des consommateurs et à développer la flexibilité des systèmes électriques européens selon les besoins évalués par chaque Etat membre.
Après avoir constaté l'absence de notification de la France, la Commission a conclu, en mars 2025, que les dispositions de la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité dans l'Union n'étaient pas encore transposées. Une procédure d'infraction a été lancée par la Commission et notifiée aux autorités françaises le 26 mars 2025.
Les dispositions intégrées dans le présent article du présent projet de loi ont pour objectif de transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1711.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La transposition des dispositions intégrées dans le projet de loi relève du domaine de la loi en ce qu'elles apportent des modifications à des normes de niveau législatif codifiées dans la partie législative du code de l'énergie et du code de la consommation.
Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu'ils visent à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce qu'elles ne font que préciser des dispositions du code de l'énergie existantes ou compléter des dispositifs déjà existants.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union impose un ensemble de définitions et de dispositions qui doivent être explicitement transposées par les Etats membres.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 3 de la directive (UE) 2024/1711 dispose que : « Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, points 2 et 5, au plus tard le 17 juillet 2026. »
En outre, il ressort des engagements internationaux de la France, et notamment de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une obligation de transposition de la directive (UE) 2024/1711 au risque d'un recours en manquement de la part de la Commission.
La transposition de ces dispositions introduit des changements qui rendent nécessaires des modifications de nature législative.
Par ailleurs, il convient de noter que ces nouvelles dispositions conduisent à réinterroger la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2019/944, à des fins de coordination et de cohérence avec les lignes directrices mises en place récemment par la Commission de régulation de l'énergie. En particulier, la directive (UE) 2024/1711 vient renforcer les obligations des fournisseurs en matière de propositions d'offres à prix fixe et à durée déterminée et en matière de définition et de surveillance du niveau des frais de résiliation anticipée. Dans ce contexte, le champ des interdictions d'application des frais de résiliation anticipée à certains consommateurs est revu. De même, certaines mesures de protection des consommateurs sont étendues aux petites entreprises, indépendamment de la puissance souscrite.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est d'adapter les dispositions du code de l'énergie et du code de la consommation afin de mettre le droit français en conformité avec la directive (UE) 2024/1711 afin de renforcer l'information et la protection des consommateurs et leur accès à des signaux de prix de long terme.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Au regard du droit européen, il n'existe aucune autre option possible que la transposition par un véhicule législatif, accompagné lorsque cela est pertinent d'une déclinaison au niveau réglementaire.
Le champ des interdictions d'application des frais de résiliation anticipée aurait pu être conservé inchangé. De même, certaines mesures de protection des consommateurs pourront demeurer applicables uniquement en-dessous d'un certain niveau de puissance souscrite.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de modifier certaines dispositions du code de l'énergie et du code de la consommation ainsi que d'introduire de nouvelles dispositions dans ces mêmes codes.
Outre des ajustements purement rédactionnels et de clarifications mineures, ces dispositions recouvrent notamment les points suivants :
· Renforcement des informations précontractuelles : évaluation du montant de la facture annuelle avant la conclusion du contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, renforcement de l'information sur les évolutions potentielles en cours de contrat ;
· Renforcement des exigences relatives aux pratiques durant l'exécution d'un contrat d'électricité ou de gaz naturel : limitation des possibilités pour le fournisseur de modifier les stipulations contractuelles en cours de contrat, renforcement de l'information du consommateur en cas de modification de contrat, obligation de réévaluation de l'échéancier en cours d'année si la situation le justifie, renforcement de la protection contre les interruptions ;
· Renforcement des exigences en matière de résiliation : information renforcée sur le montant des frais de résiliation, renforcement des exigences en matière de détermination et de contrôle des frais de résiliation ;
· Compléments en matière d'offres à prix fixe : obligation de proposer au moins une offre à prix fixe d'une durée minimale d'un an sans frais de résiliation anticipée pour tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites. Lorsqu'un fournisseur d'électricité propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur domestique (uniquement dans le cadre d'une offre destinée tout ou partie à la recharge de véhicule électrique) ou à un consommateur non domestique (qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaire, les recettes ou le bilan annuel n'excède pas 10 M€), il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. Un rapport de la CRE devra publier, au plus tard le 31 décembre 2029, un rapport portant sur les effets observés et le développement des offres à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée ;
· Extension, sous réserve d'adaptations, des mesures de protection de consommateurs aujourd'hui applicables aux consommateurs non domestiques de puissance souscrite inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) aux consommateurs non domestiques de puissance souscrite inférieure à 250 kVA, sans remettre en cause l'éligibilité des consommateurs non domestiques de plus grande taille en-dessous du seuil de 36 kVA ;
· Mise en place d'obligations prudentielles pour les fournisseurs d'électricité
· Mise en place de la possibilité d'interventions publiques dans la fixation des prix de l'électricité en cas de crise
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les articles suivants du code de la consommation sont modifiés par le présent article : Articles L. 224-1, L. 224-3, L. 224-4, L. 224-10, L.224-15, L. 511-7.
Ce même article vient créer de nouveaux articles dans le code de la consommation : Articles L. 224-10-1, L. 224-12-1.
Les articles suivants du code de l'énergie sont modifiés par le présent article : Articles L. 121-8, L. 122-3, L. 131-2, L. 332-2, L. 332-2-1, L. 332-5-1, L. 332-6, L. 333-1, L. 333-3, L. 334-4.
Ce même article vient créer de nouveaux articles dans le code de l'énergie : Articles L. 332-1-1, L. 332-1-2, L. 332-8, L. 332-9, L. 337-9-1 à L. 337-9-6.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées doivent permettre de mettre en conformité les dispositions législatives du code de l'énergie et du code de la consommation avec la directive (UE) 2024/1711.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Cf. impacts sur les entreprises (4.2.2).
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les dispositions introduites concourent à renforcer l'information et la protection des petits consommateurs professionnels (petites entreprises et structures assimilées) à tous les stades de leur contrat de fourniture.
Les dispositions concernant les bornes de recharge de véhicules électriques permettront de tenir compte du fait que certaines entreprises opérant des bornes de recharges s'approvisionnent également en électricité issue de leur production en autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.
Ces entreprises bénéficieront également du renforcement des exigences prudentielles.
Les fournisseurs devront néanmoins s'adapter à ces nouvelles exigences, qui sont néanmoins proportionnées à l'objectif poursuivi et adéquates au regard du retour d'expérience des dernières années.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les dispositions introduites prévoient la capacité pour l'État d'intervenir sur les prix de fourniture d'électricité en cas de crise. Les fournisseurs seront compensés de cette intervention. L'impact sur le budget correspondrait à cette compensation éventuelle. Le coût hypothétique d'un tel dispositif dépendrait de l'ampleur de la crise éventuelle sur les marchés de l'électricité et du choix retenu par l'Etat face à cette crise, il n'est pas chiffrable.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les dispositions introduites concourent à renforcer l'information et la protection des collectivités territoriales à tous les stades de leur contrat de fourniture. Elles bénéficieront également du renforcement des exigences prudentielles.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Cet article octroie de nouvelles missions et pouvoirs de à la Commission de régulation de l'énergie en lien avec ses missions et pouvoirs existants et de manière neutre budgétairement : obligations prudentielles, informations des consommateurs, coopération entre autorités de régulation, surveillance de la mise en oeuvre de frais de résiliation ou de la mise en oeuvre des éventuelles interventions publiques sur la fixation des prix de l'électricité prises en cas de crise.
La Commission de régulation de l'énergie s'y est d'ailleurs déjà préparée dès 2024.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les dispositions introduites concourent à renforcer l'information et la protection des consommateurs résidentiels à tous les stades de leur contrat de fourniture. Elles introduisent également le droit pour un consommateur à bénéficier d'un contrat de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée. Les dispositions renforcent la protection des consommateurs contre les interruptions de fourniture. Ces dispositions renforcent également la protection des consommateurs en cas de crise, en cas de mise en oeuvre des dispositions en matière d'intervention sur les prix de fourniture.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable le 2 octobre 2025.
Aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française sauf les dispositions du I et le 1° à 5° qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions s'appliquent de plein droit en métropole et à l'ensemble des territoires visés par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. La mesure ne s'applique pas dans les autres territoires visés par l'article 74 de la Constitution ni en Nouvelle-Calédonie.
5.2.3. Textes d'application
En cas de crise, un décret en Conseil d'Etat sera à pris en application de l'article L. 337-9-1 du code de l'énergie.
Il est prévu de prendre un décret en Conseil d'Etat au titre de l'article L. 332-9 du code de l'énergie.
Il est prévu de prendre un décret simple au titre de l'article L. 224-15 du code de la consommation.
Il est prévu que quatre arrêtés soient pris au titre des articles L. 224-3, L. 224-4, L .224-10 et L. 224-12-1 du code de la consommation.
Article 38 - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1789 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène et transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La refonte du paquet gaz ( règlement 2024/1789 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène modifiant les règlements (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) 715/2009 et directive 2024/1788) du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE), publiée le 15 juillet 2024 complète les dispositions législatives du paquet « Ajustement à l'objectif 55 ». Ces nouveaux textes européens, établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz naturel, du gaz renouvelable et de l'hydrogène, qualifiés de 4ème « paquet gaz » et réformant la législation actuelle de l'Union européenne sur le gaz naturel datant de 2009, visent, d'une part, à apporter quelques modifications au cadre du marché intérieur du gaz naturel et, d'autre part, à créer les fondements d'un cadre pour le marché intérieur de l'hydrogène. En terme de développement, ces « nouveaux » gaz, qui restent les mêmes molécules mais produites différemment, sont amenés à se développer dans les prochaines années. En 2024, il y avait déjà 11,6 TWh de biométhane injectés dans le réseau de gaz naturel et concernant l'hydrogène, les premiers projets de grande capacité en France devraient être mis en service dans le courant de 2026.
Ces modifications portent notamment sur la protection des consommateurs de gaz méthane et sur l'éventuelle réduction des réseaux gaziers.
Le 4ème « paquet gaz » met surtout en place un cadre commun pour favoriser le développement d'un marché intérieur de l'hydrogène, et notamment pour les terminaux et les infrastructures de transport et de stockage d'hydrogène.
Le paquet législatif fixe les modalités de certification des gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène, en particulier les règles d'indépendance auxquelles ils sont assujettis. Trois modèles de séparation verticale d'activité permettent aux gestionnaires de justifier leur séparation entre les maillons production et fourniture de la chaîne de valeur.
Le cadre établi pour l'hydrogène est ainsi inspiré de celui en place pour le gaz naturel. Un accès des tiers aux infrastructures d'hydrogène est consacré sauf dérogation ; des plans de développement de réseau décennaux, devant être construits en lien avec les secteurs gaz et électricités ainsi que des règles de tarification reflétant les coûts des opérateurs sont mis en place. Un régulateur indépendant, proposé pour être la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans cette transposition du fait des similarités avec le gaz et de par la nature énergétique de l'hydrogène, est désigné pour être garant du respect des différents principes mis en place.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La transposition des dispositions intégrées dans le projet de loi relève du domaine de la loi en ce qu'elles apportent des modifications à des normes de niveau législatif codifiées dans la partie législative du code de l'énergie ou en créent de nouvelles.
La Charte de l'environnement dispose à son article 6 que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». La refonte du paquet gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène s'inscrit dans ce principe.
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre des obligations civiles et commerciales.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En décembre 2021, la Commission européenne a proposé un réexamen de l'organisation du marché du gaz de l'Union européenne (UE) dans le cadre du paquet « Ajustement à l'objectif 55 », qui vise à remplacer progressivement le gaz fossile dans l'UE par des gaz renouvelables et bas carbone, y compris l'hydrogène160(*).
La directive (UE) 2024/1788 du 4ème « paquet gaz » est une refonte de la directive 2009/73/CE (3ème « paquet gaz ») sur le marché intérieur du gaz naturel et crée le cadre régulatoire pour le marché de l'hydrogène.
La directive (UE) 2024/1788 impose un ensemble de dispositions et principes généraux du cadre de régulation qui doivent être explicitement transposées par les Etats membres.
Le règlement (UE) 2024/1789, qui complète le 4ème « paquet gaz », abroge le règlement (CE) 715/2009 relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, qui composait également le 3ème « paquet gaz ». Les nouvelles règles de ce règlement doivent contribuer à opérer la transition vers des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, en particulier l'hydrogène, dans le système énergétique, en vue d'atteindre les objectifs de décarbonation de l'Union européenne.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La transposition de la directive 2024/1788 est à effectuer avant le 5 août 2026 et est toujours en cours dans la grande majorité des Etats membres.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 94 de la directive 2024/1788 dispose :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 6, aux articles 8 à 31, à l'article 33, aux articles 35 à 38, à l'article 39, paragraphe 1, point a), à l'article 39, paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9, à l'article 40, paragraphe 1, aux articles 41, 42 et 43, à l'article 44, paragraphes 1, 2, 7 et 8, à l'article 45, à l'article 46, paragraphes 2 et 3, aux articles 50 à 59, à l'article 62, à l'article 64, paragraphe 11, aux articles 68 à 75, à l'article 76, paragraphe 5, aux articles 77, 78 et 79, à l'article 81, paragraphes 1 et 6, aux articles 82 et 83 et aux annexes I et II au plus tard le 5 août 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
Ces dispositions visent à créer un cadre de régulation pour le marché de l'hydrogène contenant notamment les notions de certification, de dégroupage, d'accès des tiers et de tarification, notions déjà existantes pour le marché du gaz naturel depuis la transposition des trois précédentes directives gaz et codifiées dans la partie législative du code de l'énergie. Les dispositions proposées sont donc de nature législative.
Pour introduire les nouvelles obligations prévues par ce règlement auprès des opérateurs sur le marché du gaz naturel ou celui de l'hydrogène (voir ci-après), il est nécessaire de modifier la partie législative du code de l'énergie qui contient des dispositions dans ce domaine.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les dispositions proposées par l'article 38 visent à assurer la cohérence du cadre législatif national avec le régime européen instauré par le règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène.
Elles visent également à transposer la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène.
Tant le règlement que la directive font partie du paquet européen « fit for 55 » qui a pour ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030. Le texte ne fixe pas à proprement parler d'objectifs de décarbonation pour la France ou les autres Etats membres, cependant il pose des principes de primauté de l'efficacité énergétique, prévoit des dispositions spéciales pour les gaz renouvelables et bas carbone et instaure les règles régissant le marché intérieur de l'hydrogène, notamment son transport. Tous ces éléments contribueront directement à l'atteinte par la France de ses objectifs de décarbonation tels que prévus dans le projet de PPE en application du principe de neutralité carbone en 2050 et seront d'autant plus efficaces que complémentaires avec d'autres mécanismes déjà en place comme le marché des quotas carbone (SEQE) qui incite les entreprises les plus émettrices à se décarboner.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
S'agissant d'un cadre normatif entièrement nouveau pour le marché de l'hydrogène, aucune autre option n'a été envisagée ; seules une transposition et une adaptation en cohérence du cadre existant par un véhicule législatif ont été considérées. Pour ce qui concerne la mise en cohérence du cadre français aves le règlement (UE) 2024/1788, seules les dispositions estimées nécessaires ont été incluses dans le projet de texte.
L'intégration des modifications introduites par le 4ème paquet gaz implique par ailleurs de modifier certaines dispositions législatives.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Certains points étant laissés à la subsidiarité des Etats membres, les principaux choix retenus par le Gouvernement pour cette transposition portent sur :
- Le paquet gaz définit deux niveaux de réseaux d'hydrogène, transport et distribution. En accord avec la stratégie nationale hydrogène révisée en avril 2025, il n'est pas prévu de transposer la notion de réseaux de distribution d'hydrogène (article 43 de la directive), l'hydrogène ayant vocation à alimenter un nombre réduit de consommateurs de nature industrielle. Le texte européen prévoit en effet que les réseaux de distribution ne peuvent pas être connectés à des stockages, des terminaux d'importation ou interconnectés avec d'autres Etats membres, leur vocation principale est d'alimenter les utilisateurs en hydrogène. Un réseau de transport d'hydrogène, toujours selon le texte européen peut être connecté à tout autre élément de réseau et peut également alimenter des utilisateurs en hydrogène. Le réseau de distribution d'hydrogène est donc un cas particulier du réseau de transport d'hydrogène. Historiquement, deux niveaux de réseaux existent en gaz naturel sans que cela n'obéisse à une logique précise ni que cela ne soit harmonisé au niveau européen. Les réseaux d'hydrogène envisagés étant nouveaux, il n'est pas opportun de reprendre cette séparation historique des niveaux différenciés de réseaux. Cela signifie que l'ensemble des réseaux d'hydrogène mis en place seraient du type réseau de transport d'hydrogène, éventuellement sous dérogation pour les réseaux existants ou les réseaux géographiquement limités. Cette approche a été retenue pour i) installer un cadre plus simple et lisible pour les acteurs des infrastructures d'hydrogène et ii) les utilisateurs d'hydrogène seront uniquement des installations industrielles, des producteurs ou des stations de distribution et non des utilisateurs individuels ou des ménages ; il n'y a donc pas de sens à la mise en place, à proprement dit, d'un réseau de distribution d'hydrogène ;
- Le texte de la directive introduit, à son article 3, la notion de fourniture d'hydrogène, de la même manière que cela est défini en gaz naturel et en électricité. En gaz naturel, pour pouvoir être un fournisseur, il convient de recevoir de l'autorité administrative une autorisation de fourniture qui permet notamment d'avoir connaissance des fournisseurs et de s'assurer de la capacité de ces derniers à assurer leurs missions, notamment vis-à-vis des utilisateurs en précarité énergétique. Concernant l'hydrogène, le marché n'est pas appelé à être structuré de la même manière et notamment les utilisateurs en précarité énergétique ne seront pas visés ou atteints par le réseau d'hydrogène. Dans ces conditions, il n'est pas jugé nécessaire de mettre en place d'autorisation de fourniture d'hydrogène, étant précisé par ailleurs que la directive n'oblige pas les Etats membres à prévoir de telles autorisations. En effet, la nature industrielle des consommateurs potentiels justifie une contractualisation directe avec le producteur ou avec un intermédiaire qui aurait la confiance de l'industriel pour la fourniture. Enfin, toujours dans un souci de simplification, la procédure d'autorisation de fourniture d'hydrogène n'étant pas une nécessité pour les raisons précédemment citées, il est proposé dans cette transposition de ne pas la mettre en place ;
- Le dégroupage des activités : le texte de la directive impose à l'article 60 pour les gestionnaires de réseaux d'hydrogène de séparer leurs activités pour éviter notamment les risques de financement cachés ou de discrimination. Cette séparation d'activité, aussi appelée dégroupage, concerne le volet vertical, au sein d'une entreprise intégrée qui voudrait être active par exemple sur transport et fourniture ou production, et horizontale entre différents secteurs d'activité, notamment hydrogène et gaz naturel par exemple.
- Concernant le dégroupage vertical, trois modèles différents sont prévus par la directive, à son article 68, (OU pour ownership unbundling : séparation totale des activités de production et de transport ; ITO pour independent transmission operator : filialisation des activités de production et de transport possible sous réserve de "muraille de Chine" ; ISO pour independent system operator : producteur propriétaire du réseau de transport mais qui en confie totalement la gestion à un tiers). A date, en gaz naturel et en électricité en France, seules sont utilisées les notions de OU et de ITO. Le modèle ISO, bien que disponible dans les textes européens également sur les vecteurs gaz et électricité, n'est pas appliqué en droit français. Initialement et par simplicité, il était envisagé de ne pas mettre en place la possibilité de certification d'un opérateur ISO sur l'hydrogène. Cette approche aurait néanmoins pu bloquer l'entrée de certains acteurs non présents aujourd'hui sur le gaz naturel ou l'électricité. Le marché de l'hydrogène étant naissant, il a finalement été retenu de mettre en place l'ensemble des trois modèles de dégroupage vertical. Des dérogations, pour les réseaux existants et pour les réseaux géographiquement limités permettent à certains réseaux et leurs gestionnaires de déroger à ces obligations de dégroupage vertical sur validation de la Commission de régulation de l'énergie. La dérogation pour les réseaux existants permet également, si cela ne nuit pas au développement du marché hydrogène, de déroger aux obligations d'accès des tiers au réseau.
- Concernant le dégroupage horizontal, il est demandé par la directive à l'article 75 de mettre en place une séparation comptable et juridique entre les activités de transport d'hydrogène et de gaz ou d'électricité. L'article 49 transpose cette obligation en maintenant la possibilité de dérogation concernant la séparation juridique. En effet, pendant la montée en puissance du marché hydrogène, des synergies pourraient être trouvées en mutualisant les moyens humains au sein d'une structure qui serait active en gaz et en hydrogène par exemple. La séparation comptable est, elle, considérée comme nécessaire pour maîtriser les possibles subventions croisées (voir paragraphes suivants), sa mise en place est donc bien prévue dans le texte de l'article 49.
- La directive mentionne à l'article 6 la possibilité pour les Etats membres d'imposer des obligations de service public. Si des obligations sont déjà assignées aux entreprises du secteur du gaz naturel, tel n'est pas le cas dans le secteur naissant de l'hydrogène. Le projet de loi ne reprend pas cette possibilité considérant le secteur naissant et non destiné à atteindre les consommateurs résidentiels. Plutôt que de consacrer un service public de l'hydrogène, le projet de texte propose de ne viser que certaines infrastructures listées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour bénéficier des facilités de destinées aux infrastructures répondants à une mission de service public.
- L'interdiction de conclure des contrats pour l'approvisionnement en gaz naturel sans dispositif d'atténuation s'étendant au-delà du 31décembre 2049 est introduite par la directive à l'article 31. Elle est limitée aux contrats longs termes avec des points de livraison sur le territoire national.
- Le règlement 2024/1789 indique les principes de tarification que doit appliquer l'autorité de régulation désignée pour l'hydrogène (article 5). La tarification doit notamment rémunérer l'opérateur selon ses coûts, sur la base d'un opérateur efficace, ainsi que sur les capitaux immobilisés. Ces principes sont similaires à ceux déjà en place pour le gaz naturel. Le règlement laisse également à la main des Etats membres la possibilité d'utiliser une méthodologie de tarification qui répartit les revenus, dûs via le tarif d'utilisation d'une infrastructure de transport d'hydrogène, sur plusieurs années (appelée répartition inter-temporelle des coûts). Ce type de méthodologie permet de ne pas faire peser le coût d'une infrastructure sur les premiers utilisateurs. Pour assurer le développement d'un réseau d'hydrogène, notamment de grand transport d'hydrogène sur des distances importantes, il a été retenu de permettre la mise en place de ce type de méthodologie. La Commission de régulation de l'énergie peut ainsi approuver la mise en place, dans les cas opportuns, d'une méthodologie de répartition inter-temporelle des coûts. Les présentes dispositions ne prévoient par contre pas de mise en place d'un fond de garanti de l'Etat français pour la mise en place d'infrastructure hydrogène conformément à la stratégie nationale hydrogène révisée en avril 2025. Des mécanismes de garanties non portés par l'État français sont cependant possibles avec cette approche ;
- Le règlement 2024/1789, à son article 5, encadre de près les possibilités de faire des subventions croisées entre secteurs, c'est-à-dire de financer par exemple le développement du secteur de l'hydrogène à partir du socle des utilisateurs du réseau d'hydrogène et de gaz naturel. Le règlement permet aux Etats membres de recourir à ce type d'approche sous certaines réserves et avec un encadrement précis de la part du régulateur. Le parc d'utilisateur du réseau d'hydrogène n'est aujourd'hui pas développé ; aussi faire peser son financement sur lui seul complexifiera le développement rapide des infrastructures d'hydrogène. A contrario, les parcs d'utilisateurs d'électricité ou de gaz sont nettement plus développés et leur mobilisation sur le financement du développement du réseau d'hydrogène pourrait être envisagée. Cependant, tant le réseau de gaz naturel que celui d'électricité devront faire face dans les prochaines décennies à des modifications profondes pouvant avoir un coût élevé. Il n'est donc pas pertinent de faire peser un coût supplémentaire, non destiné aux utilisateurs concernés, pour le développement du réseau d'hydrogène. Ce choix est structurant pour le financement des réseaux d'hydrogène qui devrait donc être uniquement réalisé, même à court terme, par une couverture du risque de non utilisation propre de la part des bénéficiaires pressentis pour l'infrastructure.
- L'article L. 111-97 du code de l'énergie prévoit un droit d'accès des tiers aux réseaux gaziers. L'article 38 de la directive (UE) 2024/1788 donne la possibilité aux Etats membres de remettre en cause ce droit d'accès des tiers à travers des refus de raccordement ou des interruptions de fourniture. Le paragraphe 5 de cet article, ainsi que le considérant (88) de cette directive, précisent bien que ces remises en cause du droit d'accès des tiers aux réseaux gaziers sont un choix laissé à l'appréciation de chaque Etat membre, et non une obligation. Les perspectives de baisse de la consommation de gaz naturel posent la question de l'évolution des réseaux gaziers. Une étude d'optimisation des réseaux gaziers sera demandée aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel desservant plus de 45000 consommateurs, en application de l'article 57 de la directive (UE) 2024/1788. Afin d'éviter de réaliser de nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel dans des zones où d'autres options énergétiques seraient identifiées comme plus pertinentes, il est proposé de transposer la possibilité de refus d'accès au réseau gazier. Il est fait le choix de confier le pouvoir de création de zones d'interdiction de nouveaux raccordements aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel, en cohérence avec l'article L. 432-4 du code de l'énergie qui dispose que les réseaux publics de distribution de gaz naturel appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Il est en revanche fait le choix de ne pas transposer la possibilité d'obligation de déraccordement, afin notamment de pouvoir approfondir l'analyse des conséquences pour les consommateurs de gaz naturel qui seraient concernés par l'activation d'une telle mesure.
Le mécanisme de solidarité pour l'approvisionnement en gaz naturel a été instauré par le règlement (UE) 2017/1938 relatif à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Schématiquement, ce mécanisme consiste à prévoir, dans l'éventualité d'une crise gazière majeure, l'arrêt de la consommation de gaz naturel par des consommateurs industriels dans un Etat membre de l'Union européenne afin de pouvoir assurer l'approvisionnement des services sociaux essentiels et de l'ensemble des consommateurs résidentiels dans un autre Etat membre. Le règlement (UE) 2024/1789 vient préciser les modalités de mise en oeuvre du mécanisme de solidarité pour l'approvisionnement en gaz naturel, en exigeant que le mécanisme soit mis en oeuvre dans un premier temps « sur la base de mesures volontaires axées sur la demande », mesures qui correspondent en pratique à permettre aux consommateurs industriels de faire le choix de revendre du gaz naturel plutôt que de le consommer. Comme la vente de gaz naturel est une activité soumise à autorisation, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'énergie, et que la majorité des consommateurs industriels ne disposent pas de cette autorisation, il est proposé de créer une dérogation pour permettre aux consommateurs industriels de revendre du gaz naturel dans le cadre du mécanisme de solidarité pour l'approvisionnement en gaz naturel. Il est par ailleurs proposé de confier aux gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel la mission de développer une plateforme électronique pour faciliter les reventes de gaz naturel par les consommateurs industriels. Le choix d'assigner cette mission aux gestionnaires de réseaux de transport est basé sur le retour d'expérience de l'Allemagne et du développement réussi d'une plateforme similaire par THE, association des gestionnaires du réseau allemand de transport de gaz naturel. Le pilotage de la plateforme électronique par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel permet de limiter le nombre d'interfaces.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 38 modifie le titre Ier du livre Ier, le titre III du livre Ier et le titre Ier du livre IV du code de l'énergie en modifiant les articles L. 134-3, L. 443-7, et L. 452-1 et en créant les articles L. 111-110-6 et L. 431-6-6, pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1789.
Il prévoit également, pour la transposition de la directive (UE) 2024/1788, de :
- modifier l'article L. 224-7 du code de la consommation ;
- modifier le code de l'énergie, notamment, le Titre Ier du livre Ier, le titre III du livre Ier, le titre VIII du livre II, le titre Ier du livre IV, le titre III du livre IV, le titre IV du livre IV, le titre II du livre VIII, le titre III du livre VIII, le titre IV du livre VIII et le titre V du livre VIII du code de l'énergie, ainsi que de créer un titre VI dans le livre en modifiant les articles : L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-8-1, L. 111-8-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-11, L. 111-12, L. 111-14, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-22, L. 111-26, L. 111-27, L. 111-30, L. 111-31, L. 111-33, L. 111-34, L. 111-39, L. 111-77, L. 111-102, L. 111-103, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3, L. 134-3, L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L. 134-12, L. 134-15, L. 134-16, L. 134-18, L. 134-19, L. 134-25, L. 134-28, L. 134-29, L. 134-30, L. 135-1, L. 135-4, L. 135-13, L. 142-30, L. 142-31, L. 142-37, L. 431-6, L. 432-8, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-2, L. 453-6, L. 453-7, L. 811-1, L. 831-1, L. 851-1, L. 851-2, et en créant les articles L. 111-9-1, L. 111-50-1, L. 111-50-2, L. 111-50-3, L. 111-50-4, L. 111-50-5, L. 111-50-6, L. 111-50-7, L. 111-50-8, L. 111-50-9, L. 111-50-10, L. 111-79-1, L. 111-79-2, L. 111-82-1, L. 111-90-1, L. 111-90-2, L. 111-90-3, L. 111-97-2, L. 111-110-1, L. 111-110-2, L. 111-110-3, L. 111-110-4, L. 111-110-5, L. 111-110-6, L. 134-2-1, L. 134-16-1, L. 412-1, L. 431-6-6, L. 432-23, L. 432-24, L. 432-25, L. 442-1-1, L. 442-1-2, L. 442-2-1, L. 442-4, L. 442-5, L. 443-7, L. 452-1, L. 827-1, L. 826-1, L. 827-1, L. 831-3, L. 832-1, L. 832-2, L 832-3, L. 832-4; L. 832-5, L. 832-6, L. 832-8, L. 851-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 834-2, L. 834-3, L. 834-4, L. 835-1, L. 841-2, L. 841-3, L. 841-4, L. 841-5, L. 841-6, L. 851-1-1, L. 851-1-2, L. 861-1, L. 861-2, L. 861-3, L. 861-4, L. 871-1, L. 871-2, L. 871-3, L. 872-1.
- et enfin de créer l'article L. 555-15-1 et de modifier les articles L. 555-9et L. 555-25 du code de l'environnement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées doivent permettre de mettre en conformité les dispositions législatives du code de l'énergie avec la directive (UE) 2024/1788 et le règlement (UE) 2024/1789. Cela doit par conséquent passer par l'adoption de dispositions nouvelles et la modification de dispositions existantes applicables aujourd'hui au gaz naturel. Le code de la consommation et le code de l'environnement sont également sujets à des modifications.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La transposition de la directive 2024/1788 et la visibilité à long terme qu'elle offre aux acteurs est susceptible de favoriser les investissements français, européens et internationaux dans les infrastructures de transport, de stockage et dans les terminaux d'hydrogène. Cette dynamique est de nature à avoir un impact positif sur le développement global de la filière. Ce constat est toutefois à nuancer au vu des contraintes nouvelles qui pèseront sur les gestionnaires d'infrastructures et devra être analysé au cas par cas.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les dispositions proposées permettront d'instaurer un cadre législatif propre aux activités de transport et de stockage d'hydrogène et de gestion de terminaux d'hydrogène. Un impact plus global sur l'ensemble de la chaîne est attendu :
- Les gestionnaires d'infrastructures d'hydrogène devront tenir compte de l'impossibilité de recourir à des financements croisés depuis d'autres secteurs pour financer leurs infrastructures. Ils pourront utiliser une méthodologie d`étalement des coûts de l'infrastructure sur plusieurs années pour limiter le tarif appliqué aux premiers entrants s'ils le souhaitent ;
- Les utilisateurs du réseau d'hydrogène devront financer le réseau d'hydrogène. Ce financement ne pourra pas venir des utilisateurs du réseau d'électricité ou de gaz naturel. Cette approche pourrait conduire à un coût du transport d'hydrogène plus élevé, reflétant les coûts réels du secteur.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les dispositions transposant la directive 2024/1788 n'ont pas d'impact direct sur les collectivités territoriales s'agissant du marché naissant de l'hydrogène. Le déploiement de canalisations d'hydrogène sur le territoire des collectivités locales était déjà possible avant l'adoption et la transposition du 4ème paquet gaz sous réserve du respect des prescriptions réglementaires, et en particulier de celles prévues par le code de l'environnement.
La directive 2024/1788 prévoit, à ses articles 55 et 57, que les gestionnaires de réseaux de gaz naturel élaborent des « plans de déclassement des réseaux de distribution » associant les collectivités territoriales. La transposition de l'article 38 donne la possibilité aux collectivités territoriales de désigner des zones d'interdictions de nouveaux raccordements au réseau de gaz naturel. Ces changements ont un impact sur les collectivités territoriales qui exercent la compétence d'autorités organisatrices de la distribution, le réseau de distribution étant leur propriété.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'article 49 prévoit de confier à la Commission de régulation de l'énergie un nouveau bloc de compétences en l'identifiant comme régulateur du marché de l'hydrogène. L'autorité a notamment pour mission de certifier les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène, fixer les tarifs d'accès aux réseaux de transport et aux stockages d'hydrogène, approuver les investissements des gestionnaires de réseaux. Ces nouvelles tâches de la CRE pourront être facilement intégrées à celles déjà conduites sur le gaz naturel dans la structure existante les compétences métier demandées étant similaires. Il conviendra néanmoins à l'autorité indépendante de définir le renfort d'effectif nécessaire pour que l'unité en charge du transport du gaz puisse assumer cette nouvelle mission.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Ces dispositions devraient contribuer à faciliter la mise en place de vecteurs de décarbonation induisant de facto un impact positif sur la société au travers de l'atténuation du changement climatique. L'ampleur de cet impact reste néanmoins difficile à mesurer au sens où le texte fixe le cadre appliqué mais ne fixe pas d'objectifs.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'application du 4ème paquet conduit à apporter des protections supplémentaires aux consommateurs de gaz naturel qui correspondent à un alignement avec celles prévues pour la protection des consommateurs d'électricité en application du paquet énergie propre de 2019 et de la directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La transposition de la directive 2024/1788 poursuit l'objectif de réduction de l'utilisation des combustibles fossiles et favorise la pénétration des gaz renouvelables et bas carbone dans le système énergétique. Elle présente donc un impact positif pour l'environnement en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre des projets intéressés.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'a dû être menée en cours de l'élaboration du présent article sur la partie hydrogène de la directive. La consultation du CNEN est cependant nécessaire pour certaines dispositions de la directive sur la partie gaz naturel. En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le CNEN a été consulté à titre obligatoire le 2 octobre 2025 et a rendu un avis favorable.
Les travaux de transposition ont toutefois été menés en étroite collaboration avec la Commission de régulation de l'énergie dont les services ont été en mesure de faire remonter leurs observations et propositions à l'écrit ou lors de réunions organisées de manière récurrentes avec la DGEC.
Une consultation informelle a également été menée avec les acteurs de la filière. Natran, Teréga, GRDF, Air Liquide, France Hydrogène, Air Products, Storengy et Elengy ont été invités à présenter des observations et propositions de modification des rédactions qui leur ont été transmises. Les quelques retours reçus ont été analysés et ont été à l'origine de modifications rédactionnelles.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions proposées s'appliqueront sur l'ensemble du territoire de la République française à l'exception des territoires de Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à la Polynésie française et à la Nouvelle Calédonie.
Le texte s'applique en particulier en l'état et sans consultation aux territoires de l'article 73 (DOM) et à Saint-Pierre et Miquelon.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat devra être pris pour compléter la partie réglementaire du code de l'énergie en cohérence avec les présentes modifications législatives.
Articles 39 - Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Créations des zones d'accélération renforcée pour les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le développement des énergies renouvelables est essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique mais également pour garantir la sécurité d'approvisionnement électrique, en France comme en Europe.
La directive (UE) 2018/2001, dite RED II, encourageait le développement des énergies renouvelables mais ne proposait pas de mécanisme unifié de zonage et que les États membres pouvaient définir des zones propices à l'installation de projets renouvelables, mais sans obligations européennes précises sur la cartographie, la désignation, ou le calendrier.
Lors de l'élaboration de la directive RED III, les négociations européennes se sont concentrées sur les modalités permettant d'accélérer leur développement, tout en garantissant un impact limité sur la biodiversité. Ainsi, les nouvelles dispositions introduites dans RED III mettent l'accent sur la planification avec la désignation de « zones d'accélération ». L'article 1er de la directive RED III définit les zones d'accélération comme étant un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d'eaux intérieures, qu'un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d'énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse. Ces zones sont définies par un plan soumis à évaluation environnementale stratégique. Les projets implantés dans ces zones pourront bénéficier d'autorisations accélérées (et seront notamment exemptés d'évaluation environnementale - sous réserve de respecter des mesures d'atténuation appropriée, fixées pour chaque zone). La directive exige que, pour au moins un ou plusieurs sources d'énergies, des zones d'accélérations soient définies d'ici au 21 février 2026.
Les nouvelles dispositions de la directive permettent également de préciser que les projets d'énergies renouvelables (répondant à certaines caractéristiques, notamment de puissance, définies par voie règlementaire) répondent à une raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions nécessaires à l'octroi d'une dérogation « espèces protégées » au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et souvent la première condition attaquée lors des recours contre les projets d'énergie renouvelable. Cette disposition figure d'ores et déjà en droit français (article 19 de la loi pour l'accélération de la production d'énergie renouvelables (APER - loi n° 2023-275)).
La France a été moteur sur ces sujets en proposant dès 2023 un mécanisme de planification territorial des énergies renouvelables et en donnant la possibilité aux territoires de définir ces zones où elles souhaitent voir les projets s'installer prioritairement. La loi APER définit en effet, dans son article 15, les zones d'accélération pour la production d'énergie renouvelable. Ces zones d'accélération correspondent à des zones jugées préférentielles et prioritaires par les communes pour le développement des énergies renouvelables. Elles sont proposées par les communes, pour chaque type d'énergie renouvelable. Ce ne sont pas des zones exclusives. Des projets peuvent donc être autorisés en dehors de ces zones, et les projets se développant sur ces zones ne bénéficient pas de de mesures dérogatoires permettant d'accélérer les délais d'autorisation - à l'exception d'un délai d'enquête publique réduit.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'une directive de l'Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu'ils visent à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce qu'il permet de concilier, au sens de la décision 2023-851 DC, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation, renforcée via le développement des énergies renouvelables, et l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil prévoient toute la mise en place d'un cadre favorable pour le développement des énergies renouvelables, tant par des mesures financières que par des mesures d'autorisation. La directive (UE) 2023/2413, dite RED III, met l'accent sur la planification du développement des énergies renouvelables en demandant aux Etats Membres de définir des « zones d'accélération », définies dans des plan soumis à évaluation environnementale stratégique, dans lesquelles les projets pourront bénéficier de procédures d'instruction accélérée. En dehors de ces zones, la directive encadre également les délais d'autorisation des projets.
1.4. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Cet article transpose des dispositions relatives aux zones d'accélération mentionnées aux articles 15 quater, 15 sexies et 16 bis de la directive RED III. Les règles en vigueur ne prévoient pas de tel dispositifs et la transposition nécessitent une adaptation de la procédure d'évaluation environnementale actuellement inscrite dans la loi. Aussi, il était nécessaire de recourir à un vecteur législatif pour apporter des précisions sur ce nouveau dispositif et les possibilités d'exemption.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le développement des énergies renouvelables est indispensable pour atteindre la neutralité carbone, comme le montre l'étude de RTE sur les Futurs énergétiques 2050, qui a alimenté les travaux sur la stratégie française énergie et climat mise en consultation fin 2023. De plus, dans son bilan prévisionnel de 2019, RTE chiffre les émissions évitées grâce à la production éolienne terrestre et solaire française à environ 22 millions de tonnes de CO2 par an (5 millions de tonnes en France et 17 millions de tonnes dans les pays voisins). Cela s'explique par le fait que l'électricité produite par les éoliennes terrestres et les panneaux photovoltaïques dispose d'un coût de production marginal nul et est donc plus compétitive que l'électricité issue des centrales de production utilisant des combustibles d'origine fossile. Ces projets sont nécessaires à la transition énergétique. Ainsi, la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) montrent qu'une électrification massive de l'économie et un développement important des énergies renouvelables seront nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui implique de développer les capacités de production décarbonée et les réseaux publics d'électricité.
Ce déploiement doit se faire en conciliation avec d'autres enjeux notamment en matière de protection de la biodiversité.
L'objectif est de mettre en cohérence le droit français avec la directive sur les dispositions relatives aux zones d'accélération et d'infrastructure de réseau. Cela permettra de sécuriser les projets d'énergies renouvelables : dès lors que les zones identifiées soumises à évaluation environnementale stratégique comporteront les mesures nécessaires, les projets qui s'implantent pourront être exemptés d'évaluation environnementale.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il a été envisagé que les zones d'accélération et les zones d'infrastructure de réseaux prévues par la directive fassent l'objet de nouveaux plans ad hoc. La directive impose aux Etats de désigner des zones d'accélération, mais elle n'impose pas que ces zones fassent l'objet d'un plan dédié.
La transposition de la directive via la création de plans dédiés aurait nécessité un portage administratif supplémentaire, pour un résultat équivalent à celui du dispositif retenu.
En outre, le dispositif retenu permet d'articuler les zones d'accélération des énergies renouvelables prévues par la directive (dénommées zones d'accélération renforcée dans la transposition proposée) avec les zones d'accélération des énergies renouvelables qui existaient préalablement en droit français (créées par la loi APER (loi n° 2023-175)) et dont les caractéristiques sont différentes.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue consiste en la création de zones d'accélération renforcées pour les énergies renouvelables et de zones d'infrastructure de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique. Les projets situés dans ces zones pourront sous conditions être dispensés d'évaluation environnementale et d'évaluation des incidences Natura 2000, à l'exception des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo.
Ces zones sont définies au sein de plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Pour les zones d'énergies renouvelables, elles sont définies au sein des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)161(*) ou des documents stratégiques de façade. Si des projets se font au sein de ces zones, ils peuvent être dispensés d'évaluation environnementale162(*). Les zones d'infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration d'énergies renouvelables dans le système électrique seront définies au sein des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, des schémas décennaux de développement du réseau et des documents stratégiques de façade163(*). Les projets d'infrastructure de réseaux situés dans ces zones peuvent être exemptés d'évaluation environnementale164(*).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article L. 141-5-5 du code de l'énergie est créé pour mettre en place des zones d'accélération « renforcée » Ces zones sont identifiées dans des plans et programmes existants soumis à évaluation environnementale. Ces zones identifiées évitent l'implantation dans les zones à enjeux de biodiversité fort conformément à l'article 15 quater de la directive RED III. Il précise la procédure d'octroi de permis pour les projets d'énergies renouvelables implantés dans les zones d'accélération des énergies renouvelables renforcées, en explicitant l'exemption d'évaluation environnementale et la mise en place de l'examen préalable conformément à l'article 16 bis de la directive RED III.
Enfin les articles L. 342-5-1 et L. 342-5-2 créent des mesures équivalentes pour les zones d'infrastructures de réseau conformément à l'article 15 sexies de la directive RED III, Ces zones sont identifiées au sein des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l'article L. 342-3, du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6 et du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-1 du code de l'environnement. Les articles L. 342-3 et L. 321-6 sont modifiés pour tenir compte de la possibilité d'inclure de telles zones dans les schémas définis par ces articles. L'article L. 342-5-2 prévoit les conditions dans lesquelles les projets d'ouvrage de réseau prévus dans ces zones peuvent bénéficier d'une exemption d'évaluation environnementale.
Enfin les articles L. 219-5-1 et L. 229-26 du code de l'environnement, créent la possibilité d'inclure dans les documents stratégiques de façade et dans les plans climat-air-énergie-territoriaux les règles appropriés et proportionnées concernant les mesures d'évitement et de réduction mentionnées à l'article L. 122-6 du code de l'environnement afin de bénéficier d'une exemption d'évaluation environnementale.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les mesures proposées sont des mesures de transposition de la directive UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Elles devront être complétées par d'autres mesures de transposition, notamment au niveau règlementaire pour permettre une transposition complète des dispositions prévues aux articles 15 quater, 15 sexies et 16 bis de la directive.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Cette mesure a pour objet d'accélérer les procédures pour les porteurs de projets d'énergie renouvelable. Il est attendu un gain de temps et de visibilité dans ces procédures, qui pourrait faire gagner en fluidité pour les projets concernés et faciliter l'installation d'énergies renouvelables et de réseau électrique.
4.2.3. Impacts budgétaires
Aucune économie n'est prévue du fait de cette mesure.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Comme pour les porteurs de projets privés, la mesure a pour effet d'accélérer les procédures des projets portés par des collectivités territoriales, en particulier les projets d'énergie renouvelable financés par les collectivités, par exemple au travers de sociétés d'économie mixte prévues par l'article L. 1521-1) du code général des collectivités territoriales.
De plus certaines collectivités pourront choisir de mettre en place des zones au travers de leur PCAET. Cette nouvelle possibilité n'est cependant pas une obligation, et une nouvelle compétence leur est accordée par cet article.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Aucune charge supplémentaire sur les services ne sera apportée. Les présentes dispositions prévoient une instruction par les services d'une évaluation environnementale. Celle-ci est actuellement faite au niveau d'un projet. Dans ces nouvelles zones, elle serait faite à l'échelle du plan ou programme.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La présente disposition va contribuer à sécuriser le cadre juridique des activités humaines en cause. En particulier, s'agissant de la création de nouvelles sources d'énergie renouvelables, elle contribuera à créer un climat incitatif pour les porteurs de projets afin d'atteindre l'objectif de neutralité climatique de l'Union par le biais d'une augmentation nettement plus importante d'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'une facilitation du développement du réseau électrique.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions règlementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure contribuera à l'accélération des projets d'énergie renouvelable et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
L'accélération de ces types de projet permise par le présent article aura donc un effet positif sur la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
De plus les mesures ont pour objectif de mettre en place des évaluations environnementales stratégiques concernant les possibilités d'implanter des installations de production d'énergies renouvelables, couvrant le périmètre des zones d'accélération renforcée et des zones d'infrastructures de réseau. En cas de besoin, ces évaluations stratégiques pourront être complétées au besoin par les porteurs de projets.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée s'appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Des textes d'application au niveau réglementaire seront nécessaires pour compléter les dispositions introduites par ces trois articles. Ainsi des décrets en conseil d'état seront nécessaires pour préciser :
· Les dispositions du nouvel article L. 141-5-5 du code de l'énergie créé, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'identification des zones d'accélération, à la définition des mesures mentionnées à l'article L. 122-6 du code de l'environnement pour chaque zone et la mise en oeuvre de la procédure d'examen préalable permettant aux projets de bénéficier de l'exemption d'évaluation environnementale et les cas dans lesquels des projets peuvent être dispensés de cet examen préalable.
· Les dispositions de l'article L. 342-5-1 du code de l'énergie créé, en ce qui concerne l'identification et la délimitation du périmètre des zones d'infrastructures du réseau.
· Les dispositions de l'article L. 342-5-2 du code de l'énergie créé, en ce qui concerne les conditions de dispense de la procédure d'évaluation environnementale.
Article 40 - Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La directive (UE) 2023/2413 de RED III a été adoptée en octobre 2023. Elle fixe un nouvel objectif ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie. S'inscrivant dans la continuité de RED II, elle réhausse les ambitions afin d'accélérer la transition énergétique européenne et d'atteindre les objectifs du Green Deal et du paquet Fit For 55. Au-delà d'introduire des objectifs contraignants en matière de développement des énergies renouvelables, la création de procédures simplifiées et de zones d'accélération pour le déploiement des énergies renouvelables, elle intègre également des exigences renforcées dans certains secteurs tels que les transports ou l'industrie ainsi qu'une gouvernance accrue des données énergétiques pour favoriser la transparence, la flexibilité ainsi que la participation des acteurs de marché.
L'article 20 bis de RED III appelle à une bonne gestion et transmission des données entre gestionnaires de réseau de transport et de distribution et les acteurs de marché, afin de contribuer à la décarbonation et l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique. En France, le gestionnaire de réseau de transport, RTE, assure l'équilibre offre/demande du système électrique, l'accès au réseau de transport et la publication de nombreuses données liées à l'électricité (mix énergétique, prix, capacités transfrontalières, émissions de CO2...). Les gestionnaires de réseau de distribution, principalement Enedis (95% du territoire) ainsi que les entreprises locales de distribution (ELD), gèrent la distribution d'électricité en basse et moyenne tension, la collecte de certaines données de consommation ou de production via les compteurs communication (Linky principalement). Les acteurs du marché correspondent aux producteurs, fournisseurs, consommateurs, agrégateurs de flexibilité, opérateurs de recharge de véhicules électricité, les communautés d'énergies renouvelables...
Alors que le droit existant (code de l'énergie, RED II) prévoit déjà des obligations de mise à disposition des données, les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis renforce la granularité, la fréquence et l'interopérabilité des données afin de favoriser la flexibilité, la transparence et la participation des acteurs de marché.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La transposition des dispositions intégrées dans le projet de loi relève du domaine de la loi en ce qu'elles apportent des modifications à des normes de niveau législatif codifiées dans la partie législative du code de l'énergie, du code de la consommation et du code de l'action sociale et des familles.
Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu'ils visent à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce qu'elles ne font que préciser des dispositions du code de l'énergie existantes ou compléter des dispositifs déjà existants.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis sont cohérents avec le cadre européen existant, que ce soit la directive RED II de 2018 ainsi que le règlement (UE) 2019/943 électricité et 2018/1999 sur la gouvernance qui imposaient respectivement des obligations de transparence et d'accès aux données sans granularité ni fréquence détaillée, ainsi que de fournir certaines données techniques et de marché pour garantir la concurrence et la sécurité du système ou obligations de suivi et de reporting. Ils renforcent la transparence, l'accès équitable aux informations et l'efficacité du marché.
Par ailleurs, ils soutiennent les objectifs internationaux en matière de garantie de diffusion de données fiables sur les énergies renouvelables tels que mentionnés par l'accord de Paris (2015), les objectifs de développement durable (ODD 7 et 13) ou la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en s'inscrivant dans les engagements climatiques internationaux, respectant la liberté d'accès à l'information et le principe de transparence et ne créant pas de discrimination.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Cet article transpose les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis relatif à la facilitation de l'intégration de l'électricité renouvelable dans le système de la directive RED III. Les règles en vigueur n'encadrent pas en détail la transparence et l'accès aux données afin de garantir un accès équitable et non discriminatoire pour les acteurs de marché. Cela permettra aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution de connaitre leurs obligations en la matière. Par ailleurs, la transition vers un système électrique décarboné nécessite une planification fine et temps réel pour laquelle la mise à dispositions de données accessibles et fiables permettra une gestion efficace de l'équilibrage du réseau et l'optimisation du système électrique. Aussi, il était nécessaire de recourir à un vecteur législatif pour apporter des précisions sur ces nouvelles modalités et de se conformer aux obligations européennes et s'intégrant pleinement dans les engagements internationaux.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le Gouvernement poursuit plusieurs objectifs grâce à la transposition des paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis. Il s'agit d'une part d'assurer l'effectivité de la transposition de RED III, en intégrant clairement les obligations de publication et d'accès aux données dans le droit français. D'autre part, l'objectif est de garantir la transparence des données énergétiques, en incitant à une publication si possible en temps réel, de la part d'électricité renouvelable, du taux d'émission de gaz à effet de serre de l'électricité et du potentiel de flexibilité de la consommation en instaurant un cadre de coopération entre les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et sous garantie de l'interopérabilité de la base de formats des données. Pour finir, cela permettra au Gouvernement d'atteindre ses objectifs globaux de décarbonation du mix électrique national et européen en encourageant dans la mesure du possible la collaboration de l'ensemble des acteurs du marché.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Option 1 : S'appuyer sur les publications existantes de RTE
RTE publie déjà la majorité des données via son application Eco2mix ainsi que via ses portails de données "data" ou "Odré". Des travaux sont actuellement en cours avec RTE, en collaboration avec Enedis, afin que les dispositions de l'article 20 bis soient prises en compte dans ces outils. Cela devrait conduire à des améliorations de publication des données et la mise en place de nouvelles API si nécessaire.
Option 2 : Créer une base légale garantissant la conformité des publications avec le périmètre prévu par la directive
Au regard du droit européen, il n'existe aucune autre option possible que la transposition par un véhicule législatif, accompagné lorsque cela est pertinent d'une déclinaison au niveau réglementaire.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option 2 est retenue afin de donner une base légale aux publications des gestionnaires de réseaux et garantir le maintien dans la durée des publications prévues par la directive et du périmètre de ces publications.
Les modalités de mise à disposition et le cadre des échanges de données entre acteurs ne fait pas l'objet de la mesure, afin de disposer d'un cadre souple pouvant s'appuyer, notamment, sur l'ensemble des flux de données et plates-formes déjà mises en place par les gestionnaires de réseaux.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article prévoit l'insertion, au Livre III, au Titre V du code de l'énergie, d'un nouveau chapitre intitulé « Chapitre V : Données utiles à l'utilisation de l'électricité » et comprenant un nouvel article L. 355-1 qui reprend les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis de la directive RED III s'agissant de la transmission de données transparentes sur la part d'électricité renouvelable injectée dans le réseau.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées doivent permettre de mettre en conformité le code de l'énergie avec les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis de la directive (UE) 2023/2413.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La publication sous format numérique des données agrégées en temps réel pourrait pousser les gestionnaires de réseaux à investir davantage dans la modernisation et la digitalisation de leurs systèmes tels que des systèmes intelligents, le développement de nouvelles interfaces de programmation, etc. La mise à disposition des données pourrait favoriser également le développement de nouveaux services innovants (agrégateurs, applications énergétiques intelligentes, flexibilité, etc.).
Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité RTE publie déjà de nombreuses données via ses applications ou portails. Une nouvelle API pourrait être développée pour tenir compte de ces nouvelles obligations.
4.2.3. Impacts budgétaires
Il n'y a pas d'impact budgétaire pour l'Etat (économie ou coût).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
En France, RTE gère exclusivement le transport d'électricité. Si une collectivité est gestionnaire de réseau de distribution via par exemple une régie, elle serait soumise aux obligations de cet article. Ainsi, techniquement et financièrement, elle devrait être en capacité de collecter et diffuser les données si ces dernières sont disponibles.
Un accès aux données de manière transparence des gestionnaires de réseaux pourrait améliorer leur planification et leur résilience : anticiper par exemple les congestions locales, mieux coordonner les projets de bornes de recharge, etc. Cela permettrait aux collectivités locales de faciliter les projets locaux en améliorant par exemple la qualité du service et renforçant l'acceptabilité des projets.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Aucune charge supplémentaire sur les services ne sera apportée.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'accès à des données en temps réel permet aux particuliers de mieux adapter leur usage et de réduire leur facture in fine, cela peut les encourager à adopter une consommation davantage flexible.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Une meilleure intégration des énergies renouvelables permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant le recours aux énergies fossiles. Le développement de la flexibilité du système électrique en optimisant la production et la demande permet également de gagner en efficacité pour le réseau.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025
Aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les présentes dispositions s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions des présents articles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Elles s'appliquent également à Saint-Martin qui est assujetti au droit communautaire.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 41 - Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - Bioénergies
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
1.1.1. Cadre posé par la directive RED
La directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive RED II » est une refonte de la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables, qui dans son volet relatif aux bioénergies ne concernait que les biocarburants et les bioliquides. Elle en reprend le principe de la fixation de critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de pouvoir considérer l'énergie produite à partir de biocarburants165(*) comme renouvelable, et l'étend à tous les types de biomasse en ajoutant le biogaz166(*) et la biomasse solide167(*) - y compris produite à partir de déchets - dans le champ d'application de la directive.
Ces critères, définis à l'article 29 de la directive, sont de trois types :
- Des critères portant sur la production de biomasse, agricole168(*) ou forestière169(*), avec des pratiques culturales ou sylvicoles à respecter ainsi que l'exclusion de la biomasse issue de zones dites « interdites » présentant un intérêt écologique ou de stockage de carbone important, sauf à produire des preuves jugeant du respect de ces limitations pour certaines de ces zones ;
- Un critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'énergie produite à partir de biomasse par rapport à son équivalent fossile, calculé sur la base des émissions de GES réalisées en analyse de cycle de vie de la biomasse, à l'exclusion des émissions de la combustion même de la matière (émissions déjà prises en compte dans l'inventaire du puits de carbone des sols ou forestier, selon les conventions internationales en vigueur) ;
- Un critère d'efficacité énergétique pour les installations de production d'électricité.
Le respect de ces critères est nécessaire d'après la directive, à son article 29.1, pour :
- Déterminer l'admissibilité à une aide financière pour la consommation de biomasse ;
- Que l'énergie produite contribue aux objectifs fixés par la directive d'intégration d'énergies renouvelables dans différents secteurs, et contribuer aux parts des énergies renouvelables des Etats-Membres fixées par la directive ;
- Que l'énergie compte dans le respect des obligations d'utiliser des énergies renouvelables fixées par la directive, notamment dans le secteur des transports.
La vérification du respect de ces critères est fondée sur la base d'un système d'audits indépendants, menés auprès des entreprises (fournisseurs, producteurs de bioénergies ou tout autre opérateur) de la chaîne de valeur menant à une installation de production d'énergie à partir de biomasse. Ces audits sont menés selon des systèmes volontaires (définis à l'article 30 de la directive RED II170(*)), qui établissent des normes permettant de vérifier que les critères de durabilité de la directive sont bien respectés par les entreprises auditées. Ces systèmes sont reconnus par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution, après une procédure permettant de vérifier que les normes établies permettent bien d'attester du respect de la directive par les opérateurs qui s'y soumettent. Un Etat-membre peut aussi décider de définir un système dit national. Pour la biomasse solide et le biogaz, ce sont des systèmes volontaires qui opèrent en France, soit des organismes privés (les principaux étant, sans souci d'exhaustivité : SURE ( SUstainable REssource verification scheme), SBP ( Sustainable biomass program), 2bsvs ( Biomass, Biofuel Sustainability), ISCC ( International Sustainabilité and carbon certification), RedCert ( Renewable energy directive certification), PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)...
La directive est fondée sur un principe d'analyse basée sur les risques afin de déterminer le niveau de contraintes auxquels seront soumis les opérateurs dans le cadre de leurs audits annuels vérifiant le respect des critères de la directive RED II. Ce principe est détaillé dans la directive RED II, à son article 30, et précisé au règlement d'exécution 2022/996, pris en application de la directive (UE) 2018/2001, concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, ainsi qu'au règlement d'exécution (UE) 2022/2448 de la Commission du 13 décembre 2022 relatif à l'établissement d'orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. D'après ce principe, si le droit national présente des garanties suffisantes garantissant que la biomasse est durable, avec un système de contrôle permettant d'assurer la mise en oeuvre des différents critères de durabilité, alors les audits peuvent être simplifiés. Si le droit national ne reprend pas suffisamment les exigences de la directive, alors l'Etat-membre est qualifié de « risque fort » par les systèmes volontaires, et les audits annuels sont plus contraignants et concernent plus d'acteurs en amont de la chaîne de traçabilité. A ce titre, les dispositions de la directive RED précitée s'appliquent tout autant à la biomasse importée qu'à celle récoltée en France, selon une analyse de risque dépendant du pays d'origine de la biomasse. Les analyses de risque peuvent être réalisées soit par les systèmes volontaires, soit par les Etats en question, selon une démarche transparente et vérifiée par des publications scientifiques et experts pertinents, auquel cas elle est alors reconnue comme valide par les systèmes volontaires opérant dans le pays concerné.
Pour la biomasse forestière issue de France, une analyse de risque faible existe dans le cadre de la directive RED II, réalisée en 2023 et coordonnée par le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE) et un consortium d'acteurs de la filière (CNPF, COPACEL, EFF, FEDENE, FNB, FNCOFOR, FNEDT, FRANSYLVA, ONF, UCFF, SER171(*)), avec la contribution de la filière et du ministère de la Transition Energétique, et le soutien financier de l'ADEME et du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Cette analyse conclut que selon les critères de durabilité en vigueur dans le cadre de la directive RED II, la forêt française est gérée durablement et les audits menés peuvent donc inclure les simplifications autorisées.
Enfin, dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (SEQE, ou ETS dans son acronyme anglais), c'est-à-dire la directive 2003/97/CE, les installations produisant de l'énergie à partir de biomasse doivent également justifier du respect des critères de durabilité de la directive RED précitée afin de pouvoir comptabiliser l'énergie produite à partir de biomasse comme ayant un facteur d'émission égal à zéro. Ceci est traduit à l'article 38 relatif au flux de biomasse, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066. Ceci s'applique à toute installation concernée par l'ETS, qu'elle soit soumise à la directive RED ou non (d'après les seuils de puissance présents dans la directive RED). Ceci conduit à ce que toute modification de la directive RED entraîne une modification pour toutes les installations assujetties à l'ETS, avec des enjeux financiers importants pour ces entreprises, qui doivent payer des quotas ETS en cas de non-respect des critères de la RED (une estimation de 300 millions d'euros pour la filière du bois-énergie est issue du reporting des installations ETS concernées et de données de la filière)
1.1.2. Dispositions législatives et réglementaires nationales
Les critères de durabilité de la directive RED II ont été transposés au titre VIII du livre II du code de l'énergie, aux articles L. 281-1 à L. 285-1. Des dispositions réglementaires complètent ces dispositions législatives, en divers endroits du code de l'énergie :
- Les articles R. 281-1 à R. 284-10 pour les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse
- Les articles R. 314-93 à R. 314-107 pour la production d'électricité à partir de biomasse
- Les articles R. 446-80 à R. 446-95 pour la production de biométhane (biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel)
- Les articles R. 715-1 à R. 715-6 pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse
1.1.3. La révision de la directive RED
La directive 2023/2413 opère une révision de la directive RED II, la version révisée de la directive (UE) 2018/2001 étant communément appelée « directive RED III ». Elle s'inscrit dans le cadre du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » (Fit for 55), un ensemble de dispositions législatives qui visent à réduire les émissions de GES de l'Union européenne d'au moins 55 % en 2030 par rapport au niveau de 1990. Elle introduit notamment une révision substantielle des dispositions s'appliquant à la biomasse.
Concernant la durabilité de la biomasse, les modifications introduites résident notamment dans l'abaissement du seuil de puissance thermique nominale à partir duquel des installations utilisant des combustibles solides issus de la biomasse sont concernées par les exigences de la directive. Ce dernier passe de 20 MW à 7,5 MW. Les seuils pour la biomasse gazeuse et pour les biocarburants et bioliquides restent les mêmes.
En outre, les critères environnementaux portant sur la production de la biomasse sont considérablement renforcés pour la biomasse forestière. D'abord, le principe des « zones interdites », qui dans la RED II ne concernait que la biomasse agricole, est étendu à la biomasse forestière. La biomasse forestière concernée par la directive RED III ne doit donc plus provenir de zones présentant un intérêt écologique ou de stockage de carbone important, sauf à produire des preuves jugeant du respect de ces limitations pour certaines de ces zones. A noter que la liste des zones a été étendue par rapport à la directive RED II, avec l'ajout des landes.
En outre, la liste des critères de durabilité qui s'appliquent à la biomasse forestière a été notablement étendue. Dans la RED II, seuls quelques critères concernaient la biomasse forestière, qui étaient en outre très généraux :
1. La légalité des opérations de récolte ;
2. La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;
3. La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières ;
4. La réalisation de l'exploitation dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;
5. Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.
La directive RED III ajoute des nouveaux critères de durabilité, qui viennent remplacer en le précisant nettement le quatrième critère ci-dessus, en stipulant que la réalisation de la récolte doit, conformément aux principes de gestion durable des forêts, se faire :
· D'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines ;
· D'une manière qui permette d'éviter la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation ;
· D'une manière qui permette d'éviter la récolte sur les sols vulnérables ;
· Conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe ;
· Conformément aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort ;
· Conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats.
Selon le principe d'analyse de risque défini en supra, la directive est basée sur un système d'analyse de risque : si le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée « dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles », alors le pays est jugé de « risque faible » et les audits auxquels se soumettent les opérateurs concernés sont alors simplifiés, sinon il est jugé « de risque fort ». Ce système d'analyse de risque concerne aussi le principe des zones interdites, la directive laissant la possibilité aux Etats de fixer des règles dans le droit national garantissant que la biomasse ne provient pas de telles zones, ce qui permettrait d'éviter que les auditeurs aient à exercer des contrôles remontant jusqu'aux exploitants forestiers concernés.
Enfin, les exigences de réduction de gaz à effet de serre sont renforcées. En effet, l'article 29 directive RED III généralise, selon un calendrier progressif s'étalant jusqu'en 2030 (voire au-delà pour les installations de production de bioénergies de petite taille), le critère introduit par la directive RED II de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à toutes les installations situées au-dessus du seuil de puissance de la directive, quelle que soit leur date de mise en service. Auparavant, les installations entrées en service avant le 1er janvier 2021 n'étaient pas concernées. Cette généralisation concerne les installations de production d'énergie à partir de biomasse solide (biomasse forestière, déchets) ou de biomasse gazeuse (méthaniseurs en cogénération) et les installations de production de biométhane injecté dans le réseau.
La RED III a également introduit le principe d'utilisation en cascade de la biomasse, dans son article 3.3, visant à privilégier une utilisation hiérarchisée et efficiente de la biomasse. Celui-ci impose aux Etats-membres de prendre des mesures permettant de donner la priorité aux usages matière de la biomasse sur ses usages énergétiques lorsque cela est possible, afin de maximiser la quantité de biomasse disponible dans le système. Cela signifie que l'usage énergétique de la biomasse (électricité, chaleur) ne doit intervenir qu'après que les usages prioritaires au sens de ce principe ont été épuisés (notamment usage matière). Ce principe vise notamment la biomasse ligneuse172(*) et se concentre principalement sur la biomasse soutenue par des régimes d'aide, définis par la directive comme tout instrument appliqué par un Etat membre afin de promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables. Ce nouveau principe est distinct dans sa mise en oeuvre des critères de durabilité de la biomasse (article 29).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l'environnement dispose à son article 6 que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». La transposition de la Directive énergies renouvelables s'inscrit dans ce principe, en ce qu'elle permet d'encadrer le développement d'une énergie décarbonée, dans le respect de l'environnement.
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La transposition des dispositions intégrées dans le projet de loi relève du domaine de la loi en ce qu'elles apportent des modifications à des normes de niveau législatif codifiées dans la partie législative du code de l'énergie.
Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'une directive de l'Union européenne, le présent article et les modifications législatives qu'il vise à opérer ne contreviennent à aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle en ce qu'elles ne font que préciser des dispositions du code de l'énergie existantes ou compléter des dispositifs existants.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les présentes dispositions visent à transposer les dispositions relatives à l'énergie produite à partir de biomasse de la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023173(*), qui vient réviser la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018174(*).
Ces dispositions relèvent d'abord du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, introduit par cette révision à l'article 3.3 de la directive (UE) 2018/2001 et qui n'était pas présent dans sa précédente version. De nouvelles dispositions sont ensuite introduites au même article 3.3 concernant les aides publiques à l'énergie produite à partir de biomasse. Enfin, sont introduits de nouveaux critères dits « de durabilité », afin de renforcer le cadre qui était déjà posé par la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 dans son article 29 et 30.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Peu d'Etats membres ont transposé spécifiquement les dispositions des articles 3.3 et 29 de la directive. La liste des textes transposés est accessible sur le site de la Commission européenne.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 5 de la directive (UE) 2023/2413 dispose que :
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, point 6), en ce qui concerne l'article 15 sexies de la directive (UE) 2018/2001, et l'article 1er, point 7), en ce qui concerne les articles 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies et 16 septies de ladite directive, au plus tard le 1er juillet 2024.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
En outre, il ressort des engagements internationaux de la France, et notamment de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une obligation de transposition de l'article 1 de la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023 au risque d'un recours en manquement de la part de la Commission européenne. La transposition de ces dispositions introduit des changements qui rendent nécessaires des modifications de nature législative. En effet, au regard des évolutions de l'article 29 de la directive, les dispositions du titre VIII, livre II de la partie législative du Code de l'énergie ne sont plus compatibles avec le droit européen. En particulier, les seuils d'assujettissement de l'article L281-4, les seuils de réduction d'émission de gaz à effet de serre des article L281-5 et L281-6 ont évolué avec la directive RED III. Le principe d'utilisation en cascade de la biomasse de l'article 3.3 de la directive RED III étant nouveau, il nécessite une nouvelle disposition législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif de la transposition de ces articles de la directive est de promouvoir la consommation et production d'énergies renouvelables qui respectent un cadre ambitieux de durabilité, incluant notamment leur efficacité significative en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également les bonnes pratiques environnementales liées à leur mode de production.
L'objectif est d'adapter les dispositions du code de l'énergie, ainsi qu'une disposition du code de l'environnement, afin de mettre le droit français en conformité avec la directive (UE) 2018/2001 telle que révisée par la directive (UE) 2023/2413. Des modifications du code forestier au niveau réglementaire seront également introduites dans le cadre de l'option de transposition retenue.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Au regard du droit européen, il n'existe aucune autre option possible que la transposition. L'article 5 de la directive (UE) 2023/2413 détaille les délais de transposition.
Ø Principe d'utilisation en cascade de la biomasse (article 3.3 de la directive)
Concernant le principe d'utilisation en cascade de la biomasse, introduit à l'article 3.3 de la directive (UE) 2018/2001 révisée, la directive laisse une marge de manoeuvre aux Etats-Membres pour l'adapter selon leurs spécificités et leur cadre législatif ou règlementaire national.
En effet, l'article 3.3 stipule que « Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l'énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et l'incidence négative sur la biodiversité, l'environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE et veillent à l'application du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en mettant l'accent sur les régimes d'aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales. »
Ce paragraphe laisse aux Etats-Membres la liberté quant aux mesures prises afin d'assurer que l'utilisation de biomasse à des fins énergétiques ne conduise pas à des distorsions sur le marché des matières premières. Il indique que ces distorsions qui doivent être évitées relèvent notamment de situations contraires au principe d'utilisation en cascade de la biomasse, et qu'une focalisation particulière doit être réalisée sur les régimes d'aide.
Le principe d'utilisation en cascade de la biomasse est défini au considérant (10) de la directive (UE) 2023/2413, qui stipule que « Ce principe consiste à viser une utilisation efficace des ressources de la biomasse en donnant la priorité, chaque fois que c'est possible, à l'usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique, de façon à augmenter la quantité de biomasse disponible dans le système. Cet alignement vise à garantir un accès équitable au marché des matières premières de la biomasse pour le développement de solutions biologiques innovantes à forte valeur ajoutée et d'une bioéconomie circulaire durable. »
La directive impose donc aux Etats-Membres de prendre des mesures permettant d'assurer que la biomasse soit utilisée en priorité pour un usage matériel plutôt que pour un usage énergétique, lorsque cet usage matériel est possible, selon des critères à définir par l'Etat-Membre.
L'accent spécifique mis sur les régimes d'aide est confirmé par le second paragraphe de l'article 3.3, qui introduit également un ordre de priorité spécifique qui doit être respecté pour les utilisations de la biomasse ligneuse qui font l'objet de tels régimes d'aides. Ainsi, si le principe d'utilisation en cascade est général et concerne toutes les biomasses, un accent particulier est mis sur la biomasse ligneuse (biomasse forestière, produits connexes de scierie...) pour laquelle les utilisations sous la forme de produits à base de bois constituent l'utilisation jugée prioritaire. L'élaboration d'aides publiques doit donc viser à ce que les utilisations énergétiques de la biomasse ligneuse ne rentrent pas en concurrence directe avec les usages matière, qu'il faut favoriser.
Au vu de la marge de manoeuvre importante laissée par la directive quant à la transposition du principe d'utilisation en cascade, plusieurs options ont été envisagées :
· Option 1 : un contrôle étendu à tous les projets de production d'énergie à partir de biomasse ligneuse, qu'ils soient demandeurs d'une aide publique ou non, afin d'éviter que d'importants volumes conduisant in fine à une déstabilisation du marché de la biomasse en faveur des usages énergétiques ne soient pas soumis au principe de cascade si les projets ne sollicitent pas une aide publique. Afin de pouvoir viser les projets non aidés, une mobilisation du cadre des ICPE dans le cadre de l'instruction de l'autorisation environnementale serait nécessaire
· Option 2 : un contrôle limité aux installations aidées, avec des conditions de respect du principe d'utilisation en cascade incluses dans les cahiers des charges des aides publiques et un contrôle par les services de l'Etat. Pour les installations non aidées, le respect du principe d'utilisation en cascade devrait être vérifié par le porteur de projet dans son étude d'impact, dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale.
La directive laisse également la possibilité de prévoir des dispositions pour la biomasse non ligneuse, notamment agricole, au vu du caractère général du principe d'utilisation en cascade, même si seul la biomasse ligneuse est spécifiquement visée par l'article 3.3.
Enfin, aucun seuil minimal n'est introduit au niveau de la cascade par la directive, qui peut donc en théorie s'appliquer à toute installation consommatrice de biomasse : les Etats-Membres sont libres de définir les bornes d'application selon les tensions constatées nationalement sur le marché des matières premières issues de la biomasse. La directive pourrait donc théoriquement s'appliquer au chauffage domestique également.
Ø Critères de durabilité pour la biomasse forestière et zones « interdites » (article 29 de la directive)
Comme indiqué supra, la directive RED est fondée sur un principe d'analyse basée sur les risques pour l'application des critères de durabilité. Lorsque l'Etat d'où la biomasse forestière a été exploitée ne présente pas un droit national garantissant le respect des critères en question, alors les audits annuels auxquels doivent se soumettre les installations assujetties à la RED et leurs fournisseurs sont renforcés, et doivent remonter jusqu'à la zone d'approvisionnement forestière, pouvant même aller jusqu'à l'impossibilité de recourir aux simplifications permises par la procédure d'audit de groupe, selon des dispositions dépendant des systèmes volontaires concernés.
Dès lors, la transposition des critères de durabilité pour la biomasse forestière ainsi que du principe des zones interdites pouvait présenter deux options extrêmes :
· Option 1 : Ne rien inclure dans le droit français, ce qui aurait pu conduire à ce que la France soit jugée par les systèmes volontaires comme étant de « risque fort » et donc à des audits plus contraignants pour les opérateurs, mais sans modification du droit existant ;
· Option 2 : Modifier le droit français s'appliquant au secteur forestier concerné par la directive RED, afin d'y inclure les nouveaux critères de durabilité, et assurer aux opérateurs des audits moins contraignants.
La seconde option, implique de réviser le cadre national (au niveau législatif et/ou règlementaire), mais la directive précitée laisse aux Etats-membres une marge d'interprétation importante du fait des dispositions nationales existantes qui peuvent être très différentes selon les Etats (et qui doivent également concerner les Etats hors-UE dont le droit national est aussi vérifié selon le principe d'analyse de risque175(*))
Entre ces différentes options, il est possible de réaliser des choix de transposition différents pour chacun des critères de durabilité, étant entendu que ce sont les systèmes volontaires qui décident in fine de la solidité suffisante du droit national - notamment en reconnaissant comme solide une analyse réalisée à l'échelle d'un Etat-Membre, ou en menant leur propre analyse de risque - pour que les règles de simplification des audits puissent être appliquées, pour tous les critères de la directive RED ou uniquement une partie d'entre eux.
Des critères peuvent donc être introduits dans le droit français, dans le cadre de cette transposition, concernant les zones interdites, les seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur ou pour la rétention de bois mort, l'évitement de la récolte des souches et racines, et tous les critères introduits par la directive RED III et identifiés en supra.
Ø Clause « grand-père » (article 29.15 de la directive)
L'article 29.15 de la directive RED III laisse la possibilité à certaines installations de déroger aux nouveaux critères de durabilité et de réduction des émissions de GES de la directive RED III, tant que celles-ci vérifient certaines conditions relatives à l'aide publique qui leur a été octroyée. La décision de mettre en oeuvre ou non cette dérogation est laissée à la discrétion de chaque Etat Membre. En cas d'application de la dérogation, les installations concernées continuent d'être soumises au critère de la directive RED II avant sa modification par la directive (UE) 2023/2413 tant que la dérogation a cours et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de modifier les dispositions du code de l'énergie relatives aux biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur de transport et carburants à base de carbone recyclé ; qui avaient été introduites pour la transposition de la directive (UE) 2018/2001, afin de les mettre en conformité avec la directive révisée.
Ø Principe d'utilisation en cascade de la
biomasse (création de L.286-1 à
L. 286-9)
Concernant le principe d'utilisation en cascade, l'option retenue consiste à faire appliquer ce principe par le Préfet de région, en charge d'évaluer pour les projets candidats à un soutien public sur le territoire régional le respect de la primauté des usages matière de la biomasse ligneuse sur les usages énergétiques. Les projets des candidats doivent présenter un plan d'approvisionnement en biomasse ligneuse qui soit cohérent avec le principe d'utilisation en cascade, sur la base de l'état de la ressource au niveau local (régional et interrégional) et des utilisations matière qui en sont possibles. L'évaluation de ce plan d'approvisionnement est réalisée par les cellules régionales biomasses, instance composée de membres des DREAL, DRAAF, DREETS et de l'ADEME, selon des modalités qui seront précisées par décret en conseil d'Etat et arrêté et dans les cahiers des charges des soutiens publics concernés. Ces dispositions ne concernent donc que les nouveaux projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant une aide publique.
En outre, les modalités introduites et le périmètre des installations concernées seront précisés par décret en conseil d'Etat et arrêté, et devront tenir compte des modalités et seuils prévus pour l'application des critères de durabilité de la directive RED III (article 29), notamment le seuil de puissance thermique nominale au-dessus de 7,5 MW pour les installations consommant de la biomasse solide. Ceci permettra de limiter la charge administrative aux installations déjà concernées par le reporting usuel de la directive RED. Les précisions apportées au niveau réglementaire devront également être cohérentes avec les seuils actuels de saisine des cellules régionales biomasse, définis dans les cahiers des charges des appels à projet concernés (BCIAT, Fonds Chaleur, BCIB...) : en effet, celles-ci se prononcent uniquement sur les projets dont les plans d'approvisionnement prévisionnels prévoient une consommation de plus de 10 kt de biomasse par an dans la région concernée.
La définition du principe d'utilisation en cascade tels que prévue par la Directive est introduite au niveau législatif. Des possibilités de dérogation issues de la directive sont introduites, ainsi qu'un renvoi réglementaire permettant de préciser ultérieurement les typologies de biomasse pour lesquelles la valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée correspond à l'usage énergétique, justifiant ainsi que l'usage matière ne soit pas favorisé (notamment les bois de haies ou les CSR comprenant une fraction biogénique).
La transposition introduit aussi des modalités de suivi de ces dérogations, pour les installations existantes et nouvelles, dans le cadre d'un rapportage qui sera aligné avec celui que les installations rendent déjà au titre des exigences de l'article 29 de la directive. La possibilité de mettre en place des études et enquêtes supplémentaires pour permettre au Préfet de région d'avoir une connaissance fine de l'état du marché de la biomasse sur son territoire est introduite, cela étant nécessaire pour un bon fonctionnement des cellules régionales biomasse en charge de l'évaluation du bilan entre offre et demande de biomasse pour les différents projets pour lesquels un avis est sollicité.
Enfin, une obligation de prise en compte du principe d'utilisation en cascade dans l'étude d'impact réalisée par les porteurs de projet dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale est introduite, permettant ainsi que le principe s'applique de manière proportionnée, en limitant la charge administrative, pour les installations ne sollicitant pas une aide publique. En cohérence avec les seuils existants au titre de la procédure d'évaluation environnementale - définis en annexe à l'article R.122-2 du code de l'environnement - cette évaluation concernera de manière systématique toutes les installations relevant de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), ce qui est notamment le cas des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW au titre de la rubrique 3110 des ICPE.
En cohérence avec les procédures déjà existantes dans le cadre des évaluations des plans d'approvisionnement par les cellules biomasses et d'évaluation environnementale, les modifications substantielles de l'approvisionnement ou extensions à des projets sont également concernés par l'évaluation par le Préfet de région et les cellules régionales biomasses - pour les projets aidés - et pour la procédure d'évaluation environnementale - pour les projets aidés et non aidés (au titre de l'article R.122-2 du code de l'environnement).
Ø Critères de durabilité pour la biomasse forestière et zones « interdites » (modification du L281-1 à L285-1)
L'objectif de la transposition est de sécuriser au maximum une analyse de risque « faible » pour la biomasse forestière française, en introduisant des critères dans le droit national autant que nécessaire. La transposition repose sur le socle d'exigences existant déjà en droit français, notamment dans les dispositions du code forestier, mais vise à aligner ce socle normatif avec les critères introduits par RED III. La majorité des dispositions concernées relèvent du niveau réglementaire : la présente loi se limite à transposer de manière générale les exigences s'appliquant à toute biomasse, importée ou récoltée en France. Elle introduit également des critères généraux qui seront précisés par voie réglementaire :
· Sur les modalités de suivi de l'application du critère de non-provenance depuis une « zone interdite », via l'obligation de transmettre une attestation au sein de la chaîne de traçabilité justifiant du respect de ce critère. Les modalités de cartographie et les définitions des zones concernées seront précisées par décret en Conseil d'Etat et arrêté.
· Sur les critères de durabilité, un renvoi réglementaire est effectué pour préciser les modalités d'application de ces derniers (sur l'encadrement des coupes rases de grande ampleur, le maintien de bois mort, la récolte des souches et racines, la santé des sols...).
Les modalités réglementaires qui seront introduites en application de ces accroches législatives tiendront notamment compte du cadre juridique existant. Elles viseront les chaînes de valeur concernées par la directive RED, en cohérence avec le positionnement de ces dispositions législatives dans le code de l'énergie, à savoir celles allant des producteurs de biomasse jusqu'à une installation de production d'énergie située au-dessus des seuils de la directive, en incluant tous les fournisseurs intermédiaires.
Sur les coupes rases, plusieurs chiffres et expertises méritent d'être soulignés :
· D'après l'IGN176(*), sur la période 2013-2022, les coupes « fortes » d'au moins 50% du couvert forestier de la parcelle, représentent 85 000 ha par an soit 0,5% de la surface totale des forêts en France hexagonale, mais elles représentent 49 % du volume de bois récolté sur la période, soit un enjeu économique fort. Ces coupes englobent cependant les coupes sanitaires, les coupes rases, les coupes de taillis, les coupes définitives, les défrichements, entre autres. A ce stade, la part des coupes rases parmi les coupes fortes n'est pas connue ;
· Une expertise collective sur les coupes rases et le renouvellement des forêts (CRREF), financée par le Ministère de la Transition Ecologique, le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, l'ADEME et l'OFB, a été pilotée par le GIP Ecofor. Selon ses conclusions rendues en 2023, il ressort que :
o Le sujet de tension sociétal autour des coupes rases s'intensifie ;
o Les effets négatifs des coupes rases augmentent avec la surface des coupes ;
o Les impacts économiques, en termes de surcoûts d'exploitation, d'une réduction de la surface des coupes rases sont conséquents et différents entre forêt privée et publique ;
o Limiter la taille autorisée des coupes rases, même à un seuil supérieur aux seuils retenus pour la certification forestière, constituerait un signal indiquant qu'il est pertinent, sur un plan environnemental, d'éviter les coupes rases de grandes dimensions.
La nécessité d'encadrement de la surface des coupes rases de grande ampleur pose aussi la question du niveau où devraient s'appliquer ces dispositions, qui pourraient reposer :
· Sur les propriétaires forestiers, visés par les dispositions du code forestier ;
· Et/ou sur les exploitants forestiers, au vu du risque identifié que des coupes rases « multipropriétaires », d'une surface très importante, puissent avoir lieu. En effet, des coupes rases réalisées dans des propriétés forestières contigües peuvent aussi être contraires aux principes de gestion durable de la directive RED III.
Des précisions sur les types de coupes concernées par cet encadrement et les dérogations seront également introduites au niveau réglementaire, notamment sur les enjeux de coupes sanitaires ou réalisées pour prévenir les risques d'incendie, ainsi que sur la question spécifique de la sylviculture en région Nouvelle-Aquitaine (dans le massif des Landes de Gascogne).
Des travaux de concertation se poursuivront, en préparation de textes réglementaires qui préciseront les modalités applicables à l'ensemble des critères de durabilité.
Ø Clause « grand-père »
Un renvoi réglementaire est introduit pour permettre la mise en place de dérogations dans le cadre de l'article 29.15 de la RED, en respectant les conditions fixées par cet article.
D'abord, pour les installations produisant du biométhane injecté dans le réseau :
L'application de la clause d'antériorité prévue à l'article 29.15 sera mise en oeuvre au niveau réglementaire pour les installations de production de biométhane situées sur le territoire métropolitain français, sous réserve du respect des conditions énoncées audit article, à savoir :
- L'installation de production de biométhane bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat à tarif réglementé signé avant le 20 novembre 2023 ;
- La production de biométhane de l'installation respecte le critère de réduction des émissions de GES de la directive RED II, dans sa version antérieure à la modification introduite par la directive (UE) 2023/2413.
Le dispositif d'obligation d'achat à tarif réglementé constitue un mécanisme de soutien long-terme, le contrat d'achat de biométhane étant conclu pour une durée de 15 ans. En outre, le dimensionnement du tarif d'achat et le système de vérification du TRI (taux de rentabilité interne) de l'installation garantissent l'absence de surcompensation.
En conséquence, la production de biométhane issue d'une installation bénéficiant de la dérogation et respectant le critère de réduction de émissions de GES de l'article 29 dans sa version de la directive RED II peut être comptabilisée comme renouvelable dans le rapportage statistique établi par la France au niveau européen et peut contribuer aux objectifs d'intégration d'énergie renouvelable dans différents secteurs et au global fixés par la directive RED III.
Toutefois, il est important de noter que dans l'hypothèse d'une exportation de biométhane vers un autre État membre, les déclarations de preuves de durabilité afférentes à la production de biométhane issue d'une installation implantée sur le territoire métropolitain et bénéficiant de la dérogation ne peuvent être reconnues par les autorités compétentes dudit État membre, sauf si celui-ci décide formellement de mettre en oeuvre la clause d'antériorité.
Puis, pour les installations produisant de l'électricité à partir de biogaz produit par méthanisation de biomasse :
L'application de la clause d'antériorité prévue à l'article 29.15 sera mise en oeuvre au niveau réglementaire pour les installations de production d'électricité à partir de biogaz situées sur le territoire français, sous réserve du respect des conditions énoncées audit article, à savoir :
- L'installation de production d'électricité bénéficie d'un contrat de soutien (obligation d'achat ou complément de rémunération) signé avant le 20 novembre 2023 ;
- La production d'électricité respecte le critère de réduction des émissions de GES de la directive RED II, dans sa version antérieure à la modification introduite par la directive (UE) 2023/2413.
Le dispositif de soutien (obligation d'achat ou complément de rémunération) constitue un mécanisme de soutien long-terme, dont le tarif a été fixé au début de la période de soutien. Le contrat d'achat d'électricité ayant été conclu pour une durée de 15 ans avec un avenant permettant une prolongation de 5 ans pour certaines installations ou un avenant de prolongation fonction d'un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance pour d'autres installations. En outre, le dimensionnement du tarif de référence et le système de vérification du TRI (taux de rentabilité interne) de l'installation garantissent l'absence de surcompensation.
En conséquence, la production d'électricité produite à partir de biogaz issue d'une installation bénéficiant de la dérogation et respectant le critère de réduction de émissions de GES de l'article 29 dans sa version de la directive RED II peut être comptabilisée comme renouvelable dans le rapportage statistique établi par la France au niveau européen et peut contribuer aux objectifs d'intégration d'énergie renouvelable dans différents secteurs et au global fixés par la directive RED III.
Toutefois, il est à noter que dans l'hypothèse d'une exportation d'électricité produite à partir de biogaz vers un autre État membre, les déclarations de preuves de durabilité afférentes à la production d'électricité produite à partir de biogaz issue d'une installation implantée sur le territoire métropolitain et bénéficiant de la dérogation ne peuvent être reconnues par les autorités compétentes dudit État membre, sauf si celui-ci décide formellement de mettre en oeuvre la clause d'antériorité.
Enfin, pour des installations de production d'électricité, de chaleur ou de froid à partir d'autres bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse :
Des dispositions seront prises, au niveau réglementaire. Ces dérogations ont vocation à être moins prolongées dans le temps, ne s'étendant pas jusqu'à la fin de la période autorisée (30 décembre 2030 au plus tard). Elles ne seront prises que si la situation pour les filières concernées rend l'adaptation des entreprises aux exigences de la directive RED III révisée trop coûteuse ou porteuse de trop de contraintes administratives, nécessitant un assouplissement de calendrier.
Ø Définition de déchets municipaux solides
Les déchets municipaux solides sont, au titre de l'article 29.1 de la directive RED II, exemptés de démonstration de critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une installation produisant de l'énergie à partir de DMS est donc exemptée d'obligations au titre de la directive RED.
Dans le cadre de la transposition de la directive RED II, la notion de « déchets municipaux solides » a été transposée comme celle de « déchets municipaux et assimilés », présente à l'article R.2224-23 du code général des collectivités territoriales. Cette définition est toutefois incomplète, et conduit à ce qu'un nombre important d'installations qui devraient être exemptées ne le soient finalement pas.
La transposition actuelle cherche à corriger cet état de fait, alors même que de nombreuses installations de valorisation énergétique de déchets vont être concernées par la directive du fait de l'abaissement du seuil de puissance à partir duquel une installation est assujettie à la RED.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Pour la transposition de l'article 3.3 de la directive (UE) 2018/2001 comme révisée par la directive (UE) 2023/2413, un nouveau chapitre VI est créé, au sein du livre II, titre VIII du code de l'énergie (articles L. 286-1 à L. 286-9). Ce nouveau chapitre comprend des dispositions permettant d'introduire en droit français :
· Le principe d'utilisation en cascade de la biomasse et les modalités de dérogation prévues à ce principe sont transposés aux articles L. 286-1 à L. 286-6 du code de l'énergie, conformément aux paragraphe 3, 3 bis et 3 ter de l'article 3 la directive (UE) 2018/2001 révisée
· Des dispositions complémentaires relatives aux aides financières en faveur de l'énergie produite à partir de biomasse, présentes aux paragraphes 3 quater et 3 quinquies de l'article 3 de la directive (UE) 2018/2001 révisée, sont transposées aux articles L. 286-7 et L. 286-9 du code de l'énergie
· Au code de l'environnement, l'article L.122-3 est modifié pour introduire l'obligation de respecter le principe d'utilisation en cascade dans le cadre des études d'impact
Un nouvel alinéa est introduit à l'article L.281-1 afin d'introduire notamment la définition de bois-rond de qualité industrielle, posée à l'article 2.1 bis de la directive (UE) 2018/2001 révisée, ainsi que la définition du principe d'utilisation en cascade. La définition de déchets solides municipaux est également basculée dans cet article.
Pour la transposition de l'article 29 comme révisée par la directive (UE) 2023/2413, de nouvelles dispositions sont introduites :
· Au titre VIII du code de l'énergie, le chapitre I (articles L. 281-1 à L. 281-12) est profondément remanié afin d'introduire les nouveaux critères de durabilité, de réduction de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique que doit respecter la biomasse à vocation énergétique, tels que posés par la version révisée de la directive
· Au titre VIII du code de l'énergie, les chapitres II, III et IV sont légèrement modifiés (L.282-1, L. 282-2, L. 283-1, L. 283-2, L. 283-3, L. 283-4, L. 284-1, L. 284-7, L. 284-10) ces ajustements permettant de se conformer à la nouvelle version de la directive et de modifier certaines dispositions incorrectes
Enfin, certaines modifications mineures sont introduites dans d'autres parties du code de l'énergie afin de mettre à jour le droit national en conséquence de la transposition.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées doivent permettre de mettre en conformité les dispositions législatives du code de l'énergie et du code de l'environnement avec la directive (UE) 2018/2001 dans sa version révisée par la directive (UE) 2023/2413.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les entreprises qui sont impactées par les exigences relatives à la durabilité des bioénergies de la directive RED sont l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur allant de la production de biomasse agricole, forestière ou sous forme de déchets jusqu'à la valorisation énergétique de cette biomasse. Cela concerne donc les producteurs de biomasse, les fournisseurs éventuels et négociants et l'installation de production d'énergie, que ceux-ci soient situés sur le territoire français ou à l'étranger.
Toutefois, certaines filières ne sont pas impactées par la directive (UE) 2023/2413, car tous les critères de durabilité n'ont pas été modifiés par cette révision. C'est notamment le cas des unités de méthanisation (production d'électricité ou de chaleur renouvelable sur site et production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel), pour lesquelles les exigences de la directive sont inchangées et qui ne font donc face à aucun coût supplémentaire. C'est aussi le cas des cimentiers qui utilisent des bioliquides pour produire de la chaleur : déjà concernés par la directive RED II, rien ne change pour eux sous RED III.
Les chaînes de valeur concernées spécifiquement par la révision de la directive RED visée par cette transposition sont celles dont les acteurs étaient déjà concernés par la RED II et qui devront se conformer à des critères plus stricts de la directive révisée, ainsi que des chaînes de valeur qui auparavant étaient dispensées et sont dorénavant concernées en raison de l'abaissement des seuils d'assujettissement à la directive ou d'extension du critère GES. Les principaux acteurs sont de trois types :
- Les acteurs de la filière du bois-énergie, pour les chaînes de valeur menant à la production de chaleur et/ou d'électricité à partir de biomasse solide forestière ou de déchets bois (connexes de transformation...). L'abaissement du seuil d'assujettissement - à partir duquel une installation de production d'énergie à partir de biomasse solide est concernée par les exigences de la directive, ainsi que ses fournisseurs directs et indirects - de 20 à 7,5 MW conduit à une hausse des assujettis de 150 à 250 installations environ ;
- Les cimentiers qui utilisent des combustibles
solides de récupération (CSR) comportant une fraction
biogénique, qui sont concernés par RED III, malgré leur
date de mise en service ancienne, du fait de la généralisation de
l'applicabilité du critère de réduction de gaz à
effet de serre ;
- Parmi les installations produisant de l'énergie à partir de déchets, une partie importante était également exemptée de respect des critères de réduction de GES en raison de leur date de mise en service. L'extension de l'application du critère sous RED III conduit à ce que de nouvelles installations, notamment des unités de valorisation énergétiques (UVE), soient concernées.
Pour les unités de méthanisation, l'extension du critère de réduction de gaz à effet de serre aux installations mises en service avant 2021 conduit aussi à augmenter le nombre d'installations assujetties. Toutefois, les implications pour les filières de production d'électricité à partir de biogaz et de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel seront limitées du fait de l'application de la clause « grand-père » :
- Les installations mises en service avant 2021 disposent d'un délai jusqu'à la fin de l'année 2030 pour réaliser les investissements nécessaires, procéder aux modifications de leurs procédés et/ou équipements, et adapter leurs pratiques en vue de se conformer à cette nouvelle exigence de réduction des émissions de GES ;
- Les installations mises en service à compter du 20 novembre 2023, date d'entrée en vigueur du nouveau critère, mais ayant conclu un contrat d'obligation d'achat avant cette même date, restent soumises à un seuil de réduction des émissions moins contraignant. Soumettre ces installations dès leur mise en service au nouveau seuil de 80% fixé par la directive RED III reviendrait à appliquer rétroactivement un seuil plus exigeant à des projets d'installations conçus et développés avant la publication de la directive. Une telle rétroactivité entrainerait une hausse des coûts imprévue (liée notamment à l'approvisionnement en intrants « bas carbone », à des investissements supplémentaires pour la couverture des stockages de digestat et le captage du biogaz) et pourrait compromettre la viabilité économique des projets concernés, en remettant en question leur plan d'affaires et leur accès au financement.
En préparation de la transposition de la directive RED III, un recensement a été mené en ligne par la DGEC, avec l'appui du réseau des DREAL et des interprofessions concernées, pour connaître les installations nouvellement assujetties, en ciblant les filières du bois-énergie, du ciment et des déchets.
Les déclarations de durabilité annuelles transmises à l'administration par les installations de production d'énergie à partir de biomasse dans le cadre des obligations de la directive RED II permettent d'avoir un panel du type d'entreprises concernées par cette directive et du type d'intrants qu'elles consomment. Pour la biomasse consommée en 2023, elles montrent que la biomasse agricole représente moins de 15 % du tonnage total de biomasse utilisée pour les installations concernées par la directive. Compte tenu de cette donnée, ainsi que du fait que les nouvelles dispositions de la RED III ciblent principalement la biomasse forestière, nous avons décidé de ne pas prendre en compte les coûts associés à la biomasse agricole. Les chiffres présentés ci-après se rapportent donc exclusivement au bois énergie.
Cette focalisation sur ce secteur est également corroborée par les travaux en cours au sein de l'administration pour développer une solution numérique pour faciliter le rapportage des installations obligées RED, qui s'est basée sur des entretiens avec de nombreux acteurs de la filière. Ce travail a montré que les chaînes de valeur du bois-énergie sont celles où le nombre de fournisseurs intermédiaires est généralement le plus important, et donc celles qui supportent le plus de coûts liés à la certification et à la mise en place des exigences de traçabilité.
Concernant les déchets, une estimation précise des coûts n'a pas été menée. Le recensement conduit par la DGEC a toutefois conduit à estimer qu'environ 40 % des installations potentiellement assujetties à la directive RED III, soit environ quarante installations sur un total d'une centaine d'unités de valorisation énergétique à partir de déchets (UVE), seraient exclues du champ d'application de la directive en cas de modification de la définition de déchets municipaux solides (DMS), comme proposé dans cette loi. Ceci permettrait de limiter les impacts économiques sur la filière en limitant le nombre d'assujettis, dans un contexte où la RED III va toucher fortement une filière jusque-là relativement préservée en raison de la non-application dans la RED II du critère de réduction des émissions de GES pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2021 et consommant de la biomasse solide, ce qui est le cas de la majorité des UVE produisant de l'énergie à partir de combustibles solides de récupération (CSR).
Une rapide estimation des coûts a toutefois été menée par la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement (FNADE), organisation professionnelle du secteur, qui estime à environ 8000 € par site le coût de la certification pour les installations situées en bout de chaîne, soit environ 800 000 € au total pour la centaine d'UVE nouvellement assujetties à RED III, parmi lesquels environ 320 000 € pourraient être économisés en cas de modification de la définition de DMS. A ce chiffre doit s'ajouter le coût de la certification des installations situées en amont de la chaîne de valeur, allant des collecteurs de CSR et incluant tous les intermédiaires, ainsi que le coût pour le premier point de collecte de gestion du système d'audit de groupe, celui-ci devant centraliser les informations relatives aux réductions de GES de tous les préparateurs de CSR auprès desquels il se fournit. Ces coûts, difficiles à évaluer, sont liés à l'audit en lui-même mais aussi aux ressources humaines nécessaires à leur préparation.
Analyse détaillée de l'impact pour la filière du bois-énergie :
Il convient d'abord d'estimer le nombre d'entreprises concernées par la RED III dans le secteur du bois-énergie. Seuls les acteurs concernés effectivement par la directive RED III seront pris en compte, et non ceux concernés par les exigences de la RED III au titre du règlement ETS. Les exigences de traçabilité concernent tous les acteurs d'une chaîne de valeur dont l'opérateur final est une installation de production d'énergie à partir de biomasse solide, avec des simplifications possibles dans le cadre de la procédure dite « d'audit de groupe » (voir ci-après).
Les opérateurs concernés par les exigences de traçabilité doivent se soumettre à des audits annuels, menés par des organismes de certification, qui opèrent selon un cahier des charges défini par des « systèmes volontaires ». Ces derniers sont des organismes privés, reconnus par la Commission européenne, qui établissent des règles permettant d'attester lors d'un audit si les procédures misent en place dans une entreprise sont conformes à la directive RED, et assurent que les informations de durabilité qu'elle transmet à ses fournisseurs et reçoit de ses clients sont fiables. Le contrôle par les systèmes volontaires et les organismes de certification sont cadrés par les articles R.283-1 à R.283-23 du code de l'énergie.
Toutes les installations énergétiques concernées par les exigences de la directive doivent se soumettre à un tel audit annuel. Ses fournisseurs directs et indirects sont aussi concernés, en remontant jusqu'au « premier point de collecte » de la biomasse. Ce dernier est défini par le règlement délégué 2022/996 pris en application de la directive (UE) 2018/2001 comme « une installation de stockage ou de traitement gérée directement par un opérateur économique ou autre équivalent dans le cadre d'un accord contractuel, qui s'approvisionne en matières premières directement auprès de producteurs de biomasse agricole, biomasse forestière, déchets et résidus ou, dans le cas des carburants renouvelables d'origine non biologique, auprès de l'usine produisant ces carburants ». Dans le cadre de la procédure « d'audit de groupe », la certification obtenue par le premier point de collecte permet de dispenser les producteurs de biomasse auprès desquels il s'approvisionne d'une exigence d'audits annuels, limitant de fait le nombre d'entreprises devant être auditées.
Ø Estimation du nombre d'entreprises concernées
· Installations de production d'énergie (chaleur et/ou électricité) à partir de biomasse forestière ou de connexes de transformation
Selon le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE), interprofession représentant la filière amont et aval du bois-énergie, il y a environ 100 installations énergétiques supplémentaires obligées par la RED III qui n'étaient pas concernées par la RED II. Cette analyse est corroborée par les résultats du recensement mené par la DGEC. Cela conduit donc à un total de 230 installations environ en intégrant celles déjà concernées par RED II.
De manière schématique, sur la base d'une méthodologie développée ci-après dans la partie « impacts sur les collectivités territoriales », il sera considéré que 28 % des installations de production de chaleur et/ou électricité sont gérés par les collectivités et 72 % par les entreprises. On obtient donc 166 installations gérées par les entreprises et 64 par les collectivités, et parmi celles-ci il y a 72 nouvelles installations concernées par RED III gérées par des entreprises et 28 par des collectivités.
Il est difficile de dégager des caractéristiques moyennes pour ces entreprises, tant elles peuvent varier considérablement en nombre d'ETP comme en termes de rayon d'approvisionnement et de vente pour leur biomasse. Le secteur du bois-énergie est en effet caractérisé par la présence d'acteurs d'envergure nationale tout comme par de petites installations s'approvisionnant dans un rayon très local auprès de quelques fournisseurs limités.
· Fournisseurs directs et indirects
L'interprofession du bois-énergie met en avant environ 700 fournisseurs concernés par la RED II. Ceux-ci se répartissent en plusieurs typologies d'entreprises, qui se répartissent en deux principales catégories : des négociants ou revendeurs de biomasse, qui achètent et vendent de la matière, et des exploitants forestiers qui font office de « premier point de collecte » pour les exigences de la directive et qui s'approvisionnent chez plusieurs propriétaires forestiers. La possibilité de recourir à des audits de groupes permet aux propriétaires forestiers de ne pas avoir d'obligation de passer un audit, le coût de la certification reposant alors sur les fournisseurs plus en aval dans la chaîne de valeur (exploitant forestier ou transformateur ultérieur de la matière).
Sur la base du chiffre des fournisseurs concernés par la RED II, il est possible d'estimer de manière approximative le nombre de fournisseurs qui seront concernés suite à la transposition de la directive RED III à environ 1000 fournisseurs. En effet, l'augmentation du nombre de fournisseurs ne doit pas être prise de manière proportionnelle à la hausse des installations assujetties : les nouvelles installations concernées par la directive sont de taille plus faible, et ont donc un nombre de fournisseurs de biomasse plus faible. Il convient de se baser sur la hausse prévue en termes de volumes. Selon le CIBE, alors que 50% de la consommation totale de bois-énergie est aujourd'hui concernée par la directive RED II, ce chiffre montera à 70 % en intégrant les nouvelles installations énergétiques concernées par la RED III. Cela conduit donc à une hausse de 40 % des volumes de biomasse concernés, soit si on applique le même coefficient aux fournisseurs à environ 1000 fournisseurs impactés par la RED III au total, et parmi ceux-ci 300 qui n'étaient pas concernés par la RED II et seront impactés par la RED III. Il s'agit là d'une estimation maximaliste car en réalité, il est plus que probable que nombre de fournisseurs pris en compte ici sont en réalité déjà concernés par la directive au titre de l'approvisionnement d'une partie de leur clientèle.
Les caractéristiques moyennes de ces entreprises sont les suivantes, sur la base de données du CIBE mais aussi de l'investigation qualitative menée par l'administration auprès de nombreux acteurs de la filière.
|
Effectif (ETP) |
3 à 6 ETP |
|
Vente de biomasse (t/an) |
18 000 |
|
Origine de l'approvisionnement |
Majoritairement français |
|
Rayon d'approvisionnement maximum moyen (Km) |
80 |
|
Rayon de vente maximum moyen (Km) |
100 |
|
Nombre de clients concernés par la RED |
1 à 2 |
Ø Estimation des coûts liés à la certification
Il s'agit ensuite de déterminer le coût lié au processus d'audit annuel permettant la délivrance d'une certification. La certification implique trois types de coûts différents pour tous les acteurs, qu'ils soient opérateurs énergétiques ou fournisseurs :
a) Coûts inhérents à l'utilisation du système volontaire (droit d'usage de la marque / frais annuels, mais aussi frais liés à la déclaration de la biomasse comme étant durable) ;
b) Coûts pour l'organisme de certification (coût de la réalisation des audits) ;
c) Coûts internes liés à la gestion du système (coût de logistique interne, en termes de temps passé).
L'ensemble de ces coûts a été analysé sur la base d'entretiens avec des représentants de systèmes volontaires, d'organismes certificateurs et de représentants de la filière, menés durant l'été 2024, mais aussi avec des documents écrits consultés à cette période et valides alors. Ils sont donc exprimés en €2024.
a) Concernant les frais liés au système volontaire, nous avons pu obtenir des données concernant les deux principaux systèmes volontaires reconnus RED II et opérant dans le domaine du bois-énergie tant pour des installations de production d'énergie que des fournisseurs, à savoir SURE et SBP. Par souci d'anonymat, dans la suite de l'analyse de coûts ils seront nommés systèmes SV1 et SV2 de manière aléatoire.
Le système volontaire SV1 propose une même grille tarifaire pour toutes les installations de la chaîne de traçabilité, du producteur de granulés de bois ou de plaquettes forestières en passant par les négociants les fournisseurs intermédiaires et les installations énergétiques. Les frais annuels sont la somme des « frais de base » (forfaitaires) et des frais proportionnels à la quantité de biomasse déclarée comme durable, ces derniers étant plafonnés à 22 000 € annuels maximum (voir le tableau ci-dessous).
|
SV1 |
Frais communs à toutes les installations de la chaîne de traçabilité |
|||
|
Frais basés sur la quantité de biomasse certifiée durable, selon le type de biomasse, en €/tonne |
Granulés de bois |
Plaquettes forestières |
Montant Maximum |
|
|
0,10 €/tonne |
0,04 €/tonne |
22 000,00 € |
||
|
Frais annuel selon les tonnages
|
= 20 000 tonnes de biomasse |
= 50 000 tonnes de biomasse |
= 100 000 tonnes de biomasse |
> 100 000 tonnes de biomasse |
|
250,00 € |
750,00 € |
1 500,00 € |
3 000,00 € |
|
Le système volontaire SV2 propose une grille tarifaire distincte entre les producteurs de biomasse (au sens d'entité qui produit des granulés de bois ou des plaquettes forestières, soit légalement l'entité qui fait office de premier point de collecte au sens de la procédure d'audit de groupe) et les négociants intermédiaires ou installations énergétiques. Elle est résumée dans les tableaux ci-dessous.
Les producteurs de biomasse payent en outre pour SV2 des frais de transaction qui sont des frais proportionnels à la quantité de biomasse vendue, distincts selon le type (granulés de bois ou plaquettes forestières). Si ces frais de transactions dépassent le montant de la redevance fixe de 1000 € annuels, alors le producteur ne paye pas la redevance. En revanche, si les frais de transaction sont inférieurs à la redevance, alors seul le montant de la redevance est dû. Si aucun frais de transaction n'est engagé, la redevance est due en totalité.
|
SV3 |
Producteurs de biomasse |
|
|
Frais variables de transaction, en €/tonne |
Granulés de bois |
Plaquettes forestières |
|
0,19 €/tonne |
0,10 €/tonne |
|
|
Frais annuels fixes |
1 000 € |
1 000 € |
Les fournisseurs et les installations énergétiques paient quant à eux des frais de transaction fixes en fonction du volume annuel de biomasse vendue ou utilisée et déclarée comme durable au sens de la directive RED.
|
SV2 |
Négociants et installations énergétiques |
||
|
Quantité de biomasse déclarée comme durable (en tonnes) |
= 99 999 t |
= 249 999 t |
> 250 000 t |
|
Frais de transaction fixes (par an) |
1 200,00 € |
12 000 € |
30 000 € |
b) Concernant les coûts des audits d'un seul organisme de certification.
Plusieurs hypothèses peuvent être prises avant d'estimer les coûts liés à la procédure de certification :
· La France dispose d'une « analyse de risque faible » pour la durabilité de la biomasse forestière. Ceci est déjà le cas au titre de la directive RED II177(*) et devrait être le cas pour la directive RED III au vu de l'option de transposition choisie (voir ci-dessus)
· La matière première concernée provient à l'origine de propriétaires ou d'exploitants forestiers qui font l'objet d'une certification volontaire pour la gestion forestière auprès des référentiels PEFC ou FSC. En 2023, environ 52 % des volumes de bois commercialisés proviennent de forêts gérées durablement et certifiées (incluant le bois-énergie mais aussi le bois d'oeuvre et le bois d'industrie, dont les co-produits sous forme de connexes peuvent faire l'objet d'une valorisation énergétique)178(*)
· La matière première provient de France, ce qui est le cas pour la majorité des installations (90 % des tonnages de biomasse consommés en 2023 par des installations assujetties à la RED II provenaient de France179(*))
Les coûts liés à la procédure de certification (sur la base d'un audit annuel) dépendent de la structure de la chaîne de traçabilité, pour laquelle deux principaux scénarii existent d'après l'organisme certificateur sur lequel se sont basés ces estimations. Il est important de noter que ces deux scénarii correspondent à des cas où le nombre d'entités faisant l'objet d'un audit annuel est le plus faible, et poussant à leur maximum les simplifications permises par la notion d'audit de groupe encadrée dans le règlement d'exécution 2022/996.
Scénario 1
Dans ce scénario, deux entités légales sont certifiées pour chaque chaîne d'approvisionnement : l'utilisateur final et son fournisseur direct, qui a le statut de « premier point de collecte » en ce qu'il est l'entité produisant la biomasse consommée dans l'installation énergétique (plaquettes forestières, granulés de bois...). Les fournisseurs plus en amont dans la chaîne n'ont pas besoin d'être certifiés. Ce scénario est donc une vision simplifiée où seul un fournisseur doit être certifié, et ne couvre donc pas le cas qui existe également de chaînes de valeur plus complexes.
Scénario 2
Dans ce scénario, un unique certificat couvre l'ensemble de la chaîne de traçabilité, incluant l'installation énergétique ainsi que les fournisseurs allant jusqu'à la production de biomasse. Ce scénario de simplification maximal par rapport aux exigences de l'audit de groupe cadrées par le règlement d'exécution 2022/996 existe notamment quand un fournisseur fait partie de la même entité juridique que l'installation de production d'énergie. Il repose sur la réalisation d'audits de « seconde partie » par l'installation énergétique chez ses fournisseurs, qui a la responsabilité légale de démontrer la durabilité de toute sa chaîne d'approvisionnement à son auditeur, sans que ses fournisseurs ne soient eux-mêmes audités.
Les différents frais facturés pour la procédure d'audit annuel selon les deux scénarii sont indiqués dans le tableau ci-dessous, dans une fourchette variant légèrement en fonction de la taille de la chaîne de traçabilité ou des entreprises concernées.
|
Coût pour l'installation énergétique dans le scénario 1 |
Coût pour l'installation énergétique dans le scénario 2 et pour le fournisseur de biomasse dans le scénario 1 |
||
|
Coût minimal |
Coût maximal |
Coût minimal |
Coût maximal |
|
4 000,00 € |
6 000,00 € |
7 000,00 € |
13 000,00 € |
c) Enfin, les coûts de logistique interne liés à la gestion du système correspondent à la mise en oeuvre de la certification, aux développements informatiques supportés par les entreprises de la chaîne de valeur pour assurer la traçabilité de la biomasse durable, et principalement au temps consacré par les opérateurs. Ils sollicitent parfois l'aide d'un bureau d'étude. Selon le CIBE, ce coût de gestion interne vont autour de 7 000 à 14 000€ annuellement.
Ø Calcul de l'impact financier du système de certification pour la filière bois-énergie
Le calcul de l'impact financier du système de certification est pris sur la base d'hypothèses simplificatrices.
Pour les coûts liés à la gestion des systèmes volontaires :
· Un tonnage moyen de 22 000 tonnes de biomasse consommées par an pour les installations énergétiques est considéré ;
· Un tonnage de 18 000 tonnes de biomasse par an pour les producteurs de biomasse, réparti équitablement entre granulés de bois et plaquettes forestières (la moyenne du coût est considérée), est pris en compte ;
· La moyenne des coûts calculés pour chaque système volontaire SV1 et SV2 est ensuite prise pour aboutir à un coût unique de gestion des systèmes volontaires, différent pour les fournisseurs de biomasse et les installations énergétiques.
Pour le coût annuel des audits, une valeur moyenne globale est prise pour les installations énergétiques entre les coûts minimaux et maximaux estimés précédemment et entre les deux scénarii, ce qui amène à un coût de 7500 €. Pour les fournisseurs, une valeur moyenne de 10 000 € est prise pour tous correspondant à la moyenne du scénario 2.
Pour les coûts de gestion interne, une valeur moyenne est prise également à 10 500 € par opérateur, fournisseur ou installation énergétique.
Cela amène à un coût moyen par installation énergétique de 19 480 € annuels, et par fournisseur de 17 190 € annuels.
Soit donc au niveau français pour la RED III sur la base du nombre d'installations énergétiques et de fournisseurs considérés, environ 1,5 M€ supplémentaires pour les nouvelles installations énergétiques assujetties non gérées par des collectivités (au nombre de 78) et pour les fournisseurs un coût d'environ 5 M€ (300 fournisseurs supplémentaires), soit au total un coût annuel supplémentaire de plus de 6,5 M€ environ pour toutes les entreprises de la filière du bois-énergie.
Les coûts ci-dessous ne prennent pas en compte les coûts supportés par d'éventuelles nouvelles installations, compte-tenu de la difficulté à projeter un chiffre fiable. Ils ne prennent pas non plus en compte les baisse de coûts dans le temps liés aux effets d'apprentissage des entreprises dans le processus de rapportage au titre de la RED, ainsi que la baisse des coûts prévue dans le cadre de l'amélioration prévue des dispositifs de suivi et déclaration selon les travaux en cours menés par la DGEC pour proposer un outil numérique aux acteurs de la filière.
Enfin, ces coûts de conformité ne prennent pas en compte une hausse éventuelle des coûts de gestion de la biomasse par les différents gestionnaires liés à un renforcement de certaines exigences, ni l'augmentation du coût de cette même biomasse pour les utilisateurs. Cette estimation étant très difficile à construire.
4.2.3. Impacts budgétaires
On estime le besoin pour la RED III à 2 ETP supplémentaires au maximum en administration centrale, ce qui fait 5 ETP au total, catégorie A de la fonction publique d'Etat.
L'impact financier est calculé en multipliant le nombre d'ETP avec leur coût annuel180(*), exprimés en €2019.
Il s'agit là d'une estimation considérée comme maximaliste par la DGEC.
|
Répartition dans le temps des impacts financiers |
|||||
|
Année N+1 |
Année N+2 |
Année N+3 |
Année 4 (si nécessaire) |
Année 5 (si nécessaire) |
|
|
Coûts |
333 500 € |
333 500 € |
333 500 € |
333 500 € |
333 500 € |
|
Gains |
|||||
|
Impact net |
333 500 € |
333 500 € |
333 500 € |
333 500 € |
333 500 € |
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les collectivités territoriales sont concernées au titre de la gestion de réseaux de chaleur fonctionnant à partir de biomasse. Selon le mode de gestion choisi pour l'exploitation du service public de chaleur, les collectivités peuvent être en charge de l'intégralité de la gestion du réseau et donc en supporter les coûts liés aux exigences de durabilité de la directive RED sur le modèle décrit ci-dessus pour les entreprises de production d'énergie.
Afin de prendre en compte la répartition de la gestion des installations entre collectivité et entreprise, l'édition 2022 de l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid de la Fédération des services Energie Environnement (FEDENE), fédération professionnelle des entreprises de services pour l'énergie et l'environnement, fournit la répartition des réseaux de chaleur selon leur mode de gestion :
Figure 1 : Mode de gestions des réseaux de chaleur en France en 2021 en nombre de réseaux. Source : https://reseaux-chaleur.cerema.fr/sites/reseaux-chaleur-v2/files/inline-files/FEDENE_Rapport-de-lenquete-annuel-des-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-edition-2022.pdf
Ainsi, pour les réseaux de chaleur en situation de régie internalisée (17 % des réseaux de chaleur), ainsi que ceux en gestion publique « autre », avec ou sans contrat d'exploitation (11 % des réseaux de chaleur), il peut être considéré que tous les coûts sont supportés par la collectivité. Pour les autres réseaux de chaleur, en situation de régie ou de délégation de service public, mais qui sont bien une propriété d'une collectivité (53 % des réseaux de chaleur), il est considéré que les collectivités ont tout de même un rôle de suivi de l'approvisionnement en biomasse, de mise à jour des systèmes internes permettant un suivi des informations de traçabilité, la transmission des déclarations de durabilité à l'administration, la gestion des installations, et la vérification de la conformité des prestataires ou des entreprises en gestion déléguée. Les coûts de gestion par installation en régie supportés par les collectivités sont donc pris comme équivalents à ceux des entreprises (voir partie supra). En cas de gestion déléguée, il est estimé que les coûts sont entièrement à la charge des entreprises délégataires.
En considérant que le gestionnaire du réseau gère aussi les chaufferies concernées, il y a donc 28 % des réseaux sont gérés par les collectivités et 72 % par les entreprises. On obtient donc 166 installations gérées par les entreprises et 64 par les collectivités, parmi lesquelles 24 concernées par le passage de RED II à RED III.
Les différents coûts inhérents à la certification sont détaillés ci-dessous dans les coûts pour l'entreprise. L'impact financier est donc calculé en additionnant les coûts de logistique interne, d'adhésion au système volontaire et de certification (audit annuel) puis en les multipliant par le nombre total d'installations gérées par les collectivités. Pour les coûts de certification liés au tonnage de biomasse, les quantités des cas types présentés dans la partie relative aux impacts sur les entreprises ont été utilisés. Cela abouti donc à un coût annuel de l'ordre de 20 000 € par installation énergétique, ce qui conduit pour les 28 nouvelles installations gérées par des collectivités à un coût annuel total de la transposition de RED III de l'ordre de 500 000 à 600 000 € pour les collectivités territoriales exploitant des réseaux de chaleur.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Ø Impacts sur l'administration centrale
Le rôle de l'administration centrale est de coordonner la mise en oeuvre de la politique, suivre et gérer les déclarations de durabilité, et de suivre et vérifier les différentes informations collectées. Elle apporte également un soutien aux services déconcentrés et aux administrations publiques et se charge de l'analyse des données. Ce sont des fonctions déjà exercée pour la RED II, mais la charge de travail est amenée à augmenter du fait de l'augmentation du nombre d'installations obligées et de l'augmentation des exigences, notamment pour la biomasse forestière.
A cela s'ajoutera également la supervision et le soutien aux cellules biomasse dans l'application du principe d'utilisation en cascade nouvellement introduit, même si la mise en oeuvre s'appuiera sur un dispositif administratif existant.
Comme discuté en supra, des travaux sont également menés pour le développement d'un outil numérique facilitant la transmission des informations de traçabilité pour le bois-énergie. Cela réduira la charge administrative sur les entreprises, mais conduira à davantage de mobilisation des services d'administration centrale pour le suivi du logiciel.
Aujourd'hui, la mise en oeuvre de la durabilité des bioénergies au sens de la RED II mobilise de l'ordre de 3 ETP maximum en administration centrale. On estime le besoin pour la RED III à 2 ETP supplémentaires au maximum en administration centrale, ce qui fait 5 ETP au total, catégorie A de la fonction publique d'Etat.
Ø Impacts sur les services déconcentrés de l'Etat
Les cellules biomasse, composées de l'ADEME en région, des D(R)EAL, des D(R)AAF et des D(R)EETS (depuis 2024), ont une expertise sur les plans d'approvisionnement des projets et appuient l'avis du préfet de région dans le cadre des appels d'offres et des appels à projets concernant la biomasse, en vue de prévenir les conflits d'usage en lien avec la biomasse. Elles réalisent également un suivi de l'utilisation des ressources en biomasse. Le principe d'utilisation en cascade correspond à la continuité du rôle des cellules biomasse, elles seront donc chargées de l'appliquer.
On peut estimer grossièrement qu'à ce stade, la mise en oeuvre de la directive RED II occupe déjà de l'ordre de 50 % d'un ETP par DREAL (au sein des services énergie) et 50 % d'un ETP entre l'ADEME, les DREETS et les DRAAF (par région).
La mise en oeuvre globale de la RED III consolidée mobiliserait, de façon additionnelle, de l'ordre de 1 ETP maximum au total, réparti entre DREAL, DRAAF, DREETS et direction régionale de l'ADEME, catégorie A de la fonction publique d'Etat, à raison de 66 700 €2019 1 par ETP.
L'impact financier est calculé en multipliant le nombre d'ETP (2) par leur coût annuel par le nombre de régions (18).
Il s'agit là d'un maximum d'une estimation considérée comme maximaliste par la DGEC, notamment parce que l'activité dans certaines régions serait en réalité plus faible (notamment en Outre-Mer). Il convient de souligner que les missions spécifiques à la directive RED viendront s'articuler avec des missions relatives à la biomasse plus génériques, s'y substituer dans certains cas, et que l'impact estimé ci-dessus n'est pas nécessairement à entendre comme « un besoin additionnel net en ETP ». L'administration s'emploie à animer des discussions avec les services déconcentrés afin de renforcer les synergies.
Aucun impact n'est anticipé pour les acteurs départementaux.
|
Répartition dans le temps des impacts financiers |
|||||
|
Année N+1 |
Année N+2 |
Année N+3 |
Année 4 (si nécessaire) |
Année 5 (si nécessaire) |
|
|
Coûts |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
|
Gains |
|||||
|
Impact net |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
2 401 200 € |
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Voir impacts environnementaux et sur les particuliers infra et impacts sur les entreprises supra.
Il n'y a pas d'impact sur le marché du travail et de l'emploi autre que les impacts indirects dus aux incidences économiques de la hausse des prix des énergies fossiles.
La RED III permet l'amélioration de la connaissance de la provenance des intrants des installations de production de bioénergie et de la transparence sur la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre des dispositions relatives à la collecte de données transposées dans le principe d'utilisation en cascade. En tenant compte des contraintes liées au respect du secret des affaires, ce reporting pourrait conduire à alimenter des outils de visualisation des ressources en biomasse sur le territoire hexagonal, notamment l'outil Cartofob181(*).
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Néant. Les dispositions de la directive RED III, tant pour les critères de durabilité que pour l'utilisation en cascade dans l'option de transposition retenue, ne concernent pas l'utilisation que font les particuliers de la biomasse (notamment, pour le chauffage domestique).
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L'objet même de la directive transposée est d'avoir un impact bénéfique sur l'environnement, en garantissant le caractère durable de l'énergie produite à partir de biomasse et en assurant que celle-ci soit utilisée pour sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée selon le principe d'utilisation en cascade.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Trois différents groupes de travail réunissant les parties prenantes (entreprises, associations, interprofession) et dédiés à la transposition des différents aspects des articles 3 et 29 révisés de la directive RED ont été créés :
· Un groupe de travail sur le principe d'utilisation en cascade de la biomasse et les restrictions apportées aux aides publiques en faveur de la biomasse ;
· Un groupe de travail sur les nouveaux critères de durabilité introduits par la directive RED III pour la biomasse forestière (zones interdites, critères relatifs à l'impact de la sylviculture sur les sols et la biodiversité)
· Un groupe de travail sur des sujets divers, traitant notamment de l'abaissement des seuils d'assujettissement à la directive et de l'extension du critère de réduction de gaz à effet de serre
· Un groupe de travail spécifique sur l'application des nouvelles dispositions aux territoires ultramarins (régions ultrapériphériques en droit européen)
Ces groupes de travail ont menés des réunions entre mai et septembre 2024.
Des contributions de différentes parties prenantes ont également été collectées et ont fait l'objet d'échanges entre les services de l'Etat et ces dernières.
Ces consultations reprendront dans le cadre de la préparation des textes réglementaires.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 02 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les délais de transposition de la directive (UE) 2023/2413 sont identiques pour l'ensemble du territoire de l'Union. L'échéance de transposition des articles 3 et 29 de la directive (UE) 2018/2001 révisée est fixée par la directive (UE) 2023/2413 au 21 mai 2025.
Les présents articles s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions envisagées sont applicables sur tout le territoire de France hexagonale. Certaines dispositions visées concernent également la biomasse importée sur le territoire français et dans les territoires ultramarins où ces articles s'appliquent : les critères de durabilité de l'article 29 de la directive RED s'appliquent ainsi à toute biomasse consommée dans les territoires concernés par ces dispositions dans une installation de production d'énergie assujettie à la directive. Le respect de ces critères se vérifie selon un principe d'analyse de risque fondé sur le droit national du pays d'origine, contrôlé dans le cadre des audits annuels auxquels se soumettent les opérateurs.
La biomasse importée est donc également soumise à ces articles, sauf pour ceux portant expressément sur la biomasse « produite sur le territoire national », qui visent à garantir la conformité du droit français avec les dispositions de la directive RED afin de sécuriser une analyse de risque faible (voir supra).
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions des présents articles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Application de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au principe d'identité législative : le droit de l'énergie national s'applique de plein droit dans ces collectivités sauf dans les matières relevant de leur compétence propre ou celles constituant leurs règles statutaires en application de l'article 74 de la Constitution.
Toutefois, les articles LO 6214-3, LO 6314-3, LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confèrent à ces collectivités des matières relevant de la compétence de l'Etat :
· A la lecture de l'article LO 6213-1 du CGCT renvoyant à l'article LO6214-3 du même code, la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente pour fixer les règles relatives à l'énergie ;
· Eu égard à l'article LO 6313-1 du CGCT renvoyant à l'article LO 6314-3 du même code, Saint-Martin est compétente en matière d'énergie ;
· Au regard de l'article LO6413-1 du CGCT renvoyant à l'article LO6414-1 du même code, l'Etat est compétent en matière d'énergie à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions des présents articles sont donc applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bien que soumis au droit communautaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à Saint-Martin, la collectivité étant compétente en matière d'énergie.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
· Il résulte du 26° de l'article 22 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d'énergie ;
· Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 reconnait une compétence de principe à la Polynésie française et une compétence d'attribution à l'Etat. Au regard de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004, la Polynésie française est compétente en matière d'énergie ;
· A Wallis-et-Futuna, eu égard à l'article 12 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 renvoyant au décret n°57-811 du 22 juillet 1957, l'Etat est compétent en matière d'énergie.
Les présentes dispositions s'appliquent donc à Wallis-et-Futuna.
Mesures d'adaptation prévues pour les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer concernés
L'article L. 281-12 du code de l'énergie, légèrement modifié par la transposition, dispose que les installations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, et les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, peuvent déroger aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre tels que transposés par les présents articles, en respectant des critères différents qui doivent être établis. Cette dérogation permet à ces installations d'avoir droit à des avantages fiscaux et aides publiques, mais elle ne permet pas à l'énergie produite d'être comptabilisée comme renouvelable dans le rapportage statistique établi par la France au niveau européen, ni à cette énergie de contribuer aux objectifs d'intégration d'énergie renouvelable dans différents secteurs et au global fixés par la directive RED III.
Il convient toutefois de noter que la prise de ces critères dérogatoires ne concerne que le cadre juridique de la directive RED, telle que transposée dans le code de l'énergie. Les installations concernées par le système européen d'échange de quota d'émissions (SEQE - ETS dans son acronyme anglais) doivent donc toujours respecter les critères de droit commun fixés par la directive, sous peine de payer des quotas. Cela représente un volume théorique d'environ 200 M€ pour toutes les installations de production d'énergie à partir de biomasse concernées et situées sur ces territoires. Au vu des fortes contraintes qui pèsent sur ces installations par rapport à leurs homologues situées en Europe continentale, liées tant aux fortes températures et à une diversité de biomasse utilisées qui limitent leur rendement qu'aux spécificités des réseaux électriques des zones non-interconnectées, des discussions sont en cours entre la France et la Commission européenne afin de proposer des adaptations spécifiques du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive RED, afin de l'aligner avec les spécificités de ces territoires.
Le décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d'outre-mer a permis de prendre en droit français des dérogations pour la biomasse utilisée en Guyane et à La Réunion dans le cadre de l'application de la directive RED II. La transposition visée par cette loi devra conduire à la prise d'un décret similaire permettant de préciser les critères de durabilité dérogatoires qui s'appliquent à la biomasse et aux installations utilisant de la biomasse pour la production d'énergie dans les territoires ultramarins susvisés dans le cadre de la directive RED III. Au vu de la hausse importante des installations concernées, tant en raison de la baisse du seuil d'assujettissement à la directive pour les installations consommant de la biomasse solide (qui passe de 20 à 7,5 MW) que de l'extension du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce décret concernera davantage de territoires que le décret pris dans le cadre de RED II.
Ce décret devra en outre être adapté afin de transposer les dérogations prévues à l'article 3.3 quinquies relatif à l'interdiction des aides à la production d'électricité à partir de biomasse forestière dans des installations exclusivement électriques, qui définit des modalités permettant à une telle aide d'être octroyée dans les régions ultrapériphériques.
Enfin, concernant le principe d'utilisation en cascade de la biomasse, son application dans les territoires ultramarins susvisés ne peut faire l'objet d'aucune dérogation spécifique. Toutefois, au vu de l'importance des installations de production d'énergie à partir de biomasse pour la sécurité énergétique de ces territoires, des dérogations pourront être prises à ce titre par voie réglementaire au titre de la « sécurité de l'approvisionnement énergétique » telle que visée à l'article 3.3bis de la directive RED III, comme transposé par les présentes dispositions.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat et plusieurs textes réglementaires ultérieurs (arrêtés, décret relatif aux Outre-Mer pris en application de l'article L.281-12...) fixeront les modalités d'applications de plusieurs dispositions introduites, comme discuté en supra, nécessaires pour l'entrée en vigueur des dispositions.
Article 42 - Introduction de l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone dans les Carburants
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le « Pacte vert pour l'Europe » fixe un objectif de neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, la Commission européenne a présenté le 14 juillet 2021 un ensemble de propositions visant à réviser et à actualiser la législation de l'UE : le paquet dit « Fit for 55 » (paquet d'ajustement à l'objectif 55) qui vise une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à leur niveau de 1990.
Adoptée dans le paquet législatif « Fit for 55 », la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion des énergies renouvelables, dite RED III, revoit à la hausse les objectifs de la directive 2018/2001 dite RED II. Elle demande aux Etats membres de se fixer un objectif pour 2030 soit de 14,5% de réduction de l'intensité carbone soit de 29% d'énergie renouvelable incorporée sur l'ensemble du secteur des transports en 2030. Par ailleurs, les Etats membres doivent atteindre des objectifs de biocarburants avancés182(*) et de carburants de synthèse183(*) de 5,5% de la consommation d'énergie des transports en 2030, dont un point de pourcentage pour les carburants de synthèse, après application du double comptage.
Également adopté dans le paquet législatif « Fit for 55 », le règlement relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, dit FuelEU Maritime, crée une obligation sur le secteur maritime. Il s'applique aux compagnies maritimes, et fixe une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des navires (jauge supérieure à 5000 unités) entre 2025 et 2050, avec des flexibilités pour pouvoir les atteindre. Toutefois, ce règlement ne cible pas les navires inférieurs à 5000 unités qui soutent en France, et qui sont majoritaires.
Enfin, le paquet législatif « Fit for 55 » contient le règlement européen 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) établit des règles harmonisées pour l'utilisation et la fourniture de carburants d'aviation durables (CAD). Ce règlement spécifie cependant qu'aucune obligation supplémentaire ne peut peser sur les compagnies aériennes. Les biocarburants incorporés sur le sol français sont comptabilisés pour l'atteinte de l'objectif de la directive RED III, et il découle du règlement RefuelEU Aviation que ce sont les volumes de carburants incorporés au titre de règlement qui seront comptabilisés.
L'ensemble de ces changements de réglementation européenne suggèrent à la France d'adapter son mécanisme d'incitation à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la Taxe Incitative relative à l'Utilisation d'Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT), issu d'une transposition de la directive 2018/2001 dite RED II, pour l'étendre à toutes les énergies de la mobilité, en assurant une juste articulation avec les règlementations sectorielles européennes.
Prévue à l' article 266 quindecies du code des douanes, la TIRUERT est une taxe comportementale. Elle incite les distributeurs de carburants à utiliser une part d'énergie renouvelable dans les carburants gazoles, essences et carburéacteurs (jusqu'en 2025184(*)), avec des objectifs séparés par filière, au-delà desquels le montant de la taxe est nul pour le redevable. La taxe est proportionnelle au volume de carburant renouvelable manquant par rapport à l'objectif. Pour atteindre cet objectif, l'usage des biocarburants en concurrence avec les usages alimentaires, dits « 1G », est limité à 7% de la consommation des gazoles et des essences.
La TIRUERT constitue aujourd'hui une incitation efficace
à la consommation d'énergie renouvelable dans les filières
visées. Grâce à son mode de fonctionnement, elle permet
d'inciter certains vecteurs énergétiques considérés
plus vertueux, notamment les biocarburants
« avancés ».
La TIRUERT a vu ses objectifs d'énergie renouvelable (ENR) croître
progressivement de 2014 (à l'époque Taxe Générale
sur les Activités Polluantes) à 2025. De plus, depuis 2016, les
objectifs sont atteints pour l'ensemble des filières, à
l'exception de l'année 2022 affectée par la crise
énergétique découlant de la guerre en Ukraine. Le montant
de la pénalité a été significativement
relevé dès 2023, afin d'assurer la compétitivité du
marché français (la pénalité étant
libératoire, son montant doit être supérieur aux prix de
marché).
Si la TIRUERT a notamment permis de renforcer les filières de production de biocarburants, elle ne répond plus efficacement au besoin d'accélération de la décarbonation des transports. Une consultation publique organisée en 2023 a confirmé que la flexibilité initiale de ses objectifs, revus tous les ans et fixés sur deux ans, constituait désormais un manque de visibilité, frein aux investissements de plus long terme sur le territoire. Ces éléments ont justifié la présente proposition de dispositif sur 10 ans, apportant une visibilité suffisante pour déclencher des investissements dans les filières de production de carburants alternatifs.
De plus, la TIRUERT ne tient pas compte de l'efficacité environnementale des carburants. Ainsi, les carburants durables les plus performants, y compris ceux produits en France, peuvent être orientés vers d'autres États membres où les conditions économiques sont plus incitatives. C'est pourquoi le présent article propose un mécanisme cette fois fondé sur la réduction d'intensité carbone, neutre technologiquement et assurant une meilleure décarbonation des mobilités en France.
Enfin, le cadre européen, articulant plusieurs textes sectoriels et de nombreuses contraintes, a nécessité un changement de paradigme, d'une taxation comportementale à une obligation assortie de plusieurs pénalités inscrites dans la loi. L'articulation d'un faisceau de contraintes nécessite des discussions techniques avec les filières pour estimer leurs capacités de production, déterminer les ajustements de marché (place de l'électricité notamment) en modérant in fine les hausses de prix. Si une trajectoire globale est proposée dans cet article, c'est la raison pour laquelle des coefficients d'intégration temporelle et sous-objectifs définis par vecteur énergétique sont renvoyés à la prise en compte d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre des douanes.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La présente mesure ne porte pas préjudice au regard du principe d'égalité devant la loi (article 6 DDHC) et les charges publiques (article 13 DDHC). En effet, la mesure étend le champ d'application de la TIRUERT définie par l'article 266 quindecies du code des douanes, en recouvrant l'ensemble des metteurs à la consommation de produits énergétiques destinés à la carburation. Les exemptions du champ d'application de l'obligation sont limitées i) au secteur aérien, déjà visé par le règlement RefuelEU Aviation185(*), en application ; ii) au gazole pêche, dont ni la logistique (seuls certains metteurs à la consommation peuvent aujourd'hui incorporer des HVO C3 dans le gazole pêche, du fait d'un manque de disponibilité) ni les contraintes économiques spécifiques au secteur ne permettent l'application d'une obligation.
Saisi sur la question de l'égalité devant la loi et devant les charges publiques permise par la TIRUERT, le juge constitutionnel avait eu l'occasion de se prononcer sur son respect, en rejetant le grief tiré de la méconnaissance de ces principes186(*). A l'inverse, les droits à minoration de l'obligation sont ciblés et ouverts aux secteurs qui permettent une décarbonation du secteur des mobilités qui permet l'atteinte de l'objectif national de réduction d'intensité carbone de 14,5% en 2030 (véhicules électriques dans les bornes de recharge publiques, à l'instar de la TIRUERT, ainsi que les poids lourds les plus émetteurs).
Les sanctions sont établies sur une base linéaire provenant de la précédente TIRUERT, en les relevant du taux d'inflation moyen. En outre, la consultation publique organisée du 12 mai au 10 juin 2025 n'a pas relevé de difficulté de proportionnalité des sanctions.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte de l'environnement de 2004, « comme l'ensemble des droits et devoirs [qui y sont] définis, ont valeur constitutionnelle [et] s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ». L'article 1er de cette Charte dispose que : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les textes européens concernés sont :
- La directive 2023/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, révisée par la directive 2023/2413 du parlement européen et du conseil du 18 octobre 2023 qui oblige par son article 25 les États membres à réduire leurs émissions de GES des transports à travers un système d'obligation reposant sur les metteurs à consommation de carburants ;
- Le règlement 2023/1805 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime. Il encourage l'utilisation de carburants renouvelables à faibles émission de carbone et de technologies énergétiques propres, en fixant un objectif de réduction d'intensité carbone à tous les navires commerciaux de plus de 5000 GT faisant escale dans les ports de l'UE.
Les textes européens mentionnés s'inscrivent dans un cadre conventionnel international et européen et s'articulent avec les autres textes qui portent sur le transport. En particulier, le règlement 2023/1824 du parlement européen et du conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE fixe une obligation de maillage du territoire en bornes de recharge publiques (IRVE), que ce texte permet d'atteindre. En effet, les exploitants d'IRVE peuvent émettre des certificats, valorisés sur le marché, qui réduisent le coût d'exploitation des bornes de recharge et constituent donc une incitation bénéfique au respect de ce règlement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Si la date de transposition de la directive 2023/2413 était fixée au 21 mai 2025, seul le Danemark a déjà transposé en droit interne les obligations sur le transport. Le projet Danois habilite le ministre du climat, de l'énergie et des services publics de l'énergie à transposer le texte par voie réglementaire. Il fixe un objectif de réduction d'intensité carbone de 7% en 2030, un chiffre inférieur à celui ici présenté (10,7%), la part d'énergies renouvelables dans le mix électrique danois étant trois fois supérieure à celle française. Par ailleurs, plusieurs projets ont été soumis à la consultation du public (Pays-Bas, Allemagne, etc.), proches du projet proposé au travers du présent article. Les principales différences entre projets portent sur le choix de l'objectif final retenu, la plupart des Etats membres ayant privilégié un objectif de 29% d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelable.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La présente mesure constitue une transposition de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion des énergies renouvelables, a fixé aux Etats membres une échéance de transposition au 21 mai 2025, notamment ses articles 25, 26, 27 et 31 bis. Elle nécessite de mettre en conformité le droit national avec cette directive, notamment en modifiant l'article L. 641-6 du code de l'énergie. Elle implique également la suppression de la TIRUERT et l'abrogation de la TIRUERT GES, respectivement inscrites aux articles 266 quindecies et 266 sexdecies du code des douanes.
Il est donc nécessaire de mettre en cohérence l'objectif national avec celui désormais fixé par la règlementation européenne, en faisant explicitement référence au règlement (UE) 2019/631 (modifié par le règlement (UE) 2023/851), afin que leur divergence ne soit pas une source de confusion pour le citoyen. L'objectif national actuel étant inscrit dans la loi, sa modification ne peut intervenir que par voie législative. Cette mise en cohérence s'explique par les principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, consacrés par le Conseil constitutionnel en tant qu'objectifs à valeurs constitutionnelle dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative à certains codes.
Enfin, l'adaptation du régime des sanctions relève du domaine de la loi conformément à l'article 34 de la Constitution. Le vecteur législatif de la loi DDADUE a donc été retenu.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La présente mesure vise une mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2023/2413 et son articulation avec le règlement (UE) FuelEU Maritime. Elle vise donc la création d'un mécanisme qui soutient :
- L'atteinte d'une réduction de l'intensité carbone de l'ensemble du secteur des transports en 2030, par rapport au combustible de référence défini par la directive RED3, en parallèle de l'électrification du parc privé ;
- La mise en place d'une trajectoire, lissant cette décarbonation ;
- La consommation d'énergie renouvelable dans le secteur des transports ;
- La juste contribution de chaque vecteur énergétique à ces objectifs ;
- L'atteinte d'un objectif partagé de 5,5% entre biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique ;
- La mise en place d'un marché d'échange de certificats, qui permettra notamment aux opérateurs de bornes de recharge électrique ou pour véhicules à hydrogène de financer une partie de leurs coûts opérationnels ;
- La mise en place d'un cadre de sanctions dissuasives.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il avait été envisagé un dispositif passant l'objectif d'incorporation à 29% d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables dans la consommation finale des transports en 2030, selon l'architecture actuelle de la TIRUERT. Toutefois, cette méthode n'aurait permis de remplir les objectifs détaillés au point 2.2 et aurait été de moindre efficacité climatique. Elle n'aurait pas conduit à la prise en compte des réductions carbone sur l'ensemble du cycle de vie des carburants alternatifs (culture, production, transport, etc.), à l'inverse de l'objectif de réduction d'intensité carbone. Ainsi, elle aurait signifié une moindre ambition climatique, tout en désavantageant des productions issues de filières nationales respectueuses de l'environnement, qui n'auraient pas été valorisées en fonction de leurs pratiques vertueuses. Aussi, avec un mix électrique dans lequel les sources d'énergies renouvelables représentent environ 27% en 2023187(*), toute électrification supplémentaire aurait éloigné la France de son objectif et nécessité l'incorporation de davantage de carburants alternatifs.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article propose de remplacer la TIRUERT par un dispositif non fiscal fixant trois types d'objectifs reposant sur les metteurs à consommation, jusqu'en 2035 :
· Un objectif annuel de réduction de l'intensité carbone de l'ensemble des carburants distribués, inscrit dans la loi. Il est à noter que cet objectif est inférieur à 14,5%, ce chiffre étant atteint en comptabilisant, par ailleurs, la réduction d'intensité carbone permise par l'électrification du parc privé de véhicules et l'électrification ferroviaire, donc les trajectoires sont définies par la Stratégie nationale bas carbone.
· Des objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable séparés par filière de carburant, garantissant leur contribution respective et limitant partiellement la concurrence entre filières, déterminés par voie réglementaire ;
· Des objectifs garantissant un usage minimal de biocarburants avancés et d'hydrogène renouvelable et bas carbone, fixés par la directive RED III, déterminés par voie réglementaire.
Les objectifs sont déterminés sur le fondement des émissions relatives de l'ensemble des carburants distribués par les metteurs à consommation, soit les filières de carburants déjà visées par la TIRUERT :
- Les gazoles, incluant le GNR. A l'exception du gazole pêche, la mise en place d'une logistique dédiée, au vu des volumes en jeu et de la situation financière du secteur, n'étant pas souhaitée.
- Les essences, à l'exception des essences d'aviation, en raison de contraintes techniques et de risque de concurrence avec les carburéacteurs, couverts par le règlement RefuelEU Aviation
Auxquelles seraient inclus :
- Les carburants des secteurs maritime et fluvial (Fioul lourd, DML, gazole, GNL)
- Les gaz carburants (GNV, GPL)
L'atteinte de l'objectif de réduction d'intensité carbone devrait être justifiée par les obligés (metteurs à la consommation) au moyen de certificats de réduction de l'intensité carbone du carburant durable consommé. Ces certificats devraient être établis sur le fondement d'une comptabilité relative aux flux physiques et comptables de carburants alternatifs et d'électricité. L'ensemble du suivi des certificats serait dématérialisé, via un registre en ligne, CarbuRe, qui permettrait de définir au 31 mars de d'année suivante l'atteinte ou non des objectifs. La distribution d'électricité renouvelable dans des installations de recharge publiques pour les véhicules électriques ou dans les installations privées de recharge de poids lourds, et d'hydrogène renouvelable ou bas carbone utilisé dans la mobilité, permettrait de produire des certificats, qui contribueraient à l'atteinte de cet objectif. Les certificats liés à la distribution d'hydrogène contribueront uniquement à l'atteinte des sous-objectifs sur l'hydrogène et ses dérivés, tout en réduisant l'objectif global de réduction d'intensité carbone. En cas de non atteinte des objectifs, les pénalités pourraient être celles-ci-dessous, déterminées au regard des pénalités de la TIRUERT en 2025 et calculées pour être suffisamment dissuasives.
Le cadre général, la trajectoire de réduction d'intensité carbone de 2026 à 2035 et le montant des pénalités en cas de manquement seraient fixés par la loi. Les trajectoires des sous-objectifs, les conditions d'éligibilité et les modalités de traçabilité de l'énergie durable pour justifier l'atteinte des objectifs relèvent du niveau règlementaire.
Deux éléments essentiels de ce dispositif sont, d'une part, qu'il n'aurait pas un caractère fiscal et, d'autre part, qu'il organise une articulation des différents critères plutôt qu'une juxtaposition de manière indépendante. Ces deux éléments sont incontournables afin d'assurer la robustesse du nouveau cadre juridique au jeu des différentes contraintes européennes (cadre propre aux énergies renouvelables, droit des aides d'État, droit fiscal harmonisé) et de disposer de la souplesse nécessaire pour gérer les différentes situations, en particulier préserver l'équilibre des filières et réagir face aux imprévus.
Tableau présentant le niveau de pénalités de chacun des objectifs et sous-objectifs du dispositif :
|
Obligation concernée |
Référence |
Unité |
Montant de la pénalité |
|
Réduction d'intensité carbone |
Article L. 287-5 du code de l'énergie |
Euro par tonne de CO2 non évitée |
950 |
|
Part de carburants renouvelables ou bas carbone dans les filières soumises à sous-objectifs |
2° de l'article L. 287-3 du code de l'énergie |
Euro par gigajoule d'énergie manquant |
55 |
|
Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas carbone |
2° de l'article L. 287-3 du code de l'énergie |
Euro par gigajoule d'énergie manquant |
110 |
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les présentes dispositions prévoient les modifications suivantes :
- Ajout d'un chapitre VII intitulé « Dispositif de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes » au titre VIII du livre II du code de l'énergie comprenant les nouveaux articles L. 287-1 à 287-25 ;
- Abrogation de l'article L. 641-6 du code de l'énergie ;
- Ajout de références au nouvel article L287-22 au 21° de l'article L330-2 du code de la route.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente mesure vise une mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil. Elle assure notamment son articulation avec le règlement 2023/1805 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Parmi les premiers consommateurs de biocarburants dans l'Union européenne, la France a incorporé environ 5,5 millions de m de biocarburants en 2023188(*), majoritairement dans les gazoles. L'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone des Carburants (IRICC) constitue le mécanisme qui renforcera le marché des biocarburants, qui doit plus que doubler pour atteindre entre 50 et 55 TWh en 2030 puis entre 70 et 90 TWh en 2035 d'après les chiffres du projet de 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. La consolidation d'une filière nationale s'avère donc stratégique, d'autant qu'elle représente près de 29 000 emplois directs et indirects répartis entre production, logistique et distribution, et s'appuie sur des acteurs clés déjà engagés dans la reconversion industrielle. En donnant une trajectoire sur 10 ans à toute la filière, en sélectionnant les biocarburants les plus vertueux en termes de réduction carbone et en améliorant les conditions de traçabilité, l'IRICC doit ainsi permettre d'établir un cadre concurrentiel équitable, de stimuler l'investissement dans de nouvelles capacités industrielles et de sécuriser l'approvisionnement en biocarburants. Il se traduirait par un surcoût pour le consommateur, détaillé ci-dessous.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Ø Impacts généraux
L'ensemble des entreprises du transport (à l'exception des entreprises du secteur aérien et de la pêche) seront concernées par l'IRICC, qui représentera à la fois un nouveau cadre réglementaire, et renforcera les filières de production de carburants alternatifs.
Pour tous les metteurs à la consommation, sur lesquels repose le mécanisme, l'IRICC constituera un cadre réglementaire fixant plusieurs objectifs : un objectif global de réduction d'intensité carbone ; un sous-objectif d'incorporation d'énergies renouvelables, un objectif de biocarburants avancés et un objectif de carburants renouvelables ou bas carbone d'origine non biologique. Ces objectifs pourront soit être atteints par l'incorporation desdites énergies, soit par l'achat de certificats. Ils garantiront la décarbonation progressive de ces acteurs.
En parallèle de ces objectifs, la gestion du dispositif sera largement simplifiée pour les acteurs. La gestion des obligations sera ainsi entièrement dématérialisée et centralisée via le registre CarbuRe, là où la TIRUERT nécessitait le remplissage de formulaires douaniers sous format papier. Le registre CarbuRe simplifiera le suivi des certificats de réduction d'intensité carbone, et de surcroît réduira significativement la charge administrative pour les entreprises au regard de la TIRUERT, notamment les PME/TPE. En effet, un tableau de bord permettra à chaque metteur à la consommation de suivre l'atteinte de ses objectifs. En améliorant la traçabilité et la sécurité des opérations, cette dématérialisation répond à une demande de longue date des acteurs du secteur. Enfin, par sa gratuité et sa facilité d'utilisation, le registre CarbuRe dispensera les opérateurs des frais liés à l'installation de logiciels supplémentaires, et réduira les coûts de mise en conformité des TPE/PME.
Grâce à la connexion de CarbuRe à l'Union Database for biofuel (UDB) opéré par la Commission Européenne, les entreprises pourront également centraliser leurs données, ce qui assurera leur conformité aux exigences européennes, sans double déclaration.
Du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026, il est prévu une période d'adaptation, pour éviter les contraintes opérationnelles lors du passage du système papier à celui numérique consistant à réaliser les déclarations de la TIRUERT selon les nouvelles dispositions du dispositif. En parallèle, seront organisés des webinaires, tandis qu'un guide détaillé et une équipe de support de la DGEC faciliteront la transition. Conçu de manière agile, le système intégrera les retours d'utilisateurs, le rendant accessible même pour les entreprises avec des ressources limitées.
Ø Impacts sur les entreprises des mobilités électriques
Le présent dispositif permet aux opérateurs de recharge de générer des crédits proportionnellement à la quantité d'électricité effectivement délivrée aux véhicules électriques. Ces crédits peuvent être cédés à des entités assujetties à des obligations de décarbonation constituant ainsi une source de revenus additionnelle. Ce mécanisme apporte un soutien financier significatif aux opérateurs, en facilitant la couverture de leurs charges d'exploitation durant la phase de développement du marché, tout en renforçant leur capacité à investir dans les infrastructures de recharge, dans des conditions proches de celles du dispositif précédent.
Par ailleurs, le nouveau dispositif voit les objectifs de réduction de l'intensité carbone désormais inscrits dans la loi sur les dix prochaines années, offrant ainsi aux acteurs de la recharge une visibilité pluriannuelle accrue sur la trajectoire attendue et leur permettant d'anticiper leurs investissements dans un cadre plus stable et lisible.
Au regard de ces éléments, les dispositions envisagées devraient renforcer le modèle économique des acteurs de la recharge. Il est en outre prévu de cibler le dispositif, à partir de 2031, sur les secteurs où l'électrification connaîtrait un éventuel retard, garantissant une électrification homogène.
A l'occasion de la consultation conduite par la DGEC, du 12 mai au 10 juin 2025, sur la réforme de la TIRUERT, plusieurs acteurs ont souligné l'opportunité d'intégrer la recharge privée en dépôt des poids lourds électriques dans le dispositif. En effet, si la prise en compte pour la minoration de TIRUERT des quantités d'électricité des bornes de recharges publiques a permis de renforcer l'électrification du parc, l'électrification du segment des poids lourds accuse un retard conséquent. En 2024, les poids lourds électriques représentaient 1% des nouvelles immatriculations, contre un objectif de 14% des nouvelles immatriculations en 2025 selon la Stratégie pour le développement des mobilités propres 2. Or, la recharge en dépôt est le mode de recharge le plus économique et devrait représenter en moyenne 70% de la recharge des poids lourds en général et pourrait tendre vers 95% en moyenne pour le transport local. En outre, les poids lourds représentent une part disproportionnée des émissions de GES du transport routier (25% des émissions contre 5% des véhicules du parc roulant).
Il ressort de cette analyse qu'en étendant la minoration de TIRUERT à ces acteurs, il est possible de renforcer l'électrification du segment du transport routier le plus prioritaire à électrifier à présent. Les transporteurs pourraient bénéficier d'une génération de certificat forfaitaire fondée sur des hypothèses de distance parcourue et de consommation d'électricité moyenne, la part prévisionnelle de recharge en dépôts, pour différents segments de véhicules, ainsi qu'une marge de sécurité. Le soutien estimé serait alors d'environ 3000 € par an pour les véhicules destinés au transport longue distance. Retenue en Allemagne à un niveau de soutien estimé au tiers du soutien envisagé en France, cette méthode est moins avantageuse pour les transporteurs mais permet d'éviter aux transporteurs d'investir dans des infrastructures dédiées et dans les systèmes de comptage, de s'affranchir d'une partie des difficultés liées aux contrôles en réduisant considérablement le risque de fraude tout en limitant les contrôles nécessaires. L'impact serait dès lors très positif pour l'électrification des poids lourds.
Ø Impact sur les raffineries et la mobilité hydrogène
L'industrie française consomme actuellement environ 400 kt/an d'hydrogène carboné, produit par vaporeformage du méthane, dit « hydrogène gris », et constitue l'un des secteurs les plus émissifs. Dans ce contexte, l'IRICC constitue une aide à la décarbonation des raffineries. En effet, les raffineurs qui utilisent de l'hydrogène électrolytique pour les besoins du raffinage en France peuvent émettre des certificats, dès lors que cet hydrogène n'est pas comptabilisé dans la réduction d'intensité carbone des carburants ainsi produits. En plus d'assurer une décarbonation plus large des transports, en réduisant les émissions liées au processus de production des carburants fossiles, cette solution fournit une incitation au développement de la filière d'hydrogène électrolytique et d'électrolyseurs. Ce développement sera renforcé par le caractère pluriannuel du dispositif, offrant une visibilité recherchée par les investisseurs. Aussi, le dispositif suit la trajectoire définit au sein de la Stratégie Nationale Hydrogène 2, publiée en 2025.
En outre, les opérateurs de bornes de recharge de véhicules hydrogène, qu'ils soient motorisés avec des piles à combustible ou par combustion interne, pourront générer des certificats participant à l'objectif hydrogène et dérivés, et valorisés auprès des metteurs à la consommation.
Le présent dispositif renforce la traçabilité de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, d'ores et déjà défini par le code de l'énergie.
Le dispositif permettra de structurer le marché de l'hydrogène en France, en favorisant le développement de capacités de production et en incitant les industriels à investir dans des technologies bas-carbone et renouvelables.
Enfin, à partir de 2032, le dispositif permet de valoriser l'hydrogène recyclât des raffineurs, solution de décarbonation envisagée, qui permet de remplacer du méthane provenant du réseau, aujourd'hui vaporéformé, par des gaz fatals du processus de raffinage. Le dispositif s'accompagne nécessairement de l'installation d'un électrolyseur, qui produit de l'hydrogène renouvelable à destination des unités de désulfuration de la raffinerie. L'hydrogène issu des gaz fatals permettra la génération de certificats d'hydrogène, dans des conditions définies au niveau technique, chaque dossier devant fait l'objet d'une instruction par les services du ministre de l'énergie, pour garantir le caractère décarbonant du projet.
Ø Impacts sur les filières de production de biocarburants conventionnels, 2G et avancés
La mise en place de l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone des Carburants constitue un levier important pour les biocarburants avancés, en instaurant des objectifs différenciés entre filières conventionnelles et avancées, et en intégrant une obligation de réduction de l'intensité carbone des carburants. Celle-ci correspond aux émissions de gaz à effet de serre calculées sur l'ensemble du cycle de vie du carburant, selon des modalités fixées par arrêté ministériel. Contrairement à l'ancien mécanisme fondé sur l'incorporation de carburants atteignant un niveau suffisant de durabilité, cette approche permet de mieux refléter l'impact environnemental réel des carburants.
Les biocarburants avancés, produits à partir de résidus lignocellulosiques, déchets ou biomasses non alimentaires (cf. annexe IX-A de la directive (UE) 2023/2413), présentent un meilleur impact environnemental, avec des réductions d'émissions estimées de min 80 %, contre environ min 65 % pour les biocarburants conventionnels. En France, les volumes incorporés restent en 2024 largement dominés par les filières conventionnelles (2,3 Mt d'EMHV, 1,4 Mt d'éthanol). La filière de biocarburants avancés produits à partir de résidus lignocellulosiques, de déchets ou de biomasse non destinée à l'alimentation, présentent un profil de durabilité mais peinent encore à se développer en raison d'un marché peu mature. En instaurant des sous-objectifs spécifiques aux biocarburants avancés, la réforme crée un cadre incitatif à leur développement, encore limité par leur faible maturité industrielle. Ainsi, l'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone des Carburants fixe un objectif dédié de 5,5% de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie en 2030, dont 1% de carburants renouvelables d'origine non biologique, avec un système de certificats de durabilité que les metteurs à la consommation pourront valoriser dans ce mécanisme ce qui permet de structurer une demande ciblée.
L'IRICC apporte une visibilité à long terme, indispensable pour renforcer la confiance des investisseurs, structurer les chaînes d'approvisionnement et soutenir des projets industriels en cours de développement. Ces projets pourront donc bénéficier d'une meilleure visibilité réglementaire, condition essentielle pour mobiliser les financements, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et soutenir leur développement industriel. Cette dynamique est cruciale pour diversifier et mobiliser des ressources plus durables, réduire la dépendance de la France aux importations et accélérer l'émergence de nouvelles technologies.
Ø Impacts sur les filières de production de biocarburants gazeux
A la différence de la TIRUERT, le présent article propose l'intégration de la filière des gaz carburants (gaz naturel pour les véhicules et gaz de pétrole liquéfié) dans l'IRICC. Si ce rattachement répond aux obligations de la directive 2023/2413, il permettra également aux producteurs de ces gaz carburants de valoriser leurs projets de gaz carburants à partir de biomasse (bioGPL et bioGNV).
A l'instar des autres filières de production, celles du GNV et du GPL devront justifier d'une réduction d'intensité carbone par rapport au combustible fossile de référence. Si elles sont aujourd'hui moins émettrices que le combustible fossile de référence - diesel - elles devront progressivement s'aligner sur la même réduction d'intensité carbone que les filières de carburants routiers.
Au niveau réglementaire, seront définis des objectifs progressifs d'incorporation de bioGNV et de bioGPL, respectivement dans les volumes de GNV et de GPL mis à la consommation. Demandés par les filières, ils permettront d'enclencher des investissements dans des projets de production de bioGPL et de bioGNV. Le bioGPL constitue un produit de sortie du raffinage aujourd'hui principalement réinjecté comme combustible. Le bioGNV constitue une valorisation d'effluents d'élevage et d'autres déchets agricoles par méthanisation. Il constitue un levier de décarbonation du transport routier lourd, et potentiellement des engins agricoles en zones rural, assurant dans le même temps un complément effectif de revenu pour des agriculteurs souhaitant développer des projets de méthanisation. Toutefois, du fait des limites sur les ressources en biomasse, et de la concurrence entre les différents usages du biométhane, notamment pour décarboner les réseaux de gaz naturel, son usage devra être également plafonné par voie réglementaire.
Ø Impacts sur les filières de production de carburants de synthèse
L'IRICC devrait également favoriser la demande d'hydrogène et de carburants de synthèse travers des mandats spécifiques. Cela pourrait soutenir le développement de la filière électrolytique et le développement des gigafactories d'électrolyse qui ont été significativement soutenues au titre des Projets Importants d'Intérêt Européen Commun. Cet objectif est conforme à la stratégie française pour l'hydrogène décarboné publiée en 2020 et mise à jour en avril 2025. Les sous-objectifs de carburants de synthèse, notamment pour le maritime, pourraient faciliter les décisions finales d'investissements sur les projets aujourd'hui annoncés sur le territoire national en leur assurant un marché.
Ø Impacts sur les entreprises du secteur aérien
Les entreprises du secteur aérien ne sont pas concernées par le présent article, le règlement RefuelEU Aviation fixant déjà des obligations de décarbonation.
Ø Impacts sur les entreprises du secteur maritime
Le présent article permet aux armateurs et entreprises du secteur maritime qui soutent en France de réduire leur empreinte carbone. Il permet également de leur assurer une disponibilité de carburants durables puisque l'obligation s'applique aux metteurs à consommation, c'est-à-dire les distributeurs de carburants.
S'agissant des navires de plus de 5000 GT (tonneaux de jauge brute)189(*), soumis au règlement FuelEU Maritime, le soutage en France leur permettra l'atteinte de leurs objectifs de décarbonation fixés par ledit règlement. Malgré l'alignement de la trajectoire de réduction d'intensité carbone entre l'IRICC et le règlement FuelEU Maritime, les entreprises devront payer un léger surcoût. En effet, les objectifs de FuelEU Maritime sont définis tous les 5 ans, à l'inverse de l'IRICC, dont les objectifs sont annuels. Cette contrainte, tant nécessaire à la décarbonation que cohérente vis-à-vis des cycles industriels de production de biocarburants, a été jugée positive par la filière. Elle pourrait constituer un vecteur d'attractivité des ports français, proposant des carburants décarbonés. En raison de la technicité de l'alignement entre le règlement FuelEU Maritime, la directive RED III et l'IRICC, le calcul des objectifs du secteur maritime et la méthodologie de calcul sont renvoyés à un arrêté.
Pour éviter toute double pénalité entre FuelEU Maritime et l'IRICC, des sanctions dissuasives pèsent sur les distributeurs de carburants, qui n'auront pas d'intérêt à ne pas se plier aux obligations fixées par l'IRICC en choisissant de régler directement les pénalités.
S'agissant des navires de moins de 5000 GT, le présent article leur garantit l'accès à des carburants maritimes décarbonés, sans contrainte.
Il est à noter qu'en raison des difficultés économiques rencontrées par le secteur de la pêche et des difficultés logistiques d'acheminement de biocarburants, il est proposé de ne pas appliquer d'objectifs sur les metteurs à la consommation de gazole pêche.
Ø Impacts sur les acteurs de la logistique pétrolière
L'augmentation des biocarburants dans les circuits logistiques en vue d'atteindre les objectifs de l'IRICC nécessitera une adaptation significative des infrastructures de logistique pétrolière, notamment la conversion des infrastructures de stockage. Les entreprises devront non seulement s'assurer de la compatibilité des biodiesels et bio essences avec les infrastructures actuelles, mais également garantir la qualité de ces produits.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le dispositif n'induira pas de dépenses publiques. Il constitue un soutien extra-budgétaire au développement des mobilités plus économes en émissions de carbone, que ce soit mobilité électrique en France que déploiement de carburants renouvelables.
La TIRUERT étant une taxe incitative dont le montant est très élevé, tous les assujettis atteignent ses objectifs depuis 2023, et son rendement est nul. Il n'y aura donc pas de moindre recette budgétaire.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les autorités organisatrices de la distribution
d'énergie (AODE), regroupées au sein de syndicats
départementaux ou de syndicats mixtes, développent des
réseaux d'infrastructures de carburants alternatifs
(électricité, gaz, hydrogène) répondant notamment
à des objectifs d'aménagement du territoire. En
conséquence, elles réalisent des investissements dans un
réseau de bornes de recharge électriques, les IRVE
(infrastructures de recharge de véhicules électriques).
Définie à l'art 266 quindecies du code des
douanes, la TIRUERT permet aux opérateurs de ces bornes de recharge,
parfois différents des AODE (une centaine opèrent directement) de
générer des certificats, qui minorent la TIRUERT. Ces certificats
sont vendus à des obligés de la TIRUERT (des metteurs à la
consommation d'essence ou de gazole pour le secteur routier). Avec le passage
à l'IRICC, les opérateurs de bornes de recharge pourraient en
plus vendre ces certificats à des metteurs à la consommation de
gazole pour le fluvial ou de combustibles maritimes. Les estimations de la DGEC
montrent que cet élargissement du périmètre
n'altèrerait pas directement le prix de vente des certificats.
À ce titre, le dispositif envisagé leur offre la possibilité de couvrir une partie des charges d'exploitation de réseaux souvent structurellement déficitaires, tout en leur apportant une visibilité pluriannuelle sur une période de dix ans, essentielle à la planification de leurs investissements et au renforcement de leur modèle économique. Les collectivités territoriales bénéficieront donc d'une réduction de la charge de leurs investissements dans les infrastructures de carburants alternatifs, en vendant donc ces certificats.
Par ailleurs, certaines AODE (syndicats départementaux fixes et leurs SEM) ont réalisé des investissements dans la mobilité gaz, développant des infrastructures d'avitaillement en GNV/bioGNV. Du fait de la réforme de la TIRUERT, ces acteurs auraient une obligation de décarbonation progressive du GNV distribué, en y incorporant du bioGNV ou en achetant des certificats à d'autres metteurs à la consommation. Alors qu'un surcoût de l'ordre de quelques centimes d'euros par litre de GNV serait incident pour les AODE ayant uniquement investi dans des stations de GNV, celles choisissant déjà de distribuer du bioGNV pourraient davantage valoriser cette production.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La DGEC devra assurer le coût de développement et de maintenance de la plateforme utilisée pour le suivi des objectifs et procédures relatifs au dispositif proposé. Le coût de développement est estimé à 600 000€ par an pendant 2 ans puis un coût de maintenance annuel de 300 000€. La DGEC devra également maintenir [3] ETP pour le suivi et les contrôles du dispositif.
Par ailleurs, les services douaniers régionaux responsables des contrôles physiques devront assurer le maintien des ETP nécessaires à ces contrôles et la formation des agents concernés.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les impacts sur l'emploi sont précisés en impacts macroéconomiques. Le dispositif aura des incidences environnementales fortes, mais créera un effet signal prix pour le consommateur, impacts détaillés ci-dessous.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'Incitation à la Réduction de l'Intensité Carbone des Carburants est un mécanisme non budgétaire qui permettra de diversifier les vecteurs de décarbonation des mobilités. Il incitera à incorporer des carburants alternatifs, qui sont plus coûteux que les carburants fossiles, dans les transports et aura donc une influence sur le prix des carburants. Les mandats d'incorporation sont progressifs et permettront de limiter et de lisser cet effet sur le prix. Les premières estimations indiquent que l'augmentation de prix serait de l'ordre de quelques centimes d'euros par litre par rapport à la TIRUERT actuelle.
L'incorporation de carburants alternatifs dans le cadre de l'IRICC donnera également lieu à des réductions d'émissions, et donc à des réductions de l'impact prix qu'aura l'entrée en vigueur de l'ETS 2 dans le secteur des transports en 2027. Etant donné les taux d'incorporation, et le facteur d'émission pris en compte pour les biocarburants dans l'ETS 2, l'IRICC pourrait réduire l'impact ETS 2 de 10% en 2030. Cela compensera en partie la hausse de prix induite par cette réforme.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
En 2023, le secteur des transports représentait le principal poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec 34% du total d'émissions, un chiffre en croissance. Le secteur agricole représentait le second poste, avec 20% d'émissions, dont 13 p.% liées au carburant des engins agricoles.
Le présent article garantit la réduction de l'intensité carbone du secteur des transports de 14,5% en 2030 et de 25% en 2035. Mesurée en équivalent CO2, l'intensité carbone désigne la quantité de gaz à effet de serre émise en cycle de vie complet. Une telle réduction est à peu près deux fois plus ambitieuse que l'objectif de 15% d'énergies renouvelables dans les transports en 2030 fixée par l'article L. 641-6 du code de l'énergie.
L'utilisation d'hydrogène peut également être envisagée dans le transport, notamment pour la fabrication de carburants de synthèse à destination du maritime et de l'aérien. Ces carburants permettraient de réduire les émissions du secteur d'au moins 70 %.
Ainsi, le présent dispositif permet de tenir compte de l'efficacité environnementale des carburants, permettant désormais d'inciter à l'intégration des carburants alternatifs les plus performants en matière de réduction de l'intensité carbone.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le présent dispositif a fait l'objet d'une consultation publique facultative, du 12 mai au 10 juin 2025. Cette consultation a rassemblé 110 contributions, dont 31 fédérations, syndicats ou autres groupements d'intérêts, qui ont eux-mêmes synthétisé des retours d'acteurs. Cette consultation technique de la direction générale de l'énergie et du climat a permis de mesurer l'intérêt des acteurs concernés pour le dispositif et ses qualités : trajectoire de long-terme, prise en compte idoine des filières, distinction d'objectifs, neutralité technologie, niveau de sanctions adapté, etc. Aussi, la contribution a fait ressortir plusieurs enjeux du dispositif qui ont pu être amendés : meilleure inclusion de l'électricité, prise en compte de l'inflation dans les sanctions avec rehaussement du plafond législatif, non intégration des régions ultra périphériques, etc.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 02 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Pour que les acteurs concernés puissent anticiper les évolutions de la TIRUERT, notamment en termes de contractualisation, il est nécessaire de prévoir une entrée en vigueur décalée de plusieurs mois. Les dispositions proposées entrent ainsi en vigueur au 1er janvier 2027. En 2026, une période blanche pour les metteurs à la consommation sera organisée, sans obligation d'y participer.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions proposées s'appliqueront sur l'ensemble du territoire de la République française à l'exception des territoires des articles 73, 74 et de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue des travaux de mise à jour des Programmations pluriannuelles de l'énergie dans les zones non interconnectées, l'inclusion des territoires de l'article 73 à la réforme de la TIRUERT sera étudiée en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux.
5.2.3. Textes d'application
Pour la définition de plafonds inférieurs de sanctions, et pour l'abrogation des dispositions réglementaires liées à la TIRUERT, un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire.
Pour la définition des sous-objectifs, des modalités de calcul de ces derniers et des règles spécifiques à chaque filière, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes sera nécessaire.
Article 43 - Règlement pour une industrie à zéro émission nette
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les données géologiques sont des informations issues de l'étude du sous-sol, obtenues par des méthodes telles que le forage ou l'analyse géophysique. Elles permettent de comprendre la structure, la composition et le potentiel minéral du sous-sol d'un territoire. Dans le domaine minier, ces données sont essentielles pour identifier les ressources exploitables, évaluer leur rentabilité et planifier les opérations d'extraction. Elles constituent donc un enjeu stratégique, à la fois scientifique, économique et environnemental.
La confidentialité de ces données pendant une certaine durée est justifiée par plusieurs raisons. D'abord, elle protège les investissements réalisés par les entreprises qui financent les campagnes d'exploration. Ces données représentent un avantage concurrentiel, et leur divulgation prématurée pourrait compromettre les retours sur investissement. Enfin, la confidentialité permet aux pouvoirs publics de gérer la diffusion des données dans un cadre réglementaire cohérent, en assurant la sécurité et la transparence du processus.
Lorsque les données géologiques tombent dans le domaine public, cela favorise la recherche scientifique et la connaissance du sous-sol, stimule l'innovation, valorise les usages du sous-sol et renforce la transparence des politiques environnementales. Les chercheurs peuvent accéder librement à des informations précieuses pour leurs travaux, les citoyens peuvent mieux comprendre les enjeux liés à l'exploitation du sous-sol et les opérateurs peuvent démarrer leurs projets d'exploration plus rapidement.
Plusieurs acteurs sont impliqués dans la gestion et l'utilisation des données géologiques. Les chercheurs et universitaires les exploitent pour approfondir la connaissance du sous-sol et publier des travaux scientifiques. Les industriels s'en servent pour orienter leurs investissements et planifier leurs activités d'extraction. Les pouvoirs publics et le BRGM, encadrent la collecte, la conservation et la diffusion des données, tout en veillant à l'intérêt général.
À ce jour, il n'existe pas de texte européen spécifique qui fixe de manière uniforme les durées de confidentialité des données géologiques dans l'ensemble des États membres. L'Union européenne a certes adopté plusieurs textes qui encadrent l'accès à l'information environnementale et la gestion des données publiques, mais aucun ne définit explicitement une durée limite applicable aux données géologiques.
Les textes les plus pertinents sont la directive 2003/4/CE sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement (transposée en France via la loi sur l'accès aux documents administratifs), et la directive INSPIRE (2007/2/CE) qui vise à établir une infrastructure d'information géographique dans l'Union. Ces directives encouragent la mise à disposition des données environnementales, y compris géologiques, mais laissent aux États membres le soin de définir les modalités concrètes, notamment les délais de confidentialité.
La transparence des données nécessite de réduire les durées de confidentialités des données géologiques figurant actuellement dans le code minier.
Le code minier français impose, à son article L. 413-1, à l'administration de rendre publiques, après un délai de confidentialité de 10 ans sauf autorisation de l'auteur des travaux, les données recueillies dans le cadre d'un ouvrage en sous-sol qui sont le levé de mesures géophysiques, la campagne de prospection géochimique et tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique hydrologique, hydrographique, topographique, chimique et minier et les données brutes liées à des campagnes sismiques. Ce délai peut être réduit ou annulé pour certaines données.
Les renseignements, autres que sismiques et intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux à terre, tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, pour la recherche en mer, des renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacentes.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement européen (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesure en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement 2018/1724 (dit règlement NZIA), publié au Journal officiel de l'Union européenne le 28 juin 2024 a pour ambition d'accélérer la décarbonation de notre économie en facilitant le déploiement de technologies « zéro net ».
Il en va ainsi du CCUS (carbon capture, utilisation and storage). Cette technologie s'applique aux activités industrielles pour lesquelles il n'existe pas d'alternative bas carbone à moyen terme. Elle consiste à capter les émissions résiduelles incompressibles des industriels, le dioxyde de carbone (CO2), à le transporter jusqu'à un site de stockage et à l'injecter dans une formation géologique souterraine adaptée aux fins d'un stockage sûr et permanent ou à l'utiliser comme ressource dans la fabrication de produits.
Afin de développer cette technologie et limiter les risques, les capacités potentielles de stockage de CO2 doivent pouvoir être connues. Dans cet objectif, le I de l'article 21 du règlement européen impose la transparence des données géologiques aux zones potentielles de stockage de CO2. Il prévoit que ces données doivent être rendues publiques, tout en préservant la confidentialité des informations sensibles, à l'exception de celles concernant les champs d'hydrocarbures dont l'exploitation a cessé ou dont l'arrêt a été notifié à l'État.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'Union européenne a introduit dans le règlement NZIA (Net-Zero Industry Act) des dispositions spécifiques sur la durée de confidentialité des données géologiques dans un objectif stratégique clair : accélérer le développement des technologies liées à la neutralité carbone, notamment le stockage de CO2, en facilitant l'accès aux données du sous-sol.
Traditionnellement, les données géologiques issues de travaux de recherche ou d'exploration sont protégées pendant plusieurs années pour préserver les intérêts économiques des opérateurs. Toutefois, dans le cadre du NZIA, l'UE considère que la mise à disposition rapide de ces données est essentielle pour identifier les sites potentiels de stockage de carbone, soutenir l'innovation industrielle et garantir la sécurité énergétique du continent.
Le règlement européen pour une industrie « net zéro » (NZIA) a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juin 2024. Le I de l'article 21 prévoit, au plus tard le 30 décembre 2024, que les États membres :
- Au a) « rendent publiques des données sur toutes les zones où des sites de stockage de CO2 pourraient être autorisées sur leur territoire, y compris des données des aquifères salins, sans préjudice des exigences relatives à la protection des informations confidentielles » ;
- Au b) « obligent les entités qui sont ou ont été titulaires d'une autorisation au sens de l'article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (55) sur leur territoire à rendre publiques, uniquement à titre indicatif, les données géologiques relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l'autorité compétente et, si elles existent, des évaluations économiques des coûts correspondants à la mise en place de l'injection de CO2, à moins que l'entité n'ait fait une demande de permis d'exploration conformément à la directive 2009/31/CE, comprenant des données sur:
i) La question de savoir si le site est adapté à l'injection et au stockage de CO2 de manière durable, sûre et permanente
ii) L'existence ou le besoin d'infrastructures et de modes de transport adaptés à l'acheminement en toute sécurité du CO2 »
Ce règlement, étant d'application directe, exige une modification de la législation nationale (code minier) afin de la mettre en conformité.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les objectifs recherchés de réduction des délais de confidentialité des données du sous-sol sont de favoriser la diffusion de la connaissance, de valoriser les usages du sous-sol et de dérisquer au maximum les projets. En exploitant ces informations cruciales sans attendre plusieurs années, les opérateurs et chercheurs pourront démarrer leurs projets d'exploration plus rapidement et mieux planifier les investissements grâce à une meilleure compréhension du sous-sol, ce qui contribuera également à réduire les risques liés aux projets d'exploration minières.
Une durée de confidentialité réduite encourage la collaboration et le partage des données du sous-sol entre opérateurs. Lorsque les données deviennent accessibles, elles peuvent être utilisées pour éviter la répétition de recherches inutiles et optimiser les efforts d'exploration. Plus les données sont accessibles tôt, mieux les opérateurs peuvent évaluer les zones prometteuses et minimiser les risques associés à l'exploration.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée. Il est nécessaire de légiférer pour rendre compatible le code minier au règlement européen NZIA.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article vise à renforcer la transparence et l'accessibilité des données géologiques et géophysiques issues des travaux miniers. Elle s'inscrit dans le prolongement du règlement NZIA, en adaptant le code minier français pour notamment accélérer les projets de stockage géologique de CO2.
L'article L.412-3 est abrogé et les dispositions de l'article L. 412-4 sont supprimées, ce qui simplifie le régime applicable aux données et supprime des dispositions devenues obsolètes ou redondantes. Les dispositions de l'article L.412-4 sont remplacées par celles figurant au 4e alinéa de l'article L.413-1 relatives aux renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface. Ces dispositions traitant des prérogatives des personnes publiques sont donc remontées dans le chapitre qui y est dédié pour plus de cohérence. L'article L.413-1 est réécrit, en suivant une logique chronologique, partant des données tombant immédiatement dans le domaine public pour aller vers celles qui sont rendues publiques à l'expiration d'un certain délai. Il renvoie à un décret le soin de préciser le délai dans lequel s'effectue la publication des données géologiques et géophysiques, y compris traitées, lorsque les travaux sur un puits d'hydrocarbures font l'objet d'une procédure d'arrêt conformément aux articles L.163-1 à L.163-12. Il réduit, par ailleurs, les délais de confidentialité des données acquises par les opérateurs, que ce soit en surface ou dans les puits. Les données géologiques issues des travaux mentionnés à l'article L.411-1, ainsi que les résultats des levés et campagnes visés à l'article L.411-3, et les documents et renseignements mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 412-1 doivent désormais être rendus publiques dans un délai de cinq ans, contre dix auparavant. Ce délai est encore réduit à un an pour les données relatives aux travaux de forage et d'exploitation par puits de substances mentionnées aux articles L.111-1 (substances de mines) et L.112-1 (géothermie), ainsi que pour les travaux de stockage souterrain visés à l'article L.211-2. Cette accélération vise à favoriser l'innovation, la recherche et les investissements industriels en garantissant une meilleure disponibilité des données.
L'article L.413-2 est également modifié en apportant des restrictions à la transparence des données. L'objectif est de garantir la protection des teneurs, tonnages et destinataires des matières premières considérées comme critiques par la Commission européenne, notamment lorsqu'elles revêtent une importance stratégique pour la préservation des intérêts nationaux.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'accélération de la transparence des
données géologiques impliquent l'abrogation de l'article L.
412-3. Ces dispositions nécessitent également de modifier les
articles
L. 412-4, L. 413-1 et L. 413-2 du code minier.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
En réduisant les délais de confidentialité des données géologiques et géophysiques dans l'article L.413-1, l'article répond aux exigences du règlement NZIA. Il prévoit notamment que les données issues des travaux de forage et d'exploitation par puits, ainsi que celles relatives au stockage souterrain, tombent dans le domaine public au bout d'un an, contre dix auparavant. Cette accélération permet aux porteurs de projets industriels notamment de stockage géologique de CO2 de disposer plus rapidement des informations nécessaires pour évaluer le potentiel d'un site, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de déploiement fixés par le NZIA.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Réduire les durées de confidentialité des données géologiques peut avoir plusieurs effets macroéconomiques positifs dans le secteur minier et au-delà :
- Stimulation de l'investissement : Un accès plus rapide aux données géologiques libérées permet aux entreprises d'évaluer plus efficacement le potentiel minier d'un territoire. Cela peut accélérer les décisions d'investissement et attirer davantage d'acteurs.
- Amélioration de la compétitivité : En réduisant les asymétries d'information, on favorise une concurrence plus équitable entre opérateurs. Cela peut conduire à une meilleure allocation des ressources et à une baisse des coûts d'exploration.
Accélération de l'innovation : Les données géologiques sont aussi utiles à la recherche scientifique, à la transition énergétique (géothermie, stockage de CO2, etc.) et à l'aménagement du territoire. Leur diffusion rapide peut stimuler la filière capture, de transport et de stockage de CO2 (CCS) en France.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Réduire les durées de confidentialité des données géologiques minières peut transformer en profondeur la dynamique des entreprises du secteur. Voici les principaux impacts :
- Accès élargi à l'information : Les entreprises, notamment les plus petites ou les nouveaux entrants, bénéficient d'un accès plus rapide à des données précieuses sans avoir à financer elles-mêmes des campagnes d'exploration coûteuses. Cela favorise une plus grande diversité d'acteurs sur le marché.
- Accélération des projets miniers : Moins de barrières à l'information signifie des délais réduits pour identifier des opportunités, déposer des demandes de titres miniers ou lancer des études de faisabilité.
- Renforcement de la concurrence : La libération rapide des données réduit les situations de monopole informationnel. Cela incite les entreprises à innover et à optimiser leurs stratégies d'exploration.
- Valorisation des données comme actif stratégique : Les entreprises doivent repenser leur modèle économique : les données collectées ne peuvent plus être conservées longtemps comme avantage concurrentiel exclusif. Cela peut inciter à une meilleure valorisation immédiate (partenariats, publications, transferts technologiques).
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le présent article n'a pas d'impact sur les services de l'Etat ou les opérateurs de l'Etat. Les données géologiques sont archivées sur Minergies qui est le portail national des ressources énergétiques du sous-sol, développé par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il centralise les données relatives aux hydrocarbures, à la géothermie profonde et au stockage souterrain, collectées auprès des opérateurs et des autorités compétentes.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La réduction des données géologiques liés au stockage de CO2 a pour objectif d'accélérer les projets CCS en France. Le CCS est un levier essentiel pour à la fois atteindre nos objectifs climatiques et soutenir la compétitivité des filières industrielles.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Ces modifications vont permettre d'accélérer la transition énergétique. Des données géologiques accessibles plus rapidement vont favoriser le développement de projets de géothermie, de stockage de CO2.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Concertations informelles avec la filière géothermie et CCUS.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le I de l'article 21 « transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2 » du règlement européen est applicable depuis le 30 décembre 2024. S'agissant uniquement d'une mise en conformité du code minier au règlement européen le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
- Dispositions applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à Mayotte
Le régime juridique est identique que celui applicable en métropole.
- Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
L'article L. 631-1 du code minier prévoit que les dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à Mayotte, regroupées au sein du titre Ier du livre VI du code minier, s'appliquent également à Saint-Barthélemy.
- Dispositions applicables à Saint-Martin
Les dispositions des articles LO 6311 à LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales sont dans l'ensemble identiques à celles concernant Saint-Barthélemy. Toutefois, l'environnement ne figure pas dans les domaines susceptibles d'être réglementés par la collectivité.
L'article L. 641-1 du code minier rend applicables à Saint-Martin les dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à Mayotte avec les mêmes réserves que pour Saint-Barthélemy.
- Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous réserve de l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel la collectivité « fixe les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes (...) et urbanisme, construction » et « peut adapter les lois et règlements en vigueur localement », « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon » en application de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales.
Selon les termes de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales, l'État peut concéder, sous réserve des engagements internationaux de la France, à la collectivité l'exercice des compétences, en vertu d'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil territorial en mer. Un tel cahier des charges n'a à ce jour jamais été adopté.
- Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises
Les articles L. 661-1 et L. 661-2 du code minier prévoient que ce dernier s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises.
Le régime encadrant les activités minières s'applique donc dans les Terres australes et antarctiques françaises comme sur le territoire métropolitain, sauf droit d'entrée et de séjour des étrangers, en application de l'article L. 661-2 du code minier.
- Dispositions applicables à la Polynésie française
La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment le 4° de son article 14, réserve à l'État la compétence sur les seules « matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux ».
Les matières classées stratégiques sont listées dans une décision du Président de la Communauté en date du 14 avril 1959. Elle contient pour l'heure les minerais ou produits utiles à l'énergie atomique et les hydrocarbures liquides ou gazeux.
A l'exception du régime applicable aux matières stratégiques, le droit minier de la Polynésie française est régi (terre, domaine public maritime, ZEE) par les « lois du pays » adoptées par l'assemblée de la collectivité. En revanche, l'État est compétent sur le plateau continental au-delà des 200 milles marins des lignes de base.
- Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
L'État y est compétent pour les seules substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, en application des articles L. 681-1 du code minier et 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à savoir les substances utiles aux recherches et réalisations concernant l'énergie atomique telles qu'elles sont énumérées dans un décret en Conseil d'État (...) et les installations qui en font usage.
Le décret n° 56-992 du 28 septembre 1956, pris en application du code minier de 1956 et définissant les substances utiles à l'énergie atomique, énumère ces substances.
La collectivité de Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
- Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation et de gestion et de conservation des ressources naturelles non biologiques de la ZEE ;
- Réglementation relative aux hydrocarbures, chrome, nickel et cobalt (article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) qui a donné lieu à l'élaboration, pour ces trois dernières substances, d'un code minier de Nouvelle-Calédonie.
L'État est seul compétent pour réglementer et exercer les droits d'exploration, d'exploitation et de gestion et de conservation des ressources naturelles de la partie du plateau continental situé au-delà des 200 milles marins des lignes de base.
- Dispositions applicables aux Îles Wallis et Futuna
L'article L. 691-1 du code minier soumet l'exploration et l'exploitation des substances minérales ou fossiles à Wallis et Futuna, au livres Ier, à l'exception de ses titres VIII (sécurité et santé au travail) et IX (autres dispositions sociales), au livre III, à l'exception de son titre V (réglementation sociale) et aux livres IV et V du code minier, « dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité ».
En matière minière, selon l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna : « l'assemblée prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières suivantes : (...) 21° modalités d'application du régime des substances minérales (...) », qu'elle n'a pas, à ce jour, adoptée.
Certaines dispositions datant des années 1950, aujourd'hui obsolètes, n'ont pas été supprimées.
- Dispositions applicables à l'ile de Clipperton
Le code minier, en tant que texte législatif national, s'applique dans son intégralité sur l'île de Clipperton. L'État y délivre les titres miniers à terre et en mer.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article requiert un décret d'application à l'article L. 413-1 du code minier.
Article 44 - Cadre de sanctions applicables aux violations du règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 a fixé un objectif de neutralité climatique dans l'Union européenne d'ici à 2050. Pour y parvenir, les Etats membres de l'Union européenne doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Dans ce contexte, le règlement (UE) 2024/1787 a introduit des obligations visant à la diminution des émissions de gaz méthane dans le secteur énergétique. L'article 33 du règlement 2024/1787 assigne aux Etats membres l'obligation de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ce règlement.
La grande majorité des obligations imposées par le règlement (UE) 2024/1787 ne préexistaient pas dans le droit national. Sans création d'un régime spécifique de sanctions, il n'existe donc pas de disposition permettant de sanctionner les éventuels manquements aux obligations créées par le règlement (UE) 2024/1787.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 88-1 de la Constitution dispose que la République participe à l'Union européenne.
L'article 34 de la Constitution énonce que la loi fixe les règles concernant les peines applicables aux crimes et aux délits.
En outre, par la décision n°88-248 DC du 17 janvier 1989 relative au Conseil supérieur de l'audiovisuel et la décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 relative à la Commission des opérations de bourse devenue Autorité des marchés financiers, le Conseil constitutionnel confère à l'administration un pouvoir de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 33 du règlement (UE) 2024/1787 requiert des Etats membres qu'ils mettent en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour prévenir tout manquement aux obligations citées dans les articles 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29 de ce même règlement.
Les manquements aux obligations de l'article 6 comprennent notamment l'absence de mise en oeuvre des mesures correctives prescrites par l'autorité compétente à l'issue d'une inspection.
Les manquements aux obligations des articles 12, 20 et 25 comprennent notamment l'absence de transmission d'un rapport de quantification des émissions de méthane, la transmission d'un rapport incomplet, ou la transmission d'un rapport erroné.
Les manquements aux obligations de l'article 14 comprennent notamment l'absence de soumission d'un programme de détection et de réparation des fuites, l'absence de réalisation d'une enquête de détection et de réparation des fuites, l'absence de réparation des composants sur lesquels une émission de méthane est constatée ou l'absence de soumission d'un rapport résumant les résultats des enquêtes de détection et de réparation des fuites menées l'année précédente.
Les manquements aux obligations de l'article 15 comprennent notamment la réalisation d'opérations d'éventage ou de torchage systématique.
Les manquements aux obligations des articles 16 et 26 comprennent notamment l'absence de notification ou de déclaration des opérations d'éventage ou de torchage.
Les manquements aux obligations des articles 17, 22 et 23 comprennent notamment l'utilisation de torchères ou de dispositifs de combustion non conformes.
Les manquements aux obligations de l'article 18 comprennent notamment l'absence d'application de mesures d'atténuation sur les puits inactifs.
Les manquements aux obligations des articles 27, 28 et 29 comprennent notamment l'absence de transmission par les importateurs de pétrole, de gaz naturel ou de charbon des informations requises.
L'article 33 impose par ailleurs un certain nombre d'exigences sur le régime de sanctions applicable aux violations du règlement. L'autorité compétente doit, notamment, pouvoir adopter une décision ordonnant à la personne de mettre fin à l'infraction, ordonner la confiscation du montant des profits obtenus du fait de ces infractions ou des pertes que ces infractions ont permis d'éviter, délivrer un avertissement ou une communication au public, adopter une décision imposant des astreintes, adopter une décision imposant des amendes administratives.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
En mai 2025, lors des derniers échanges entre les administrations des Etats membres, aucun Etat membre n'avait encore déterminé le régime de sanctions applicable aux violations du règlement (UE) 2024/1787.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le règlement (UE) 2024/1787 assigne aux Etats membres l'obligation de déterminer le régime des sanctions applicable aux violations de ce règlement, et demande que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
En application des articles 131-13 et 131-38 du code pénal, le maximum de l'amende encourue par une personne morale dans le cadre d'une peine contraventionnelle s'élève à 7 500 €, montant pouvant être porté à 15 000 € en cas de récidive. Au regard des chiffres d'affaires de certaines sociétés exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon, de telles peines contraventionnelles risqueraient de ne pas être dissuasives. L'adoption d'une loi s'avère nécessaire pour instaurer un régime de sanctions conforme à l'article 33 du règlement (UE) 2024/1787.
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les peines applicables aux crimes et aux délits.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à déterminer le régime de sanctions applicable aux violations du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie, conformément à l'obligation assignée aux Etats membres par l'article 33 de ce règlement.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les options envisagées consistaient soit à créer un cadre de sanctions spécifique pour les violations énoncées à l'article 33 du règlement (UE) 2024/1787, soit à réutiliser un cadre de sanctions existant. Dans un souci de cohérence et d'uniformité avec les sanctions déjà prévues par le code de l'environnement, le choix s'est porté sur la seconde solution. Dans l'attente de l'adoption de mesures législatives, la prise d'un décret a également été envisagée. Néanmoins, bien que cette solution permette la détermination rapide d'un régime de sanctions provisoire, elle limite le montant des sanctions financières et ne répond qu'en partie aux exigences de l'article 33.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Pour les activités effectuées sur le territoire français, notamment la production de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon, ou l'exploitation d'infrastructures gazières, il est proposé de réutiliser le cadre de sanctions prévu aux articles L. 171-8 et suivants du code de l'environnement. Ce cadre de sanctions est actuellement appliqué en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu de ce même code.
Ce cadre de sanctions répond aux exigences prévues par l'article 33 du règlement (UE) 2024/1787. Il permet d'imposer un ensemble de sanctions en fonction du manquement : telles qu'une mise en demeure, un recouvrement d'une somme dédiée à la mise en conformité, une sanction pécuniaire ou une suspension de l'activité. Ce cadre de sanctions a démontré son efficacité pour sanctionner des manquements dans le domaine de l'environnement. En comparaison à la création d'un nouveau cadre spécifique de sanctions, la réutilisation d'un régime de sanctions existant permet de limiter la complexité administrative.
Le cadre de sanctions prévu aux articles L. 171-8 et suivants du code de l'environnement ne semble, en revanche, pas adapté pour sanctionner des éventuelles importations non-conformes de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon. Ces importations peuvent en effet être effectuées par des acteurs n'ayant pas d'activité durable sur le territoire français. Les articles 27, 28 et 29 du règlement (UE) 2024/1787 disposent en effet que les importateurs et les producteurs de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon ont l'obligation de transmettre aux autorités compétentes des informations relatives aux émissions de méthane induites par leurs importations ou leur production. Afin de disposer d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive en cas d'importations de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon ne respectant pas les exigences de transmission des informations prévues par le règlement (UE) 2024/1787, il est proposé de créer une nouvelle possibilité d'amende administrative d'un montant proportionnel à la quantité d'énergie importée, pouvant aller jusqu'à 1 euro par mégawattheure d'énergie concernée.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Il est proposé de compléter le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement par une section 12 dédiée à l'application du règlement (UE) 2024/1787 relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.
Le projet d'article L. 229-94 du code de l'environnement vise à créer une nouvelle possibilité d'amende administrative d'un montant proportionnel à la quantité d'énergie importée en cas d'importations non conformes de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon.
Le projet d'article L. 229-93 du code de l'environnement vise à étendre l'application du cadre de sanctions prévu aux articles L. 171-8 et suivants du code de l'environnement aux autres violations du règlement (UE) 2024/1787.
Le projet d'article L. 229-95 du code de l'environnement vise à préciser les modalités des contrôles administratifs, notamment les fonctionnaires et agents concernés. Les modifications proposées au code de l'énergie visent à étendre le champ de l'habilitation des fonctionnaires et agents afin de pouvoir mener des enquêtes et contrôles dans l'ensemble du domaine de l'énergie, de façon à inclure le pétrole brut et le charbon, en plus du gaz naturel.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions proposées visent à se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 33 du règlement (UE) 2024/1787 relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie qui assignent aux Etats membres une obligation de déterminer le régime de sanctions applicable aux violations du règlement.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Il est difficile d'estimer à ce jour le nombre et l'importance des violations au règlement (UE) 2024/1787 relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Il est difficile d'estimer à ce jour le nombre et l'importance des violations au règlement (UE) 2024/1787 relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. Les dispositions proposées permettront de mettre en oeuvre des sanctions proportionnées aux violations, aussi bien pour les activités effectuées sur le territoire français, que pour les importations de pétrole brut, gaz naturel et charbon.
4.2.3. Impacts budgétaires
Il est proposé que les amendes et les astreintes soient recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Il est difficile d'estimer à ce jour le nombre et l'importance des violations au règlement (UE) 2024/1787 relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Il est difficile d'estimer à ce jour le nombre et l'importance des violations au règlement (UE) 2024/1787 relatives à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. La réutilisation du cadre de sanctions prévu aux articles L. 171-8 et suivants du code de l'environnement permettra de limiter la charge administrative, en comparaison à l'application d'un nouveau cadre.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Il est difficile à ce jour d'évaluer l'importance des violations au règlement (UE) 2024/1787 relatives à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. De ce fait, la quantité d'émissions de méthane évitées par la mise en oeuvre du règlement et l'application d'un régime de sanctions reste à déterminer. Néamoins, une réduction avérée des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie aurait un impact positif sur l'environnement et les populations.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les dispositions proposées permettront de mettre en oeuvre des sanctions dissuasives an cas de violations du règlement (UE) 2024/1787 relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions proposées ont vocation à entrer en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions proposées ont vocation à s'appliquer aux collectivités de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités de l'article 74 relevant du régime d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint- Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon).
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application. En revanche, un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour mettre en cohérence la sous-section 2, de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie avec les dispositions législatives proposées.
Article 45- Transposition de la directive 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments
1. ÉTAT DES LIEUX
L'article L. 100-4 du code de l'énergie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale, dans l'optique de répondre à l'urgence écologique et climatique. Parmi ces objectifs figurent notamment la réduction de la consommation énergétique finale du secteur du bâtiment et la rénovation de l'ensemble des bâtiments en fonction des normes "bâtiment basse consommation" ou assimilées, à l'horizon 2050.
La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie et le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, fixe les modalités pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale identifiés à l'article L. 100-4. Elle fixe notamment les objectifs de réduction de la consommation d'énergie du secteur du bâtiment (cf. partie 2.2.1 de la PPE).
La stratégie nationale bas-carbone (SNBC), instituée par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, définit la feuille de route française pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. La SNBC encore en cours a défini une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions du secteur du bâtiment, avec un objectif de -49% d'émission de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015 et l'atteinte de la décarbonation complète de l'énergie consommée dans les bâtiments en 2050. Les objectifs de la SNBC supposent une diminution annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de 2,5 Mt CO2eq/an entre 2015 et 2050, alors que ces dernières ont globalement stagné entre 1990 et 2015 et ont diminué de 2,1 Mt CO2eq/an sur la période plus récente 2005-2015.
En ce qui concerne le secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires, les émissions associées de 2022 sont en forte baisse par rapport à celles de 2021 (-14,7 %, soit -11,1 Mt CO2e). Cette baisse s'explique notamment par une forte réduction de la consommation d'énergie fossile dans un contexte de crise énergétique avec une hausse des prix du gaz et d'autres produits pétroliers, des appels à la sobriété énergétique auprès des ménages et des entreprises et un hiver doux. Ce secteur a contribué le plus fortement à la baisse globale des émissions entre 2021 et 2022. Ce secteur atteint ainsi en 2022, avec 64,0 Mt CO2e, soit 16% des émissions nationales, son niveau d'émissions de gaz à effet de serre (GES) le plus bas depuis la période observée (1990).
De fait, le secteur du bâtiment constitue un enjeu majeur pour la réduction des GES en France. Représentant environ 16 %190(*) des émissions nationales de GES et près de 45 %191(*) (dont environ 16% pour le tertiaire) de la consommation d'énergie finale, il est au coeur des politiques climatiques. En particulier, le secteur tertiaire représente un levier stratégique pour la réduction des gaz à effet de serre, notamment dans le cadre de la décarbonation du parc bâti puisqu'il est à la fois énergivore et largement dépendant des énergies fossiles, notamment pour le chauffage et la climatisation. Sa transformation est essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC).
De plus, au-delà de leurs enjeux propres, les bâtiments interagissent avec les diverses autres politiques publiques : le déploiement d'infrastructures de mobilité durables ou de panneaux solaires, par exemple, se font de manière privilégiée au sein ou sur les emprises bâtimentaires.
Section 1 : définition de la rénovation importante
Dans le cadre de la DPEB, une rénovation importante désigne une rénovation dont l'importance déclenche l'application d'exigences de performance énergétique, la délivrance d'un diagnostic de performance énergétique, l'installation d'infrastructures de mobilité durable, ainsi que, pour les bâtiments non résidentiels, la mise en place de panneaux solaires ou l'installation de dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur.
L'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation définit les différentes notions employées dans le livre Ier du code, portant sur la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments. La modification envisagée ajoute la définition de « rénovation importante » à cet article, à la suite des définitions de « rénovation » et de « rénovation énergétique performante ».
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Soutenus par les pouvoirs publics, les modes de transport décarbonés ont connu une croissance soutenue en France au cours des dernières années. Dès 2010, un objectif ambitieux de 2 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables à l'horizon 2020 est fixé par le ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, accompagné de premières dispositions législatives comme l'inclusion des infrastructures de recharge (IRVE) dans la loi Grenelle 2. En 2014, les IRVE deviennent une compétence obligatoire des métropoles avec la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Depuis 2015, cette dynamique s'est renforcée par la mise en place de nombreuses mesures incitatives, notamment fiscales, telles que le bonus écologique, le bonus vélo (clos depuis février 2025) ou encore la prime à la conversion.
En juin 2025, la France avec près de 170 000 points de recharge ouverts au public et plus de 2,5 millions avec les bornes à usage privé, fait partie des 3 pays de l'UE les plus équipés. Les objectifs à terme de 400 000 points de recharge ouverts au public, dont 50 000 points à haute puissance192(*) et de 7 millions de points de recharge publics et privés ont été confirmés par le gouvernement.193(*)
Parallèlement, l'usage du vélo progresse rapidement : selon Vélo & Territoires, l'utilisation du vélo a augmenté de 37 % entre 2019 et 2023194(*). Cependant, l'absence de places de stationnement pour les bicyclettes constitue un obstacle majeur à l'adoption de ce mode de transport, tant dans les bâtiments résidentiels que non résidentiels. Les exigences de l'Union Européenne et du code de la construction et de l'habitation peuvent soutenir efficacement la transition vers une mobilité moins polluante en fixant des exigences concernant un nombre minimal d'emplacements de stationnement pour bicyclettes, et l'aménagement d'emplacements de stationnement pour bicyclettes et d'infrastructures connexes dans les zones où la bicyclette est moins utilisée peut conduire à une augmentation de son utilisation.
Enfin, le code de la construction et de l'habitation prévoit des dispositions concernant le stationnement des véhicules électriques, ainsi que les infrastructures de stationnement des vélos, dans ses articles L.113-11 à L.113-20 et R.113-6 à R.113-18. Ils sont complétés par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est aujourd'hui obligatoire dans plusieurs cas : vente ou location d'un bien immobilier, construction neuve. Ces cas sont régis par les articles L.126-27, L.126-28 et L.126-29 du code de la construction et de l'habitation. Depuis le 1er juillet 2021, plus de 14 millions de DPE ont ainsi été produits, soit environ 4 millions de DPE par an. En revanche, la loi ne prévoit pas d'obligation de délivrance du DPE à l'issue d'une rénovation importante. La DPEB impose aux États membres de prévoir cette obligation d'établissement d'un DPE post-travaux dans les cas d'une rénovation dite "importante" dans son article 20, paragraphe 1, et ceci avant le 29 mai 2026.
Par ailleurs, l'article 20, paragraphe 1, de la DPEB impose la délivrance d'un DPE pour les bâtiments ou unités de bâtiments pour lesquels le contrat de location est renouvelé. Si pour les bâtiments résidentiels cette obligation est déjà en vigueur via l'article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la délivrance d'un DPE lors d'un renouvellement de bail n'est pas prévue explicitement dans l'article L.126-29 du CCH, et ne s'applique donc pas aux bâtiments non résidentiels. La modification proposée vient donc également ajouter cette obligation au sein du CCH.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Les articles 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », et 41 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dite loi « APER » ( codifiés au L. 171-4 du code la construction et de l'habitation), ainsi que l'article 43 de la loi « APER » (codifié au L. 171-5 du même code) prévoient une obligation d'installation soit d'un système de production d'énergies renouvelables, soit d'un dispositif de végétalisation en toitures des bâtiments. Les dernières obligations prévues au L. 171-4 sont entrées en application au 1er janvier 2025 et les obligations prévues au L. 171-5 doivent entrer en application au 1er janvier 2028.
L'article 10 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (dite DPEB), impose le déploiement d'installations d'énergie solaire sur les bâtiments. L'article 10 défini les bâtiments concernés par cette obligation, à savoir :
- les bâtiments neufs publics et non résidentiels ;
- les bâtiments publics existants ;
- les bâtiments non résidentiels existants lorsque le bâtiment fait l'objet d'une rénovation importante ;
- les bâtiments résidentiels neufs ;
- les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment.
Pour chacune des typologies citées, des seuils de surface d'assujettissement sont prévus, avec une entrée en application échelonnée dans le temps. Ainsi, la mesure porte sur un champ d'application différent de celui de la réglementation nationale actuelle aussi bien pour les seuils des surfaces des bâtiments assujettis que pour les typologies et les dates d'entrée en application.
De plus, la directive étant centrée sur une approche énergétique, elle ne prévoit pas la possibilité de choisir entre végétalisation des toitures et installation d'équipement de production d'énergies renouvelables tel que le prévoit la réglementation nationale actuelle. Toutefois la directive permet de tenir compte de la végétalisation.
Le présent projet de loi vise donc à transposer les dispositions de la DPEB en alignant le droit français sur la directive européenne.
Afin de ne pas modifier les dispositions préexistantes applicables aux parcs de stationnement non couverts associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnées à l'article L. 171-4, non concernés par l'article 10 de la DPEB, le présent projet de transposition prévoit également une séparation plus claire des obligations faites aux bâtiments (impactées par la transposition) et aux parcs de stationnement non couverts (conservées à droit constant mais transférées au code de l'urbanisme).
- En effet, actuellement le L. 111-19-1 du CU prévoit une obligation de revêtement de surface, d'aménagements hydrauliques ou de dispositif végétalisé favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, ainsi qu'une obligation d'intégration de dispositifs végétalisés ou d'ombrières (devant intégrer un procédé de production d'EnR) concourant à l'ombrage pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments mentionnés au L. 171-4 du CCH.
- Or, la transposition de l'article 10 de la DPEB vient modifier le périmètre des bâtiments assujettis au L. 171-4 - par exemple en incluant les bâtiments neufs résidentiels. La DPEB ne prévoit aucune obligation concernant les parcs de stationnement non couverts associés à un bâtiment. Sans modification du L. 111-19-1 du CU, cela aurait pour effet d'assujettir les parcs de stationnement associés aux typologies de bâtiments nouvellement intégrées au L. 171-4 du CCH alors que ni le législateur français, ni la DPEB ne prévoit un tel assujettissement.
- Ainsi, le projet de transposition modifie l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme (CU) pour conserver le droit existant pour les parcs de stationnement non couverts par la directive.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
L'article L.100-1-A du code de l'énergie dresse la liste des documents stratégiques encadrant la politique énergétique nationale. Il mentionne actuellement la stratégie de rénovation à long terme (LTRS), instituée par la directive 2010/31/UE (article 2bis) relative à la performance énergétique des bâtiments. Cette référence sera remplacée par celle au plan national de rénovation (NBRP), conformément à l'article 3 de la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024, qui remplace la précédente obligation de réalisation d'une LTRS.
|
Comparaison des attendus du NBRP et de la LTRS |
|
|
NBRP (DPEB 2024) |
LTRS (2020) |
|
a) Aperçu du parc immobilier national (types de bâtiments, parts, périodes, zones climatiques), obstacles du marché, capacités du secteur, part des ménages vulnérables. |
a) Aperçu du parc immobilier national (statistiques, proportion de bâtiments rénovés en 2020). d) Politiques ciblant les segments les moins performants et la précarité énergétique. f) Initiatives sur les compétences et formations (secteurs construction/énergie). |
|
b) Feuille de route nationale avec objectifs et indicateurs mesurables, incluant la précarité énergétique, vers la neutralité climatique 2050 (parc décarboné, bâtiments à émissions nulles). |
b) Inventaire des approches de rénovation rentables adaptées aux bâtiments/zones climatiques. c) Politiques pour stimuler les rénovations lourdes et par étapes, y compris passeports de rénovation. |
|
c) Aperçu des politiques et mesures exécutées et planifiées à l'appui de la feuille de route. |
c) Politiques et actions pour stimuler la rénovation lourde. d) Politiques pour les segments les moins performants et la précarité énergétique. e) Politiques pour les bâtiments publics. |
|
d) Description des besoins en investissements, sources/mesures de financement et ressources administratives. |
(Pas d'équivalent direct, mais des éléments indirects dans les points c, d et e sur les actions et politiques de soutien.) |
|
e) Seuils d'émissions de GES et de demande annuelle d'énergie primaire pour les bâtiments neufs ou rénovés à émissions nulles. |
/ |
|
f) Normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels. |
/ |
|
g) Trajectoire nationale de rénovation du parc résidentiel, avec jalons 2030 et 2035 (consommation moyenne en kWh/(m².an)). |
/ |
|
h) Estimation des économies d'énergie et bénéfices plus généraux (dont qualité de l'environnement intérieur). |
g) Estimation des économies d'énergie et bénéfices (santé, sécurité, qualité de l'air). |
Le plan national de rénovation vise à organiser la transformation progressive du parc de bâtiments (public et privé, résidentiel et non résidentiel) en un parc à haute efficacité énergétique et décarboné à l'horizon 2050.
Il sera, à compter de 2029, couplé au plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNIEC), et est à mettre à jour tous les 5 ans. Avant ça, une première version doit être produite d'ici fin 2026.
Le plan national de rénovation doit inclure une analyse détaillée du parc de bâtiments, une feuille de route pour le faire évoluer à horizon 2030, 2040 et 2050, un récapitulatif des mesures en place ou envisagées pour ce faire, ainsi qu'une estimation des besoins d'investissements et soutiens publics associés.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
A ce jour, les articles 14 et 15 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique imposent d'ores et déjà une inspection périodique des systèmes de chauffage et de climatisation d'une puissance supérieure à 70 kW.
Ces exigences ont été transposées à l'article L. 224-1 du Code de l'Environnement, complétées par les dispositions du décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020, portant sur l'inspection et l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation. Les dispositions règlementaires ont instauré des obligations pour les systèmes thermodynamiques et systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet Joule d'une puissance supérieure à 70 kW et ont introduit également des dispositions pour les systèmes de puissance intermédiaire (4 à 70 kW).
En revanche, les systèmes de ventilation ne sont aujourd'hui pas concernés par une obligation d'inspection.
L'article 13 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (dite directive « DEPB ») prévoit que cette inspection obligatoire s'applique aux ensembles de systèmes de chauffage, climatisation et ventilation d'une puissance supérieure à 70 kW, donc en incluant désormais l'inspection des systèmes de ventilation.195(*) Cette exigence est transférée par la modification du 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.
L'article 22 de cette même directive impose également que les États membres recueillent les données issues de ces inspections dans une base nationale de données énergétiques.
La France ne dispose pas de base juridique pour la collecte des rapports d'inspection des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation dans un outil unique. Les obligations de mettre en place des inspections des systèmes de ventilation ainsi que d'établir une base de données pour la collecte de ces rapports sont à transposer avant le 29 mai 2026. Il convient de rappeler que, pour les bâtiments soumis au décret BACS (concernant tous les bâtiments tertiaires équipés de système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation et seulement ces bâtiments) et applicable à partir du 1er janvier 2027 dès lors que la puissance est supérieure à 70kW, les données des systèmes seront collectées selon un dispositif prévu par ce décret, assurant ainsi un suivi centralisé et systématique de leur performance énergétique. Ce dispositif de collecte sera mis en place par voie réglementaire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Par ailleurs, les dispositions de la Charte de l'environnement de 2004, « comme l'ensemble des droits et devoirs [qui y sont] définis, ont valeur constitutionnelle [et] s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ». L'article 1er de cette Charte dispose que : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »
Section 1 : définition de la rénovation importante
La modification envisagée entre dans le champ de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, puisqu'elle fixe des règles relatives ayant trait au régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales.
Notamment, le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er de la Constitution relatif à l'égalité devant la loi.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
À l'échelle de l'Union européenne, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB)196(*) prévoit l'intégration d'infrastructures destinées aux mobilités durables à l'intérieur et à proximité des bâtiments.
De plus, le nouveau règlement sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR) 197(*) fixe des objectifs de déploiement des infrastructures de recharge, en prenant en compte les caractéristiques de puissance des bornes, à hauteur d'1,3 kW par voiture électrique en circulation et de 0,8 kW par voiture hybride rechargeable en circulation et abroge l'objectif de nombre brut de points de recharge (1 pour 10 voitures électrique en circulation) qui était la directive précédente (AFID abrogée par l'AFIR). Le texte prévoit par ailleurs le déploiement d'au moins une station de recharge rapide tous les 60 km sur les principaux axes routiers d'ici fin 2025 (pour les véhicules légers) et fin 2030 (pour les véhicules lourds), ainsi que le déploiement de points de recharge pour véhicules lourds dans les aires de stationnement sûres et sécurisées et dans les noeuds urbains.
Enfin, le 3 avril 2024, les institutions européennes ont signé la déclaration européenne sur le vélo dont l'objectif est de promouvoir ce moyen de déplacement et de renforcer ainsi l'engagement de l'Union européenne dans la lutte en faveur de la réduction des émissions dues au transport 198(*).
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
La modification envisagée entre dans le champ de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, puisqu'elle fixe des règles relatives ayant trait au régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales.
Notamment, le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er de la Constitution relatif à l'égalité devant la loi.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Imposer une obligation d'équipement des toitures de bâtiments pourrait être considéré comme une restriction du droit de propriété fondé sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil Constitutionnel a toutefois à plusieurs reprises estimé que des limites pouvaient être apportées à son exercice si elles étaient justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi (voir par exemple la décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011 ou la décision n° 2024-1109 DC du 18 octobre 2024 ). Le présent article apparaît justifiée du fait de l'intérêt général impérieux qui s'attache au développement des énergies renouvelables dans une perspective de lutte contre le changement climatique. En effet, la mesure permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribue à la sécurité d'approvisionnement en électricité, tout en limitant l'artificialisation des sols. De plus, elle est proportionnée à l'objectif poursuivi car elle prend en compte le fait que les toitures sont principalement inutilisées, que les coûts d'investissements auront pour conséquence un retour sur investissement du propriétaire grâce à la revente de l'énergie produite, ou s'ils sont disproportionnés, ouvriront droit à dérogation.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
La modification envisagée entre dans le champ de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, puisqu'elle fixe des règles relatives ayant trait au régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales.
De plus, le 2° du II de l'article 224-1 du code de l'environnement précise actuellement une obligation pour les chaudières, systèmes de chauffage et de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret. La modification du champ d'application, incluant la ventilation et la modification du principe de calcul, devenant un cumul, relève de la loi, afin de garantir une cohérence juridique des dispositions législatives et réglementaires existantes.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La politique climatique de la France s'inscrit dans un cadre juridique structuré, intégrant des engagements internationaux, européens et nationaux. Au niveau international, l'Accord de Paris, adopté en 2015 dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, engage les États signataires à contenir l'élévation de la température moyenne mondiale en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 °C.
En réponse, l'Union européenne a adopté en 2019 le Pacte vert pour l'Europe, qui fixe l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 et structure l'ensemble des politiques communautaires autour de cette finalité. Cet objectif a été consacré juridiquement par la Loi européenne sur le climat ( règlement (UE) 2021/1119), qui rend contraignante une réduction d'au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
Afin de permettre l'atteinte de ces objectifs, l'Union européenne a mis en oeuvre un ensemble de réformes législatives regroupées dans le paquet « Fit for 55 », incluant notamment la révision de deux directives sectorielles structurantes. La directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique (DEE) renforce les objectifs contraignants de réduction de la consommation d'énergie au niveau européen et impose aux États membres des trajectoires annuelles précises, en ciblant notamment les bâtiments publics et les grandes entreprises. Parallèlement, la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), récemment révisée, fixe des exigences accrues en matière de rénovation énergétique du parc immobilier, et introduit des objectifs de réduction progressive de la consommation des bâtiments les moins performants, en lien avec la notion de « bâtiment à émission nulle » à l'horizon 2050.
Enfin, la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil a rehaussé les objectifs fixés aux Etats membres en matière de production d'énergies renouvelables. L'article 3 de cette directive prévoit que les Etats « doivent veiller à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 42,5 % ».
Ce socle oriente l'ensemble des politiques climatiques françaises, en particulier la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la future Stratégie française pour l'énergie et le climat (SFEC).
Le projet vise à se conformer à une norme de l'Union européenne, laquelle est supérieure à la loi interne.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Section 1 : définition de la rénovation importante
L'intégralité des Etats membre de l'Union européenne devront aussi utiliser cette définition dès l'entrée en vigueur de la directive, le 29 mai 2026.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
A l'instar de la France, de nombreux autres pays ont pris des mesures pour le déploiement des mobilités durables.
Aux Pays-Bas, le développement des infrastructures cyclables s'appuie largement sur le Design Manual for Bicycle Traffic publié par l'institut CROW. Bien qu'il ne constitue pas une norme juridique, ce guide technique de référence fait autorité auprès des collectivités et des aménageurs. Il fixe des standards précis en matière de cohésion, de sécurité, de confort et d'attractivité du réseau cyclable, et recommande des aménagements adaptés aux contextes urbains et ruraux, ainsi que des solutions de stationnement sécurisé. Utilisé comme base dans la plupart des projets, il contribue à intégrer pleinement le vélo dans la planification urbaine et à soutenir une politique cyclable cohérente à l'échelle nationale.
Enfin, tous les autres États membres de l'Union Européenne procèdent à la mise en oeuvre des mesures issues de la précédente directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, qui devaient également être transposées dans leur droit national depuis 2020.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
L'intégralité des Etats membre de l'Union européenne devront aussi se conformer à cette obligation dès l'entrée en vigueur de la directive, le 29 mai 2026.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
L'intégralité des Etats membre de l'Union européenne devront aussi se conformer à cette obligation dès l'entrée en vigueur de la directive, le 29 mai 2026.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
L'intégralité des Etats membre de l'Union européenne devront aussi se conformer à la rédaction et à la transmission à la Commission Européenne du plan national de rénovation, dans une version projet au plus tard le 31 décembre 2025, et dans sa version finalisée au plus tard le 31 décembre 2026.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
L'intégralité des Etats membres de l'Union européenne devront aussi se conformer à cette obligation dès l'entrée en vigueur de la directive, le 29 mai 2026.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Section 1 : définition de la rénovation importante
La notion de rénovation importante n'est à ce jour pas définie de manière unique dans le droit français, même si des notions équivalentes sont utilisées. Ainsi, la réglementation thermique pour les bâtiments existants utilise une notion similaire sans la nommer. Dans le même temps, les obligations de déploiement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques peuvent être déclenchées par une rénovation importante, définie directement dans les articles correspondants. De même, les obligations de déploiement de panneaux solaires en toiture font référence à la notion de rénovation lourde.
Une codification claire de la définition d'une rénovation importante est donc nécessaire pour assurer une transposition claire de la directive et permettre une application simple et cohérente des dispositions découlant d'une rénovation importante, avec une définition unique pour les différents cas pouvant être concernés.
Le concept de rénovation importante vient compléter celui de rénovation performante, en proposant un cadre de déclenchement d'obligations relatives à la performance énergétique, lorsqu'une rénovation importante est menée, sans qu'elle ait forcément un lien avec l'énergie. La rénovation performante, elle, définit l'état souhaitable à atteindre en termes de rénovation énergétique.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Le Parlement européen, dans sa directive (UE) n°2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments, relève que « la promotion de la mobilité verte est un volet essentiel du pacte vert pour l'Europe et les bâtiments peuvent jouer un rôle important en fournissant les infrastructures nécessaires pour la recharge, non seulement des véhicules électriques, mais aussi des bicyclettes. Le passage à une mobilité active telle que la bicyclette peut réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports. ».
Dans ce contexte, la directive indique qu'« il est possible d'utiliser efficacement les codes de construction pour introduire des exigences ciblées visant à soutenir le déploiement d'infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels. ».
Les exigences portées par cette directive sur les mobilités durables imposent la modification des articles L. 113-11 à L. 113-15 et L. 113-18 à L .113-20 du code de la construction et de l'habitation. En effet, les seuils existants reposent sur la directive (UE) n°2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, et ne sont donc plus compatibles avec les nouvelles dispositions fixées par la directive (UE) n°2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
La délivrance d'un DPE après une rénovation importante n'est pas prévue à ce jour par le droit français. Une modification législative est donc nécessaire pour assurer la transposition conforme de la directive.
De plus, une clarification législative est proposée concernant la délivrance du DPE lors du renouvellement d'un bail. Cette obligation préexiste pour les logements au-travers de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, mais n'existe pas explicitement en ce qui concerne les bâtiments tertiaires notamment. Il est proposé de la préciser dans l'article L. 126-29 du CCH.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Les exigences portées par l'article 10 de la DPEB imposent de modifier les dispositions prévues à l'article L. 171-4 du CCH ainsi que les dispositions prévues au I de l'article 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (loi « APER »), reprises à l'article L. 171-5 du CCH car la mesure porte sur un champ d'application différent de celui de la réglementation nationale actuelle pour les seuils des surfaces des bâtiments assujettis, les typologies, les dates d'entrée en application et la possibilité de végétaliser les toitures. Le délai de transposition est de deux ans, soit une échéance en mai 2026.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
La directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 remplace la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) par un Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP), au contenu légèrement différent. Le droit français doit être mis en conformité avec cette nouvelle dénomination.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Le droit français ne prévoit pas actuellement d'obligation d'inspection des systèmes de ventilation. Une disposition de niveau législatif est nécessaire pour garantir la cohérence et la sécurité juridique du dispositif national, en élargissant son champ d'application à la ventilation et en prenant en compte le cumul de puissance des systèmes techniques.
À ce titre, il est proposé de modifier le II.2° de l'article L.224-1 du Code de l'environnement afin d'y ajouter explicitement les systèmes de ventilation et les systèmes combinant des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation dont la puissance nominale est supérieure à un certain seuil définit règlementairement parmi les équipements soumis à inspection périodique. Cette modification permettra de fonder juridiquement l'obligation d'inspection de ces systèmes au même titre que les chaudières et les systèmes de climatisation.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Section 1 : définition de la rénovation importante
Les objectifs poursuivis par ces dispositions sont :
· S'assurer de l'alignement du droit français sur les exigences européennes
· Clarifier le cadre législatif et réglementaire existant
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
L'objectif poursuivi est d'une part de développer le réseau d'infrastructures permettant la recharge des véhicules électriques, et d'autre part de permettre le stationnement sécurisé des vélos.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Les objectifs poursuivis par ces dispositions sont :
· Aligner le droit français sur les exigences européennes ;
· Améliorer la connaissance de la performance énergétique après des rénovations importantes ;
· Clarifier une obligation existante pour le logement en l'étendant au tertiaire, renforçant la sécurité juridique des relations bailleurs-locataires ;
· Favoriser la transparence et la cohérence dans les démarches de rénovation énergétique.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
L'objectif est le développement des énergies renouvelables (EnR) sur bâtiment en vue notamment de contribuer à l'augmentation de la production d'énergie renouvelable dans l'Union européenne et en France. En effet, ces surfaces par nature déjà artificialisées sont à privilégier pour le développement des EnR par rapport aux espaces naturels et agricoles. Au plan national, cette mesure participe à l'atteinte des objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour le déploiement des énergies renouvelables. En effet, la PPE a notamment pour objectif le développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, par la production de 1,85 à 2,5 TWh de solaire thermique et 35,1 à 44,0 GW de photovoltaïque en 2028.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Les objectifs poursuivis par ces dispositions sont :
- Assurer la cohérence du droit interne avec le droit européen.
- Garantir la lisibilité et la sécurité juridique des textes stratégiques de politique énergétique.
- Permettre la bonne mise en oeuvre du futur NBRP.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Les objectifs poursuivis par ces dispositions sont :
· Aligner le droit français sur les exigences européennes.
· Se conformer à la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024.
· Assurer l'inspection régulière des systèmes de ventilation et des systèmes combinant des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation d'une puissance > 70 kW.
· Garantir la protection de la santé publique par une meilleure qualité de l'air intérieur, renforcer la performance énergétique des bâtiments et assurer la cohérence juridique du dispositif.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Section 1 : définition de la rénovation importante
La directive laisse aux États membres le choix entre deux définitions alternatives de la rénovation importante :
Option 1 : Définir la rénovation importante comme une rénovation dont le coût total concernant l'enveloppe ou les systèmes techniques est supérieur à 25% de la valeur du bâtiment hors terrain.
Cette définition se rapproche de critères déjà utilisés pour l'application d'exigences actuelles qui seront renforcées par la DPEB. C'est le cas de règlementation thermique existant globale, qui s'applique aux bâtiments de plus de 1000 m², ainsi que l'obligation d'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Option 2 : La rénovation importante est définie comme toute rénovation concernant plus de 25% de la surface de l'enveloppe du bâtiment.
Cette définition basée sur la surface de l'enveloppe rénovée n'est actuellement pas employée dans les dispositifs existants. De plus, elle pourrait limiter la possibilité de réaliser des rénovations par geste, dans la mesure où le traitement d'un ou deux postes de travaux (e.g., isolation toiture et plancher) pourrait suffire à faire entrer l'opération dans la catégorie des rénovations importantes, avec les exigences qui en découlent.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
La disposition vise la mise en conformité avec la directive (UE) n°2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments. Aucune autre option n'a été envisagée.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Cette disposition relève du niveau législatif, il est donc nécessaire de modifier la loi (code de la construction et de l'habitation) pour intégrer explicitement ce nouveau cas d'obligation de délivrance d'un DPE. D'autres options n'ont pas été envisagées.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Pour adapter la législation française préexistante, il pouvait être envisagé :
- Un alignement « strict » du cadre législatif national sur la directive européenne : cela amenant à réduire les exigences préexistantes sur certains points (bâtiments existants tertiaires), et l'augmenter sur d'autres points (le résidentiel neuf) ;
- Maintenir l'ensemble des exigences initiales de la législation nationale, en y ajoutant les exigences de la directive lorsqu'elles sont plus strictes que la législation nationale ;
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Deux options ont pu être envisagées :
- Option 1 : Réaliser le plan national de rénovation sans assise législative. Une mention obsolète de la stratégie long terme de rénovation serait alors conservée dans la législation.
- Option 2 : Remplacer la mention existante de la stratégie long terme de rénovation, afin de mettre en cohérence notre cadre législatif avec l'évolution du droit européen.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Ces dispositions relevant du niveau législatif, il est nécessaire de modifier la loi (code de l'environnement) pour imposer explicitement les inspections des systèmes de ventilation et préciser que le seuil s'apprécie en cumulant la puissance de ces systèmes techniques du bâtiment. D'autres options n'ont pas été envisagées.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Section 1 : définition de la rénovation importante
Le dispositif prévoit la définition de la notion de « rénovation importante ». Une rénovation est considérée comme importante lorsque le coût des travaux portant sur l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain sur lequel il se trouve. Les modalités de calcul de la valeur du bâtiment sont fixées par voie réglementaire. L'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation définit les différentes notions employées dans le livre Ier du code, portant sur la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments. La modification envisagée ajoute la définition de « rénovation importante » à cet article, à la suite des définitions de « rénovation » et de « rénovation énergétique performante » (création d'un 17ter).
La première option a été retenue par cohérence avec le cadre préexistant : les obligations relatives aux infrastructures de recharge ou la réglementation thermique globale font référence à cette notion de coût. De plus, elle englobe un panel plus large de situations, ne correspondant pas uniquement à de la rénovation énergétique, et elle permet de conserver la possibilité de réaliser des rénovations énergétiques par étapes.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen, il est proposé de modifier les articles L. 113-11 à L. 113-15 et L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l'habitation. En effet, ce sont les articles définissant les exigences concernant les infrastructures pour une mobilité durable.
Les articles L. 113-12 et L. 113-13 tels que modifiés définissent les principes de l'obligation s'appliquant aux IRVE dans les bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovation importante, en distinguant l'usage résidentiel ou non et en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application et notamment les seuils précis à partir des quels l'obligation s'applique les taux d'équipement à respecter en fonction de l'usage, les éléments techniques et les exemptions possibles.
Les articles L. 113-18 et L. 113-19 définissent les principes s'appliquant aux stationnements des vélos, dans les bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovation importante, en distinguant l'usage résidentiel ou non en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application et notamment les moyens par lesquels l'obligation peut être satisfaite, et les cas dérogatoires.
La nouvelle rédaction de ces articles permet ainsi de mettre en cohérence les conditions de dérogation avec la directive (UE) n°2024/1275.
De plus, la modification de l'article L. 113-11 permet de clarifier les termes nécessaires à la bonne application des articles L. 113-12 à L. 113-15.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Le dispositif prévoit :
- L'introduction dans le code de la construction et de l'habitation d'une obligation de fournir un DPE après une rénovation importante ;
- La modification de l'article L.126-29 pour préciser que la délivrance du DPE est requise lors de la conclusion d'un contrat de bail ou de son renouvellement ;
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Pour éviter une « surtransposition », l'option retenue est un alignement « strict » des exigences de la législation française, à la hausse comme à la baisse, sur les exigences de la DPEB concernant le périmètre des bâtiments assujettis à l'obligation seule de solarisation, les seuils et le calendrier d'entrée en vigueur.
Par année d'entrée en vigueur, le texte prévoit :
- Au 1er janvier 2027 : de réduire la surface à partir de laquelle les bâtiments sont soumis à l'obligation de solariser, lors de la construction de bâtiments neuf non résidentiels, de 500 à 130 m² d'emprise au sol et substituer la notion de rénovation « lourde » actuellement en vigueur en droit français par celle de rénovation « importante » conformément à la DPEB ; Par ailleurs, il est introduit une exemption pour les bâtiments existants dont la toiture est déjà végétalisée.
- Au 1er janvier 2028 : d'aligner les seuils d'assujettissement sur la DPEB (de 500 à 270m² d'emprise au sol pour les rénovations importantes et de 500 à 1100m² pour les bâtiments publics non-résidentiels existants), et de limiter les obligations pesant sur les bâtiments existants aux seuls bâtiments publics.
- Au 1er janvier 2029 : d'aligner le seuil d'assujettissement pour les bâtiments publics existant sur celui prescrit par la DPEB à cette date (de 1100 à 410 m² d'emprise au sol).
- Au 1er janvier 2030 : d'étendre les obligations à toutes les constructions de bâtiments résidentiels neufs et aux parkings de plus de trois places jouxtant un bâtiment, conformément à la DPEB.
- Au 1er janvier 2031 : d'aligner le seuil d'assujettissement pour les bâtiments publics existant sur celui prescrit par la DPEB à cette date (de 410 à 130 m² d'emprise au sol).
Par ailleurs, le texte propose également de transférer à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme les obligations concernant les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés provenant de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ainsi, le champ d'application des dispositions de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme qui s'appliquent aux parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments listés dans l'article L. 171-4 du CCH n'est pas modifié, en cohérence avec le fait que ces derniers ne soient pas concernés par le périmètre d'application de l'article 10 de la directive.
En effet, maintenir les obligations prévues au L. 171-4 du CCH concernant les parcs de stationnements non couverts emporterait un élargissement de ces obligations, non prévues par la loi APER et non prévues par la DPEB, notamment cela élargirait ces obligations aux stationnements associés aux bâtiments résidentiels neufs. Le transfert de l'obligation vers le code de l'urbanisme permet également de rendre ces obligations beaucoup plus lisibles.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Il a été choisi de remplacer explicitement dans l'article L.100-1-A du code de l'énergie la mention de la LTRS par la mention du plan national de rénovation. Le plan national de rénovation devra donc être conforme aux lois de programmation énergie-climat, qui sont l'instrument de programmation principal dans ce domaine, et le contenu de la loi sera clair pour toutes et tous.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Le dispositif prévoit la modification de l'article L. 224-1 du code de l'environnement pour y introduire l'obligation d'inspection des systèmes de ventilation lorsque le système de ventilation ou la combinaison des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dépasse un niveau de puissance fixé règlementairement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Section 1 : définition de la rénovation importante
La présente section modifie l'article L. 111-1 (en introduisant la définition de « rénovation importante ») du code de la construction et de l'habitation.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
La présente section modifie les dispositions des articles L. 113-11 à L. 113-15 et L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l'habitation.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
La présente section modifie les articles L. 126-27 (rénovation importante) et L.126-29 (renouvellement de bail) du code de la construction et de l'habitation.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Les articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, sont modifiés.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
La présente section modifie le 5° du II de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Une modification est introduite dans le code de l'environnement à l'article L.224-1.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Section 1 : définition de la rénovation importante
La disposition permet une pleine mise en conformité avec l'article 2 de la DPEB. Elle n'entre pas en contradiction avec d'autres normes internationales.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Les dispositions envisagées permettent de se mettre en conformité avec l'article 14 de la DPEB. Elle n'entre pas en contradiction avec d'autres normes internationales.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
La disposition permet une pleine mise en conformité avec l'article 20 de la DPEB. Elle n'entre pas en contradiction avec d'autres normes internationales.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Les dispositions envisagées permettent de se mettre en conformité avec l'article 1 de la DPEB.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
La disposition est conforme à l'article 3 de la DPEB, qui prévoit la réalisation du plan national de rénovation, et, à l'annexe II, le contenu de celui-ci. Elle n'entre pas en contradiction avec d'autres normes internationales.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
La disposition assure la cohérence du droit national en intégrant la ventilation et permet une pleine mise en conformité avec les articles 13 et 23 de la directive 2024/1275 du 24 avril 2024.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Evaluation du périmètre : l'estimation du nombre de bâtiments (constructions neuves, rénovations importantes et bâtiments existants) et du nombre de m² d'emprise au sol assujettis à la mesure ont été estimées par une étude du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) en 2025. L'évaluation de l'impact prend en compte les bâtiments impactés par le projet de loi de transposition en intégrant les différentes typologies.
Les hypothèses retenues sont les suivantes ;
- Le nombre de bâtiments faisant l'objet d'une rénovations importantes est très difficile à évaluer au travers des données disponibles. Cependant, afin de l'estimer, nous pouvons considérer un taux de rénovation importante de l'ordre de 1,5% du parc existant par an (« Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de l'Île-de-France » de 2012, Préfecture de la région Île-de-France et Conseil régional d'Ile-de-France) ;
- La répartition des bâtiments par type d'acteur (Etat, collectivité, entreprises...) est issue des fichiers fonciers qui ne disposent cependant pas d'une information systématique de la nature du propriétaire ;
- Enfin, il n'est pas possible d'estimer le nombre de maîtres d'ouvrages ou de propriétaires de bâtiments qui solliciteront une dérogation à l'obligation. En effet, il existe plusieurs cas possibles de dérogations : pour raisons architecturales et patrimoniales, conditions économiques, difficultés techniques insurmontables et pour des questions de sécurité (notamment incendie) - comme prévu par le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. Par conséquent, l'évaluation de l'impact est estimée de façon maximaliste en prenant en compte l'ensemble des assujettis, quand bien mêmes ceux-ci pourraient solliciter une dérogation. Les données à cet égard sont surestimées.
Calcul de l'impact économique :
- Seul l'impact économique de l'installation d'un dispositif d'énergie renouvelable solaire est évalué (la végétalisation étant supprimée de l'obligation par le présent projet de transposition).
- La loi en vigueur prévoit au III du L. 171-4, un pourcentage minimal de surface à couvrir (30% depuis juillet 2023, puis 40% en 2026 et enfin 50% en 2027), l'impact économique est donc calculé sur la base de cette exigence minimale ;
- Le calcul prend en compte un coût d'installation de panneaux solaires en toiture (pose, raccordement, matériel...) moyen de 200 €/m² ;
- Il faut également considérer le retour sur investissement : celui-ci, pour les panneaux photovoltaïques, varie en fonction de différents paramètres (autoconsommation, valorisation du surplus, ensoleillement du site...). En moyenne, d'après les informations des administrations prenant en compte les informations données par les installateurs de panneaux solaires modulées avec les risques (ensoleillement moindre, panneaux moins rentables que prévu etc) pour garder une approche conservatrice, le temps de retour sur investissement se situe entre 10 à 20 ans.
Impacts globaux en fonction de la date l'entrée en vigueur de la mesure :
1er janvier 2027 :
- Pour les constructions neuves : les typologies précises de bâtiments décrites au L. 171-4 du CCH sont remplacées par la typologie générique “non-résidentielle” qui couvre un plus large périmètre que celui prévu dans la loi française actuelle, et le seuil d'assujettissement est abaissé de 500m² à 130m² ;
- Ainsi, au 1er janvier 2027, la mesure aura un impact sur 23 000 bâtiments supplémentaires (par rapport au périmètre actuel de la loi) - cela représentant 22 millions m² d'emprise au sol supplémentaires.
1er janvier 2028 :
- Pour les bâtiments existants : les typologies précises de bâtiment publics et privés décrites au L. 171-5 du CCH sont remplacées par la typologie “ Bâtiments publics existants, non-résidentiels ” qui couvre un plus faible périmètre que celui prévu dans la loi française à l'heure actuelle. En effet, la DPEB vise à échelonner l'entrée en vigueur de l'obligation, et ne cible que le tertiaire public, tandis que la loi actuelle assujettit tous les bâtiments existants des typologies concernées en même temps. De plus, le seuil d'assujettissement à l'entrée en vigueur des dispositions en 2028 est augmenté de 500m² (droit actuel) à 1100m² (DPEB).
- Ainsi, au 1er janvier 2028, moins de bâtiments existants seront concernés par l'obligation que dans la loi actuelle - on passe de 489 000 bâtiments à 66 000 bâtiments, ce qui représente une diminution de 845 millions à 155 millions de m² d'emprise au sol.
- Pour les bâtiments rénovés : les bâtiments non-résidentiels dont la surface d'emprise au sol est supérieure à 270 m², lorsque le bâtiment fait l'objet d'une rénovation importante, sont soumis à la mesure (par rapport au seuil actuel de 500m²) ;
- Ainsi, au 1er janvier 2028, pour les bâtiments rénovés, la mesure aura un impact sur 11 000 bâtiments supplémentaires (par rapport au périmètre actuel de la loi) - cela représentant 12.6 millions de m² d'emprise au sol supplémentaires.
1er janvier 2029 :
- Pour les bâtiments publics existants : le seuil d'emprise au sol pour l'assujettissement abaissé de 1100 m² à 410 m² ;
- Ainsi, au 1er janvier 2029, la mesure aura un impact sur 124 000 bâtiments supplémentaires - cela représentant 82 millions de m² d'emprise au sol supplémentaires.
1er janvier 2030 :
- Pour les bâtiments neufs résidentiels : tous les bâtiments sont assujettis, quelle que soit leur surface.
- Ainsi, au 1er janvier 2030, la mesure aura un impact sur 162 000 bâtiments supplémentaires (par rapport au périmètre actuel de la loi, qui ne concerne pas les bâtiments résidentiels) - cela représentant 24 millions m² d'emprise au sol supplémentaires.
1er janvier 2031 :
- Pour les bâtiments publics existants : le seuil d'emprise au sol pour l'assujettissement est abaissé de 410 m² à 130 m².
- Ainsi, au 1er janvier 2031, la mesure aura un impact sur 256 000 bâtiments supplémentaires (par rapport au périmètre actuel de la loi) - cela représentant 60 millions de m² d'emprise au sol.
|
1er janvier 2027 |
1er janvier 2028 |
1er janvier 2029 |
1er janvier 2030 |
1er janvier 2031 |
||
|
Neuf |
Surface d'emprise au sol [m²] |
+22m |
+24 m |
|||
|
Nombre de bâtiments |
+23 000 |
+162 000 |
||||
|
Rénovation |
Surface d'emprise au sol [m²] |
+12.6 m |
||||
|
Nombre de bâtiments |
+11 000 |
|||||
|
Existant |
Surface d'emprise au sol [m²] |
-690m |
+82 m |
+60m |
||
|
Nombre de bâtiments |
-423 000 |
+124 000 |
+256 000 |
|
Nombre de bâtiments supplémentaires |
1er janvier 2027 |
1er janvier 2028 |
1er janvier 2029 |
1er janvier 2030 |
1er janvier 2031 |
|
|
Neuf |
Surface d'emprise au sol [m²] |
+22m |
+22m |
+22m |
+47 m |
+47 m |
|
Nombre de bâtiments |
+23 000 |
+23 000 |
+23 000 |
+182 000 |
+182 000 |
|
|
Rénovation |
Surface d'emprise au sol [m²] |
+12.6 m |
+12.6 m |
+12.6 m |
+12.6 m |
|
|
Nombre de bâtiments |
+11 000 |
+11 000 |
+11 000 |
+11 000 |
||
|
Existant |
Surface d'emprise au sol [m²] |
-690m |
+82 m |
0 |
+60m |
|
|
Nombre de bâtiments |
-423 000 |
+124 000 |
0 |
+256 000 |
||
|
Total |
Surface d'emprise au sol [m²] |
-655 m |
+117 m |
+60m |
+255m |
|
|
Nombre de bâtiments |
-389 000 |
+158 000 |
+193 000 |
+449 000 |
Attention : les surfaces (m²) exprimées ci-dessus sont les surfaces totales d'emprise au sol des bâtiments soumis à l'obligation, sans déduction du pourcentage minimum de toiture à couvrir (à savoir 40%, puis 50% à compter du 1er juillet 2027) pour évaluer l'impact économique de la mesure.
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Section 1 : définition de la rénovation importante
Sans objet.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
L'impact sur l'emploi concerne un large éventail d'activités, non seulement dans le secteur des transports (construction, maintenance, exploitation), mais aussi dans l'industrie. La transition vers les mobilités durables génère déjà des créations d'emplois, par exemple dans la filière automobile électrique (fabrication de batteries, véhicules, bornes de recharge) ou encore dans l'économie du vélo, qui représentait environ 47 000 emplois directs en France en 2022.199(*) Face à ces évolutions, les opérateurs de transport et les industriels engagent des réflexions sur l'adaptation des compétences. En effet, étendre le champ d'application de la législation peut contribuer à mobiliser un plus grand nombre de professionnels, qu'il s'agisse du secteur automobile ou de la filière vélo. Ces mutations s'accompagnent d'enjeux forts en matière de formation, de reconversion professionnelle et de structuration des filières, afin d'accompagner les transitions technologiques et répondre aux besoins en compétences émergents.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
L'obligation pourrait dynamiser la filière du diagnostic énergétique, créant une demande accrue en prestations de DPE après rénovation. Elle favorisera à long terme la performance énergétique du parc bâti, avec des retombées positives en termes de consommation énergétique nationale.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
À court terme, ces nouvelles obligations pourraient stimuler la croissance économique par une augmentation de l'investissement privé et public dans les filières concernées (gestion de l'énergie produite, fourniture de panneaux solaires et photovoltaïques, travaux d'installation, maintenance). Des emplois seront créés dans les secteurs du bâtiment, de l'ingénierie, de la logistique et des énergies renouvelables.
Il faut également considérer le retour sur investissement : celui-ci, pour les panneaux photovoltaïques, varie en fonction de différents paramètres (autoconsommation, valorisation du surplus, ensoleillement du site...). En moyenne, d'après l'information des administrations au regard des données fournies par les installateurs de panneaux solaires corrigées des risques potentiels (voir supra), le temps de retour sur investissement se situe entre 10 à 20 ans.
À moyen terme, la montée en compétence des entreprises et la structuration de la filière pourraient améliorer la compétitivité industrielle nationale, en particulier si une part significative des équipements est produite localement.
Sur le long terme, la réduction de la dépendance énergétique et la substitution partielle aux importations d'énergies fossiles pourraient contribuer à un rééquilibrage de la balance commerciale.
Toutefois, la montée en puissance de la demande pourrait aussi entraîner des tensions sur les prix et les chaînes d'approvisionnement, susceptibles d'alimenter temporairement l'inflation.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Cette disposition permet de favoriser la connaissance des systèmes de ventilation et favorisera la réflexion sur de futures mesures qui pourraient avoir un impact sur la filière de construction. Cette mesure ne devrait pas entrainer de conséquences macroéconomiques à court et long terme.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Section 1 : définition de la rénovation importante
Sans objet.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Les évolutions législatives récentes visent à harmoniser le cadre juridique avec les exigences européennes. Ainsi, une dérogation demeure possible, notamment en cas de rénovation importante, lorsque le coût des équipements de recharge et de raccordement dépasse 10 % du coût total des travaux.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Les diagnostiqueurs verront leur activité augmenter légèrement. Les entreprises de travaux devront intégrer le coût du DPE dans les offres de rénovation.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
A l'heure actuelle, telle qu'issues des lois « climat et résilience » et APER, l'obligation d'installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation des bâtiments non résidentiels, concerne les bâtiments neufs (depuis 2023), ceux qui font l'objet d'une extension ou rénovation lourde (depuis 2023) et les bâtiments existants (à partir de 2028) sous réserve que ce soient des bâtiments non résidentiels d'une taille supérieure à 500m² d'emprise au sol. Les typologies des bâtiments concernés sont définie aves précision : “bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol.”
En cohérence avec la DPEB, le projet de loi prévoit de modifier la description des typologies concernées (plus large puisqu'on vise les bâtiments résidentiels ou non résidentiels) et les surfaces d'emprise au sol qui diminuent. La principale différence qui constitue un impact majeur est la suppression de la mesure pour les bâtiments non résidentiels existants privés. Plus précisément le projet de loi prévoit que les entreprises seront amenées à installer des équipements de solarisation sur :
· Les bâtiments non résidentiels neufs (au-delà de 130m² d'emprise au sol) dès 2027 ;
· Les bâtiments non résidentiels, faisant l'objet de rénovations importantes (au-delà de 270m² d'emprise au sol) dès 2028 ;
· Ainsi que sur tous leurs bâtiments résidentiels neufs dès 2030, quelle que soit la taille du bâtiment.
En termes d'activité économique, il en résulte une augmentation d'activité, pour les entreprises qui produisent, importent, commercialisent, maintiennent et équipent les bâtiments en panneaux solaires. Celle-ci n'a pas pu être quantifiée. En revanche, le retrait de la possibilité de choisir de végétaliser le toit, fait perdre aux entreprises concernées le marché escompté du fait d'une mesure obligatoire ; toutefois il était déjà attendu que la solarisation emporte davantage d'intérêt compte tenu du retour sur investissement possible.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Le renforcement des obligations d'inspection devrait bénéficier à plusieurs filières économiques :
· Bureaux d'études et entreprises qualifiées (certifiées Qualibat, OPQIBI...) pour la réalisation des inspections.
· Organismes de formation : montée en compétence des professionnels en inspection, équilibrage aéraulique, contrôle de performance énergétique.
· Fabricants d'équipements de mesure, en lien avec les protocoles PROMEVENT200(*) et PROMEVENT tertiaire201(*) pour les systèmes de ventilation notamment.
La montée en charge progressive permettra de structurer l'offre sur tout le territoire, tout en évitant un effet inflationniste à court terme.
Parallèlement, les entreprises disposant d'établissements recevant du public (ERP) et de bâtiments à usage professionnel dotés de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation d'une puissance supérieure à 70 kW non équipés de BACS (système d'automatisation et de contrôle des bâtiments) devront financer le coût de ces inspections.
Ce nombre devra être très limité, en raison du Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur (dit BACS), qui impose l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle pour tous les bâtiments tertiaires équipés de système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance est supérieure à 70 kW d'ici le 1er janvier 2027.
4.2.3. Impacts budgétaires
Section 1 : définition de la rénovation importante
Sans objet.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
L'Etat est impacté dans la mesure où il possède des parcs de stationnement associés à des bâtiments. L'évaluation précise de l'impact financier de cette mesure demeure complexe à ce stade, les conditions d'application, notamment le type et le nombre d'infrastructures à installer, devant être définies par les textes réglementaires à venir. Les fiches d'impact accompagnant les textes d'application viendront préciser les incidences financières induites par l'augmentation du nombre d'emplacements devant être pourvus en infrastructures de recharge pour véhicules électriques ainsi qu'en dispositifs de stationnement sécurisé pour les vélos.
À titre indicatif, l'étude d'impact de la loi n°2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 avait estimé le coût d'installation d'une borne de recharge pour un véhicule électrique à 2 500 € par borne installée et à 350 € par place pré-équipée. Le coût d'une place précâblée n'avait pas été estimé car le précâblage est introduit par la directive (UE) n°2024-1275.
Par ailleurs, la fiche d'impact du décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments avait estimé le coût financier associé à l'installation d'une place de stationnement pour un vélo à environ 464,50 € TTC par place.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Sans objet.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
L'équipement massif en panneaux solaires engendrera des retombées fiscales. Celles-ci se traduisent principalement par des recettes supplémentaires liées aux investissements, à l'exploitation et aux emplois créés. On peut notamment citer la TVA, les impôts, les cotisations sociales.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Section 1 : définition de la rénovation importante
Sans objet.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Les collectivités territoriales seront impactées dans la mesure où elles possèdent des parcs de stationnement associés à des bâtiments. Les incidences financières en lien avec cette mesure s'inscrivent dans le cadre plus large décrit précédemment. Leur ampleur dépendra notamment des caractéristiques techniques des équipements retenus et du dimensionnement des aménagements. Les modalités précises, ainsi que les estimations financières afférentes, seront précisées par les textes d'application.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Les collectivités territoriales supporteront le coût de réalisation d'un DPE lors d'opérations de rénovations importantes dans leur parc de bâtiments. Il n'est pas possible de chiffrer un tel coût faute de connaître l'ampleur de telles rénovations dans les années à venir.
Les collectivités n'auront pas de rôle direct dans la délivrance des DPE, mais pourront intégrer cette donnée dans leur stratégie énergétique et de rénovation locale.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
La législation en vigueur prévoit que les bâtiments publics neufs (dès 2025), ou faisant l'objet d'une rénovation lourde (dès 2025) ou les bâtiments publics existants (à partir de 2028), qui ont une surface de plus de 500m² d'emprise au sol, sont soumis à l'obligation de solariser ou végétaliser.
L'impact sur les collectivités territoriales de l'article L. 171-4 du CCH, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi APER, aboutissait ainsi à soumettre dès le 1er janvier 2025, 1 700 bâtiments/an et 2.4 millions m² d'emprise au sol par an. De même l'article L. 171-5 du CCH, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi APER, conduisait à assujettir 72 000 bâtiments existants et 95 millions de m² de surface d'emprise au sol.
Avec la présente proposition de transposition, les dispositions régissant la solarisation des bâtiments appartenant aux collectivités locales (essentiellement la catégorie « non résidentiels publics » et « résidentiel ») sont les suivantes :
· Dès 2027 pour les bâtiments neufs non résidentiels publics de taille supérieure à 130m² d'emprise au sol ;
· dès 2028 pour les bâtiments non résidentiels publics faisant l'objet d'une rénovation importante de taille supérieure à 275m²;
· successivement dès 2028, 2029, 2031 pour les bâtiments non résidentiels publics existants au-delà de 1100m², puis 410m², puis 130m² d'emprise au sol.
· ainsi que sur tous leurs bâtiments résidentiels neufs dès 2030, quelle que soit la taille du bâtiment appartenant à la collectivité.
Il est donc à noter qu'en termes d'impact, le fait que désormais l'ensemble des bâtiments publics existants soient soumis à la mesure, accroit significativement le nombre de bâtiments concernés. On estime que la transposition de l'article 10 de la DPEB impacterait 246 000 bâtiments de plus que la réglementation actuelle, soit plus de 100 millions de mètres carrés d'emprise au sol supplémentaires.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Les collectivités territoriales disposant d'établissements recevant du public (ERP) et de bâtiments à usage professionnel dotés de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation d'une puissance supérieure à 70 kW non équipés de BACS (système d'automatisation et de contrôle des bâtiments) devront financer le coût de ces inspections.
Ce nombre devrait être très limité, en raison du décret BACS, qui impose l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle pour tous les bâtiments tertiaires équipés de système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance est supérieure à 70 kW d'ici le 1er janvier 2027.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Section 1 : définition de la rénovation importante
Sans objet.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Sans objet.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Sans objet.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Avec la présente proposition de transposition, les dispositions régissant l'installation d'équipement solaires en toiture des bâtiments appartenant aux administrations (essentiellement la catégorie « « non résidentiels publics » et « résidentiel ») sont les suivantes :
· dès 2027 pour les bâtiments neufs non résidentiels publics de taille supérieure à 130m² d'emprise au sol;
· dès 2028 pour les bâtiments non résidentiels publics faisant l'objet d'une rénovation lourde de taille supérieure à 275m²;
· successivement dès 2028, 2029, 2031 pour le bâtiments non résidentiels publics existants au delà de 1100m², puis 410m², puis 130m² d'emprise au sol;
· ainsi que pour les bâtiments résidentiels neufs dès 2030, quelle que soit la taille du bâtiment appartenant à la collectivité.
Comme pour les bâtiments relevant des collectivités territoriales, la transposition de la DPEB a pour effet d'augmenter de nombre de typologies de bâtiments publics compte tenu de la prise en compte de l'ensemble des « bâtiments publics non résidentiels » en lieu et place d'une liste de typologies spécifiques. De plus le seuil des bâtiments diminue d'un seuil de 500m² d'emprise au sol minimum, à un seuil de 130m² d'emprise au sol minimum. Enfin, les bâtiments existants appartenant à l'Etat et aux services administratifs, sont désormais soumis à l'obligation de solariser. L'impact est ainsi évalué à 18 millions de m² de plus et 45400 bâtiments supplémentaires assujettis à l'obligation de solarisation entre 2028 et 2031.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Section 1 : définition de la rénovation importante
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
La généralisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de stationnement sécurisé pour vélos dans les bâtiments contribue à lever un frein structurel à l'adoption des mobilités durables. Elle favorise la réduction des émissions polluantes et l'amélioration de la qualité de l'air, avec des effets positifs sur la santé publique. En intégrant ces équipements dans les lieux de vie, la mesure participe également à la normalisation des usages durables et à une meilleure équité d'accès, en particulier dans l'habitat collectif urbain.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
L'information du public en matière de performance énergétique sera améliorée, permettant de dynamiser les rénovations énergétiques, avec les bénéfices environnementaux associés.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Sans objet.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
La réalisation du plan national de rénovation, en cohérence avec les lois de programmation énergie-climat, permettra de traduire opérationnellement les grandes orientations nécessaires à l'atteinte des objectifs de rénovation énergétique.
Cela permettra de concerter autour des choix de politiques publiques à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de rénovation, et de donner de la visibilité sur les actions retenue par l'Etat.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Les diagnostiqueurs DPE, qui font partie des professions réglementées, sont directement concernés. Le rôle de ces professionnels est renforcé mais le présent article ne limite ni l'accès ni les modalités d'exercice de cette profession et n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive 2018/958 du 28 juin 2018 relative au contrôle de proportionnalité pour une nouvelle réglementation de professions.
Sans objet pour les autres sections.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Section 1 : définition de la rénovation importante
Sans objet.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
La multiplication des solutions de recharge accessibles à tous permet de favoriser le passage d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Pour les ménages, la disponibilité de ces infrastructures à domicile facilite le passage à un véhicule électrique ou à un vélo comme mode de transport principal. Elle permet de réduire les contraintes liées à la recharge et au stationnement, encourageant ainsi un changement durable des habitudes de mobilité.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Les propriétaires seront tenus de fournir un DPE dans les cas précisés. Cela représente un coût modéré mais utile pour valoriser la rénovation réalisée.
On peut estimer un nombre de 80 000 logements faisant l'objet d'une rénovation importante et donc concernées annuellement, au vu des rénovations aidées en 2025. Dans le cadre de ces parcours de rénovation, la réalisation du DPE sera cependant mutualisable avec d'autres étapes (audit énergétique, visite de fin de chantier par l'accompagnateur, etc.).
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
La transposition conduit à intégrer les bâtiments résidentiels neufs à l'obligation de développer de l'énergie solaire quelle que soit la taille du bâtiment à partir de 2030. Ainsi, les particuliers qui font construire leur logement seront concernés par l'obligation, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il est à noter que la prise en compte dès la conception du bâtiment de la nécessité d'intégrer des dispositifs de production d'énergie solaire, réduit les couts d'équipement par rapport à l'installation sur bâtiment existant. Cela n'empêche pas de nombreux particuliers de choisir d'équiper, à titre volontaire, leurs maisons individuelles existantes.
A noter que la base de données nationale des bâtiments (BDNB) du CSTB indique que de nombreux bâtiments non résidentiels appartiennent à des particuliers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation liée aux bâtiments non résidentiels privés.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Les copropriétés dotées de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation d'une puissance supérieure à 70 kW non équipés de BACS (système d'automatisation et de contrôle des bâtiments) seront tenues d'effectuer ces inspections.
L'introduction de l'obligation d'inspection des systèmes de ventilation, en complément de ceux de chauffage et de climatisation, devrait avoir un impact limité sur le volume total de bâtiments concernés. En effet, les systèmes de chauffage restent prédominants en termes de puissance installée, et donc de déclenchement de l'obligation réglementaire (seuil à fixer règlementairement mais qui ne peut être supérieur à 70 kW en application de la directive).
· La puissance d'un système de ventilation est généralement comprise entre 0,1 et 1 kW.202(*)
· À l'inverse, celle des systèmes de chauffage est couramment de l'ordre de 10 à plusieurs centaines de kW.203(*)
· La climatisation, lorsqu'elle existe, est généralement entre 8 et 20 kW par logement, mais peut être mutualisée dans le cas de systèmes collectifs.204(*)
Ø Logements individuels
Les maisons individuelles sont très largement exclues du champ de la mesure, car leur puissance cumulée en chauffage, climatisation et ventilation reste en dessous du seuil réglementaire.
Par exemple, pour une maison de 70 m² et de 2,5m
de hauteur sous plafond mal isolée :
· Chauffage : 8-12 kW205(*)
· Climatisation : 8-9 kW (si présente)206(*)
· Ventilation : < 1 kW207(*)
? Total
cumulé : 17 à 22 kW, bien inférieur aux 70 kW
requis.
Ø Logements collectifs
Selon les données du registre national des copropriétés (ANAH), la répartition du parc résidentiel collectif est la suivante :
|
Taille des copropriétés |
Nombre de copropriétés |
|
Inférieure à 10 lots |
Environ 327 000 (294 300 dites non horizontales) |
|
Comprise entre 11 et 49 lots |
Environ 213 000 |
|
Comprise entre 50 et 199 lots |
Environ 55 000 |
|
Supérieure à 200 lots |
Environ 3 000 |
|
Total |
Environ 598 000 |
En excluant les copropriétés horizontales (environ 10 %), soit 32 700 entités constituées de maisons individuelles, on retient 565 000 copropriétés relevant potentiellement de l'obligation.
En l'absence de données complètes sur la puissance cumulée dans les petits immeubles, l'hypothèse suivante est retenue :
|
Taille de copropriété |
Part estimée soumise à inspection |
Nombre estimé de copropriétés à inspecter |
|
< 10 lots |
30% |
88 290 |
|
11-49 lots |
80% |
170 400 |
|
50-199 lots |
95% |
52 250 |
|
= 200 lots |
95% |
2 850 |
|
Total |
313 790 |
On estime alors qu'environ 315 000 immeubles collectifs, déjà soumis à des inspections régulières de leur système de chauffage, devront réaliser des inspections de leurs systèmes de ventilation et de climatisation après l'entrée en vigueur de la mesure.
En se basant par les tarifs réalisés par Qualibat et l'Organisme professionnel de qualification de l'ingénierie bâtiment industrie (OPQIBI), on arrive à l'estimation suivante pour une inspection :
|
Type de Bâtiment |
Estimation coût contrôle (systèmes techniques complets) |
|
Logement collectif |
2 600 à 6 000 € HT |
|
Tertiaire/Industriel |
5 000 à 12 000 € HT |
Notons que les coûts varient fortement selon notamment :
· Puissance et le type de système installées
· Niveau de centralisation
· Accessibilité des réseaux et équipements
· Besoin de tests de débits réels ou balances aérauliques
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Section 1 : définition de la rénovation importante
Sans objet.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
La disposition proposée vise à accélérer le développement des mobilités durables, en soutenant à la fois le déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et celui d'espaces de stationnement sécurisé pour les vélos. La mise à disposition d'infrastructures adaptées constitue un levier essentiel pour encourager le recours à des modes de déplacement plus durables. Cet enjeu est d'autant plus important que le secteur des transports reste le principal émetteur de gaz à effet de serre (GES) en France. Selon le ministère de la Transition écologique 208(*), 97 % des GES émis par ce secteur proviennent de la combustion de carburants fossiles, et les véhicules particuliers sont responsables à eux seuls de 54 % des émissions liées à la circulation routière.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
La mesure a un impact environnemental positif indirect : elle encourage la réalisation de rénovations énergétiques performantes et en assure le suivi. Elle s'inscrit dans les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
La mesure contribuera à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, ce qui est favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique. Cela contribue à atteindre la neutralité carbone, comme le montre l'étude de Réseau de transport d'électricité (RTE) sur les Futurs énergétiques 2050209(*).
La mobilisation des toitures, qui constituent des surfaces par nature déjà artificialisées, est conforme à l'objectif de zéro artificialisation nette et permet d'éviter la consommation d'espaces naturels ou agricoles.
A noter que la suppression de l'alternative permettant aux maîtres d'ouvrages et propriétaire de bâtiments de faire le choix entre solarisation ou végétalisation, conformément à la DPEB, conduira à réduire le nombre de bâtiments faisant le choix de la végétalisation pour répondre à l'obligation et, ce faisant, à réduire les impacts bénéfiques de la végétalisation notamment pour lutter contre les ilots de chaleur et favoriser la biodiversité en ville, ou améliorer la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Des solutions mixtes « bio solaires », qui consistent en la pose de panneaux solaires sur une toiture végétalisée (donc de la combinaison sur la même surface des deux dispositifs), sont cependant possibles.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
La mesure a un impact environnemental positif indirect : elle encourage le remplacement de systèmes techniques anciens et peu performants par des systèmes techniques récents et plus performants, à travers l'exemption de l'obligation d'inspection lorsque le bâtiment est équipé d'un BACS (système d'automatisation et de contrôle des bâtiments).
L'inspection des systèmes de ventilation permet de garantir leur bon fonctionnement et de garantir la protection de la santé des occupants par un renouvellement de l'air intérieur dans les bâtiments et ainsi de respecter les normes de qualité de l'air intérieur.
Elle s'inscrit donc dans les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Section 1 : définition de la rénovation importante
Des échanges préliminaires ont été engagés avec les acteurs de la filière (diagnostiqueurs, bailleurs, agences de l'État).
En application de l'article R.361-2 du code de la construction et de l'habitation, le Conseil national de l'habitat (CNH) a été consulté et a rendu un avis favorable le 4 juillet 2025.
En application de l'article L.121-6 du code de la construction et de l'habitation, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) a été consulté et a rendu un avis défavorable le 08 juillet 2025.
En application de l'article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté et a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
En application de l'article L.121-6 du code de la construction et de l'habitation, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) a été consulté et a rendu un avis défavorable sur l'ensemble du présent article le 8 juillet 2025.
En application de l'article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté et a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Des échanges préliminaires ont été engagés avec les acteurs de la filière (diagnostiqueurs, bailleurs, agences de l'État).
En application de l'article R.361-2 du code de la construction et de l'habitation, le Conseil national de l'habitat (CNH) a été consulté et a rendu un avis favorable le 4 juillet 2025.
En application de l'article L.121-6 du code de la construction et de l'habitation, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) a été consulté et a rendu un avis défavorable le 08 juillet 2025.
En application de l'article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté et a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
En application de l'article L.121-6 du code de la construction et de l'habitation, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) a été consulté et a rendu un avis défavorable sur l'ensemble du présent article le 8 juillet 2025.
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire et a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Le Conseil Supérieur de la Construction et de l'Efficacité Energétique a été consulté sur ces dispositions et a rendu un avis défavorable le 08/07/2025, en même temps que le reste des dispositions de transposition de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments. Cette consultation n'était pas obligatoire.
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire et a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire et a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.
En application des articles L. 121-6 et D. 121-12 du code de la construction et de l'habitation, d'un avis défavorable du CSCEE le 08/07/2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Section 1 : définition de la rénovation importante
Les présentes dispositions s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Les dispositions des d) et i) du 1° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Elles peuvent toutefois être satisfaites au plus tard au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui ont fait l'objet d'une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.
Les autres dispositions du II du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Les présentes dispositions s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. L'obligation de DPE post-rénovation s'appliquera aux rénovations achevées après l'entrée en vigueur du texte.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Les dispositions prévoient un calendrier d'entrée en application graduel entre 2027 et 2031.
Par année d'entrée en vigueur, le texte prévoit :
- Au 1er janvier 2027 : de réduire la surface des bâtiments soumis à l'obligation de solariser lors de la construction de bâtiments non résidentiels de 500 à 130 m².
- Au 1er janvier 2028 : de substituer la notion de rénovation « lourde » actuellement en vigueur en droit français par celle de rénovation « importante » conformément à la DPEB, d'aligner le seuil d'assujettissement sur la DPEB (de 500 à 270m² d'emprise au sol pour les rénovations importantes et de 500 à 1100m² pour les bâtiments publics non-résidentiels existants), et de limiter les obligations pesant sur les bâtiments existants aux seuls bâtiments publics, comme cela est prévu par la DPEB. Par ailleurs, une exemption est accordée pour les bâtiments existants déjà végétalisés.
- Au 1er janvier 2029 : d'aligner le seuil d'assujettissement pour les bâtiments publics existant sur celui prescrit par la DPEB à cette date (de 1100 à 410 m² d'emprise au sol).
- Au 1er janvier 2030 : d'étendre les obligations à tous les bâtiments résidentiels neufs et aux parkings couverts de plus de trois places jouxtant un bâtiment, conformément à la DPEB.
- Au 1er janvier 2031 : d'aligner le seuil d'assujettissement pour les bâtiments publics existant sur celui prescrit par la DPEB à cette date (de 410 à 130 m² d'emprise au sol).
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
La mesure entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le plan national de rénovation, quand il sera produit, devra être cohérent avec les lois de programmation énergie-climat.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Afin de permettre aux acteurs de s'organiser, une application progressive de la mesure pourra être prévue sur une période transitoire, dont les modalités exactes seront fixées par Décret en Conseil d'Etat. Pendant cette période, tous les systèmes techniques concernés (chauffage, climatisation, ventilation) devront faire l'objet d'une première inspection conforme aux exigences prévues.
5.2.2. Application dans l'espace
Section 1 : définition de la rénovation importante
La présente disposition est applicable en France.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
La mesure proposée est applicable sur le territoire métropolitain ainsi qu'aux collectivités de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Elle n'est pas applicable aux collectivités de l'article 74 de la Constitution (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et Polynésie française), ni à la Nouvelle-Calédonie.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Application sur l'ensemble du territoire hexagonal.
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments s'applique, en vertu de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) ainsi que dans la collectivité de Saint-Martin, qui relève du statut de région ultrapériphérique de l'Union.
Toutefois, la méthode nationale du diagnostic de performance énergétique (3CL-DPE), socle du dispositif métropolitain, n'a pas été conçue pour les conditions climatiques, énergétiques et constructives propres aux territoires ultramarins. Dans le cadre des habilitations prévues par la loi, certaines collectivités (Guadeloupe, Martinique) ont, à ce titre, développé des outils adaptés (DPE-G et DPE-M).
En conséquence, si la transposition nationale couvrira bien l'ensemble du territoire de la République, son effectivité dans les régions ultrapériphériques suppose l'adoption de mesures réglementaires d'adaptation, destinées à :
- intégrer les spécificités climatiques et constructives locales (ensoleillement, hygrométrie, ventilation naturelle, inertie, mix énergétique insulaire) dans le moteur de calcul ;
- assurer la comparabilité des classes et indicateurs avec ceux de la métropole, conformément à l'exigence d'harmonisation européenne ;
- garantir l'uniformité des registres, formats et obligations de délivrance prévus par la directive, sur l'ensemble du territoire de la République, y compris dans les collectivités à statut particulier.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
La mesure proposée s'applique à l'ensemble des territoires de la République française soumis aux dispositions du code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation à savoir la France métropolitaine ainsi que les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Elle ne s'applique pas aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Sans objet. Les dispositions concernent uniquement la production du plan national de rénovation.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Application sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pas d'application de la mesure dans les territoires ultramarins RUP et non RUP.
5.2.3. Textes d'application
Section 1 : définition de la rénovation importante
Cette section crée une définition, elle ne renvoie donc pas à un texte d'application.
Section 2 : développer les infrastructures de mobilités durables
Cette section renvoie expressément à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour sa mise en oeuvre, afin de fixer les conditions techniques auxquelles doivent répondre les infrastructures de recharge des véhicules électriques et de stationnement sécurisé des vélos, notamment les taux d'équipement à respecter en fonction de l'usage du bâtiment.
Section 3 : délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors d'une rénovation importante ou d'un renouvellement de bail
Cette section ne nécessite pas de texte d'application.
Section 4 : déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments et les parcs de stationnement
Les textes pris en application du L. 171-4 devront être modifiés, à savoir :
· Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ;
· Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes ;
· Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture ;
De plus, les textes d'application du L. 171-5, actuellement non rédigés, devront être publiés (décret en Conseil d'Etat).
Section 5 : substituer à la mention de la stratégie de rénovation à long terme (LTRS) le Plan national de rénovation des bâtiments (NBRP)
Cette disposition ne requiert pas de mesure d'application.
Section 6 : mise en place des inspections des systèmes de ventilation
Un décret en Conseil d'Etat viendra compléter les articles R. 224-20 à R. 224-45-9 de la partie réglementaire du Code de l'Environnement pour permettre de préciser les modalités d'inspection applicables pour les systèmes de ventilation et les combinaisons de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation.
Ce même décret en Conseil d'Etat définira les modalités de transmission et de mise à disposition des informations contenues dans les rapports d'inspection.
Un arrêté définira un modèle de rapport pour l'inspection des systèmes de ventilation.
Un arrêté adaptera les modèles de rapport pour l'inspection des combinaisons de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation.
Un arrêté définira enfin l'opérateur chargé de collecter les données issues de la collecte des rapports d'inspection.
TITRE VI - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'INDUSTRIE, D'ENVIRONNEMENT ET D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Article 46 - Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l`environnement - ajout des infrastructures aéroportuaires
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement vise, au moyen de cartes stratégiques de bruit (CSB), à évaluer de façon harmonisée l'exposition au bruit des populations et, par les plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE), à prévenir et à réduire les effets du bruit. Les articles 3 et 4 de la directive susmentionnée prévoient que les CSB et PPBE sont élaborés pour les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants et pour les grandes infrastructures de transport suivantes : les voies routières empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an, les voies ferroviaires comptant plus de 30 000 passagers de trains par an, les aéroports de plus de 50 000 mouvements par an.
Les CSB réalisent un diagnostic sur le niveau d'exposition au bruit actuel et à venir. Fondées sur les indices réglementaires Lden (indicateur du niveau sonore moyen sur une journée complète prenant en compte des pondérations selon les plages horaires) et Lnight (indicateur du niveau sonore moyen la nuit, de 22h à 6h), elles permettent de calculer et dénombrer, dans des tableaux d'exposition, la superficie exposée, le nombre d'habitants, le nombre d'établissements d'enseignement et le nombre d'établissements de santé. Ces tableaux, produits par le service modélisateur au moment de l'élaboration des CSB, sont intégrés dans les PPBE.
Les PPBE sont des documents stratégiques qui s'appuient sur les données contenues dans les CSB et sur les tableaux d'exposition pour faire, sur une base périodique, le point sur la situation en matière de nuisances sonores aéroportuaires, l'impact des mesures prises antérieurement et des mesures nouvelles sur lesquelles les acteurs concernés vont s'engager.
Cette directive a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 et codifiée, par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, au code de l'environnement ( article L.572-1 et suivants) pour les infrastructures terrestres, ferroviaires et pour les agglomérations.
Le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 a quant à lui procédé à la transposition des dispositions pour les aérodromes dans le code de l'urbanisme, en faisant le choix d'annexer les PPBE et les CSB des aéroports au plan d'exposition au bruit (PEB) (article R.112-5). Le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 a ensuite abrogé le décret de 2006 susmentionné et codifié ses dispositions. Pour l'aérien, s'agissant de la procédure d'élaboration des CSB et des PPBE, l'article R.112-5 renvoie alors aux articles R. 572-1 et suivants du code de l'environnement.
Le PPBE n'a pourtant pas la même portée ni le même objectif qu'un PEB.
Les PEB trouvent leur origine dans le cadre d'une directive d'aménagement nationale relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes. Les PPBE sont une création communautaire issus de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Il convient de noter que, pour ces deniers, leur champ d'application ne se limite pas aux aéroports et englobe toutes les infrastructures de transport.
Le PEB est un document d'urbanisme prescriptif : approuvés par arrêté (inter)préfectoral après une série de consultations officielles, les PEB ont un véritable effet sur l'urbanisation puisqu'ils s'imposent aux nouvelles constructions aux abords des aéroports. Ils sont d'ailleurs annexés aux plans locaux d'urbanisme des communes ou de groupements de communes : ils sont, de ce fait, opposables aux tiers lesquels peuvent s'en prévaloir devant le juge administratif à l'appui de tout recours administratif. Environ 250 PEB sont ainsi répertoriés.
Les PPBE sont des instruments de coordination de l'action des différents acteurs sur un territoire, sur la base d'une analyse partagée de la gestion du bruit. Ils sont de simples documents de planification qui reflètent l'engagement des acteurs mais n'imposent aucune mesure réglementaire visant à assurer la protection de l'environnement sonore d'un aérodrome. Ils ne sont obligatoirement établis et révisés que pour les principales plateformes nationales.
Par ailleurs, le PEB et le PPBE ne s'articulent pas de la même manière autour du concept d'approche équilibrée de la gestion du bruit aérien défini par l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) sur lequel se fonde la DGAC pour sa politique de lutte contre les nuisances sonores : les actions du PPBE relèvent des trois premiers piliers de l'approche équilibrée (réduction du bruit à la source, planification et gestion de l'utilisation des terrains environnant l'aéroport, procédures d'exploitation à moindre bruit), tandis que le PEB s'inscrit dans le cadre du 2e pilier de l'approche équilibrée uniquement (planification et gestion de l'utilisation des terrains environnant l'aéroport).
Enfin, leur élaboration ne répond pas aux mêmes temporalités. La directive 2002/49/CE prévoit que les PPBE sont révisés tous les 5 ans selon un calendrier fixé par la Commission européenne. Les articles R. 112-8 et R. 112-9 du code de l'urbanisme disposent quant à eux que seules les hypothèses sur lesquelles se fondent les PEB sont revues tous les cinq ans au moins, au regard des changements de l'activité aérienne. Si l'annexion des CSB et des PPBE aux PEB, fruit d'une erreur de compréhension du législateur, n'a pas empêché l'établissement de ces documents, cette situation a pu créer une incompréhension chez les administrés (cf. notamment la décision CE du 28 octobre 2021 à la suite de la saisine de plusieurs associations de riverains qui considéraient que le PPBE était prescriptif et qu'il devait ainsi être soumis à évaluation environnementale comme le PEB.)
Ainsi, afin de créer une séparation claire entre les PEB, d'une part, et, les CSB et les PPBE, d'autre part, le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires, a détaché les PPBE et les CSB des PEB, en rapatriant, à droit constant, les dispositions réglementaires sur les CSB et les PPBE des aérodromes dans le code de l'environnement aux côtés de celles relatives aux autres infrastructures soumises à ces plans et cartes (abrogation de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme et modification de l'article R.572-2 du code de l'environnement).
Dans sa note sur le projet de décret précité, le Conseil d'Etat reconnaît la nécessité de réorganiser l'articulation entre les CSB et les PPBE, qui sont des documents non prescriptifs, et les PEB, qui sont des servitudes d'urbanisme, et observe qu'il revient au législateur de modifier le cadre légal initialement défini pour transposer la directive 2002/49/CE et de clarifier ainsi de manière définitive l'état du droit, en ajoutant les infrastructures aéroportuaires au sein de l'article L. 572-2 du code de l'environnement, lequel ne fait aujourd'hui référence qu'aux seules grandes infrastructures de transports terrestres.
La modification proposée de l'article L. 572-2 consolide le cadre juridique des CSB et des PPBE de l'aérien en rapatriant les CSB et les PPBE aériens dans le code de l'environnement et en leur garantissant une base légale.
La prochaine loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) permettrait de procéder à cet ajustement législatif pour lequel aucun vecteur législatif n'avait jusqu'à présent été identifié.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La Charte de l'environnement (notamment son article 6) participe également du cadre constitutionnel considéré, dans la mesure où le Conseil constitutionnel s'appuie régulièrement sur cette charte dans le cadre de sa jurisprudence environnementale. La consolidation du cadre juridique de l'évaluation, de la prévention et de la réduction du bruit dans l`environnement respecte l'article 6 de la Charte qui prévoit que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La présente s'inscrit dans le cadre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans sa note sur le projet de décret relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires, le Conseil d'Etat reconnaît la nécessité de réorganiser l'articulation entre les CSB et les PPBE, qui sont des documents non prescriptifs, et les PEB, qui sont des servitudes d'urbanisme, et observe qu'il revient au législateur de modifier le cadre légal initialement défini pour transposer la directive 2002/49/CE et de clarifier ainsi de manière définitive l'état du droit, en ajoutant les infrastructures aéroportuaires au sein de l'article L. 572-2 du code de l'environnement, lequel ne fait aujourd'hui référence qu'aux seules grandes infrastructures de transports terrestres.
La modification proposée de l'article L. 572-2 consolide le cadre juridique des CSB et des PPBE de l'aérien en rapatriant les CSB et les PPBE aériens dans le code de l'environnement et en leur garantissant une base légale.
La prochaine loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) permettrait de procéder à cet ajustement législatif pour lequel aucun vecteur législatif n'avait jusqu'à présent été identifié.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La modification proposée de l'article L. 572-2 consolide le cadre juridique des CSB et des PPBE de l'aérien en rapatriant les CSB et les PPBE aériens dans le code de l'environnement et en leur garantissant une base légale.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Dans sa note de 2023 sur le projet de décret relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires, le Conseil d'Etat observe qu'il revient au législateur de modifier le cadre légal initialement défini pour transposer la directive 2002/49/CE et de clarifier ainsi de manière définitive l'état du droit, en ajoutant les infrastructures aéroportuaires au sein de l'article L. 572-2 du code de l'environnement, lequel ne fait aujourd'hui référence qu'aux seules grandes infrastructures de transports terrestres. Aucun vecteur législatif n'avait jusqu'à présent été identifié pour procéder à cet ajustement législatif.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de compléter le deuxième alinéa de l'article L. 572-2 du code de l'environnement afin d'y intégrer les infrastructures aéroportuaires aux côtés des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires.
Les dispositions de l'article 3 de la directive 2002/49 seront ainsi transposées en intégralité au sein de dispositions législatives conférant une unité et une cohérence au dispositif d'évaluation et de prévention du bruit dans l'environnement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article L. 572-2 du code de l'environnement est modifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
- Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- Règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE.
- Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, et les protocoles qui l'ont modifiée
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Cette modification n'amène aucun changement de pratique dans la révision des PPBE quel que soit le domaine concerné.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure devrait avoir comme conséquence la diminution du risque contentieux.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La modification proposée consolide le cadre juridique des CSB et des PPBE de l'aérien, dont l'établissement participe de l'évaluation, de la prévention et de la réduction du bruit dans l'environnement.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'a été conduite et aucune consultation facultative n'a été menée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'appliquera sur l'ensemble du territoire de la République française. Les aérodromes ultramarins ne sont pas concernés car leur trafic est inférieur au seuil de 50 000 mouvements annuels requis par le code de l'environnement pour que ce dispositif soit mis en oeuvre.
5.2.3. Textes d'application
Cet article ne requiert aucun texte d'application.
Article 47 - Mise en cohérence du code de l'environnement avec la directive 2008/98/CE relative aux déchets et la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Ø Directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives
La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 modifiée constitue le socle juridique européen en matière de prévention et gestion des déchets, avec pour objectif principal la protection de l'environnement et de la santé humaine. Adoptée le 19 novembre 2008 par le Parlement européen et le Conseil, elle vise à moderniser et harmoniser la législation sur les déchets au sein de l'Union européenne, en abrogeant plusieurs textes antérieurs.
Elle introduit une hiérarchie des modes de
traitement des déchets, allant de la prévention à
l'élimination, en passant par le réemploi, le recyclage et la
valorisation énergétique. La directive harmonise les
définitions clés relatives aux déchets et renforce la
responsabilité élargie des producteurs, les incitant à
concevoir des produits plus durables. Elle impose également aux
États membres des objectifs à atteindre en matière de
gestion des déchets et des dispositifs de traçabilité des
déchets. Enfin, elle établit des exigences en matière de
sortie du statut de déchet, permettant à un déchet
recyclé (par exemple) de redevenir un produit à mettre sur le
marché. La directive précitée a été
transposée en droit français notamment par
l'ordonnance
n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine
des déchets et la
loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, puis adaptée à plusieurs reprises pour
intégrer les évolutions européennes
Cette directive constitue un pilier central de la politique européenne des déchets. Cette dernière a été notamment été modifiée par la directive (UE) 2018/851qui renforce les exigences en matière de prévention, de réemploi et de recyclage, et s'inscrit dans la stratégie européenne d'économie circulaire aussi appelé « paquet économie circulaire ». En 2025, la directive 2008/98/CE relative aux déchets fera l'objet de modifications importantes, notamment pour renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire et la responsabilité élargie du producteur pour les textiles.
Ø Directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement
La directive 2019/904 du 5 juin 2019, également appelée directive sur les plastiques à usage unique, vise à réduire l'incidence environnementale de certains produits en plastique, en particulier ceux fréquemment retrouvés dans les déchets marins. Elle s'inscrit dans le cadre de la transition vers une économie circulaire et la lutte contre la pollution plastique. Cette directive impose l'interdiction de plusieurs articles en plastique à usage unique (comme les pailles, les couverts ou les cotons-tiges), fixe des objectifs de réduction de consommation, d'éco-conception, ainsi que des obligations de collecte et de sensibilisation. Elle impose également la mise en place de filière à responsabilité élargie du producteur pour certains flux de déchets tels que les lingettes humides, les produits du tabac ou les engins de pêche contenant du plastique.
Les filières à responsabilité élargie du producteur sont des dispositifs particuliers d'organisation de la prévention et de la gestion de déchets, qui concernent certains types de produits. Ils reposent sur le principe de responsabilité élargie du producteur, reconnu dans la directive-cadre européenne sur les déchets (article 8 et 8 bis), selon lequel les personnes responsables de la mise sur le marché des produits peuvent être rendus responsables d'assurer la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Il s'agit d'une application du principe pollueur-payeur. Un tel dispositif permet l'intégration par le producteur du coût de prévention et de gestion des déchets dans le coût du produit, ce qui l'incite à l'éco-conception de son produit pour réduire ces coûts. Les producteurs ont généralement le choix de mettre en place des structures collectives (éco-organismes) ou un système individuel pour la gestion des déchets issus de leurs produits.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Le préambule de la Constitution de 1958 dispose par ailleurs que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits et devoirs définis la Charte de l'environnement de 2004 ; cette Charte est ainsi rattachée au bloc de constitutionnalité (voir, les décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La base légale de la directive 2008/98/CE est l'article 175 (ex-article 130 S) du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu article 192 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) depuis le traité de Lisbonne. Cet article permet à l'Union européenne d'adopter des mesures pour la protection de l'environnement, y compris en matière de gestion des déchets, en vue de promouvoir un développement durable, protéger la santé humaine, et garantir une utilisation prudente des ressources naturelles.
La base légale de la directive 2019/904/UE est également l'article 192, paragraphe 1 du TFUE. Cette directive repose donc également sur le droit de l'environnement de l'Union européenne, en s'inscrivant dans les politiques de l'économie circulaire, de la protection des écosystèmes marins, et de la réduction des impacts négatifs des produits en plastique sur la santé humaine et l'environnement.
La directive 2008/98/CE relative aux déchets devait être transposée dans le droit national au plus tard le 12 décembre 2010. La directive modificative (UE) 2018/851 devait être transposée dans le droit national au plus tard le 5 juillet 2020.
La directive 2018/904/UE relative aux plastiques à usage unique devait être transposée en droit national au plus tard le 3 juillet 2021.
Ces textes ont fait l'objet de différentes mesures de transposition dans le droit français. Le présent article fait, pour partie, suite à un avis motivé de la Commission s'agissant de ces mesures de transposition.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Ø Mise en conformité de la directive 2008/98/CE relative aux déchets
En avril 2024, la Commission européenne a transmis à la France une lettre de mise en demeure pour mauvaise transposition de certaines dispositions de la directive 2008/98/CE relative aux déchets telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant cette directive.
Les autorités françaises ont répondu à la lettre de mise en demeure. Après analyse de la réponse de la France, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé ([ INFR(2024)2017]) pour les motifs exposés ci-dessous :
- Transposition non conforme de l'article 3, point 1) relatif à la définition de déchet. La définition de déchet doit être dépourvue de toute ambiguïté et doit donc être strictement la même que celle de la directive ;
- Transposition non conforme de l'article 5, paragraphe 1 relatif aux conditions en vertu desquelles un résidu de production doit être considéré comme un « sous-produit » et non comme un « déchet », pour ce qui concerne les plateformes industrielles définies à l'article L. 515-48 du code de l'environnement. Le droit français ne fait en effet pas le lien entre les dispositions de l'article L. 541-4-5 (cas particulier des plateformes industrielles) et l'article L. 541-4-2 (cas général des sous-produit) ;
- Transposition non conforme de l'article 8 bis, paragraphe 4 qui permet aux Etats-membres de déroger à la répartition de la responsabilité financière des producteurs. La transposition de cette disposition ne serait pas totalement conforme car il n'existe pas actuellement en droit français la certitude juridique garantissant que les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs supportent systématiquement les coûts restants de la gestion des déchets en cas de dérogation à la répartition de la responsabilité financière dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie du producteur ;
- Transposition non conforme de l'article 9, paragraphe 1, lettre c) relatif à la liste minimale des mesures de prévention de production des déchets que les Etats-membres doivent mettre en oeuvre. L'article du code de l'environnement dédié à cette liste ne contient aucune référence explicite aux produits contenant des matières premières critiques comme cela est prévu dans la directive ;
- Transposition non conforme de l'article 10, paragraphe 4 relatif à l'interdiction d'incinérer des déchets ayant été collectés séparément en vue d'une préparation au réemploi ou au recyclage. Le droit français a ajouté une mesure de dérogation temporaire à l'interdiction d'incinérer les déchets concernés en cas de circonstances exceptionnelles, qui n'est pas prévue par la directive.
En application de l'article 258, premier alinéa,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la
Commission invite la République française à prendre les
mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un
délai de deux mois à compter de la réception de
celui-ci. Ainsi, pour répondre à cette infraction dans les
délais et éviter la saisine de la cour de justice par la
Commission européenne, il est proposé de mettre en
conformité ces cinq dispositions dans le code de l'environnement
grâce au présent projet de loi.
Ø Mise en conformité avec la directive 2019/904/UE relative aux plastiques à usage unique (BREP)
Les présentes dispositions visent à corriger la sur-transposition faite dans la loi française des filières REP consistant à mettre en place dans le cadre de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement : en effet le législateur français avait choisi d'imposer :
- d'une part la mise en place d'une filière relative aux gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, filière non prévue dans ladite directive ;
- d'autre part l'extension de la filière imposée par cette directive relative aux lingettes à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique.
Au regard de l'analyse coûts / bénéfices de ces dispositions, il est proposé de supprimer la filière des gommes à mâcher, non prévue dans la directive, et de restreindre la REP des textiles sanitaires à usage unique aux seules lingettes. Par ailleurs, la filière relative aux gommes à mâcher et l'extension à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique de la filière actuellement mise en oeuvre sur les seules lingettes, en application de la directive 2019/904, ne sont à date pas opérationnelles (pas de cahiers des charges publiés ni d'éco-organisme ou de système individuel agréés).
Enfin, une dernière mesure concerne la déclaration des données de gestion de déchets à l'ADEME (Agence de la transition écologique) afin de répondre aux exigences de rapportages européens : la loi française prévoit actuellement que l'ensemble de ces données soient communiquées directement par les producteurs, le cas échéant via leurs les éco-organismes et les systèmes individuels agréés à l'ADEME. La modification proposée vise à acter des pratiques en oeuvre (consistant à ce que les producteurs déclarent par le biais de leurs éco-organismes), prévues par ailleurs dans le règlement relatif aux emballages et aux batteries récemment adoptés, et généralisable à l'ensemble des filières REP. Elle ouvre également la possibilité, pour une filière REP spécifique (celle des véhicules hors d'usage), au regard de sa structuration et de son historique) que cette transmission puisse être réalisée sous la responsabilité d'opérateurs en contrat avec les éco-organismes et systèmes individuels, directement auprès de l'ADEME.
Par ailleurs comme le constate le rapport relatif aux performances et la gouvernance des filières REP des inspections générales des finances, de l'environnement et du développement durable ainsi que le conseil général de l'économie (juin 2024), le pilotage de ces filières nécessite des données économiques et financières qui doivent être mises à disposition de l'ADEME. Il est donc proposé une disposition en ce sens.
Ceci est en conformité avec les dispositions de l'article 8 bis de la directive 2008/98 modifiée qui prévoit que les Etats Membres définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés par les REP et qu'ils veillent à ce qu'un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l'État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits. Il permettra par ailleurs de répondre aux obligations fixées par l'article 8 § 3 de cette même directive qui prévoit que dans le cadre de la mise en oeuvre des REP les Etats Membres tiennent compte de la viabilité économique de ces filières.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
L'avis motivé de la Commission européenne concernant la mauvaise transposition de la directive 2008/98/CE ne laisse pas de marge de manoeuvre quant à la mise en conformité.
S'agissant des dispositions relatives aux filières à responsabilité élargie du producteur, les deux options possibles étaient de garder la mesure de sur-transposition du champ de la directive 2019/904 ou d'en restreindre le champ.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article modifie divers articles du titre IV du code de l'environnement afin de se mettre en conformité avec la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets et abrogeant certaines directives et avec la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastiques sur l'environnement.
Cet article prévoit ainsi neuf dispositions, dont six portant sur la mise en conformité avec la directive 2008/98/CE.
L'article prévoit ainsi de corriger la définition de « déchet », de clarifier les conditions permettant de différencier un sous-produit d'un déchet dans le cas des résidus de produits au sein d'une plateforme industrielle, de supprimer la dérogation à l'interdiction d'éliminer des déchets qui ont fait l'objet d'une collecte séparée en vue d'une valorisation matière en cas de circonstances exceptionnelles, et de faire référence plus explicitement aux mesures permettant de réduire la production de déchets contenant des matières premières critiques dans l'article relatif au contenu des plans nationaux de prévention des déchets.
Concernant les filières à responsabilité élargie du producteur, cet article vient clarifier la répartition de la couverture des coûts, en cohérence avec les termes de la directive 2008/98/CE. Il est également proposé de profiter de ces modifications de mise en conformité pour effectuer deux autres modifications de la partie déchets du code de l'environnement relative aux filières REP.
D'une part, il est prévu de supprimer deux mesures de surtransposition de la directive 2019/904 du 5 juin 2009 qui sont la mise en place d'une filière relative aux gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, et l'extension de la filière relative aux lingettes à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique.
D'autre part, le présent article vise à donner la possibilité, pour certaines filières REP spécifiques, de transmettre les données de gestion des déchets directement de l'opérateur à l'ADEME sans passer par les éco-organismes, en raison du caractère sensible de ces données en matière concurrentielle et que l'ADEME puisse être destinataire de certaines données économiques et financières afin d'améliorer le pilotage des filières.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie les articles suivants
du code de l'environnement : L. 541-1-1,
L. 541-4-2, L. 541-4-5, L.
541-10-1, L. 541-10-2, L. 541-10-13, L. 541-11, et L. 541-25-2. Il ajoute également un article L. 541-10-13-1
à ce même code.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions prévues viennent mettre en conformité et compléter le droit français avec la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets et abrogeant certaines directives et avec la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastiques sur l'environnement.
Les articles de la directive 2008/98/CE concernés par une mise en conformité dans la loi française sont les suivants : 3(1), 5(1), 8 bis (4), 9(1), et 10(4).
L'article de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 concerné par les modifications dans la loi française est l'article 8.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les modifications du code de l'environnement proposées en réponse à l'avis motivé de la Commission européenne sur la directive 2088/98/CE relative aux déchets n'auront à priori aucun impact car il s'agit de modifications de clarification et non de modifications de fond.
S'agissant des modifications liées aux filières à responsabilité élargie du producteur, la dé-surtransposition de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 aura un impact neutre d'un point de vue macro-économique (la mise en place d'une filière REP consistant essentiellement en un transfert de charges des détenteurs des déchets vers les producteurs des produits soumis à la REP),
4.2.2. Impacts sur les entreprises
S'agissant des modifications liées aux filières à responsabilité élargie du producteur, la dé-surtransposition de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 aura un impact positif sur les entreprises concernées puisqu'elles n'auront pas à couvrir les coûts de la gestion des déchets issus de leurs produits. A titre d'exemple, en ce qui concerne la filière REP des textiles sanitaires à usage unique prévue actuellement au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, le coût moyen estimé pour les entreprises semble pouvoir être évalué à 219 millions d'euros sur la base d'une filière au périmètre élargi (surtransposition) contre un coût moyen estimé de 12 millions d'euros pour une filière au périmètre restreint aux seules lingettes.
S'agissant des dispositions relatives aux déclarations à l'ADEME pour améliorer la régulation des filières, l'impact sera limité car les opérateurs disposent déjà des données concernées. Par ailleurs ces mêmes opérateurs ont déjà fait part de leur souhait d'une meilleure régulation des filières REP et que l'ADEME soit destinataire d'un certain nombre d'informations à cet effet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
S'agissant des modifications liées aux filières à responsabilité élargie du producteur, la dé-surtransposition de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 aurait un impact négatif sur les collectivités, dans l'hypothèse du scénario dans lequel la REP aurait été mise en place (ce qui n'est pas le cas à date), puisque les producteurs n'auraient pas à couvrir les coûts de gestion des déchets concernés, qui continueraient donc à être couverts par les collectivités s'agissant des déchets ménagers et assimilés.
Ainsi, en ce qui concerne la filière REP des textiles sanitaires à usage unique, le gain moyen pour les collectivités semble pouvoir être estimé à 54 millions d'euros par an dans un scénario de surtransposition alors qu'il serait estimé à environ 6 millions sur le périmètre des seules lingettes.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
S'agissant des dispositions relatives à la désurtransposition pour les filières REP des textiles sanitaires et des gommes à mâcher, les filières REP conduisent à transférer les coûts de prévention et de gestion des producteurs de déchets vers les producteurs de produits, de ce point de vue les dispositions sont sans impact direct sur l'environnement. Ce transfert a toutefois comme vocation de conduire les producteurs à éco-concevoir leurs produits et à améliorer les modalités de prévention (au travers du réemploi ou de la réparation) et de gestion des déchets (massification, développement de solutions de recyclage). Toutefois s'agissant des gommes à mâcher, au regard de la spécificité de ces produits, de leur usage et des quantités concernés, de telles objectifs ne sont pas pertinents (impossibilité de réemployer ou réparer une gomme à mâcher par exemple ou de massifier les déchets pour développer du recyclage à l'échelle). Pour les textiles sanitaires, des dispositifs auraient effectivement pu être développés via la filière REP s'agissant du recyclage (car en matière de réemploi ou réparation les possibilités sont inexistantes étant donné que la filière ne vise que, par nature, les produits à usage unique). De tels dispositifs pourront toutefois se développer et être soutenus dans d'autres cadres que celui de la REP, et notamment à des échelles territoriales adaptées.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales s'agissant des dispositions relatives à la dé-surtransposition pour les filières à responsabilité élargie du producteur et pour la suppression de la mesure relative aux demandes de dérogation à l'interdiction de réception de déchets collectés séparément dans les installations d'élimination de déchets par stockage ou incinération. Le CNEN a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
Les membres du Conseil national de l'économie circulaire (CNEC) ont été consulté à titre facultatif en application de l'article D. 541-1 du code de l'environnement du 31 juillet au 29 août.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions du présent article entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions du projet de loi sont applicables sur l'ensemble du territoire national y compris les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas applicables, comme toutes les autres dispositions du code de l'environnement, dans les autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5.2.3. Textes d'application
Il sera nécessaire de modifier l'arrêté ministériel relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).
En outre, le présent article induira de mettre à jour le décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique afin que ce dernier soit en conformité avec les dispositions du règlement.
Article 48 - Dispositions relatives aux emballages et aux déchets d'emballages et aux filières de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et professionnels
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les produits ont besoin d'emballages pour être protégés et facilement transportés de leur lieu de production à leur lieu d'utilisation ou de consommation. Cependant, les emballages soulèvent des enjeux environnementaux majeurs : ils consomment une part significative de matières premières primaires (matières vierges), avec 40 % des plastiques et 50 % du papier utilisés dans l'Union européenne (UE) qui leur sont dédiés, et ils représentent 36 % des déchets municipaux solides210(*). Les déchets d'emballage polluent l'air et le sol, et représentent environ la moitié des déchets marins. Les quantités élevées et en constante augmentation de la production d'emballages, ainsi que les niveaux faibles de réemploi, de collecte et de recyclage, constituent des obstacles importants à la mise en place d'une économie circulaire à faible intensité de carbone. De plus, des défis subsistent pour permettre au marché intérieur européen de fonctionner de manière optimale en ce qui concerne les emballages, notamment en raison des différentes approches réglementaires à travers l'Europe.
Le règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages211(*) résulte d'un processus de révision des exigences relatives aux emballages et aux déchets d'emballages dans l'UE. Il abroge la directive n°94/62/CE du même nom et complète la législation existante, notamment en matière de gestion des déchets.
Le règlement définit un cadre harmonisé pour la mise sur le marché de tous les emballages, ménagers et professionnels. Le règlement établit des règles couvrant l'ensemble du cycle de vie des emballages, afin de contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur par l'harmonisation des mesures nationales, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d'emballages sur l'environnement et la santé humaine, et en contribuant à la transition vers une économie circulaire.
Le règlement a pour objectif de réduire la production d'emballages mis sur le marché (notamment en luttant contre le suremballage et en supprimant les plastiques évitables et substituables), la quantité de déchets d'emballages (en particulier via le développement du réemploi), et d'augmenter la qualité du recyclage et le contenu en matière recyclée des emballages (en particulier de ceux en plastique), et favoriser le réemploi et le recyclage.
Le texte prévoit notamment une restriction de mise sur le marché des emballages alimentaires contenant des per et polyfluoroalkylées (PFAS) au-dessus de certains seuils, dans l'attente d'une restriction universelle dans le cadre du règlement REACH212(*).
Il impose aux fabricants et aux importateurs que leurs emballages soient conçus de manière à minimiser leur volume et leur poids tout en conservant leur capacité à remplir la fonction d'emballage et à permettre leur recyclage. Il fixe un taux d'espace vide à ne pas dépasser dans certains emballages. Des restrictions d'utilisation de certains formats d'emballages sont également prévues (emballages plastiques de fruits et légumes frais ; vaisselle plastique jetable utilisée dans la restauration sur place ; etc.).
Le texte fixe des objectifs contraignants pour 2030 et aspirationnels pour 2040 en matière de réemploi de certains emballages. Le règlement impose en outre à certains distributeurs de consacrer un pourcentage de leur surface de vente à des stations de recharge (pour les produits alimentaires et non-alimentaires), à compter de 2030.
Le règlement impose que tous les emballages soient recyclables en 2030, et recyclés de manière effective dans le respect des taux de recyclage européens, en 2035. Il fixe des objectifs minimums de contenu recyclé dans les emballages plastiques pour 2030 et 2040 (une mesure miroir a été introduite s'agissant des critères de production du contenu recyclé).
Le règlement fixe une liste d'emballages devant être compostables en milieu industriel. Les États membres peuvent par ailleurs conditionner la mise sur le marché d'autres emballages (une liste très limitée) à cette compostabilité. Le règlement prévoit également que pour certains types d'emballages les Etats Membres peuvent choisir d'imposer la compostabilité domestique. Tous les autres emballages en plastique, sauf exceptions précisées dans le règlement, doivent être recyclables, afin de permettre leur recyclage effectif.
Il réaffirme l'obligation de responsabilité élargie du producteur (REP) pour tous les emballages d'ici à 2025, impose la mise en place d'un registre national des producteurs, et impose une éco-modulation basée sur leur recyclabilité (les États membres gardent la possibilité de prévoir d'autres critères d'éco-modulation comme le contenu recyclé).
Le texte impose par ailleurs aux États membres de mettre en place une consigne (pouvant être régionalisée) pour recyclage sur les bouteilles plastiques à usage unique et les canettes, afin d'atteindre un taux de collecte de ces emballages de 90 % d'ici à 2029. Les Etats Membres peuvent être exemptés de cette obligation sous certaines conditions (qui sont précisées à l'article 50 du règlement, et notamment que le taux de collecte du format d'emballage concerné soit supérieur ou égal à 80 % en poids de cet emballage mis à disposition sur le territoire de l'Etat Membre sur l'année 2026).
Le règlement prévoit également des dispositions en matière d'information du consommateur (règles de tri des déchets, recyclabilité, réemployabilité, compostabilité, contenu recyclé ou biosourcé, substances préoccupantes).
Le règlement, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 22 janvier 2025, est entré en vigueur le 11 février 2025. Il sera applicable 18 mois après son entrée en vigueur, soit à partir du 12 août 2026. Cependant, certaines dispositions ne s'appliqueront qu'en 2030 ou ne pourront être pleinement applicables qu'après l'adoption de législation secondaire. Par ailleurs, les dispositions liées à la directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique seront applicables à partir de février 2029.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Le préambule de la Constitution de 1958 dispose par ailleurs que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits et devoirs définis la Charte de l'environnement de 2004 ; cette Charte est ainsi rattachée au bloc de constitutionnalité (voir, les décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014).
Par ailleurs, dans le champ de la disposition proposée dans le présent projet de loi, le juge constitutionnel a considéré (voir la décision n° 2023-1055 QPC du 16 juin 2023) que s'agissant de dispositions en matière d'interdiction des étiquettes des fruits et légumes le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et que les dispositions imposées en la matière ne constituaient pas une atteindre disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'initiative portée par la Commission européenne en novembre 2022 a permis d'actualiser le cadre législatif de l'UE concernant les emballages et les déchets d'emballages et d'aboutir à l'adoption du règlement (UE) n°2025/40 du 19 décembre 2024.
Partie intégrante du Pacte vert pour l'Europe213(*) et du plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire214(*), le règlement contribue à la stratégie de croissance de l'UE pour une économie moderne, économe en ressources, propre et compétitive, sans émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050 et avec une croissance économique découplée de l'utilisation des ressources.
Cette initiative revêt une importance majeure, notamment en raison de l'impact significatif des emballages sur l'environnement. En effet, ceux-ci figurent parmi les principaux consommateurs de matériaux vierges. Les déchets d'emballage polluent non seulement l'air et le sol, mais représentent également près de la moitié des déchets marins. Malgré une hausse des taux de recyclage au sein de l'UE, la quantité de déchets produits augmente plus rapidement que les efforts de recyclage, avec une croissance de plus de 20 % sur la dernière décennie, principalement due aux emballages à usage unique. Sans interventions supplémentaires, le volume de déchets plastiques pourrait s'accroître de 46 % d'ici 2030 et de 61 % d'ici 2040, par rapport à 2018215(*).
Le règlement (UE) n°2025/40 repose sur une base légale marché intérieur (article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), qui est celle de la directive précédente relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Par ailleurs, comme indiqué dans le considérant 188 du règlement (UE) n°2025/40 les objectifs du règlement, à savoir améliorer la durabilité environnementale des emballages et garantir la libre circulation des emballages sur le marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, ce qui a conditionné l'adoption dudit règlement. En outre, comme indiqué dans ce même considérant, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, le règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le règlement (UE) 2025/40 abroge la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui imposait déjà aux États membres un certain nombre de dispositions concernant les emballages. Les États membres avaient donc adapté, chacun pour ce qui les concerne, ces dispositions dans leur réglementation nationale. Le règlement est par ailleurs d'application directe.
Il modifie le règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits216(*), ainsi que la directive (UE) 2019/904 sur la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement217(*).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Concernant les exigences applicables aux substances présentes dans les emballages, l'article 5 du règlement vise à minimiser la présence de substances préoccupantes, y compris dans les émissions et les déchets résultants, afin de réduire les effets néfastes sur l'environnement, y compris ceux liés aux microplastiques. Il prévoit notamment une restriction de mise sur le marché des emballages alimentaires contenant des per et polyfluoroalkylées (PFAS) au-dessus de certains seuils, dans l'attente d'une restriction universelle dans le cadre du règlement REACH. L'article 68 du règlement stipule que les États membres doivent déterminer le régime des sanctions applicables aux violations et veiller à sa mise en oeuvre. Pour permettre aux inspecteurs de mener des inspections, d'appliquer ces restrictions, de mettre en oeuvre des mesures administratives et de sanctionner si nécessaire, la partie législative du code de l'environnement (chapitre produits chimiques et les articles correspondants) doit être adaptée en incluant une référence au règlement.
Le règlement est d'application directe. Toutefois, certaines dispositions actuelles du code de l'environnement deviennent incompatibles avec des dispositions prévues dans le règlement, et doivent donc être modifiées. Ainsi, conformément à l'article 6 du règlement, il est prescrit que tous les emballages mis sur le marché de l'Union européenne doivent être recyclables, tout en définissant les critères selon lesquels un emballage est considéré comme tel. Par conséquent, il est nécessaire de modifier l'article L. 541-9 du code de l'environnement, qui traite transversalement de cette question à son IV, afin d'exclure les emballages de ces dispositions, ainsi que de modifier à la marge les articles L. 541-1 et L. 541-15-10 qui comportaient aussi une telle mention.
Afin de faciliter le tri des déchets d'emballages par les consommateurs, l'article 12 du règlement prévoit la mise en place d'un dispositif de symboles harmonisés sur les matériaux qui composent l'emballage, lequel figurera sur les emballages et les contenants de déchets. Pour tenir compte de ces dispositions et de celles de l'article 4 du règlement sur la libre circulation des emballages conformes au règlement, il convient d'adapter l'article L. 541-9-3 pour que le dispositif d'information actuellement applicable soit remplacé (puisqu'il ne pourra pas être maintenu), lorsqu'il sera en vigueur, par le dispositif harmonisé européen. Il y a également lieu d'adapter les articles L. 541-9-4 (amende administrative pour non-respect des obligations d'étiquetage), L. 541-10-3 (signalétique et marquage pouvant induire une confusion sur la règle de tri, étant donné que le règlement prévoit déjà, à son article 12 § 8 une interdiction en ce sens) et L. 541-15-10 (signalétique de tri des emballages ménagers). A noter qu'un délai d'écoulement des stocks, de 3 ans après l'entrée en vigueur de l'étiquetage européen, est prévu dans le règlement.
L'article 29 du règlement fixe quant à lui divers objectifs de réemploi des emballages, selon les usages et les formats. Ces objectifs européens, directement applicables, nécessitent une modification des articles L. 541-1, L. 541-9-10 et L. 541-10-18, afin de s'aligner sur la terminologie européenne concernant les emballages réutilisables. Il est également nécessaire de modifier l'article L. 541-10-17 pour permettre l'activation d'une clause optionnelle du règlement. Cette clause autorise la constitution, sous certaines conditions, de groupements par les distributeurs finaux afin de satisfaire à certaines de leurs obligations.
Concernant les sacs plastiques, l'article 34, en lien avec les articles 9 et 25, impose aux États membres de mettre en oeuvre des mesures visant à réduire durablement leur consommation. Il interdit, à partir de 2030, les sacs plastiques très légers, à l'exception de ceux nécessaires pour des raisons d'hygiène ou fournis comme emballages de vente pour les aliments en vrac afin de prévenir le gaspillage alimentaire. Le règlement permet aux États membres de maintenir les restrictions déjà en place et de conditionner la mise sur le marché des sacs plastiques légers à leur compostabilité industrielle. Cette dernière disposition nécessite de modifier l'article L. 541-15-10 concernant cet aspect de compostabilité.
Ce même article L. 541-15-10 nécessite également d'être modifié du fait des articles 9, 25, 33 et 67 du règlement, respectivement relatifs :
- aux emballages compostables (ce qui concerne notamment les sachets de thé et de tisane et les étiquettes apposées sur les fruits et légumes pour permettre l'activation de l'obligation de compostabilité domestique - ce qui nécessite par ailleurs d'abroger et réintégrer dans cet article les dispositions de l'article 80 de la loi antigaspillage),
- aux restrictions à l'utilisation de certains formats d'emballages, notamment pour les fruits et légumes. En effet, du fait de l'annulation du décret d'application du 20 juin 2023 par une décision du Conseil d'Etat du 8 novembre 2024, la disposition législative n'était plus en vigueur (en l'absence de décret d'application) au 1er janvier 2025, date à laquelle il fallait disposer d'une restriction en vigueur en France pour pouvoir activer la clause de sauvegarde prévue dans le règlement. Ne pouvant activer cette clause de sauvegarde, la disposition législative est incompatible avec le règlement et doit donc être supprimée,
- à l'obligation d'offres de réemploi pour le secteur de la vente à emporter (les dispositions nationales, qui imposent aux services de restauration collective de proposer des contenants réutilisables ou recyclables à partir du 1er janvier 2025, sont renforcées pour n'inclure que l'obligation de contenants réutilisables à l'échéance 2030)
- et aux modifications de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (concernant notamment les récipients et gobelets pour aliments / boissons en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), les emballages par rétraction utilisés dans les aéroports ou les gares pour la protection des bagages pendant le transport, les copeaux de polystyrène et autres matières plastiques utilisés pour protéger les marchandises emballées pendant le transport et la manipulation et les anneaux en plastique pour emballage multiple utilisés comme emballage groupé).
L'article 44 du règlement prévoit que les producteurs mettant sur le marché des emballages ou des produits emballés soient enregistrés au registre des producteurs de l'Etat Membre concerné, préalablement à cette mise en marché. Il impose de modifier l'article L. 541-10 afin de conditionner la mise sur le marché de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur à la détention préalable d'un identifiant unique (pour chaque filière pour laquelle le produit est concerné). Cette problématique n'étant pas propres à la filière REP des emballages, il est proposé que cette obligation soit étendue à l'ensemble des filières de responsabilité élargie du producteur concernées.
Cet article donne également la possibilité aux Etats membres d'imposer aux producteurs établis dans des pays tiers de désigner un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits emballés mis à disposition sur leur territoire. Pour l'activation de cette disposition, qui permet d'imposer une contractualisation avec un mandataire aux producteurs étrangers, il est proposé de modifier de l'article L. 541-10-9 relatif aux places de marché et de préciser que l'obligation de désigner un mandataire est satisfaite lorsque les obligations de REP sont assurées par l'intermédiaire d'une place de marché implantée en France.
L'article 45 du règlement, qui conditionne l'utilisation des services de places de marchés, plateformes et portails électroniques qui facilitent les ventes à distance de produits, de produits emballés ou d'emballages soumis au principe de responsabilité élargie du producteur à la production des justificatifs certifiant le respect des obligations liées à la responsabilité élargie du producteur, emporte une évolution majeure au regard des modes de consommation et de la part croissante des ventes en ligne de produits, permettant ainsi de s'assurer que l'ensemble des metteurs sur le marché contribuent bien à la REP (commerces en ligne au même titre que les commerces physiques). Cette évolution passe par la modification de l'article L. 541-10-9. Cette problématique n'étant pas propre à la filière REP des emballages, il est proposé que cette obligation soit étendue à l'ensemble des filières de responsabilité élargie du producteur.
L'article 46 du règlement prévoit des dispositions particulières lorsque, sur le territoire d'un État membre, une ou plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s'acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs. Il prévoit en particulier, en cas de pluralité d'organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, qu'un tiers indépendant veille à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s'acquittent de leurs obligations de manière coordonnée. Il est donc proposé de modifier l'article L. 541-10 s'agissant des dispositions applicables aux organismes coordonnateurs agréés (qui sont mis en place lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits). Cette problématique n'étant pas propre à la filière REP des emballages, il est proposé que cette obligation soit étendue à l'ensemble des filières de responsabilité élargie du producteur.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le règlement définit un cadre harmonisé pour la mise sur le marché des emballages, en termes d'éco-conception et de marquage. La conformité à ces exigences conditionnera l'accès au marché européen. En matière de gestion des déchets d'emballages et de responsabilité élargie du producteur, les exigences minimales définies par la directive-cadre sur les déchets s'appliquent.
Le règlement ne laisse qu'une marge de manoeuvre très limitée pour aller au-delà des exigences et objectifs européens, à l'exception des dispositions suivantes :
- L'article 9 relatif aux emballages compostables en conditions industrielles, pour lequel il est possible pour les États membres d'activer l'obligation de compostabilité domestique pour certains emballages comme les sachets de thé et de tisane ainsi que pour les étiquettes apposées sur les fruits et légumes (mais pas pour les sacs plastiques à usage unique, visés par ailleurs par l'article 34 relatif à leur réduction pour lesquels le règlement ne permet pas d'imposer la compostabilité domestique, bien qu'elle soit imposée à date dans la réglementation française) ;
- L'article 29 relatif aux objectifs de réemploi, qui imposent aux distributeurs la mise à disposition d'emballages réutilisables et prévoient que les États membres puissent autoriser les distributeurs à satisfaire à ces obligations de manière groupée, sous certaines conditions.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Comme indiqué au 2.1, la France, à travers cette loi, choisit de se saisir de ces possibilités, en tenant compte de l'impact significatif des déchets d'emballage sur l'environnement et de la nécessité de s'orienter vers une sobriété dans l'utilisation des ressources. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire à faible intensité de carbone, en ligne avec les objectifs de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) et de la loi Climat et Résilience.
Concernant les exigences de compostabilité de certains emballages prévues à l'article 9, le règlement impose pour les sachets en plastique de thé et de tisane, qui sont interdits par la loi AGEC depuis 2022 (sauf s'ils sont compostables industriellement), leur compostabilité industrielle et donne la possibilité aux Etats membres d'être plus exigeant. Ainsi que le permet le règlement, il est proposé de renforcer l'obligation de compostabilité existante en passant de la compostabilité industrielle à domestique au regard du développement de ce type de pratique en France (au 1er janvier 2025, 58 % des français couverts par une solution de tri à la source des biodéchets l'étaient par du compostage domestique).
S'agissant des étiquettes apposées sur les fruits et légumes, interdits par et depuis la loi AGEC (sauf si elles sont compostables domestiquement), le règlement impose également leur compostabilité industrielle comme la possibilité pour les Etats membres d'être plus exigeant. Afin de maintenir l'exigence de la loi AGEC de compostabilité domestique, il est proposé d'activer la possibilité offerte par le règlement de conditionner la mise sur le marché de ces étiquettes à leur compostabilité domestique (pour les mêmes raisons que celles exposées dans le paragraphe précédent).
Concernant les sacs plastiques à usage unique, le règlement prévoit à son article 34 que les Etats membres réduisent durablement la consommation de ces produits. Pour y parvenir, les Etats membres sont autorisés à prendre des mesures de restriction à la commercialisation, comme le prévoyait déjà la directive (UE) 2015/720 du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. Dans le cadre de la directive de 2015, la France avait fait ce choix qui trouve sa traduction dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Les sacs plastiques à usage unique (pour l'emballage des fruits et légumes, par exemple) sont ainsi interdits depuis 2017 sauf s'ils sont compostables domestiquement. Or, le règlement impose pour ces sacs plastiques qu'ils soient seulement compostables industriellement, sans qu'il ne soit prévu de possibilité pour les Etats Membres d'imposer ou de maintenir une obligation de compostabilité domestique pour ces emballages. Il est donc prévu d'alléger, conformément à ce qu'impose le règlement, l'exigence de compostabilité de ces sacs en passant de la compostabilité domestique à industrielle.
Concernant les objectifs chiffrés d'utilisation d'emballages réutilisables, la France souhaite permettre aux distributeurs de boissons concernés par ces objectifs de satisfaire à ces obligations de manière groupée, ainsi que le permet le règlement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie les articles suivants
du code de l'environnement : L. 521-1,
L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17,
L. 521-18, L. 521-21, L. 521-24, L. 541-1, L. 541-9, L. 541-9-3, L. 541-9-4, L.
541-9-10, L. 541-10, L. 541-10-3, L. 541-10-9, L. 541-10-17,
L. 541-10-18,
L. 541-15-10 et abroge l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions prévues viennent mettre en conformité et compléter le droit français avec le règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Ce règlement modifie le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abroge la directive 94/62/CE. Ces deux directives avaient été transposées en droit français notamment dans le code de l'environnement ce qui conduit à la nécessité de modifier certaines de ces dispositions de transposition du fait des modifications introduites par le règlement 2025/40.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE est d'application directe sur une majorité de dispositions.
Il convient de souligner quelques points importants de l'analyse d'impact menée au niveau européen. Celle-ci prévoit pour 2030 une réduction de la production de déchets de 18 millions de tonnes par rapport au scénario de référence, et de 3,1 millions de tonnes par rapport à 2018. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) devraient diminuer de 23 millions de tonnes d'équivalent CO2 (42 % des émissions annuelles totales), réduisant les externalités environnementales de 6,4 milliards d'euros.
Les économies globales s'élèvent à 47,2 milliards d'euros, grâce à une réduction des coûts de gestion des déchets et de la consommation d'emballages, malgré des coûts supplémentaires pour les programmes de réemploi et de consigne. Cependant, cela entraîne des coûts administratifs annuels supplémentaires de 1,3 milliard d'euros, principalement pour la certification de la recyclabilité des emballages.
Les mesures relatives au contenu recyclé réduisent les besoins en combustibles fossiles de l'UE de 3,1 millions de tonnes par an (près d'un quart des combustibles fossiles actuellement nécessaires à la production d'emballages plastiques). Les économies de GES de cette mesure représentent 22 % des économies totales, indiquant une réduction potentielle de 12 à 15 millions de tonnes de combustibles fossiles. Les mesures de recyclabilité augmentent le taux global de recyclage des emballages de 66,5 % en 2018 à 73 % en 2030, réduisant la mise en décharge de 18,7 % à 9,6 %. Cela se traduit par une réduction significative des besoins en matières premières vierges comme le bois, le verre et l'aluminium.
Le présent article de la loi, qui vise principalement à mettre en conformité le droit français, est donc sans impact économique supplémentaire à ceux mentionnés pour le règlement.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le texte européen prévoit un traitement spécifique pour les PME et les micro-entreprises afin de garantir des impacts proportionnés. En outre, les exigences s'appliqueront de manière non discriminatoire aux entreprises européennes et non européennes. Enfin, les mesures ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux poursuivis par le règlement européen.
Plus spécifiquement, et ainsi que l'a évalué la Commission européenne, une réduction des coûts de gestion des déchets de 4,2 milliards d'euros, des coûts supplémentaires des programmes de réemploi et de dispositifs de consigne de 4,6 milliards d'euros et une réduction des ventes et de la consommation d'emballages de 51,7 milliards d'euros se traduiront par des économies globales de 47,2 milliards d'euros. À l'inverse, des coûts administratifs annuels supplémentaires de 1,3 milliard d'euros, principalement pour la certification de la recyclabilité des emballages et du contenu recyclé des emballages plastiques sont envisagés. Une légère augmentation nette des emplois « verts » est par ailleurs attendue.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'impact pour les collectivités sera limité bien que la mise en oeuvre du règlement européen sur les emballages et déchets d'emballages puisse faire évoluer à terme la composition du bac de tri des emballages
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les exigences en matière d'écoconception et d'information peuvent présenter des avantages en matière de protection et de promotion des droits fondamentaux tels qu'énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les impacts de cette réglementation seront très positifs sur l'environnement, car ils permettront de réduire l'utilisation de matières vierges, et de favoriser une économie circulaire et durable.
Plus précisément, l'étude d'impact précitée du règlement européen, réalisée par la Commission européenne, suggère pour 2030 une réduction de la production de déchets de 18 millions de tonnes par rapport au scénario de référence, et de 3,1 millions de tonnes par rapport à 2018. La réduction des gaz à effet de serre (GES) sera d'environ 23 millions de tonnes d'équivalent CO2 (42 % des émissions annuelles totales) et les externalités environnementales monétisées seront réduites de 6,4 milliards d'euros par rapport aux projections de référence pour 2030.
Les mesures relatives au contenu recyclé favorisant l'efficacité des ressources réduiront les besoins en combustibles fossiles de l'UE de 3,1 millions de tonnes par an (près d'un quart des combustibles fossiles actuellement nécessaires à la production d'emballages plastiques). La diminution globale des besoins en combustibles fossiles est difficile à quantifier, mais le fait que les économies de GES de la mesure du contenu recyclé représentent 22 % des économies totales de GES indique un ordre de grandeur de 12 à 15 millions de tonnes d'économies de combustibles fossiles. En outre, les mesures visant à améliorer la recyclabilité augmenteront le taux global de recyclage des emballages de 66,5 % en 2018 à 73 % en 2030, tandis que la mise en décharge diminuera de 18,7 % à 9,6 %. Cette volonté de circularité se traduira par une réduction significative des besoins en matières premières vierges telles que le bois, le verre et l'aluminium.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
Les membres du Conseil national de l'économie circulaire (CNEC) ont été consulté à titre facultatif en application de l'article D. 541-1 du code de l'environnement du 31 juillet au 29 août.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le 12 août 2026 à l'exception :
1. Des dispositions de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du 10° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 août 2028 ou vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, si cette seconde date est postérieure ;
2. Des dispositions du I de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du a du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 août 2028 ou vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, si cette seconde date est postérieure ;
3. Des dispositions du II du même article L. 541-15-10 dans leur rédaction résultant du c, du g, du h et du i du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 février 2028 ;
4. Des dispositions du III du même article dans leur rédaction résultant du e et du l du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 février 2029 ;
5. Des dispositions du même III dans leur rédaction résultant du j du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, si cette seconde date est postérieure.
5.2.2. Application dans l'espace
Les présentes dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire national y compris les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon. Elles ne sont pas applicables, comme toutes les autres dispositions du code de l'environnement, dans les autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5.2.3. Textes d'application
- Un décret en Conseil d'Etat précisera les missions des éco-organismes pouvant être confiées à l'organisme coordonnateur agréé ;
- Par ailleurs les textes suivants devront être modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du règlement :
- Décret en Conseil d'Etat relatif aux emballages et déchets d'emballages modifiant la section 5 du chapitre III et les section 1 et 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
- Décret modifiant le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 ;
- Arrêtés modifiant les arrêtés portant cahier des charges des filières à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et des emballages professionnels ;
- Arrêté modifiant l'arrêté du 15 mars 2022 listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets.
Article 49 - Dispositions relatives aux transferts transfrontaliers de déchets
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets (TTD) vise à inscrire, dans le droit européen et dans le droit français, les engagements de l'Union Européenne et de la France pris dans le cadre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Ce traité international a été conclu en 1989 sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'Environnement.
Il a été conçu afin de réduire au minimum le transfert transfrontalier de déchets dangereux, de les faire traiter aussi près que possible de leur lieu de production ainsi que de limiter leurs flux transfrontaliers en imposant des conditions strictes à leur circulation. Il concerne les déchets présentant des caractéristiques de danger (notamment les matières explosives, inflammables, comburantes, toxiques, infectieuses corrosives, écotoxiques). Les déchets radioactifs, soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, n'entrent pas dans le champ d'application de la convention.
Pour ces flux de déchets dangereux, la convention impose au notifiant, c'est-à-dire la personne qui souhaite organiser un transfert de déchets, l'obligation de respecter une procédure dite de notification. Cette procédure consiste à obtenir, préalablement à tout départ de déchets dangereux, le consentement de l'ensemble des pays concernés par le transfert de déchet en question.
En France, les demandes d'exportations de déchets soumises à procédure de notification doivent être déposées sous l'application GISTRID du Ministère de la Transition écologique.
Cette application permet la gestion, la consultation et le suivi des dossiers d'exportation et d'importation de déchets, du dépôt initial jusqu'à l'achèvement du transfert et la certification du traitement des déchets. GISTRID assure également l'interconnexion avec des systèmes similaires d'autres pays européens pour fluidifier les démarches de notification.
En 1995, a été adopté un amendement à la convention de Bâle visant à interdire les exportations de déchets dangereux en provenance des pays industrialisés vers les pays en développement. La loi n° 2003-623 du 8 juillet 2003 a autorisé l'approbation de cet amendement.
Au niveau européen, le règlement N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, puis le règlement CE N°1013/2006 du 14 avril 2006, ont établi des règles visant à restreindre et à contrôler ces mouvements dans le but, notamment, de rendre le système communautaire existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle.
Le règlement CE N°1013/2006 a été amendé à quinze reprises, notamment afin de tenir compte des avancées intervenues au niveau de la convention de Bâle sur le contrôle renforcé des déchets plastiques et d'équipements électriques et électroniques.
En décembre 2019, la Commission européenne a adopté la communication sur le pacte vert pour l'Europe qui vise à transformer l'Europe en une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive. Ce pacte définit une feuille de route ambitieuse et précise qu'il convient de s'interroger sur les règles régissant les transferts transfrontaliers de déchets et stipule que l'Europe doit arrêter d'exporter ses déchets en dehors de ses frontières.
Le 9 septembre 2024, l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a remis à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, un rapport sur le futur de la compétitivité européenne dans lequel il préconise la création d'un marché unique pour les déchets et le recyclage. En 2050, l'UE pourrait répondre à plus de la moitié ou aux trois quarts de ses besoins en métaux pour les technologies propres grâce au recyclage. Un marché unique de la circularité améliorerait la rentabilité du recyclage grâce à ses économies d'échelle.
Le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 remplacera l'actuel règlement sur les TTD. Il permettra de répondre dans le domaine des transferts transfrontaliers de déchets aux enjeux d'économie circulaire pour l'Europe.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). ll en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Le préambule de la Constitution de 1958 dispose par ailleurs que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits et devoirs définis la Charte de l'environnement de 2004 ; cette Charte est ainsi rattachée au bloc de constitutionnalité (voir, les décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014).
Par ailleurs, dans le champ de la disposition proposée dans le présent projet de loi, le juge constitutionnel a considéré (voir la Décision n° 2023-1055 QPC du 16 juin 2023) que s'agissant de dispositions en matière d'interdiction des étiquettes des fruits et légumes le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et que les dispositions imposées en la matière ne constituaient pas une atteindre disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'objectif du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, est de renforcer la maîtrise des transferts de déchets permettant de s'assurer qu'un déchet faisant l'objet d'un transfert est traité dans des conditions qui garantissent la maîtrise des impacts sur l'environnement. Pour ce faire, le Règlement introduit un système de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets et représente une exception au principe de libre circulation communautaire des marchandises.
Le règlement est fondé sur les principes directeurs de la Convention de Bâle et de la directive cadre 2008/98/CE relative aux déchets :
- Le principe de proximité ;
- L'autosuffisance communautaire et nationale ;
- La priorité à la valorisation.
Le règlement encadre différents cas de transferts, d'exportations et d'importations en établissant des procédures et des régimes de contrôle en fonction de l'origine, de la destination, du type de déchet transféré et du type de traitement réalisé. Ainsi, le Règlement prévoit :
- Les transferts à l'intérieur de la Communauté Européenne, transitant ou non par des pays tiers ;
- Les exportations de la Communauté Européenne vers des pays tiers ;
- Les importations dans la Communauté Européenne en provenance des Pays tiers ;
- Le transit par la Communauté Européenne au départ et à destination des Pays tiers.
La mise en oeuvre du règlement est précisée aux articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du code de l'environnement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets abroge le règlement (CE) n°1013/2006 qui fixait déjà le cadre juridique des exportations et des importations européennes de déchets ainsi que du transit des déchets sur le territoire de l'Union européenne. Ces règlements sont d'application directe. Ces règlements mettent en oeuvre les dispositions de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets abroge le règlement (CE) n°1013/2006 est paru au JOUE le 30 avril 2024. Il est entré en vigueur le 20 mai 2024 et sera applicable pour la majorité de ses dispositions à partir du 21 mai 2026.
Ainsi, il convient de modifier à compter du 21 mai 2026, le cadre juridique national des transferts de déchets afin de le rendre conforme au règlement (UE) 2024/1157.
En effet, l'article 27 du règlement prévoit la dématérialisation des procédures relatives aux transferts transfrontaliers de déchets. Sera ainsi mis en place, à compter du 21 mai 2026, un téléservice central européen d'échange électroniques (DIWASS) qui sera utilisé pour l'échange de l'ensemble des documents et informations relatifs aux transferts de déchets. Ce système sera interopérable avec le système français GISTRID (Gestion par Internet du Suivi des Transferts Internationaux de Déchets). Cela implique de modifier l'article L. 541-40.
Le règlement introduit par ailleurs à l'article 3. 7 une définition de la personne physique ou morale qui organise le transfert et ne prévoit plus, dans la définition du notifiant, une hiérarchie décroissante pour la désignation de celui-ci entre le producteur, le nouveau producteur, le collecteur ou le négociant courtier. Ainsi, lorsqu'en cas de transfert de déchets auquel il a été consenti et ne pouvant être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant la reprise des déchets, le règlement (UE) 2024/1157 ne renvoie plus à l'article définissant le notifiant. Cela implique de modifier les articles L. 541-40 et L. 541-41.
En outre, le règlement explicite les règles à appliquer s'agissant des transferts ne pouvant être menés à leur terme auxquels il a été consenti (article 22) ou soumis aux exigences générales en matière d'information (article 23), ou des transferts illicites (article 25). Cela implique de modifier les articles L. 541-41 et L. 541-42.
Plus globalement, l'ensemble des références au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, figurant aux articles L. 541-40 à L. 541-42-3, relatifs aux dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets, à l'article L. 541-46, relatif aux sanctions pénales en matière de déchets et à l'article L. 541-4-3, relatif aux déchets ayant cessé de l'être, ont été remplacées par les références ad-hoc du nouveau règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les modifications apportées ont pour but de permettre en conformité le cadre juridique national des transferts transfrontaliers de déchets avec le règlement (UE) 2024/1157.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le règlement étant directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, la première option était de ne pas transposer le règlement. Cette option a été écartée car il était nécessaire de modifier a minima les références faites dans le code de l'environnement au règlement (CE) no 1013/2006 abrogé.
La seconde option était de ne modifier que les références au règlement et aux articles dont la numérotation a été affectée par le nouveau règlement. Cette option a également été écartée car ce travail se serait révélé incomplet et n'aurait notamment pas permis de prendre en compte les améliorations ciblées apportées aux dispositions en vigueur, la modernisation et numérisation des procédures, la création d'un nouveau cadre pour garantir une gestion durable des déchets exportés et le renforcement du contrôle et des sanctions.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Comme indiqué au 2.1, la France fait le choix, au travers du présent article, de se saisir de la possibilité de mettre à jour les références réglementaires applicables dans la perspective de l'abrogation du règlement (CE) 1013/2006 et l'applicabilité de la majorité des dispositions du règlement (UE) 2024/1157 à compter du 21 mai 2026.
Le présent article dispose que les informations et documents mentionnés au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement mentionné au I sont présentés et échangés par l'intermédiaire d'un téléservice. La plateforme française (GISTRID) va ainsi évoluer et sera interconnectée à l'application européenne (DIWASS), ce qui permettra de gérer et d'échanger toutes les données relatives aux transferts de déchets entre la France et les autres pays européens de façon fluide et totalement dématérialisée. Cela inclut les notifications, mouvements, contrats, consentements, et tous les échanges administratifs et techniques nécessaires au suivi réglementaire. Chaque acteurs impliqués (notifiant, autorités compétentes...) disposera d'un compte dans DIWASS ; la plateforme intégrera aussi des fonctions multilingues (français et anglais pour la France). Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le présent article renvoie à l'article 3. 7) du règlement (UE) 2024/1157 qui introduit désormais, pour une meilleure clarté juridique, une définition de « la personne qui organise le transfert » de flux de déchets non soumis à notification mais à procédure dite d'information. Cette procédure vise à s'assurer de la traçabilité de déchets, sans pour autant que le flux soit soumis à autorisation préalable des pays concernés. La personne qui organise le transfert peut ainsi être une des catégories d'acteurs suivantes : producteur, nouveau producteur, collecteur, négociant, courtier ou détenteur, calquées celles de la définition du notifiant (article 3.6).
S'agissant des transferts de déchets auxquels il a été consenti et ne pouvant être menés à leur terme, désormais la prescription de la reprise des déchets ne se fera plus au notifiant tel que désigné par un ordre de hiérarchie décroissante (allant du producteur au détenteur) mais d'abord et en premier lieu au notifiant de fait (article 22.2. du règlement (UE) 2024/1157). Et à défaut de s'acquitter de cette obligation de reprise, les règles de poursuite des prescriptions sont clarifiées selon que ce notifiant de fait a la qualité de négociant ou courtier (les autorités se retourneront alors ensuite vers le producteur, le nouveau producteur ou le collecteur) ou bien à la qualité de producteur, nouveau producteur ou collecteur (les autorités se retourneront alors vers le détenteur).
Le présent article introduit également des dispositions nouvelles par renvoi à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1157 qui prévoit désormais des conditions de la reprise de déchets en cas de transferts soumis à procédure d'information et ne pouvant être menés à leur terme. Ces conditions qui ne sont pas définies dans l'actuel règlement (CE) N°1013/2006 viennent ainsi combler un vide juridique et confier par là même un nouveau rôle à l'autorité compétente d'expédition lorsque la personne qui organise le transfert omet de s'acquitter de son obligation de reprise. Ce dispositif, en donnant un rôle à jouer à l'autorité compétente d'expédition, permet ainsi de maximiser la probabilité de la reprise effective des déchets et leur gestion écologiquement rationnelle.
En matière de transfert illicites, le présent article permet, conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1157, d'apporter là encore une clarté juridique en précisant la procédure de prescription de la reprise des déchets lorsqu'une notification a été effectuée et que le notifiant, qui omet de s'acquitter de son obligation de reprise, a la qualité de producteur, nouveau producteur des déchets ou de collecteur. En effet, désormais pour ce cas de figure le présent article prévoit que la prescription de reprise est alors effectuée auprès du détenteur des déchets.
Enfin le présent article, clarifie désormais également les règles de prescription de reprise lorsqu'aucune notification n'a été effectuée. La disparition de la hiérarchie décroissante dans la définition du notifiant (article 3.6 du règlement 1157/2024, visé au présent article) permettra aux autorités en cas de transfert illicite, effectué sans notification (article 25.2 a du règlement 1157/2024), de prescrire la reprise dans un premier temps à l'une « quelconque des personnes physiques ou morales » listée à cet article 3.6. Ce choix de l'interlocuteur, en fonction par exemple de sa solvabilité, pourra permettre à une autorité de maximiser les chances de reprise effective des déchets en vue de leur gestion écologiquement rationnelle.
L'ensemble de ces modifications permettront de garantir que le Code de l'environnement français est en conformité avec les nouvelles exigences du règlement européen (UE) 2024/1157, assurant ainsi une gestion écologiquement rationnelle des déchets et une meilleure protection de l'environnement et de la santé humaine.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie les articles suivants du code de l'environnement : L. 541-4-3, L. 541-40, L. 541-41, L. 541-42, L. 541-42-2, L. 541-42-3, L. 541-46.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le règlement (UE) 2024/1157 vise à inscrire, dans le droit européen et dans le droit français, les engagements de l'Union Européenne et de la France pris dans le cadre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
Le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, abroge le règlement (CE) n°1013/2006.
Les dispositions prévues viennent mettre en conformité le droit français avec le règlement (UE) 2024/1157.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les modifications apportées par le nouveau règlement ont pour objectifs principaux de soutenir l'économie circulaire au sein de l'Union, d'encourager les transferts de déchets destinés à être recyclés, de réduire l'impact des déchets européens dans les pays tiers qui ne seraient pas en capacité de les gérer de manière durable, et de lutter plus efficacement contre les transferts illicites de déchets.
Le nouveau règlement vise à favorise la réutilisation et la valorisation des déchets en intra-EU sur l'export hors EU et l'élimination des déchets. Son impact économique varie en fonction de l'opérateur économique impliqué (producteur de déchets, installation de traitement, négociant). D'une manière générale, il n'entraîne pas de coûts excessifs ni de perturbation majeure des marchés des déchets. Il en est donc de même pour le présent projet de loi, dont l'objet est de transposer les dispositions du règlement. Les impacts plus spécifiques sur les entreprises sont eux détaillés par la suite.
En outre, le nouveau règlement vise à réduire la dépendance de l'Union à l'égard des matières premières en augmentant le gisement de matières premières secondaires disponibles sur le sol européen.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
S'agissant de l'impact du présent article, l'impact sur les entreprises sera la numérisation des démarches administratives relatives aux transferts transfrontaliers de déchets, que cela concerne la procédure de notification avec consentement préalable des pays d'export, d'import et de transit ou la procédure d'information. L'impact pour les entreprises sera toutefois minimisé en France qui dispose déjà de l'application dénommée GISTRID qui permet la saisie des demandes de transfert transfrontalier de déchets, ainsi que le suivi des notifications. L'application GISTRID est actuellement déjà utilisée systématiquement par l'ensemble des professionnels du secteur en cas d'export au départ de France d'un déchet couvert par la procédure de notification. L'impact à ce titre pour les entreprises se concentrera donc sur la procédure d'information dont la saisie est actuellement possible via l'application GISTRID mais non obligatoire. Les entreprises qui actuellement remplissent les documents associés à la procédure d'information au format papier seront désormais obligées de passer par l'application GISTRID. L'Etat ne dispose pas à ce jour de données sur les exports de déchets soumis à la procédure d'information et il n'est donc pas possible d'évaluer l'impact de la disposition. L'absence de données met toutefois en évidence l'intérêt de la mise en oeuvre d'une telle mesure. En outre, les déploiements des outils numériques sont devenus incontournables et leur usage par les professionnels des déchets inéluctables. Si des développements s'avèrent nécessaires pour certains professionnels, des gains de temps dans le traitement des dossiers sont estimés compenser une partie des coûts engendrés.
4.2.3. Impacts budgétaires
Une évolution de GISTRID afin de rendre l'application inter-opérationnelle avec le futur système DIWASS sera nécessaire. Cette mesure n'aura cependant pas d'impact budgétaire significatif pour le budget de l'Etat qui réalise régulièrement des mises à jour de l'application GISTRID pour améliorer l'interface utilisateur et tenir compte des évolutions réglementaires au fil de l'eau.
Il est à noter que le traitement des demandes de transferts de déchets pour l'import, l'export ou transit de déchets est totalement gratuit en France tandis qu'une majorité d'Etats Membres, ainsi que des pays tiers comme le Royaume-Uni, la Norvège ou la Suisse, facturent ces opérations aux notifiants. Les montants facturés diffèrent significativement d'un pays à l'autre, en fonction de la nature du déchet, des quantités transférées, du nombre de transferts demandés ou de l'opération demandée (import, export, transit).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Une collectivité territoriale peut être notifiante d'un transfert de déchet, au même titre que toute personne qui détient des déchets et souhaite les exporter à l'étranger. Dès lors, qu'une collectivité souhaiterait opérer un transfert de déchets, les dispositions prévues par le présent article s'appliquerait à elle. Pour autant, ce cas est très peu fréquent et largement minoritaire dans les transferts opérés. Aussi le présent article ne prévoit aucune spécificité particulière pour ce type d'acteurs.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'ensemble des documents relatifs aux transferts transfrontaliers déchets seront intégralement numériques (notifications, consentement, mouvements). Le degré de dématérialisation déjà instauré par l'autorité compétente française en matière de transferts transfrontaliers étant déjà élevé, l'impact sur les services administratifs ne sera que limité.
L'autorité compétente française devra assurer néanmoins assurer la continuité, la synchronisation et la gestion des données entre GISTRID et DIWASS.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
Sans objet.
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Un des enjeux majeurs du nouveau règlement est de réduire l'impact des transferts de déchets, notamment dangereux ou problématiques pour l'environnement, sur l'environnement et la santé humaine. Les objectifs poursuivis sont d'établir des règles pour contribuer à faciliter la gestion écologiquement rationnelle des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE dite directive cadre déchets, de réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation. Ce règlement s'inscrit dans la transition vers une économie circulaire et vise à contribuer, en agissant sur l'aval de la chaîne de valeur, à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Le nouveau règlement a été élaboré en tenant compte de la feuille de route ambitieuse en vue de transformer l'Union en une économie durable, économe en ressources et neutre pour le climat, établie dans le pacte vert pour l'Europe qui figure dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019.
S'agissant plus précisément de l'impact du présent article, il prévoit que les informations et documents relatifs aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d'information seront présentés et échangés par l'intermédiaire du téléservice. Cette disposition va permettre désormais aux autorités une vision, exhaustive, des flux de déchets transférés à l'étranger sous procédure d'information. Il sera ainsi possible d'identifier le volume de ces déchets transférés notamment dans les pays en développement, et d'analyser ainsi ces données à la lumière d'éventuels problèmes environnementaux.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire.
Les membres du Conseil national de l'économie circulaire (CNEC) ont été consulté à titre facultatif en application de l'article D. 541-1 du code de l'environnement du 31 juillet au 29 août.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025. La procédure projetée n'affectant les collectivités qu'à titre exceptionnel.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions de cet article s'appliqueront à compter du 21 mai 2026 date à laquelle les dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets pour lesquelles une modification du droit français est réalisée seront applicables.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions du projet de loi sont applicables sur l'ensemble du territoire national y compris les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon. Elles ne sont pas applicables, comme toutes les autres dispositions du code de l'environnement, dans les autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5.2.3. Textes d'application
Les mesures d'application suivantes devront être prises :
- Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour préciser les conditions de mises en oeuvre du téléservice mentionné au III du futur article L 541-40.
Par ailleurs les textes suivants devront être mis à jour pour être mis en conformité avec les dispositions du règlement :
- Un décret relatif aux sanctions applicables pour les transferts illicites de déchets, modifiant notamment la section 7 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement devra être pris (modifications des article R 541-83 et R 541-84).
- La section 5 du chapitre 1er du titre IV du code l'environnement devra être modifiée par voie règlementaire afin que les articles R541-62 à R541-64-4 intègrent les références au nouveau règlement (UE) 2024/1157
- Enfin, l'arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux modalités de constitution des garanties financières en matière de transferts transfrontaliers de déchets fait référence au RTD 1013/2006 et devra être modifié.
Article 50 - Adaptation du droit français au règlement 2024/1781 sur l'écoconception pour des produits durables
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le règlement 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences d'écoconception pour des produits durables218(*), dit « règlement ESPR », vise à réduire l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne (UE), via une meilleure conception des produits (« l'écoconception ») et une meilleure information des consommateurs.
Le règlement définit l'écoconception comme « l'intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d'un produit et dans les processus mis en oeuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit ». En d'autres termes, il s'agit de concevoir un produit en cherchant à réduire son empreinte environnementale tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières nécessaires, de sa fabrication, de sa distribution, de son utilisation, jusqu'à sa fin de vie, lorsqu'il devient un déchet. Il s'agit d'une approche préventive et centrée sur le produit.
Le règlement ESPR a vocation à abroger et remplacer, après une période de transition, la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie219(*). Cette dernière directive a été transposée aux articles R. 224-61 et suivants du code de l'environnement.
La Commission européenne estime220(*) que les exigences actuelles en matière d'écoconception et d'étiquetage énergétique ont permis de réduire de 12 % la consommation finale d'énergie en 2023, évitant ainsi 145 millions de tonnes d'émissions de CO2 cette année-là, équivalent aux émissions combinées de la Belgique et de la République tchèque. Le règlement EPSR élargit le cadre posé par la précédence directive, tant en matière de produits visés que de critères d'éco-conception. Avec la mise en oeuvre de celui-ci, la Commission a chiffré le périmètre de son premier programme de travail, listant les produits prioritaires à réglementer : à terme, ESPR devrait réguler un marché UE de 600 milliards d'euros pour les produits liés à l'énergie et de 500 milliards d'euros pour les autres produits. Les produits inclus représentent une part importante des impacts environnementaux de la consommation de l'UE : ils sont responsables d'environ 31 % des impacts du changement climatique et de 34 % de l'utilisation des ressources fossiles de l'ensemble des produits couverts par ESPR consommés dans l'UE.
L'écoconception est un levier de transition écologique des entreprises, tout en étant un outil pour leur compétitivité. Le dernier baromètre de l'écoconception de l'ADEME221(*) illustre la tendance : 75 % des entreprises ont intégré l'écoconception dans leur stratégie, dont 33 % systématiquement ; 21 % des entreprises appliquent la démarche d'écoconception à un niveau généralisé du portefeuille de produits ; pour 40 % des entreprises, écoconcevoir des produits et des services est un moyen d'anticiper les futures réglementations.
Le règlement offre donc un cadre réglementaire harmonisé pour stimuler l'offre et la demande en produits durables.
En appliquant l'approche d'écoconception à un très large éventail de produits et en définissant des exigences ciblées pour différentes catégories de produits, le règlement vise à remédier aux incidences les plus néfastes des produits sur l'environnement, y compris les effets sur le climat, l'environnement, l'énergie, l'utilisation de ressources et la biodiversité. Ce règlement s'applique quel que soit le lieu de fabrication des produits, aussi bien aux produits fabriqués dans l'Union européenne qu'aux produits importés.
Le règlement ESPR établit un cadre pour l'élaboration d'exigences d'écoconception par actes délégués pour les différentes catégories de produits, en distinguant les produits dits « finis » (comme le textile, les pneus, les produits d'ameublement, les produits liés à l'énergie) les produits dits « intermédiaires », qui nécessitent une transformation ultérieure avant de devenir des produits « finis » (comme le fer, l'acier et l'aluminium). Il ne s'applique pas à certains produits, qui sont déjà réglementés par des réglementations sectorielles, comme les denrées alimentaires et les médicaments.
Les dispositions seront adoptées par groupe de produits (et pourront donc être différentes selon les groupes de produits) ou de façon horizontale si des dispositions minimales sont nécessaires et adaptables pour plusieurs groupes à la fois (par exemple, des exigences transversales sur la réparabilité des produits pourront être adoptées). Les exigences d'écoconception pourront recouvrir des exigences de performance, quantitatives ou qualitatives, et/ou des exigences d'information.
L'élaboration de ces exigences sera précédée d'études préparatoires spécifiques, d'analyses d'impact et de consultations des parties prenantes, ayant pour objectif d'améliorer la durée de vie des produits, la possibilité de réemploi, d'amélioration et la réparabilité des produits, l'efficacité des produits sur le plan énergétique et de l'utilisation efficace des ressources, la teneur en matériaux recyclés, le remanufacturage des produits et le recyclage de haute qualité.
Les produits soumis à des exigences d'écoconception devront par ailleurs comporter un passeport produit. Ce passeport est un outil numérique222(*) qui permettra de renforcer la traçabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit (extraction des matières premières, production, distribution, utilisation, réparation, et fin de vie), et d'améliorer la communication à destination des consommateurs. Le passeport sera apposé sur les produits et offrira un accès à un certain nombre d'information : des données sur la performance, sur la circularité (durabilité, recyclabilité), sur la conformité, mais aussi des informations relatives à l'utilisation du produit (par exemple, un manuel d'utilisation). Les informations contenues dans le passeport seront intégrées par le fabricant et accessibles aux distributeurs, aux autorités de contrôle, aux autorités douanières et aux consommateurs, avec des droits d'accès différenciés. L'objectif final du passeport est multiple :
- Faciliter la réparation ou le recyclage grâce à la disponibilité des informations pertinentes sur le produit
- simplifier la conformité aux exigences de traçabilité pour les entreprises
- aider les consommateurs à faire des choix éclairés avant l'achat d'un produit ;
- faciliter les contrôles
En complément, le règlement prévoit des dispositions visant à limiter la destruction d'invendus de certains produits, tels que les textiles.
Enfin, il définit un cadre pour la mise en oeuvre de dispositions relatives aux considérations environnementales dans les marchés publics.
En favorisant la durabilité des matériaux, la conservation de leur valeur et l'utilisation de matériaux recyclés, le règlement écoconception cherche à soutenir les objectifs généraux de l'UE en matière de climat, d'environnement et d'énergie (notamment l'Accord de Paris, l'objectif de réduction de 55% des émissions de l'UE « Ajustement à l'objectif 55 » et le 8ème programme d'action pour l'environnement), tout en stimulant la croissance économique, la création d'emplois et l'inclusion sociale. Il vise également à renforcer l'autonomie stratégique et la résilience de l'UE en réduisant la dépendance aux ressources naturelles, et contribue également aux objectifs de la politique industrielle de l'UE en encourageant la production et la demande de biens durables et en assurant des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur.
Ce texte fait partie d'un ensemble d'initiatives de la Commission européenne visant à promouvoir les produits durables, ainsi que des mesures pour permettre aux consommateurs de prendre part à la transition écologique, tels que la directive « Donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte »223(*) et la directive « Droit à la réparation »224(*).
Le règlement écoconception s'inspire de l'actuelle directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et la remplacera à terme. Une période de transition entre les deux instruments est prévue par le texte.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Le présent article n'entre pas en contradiction avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle, notamment avec la liberté d'entreprendre à laquelle, s'agissant de définir des règles de conception des produits dans le but de protéger l'environnement, il n'est pas porté ici d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement ESPR est un texte clé du Plan d'action européen pour l'économie circulaire225(*) de la Commission européenne. Ce plan envisage notamment le déploiement progressif d'un cadre pour une politique de « produits durables », assortie de mesures relatives à la conception des produits, d'une responsabilisation des consommateurs et des acheteurs publics et d'une plus grande circularité des processus de production. Il fait partie intégrante du Pacte Vert européen (« Green Deal »), la feuille de route pour une croissance durable et la neutralité carbone d'ici 2050.
Le règlement dispose d'une base légale unique, relative au marché intérieur ( article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) depuis le traité de Lisbonne. Cet article permet à l'Union européenne d'harmoniser les réglementations nationales et d'éviter les distorsions du marché européen et les obstacles à la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne.
Le texte publié renvoie à une série de règlements délégués relatifs :
- Aux exigences d'écoconception afin de :
§ Établir des exigences d'écoconception applicables à certains produits ;
- Au passeport produit afin de :
§ Préciser certaines informations devant figurer dans le passeport produit ;
§ Établir des exigences pour les prestataires de services de passeport ;
§ Établir des règles et des procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données ;
- A la lutte contre la destruction des invendus afin de :
§ Amender la liste des produits soumis à interdiction de destruction des invendus ;
§ Proposer des dérogations à l'interdiction de destruction des invendus.
Il prévoit également plusieurs actes d'exécution pour :
- Mettre en place des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques ;
- Définir des modalités détaillées du fonctionnement du registre du passeport produit ;
- Définir des exigences communes pour la présentation des étiquettes requises ;
- Officialiser des mesures d'autoréglementation dans le cadre prévu par le règlement ;
- Préciser des modalités et le format de la publication des informations sur les produits de consommation invendus ;
- Définir à l'échelle de l'Union des « spécifications communes », à savoir des règles relatives à des méthodes d'essai, de mesure ou de calcul ;
- Définir les exigences minimales pour les marchés publics écologiques.
Le règlement (UE) 2024/1781 est entré en vigueur le 13 juin 2024 et abroge, au 31 décembre 2030, la directive 2009/125/CE fixant des exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie. Une période de transition est prévue jusqu'en 2030.
S'agissant d'un règlement, ses effets sont immédiats, et il ne nécessite pas en principe d'être transposé dans le droit interne. En cas de conflit, le droit de l'Union européenne l'emporte sur toute disposition contraire du droit national. Toutefois, les Etats membres ne peuvent maintenir des dispositions de droit interne contraires au règlement ou qui auraient pour effet de compromettre sa mise en oeuvre. Les dispositions contraires au règlement doivent donc être retirées, en l'absence, dans le règlement, de mesures transitoires qui permettraient leur maintien.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En premier lieu, le règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché prévoit la désignation d'autorités de contrôle pour la surveillance du marché des produits soumis à des exigences d'écoconception au titre de la directive 2009/125/CE. L'article 79 du règlement 2024/1781, qui prévoit les mesures de transition entre ce règlement et la directive 2009/125/CE, précise dans son point 3 que « Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement ».
Dès lors, l'habilitation des corps de contrôle adéquats est nécessaire, afin de procéder à la recherche et à la constatation d'infractions et de manquements au règlement. Les obligations issues du règlement « ESPR » et de ses actes délégués seront inscrites au code de l'environnement (article nouvellement créé dans le code de l'environnement par cet article du projet de loi DDADUE) ; dès lors, afin que des corps de contrôles autres que les inspecteurs de l'environnement puissent intervenir, il est nécessaire de prévoir cette habilitation afin que les corps de contrôles en question soit habilité à rechercher et constater les infractions.
En second lieu, en ce qui concerne la destruction des invendus non-alimentaires, le règlement 2024/1781 impose par ailleurs aux opérateurs économiques (producteurs, importateurs, distributeurs) de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la destruction de leurs invendus (excès de stocks, produits retournés par les consommateurs sur la base de leur droit de rétraction, etc.).
Il prévoit deux dispositifs, qui ne visent que les grandes et moyennes entreprises, suivant un calendrier différencié, et les seuls produits destinés aux ménages :
- Une obligation pour les opérateurs économiques de rendre public chaque année, des informations sur leurs invendus par « type ou catégorie de produits » (les quantités d'invendus détruits ventilées par catégories de produits, les raisons de cette destruction et le cas échéant la dérogation correspondante, les mesures prises et prévues visant à prévenir la destruction, etc.). Les modalités et le format de publication de ces informations seront précisés par un acte d'exécution de la Commission d'ici fin 2025.
- Une interdiction de destruction des textiles, accessoires et chaussures à compter du 19 juillet 2026 pour les grandes entreprises, et du 19 juillet 2030 pour les moyennes. La Commission est habilitée à édicter des interdictions de destruction pour d'autres catégories de produits ménagers. Elle doit ainsi examiner d'ici 2028, la possibilité d'élargir la liste des produits concernés, et considérer en premier lieu les équipements électriques et électroniques ;
- Le recyclage est inclus dans la définition de « destruction », et est donc interdit au même titre que l'incinération et la mise en décharge, mais des dérogations seront précisées par acte délégué de la Commission européenne d'ici fin 2025.
L'article L. 541-15-8 du code de l'environnement prévoit une interdiction d'élimination pour toutes les catégories d'invendus, autorise le recyclage, et s'impose à l'ensemble des entreprises.
Les Etats membres sont néanmoins autorisés à introduire ou de maintenir une interdiction de destruction pour d'autres catégories de produits que les textiles, accessoires et chaussures, en s'appuyant sur le considérant 59 du règlement.
S'agissant des entreprises concernées par l'interdiction de destruction, il est également possible de maintenir les dispositions de l'article L. 541-15-8 (pour les produits autres que les textiles, accessoires et chaussures) à l'ensemble des entreprises, y compris aux petites entreprises, sous réserve de notifier cette disposition à la Commission européenne au titre de l'article 114 paragraphe 4 du TFUE (qui prévoit la possibilité pour les Etats membres, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes relatives à la protection de l'environnement), et que la Commission donne son accord.
En conséquence, le présent article prévoit l'exclusion des textiles, accessoires et chaussures du champ d'application de l'article L. 541-15-8, ces produits étant directement visés par l'interdiction de destruction prévue par le règlement 2024/1781.
Il en résulte donc :
- Le maintien de l'interdiction pour toutes les catégories de produits visées par l'article L. 541-15-8 (seuls les textiles, accessoires et chaussures sont concernés au niveau européen) ;
- Le maintien de l'interdiction pour l'ensemble des entreprises comme prévu par l'article L. 541-15-8 (seules les grandes et moyennes entreprises sont concernées au niveau européen) ;
- Le maintien de la possibilité de recycler les invendus et les dérogations prévues par l'article L. 541-15-8 et son décret d'application, pour tous les produits, sauf pour les textiles, accessoires et chaussures (car le recyclage entre dans la définition de « destruction » au niveau européen) en reprenant pour cette catégorie de produits les dérogations à l'interdiction de destruction qui seront définies au niveau européen, par un acte délégué, courant 2025.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le règlement vise à élaborer et imposer des exigences d'écoconception pour améliorer la durabilité environnementale des produits, afin de faire des produits durables la norme. En pratique, cela aura pour conséquence d'interdire la mise sur le marché européen des produits les moins-disant sur le plan environnemental.
Sur le plan environnemental, le règlement va contribuer à :
- une meilleure information du consommateur afin de favoriser des choix durables au moment de l'acte d'achat ;
- disposer de produits plus durables, plus fiables, plus réparables, plus recyclables, avec une empreinte environnementale et empreinte carbone réduites ;
- avoir plus de contenu recyclé dans les produits ;
- favoriser la réparation et le réemploi.
Les dispositions proposées par le présent article visent à mettre en place la surveillance du marché, prévu à l'article 66 du règlement ESPR.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le règlement étant directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, une option aurait pu être de ne pas transposer le règlement.
Toutefois, s'agissant des dispositions relatives à l'écoconception, plusieurs options ont été envisagées pour habiliter certains corps de contrôle.
La première option est d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en mentionnant le règlement ESPR à l'article L. 511-12 du code de la consommation. Grâce à une lecture croisée des articles L. 511-12 et L. 511-22 du même code, d'autres agents de contrôle, comme les agents des douanes, sont ainsi habilités. Les agents du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) pourront être ajoutés à l'article L. 511-22, afin qu'ils puissent réaliser des contrôles des futures exigences d'écoconception qui seront définies pour les pneumatiques.
La seconde option est de prévoir la même habilitation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en mentionnant le règlement ESPR à l'article L. 511-12 du code de la consommation, tout en prévoyant une habilitation spécifique des agents du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) dans le code de la route.
En outre, s'agissant des dispositions relatives aux invendus non-alimentaires, cette option doit être écartée au profit d'une seconde option permettant d'expliciter, pour plus de visibilité pour les entreprises concernées, les produits invendus soumis aux exigences du règlement 2024/1781 et ceux restant concernés par les dispositions de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement.
Par ailleurs, s'agissant des exigences s'appliquant aux produits qui seront couverts par des actes délégués, la désignation dès à présent des autorités de surveillance du marché permet d'apporter de la visibilité et de se préparer aux échéances futures. En effet, les actes délégués sectoriels par groupe de produits vont être adoptés progressivement en application du programme de travail adopté par la Commission, et il reviendra aux autorités de contrôle d'adapter leurs plans de contrôle : celles-ci ont par conséquent besoin d'être désignées en amont pour pouvoir prendre part aux négociations de ces actes délégués et anticiper les modalités et techniques de contrôles qui seront nécessaires.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le I porte adaptation du code de la consommation. Il vise à habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder à la recherche et à la constatation d'infractions et de manquements au règlement en tant qu'autorité de surveillance du marché pour le règlement ESPR. Ainsi, ils pourront engager des procédures pénales et administratives, en mettant en oeuvre des procédures déjà prévues par le code de la consommation (injonctions, retraits).
Le II vise à adapter le code de la route, afin d'habiliter les agents du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM), de réaliser des contrôles des futures exigences d'écoconception qui seront définies pour les pneumatiques. Ces agents sont déjà habilités à réaliser des contrôles d'exigences d'étiquetage des pneumatiques.
Il a été préféré une modification du chapitre du code de la route relatif à la surveillance des véhicules pour plusieurs raisons, afin d'offrir une meilleure lisibilité du droit pour les agents du SSMVM en regroupant toutes les textes pour lesquels ces agents sont habilités dans le même article du code de la route et leur permettre de mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 329-9 à L. 329-29 du code de la route.
En outre, des mesures sont prises pour distinguer le cas des textiles, accessoires et chaussures, soumis aux règles définies par le règlement 2024/1781 en matière d'interdiction de destruction des invendus, des autres produits qui restent concernés par les dispositions de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement.
Il est donc proposé au III du présent article d'exclure du champ d'application de l'article L. 541-15-8, les produits mentionnés à l'annexe VII du règlement 2024/1781.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le I créé un nouvel alinéa à l'article L. 511-12 du code de la consommation.
Le II crée un nouvel alinéa à l'article L. 329-1 du code de la route.
Le III modifie l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions prévues permettent de transposer en droit interne les dispositions de l'article 66 du règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences d'écoconception pour des produits durables. Il prévoit la base législative pour permettre le contrôle des exigences au titre du règlement 2024/1781 et des actes délégués adoptés en application de son article 4.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le règlement ESPR ne fixe pas les exigences spécifiques qui seront applicables à un ou plusieurs groupes de produits. L'article 4 du règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués pour définir ces exigences applicables à un ou plusieurs groupes de produits.
Ces actes délégués seront adoptés à partir de 2026, en fonction des priorités établies par la Commission dans son programme de travail écoconception rendu public en avril 2025. Ce premier programme de travail devrait réguler, à terme, un marché européen de 600 milliards d'euros pour les produits liés à l'énergie et 500 milliards pour les autres produits. Selon la Commission européenne dans le programme de travail écoconception-étiquette énergie 2025-2030, les produits inclus représentent une part importante des impacts environnementaux de la consommation de l'UE : ils sont responsables d'environ 31 % des impacts du changement climatique et de 34 % de l'utilisation des ressources fossiles de l'ensemble des produits amenés à être couverts par des exigences d'écoconception au titre de ce règlement, et consommés dans l'UE. Il s'agit (avec la date d'adoption indicative de l'acte délégué entre parenthèses) de :
- Produits finis : textiles (2027), ameublement (2028), pneus (2027), matelas (2029) ;
- Produits intermédiaires : fer/acier (2026), aluminium (2027) ;
- Actes délégués horizontaux : réparabilité (2027, périmètre exact non précisé à ce stade), recyclabilité et contenu recyclé des équipements électriques et électroniques (2029).
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les exigences d'écoconception visent les produits régulés par un acte délégué et mis sur le marché européen, aussi bien ceux qui sont fabriqués en Union européenne que ceux qui sont fabriqués hors de l'Union puis importés. Dès lors, il devrait en ressortir des impacts positifs en termes de compétitivité pour les entreprises françaises et européennes, qui seront plus à même de se conformer à ces exigences.
S'agissant des modifications liées aux invendus non-alimentaires, et plus spécifiquement des textiles, accessoires et chaussures mentionnés à l'annexe VII du règlement 2024/1781, leur incinération et mise en décharge est interdite par la loi antigaspillage au niveau national, mais leur recyclage reste autorisé par la loi. Avec le règlement 2024/1781, ces produits invendus ne pourront plus être recyclés, sauf dérogations qui seront précisés par acte délégué de la Commission européenne, fin 2025. Il n'est donc pas possible en l'état, du fait de la méconnaissance du périmètre et des conditions des exemptions, d'évaluer l'impact de cette évolution sur les entreprises possédant des invendus de textiles, accessoires et chaussures.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les I et le II de l'article présenté habilitent des corps de contrôle afin qu'ils puissent procéder à la recherche et à la constatation d'infractions et de manquements au règlement.
Le règlement confie la mission aux Etats membres de procéder à la surveillance du marché des produits circulant sur leur territoire national.
Le nombre de contrôle dépendra, entre autres, du nombre d'actes délégués qui seront adoptés à l'avenir et du volume de produits couverts par ces actes. Cela pourrait générer une activité supplémentaire pour les autorités de surveillance, qui pourrait alors nécessiter des ETP supplémentaires pour réaliser ces missions.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les consommateurs bénéficieront, à terme, d'une offre de produits plus durables, ainsi que de la mise à disposition d'informations fiables sur ces produits et d'un accès facilité aux services de réparation.
L'étude d'impact réalisée par la Commission européenne rappelle que les produits les moins performants seront progressivement retirés du marché, ce qui se traduira pour les consommateurs par une amélioration de la durabilité, de la fiabilité et de la réparabilité des produits.
Plus largement au niveau des secteurs économiques et plus particulièrement du secteur de l'économie circulaire, les exigences visant à garantir un recyclage de qualité des produits et à augmenter leur contenu recyclé contribueront à stimuler l'offre et la demande de matières premières secondaires.
Il est attendu de manière globale un « verdissement » du marché des produits et des retombées positives sur les plans économiques et sociaux.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les consommateurs bénéficieront, à terme, d'une offre de produits plus durables, ainsi que de la mise à disposition d'informations fiables sur ces produits et d'un accès facilité aux services de réparation.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le règlement encouragera les modes de production et de consommation en accord avec les objectifs généraux de durabilité de l'Union européenne, y compris sur les plans du climat, de l'environnement, de l'énergie, de l'utilisation des ressources et de la biodiversité, dans le respect des limites de la planète.
Pour cela, il est mis en place un cadre législatif favorable aux produits adaptés à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources, contribuant à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation (accord interinstitutionnel « Mieux légiférer »), plusieurs consultations ont été organisées par la Commission européenne :
- une consultation sur l'analyse d'impact initiale, du 14 septembre au 16 novembre 2020, au cours de laquelle 193 réponses ont été recueillies ;
- une consultation publique ouverte, du 17 mars au 9 juin 2021, au cours de laquelle 626 réponses ont été recueillies ;
- une série d'ateliers, d'avril à juillet 2021, sur différents sujets liés à l'initiative relative aux produits durables, auxquels ont largement contribué les participants de plusieurs groupes de parties prenantes ;
- une enquête auprès des petites et moyennes entreprises, du 26 avril au 15 juin 2021, au cours de laquelle 332 réponses ont été recueillies ;
- une deuxième enquête ciblée sur les petites et moyennes entreprises (PME), du 20 octobre au 4 novembre 2021, qui s'est principalement appuyée sur l'expertise des organisations représentant les PME et au cours de laquelle 35 réponses ont été recueillies ;
- des questionnaires sur mesure soumis à une sélection de représentants des parties prenantes du 20 mai au 9 juin 2021 ;
- un certain nombre d'entretiens avec les parties prenantes menés avec une sélection de représentants de parties prenantes.
Au niveau français, les parties prenantes françaises ont été réunies à deux reprises sur le projet de règlement, avant son adoption : le 7 juillet 2022 et le 26 janvier 2023.
Les dispositions relatives aux invendus non-alimentaires feront également l'objet d'une consultation facultative du Conseil national de l'économie circulaire (CNEC), en application de l'article D. 541-1 du code de l'environnement.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le règlement ESPR est entré en vigueur le 18 juillet 2024.
Les obligations relatives à la destruction des invendus en application le 19 juillet 2026 pour les grandes entreprises. L'absence de mesure d'adaptation du droit national existant entrainerait la poursuite de disposition contraires à ce règlement européen.
Les dispositions relatives à l'écoconception seront effectives à l'entrée en application du premier acte délégué, dont la date estimative est l'année 2026. Les actes délégués établiront les obligations pour les opérateurs économiques, et seront adoptés en fonction du programme de travail de la Commission européenne.
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception du IV qui entrera en vigueur le 19 juillet 2026.
5.2.2. Application dans l'espace
Les présentes dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire national y compris les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon. Elles ne sont pas applicables, comme toutes les autres dispositions du code de l'environnement, dans les autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 51 - Directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Adoptée en 2010, la directive 2010/75/UE, relative aux émissions industrielles, dite « IED », est un pilier de la législation environnementale de l'Union européenne. Elle encadre les émissions polluantes issues des installations industrielles à fort impact environnemental.
En France, sont notamment concernées, les activités suivantes :
- Les industries d'activités énergétiques (raffineries, grandes installations de combustion) ;
- La production et transformation des métaux (dont les aciéries, forges et le traitement de surface) ;
- L'industrie minérale (verrerie, céramique, production de ciment) ;
- L'industrie de la chimie ;
- La gestion des déchets ;
- Autres secteurs notamment l'agro-alimentaire, papeteries, les cimentiers et l'industrie textile.... ;
- Les installations d'élevages de volailles et de porcins.
La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles a été transposée dans le droit interne en 2013 :
- La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement ( articles L. 515-28 à L. 515-31) comporte les dispositions législatives propres aux installations relevant de la directive (définies à l'annexe I à la directive). Ces dispositions portent sur les installations figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
- La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement ( articles R. 515-58 à 84) comporte les dispositions réglementaires d'application de la section législative précitée ;
- Le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 a modifié la nomenclature des ICPE afin de créer des rubriques spécifiques aux installations relevant de la directive IED (rubriques n° 3000) ;
- L' arrêté du 2 mai 2013 porte sur les définitions, liste et critères de la directive IED.
La stratégie européenne intitulée « Pacte vert pour l'Europe » vise à garantir, d'ici à 2050, une économie propre, circulaire, et neutre pour le climat. À ce titre, la directive IED a fait l'objet d'une évaluation en 2019 qui a mis en exergue 5 axes d'amélioration de la directive :
1. L'efficacité en matière de réduction des émissions polluantes, de participation et d'information du public et de protection de la biodiversité ;
2. Le soutien du déploiement rapide des technologies innovantes ;
3. L'efficacité dans l'utilisation des ressources, l'économie circulaire et le recours à des alternatives de produits chimiques plus sûrs ;
4. La cohérence dans la stratégie de réduction des gaz à effet de serre ;
5. La réglementation de certains secteurs agro-industriels.
En conséquence, une proposition de révision de la directive IED a été présentée par la Commission européenne en 2022. Après deux ans d'examen par le Conseil et le Parlement européen, un compromis a été obtenu pour une profonde refonte de cette directive, adoptée le 24 avril 2024.
Cette refonte vise à renforcer la prévention et la réduction des pollutions industrielles, à améliorer la transparence et à intégrer davantage les objectifs de durabilité. Elle s'inscrit dans une logique d'exigence accrue en matière de protection de l'environnement, tout en cherchant à favoriser l'innovation et la compétitivité durable de l'industrie européenne. Elle reflète une volonté d'équilibrer impératifs économiques, environnementaux et sociaux, en impliquant l'ensemble des acteurs de la société. Enfin, elle favorise un meilleur accès aux informations environnementales et une meilleure participation du public à l'élaboration des décisions qui portent des enjeux environnementaux.
Plus en détails, cette refonte de la directive « IED » élargit, par une modification de son annexe I, son champ d'application à de nouveaux secteurs industriels (minerais, industries de batteries, installations de stockage de déchets...) et s'étend à de nouvelles installations d'élevages.
Cette refonte a tenu compte des spécificités inhérentes aux élevages afin d'alléger les procédures administratives les concernant, tout en conservant un niveau de protection de l'environnement élevée. Ces installations - définies à l'annexe I bis à la directive - feront ainsi l'objet de règles dédiées.
Le principal levier de cette directive est de définir et de mettre à jour, pour chaque activité concernée, les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la protection de l'environnement. Ces MTD, spécifiques à chaque activité, décrivent les modes d'exploitation, tant relativement au matériel utilisé qu'aux processus de fabrication développés, les plus efficaces et avancés, pour limiter les émissions de polluants et les impacts sur l'environnement. Elles constituent ainsi la base des valeurs limite d'émission applicables, c'est-à-dire, les quantités de polluants rejetés dans l'environnement qu'un établissement ne doit pas dépasser.
Cette refonte vient renforcer ce levier MTD en établissant des règles plus exigeantes auprès des États membres et des exploitants industriels afin qu'ils réduisent plus efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur impact sur les ressources naturelles. De plus, une meilleure harmonisation des conditions d'autorisation des activités industrielles au sein des États membres est mise en place pour garantir l'équité et l'efficacité environnementale et l'actualisation des documents de référence sur les MTD est accélérée.
Par ailleurs, avec cette refonte, les conditions d'exploitation des installations ne sont plus uniquement réglementées en vue de réduire les émissions de polluants. En effet, sont désormais prévus des niveaux de performances environnementales qui obligent les opérateurs à tenir compte des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits et de développer des procédés industriels qui favorisent l'écoconception, la réduction des déchets à la source, une meilleure efficacité énergétique et une moindre consommation de ressources (eau, matières premières). De plus, elle contribue aux objectifs climatiques de l'Union européenne (UE), exigeant pour chaque opérateur d'une installation industrielle qu'il démontre, au sein d'un plan de transformation, comment il contribue à la transition vers la neutralité carbone.
En outre, la directive révisée introduit des obligations renforcées en matière de transparence : les citoyens auront un meilleur accès aux informations relatives à l'impact environnemental des installations industrielles, par le biais notamment d'un portail européen unique qui rassemblera les informations relatives aux émissions de substances polluantes, notamment les GES, aux autorisations des activités industrielles et à leurs contrôles. L'objectif est de renforcer le rôle des parties prenantes et de favoriser la participation du public aux décisions qui ont un effet sur l'environnement.
Par ailleurs, cette refonte renforce les sanctions de la directive, afin qu'elles soient davantage effectives, proportionnées et dissuasives.
Les dispositions de la nouvelle directive doivent être transposées au plus tard le 1er juillet 2026. C'est l'objet du présent article.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (CC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économique numérique, n° 2994-96 DC). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (CC, 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, n° 2018-765 DC).
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement.
Le préambule de la Constitution de 1958 dispose par ailleurs que le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits et devoirs définis la Charte de l'environnement de 2004 ; cette Charte est ainsi rattachée au bloc de constitutionnalité (voir, les décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014).
A titre d'exemple, le Conseil constitutionnel a récemment fait application du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement, en censurant une disposition qui permettait de déroger à l'interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées (décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025).Cadre conventionnel
En application de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les directives adoptées au niveau des instances de l'UE doivent faire l'objet d'une transposition par les Etats membres afin qu'elles aient force de loi dans lesdits États.
Conformément à l'article 288 du TFUE la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. Les mesures nationales doivent ainsi permettre d'atteindre les objectifs définis par la directive selon les modalités propres qu'elles définissent.
Une fois adoptées les mesures nationales doivent être communiquées à la Commission européenne. En cas de défaut de transposition, la Commission peut engager une procédure d'infraction contre l'Etat concerné auprès de la Cour de justice de l'UE.
En outre, l'Union européenne et la France sont signataires de la Convention internationale d'Aarhus dont l'objet est : « [...] de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'Environnement [...] ». La refonte de la directive IED s'inscrit dans ce cadre puisqu'elle poursuit et décline les objectifs de cette Convention.
1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La refonte de la directive IED nécessite de nouvelles mesures législatives et réglementaires.
La présente étude d'impact se concentre sur les dispositions législatives proposées par le Gouvernement afin d'appliquer fidèlement les nouvelles obligations de la directive. Des adaptations réglementaires, en cours d'élaboration, seront également nécessaires.
La refonte de la directive IED nécessite la modification et la création d'articles législatifs du code de l'environnement et du code minier ayant pour objet les 5 axes suivants :
1. Refonte de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement du code de l'environnement, pour tenir compte de la création d'une annexe I bis à la directive ;
2. Ajustement du régime de sanctions administratives ;
3. Extension du champ de la consultation du public en cas d'actualisation des conditions d'autorisation de l'exploitation ;
4. Application de la directive IED aux travaux miniers ;
5. Ajustement de la dénomination de la directive.
Le Gouvernement a veillé à ce que les dispositions proposées répondent strictement aux exigences de la directive, sans « surtransposition » ou « sous-transposition ».
- Refonte de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour tenir compte de la création d'une annexe I bis à la directive
En l'état, la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement (articles L. 515-28 à L. 515-31) comporte des dispositions législatives propres aux installations couvertes par la directive, définies comme les installations relevant de son annexe I.
Or, la directive révisée a créé une annexe I bis, propre aux installations d'élevage. En effet, la directive IED revue reconnaît la spécificité des élevages, dont l'activité présente des caractéristiques d'exploitation sensiblement différentes des activités industrielles, et prévoit à ce titre qu'ils bénéficient de dispositions spécifiques afin d'atteindre un haut niveau de protection de l'environnement.
Les règles spécifiques applicables aux installations d'élevage relevant de l'annexe I bis de la directive sont en cours d'élaboration par la Commission européenne.
Toutefois, on sait déjà que les dispositions législatives suivantes inscrites dans le code de l'environnement et applicables aux installations relevant de l'annexe I ne s'appliqueront pas aux installations d'élevage relevant de l'annexe I bis, ainsi que le prévoit la directive :
- article L. 515-28 : prescriptions fixées de telle sorte que les installations soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques ; réexamen périodique et, si nécessaire, actualisation des conditions d'exploitation ;
- article L. 515-29 : participation du public à l'occasion de l'actualisation des conditions d'autorisation dans le cadre d'un réexamen ;
- article L. 515-30 : description de l'état du site d'implantation lors du premier réexamen dans un rapport de base ; conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport lors de la mise à l'arrêté définitif ;
- seconde phrase de l'article L. 515-31 : décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état.
Une adaptation de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est donc nécessaire, afin de n'appliquer que certaines dispositions de la directive IED aux installations d'élevage, comme l'exige la directive.
- Ajustement du régime de sanctions administratives
Afin d'assurer la bonne application des mesures de protection de l'environnement, la directive IED prévoit des sanctions qu'elle laisse chaque État membre définir les modalités en assurant l'efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif.
Les sanctions applicables aux exploitants d'installations soumises à la directive IED sont prévues par la loi aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, qui listent les mesures et les sanctions applicables, respectivement, en cas d'exploitation sans titre ou d'inobservation des prescriptions applicables.
La refonte de la directive renforce ces mesures de sanction et prévoit un socle commun minimal de sanctions applicables.
En effet, le paragraphe 2 de l'article 79 de la directive revue prévoit que, pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières est égal à au moins 3% du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne par l'exploitant au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende a été infligée. Cette sanction administrative financière doit également être fixée de telle sorte qu'elle puisse priver les auteurs de la violation des avantages économiques qu'ils ont tirés de leurs violations.
Ce plafond obligatoire diffère du plafond actuellement retenu par le droit interne (L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement) pour deux raisons : i) d'une part, car il est exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, là où le code de l'environnement prévoit un plafond en valeur absolue (45 000 euros) ; ii) d'autre part, car il est vraisemblablement plus élevé, en pratique, que le plafond fixé par le droit national.
Par ailleurs, les articles L. 171-7 et L. 171-8 ne prévoient pas explicitement qu'il est tenu compte des avantages qui sont tirés des manquements constatés pour la fixation des amendes et astreintes.
Par conséquent, il est nécessaire de modifier la loi pour adapter les mesures et sanctions administratives afin d'être conforme au droit européen.
- Extension du champ d'application de la consultation du public
La directive IED prévoit périodiquement le réexamen et l'actualisation des conditions d'autorisation des installations de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les MTD.
La directive refondue prévoit désormais, lors de ces réexamens, une consultation du public lorsque des conditions d'autorisation de l'installation sont actualisées (cf. points 1.d et 1.e de l'article 24).
Les dispositions législatives existantes relatives aux conditions dans lesquelles la participation du public est obligatoire lors du réexamen des MTD sont fixées à l'article L. 515-29 du code de l'environnement.
Or, cet article ne prévoit une consultation du public que dans certains cas d'actualisation des conditions d'exploitation :
- d'une part, dans le cas où l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
- d'autre part, dans le cas où la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
Par conséquent, il est nécessaire de modifier la loi pour étendre cette consultation du public à toute actualisation des conditions d'autorisation que nécessite le réexamen des meilleurs techniques disponibles.
- Application de la directive aux travaux miniers
La nouvelle mouture de la directive inclue à présent les travaux miniers d'extraction dans le champ des activités relevant de la directive IED (3.6 de l'annexe I).
Les travaux d'extraction sont, en droit national, régis par le code minier. Ils ne relèvent pas de la législation des ICPE. Or, le droit national établit, en l'état, un lien direct entre installations relevant de la directive IED et droit des ICPE : en effet, les articles L. 515-28 et suivants du code de l'environnement portent sur les installations mentionnées à l'annexe I à la directive et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet, en l'état, de transposer la directive IED aux travaux miniers.
Une adaptation de la loi est à cet égard nécessaire.
- Ajustement de la dénomination de la directive
Le nom de la directive doit être modifié dans l'ensemble des articles législatifs qui le citent.
La directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles a en effet été renommée, à la faveur de la refonte, comme suit : « directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) ».
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif du Gouvernement est de transposer les dispositions de la directive IED et d'éviter :
- les « surtranspositions » - afin de ne pas exposer les acteurs économiques concernés à une concurrence déloyale au sein de l'Union européenne - ;
- les « sous-transpositions » - afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de préserver les acteurs économiques concernés de risques en matière de contentieux.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
- Refonte de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement
Compte tenu des marges de manoeuvre limitées laissées au Gouvernement pour transposer la directive, aucune autre option n'a été envisagée.
- - Ajustement du régime de sanctions administratives
Compte tenu des marges de manoeuvre limitées laissées au Gouvernement pour transposer la directive, aucune autre option n'a été envisagée.
- Extension du champ d'application de la consultation du public
Compte tenu des marges de manoeuvre limitées laissées au Gouvernement pour transposer la directive, aucune autre option n'a été envisagée.
- Application de la directive aux travaux miniers
Une option alternative à celle retenue par le Gouvernement aurait été de classer ces travaux d'extraction au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Cette option a été écartée car elle aurait été source de complexité pour les acteurs économiques concernés. En effet, les travaux d'extraction relevant de la directive IED auraient été classés ICPE, alors que les travaux d'extraction non-couverts par la directive auraient été exclusivement régis par les dispositions du code minier.
- Ajustement de la dénomination de la directive
Compte tenu des marges de manoeuvre limitées laissées au Gouvernement pour transposer la directive, aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
- Refonte de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement
Une refonte de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est nécessaire, afin de n'appliquer que certaines dispositions de la directive IED aux installations d'élevage.
Ainsi, une sous-section 1 est créée afin de circonscrire les dispositions suivantes de la directive IED aux installations industrielles, relevant de l'annexe I :
- article L. 515-28 : prescriptions fixées de telle sorte que les installations soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques ; réexamen périodique et, si nécessaire, actualisation des conditions d'exploitation ;
- article L. 515-29 : participation du public à l'occasion de l'actualisation des conditions d'autorisation dans le cadre d'un réexamen ;
- article L. 515-30 : description de l'état du site d'implantation lors du premier réexamen dans un rapport de base ; conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport lors de la mise à l'arrêté définitif.
La sous-section 2 est commune aux installations relevant de l'annexe I (installations industrielles) et de l'annexe I bis, dans un souci de transposition au plus juste de la directive. Elle se contente de procéder à un renvoi par décret en Conseil d'État pour définir les conditions d'application de la section (en reprenant l'actuel article L. 515-31), tout en supprimant la seconde phrase de ce dernier article, qui ne s'appliquera pas aux installations d'élevages relevant de l'annexe I bis.
Les dispositions de nature législative propres aux élevages seront déterminées dans le cadre de l'ordonnance prévue à l'article 52 du présent projet de loi.
- Ajustement du régime de sanctions administratives
Des modifications des articles L. 171-7 et L. 171-8 sont prévues pour adapter le régime de sanctions administratives aux exigences de la directive révisée.
Il est ainsi prévu, pour les installations relevant de l'annexe I et de l'annexe I bis, que le montant maximal de l'amende administrative est porté à 3 % du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne de la personne sanctionnée au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée. Ce plafonnement du montant de l'amende étant une mesure spécifiquement applicable à l'ensemble des installations soumises à directive IED, il est proposé de la retranscrire de telle sorte qu'elle ne s'applique qu'à ces installations. De plus, le pourcentage prévu par la directive a été strictement repris.
Une adaptation des articles L. 171-7 et L. 171-8 est également proposée afin que les amendes et les astreintes soient proportionnées à la gravité des manquements constatés ainsi « le cas échéant, qu'aux avantages qui en sont tirés ». Cette précision, prévue par la directive, est inscrite dans les articles transversaux du code de l'environnement (L. 171-7 et L. 171 8) ; il ne serait pas pertinent de la restreindre aux seules installations IED.
- Extension du champ d'application de la consultation du public
Le code de l'environnement disposant déjà d'un article spécialement dédié aux obligations de consultation du public lors d'un réexamen des meilleurs techniques disponibles (art L. 515-29), le Gouvernement a fait le choix de modifier cet article pour étendre les obligations de consultation du public comme le prévoit la directive révisée.
Il est ainsi prévu de remplacer les cas spécifiques actuels par un principe général de consultation du public à l'occasion de l'actualisation des conditions d'autorisation dans le cadre d'un réexamen.
- Application de la directive aux travaux miniers
Les travaux d'extraction étant régis par le code minier, la rédaction proposée contribue à transposer, dans ce même code, les dispositions d'application de la directive IED qui sont aujourd'hui inscrites dans le code de l'environnement. Cette solution contribue à la stabilité du cadre réglementaire pour ces activités.
La rédaction proposée conduit au rétablissement de deux articles du code minier (L. 162-4 et L. 162-5).
L'article L. 162-4 prévoit l'application, aux travaux miniers relevant de la directive IED et dont la définition figure dans le décret prévu à l'article L. 162-1 du code minier (qui définit les travaux de recherches et d'exploitation relevant de l'autorisation ou de la déclaration), des dispositions suivantes :
- article L. 515-28 du code de l'environnement : prescriptions fixées de telle sorte que les installations soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques ; réexamen périodique et, si nécessaire, actualisation des conditions d'exploitation ;
- article L. 515-29 du code de l'environnement : participation du public à l'occasion de l'actualisation des conditions d'autorisation dans le cadre d'un réexamen.
L'article L. 162-5 reprend les dispositions de l'article L. 515-30 du code de l'environnement, en les adaptant aux spécificités des travaux miniers. En effet, de par la nature de cette activité modifiant le paysage, la zone d'extraction du minerai ne pourrait être remise en état à l'identique à l'issue des travaux.
L'article L. 162-12 du code minier prévoit d'ores et déjà que les modalités d'application du chapitre II du titre VI du livre Ier - et donc des articles susmentionnés - sont fixées par décret en Conseil d'État. Il n'y a donc pas lieu de créer un nouveau renvoi à un décret en Conseil d'État pour l'application des nouvelles dispositions issues du présent article.
- Ajustement de la dénomination de la directive
L'article proposé ajuste la dénomination de la directive dans le code de l'environnement (intitulé de la section 8 précitée, L. 593-32) et dans le code de l'énergie (L. 262-3 et L. 281-11).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les mesures proposées :
- créent la sous-section 1 « Installations mentionnées à l'annexe I de la directive » de la section 8 du chapitre V du tire Ier du livre V du code de l'environnement, intégrant les articles existants L. 515-28 à L. 515-30 ;
- créent la sous-section 2 « dispositions communes » de la même section, intégrant la premier phrase de l'article existant L. 515-31 ;
- modifient les dispositions existantes du code de l'environnement (articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 515-28 à L. 515-31) ;
- modifient les dispositions existantes pour faire référence à la nouvelle dénomination de la directive IED (articles L. 262-3 et L. 281-11 du code de l'énergie et article L. 593-32 du code de l'environnement) ;
- rétablissent les articles L. 162-4 et L. 162-5 du code minier pour transposer la directive IED aux travaux miniers.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions du présent article permettent la bonne transposition de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La refonte de la directive IED ne porte pas d'impact macroéconomique direct.
Elle prévoit la mise à jour périodique des meilleures techniques disponibles (MTD). Leur application, par secteur d'activité, nécessite un niveau d'investissement proportionné au niveau de performance environnemental des installations françaises au regard des mesures de réduction des émissions de polluants fixées à l'échelle des États membres. Ce processus de réexamen des meilleurs techniques disponibles étant par définition en constante évolution, il n'est pas possible d'estimer l'impact macroéconomique causée par leur application.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les mesures législatives proposées ne comportent aucune mesure sur les élevages visés par la directive IED ; elles n'ont ainsi aucun impact financier pour ces entreprises.
La refonte de la directive IED, en étendant son champ à de nouvelles activités industrielles, a pour effet d'ajouter environ 100 sites industriels aux 3500 sites déjà soumis.
Les évolutions législatives proposées n'ont, en tant que telles, que peu d'impacts financiers sur ces entreprises.
La description de l'état du site d'implantation de l'installation, transposée par le présent article, concernera un plus grand nombre d'installations. Les 100 nouveaux sites industriels visés par la directive devront à l'occasion de leur réexamen décrire l'état de leur site dans un rapport. Le coût de cette description et de la production du rapport est estimé à 10 000 € pour 80% des cas et 20 000€ dans 20% des cas. Ces nouveaux rapports seront tous produit au plus tard en 2034. Ainsi le montant estimé sur dix années est de 1,2 million d'euros soit 120 000 euros par an.
4.2.3. Impacts budgétaires
Aucune des mesures législatives proposées n'a d'impact budgétaire.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La refonte de la directive IED permet une meilleure association du public aux évolutions de l'encadrement technique et administratif des sites IED à la suite d'un réexamen des meilleurs techniques disponibles.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La refonte de la directive s'inscrit dans la stratégie européenne « Zéro pollution 2050 » et vise une réduction maximale et optimisée des émissions. En effet, malgré des progrès notables (la directive IED a contribué à réduire de 40 à 75% l'émission des principaux polluants sur la période 2007-2017), des faiblesses subsistent en raison de la disparité dans l'application nationale et d'une interprétation excessive des flexibilités de la directive.
La refonte de la directive IED vise ainsi à réduire l'impact environnemental des activités les plus polluantes, d'une part en élargissant le champ des installations concernées, d'autre part en renforçant ses exigences.
À ce titre, elle introduit des sanctions plus dissuasives et proportionnées au bénéfice tiré d'une infraction afin d'inciter les exploitants de sites industriels à appliquer les meilleures techniques disponibles. Le recours à ces techniques assure une réduction durable des émissions de polluants qui améliore la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol.
Cette refonte permet d'accroitre la participation du public dans l'élaboration de décisions administratives ayant un enjeu environnemental qui contribue à l'amélioration des mesures environnementales.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
De par son caractère technique et de par l'objectif visé d'une meilleure harmonisation des dispositions prises à l'échelle européenne, la refonte de la directive IED n'offre qu'une faible latitude sur les dispositions à prendre.
Par ailleurs, eu égard au fait que toute surtransposition du droit européen est évitée, aucune consultation n'a été menée pour la rédaction de ces mesures législatives.
Il est à noter toutefois que plusieurs échanges ont eu lieu lors de l'élaboration de la directive avec des organismes professionnels représentant les intérêts notamment des secteurs de la chimie, de l'élevage et de l'extraction minière. Des échanges avec des organisations non gouvernementales, notamment l'European environnemental bureau (EEB) ont également eu lieu lors de l'élaboration de la directive.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La directive entre en vigueur le 1er juillet 2026. Il est donc proposé de faire entrer en vigueur les dispositions du présent article à la même date.
- Application des dispositions de l'actuelle section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement (articles L. 515-28 à L. 515-31) aux installations d'élevage qui relevaient de l'annexe I avant l'entrée en vigueur de la directive révisée
Un acte d'exécution, prévu par l'article 70 decies, paragraphe 2, doit établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation pour chacune des activités visées à l'annexe I bis.
L'article 3 de la directive modifiant la directive 2010/75/UE dispose par ailleurs que les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de :
- 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, si l'installation a une capacité de 600 unités de cheptel ou plus.
- 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, si l'installation a une capacité de 400 unités de cheptel ou plus.
- 6 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, pour toutes les autres installations couvertes par l'annexe I bis.
Le présent article fixe des modalités transitoires transposant, en droit national, ces échéances.
Il est ainsi prévu, afin de garantir une continuité juridique entre les anciennes et les nouvelles dispositions applicables aux élevages, que les dispositions de l'actuelle section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement (articles L. 515-28 à L. 515-31) continueront de s'appliquer aux installations d'élevage mentionnées à l'annexe I bis de la directive qui relevaient de son annexe I avant l'entrée en vigueur de la directive révisée, jusqu'à la date d'application mentionnée au paragraphe 5 de l'article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.
Dans la même logique, il est prévu que :
- les dispositions relatives aux sanctions administratives du code de l'environnement (L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement), dans leur rédaction résultant du présent article, soient directement applicables aux installations mentionnées à l'annexe I bis qui relevaient de son annexe I avant l'entrée en vigueur de la directive 2024/1785 ;
- et que ces mêmes dispositions soient applicables aux installations mentionnées à l'annexe I bis, qui ne relevaient pas de son annexe I avant l'entrée en vigueur de la directive 2024/1785, à compter de la date d'application mentionnée au paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2024/1785.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition est applicable sur l'ensemble du territoire français métropolitain.
S'agissant de l'application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution), ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; elle ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et à Saint-Barthélemy.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les conditions d'application du présent article.
Article 52 - Police environnementale des élevages
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La stratégie européenne intitulée « Pacte vert pour l'Europe » vise à garantir, d'ici à 2050, une économie propre, circulaire, et neutre pour le climat. À ce titre, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite directive « IED », a fait l'objet d'une évaluation en 2019 qui a mis en exergue cinq axes d'amélioration :
1. l'efficacité en matière de réduction des émissions polluantes, de participation et d'information du public et de protection de la biodiversité ;
2. le soutien du déploiement rapide des technologies innovantes ;
3. l'efficacité dans l'utilisation des ressources, l'économie circulaire et le recours à des alternatives de produits chimiques plus sûrs ;
4. la cohérence dans la stratégie de réduction des gaz à effet de serre ;
5. la réglementation de certains secteurs agro-industriels.
En conséquence, une proposition de révision de la directive « IED » a été présentée par la Commission européenne en 2022. Cette directive est en effet un pilier de la législation environnementale de l'Union européenne. Elle encadre les émissions polluantes issues des installations industrielles et agricoles à fort impact environnemental. Après deux ans d'examen par le Conseil et le Parlement européen, un compromis a été obtenu pour une profonde refonte de cette directive, se traduisant par l'adoption le 24 avril 2024 de la directive 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchet, dite directive « IED 2 ».
Cette refonte vise à renforcer la prévention et la réduction des pollutions industrielles, à améliorer la transparence et à intégrer davantage les objectifs de durabilité. Elle s'inscrit dans une logique d'exigence accrue en matière de protection de l'environnement, tout en cherchant à favoriser l'innovation et la compétitivité durable de l'industrie européenne. Elle reflète une volonté d'équilibrer impératifs économiques, environnementaux et sociaux, en impliquant l'ensemble des acteurs de la société. Enfin, elle favorise un meilleur accès aux informations environnementales et une meilleure participation du public à l'élaboration des décisions qui portent des enjeux environnementaux.
En France, sont notamment concernées par la directive IED les activités énergétiques, les activités de production et de transformation de la matière (acier, verre, ciment, chimie, etc.) et les activités de gestion des déchets. Concernant les installations agricoles entrant dans le cadre de la directive 2010/75/UE, il s'agit des activités d'élevages porcins et de volailles.
Pour les activités d'élevages, cette refonte de la directive « IED » élargit son champ d'application (à partir de 350 unités de cheptel (UGB) pour les porcs, 300 UGB pour les poules pondeuses, 280 UGB pour les volailles de chair, et 380 UGB pour les exploitations mixtes (porcs et volailles)) par une modification de son annexe I bis et s'étend ainsi à de nouvelles installations d'élevages.
Aujourd'hui le nombre d'élevages soumis à la directive est de 2 930. La répartition géographique (par région) des élevages aujourd'hui soumis à la directive IED est présentée dans le tableau ci-après. D'après les données du recensement général agricole de 2024, le nombre d'élevages226(*) qui seront concernés par la directive révisée est estimé entre 4 000 et 4 500.
|
Régions |
Effectif des élevages soumis à IED en 2025 |
Proportion parmi la totalité des élevages soumis à IED en France en 2025 (%) |
|
Auvergne Rhône Alpes |
134 |
4,57% |
|
Bourgogne Franche Comte |
62 |
2,12% |
|
Bretagne |
1425 |
48,63% |
|
Centre Val de Loire |
108 |
3,69% |
|
Corse |
0 |
- |
|
Grand Est |
124 |
4,23% |
|
Guadeloupe |
2 |
0,07% |
|
Guyane |
0 |
- |
|
Hauts-de-France |
160 |
5,46% |
|
Martinique |
2 |
0,07% |
|
Normandie |
122 |
4,16% |
|
Nouvelle-Aquitaine |
201 |
6,86% |
|
Occitanie |
41 |
1,40% |
|
Pays-de-la-Loire |
539 |
18,40% |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4 |
0,14% |
|
Réunion |
6 |
0,20% |
|
Total |
2 930 |
100% |
En contrepartie, cette refonte a tenu compte des spécificités inhérentes aux élevages en permettant d'ouvrir à ces activités la possibilité de procédures plus légères, tout en conservant un niveau de protection de l'environnement élevé, par le respect de règles techniques générales définies au niveau européen. Ces installations font ainsi l'objet de dispositions spéciales au chapitre VI bis de la directive. A ce titre, outre une procédure d'autorisation déjà prévue par la directive non révisée, la directive renforcée introduit spécialement pour les activités agricoles une nouvelle procédure appelée « procédure d'enregistrement » (qui diffère de la procédure d'enregistrement prévue en France pour les installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE).
Le principal levier de cette directive est de définir et de mettre à jour, pour chaque activité concernée, les meilleurs techniques disponibles (MTD) pour la protection de l'environnement. Ces MTD, spécifiques à chaque activité, décrivent les modes d'exploitation, tant sur les matériels utilisés que les processus de fabrication développés, les plus efficaces et avancés pour limiter les émissions de polluants et les impacts sur l'environnement. Elles constituent ainsi la base des valeurs limites d'émission applicables, c'est-à-dire, les quantités de polluants rejetés dans l'environnement qu'un établissement ne doit pas dépasser. Pour les activités d'élevage, les MTD sont inscrites dans un document de référence dénommé « Règles d'exploitation ».
Outre les aspects techniques, la directive révisée introduit des obligations renforcées en matière de transparence : les citoyens auront ainsi un meilleur accès aux informations environnementales des installations industrielles, par le biais notamment d'un portail européen unique qui rassemblera les informations relatives aux émissions, aux autorisations et aux contrôles. L'objectif est de renforcer le rôle des parties prenantes et de favoriser la participation du public pour les décisions qui ont un effet sur l'environnement. La refonte renforce enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions, afin qu'elles soient davantage effectives, proportionnées et dissuasives.
Les dispositions de la directive doivent être transposées au plus tard le 1er juillet 2026.
Le cadre actuel de la police environnementale encadrant l'activité des éleveurs est inscrit dans le code de l'environnement :
- à son titre Ier du livre V pour les installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE (dont les dispositions générales, le contrôle et le contentieux) ;
- à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V pour ce qui est la transposition de la directive IED ;
- au chapitre IV du titre Ier du livre V en ce qui concerne les procédures administratives ;
- au titre VII du livre Ier en ce qui concerne les contrôles administratif et pénal.
Ces dispositions s'appliquent tant aux activités industrielles qu'aux activités agricoles. Cela s'articule avec les dispositions relatives à l'eau, à l'urbanisme, à l'information et à la participation du public.
Pour répondre aux spécificités de l'activité d'élevage d'animaux, les récentes dispositions législatives et règlementaires ont toutefois introduit des dispositions particulières pour les éleveurs, en matière de procédures administratives, de contentieux et de sanctions.
- La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (OSARGA) a par exemple prévu, à son article 32, une dérogation aux règles de droit commun concernant les poursuites administratives ou pénales en cas de dépassement du seuil du régime de la déclaration ou de l'enregistrement de plus de 15 %. L'article L. 171-7-3 du code de l'environnement, introduit par cet article 32, prévoit ainsi qu'en cas de mise en place, de participation à la mise en place ou d'exploitation d'une installation d'élevage sans la déclaration ICPE ou sans l'enregistrement ICPE, lorsque l'installation relève de l'un ou l'autre de ces régimes de déclaration ou d'enregistrement à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors, selon le cas, sans déclaration ou au bénéfice seulement de celle-ci, et à la condition que, selon le cas, l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration ou de l'enregistrement de plus de 15 %, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement ne peut excéder 450 € (contre 45 000 € en principe). Dans les mêmes cas, le fonctionnement sans déclaration ou enregistrement ne sont pas pénalement punissables et ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction pénale (L. 173-1).
- Plus récemment, l'article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur a modifié les dispositions de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement, relatives à l'organisation de la consultation du public pour les demandes d'autorisation environnementale concernant les élevages bovins, porcins et avicoles. Pour ces installations, lors de la phase d'examen et de consultation, la réunion publique d'ouverture ou de clôture est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête le maintien de l'organisation d'une réunion publique d'ouverture ou de clôture.
- Enfin, la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (OSARGA), dans ses articles 47 et 48, et la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, dans son article 3, ont renforcé le caractère spécifique de la nomenclature ICPE applicable aux élevages (piscicultures, bovins, porcins, avicoles ...) en introduisant pour des rubriques de la nomenclature ICPE spécifiques aux élevages des exceptions au principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ces exceptions ont conduit notamment à revoir à la hausse les seuils déclenchant l'obligation d'enregistrement des élevages bovins, les soumettant néanmoins au régime de la déclaration, une centaine d'élevage sont ainsi potentiellement concernés.
Cette tendance actuelle, consistant à adapter le cadre général ICPE aux spécificités des élevages, aurait pu être prolongée pour transposer la directive IED révisée. Le Gouvernement estime toutefois que cette logique se traduirait par une complexité accrue, à rebours de l'objectif de simplification du cadre juridique applicable au secteur agricole, dont les exploitations sont exposées à une concurrence élevée au sein de l'Union européenne et à l'international. Dans ce contexte, le Gouvernement considère plus pertinent de définir un nouveau cadre juridique global propre aux élevages, cohérent avec le droit français et communautaire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le présent article porte de manière élargie des objectifs en manière de préservation de l'environnement et de transposition de directives communautaires en droit interne.
Dans l'article préambule de la Constitution, le peuple français proclame son attachement aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Par ailleurs, la Constitution prévoit, à son article 34, que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement.
La Charte de l'environnement est rattachée au bloc de constitutionnalité par les décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014. La Charte porte notamment des droits et devoirs en matière de politiques publiques qui concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social, et en matière d'accès par les citoyens aux informations relative à l'environnement.
L'article 38 de la Constitution prévoit que « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'Union européenne et la France sont signataires de la Convention internationale d'Aarhus dont l'objet est : « [...] de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'Environnement [...] ».
La refonte de la police environnementale s'inscrit dans ce cadre puisqu'elle poursuit et décline au titre de la directive IED révisée les objectifs de cette Convention.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La refonte de la police environnementale des élevages induit de définir un nouveau cadre juridique global et cohérent avec le droit français et communautaire, tant sur le plan législatif que règlementaire. La refonte envisagée appelle une loi d'habilitation nécessaire pour autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine de la loi, au titre du code de l'environnement et pour mener à bien la transposition de la directive IED révisée.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de transposer les dispositions de la directive IED révisée en ce qui concerne les activités d'élevage et de définir en cohérence un nouveau cadre juridique pour répondre aux spécificités de l'activité d'élevage d'animaux.
Le Gouvernement a veillé à ce que les dispositions proposées répondent strictement aux exigences issues du droit européen, sans « sur-transposition » ou « sous-transposition ».
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option possible consisterait à procéder à des adaptations marginales du cadre législatif existant pour la transposition des dispositions de la directive 2010/75/UE s'appliquant aux activités agricoles.
Cette option conduirait à prolonger la tendance récemment poursuivie par le législateur de répondre aux spécificités de l'activité d'élevage en mettant en oeuvre des dispositions particulières au coeur du cadre législatif général encadrant les activités industrielles (ICPE) (cf. 1.1).
Transposer la directive révisée, qui élargit le nombre d'exploitations agricoles et qui introduit une nouvelle procédure administrative permettant d'exploiter les élevages d'animaux, au sein du régime ICPE actuel ne peut que se traduire par une complexité accrue, à rebours de l'objectif de simplification du cadre juridique applicable au secteur agricole.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La voie d'une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance a été privilégiée.
L'habilitation doit permettre la définition de mesures procédant à l'encadrement des élevages, en prenant en compte les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement.
Le périmètre de la présente habilitation est précis et s'articule autour de plusieurs axes.
Ce choix est justifié par la nécessité :
- de construire un cadre global des procédures encadrant l'exploitation des élevages d'animaux proportionnées aux enjeux environnementaux (par la définition d'un classement des activités en différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients présentés par ces activités), des modalités d'exercice de la police administrative et judiciaire de ces installations ainsi que les sanctions applicables, et du règlement des contentieux ;
- d'articuler ce cadre avec les directives qui peuvent s'appliquer à certaines installations d'élevages :
- directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : cette directive prévoit notamment que les États membres déterminent les autorités environnementales chargées d'émettre un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale et les autorités en charge de l'examen au cas par cas. Elle prévoit également que les Etats membres déterminent les modalités de consultation du public et d'information du public pour les projets soumis à évaluation environnementale ;
- directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
- directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) ;
- d'articuler ce cadre avec le droit français, notamment le code de l'urbanisme ou les installations d'accès à l'eau liées à l'activité d'élevage.
La démarche, assez complexe de par la diversité des dispositions législatives et règlementaires engagées, appelle une habilitation à légiférer par ordonnance pour présenter aux acteurs économiques et fédérations agricoles un cadre juridique global et cohérent, dans une démarche de simplification administrative largement attendue.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
Le présent article porte des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, la présente étude d'impact ne présentera pas l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et sur l'emploi public, ainsi que les textes d'application nécessaires.
L'analyse précisant les conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation. Le dispositif se traduira par une simplification des démarches pour les agriculteurs, via l'édification d'un régime dédié répondant strictement aux exigences issues du droit européen, sans « sur-transposition » ou « sous-transposition ».
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Concernant l'habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de douze mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions susceptibles d'être prises et des indispensables échanges préalables avec les acteurs du secteur agricole. Il existe, par ailleurs, une intention politique de prendre au plus vite l'ordonnance et ses décrets d'application
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 53 - Stratégie pour le milieu marin
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » ou DCSMM)227(*) vise au plus tard en 2020, à atteindre ou maintenir le bon état écologique des eaux marines et impose aux Etats membres l'élaboration de stratégies marines à cette fin. Celles-ci comprennent cinq volets (évaluation de l'état écologique des eaux marines, définition du bon état écologique, objectifs environnementaux, programme de surveillance et programme de mesures) adoptés de façon échelonnée suivant une logique de cycles, à des échéances prévues pour la directive.
La DCSMM a été transposée dans le code de l'environnement ( articles L.219-9 à L.219-18 et R.219-2 à R.219-10). L'ensemble des composantes de la stratégie marine prévue par la DCSMM constitue le « Plan d'Action pour le Milieu Marin » (PAMM).
Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l'environnement et le décret n°2017-724 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, le contenu des PAMM (évaluation de l'état écologique des eaux marines, définition du bon état écologique, objectifs environnementaux, programme de surveillance et programme de mesures) est intégré dans les documents stratégiques de façade (DSF), documents de planification maritime qui assurent par ailleurs la mise en oeuvre de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime (DCPEM). Les dispositions relatives aux document stratégiques de façades sont prévues aux articles L.219-3 et suivants et R.219-2 et suivants du code de l'environnement.
S'agissant des modalités de mise à jour, l'article 17 de la DCSMM prévoit que les composantes des stratégies marines sont « réexaminées », et le cas échéant mises à jour tous les six ans. Dans sa transposition, l'article L.219-10 du code de l'environnement prévoit que ces différents éléments sont « mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale ».
L'article R.219-1-14 du code de l'environnement (partie relative aux DSF) prévoit également une mise à jour périodique des différentes parties des DSF tous les 6 ans, en cohérence avec les dispositions de l'article L. 219-10 transposant la DCSMM.
S'agissant des modalités de consultation du
public, l'article 19 de la DCSMM prévoit que les Etats membres publient
et soumettent aux observations du public des résumés des
éléments des stratégies marines ou des mises à jour
correspondantes, sans contraintes de délais. L'article
L.219-11 du
code de l'environnement va plus loin et prévoit un délai de mise
à disposition du public des résumés de projets
d'éléments des plans de 5 mois avant leur mise en oeuvre ou de
leur achèvement ainsi qu'une durée de consultation de 3 mois.
Dans la partie relative aux documents stratégiques de façade, l'article L.219-3 prévoit qu'une synthèse de son contenu est mise à disposition du public selon la procédure applicable à l'article L.123-19 (renvoyant ainsi aux modalités de participation du public par voie électronique dans le cadre de l'évaluation environnementale).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Néanmoins, le Conseil constitutionnel précise également que : « si le législateur reste loisible d'aller au-delà des exigences minimales fixées par le droit de l'Union européenne, la surtransposition peut être source de situations juridiques contradictoires, voire porter atteinte à des exigences constitutionnelles. » (CC Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016). Les mesures envisagées visent ainsi à corriger cette sur-transposition de la directive DCSMM en droit français.
Dans un deuxième temps, la conciliation des enjeux qu'implique le développement durable, mis en avant par l'article 6 de la charte de l'environnement rend indispensable le réexamen périodique des plans d'actions. L'article 17 de la DCSMM impose ce réexamen et le projet de texte propose de reprendre cette étape en droit interne, pour mieux la formaliser avant de mettre à jour les différents volets des documents stratégiques de façades en fonction du résultat de ce réexamen.
Dans un troisième temps, l'application du principe de l'article 7 de la charte de l'environnement est prévue notamment par les articles L. 123-19 et suivants du code de l'environnement. Ces articles sont applicables uniquement lorsqu'une procédure particulière organisant la participation du public à l'élaboration de décision ayant une incidence sur l'environnement n'est pas prévue par d'autres dispositions législatives.
Or, il appartient au législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ainsi, le législateur ne peut, sans méconnaître l'article 7 de la Charte de l'environnement, se borner à fixer le principe d'une participation du public, sans en préciser les conditions et limites, et renvoyer au décret le soin d'en fixer les modalités (CC, n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014). Dès lors, le présent projet de loi respecte le principe de la participation du public, en adaptant les conditions dans lesquelles s'exerce ce droit.
Les principes de la Convention d'Aarhus se retrouvent de surcroît dans cette charte, intégrée au préambule de la Constitution de 1958 depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
L'inscription à l'article L. 219-7 du milieu marin comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation découle également de ces principes.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin s'inscrit dans le cadre de la gouvernance internationale pour les océans notamment portée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui définissent des principes de préservation de la biodiversité, d'usage durable, de coopération régionale et de prévention des pollutions marines. La DCSMM, acte juridique de droit dérivé au titre de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée portée par l'Union européenne : elle établit une approche et des objectifs communs pour l' Union européenne (UE) et ses Etats membres en matière de protection et de conservation du milieu marin, compte tenu des pressions et des incidences des activités humaines, tout en permettant son utilisation durable, par le biais d'une démarche fondée sur une approche écosystémique.
La DCSMM a été transposée dans le code de l'environnement par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Concernant les modalités de transposition d'une directive, la transposition ne doit pas en principe aller au-delà de ce qu'exige la directive. Les interdictions qu'elle exprime doivent être textuellement reproduites (CJCE, 27 avril 1988, Commission/France, aff. 252/85). Lorsque la directive énumère les conditions de mise en oeuvre d'une règle, les mesures nationales de transposition ne peuvent introduire des conditions supplémentaires (CJCE, 23 novembre 1989, Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfumerie Fabrik/Provide, aff. 150/88).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les dispositions du code de l'environnement relatives aux modalités de mise à jour des composantes des stratégies marines au sens de la DCSMM et aux modalités de consultation du public vont au-delà des dispositions prévues par la DCSMM et peuvent être ainsi considérés comme surtransposant le texte.
S'agissant des modalités de mise à jour des composantes du plan d'action pour le milieu marin, l'article L. 219-10 du code de l'environnement ne reprend pas la notion de « réexamen » prévue par la DCSMM afin que « les stratégies marines soient tenues à jour » et prévoit une « mise à jour » systématique tous les six ans, ne laissant pas la possibilité à une absence de mise à jour suite à réexamen si celui-ci concluait que les éléments sont toujours appropriés. Or le processus de mise en oeuvre de la DCSMM via les documents stratégiques de façade en France est particulièrement complexe et s'étale sur une durée totale d'environ 2 à 3 ans (incluant les phases de consultation du public et des instances amont et aval) alors que les deux volets du DSF (volet dit « stratégique » et volet dit « opérationnel ») sont adoptés avec 3 années d'écart. En conséquence, ces documents font l'objet d'un processus de mise à jour de l'un ou de l'autre des volets en continu, ce qui ne permet pas aux services de dégager du temps utile à la mise en oeuvre concrète des documents qui comprennent des actions opérationnelles de nature à répondre aux enjeux de planification maritime et de préservation du milieu marin. Une mise à jour tous les 6 ans constituant une échelle courte compte-tenu des enjeux du document, il convient donc d'ouvrir comme le prévoit la directive la possibilité d'un « réexamen » ne menant pas automatiquement à une mise à jour, celle-ci ayant vocation à être menée en tant que de besoin. Il s'agit donc de sécuriser juridiquement un scénario prévu par la directive mais non traduit en droit français.
S'agissant des modalités de consultation du public, l'article L. 219-11 du code de l'environnement prévoit des échéances de mise à disposition du public et de consultation de celui-ci plus contraignantes que le texte de la DCSMM (celle-ci ne fixant pas de durée), alors que l'article L. 219-3 traitant des DSF renvoie simplement aux règles générales de participation du public par voie électronique prévue dans la partie relative à la participation du public aux décisions ayant un impact sur l'environnement (le DSF et le PAMM étant soumis à évaluation environnementale systématique). Pour alléger la phase de consultation du public aval (la phase de consultation amont ayant pris la forme d'une concertation préalable pour les premiers DSF et d'un débat public pour leur mise à jour - soit des processus particulièrement complexes), il convient d'aligner les dispositions relatives à la consultation du public concernant les composantes du PAMM sur les règles générales, en tirant parti de la souplesse de la DCSMM sur ce point.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif de ces modifications est de mettre fin aux surtranspositions de la DCSMM identifiées afin d'alléger la procédure associée à la mise à jour des documents stratégiques de façade. Ces modifications permettront de ne pas imposer une mise à jour systématique de plans tous les 6 ans si leur contenu se révélait encore pertinent et à jour au regard des enjeux de préservation du milieu marin et par ailleurs de réduire la longueur de la consultation du public aval pour la réaligner au droit commun applicable. Ces évolutions sont de nature à alléger la charge administrative liée à la mise à jour des DSF et permettront de dégager plus de temps pour leur mise en oeuvre concrète, gage de simplification et de meilleure efficacité de la politique publique.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le cadre législatif et réglementaire actuel ne permet pas à droit constant de dégager des pistes d'allègement du processus de mise à jour des documents stratégiques de façade.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Ainsi, seule une modification législative de nature à traduire plus fidèlement le texte d'origine permettra d'ouvrir la possibilité d'un allègement dans la procédure de mise à jour des DSF. Le présent article vise ainsi :
· A introduire à l'article L. 219-10 du code de l'environnement la notion de "réexamen" (prévue par la DCSMM) préalable à toute éventuelle mise à jour d'un volet du plan d'action pour le milieu marin. Cette modification doit permettre une transposition plus fidèle du texte de la DCSMM et d'ouvrir la possibilité de maintenir un volet des PAMM sans mise à jour si à l'issue du réexamen, il s'avérait encore pertinent et à jour au regard des enjeux. Ainsi, au II. de l'article L.219-10 (« II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale. »), après le mot « sont » les mots « réexaminés et, en tant que de besoin, » sont insérés ;
· A aligner sur le droit commun les modalités de consultation du public « aval » des plans d'action pour le milieu marin, via une modification de l'article L. 219-11 et de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. En effet, l'article L. 219-11 prévoit des modalités de consultation plus contraignantes que le texte de la DCSMM avec notamment la mise à disposition du public au moins cinq mois avant la mise en oeuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, pour une durée de 3 mois. La modification vise donc à aligner la procédure sur celle de droit commun en renvoyant aux dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, détaillant les modalités de participation du public par voie électronique notamment applicables aux documents stratégiques de façade, ces derniers intégrant les plans d'action pour le milieu marin. Cela conduira à une durée de consultation minimum de 30 jours au lieu de 3 mois actuellement et à ne pas mettre à disposition du public des résumés des documents 5 mois avant leur mise en oeuvre ou leur achèvement. La procédure de consultation au titre de la participation du public par voie électronique, dont les modalités sont précisées à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, prévoit ainsi la publication d'un avis de consultation précisant ses modalités 15 jours avant son ouverture, et la mise à disposition du plan objet de la consultation au moment de son ouverture. Une synthèse des observations du public doit être publiée au plus tard au moment de l'adoption de la décision associée au plan/programme. Cette modification suppose également de supprimer la référence aux plans d'action pour le milieu marin comme faisant l'objet de dispositions spécifiques de participation du public dans l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article viendra modifier trois articles du code de l'environnement :
- L'article L. 219-10, II du code de l'environnement, prévoyant une mise à jour des différents volets des « plans d'action pour le milieu marin » (intégrés aux documents stratégiques de façade) tous les six ans est modifié afin d'intégrer la notion de « réexamen » préalable à une éventuelle mise à jour, possibilité offerte par la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin qu'il contribue à transposer ;
- Les articles L. 219-11 et L. 123-19 du code de l'environnement afin d'aligner la procédure de participation du public « aval » prévue pour les plans d'action pour le milieu marin sur les modalités prévues par les dispositions générales relatives à la participation du public par voie électronique prévues par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Il conviendra de compléter cette modification
législative par une modification de l'article
R. 219-1-14 du code de
l'environnement par décret en Conseil d'Etat, cet article
prévoyant également une mise à jour systématique
des différents éléments des documents stratégiques
de façade tous les 6 ans.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le projet de loi permettra de réaligner le code de l'environnement avec les dispositions de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Aucun impact n'est identifié en termes d'ETP, dans la mesure où ces dispositions permettraient un simple allègement de procédure pour la mise à jour des plans d'action pour le milieu marin. Elles permettraient éventuellement, dans l'hypothèse où une mise à jour de ces documents ne serait pas jugée nécessaire, de dégager du temps utile à la mise en oeuvre concrète de ces plans, temps aujourd'hui insuffisant en raison de la lourdeur des procédures.
S'agissant des coûts liés aux procédures de participation du public dans le cadre de la mise à jour des PAMM, les modifications proposées présentent un impact budgétaire positif en permettant d'éviter, dans l'hypothèse où une mise à jour de ces documents ne serait pas jugée nécessaire, une dépense supportée par l'Etat pour l'organisation des consultations relatives aux documents mis à jour. A titre indicatif, l'Etat a financé la Commission nationale du débat public à hauteur de 6 millions d'euros pour l'organisation des débats publics relatifs à la mise à jour des stratégies de façade maritime, tenus en 2023-2024.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les modifications proposées pourraient avoir un impact positif très marginal pour les collectivités territoriales, qui peuvent être associées selon les cas au processus d'élaboration (instances de gouvernance et instances techniques réunies sous l'égide des préfets coordonnateurs de façades, responsables des documents stratégiques de façades) et de mise en oeuvre des plans d'action pour le milieu marin. Les collectivités territoriales sont cependant davantage susceptibles d'être concernées par la mise en oeuvre des actions prévues par les PAMM que par le processus de mise à jour de ces documents.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'impact de la mesure est positif pour les services déconcentrés de l'Etat. En effet, l'allègement possible dans le processus de mise à jour des DSF permettra une simplification du processus et ainsi de dégager du temps de travail des services impliqués pour d'autres missions, gage d'une meilleure efficacité de l'action publique. Ainsi le temps dédié aux phases de mise à jour des DSF incluant l'organisation des consultations du public, des instances et des autorités compétentes pourra être mobilisé pour la mise en oeuvre des actions environnementales et socio-économiques du DSF, soutenues par les acteurs en façade.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La période de temps offerte au public pour s'exprimer sur les projets de DSF mis à jour sera réduite (de 3 mois à 30 jours minimum), mais viendra s'aligner avec la réglementation de droit commun applicable à la participation du public par voie électronique. L'impact est relatif dans la mesure où les DSF, lorsqu'ils sont mis à jour, font l'objet d'une consultation « amont » permettant déjà au public de s'exprimer.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les modifications du code de l'environnement dans ses dispositions transposant la directive cadre stratégie pour le milieu marin doivent permettre de laisser plus de place à la mise en oeuvre concrète des documents de planification relatifs à la protection du milieu marin et alléger la procédure de mise à jour. En effet, les services peinent aujourd'hui à trouver du temps disponible pour travailler à la mise en oeuvre des actions visant à la réduction des pressions sur le milieu marin, compte-tenu de la lourdeur du processus de mise à jour du DSF. Les impacts positifs sur l'environnement marin des documents stratégiques de façades devraient donc être renforcés.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national de la mer et des littoraux a été saisi en application de l'article L. 219-1 A du code de l'environnement et a rendu un avis le 9 septembre 2025.
La mission interministérielle de l'eau a été consultée et a rendu un avis favorable le 10 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée s'appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article sera applicable sur l'ensemble du territoire de la République française, hors départements et régions d'outre-mer, la DCSMM ne s'appliquant qu'en France métropolitaine.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application. Toutefois, il conviendra de compléter cette évolution législative par la modification de l'article R. 219-1-14 de l'environnement (dont la rédaction est issue du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade) par décret en conseil d'Etat, l'obligation de « mise à jour » tous les 6 ans ayant également été traduite dans la partie réglementaire du code relative aux documents stratégiques de façade.
TITRE VII - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORT ET D'INFRASTRUCTURES
Article 54 - Déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 2 du règlement (UE) 2023/1804 comporte 72 définitions en lien avec les carburants alternatifs, dont la recharge pour véhicules électriques. En particulier, la 48ième définition du règlement correspond à celle du « point de recharge », unique définition sur la recharge à l'article L. 353-1 du code de l`énergie. Il est proposé, par souci de cohérence, de supprimer l'article L. 353-1 du code précité. Par ailleurs, les éventuelles autres définitions nécessaires à la règlementation pourront être introduite dans la partie règlementaire du code de l'énergie.
Le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, dit règlement « AFIR », modifie les obligations relatives à la fourniture des données mises à disposition en open data par les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public. Les Etats membres s'assurent que les données transmises soient sur une base de données ouverte et non discriminatoire par l'intermédiaire de leur point d'accès national. Le règlement d'exécution (UE) 2025/655 de la Commission du 2 avril 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/1804 précise les spécifications et procédures relatives à la mise à disposition et à l'accessibilité des données relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs.
Au vu de la diversité croissante des carburants de
véhicules à moteur et de la mobilité routière de
plus en plus grande des citoyens de l'Union, il est nécessaire de
fournir aux consommateurs des informations claires et faciles à
comprendre sur les carburants disponibles dans les stations de ravitaillement
et sur la compatibilité de leur véhicule avec les
différents carburants ou points de recharge existant sur le
marché de l'Union. Par ailleurs, une base de données ouverte
gérée par chaque Etat membre regroupe les données devant
obligatoirement être fournies sans frais par les exploitants de points de
recharge et ravitaillement ouverts au public
(
https://transport.data.gouv.fr
pour la France).
Il est nécessaire que les consommateurs aient accès à des données fiables et loyales relatives à l'exploitant du point de recharge, l'emplacement géographique, les caractéristiques techniques (disponibilité, accessibilité, type de connecteur), le prix, et les services proposés aux points de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public. L'accès facilité aux données permet aux utilisateurs de comparer les informations sur le prix et d'obtenir des informations sur les caractéristiques des infrastructures pour carburants alternatifs, telles que la localisation, l'accessibilité, la disponibilité ou la capacité d'alimentation.
Les obligations et prescriptions du règlement sont d'application directe dans le droit national des Etats membres. Leur bonne mise en oeuvre devra donc être contrôlée par les autorités de surveillance des Etats membres. En l'occurrence, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est en charge du contrôle de la loyauté des données communiquées par les exploitants.
Le règlement (UE) 2023/1804 avait fait l'objet d'une première adaptation législative dans la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Celle-ci a habilité les agents de la DGCCRF à contrôler les articles 5, 7 et 19 du règlement précité. Or, les dispositions concernant la mise à disposition des données par les exploitants de points de recharge et ravitaillement se trouvent à l'article 20 du règlement.
Etant donné que le code de la consommation confère aux agents de la DGCCRF des pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction, il est proposé de modifier le code de la consommation par voie législative afin d'habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler la loyauté des données devant obligatoirement être fournies par les exploitants pour informer correctement les utilisateurs de points de recharge ou ravitaillement conformément au règlement (UE) n°2023/1804, la DGCCRF ne disposant pas d'habilitation spécifique pour contrôler la loyauté des informations figurant la base de données ouverte (point d'accès national). Au titre des pouvoirs prévus par le livre V du code de la consommation et des obligations d'information des consommateurs prévues aux livres I et II du code précité, les agents de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) peuvent vérifier les obligations générales d'information et d'affichage des prix sur tout support y compris sur une base de données. L'objet du présent article est d'habiliter les agents CCRF au contrôle de ces données pour garantir une information loyale des consommateurs.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a admis « qu'aucun
principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à
ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de
sanction », à la condition, « d'une part, que la
sanction susceptible d'être infligée [soit] exclusive de toute
privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de
sanction [soit] assorti par la loi de mesures destinées à
sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis
» (décision n° 89-260 DC
du 28 juillet 1989).
Le principe de légalité des délits et des peines implique que les infractions administratives et les sanctions correspondantes soient prévues par un texte (décision 88-248 DC du 17 janvier 1989).
Les règles de fond applicables aux sanctions pénales le sont également aux sanctions administratives ayant le caractère de punition, à savoir :
- le principe de légalité des délits (décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013) et le principe de légalité des peines (décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 ; décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014, cons. 55 ; décision n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016) ;
- le principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères (décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ; décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 ; CE, 14 avril 1986, SCI Fournier, n° 44614, en matière de pénalités fiscales) et de rétroactivité ou d'application immédiate des lois répressives plus douces (CE, avis, Sect. 5 avril 1996, Houdmond, n° 176611 et CE, 27 mai 2009, SNC Saint Honoré, n° 307957, toujours en matière de pénalités fiscales) ;
- le principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions (décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, §15) ;
- le principe d'individualisation des peines ;
- le principe de la personnalité des peines ;
- le principe d'égalité devant la loi (décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012).
En outre, aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le droit actuel est régi par le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE a été adopté en juillet 2023, publié le 22 septembre 2023 et entré en vigueur le 13 avril 2024 (précité).
Le règlement d'exécution (UE) 2025/655 de la commission du 2 avril 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/1804 (précité) précise les spécifications et procédures relatives à la mise à disposition et à l'accessibilité des données relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs.
Le contrôle de certaines des dispositions du règlement (UE) 2023/1804 a été prévu par le 33° de l'article L. 511-7 du code de la consommation qui permet aux agents CCRF de contrôler les manquements à l'article 1, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement précité. En cas de méconnaissance de ces dispositions la sanction a été prévue à l'article L. 132-29 du même code et prévoit une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
- Habilitation des agents CCRF pour contrôler les paragraphes 2 à 4 de l'article 20
L'article 20 du règlement (UE) 2023/1804 est intitulé « Fourniture des données ». Il prévoit que les exploitants de points de recharge fournissent au public des données statiques (données immuables du point de recharge telles que la localisation géographique, la puissance, le type de connecteur, etc.) et dynamiques (statut opérationnel, disponibilité, prix) concernant les points de recharge ouverts au public (notamment localisation géographique, disponibilité, type de connecteurs et prix).
Il est prévu que ces données soient communiquées au public par les exploitants de points de recharge sans frais. Pour cela, chaque exploitant devra mettre en place une base en open data - soit une interface de programmation d'application (API). Les informations sur cette API sont communiquées aux points d'accès nationaux c'est-à-dire l'interface mise en place par l'Etat qui permet l'accès unique aux données ( https://transport.data.gouv.fr). L'administration en charge de ce point d'accès national est le ministère chargé des Transports, qui est également chargé de la mise en oeuvre des API par les exploitants. Les agents CCRF pourront contrôler la loyauté des données fournies par les exploitants de points de recharge et ravitaillement et leur véracité au regard de l'information délivrée aux consommateurs au niveau du point de recharge.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Nous ne disposons pas d'éléments sur la mise en place de contrôles par d'autre Etats membres concernant l'application du règlement (UE) 2023/1804. A noter que le règlement d'exécution (UE) 2025/655 est récent (avril 2025).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le règlement nécessite une adaptation législative pour pouvoir en contrôler l'application. Le projet de loi DADDUE a été envisagé pour inscrire un article habilitant les agents CCRF à en contrôler les dispositions pour lesquelles ils sont compétents.
Le projet d'article inscrit dans la partie législative du code de la consommation une nouvelle habilitation et prévoit un régime de sanction en cas de non-respect des dispositions du règlement sur lesquelles les agents sont habilités.
Aux termes de l'article 288 du TFUE ( Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne), les règlements européens ont une portée générale et sont d'application directe. Tel est le cas du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE précité. Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous les États membres. Cependant, pour en assurer la bonne application, le droit national doit être adapté. Il appartient ainsi aux Etats membres de définir des sanctions.
Le règlement « AFIR » sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs abrogeant la directive du même nom 2014/94/UE a été adopté par le Conseil de l'UE le 25 juillet 2023. Les habilitations des agents CCRF pour le contrôle de la recherche des manquements à la réglementation sont de nature législative (cf. articles L. 551-5 à L. 551-26 du code de la consommation). En outre, si toutes les sanctions administratives ne relèvent pas systématiquement de la loi, par souci de cohérence avec la rédaction actuelle du code de la consommation qui mentionne les amendes administratives d'un montant de 3 000 euros pour les personnes physiques dans la partie législative du livre Ier, la sanction créée est insérée dans la même partie législative.
Certaines des dispositions du règlement concernent l'information du consommateur sous la responsabilité de la DGCCRF au sein du ministère de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté Industrielle et Numérique. Il est donc nécessaire de prévoir un article habilitant les agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes, responsables de la bonne information du consommateur, à les contrôler et à en sanctionner le non-respect le cas échéant.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le règlement (UE) 2023/1804 impose des obligations aux exploitants de points de recharge concernant la communication de certaines données sans frais par une API propre à chaque exploitant. Ces API communiquent avec une base de données ouverte gérée par l'Etat et accessible aux utilisateurs de véhicules électriques souhaitant comparer les prix de recharge de différentes infrastructures de recharge et disposer des informations nécessaires à la recharge.
L'objectif de l'article d'adaptation inséré dans le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DADDUE) est donc de permettre aux agents CCRF de s'assurer que les données fournies par les exploitants sont loyales.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Outre le fait que la France porte le risque de manquement en application d'un règlement Européen, l'accès libre aux informations fiables et loyales des informations concernant les infrastructures de recharge et d'avitaillement permettent de rassurer les utilisateurs et de faciliter l'adoption des carburants alternatifs dans un objectif de décarbonation des transports.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de modifier le 33° de l'article L. 511-7 du code de la consommation pour habiliter les agents CCRF à contrôler certaines dispositions de l'article 20 (article relatif à la fourniture de données techniques, de prix et de caractéristiques des points de recharge ou de ravitaillement) du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
Il est proposé de modifier l'article L. 132-29 du code de la consommation pour prévoir une sanction en cas de non-respect de certaines dispositions de l'article 20 (article relatif à la fourniture de données techniques, de prix et de caractéristiques des points de recharge ou de ravitaillement) du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
L'article 2 du règlement (UE) 2023/1804 comporte 72 définitions en lien avec les carburants alternatifs, dont la recharge pour véhicules électriques. En particulier, la 48ième définition du règlement correspond à celle du « point de recharge », unique définition sur la recharge à l'article L. 353-1 du code de l`énergie. Il est proposé, par souci de cohérence, de supprimer l'article L. 353-1 du code précité. Par ailleurs, les éventuelles autres définitions nécessaires à la règlementation pourront être introduites dans la partie règlementaire du code de l'énergie.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article L. 353-1 du code de l'énergie est supprimé. Les articles L. 511-7 et L. 132-29 du code de la consommation sont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article permet une adaptation du code de la consommation au règlement « AFIR » afin de permettre aux agents de la CCRF de contrôler l'application loyale de certaines des dispositions relevant des missions de la DGCCRF.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les exploitants de points de recharge et de ravitaillement ou les propriétaires ne respectant pas les obligations prévues par les articles précités du règlement pourront faire l'objet de sanctions à l'issue des contrôles.
Les exploitants de points de recharge et de ravitaillement ou les propriétaires de ces points devront se mettre en conformité avec les nouvelles obligations issues du règlement dont certaines dispositions en ce qui concerne la transmission des données via une API. Les agents CCRF pourront contrôler l'adéquation entre les informations mises à disposition sur la base de données ouverte au public et les informations effectivement présentes aux points de recharge.
4.2.3. Impacts budgétaires
Concernant les contrôles de la loyauté des données/prix par la DGCCRF. Ce travail se fera à moyen constants, la DGCCRF faisant le choix des priorités en fonction de ces moyens.
4.2.4. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La modification du code de la consommation va élargir les compétences des agents de la CCRF en permettant de contrôler la mise en oeuvre loyale de certaines obligations prévues par le règlement (UE) n° 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
Le règlement implique également une gestion des API dans transport.data.gouv par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM).
4.4. IMPACTS SOCIAUX
4.4.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.4.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.4.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.4.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.4.5. Impacts sur les professions réglementées
Les dispositions du règlement (UE) n° 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ont vocation à s'appliquer à toute borne de recharge ou de ravitaillement dans l'espace public. Par conséquent les dispositions relatives à une mise à disposition des données des points de recharge et de ravitaillement sur une base de données ouverte et sans frais bénéficieront aux professions réglementées dans le secteur des transports qui peuvent être emmenées à utiliser ces infrastructures telles que les conducteurs de taxi, conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, conducteurs routiers professionnels de véhicules poids lourds.
Ces professions réglementées auront un meilleur accès à l'information sur les carburants alternatifs.
4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le contrôle des exigences prévues par le règlement en matière de mise à disposition des données des points de recharge et de ravitaillement sur une base de données ouverte et sans frais permettra une meilleure information des utilisateurs pour effectuer leur recharge de carburant.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
En permettant une mise à disposition des données des points de recharge et de ravitaillement sur une base de données ouverte et sans frais, les dispositions du règlement concourent au développement des carburants alternatifs. Certaines des dispositions du règlement permettront d'apporter de la clarté pour les utilisateurs d'infrastructures de carburants alternatifs ce qui pourra concourir au développement de ces carburants alternatifs qui améliorent la performance environnementale du secteur des transports.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République français.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 55 - Vérification des antécédents et habilitation de personnels intervenant dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La sûreté de l'aviation civile se définit comme une combinaison de mesures, de moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue de prévenir les actes malveillants contre l'aviation civile, dont les motivations peuvent être très diverses (terrorisme, criminalité, activisme politique, folie individuelle d'un passager...).
Dans l'Union européenne (UE), ont été instaurés, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, des règles et des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation, ainsi que des mécanismes pour veiller à leur respect, qui s'appliquent à tous les Etats membres de l'UE.
En matière de vérification des antécédents des personnels du secteur aérien, la règlementation de l'Union européenne prévoit actuellement que certaines catégories de personnels du secteur aérien doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents :
- les personnes titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage, employées comme membres d'équipage par un transporteur aérien, permettant l'accès de ces personnes en zone de sûreté à accès réglementé (point 1.2.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile) ;
- les personnes titulaires d'une carte d'identification aéroportuaire (point 1.2.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015), permettant l'accès de ces personnes en zone de sûreté à accès réglementé ;
- les personnes mentionnées au point 11.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015.
La vérification renforcée des antécédents définie au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015 consiste à :
a) établir l'identité de la personne sur la base de documents ;
b) prendre en considération le casier judiciaire au cours des cinq dernières années ;
c) prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années ;
d) prendre en considération les informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu'elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer la fonction envisagée.
La conformité au b) et d) du point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015 est assurée en France par le suivi de la procédure d'habilitation prévue à l' article L.6342-3 du code des transports qui dispose que : « la délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ».
L'article L.6342-3 du code des transports (CT) dresse également la liste des personnes qui doivent être habilitées. Cette liste a fait l'objet d'une dernière modification en application de l' article 9 de la loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Sont actuellement mentionnées :
« 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. »
Le règlement d'exécution (UE) 2022/1174 de la Commission du 7 juillet 2022 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 ajoute une nouvelle catégorie de personnes devant avoir subi avec succès une vérification renforcée des antécédents (b) du point 11.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015) : les personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en oeuvre (« responsable de la sûreté »).
Le 1° de l'article L.6342-3 du CT indique que les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé (ZSAR) des aérodromes doivent être habilitées. Les responsables de la sûreté des entreprises mettant en oeuvre un programme de sûreté accèdent aux ZSAR des aérodromes dans le cadre de leurs activités professionnelles. C'est pourquoi une modification de l'article L.6342-3 du code des transports n'a pas été nécessaire.
Le règlement d'exécution (UE) 2024/1255 de la Commission du 3 mai 2024 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 introduit un nouvel acteur dans la chaîne de sûreté du fret aérien : le transporteur terrestre. En application de cette nouvelle disposition, les transporteurs terrestres travaillant pour le compte, soit des entreprises de transport aérien soit des entreprises mettant en oeuvre les mesures de sûreté du fret aérien, doivent disposer d'un agrément délivré après approbation d'un programme de sûreté. Le responsable de la sûreté de ces entreprises doit être soumis à une vérification renforcée des antécédents (point 6.5.1.6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015).
Les responsables de la sûreté des transporteurs terrestres n'ont pas la nécessité dans le cadre de leur activité professionnelle d'accéder à la ZSAR des aérodromes, ils ne sont donc pas couverts par le 1° de l'article L.6342-3 du code des transports. Ainsi, il devient nécessaire de modifier la liste des personnes devant être habilitées mentionnées à l'article L.6342-3 du CT pour ajouter la catégorie des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en oeuvre (« responsable de la sûreté »).
Enfin, le renforcement de la réglementation européenne relatif, tant aux catégories de personnes concernées qu'à l'introduction d'une fréquence annuelle de vérification des antécédents228(*), a conduit à l'abrogation de la procédure d'agrément du préfet et du procureur de la République mentionnée à l'article L. 6342-4 du CT. En effet, il est apparu que cet agrément, requis uniquement pour les agents de sûreté aéroportuaire, était superfétatoire, dans la mesure où l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du CT et l'agrément du préfet et du procureur de la République reposent sur la consultation des mêmes fichiers de renseignement.
Ainsi, l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports abroge l'agrément du préfet et du procureur de la République. Néanmoins cette loi ne contient pas de disposition d'application dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Or, l'habilitation telle que définie par l'article L. 6342-3 du CT est également applicable dans ces collectivités en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 6783-1 du CT pour les îles Wallis-et-Futuna, de l'alinéa 3 de l'article L. 6763-1 du CT pour la Nouvelle-Calédonie et de l'alinéa 2 de l'article 6773-1 pour la Polynésie française. En conséquence, le gouvernement propose d'étendre les effets de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 à ces collectivités.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduite de cette disposition qu'une loi ayant pour objet d'adapter le droit inter à un règlement de l'Union européenne résulte d'une exigence constitutionnelle (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
En tout état de cause, la mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre des droits civiques et des garanties fondamentales accordées aux citoyens.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ont été initialement fixées par le règlement (CE) n°2320/2002 du 16 décembre 2002, qui a par la suite été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, toujours en vigueur.
Le règlement n°300/2008 du 11 mars 2008 est complété au niveau européen par des textes d'exécution, notamment le règlement d'exécution (UE) n°2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
Au titre de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre. Il convient donc de mettre le droit national en cohérence avec les dispositions des règlements précités.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La mise en oeuvre de cette exigence de vérification renforcée des antécédents pour cette nouvelle catégorie de personnes, à travers la réalisation d'enquêtes administratives, requiert l'intervention du législateur.
En effet, il est nécessaire de mettre en cohérence la liste contenue dans la loi des personnes soumises à habilitation au titre de la sûreté de l'aviation civile, et donc à enquête administrative, avec celle des personnes pour lesquelles la réglementation européenne exige qu'elles soient soumises, au titre également de la sûreté de l'aviation civile, à une enquête administrative préalable à l'exercice de leurs fonctions. Le renvoi opéré de la loi vers les dispositions pertinentes du droit européen permet une parfaite conformité de ces listes.
Aussi, il est nécessaire d'expliciter en droit national la répartition entre personnes devant être soumises à une enquête administrative au titre de la sûreté de l'aviation civile et celles pour lesquelles cela n'est pas requis, lorsque la réglementation européenne confie aux autorités nationales le soin de déterminer si cela est nécessaire ou non.
De plus, la mise en oeuvre de l'habilitation dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans les mêmes conditions qu'en métropole, nécessite d'étendre l'application de l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports à ces collectivités.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est d'assurer la bonne transposition en droit national des exigences européennes en matière de sûreté de l'aviation civile. Pour cela, il est nécessaire modifier la loi pour soumettre au principe d'une vérification renforcée de leurs antécédents, notamment par la réalisation d'enquêtes administratives, une nouvelle catégorie de personnes : les personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en oeuvre (« responsable de la sûreté »).
Cela nécessite également de fixer de manière explicite dans la loi la liste des personnes soumises, en France, à une vérification ordinaire de leurs antécédents, c'est-à-dire pour lesquelles la tenue d'une enquête administrative n'est pas requise.
Concernant l'application de l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'objectif est d'harmoniser le cadre juridique entre la métropole et ces collectivités.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il a initialement été envisagé de reprendre à l'identique dans la législation nationale, à l'article L. 6342-3 du code des transports, la liste des personnes devant être soumises à une vérification renforcée de leurs antécédents mentionnée par la réglementation européenne. Toutefois, si cette option avait été retenue, une modification de la loi pour mise en cohérence aurait été nécessaire à chaque modification de la règlementation européenne. Cette option n'a donc pas été jugée pertinente et retenue.
La question s'est par ailleurs posée de la nécessité d'intégrer au sein de l'article L. 6342-3 du code des transports la liste des personnes devant détenir une habilitation parmi celles pour lesquelles la règlementation européenne laisse aux autorités nationales la possibilité de réaliser ou non une enquête administrative. Cette répartition n'étant pas, à ce jour, explicite en droit national, le choix a été fait de lister l'ensemble des personnes soumises à habilitation et donc à enquête administrative.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Afin de ne pas répliquer en droit national la liste des personnes soumises à vérification renforcée de leurs antécédents mentionnées dans la réglementation européenne, il a été décidé d'opérer un renvoi de la loi vers le point 11.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 précité.
Par ailleurs, le point 11.1.2 de l'annexe de ce même règlement donne à l'autorité nationale compétente la possibilité d'appliquer aux personnes mentionnées une vérification renforcée de leurs antécédents ou une vérification ordinaire.
La vérification ordinaire des antécédents définie au point 11.1.4 de l'annexe du même consiste à :
- établir l'identité de la personne sur la base de documents;
- prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années;
- prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années.
Il convient donc, au sein de l'article L. 6342-3 du code des transports, de déterminer les personnes qui ne font, en France, l'objet que d'une vérification ordinaire de leurs antécédents. Cette répartition n'est, à ce jour, pas explicitement définie en droit national.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mise en oeuvre de l'exigence de vérification renforcée des antécédents à travers la délivrance d'une habilitation pour les responsables de la sûreté implique une modification de l'article L.6342-3 du code des transports.
En revanche, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'article L.114-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux enquêtes administratives. En effet, cet article, en ce qu'il mentionne « les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense », couvre d'ores et déjà les nouvelles catégories de personnes concernées par la mesure envisagée.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
L'enquête administrative préalable à la délivrance de l'habilitation prévue à l'article L.6342-3 du code des transports permet de réaliser les obligations prévues au b) et au d) du point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015 qui définit la vérification renforcée des antécédents. Il permet également la conformité du dispositif national au point 3.5.2 de l'annexe 17 à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago.
La modification de l'article L. 6342-3 du code des transports permet sa mise en cohérence avec le point 11.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution n°2015/1998 du 5 novembre 2015. Elle permet également d'expliciter, en France, la répartition entre personnes soumises à une vérification renforcée et celles soumises à une vérification ordinaire de leurs antécédents, tel que permis par le point 11.1.2 de cette même annexe.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le présent article n'a aucun impact économique. Il aura un faible impact budgétaire, puisqu'il impliquera une hausse de la charge de travail pour les services d'enquête du ministère de l'Intérieur, du fait de l'ajout de cette nouvelle catégorie de personnels devant faire l'objet d'enquêtes administratives. Le travail de recensement des transporteurs agrées est en cours par les services de la direction générale de l'aviation civile. Près de trois cents entreprises devraient être concernées. Par conséquent, deux cents responsables sûreté de ces entreprises devront être soumis à habilitation. Cette augmentation est à mettre en regard du nombre total d'habilitation en cours qui s'établit à plus de quatre-vingt mille.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le présent article impliquera une hausse de la charge de travail pour les services d'enquête du ministère de l'Intérieur, du fait de l'ajout de cette nouvelle catégorie de personnels devant faire l'objet d'enquêtes administratives.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mise à jour en droit national de la liste des personnes soumises à enquête administrative afin de pouvoir exercer leurs fonctions au sein du secteur aéronautique, notamment suite à la création au niveau européen d'un nouvel agrément pour les transporteurs terrestres, permet un renforcement du dispositif global de sûreté de l'aviation civile bénéfique à l'ensemble des usagers du transport aérien. En effet, jusqu'alors les personnes pouvant assurer le transport par voie terrestres de biens destinés par la suite à embarquer sur un aéronef n'étaient pas soumis à des contrôles de ce type.
L'application de l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, est particulièrement attendue par les entreprises du secteur aéroportuaire de ces collectivités. En effet, la délivrance de l'agrément est une charge administrative pour les entreprises et peut différer la prise de poste des agents de sûreté aéroportuaire.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'a été conduite et aucune consultation facultative n'a été menée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les nouvelles obligations précitées du règlement d'exécution (UE) 2024/1255 de la Commission du 3 mai 2024 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.
Une entrée en vigueur différée n'est toutefois pas nécessaire. En effet, l'article est ainsi rédigé qu'il renvoie directement au point 11.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015. Celui-ci ne cite pas directement les responsables de la sûreté des transporteurs agréés mais les responsables de la sûreté des entités mettant en oeuvre un programme de sûreté (b du point 11.1.1 précité). Ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2027 que l'obligation pour les transporteurs agréés de mettre en oeuvre un programme de sûreté ne deviendra effective dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Ainsi l'entrée en vigueur immédiate du texte n'imposera nullement aux responsables de la sûreté des transporteurs agréés d'être habilités avant le 1er janvier 2027.
En outre, la date du 1er janvier 2027 est la date à partir de laquelle les responsables de la sûreté des transporteurs agréés devront être habilités. Au regard des délais d'obtention de l'habilitation, ces derniers devront effectuer leur demande dans le courant de l'année 2026.
Enfin, une entrée en vigueur immédiate est requise pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les articles L.6733-3, L.6753-2, L.6763-6, L.6773-7 et L.6783-7 du code des transports étendent l'applicabilité de l'article L. 6342-3 du même code aux collectivités de Nouvelle Calédonie, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon. Il convient donc de les modifier également pour que la modification de la loi opérée y soit également applicable.
Il convient également de modifier les articles L. 6763-1, L. 6773-1 et L. 6783-1 du CT pour que la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté soient applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Cet article ne requiert aucun texte d'application.
Article 56 - Compétences de l'Autorité de régulation des transports en matière de qualité de service
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen clarifie les lois applicables au secteur ferroviaire de l'Union européenne de manière à améliorer la qualité des services ferroviaires par la stimulation de la concurrence et en assurant la transparence et un accès non-discriminatoire aux infrastructures ferroviaires pour toutes les « entreprises ferroviaires » au sens de la directive229(*) (à savoir les fournisseurs de services ferroviaires) notamment à travers la surveillance du marché et le contrôle de la tarification des infrastructures. En France, ces missions sont confiées à l'Autorité de régulation des transports (ART)230(*) qui, aux termes de l' article L. 2131-1 du code des transports, « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire »231(*).
Or, pour le secteur ferroviaire, la directive 2012/34/UE (précitée) comporte dans ses considérants et articles des éléments sur la qualité de service qui justifient certaines pratiques de l'ART en ce domaine, mais qui n'ont pas été dûment pris en compte en droit national lors de leurs transpositions232(*).
Les lignes directrices publiées par la Commission européenne le 7 mai 2025 concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire233(*) confirment l'importance de ces éléments relatifs à la qualité de service. Elles précisent d'ailleurs que le contrat de performance conclu entre l'Etat et le gestionnaire d'infrastructure doit comprendre « des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur (sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité) » 234(*).
Ces lignes directrices rappellent en outre que les majorations tarifaires instaurées par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire devraient aussi garantir une compétitivité optimale du « marché ferroviaire, considéré par rapport aux autres modes de transport ». C'est pourquoi le secteur des autocars interurbains librement organisés, pour lesquels l'ART exerce déjà des missions de régulation, est également visé par cet article.
S'agissant en particulier du secteur ferroviaire, les articles 32 et 56 de la directive prévoient un contrôle par l'Autorité de la définition des segments de marchés, lesquels constituent un préalable à la mise en place de majorations tarifaires par le gestionnaire d'infrastructure235(*).
En effet, la directive 2012/34/UE précitée établit les principes pour la perception des redevances d'accès aux voies qui sont les redevances que les entreprises ferroviaires doivent payer au gestionnaire d'infrastructure pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. L'article 31, paragraphe 1, impose aux entreprises ferroviaires de verser des redevances d'utilisation de l'infrastructure. L'article 31, paragraphe 3, précise que les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales236(*) concernant l'accès à l'infrastructure ferroviaire doivent être égales au « coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ». L'article 31, paragraphe 5, autorise la modification de ces redevances pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. L'article 31, paragraphe 4, ajoute que ces redevances peuvent inclure des éléments supplémentaires au titre de la rareté des capacités pendant les périodes de saturation. Enfin, l'article 32 de la directive précise en outre que des majorations tarifaires peuvent être perçues afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l'infrastructure.
Ainsi, l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, transposant l'article 32 de la directive précitée, prévoit que le gestionnaire d'infrastructure peut, « afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par lui et si le marché s'y prête, percevoir des majorations des redevances d'infrastructure ». Pour cela, le gestionnaire d'infrastructure définit au minimum trois segments de marché : « services de fret, services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public et autres services de transport de passagers ». Par ailleurs, il « peut procéder à une différenciation plus poussée des segments de marché en fonction des marchandises ou des passagers transportés ». Toujours en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 précité, les majorations tarifaires sont « calculées sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire ».
La définition des segments de marché préalablement à la mise en place de majorations tarifaires est dès lors obligatoire et doit se faire en conformité avec les dispositions de l'annexe VI de la directive 2012/34/UE précitée et sans préjudice du considérant 41237(*) mentionnant expressément le niveau de qualité de service des services ferroviaires, comme le rappellent les lignes directrices238(*).
De plus, l'article 35 de la directive établit un système d'amélioration des performances directement lié à la qualité de service devant permettre aux systèmes de tarification de l'infrastructure d'encourager les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
Enfin, en ce qui concerne l'observation des marchés ferroviaires incombant à l'Autorité en application de l'article 56, celle-ci intègre nécessairement des indicateurs de qualité de service, ainsi qu'une consultation régulière des usagers.
S'agissant du secteur du transport routier interurbain de voyageurs, l'ART assure la gestion des gares routières239(*) et garantit l'équilibre entre nouvelles liaisons par autocar librement organisées et les services publics ferroviaires conventionnés240(*) depuis 2015 et 2016241(*).
On peut noter que dans les lignes directrices interprétatives concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire du 7 mai 2025, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, les majorations tarifaires instaurées par le gestionnaire d'infrastructure, devraient aussi « garantir une compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire ». A ce propos, la Commission souligne que la Cour de justice de l'Union européenne242(*) considère que la « notion de « compétitivité » se rapporte non pas à la concurrence entre entreprises ferroviaires, mais à la compétitivité du secteur ferroviaire, considéré par rapport aux autres modes de transport ».
Ainsi, le rapport concernant les transports routiers de voyageurs librement organisés, que l'ART est tenue de produire conformément à l' article L. 3111-23 du code des transports, évalue globalement l'offre de transports interurbains, routiers et ferroviaires, ce qui inclut nécessairement une analyse de la qualité du service assuré par les entreprises de transport.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Cet article qui vise à compléter la transposition de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'observation de la qualité des services de transport par l'ART, autorité compétente en France pour la régulation de ce secteur, s'inscrit dans le cadre de l'exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives européennes.
L'ART est en France l'organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire qui, conformément à l'article 55 de la directive 2012/34/UE précitée, est « une autorité autonome juridiquement distincte et indépendante sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, de toute autre entité publique ou privée. Dans son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses prises de décisions, cet organisme est en outre indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou candidat. Il est par ailleurs fonctionnellement indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l'attribution d'un contrat de service public ».
L'article 88-1 de la Constitution rappelle en effet que la République participe à l'Union européenne, notamment en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 288 dudit traité prévoit que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen prévoit notamment les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires peuvent accéder à l'infrastructure ferroviaire et les règles d'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. Elle a été modifiée par la directive (UE) 2016/2370 du 14 décembre 2016 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.
Cet article vise à compléter la transposition de ladite directive en ce qui concerne l'observation de la qualité des services de transport par l'ART.
1.4. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La Commission européenne, chargée de surveiller la transposition en droit national par les Etats membres de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, constate dans son récent rapport sur sa mise en oeuvre243(*) que les gestionnaires d'infrastructure « adoptent différentes approches en matière de redevances d'accès aux voies, en particulier pour fixer les majorations et déterminer les segments de marché dans lesquels ces redevances sont appliquées. [...] C'est pourquoi la Commission a adopté », le 7 mai 2025, « des lignes directrices » interprétatives concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Celles-ci, comme expliqué dans la section 1.1 de cet état des lieux, sont prises en considération dans la mesure ici proposée puisqu'elles soulignent, entre autres, l'importance des éléments relatifs à la qualité de service et à la concurrence efficace entre le rail et d'autres modes de transport.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Toutes les missions, les compétences et les pouvoirs de récolte de données et d'enquête auprès des opérateurs des secteurs où l'Autorité intervient en tant que régulateur sont définis par voie législative dans le code des transports. Il apparaît dès lors indispensable de compléter et modifier les dispositions législatives afférentes.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure vise à assurer le suivi par l'ART de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars interurbains librement organisés, nécessaire à l'exercice de ses missions et garantissant une meilleure prise en compte des besoins des usagers des services de transport.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option que l'intervention de la loi n'a été envisagée, dans la mesure où toutes les missions, les compétences et les pouvoirs de collecte de données et d'enquête, auprès des opérateurs des secteurs où l'Autorité intervient en tant que régulateur, sont définis par voie législative dans le code des transports.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Trois groupes de dispositions modifiant le code des transports sont ainsi proposées.
En premier lieu, il s'agit de définir juridiquement les compétences de l'ART en matière de suivi de la qualité de service :
- au 2° du présent article, en ajoutant un nouvel alinéa à l'article L. 2131-1 relatif aux compétences de l'ART dans le secteur ferroviaire,
- au 4°, en mentionnant la qualité de service à l'article L. 3111-23 relatif au rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés établi par l'ART.
En deuxième lieu, il s'agit de disposer du pouvoir de collecte de données de l'ART en matière de qualité de service et de lui permettre l'envoi de questionnaires aux usagers au travers des opérateurs de transports, dans l'objectif de réaliser ponctuellement des enquêtes clients notamment sur des aspects de la qualité des services de transport autres que les indicateurs statistiques mesurables tels que la ponctualité et la régularité des services :
- au 3°, en complétant l'article L. 2132-7 relatif aux pouvoirs de récolte régulière de données par l'ART dans le secteur ferroviaire,
- aux 5° et 6°, en complétant les articles L. 3111-24 et L. 3114-11 concernant la collecte des données relatives, respectivement, aux services routiers interurbains librement organisés et aux gares routières.
Enfin, au 1°, il est proposé de créer un nouvel article (L. 1262-7) disposant que, pour l'exercice de ses missions en matière de qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, l'ART réunit et consulte au moins une fois par an les usagers et les autres parties prenantes, et publie au moins une fois par an des états des lieux. Le secteur aérien n'est pas visé puisque la qualité de service fait l'objet d'un suivi par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans le cadre d'un Plan national d'actions en faveur de la qualité de service défini par la Charte d'engagement des acteurs du transport aérien français en faveur de la qualité de service, signée en novembre 2022244(*).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article complète les dispositions législatives du code de transport en ajoutant un nouvel article (L. 1262-7) et en modifiant les articles suivants :
- l'article L. 2131-1 relatif aux compétences de l'ART dans le secteur ferroviaire,
- l'article L. 2132-7 relatif aux pouvoirs de récolte régulière de données par l'ART dans le secteur ferroviaire,
- l'article L. 3111-23 relatif au rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés établi par l'ART,
- les articles L. 3111-24 et L. 3114-11 concernant la collecte des données relatives, respectivement, aux services routiers interurbains librement organisés et aux gares routières.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées par ce projet de loi sont conformes aux exigences à la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen et aux lignes directrices publiées par la Commission européenne le 7 mai 2025 concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (C/2025/2606).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les incidences sur les entreprises seraient limitées puisque l'objectif de cette mesure est de disposer de manière expresse dans le code des transports des missions, compétences et pouvoirs de l'ART en matière de qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, afin de sécuriser et compléter le cadre législatif des pratiques de l'ART dans ce domaine.
Il s'agit en premier lieu de préciser son pouvoir de collecte régulière de données et informations relatives à la qualité de service lui permettant d'exercer dans un cadre prévisible et concerté avec les opérateurs l'observation des marchés concernés. En effet, dans les secteurs ferroviaires et des autocars librement organisés, l'ART collecte déjà des données relatives à la qualité de service et publie déjà des indicateurs sur la performance des services fournis aux usagers dans ses rapports245(*), il ne s'agirait dès lors que de compléter de façon limitée les collectes déjà faites.
En revanche, cette collecte régulière de données serait sécurisée dans la mesure où des sanctions pourraient être prévues, en application de l'article L. 1264-7 du code des transports, en cas de manquement de transmission par les opérateurs des informations concernant la qualité de service demandées par l'ART.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La disposition envisagée au 1° de ce projet de loi, qui crée un nouvel article (L. 1262-7) dans le code des transports, prévoit que pour l'exercice de ses missions en matière de qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, l'ART réunit et consulte au moins une fois par an les usagers et les autres parties prenantes, dont les autorités organisatrices de la mobilité. Celles-ci pourront donc partager leurs visions et positions au sujet de la qualité de service. Cette disposition leur garantit également, comme à toutes les autres parties prenantes, la continuation de la publication par l'ART, au moins une fois par un, d'un état des lieux sur la qualité des services de transport ferroviaire, incluant les services d'intérêt régional qu'elles organisent246(*). Il s'agit des services ferroviaires conventionnés en Ile-de-France au sens de l' article L.2121-9 du code des transports, qui sont organisés par Ile-de-France Mobilités en application de l' article L.1241-1 du même code (dénommés « Transilien » et « RER »), et ceux organisés dans les autres régions (« TER ») en application de l' article L.2121-3 du même code.
Par ailleurs, les dispositions envisagées n'ont pas d'impacts techniques ou financiers directs sur les collectivités territoriales au sens de l' article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales puisque ce projet de loi ne crée ni ne modifie des normes qui leur sont applicables. Ces dispositions viendraient en effet renforcer les moyens juridiques dont dispose l'ART pour observer la qualité de service dans les secteurs des services de transport ferroviaire de voyageurs et des autocars interurbains librement organisés. Pour ces derniers, il s'agit de services de transport exploité à titre commercial ne relevant pas de la compétence de collectivités territoriales. Pour les services ferroviaires d'intérêt régional précités, les dispositions envisagées ne visent pas directement leurs autorités organisatrices régionales, mais leurs transporteurs conventionnés sur lesquels l'impact est limité dans la mesure où le suivi de la qualité de service réalisé par l'ART inclut déjà les services ferroviaires qu'ils exploitent247(*)..
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions envisagées n'auraient qu'un impact limité sur le fonctionnement et le dimensionnement de l'ART dans la mesure où le suivi de la qualité de service est déjà en partie réalisé par sa direction de l'observation des marchés qui dispose des compétences nécessaires pour réaliser ces travaux. Il s'agirait en effet pour l'ART d'organiser cette mission en lien avec l'observation générale des marchés qu'elle effectue déjà.
Le suivi de la qualité, les consultations des parties prenantes, et la réalisation d'enquêtes ponctuelles auprès des usagers étant réalisés par la direction de l'observation des marchés de l'ART, ce projet de loi n'emporte pas de conséquences directes et significatives sur l'organisation ou le fonctionnement des services de l'Autorité.
Ces dispositions viendraient en revanche renforcer et compléter les moyens dont dispose l'ART pour observer la qualité de service dans les secteurs de transport visés, en précisant son pouvoir de collecte régulière de données en ce domaine auprès des opérateurs concernés et en prévoyant la réalisation d'enquêtes ponctuelles auprès des usagers ainsi que la consultation annuelle des toutes les parties prenantes.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les dispositions envisagées précisant les compétences de l'ART en matière de qualité des services de transports visés, n'ont pas par elles-mêmes d'impacts sur la société.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les dispositions envisagées précisant juridiquement les missions et compétences de l'ART en matière de qualité des services de transport visés, n'ont pas d'impacts directs sur les particuliers.
Toutefois, elles contribuent à une meilleure prise en compte des besoins des usagers des services de transport.
On peut à ce propos noter que le 1° de la mesure proposée vise à garantir, d'une part, aux usagers des transports ferroviaires et des autocars librement organisés la disponibilité d'une source d'information publique indépendante sur la qualité de ces services et, d'autre part, à leurs associations représentatives d'être consultées avec les autres parties prenantes pour exprimer leurs avis et appréciations à ce sujet. L'ART estime d'ailleurs que les consultations déjà conduites concernant les gares routières ou les usagers des services ferroviaires montrent une très forte sensibilité de ces associations et de leurs adhérents pour la qualité de service des services de transports.
Dans ce cadre, l'ART pourrait d'ailleurs développer des dimensions de suivi de la qualité plus orientées clients, par exemple, à travers des statistiques pondérées par rapport à la fréquentation des services de transport, et pas seulement par rapport à leur nombre. De surcroît, la pérennité de ce suivi serait garantie, comme expliqué dans la section 4.2.2 de ce chapitre, par son pouvoir de collecte des données opposable par loi aux opérateurs.
Enfin, on peut considérer que les constats et les recommandations de l'ART auraient un certain impact incitatif à l'amélioration de la qualité de service des systèmes de transport visés, d'autant plus qu'elle peut exploiter les résultats de ses analyses directement auprès des gestionnaires d'infrastructure, dans le cadre de ses avis relatifs à la régulation des marchés concernés.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les dispositions envisagées précisant les compétences de l'ART en matière de qualité des services de transports visés, n'ont pas par elles-mêmes d'impacts environnementaux.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La mesure proposée n'est soumise à aucune consultation obligatoire.
La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités a consulté de manière facultative et informelle entre mi-avril et fin juin 2025 les services de l'ART qui accueillent favorablement la mesure proposée.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure s'appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Aucun texte réglementaire d'application n'est nécessaire.
Article 57 - Ciel unique européen
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen est entré en vigueur le 1er décembre 2024. Il vise à améliorer l'efficacité globale de la règlementation, l'organisation et la gestion de l'espace aérien européen et de la fourniture de services de navigation aérienne, et à s'aligner sur le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, en particulier pour remédier aux chevauchements.
En particulier, une distinction claire est établie entre :
- l'autorité nationale de surveillance, qui est créée en vertu du règlement (UE) 2024/2803, et dont les tâches concernent la mise en oeuvre de celui-ci, principalement la réglementation économique des services de navigation aérienne; et
- l'autorité nationale compétente établie en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et dont les tâches concernent la supervision de la sécurité.
Ces deux autorités sont désignées au niveau national, avec une certaine liberté dans leur périmètre et leur organisation.
Le règlement (UE) 2024/2803 abroge les trois règlements suivants, qui constituaient jusqu'à présent le cadre juridique européen applicable au ciel unique européen :
· (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ;
· (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ;
· (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen.
L'article L. 6221-1du code des transports confère à l'autorité administrative les pouvoirs de police nécessaires à l'exercice de sa mission, qui est notamment de contrôler les « exigences techniques de sécurité et de sûreté » fixées, entre autres, par le règlement (CE) n° 550/2004, et plus particulièrement ses articles 4 et 6. Or ces articles n'ont pas été repris par le règlement (UE) 2024/2803, du fait d'un chevauchement existant avec le règlement (UE) 2018/1139, auquel le L. 6221-1 fait déjà également référence.
Les articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports étendent les dispositions de l'article L. 6221-1 aux territoires ultramarins de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
L'article L. 611-5 du code de l'aviation civile, relatifs aux redevances pour services rendus, fait quant à lui référence au règlement (CE) n°550/2004 afin de préciser que l'autorité de surveillance dont les coûts sont pris en compte dans l'établissement du montant de redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est celle définie au titre du cadre règlementaire « ciel unique ». Il fait ainsi implicitement référence aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n°550/2004, désormais repris par l'article 5 du règlement (UE) 2024/2803.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Les dispositions du règlement (UE) 2024/2803 sont sans préjudice de la souveraineté des États membres sur leur espace aérien, des exigences des États membres en matière d'ordre public, de sécurité publique et de défense, ainsi que des droits et obligations des États membres en vertu de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, dit « règlement de base », et les règlements d'exécution pris en application définissent maintenant l'ensemble des exigences de sécurité applicables aux organismes et aux personnes assurant les services de navigation aérienne.
Les exigences essentielles applicables aux organismes et aux personnels rendant les services de navigation aérienne, sont maintenant définies dans les articles 40 à 54, ainsi qu'en annexe VIII, du règlement de base, et viennent donc se substituer à celles définies par les articles 4 et 6 du règlement (CE) n°550/2004.
Le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen constitue quant à lui le nouveau cadre règlementaire du ciel unique européen. Il définit à son chapitre II la notion d'autorité nationale de surveillance, et à son chapitre III, le système de performance et de tarification régissant les redevances de navigation aérienne sur la partie de l'Union européenne située sur le continent européen, qui fait par ailleurs également l'objet du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article L. 6221-1 du code des transports édicte que « sont soumis au contrôle de l'autorité administrative les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées [...] [par] le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. »
Les exigences techniques du règlement (CE) n° 550/2004 précité faisaient référence plus spécifiquement à ses articles 4 et 6. Or, ces deux articles n'ont pas été repris par le règlement (UE) 2024/2803 précité, du fait de la publication entre temps d'un règlement dédié aux aspects liés à ces exigences : le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, auquel le L. 6221-1 fait déjà référence.
Il convient donc de supprimer toute référence au règlement (CE) n° 550/2004 au sein de l'article L. 6221-1 du code des transports.
Les articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports ne faisant référence au règlement (CE) n°550/2004 précité que pour l'application outre-mer de l'article L. 6221-1 du code des transports, il convient également de supprimer cette référence au sein de ces articles.
Concernant l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile, les tâches de l'autorité nationale de surveillance étant désormais définies par le règlement (UE) 2024/2803 précité, il convient de mettre à jour la référence règlementaire.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est de mettre à jour les références au règlement européen en vigueur et de supprimer celles aux règlements abrogés.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée, du fait :
- de la nécessite de clarifier à quelle autorité de surveillance l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile fait référence lorsqu'il s'agit du périmètre des coûts pris en charge dans le calcul des redevances ;
- de la suppression de toute référence aux « exigences techniques » dans le nouveau règlement (UE) 2024/2803, couplée à une référence déjà existante au règlement (UE) 2018/1139 dans l'article L. 6732-3 du code des transports.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Une suppression des références au règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen est retenue pour les articles L. 6221-1, L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports.
Une modification des références règlementaires est en revanche retenue pour l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les articles L. 6221-1, L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports sont modifiés.
L'article L. 611-5 du code de l'aviation civile est modifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Cette mesure actualise les références règlementaires européennes au regard notamment des :
- Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;
- Règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen ;
La France est par ailleurs signataire de la Convention relative à l'aviation civile internationale, dite Convention de Chicago, et à ce titre, s'est engagée à « atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières [...] . » (article 37) en déclinant les standards et pratiques recommandées dans sa propre réglementation. Les normes et pratiques recommandées (SARP) appliquées aux organismes et personnes fournissant les services de la navigation aérienne sont notamment définies dans les annexes suivantes à la Convention de Chicago :
- Annexe 1 : licences du personnel, dont les contrôleurs de la circulation aérienne,
- Annexe 3 : assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
- Annexe 10 : télécommunications aéronautiques
- Annexe 11 : services de la navigation aérienne
- Annexe 15 : services d'information aéronautique
- Annexe 19 : gestion de la sécurité.
Les SARP ne sont pas à application directe dans les Etats signataires de la Convention de Chicago mais doivent être déclinées dans la réglementation nationale. Au niveau européen, les SARP relevant de ces Annexes, sont principalement déclinées dans le règlement de base, et dans les règlements européens pris en application :
- Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 ;
- Le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n ° 805/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Le règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) n° 677/2011Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
La mesure vise à actualiser les références règlementaires européennes permettant de définir le périmètre des articles du code des transports et du code de l'aviation civile visés. L'actualisation de ces références permet de conserver un périmètre constant, et est donc sans impact économique et financier.
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'a été conduite et aucune consultation facultative n'a été menée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le périmètre géographique des articles modifiés reste inchangé et concerne :
- l'ensemble du territoire de la République française, territoires ultramarins inclus (les articles d'extension aux Pays et Territoires d'Outre-mer sont également amendés) pour les modifications apportées au code des transports ;
- Le territoire de la République française situé en zone EUR de l'OACI (soit sur le continent européen), conformément au champ d'application du règlement (UE) 2024/2803 pour la modification apportée au code de l'aviation civile.
5.2.3. Textes d'application
Cet article ne requiert aucun texte d'application.
Article 58 - Mesures relatives à la modulation en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des véhicules lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dite directive Eurovignette, permet aux Etats membres de prévoir un dispositif de taxation des véhicules les plus polluants sur certaines infrastructures, notamment les autoroutes. Son objectif principal est de fixer des règles communes pour la taxation des poids lourds circulant sur des axes routiers importants. Cette directive a introduit la modulation des péages en fonction de la classe d'émission Euro des véhicules lourds c'est-à-dire selon des normes d'émission de polluants atmosphériques tels que les particules fines ou l'oxyde d'azote. Cette disposition a été transposée à l'article L.119-7 du code de la voirie routière.
La directive 2022/362 du 24 février 2022 a modifié la directive 1999/62/CE précitée et a conduit à moduler les péages applicables à ces véhicules en tenant compte non seulement des polluants atmosphériques mais aussi de leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2). Cette modification a été transposée, s'agissant des péages autoroutiers, par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, en modifiant l'article L. 119-7 et en créant l'article L. 119-11 du code de la voirie routière. Cette modulation s'applique aux contrats de concessions autoroutières pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022.
La directive 2022/362 du 24 février 2022 a également rendu obligatoire à partir du 25 mars 2026 la mise en place d'une redevance pour coûts externes liée au coût de la pollution atmosphérique due au trafic, dispositifs visant à un approfondissement de l'approche pollueur-payeur poursuivie par la directive 2022/362. Cette nouveauté a été transposée, par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, à l'article L.119-12 du code de la voirie routière.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »).
Le projet d'article vise tout d'abord à permettre de déroger à l'obligation de mettre en place des modulations de CO2 pour les péages dès lors que l'obligation de prendre en compte les émissions de CO2 dans la tarification du carburant serait remplie par la mise en oeuvre du système européen d'échange de quotas d'émission étendu au secteur du transport routier, système dit ETS2. Il vise également à permettre de déroger à l'obligation de modulation des tarifs de péage lorsque le péage comprend déjà une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique.
Ces dérogations ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques puisqu'elles s'appliquent à l'ensemble des usagers du réseau routier concerné.
Ces dérogations ne changent pas fondamentalement les règles applicables aux péages. Leur mise en place s'inscrit dans les règles relatives aux finances publiques puisque les mesures ne changent pas les règles d'assiette, le champ d'application et les modalités de perception de la taxe.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive Eurovignette a été adoptée en 1999 afin de fixer le cadre harmonisé dans lequel les États membres peuvent taxer les véhicules à raison de leur utilisation des infrastructures routières. Cette directive a été révisée en 2022 afin de permettre que les péages et les taxes kilométriques puissent être augmentés en prenant en compte les externalités négatives générées par le transport routier, notamment les émissions de polluants.
La dérogation au recours aux modulations CO2 est expressément prévue dans le paragraphe 11 de l'article 7 octies bis de la directive (UE) 2022/362. La possibilité de déroger à l'obligation de modulation des tarifs de péage lorsque le péage comprend déjà une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique est expressément prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive (UE) 2022/362.
1.4. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Les autres Etat-membres de l'Union Européenne sont confrontés aux mêmes difficultés. L'Allemagne et l'Autriche vont ainsi mettre en place des modulations CO2 après la réalisation d'importants investissements sur les dispositifs de perception et avoir fixé des grilles tarifaires particulièrement complexes pour le redevable.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il s'avère que la mise en oeuvre de la modulation CO2 des tarifs pose des difficultés. En effet, contrairement à la modulation en fonction de la classe Euro, une partie des informations ne figure pas directement sur le certificat d'immatriculation et n'est donc pas facilement accessible à l'heure actuelle car il s'agit de données techniques qui relèvent de la compétence des constructeurs et des importateurs de véhicules, ainsi que, le cas échéant, des réparateurs de véhicules lorsque ceux-ci sont modifiés. En outre, les classes CO2 étant régulièrement réévaluées, les véhicules sont appelés à changer de classe au fil du temps. Ainsi, la solution technique à mettre en oeuvre s'avère complexe et les moyens associés importants. Par ailleurs, la modulation en fonction des émissions de CO2 soulève des enjeux d'acceptabilité car elle entraîne une grande complexification des grilles tarifaires qui restent donc très peu lisibles pour les usagers tant que les éléments servant à l'identification de la classe CO2 d'un véhicule ne sont pas aisément consultables.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le paragraphe 11 de l'article 7 octies bis de la directive (UE) 2022/362 permet aux États qui le souhaitent de prévoir la possibilité de déroger à l'obligation de moduler les tarifs des péages des véhicules lourds en fonction des émissions de CO2 lorsque s'applique une autre mesure de l'Union européenne en matière de tarification du carbone sur le carburant utilisé pour le transport routier. Or cette possibilité de dérogation n'avait pas été inscrite dans la loi.
Le « 3° » du présent article consiste à transposer dans le droit national cette faculté dès lors que l'obligation de prendre en compte les émissions de CO2 dans la tarification du carburant sera remplie du fait de la mise en oeuvre, prévue à compter du 1er janvier 2027 en vertu de la directive de 2023/959 modifiant la directive 2003/87/CE, du système européen d'échange de quotas d'émission étendu au secteur du transport routier, système dit « ETS2 ». L'obligation de moduler les tarifs en fonction des classes d'émission de polluant Euro serait le cas échéant maintenue.
Cette transposition permettrait de remédier à la difficulté d'identifier les véhicules selon leur classe CO2. En effet, contrairement aux classes CO2, les informations permettant d'identifier la classe Euro d'émission de polluants sont facilement accessibles, via les certificats d'immatriculation. La mesure a pour objectif de simplifier la modulation des tarifs de péages à appliquer aux véhicules lourds tout en respectant l'application du principe du pollueur-payeur.
Si dans l'immédiat, les concessionnaires existants d'autoroute ou d'ouvrage d'art existants ne sont pas concernés par les modulations CO2, en revanche, les futurs concessionnaires, notamment ceux dont les procédures d'attribution des contrats de concession sont en cours, se heurteront aux nombreuses difficultés techniques permettant d'identifier les véhicules selon leur classe CO2. Les solutions n'existent pas aujourd'hui à des coûts raisonnables, la mesure allègerait donc leurs coûts de collecte.
Le paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive (UE) 2022/362 impose aux Etats membres de continuer à moduler les tarifs en fonction des classes d'émissions Euro tant que le passage à la modulation des tarifs selon les classes CO2 n'est pas effectif. Cette obligation est prise en compte via la modification introduite par le « 1° » du présent article.
Le même paragraphe de la directive précise également les dérogations permettant aux Etats membres de se soustraire à l'obligation de modulation des tarifs de péage. Ainsi, selon le d) de ce paragraphe, il n'y a pas d'obligation de modulation des tarifs lorsque le péage comprend déjà une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. Cette possibilité de dérogation n'avait également pas été inscrite dans la loi.
La seconde mesure du présent article consiste donc à transposer cette possibilité de dérogation à l'article L.119-7 qui comprend déjà les autres dérogations possibles permises par la directive (UE) 2022/362.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée. Seule une modification législative peut permettre d'atteindre les objectifs poursuivis, la modulation selon la classe CO2 étant prévue, pour les péages, par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article modifie le II de l'article L.119-7 du code de la voirie routière pour mettre en place la dérogation au recours aux modulations CO2 pour les péages autoroutiers. Il prévoit également des adaptations rédactionnelles de l'article L.119-11 afin de tenir compte de cette dérogation. Enfin, il intègre dans le III de l'article L.119-7, la possibilité de déroger aux modulations des tarifs de péage lorsque les péages comprennent déjà une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie les articles L. 119-7 et L. 119-11 du code de la voirie routière.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La mesure respecte le cadre européen prévu par la directive Eurovignette puisqu'elle transpose certaines possibilités fixées par celle-ci.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure favorise l'acceptabilité du péage, le calcul des tarifs devenant plus lisible pour les entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mesure ne modifie pas le niveau global des recettes du péage dans la mesure où une modulation (en fonction des classes CO2 comme en fonction des classes Euro) est sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant conformément à l'article L. 119-7 du code de la voirie routière. Par conséquent, cette mesure est sans impact pour le budget de l'Etat.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure n'a pas d'impact sur les collectivités territoriales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet. Les véhicules des particuliers ne sont pas en principe concernés.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure participe à la lutte contre la pollution de l'air par l'application du principe pollueur-payeur. En effet, les difficultés techniques pour mettre en place les modulations CO2 nécessitent de pouvoir les remplacer par les modulations classes Euro existantes afin de pouvoir continuer à moduler les péages et les taxes kilométriques en fonction de la pollution.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Les mesures transposent des dispositions de la directive « Eurovignette » et sont sans impact sur les collectivités territoriales. Il n'y a donc pas de consultation à mener.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer. En effet, dans les faits, il n'y a pas d'infrastructures soumises à péage dans les collectivités, et assimilées, d'outre-mer compte tenu de leur situation géographique et économique. Aussi, des dispositions relatives au péage ne trouvent pas à s'y appliquer.
5.2.3. Textes d'application
Cette disposition ne requiert aucun texte d'application.
Article 59 (1°) - Définition du Guichet unique maritime et portuaire
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le transport maritime occupe une place centrale dans les échanges commerciaux, tant au sein de l'Union européenne que dans les relations avec les partenaires commerciaux extracommunautaires. En volume, la part du transport maritime dans les échanges de biens entre l'Union européenne et des Etats tiers a été estimée à 74%. Cette contribution est réduite lorsque l'on étudie le poids en valeur puisqu'elle s'établit à seulement 47% mais le transport maritime n'en demeure pas moins le moyen de transport principal.248(*) A l'échelle mondiale les chiffres sont encore plus éloquents, avec 80% des échanges commerciaux réalisés par voie maritime.
Le secteur du transport maritime a été particulièrement frappé par la pandémie de Covid 19 et peine encore à retrouver les niveaux observés en 2019. En effet, le volume total de marchandises transitant par les principaux ports français métropolitains est passé de 82 111 milliers de tonnes au premier trimestre 2019 à 71 954 milliers de tonnes au second trimestre 2024.249(*)
Ainsi, ce secteur demeure un vecteur essentiel des échanges commerciaux et communications à la fois au sein du marché unique et avec les marchés internationaux. Dès lors, il convient d'en faciliter le fonctionnement et d'en fluidifier le travail administratif, notamment concernant les formalités déclaratives à accomplir lors des escales, pesant sur les responsables de navire.
A ce jour, ces formalités sont régies par des dispositions juridiques émanant de l'Union européenne, du droit international ainsi que du droit national. Ainsi, une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les déclarants réside dans l'identification des formalités spécifiques à soumettre lorsqu'ils réalisent une escale sur le territoire national. Un autre obstacle majeur à l'accomplissement de ces formalités est l'absence d'harmonisation dans les modalités de transmission à la capitainerie. En effet, en raison notamment de l'existence de différents systèmes d'information portuaires, les informations requises, bien que souvent similaires, doivent parfois être présentées sous des formats différents. Actuellement, sept systèmes d'information portuaires distincts sont en place dans les ports français, dont certains sont propres à un port spécifique, comme c'est le cas du système Neptune, exclusivement utilisé par le grand port maritime de Marseille.
En raison de la compétence partagée de l'Union européenne en matière de transport, celle-ci a entrepris de simplifier les démarches liées au trafic maritime, notamment par l'adoption de la directive 2010/65/CE relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres. Cette directive imposait aux Etats membres la création d'un guichet unique capable de recevoir électroniquement les formalités déclaratives. Toutefois, l'obligation d'harmonisation au sein des Etats membres et au niveau européen n'a pas été jugée suffisamment efficace. En 2017, un rapport de la Commission européenne a révélé que le niveau de mise en oeuvre espéré n'avait pas été atteint. Selon cette étude, la simplification de la procédure de transmission des formalités déclaratives n'a été constatée que dans 10% des ports analysés250(*).
La transposition de la directive 2010/65/CE en droit national a été réalisée par l'ordonnance n°2013-139 du 13 février 2013. Ce texte a introduit deux sous-sections dans le livre III de la cinquième partie du Code des transports, régissant l'organisation des ports maritimes. La première sous-section est dédiée au suivi du trafic maritime tandis que la seconde est consacrée aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes. Cette dernière a instauré le guichet unique portuaire à travers trois articles.
Par la suite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement 2019/1239/UE établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive susvisée. Ce règlement impose notamment aux Etats membres la mise en place d'un guichet unique maritime national, contribuant à l'harmonisation des procédures de transmission des formalités déclaratives, tant au niveau national qu'à l'échelle de l'Union européenne. Le présent projet de loi a pour objectif d'adapter ce règlement en droit national.
Actuellement, la sous-section 1, de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie législative) est relative au « suivi du trafic ».
L'article L.5334-6-1 du code des transports définit le « guichet unique » comme l'unique point auquel sont adressés les données comprises dans les formalités déclaratives exigées par la directive 2010/65/UE. Ainsi, cette disposition du code des transports remplit l'exigence de la directive susmentionnée d'établir et d'utiliser un guichet unique, afin d'harmoniser et coordonner la transmission de ces formalités.
La présente disposition procède à la reprise, en l'adaptant, des dispositions antérieurement codifiées à l'article L.5334-6-1 du code des transports. Il redéfinit la version nationale du guichet unique portuaire telle qu'issue de la directive 2010/65/UE, afin d'en assurer la mise en conformité avec les exigences du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE. Cette réécriture permet ainsi de préciser les contours juridiques et opérationnels du guichet unique maritime et portuaire, tant au regard de sa définition que de son champ d'application. La rédaction de l'article en projet s'attache à définir le champ d'application du guichet unique maritime et portuaire. Outre le terme « guichet unique maritime et portuaire », les autres termes proposés par le présent article renvoient soit au règlement UE 2019/1239, soit sont explicités. Par exemple, s'agissant du terme « déclarant », l'article précise qu'il s'agit ici du capitaine du navire, de l'armateur ou du représentant du navire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution, « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle »251(*). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne252(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement 2019/1239/UE établissant un système de guichet unique maritime et européen et abrogeant la directive 2010/65/UE a été adopté le 20 juin 2019 par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Son objectif, exprimé en son article premier, est d'harmoniser les règles régissant la fourniture des informations requises dans le cadre des escales des navires. Le règlement est à considérer comme la réponse commune des Etats membres et coordonnée par la Commission vis-à-vis des exigences de l'Organisation maritime Internationale (OMI) en matière de simplification des formalités déclaratives dues par les navires à l'entrée dans les ports.
Les « considérants » du règlement 2019/1239, notamment les (13) et (23) mentionnent les adhérences et cohérences entre le règlement et la convention FAL.
L'annexe relative aux obligations de déclaration prévoit bien dans sa partie B l'intégration des informations contenues dans les documents FAL
Si les Etats membres peuvent demander l'intégration de données supplémentaires répondant à leur réglementation nationale, le règlement prévoit en réponse que : Dans le cas où la Commission décide de ne pas introduire les éléments de données demandés, elle fournit les motifs justifiant dûment son refus, en faisant référence à la sécurité de la navigation et aux principes de la convention FAL.
Le Guichet unique maritime et portuaire français est la réponse de la France au règlement 2019/1239 instaurant un Guichet unique maritime européen, qui satisfait aux spécifications du Guichet unique maritime instauré par les circulaires de l'OMI.
Il est à noter que les guichets uniques, européen et de l'OMI, ne constituent pas des interfaces, ni des systèmes propres, mais un ensemble de spécifications et de recommandations à l'attention des Etats qui doivent les développer et les mettre en service.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'adoption par l'Union européenne du règlement 2019/1239/UE nécessite une évolution du droit français. Le système de guichet unique maritime européen qu'il institue utilise une terminologie jusqu'alors non utilisée en droit français. Dès lors, afin d'assurer une adaptation claire et précise du droit français au regard du droit de l'Union, il convient de définir le guichet unique maritime et portuaire et son champ d'application.
L'état actuel du droit national consacré aux formalités déclaratives à accomplir lors d'une escale dans un port français est contenu principalement dans la sous-section du code des transports intitulé « Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes ». Cependant, l'article L.5334-6-1 de cette sous-section institue le guichet unique portuaire mais n'est plus conforme aux exigences européennes. En effet, cette disposition transpose la directive 2010/65/UE dans le droit national, or cette directive a été abrogée par le règlement 2019/1239/UE. Il convient désormais de modifier cette disposition afin qu'elle reflète le règlement 2019/1239/UE. Dès lors, une modification législative est nécessaire.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La présente disposition a pour objet de clarifier le cadre juridique applicable aux formalités déclaratives à transmettre lors de l'entrée et/ou de la sortie des ports maritimes nationaux, afin d'assurer une compréhension claire et exhaustive des nouvelles dispositions par les utilisateurs concernés.
En effet, le transport maritime demeure un vecteur essentiel des échanges commerciaux et communications à la fois au sein du marché unique et avec les marchés internationaux. Dès lors, il convient d'en faciliter le fonctionnement et d'en fluidifier le travail administratif, notamment concernant les formalités déclaratives à accomplir lors des escales, pesant sur les responsables de navire.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Différentes options ont été envisagées concernant l'intégration de cet article dans le droit national. En effet, la possibilité de définir les termes précis applicables au guichet unique maritime et portuaire a été envisagée. L'idée sous-jacente était d'éviter de surcharger le code des transports tout en reproduisant des définitions clairement établies dans le règlement de l'union européenne. Cependant, cette possibilité a été écartée car les définitions proposées se trouvent déjà dans le règlement européen, d'applicabilité directe en droit français.
L'emplacement de cette disposition dans le code des transports a également été discuté. Il a notamment été envisagé de créer un article consacré aux définitions dans le chapitre 1er du titre III du Cinquième Livre du code des transports, dédié aux dispositions générales applicable dans le cadre de la police des ports maritimes. Toutefois, cette solution a été écartée afin d'éviter toute confusion.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Dans le souci d'assurer une compréhension complète du dispositif, il est donc préférable de supprimer la sous-section consacrée au suivi du trafic. En conséquence, le présent article définit le guichet unique maritime et portuaire conformément au règlement (UE) 2019/1239 et cadre son champ d'application en utilisant les termes définis dans le règlement tels que « déclarants », « escale » et « navires ».
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition modifie l'article L. 5334-6 du code des transports en le réécrivant intégralement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le processus d'intégration de définitions dans le code des transports se fait en application du règlement 2019/1239/UE. En effet, la formulation de celle-ci reprend l'approche adoptée par le droit de l'Union tout en l'adaptant au droit national.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Ce projet de loi, par sa finalité de simplification administrative et d'harmonisation des modalités de transmission des obligations déclaratives des navires escalant en France, permettra d'accroître l'attractivité des ports maritimes français. S'il est difficile d'estimer précisément les répercussions à l'échelle macroéconomique, il est indéniable que, dans un monde maritime concurrentiel, les apports du guichet unique maritime et portuaire leur permettront d'être plus compétitifs.
Simplifiant considérablement les démarches administratives pour les navires qui escalent dans les ports français, le guichet unique maritime et portuaire français sera connecté au noeud central européen baptisé « SafeSeaNet » et institué par la directive 2002/59-CE. Ce noeud collecte, stocke et diffuse l'information aux autres Etats ayant à en connaître, puisqu'il n'y a pas de connexion directe entre les Etats mais via ce noeud qui distribue l'information en étoile. Il est donc relié aux guichets uniques maritimes des autres Etats membres.
En outre, le guichet unique maritime et portuaire dispose de connexions avec les administrations concernées (notamment, douanes, agence nationale des données de voyage, agences régionales de santé) permettant l'application du principe du « dîtes-le nous une fois » pour les déclarants. Les capitaines des navires, ou leurs représentants, auront par ailleurs des possibilités de réutiliser des déclarations déjà transmises, par exemple pour les modalités de sortie en reprenant des données utilisées à l'entrée du navire.
Enfin, il apporte une harmonisation dans la manière de déclarer, au niveau national, et au niveau européen, qui permet un gain de temps et une simplification du processus. En conséquence ce système renforce l'attractivité des ports français, permettant aux navires de réduire leurs coûts administratifs et d'optimiser leurs escales.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le règlement européen 2019/1239/UE établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/CE impose un certain nombre d'évolutions dans le format des obligations déclaratives à des fins d'harmonisation.
Il prévoit également la possibilité pour les déclarants de répondre à leurs obligations déclaratives en transmettant directement de système d'information à système d'information, les données demandées pour la réalisation de l'escale, dans le respect du format et des modalités européennes. Si cela peut représenter un coût de développement pour ces entreprises, le gain d'efficacité est non négligeable puisqu'une évolution de leur système d'information pourrait, à terme, leur permettre de communiquer avec les guichets maritimes nationaux des Etats membres de l'Union européenne.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mise en oeuvre du guichet unique maritime européen constituera un gain essentiellement qualitatif pour les administrations qui instruisent les formalités en vue d'effectuer les contrôles nécessaires sur les risques sanitaires, d'entrées sur le territoire de personnes recherchés ou ciblées, de circulations de matières dangereuses, de navires frappés de sanctions économiques...
En effet, le retour d'expériences des crises COVID, migratoire, économique et géopolitique (sanction des intérêts russes) montre que l'application des mesures de réduction des risques, de contrôles ou de lutte aurait été considérablement aidé et rendu plus efficace avec un tel système.
Le coût pour l'Etat est de 3,5M€ pour le développement puis autour de 0,8 à 1,2M€ pour le fonctionnement annuel.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La réception des formalités déclaratives, constituant le dossier d'escale du navire, permet d'accepter le navire dans le port, de l'autoriser à entrer, à sortir et de lui attribuer une place à quai afin qu'il puisse charger ou décharger les marchandises et/ou passagers qu'il a ou va prendre à son bord. Par conséquent le guichet unique maritime et portuaire permet aux autorités portuaires, au titre de leurs compétences en matière de police de l'exploitation, d'attribuer le quai qu'occupera le navire lors de son escale et aux officiers de ports et officiers de ports adjoints d'autoriser, au titre de leurs compétences relatives à la police du plan d'eau, l'entrée ou la sortie du navire au port. Les collectivités territoriales étant autorité portuaire et investies du pouvoir de police portuaire, elles devront mettre en oeuvre le guichet unique maritime et portuaire.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les systèmes d'information portuaires, qui constituent, à la demande des ports, un élément d'entrée du guichet unique maritime et portuaire, sont appelés à évoluer pour tenir compte des nouvelles modalités de déclaration, impliquant un coût de développement associé pour les services concernés.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article 2 du décret n°2002-647 du 29 avril relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du CSMM et a rendu un avis favorable en séance le 01/07/2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique en France hexagonale.
Elle s'applique également de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, et à Mayotte), sans adaptation particulière.
En revanche, cette disposition ne s'applique pas à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. En vertu des articles LO. 6214-3 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, il revient à ces deux collectivités de fixer les règles applicables pour la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes. De même, elle ne s'applique pas à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie qui relèvent du principe de spécialité législative.
Par ailleurs, l'article L. 5753-2 du code des transports exclut explicitement Saint-Pierre-et-Miquelon du champ d'application des articles L. 5334-6-1 alinéa 1, L. 5334-6-2 à L. 5334-6-4, L. 5336-1-5 et L. 5336-18.
Dans le cadre de l'application du droit de l'Union européenne aux territoires ultramarins, il convient de prendre en compte les spécificités des RUP (Régions ultrapériphériques) et des PTOM (Pays et territoires d'Outre-mer) en vertu des articles 349 et 355 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). En ce qui concerne les RUP, comme Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et la Guyane qui sont des départements français d'outre-mer et Saint-Martin, qui est une collectivité d'outre-mer, les dispositions législatives de l'Union Européenne sont applicables sous réserve de certaines adaptations spécifiques liées aux contraintes géographiques, économiques et sociales.
Pour les PTOM tels que Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, les TAAF et Wallis-et-Futuna, ces territoires ne font pas partie intégrante du marché unique de l'Union européenne et, par conséquent, ne sont soumis qu'à des engagements spécifiques dans le cadre de leurs relations avec l'Union européenne, sans pour autant être tenus de suivre les mêmes règles que celles applicables aux Etats-membres.
Selon le Rapport au Président de la république relatif à l'ordonnance n°2013-139 du 13 février 2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes, l'ordonnance 2013-139 est applicable aux RUP, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin « sous réserve de leurs compétences propres ». L'article 74 de la Constitution et le principe de spécialité législative qui en découle impose d'examiner la situation au cas par cas. Les articles LO. 6213-1 et LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit, respectivement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'article L. 5733-1 du code des transports recense les dispositions non applicables à Saint-Barthélemy et l'article L. 5743-1 remplit la même fonction pour Saint-Martin. Dans les deux cas, les dispositions relatives aux formalités déclaratives ne sont pas mentionnées. En revanche, en vertu des articles LO. 6214-3 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, il revient aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de fixer les règles applicables pour la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes.
Dès lors, les dispositions du présent projet de loi relatives à la mise en place du guichet unique maritime et portuaire entrent dans le cadre de l'exploitation du port. La réception des formalités déclaratives, constituant le dossier d'escale du navire, permet d'accepter le navire dans le port, de l'autoriser à entrer, à sortir et de lui attribuer une place à quai afin qu'il puisse charger ou décharger les marchandises et/ou passagers qu'il a ou va prendre à son bord. Par conséquent le guichet unique maritime et portuaire permet aux Autorités portuaires, au titre de leurs compétences en matière de police de l'exploitation, d'attribuer le quai qu'occupera le navire lors de son escale et aux officiers de ports et officiers de ports adjoints d'autoriser, au titre de leurs compétences relatives à la police du plan d'eau, l'entrée ou la sortie du navire au port.
De même, il est expressément prévu par l'article L.5753-2 du code des transports que les actuels articles L.5334-6-1, L.5334-6-2 et L.5334-6-3 du code des transports ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le présent projet de loi modifie l'article L.5753-2 du code des transports afin qu'il intègre les nouveaux articles relatifs au guichet unique maritime et portuaire.
Quant à Wallis et Futuna, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, aucune disposition ne prévoit l'applicabilité de la sous-section relative aux formalités déclaratives. Dès lors, en vertu du principe de spécialité législative, les dispositions du présent projet de loi ne sont pas applicables.
5.2.3. Textes d'application
Les modalités de saisie et de transmission des données dans le guichet unique maritime et portuaire devront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 59 (2°) - Mise en place, obligations relatives au guichet unique maritime et portuaire et mode de financement
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
- Sur les obligations des autorités portuaires dans le cadre du guichet unique maritime et portuaire :
En vertu de l'article L. 5331-7 du code des transports, l'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, comprenant notamment l'attribution des postes à quai. Elle se différencie de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, compétente notamment pour les missions relevant de la police du plan d'eau comprenant l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires. Le représentant de l'autorité portuaire diffère selon la catégorisation du port. Selon l'article L. 5331-5 du code des transports il existe quatre catégories de ports. En premier lieu les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes où l'autorité portuaire est respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome. En deuxième lieu, concernant les ports maritimes relevant de l'arrêté du 27 octobre 2006, dont l'activité principale est le commerce et où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est exercée par l'Etat, l'Autorité portuaire est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Enfin pour les ports maritimes totalement décentralisés, l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire sont exercées par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Le guichet unique maritime et portuaire aura vocation à s'appliquer aux trois premières catégories de ports mentionnées à l'article L. 5331-5 dudit code.
Actuellement, l'article L.5334-6 du code des transports impose à l'autorité portuaire de mettre à disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente certaines informations et statistiques relatives aux navires. Cependant, aucune mention n'existe quant à ses obligations relatives à une escale de navire dans le cadre du guichet unique maritime et portuaire.
- Sur les formalités déclaratives :
Le droit national relatif aux formalités déclaratives à accomplir lors d'une escale sur le territoire national est composé, dans son état actuel, des textes transposant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du Code des transports est dédiée aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes.
L'article L.5334-6-1, de ladite sous-section, définit le « guichet unique » comme l'unique point auquel sont adressés les données comprises dans les formalités déclaratives exigées par la directive 2010/65/UE. Ainsi, cette disposition du Code des transports remplit l'exigence de la directive susmentionnée d'établir et d'utiliser un guichet unique, afin d'harmoniser et coordonner la transmission de ces formalités.
Actuellement, cette disposition est complétée par l'article L.5334-6-2 du code des transports qui organise le fonctionnement du guichet unique et portuaire. Sans utiliser le terme « déclarants », il renseigne sur la qualité des personnes devant satisfaire aux obligations relatives à la transmission des formalités déclaratives prévues à l'article L.5334-6-1. Dans le cas du guichet unique portuaire, il s'agit du capitaine du navire, du consignataire et de l'armateur.
Ensuite, sans en donner de définition, l'article L. 5334-6-2 du code des transports met à la charge du gestionnaire du guichet unique la responsabilité de mettre à disposition des autorités publiques qui en sont destinataires, les informations qu'il reçoit. Ainsi, la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) est chargée de la gestion du guichet unique et assure le rôle de maîtrise d'ouvrage pour la collecte, le stockage et la diffusion des données vers les services instructeurs, notamment les douanes, l'Agence nationale des données de voyage (ANDV), le Ministère de l'intérieur ou encore les Agences régionales de santé (ARS).
En son troisième paragraphe, l'article susmentionné précise qu'à l'exception de certaines informations relatives aux personnes et aux biens et obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (UE) n° 2016/399 et (CE) n° 450/2008), les autres informations doivent être communiquées. Ce processus est réalisé sur demande des autorités publiques en charge des contrôles aux frontières ainsi que douaniers, et par le biais du système d'information national sur le trafic maritime. En outre, il ajoute que ces données sont mises à la disposition, de la même manière, des autorités portuaires énumérées à l'article L.5331-5 du code des transports et des autres Etats membres de l'UE.
Le droit actuel doit donc être modifié afin de correspondre aux nouvelles exigences juridiques de l'Union.
- Sur les modalités de financement du guichet unique maritime et portuaire :
Le guichet unique maritime et portuaire représente une opportunité pour les déclarants, qui sont les premiers concernés par l'envoi des formalités déclaratives et bénéficient directement de la simplification des procédures de transmission des données. Cependant, l'impact sur les capitaineries n'est pas à négliger. En effet, les ports maritimes disposaient auparavant d'une forte autonomie quant aux modalités de transmission des formalités déclaratives.
En vertu de l'article L.5334-6-3 du code des transports, les charges liées à la mise en oeuvre du guichet reposaient sur l'établissement portuaire ou la collectivité territoriale compétente. Dès lors, le financement du guichet unique maritime et portuaire est une question importante pour les autorités portuaires.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution, « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle »253(*). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne254(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement 2019/1239/UE établissant un système de guichet unique maritime et européen et abrogeant la directive 2010/65/UE a été adopté le 20 juin 2019 par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Son objectif, exprimé en son article premier, est d'harmoniser les règles régissant la fourniture des informations requises dans le cadre des escales des navires. A cette fin, il met en place un système de guichet unique maritime européen (« EMSWe ») alimenté par les guichets uniques maritimes nationaux des Etats membres, dont il impose la création selon les dispositions de l'article 5. Ce dernier exigeant que la plateforme ainsi créée respecte un certain nombre de conditions, d'ordre technique et juridique.
Par ailleurs, afin de limiter les risques de duplication, l'article 8 du règlement exige le respect du principe de transmission unique d'informations lors de l'accomplissement des formalités déclaratives.
Son article 2 définit la notion de déclarant comme une catégorie de personnes soumise à l'obligation de transmettre les formalités déclaratives. Contrairement à la rédaction actuelle de l'article L.5334-6-2, ce règlement de l'UE n'indique donc pas expressément qui sont les déclarants. Toutefois, l'identité des déclarants est déterminée dans les textes exigeant la transmission des formalités déclaratives, énumérés dans son annexe. Pour exemple, l'article 4 de la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, précise que les informations doivent être transmises par l'exploitant, l'agent maritime ou le capitaine du navire.
L'obligation de transmettre les informations requises aux autorités publiques, prévue par les paragraphes 2 et 3 de l'article L.5334-6-2 du code des transports, est en conformité avec le paragraphe 4 de l'article 5 du règlement 2019/1239/UE. Cette correspondance s'explique par la transposition de l'article 6 de la directive 2010/65/UE, lequel est intégré dans le règlement 2019/1239/UE.
Tel qu'il est actuellement prévu, le guichet unique portuaire ne remplit donc pas les exigences imposées par le règlement 2019/1239/UE tant sur le plan technique que juridique.
Par ailleurs, le Comité de la simplification des formalités (FAL 46) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) a adopté des amendements à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965, dite Convention FAL. Ces amendements, entrés en vigueur le 1er janvier 2024, imposent aux Etats parties à la Convention FAL d'établir un système de guichet unique pour transmettre électroniquement les formalités déclaratives à l'arrivée et à la sortie des ports. De même, ces dispositions privilégient le principe de transmission unique des informations afin de faciliter le trafic maritime international. Certaines formalités déclaratives imposées par l'UE aux navires lors d'une escale reposent sur cette même convention. Ces formalités sont reprises par la Directive 2010/65/UE et le règlement 2019/1239/UE, qui les intègrent dans les obligations déclaratives à accomplir. Ainsi, elles figurent dans la partie B de l'annexe du règlement (UE) aux côtés des obligations de déclaration découlant d'autres instruments juridiques internationaux.
Enfin, à l'échelle du droit européen, le règlement 2019/1239/UE mentionne à son article 20 les coûts à la charge du budget général de l'Union européenne. Toutefois, il ne s'agit que de financer le projet au niveau de l'Union et non pas à l'échelle des Etats membres. Dès lors, il est clair que l'article 5 dudit règlement, en particulier son premier paragraphe, fait reposer le coût des guichets uniques maritimes nationaux sur les Etats membres. Ainsi, il revient à la France de financer la mise en place du guichet unique maritime et portuaire.
En l'absence d'un financement clairement établi, il serait impossible de mettre en oeuvre le guichet unique maritime et portuaire et, ainsi, de satisfaire aux exigences de l'Union européenne.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Tout d'abord, à l'instar des autres articles de ce projet de loi, il est nécessaire d'adapter le droit national au règlement 2019/1239/UE afin de se conformer aux exigences européennes. En effet, certains éléments de la version actuelle de des articles L.5334-6-1, L.5334-6-2 et L.5334-6-3 ne sont plus en vigueur. Par exemple, dans sa rédaction actuelle, le code des transports ne prévoit pas d'obligation pesant sur l'autorité portuaire quant à la validation de l'escale dans le guichet unique maritime et portuaire, de la demande jusqu'au départ du navire. Cependant, cette mention est nécessaire à plusieurs titres. D'une part, valider la demande d'escale, et l'autorisation de départ dans le guichet unique maritime et portuaire, permet de garantir un suivi efficace des escales des navires, en s'assurant notamment qu'une place à quai lui a été attribuée. Ainsi, le dossier d'escale peut être considéré comme complet.
D'autre part, cette obligation permet une harmonisation du système de validation d'escales à l'échelle nationale. En effet, à ce jour certains ports recevant des navires soumis aux obligations de déclaration ne sont pas reliés à un système d'information portuaire et d'autres se contentent de recevoir les formalités déclaratives mais ne valident pas et ne clôturent pas les escales dans le système d'information portuaire (relié à l'actuelle guichet unique portuaire) ce qui a des conséquences sur la traçabilité des escales et fausse les données remontées à la Commission européenne. La nouvelle disposition prévoit que les ports maritimes recevant des navires soumis aux obligations de déclaration doivent s'équiper d'un système d'information portuaire ou utiliser directement le guichet unique maritime et portuaire.
Il en est de même pour le troisième paragraphe de l'article L.5334-6-2 du code des transports qui fait référence au règlement 2913/92/CEE abrogé et remplacé par le Code des douanes de l'Union européenne, mis en place par le règlement 952/2013/UE.
En outre, après avoir défini le guichet unique maritime et portuaire à l'article L.5334-6, il est nécessaire de déterminer sur quelle entité pèse la charge de renseigner les données et les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale dans la plateforme. Dans le même temps, afin de permettre l'accomplissement des obligations de déclaration, il revient au décret d'application, puis au ministre chargé de la mer de fixer, par arrêté, l'adresse du guichet unique maritime et portuaire.
Il est également indispensable d'énumérer les différents moyens de transmission des formalités déclaratives. Non seulement, cela est exigé par le droit de l'Union mais il est également important pour les déclarants de connaître l'ensemble de leurs options.
Dès lors, il est nécessaire d'inscrire, dans le texte de loi correspondant, qu'il revient au guichet unique maritime et portuaire de mettre les informations pertinentes à disposition des ports et administrations ayant à en connaître.
Enfin, la mise en place du guichet unique maritime et portuaire implique nécessairement d'intégrer une disposition législative relative au financement de celui-ci. L'absence d'un tel article est susceptible de retarder, voire de bloquer, sa mise en place. Ainsi, il est nécessaire de légiférer sur ce sujet, afin d'éviter une sanction potentielle pour non-conformité au droit de l'Union européenne.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Tout d'abord, le présent article recherche une harmonisation à l'échelle nationale du processus de validation de l'escale. L'usage de système d'information portuaire, ou directement du guichet unique maritime et portuaire, permet ainsi de garantir la sécurisation de la transmission des informations. Cette nouvelle disposition cherche également à améliorer la surveillance du trafic maritime et portuaire, notamment lors des escales. L'information enregistrée dans le guichet unique maritime et portuaire est ainsi mise à la disposition des services compétents nationaux et européens.
A l'instar des objectifs poursuivis par l'Union européenne avec l'adoption du règlement 2019/1239/UE, le présent article recherche une harmonisation et une simplification des procédures de déclarations à transmettre lors des escales sur le territoire français.
Le guichet unique maritime et portuaire, en facilitant l'accomplissement des obligations déclaratives, permettra également d'assurer le transit des données sur une plateforme sécurisée.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
- Sur les obligations des autorités portuaires dans le cadre du guichet unique maritime et portuaire :
Il a été envisagé de créer un nouvel article spécialement dédié à l'obligation pour l'autorité portuaire de valider la demande d'escale dans le guichet unique maritime et portuaire. Cette disposition aurait été insérée à la suite de l'actuel article L.5334-6. Toutefois, celui-ci traitant déjà des obligations de l'autorité portuaire, une telle création d'article ne serait pas conforme avec l'objectif de simplification du droit et permet de limiter la prolifération des normes.
- Sur les formalités déclaratives :
Aucune autre option n'a été envisagée pour accomplir les objectifs poursuivis.
- Sur les modalités de financement du guichet unique maritime et portuaire :
La question du financement de guichet unique maritime et portuaire a fait l'objet de différentes propositions. Tout d'abord, il était possible de reconduire le système mis en place par l'actuel article L.5334-6-3 du code des transports, c'est-à-dire faire reposer les charges sur l'autorité portuaire donc l'établissement portuaire ou la collectivité territoriale compétente. Toutefois, en raison de la complexité du projet et de son coût important, faire peser les charges sur les collectivités territoriales ou l'établissement portuaire a semblé disproportionné par rapport à leur budget et leur structure.
3.2. DISPOSITIF RETENU
- Sur les obligations des autorités portuaires dans le cadre du guichet unique maritime et portuaire :
Le présent article procède à une réorganisation des dispositions, en insérant dorénavant au sein de l'article L.5334-6-1 les attributions dévolues à l'autorité portuaire en matière de réception des navires et de surveillance du trafic portuaire en reprenant les dispositions de l'ancien article L.5334-6 et ajoutant une seconde obligation pour l'autorité portuaire. Cette solution présente l'avantage de rassembler les obligations pesant sur l'autorité portuaire au sein du même article et d'assurer une cohérence avec la section qu'il complète. La sous-section 1 de la section 2 est abrogée. L'article L.5334-6-1 est désormais rattaché à la section 2 du chapitre IV, intitulé « Accueil des navires ».
- Sur les formalités déclaratives :
Le présent article propose également une modification de l'article L.5334-6-2 du code des transports. La version ainsi présentée reprend et modifie le contenu de l'article L.5334-6-2 du code des transports actuellement en vigueur, selon les éléments exposés ci-après.
En vue d'assurer la clarté de cet article, notamment au regard des formalités déclaratives à transmettre au guichet unique maritime et portuaire et des renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale, il est nécessaire de définir le guichet unique maritime et portuaire puis de renvoyer aux obligations contenues dans l'annexe du règlement du règlement 2019/1239/UE. La pluralité des sources de ces obligations aurait représenté un risque pour la lisibilité dudit article.
Au premier paragraphe de sa nouvelle rédaction, la mention du guichet unique portuaire est remplacée par celle du guichet unique maritime et portuaire. Il prévoit ainsi les personnes soumises à l'obligation de transmission des formalités déclaratives, c'est-à-dire les déclarants.
Dans sa nouvelle version, le second paragraphe traite des différents moyens de saisie et de transmission des formalités déclaratives et des renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale, soit par l'intermédiaire de fournisseurs de service de données ou par les systèmes d'informations portuaires.
Le troisième paragraphe prévoit la mise à disposition des données reçues ou intégrées au guichet unique maritime et portuaire au port d'escale et aux administrations compétentes
Par son quatrième paragraphe, la nouvelle disposition reformule le paragraphe 4 de l'actuel article L.5334-6-2 tout en conservant sa substance. À l'exception notable que la mention du guichet unique portuaire est remplacée par le guichet unique maritime et portuaire et que l'article renvoie à un décret en conseil d'Etat et non plus un arrêté, afin d'être plus respectueux de l'ordre juridique interne.
- Sur les modalités de financement du guichet unique maritime et portuaire :
Le présent projet de loi retient également la modification de l'article L.5334-6-3. Selon cette nouvelle rédaction, les charges afférentes au développement et au fonctionnement du guichet unique maritime et portuaire incomberont à l'Etat.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifient les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3 du code des transports.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent projet d'article permet l'adaptation du droit français au règlement 2019/1239/UE. Ainsi, il contribue à l'articulation entre le droit français et les obligations européennes.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le guichet unique maritime et portuaire apporte une harmonisation dans la manière de déclarer, au niveau national, et au niveau européen, qui permet un gain de temps et une simplification du processus. En conséquence ce système renforce l'attractivité des ports français, permettant aux navires de réduire leurs coûts administratifs et d'optimiser leurs escales.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le règlement européen 2019/1239/UE établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/CE impose un certain nombre d'évolutions dans le format des obligations déclaratives à des fins d'harmonisation dans la manière de déclarer. Les systèmes d'information portuaires, qui constituent, à la demande des ports, un élément d'entrée du guichet unique maritime et portuaires, sont donc appelés à évoluer pour tenir compte de ces nouvelles modalités de déclaration, impliquant un coût de développement associé.
Ce même règlement européen prévoit également la possibilité pour les déclarants de répondre à leurs obligations déclaratives en transmettant directement de système d'information en système d'information les données demandées pour la réalisation de l'escale, dans le respect du format et des modalités européennes. Là encore, cela peut représenter un coût de développement pour ces entreprises. Néanmoins, le gain d'efficacité est non négligeable puisqu'une évolution de leur système d'information pourrait, à terme, leur permettre de communiquer avec les guichets maritimes nationaux des Etats membres de l'Union européenne.
En effet, le guichet unique maritime et portuaire dispose de connexions avec les administrations concernées (notamment, douanes, agence nationale des données de voyage, agences régionales de santé) permettant l'application du principe du « dîtes-le nous une fois » pour les déclarants. Les capitaines des navires, ou leurs représentants, auront par ailleurs des possibilités de réutiliser des déclarations déjà transmises, par exemple pour les modalités de sortie en reprenant des données utilisées à l'entrée du navire.
Par ailleurs, en termes de nouvelles contraintes, le guichet unique maritime et portuaire implique une modification des processus métier de transmission de l'information. Ces transformations sont susceptibles d'engendrer des résistances de la part de certains déclarants.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le périmètre des navires assujettis n'évolue pas par rapport à la directive 2010/65, abrogée par le règlement 2019/1239. Les ports sont donc déjà équipés de système d'information portuaire.
Toutefois, l'impact budgétaire de cette mesure est estimé à 1,2 million d'euros. Le financement sera pris en charge par l'Etat afin d'éviter de faire reposer une charge trop importante sur les autorités portuaires.
Ce montant correspond aux coûts de maintien en condition opérationnelle (maintenance), de maintien en condition de sécurité (cybersécurité), d'hébergement et d'adaptation évolutive (trajectoire d'intégration progressive de fonctionnalités réalisées par d'autres systèmes (Trafic2000 et E-scaleport) qui devraient être décommissionnés au 1er septembre 2028 par mesure de rationalisation.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le présent projet d'article aura un impact sur les collectivités territoriales dans certains cas. En vertu de l'article L.5331-5 alinéa 3, l'autorité portuaire dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Dès lors, les collectivités territoriales, à travers leurs agents, ont désormais l'obligation de valider les demandes d'escale dans le guichet unique maritime et portuaire dans les cas correspondants. Cet état de fait implique que si les agents de la collectivité territoriale, agissant en qualité d'autorité portuaire, ne valident pas l'escale dans le guichet unique maritime et portuaire, elle s'expose aux sanctions administratives mises en place par le présent article.
Pour les ports n'effectuant pas leur validation d'escale au sein de l'actuel guichet unique portuaire, cette obligation implique la formation des agents concernés ainsi que la mise en place d'un système d'information portuaire, ou à minima des moyens techniques permettant d'utiliser le guichet unique maritime et portuaire.
De plus, lorsqu'elles ont la qualité d'autorité portuaire, en vertu de ce titre, elles pourraient voir les frais liés à un abonnement à un système d'information portuaire évoluer, les éditeurs de logiciel devant nécessairement réaliser des développements pour que leur service soit en adéquation avec les exigences du guichet unique maritime et portuaire, telles que précisées par la règlementation européenne.
Par ailleurs, les autorités portuaires qui avaient privilégié le recours au système d'information portuaire E-scaleport, mis à disposition par l'Etat, devront étudier les solutions ou développements à mettre en oeuvre dans le cadre du « décommissionnement » de ce système, qui est prévu à échéance de trois ans.
En outre, l'adoption de ce texte implique une modification des processus métier d'accès à l'information. Ces transformations font l'objet d'un service d'assistance au cours de la première année de mise en oeuvre du guichet unique maritime et portuaire, afin d'accompagner les différentes parties prenantes dans les changements induits.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'article proposé institue un guichet unique maritime et portuaire qui se caractérise par l'informatisation et l'automatisation de la transmission des formalités déclaratives sous un format structuré totalement adaptée au post-traitement de criblage. Dès lors, la charge représentée par la réception (mail...) et le traitement (souvent manuel) des informations pour les services administratifs et les services déconcentrés de l'Etat s'en voit réduite. Les informations pertinentes seront directement mises à la disposition des autorités compétentes. Il s'agit donc également d'une simplification pour l'administration qui pourra se concentrer sur les cas utiles de non-conformité identifié par un traitement et des contrôles automatiques.
Dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles, du maintien en conditions de sécurité (cybersécurité), d'hébergement (serveurs) et de la maintenance évolutive du guichet unique maritime et portuaire, les coûts associés sont évalués à 1,2 million d'euros annuels.
Le guichet unique maritime et portuaire est un système requérant une haute disponibilité, une totale intégrité des données qui contient, une confidentialité des données à caractère personnel, de santé ou commerciales et enfin une totale traçabilité des connexions et des actions réalisées pour chaque connexion. Plus de 80 000 escales de navires de commerces et à passagers vont être traitées par ce guichet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
A travers le respect des exigences d'accessibilité des services de communication en ligne, mises en place par l'article 47 de la Loi n°2005-102 et les textes réglementaires qui en découlent, le présent article prend en compte les personnes en situation de handicap. En effet, l'interface créé dans le cadre du guichet unique maritime et portuaire a pour objectif d'atteindre les 75% d'accessibilité. Ce taux a été établi en conformité avec le Référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité (RGAA), mis en vigueur par l'arrêté du 20 septembre 2019.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mise en oeuvre du guichet unique maritime et portuaire permettra la mise à disposition d'informations portant sur les caractéristiques des cargaisons des navires en escale, notamment s'agissant des cargaisons dangereuses ou polluantes. Ces informations seront utiles, par exemple, afin d'anticiper les conséquences sur l'environnement en cas d'incident.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article 2 du décret n°2002-647 du 29 avril relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du CSMM et a rendu un avis favorable en séance le 01/07/2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique en France hexagonale.
Dans le cadre de l'application du droit de l'Union européenne aux territoires ultramarins, il convient de prendre en compte les spécificités des RUP (Régions ultrapériphériques) et des PTOM (Pays et territoires d'Outre-mer) en vertu des articles 349 et 355 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). En ce qui concerne les RUP, comme Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et la Guyane qui sont des départements français d'outre-mer et Saint-Martin, une collectivité d'outre-mer, les dispositions législatives de l'Union Européenne sont applicables sous réserve de certaines adaptations spécifiques liées aux contraintes géographiques, économiques et sociales.
Pour les PTOM tels que Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, les TAAF et Wallis-et-Futuna, ces territoires ne font pas partie intégrante du marché unique de l'Union européenne et, par conséquent, ne sont soumis qu'à des engagements spécifiques dans le cadre de leurs relations avec l'Union européenne, sans pour autant être tenus de suivre les mêmes règles que celles applicables aux Etats-membres.
Selon le Rapport au Président de la république relatif à l'ordonnance n°2013-139 du 13 février 2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes, l'ordonnance 2013-139 est applicable aux RUP, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin « sous réserve de leurs compétences propres ». L'article 74 de la Constitution et le principe de spécialité législative qui en découle impose d'examiner la situation au cas par cas. Les articles LO6213-1 et LO6313-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit, respectivement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'article L.5733-1 du code des transports recense les dispositions non applicables à Saint-Barthélemy et l'article L.5743-1 remplit la même fonction pour Saint-Martin. Dans les deux cas, les dispositions relatives aux formalités déclaratives ne sont pas mentionnées. En revanche, en vertu des articles LO6214-3 et LO6314-3, il revient aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de fixer les règles applicables pour la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes. Dès lors, les dispositions du présent projet de loi relatives à la mise en place du Guichet unique maritime et portuaire entrent dans le cadre de l'exploitation du port. La réception des formalités déclaratives constituant le dossier d'escale du navire, permet d'accepter le navire dans le port, de l'autoriser à entrer, à sortir et de lui attribuer une place à quai afin qu'il puisse charger ou décharger les marchandises et/ou passagers qu'il a ou va prendre à son bord. Par conséquent le guichet unique maritime et portuaire permet aux Autorités portuaires, au titre de leurs compétences en matière de police de l'exploitation, d'attribuer le quai qu'occupera le navire lors de son escale et aux officiers de ports et officiers de ports adjoints d'autoriser, au titre de leurs compétences relatives à la police du plan d'eau, l'entrée ou la sortie du navire au port. Les dispositions du projet de loi ne sont donc pas applicables dans ces deux collectivités d'outre-mer car elles sont intrinsèquement liées à l'exploitation des ports maritimes.
De même, il est expressément prévu par l'article L.5753-2 du code des transports que les actuels articles L.5334-6-1, L.5334-6-2 et L.5334-6-3 du code des transports ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le présent projet de loi modifie l'article L.5753-2 du code des transports afin qu'il intègre les nouveaux articles relatifs au guichet unique maritime et portuaire.
Quant à Wallis et Futuna, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, aucune disposition ne prévoit l'applicabilité de la sous-section relative aux formalités déclaratives. Dès lors, en vertu du principe de spécialité législative, les dispositions du présent projet de loi ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 73 de la Constitution, le présent projet de loi est applicable de plein droit dans les départements et les régions d'outre-mer. Il en va ainsi de La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Guyane.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article, s'agissant de la nouvelle rédaction de l'article L. 5334-6-1 du code des transports, ne requiert aucun texte d'application. Toutefois, l'actuel article R.5333-3 devra être amendé afin de définir le nouveau processus de demande d'escale. Cette disposition précisera les obligations de l'autorité portuaire, de la validation de l'escale dans le guichet unique maritime et portuaire à l'attribution des postes à quai. En outre, il renverra à l'arrêté fixant les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale que les déclarants ont l'obligation de fournir.
Le présent article prévoit, dans la nouvelle rédaction de l'article L.5334-6-2 du code des transports, que l'adresse du guichet unique maritime et portuaire, la liste des administrations ayant à connaitre des informations transitant dans le guichet unique maritime et portuaire ainsi que les modalités de transmission des formalités et des données requises pour l'établissement de l'escale seront fixées par arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.
Article 60 - Obligations relatives au dépôt des déchets
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le droit national traite du dépôt des déchets par les navires dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. L'une des sous-sections de ladite section couvre directement les obligations relatives au dépôt des déchets des navires. Au sein de celle-ci, l'article L.5334-8-1 concerne le guichet unique maritime et portuaire puisque certaines formalités déclaratives, dont la transmission est rendue obligatoire par l'article L.5334-6-2, tel que modifié par le présent projet de loi, ont trait aux déchets. En effet, cette disposition mentionne actuellement l'obligation pour les capitaines de navire de fournir, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires255(*) avant l'arrivée dans le port. En vertu de l'article L.5336-1-4 du code des transports, une majoration de 10% du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée en cas de méconnaissance de cette obligation.
Ainsi, il convient d'adapter le mode de transmission ou de saisie de ces informations à la mise en place du guichet unique maritime et portuaire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution, « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle »256(*). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne257(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les informations relatives aux déchets, dont la transmission est exigée par le code des transports, trouvent leur origine au sein du droit de l'Union européenne. En effet, la directive 2019/883/UE relative aux installations de réception portuaire pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE met en place deux modèles normalisés relatifs à la transmission d'informations liées aux déchets. Le premier de ces modèles correspond à la notification préalable de dépôt des déchets dans des installations de réception portuaire, tandis que le second concerne le reçu de dépôt des déchets. Non seulement ces modèles sont utilisés en droit français, mais les informations qu'ils contiennent font également partie de l'ensemble de données exigées par l'Union européenne, dans le cadre de la mise en place par les Etats de leur guichet unique maritime national.
La directive (UE) 2019/883 a pour objectif principal la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des déchets des navires dans les ports des Etats membres de l'Union européenne. Elle est transposée dans le droit national par le décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021. En vertu de l'article 13 de ce décret, la section 3 du Chapitre IV, Titre III, Livre III de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports a été modifiée pour être consacrée aux « Déchets des navires ». Cette section contient notamment les dispositions consacrées la mise en oeuvre de l'obligation d'information sur les déchets des navires, soit, l'article R.5334-4.
La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) de 1973 fixe, dans son annexe V, les types d'ordures pouvant être rejetés en mer. L'application de cette convention dans le droit national est prévue aux articles L. 218-1 et suivants du code de l'environnement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans le cadre de la mise en place du guichet unique maritime et portuaire, il est nécessaire de modifier les dispositions en rapport avec la transmission des formalités déclaratives par les navires lors de leur arrivée et de leur sortie du territoire national. Le présent projet de loi introduit le guichet unique maritime et portuaire comme la nouvelle plateforme à travers laquelle ces formalités doivent être transmises. A l'instar d'autres obligations de déclaration, la notification préalable des déchets doit être impérativement communiquée dans le guichet unique maritime et portuaire.
Dès lors, la terminologie employée dans l'article L.5334-8-1 du code des transports, indiquant actuellement le bureau des officiers de port comme destinataire de la notification préalable de dépôt des déchets et du reçu de dépôt des déchets, doit être révisée afin d'être en cohérence avec l'obligation déclinée par l'article L.5334-6-2, tel que modifié par le présent projet de loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le suivi des déchets des navires vise à protéger le milieu marin en prévenant les rejets illicites des déchets des navires faisant escale dans les ports français.
Anis, l'objectif principal poursuivi par cet article est la mise en conformité des articles du code des transports, relatifs à la transmission des formalités déclaratives, avec la mise en place du guichet unique maritime et portuaire. A ce titre, il est important d'utiliser la terminologie employée dans la disposition créatrice d'obligations.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune option autre que le dispositif retenu n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Ce présent article retient la modification de l'article L.5334-8-1. Les informations relatives aux déchets ne seront désormais plus adressées au bureau des officiers de port, mais transmises avant l'arrivée au port, au guichet unique maritime et portuaire. En outre, ce ne sont plus les capitaines des navires qui sont directement désignés pour transmettre ces formalités déclaratives mais les déclarants au sens de l'article L.5334-6, disposition dont le contenu a été modifié par l'article 1 du présent projet de loi.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article L. 5334-8-1 du code des transports est modifié, afin de mettre en cohérence les dispositions relatives à la mise en oeuvre du guichet unique maritime et portuaire.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent projet d'article permet de faire appliquer en droit français le règlement 2019/1239/UE établissant un système de guichet unique maritime et européen, ainsi que la directive 2019/883/UE relative aux installations de réception portuaire pour le dépôt des déchets des navires.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Ce projet de loi, par sa finalité de simplification administrative et d'harmonisation des modalités de transmission des obligations déclaratives des navires escalant en France, permettra d'accroître l'attractivité des ports maritimes français. S'il est difficile d'estimer précisément les répercussions à l'échelle macroéconomique, il est indéniable que, dans un monde maritime concurrentiel, les apports du guichet unique maritime et portuaire leur permettront d'être plus compétitifs.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le règlement européen 2019/1239/UE établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/CE impose un certain nombre d'évolutions dans le format des obligations déclaratives à des fins d'harmonisation dans la manière de déclarer. Les systèmes d'information portuaires, qui constituent, à la demande des ports, un élément d'entrée du guichet unique maritime et portuaires, sont donc appelés à évoluer pour tenir compte de ces nouvelles modalités de déclaration, impliquant un coût de développement associé.
Ce même règlement européen prévoit également la possibilité pour les déclarants de répondre à leurs obligations déclaratives en transmettant directement de système d'information en système d'information les données demandées pour la réalisation de l'escale, dans le respect du format et des modalités européennes. Là encore, cela peut représenter un coût de développement pour ces entreprises. Néanmoins, le gain d'efficacité est non négligeable puisqu'une évolution de leur système d'information pourrait, à terme, leur permettre de communiquer avec les guichets maritimes nationaux des Etats membres de l'Union européenne.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les autorités portuaires qui avaient privilégié le recours au système d'information portuaire E-Scaleport, mis à disposition par l'Etat, devront étudier les solutions ou développements à mettre en oeuvre dans le cadre du « décommissionnement » de ce système qui est prévu à échéance de trois ans.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le présent projet d'article pourrait avoir des répercussions sur les collectivités territoriales lorsqu'elles ont la qualité d'autorité portuaire. En vertu de ce titre, elles pourraient voir les frais liés à un abonnement à un système d'information portuaire évoluer, les éditeurs de logiciel devant nécessairement réaliser des développements pour que leur service soit en adéquation avec les exigences du guichet unique maritime et portuaire, telles que précisées par la réglementation européenne.
Par ailleurs, les autorités portuaires qui avaient privilégié le recours au système d'information portuaire E-Scaleport, mis à disposition par l'Etat, devront étudier les solutions ou développements à mettre en oeuvre dans le cadre du « décommissionnement » de ce système qui est prévu à échéance de trois ans.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le guichet unique maritime et portuaire se caractérise par l'informatisation et l'automatisation de la transmission des formalités déclaratives. Dès lors, la charge représentée par la réception et le traitement des informations pour les services administratifs et les services déconcentrés de l'Etat s'en voit réduite. Les informations pertinentes seront directement mises à la disposition des autorités compétentes. Il s'agit donc d'une simplification pour l'administration.
Dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles, du maintien en conditions de sécurité et de la maintenance évolutive du guichet unique maritime et portuaire, les coûts associés sont évalués à 1,2 million d'euros annuels.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La problématique de gestion des déchets, à laquelle a trait le présent article, est le reflet immédiat de politiques relatives à la protection de l'environnement. L'objectif poursuivi par cette disposition est de mieux gérer les déchets issus des navires, en particulier lorsque ces derniers arrivent dans les ports. La modification proposée par le présent projet de loi concerne la manière de transmettre les informations relatives aux déchets. Désormais, elles vont transiter de manière électronique à travers le guichet unique maritime et portuaire.
L'ambition de simplifier la transmission des formalités déclaratives, représentée par le guichet unique maritime et portuaire, pourrait occasionner une réduction de la pollution liée aux déchets des navires. En effet, la télétransmission des nouveaux messages au contenu étoffé permettra de mieux suivre les capacités des navires à stocker les déchets à leur bord, de tracer les dépôts de déchets réalisés et ainsi comparer que les volumes sont équivalents. L'écart entre le volume de déchets produits et le volume de déchets débarqués permet d'identifier les comportements suspicieux de rejet à la mer Dans ce cas, une suspicion de rejet à la mer pourrait conduire à un contrôle à bord, voire à une verbalisation. Ainsi, le présent projet d'article est susceptible affecter positivement l'environnement.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article 2 du décret n°2002-647 du 29 avril relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du CSMM et a rendu un avis favorable en séance le 01/07/2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique en France hexagonale.
Elle s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, et à Mayotte), sans adaptation particulière.
En revanche, cette disposition ne s'applique pas à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. En vertu des articles LO6214-3 et LO6314-3 du code général des collectivités territoriales, il revient à ces deux collectivités de fixer les règles applicables pour la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes. De même, elle ne s'applique pas à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie qui relèvent du principe de spécialité législative.
Par ailleurs, l'article L.5753-2 exclut explicitement Saint-Pierre-et-Miquelon du champ d'application des articles L.5334-6-1 alinéa 1, L.5334-6-2 à L.5334-6-4, L.5336-1-5 et L.5336-18.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat précisera les délais dans lesquels cette notification préalable des informations sur les déchets doit être transmise.
L'arrêté du 12 aout 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets restera en vigueur.
Article 61 - Sanctions à l'encontre de l'autorité portuaire et du déclarant
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le droit national dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas de sanction à l'encontre des autorités portuaires n'organisant pas les escales à travers le guichet unique portuaire. De fait, certaines autorités portuaires ne valident pas les demandes d'escale d'une manière uniforme et sécurisée. L'Agence européenne pour la sécurité maritime établit annuellement des statistiques sur le volume d'anomalies constatées. Près d'un millier d'escales par an sont non finalisées, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments dus n'ont pas été déposés avant le départ du navire. Cela n'inclut pas la qualité des données fournis par les déclarants puisque l'agence nationale des données du voyage qui exploite notamment les listes de passagers constate un taux important de listes vide ou erronées dans le dispositif actuel de remontée. L'entrée en vigueur du guichet unique maritime et portuaire implique de nouvelles obligations pour elles. En effet, le présent article vise à remplacer l'article L. 5334-6-1 du code des transports actuel en y insérant le contenu de l'article L.5334-6 et une obligation pour l'autorité portuaire relative à la validation du dossier d'escale dans le guichet unique maritime et portuaire. Cette exigence est désormais indispensable pour la réalisation de l'escale.
Dans sa rédaction actuelle, le droit national ne contient pas non plus de dispositions susceptibles de sanctionner un manquement aux obligations de transmission des formalités déclaratives. Lors de l'arrivée dans un port d'un navire n'ayant pas respecté lesdites obligations, la capitainerie se contente de lui en interdire l'accès. Or, cette interdiction d'accès ne résulte que de l'absence de formalité transmise mais ne s'intéresse pas au contenu. Ainsi il apparaît parfois que des formalités vides sont transmises pour contourner cette sanction. Le nouveau dispositif de sanctions proposé traite bien de la qualité des données contenues et non du formulaire dans lequel elles sont transmises.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
De plus, selon l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le Conseil Constitutionnel a précisé dans la décisions n°84-176 DC du 25 juillet 1984 que le principe de légalité des délits et des peines pose une exigence de précision et de clarté des dispositions.
Les sanctions pour les obligations portuaires s'inspirent de celles applicables aux obligations maritimes portées par l'article L. 5242-2 du code des transports.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ».
De plus, lors de l'audit réalisé en 2023, l'agence européenne pour la sécurité maritime, a mis en lumière l'absence de sanction dans le texte de la transposition de la directive 2010/65/UE. La mise en place d'un régime de sanction est donc apparue comme étant nécessaire dans le cadre du guichet unique maritime et portuaire afin de respecter les exigences de l'Union européenne.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le droit national irlandais offre un exemple de régime de sanctions mis en place en cas de non-respect des obligations de transmission de certaines formalités déclaratives. A travers la Regulation 15 du Statutory Instruments No. 677/2019, il est déterminé qu'en cas de violation des Regulations 5, 6, 7, 8, 10, 12, le responsable sera soumis à une amende de classe A. Les dispositions en question correspondent aux formalités déclaratives que les déclarants ont l'obligation de transmettre à l'arrivée dans les ports. Le Fines Act de 2010 prévoit que les amendes de classe A s'élèvent à des montants compris entre 4 000€ et 5000€.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de créer une disposition législative pour sanctionner les autorités portuaires est issue d'un triple constat. Tout d'abord, dans la situation actuelle, certaines autorités portuaires, notamment les ports décentralisés (6 à ce jour) qui ne traitent exclusivement de que la grande plaisance (yachts de luxe), ne valident pas les escales dans le guichet unique portuaire ou dans les différents systèmes d'information portuaires. Le guichet unique maritime et portuaire offre un cadre propice et sécurisé à la validation du dossier d'escale. Dès lors, il est essentiel de s'assurer que cette validation suive ladite procédure.
Ensuite, l'absence de suivi et de clôture des escales par les autorités portuaires dans l'actuel guichet unique portuaire entraine de nombreuses erreurs dans les systèmes d'information, notamment dans le système de suivi du trafic maritime. En effet, en l'absence de validation administrative du départ alors que le navire a pris la mer, voire arrive dans un autre port de l'union, cette « double présence » informatique du même navire dans deux ports, génèrent des alertes sur le système de suivi européen. Ces dysfonctionnements sont visibles par la Commission européenne, puisque l'Agence européenne pour la sécurité maritime dispose d'un service de veille permanent en charge d'assurer la qualité des informations transmises par les Etats membres et concentrés dans le système européen SafeSeaNet, ce qui pourrait exposer l'Etat français à de potentielles sanctions pour manquement dans le suivi des escales des navires.
Enfin, le régime de sanction ainsi mis en place est nécessaire afin de réprimander le non-respect de l'obligation créée par le présent article. L'inscription dans la loi d'une sanction est un moyen d'inciter au respect de celle-ci. En l'absence d'une telle mention, les sanctions risquent de demeurer inapplicables. Ainsi, l'objectif poursuivit étant de dissuader tout manquement aux obligations de déclaration, le recours à la loi pour le régime de sanction est apparu être le plus pertinent.
Concernant la sanction à l'encontre des déclarants, la création d'un régime de sanctions est nécessaire afin d'assurer la conformité de la législation nationale au droit de l'Union européenne. En effet, à travers un audit réalisé en 2023, l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), a mis en lumière l'absence de sanctions dans le texte de transposition de la directive 2010/65/UE. La substitution du règlement 2019/1239/UE à la directive susmentionnée ne semble pas remettre en cause la validité des conclusions précédemment tirées. Afin de faire appliquer un régime de sanction, il est également nécessaire de déterminer qui sont les agents habilités au constat de l'infraction.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Ainsi, le principal but de cette création d'article est de sanctionner l'éventuel manquement à l'obligation pesant sur l'autorité portuaire de valider le dossier d'escale dans le guichet unique maritime et portuaire, tout au long du processus, c'est-à-dire, de la demande d'escale jusqu'au départ du navire.
L'objectif est également de punir la violation des obligations relatives à la transmission des formalités déclaratives, de dissuader et de prévenir les manquements à ces obligations.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Lors de la rédaction du projet de loi, il a été envisagé d'intégrer dans un article dédié au régime de sanction, une infraction spécifique en cas de violation de l'obligation de transmettre les informations relatives aux matières et marchandises dangereuses. Cependant, l'article L.5242-7 du code des transports prévoit une sanction lorsqu'un navire pénètre dans les eaux territoriales ou intérieures sans avoir transmis certaines informations, notamment la date, l'heure d'entrée, ainsi que la nature et l'importance du chargement, alors qu'il transporte des hydrocarbures et d'autres substances dangereuses. Ainsi, une telle disposition n'a pas été retenue afin d'éviter de constituer un doublon.
Par ailleurs, il était prévu de mettre en place une sanction pénale, par analogisme avec la sanction visée par l'article L.5242-7, cependant après consultation avec la DACG il a été décidé de préférer une sanction administrative afin de se conformer à l'objectif de dépénalisation de la vie économique et sociale du Gouvernement.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Afin de remplir les objectifs poursuivis, il a été proposé de créer une sous-section 1 intitulée « Sanctions administratives des manquements aux mesures de police des ports maritimes », comprenant les articles L. 5336-1 à L. 5336-1-4 et de créer une sous-section 2 intitulée « Sanctions administratives spécifiques à la méconnaissance des obligations de suivi du trafic et de formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » afin de regrouper le régime de sanction prévu quant aux obligations intrinsèquement liées au guichet unique maritime et portuaire et à son utilisation, permettant d'insérer en premier lieu, un article L.5336-1-5 prévoyant une sanction à l'encontre de l'Autorité portuaire, son montant maximal, la récidive et la possibilité d'y ajouter une astreinte journalière. Ainsi, cette rédaction suit pour partie le modèle institué par la section 3 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et celui de l'article L.6143-34 du code des transports. Cette mouture correspond à la manière de rédiger une sanction administrative dans le code des transports.
De plus, le présent article crée un nouvel article L.5336-1-6 du code des transports qui s'insère à la suite du nouvel article L.5336-1-5.
Le I du nouvel article L. 5336-1-6 prévoit différentes sanctions pour des infractions distinctes. Le premier alinéa sanctionne l'absence de transmission des formalités déclaratives requises conformément aux articles L.5334-6 et L.5334-6-2. Les deux suivant traitent respectivement des transmissions lacunaires et erronées. L'article prévoit qu'une mise en demeure, dans un délai qui sera prévu par décret, intervient avant de prononcer la sanction pécuniaire. Le II informe du montant des amendes prévues au titre du I lorsque le délai pour se mettre en conformité est expiré.
Le dernier alinéa du II envisage les potentiels cas de récidive. Dans une telle situation, le montant des amendes prévu pour chaque violation est porté au double.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure proposée prévoit :
- De créer une sous-section au sein de la section relative aux sanctions administratives du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports intitulée « Sanctions administratives des manquements aux mesures de police des ports maritimes » comprenant les articles L. 5336-1 à L. 5336-1-4 ;
- De créer une sous-section 2 intitulée « Sanctions administratives spécifiques à la méconnaissance des obligations de suivi du trafic et de formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » comprenant les nouveaux articles L. 5336-1-5 et L. 5336-1-6.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le régime de sanctions mis en place ne contrevient pas aux dispositions du droit de l'Union européenne. Il a pour vocation de sanctionner les manquements aux obligations édictées par le droit national, elles-mêmes prises sur le fondement de la législation de l'Union européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Ce présent article est susceptible d'avoir un impact sur les autorités portuaires. La sanction administrative infligée pouvant engendrer des coûts. En vertu de l'article L.5331-5 alinéa 3, dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'autorité portuaire est l'exécutif de la collectivité territoriale ou dudit groupement compétent. Dans ce cas, l'amende prononcée sera à la charge de la collectivité territoriale.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La charge administrative incombant aux services administratifs et aux services déconcentrés de l'Etat est susceptible d'être accentuée puisqu'en l'état actuel, le droit national ne prévoit pas de mécanisme de sanctions. Dès lors, une telle création entrainera nécessairement une charge en termes de constatation de la violation et d'application de la sanction.
Dans un premier temps l'objectif n'est pas de sanctionner en tant que tel mais de pouvoir disposer d'un levier pour imposer la mise en oeuvre des évolutions introduites par le règlement dans un délai de 3 ans, jusqu'au décommissionnement des solutions de contournements. La mise en demeure et la menace de sanction lourde devrait suffire. Il est donc peu probable que l'on dépasse les 3 cas de sanction par an sur les 80 000 escales. Ainsi, grâce à cette possibilité de sanctions, si les données nécessaires à l'instruction des dossiers sont complètes dans la quasi-totalité du temps, il y aura un gain d'efficacité dans l'activité quotidienne des services.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Indirectement, l'élaboration d'une disposition sanctionnant le non-respect des formalités à accomplir par les navires lors d'escales sur le territoire national peut contribuer à la protection de l'environnement. En effet, certaines formalités déclaratives à accomplir concernent la sécurité des navires et le respect de certaines normes impactant l'environnement. Dès lors, si effectivement l'existence de sanctions dissuade les violations susceptibles de subvenir, alors l'article en question pourrait impacter positivement l'environnement.
En outre, si ce mécanisme a l'effet escompté, la procédure actuelle, qui consiste à imposer au navire de patienter et réaliser un circuit d'attente hors du port jusqu'à ce que les informations soient correctement transmises, ne sera plus utilisée. En conséquence, les effets dus à consommation vaine de carburant en seront diminués.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article 2 du décret n°2002-647 du 29 avril relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du CSMM et a rendu un avis favorable en séance le 01/07/2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 2 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique en France hexagonale.
Dans le cadre de l'application du droit de l'Union européenne aux territoires ultramarins, il convient de prendre en compte les spécificités des RUP (Régions ultrapériphériques) et des PTOM (Pays et territoires d'Outre-mer) en vertu des articles 349 et 355 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). En ce qui concerne les RUP, comme Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et la Guyane qui sont des départements français d'outre-mer et Saint-Martin qui est une collectivité d'outre-mer, les dispositions législatives de l'Union Européenne sont applicables sous réserve de certaines adaptations spécifiques liées aux contraintes géographiques, économiques et sociales.
Pour les PTOM tels que Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, les TAAF et Wallis-et-Futuna, ces territoires ne font pas partie intégrante du marché unique de l'Union européenne et, par conséquent, ne sont soumis qu'à des engagements spécifiques dans le cadre de leurs relations avec l'Union européenne, sans pour autant être tenus de suivre les mêmes règles que celles applicables aux Etats-membres.
Selon le Rapport au Président de la république relatif à l'ordonnance n°2013-139 du 13 février 2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes, l'ordonnance 2013-139 est applicable aux RUP, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin « sous réserve de leurs compétences propres ». L'article 74 de la Constitution et le principe de spécialité législative qui en découle impose d'examiner la situation au cas par cas. Les articles LO6213-1 et LO6313-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit, respectivement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'article L.5733-1 du code des transports recense les dispositions non applicables à Saint-Barthélemy et l'article L.5743-1 remplit la même fonction pour Saint-Martin. Dans les deux cas, les dispositions relatives aux formalités déclaratives ne sont pas mentionnées. En revanche, en vertu des articles LO6214-3 et LO6314-3, il revient aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de fixer les règles applicables pour la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes. Dès lors, les dispositions du présent projet de loi relatives à la mise en place du Guichet unique maritime et portuaire entrent dans le cadre de l'exploitation du port. La réception des formalités déclaratives constituant le dossier d'escale du navire, permet d'accepter le navire dans le port, de l'autoriser à entrer, à sortir et de lui attribuer une place à quai afin qu'il puisse charger ou décharger les marchandises et/ou passagers qu'il a ou va prendre à son bord. Par conséquent le guichet unique maritime et portuaire permet aux Autorités portuaires, au titre de leurs compétences en matière de police de l'exploitation, d'attribuer le quai qu'occupera le navire lors de son escale et aux Officiers de ports et Officiers de ports adjoints d'autoriser, au titre de leurs compétences relatives à la police du plan d'eau, l'entrée ou la sortie du navire au port. Les dispositions du projet de loi ne sont donc pas applicables dans ces deux collectivités d'outre-mer car elles sont intrinsèquement liées à l'exploitation des ports maritimes.
De même, il est expressément prévu par l'article L.5753-2 du code des transports que les actuels articles L.5334-6-1, L.5334-6-2 et L.5334-6-3 du code des transports ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le présent projet de loi modifie l'article L.5753-2 du code des transports afin qu'il intègre les nouveaux articles relatifs au guichet unique maritime et portuaire.
Quant à Wallis et Futuna, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, aucune disposition ne prévoit l'applicabilité de la sous-section relative aux formalités déclaratives. Dès lors, en vertu du principe de spécialité législative, les dispositions du présent projet de loi ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 73 de la Constitution, le présent projet de loi est applicable de plein droit dans les départements et les régions d'outre-mer. Il en va ainsi de La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Guyane.
5.2.3. Textes d'application
Le nouvel article L. 5336-1-6 prévoit un décret en Conseil d'Etat qui fixera le délai incombant au déclarant pour satisfaire à cette obligation.
Article 62 - Non-application du guichet unique maritime et portuaire à Saint-Pierre-et-Miquelon
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le guichet unique portuaire s'applique sur l'ensemble du territoire français à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Ainsi, l'ensemble des départements et régions d'outre-mer sont soumis à la sous-section du code des transports, dédiées aux formalités déclaratives. Le code des transports traite uniquement de l'applicabilité de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet l'article L.5753-2 prévoit explicitement que les articles L.5334-6-1 à L.5334-6-3 ne sont pas applicables dans cette collectivité.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 74 de la Constitution instaure le principe de spécialité législative dans les collectivités d'outre-mer. Ainsi, la loi organique confère un statut aux collectivités territoriales qui fixe les conditions d'application des lois et des règlements. Dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales affirme que les dispositions législatives et règlementaires y sont applicables de plein droit, sauf lorsque la compétence en cette matière revient explicitement à la collectivité au regard de l'article LO6414-1 du même code. Aucune des compétences mentionnées à cet article n'a trait à l'exploitation des ports maritimes. Dès lors, en principe, au regard du droit constitutionnel, les dispositions relatives au guichet unique maritime et portuaire sont susceptibles de s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'application du droit de l'Union dans les territoires d'outre-mer suit le régime mis en place par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. A ce titre, l'article 198 mentionne les pays et territoires non européens entretenant des relations particulières avec certaines Etats de l'Union. La liste de ces Etats peut être trouvée à l'Annexe II dudit traité. Elle comprend, parmi d'autres, Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette qualité de pays et territoires d'outre-mer a pour vocation de promouvoir le développement de la région mais ne fait pas pour autant d'eux des territoires de l'Union européenne. Ainsi, en vertu du droit de l'Union, le règlement 2019/1239/UE instituant le guichet unique maritime et portuaire n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité d'insérer dans le projet de loi une disposition relative à son applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon s'explique par deux éléments principaux. D'une part, au regard de la loi organique et des textes constitutionnels évoqués rien n'indique que les articles relatifs à l'exploitation des ports maritimes ne s'appliquent pas dans cette collectivité territoriale. Cependant, Saint-Pierre-et-Miquelon étant reconnu comme un pays et territoire d'outre-mer par le droit de l'Union, le règlement 2019/1239/UE, pour lequel le présent projet adapte le droit national, n'y est pas applicable. Ainsi, cet article permet de concilier les exigences du droit de l'Union européenne avec le droit national.
D'autre part, il est également nécessaire de légiférer sur le sujet car de nouvelles dispositions ont été ajoutées par le présent projet de loi. La question de leur applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon doit également être traitée. De même, des changements de numérotation interviennent suite à ce projet de loi. Ils impliquent une modification de l'article L.5753-2 du code des transports, consacré à l'applicabilité des mesures relatives aux ports maritimes à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article a pour objectif principal de régir l'applicabilité dans l'espace des dispositions relatives au guichet unique maritime et portuaire. Il est exclusivement consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon puisque dans les autres territoires outre-mer français, la question de l'applicabilité est réglée par des dispositions constitutionnelles ou issues de la loi organique correspondante.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option que le dispositif retenu n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article retient une modification de l'article L.5753-2 du code des transports.
Sont également ajoutés à la liste des dispositions non applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, créée par l'article L.5753-2, les articles L.5336-1-5 et L.5336-18, mis en place par le présent projet de loi.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
D'une part, le présent article modifie le 3° de l'article L. 5733-1 et le 3° de l'article L. 5743-1 du code des transports. D'autre part, l'article L. 5753-2 du code des transports est également modifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Ce projet d'article suit les exigences européennes puisqu'il contribue à la mise en place du guichet unique maritime et portuaire en faisant respecter le champ d'application du droit de l'Union.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article 2 du décret n°2002-647 du 29 avril relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du CSMM et a rendu un avis favorable en séance le 01/07/2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable le 02 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente disposition entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'applique en France hexagonale.
Dans le cadre de l'application du droit de l'Union européenne aux territoires ultramarins, il convient de prendre en compte les spécificités des RUP (Régions ultrapériphériques) et des PTOM (Pays et territoires d'Outre-mer) en vertu des articles 349 et 355 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). En ce qui concerne les RUP, comme Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et la Guyane qui sont des départements français d'outre-mer et Saint-Martin qui est une collectivité d'outre-mer, les dispositions législatives de l'Union Européenne sont applicables sous réserve de certaines adaptations spécifiques liées aux contraintes géographiques, économiques et sociales.
Pour les PTOM tels que Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, les TAAF et Wallis-et-Futuna, ces territoires ne font pas partie intégrante du marché unique de l'Union européenne et, par conséquent, ne sont soumis qu'à des engagements spécifiques dans le cadre de leurs relations avec l'Union européenne, sans pour autant être tenus de suivre les mêmes règles que celles applicables aux Etats-membres.
Selon le Rapport au Président de la république relatif à l'ordonnance n°2013-139 du 13 février 2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes, l'ordonnance 2013-139 est applicable aux RUP, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin « sous réserve de leurs compétences propres ». L'article 74 de la Constitution et le principe de spécialité législative qui en découle impose d'examiner la situation au cas par cas. Les articles LO6213-1 et LO6313-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit, respectivement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'article L.5733-1 du code des transports recense les dispositions non applicables à Saint-Barthélemy et l'article L.5743-1 remplit la même fonction pour Saint-Martin. Dans les deux cas, les dispositions relatives aux formalités déclaratives ne sont pas mentionnées. En revanche, en vertu des articles LO6214-3 et LO6314-3, il revient aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de fixer les règles applicables pour la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes. Dès lors, les dispositions du présent projet de loi relatives à la mise en place du Guichet unique maritime et portuaire entrent dans le cadre de l'exploitation du port. La réception des formalités déclaratives constituant le dossier d'escale du navire, permet d'accepter le navire dans le port, de l'autoriser à entrer, à sortir et de lui attribuer une place à quai afin qu'il puisse charger ou décharger les marchandises et/ou passagers qu'il a ou va prendre à son bord. Par conséquent le guichet unique maritime et portuaire permet aux Autorités portuaires, au titre de leurs compétences en matière de police de l'exploitation, d'attribuer le quai qu'occupera le navire lors de son escale et aux Officiers de ports et Officiers de ports adjoints d'autoriser, au titre de leurs compétences relatives à la police du plan d'eau, l'entrée ou la sortie du navire au port. Les dispositions du projet de loi ne sont donc pas applicables dans ces deux collectivités d'outre-mer car elles sont intrinsèquement liées à l'exploitation des ports maritimes.
De même, il est expressément prévu par l'article L.5753-2 du code des transports que les actuels articles L.5334-6-1, L.5334-6-2 et L.5334-6-3 du code des transports ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le présent projet de loi modifie l'article L.5753-2 du code des transports afin qu'il intègre les nouveaux articles relatifs au guichet unique maritime et portuaire.
Quant à Wallis et Futuna, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, aucune disposition ne prévoit l'applicabilité de la sous-section relative aux formalités déclaratives. Dès lors, en vertu du principe de spécialité législative, les dispositions du présent projet de loi ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 73 de la Constitution, le présent projet de loi est applicable de plein droit dans les départements et les régions d'outre-mer. Il en va ainsi de La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Guyane.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition n'appelle pas de mesure d'application.
TITRE VIII - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE PRODUITS TECHNIQUES
Article 63 - Mesures d'adaptation du cadre européen applicable à la conception et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Au cours des dernières années, l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, relatif à la conception et à la mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection, qui étaient issues de directives européennes, ont été substituées par des règlements européens d'application directe rendant nécessaire la suppression ou l'adaptation des dispositions du droit national (ces travaux sont en cours concernant le règlement EPI et machines).
- Le règlement de 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements de protection individuelle relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) ;
- Le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines ;
- Le règlement (UE) 2024/1689 relatif à l'intelligence artificielle (IA), et en particulier les systèmes d'IA à haut risque pouvant être intégrés à des équipement de travail ou de protection ;
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs relève du bloc de constitutionnalité :
- Préambule de 1946 : alinéa 11 (protection de la santé, sécurité matérielle), alinéa 12 (solidarité nationale) ;
- Charte de l'environnement de 2004 : article 1er (droit à un environnement respectueux de la santé) ;
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : article 4 (conciliation entre liberté d'entreprendre et protection de la santé).
Ces principes constitutionnels fondent l'obligation de l'État d'assurer un encadrement législatif et réglementaire garantissant la sécurité des équipements de travail.
Par ailleurs :
- aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
- aux termes de l'article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
Les règlements européens possèdent ainsi une autorité supérieure à celle des lois, comme l'avait rappelé le Conseil d'Etat dans on arrêt Boisdet (CE, 1990). Le Conseil constitutionnel veille ainsi au respect des règlements lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne (Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La protection des personnes face aux risques liés à l'utilisation d'équipements de travail relève également du champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme (article 2 droit à la vie article 8 droit au respect de la vie privée et familiale) Ces dispositions créent pour l'État des obligations positives en matière de sécurité. Celles-ci se traduisent par :
- un encadrement législatif et réglementaire des conditions de mise sur le marché et d'utilisation des équipements de travail ;
- des procédures de certification et de mise en conformité avant leur mise en service ;
- des contrôles a posteriori dans le cadre de la surveillance du marché et de l'inspection du travail.
Ces garanties sont indispensables pour assurer la protection effective des droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
En matière de droit de l'Union européenne :
- l'article 153 du TFUE donne à l'Union européenne la compétence pour adopter des mesures visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs ;
- l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux pose que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
- l'article 114 du TFUE constitue par ailleurs la base juridique principale pour l'adoption de mesures relatives au fonctionnement du marché intérieur, y compris en matière de santé et de sécurité.
Ainsi, les différents règlements européens concernés par le présent article :
- posent le cadre transversal relatif à la surveillance du marché intérieur de l'Union (règlement 2019/1020) ;
- fixent les règles de sécurité sectorielles, applicables à certaines catégories de produit (règlement machines, règlement EPI, règlement tracteur) ;
- fixent le cadre transversal relatif à l'intelligence artificielle et prévoient l'articulation de ce cadre avec les règlements sectoriels (règlement IA).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La réglementation relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des équipements de travail trouve ses équivalents dans les principaux États membres de l'Union européenne, tous soumis à la directive 2006/42/CE dite « directive Machines », prochainement remplacée par le règlement (UE) 2023/1230. Des travaux de révision du droit interne seront nécessaires pour les Etats membres, par exemple en :
- Allemagne : transposition par l'Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) et Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Ces textes imposent au fabricant des obligations de conformité et à l'employeur des obligations d'évaluation des risques et de contrôle périodique des équipements.
- Espagne : transposition par le Real Decreto 1644/2008 relatif à la mise sur le marché des machines et le Real Decreto 1215/1997 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail par les travailleurs.
- Italie : reprise des règles européennes dans le Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), qui regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, y compris l'utilisation d'équipements de travail.
Compte tenu que le règlement machines comme le règlement IA ne seront pleinement applicables qu'en 2027, ces travaux sont en cours dans les différents Etats membres.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le présent article vise à clarifier le code du travail (article L. 4311-6 notamment) du fait de la publication de nouveaux règlements européens dans le champ des équipements de travail. En effet, certaines dispositions doivent être clarifiées et adaptées en vue de l'application du règlement machines de 2023 (précité) et du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (règlement IA), qui seront applicables en 2027.
Il vise également à corriger certaines dispositions qui ne sont plus compatibles avec ce nouveau cadre européen (L. 4746-1 notamment) ou qui n'étaient pas en phase avec le règlement de 2019 relatif à la surveillance de marché (article L. 4311-3 et article L. 4314-2 notamment).
Enfin, il complète le code du travail avec des pouvoirs et sanctions prévus par le règlement de 2019 relatif à la surveillance de marché qui n'y figuraient pas (article L. 4314-1 et article L. 4755-3).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à :
- Introduire dans le code du travail, par souci d'intelligibilité, les différents règlements européens applicables. Les mesures réglementaires actuelles du code du travail seront par la suite en grande partie réduites ;
- Corriger les pouvoirs de contrôle et de sanctions des autorités de surveillance du marché afin qu'elles soient alignées sur les dispositions permises par le règlement (UE) 2019/1020.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Cet article a constitué la seule option envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) afin d'être compatible avec les délais de transposition attendue.
Le présent article vise principalement à compléter (au point I. B.) l'article L. 4311-6 du code du travail afin d'y mentionner expressément l'application du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 relatif aux machines. Ce nouveau règlement, qui se substitue à la directive 2006/42/CE, entrera en application en janvier 2027.
Le présent article introduit également le nouveau règlement (UE) 2024/1689 relatif à l'intelligence artificielle (IA), et plus particulièrement aux systèmes d'IA à haut risque susceptibles d'être intégrés à des équipements de travail ou à des moyens de protection individuelle (l'article 6 de ce règlement, qui prévoit l'articulation des dispositions relatives aux systèmes d'IA à haut risque, avec les législations sectorielles sera applicable à partir du 2 août 2027).
Cet article est également complété par la référence à deux règlements déjà en application :
- le règlement (UE) 167/2013 dit “tracteurs” (les tracteurs sont des équipements de travail) ;
- le règlement de 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI), cette mention déjà présente dans le L. 4311-6 actuel est réorganisée en cohérence avec les autres textes européens.
Le présent article apporte également des clarifications sur plusieurs points relatifs à l'application du règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et sur le régime de sanctions pouvant être appliquées aux opérateurs économiques dans ce cadre.
Une proposition (point I. A.et I.D.) vise à corriger une erreur d'écriture en regard de l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 qui prévoit qu'une mesure de surveillance du marché doit être prise lorsque qu'un produit utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu :
- est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs
ou
- n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.
Ces deux conditions sont non cumulatives, or les articles L. 4311-3 et L. 4314-2 du code du travail sont actuellement rédigés de manière telle qu'une action ne peut être mise en oeuvre qu'au regard de manquements cumulatifs à ces deux principes. Il convient de revenir à l'interprétation du règlement européen, en particulier pour les équipements actuellement mis sur le marché qui présentent un risque d'accident grave ou mortel alors qu'ils sont considérés, compte tenu de l'état de l'art, comme conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
Le point I. C. vise à compléter l'article L. 4314-1 du code du travail afin de mentionner la possibilité pour l'autorité de surveillance du marché de recourir à une procédure de vérification de la conformité aux frais de l'opérateur économique (fabricant, distributeur ou importateur) (UE) 2019/1020. Cette demande, qui a pour fondement l'article 14 (4) d) du règlement (UE) 2019/1020, devra être précisée par voie réglementaire. Elle permettra, dès lors qu'un doute important subsiste, de demander une vérification de conformité d'une machine mise sur le marché et non encore mise en service (foires et expositions par exemple ou locaux des distributeurs).
Le projet vise à apporter des compléments au régime de sanctions pouvant être exercées par l'autorité de surveillance du marché :
Le point I. E. supprime une exclusion du régime de sanction au L. 4746-1, en contradiction directe avec l'article 3 18) b) du règlement du règlement 2023/1230 précisant que le «fabricant» peut être également « toute personne physique ou morale [...] qui fabrique des produits relevant du champ d'application du présent règlement et les met en service pour son propre usage ».
Le point I. F. apporte les précisions suivantes au régime de sanctions :
- Il introduit le régime de sanction, associé à la nouvelle disposition portée par le I. C., lorsque le fabricant n'exécute pas la demande de vérification de l'autorité de surveillance du marché.
- Il corrige l'absence de sanction lorsqu'un acteur économique n'apporte pas les informations requises par l'autorité de surveillance du marché. Sur le fondement de l'article 50 du règlement (UE) 2023/1230 et de l'article 14 (4) a, b, c, du règlement (UE) 2019/1020, s'agissant de la liste des documents exigibles par les autorités de surveillance du marché, il ajoute un critère de sanction portant sur le défaut de fourniture de documents, données et informations demandées par l'autorité de surveillance du marché. Cette sanction constitue un outil de nature à faciliter la communication aux autorités de surveillance du marché de certains documents, notamment des extraits du dossier technique ou des informations sur le détail d'un produit vendu (nombre d'exemplaires, etc.)
Le Point II. prévoit des entrées en vigueur des dispositions nationales en cohérence avec les périodes transitoires des textes européens.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article propose de modifier les articles L. 4311-3, L. 4311-6, L. 4314-1, L. 4314-2, L. 4746-1, L. 4755-3 du code du travail.
En outre, l'article R. 4312-1-1 du même code devrait être abrogé par le décret en Conseil d'Etat qui sera pris pour l'adaptation de la règlementation au nouveau règlement machines.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
L'article L. 4311-6 du code du travail prévoit que les équipements de travail et les équipements de protection individuelle puissent être contrôlés au regarde de leur conformité aux règles de conception et spécifications techniques du droit européen lorsqu'ils sont mis sur le marché. Le projet d'article modifie cet article L.4311-6 afin d'y inscrire de façon la plus claire possible l'ensemble du cadre européen en vigueur.
Le présent article permet également de modifier certaines dispositions du code du travail pour les mettre en conformité avec le règlement machines et le règlement relatif à la surveillance de marché de 2019.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les mesures qui auront un impact sur les entreprises sont :
- La possibilité de recourir à une procédure de vérification de la conformité aux frais de l'opérateur économique (fabricant, distributeur ou importateur), qui ne peut être engagée que dans des cas très limités, et difficilement quantifiables précisément (a priori moins de 10 demandes de l'autorité de surveillance du marché par an), mais toujours dans le cadre d'une forte suspicion d'un équipement de travail, ou d'un moyen de protection, non conforme ;
- Les sanctions issues du règlement 2019/1020.
Les mesures portées par le présent article ne devraient donc avoir qu'un impact marginal sur les entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'impact porte sur l'autorité de surveillance de marché en charge de contrôler les équipements (travail et agriculture) et le recouvrement des sanctions administratives, à savoir du bureau des équipements et des lieux de travail de la direction générale du travail (DGT) et du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture au secrétariat général du ministère de l'Agriculture.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Indirectement, le renforcement de la règlementation doit permettre une meilleure protection des travailleurs face aux risques liés à l'utilisation des équipements de travail afin d'éviter les accidents du travail et leurs conséquences pour les travailleurs et pour les entreprises.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En application de l'article L. 4641-1 du code du travail, les dispositions envisagées ont été soumises au Conseil d'orientation des conditions de travail qui a rendu un avis le 21 juillet 2025.
Les organisations syndicales ont pris acte du texte, et certaines organisations patronales ont émis un avis négatif, en particulier du fait du principe de l'application du règlement IA.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française a l'exception des dispositions suivantes :
- L'article L. 4311-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I du présent article, entre en vigueur le 20 janvier 2027. Il entre en vigueur, dans sa rédaction résultant du 3° du même B du I du présent article, le 2 août 2027.
- L'article L. 4746-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du D du I du présent article, et l'article L. 4755-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 4° du E du I du présent article, entrent en vigueur le 20 janvier 2027.
5.2.2. Application dans l'espace
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent article sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite pas de textes d'application. En revanche, un travail sur les mesures réglementaires devant accompagner ces modifications législatives est en cours. Il sera, en effet, nécessaire de prendre les dispositions réglementaires correspondantes afin :
- de supprimer les articles du code du travail devenus sans objet,
- et d'adopter les mesures d'adaptation rendues nécessaires notamment par l'entrée en vigueur du règlement machines.
Le vecteur requis est un décret en Conseil d'Etat.
Article 64 - Mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive 2005/36/CE
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les articles L.413-1 à L.413-5 du Code de l'environnement portent sur les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. L'article L.413-2 porte plus spécifiquement sur le « certificat de capacité » dont les responsables de ces établissements doivent, en règle générale, être titulaires.
La profession de « responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèce non domestique, de vente ou de location, de transit, de présentation au public de spécimens vivants de la faune française et étrangère » correspond aux animaleries, aux laboratoires de recherche travaillant avec des animaux sauvages, aux élevages ouverts au public, aux parcs zoologiques et aux cirques. Ces établissements, qui accueillent des visiteurs en présence d'animaux parfois dangereux, doivent assurer leur sécurité notamment en veillant à ce que les animaux sauvages ne soient pas en contact avec les visiteurs. Le responsable de l'établissement est ainsi chargé d'assurer les soins appropriés (bien-être et santé des animaux), de prévenir les risques de fuite, et de minimiser les dangers pour les soigneurs et visiteurs (sécurité et santé publiques). Cela inclut la mise en place d'installations adaptées, ainsi que des mesures préventives pour éviter les blessures ou évasions, notamment d'animaux dangereux (tigres, lions, loups, ours, primates, éléphants, etc.). Chaque espèce ayant des comportements spécifiques, une connaissance approfondie de leur biologie est indispensable pour concevoir des infrastructures adaptées (par exemple, la profondeur des clôtures, la mise en place de sas d'entrée ou l'épaisseur du vitrage) et ainsi prévenir les accidents ou les évasions.
Depuis les années 2000, près d'une trentaine d'incidents et accidents ont été recensés en France (recensement non exhaustif). Parmi eux, on dénombre la fuite de 8 chimpanzés, au cours de laquelle un employé a été blessé par morsure, ainsi que la fuite d'un gibbon, de wallabies et de tapirs. Deux loups se sont échappés en sautant par-dessus une clôture, et un lion s'est évadé et a mordu et griffé un employé. Par ailleurs, une employée a été tuée par un tigre, un autre a été blessé par une panthère, et une personne a été mordue par un félin.
En application de l'article L.413-2 I du code de l'environnement, un responsable d'établissement doit être titulaire d'un certificat de capacité adapté aux espèces détenues et à l'activité exercée, afin de valider ses compétences pour gérer les espèces concernées.
L'article L.413-2 II du code de l'environnement précise que, dans le cadre de la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne, « les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne [...] sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :
« 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;
2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ».
Ces professionnels « doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes ».
Cette vérification préalable permet de s'assurer de ces compétences et dispense le prestataire de l'obtention du certificat de capacité. La vérification est donc une possibilité, mais elle n'est pas systématique.
La directive 2005/36/CE prévoit un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans l'UE, dans le but général de faciliter, « pour les ressortissants des Etats membres, l'exercice d'une profession dans un autre Etat membre que celui où ils ont acquis leur qualification professionnelle », et ainsi de contribuer à « l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services », l'un des objectifs de l'UE. En particulier, l'article 7, paragraphe 4, de cette directive, dispose que, avant « la première prestation de services [d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE sur le territoire d'un autre Etat membre], dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques (...), l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire (...) », mais que « une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. »
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La législation applicable à la « détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques » (ou relative à la « faune sauvage captive »), établie aux articles L.413-1 A à L.413-14 du code de l'environnement, contribue à la préservation de l'environnement, objectif constitutionnel en application de la Charte de l'environnement de 2004, et dont les principes fondamentaux relèvent du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution.
Enfin, aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La législation sur la faune sauvage captive diffère significativement d'un Etat à l'autre au sein de l'UE. Elle est par ailleurs en constante évolution, notamment pour tenir compte de la montée en puissance des préoccupations de bien-être animal au sein de la société. La législation française a ainsi évolué en France en 2021 avec la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (cette loi n'a cependant pas affecté la disposition concernée par le présent article de loi).
Néanmoins, dans le domaine des parcs zoologiques, les législations des Etats membres ont été harmonisées en application de la directive européenne n° 99-22 du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique : dans ce domaine, compte tenu de la dangerosité de certains animaux et du fait qu'ils sont présentés au public, des dispositions équivalentes à celles de la législation française existent dans l'ensemble de l'Union. Il n'en va pas de même pour l'encadrement des autres cas de détention d'animaux d'espèces non domestiques : différents régimes d'autorisations ou de déclaration existent, mais ils ne correspondent pas nécessairement aux certificats de capacité et aux autorisations d'ouverture, définis respectivement aux articles L.413-2 et L.413-3 du code de l'environnement français.
Il n'existe pas de convention internationale sur le thème de la faune sauvage captive.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans sa lettre de mise en demeure datée du 16 décembre 2024 [INFR(2024)2108 C(2024)8751 final], relative à l'application de l'article 2005/36 CE à un certain nombre de professions, la Commission européenne a estimé que l'article L. 413-2 II du code de l'environnement n'était pas conforme à ladite directive en ce qu'il prévoit la possibilité d'une vérification préalable des compétences professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne responsables d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente ou de location, de transit, de présentation au public de spécimens vivants de la faune française et étrangère.
Elle a ainsi estimé que, pour cette profession, entre autres, « il n'y a[vait] pas d'implications en matière de santé ou sécurité publique, et que, de toute façon, il n'y a[vait] donc pas de risque appréciable pouvant causer de graves dommages aux destinataires de services résultant de l'exercice » de cette profession. Selon la Commission, les professionnels concernés « ne travaillent pas en contact direct avec des personnes ou leurs activités sont de type gestion/vérification/test/protection des animaux sans incidence directe sur la santé ou la sécurité des destinataires de services ».
Ainsi, par la même lettre, la Commission européenne a demandé aux autorités françaises une mise en conformité du droit national avec la directive 2005/36/CE. Dans la mesure où cette mise en conformité ne peut être effectuée qu'à travers une modification de l'article L.413-2 II, elle implique nécessairement un vecteur législatif, tel que le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le Gouvernement reconnaît que la possibilité d'effectuer la vérification préalable prévue à l'article L. 413-2 II du code précité ne se justifie pas systématiquement pour l'exercice temporaire et occasionnel de la profession de responsable d'un établissement d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non-domestiques. Cependant, il estime que cette possibilité de vérification préalable se justifie dans le cas où l'établissement en question héberge des animaux non-domestiques dangereux.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il aurait été envisageable de maintenir l'état actuel du droit en faisant valoir que, contrairement à ce qu'affirme la Commission, toute détention d'animal est susceptible de présenter des enjeux sanitaires et de sécurité plus ou moins importants. Cependant, l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE mentionne « l'évitement des dommages graves pour la santé ou la sécurité des bénéficiaires du service » comme seul motif pouvant justifier la vérification préalable des qualifications professionnelles. Il était donc nécessaire d'adopter une approche proportionnée, tenant compte du degré de gravité des risques sanitaires et sécuritaires liés au manque potentiel de qualification professionnelle du prestataire.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Pour répondre aux griefs de la Commission, le Gouvernement propose donc d'adopter une approche différenciée en fonction de la dangerosité des espèces animales détenues. En limitant le champ de la possible vérification des compétences aux responsables d'établissements hébergeant des animaux dangereux, le mécanisme respecte les deux critères cumulativement exigés par le paragraphe 4 de l'article 7 de la directive 2005/36/CE pour que l'autorité compétente puisse procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services : la profession réglementée a des implications en matière de santé et de sécurité publiques d'une part, et une telle vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire d'autre part (CJUE, 29 juillet 2024, République slovaque, C-773/22, points 69 à 72). En effet, d'une part, la nature de l'activité d'un établissement d'élevage, de vente ou de présentation au public d'animaux non-domestiques dangereux et, partant, la nature de la profession exercée par son responsable, présentent par elles-mêmes des implications directes en matière de santé et de sécurité publiques et, d'autre part, la qualité des qualifications professionnelles du responsable de cet établissement, compte tenu de la dangerosité des animaux concernés, est de nature à permettre d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité des bénéficiaires du service.
L'article L.413-2 modifié par le présent article du projet de loi prévoit que la liste des espèces qui seront considérées comme dangereuses pour son application sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cette liste pourra, le cas échéant, être identique à la liste des animaux dangereux établie par l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie l'article L.413-2 du code de l'environnement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article permet la mise en conformité du droit français avec le droit de l'Union européenne, en l'occurrence l'article 7, alinéa 4, de la directive 2005/36/CE. Il n'impacte aucune autre disposition du droit international ni du droit de l'UE.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Il importe de souligner que la modification législative ne trouvera à s'appliquer que dans des cas extrêmement rares. En effet, le nombre de cas où des ressortissants d'autres pays membres de l'UE déclarent auprès de l'autorité compétente vouloir exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession de responsable de l'un des types d'établissement susmentionnés, et donc le nombre de cas pour lesquels la question de la vérification préalable de la qualification professionnelle se pose, oscille entre zéro et quelques unités par an (zéro en 2024). Son impact macro-économique sera donc nul.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Pour la raison précisée en 4.2.1, l'impact de la modification législative sur les entreprises, qu'il s'agisse des entreprises étrangères susceptibles de bénéficier de la modification, ou des entreprises françaises susceptibles de subir une concurrence accrue de la part des premières, sera de facto négligeable.
4.2.3. Impacts budgétaires
Pour la raison précisée en 4.2.1, l'impact budgétaire de la modification législative, consistant en un allègement du coût administratif de la vérification des qualifications professionnelles, sera de facto négligeable.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS258(*)
Pour la raison précisée en 4.2.1, l'impact de la modification législative sur les services administratifs, consistant en l'instruction d'un moindre nombre de demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles, sera de facto négligeable.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Par le maintien de la possibilité de vérification préalable de la qualification professionnelle des ressortissants étrangers responsables des établissements susmentionnés, en cas de présence d'animaux dangereux, la mesure tient compte des considérations de santé et de sécurité publique.
En outre, il importe de souligner que les ressortissants européens concernés, lorsqu'ils effectueront pour la première fois leur prestation en France, continueront à devoir en informer au préalable l'autorité administrative compétente, et à respecter l'ensemble de la réglementation applicable à la détention des animaux d'espèces non domestiques. Ainsi, malgré l'absence (sauf cas des animaux dangereux) de vérification préalable de leur qualification professionnelle, ils continueront à faire l'objet de contrôles, au même titre que les autres responsables d'établissements analogues.
L'impact de la modification législative sur la société sera donc de facto négligeable.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
L'application de cette disposition permet de rendre le droit français conforme à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en ce qu'elle s'applique aux professions réglementées, comme demandé par la Commission européenne. Elle contribuera à faciliter l'exercice temporaire et occasionnel d'une profession en France, par les citoyens européens ayant acquis leur qualification professionnelle dans d'autres Etats membres. Cependant, pour la raison précisée en 4.2.1, l'impact réel de cette mesure sur les professions réglementées sera de facto négligeable.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Pour la raison précisée en 4.2.1, l'impact potentiel de la modification législative sur l'environnement et le bien-être animal, consistant en un risque accru de prise en charge inapproprié des animaux, lié à l'absence de vérification de la qualification professionnelle des responsables des établissements, sera de facto négligeable.
Comme indiqué au point 4.5.1 ci-dessus, les ressortissants européens concernés, lorsqu'ils effectueront pour la première fois leur prestation en France, continueront à devoir en informer au préalable l'autorité administrative compétente, et à respecter l'ensemble de la réglementation applicable à la détention des animaux d'espèces non domestiques. Ainsi, malgré l'absence (sauf cas des animaux dangereux) de vérification préalable de leur qualification professionnelle, ils continueront à faire l'objet de contrôles, au même titre que les autres responsables d'établissements analogues.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été menée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article sera applicable dans toutes les parties du territoire national où s'appliquent les dispositions du Code de l'environnement : France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucun texte d'application.
Article 65 - Convention du travail maritime
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le droit conventionnel a créé une obligation pour tous les gens de mer d'être médicalement aptes à exercer leurs fonctions en mer. Le droit européen a ajouté à cette obligation le principe de la gratuité du contrôle de cette aptitude. Le droit français a transposé ces textes dans le code des transports.
Le service de santé des gens de mer est le service de l'administration de la mer contrôlant à titre gratuit l'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, selon l'article L 5521-1 du code des transports.
Le service de santé des gens de mer se compose de 77 personnels dont 31 médecins, répartis sur 36 lieux de consultations sur le littoral de métropole et dans les outremers. Ces médecins réalisent plus de 40 000 visites d'aptitude chaque année (44 825 en 2025)259(*).
Les 31 médecins du service sont répartis dans deux statuts différents : le médecin des gens de mer de l'article R. 5545-6-6 du code des transports, placé sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, et le médecin habilité pour une durée déterminée par le ministre chargé de la mer en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation de l'article R. 5545-6-7 du même code.
Le recours à des médecins habilités permet d'effectuer des visites d'aptitude dans les outremers, où le recrutement de médecins est plus ardu. Il permet également une meilleure prise en charge des gens de mer dans les régions où le service est en tension. Le service de santé des gens de mer fait par exemple appel à un médecin habilité sur la Côte d'Azur pour répondre aux demandes de visites d'aptitude du secteur du yachting.260(*)
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
En outre, l'article 88-1 de la Constitution dispose que : « La République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que, tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent d'une exigence constitutionnelle (voir par exemple la décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, la convention du travail maritime de l'organisation internationale du travail crée un socle de normes minimales applicables aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche. La règle 1.2 de cette convention prévoit qu'« aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat médical attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions ».
La gratuité de la visite médicale d'aptitude à la navigation a été implantée au niveau européen par la clause 13 de l'annexe de la directive 199/63/CE du conseil de 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La majorité des Etats membres prévoient la prise en charge des frais de visite médicale d'aptitude à la navigation directement par l'employeur ou leur remboursement par l'employeur dans les cas où le marin fait l'avance des frais (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède...).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La clause 13 de l'accord européen annexé à la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, telle que modifié par la directive 2009/13/CE prévoit que « aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat médical attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions » et « Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ».
Pour mieux se conformer à cette directive, sur la gratuité des visites, la directive européenne prévoit la gratuité de la visite pour le marin, alors que le code des transports impose une prise en charge financière par l'Etat, créant ainsi plus de contraintes que la directive européenne. L'élargissement de l'offre de visites médicales est de nature à fluidifier la gestion des ressources humaines, notamment dans des secteurs maritimes très concurrentiels comme le yachting.
Malgré un maillage territorial important à l'échelle du territoire national, certaines façades maritimes ne disposent pas d'assez de médecins des gens de mer pour absorber le flux des demandes de visites. Il en résulte des difficultés récurrentes pour obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin des gens de mer.
Le service de santé des gens de mer doit aussi prendre en charge des pics de demandes de visites d'aptitude dû à des secteurs à forte saisonnalité. Ce point concerne surtout les ferries (trans-Manche et Corse) et le yachting. La saison du yachting en particulier est très courte et génère une très forte demande de personnels sur un espace géographique restreint, ce qui est répercuté sur l'activité du service de santé des gens de mer.
Par ailleurs, le système d'agrément spécifique requis dans certains cas (notamment petits navires de plaisance), ainsi que le dispositif spécifique prévu pour les gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français ne sont pas opérants et appellent à être modifiés pour gagner en efficacité.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est de clarifier les différents types de visites médicales d'aptitude à la navigation en maintenant le principe de gratuité pour les gens de mer marins et non-marins. Par ailleurs, le projet de loi vise à simplifier la prise de rendez-vous des marins.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Afin de sécuriser la gratuité des visites médicales pour les gens de mer, il est nécessaire de modifier les dispositions législatives du code des transports qui posent le principe de la gratuité des visites d'aptitude médicale des gens de mer. Il n'existe pas d'autres options alternatives que de modifier les dispositions législatives du code des transports.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le principe de gratuité du suivi médical des marins est clarifié en deux temps :
· le II de l'article L. 5521-1 dispose qu'aucun frais ne peut être mis à la charge du marin, disposition applicable dans le cadre d'une visite médicale au service de santé des gens de mer et chez un médecin habilité.
· le 2° du IV de ce même article mentionne une possible prise en charge par l'employeur, uniquement en cas d'une visite médicale assurée par un médecin habilité et selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont compatibles avec la clause 13 de l'accord européen annexé à la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin précitée.
Les modalités du contrôle de l'aptitude médicale à la navigation (par les médecins du service de santé des gens de mer ou par des médecins habilités) sont redéfinies au III de l'article L. 5521-1. Cet article précise par ailleurs les cas de recours à l'habilitation spécifique requise dans certains cas (notamment petits navires de plaisance). Enfin, cet article ne reprend pas le dispositif spécifique prévu pour gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français.
A la place, l'article L. 5521-1-2 donne la possibilité à cette catégorie de personnels de bénéficier du suivi médical de droit commun (assuré par le service de santé des gens de mer et les médecins habilités).
Suivant le même modèle que celui retenu pour l'aptitude à la navigation des marins, l'article L. 5545-13 étend, aux médecins habilités, la compétence pour assurer le suivi médical au poste de travail des marins (jusqu'alors assuré par le seul service de santé des gens de mer).
En concordance avec les modifications apportées précédemment, la rédaction de l'article L. 5545-3 est modifiée pour prendre en compte cette compétence des médecins habilités, en plus de celle, déjà inscrite dans ces articles, du service de santé des gens de mer (ajout de la mention « ou les médecins habilités »).
Enfin, les modifications apportées à l'article L. 5549-1 permettent aux gens de mer autres que marins de bénéficier des mêmes modalités de suivi médical que les marins, à savoir un recours possible au service de santé des gens de mer ou à un médecin habilité.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition modifie les articles suivants du code des transports : les articles L. 5521-1, L. 5521-1-2, L. 5545-3, L. 5545-13 et L. 5549-1.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les présentes dispositions sont conformes avec la clause 13 de la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la directive 2009/13 du 16 février 2009.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les visites d'aptitude à la navigation sont obligatoires, en France et à l'international, pour le maintien des titres et qualifications des gens de mer dont le yachting. Ce secteur est caractérisé par une très forte saisonnalité, une nécessité de réactivité et une concurrence des pays méditerranéens limitrophes du littoral français comme l'Italie et l'Espagne. L'ouverture de prise en charge financière par l'employeur permettra d'augmenter le nombre de médecins habilités et l'offre de visites. La fluidification et l'amélioration des délais d'obtention des certificats d'aptitude médical permettra de maintenir le positionnement des gens de mer français dans ce secteur très concurrentiel.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Ces dispositions créent un coût direct pour les employeurs du milieu maritime quand les visites médicales seront assurées par des médecins habilités.
En contrepartie de ce coût, l'ouverture de nouvelles possibilités d'accès à des visites médicales d'aptitude à la navigation permettra aux armements de sécuriser la gestion des contrats de travail des gens de mer. L'effet attendu est une fluidification de la gestion des ressources humaines de ces entreprises notamment dans des secteurs avec de fortes saisonnalités comme les ferries ou le yachting.
En outre, l'impact financier sur les entreprises est limité par la conservation de la possibilité de visites gratuites au sein du service de santé des gens de mer.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Un effet attendu est une régulation de la charge de travail des médecins des gens de mer en période de fortes demandes de visites d'aptitude grâce à une meilleure répartition de cette charge entre des lieux de consultations plus nombreux. Cette régulation dépendra du nombre de médecins habilités par l'administration.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur les professions réglementées
Le texte permettra un accès facilité à la profession de gens de mer marin.
4.6. Impact sur les particuliers
Sans objet.
4.7 Impacts environnementaux
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCMEFP) a été consultée sur cette mesure le 10 septembre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition est applicable sur l'ensemble du territoire français métropolitain.
S'agissant de l'application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution) ; elle s'applique à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, déterminera les conditions d'application du présent article. Le décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 codifiant les dispositions relatives au suivi et à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer répond à cet objectif et n'appelle pas de modification.
Article 66 - Organisation du temps de travail des gens de mer
1. ÉTAT DES LIEUX
Le droit à un repos annuel sans perte de ressources constitue un droit fondamental consacré par les normes internationales et européennes et mis en oeuvre par la plupart des législations nationales. En vertu de ce droit, les salariés bénéficient chaque année d'un certain nombre de jours de congés pendant lesquels ils reçoivent une indemnité de congés payés à la charge de leur employeur.
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Aux fins de conformité au droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par les jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a consacré le droit d'acquérir des congés payés au titre des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident sans caractère professionnel.
Cette modification de la législation en matière de congés payés intervient postérieurement à deux arrêts du 13 septembre 2023260(*), par lesquels la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d'écarter pour la première fois, dans un litige opposant un employeur privé et son salarié, les dispositions du code du travail considérées non conformes au droit de l'UE au motif qu'elles ne permettent pas l'acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
L'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a également instauré un droit pour les salariés au report des congés qu'ils n'ont pas pu prendre en raison d'une maladie ou d'un accident. Ce délai de report est fixé à 15 mois. Il court à compter de l'information que le salarié reçoit de son employeur sur les congés dont il dispose, postérieurement à sa reprise d'activité. Par dérogation, le délai de report de 15 mois débute à la fin de la période d'acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d'un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu.
Ces règles d'acquisition et de report des droits à congés s'appliquent depuis le 1er décembre 2009.261(*) En outre, il est prévu un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, qui s'impose au salarié qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d'arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.
Les modifications apportées au code du travail par l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 s'appliquent aux gens de mer salariés.
Les gens de mer sont définis comme « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit. » (L. 5511-1 4° du code des transports). En matière de droit du travail, les gens de mer relèvent des dispositions du code du travail, sous réserve des dispositions particulières du code des transports et d'exclusion expresse prévue par le code des transports de l'application aux gens de mer de certaines dispositions du code du travail.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
Le conseil constitutionnel262(*) a reconnu l'existence d'un droit au repos sur le fondement sur le fondement du onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946.
Par une décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024, le Conseil précise la portée du onzième alinéa du préambule de la constitution, il juge que « Le principe d'un congé annuel payé est l'une des garanties du droit au repos ainsi reconnu au salariés »
Par cette même décision, le Conseil constitutionnel a jugé que l'absence de droit à l'acquisition de jours de congés annuels durant une absence pour un motif autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle, n'est pas contraire à la Constitution.
Il a écarté le grief portant sur l'atteinte du droit au repos au motif qu'il reconnait au législateur une marge de manoeuvre pour la mise en oeuvre du droit au repos. En effet, « le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé263(*). »
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, la convention du travail maritime, 2006 de l'organisation international du travail crée un socle de normes minimales applicables aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche. Elle prévoit que les gens de mer ont droit à des congés payés annuels calculés sur la base de 2,5 jours civils par mois d'emploi (Norme A2.4 de la convention du travail maritime).
En outre, le droit de l'Union européenne fixe des normes minimales applicables aux Etats membres en ce qui concerne le droit à congé payé.
En effet, l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose que « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés ».
L'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit un minimum incompressible de quatre semaines de congés payés par an. Il stipule également que cette période minimale de congé annuel ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. La directive 2003/88 est applicable aux gens de mer travaillant à bord des navires de pêche.
La clause 16 de la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, applicable à bord des navires autres que de pêche, prévoit que les congés payés sont calculés sur la base de 2,5 jours civils par mois d'emploi.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a apporté des précisions sur la prise en compte des arrêts maladie pour l'acquisition des congés payés.
A cet égard, la CJUE264(*) a jugé que des dispositions nationales privant le salarié de son droit à congés annuel en raison d'une absence pour maladie de quelque nature que ce soit est contraire au droit de l'Union Européenne. Il en résulte que les périodes d'arrêt maladie même d'origine non professionnelle doivent être assimilées à du temps de travail pour la détermination des droits à congés payés.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La grande majorité des Etats membres prévoient l'acquisition de congés payés pour les salariés en arrêts de travail (Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Autriche, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Roumanie, Suède...) et ne font pas de distinction entre les arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et ceux résultant d'une maladie non professionnelle pour l'acquisition des congés payés (Allemagne, Croatie, Danemark, Espagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Irlande, Suède).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Conformément à la règle d'articulation entre le code du travail et le code des transports ( article L. 5541-1 du code des transports), en l'absence de disposition expresse d'exclusion des dispositions du code du travail ou de dispositions particulières du code des transports en matière d'acquisition de droit à congés payés, les modifications apportées au code du travail octroyant aux salariés des droits à congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail dont l'origine n'est pas professionnelle sont applicables aux gens de mer.
Toutefois, les nouvelles dispositions du code du travail limitant à 2 jours ouvrables par mois et à 24 jours par an les droits à congés payés acquis en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle, prévues à l'article L. 3141-5-1 du code du travail, renvoient à l'article L. 3141-3 du code du travail relatif au droit à congés qui n'est pas applicable aux gens de mer. En effet, le code des transports prévoit une disposition particulière pour les gens de mer en matière de quantum de congés payés qui sont de 3 jours calendaires par mois ( article L. 5544-23 du code des transports)
Le renvoi à l'article L. 3141-3 du code du travail, non applicable aux gens de mer, à l'article L. 3141-5-1 du code du travail constitue une incohérence, source d'insécurité juridique, sur le nombre de droit à congés acquis devant être attribué aux gens de mer en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle.
En outre, la limitation du code du travail est fixée en jours ouvrables alors que les droits à congés des gens de mer sont calculés en jours calendaires.
Ainsi, une adaptation est nécessaire aux fins de sécuriser le nombre de congés payés acquis par les gens de mer au titre des périodes de maladies non professionnelle qui tiennent compte du quantum de congés payés prévu par la directive 1999/63 du 21 juin 1999 et du calcul des jours de congés payés en jour calendaire.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est donc de rendre le droit du travail français conforme au droit de l'UE en adaptant aux gens de mer les dispositions du code du travail relatives au nombre de jours de congés payés acquis en cas de suspension du contrat pour un arrêt de travail d'origine non professionnelle.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
L'adaptation des dispositions du code du travail, aux fins de mise en conformité avec le droit de l'UE des dispositions législatives du code du travail ne laisse pas d'options alternatives. Il est nécessaire pour adapter les dispositions législatives du code du travail de créer des dispositions de niveau législatif dans le code des transports.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La limitation à 2 jours par mois, soit à 24 ouvrables jours par an, prévue par l'article L. 3141-5-1 du code du travail est rendue possible en raison de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qui prévoit un congé payé annuel d'au moins quatre semaines, soit 24 jours ouvrables. Or, la directive 2003/88/CE n'est pas applicable aux gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche (art. 1er paragraphe 3). En effet, en matière de congés payés, ces professions relèvent de la directive 1999/63 dans sa version modifiée par la directive 2009/13 qui prévoit que les gens de mer bénéficient de congés payés annuels calculés sur la base d'un minimum de 2,5 jours civils par mois d'emploi.
Ainsi, les présentes dispositions créent l'article L. 5544-23-2 dans le code des transports qui fixe la durée des congés payés des gens de mer à bord des navires autres que de pêche acquis au titre des périodes d'arrêt de travail d'origine non professionnelle à 2,5 jours calendaires par mois, soit à 30 jours calendaires par an aux fins de se conformer au droit de l'union européenne.
En revanche concernant le secteur de la pêche, les pêcheurs ne relèvent pas de la directive 1999/63 en matière de droit à congés payés mais de la directive 2003/88/CE (4 semaines de congés payés par an) comme les salariés terrestres. Toutefois, les dispositions du code du travail limitant le droit à congés payés fondées sur la directive 2003/88 ne sauraient s'appliquer aux pêcheurs sans adaptation en raison, d'une part, du renvoi à l'article L. 3141-3 relatif au droit à congés payés qui n'est pas applicable aux gens de mer et, d'autre part, du calcul du droit à congés payés qui s'effectue en jours calendaires pour les gens de mer et non en jours ouvrables comme les salariés terrestres.
Par conséquent, les présentes dispositions créent l'article L. 5544-23-3 dans le code des transports qui fixe les droits à congés des pêcheurs à 2,4 jours calendaires par mois et 28 jours par an correspondant à 4 semaines de congés payés tel que prévu par la directive 2003/88. Il s'agit de la conversion en jours calendaires du plafond fixé en jours ouvrables par le code du travail.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition crée deux nouveaux articles dans le code des transports : les articles L. 5544-23-2 et L. 5544-23-3.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les présentes dispositions sont conformes avec l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la clause 16 de la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la directive 2009/13 du 16 février 2009 et à l'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Néant
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Ces dispositions adaptent pour les gens de mer les dispositions du code du travail relatives au nombre des congés payés acquis pendant les périodes d'arrêts d'origine non professionnelle.
Le quantum de congés payés fixé par les présentes dispositions est déjà appliqué par les entreprises d'armement maritime. Ainsi, ces dispositions n'ont pas d'implication financière pour celles-ci.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les présentes dispositions envisagées n'ont pas d'impact direct les finances publiques.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACT SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCMEFP) a été consultée sur cette mesure le 2 juillet 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le nombre de congés payés acquis en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnel pour les gens de mer, prévue par la présente mesure, s'applique depuis le 1er décembre 2009. Il s'agit d'une mesure de cohérence avec l'application dans le temps des dispositions du code du travail, créées par l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 applicable au 1er décembre 2009, qui instaurent pour l'ensemble des salariés y compris les gens de mer l'acquisition de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou maladie sans caractère professionnel applicable aux gens de mer.
Les présentes dispositions limitent les effets de la rétroactivité en tenant compte des congés payés déjà acquis pour déterminer le nombre de congés payés acquis pour arrêt de travail d'origine non professionnel. En effet, pour chaque période de référence mentionnée à l' article L. 3141-10 du code du travail, le nombre de congés payés acquis ne peut excéder le nombre de jours permettant selon le cas aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche de bénéficier de trente jours calendaires de congés, ou aux gens de mer à bord des navires de pêche de bénéficier de vingt-huit jours calendaires, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.
Il est également introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, qui s'impose au salarié qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d'arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.
S'agissant des contrats de travail rompus lors de l'entrée en vigueur de la loi, le texte ne modifie pas les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition est applicable sur l'ensemble du territoire français métropolitain.
S'agissant de l'application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution) ; elle ne s'applique pas à Saint-Barthélemy, ni à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, ni dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
5.2.3. Textes d'application
Ces dispositions ne nécessitent aucun texte d'application.
Article 67 - Extension du principe de l'extraterritorialité des sanctions aux règles relatives aux tachygraphes (paragraphes I et II) et possibilité d'immobilisation de véhicules de transport routier de marchandises lors d'infractions aux règles relatives aux transports de cabotage (paragraphe III)
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
D'une part, concernant les I. et II. du présent article, avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) n°2024/1258 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024, le principe de l'extraterritorialité des sanctions s'appliquait aux seules infractions au règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Les infractions au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes étaient exclues du champ du code pénal ( article 113-6) et du code de procédure pénale ( article 689-12).
D'autre part, s'agissant du III. du présent article, la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances a procédé à la création de deux nouveaux articles au sein du code des transports ( L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2) réprimant le délit de cabotage irrégulier pour les entreprises de transport routier de marchandises. Dans le même temps, la répression de ces faits a été supprimée de l'article L. 3452-7 du même code.
Ainsi, l'article L. 3451-2 du code des transports qui prévoit la possibilité d'immobilisation du véhicule en infraction avec les dispositions de l'article L. 3452-7 n'a pas été modifié en conséquence. Le renvoi aux articles L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2 n'étant pas prévu, l'immobilisation des véhicules en cas de cabotage irrégulier lors d'opérations de transport routier de marchandises est devenue impossible.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi est un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il a été reconnu par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 et précisé dans une décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.
En outre, aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les mesures relèvent de règlements européens et sont appliquées par chaque Etat membre de l'Union européenne à qui il appartient de les traduire dans son régime national de sanctions.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIF POURSUIVI
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
S'agissant des I. et II. du présent article, il est nécessaire de transposer en droit interne l'extension du principe d'extraterritorialité des infractions au règlement (UE) n° 165/2014 relatif aux tachygraphes, conformément à ce que prévoit le règlement (UE) n° 2024/1258 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
Concernant le III. du présent article, il apparaît nécessaire de corriger une erreur de rédaction de l'article L. 3451-2 du code des transports, introduite par l'article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, afin de permettre aux agents de contrôle d'avoir à nouveau la possibilité d'immobiliser les véhicules de transport routier de marchandises, dans les mêmes conditions que les véhicules de transport routier de personnes.
2.2. OBJECTIF POURSUIVI
L'objectif poursuivi par les I. et II. du présent article, est de procéder à l'alignement de la législation nationale sur la rédaction issue de l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 561/2006 qui prévoit la possibilité de sanctionner des infractions commises dans un Etat de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
Par ailleurs, s'agissant du III., l'objectif recherché est de rétablir une disposition qui existait avant la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
S'agissant des I. et II. du présent article, le règlement européen étant d'application directe, il avait été envisagé de ne pas modifier les textes du code pénal et du code de procédure pénale.
S'agissant du III. du présent article, aucune autre option n'a été envisagée au regard de la finalité d'ordre public de la mesure.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Aux fins d'intelligibilité de la loi pénale, il a été décidé de transcrire les dispositions introduites par le règlement (UE) n° 2024/1258 dans l'article 689-12 du code de de procédure pénale et de simplifier l'article 113-6 du code pénal qui apparaissait redondant.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Dans son I. et II., le présent article procède à la modification de l'article 689-12 du code de procédure pénale pour intégrer dans son champ d'application les infractions au règlement (UE) n° 165/2014, relatif aux tachygraphes. Les autorités de contrôle françaises pourront ainsi infliger une sanction à un transporteur ayant commis une infraction à ce règlement sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 113-6 du code pénal est abrogé car redondant avec le nouvel article 689-12 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, dans son III., la présente disposition opère également la modification de l'article L. 3451-2 du code des transports afin d'intégrer la possibilité de procéder à l'immobilisation des véhicules de transport routier de marchandises, de manière analogue à ce qui est actuellement prévu par la règlementation en matière d'immobilisation des véhicules de transport routier de personnes.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Dans son I et II, le présent article vise à transcrire en droit interne les dispositions du règlement (UE) n° 2024/1258 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 s'agissant de l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
S'agissant du III, selon l'article 10 bis du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, « pour mieux faire respecter les obligations établies [...], les États membres veillent à ce qu'une stratégie nationale de contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire ». Par conséquent, l'immobilisation des véhicules de transport routier de marchandises (comme de personnes) en infraction est une mesure autorisée et nécessaire participant au respect des règles sur les transports de cabotage et régulant l'accès au marché du transport international.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet
4.2.2. Impacts sur les entreprises
S'agissant de mesures de contrôle et de sanction, celles-ci n'auront d'impacts que sur les entreprises en infraction. Elles assureront une meilleure équité entre les entreprises en concurrence sur le marché des transports routiers.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les mesures ne créent pas de dépenses nouvelles. Elles sont susceptibles de générer des recettes via la perception d'amendes.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le présent article crée de nouvelles possibilités de sanction des infractions constatées par les agents du contrôle des transports terrestres des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT IdF) ou par les forces de l'ordre.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Même si la profession de transporteur routier est réglementée, les dispositions envisagées n'ont pas d'impact sur les conditions d'accès à la profession.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les mesures permettront de mieux garantir les conditions de travail et les droits sociaux des conducteurs routiers.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire et aucune consultation facultative n'a été menée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les mesures s'appliqueront dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Les mesures s'appliqueront à l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Aucun texte réglementaire d'application n'est nécessaire.
TITRE IX - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'AGRICULTURE, D'ALIMENTATION ET DE PÊCHE
Article 68 - Mesures d'adaptation du code rural et de la pêche maritime au règlement (UE) 2024/1143 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, dit « règlement IG », publié le 23 avril 2024, est applicable depuis le 13 mai 2024.
Ce règlement a notamment pour objet de réunir, dans un même texte, les dispositions relatives aux procédures d'instruction des demandes d'enregistrement des indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, et ainsi de les harmoniser dans une base juridique unique pour les trois secteurs (aliments, vins et spiritueux), lesquels étaient auparavant traités dans trois règlements distincts.
Si le règlement n'apporte pas de modifications majeures au fonctionnement du système des indications géographiques, il instaure une protection accrue des indications géographiques en tant qu'ingrédients, en créant une obligation pour les producteurs de produits transformés de notifier l'utilisation d'une indication géographique dans la dénomination des produits transformés pour lesquels le produit sous indication géographique est un ingrédient.
Il renforce aussi la protection des indications géographiques en ligne, en étendant explicitement son champ d'application aux noms de domaine qui pourraient enfreindre une indication géographique.
Il prévoit par ailleurs la possibilité de modifier temporairement les cahiers des charges concernés dans des cas de « perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l'approvisionnement en matières premières » (article 24).
Ce règlement a aussi instauré, au niveau de l'Union, un système de « groupements de producteurs reconnus » (GPR) inspiré du système français des organismes de défense et de gestion (ODG), chargés, conformément au premier alinéa de l'article L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime, de « la défense et la gestion d'un produit bénéficiant (...) d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie » et du système italien des consortiums, renforçant ainsi le rôle des producteurs dans la gestion de leurs indications géographiques.
Le droit français relatif aux indications géographiques, s'il est en majorité conforme aux dispositions de ce nouveau règlement, doit être adapté pour refléter le champ d'application du système des indications géographiques tel qu'il ressort de cette nouvelle base juridique unique, ainsi que les possibilités données dans le cadre des modifications temporaires des cahiers des charges. Il doit en outre, comme cela est développé ci-après, prendre en compte l'instauration du système des GPR, et sa connexion avec celui existant des ODG.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765 DC, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
La mesure relève du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution, au titre de l'exercice des professions et de l'activité économique liées aux indications géographiques.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le règlement IG constitue la base commune de la réglementation de l'Union européenne relative aux indications géographiques, aux spécialités traditionnelles garanties et aux mentions de qualité facultative.
Il est complété par des définitions et règles spécifiques, pour les indications géographiques relatives aux vins, par les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, dit « règlement OCM », et pour les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, par les dispositions du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008.
Ce règlement prévoit les règles applicables aux données à caractère personnel traitées dans le cadre des procédures qu'il prévoit, en application des règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679.
Les présentes dispositions visent à modifier les articles du CRPM concernés afin de mettre en cohérence le cadre législatif français aux dispositions de ces règlements de l'Union européenne.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le système des GPR, instauré par le règlement IG, est encadré par les dispositions de son article 33, en application duquel les Etats membres peuvent attribuer une reconnaissance aux groupements de producteurs remplissant les conditions prévues à cet article.
Le paragraphe 8 de l'article 33 du règlement IG prévoit que « Si un État membre applique le système des groupements de producteurs reconnus visés au paragraphe 1, il notifie à la Commission, au moyen d'un système numérique, le nom et l'adresse du groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique enregistrée, et il met ces informations à jour en cas de changement. La Commission met ces informations à la disposition du public et met à jour le registre de l'Union des indications géographiques en conséquence. »
Il ressort de la consultation du registre de l'Union des indications géographiques que les autorités italiennes ont reconnu plusieurs GPR. C'est par exemple le cas du Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano.
Cette reconnaissance a pour effet de permettre au groupement de producteurs concerné de mettre en oeuvre les missions réservées aux GPR, telles que prévues par l'article 33 précité.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il résulte des stipulations de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( TFUE) que « Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. / Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. »
Il en résulte que le règlement IG est directement applicable depuis le 13 mai 2024 (cf. art. 97 de ce règlement).
Si, en raison même de la nature des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit communautaire, les dispositions desdits règlements ont, en général, effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu'il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d'application, certaines de leurs dispositions peuvent néanmoins nécessiter, pour leur mise en oeuvre, l'adoption de mesures d'application par les États membres. Tel est le cas des dispositions qui, eu égard à la marge d'appréciation laissée aux Etats membres pour leur mise en oeuvre, ne sauraient conférer aux particuliers des droits en l'absence de mesures d'application.
Le paragraphe 1 de l'article 33 du règlement IG ouvre la faculté aux Etats membres d'appliquer un système de reconnaissance de groupements de producteurs. Une telle disposition ne saurait conférer aux particuliers des droits en l'absence de mesure d'application. Il en va de même, à plus forte raison, du paragraphe 4 du même article qui permet aux Etats membres de prévoir, s'ils le souhaitent, que le GPR est seul habilité à effectuer certaines tâches. L'article 33 du règlement (UE) 2024/1143 appelle donc des mesures d'application.
La section 3 du chapitre II « reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine » du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est consacrée aux organismes de défense et de gestion.
Introduisant cette section, le premier alinéa de l'article L. 642-17 de ce code attribue à ces organismes « la défense et la gestion d'un produit bénéficiant (...) d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ». Le troisième alinéa du même article prévoit qu'ils doivent être reconnus en tant que tels par l'autorité administrative. De plus, les ODG remplissent déjà en France les missions des GPR.
Dès lors, les dispositions relatives aux organismes de défense et de gestion appliquent déjà, à tout le moins partiellement, l'article 33 du règlement (UE) 2024/1143.
Aux termes du paragraphe 7 de l'article 33 du règlement IG : « Les États membres peuvent décider que les groupements de producteurs reconnus au titre du droit national avant le 13 mai 2024 sont reconnus (...) ». Il résulte expressément de ces dispositions que, quand bien même des organismes auraient été reconnus dans des conditions strictement conformes au règlement IG dès avant son entrée en vigueur, une mesure d'application doit être prise pour les qualifier de GPR au sens de l'article 33 de ce règlement.
Il en résulte également, implicitement mais nécessairement et de manière plus générale, qu'une mesure d'application doit expressément qualifier les ODG, quelle que soit la date de leur reconnaissance, de groupements de producteurs reconnus au sens de l'article 33 du règlement. Cette simple mesure aura en particulier pour portée, eu égard à l'effet direct des règlements européens rappelé plus haut, de conférer aux ODG l'ensemble des prérogatives obligatoires des GPR.
Ainsi les dispositions nationales relatives aux ODG doivent être complétées.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 33 du règlement IG : « Les États membres qui appliquent le système visé au paragraphe 1 prévoient les critères suivants pour qu'un groupement de producteurs soit reconnu : / a) une certaine forme juridique ; et b) le respect de l'une des conditions suivantes : / i) une proportion minimale de plus de 50 % des producteurs du produit étant membres ; ou ii) une proportion minimale de producteurs du produit étant membres et une proportion minimale de plus de 50 % en volume ou en valeur de la production commercialisable. / Les États membres peuvent prévoir des critères supplémentaires, tels que : / a) le fait de disposer des contributions financières nécessaires de ses membres ; / b) des règles relatives à l'admission des membres, à l'extinction de la qualité de membre du groupement et au non-respect des obligations qui incombent aux membres ; / c) des statuts écrits ».
Certes, en vertu de l' article L. 642-21 du CRPM, les opérateurs au sens de l'article L. 642-3 de ce code sont tous adhérents de l'ODG. Cet article précise qu'a le caractère d'un tel opérateur « toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ». Dès lors, et dans la généralité des cas, les ODG doivent avoir pour membres, non pas seulement une fraction, mais la totalité des producteurs. A cet égard, le droit national va au-delà des exigences du règlement.
Mais l'article L. 642-21 du CRPM réserve expressément le cas des ODG qui ont le caractère d'une organisation interprofessionnelle.
Or, et d'une part, tant l'article 158 du règlement OCM qui autorise ces organisations interprofessionnelles, que l'article L. 632-1 du CRPM qui adapte sur ce point le droit national au règlement OCM, exigent des organisations interprofessionnelles qu'elles représentent une part significative des activités économiques concernées.
D'autre part, la fraction correspondant à cette part significative n'a pas été précisée par voie réglementaire. La jurisprudence en a une interprétation souple265(*).
Par suite, lorsque l'ODG est également une organisation interprofessionnelle, il n'est pas exigé de lui, en l'état du droit national, qu'il rassemble une proportion minimale de plus de 50 % des producteurs du produit ou une proportion minimale de producteurs du produit représentant une proportion minimale de plus de 50 % en volume ou en valeur de la production commercialisable. Dans cette mesure, les conditions de reconnaissance des ODG ne paraissent pas complètement conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2024/1143.
Dès lors et à tout le moins à l'égard des organisations interprofessionnelles, les dispositions nationales relatives aux ODG doivent être adaptées.
L'article 34 de la Constitution prévoit que : « (...) La loi détermine les principes fondamentaux : / (...) des droits réels et des obligations civiles et commerciales (...) ». Ressortissent ainsi en particulier aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause leur existence même ou qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.
Or le paragraphe 3 de l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 24 du règlement IG prévoient que les GPR peuvent respectivement décider de rendre obligatoires certaines pratiques pour les producteurs de produits sous indication géographique, avoir l'exclusivité du dépôt d'une demande de modification d'un cahier des charges et avoir l'exclusivité du dépôt d'une demande d'annulation d'enregistrement d'une indication géographique.
En outre, les articles 27 et 33 de ce règlement leur assignent de larges missions de gestion des indications géographiques. En particulier, le paragraphe 2 de l'article 27 du règlement crée l'obligation - qui n'existe pas en droit national - pour les producteurs d'une denrée alimentaire préemballée contenant un produit désigné par une indication géographique de notifier au préalable au groupement concerné leur utilisation de cette indication géographique.
Dans ces conditions, l'application de l'article 33 du règlement (UE) 2024/1143 met sans aucun doute en cause, au sens de l'article 34 de la Constitution, l'exercice des professions et de l'activité économique liées aux indications géographiques.
Par suite, il apparaît que les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 33 du règlement (UE) 2024/1143 sont de nature législative. Les présentes dispositions ont donc pour objet de désigner explicitement les ODG en tant que GPR, en assurant le respect, par les organisations interprofessionnelles reconnues en tant qu'organismes de défense et de gestion, des conditions de composition des groupements de producteurs reconnus.
Le législateur européen a entendu, dans le
cadre du règlement (UE) 2024/1143, harmoniser au sein d'un même
acte législatif les procédures de reconnaissance, de modification
et d'annulation des indications géographiques, qui étaient
auparavant prévues respectivement par les règlements n° (UE)
1151/2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires,
n° (UE) 1308/2013 pour les vins et (UE) 2019/787 pour les boissons
spiritueuses.
Cette harmonisation s'est accompagnée d'une évolution du champ d'application des indications géographiques de produits agricoles, lequel couvre, aux termes de dispositions de l'article 5 du règlement, « les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l'aquaculture, inscrits aux chapitres 1 à 23 de la n omenclature combinée figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87, ainsi que les produits agricoles relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du présent règlement, à l'exception du vin et des boissons spiritueuses. »
De plus, contrairement aux précédentes dispositions du droit de l'Union européenne, l'article 10 du règlement (UE) 2024/1143 prévoit explicitement que les modifications éventuelles du cahier des charges dans le cadre de l'instruction nationale de la demande d'enregistrement d'une indication géographique sont « convenues avec le groupement de producteurs demandeurs ».
Les présentes dispositions ont pour objet d'assurer l'adéquation des procédures nationales de reconnaissance des indications géographiques avec les procédures prévues par le règlement (UE) 2024/1143, en modifiant la rédaction des articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2 et L. 641-12 et L. 642-4 du CRPM, afin d'harmoniser leur rédaction et de clarifier leur champ d'application sur la base de celui prévu par le droit de l'Union européenne, et de prévoir la consultation des groupements de producteurs demandeurs quant aux modifications apportées aux cahiers des charges lors de la phase nationale d'instruction des demandes.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le règlement (UE) 2024/1143 vise à accroître l'adoption des indications géographiques dans l'Union et à offrir un niveau de protection plus élevé, en particulier en ligne. Il prévoit notamment une base juridique unique pour les trois secteurs (aliments, vins et spiritueux), qui se traduit par une procédure d'enregistrement unique, un renforcement du rôle des groupements de producteurs (les États membres de l'Union peuvent mettre en place un système volontaire de GPR, habilités à gérer, appliquer et développer leurs indications géographiques), une protection accrue des indications géographiques en tant qu'ingrédients dans les produits transformés et en ligne et une plus grande attention à la durabilité (mise en avant des pratiques de durabilité).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La disposition vise à la mise en conformité avec le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024.
Concernant la mise en oeuvre de l'article 33 de ce règlement, comme développé ci-avant, son paragraphe 1 ouvrant la faculté aux Etats membres d'appliquer un système de reconnaissance de groupements de producteurs, une telle disposition ne saurait conférer aux particuliers des droits en l'absence de mesure d'application.
En outre, ces mesures d'application mettant sans aucun doute en cause, au sens de l'article 34 de la Constitution, l'exercice des professions et de l'activité économique liées aux indications géographiques, il a été jugé nécessaire de modifier les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu vise, concernant les références aux règlements de l'Union européenne et à leur champ d'application, à remplacer les références au règlement (UE) 1151/2012 par des références au règlement (UE) 2024/1143, et en supprimant la référence aux produits agricoles, forestiers, alimentaires ou aux produits de la mer pour maintenir la seule référence au champ d'application du règlement (UE) 2024/1143.
Il prévoit par ailleurs la possibilité de modifier temporairement les cahiers des charges concernés dans des cas de « perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l'approvisionnement en matières premières », afin d'assurer de maintenir, en droit interne, les possibilités données par le règlement (UE) 2024/1443, et notamment son article 24, et assure la conformité de la procédure nationale d'instruction des demandes à l'obligation fixée par le règlement (UE) 2024/1143 de convenir avec les groupements de producteurs demandeurs des modifications apportées aux cahiers des charges.
Les mesures d'adaptation poursuivent les objectifs suivants :
- Concernant la clarification et l'harmonisation des dispositions relatives aux procédures d'instruction des demandes d'enregistrement des indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, et notamment de leur champ d'application, elles semblent nécessaires pour des raisons de clarté.
La référence aux produits agricoles notamment, peut être sujette à interprétation, cette notion étant définie différemment dans le cadre du règlement (UE) n° 1151/2012 et dans le cadre du règlement (UE) 2024/1143 qui l'a remplacé. En effet, le premier faisait référence à l'annexe I du TFUE, quand le second renvoie aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature douanière combinée.
- Concernant la sollicitation de l'avis du groupement de producteurs demandeurs à propos des modifications des projets de cahiers des charges lors de leur instruction, cet avis est, dans les faits, systématiquement sollicité avant l'homologation du cahier des charges. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime ne rend cet avis obligatoire que pour le cas des demandes de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (article L. 641-6).
Le présent article prévoit donc explicitement cet avis pour les demandes de reconnaissance de l'ensemble indications géographiques, en reprenant, aux articles L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, la formule déjà employée à l'article L. 641-6 du même code, qui précise que les produits font l'objet d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité « après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17 ».
- Concernant la reconnaissance des organismes de défense et de gestion en tant que groupements de producteurs reconnus, le règlement (UE) 2024/1143 a introduit une nouvelle obligation pour les producteurs de produits transformés incorporant une indication géographique en tant qu'ingrédient et souhaitant utiliser cette indication géographique dans le nom dudit produit transformé.
Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de l'article 27 de ce règlement : « (...) les producteurs d'une denrée alimentaire préemballée, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1169/2011, contenant en tant qu'ingrédient un produit désigné par une indication géographique, qui souhaitent utiliser ladite indication géographique dans la dénomination de cette denrée alimentaire préemballée, y compris sur la publicité, adressent une notification écrite préalable au groupement de producteurs reconnu lorsqu'un tel groupement existe pour cette indication géographique. Ces producteurs incluent dans cette notification les informations démontrant qu'ils respectent les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, et ils agissent en conséquence. Le groupement de producteurs reconnu accuse réception de cette notification par écrit dans un délai de quatre mois. Le producteur de denrées alimentaires préemballées peut commencer à utiliser l'indication géographique dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée après avoir reçu ledit accusé de réception ou après l'expiration dudit délai, la date la plus proche étant retenue. Le groupement de producteurs reconnu peut joindre audit accusé de réception des informations non contraignantes sur l'utilisation de l'indication géographique concernée. / Les États membres peuvent prévoir, conformément aux traités, des règles de procédure supplémentaires concernant les producteurs de denrées alimentaires préemballées établis sur leur territoire. »
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de notification n'est applicable que lorsqu'un GPR a été reconnu pour l'indication géographique en question. Or, le paragraphe 8 de l'article 33 du même règlement dispose que la Commission européenne met à disposition du public le nom et l'adresse du GPR pour chaque indication géographique enregistrée après que l'Etat membre lui ait notifié.
Il s'ensuit que l'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 27 précité ne peut faire l'objet d'une mise en oeuvre effective pour les indications géographiques françaises qu'une fois que la France aura notifié à la Commission le nom et l'adresse de l'ensemble de ses organismes de défense et de gestion, reconnus préalablement en tant que groupements de producteurs reconnus.
Afin qu'il n'existe pas de différence de traitement entre les ODG français et les GPR dans d'autres Etats membres, il est nécessaire de désigner ces ODG en tant que GPR.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Au sein du CRPM, les articles L. 641-5, L. 641-8, L. 641-10, L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-12, L. 641-16, L. 642-1, L. 642-2, L. 642-4, L. 642-4-1, L. 642-13, L. 642-17 et L. 642-19 sont modifiés. L'article L. 641-11-2 est abrogé. Le présent article crée un article L. 692-4 s'agissant de l'application à Saint-Barthélemy.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Ces dispositions assurent la mise en conformité avec le règlement IG et permet la mise en oeuvre des dispositions de l'article 33 de ce règlement en prévoyant la reconnaissance des ODG en tant que GPR.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Concernant la reconnaissance des ODG en tant que GPR, le règlement (UE) 2024/1143 a introduit une nouvelle obligation pour les producteurs de produits transformés incorporant une indication géographique en tant qu'ingrédient et souhaitant utiliser cette indication géographique dans le nom dudit produit transformé.
Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de l'article 27 du règlement : « (...) les producteurs d'une denrée alimentaire préemballée, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1169/2011, contenant en tant qu'ingrédient un produit désigné par une indication géographique, qui souhaitent utiliser ladite indication géographique dans la dénomination de cette denrée alimentaire préemballée, y compris sur la publicité, adressent une notification écrite préalable au groupement de producteurs reconnu lorsqu'un tel groupement existe pour cette indication géographique. Ces producteurs incluent dans cette notification les informations démontrant qu'ils respectent les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, et ils agissent en conséquence. Le groupement de producteurs reconnu accuse réception de cette notification par écrit dans un délai de quatre mois. Le producteur de denrées alimentaires préemballées peut commencer à utiliser l'indication géographique dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée après avoir reçu ledit accusé de réception ou après l'expiration dudit délai, la date la plus proche étant retenue. Le groupement de producteurs reconnu peut joindre audit accusé de réception des informations non contraignantes sur l'utilisation de l'indication géographique concernée. / Les États membres peuvent prévoir, conformément aux traités, des règles de procédure supplémentaires concernant les producteurs de denrées alimentaires préemballées établis sur leur territoire. »
Cette obligation étant prévue par un règlement de l'Union européenne, elle est d'application directe pour l'ensemble des producteurs de denrées alimentaires préemballées de l'Union européenne. Toutefois, la reconnaissance des ODG français en tant que GPR aura pour objet d'étendre cette obligation à l'utilisation comme ingrédients des indications géographiques françaises.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Il résulte des dispositions de l'article R. 642-34 du CRPM que « La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité national compétent pour le produit en cause. »
Toutefois, la présente disposition prévoyant directement la reconnaissance des ODG en tant que GPR, elle n'a pas pour effet de rendre une nouvelle reconnaissance nécessaire, et n'a donc pas d'impact sur les services administratifs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 5 septembre 2025.
L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a été consulté de manière informelle et a donné son avis sur la rédaction de la présente disposition.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 est applicable depuis le 13 mai 2024.
La présente disposition entrera en vigueur lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Application de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
Concernant l'application à Saint-Martin, il résulte des dispositions de l'article L. 693-1 du code rural et de la pêche maritime que « Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. »
En l'absence d'exception ou d'adaptation concernant le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les dispositions législatives relatives aux indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties sont applicables à Saint-Martin.
Concernant l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, il résulte des dispositions de l'article L. 694-1 du code rural et de la pêche maritime que « Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. »
En l'absence d'exception ou d'adaptation concernant le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les dispositions législatives relatives aux indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Concernant l'application à Saint-Barthélemy, il résulte des dispositions de l'article L. 692-2 du code rural et de la pêche maritime que « Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. »
En l'absence de dispositions contraires, les dispositions législatives relatives aux indications géographiques protégées et spécialités traditionnelles garanties ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. De surcroît, Saint-Barthélemy relève en droit de l'Union européenne de la catégorie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), dans lesquels le droit de l'Union est en principe inapplicable.
Toutefois, en l'état actuel du droit, les dispositions relatives aux appellations d'origine contrôlée (articles L. 641-5 et suivants) sont applicables à Saint-Barthélemy, ne faisant pas référence au droit de l'Union européenne.
Or, la modification apportée à l'article L. 641-5 par la présente disposition a pour effet d'y introduire une référence au droit de l'Union européenne, ce qui aura pour effet de la rendre inapplicable à Saint-Barthélemy en application des dispositions de l'article L. 692-2 précité.
Aussi, afin de ne pas supprimer la possibilité de reconnaître, pour Saint-Barthélemy, des appellations d'origine contrôlée, il est proposé d'introduire, au chapitre II du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime un nouvel article prévoyant que « Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 641-5 est ainsi rédigé : / Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.».
L'introduction des dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy susmentionnées a pour effet de rendre obligatoire la consultation du conseil territorial de Saint-Barthélemy en application du 1° de l'article LO 6213-3 du code général des collectivités territoriales.
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse d'applicabilité.
En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse d'applicabilité. Le Conseil d'Etat rattache le droit de la consommation et le droit de la propriété intellectuelle - matières dont relèvent les indications géographiques - au droit des obligations civiles et au droit commercial, matières qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.
De surcroît, ces territoires relèvent en droit de l'Union européenne de la catégorie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), dans lesquels le droit de l'Union est en principe inapplicable.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article de requiert pas de texte d'application
Article 69 - Modification du code de la propriété intellectuelle pour mettre en cohérence la durée des certificats nationaux d'obtention végétale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Dans l'Union européenne, les variétés nouvellement créées peuvent être protégées intellectuellement par un certificat d'obtention végétale (COV)266(*). Ce certificat confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
L'article L.623-2 du code de propriété intellectuelle (CPI), indique qu'une variété végétale peut faire l'objet d'un COV et partant, être certifiée « obtention végétale », si :
- elle est nouvelle et qu'elle se distingue des autres variétés considérées comme notoirement connues ;
- elle est suffisamment homogène dans ses caractéristiques ;
- elle est stable au regard de sa définition initiale malgré les cycles de reproduction ou de multiplication successifs ou particuliers.
L'examen DHS (distinction, homogénéité et stabilité) est réalisé à l'aune de ces critères. Le certificat d'obtention végétale peut avoir une portée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne s'il est délivré par l'Office communautaire des variétés végétales, ou simplement sur le territoire d'un Etat membre s'il est délivré par un office national chargé des COV. Une variété peut être protégée par plusieurs COV nationaux. Une protection communautaire n'est pas cumulable avec une protection de niveau national. L'effet d'une protection nationale pour la même variété est suspendu pendant toute la durée de la protection communautaire.
La durée de la protection est fixée à 25 ou 30 ans selon les espèces. Pour les espèces à cycle de développement rapide, la durée est fixée à 25 ans. Pour les espèces à cycle de développement plus lent, les espèces ligneuses notamment, pour lesquelles les travaux de sélection sont plus longs, il s'agit de 30 ans.
Au niveau de l'Union européenne, le règlement (UE) 2021/1873 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 a augmenté la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, afin de tenir compte des difficultés techniques liées à la sélection de ces espèces. Jusqu'à ce règlement, la durée de la protection nationale était alignée sur celle communautaire. Il est fait le choix d'aligner de nouveau la durée des titres nationaux de protection des variétés végétales sur la durée de protection communautaire.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « (l)a loi détermine les principes fondamentaux : / (...) - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». A ce titre, le dispositif envisagé relève du domaine de la loi.
Le Conseil constitutionnel reconnait de façon constante qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi267(*).
Dans ce cadre, le dispositif prévoit d'allonger la durée de la protection de l'obtention végétale pour certaines variétés. Ce faisant, il étend la durée du droit exclusif détenu par le titulaire du certificat. Il porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre.
Néanmoins, la sauvegarde de la propriété intellectuelle constitue un objectif de valeur constitutionnelle268(*) et l'allongement de la durée de la protection est calquée sur celle de la protection communautaire. Cette atteinte est donc justifiée et proportionnée.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'Union européenne a choisi de baser son système de protection des obtentions végétales sur le système prévu par la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), de sorte de disposer d'un système sui generis reconnu au niveau international. L'ensemble des Etats membres de l'Union européenne sont membres de l'UPOV.
Le règlement (CE) n° 2100/94 précité a institué un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Il s'appuie sur les règles définies par la Convention de l'UPOV269(*) et charge l'Office communautaire des variétés végétales de la mise en oeuvre et l'application du régime communautaire.
En France, la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale a permis d'actualiser de la législation nationale en matière d'obtention végétale, en tenant compte des modifications qui avaient été apportées en 1991 à la Convention UPOV et du règlement (CE) n° 2100/94 précité. La rédaction du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie législative du CPI, relatif aux obtentions végétales, est issue de cette loi.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Plusieurs Etats membres de l'Union européenne, par exemple les Pays-Bas, ont d'ores et déjà aligné la durée de leur protection nationale sur la durée de protection communautaire.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La durée de la protection nationale des obtentions végétales étant fixée par l'article L. 623-13 du CPI, la modification à apporter est de nature législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle afin d'aligner le droit français sur les règlements (CE) n° 2100/94 et (UE) 2021/1873 précités concernant la durée de la protection des obtentions végétales.
Un tel alignement vise à préserver l'attractivité du dispositif de COV français pour la protection de variétés intéressant avant tout le marché national. Cela permettra d'éviter les surcoûts inutiles pour des opérateurs exerçant en France qui se tourneraient vers le COV européen au lieu du COV national uniquement pour des raisons de durée de la protection.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La durée de la protection nationale des obtentions végétales étant fixée par l'article L. 623-13 du CPI, il n'y a pas d'autre option que d'apporter une modification législative.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est fait le choix de de modifier l'article L. 623-13 du CPI afin d'aligner le droit français sur les règlements (CE) n° 2100/94 et (UE) 2021/1873 précités concernant la durée de la protection des obtentions végétales.
En effet, l'article L. 623-13 du CPI prévoit :
- la durée de la protection conférée par un certificat d'obtention végétale est de vingt-cinq ans à compter de la délivrance du certificat ;
- pour certaines plantes telles que les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, la vigne, ainsi que les plantes à multiplication végétative, la durée de protection est étendue à trente ans.
Cet article précise donc la durée pendant laquelle le titulaire du certificat bénéficie de droits exclusifs de production et d'introduction sur le territoire français et de vente de la variété végétale protégée, en différenciant selon les espèces végétales la durée de cette protection, adaptée à leur cycle biologique.
Ce cadre fixe un équilibre entre la reconnaissance des droits d'obtention et la nécessaire limitation temporelle pour ne pas entraver indéfiniment l'utilisation des variétés dans l'intérêt général.
Cependant, le règlement (UE) 2021/1873 précité a étendu le champ d'application de la protection des obtentions végétales à l'espèce Asparagus officinalis L. ainsi qu'aux groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales. Le second alinéa de l'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle doit être modifié afin de permettre à ces espèces de jouir d'une durée de protection fixé à 30 ans.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle est modifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées permettent d'aligner le droit français sur les règlements (CE) 2100/94 et (UE) 2021/1873 précités concernant la durée de la protection des obtentions végétales. Ces modifications sont conformes à la Convention internationale UPOV de 1991, qui ne fixe que des durées minimales du droit d'obtenteur : celles-ci sont de 20 ans pour la quasi-totalité des espèces végétales et de 25 ans pour les vignes et les arbres. Sur la base de ces minima, les Etats peuvent prévoir des durées de protection plus longues.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les entreprises de sélection travaillant sur l'espèce Asparagus officinalis L. et sur les groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales pourront bénéficier d'une protection supplémentaire de 5 ans (30 ans au lieu de 25 ans).
Les entreprises doivent s'acquitter d'une redevance annuelle pendant toute la durée de validité du certificat. Elles devront donc le faire pendant 5 ans supplémentaires si elles souhaitent bénéficier de cette durée supplémentaire. Elles peuvent néanmoins renoncer à leur droit quand elles le souhaitent.
Actuellement, pour les espèces concernées par l'extension de la durée de protection, environ 200 COV nationaux sont actifs, essentiellement pour des rosiers et des chrysanthèmes. Ces COV concernent 39 entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La prorogation de la durée de validité des COV sera mise en oeuvre par l'organisme chargé de leur délivrance, à savoir l'Instance nationale des obtentions végétales (INOV). S'agissant de 200 COV actifs, l'impact est considéré comme négligeable.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure contribue indirectement à la durabilité et à la résilience des cultures. En effet, l'allongement de la durée de la protection vise à encourager les investissements dans la recherche et le développement portant sur les variétés de cette espèce et de ces groupes d'espèces, contribuant ainsi à favoriser les activités de sélection visant à développer de nouvelles variétés afin de répondre aux défis que doit relever l'agriculture, notamment les conséquences du changement climatique, et aux attentes des consommateurs 270(*).
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. La durée de la protection, mentionnée à l'article L. 623-13 du CPI, des certificats d'obtention végétale délivrés avant la promulgation du présent projet de loi pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales est prorogée de cinq ans.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) sans adaptation particulière.
Il s'applique également à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, qui relèvent du principe d'identité législative pour la matière traitée par le présent article, sans nécessité d'adaptation.
En l'état du droit, l'article L. 623-13 du CPI est applicable aux îles Wallis et Futuna, en vertu de l'article L. 811-1-1 du même code. Afin que la modification issue du présent article soit également applicable dans cette collectivité, il convient d'ajouter une mention d'applicabilité de l'article L. 623-13 résultant du présent projet de loi à l'article L. 811-1-1. De même, pour que la prorogation de la durée des COV délivrés avant la promulgation du présent projet de loi prévue au II du présent article soit rendue applicable aux îles Wallis et Futuna, il convient de le prévoir expressément.
La présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article modifié étant rendu applicable par L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle.
En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, le III de l'article 21 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a prévu que l'Etat était compétent jusqu'au transfert de la compétence de droit commercial à la Nouvelle-Calédonie. Et la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil et de droit commercial, adoptée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, prévoit que la Nouvelle-Calédonie est désormais compétente en matière de propriété industrielle, dont fait partie la propriété intellectuelle.
L'Etat n'est donc plus compétent en matière de propriété industrielle et le présent article ne peut être rendu applicable dans ce territoire. En revanche, dès lors que la Nouvelle Calédonie n'a pas adopté de dispositions régissant la propriété intellectuelle, il convient de modifier l'article L. 811-1 pour prévoir que l'article L. 623-13 du code de propriété intellectuelle demeure applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version antérieure à la présente modification.
Le présent article n'est pas applicable en Polynésie française, l'Etat n'étant pas compétent dans la matière dans cette collectivité.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 70 - Contrôle des pêches
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le titre IV du livre IX du CRPM édicte un ensemble de dispositions qui, d'une part, permettent de contrôler le respect de la règlementation prévue par les dispositions de ce livre et par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche (PCP), et, d'autre part, fixent le régime des sanctions pénales et administratives encourues en cas de manquements à ces réglementations.
Le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la politique de contrôle des pêches au sein de l'Union européenne établit un nouveau cadre juridique commun en matière de contrôle des pêches au sein de l'Union européenne.
Son adaptation en droit interne nécessite de modifier le titre IV du livre IX du CRPM.
L'objectif principal du règlement (UE) 2023/2842 est de renforcer l'efficacité de la PCP en introduisant :
- une meilleure surveillance des activités de pêche grâce à l'utilisation accrue d'outils numériques et de technologies de suivi ;
- une traçabilité renforcée des produits halieutiques ;
- un cadre harmonisé en matière de sanctions, garantissant un traitement équitable et dissuasif des infractions à la réglementation européenne ;
- une coopération accrue entre les États membres et les institutions de l'Union afin d'assurer un contrôle homogène et efficace.
Ce règlement est entré en vigueur le 10 janvier 2024. Toutefois, certaines dispositions, en particulier celles relatives au nouveau régime de sanctions applicables en cas d'infractions à la PCP, bénéficieront d'un délai d'adaptation et ne s'appliqueront qu'à compter du 10 janvier 2026.
En effet, le règlement (UE) 2023/2842 vient modifier le règlement (CE) n° 1224/2009 afin de mettre à jour et de renforcer le régime de contrôle des pêches. Il permet notamment de rendre électroniques les outils de surveillance afin d'en optimiser leur utilisation et de renforcer les systèmes de sanctions administratives des Etats membres.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 88-1 de la Constitution dispose que : « La République participe aux communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que, tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent d'une exigence constitutionnelle (voir par exemple la décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3).
Le présent article a pour objet d'adapter le droit interne aux modifications du droit de l'Union européenne opérées par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023.
Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition271(*).
Et le Conseil constitutionnel s'assure de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue272(*).
Le projet de loi n'établit que des peines strictement et évidemment nécessaires. En modifiant l'article L. 945-4 du CRPM afin de préciser les sanctions applicables aux manquements à la réglementation relative à la pêche et l'article L. 945-5 du CRPM en précisant les peines complémentaires applicables aux personnes coupables d'une infraction, le projet de loi n'institue pas de peine manifestement disproportionnée.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En vertu des dispositions combinées du d) du paragraphe 1 de l'article 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du d) du paragraphe 2 de l'article 4 du TFUE, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, qui fait l'objet d'une compétence exclusive de l'Union, cette dernière dispose d'une compétence partagée avec les Etats membres dans le domaine de la pêche.
L'article 38 du TFUE dispose que « 1. L'Union définit et met en oeuvre une politique commune (...) de la pêche. (...) ».
Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 43 du TFUE : « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (...), établissent (...) les (...) dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. (...) ».
Afin de garantir le caractère durable de la pêche, a été adopté le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et le Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, dit règlement PCP.
Le régime de contrôle du règlement PCP est prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. L'objectif est de disposer d'un système de contrôle général cohérent sur toute la chaîne de production et de commercialisation pour garantir le respect du règlement PCP, du producteur jusqu'à la dernière mise en marché.
En parallèle, le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008, dit règlement INN, définit les règles destinées à prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (qualifiée de pêche « INN ») afin de ne pas compromettre l'exploitation durable des ressources halieutiques.
Toutefois, les règlements (CE) n° 1224/2009 et (CE) n° 1005/2008 ont été adoptés avant l'adoption du règlement PCP du 11 décembre 2013.
Dans ces conditions, le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 vient notamment modifier ces deux règlements afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l'application de la politique commune de la pêche déterminées par le règlement (UE) n° 1380/2013273(*).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 96 du règlement (CE) n° 1224/2009 fixe les principes généraux selon lesquels la Commission contrôle et évalue l'application des règles de la politique commune de la pêche par les Etats membres. L'article 118 du même règlement prévoit, quant à lui, que, tous les cinq ans, les Etats membres transmettent à la Commission un rapport sur l'application de ce règlement. Sur la base des rapports des Etats membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les cinq ans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil.
Et la Commission est particulièrement vigilante quant à l'efficacité des régimes de sanction applicables en matière de pêche des Etats membres.
Dans ce contexte, les présentes dispositions ont non seulement pour objet d'adapter le droit national aux nouvelles règles issues du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023, mais également d'assurer une meilleure efficacité des politiques de contrôle et de sanction applicables en matière de pêche.
En premier lieu, le règlement (UE) 2023/2842 a modifié l'article 91 du règlement (CE) n° 1224/2009 en vue d'adapter le régime applicable aux mesures exécutoires d'office qui doivent être prises par les Etats membres en cas d'infraction grave.
Aux termes de cet article : « 1. Lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu'une personne physique a commis une infraction grave ou qu'une personne morale est responsable d'une infraction grave, ou lorsqu'une personne physique est prise en flagrant délit d'infraction grave, les États membres, en plus d'ouvrir une enquête sur l'infraction en vertu des dispositions de l'article 85, prennent immédiatement, conformément à leur droit national, les mesures pertinentes et immédiates qui s'imposent, telles que : / (...) / b) le rappel du navire de pêche vers un port ; (...) / f) la restriction à la mise sur le marché de produits de la pêche ou l'interdiction de celle-ci ; (...) ».
Le présent article du projet de loi entend modifier l'article L. 943-1 et l'article L. 943-8 du CRPM pour introduire ces deux nouvelles mesures conservatoires de déroutement du navire vers un port avec l'accord du capitaine et d'interdiction ou de restriction de vente des produits de la pêche.
En deuxième lieu, le règlement (UE) 2023/2842 modifie l'article 13 du règlement (CE) 1224/2009 afin d'imposer aux Etats membres de s'assurer que certains navires soient équipés d'un système de surveillance électronique à distance.
Et de nombreuses dispositions prises pour l'application du règlement PCP n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 imposent des obligations de suivi scientifique et l'emport de dispositifs techniques.
A titre d'exemple, l'article 12 du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017274(*) impose aux capitaines de navire d'accueillir les observateurs scientifiques chargés de la mise en oeuvre du plan de travail national275(*) ou de collecter les données selon les méthodes établies par ce plan. De même, le règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 prévoit l'obligation de disposer, à bord du navire, d'observateurs scientifiques ou de dispositifs électroniques de contrôle à distance, ainsi que l'obligation de permettre l'échantillonnage des captures à des fins scientifiques276(*). Et l'arrêté du 13 décembre 2024 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français prévoit également l'obligation de collecter des données scientifiques relatives aux captures accidentelles de cétacés.
En outre, l'article 39 bis du règlement (CE) n° 1224/2009, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2023/2842 et le paragraphe 1 de la partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 2019/1241 du 20 juin 2019277(*) créent, dans les cas qu'ils prévoient, respectivement l'obligation d'être équipé d'un dispositif de contrôle continu de la puissance du moteur et d'un dispositif de dissuasion acoustique. Et l'arrêté du 13 décembre 2024 précité prévoit également l'obligation d'être équipé d'un dispositif de dissuasion acoustique.
Dans ce contexte, le présent article modifie l'article L. 945-4 du CRPM afin de préciser qu'est puni de 22 500 euros d'amende le fait de ne pas se conformer aux obligations de collecte, de contrôle ou de suivi scientifiques requises par les dispositions du livre IX du CRPM, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la PCP et par les textes pris pour leur application, et le fait de ne pas se conformer à l'obligation d'équipement d'un système de surveillance électronique à distance ou de dispositifs de contrôle de la puissance du moteur ou de dissuasion acoustique.
En troisième lieu, l'article 91 ter du règlement (CE) n° 1224/2009 modifié par le règlement (UE) 2023/2842 régit les sanctions accessoires pouvant être prononcées en cas de manquements à la réglementation européenne.
Aux termes de cet article : « 1. Les sanctions prévues aux articles 89, 89 bis et 91 bis peuvent être assorties d'autres sanctions, et notamment : / (...) / e) l'exclusion du droit à obtention de nouveaux droits de pêche ; / (...) / ; g) la suspension ou le retrait du statut d'opérateur économique habilité accordé en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008 ; / h) le retrait du navire de pêche du fichier national ; (...) ».
Ainsi, le présent article propose de modifier l'article L. 945-5 du CRPM afin de prévoir que ces peines complémentaires sont applicables aux personnes coupables d'une infraction.
En quatrième lieu, en vertu du 1° de l'article L. 946-1 du CRPM, l'autorité administrative peut prononcer une amende administrative égale au plus : « a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. (...) ».
Ce renvoi à un décret en Conseil d'Etat ne se justifie pas compte tenu, d'une part, du caractère technique des modalités de calcul en cause. D'autre part, la disposition législative permet, à elle seule, à l'autorité compétente de calculer la valeur des produits, en se fondant sur les prix du marché national indiqués par FranceAgriMer sur le lien suivant : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?SAINOMPRODUIT et en utilisant, quand elles sont disponibles, les factures et notes de vente fournies par les intéressés. Au surplus, en cas d'amende sanctionnant des faits correspondant à une « infraction grave » au sens du règlement 1224/2009, le paragraphe 5 de l'article 91 bis du règlement 1224/2009, dans sa version issue du règlement 2023/2842, dispose que « Pour calculer la valeur des produits de la pêche ou de l'aquaculture obtenus à la suite de l'infraction grave, les États membres prennent en compte les prix nationaux en première vente, les prix relevés sur les principaux marchés internationaux pertinents pour l'espèce et la zone de pêche concernée ou les prix de la plateforme de l'Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA) au moment où l'infraction a été commise. »
Ainsi, le présent article prévoit de modifier l'article L. 946-1 en vue de supprimer le renvoi de la définition des modalités de calcul par décret en Conseil d'Etat.
En cinquième lieu, il résulte des articles 89 bis et 91 bis du règlement (CE) n° 1224/2009 que les Etat membres doivent veiller à ce que les sanctions, qu'elles soient administratives ou pénales, soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par suite, cet article modifie les articles L. 951-9 et L. 951-10 du CRPM pour adapter les règles contentieuses applicables en Guyane et permettre au juge des libertés et de la détention d'ordonner, sous certaines conditions, la destruction en mer des embarcations qui ont servi à commettre des infractions lorsque ni le propriétaire de l'embarcation ni une personne ayant des droits sur elle ne sont connus.
En effet, la pêche illicite (dite également « pêche INN ») constitue en Guyane un enjeu de taille et représente l'une des menaces les plus graves pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche et des efforts déployés à l'échelle internationale en faveur d'une meilleure gouvernance des océans.
Ainsi, en Guyane, sur la période 2019-2023, l'effort de pêche INN total des navires étrangers, calculé en kilomètres de filet déployés, représenterait entre 0,7 et 3 fois l'effort de pêche légal local, selon les hypothèses « faible » et « forte » formulées sur les longueurs de filet INN. Sur cette même période, la production INN totale des navires étrangers est estimée entre 0,7 et 4 fois la production des navires légaux locaux, selon les hypothèses « faible » et « forte » formulées sur les rendements INN278(*). Sur cette même période, la production totale de la pêche INN, quant à elle, est estimée entre 1446 tonnes et 9073 tonnes279(*). La pêche INN des navires étrangers a donc un fort impact sur les pêcheries locales légales, les ressources halieutiques exploitées (ex. : acoupa rouge) mais aussi sur les habitats et les autres espèces non ciblées (mammifères marins, tortues luth).
Compte tenu de ces éléments, il est essentiel de renforcer le dispositif de répression de la pêche illégale en Guyane.
Enfin, cet article du projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à introduire par voie d'ordonnance des dispositions permettant, d'une part, de rendre applicable la procédure d'amende forfaitaire à certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, d'instituer un régime de transaction pénale pour certains de ces délits.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à renforcer la surveillance et le contrôle en vue d'assurer le respect de la PCP, ainsi qu'à mettre en conformité le droit national avec le droit européen, à dissuader de commettre des manquements à la réglementation relative à la pêche et à protéger durablement les ressources.
L'habilitation prévue par le II a pour objet d'introduire des mesures recourant à la procédure de l'amende forfaitaire et à la transaction pénale pour réprimer les délits correspondant aux infractions au sens des articles 89 bis et 91 bis du règlement (CE) n° 1224/2009, dans leur version issue du règlement (UE) 2023/2842 du 22 novembre 2023.
La procédure de l'amende forfaitaire contraventionnelle, créée par le décret-loi du 28 décembre 1926, a été intégrée dans le code de procédure pénale (CPP) en 1958. Elle permet d'apporter une réponse pénale simplifiée aux contentieux de masse par la verbalisation immédiate et automatique de certaines infractions, que le contrevenant pourra contester devant le juge sous certaines conditions.
Cette procédure peut ainsi être analysée comme une procédure de transaction : lorsque le contrevenant paie l'amende, dont le montant est inférieur au maximum légal encouru, l'action publique est éteinte sans qu'il y ait recours au juge.
Le recours à la forfaitisation a pour objectif d'offrir une réponse pénale rapide, plus simple et plus efficace dans un certain nombre de procédures se rapportant à des infractions de faible gravité, aisément constatables en matière de pêche. Elle permet une répression immédiate des faits en cause, qui sont actuellement peu poursuivis par les ministères publics. Cette voie de poursuite est adaptée aux circonstances de commission des délits prévus en matière de pêche, les faits en cause ayant lieu en mer et pouvant être aisément constatables.
La procédure de l'amende forfaitaire présente l'avantage d'apporter une réponse pénale plus systématique dans certains contentieux de masse pour lesquels l'intervention du juge pénal n'apparaît pas possible, tout en préservant le droit au recours effectif par la possibilité de porter une réclamation ou une requête en exonération.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le règlement européen laisse peu de marge d'adaptation aux Etats membres sur les points repris dans cet article du projet de loi.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Afin d'adapter le droit national au droit de l'Union européenne, le I. du présent article modifie le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime (CRPM) de la façon suivante :
- l'article L. 942-1 est modifié en vue de permettre à tous les agents publics affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes de constater et rechercher les infractions à la réglementation relative à la pêche ;
- les articles L. 943-1 et L. 943-8 sont modifiés en vue d'élargir les pouvoirs des autorités compétentes en leur permettant, à titre de mesures conservatoires, d'ordonner le rappel au port avec l'accord du capitaine et de restreindre ou interdire la vente de certains produits de la pêche ;
- l'article L. 945-4 est modifié en vue de prévoir qu'est puni de 22 500 euros d'amende le fait de ne pas se conformer aux obligations de collecte, de contrôle ou de suivi scientifique et de ne pas se conformer aux obligations d'équipement d'un système de surveillance électronique à distance ou de dispositifs de contrôle de la puissance du moteur ou de dissuasion acoustique ;
- l'article L. 945-5 est modifié en vue d'élargir les peines complémentaires prononcées à l'encontre des personnes coupables d'une infraction. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'obtenir de nouveaux droits de pêche, d'une suspension ou d'un retrait du statut d'opérateur économique habilité prévu par le règlement (UE) n° 1005/2008 et du retrait du navire de pêche en cause du fichier national ;
- l'article L. 946-1 est modifié en vue de supprimer le renvoi par décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités de calcul de l'amende administrative qu'il institue ;
- les articles L. 951-9 et L. 951-10 sont modifiés en vue de prévoir que, en Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, s'il constate que ni le propriétaire de l'embarcation ni une personne ayant des droits sur elle ne sont connus, ordonner la destruction de l'embarcation en mer s'il n'est pas possible de procéder à sa destruction à terre dans un lieu situé à proximité ; et que l'appel contre cette décision n'est pas suspensif.
Le II du présent article sollicite une habilitation à procéder par ordonnance pour rendre applicables la procédure d'amende forfaitaire et la procédure de transaction pénale à certains délits prévus au livre IX du CRPM.
L'habilitation permettra d'introduire une voie de poursuite simplifiée pour réprimer les délits en matière de pêche et garantir une meilleure efficacité des politiques de contrôle et de sanction.
L'application de la procédure d'amende forfaitaire implique d'examiner chaque délit et de fixer, le cas échéant, les montants dont le paiement paraît devoir éteindre l'action publique au regard de l'infraction considérée. Son examen technique correspondant à des objectifs de la politique contrôle des pêches de l'Union européen justifie le recours à l'habilitation.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les impacts des dispositions du présent article sont les suivants :
- Modification des articles L. 942-1 et L. 942-2 du CRPM ;
- Modification et ajout d'un alinéa à l'article L. 943-1 du CRPM ;
- Modification de l'article L. 943-8 du CRPM ;
- Ajout de deux nouveaux alinéas (23° et 24°) à l'article L. 945-4 du CRPM ;
- Ajout de trois alinéas (7°, 8° et 9°) à l'article L. 945-5 du CRPM ;
- Modification de l'article L. 946-1 du CRPM ;
- Modifications de l'article L. 951-9 et ajout d'un alinéa au L. 951-10 du CRPM ;
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les mesures reprises dans le présent article visent expressément à traduire en droit national certaines dispositions du règlement (UE) 2023/2842. Elles sont donc conformes au droit européen tel qu'il sera applicable à partir du 10 janvier 2026.
Le droit européen issu de ce règlement ne comporte pas de disposition identifiée comme contraire à des traités en vigueur.
Les dispositions qui seront adoptées dans le cadre d'habilitation prévue au II du présent article seront adoptées en conformité avec les articles 89 bis et 91 bis du règlement (CE) n° 1224/2009 dans leur rédaction issue du règlement (UE) 2023/2842, qui imposent que les sanctions pénales auxquelles les Etats membres peuvent avoir recours soient « effectives, proportionnées et dissuasives » et, s'agissant des « infractions graves » prévues par l'article 91 bis, qu'elles « aient un effet équivalent à celui des sanctions administratives financières ».
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L'amende forfaitaire et la transaction pénale sont des modes simplifiés de sanction des délits. Dans ces conditions, les dispositions qui seront prises dans le cadre de l'habilitation seront susceptibles d'entraîner un allégement des charges financières induites par les procédures pénales pour la Chancellerie et les services de l'Etat. L'application de ces dispositions permettra également de faciliter le recouvrement des amendes pénales et génèreront ainsi un gain pour les recettes de l'Etat.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le présent article concerne les entreprises de pêche mais il n'entraîne pas de coût de mise en conformité.
Le volume des sanctions administratives prononcées ne devrait pas évoluer avec la modification du CRPM envisagée ; il ne devrait donc pas y avoir d'impact financier sur les entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Un régime de sanctions plus efficace et plus clair assurera une meilleure sécurité juridique pour les autorités décisionnaires. Le présent article ne nécessitera pas l'embauche de nouveaux ETP.
Les dispositions qui seront prises dans le cadre de l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance seront susceptibles d'entraîner un allégement de la charge de travail dans les tribunaux et de faciliter le travail des agents de contrôle.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les dispositions qui figureront dans l'ordonnance adoptée en vertu de l'habilitation prévue au II du présent article adapteront le régime de sanction pénale applicable en matière de pêche en considérant la viabilité économique et la possible charge psychologique supportée par l'acteur poursuivi pénalement.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Ces mesures visent à renforcer l'effectivité du contrôle de la PCP, laquelle, en application de l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, « (...) garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental (...) [et] met en oeuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin ».
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
En vertu de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée de Guyane doit être consultée préalablement à la modification des articles L. 951-9 et L. 951-10 du CRPM. L'assemblée a été saisie le 11 septembre 2025.
La mission interministérielle de l'eau a été consultée et a rendu un avis favorable le 10 octobre 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi au Journal Officiel de la République française. Aucune disposition relative aux modalités d'application de la loi dans le temps n'est nécessaire.
5.2.2. Application dans l'espace
A l'exception de la modification des articles L. 951-9 et L. 951-10 du CRPM, qui ne concernent que la Guyane, les dispositions s'appliquent de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution : Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (article L. 951-1 du CRPM).
Elles s'appliquent également à Saint-Barthélemy (article LO 6213-1 du CGCT et articles L. 952-1 et L. 952-6 du CRPM), à Saint-Martin (article LO 6313-1 du CGCT et article L. 953-1 du CRPM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article LO 6413-1 du CGCT et article L. 954-1 du CRPM), où s'applique le principe d'identité législative pour les matières traitées par le présent projet.
Par ailleurs, tous les articles du CRPM que le présent article entend modifier (à l'exception des articles L. 951-9 et L. 951-10 du CRPM relatif à la Guyane) sont applicables aux TAAF (tableau figurant à l'article L. 958-2 CRPM), mais dans leur rédaction résultant d'anciennes lois qui ne sont plus en vigueur.
Et certains articles du CRPM (tous, à l'exception des articles L. 951-9 et L. 951-10 du CRPM relatif à la Guyane et des articles L. 946-1 et L. 946-4) sont applicables à Wallis-et-Futuna (tableau figurant à l'article L. 955-3 CRPM), en Polynésie française (tableau figurant à l'article L. 956-3 CRPM) et en Nouvelle-Calédonie (tableau figurant à l'article L. 957-3 du CRPM), mais dans leur rédaction résultant d'anciennes lois qui ne sont plus en vigueur.
Toutefois, la PCP n'est pas applicable dans les TAAF, sur l'île de Clipperton, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (voir, en ce sens, les dispositions combinées de l'article 1er du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 dit règlement PCP, de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) et de l'annexe II du TFUE).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'actualiser les dispositions du CRPM.
Par suite, les dispositions du présent article du PJL ne s'appliquent pas à Wallis-et-Futuna (articles L. 955-1 et L. 955-3 du CRPM), en Polynésie française (article L. 956-1 et L. 956-3), en Nouvelle-Calédonie (articles L. 957-1 et L. 957-3 du CRPM), ni dans les TAAF (articles L. 958-1 et L. 958-2 du CRPM) et sur l'île de Clipperton (article L. 958-15 CRPM).
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions du présent article n'impliquent aucun texte d'application en dehors de l'ordonnance prévue au II du présent article.
6. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Un délai de douze mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre et des arbitrages dont elles doivent faire l'objet, s'agissant par exemple des catégories de délits concernés, ainsi que des concertations à mener auprès notamment de la Chancellerie.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
ANNEXES
Article 1er - Tableau de transposition d'une directive 2014/17/UE du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/ce et 2013/36/UE et le règlement (UE) 1093/2010
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2014/17/UE Article 32 : Liberté d'établissement et libre prestation de services des intermédiaires de crédit 1. L'admission d'un intermédiaire de crédit par l'autorité compétente de son État membre d'origine conformément à l'article 29, paragraphe 1, est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union, sans qu'une autre admission par les autorités compétentes des États membres d'accueil soit nécessaire en vue d'exercer les activités et de fournir les services couverts par l'admission, à condition que les activités qu'un intermédiaire de crédit compte exercer dans les États membres d'accueil soient couvertes par l'admission. Cependant, les intermédiaires de crédit ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de contrats de crédit proposés aux consommateurs par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer. 2. Les représentants désignés dans des États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 31 ne sont pas autorisés à exercer tout ou partie des activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5, ou à fournir des services de conseil dans les États membres où ces représentants désignés ne sont pas autorisés à opérer. 3. Tout intermédiaire de crédit admis qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres en régime de libre prestation des services ou lors de l'établissement d'une succursale en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Dans un délai d'un mois après avoir reçu cette information, ces autorités compétentes notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d'accueil concernés l'intention de l'intermédiaire de crédit et informent concomitamment l'intermédiaire de crédit concerné de cette notification. Elles notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d'accueil concernés les prêteurs auxquels l'intermédiaire de crédit est lié et elles font savoir si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. L'État membre d'accueil utilise les informations communiquées par l'État membre d'origine pour introduire les informations nécessaires dans son registre. L'intermédiaire de crédit peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la notification visée au deuxième alinéa. 4. Avant que la succursale d'un intermédiaire de crédit ne commence à exercer ses activités ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se préparent pour la surveillance de l'intermédiaire de crédit conformément à l'article 34 et, s'il y a lieu, lui indiquent les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l'Union, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil. |
Article L. 519-9 du code monétaire et financier Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle. Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat. Article L. 519-3-2 du code monétaire et financier Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code. |
Législative |
Article L. 519-9 du code monétaire et financier Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. Tout intermédiaire de crédit mentionné à l'article L. 519-7 immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en régime de libre établissement ou de libre prestation de services peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l'autorité de son État membre d'origine de ce que la notification a été faite à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. [...] Article L. 519-3-2 du code monétaire et financier Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés sur le registre unique mentionné au I de l'article L.512-1 du code des assurances conformément à l'article L. 519-3-1. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à qu'il a reçu la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 519-9 du présent code. |
L'article 32 de la directive 2014/17/UE prévoit que l'intermédiaire de crédit « entrant » peut exercer en France sous le régime de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services un mois après la réception par l'autorité française (l'ORIAS) des informations provenant de l'État membre d'origine et indépendamment de toute immatriculation. Or, le droit français ne rappelle pas cette règle. En sus, l'article L. 519-3-2 renvoie aux « formalités requises à l'article L. 519-9 » pour préciser l'obligation de vérification des partenaires commerciaux des intermédiaires de crédit « entrant ». La notion de « formalité n'est pas clairement définie et pourrait laisser penser que l'activité des intermédiaires de crédits « entrant » est conditionnée à leur inscription sur le registre tenu par l'ORIAS. Il convient donc 1) de préciser les conditions de liberté d'entreprendre et de libre prestation de services à l'article L. 519-9 et 2) de préciser le renvoi de l'article L. 519-3-2 à l'article L. 519-9. |
|
Directive 2014/17/UE Article 34 de la directive sur le crédit immobilier (surveillance des intermédiaires de crédit et de leurs représentants désignés) 1. Les États membres veillent à ce que l'activité en cours des intermédiaires de crédit soit soumise à la surveillance des autorités compétentes de l'État membre d'origine. Les États membres d'origine prévoient que les intermédiaires de crédit liés doivent être soumis à cette surveillance soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce prêteur est un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou un autre établissement financier qui, en vertu du droit national, est soumis à un régime d'agrément et de surveillance équivalent. Cependant, si l'intermédiaire de crédit lié fournit des services dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il est alors soumis à la surveillance directe. Les États membres d'origine qui autorisent les intermédiaires de crédit à désigner des représentants conformément à l'article 31 veillent à ce que ces représentants désignés fassent l'objet d'une surveillance soit directe, soit dans le cadre de la surveillance de l'intermédiaire de crédit pour le compte duquel ils agissent. 2. Il incombe aux autorités compétentes des États membres où l'intermédiaire de crédit a une succursale de veiller à ce que les services fournis par l'intermédiaire de crédit sur leur territoire satisfassent aux obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, et aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 et dans les dispositions arrêtées conformément à ces articles. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'un intermédiaire de crédit qui a une succursale sur leur territoire viole les dispositions adoptées dans cet État membre en vertu de l'article 7, paragraphe 1, et des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 de la présente directive, ces autorités exigent que l'intermédiaire de crédit concerné mette un terme à sa situation irrégulière. Si l'intermédiaire de crédit concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'intermédiaire de crédit persiste à enfreindre les dispositions visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État, celui-ci peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit de commencer à effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée dans les meilleurs délais des mesures de ce type. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine est en désaccord avec les mesures prises par l'État membre d'accueil, elle peut saisir l'ABE et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n o 1093/2010. Dans ce cas, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article. [...] |
Article L. 519-9 du code monétaire et financier Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle. Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat. |
Législative |
Article L. 519-9 du code monétaire et financier [...] Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle. Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau minimal de connaissances et de compétences professionnelles requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France. A cet effet, il distingue selon que ces intermédiaires exercent en régime de libre prestation de service ou de libre établissement. Les dispositions suivantes sont seules applicables aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 519-7 immatriculés dans un autre Etat membre et agissant en France en vertu du libre établissement : - Les dispositions des articles L. 316-1, L. 519-1-1, L. 519-3-2, L. 519-4-1, L 519-4-2 et L. 519-6-1 ; - Les dispositions du titre I du livre VI, des articles L.121-1 à L. 121-5, L.122-1 à L.122-10, L. 313-3 à L. 313-7, L. 313-11 à L. 313-19, L. 313-34, L. 314-1 à L. 314-5, L. 314-22, L. 314-24 et L. 314-25 du code de la consommation. |
L'article 34, paragraphe 1, de la directive sur le crédit immobilier dispose que l'activité en cours des intermédiaires de crédit est soumise à la surveillance des autorités compétentes de l'État membre d'origine. A contrario, ledit article 34 confère aux autorités d'accueil des responsabilités limitées en matière de surveillance. Le droit français exige des intermédiaires de crédit ressortissant d'un autre État membre qui souhaitent fournir leurs services en France la souscription à une assurance en responsabilité civile professionnelle et le respect des exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences requis définies pour tout intermédiaire de crédits, ce qui n'est pas complètement compatible avec les exigences. Pour respecter les exigences de la directive, le droit français doit : - Supprimer les exigences en matière d`assurance qui ne ressortent pas de l'Etat membre d'accueil ; - Préciser les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences selon qu'il concerne les intermédiaires de crédit exerçant sous le régime de la liberté d'établissement ou sous le régime de la libre prestation de services (en application du 2 de l'article 9 de la directive) ; - Préciser les dispositions du code monétaire et financier et du code de la consommation qui s'appliquent aux intermédiaires de crédit exerçant sous le régime de la liberté d'établissement et qui transposent les articles 7, paragraphe 1, et aux articles 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 de la directive. |
Article 2 - Tableau de transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dite « BRRD 2 » et modifiant la directive BRRD
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (EU) 2019/879 dite BRRD II modifiant la directive 2014/59/UE dite BRRD Article 45 quaterdecies [...] 20) L'article 48 est modifié comme suit : [...] c) le paragraphe suivant est ajouté: 7. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), toutes les créances résultant d'éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres. Aux fins du premier alinéa, dans la mesure où un instrument n'est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d'un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres. [...] |
Article L. 613-30-3 du code monétaire et financier I. - Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque : [...] 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce. Parmi ces créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui ne sont pas, et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2. [...] I bis.-Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu, les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes : 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ; 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; 3° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mère dans l'Union ; 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. |
Législative |
Article L. 613-30-3 du code monétaire et financier I. - Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque : [...] 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce et de prêts ou titres participatifs mentionnés respectivement à l'article L. 313-13 du présent code et à l'article L. 228-36 du code de commerce. créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce. Parmi ces créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui ne sont pas, et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2. Parmi ces créanciers subordonnés, ceux dont les titres, créances, instruments ou droits ne sont pas, à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, retenus en tout ou partie comme instruments de fonds propres au sens du règlement (UE) n° 575/2013, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les autres créanciers subordonnés, sans que puisse y faire obstacle un contrat établissant une hiérarchie de rangs entre créanciers subordonnés. La modification, consécutive aux dispositions de l'alinéa précédent, du rang d'une créance subordonnée, en particulier de titres ou prêts participatifs, n'affecte pas l'ordre, tel qu'il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles. I bis. - Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu, les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes : 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 qui sont agréées pour la fourniture d'un service du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 ou 6-2 1,2,4 ou 5 de l'article L. 321-1 ou et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ; |
Nouvelle transposition française des dispositions de l'article 48(7) de la directive BRRD (introduit par BRRD2), lequel prévoit que tous les détenteurs de titres et créances éligibles en tant que fonds propres au sens du règlement (UE) n° 575/2013 ont un rang de priorité inférieur à celui de tout titre ou toute créance qui ne serait pas éligible en tant que fonds propres au moment de la liquidation. Les titres et prêts participatifs ne sont pas des instruments de fonds propres au sens du règlement précité. Cette transposition supprime la règle de non-rétroactivité qui permettait à des titres et prêts participatifs de conserver leur ancien rang (pré-BRRD2) dans la hiérarchie des créanciers lorsqu'ils avaient été émis avant le 28 décembre 2020, date de transposition de la directive. Avant-dernier alinéa : La règle impérative transposant l'article 48(7) BRRD s'imposera sans exception, par l'effet de la loi, y compris rétroactivement aux engagements conclus ou émis avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions nationales de transposition. Elle laissera subsister la flexibilité contractuelle pour la définition des rangs subordonnés qu'autorise le droit français (voir ci-dessus), mais exclusivement dans la mesure où celle-ci ne s'oppose pas à la pleine application de cette règle impérative. Celle-ci prévaudra notamment en cas de contradiction avec une clause de subordination non conforme. Dernier alinéa : La documentation contractuelle des instruments subordonnés des établissements bancaires français s'appuie fréquemment sur les rangs subordonnés des titres participatifs et prêts participatifs (ci-après TP et PP) pour définir d'autres rangs subordonnés. Ces autres rangs sont contractuellement définis soit comme plus subordonnés (junior) que les TP et PP, soit comme moins subordonnés (senior) que les TP et PP. C'est notamment le cas de la plupart des instruments de dette AT1 et T2 émis par les groupes bancaires français pour satisfaire leurs exigences prudentielles. La modification de rang qu'imposera la nouvelle transposition à certains TP et PP n'entrainera pas de modification du rang d'autres instruments entre eux, par le jeu de ces références au rang des TP et PP. Pour écarter tout risque d'application « dynamique » de ces clauses de rang, susceptible de bouleverser indument la hiérarchie des créanciers subordonnés, ce dernier alinéa rappelle que lorsque des TP et PP sont utilisés comme une référence extérieure pour la définition du rang d'autres instruments, les rangs des TP et PP devraient être considérés comme « statiques ». |
|
Directive (EU) 2019/879 dite BRRD II modifiant la directive 2014/59/UE dite BRRD Article premier - Modifications de la directive 2014/59/UE [...] 2) L'article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, les alinéas suivants sont ajoutés: « Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en oeuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 59. Lorsqu'elle fixe les délais visés au paragraphe 7, points o) et p), du présent article, dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.»; |
L. 613-38 du code monétaire et financier |
Législative |
L. 613-38 du code monétaire et financier [...] IV. - Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont, sous réserve du V, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an ainsi qu'après la mise en oeuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la sous-section 10 de la présente section et après chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de mise en oeuvre. Aux fins du réexamen ou de la mise à jour
mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au
I et les autorités compétentes au sens des articles
L.
511-21 et
L.
532-15 communiquent rapidement au collège de
résolution toute modification rendant nécessaire ce
réexamen ou cette mise à jour. |
Comme relevé par les services de la Commission, le III de l'article L. 511-41-3 du CMF, auquel fait référence l'article L. 613-38, IV, 3ème al. du même code, ne concerne pas à la prérogative visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE (« Pillar 2 Guidance »), que mentionne l'article 10, paragraphe 6, quatrième alinéa de la BRRD, mais à certains pouvoirs de supervision visés aux points g), h) et l) de l'article 104 de la directive 2013/36/UE. Il s'agit donc ici d'une erreur de renvoi puisque la disposition visant l'exigence de l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE a été transposée non au III mais au II bis de l'article L. 511-41-3 du CMF. En pratique, celle-ci n'occasionnera aucune violation de la BRRD lors de l'application des pouvoirs de l'autorité de résolution, dès lors que : - Les dispositions concernent les délais et périodes transitoires pour l'application des cibles de MREL dans le cas très exceptionnel d'une banque qui, après sa défaillance avérée ou prévisible, aurait fait l'objet de pouvoirs de résolution et/ou de WDCCIEL ; - Indépendamment de l'erreur de renvoi qui ne concerne qu'un des critères d'appréciation, ces délais et périodes transitoires pourront être modulés par application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, dont les critères sont suffisamment larges pour éviter toute méconnaissance de l'article 10, paragraphe 6, quatrième alinéa de la BRRD, dans un éventuel cas relevant de l'hypothèse susmentionnée. |
Article 3 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE Article 2 de la directive 5. La présente directive ne s'applique pas : a) à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par : i) un établissement de crédit établi dans l'Union ; ii) un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif iii) un prêteur autre qu'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l'article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu'il exerce des activités dans cet État membre ; [...] |
Article L. 515-1 du code monétaire et financier Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes : -fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; -émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; -émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ; -fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose. Article L. 54-11-3 du code monétaire et financier I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités de gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par : a) Un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ; b) Une société de gestion de fonds d'investissement alternatif agréé, une société de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou une société d'investissement à capital variable agréée, à condition que cette dernière n'ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu'elle gère ; c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits au sens de l'article L. 54-11-1 dans le cadre et sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables. [...] Article L. 54-11-10 du code monétaire et financier Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation. [...] Article L. 54-11-27 du code monétaire et financier Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un établissement de crédit, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même. Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30, s'il est établi en France, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité appartenant à l'une de ces catégories, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Article L. 54-11-28 du code monétaire et financier Le gestionnaire de crédits ou l'établissement de crédit désigné, respecte, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu de la présente section. En l'absence de désignation d'un gestionnaire de crédits ou d'un établissement de crédit, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations. Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour Etat membre d'origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l'article L. 54-11-4. Article L. 54-11-29 du code monétaire et financier Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits ou son représentant informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité qu'il a ainsi nommée. Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu de l'alinéa premier, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même. Lorsque l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues en application des deux premiers alinéas. |
Législative |
Article L. 515-1 du code monétaire et financier Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes : -fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; -émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; -émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ; - exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l'article L. 54-11-1 -fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7. [...] Article L. 54-11-3 du code monétaire et financier I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités de gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par : a) Un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ; b) Une société de gestion de fonds d'investissement alternatif agréé, une société de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou une société d'investissement à capital variable agréée, à condition que cette dernière n'ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu'elle gère ; c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits au sens de l'article L. 54-11-1 dans le cadre et sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables. d) à une société de financement. [...] Article L. 54-11-10 du code monétaire et financier Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, une société de financement, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation. [...] Article L. 54-11-27 du code monétaire et financier Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un établissement de crédit, une société de financement ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même. Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30, s'il est établi en France, désigne un établissement de crédit, une société de financement ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité appartenant à l'une de ces catégories, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Article L. 54-11-28 du code monétaire et financier Le gestionnaire de crédits, la société de financement ou l'établissement de crédit désigné, respecte, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu de la présente section. En l'absence de désignation d'un gestionnaire de crédits, d'une société de financement, ou d'un établissement de crédit, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations. Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour Etat membre d'origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l'article L. 54-11-4. Article L. 54-11-29 du code monétaire et financier Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne un établissement de crédit, une société de financement, ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits ou son représentant informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité qu'il a ainsi nommée. Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu de l'alinéa premier, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même. Lorsque l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues en application des deux premiers alinéas. |
Ces dispositions tirent les conséquences de l'article 2, paragraphe 5, a), iii), de la directive (UE) 2021/2167, en étendant l'exemption de l'exigence d'agrément « gestionnaire de crédits » aux sociétés de financement. Celles-ci, bien que non établissements de crédit, sont agréées et soumises au contrôle prudentiel de l'ACPR, conformément aux exigences des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. |
Article 4 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II Review)
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2024/790 consolidée Article 1er 1. La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement, aux opérateurs de marché, ainsi qu'aux entreprises de pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement au moyen de l'établissement d'une succursale dans l'Union. 2. La présente directive établit des exigences en ce qui concerne : a) les conditions d'agrément et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement ; b) la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l'établissement d'une succursale ; c) l'agrément et le fonctionnement des marchés réglementés ; et e) la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci. 3. Les dispositions suivantes s'appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement : a) l'article 2, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20; b) le chapitre II du titre II, à l'exclusion de l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa ; c) le chapitre III du titre II, à l'exclusion de l'article 34, paragraphes 2 et 3, et de l'article 35, paragraphes 2 à 6 et 9 ; d) les articles 67 à 75 et les articles 80, 85 et 86. 4. Les dispositions suivantes s'appliquent également aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, lorsqu'ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients : a) l'article 9, paragraphe 3, l'article 14, et l'article 16, paragraphes 2, 3 et 6; b) les articles 23 à 26, l'article 28, l'article 29 à l'exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, et l'article 30; et c) les articles 67 à 75. 5. L'article 17, paragraphes 1 à 6, s'applique également aux membres ou participants des marchés réglementés et des MTF qui ne sont pas tenus d'obtenir un agrément au titre de la présente directive en vertu de l'article 2, paragraphe 1, points a), e), i) et j). 6. Les articles 57 et 58 s'appliquent également aux personnes exemptées de l'application de l'article 2. |
Article L. 420-1 du code monétaire et financier : [...] Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre I, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre. [...] Article L. 533-32 du code monétaire et financier Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéral. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. [...] Article L. 531-2 2° i) du code monétaire et financier [...] - les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; Article L. 533-32 du code monétaire et financier Un internalisateur systématique est un prestataire
de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille qui, de façon organisée, fréquente,
systématique et substantielle, négocie pour compte propre en
exécutant les ordres des clients sans opérer de système
multilatéral. Son dispositif doit fonctionner conformément au
titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers. |
Législative |
Article L. 420-1 du code monétaire et financier Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. Tout système multilatéral Article L. 533-32 du code monétaire et financier Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéral. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans opérer être opérateur de système multilatéral ou qui opte pour le statut d'internalisateur systématique dans les conditions décrites au second alinéa du présent article. Son Le dispositif qu'il met en oeuvre se conforme fonctionne conformément aux dispositions du titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. Lorsqu'un prestataire opte pour le statut d'internalisateur systématique, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. Article L. 531-2 2° i) du code monétaire et financier [...] - les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; - les membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de la liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; Article L. 533-32 du code monétaire et financier Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans opérer être opérateur de système multilatéral ou qui opte pour le statut d'internalisateur systématique dans les conditions décrites au second alinéa du présent article. Son Le dispositif qu'il met en oeuvre se conforme fonctionne conformément aux dispositions du titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. « Lorsqu'un prestataire opte pour le statut d'internalisateur systématique, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. |
Concernant l'article L. 420-1, la bascule de l'article 1(7) de MiFID II à l'article 1(5ter) de MiFIR implique que l'actuelle transposition de MiFID II devient de facto inutile. Il est proposé de faire un renvoi vers la définition inscrite dans le règlement MiFIR. |
|
Directive (UE) 2024/790 consolidée Article 27 Obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client 1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise d'investissement exécute l'ordre en suivant cette instruction. Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre au nom d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre. En vue d'assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise d'investissement qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l'entreprise d'investissement et les coûts pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles. 3. En ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les États membres exigent qu'à la suite de l'exécution d'un ordre pour le compte d'un client, une entreprise d'investissement communique au client le lieu où l'ordre a été exécuté. 4. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d'investissement qu'elles établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1. 5. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l'entreprise d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l'entreprise d'investissement d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l'entreprise d'investissement pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d'exécution. Les États membres exigent que, lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plate-forme de négociation, l'entreprise d'investissement informe notamment ses clients de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plate-forme de négociation. Les entreprises d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées. 7. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres de clients qu'elles surveillent l'efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d'exécution des ordres dans le but d'en déceler les lacunes et, le cas échéant, d'y remédier. En particulier, les États membres exigent de ces entreprises d'investissement qu'elles évaluent régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans leur politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d'exécution. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions ou de leur politique en matière d'exécution des ordres. 8. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu'elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise d'investissement, et démontrer à l'autorité compétente, à sa demande, qu'elles respectent le présent article. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 89, en ce qui concerne: a) les critères permettant de déterminer l'importance relative des différents facteurs qui, en vertu du paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l'ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel); b) les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d'investissement lorsqu'elle revoit ses dispositions en matière d'exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s'agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d'investissement d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients; c) la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d'exécution, en vertu du paragraphe 5. 10. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères à prendre en considération afin de déterminer et d'évaluer l'efficacité de la politique d'exécution des ordres en vertu des paragraphes 5 et 7, selon que ces ordres sont exécutés pour le compte de clients de détail ou de clients professionnels. Ces critères comprennent au moins les éléments suivants: a) les facteurs déterminant le choix des lieux d'exécution qui sont inclus dans la politique d'exécution des ordres; b) la fréquence de l'évaluation et de la mise à jour de la politique d'exécution des ordres; c) la manière dont sont définies les catégories d'instruments financiers visées au paragraphe 5. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Pouvoir est délégué à la Commission pour compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. |
Article L. 533-33 du code monétaire et financier Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers. Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023. Article L. 533-18-2 du code monétaire et financier Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestions de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l'efficacité de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres et de leur politique d'exécution afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans leur politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s'ils doivent procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution compte tenu notamment des informations disponibles en application des articles L. 420-17, L. 533-18-1, L. 533-19 et L. 533-33. Chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille reconnu comme lieu d'exécution par l'article 1 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers. Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont applicables à compter du 28 février 2023. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de leur politique d'exécution. Article L. 533-19 I du code monétaire et financier [...] Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté. Article L. 533-18-1 du code monétaire et financier Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d'exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue. |
Législatif |
Article L. 533-33 du code monétaire et financier Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers. Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023. Article L. 533-18-2 du code monétaire et financier Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l'efficacité de leur politique et de leurs dispositifs en matière d'exécution des ordres afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans cette politique permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s'ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en ce domaine. Article L. 533-19 I du code monétaire et financier : [...] Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté. Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients portant sur un instrument financier soumis aux obligations de négociation prévues à l'article 23 ou à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, les prestataires communiquent aux clients le lieu où l'ordre a été exécuté. Article L. 533-18-1 du code monétaire et financier Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d'exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue. |
Abrogation |
|
Directive (UE) 2024/790 consolidée Article 31 Contrôle du respect des règles du MTF ou de l'OTF et d'autres obligations légales 1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l'OTF, pour contrôler régulièrement que les membres, les participants ou les utilisateurs en respectent ses règles. Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF contrôlent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres, les participants ou les utilisateurs dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les violations à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier, et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l'efficacité dudit contrôle. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l'article 22 ter du règlement (UE) no 600/2014. 2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Les autorités compétentes des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF transmettent à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, une autorité compétente doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d'en informer les autorités compétentes des autres États membres et l'AEMF. 3. Les États membres exigent aussi des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils transmettent également sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité habilitée à instruire et poursuivre les abus de marché et qu'ils prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l'obligation d'information visée au paragraphe 2 du présent article. |
Article L. 420-9 du code monétaire et financier I.- Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres respectent les règles de la plate-forme de négociation et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celle-ci. Il surveille les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres sur la plate-forme de négociation, en vue de détecter tout manquement à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. |
Législative |
Article L. 420-9 du code monétaire et financier I.- Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres respectent les règles de la plate-forme de négociation et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celle-ci. Il surveille les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres sur la plate-forme de négociation, en vue de détecter tout manquement à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des dispositifs afin de respecter les normes de qualités des données conformément à l'article 22 ter du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. |
|
|
Directive (UE) 2024/790 consolidée Article 47 Exigences organisationnelles 1. Les États membres exigent des marchés réglementés : a) qu'ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui leur a été déléguée par l'autorité compétente; b) qu'ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, y compris le risque lié aux TIC conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, qu'ils mettent en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant de cerner les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et qu'ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques ; d) qu'ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres; e) qu'ils mettent en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; f) qu'ils disposent, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés; g) qu'ils prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l'article 22 ter du règlement (UE) no 600/2014 ; h) qu'ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. 2. Les États membres n'autorisent pas les opérateurs de marché à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux ou à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu'ils exploitent. |
Article L. 421-11 du code monétaire et financier I. - L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ; 2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ; 3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ; 4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ; 5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes. II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché. III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II. L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent. |
Législative |
Article L. 421-11 du code monétaire et financier I. - L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ; 2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ; 3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ; 4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ; 5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes. 6. S'assurer que le marché réglementé qu'elle gère dispose d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché. III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II. L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent. |
|
|
Article L. 424-1 du code monétaire et financier Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre. Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11. Article L424-2 du code monétaire et financier Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 424-5. Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques. |
Législative |
Article L. 424-1 du code monétaire et financier Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre. Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11. Article L424-2 du code monétaire et financier Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 424-5. Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation s'assure que le système qu'il gère dispose d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques. |
A l'occasion de cette transposition, proposition d'aligner la rédaction de cette disposition applicable aux SMN avec celle applicable aux marchés réglementés. Cette disposition n'étant pas un élément de définition d'un SMN mais un élément de régime devant être respecté par le SMN. |
|
|
Article L425-1 du code monétaire et financier Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur : 1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ; 2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ; 3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ; 4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ; 5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre. Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11. Article L425-2 du code monétaire et financier Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8. Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système. Le gestionnaire du système organisé de négociation met en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. |
Article L425-1 du code monétaire et financier Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur : 1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 ; 2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ; 3° Des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ; 4° Des instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ; 5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre. Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. Le gestionnaire d'un système organisé de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11. Article L425-2 du code monétaire et financier Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8. Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. Le gestionnaire du système organisé de négociation s'assure que le système qu'il gère dispose d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système. Le gestionnaire du système organisé de négociation met en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. |
A l'occasion de cette transposition, nous proposons d'aligner la rédaction de cette disposition applicable aux SON avec celle applicable aux marchés réglementés. Cette disposition n'étant pas un élément de définition d'un SMN mais un élément de régime devant être respecté par le SON. |
||
|
Directive (UE) 2024/790 consolidée Article 48 Résilience des systèmes, disjoncteurs et commerce électronique 1. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il établisse et maintienne sa résilience opérationnelle conformément aux exigences énoncées au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 afin de garantir la résilience de ses systèmes de négociation, qu'ils disposent d'une capacité suffisante pour faire face aux pics de volumes d'ordres et de messages, et qu'il est en mesure d'assurer une négociation ordonnée dans des conditions de fortes tensions sur le marché, soient entièrement testés pour s'assurer que ces conditions sont remplies et sont soumis à des dispositions efficaces en matière de continuité des activités, y compris une politique et des plans de continuité des activités TIC et des plans de réponse et de redressement en matière de TIC établis conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2022/2554, afin d'assurer la continuité de ses services en cas de défaillance de ses systèmes commerciaux. 2. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il mette en place : a) des accords écrits avec toutes les entreprises d'investissement poursuivant une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé ; b) des plans visant à garantir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises d'investissement à de tels accords qui les obligent à publier des cotations fermes à des prix compétitifs, ce qui a pour résultat de fournir de la liquidité au marché sur une base régulière et prévisible, lorsqu'une telle exigence est adaptée à la nature et à l'ampleur des transactions sur ce marché réglementé. 3. L'accord écrit visé au paragraphe 2 doit préciser au moins : a) les obligations de l'entreprise d'investissement en matière de fourniture de liquidités et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point b) ; b) toute incitation, sous forme de rabais ou d'une autre manière, offerte par le marché réglementé à une entreprise d'investissement afin de fournir des liquidités au marché sur une base régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l'entreprise d'investissement du fait de sa participation au régime visé au paragraphe 2, point b). Le marché réglementé surveille et fait respecter par les entreprises d'investissement les exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe l'autorité compétente du contenu de l'accord écrit contraignant et, sur demande, fournit à l'autorité compétente toutes les informations complémentaires nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de s'assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe. 4. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il mette en place des systèmes, des procédures et des dispositions efficaces pour rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou qui sont manifestement erronés. 5. Les États membres exigent qu'un marché réglementé soit en mesure d'interrompre ou de restreindre temporairement les transactions dans des situations d'urgence ou en cas de variation significative des prix d'un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié pendant une courte période et, dans des cas exceptionnels, qu'il soit en mesure d'annuler, de modifier ou de corriger toute transaction. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il veille à ce que les paramètres permettant d'interrompre ou de restreindre les transactions soient calibrés de manière à tenir compte de la liquidité des différentes classes et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des types d'utilisateurs, et à ce qu'ils soient suffisants pour éviter des perturbations importantes du bon déroulement des négociations. Les États membres veillent à ce qu'un marché réglementé communique à l'autorité compétente les paramètres d'arrêt des transactions et toute modification importante de ces paramètres de manière cohérente et comparable, et à ce que l'autorité compétente les notifie à son tour à l'AEMF. Les États membres exigent que, lorsqu'un marché réglementé qui est significatif en termes de liquidité de cet instrument financier interrompe la négociation, dans tout État membre, cette plate-forme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour s'assurer qu'elle informera les autorités compétentes afin qu'elles puissent coordonner une réponse à l'échelle du marché et déterminer s'il est approprié d'arrêter la négociation sur d'autres plates-formes sur lesquelles l'instrument financier est négocié jusqu'à la négociation. reprend sur le marché d'origine. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il publie sur son site internet des informations sur les circonstances ayant conduit à l'arrêt ou à la limitation des transactions et sur les principes permettant d'établir les principaux paramètres techniques utilisés pour ce faire. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un marché réglementé n'interrompt pas ou ne limite pas les transactions visées au premier alinéa, malgré le fait qu'une fluctuation significative des prix d'un instrument financier ou d'instruments financiers liés a entraîné des conditions de négociation désordonnées sur un ou plusieurs marchés, les autorités compétentes soient en mesure de prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris l'utilisation des pouvoirs de surveillance visés à l'article 69, paragraphe 2, points m) à p). 6. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il mette en place des systèmes, des procédures et des dispositifs efficaces, notamment en exigeant des membres ou des participants qu'ils procèdent à des tests appropriés d'algorithmes et en fournissant des environnements permettant ces tests conformément aux exigences énoncées aux chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554, afin de garantir que les systèmes de trading algorithmique ne puissent pas créer ou contribuer à des conditions de négociation désordonnées sur le marché, et gérer toute situation de négociation désordonnée qui découle de ces systèmes de négociation algorithmique, y compris les systèmes permettant de limiter le rapport entre les ordres non exécutés et les transactions qui peuvent être saisies dans le système par un membre ou un participant, afin de pouvoir ralentir le flux d'ordres s'il y a un risque que la capacité de son système soit atteinte et de limiter et d'appliquer le nombre minimal de pas qui peut être exécuté sur le marché. 7. Les États membres exigent d'un marché réglementé qui autorise un accès électronique direct qu'il mette en place des systèmes, des procédures et des dispositions efficaces pour garantir que les membres ou les participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s'ils sont des entreprises d'investissement agréées en vertu de la présente directive ou des établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, que des critères appropriés soient fixés et appliqués en ce qui concerne l'aptitude des personnes auxquelles un tel accès peut être accordé ; et que le membre ou le participant demeure responsable des ordres et des transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la présente directive. Les États membres exigent également que le marché réglementé établisse des normes appropriées en ce qui concerne les contrôles des risques et les seuils de négociation par le biais d'un tel accès et qu'il soit en mesure de distinguer et, si nécessaire, d'arrêter les ordres ou les transactions d'une personne utilisant un accès électronique direct séparément des autres ordres ou des transactions effectuées par le membre ou le participant. Le marché réglementé a pris des dispositions pour suspendre ou mettre fin à la fourniture d'un accès électronique direct par un membre ou un participant à un client en cas de non-respect du présent paragraphe. 8. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires. 9. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il veille à ce que ses barèmes de redevances, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les remises éventuelles, soient transparents, équitables et non discriminatoires et qu'ils n'incitent pas à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d'une manière qui contribue à des conditions de négociation désordonnées ou à des abus de marché. En particulier, les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il impose des obligations de tenue de marché portant sur des actions individuelles ou sur un panier d'actions approprié en échange de tout rabais accordé. Les États membres autorisent un marché réglementé à ajuster ses redevances pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l'ordre a été maintenu et à calibrer les redevances pour chaque instrument financier auquel elles s'appliquent. Les États membres peuvent autoriser un marché réglementé à imposer des frais plus élevés pour le placement d'un ordre annulé par la suite qu'un ordre exécuté et à imposer des frais plus élevés aux participants qui placent un ratio élevé d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui utilisent une technique de trading algorithmique à haute fréquence afin de tenir compte de la charge supplémentaire pesant sur la capacité du système. 10. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il soit en mesure d'identifier, au moyen d'un signalement par les membres ou les participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d'ordres et les personnes concernées à l'origine de ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes sur demande. 11. Les États membres exigent que, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un marché réglementé, les marchés réglementés mettent à la disposition de l'autorité compétente les données relatives au carnet d'ordres ou lui donnent accès au carnet d'ordres afin qu'elle soit en mesure de surveiller les transactions. 12. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant en outre : a) les exigences visant à garantir la résilience et la capacité des systèmes de négociation des marchés réglementés, à l'exception des exigences relatives à la résilience opérationnelle numérique ; b) le ratio visé au paragraphe 6, compte tenu de facteurs tels que la valeur des ordres non exécutés par rapport à la valeur des opérations exécutées ; (c) les contrôles concernant l'accès électronique direct de manière à garantir que les contrôles appliqués à l'accès parrainé sont au moins équivalents à ceux appliqués à l'accès direct aux marchés ; d) l'obligation de veiller à ce que les services de colocalisation et les structures tarifaires soient équitables et non discriminatoires et à ce que les structures tarifaires n'incitent pas à des conditions commerciales désordonnées ou à des abus de marché ; e) la détermination de l'endroit où un marché réglementé est significatif en termes de liquidité de cet instrument financier ; f) l'obligation de veiller à ce que les systèmes de tenue de marché soient équitables et non discriminatoires et d'établir les obligations minimales de tenue de marché que les marchés réglementés doivent prévoir lors de la conception d'un système de tenue de marché et les conditions dans lesquelles l'obligation de mettre en place un système de tenue de marché n'est pas appropriée, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions sur ce marché réglementé, y compris si le marché réglementé permet ou permet le trading algorithmique par le biais de ses systèmes ; g) l'obligation d'assurer des tests appropriés des algorithmes, autres que les tests de résilience opérationnelle numérique, afin de garantir que les systèmes de trading algorithmique, y compris les systèmes de trading algorithmique à haute fréquence, ne peuvent pas créer ou contribuer à des conditions de trading désordonnées sur le marché ; h) les principes que les marchés réglementés doivent prendre en considération lorsqu'ils établissent leurs mécanismes d'arrêt ou de limitation des transactions conformément au paragraphe 5, en tenant compte de la liquidité des différentes classes et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des types d'utilisateurs, et sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des marchés réglementés dans la définition de ces mécanismes ; (i) les informations que les marchés réglementés sont tenus de publier, y compris les paramètres d'arrêt des transactions que les marchés réglementés doivent communiquer aux autorités compétentes, conformément au paragraphe 5. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025. La Commission est habilitée à compléter la présente directive par l'adoption des normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. |
Article 420-3 II du code monétaire et financier [...] II. - Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation notifie à l'Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et permettant les comparaisons. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l'Autorité des marchés financiers. Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. L'Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s'il convient d'étendre la suspension sur d'autres plates-formes jusqu'à la reprise de la négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour l'instrument financier concerné. |
Législative |
Article 420-3 II du code monétaire et financier [...] II. - Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation dans les situations d'urgence ou en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension ou de limitation de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation notifie à l'Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et permettant les comparaisons. Lorsque la négociation a été suspendue ou limitée, le gestionnaire d'une plate-forme de négociation rend publiques sur son site internet, d'une part, les informations sur les situations qui ont conduit à cette décision et, d'autre part, la suspension ou à la limitation de la négociation et sur les principes des paramètres techniques les plus importants présidant à la définition des paramètres techniques prééminents utilisés à cette fin. Lorsqu'un gestionnaire d'une plate-forme de négociation ne suspend pas ou ne limite pas la négociation, comme visé au premier alinéa, en dépit du fait qu'une fluctuation importante des prix d'un instrument financier ou d'instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d'un ou de plusieurs marchés, le président de l'Autorité des marchés financiers peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 420-10, et aux I et II de l'article L. 621-13-6 Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l'Autorité des marchés financiers. Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. L'Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s'il convient d'étendre la suspension sur d'autres plates-formes jusqu'à la reprise de la négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour l'instrument financier concerné. |
Reprise de la rédaction de la directive sur ce point modulo certaines améliorations de formulation conservées. L'article L420-3 étend les obligations de l'article 48 aux SMN et SON quand celui-ci ne concerne que les MR. Reprise de la rédaction du premier paragraphe en étendant le champ de la disposition à toutes les plateformes de négociation (cf commentaire ci-dessus). S'agissant du second paragraphe, transposition large en couvrant la possibilité pour l'AMF de prendre des mesures de suspension ou de limitation des négociations (art. 69 para. 2 point m) de MiFID II) en l'absence de suspension ou de limitation des négociations par le MR et en restant ouvert sur d'autres mesures appropriées qui pourraient être prises dans cette situation. |
|
Directive (UE) 2024/790 consolidée Article 57 Limites de position sur dérivés de matières premières et contrôles de gestion de positions sur dérivés de matières premières et dérivés de quotas d'émission [...] 8. Les États membres veillent à ce qu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des dérivés de quotas d'émission applique des contrôles de gestion de position, y compris des pouvoirs permettant à la plate-forme de négociation : a) surveiller les positions d'intérêts ouverts des personnes ; b) obtenir de personnes des informations, y compris tous les documents pertinents, sur l'importance et l'objet d'une position ou d'une exposition sous-jacente, des informations sur les propriétaires véritables ou sous-jacents, tout accord de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, les positions détenues sur des dérivés de quotas d'émission ou les positions détenues sur des dérivés de marchandises qui sont fondées sur le même sous-jacent et qui partagent les mêmes caractéristiques sur d'autres opérations de négociation. les lieux et dans le cadre de contrats de gré à gré économiquement équivalents par l'intermédiaire des membres et des participants ; [...] |
Article L. 420-14 du code monétaire et financier Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :
|
Législative |
Article L. 420-14 du code monétaire et financier Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir : 1° De surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ; 2° D'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ; 3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; 4° D'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, afin d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante. |
Nous avons reflété la rédaction de la directive sur ce point. Nous avons également remplacé la terminologie « instruments dérivés » par celle de « contrats financiers ». |
|
Directive (UE) 2024/790 consolidée Article 58 Déclaration des positions par catégories de titulaires de positions 1. Les États membres veillent à ce qu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des dérivés de quotas d'émission : a) rendre public : (i) pour les plates-formes de négociation où des options sont négociées, deux rapports hebdomadaires, dont l'un vise à exclure les options, avec l'ensemble des positions détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou dérivés de quotas d'émission négociés sur leur plate-forme de négociation, en précisant le nombre de positions longues et courtes par catégories, l'évolution de ces positions depuis le rapport précédent, le pourcentage de l'intérêt ouvert total représenté par chaque catégorie et le nombre de personnes occupant une position dans chaque catégorie conformément au paragraphe 4 ; (ii) pour les plates-formes de négociation où les options ne sont pas négociées, un rapport hebdomadaire sur les éléments énoncés au point i) ; b) fournir à l'autorité compétente une ventilation complète des positions détenues par toutes les personnes, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation, au moins sur une base quotidienne. L'obligation prévue au point a) ne s'applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes dépassent les seuils minimaux. La déclaration de position ne s'applique pas à d'autres titres visés à l'article 44, paragraphe 1, point 44), point c), qui se rapportent à une matière première ou à un sous-jacent visé à l'annexe I, section C.10. Les États membres veillent à ce qu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des dérivés de quotas d'émission communique les déclarations visées au premier alinéa, point a), à l'autorité compétente et à l'AEMF. L'AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports. 2. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés de quotas d'émission en dehors d'une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, l'autorité centrale compétente visée à l'article 57, paragraphe 6 ou, en l'absence d'autorité centrale compétente, l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les instruments dérivés de quotas d'émission sont négociés, avec une ventilation complète de leurs positions prises dans des contrats de gré à gré économiquement équivalents ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'à ce que le client final soit atteint, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011. 3. Afin de permettre le contrôle du respect de l'article 57, paragraphe 1, les États membres exigent des membres ou des participants de marchés réglementés, d'MTF et de clients d'OTF qu'ils communiquent à l'entreprise d'investissement ou à l'opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues par le biais de contrats négociés sur cette plate-forme de négociation au moins une fois par jour, ainsi que ceux de leurs clients et les clients de ces clients jusqu'à ce que le client final soit atteint. 4. Les personnes détenant des positions sur un dérivé sur matières premières ou sur un dérivé de quotas d'émission sont classées par l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation en fonction de la nature de leur activité principale, compte tenu de tout agrément applicable, comme suit : a) les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit ; b) fonds d'investissement, soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) tel que défini dans la directive 2009/65/CE, soit un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif tel que défini dans la directive 2011/61/CE ; (c) d'autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, et les établissements de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE ; d) les entreprises commerciales ; e) dans le cas des dérivés de quotas d'émission, les exploitants soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE. Les rapports visés au paragraphe 1, point a), précisent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toute modification de ce nombre depuis le rapport précédent, le pourcentage de l'intérêt ouvert total représenté par chaque catégorie et le nombre de personnes dans chaque catégorie. Les rapports visés au paragraphe 1, point a), et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent une distinction entre : a) les positions identifiées comme des positions qui, de manière objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales ; et b) autres postes. 5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de déterminer le format des rapports visés au paragraphe 1, point a), et des ventilations visées au paragraphe 2. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. Dans le cas des dérivés de quotas d'émission, la déclaration ne préjuge pas des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 89 pour préciser les seuils visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, compte tenu du nombre total de postes vacants et de leur taille, ainsi que du nombre total de personnes occupant un poste. 7. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les mesures à prendre pour exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l'AEMF à une heure hebdomadaire déterminée, en vue de leur publication centralisée par cette dernière. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. |
Article L. 420-16 du code monétaire et financier I. - Les gestionnaires de plate-forme de négociation : 1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents instruments dérivés sur matières premières, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie. Ils communiquent ce rapport à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate-forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du rapport aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles-ci sont inférieurs aux seuils minimaux ; 2° Fournissent à l'Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation. Les obligations d'informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles concernent un titre dérivé sur matières premières ou sur variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles. II. - Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420-11 et L. 420-12, les membres d'une plate-forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final. III. - Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie. Le rapport et les ventilations mentionnées au 2° du I établissent une distinction entre les positions identifiées comme réduisant de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales et les autres positions. IV. - Les personnes qui détiennent des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes : 1° Entreprises d'investissement ou établissements de crédit ; 2° Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens du II de l'article L. 214-1 ; 3° Autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance mentionnés aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III, livre IX, du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code, ainsi que les fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; 4° Entreprises commerciales ; 5° Dans le cas d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l'article L. 229-5 du code de l'environnement. Article L. 533-9 du code monétaire et financier Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète : 1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ; 2° Des positions de leurs clients ; 3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final. |
Législative |
Article L. 420-16 du code monétaire et financier I. - Les gestionnaires de plate-forme de négociation : 1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents instruments dérivés sur matières premières, les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie. Ils communiquent ce rapport à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate-forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du rapport aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles-ci sont inférieurs aux seuils minimaux Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents contrats financiers sur matières premières ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement négociées sur leurs plates-formes de négociation, qui mentionnent, d'une part, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories détiennent ces personnes et, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, d'autre part, le pourcentage du total des positions ouvertes au sein de que représente chaque catégorie et le nombre de personnes y détenant une position dans chaque catégorie. Ils publient également un rapport hebdomadaire distinct, excluant les contrats d'option lorsque des contrats d'option sont négociés sur la plate-forme de négociation. Ils communiquent ces rapports à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate-forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du des rapports aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles-ci sont inférieurs aux seuils minimaux ; 2° Fournissent à l'Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation. Les obligations d'informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles concernent un titre dérivé sur matières premières ou sur variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles. II. - Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420-11 et L. 420-12, les membres d'une plate-forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate-forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final. III. - Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles-ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie. Le rapport et les ventilations mentionnées au 2° du I établissent une distinction entre les positions identifiées comme réduisant de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales et les autres positions. IV. - Les personnes qui détiennent des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, des unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes Les personnes qui détiennent des positions sur un contrat financier sur matières premières ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes : 1° Entreprises d'investissement ou établissements de crédit ; 2° Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens du II de l'article L. 214-1 ; 3° Autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance mentionnés aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III, livre IX, du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code, ainsi que les fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; 4° Entreprises commerciales ; 5° Dans le cas d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l'article L. 229-5 du code de l'environnement. Dans le cas des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l'article L. 229-5 du code de l'environnement. Article L. 533-9 du code monétaire et financier Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des contrats financiers économiquement équivalents à des contrats financiers sur matières premières ou, à des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13, une ventilation complète de ces contrats. ou, l Lorsque ces contrats financiers ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils fournissent la même ventilation selon les mêmes obligations à l'autorité compétente pour la supervision de la plate-forme de négociation où au moyen de laquelle ces contrats financiers sont négociés, une ventilation complète : 1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ; 2° Des positions de leurs clients ; 3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final. |
Reprise de la rédaction de la directive sur ce point et remplacement de la terminologie « instruments dérivés » par celle de « contrats financiers ». Reprise de la rédaction de la directive sur ce point et remplacement de la terminologie « instruments dérivés » par celle de « contrats financiers ». |
Article 7 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE (dite CRD V) Article premier [...] 9) Les articles suivants sont insérés: « Article 21 bis Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes [...] 6. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à: a) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte; b) adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des membres de l'organe de direction et des directeurs, sous réserve des articles 65 à 72; c) adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales; d) désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée; e) limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires; f) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent; g) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder. |
Article L. 517-16 du code monétaire et financier Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée, ainsi que pour veiller au respect des exigences prévues par une disposition des titres Ier et III du livre V ou dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur base consolidée, cette Autorité peut prendre les mesures conservatoires nécessaires mentionnées aux 9°, 10°, 12° et 13° du I de l'article L. 612-33 et à l'article L. 612-32. En sus de ces mesures l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut : 1° Suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ; 2° Adresser des instructions à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer aux actionnaires de ces dernières les participations dans ses établissements filiales ; 3° Désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées aux titres Ier et III du livre V et dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur base consolidée ; 4° Exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent. |
Législative |
Article L. 517-16 du code monétaire et financier Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée, ainsi que pour veiller au respect des exigences prévues par une disposition des titres Ier et III du livre V ou dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur base consolidée, cette Autorité peut prendre les mesures conservatoires nécessaires mentionnées aux 9°, 10°, 12° et 13° du I de l'article L. 612-33 et à l'article L. 612-32. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article tiennent compte des effets sur le conglomérat financier. En sus de ces mesures l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut : 1° Suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ; 2° Adresser des instructions à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer aux actionnaires de ces dernières les participations dans ses établissements filiales ; 3° Désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées aux titres Ier et III du livre V et dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur base consolidée ; 4° Exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent. |
Seuls les pouvoirs qui n'existent pas déjà au L. 612-33 sont listés dans ce nouvel article (Il s'agit des points a), c), d) et f)). Pour le reste, une référence croisée avec le L. 612-33 CMF est faite : Transposition de la dernière phrase de la partie introductive du paragraphe 6. Cf. par exemple L. 612-33 I 12° et 13° (b°) Cf. L. 612-33 9° et 10° (e) Cf. L. 612-32 (g) |
|
Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE (dite CRD V) Article premier [...] 9) Les articles suivants sont insérés: « Article 21 bis Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes [...] 8. Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 3 et 4, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation. L'autorité de surveillance sur base consolidée élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune. |
Article L. 613-20-6-1 du code monétaire et financier Lorsque en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14 par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre Etat membre ou lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517-16 et L. 517-17, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517-13, L. 517-14, L. 517-16 ou L. 517-17 et la communique à l'autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune. Article L. 613-21-6-1 du code monétaire et financier (renumérotation) Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée. La décision commune est dûment documentée et motivée. En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune. |
Législative |
Article L. 613-20-6-1 du code monétaire et financier Lorsque en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14 par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre Etat membre ou lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517-16 et L. 517-17, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517-13, L. 517-14, L. 517-16 ou L. 517-17 et la communique à l'autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution saisit l'Autorité bancaire européenne avant l'adoption d'une décision commune. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent alors une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune. » ; Article L. 613-21-6-1 du code monétaire et financier (renumérotation) Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée. La décision commune est dûment documentée et motivée. En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution saisit l'Autorité bancaire européenne avant l'adoption d'une décision commune. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent alors une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune. |
Le L. 613-20-6-1 vaut quand l'ACPR est autorité home, le L. 613-21-6-1 lorsqu'elle est host. |
|
Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE (dite CRD V) Article premier [...] 38) L'article 113 est remplacé par le texte suivant: « Article 113 Décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement 1. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune: a) sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée; b) sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105; c) sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 104 ter, paragraphe 3. 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises: a) aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 bis; b) aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105; c) aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 ter. En outre, les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter. Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative. 3. En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2 du présent article, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine par l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, sur base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'ABE de la saisine. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union. Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement. 4. Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés. Les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 du présent article sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105. Dans ces cas exceptionnels, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. » |
Article L. 613-20-4 du code monétaire et financier I. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision commune. II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur : 1° L'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ; 2° Le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales ; 3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3. IV. - En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. Art. L. 613-21-3 du code monétaire et financier I. - Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. II. - Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise. III. - Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil d'Etat. Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France. Art. L. 613-21-4 du code monétaire et financier A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. |
Législative et réglementaire |
Article L. 613-20-4 du code monétaire et financier I. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision commune. II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur : 1° , d'une part, l'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ; 2° et, d'autre part, le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe, le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées au II de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales ; 3° les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l'adéquation de l'organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article L. 511-41-3. IV. - En l'absence d'une décision commune mentionnée au I, II ou III, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte sensiblement de cette décision.. Art. L. 613-21-3 du code monétaire et financier I. - Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres du groupe les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. II. - Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de prendre, pour le groupe, une ou plusieurs mesures équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l'Autorité apporte toute la coopération requise. III. - Dans les cas prévus aux I ou II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans un délai et dans des limites fixés par décret en Conseil d'Etat. Si aucune autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, la décision commune communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est applicable en France. Art. L. 613-21-4 du code monétaire et financier A défaut de décision commune de l'autorité de surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous-consolidée au sens du 49) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur le niveau requis de fonds propres les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une autorité compétente au sens du 40) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, saisit l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte sensiblement de cette décision. |
Les mesures de transposition de l'article 38 sont ajustées pour mieux faire apparaitre la distinction qui existe désormais entre le P2R (104bis CRD5) et le P2G (104ter CRD5). C'est également l'occasion de clarifier que les décisions communes concernant P2R et P2G sont prises au niveau consolidée ainsi qu'au niveau de chaque filiale comme cela est précisée (depuis CRD4) au a) du (1) de l'article 38). Ces ajustements impliquent de modifier le II de l'article L. 613-20-4 et d'aligner la rédaction des articles L. 613-21-3 I / L. 613-21-4 / R. 613-1 A / R. 613-3-4 / R. 613-1 A sur cette base. À part cela, la procédure d'adoption des décisions communes, que l'ACPR soit l'autorité Home ou l'autorité Host, ne change pas. Des mesures réglementaires d'application seront prises pour la transposition de ces dispositions sur le fondement de l'article L. 613-21-5 du code monétaire et financier |
|
Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE (dite CRD V) Article premier [...] 47) L'article 131 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres désignent une autorité qui sera chargée du recensement, sur base consolidée, des EISm et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, des autres établissements d'importance systémique (EIS) qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité. Les EISm peuvent être: a) un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; ou b) un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. Les autres EIS peuvent être soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre.» b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes: a) les catégories visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article; b )l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*9). Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 2. La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, sur la base duquel les autorités compétentes ou les autorités désignées peuvent prendre une des mesures visées au paragraphe 10, point c). (*9) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).» " c) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Avant le 1er janvier 2015, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et spécificités nationales. Après avoir consulté le CERS, l'ABE fait rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020, sur la méthode appropriée aux fins de la conception et du calibrage des taux de coussin pour les autres EIS.» d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres EIS pouvant atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.» e) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis. Sous réserve de l'autorisation de la Commission visée au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autre EIS supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010. Dans un délai de trois mois après que le CERS a transmis la notification visée au paragraphe 7 à la Commission, celle-ci, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour les autres EIS n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.» f) au paragraphe 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «7. Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse une notification au CERS un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5 et trois mois avant la publication de la décision de l'autorité compétente ou de l'autorité désignée visée au paragraphe 5 bis. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. Ces notifications décrivent en détail:»; g) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants: a) la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et b) 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou le taux dont la Commission a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément au paragraphe 5 bis du présent article.» h) les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «9. Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthode de recensement visée au paragraphe 2 du présent article. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement. 10. Sans préjudice des paragraphes 1 et 9 et sur la base des sous-catégories et des scores seuils visés au paragraphe 9, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, dans l'exercice d'une saine surveillance: a) réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure; b) affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global visé au paragraphe 2 est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm; c) compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 2 bis, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.» i) le paragraphe 11 est supprimé; j) le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «12. L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie au CERS le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 10, points a), b) et c). Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission et à l'ABE et rend publics les noms des EISm et des autres EIS. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm aux sous-catégories correspondantes, et communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné et au CERS, ce dernier transmettant sans tarder les résultats à la Commission et à l'ABE. L'autorité compétente ou l'autorité désignée rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.» k) le paragraphe 13 est supprimé; l) les paragraphes 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant: «14. Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s'applique. 15. Lorsqu'un établissement est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l'article 133, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article. Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s'applique.» m) les paragraphes 16 et 17 sont supprimés; n) le paragraphe 18 est remplacé par le texte suivant: «18. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, les méthodes selon lesquelles l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement ou un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthode applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm aux différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. » |
Art. L. 511-41-1-A [...] V.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être : 1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; 2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; 3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. [...] VI.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. [...] VIII. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine surveillance. |
Législative |
Art. L. 511-41-1-A - VI (2ème al.) [...] V.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être : 1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; 2° Des entreprises d'investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ; 3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013. [...] VI.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de compagnies holding d'investissement ou compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et un pays tiers. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également évaluer les activités transfrontières sans prendre en compte les activités menées dans les Etats membres participants mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
Alinéa indument supprimé par l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE, dite « IFD ». Cette suppression n'apparaît juridiquement pas motivée et constitue une conséquence non anticipée d'une erreur d'écriture de l'ordonnance mentionnée. Alinéa indument supprimé par l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE, dite « IFD ». Cette suppression n'apparaît juridiquement pas motivée et constitue une conséquence non anticipée d'une erreur d'écriture de l'ordonnance mentionnée. Alinéa indument supprimé par l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE, dite « IFD ». Cette suppression n'apparaît juridiquement pas motivée et constitue une conséquence non anticipée d'une erreur d'écriture de l'ordonnance mentionnée. |
Article 8 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/2994 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2024/2994 Article 2 Modifications de la directive 2013/36/EU La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit : 2) À l'article 76, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté : « Les États membres veillent à ce que l'organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l'article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d'importance systémique substantielle pour l'Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres.». |
Article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités. Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en oeuvre. Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d'intérêt, ils utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C. Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité. Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
Législative |
Article L. 511-41-1-B du code monétaire et financier Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités. Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en oeuvre. Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d'intérêt, ils utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C. Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité. Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés. L'organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l'article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d'importance systémique substantielle pour l'Union ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
Les nouvelles obligations pesant sur l'organe de direction des sociétés de financement et établissements de crédit sont ajoutées à l'article L. 511-41-1-B. |
|
Directive 2024/2994 Article 2 Modifications de la directive 2013/36/EU La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit : 1) À l'article 74, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant : «b) des processus efficaces d'identification, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, y compris des risques ESG à court, moyen et long termes, ainsi qu'un risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l'article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*); (*) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).». |
Article L. 511-55 du code monétaire et financier Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement. |
Législative |
Article L. 511-55 du code monétaire et financier Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, ainsi que le risque de concentration résultant de l'exposition aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l'article 7 bis du règlement EU 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement. |
Les obligations en matière de gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement est complété avec la prise en compte du risque de concentration résultant de l'exposition aux contreparties centrales. |
|
Directive 2024/2994 Article 3 modification de la directive (UE) 2019/2034 La directive (UE) 2019/2034 est modifiée comme suit : 2) À l'article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ces entreprises d'investissement sont ou pourraient être exposées, ou les des risques qu'elles font peser ou pourraient sont susceptibles de faire peser sur d'autres, y compris des risques de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, en tenant compte des conditions énoncées à l'article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012;» |
Article L. 533-29 du code monétaire et financier Les entreprises d'investissement se dotent : 1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ; 2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ; 3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. |
Législatif |
Article L. 533-29 du code monétaire et financier Les entreprises d'investissement se dotent : 1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres, y compris le risque de concentration résultant des expositions aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l'article 7 bis du règlement 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Les causes et effet significatifs des risques de concentration ; 2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ; 3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. |
|
|
Directive 2024/2994 Article 3 modification de la directive (UE) 2019/2034 3) L'article 29, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point suivant est ajouté: «e) les causes et effets significatifs des risques de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres.»; b) l'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa: «Aux fins du premier alinéa, point e), les États membres veillent à ce que l'organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l'article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d'importance systémique substantielle pour l'Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres.» 4) À l'article 36, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du premier alinéa, point a), les autorités compétentes évaluent et suivent l'évolution des pratiques des entreprises d'investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis en termes d'adaptation de leur modèle d'entreprise aux exigences énoncées à l'article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012.». |
Article L. 533-29-1 du code monétaire et financier I.-Les entreprises d'investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants : 1° Les causes et effets significatifs des risques pour les clients et toute incidence significative sur les fonds propres ; 2° Les causes et effets significatifs des risques pour le marché et toute incidence significative sur les fonds propres ; 3° Les causes et effets significatifs des risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ; 4° Le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris au cours d'une journée, de manière à garantir que l'entreprise d'investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour répondre aux causes significatives des risques mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d'activité de l'entreprise d'investissement ainsi qu'au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction et reflètent l'importance de l'entreprise d'investissement dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques relatives à l'appétence en matière de risques de l'entreprise d'investissement et relative à la gestion, au suivi et à l'atténuation des risques auxquels elle est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière. II.-Si l'entreprise d'investissement doit liquider ou cesser ses activités, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de ses modèles et de sa stratégie d'entreprise, elle prend en considération les exigences et les ressources permettant d'assurer le maintien des fonds propres et des ressources liquides à un niveau suffisant au cours du processus de sortie du marché. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 533-24-2, les entreprises d'investissement de classe 3 disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments indiqués aux 1°, 3° et 4° du I. IV.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application des stratégies, politiques, processus et systèmes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques, ainsi que la façon dont l'entreprise rapporte la mise en oeuvre de ces stratégies, politiques, processus et systèmes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
Législatif |
Article L. 533-29-1 du code monétaire et financier I.- Les entreprises d'investissement disposent de
stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides
permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les
éléments suivants : 5° Les causes et effet significatifs des
risques de concentration résultant de l'exposition aux contreparties
centrales, notamment ceux ayant un impact significatif sur les fonds propres. A
cette fin, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout
autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes
met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables
respectant les exigences énoncées à l'article 7
bis du règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits
dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et
traiter le risque de concentration découlant d'expositions sur des
contreparties centrales qui offrent des services d'importance systémique
substantielle pour l'Union ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance
ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance
équivalentes approuve et revoit régulièrement les
stratégies et politiques relatives à l'appétence en
matière de risques de l'entreprise d'investissement et relative à
la gestion, au suivi et à l'atténuation des risques auxquels elle
est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement
macroéconomique et du cycle économique de cette
dernière. III.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 533-24-2, les entreprises d'investissement de classe 3 disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments indiqués aux 1°, 3° et 4° du I. III bis. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et suit l'évolution des pratiques des entreprises d'investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément au présent article, ainsi que les progrès accomplis en termes d'adaptation de leur modèle d'entreprise aux exigences énoncées à l'article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. IV.- Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application des stratégies, politiques, processus et systèmes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques, ainsi que la façon dont l'entreprise rapporte la mise en oeuvre de ces stratégies, politiques, processus et systèmes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
|
Directive 2024/2994 Article 2 Modifications de la directive 2013/36/EU La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit : 5) À l'article 104, paragraphe 1, le point suivant est ajouté : « o) exiger des établissements, si elles estiment qu'il existe un risque de concentration excessif découlant d'expositions vis-à-vis d'une contrepartie centrale, qu'ils réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou qu'ils réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l'article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012. ». Article 3 modification de la directive (UE) 2019/2034 La directive (UE) 2019/2034 est modifiée comme suit: 5) À l'article 39, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l'article 29, de l'article 36, de l'article 37, paragraphe 3, et de l'article 38 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes sont dotées au moins des pouvoirs suivants:» b) le point suivant est ajouté: « n) exiger des entreprises d'investissement qu'elles réduisent leurs expositions vis-à-vis d'une contrepartie centrale ou qu'elles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l'article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, si les autorités compétentes estiment qu'il existe un risque de concentration excessif découlant d'expositions vis-à-vis de cette contrepartie centrale.». |
Article L. 612-33 du code monétaire et financier I. - Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. Elle peut, à ce titre : 1° Placer la personne sous surveillance spéciale ; 2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ; 3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ; 4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ; 5° Exiger de cette personne la cession d'activités ; 6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ; 7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ; 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ; 9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ; 10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ; 11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement, y compris aux activités externalisées ; 12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée ; 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 du code de la sécurité sociale ; 14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2 ; 15° Exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 la réduction des risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information utilisés par les entreprises d'investissement en vue de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ou de l'article L. 533-4-3 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. IV. - En cas de manquement aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre la commercialisation ou la vente de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 sont remplies ou lorsqu'un établissement de crédit n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformé aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1 du présent code. |
Législatif |
Article L. 612-33 du code monétaire et financier I. - Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. Elle peut, à ce titre : 1° Placer la personne sous surveillance spéciale ; 2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ; 3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ; 4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ; 5° Exiger de cette personne la cession d'activités ; 6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ; 7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ; 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ; 9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ; 10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ; 11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de financement, y compris aux activités externalisées ; 12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée ; 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 du code de la sécurité sociale ; 14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2 ; 15° Exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 la réduction des risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information utilisés par les entreprises d'investissement en vue de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d'intervention précoce prises en application de l'article L. 511-41-5 ou de l'article L. 533-4-3 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, ou tout ou partie des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétences, d'expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. IV. - En cas de manquement aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre la commercialisation ou la vente de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 sont remplies ou lorsqu'un établissement de crédit n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformé aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1 du présent code. V. « Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il existe un risque de concentration excessif découlant d'expositions sur une contrepartie centrale, elle peut enjoindre aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d'investissement de réduire leurs expositions sur celle-ci ou de les adapter entre leurs comptes de compensation conformément à l'article 7 bis du règlement (UE) n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. ». |
Article 9 - Tableau de transposition d'une directive de l'Union européenne : Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2013/34/UE Article 19bis (3) Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité Article 29bis (3) Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité |
Article L. 232-23 du code de commerce I. - Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ; L. 232-6-3 II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités. L. 233-28-4 II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires du groupe, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités. |
Législative |
Article L. 232-23 du code de commerce I. - Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ; 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. |
Le dernier alinéa est supprimé pour rétablir la cohérence du dispositif d'occultation des informations en matière de durabilité entre les différentes formes de sociétés. |
Article 11 - Tableau de transposition de la directive 2024/1640 Anti-blanchiment de capitaux et Financement du terrorisme
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directives |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2024/1640 anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Article 11 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, sans filtre, direct et libre aux informations contenues dans les registres centraux interconnectés visés à l'article 10 sans alerter l'entité juridique ou la construction juridique concernée. 2. L'accès visé au paragraphe 1 est accordé : a) aux autorités compétentes; b) aux organismes d'autorégulation dans l'exercice des fonctions de surveillance conformément à l'article 37; c) aux autorités fiscales; d) aux autorités nationales chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la mise en oeuvre des mesures restrictives de l'Union recensées en vertu des règlements pertinents du Conseil adoptés sur la base de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; e) à l'ALBC aux fins des analyses communes visées à l'article 32 de la présente directive et à l'article 40 du règlement (UE) 2024/1620; f) au Parquet européen; g) à l'OLAF; h) à Europol et Eurojust lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités compétentes des États membres. 3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/1624, les entités assujetties disposent d'un accès en temps utile aux informations conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l'article 10 de la présente directive. 4. Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à la disposition des entités assujetties lors du paiement d'une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations conservées dans les registres centraux et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l'accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux. 5. Au plus tard le 10 octobre 2026, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation et les catégories d'entités assujetties qui ont obtenu l'accès aux registres centraux et le type d'informations qui seront mises à la disposition des entités assujetties. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modifications apportées à la liste des autorités compétentes ou des catégories d'entités assujetties ou à la portée de l'accès accordé aux entités assujetties. La Commission met les informations relatives à l'accès accordé aux autorités compétentes et aux entités assujetties, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres. |
Article L. 167 du livre des procédures fiscales I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; [...] f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier. Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions. II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code. Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles : 1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ; 2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret. III.-L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne. |
Législative |
Article L. 167 du livre des procédures fiscales I. - Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction ni information du trust ou de la fiducie concernés, et de manière immédiate et directe, aux autorités compétentes mentionnées au 3° de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires [...] f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier. Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions. II. - Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées au 4° de l'article L561-46 du code monétaire et financier. à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code. Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles : 1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ; 2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret. III.-Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I, sont accessibles aux personnes physiques, pour les seules informations des trusts ou des fiducies dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs. [...] |
L'article 11 de la directive 2024/1640 (dite AMLD6) liste les autorités et entités ayant accès de manière directe et immédiate au registre des bénéficiaires effectifs (RBE), en précisant que l'entité juridique dont les informations relatives aux bénéficiaires effectifs (BE) sont consultées ne doit pas être notifiée de cette consultation (paragraphes 1 et 2). Le paragraphe 3 prévoit un accès des entités assujetties à ce registre dans le cadre de l'exercice de leurs obligations de vigilance à l'égard de leur clientèle. En ce qui concerne les entités immatriculées au RCS et RNE, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (article 4) a modifié l'article L. 561-46 et créé un article L. 561-46-2 du code monétaire et financier (CMF), satisfaisant les exigences des articles 11 et 12 de la directive. Les modifications proposées ne concernent donc que les registres des trusts et des fiducies, pour lesquelles les modalités de consultation des informations BE sont prévues à l'article L. 167 du livre des procédures fiscales (LPF). La transposition des exigences des paragraphes 1 et 2 (accès aux informations sur les BE par les autorités compétentes) est assurée par le renvoi aux autorités listées au 3° de l'article L. 561-46 au sein du I de l'article L. 167 du LPF. Le dernier alinéa de ce I, prévoyant l'accès à ces informations par les autorités homologues d'autres Etats membres de l'Union européenne, est supprimé puisque satisfait par le renvoi à l'article L. 561-46-2 du CMF au sein du nouveau IV proposé (voir infra). La transposition des exigences du paragraphe 3 (accès aux informations sur les BE par les entités assujetties à la LBC/FT) est assurée par le renvoi aux autorités listées au 4° de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. Les 1° et 2° de l'article L. 561-46 du CMF prévoient respectivement un accès des sociétés aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs qu'elles ont déclaré, et des personnes physiques aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés dont ils sont eux-mêmes déclarés comme bénéficiaires effectifs. Ces dispositions permettent aux sociétés et bénéficiaires effectifs de vérifier l'exactitude des informations déclarées. Les trusts et fiducies n'ayant pas de personnalité morale, il n'est pas nécessaire de leur étendre l'accès prévu au 1° de l'article L. 561-46. L'accès prévu au 2° est étendu aux trusts et fiducies par un nouveau III. |
|
Directive 2024/1640 anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Article 12 1. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime pour la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme ainsi que la lutte contre ces phénomènes ait accès aux informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques et de constructions juridiques conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l'article 10, sans alerter l'entité juridique ou la construction juridique concernée: a) le nom du bénéficiaire effectif; b) le mois et l'année de naissance du bénéficiaire effectif; c) le pays de résidence et la ou les nationalités du bénéficiaire effectif; d) pour les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus; e) pour les bénéficiaires effectifs de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires, la nature des intérêts effectifs. Outre les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale visée au paragraphe 2, points a), b) et e), ait également accès aux informations sur l'historique relatives aux bénéficiaires effectifs de l'entité ou de la construction juridique, y compris des entités juridiques ou constructions juridiques qui ont été dissoutes ou ont cessé d'exister au cours des cinq années précédentes, ainsi qu'à une description de la structure de contrôle ou de propriété. L'accès prévu au présent paragraphe est accordé par voie électronique. Toutefois, les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales qui peuvent démontrer un intérêt légitime puissent également accéder aux informations sous d'autres formes si elles ne peuvent pas utiliser des moyens électroniques. 2. Les personnes physiques ou morales suivantes sont réputées avoir un intérêt légitime à accéder aux informations énumérées au paragraphe 1: a) les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d'expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes; b) les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les universitaires, qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes; c) les personnes physiques ou morales susceptibles de conclure une transaction avec une entité ou construction juridique et qui souhaitent empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme; d) les entités soumises à des exigences en matière de LBC/FT dans des pays tiers, à condition qu'elles puissent démontrer la nécessité d'accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique pour exercer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle eu égard à un client ou un client potentiel conformément aux exigences en matière de LBC/FT dans ces pays tiers; e) les homologues de pays tiers des autorités compétentes de l'Union en matière de LBC/FT, à condition qu'ils puissent démontrer la nécessité d'accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique pour s'acquitter de leurs tâches au titre des cadres LBC/FT de ces pays tiers dans le cadre d'un cas concret; f) les autorités des États membres chargées de mettre en oeuvre le titre I, chapitres II et III, de la directive (UE) 2017/1132, en particulier les autorités chargées de l'immatriculation des sociétés dans le registre visé à l'article 16 de ladite directive, et les autorités des États membres chargées de contrôler la légalité des transformations, fusions et scissions des sociétés de capitaux conformément au titre II de ladite directive; g) les autorités responsables des programmes désignées par les États membres conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les bénéficiaires de fonds de l'Union; h) les autorités publiques mettant en oeuvre la facilité pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241, en ce qui concerne les bénéficiaires au titre de la facilité; i) les autorités publiques des États membres dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, en ce qui concerne les soumissionnaires et les opérateurs auxquels le marché est attribué dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics ; j) les fournisseurs de produits LBC/FT, dans la stricte mesure où les produits élaborés sur la base des informations visées au paragraphe 1 ou contenant ces informations ne sont fournis qu'à des clients qui sont des entités assujetties ou des autorités compétentes, à condition que ces fournisseurs puissent démontrer la nécessité d'accéder aux informations visées au paragraphe 1 dans le cadre d'un contrat conclu avec une entité assujettie ou une autorité compétente. Outre les catégories recensées au premier alinéa, les États membres veillent également à ce que d'autres personnes qui sont en mesure de démontrer un intérêt légitime en ce qui concerne la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, ainsi que de la lutte contre ces phénomènes, aient accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. 3. Au plus tard le 10 juillet 2026, les États membres communiquent à la Commission: a) la liste des autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe 2, points f), g) et h), et des autorités publiques ou catégories d'autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe 2, point i); b) toutes les catégories supplémentaires de personnes qui ont été déclarées comme ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs identifiées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa. Les États membres notifient à la Commission toute modification ou tout ajout aux catégories visées au premier alinéa sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa survenance. La Commission met les informations reçues en vertu du présent paragraphe à la disposition des autres États membres. 4. Les États membres veillent à ce que les registres centraux tiennent des registres des personnes accédant aux informations en vertu du présent article et puissent les divulguer aux bénéficiaires effectifs lorsqu'ils présentent une demande conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Toutefois, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les registres centraux ne permettent pas d'identifier toute personne qui consulte le registre lorsque ces personnes sont: a) des personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d'expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et avec la lutte contre ces phénomènes; b) des organisations de la société civile qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes. En outre, les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux s'abstiennent de divulguer l'identité de tout homologue de pays tiers des autorités compétentes de l'Union en matière de LBC/FT visées à l'article 2, paragraphe 1, point 44) a) et c), du règlement (UE) 2024/1624, aussi longtemps que le nécessite la protection des analyses ou des enquêtes de cette autorité. En ce qui concerne les personnes visées au deuxième alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que, lorsque les bénéficiaires effectifs présentent une demande conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, ils reçoivent des informations sur la fonction ou l'emploi occupé par les personnes ayant consulté leurs informations sur les bénéficiaires effectifs. Aux fins du troisième alinéa, lorsqu'elles demandent l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du présent article, les autorités indiquent la période pendant laquelle elles demandent aux registres centraux de s'abstenir de divulguer leur identité, qui ne dépasse pas cinq ans, et les raisons justifiant cette restriction, y compris la manière dont la transmission des informations compromettrait l'objectif de leurs analyses et enquêtes. Les États membres veillent à ce que, lorsque les registres centraux ne divulguent pas l'identité de l'entité ayant consulté les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute prolongation de ce délai ne soit accordée que sur la base d'une demande motivée de l'autorité du pays tiers, pour une période maximale d'un an, après laquelle une nouvelle demande motivée de prolongation est présentée par cette autorité. |
Article L. 167 du livre des procédures fiscales I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; [...] f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier. Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions. II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code. Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles : 1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ; 2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret. III.-L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne. |
Article L. 167 du livre des procédures fiscales [...] IV - Les dispositions du I, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et du II de l'article L561-46-2 du code monétaire et financier s'appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I. La demande d'accès à ces informations est adressée à l'administration fiscale, qui vérifie l'existence d'un intérêt légitime et statue sur cette demande. [...] |
A la suite de l'arrêt du 22 novembre 2022 de la CJUE ( affaires C-37/20 et C-601/20), l'accès aux RBE des Etats membres a été conditionné à la démonstration d'un intérêt légitime. Cet intérêt légitime est précisé par la directive AMLD6. Les paragraphes 1 à 3 de l'article 12 précisent les informations accessibles aux personnes démontrant un intérêt légitime, plus restreintes que celles figurant dans le RBE, et listent les personnes physiques et morales pour lesquelles l'intérêt légitime est présumé. L'article 12, paragraphe 4 prévoit la tenue d'un registre des personnes accédant aux informations BE sur le fondement de ce même article 12, qui puisse être communiqué au BE à sa demande par le teneur de registre. Des exceptions sont prévues pour exclure (i) journalistes et organisations de la société civile, et (ii) CRF et autorités chargées d'investigation de pays tiers. S'agissant du RBE associé aux RCS/RNE, un article L. 561-46-2 a été ajouté au sein du CMF par la loi du 30 avril 2025. Il introduit un dispositif de contrôle de l'intérêt légitime par l'INPI et les greffes des tribunaux de commerce (GTC), satisfaisant les exigences des paragraphes 1 à 3 l'article 12 de la directive en la matière. Les dispositions du paragraphe 4 sont partiellement transposées par l'article L. 561-46-2 du CMF, le reste relevant du domaine réglementaire. S'agissant des registres des trusts et des fiducies, les dispositions de l'article 12 de la directive sont transposées par un renvoi par le IV de l'article L. 167 du LPF à l'article L. 561-46-2 du CMF. Les dispositions de cet article concernant spécifiquement le rôle de l'INPI et des greffes des tribunaux de commerce sont exclus de ce renvoi. Il est précisé que l'appréciation de l'intérêt légitime relèvera de l'administration fiscale, dans sa fonction de teneur des registres concernés. |
|
|
Directive 2024/1640 anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Article 15 Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l'accès visé à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 1, exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité, les États membres prévoient une dérogation concernant l'accès à tout ou partie des informations personnelles sur le bénéficiaire effectif. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées au cas par cas sur la base d'une évaluation détaillée du caractère exceptionnel des circonstances et de la confirmation de l'existence de ces risques disproportionnés. Le droit d'obtenir une révision administrative de la décision accordant la dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons données, et communique ces données à la Commission. Les dérogations accordées conformément au présent article ne s'appliquent pas aux entités assujetties visées à l'article 3, point 3) b), du règlement (UE) 2024/1624 lorsqu'il s'agit de fonctionnaires. |
Article L. 123-6 du code de commerce modifié Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier. Article L. 123-52 du code de commerce L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 561-46, L. 561-46-2 code monétaire et financier, fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation. [...] Article L. 123-53 du code de commerce [...] L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46, L. 561-46-2 du code monétaire et financier. |
Nouveau Article L. 561-46-3 du code monétaire et financier I. Le bénéficiaire effectif peut demander qu'il soit dérogé à l'accès prévu par le 4° de l'article L. 561-46 ou par l'article L. 561-46-2 pour tout ou partie des informations le concernant dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque, eu égard à des circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d'Etat, cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation ; 2° Lorsque le bénéficiaire effectif est une personne mineure ; 3° Lorsque le bénéficiaire effectif est placé sous mesure de protection judiciaire. La demande est adressée, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce, au greffier du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité, dont le demandeur est bénéficiaire effectif, est immatriculée. Le greffier statue sur la demande de dérogation selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 123-50, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les conditions ne lui en apparaissent plus remplies, le greffier compétent met fin, d'office ou sur demande d'une personne mentionnée au 4° de l'article L. 561-46 ou au I de l'article L. 561-46-2, à la dérogation prévue au premier alinéa, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. Il signale sans délai les informations concernées par la levée de la dérogation au teneur du registre national des entreprises selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 123-50 du code de commerce. Article L. 123-6 du code de commerce modifié Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des articles L. 561-46-2 ou L. 561-46-3 du code monétaire et financier. Article L. 123-52 du code de commerce L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 561-46, L. 561-46-2 et L. 561-46-3 du code monétaire et financier, fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation. [...] Article L. 123-53 du code de commerce [...] L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46, L. 561-46-2 et L. 561-46-3 du code monétaire et financier. Article L. 167 du livre de procédures fiscales [...] IV. Les dispositions du I, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et du II de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier s'appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I. La demande d'accès à ces informations est adressée à l'administration fiscale qui vérifie l'existence d'un intérêt légitime et statue sur cette demande. V - Le bénéficiaire effectif peut demander à l'administration fiscale qu'il soit dérogé à l'accès prévu par le 4° de l'article L. 561-46 ou par l'article L. 561-46-2 pour tout ou partie des informations le concernant dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque, eu égard à des circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d'Etat, cette communication exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation ; 2° Lorsque le bénéficiaire effectif est une personne mineure ; 3° Lorsque le bénéficiaire effectif est placé sous mesure de protection judiciaire. L'administration fiscale statue sur cette demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les conditions n'en sont plus remplies, l'administration fiscale met fin, d'office ou sur demande d'une personne mentionnée au 4° de l'article L. 561-46 ou au I de l'article L. 561-46-2, à la dérogation prévue au premier alinéa, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. VI - L'administration fiscale conserve l'historique des consultations des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au IV. Un bénéficiaire effectif peut, par requête, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa. Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I de l'article L. 561 46 2 du code monétaire et financier, l'administration ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée. Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I de l'article L. 561 46 2 du code monétaire et financier, cette autorité peut demander de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. VII. - L'Institut national de la propriété industrielle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne. VIII - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
L'article 15 de la directive AMLD6 introduit un mécanisme de dérogation au dispositif de transparence des bénéficiaires effectifs pour les cas où la diffusion de ces informations exposerait la personne concernée à un risque, du fait d'une situation de vulnérabilité (minorité et incapacité) ou de l'existence d'une menace pesant sur sa personne. Le droit national ne prévoit en l'état aucun dispositif équivalent. L'article 15 distingue deux types de dérogation : - Une dérogation systématique en ce qui concerne les mineurs et les majeurs protégés, dès lors qu'ils en formulent la demande auprès du teneur de registre ; - Un octroi à la discrétion du teneur de registre, à la demande de tout autre bénéficiaire effectif, conditionné à l'existence d'un risque disproportionné de fraude, enlèvement, chantage, extorsion, etc. Les circonstances exceptionnelles visées par le texte de la directive s'interprètent comme n'étant à mobiliser que dans le cadre de l'octroi pour risque disproportionné. Par ailleurs, dès lors que les conditions d'octroi sont remplies, la directive prévoit une dérogation concernant l'accès spécifiquement visé à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 1. Ce mécanisme de dérogation n'empêche donc que l'accès aux informations par les entités assujetties aux obligations LBC/FT (art. L. 561-46 du CMF) ou par les personnes justifiant d'un intérêt légitime (art. L. 561-46-2 du CMF). Elle prévoit que cette dérogation peut concerner tout ou partie des informations. Le registre des bénéficiaires effectifs prévu pour les sociétés est tenu par deux teneurs de registre au sens européen : l'INPI et les greffiers des tribunaux de commerce (GTC). Le mécanisme prévu pour la transposition de ces dispositions suit le même schéma que celui retenu pour l'immatriculation des entreprises aux art. L. 123-33 et suivants et R. 123-92 et suivants du code de commerce : les demandes de dérogation sont effectuées auprès de l'INPI, puis transmises au greffier du tribunal de commerce territorialement compétent. Des précisions sur le plan opérationnel seront apportées par voie réglementaire. La directive exige des voies de recours administratif et contentieux. L'article L. 123-6 du code de commerce, qui prévoit les modalités de recours contre les décisions du greffier du tribunal de commerce prises sur le fondement de l'article L. 561-46-2 du CMF, est donc modifié pour ajouter la possibilité d'un recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 561-46-3 du CMF. Comme l'exige la directive, cet article prévoit par ailleurs une possibilité de révision de la décision d'octroi de la dérogation. Cette possibilité est ouverte aux personnes pouvant avoir accès au RBE, et avoir connaissance du fait qu'une demande de dérogation a été octroyée, ou à tout autre personne intéressée. La demande de révision sera traitée par les greffiers de tribunaux de commerce. Une architecture similaire est prévue au LPF pour le registre des trusts et fiducies, la DGFIP agissant en ce cas comme teneur de registre. Des renvois à l'article L. 561-46-3 du CMF sont ajoutés aux articles L. 123-52 et L. 123-53 du code de commerce pour des questions de cohérence. Enfin, une erreur de plume dans le nom de l'INPI est corrigée à l'article L. 167 du LPF. |
Article 13 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/2749 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2024/2749 Article 3 La directive 2010/35/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés : «27) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil *+ ; 28) “mode d'urgence dans le marché intérieur”, le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3), du règlement (UE) 2024//...++. Article 4 La directive 2014/29/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés : «18) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil *+ ; 19) “mode d'urgence dans le marché intérieur”, le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3), du règlement (UE) 2024//...++. Article 7 La directive 2014/34/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés : «27) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil *+ ; 28) “mode d'urgence dans le marché intérieur”, le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3), du règlement (UE) 2024//...++. Article 10 La directive 2014/68/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés : «33) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil *+ ; 34) “mode d'urgence dans le marché intérieur”, le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3), du règlement (UE) 2024//...++. |
Article L. 557-2 du code de l'environnement Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire. |
Législative |
Article L. 557-2 du code de l'environnement Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et de l'article 3 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire. |
Prise en compte des nouvelles définitions du règlement (UE) 2024/2747 |
|
Directive (UE) 2024/2749 Article 3 Modifications de la directive 2010/35/U La directive 2010/35/UE est modifiée comme suit : [...] 2) Le chapitre suivant est inséré: « Chapitre 5 bis Procédures d'urgenc Article 33 bis Application des procédures d'urgence 1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s'appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression transportables relevant de la présente directive. 2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s'appliquent qu'aux équipements sous pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s'appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l'article 33 quater, paragraphe 7, de la présente directive s'applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 4 Modifications de la directive 2014/29/UE La directive 2014/29/UE est modifiée comme suit: [...] 2) Le chapitre suivant est inséré: « Chapitre V bis Procédures d'urgence Article 38 bis Application des procédures d'urgence 1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s'appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements radioélectriques relevant de la présente directive. 2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s'appliquent qu'aux équipements radioélectriques qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s'appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l'article 43 quater, paragraphe 7, de la présente directive s'applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. 4. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements radioélectriques mis sur le marché conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3. [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 7 Modifications de la directive 2014/34/UE La directive 2014/34/UE est modifiée comme suit: « Chapitre 5 bis Procédures d'urgence Article 38 bis Application des procédures d'urgence [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 10 Modifications de la directive 2014/68/UE La directive 2014/68/UE est modifiée comme suit: « Chapitre 5 bis Procédures d'urgence Article 43 bis Application des procédures d'urgence [...] |
Aucun |
Législative |
Après l'article L. 557-8-1, il est ajouté une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis Procédures d'urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise Art. L. 557-8-2. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d'exécution en application de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d'urgence qu'il énumère. Lorsque cet acte d'exécution le prévoit et pour sa durée d'application, les dispositions prévues aux articles L. 557-8-3 et L. 557-8-4 s'appliquent. |
Ajout d'un nouvel article L. 557-8-2, paragraphe I |
|
Directive (UE) 2024/2749 Article 3 Modifications de la directive 2010/35/U La directive 2010/35/UE est modifiée comme suit : [...] 2) Le chapitre suivant est inséré: « [...] Article 33 ter Priorité donnée à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1. Le présent article s'applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 33 bis, paragraphe 1, qui font l'objet des procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 12, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié. 2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d'urgence en vertu de l'article 33 bis. 3. La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité d'équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes. 4. Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés. [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 4 Modifications de la directive 2014/29/UE La directive 2014/29/UE est modifiée comme suit: [...] 2) Le chapitre suivant est inséré: « [...] Article 38 ter Priorité donnée à l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1. Le présent article s'applique aux équipements radioélectriques énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 43 bis, paragraphe 1, qui font l'objet des procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 17, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié. 2. Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d'urgence en vertu de l'article 43 bis. 3. La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité d'équipements radioélectriques visées au paragraphe 2 n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes. 4. Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les équipements radioélectriques visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés. [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 7 Modifications de la directive 2014/34/UE La directive 2014/34/UE est modifiée comme suit: « [...] Article 38 ter Priorité donnée à l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 10 Modifications de la directive 2014/68/UE La directive 2014/68/UE est modifiée comme suit: « [...] Article 43 ter Priorité donnée à l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise [...] |
Aucun |
Législative |
Art. L. 557-8-3. - Les organismes habilités mentionnés à l'article L. 557-31 : « 1° Examinent en priorité les demandes d'évaluation de la conformité des produits mentionnés à l'article L. 557-8-2 qui sont, en application de l'article L. 557-5, soumis à une telle procédure, sans considération de la date à laquelle elles ont été formulées. La priorité donnée à ces demandes est mise en oeuvre sans surcoût ou pour un surcoût limité ; « 2° Le cas échéant, accroissent, dans des conditions économiquement acceptables, leurs capacités d'essai pour les produits mentionnés à l'article L. 557-8-2. |
Ajout d'un nouvel article L. 557-8-3 |
|
Directive (UE) 2024/2749 Article 3 Modifications de la directive 2010/35/U La directive 2010/35/UE est modifiée comme suit : [...] 2) Le chapitre suivant est inséré: « [...] Article 33 quater Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié 1. Par dérogation à l'article 12, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d'un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 33 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 12, requérant l'intervention d'un organisme notifié n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. 2. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l'autorisation permettent d'assurer la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, la Commission adopte sans retard un acte d'exécution qui étend la validité de l'autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l'ensemble de l'Union et fixe les conditions auxquelles l'équipement sous pression transportable spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu'elle élabore le projet d'acte d'exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l'évaluation technique ayant servi de base à l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 38 bis, paragraphe 2, de la présente directive. L'équipement sous pression transportable concerné par l'extension de validité visée au premier alinéa porte l'information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L'acte d'exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. [...] 4. Tant qu'un acte d'exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n'est pas adopté, l'autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n'est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l'autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l'adoption de cet acte d'exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation. 5. Les fabricants et les importateurs d'un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l'équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, et ils sont responsables de l'exécution de toutes les procédures d'évaluation de la conformité indiquées par l'autorité nationale compétente. 6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: 7. Par dérogation aux articles 14 et 16, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage Pi et l'article 16 ne s'applique pas. [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 4 Modifications de la directive 2014/29/UE La directive 2014/29/UE est modifiée comme suit: [...] 2) Le chapitre suivant est inséré: « [...] Article 38 quater Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 7 Modifications de la directive 2014/34/UE La directive 2014/34/UE est modifiée comme suit: « [...] Article 38 quater Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié [...] Directive (UE) 2024/2749 Article 10 Modifications de la directive 2014/68/UE La directive 2014/68/UE est modifiée comme suit: « [...] Article 43 quater Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié [...] |
Aucun |
Législative |
Art. L. 557-8-4. - I. - Lorsque, pour les produits mentionnés à l'article L. 557-8-2, les procédures d'évaluation de la conformité qui requièrent l'intervention obligatoire d'un organisme habilité n'ont pas été menées, l'autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser, sur le territoire national, leur mise sur le marché, ou leur utilisation par le fabricant à ses propres fins. Cette autorisation peut être délivrée : 1° Soit lorsqu'il est démontré, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat, que le produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ; 2° Soit lorsqu'un autre Etat membre a pris, dans ces mêmes conditions, une telle autorisation. Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Les produits mentionnés à l'article L. 557-8-2 pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d'exécution qui étend la validité de l'autorisation accordée par un Etat membre peuvent également être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins selon les conditions fixées dans cet acte. III. - Les fabricants et, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, les importateurs, déclarent que les produits dont la mise sur le marché ou l'utilisation résulte de la procédure d'autorisation prévue par cet article sont conformes aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4. Ces produits ne portent pas le marquage mentionné à l'article L. 557-4. IV. - Les autorisations mentionnées dans le présent article ne font pas obstacle à l'exercice des prérogatives en matière de surveillance de marché de l'autorité compétente et à l'édiction par celle-ci de mesures correctives ou restrictives au niveau national. Art. L. 557-8-5. - Aux termes des procédures d'urgence adoptées par un acte d'exécution de la Commission et de l'acte d'exécution pris par le Conseil mentionné à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire qu'ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, peuvent continuer à être exploités sans porter le marquage mentionné à l'article L. 557-4, les produits dont la mise sur le marché ou l'utilisation résulte : 1° D'une autorisation mentionnée à l'article L. 557-8-4 ; 2° D'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité prévues par l'article L. 557-4 fondée sur des normes ou spécifications communes adoptées par un acte d'exécution de la Commission. ; 3° Le 4° de l'article L. 557-58 est complété par les mots suivants : « ou, le cas échéant, ne respectant pas les conditions de mise sur le marché ou d'utilisation prévues à la section 1 bis du présent chapitre . |
Ajout d'un nouvel article L. 557-8-4, |
Article 15 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/2749 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2024/2749 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Article 43 quater 1. Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié 1.Par dérogation à l'article 17, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d'un équipement radioélectrique spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 43 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 17, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 3 a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. 2. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l'autorisation permettent d'assurer la conformité aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 3, la Commission adopte sans retard un acte d'exécution qui étend la validité de l'autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l'ensemble de l'Union et fixe les conditions auxquelles l'équipement radioélectrique spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu'elle élabore le projet d'acte d'exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l'évaluation technique ayant servi de base à l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3. L'équipement radioélectrique concerné par l'extension de validité visée au premier alinéa porte une information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L'acte d'exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 45, paragraphe 4. 4. Tant qu'un acte d'exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n'est pas adopté, l'autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n'est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l'autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l'adoption de cet acte d'exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation. 5. Les fabricants d'équipements radioélectriques soumis à la procédure d'autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l'équipement radioélectrique concerné est conforme à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 3, et ils sont responsables de l'exécution de toutes les procédures d'évaluation de la conformité indiquées par l'autorité nationale compétente. 6. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l'équipement radioélectrique. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: [...] |
Législative |
Article L. 34-9 [I : sans changement] [II : sans changement] III. - Les dispositions suivantes ne s'appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d'exécution en application de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d'urgence qu'il énumère. Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque l'acte d'exécution mentionné à l'alinéa précédent permet de recourir à cette procédure, l'Agence nationale des fréquences peut délivrer une autorisation de mise sur le marché pour des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Cette autorisation ne peut être délivrée que dans les conditions cumulatives suivantes : 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ; 2° Les procédures d'évaluation de la conformité nécessitant l'intervention obligatoire d'un organisme d'évaluation de la conformité n'ont pas été menées ; 3° La conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes telles que définies au 12° de l'article L. 32 a été démontrée conformément aux procédures visées dans l'autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation peut également être délivrée lorsqu'un autre Etat membre en a accordé une, dans ces mêmes conditions. Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit. Les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d'exécution qui étend la validité de l'autorisation accordée par un Etat membre peuvent également être mis sur le marché selon les conditions fixées dans cet acte. Les fabricants déclarent que les produits dont la mise sur le marché résulte de la procédure d'autorisation prévue par cet article sont conformes aux exigences essentielles pertinentes mentionnées au 12° de l'article L. 32. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent III. |
Les autres éléments nécessitant une transposition seront transposés au niveau réglementaire |
Article 18 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/2161 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2019/2161 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs Article 2 Modifications de la directive 98/6/CE La directive 98/6/CE est modifiée comme suit: 1) L'article suivant est inséré: « Article 6 bis 1. Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l'application de la réduction de prix. 2. Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d'une période qui n'est pas inférieure à trente jours avant l'application de la réduction de prix. 3. Les États membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d'expirer rapidement. 4. Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les États membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2. 5. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.». |
Article L. 112-1-1 du code de la consommation I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique
le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant
l'application de la réduction de prix. |
Législative |
Article L. 112-1-1 du code de la consommation I.- Toute annonce d'une réduction de prix
portant sur la vente d'un bien indique le prix
antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la
réduction de prix. |
Les autorités françaises prennent acte de la non-conformité de l'article L. 112-1-1 du code de la consommation au droit de l'UE et plus précisément aux dispositions de la directive 2005/29/CE, en ce qu'il s'applique non seulement aux biens mais aussi à la fourniture de services, y compris numériques ou encore de contenus numériques. Dans ces conditions et pour ces raisons, une mesure législative sera proposée pour limiter le champ d'application de l'article L.112-1-1 du code de la consommation à l'encadrement des seules annonces de réduction de prix portant sur des biens. |
|
Directive 2005/29/CE Article 6 Actions trompeuses 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement: |
Article L. 121-2 du code de la consommation Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...] 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes. |
Législative |
Article L. 121-2 du code de la consommation Une pratique commerciale est trompeuse si elle conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement lorsqu'elle a lieu dans l'une des circonstances suivantes Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances reprises ci-après et qu'elle amène le consommateur ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur, même si les informations présentées sont factuellement correctes, concernant l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...] 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes. |
Cet article corrige des sous transpositions passées de la directive 2005/29/CE. Il s'agit notamment d'intégrer le critère lié à la décision commerciale dans le délit de pratique commerciale trompeuse. |
|
Directive (UE) 2019/2161 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs directive 2005/29/CE Article 7 Omissions trompeuses 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement [...] 5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles. [...] |
Article L. 121-3 du code de la consommation Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou
du service ; [...] |
Législative |
Article L. 121-3 du code de la consommation Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et, par conséquent, dans l'un ou l'autre cas, conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou
du service ; [...] Les informations relatives aux communications commerciales prévues par les dispositions du droit européen et reprises dans liste non exhaustive figurant à l'annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont réputées substantielles. |
Cet article corrige des sous transpositions passées de la directive 2005/29/CE. Il s'agit notamment d'intégrer le critère lié à la décision commerciale dans le délit de pratique commerciale trompeuse par omission. |
|
Directive (UE) 2019/2161 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs Article 3 Modifications de la directive 2005/29/CE La directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: « Article 13 Sanctions [...] « 4. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d'infliger des amendes, dont le montant maximal est d'au moins 2 millions d'euros. [...] |
Article L. 132-2 du code de la consommation Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. Article L. 132-11 du code de la consommation Les pratiques commerciales agressives mentionnées
aux articles
L.
121-6 et L. 121-7 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300 000 euros. [...] |
Législative |
Article L. 132-2 du code de la consommation Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. Dans les conditions fixées par l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, en cas d' infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne et à défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. Article L. 132-11 du code de la consommation Les pratiques commerciales agressives mentionnées
aux articles
L.
121-6 et L. 121-7 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 300 000 euros. Dans les conditions fixées par l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, en cas d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne et à défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. [...] |
Cet article précise expressément la sanction lorsque le chiffres d'affaires annuel n'est pas connu, en cas de pratiques commerciales trompeuses constatées dans le cadre d'actions coordonnées engagées sur le fondement de l'article 21 du règlement 2017/2394/UE et constitutives d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'UE Cet article précise expressément la sanction lorsque le chiffres d'affaires annuel n'est pas connu, en cas de pratiques commerciales agressives constatées dans le cadre d'actions coordonnées engagées sur le fondement de l'article 21 du règlement 2017/2394/UE et constitutives d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'UE |
|
Directive (UE) 2019/2161 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs Article 4 Modifications de la directive 2011/83/CE La directive 2011/83/CE est modifiée comme suit: [...] 7) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question ou au moyen de celle-ci et avant la conclusion d'un tel contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées respectivement à l'article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et o), à l'exception du modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe I, partie B, visé au point h). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l'article 6, paragraphe 1, y compris le modèle de formulaire de rétractation, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.»; [...] |
Article L. 221-12 du code de la consommation Lorsque la technique de communication à distance
utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la
présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur
par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion
du contrat et dans les conditions prévues à l'article
L.
221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques
essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son
identité, à la durée du contrat et au droit de
rétractation. |
Législative |
Article L. 221-12 du code de la consommation Lorsque la technique de communication à distance
utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la
présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur
par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion
du contrat et dans les conditions prévues à l'article
L.
221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques
essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son
identité, à la durée du contrat et au droit de
rétractation à l'exclusion du formulaire type de
rétractation. |
Cet article corrige une sous transposition de l'article L. 221-12 et intègre la précision apportée par la directive (UE) 2019/2161, selon laquelle le formulaire de rétractation n'est pas exigé au titre des informations précontractuelles obligatoires à fournir au consommateur par la technique de communication à distance utilisée imposant des contraintes d'espace ou de temps ou au moyen de celle-ci, mais qu'il doit être fourni sous une forme adaptée, n'a pas été ajoutée à l'article L. 221-12 du code de la consommation qui ne renvoie qu'à la transmission au consommateur d'une information sur l'existence du droit de rétractation, mais dans les conditions prévues par l'article L. 221-5 de ce code, lequel prévoit la fourniture du formulaire type de rétractation. |
|
Directive (UE) 2019/2161 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs Article 4 Modifications de la directive 2011/83/CE La directive 2011/83/CE est modifiée comme suit: [...] 13) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: « Article 24 Sanctions [...] 3. Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d'infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d'engager des procédures judiciaires en vue d'infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans l'État membre ou les États membres concernés. |
Article L. 242-7-2 du code de la consommation Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. L. 242-14-1 du code de la consommation Lorsqu'une amende est prononcée en application des
articles
L.
242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance
mutuelle prévue par l'article
L.
511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande
ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application
de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les
autorités nationales chargées de veiller à l'application
de la législation en matière de protection des consommateurs, son
montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen
annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels
connus à la date des faits. |
Législative |
Article L. 242-7-2 du code de la consommation Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. L. 242-14-1 du code de la consommation Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour
calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut
être porté à deux millions d'euros. |
Cet article prévoit un montant d'amende conforme aux exigences européennes, en l'absence d'information sur le chiffre d'affaires annuel, lorsque des manquements aux dispositions de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs sont constatés dans le cadre d'actions coordonnées engagées sur le fondement de l'article 21 du règlement 2017/2394/UE et constitutives d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'UE Cet article prévoit un montant d'amende conforme aux exigences européennes, en l'absence d'information sur le chiffre d'affaires annuel, lorsque des manquements aux dispositions de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs sont constatés dans le cadre d'actions coordonnées engagées sur le fondement de l'article 21 du règlement 2017/2394/UE et constitutives d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'UE |
|
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur Article 12 Tribunaux et autorités administratives: justification des allégations Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, lors d'une procédure judiciaire ou administrative visée à l'article 11: a) à exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l'exactitude de ses allégations factuelles en rapport avec une pratique commerciale si, compte tenu de l'intérêt légitime du professionnel et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce, et b) à considérer des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes par le tribunal ou l'autorité administrative. |
Article L. 512-15 du code de la consommation Pour la recherche et la constatation des pratiques
commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du
responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la
communication de tous les éléments propres à justifier les
allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces
éléments sont détenus par un fabricant implanté
hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de
l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la
mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
|
Législative |
Article L. 512-15 du code de la consommation Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les allégations, indications ou
présentations en cause sont considérées comme inexactes en
l'absence de communication ou de mise à disposition des
éléments propres à les justifier ou si ceux-ci se
révèlent insuffisants. |
Cet article corrige une sous transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Il s'agit d'alléger la démonstration du délit en considérant des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées ne sont pas apportées par le professionnel ou sont jugées insuffisantes, conformément à l'article 12 de la directive 2005/29/CE. |
Articles 20 et 21 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/825 du parlement européen et du conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyale et grâce à une meilleure information
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE 1) A l'article 2, le premier alinéa est modifié comme suit : [...] b) Les points suivants sont ajoutés : « o) “allégation environnementale”: tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l'Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d'une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu'un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, est moins préjudiciable pour l'environnement que d'autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps; [...] |
Article liminaire du code de la consommation « Pour l'application du présent code, on entend par : [...] » |
Législative |
Article liminaire du code de la consommation « Pour l'application du présent code, on entend par : [...] 20°: [...] |
La présente disposition permet d'ajouter à l'article liminaire du code de la consommation la définition introduite par la directive. Il est proposé d'introduire dans l'article liminaire du code de la consommation les définitions qui sont transverses et non spécifiques à cette directive. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE 1) A l'article 2, le premier alinéa est modifié comme suit : [...] b) Les points suivants sont ajoutés : p) “allégation environnementale générique” : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d'un label de développement durable, et lorsque la spécification de l'allégation n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; [...] |
Article liminaire du code de la consommation « Pour l'application du présent code, on entend par : [...] » |
Législative |
Article liminaire du code de la consommation « Pour l'application du présent code, on entend par : [...] : 21° « allégation environnementale générique » : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d'un label de développement durable, dont le contenu n'est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; » [...] |
La présente disposition permet d'ajouter à l'article liminaire du code de la consommation la définition introduite par la directive. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE 1) A l'article 2, le premier alinéa est modifié comme suit : [...] b) Les points suivants sont ajoutés : q) “label de
développement durable” : tout label de confiance volontaire, label
de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise
à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé
ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou
sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du
droit de l'Union ou du droit national ; i) le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système ii) les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées. iii) le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit le retrait ou la suspension de l'utilisation du label de développement durable par le professionnel en cas de non-respect des exigences définies par le système. iv) le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l'objet d'une procédure objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l'indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l'Union ou nationales [...] |
Aucun |
Législative |
Article L. 433-11, est ajouté un chapitre IV ainsi rédigée : Chapitre IV : Label de développement durable Art. L. 434-1. - Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l'exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Pour bénéficier d'un label de développement durable, un bien, un service, un processus ou une entreprise doivent répondre aux exigences qui en conditionnent l'octroi, dont la vérification objective relève d'un système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l'indépendance à l'égard du propriétaire du label et de l'utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national. Le système de certification respecte les principes et garanties suivants : 1° Il est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels qui souhaitent se conformer aux exigences du système ; 2° Les exigences qu'il prévoit sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes concernées et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ; 3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non-conformité aux exigences mentionnées au présent 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label. |
Afin de transposer le nouveau label de développement durable européen, il convient de créer une chapitre IV intitulée « Label de développement durable » au sein du titre III du livre IV du code de la consommation. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE 1) A l'article 2, le premier alinéa est modifié comme suit : [...] b) Les points suivants sont ajoutés : v) “consommable” : tout composant d'un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne comme prévu [...] |
Article liminaire du code de la consommation « Pour l'application du présent code, on entend par : [...] » |
Législative |
Article liminaire du code de la consommation Pour l'application du présent code, on entend par : [...] 22° Consommable : tout composant d'un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne normalement. [...] |
|
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE [...] 2) L'article 6 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1 le point b) est remplacé par le texte suivant : «b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses caractéristiques environnementale ou sociale, ses accessoires, les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit.» ; |
Article L.121-2 du code de la consommation « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [...] 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; [...] » |
Législative |
Article L.121-2 du code de la consommation « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances [...] 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...] b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s'y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. ; [...] » |
Il est ajouté des éléments précisant que les caractéristiques environnementales ou sociales, les aspects liés à la circularité (tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité) sont des éléments sur lesquels peut être fondée une pratique commerciale trompeuse. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE [...] 2) L'article 6 est modifié comme suit : [...] b) au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés : « d) une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, Objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que d'autres éléments pertinents requis à l'appui de sa réalisation, tels que l'affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs ; » |
Article L.121-2 du code de la consommation « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [...] ». |
Législative |
Article L. 121-2 code de la consommation Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [...] 5° Une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l'affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel. [...] |
La disposition proposée permet l'ajout de nouvelles pratiques susceptibles d'être trompeuses prévues par la directive au code de la consommation. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE [...] 2) L'article 6 est modifié comme suit : [...] b) au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés : [...] « e) la publicité d'avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d'aucune caractéristique du produit ou de l'entreprise.» |
Article L.121-2 du code de la consommation « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [...] ». |
Législative |
Article L.121-2 du code de la
consommation [...] 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d'une entreprise sans que cela ne soit pertinent ni ne résulte d'une caractéristique propre à ce produit ou à l'activité de cette entreprise. [...] |
La disposition proposée permet l'ajout de nouvelles pratiques susceptibles d'être trompeuses conformément aux ajouts prévus par la directive. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2005/29 CE [...] 2) L'article 6 est modifié comme suit : [...] 3) A l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté : « 7. Lorsqu'un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d'aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l'objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles. » [...] |
Article L.121-3 du code de la consommation « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. [...] » |
Législative |
Article L.121-3 du code de la consommation « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. [...] Lorsqu'un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d'information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales ou liées à la circularité qui s'y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l'objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. |
|
|
Directive (UE) 2024/825 Article 2 Modification de la directive 2011/83/UE 1) A l'article 2, les points suivants sont insérés : « 14 bis) “garantie commerciale de durabilité”, la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l'article 17 de la directive (UE) 2019/771, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l'article 14 de la directive (UE) 2019/771, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée: » [...] |
Article L.217-23 « Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité, il est également tenu de mettre celle-ci en oeuvre dans des conditions identiques à la garantie légale. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions
plus favorables que celles décrites au premier alinéa. |
Législative |
Article L.217-23 du code de la consommation « Le producteur peut consentir au consommateur
une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée,
supérieure à deux ans,
dénommée “ garantie commerciale de durabilité
”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le
producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de
réparer ou de remplacer le bien, pendant la période
indiquée dans l'offre de garantie commerciale de
durabilité,; il est également tenu de mettre
celle-ci en oeuvre dans des conditions identiques à la garantie
légale. Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité ». |
|
|
Directive (UE) 2024/825 Article 1 Modification de la directive 2011/83/UE 1) A l'article 2, les points suivants sont insérés : [...] « 14 quinquies) “indice de réparabilité”, une note exprimant la capacité d'un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l'Union « 14 sexies) “mise à jour logicielle”, une mise à jour gratuite, y compris une mise à jour de sécurité, qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771; » [...] |
Article L. 111-1 du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un
contrat à titre onéreux, le professionnel communique au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes : Article L. 221-5 du code de la consommation I.-Préalablement à la conclusion d'un
contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu
numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes : [...] |
Législative |
Article L. 111-1 du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un
contrat à titre onéreux, le professionnel communique au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes : 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu'elles sont gratuites ; [...] Article L. 221-5 du code de la consommation I.-Préalablement à la conclusion d'un
contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu
numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes : [...] 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu'elles sont gratuites ; [...] |
Cette définition est intégrée dans le 5° ter des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 2 Modification de la directive 2011/83/UE [...] 2) À l'article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit : a) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans comme le prévoit la directive (UE) 2019/771, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l'article 22 bis de la présente directive;»; b) les points suivants sont insérés: «e bis) lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s'appliquant à l'ensemble du bien et d'une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d'une telle garantie, et sa durée ainsi qu'un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé à l'article 22 bis; e ter) un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques; e quater) le cas échéant, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; e quinquies) pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.»; |
Article L.111-1 du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : [...] 5° L'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; [...] Article L. 221-5 du code de la consommation I.-Préalablement à la conclusion d'un
contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu
numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes : [...] 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; |
législative |
Article L.111-1 du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : [...] 5° D'une part, l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu'elle est d'une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d'autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d'exécution de la Commission pris conformément à l'article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiée par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 ; Article L. 221-5 du code de la consommation I.-Préalablement à la conclusion d'un
contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu
numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes : [...] 5° D'une part, l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu'elle est d'une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d'autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d'exécution de la Commission pris en application de l'article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiée par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 |
|
|
Directive (UE) 2024/825 Article 2 Modification de la directive 2011/83/UE [...] 2) À l'article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit : [...] c) Les points suivants sont ajoutés : « i) le cas échéant, l'indice de réparabilité des biens; » j) Lorsque le point i) n'est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du Professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechanges nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. » [...] |
Article L.111-1 du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : [...] |
Législative et réglementaire |
Article L.111-1 du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : [...] 5° ter Le cas échéant, l'indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l'Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. [...] |
Un décret en Conseil d'Etat devrait modifier l'article R.111-1 du code de la consommation. |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 2 Modification de la directive 2011/83/UE [...] 3) À l'article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit : [...] b) le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans, comme le prévoit la directive (UE) 2019/771, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l'article 22 bis de la présente directive;» ; c) les points suivants sont insérés: «l bis) lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s'appliquant à l'ensemble du bien et d'une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d'une telle garantie, et sa durée ainsi qu'un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé à l'article 22 bis; l ter) un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques l quater) pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.» [...] |
Article L.221-5 du code de la consommation « I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1°Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; [...] 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ». |
Législative et réglementaire |
Article L.221-5 du code de la consommation « I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : [...] 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment, d'une part, les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique et, d'autre part, l'existence de toute restriction d'installation de logiciel [...] 5° D'une part, l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu'elle est d'une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d'autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d'exécution de la Commission pris en application de l'article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiée par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 ; 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu'elles sont gratuites ; |
Il est procédé à un alignement de l'article L. 221-5 sur l'article L. 111-1 afin que les obligations d'informations précontractuelles soient dans une grande mesure symétrique (vente physique ou vente à distance) à l'instar du droit européen (articles 5 et 6 de la directive 2011/83). Cette disposition implique la nécessité d'abroger l'article L.111-6 du code de la consommation (information sur la durée de fourniture de la mise à jour). |
|
Directive (UE) 2024/825 Article 2 Modification de la directive 2011/83/UE [...] 3) À l'article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit : [...] d) les points suivants sont ajoutés : « u) le cas échéant, l'indice de réparabilité des biens ; v) lorsque le point u) n'est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. » [...] |
Article L.221-5 du code de la consommation « I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : [...] » |
Législative |
Article L.221-5 du code de la consommation « I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : [...] 5° ter Le cas échéant, l'indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l'Union européenne ou, à défaut, lorsque le producteur les met à disposition du professionnel, les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation ; |
|
|
Directive (UE) 2024/825 Article 2 Modification de la directive 2011/83/UE [...] 4) À l'article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique impose au consommateur une obligation de payer, le professionnel informe le consommateur de manière claire et bien visible, et juste avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article 6, paragraphe 1, points a), e), l bis), o) et p). » |
Article L.221-14 code de la consommation : Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5. [...] |
Législative |
Article L.221-14 code de la consommation Pour les contrats conclus par voie électronique, qui imposent au consommateur une obligation de payer, le professionnel informe le consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière claire et bien visible les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5. Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité s'appliquant à l'ensemble du bien et d'une durée de plus de deux ans et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° de l'article L. 221-5, que le bien bénéficie d'une telle garantie, la durée de celle-ci et l'existence de la garantie légale de conformité. |
|
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: 1) le point suivant est inséré : « 2 bis) Afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques. » |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 2° bis De présenter un label de développement durable qui n'est fondé ni sur un système de certification au sens de l'article L. 434-1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ; ; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 2) les points suivants sont insérés : « 4 bis) Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation [...] » |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale du bien ou du service concerné, ou lorsque cette dernière est démontrée, est sans lien avec celle-ci. L'excellente performance environnementale est reconnue conformément à l'une au moins des normes suivantes : « a) le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au label écologique de l'Union européenne ; « b) les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les Etats membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024; « c) D'autres dispositions du droit de l'Union européenne définissant les meilleures performances environnementales |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. La définition « d'excellente performance environnementale » figurant au s) du 1) de l'article1 de la directive est directement intégrée à l'article L.121-4 du code de la consommation. Par ailleurs, cette nouvelle pratique en toutes circonstances nécessite de modifier l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement qui interdit certaines allégations environnementales , tandis que le droit européen autorise les allégations environnementales génériques sous certaines conditions. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 2) les points suivants sont insérés : « [...] 4 ter) Présenter une allégation environnementale concernant l'ensemble du produit ou de l'entreprise du professionnel, alors qu'elle ne concerne qu'un des aspects du produit ou une activité spécifique de l'entreprise du professionnel. [...] » |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 4 ter° De présenter une allégation environnementale comme portant sur l'ensemble d'un produit ou de l'activité d'une entreprise, alors qu'elle ne concerne qu'un de leurs aspects ; [...] |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. . |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 2) les points suivants sont insérés : « [...] 4 quater) Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre » |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 4° quater D'affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement du fait de ces émissions ; [...] |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 3) le point suivant est inséré : « 10 bis) Présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l'Union. » [...] |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 10 ° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie concernée ; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 4) les points suivants sont insérés : « [...] 23 quinquies) Dissimuler au consommateur le fait qu'une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l'utilisation de contenu numérique ou de services numériques » [...] |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 29° De dissimuler qu'une mise à jour logicielle sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d'un bien comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques a une incidence négative sur le fonctionnement d'un tel bien ou sur l'utilisation de contenu ou de services numériques ; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 4) les points suivants sont insérés : « [...] 23 sexies) Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu'elle ne fait qu'améliorer des fonctionnalités » [...] |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques, une mise à jour qui a en réalité pour objet d'améliorer leurs fonctionnalités ; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. La définition de « mise à jour
logicielle » figurant à l'article 14 sexies est directement
intégrée à l'article L.121-4 du code de la consommation.
|
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 4) les points suivants sont insérés : « [...] 23 septies) Toute communication commerciale sur un bien doté d'une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l'information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel» [...] |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d'un bien doté d'une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l'information sur l'existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel ; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 4) les points suivants sont insérés : « [...] 23 octies) Affirmer à tort qu'un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d'utilisation ou de l'intensité, dans des conditions normales d'utilisation » [...] |
Article L.121-4 du code de la consommation « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] » |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 32° D'affirmer à tort qu'un bien présente, dans des conditions normales d'utilisation, une certaine durabilité en termes de temps d'utilisation ou d'intensité; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 4) les points suivants sont insérés : « [...] 23 nonies) Présenter un bien comme réparable alors qu'il ne l'est pas.» [...] |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 33° De Présenter un bien comme réparable alors qu'il ne l'est pas ; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 4) les points suivants sont insérés : « [...] 23 decies) Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d'un bien avant que des raisons techniques ne le justifient » [...] |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 34° D'inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d'un bien avant que des raisons techniques ne le justifient ; |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
|
ANNEXE L'annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: [...] 4) les points suivants sont insérés : « [...] 23 undecies) Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d'un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d'origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu'une telle détérioration va se produire » |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] |
Législative |
Article L.121-4 du code de la consommation Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : [...] 35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d'un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d'origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu'une telle détérioration va se produire. |
La disposition proposée permet l'ajout de la nouvelle pratique commerciale trompeuses en toute circonstance à l'article L.121-4 du code de la consommation. |
Article 22 - Tableau de transposition de la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Article 3 Interdiction de pratiques commerciales déloyales 1. b) l'acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits ; un délai inférieur à 30 jours est toujours considéré comme une brève échéance ; les États membres peuvent fixer des délais inférieurs à 30 jours pour des secteurs spécifiques et dans des cas dûment justifiés ; c) l'acheteur demande au fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles ; d) l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires ; et c) et d) du 2. de l'art 3 1. Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites : [...] c) l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés au paragraphe 2 ; |
Article L. 443-5 du code de commerce L'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l'article L. 441-11 ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Toutefois, pour un secteur d'activité, pour une catégorie d'acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai peut être réduit, suivant des modalités fixées par décret, lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes. [...] Article L. 443-2 du code de commerce I. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Si le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4. |
Législative |
Article L. 443-5 du code de commerce L'acheteur ne peut annuler une commande de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l'article L. 441-11 dans un délai trop bref. Un délai est réputé être trop bref lorsqu'il n'est raisonnablement pas possible pour le fournisseur de trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits. Un délai inférieur à trente jours est, en toute circonstance, réputé trop bref. [...] Article L. 443-2 du code du commerce I. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Si le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4. Article L. 443-9 du code du commerce (nouveau) I. - Les modalités selon lesquelles le fournisseur de produits agricoles et alimentaires accepte, à la demande de l'acheteur, de prendre en charge tout ou partie des frais liés à une remise accordée par ce dernier lors de la revente de ces produits dans le cadre d'opérations promotionnelles sont fixées au préalable, en termes clairs et dénués d'ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur entre eux. Ces modalités comprennent notamment la durée de chaque opération promotionnelle ainsi que la quantité des produits concernés. A la demande du fournisseur, l'acheteur lui communique par écrit une estimation des remises dont il supportera la charge pour chacune des opérations promotionnelles ou pour l'ensemble de ces dernières. II. - Les conditions dans lesquelles un acheteur demande au fournisseur de contribuer aux dépenses de publicité réalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont préalablement fixées en termes clairs et dénués d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur conclu entre le fournisseur et l'acheteur. A la demande du fournisseur, l'acheteur lui communique par écrit une estimation des dépenses mises à sa charge, calculées par unité ou globalement, ainsi qu'une estimation écrite des coûts correspondants et des éléments sur lesquels repose cette estimation. III. - Dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, un acheteur ne peut modifier unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou encore sur la fourniture de services par l'acheteur au fournisseur. IV. - En cas de méconnaissance des dispositions prévues au III, les conditions convenues antérieurement à la modification unilatérale opérée à l'initiative de l'acheteur demeurent applicables. V. - Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. |
Articles relatifs à la première transposition
de la directive : |
Article 37 - Tableau de transposition de la Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union Article 2 point 4) c) Modifications apportées à l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 1 bis. Avant la conclusion ou la prorogation de tout contrat visé au paragraphe 1 du présent article, les clients finals reçoivent une synthèse des principales modalités et conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage clair et concis. Cette synthèse présente les droits énoncés à l'article 10, paragraphes 3 et 4, et comporte au minimum les informations suivantes : a) le prix total et sa composition; b) une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification; c) l'adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d'un service d'assistance aux consommateurs; et d) le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises. La Commission fournit des orientations à cet égard. 1 ter. Les États membres veillent à ce que les clients finals ayant conclu des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée ne se voient pas refuser la possibilité de participer, s'ils le décident, à la participation active de la demande et au partage d'énergie et de contribuer activement à la réalisation des besoins de flexibilité du réseau national d'électricité. |
Article L.224-1 du code de la consommation [...] II.- Les dispositions de l'article
L.
224-2, de l'article
L.
224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, des articles
L.
224-4,
L.
224-6, de l'article
L.
224-7 à l'exception de son 2°, des articles
L.
224-8 à L. 224-12 et
L.
224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions
mentionnées à l'
article
L. 442-2 du code de l'énergie pour la fourniture de gaz
naturel. |
Législative |
Article L. 224-1 du code de la consommation [...] II.-Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 442-2 du code de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel. Les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des articles L. 224-14 et L. 224-15 sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci. Les dispositions de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie, de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 et des articles L. 224-14 et L. 224-16 sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2-1 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci. II. - Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2 du code de l'énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article. Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2-1 du code de l'énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article ou, le cas échéant, à l'article L. 332-1-1 du même code. Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 442-2 du code de l'énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article ou, le cas échéant, à l'article L. 442-1-1 du même code. Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 442-2-1 du code de l'énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article ou, le cas échéant, à l'article L. 442-1-1 du même code. |
Ces alinéas visent à clarifier l'articulation entre le code de la consommation et le code de l'énergie s'agissant des droits contractuels listés aux articles 10, 11 et 12 de la directive 2019/944 |
|
Article 2 point 4) c) et d) de la directive (UE) 2024/1711 modifiant l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 Article 11 «1 bis. Avant la conclusion ou la prorogation de tout contrat visé au paragraphe 1 du présent article, les clients finals reçoivent une synthèse des principales modalités et conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage clair et concis. Cette synthèse présente les droits énoncés à l'article 10, paragraphes 3 et 4, et comporte au minimum les informations suivantes: a) le prix total et sa composition; b) une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification; c) l'adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d'un service d'assistance aux consommateurs; et d) le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises. La Commission fournit des orientations à cet égard. 1 ter. Les États membres veillent à ce que les clients finals ayant conclu des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée ne se voient pas refuser la possibilité de participer, s'ils le décident, à la participation active de la demande et au partage d'énergie et de contribuer activement à la réalisation des besoins de flexibilité du réseau national d'électricité.» ; d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats de fourniture d'électricité, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d'installer un compteur d'électricité adapté. Les autorités de régulation: a) surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives. b) prennent des mesures appropriées lorsqu'il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l'article 12, paragraphe 3.» |
Article L.224-3 du code de la consommation L'offre de fourniture d'électricité ou de
gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles,
les informations suivantes : 16° Les conditions d'accès à la
tarification spéciale " produit de première
nécessité " pour l'électricité et au tarif
spécial de solidarité pour le gaz naturel ; |
Législative |
Article L. 224-3 du code de la consommation L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur et les coordonnées du service d'assistance du fournisseur aux consommateurs ; 3° La description des produits et des services proposés ainsi que des niveaux de qualité des service offerts ; 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; 4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables. Pour les offres dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n'excédant pas un trimestre ou les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ces types d'offres sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre, dont le prix total, sa composition et les remises et promotions éventuelles ainsi que la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification, les conditions d'évolution de ces prix et les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables. Les opportunités, les coûts, les risques ainsi que l'estimation de la facture annuelle liés à l'offre permettant aux consommateurs de comprendre leur exposition à la volatilité des prix sont également indiqués. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent alinéa. 5° Pour la fourniture d'électricité, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ainsi que, pour les offres mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, la nécessité de disposer d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du même code ; 6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement La durée du contrat, l'existence ou non d'une période d'engagement du fournisseur sur les modalités de détermination du prix de fourniture et le cas échéant sa durée, et les conditions de renouvellement du contrat ; 7° La durée de validité de l'offre ; 8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ; 9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet, et le cas échéant des informations sur les paiements unitaires ; [...] |
|
|
Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union Article 2 point 4) d) Modifications apportées à l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 2. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats de fourniture d'électricité, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d'installer un compteur d'électricité adapté. Les autorités de régulation : a) surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives. b) prennent des mesures appropriées lorsqu'il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l'article 12, paragraphe 3 |
Article L. 224-4 du code de la consommation Les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d'une synthèse des principales dispositions contractuelles. |
Législative |
Article L. 224-4 du code de la consommation Les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d'une synthèse des principales dispositions contractuelles, qui comporte au minimum les informations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L.224-3, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. |
|
|
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE Article 10 paragraphe 4 Droits contractuels de base [...] 4. Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur. |
Article L. 224-10 du code de la consommation Tout projet de modification envisagé par le
fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur
par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au
moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière
d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de
modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de
détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les
conditions préalables et la portée de cette modification sont
communiqués de manière transparente et
compréhensible. |
Législative |
Article L. 224-10 du code de la consommation Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. I. - Tout projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur au moins un mois avant la date d'application envisagée. Ce projet est accompagné de la présentation circonstanciée, transparente et compréhensible des raisons et de la portée du projet de modification, ainsi que de la différence entre les conditions contractuelles en vigueur et le projet de modification. Cette notification est faite par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique. Lorsque les modifications envisagées ont un impact sur le prix, cette communication est accompagnée d'une comparaison, présentée dans des termes clairs et compréhensibles, entre, d'une part, le montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours et, d'autre part, le montant de la facture annuelle estimée compte tenu de ces modifications. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de mise en oeuvre du présent I. Les dispositions du présent I ne font pas obstacle à des modalités de modification du contrat plus favorables au consommateur prévues par le contrat. II. - Les communications mentionnées aux deux premiers alinéas du I sont assorties d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité à tout moment, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 224-15, où il sera précisé que cette faculté s'exerce sans frais dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information par le consommateur. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. |
Cette disposition assure la conformité du code de la consommation avec les droits contractuels de base des consommateurs prévus à l'article 10 de la directive (UE) 2019/944 en renforçant la protection de l'information du consommateur en cas de modification contractuelle proposée par le fournisseur |
|
Article 2 point 4) b) de la directive (UE) 2024/1711 modifiant l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union Article 2 point 4) b) Modifications apportées à l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 [...] Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne modifient pas unilatéralement les modalités et conditions des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée, et à ce qu'ils ne résilient pas de tels contrats avant leur échéance. |
Article L. 224-10 du code de la consommation |
Législative |
Article L. 224-10-1 du code de la consommation (nouveau) La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation à l'initiative du fournisseur pour un autre motif qu'une facture impayée ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf accord explicite du consommateur sur la modification contractuelle proposée. Lorsque le contrat prévoit une durée supérieure à un an pendant laquelle le fournisseur s'est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, ce qui inclut les offres de fourniture à prix fixe et à durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 du code de l'énergie sans s'y limiter, la modification de ces dispositions contractuelles ou la résiliation à l'initiative du fournisseur pour un autre motif qu'une facture impayée ne peuvent intervenir qu'à ce terme, sauf en cas d'accord explicite du consommateur. |
Cette disposition protège les consommateurs contre une modification durant la première année. Cette disposition conditionne la modification des offres à prix fixe et à durée déterminée à l'accord du consommateur. |
|
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE Article 10 point 4 Droits contractuels de base 4.Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur. Point 2. d) de l'annexe I d) lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois; ces informations peuvent également être mises à disposition sur l'internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. |
Article L.224-10 du code de la consommation |
Législative |
Article L. 224-12-1 du code de la consommation (nouveau) Lorsque les données de consommation ou l'évolution des prix de marché conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle visée à l'article L. 224-11 dont l'ampleur excède l'un des seuils fixés par l'arrêté mentionné à l'alinéa suivant, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l'échéancier de paiement pour qu'il reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'échéancier révisé, ce dernier entre en vigueur à l'issue du même délai. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie. |
|
|
Directive (UE) 2019/944 Article 12 point 3) Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur [...] 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l'agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente. |
Article L.224-15 du code de la consommation Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondants aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture. |
Législative |
Article L. 224-15 du code de la consommation (modification) Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondants aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsqu'il s'agit d'offres de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée destinées en tout ou partie à la recharge de véhicules électriques pour une durée excédant un seuil fixé par voie réglementaire, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l'échéance. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles et le seuil de durée, sont précisées par décret. L'existence de ces frais de résiliation anticipée est clairement communiquée avant la conclusion du contrat en application du 14° de l'article L. 224-3 et leurs modalités de calcul sont explicitement mentionnées dans le contrat souscrit. A tout moment, le fournisseur communique gratuitement au consommateur à sa demande le montant des frais applicables si ce dernier décide de résilier le contrat. En cas de résiliation, la facturation de ces frais détaille le calcul de ce montant. Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe est déterminée en tenant compte des conditions de marché et de la stratégie de couverture du fournisseur, ainsi que les investissements et services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. |
Cette disposition assure la conformité du code de la consommation avec l'article 12 de la directive (UE) 2019/944 |
|
Article 10 points 2 et 8 de la directive (UE) 2019/944 [...] 2. Sans préjudice des règles de l'Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (20) et la directive 93/13/CEE du Conseil (21), les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficient des droits prévus aux paragraphes 3 à 12 du présent article. 8. Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. |
Article L. 511-7 du code de la consommation |
Législative |
Article L. 511-7 du code de la consommation (modification) Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; [...] 34° Des articles L. 332-2, L. 332-2-1, L. 442-2 et L. 442-2-1 du code de l'énergie. |
|
|
Directive (UE) 2019/944 Article 12 3) Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur 3.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l'agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente. |
Article L. 332-2 du code de l'énergie (5ème alinéa) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. |
Législative |
Article L. 332-1-1 du code de l'énergie (nouveau) Les trois premiers alinéas de l'article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d'euros, ainsi qu'aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères. |
Cette disposition assure la conformité du code de l'énergie avec l'article 12 point 3 de la directive (UE) 2019/944 |
|
Directive (UE) 2019/944 Article 12 3) Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur 3.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l'agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente. |
Article L. 332-2 du dode de l'énergie (5ème alinéa) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. |
Législative |
Article L. 332-1-2 du code de l'énergie (nouveau) Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues à l'article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l'échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. |
|
|
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE Article 10 3), 4) et 5) Droits contractuels de base [...] 3.Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant: a) l'identité et l'adresse du fournisseur; b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial; c) les types de services de maintenance offerts; d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues; e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive; g) les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26; h) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe. Les conditions sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat. Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis. 4.Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur. 5.Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services. |
Article L. 332-2 du code de l'énergie Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale. Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours. L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. |
Législative |
Article L. 332-2 du code de l'énergie (modification) Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale. Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours. L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. I. - Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l'article L. 332-1-1, les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article sont applicables aux contrats et offres correspondantes conclus entre les fournisseurs d'électricité et les catégories suivantes de consommateurs finals : 1° Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ; 2° Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kilovoltampères, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions au titre de la souscription d'une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), le consommateur final atteste sur l'honneur qu'il respecte ces critères. Ces dispositions sont d'ordre public. II. - Hors les cas prévus à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, ainsi que des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l'article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables. Les dispositions du 10° et du 12° de l'article L. 224-3 du code de la consommation et des 3°, 4° et 5° de l'article L. 224-7 du même code ne s'appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie. Pour l'application du II de l'article L. 224-10 du code de la consommation, la communication du projet de modification des conditions contractuelles, adressée par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique, est assortie d'une information précisant au consommateur final qu'il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. |
Cette disposition assure la conformité du code de l'énergie avec les droits contractuels de base des consommateurs prévus à l'article 10 de la directive (UE) 2019/944 |
|
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE Article 10 3), 4) et 5) Droits contractuels de base [...] 3.Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant: a) l'identité et l'adresse du fournisseur; b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial; c) les types de services de maintenance offerts; d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues; e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive; g) les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26; h) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe. Les conditions sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat. Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis. 4.Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur. 5.Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services. |
Articles L. 332-2-1 du code de l'énergie Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, ainsi que de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale. Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours. |
Législative |
Article L. 332-2-1 du code de l'énergie (modification) Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, ainsi que de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. I. - Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l'article L. 332-1-1, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs non domestiques autres que ceux visés au I de l'article L. 332-2 les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article. Elles sont d'ordre public. II. - Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 3° bis, 5°, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, de l'article L. 224-7 du code de la consommation à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, du premier alinéa du I et du III de l'article L. 224-10 , du second alinéa de l'article L. 224-10-1 du code de la consommation, de la première phrase de l'article L. 224-11 du code de la consommation, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 du code de la consommation et de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables. Par dérogation au 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation, la communication de l'estimation de la facture annuelle n'est pas requise. |
|
|
Article 2 point 4) a) et b) de la directive (UE) 2024/1711 modifiant l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 l'article 11 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le titre suivant: «Droit à un contrat de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée et droit à un contrat d'électricité à tarification dynamique» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée et des contrats à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui disposent d'un compteur intelligent puissent demander la conclusion d'un contrat d'électricité à tarification dynamique et à ce que tous les clients finals puissent demander la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée d'une durée d'au moins un an, avec au moins un fournisseur et avec chaque fournisseur ayant plus de 200 000 clients finals. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exempter un fournisseur ayant plus de 200 000 clients finals de l'obligation de proposer des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque: a) le fournisseur ne propose que des contrats à tarification dynamique; b) l'exemption n'a pas d'incidence négative sur la concurrence; et c) il reste un choix suffisant de contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée pour les clients finals. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne modifient pas unilatéralement les modalités et conditions des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée, et à ce qu'ils ne résilient pas de tels contrats avant leur échéance.» 1 ter. Les États membres veillent à ce que les clients finals ayant conclu des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée ne se voient pas refuser la possibilité de participer, s'ils le décident, à la participation active de la demande et au partage d'énergie et de contribuer activement à la réalisation des besoins de flexibilité du réseau national d'électricité.» |
Article L. 332-7 du code de l'énergie II.- Tout fournisseur d'électricité
assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer
à un client équipé d'un dispositif de comptage
mentionné à l'article L. 341-4 qui en fait la demande une offre
de fourniture d'électricité à tarification dynamique
reflétant les variations de prix à des intervalles
équivalant au moins à la fréquence du règlement du
marché. Les modalités selon lesquelles cette offre prend en
compte les variations des prix de marché sont définies par
délibération de la Commission de régulation de
l'énergie. |
Législative |
Article L. 332-8 du code de l'énergie (nouveau) I. - Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d'un an minimum sur le prix. La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie. II. - Lorsqu'un fournisseur d'électricité propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur domestique ou à un consommateur non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires le total de bilan annuels ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, n'excèdent pas dix millions d'euros, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. III. - Un client final ayant souscrit à une offre à prix fixe et à durée déterminée peut valoriser la flexibilité de sa consommation d'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, ou participer à une opération d'autoconsommation mentionnée aux articles L. 351-1 et L. 351-2, au même titre que tout client final ayant souscrit une offre de fourniture d'électricité et dans les mêmes conditions. |
|
|
Article 2 point 4) de la directive (UE) 2024/1711 modifiant l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 |
Articles L.332-6 et L. 122-3 du code de l'énergie |
Législative |
Article L. 332-6 du code de l'énergie (modification) Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite. Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7 et à prix fixe et à durée déterminée définies à l'article L. 332-8, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. 5° Au second alinéa de l'article L.332-6, après les mots : « y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7 », sont insérés les mots : « et à prix fixe et à durée déterminée définies à l'article L. 332-8 ». Article L. 122-3 du code de l'énergie (modification) Le médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d'offres commerciales comprenant une part d'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée en application de l'article L. 311-25, de l'article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et de l'article L. 446-21 selon des critères définis par décret. Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du présent code, les offres à prix fixe et durée déterminée et les offres à prix variable, selon des critères définis par ce même décret. [...] |
|
|
Article 2 point 9) de la directive (UE) 2024/1711 (création d'un article 28 bis dans la directive (UE) 2019/944) Article 28 bis Protection contre les interruptions de fourniture 1. Les États membres veillent à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d'électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l'interdiction des interruptions ou d'autres mesures équivalentes. Les États membres assurent cette protection dans le cadre de leur politique à l'égard des clients vulnérables visée à l'article 28, paragraphe 1, et sans préjudice des mesures énoncées à l'article 10, paragraphe 11. Lorsqu'ils notifient à la Commission les mesures transposant la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. 2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne résilient pas les contrats et n'interrompent pas la fourniture aux clients au motif que les clients ont présenté une plainte conformément à l'article 10, paragraphe 9, ou faisant l'objet d'un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l'article 26. Une telle plainte ou l'utilisation d'un tel mécanisme n'affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour éviter toute procédure abusive. 3. Les États membres prennent des mesures appropriées visées au paragraphe 1 pour permettre aux clients d'éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure : a) la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement; ces accords peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d'énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou d'utilisations inhabituelles en saisons hivernale et estivale, avec la proposition d'échéanciers de paiement souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d'endettement, des relevés pratiqués par les clients, et une meilleure communication avec les clients et les organismes d'aide ; b) la promotion de l'éducation et de la sensibilisation des consommateurs à leurs droits en matière de gestion de dette ; c) l'accès à un financement, à des bons d'achat ou à des subventions pour aider au règlement des factures ; d) l'encouragement et la facilitation de la fourniture de relevés des compteurs tous les trois mois, ou, le cas échéant, pour des périodes de facturation plus courtes, lorsqu'un système permettant au client final de faire régulièrement ses relevés lui-même a été mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations énoncées à l'annexe I, points 2 a) et b), en ce qui concerne la fréquence de facturation et la fourniture d'informations relatives à la facturation. |
Article L.332-5-1 du code de l'énergie Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. |
Législative |
Article L. 332-5-1 du code de l'énergie (modification) Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. Les fournisseurs ne peuvent procéder à l'interruption de la fourniture d'électricité d'un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que : 1° Le client a eu recours à la procédure de plaintes gérées par son fournisseur ; 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l'énergie ou des médiateurs de la consommation, prévue à l'article L. 612-1 du code de la consommation. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n'affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. |
|
|
Article 2 point 6) de la directive (UE) 2024/1711 (création d'un article 18 bis dans la directive (UE) 2019/944) Article 18 bis Gestion des risques fournisseurs 1. Les autorités de régulation, ou lorsqu'un État membre a désigné une autre autorité compétente indépendante à cette fin, cette autorité compétente désignée, compte tenu de la taille du fournisseur ou de la structure du marché et y compris, le cas échéant, en procédant à des tests de résistance, veillent à ce que les fournisseurs : a) aient mis en place et en oeuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d'électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent ; b) prennent toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture. 2. Les stratégies de couverture des fournisseurs peuvent inclure le recours à des accords d'achat d'électricité au sens de l'article 2, point 77), du règlement (UE) 2019/943 ou d'autres instruments appropriés, tels que des contrats à terme. Lorsqu'il existe des marchés suffisamment développés pour des accords d'achat d'électricité permettant une concurrence effective, les États membres peuvent exiger qu'une part de l'exposition au risque des fournisseurs à l'évolution des prix de gros de l'électricité soit couverte au moyen d'accords d'achat d'électricité pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables correspondant à la durée de leur exposition au risque du côté du consommateur, sous réserve du respect du droit de la concurrence de l'Union. 3. Les États membres s'efforcent de garantir l'accessibilité des produits de couverture pour les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable et de mettre en place des conditions propices à cette fin. |
Articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l'énergie |
Législative |
Article L. 332-9 du code de l'énergie (nouveau) I. - Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu'ils proposent. II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l'énergie, les procédures suivies par les fournisseurs d'énergie pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. III. - Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l'énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l'énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants. L'autorité administrative informe la Commission de régulation de l'énergie de son intention de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 333-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie informe l'autorité administrative de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 332-9 et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné à l'alinéa précédent. Ces communications revêtent un caractère confidentiel. Article L. 333-1 du code de l'énergie (modification) [...] II. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat. L'autorisation est délivrée en fonction : 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ; 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III et à l'article L. 332-9. [...] Article L. 333-3 du code de l'énergie (modification) Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne s'acquitte pas de la sanction ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de mise en conformité prévu au II de l'article L. 332-9, en cas de résiliation du contrat d'accès au réseau prévu à l'article L. 111-92, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire. [...] |
|
|
Article 2 point 14 de la directive (UE) 2024/1711 (création d'un article 66 bis dans la directive (UE) 2019/944) Article 66 bis Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l'électricité 1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut, par voie de décision d'exécution, déclarer une crise des prix de l'électricité au niveau régional ou à l'échelle de l'Union, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l'électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s'attend à ce qu'ils se prolongent pendant au moins six mois, le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tenant pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix de l'électricité au niveau régional ou à l'échelle de l'Union a été déclarée ; b) de fortes hausses des prix de détail de l'électricité, de l'ordre de 70 %, dont on s'attend à ce qu'elles se prolongent pendant au moins trois mois. 2. La décision d'exécution visée au paragraphe 1 précise sa durée de validité, qui peut être d'un an au maximum. Cette durée peut être prolongée conformément à la procédure définie au paragraphe 8 pour des périodes consécutives d'une durée maximale d'un an. 3. La déclaration d'une crise régionale ou à l'échelle de l'Union en matière de prix de l'électricité en vertu du paragraphe 1 garantit une concurrence et des échanges équitables dans tous les États membres concernés par la décision d'exécution, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé. 4. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix de l'électricité au niveau régional ou à l'échelle de l'Union, qui comprend la durée de validité proposée pour la décision d'exécution. 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier une proposition de la Commission présentée conformément aux paragraphes 4 ou 8. 6. Lorsque le Conseil a adopté une décision d'exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, effectuer des interventions publiques temporaires ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux petites et moyennes entreprises. Ces interventions publiques : a) sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l'année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande ; b) respectent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 4 et 7 ; c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7 du présent article ; d) sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur. 7. Lorsque le Conseil a adopté une décision d'exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour la durée de validité de cette décision, par dérogation à l'article 5, paragraphe 7, point c), lorsqu'ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité conformément à l'article 5, paragraphe 6, ou au paragraphe 6 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture d'électricité inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le prix fixé pour les clients résidentiels s'applique seulement à 80 %, au maximum, de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande ; b) il n'y a pas de discrimination entre les fournisseurs ; c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d'une manière transparente et non discriminatoire ; d) tous les fournisseurs, sur la même base, peuvent proposer pour la fourniture d'électricité des offres à un prix inférieur aux coûts ; e) les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur de l'électricité. 8. En temps utile avant l'expiration de la durée de validité fixée conformément au paragraphe 2, la Commission évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d'être remplies. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d'être remplies, elle soumet au Conseil une proposition visant à prolonger la durée de validité d'une décision d'exécution adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsque le Conseil décide de prolonger la durée de validité, les paragraphes 6 et 7 s'appliquent pendant cette période prolongée. La Commission évalue et surveille en permanence l'incidence des mesures adoptées en vertu du présent article et publie régulièrement les résultats de ces évaluations. |
Aucune Article L. 121-8 du code de l'énergie |
Législative |
Article L. 337-9-1 du code de l'énergie (nouveau) Lorsque le Conseil de l'Union européenne a déclaré une crise des prix de l'électricité à l'échelle de l'Union ou à une échelle régionale incluant la France en application paragraphe 1 de l'article 66 bis de la directive UE 2019/944 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de la Commission de régulation de l'énergie, impose aux titulaires d'une autorisation de fourniture au titre de l'article L. 333-3 une intervention temporaire dans la fixation des prix de fourniture d'électricité aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs non-domestiques éligibles dont les caractéristiques sont définies par ce décret. Article L. 337-9-2 du code de l'énergie (nouveau)
Les consommateurs finals non-domestiques éligibles attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 337-9-1. Les consommateurs finals non-domestiques sont redevables au fournisseur des montants hors taxe octroyés indûment en application de l'article L. 337-9-1, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l'Etat d'une majoration de 20 % des montants hors taxe octroyés indûment, en cas de manquement délibéré. Les montants hors taxe, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur en application de l'article L. 121-8. Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée à l'alinéa précédent correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants est effectué par l'Etat. Ces montants recouvrés par l'Etat sont majorés de 30 % des montants hors taxe octroyés indûment en cas de manquement délibéré. Article L. 337-9-3 du code de l'énergie (nouveau) Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle des consommateurs éligibles nécessaires pour l'application des mesures prises en application de l'article L. 337-9-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie. Article L. 337-9-4 du code de l'énergie (nouveau) Les pertes de recettes supportées, le cas échéant, par les fournisseurs d'électricité en raison des mesures prises en application de l'article L. 337-9-1 ainsi que les frais de gestion supportés pour leur mise en oeuvre constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6, compensées par l'Etat. Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28, le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 337-9-1 définit les modalités selon lesquelles les pertes sont déclarées par les fournisseurs, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie et compensées aux fournisseurs. Article L. 337-9-5 du code de l'énergie (nouveau) Les fournisseurs d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient en application des mesures prises en application de l'article L. 337-9-1. Article L. 337-9-6 du code de l'énergie (nouveau) La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application des mesures prises en application de l'article L. 337-9-1 dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger des fournisseurs qu'ils fassent attester par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public, de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Article. 121-8 du code de l'énergie (modification) En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : 1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ; 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ; 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre des mesures prises en cas de crise en application de l'article L. 337-9-1. |
Les dispositions de cette sous-section se rapporte à l'article 2 point 14) de la directive (UE) 2024/1711 (création d'un article 66 bis dans la directive (UE) 2019/944) |
|
Article 2 point 4 d) de la directive (UE) 2024/1711 modifiant l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 [...] d)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 2. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats de fourniture d'électricité, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d'installer un compteur d'électricité adapté. Les autorités de régulation: surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives. prennent des mesures appropriées lorsqu'il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l'article 12, paragraphe 3. |
Article L.131-2 du code de l'énergie |
Législative |
Article L. 131-2 du code de l'énergie (modification) La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. [...] Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en oeuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle surveille la mise en oeuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et des contrats à prix fixe et à durée déterminée et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution de ces contrats, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle peut préciser les modalités de détermination des frais de résiliation prévus à l'article L. 224 15 du code de la consommation et prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate des frais de résiliation excessifs. Elle surveille également la mise en oeuvre des interventions publiques sur la fixation des prix de l'électricité prises en cas de crise en application de l'article L. 337-9-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2. Dans le cadre des travaux de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie mentionnée à l'article L. 134-13, la Commission de régulation de l'énergie oeuvre afin de garantir que la plateforme d'allocation unique instituée par le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme, le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et l'entité des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité de l'Union, respectent les obligations qui leur incombent au titre du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne des enjeux transfrontaliers impliquant la France sur le marché de l'électricité. A ce titre, la Commission de régulation de l'énergie participe au recensement conjoint avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union, des cas de non-respect par les acteurs précités de leurs obligations respectives. |
Dispositions nécessaires en cohérence avec la transposition de l'article 2 point 4 d) de la directive (UE) 2024/1711 modifiant l'article 11 de la directive (UE) 2019/944 |
Article 38 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Dispositions proposées |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 2 - Définitions |
||||
|
[...] 11) « hydrogène bas carbone »: l'hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources non renouvelables et qui respecte le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d'origine non biologique énoncé dans la méthode d'évaluation des réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d'origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, adoptée en vertu de l'article 29 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 [...] |
Article L. 811-1 du code de l'énergie Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en oeuvre d'un procédé industriel. L'hydrogène renouvelable est l'hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe. Cette électricité peut être fournie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d'hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil. L'hydrogène bas-carbone est l'hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères. Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, l'hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d'émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone. L'hydrogène carboné est l'hydrogène qui n'est ni renouvelable, ni bas-carbone. L'hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l'article L. 813-2, au sein du même processus n'est pas considéré comme de l'hydrogène bas-carbone au sens du présent code. Il n'est pas comptabilisé au titre de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4. La définition de l'ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l'application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
Législative |
Article L. 811-1 du code de l'énergie Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en oeuvre d'un procédé industriel. L'hydrogène renouvelable est l'hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe. Cette électricité peut être fournie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d'hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil. L'hydrogène bas-carbone est l'hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères. Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, l'hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d'émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone. L'hydrogène carboné est l'hydrogène qui n'est ni renouvelable, ni bas-carbone. L'hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l'article L. 813-2, au sein du même processus n'est pas considéré comme de l'hydrogène bas-carbone au sens du présent code. Il n'est pas comptabilisé au titre de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4. La définition de l'ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l'application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie et tient compte du seuil défini par décret en application de l'article L. 282-2. |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 3 - Marchés du gaz naturel et de l'hydrogène concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires |
Législative |
|||
|
1. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter du gaz naturel et de l'hydrogène auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu'ils soient libres d'avoir plus d'un contrat de fourniture de gaz naturel ou d'hydrogène à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. [...] |
Pour le gaz naturel : Article L. 441-1 du code de l'énergie Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel. Article L. 851-1 du code de l'énergie Les activités de production et de vente d'hydrogène renouvelable aux consommateurs finals s'exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code. Pour l'hydrogène : Article L 851-2 du code de l'énergie Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est injecté dans le réseau de gaz naturel, figurent au chapitre V du titre IV du livre IV. |
Législative |
Pour le gaz naturel : Article L. 441-1 du code de l'énergie Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel et d'avoir plus d'un contrat de fourniture de gaz à la fois, dès lors que la connexion requise et les points de mesure sont établis. Article L 851-1 du code de l'énergie Les activités de production et de vente d'hydrogène aux consommateurs finals s'exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code. Pour l'hydrogène : Nouveau : Article L. 851-1-1 du code de l'énergie Est considérée comme un fournisseur d'hydrogène au sens du présent code, toute personne physique ou morale qui vend ou revend à des clients de l'hydrogène. Article L 851-2 du code de l'énergie Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène, lorsqu'il est injecté dans le réseau de gaz naturel, figurent au chapitre V du titre IV du livre IV. |
|
|
[...] 2. Les États membres veillent à ce que leur droit national n'entrave pas indûment les échanges transfrontaliers de gaz naturel et d'hydrogène, le fonctionnement et l'émergence de la liquidité des échanges pour le gaz naturel et l'hydrogène, la participation des consommateurs, les investissements, en particulier dans les gaz renouvelables et les gaz bas carbone, ou dans le stockage de l'énergie entre États membres, et à ce que les prix du gaz naturel et de l'hydrogène reflètent l'offre et la demande réelles. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 851-1-2 du code de l'énergie Tout client grossiste ou qui consomme l'hydrogène qu'il achète a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur d'hydrogène et d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'hydrogène à la fois. |
||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 8 - Procédure d'autorisation |
||||
|
1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel, d'installations de production d'hydrogène et d'infrastructures de système d'hydrogène nécessitent une autorisation, comme une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation, les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction ou d'exploitation de ces installations, infrastructures, conduites ou équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 11. Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et d'hydrogène et des autorisations à des clients grossistes. |
Législative |
Nouveau : Article L. 834-1 du code de l'énergie Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation pour la construction et l'exploitation de canalisations de transport d'hydrogène sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement. Nouveau : Article L. 834-2 du code de l'énergie Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport d'hydrogène et à l'établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement. Nouveau : Article L. 834-3 du code de l'énergie Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport d'hydrogène est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales. Nouveau : Article L. 834-4 du code de l'énergie Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement. |
Pour le gaz naturel, déjà transposé aux articles suivants : articles L. 431-1 du code de l'énergie (autorisation pour le transport de gaz) ; L. 231-3 du code minier (stockages), L. 432-6 du code de l'énergie (distribution de gaz) |
|
|
[...] 2. Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires et des procédures transparentes que doit respecter l'entreprise qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel et de l'hydrogène ou pour construire ou exploiter des installations de gaz naturel, des installations de production d'hydrogène ou des infrastructures de système d'hydrogène. Les critères et les procédures d'octroi d'autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d'autorisation applicables à ces installations, infrastructures, conduites ou équipements connexes tiennent compte, le cas échéant, de l'importance du projet pour les marchés intérieurs du gaz naturel et de l'hydrogène. Les États membres veillent à ce que le système d'autorisations des infrastructures du système d'hydrogène soit cohérent avec les plans de développement du réseau pour les réseaux de transport et de distribution d'hydrogène adoptés en vertu des articles 55 et 56. [...] |
Article L. 555-25 du code de l'environnement I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l'atteinte de l'objectif mentionné au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique. II. - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics. Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général. III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. |
Législative |
Article L. 555-25 du code de l'environnement I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l'atteinte de l'objectif mentionné au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique. II. - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé et les canalisations d'hydrogène mentionnées à l'article L. 831-3 du code de l'énergie, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics. Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général. III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie et les canalisations d'hydrogène mentionnées à l'article L. 831-3 du code de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. |
Pour le gaz naturel, déjà transposé aux articles suivants : L 443-1 et L. 443-2 du code de l'énergie (autorisation de fourniture) ; L. 431-1 du code de l'énergie (autorisation pour le transport de gaz) ; L. 221-2 du code minier (stockages), L. 432-6 du code de l'énergie (distribution de gaz) |
|
[...] 9. Les États membres veillent à ce que les autorisations octroyées au titre du droit national pour la construction et l'exploitation d'infrastructures de système de gaz naturel s'appliquent également aux infrastructures de système d'hydrogène. Cela est sans préjudice du droit des États membres de révoquer ces autorisations si l'infrastructure d'hydrogène ne respecte pas les règles techniques de sécurité applicables aux infrastructures de système d'hydrogène énoncées dans le droit de l'Union ou le droit national. [...] |
Législative |
Pour le gaz naturel et l'hydrogène Nouveau Article L. 555-15-1 du code de l'environnement Par exception à l'article L. 555-15, les autorisations délivrées pour la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sont valables pour le transport d'hydrogène sans qu'il soit besoin de délivrer une nouvelle autorisation. Ce changement de la nature du produit transporté constitue une modification de l'autorisation dont les modalités sont encadrées par le 5° de l'article L. 555-10. La mise en exploitation de la canalisation pour le transport d'hydrogène ne peut intervenir qu'après la mise à jour du dossier prévu à l'article L. 555-7, et la fourniture à l'autorité compétente d'une note d'intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du nouveau produit avec l'ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée. Sur la base de ce dossier et de cette note d'intégrité, l'autorité compétente fixe, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires en application de l'article L. 555-12. Si la canalisation de transport ne respecte par les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 relatives au transport d'hydrogène, l'autorité compétente retire l'autorisation de transporter de l'hydrogène. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
||
|
[...] 14. Les États membres refusent d'octroyer une autorisation de construction et d'exploitation d'une infrastructure de transport ou de distribution de gaz naturel lorsque le plan de développement du réseau établi en vertu de l'article 55 prévoit le déclassement du réseau de transport ou de parties pertinentes de celui-ci ou lorsqu'un plan de déclassement du réseau de distribution a été approuvé en vertu de l'article 57. [...] |
Article L.555-9 code de l'environnement : I. - La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment : - au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - à la mise en oeuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13. Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public. II. - L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée. III. - Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
Législative |
Article L. 555-9 code de l'environnement : I. - La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment : - au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - à la mise en oeuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13. Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public. Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction ou l'exploitation d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé appartenant à un réseau de transport dont le déclassement, total ou partiel, est prévu par le plan de développement du réseau établi en vertu de l'article L. 431-6 du code de l'énergie. II. - L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée. III. - Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
Pour le gaz naturel : La transposition de cet alinéa modifie le code de l'environnement et touche en partie aux missions de la DGPR. L'article L. 555-9 du code de l'environnement est applicable aux canalisations de transport de gaz. Pour les réseaux de distribution de gaz naturel, le projet d'article L. 432-25 du code de l'énergie vise à instaurer des zones d'interdiction de raccordement. |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 9 - Certification des gaz renouvelables et des carburants bas carbone |
||||
|
[...] 4. Les obligations prévues au paragraphe 2 s'appliquent indépendamment du fait que les carburants bas carbone sont produits dans l'Union ou importés. Des informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des carburants bas carbone ou de l'hydrogène bas carbone par fournisseur de carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an. [...] |
Article L. 826-1 du code de l'énergie Les conditions d'application du présent titre sont définies par voie réglementaire. |
Législative |
Article L. 826-1 du code de l'énergie Les conditions d'application du présent titre sont définies par voie réglementaire. Les dispositions relatives au suivi et à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas-carbone sont mentionnées au chapitre III du titre VIII du livre II. Nouveau Article L. 827-1 du code de l'énergie Les conditions d'application du présent titre sont définies par voie réglementaire. |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 10 - Prescriptions techniques |
||||
|
1. Les États membres ou, lorsque les États membres l'ont prévu ainsi, les autorités de régulation, veillent à ce que soient établis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au système des installations de GNL, des installations de stockage de gaz naturel, des autres réseaux de transport ou de distribution, ou des conduites directes ainsi que du système d'hydrogène. Ces prescriptions techniques assurent l'interopérabilité des systèmes, et sont objectives et non discriminatoires. L'ACER peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Ces prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 872-1 du code de l'énergie Tout gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène, tout exploitant de terminaux d'hydrogène et tout exploitant d'une installation de stockage d'hydrogène élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L'autorité administrative peut, tant lors de l'élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène, tout exploitant de terminaux d'hydrogène et tout exploitant d'une installation de stockage d'hydrogène de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les utilisateurs des infrastructures d'hydrogène respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent. Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret. |
||
|
[...] 2. Le cas échéant, les États membres ou, lorsque les États membres l'ont prévu ainsi, les autorités de régulation, font obligation aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseau d'hydrogène établis sur leur territoire de publier des prescriptions techniques conformément au présent article, en particulier en ce qui concerne des règles de raccordement au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d'odorisation et de pression du gaz. Les États membres exigent également des gestionnaires de réseau de transport et de distribution qu'ils publient leurs frais de raccordement pour le raccordement au gaz issu de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. [...] |
Article L. 453-6 du code de l'énergie Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement. Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. |
Législative |
Article L 453-6 du code de l'énergie Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement. Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des installations de production de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. |
Pour le gaz naturel, déjà transposé aux articles suivants : articles L. 453-4 et R. 433-17 (Obligation de publication), article L. 453-2 (raccordement distribution) et L. 453-6 (raccordement transport) du code de l'énergie ; mais complété pour le gaz renouvelable et bas carbone aux articles : L 453-6 deuxième alinéa (raccordement pour le transport) |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 11 - Droits contractuels de base |
||||
|
[...] 3. Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant : a) l'identité et les coordonnées du fournisseur, y compris l'adresse, l'adresse électronique et un service d'assistance aux consommateurs (hotline) ; b) les services fournis (y compris la dénomination du produit et de la formule tarifaire), les principales caractéristiques des services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, et le délai nécessaire au raccordement initial ; c) les types de services de maintenance offerts ; d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues ; e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée ; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive ; g) lorsque la performance environnementale, y compris, le cas échéant, les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle, les engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur et en cas de fourniture de gaz renouvelables et de gaz bas carbone, la certification des gaz renouvelables et des gaz bas carbone fournis conformément à l'article 9 ; h) les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 25 ; i) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise de gaz naturel ou d'hydrogène, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations claires et compréhensibles sur le traitement des plaintes et les modalités de soumission des plaintes, et toutes les informations visées au présent paragraphe ; j) le cas échéant, les informations concernant le fournisseur et le prix des produits ou services qui sont liés à la fourniture de gaz naturel ou d'hydrogène ou groupés avec celle-ci. Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies dans un langage aisément compréhensible pour les consommateurs, clair et sans ambiguïté, avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations visées au présent paragraphe sont également communiquées avant que le contrat soit conclu. Les informations concernant le fournisseur de produits ou services ainsi que le prix de ces produits ou services qui sont liés à la fourniture de gaz ou groupés avec celle-ci sont communiquées avant que le contrat soit conclu. Les clients finals reçoivent une seule synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible et dans un langage simple et concis. Les États membres exigent que le fournisseur utilise une terminologie commune. La Commission fournit des orientations non contraignantes à cet égard. [...] |
Pour le gaz naturel : Article L. 224-7 du code de la consommation Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants : 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. |
Législative |
Pour le gaz naturel : Article L. 224-7 du code de la consommation Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants : 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat ; 6° Lorsque la performance environnementale, notamment les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle du contrat, les engagements objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur et, le cas échéant, les garanties d'origine des gaz renouvelables et du biogaz fournis conformément aux articles L. 445-3 et L. 446-18 du code de l'énergie. |
|
|
[...] 9. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 442-4 du code de l'énergie Les fournisseurs de gaz naturel assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. Les fournisseurs ne peuvent procéder à l'interruption de la fourniture de gaz naturel d'un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que : 1° Le client a eu recours à la procédure de plainte gérée par son fournisseur ; 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l'énergie ou des médiateurs de la consommation prévue à l'article L. 612-1 du code de la consommation, et ce jusqu'au terme de celle-ci. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n'affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. |
||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 12 - Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur |
||||
|
1. Les clients ont le droit de changer de fournisseur de gaz naturel et d'hydrogène ou de changer d'acteur du marché du gaz naturel et de l'hydrogène. Les États membres veillent à ce qu'un client qui souhaite changer de fournisseur ou d'acteur du marché, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai le plus court possible, et en tout état de cause dans les trois semaines à compter de la date de la demande du client. Au plus tard le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d'acteur du marché est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable. [...] |
Article L. 224-14 du code de la consommation Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. |
Législative |
Nouveau Article L. 111-97-2 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en oeuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. |
Complète les dispositions du code de la consommation. |
|
[...] 2. Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. [...] |
Nouveau Article L. 111-97-2 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en oeuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. |
|||
|
[...] 3. Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels, les microentreprises et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur en ce qui concerne le gaz naturel et l'hydrogène, y compris lorsque la fourniture de gaz est liée à d'autres services, équipements ou produits ou lorsqu'elle est groupée avec ceux-ci. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché à facturer à leurs clients des frais de résiliation du contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais : a) relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré; et b) soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché du fait de la résiliation du contrat par le client. En cas d'offres groupées, les clients sont en mesure de résilier les services individuels d'un contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché. L'admissibilité des frais de résiliation du contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation ou d'une autre autorité nationale compétente. [...] |
Article L. 442-2 du code de l'énergie Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et de l'article L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes. |
Législative |
Article L. 442-2 du code de l'énergie Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l'article L. 442-1-1, les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l'article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats -et offres correspondantes- conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les catégories suivantes de consommateurs finals: 1° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ; 2° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d'euros dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. Pour bénéficier de ces dispositions, ces derniers consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères. Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l'article L. 224-3 et des 3°, 4° et 5° de l'article L. 224-7 du même code ne s'appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-97 du code de l'énergie. Pour l'application du II de l'article L. 224-10 du même code, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. Ces dispositions sont d'ordre public. Nouveau Article L. 442-2-1 du code de l'énergie Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs mentionnés à l'article L. 442-1-1, les dispositions de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, de l'article L. 224-9, du premier alinéa du I et du III de l'article L. 224-10, du second alinéa de l'article L. 224-10-1, de la première phrase de l'article L. 224-11, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 et de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 442-2, ainsi qu'aux offres correspondantes. Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l'article L. 224-3 et des 3°, 4° et 5° de l'article L. 224-7 du même code ne s'appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-97 du code de l'énergie. Par dérogation au 4° de l'article L. 224-3 du même code, la communication de l'estimation de la facture annuelle n'est pas requise. Ces dispositions sont d'ordre public. Nouveau Article L. 442-1-1 du code de l'énergie Les trois premiers alinéas de l'article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d'euros, ainsi qu'aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères. Nouveau Article L. 442-1-2 du code de l'énergie Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues à l'article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l'échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixes et à durée déterminée. Nouveau Article L. 442-5 du code de l'énergie I. - Tout fournisseur de gaz naturel assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture de gaz à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d'un an minimum sur le prix. Une telle offre respecte des conditions définies par voie réglementaire. La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie. II. - Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d'euros, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. |
|
|
[...] 4. En ce qui concerne le gaz naturel et l'hydrogène, les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et établissent un cadre qui garantit la protection des consommateurs à l'égard de toute pratique abusive. [...] |
Article L. 441-2 du code de l'énergie Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 par site de consommation. |
Législative |
Article L. 441-2 du code de l'énergie Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 par site de consommation. Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 18 - Systèmes intelligents de mesure dans le système d'hydrogène |
||||
|
1. Les États membres veillent au déploiement de systèmes intelligents de mesure capables de mesurer avec précision la consommation, de donner des informations sur le moment réel où l'énergie a été utilisée et de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 832-7 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d'énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d'information, de surveillance et de contrôle. Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l'annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret. |
||
|
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, cette obligation de déploiement est subordonnée à une évaluation coûts-avantages, au moins pour les clients résidentiels, qui est réalisée conformément aux principes fixés à l'annexe II. |
Nouveau Article L. 832-7 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d'énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d'information, de surveillance et de contrôle. Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l'annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret. |
|||
|
3. Les États membres assurent la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données concernées, ainsi que le respect de la vie privée des clients finals, conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée, ainsi que leur interopérabilité, dans le respect des normes appropriées. |
Nouveau Article L. 832-7 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d'énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d'information, de surveillance et de contrôle. Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l'annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret. |
|||
|
4. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des exigences d'interopérabilité pour les systèmes intelligents de mesure et des procédures assurant aux personnes éligibles l'accès aux données provenant de ces systèmes intelligents de mesure. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 91, paragraphe 2. |
Nouveau Article L. 832-7 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d'énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d'information, de surveillance et de contrôle. Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l'annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret. |
|||
|
5. Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d'une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris des avantages pour l'exploitation du réseau, lors du calcul des redevances d'accès au réseau applicables aux clients ou des frais que ceux-ci paient. Les États membres contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d'avantages pour les clients. |
Nouveau Article L. 832-7 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d'énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d'information, de surveillance et de contrôle. Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l'annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret. |
|||
|
6. Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l'évaluation soit révisée périodiquement en réponse à des changements importants dans les hypothèses sous-jacentes et de l'évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-avantages actualisée dès que celle-ci est disponible. |
Nouveau Article L. 832-7 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d'énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d'information, de surveillance et de contrôle. Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l'annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 19 - Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 17, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 août 2024, les États membres déploient ces systèmes conformément aux normes européennes, à l'annexe II et aux exigences suivantes : a) les systèmes intelligents de mesure mesurent avec précision la consommation réelle de gaz naturel et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l'énergie a été utilisée, y compris des données validées relatives à l'historique de consommation auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder et qu'ils doivent pouvoir visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires, et les données non validées relatives à la consommation les plus récentes auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder facilement et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres services ; b) la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l'Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité ; c) le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l'Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée ; d) lorsque les clients finals le demandent, les données relatives à leur consommation de gaz naturel sont mises à leur disposition, conformément aux actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 23, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou sont mises à la disposition d'un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente ; e) des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l'installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu'ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d'énergie, ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données ; f) les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l'objet de relevés et d'une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la plus courte période de compensation sur le marché national. Aux fins du point d), les clients finals ont la possibilité d'extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l'Union en matière de protection des données. |
Article L. 453-7 du code de l'énergie Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en oeuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur. La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. |
Législative |
Article L. 453-7 du code de l'énergie Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en oeuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Les transporteurs et distributeurs informent les consommateurs des fonctionnalités rendues possibles par le dispositif de comptage installé. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur. La fourniture de services mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. |
Globalement, déjà transposé dans la loi, dans le L.453-7 du code de l'énergie. Les points b) et c) font référence au RGPD qui est un règlement européen, donc d'application directe et ne nécessitant pas de transposition supplémentaire. Il est proposé de transposer le point e) dans l'article L.453-7 du code de l'énergie qui fixe les grandes exigences concernant le déploiement des compteurs communicants. |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 20 - Droit de disposer d'un compteur de gaz naturel intelligent 1. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 17, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que les clients soient en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui : a) est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l'article 19, ou d'un ensemble minimal de fonctionnalités à établir et à publier par les États membres au niveau national conformément à l'annexe II ; b) est interopérable et capable d'atteindre les objectifs de connectivité de l'infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. [...] |
Article L453-7 code de l'énergie. Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en oeuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur. La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. |
Législative |
Article L453-7 code de l'énergie. Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en oeuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. Lorsqu'un consommateur est raccordé à un réseau pour lequel le projet de mise en oeuvre de dispositifs de comptage interopérables a été rejeté, il peut demander l'installation d'un dispositif de comptage interopérable. Le consommateur supporte le coût de cette installation. Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel informent les consommateurs des fonctionnalités offertes par ces dispositifs et mettent à leur disposition leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur. La fourniture de services mentionnés aux troisièmes et quatrièmes alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 31 - Accès des tiers aux réseaux de distribution et de transport du gaz naturel et aux terminaux de GNL [...] 3. La présente directive ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour les gaz renouvelables et les gaz bas carbone, pour autant qu'ils respectent les règles de l'Union en matière de concurrence et qu'ils contribuent à la décarbonation. Aucun contrat à long terme pour la fourniture de gaz fossile sans dispositif d'atténuation n'est conclu pour une durée s'étendant au-delà du 31 décembre 2049. [...] |
Législative |
Nouveau Chapitre II : Les importations de gaz naturel Article L. 412-1 du code de l'énergie Les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ne peuvent pas conclure de contrat d'approvisionnement en gaz naturel d'origine fossile prévoyant une livraison sur le territoire national dont l'échéance intervient au-delà du 31 décembre 2049. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux contrats conclus à compter du 5 août 2026. |
Pour le gaz naturel : Introduction dans le code de l'énergie de de l'interdiction de la conclusion des contrats à long terme pour la fourniture de gaz naturel sans dispositif d'atténuation pour une durée au-delà de la date butoir du 31 décembre 2049. Le titre Ier du livre IV est renommé : « Approvisionnement en gaz naturel » Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « La recherche et l'exploitation des gîtes contenant du gaz naturel ». |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 35 - Accès des tiers aux réseaux d'hydrogène |
||||
|
1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès réglementé des tiers aux réseaux d'hydrogène, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau d'hydrogène. [...] |
Législative |
Nouveau Article L 111-110-1 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l'accès aux ouvrages de transport d'hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d'hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d'accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. Nouveau Article L 111-110-2 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent un droit d'accès aux ouvrages définis à l'article L. 111-110-1 pour assurer l'exécution des contrats de transit d'hydrogène entre les réseaux de transport d'hydrogène à haute pression au sein de l'Espace économique européen. |
||
|
[...] 2. Les États membres veillent à ce que les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 78 par une autorité de régulation, et à ce que ces tarifs, et les méthodes, lorsque seules les méthodes sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. [...] |
Nouveau Article L 111-110-1 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l'accès aux ouvrages de transport d'hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d'hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d'accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. |
|||
|
[...] 3. Les gestionnaires de réseau d'hydrogène doivent, si nécessaire et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier d'hydrogène, avoir accès au réseau d'autres gestionnaires de réseau d'hydrogène. [...] |
Nouveau Article L 111-110-2 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent un droit d'accès aux ouvrages définis à l'article L. 111-110-1 pour assurer l'exécution des contrats de transit d'hydrogène entre les réseaux de transport d'hydrogène à haute pression au sein de l'Espace économique européen. |
|||
|
[...] 4. Jusqu'au 31 décembre 2032, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. Dans ce cas, l'État membre veille à ce que soit mis en oeuvre un système d'accès négocié des tiers aux réseaux d'hydrogène conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du réseau d'hydrogène soient en mesure de négocier l'accès aux réseaux d'hydrogène et pour veiller à ce que les parties soient tenues de négocier l'accès aux réseaux d'hydrogène de bonne foi. [...] |
Nouveau Article L 111-110-2 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent un droit d'accès aux ouvrages définis à l'article L. 111-110-1 pour assurer l'exécution des contrats de transit d'hydrogène entre les réseaux de transport d'hydrogène à haute pression au sein de l'Espace économique européen. |
|||
|
[...] 5. En cas d'utilisation de l'accès négocié prévu au paragraphe 4, les autorités de régulation fournissent aux utilisateurs du réseau d'hydrogène des indications quant à la manière dont les tarifs négociés sont influencés lors de l'introduction de l'accès réglementé des tiers. [...] |
Nouveau Article L 111-110-1 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l'accès aux ouvrages de transport d'hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d'hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d'accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. Nouveau Article L 111-110-2 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent un droit d'accès aux ouvrages définis à l'article L. 111-110-1 pour assurer l'exécution des contrats de transit d'hydrogène entre les réseaux de transport d'hydrogène à haute pression au sein de l'Espace économique européen. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 36 - Accès des tiers aux terminaux d'hydrogène |
||||
|
1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès des tiers aux terminaux d'hydrogène fondé sur un accès négocié, de manière objective, transparente et non discriminatoire, par lequel les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs de terminaux d'hydrogène soient en mesure de négocier l'accès à ces terminaux. Les parties sont tenues de négocier l'accès de bonne foi. [...] |
Législative |
Nouveau Article L 861-1 du code de l'énergie Les exploitants de terminaux d'hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l'accès aux capacités de ces terminaux d'hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Les exploitants de terminaux d'hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d'hydrogène et à leurs mandataires un droit d'accès aux capacités de ces terminaux dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. Nouveau Article L. 861-2 du code de l'énergie Les modalités de l'accès aux capacités des terminaux d'hydrogène et en particulier son prix sont négociés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
||
|
2. Les autorités de régulation surveillent les conditions d'accès des tiers aux terminaux d'hydrogène et leur impact sur le marché de l'hydrogène et prennent, si nécessaire pour préserver la concurrence, des mesures pour améliorer l'accès conformément aux critères énoncés au paragraphe 1. |
Nouveau Article L 861-1 du code de l'énergie Les exploitants de terminaux d'hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l'accès aux capacités de ces terminaux d'hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Les exploitants de terminaux d'hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d'hydrogène et à leurs mandataires un droit d'accès aux capacités de ces terminaux dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 37 - Accès au stockage d'hydrogène |
||||
|
1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès réglementé des tiers au stockage d'hydrogène et, lorsque la fourniture d'un accès efficace au système l'exige pour des raisons techniques et économiques en vue de l'approvisionnement des clients, un accès au stockage en conduite, ainsi que pour l'organisation de l'accès aux services auxiliaires, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du système d'hydrogène. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés par l'autorité de régulation avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 78. [...] |
Législative |
Nouveau Article L 841-2 du code de l'énergie Les exploitants de stockage d'hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Les exploitants de stockage d'hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d'accès à ces installations dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. Nouveau Article L. 841-3 du code de l'énergie Les infrastructures de stockage souterrain d'hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. |
||
|
[...] 2. Jusqu'au 31 décembre 2032, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En pareil cas, l'État membre veille à ce que soit mis en place un système d'accès négocié des tiers au stockage d'hydrogène et, lorsque la fourniture d'un accès efficace au système l'exige pour des raisons techniques et économiques en vue de l'approvisionnement des clients, un accès au stockage en conduite, ainsi que pour l'organisation de l'accès à des services auxiliaires, conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du stockage d'hydrogène soient en mesure de négocier l'accès au stockage d'hydrogène et pour veiller à ce que les parties soient tenues de négocier l'accès au stockage d'hydrogène de bonne foi. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 841-4 du code de l'énergie La direction générale ou le directoire de l'exploitant d'une infrastructure de stockage souterrain d'hydrogène mentionnée à l'article L. 841-3 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire. |
||
|
3. Les États membres peuvent prévoir que les droits à capacité attribués avant le 5 août 2026 dans le cadre d'un système d'accès négocié des tiers en vertu du paragraphe 2 soient respectés jusqu'à leur date d'expiration et qu'ils ne soient pas affectés par la mise en oeuvre d'un accès réglementé des tiers en vertu du paragraphe 1. |
Nouveau Article L 841-2 du code de l'énergie Les exploitants de stockage d'hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Les exploitants de stockage d'hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d'accès à ces installations dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. Nouveau Article L. 841-3 du code de l'énergie Les infrastructures de stockage souterrain d'hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Nouveau Article L. 841-4 du code de l'énergie La direction générale ou le directoire de l'exploitant d'une infrastructure de stockage souterrain d'hydrogène mentionnée à l'article L. 841-3 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 38 - Refus de l'accès et du raccordement |
||||
|
1. Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau d'hydrogène peuvent refuser l'accès ou le raccordement au système de gaz naturel ou d'hydrogène en se fondant sur le manque de capacité ou le manque de connexion. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L 111-110-3 du code de l'énergie Tout refus d'accès à un ouvrage de transport d'hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Nouveau Article L 111-110-4 du code de l'énergie Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-110-1 et L. 111-110-2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux. Si un exploitant refuse l'accès à un ouvrage de transport d'hydrogène, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge. |
Modifications significatives par rapport à la directive 2009/73 Pour le gaz naturel : déjà transposé |
|
|
[...] 2. Sans préjudice des objectifs de l'Union et des objectifs nationaux en matière de décarbonation et des exigences existantes en matière de réduction ou d'abandon de la consommation de gaz fossile, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau d'hydrogène qui refuse l'accès ou le raccordement au système de gaz naturel ou d'hydrogène en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L 111-110-3 du code de l'énergie Tout refus d'accès à un ouvrage de transport d'hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. |
||
|
[...] 3. L'accès au système pour les gaz renouvelables et les gaz bas carbone ne peut être refusé que sous réserve des articles 20 et 36 du règlement (UE) 2024/1789. [...] |
Législative |
Nouveau Article L 111-110-4 du code de l'énergie Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-110-1 et L. 111-110-2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux. Si un exploitant refuse l'accès à un ouvrage de transport d'hydrogène, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge. |
||
|
[...] 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, un État membre veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution soient autorisés à refuser l'accès ou le raccordement d'utilisateurs du réseau de gaz naturel, ou à interrompre la fourniture à leur égard, en particulier pour assurer le respect de la mise en oeuvre de l'objectif de neutralité climatique énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, à condition que : a) le plan de développement du réseau établi en vertu de l'article 55 prévoie le déclassement du réseau de transport ou de parties pertinentes de celui-ci ; b) l'autorité nationale concernée ait approuvé le plan de déclassement du réseau en vertu de l'article 57, paragraphe 3 ; c) le gestionnaire de réseau de distribution concerné, qui a été dispensé de présenter un plan de déclassement du réseau en vertu de l'article 57, paragraphe 5, ait informé l'autorité nationale concernée du déclassement du réseau de distribution ou de parties pertinentes de celui-ci. [...] |
Pour le gaz naturel : Article L. 111-102 code de l'énergie Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Article L. 111-103 code de l'énergie I. Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur : 1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ; 2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ; 3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105. II. Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge. |
Législative |
Pour le gaz naturel : Article L. 111-102 code de l'énergie Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus d'accès à un ouvrage de transport de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, ou à un ouvrage de distribution de gaz naturel situé en dehors d'une zone d'interdiction de raccordement mentionnée à l'article L. 432-25 est notifié à la Commission de régulation de l'énergie. Article L. 111-103 code de l'énergie I. Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur : 1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ; 2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ; 3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105. 4° La localisation du réseau de distribution de gaz naturel dans une zone d'interdiction de raccordement mentionnée à l'article L. 432-25. II. Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge. |
Pour le gaz naturel : Proposition de supprimer la notification à la CRE des refus d'accès liées aux zones d'interdiction de raccordement, afin d'éviter le risque d'embolie de la CRE. |
|
[...] 9. Les gestionnaires de système de GNL, de réseau de transport et de système de stockage de gaz naturel coopèrent, au sein d'un État membre et au niveau régional, pour assurer l'utilisation la plus efficace des capacités des installations et des synergies entre ces installations en tenant compte de l'intégrité et du fonctionnement du système et en évitant de créer des contraintes pour l'exploitation des installations de stockage de GNL ou de gaz naturel. [...] |
Article L. 111-102 du code de l'énergie Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. |
Législative |
Article L. 111-102 du code de l'énergie Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. |
Pour le gaz naturel : déjà transposé mais complété pour les infrastructures de stockages de gaz naturel. |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 42 - Pouvoir de décider du raccordement au réseau de transport et au réseau de transport d'hydrogène |
||||
|
1. Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène établissent et publient des procédures et des tarifs transparents et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage de gaz naturel et d'hydrogène, des installations de GNL, des terminaux d'hydrogène et des clients industriels au réseau de transport et au réseau de transport d'hydrogène. Ces procédures sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 111-110-5 du code de l'énergie Les gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène publient leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage d'hydrogène, des terminaux d'hydrogène et des clients industriels au réseau de transport d'hydrogène qui sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène ne peuvent refuser le raccordement d'une nouvelle installation ou d'un nouveau client mentionnés au précédent alinéa en invoquant d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'augmenter les capacités. Les gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène garantissent des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement. |
Pour le gaz naturel : Rédaction équivalente à l'article 23, paragraphe 11, de la directive 2009/73- Déjà transposé |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 44 - Tâches des gestionnaires de réseau de distribution |
|
|||
|
1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz naturel conformément aux articles 55 et 57 de la présente directive, y compris en ce qui concerne l'injection de biométhane, ainsi que d'assurer l'exploitation, la maintenance et le développement ou le déclassement, dans des conditions économiquement acceptables, d'un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement, des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1787 et de l'efficacité énergétique. [...] |
Article L. 432-8 du code de l'énergie Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 : 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ; 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ; 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ; 8° De mettre en oeuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. |
Législative |
Article L. 432-8 du code de l'énergie Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 : 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et d'optimisation des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ; 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ; 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ; 8° De mettre en oeuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. |
Rédaction équivalente à l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2009/73 L'application pour le biométhane est déjà assurée par l'article L. 400-1 du code de l'énergie |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 50 - Tâches des gestionnaires de réseau, de stockage et de terminal d'hydrogène |
Législative |
Articles 50 à 54 applicables uniquement à l'hydrogène |
||
|
1. Il appartient à chaque gestionnaire de réseau, de stockage et de terminal d'hydrogène : a) d'exploiter, d'entretenir et de développer, y compris de réaffecter, dans des conditions économiquement acceptables, une infrastructure sûre et fiable pour le transport ou le stockage de l'hydrogène, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau d'hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la colocalisation de la production et de l'utilisation d'hydrogène et sur la base du plan décennal de développement du réseau visé à l'article 55 ; b) de garantir la capacité à long terme du système d'hydrogène à répondre aux demandes raisonnables recensées de transport et de stockage de l'hydrogène conformément au plan décennal de développement du réseau visé à l'article 55 ; c) d'assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations ; d) de fournir au gestionnaire d'autres réseaux ou systèmes avec lesquels son système est interconnecté des informations suffisantes, notamment sur la qualité de l'hydrogène, pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du système interconnecté ; e) de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du système d'hydrogène ou les catégories d'utilisateurs de l'infrastructure, notamment en faveur de ses entreprises liées ; f) de fournir aux utilisateurs du système d'hydrogène les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace à l'infrastructure ; g) de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et minimiser les émissions d'hydrogène dues à ses activités et d'effectuer, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection et la réparation des fuites d'hydrogène de tous les composants concernés sous la responsabilité du gestionnaire ; h) de soumettre aux autorités compétentes un rapport de détection des fuites d'hydrogène et, lorsque cela est nécessaire, un programme de réparation ou de remplacement, et de rendre publiques chaque année des informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d'hydrogène. [...] |
Article L 831-1 du code de l'énergie Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d'hydrogène lorsqu'il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage. |
Législative |
Article L 831-1 du code de l'énergie Le présent titre prévoit le régime applicable au transport d'hydrogène lorsqu'il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage. Nouveau Article L. 832-1 du code de l'énergie Le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les exploitants d'ouvrages de transport d'hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l'utilisation d'hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 832-6. Le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène garantit la capacité à long terme du système d'hydrogène à répondre aux demandes de transport d'hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau. Il assure une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l'infrastructure européenne d'hydrogène en prenant en compte la sécurité d'approvisionnement en hydrogène. Il est en mesure de répondre aux demandes de capacité techniquement réalisables et économiquement raisonnables identifiées dans le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne pour l'hydrogène mentionné à l'article 60 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Lors de la désignation des gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la Commission de régulation de l'énergie peut décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène la responsabilité d'assurer la capacité transfrontalière. Le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène fournit aux autres gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour assurer une exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du système interconnecté. Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace au réseau. Nouveau Article L. 841-5 du code de l'énergie L'exploitant d'une installation de stockage d'hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d'hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l'utilisation d'hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 832-6. Il garantit la capacité à long terme du système d'hydrogène à répondre aux demandes de stockage d'hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau. Il fournit aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l'hydrogène, pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du système interconnecté. Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l'infrastructure. Nouveau Article L. 841-6 du code de l'énergie L'exploitant d'une installation de stockage d'hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d'hydrogène dues à ses activités. Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d'hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu'il soumet à l'autorité compétente. Il procède à la réparation des fuites d'hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu'il a préalablement soumis à l'autorité compétente. Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d'hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. Nouveau Article L. 861-3 du code de l'énergie L'exploitant de terminal d'hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d'hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l'utilisation d'hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 832-6. Il fournit au gestionnaire des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l'hydrogène, pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du système interconnecté. Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l'infrastructure. Nouveau Article L. 861-4 du code de l'énergie L'exploitant de terminal d'hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d'hydrogène dues à ses activités. Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d'hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu'il soumet à l'autorité compétente. Il procède à la réparation des fuites d'hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu'il a préalablement soumis à l'autorité compétente. Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d'hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. |
|
|
[...] 2. Les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène s'efforcent d'assurer une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l'infrastructure européenne d'hydrogène en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables recensées dans le plan décennal de développement du réseau visé à l'article 55 de la présente directive et le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union pour l'hydrogène visé à l'article 60 du règlement (UE) 2024/1789, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en hydrogène. Lors de leur certification en vertu de l'article 71 de la présente directive et de l'article 14 du règlement (UE) 2024/1789, les autorités compétentes des États membres peuvent décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène la responsabilité d'assurer la capacité transfrontalière. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 832-2 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène de garantir une qualité stable de l'hydrogène dans son réseau conformément aux normes de qualité de l'hydrogène applicables. Nouveau Article L. 832-3 du code de l'énergie Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport d'hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en oeuvre les programmes de mouvements d'hydrogène établis par les utilisateurs du réseau. Le gestionnaire de réseau de transport assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux d'hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport d'hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en oeuvre des actions d'efficacité énergétique. Les utilisateurs du réseau, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène et les exploitants de terminaux d'importation d'hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène et les exploitants de terminaux d'importation d'hydrogène, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie et rend public leur objet. Nouveau Article L. 832-4 du code de l'énergie Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l'équilibrage des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en oeuvre. Nouveau Article L. 832-5 du code de l'énergie Le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d'hydrogène dues à ses activités. Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d'hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu'il soumet à l'autorité compétente. Il procède à la réparation des fuites d'hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu'il a préalablement soumis à l'autorité compétente. Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d'hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. |
||
|
[...] 3. Lorsque cela est approprié pour la gestion du système et pour les utilisateurs finaux, l'autorité de régulation confie aux gestionnaires de réseau d'hydrogène la responsabilité d'assurer une gestion efficace de la qualité de l'hydrogène et de garantir une qualité stable de l'hydrogène dans leurs réseaux conformément aux normes de qualité de l'hydrogène applicables. [...] |
Nouveau Article L. 832-3 du code de l'énergie Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport d'hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en oeuvre les programmes de mouvements d'hydrogène établis par les utilisateurs du réseau. Le gestionnaire de réseau de transport assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux d'hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport d'hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en oeuvre des actions d'efficacité énergétique. Les utilisateurs du réseau, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène et les exploitants de terminaux d'importation d'hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène et les exploitants de terminaux d'importation d'hydrogène, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie et rend public leur objet. |
|||
|
4. Les gestionnaires de réseau d'hydrogène sont responsables de l'équilibrage de leurs réseaux à partir du 1er janvier 2033, ou à partir d'une date antérieure si l'autorité de régulation le prévoit. Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau d'hydrogène pour l'équilibrage du réseau d'hydrogène sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs de leurs réseaux en cas de déséquilibre énergétique. [...] |
Nouveau Article L. 832-4 du code de l'énergie Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l'équilibrage des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en oeuvre. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 51 - Réseaux d'hydrogène existants |
||||
|
1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation accordent une dérogation aux exigences prévues à un ou plusieurs des articles 35, 46, 68, 69, 70 et 71 de la présente directive, et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 aux réseaux d'hydrogène qui appartenaient à une entreprise verticalement intégrée au 4 août 2024. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 111-50-9 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie peut accorder à un réseau de transport d'hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d'hydrogène au sens de l'article L. 111-10 au 4 août 2024 une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111-2 et L. 111-3, L. 111-7, L. 111-50-1, L. 111-90-1, L. 111-110-1, L. 871-1 et suivants et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. La Commission de régulation de l'énergie retire cette dérogation dans les cas suivants : 1° A la demande de l'entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d'hydrogène qui bénéficie de la dérogation ; 2° Lorsque le réseau d'hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d'hydrogène ; 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d'hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport au 4 août 2024 ; 4° Lorsque la poursuite de la mise en oeuvre de la dérogation risque d'entraver la concurrence ou d'affecter négativement le déploiement d'infrastructures pour l'hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène en France ou dans l'Union européenne. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l'énergie publie une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d'hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union européenne ou en France. |
||
|
[...] 2. Toute dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 expire lorsque : a) l'autorité de régulation décide, à la demande de l'entreprise verticalement intégrée, de mettre fin à la dérogation ; b) le réseau d'hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d'hydrogène ; c) le réseau d'hydrogène bénéficiant de la dérogation ou sa capacité est étendu de plus de 5 % en ce qui concerne sa longueur ou sa capacité par rapport au 4 août 2024 ; ou d) l'autorité de régulation conclut, par voie de décision, que la poursuite de l'application de la dérogation risquerait d'entraver la concurrence ou d'affecter négativement le bon déploiement d'infrastructures pour l'hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'État membre ou l'Union. [...] |
Nouveau Article L. 111-50-9 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie peut accorder à un réseau de transport d'hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d'hydrogène au sens de l'article L. 111-10 au 4 août 2024 une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111-2 et L. 111-3, L. 111-7, L. 111-50-1, L. 111-90-1, L. 111-110-1, L. 871-1 et suivants et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. La Commission de régulation de l'énergie retire cette dérogation dans les cas suivants : 1° A la demande de l'entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d'hydrogène qui bénéficie de la dérogation ; 2° Lorsque le réseau d'hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d'hydrogène ; 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d'hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport au 4 août 2024 ; 4° Lorsque la poursuite de la mise en oeuvre de la dérogation risque d'entraver la concurrence ou d'affecter négativement le déploiement d'infrastructures pour l'hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène en France ou dans l'Union européenne. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l'énergie publie une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d'hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union européenne ou en France. |
|||
|
[...] 3. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée en vertu du paragraphe 1, l'autorité de régulation publie une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d'hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union ou dans l'État membre. [...] |
Nouveau article L.111-50-9 code de l'énergie : [...] Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l'énergie publie une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d'hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union européenne ou en France. |
|||
|
[...] 4. Les autorités de régulation peuvent demander aux gestionnaires de réseau d'hydrogène existants de leur fournir toutes les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches. [...] |
Nouveau Article L 111-110-1 du code de l'énergie Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l'accès aux ouvrages de transport d'hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d'hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d'hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d'accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa. Ce contrat est transmis à l'autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 52 - Réseaux d'hydrogène géographiquement limités |
||||
|
1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation accordent une dérogation aux articles 68 et 71 ou à l'article 46 pour les réseaux d'hydrogène qui transportent de l'hydrogène à l'intérieur d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée. Pendant la durée de la dérogation, ce réseau remplit toutes les conditions suivantes : a) il ne comprend pas d'interconnexions d'hydrogène ; b) il n'a pas de raccordements directs avec des installations de stockage d'hydrogène ou des terminaux d'hydrogène, à moins que ces installations de stockage ou terminaux ne soient également raccordés à un réseau d'hydrogène qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l'article 51 ; c) il sert principalement à fournir de l'hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ; et d) il n'est raccordé à aucun autre réseau d'hydrogène, à l'exception des réseaux bénéficiant également d'une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d'hydrogène. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 111-50-10 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie peut accorder à un réseau de transport d'hydrogène qui transporte de l'hydrogène à l'intérieur d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes : 1° Il ne comprend pas d'interconnexions d'hydrogène ; 2° Il n'a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d'hydrogène ou des terminaux d'hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou terminaux sont raccordés à un réseau d'hydrogène qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l'article L. 111-50-9 ; 3° Il sert principalement à fournir de l'hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ; 4° Il n'est raccordé à aucun autre réseau d'hydrogène, à l'exception des réseaux bénéficiant également d'une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d'hydrogène. La Commission de régulation de l'énergie retire la dérogation lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie ou lorsqu'elle conclut que la poursuite de l'application de la dérogation risquerait d'entraver la concurrence ou d'affecter négativement le bon déploiement d'infrastructures d'hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union européenne ou en France. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l'énergie publie une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d'hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union européenne ou en France. Lors de l'octroi d'une dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2024/1789 à ce réseau s'il n'est pas connecté à un autre réseau d'hydrogène. |
||
|
[...] 2. L'autorité de régulation adopte une décision visant à retirer la dérogation visée au présent paragraphe si elle conclut que la poursuite de l'application de la dérogation risquerait d'entraver la concurrence ou d'affecter négativement le bon déploiement d'infrastructures d'hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union ou dans l'État membre ou lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 n'est plus remplie. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée en vertu du paragraphe 1, l'autorité de régulation publie une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d'hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union ou dans l'État membre. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les demandes d'accès des producteurs d'hydrogène ainsi que les demandes de raccordement des clients industriels soient notifiées à l'autorité de régulation, rendues publiques et traitées conformément à l'article 42. La publication des demandes d'accès préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles. [...] |
Nouveau Article L. 111-50-10 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie peut accorder à un réseau de transport d'hydrogène qui transporte de l'hydrogène à l'intérieur d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes : 1° Il ne comprend pas d'interconnexions d'hydrogène ; 2° Il n'a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d'hydrogène ou des terminaux d'hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou terminaux sont raccordés à un réseau d'hydrogène qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l'article L. 111-50-9 ; 3° Il sert principalement à fournir de l'hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ; 4° Il n'est raccordé à aucun autre réseau d'hydrogène, à l'exception des réseaux bénéficiant également d'une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d'hydrogène. La Commission de régulation de l'énergie retire la dérogation lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie ou lorsqu'elle conclut que la poursuite de l'application de la dérogation risquerait d'entraver la concurrence ou d'affecter négativement le bon déploiement d'infrastructures d'hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union européenne ou en France. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l'énergie publie une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d'hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l'hydrogène dans l'Union européenne ou en France. Lors de l'octroi d'une dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2024/1789 à ce réseau s'il n'est pas connecté à un autre réseau d'hydrogène. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 54 - Confidentialité pour les gestionnaires de réseaux d'hydrogène, d'installations de stockage d'hydrogène et de terminaux d'hydrogène |
Articles 50 à 54 applicables uniquement à l'hydrogène |
|||
|
1. Sans préjudice des obligations légales de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau d'hydrogène, d'installation de stockage d'hydrogène ou de terminal d'hydrogène et chaque propriétaire de réseau d'hydrogène préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. En particulier, si le gestionnaire de réseau d'hydrogène, d'installation de stockage d'hydrogène ou de terminal d'hydrogène ou le propriétaire de réseau d'hydrogène fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il s'abstient de divulguer toute information commercialement sensible aux parties de l'entreprise verticalement intégrée autres que les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau d'hydrogène, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. [...] |
Législative |
Nouveau Article L.111-79-1 du code de l'énergie Tout exploitant d'un ouvrage de transport d'hydrogène, d'une installation de stockage d'hydrogène ou d'un terminal d'hydrogène et tout utilisateur de ces ouvrages et installations fournit aux autres exploitants de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages. Nouveau Article L. 111-79-2 du code de l'énergie Chaque exploitant d'un ouvrage de transport d'hydrogène, d'une installation de stockage d'hydrogène ou d'un terminal d'hydrogène préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les mesures prises par les exploitants pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Nouveau Article L. 111-82-1 du code de l'énergie I. Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'exploitant des ouvrages de transport, d'installations de stockage d'hydrogène ou des terminaux d'hydrogène d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-79-2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. II. La peine prévue au I ne s'applique pas : 1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-79-2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d'hydrogène, des terminaux d'hydrogène ou des stockages d'hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ; 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-110-1 ; 3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête. |
||
|
[...] 2. Le gestionnaire d'un réseau d'hydrogène, d'une installation de stockage d'hydrogène ou d'un terminal d'hydrogène, dans le cadre des ventes ou des achats d'hydrogène effectués par une entreprise liée, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au système. [...] |
Nouveau Article L. 111-82-1 du code de l'énergie I. Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'exploitant des ouvrages de transport, d'installations de stockage d'hydrogène ou des terminaux d'hydrogène d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-79-2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. II. La peine prévue au I ne s'applique pas : 1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-79-2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d'hydrogène, des terminaux d'hydrogène ou des stockages d'hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ; 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-110-1 ; 3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête. |
|||
|
[...] 3. Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles. [...] |
Nouveau Article L. 111-82-1 du code de l'énergie I. Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'exploitant des ouvrages de transport, d'installations de stockage d'hydrogène ou des terminaux d'hydrogène d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-79-2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. II. La peine prévue au I ne s'applique pas : 1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-79-2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d'hydrogène, des terminaux d'hydrogène ou des stockages d'hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ; 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-110-1 ; 3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 55 - Développement du réseau pour le gaz naturel et pour l'hydrogène et pouvoir de prendre les décisions d'investissements |
||||
|
1. Tous les deux ans au moins, tous les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène soumettent à l'autorité de régulation concernée un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation des parties prenantes concernées conformément au paragraphe 2, point f). Chaque État membre dispose d'un plan unique de développement du réseau pour le gaz naturel et d'un plan unique de développement du réseau pour l'hydrogène, ou d'un plan commun pour le gaz naturel et l'hydrogène. Les États membres qui autorisent un plan commun veillent à ce qu'un tel plan soit suffisamment transparent pour permettre à l'autorité de régulation de cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l'hydrogène visés par le plan. Une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l'hydrogène. Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l'hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l'efficacité du système, telle qu'elle est définie à l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2023/1791, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation. Les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène coopèrent étroitement avec les gestionnaires de réseau de transport d'électricité et les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, le cas échéant, afin de coordonner les exigences en matière d'infrastructures communes, telles que la localisation des électrolyseurs et les infrastructures de transport pertinentes, et tiennent le plus grand compte de leurs points de vue. Les États membres s'efforcent d'assurer la coordination des étapes de planification des plans décennaux de développement des réseaux respectifs pour le gaz naturel, l'hydrogène et l'électricité. Les gestionnaires d'infrastructure, y compris les gestionnaires de terminal de GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de réseau de distribution d'hydrogène, les gestionnaires de terminal d'hydrogène, les gestionnaires de stockage d'hydrogène, les gestionnaires d'infrastructure de chauffage urbain et les gestionnaires de réseau d'électricité sont tenus de fournir aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène et d'échanger avec eux toute information pertinente relative aux plans décennaux de développement du réseau. Le plan décennal de développement du réseau pour le gaz naturel contient des mesures effectives pour garantir l'adéquation du système de gaz naturel et la sécurité de l'approvisionnement, notamment le respect des normes d'infrastructure prévues par le règlement (UE) 2017/1938. Les plans décennaux de développement du réseau sont publiés et accessibles sur un site internet, accompagnés des résultats de la consultation des parties prenantes. Ce site internet est mis à jour régulièrement afin de veiller à ce que toutes les parties prenantes concernées soient informées du calendrier, des modalités et de la portée de la consultation. [...] |
Pour le gaz naturel : Article L. 431-6 du code de l'énergie I. - Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes, sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211-2 ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie. Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements. Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation. Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau. II. - Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement : a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ; b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers. La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. |
Législative |
Pour le gaz naturel : Article L. 431-6 du code de l'énergie I. - Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes, sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211-2 ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d'infrastructure de gaz naturel, d'hydrogène, d'électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements. Tous les deux ans, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation. Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (UE) n° 2024/1789 du 13 juin 2024. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) n° 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau. II. - Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement : a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ; b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers. La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 832-6 du code de l'énergie I. - Les gestionnaires des réseaux de transport d'hydrogène, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7, élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes, sur les prévisions d'injection d'hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures d'hydrogène, de consommation d'hydrogène et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d'infrastructure de gaz naturel, d'hydrogène, d'électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modernisées dans les dix ans en tenant compte des renforcements d'infrastructure nécessaires pour connecter les installations de gaz renouvelable et bas carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport. Le plan décennal répertorie les investissements déjà décidés, les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans. Le plan décennal mentionne les caractéristiques des infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d'hydrogène. Pour chaque projet d'investissement ou de réaffectation, un calendrier prévisionnel de réalisation est fourni. Le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau et rend publique la synthèse de cette consultation. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau. II. - Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement : 1° Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène de se conformer à ses obligations ; 2° Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers. La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions du chapitre IV du présent titre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. |
Le règlement (UE) 2024/1789 du paquet gaz abroge notamment le règlement 715/2009. Les présentes dispositions remplacent les références à ce règlement par celles du règlement 2024/1789. |
|
[...] 8. Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, les tarifs d'accès au réseau applicables tels qu'ils ont été fixés ou approuvés par l'autorité de régulation couvrent les coûts de l'investissement en question. [...] |
Pour le gaz naturel : Article L. 452-1 du code de l'énergie |
Législative |
Pour l'hydrogène Nouveau Article L. 871-1 du code de l'énergie Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport d'hydrogène et des installations de stockage d'hydrogène sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d'hydrogène et les exploitants des installations de stockage d'hydrogène, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'exploitants efficaces. Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d'hydrogène et les exploitants des installations de stockage d'hydrogène les dépenses d'exploitation et une rémunération normale des capitaux investis. Les gestionnaires des réseaux de transport d'hydrogène et les exploitants des installations de stockage d'hydrogène sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. Nouveau Article L. 871-2 du code de l'énergie Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport d'hydrogène et les tarifs d'utilisation des installations de stockage d'hydrogène sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène et les exploitants des installations de stockage d'hydrogène adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux de transport d'hydrogène et des installations de stockage d'hydrogène. Nouveau Article L. 871-3 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires des réseaux de transport d'hydrogène ou des installations de stockage d'hydrogène avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des exploitants et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les exploitants à améliorer leurs performances. Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport d'hydrogène et des installations de stockage d'hydrogène et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée. |
Pour le gaz naturel : déjà transposé |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 57 - Plans de déclassement des réseaux pour les gestionnaires de réseau de distribution |
||||
|
1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution élaborent des plans de déclassement des réseaux lorsqu'une réduction de la demande de gaz naturel nécessitant le déclassement de réseaux de distribution de gaz naturel ou de parties de ces réseaux est prévue. Ces plans sont élaborés en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution d'hydrogène, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, et les gestionnaires d'installation de chauffage et de refroidissement urbains, afin d'assurer une intégration efficace du système énergétique et de tenir compte de la réduction de l'utilisation du gaz naturel pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments lorsqu'il existe des alternatives plus efficaces sur le plan énergétique et économique. Les États membres peuvent permettre aux gestionnaires de réseau de distribution, conformément au présent article, et aux gestionnaires de réseau de distribution d'hydrogène, conformément à l'article 56, qui sont actifs dans la même région, de développer un plan commun si des parties de l'infrastructure de gaz naturel doivent être réaffectées. Les États membres qui autorisent l'élaboration d'un plan commun veillent à ce que ce plan soit suffisamment transparent pour cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l'hydrogène visés par le plan. Le cas échéant, une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l'hydrogène. Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l'hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution d'hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l'efficacité du système, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 432-23 du code de l'énergie Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l'optimisation des réseaux qu'il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d'actualisation de cette étude. Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d'y apporter des modifications. Nouveau Article L. 432-24 du code de l'énergie Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l'étude d'optimisation de ce réseau mentionnée à l'article L. 432-23. Nouveau Article L. 432-25 du code de l'énergie La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d'interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. Une commune peut décider de supprimer une zone d'interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d'interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l'établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant. Il peut être dérogé à l'interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. |
||
|
[...] 2. Les plans de déclassement des réseaux de distribution satisfont au moins aux principes suivants : a) les plans sont fondés sur les plans en matière de chaleur et de froid mis au point conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791, et tiennent dûment compte de la demande des secteurs non couverts par les plans en matière de chaleur et de froid ; b) les plans sont fondés sur des hypothèses raisonnables concernant l'évolution de la production, de l'injection et de la fourniture de gaz naturel, y compris de biométhane, d'une part, et la consommation de gaz naturel dans tous les secteurs, au niveau de la distribution, d'autre part ; c) les gestionnaires de réseau de distribution recensent les adaptations nécessaires des infrastructures, tandis que la priorité est donnée aux solutions du côté de la demande qui ne nécessitent pas de nouveaux investissements dans les infrastructures, et les plans dressent la liste des infrastructures qui doivent être déclassées, notamment en vue d'assurer la transparence en ce qui concerne l'éventuelle réaffectation de ces infrastructures au transport d'hydrogène ; d) les gestionnaires de réseau de distribution mènent un processus de consultation ouvert aux parties prenantes concernées lors de l'élaboration du plan, afin de permettre leur participation effective au processus de planification dès ses débuts, y compris la fourniture et l'échange de toute information pertinente ; les résultats de la consultation et le plan de déclassement du réseau sont présentés à l'autorité nationale compétente ; e) les plans et les résultats de la consultation des parties prenantes sont publiés sur les sites internet des gestionnaires de réseau de distribution, et ces sites internet sont mis à jour régulièrement afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation ; f) les plans sont mis à jour au moins tous les quatre ans, en fonction des dernières projections relatives à la demande et à l'offre de gaz naturel dans la région concernée, et couvrent une période de dix ans ; g) les gestionnaires de réseau de distribution actifs dans une même zone régionale peuvent choisir d'élaborer un seul plan commun de déclassement du réseau ; h) les plans sont cohérents avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union pour le gaz naturel visé à l'article 32 du règlement (UE) 2024/1789 et avec les plans décennaux nationaux de développement du réseau mis au point conformément à l'article 55 de la présente directive ; i) les plans sont cohérents avec le plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre, avec le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat et avec la stratégie à long terme présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999, et soutiennent l'objectif de neutralité climatique énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. [...] |
Nouveau Article L. 432-23 du code de l'énergie Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l'optimisation des réseaux qu'il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d'actualisation de cette étude. Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d'y apporter des modifications. Nouveau Article L. 432-24 du code de l'énergie Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l'étude d'optimisation de ce réseau mentionnée à l'article L. 432-23. Nouveau Article L. 432-25 du code de l'énergie La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d'interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. Une commune peut décider de supprimer une zone d'interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d'interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l'établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant. Il peut être dérogé à l'interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. |
|||
|
[...] 3. Les autorités nationales compétentes évaluent la conformité des plans de déclassement des réseaux de distribution avec les principes énoncés au paragraphe 2. Elles approuvent ou rejettent le plan de déclassement du réseau de distribution et peuvent demander que des modifications soient apportées à ce plan. [...] |
Nouveau Article L. 432-23 du code de l'énergie Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l'optimisation des réseaux qu'il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d'actualisation de cette étude. Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d'y apporter des modifications. Nouveau Article L. 432-24 du code de l'énergie Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l'étude d'optimisation de ce réseau mentionnée à l'article L. 432-23. Nouveau Article L. 432-25 du code de l'énergie La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d'interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. Une commune peut décider de supprimer une zone d'interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d'interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l'établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant. Il peut être dérogé à l'interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. |
|||
|
[...] 4. L'élaboration des plans de déclassement des réseaux de distribution facilite la protection des clients finals conformément à l'article 13, et tient compte de leurs droits en vertu de l'article 38, paragraphe 6. [...] |
Nouveau Article L. 432-23 du code de l'énergie Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l'optimisation des réseaux qu'il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d'actualisation de cette étude. Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d'y apporter des modifications. Nouveau Article L. 432-24 du code de l'énergie Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l'étude d'optimisation de ce réseau mentionnée à l'article L. 432-23. Nouveau Article L. 432-25 du code de l'énergie La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d'interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. Une commune peut décider de supprimer une zone d'interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d'interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l'établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant. Il peut être dérogé à l'interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. |
|||
|
[...] 5. Les États membres peuvent décider de ne pas imposer les obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 aux gestionnaires de réseau de distribution qui alimentent moins de 45 000 clients raccordés au 4 août 2024. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution sont exemptés de présenter un plan de déclassement du réseau de distribution, ils informent l'autorité de régulation du déclassement des réseaux de distribution ou de parties de ces réseaux. [...] |
Nouveau Article L. 432-23 du code de l'énergie Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l'optimisation des réseaux qu'il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d'actualisation de cette étude. Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d'y apporter des modifications. Nouveau Article L. 432-24 du code de l'énergie Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l'étude d'optimisation de ce réseau mentionnée à l'article L. 432-23. Nouveau Article L. 432-25 du code de l'énergie La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d'interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. Une commune peut décider de supprimer une zone d'interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d'interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l'établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant. Il peut être dérogé à l'interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. |
|||
|
[...] 6. Lorsque des parties du réseau de distribution de gaz naturel sont susceptibles de devoir être déclassées avant la fin de leur cycle de vie initialement prévu, l'autorité de régulation établit des lignes directrices pour une approche structurelle de l'amortissement de tels actifs et la fixation des tarifs conformément à l'article 78, paragraphe 7. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, les autorités de régulation consultent les parties prenantes concernées, en particulier les gestionnaires de réseau de distribution et les organisations de consommateurs. [...] |
Nouveau Article L. 432-23 du code de l'énergie Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l'optimisation des réseaux qu'il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d'actualisation de cette étude. Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d'y apporter des modifications. Nouveau Article L. 432-24 du code de l'énergie Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l'étude d'optimisation de ce réseau mentionnée à l'article L. 432-23. Nouveau Article L. 432-25 du code de l'énergie La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d'interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. Une commune peut décider de supprimer une zone d'interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d'interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l'établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant. Il peut être dérogé à l'interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 59 - Financement des infrastructures d'hydrogène transfrontalières |
||||
|
1. Lorsque les États membres appliquent un système d'accès réglementé des tiers aux réseaux de transport d'hydrogène conformément à l'article 35, paragraphe 1, et lorsqu'un projet d'interconnexion d'hydrogène n'est pas un projet d'intérêt commun au sens du chapitre II et du point 3 de l'annexe I du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (49), les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène adjacents et concernés supportent les coûts du projet et peuvent les inclure dans leurs systèmes tarifaires respectifs, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation. Si les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène constatent un écart important entre les avantages et les coûts, ils peuvent élaborer un plan de projet, y compris une demande de répartition transfrontalière des coûts, et le soumettre conjointement aux autorités de régulation concernées pour approbation conjointe. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 833-1 du code de l'énergie Le coût des projets d'interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d'intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène concernés, français et de l'Etat membre adjacent. Le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire sous réserve d'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. « Un décret précise la procédure relative à la répartition des coûts entre les deux gestionnaires lorsqu'est constaté un écart important entre les avantages et les coûts du projet pour l'un deux. |
||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 60 - Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport |
||||
|
1. Les États membres veillent à ce que : a) chaque entreprise qui est propriétaire d'un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport ; b) la même personne ne soit autorisée : i) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; c) la même personne ne soit pas autorisée à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ; d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport. [...] |
Pour l'hydrogène : Article L. 111-8 du code de l'énergie Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe. Article L. 111-8-1 du code de l'énergie Pour l'application du présent paragraphe : 1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ; 2° La notion de « quelconque pouvoir » correspond, en particulier : - au pouvoir d'exercer des droits de vote ; - au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ; - à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise. Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : « gestionnaire de réseau de transport », « réseau de transport », « entreprise de production ou de fourniture » concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz. Article L. 111-8-4 du code de l'énergie Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers. |
Législative |
Pour l'hydrogène : Article L. 111-8 du code de l'énergie Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe. A l'exception des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène mentionnées aux articles L. 111-9 et L. 111-50-4, toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'hydrogène est soumise aux dispositions du présent paragraphe. Article L. 111-8-1 du code de l'énergie Pour l'application du présent paragraphe : 1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ; 2° La notion de « quelconque pouvoir » correspond, en particulier : - au pouvoir d'exercer des droits de vote ; - au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ; - à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise. Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : « gestionnaire de réseau de transport », « réseau de transport », « entreprise de production ou de fourniture » concernent indistinctement les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène. Article L. 111-8-4 du code de l'énergie Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture d'électricité, de gaz ou d'hydrogène, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers. |
|
|
[...] 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier : a) le pouvoir d'exercer des droits de vote; b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ; ou c) la détention d'une part majoritaire. [...] |
Article L. 111-8-1 du code de l'énergie Pour l'application du présent paragraphe : 1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ; 2° La notion de « quelconque pouvoir » correspond, en particulier : - au pouvoir d'exercer des droits de vote ; - au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ; - à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise. Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : « gestionnaire de réseau de transport », « réseau de transport », « entreprise de production ou de fourniture » concernent indistinctement les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène. |
|||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 61 - Gestionnaires de réseau indépendants |
||||
|
1. Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 60, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 60, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. La désignation d'un gestionnaire de réseau indépendant est soumise à l'approbation de la Commission. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 111-50-4 du code de l'énergie Lorsqu'un réseau de transport d'hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée d'hydrogène définie à l'article L. 111-10, la société propriétaire du réseau de transport peut en confier la gestion à un gestionnaire de réseau d'hydrogène indépendant préalablement désigné, sur proposition de la société propriétaire du réseau de transport d'hydrogène, par l'autorité administrative conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5. Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission européenne. |
||
|
[...] 2. L'État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si : a) le candidat gestionnaire a démontré qu'il respectait les exigences de l'article 60, paragraphe 1, points b), c) et d); b) le candidat gestionnaire a démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches en vertu de l'article 39; c) le candidat gestionnaire s'est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau surveillé par l'autorité de régulation; d) le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5; à cette fin, il présente tous les projets d'arrangements contractuels avec l'entreprise candidate et toute autre entité concernée; e) le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2024/1789, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 111-50-5 du code de l'énergie La désignation par l'autorité administrative d'un gestionnaire de réseau indépendant est conditionnée à la satisfaction des conditions suivantes : «1° Le candidat gestionnaire remplit les conditions fixées par l'article L. 111-8-3 ; 2° Le candidat gestionnaire dispose des ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires à l'exercice de ses missions déterminées à l'article L. 111-50-6 ; 3° Le candidat gestionnaire s'engage à se conformer au plan décennal de développement du réseau établi en vertu de l'article L. 832-6 ; 4° Le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-50-7 et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. |
||
|
[...] 4. Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d'accès, des redevances résultant de la gestion de la congestion des interconnexions, d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport, ainsi que d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable, grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification, y compris la procédure d'autorisation, de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d'un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni de la planification des investissements. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 111-50-6 du code de l'énergie Les missions du gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène indépendant sont définies aux articles L. 832-1 à L. 832-5. |
||
|
[...] 5. Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport : a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles ; b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant ; les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation ; celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation; c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant ; d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 111-50-7 du code de l'énergie Le propriétaire de réseau de transport d'hydrogène ayant confié sa gestion à un gestionnaire de réseau indépendant : 1° Coopère et soutient le gestionnaire de réseau indépendant dans l'exercice de ses missions, y compris en lui fournissant toutes les informations utiles ; 2° Assure la couverture de la responsabilité relative à ses actifs de réseau, à l'exception de la responsabilité liée aux missions du gestionnaire de réseau indépendant ; 3° Finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, ou donne son consentement pour que ces investissements soient financés par toute autre partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les mécanismes de financement correspondants sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, après consultation du propriétaire des actifs et des autres parties concernées ; 4° Fournit les garanties nécessaires pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels il a donné son consentement à un financement par une autre partie intéressée. Les engagements et responsabilités de chacune des parties sont consignés dans un contrat conclu entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire du réseau de transport d'hydrogène, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie. |
||
|
[...] 6. En étroite coopération avec l'autorité de régulation, l'autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 111-50-8 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité de la concurrence veillent, en vertu de leurs attributions respectives, au respect, par le propriétaire du réseau de transport d'hydrogène et par le gestionnaire de réseau indépendant, des dispositions du présent paragraphe. À cette fin, elles peuvent demander toute information qu'elles jugent nécessaire à l'exercice de cette mission et procéder à des inspections des installations du propriétaire du réseau de transport d'hydrogène et du gestionnaire de réseau indépendant. |
||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 68 - Dissociation des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène |
Législative |
|||
|
1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 5 août 2026, les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène soient dissociés conformément aux règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel énoncées à l'article 60. [...] |
Article L. 111-7 du code de l'énergie La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz. Article L. 111-9 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12. |
Législative |
Article L. 111-7 du code de l'énergie La gestion d'un réseau de transport d'électricité, de gaz ou d'hydrogène est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité, de gaz ou d'hydrogène. Article L. 111-9 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12. Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et les entreprises d'hydrogène verticalement intégrées au 4 août 2024, désignées comme sociétés gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12. Une société placée sous le contrôle exclusif d'un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 ou sous le contrôle exclusif d'une entreprise verticalement intégrée d'hydrogène au 4 août 2024 peut être désignée société gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, selon des modalités encadrées par la Commission de régulation de l'énergie. Cette société est soumise à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111 12. |
|
|
[...] 4. Lorsqu'un réseau de transport d'hydrogène appartient à un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel certifiés, ou lorsque, au 4 août 2024, un réseau de transport d'hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée active dans le domaine de la production ou de la fourniture d'hydrogène, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article et désignent une entité placée sous le contrôle exclusif du gestionnaire de réseau de transport, sous le contrôle conjoint de deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, ou sous le contrôle exclusif de l'entreprise verticalement intégrée active dans le domaine de la production ou de la fourniture d'hydrogène en tant que gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène intégré dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences prévues à l'article 69 en vertu du paragraphe 2 dudit article et lorsqu'un réseau de transport d'hydrogène appartient à un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel certifiés dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article et désigner cette entité ou une entité placée sous le contrôle conjoint de deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport en tant que gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène intégré dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre. Lorsqu'une entreprise inclut un gestionnaire de réseau de transport dissocié, conformément à l'article 60, paragraphe 1, et un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène intégré, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d'hydrogène, mais pas dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d'électricité. Lorsqu'une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d'hydrogène, le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées à la section 3 du présent chapitre, et l'entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n'utilise pas de droits à capacité pour injecter de l'hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel exploité par l'entreprise. [...] |
Article L. 111-10 du code de l'énergie Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité. Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz. Article L. 111-11 du code de l'énergie Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 : 1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ; 2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ; 3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ; 4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10. Article L. 111-12 du code de l'énergie Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L. 111-8. Article L. 111-14 du code de l'énergie Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature. Article L. 111-17 du code de l'énergie La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie tous les accords commerciaux et financiers qu'elle conclut avec l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci, y compris les prêts qu'elle consent à l'entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en oeuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l'énergie. Pour l'application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18, en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté. Article L. 111-18 du code de l'énergie Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d'un réseau de transport, à l'exception des prestations de services exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du gestionnaire de réseau de transport en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu'elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa. La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l'entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article L. 111-19 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information. Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite. Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants. Article L. 111-22 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. Article L. 111-26 du code de l'énergie L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : 1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ; 2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10 ; 3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33. Article L. 111-27 du code de l'énergie Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. Article L. 111-30 du code de l'énergie I. L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : 1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ; 2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ; 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ; 4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33. II. La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Article L. 111-31 du code de l'énergie A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. Article L. 111-33 du code de l'énergie La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière. Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. Article L. 111-34 du code de l'énergie Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée. Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en oeuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce code, qu'il lui transmet. Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport. Article L. 111-39 du code de l'énergie La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou de gaz peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport de l'Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion d'un réseau de transport régional transfrontalier. L'intégralité du capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui s'imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de la présente sous-section. |
Législative |
Nouveau Article L. 111-9-1 du code de l'énergie Lorsqu'une entreprise inclut une société gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionnée à l'article L. 111-8 et une société gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène mentionnée à l'article L. 111-9, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d'hydrogène, mais pas dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d'électricité. Lorsqu'une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d'hydrogène, la société gestionnaire de réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12, et l'entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n'utilise pas de droits à capacité pour injecter de l'hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel qu'elle exploite. Article L. 111-10 du code de l'énergie Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité. Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz. Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'hydrogène est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'hydrogène, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'hydrogène. Article L. 111-11 du code de l'énergie Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 : 1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité, de gaz ou d'hydrogène ; 2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité, de gaz ou d'hydrogène ; 3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ; 4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 111-10. Article L. 111-12 du code de l'énergie Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L. 111-8. Article L. 111-14 du code de l'énergie Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz, d'électricité ou d'hydrogène ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature. Article L. 111-17 du code de l'énergie La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie tous les accords commerciaux et financiers qu'elle conclut avec l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci, y compris les prêts qu'elle consent à l'entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en oeuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l'énergie. Pour l'application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18, en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique, gazier ou d'hydrogène ainsi que sa sécurité et sa sûreté. Article L. 111-18 du code de l'énergie Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d'un réseau de transport, à l'exception des prestations de services exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du gestionnaire de réseau de transport en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique, gazier ou d'hydrogène ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu'elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa. La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l'entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article L. 111-19 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information. Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite. Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants, L. 452-1 et suivants et L. 871-1 et suivants. Article L. 111-22 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité, de gaz ou d'hydrogène mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. Article L. 111-26 du code de l'énergie L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : 1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ; 2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10 ; 3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33. Article L. 111-27 du code de l'énergie Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. Article L. 111-30 du code de l'énergie I. L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : 1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ; 2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ; 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10 ; 4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33. II. La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Article L. 111-31 du code de l'énergie A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. Article L. 111-33 du code de l'énergie La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière. Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité, de gaz ou d'hydrogène définie à l'article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. Article L. 111-34 du code de l'énergie Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée. Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en oeuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce code, qu'il lui transmet. Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz, d'électricité ou d'hydrogène. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport. Article L. 111-39 du code de l'énergie La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité, de gaz ou d'hydrogène peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport de l'Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion d'un réseau de transport régional transfrontalier. L'intégralité du capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui s'imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de la présente sous-section. |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 69 - Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène |
Uniquement appliqué à l'hydrogène |
|||
|
1. Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène fait partie d'une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz naturel ou d'électricité, il est indépendant au moins sur le plan de sa forme juridique. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 111-50-1 du code de l'énergie Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène fait partie d'une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz ou d'électricité, il est doté de la personnalité morale et respecte les règles comptables fixées à l'article L. 111-90-1. |
||
|
[...] 2. Les États membres peuvent octroyer aux gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène des dérogations aux exigences du paragraphe 1, sur la base d'une analyse coûts-avantages positive rendue publique, sous réserve d'une évaluation positive effectuée par l'autorité de régulation, conformément au paragraphe 4. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 111-50-2 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie peut octroyer à une société gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène une dérogation à l'obligation prévue par l'article L. 111-50-1 sur la base d'une analyse coûts bénéfice rendue publique. Avant d'octroyer la dérogation, et au moins tous les sept ans par la suite, elle évalue notamment l'impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées entre les secteurs du gaz naturel, de l'électricité et de l'hydrogène, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Le contenu de l'évaluation est précisé par délibération de la Commission de régulation de l'énergie. |
||
|
[...] 4. Au moment d'octroyer une dérogation en vertu du paragraphe 2, et au moins tous les sept ans par la suite, ou sur demande motivée de la Commission, l'autorité de régulation de l'État membre qui octroie la dérogation publie une évaluation d'impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Une telle évaluation comprend au minimum le calendrier des transferts d'actifs attendus du secteur du gaz naturel au secteur de l'hydrogène. Si l'autorité de régulation conclut, sur la base d'une évaluation, que la poursuite de l'application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d'actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l'hydrogène s'achève, l'État membre retire la dérogation. [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 111-50-3 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie retire la dérogation si elle conclut, sur la base d'une évaluation, que la poursuite de l'application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d'actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l'hydrogène s'achève. |
||
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 71 - Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène |
||||
|
1. Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène, elle est certifiée conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 14 du règlement (UE) 2024/1789. [...] |
Article L. 111-1 du code de l'énergie Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d'énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV. Article L. 111-3 du code de l'énergie Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz. L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance. La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie. |
Législative |
Article L. 111-1 du code de l'énergie Les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel ainsi que d'exploitation des réseaux de transport d'hydrogène sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d'énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III, IV et VIII. Article L. 111-3 du code de l'énergie Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité, de gaz ou d'hydrogène. L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance. La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie. |
Déjà transposé pour le gaz naturel et modifié pour prendre en compte le secteur de l'hydrogène |
|
[...] 2. Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles s'étaient conformées aux exigences prévues à l'article 60 ou 68, en application de la procédure de certification, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport ou gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène désignés est notifiée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. [...] |
Article L. 111-2 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l'autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir, respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis pour exercer leurs activités. La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
Législative |
Article L. 111-2 du code de l'énergie Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité, les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'hydrogène agréées sont désignées par l'autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir, respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis pour exercer leurs activités. La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
Déjà transposé pour le gaz naturel et modifié pour prendre en compte le secteur de l'hydrogène |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 72 - Certification concernant des pays tiers |
||||
|
1. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène ou un propriétaire de réseau de transport d'hydrogène sur lesquels une personne d'un pays tiers exerce un contrôle, l'autorité de régulation adresse une notification à la Commission. L'autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une personne d'un pays tiers acquiert le contrôle d'un réseau de transport, d'un gestionnaire de réseau de transport, d'un réseau de transport d'hydrogène ou d'un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène. [...] |
Article L. 111-5 du code de l'énergie Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification. Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est tenue d'aviser la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité administrative de ce qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa. L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions d'application du présent article, en particulier l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l'énergie la décision d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L. 111-6 du code de l'énergie La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas de création en France d'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Législative |
Article L. 111-5 du code de l'énergie Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité, de gaz ou d'hydrogène de passer sous le contrôle d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification. Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité, de gaz ou d'hydrogène est tenue d'aviser la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité administrative de ce qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa. L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions d'application du présent article, en particulier l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l'énergie la décision d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L. 111-6 du code de l'énergie La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas de création en France d'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité, de gaz ou d'hydrogène par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Déjà transposé pour le gaz naturel et modifié pour prendre en compte le secteur de l'hydrogène |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 74 - Droit d'accès à la comptabilité |
||||
|
1. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation et les autorités de règlement des litiges visées à l'article 32, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ont un droit d'accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel et d'hydrogène conformément à l'article 75. [...] |
Article L. 135-1 du code de l'énergie Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l'énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle. Article L. 135-4 du code de l'énergie Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture. Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
Législative |
Article L. 135-1 du code de l'énergie Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène, la Commission de régulation de l'énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans les secteurs de l'électricité, du gaz naturel et de l'hydrogène ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle. Article L. 135-4 du code de l'énergie Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou d'hydrogène ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture. Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 75 - Dissociation comptable |
||||
|
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel et d'hydrogène est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5. [...] |
Nouveau Article L. 111-90-1 du code de l'énergie Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l'hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d'hydrogène, du stockage d'hydrogène, de l'exploitation des terminaux d'hydrogène ainsi que de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l'hydrogène. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé. Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|||
|
[...] 2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel et d'hydrogène établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles du droit national relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées en vertu de la directive 2013/34/UE. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 111-90-1 du code de l'énergie Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l'hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d'hydrogène, du stockage d'hydrogène, de l'exploitation des terminaux d'hydrogène ainsi que de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l'hydrogène. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé. Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nouveau Article L. 111-90-2 du code de l'énergie Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les exploitants concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111 90 1, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-90-1 lui sont transmis annuellement. Nouveau Article L. 111-90-3 du code de l'énergie L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section. |
Pour le gaz naturel : déjà transposé |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 77 - Objectifs généraux de l'autorité de régulation |
||||
|
Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et pouvoirs définis à l'article 78, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence et les autorités des États membres voisins et de pays tiers voisins concernées, et sans préjudice de leurs compétences : a) promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l'ACER, des marchés intérieurs du gaz naturel, du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l'hydrogène concurrentiels, souples, sûrs et durables pour l'environnement au sein de l'Union, garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz naturel et d'hydrogène fonctionnent de manière effective et fiable et faire progresser l'intégration du système énergétique, en tenant compte d'objectifs à long terme, contribuant ainsi à l'application cohérente, efficiente et efficace du droit de l'Union pour atteindre les objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie ; b) développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l'Union, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a) ; c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel et d'hydrogène entre États membres, notamment en supprimant les restrictions dues à des différences concernant la qualité du gaz naturel et de l'hydrogène ou concernant le volume d'hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel ou dues à des différences concernant la qualité de l'hydrogène dans le système d'hydrogène, en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, en garantissant l'interopérabilité du système interconnecté de gaz naturel de l'Union ou du système d'hydrogène de l'Union, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de l'Union ; d) contribuer à assurer de la manière la plus avantageuse par rapport au coût et en tenant compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique et climatique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande et à petite échelle à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques d'électricité et de chaleur ; e) faciliter la connexion et l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher la connexion et l'accès des entrants sur les marchés du gaz et de l'hydrogène à partir de sources renouvelables ; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du système reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des systèmes, en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, et favoriser l'intégration du marché ; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace de leurs marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir de hauts niveaux de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées et en consultation avec les organisations de consommateurs concernées ; h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur. |
Article L. 131-1 du code de l'énergie Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2. A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence. Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV. Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs. Article L. 131-2 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d'un contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 443-1, lorsque ce contrat est mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6, la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'évaluation de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements. Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en oeuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2. Article L. 131-3 du code de l'énergie Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel. |
Législative |
Article L. 131-1 du code de l'énergie Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité, du gaz naturel et de l'hydrogène au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2. A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, aux réseaux de transport d'hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrogène ainsi qu'aux terminaux d'hydrogène n'entravent pas le développement de la concurrence. Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel et de réseaux de transport d'hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène, par les exploitants de terminaux d'hydrogène et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, IV et VIII. Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs. Article L. 131-2 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité, le gaz naturel et l'hydrogène, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d'un contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 443-1, lorsque ce contrat est mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6, la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'évaluation de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et, pour le gaz et l'hydrogène, par le règlement (UE) n° 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2004 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements. Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en oeuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2. La Commission de régulation de l'énergie surveille les relations et les communications entre le propriétaire de réseau de transport d'hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène indépendant mentionné à l'article L. 111-50-4 de manière à garantir que ce dernier se conforme à ses obligations. Article L. 131-3 du code de l'énergie Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité, de gaz naturel et d'hydrogène. |
|
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 78 - Missions et pouvoirs de l'autorité de régulation |
Dispositions nouvelles ou modifiées par rapport à 2009 |
|||
|
1. L'autorité de régulation est investie des missions suivantes : c) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs pour l'accès au réseau d'hydrogène ou leurs méthodes de calcul, ou les deux, sans préjudice des décisions des États membres prises en vertu de l'article 35, paragraphe 4 ; |
Pour l'hydrogène : Article L. 134-3 du code de l'énergie La commission approuve : 1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ; 2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi qu'à l'article L. 421-7-1 ; 3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ; 4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ; 5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ; 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ; 7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés ; 8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91. Article L. 134-7 du code de l'énergie La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d'électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau. Article L. 134-8 du code de l'énergie La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement. Article L. 134-10 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu'à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10.[...] Article L. 134-12 du code de l'énergie La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines. Article L. 134-15 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires de ces réseaux. Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance. Elle publie tous les deux ans un rapport d'évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d'un réseau électrique intelligent promouvant l'efficacité énergétique et l'insertion de l'énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs rendus publics. Article L. 134-16 du code de l'énergie Le président de la Commission saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. Article L. 134-16-1 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres chargés de l'économie et de l'énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu'elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité. Le ministre chargé de l'économie ou de l'énergie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. Article L. 134-18 du code de l'énergie Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. [...] |
Législative |
Pour l'hydrogène : Nouveau Article L. 134-2-1 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ; 2° Les missions des gestionnaires de terminaux d'hydrogène et celles des exploitants d'installations de stockage d'hydrogène ; 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport d'hydrogène ; 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport d'hydrogène et des installations de stockage souterrain d'hydrogène, y compris les tarifs de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ; 5° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Article L. 134-3 du code de l'énergie La commission approuve : 1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ; 2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II des articles L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6, ainsi qu'aux articles L. 421-7-1 et L. 841-4 ; 2° bis Les montages financiers correspondant à l'investissement mentionné au dernier alinéa des articles L. 431-6 et L. 832-6 ; 3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension mentionnées à l'article L. 321-11 ; 4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ; 4°bis Les règles techniques et financières élaborées par les exploitants et relatives à l'équilibrage des réseaux d'hydrogène et la couverture des besoins mentionnées à l'article L. 832-4 ; 5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ; 5°bis Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport d'hydrogène prévues à l'article L. 111-110-5 ; 5 ter La répartition dans le temps des coûts du réseau de transport d'hydrogène et sa méthodologie mentionnées à l'article L. 111-110-6 ; 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ; 7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés ; 8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91. ; 9° Le contrat conclu entre un propriétaire de réseau de transport d'hydrogène et le gestionnaire de réseau indépendant mentionné à l'article L. 111-50-7 ; 10° Le système tarifaire du gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène incluant le coût des projets d'interconnexion mentionné à l'article L. 833-1. Article L. 134-7 du code de l'énergie La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz, d'hydrogène et d'électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau. Article L. 134-8 du code de l'énergie La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement. Article L. 134-10 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport de gaz naturel et d'hydrogène et de distribution de gaz naturel, aux terminaux d'hydrogène et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation ainsi qu'à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrogène. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10.[...] Article L. 134-12 du code de l'énergie La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel et de l'hydrogène. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines. Article L. 134-15 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, de gaz et d'hydrogène et de distribution d'électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires de ces réseaux. Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance. Elle publie tous les deux ans un rapport d'évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d'un réseau électrique intelligent promouvant l'efficacité énergétique et l'insertion de l'énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs rendus publics. Article L. 134-16 du code de l'énergie Le président de la Commission saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité, du gaz naturel ou de l'hydrogène, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité, du gaz naturel ou de l'hydrogène. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. Article L. 134-16-1 du code de l'énergie La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres chargés de l'économie et de l'énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu'elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité, du gaz naturel ou de l'hydrogène, y compris des clauses d'exclusivité. Le ministre chargé de l'économie ou de l'énergie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. Article L. 134-18 du code de l'énergie Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des ouvrages de transport d'hydrogène, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des exploitants de stockage d'hydrogène, des exploitants de terminaux d'hydrogène, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité, de l'hydrogène ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. [...] |
Pour le gaz naturel : déjà transposé |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 78 - Missions et pouvoirs de l'autorité de régulation |
Législative |
|||
|
[...] 4. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les pouvoirs suivants: [...] |
Article L. 142-30 du code de l'énergie Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33. Article L. 142-31 du code de l'énergie Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement : 1° Une sanction pécuniaire ; 2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire. Article L. 142-37 du code de l'énergie Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21. Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
Législative |
Article L. 142-30 du code de l'énergie Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV, V et VIII du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33. Article L. 142-31 du code de l'énergie Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement : 1° Une sanction pécuniaire ; 2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1, à l'article L. 431-1 ou à l'article L. 834-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire. Article L. 142-37 du code de l'énergie Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV, V et VIII du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz, de l'hydrogène et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21. Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Nouveau Article L 835-1 du code de l'énergie L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : 1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ; 2° A l'organisation des entreprises de transport d'hydrogène prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ; 3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-79-1 et L. 111-79-2 ; 4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111 110-1 et suivants ; 5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène prévues au chapitre II du présent titre. |
Application du régime de sanctions prévu pour les secteurs de l'électricité et du gaz au secteur de l'hydrogène Régime de sanctions applicables au secteur de l'hydrogène. |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 79 - Décisions et plaintes |
||||
|
[...] 2. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL ou de réseau de distribution ou un gestionnaire de réseau d'hydrogène, de stockage d'hydrogène ou de terminal d'hydrogène en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours. [...] |
Article L. 134-19 du code de l'énergie Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; 3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; 4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent. Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité. Article L. 134-25 du code de l'énergie Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan. [...] Article L. 134-28 du code de l'énergie Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure. Article L. 134-29 du code de l'énergie En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1 ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire. Article L. 134-30 du code de l'énergie En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d'indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l'énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l'article L. 111-8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d'électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel. Article L. 135-13 du code de l'énergie Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4. Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
Législative |
Article L. 134-19 du code de l'énergie Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; 2bis° Entre les exploitants et les utilisateurs des ouvrages de transport d'hydrogène ; 3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage souterrain d'hydrogène ; 3° ter Entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d'hydrogène ; 4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 111-110-1, L. 321-11, L. 321-12, L. 841-2 et L. 861-1, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent. Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité. Article L. 134-25 du code de l'énergie Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants de réseaux de transport d'hydrogène ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou d'hydrogène ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de terminaux d'hydrogène ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, dans les conditions fixées aux articles suivants. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou d'hydrogène de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou bisannuelle des plans décennaux de développement du réseau mentionnés aux articles L. 431-6 et L. 832-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ces plans. [...] Article L. 134-28 du code de l'énergie Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure. Article L. 134-29 du code de l'énergie En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité, du gaz naturel ou d'hydrogène ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1 ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire. Article L. 134-30 du code de l'énergie En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou d'hydrogène, aux règles d'indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l'énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l'article L. 111-8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d'électricité, du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel ou du titre III du livre VIII pour le transport d'hydrogène. Article L. 135-13 du code de l'énergie Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4. Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz et au marché de l'hydrogène sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
Déjà transposé pour le gaz naturel et modifié pour prendre en compte le secteur de l'hydrogène. |
|
Directive (UE) 2024/1788 Article 82 - Conservation d'informations |
||||
|
1. Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation et les autorités nationales de la concurrence, et de la Commission, aux fins de l'accomplissement de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel et d'hydrogène ou des instruments dérivés sur le gaz naturel et l'hydrogène passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, avec des gestionnaires de stockage de gaz naturel et de GNL, ainsi qu'avec des gestionnaires de réseau d'hydrogène, de stockage d'hydrogène et de terminal d'hydrogène. [...] |
Article L. 134-18 du code l'énergie Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions. La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. Article L. 111-77 du code de l'énergie Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. |
Législative |
Article L. 134-18 du code l'énergie Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des opérateurs des ouvrages de transport d'hydrogène, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrogène, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité, du gaz naturel, de l'hydrogène ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions. La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. Article L. 111-77 du code de l'énergie Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la durée de mise à disposition des données, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. |
Article 39 - Tableau de transposition de la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables Article 15 quater Zones d'accélération des énergies renouvelables 1. Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l'article 15 ter, paragraphe 1, des zones d'accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d'énergie. Les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques. Dans ces plans, les autorités compétentes : a) désignent des zones terrestres, d'eaux intérieures et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d'un ou de plusieurs types spécifiques de sources d'énergie renouvelable ne devrait pas avoir d'incidence importante sur l'environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu'elles: i) donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d'immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d'eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l'agriculture; ii) excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, les principales routes migratoires des oiseaux et des mammifères marins ainsi que d'autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii)), à l'exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport; iii) utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d'énergie renouvelable n'auraient pas d'incidence importante sur l'environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l'aménagement d'un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d'habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil (*13), ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (*14); b) établissent des règles appropriées pour les zones d'accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d'atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d'énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d'éviter les incidences négatives sur l'environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n'est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d'atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l'article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*15), et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE. Les règles visées au premier alinéa, point b), ciblent les spécificités de chaque zone d'accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d'énergie renouvelable à mettre en oeuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées. Le respect des règles visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et la mise en oeuvre des mesures d'atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l'article 16 bis, paragraphes 4 et 5, de la présente directive. Lorsque de nouvelles mesures d'atténuation visant à prévenir, autant que possible, la mise à mort ou la perturbation d'espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l'environnement, n'ont pas été largement testées du point de vue de leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l'efficacité de ces mesures d'atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s'avèrent inefficaces. Dans les plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés au premier alinéa, les autorités compétentes expliquent l'évaluation effectuée pour recenser chaque zone d'accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés au premier alinéa, point a), et pour définir des mesures d'atténuation appropriées. 2. Avant leur adoption, les plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables font l'objet d'une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (*16) et, s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d'une évaluation appropriée en application de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE. 3. Les États membres décident de la taille des zones d'accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place des zones d'accélération des énergies renouvelables. S'ils conservent toute latitude pour décider de la taille de ces zones, les États membres s'efforcent de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive. Les plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont rendus publics et sont réexaminés périodiquement comme il convient, en particulier dans le cadre de la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. 4. Au plus tard le 21 mai 2024, les États membres peuvent déclarer comme zones d'accélération des énergies renouvelables des zones spécifiques qui ont déjà été désignées comme zones propices au déploiement accéléré d'un ou plusieurs types de technologie en matière d'énergie renouvelable, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) ces zones se situent en dehors des sites Natura 2000, des zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et la biodiversité et des routes connues de migration des oiseaux; b) les plans recensant ces zones ont fait l'objet d'une évaluation de l'incidence sur l'environnement des activités stratégiques en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d'une évaluation en application de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; c) les projets situés dans ces zones mettent en oeuvre des règles et mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l'environnement qui pourraient survenir. 5. Les autorités compétentes appliquent la procédure d'octroi de permis et les délais visés à l'article 16 bis à chaque projet dans les zones d'accélération des énergies renouvelables. |
Article L. 219-5-1 du code de l'environnement I. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en oeuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines. La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité. Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières. Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade. II. - Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité. La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent faire application de l'article L. 121-8-1. La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'énergie, en prenant en compte l'objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 du présent code. Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L. 229-26 du code de l'environnement I. - La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. [...] II. - Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole : 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ; [...] 2° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie ; [...] |
Législative |
Nouveau Article L. 141-5-5 du code de l'énergie A l'occasion de leur adoption ou de leur mise à jour, les documents stratégiques de façade prévus à l'article L. 219-3 du code de l'environnement et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du même code peuvent identifier, comme un sous-ensemble des zones mentionnées à l'article L. 141-5-4 du présent code, des zones, dites d'accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables, s'appliquant à un ou à plusieurs types de sources d'énergie, en donnant la priorité aux surfaces artificialisées et construites. Les installations de combustion de biomasse et les installations de production d'énergie hydraulique en sont exclues. En sont exclues les zones dans lesquelles les installations d'énergie renouvelable seraient susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité. Sont définies, pour chaque technologie concernée, les règles appropriées concernant les mesures d'évitement et de réduction prévues à l'article L. 122-6 du code de l'environnement à adopter pour accueillir des installations d'énergie renouvelable. II. - Au sein de ces zones d'accélération renforcée, les projets d'installations de production d'énergie renouvelable respectant les mesures d'évitement et de réduction appropriées mentionnées au I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l'article L. 414-4 du même code. Cette dispense ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'un Etat susceptible d'être touché de manière notable le demande. Tout projet d'installation fait l'objet d'un examen préalable par l'autorité administrative, au regard d'un dossier établi par le maître d'ouvrage présentant le projet et les mesures d'évitement et de réduction envisagées, afin de déterminer s'il est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante qui n'aurait pas été recensée lors de l'évaluation environnementale du plan définissant la zone d'accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l'implanter. Si l'examen préalable conclut à l'existence d'un tel risque, le projet ne peut bénéficier de la dispense prévue au premier alinéa du II. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d'évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l'absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d'ouvrage. Article L. 219-5-1 du code de l'environnement I. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en oeuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines. La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité. Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières. Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade. II. - Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité. La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent faire application de l'article L. 121-8-1. La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'énergie, en prenant en compte l'objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 du présent code. Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. Le document stratégique de façade peut également définir les zones d'accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l'article L. 141-5-5 du code de l'énergie, ainsi que les zones d'infrastructure de réseau et les règles appropriées prévues à l'article L. 342-5-1 du même code. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L. 229-26 du code de l'environnement I. - La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. [...] II. - Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole : 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ; [...] 2° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie ; 2° ter Les zones d'accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l'article L. 141-5-5 du code de l'énergie ; [...] |
Le dispositif législatif proposé créé des zones sur le territoire, lesquelles n'existent actuellement pas en droit français, qui seraient inclues dans des plan programme à savoir les Plans climat air énergie et territoire et les Documents stratégiques de façades. Ces zones ne peuvent se faire sur un certain nombre de sites sensibles et priorisent les zones déjà artificialisées. Les plans dans lesquelles elles sont définies identifient pour chaque technologie visée, les règles appropriées concernant les mesures d'évitement à mettre en place. Pour les zones terrestres, elles sont définies comme des sous ensemble des zones d'accélération déjà définis par la loi APER. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ces dispositions. |
|
Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables Article 15 sexies Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique 1. Les États membres peuvent adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d'infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d'incidence importante sur l'environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n'est pas possible, compensée. L'objectif de ces zones est d'appuyer et de compléter les zones d'accélération des énergies renouvelables. Ces plans : a) évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n'existe pas d'autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets; b) excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection; c) veillent à assurer des synergies avec la désignation des zones d'accélération des énergies renouvelables; d) font l'objet d'une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d'une évaluation en application de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; et e) établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d'atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d'éviter toute incidence négative sur l'environnement ou, s'il n'est pas possible d'éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative. Lors de la préparation de ces plans, les États membres consultent les exploitants de système d'infrastructures pertinents. 2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, ainsi qu'à l'annexe I, point 20, à l'annexe II, point 3 b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (*17), et par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie renouvelable, exempter les projets de réseau et de stockage qui sont nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique de l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, d'une évaluation de leur incidence sur les sites Natura 2000 en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE et de l'évaluation de leur incidence sur la protection des espèces en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l'article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d'infrastructure spécifique désignée conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d'atténuation proportionnées à adopter, conformément au paragraphe 1, point e), du présent article. Les États membres peuvent également accorder ces exemptions aux zones d'infrastructure désignées avant le 20 novembre 2023 si elles avaient fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement en application de la directive 2001/42/CE. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux projets susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'environnement dans un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être touché de manière importante le demande, comme le prévoit l'article 7 de la directive 2011/92/UE. 3. Lorsqu'un État membre exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du paragraphe 2 du présent article des évaluations visées audit paragraphe, les autorités compétentes de cet État membre procèdent à un examen préalable des projets situés dans les zones d'infrastructure spécifiques. Cet examen préalable s'appuie sur les données existantes tirées de l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la directive 2001/42/CE. Les autorités compétentes peuvent inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose. L'examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. Il vise à déterminer si l'un ou l'autre de ces projets est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n'ont pas été recensées lors de l'évaluation environnementale des plans désignant les zones d'infrastructure spécifiques réalisée en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE. 4. Lorsque l'examen préalable constate qu'un projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 3, l'autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d'atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer de telles mesures d'atténuation, l'autorité compétente veille à ce que l'exploitant adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d'autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d'une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l'état de conservation des espèces touchées. 5. Lorsque l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l'infrastructure du réseau dans des zones d'infrastructure spécifique ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 3 du présent article, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement, ou à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. |
Article L. 321-6 du code de l'énergie I.-Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d'installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et le plan national intégré en matière d'énergie et de climat prévu par l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 342-3. Il tient également compte du potentiel d'utilisation de l'effacement de consommation, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau. Il évalue, par ailleurs, les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en oeuvre par le gestionnaire du réseau de transport. Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements. [...] Article L. 342-3 du code de l'énergie Le schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables définit, pour une
période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à
créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des
installations de production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables une capacité globale de
raccordement. |
Législative |
Article L. 321-6 du code de l'énergie I.-Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d'installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens. A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et le plan national intégré en matière d'énergie et de climat prévu par l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 342-3. Il tient également compte du potentiel d'utilisation de l'effacement de consommation, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau. Il évalue, par ailleurs, les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en oeuvre par le gestionnaire du réseau de transport. Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements. Il peut également définir les zones d'infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l'article L. 342-5-1. Ces zones et ces règles sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente, qui peut demander des modifications ou des compléments. [...] Article L. 342-3 du code de l'énergie Le schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables définit, pour une
période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à
créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des
installations de production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables une capacité globale de
raccordement. Il peut également définir les zones d'infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l'article L. 342-5-1. Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat, qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit ainsi que les zones d'infrastructures et les règles appropriées mentionnées à l'alinéa précédent . A compter de l'approbation de la quote-part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut être qu'inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma. Les capacités d'accueil de la production
prévues dans le schéma régional de raccordement sont
réservées pendant une période de dix ans au
bénéfice des installations de production
d'électricité à partir d'énergies
renouvelables. Section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'environnement Nouveau Paragraphe 3 Les zones d'infrastructures de réseau Art. L. 342-5-1. Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6 du présent code, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l'article L. 342-3 du présent code et les documents stratégiques de façade prévus à l'article L. 219-3 du code de l'environnement peuvent prévoir des zones d'infrastructure de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique. Les zones d'infrastructure de réseau respectent les conditions suivantes : 1°Elles sont identifiées en appui et en complément des zones d'accélération renforcée définies à l'article L. 141-5-5 du présent code et permettent l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ; 2° Elles évitent les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf s'il n'existe pas d'autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets ; 3° Elles tiennent compte de l'implantation des infrastructures déjà existantes et privilégient le regroupement d'infrastructures. Les schémas et documents mentionnés au premier alinéa définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures d'évitement et de réduction mentionnées à l'article L. 122-6 du code de l'environnement à adopter pour le développement des projets d'infrastructures de réseau. Les modalités d'identification et de délimitation des zones d'infrastructures de réseau sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 342-5-2. I. - Par dérogation aux articles L. 122-1 et L. 414-4 du code de l'environnement, les projets d'infrastructures de réseau nécessaires à l'intégration des installations d'énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d'infrastructure de réseau définies à l'article L. 342-5-1 du présent code peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de l'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° L'ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s'inscrit dans le périmètre d'une ou de plusieurs zones d'infrastructure de réseau ; 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d'évitement et de réduction définies par la zone d'infrastructure de réseau dans le périmètre de laquelle il s'insère. Cette dispense ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'un Etat susceptible d'être touché de manière notable le demande. II. - Lorsqu'il est dispensé d'évaluation environnementale conformément au I du présent article, le projet de réseau fait l'objet d'un examen préalable par l'autorité administrative, afin de déterminer s'il est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l'implanter, qui n'aurait pas été recensée lors de l'évaluation environnementale réalisée pour l'adoption des plans désignant les zones d'infrastructure de réseau prévues à l'article L. 342-5-1 du présent code. Si l'examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, l'autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures d'évitement et de réduction proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer de telles mesures d'évitement et de réduction, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en oeuvre par l'exploitant. En l'absence d'autres mesures compensatoires disponibles, celles-ci peuvent prendre la forme d'une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou améliorer l'état de conservation des espèces touchées. III. - Lorsque l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l'objet est de modifier ou renforcer des ouvrages existants dans une zone d'infrastructure de réseau prévue à l'article L. 342-5-1 du présent code et qu'il répond aux conditions fixées par le I du présent article, l'examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension envisagées par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. Lorsque l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d'une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d'infrastructure de réseau, l'examen au cas par cas ou l'évaluation environnementale du projet prévus à l'article L. 122-1 du code de l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension envisagées par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
Les dispositions créent les zones d'infrastructures de réseau, lesquelles n'existent actuellement pas en droit français . Elles ont pour objectif de simplifier les exigences procédurales en matière d'environnement pour l'implantation des postes et lignes électriques nécessaires à l'intégration des énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ces dispositions. |
|
Article 16 bis Procédure d'octroi de permis dans les zones d'accélération des énergies renouvelables 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5 du présent article, par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, et à l'annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a), de la directive 2011/92/UE, en ce qui concerne les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau, sont exemptées de l'obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement en application de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent l'article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive. Cette dérogation ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'environnement dans un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être touché de manière importante le demande, en application de l'article 7 de la directive 2011/92/UE. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les installations d'énergie renouvelable visées au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 pour autant que ces projets en matière d'énergie renouvelable respectent les règles et mesures établies conformément à l'article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive. 4. Les autorités compétentes procèdent à un examen préalable des demandes visées au paragraphe 3 du présent article. Cet examen préalable vise à déterminer si l'un ou l'autre des projets d'énergie renouvelable est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n'ont pas été recensées lors de l'évaluation environnementale des plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés à l'article 15 quater, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive réalisés en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE. Cet examen préalable vise également à déterminer si l'un de ces projets d'énergie renouvelable entre dans le champ d'application de l'article 7 de la directive 2011/92/UE parce qu'il est susceptible d'avoir une incidence importante sur l'environnement dans un autre État membre ou parce qu'un État membre susceptible d'être touché de manière importante en a fait la demande. Aux fins de cet examen préalable, le promoteur du projet fournit des informations sur les caractéristiques du projet d'énergie renouvelable, sur le respect des règles et mesures définies en application de l'article 15 quater, paragraphe 1, point b), pour la zone d'accélération des énergies renouvelables concernée, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le promoteur du projet et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l'environnement. L'autorité compétente peut inviter le promoteur du projet à fournir des informations complémentaires dont il dispose. L'examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d'énergie renouvelable est achevé dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle suffisamment d'informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s'agissant des demandes concernant des installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, l'examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. 5. À l'issue de l'examen préalable, les demandes visées au paragraphe 3 du présent article sont acceptées d'un point de vue environnemental sans qu'une décision expresse de l'autorité compétente ne soit requise, à moins que l'autorité compétente n'adopte une décision administrative, dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d'accélération des énergies renouvelables ou proposées par le promoteur du projet. De telles décisions sont rendues publiques. De tels projets d'énergie renouvelable font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE et, le cas échéant, d'une évaluation en application de la directive 92/43/CEE, qui ont lieu dans un délai de six mois suivant la décision administrative constatant que le projet est hautement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de six mois peut être prolongé de six mois au maximum. Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu'il est nécessaire d'accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie renouvelable, les États membres peuvent exempter de ces évaluations les projets éoliens et photovoltaïques solaires. Lorsque les États membres exemptent des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, l'exploitant adopte des mesures d'atténuation proportionnées ou, si ces mesures d'atténuation ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires, qui, si d'autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d'une compensation financière, afin de remédier à toute incidence négative. Lorsque cette incidence négative a un effet sur la protection des espèces, l'exploitant verse une compensation financière en faveur des programmes de protection des espèces pour la durée d'exploitation de l'installation d'énergie renouvelable afin de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des espèces touchées. |
= |
Législative |
Nouveau Article L. 141-5-5 du code de l'énergie II. - Au sein de ces zones d'accélération renforcée, les projets d'installations de production d'énergie renouvelable respectant les mesures d'évitement et de réduction appropriées mentionnées au I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l'article L. 414-4 du même code. Cette dispense ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'un Etat susceptible d'être touché de manière notable le demande. Tout projet d'installation fait l'objet d'un examen préalable par l'autorité administrative, au regard d'un dossier établi par le maître d'ouvrage présentant le projet et les mesures d'évitement et de réduction envisagées, afin de déterminer s'il est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante qui n'aurait pas été recensée lors de l'évaluation environnementale du plan définissant la zone d'accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l'implanter. Si l'examen préalable conclut à l'existence d'un tel risque, le projet ne peut bénéficier de la dispense prévue au premier alinéa du II. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d'évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l'absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d'ouvrage. Nouveau Article L. 342-5-2 du code de l'énergie Par dérogation aux articles L. 122-1 et L. 414-4 du code de l'environnement, les projets d'infrastructures de réseau nécessaires à l'intégration des installations d'énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d'infrastructure de réseau définies à l'article L. 342-5-1 du présent code peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de l'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° L'ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s'inscrit dans le périmètre d'une ou de plusieurs zones d'infrastructure de réseau ; 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d'évitement et de réduction définies par la zone d'infrastructure de réseau dans le périmètre de laquelle il s'insère. Cette dispense ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'un Etat susceptible d'être touché de manière notable le demande. II. - Lorsqu'il est dispensé d'évaluation environnementale conformément au I du présent article, le projet de réseau fait l'objet d'un examen préalable par l'autorité administrative, afin de déterminer s'il est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l'implanter, qui n'aurait pas été recensée lors de l'évaluation environnementale réalisée pour l'adoption des plans désignant les zones d'infrastructure de réseau prévues à l'article L. 342-5-1 du présent code. Si l'examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, l'autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures d'évitement et de réduction proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer de telles mesures d'évitement et de réduction, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en oeuvre par l'exploitant. En l'absence d'autres mesures compensatoires disponibles, celles-ci peuvent prendre la forme d'une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou améliorer l'état de conservation des espèces touchées. III. - Lorsque l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l'objet est de modifier ou renforcer des ouvrages existants dans une zone d'infrastructure de réseau prévue à l'article L. 342-5-1 du présent code et qu'il répond aux conditions fixées par le I du présent article, l'examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension envisagées par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. Lorsque l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d'une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d'infrastructure de réseau, l'examen au cas par cas ou l'évaluation environnementale du projet prévus à l'article L. 122-1 du code de l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension envisagées par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
La disposition permet une évolution du droit encadrant la procédure d'évaluation environnementale et permet notamment l'exemption de cette évaluation environnementale pour les zones d'accélération si les mesures d'atténuation prévues sont mises en place, procédure qui n'existe pas à ce jour en droit français. L'article précise la procédure d'octroi de permis dans les zones d'accélération renforcée et des zones d'infrastructure de réseau. Il prévoit que, dès lors que des zones d'accélération renforcée sont identifiées, les projets d'installation de production énergie renouvelable susceptibles de s'y installer seraient exemptés d'évaluation environnementale. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ces dispositions. |
Article 40 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables Article 20 bis Facilitation de l'intégration de l'électricité renouvelable dans le système 1. Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et, s'ils disposent des données, des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu'ils mettent à disposition des données sur la part de l'électricité renouvelable et le taux d'émissions de gaz à effet de serre de l'électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible à des intervalles équivalant à la fréquence de règlement du marché, mais ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu'elles sont disponibles. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution aient accès aux données nécessaires. Si les gestionnaires de réseau de distribution n'ont pas accès, en application du droit national, à toutes les données nécessaires, ils appliquent le système de communication des données existant dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944. Les États membres prévoient des incitations en faveur de la modernisation des réseaux intelligents pour mieux surveiller l'équilibre du réseau et mettre à disposition des données en temps réel. Si elles sont disponibles techniquement, les gestionnaires de réseau de distribution mettent également à disposition des données anonymisées et agrégées sur le potentiel de participation active de la demande et sur l'électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par les autoconsommateurs et les communautés d'énergie renouvelable. 2. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme numérique d'une manière qui garantit l'interopérabilité sur la base de formats de données harmonisés et d'ensembles de données normalisés, afin qu'elles puissent être utilisées de manière non discriminatoire par les participants au marché de l'électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et qu'elles puissent être lues par des dispositifs de communication électronique tels que les systèmes de comptage intelligents, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments. [...] |
|
Législative |
NOUVEAU « CHAPITRE V DONNÉES UTILES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ Art. L. 355-1. - Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les données sur la part de l'électricité renouvelable et le taux d'émissions de gaz à effet de serre de l'électricité fournie dans la zone de dépôt des offres du marché de l'électricité français, aussi précisément que possible à des intervalles de temps équivalent à la fréquence de règlement du marché et, si possible, en temps réel. A cette fin, les gestionnaires de réseau de distribution transmettent, s'ils en disposent, les données nécessaires au gestionnaire de réseau de transport. Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent également à disposition, si elles sont techniquement disponibles, des données anonymes et agrégées sur le potentiel de flexibilité de la consommation et sur l'électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par une opération d'autoconsommation et par les communautés d'énergie renouvelable définies aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 291-1. Ces données sont rendues publiques sous format numérique en cohérence avec les standards de gestion des données afin notamment qu'elles puissent être accessibles et utilisées de manière non discriminatoire par l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité ainsi que par les systèmes de comptage intelligents mentionnés à l'article L. 341-4, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments. |
Article 41 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; ainsi que de mesures de transposition complémentaires de la directive (UE) 2018/2001 relatives aux bioénergies
|
Disposition de la directive à transposer |
Norme de droit interne existante portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Article premier - paragraphe 1 Définitions À l'article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit : a) le point 1) est remplacé par le texte suivant: « [...] 1 bis) “bois rond de qualité industrielle”: les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l'exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l'essence, les dimensions, la rectitude et la densité des noeuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu'il est défini et dûment justifié par les États membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes;»; |
Législative |
Article L. 281-1 du code de l'énergie « 11° Bois rond de qualité industrielle : les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l'exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l'état général de dégradation, l'essence, les dimensions, la rectitude et la densité des noeuds, le rendent impropre à un usage industriel, conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes. ». |
||
|
f) les points suivants sont insérés: «22 bis) “combustibles renouvelables”: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d'origine non biologique; |
Compte-tenu de la rédaction du droit français, cette locution ne sera pas nécessaire car nous listons systématiquement les sous-catégories (qui font l'objet de dispositions souvent distinctes dans le code de l'énergie : Chapitre II du Titre VIII du Livre II du code de l'énergie). |
|||
|
g) le point 36) est remplacé par le texte suivant: «36) “carburants renouvelables d'origine non biologique”: les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;»; |
La définition est déjà présente dans le code de l'énergie et elle doit être modifiée |
Législative |
13° A l'article L. 282-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « liquides et gazeux » ainsi que les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas-carbone » ; b) Au 1°, les mots : « liquides et gazeux » ainsi que les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, » sont remplacés par les mots : « et combustibles liquides et gazeux » ; |
Modification opérée sur le L. 282-1 et toilettage global des dispositions du Titre VIII du livre II |
|
Article 1er - paragraphe 2 Modification article 3 le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l'énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et l'incidence négative sur la biodiversité, l'environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE et veillent à l'application du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en mettant l'accent sur les régimes d'aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales. Les États membres élaborent des régimes d'aide en faveur de l'énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse de manière à éviter d'encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l'ordre de priorité suivant: a) produits à base de bois; b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois; c) réutilisation; d) recyclage; e) bioénergie; et f) élimination. 3 bis. Les États membres peuvent déroger au principe d'utilisation en cascade de la biomasse visé au paragraphe 3 lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Les États membres peuvent également déroger audit principe lorsque l'industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d'utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues: a) d'activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d'éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque; b) de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées; ou c) de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement. 3 ter. Une fois par an au maximum, les États membres notifient à la Commission un résumé des dérogations au principe d'utilisation en cascade de la biomasse en application du paragraphe 3 bis, ainsi que les motifs de ces dérogations et l'échelle géographique à laquelle elles s'appliquent. La Commission rend publiques les notifications reçues et peut rendre un avis public sur celles-ci. 3 quater. Les États membres n'accordent pas d'aide financière directe: a) à l'utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d'énergie; b) à la production d'énergie renouvelable provenant de l'incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE aient été satisfaites. 3 quinquies. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres n'accordent pas d'aide nouvelle ni ne renouvellent d'aide en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que ladite électricité remplisse au moins l'une des conditions suivantes: a) elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (*7) en raison de la dépendance de cette région à l'égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l'article 29, paragraphe 11, de la présente directive; b) elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l'article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa; c) elle est produite dans une région ultrapériphérique visée à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour une durée limitée et dans l'objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l'utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l'accès à une énergie sûre et sécurisée. Au plus tard en 2027, la Commission publie un rapport sur l'incidence des régimes d'aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité, sur le climat et l'environnement, et sur d'éventuelles distorsions du marché, et évalue la possibilité d'introduire des limitations supplémentaires pour les régimes d'aide en faveur de la biomasse forestière. (*7) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).»;" |
Loi : nouveau chapitre VI au sein du titre VIII du livre II du code de l'énergie Des dispositions réglementaires viendront compléter dans un second temps. Des dispositions relèvent du code de l'environnement pour l'étude d'impact. |
23° Le titre VIII du livre II et complété par un chapitre ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « PRINCIPE D'UTILISATION EN CASCADE DE LA BIOMASSE ET AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES PUBLIQUES À LA PRODUCTION D'ÉNERGIE À PARTIR DE BIOMASSE « Section 1 « Règles relatives à l'utilisation en cascade de la biomasse « Art. L. 286-1. - L'énergie issue de la biomasse est produite de manière à ramener à un minimum les effets de distorsion sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les incidences négatives sur la biodiversité, l'environnement et le climat. « A cette fin, les utilisations énergétiques de la biomasse tiennent compte de la hiérarchie des modes de traitements des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et veillent à l'application du principe d'utilisation en cascade de la biomasse défini à l'article L. 281-1 du présent code. « Art. L. 286-2. - Les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de l'énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse sont élaborés de manière à éviter d'encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l'ordre de priorité suivant : « 1° Produits à base de bois ; « 2° Allongement de la durée de vie des produits à base de bois ; « 3° Réutilisation ; « 4° Recyclage ; « 5° Bioénergie ; « 6° Elimination. « Art. L. 286-3. - Il peut être dérogé au principe d'utilisation en cascade de la biomasse et à l'ordre de priorités définis, respectivement, aux articles L. 286-1 et L. 286-2, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique. « Il peut également être dérogé au principe d'utilisation en cascade de la biomasse et à l'ordre de priorité mentionnés au premier alinéa lorsque l'industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d'utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues : « 1° D'activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d'éclaircies pré-commerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque ; « 2° De coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées ; « 3° De la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement du bois. « Certaines typologies de biomasse ligneuse non forestière pour lesquelles la production de bioénergie peut correspondre à la valorisation économique et environnementale la plus élevée peuvent déroger au principe d'utilisation en cascade et à l'ordre de priorité énoncés aux articles précédents. « Art. L. 286-4. - Le préfet de région assure une évaluation et un suivi de la disponibilité des ressources en biomasse et des usages énergétiques et non-énergétiques et la prévention des conflits d'usage sur le territoire régional. Dans ce cadre, il évalue la faisabilité, les incidences sur les filières locales et le respect du principe d'utilisation en cascade de la biomasse et de l'ordre de priorité, définis, respectivement, aux articles L. 286-1 et L. 286-2, des plans d'approvisionnement des projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant une aide publique ainsi que des modifications substantielles de l'approvisionnement d'installations existantes consommatrices de biomasse ligneuse percevant une aide publique. En cas d'avis défavorable du préfet de région, une aide publique ne peut être accordée à un nouveau projet. Pour les installations existantes, l'aide peut être suspendue au regard des seules modifications substantielles apportées à leur approvisionnement. « Art. L. 286-5. - Les installations de production d'énergie à partir de biomasse forestière assurent un suivi des motifs de dérogation prévus à l'article L. 286-3, au regard des informations transmises par les opérateurs de la chaîne mentionnée à l'article L. 281-2. A cette fin, elles transmettent un bilan annuel de leur approvisionnement en biomasse ligneuse au préfet de région. « Art. L. 286-6. - Pour évaluer les potentielles distorsions du marché des matières premières issues de la biomasse au titre de l'article L. 286-1 des études et enquêtes complémentaires au suivi prévu à l'article L. 286-5 peuvent être mises en place par arrêté conjoint des ministres en charge de la forêt, de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie. Des études et enquêtes complémentaires peuvent également être mises en place par arrêté du préfet de région afin d'assurer le respect des missions définies à l'article L. 286-4. « Ces arrêtés définissent les modalités de collecte et la nature des données demandées. Elles peuvent, notamment, comprendre les typologies de biomasses consommées, leur provenance ainsi que des données économiques sur les chaînes de valeur concernées. « Le périmètre de ces études et de ces enquêtes complémentaires peut concerner les installations consommatrices de biomasse, ainsi que leurs fournisseurs directs et indirects jusqu'aux producteurs de biomasse sur l'ensemble du territoire national. « Section 2 « Dispositions relatives aux aides financières en faveur de l'énergie produite à partir de biomasse « Art. L. 286-7. - Sans préjudice de l'article L. 286-1, est interdite toute aide publique, hors avantage fiscal, ou tout renouvellement d'aide publique, hors avantage fiscal, à partir du 1er juin 2026 : « 1° A l'utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d'énergie ; « 2° A la production d'énergie renouvelable provenant de l'incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées aux articles L. 541-21-1, L. 541-21-2 et au 17° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, aient été satisfaites. « Art. L. 286-8. - Sans préjudice de l'article L. 286-1, est interdite toute nouvelle aide publique ou nouvel avantage fiscal, ou tout renouvellement d'aide publique ou d'avantage fiscal en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que l'électricité remplisse au moins l'une des conditions suivantes : « 1° Elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste, en raison de la dépendance de cette région à l'égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l'article L. 281-11 ; « 2° Elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées au septième alinéa de l'article L. 281-11 ; « 3° Elle est produite sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna, pour une durée limitée et dans l'objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l'utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l'accès à une énergie sûre et sécurisée. « Section 3 « Dispositions communes « Art. L. 286-9. - Les conditions d'application du présent chapitre, notamment le champ d'application des installations concernées tenant compte de leur consommation annuelle de biomasse et de leur puissance thermique nominale, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ; |
||
|
Article 1er - paragraphe 19 Modification Article 29 a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) contribuer aux parts des énergies renouvelables des États membres et aux objectifs fixés à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 15 bis, paragraphe 1, à l'article 22 bis, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 1;»; |
L. 281-3 du code de l'énergie |
Loi |
14° A l'article L. 282-2 : a) Au début de l'article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour mesurer les résultats en matière d'énergie renouvelable, produite à partir de carburants renouvelables d'origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, dont la France rend compte auprès de l'Union européenne, seuls sont pris en considération les carburants respectant les émissions de gaz à effet de serre suivantes : » ; b) Au premier alinéa, qui devient un 1°, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ; c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants bas-carbone sont définies par décret » ; d) Au troisième alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du présent article » ; |
La formulation générique du L. 281-3 couvre déjà tous les objectifs visés au point a) : pas de modification structurelle nécessaire pour transposer. Modification du 1er alinéa du L. 281-3 pour prendre en compte l'ajout de l'article 29bis et la modification du 1er paragraphe de l'article 30 (RFNBO et RCF) |
|
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: [...] iii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les combustibles ou carburants issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 s'ils sont utilisés: a) dans le cas des combustibles ou carburants solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 7,5 MW; b) dans le cas de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW; c) dans des installations produisant des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants: i) supérieur à 200 m3 d'équivalent méthane/h, mesuré dans des conditions normales de température et de pression, à savoir 0 °C et 1 bar de pression atmosphérique; ii) si le biogaz est composé d'un mélange de méthane et d'un autre gaz non combustible, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé au point i), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations ayant une puissance thermique nominale totale ou un débit de méthane inférieur.»; |
L.281-4 du code de l'énergie |
Loi |
Le I de l'article L. 281-4 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « I.- Concernant les combustibles ou carburants issus de la biomasse, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 s'appliquent uniquement « 1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s'ils sont utilisés dans des installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 7,5 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ; « 2° Au biogaz s'il est utilisé dans des installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ; « 3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est supérieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an. ». |
La partie laissant la possibilité aux Etats-Membres de prendre des mesures sous le seuil de biométhane ne nécessite pas de transposition. La rédaction est ici profondément remaniée afin de clarifier les différents seuils applicables. Le point c) i) est transposé comme la « capacité de production » supérieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an, qui est équivalent au seuil de 200 m3 d'équivalent méthane/h Le point c) ii) ne nécessite pas transposition car tout le biogaz injecté en France l'est sous forme de biométhane (pas de mélange) Le terme de biométhane n'est pas présent dans la partie législative du code de l'énergie. |
|
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de biodiversité, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, indépendamment du fait qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour: a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante; et forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où se situe la forêt; b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; c) zones affectées: i) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; ou ii) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 30, paragraphe 4, premier alinéa, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; d) prairies naturelles de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire: i) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité; ou e) landes. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alinéa du présent paragraphe, à l'exception du point c), s'applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. La Commission peut adopter des actes d'exécution qui précisent davantage les critères permettant de déterminer quelles prairies doivent être régies par le premier alinéa, point d), du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 3.» c) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alinéa du présent paragraphe, à l'exception des points b) et c), et le deuxième alinéa du présent paragraphe s'appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.»;* d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières en janvier 2008, à moins qu'il ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le présent paragraphe s'applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.» |
L281-7 du code de l'énergie pour la biomasse agricole Inexistant pour la biomasse forestière |
Loi pour la biomasse forestière Textes réglementaires ultérieurs pour la biomasse forestière et agricole |
8° Après l'article L. 281-9, est inséré un article L. 281-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 281-9-1. - Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière doivent provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation, afin de garantir que : « 1° Les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas : « a) De terres de grande valeur en termes de biodiversité ; « b) De terres présentant un important stock de carbone ; « c) De terres ayant le caractère de tourbières ; « 2° Les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une attestation garantissant que la biomasse forestière n'est pas issue des terres mentionnées au 1°. « Dans le cas contraire, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent des catégories de terres définies au 1°. « La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ; |
Pas de nécessité de transposer ces modifications au niveau législatif pour la biomasse agricole. Pour la biomasse forestière, un article permet de transposer les exigences conditionnelles « Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6 ... » Les types de zones seront précisées au niveau réglementaire |
|
e) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) au point a), les points iii)) et iv) sont remplacés par le texte suivant: «iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats; iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récolte conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»; ii) au point a), les points suivants sont ajoutés: «vi) que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés au paragraphe 3, points a), b), d) et e), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres précisées dans ces paragraphes; et vii) que les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d'assurance s'appuyant sur des processus internes au niveau de l'entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l'article 30, paragraphe 3, garantissant que la biomasse forestière n'est pas issue des terres visées au point vi)) du présent alinéa.»; iii) au point b), les points iii)) et iv) sont remplacés par le texte suivant: «iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes, et les tourbières, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats, sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature; iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles tels qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort; et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats; et»; |
L.281-9 |
Loi et textes réglementaires ultérieures |
7° A l'article L. 281-9 : a) Au 3°, les mots : « dans les zones humides ou les tourbières » sont remplacés par les mots : « dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats » ; b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° La réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter : « a) La récolte des souches et des racines ; « b) La dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles, ou leur conversion en forêt de plantation ; « c) La récolte sur les sols sensibles ; « 5° La réalisation des récoltes conformément à des seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur ; « 6° La réalisation des récoltes conformément à des seuils de rétention de bois mort, appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique ; « 7° La réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; » c) Le 5° devient le 8° ; d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'applications des 1° à 8° sont précisées, pour le prélèvement de biomasse forestière sur le territoire national, par décret en Conseil d'Etat. » ; |
Renvoi réglementaire pour l'application des critères en France, notamment seuil de coupes rases appliqué à l'exploitant forestier. |
|
f) les paragraphes suivants sont insérés: «7 bis. La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (*20) et avec les politiques et mesures décrites par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat présentés conformément aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. 7 ter. Dans leur plan national intégré actualisé final en matière d'énergie et de climat, qui doit être présenté au plus tard le 30 juin 2024 conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres font figurer tous les éléments suivants: a) une évaluation de l'approvisionnement national en biomasse forestière disponible à des fins énergétiques pour la période 2021-2030, conformément aux critères énoncés au présent article; b) une évaluation de la compatibilité de l'utilisation prévue de la biomasse forestière pour la production d'énergie avec les objectifs et budgets des États membres pour la période 2026-2030 énoncés à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841; et c) une description des mesures et politiques nationales garantissant la compatibilité avec ces objectifs et budgets. Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures et politiques visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans le cadre des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat présentés en application de l'article 17 du règlement (UE) 2018/1999. (*20) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).»;" |
Loi pour le 7bis. Le 7ter ne nécessite pas de transposition (le PNIEC prendra bien ces éléments en compte) |
I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Au 10° de l'article L. 100-2, après les mots : « qualité des sols », sont insérés les mots : « , et en assurant la compatibilité de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 » ; |
Modification pour aligner le droit national et la politique énergétique relative à la biomasse avec la compatibilité au règlement 2018/841 (LULUCF) |
|
|
g) au paragraphe 10, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations qui ont été mises en service après le 20 novembre 2023, d'au minimum 80 %; e) pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d'au minimum 70 % jusqu'au 31 décembre 2029 et d'au minimum 80 % à partir du 1er janvier 2030; f) pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d'au minimum 70 % avant d'avoir été en service pendant quinze ans et d'au minimum 80 % après avoir été en service pendant quinze ans; g) pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d'au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029; h) pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d'au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026.»; |
L.281-6 |
Loi |
L'article L. 281-6 du même code est remplacé par un article L. 281-6 ainsi rédigé : « Art. L. 281-6. - La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports doivent présenter une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile d'au moins : « 1° 80 % pour les installations mises en service après le 20 novembre 2023 ; « 2 70 % jusqu'au 31 décembre 2029 et d'au moins 80 % à partir du 1er janvier 2030 pour les installations de production d'électricité, de chaleur ou de froid de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ; « 3° 70 % jusqu'au 31 décembre 2029 et d'au moins 80 % à partir du 1er janvier 2030 pour les installations de production de biogaz de capacité de production supérieure ou égale à 97,2 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ; « 4° 70 % avant d'avoir été en service pendant quinze ans et d'au moins 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production d'électricité, de chaleur ou de froid à partir de biogaz de puissance thermique nominale inférieure à 10 MW mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ; « 5° 70 % avant d'avoir été en service pendant quinze ans et d'au moins 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production de biogaz de capacité de production inférieure ou égale à 97,2 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ; « 6° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production d'électricité, de chaleur ou de froid de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW mises en service avant le 1er janvier 2021 ; « 7° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production de biogaz de capacité de production supérieure ou égale à 97,2 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021 ; « 8° 80% après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production de production d'électricité, de chaleur ou de froid à partir de biogaz de puissance thermique nominale inférieure à 10 MW mises en service avant le 1er janvier 2021 ; « 9° 80% après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production de biogaz de capacité de production inférieure ou égale à 97,2 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021 ; |
Refonte de l'article L.281-6 pour clarifier tous les cas possibles Le seuil de 10 MW pour le biométhane est transposé comme 97,2 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an (seuils équivalents) |
|
h) au paragraphe 13, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) aux installations situées dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour autant que ces installations produisent de l'électricité ou de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse et de bioliquides ou qu'elles produisent des biocarburants; et b) aux combustibles ou carburants issus de la biomasse et bioliquides utilisés dans les installations visées au point a) du présent alinéa et aux biocarburants produits dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de cette biomasse, pour autant que ces critères soient justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer, dans cette région ultrapériphérique, l'accès à une énergie sûre et sécurisée et de faciliter l'introduction des critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article, et d'encourager ainsi le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants issus de la biomasse, biocarburants et bioliquides durables.»; |
L.281-12 du code de l'énergie |
Loi et textes réglementaires ultérieurs |
10° A l'article L. 281-12 : a) Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « de la biomasse », sont insérés les mots : « ou de bioliquides, ou produisant des biocarburants, » et les mots : « utilisés dans ces installations » sont remplacés par les mots : « ou les bioliquides utilisés dans ces installations, ainsi que les biocarburants produits dans ces installations » ; b) Au second alinéa, après les mots : « but d'assurer », sont insérés les mots : « l'accès à une énergie sûre et sécurisée et » après les mots : « de la biomasse », sont insérés les mots : « , bioliquides ou biocarburants durables » ; |
|
|
le paragraphe suivant est ajouté: «15. Jusqu'au 31 décembre 2030, l'énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse peut également être prise en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article si: a) le soutien a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 dans sa version en vigueur le 29 septembre 2020; et b) l'aide a été accordée sous la forme d'un soutien à long terme pour lequel un montant fixe a été déterminé au début de la période de soutien et à condition qu'un mécanisme de correction visant à garantir l'absence de surcompensation soit en place.». |
11° Après l'article L. 281-12, est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 281-12-1. - Dans des cas précisés par voie réglementaire, des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être prévues pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse ainsi que pour la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur du transport, pour une durée n'excédant pas le 31 décembre 2030 et à condition qu'un soutien de long terme ait été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre applicables à cette dernière date. » ; |
Les dérogations seront introduites dans des textes réglementaires |
||
|
Article 1er - paragraphe 21 Modification Article 30 L'article 30 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Lorsqu'il est prévu de comptabiliser les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé aux fins de la réalisation des objectifs visés à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 15 bis, paragraphe 1, à l'article 22 bis, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 1, les États membres exigent des opérateurs économiques qu'ils démontrent, au moyen de contrôles obligatoires indépendants et transparents, conformément à l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 8 du présent article, que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l'article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l'article 29 bis, paragraphes 1 et 2, pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé ont été respectés. À cette fin, ils exigent des opérateurs économiques qu'ils utilisent un système de bilan massique qui:»; |
L.283-2 |
Loi |
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 283-2 du même code, après les mots : « à un contrôle », sont insérés les mots : « obligatoire, transparent, ». |
Article 42 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2018/2001 modifiée par la directive 2023/2413 Article 25 1. Chaque État membre impose aux fournisseurs de carburants l'obligation de veiller à ce que: a) la quantité de carburants et d'électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne: i) une part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale dans le secteur des transports d'au moins 29 % d'ici à 2030; ou ii) une réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre d'au moins 14,5 % d'ici à 2030 par rapport à la valeur de référence fixée à l'article 27, paragraphe 1, point b), conformément à une trajectoire indicative fixée par l'État membre; b) la part cumulée des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, et des carburants renouvelables d'origine non biologique dans l'énergie fournie au secteur des transports soit d'au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1 point de pourcentage en 2030. 2. Pour le calcul des objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et des parts visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres: a) tiennent compte des carburants renouvelables d'origine non biologique également lorsqu'ils sont utilisés comme produits intermédiaires pour la production: i) de carburants conventionnels destinés au transport; ou ii) de biocarburants, à condition que la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue par l'utilisation de carburants renouvelables d'origine non biologique ne soit pas comptabilisée dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants; 4. Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d'échanger des crédits pour la fourniture d'énergie renouvelable au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l'électricité renouvelable aux véhicules électriques dans des points de recharge publics reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s'ils sont soumis à l'obligation imposée par l'État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l'obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa. Les États membres peuvent inclure des points de recharge privés dans ce mécanisme, s'il peut être démontré que l'électricité renouvelable fournie à ces points de recharge privés est fournie uniquement aux véhicules électriques. |
Législative |
Article L. 287-1 du code de l'énergie (nouveau) Le dispositif de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l'atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Pour 2030, ces objectifs sont fixés à : 1° 14,5 % de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l'article L. 287-2 ; 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 5,5 % dans la quantité d'énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins un 1 % ; « 3° Une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1,2 % dans la quantité totale d'énergie fournie au secteur du transport maritime. Article L. 641-6 du code de l'énergie L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030. Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030. Pour l'application du
présent article, seuls sont pris en compte les produits qui
vérifient les critères de durabilité définis aux
articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées
par voie réglementaire. Article L. 287-4 du code de l'énergie (nouveau) Pour l'application de l'article L. 287-3, sont pris en compte : « 2° L'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public ou de poids lourds électriques au moyen d'infrastructures privées de recharge. « Pour la comptabilisation des quantités d'électricité alimentant des poids lourds électriques, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe des valeurs des quantités d'électricité estimées. Ces valeurs sont calculées forfaitairement selon la masse techniquement admissible du poids du poids lourd électrique, sa catégorie et son activité. Elles sont déterminées à partir des consommations moyennes des poids lourds électriques en France. « Les modalités de calcul de la part renouvelable de l'électricité sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. Cet arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2031, une diminution progressive de la prise en compte des quantités d'électricité renouvelable comptabilisées au titre de l'atteinte des objectifs de l'article L. 287-3, dans la limite de 50 % des quantités réelles d'électricité renouvelable fournie. Cet arrêté peut fixer une trajectoire de baisse moins élevée pour certains types d'usages, en fonction de critères géographiques, de la typologie de véhicules électriques alimentés, ou du type de borne concerné et en préciser les conditions d'éligibilité, les catégories de bénéficiaires, les types d'énergie ou d'équipements concernés, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement ; « 3° L'hydrogène renouvelable ou bas-carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l'une des conditions suivantes : « b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse ; Article L. 287-9 du code de l'énergie (nouveau) « Les obligés justifient l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 287-3 par le biais de certificats de réduction de l'intensité carbone, à raison des quantités d'énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, au sens de l'article L. 287-2. « Les certificats de réduction d'intensité carbone ne peuvent être établis qu'à partir de l'énergie incorporée ou consommée l'année de l'obligation ou l'année précédant celle-ci. « La création et l'utilisation des certificats de réduction de l'intensité carbone sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. Article L. 287-10 du code de l'énergie (nouveau) Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l'atteinte de leurs objectifs : « 1° Les autres obligés ; « 2° Les opérateurs incorporant des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou produisant des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l'objet des mesures de suivi et de gestion prévues au 3° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ; « 3° Les fournisseurs d'hydrogène renouvelable ou bas carbone ; « 4° Les aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers ; « 5° Les titulaires principaux de l'immatriculation des poids lourds électriques situés dans des dépôts équipés d'une infrastructure privée de recharge. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité des certificats. |
Des transpositions précédentes se trouvent dans les articles suivants : - Article 266 quindecies du code des douanes et décret du 7 juin 2019 sur la TIRUERT Abrogation de l'article L 641-6 car rendu inutile du fait de la création de l'article 287-1 |
|
|
Directive (UE) 2018/2001 modifiée par la directive 2023/2413 Article 26 2. Pour le calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre visée à l'article 7 et de la part minimale d'énergie renouvelable et de l'objectif de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre visé à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la part des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles ou carburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d'affectation des terres produits à partir de cultures vivrières et fourragères pour lesquelles une expansion significative de la zone de production vers des terres à fort stock de carbone est observée ne dépasse pas le niveau de consommation de ces combustibles dans cet État membre en 2019, à moins qu'ils ne soient certifiés comme étant des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles ou carburants issus de la biomasse à faible risque indirect de changement d'affectation des sols en application du présent paragraphe. |
Article 266 quindecies du code des douanes et décret du 7 juin 2019 sur la TIRUERT |
Législative |
Article L. 287-4 du code de l'énergie (nouveau) Pour l'application de l'article L. 287-3, sont pris en compte : « 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre I er du présent titre. « Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d'affectation des terres ne sont pas éligibles à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article L. 287-3. Les biocarburants issus d'huile de soja et d'huile de palme, y compris les distillats d'acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d'affectation des sols. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes définit des règles d'éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d'affectation des sols peuvent être pris en compte ; |
Dispositions relatives à cette transposition : - Article 266 quindecies du code des douanes et décret du 7 juin 2019 sur la TIRUERT |
|
Directive (UE) 2018/2001 modifiée par la directive 2023/2413 Article 27 1. Pour le calcul de la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre visée à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), les règles suivantes s'appliquent: a) les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont calculées comme suit: i) pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d'émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément à l'article 31; ii) pour les carburants renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d'émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 29 bis, paragraphe 3; iii) pour l'électricité renouvelable, en multipliant la quantité d'électricité renouvelable fournie à tous les modes de transport par le combustible fossile de référence ECF(e) figurant à l'annexe V; |
Législative |
Article L. 296-4 du code de l'énergie (nouveau) Au titre de chaque année civile, l'objectif de réduction d'intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants : «1° Le taux fixé au 1° de l'article L.296-2 ; «2° La quantité totale d'énergie contenue dans les carburants fournis par l'obligé ; «3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante à l'annexe V de la directive ENR susvisée. Article L. 296-5 du code de l'énergie (nouveau) Les réductions d'intensité carbone sont calculées dans les conditions suivantes : 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant leur quantité d'énergie par leurs réductions d'émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 31 de la directive ENR ; 2° Pour les carburants renouvelables d'origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d'énergie par leurs réductions effectives d'émissions de gaz à effet de serre en application de l'article L. 282-2 ; 3° Pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d'électricité renouvelable fournie par la valeur de référence définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. |
Dispositions relatives à cette transposition : - Article 266 quindecies du code des douanes et décret du 7 juin 2019 sur la TIRUERT |
|
|
Directive (UE) 2018/2001 modifiée par la directive 2023/2413 Article 31 bis 2. Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans la base de données de l'Union des données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l'objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au moment de leur mise sur le marché dans l'Union. Aux fins de la saisie de données dans la base de données de l'Union, le système de gaz interconnecté est considéré comme un seul système de bilan massique. Des données sur l'injection et le retrait de carburants gazeux renouvelables sont fournies dans la base de données de l'Union. Des données sur l'octroi ou non d'une aide pour la production d'un lot spécifique de carburant et, dans l'affirmative, sur le type de régime d'aide, sont également introduites dans la base de données de l'Union. Ces données peuvent être introduites dans la base de données de l'Union par l'intermédiaire des bases de données nationales. Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu'ils saisissent les données nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l'Union. 5. Chaque État membre peut utiliser une base de données nationales existante alignée sur la base de données de l'Union et reliée à cette dernière par l'intermédiaire d'une interface, ou établir une base de données nationale qui peut être utilisée par les opérateurs économiques en tant qu'outil pour collecter et déclarer des données et pour introduire et transférer ces données dans la base de données de l'Union, à condition que: a) la base de données nationale soit conforme à la base de données de l'Union, notamment en ce qui concerne la promptitude de la transmission des données, la typologie des ensembles de données transférés et les protocoles relatifs à la qualité et à la vérification des données; b) les États membres veillent à ce que les données introduites dans la base de données nationale soient immédiatement transférées à la base de données de l'Union. |
Législative |
Article L. 287-11 du code de l'énergie (nouveau) Les certificats sont dématérialisés dans une base de données, sous la responsabilité du ministère chargé de l'énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l'Union européenne conformément à l'article 31 bis de la directive ENR. Tout opérateur de la chaîne d'approvisionnement en énergie utilisée dans le secteur des transports peut ouvrir un compte dans cette base nationale. Les personnes mentionnées à l'article L.287-10 saisissent dans la base de données nationale les informations relatives aux opérations effectuées ainsi qu'aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l'objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au moment de leur mise sur le marché dans l'Union. Ces données sont transférées à la base de données de l'Union. Ces personnes communiquent également à l'administration les prix des transactions des certificats mentionnés à l'article L.287-10 par le biais de la base de données mentionnée au présent article. Les comptabilités tenues par ces personnes dans ladite base de données ne peuvent aboutir à un solde négatif à l'issue des périodes de déclarations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs. Article L. 287-12 du code de l'énergie (nouveau) Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les dispositions prévues à l'article L. 287-3 s'appliquent, un rapport sur l'atteinte de l'obligation de réduction d'intensité carbone est établi par la base de données prévue à l'article L.287-11, sur la base des certificats de réduction d'intensité carbone déclarés par l'obligé. A compter de la date de mise à disposition du rapport, l'obligé dispose d'un délai de trente jours pour le valider. Dans ce délai, l'obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles 67 B à 67 D-1 du code des douanes. A défaut de validation à l'issue du délai de 30 jours, le rapport est réputé validé. Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité, le rapport prévu au premier alinéa est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d'activité. A défaut de validation à l'issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l'obligation est devenue exigible avant cette date. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l'atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction d'intensité carbone à l'administration. |
Article 45 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directives |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2024/1275 Article 2 Définitions [...] 22) « rénovation importante » : la rénovation d'un bâtiment lorsque : a) le coût total de la rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ; ou b) plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une rénovation. Les États membres peuvent choisir d'appliquer le point a) ou b) [...] |
Article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation [...] 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes : [...] |
Législatif |
Article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (introduction d'un alinéa après le 17bis) [...] 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes : 17° ter Rénovation importante : la rénovation d'un bâtiment est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve. . |
Il a été choisi de retenir la définition du a). |
|
Directive 2024/1275 Article 3 Plan national de rénovation des bâtiments 1. Chaque État membre établit un plan national de rénovation des bâtiments pour garantir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, en vue de transformer les bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles. [...] |
Article L. 100-1-A. du code de l'énergie : [...] II.- Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I : [...] [...] |
Législatif |
Article L. 100-1-A du code l'énergie. [...] II.- Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I : [...] Le plan national de rénovation, mentionné à l'article 3 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. [...] |
Rapport à produire Le premier projet de plan de rénovation est
attendu pour le 31 décembre 2025. |
|
Directive 2024/1275 Article 23 Inspections 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation, y compris toute combinaison de ceux-ci, ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. Le calcul de la puissance nominale utile du système est fondé sur la somme de la puissance nominale des générateurs de chaleur et des générateurs de froid. |
Article L. 224-1 du code de l'environnement [...] II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : [...] 2° Prévoir que les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; [...] |
Législatif |
Article L. 224-1 du code de l'environnement [...] II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : [...] 2° Prévoir que les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation, les systèmes de climatisation et les systèmes de ventilation dont la puissance ou la combinaison de puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; [...] |
|
|
Directive 2024/1275 Article 10 Énergie solaire dans les bâtiments [...] 3. Les États membres veillent au déploiement d'installations d'énergie solaire appropriées, si elles conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables, comme suit : [...] |
Article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation : I.- Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. II.- Les obligations prévues au présent article s'appliquent : 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu'aux parcs de stationnement non couverts mentionnés au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les parcs de stationnement non couverts, couverts par cette obligation. III.- Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. IV.- L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. V.- Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. |
Législatif |
Le L.171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : I.- Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. I - Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables. II.- Les obligations prévues au présent article s'appliquent : 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu'aux parcs de stationnement non couverts mentionnés au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les parcs de stationnement non couverts, couverts par cette obligation. II - Les obligations prévues au présent article s'appliquent aux constructions de bâtiments non-résidentiels lorsqu'elles créent plus de 130 mètres carrés d'emprise au sol et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. Ces obligations s'appliquent également aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, et, à compter du 1er janvier 2028, à celles ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés. A compter du 1er janvier 2030, ces obligations s'appliquent également aux constructions de bâtiments résidentiels ainsi qu'aux constructions de parcs de stationnement couverts de plus de trois places qui jouxtent un bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II. III.- Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. III.- Les obligations résultant du I sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière importante, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 40 %, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. IV.- L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation d'un procédé de production d'énergie renouvelable des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes importantes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs à encadrant ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. V.- Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les l'obligation est incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. VI - Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments équipés, avant une rénovation importante, d'un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction, sous réserve que ce système soit conservé. |
Législatif (PJL de transposition) : Mise en cohérence les articles L. 171-4 et 5 du CCH avec l'article 10 de la DPEB : - Suppression de l'alternative entre végétalisation et EnR pour s'aligner sur l'objectif de solarisation de la DPEB ; - Définition des rénovations concernées ; - Harmonisation des typologies soumises ; - Mise en cohérence des seuils de surface (en emprise au sol) ; - Mise en cohérence du calendrier ; - Transfert des obligations concernant les parcs de stationnement extérieurs du CCH vers le code de l'urbanisme pour éviter une modification du champ d'application lors de la transposition ; - Remplacement du mot « gestionnaire » par « propriétaire » pour plus de clarté. |
|
Article L.171-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du 1° du I de l 'article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : I.- Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret. II.- Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas : 1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; 2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du bâtiment de démontrer qu'il répond à ces critères. III.- Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l'installation. IV.- Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie |
B du IV de l'article 45 : Dans le 1° du I de l 'article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, l'article 171-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : I.- Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments publics non-résidentiels dont l'emprise au sol est supérieure à : -1 100 m², à compter du 1er janvier 2028, -410 m², à compter du 1er janvier 2029, -130 m², à compter du 1er janvier 2031. Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret. II.- Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas : 1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; 2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. 3° Aux bâtiments ou parties de bâtiment déjà équipés d'un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° 1°, 2° et 3° du présent II sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire propriétaire du bâtiment de démontrer qu'il répond à ces critères. III.- Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l'installation. IV.- Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie. |
|||
|
Directive 2024/1275 Article 14 Infrastructures pour une mobilité durable 1. Pour les bâtiments neufs non résidentiels comprenant plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures et les bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante comprenant plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent à: a) l'installation d'au moins un point de recharge pour cinq emplacements de stationnement pour voitures ; b) la pose d'un précâblage pour au moins 50
% des emplacements de stationnement pour voitures et de l'infrastructure de
raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles
électriques, pour les emplacements de stationnement pour voitures
restants afin de permettre l'installation ultérieure de points de
recharge pour les véhicules électriques, les vélos
à assistance électrique et d'autres types de véhicules de
catégorie L; et Le premier alinéa s'applique lorsque : a) le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment ; ou b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du parc de stationnement. [...] 4. Pour ce qui est des bâtiments neufs résidentiels comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures et les bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante comprenant plus de trois emplacements de stationnement pour voitures, les États membres veillent à: [...] |
Code de la construction et de l'habitation Article L. 113-11 Pour l'application des articles L. 113-12 à L. 113-15, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Article L113-12 I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de
dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non
résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ; b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix
emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non
résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant
le parc de stationnement ou son installation électrique. 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ; 2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel. L. 113-13 Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel. - L113-18 : (Vélos) « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble
commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant
un établissement de spectacles cinématographiques
équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle, Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. - L113-19 : (Vélos) Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un
ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle, Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions et les modalités d'application du présent article,
notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des
bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de
travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et
la valeur des bâtiments. - L113-20 : (Vélos) Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
Législatif |
Article L. 113-11 Pour l'application des articles L. 113-12 à L. 113-15, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. on entend par : 1° Pré-équipement : la mise en place du cheminement de câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ; 2 ° Précâblage : toutes les mesures nécessaires pour permettre l'installation de points de recharge, y compris la transmission de données, les câbles, les cheminements de câbles et, le cas échéant, les compteurs électriques ; 3° Point de recharge : un point de recharge au sens du point 48 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement Européen et du Conseil. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Article L113-12 I. - Dans les parcs de
stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement,
situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou
jouxtant de tels bâtiments a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ; b) Pour les parcs de stationnement
comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des
bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation
importante incluant le parc de stationnement ou son installation
électrique. 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ; 2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel. » Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d'un parc de stationnement, ou qui procède à une rénovation importante, incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment, le dote de points de recharge pilotables et d'infrastructures permettant la mise en place de points de recharge pilotables des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces points de recharge et de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l'obligation s'applique et les conditions d'adaptation en fonction de l'usage du bâtiment, ainsi que le nombre ou le taux d'emplacements concernés dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. L. 113-13 Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel. Tout propriétaire d'un bâtiment non résidentiel équipé d'un parc de stationnement le dote de points de recharge pilotables ou d'infrastructures permettant la mise en place de points de recharge pilotables pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces points de recharge et de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière, ou à proximité immédiate du bâtiment. Lorsque plusieurs parcs de stationnement ouverts au public sont adjacents, l'obligation peut être mutualisée. Cette obligation est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établis conformément à l'article 8, paragraphe 3 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, ont fait l'objet d'une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l'obligation s'applique et les taux d'équipement à respecter en fonction de l'usage du bâtiment ainsi qu'en fonction des caractéristiques des équipements telles que la puissance délivrable par point de recharge ou leur dimensionnement permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il précise les exemptions en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à des dispositions relatives à la sécurité incendie. Il définit les exigences particulières s'appliquant aux bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics tels que définis à l'article L. 235-1 du code de l'énergie. L113-18 : (Vélos) « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment
constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de
commerce, ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques équipé de places de stationnement
destinées à la clientèle, Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d'un parc de stationnement pour voitures le dote d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal d'emplacements que doivent comporter les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, selon les caractéristiques d'occupation des bâtiments. L113-19 : (Vélos) Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un
bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L.
752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques équipé de places de stationnement
destinées à la clientèle, Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe d'un bâtiment existant, ou à une rénovation importante de ce bâtiment incluant le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique, le dote d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos : « 1° Pour un bâtiment résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures ; « 2° Pour un bâtiment non résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures ; « 3° Pour un bâtiment d'usage mixte, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures. Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article notamment en fonction du coût des travaux, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique. L113-20 : (Vélos) Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. Tout propriétaire d'un bâtiment non résidentiel doté d'un parc de stationnement comportant au moins dix emplacements de stationnement pour voitures le dote d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. Elle est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établis conformément à l'article 8, paragraphe 3 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, ont fait l'objet d'une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les adaptations des exigences en fonction des caractéristiques d'occupation ou des activités accueillies par le bâtiment, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique. |
Modification de l'article L113-12 (CCH) : - Ajout du critère de rénovation importante pour les bâtiments non résidentiels existants Modification des articles L113-18 à L113-20 (CCH) : - Modification du champ d'application (usage résidentiel ou non) ; - Introduction des seuils d'application. Modification de l'article L113-12 (CCH) : - Déplacement des seuils en réglementaire. Modification de l'article L113-18 (CCH) : - Généralisation de la mesure inscrite dans le CCH à tous les bâtiments non résidentiels neufs Article L. 113-12 (CCH) : - Déplacement des seuils en réglementaire. |
|
Directive 2024/1275 Article 14 Infrastructures pour une mobilité durable [...] [...] |
Article L113-14 du code de la construction et de l'habitation : Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas
applicables : [...] Article 113-15 du code de la construction et de l'habitation Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables, sont définies pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l' article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV. |
Législatif |
Article L113-14 du code de la construction et de l'habitation : Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas
applicables : [...] Article 113-15 du code de la construction et de l'habitation Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 de l'article 14 de la directive 2024/1275/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables, sont définies pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l' article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV. |
Article L113-14 (CCH) : - Modification du seuil (7% à 10%). |
|
Directive 2024/1275 Article 20 Délivrance des certificats de performance énergétique 1. Les États membres veillent à ce qu'un certificat de performance énergétique numérique soit délivré pour: a) tous les bâtiments ou unités de
bâtiment lorsqu'ils sont construits, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une
rénovation importante, lorsqu'ils sont vendus ou loués à
un nouveau locataire ou pour lesquels le contrat de location est
renouvelé;
[...] |
Article L126-27 du code de la construction et de
l'habitation : Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une
extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le
diagnostic mentionné à l'article L. 126-26. Il le remet au
propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception
de l'immeuble.
En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative. |
Législatif |
Article L126-27 du code de la construction et de l'habitation : Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble. Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, ou lors d'une rénovation importante d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic prévu à l'article L. 126-26. Il le remet au propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au plus tard à la réception de l'immeuble ou des travaux de rénovation. Article L-126-29 du code de la construction et de l'habitation : En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion et de son renouvellement, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative. |
Modification de l'article L. 126-27 et du L.126-29 du CCH (livre I, titre II, chap VI, section 5, sous-section 2 : DPE) pour ajouter une obligation de DPE pour : - les rénovations importantes dans le résidentiel - les renouvellements de contrats et les rénovations importantes |
Article 46 - Tableau de transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directives |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement |
Cette directive a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 et codifiée, par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, au code de l'environnement pour les infrastructures terrestres, ferroviaires et pour les agglomérations. Le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 a quant à lui procédé à sa transposition, pour les aérodromes, dans le code de l'urbanisme, en faisant le choix d'annexer les PPBE et les CSB des aéroports au plan d'exposition au bruit (PEB). Afin de créer une séparation claire entre les PEB, d'une part, et, les CSB et les PPBE, d'autre part, le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires, a détaché les PPBE et les CSB des PEB, en déplaçant les dispositions réglementaires sur les CSB et les PPBE des aérodromes dans le code de l'environnement aux côtés de celles relatives aux autres infrastructures soumises à ces plans et cartes. |
Législative |
Article L. 572-2 du code de l'environnement
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis : 1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. |
La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement vise, par les plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE), à prévenir et à réduire les effets du bruit. Cette directive a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 et codifiée, par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, au code de l'environnement pour les infrastructures terrestres, ferroviaires et pour les agglomérations. La DGAC souhaite clarifier de manière définitive l'état du droit, en ajoutant les infrastructures aéroportuaires au sein de l'article L. 572-2 du code de l'environnement. |
Article 47 - Tableau de transposition de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, et de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 Article 3, point 1) Aux fins de la présente directive, on entend par : |
Article L.541-1-1 du code de l'environnement Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; [...] |
Législative |
Article L.541-1-1 du code de l'environnement Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; [...] |
|
|
Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 Article 5, § 1 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce qu'une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit, si les conditions suivantes sont réunies [...] |
Article L. 541-4-2 du code de l'environnement Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : 1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; 2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; 3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; 4° la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; 5° la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. |
Article L. 541-4-2 du code de l'environnement I. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : 1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; 2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; 3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; 4° la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; 5° la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. II. - Une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48, dont la production n'était pas le but premier du processus de production, et dont l'utilisation au sein de cette même plateforme industrielle est certaine, est présumé satisfaire les conditions mentionnées au 1°, 3° et 4° du I. |
||
|
Article L. 541-4-5 du code de l'environnement Une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et dont la production n'était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : 1° L'utilisation de la substance ou de l'objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ; 2° La substance ou l'objet n'a pas d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine ; 3° L'exploitant de l'installation ayant produit la substance ou l'objet a transmis à l'autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l'objet est susceptible d'être dangereux. |
Législative |
Article L. 541-4-5 du code de l'environnement Une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et dont la production n'était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : 1° L'utilisation de la substance ou de l'objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ; 2° La substance ou l'objet n'a pas d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine ; 3° L'exploitant de l'installation ayant produit la substance ou l'objet a transmis à l'autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l'objet est susceptible d'être dangereux. |
||
|
Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 Article 8bis Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place conformément à l'article 8, paragraphe 1, y compris en vertu d'autres actes législatifs de l'Union, les États membres : a) définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l'État membre, les organisations mettant en oeuvre la responsabilité élargie des producteurs pour leur compte, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de prépa ration en vue du réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ; b) établissent, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d'atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (1 ) et établissent d'autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs; c) veillent à ce qu'un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l'État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du point b); d) garantissent l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits [...] |
Article L. 541-10-13 du code de l'environnement Les producteurs soumis au principe de
responsabilité élargie du producteur en application de l'article
L.
541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité
administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent
annuellement à l'autorité administrative, pour chaque
catégorie de produits relevant de cette responsabilité
élargie : |
Législative |
Article L. 541-10-13 du code de l'environnement Les producteurs soumis au principe de
responsabilité élargie du producteur en application de l'article
L.
541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité
administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent
annuellement à l'autorité administrative, pour chaque
catégorie de produits relevant de cette responsabilité
élargie : La transmission des données est réalisée par les producteurs disposant d'un agrément en tant que système individuel, ou par l'éco-organisme agréé pour ses producteurs adhérents. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits mentionnés au 15° de l'article L. 541-10-1, la transmission des données visées au 3° et 4° peut être réalisée par les titulaires d'un contrat passé avec un éco-organisme ou un système individuel agréés en application de l'article L. 541-10-26. L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique. |
|
|
Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 Article 8bis 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits ou toute organisation mettant en oeuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits: [...] c) dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs; [...] 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie: a) couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché dans l'État membre concerné: -- les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l'Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b), compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés, -- les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2, -- les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, point c). |
Article L. 541-10-13-1 du code de l'environnement (nouveau) Dans le cadre des missions de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie du producteur prévues au V de l'article L. 131-3, lorsque cela est nécessaire à la définition des objectifs et modalités de mise en oeuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur, à l'évaluation des performances des filières à responsabilité élargie du producteur, à la connaissance des coûts liés à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets ou à la vérification des informations et données communiquées par les éco-organismes et systèmes individuels agréés ou ayant sollicité un agrément, ces derniers ainsi que les opérateurs de prévention et de gestion de déchets issus des produits visés à l'article L. 541-10-1 transmettent à l'agence mentionnée à l'article L. 131-3, à sa demande, les données, y compris économiques, relatives aux produits ou aux déchets dont ils assurent la prévention et la gestion. Lorsque les données visées à l'alinéa précédent sont mises à disposition de tiers dans le cadre des missions prévues au V de l'article L. 131-3, l'agence veille à ce que cette mise à disposition ne soit pas susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, notamment le secret des affaires. L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article L. 541-10-16 détermine les opérateurs assujettis, les données à renseigner, les modalités de leur transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. |
|||
|
Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 Article 9, § 1, lettre c) 1.Les Etats membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures : [...] c) ciblent les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ; [...] |
Article L. 541-11 du code de l'environnement [...] 4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en oeuvre, notamment celles permettant d'éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ; [...] |
Législative |
L'article L. 541-11 du code de l'environnement [...] 4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en oeuvre, notamment celles ciblant les produits contenant des matières premières critiques, celles permettant d'éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ; [...] |
|
|
Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 Article 8bis 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie: a) couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché dans l'État membre concerné: -- les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l'Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b), compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés, -- les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2, -- les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, point c). Le présent point ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à la directive 2000/53/CE, à la directive 2006/66/CE ou à la directive 2012/19/UE; b) lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l'Union en la matière et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; et c) n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Lorsque la nécessité d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, les États membres peuvent s'écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au point a) à condition que: i) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l'Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires; ii) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l'État membre, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires; iii) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l'État membre, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires, et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. |
Article L. 541-10-2 du code de l'environnement Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l'ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. [...] |
Législative |
Article L. 541-10-2 du code de l'environnement Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l'ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. Lorsque la nécessité d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie du producteur le justifie, ces coûts sont partagés avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs, dans les limites prévues au paragraphe 4 de l'article 8bis de la 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives [...] |
|
|
Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/851 Article 10, § 4 4. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 22 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 4. |
Article L. 541-25-2 du code de l'environnement La réception de déchets ayant fait l'objet
d'une collecte séparée pour une préparation en vue de la
réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations
d'élimination de déchets par stockage ou incinération et
dans les installations d'incinération de déchets avec
valorisation énergétique, à l'exception des déchets
issus d'opérations de traitement ultérieures de ces
déchets collectés séparément pour lesquels le
stockage ou l'incinération produit le meilleur résultat sur le
plan de l'environnement, conformément à la hiérarchie des
modes de traitement définie au 2° du II de l'article
L.
541-1. |
Législative |
Modification de l'article L. 541-25-2 du code de l'environnement La réception de déchets ayant fait l'objet
d'une collecte séparée pour une préparation en vue de la
réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations
d'élimination de déchets par stockage ou incinération et
dans les installations d'incinération de déchets avec
valorisation énergétique, à l'exception des déchets
issus d'opérations de traitement ultérieures de ces
déchets collectés séparément pour lesquels le
stockage ou l'incinération produit le meilleur résultat sur le
plan de l'environnement, conformément à la hiérarchie des
modes de traitement définie au 2° du II de l'article
L.
541-1. |
|
|
Directive 2019/904 modifiée Article 8 1. Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l'annexe qui sont mis sur le marché de l'État membre, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE. PARTIE E I. Produits en plastique à usage unique visés à l'article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs 1) Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques; |
Article L.541-10-1 du code de l'environnement [...] 20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; 21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; [...] |
Législative |
Article L.541-10-1 du code de l'environnement [...] 20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; 21° Les textiles sanitaires à usage unique, les lingettes y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; [...] |
Article 51 - Tableau de transposition de la directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Article 79 paragraphe 2 (relatif aux sanctions applicables aux installations) 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions financières administratives qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leurs violations. Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au premier alinéa est au moins égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union par l'exploitant au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée. Les États membres peuvent également, à titre d'alternative, recourir à des sanctions pénales à condition qu'elles soient aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions financières administratives visées au présent article |
Article L. 171-7 du code de l'environnement I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. [...] L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ; Article L. 171-8 du code de l'environnement II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : [...] 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. |
Législative |
Article L. 171-7 du code de l'environnement I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. [...] L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés ainsi, le cas échéant, qu'aux avantages qui en sont tirés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte. Pour les installations mentionnées à l'annexe I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l'amende administrative est porté à 3 % du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne de la personne sanctionnée au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée ; Article L. 171-8 du code de l'environnement II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : [...] 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Pour les installations mentionnées à l'annexe I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l'amende est porté à 3 % du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne de la personne morale sanctionnée au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle cette amende est infligée. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés ainsi, le cas échéant, qu'aux avantages qui en sont tirés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Changement d'intitulé de la directive |
Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles Article L. 515-28 Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques. |
Législative |
Section 8 : Installations relevant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) Sous-section 1 : Installations mentionnées à l'annexe I à la directive Article L. 515-28 Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques. |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Article 24 (relatif à la consultation du public) 1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes : a) la délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations ; b) la délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle ; c) la délivrance ou actualisation d'une autorisation délivrée à une installation pour laquelle il est proposé d'appliquer l'article 15, paragraphe 4; d) l'actualisation d'une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l'article 21, paragraphe 5; e) l'actualisation d'une autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3 ou 4. La procédure décrite à l'annexe IV s'applique à cette participation. |
Article L. 515-29 du code de l'environnement I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants : -lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ; -lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission. A l'issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14. Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie. II.- Les informations mentionnées au I font l'objet d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques. Les observations recueillies font l'objet d'une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte. |
Législative |
Article L. 515-29 du code de l'environnement I.- - L'exploitant fournit à l'autorité administrative les informations nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation. Lorsqu'elle estime que les conditions d'autorisation doivent être actualisées, l'autorité administrative met ces informations à disposition du public, dans les conditions prévues au II. Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants : -lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ; -lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission. A l'issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14. Si une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes que celles associées à ces mêmes conclusions est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie. |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Article 22 (relatif à la fermeture du site) 3. Lors de la cessation définitive des activités, l'exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l'installation. Si l'installation est responsable d'une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l'état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées. Sans préjudice du premier alinéa, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, en raison des activités autorisées exercées par l'exploitant avant que l'autorisation relative à l'installation ait été mise à jour pour la première fois après le 7 janvier 2013, et compte tenu de l'état du site de l'installation constaté conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d), l'exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l'utilisation qu'il a été convenu de lui donner à l'avenir, cesse de représenter un tel risque. |
Article L. 515-30 du code de l'environnement L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 181-12 et au dernier alinéa de l'article L. 181-14 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport. |
Législative |
Article L. 515-30 du code de l'environnement L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 181-12 et au dernier alinéa de l'article L. 181-14 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport. Le décret prévu à l'article L. 515-31 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Changement d'intitulé de la directive |
Article L. 515-31 du code de l'environnement Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. |
Législative |
Sous-section 2 : Dispositions communes Article L. 515-31 du code de l'environnement Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Changement d'intitulé de la directive |
Article L. 593-32 du code de l'environnement Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont soumises aux dispositions suivantes. [...] |
Législative |
Article L. 593-32 du code de l'environnement Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions d'élevage sont soumises aux dispositions suivantes. [...] |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Changement d'intitulé de la directive |
Article L. 262-3 du code de l'énergie Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion sont applicables à Wallis-et-Futuna. [...] |
Législative |
Article L. 262-3 du code de l'énergie Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions d'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion sont applicables à Wallis-et-Futuna. [...] |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Changement d'intitulé de la directive |
Article L. 281-11 du code de l'énergie Aux fins visées à l'article L. 281-3, l'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse doit satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences suivantes : [...] 2° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures technologies disponibles, au sens de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion ; [...] |
Législative |
Article L. 281-11 du code de l'énergie Aux fins visées à l'article L. 281-3, l'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse doit satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences suivantes : [...] 2° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures technologies disponibles, au sens de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion ; |
|
|
Directive 2024/1785 relative aux émissions industrielles Modification de l'annexe I de la directive 3.6. Extraction, y compris traitement sur site (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l'enrichissement et la mise à niveau) des minerais suivants à une échelle industrielle: bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc. |
Législative |
Nouveau Article L. 162-4 du code minier Les articles L. 515-28 et L. 515-29 du code de l'environnement sont applicables aux travaux d'extraction mentionnés au 3.6 de l'annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition figure dans le décret prévu à l'article L. 162-1. Article L. 162-5 du code minier Pour les travaux d'extraction mentionnés au 3.6 de l'annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition figure dans le décret prévu à l'article L. 162-1 : 1° L'état de la zone concernée par les travaux d'extraction est décrit avant leur démarrage ou, pour les travaux autorisés avant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au paragraphe 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 162-4, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 162-12 ; 2° Les arrêtés prévus à l'article L. 181-12 du code de l'environnement et au dernier alinéa de l'article L. 181-14 du même code précisent les conditions de remise en état de la zone concernée lors de l'arrêt des travaux. Le décret prévu à l'article L. 162-12 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. |
Article 53 - Tableau de transposition de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin Article 17 1. Les États membres veillent à ce que, pour chacune des régions ou sous-régions marines concernées, les stratégies marines soient tenues à jour. 2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres réexaminent, d'une manière coordonnée, tel qu'il est précisé à l'article 5, les éléments ci-après de leurs stratégies marines tous les six ans à compter de leur élaboration initiale: 3. Les modalités des mises à jour effectuées à l'issue des réexamens prévus au paragraphe 2 sont communiqués à la Commission, aux conventions sur la mer régionale et à tous les autres États membres concernés dans les trois mois à compter de leur publication conformément à l'article 19, paragraphe 2. 4. Les articles 12 et 16 s'appliquent mutatis mutandis au présent article. |
Article L. 219-10 du code de l'environnement I. - La mise en oeuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012. La mise en oeuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014. L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015. Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016. II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale. |
Législative Décret en Conseil d'Etat en complément pour modifier l'article R. 219-1-14 du code de l'environnement. |
Article L. 219-10 du code de l'environnement I. - La mise en oeuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012. La mise en oeuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014. L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015. Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016. II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont réexaminés et, en tant que de besoin, mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale. |
Ces modifications visent à assurer une transposition plus fidèle des termes de la directive par rapport aux dispositions existantes. |
|
Directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin Article 17(cf supra) |
Article L. 219-11 du code de l'environnement Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en oeuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations. Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition. L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte. |
Législative |
Article L. 219-11 du code de l'environnement Des résumés des projets
d'éléments du plan d'action pour le milieu marin,
accompagnés de l'indication des modalités d'accès à
l'intégralité de ces projets, sont soumis à la
procédure de participation du public applicable en vertu de l'article
|
Ces modifications visent à assurer une transposition plus fidèle des termes de la directive par rapport aux dispositions existantes. |
|
Directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin Article 17(cf supra) |
Article L. 123-19 I., 2°, alinéa 2 du code de l'environnement I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : 1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 , s'ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; 2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent. Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public. La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. II- [...] |
Législative |
Article L. 123-19 I., 2°, alinéa 2 du code de l'environnement I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : 1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 , s'ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; 2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent. Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, et les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public. La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. II- [...] |
Ces modifications visent à assurer une transposition plus fidèle des termes de la directive par rapport aux dispositions existantes. |
Article 58 - Tableau de transposition de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures Paragraphe 11 de l'article 7 octies bis [...] L'application de la variation des redevances en fonction des émissions de CO2 visée dans le présent article n'est pas obligatoire lorsqu'une autre mesure de l'Union de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier s'applique. |
Article L. 119-7 du code de la voierie routière [...] II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Les modulations de péages prévues au présent II sont applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. III. - Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II lorsque : 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ; 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ; 3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. [...] Article L. 119-11 du code de la voierie routière Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. [...] |
Législative |
Article L. 119-7 du code de la voierie routière [...] II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Les modulations de péages prévues au présent II sont applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. Ces modulations sont également applicables lorsque la modulation prévue au premier alinéa de l'article L. 119-11 n'est pas mise en oeuvre. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. III. - Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II lorsque : 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ; 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ; 3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. 4° Les péages comprennent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. [...] Article L. 119-11 du code de la voierie routière Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022 sont peuvent être modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. |
Article 64 - Tableau de transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directives |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 2005/36/CE Article 7, alinéa 4 Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'État membre d'accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent. En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil. |
L'article L. 413-2 du code de l'environnement I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve : 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ; 2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes. Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ; 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. |
Législative |
L'article L. 413-2 du code de l'environnement I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve : 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ; 2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration. Lorsque l'établissement concerné héberge, à des fins d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public, des animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, la déclaration adressée à l'autorité administrative compétente peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes. Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ; 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. |
La Commission reproche à la France une non-conformité avec la directive 2005/36. Les écritures proposées par le projet de loi DDADUE ont pour objectif de modifier un article de loi existant. Cette modification consiste à restreindre les cas où la vérification préalable des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de l'UE, s'agissant des responsables d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente ou de location, de transit, et de présentation au public de spécimens vivants de la faune française et étrangère. Cette vérification préalable ne sera désormais plus possible que dans le cas de responsables d'établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses. En effet, dans ce cas, il peut être soutenu que la profession réglementée a des implications en matière de santé et de sécurité publiques, d'une part, et qu'une telle vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, d'autre part. |
Article 65 - Tableau de transposition de la Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directives |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Clause 13 Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat médical attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. L'autorité compétente exige qu'avant de commencer à servir à bord d'un navire, les gens de mer soient en possession d'un certificat médical valide attestant qu'ils sont médicalement aptes aux fonctions qu'ils accompliront en mer. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié. L'examen de santé mentionné aux points 13 et 14 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé. |
Art. L. 5521-1 du code des transports I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale. II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer. III.-Par dérogation au II : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur. 2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat. IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment : 1° L'organisation du service de santé des gens de mer ; 2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ; 3° (Abrogé) 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. |
Législative |
Article L. 5521-1 du code des transports I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale. II.- L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer. Le contrôle de l'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est gratuit pour le marin. Aucun frais en résultant ne peut être mis à sa charge. III.- Par dérogation au II : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur. 2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat. L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée par : « 1° Des médecins du service de santé des gens de mer ; « 2° Des médecins habilités n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au 1°. « Outre les médecins habilités mentionnés au 2°, des médecins peuvent être spécifiquement habilités à signer le certificat, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1, attestant de l'aptitude médicale à exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.. IV.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment : 1° L'organisation du service de santé des gens de mer ; 2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ; 3° (Abrogé) 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment : « 1° L'organisation du service de santé des gens de mer ; « 2° Les conditions d'habilitation des médecins mentionnés aux deux derniers alinéas du III et les cas dans lesquels les frais de la visite médicale effectuée par un médecin habilité sont pris en charge par l'employeur ; « 3° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ; V.- Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. |
|
|
Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat médical attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. L'autorité compétente exige qu'avant de commencer à servir à bord d'un navire, les gens de mer soient en possession d'un certificat médical valide attestant qu'ils sont médicalement aptes aux fonctions qu'ils accompliront en mer. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié. L'examen de santé mentionné aux points 13 et 14 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé . |
Art. L. 5521-1-2 du code des transports I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque : 1° Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d'une convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ; 3° Les certificats d'aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales internationales mentionnées au 1° ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l'anglais et revêtus des références de l'agrément du médecin. II.-En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2. III.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, détectée avant l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur, avant tout embarquement du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1. IV.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, révélée au cours de l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur dès le premier port d'escale où cela est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III. V.-Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées, peuvent faire l'objet des poursuites pénales prévues par l'article 441-7 du code pénal. VI.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article. |
Législative |
Art. L. 5521-1-2 du code des transports I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque : 1° Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d'une convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ; 3° Les certificats d'aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales internationales mentionnées au 1° ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l'anglais et revêtus des références de l'agrément du médecin. II.-En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2. I.- Tout Français résidant hors de France peut demander en vue d'exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité dans les conditions des II et III de l'article L. 5521-1. La première visite est effectuée à l'occasion d'un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l'une des conventions de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article. II.- En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2. Les gens de mer mentionnés au I effectuent au moins tous les six ans une visite d'aptitude auprès d'un médecin du service de santé des gens de mer ou d'un médecin habilité à l'occasion du renouvellement de leur certificat. Ils communiquent à ce médecin le ou les certificats en leur possession établis par tout médecin agréé. III, IV, V et VI sans changement |
|
|
Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat médical attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. L'autorité compétente exige qu'avant de commencer à servir à bord d'un navire, les gens de mer soient en possession d'un certificat médical valide attestant qu'ils sont médicalement aptes aux fonctions qu'ils accompliront en mer. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié. L'examen de santé mentionné aux points 13 et 14 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé . |
Art. L. 5545-3 du code des transports Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L.4141-2 du code du travail, les mots : « médecin du travail » sont remplacés par les mots : « médecin du service de santé des gens de mer ». |
Législative |
Article L. 5545-3 du code des transports Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L.4141-2 du code du travail, les mots : « médecin du travail » sont remplacés par les mots : « médecin du service de santé des gens de mer ou du médecin habilité, mentionnés à l'article L. 5521-1 ». |
|
|
Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat médical attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. L'autorité compétente exige qu'avant de commencer à servir à bord d'un navire, les gens de mer soient en possession d'un certificat médical valide attestant qu'ils sont médicalement aptes aux fonctions qu'ils accompliront en mer. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié. L'examen de santé mentionné aux points 13 et 14 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé . |
Art. L. 5545-13 du code des transports Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de prévention et de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du code du travail, le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l'infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. |
Législative |
Art. L. 5545-13 du code des transports Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de prévention et de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer ou les médecins habilités, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du code du travail, le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer ou les médecins habilités. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéa de l'article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l'infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. |
|
|
Art. L. 5549-1 du code des transports I. Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins. II. Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale. L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer. Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. III. Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire. |
Législative |
Art. L. 5549-1 du code des transports I.- Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins. II.- Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale. L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer. Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. Les II à V de l'article L. 5521-1 et les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. III. Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire. |
Article 66 - Tableau de transposition de la directive 1999/63/CE du conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer et de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
|
Dispositions de la directive à transposer |
Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directives |
Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive |
Dispositions proposées |
Observations |
|
Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer - Clause 16 Tout marin bénéficie de congés payés. Les congés payés annuels sont calculés sur la base d'un minimum de 2,5 jours civils par mois d'emploi et au prorata pour les mois incomplets. La période minimale de congés payés ne peut être remplacée par une indemnité compensatoire, sauf si la relation de travail est arrivée à terme. |
Article L. 5544-23 du code des transports : Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois. Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin. La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. |
Législative |
Article L. 5544-23-2 du code des transports (nouveau) Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires autres que de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail est deux jours et demi calendaires par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de trente jours calendaires par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du même code, ou à défaut celle mentionnée à l'article L. 3141-11 de ce même code |
La clause 16 de la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)a été modifiée par la directive 2009/13 du 16 février 2009. Cette directive ne s'applique pas aux gens de mer qui travaillent à bord des navires de pêche. La disposition proposée adapte en conformité avec le quantum de congés payés prévu par la directive 1999/63 du 21 juin 1999, les dispositions du code du travail limitant le nombre de congés payés acquis au titre des périodes de maladies non professionnelle, créées aux fins de se conformer à la jurisprudence de la CJUE. |
|
Article 7 Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. |
Art. L. 5544-23 du code des transports Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois. Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin. La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. |
Législative |
Article L. 5544-23-3 du code des transports (nouveau) Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail est 2,4 jours calendaires par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-huit jours calendaires par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du même code, ou à défaut celle mentionnée à l'article L. 3141-11 de ce même code. |
La directive 2003/88/CE n'est pas applicable aux gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche. « [...] la présente directive ne s'applique pas aux gens de mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE." (art. 1er paragraphe 3 de la directive 2003/88). |
* 1 Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches.
* 2 Cette obligation est transcrite dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le juge français doit écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
* 3 Communication de la Commission relative à l'interprétation de certaines dispositions juridiques du cadre révisé de résolution des défaillances bancaires en réponse aux questions soulevées par les autorités des États membres (JO C 321 du 29.9.2020, p. 1)
* 4 Valeurs mobilières sans droit de vote mais qui prévoient une rémunération compensatrice. Il s'agit souvent des titres d'une institution bancaire qui sont détenus par ses clients, par exemple les parts sociales pour les banques mutualistes.
* 5 Voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique ».
* 6 Plateformes électroniques qui mettent en relation plusieurs acheteurs et vendeurs d'instruments financiers selon des règles non discrétionnaires.
* 7 Infrastructures organisées (marchés réglementés, SMN, SON) permettant la négociation d'instruments financiers.
* 8 Données regroupées indiquant les volumes et la répartition des positions (acheteuses/vendeuses) sur un instrument dérivé.
* 9 Instruments dérivés donnant le droit (mais non l'obligation) d'acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix fixé, avant ou à une date donnée.
* 10 Plateformes hybrides, introduites par MiFID II, permettant la négociation d'instruments financiers hors marchés réglementés et SMN, souvent de gré à gré.
* 11 Entreprises d'investissement de manière bilatérale qui exécutent de manière organisée, fréquente et substantielle des ordres de clients pour leur propre compte, en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en se portant directement contrepartie des ordres de ses clients. Les internalisateurs systématiques étant des entreprises d'investissement agréées en France sont supervisées par l'AMF, y compris au titre de leurs activités d'internalisateurs systématiques pour celles relevant de ce statut, en application de l'article L621-9 du code monétaire et financier. S'agissant des internalisateurs systématiques en particulier, l'AMF vérifie notamment qu'ils respectent les conditions d'exécution des ordres prévues à l'article 15 de MiFIR (obligation de publier des prix de façon régulière et continue sur les instruments couverts, et d'exécuter les transactions de leurs clients à des niveaux au moins aussi intéressants que ces prix).
* 12 Directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l'octroi de prêts par les fonds d'investissement alternatifs.
* 13 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010.
* 14 Un fonds d'investissement alternatif au sens du droit européen est défini de manière large comme tout organisme de placement collectif (entité qui lève des capitaux auprès d'investisseurs afin de les investir, selon une politique d'investissement définie, dans des actifs), autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui investissent principalement dans des actifs cotés. Cette catégorie regroupe donc un ensemble de fonds très divers : fonds de private equity, fonds immobiliers, hedge funds, fonds d'infrastructures, etc.
* 15 La délégation de fonctions consiste à confier certaines tâches, comme la gestion de portefeuille ou la gestion des risques, à des prestataires externes, tout en restant responsable devant les investisseurs et les autorités de supervision.
* 16 Le dépositaire d'un FIA est chargé de conserver les actifs du fonds, de surveiller ses opérations et de s'assurer qu'il respecte les règles applicables afin de protéger les investisseurs.
* 17 Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est un organisme de placement collectif (entité qui lève des capitaux auprès d'investisseurs afin de les investir, selon une politique d'investissement définie, dans des actifs) investissant majoritairement dans des instruments financiers liquides, principalement des actions et obligations, selon des règles strictes de diversification et de liquidité. Encadré par la directive OPCVM, ils peuvent être commercialisés facilement dans l'ensemble de l'Union européenne à des investisseurs professionnels et particuliers.
* 18 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
* 19 Il s'agit donc d'une sous-catégorie des FIA qui octroient des prêts.
* 20 La valeur notionnelle est le montant nominal du prêt, sur lequel sont calculés les intérêts et les remboursements, sans tenir compte des paiements déjà effectués ou des intérêts accumulés.
* 21 Les fonds d'investissement fermés sont des fonds dont les parts ne peuvent en principe être rachetées par les investisseurs avant son échéance. Ils s'opposent aux fonds d'investissement ouverts, dont les parts peuvent en principe être rachetées à tout moment par les investisseurs, à leur demande, auprès du gestionnaire.
* 22 Le levier est le rapport entre l'exposition de ce FIA (tout ce sur quoi le fonds prend des risques financiers au-delà du capital qu'il possède, soit en s'endettant directement, soit en s'engageant via des instruments plus complexes comme des produits dérivés) et sa valeur nette d'inventaire (la valeur de ses actifs).
* 23 Conformément au modèle de théorie de l'agence, la rétention des risques signifie qu'un FIA qui accorde des prêts doit garder une part du risque lié à ces prêts, pour s'assurer qu'il reste exposé aux conséquences de ses décisions et gère les risques de manière responsable.
* 24 C'est-à-dire de la possibilité de commercialiser ces fonds sans restriction à des investisseurs dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
* 25 Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
* 26 Le tranchage du risque consiste à séparer les parts du véhicule en plusieurs catégories (ou tranches) ayant des niveaux de risque et de priorité de remboursement différents, afin d'adapter l'exposition au risque aux besoins des investisseurs.
* 27 Paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
* 28 4° du II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier
* 29 II de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier
* 30 Relance du marché européen de la titrisation : Réponse conjointe des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne.
* 31 Rapport Noyer : développer les marchés de capitaux européens pour financer l'avenir.
* 32 Rapport Letta sur le futur du marché unique.
* 33 Rapport Draghi sur le futur de la compétitivité européenne.
* 34 Commission proposes measures to revive the EU securitisation framework.
* 35 Communication de la Commission européenne sur l'Union de l'épargne et de l'investissement (UEI), page 12.
* 36 Soit l'attribution d'un prix à une action boursière
* 37 Document d'introduction en bourse d'une action permettant la bonne information des investisseurs potentiels et l'engagement de la responsabilité de la société émettrice
* 38 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/740253/EPRS_BRI(2023)740253_EN.pdf
* 39 Voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique ».
* 40 C'est-à-dire au niveau de la tête pour l'ensemble du groupe.
* 41 Ces critères figurent à l'article 131(2) de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dite CRD. Le règlement délégué du 8 octobre 2014 n° 1222/2014 précise ces critères.
* 42 Liste des Établissements d'importance systémique mondiale (EISm) au titre de l'exercice 2024 conformément aux dispositions de l'article L511-41-1 A VI du Code monétaire et financier | Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
* 43 Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale.
* 44 Un organisme qui opère entre deux contreparties à une transaction, se posant comme vendeur auprès de tout acheteur, et comme acheteur auprès de tout vendeur. Le principal rôle d'une contrepartie centrale est de prendre en charge les risques en cas d'incapacité de l'une des parties d'assurer les paiements prévus en temps voulu, c'est-à-dire un défaut de paiement.
* 45 Règlement (UE) n° 648/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
* 46 Règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l'efficacité des marchés de la compensation de l'Union.
* 47 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
* 48 Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.)
* 49 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
* 50 Il s'agit en réalité de deux directives : la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit
* 51 Règlement (UE) n° 468/2014 établissant le cadre de coopération entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales au sein du mécanisme de surveillance unique (règlement-cadre MSU)
* 52 La cinquième directive anti-blanchiment, directive (UE) n°2018/843 du 19 juin 2018, a été transposée en droit national par l'ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 et le décret n°2020-118 du 12 février 2020.
* 53 Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
* 54 Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.
* 55 Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010
* 56 Voir à cet égard l'article 67, paragraphe 3 et l'article 82 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui admettent toutefois la possibilité de rapprochement des législations pénales, notamment via l'établissement de « règles minimales » dans « les matières pénales ayant une dimension transfrontière » à des fins de facilitation de cette coopération policière et judiciaire et de la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.
* 57 Directive (UE) n° 2024/1654 du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) n°2019/1153 en ce qui concerne l'accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l'intermédiaire du système d'interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l'utilisation des relevés de transactions
* 58 CJUE, 22 novembre 2022, WM et Sovim SA c. Luxembourg Business Registers, (aff. C-37/20 et C-601/20).
* 59 Articles 11 et 12 de la directive 2024/1640 transposés par l'article 4 de la loi n° 2025-391, modifiant l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et créant un nouvel article L. 561-46-2 au même code.
* 60 Est conforme à la Constitution l'instauration d'un répertoire public des représentants d'intérêt au regard de la liberté d'entreprendre (considérant 45), mais est contraire à ce même principe l'obligation déclarative publique des sociétés en matière d'impôt sur les bénéfices à compter d'un certain seuil de chiffre d'affaires, dès lors qu'elle oblige de révéler « des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale » (considérant 103).
* 61 Article L. 561-2 du CMF issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
* 62 La « 5e directive anti-blanchiment », directive (UE) n°2018/843 du 19 juin 2018, a été transposée en droit national par l'ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 et le décret n°2020-118 du 12 février 2020.
* 63 Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
* 64 Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.
* 65 Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010
* 66 Articles 11 et 12 de la directive 2024/1640 transposés par l'article 4 de la loi n° 2025-391, modifiant l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et créant un nouvel article L. 561-46-2 au même code.
* 67 CJUE, 22 novembre 2022, WM et Sovim SA c. Luxembourg Business Registers, (aff. C-37/20 et C-601/20).
* 68 L'arrêt précité de la CJUE du 22 novembre 2022 portait sur la conformité du principe de publicité du registre visé, posé par la cinquième directive anti-blanchiment, aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, respectivement relatifs au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données à caractère personnel. Il peut être rappelé que le droit au respect de la vie privée est constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (CC, 23 juillet 1999, n°99-416 DC, cons. 45), la protection des données bénéficiant par suite aussi d'une protection constitutionnelle (CC, 22 mars 2012, n°2012-652 DC, cons. 8).
* 69 2014-691 DC du 20 mars 2014.
* 70 Civ. 3e, 5 juillet 2018, n°18-40.014.
* 71 2018-772 DC du 15 novembre 2018.
* 72 Conseil d'État, 6e chambre, 31 décembre 2024, n° 498468,
* 73 Voir CJUE, gr. ch., 19 déc. 2019, aff. C-390/18, YA et Airbnb Ireland UC c/ Hôtelière Turenne SAS, Assoc. pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP) et Valhotel. Le juge européen a ainsi considéré qu'un « service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d'intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de l'information » relevant de la directive 2000/31 ».
* 74 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
* 75 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
* 76 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
* 77 Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
* 78 CJUE, gr. ch., 12 sept. 2020, Cali Apartments, aff. C-724/18 et C-727/18.
* 79 Ibid.
* 80 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
* 81 Etude d'impact réalisée par la Commission européenne et accompagnant la proposition de règlement sur la collecte et le partage d'informations relatives à la location de courte durée.
* 82 Décret royal 7/2019 du 5 mars 2019.
* 83 Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje (avril 2019) ; Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona ; Ley de Turismo y Hospitalidad (2018).
* 84 Ordonnance relative à l'hébergement touristique du 8 mai 2014 ; arrêté du 24 mars 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique.
* 85 L'article 19 du règlement STR prévoit que ce règlement, qui entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, est applicable à partir du 20 mai 2026. L'article 64 de la loi SREN du 21 mai 2024 prévoit que l'article 43 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la loi. L'essentiel des dispositions de l'article 1 de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.
* 86 Précision étant faite que le reste de la directive 2024/2749 sera transposée dans la partie règlementaire du CPCE en vertu de ces dispositions.
* 87 La directive ATEX 2014/34/UE fixe les exigences pour les équipements et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives (ex. moteurs, lampes, capteurs, etc.).
* 88 Commission Staff Working Document - Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Single Market emergency instrument and amending certain Union legal acts. SWD(2022) 289 final, Brussels, 19.9.2022, Part ½. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0289
* 89 Les aides dites « de minimis » sont des aides accordées par l'Etat aux entreprises dont le faible montant permet de financer tous les types de coûts même ceux qui ne sont pas explicitement retenus dans la réglementation européenne. Leur montant est plafonné par entreprise consolidée au niveau du groupe sur une période de 3 années glissantes afin de concrétiser la présomption qu'une aide de faible montant n'affecte pas les échanges intracommunautaires à hauteur de ce plafond.
* 90 Plafond des aides de minimis qui ne relèvent pas d'un règlement de minimis spécifique (agriculture, pêche et aquaculture, SIEG) : 300 000 € sur trois années glissantes ; plafond des compensations de minimis accordées aux entreprises chargées de la gestion d'un SIEG : 750 000 € sur trois années glissantes ; plafond des aides de minimis dans le domaine de la production primaire de produits agricoles : 50 000 € sur trois années glissantes.
* 91 V. par exemple Conseil constitutionnel, 31 mai 1999, décision n° 99-186.
* 92 Par exemple pour demander un crédit d'impôt, une TPE sollicitera l'avis d'une expert-comptable externe ce qui entraînera des dépenses supplémentaires conséquentes (plusieurs milliers d'euros) alors que le gain est souvent mineur. Une entreprise de plus grande taille pourra trouver au contraire la ressource en interne et donc postuler à moindre frais.
* 93 La complexité de l'analyse juridique ou comptable est la même quel que soit le montant de l'aide demandé.
* 94 Camille Schweitzer « L'enquête R&D : mesurer l'effort de R&D des entreprises, au-delà du crédit d'impôt recherche » Les entreprise en France Insee Références édition 2019
* 95 « Les sociétés qui déclarent des dépenses de R&D et ne demandent pas le CIR ont un profil différent de celles qui le demandent. Sans comptabiliser les sociétés agréées, le taux de non-recours au CIR est de 18 %. Les entreprises non déclarantes au CIR et non agréées ont des dépenses de R&D de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, soit 4,6 % de la DIRDE totale. Elles réalisent en moyenne peu de dépenses de R&D par rapport à celles demandant le CIR, et sont plus petites en termes de chiffre d'affaires et d'effectif salarié. Parmi les sociétés qui ne demandent pas le CIR, les sociétés indépendantes (c'est-à-dire celles qui ne font pas partie d'un groupe de sociétés) sont aussi légèrement surreprésentées : elles sont 44 %, contre 39 % parmi les sociétés déclarant des dépenses éligibles au CIR. De plus, elles sont moins nombreuses à bénéficier d'aides publiques directes (15 % contre 27 % pour les sociétés demandant le CIR), ce qui traduit un cumul des aides publiques (directes ou fiscales) plutôt qu'une substitution ».
* 96 Cette augmentation confirme que l'entreprise arbitre bien entre le coût induit par la demande d'aide et le montant espéré de l'aide. Pour toutes les mesures d'aide dont le montant est lié à la taille de l'entreprise l'arbitrage se fera d'autant plus facilement pour la non demande d'aide que l'entreprise est petite.
* 97 De l'ordre de 18 % pour les sociétés qui ne sont pas agréées à réaliser des activités de R&D pour le compte d'entreprises tierce (ces entreprises ne bénéficient pas toujours du CIR car il peut être perçu par leur client).
* 98 Par exemple pour les exonérations de CFE, on a le dispositif d'aides aux zones de restructuration de la défense (ZRD), le dispositif d'aides aux zones franches urbaines- territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les mesures en faveur des bassins d'emploi à redynamiser, une mesure pour la reprise d'entreprise en difficulté, une exonération pour les jeunes entreprises innovantes, un dispositif zones de revitalisation des commerces en milieu rural, un dispositif zones de revitalisation des centres-villes, l'exonération en faveur des diffuseurs de presse, l'exonération en faveur des disquaires indépendants, l'exonération en faveur des médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent dans une petite commune, l'exonération au profit des vendeurs ambulants à domicile et les exonérations de CFE minimum.
* 99 Dans sa communication, la Commission indique « Étant donné que la charge administrative et les obstacles réglementaires constituent un problème pour la majorité des PME et que la Commission entend réduire de 25 % la charge découlant des obligations de déclaration, il convient que tout registre central soit conçu de manière à réduire la charge administrative. Les bonnes pratiques administratives, telles que celles définies dans le règlement relatif au portail numérique unique, peuvent servir de référence en vue de la création et du fonctionnement du registre central au niveau de l'Union, ainsi que des registres centraux nationaux. »
* 100 Le règlement fixe comme exigence minimale que le registre soit « mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l'Union en matière de protection des données... » (article 6, paragraphe 1). Le considérant (26) du préambule renvoie, par ailleurs, au règlement européen relatif au portail numérique unique comme modèle de référence en vue de la création et du fonctionnement du registre de minimis. L'article 9 de ce règlement comporte, notamment, des précisions sur la qualité des informations rendues disponibles (convivialité, exactitude des informations etc.).
* 101 Toutefois, les taux d'aide de l'enquête (par exemple le taux de 97% pour le dernier décile des microentreprises) sont par essence surestimés : en effet, les aides reçues au cours d'une année peuvent couvrir une partie plus ou moins grande des dépenses réalisées la même année, mais elles vont principalement financer des dépenses qui vont s'étaler sur plusieurs années. Par suite, la proportion des entreprises ayant reçu des aides dépassant les plafonds est également possiblement surestimée, mais l'existence du risque est bel et bien confirmée.
* 102 Pour la publication des aides d'Etat, la réglementation européenne ne prévoit pas, à ce stade, d'obligation pour les Etats membres d'imposer un registre unique à `l'ensemble de leurs autorités d'octroi. Dès lors, chaque autorité d'octroi conserve le choix de son outil de publication des aides d'Etat supérieures à 100 000 euros (plateforme européenne dite TAM (transparency award module) ou autre qui pourra être la plateforme nationale des aides d'Etat).
* 103 V. notamment Règlement (UE) 2023/2831, précité, article 6.
* 104 Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
* 105 Depuis 1986, le respect du principe de proportionnalité est intégré dans le contrôle de constitutionnalité (Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986)
* 106 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui a elle-même transposé la directive sur le commerce électronique n° 2000/31/CE du 8 juin 2000.
* 107 Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 (corporations d'Alsace-Moselle) ;
* 108 Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 (cons. 33, J.O. du 30 décembre 2015, p. 24763 ;
* 109 Le DDADUE 24 ayant conduit aux principales modifications nécessaires du code de la consommation afin d'adapter le droit national à l'entrée en vigueur du règlement 2023/988, complété par un décret en Conseil d'Etat (n° 2024-1171 du 6 décembre 2024).
* 110 Communications commerciales portant sur au moins une qualité ou caractéristique environnementale d'un bien ou d'un service
* 111 Amsterdam Court, Private Law Department, C/13/719848 / HA ZA 22-524, judgment of 20 March 2024, Foundation to Promote the Fossil-Free Movement (plaintiff) v. Royal Airline N.V. (defendant) / Landgericht Düsseldorf, Jugement du 5 avril 2023 dans l'affaire Deutsche Umwelthilfe c. TotalEnergies Wärme & Kraftstoff Deutschland GmbH,/ PS12525 - Italian Competition Authority / Analysis of the Iberdrola vs Repsol judgment: first ruling in Spain on greenwashing practices.
* 112 Voir étude de la Commission sur les allégations environnementales - https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2024/759609/EPRS_ATA(2024)759609_FR.pdf
* 113 L'article D. 229-106 du même code précise ces exigences, notamment la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre, la démarche suivie pour éviter, puis réduire ces émissions, ainsi que les modalités de leur compensation.
* 114 L'entreprise pourrait toutefois toujours alléguer d'une baisse de l'impact GES de son produit ou service si celui-ci a connu une baisse brute des émissions de GES sur son cycle de vie, et alléguer sur l'achat de crédits carbone sans faire de lien avec le produit ou service.
* 115 Être ouvert à tous les professionnels selon des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires ;
Reposer sur des critères élaborés en concertation avec des experts et des parties prenantes ;
Prévoir une procédure de vérification du respect de ces critères par un organisme tiers indépendant ainsi qu'un mécanisme de traitement des cas de non-conformité
* 116 Parmi cette jurisprudence, peuvent notamment être cités les arrêts suivants : arrêt de la Cour d'appel, 18 septembre 2013, GALEC c/ Ministre, arrêt de la Cour de Cassation, 25 janvier 2017, GALEC c/ Ministre, arrêt de la Cour de cassation, 4 octobre 2016, CARREFOUR c/ Ministre, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2014, Ministre c/ CARREFOUR, arrêt de la Cour de Cassation, 3 mars 2015, EURAUCHAN c/ Ministre, arrêt de la Cour de Cassation, 26 avril 2017, Darty c/ Ministre, arrêt de la Cour d'appel, 20 décembre 2017, Ministre c/ITM, arrêt de la Cour d'appel, 12 juin 2019, GEEPF c/ Ministre.
* 117 Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)
* 118 Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022, RG 20/03912 et Tribunal judiciaire de Paris, 12 octobre 2023, RG 22/03826
* 119 Les pépites du tourisme de savoir-faire en Nouvelle-Aquitaine (nouvelle-aquitaine-tourisme.com)
* 120 Argile du Velay | Auvergne Destination (auvergne-destination.com)
* 121 Le chapitre IX du Data Act énonce trois critères principaux : l'expérience en matière de données et de communications électroniques (article 37.4 b), la capacité à édicter des sanctions (article 37.5 d) et l'impartialité (article 37.8). Il décrit également les conditions de fonctionnement des autorités compétentes.
* 122 Le chapitre II du règlement sur la gouvernance des données vise les données protégées pour des motifs de confidentialité commerciale (y compris le secret des affaires et le secret professionnel), de secret statistique, de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers, ou de protection des données à caractère personnel.
* 123 Le 4° de l'article 6 du Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 modifié relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique dispose que « Conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement du 30 mai 2022 susvisé, [la DINUM] aide les organismes du secteur public qui octroient ou refusent l'accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l'article 3, paragraphe 1 dudit règlement et assure le point d'information unique prévu à l'article 8 de ce même règlement ».
* 124 L'article 36 de la loi SREN dispose que « l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l'autorité compétente en matière de services d'intermédiation de données, en application de l'article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ».
* 125 NOR : ECOI2504240D
* 126Cf. Le Titre IV BIS de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
* 127 Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83524, (pp.39 et suivantes).
* 128 Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83524, (pp.39 et suivantes).
* 129 Relations entre entreprises fournissant des produits et services connectés et leurs utilisateurs (chapitres II et III) ; relations entre entreprises (chapitre IV) ; relations entre entreprises et certains organismes du secteur public (chapitre V).
* 130 Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83524, (p.160, à titre d'exemple).
* 131 Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83524, (p.61).
* 132 En particulier dans les relations entre entreprises et certains organismes du secteur public (chapitre V).
* 133 Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83524, et Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European data governance (Data Governance Act) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0295.
* 134 Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83524, (p.160, à titre d'exemple).
* 135 Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83524, (p.160, à titre d'exemple).
* 136 Chapitre IV « Altruisme en matière de données » du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données.
* 137 En particulier dans les relations entre entreprises et certains organismes du secteur public (chapitre V du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023).
* 138 Le terme « haut débit » en droit européen est équivalent au terme « très haut débit » en droit français. Dans les deux cas, il s'agit d'un service d'au moins 30 Mbps en débit descendant. Pour éviter la confusion, cette note utilise uniquement le terme « haut débit ».
* 139 Pour la plupart des dispositions du règlement 2024/1309.
* 140 Il s'agit des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 (infrastructures physiques intérieures et câblage intérieur en fibre optique) du règlement 2024/1309. Ces paragraphes ne sont pas concernés par les mesures faisant l'objet de la présente étude d'impact.
* 141 Il s'agit du paragraphe 3 de l'article 4 (Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques) ; du paragraphe 1 de l'article 6 (Transparence en ce qui concerne les travaux de génie civil prévus) ; des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 (Procédure d'octroi des autorisations et des droits de passage) ; et des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12 (Dématérialisation des points d'information uniques) du règlement 2024/1309.
* 142 Aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement 2024/1309, « [p]endant une période transitoire aussi courte que possible et ne dépassant pas douze mois, les États membres peuvent exempter les municipalités de moins de 3 500 habitants de l'obligation visée au paragraphe 3 ».
* 143 Voir le tableau 9, à la page 54, de l'étude d'impact du 23 février 2023 [IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to reduce the cost of deploying gigabit electronic communications networks and repealing directive 2014/61/EU (Gigabit Infrastructure Act) SWD (2023) 46 final]
* 144 Les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relèvent d'un régime distinct des autres PTOM dès lors qu'elles sont, sauf exception, régies par le principe d'identité législative. Lorsque le législateur adopte des dispositions d'adaptation du droit national aux règlements UE, ces dispositions s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy y compris en ce qu'elles font référence à des règlements UE (voir en ce sens décision Conseil constitutionnel n°2018-765 DC du 12 juin 2018 ; Conseil d'Etat, avis du 13 octobre 2020, section des finances, n°401046).
* 145 Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 (corporations d'Alsace-Moselle) ;
* 146 Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 (cons. 33, J.O. du 30 décembre 2015, p. 24763 ;
* 147 CJUE, 22 janvier 2013, Sky Österreich, aff. C-283/11 ; CJUE, 17 octobre 2013, Schaible, aff. C-101/12 ; CJUE, 16 juillet 2020 OC e. a., aff. C-686/18 ;
* 148 Une mesure provisoire est réputée justifiée lorsqu'aucune objection n'a été émise dans les trois mois suivant la notification aux Etats membres et à la Commission.
* 149 il s'agit respectivement :
- du règlement (UE) 2018/1860 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- du règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l`accord de Schengen et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
- et du règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale.
* 150 Recommandation n° 8 du Conseil de l'UE du 11 novembre 2023 : mettre en oeuvre le système automatisé d'identification des empreintes digitales du SIS afin de permettre des identifications à partir des empreintes digitales, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'a l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil.
* 151 voir par exemple la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.
* 152 Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité.
* 153 voir par exemple la décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023.
* 154 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - considérants n° 52 a 57 ; décision n° 2010-25 QPC, 16 septembre 2010, « fichier des empreintes génétiques »).
* 155 Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997.
* 156 Une conduite à tenir décrit de manière structurée l'action attendue de l'agent ayant identifié la personne de la part de l'autorité ayant émis le signalement (arrestation aux fins de remise, surveillance discrète...).
* 157 L'entreprise britannique Cambridge Analytica, spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle et dans le conseil en communication, a collecté et analysé les données de dizaines de millions d'utilisateurs du réseau social Facebook, recueillies sans leur consentement, en proposant aux utilisateurs un questionnaire qui se présentait comme un simple exercice académique. Durant l'élection présidentielle de 2016, la campagne du candidat et futur président, Donald Trump, a versé à Cambridge Analytica près de 6 millions de dollars en « gestion de données » et « services de gestion de données ». Selon la Commission européenne, l'affaire a démontré comment l'analyse de données, couplée à des techniques de microciblage et de profilage psychologique, peut être utilisée pour tromper les électeurs, les dissuader d'aller voter et manipuler les comportements de vote.
* 158 Recommandation CM/Rec(2007)15 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des mesures concernant la couverture des campagnes électorales par les médias - https://search.coe.int/cm#{%22CoEIdentifier%22:[%2209000016805d4a59%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}
* 159 Un contrat pour différence (CfD) est un contrat de soutien public direct aux revenus des producteurs d'électricité issus de la vente de l'électricité produite sur les marchés de l'électricité. Ces contrats contiennent un prix de référence en €/MWh qui implique que : (i) si les revenus de vente d'électricité en €/MWh du producteur est inférieur au prix de référence, alors l'Etat lui verse un soutien égal à la différence entre les revenus captés et le prix de référence et ; (ii) dans le cas contraire, le producteur verse à l'Etat la différence. Ainsi, le producteur est assuré de percevoir un revenu égal au prix de référence sans risque de sur-rémunération.
* 160 Rapport d'analyse d'impact (SWD/2021/455), Résumé du rapport d'analyse d'impact (SWD/2021/456), Rapport d'évaluation (SWD/2021/457), Résumé de l'évaluation (SWD/2021/458), Études sur l'hydrogène, réalisées pour la DG Énergie, Étude : Assistance à l'évaluation des options améliorant les conditions du marché pour les règles du marché du biométhane et du gaz, réalisée pour la DG Énergie (2021)
* 161 Nouvel article L. 141-5-5 créé
* 162 Nouvel article L. 141-5-5 créé
* 163 Nouvel article L. 342-5-1 créé
* 164 Nouvel article L. 342-5-1 créé
* 165 Un biocarburant est un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse. La biomasse étant la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique.
* 166 Les biogaz sont des combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse.
* 167 La biomasse solide désigne la biomasse au sens de l'article L211-2 lorsqu'elle est dans un état physique solide. Cela désigne en général le bois énergie, les déchets issus de manière organique, de la production ou résidus agricoles.
* 168 La biomasse issue de l'agriculture.
* 169 La biomasse issue de la sylviculture.
* 170 Au sens de l'article 30 de RED II, les systèmes volontaires sont des normes opérationnelles pour la production de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé qui fournissent des données précises concernant les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre et l'évaluation des critères de durabilités prévus par la directive.
* 171 Respectivement : Centre national de la propriété forestière, l'Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses, Experts forestiers de France, fédération professionnelle des entreprises de services pour l'énergie et l'environnement, Fédération Nationale du Bois, Fédération Nationale des Communes Forestières, Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires, Fédération des Syndicats de Forestiers Privés de France, Office national des Forêts, Union de la Coopération Forestière Française, Syndicat des énergies renouvelables.
* 172 Biomasse dont la composition chimique est structurée autour de la lignine, qui désigne en pratique la biomasse des arbres, arbustes ou broussailles morts ou vivants (bois, écorce, branches, rameaux, souches et racines)
* 173 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
* 174 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
* 175 En effet, toute consommation de biomasse par un acteur assujetti aux seuils de la RED doit être durable au sens de l'article 29. Un producteur de biomasse issue d'un pays hors de l'UE doit donc être en capacité de montrer qu'il respecte les critères de l'article 29. Pour ce faire, ne disposant pas de transposition à proprement parler, une analyse de risque peut être conduite, montrant que dans le pays en question, un certain nombre de dispositions de la directive sont respectés (car inscrits dans la réglementation), et donc limiter le travail de contrôle à un nombre restreints de dispositions.
* 176 IGN, Memento Edition 2023 de l'inventaire forestier national, - https://www.ign.fr/files/default/2023-10/memento_oct_2023.pdf
* 177 https://agriculture.gouv.fr/durabilite-de-la-biomasse-forestiere-criteres-red-ii
* 178 https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2501/detail/ Enquête Agreste 2025
* 179 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/240829%20Document%20synthèse%20DD2023.pdf
Ce chiffre inclut la biomasse agricole et forestière et serait légèrement inférieur si seule la biomasse forestière était considérée, toute la biomasse provenant de l'étranger étant de la biomasse forestière (notamment des granulés de bois d'Amérique du Nord pour approvisionner des centrales en OM, cette analyse n'est donc pas valide pour ces installations)
* 180 La méthodologie utilisée est décrite au Guide méthodologique pour calculer l'impact économique et financier de la norme (Secrétariat Général du Gouvernement, 2019)
* 181 https://cartofob.ign.fr/
* 182 Biocarburants issus des ressources listées en annexe IX-A de la directive RED 2018/2001.
* 183 Carburants à base d'hydrogène pur ou recombiné avec du carbone.
* 184 Afin d'assurer une cohérence avec l'entrée en vigueur du règlement RefuelEU Aviation, l'article 24 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a exclus les carburéacteurs du champ d'application de la TIRUERT.
* 185 Ce règlement précise qu'aucune obligation supplémentaire ne peut être imposée au niveau national, ce qui a été précisé par la lettre Ref.ares(2024)44193745-19/06/2024 de la DG ENER et de la DG MOVE.
* 186 2021-946 QPC, 19 novembre 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0270 du 20 novembre 2021, texte n° 67
* 187 SDES, Bilan énergétique de la France en 2023, édition 2024
* 188 Source : Données déclarées sur CarbuRe
* 189 Unité de mesure de la capacité de transport d'un navire, en fonction du volume total des espaces fermés du navire.
* 190 Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique - Rapport SECTEN 2023
* 191 Service des données et études statistiques - Bilan énergétique de la France (édition 2023)
* 192 Un point de recharge à haute puissance (supérieure à 150 kW) permet une recharge en moins de 30 minutes. D'après Je roule en électrique.
* 193 Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Dossier de presse : Déploiement des bornes de recharge, mai 2025.
* 194 Etude d'impact de la précédente directive : Registre de documents de la Commission - SWD(2021)453.
* 195
* 196 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
* 197 Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
* 198 European Commission, EU institutions commit to boost cycling across Europe, 2024.
* 199 France Vélo, Les chiffres clés - France Vélo, filière économique, 2022.
* 200 Méthode standardisée pour évaluer la performance des systèmes de ventilation dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, en vérifiant les débits d'air et la qualité de l'air intérieur. Il comprend des inspections, des mesures aux bouches et des tests de perméabilité des réseaux afin d'assurer une ventilation efficace et économe en énergie : Promevent
* 201 Adaptation du protocole Promevent pour les bâtiments à usage professionnel (bureaux, écoles, commerces, etc.), visant à vérifier la performance des systèmes de ventilation de ces bâtiments.
* 202 Fiches techniques des différents caissons de ventilation installés dans les logements collectifs ou dans les bâtiments tertiaires : Caissons d'extraction classés au feu | Aldes
* 203 Liste des chaudières collectives Atlantic : atlantic-pros.fr/Produits/Chaudieres/Chaudieres-collectives
* 204 Présentation d'une climatisation classique pour un logement individuel : Climatiseur mural Daikin Perfera | Daikin
* 205 Comment calculer la puissance de chauffage nécessaire ?
* 206 Quelle puissance de climatiseur choisir par m² ?
* 207 VMC simple flux EasyHOME® Hygroréglable Classic - Aldes Storeonline
* 208 Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, notre-environnement, 2021.
* 209 https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques#Lesresultatsdeletude.
* 210 Statistiques sur les déchets d'emballages d'Eurostat pour la période 2010-2021.
* 211 Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
* 212 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
* 213 Communication de la Commission du 11 décembre 2019
* 214 Plan d'action établi dans la communication de la Commission du 11 mars 2020
* 215 Données issues de l'étude d'impact de la proposition européenne
* 216 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011
* 217 Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement
* 218 Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE
* 219 Chauffe-eaux et ballons d'eau chaude, modules, invertisseurs et systèmes photovoltaïques, dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, climatiseurs (y compris. pompes air/air), chaudières à combustible solide, appareils de chauffage et de refroidissement à air, aspirateurs, appareils de cuisson domestiques, unités de ventilation, circulateurs, ordinateurs, serveurs et produits de stockage de données, transformateurs de courant, équipements de réfrigération professionnels, lave-linges ménagers et machines lavantes-séchantes ménagères, lave-vaisselles ménagers, équipements de réfrigération ménagers (y compris réfrigérateurs ménagers et congélateurs), équipements de réfrigération avec une fonction de vente, moteurs électriques et variateurs de vitesse, dispositifs d'affichage électroniques, sources lumineuses et dispositifs de contrôle, équipements de soudure, dispositifs de chauffage décentralisés, smartphones et tablettes, sèche-linges, ventilateurs industriels
* 220 Communication de la Commission européenne - Programme de travail écoconception pour des produits durables-étiquette énergie 2025-2030 de la Commission européenne.
* 221 Baromètre de l'écoconception, ADEME, 2020
* 222 Les actes délégués préciseront si le passeport s'appliquera à l'échelle d'un produit individuel, d'un lot ou du modèle.
* 223 Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
* 224 Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828
* 225 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d'action pour une économie circulaire - Pour une Europe plus propre et plus compétitive, 11 mars 2020.
* 226 Dont environ 1 800 élevages porcins et 2 400 élevages de volailles et 100 élevages mixtes
* 227 Directive-cadre dont l'analyse d'impact initiale, réalisée par la Commission européenne, est disponible en ligne : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12898-Protecting-the-marine-environment-review-of-EU-rules_fr
* 228 Règlement d'exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques et Règlement d'exécution (UE) 2020/910 de la Commission du 30 juin 2020 modifiant les règlements d'exécution (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 et (UE) 2019/1583
* 229 Conformément au point 1) de l'article 3 de la directive 2012/34/UE précitée, par « entreprise ferroviaire » on entend « toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente directive, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ».
* 230 L'ART a été créée en 2009 sous le nom d'Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf) par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, pour accompagner l'ouverte à la concurrence du marché des transport ferroviaire. Ses missions ont été étendues depuis, notamment en 2014, par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, et en 2018, par la loi n° 2028--515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.
* 231 Pour ce faire, l'ART dispose notamment d'un pouvoir d'avis s'agissant de la tarification et de l'accès à l'infrastructure et aux installations de service, d'un pouvoir de règlement de différends et d'un pouvoir de sanction (cf. articles L. 2131-1 à L. 2135-1 du code des transports).
* 232 cf. notamment l'article 30 de la directive 2012/34/UE disposant que : « le gestionnaire de l'infrastructure, tout en respectant les exigences en matière de sécurité et en maintenant et améliorant la qualité de service de l'infrastructure, est encouragé par des mesures d'incitation à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès », et le considérant 41 (cf. nota en bas de page n° 6).
* 233 Cf. C/2025/2606 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202502606)
* 234 Cf. chapitre 6 : « L'article 30, paragraphe 2, de la directive traite de cette question en exigeant des États membres qu'ils « veillent à ce qu'un contrat [...] soit conclu, pour une durée minimale de cinq ans, entre l'autorité compétente et le gestionnaire de l'infrastructure ». L'annexe V de la directive précise en outre les éléments à intégrer dans le contrat. Il s'agit notamment de la structure des versements ou des fonds alloués aux différents services d'infrastructure ainsi que des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur (sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité). [...] »
* 235 Conformément au point 2) de l'article 3 de la directive 2012/34/UE précitée, par « gestionnaire d'infrastructure » on entend « toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l'État membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ».
* 236 L'annexe II de la directive liste l'ensemble des prestations minimales comprenant : a) le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ; b) le droit d'utiliser les capacités accordées ; c) l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau ; d) le contrôle de la circulation des trains, y compris la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ; e) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant ; f) toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.
* 237 « Lors de la perception de majorations, différents segments de marché devraient être définis par le gestionnaire de l'infrastructure, lorsque les coûts de la fourniture de services de transport, leurs prix sur le marché ou leurs exigences en matière de qualité de service diffèrent considérablement. »
* 238 Cf. chapitre 3.3 : « [...] les gestionnaires de l'infrastructure [...] peuvent [...], lors de la détermination des majorations et des sous-segments de marché, prendre en considération des critères concernant le réseau, tels que les différents aspects liés à la performance (vitesse maximale, nombre de voies, etc.) et le contexte géographique différent du réseau (par exemple, les noeuds métropolitains). En effet, ces aspects peuvent avoir une incidence sur le type et la qualité des services de transport et la demande y afférente et, partant, sur la capacité du marché à supporter ces redevances. »
* 239 En vertu de l'article L. 3114-8 du code des transports (chapitre relatif aux « Gares et autres aménagements de transport routier », articles L. 3114-1 à L. 3116-8 du code des transports), modifié par l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019, « L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie »
* 240 En vertu de l'article L. 3111-22 du code des transports, modifié par l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019, « L'Autorité de régulation des transports concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire ».
* 241 Cf. ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
* 242 Cf. chapitre 3.6.3 des de lignes directrices interprétatives concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, et point 59 de l'arrêt de la CJUE du 9 septembre 2021 relatif à l'affaire LatRailNet et Latvijas dzelzceïð»/Valsts dzelzceïa administrâcija.
* 243 « Rapport de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions sur la mise en oeuvre de la directive 2012/34/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2016/2370 » du 8 juillet 2025 (cf. COM(2025) 368 final)
* 244 Cf. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/plan-national-dactions-faveur-qualite-service
* 245 Voir par exemple le rapport sur « Le marché français du transport ferroviaire en 2023 » (pages 29-31) et le « Rapport annuel sur le marché du transport par autocar et sur les gares routières en France en 2023 » (pages 10-12 et 19).
* 246 Voir par exemple le rapport sur « Le marché français du transport ferroviaire en 2023 » (pages 29-36).
* 247 Voir les parties 9 et 10 du « Jeu de données du transport ferroviaire » disponible sur le site de l'ART, qui présente les statistiques annuelles des indicateurs de qualité des services conventionnés TER, Transilien et RER.
* 248 Eurostat, International trade in goods by mode of transport, 2024, disponible à l'adresse : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods_by_mode_of_transport#Trade_by_mode_of_transport_in_value_and_quantity
* 249 SDES, données provisoires CVS-CJO, disponible à l'adresse : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/672
* 250 Commission européenne, Direction générale pour la Mobilité et les transports, Ex-post evaluation of Reporting Formalities Directive (RFD) and Directive on vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS), Octobre 2017, pp 4-8.
* 251 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique.
* 252 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, cons. 3.
* 253 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique.
* 254 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, cons. 3.
* 255 Tous les types de déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, ainsi que les déchets pêchés passivement.
* 256 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique.
* 257 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, cons. 3.
* 258 Dont l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public. Une attention particulière doit être portée sur les services déconcentrés de l'État (article 8 du décret portant charte de la déconcentration).
* 259 Rapport Annule du Service de Santé des Gens de Mer présenté au conseil supérieur des gens de mer du 18 mars 2025
* 260 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340 pourvoi n°22-17.638
* 261 Selon l'avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d'acquisition de congés pendant les périodes d'arrêt maladie du Conseil d'Etat du 13 mars 2024, il est compris que la date du 1er décembre 2009 correspond à la date d'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui a rendu opposable l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux relatif au droit au congés annuel. Cet article a un effet horizontal (cela signifie qu'un individu peut invoquer une disposition du droit de l'UE vis-à-vis d'un autre particulier) contrairement à la directive 2003/88 dont l'effet est vertical.
* 262 Conseil constitutionnel, Décision nº 99-423 DC du 13 janvier 2000
* 263 Paragraphe 10 de la décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024
* 264 CJUE, 20 janvier 2009, Schultz Hoff, C-350/06 et C-520/06 ; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez C-282/10
* 265 CE, 24 février 2020, Interprofession des vins de Loire (InterLoire), n° 431255, aux Tables ou CE, 21 juin 2022, Union nationale interprofessionnelle cidricole (UNICID), n° 448921.
* 266 Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
* 267 Cons. const., 16 juin 2023, n° 2023-1055 QPC.
* 268 Cons. const., 20 mai 2020, n° 2020-841 QPC.
* 269 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991.
* 270 Considérants du règlement (UE) 2021/1873 précité.
* 271 Voir, par exemple : décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015.
* 272 Voir, par exemple : décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017
* 273 Voir le considérant 3 du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023.
* 274 Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil (refonte).
* 275 Le plan de travail national en vigueur pour la période 2025/2027 est accessible sur le lien suivant : https://dcf.ec.europa.eu/wps-and-ars/work-plans_en?prefLang=fr.
* 276 Paragraphe 7 de l'article 8 et article 16 du règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil.
* 277 Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil.
* 278 Page 53 du rapport de l'Ifremer, du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Guyane et du WWF sur l'estimation de la pêche illégale étrangère en Guyane française, juin 2024, https://archimer.ifremer.fr/doc/00909/102042/113281.pdf.
* 279 Tableau figurant à la page 52 du rapport de l'Ifremer, du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Guyane et du WWF sur l'estimation de la pêche illégale étrangère en Guyane française, juin 2024, https://archimer.ifremer.fr/doc/00909/102042/113281.pdf.