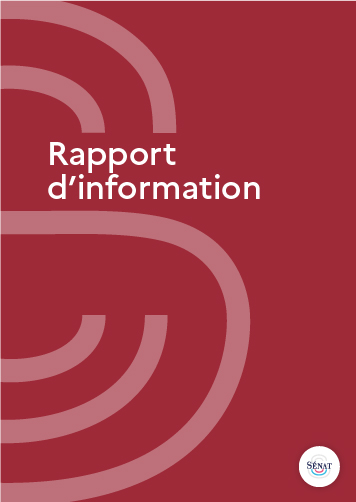Le résumé
En application de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les rapporteurs spéciaux de la mission « Aide publique au développement », Michel Canévet et Raphaël Daubet, ont mené un contrôle budgétaire sur la prise en compte des questions migratoires dans la politique de développement.
Ce contrôle visait à répondre à trois questions : l'aide au développement a t elle un impact sur les migrations ? Peut elle constituer un levier dans les négociations migratoires ? Quel est l'effort budgétaire de la France dans ce domaine ?
Les publications universitaires identifient des liens ambivalents entre développement et migrations. Toutefois, l'Union européenne et ses États membres ont renforcé la dimension migratoire de leur politique de développement, notamment suite à l'adoption du Plan d'action de La Valette en 2015.
Dans ce contexte, entre 2017 et 2024, la France a engagé près d'un milliard d'euros d'aide au développement en matière migratoire. Pour autant, ces financements labellisés « migrations » n'ont fait l'objet d'aucune évaluation d'ensemble et leur impact sur les migrations est difficile à mesurer. Cet effort budgétaire découlait davantage d'un accroissement de l'aide humanitaire de la France que d'une véritable priorisation de l'enjeu migratoire dans la politique de développement.
La poursuite de l'intégration des enjeux migratoires dans notre politique de développement impliquera une clarification des objectifs assignés à cette priorité, dans une perspective qualitative et non plus quantitative. Une approche plus transactionnelle de ces financements pourrait également être envisagée.
Les rapporteurs spéciaux identifient deux axes de progression auxquels doivent contribuer les 10 recommandations : l'adaptation de la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 pour tirer les conséquences de l'échec de la stratégie précédente, d'une part, le développement d'une approche partenariale avec les pays bénéficiaires, d'autre part.