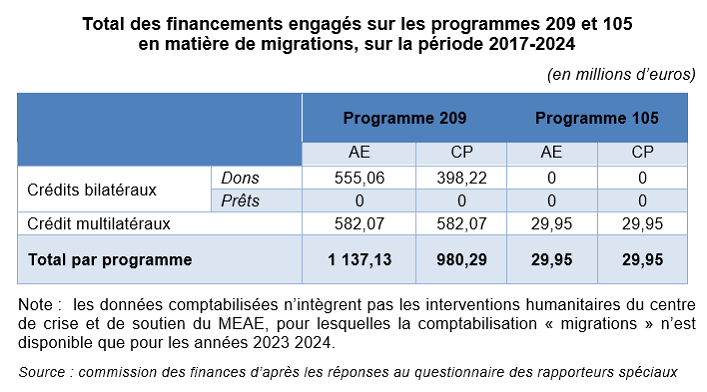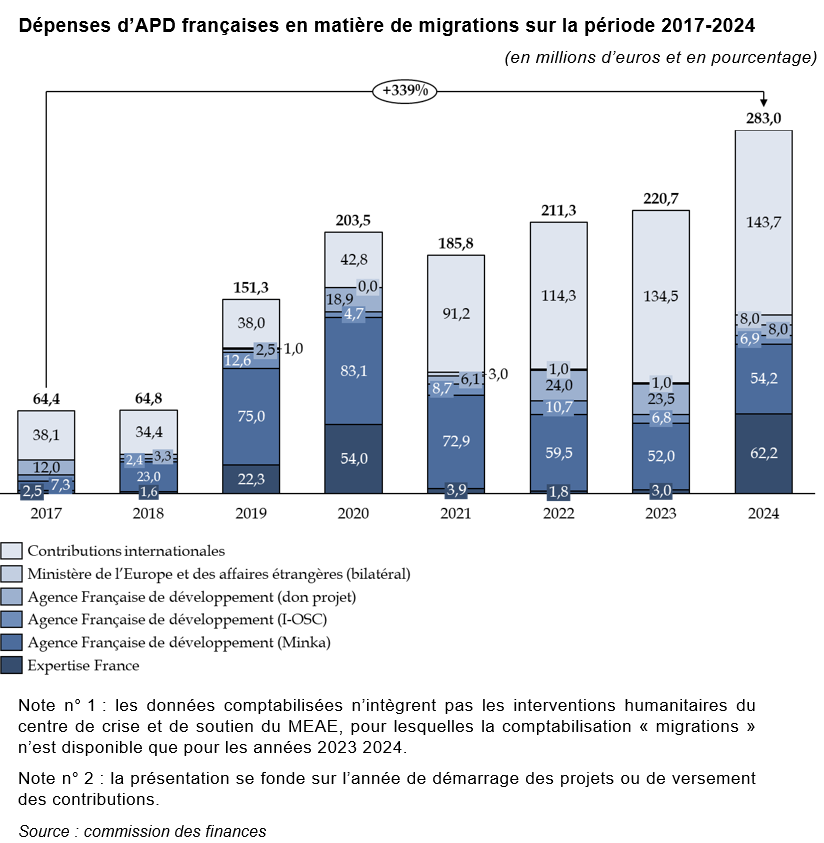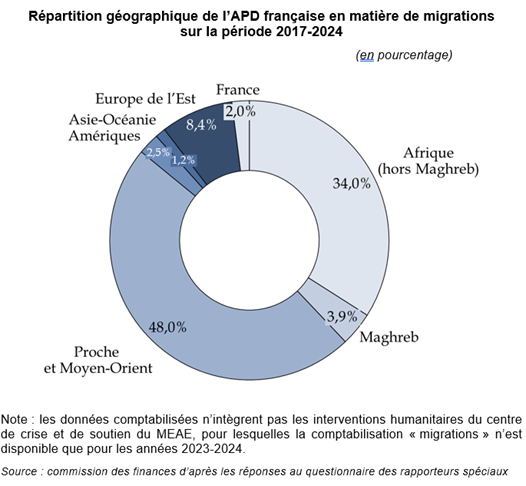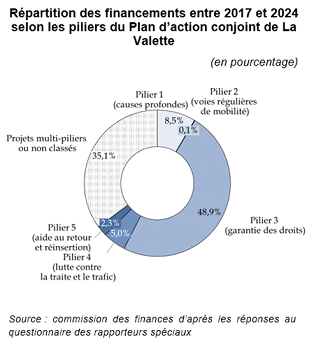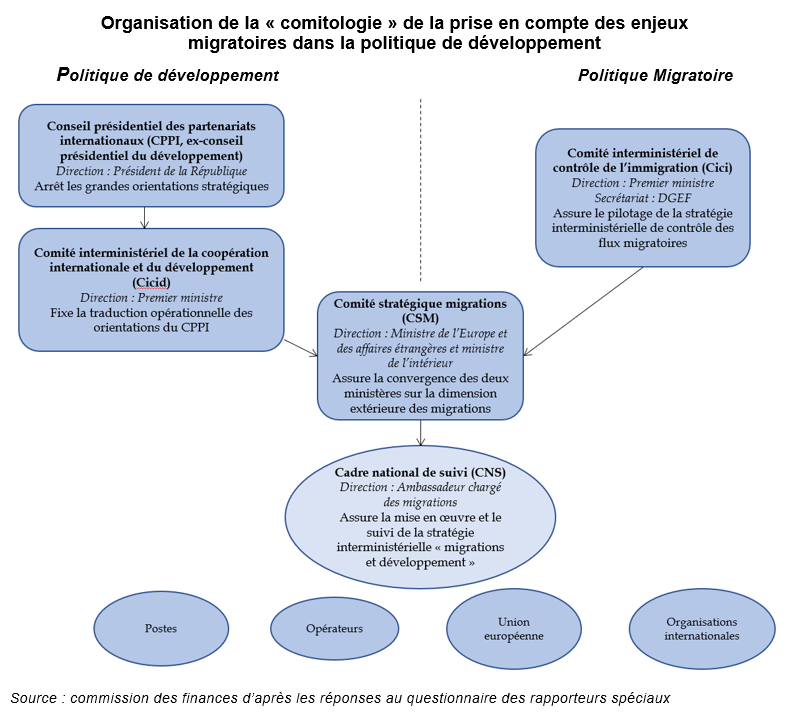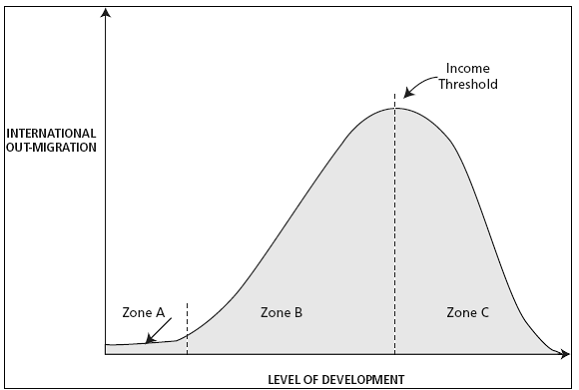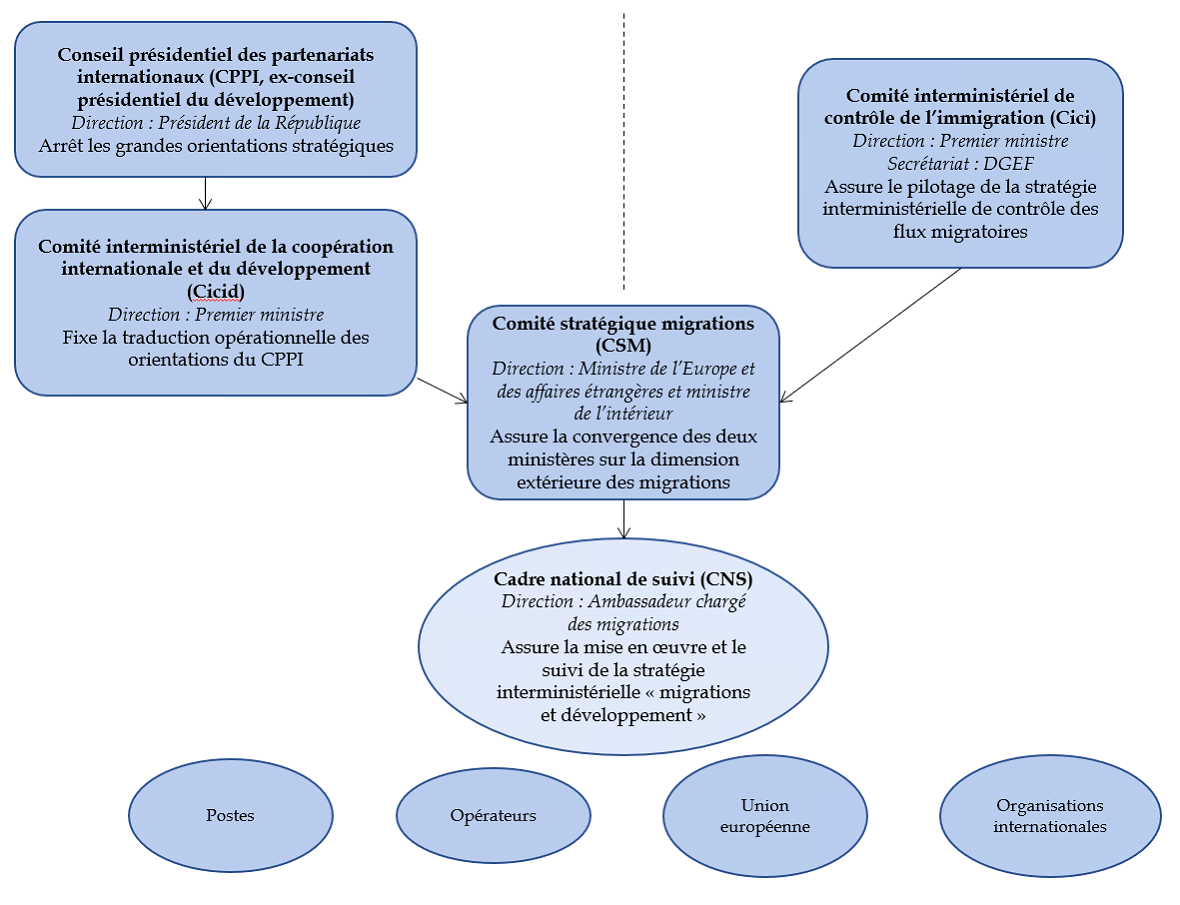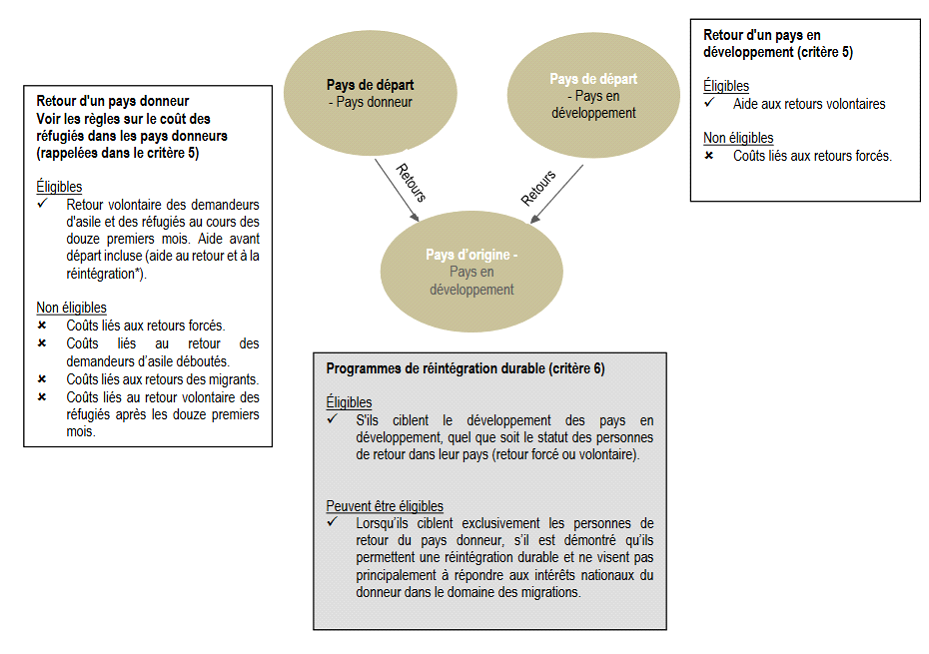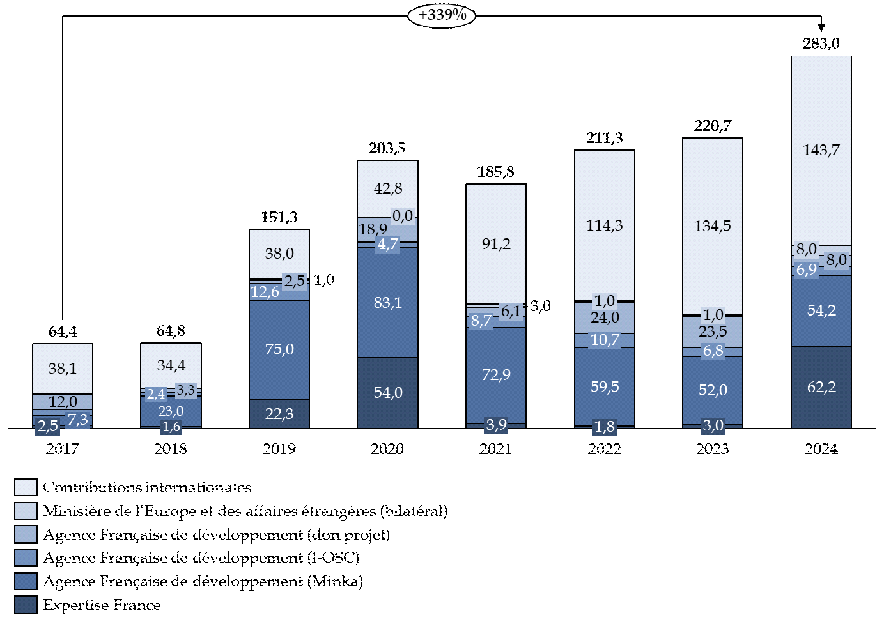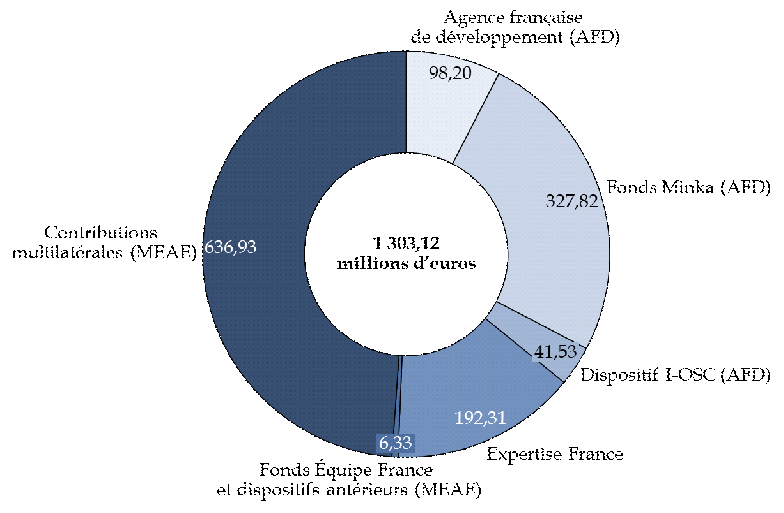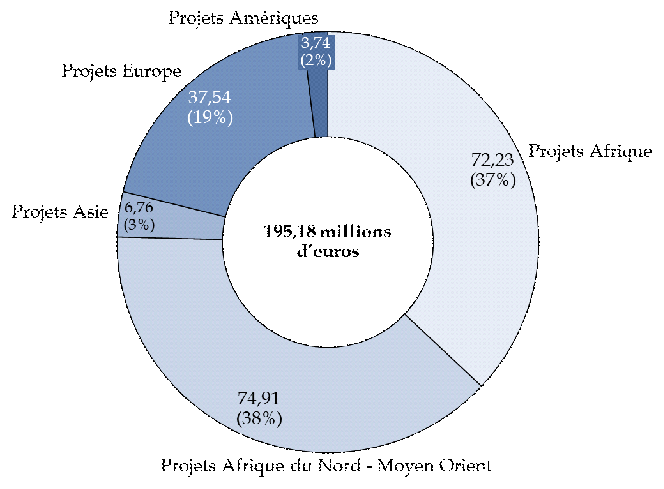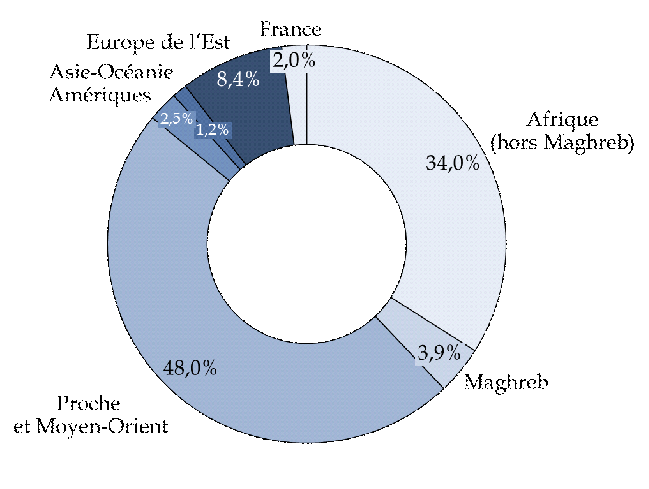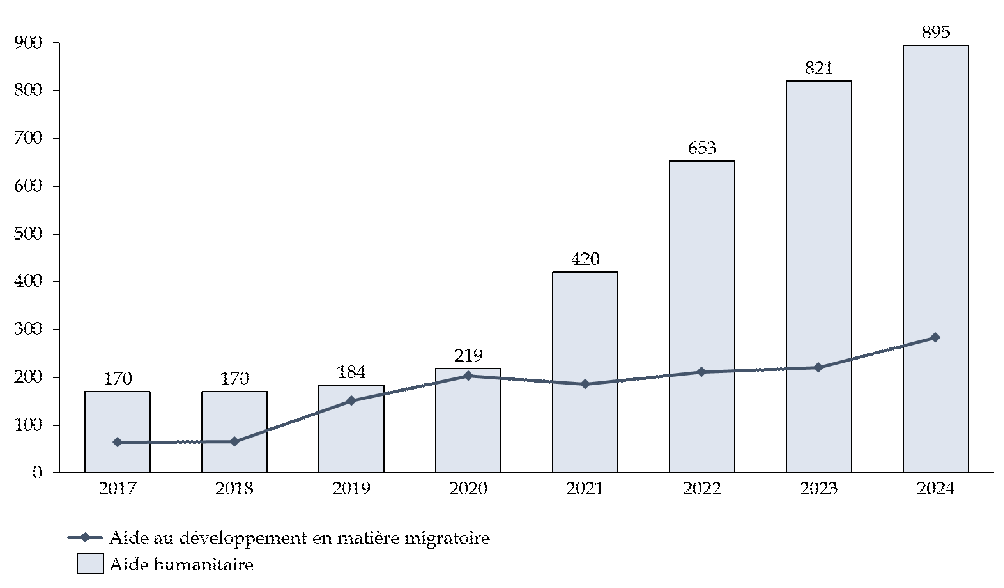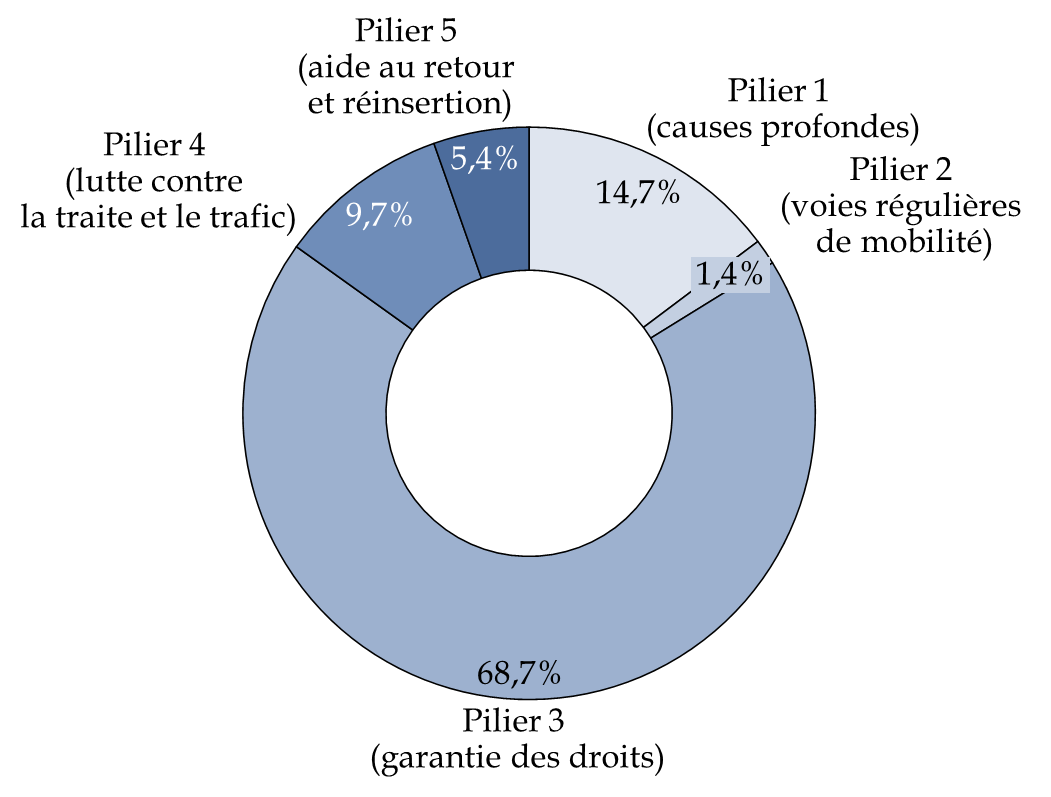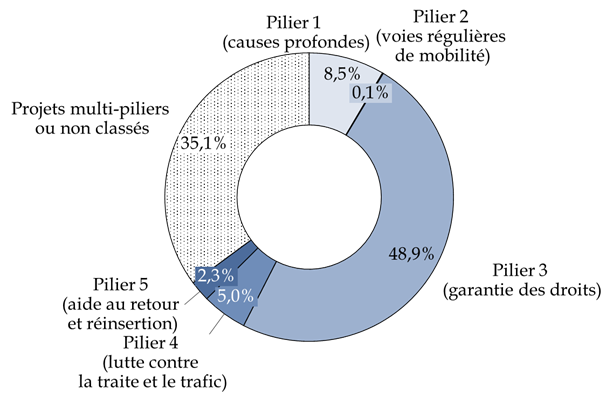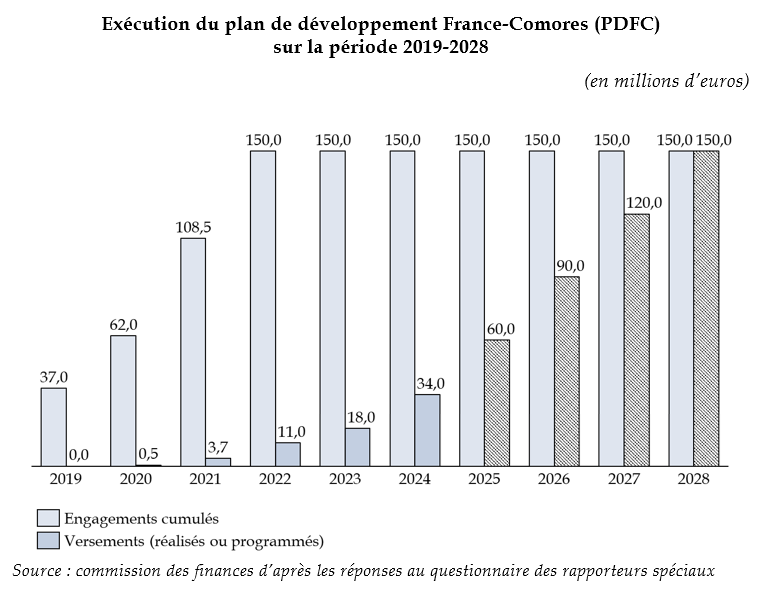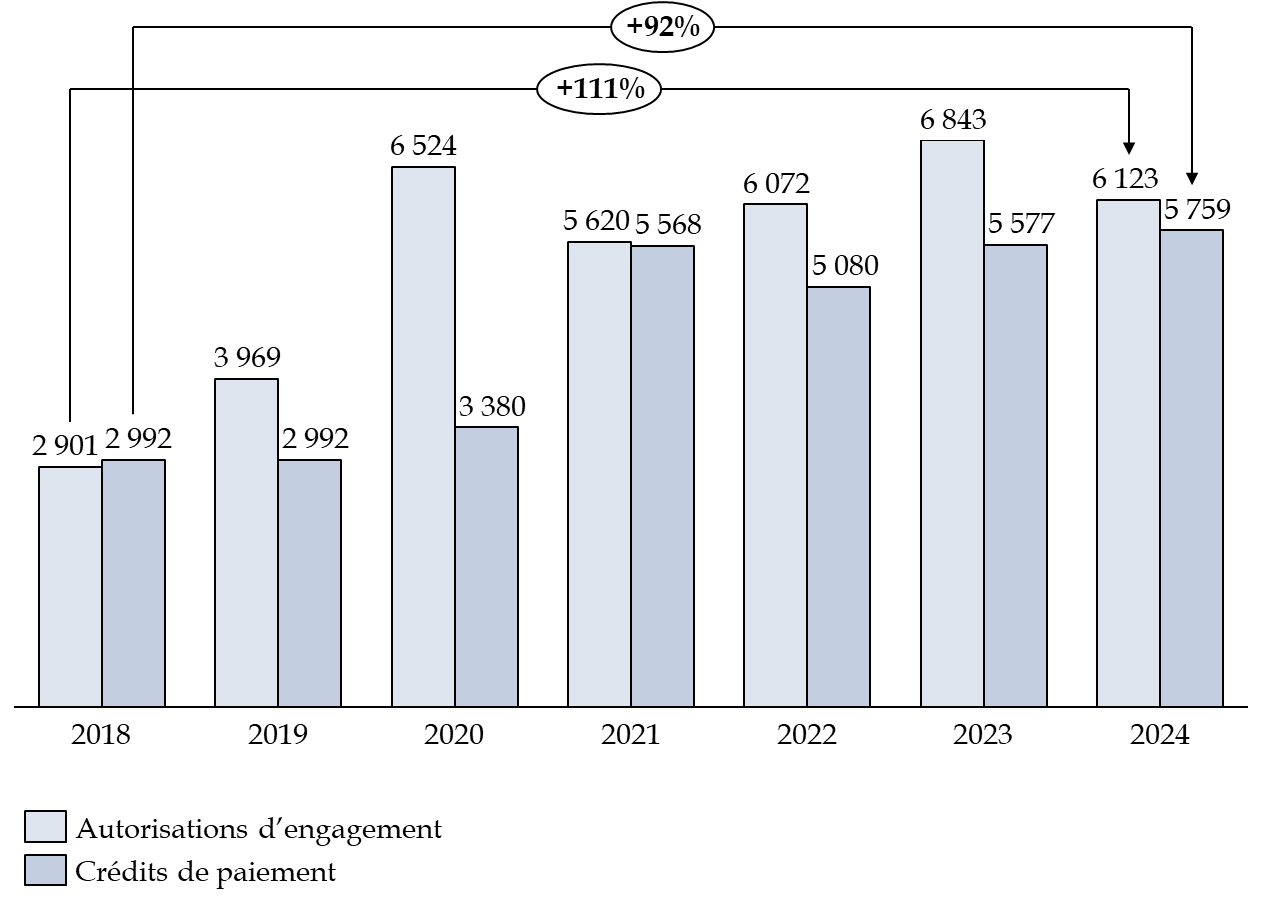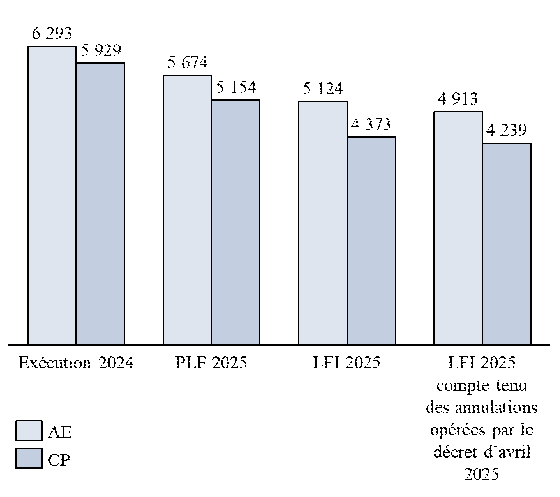- L'ESSENTIEL
- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX
- I. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES QUESTIONS
MIGRATOIRES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
- A. L'IMPACT DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUR
LES MIGRATIONS NE RELÈVE PAS DE L'ÉVIDENCE
- B. LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT
PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
EUROPÉENNE ET FRANÇAISE
- 1. À partir des années 1990, la
France a intégré les enjeux migratoires dans sa politique de
développement au travers de la notion de codéveloppement
- 2. L'année 2015 marque, au niveau
français comme au niveau européen, un tournant dans la prise en
compte des enjeux migratoires
- 3. À compter de 2023, une priorisation
affichée de la thématique migratoire dans la politique
française de développement
- 1. À partir des années 1990, la
France a intégré les enjeux migratoires dans sa politique de
développement au travers de la notion de codéveloppement
- C. UNE COMPTABILISATION STRICTE DES PROJETS
MIGRATOIRES DANS L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
- A. L'IMPACT DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUR
LES MIGRATIONS NE RELÈVE PAS DE L'ÉVIDENCE
- II. DES FINANCEMENTS CROISSANTS MAIS UNE
STRATÉGIE ENCORE INACHEVÉE DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS
- A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT,
PORTÉ PAR UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ET DE CANAUX
- 1. Le total des financements engagés par la
France sur la période 2017-2024 en matière migratoire
représente plus d'un milliard d'euros
- 2. Canaux et instruments de la politique de
développement de la France en matière migratoire
- a) Les financements bilatéraux du
ministère de l'Europe et des affaires étrangères
- b) Le groupe AFD, acteur majeur de l'APD en
matière migratoire
- c) Le ministère de l'intérieur et ses
opérateurs, un engagement quantitativement limité mais
qualitativement significatif
- d) Une mise en oeuvre marginale, par les
organisations de la société civile de l'APD française en
matière de migrations
- a) Les financements bilatéraux du
ministère de l'Europe et des affaires étrangères
- 3. Un recours significatif aux organisations
internationales
- 4. L'aide de la France se prolonge par le canal
européen au travers de deux instruments financiers
- 1. Le total des financements engagés par la
France sur la période 2017-2024 en matière migratoire
représente plus d'un milliard d'euros
- B. UNE ÉVALUATION DIFFICILE DE L'AIDE AU
DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCE EN MATIÈRE MIGRATOIRE
- A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT,
PORTÉ PAR UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ET DE CANAUX
- III. ALORS QUE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT
PÂTIT DES RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES, LA PRIORITÉ
ACCORDÉE AUX MIGRATIONS DEVRA FAIRE L'OBJET D'UN SUIVI PLUS
POUSSÉ
- A. LA BONNE MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE
INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET
DÉVELOPPEMENT » 2024-2030 IMPLIQUERA CERTAINES
ADAPTATIONS
- 1. La dimension migratoire de notre APD doit
être clarifiée et articulée avec les autres
priorités, parfois contradictoires, de cette politique
- 2. Renforcer le pilotage de la prise en compte des
enjeux migratoires de la politique de développement, tout en confortant
sa dimension interministérielle
- 3. Concrétiser les objectifs fixés
par la stratégie 2024-2030 en tenant compte de l'environnement
budgétaire contraint
- 4. Dans la prise en compte des enjeux migratoires,
renforcer l'effort en matière de coopération technique, notamment
en matière d'état civil
- 5. Conserver une démarche de suivi et
d'évaluation dans la mise en oeuvre de la stratégie
interministérielle « migrations et
développement »
- 1. La dimension migratoire de notre APD doit
être clarifiée et articulée avec les autres
priorités, parfois contradictoires, de cette politique
- B. S'IL EST POSSIBLE D'ENVISAGER UNE APPROCHE PLUS
PARTENARIALE, L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT NE CONSTITUE QU'UNE PARTIE DE LA
DIMENSION EXTÉRIEURE DES POLITIQUES MIGRATOIRES
- A. LA BONNE MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE
INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET
DÉVELOPPEMENT » 2024-2030 IMPLIQUERA CERTAINES
ADAPTATIONS
- I. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES QUESTIONS
MIGRATOIRES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 67
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur la
prise en compte
des
questions migratoires dans
la politique de
développement,
Par MM. Michel CANÉVET et Raphaël DAUBET,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
I. SI L'IMPACT DE L'APD SUR LES MIGRATIONS RESTE EN DÉBAT, LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
A. DES EFFETS DIFFICILES À OBJECTIVER DE L'APD SUR LES MIGRATIONS
La théorie économique étudie depuis les années 1970 les liens entre migrations et développement.
Une théorie ancienne, dite de la « bosse migratoire » (migration hump), identifie une relation positive, sous la forme d'une courbe en « U inversé », entre développement et migration et soutient, par conséquent, que l'aide au développement encourage les migrations à moyen terme. Cette analyse permet de soutenir que les pays à revenus intermédiaires présentent un potentiel migratoire plus important que les pays les moins avancés.
Des publications universitaires plus récentes ont débattu de la pertinence de la théorie de la « bosse migratoire » et il semble désormais nécessaire de prendre en considération d'autres facteurs que la seule dimension économique. Trois enseignements principaux peuvent être retirés de la littérature économique :
- tout d'abord, l'évolution des flux migratoires ne peut être imputée seulement à la hausse du niveau de vie ou à l'aide publique au développement. La situation géographique du pays de départ, ses attaches linguistiques et historiques avec les pays d'arrivée, son intégration régionale ou son niveau d'inégalités peuvent aussi constituer des facteurs explicatifs ;
- ensuite, une aide publique au développement mal orientée peut renforcer, de manière transitoire, l'immigration dès lors qu'elle favorise la croissance économique de certains territoires au détriment d'autres ;
- enfin, les mobilités depuis les pays à revenus intermédiaires correspondent davantage à des mouvements réguliers.
Davantage que l'aide au développement, les pays de départ sont attentifs aux revenus de transfert issus de la diaspora, bien supérieurs à l'APD ou aux investissements étrangers (656 milliards de dollars de transferts dans le monde en 2023).
B. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES ENJEUX MIGRATOIRES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
La crise migratoire de 2015, résultant de l'exode massif de ressortissants syriens en Europe, a conduit l'Union européenne à établir une stratégie et des instruments visant à lier migrations et développement.
Les cinq piliers du plan d'action conjoint
de
La Valette (2015)
Source : ministère de l'Europe et des affaires étrangères
L'UE et ses États membres ont défini en 2015 un plan d'action conjoint à La Valette (PACV) sur la problématique des migrations et des déplacements forcés, articulé autour de cinq piliers, suivant un découpage chronologique du parcours migratoire :
- lutter contre les causes profondes des déplacements contraints et des migrations irrégulières et maximiser les apports des migrations pour le développement (pilier 1) ;
- promouvoir les voies régulières de mobilité et accompagner les migrants sur leur parcours migratoire (pilier 2) ;
- garantir le respect des droits, l'accès aux services de base et la dignité des migrants (pilier 3) ;
- lutter contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (pilier 4) ;
- renforcer les modalités d'accompagnement au retour durable grâce à des solutions personnalisées favorisant la réinsertion (pilier 5).
Au niveau national, prenant en compte les avancées du plan d'action conjoint de La Valette, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid)1(*) du 8 février 2018 a adopté un plan d'action « migrations internationales et développement » pour les années 2018-20222(*), avec pour objectif le déploiement de 1,8 milliard d'euros de crédits budgétaires pour la mise en oeuvre de ses actions.
C. UNE STRICTE COMPTABILISATION PAR L'OCDE DES PROJETS MIGRATOIRES DANS L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Le Comité d'aide au développement (CAD), instance de coordination des politiques de développement relevant de l'OCDE, définit, pour les pays donateurs, les règles de comptabilisation de l'APD. Depuis 2018, les projets « migrations » font l'objet d'un cadre de comptabilisation précisée :
- premièrement, les projets financés, comme l'ensemble des projets d'aide au développement, doivent avoir pour objectif principal le développement durable des pays bénéficiaires ;
- deuxièmement, les activités de sécurité « dure » sont exclues du champ de l'APD. Les actions de coopération de défense, les opérations civilo-militaires menées dans le cadre des Nations unies, les programmes de renforcement des institutions de l'État ou la coopération policière ne relèvent donc pas de l'aide au développement car l'objectif principal de ces projets demeure la sécurité nationale des États bailleurs ;
- troisièmement, toute action dont le bénéfice principal revient au donateur ne peut être comptabilisée comme de l'APD. Un projet dont l'objectif principal est de limiter les migrations vers le pays bailleur ne peut être ainsi validé.
II. ENTRE 2017 ET 2024, LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX MIGRATOIRES FAIT FIGURE D'ACTE MANQUÉ
A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE D'UN MILLIARD D'EUROS, PORTÉ PAR UN PLAN D'ACTION « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT »
Au total, sur la période 2017-2024, le montant total de l'APD française en matière migratoire avoisinait le milliard d'euros. Si ces montants sont loin de l'objectif de 1,8 milliard d'euros consacrés aux migrations fixé par le plan d'action 2018-2022, a fortiori lorsque l'on se réfère à la stricte période d'application du plan d'action (moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022), ils représentent néanmoins des engagements significatifs.
Trois enseignements principaux peuvent être tirés de la mise en oeuvre de ces financements :
- comme souvent, dans une approche thématique de l'aide au développement, l'ensemble des acteurs de cette politique, nationaux ou internationaux, se trouvent impliqués. Cette fragmentation de l'action publique, qui s'explique par des échelles et des domaines d'action distincts, ne contribue pas à sa lisibilité, d'autant qu'elle conduit fréquemment à des financements croisés et à une coordination perfectible ;
- près de la moitié de l'aide au développement de la France en matière migratoire (48,9 %) transite par le canal multilatéral, avec 636,93 millions d'euros sur la période 2017-2024. Cette montée en puissance des contributions internationales, particulièrement à destination du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de l'Organisation internationale des migrations (OIM), s'explique par le renforcement de notre aide humanitaire ;
- sur le plan bilatéral, il apparaît que c'est l'investissement conséquent de la France en matière humanitaire, plus qu'une priorisation de la thématique migratoire, qui peut expliquer la hausse continue des financements labellisés « migrations ».
B. SANS ÉVALUATION ET FAUTE DE PILOTAGE FORT, IL EST IMPOSSIBLE DE MESURER L'IMPACT DE DÉPENSES AYANT, POUR UNE GRANDE PARTIE, FAIT L'OBJET D'UNE LABELLISATION « MIGRATIONS » A POSTERIORI
Il est possible d'identifier les priorités géographiques de l'APD en matière migratoire : la majorité des projets est dirigée vers le Proche et Moyen Orient et l'Afrique. De plus, une liste de quinze pays prioritaires en matière migratoire a été définie en 2023 par le Gouvernement3(*).
Cette orientation géographique est contradictoire avec les priorités géographiques fixées à notre APD, censée se concentrer à 60 % sur les pays les moins avancés (PMA) et vulnérables. Or, les principaux bénéficiaires de notre aide en matière migratoire sont des pays à revenus intermédiaire.
Cette contradiction s'explique par la structure même des flux migratoires, les pays les moins avancées n'étant pas les plus gros pourvoyeurs de migrants vers la France.
Sur le plan thématique, la majeure partie des projets (68,7 %) comme des financements (48,9 %) relèvent du troisième pilier consacré à la garantie des droits et à la protection des personnes déplacées. C'est dans ce domaine que s'inscrivent les financements humanitaires.
En revanche, les piliers 4 (lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants) et 5 (aide au retour) représentent une part beaucoup plus faible des financements octroyés par la France (respectivement 5 % et 2,3 %). Il s'agit pourtant des domaines d'action que les précédents gouvernements ont déclaré prioritaires et qui correspondent à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (« aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines »).
Il importe de noter que les données transmises par le MEAE correspondent à une méthodologie récente de comptabilisation des projets. Or, le risque d'une comptabilisation a posteriori est d'intégrer des projets qui n'ont pas forcément de liens directs avec la problématique migratoire et surtout, qui n'ont pas été pensés en prenant en compte ces enjeux.
Par ailleurs, le plan d'action « migrations et développement » 2018-2022 n'a fait l'objet d'aucun bilan ni évaluation, contrairement à ce qui était prévu dans sa programmation initiale. La réticence du MEAE à mener un tel bilan conforte l'impression d'un suivi pour le moins perfectible des engagements, d'une part, et de la prévalence d'un objectif de moyens sur un objectif de résultat, d'autre part. Même si le résultat anticipé est défavorable, ne pas mener d'évaluation ne paraît pas constituer une bonne pratique administrative.
III. DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT, IL IMPORTE DE RENFORCER LE SUIVI DE NOTRE AIDE ET D'ADOPTER UNE APPROCHE PARTENARIALE EN MATIÈRE MIGRATOIRE
A. LA MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT » IMPLIQUERA DE FORTES ADAPTATIONS
Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a finalisé une stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 visant à traduire les objectifs définis par le conseil présidentiel du développement et le Cicid de 2023.
Les rapporteurs formulent à ce titre quatre observations.
- Premièrement, les rapporteurs estiment que l'objectif migratoire doit être clarifié et mieux articulé avec les autres priorités de notre APD. De fait, les ministères en charge de cette politique ne sont pas en mesure d'établir clairement de quels enjeux migratoires parler : s'agit-il de la lutte contre l'immigration irrégulière, visée par le Cicid, ou d'une approche plus large des migrations, comme envisagée par la stratégie pluriannuelle ? Actuellement, la seule lutte contre l'immigration irrégulière représente un volume d'aide au développement relativement faible. De plus, la priorité accordée à la dimension migratoire risque d'affaiblir la cible de concentration de 60 % de l'aide sur les pays les moins avancés (PMA) et pays vulnérables, dès lors que les principaux pays de départ et de transit sont des États à revenus intermédiaires.
- Deuxièmement, le pilotage de notre politique de développement en matière migratoire doit être renforcé et intégrer une véritable dimension interministérielle. La France a, au cours des dernières années, adapté son organisation administrative autour d'une comitologie visant à encourager une plus grande coopération interministérielle sur la dimension extérieure des migrations (cf. schéma infra). Toutefois, les rapporteurs spéciaux ont identifié plusieurs limites :
- d'une part, cette organisation, opérationnelle sur le papier, peine à se concrétiser et le comité stratégique migrations (CSM) ne s'est réuni qu'une seule fois au niveau des ministres depuis 2023 ;
- d'autre part, la réalité de la coopération entre le MEAE, qui dispose de l'essentiel des financements, et le ministère de l'intérieur est encore en construction.
- Troisièmement, dans un contexte budgétaire contraint et à enveloppe constante, il faudra être explicite sur le fait que cette priorisation impliquera une baisse des moyens consacrés aux autres thématiques. Face à la dégradation de nos finances publiques, la multiplication des objectifs de la politique de développement ne pourra conduire qu'à la dilution de son impact. Une priorisation formelle devrait être concrétisée par la claire définition d'une enveloppe budgétaire.
Les ambitions affichées par le Gouvernement sur la thématique migratoire en matière d'aide au développement risquent fortement de se concrétiser au détriment d'autres dimensions de l'APD.
- Quatrièmement, il est indispensable de prévoir une démarche de suivi et d'évaluation dans la mise en oeuvre de la stratégie interministérielle « migrations et développement ». En effet, les rapporteurs spéciaux ont été particulièrement surpris, au cours de leurs auditions, d'apprendre que la stratégie interministérielle précédente n'avait pas fait l'objet d'une évaluation ex post. Pour opérer un suivi des financements d'APD en matière migratoire, il sera également indispensable de disposer, dans les documents budgétaires, d'une identification des crédits budgétaires concourant à cet objectif.
B. LA FRANCE DOIT ENVISAGER UNE APPROCHE PLUS PARTENARIALE, SANS SURESTIMER L'IMPACT DE L'APD SUR LES MIGRATIONS
Une conditionnalité stricte de l'aide publique au développement en matière migratoire, qui conduirait à interrompre l'aide à l'égard d'États non coopératifs en matière migratoire, présente des limites de trois ordres :
- tout d'abord, la formalisation explicite d'une conditionnalité des versements à des objectifs de politique migratoire et donc à un avantage pour le pays donateur, exclurait cette aide de la qualification d'APD, en application des règles fixées par l'OCDE ;
- ensuite, d'un point de vue plus opérationnel et pratique, la décision de suspendre l'aide comporte des difficultés d'ordre pratiques et juridiques. La suspension soudaine d'un projet en cours rend particulièrement incertaine sa reprise et impose à l'opérateur de régler des pénalités à ses prestataires ;
- enfin, la conditionnalité comporte des risques politiques et réputationnels non négligeables pour nos opérateurs et entreprises. D'une part, suspendre l'aide signifie renoncer aux avantages induits par la logique d'aide au développement dans sa coopération avec l'État bénéficiaire. D'autre part, elle peut placer ce dernier en position de force dans les négociations, en écartant des négociations d'autres thématiques sur lequel il se sollicite davantage l'assistance de la France.
Dès lors, les rapporteurs spéciaux, conscients des limites d'une conditionnalité « stricte », défendent cependant une orientation plus transactionnelle de notre politique de développement, qui doit assumer la préservation des intérêts de la France, dans le respect, toutefois, de l'objectif prioritaire de l'APD, à savoir le développement des pays bénéficiaires.
Cette logique transactionnelle devrait se poursuivre à l'échelon européen. L'Union européenne a en effet développé, dans le cadre de sa politique de voisinage, des « partenariats stratégiques globaux », de nature multisectorielle, avec plusieurs États du voisinage méditerranéen. La conclusion de ces accords présente des résultats encourageants sur les départs depuis ces États.
LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX
Recommandation n° 1 : intégrer, dans la stratégie interministérielle « migrations et développement » et dans la liste des pays prioritaires en matière migratoire, une prise en compte des enjeux spécifiques aux territoire ultramarins (direction générale de la mondialisation).
Recommandation n° 2 : réunir à intervalles réguliers, a minima biannuels, le comité stratégique migrations (CSM) et le cadre national de suivi (CNS) pour conforter le pilotage de la stratégie interministérielle (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'intérieur).
Recommandation n° 3 : pour les postes des États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire, inscrire obligatoirement l'objectif migratoire dans la stratégie-pays (direction générale de la mondialisation, postes diplomatiques).
Recommandation n° 4 : préciser, au sein du plan d'action « migrations et développement » devant opérationnaliser la stratégie interministérielle 2024-2030, le montant des crédits budgétaires dédiés à la mise en oeuvre des objectifs de cette stratégie (direction générale de la mondialisation).
Recommandation n° 5 : réserver, au sein de l'enveloppe dédiée aux migrations, une part dédiée à la coopération technique et renforcer les moyens dédiés à l'assistance en matière d'état civil (direction générale de la mondialisation, Expertise France, Civipol).
Recommandation n° 6 : organiser une évaluation à mi-parcours de la stratégie interministérielle 2024-2030 et dresser un bilan à l'issue de sa mise en oeuvre (direction générale de la mondialisation, AFD, Expertise France).
Recommandation n° 7 : identifier, dans les documents budgétaires, les crédits dédiés à chaque objectif prioritaire de notre politique de développement (direction générale de la mondialisation, direction générale du Trésor).
Recommandation n° 8 : réviser les indicateurs de performance de la mission « Aide publique au développement » consacrés à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération international et du développement (direction générale de la mondialisation).
Recommandation n° 9 : adopter une approche transactionnelle, y compris dans la coopération migratoire, en matière d'aide au développement, en priorisant notre soutien aux pays les plus volontaristes (Gouvernement).
Recommandation n° 10 : au niveau européen, soutenir la conclusion de partenariats stratégiques globaux avec l'ensemble des pays-clés dans le transit des migrations, et y défendre l'inclusion des priorités stratégiques de la France (ministère de l'Europe et des affaires, ministère de l'intérieur).
I. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES QUESTIONS MIGRATOIRES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
A. L'IMPACT DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUR LES MIGRATIONS NE RELÈVE PAS DE L'ÉVIDENCE
1. Des liens ambivalents entre migration et développement
La théorie économique appréhende les liens entre migrations et aide publique au développement depuis les années 1970. La théorie dite de la « bosse migratoire » (migration hump), développée dans un article de 19714(*), identifie une relation positive entre développement et migration et soutient, par conséquent, que l'aide au développement encourage les migrations.
Dans un schéma en « U inversé », illustré infra, un développement économique plus soutenu signifie une plus grande migration, en raison :
- d'un facteur économique, les personnes dont les revenus ne leur permettaient pas de financer leur départ peuvent désormais quitter leur pays. La poursuite du développement économique, dans une période ultérieure de modernisation conduirait à une diminution des migrations. Même si les populations ont acquis les moyens de partir, elles décident de ne pas le faire ;
- d'un facteur démographique, la hausse des revenus étant traditionnellement associée à des changements démographiques favorisant l'émigration ;
- de facteurs structurels associés au processus de développement, accélérant les mobilités internes et potentiellement internationales.
Cette analyse permet de soutenir que les pays à revenus intermédiaires présentent un potentiel migratoire plus important que les pays les moins avancés.
Illustration de la théorie de la « bosse migratoire »
Note de traduction : international out-migration (émigration internationale) ; income treshold (seuil de revenu) ; level of development (niveau de développement).
Source : Parlement britannique, Select Committee on International Development
Les recherches les plus récentes ont permis de remettre en cause cette corrélation entre développement et migration. Dans une publication de 20185(*), Mauro Lanati et Rainer Thiele identifient même une relation négative entre aide au développement et migrations, pour laquelle ils avancent deux explications : d'une part, la contrainte financière pesant sur les ménages ne serait pas le seul paramètre dans leur décision de départ ; d'autre part, l'aide au développement, dans la période contemporaine, ne conduit pas forcément à un accroissement du revenu disponible des ménages mais vise davantage à renforcer les services publics locaux. Une étude de 2020 suggère, quant à elle, que l'augmentation des revenus des individus suscitée par un développement économique croissant ne les conduit pas à émigrer. En ce sens, l'aide au développement, en stimulant la croissance économique, pourrait, à terme, réduire les migrations6(*). Tout en soulignant que les éléments suggérant que l'aide au développement peut efficacement dissuader les migrations sont faibles, Michael Clemens et Hannah Postel observent que les programmes de soutien à l'emploi des jeunes, en particulier en milieu rural, peuvent contribuer à limiter les départs7(*).
Si les débats universitaires demeurent ouverts sur la pertinence de la théorie de la « bosse migratoire », il semble nécessaire de prendre en considération d'autres facteurs que la seule dimension économique. La situation géographique du pays, ses attaches linguistiques et historiques avec les pays d'arrivée, son intégration régionale ou son niveau d'inégalités peuvent entrer en compte. Cette approche multidimensionnelle ne permet pas de confirmer une causalité APD-migrations et, en tout état de cause, limite l'utilité de la théorie de la « bosse migratoire » dans la mise en oeuvre de politiques publiques.
Pour autant, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères identifie trois conclusions principales de la littérature économique :
- premièrement, comme indiqué supra, l'évolution des flux migratoires ne peut être imputée seulement à la hausse du niveau de vie ou à l'aide publique au développement. Il est impératif d'adopter, dans la construction d'une politique de développement en matière de migrations, une approche multidimensionnelle intégrant des facteurs historiques, géographiques ou climatiques ;
- deuxièmement, une aide publique au développement mal orientée peut renforcer, de manière transitoire, l'immigration dès lors qu'elle favorise la croissance économique de certains territoires au détriment d'autres. Une aide au développement plus ciblée, concentrée sur des actions visant à stabiliser les populations en leur proposant des alternatives au départ (développement local, développement agricole, création d'emplois durables, renforcement des services publics ou de l'État de droit) doit être privilégiée ;
- troisièmement, les mobilités depuis les pays à revenus intermédiaires correspondent davantage à des mouvements réguliers. Les instruments d'aide peuvent accompagner ces flux, dans un sens mutuellement bénéfique aux pays de départ et d'arrivée.
Par ailleurs, la littérature scientifique suggère que les migrants ont une préférence pour des destinations proches de leurs lieux de départ. Les migrations Sud-Sud représentent l'immense majorité des flux : une étude de l'Organisation internationale des migrations (OIM) estimait en 2022 que seulement 1 % des migrants transitant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale avait pour destination l'Europe8(*).
2. Les revenus de transferts de la diaspora, une ressource essentielle pour les pays de départ
Les transferts de fonds constituent le lien le plus avéré entre les migrations et le développement des pays de départ. Le Fonds international de développement agricole (Fida) estime que 200 millions d'immigrants envoient des fonds vers leurs pays d'origine, pour un montant moyen de 250 dollars par mois et par envoi individuel9(*).
Avec 656 milliards de dollars de transferts dans le monde en 2023, soit environ 2 % du PIB agrégé des pays à revenu faible et intermédiaire, ce canal est la première source de financements extérieurs pour les pays en développement, devant l'aide publique au développement (qu'il dépasse de trois fois) et les investissements directs étrangers (IDE). Ce montant devrait atteindre 5 000 milliards de dollars à horizon 2030 selon les projections du Fida. Ces données ne prennent naturellement pas en compte les transferts de fonds informels, du fait des coûts de transfert et de la difficulté d'accéder à des services financiers.
Au Sénégal, les transferts de fonds de la diaspora s'élevaient à 2,4 milliards d'euros en 2023, soit 10,5 % du PIB, bien plus que le total de l'APD versée par les bailleurs internationaux à ce pays (1,4 milliard d'euros cette même année). Selon l'ambassadrice de France, Mme Christine Fages, les revenus de transfert se seraient élevés à 7 % du PIB du pays en 2024.
Comme a pu le souligner Flore Gubert, directrice de recherche à l'IRD, les transferts, dont l'impact macroéconomique est complexe à mesurer, comportent une fonction assurantielle avérée en période de crise. Alors que les IDE reculent au cours des périodes de crise et que l'APD est soumise aux choix budgétaires des pays donateurs, les revenus de transfert sont contracycliques et moins volatils. Cette fonction assurantielle permet d'éviter aux ménages, dans les pays d'origine, d'entamer leur patrimoine ou de renoncer à certaines dépenses, comme la scolarisation des enfants.
D'un point de vue plus politique, l'importance des transferts de fonds de la diaspora peut expliquer la réticence des pays d'origine à réguler les départs irréguliers. Pour un pays en développement, renoncer à l'immigration signifie, pour les ménages, renoncer à une source de devises et de financements. En outre, la régulation des migrations suppose de lourds investissements pour des États aux moyens limités et les exposent à des risques de tensions sociales, notamment chez les jeunes.
S'agissant de la France, les transferts financiers réalisés par les diasporas s'élevaient à 11,4 milliards d'euros en 2023, en hausse de 6,75 % par rapport à l'année précédente. Outre que l'ensemble de ces transferts ne se fait pas seulement vers des pays en développement, le total de ces envois était inférieur à l'APD française la même année (14,2 milliards d'euros selon les données de l'OCDE). À noter que 76 % des transferts depuis la France sont à destination des pays de la péninsule ibérique et du Maghreb.
Dix premiers pays bénéficiaires de
transferts de fonds depuis la France
entre 2021 et 2023
(en millions d'euros et en pourcentage)
|
Pays bénéficiaires |
2021 |
2022 |
2023 |
Variation 2023/2022 |
|
Maroc |
3 042 |
3 308 |
3 531 |
6,75 % |
|
Algérie |
1 295 |
1 351 |
1 442 |
6,75 % |
|
Portugal |
1 241 |
1 200 |
1 281 |
6,75 % |
|
Tunisie |
1 109 |
1 181 |
1 261 |
6,75 % |
|
Espagne |
1 048 |
1 094 |
1 168 |
6,75 % |
|
Vietnam |
790 |
831 |
888 |
6,75 % |
|
Sénégal |
482 |
512 |
546 |
6,74 % |
|
Serbie |
381 |
493 |
527 |
6,75 % |
|
Chine |
359 |
367 |
392 |
6,76 % |
|
Madagascar |
318 |
338 |
361 |
6,74 % |
Source : commission des finances d'après les données de la Banque de France
Dans le cadre de leur Agenda 2030, les Nations unies ont adossé à leur objectif de développement durable (ODD) n° 10 une cible, d'ici 2030, de « faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %. » Suivant cet objectif, la France a adapté sa réglementation, par un arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement. Cette évolution visait à renforcer et standardiser l'information des utilisateurs pour les opérations de paiement pouvant avoir pour but d'envoyer de l'argent à l'étranger. Les utilisateurs se retrouvaient, en effet, en difficulté pour identifier et comparer les tarifs entre prestataires et ainsi faire jouer la concurrence, faute d'une présentation tarifaire uniforme.
B. LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉENNE ET FRANÇAISE
1. À partir des années 1990, la France a intégré les enjeux migratoires dans sa politique de développement au travers de la notion de codéveloppement
La prise en compte par la France des enjeux migratoires dans sa politique de développement repose historiquement sur la notion de codéveloppement. Forgé dans les années 198010(*), ce concept visait originellement à encourager les retours volontaires et la réinsertion, en promouvant des opportunités économiques et en renforçant les services publics des zones à forte émigration. Le « Programme développement local/migration » (PDLM), lancé à cette période, illustre cette logique : ses objectifs étaient d'accompagner par des aides financières et un appui technique les migrants désireux de se réinstaller dans leur pays d'origine tout en soutenant une action locale de développement. Selon Flore Gubert, la mise en oeuvre de ce programme à destination de trois pays de départ (Mali, Mauritanie et Sénégal) a produit des effets limités, les bénéficiaires potentiels le percevant davantage comme une aide au retour qu'une action de promotion du développement.
La publication du rapport de la mission interministérielle « Migrations/codéveloppement » confiée au Professeur Samir Naïr et remis en 199711(*) a permis de redéfinir la notion de codéveloppement, tout en reconnaissant le rôle positif des immigrés pour le développement de leurs pays d'origine. Dans ce cadre, la politique de codéveloppement vise à soutenir le développement local, à valoriser l'engagement des diasporas, notamment en développant la coopération décentralisée au niveau des collectivités territoriales, et à renforcer la gouvernance locale.
La notion de codéveloppement a connu sa concrétisation la plus poussée en 2007, avec la création du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Sur le plan budgétaire, ce nouveau cadre s'est traduit par la création d'un nouveau programme budgétaire 301 « Développement solidaire et migrations », piloté par le ministère précité, au sein de la mission APD. Ce programme entendait opérer une synthèse entre les intérêts du pays d'accueil et des pays d'origine, entre la maîtrise de l'immigration et l'implication des ressortissants dans le développement. Il mettait notamment en oeuvre le volet budgétaire d'un nouvel instrument de diplomatie migratoire, les accords de gestion concertée (AGC), pour un financement total de 128 millions d'euros sur la période 2008-201212(*).
Un instrument tombé en quasi-désuétude : les accords de gestion concertée
Conclus à compter de 2006, les accords de gestion concertée des flux migratoires (AGC) visaient à adopter une approche globale, combinant des impératifs de sécurité, de croissance économique et de solidarité internationale. Cette approche transversale s'inspirait de la logique du « triple gagnant » défendus par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), visant à bénéficier aux pays d'origine, de transit et d'accueil.
De formes diverses, les AGC reposaient sur trois piliers :
- l'organisation de migrations légales par des dispositifs adaptés aux besoins économiques, comprenant des facilités d'obtention de visas ou de titres de séjour et la définition de listes de métiers en tension ;
- la lutte contre l'immigration irrégulière, par un renforcement des coopérations en matière de réadmission et de contrôle des frontières ;
- la promotion d'un développement solidaire en liant les dynamiques migratoires à des projets de codéveloppement impliquant les diasporas.
Seulement huit ACG sur une cible de vingt ont été signés par la France entre 2007 et 2008 et sept sont entrés en vigueur (avec le Sénégal, le Gabon, le Congo, le Bénin, la Tunisie, le Cap-Vert et le Burkina Faso).
Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères souligne les acquis dégagés par ces accords qui ont permis de construire des mécanismes de dialogue pérenne entre les administrations françaises et leurs partenaires étrangers, qui se retrouveraient aujourd'hui dans les « dialogues migratoires ». Ils auraient également permis d'engager une dynamique financière en matière d'aide au développement et de faciliter des échanges techniques et de la coopération opérationnelle avec les pays signataires en matière de retour et réadmission.
Pour autant, la plupart des AGC est tombée en désuétude et seulement deux (Tunisie et Sénégal) sont toujours actifs, même si plusieurs États (Bénin, Congo et Gabon) ont notifié la France de leur volonté de réactiver ce partenariat. De plus, la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur la diplomatie migratoire13(*) a estimé que les AGC n'avaient pas rempli leurs objectifs en matière de migrations légales et de développement. D'une part, les effets sur les migrations professionnelles ont été particulièrement marginaux. D'autre part, les financements en matière d'aide au développement n'étaient pas suffisants pour produire des effets notables.
Pour le MEAE, la nature juridique même de ces accords intergouvernementaux justifie de privilégier d'autres canaux. Les pays partenaires sont, en effet, réticents à s'engager sur de tels instruments dont la visibilité est peu compatible avec la discrétion avec laquelle les autorités entendent traiter les questions liées à l'émigration de leurs ressortissants.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux et les travaux de la commission des lois
2. L'année 2015 marque, au niveau français comme au niveau européen, un tournant dans la prise en compte des enjeux migratoires
a) Au niveau international et européen, un ensemble de documents multilatéraux traite des enjeux migratoires sous l'angle du développement
Pour rappel, en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la politique de coopération au développement et l'action humanitaire constituent une compétence partagée entre l'Union et les États membres (article 4). Le TFUE stipule, à cet égard, que « l'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté » (article 208). Dans le même sens, dans le cadre de la politique de coopération avec les pays du voisinage, l'Union « développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. »14(*) Cette compétence lui permet de traiter de manière plus approfondie les enjeux migratoires avec les pays du voisinage, en particulier en Méditerranée.
La crise migratoire de 2015, résultant de l'exode massif de ressortissants syriens en Europe, a conduit l'Union européenne à établir une stratégie et des instruments visant à lier migrations et développement. L'UE et ses États membres ont ainsi défini en 2015 un plan d'action conjoint à La Valette (PACV) sur la problématique des migrations et des déplacements forcés. Endossé par la Commission européenne et les États membres, ce plan d'action s'articule autour de cinq piliers, selon un découpage chronologique du parcours migratoire :
- lutter contre les causes profondes des déplacements contraints et des migrations irrégulières et maximiser les apports des migrations pour le développement (pilier 1) ;
- promouvoir les voies régulières de mobilité et accompagner les migrants sur leur parcours migratoire (pilier 2) ;
- garantir le respect des droits, l'accès aux services de base et la dignité des migrants (pilier 3) ;
- lutter contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (pilier 4) ;
- renforcer les modalités d'accompagnement au retour durable grâce à des solutions personnalisées favorisant la réinsertion (pilier 5).
La France, à l'instar de la plupart de ses partenaires, structure sa politique de développement en matière de migrations selon cette approche en cinq domaines d'action.
Les cinq piliers du plan d'action conjoint de La Valette (2015)
Source : ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Sur le plan multilatéral, trois instances régionales de dialogue et de consultation ont vu le jour pour assurer la mise en oeuvre du plan d'action de La Valette15(*), selon une approche géographique :
- premièrement, le processus de Khartoum, qui constitue une plateforme de dialogue entre les pays situés sur la route migratoire reliant la corne de l'Afrique à l'Europe. La France en assure la présidence tournante depuis avril 2025 et a souhaité orienter son action sur l'enjeu de l'état civil ;
- deuxièmement, le processus de Rabat, organise un dialogue politique entre les pays situés le long des routes migratoires reliant l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord à l'Europe. La France en a assuré la présidence entre 2019 et 2020 ;
- troisièmement, le processus de Niamey, se concentre sur la lutte contre le trafic illicite de migrants en Afrique de l'Ouest.
Sur le plan financier, pour la réalisation des objectifs du PACV, l'Union européenne a recours à deux instruments (développés infra) : le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique créé en octobre 2015 et doté de cinq milliards d'euros pour une période de cinq ans, d'une part, et l'instrument unique de coopération extérieur NDICI, introduit dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et dont une partie des financements se trouve fléchée vers des actions soutenant la gestion et la gouvernance des migrations et des déplacements forcés dans le monde, d'autre part.
Les Nations unies ont également développé un corpus de textes internationaux dédié aux problématiques migratoires, qui ont orienté l'action des États en matière d'APD :
- en 2015, les 193 États membres des Nations unies ont adopté l'Agenda 2030, large programme de dix objectifs de développement durable (ODD), dont l'objectif 10.7 appelle à « faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en oeuvre de politiques de migrations planifiées et bien gérées » ;
- en 2018, le Pacte mondial sur les réfugiés (PMR) et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM ou « Pacte de Marrakech ») ont été endossés sous l'égide des Nations unies lors du sommet de Marrakech. Le PMM constitue le premier accord global des Nations unies proposant une approche globale des migrations à l'échelle internationale associant pays de départ, de transit et de destination. Ce texte prévoit 23 objectifs soulignant à la fois les risques et les défis s'attachant aux migrations internationales.
b) Au niveau français, la construction progressive d'une doctrine sur la prise en compte des enjeux migratoires
Dès 2013, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'est doté d'un document stratégique présentant les principales orientations de la politique française « mobilité, migration et développement ». Préparée par le seul MEAE, sans participation d'autres départements ministériels, cette stratégie s'est rapidement révélée obsolète, en particulier en raison de l'absence de prise en compte de l'échelon européen. Pour M. Matthieu Boussichas, chargé de programme à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, le début de années 2010 marque en France le rapprochement opérationnel entre deux politiques publiques fondamentalement différentes, la politique migratoire et la politique de développement.
Prenant en compte les avancées du plan d'action conjoint de La Valette, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid)16(*) du 8 février 2018 a consacré l'importance des enjeux migratoires dans la politique de développement en indiquant que « l'aide au développement est un facteur déterminant pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle ce qui contribue à réduire les incitations aux départs par les réseaux de passeurs et, ce faisant, l'immigration irrégulière. »17(*)
Afin de concrétiser cette prise en compte, le Cicid de 2018 a précisé que la France adoptait le plan d'action « migrations internationales et développement » pour les années 2018-202218(*), élaboré par l'Agence française de développement en concertation avec les ministères et opérateurs concernés. L'élaboration de ce plan d'action avait été confiée à l'AFD à l'occasion de la précédente réunion du Cicid, « afin de soutenir les apports positifs des migrations pour le développement, d'agir sur les facteurs structurels des migrations contraintes et de coordonner les réponses d'urgence et les actions de long terme. »19(*) Ce plan d'action 2018-2022 s'est articulé autour de cinq objectifs (étonnamment distincts des domaines d'action identifiés par le plan d'action conjoint de La Valette) :
- améliorer la gouvernance des migrations pour la sécurité des personnes et le développement (objectif 1) ;
- valoriser les apports des migrations pour le développement (objectif 2) ;
- intégrer la dimension migratoire aux politiques de développement (objectif 3) ;
- garantir le respect des droits fondamentaux et protéger les personnes migrantes (objectif 4) ;
- et promouvoir un discours responsable sur les migrations et le lien migrations-développement (objectif 5).
Au terme des cinq années couvertes, le plan d'action devait faire l'objet d'un bilan, auquel l'AFD et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ont finalement renoncé. Ce renoncement était d'autant plus étonnant que le plan d'action ambitionnait le déploiement de 1,8 milliard d'euros de crédits budgétaires pour la mise en oeuvre de ses actions.
Par ailleurs, la dimension migratoire n'est apparue qu'incidemment dans la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Cette dernière rappelait simplement, dans le rapport annexe, l'importance de la mise en cohérence des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales avec ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), dont la politique migratoire.
3. À compter de 2023, une priorisation affichée de la thématique migratoire dans la politique française de développement
Pour la politique française de développement, l'année 2023 a marqué un tournant significatif dans la doctrine du gouvernement. Sans concertation parlementaire, les réunions du conseil présidentiel du développement en mai 2023 et du Cicid en juillet 2023 ont consacré une évolution des orientations stratégiques de la politique de développement autour de dix objectifs. Sur la méthode, le Cicid adopte un positionnement plus « partenarial » ou « transactionnel », assumant de placer les priorités stratégiques et thématiques de la France au coeur de son aide à destination des pays en développement, en rupture, selon les termes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, avec une « politique de guichet ».
À cet égard, la priorité accordée à la dimension migratoire est significative : l'objectif n° 10 assigné à la politique d'investissement solidaire (nouvelle dénomination de la politique d'aide au développement) consiste à « aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines ». En ce sens, l'AFD et Expertise France ont été enjoints par un courrier conjoint d'avril 2023 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur de renforcer leurs actions dans ce domaine, notamment sur les piliers 4 et 5 du PACV (lutte contre la traite des êtres humains, d'une part, retour, réadmission et réintégration, d'autre part).
Dans le prolongement des réunions du CPD et du Cicid, un nouveau document stratégique a été élaboré et devrait être prochainement publié par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Préparée par la direction générale de la mondialisation, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030, transmise aux rapporteurs spéciaux, se démarque de la stratégie précédente sur trois points, selon ses auteurs :
- premièrement, la nouvelle stratégie interministérielle intègre les évolutions internationales survenues au cours des dix dernières années, en particulier du fait de l'adoption par les Nations unies de textes structurants de droit international en matière de migrations ;
- deuxièmement, elle prend davantage en compte la dimension européenne du lien entre migrations et développement. Si les deux précédents documents faisaient abstraction de l'échelon européen, la nouvelle stratégie adopte clairement le cadre de référence du Plan d'action conjoint de La Valette et les domaines d'action identifiées par ce dernier ;
- troisièmement, elle s'inscrit dans un cadre interministériel en synthétisant les positions du MEAE et du ministère de l'intérieur ainsi qu'en tendant à proposer une vision unifiée pour l'ensemble des ministères et opérateurs engagés sur cette thématique.
En complément, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 devrait faire prochainement l'objet d'une traduction opérationnelle, au travers d'un plan d'action, en cours d'élaboration.
Les objectifs fixés à la politique
française en matière d'aide au développement
en
matière de migrations, entre 2018 et 2025
|
Cadre |
Principes et objectifs |
|
Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) de 2018 |
« L'aide au développement est un facteur déterminant pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle ce qui contribue à réduire les incitations aux départs par les réseaux de passeurs et, ce faisant, l'immigration irrégulière » (point 9 des conclusions du Cicid) |
|
Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales |
« L'État favorise la cohérence entre les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans la réalisation des ODD dans les pays partenaires, en particulier les politiques sociale, éducative, sportive et culturelle, commerciale, fiscale, migratoire, de sécurité et de défense, de recherche et d'innovation et d'appui aux investissements à l'étranger. » « La France contribue à soutenir le potentiel de solidarité des migrants, notamment par l'appui à la création d'entreprises et à l'investissement productif des diasporas. » (rapport annexé) |
|
Conseil présidentiel du développement et comité interministériel de la coopération internationale et du développement de 2023 |
« Aider nos partenaires à lutter contre les réseaux d'immigration clandestine » (objectif 10 des conclusions du Cicid). |
|
Conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025 |
« Aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines » (objectif 10 des conclusions du conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025) |
Source : commission des finances d'après les documents cités
La prise en compte conjointe des politiques migratoires et de développement s'inscrit dans la rénovation de la dimension extérieure des migrations (DEM), dont l'enjeu principal consiste à assurer la cohérence interministérielle entre le MEAE et le ministère de l'intérieur, sans dissocier les approches sécuritaires, économiques et sociales du développement. La dimension externe des migrations s'organise autour d'une pluralité de volets (politique des visas, attractivité et migrations légales, coopération migratoire au sein de l'APD...). L'articulation migration-développement illustre un jeu complexe de coordination entre deux départements ministériels dont les cultures et objectifs peuvent profondément différer.
Pour assurer cette bonne coordination interministérielle et organiser la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie « migrations et développement », deux instances interministérielles ont été constituées.
D'une part, le comité stratégique migrations (CSM), conjointement présidé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur, est chargé d'assurer la convergence des deux départements ministériels sur la dimension externe des migrations. Son secrétariat général est assuré par l'ambassadeur chargé des migrations. Quatre priorités structurent les travaux de cette instance (le dialogue et les partenariats avec les pays tiers prioritaires, la politique des visas, l'attractivité et migrations légales, les programmes de coopération migratoire au sein de l'aide publique au développement).
Lors de sa réunion du 16 janvier 2023, le CSM a défini, sous l'autorité des deux ministres, une liste de quinze pays prioritaires en matière de coopération migratoire20(*). En cours d'ajustement, cette liste comprend à la fois des pays de transit et des pays de départ. Plusieurs États figurant sur cette liste ont été retenus du fait de l'impact des flux migratoires sur les départements et régions d'outre-mer, comme le Sri Lanka ou les Comores.
D'autre part, le cadre national de suivi (CNS), créé par le Cicid de 2018, constitue l'échelon interministériel de coordination sur la thématique « migrations et développement ». Sous la présidence de l'ambassadeur chargé des migrations, il réunit les administrations compétentes des deux ministères21(*), le secrétariat général des affaires européennes (SGAE), les opérateurs concernés22(*) et des représentants de la société civile. Le CNS est notamment chargé du suivi de la stratégie interministérielle « migrations et développement » et de la préparation du plan d'action censé proposer une traduction opérationnelle de cette dernière.
Cependant, si cette organisation semble séduisante sur le papier, sa mise oeuvre apparait pour le moins sporadique compte tenu de la fréquence des réunions du CSM et du CNS (cf. infra, III).
Or, faute de portage politique, l'ambition affichée par la communication gouvernementale pourrait faire long feu, à l'image de la précédente stratégie « migrations et développement » dont le suivi a rapidement été abandonné.
Organisation de la « comitologie » de la prise en compte des enjeux migratoires dans la politique de développement
Politique de développement Politique Migratoire
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
L'ambassadeur chargé des migrations, ambassadeur thématique crée en 2017 dont les fonctions sont occupées depuis 2024 par M. Cyrille Baumgartner23(*), dispose d'un rôle de coordination de la dimension externe des migrations et ce, à plusieurs niveaux :
- au niveau bilatéral, en plus d'assurer le secrétariat général du CMS et de présider le CNS, l'ambassadeur pilote la « task force migrations » du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et anime le réseau des référents « migrations » présents dans le réseau diplomatique. Conjointement avec le directeur de l'immigration, il est également chargé d'assurer un dialogue de gestion migratoire avec nos ambassades dans les pays prioritaires ;
- au niveau européen, l'ambassadeur chargé des migrations participe à l'élaboration des positions de la France au groupe de travail du Conseil de l'UE sur la dimension extérieure des migrations (External Migration Working Party, EMWP), au groupe de coordination sur les fonds de l'instrument NDICI consacrés aux migrations et au comité de gestion des initiatives équipe Europe (IEE) migratoires, où il assure la représentation de la France ;
- au niveau multilatéral, en lien avec la direction générale de la mondilisation et la direction des Nations unies, il assure le suivi des questions migratoires au sein des enceintes multilatérales.
La prise en compte des enjeux migratoires dans les
politiques
de développement : une approche
comparatiste
En 2024, les services de l'ambassadeur chargé des migrations ont mené un travail de parangonnage après de plusieurs de nos voisins européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse). Trois points de comparaison ont été mis en avant par cette note.
Premièrement, dans la plupart des pays étudiés, les autorités ont adopté une approche globale des enjeux migratoires dans la politique de développement, en se fondant sur le cadre proposé par les cinq domaines d'action de La Valette. Ces approches sont généralement menées, comme en France, par un ambassadeur thématique ou un représentant spécial.
Deuxièmement, en complémentarité de l'aide au développement portée par le budget de leurs ministères des affaires étrangères, certains de nos partenaires ont doté leurs ministères de l'intérieur d'un budget significatif en matière de coopération internationale. En Allemagne et en Italie, les ministères de l'intérieur disposaient, en 2023, d'enveloppes de coopération respectives de 45,1 et de 49 millions d'euros.
Troisièmement, le cadre européen constitue, pour la majorité de nos partenaires européens, le principal échelon de référence pour la définition et la mise en oeuvre d'actions concertées en matière de dimension extérieure des migrations. Au surplus, plusieurs de nos partenaires contribuent financièrement aux actions portées par les organisations internationales compétentes dans le champ migratoire.
Source : commission des finances d'après l'étude comparative menée par l'Ambassadeur des migrations
C. UNE COMPTABILISATION STRICTE DES PROJETS MIGRATOIRES DANS L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
Le domaine des migrations constituant un champ d'intervention croissant en matière d'aide publique au développement, le Comité d'aide au développement (CAD), instance de coordination des politiques de développement relevant de l'OCDE, a engagé en 2018 une révision de la comptabilisation de ces actions. Auparavant, les projets liés aux migrations ne faisaient pas l'objet de critères spécifiques de comptabilisation et le CAD se référait à la définition générale de l'APD (une dépense dont l'objectif principal est la promotion du développement économique et du bien-être des pays en développement).
Depuis 2018, les actions menées dans le domaine des migrations font l'objet d'un nouveau code de comptabilisation, le code 15 190 « Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable » qui précise leur éligibilité à l'APD. Ce document ne modifie pas la définition de l'aide au développement mais identifie « un ensemble de règles plus claires sur les dépenses liées aux migrations, dans le but de préserver l'intégrité de l'APD »24(*). Il a été complété en 2022 par une série de lignes directrices, à la suite de négociations entre le CAD et les États membres de l'OCDE.
Premièrement, les projets doivent avoir pour objectif principal le développement durable des pays bénéficiaires.
Deuxièmement, les activités de sécurité « dure » sont exclues du champ de l'APD. Aussi, pour la France, les actions de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du MEAE, les opérations civilo-militaires menées dans le cadre des Nations unies, les programmes de renforcement des institutions de l'État ou la coopération policière du Programme des Nations unies pour le développement ou certaines activités des opérateurs du ministère de l'intérieur ne relèvent pas de l'APD. En effet, en dépit d'effets indirects sur le développement, l'objectif principal de ces projets demeure la sécurité nationale des États bailleurs.
Troisièmement, toute action dont le bénéfice principal revient au donateur ne peut être comptabilisée comme de l'APD. Ainsi, certaines activités, menée dans le cadre d'une coopération migratoire avec des pays en développement, peuvent ne pas être comptabilisées en tant qu'APD, dès lors qu'elles entrent dans l'un des champs d'exclusion de l'OCDE. Un projet dont l'objectif principal est de limiter les migrations vers le pays bailleur ne peut être validé.
Selon l'OCDE, ces « règles garantissent que la coopération au développement n'est pas utilisée comme un moyen de promouvoir l'agenda national du pays donateur en matière de migration. »25(*) Pour autant, cela n'exclut pas l'ensemble des projets visant à encadrer les migrations dès lors qu'ils portent un bénéfice mutuel pour le donateur et le bénéficiaire.
Pour diffuser une plus grande compréhension des règles de comptabilisation, l'OCDE a développé une plateforme de contributions alimentée par les États bailleurs et présentant des projets éligibles et non éligibles à la qualification d'APD26(*). Par exemple, un projet financé par la Suisse entre 2020 et 2021 et visant à renforcer les capacités nigérianes de contrôle des frontières ne constitue pas de l'APD, tandis qu'un projet porté par l'Espagne et visant à soutenir le système hospitalier mexicain en raison de l'afflux de migrants durant la crise sanitaire en 2020 sera comptabilisée comme tel.
Illustration des règles
d'éligibilité à l'aide publique au développement
des programmes d'aide au retour et à la
réintégration
II. DES FINANCEMENTS CROISSANTS MAIS UNE STRATÉGIE ENCORE INACHEVÉE DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS
A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT, PORTÉ PAR UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ET DE CANAUX
1. Le total des financements engagés par la France sur la période 2017-2024 en matière migratoire représente plus d'un milliard d'euros
Selon les données transmises par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, sur l'ensemble de la période 2017-2024, qui couvre le déploiement du plan d'action « migrations internationales et développement », le montant total de l'APD française en matière migratoire avoisinait le milliard d'euros : 1,17 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,01 milliard d'euros en crédits de paiement.
Total des financements engagés sur les
programmes 209 et 105
en matière de migrations, sur la
période 2017-2024
(en millions d'euros)
|
|
Programme 209 |
Programme 105 |
|||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
||
|
Crédits bilatéraux |
Dons |
555,06 |
398,22 |
0 |
0 |
|
Prêts |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Crédit multilatéraux |
582,07 |
582,07 |
29,95 |
29,95 |
|
|
Total par programme |
1 137,13 |
980,29 |
29,95 |
29,95 |
|
Note : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023 2024.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Curieusement, d'autres montants ont été évoqués par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères au cours des auditions menées. L'ambassadeur chargé des migrations a ainsi communiqué aux rapporteurs spéciaux le chiffre de 622 millions d'euros de crédits dédiés aux migrations dans l'APD française et bénéficiant aux pays de départ et de transit depuis 2017.
En tout état de cause, ces montants ne rejoignent pas l'objectif de 1,8 milliard d'euros consacrés aux migrations fixé par le plan d'action 2018-2022, a fortiori lorsque l'on se réfère à la stricte période d'application du plan d'action (moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022). Il s'agit toutefois, sur le papier, d'engagements financiers significatifs.
Dépenses d'APD françaises en matière de migrations sur la période 2017-2024
(en millions d'euros et en pourcentage)
Note n° 1 : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023 2024.
Note n° 2 : la présentation se fonde sur l'année de démarrage des projets ou de versement des contributions.
Source : commission des finances
La mise en oeuvre de ces financements a été progressive sur la période 2017-2024, avec un montant annuel ayant plus que quadruplé. Cette progression marquée, à compter de 2019 notamment, s'explique par la hausse soutenue des contributions internationales (détaillée infra).
L'identification par la France de ses
dépenses d'APD
intervenant dans le domaine des migrations
Pour le suivi et l'identification des projets « migrations », le MEAE et les opérateurs de la politique de développement ont développé une méthode de comptabilisation, inspirée de celle utilisée pour les projets de l'instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale (Ndici). Sont comptabilisés comme projets « migrations », les initiatives :
- mises en oeuvre par des acteurs du développement ou de l'humanitaire, qu'il s'agisse d'acteurs institutionnels ou de la société civile ;
- à des fins de développement ou de réponse à des situations d'urgence des pays bénéficiaires ;
- et correspondant à l'un des deux marqueurs retenus, à savoir le marqueur 1 (projets dont les migrations sont un objectif secondaire, comptabilisés à 40 %) et le marqueur 2 (projets dont les migrations sont l'objectif principal, comptabilisés à 100 %).
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
2. Canaux et instruments de la politique de développement de la France en matière migratoire
Comme souvent, dans une approche thématique de l'aide au développement, l'ensemble des acteurs de cette politique, nationaux ou internationaux se trouvent impliqués. Cette fragmentation de l'action publique, qui s'explique par des échelles et des domaines d'action distincts, ne contribue pas à sa lisibilité, d'autant qu'elle conduit fréquemment à des financements croisés et une coordination perfectible.
Répartition des financements engagés
sur la période 2017-2024
en matière de migrations par
canal d'intervention
(en millions d'euros)
Note : ces financements comprennent les crédits de l'Union européenne ou de tiers mis en oeuvre par l'AFD et Expertise France.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Les crédits directement gérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, hors contributions internationales, sont marginalement mobilisés en matière de migrations, l'AFD demeurant le principal canal bilatéral de financement sur cette thématique.
a) Les financements bilatéraux du ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Les crédits directement gérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, hors contributions internationales, sont marginalement mobilisés en matière de migrations, l'AFD demeurant le principal canal bilatéral de financement sur cette thématique.
En premier lieu, le Fonds équipe France (FEF) permet d'appuyer des projets en matière de migrations. Créé en 2023, cet instrument a regroupé l'ensemble de l'aide-projet du ministère et distincte du don-projet de l'AFD. Ces crédits financent des initiatives de taille limitées, sous le pilotage direct des postes diplomatiques. Néanmoins, entre 2023 et 2024, les financements du FEF et des outils antérieurs sont demeurés limités, de l'ordre de 6,33 millions d'euros. La direction de la mondialisation, responsable du programme 209, a indiqué aux rapporteurs spéciaux vouloir prioriser le soutien à des projets FEF en matière migratoire pour les années à venir.
En second lieu, le centre de crise et de soutien (CDCS) du MEAE, centre de gestion de crise et chef de file sur l'action humanitaire de la France, peut mobiliser les crédits du fonds d'urgence humanitaire et de stabilisation (FUHS) pour financer des projets sur cette thématique, dans des contextes d'urgence internationale. Avant l'exercice 2023, le CDCS ne distinguait pas les projets contribuant au sujet migratoire, et le ministère ne dispose par conséquent pas de données antérieures. Toutefois, pour la période 2023-2024, le montant des financements bilatéraux engagés par le centre s'est élevé à 195,2 millions d'euros. À ce volet bilatéral s'ajoutent les financements multilatéraux versés aux organisations internationales évoqués infra.
Répartition géographique des projets financés par le CDCS sur fonds bilatéraux sur la période 2023-2024
(en millions d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
b) Le groupe AFD, acteur majeur de l'APD en matière migratoire
Comme indiqué supra, les différents documents stratégiques ont, depuis 2013, étroitement associé l'Agence française de développement à la prise en compte des questions migratoires. Au total, sur la période 2017-2024, l'AFD a mis oeuvre un total de 433 millions d'euros de financement au titre du budget de l'État. À ces moyens s'ajoutent 227 millions d'euros de financements sur fonds européens dont l'agence a assuré le déploiement.
En matière d'APD, l'une des spécificités de la thématique migratoire tient à la réticence des États bénéficiaires de l'aide à recourir à des instruments de prêts. Selon l'AFD, les autorités locales font face à des difficultés d'ordre politique : s'il est acceptable pour les populations que leur État s'endette pour financer des infrastructures ou des projets de long-terme, s'endetter pour encadrer les migrations est perçu négativement. Pour cette raison, le portefeuille de prêts de l'AFD porte peu sur ce volet qui apparait dès lors moins rentable pour l'agence.
En revanche, s'agissant des subventions, trois canaux de l'agence sont mobilisés :
- l'enveloppe des crédits du don-projet, qui regroupe l'essentiel des subventions délégués à l'AFD et dont la contribution au volet migratoire de notre APD représente 98,2 millions d'euros ;
- le fonds Minka27(*), instrument de l'AFD dédié à la consolidation de la paix dans les zones de conflits, est intervenu à hauteur de 327,8 millions d'euros entre 2017 et 2023. Ces financements, de nature humanitaire, ont essentiellement porté sur les déplacements forcés, thématique sur laquelle l'agence a engagé une évaluation en cours de finalisation ;
- le dispositif I-OSC (pour Initiatives OSC), transféré depuis 2010 à l'agence, qui constitue le guichet de financement des projets portés par des organismes de la société civile.
L'ensemble de ces instruments fait de l'AFD le principal canal bilatéral de l'aide en matière migratoire. Plusieurs facteurs expliquent ma mobilisation significative de cet opérateur en matière d'appui à la gouvernance des migrations, dont :
- tout d'abord, une forte connaissance du terrain et une capacité à répondre aux demandes des autorités locales ;
- ensuite, un positionnement et un mandat clairs sur l'aide au développement, qui font entrer l'ensemble de ses actions dans la comptabilisation de l'OCDE ;
- enfin, une bonne capacité à mobiliser des financements européens, notamment sur la mise en oeuvre d'action relatives aux collaborations avec les diasporas et au soutien aux personnes déplacées (piliers 1 à 3 du PACV).
Les auditions menées par les rapporteurs spéciaux ont mis en évidence une approche traditionnellement mesurée de l'AFD sur la thématique migratoire, en particulier lorsqu'il s'agit de projets liés à l'encadrement des flux.
Dans un esprit de renforcement nécessaire du dialogue entre politiques de développement et politiques migratoires, le courrier conjoint adressé en avril 2023 par les ministres de l'Europe et de l'intérieur au groupe AFD marque une volonté de renforcer la coordination interministérielle sur les enjeux migratoires et d'assurer une meilleure articulation entre les instruments de développement et les priorités diplomatiques et de sécurité.
Par ailleurs, l'Agence française d'expertise technique internationale, « Expertise France », filiale du groupe AFD, participe également à l'action de la France en matière de migrations. Entre 2017 et 2024, Expertise France a mis en oeuvre 192,1 millions de financements dont la quasi-totalité sur fonds européens, cet opérateur se distinguant par sa forte capacité à se positionner sur des appels à projets de la Commission européenne.
Suivant les priorités de la France, le portefeuille d'Expertise France sur les migrations a cependant doublé entre 2024 et 2025. Au total, en 2025, 12 projets sont en cours sur la thématique migratoire, pour un montant de 100 millions d'euros dont 40 % concentrés sur l'espace syro-turc. Cinq axes d'intervention sont privilégiés par Expertise France :
- la promotion des voies légales d'immigration, notamment entre pays du Sud ;
- la gestion intégrée des frontières, ce domaine faisant l'objet d'un partage avec l'opérateur Civipol, en charge de la coopération technique policière. Expertise France conduit par exemple un projet, pour le compte du ministère des Armées, en appui des forces jordaniennes sur la gestion des frontières ;
- la lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains (organisation de la chaîne pénale, prévention du trafic, protection des victimes...), principalement en Afrique de l'Ouest. L'opérateur a été chargé de la mise en oeuvre, entre 2019 et 2024, d'un projet d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée (ALTP), pour 18 millions d'euros, avec un co-financement du Fonds fiduciaire d'urgence (FFU) pour l'Afrique ;
- l'appui au retour et à la réinsertion des migrants, en partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le soutien aux initiatives des diasporas.
c) Le ministère de l'intérieur et ses opérateurs, un engagement quantitativement limité mais qualitativement significatif
Contrairement à d'autres États européens comme l'Allemagne ou l'Italie, le ministère de l'intérieur français ne dispose pas d'une véritable enveloppe financière dédiée à la coopération internationale. La direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère ne dispose que d'un budget très limité (1,5 million d'euros). En revanche, deux opérateurs relevant du champ du ministère de l'intérieur interviennent en matière de migrations et de développement :
- d'une part, l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii), opère en matière d'immigration légale, d'accueil et d'intégration des étrangers en France, de même que l'organisation des retours volontaires ;
- d'autre part, Civipol, opérateur de coopération technique internationale du ministère de l'intérieur, intervient dans le renforcement des capacités policières et sécuritaires dans les pays tiers.
S'agissant du ministère comme de ses opérateurs, une difficulté réside dans la comptabilisation des projets menés au regard des critères fixés par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. En effet, une partie des activités réalisées en matière de coopération migratoire, bien que destinées à des pays en développement, ne peuvent être qualifiés d'aide au développement car elles relèvent des champs d'exclusion définies par l'OCDE. Il s'agit notamment : du renforcement capacitaire (appui aux forces de sécurité dans la lutte contre l'immigration irrégulière), de la coopération policière et de la formation des personnels en matière de surveillance des frontières et de la dotation en matériel de sécurité.
Pour les actions relevant bien de la catégorie d'APD, l'opérateur Civipol constitue un modèle intéressant. Doté du statut de société anonyme, il ne reçoit aucune subvention, ni de la part de l'État ni d'un autre opérateur et finance son activité sur ses seuls produits d'exploitation. L'essentiel des financements mis en oeuvre par Civipol provient des instruments de l'action extérieure de l'Union européenne et, subsidiairement, d'autres entités multilatérales comme le groupe Banque mondiale.
Au total, plus de 80 % du budget mis en oeuvre par Civipol relève du domaine des migrations. Les actions menées se limitent toutefois au pilier 4 du Plan d'action conjoint de La Valette (lutter contre l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic des migrants). En effet, Civipol mène ses actions dans le cadre d'un mandat qui précise ses domaines d'intervention. L'encadrement de son activité vise notamment à organiser une répartition des compétences avec Expertise France sur le reste de la coopération technique28(*). L'Afrique subsaharienne concentre une grande partie des projets menés par Civipol (21 en cours), principalement centrés sur les thématiques d'état civil et de lutte contre la traite des êtres humains.
Détail du portefeuille d'activité de Civipol
(en millions d'euros, nombre de projets et pourcentage)
|
Zones géographiques |
Nombre de projets |
Budget |
|
Pays de départ (Afrique) |
21 |
129,56 |
|
Pays de transit (zone Moyen-Orient / Afrique du Nord) |
6 |
158,18 |
|
Pays de destination (Europe) |
10 |
11,26 |
|
Total |
38 |
289,99 |
|
Contribution migration |
39 % |
81 % |
Source : commission des finances d'après les réponses de Civipol au questionnaire des rapporteurs spéciaux
d) Une mise en oeuvre marginale, par les organisations de la société civile de l'APD française en matière de migrations
Au regard de l'importance des financements de l'APD française ayant transité par des organisations de la société civile entre 2017 et 2023 (soit un total de 3,85 milliards d'euros), la proportion de projets mis en oeuvre par ces acteurs en matière de migrations demeure faible. Seulement 3,2 % des projets, soit 125 millions d'euros, portaient sur cette thématique.
La majorité de ces projets sont mis en oeuvre par des organisations de la société civile opérant pour la protection des personnes déplacées et vulnérables dans des situations d'urgence et, dans une moindre mesure, des organisations de la société civile (OSC) issues des diasporas et intervenant pour financer des projets de développement dans les pays de départ.
Deux mécanismes permettent d'associer ces organismes à la prise en compte des migrations dans la politique de développement :
- d'une part, le dispositif I-OSC de l'Agence française de développement, mentionné supra, permet notamment de soutenir les initiatives des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des migrations ;
- d'autre part, les OSC actives sur cette thématique prennent part au cadre national de suivi (CNS) de la stratégie interministérielle, dès lors qu'elles concourent à la mise en oeuvre de cette dernière.
Il est possible d'expliquer la faible implication des OSC sur la thématique migratoire par une réticence traditionnelle de ces structures, soit qu'il ne s'agisse pas de leur domaine d'intervention, soit pour des raisons philosophiques. L'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales consacre d'ailleurs un droit d'initiative des OSC, qui confirme le libre choix de leurs thématiques d'intervention29(*).
À l'occasion des débats ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, Coordination SUD, qui assure la représentation de nombreuses ONG françaises, avait publié une tribune dénonçant une possible conditionnalité de l'APD française30(*).
3. Un recours significatif aux organisations internationales
Près de la moitié de l'aide au développement de la France en matière migratoire (48,9 %) transite par le canal multilatéral, avec 636,93 millions d'euros sur la période 2017-2024. L'essentiel de ces contributions a été porté par le programme 209 de la mission « Aide publique au développement », à hauteur de 616,5 millions d'euros, le reste reposant sur des crédits du programme 105 de la mission « Action extérieure de l'État », pour 20,4 millions d'euros.
En matière de migrations, les contributions internationales de la France sont principalement dirigées vers le « système des Nations unies » et ce, dans deux domaines : d'une part, l'action humanitaire (assistance aux personnes déplacés et aide aux retours des réfugiés) et, d'autre part, en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants.
Elles transitent par deux « guichets » du ministère de l'Europe et des affaires étrangères :
- la direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie, au travers de ses contributions volontaires aux institutions multilatérales, inscrites sur le programme 209 et le programme 105. Une partie de ces versements peut être conjointement suivie par la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement (ASD) pour les sujets de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants ;
- le centre de crise et de soutien (CDCS), qui assure la gestion du Fonds d'urgence humanitaire et de stabilisation (FUHS), dont les crédits peuvent contribuer à des actions d'urgence mises en oeuvre par des organisations internationales.
Dans une logique de « bilatéralisation » des contributions multilatérales à ces organisations internationales, une partie des contributions volontaires de la France dans le domaine des migrations fait l'objet d'un « fléchage » sur nos priorités thématiques et géographiques. Traditionnellement rétive à la pré-affectation de ses contributions par rapport à ses partenaires britanniques ou allemands31(*), la France a désormais davantage recours au fléchage. En matière migratoire, cette évolution est confirmée par le fléchage quasi-intégral de la contribution de la France à l'Organisation internationale des migrations (OIM) pour laquelle les financements français sont orientés vers des projets de stabilisation et d'accompagnement au retour des réfugiés en Ukraine, en Tunisie, à Haïti et au Liban.
À noter que, si les agences et programmes de l'Onu ont bénéficié de la quasi-totalité des versements français sur la période 2017-2024, des financements ont également été apportés à des organismes relevant de ce que la Cour des comptes qualifie d'« autres entités », à savoir, des dispositifs spécialisés, généralement reliés de manière formelle aux Nations unies, mais qui en pratique fonctionnent de manière indépendante32(*). La multiplication de ces entités soulève un risque de dispersion de l'aide et de doublonnage de l'action internationale. La France a ainsi pu contribuer, pour de faibles montants, au Forum mondial sur la migration et le développement et au Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire pour la migration, deux instruments spécialisés associés à l'OIM.
Organismes bénéficiaires des
contributions internationales de la France
en matière migratoire sur
la période 2017-2024
(en millions d'euros)
|
Organisme |
Montant des contributions sur la période |
|
Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) |
0,4 million d'euros |
|
Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) |
549,6 millions d'euros |
|
Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire pour la migration |
3,4 millions d'euros |
|
Organisation internationale des migrations (OIM) |
75,5 millions d'euros |
|
Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) |
3,3 millions d'euros |
|
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) |
0,2 million d'euros |
|
Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (PDD) |
3,8 millions d'euros |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire de contrôle des rapporteurs spéciaux
Deux organisations internationales ont bénéficié de la grande majorité des financements de la France sur le volet migratoire.
D'une part, pour les exercices 2023 et 2024, la France a contribué aux activités du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à hauteur de 120 millions d'euros. En particulier, une part des financements français au HCR était ciblée sur la Syrie et son environnement régional, afin de soutenir la réinstallation des réfugiés syriens dans leur pays. Doté d'un budget de 8,6 milliards de dollars en 2019, le HCR a pour mission d'assurer la protection internationale des réfugiés qui ne bénéficient pas de la protection de leur pays d'origine, en veillant à la mise en oeuvre de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967.
Pour autant, l'augmentation soutenue de la contribution de la France s'inscrit, à titre principal, dans le cadre du renforcement du volet humanitaire de l'aide française, et non dans son volet migratoire33(*). Certes, les actions humanitaires ainsi financées contribuent à limiter les déplacements de populations et à accompagner le retour des réfugiés vers les pays d'origine ; mais cet exemple illustre le chevauchement des objectifs de notre politique de développement, sans véritable priorisation.
D'autre part, la France a contribué, entre 2017 et 2024, à hauteur de 75,5 millions d'euros à l'Organisation internationale des migrations (OIM), reconnue cheffe de file des Nations unies pour les questions migratoires depuis 2013.
À l'inverse du HCR, la contribution de la France à l'OIM a marqué un recul au cours des derniers exercices, du fait du recentrement de nos versements internationaux. De fait, dans un contexte budgétaire contraint et à la suite des observations de la Cour des comptes34(*) et de la commission des finances du Sénat35(*), le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a engagé une rationalisation des contributions internationales. Les lois de finances pour 2024 puis 2025 ont ainsi prévu une forte contraction du volet multilatéral du programme 209. La participation de la France à l'OIM est, par conséquent, passée de 19,5 millions d'euros à 8 millions d'euros entre 2023 et 2024.
L'Organisation internationale des migrations
Créée en 1951, l'Organisation internationale des migrations (OIM) est une organisation intergouvernementale, reconnue depuis 2013 comme cheffe de file sur les questions migratoires et, depuis 2016, comme une agence apparentée aux Nations unies. Son siège est situé à Genève et sa direction assurée, depuis mai 2023, par Mme Amy Pope, ancienne conseillère principale du président Biden sur les migrations.
L'OIM intervient pour venir en aide aux migrants et aux États en élaborant des réponses intégrées aux problématiques migratoires. Elle assure également la promotion de la coopération internationale sur les questions de migration, par le renforcement de l'état civil et des services de contrôle frontalier, la prise en compte des liens entre climat et mobilité et la prise en compte de la dimension de genre.
Le plan stratégique 2024-2028 consacre trois priorités pour l'action de l'organisation :
- sauver des vies et protéger les personnes en déplacement (action humanitaire et protection des personnes déplacées) ;
- trouver des solutions aux déplacements (action sur les causes profondes et aide au retour et à la réinstallation) ;
- faciliter des voies de mobilité régulière, tout en réduisant l'immigration irrégulière.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
4. L'aide de la France se prolonge par le canal européen au travers de deux instruments financiers
Pour assurer la mise en oeuvre des orientations du plan d'action de La Valette, l'Union européenne s'est dotée de deux instruments financiers distincts.
En premier lieu, le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique (FFU)36(*) a été créé en 2016 pour une durée de cinq ans. Ce mécanisme37(*), spécifiquement destiné à financer des actions relatives aux migrations et aux déplacements forcés, a été doté d'une enveloppe de cinq milliards d'euros répartie entre 4,4 milliards d'euros de fonds européens et 500 millions d'euros financés par les États membres. Arrivé à échéance en 2021, le FFU ne finance plus de nouveaux projets mais les initiatives en cours ne devraient cesser qu'à la fin de l'année 2025.
Son action s'est concentrée sur trois régions, jugées prioritaires par les États membres de l'Union : la zone Sahel-Lac Tchad (2,2 milliards d'euros sur cinq ans), la zone Corne de l'Afrique (1,8 milliard d'euros) et la zone Afrique du Nord (907 millions d'euros).
En second lieu, au sein du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale « l'Europe dans le monde » (Ndici) a succédé au FFU, avec une enveloppe totale de 79,5 milliards d'euros. Contrairement au FFU, le Ndici ne constitue pas un instrument uniquement consacré aux questions migratoires mais couvre l'ensemble des priorités de l'action extérieure de l'Union. Toutefois, les États membres ont fixé une cible de 10 % des fonds devant être consacrés à la gouvernance des migrations soit environ huit milliards d'euros, ce quota étant vérifié par un système de marqueurs « migrations »38(*). Si le Ndici entend s'inscrire dans la continuité des objectifs du plan d'action conjoint de La Valette, il n'a prévu aucune clé de répartition entre les cinq domaines du plan d'action au sein de la cible des 10 %. La Commission européenne, dans ses prévisions initiales publiées en 2021, estimait que cette enveloppe serait ventilée entre l'Afrique subsaharienne (3,24 milliards d'euros), le Moyen-Orient (1,67 milliard d'euros), l'Asie-Pacifique (1,19 milliard d'euros), l'Afrique du Nord (1,13 milliard d'euros), le voisinage oriental (398 millions d'euros) et la zone Amérique-Caraïbes (126 millions d'euros).
Au cours des trois premières années de mise en oeuvre39(*), sous la pression des États membres, soucieux d'investir davantage dans le domaine migratoire, la cible de financement « migrations » a été portée à 15 % des montants alloués par le Ndici.
À noter que l'allocation des fonds dans le cadre du Ndici doit, selon le règlement encadrant cet instrument, répondre aux critères de classification de l'aide publique au développement. Ainsi, 93 % des financements Ndici doivent être éligibles à la comptabilisation en APD telle que définie par le Comité d'aide publique au développement (CAD) de l'OCDE. Un reliquat de 7 % de l'enveloppe totale peut dont financer des projets non éligibles à la qualification d'aide au développement, tels que des actions de renforcement de la sécurité intérieure dans les pays de départ ou de transit. De plus, au sein du Ndici, la Commission dispose d'une « mécanisme flexible » permettant la mise en oeuvre d'une approche flexible et incitative pour la conduite du dialogue migratoire. Doté de 600 millions d'euros, cet instrument est directement géré par la Commission européenne et les projets financés dans ce cadre ne sont pas soumis à la comitologie classique, ce qui opacifie son fonctionnement pour les États membres.
Outre ces deux instruments principaux, d'autres mécanismes européens ont pu participer à l'effort de développement en matière migratoire, dont :
- la Facilité de l'UE pour les réfugiés syriens en Turquie (FriT), créée en 2015 à l'initiative de la Commission européenne et initialement dotée de 6 milliards d'euros jusqu'en 2021 ;
- et le Fond « Asile, Migration et Intégration » (FAMI), qui a pu financer des projets d'accueil et d'assistance aux réfugiés en provenance d'Ukraine après le déclenchement de l'agression russe.
Au total, sur la période 2017-2024, les opérateurs français accrédités auprès de la Commission européenne (Agence française de développement, Expertise France et Civipol) se sont imposés comme les deuxièmes bénéficiaires de fonds européens en matière de migrations, derrière l'agence allemande de coopération (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Le seul groupe AFD a mis en oeuvre un total de 227 millions d'euros sur la période.
B. UNE ÉVALUATION DIFFICILE DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCE EN MATIÈRE MIGRATOIRE
1. Des orientations géographiques et thématiques identifiables...
Premièrement, il est possible d'identifier les orientations géographiques des projets d'aide au développement financés par la France en matière de migrations. De fait, l'immense majorité de l'aide est dirigée vers le Proche et Moyen Orient (48 %) et vers l'Afrique (38 %). Ces zones concentrent à la fois une majorité des pays de départ vers l'Europe et une part significative des pays de transit (Afrique du Nord et Turquie notamment). De fait, plus d'un tiers du total des réfugiés dans le monde vivait en Afrique subsaharienne en 2022, selon le HCR.
Répartition géographique de l'APD
française en matière de migrations
sur la période
2017-2024
(en pourcentage)
Note : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023-2024.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Toutefois, cette répartition géographique de l'aide en matière migratoire dénote avec les objectifs géographiques fixés à notre politique de développement par ses instances de pilotage. Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement a, depuis 2013, défini et actualisé à plusieurs reprises une liste des pays prioritaires en matière d'APD, toutes thématiques confondues40(*). Lors de la réunion du Cicid du 8 février 2018, une liste de 19 pays41(*), essentiellement situés en Afrique (à l'exception d'Haïti), a été adoptée. Elle a finalement été abandonnée par le Cicid, lors de sa réunion de juillet 2023, au profit d'une cible de 50 % de l'effort financier bilatéral de l'État vers les pays les moins avancés (PMA)42(*), portée à 60 % par le conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025 qui y a également inclus les pays à forte vulnérabilité43(*). À cette cible générale, s'ajoute une liste de quinze pays prioritaires en matière migratoire, retenue par le comité stratégique migration en 2023.
Financements engagés par la France en matière de migration dans les pays prioritaires de la politique de développement sur la période 2017-2024
(en millions d'euros)
|
Catégories de pays |
Financements engagés par la France |
|
19 pays prioritaires identifiés par le Cicid jusqu'en 2023 |
147,43 millions d'euros |
|
Catégorie des « pays les moins avancés » identifiés par l'Onu |
203,5 millions d'euros |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Ces cibles géographiques, qui suivent la répartition de l'aide française plus qu'elles ne l'orientent véritablement, n'apparaissent pas véritablement respectées en matière migratoire. Sur l'ensemble de la période 2017-2024, hors projets du CDCS, les financements apportés aux 19 pays prioritaires du Cicid et aux PMA apparaissent largement minoritaires. Sur les quinze pays ayant reçu le plus de financements français en matière de migrations (voir tableau infra), sur la même période, seulement six figurent sur la liste des PMA. Les trois premiers bénéficiaires sont des pays à revenus intermédiaires.
Cette contradiction entre la priorité thématique accordée par la France au sujet migratoire et la cible géographique qu'elle s'est fixée pour orienter son aide peut s'expliquer par la structure même des flux migratoires. Mme Flore Gubert, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), souligne un paradoxe : les pays les moins avancées ne sont pas les plus gros pourvoyeurs de migrants vers la France. Seuls quelques PMA (Guinée, Mali et Sénégal) se caractérisent par des flux migratoires notables.
Expertise France, auditionné par les rapporteurs, a également mis en avant ce paradoxe qui se traduit, pour l'opérateur, par une difficulté à concilier la priorité accordée aux migrations dans la politique de développement avec le recentrement de cette dernière sur les pays les moins avancées et les pays vulnérables dans son portefeuille de projets. L'opérateur a souligné que le financement de la gouvernance des migrations ne pouvait faire abstraction de pays à revenus intermédiaires comme la Côte d'Ivoire et le Kenya, qui constituent des pôles d'attractivité pour les migrations sud-sud.
Aperçu des quinze premiers pays
bénéficiaires d'aide publique
au développement en
matière de migrations sur la période 2017-2024
(en millions d'euros)
|
Pays |
Financements français |
Financements européens |
Total des financements perçus sur la période 2017-2024 |
|
Liban |
195,35 |
41,20 |
236,55 |
|
Ukraine |
89,15 |
- |
89,15 |
|
Jordanie |
53,32 |
- |
53,32 |
|
Afghanistan |
49,25 |
- |
49,25 |
|
Tchad |
49,10 |
- |
49,10 |
|
Irak |
25,82 |
- |
25,82 |
|
Sénégal |
19,03 |
11,86 |
30,89 |
|
Mauritanie |
18,80 |
- |
18,80 |
|
Burkina Faso |
17,11 |
- |
17,11 |
|
République centrafricaine |
16,23 |
- |
16,23 |
|
Cameroun |
16,17 |
0,83 |
17,01 |
|
Soudan |
15,65 |
4,10 |
19,75 |
|
République démocratique du Congo |
15,13 |
- |
15,13 |
|
Tunisie |
15,01 |
16,53 |
31,54 |
|
Syrie |
13,49 |
- |
13,49 |
Note : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023-2024.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Deuxièmement, cette orientation géographique découle également de la nature de l'aide apportée par la France.
Une distinction selon le caractère de l'aide (humanitaire ou de développement strico sensu) peut, en effet, être effectuée. Selon le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, l'aide humanitaire vise à « assurer l'assistance et la protection des personnes vulnérables et à répondre aux besoins fondamentaux des populations affectées par une catastrophe naturelle ou un conflit ». Il s'agit d'une aide d'urgence, devant intervenir dans des délais courts, systématiquement dans des contextes de crise ou de post-crise. Outre un objectif de protection des personnes vulnérables, l'aide humanitaire peut répondre à d'autres orientations de l'APD (sécurité alimentaire, protection de l'enfance, égalité homme-femme, protection des personnes déplacées...).
En ce sens, la progression des financements d'aide au développement dans le domaine des migrations entre 2017 et 2024 est concomitante d'une forte progression de l'aide humanitaire sur la même période (voir graphique infra). De plus, une part significative de l'aide apportée dans le domaine des migrations relève de l'aide humanitaire, parmi lesquelles :
- les financements mis en oeuvre par le centre de crise et de soutien pour assurer la protection des personnes déplacées dans des zones de crise ;
- le dispositif d'aide alimentaire programmée (AAP), outil de réponses à des situations d'urgence et de moyen terme en matière d'insécurité alimentaire et de malnutrition, sur lequel 35 millions d'euros en 2022 et 63 millions d'euros en 2023 ont été mobilisés sur la thématique migratoire ;
- les contributions multilatérales à des organisations internationales menant des actions d'urgence humanitaire. Ainsi, l'augmentation de la contribution française au Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, s'inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire de la France et non pas dans le cadre de sa politique migratoire, même si cette réponse humanitaire peut contribuer à réduire les flux migratoires vers l'Europe, selon le MEAE ;
- les financements du fonds Minka de l'AFD.
Mise en perspective de la progression des financements en matière de migrations avec la progression des financements humanitaires sur la période 2017-2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux et les documents budgétaires
Il apparaît ainsi que c'est l'investissement conséquent de la France en matière humanitaire, plus qu'une priorisation de la thématique migratoire, qui peut expliquer la hausse continue des financements labellisés « migrations ».
Cela ne signifie pas pour autant que ces financements ne correspondent pas à un véritable effort dans le domaine migratoire. En effet, l'action humanitaire permet, dans une certaine mesure, de contribuer à une stabilisation des personnes déplacées. Les projets soutenus par la France, soit par le CDCS soit au travers d'organisations d'internationales ou d'OSC, aident les populations déplacées à rester à proximité de leur pays, dans l'attente d'un retour volontaire et sûr. Dans le même sens, les actions de stabilisation, menées dans un contexte post-crise, et visant à soutenir les secteurs de la santé ou de l'agriculture ou l'aide à la relance des missions régaliennes de l'État contribuent à rétablir les conditions d'un retour durable. Toutefois, l'aide humanitaire d'urgence ne peut être considérée comme une modalité d'encadrement des flux migratoires.
Troisièmement, l'analyse des projets menés entre 2017 et 2024 permet de repérer leur répartition entre les domaines d'intervention du Plan d'action conjoint de La Valette. Sans surprise et dans le prolongement des développements précédents, la majeure partie des projets (68,7 %) comme des financements (48,9 %) relèvent du troisième pilier consacré à la garantie des droits et la protection des personnes déplacées. C'est dans ce domaine que s'inscrivent les financements humanitaires.
En revanche, les piliers 4 (lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants) et 5 (aide au retour) représentent une part beaucoup plus faible des financements octroyés par la France (respectivement 5 % et 2,3 %). Il s'agit pourtant des domaines d'action que les précédents gouvernements ont déclaré prioritaires et qui correspondent à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (« aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines »).
|
Répartition du nombre de projets
financés entre 2017 et 2024 selon les piliers (en pourcentage) |
Répartition des financements entre
2017 et 2024 (en pourcentage) |
|
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux |
2. ...pour un impact difficilement mesurable, faute de pilotage et d'une évaluation du plan d'action « migrations et développement » 2018-2022
Au-delà de l'absence d'atteinte de l'objectif chiffré de 1,8 milliard d'euros consacré aux migrations sur la période 2018-2024 (limité à un milliard sur la période 2018-2024 et moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022), la mise en oeuvre du précédent plan d'action 2018-2022 soulève plusieurs difficultés.
En premier lieu, l'application du plan d'action s'est faite, semble-t-il, en l'absence d'un véritable suivi ou d'un portage au plus haut niveau. Un cadre national de suivi, de coordination et de concertation (CNS), présidé par l'ambassadeur chargé des migrations et dont le secrétariat général était assuré par l'AFD, avait bien été mis en place avec l'objectif de se réunir annuellement. Toutefois, rien n'indique que le CNS se soit réuni effectivement régulièrement. Une évaluation des travaux de l'AFD en matière migratoire a pu souligner que « les travaux du CNS n'ont pas pris une dimension suffisamment opérationnelle, c'est-à-dire inscrite dans les projets. Les échanges sont devenus plus verticaux avec les prises de parole de l'ambassadeur chargé des migrations et du directeur général adjoint de l'AFD. »44(*) De plus, l'impression d'un abandon du plan d'action en cours d'application se trouve confortée par l'absence de mention de ce document ou de ses apports dans les conclusions du comité interministériel de la coopération internationale et du développement de juillet 2023.
Un bilan annuel du plan d'action a bien été réalisé45(*), limité à un recensement du nombre de projets, en cours de réalisation ou de contractualisation, correspondant à une méthode de comptabilisation ad hoc46(*), distincte de celle désormais utilisée, sur le modèle des pratiques du Ndici et présentée supra. De manière générale, les données transmises par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères correspondent à une méthodologie récente de comptabilisation des projets. Le risque d'une comptabilisation a posteriori est d'intégrer des projets qui n'ont pas forcément de liens directs avec la problématique migratoire et surtout, qui n'ont pas été pensés en prenant en compte les enjeux migratoires. Pour les projets mis en oeuvre par le centre de crise et de soutien, cette labellisation n'a pu être effectuée que pour les années 2023 et 2024, faute d'intégration préalable des marqueurs « migrations ».
Cependant, l'absence d'un portage global n'a pas empêché le développement d'instruments plus ciblés géographiquement. Ainsi, la France, au travers de l'AFD, a engagé un partenariat spécifique et pluriannuel avec l'Union des Comores, le plan de développement France-Comores (PDFC). Le montant élevé des engagements de l'AFD, soit 150 millions d'euros, au regard du produit intérieur brut des Comores (1,42 milliard d'euros en 2024 selon la Banque mondiale), s'explique par l'importance des enjeux migratoires dans la relation bilatérale.
Le plan de développement France-Comores
(PDFC) :
un partenariat à l'impact incertain
Depuis 2019, les projets de l'Agence française de développement aux Comores s'inscrivent dans le cadre d'un plan de développement France-Comores, dont l'ambition est la construction d'une relation transactionnelle associant la lutte contre l'immigration irrégulière et aide au développement.
Les actions de l'AFD aux Comores se concentrent ainsi sur les causes profondes des migrations avec pour objectif de lutter contre les fragilités à l'origine des départs et d'offrir des alternatives aux migrations irrégulières. Une priorisation géographique et est opérée, avec un ciblage sur l'île d'Anjouan, principal site de départ des migrations.
S'agissant des thématiques retenues, une dizaine de secteurs à fort impact socio-économique se partagent les financements, dont : l'éducation et la formation (65,5 millions d'euros), le développement économique (59 millions d'euros), la santé (58,5 millions d'euros), la biodiversité (22,6 millions d'euros), la gouvernance (20,3 millions d'euros) et l'eau et l'assainissement (12,2 millions d'euros).
Au total, le portefeuille de l'AFD aux Comores comprend 25 projets en cours, pour un montant de 243 millions d'euros dont 150 millions d'euros au titre du seul PDFC. Les projets d'infrastructures les plus importants devraient s'achever en 2028.
Sans contrefactuel, il est délicat d'évaluer la contribution du PDFC à la réduction de l'immigration irrégulière vers Mayotte. Les projets menés contribuent au développement de l'archipel mais il paraît extrêmement difficile de quantifier le nombre de départs évités. L'ambassadeur de France aux Comores, entendu par les rapporteurs spéciaux, reconnaît des résultats limités en termes de développement.
L'impact du PDFC sur la coopération bilatérale avec les autorités comoriennes n'a également rien d'évident. Le PDFC se caractérise par l'absence de toute conditionnalité effective dans le versement des fonds. Ainsi, à trois reprises, en 2018, 2020 et 2023, le gouvernement comorien a unilatéralement interrompu les éloignements depuis Mayotte pendant six mois, sans que cela affecte la mise en oeuvre du PDFC47(*).
Le cabinet du ministre délégué chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux de France a, lors de son audition, défendu l'approche du PDFC. En proposant des financements croissants à son voisin, le PDFC constituerait une incitation pour les Comores à davantage contrôler les départs. Une approche plus restrictive, reposant sur un strict conditionnement des versements, serait moins efficace.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
En second lieu, le plan d'action « migrations et développement » n'a fait l'objet d'aucun bilan ni évaluation, contrairement à ce qui était prévu dans sa programmation initiale. En ce sens, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dans les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux, indiquent simplement que « les programmes mis en oeuvre dans le cadre du plan d'action « Migrations internationales et développement » 2018-2022 ont fait l'objet de suivi et d'évaluation individuels. Toutefois le plan d'action n'a pas été évalué dans son intégralité. »48(*)
Interrogée sur ce point, à l'occasion de leurs auditions respectives, la direction générale de la mondialisation comme les cabinets ministériels ont souligné qu'une telle évaluation semblait inutile tant le plan d'action était apparu dépassé par l'évolution du contexte européen et international. Il n'aurait ainsi pas pris en compte les apports du Plan d'action conjoint de La Valette (2015), du Pacte mondial sur les réfugiés et du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMR et PMM, 2018) ainsi que des travaux réalisés dans le cadre de la présidence française du Processus de Rabat (2019-2020) et du Forum mondial sur la migration et le développement (2022-2024).
Outre qu'une partie des travaux cités étaient déjà publiés (s'agissant du PACV de 2015) ou engagés (concernant le PMR et le PMM de 2018) lors de son lancement, l'évolution du contexte international ne suffit pas à écarter la nécessité d'une évaluation. Par comparaison, en matière d'aide humanitaire, la stratégie humanitaire de la République française 2018-2022 a, quant à elle, bien fait l'objet d'un bilan de ses engagements, remis en 202349(*). Réalisée par un think tank indépendant spécialisé sur les questions de développement, cette évaluation avait permis d'identifier les réalisations et points d'amélioration, dans la perspective de la rédaction d'une nouvelle stratégie humanitaire. Un tel exercice paraissait transposable à la thématique migratoire.
En tout état de cause, la réticence du ministère à mener ce travail de bilan conforte l'impression d'un suivi pour le moins perfectible des engagements du précédent plan d'action « migrations et développement », d'une part, et de la prévalence d'un objectif de moyens sur un objectif de résultat, d'autre part. Refuser de réaliser une évaluation sous prétexte que les conclusions seraient nécessairement défavorables ne paraît pas constituer une bonne pratique administrative.
L'absence de pilotage et de réalisation d'un bilan du plan d'action 2018-2022 ne signifie pas qu'aucune évaluation des projets n'a été réalisée sur la période. L'ensemble des projets fait, par principe, l'objet d'une évaluation par le pôle de l'évaluation et de la performance du MEAE, pour les projets relevant du ministère, par l'unité d'évaluation des activités de développement du ministère de l'économie et des finances ou par le département de l'évaluation et de l'apprentissage de l'AFD. Mais ce suivi individuel des projets ne permet pas de mesurer l'investissement total réalisé sur la thématique des migrations.
De manière générale, la mesure de l'impact des projets « migrations » sur les flux en provenance des pays bénéficiaires de l'aide est complexe, d'autant que l'impact positif de ces programmes est inséparable de la qualité du dialogue politique dans sa globalité dans lequel ils s'insèrent : la détérioration du dialogue politique peut avoir des incidences négatives avérées sur les flux migratoires et la coopération en matière de retour. Ce fut notamment le cas durant les périodes d'interruption totale ou partielle des reconduites depuis Mayotte vers les Comores en 2018, 2020 et 2023.
Seule l'Agence française de développement a engagé une évaluation de son action en matière de migrations pour la période 2016-202450(*). Ses conclusions dressent un bilan majoritairement négatif, malgré les atouts dont disposent l'agence pour investir le champ des migrations51(*) :
- premièrement, la thématique des migrations a été peu investie au-delà de personnels spécialisés sur cette question. Une fois la première impulsion donnée, sous pression de la tutelle, à partir de 2018 le portage de la direction générale a été limité par rapport à d'autres sujets. La mission d'évaluation concluant que « cinq ans après le transfert de mandat, on ne peut que constater un décalage entre les ambitions stratégiques affichées en 2018 et l'investissement et le portage beaucoup plus limités qui se sont ensuivis » ;
- deuxièmement, les ambitions affichées ont été freinées par le manque de ressources internes pour traiter de cette thématique et la réticence de l'agence à s'engager auprès des postes diplomatiques pour porter cette thématique sur un plan plus politique avec les pays bénéficiaires ;
- troisièmement, le rapport d'évaluation se montre sceptique sur la logique de « labellisation » de projets en lien avec les migrations, constatant « que le portefeuille des opérations AFD « labellisées » migrations recouvre des degrés de connexion très variés avec la thématique « Migrations », ce qui limite sa cohérence d'ensemble » et estimant que, sur certains projets, la dimension migratoire n'est que très accessoire. »
Au total, la difficulté à réaliser un suivi d'ensemble se retrouve sur la plupart des priorités thématiques de notre APD : le suivi est réalisé par opérateur et par dispositif. Les documents budgétaires, qu'il s'agisse des projets et rapports annuels de performances comme du document de politique transversale, n'isolent ni les grandes thématiques ni les géographies de l'aide apportée par la France. Pour les parlementaires comme pour le public, il est presque impossible, dans la construction du budget de la mission comme dans son exécution, de retracer ces grands objectifs. Ce suivi ne peut être réalisé que partiellement et a posteriori ; généralement deux ans après l'exécution lorsque ces dépenses ont été validées par le CAD de l'OCDE. Il est alors possible d'identifier, grâce à la plateforme aide-developpement.gouv.fr52(*), les dépenses d'APD par secteur et géographie. Toutefois, les migrations ne figurent pas dans les onglets de la plateforme et la qualité du remplissage des données n'est pas forcément au rendez-vous.
L'évaluation de l'APD européenne en matière de migrations
Les deux principaux instruments de l'aide publique au développement de l'Union européenne en matière migratoire, le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique (FFU) et le Ndici, ont chacun fait l'objet d'une évaluation récente.
En premier lieu, la Cour des comptes européenne, après un premier rapport en 2018, a évalué les résultats du FFU en 202453(*). Fin 2023, sur une enveloppe de cinq milliards d'euros près de 4,8 milliards avaient été consommés et 80 % alloués aux zones « Sahel et Lac Tchad » et « Corne de l'Afrique ». La Cour des comptes européenne a toutefois constaté, pour une part des projets, une absence de ciblage et d'adéquation sur les priorités stratégiques du fonds.
L'auditeur européen relève à cet égard deux points, également applicables à l'aide française en matière migratoire :
- d'une part, « les objectifs et les priorités du fonds ont conservé une formulation aussi générale que possible, de sorte que la plupart des actions puissent être considérées comme éligibles », renforçant ainsi un risque de labellisation artificielle ;
- d'autre part, les actions relevant du domaine humanitaire représentent une part disproportionnée des financements du FFU (48,5 % des engagements sur la zone sahélienne et la Corne de l'Afrique), alors que cet instrument n'est pas prioritairement orienté vers la stabilisation.
Le suivi et l'évaluation des projets sont également apparus perfectibles pour la Cour qui relève que les mécanismes de détection et de réaction aux atteintes aux droits de l'homme demeurent insuffisants. De manière générale, elle estime que « les données disponibles restent insuffisantes pour démontrer que le FFU pour l'Afrique remédie aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de manière durable. » D'un point de vue pratique, la majeure partie des évaluations n'a été disponible qu'à l'issue de l'engagement des fonds du FFU.
En second lieu, une série d'initiatives « Équipe Europe », financées par le Ndici dans le domaine migratoire entre 2021 et 2024 sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale ont fait l'objet d'une évaluation par le cabinet Altai54(*). Cette évaluation est d'autant plus intéressante qu'une part significative des engagements financiers reposait sur les États membres (4,3 milliards d'euros sur un total de 8,4 milliards d'euros). L'évaluation se penche notamment sur la répartition des projets selon la classification du PACV :
- d'une part, un fort investissement sur le pilier 2 (protection) et le pilier 3 (lutte contre les migrations irrégulières et les trafics) respectivement de l'ordre de 40 % et 34 % des financements. Comme dans le cas de la France, la part substantielle de projet relevant du pilier 2 s'explique par une multiplication des crises régionales et l'augmentation du nombre de personnes déplacées, suscitant un accroissement des besoins d'aide humanitaire. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, la plupart des fonds a été orienté vers l'Afrique du Nord afin de soutenir les pays de transit dans la gestion de leurs frontières ;
- d'autre part, un effort nettement plus faible sur les piliers 1 (mobilité légale) et 5 (lutte contre les causes profondes), avec respectivement 7 % et 2 % des financements. S'agissant des mobilités légales, ce moindre financement peut s'expliquer par la préférence des États européens pour le canal bilatéral. Pour autant, ces faibles montants pourraient être perçues négativement par les États bénéficiaires, soucieux de développer ces voies de mobilité. Concernant le pilier 5, l'évaluation souligne la difficulté à cadrer les critères de définition des projets, dont beaucoup n'ont pas de lien direct avec les migrations.
En outre, l'évaluation note un recul des financements en matière de retours et de réintégration, ce qui paraît dommageable pour l'action de l'Union en la matière, alors que les États bénéficiaires multiplient les demandes de renforcement de leurs capacités internes.
Source : commission des finances d'après la Cour des comptes européenne, le cabinet Altai et les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
III. ALORS QUE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT PÂTIT DES RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES, LA PRIORITÉ ACCORDÉE AUX MIGRATIONS DEVRA FAIRE L'OBJET D'UN SUIVI PLUS POUSSÉ
A. LA BONNE MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT » 2024-2030 IMPLIQUERA CERTAINES ADAPTATIONS
1. La dimension migratoire de notre APD doit être clarifiée et articulée avec les autres priorités, parfois contradictoires, de cette politique
À l'issue des auditions menées, les rapporteurs spéciaux estiment que deux éléments doivent être clarifiés par le Gouvernement sur la prise en compte des enjeux migratoires dans l'aide publique au développement.
En premier lieu, il est préoccupant de constater que dix ans après la signature du plan d'action conjoint de La Valette, les ministères en charge de cette politique ne soient pas en mesure d'établir clairement de quels enjeux migratoires parler.
D'un côté, le comité interministériel de la coopération international et du développement de juillet 2023 a adopté une approche restrictive des enjeux migratoires en fixant un objectif de lutte contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines (objectif n° 10 du Cicid), ce qui exclut tout un pan de l'APD en matière migratoire. Cette approche a également été retenue par les deux ministres de l'Europe et des affaires étrangères et de l'intérieur, dans leur courrier conjoint d'avril 2023 demandant à l'AFD et à Expertise France de renforcer leurs actions dans la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment sur les piliers 4 et 5 du PACV (lutte contre la traite des êtres humains, d'une part, retour, réadmission et réintégration, d'autre part).
De l'autre côté, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 conserve une approche plus large, intégrant l'ensemble des piliers du PACV. Elle ambitionne de « développer une approche globale qui tend à couvrir toutes les dimensions de la question migratoire. » Certes la prévention de l'immigration irrégulière et des trafics est présente mais ne forme qu'une composante de l'approche française.
Ce hiatus n'est pas anodin et il aura des conséquences de deux ordres :
- sur le plan communicationnel, intégrer les enjeux migratoires dans la politique de développement et lutter contre l'immigration n'ont pas la même portée. Si aucun consensus n'existe dans la sphère scientifique (voir supra, partie I.A.1), il est possible de douter de l'incidence de l'aide au développement sur le nombre de départs. Le Cicid expose donc l'action de la France à des résultats décevants ;
- sur le plan opérationnel, se concentrer sur la seule lutte contre l'immigration irrégulière aura un impact sur le volume d'aide au développement qui sera consacré à la thématique migratoire. En effet, une partie seulement des piliers du PACV concoure principalement à cet objectif : seule une minorité des financements d'aide au développement de la France en matière migratoire porte directement sur la lutte contre l'immigration irrégulière55(*) (moins de 7 % des financements sur la période 2018-2024). Les volumes effectivement mis en oeuvre seront donc beaucoup plus limités. En outre, une grande partie des actions de coopération avec les pays de départ menées pour réduire les départs irréguliers ne sont pas éligibles à l'APD.
En second lieu, ce hiatus s'accompagne d'une contraction entre les priorités géographiques de l'aide de la France. Comme rappelé dans les développements précédents supra, le Cicid a remplacé en 2023 la liste des 19 pays prioritaires par une cible de concentration de 50 % (relevée à 60 %) de l'aide sur les pays les moins avancés et les pays vulnérables.
Or, comme a pu le souligner Matthieu Boussichas, chargé de programmes à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi), en matière de migrations, les pays de départ sont essentiellement des pays à revenus intermédiaires et non des PMA56(*). Si plusieurs PMA figurent sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire identifiée par le CSM du 16 janvier 2023, une grande partie d'entre eux sont des pays à revenus intermédiaires comme les trois pays du Maghreb, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie ou le Vietnam. La priorité accordée à la dimension migratoire risque donc d'affaiblir la cible de concentration de 60 % de l'aide sur les PMA et pays vulnérables.
Par ailleurs, les rapporteurs spéciaux déplorent l'absence d'articulation entre la priorité accordée à la thématique migratoire et l'importance accordée par le conseil présidentiel pour les partenariats internationaux d'avril 2025 à l'intégration de « nos départements et territoires d'outre-mer à leur environnement régional, en capitalisant sur leurs atouts ». À cet égard, il est particulièrement étonnant que les termes « outre-mer » et « ultramarin » n'apparaissent nulle part dans le document présentant la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030.
Dans le même sens, au sein de la liste des pays prioritaires en matière migratoire, identifiée par le CSM, seuls deux États sont limitrophes ou proches de départements et régions d'outre-mer : les Comores, situés à proximité de Mayotte, et le Sri Lanka, qui comprend une forte diaspora à La Réunion. Ni les pays frontaliers de la Guyane, ni les pays de départ situés dans l'espace Caraïbes ou dans l'Océanie ne figurent sur cette liste. Plus surprenant encore est l'absence de Madagascar. Compte tenu de ses fragilités économiques et politiques et de sa démographie dynamique, l'ensemble des interlocuteurs auditionnés dans le cadre de ce rapport a souligné qu'il s'agirait probablement du principal pays de départ à destination de Mayotte et de la Réunion dans les prochaines années.
La littérature scientifique a établi une préférence des migrants pour une destination proche de leur lieu d'origine. Dans ce contexte, il est indéniable que les territoires ultramarins présentent des spécificités géographiques par rapport à l'hexagone et l'absence de prise en compte de ces dernières dans la stratégie interministérielle est un manque notable.
Recommandation : intégrer, dans la stratégie interministérielle « migrations et développement » et dans la liste des pays prioritaires en matière migratoire, une prise en compte des enjeux spécifiques aux territoire ultramarins (direction générale de la mondialisation).
2. Renforcer le pilotage de la prise en compte des enjeux migratoires de la politique de développement, tout en confortant sa dimension interministérielle
Si la France a, au cours des dernières années, adaptée son organisation administrative autour d'une comitologie visant à encourager une plus grande coopération interministérielle sur la dimension extérieure des migrations, les rapporteurs spéciaux identifient plusieurs limites à cette approche.
D'une part, cette organisation, opérationnelle sur le papier, peine à se concrétiser. De fait le cadre national de suivi (CNS), censé animer la mise oeuvre de la stratégie « migrations et développement », s'est très peu réuni depuis 2023. L'ambassadeur chargé des migrations, M. Cyrille Baumgartner, entendu par les rapporteurs spéciaux, déplore cette situation et recommande de réunir plus fréquemment le CNS, y compris au niveau des services.
Dans le même sens, le comité stratégique migrations (CSM) ne s'est réuni qu'une seule fois au niveau des ministres, le 16 janvier 2023. S'il a également été réuni au niveau des directeurs de cabinet en juin et septembre 2023 et au niveau des administrations des deux ministères en avril 2023, l'intérêt pour cette structure de coordination paraît, pour le moins, s'étioler.
Sans réunion de ces instances, il est probable que les efforts de services comme des postes se concentreront sur d'autres thématiques avec un portage politique plus significatif. La stratégie interministérielle 2024-2030 se déclinera de la même manière que le plan d'action 2018-2022 : sans pilotage ni évaluation et avec une mise en oeuvre bien en-deçà des objectifs affichés.
Recommandation : réunir à intervalles réguliers, a minima biannuels, le comité stratégique migrations (CSM) et le cadre national de suivi (CNS) pour conforter le pilotage de la stratégie interministérielle (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'intérieur).
D'autre part, la réalité de la coopération entre le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur est encore en construction.
Sur le plan budgétaire, l'essentiel des financements relève de la mission « Aide publique au développement » et des crédits mis en oeuvre par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et ses opérateurs. Contrairement à nombre de ses homologue étrangers, le ministère de l'intérieur ne dispose pas d'un véritable budget dédié à la coopération et ne peut donc pas directement engager des projets ambitieux dans ce domaine. De plus, ce ministère ne participe pas à la tutelle sur l'AFD, principal acteur de notre politique, ni sur celle d'Expertise France. Il se trouve donc relativement en marge du pilotage de la politique de développement en matière migratoire en dépit de sa participation aux instances de coordination.
Sur le plan opérationnel, signe d'une certaine divergence d'approches, le ministre de l'intérieur a nommé en novembre 2024 un représentant spécial, M. Patrick Stéfanini, chargé du suivi du dispositif de réadmission des personnes en situation irrégulière et plus largement de la « diplomatie migratoire ». Ce poste vient directement concurrencer les attributions de l'ambassadeur chargé des migrations. Ce dernier est notamment supposé piloter, conjointement avec le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur, un dialogue de gestion migratoire avec nos ambassades dans les pays prioritaires. Si une coordination entre l'ambassadeur et le représentant est prévue57(*), cette coexistence paraît contradictoire avec l'existence même d'un ambassadeur thématique chargé de la coordination interministérielle et doté pour cela d'une équipe issue des deux ministères.
Dans le même esprit, la coopération entre les opérateurs du MEAE et du ministère de l'intérieur apparait perfectible. Au cours de son audition, l'opérateur Civipol a regretté que ni le MEAE ni l'Agence française de développement fassent davantage appel à ses services. Seulement 2 % du portefeuille de projets de Civipol est financé sur fonds français. Or, cet opérateur détient une spécialisation notable sur les thématiques d'état civil, essentielles dans la prise en compte des enjeux migratoires en matière de développement. En 2023, la Cour des comptes avait ainsi pu noter, qu'en matière d'état civil, « le MEAE s'abstient de faire appel directement à Civipol en raison du lien entre identité et contrôle des migrations, qu'il juge peu compatible avec l'approche développement adoptée dans le cadre du dialogue avec le pays bénéficiaire. »58(*)
3. Concrétiser les objectifs fixés par la stratégie 2024-2030 en tenant compte de l'environnement budgétaire contraint
La politique de développement de la France a fait l'objet d'une mise à contribution significative au redressement des finances publiques au cours des exercices 2024 et 2025. De fait, la loi de finances pour 2024 a marqué un coup d'arrêt à la progression continue des crédits de la mission « Aide publique au développement » depuis 2017. Les crédits de la mission avaient ainsi augmenté de 92 % entre 2017 et 2024 (+ 3,2 milliards d'euros) et de 106 % entre 2019 et 2024. Il s'agissait de l'un des plus forts taux d'augmentation constatés pour une mission du budget de l'État.
Évolution des crédits de la mission
« Aide publique au développement »
entre
2017 et 2024
(en AE et CP et en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Ensuite, la loi de finances pour 2025 a confirmé la volonté du Gouvernement d'associer la mission APD au redressement des comptes publics. Majorées par voie d'amendement gouvernemental au cours des débats budgétaires en séance au Sénat, les baisses de crédits ont réduit le volume de la mission de 18,6 % en AE et de 26,3 % en CP par rapport à l'exécution 2024. Il est probable que cette orientation soit poursuivie dans le prochain budget. Auditionnée en juillet 2025 par la commission des finances, la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, avait ainsi indiqué : « Nous avons voulu reprendre une vision de budget base zéro. Je ne doute pas que cela fera l'objet de nombreux débats, mais c'est ainsi que nous avons essayé de reconstruire l'APD. »59(*)
Évolution des crédits de la mission
« Aide publique au développement »
entre
2024 et 2025
(en AE et CP et en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Dans ce contexte, il paraît nécessaire aux rapporteurs spéciaux de souligner que les ambitions affichées par le Gouvernement sur la thématique migratoire supposent de mieux hiérarchiser les priorités au sein d'un cadre budgétaire contraint. Il conviendra de veiller à ce que cette priorisation se fasse sans fragiliser la cohérence d'ensemble de notre politique de développement.
L'Agence française de développement, comme Expertise France, ont clairement indiqué au cours de leurs auditions qu'une priorisation de la thématique migratoire les conduiraient à réduire par exemple leurs investissements en matière de transition écologique ou de soutien au commerce extérieur français. Face à la dégradation de nos finances publiques, la multiplication des objectifs ne pourra de la politique de développement ne pourra conduire qu'à la dilution de son impact.
Comme avaient pu le souligner les rapporteurs spéciaux à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, l'APD se trouve à l'heure des choix60(*) ; il appartient aux Gouvernement de les assumer.
Cet arbitrage semble avoir été formellement intégré par les ministères dans leurs instructions à l'égard des postes diplomatiques comme dans le mandat proposé aux opérateurs de la mission.
D'une part, les conclusions du conseil présidentiel pour les partenariats internationaux d'avril 2025 précisent que « toutes les ambassades dans les pays concernés par la politique de partenariats internationaux, établiront, en accord avec le gouvernement du pays, une stratégie-pays concentrée sur trois priorités sélectionnées parmi les dix objectifs [du Cidid], auxquelles pourra toujours être ajoutée la lutte contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines. Les ambassadeurs en pilotent le déploiement et sont les garants de la cohérence des moyens déployés au regard de l'ensemble de ces objectifs »61(*).
La priorité de l'objectif migratoire sur les autres dimensions de notre aide paraît donc assumée au plus haut niveau de l'État. Pourtant, les postes dans les États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire ne sont qu'incités à inclure l'objectif migratoire dans leurs stratégies-pays. À ce jour, seulement trois stratégies en cours de validation ou validées retiennent l'objectif n° 10 (Comores, Tunisie et Vietnam). Il parait nécessaire de rendre obligatoire l'inscription de l'objectif n° 10 pour les postes des pays placés sur la liste des pays prioritaires, afin que cette dernière ait une utilité opérationnelle.
Recommandation : pour les postes des États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire, inscrire obligatoirement l'objectif migratoire dans la stratégie-pays (direction générale de la mondialisation, postes diplomatiques).
D'autre part, cette priorité est également déclinée auprès des opérateurs de notre politique de développement. La direction générale de la mondialisation a ainsi indiqué, lors de son audition par les rapporteurs spéciaux, sa volonté d'inscrire dans le tant attendu contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2025-2027 entre l'AFD et sa tutelle une priorité « migrations » pour les crédits d'aide-projet mis en oeuvre par l'agence. Près de 80 millions d'euros seraient ainsi fléchés sur cette thématique.
Dans le même sens, le contrat d'objectifs et de moyens 2024-2026 d'Expertise France fixe à cette agence un objectif d'amélioration de la gestion et de la gouvernance des migrations, articulé autour des cinq piliers du PACV avec une attention toute particulière aux piliers 2 à 5.
Néanmoins, une priorisation formelle devrait être concrétisée par la claire définition d'une enveloppe budgétaire. Le plan d'action « migrations et développement » 2018-2022 comprenait une cible, certes trop peu réaliste, de 1,8 milliard d'euros consacrés à la dimension migratoire de notre aide. Le plan d'action, en cours de préparation, qui viendra décliner la nouvelle stratégie interministérielle, devra lui aussi impérativement définir une enveloppe de crédits dédiée à la thématique migratoire, faute de quoi il se limiterait à un effet d'annonce sans lendemain. Si le ministère de l'Europe et des affaires étrangères assure que le plan d'action comprendra « des valeurs seuils et des indicateurs cibles permettant d'améliorer le suivi et la redevabilité de nos actions », les rapporteurs spéciaux resteront particulièrement attentifs à cette concrétisation.
Recommandation : préciser, au sein du plan d'action « migrations et développement » devant opérationnaliser la stratégie interministérielle 2024-2030, le montant des crédits budgétaires dédiés à la mise en oeuvre des objectifs de cette stratégie (direction générale de la mondialisation).
4. Dans la prise en compte des enjeux migratoires, renforcer l'effort en matière de coopération technique, notamment en matière d'état civil
L'aide publique au développement comporte deux volets distincts : l'assistance financière, composée de dons et de prêts, et l'assistance technique, reposant sur l'envoi d'experts techniques français et le transfert de savoir-faire. Sur les sujets migratoires, la coopération technique est essentielle, notamment pour agir sur les causes profondes des migrations et pour renforcer les capacités des pays de départ.
Si la France se situe en recul par rapport à d'autres bailleurs internationaux, notamment l'Allemagne, en matière de coopération technique, elle dispose en revanche d'un avantage comparatif sur l'assistance technique en matière migratoire : la coopération en matière d'état civil. La loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a en effet identifié l'état civil comme un levier de développement à renforcer. La politique de développement de la France vise ainsi, aux termes de la loi de programmation, à renforcer « les capacités des citoyens afin qu'ils soient en mesure de faire valoir leurs droits et à accompagner les États partenaires pour qu'ils se conforment à leurs obligations de respect, de protection et de mise en oeuvre de ces mêmes droits, au premier rang desquels figure l'identité juridique, réalisable notamment via l'existence d'un état civil fiable et en permettant aux populations d'y avoir accès. »
La loi de programmation a été prolongée par une feuille de route interministérielle « améliorer l'universalité et la fiabilité de l'enregistrement des faits d'état civil » (2021-2027), préparée en réponse à la recommandation d'un rapport de l'Assemblée nationale62(*).
Comme l'a souligné Mme Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal, l'assistance technique en matière d'état civil est fondamentale. Pour un pays comme le Sénégal, la structuration et le contrôle de l'état civil supposent de lourds investissements pour contrer les réseaux, former des officiers d'état civil ou constituer des bases de données. L'assistance étrangère est indispensable en la matière et présente différentes externalités positives :
- en permettant aux États d'établir des statistiques et d'adapter ainsi leurs politiques publiques ;
- en élargissant l'assiette fiscale à la disposition des États ;
- en renforçant l'accès à la protection sociale et à la bancarisation, limitant ainsi la marginalisation ;
- et en permettant la constitution de listes électorales sincères.
Le fait de disposer d'un opérateur doté d'une spécialisation marquée sur l'état civil, Civipol, constitue dès lors un atout dans la mise en oeuvre de l'objectif migratoire assigné à notre politique de développement. D'un point de vue purement administratif, le renforcement de nos efforts en matière d'état civil permet un plus grand décloisonnement entre politique migratoire et politique de développement.
Recommandation : réserver, au sein de l'enveloppe dédiée aux migrations, une part dédiée à la coopération technique et renforcer les moyens dédiés à l'assistance en matière d'état civil (direction générale de la mondialisation, Expertise France, Civipol).
5. Conserver une démarche de suivi et d'évaluation dans la mise en oeuvre de la stratégie interministérielle « migrations et développement »
Les rapporteurs spéciaux ont été particulièrement surpris, au cours de leurs auditions, d'apprendre que la stratégie interministérielle précédente n'avait pas fait l'objet d'une évaluation ex post.
Pourtant et, par comparaison, la stratégie humanitaire de la France pour les années 2018 à 2022 a fait l'objet d'une évaluation détaillée (comme indiqué supra), permettant d'inspirer la conception de la stratégie pluriannuelle qui lui a succédée pour les années 2023 à 2030. De même, la feuille de route pour l'action de la France à l'international en matière d'état civil pour les années 2021 à 2023 a bien été évaluée a posteriori.
Si l'évolution du contexte international et européen peut conduire à rendre obsolètes certains éléments de conception de la stratégie, cette éventualité plaide davantage pour une évaluation en cours de mise en oeuvre que pour un abandon pur et simple de toute démarche de suivi.
En matière d'APD, la France s'est récemment et tardivement dotée d'outils d'évaluation de sa politique de développement. La commission d'évaluation de l'aide publique au développement, prévue par l'article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, dont l'installation est désormais imminente, pourrait notamment participer à ces travaux d'évaluation. Chargée de mener « des évaluations portant sur l'efficience, l'efficacité et l'impact des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement financés ou cofinancés par la France », elle pourra apprécier l'avancement de la stratégie pluriannuelle.
Si cette commission sera rattachée au Quai d'Orsay, comme l'a souhaité la loi n° 2024-309 du 5 avril 202463(*), la présence de parlementaires en son sein constitue une garantie d'indépendance par rapport à l'exécutif. De plus, le V de l'article 12 de la loi de programmation du 4 août 2021 prévoit que le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat peuvent saisir la commission de demandes d'évaluation. En cas de défaut d'initiative de l'exécutif sur cette thématique, il sera loisible au Parlement d'en saisir la commission.
Pour opérer un suivi des financements d'APD en matière migratoire, il sera également indispensable de disposer, dans les documents budgétaires, d'une identification des crédits budgétaires concourant à cet objectif. Actuellement, les documents budgétaires ne présentent qu'une approche par instrument et opérateur. Plus largement, il serait souhaitable, pour la bonne information du public et des parlementaires, qu'une telle identification soit opérée pour chaque objectif prioritaire du Cicid. Elle pourrait figurer dans le document de politique transversale (DPT) « politique de développement », tandis que les projets annuels de performances continueraient de présenter une déclinaison par canal de financement.
Recommandation : organiser une évaluation à mi-parcours de la stratégie interministérielle 2024-2030 et dresser un bilan à l'issue de sa mise en oeuvre (direction générale de la mondialisation, AFD, Expertise France).
Recommandation : identifier, dans les documents budgétaires, les crédits dédiés à chaque objectif prioritaire de notre politique de développement (direction générale de la mondialisation, direction générale du Trésor).
Par ailleurs, les outils de suivi de la performance du volet migratoire de notre politique de développement semblent clairement insuffisants.
Les conclusions du Cicid de juillet 2023 ont introduit deux indicateurs de suivi pour l'objectif n° 10, assigné à la politique de développement (« Aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines ») :
- d'une part, le nombre de pays partenaires bénéficiant d'un appui français pour améliorer l'accessibilité et la fiabilité de leurs systèmes d'état civil ;
- d'autre part, le nombre de pays partenaires bénéficiant d'un appui français pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre la traite des êtres humains.
Il est étonnant de constater que ces deux indicateurs n'ont pas été intégrés dans les indicateurs de performance de la mission APD. Les outils de suivi du Cicid coexistent ainsi avec les indicateurs de performance figurant dans les documents budgétaires, ce qui présente l'avantage pour les administrations chargées de leur mise en oeuvre de ne pas avoir à les remplir annuellement ni à les présenter au Parlement. Outre cette curieuse coexistence, force est de constater que ces deux indicateurs sont essentiellement descriptifs et dépourvus de tout intérêt analytique. Il s'agit de deux indicateurs purement quantitatifs qui n'incitent en rien les administrations à améliorer la conduite des projets ou la performance de la dépense publique.
Quant aux indicateurs de performance figurant dans les documents budgétaires de la mission « Aide publique au développement », aucun ne porte spécifiquement sur l'objectif migratoire assigné à la politique de développement. Plusieurs indicateurs visent à mesurer la part de financements consacrés aux « priorités stratégiques françaises »64(*) définies par le Cicid de 2018, sans que l'immigration y figure. Deux ans après le Cicid de 2023, leur actualisation paraît nécessaire. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a confirmé aux rapporteurs spéciaux qu'un travail de refonte de la nomenclature des indicateurs était en cours, reste à savoir quand est-ce qu'il sera véritablement mis en oeuvre.
Recommandation : réviser les indicateurs de performance de la mission « Aide publique au développement » consacrés à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (direction générale de la mondialisation).
B. S'IL EST POSSIBLE D'ENVISAGER UNE APPROCHE PLUS PARTENARIALE, L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT NE CONSTITUE QU'UNE PARTIE DE LA DIMENSION EXTÉRIEURE DES POLITIQUES MIGRATOIRES
1. Sans opter pour une stricte conditionnalité de son aide publique au développement, la France devrait s'orienter vers une approche plus partenariale en matière de migrations
La notion de conditionnalité recoupe, en matière d'aide publique au développement, l'ensemble des conditions exigées par les bailleurs aux États bénéficiaires. Par exemple, les programmes d'ajustement structurel portés par le FMI ou la Banque mondiale ont traditionnellement comporté une conditionnalité macroéconomique.
Appliquer une conditionnalité négative à l'APD en matière de migrations, c'est-à-dire conditionnant le versement de l'aide à un niveau de coopération migratoire, présenterait néanmoins des limites de trois ordres.
Tout d'abord, la conditionnalité négative soulève une difficulté majeure s'agissant de la comptabilisation de l'aide comme APD. Si, pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « il n'existe pas de contrainte juridique stricto sensu à la mise en relation du niveau d'aide au développement avec le niveau de coopération migratoire des pays bénéficiaires de l'aide »65(*), la comptabilisation par le comité de l'aide au développement (CAD) de l'OCDE répond à des règles strictes, exposées supra (partie I.C.). La formalisation explicite d'une conditionnalité des versements à des objectifs de politique migratoire et donc à un avantage pour le pays donateur, exclurait de fait cette aide de la qualification d'APD. Pour l'OCDE, l'aide au développement conserve un but unique : l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement économique des pays bénéficiaires. Toute action dont le bénéfice principal revient au donateur ne saurait être comptabilisée comme de l'APD.
Cette contrainte n'empêcherait donc pas la France de développer une conditionnalité négative mais aurait pour conséquence de mécaniquement réduire le montant de l'APD française validée et formellement affichée par le CAD. Or, en raison des mesures de restrictions budgétaires décidées par les lois de finances pour 2024 et 2025, le volume d'aide apportée par la France risque déjà de reculer dans les classements internationaux.
Ensuite, d'un point de vue plus opérationnel et pratique, la décision de suspendre l'aide comporte des difficultés conséquentes. La temporalité du contrôle de la coopération migratoire, généralement mesurée par les facilités d'octroi des laissez-passer consulaires par les représentations diplomatiques présentes sur le territoire français, s'oppose à celle, plus courte, relative à la mise en oeuvre des projets d'aide au développement. À titre d'exemple, un projet de l'AFD suit une instruction de neuf mois et une exécution de l'ordre de deux ans. La suspension soudaine d'un projet en cours rend particulièrement incertaine sa reprise. Les trois ambassadeurs auditionnés par les rapporteurs spéciaux ont souligné les effets néfastes d'une irrégularité des financements, dans une logique de « stop and go ».
De plus, le précédent de l'interruption de la coopération en matière d'APD, décidée par les pays du Sahel (Mali, Niger et Burkina Faso) en 2022-2023, a permis d'identifier des difficultés juridiques et économiques dans la mise en extinction de projets en cours. La suspension du contrat pour un motif extracontractuel expose, de fait, l'opérateur au paiement de pénalités à l'égard des entreprises prestataires et fragilise l'activité de ces dernières qui, dans une forte proportion, sont des entreprises françaises.
Enfin, la conditionnalité comporte des risques politiques et réputationnels non négligeables pour nos opérateurs et entreprises. D'une part, suspendre l'aide signifie renoncer aux avantages induits par la logique d'aide au développement en termes d'appui au dialogue politique, de soutien aux entreprises françaises et de projection de nos valeurs. Cela équivaut également à laisser la place à des États compétiteurs de la France. D'autre part, introduire une conditionnalité négative consiste également à faire primer la dimension migratoire dans la relation bilatérale et à renoncer à une approche holistique de la coopération. Conditionner l'APD à une coopération migratoire expose le pays donateur à des effets contreproductif en plaçant le pays bénéficiaire de l'aide en position de force dans les négociations. Pour renoncer aux revenus de transfert et à l'influence des diasporas, les pays d'origine peuvent entrer dans une logique d'enchères pour accepter un renforcement des contrôles frontaliers et de leur coopération consulaire. Il s'agit, en outre, d'une problématique politiquement sensible pour les opinions publiques locales, qui offre un levier aisé à un gouvernement souhaitant encourager un discours hostile à la France.
Dans son approche de l'APD en matière de migration, la France défend une conditionnalité positive, selon le principe de « more for more » : une augmentation de l'aide à destination des pays les plus coopératifs en matière migratoire. S'opposant à une conditionnalité négative, cette conception, plus conforme aux règles d'éligibilité à l'APD, présenterait l'avantage de renforcer notre soutien aux pays les plus volontaristes. En ce sens, les réunions du CPD et du Cicid de 2023 puis du conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025 ne se sont pas prononcées en faveur d'une conditionnalisation de notre APD.
Les rapporteurs spéciaux, conscients des limites d'une conditionnalité « stricte », défendent cependant une orientation plus transactionnelle de notre politique de développement, qui doit assumer la préservation des intérêts de la France, dans le respect de l'objectif prioritaire de l'APD, à savoir le développement des pays bénéficiaires. Dans leur appréciation des contributions multilatérales de la France, les rapporteurs spéciaux avaient soutenu une approche similaire en recommandant un recours plus systématique au fléchage des contributions volontaires aux organisations internationales vers nos priorités thématiques et géographiques.
Dans une même perspective, le MEAE et ses opérateurs devraient défendre plus systématiquement un ensemble de priorités qui permettrait de mesurer la qualité de la coopération. Dans cette approche globale, la thématique migratoire n'apparaitrait pas comme le seul déterminant de la qualité de la relation bilatérale.
Recommandation : adopter une approche transactionnelle, y compris dans la coopération migratoire, en matière d'aide au développement, en priorisant notre soutien aux pays les plus volontaristes (Gouvernement).
2. Une approche globalisante de la coopération pourrait également être privilégiée
Les difficultés soulevées par une éventuelle conditionnalisation de l'APD en matière migratoire, si elles ne doivent pas conduire à écarter toute approche transactionnelle, invitent à envisager la problématique migratoire dans une approche « globalisante » de l'aide au développement.
Dans une logique transactionnelle, l'Union européenne a développé, dans le cadre de sa politique de voisinage, des « partenariats stratégiques globaux » avec plusieurs États du voisinage méditerranéen (Tunisie, Égypte, Liban, Jordanie) ou d'Afrique subsaharienne (Mauritanie). Selon une approche globalisante, ces accords comprennent des actions portant sur l'ensemble du champ migratoire (des causes profondes à la mobilité légale) et intègrent un renforcement du contrôle aux frontières (qui ne relève pas du champ de l'aide au développement).
Ces accords sont de nature multisectorielle. À titre d'exemple, le partenariat stratégique global UE-Jordanie, signé en janvier 2025, s'organise autour de cinq piliers (relations politiques et coopération régional, sécurité et défense, résilience économique/commerce et investissements, capital humain, migration, protection et soutien aux réfugiés). La thématique migratoire n'est donc qu'une composante de cette coopération. Il importe également de souligner que tous les partenariats stratégiques globaux ne poursuivent pas les mêmes objectifs, y compris sur la dimension migratoire. Ainsi, le partenariat entre l'UE et l'Égypte, signé le 17 mars 2024, n'a pas été conclu avec l'objectif de réduire les flux irréguliers depuis ce pays. Il vise prioritairement à renforcer les capacités d'intégration de ce pays à l'égard des étrangers présents sur son territoire (l'Égypte connaît une forte pression régionale, avec plus de neuf millions d'étrangers principalement originaires du Soudan) et subsidiairement à renforcer le contrôle de ses frontières avec la Libye.
Le caractère contractualisé de cette coopération permet de suivre la logique de « more for more » en accentuant les volumes d'engagement en fonction des résultats constatés sur les flux migratoires.
En dépit des limites inhérentes à tout exercice de corrélation en matière de migrations, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères met en avant les résultats encourageants des partenariats stratégiques globaux déjà conclus. Ainsi, le partenariat conclu entre l'Union européenne et la Tunisie le 16 juillet 2023 et comportant un important volet migratoire, aurait contribué à une réduction des entrées irrégulières dans l'espace Schengen par la route de la Méditerranée centrale de 16 % entre janvier et mars 2025 par rapport à 2024 et de 59 % par rapport à 2023. De même, le renforcement de la coopération entre l'UE et la Turquie, le Liban et la Jordanie aurait conduit à une diminution des entrées par la Méditerranée orientale de l'ordre de 28 % au premier trimestre 2025.
Recommandation : au niveau européen, soutenir la conclusion de partenariats stratégiques globaux avec l'ensemble des pays-clés dans le transit des migrations, et y défendre l'inclusion des priorités stratégiques de la France (ministère de l'Europe et des affaires, ministère de l'intérieur).
Néanmoins, tout en soutenant le recours à l'échelon européen et la démarche de contractualisation engagée par l'Union européenne avec ses voisins il convient d'en mentionner les limites, rappelées par l'ambassadeur chargé des migrations66(*) :
- tout d'abord, la conclusion d'accords entre l'Union et les États de transit peut avoir pour effet de déplacer les flux vers d'autres routes migratoires, avec un impact potentiel sur les entrées en France. Dans le même sens, Flore Gubert utilise la métaphore de la digue, lorsqu'un pays de transit contrôle ses frontières, les flux se déportent ;
- ensuite, ces accords, passés au niveau de l'Union européenne, ne comprennent pas de stipulations spécifiques aux enjeux bilatéraux sur lesquels la France est prioritairement engagée, notamment les retours et réadmissions ;
- enfin, la mise en oeuvre de ces accords peut avoir pour effet indirect une dégradation des conditions de vie des migrants, exposés à des violations des droits humains. Il en découle un risque réputationnel pour l'Union européenne.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le jeudi 23 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de MM. Michel Canévet et Raphaël Daubet, rapporteurs spéciaux, sur la prise en compte des questions migratoires dans la politique de développement.
M. Claude Raynal, président. - Nous débutons nos travaux par la communication de nos collègues Raphaël Daubet et Michel Canévet, rapporteurs spéciaux, sur la prise en compte des questions migratoires dans la politique de développement.
M. Raphaël Daubet, rapporteur spécial. - En tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Aide publique au développement » (APD), nous avons choisi, avec Michel Canévet, de mener un travail de contrôle sur la prise en compte des questions migratoires dans la politique de développement.
Le choix de notre contrôle repose sur deux constats.
D'une part, nous assistons, au sein des ministères et des administrations, sous l'effet également d'une préoccupation du public, à l'intensification de la réflexion sur l'efficacité de notre aide au développement et sur sa contribution au soutien de nos intérêts stratégiques. L'APD ne constitue pas seulement un outil de solidarité, elle est aussi un levier d'influence et de stabilité, qui porte la voix de la France et promeut nos valeurs à travers le monde.
D'autre part, notre politique de développement se trouve aujourd'hui contrainte par la dégradation de nos finances publiques. Qu'on le déplore ou non, la mission « Aide publique au développement » figure parmi celles qui ont été les plus sollicitées au cours des deux derniers exercices budgétaires, avec une baisse de près de 30 % de ses crédits en 2025. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de mieux cibler les objectifs de cette politique.
Notre contrôle s'est articulé autour de trois questions principales : l'aide au développement exerce-t-elle un impact sur les migrations ? Peut-elle constituer un levier dans les négociations migratoires ? Enfin, quel est l'effort budgétaire réel consenti par la France dans ce domaine ?
S'agissant de la première question, la réponse demeure incertaine : la recherche académique n'offre pas de consensus clair sur les liens entre migration et développement.
Dans les années 1970, la théorie dite de la « bosse migratoire » postulait qu'une amélioration du niveau de développement entraînait d'abord une hausse, puis une baisse des flux migratoires. Cette théorie est aujourd'hui largement discutée. Toutefois, nous pouvons tirer trois enseignements de la littérature académique.
Tout d'abord, l'évolution des flux migratoires ne dépend pas seulement du niveau de vie ou de l'aide au développement. Elle s'explique également par d'autres facteurs, tels que la situation géographique du pays de départ, ses liens historiques et linguistiques avec le pays d'arrivée, son intégration régionale ou encore son niveau d'inégalités.
Ensuite, une APD mal ciblée peut renforcer l'immigration de manière transitoire, dès lors qu'elle favorise la croissance économique de certains territoires au détriment d'autres.
Enfin, les mobilités depuis les pays à revenus intermédiaires correspondent davantage à des mouvements réguliers, et la grande majorité des mobilités s'effectue dans une aire géographique restreinte - il s'agit, par exemple, de flux d'immigration dits « Sud-Sud ».
Je précise que le cadre fixé par l'OCDE revêt une importance particulière, dans la mesure où il garantit la crédibilité internationale de notre aide et la cohérence des efforts du pays donateur. Le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE a, en 2018, précisé les critères d'éligibilité des dépenses pouvant être qualifiées d'APD. Deux principes majeurs s'en dégagent : d'une part, les projets doivent avoir pour objectif principal le développement du pays bénéficiaire, et non la poursuite d'intérêts propres au pays donateur ; d'autre part, les activités relevant du domaine de la sécurité en sont exclues. Concrètement, un projet dont la finalité première serait de réduire les flux migratoires vers le pays donateur ne saurait être considéré comme de l'aide au développement.
Le respect de ce cadre est essentiel, car il protège à la fois l'intégrité et la légitimité de notre politique de développement.
J'en viens à notre deuxième interrogation : quel est l'effort de la France pour la prise en compte des questions migratoires dans la politique de développement ?
En premier lieu, la France, comme plusieurs partenaires européens, a engagé depuis 2015 une réflexion doctrinale dans le cadre du plan d'action conjoint de La Valette (PACV), qui identifie cinq champs d'action pour l'APD en matière migratoire.
Sur cette base, la France a construit un Plan d'action « Migrations internationales et développement » 2018-2022, qui fixait une feuille de route à notre politique de développement en matière migratoire et ambitionnait le déploiement de 1,8 milliard d'euros de crédits budgétaires.
En second lieu, entre 2017 et 2024, selon les données transmises par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), la France a engagé un effort budgétaire de près de 1 milliard d'euros sur la thématique migratoire. Nous sommes très loin de la cible de 1,8 milliard d'euros fixée par le plan d'action, mais il s'agit tout de même de montants significatifs.
Géographiquement, les crédits ont été principalement orientés vers le Proche et le Moyen-Orient et vers l'Afrique, qui ont respectivement bénéficié de 48 % et 38 % des enveloppes. Les principaux destinataires sont des pays à revenus intermédiaires, ce qui apparaît en décalage avec l'objectif d'allouer 60 % de notre APD aux pays les moins avancés.
Cette concentration s'explique par la géographie des flux migratoires, les pays à revenus intermédiaires constituant les principaux territoires de départ ou de transit. Elle soulève néanmoins une question de cohérence de notre politique : en privilégiant ces zones, nous risquons évidemment de détourner l'APD de sa vocation première, à savoir la lutte contre la pauvreté, au profit d'objectifs de stabilisation à court terme.
Cet équilibre entre solidarité et stratégie mérite donc d'être clarifié.
S'agissant de la répartition thématique de notre aide en matière migratoire entre 2017 et 2024, près de la moitié des financements relève du troisième pilier du PACV, consacré à la garantie des droits et à la protection des personnes déplacées. En revanche, seulement 7 % des financements ont été consacrés à la lutte contre le trafic de migrants et la traite, ainsi qu'à l'aide au retour. Pourtant, ce sont des domaines d'action que les précédents gouvernements avaient déclarés prioritaires pour lutter contre l'immigration irrégulière. Cette divergence entre les priorités affichées et les financements engagés traduit, là aussi, une difficulté de pilotage.
Les actions les plus sensibles restent marginales, alors même qu'elles conditionnent la crédibilité de notre politique migratoire. Il est donc nécessaire de mieux articuler les moyens budgétaires avec les objectifs stratégiques, afin de donner à ces priorités les ressources qu'elles méritent.
Au-delà de ces constats globaux, notre analyse a mis en évidence plusieurs points d'alerte relatifs à la cohérence et au suivi de ces financements.
M. Michel Canévet, rapporteur spécial. - Dans la continuité du propos de Raphaël Daubet, je présenterai une analyse critique de l'engagement budgétaire de la France dans la prise en compte des enjeux migratoires dans notre politique de développement.
En effet, nous avons identifié quatre points qui nous conduisent à qualifier le plan d'action 2018-2022 d'« acte manqué ».
Premièrement, comme souvent en matière d'aide publique au développement, de nombreux acteurs de cette politique sont impliqués. Cette fragmentation de l'action publique, qui s'explique par des échelles et des domaines d'action distincts, perturbe sa lisibilité. Elle conduit, de plus, à des difficultés de coordination, particulièrement entre le groupe AFD et Civipol, l'opérateur du ministère de l'intérieur.
Deuxièmement, en étudiant les données transmises par le MEAE, nous en avons tiré la conclusion que la progression des financements « migrations » découlait en réalité essentiellement de l'investissement important de la France en matière humanitaire. En effet, entre 2018 et 2024, les crédits de l'aide humanitaire ont été multipliés par plus de cinq. Or, si les actions humanitaires ainsi financées contribuent à limiter les déplacements de populations et à accompagner le retour des réfugiés vers les pays d'origine, le lien avec les enjeux migratoires demeure secondaire.
Troisièmement et en conséquence du point précédent, les projets financés en matière de migrations n'ont pas tous un lien direct avec les migrations. Nous avons observé un effet de « labellisation » a posteriori de ces projets par le MEAE. Le risque d'une telle comptabilisation est d'intégrer des projets qui n'ont pas été pensés en prenant en compte les enjeux migratoires.
Quatrièmement, le plan d'action « Migrations internationales et développement » 2018-2022 n'a fait l'objet ni d'un véritable pilotage ni d'une évaluation a posteriori. S'agissant du pilotage, les instances de concertation chargées du suivi de la mise en oeuvre de ce plan ne paraissent pas se réunir à intervalles réguliers, et leurs travaux n'ont vraisemblablement pas comporté de dimension opérationnelle. Concernant l'évaluation, aucun bilan du plan d'action n'a été opéré, contrairement à ce qui était prévu dans sa programmation initiale. Le ministère n'a pas jugé cette évaluation utile, en estimant que le plan était déjà obsolète, ce qui ne constitue pas, à nos yeux, une justification probante.
La nouvelle stratégie interministérielle « Migrations et développement » pour les années 2024 à 2030 devra nécessairement tirer les conséquences des errements des années passées. Nous identifions, pour cela, plusieurs pistes de réflexion.
Tout d'abord, il importe de clarifier l'objectif migratoire assigné à notre politique de développement. Actuellement, les ministères chargés de cette politique ne sont pas en mesure de définir précisément les enjeux migratoires concernés : s'agit-il de la lutte contre l'immigration irrégulière, visée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid), ou d'une approche plus large des migrations, comme envisagée par la stratégie pluriannuelle ?
Ce calibrage a son importance. Si nous adoptons une vision trop restrictive de cet enjeu, concentrée sur la lutte contre l'immigration irrégulière, nous risquons de sortir du champ de l'aide publique au développement et d'entrer dans celui de la coopération sécuritaire. Si nous privilégions une conception trop large de la prise en compte des enjeux migratoires, le risque est de reproduire les erreurs passées et de « labelliser » des projets sans rapport direct avec les migrations.
Ensuite, il nous semble que le pilotage de notre politique de développement en matière migratoire doit être renforcé et intégrer une véritable dimension interministérielle. Au cours de nos auditions, les différentes parties prenantes nous ont présenté, non sans une certaine fierté, la nouvelle comitologie de la dimension migratoire de notre politique de développement. Nous avons cependant constaté qu'elle peinait à se concrétiser : une seule réunion du comité stratégique migrations (CSM) a eu lieu depuis 2023.
De plus, dans un contexte budgétaire contraint, il faudra être explicite sur le fait que cette priorisation impliquera une baisse des moyens consacrés aux autres thématiques. Faute de quoi, la multiplication des objectifs de la politique de développement ne pourra conduire qu'à la dilution de son impact.
Enfin, le Quai d'Orsay et nos opérateurs doivent adopter une démarche de suivi et d'évaluation. Il est indispensable que la nouvelle stratégie interministérielle fasse l'objet d'un bilan et d'un suivi en cours de gestion. En outre, les documents budgétaires devront être complétés pour identifier clairement les crédits budgétaires assignés à nos priorités thématiques.
J'aborderai ensuite notre troisième interrogation : l'APD peut-elle constituer un levier dans les négociations migratoires avec les pays bénéficiaires ?
Cette question rejoint celle de la conditionnalité de l'APD en matière migratoire, soit la possibilité de suspendre notre aide dès lors que le niveau de coopération avec les pays bénéficiaires ne paraît plus satisfaisant.
Une conditionnalité stricte présente cependant des limites : elle risquerait de sortir cette aide de la qualification d'aide publique au développement ; l'interruption de projets en cours soulève des risques juridiques pour nos opérateurs ; et une stricte conditionnalité présente un risque politique et réputationnel non négligeable.
Toutefois, sans adopter une démarche trop restrictive, il nous paraît nécessaire d'envisager, en matière migratoire, une approche plus partenariale, plus transactionnelle, de notre APD qui devrait nous conduire à adapter notre niveau d'aide au degré de coopération de nos partenaires. Une telle approche nous permettrait d'assurer la préservation de nos intérêts, tout en maintenant l'objectif prioritaire de notre aide, à savoir le développement des pays bénéficiaires.
Pour conclure, nous proposons, à l'issue de nos travaux, dix recommandations pour répondre aux deux grands enjeux que j'ai évoqués au cours de mon propos : le bon déploiement de la nouvelle stratégie pluriannuelle, d'une part, et une nouvelle approche partenariale et globalisante dans nos relations bilatérales avec les pays bénéficiaires, d'autre part.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il arrive que certains sujets, faute d'efficacité mesurée, d'intérêt réel ou d'évaluations approfondies des mesures, donnent lieu à beaucoup de débats. C'est vrai pour l'écologie, l'aide au développement ou les questions migratoires. Vous faites oeuvre de pédagogie, car vos éclairages permettent de clarifier les enjeux, de poser les limites.
Je note avec intérêt le flou dans l'appréciation budgétaire et l'efficacité de ces politiques. Comme vous le soulignez, alors que l'on souhaite coopérer et articuler les politiques, recourir à l'interministériel pour avoir une approche consolidée, la mise en oeuvre des mesures est quasiment existante. C'est dramatique pour de tels sujets, qui restent très méconnus.
Ne pourrait-on pas imaginer un outil ou un temps d'échange annuel pour rappeler à chacun ses responsabilités collectives, afin de s'assurer que le travail soit réalisé concrètement, plutôt que de continuer à discourir dans le vide ? Est-ce une piste qui pourrait être explorée et mise en oeuvre ?
M. Jean-Raymond Hugonet. - Je remercie les rapporteurs spéciaux pour leur travail, qui permet de mieux comprendre la situation. Ce sujet est extrêmement délicat et polémique, et il peut être traité de deux façons : soit sur le plan politique, avec des exagérations et des globalisations utilisées comme argument politique pour « surfer sur la vague », soit sur le plan technique, comme vous le faites ici. On comprend alors que l'évolution chaotique des choses peut s'expliquer par la multiplication des comités et l'interministériel, qui ralentit les décisions. Je note, à titre d'exemple, la dernière polémique concernant les étudiants algériens et la communication de l'ambassade de France sur leur nombre.
Je crains que les recommandations ne soient que des voeux pieux, mais elles présentent le mérite de montrer la complexité de la question, a fortiori dans un contexte interministériel. Ne serait-il pas utile de les orienter davantage pour éviter cette espèce de « foire à tout » ?
Mme Nathalie Goulet. - À mon tour de remercier les rapporteurs spéciaux d'avoir identifié un sujet de niche dans leur mission qui, comme les autres sujets, manque de pilotage et de contrôle, ce qui illustre une certaine cohérence, pourrais-je dire...
Je n'ai pas saisi le sens de la comitologie ; à ce propos, je suggère que le prochain rapport sur les organes multiples, variés et souvent inutiles, reprenne ce terme.
En tant que citoyenne, je suis très préoccupée par ce que j'ai entendu, notamment l'absence de dimension de sécurité dans les programmes.
Ayant beaucoup travaillé sur l'Afrique de l'Ouest, j'ai constaté que l'Agence française de développement tentait de coordonner des programmes pour sécuriser les états civils, essentiels au développement local et à la sécurité régionale, alors que, dans plusieurs pays de la région, ces états civils sont défaillants. Comment expliquer que cette dimension soit totalement exclue ? Même lorsque les évaluations sont inexistantes ou insuffisantes, ne peut-on pas introduire des obligations de résultat et un meilleur encadrement des agences impliquées ? Avec tous les dysfonctionnements actuels, il est temps de responsabiliser toutes ces agences !
M. Victorin Lurel. - Quelle est la politique transactionnelle ? Qu'implique-t-elle véritablement ? Des accords de réadmission sont conclus dans les territoires ultramarins, souvent en secret. J'ai écrit plusieurs fois, sans obtenir les éléments demandés. En Guadeloupe et à la Martinique, la coopération avec des voisins comme la Dominique ou Sainte-Lucie se fait par accords bilatéraux, de même qu'en Guyane avec ses pays frontaliers. Pourtant, ces États refusent de signer des conventions sur la sécurité, la présence d'officiers et de magistrats de liaison, la délimitation des zones territoriales ou les conventions de pêche avec l'Europe. Des Dominiquais peuvent néanmoins séjourner jusqu'à 180 jours par an en Guadeloupe, en effectuant plusieurs séjours courts cumulés, sans que l'on dispose de bilan précis.
Comment intégrer les outre-mer dans cette politique et contrôler ces flux continus, à Haïti, en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, alors que les préfectures, transformées en bunkers, ne peuvent plus rendre le service public attendu ?
M. Michel Canévet, rapporteur spécial. - Comme l'évoquait le rapporteur général, il faut suivre ce sujet de façon continue et régulière pour vérifier que nos recommandations seront effectivement suivies d'effets. Il est essentiel que l'action de l'État soit coordonnée. M. Hugonet a montré que ce sujet avait de larges conséquences, touchant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, les outre-mer, l'intérieur, l'Europe ou encore les affaires étrangères. Le fonctionnement en silo perdure, d'où la nécessité de travailler selon des orientations communes. Nous avons veillé à garder une approche technique du sujet.
S'agissant de la coordination, un ambassadeur chargé des migrations au MEAE est censé piloter le dossier, mais vous avez raison, madame Goulet, la comitologie est impressionnante et nécessite une simplification.
Sur l'état civil, nous préconisons, dans notre recommandation n° 5, un accompagnement technique par Civipol et Expertise France, qui dépend désormais du groupe AFD. C'est un préalable pour identifier les populations et permettre aux pays d'Afrique de mieux gérer leurs flux.
Monsieur Lurel, notre recommandation n° 1 souligne l'absolue nécessité de prendre en compte la spécificité des outre-mer. L'immigration y est trop importante et complique la mise en oeuvre des politiques ultramarines. À Mayotte, par exemple, la reconstruction suppose au préalable la maîtrise des arrivées sur le territoire. Il faut également rester attentif à Madagascar, dont la situation pourrait avoir des répercussions sur nos territoires de l'océan Indien.
M. Raphaël Daubet, rapporteur spécial. - Je compléterai la réponse à l'intervention de M. le rapporteur général, qui souligne le flou qui touche à la fois au budget, à la gouvernance, voire aux objectifs eux-mêmes de l'aide publique au développement, laquelle est percutée par d'autres politiques, notamment l'approche sécuritaire, qui n'en relève pas.
L'aide au développement, qui obéit à des définitions très précises, demeure une politique publique internationale et n'intègre pas la dimension sécuritaire relevant du ministère de l'intérieur.
Nous assistons depuis quelques années à une refonte très profonde de la définition de l'aide publique au développement. Les réflexions menées sur le lien entre migration et développement sont anciennes, mais cette évolution s'est accélérée depuis le sommet de La Valette en 2015, à l'occasion du conflit syrien.
En 2023, le Gouvernement a choisi de modifier profondément la doctrine et les objectifs de notre APD. Cette politique publique est aujourd'hui frappée par une réduction de nos capacités d'action, en raison des enjeux budgétaires, mais aussi par un bouleversement très profond de son paradigme, sous l'influence du comportement des autres puissances mondiales et de la question migratoire, qui devient particulièrement prégnante, notamment dans les outre-mer.
Ce changement profond peut donner le sentiment d'une « foire à tout », pour reprendre l'expression de Jean-Raymond Hugonet, parce que ni les objectifs, ni la gouvernance, ni l'approche de ces différentes dimensions ne sont encore clairement définis. Ainsi, la question ultramarine, pourtant essentielle, n'apparaît pas dans notre plan d'action.
Je citerai l'exemple des Comores, où deux piliers se complètent : la coopération sécuritaire, notamment en ce qui concerne les garde-côtes, qui apporte des résultats, et l'aide au développement. Les 260 millions d'euros investis visent à tarir les causes profondes des migrations et constituent, selon l'ambassadeur, une contrepartie politique qui facilite considérablement les réadmissions. Des résultats importants ont été obtenus dans le recrutement et la formation de magistrats, l'argent de la diaspora revient, des écoles sont construites. Une filière de matériaux de construction locale a même été développée pour produire des briques de terre.
Il s'agit d'une approche de solidarité qui vient compléter la dimension sécuritaire, portée par ailleurs.
Quant à la politique transactionnelle qu'évoquait M. Lurel, il convient peut-être de la nommer autrement, car le terme peut paraître trivial. Il s'agit en réalité de s'opposer à la politique de guichet - autre caricature, mais qui est éloquente.
Cette politique transactionnelle est une politique d'engagement réciproque entre le pays donateur et le pays bénéficiaire, qui permet un dialogue de gestion renforcé entre les États, sans négliger les intérêts de la France dans la manière de délivrer l'APD, ce que certains nomment le « more for more », avec une priorisation des pays les plus coopératifs.
Cela peut interroger au regard des exigences de la lutte contre la pauvreté, qui est d'abord une politique de solidarité désintéressée, mais cette réorientation de notre APD apparaît aujourd'hui absolument incontournable.
Enfin, s'agissant du volet multilatéral, cette redéfinition de la doctrine, de la gouvernance et des crédits budgétaires touche également au choix de privilégier l'aide bilatérale ou multilatérale. Pour ce qui concerne cette dernière, l'Europe a mis en place des partenariats stratégiques globaux qui, en intégrant toutes les dimensions de nos politiques, permettent certainement d'obtenir des résultats plus efficaces.
M. Victorin Lurel. - Plus on aide les gens, plus ils partent ! La politique transactionnelle, est plutôt bilatérale que multilatérale ; défendre ses intérêts, c'est plutôt traiter en bilatéral. Dès lors, la dimension multilatérale s'efface quelque peu...
M. Raphaël Daubet, rapporteur spécial. - Les partenariats stratégiques globaux européens n'en constituent pas moins une manière transactionnelle d'aborder la question, bien qu'à une autre échelle, et cette approche peut se déployer dans les deux dimensions.
M. Victorin Lurel. - Quelle est aujourd'hui la liste des pays clés, que nous considérons comme prioritaires ?
M. Raphaël Daubet, rapporteur spécial. - Officiellement, la priorité est accordée aux pays les moins avancés et vulnérables, mais la doctrine conduit en réalité à privilégier les pays à revenus intermédiaires, que concerne la question migratoire. En parallèle de la cible de concentration de l'aide sur les pays les moins avancés et vulnérables, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a défini une liste de quinze pays prioritaires en matière migratoire. Il importe de résoudre cette contradiction par une redéfinition d'ensemble, sans quoi nous risquons de faire n'importe quoi.
La commission a adopté les recommandations des rapporteurs spéciaux et autorisé la publication de leurs communications sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation - Direction générale des collectivités locales
- M. Yoann BLAIS, adjoint au sous-directeur des finances locales et de l'action économique ;
- M. Pierre MADELIN, adjoint au chef de bureau des concours financiers de l'État ;
- M. Louis METAIS-LISSOWSKI, chef de bureau des budgets locaux et de l'analyse financière ;
- M. Florentin BERTHEAS, chef du bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique.
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères - Direction générale de la mondialisation
- Mme Anne GRILLO, directrice générale ;
- M. Patrick LACHAUSSEE, directeur du pilotage et de la stratégie ;
- Mme Alison LARCHER, rédactrice au Pôle gouvernance financière, migratoire et territoriale.
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
- M. Cyrille BAUMGARTNER, ambassadeur thématique chargé des migrations ;
- M. Frédéric RIMOUX, adjoint de l'ambassadeur chargé des migrations ;
- Mme Alison LARCHER, rédactrice migration et développement, Diasporas, Dialogues internationaux ;
- Mme Camille ANTOINE, rédactrice à la sous-direction du développement et de l'investissement solidaire et durable.
7e Sous-direction du Budget - Budgets de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, des affaires rurales, de l'aide publique au développement, de l'action extérieure de l'État, de l'immigration, de l'asile et de l'intégration
- M. Thomas CALTAGIRONE, chef de bureau ;
- M. François DESCHAMPS, adjoint au sous-directeur ;
- M. Hippolyte DERVAUX, adjoint au chef du bureau des affaires étrangères et de l'aide au développement.
Agence française de développement
- M Bertrand WALCKENAER, directeur général adjoint ;
- M. Philippe BAUMEL, responsable du secrétariat des instances en charge des relations avec les administrateurs et le Parlement.
Expertise France
- M. Jérémie PELLET, directeur général ;
- M. Xavier CHAMBARD, directeur de la stratégie et des partenariats ;
- Mme Tiguida CAMARA, responsable du pôle migration, genre et droits humains ;
- M. Lucas IVERNEL, chargé de mission
Table ronde de chercheurs
- Mme Virginie GUIRAUDON, membre du groupe international d'experts sur les migrations (GIEM) de Sciences Po ;
- Mme Flore GUBERT, directrice de recherche à l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) ;
- M. Matthieu BOUSSICHAS, chargé de programmes à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) ;
- M. Philippe MARCHESIN, maître de conférences à l'université Paris 1.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Intégrer, dans la stratégie interministérielle « migrations et développement » et dans la liste des pays prioritaires en matière migratoire, une prise en compte des enjeux spécifiques aux territoire ultramarins. |
Direction générale de la mondialisation |
Dès que possible |
Modification de la stratégie interministérielle |
|
2 |
Réunir à intervalles réguliers, a minima biannuels, le comité stratégique migrations (CSM) et le cadre national de suivi (CNS) pour conforter le pilotage de la stratégie interministérielle. |
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'intérieur |
Dès que possible |
Toutes mesures nécessaires |
|
3 |
Pour les postes des États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire, inscrire obligatoirement l'objectif migratoire dans la stratégie-pays. |
Direction générale de la mondialisation, postes diplomatiques |
Dès que possible |
Stratégie-pays |
|
4 |
Préciser, au sein du plan d'action « migrations et développement » devant opérationnaliser la stratégie interministérielle 2024-2030, le montant des crédits budgétaires dédiés à la mise en oeuvre des objectifs de cette stratégie. |
Direction générale de la mondialisation |
2026 |
Plan d'action |
|
5 |
Réserver, au sein de l'enveloppe dédiée aux migrations, une part dédiée à la coopération technique et renforcer les moyens dédiés à l'assistance en matière d'état civil. |
Direction générale de la mondialisation, Expertise France, Civipol |
Dès que possible |
Toutes mesures nécessaires |
|
6 |
Organiser une évaluation à mi-parcours de la stratégie interministérielle 2024-2030 et dresser un bilan à l'issue de sa mise en oeuvre. |
Direction générale de la mondialisation, direction générale du Trésor |
2028 |
Rapport d'évaluation |
|
7 |
Identifier, dans les documents budgétaires, les crédits dédiés à chaque objectif prioritaire de notre politique de développement. |
Direction générale de la mondialisation |
2026 |
Annexes au projet de loi de finances pour 2027 |
|
8 |
Réviser les indicateurs de performance de la mission « Aide publique au développement » consacrés à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération international et du développement. |
Direction générale de la mondialisation |
2026 |
Annexes au projet de loi de finances pour 2027 |
|
9 |
Adopter une approche transactionnelle, y compris dans la coopération migratoire, en matière d'aide au développement, en priorisant notre soutien aux pays les plus volontaristes. |
Gouvernement |
Dès que possible |
Relations diplomatiques bilatérales |
|
10 |
Au niveau européen, soutenir la conclusion de partenariats stratégiques globaux avec l'ensemble des pays-clés dans le transit des migrations, et y défendre l'inclusion des priorités stratégiques de la France. |
Ministère de l'Europe et des affaires, ministère de l'intérieur |
Dès que possible |
Négociations européennes |
* 1 Pour rappel, institué par le décret n° 98 66 du 4 février 1998, le Cicid définit les grandes orientations de la politique de développement. Présidé par la Première ministre, il réunit les principaux ministères concernés par la politique de développement. Son secrétariat est assuré conjointement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'intérieur. L'AFD peut être associée à ses réunions.
* 2 Plan d'action « migrations internationales et développement » 2018-2022.
* 3 Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigéria, Comores, Sri Lanka, Inde, Vietnam, Indonésie, Bangladesh.
* 4 Wilbur Zelinsky, The Hypothesis of the Mobility Transition, Geographical Review, Vol. 61, No. 2 (1971), pp. 219-249.
* 5 Mauro Lanati et Rainer Thiele, The impact of foreign aid on migration revisited, World Development, November 2018, Kiel Institute for the World Economy.
* 6 David Bencek et Claas, Higher economic growth in poor countries, lower migration flows to the OECD - Revisiting the migration hump with panel data, World Development, October 2024, Kiel Institute for the World Economy.
* 7 Michael Clemens et Hannah Postel, Deterring Emigration with Foreign Aid: An Overview of Evidence from Low-Income Countries, Popul Dev Rev., December 2018.
* 8 OIM, « Regional mobility mapping - West and Central Africa - December 2022 », 2023.
* 9 Fida, Envois de fonds, Les domaines d'interventions du Fida, consulté le 24 septembre 2025.
* 10 Notamment par Jean-Pierre Cot, ministre chargé de la coopération et du développement de 1981 à 1982.
* 11 Rapport de bilan et d'orientation sur la politique de codéveloppement liée aux flux migratoires, remis au Premier ministre le 1er décembre 1997.
* 12 Rapport d'information n° 304 (2024-2025) fait par Mme Muriel Jourda et M. Olivier Bitz au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur les accords internationaux conclus par la France en matière migratoire.
* 13 Idem.
* 14 Article 8 du traité sur l'Union européenne.
* 15 Les États membres du Processus de Rabat et du Processus de Khartoum ont endossé le PACV et ses objectifs.
* 16 Pour rappel, institué par le décret n° 98 66 du 4 février 1998, le Cicid définit les grandes orientations de la politique de développement. Présidé par la Première ministre, il réunit les principaux ministères concernés par la politique de développement. Son secrétariat est assuré conjointement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'intérieur. L'AFD peut être associée à ses réunions.
* 17 Relevé de conclusions du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) du 8 février 2018.
* 18 Plan d'action « migrations internationales et développement » 2018-2022.
* 19 Relevé de décision du comité interministériel de coopération internationale et de développement (Cicid) du 30 novembre 2016.
* 20 Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigéria, Comores, Sri Lanka, Inde, Vietnam, Indonésie, Bangladesh.
* 21 En particulier la direction générale de la mondialisation pour le MEAE et la direction générale des étrangers en France pour le ministère de l'intérieur.
* 22 À savoir, l'Agence française de développement (AFD), Expertise France (EF), Civipol, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
* 23 Troisième titulaire du poste, après MM. Pascal Teixeira et Christophe Léonzi.
* 24 OCDE, « Questions fréquentes : activités liées aux migrations dans l'APD », 2024.
* 25 Idem.
* 26 OCDE, ODA and non ODA-eligible activities.
* 27 Fonds Paix et Résilience Minka ou Fonds Minka.
* 28 Formalisée en 2018 par voie d'arbitrage interministériel, la répartition des compétences entre Civipol et Expertise France confie au premier l'ensemble des sujets relevant de la sécurité au sens strict (dont le contrôle des flux migratoires et des frontières) et au second les projets en matière de développement (dont l'administration territoriale et la décentralisation).
* 29 Article 2, VIII : « L'Etat reconnaît le rôle, l'expertise et la plus-value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l'ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en oeuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu'elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d'initiative, en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une subvention. Les projets financés participent à l'atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. »
* 30 Coordination SUD, « Conditionner l'aide au développement au contrôle de l'immigration, une ligne rouge que la France ne doit pas franchir », 11 décembre 2023.
* 31 Dès 2019, le rapport d'information n° 392 (2021-2022) de MM. Vincent Delahaye et Rémi Féraud, au nom de la commission des finances sur les contributions de la France au financement des organisations internationales recommandait d'augmenter la part de contributions volontaires fléchées (recommandation n° 9).
* 32 Cour des comptes, « Le financement des actions multilatérales de la France - Exercices 2017-2023 », communication à la commission des finances du Sénat, juillet 2024.
* 33 De 2018 à 2024, l'aide humanitaire de la France s'est distinguée par une hausse significative de ses moyens. Les crédits humanitaires ont été multipliés par 5,3 sur cette période, pour atteindre 895 millions d'euros en 2024. La loi de finances pour 2025 a néanmoins ramené ce total à 500 millions d'euros.
* 34 Cour des comptes, « Le financement des actions multilatérales de la France - Exercices 2017-2023 », communication à la commission des finances du Sénat, juillet 2024.
* 35 Rapport d'information n° 779 (2023-2024) par MM. Michel Canévet et Raphaël Daubet, au nom de la commission des finances, pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur le financement des actions multilatérales de la France - exercices 2017 à 2023, 25 septembre 2024.
* 36 De sa dénomination complète Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique.
* 37 Pour rappel, depuis 2013, la Commission européenne peut mettre en place et administrer des fonds fiduciaires de l'UE. Il s'agit d'instruments financiers souples mener des actions d'urgence et de posturgence ou des actions thématiques. Les FFUE présentent l'avantage de pouvoir recourir, outre le budget de l'Union, à des ressources additionnelles provenant des États membres, voire de donateurs extérieurs comme la Norvège ou la Suisse.
* 38 Un marqueur 1 est appliqué aux actions dont l'objectif principal et l'intégralité de la contribution financière visent le soutien à la migration et aux déplacements forcés et permet de comptabiliser 100 % du projet ; un marqueur 2 est appliqué aux actions dont le soutien à la migration et aux déplacements forcés constitue un enjeu conséquent et qui y consacre au moins un résultat et indicateur associé et permet de valider 40 % des financements.
* 39 Entre 2021 et 2023.
* 40 En juillet 2013, novembre 2016 et février 2018.
* 41 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.
* 42 46 États figurent à ce jour dans la catégorie des PMA : Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Tchad, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Iles Salomons, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Laos, Tanzanie, Yémen et Zambie.
* 43 Permettant d'inclure l'Ukraine dans les priorités géographiques de l'aide.
* 44 AFD, Évaluation de l'action de l'Agence française de développement (AFD) en matière de migrations (2016-2021), réalisée par Technopolis, 2023.
* 45 En 2018, 2019, 2020-2021 et 2022.
* 46 La comptabilisation utilisée dans les bilans annuels du plan d'action recensait les projets et initiatives pilotées par l'un des acteurs de la politique de développement ; contribuant à l'une des actions du plan d'action ; et répondant à deux des trois critères définis (un critère de pilotage, un critère géographique et un critère thématique).
* 47 Cour des comptes, La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, rapport public thématique, janvier 2024.
* 48 Réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 49 Bilan des engagements de la stratégie humanitaire de la République française 2018-2022 : une aide humanitaire plus efficace face aux défis de demain ?, groupe URD, 2023.
* 50 AFD, Évaluation de l'action de l'Agence française de développement (AFD) en matière de migrations (2016-2021), réalisée par Technopolis, 2023.
* 51 À savoir une expertise marquée sur le sujet des diasporas et une réelle capacité à mobiliser les fonds européens.
* 52 Demandée par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, cette plateforme unique, accessible depuis 2022, donne accès aux informations relatives à l'aide au développement et à l'ensemble des pays en développement partenaires.
* 53 Cour des comptes européenne, Rapport spécial 17/2024 : Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique - Malgré de nouvelles approches, le soutien est resté peu ciblé, septembre 2024.
* 54 Altai Consulting, A Comprehensive Team Europe Approach to the Atlantic/Western Mediterranean and Central Mediterranean Migration Routes, 2024.
* 55 Essentiellement les piliers 4 et 5 du PACV.
* 56 Table ronde du 27 mai 2025.
* 57 Selon l'ambassadeur chargé des migrations, « l'ambassadeur chargé des migrations veille aussi à assurer la meilleure synergie avec l'action du représentant spécial du ministre de l'Intérieur - préparation, conduite et suivi conjoints de missions notamment en Asie centrale (Ouzbékistan, Kirghizstan), Asie (Vietnam) et Afrique du Nord (Égypte) » (réponses de l'ambassadeur chargé des migrations au questionnaire d'audition des rapporteurs spéciaux).
* 58 Cour des comptes, Civipol SA - Exercices 2016-2022, rapport portant sur une entreprise publique, 9 novembre 2023.
* 59 Audition de Mme Amélie de Montchalin, ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, mercredi 16 juillet 2025.
* 60 Contribution sur la mission « Aide publique au développement » et le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » de MM. Michel Canévet et Raphaël Daubet au rapport général n° 144 (2024-2025), fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.
* 61 Relevé de décisions du Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux, 6 avril 2025.
* 62 Rapport n° 3349 (15e législature) fait par Mme Laurence Dumont et Mme Aina Kuric, au nom de la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enfants sans identité, 23 septembre 2020.
* 63 Loi n° 2024-309 du 5 avril 2024 relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement instituée par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021.
* 64 Par exemple, l'indicateur 3.1 du programme 209 « Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises ».
* 65 Réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 66 Réponses de l'ambassadeur chargé des migrations au questionnaire d'audition des rapporteurs spéciaux.