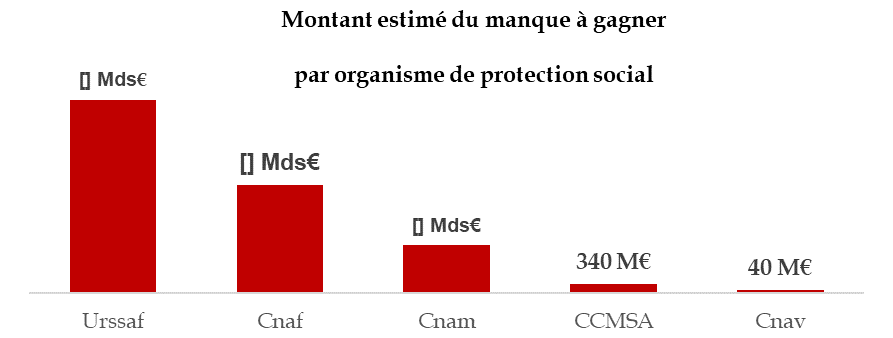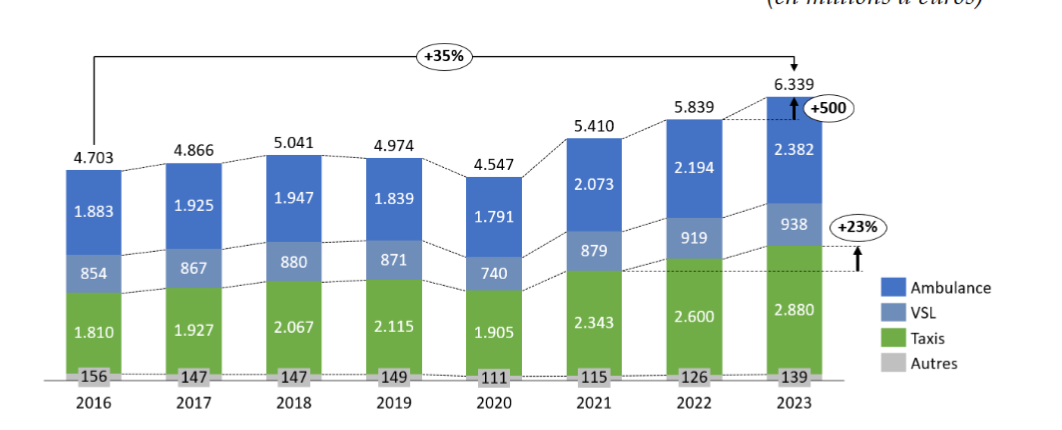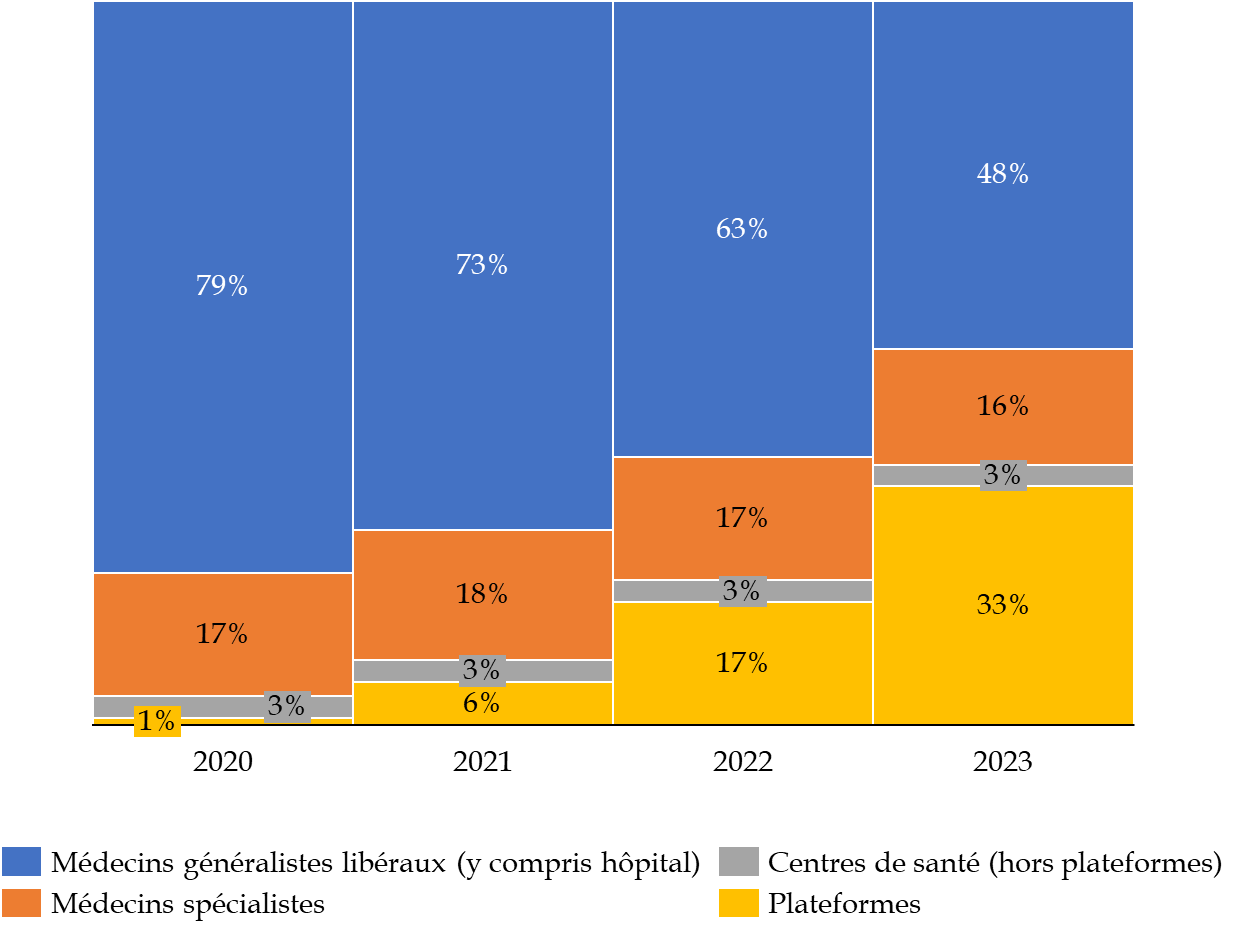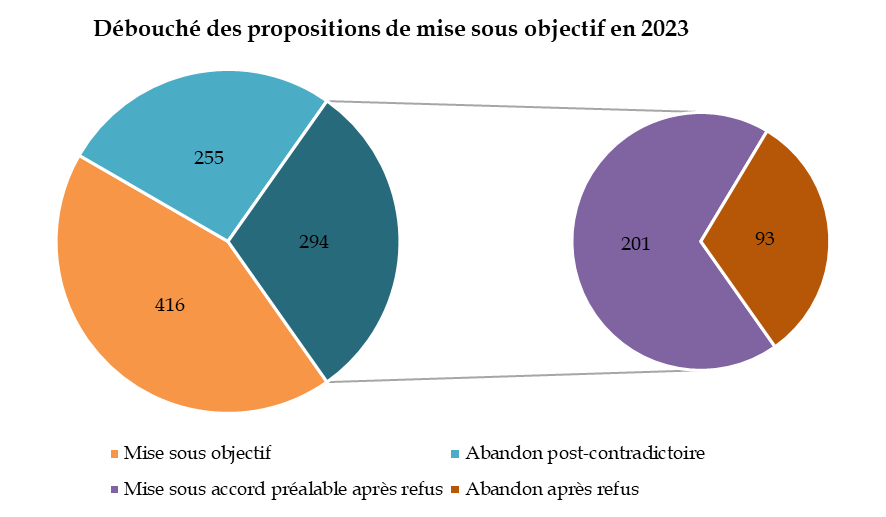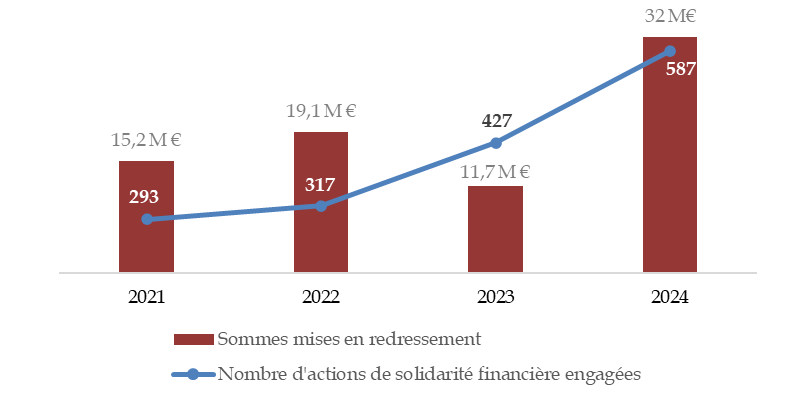- L'ESSENTIEL
- I. DES MESURES QUI CONTRIBUENT À LEVER
CERTAINS FREINS RENCONTRÉS PAR LES SERVICES LUTTANT CONTRE LA
FRAUDE
- A. ACCROÎTRE LE PARTAGE D'INFORMATION ET
FACILITER SON TRAITEMENT PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE AFIN DE MIEUX
DÉTECTER LES MANoeUVRES FRAUDULEUSES
- B. MIEUX LUTTER CONTRE LES COMPORTEMENTS ABUSIFS EN
MATIÈRE DE SANTÉ ET DE RISQUES PROFESSIONNELS, QUELLE QUE SOIT
LEUR ORIGINE
- C. RENFORCER LE CADRE RÉPRESSIF CONCERNANT
LE TRAVAIL DISSIMULÉ, LES REVENUS ILLICITES ET LES FRAUDES AUX
ALLOCATIONS CHÔMAGE
- D. ÉTENDRE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU
CHAMP DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- A. ACCROÎTRE LE PARTAGE D'INFORMATION ET
FACILITER SON TRAITEMENT PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE AFIN DE MIEUX
DÉTECTER LES MANoeUVRES FRAUDULEUSES
- II. LES AJOUTS DE LA COMMISSION DOIVENT PERMETTRE
AUX SERVICES DE JOUER À ARMES ÉGALES AVEC LES FRAUDEURS
- A. EXPLOITER L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DONT
DISPOSENT FRANCE TRAVAIL ET LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
POUR DÉTECTER LES FRAUDES LES PLUS SOPHISTIQUÉES
- B. AUTORISER LES SUSPENSIONS CONSERVATOIRES DE
PRESTATIONS POUR DONNER UN TEMPS D'AVANCE AUX SERVICES DE LUTTE CONTRE LA
FRAUDE
- C. FAIRE ÉVOLUER LES SANCTIONS EN ACCORD
AVEC LES NOUVEAUX USAGES DES FRAUDEURS
- A. EXPLOITER L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DONT
DISPOSENT FRANCE TRAVAIL ET LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
POUR DÉTECTER LES FRAUDES LES PLUS SOPHISTIQUÉES
- I. DES MESURES QUI CONTRIBUENT À LEVER
CERTAINS FREINS RENCONTRÉS PAR LES SERVICES LUTTANT CONTRE LA
FRAUDE
- EXAMEN DES ARTICLES
- TITRE IER
AMÉLIORER LA DÉTECTION
DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE
- CHAPITRE IER
Mettre en commun et exploiter les informations
nécessaires à la lutte contre la fraude
- Article 1er
Favoriser la communication des informations fiscales et douanières
- Article 2
Étendre l'accès des organismes de protection sociale aux bases de données patrimoniales
- Article 3
Favoriser la communication des informations fiscales pour l'immatriculation des personnes exerçant une activité occulte
- Article 3 bis (nouveau)
Possibilité pour l'administration fiscale et l'administration des douanes de demander aux établissements de crédit et assimilés des informations sous format dématérialisés
- Article 4
Permettre aux caisses de sécurité sociale de mandater l'une d'entre elles pour déposer une plainte pénale unique et renforcer l'articulation de l'action pénale des organismes sociaux
- Article 5
Coordination de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire en matière de lutte contre la fraude
- Article 6
Renforcement des prérogatives des services départementaux chargés du handicap et de l'autonomie en matière de lutte contre la fraude
- Article 7
Rendre obligatoire la géolocalisation des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés et le système électronique de facturation intégré
- Article 8
Lutter contre les fraudes fiscales et sociales dans le secteur des transports publics particuliers de personnes
- Article 9
Transmission des documents à l'Autorité des marchés financiers
- Article 1er
- CHAPITRE II
Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle
- Article 10
Extension du droit de communication aux agents
de l'Assurance maladie chargés de la lutte contre la fraude
- Article 10 bis (nouveau)
Consacrer légalement les missions de contrôle du régime de garantie des salaires et son droit de communication
- Article 10 ter (nouveau)
Sanction du délit d'entrave au droit de communication
des juridictions financières
- Article 11
Possibilité de recourir à des identités d'emprunt dans le cadre du contrôle de la formation professionnelle
- Article 12
Renforcement de la lutte contre la fraude, les fautes et abus aux risques professionnels
- Article 10
- TITRE II
ADAPTER LES LEVIERS DE LA LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
- CHAPITRE IER
Tarir les sources de revenus occultes ou illicites
et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
- Article 13
Obligation de versement de l'indemnisation chômage sur un compte bancaires domicilié dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et obligation de se présenter aux épreuves en cas de mobilisation du compte personnel de formation
- Article 13 bis (nouveau)
Renforcer les échanges d'informations au bénéfice de la Caisses des dépôts et consignations en matière de lutte contre la fraude au CPF
- Article 13 ter
(nouveau)
Création d'une amende réprimant de le fait de se prévaloir faussement de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle
- Article 14
Renforcement du cadre répressif en matière sociale concernant les revenus issus d'activités illicites
- Article 15
Maitriser la circulation des espèces pour lutter contre le blanchiment d'argent et le travail
- Article 16
Création d'un dispositif de sanctions administratives des organismes de formation professionnelle
- Article 16 bis (nouveau)
Respect des principes républicains et des conditions de diplôme
par les organismes de formation professionnelle
- Article 16 ter (nouveau)
Renforcement du contrôle a priori des structures déposant une déclaration d'activité
- Article 17
Levée de l'interdiction du cumul des sanctions conventionnelles et financières, extension du domaine de contrôle et renforcement des mesures de lutte contre la sur-prescription
- Article 17 bis (nouveau)
Augmentation des majorations de redressement pour travail dissimulé
- Article 17 ter (nouveau)
Suspension temporaire du tiers payant pour les assurés ayant été condamnés pour fraude à l'assurance maladie
- Article 18
Sanctionner plus sévèrement les escroqueries aux finances publiques commises en bande organisée
- Article 19
Renforcer le délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale
- Article 20
Renforcer les obligations déclaratives et des sanctions pour les trusts
- Article 20 bis (nouveau)
Extension du droit de copie de l'administration fiscale dans le cadre du contrôle des organismes délivrant des reçus fiscaux
- Article 20 ter (nouveau)
Possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques de contrôler les terminaux de paiement électronique des professionnels
- Article 20 quater (nouveau)
Demande d'évaluation du dispositif de collecte de la taxe sur les transactions financières
- Article 13
- TITRE III
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
- Article 21
Renforcer l'efficacité des mesures conservatoires dans la procédure dite
de « flagrance sociale » et supprimer le caractère suspensif de l'opposition à contrainte en cas de redressement pour travail dissimulé
- Article 22
Renforcer les obligations et la solidarité financière des maîtres d'ouvrage pour lutter contre le travail dissimulé
- Article 22 bis (nouveau)
Renforcer le dispositif de liste noire pour lutter contre le travail illégal
- Article 23
Délais de reprise de l'administration fiscale
- Article 24
Précision du délai de reprise de l'administration en matière de financement de la formation professionnelle
- Article 24 bis (nouveau)
Renforcement du recouvrement des indus frauduleux de RSA, et des conditions de cumul avec des revenus d'auto-entrepreneur
- Article 25
Pouvoir de contrainte de la Caisse des dépôts et consignations
- Article 26
Autorisation des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales à saisir la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre de la procédure d'opposition à tiers détenteur
- Article 27
Renforcement des moyens de recouvrement des fraudes
aux allocations de chômage
- Article 28 (nouveau)
Droit d'information de France Travail et suspension conservatoire des allocations versées dans le cas d'un doute sérieux de fraude
- Article 29 (nouveau)
Suspension conservatoire des prestations sociales versées dans le cas d'un doute sérieux de fraude
- Article 21
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 111
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (procédure accélérée),
Par Mme Frédérique PUISSAT et M. Olivier HENNO,
Sénateurs
(1)
Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller,
président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure
générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol,
Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique
Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin,
M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge,
vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne
Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ;
Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne
Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa,
Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne,
Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc
Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli,
Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude
Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte
Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges
Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel,
Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre
Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia
Sollogoub, Anne Souyris.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
24, 104, 106 et 112 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La commission des affaires sociales a adopté avec modifications le projet de loi, considérant qu'il apporterait des mesures utiles à la lutte contre la fraude et qu'il améliorerait le consentement à l'impôt.
L'examen de ce texte a été pour partie délégué à la commission des finances et à la commission du développement durable.
*
**
Selon les évaluations du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), la fraude sociale représenterait un manque à gagner annuel d'au moins 13 milliards d'euros (Mds €), réparti, à peu près équitablement entre la fraude aux cotisations sociales et la fraude aux prestations sociales. Pourtant, les organismes de sécurité sociale n'ont été en mesure de détecter, en 2024, qu'une fraude totale de 2,9 Mds € et d'en recouvrer un montant marginal.
Source : Haut Conseil du financement de la protection sociale
Les rapporteurs ont accueilli favorablement les mesures contenues dans ce texte qu'ils ont jugées pertinentes, quoique parfois insuffisantes. Sur leur proposition, la commission a significativement réhaussé l'ambition du texte en donnant aux caisses de sécurité sociale, aux départements ou aux opérateurs les moyens de « muscler le jeu » face aux fraudeurs. Il s'agit de permettre une détection des fraudes plus rapide, ainsi qu'un recouvrement plus efficace.
I. DES MESURES QUI CONTRIBUENT À LEVER CERTAINS FREINS RENCONTRÉS PAR LES SERVICES LUTTANT CONTRE LA FRAUDE
A. ACCROÎTRE LE PARTAGE D'INFORMATION ET FACILITER SON TRAITEMENT PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE AFIN DE MIEUX DÉTECTER LES MANoeUVRES FRAUDULEUSES
L'article 2 propose d'étendre plus largement l'accès aux bases de données patrimoniales de la direction générale des finances publiques (DGFiP) au bénéfice des agents habilités d'organismes qui n'y sont pas autorisés jusque-là, à commencer par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). La commission a étendu cette logique à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et à certains services départementaux pour l'instruction de certaines prestations comme le revenu de solidarité active (RSA)
L'article 5, reprend le dispositif d'un amendement sénatorial en PLFSS pour 2025, et entend supprimer la logique de travail « en silo » des services en charge de la lutte contre la fraude au sein de l'assurance maladie obligation (AMO) et complémentaire (AMC). Pour cela, il autorise les entreprises d'assurance et les mutuelles à mieux exploiter les données de santé de leurs assurés couverts par un contrat d'assurance maladie, maternité ou accident, ainsi qu'à échanger des informations avec les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM).
Dans la même logique, l'article 6 doit permettre aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services chargés de l'instruction de l'aide personnalisée d'autonomie (APA) de partager des informations personnelles dans le seul objectif d'une meilleure détection des agissements frauduleux.
De même, l'article 10 entend renforcer le partage d'information en élargissant le droit de communication des CPAM afin d'obtenir des renseignements et documents sans que le secret professionnel n'y soit opposé.
Enfin, afin de simplifier et d'adapter les procédures, l'article 4 met en place un dispositif de plainte pénale unique pour les caisses et organismes victimes de fraude d'ampleur.
B. MIEUX LUTTER CONTRE LES COMPORTEMENTS ABUSIFS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE RISQUES PROFESSIONNELS, QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE
L'article 7 vise à imposer, à compter de 2027, la géolocalisation des véhicules des transporteurs sanitaires ou de taxis conventionnés, ainsi que le recours au système électronique de facturation intégré. Cette mesure doit, à elle seule, permettre une économie de 32 millions d'euros par an.
Dans le champ de la branche AT-MP, l'article 12 doit permettre d'adapter les sanctions à la progression des fraudes concernant les aides versées par la branche en matière de prévention, et renforcer les prérogatives des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité. La commission a cependant souhaité maintenir les sanctions financières en vigueur concernant la sanction d'absence de dématérialisation de la notification d'AT-MP.
L'article 17 vise à mieux réguler la sur-prescription des professionnels de santé, d'une part en permettant le cumul entre la sanction conventionnelle et la pénalité financière, et d'autre part en renforçant la procédure de mise sous objectif des médecins les plus prescripteurs. En outre, il aligne le contrôle des centres de santé et des plateformes de téléconsultation sur celui des autres professionnels de santé.
C. RENFORCER LE CADRE RÉPRESSIF CONCERNANT LE TRAVAIL DISSIMULÉ, LES REVENUS ILLICITES ET LES FRAUDES AUX ALLOCATIONS CHÔMAGE
L'article 14 propose de majorer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) des revenus issus d'activités illicites, et de les prendre en compte dans le calcul des revenus de remplacement servis par France Travail. La commission a étendu cette possibilité à l'ensemble des prestations sous condition de ressources. Parallèlement, l'article 27 permet enfin de renforcer l'efficacité du recouvrement des indus frauduleux par France travail, en autorisant l'opérateur à saisir directement les indus chez des tiers débiteurs du fraudeur.
L'article 21 vise à faciliter le recouvrement des cotisations éludées en cas de travail dissimulé à travers un dispositif de flagrance sociale, en permettant une saisie à titre conservatoire des actifs d'une entreprise suspectée de travail dissimulé dès lors que le procès-verbal de constat été dressé.
L'article 22 vise à rehausser les obligations qui incombent au maître d'ouvrage sur l'absence de travail dissimulé en instaurant un devoir de vigilance vis-à-vis de tous les sous-traitants, y compris ceux qui ne sont pas ses cocontractants. Cette mesure doit permettre de lutter contre le phénomène de sous-traitance en cascade. La commission a soutenu la mesure et a renforcé le dispositif.
D. ÉTENDRE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU CHAMP DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'article 13 oblige le titulaire du compte personnel de formation (CPF) à se présenter aux épreuves de sa formation certifiante, évitant ainsi les inscriptions de complaisance et autres montages financiers frauduleux (inscription du stagiaire contre rétribution).
L'article 16 propose de créer un dispositif de sanctions administratives mobilisables par les services régionaux de contrôles (SRC) de la formation professionnelle, afin de déjudiciariser ces contrôles et d'en renforcer l'efficacité.
Enfin, l'article 24 permet de préciser le délai de reprise de l'administration en matière de financement de la formation professionnelle, tandis que l'article 25 octroie à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir de contrainte sur les titulaires d'un CPF en cas de manoeuvres frauduleuses.
II. LES AJOUTS DE LA COMMISSION DOIVENT PERMETTRE AUX SERVICES DE JOUER À ARMES ÉGALES AVEC LES FRAUDEURS
Les rapporteurs considèrent que le législateur doit tenir compte de la métamorphose de la fraude sociale, qui est entrée dans une nouvelle ère : plus complexe, plus systématique, et plus surtout lucrative.
A. EXPLOITER L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DONT DISPOSENT FRANCE TRAVAIL ET LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR DÉTECTER LES FRAUDES LES PLUS SOPHISTIQUÉES
Les travaux des rapporteurs, et notamment les échanges avec les services de France Travail, ont mis en lumière que les fraudeurs tirent profit des outils numériques et se jouent des frontières, tandis que l'administration ne s'autorise pas l'exploitation des données dont elle dispose pourtant. Pour mettre un terme à ce rapport de force déséquilibré, la commission a choisi de doter les services de France Travail et des organismes de sécurité sociale, d'un accès au fichier des compagnies aériennes, d'un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie ou encore les autoriser à traiter les données de connexion de leurs assurés. Ces outils ne sont mobilisables que dans l'unique but de déceler des manoeuvres frauduleuses, et doivent par ailleurs respecter les exigences du droit européen de la protection des données.
De même, la commission a permis à la Caisse des dépôts de se voir communiquer les informations qui lui manquent, de la part des greffes des tribunaux de commerces ou des banques, pour identifier les entreprises éphémères qui se comportent en prédatrices sur le marché de la formation.
B. AUTORISER LES SUSPENSIONS CONSERVATOIRES DE PRESTATIONS POUR DONNER UN TEMPS D'AVANCE AUX SERVICES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Face à des sociétés qui organisent leur liquidation avant le recouvrement de la fraude ou qui transfèrent les fonds à l'étranger, la commission a souhaité innover, en supprimant l'effet suspensif des contraintes que peut délivrer la Caisse des dépôts pour recouvrer, avant qu'il ne soit trop tard, les sommes indues de CPF versées à des sociétés fraudeuses.
Dans la même logique, elle a entendu permettre aux organismes de protection sociale de suspendre à titre conservatoire le versement d'une allocation en cas d'indices sérieux de fraudes. Cette possibilité a, là encore, été encadrée par des garanties procédurales pour l'assuré social présumé fraudeur, notamment en matière de contradictoire et de délai de suspension.
La fraude se nourrit du système déclaratif français qui repose sur le contrôle a posteriori du versement des prestations sociales.
C. FAIRE ÉVOLUER LES SANCTIONS EN ACCORD AVEC LES NOUVEAUX USAGES DES FRAUDEURS
La commission a enfin souhaité agir face à certaines fraudes relativement nouvelles, auxquelles le droit en vigueur ne permet pas encore de répondre de manière satisfaisante. Il en va ainsi de la nouvelle sanction contre les organismes de formation professionnelle relevant de logiques d'emprise, d'entrisme ou de charlatanisme.
La commission a aussi renforcé le dispositif de « liste noire » du ministère du travail, sur laquelle est diffusé le nom des entreprises condamnées pour travail dissimulé faisant l'objet de cette peine complémentaire. De même, sur la proposition des rapporteurs, a été introduit le déremboursement des prescriptions des professionnels de santé déconventionnés pour cause de fraude avérée.
Réunie le mercredi 5 novembre 2025 sous la présidence de Jean Sol, vice-président, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de ses rapporteurs Frédérique Puissat et Olivier Henno et a adopté le projet de loi modifié par 48 amendements.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
IER
AMÉLIORER LA DÉTECTION
DE LA FRAUDE FISCALE ET
SOCIALE
CHAPITRE
IER
Mettre en commun et exploiter les informations
nécessaires à la lutte contre la fraude
Article 1er
Favoriser la communication des informations
fiscales et douanières
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2
Étendre l'accès des organismes de protection
sociale aux bases de données patrimoniales
Cet article propose d'autoriser les agents habilités des organismes de protection sociale, et notamment la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), à accéder aux bases de données patrimoniales de la direction générale des finances publiques.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement des rapporteurs, lequel étend aux départements, aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) le bénéfice des présentes dispositions.
I - Le dispositif proposé
A. Des premiers accès octroyés par le législateur en 2018 et 2020
Le livre des procédures fiscales, à son article L. 103, consacre le principe du secret fiscal qui s'applique « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services ». Ce secret fiscal s'impose donc aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les conditions prévues par le code pénal1(*) pour encadrer et réprimer les atteintes au secret professionnel.
Aux articles L. 115 et suivants, il assortit toutefois cette obligation de dérogations au bénéfice de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics dont les agents habilités sont alors soumis au secret dans les mêmes conditions.
Dans le champ social, ces dérogations furent prévues par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude2(*) et étendues par la loi de finances pour 20213(*). Elles consistent à un accès direct à trois bases de données de la DGFiP.
Les trois fichiers mis en oeuvre par la DGFiP
Prévue par un arrêté du 11 avril 20254(*), le traitement de données dénommé « base nationale des données patrimoniales » (BNDP) recense les informations patrimoniales contenues dans les documents déposés par les redevables auprès des services d'enregistrement ou en charge de la publicité foncière. Les informations répertoriées comprennent l'identité et l'adresse des parties, les références cadastrales et les adresses des biens immobiliers ou les descriptifs des biens mobiliers ainsi que les montant des transactions.
L'outil « Estimer un bien » (soit le fichier Patuela anciennement dénommé PATRIM5(*)) recensent, en vertu de l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales, les informations (adresses, références cadastrales et montant de la transaction) concernant les ventes de biens immobiliers pour les besoins d'évaluation des biens.
Enfin, le fichier « Ficovie »6(*) répertorie les informations, recensées en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, relatives aux contrats de capitalisation ou aux placements de même nature, notamment les contrats d'assurance-vie, dont le montant est supérieur ou égal à 7 500 €.
Ainsi l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales autorise-t-il, aux fins de mener leurs missions de lutte contre le travail illégal, les agents de contrôle de l'inspection du travail, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), des caisses générales de sécurité sociale en outre-mer, et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) l'accès aux trois bases BNDP, Patuela et Ficovie.
De même, pour les besoins de l'accomplissement des missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions en matière de fraude sociale7(*), l'article L. 134 D du même livre prévoit l'accès direct :
- au fichier Ficovie au bénéfice des agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), des caisses générales de sécurité sociale, de l'opérateur France Travail8(*) et des caisses de MSA ;
- aux bases BNDP et Patuela au profit des agents des CAF, des caisses générales de sécurité sociale, de l'opérateur France Travail et des caisses de MSA.
Cet accès direct est autorisé à des agents individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret9(*).
B. Le dispositif proposé : compléter ce droit d'accès
Le présent article vise à compléter les droits d'accès aux bases de données de la DGFiP afin, selon l'étude d'impact, de faciliter le repérage des fraudes et surtout le recouvrement des sommes dues par les fraudeurs.
• Il est proposé une rédaction globale de l'article précité L. 134 D qui fusionnerait les deux listes prévues par le droit en vigueur, en autorisant tous les organismes mentionnés à accéder à l'ensemble des bases de données. Ainsi, les agents habilités des Cpam, des Carsat et de la Cnav disposerait d'une autorisation légale d'accéder aux bases BNDP et Patuela.
• En outre, il est proposé d'adjoindre la Caisse nationale d'assurance maladie à cette liste d'organisme, considérant que l'installation nouvelle d'enquêteurs judiciaires au sein de la Cnam rend désormais nécessaire cette autorisation législative.
• Enfin, un second alinéa à l'article L. 134 D renverrait à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les organismes « assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées ». Cet encadrement a été retenu par le Gouvernement sur la proposition du Conseil d'État10(*) afin de tenir compte d'une décision du 12 juin 2025 du Conseil constitutionnel dans laquelle l'absence de ces conditions avait, en partie, justifié la censure d'une dérogation au secret fiscal11(*).
II - La position de la commission : des dispositions bienvenues qu'il convient encore d'étendre
Les rapporteurs accueillent favorablement cet élargissement de l'accès direct aux fichiers tenus par la DGFiP et qui doit notamment, selon le Gouvernement, renforcer les moyens donnés aux organismes de protection sociale, en particulier à la Cnam, pour lutter contre les fraudes dites à enjeux. Il s'agit de contrer les organisations mises en oeuvre par des fraudeurs afin de dissimuler des biens et ainsi de limiter les possibilités de recouvrement par les organismes de protection sociale.
À l'initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-115, qui a étendu le dispositif sur trois points :
- en ajoutant la Cnaf aux organismes autorisés à habiliter certains de ses agents à accéder aux trois bases de données. Il apparait en effet opportun de donner les mêmes pouvoirs d'enquête aux agents de contrôle du service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE) créé en 2021 au sein de la Cnaf ;
- en étendant les présentes dispositions aux agents des services des départements et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour lutter contre la fraude liée à l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap ;
- et en donnant également un accès direct à Ficovie et au fichier des comptes bancaires (Ficoba) aux agents des services départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA). Selon l'association Départements de France, dans sa contribution adressée aux rapporteurs, les informations contenues dans ces bases de données sont nécessaires pour apprécier les conditions de ressources des allocataires et garantir le paiement à bon droit. Un accès indirect, via des portails spécifiques, fait l'objet d'échanges, depuis 2021, avec la DGFiP, laquelle n'a toujours pas mis en oeuvre les développements opérationnels nécessaires.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
3
Favoriser la communication des informations fiscales pour
l'immatriculation des personnes exerçant une activité occulte
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-98 du rapporteur pour avis.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 bis
(nouveau)
Possibilité pour l'administration fiscale et
l'administration des douanes de demander aux établissements de
crédit et assimilés des informations sous format
dématérialisés
Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement n° COM-99 du rapporteur pour avis insérant le présent article additionnel.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article
4
Permettre aux caisses de sécurité sociale de mandater l'une
d'entre elles pour déposer une plainte pénale unique et renforcer
l'articulation de l'action pénale des organismes sociaux
Cet article propose de créer une plainte pénale unique qui pourra être déposée par un organisme de sécurité sociale pour le compte d'autres organismes victimes d'une seule et même fraude. Cette procédure fluidifiera le traitement judiciaire des plaintes pour fraude, alors que les organismes de sécurité sociale sont tenus de déposer plainte lorsque la fraude excède un plafond fixé par décret.
La commission a adopté cet article modifié par deux amendements, le premier sécurisant le dispositif de plainte pénale unique et le second étendant la dispense de consignation des organismes de sécurité sociale à la procédure de citation directe de l'auteur présumé d'une fraude devant un tribunal.
I°- Le dispositif proposé
A. Les organismes de sécurité sociale ont l'obligation de déposer plainte lorsqu'ils sont victimes d'une fraude qui excède un certain plafond
1°- Les différentes modalités de dépôt de plainte qui s'offrent à la victime alléguée d'une infraction pénale
Le code de procédure pénale organise différents moyens dont disposent les personnes morales et physiques victimes d'une infraction pour en obtenir réparation devant les juridictions pénales.
Le dépôt d'une plainte est laissé à la libre appréciation de la victime. Il peut y être recouru à tout moment de la procédure pénale : elle peut être faite en ligne ou adressée par courrier au procureur de la République territorialement compétent. Elle peut également être déposée pendant une audition de la victime lors de l'enquête préliminaire. L'article 15-3 du code de procédure pénale prévoit que tout dépôt de plainte soit consigné au terme d'un procès-verbal.
L'action publique, qui consiste en le fait de poursuivre des infractions pour réparer le préjudice qu'elles ont causé au corps social, appartient à la société qui en confie l'exercice à titre principal au ministère public, soit le procureur de la République et les magistrats qui composent son Parquet. Ces derniers peuvent mettre en mouvement l'action publique dès qu'ils ont connaissance de faits matériels susceptibles de caractériser une infraction pénale, et ils ne sont pas liés par l'existence d'une plainte d'une victime alléguée.
La constitution de partie civile permet à la victime alléguée de s'associer à la mise en mouvement de l'action publique par voie d'intervention, en se joignant à l'action engagée par le procureur de la République, et à défaut, de mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie d'action, en saisissant le doyen des juges d'instruction du tribunal territorialement compétent.
Le dépôt de plainte par la victime lors de l'enquête diligentée par le procureur de la République, ou directement auprès de ses services, est la voie la plus simple et la plus répandue dans les faits. La plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction est procéduralement plus lourde, ce qui explique qu'elle soit soumise à de strictes conditions de recevabilité, définies à l'article 85 du code de procédure pénale.
La plainte portant sur un délit n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie de l'absence de poursuites engagées par le Parquet, soit que le procureur de la République l'ait expressément informée du fait qu'il n'engagerait pas de poursuites à la suite de la plainte qui a été déposée devant lui ou les services de police 12(*), soit qu'un délai de trois mois se soit écoulé depuis son dépôt de plainte.
Au-delà de la plainte, la constitution de partie civile, qui est un préalable à la formulation de demandes civiles d'indemnisation du préjudice subi, peut se faire tout au long de la procédure pénale, jusqu'aux réquisitions du Parquet à l'audience de jugement d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel, d'une cour d'assises ou d'une cour criminelle départementale.
2 - Le code de la sécurité sociale comporte des dispositions spéciales encadrant les plaintes des organismes de sécurité sociale victimes de fraude
Si le dépôt de plainte relève en droit commun de la simple faculté, l'objectif de lutte contre la fraude a justifié que le législateur impose aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'une part, et chargés du recouvrement de cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations sociales d'autre part, de porter plainte en se constituant partie civile lorsqu'à l'issue des investigations menées par leurs agents, une fraude dont le préjudice excède un certain plafond fixé par décret est constatée.
Ce plafond est fixé à l'article D. 114-5 du code de la sécurité sociale, à huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les fraudes aux prestations des branches maladie, accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que pour le recouvrement de cotisations et contributions, et à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les fraudes aux prestations relevant de la branche vieillesse.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction est déposée par les organismes de sécurité sociale qui en ont l'obligation, ils sont dispensés de la consignation qui est normalement obligatoire aux termes de l'article 88 du code de procédure pénale.
L'une des conditions de recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile est l'existence d'un préjudice allégué et une relation directe entre celui-ci et une infraction pénale. Or, le versement de cotisations, de prestations et de contributions sociales est toujours effectué par des organismes locaux, les caisses de sécurité sociale étant soit départementales, soit régionales.
Les dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction actuellement en vigueur, prévoient que les organismes nationaux soient avisés par les organismes locaux de la suite donnée à la fraude, mais qu'à défaut de plainte avec constitution de partie de l'organisme local lésé, les organismes nationaux puissent agir en leur nom ou pour leur compte après l'expiration d'un délai d'un mois suivant une mise demeure décernée à l'encontre des organismes locaux et restée infructueuse, ou que les organismes nationaux déposent une plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes qui les mandatent à cette fin.
B. Le présent article rationalise et simplifie le dépôt de plainte des organismes de sécurité sociale via un mécanisme de plainte pénale unique.
Le présent article réécrit entièrement l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale en créant une plainte pénale unique. Cet article L. 114-9 serait désormais structuré en six parties.
Certaines dispositions du droit existant restent inchangées, et font l'objet d'un simple réagencement. Le I reprend ainsi in extenso les dispositions qui figurent à l'alinéa 3 de l'article L. 114-9 dans sa version actuelle, et qui énoncent l'obligation qui incombe aux organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale, de concevoir et de mettre en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale, de suivre les opérations réalisées annuellement à ce titre et d'en établir une synthèse annuelle selon des modalités précisées par arrêté.
Le II reprend les dispositions qui figuraient au premier alinéa de la version de l'article actuellement vigueur, qui prévoient que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnés au code de la sécurité sociale sont tenus de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires lorsqu'ils ont connaissance d'information ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, et de transmettre à l'autorité compétente le rapport établi à l'issue des investigations.
Les dispositions du nouveau III réécrivent l'obligation qui incombe aux organismes de porter plainte lorsque la fraude constatée excède un montant fixé par plafond, en supprimant la référence à la plainte avec constitution de partie civile, porteuse d'ambigüité en ce qu'elle pouvait être interprétée comme faisant uniquement référence à la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Or, une telle rédaction n'était pas conforme à la lettre de l'article 85 du code de procédure pénale, qui fixe comme condition de recevabilité d'une plainte avec constitution de partie devant le juge d'instruction en cas de délit, à l'absence de poursuites de la part du procureur de la République.
Désormais, les organismes de sécurité sociale victimes d'une fraude dont le montant dépasse le plafond fixé à l'article D. 114-5 du code de la sécurité, seraient tenus de déposer plainte, ce qui vise d'abord une plainte devant le procureur de la République.
La possibilité, pour les organismes locaux de mandater un organisme tiers pour déposer plainte, est élargie non plus aux seuls organismes nationaux mais à des organismes tiers, ce qui inclut désormais les autres caisses de sécurité sociale. Ce mécanisme est désormais ouvert pour les dépôts de plainte pénale, alors qu'ils l'étaient auparavant pour les seules plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
Cela permet de favoriser le regroupement des plaintes pénales pour fraude qui seraient déposées par plusieurs organismes.
Lorsque la fraude est constatée au terme d'un procès-verbal transmis au procureur de la République, les dispositions du nouveau IV prévoient désormais que les organismes sont dispensés de l'obligation de déposer plainte, et ce afin de simplifier la mise en mouvement de l'action publique. Il n'en demeure pas moins que le monopole de l'opportunité des poursuites permet déjà au Parquet de mettre en mouvement l'action publique sur le fondement d'éléments matériels en sa possession (tels que les procès-verbaux). La dispense de consignation prévue en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction est maintenue et précisée.
Le V prévoit qu'un organisme d'assurance maladie obligatoire qui dépose une plainte au pénal ou constate une fraude par procès-verbal transmette au procureur de la République le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaires concernés afin que le Parquet puisse les informer des suites de la procédure pénale en cas d'engagement de poursuites. Les dispositions prévoyant l'information des caisses complémentaires dès la mise en oeuvre de la procédure de contrôle sont supprimées et réintroduites à l'article L. 114-9-1 nouvellement créé par l'article 5 du présent projet de loi.
Le VI reprend les dispositions de l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale informent les employeurs d'un assuré en cas de fraude avérée en vue du versement d'indemnités journalières, et les transmettent les renseignements et documents strictement utiles à caractériser cette fraude. Cet ajout a été inspiré par un amendement déposé par la sénatrice Nathalie Goulet.13(*)
III - La position de la commission
La commission des affaires sociales est favorable à tous les dispositifs qui permettent de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
De ce point de vue, la réécriture de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale était nécessaire afin de lever l'ambigüité relative à l'obligation de déposer plainte qui s'impose aux organismes de sécurité sociale lorsque la fraude dépasse un certain plafond fixé par décret, et dont la rédaction pouvait laisser à penser que cette obligation se matérialisait nécessairement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
La commission a toutefois apporté certaines modifications de fond pour enrichir le dispositif. Elle a ainsi adopté un amendement COM-117 visant à étendre la dispense de consignation aux procédures de citation directe initiées par les organismes de sécurité sociale pour obtenir indemnisation de fraude par eux subis. En effet, la victime alléguée d'une fraude dispose de deux voies procédurales distinctes pour mettre en mouvement l'action publique par voie d'action et se substituer au Parquet : soit en saisissant le juge d'instruction en se constituant partie civile, soit en saisissant directement un tribunal, par exploit de commissaire de justice. Dans ces deux cas, lorsqu'elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, la partie civile est tenue de consigner14(*). La commission a donc étendu la dispense de consignation à la procédure de citation directe.
Enfin, elle a également adopté un amendement COM-116 supprimant la mention selon laquelle les organismes de sécurité sociale se constituent partie civile lorsque le procureur de la République « donne suite à la plainte ». Cette rédaction était trop imprécise et source d'insécurité juridique, et superflue dans la mesure où les articles 418 et suivants du code de procédure pénale permettent déjà à la victime de se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale. Il n'y avait donc pas nécessité de d'introduire des dispositions dérogatoires.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
5
Coordination de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire
en matière de lutte contre la fraude
Cet article propose de faire évoluer le cadre juridique des traitements de données de santé opérés par les organismes complémentaires afin de renforcer les échanges d'information en matière de lutte contre la fraude sociale.
La commission a adopté cet article modifié par quatre amendements précisant l'encadrement règlementaire des garanties de sécurité des tiers chargés du traitement des données de santé ainsi que la consultation des professionnels de santé et mettant en place une communication de l'employeur aux organismes chargés d'un régime de prévoyance pour les indemnités journalières.
I - Le dispositif proposé
A. La coopération entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé reste un axe inabouti de la lutte contre la fraude
1. Un cadre législatif restrictif qui semble inadapté aux enjeux de la fraude
La mission d'information sénatoriale sur les complémentaires santé a alerté dès 202415(*) sur les défaillances de la lutte contre la fraude sociale due « à une organisation en silo » de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. Face aux enjeux financiers de la fraude sociale, l'assurance maladie obligatoire (AMO) comme l'assurance maladie complémentaire (AMC) mettent en place des actions de détection de la fraude, sans toujours coordonner leurs efforts, ni communiquer leurs résultats le cas échéant.
Ce manque de coordination trouve en grande partie son origine dans le cadre législatif, qui permet une communication asymétrique et limitée entre AMO et AMC. L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale prévoit en effet la possibilité pour les directeurs d'organismes du régime obligatoire « d'informer (...) s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré » des résultats des contrôles ou enquêtes qui ont été conduites à la suite d'une suspicion de fraude. En revanche aucune base légale ne permet explicitement aux organismes de complémentaires de communiquer de telles informations à l'AMO. De même, les informations transmises par les organismes de l'AMO ne peuvent pas excéder celles qui ressortent strictement de l'enquête pour fraude, alors même que d'autres informations peuvent être susceptibles de conduire à des détections de fraudes.
2. Une volonté de décloisonnement déjà portée lors du PLFSS pour 2025, mais censurée comme cavalier social par le Conseil constitutionnel
Lors du PLFSS pour 202516(*), l'article 16 bis A, introduit en première lecture par un amendement de la rapporteure de la branche maladie de la commission des affaires sociales du Sénat17(*), visait déjà à mieux coordonner la lutte contre la fraude entre AMO et AMC.
Cet article prévoyait déjà une base légale au partage de données de l'AMC vers l'AMO, tout en assoupissant les motifs de communication de données depuis l'AMO. Parallèlement, il posait des garanties relatives au respect du droit à la protection des données en prévoyant l'effacement desdites données passé l'exploitation, et le respect d'un avis de la Cnil dans l'élaboration des décrets d'application.
Cependant, cet article a été censuré en tant que cavalier social par la décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025 du Conseil constitutionnel, considérant que ses dispositions « n'avaient pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. »18(*)
Cette censure était d'autant plus dommageable que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a appelé en 2022, dans un avis relatif à la mise en oeuvre du « 100% santé », à une adaptation du cadre juridique afin de sécuriser le traitement par les organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) des données couvertes par le secret médical.
B. Le dispositif proposé
Le présent article propose donc de procéder à une meilleure coordination des actions de lutte contre la fraude entre les organismes de l'AMO et de l'AMC, en reprenant les apports de l'article proposé par la commission des affaires sociales lors du dernier PLFSS.
1. Les dispositions consacrées au traitement des données de santé par les organismes d'assurance
Le I tend à créer un nouveau chapitre, composé de cinq articles, au sein du code des assurances, consacré aux « contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident ».
L'article L. 135-1 nouvellement créé autorise les entreprises d'assurance à traiter les données de santé de leurs assurés couverts par un contrat d'assurance relatif aux frais de maladie, maternité ou accident, de même que les données des professionnels et organismes ayant prescrit ou dispensé les actes ou prestations. Cette possibilité est cependant restreinte aux conditions posées par le règlement général sur la protection des données (RGPD)19(*), et par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de 197820(*).
La protection des données à
caractère personnel relatives à la santé
par le droit
européen - l'article 9 du RGPD
1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée ;
b) le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée ;
c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées;
e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ;
f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle ;
g) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un `État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ;
h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, la prise en charge sanitaire ou sociale, ou la gestion des systèmes et des services sanitaires ou sociaux sur la base du droit de l'Union, du droit d'un' État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3 ;
i) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel; ou
j) le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.
3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.
4. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé.
L'article L. 135-2 nouvellement créé précise que les données concernées par ce traitement doivent être strictement nécessaires à un de ces trois objectifs :
- le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, maternité ou accident dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
- le contrôle et les vérifications du respect des contrats couvrant les assurés ou des conventions souscrites avec les professionnels de santé ;
- le soutien d'une action en justice.
L'article L. 135-3 nouvellement créé impose aux entreprises d'assurance de garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des droits des personnes concernées. Il impose notamment que les données soient conservées pour une durée nécessaire, qu'elles soient stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, et que seuls des professionnels de santé ou des personnes placés sous leur autorité tenues au secret médical puissent y avoir accès.
L'article L. 135-4 nouvellement créé autorise par dérogation21(*) les professionnels de santé et les établissements ou organismes auxquels ils appartiennent à communiquer aux entreprises d'assurance, dans le cadre du tiers-payant, les données « relatives aux actes effectués et aux prestation servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droits »22(*).
L'article L. 135-5 nouvellement créé prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, précise les modalités d'application du chapitre créé concernant les catégories de données traitées, les durées de conservation ainsi que les modalités d'information des assurés et professionnels de santé concernés.
2. Les dispositions consacrées au traitement des données de santé par les mutuelles
Le II du présent article créé une nouvelle section au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité. Cette section, également intitulée « contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident », est composée de cinq articles nouvellement créés, dupliquant à l'identique, pour les mutuelles et unions mutuelles, les dispositions relatives aux organismes d'assurance présentées ci-avant.
3. Les dispositions consacrées aux échanges des organismes relevant du régime obligatoire
Le 1° du III du présent article insère cinq nouveaux articles au sein du code de la sécurité sociale.
L'article L. 114-9-1 nouvellement créé impose aux agents des organismes d'AMO de communiquer aux organismes de l'AMC les informations nécessaires à l'identification des auteurs de fraudes sociales identifiée lors d'une enquête ou d'un contrôle. De même les décisions de déconventionnement prononcées doivent faire l'objet d'une communication.
L'article L. 114-9-2 nouvellement créé impose une communication analogue de la part des agents des organismes de complémentaire vers les agents de l'assurance maladie obligatoire. Les informations ainsi obtenues par l'AMO ne peuvent être conservées que si elles conduisent à un contrôle ou à une enquête.
L'article L. 114-9-3 nouvellement créé impose le secret professionnel à tous les agents d'organismes de l'AMC impliqués dans les échanges de données de santé prévus aux deux articles précédents. De même, l'utilisation des données communiquées à d'autres fin que la lutte contre la fraude est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
L'article L. 114-9-4 nouvellement créé autorise les organismes de l'AMC à recourir à un intermédiaire afin de communiquer les données de santé dans les cas prévus dans les articles précédents, à la condition que celui-ci présente des garanties de haut niveau de sécurité des données.
L'article L. 114-9-5 nouvellement créé renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, les conditions et modalités de mise en oeuvre des échanges d'information prévus.
Le 2° du III du présent article propose de compléter par cinq articles la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Ces articles nouvellement créés dupliquent à l'identique, pour les institutions de prévoyance, les dispositions relatives aux organismes d'assurance présentées ci-avant.
4. La coordination du présent article avec la loi de 1978
Le IV du présent article ajoute à la liste prévue à l'article 65 de la loi dite « informatique et libertés », qui précise les traitements de données de santé permis à titre dérogatoire, les traitements en vue de lutte contre la fraude ouverte par le présent article.
II - La position de la commission
Les rapporteurs se félicitent que l'initiative sénatoriale adoptée l'année dernière trouve un véhicule législatif ad hoc pour entrer dans le droit positif. Cet article reprend en effet l'essentiel du travail de la commission des affaires sociales afin de décloisonner les efforts des organismes de l'AMO et de l'AMC afin de renforcer la lutte contre la fraude.
Par ailleurs, les garanties en matière de protection des données de santé à caractère personnel sont conformes à l'avis rendu par la Cnil communiqué aux rapporteurs, ainsi que plus largement aux exigences du RGPD. Néanmoins, l'amendement n° COM-119 des rapporteurs resserre encore ces exigences en disposant que le décret en Conseil d'État relatif aux intermédiaires de traitement des données précise les garanties nécessaires pour opérer de la sorte.
Afin de prendre en compte les fraudes majeurs pouvant toucher les prestations en espèces, les rapporteurs ont entendu les inquiétudes des organismes mutualistes, et ont prévu un mécanisme d'information par l'employeur des organismes chargés d'un régime de prévoyance lorsque ce dernier est prévenu par la Cpam de la suspension du versement d'une indemnité journalière (IJ) à raison d'une fraude (amendement n° COM-120).
La commission a également adopté un amendement du sénateur Alain Milon (n° COM-32 rect. quater) associant les représentants des professionnels de santé à la prise des décrets d'application, ainsi qu'un amendement rédactionnel des rapporteurs (n° COM-118).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
6
Renforcement des prérogatives des services départementaux
chargés du handicap et de l'autonomie en matière de lutte contre
la fraude
Cet article propose d'inscrire les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les services chargés de l'instruction de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au sein de la liste des organismes pouvant partager des informations personnelles dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La lutte contre la fraude dans le champ du handicap souffre de la dualité entre contrôleur et payeur des prestations
En tant que gestionnaire de la branche autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est tenue de « concevoir et mettre en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude » concernant les prestations entrant dans son périmètre23(*). Cependant, contrairement aux autres branches du régime général, la CNSA ne dispose pas d'un réseau de caisses locales, et finance donc directement des prestations via le réseau déconcentré des agences régionales de santé (ARS) ou les caisses d'allocation familiales (CAF)24(*), et indirectement via des fonds de concours aux départements25(*).
La lutte contre la fraude au sein de la
feuille
de route stratégique 2025-2026 de la CNSA
Publiée le 10 juillet 2025, la feuille de route stratégique de la CNSA pour 2025-2026 comporte notamment un axe « Capitaliser sur notre patrimoine de données », au sein duquel l'action 4.5 vise à exploiter les données au service de la lutte contre le non-recours et contre la fraude. Le catalogue de données disponibles devrait, dans ce cadre, donner lieu à une exploitation sécurisée, recourant le cas échéant à des solutions d'intelligence artificielle, afin de mieux cibler les actions de contrôle engagées par la CNSA.
Source : Feuille de route stratégique 2025-2026 de la CNSA
Les MDPH en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de même que les services en charge de l'APA au sein des départements, ne constituent des organismes de sécurité sociale. Dès lors, ils ne sont pas couverts par les objectifs de lutte contre la fraude définis à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, et doivent se voir consacrer en la matière des objectifs et des moyens spécifiquement au sein du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, les missions assignées par le législateur aux MDPH26(*) ne contiennent aucune mention à la lutte contre la fraude. En revanche les services chargés de l'Apa peuvent effectuer un contrôle de l'effectivité des heures d'aide à domicile relevant du plan d'aide27(*).
C'est ce constat qui a conduit l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales, dans un rapport de mai 202528(*) à parler d'une « culture du contrôle et de la lutte contre la fraude embryonnaire », et à en analyser les raisons structurelles. Ledit rapport souligne tout d'abord la distinction entre instructeur et payeurs des demandes d'aide sociale, qui rend plus difficile la définition des responsabilités des acteurs, et réduit l'intérêt pour certains d'investir dans la lutte contre la fraude. Par ailleurs, l'absence d'automatisation des échanges de données entre services instructeurs et payeurs fait obstacle à l'actualisation des dossiers en fonction de l'évolution de la situation du bénéficiaire, multipliant les risques d'indus, voire de fraude. Enfin, il semble que l'allocation des moyens à la lutte contre la fraude soit limitée par la priorisation du traitement des demandes dans les meilleurs délais : « cette dépriorisation du contrôle est également parfois justifiée localement par la revendication d'une culture administrative et sociale d'accompagnement des bénéficiaires et de leurs besoins, passant d'abord et surtout par l'ouverture des droits. »29(*)
B. Le dispositif proposé
Le présent article propose d'inscrire les MDPH, les services APA des ministères ainsi que leurs agents en tant que bénéficiaires du partage d'information des organismes et personnes oeuvrant dans le champ de la lutte contre la fraude sociale.
À cette fin, le 1° modifie l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale afin d'y faire figurer les MDPH et les services en charge de l'APA parmi les personnes devant recevoir un signalement de la part du directeur de l'Union des caisses d'assurance maladie lorsqu'un professionnel de santé est interdit d'exercer sa profession.
Le 2° modifie l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre aux agents des MDPH et des services en charge de l'APA de pouvoir s'échanger des renseignements avec les autres organismes de l'État ou de la protection sociale en vue de rechercher ou constater des fraudes.
Enfin le 3° procède à un élargissement selon le même périmètre de concernant la liste des personnes pouvant faire l'objet d'une communication de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure permettant de présumer une fraude sociale au titre de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale.
II - La position de la commission
Les rapporteurs rejoignent la préoccupation d'un renforcement des outils de lutte contre la fraude des MDPH et des services APA des départements, via des communications d'information par d'autres organismes de sécurité sociale notamment.
Plus largement, ils appellent à une acculturation de ces services à la lutte contre la fraude, et considèrent que les agissements frauduleux ne sont peut-être jamais aussi condamnables que lorsqu'ils sont faits à l'encontre des services publics destinés aux publics dont la situation est la plus vulnérable.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
7
Rendre obligatoire la géolocalisation des transporteurs sanitaires
et des taxis conventionnés et le système électronique de
facturation intégré
Cet article propose de rendre obligatoire la géolocalisation des véhicules des transporteurs sanitaires et des entreprises de taxis ayant conventionnés avec une caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que le recours au système électronique de facturation intégré.
La commission a adopté cet article sans modification.
I°- Le dispositif proposé : rehausser au niveau législatif des obligations conventionnelles
A. La recherche d'une modération des dépenses de transport sanitaire
1. Des mesures de régulation au vu de la dynamique des dépenses
En application de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie obligatoire prend en charge les « frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ». Cette prise en charge est conditionnée à une prescription médicale30(*) justifiée par l'état de santé du patient et précisant le mode de transport retenu31(*) et le motif du déplacement.
Les différents modes de transports pouvant
faire l'objet d'une prise en charge
par l'assurance maladie
obligatoire
L'assurance maladie peut couvrir différents modes de déplacement32(*), faisant intervenir différentes professions.
Les transporteurs sanitaires, conventionnés avec l'assurance maladie33(*), peuvent opérer des ambulances, permettant le transport couché, ou des véhicules sanitaires légers (VSL), permettant le transport assis de trois patients au plus.
Les frais de transport en taxi peuvent également faire l'objet d'une prise en charge lorsque l'entreprise est signataire d'une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), établie sur le modèle d'une convention-type nationale34(*).
Les dépenses de transport sanitaire ont atteint 6,74 milliards d'euros en 2024 (+ 43,3 % depuis 2016), dont 3,67 milliards d'euros pour les transporteurs sanitaires - ambulances ou véhicules sanitaires légers (VSL) - et 3,07 milliards d'euros pour les taxis conventionnés.
Évolution de la dépense remboursable en transport sanitaire de 2016 à 2023
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, Tome II du rapport sur le PLFSS pour 2025, p. 278
Ce dynamisme a justifié plusieurs mesures pour tenter de freiner les dépenses.
• Premièrement, l'incitation à recourir au transport partagé, que l'assurance maladie s'efforçait à mettre en oeuvre par la voie conventionnelle, a été renforcé par la LFSS pour 202435(*), laquelle a visé à décourager financièrement les patients à refuser le transport partagé. Ainsi, lorsqu'un patient refuse un transport partagé en VSL ou taxi conventionné, alors que son état de santé est jugé compatible avec une telle solution par le prescripteur, la prise en charge de ses frais de transport est réduite par l'application d'un coefficient de minoration et il ne peut bénéficier d'une dispense d'avance de frais36(*).
• Deuxièmement, la LFSS pour 202537(*) a donné une base légale pour réformer les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les taxis en renforçant les prérogatives, notamment en matière de régulation tarifaire, de la convention-nationale, à laquelle est annexée la convention type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie38(*). Une nouvelle convention-cadre nationale, prévoyant une tarification révisée, applicable à compter du 1er novembre 2025, est ainsi entrée en vigueur en juillet 202539(*).
2. Des mesures de fiabilisation s'inscrivant dans la lutte contre la fraude
Selon l'étude d'impact, seuls 9,36 millions d'euros d'anomalies ont été recensés, en 2024, s'agissant du transport sanitaire alors que le montant des préjudices est plutôt estimé à 427 millions d'euros pour les transporteurs sanitaires et 209 millions d'euros pour les taxis conventionnés. La distance retenue serait une des erreurs principales commises lors de la facturation du transport sanitaire.
Afin de vérifier la conformité de la facturation et la réalité des courses effectuées, l'assurance maladie a incité au déploiement des outils de géolocalisation et de la facturation via le télé-service « SEFI ».
Le service électronique de facturation intégré
Déployé depuis février 2016, le service SEFI est une solution de facturation intégrée au logiciel métier du transporteur qui offre plusieurs services en ligne. Il comporte des fonctionnalités obligatoires : accéder à la prescription électronique quand elle existe ; envoyer la demande de vérification de certaines des données à l'Assurance maladie avant toute validation de la facture ; valider la facture en ligne.
Toutefois, il permet aussi d'intégrer directement les informations mises à disposition par l'Assurance maladie ou de numériser les pièces justificatives, à l'issue de la journée de facturation.
Un des prérequis techniques est toutefois de commander une carte CDE ou CPE auprès de l'Agence du numérique en santé.
a) Les transporteurs sanitaires privés
• À l'issue d'une expérimentation, l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés40(*) a ainsi rendu obligatoire le recours au télé-service « SEFi » tout en créant une aide financière rémunérant l'utilisation de « SEFi » et le couplage de leur logiciel avec un dispositif de géolocalisation.
• L'avenant n° 1141(*) a prévu la mise en place d'une tarification majorée qui bénéficie aux transporteurs équipés de véhicules disposant d'un système de géolocalisation certifié par l'assurance maladie et qui facture via SEFi42(*).
La certification des dispositifs de géolocalisation par l'assurance maladie
Afin d'être certifié par l'assurance maladie, le dispositif de géolocalisation, doit, conformément au cahier des charges annexé à l'avenant 11 précité, doit être fixé de manière pérenne au véhicule et toute intervention doit être tracée.
Le logiciel GPS embarqué doit « permettre de déterminer avec précision le lieu et l'heure de prise en charge et d'arrivée du patient ». La facture doit comporter le kilométrage « réel » parcouru entre le lieu de prise en charge et le lieu de dépôt du patient.
• Le protocole d'accord de maitrise des dépenses du 24 septembre 202543(*), conclu entre l'Assurance maladie et les représentants des transporteurs sanitaires44(*), prévoit de diminuer, à partir d'octobre 2025, de 13 % les tarifs des entreprises non certifiées.
b) Les entreprises de taxi ayant conventionné avec un organisme local d'assurance maladie
La nouvelle convention-cadre nationale applicable aux taxis conventionnés de juillet 2025 prévoit que l'équipement d'un dispositif certifié de géolocalisation pour les taxis, sera obligatoire pour les taxis à compter du 1er janvier 202745(*).
La même convention-cadre46(*) dispose que le « SEFi » deviendra progressivement, et au plus tard au 1er janvier 2027 le mode de facturation obligatoire. Il s'agit ainsi d'un des « enjeux forts de cette convention-cadre » pour « alléger la charge administrative des entreprises, simplifier les contrôles et améliorer la lutte contre la fraude ».
À noter que l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit, à l'initiative du Sénat, qui avait introduit cette disposition lors de l'examen du PLFSS pour 2025, que des aides à l'équipement puissent être versées aux entreprises de taxis en vue de l'acquisition d'outils de géolocalisation. La convention-cadre se borne à préciser qu'« un dispositif d'aide à l'équipement à destination des entreprises de taxi sera également étudié ».
B. Donner une base légale à l'obligation de géolocalisation des véhicules et de recours au système électronique de facturation intégré
Le présent article propose de rétablir un article L. 322-5-3 du code de la sécurité sociale, afin de rendre obligatoire, à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027, pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conventionné avec un organisme local d'assurance maladie :
- l'équipement des véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret47(*) ;
- le recours au système électronique de facturation intégré.
Cette obligation, pour les seuls transporteurs sanitaires, avait été adoptée au sein du PLFSS pour 2025, à l'initiative du Sénat48(*) au sein de la LFSS pour 2025. Toutefois, les dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel49(*) qui avait considéré qu'elles n'avaient pas d'effet ou un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.
Le présent article vise donc à « sécuriser » cette généralisation, selon l'étude d'impact, et à utiliser un autre véhicule législatif que la LFSS.
Selon l'étude d'impact50(*), une économie de 32 millions d'euros en année pleine est estimée par la Cnam bien que cette estimation ne puisse être certaine compte tenu de l'incertitude pesant sur l'évolution des comportements des transporteurs sanitaires et taxis conventionnés.
II - La position de la commission : des mesures cohérentes pour fiabiliser la facturation du transport sanitaire
Les rapporteurs souscrivent à ces dispositions qui inscrivent dans la loi des obligations qui sont déjà en vigueur au niveau des textes conventionnels. Ils notent que l'application de ces obligations en 2027 est conforme aux délais par la conventions-cadre et la convention nationale mentionnées plus en amont et laisse ainsi le temps pour les entreprises de se mettre en conformité avec ces exigences.
Selon les informations transmises par la direction de la sécurité sociale, dans le champ des transports sanitaires, 3 110 entreprises sur 5 146 étaient déjà équipées en logiciel de facturation et/ou de géolocalisation en 2024. S'agissant des taxis, la proportion de véhicules équipées est nécessairement moindre puisque ces dispositifs étaient encore expérimentaux jusqu'à juillet 2025.
Les rapporteurs ne peuvent toutefois qu'appeler l'assurance maladie à poursuivre ses efforts d'aide à l'équipement des véhicules, pour les transporteurs sanitaires, et à mettre effectivement en oeuvre l'aide pour les taxis conventionnés, ainsi que le prévoit la loi, à l'initiative de la commission.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
8
Lutter contre les fraudes fiscales et sociales dans le secteur des
transports publics particuliers de personnes
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté les amendements COM-111, COM-112, COM-113 et COM-114 du rapporteur pour avis.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
9
Transmission des documents à l'Autorité des marchés
financiers
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.
La commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II
Renforcer les moyens d'enquête et
de contrôle
Article 10
Extension du droit de communication aux
agents
de l'Assurance maladie chargés de la lutte contre la
fraude
Cet article vise à aligner le droit de communication des agents placés sous l'autorité du directeur ou du directeur comptable et financier d'une caisse primaire d'assurance maladie sur le droit applicables aux organismes de recouvrement afin de lutter contre la fraude sociale.
La commission a adopté cet article modifié par deux amendements. Le premier vise à étendre le dispositif initial de cet article aux caisses d'allocations familiales. Le second donne la possibilité aux agents en charge du contrôle de l'activité partielle d'obtenir des données relatives au chiffre d'affaires des entreprises concernées.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit de communication, outil nécessaire de la lutte contre la fraude sociale
1. Un droit de communication régulièrement élargi par le législateur
Instauré par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 200851(*) sur le modèle des prérogatives de l'administration fiscale, le droit de communication reconnu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale permet aux agents des organismes de sécurité sociale de prendre connaissance d'informations et, au besoin, d'obtenir copie de documents détenus par des tiers, sans que ne s'y oppose le secret professionnel, pour l'exercice de certaines de leurs missions.
Ce droit bénéficie ainsi aux agents :
- des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par les organismes concernés ;
- des Urssaf et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) chargés du contrôle pour accomplir leurs missions de contrôle et leur mission de lutte contre le travail dissimulé ;
- des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
La LFSS pour 202352(*) a reconnu ce droit de communication au profit des agents des Urssaf et des caisses de MSA pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé.
La LFSS pour 202553(*) a enfin élargi cette prérogative au bénéfice des directeurs et directeurs comptables et financiers des Urssaf et des caisses de MSA, ainsi que des agents placés sous leur autorité, pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude sociale.
L'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale se réfère aux dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux conditions d'exercice du droit de communication des agents de l'administration fiscale pour déterminer les conditions d'utilisation de ce droit dans le champ social et la liste des tiers auprès duquel il s'exerce - parmi lesquels des administrations et entreprises publiques, des organismes et agences divers, des personnes versant des revenus de capitaux mobiliers, des compagnies d'assurance, des établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les agences immobilières etc.
Les documents et informations exigés doivent être communiqués dans un délai de trente jours suivant la demande de l'agent chargé du contrôle. Le législateur a prévu une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sous un plafond de 10 000 € par pénalité totale, en cas de de silence gardé ou de refus de déférer à une demande de communication d'information ou de document. Dans les cinq ans suivant une première absence de coopération, la récidive par le même tiers entraine un doublement des montants de pénalité.
2. Les garanties qui encadrent le droit de communication
En outre, l'article L. 114-21 du même code oblige l'organisme de sécurité sociale ayant usé du droit de communication à informer l'assuré, l'allocataire ou le cotisant, à l'encontre duquel il a pris une décision, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers ayant fondé cette décision. En cas de demande, il est tenu de communiquer une copie des documents avant l'application de sa décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement.
Si le droit de communication poursuit un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière sociale, il porte également atteinte au respect de la vie privée. Par une décision du 14 juin 201954(*), le Conseil constitutionnel a jugé toutefois que le législateur a assuré une conciliation équilibrée en consacrant un droit de communication des données bancaires au profit des organismes de sécurité sociale eu égard aux informations que contiennent ces données au regard des objectifs poursuivis - apprécier le droit à prestation ou de l'obligation de cotisation de la personne contrôlée.
Cependant, dans la même décision de 2019, le Conseil constitutionnel a jugé non conformes à la Constitution des dispositions légales insuffisamment encadrées permettant aux organismes de sécurité sociale d'obtenir les données de connexion détenues par certains opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès ou les hébergeurs de contenu. Au regard de cette jurisprudence55(*), le législateur a ainsi prévu des conditions dérogatoires d'exercice du droit de communication pour ces données particulières56(*).
B. Le dispositif proposé : une nouvelle extension du droit de communication
Le présent article propose de modifier le 5° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, inséré en LFSS pour 2025 au profit des Urssaf et des caisses de la MSA, afin d'étendre aux agents placés sous l'autorité du directeur ou du directeur comptable et financier d'une CPAM le droit de communication pour lutter contre la fraude sociale.
Cette disposition permettra ainsi, selon la Caisse nationale d'assurance maladie, à des agents autres que les agents de contrôle agréés et assermentés d'effectuer les demandes nécessaires aux vérifications dont ils ont la charge. La Cour de cassation57(*) a en effet rappelé, dans un arrêt du 7 septembre 2023, que le droit de communication ne pouvait être exercé que par les agents agréés et assermentés58(*). Or les contrôles sur les prestations ne sont pas réalisés par ces seuls agents. Il s'agira ainsi, selon l'étude d'impact, de permettre « aux caisses d'optimiser leurs démarches au regard de leurs impératifs de contrôle, et de recentrer l`action des agents de contrôles agréés assermentés sur des contrôles plus rentables »59(*).
II - La position de la commission
Les rapporteurs souscrivent à cette extension du droit de communication en faveur des CPAM afin d'accomplir leurs missions de lutte contre la fraude. Le renforcement des moyens humains de contrôle de l'Assurance maladie - plus de 1 600 agents y sont affectés - nécessite d'accorder les habilitations législatives adaptées afin de lutter efficacement contre les fraudes à enjeux.
Les rapporteurs notent au demeurant que ce nouveau droit au profit des agents des CPAM s'appliquera dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles déjà prévues par le code de la sécurité sociale et le livre de procédures fiscales. Le présent article ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au respect du secret professionnel ou de la vie privée au regard de l'objet poursuivi de lutte contre la fraude sociale.
La commission a adopté un amendement n° COM-122, lequel étend le bénéfice des présentes dispositions aux caisses d'allocations familiales (CAF), considérant la prégnance des risques de fraudes s'agissant des prestations services par les CAF.
Elle a adopté un second amendement n° COM-121 des rapporteurs qui donne la possibilité aux agents des services du ministère de l'emploi en charge du contrôle du dispositif d'activité partielle d'obtenir des données relatives au chiffre d'affaires des entreprises concernées, sans se voir opposer le secret des affaires ni le secret fiscal. Cette transmission est nécessaire pour identifier d'éventuelles anomalies dans les déclarations relatives à la situation économique d'une entreprise ayant placé ses salariés en activité partielle.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 10 bis
(nouveau)
Consacrer légalement les missions de contrôle du
régime de garantie des salaires et son droit de communication
Cet article, introduit par la commission des affaires sociales, vise à reconnaître les missions de contrôle du régime de garantie des salaire (AGS) et octroyer à celui-ci un droit autonome de communication.
A. Un droit existant lacunaire pour les fraudes aux garanties de salaire
Les dispositions légales régissant le régime des garanties des salaires (AGS) sont codifiées à l'article L. 3253-14 et suivants du code du travail. Ces dispositions ne font nullement mention des missions de lutte contre la fraude exercées par l'AGS.
En application combinée des articles L. 114-16-1 et L. 114-16-3, le code de la sécurité sociale se borne à disposer que les agents de l'AGS désignés par le directeur de l'association « sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale (...) ».
En l'absence de base légale explicite, l'AGS ne peut aujourd'hui obtenir des informations que de la part des autres organismes de protection sociale et de France Travail. De même, s'agissant de sa mission de lutte contre la fraude, l'AGS mentionne aux rapporteurs que « l'ambiguïté nuit à ses contrôles et à la modernisation de son processus de détection des fraudes ». Or, le régime de garantie des salaires est concerné par les comportements abusifs ; en 2024, 16 millions d'euros de fraude ont ainsi été évités et ce montant atteint 14 millions d'euros pour le seul premier semestre de 2025.
B. La consécration législative proposée pour la mission de lutte contre la fraude
À l'initiative des rapporteurs (amendement COM-123), la commission a souhaité reconnaître un droit de communication autonome à l'AGS sur le modèle des dispositions régissant le droit de communication pour les caisses de sécurité sociale ou l'opérateur France Travail, en adoptant le présent article.
À cette fin, le I du présent article créée un article L. 3253-17-1 du code du travail afin de reconnaître les missions de contrôles que doit exercer l'AGS lorsqu'elle a connaissance de faits frauduleux. Ces missions seront exercées par des agents désignés par le directeur de l'AGS.
Le troisième alinéa de cet article L. 3253-17-1 reconnaît expressément un droit de communication à ces agents chargés de la fraude. Les alinéas suivants précisent le cadre applicable à ce droit de communication et notamment les personnes auprès desquels ce droit pourra s'exercer.
Les personnes auprès desquelles le droit de
communication de l'AGS
pourra s'exercer
Le droit qui s'exercera auprès de toutes les personnes prévues par le livre de procédure fiscale, à l'exception des personnes ci-dessous :
- le ministère public (article L. 82 C) ;
- les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la concurrence, et de la consommation et de la répression des fraude (article L. 83 A) ;
- l'agence nationale de contrôle du logement social (article L. 83 C) ;
- l'Agence nationale de l'habitat (article L. 83 D) ;
- le Crédit foncier de France (article L. 83 E) ;
- la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (article L. 84 A) ;
- l'Autorité nationale des jeux (article L. 84 B) ;
- l'Établissements de jeux (article L. 84 C) ;
- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (article L. 84 D) ;
- l'Autorité des marchés financiers (article L. 84 E) ;
- les personnes effectuant des opérations d'assurance (article L. 89) ;
- les entrepreneurs de transport (article L. 90) ;
- les redevables du droit d'accroissement (article L. 91) ;
- les caisses de mutualité sociale agricole (article L. 95) ;
- les banques, en ce qui concerne les formules de chèques non barrées (article L. 96) ;
- les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts, relatifs aux assujettis à la taxe à la valeur ajoutée (article L. 96 B) ;
- les intermédiaires pour des instruments financiers à terme (article L. 96 CA)
- le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie (article L. 96 F) ;
- les opérateurs de communications électroniques (article L. 96 G) ;
- les fabricants et marchands de métaux précieux (article L. 96 H) ;
- les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse (article L. 96 J).
• Le II du présent article opère une coordination à l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-123.
Article 10 ter
(nouveau)
Sanction du délit d'entrave au droit de communication
des juridictions financières
Cet article, introduit par la commission, vise à sanctionner les entraves au droit de communication des juridictions financières.
A. Les juridictions financières disposent d'un droit de communication connaissant parfois des entraves
Les juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), disposent, pour l'exercice de leurs missions, d'un droit de communication. Ce droit de communication répond à l'article XV de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Ce droit de communication a été formellement inscrit par le législateur à l'article L. 141-5 du code des juridictions financières. Aux termes de cet article, la Cour des comptes est ainsi « habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé ». Des dispositions similaires existent pour les CRTC et pour le conseil des prélèvements obligatoires (CPO)60(*).
Le droit de communication des juridictions financières est adossé à un délit d'obstacle, puni de 15 000 euros d'amende, après saisine du parquet par le procureur général près la Cour des comptes, le président du CPO ou le ministère public près la chambre territoriale61(*). Les juridictions financières doivent donc se tourner vers la juridiction judiciaire en cas d'obstacle à leur droit de communication.
Ce délit d'obstacle s'applique à tous les justiciables de la Cour des comptes, c'est-à-dire aux membres du cabinet d'un ministre ou d'un élu exerçant une fonction exécutive62(*), à tout fonctionnaire, agent civil ou militaire de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des groupements des collectivités territoriales, ainsi qu'à « tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une CRTC »63(*).
Le législateur a étendu, au cours des dernières années, le périmètre de ces organismes susceptibles d'être contrôlés par la Cour des comptes, notamment dans le secteur médico-social. Ainsi, outre les entreprises publiques et les organismes bénéficiant de concours financiers publics, les juridictions financières peuvent contrôler :
- les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux de statut privé, dès lors que ceux-ci sont financés par l'État, une collectivité territoriale ou leurs établissements publics64(*) ;
- les structures privées contrôlant des établissements et services publics du secteur médico-social65(*).
Contrôles sur les établissements médico-sociaux de statut privé non lucratif ou commercial (nombre d'établissements contrôlés)
|
Cour des comptes |
CRTC |
Total |
|
|
2021 |
1 |
34 |
35 |
|
2022 |
1 |
8 |
9 |
|
2023 |
1 |
12 |
13 |
|
2024 |
3 |
23 |
26 |
Source : Annexes budgétaires PLF pour 2025
Depuis lors, la Cour des comptes a fait état de difficultés dans l'exercice de cette compétence, elle se heurterait en effet à « des obstacles », prenant la forme de refus réitérés de la maison mère d'un groupe privé gestionnaire d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de transmettre ses comptes annuels et d'autres documents demandés.
B. Le dispositif proposé vise à donner des moyens supplémentaires aux juridictions financières en cas d'entrave à leur droit de communication
Le présent article, issu de l'adoption par la commission de l'amendement COM-124 des rapporteurs instaurerait un mécanisme propre aux juridictions financières, applicable en cas d'obstacle au droit de communication. Surtout, cette procédure permettrait aux juridictions financières de régler ces difficultés en autonomie, sans recourir au juge judiciaire, comme c'est le cas actuellement, et donc de gagner en célérité.
Le 1° confierait à la Cour des comptes une nouvelle attribution, celle « [d']assurer le respect du droit de communication » dont disposent respectivement la Cour des comptes66(*), les CRTC67(*) et le conseil des prélèvements obligatoires68(*).
En cas d'atteinte à ce droit de communication, ces autorités pourraient alors déférer les faits au procureur général près la Cour des comptes, c'est-à-dire au ministère public, qui disposerait alors de deux possibilités, non exclusives l'une de l'autre :
- soit renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, laquelle pourrait alors prononcer une amende maximale de 15 000 euros proportionnée « à la gravité des manquements constatés » ;
- soit, préalablement à ce renvoi, enjoindre la personne concernée de procéder à la communication des documents ou données demandés dans un délai ne pouvant être inférieur à trois jours, tout retard dans l'exécution de cette injonction pouvant entraîner une amende pouvant atteindre 1 000 euros par jour.
Les montants précités sont inspirés des montants des amendes déjà prévues par le code des juridictions financières en cas de délit ou, pour ce qui concerne le pouvoir d'injonction, par le législateur pour l'inspection générale des finances.
La décision de renvoi ou l'injonction de transmission ne pourraient être prises par le procureur général qu'après avoir invité le justiciable à présenter ses observations. Le justiciable pourrait aussi bien être une personne morale qu'une personne physique.
Le 2°, organise la procédure de jugement, par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, du non-respect du droit de communication. Pour ce faire, il crée une nouvelle section au sein des dispositions relatives aux activités juridictionnelles de la Cour des comptes. Ce jugement serait prononcé par un juge unique, aurait lieu sans instruction préalable par le siège et devrait être rendu dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi par le procureur général.
Par ailleurs, le présent article précise le caractère non suspensif de l'appel.
Ce dispositif reprend la proposition de loi n° 898 (2024 - 2025) visant à renforcer l'effectivité du droit de communication des juridictions financières, déposée M. le président Philippe Mouiller le 19 septembre 2025, à la suite d'échanges avec Mme le procureur général près la Cour des comptes, Mme Véronique Hamayon.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-124.
Article
11
Possibilité de recourir à des identités d'emprunt
dans le cadre du contrôle de la formation professionnelle
Cet article propose de permettre aux agents de services régionaux de contrôle (SRC) de la formation professionnelle la possibilité de prendre une identité d'emprunt lors des phases d'investigation.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement étendant la possibilité de recours à l'anonymat aux agents de la Caisse des dépôts et de consignation.
I - Le dispositif proposé : un renforcement des prérogatives des inspecteurs de la formation professionnelle
A. Les services régionaux de contrôle (SRC) assurent le contrôle des dépenses et de l'activité de formation professionnelle
1. Le contrôle des activités de formation professionnelle est assuré par les services déconcentrés de l'État
La mission de l'État de contrôle administratif et financier de la formation professionnelle69(*) est coordonnée par la mission d'organisation des contrôles (MOC) de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Au sein du réseau déconcentré des Dreets (directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dix-huit services régionaux de contrôle (SRC) sont chargés d'exercer un contrôle administratif et financier des actions de formation professionnelle.
Ce contrôle porte donc sur « l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques »70(*) des actions de formation, quel qu'en soit le financeur (État, collectivités territoriales, Caisse des dépôts et consignations, France Travail ou Opérateur de compétences (Opco)). Il peut aussi bien s'agir d'actions de formation, que de bilans de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et ou de formation par apprentissage71(*).
Pour mener à bien ces contrôles, les SRC s'appuient sur des agents qui peuvent être inspecteurs du travail, contrôleurs du travail ou agents de la fonction publique de l'État de catégorie A assermentés et commissionnés à cette fin72(*). Dans tous les cas, leurs investigations doivent respecter une procédure contradictoire73(*). Après un travail sur pièce ou sur place74(*), un rapport de contrôle peut être dressé pour caractériser les manquements et le cas échéant proposer des sanctions administratives ou financières : annulation de la déclaration d'activité ou versement de sommes exigibles au Trésor public75(*).
D'après l'étude d'impact76(*), les contrôles des SRC ont porté l'année dernière sur environ 150 000 organismes représentant 16 milliards d'euros de fonds publics.
2. Les limites du contrôle des activités de formation en ligne
Parmi les organismes de formation professionnelle, plus de 10 % proposeraient des formations ouvertes ou à distance (Foad), remettant en cause le mode de travail des SRC. En effet, la procédure de contrôle n'est pas adaptée aux sites internet, puisque les organismes concernés ne peuvent pas faire l'objet de visite inopinée ou de constats sur place, et que l'inscription sous le nom de l'agent permet de repérer les inspecteurs immédiatement.
Confrontés au même problème dans le cadre du contrôle de la vente en ligne77(*), les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude (CCRF) se voient autoriser l'utilisation d'une identité d'emprunt afin de pouvoir effectuer un achat comme n'importe quel consommateur. De même, ces agents peuvent différer la révélation de leur qualité d'enquêteur lorsque la preuve de l'infraction en dépend78(*).
B. Le dispositif proposé
Le 1° du présent article vise à créer un article L. 6362-8-1 au sein du code du travail, afin de permettre aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle de recourir à une identité d'emprunt dans les cas limitatifs suivants :
- lorsque les organismes de formations proposent tout ou partie de leurs actions de formation à distance ;
- lorsque l'inscription aux actions de formation peut se faire en ligne.
Le 2° effectue une coordination à l'article L. 6362-13 du même code afin de préciser que le décret prévu en Conseil d'État précise les conditions procédurales à respecter dans l'utilisation d'une identité d'emprunt.
II - La position de la commission
Les rapporteurs partagent l'objectif d'adapter les outils des agents des SRC afin de répondre à l'évolution de l'offre de formation professionnelle, et notamment le développement d'action de formation en ligne.
Par ailleurs, la contribution reçue de la part des services de la DGFiP, qui bénéficie d'une disposition analogue du fait des droits de la consommation et du commerce, atteste de l'intérêt d'une identité d'emprunt dans l'instruction de certains contrôles.
Cependant, il semble que cette possibilité gagne à être étendue aux autres agents qui concourent au contrôle la formation professionnelle, et notamment aux agents de la Caisse des dépôts et consignation (amendement n° COM-125).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
12
Renforcement de la lutte contre la fraude, les fautes et abus aux risques
professionnels
Cet article propose de rénover le régime de sanction et de pénalités financières en cas de manquement ou d'agissement frauduleux en matière d'incitations financières de la branche AT-MP, et de renforcer les prérogatives en matière de lutte contre la fraude des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement maintenant le droit en vigueur concernant la sanction d'absence de dématérialisation de la notification d'AT-MP et par un amendement rédactionnel.
I°- Le dispositif proposé
A. La branche AT-MP fait l'objet de comportements frauduleux de différents types
Dans son rapport de 2024 sur la fraude sociale79(*), le Haut conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS) évalue à 70 millions d'euros le coût annuel de la fraude aux prestations sociales dans le domaine des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Ce montant est à rapporter au budget de la branche AT-MP pour la même année, qui était de 14 milliards d'euros.
Article R. 147-11 du code de la
sécurité sociale : la définition d'une fraude
dans le domaine de la protection sociale
Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'État, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'État, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° la falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° l'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
La branche AT-MP connaît de nombreux risques de fraudes compte tenu de sa spécificité. Aux fraudes classiques aux prestations pratiquées par les assurés sociaux, et à celles effectuées par des professionnels de santé, viennent s'ajouter côté employeur les fraudes aux cotisations sociales - visant à diminuer le montant de cotisations payées - la sous-déclaration de la sinistralité afin d'éviter une surcotisation et les fraudes aux incitations financières.
Pour dissuader, détecter et recouvrir les fraudes en question, le réseau des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) dispose de plusieurs leviers prévus par le législateur :
- l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit une pénalité financière dans le cas de fausse déclaration d'accident du travail, ou de non-déclaration ;
- l'article L. 242-5 du code de la sécurité social prévoit également une obligation de dématérialisation de la notification de taux AT-MP, sanctionnée le cas échéant d'une pénalité difficile à mettre en oeuvre du fait de la coordination nécessaire entre Carsat et Urssaf ;
- enfin la Cnam et les Carsat ont recours aux signalements de l'article 40 du code de procédure pénale dans le cas de fraudes, de fautes et d'abus en matière de subventions qui revêtent un caractère particulièrement grave.
En revanche, l'arsenal législatif de la lutte contre la fraude au sein de la branche AT-MP n'est pas complet dans la mesure où la répression de certaines pratiques frauduleuses n'a pas de fondememnt légal. C'est notamment le cas de agissements frauduleux relatifs au compte professionnel de prévention, ou de fraude spécifique sur le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) nouvellement créé.
B. Le dispositif proposé
Le présent article vise à « étendre le champ des fraudes pouvant être constatées au sein de la branche AT-MP »80(*), en complétant les mécanismes juridiques à disposition des organismes mettant en oeuvre la législation de sécurité sociale concernant les risques professionnels (Carsat et Cpam).
1. Dispositions concernant les pénalités et incitations financières
Le 1° du I du présent article modifie l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale afin d'ajouter à la liste des agissements faisant l'objet de vérifications et contrôles par les organismes des régimes obligatoires de la sécurité sociale ceux concernant « l'octroi des subventions ou financements au titre de la législation sur les AT-MP ». Cela vise par exemple les subventions obtenues via le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (FNPAT), via le Fip ou via des ristournes de cotisations.
Le 2° du I du présent article procède à plusieurs modifications de l'article L. 114-17-1 du même code afin de rénover la nature des agissements pouvant faire l'objet d'une pénalité financière prononcée par la caisse chargée de verser les prestations AT-MP :
- le a élargit le périmètre des personnes sanctionnables aux travailleurs indépendants ;
- le i du b étend la possibilité d'une sanction aux « inobservation des règles » du code du travail ayant conduit à un indu ;
- le ii du b établit les coordinations nécessaires aux refus d'information susceptibles de justifier une pénalité financière compte tenu des nouveaux motifs créés ;
- le iii du b introduit un motif de pénalité financière pour les manoeuvres frauduleuses relatives à l'obtention d'une aide financière via le Fipu81(*), d'une ristourne de cotisation82(*) ou d'une avance remboursable83(*) de la part d'une caisse, ou à la déclaration dématérialisée des risques subis par les salariés conditionnant leurs droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P) ;
- le iv du b élargit la définition des manoeuvres frauduleuses concernant la déclaration des AT-MP à l'ensemble des manoeuvres visant à priver les victimes et leurs ayants droits de leurs droits ;
- le v du b introduit un nouveau motif de pénalité financière correspondant aux agissements frauduleux de l'employeur visant à obtenir des avantages ou à réduire ceux des salariés en matière de C2P ;
- le c ajoute les employeurs à la liste des personnes pouvant faire l'objet d'une instruction unique par un directeur d'organisme alors que les agissements concernent le ressort de plusieurs caisses.
2. Dispositions concernant l'obligation de dématérialisation de la communication du taux AT-MP
Le a du 3° du présent article modifie l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que le secret professionnel ne peut pas s'opposer à la communication de documents et informations nécessaires à la détermination de l'exactitude des pièces visant à l'attribution d'une aide financière via le Fipu, d'une ristourne de cotisation ou d'une avance remboursable, ou de droits au titre d'un compte professionnel de prévention (C2P). Tandis que le b du même 3° élargit ce droit de communication aux directeurs et directeurs comptables des Carsat et pour la Cramif en Île-de-France.
Le 4° du présent article modifie enfin l'article L. 242-5 du même code afin de remplacer la pénalité en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur des informations permettant le calcul de son taux de cotisation AT-MP par une majoration dudit taux pouvant aller jusqu'à 5 %.
Le 5° modifie l'article L. 242-7 du même code afin de permettre aux Carsat de procéder à une majoration de cotisation dans le cas de non mise à disposition, tel que prévu par le 4° précédemment décrit. Parallèlement, il est précisé que le recours contentieux contre une décision de majoration de la cotisation AT-MP, dans ce cas précis, doit faire l'objet d'un recours administratif préalable.
3. Dispositions concernant les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité
Le 6° du présent article modifie l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale afin de renforcer les moyens de contrôle des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des Carsat.
Le a du 6° précise que les employeurs, personnes privées ou publiques ainsi que les travailleurs indépendants sont tenus de présenter tous les documents nécessaires à ces agents, ainsi que de leur garantir l'accès aux locaux de l'entreprise.
Le b du 6° confie aux ingénieurs-conseils et aux contrôleurs de sécurité de nouvelles prérogatives tenant au contrôle de l'exactitude des déclarations et justificatifs fournis pour le calcul du taux de cotisation AT-MP ainsi que pour le bénéfice de subventions, ristournes, financements ou prestations servies par la branche. Il précise en outre que ces constats font foi, et qu'ils sont communicables aux organismes de protection sociale concernés par les prestations en cause.
Le II du présent article vise à modifier l'article L. 4163-16 du code du travail afin de préciser que les agents menant les contrôles de l'exposition aux facteurs de risques professionnels pris en compte par le C2P doivent se voir présenter tous document nécessaire à l'exercice de leur mission. Par ailleurs, ces derniers vérifient l'exactitude des documents fournis et peuvent communiquer leurs constats à un autre organisme de protection sociale concerné par les manquements afin qu'il le prenne en compte.
II - La position de la commission
Les rapporteurs soulignent l'importance des évolutions proposées par le présent article concernant la lutte contre la fraude aux incitations financières proposées par la branche AT-MP. Ce d'autant que les moyens dédiés à la prévention des risques professionnels augmentent, que la sinistralité de la branche stagne, et que de nombreuses branches s'emploient activement à répondre aux enjeux rencontrés dans leur activité - ce qu'a particulièrement confirmé l'audition de la branche du BTP.
Cependant, les rapporteurs proposent de maintenir le droit en vigueur concernant l'absence de dématérialisation de la notification de survenue d'un AT-MP (amendement n° COM-127). En effet, la sanction financière existant semble mieux à même d'individualiser la pénalité, et moins complexe à mettre en oeuvre qu'une surcotisation du taux AT-MP. La commission a également adopté un amendement rédactionnel (n° COM-126).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE
II
ADAPTER LES LEVIERS DE LA LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET
RENFORCER LES SANCTIONS
CHAPITRE
IER
Tarir les sources de revenus occultes ou illicites
et mieux
sanctionner leurs bénéficiaires
Article
13
Obligation de versement de l'indemnisation chômage sur un compte
bancaires domicilié dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union
européenne et obligation de se
présenter aux épreuves en cas de mobilisation du compte personnel
de formation
Cet article propose, d'une part, de conditionner le versement de l'indemnisation chômage à la domiciliation des comptes bancaires en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne.
D'autre part, il vise à obliger le titulaire du compte personnel de formation (CPF) à se présenter aux épreuves de sa formation certifiante. Il organise aussi la communication par les ministères et organismes certificateurs des données permettant à la Caisse des dépôts de faire appliquer cette obligation.
La commission a adopté cet article modifié par deux amendements afin de prévoir qu'un décret devra préciser les motifs légitimes pouvant justifier une absence du stagiaire à l'examen et, par ailleurs, que le titulaire du CPF reste tenu, dans tous les cas, de payer l'organisme de formation.
I°- Le dispositif proposé
A. Le versement des allocations chômages dans l'espace unique de paiement de l'Union européenne
1. Une condition de résidence en France pour bénéficier de l'indemnisation au titre du chômage
Le bénéfice des allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail sont soumises à la condition de résidence sur le territoire national.
S'agissant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), le Règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'Assurance chômage84(*) prévoit que l'allocataire doit résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, lequel recouvre, en vertu de l'article 5 de la convention, le territoire hexagonal, les départements d'outre-mer (hors Mayotte) et les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est ouverte après épuisement des droits à l'ARE, en application de l'article L. 5423-1 du code du travail. Par transitivité, la condition de résidence liée à l'ARE s'applique donc aussi à l'ASS.
Enfin, une circulaire Unedic du 13 juillet 202285(*) a précisé que l'allocation pour les travailleurs indépendants (ATI) était également soumise à la même condition de résidence que l'ARE.
L'allocataire doit donc justifier d'une résidence stable et effective sur le territoire national, qui est réputée établie s'il « justifie y être effectivement présent plus de six mois au cours de l'année de versement de l'allocation »86(*). Dès lors que cette condition cesse d'être remplie, l'indemnisation n'est plus due à l'allocataire.
En 2024, France Travail a identifié pour 136 millions d'euros de fraudes aux allocations chômage dont le premier motif - 41 % du préjudice total - était la non-déclaration de résidence ou d'activité à l'étranger87(*).
2. Le droit proposé : renforcer le contrôle de cette condition de résidence
Il est proposé - au 1° du présent article - de créer un article L. 5421-5 au sein du code du travail afin d'obliger le versement des trois allocations ARE, ASS et ATI, dès lors que celles-ci sont soumises à condition de résidence en France, sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne (ou SEPA, single euro payments area) et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire.
Ce versement exclusif de l'indemnisation chômage sur des comptes bancaires européens serait exigé à l'instar de ce que prévoit l'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale pour les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes de sécurité sociale. En revanche, la condition de résidence en elle-même ne ferait pas l'objet d'une codification législative mais resterait de la compétence des partenaires sociaux via la convention d'assurance chômage.
Ce versement exclusif des allocations chômage sur un compte domicilié en France ou au sein du SEPA permettrait de lutter contre la fraude à la résidence par deux effets que sont :
- l'augmentation du montant des préjudices évités, puisque, selon le Gouvernement, « certains versements sur des comptes situés en dehors de cet espace unique de paiement en euros suggèrent, de la part des demandeurs d'emploi, le non-respect des conditions de résidence ou de leurs obligations déclaratives en matière de changements de résidence ou d'exercice d'activités à l'étranger »88(*) ;
- la possibilité plus facile, toujours selon le Gouvernement89(*), de recouvrer les montants indus puisque France Travail fait aujourd'hui face à des attitudes parfois non coopératives de la part de banques étrangères.
B. Rendre obligatoire l'inscription et la présentation du titulaire du compte personnel de formation à l'examen de la certification ou du bloc de compétences
Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le compte personnel de formation (CPF), créé en 2014, a été monétisé et désintermédié, permettant ainsi aux actifs de choisir directement et de payer leur formation via une application numérique, Mon Compte Formation.
La gestion du CPF pour le compte de l'État a été confié à la Caisse des dépôts et consignation, et le financement est assuré par France compétences, quoique le législateur ait élargi la liste des personnes pouvant abonder le CPF : collectivités territoriales, l'Unédic, opérateurs de compétences (OPCO) etc.
L'éligibilité des formations a également été simplifié puisque désormais, en application de l'article L. 6323- 6 du code du travail, sont éligibles au CPF les actions de formation sanctionnées :
- par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- par les attestations de validation de blocs de compétences constitutifs des certifications professionnelles ;
- par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (RS).
1. De simples engagements à se présenter à la certification
Les conditions générales d'utilisations de Mon Compte Formation, déterminées par la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article L. 6323-9 du code du travail, stipulent que le stagiaire s'engage à s'inscrire à l'examen de certification auprès de l'organisme de formation, de l'administration ou de l'organisme concerné par les évaluations, examens ou concours préparés mais aussi à « se présenter aux évaluations, examens ou concours à l'issue d'une formation (...) en vue de l'obtention de la certification visée »90(*).
En outre, l'article 7.4 de ces mêmes conditions générales impose aux organismes de formation d'informer le stagiaire sur les conditions d'inscription à la certification, de s'engager « à tout mettre en oeuvre pour accompagner le stagiaire dans son inscription et sa préparation de la certification », étant entendu que l'organisme de formation reste tenu à un seul « objectif de moyen et non de résultat quant à la réussite de la certification par le stagiaire ».
Or, selon une étude de France compétences en partenariat avec la Dares91(*), parmi les stagiaires sortants du CPF de novembre 2021, 36% des personnes qui suivaient une formation certifiante déclaraient ne pas s'être présentées pour passer la certification. La non-présentation au passage de la certification était donc la première cause d'absence de certification à la fin d'une formation (contre seulement 7 % d'échec à l'examen).
France compétences, dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, notent toutefois, que la part d'individus passant la certification est vraisemblablement plus importante aujourd'hui, considérant que « la part des formations les moins suivies par un passage de certification [a] beaucoup diminué les langues, la bureautique et la communication numérique (...) ».
2. Le droit proposé : une obligation de se présenter aux examens sous peine de perdre la prise en charge au titre du compte
• Il est proposé - au 3° du présent article - de compléter le I de l'article L. 6323-6 précité du code du travail afin de prévoir que l'action de formation suivie par le titulaire, et menant à des certifications inscrites à l'un des deux répertoires nationaux RNCP ou RS, n'est pas prise en charge au titre de ce compte si le titulaire ne se présente pas aux évaluations ou épreuves d'examen prévues en vue de la certification.
Cette absence de prise en charge ne serait pas appliquée en cas de motif légitime ayant empêché le titulaire de passer la certification.
• Enfin, le 2° vise à réécrire l'article L. 6113-8 du code du travail afin de prévoir que les ministères et organismes certificateurs doivent communiquer à la Caisse des dépôts et consignations, via le système d'information du compte personnel de formation qu'elle gère, des informations concernant :
- les personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification enregistrés dans les répertoires nationaux, d'une attestation de validation d'un ou plusieurs blocs de compétences ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
- les personnes présentes à ces sessions d'examen ;
- les personnes titulaires des certifications, attestations et habilitations obtenues.
La transmission de ces informations permettrait à la Caisse des dépôts de faire appliquer l'obligation prévue au 3°, quitte à demander le remboursement des sommes mobilités au titre du CPF, et de procéder à des contrôles.
II - La position de la commission : deux mesures bienvenues de lutte contre des comportements abusifs
1. Une aide au respect de la condition de résidence pour le versement de l'indemnisation au titre du chômage
Les rapporteurs accueillent favorablement cette mesure qui doit aider France Travail à éviter les indus frauduleux liés à la condition de résidence, lesquels représentaient une somme de 56 millions d'euros en 2024. Ils constatent qu'une disposition similaire est entrée en vigueur pour les prestations et allocations sociales depuis le 1er juillet 2023, en vertu de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Enfin, il convient de noter que si la loi tolèrerait la domiciliation au sein de l'espace unique de paiement en euros92(*), quand bien même la condition d'éligibilité impose une résidence stable et effective sur le seul territoire national, il s'agit là d'une mesure évitant toute discrimination fondée sur la domiciliation bancaire qu'impose le respect de la directive n° 2014/92/UE du 23 juillet 2014.
La mesure ne pouvant suffire, à elle-seule, à garantir le respect unanime de la condition de résidence, les rapporteurs ont donc proposé à la commission des mesures complémentaires, constituant le nouvel article 28 du projet de loi.
2. Une mesure de meilleure responsabilisation des titulaires du CPF
Les rapporteurs sont favorables à cette plus grande responsabilisation des titulaires du CPF par le biais de cette obligation de présence à l'examen. Cette mesure s'inscrit pleinement dans les évolutions législatives ayant régulé des dépenses de CPF qui étaient devenues trop dynamiques et notamment la participation obligatoire du titulaire au frais de formation en vertu de la loi de finances pour 202393(*). Certains comportements abusifs, détaillés en audition par la Caisse des dépôts et consignations, demeurent :
- des situations de collusion entre des organismes fraudeurs et des titulaires de CPF s'inscrivant par complaisance à des formations voire contre rétribution parfois ou victimes d'abus de faiblesse ;
- des situations de cession de droits - comme des parents utilisant leur CPF pour financer le permis de conduire de leurs enfants ;
- des inscriptions volontaires à une formation qui ne prépare pas à la certification visée.
Le dispositif vise ainsi à recentrer le CPF sur sa la logique première, dans laquelle le passage de la certification a tout son sens, qui est de servir le projet professionnel du titulaire. France compétences fait ainsi état de personnes manquant l'examen car leur objectif premier, d'acquisition de nouvelles compétences, est rempli mais qui finissent - lors d'une transition professionnelle par exemple - par regretter l'absence de certification.
Les rapporteurs souscrivent néanmoins à l'importance, soulignée par France compétences, de préciser avec justesse, lors de l'actualisation des conditions générales d'utilisation, les motifs légitimes permettant d'exonérer le titulaire de l'application de la disposition. C'est pourquoi, un amendement des rapporteurs n° COM-129, adopté par la commission, prévoit que ces motifs légitimes devront être précisés par décret afin de prendre en compte tous les cas de force majeur qui exonéreront naturellement le stagiaire de la sanction instaurée au présent article.
Le même amendement vise à clarifier que le titulaire du CPF ne se présentant pas à l'examen exigé par sa formation reste tenu de payer l'organisme de formation. Il incombera à la Caisse des dépôts et consignations de recouvrer les sommes déjà engagées au titre du compte, le cas échéant par des moyens de recouvrement forcé. Comme l'ont fait valoir à juste titre la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et la Caisse des dépôts et consignations aux rapporteurs, l'absence de prise en charge au titre du CPF ne saurait faire peser un risque d'impayés sur les organismes de formation de bonne foi.
La commission a également adopté un amendement n° COM-128 de nature rédactionnelle.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 13 bis
(nouveau)
Renforcer les échanges d'informations au
bénéfice de la Caisses des dépôts et consignations
en matière de lutte contre la fraude au CPF
Cet article, introduit par la commission des affaires sociales, vise à instaurer des canaux de transmission d'informations des greffiers des tribunaux de commerce et des établissements bancaires vers la Caisse des dépôts pour lutter contre la fraude au compte personnel de formation.
A. Le droit existant
Les mesures à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations en matière de lutte contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) ont été progressivement complétées par le législateur - notamment - par la loi du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires94(*), et plus récemment par la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques95(*).
Il n'en demeure pas moins que cet arsenal juridique est encore en peine de faire face aux organismes fraudeurs qui se placent sur le marché de la formation professionnelle. La Caisse des dépôts et consignations note ainsi, dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, que « les fraudeurs ne cessent de s'adapter aux renforcements des dispositifs publics, les schémas de fraude se transforment, se complexifient ». En particulier, la Caisse ne dispose pas suffisamment d'informations précoces permettant, avant que les fonds ne soient hors de portée du recouvrement forcé, d'éviter la fraude.
B. Le dispositif proposé
À l'initiative des rapporteurs (amendement COM-130), la commission a souhaité enrichir les informations dont peut disposer la Caisse des dépôts et consignations dans sa mission de gestion du CPF pour le compte de l'État.
• Le 1° du I du présent article vise à compléter l'article L. 6333-7-1 du code du travail afin d'autoriser les greffes des tribunaux de commerce à communiquer à la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement et tout document de nature à faire présumer des fraudes liées au CPF ou des manoeuvres ayant pour objet ou pour résultat de compromettre le remboursement de sommes indûment versées.
• Le 2° du I propose de créer au sein du code du travail un article L. 6333-7-3 qui prévoit un dispositif de signalement, de la part des établissements bancaires à la Caisse des dépôts et consignations, des opérations financières liées à un organisme de formation et qui paraissent concourir à une fraude préjudiciable pour les ressources gérées par la Caisse afin de financer le CPF.
• Le II prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application du présent article.
Ainsi que la Caisse l'indique, les interactions avec les greffes des tribunaux de commerces permettraient « d'identifier dès leur création des sociétés ayant pour objet la formation professionnelle présentant des incohérences, de bloquer tout paiement à destination de sociétés faisant l'objet d'une procédure de radiation d'office en cas de fraude à l'immatriculation (...) ».
De même, le dispositif de signalement de la part des établissements bancaires teneurs des comptes des organismes de formation s'inscrit dans la même philosophie de déclencher des contrôles et de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des fonds publics dès la détection d'un flux financiers suspects.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-130.
Article 13 ter (nouveau)
Création d'une amende
réprimant de le fait de se prévaloir faussement de la
qualité d'opérateur de conseil en évolution
professionnelle
Cet article, introduit par la commission des affaires sociales, vise à réprimer le fait de se prévaloir indûment de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle.
A. Le droit existant
L'article L. 6111-6 du code du travail prévoit que le conseil en évolution profession (CEP), dispensé à titre gratuit afin de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel de la personne, peut être assuré par :
- les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
- les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
-l'opérateur France Travail ;
- l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres (l'Apec) ;
- les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code.
Le 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail confie, en effet, à France compétences la mission d'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics.
B. Le dispositif proposé
À l'initiative des rapporteurs (amendement COM-131), la commission a souhaité sanctionner les personnes qui utilisent le logo « Mon conseil en évolution professionnelle » sans avoir été sélectionnés par France compétences, afin de créer sciemment la confusion auprès du public avec un dispositif de CEP gratuit.
Cette situation, ainsi que l'a indiqué France compétences aux rapporteurs, ne peut trouver de solution à droit constant dans la mesure où « Mon conseil en évolution professionnelle » n'est pas protégé au titre de la propriété intellectuelle.
À cette fin, le présent article vise à créer, au sein du code du travail, un article L. 6355-17-1 qui punirait d'une amende de 4 500 euros le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur en évolution professionnelle en méconnaissance du code du travail ou de créer la confusion avec cette qualité.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-131.
Article
14
Renforcement du cadre répressif en matière sociale
concernant les revenus issus d'activités illicites
Cet article propose de majorer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) des revenus issus d'activité illicite, et de les prendre en compte dans le calcul des revenus de remplacement servis par France travail.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement étendant la prise en compte des revenus illicite dans le versement des prestations sous condition de ressources et par un amendement rédactionnel.
I°- Le dispositif proposé
A. Les revenus illicites sont mal appréhendés par la sphère sociale
1. Les revenus illicites connus par l'administration fiscale font l'objet d'une socialisation semblable aux autres revenus d'activité
Les revenus illicites sont, en droit, assimilés sous certaines conditions à des revenus imposables, et font donc l'objet de l'imposition adéquate selon leur nature. Parallèlement, ces revenus sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) dans les mêmes conditions que les revenus du patrimoine96(*), c'est-à-dire au taux de droit commun de 9,2 %, auquel s'ajoute la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. L'article 1758 du code général des impôts prévoit en outre que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu (IR) et de la CSG soient majorés de 80 % lorsqu'elles émanent d'activités illicites.
Il faut cependant souligner que, d'une part cette imposition nécessite la transmission préalable d'informations par le ministère public, l'autorité judiciaire ou les agents de police judiciaire ayant mis en évidence une infraction, et que d'autre part la CSG acquittée bénéficie de la déductibilité de droit commun du revenu imposable à hauteur de 6,8 points.
La définition des revenus illicites pour l'administration fiscale :
Le code général des impôts (CGI) prévoit deux dispositifs spécifiques, permettant aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'assurer l'imposition des revenus susceptibles d'être retirés d'activités illicites. Ces revenus sont qualifiés d'illicites dès lors qu'ils sont « perçus » à l'occasion de la commission de certaines infractions pénales limitativement énumérées97(*). Cependant, dans tous les cas, une transmission préalable d'informations par le ministère public, l'autorité judiciaire ou les agents de police judiciaire ayant mis en évidence une infraction est nécessaire pour mettre en oeuvre cette imposition.
La présomption de revenus est prévue par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, et permet d'assimiler à un revenu la libre disposition par un redevable de biens ou de sommes d'argent en lien avec les infractions pénales mentionnées précédemment. Dans ce cas le revenu présumé est déterminé par équivalence à la valeur vénale des biens concernés ou selon le montant des sommes en cause.
La taxation des éléments du train de vie, prévue à l'article 1649 quater-B ter du code général des impôts, permet quant à elle de porter la base d'imposition à l'IR à une somme forfaitaire déterminée au regard de la disproportion constatée entre le train de vie d'un contribuable ayant participé à une activité illicite et ses revenus déclarés.
Source : DGFiP
2. Des revenus non pris en compte dans le calcul des revenus de remplacement versés par France travail
Si le droit actuel permet à l'administration fiscale de qualifier les revenus illicites afin de les imposer, il ne prévoit pas leur prise en compte par l'opérateur France Travail dans le calcul des indemnités des travailleurs privés d'emploi qu'il verse.
France Travail ne bénéficiant d'aucune déclaration des revenus illicites, et en l'absence de disposition législative interdisant le versement d'un revenu de remplacement dans le cas où le bénéficiaire perçoit des revenus issus d'activités illicites, le cumul de ces revenus avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) est de fait possible. Étant licites, ces revenus de remplacement ne peuvent en outre, par la suite, faire l'objet d'une récupération par France Travail.
B. Le dispositif proposé
1. Une majoration de la CSG due au titre des revenus d'activité illicite
L'étude d'impact du présent projet de loi souligne que « en dépit du coût qu'elles représentent pour les finances publiques et sociales, les activités illicites ne contribuent que très marginalement à la couverture des risques sociaux »98(*). Cette faible contribution s'explique à la fois par la difficulté à identifier ces revenus pour l'administration, mais également aux taux de droit commun auxquels ils sont assujettis.
Le I du présent article propose donc de rétablir au sein de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale un IV prévoyant un assujettissement à la CSG à un taux de 25 % pour les revenus illicites au sens de l'administration fiscale.
Le II complète en outre l'article 154 quinquies du code général des impôts afin de faire obstacle à la déductibilité à l'IR du montant de CSG dû dans ce cadre.
Le III prévoit l'entrée en vigueur de ce nouveau régime fiscal au 1er janvier 2026, en excluant une petite rétroactivité pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025.
2. Une prise en compte des revenus illicites dans le calcul des revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi
Le IV du présent article créé un nouvel article L. 5424-1-1 au sein du code du travail, qui prévoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) ne peuvent être cumulées au titre d'une même période avec des revenus illicites au sein de l'administration fiscale. Pour permettre à l'opérateur France Travail d'appliquer cette disposition, le même article prévoit que l'administration fiscale lui communique les revenus dont elle a connaissance.
En outre, les modalités d'application de ce nouvel article seraient fixées par décret en Conseil d'État pour l'ASS, et par un accord relatif à l'assurance chômage conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au titre de l'article L. 5422-20 compte tenu de la gestion paritaire de ce régime.
II - La position de la commission
Les rapporteurs se félicitent de la mesure portée par le présent article. Les revenus illicites, dont les activités rattachées heurtent la collectivité et ont un coût direct et indirect pour les finances sociales, doivent contribuer à plus forte raison au financement des politiques publiques de prévention, ou d'insertion sociale. C'est ce qui justifie la majoration du taux de CSG à 25% pour ces seuls revenus.
De même, la prise en compte de ces revenus dans le calcul des allocations chômages est à saluer. Cependant, cette logique doit prévaloir pour l'ensemble des prestations sous condition de ressources, ce que prévoit l'amendement n° COM-132 adopté par la commission, à l'initiative des rapporteurs - de même qu'un amendement rédactionnel (n° COM-133), par la commission.
Cependant, le réalisme invite à rappeler que cette mesure ne concernera que trop peu d'activités illicites, dans la mesure où l'identification par les forces de l'ordre, et la condamnation par la justice des individus bénéficiant de ces revenus illicites est toujours complexe, et que les efforts doivent redoubler en la matière.
La commission a adopté cet article ainsi modifié
Article
15
Maitriser la circulation des espèces pour lutter contre le
blanchiment d'argent et le travail
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
16
Création d'un dispositif de sanctions administratives des
organismes de formation professionnelle
Cet article propose de créer un dispositif de sanctions administratives mobilisables par les services régionaux de contrôles (SRC) de la formation professionnelle et d'ajouter une nouvelle infraction pénale en absence de remontée des données issues des comptabilités analytiques vers France compétences par les centres de formation d'apprentis (CFA).
La commission a adopté cet article modifié par un amendement d'ordre rédactionnel, et un amendement d'harmonisation des procédures de sanctions en matière de formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
A. Le code du travail prévoit des dispositions pénales en cas de manquements des organismes de formation, qui sont peu employées
1. De nombreuses sanctions pénales sont prévues en cas de manquement des organismes de formation professionnelle
Le code du travail99(*) prévoit des dispositions pénales pour de nombreuses incriminations auxquelles les organismes de formation professionnelle sont, en principe, susceptibles de répondre.
Synthèse des différentes sanctions
pénales prévues par le code du travail
pour les organismes de
formation professionnelle
|
Article |
Infraction |
Montant de l'amende |
|
L. 6355-1 |
Absence de déclaration d'activité auprès de l'autorité administrative |
4 500 euros |
|
L. 6355-2 |
Déclaration d'activité sans mention du déclarant ou du descriptif de l'activité |
4 500 euros |
|
L. 6355-3 |
Absence de déclaration rectificative en cas de modification d'un élément de la déclaration initiale |
4 500 euros |
|
L. 6355-4 |
Absence de déclaration de la cessation d'activité |
4 500 euros |
|
L. 6355-6 |
Non justification des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés |
4 500 euros |
|
L. 6355-7 |
Fait de diriger, d'enseigner ou d'administrer dans un organisme en ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur |
4 500 euros |
|
L. 6355-8 |
Ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis |
4 500 euros |
|
L. 6355-9 |
Établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions nécessaires en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline |
4 500 euros |
|
L. 6355-10 |
Absence de bilan, de compte de résultat et d'annexe |
4 500 euros |
|
L. 6355-11 |
Absence de suivi de façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, d'une part, et de l'apprentissage (secteur privé) |
4 500 euros |
|
L. 6355-12 |
Non désignation d'un commissaire aux comptes (secteur privé) |
4 500 euros |
|
L. 6355-13 |
Ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes en cas de constitution en groupement d'intérêt économique (GIE) (secteur privé) |
4 500 euros |
|
L. 6355-14 |
Absence de suivi de façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, d'une part, et de l'apprentissage (secteur public) |
4 500 euros |
|
L. 6355-15 |
Ne pas adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité |
4 500 euros |
|
L. 6355-16 |
Réalisation d'une publicité mentionnant la déclaration d'activité sans respecter les règles afférentes |
4 500 euros |
|
L. 6355-17 |
Réalisation d'une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement |
4 500 euros |
|
L. 6355-18 |
Ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais |
4 500 euros |
|
L. 6355-19 |
Établissement d'un contrat ne comportant pas les prescriptions légales |
4 500 euros |
|
L. 6355-20 |
Exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation, le paiement de sommes |
4 500 euros |
|
L. 6355-21 |
Exiger le paiement du stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure |
4 500 euros |
|
L. 6355-22 |
Ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document pédagogique de la formation |
4 500 euros |
Source : Code du travail
Ces sanctions peuvent être accompagnées d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle100(*).En cas d'utilisation de moyens frauduleux, une peine de 5 ans d'emprisonnement peut de surcroît être requise101(*).
Cependant, ces amendes supposent que, lors d'un contrôle, le SRC dresse un procès-verbal102(*), ce qui est particulièrement lourd d'un point de vue administratif, au regard de la faible gravité des manquements le plus souvent constatés, et ouvre la voie à de nombreux contentieux. Ainsi, selon la DGEFP, moins d'une vingtaine de procès-verbaux sont dressés chaque année, puisque le plus souvent les agents des SRC signalent les non-conformités par de simples recommandations.
2. Les centres de formation d'apprentis (CFA) se voient imposer la mise en place d'une comptabilité analytique
Afin de mieux contrôler l'activité des CFA, mais aussi d'en améliorer la gestion, le législateur leur a imposé la mise en place d'une comptabilité analytique103(*).
Cependant, en l'absence de toute sanction, cette dernière n'est pas systématiquement déployée, et encore moins souvent exploitée par France compétence qui n'en dispose qu'à l'occasion d'un contrôle déjà ouvert.
B. Le dispositif proposé : la création d'un régime
Le présent article entend, selon l'étude d'impact104(*), « proposer un dispositif déjudiciarisé en substitution des procès-verbaux (...) afin de (...) sanctionner efficacement les petites et moyennes irrégularités aujourd'hui peu poursuivies. »
Le 3° créé ainsi un chapitre VI au sein du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, composé de sept articles :
- l'article L. 6356-1 nouvellement créé permet aux agents de SRC, en l'absence de poursuite pénale conformément au principe de non-cumul des sanctions, de donner une amende pour les manquements des organismes de formation professionnelle à leurs obligations ;
- l'article L. 6356-2 nouvellement créé impose aux SRC l'information du procureur de la République des suites données à leur rapport ;
- l'article L. 6356-3 nouvellement créé limite à 4 000 euros au maximum ladite amende, mais permet son application à chaque manquement constaté, tout en prévoyant une majoration de 50 % en cas de récidive dans l'année ;
- l'article L. 6356-4 nouvellement créé pose le principe de proportionnalité du montant retenu pour l'amende ;
- l'article L. 6356-5 nouvellement créé précise le régime de notification des voies et délais de recours à l'intéressé ;
- l'article L. 6356-6 nouvellement créé précise que le recours ne suspend pas le recouvrement de l'amende ;
- les modalités d'application du chapitre sont renvoyées à un décret pris en Conseil d'État par l'article L. 6356-7 nouvellement créé.
Parallèlement, le 1° du présent article met en place une obligation de transmission des données issues de la mise en oeuvre de la comptabilité analytique des CFA à France compétence, tandis que le 2° créé un article L. 6355-15-1 au sein du code du travail afin de permettre d'infliger une amende de 4 500 euros aux CFA qui manqueraient à cette obligation.
II - La position de la commission
Après leurs auditions avec les représentants syndicaux et patronaux, les rapporteurs sont convaincus de l'intérêt de déjudiciariser les contrôles de la formation professionnelle, afin de mieux réguler ces activités par des sanctions moins importantes, mais plus dissuasives.
La création d'un panel de sanctions administratives permettra également aux SRC de concentrer la mobilisation des sanctions pénales pour les seuls cas les plus graves.
Les rapporteurs ont proposé deux amendements nos COM-134 et COM-135, afin respectivement d'étendre la possibilité de suspension de déclaration d'activité et d'apporter une précision rédactionnelle.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 16 bis
(nouveau)
Respect des principes républicains et des conditions de
diplôme
par les organismes de formation professionnelle
Cet article, introduit par la commission, vise à imposer aux organismes de formation professionnelle recevant des fonds publics le respect de principes républicains, ainsi que des conditions de diplômes pour leurs intervenants.
A. Le droit en vigueur
Le code du travail prévoit de nombreuses sanctions d'ordre général pour les organismes de formation professionnelle (cf. commentaire de l'article 16), ainsi que quelques obligations spécifiques en matière de gestion comptable105(*).
Cependant, ces obligations et sanctions répondent mal aux phénomènes observés, et parfois abondamment relayés sur les réseaux sociaux, d'organismes promouvant des formations dont le contenu pédagogique est douteux, voire trompeur.
B. Le droit proposé
Face à cette situation, la commission a adopté, à l'initiative des rapporteurs, un amendement COM-136 dont est issu le présent article additionnel. Il vise à créer un motif de sanction contre les organismes de formation professionnelle relevant notamment de logiques d'emprise, d'entrisme ou de charlatanisme.
Son 2° propose de rétablir un article L. 6352-4 précisant l'obligation pour les organismes de formation de respecter le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis, le respect de la liberté d'expression et de conscience, ainsi que la neutralité des enseignements dispensés.
Par ailleurs, le 3° permet d'exiger le remboursement de fonds publics à tout organisme de formation qui :
- détourne lesdits fonds ;
- ne recourt par à des formateurs disposant les diplômes requis par l'activité concernée ;
- ne respecte par les principes républicains listés à l'article L. 6352-4 précité.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-136.
Article 16 ter (nouveau)
Renforcement du contrôle
a priori des structures déposant une déclaration
d'activité
Cet article, introduit par la commission des affaires sociales, vise à renforcer le contrôle a priori des structures déposant une déclaration d'activité afin de dispenser des actions de formation.
A. Le droit existant
L'article L. 6351-1 code du travail prévoit l'obligation, pour toute personne physique ou morale réalisant des actions de formation de déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Cette déclaration comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité106(*).
La déclaration est enregistrée sauf dans les cas prévus à l'article L. 6351-3 du code du travail qui donnent possibilité de refuser l'enregistrement, de manière motivée, si :
- les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions de formation professionnelle prévues par le code du travail ;
- les dispositions relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
- les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage ;
- l'une des pièces justificatives n'est pas produite.
B. Le dispositif proposé
En outre, ces demandes s'inscrivent dans le contexte d'une augmentation importante des demandes de déclaration d'activité. Toujours selon le Gouvernement, 16 150 demandes avaient ainsi été présentées en 2018 alors que ce nombre a atteint 46 823 en 2024.
La commission a souhaité, en adoptant l'amendement COM-137 des rapporteurs, mieux protéger le marché de la formation professionnelle en élargissant le champ du contrôle a priori des déclarations d'activité. Selon les informations transmises par le Gouvernement aux rapporteurs, il arrive notamment, qu'un organisme qui s'est vu refuser ou annuler sa déclaration d'activité dépose une nouvelle d'enregistrement dès le lendemain de cette décision.
Ainsi, le présent article vise à compléter l'article L. 6351-3 du code du travail, afin de prévoir des nouveaux cas justifiant le refus d'enregistrer la déclaration d'activité. Il s'agirait des organismes suivants :
- les organismes de formation ayant été sévèrement sanctionnés par les services de contrôle moins de quatre ans avant la nouvelle demande d'activité ;
- les organismes ayant fait l'objet d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, dans les cinq ans précédant la demande, et n'ayant pas acquitté la sanction financière ;
- les organismes se présentant comme des centres de formation des apprentis (CFA) mais ne disposant pas de locaux permettant de justifier de sa capacité à réaliser ses actions de formation.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-137.
Article
17
Levée de l'interdiction du cumul des sanctions conventionnelles et
financières, extension du domaine de contrôle et renforcement des
mesures de lutte contre la sur-prescription
Cet article propose de lever l'interdiction de cumul d'une sanction conventionnelle et d'une pénalité financière en cas de fraude d'un professionnel de santé, d'étendre le champ du contrôle de la sur-prescription des centres de santé et des plateformes de téléconsultation, et de rendre imposable la mise sous objectif des professionnels de santé sur-prescripteurs.
La commission a adopté cet article modifié par deux amendements des rapporteurs.
I - Le droit existant
A. La levée de l'interdiction de cumul d'une sanction conventionnelle avec une pénalité financière
1. La genèse de la pénalité financière et du non-cumul de la sanction conventionnelle et de la pénalité financière
L'article 23 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a créé un pouvoir de sanction financière à l'encontre des professionnels de santé en raison de l'inobservation des règles du code de la sécurité sociale, « ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus »107(*). Cette pénalité, prononcée par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) après avis d'une commission spécialisée, est proportionnelle à la gravité des faits et plafonnée à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, doublé en cas de récidive.
Le rapport de M. Alain Vasselle108(*) sur ladite loi revient sur la genèse de cet article. Issue du rapport sur l'exécution de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie 2003, cette nouvelle sanction vise à répondre à l'absence de sanctions intermédiaires pour les faits n'étant pas des faits graves, en créant une gradation de la sanction à l'encontre des professionnels de santé.
Dès sa création, le principe d'une interdiction du cumul de la sanction conventionnelle et de la pénalité financière pour la même inobservation des règles a été prévu. Les raisons de ce non-cumul sont probablement à trouver dans l'interprétation du principe de non bis in idem (cf infra).
2. Le dispositif de pénalité financière actuellement prévu
Depuis sa création en 2004, le régime de pénalité financière a été progressivement renforcé dans sa dimension répressive afin de renforcer son caractère dissuasif et améliorer l'efficacité du contrôle de l'assurance maladie. Parmi les évolutions récentes, l'article 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a augmenté les montants des plafonds de la pénalité financière.
Actuellement, le dispositif de pénalité financière peut être prononcé à l'encontre d'un professionnel ou d'un établissement de santé en cas d'inobservation des règles de la sécurité sociale aboutissant à une prestation, un acte ou un versement indu, d'inobservation des règles visant à empêcher le contrôle ou la bonne gestion de la caisse primaire d'assurance maladie, la récidive après deux mises sous accord préalable, le non-respect des objectifs prescrits dans une mise sous objectifs, les abus prévus à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation ou la participation à une fraude organisée.
Le montant de la pénalité est proportionnel à la gravité des faits reprochés. L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit des plafonds différents selon que le montant de l'indu a pu être chiffré ou pas. Lorsque le montant est chiffré, la pénalité financière est plafonnée à 70 % de la somme. Ce plafond n'est applicable qu'aux manquements ne constituant pas une fraude, le plafond des fraudes étant majoré (cf infra). À l'inverse, lorsque le montant n'est pas chiffrable, le plafond correspond à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, lui-même défini par un arrêté annuel. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre de la même année, il s'élève à 3 925 euros109(*). En cas de récidive, le montant de la pénalité est doublé.
Pour les cas de fraude définis par voie réglementaire, il est défini un plancher fixé à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Les plafonds sont, quant à eux, revus à la hausse et correspondent à 300 % de la somme et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Parmi ces fraudes, énumérées à l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, sont mentionnées la tentative ou l'obtention d'un versement pour des actes ou des prestations non réalisés, ou bien le non-respect répété du signalement du caractère non remboursable de produits, de prestations ou d'actes sur l'ordonnance en dehors d'une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie.
En cas de fraude commise en bande organisée, le plafond est fixé à 400 % de la somme et seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La pénalité est prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie à la suite d'une procédure, respectant le principe du contradictoire. En premier lieu, en application de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM notifie les faits reprochés au professionnel ou l'établissement de santé. La personne ou l'établissement en cause dispose alors d'un mois pour être entendu. À l'issue de ce délai, le directeur peut abandonner la procédure, notifier un simple avertissement ou poursuivre la procédure. En cas de poursuite, il saisit la commission spéciale prévue par l'article L. 114-17-2 et dont la composition est définie à l'article R. 147-3 du même code, qui rendra un avis. À l'issue, le directeur de la CPAM peut soit abandonner la procédure, soit saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour une demande d'avis conforme. L'absence de réponse dans un délai d'un mois vaut avis favorable. La personne mise en cause dispose alors de deux mois pour payer la pénalité financière, sous peine d'une majoration de 10 % de la pénalité.
3. Le principe de non cumul de la sanction conventionnelle et de la pénalité financière : une interprétation extensive du principe de non bis in idem
Le dernier alinéa du III de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'interdiction pour le directeur de la CPAM de recourir de façon concurrente aux procédures pouvant aboutir à une sanction conventionnelle et à une pénalité financière pour les mêmes faits. Cette interdiction du cumul des sanctions a été prévu dès la création du régime de la pénalité financière, probablement en raison d'une interprétation du principe de non bis in idem.
Le principe de non bis in idem est issu du droit romain et correspond à l'interdiction de cumuler des poursuites pour des mêmes faits. Intégré au principe de nécessité des délits et des peines prévus à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'interprétation de ce principe a été précisée par le Conseil constitutionnel. Le principe de non bis in idem ne s'applique pas aux poursuites conduisant à des sanctions de nature différente110(*) et ne protégeant pas les mêmes intérêts sociaux111(*).
Les sanctions conventionnelles correspondent à plusieurs types de mesures, graduées selon la gravité des faits reprochés au professionnel de santé. Les mesures conventionnelles à disposition de l'assurance maladie sont les suivantes : avertissement, blâme, suspension de la participation de la CPAM au versement des cotisations sociales ou au versement des rémunérations conventionnelles, déconventionnement. Ce dernier est donc la sanction la plus répressive dans l'arsenal conventionnel de l'assurance maladie. La durée maximale du déconventionnement varie selon les conventions. Pour les médecins et les chirurgiens-dentistes, elle est établie à 3 ans contre 5 ans pour les centres de santé. Toutes professions confondues, en moyenne, la durée d'un déconventionnement sans sursis est de 3 ans.
La pénalité financière correspond, quant à elle, à une sanction intermédiaire prononcée par le directeur de la CPAM. Elle vise à réprimer l'inobservation des règles de la sécurité sociale par le professionnel ou l'établissement de santé, mais aussi à assurer le redressement financier lié à un abus. Il s'agit donc d'une pénalité à visée répressive, mais aussi réparatrice pour l'organisme créancier. Toutefois, il convient de préciser que le principe de non bis in idem s'oppose à un cumul des pénalités financières pour des mêmes faits. Comme le prévoit l'article R. 147-5 du code de la sécurité sociale, lorsque les mêmes faits relèvent de plusieurs cas d'inobservation des règles, seule la pénalité la plus élevée est encourue. Ainsi, pour des mêmes faits, les sanctions de même nature et ayant le même intérêt ne sont pas cumulables.
Ainsi interprété, le principe de non bis in idem ne fait pas obstacle à un cumul entre la sanction conventionnelle et la pénalité financière dès lors qu'elles relèvent d'une nature différente et poursuivent des finalités distinctes.
B. Le renforcement du contrôle de la sur-prescription
1. Un renforcement du poids des centres de santé et des plateformes de téléconsultation
Les arrêts maladie figurent parmi les dépenses d'assurance maladie dont la croissance est la plus forte. En effet, depuis 2010, l'évolution des dépenses d'indemnités journalières est en hausse ininterrompue. La croissance annuelle des dépenses liées est en accélération, passant de 2,9 % entre 2010 et 2019 à 6,3 % depuis 2020112(*). Si cette progression depuis 2019 est explicable à 60 % par la hausse du taux d'emploi, le vieillissement de la population, la situation épidémiologique et l'augmentation des salaires, 40 % de cette croissance reste inexpliquée113(*).
Entre 2020 et 2023, bien que la part des téléconsultations dans l'ensemble des consultations ait diminué de 5 % à 3 %, les dépenses de l'assurance maladie pour ces prestations s'élèvent à 266 millions d'euros, soit 3 % des 8,1 milliards d'euros de remboursements de consultations. Si le poids de ces dépenses est en baisse, la restructuration du secteur autour des plateformes de téléconsultation interroge quant aux modalités de contrôle de ces structures. Entre 2020 et 2023, la part des centres de santé et des plateformes de téléconsultation dans les téléconsultations de médecine se renforce, passant de 4 % en 2020 à 36 % en 2023. En parallèle, certains coûts indirects (sur-prescription, reconsultation, arrêt maladie) demeurent mal documentés et mal contrôlés pour évaluer le coût réel de ces plateformes.
Répartition des téléconsultations par secteur entre 2020 et 2023
Source : Commission des affaires sociales, d'après Cour des comptes, Les téléconsultations. Une place limitée dans le système de santé, une stratégie à clarifier pour améliorer l'accès aux soins, avril 2025
Concernant la prescription d'antibiotiques, les autorités de santé rappellent qu'un examen clinique, assorti le cas échéant d'un prélèvement bactériologique, constitue un préalable indispensable à toute antibiothérapie. Or, si la proportion de prescriptions d'antibiotiques apparaît légèrement inférieure en téléconsultation (7 %) qu'en présentiel (8,3 %), elle demeure particulièrement préoccupante au regard du très faible nombre de situations cliniques pouvant justifier un tel traitement sur la seule base d'un interrogatoire à distance. Ce taux s'élève même à 9,6 % pour les plateformes de téléconsultation avec des écarts entre les plateformes allant de 2 % à 18 %114(*), révélant des pratiques contraires aux bonnes règles de prescription et témoignant d'une dérive de certaines structures, et appelant à un meilleur contrôle de la Cnam.
2. Un périmètre réduit de contrôle de la sur-prescription des centres de santé et des plateformes de téléconsultation réduit
L'article 162-2 du code de la sécurité sociale prévoit un principe de liberté de prescription du médecin, prenant en compte l'état de santé du patient. Élevé au rang de principe général du droit115(*), la liberté de prescription des médecins peut être encadrée dans un objectif de préservation de « l'équilibre financier de la sécurité sociale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle »116(*). Le législateur est donc tenu de concilier ces deux principes.
Constatant une hétérogénéité des prescriptions pour des publics et des zones géographiques similaires, et dans un objectif de maîtrise des dépenses de l'assurance maladie, les caisses primaires d'assurance maladie disposent de deux dispositifs, prévus à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, pour limiter les prescriptions des médecins : la mise sous objectif (MSO)117(*) et la mise sous accord préalable (MSAP)118(*). Ces mesures peuvent être engagées par l'assurance maladie après un contrôle portant sur des périmètres différents selon la personne physique ou morale contrôlée, le périmètre étant réduit pour les centres de santé et les plateformes de téléconsultation.
L'article 63 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a introduit la possibilité pour l'assurance maladie d'engager les procédures de MSAP et de MSO dès lors que les centres de santé ou les sociétés de consultations ne respectent pas les dispositions légales régissant les arrêt de travail ou bien génèrent un nombre ou une durée trop élevés de prescriptions d'arrêts de travail en comparaison aux centres ou aux sociétés ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. Cependant, aucun décret d'application n'a été pris. Aucun bilan n'existe donc de cette évolution.
Le périmètre de contrôle des professionnels de santé pouvant conduire à une MSO ou une MSAP est lui plus étendu et comprend les prescriptions de transports, d'actes, de produits ou de prestations, en sus des arrêts maladie. Alors que des indicateurs semblent pointer une sur-prescription des centres de santé et des plateformes de téléconsultation (cf supra sur les antibiotiques), il apparaît nécessaire d'aligner le périmètre de contrôle de la sur-prescription des centres de santé et des plateformes de téléconsultation sur celui des professionnels de santé.
3. Une mise sous objectif non imposable aux professionnels de santé
Le II de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale prévoit une mesure alternative à la mise sous accord préalable : la mise sous objectif. Procédure à l'amiable proposée par le directeur de la CPAM, conjointement au service du contrôle médical, celle-ci vise à réduire la sur-prescription identifiée d'un professionnel de santé dans un délai allant jusqu'à six mois (comme pour une MSAP).
Les fédérations des professionnels de santé, tout comme le Conseil national de l'ordre des médecins, sont opposés à ces dispositifs au titre de la liberté de prescription. Plusieurs syndicats incitent les médecins à refuser la MSO, celle-ci équivalent, selon eux, à une reconnaissance indirecte d'une faute ou de prescriptions de complaisance de la part du médecin. Plusieurs biais méthodologiques sont également dénoncés, notamment une mauvaise prise en compte de la typologie de la patientèle119(*).
Annoncées en juin 2025 et tirant les conséquences de l'exercice 2024-2025, de nouvelles modalités de MSO et MSAP s'appliquent pour la période du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 afin de mieux cibler les sur-prescripteurs. Désormais, la comparaison des pratiques s'effectuera sur la base de territoires similaires, cette analyse étant fondée sur des données de l'Insee. Ce nouveau cadre tiendra compte des caractéristiques socio-économiques locales et de l'offre médicale disponible, mais également d'une analyse plus fine de la patientèle. Le dispositif sera mis en oeuvre en deux phases :
· de septembre 2025 à février 2026, il concernera les médecins ayant fait l'objet d'un accompagnement avant août 2024 ou ayant été engagés dans une procédure MSO-MSAP pour un excès d'indemnités journalières au cours des années précédentes ;
· de janvier à juin 2026, il s'étendra aux professionnels ayant échangé avec l'assurance maladie entre septembre et décembre 2024.
La procédure pour mise sous accord préalable ou mise sous objectif est la suivante120(*). Dans un premier temps, le professionnel de santé est notifié du déclenchement de la procédure par appel de l'assurance maladie, puis formellement par un courrier comprenant notamment les faits constatés et les données relatives à ses prescriptions. Le médecin dispose alors d'un mois pour exercer son droit au contradictoire, soit par en adressant des observations écrites, soit en sollicitant un entretien avec la caisse.
À l'issue de ce délai, le directeur de la CPAM peut abandonner la procédure, proposer la mise sous objectif ou poursuivre la procédure de mise sous accord préalable. En cas de proposition de mise sous objectif, le médecin peut soit refuser la procédure, entraînant alors un réexamen de son dossier pouvant conduire à une mise sous accord préalable (ou à un abandon), soit accepter la proposition. Dans ce dernier cas, un plan de réduction de la prescription est établi par le médecin-conseil chef de service. Ce plan fait l'objet d'un suivi personnalisé, comprenant au minimum un entretien à mi-parcours pour évaluer l'évolution de la pratique. À l'issue de la période de mise sous objectif, dont la durée maximale est de six mois, le professionnel reçoit un bilan détaillé précisant s'il a atteint ou non l'objectif fixé. En cas de non-respect, une pénalité financière peut être appliquée.
En 2023, ce sont 965 médecins qui ont vu l'assurance maladie déclencher une procédure de MSO ou MSAP à leur encontre. Ces procédures ont débouché sur :
· 416 mises sous objectif ;
· 255 abandons de mises sous objectif à l'issue de la phase contradictoire ;
· 294 refus de mises sous objectifs, dont 201 donnant lieu à une mise sous accord préalables et 93 abandonnées.
Source : Commission des affaires sociales, d'après la réponse au questionnaire de la Caisse nationale d'assurance maladie
Les économies générées par les MSO et MSAP sont de l'ordre de 160 millions d'euros pour l'exercice 2023 et 2024. Les médecins ciblés avaient une prescription d'indemnités journalières supérieure de deux à trois à l'écart-type à la moyenne de leurs confrères121(*). Selon la Cnam, à la suite d'une mise sous objectif ou d'une mise sous accord préalable, le nombre d'indemnités journalières prescrites par patient actif a diminué de 30 % entre le 2e semestre 2022 et celui de 2024 contre une croissance de 2 % pour les autres médecins sur la même période122(*).
II - Le dispositif proposé
A. En matière de cumul des sanctions
Le 1° du présent article, par la suppression du dernier alinéa du III de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, prévoit la levée de l'interdiction de cumul d'une pénalité financière avec une sanction conventionnelle pour les mêmes faits prononcées par le directeur de la CPAM.
B. En matière de contrôle de la sur-prescription
1. L'alignement du périmètre de contrôle de la sur-prescription pour les centres de santé et les plateformes de téléconsultation sur celui des professionnels de santé
Le a du 2° de l'article 17 prévoit une modification du I bis de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité au profit d'un alignement du périmètre de contrôle de la sur-prescription pour les centres de santé et les plateformes de téléconsultation sur celui des professionnels de santé. Ainsi, le périmètre de contrôle porterait sur prescriptions de transports, d'actes, de produits ou de prestations, en sus des arrêts maladie.
2. La transformation de la mise sous objectif en obligation
Le b du 2° de l'article 17 prévoit une modification du II de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale pour rendre obligatoire et non facultative la mise sous objectif du prescripteur par la caisse primaire d'assurance maladie. Ainsi, le professionnel de santé n'aura plus la possibilité de refuser la mise sous objectif au profit d'une mise sous accord préalable.
III - La position de la commission
A. En matière de cumul des sanctions
Attachée à la lutte contre la fraude sociale, votre commission soutient la volonté du Gouvernement de renforcer l'arsenal répressif en cas de fraude à l'assurance maladie. À ce titre, la possibilité offerte aux directeurs de CPAM, relais locaux de l'assurance maladie, de prononcer le cumul d'une pénalité financière et d'une sanction conventionnelle va dans le sens d'un renforcement de l'arsenal répressif à l'encontre des fraudeurs.
En 2024, 800 pénalités financières ont été prononcées à l'encontre d'offreurs de soins et de prestataires de biens et services pour un montant de 23 millions d'euros. Durant la même année, sur 107 actions conventionnelles engagées, 79 ont débouché sur une sanction conventionnelle, dont 61 sans sursis. Selon la Cnam, si ces dossiers avaient également donné lieu à une pénalité financière, 5 millions d'euros de pénalités financières supplémentaires auraient été perçus.
Ainsi, si la commission reste favorable à tout dispositif renforçant la lutte contre toute fraude à l'assurance maladie, elle rappelle que ce dispositif ne constitue pas un vecteur majeur d'amélioration des finances sociales. Il est, au mieux, un outil offrant à l'assurance maladie un meilleur redressement financier des fraudes constatées, sans avoir un effet significatif sur les finances sociales.
Aussi la commission s'interroge-t-elle sur l'efficacité de tels dispositifs. Comme le relève un rapport de la Cour des comptes de 2020, commandé par la commission des affaires sociales en application de l'article LO. 132-3-1 du code des juridictions financières, le faible nombre de déconventionnements prononcés par l'assurance maladie conduit à une ineffectivité du caractère dissuasif des sanctions conventionnelles. Dès lors, en sus de la faculté de cumul offerte par ce texte, un changement de culture dans la réponse de l'assurance maladie aux fraudes constatées semble être nécessaire pour utiliser de façon efficace la sanction conventionnelle en cas de récidive.
L'absence de transmission systématique, pourtant prévue par l'article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale, des dossiers de fraude des CPAM vers les conseils départementaux de l'ordre des médecins interroge également, les ordres ne pouvant prendre de sanctions disciplinaires sans être informés de la situation.
La commission a adopté deux amendements présentés par les rapporteurs :
- l'amendement COM-139, qui vise à dérembourser les prescriptions des personnels de santé déconventionnés en raison d'une fraude à l'assurance maladie pour la durée de la sanction.
- et l'amendement COM-138, qui procède à une correction d'erreur matérielle.
B. En matière de contrôle de la sur-prescription
La commission considère que l'alignement du périmètre de contrôle de la sur-prescription sur celui des professionnels de santé, le mieux-disant en la matière, est un outil pertinent de maîtrise des dépenses de l'assurance maladie, mais aussi une évolution juste afin que les professionnels soient placés sur un pied d'égalité avec ces structures pouvant être peu vertueuses. Cette extension du périmètre de contrôle au niveau de l'ensemble de la structure garantit également qu'il n'y ait pas de déversement en interne de prescriptions d'un professionnel de santé à un autre pour éviter une procédure individuelle de mise sous objectif ou de mise sous accord préalable.
Il est estimé que cette mesure générerait jusqu'à 10 millions d'euros d'économies supplémentaires par an. Toutefois, votre commission s'interroge sur la pertinence de cette estimation, alors même que l'article I bis n'est toujours pas appliqué, faute de décret. Elle regrette donc que cette extension du périmètre n'ait pas été précédée d'une mise en application de l'article 63 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
C. En matière d'obligation de mise sous objectif du prescripteur
La commission considère que la transformation de la faculté de mise sous objectif en obligation est une avancée nécessaire dans la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie, particulièrement des indemnités journalières. Seuls sont concernés les médecins ayant une prescription d'indemnités journalières au moins deux fois supérieure à la moyenne de leurs confrères à caractéristiques similaires. C'est un outil pertinent de pilotage de la dépense de santé, ne dégradant pas la qualité des soins. L'imposition de la mise sous objectif aux médecins générerait jusqu'à 10 millions d'euros d'économies supplémentaires par an.
La faculté, pour les médecins concernés, de refuser une mise sous objectif au profit d'une mise sous accord préalable est devenu un vecteur d'inefficacité du dispositif qu'il convient de corriger par sa transformation en obligation. La mise sous accord préalable doit rester l'exception, celle-ci demandant des moyens humains particulièrement développés pour les services de l'assurance maladie, le service médical validant chaque prescription dans le champ ciblé.
Toutefois, votre commission s'interroge sur les modalités d'application conduisant à une mise sous objectif. Il n'apparaît pas raisonnable de cibler des médecins pour des pratiques ayant eu cours plus d'un an auparavant. Ce délai entre la prescription et le contrôle, également dénoncé par le Conseil national de l'ordre des médecins, pourrait fausser la pertinence de cette analyse.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 17 bis
(nouveau)
Augmentation des majorations de redressement pour travail
dissimulé
Cet article, introduit par la commission, vise à augmenter les majorations du montant de redressement qui s'appliquent automatiquement en cas de redressement pour travail dissimulé.
A. Le droit en vigueur
L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, et de 40 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé avec circonstances aggravantes, telles que l'emploi de mineurs soumis à obligation scolaire.
Ces majorations peuvent être minorées ou augmentées selon que la personne physique ou morale redressée s'acquitte rapidement de ses obligations, ou au contraire récidive.
En effet, l'article précité offre à la personne morale redressée la possibilité de bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration de redressement si elle s'acquitte du règlement intégral des sommes appelées au titre du recouvrement de cotisations, majorations et pénalités de retard dans les trente jours suivant la notification, ou si elle a présenté dans ce délai un plan d'échelonnement des paiements qui a été accepté par le directeur de l'organisme de recouvrement.
À l'inverse, en cas de récidive du constat d'un recours au travail dissimulé dans les cinq ans suivant une première condamnation, la majoration de redressement en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié est portée à 45 %, et celle résultant du constat de l'infraction de travail dissimulé avec circonstances aggravantes à 60 %.
B. Le dispositif proposé
Le présent article, issu de l'amendement COM-62 de Mme Raymonde Poncet Monge, aggrave les majorations de redressement qui sont prononcées en première intention. Il augmente, au sein de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de redressement en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, à 35 % au lieu de 25 %, et le montant de la majoration de redressement résultant du constat de l'infraction de travail dissimulé avec circonstances aggravantes, à 50 % au lieu de 40 %.
De telles proportions restent raisonnables, afin de ne pas obérer la capacité qu'ont les personnes physiques et morales redressées à s'acquitter des sommes dues.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-62.
Article 17 ter
(nouveau)
Suspension temporaire du tiers payant pour les assurés
ayant été condamnés pour fraude à l'assurance
maladie
Cet article additionnel, introduit par la commission propose la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour fraude.
La commission a adopté cet article additionnel.
A. Le tiers payant, un dispositif facilitateur de fraude par les assurés
Le tiers payant est un dispositif permettant aux patients de ne pas avancer les frais de santé pour la partie relevant de l'assurance maladie. Afin de réduire les inégalités et freins à l'accès aux soins, ce dispositif a été généralisé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Concrètement, l'Assurance maladie s'engage à payer dans un délai réduit les professionnels de santé la partie prise en charge par elle-même. Les complémentaires de santé peuvent également pratiquer le tiers payant par des conventions. Il ne reste alors au patient à payer que la différence entre la partie prise en charge et les honoraires.
Si ce système a permis de solvabiliser de nombreux patients, il est également un facilitateur de fraudes par les assurés. En effet, certaines fraudes reposent sur la présentation de faux documents à l'instar d'ordonnances, permettant une délivrance sans frais de produits de santé. Dès lors, aucun outil dans l'arsenal juridique ne permet à l'assurance maladie de suspendre le tiers payant pour un assuré fraudeur, ce qui permet à un individu malintentionné de récidiver.
B. Le dispositif proposé : la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés fraudeurs
L'amendement COM- 38 rect. bis de Mme Patricia Demas et plusieurs de ses collègues prévoit la modification de l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale en vue de suspendre temporairement le droit au tiers payant d'un assuré sanctionné ou condamné à la suite d'une fraude ou d'une tentative de fraude. Les modalités d'application de cette suspension seront prévues par décret.
II - La position de la commission
La commission a accueilli favorablement ce dispositif, considérant que la fraude sociale des assurés remet en cause le contrat de confiance qui réside entre les organismes de sécurité sociale et le bénéficiaire. Aussi, convient-il d'infliger une sanction marquant cette rupture de confiance, graduée et limitant la récidive.
La suspension temporaire du tiers payant participe à la fois de cette lutte contre la récidive, en contraignant le patient à devoir avancer les frais, et graduée car ne remettant pas en cause les droits du patient à l'accès aux soins.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé
Article
18
Sanctionner plus sévèrement les escroqueries aux finances
publiques commises en bande organisée
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
19
Renforcer le délit de mise à disposition d'instruments
facilitant la fraude fiscale
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
20
Renforcer les obligations déclaratives et des sanctions pour les
trusts
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 20 bis
(nouveau)
Extension du droit de copie de l'administration fiscale dans le
cadre du contrôle des organismes délivrant des reçus
fiscaux
Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-103 de Nathalie Goulet insérant le présent article additionnel.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 20 ter
(nouveau)
Possibilité pour les agents de la direction
générale des finances publiques de contrôler les terminaux
de paiement électronique des professionnels
Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-100 du rapporteur pour avis insérant le présent article additionnel.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 20 quater (nouveau)
Demande d'évaluation
du dispositif de collecte de la taxe sur les transactions
financières
Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-101 du rapporteur pour avis insérant le présent article additionnel.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
TITRE
III
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR
FRAUDE
Article 21
Renforcer l'efficacité des mesures
conservatoires dans la procédure dite
de « flagrance
sociale » et supprimer le caractère suspensif de l'opposition
à contrainte en cas de redressement pour travail dissimulé
Cet article propose de créer un procès-verbal de flagrance sociale sur le fondement duquel les organismes de recouvrement peuvent diligenter des mesures conservatoires afin de garantir le paiement d'une créance sociale. Il propose également de rendre immédiatement exécutoires les contraintes émises à la suite d'un recouvrement pour travail dissimulé.
La commission a adopté cet article modifié par deux amendements, le premier étendant le procès-verbal de flagrance sociale aux infractions de travail illégal, et le second effectuant des modifications aux fins de coordination.
I°- Le dispositif proposé
A. Les mécanismes de recouvrement des créances sociales nées d'un contrôle relevant l'infraction de travail dissimulé
Lorsque les agents des organismes de protection sociale habilités à effectuer des contrôles recensent des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé 123(*), ce constat peut donner lieu à des poursuites pénales diligentées par le procureur de la République à réception des procès-verbaux établis par les agents, ainsi qu'à des redressements des cotisations éludées. Ces redressements sont le plus souvent forfaitaires, en l'absence d'éléments renseignant le nombre d'heures de travail réellement effectué.
Les redressements pour travail dissimulé sont exorbitants du droit commun : le montant de la créance de cotisations est majoré de 25 %, et de 40 % en présence de circonstances aggravantes de l'infraction. Le délai de prescription des créances de cotisations, majorations et pénalités de retard, qui est de trois ans en droit commun, est porté à cinq ans. Ce délai s'applique également à l'action civile de l'organisme de recouvrement devant les juridictions judiciaires pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi qu'à l'action en exécution de la contrainte, qui est le premier moyen dont disposent les organismes sociaux pour recouvrir leurs créances.
Le second moyen de recouvrir des sommes éludées au titre du travail dissimulé, qui sera ici étudié en premier lieu, consiste en des mesures de saisies conservatoires correspondant au montant de la créance sociale que les directeurs des organismes de recouvrement peuvent mettre en oeuvre face à des entreprises éphémères ou en présence d'indice suggérant que les dirigeants d'une structure contrôlée pourraient être tentés de faire rapidement disparaître les actifs de celle-ci.
1.° L'organisme de protection sociale peut recouvrir des créances sociales nées d'une infraction de travail dissimulé en gelant à titre conservatoire les biens de la personne contrôlée
a) Le précédent de la procédure de flagrance fiscale
Pour mémoire, le terme de flagrance renvoie à l'enquête de flagrance en droit pénal, qui confère aux policiers, pendant une durée limitée de 8 jours renouvelable une fois, des pouvoirs d'enquête exceptionnels en cas de découverte d'un flagrant délit ou crime124(*), et ce afin de faciliter la recherche et l'obtention de preuves.
La première procédure de recouvrement dite de flagrance est celle de la flagrance fiscale, introduite par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
Cette procédure a été créée afin de permettre à l'administration fiscale constatant une activité frauduleuse, de procéder, sur le fondement d'un procès-verbal de flagrance fiscale, à des mesures de saisies conservatoires à hauteur du montant de l'impôt afférent à la période pendant laquelle est réalisée la fraude. En effet, le délai entre l'accomplissement matériel de la fraude et l'établissement de l'assiette de l'impôt en résultant pouvait être très long, compte tenu du fait que la créance fiscale n'existait juridiquement qu'à compter du moment où l'échéance déclarative était intervenue. Or, certaines entreprises éphémères et certains contribuables profitaient de ce délai pour faire disparaître leur activité, ce qui rendait de fait le recouvrement impossible.
Les faits dont le constat donne lieu à l'ouverture d'une procédure de flagrance fiscale sont limitativement énumérés à l'article 16-0 BA du livre des procédures fiscales.
Le législateur a créé deux recours distincts devant le juge des référés administratif, dont la décision est elle-même susceptible d'appel devant le tribunal administratif. L'article L. 201-A du livre des procédures fiscales prévoit ainsi un recours contre le procès-verbal de flagrance fiscale, et l'article L. 201-B du même livre, contre les mesures de saisie conservatoire. Dans les deux cas, le juge des référés administratif est tenu de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et à l'exécution des saisies conservatoires « en cas d'urgence », et « lorsque le contribuable présente un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure ».
Les mesures de saisie conservatoire
Il existe deux catégories de mesures conservatoires : les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires.
Les premières peuvent être mises en oeuvre avant que le créancier ne soit muni d'un titre exécutoire125(*), comme c'est le cas dans la procédure de flagrance fiscale. Les mesures conservatoires permettent à un créancier de geler des biens de son débiteur le temps que sa créance soit constatée par un titre exécutoire, auquel cas la mesure conservatoire se transformera en mesure d'exécution forcée lui attribuant la propriété du bien gelé. Une mesure conservatoire est donc un préalable qui assure l'efficacité d'une mesure d'exécution forcée. Le code des procédures civiles d'exécution envisage une seule mesure de saisie conservatoire, qui peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels (titres financiers, sommes d'argent), sur des biens spécifiques (navires, aéronefs, biens placés dans un coffre-fort) ainsi que sur des biens détenus par un tiers. Cette mesure a pour effet de rendre indisponibles les biens sur lesquels elle porte. La protection des droits du débiteurs subordonne l'exercice d'une mesure conservatoire à la délivrance d'une autorisation préalable du juge de l'exécution.
Les mesures de sûreté judiciaire sont des garanties apportées au créancier, qui lui confèrent un droit de suite (il peut suivre le bien malgré un changement de propriétaire à l'issue d'une vente ou d'une donation) et un droit de préférence dans l'ordre des créanciers. Ces mesures n'ont pas pour objet de rendre le bien indisponible.
b) Le précédent désormais abrogé de la procédure de flagrance sociale pour travail illégal
Afin d'améliorer le recouvrement des cotisations pour travail illégal, la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit en son article 128 une procédure dite de flagrance sociale, sur le modèle de la procédure de flagrance fiscale.
L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale permettait ainsi à l'inspecteur chargé du recouvrement, à l'issue d'un contrôle s'étant soldé par l'établissement d'un procès-verbal constatant une situation de travail illégal, et lorsque la situation ou le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettaient en péril le recouvrement des cotisations éludées, de dresser un procès-verbal de flagrance sociale renseignant le montant desdites cotisations, dont la copie était signée par l'inspecteur et le responsable de l'entreprise, l'organisme de recouvrement en conservant l'original.
Le directeur de l'organisme de recouvrement pouvait ensuite, sur le fondement des deux procès-verbaux pour travail illégal et de flagrance sociale, solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens de la personne morale ou physique contrôlée des mesures de saisie conservatoires.
3° Les mesures de saisie conservatoire prises sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement en l'absence de garanties de paiement d'une créance sociale née d'un contrôle pour travail dissimulé
Face au constat de la lenteur des procédures de saisies conservatoires soumises à l'autorisation du juge de l'exécution, le législateur a finalement supprimé au 1er janvier 2017 126(*) la procédure de flagrance sociale pour la remplacer par un dispositif de saisies conservatoires pour les seules créances en lien avec un contrôle relevant une infraction de travail dissimulé.
L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, permet ainsi au directeur d'un organisme de recouvrement d'effectuer des mesures de saisies conservatoires127(*) sur les biens d'une personne ayant fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel a été dressé un procès-verbal constatant la matérialité de l'infraction de travail dissimulé128(*), et ce sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution129(*). Les mesures de saisie ne peuvent porter sur les montants constatés au terme du contrôle pour travail dissimulé.
Ces mesures ne peuvent toutefois être mises en oeuvre qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, au terme de laquelle la personne contrôlée se voit remettre par l'organisme chargé du recouvrement, à l'issue du contrôle, un document constatant l'infraction de travail dissimulé et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, ainsi que des majorations, pénalités et exonérations annulées. Ce document informe également la personne contrôlée du pouvoir dont dispose le directeur de l'organisme de recouvrement de procéder à des mesures de saisies et lui indique l'ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes avant même qu'une telle décision ne soit effective.
À la remise de ce document, la personne contrôlée est tenue de produire des garanties suffisantes à couvrir le montant de la créance, à défaut de quoi le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à des mesures de saisie conservatoire.
Ces mesures de saisies sont prises à l'issue d'une décision formalisée du directeur, qui est susceptible de recours devant le juge de l'exécution, selon la procédure de saisine en urgence. Ce dernier est alors tenu de statuer dans un délai de quinze jours. Contrairement aux dispositions relatives à la flagrance sociale, le fait d'ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires en cas de non-respect des conditions de leur mise en oeuvre, ou sur le fondement de preuves de garanties de paiement, relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas acquise de plein droit.
Nonobstant la voie de recours ouverte devant le juge de l'exécution, il est prévu que la personne contrôlée puisse, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire devenu définitif, solliciter la mainlevée des mesures conservatoires en apportant au directeur la preuve de garanties suffisantes de paiement correspondant au montant de la créance sociale.130(*)
Au 30 septembre 2025, l'Urssaf avait initié 741 mesures de saisie conservatoire, pour un montant total de 315 millions d'euros. 131(*)
Le spectre de la procédure de saisie pour
travail dissimulé
est beaucoup plus restreint que celui de
l'ancienne procédure
de flagrance sociale pour travail
illégal
La procédure de flagrance sociale abrogée au 1er janvier 2017 s'appliquait à la suite de contrôles relevant des infractions de travail illégal, qui recoupent, selon l'énumération figurant à l'article L. 8211-1 du code du travail, les infractions de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, emploi d'étranger non autorisé à travailler, cumuls irréguliers d'emploi et de fraude ou fausse déclaration.
A l'inverse, la procédure de saisie prévue à l'article L. 133-1 est circonscrite à la seule infraction de travail dissimulé.
2° Les organismes de protection sociale peuvent mettre en oeuvre des procédures de recouvrement forcé sur le fondement de contraintes
Le second moyen dont disposent les organismes de recouvrement pour se voir rembourser les créances de cotisations dont ils sont détenteurs est le recours au mécanisme de la contrainte, qui est largement usité. Il y est en effet recouru pour recouvrir le paiement de cotisations en souffrance, notamment parmi les professions libérales et indépendantes qui sont tenues de s'en acquitter à échéance régulière sur le fondement d'un système déclaratif, mais également pour récupérer les créances nées de contrôle ayant donné lieu à redressement de cotisations, en ce compris les contrôles constatant des faits de travail dissimulé.
a) Devenue exécutoire, la contrainte permet l'exercice de mesures de saisies sur les biens du débiteur pour recouvrir les créances sociales
Les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent décerner des contraintes, qui sont des titres exécutoires 132(*) au sens de décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de protection sociale, comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans un délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent, tous les effets d'un jugement.
Un titre exécutoire permet de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée pour obtenir l'attribution directe d'une somme d'argent en remboursement de la créance sociale. Parmi les mesures d'exécution forcée auxquelles les organismes de recouvrement ont fréquemment recours, figurent la mesure dite de saisies-attribution, qui permet la saisie d'argent sur les comptes bancaires du débiteur, ainsi que la mesure d'opposition à tiers détenteur, qui permet de saisir auprès d'un tiers dépositaire, détenteur ou redevable de sommes appartenant à un débiteur, de saisir le montant d'une créance sociale. À défaut de recours formé par le débiteur selon les voies légales, ces mesures ne sont pas conservatoires comme dans le cas du procès-verbal de flagrance, mais bien effectives et entraînent attribution définitive des sommes réclamées.
L'opposition à la contrainte n'a pas pour effet de la mettre à néant, mais de suspendre son caractère exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit validée ou infirmée par jugement. Le greffe du tribunal informe l'organisme de recouvrement de la réception de l'opposition à la contrainte, afin de l'avertir de la suspension du caractère exécutoire avant même que l'affaire ne soit convoquée à l'audience.
La charge de la preuve de la contestation de la contrainte repose sur le cotisant ayant formé opposition et non sur l'organisme de protection sociale émetteur de la contrainte. Dans les faits, les juridictions judiciaires organisent souvent le renvoi de l'affaire à brève échéance afin de permettre au cotisant de bonne foi de rapporter à l'organisme de protection sociale la preuve des revenus par lui perçus (la procédure étant déclarative), auquel cas l'organisme peut procéder au recalcul des sommes appelées au titre des cotisations et solliciter du tribunal qu'il valide une créance différente de celle initialement appelée.
b) Le contenu de la contrainte et l'information délivrée au cotisant sur le montant de la créance réclamée sont strictement encadrés par la jurisprudence de la Cour de cassation
La délivrance par un organisme de protection sociale d'une contrainte est strictement encadrée par le code de sécurité sociale. Elle doit nécessairement être précédée d'une mise en demeure préalable ou d'un avertissement resté sans effet un mois suivant sa notification. 134(*)
La contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature, et de l'étendue de son obligation. Cela se justifie au regard de l'atteinte portée à ses biens dans l'hypothèse où la contrainte n'est pas contestée et devient exécutoire, mais également par le fait que la charge de la preuve du caractère mal-fondé de la contrainte incombe au cotisant. La Cour de cassation a précisé que la connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de l'obligation devait se matérialiser par l'obligation, pour la contrainte, de détailler la nature des cotisations et contributions appelées (soit l'échéance à laquelle elles correspondent, leur nature et leur montant), dans des termes strictement identiques à ceux de la mise en demeure qui l'a précédée.
L'inobservation de ces prescriptions est sanctionnée par l'infirmation de la contrainte par le tribunal judiciaire. L'organisme de recouvrement doit alors délivrer une autre contrainte conforme aux mises en demeure qui l'ont précédée, ou reprendre la procédure de recouvrement dès son commencement en délivrant de nouvelles mises en demeure.
B. Le présent article réintroduit une procédure de flagrance sociale et rend les contraintes appelant des créances liées au travail dissimulé exécutoires de plein droit, y compris en cas d'opposition formée par le débiteur.
L'article 21 du présent projet de loi réécrit l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale en supprimant la référence au document émis à l'issue du contrôle ayant constaté des faits de travail dissimulé et renseignant périmètre de la créance sociale à recouvrir. Ce document informait par ailleurs l'entreprise contrôlée de la possibilité, pour le directeur de l'organisme de recouvrer, de diligenter une procédure de saisies conservatoires pour geler à titre temporaire les actifs de l'entreprise et les biens du débiteur si la preuve de garanties de paiement correspondant au montant de la créance sociale n'était pas rapportée.
Ce document serait désormais remplacé par un procès-verbal de flagrance sociale, dressé par l'agent chargé du contrôle et signé par lui, sur le modèle de celui préexistant et supprimé en 2017. Il serait notifié au cotisant, l'organisme de recouvrement en conservant l'original.
La différence avec la procédure de flagrance sociale abrogée au 1er janvier 2017 consiste en le fait que le directeur de l'organisme de recouvrement pourrait désormais procéder à des mesures de saisie conservatoire sans l'autorisation du juge de l'exécution, sur le seul fondement du procès-verbal de flagrance régulièrement notifié.
Cette réécriture vise à créer un effet de surprise pour effectuer des saisies conservatoires, dès l'issue du contrôlée, sur des biens d'entreprises éphémères ou de personnes qui auraient procédé à la liquidation de leur patrimoine saisissable dans le délai entre la réception du document et la décision du directeur d'effectuer des mesures de saisies.
Selon les chiffres communiqués par l'Urssaf caisse nationale aux Rapporteurs de la commission des affaires sociales, en 22 % des entreprises redressées en 2022 et 2023 et ayant donné lieu à 59% des montants redressés pour ces deux années, ont été radiées dans les douze mois suivant le contrôle opéré.
Le recours au procès-verbal de saisie supprime la phase de contradictoire qui existe actuellement au terme de laquelle la personne contrôlée est tenue d'apporter des garanties de paiement de la créance sociale avant que toute décision de saisir ses biens ne soit effectivement prise.
Si la notification du procès-verbal de flagrance sociale ouvre droit, pour le directeur, à la possibilité d'effectuer des saisies conservatoires sur son fondement, en revanche, elle n'ouvre pas droit, pour la personne contrôlée, à un recours devant le juge judiciaire, contrairement aux dispositions de l'article L. 201B du livre des procédures fiscales.
Toutefois, la rédaction proposée conserve les alinéas prévoyant que la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires en apportant au directeur la preuve de garanties suffisantes de paiement correspondant au montant de la créance sociale, ainsi que le recours devant le juge de l'exécution contre la décision du directeur d'ordonner des mesures de saisie conservatoire.
Dans son avis du 11 septembre 2025, le Conseil d'État estimait que cette mesure portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété au motif que les conditions dans lesquelles un agent de contrôle dresse un procès-verbal de flagrance n'étaient pas assez encadrées. Il a proposé de conditionner le recours à un procès-verbal de flagrance sociale au constat de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, comme cela est prévu dans la procédure dite de flagrance fiscale.135(*)
Le texte a été modifié à la réception de l'avis du Conseil d'État pour prendre en compte cette recommandation, qui figure dans la version de l'article déposée au Sénat.
La suppression de la précédente procédure fondée sur la délivrance d'un document, et qui s'appliquait en l'absence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués, interroge toutefois le champ d'application réel de la procédure de flagrance sociale, qui apparaît plus restreint eu égard à cette condition explicite de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Il peut alors être envisagé qu'en l'absence de telles circonstances, il soit recouru à des contraintes pour récupérer les sommes appelées au titre de la créance de cotisations pour travail dissimulé.
Cette hypothèse est renforcée par le fait que la seconde mesure portée par le présent article confère aux contraintes décernées pour recouvrir des créances sociales issues de contrôles pour travail dissimulé un caractère exécutoire nonobstant le maintien du mécanisme d'opposition à contrainte prévu devant le pôle social du tribunal judiciaire statuant en sa formation collégiale.
Un recours visant à suspendre le caractère exécutoire d'une telle contrainte serait désormais possible devant le président du pôle social du tribunal judiciaire statuant seul, « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Aux termes de son avis du 11 septembre 2025, le Conseil d'État considère que la suppression de l'effet suspensif de l'opposition à une contrainte devenue immédiatement exécutoire ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel dans la mesure où un recours reste possible devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il sollicite toutefois de prévoir qu'un décret en Conseil d'État précise la procédure applicable.
Il convient enfin de souligner que l'exécution provisoire de la contrainte est poursuivie au risque du créancier. Si l'organisme de recouvrement décide de faire exécuter une contrainte malgré une opposition formée par le débiteur devant le tribunal, et que la juridiction décide in fine d'annuler la contrainte, alors l'organisme devra restituer les sommes prélevées au cotisant. 136(*)
II - La position de la commission
La commission des affaires sociales se félicite du renforcement des mécanismes de recouvrement dont disposent les organismes de protection sociale pour lutter contre la fraude perpétrée au titre du travail dissimulé. Elle partage l'appréciation de la ministre des comptes publics Amélie de Montchalin, qui a qualifié ces dispositions de « précieuses », en ce qu'elles permettent d'agir « immédiatement en cas de détection d'une fraude »137(*).
Ces dispositions permettront de lutter plus efficacement contre les entreprises éphémères, qui vidaient leurs comptes bancaires pour transférer leur argent dans des pays avec lesquels la coopération pénale s'avère complexe, dès qu'elles étaient informées de la possibilité offerte au directeur des organismes de sécurité sociale d'effectuer des mesures conservatoires.
Afin de renforcer l'efficacité de ce dispositif, la commission a adopté un amendement COM-141 des rapporteurs visant à étendre le procès-verbal de flagrance sociale aux infractions de travail illégal, et non plus à la seule infraction de travail dissimulé, comme le prévoyait le dispositif de flagrance sociale abrogé au 1er janvier 2017. Elle a également adopté un amendement COM-140 réécrivant le III de l'article L. 133-1 afin de supprimer la référence à la décision du directeur de l'organisme de procéder à des mesures conservatoires eu égard au fait que ces dernières sont désormais fondées sur le procès-verbal de flagrance sociale.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 22
Renforcer les obligations et la solidarité
financière des maîtres d'ouvrage pour lutter contre le travail
dissimulé
Cet article propose de réviser les obligations de vigilance et la solidarité financière des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre138(*) au regard du respect par les sous-traitants de l'interdiction du travail dissimulé.
La commission a adopté cet article modifié par deux amendements visant, en premier, à préciser les circonstances dans lesquelles le maître d'ouvrage procède à la vérification de l'authenticité des documents reçus dans le cadre de son devoir de vigilance et également à étoffer davantage le devoir de vigilance imposé au maître d'ouvrage.
I - Le dispositif proposé
A. Le législateur a progressivement enrichi l'arsenal de lutte contre le travail dissimulé dans le cas des sous-traitances
Infraction la plus courante parmi les infractions constitutives du travail illégal139(*), le travail dissimulé recouvre :
- la dissimulation d'activité définie à l'article L. 8221-3 du code du travail comme l'exercice à but lucratif d'une activité ou l'accomplissement d'actes de commerce en se soustrayant intentionnellement à certaines obligations comme l'immatriculation au registre national des entreprises en ou au registre du commerce et des sociétés, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ou en se plaçant frauduleusement dans le champ de la prestation de services internationales (situation de « faux détachement ») ;
- la dissimulation d'emploi, définie à l'article L. 8221-5 du même code comme le fait de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent, de falsifier sur ces documents le nombre d'heures de travail ou, enfin, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ;
1. Les réponses civiles et pénales au travail dissimulé commis directement par l'entrepreneur
Au plan civil, la méconnaissance, même partielle, des interdictions de travail dissimulé entraîne un redressement de cotisations et contributions sociales assorti de majoration.
En application combinée des articles L. 243-7 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général - les Urssaf - réalisent un redressement des cotisations et contributions sociales sur le fondement :
- des procès-verbaux constatant l'infraction que leurs agents assermentés et agréés ont dressés ;
- des procès-verbaux communiqués par les autres agents ayant qualité pour constater les infractions au travail illégal.
Les agents de contrôle compétents pour constater des infractions au travail illégal
L'article L. 8271-1-2 du code du travail liste les agents compétents, à savoir :
1° les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
2° les officiers et agents de police judiciaire ;
3° les agents des impôts et des douanes ;
4° les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° les agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ;
9° les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés.
L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales est majoré de 25 %. Ce taux peut être réduit de 10 points en cas de paiement dans un délai de trente jours ou de présentation, dans le même délai, d'un plan d'échelonnement du paiement, accepté par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Sur le plan pénal, la méconnaissance de l'interdiction de travail dissimulé est punie, à l'article L. 8224-1 du code du travail, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros. Ces peines sont également alourdies en cas de circonstances aggravantes prévues à l'article L. 8224-2.
2. Depuis 1991, la prise en compte des chaines de sous-traitance pour lutter contre le travail dissimulé
Depuis la loi du 31 décembre 1991140(*), le code du travail interdit « d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce » un travail dissimulé141(*). Par cette notion de « personne interposée », le législateur a pris ainsi en compte les cas de sous-traitance et a permis de réprimer pénalement les cas de recours intentionnel à de la sous-traitance faisant appel à du travail dissimulé.
Toutefois, le législateur a également poursuivi une voie plus efficace puisque, sur le plan civil, la même loi du 31 décembre 1991 a prévu une mise en cause des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé, pouvant être actionnée de manière autonome à la marche du procès pénal.
Le mécanisme repose, d'une part, sur une obligation de vigilance dans le choix du contractant, qui s'applique à tous les donneurs d'ordre dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 5 000 euros142(*).
L'article L. 8222-1 du code du travail oblige en effet tout signataire d'un contrat - exécution d'un travail, fourniture d'une prestation de services, accomplissement d'un acte de commerce - à vérifier, pendant toute la durée de la prestation, que son cocontractant ne commet pas de délit de travail dissimulé. Ce devoir de vigilance est toutefois allégé pour les particuliers.
L'article L. 8222-4 du code du travail adapte également la nature des documents à vérifier dans le cas où le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger.
Le Conseil d'État143(*) a pu préciser que le donneur d'ordre est considéré comme avoir rempli son devoir de vigilance, y compris dans sa dimension de vérification de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, lorsqu'il s'est fait remettre les documents prévus par décret. Ce devoir de vigilance ne serait en revanche pas satisfait s'il existait « une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation [de vigilance délivrée par l'Urssaf], l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant ».
Les obligations incombant au titre du devoir de vigilance
En vertu de l'article D. 8222-5 du code du travail, le contractant est considéré comme ayant rempli son devoir de vigilance s'il se fait remettre par son cocontractant établi en France, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin du contrat :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois dont le contractant s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
2° Un document parmi les suivants :
- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat (...)
Dans le cas d'un cocontractant établi à l'étranger, en vertu de l'article D. 8222-7 du code du travail, les documents devant être remis lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin du contrat sont les suivants :
1° Un document mentionnant son numéro individuel d'identification fiscal ou un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
2° Un document attestant de la régularité de la situation sociale (...)
3° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
D'autre part, l'article L. 8222-2 du code du travail prévoit un mécanisme de solidarité financière dès lors que le donneur d'ordre ne s'est pas acquitté de son devoir de vigilance. Ce dernier est alors tenu solidairement, avec l'auteur de l'infraction au travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes, cotisations, majorations, pénalités, remboursements d'aides publiques, rémunérations ou charges. Les sommes exigibles sont toutefois calculées à due proportion de la valeur du marché en cause.
Par ailleurs, l'article L. 8222-5 institue un devoir de diligence du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre en cas de signalement émanant d'un agent de contrôle, d'un syndicat, d'une association professionnelle ou d'une institution représentative du personnel quant à une irrégularité d'un cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire au regard des dispositions sur le travail dissimulé. Dans cette situation, le signataire est tenu d'enjoindre sans délai à la personne en irrégularité de faire cesser cette situation sous risque d'engager, là encore, sa responsabilité financière de maître d'ouvrage ou de donneur d'ordre.
Enfin, l'article L. 8222-6 prévoit un devoir de diligence spécifique à l'égard de toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise.
B. Toutefois, les sous-traitances en cascade mettent à mal le mécanisme de solidarité financière des maîtres d'ouvrage
Le Gouvernement rappelle que « la solidarité financière constitue un levier important d'optimisation du recouvrement des sommes dues en cas de travail dissimulé »144(*), considérant que les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre sont plus susceptibles d'être pérennes et solvables. Les Urssaf ont donc eu tendance à recourir de manière croissante à ce mécanisme.
Mobilisation de la solidarité financière des dettes sociales pour le régime général
Source : Étude d'impact, p. 239
Toutefois, le développement de chaines de sous-traitances de plus en en plus sophistiquées met à mal les outils pensés par le législateur. En effet, le devoir de vigilance n'est opérant qu'à l'égard du cocontractant direct du donneur d'ordre. En cas de sous-traitances dites « en cascade », le maître d'ouvrage, généralement une entreprise ou une collectivité établie en France, ne peut donc être conjointement responsable du paiement de la dette sociale pour les infractions aux travails dissimulés commises par les sous-traitants de rang n-2. Cette irresponsabilité a été confirmée récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025145(*), qui a jugé expressément que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant.
Si le devoir de diligence du maître d'ouvrage s'applique, quant à lui, à l'égard de tous les sous-traitants, la solidarité financière de ce dernier n'est pas susceptible d'être actionnée fréquemment dès lors qu'une simple lettre recommandée avec avis de réception satisfait à l'obligation d'injonction146(*).
Enfin, le volet pénal n'apporte pas non plus de réponse satisfaisante du fait de l'engorgement des parquets, de la lourdeur des procédures et de la difficulté de prouver l'intentionnalité du maître d'ouvrage initial.
Entendu le 26 mars 2025 par la commission, le général José-Manuel Montull, commandant de l'Office central de lutte contre le travail illégal, résume ainsi les difficultés juridiques : « nous devons également nous concentrer sur la dissuasion des maîtres d'ouvrage, notamment concernant la sous-traitance en cascade. Actuellement, des entreprises connues sous-traitent à un premier sous-traitant, qui lui-même sous-traite à son tour, créant ainsi une chaîne complexe. L'obligation de vigilance ne s'applique qu'au niveau n-1, ce qui permet aux entreprises d'organiser leur irresponsabilité. En bout de chaîne, on peut trouver des travailleurs non déclarés, voire exploités »147(*).
C. Le dispositif proposé : répondre à ces difficultés en responsabilisant davantage les maîtres d'ouvrage
? Le 1° du I du présent article tend à créer un nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail qui vise à imposer au maître de l'ouvrage un nouveau devoir de vigilance à l'égard de l'ensemble des sous-traitants intervenant au sein du marché et dont il a nécessairement connaissance puisqu'il doit déjà, en vertu du droit existant, les accepter (voir encadré infra). Ainsi, le maître d'ouvrage devrait vérifier périodiquement si chaque sous-traitant s'acquitte des formalités évitant la dissimulation d'activité ou d'emploi.
Pour s'acquitter de ce devoir de vigilance, le maître de l'ouvrage doit avoir reçu « les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et [s'assurer], le cas échéant de leur authenticité ». Selon la direction générale du travail, la liste des documents exigés sera identique à celle fixée pour l'application des obligations de vigilance s'imposant à tout contractant.
Enfin, les particuliers qui contracteraient pour leur usage personnel ou celui d'un proche seraient dispensé de ce nouveau régime.
Le 2° du I modifie l'article L. 8222-2 du code du travail afin de prévoir l'engagement de la solidarité financière du maître d'ouvrage en cas d'infraction au travail dissimulé d'un des sous-traitants de la chaine.
Agrément des sous-traitants par le maître d'ouvrage
S'agissant des marchés privés, l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 oblige l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat en recourant à la sous-traitance à « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) ». En application de l'article L. 8271-1-1 du code du travail, ces formalités doivent être accomplies sous peine d'une amende de 7 500 euros.
La même règle s'impose pour les marchés publics en vertu de l'article L. 2193-4 du code de la commande publique qui dispose que « l'opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ».
? Le II du présent article modifie l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale afin que l'auteur de l'infraction bénéficie du droit de la réduction de dix points du redressement majoré de cotisations et contributions sociales, dès lors que celui-ci procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard dans le délai de trente jours qui lui imparti.
En outre, il est proposé de dispenser les maîtres d'ouvrage ou les donneurs d'ordre de tout paiement de la majoration de cotisation sociale en cas de paiement des sommes dues dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure ou de conclusion d'un plan d'échelonnement dans le même délai. Cette limitation de la solidarité financière vis-à-vis d'un sous-traitant auteur de l'infraction au travail dissimulé viserait à « encourager davantage le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage au paiement rapide des sommes dues (...) ».
? Enfin, le III propose une entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2026.
II - La position de la commission : un article qui responsabilise les maîtres d'ouvrage
Les rapporteurs ne peuvent que se réjouir de dispositions visant à lutter davantage contre le travail dissimulé, délit causant un manque à gagner estimé entre 6,2 et 7,8 milliards d'euros148(*) de cotisations et contributions éludées sur le champ social.
Les rapporteurs partagent pleinement la philosophie de cet article qui permettra de responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage et de renforcer les moyens de recouvrement des dettes sociales en cas de travail dissimulé. Les dispositions permettront en outre de ne pas accentuer les obligations qui pèsent sur les sous-traitants eux-mêmes, dont une part importante peut être des TPE ou PME.
La commission a adopté un amendement n° COM-142 des rapporteurs précisant les circonstances dans lesquelles le maître d'ouvrage procède à la vérification de l'authenticité des documents reçus dans le cadre de son devoir de vigilance. En lieu et place des termes « le cas échéant », laissant place à l'interprétation, la commission a considéré que la vérification de la validité des documents remis était exigible du maître d'ouvrage « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs ». Celui-ci devra ainsi procéder au contrôle des documents lorsque le nombre de salariés déclarés est manifestement incompatibles avec l'ampleur des missions remplies par le sous-traitant.
La commission a également souhaité, sur proposition de ses rapporteurs, d'aligner le nouveau devoir de vigilance incombant aux maîtres d'ouvrage sur celui existant des donneurs d'ordre afin de le durcir. Un amendement n° COM-143 a ainsi prévu que le maître d'ouvrage encourrait l'annulation des exonérations des cotisations ou contributions dont il a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés dans le cas où il manquait à ses obligations et que l'un des sous-traitants était condamné pour du travail dissimulé149(*).
De même, cet amendement prévoit que, pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant que le maître d'ouvrage a bien accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants150(*).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 22 bis
(nouveau)
Renforcer le dispositif de liste noire pour lutter contre le
travail illégal
Cet article, introduit par la commission des affaires sociales, durcit et harmonise le cadre régissant la peine complémentaire de diffusion de la condamnation pour travail illégal.
A. Les dispositions actuelles relative à la peine complémentaire de diffusion de diffusion
Outre les sanctions civiles encourues et décrites plus en amont151(*), la méconnaissance de l'interdiction de travail dissimulé est réprimée, en application de l'article L. 8224-1 du code du travail, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros. Aux termes de l'article L. 8224-2 du même code, ces peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes. Ainsi :
- lorsque l'infraction est commise à l'égard d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la peine est portée à un emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros.
- lorsque l'infraction est commise en bande organisée, le prévenu encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
En vertu des articles L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail, le juge peut en outre prononcer des peines complémentaires, par exemple :
- la dissolution de la personne morale ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements concernés ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- la confiscation des biens ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel152(*), cette peine complémentaire de diffusion, qui prend la forme d'une inscription pour une durée maximale d'un an sur la liste noire du ministère du travail, est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du juge, dans les cas d'infraction au travail dissimulé avec circonstances aggravantes.
Le dispositif de « liste noire »
Instaurée par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, le dispositif dit de « liste noire » prend la forme d'une peine complémentaire de diffusion sur un site Internet géré par le ministère du travail - à l'adresse https://liste-noire.travail-emploi.gouv.fr/ - de certaines condamnations pénales prononcées pour travail illégal. Le code du travail distingue ainsi actuellement trois régimes de peine complémentaire de diffusion sur le site du ministère du travail selon que l'infraction concerne :
- le travail dissimulé avec circonstances aggravantes (art. L. 8824-2) : le juge doit prononcer la peine complémentaire de diffusion, sauf décision spécialement motivée. Il n'est pas exigé qu'une amende soit prononcée à titre principal. La durée maximale de diffusion est d'un an ;
- le travail dissimulé sans circonstances aggravantes (L. 8224-1) : la peine est facultative, et peut être ordonnée par le juge même en l'absence d'une amende principale. La durée maximale de diffusion est de deux mois ;
- les autres formes de travail illégal (marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, emploi d'étranger sans titre) : la peine est facultative, mais ne peut être prononcée que si une amende est également prononcée à titre principal. La durée maximale de diffusion est toutefois de deux ans.
Toutefois, ainsi qu'il était noté dans le plan national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) 2023-2027, « cette accumulation rend peu lisibles les conditions de mise en oeuvre de la peine. Il est en effet constaté une méconnaissance du dispositif par les magistrats, ainsi que par les greffes. Le volume des demandes de publication reçues est ainsi très faible en comparaison au nombre de condamnations pour travail illégal. Des décisions s'avèrent également non publiables notamment en l'absence ou en cas d'erreur sur la durée de la condamnation, d'erreur dans la mention du site Internet ou de condamnation pour des faits autres que travail illégal ».
Le PNLTI proposait donc d'harmoniser les trois régimes en l'alignant sur celui du travail dissimulé avec circonstances aggravantes soit une durée maximale d'un an et la suppression de la condition du prononcé d'une amende à titre principal.
B. Le dispositif proposé
À l'initiative des rapporteurs (amendement COM-144), la commission a souhaité simplifier les dispositions régissant le dispositif de liste noire afin de ne pas décourager l'application de la peine complémentaire par les juges lorsque celle-ci est pertinente. Ainsi que le notait le général José-Manuel Montull, entendu en audition devant la commission153(*) :
La peine complémentaire de publicité est un outil extrêmement intéressant, mais son application a été tellement restreinte qu'elle est devenue presque inopérante. Par curiosité, j'ai consulté hier le site Internet qui répertorie les personnes morales et physiques condamnées définitivement pour travail dissimulé. On y trouve seulement 82 personnes physiques et 32 personnes morales pour l'année dernière, alors que plus de 13 400 personnes ont été mises en cause pour du travail illégal. Ces chiffres révèlent la nécessité d'améliorer la publicité de ces condamnations.
La commission a également souhaité aligner la durée maximale d'application de cette peine pour le travail dissimulé sur la durée prévue pour les autres infractions du travail illégal soit deux ans.
? A cette fin, le 1° et le 2° du présent article modifient les articles L. 8224-3154(*) et L. 8224-5155(*) du code du travail afin de porter à deux ans la durée maximale de la condamnation à la diffusion en cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes.
? Le a du 3° supprime la condition du prononcé d'une amende à titre principal pour les cas de marchandage156(*), prêt illicite de main-d'oeuvre157(*) et emploi d'étranger sans titre158(*)
? Le b du même 3°, de nature rédactionnelle, vise à supprimer un anglicisme du code du travail. En outre, il ne semble pas nécessaire de prévoir au niveau de la loi que le site internet diffusant la liste noire doit être spécifique.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-144.
Article
23
Délais de reprise de l'administration fiscale
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
24
Précision du délai de reprise de l'administration en
matière de financement de la formation professionnelle
Cet article propose d'inscrire au sein du code du travail un délai de reprise de l'administration de trois ans pour la récupération des fonds publics perçus par les organismes de formation, et de le porter à dix ans dans le cas d'une manoeuvre frauduleuse.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement d'ordre légistique.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit de reprise en matière de formation professionnelle : une analogie implicite fondée sur le droit fiscal
Le droit de reprise désigne la possibilité dont l'administration fiscale dispose de rectifier « les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition »159(*) constatées chez un contribuable à l'issue d'une enquête. Afin de concilier le principe de nécessité de l'impôt avec celui de protection des situations acquises, l'administration fiscale ne dispose de cet avantage que dans un délai déterminé par la loi.
Le délai de prescription du droit de reprise est, en principe, fixé à six années sauf si la loi prévoit un délai plus court ou plus long160(*). C'est notamment le cas pour en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés161(*) ainsi que pour les taxes sur le chiffre d'affaires162(*), pour lesquels le droit de reprise jusqu'à la fin de la troisième année. Cependant, le droit fiscal prévoit un allongement des délais pour l'ensemble des taxes et impositions en cas :
- d'agissements frauduleux163(*) ;
- de recours à l'assistance administrative internationale164(*) ;
- de dépôt de plainte pour fraude fiscale165(*) ;
- d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse166(*).
Dans le cas spécifique de manoeuvres frauduleuses constatées par l'administration fiscale, le délai de reprise est porté à dix ans pour l'impôt sur le revenu et sur les sociétés167(*) (exercice d'une activité occulte, défaillance déclarative à l'égard des actifs détenus à l'étranger, de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale) ou pour la taxe sur le chiffre d'affaires168(*) (exercice d'une activité occulte ou mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale).
· Contrairement à la matière fiscale, le code du travail ne précise pas le délai de reprise en matière de contrôle de la formation professionnelle. Ce délai correspond à la durée durant laquelle les services régionaux de contrôle (SRC) peuvent constater une dette envers l'administration. Cette dette correspond aux demandes de remboursement, le cas échéant assorties de sanctions administratives, des financeurs des sommes indûment perçues et à défaut ou en cas de fraude, du versement du même montant au Trésor public.
Cependant, en l'absence de disposition légale précisant ce délai de reprise, le délai a jusqu'ici été fixé à trois ans par une analogie constructive, considérant :
- d'une part que, la déclaration fiscale n° 2483169(*), qui concernait le niveau de participation des entreprises de plus de dix salariés versée à l'organisation collecteur paritaire de la branche faisait l'objet d'un délai de reprise de trois ans ;
- d'autre part que l'article L. 6362-12 du code du travail, concernant le recouvrement des versements exigibles au titre du contrôle des dépenses et activités de formation, renvoyait aux dispositions du livre des procédures fiscales relatives au recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires, dont le délai est de trois ans.
B. Le dispositif proposé : une clarification du délai de reprise à la suite de l'évolution du financement de la formation professionnelle
L'analogie retenue par l'administration a été mise à mal par la réforme du financement de la formation professionnelle, qui a conduit à la suppression de la déclaration administrative n° 2483 précitée170(*), et par le transfert depuis le 1er janvier 2022, de la collecte des contributions légales de la formation professionnelle et de l'apprentissage au réseau des Urssaf171(*).
Dans ce contexte, le 1° du présent article propose la création d'un nouvel article L. 6362-8-1 au sein du code du travail afin de préciser que le délai de reprise de l'administration à l'égard des fonds versés en vue du financement des actions de formation professionnelle est fixé à trois années suivant la clôture de l'exercice du versement dudit fond. Le même article nouvellement créé prolonge jusqu'à dix années ce délai de reprise dans le cas où :
- l'employeur ou l'organisme n'a pas respecté au moins deux obligations qui lui incombent au titre de la loi172(*) ;
- l'employeur ou l'organisme a commis une manoeuvre frauduleuse liée à l'usage d'un faux document pour obtenir un financement173(*) ;
- des manquements aux obligations prévues par la sixième partie du code du travail sont révélés par une procédure judiciaire, administrative ou contentieuse.
Le 2° du présent article effectue une coordination à l'article L. 6362-9 du code du travail concernant l'interruption du délai de prescription à l'encontre du Trésor public.
II - La position de la commission
Cet article, procédant à une simple clarification du droit existant, sans modifier les délais applicables, est apparue comme opportune aux rapporteurs, en ce qu'elle procède de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de loi. Ils ont cependant proposé un amendement (n° COM-145) adopté par la commission, afin de procéder à une coordination légistique.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 24 bis
(nouveau)
Renforcement du recouvrement des indus frauduleux de RSA, et des
conditions de cumul avec des revenus d'auto-entrepreneur
Cet article, introduit par la commission, vise à préciser la non-recevabilité des dettes liées au RSA dans les procédures de rétablissement personnel, et à supprimer la dérogation aux obligations de recherche d'un emploi pour les bénéficiaires du RSA cumulant de manière pérenne ce dernier avec des revenus d'auto-entrepreneur.
I- Le dispositif proposé
A. Le droit en vigueur
· Le Conseil d'État a précisé que la recevabilité d'un indu RSA. Ainsi, quelle que soit son origine, même frauduleuse, ces dettes peuvent rentrer dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel174(*). Cette décision a conduit à ce que les dettes liées à un indu de RSA puissent faire l'objet d'un effacement de dette pour surendettement, contrairement aux dettes concernant les organismes de protection sociale.
Lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi de lutte contre les fraudes aux aides publiques175(*), un amendement de la majorité sénatoriale a été adopté176(*) afin d'aligner en la matière les dettes détenues par les départements sur le régime des organismes de sécurité sociale. Cependant cet article 3 a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif177(*).
· Par ailleurs, l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles précise les obligations en matière de recherche ou de création d'emploi. Le bénéficiaire du RSA est ainsi tenu de telle recherche sauf à ce qu'il tire de l'exercice d'une activité professionnelle des revenus supérieurs à une limite fixée par décret, quelle qu'en soit la nature.
B. Le droit proposé
Cet amendent propose de calquer le régime de recevabilité des indus du RSA sur celui des autres dettes vis-à-vis d'organismes de sécurité sociale, et de supprimer la dérogation à la recherche d'un emploi pour les bénéficiaires du RSA ayant depuis deux ans cumulé son bénéfice avec des revenus d'activité en tant qu'auto-entrepreneur.
II - La position de la commission
Les évolutions proposées par cet amendement concernant le RSA permettent, d'une part de répondre à une préoccupation des départements depuis la censure de la disposition précitée par le Conseil constitutionnel, et d'autre part de limiter les phénomènes de trappe à activité, où les bénéficiaires concernés peuvent être tentés de maintenir durablement une activité limitée d'auto-entrepreneur pour bénéficier du RSA.
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-146.
Article 25
Pouvoir de contrainte de la Caisse des dépôts
et consignations
Cet article propose d'octroyer à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir de contrainte sur les titulaires d'un compte personnel de formation (CPF) en cas de manoeuvres frauduleuses et de mobilisation indue des fonds du CPF.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement visant à supprimer l'effet suspensif des contraintes délivrées par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre des organismes fraudeurs
I - Le dispositif proposé
A. Un arsenal juridique complété par les lois du 19 décembre 2022 et du 30 juin 2025
La loi du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires178(*) a renforcé les pouvoir de recouvrement des indus à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa mission de gestion du compte personnel de formation pour le compte de l'État définie au chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail.
Aux fins de récupérer des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations à des organismes de formation, l'article L. 6323-44 du code du travail prévoit que le directeur général de la Caisse dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition de l'organisme devant le juge, comporte tous les effets d'un jugement.
En outre, lorsqu'il est constaté une mobilisation indue des fonds par le titulaire du CPF ou une utilisation en violation de la règlementation, l'article L. 6323-45 du même code donne le pouvoir à la Caisse de procéder au recouvrement par retenue des sommes sur les droits inscrits ou sur les droits futurs du titulaire.
Il convient enfin de noter que la loi du 30 juin 2025179(*) a donné à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de suspendre, pendant trois mois et sur signalement d'une administration ou des services judiciaires, les paiements à destination d'un organisme de formation à l'égard duquel des soupçons de fraude sont caractérisés180(*).
B. Le droit proposé : conférer un nouveau pouvoir de contrainte à la Caisse des dépôts et consignations
Le présent article propos de créer un nouvel article L. 6323-45-1 au sein du code de travail afin d'octroyer à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de délivrer une contrainte en cas de manoeuvres frauduleuses et pour le remboursement de sommes indument mobilisées par le titulaire ou mobilisés en violation de la règlementation.
La contrainte, en tant que titre exécutoire, permettrait ainsi de recouvrer la créance - le cas échéant, par saisie sur un compte bancaire - dès lors que le débiteur n'y a pas formé opposition devant la juridiction compétente181(*).
L'article L. 5426-8-2 du code du travail donne déjà une semblable prérogative au directeur général de France Travail pour le recouvrement des allocations, aides et prestations indûment versées.
II - La position de la commission : un renforcement bienvenu des pouvoirs de la Caisse des dépôts et consignations
Les rapporteurs prennent acte de la poursuite de la lutte contre la fraude au CPF, utilement renforcée par la loi de 2022. Selon l'étude d'impact, 40 plaintes ont été déposées en 2024 concernant des organismes de formation frauduleux pour un préjudice estimé à près de 100 millions d'euros. La Caisse des dépôts et consignations a traité, au cours de la même année, 1 132 réquisitions judiciaires relatives au CPF, soit une hausse de 40 % des volumes par rapport à 2023.
Les rapporteurs notent que les dispositions proposées éviteraient à la Caisse des dépôts et consignations de recourir à des actions en justice pour obtenir le remboursement forcé des sommes. La mesure est donc source d'efficacité et d'économies de moyens pour la Caisse.
La commission a adopté un amendement n° COM-147 des rapporteurs visant à supprimer l'effet suspensif des contraintes délivrées par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre des organismes fraudeurs. En effet, interrogée par les rapporteurs, la Caisse dresse un bilan mitigé du pouvoir de contrainte qui lui est octroyé par la loi du 19 décembre 2022 dans les cas de créances frauduleuses :
« (...) le recouvrement est extrêmement difficile. En effet, les fraudeurs sécurisent leurs gains dès perception et la Caisse des dépôts et consignations - comme d'autres - est confrontée à toutes sortes de manoeuvres faisant échec à ses actions : dissipation immédiate des fonds à l'étranger, sociétés éphémères créées spécifiquement pour la captation rapide de fonds publics, dont les sièges sociaux sont souvent dans des adresses de domiciliation et qui disparaissent ensuite rapidement, etc. Au regard de ce premier retour d'expérience, l'impact du recouvrement forcé est à relativiser en termes de retour sur investissement, car il ne génère in fine que très peu de retour des fonds (...) ».
La suppression de l'effet suspensif devrait donc réduire les délais dans lesquels les sociétés fraudeuses peuvent organiser l'évasion des fonds et leur insolvabilité.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article
26
Autorisation des organismes chargés du recouvrement des
cotisations et contributions sociales à saisir la valeur de rachat d'un
contrat d'assurance-vie dans le cadre de la procédure d'opposition
à tiers détenteur
Cet article propose de permettre à certains organismes de sécurité sociale de saisir la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre d'une procédure d'opposition à tiers détenteur, comme cela existe déjà pour les avis à tiers détenteurs délivrés par l'administration fiscale et les collectivités territoriales.
La commission a adopté cet article sans modification.
I°- Le dispositif proposé
A. Les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale peuvent recouvrer leurs créances sociales sur le fondement de la procédure d'opposition à tiers détenteur, qui ne peut actuellement pas s'appliquer aux contrats d'assurance rachetables
1 - L'opposition à tiers détenteur est une procédure civile d'exécution permettant l'attribution à l'organisme de sécurité sociale, de sommes détenues par un tiers pour le compte d'un débiteur
Comme il a déjà été explicité au commentaire de l'article 21 du présent projet de loi, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales qui détiennent des créances de cotisations arriérées, de majorations de retard et de pénalités, sont habilités à décerner des contraintes, qui sont des titres exécutoires 182(*) au sens de décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En effet, l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition formée par le débiteur devant un tribunal judiciaire dans les quinze jours suivant sa signification par voie de commissaire de justice 184(*) , tous les effets d'un jugement.
Parmi les procédures civiles d'exécution dont disposent les organismes de recouvrement et ceux chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, pour recouvrer, sur le fondement d'une contrainte, les créances de cotisations et prestations dont ils sont détenteurs, figure la procédure d'opposition à tiers détenteur.
Les dispositions de l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, qui régissent la procédure d'opposition à tiers détenteurs, prévoient ainsi que les organismes précités puissent, en y recourant, enjoindre à des tiers « dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser en lui et place celui-ci [...] les fonctions qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.185(*) »
L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Cela signifie qu'une fois notifiée au tiers détenteur par le directeur de l'organisme émetteur, l'opposition affecte les sommes détenues par ce dernier au paiement de la créance sociale à hauteur du montant porté sur la contrainte, et ce même si les créances que le débiteur possède à l'encontre du tiers ne sont pas encore exigibles 186(*).
Dans un délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, le tiers détenteur est tenu de communiquer à l'organisme créancier les renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures lorsqu'elles existent187(*)
Le débiteur, qui est informé de la notification de l'opposition à tiers détenteur concomitamment et par tous moyens 188(*), dispose d'un recours contre la procédure d'opposition à tiers détenteur devant le juge de l'exécution, qu'il peut exercer dans le mois suivant la notification de l'opposition. La contestation diffère le paiement jusqu'à ce que le juge statue sur le recours, soit lorsque la créance fait suite à une situation d'obstacle à contrôle perpétré par le débiteur, soit lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
Enfin, la procédure d'opposition à tiers détenteur ne s'applique pas aux rémunérations, qui peuvent être recouvrées selon la procédure ad hoc de saisie des rémunérations. 189(*)
2 - Contrairement à son pendant fiscal qu'est l'avis à tiers détenteur, l'opposition à tiers détenteur ne peut aujourd'hui s'appliquer aux contrats d'assurance rachetables
Le contrat d'assurance-vie, qui s'entend d'un contrat d'assurance rachetable, repose sur un transfert définitif de la propriété des primes et cotisations qui sont versées par le souscripteur au bénéfice de l'organisme gestionnaire. En contrepartie, l'organisme gestionnaire est tenu de verser la prestation prévue au contrat lors de la réalisation de l'évènement visé par le contrat, qui peut être soit la vie, soit le décès du souscripteur.
Les articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité prévoient que les contrats d'assurance rachetables ne sont pas saisissables par les créanciers du souscripteur. Ces articles disposent ainsi que « le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractants », ces derniers ayant seulement droit au remboursement de primes et de cotisations. En effet, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur du contrat est seulement investi du droit personnel de se faire racheter le contrat, et de désigner ou d'en modifier le bénéficiaire. Il n'est donc pas créancier de l'assureur, de sorte que la Cour de cassation en a déduit qu'aucune saisie ne peut être effectuée sur la valeur de rachat du contrat tant que le contrat n'est pas dénoué ou que la faculté de rachat n'a pas été exercée par le souscripteur.190(*)
La loi n ° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a toutefois admis une exception à ce principe d'insaisissabilité, qui ne s'applique pas aux saisies administratives à tiers détenteurs.
Les saisies administratives à tiers détenteurs
Comme les oppositions à tiers détenteurs, les saisies administratives à tiers détenteurs, plus communément appelées avis à tiers détenteurs, sont des procédés de recouvrement exorbitants de droit commun. Elles permettent aux comptables publics chargés du recouvrement d'obliger, sur simple demande, un tiers à lui verser sur les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur, à l'égard d'un contribuable, les impôts et pénalités dus par celui-ci.
L'article 41 de la loi du 6 décembre 2013 précité a ainsi modifié l'article L. 262 du livre de procédure fiscale pour autoriser les procédures de saisie administratives à tiers détenteurs portant sur des contrats d'assurance rachetables, et a créé un nouvel article L. 263-0 A au même code, prévoyant que « peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement [...] les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.»191(*)
Depuis le 8 décembre 2013, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, les saisies administratives à tiers détenteurs entraînent le rachat forcé de la part d'assurance rachetable du contrat, qui est la seule part pouvant être assimilée à de l'épargne détenue par le souscripteur ou l'adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, et ce y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
Il peut y être recouru pour le recouvrement des créances dont la loi prévoit qu'elles puissent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur que sont les créances de toute nature régies par le code des douanes 192(*), ainsi que pour le recouvrement des titres exécutoires rendus dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
B. Le présent article étend la procédure d'opposition à tiers détenteurs à la part rachetable des contrats d'assurance rachetables.
L'article 26 a pour effet d'étendre la procédure d'opposition à tiers détenteur aux contrats d'assurance rachetables, et ce afin multiplier les outils dont disposent les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pour recouvrer des sommes indûment versées, notamment à la suite d'une fraude.
Il sera toutefois relevé que parmi les organismes pouvant recourir à une procédure d'opposition à tiers détenteurs, c'est-à-dire les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire, seuls certains seront autorisés par le présent article à pratiquer de telles procédures sur des contrats d'assurance rachetables.
En effet, le I du présent article vise à ajouter à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, qui régit la procédure d'opposition à tiers détenteur, un second alinéa autorisant les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'une part, les caisses générale de sécurité sociale et d'allocation familiales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion d'autre part, et enfin les caisses de mutualité sociale agricole, de procéder à des oppositions à tiers détenteurs sur des contrats d'assurance rachetable, dans des conditions similaires à celles prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Cette procédure ne peut porter que sur la part d'assurance rachetable. Les organismes se voient affecter la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de l'opposition, dans la limite du montant de celle-ci. Il est également précisé que ces dispositions s'appliquent à tout contrat d'assurance rachetable, et ce même si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
Le II de l'article 26 modifie les articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, qui énoncent le caractère insaisissable du capital ou de la rente garantis au profit du bénéficiaire d'une assurance-vie, afin d'adjoindre parmi les exceptions à ce caractère insaisissable les oppositions à tiers détenteurs telles que prévues par les dispositions de l'article L. 133-4-9 modifiées par le I de l'article 26.
III - La position de la commission
La commission des affaires sociales se félicite de l'extension de la procédure à tiers détenteurs aux contrats d'assurance rachetables. Les créances sociales frauduleuses pourront désormais être recouvrées sur la part rachetable des contrats d'assurance vie, qui constituent des sommes parfois non négligeables. En effet, selon les données de France Assureurs, 14,9 milliards d'euros étaient placés sur des contrats d'assurance-vie en septembre 2025, ce qui constitue une hausse de 20% par rapport à septembre 2024. Cette extension constitue donc un vecteur utile pour recouvrer les sommes frauduleusement détournées.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
27
Renforcement des moyens de recouvrement des fraudes
aux allocations de
chômage
Cet article propose d'autoriser le directeur général de France Travail de procéder à des saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que de créer une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par ledit opérateur.
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Le recouvrement des indus frauduleux par France Travail connaît des limites
1. L'opérateur France Travail est particulièrement concerné par les comportements frauduleux en matière de revenus de remplacement
La fraude aux revenus de remplacement consiste dans le fait, pour un bénéficiaire, de percevoir ou de tenter de percevoir indûment, en toute connaissance de cause, par des procédés illégaux un revenu perçu en remplacement de la rémunération que l'on reçoit quand on travaille. Cette fraude constitue un délit193(*) puni par une amende de 4 000 euros, mais représente également un coût pour l'opérateur versant ledit revenu de remplacement.
L'opérateur France Travail, qui effectue le versement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi194(*), est à ce titre particulièrement concerné par ce type de fraude. Les manoeuvres frauduleuses les plus courantes consistent en la reprise d'une activité non déclarée, la non-déclaration d'une résidence ou d'activité professionnelle à l'étranger, l'usurpation d'identité et l'usage de faux documents. La difficulté, pour les indus qui en résulte, est triple : les agents de France Travail doivent détecter ces situations, établir qu'une intention délibérée de tromper est établie afin de pouvoir parler de fraude et non de simple erreur, et par la suite recouvrer les indus en cause.
Concernant la détection, l'action de France Travail repose sur des moyens techniques et humains permettant d'identifier des incohérences, notamment en analysant les signalements reçus et en croisant automatiquement les données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) et d'organismes partenaires.
Cependant, les résultats du recouvrement des sommes indues semblent indiquer une difficulté particulière pour les indus frauduleux. En 2024, le montant total des trop-perçus liés à la fraude s'élève à 84 millions d'euros, un chiffre somme toute modeste par rapport aux 1,22 milliard d'euros d'indus hors fraude. Cependant, là où les trop-perçus sont recouvrés à 86 % dans les cinq ans, les indus frauduleux connaissent un taux de recouvrement de seulement 43,7 %. Cette différence s'explique par l'insolvabilité des fraudeurs, les stratégies d'évitement des contrôles ainsi que des délais de détection plus longs compte tenu de la complexité des stratégies employées.
2. Le cadre juridique du recouvrement des indus frauduleux par France Travail dote l'opérateur de moins d'outils que l'administration fiscale
Une fois le trop-perçu identifié par les services de France Travail, il doit être notifié au demandeur d'emploi par une lettre amiable afin de lui permettre de contester son existence ou son montant. En l'absence de contestation dans un délai de deux mois, France Travail peut procéder au recouvrement de l'indu en pratiquant une retenue sur les échéances à venir195(*).
Le contentieux de l'indu d'une allocation versée par France Travail
Toute contestation du bénéficiaire, par tout moyen, suspend la procédure de recouvrement. Dans le cas où la contestation porte sur le caractère indu des sommes versées, un recours gracieux préalable devant le directeur général de France Travail est obligatoire196(*) avant tout recours devant les juridictions compétentes, de même qu'une médiation préalable obligatoire (MPO) pour certaines matières.
Pour ce qui concerne les litiges relatifs à un trop-perçu, c'est la décision de rejet implicite du recours gracieux qui est contestée devant le tribunal administratif.
• Cependant, les retenues effectuées par France Travail sur les échéances suivantes sont encadrées par le droit du travail, les aides et prestations versées par France Travail sont notamment cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires197(*). Cela signifie que seule une « quotité saisissable »198(*) peut faire l'objet d'une retenue. De manière schématique, les allocations versées par France Travail ont une part strictement insaisissable correspondant approximativement au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule.
Barème de la quotité saisissable maximale par tranche de revenu
|
Total des ressources mensuelles saisissables |
Part saisissable |
Montant maximum |
|
Tranche 1 : jusqu'à 370 € |
1/20e |
18,50 € |
|
Tranche 2 : |
1/10e |
53,67 € |
|
Tranche 3 : |
1/5e |
124,17 € |
|
Tranche 4 : |
1/4 |
211,67 € |
|
Tranche 5 : |
1/3 |
328,61 € |
|
Tranche 6 : |
2/3 |
567,50 € |
|
Tranche 7 : |
100 % |
567,50 € (et la totalité des sommes au-delà de 2 133,33 €) |
Source : Article R. 3252-2 du code du travail
• Une fois la contrainte communiquée au bénéficiaire pour le remboursement d'un trop-perçu, la procédure de recouvrement contentieux est ouverte. Concrètement, France Travail va mandater un commissaire de justice afin de procéder à des saisies mobilières ou immobilières. Or ce recours à un auxiliaire prend du temps, et engendre des frais de gestion de l'ordre de 8 millions d'euros en 2024199(*).
Afin d'éviter ces écueils, l'administration fiscale se voit ouverte la possibilité de procéder à des saisies administratives à tiers détenteur (SATD)200(*). La SATD est un acte de procédure d'exécution dérogatoire au droit commun, qui permet au comptable public, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser sur les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable, les créances dues par ce dernier. Encadrée par des conditions strictes, cette procédure permet donc de solvabiliser la personne concernée en récupérant directement les sommes dues sur un tiers devant lui-même de l'argent à ladite personne - par exemple son employeur.
Cette procédure, gage d'efficacité, n'est pas ouverte en l'état à l'opérateur France Travail.
B. Le dispositif proposé
Le I du présent article complète l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en permettant au directeur général de France Travail ou à des agents placés sous son autorité de procéder à une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) dans les conditions prévues jusqu'alors pour les comptables publics à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Cette saisie doit être notifiée au tiers détenteur afin de permettre l'exercice des délais et voies de recours.
Par souci de coordination, le III du présent article complète l'article L. 262 du livre de procédures fiscales précité, afin de prévoir qu'en cas de saisie administrative à tiers détenteur simultanées par le comptable public et France Travail, et dans l'hypothèse où les fonds de la personne redevables ne suffisent pas à opérer ces deux dernières, la créance recouvrée par le comptable publique est prioritaire.
Le II du présent article complète par ailleurs l'article L. 5428-1 du code du travail, afin d'introduire une exception au respect de la quotité saisissable des prestations versées par France Travail, dans le cas où des indus frauduleux seraient recouvrés via une retenue sur des paiements à venir.
II - La position de la commission
Les rapporteurs ont pu constater, lors de leurs auditions, que cet article porte des dispositifs attendus et plébiscités par les services de France Travail. En effet, il y a quelque chose d'insatisfaisant à l'idée de mettre en oeuvre des moyens humains et financiers au service de la détection d'indus frauduleux, et de ne pas se doter, par la suite, des moyens juridiques permettant de les recouvrer dans les meilleures conditions.
La SATD répond pleinement à cet objectif, et doit permettre à France Travail de contourner les difficultés posées par les fraudeurs qui organisent leur insolvabilité afin de ne jamais répondre de leurs dettes.
Concernant l'exception faite à la quotité insaisissable, les rapporteurs estiment que les préventions exprimées dans l'avis du Conseil d'État201(*) ne sont pas dirimantes. Certes, le chiffrage exact du gain attendu n'a pas été fourni par l'administration, mais l'estimation du surplus de recette est par nature extrêmement difficile à effectuer. Par ailleurs, cette mesure n'interdit pas un traitement individualisé, afin de prendre en compte la situation de l'assuré concerné, ainsi que la durée des retenues, et ainsi maintenir, en moyenne sur une période raisonnable, un niveau de ressource minimal.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 28
(nouveau)
Droit d'information de France Travail et suspension conservatoire
des allocations versées dans le cas d'un doute sérieux de
fraude
Cet article, introduit par la commission, a pour objet de permettre à France Travail d'accéder à des bases de données, ou de traiter les données dont il dispose à des fins de lutte contre la fraude. Par ailleurs, il permet à ce même opérateur de suspendre à titre conservatoire le versement d'une allocation lorsqu'il est confronté à un doute sérieux de fraude.
A. Le droit en vigueur
La lutte contre la fraude constitue un enjeu stratégique pour France Travail. Ainsi, selon l'opérateur, en 2024 le montant global des fraudes détectées à est de 136 millions d'euros, pour un préjudice moyen de 12 159 euros par fraudeur. Or, là où les trop-perçus liés à des erreurs de déclaration ou de calcul ont un taux de recouvrement à 5 ans de 86 %, ceux liés à la fraude n'ont un taux que de 43,7 % du fait des stratégies d'évitement.
Concrètement, les principales fraudes concernent :
- la fraude à la résidence ou le travail à l'étranger non déclarés, pour 56,2 millions d'euros la même année ;
- la reprise d'activité non déclarée pour 20,5 millions d'euros ;
- l'usurpation ou la falsification d'identité pour 22,4 millions d'euros ;
- l'usage de faux documents pour 7 millions d'euros.
B. Le dispositif proposé
La commission, considérant que le système déclaratif concernant les allocations chômage, suivi d'un contrôle a posteriori, était particulièrement propice au développement de fraudes complexes, a souhaité limiter ce risque en adoptant l'amendement COM-148 des rapporteurs.
À cette fin, le présent article vise à créer un nouveau chapitre au sein du titre Ier du livre III du code du travail, destiné aux moyens de lutte contre la fraude de l'opérateur France Travail.
D'abord, il tend à permettre, au seul but de l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 du code du travail de recourir à de nouveaux moyens d'enquête. Ces agents pourraient ainsi :
- interroger le fichier des compagnies aériennes (PNR, pour passengers name record) afin de vérifier le respect de la condition de résidence en France des allocataires de l'indemnisation d'assurance chômage, ainsi que le registre des français établis hors de France ;
- obtenir un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie afin d'accéder aux relevés de communication afin de prouver une résidence à l'étranger ;
- traiter les données de connexion des inscrits à France travail à la seule fin de lutte contre la fraude.
Parallèlement, cet amendement met en place une suspension à titre conservatoire des allocations. Dans le cas où les agents en question auraient réuni plusieurs indices sérieux de manoeuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations versées par France Travail, le directeur général pourrait procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
La décision de suspension devra être motivée, et immédiatement notifiée à l'intéressé. Ce dernier dispose des recours habituels, ainsi que de la possibilité de demander à avoir un débat contradictoire dans les deux semaines à compter de la notification afin de fournir des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
Par ailleurs, cette suspension est encadrée puisqu'elle ne peut dépasser trois mois, le temps raisonnable pour terminer l'enquête et prendre une décision de sanction le cas échéant. Un décret en Conseil d'État précise les garanties pour l'allocataire suspecté.
Les rapporteurs soulignent que ce mouvement vers une action préventive en matière de fraude est partagé par le législateur en de nombreux domaines, et a été récemment illustré au sujet des fraudes aux aides publiques - sans que le Conseil constitutionnel ne censure ces dispositions compte tenu des enjeux202(*).
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-148.
Article 29
(nouveau)
Suspension conservatoire des prestations sociales versées
dans le cas d'un doute sérieux de fraude
Cet article, introduit par la commission, entend permettre aux organismes de sécurité sociale de suspendre le versement d'une prestation dans le cas d'un doute sérieux de manoeuvre frauduleuse, pour un délai ne pouvant excéder deux mois.
Par souci de cohérence et d'harmonisation des moyens de lutte contre la fraude, la commission, en adoptant l'amendement COM-149 des rapporteurs, a entendu doter les organismes de sécurité sociale des mêmes prérogatives que celles conférées à l'opérateur France Travail, et ce dans le même objectif.
Ainsi, le présent article donne aux agents de lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale203(*) la possibilité, lorsqu'ils réunissent plusieurs indices sérieux de manoeuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, de demander au directeur de l'organisme auquel ils appartiennent de procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
Ce pouvoir à titre conservatoire est doté des mêmes délais et contraintes que celui donné au directeur général de France Travail à l'article 28 (voir commentaire).
La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-149.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 5 novembre 2025, sous la présidence de M. Jean Sol vice-président, la commission examine le rapport de Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno, rapporteurs, sur le projet de loi (n° 111, 2025-202) relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
M. Jean Sol, président. - Nous examinons le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont le Sénat est saisi en premier.
Je rappelle que nous avons délégué l'examen au fond des articles 1er, 3, 9, 15, 18, 19, 20 et 23 à la commission des finances, et de l'article 8 à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Nous ne ferons donc qu'entériner les décisions de nos collègues sur ces articles, qu'il s'agisse des irrecevabilités, du périmètre ou encore de la rédaction proposée pour les articles confiés à leur examen.
M. Olivier Henno, rapporteur. - À coup sûr, l'automne budgétaire 2025 détonnera parmi tous ceux de la Ve République ; cette année, le Parlement adoptera, non pas deux, mais trois textes budgétaires... ou n'en adoptera aucun. En effet, trois textes seront débattus, car le Gouvernement, comme vous le savez, a fait le choix de lier les discussions du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) à un projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Je ne reviendrai pas sur la seconde option...
Le texte que nous examinons aujourd'hui s'annonce donc déterminant. Il doit, d'abord, garantir l'acceptabilité des mesures d'effort demandées aux Français en luttant davantage contre ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. Or les montants de la fraude sont triplement inacceptables.
Sur le champ de la protection sociale, le manque à gagner estimé atteint 13 milliards d'euros par an, au bas mot, réparti entre 6,9 milliards d'euros de cotisations éludées et 6,1 milliards d'euros de fraude sur les dépenses.
Sur ce montant, les organismes de sécurité sociale n'ont été en mesure de détecter, en 2024, qu'une fraude totale de 2,9 milliards d'euros.
Enfin, une part très faible de ces montants est effectivement recouvrée sur les cotisations sociales éludées à cause du travail dissimulé, seuls 121 millions d'euros ont pu être recouvrés en 2024.
Ce projet de loi est également déterminant : en renforçant l'arsenal législatif à la main des administrations et des organismes, il pourrait rapporter 1,5 milliard d'euros de recettes nouvelles pour l'État en matière de fraude fiscale et 800 millions d'euros pour le volet social, selon le peu d'informations transmises par le Gouvernement. Ces chiffrages - au moins le premier - laissent perplexe, comme le note le Haut Conseil des finances publiques (HCFP).
Pour résumer notre état d'esprit, je dirais que la copie du Gouvernement est tout à fait acceptable : les mesures sont pertinentes dans leur grande majorité et contribuent à lever utilement des freins pour tous les acteurs de la lutte contre la fraude sociale. Toutefois, ce sont souvent des ajustements marginaux ou techniques qui ne paraissent pas décisifs ; le contenu du texte n'est pas à l'image de l'ambition affichée.
Nous exposerons donc dans un premier temps notre position sur les articles proposés par le Gouvernement, avant de vous présenter les propositions que nous vous formulerons afin de rehausser la portée du texte.
Une partie du texte concerne la fraude à la sécurité sociale et vise à accroître le partage des informations entre ses acteurs.
L'article 2 prévoit d'étendre plus largement l'accès aux bases de données patrimoniales de la direction générale des finances publiques (DGFiP) au bénéfice des agents habilités des organismes de protection sociale. Cette démarche est tout à fait pertinente et nous vous proposerons de l'étendre à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), mais également aux services des départements et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour l'instruction de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et du revenu de solidarité active (RSA).
L'article 10 suit la même logique vertueuse et étend le droit de communication des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) permettant d'obtenir des renseignements et documents sans que le secret professionnel y soit opposé. Nous proposerons de compléter cet article, là encore, par une extension à la branche famille, compte tenu de la prégnance des risques de fraudes auxquels sont confrontées les caisses d'allocations familiales (CAF). Un second amendement renforcera le droit de communication de l'administration fiscale s'agissant du dispositif d'activité partielle.
L'article 4 tend à réécrire le dispositif de dépôt de plainte pénale des organismes de sécurité sociale, en créant une plainte unique déposée par une caisse locale ou un organisme de sécurité sociale pour ses homologues, en cas de fraude d'ampleur. Cela permettra une action pénale plus rapide et fluidifiera le traitement de ces plaintes par les parquets, en espérant que ces poursuites donnent lieu à des recouvrements effectifs. Nous proposerons d'amender cet article afin de renforcer la sécurité juridique et d'étendre la dispense de consignation en cas de citation directe des auteurs présumés de la fraude devant les tribunaux.
L'article 5 prévoit une meilleure coordination des actions de lutte contre la fraude entre les organismes de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, en reprenant les apports de l'article proposé par notre commission lors du dernier PLFSS, et censuré comme cavalier social par le juge constitutionnel. Cet article autorise les sociétés d'assurances et mutuelles à traiter les données de santé de leurs assurés couverts par un contrat d'assurance maladie, maternité ou accident, ainsi qu'à échanger des informations avec les CPAM.
L'article 6 vise à inscrire les MDPH et les services chargés de l'instruction de l'APA au sein de la liste des organismes pouvant partager des informations personnelles dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Cette mesure rejoint la nécessaire acculturation de ces services à la lutte contre la fraude.
Un deuxième volet porte sur les comportements abusifs en matière de santé et de risques professionnels, qu'ils soient le fait des entreprises, des professionnels de santé ou des assurés sociaux.
L'article 7 a pour objet de rendre obligatoire, à compter de 2027, la géolocalisation des véhicules des transporteurs sanitaires et des entreprises de taxis ayant conventionné avec une CPAM, ainsi que le recours au système électronique de facturation intégré. Ces dispositions s'inscrivent dans une logique de fiabilisation de la facturation du transport sanitaire et pourraient conduire à une économie de 32 millions d'euros par an. Nous vous proposons de soutenir cet article, qui est cohérent avec la position que notre commission avait défendue l'an passé. Nous avions soutenu un amendement portant ce dispositif pour les transporteurs sanitaires, mais il n'avait pas prospéré en raison des règles de recevabilité en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS). En outre, la convention des transporteurs sanitaires et la convention-cadre des taxis conventionnés prévoient déjà cette obligation.
L'article 12 opère une rénovation du régime de sanctions et de pénalités financières en cas d'agissement frauduleux relatif aux aides versées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), et permet de renforcer les prérogatives en matière de lutte contre la fraude des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité. Nous vous proposerons un amendement visant à maintenir le droit en vigueur concernant la sanction d'absence de dématérialisation de la notification d'AT-MP.
L'article 17 vise à renforcer la lutte contre la fraude et la surprescription des professionnels de santé, ces deux sujets étant distincts et ne pouvant être amalgamés.
D'une part, il prévoit la levée de l'interdiction de cumul entre la sanction conventionnelle et la pénalité financière.
D'autre part, l'article renforce la mise sous objectif, outil de régulation des pratiques de surprescription des médecins. Il aligne le périmètre de contrôle des centres de santé et plateformes de téléconsultation sur celui des professionnels de santé, corrigeant ainsi une inégalité de traitement, et transforme en obligation la proposition de mise sous objectif à l'encontre des surprescripteurs. Cette mesure, qui ne vise que les médecins ayant un niveau de prescriptions deux fois supérieur à la moyenne de leurs confrères à patientèle similaire, est ciblée et responsabilisante : elle ne concernait que 416 médecins en 2024.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Un troisième volet concerne la lutte contre le travail dissimulé et les revenus illicites.
L'article 14 tend à majorer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) des revenus issus d'activités illicites, et de les prendre en compte dans le calcul des revenus de remplacement servis par France Travail. Nous vous proposerons d'étendre cette logique à l'ensemble des prestations sous condition de ressources.
L'article 21 vise à faciliter le recouvrement des cotisations éludées en cas de travail dissimulé à travers un dispositif de flagrance sociale. Il permet, dès notification d'un procès-verbal établi par les agents de contrôle, de saisir à titre conservatoire les actifs d'une entreprise suspectée de travail dissimulé. Concrètement, cela veut dire que l'Urssaf pourra mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur les biens des entreprises fraudeuses pour recouvrer ses créances de cotisations. Nous proposerons d'amender cet article afin d'élargir ces mécanismes à toutes les infractions relevant du travail illégal : marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, etc.
L'article 22 vise à accroître les obligations qui incombent au maître d'ouvrage sur l'absence de travail dissimulé en instaurant un devoir de vigilance à l'égard de tous les sous-traitants, y compris ceux qui ne sont pas ses cocontractants. Aussi élargit-il le mécanisme de solidarité financière qui découle du manquement à cette obligation ; en cas d'infraction de travail dissimulé et d'absence d'accomplissement de ce devoir de vigilance, le maître d'ouvrage sera solidairement tenu de payer les dettes sociales des entreprises délinquantes.
Nous vous inviterons à adopter cet article, qui permet de s'adapter à des chaînes de sous-traitances « en cascade » de plus en en plus sophistiquées, dans lesquelles des entreprises éphémères peuvent disparaître avant toute mise en oeuvre du recouvrement social. Nous vous proposerons cependant de renforcer ce régime en étendant aux maîtres d'ouvrage le dispositif d'annulation des exonérations de cotisations dont il a bénéficié en cas de travail dissimulé et de manquement à ses obligations de vigilance.
Le troisième volet vise à lutter contre les comportements abusifs et les fraudes en matière de formation professionnelle.
L'article 13 oblige le titulaire du compte personnel de formation (CPF) à se présenter aux épreuves de sa formation certifiante. Il organise aussi la communication par les ministères et organismes certificateurs des données permettant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de faire appliquer cette obligation. Il s'agit ainsi de lutter contre certains comportements abusifs, voire de réelles fraudes, à l'instar des collusions entre organismes fraudeurs et titulaires de CPF qui s'inscrivent à des formations en échange de rétributions. Toutefois, nous repréciserons, d'une part, que les motifs légitimes d'absence à l'examen doivent être prévus par décret, et, d'autre part, que cette non-prise en charge au titre du CPF ne doit pas exonérer le stagiaire de régler l'organisme de formation qui n'est pas fraudeur.
L'article 16 prévoit de créer un dispositif de sanctions administratives mobilisables par les services régionaux de contrôle (SRC) de la formation professionnelle et d'ajouter une nouvelle infraction pénale en l'absence de remontée des données issues des comptabilités analytiques des centres de formation d'apprentis (CFA) vers France compétences.
L'article 24 permet de préciser le délai de reprise de l'administration en matière de financement de la formation professionnelle, tandis que l'article 25 octroie à la CDC un pouvoir de contrainte sur les titulaires d'un CPF en cas de manoeuvres frauduleuses.
Enfin, une dernière partie vise à lutter contre la fraude spécifique aux allocations chômage.
L'article 13 impose ainsi le versement de ces allocations sur un compte bancaire domicilié au sein de l'Union européenne.
L'article 27 permet de renforcer l'efficacité du recouvrement des indus frauduleux par France Travail, en autorisant l'opérateur à saisir directement les indus chez des tiers débiteurs du fraudeur, ou à retenir une plus grande quotité des versements à venir.
À l'occasion de l'examen de ce texte, nous avons décidé de procéder à un « réarmement » collectif contre la fraude en donnant les moyens aux opérateurs, aux caisses, aux collectivités territoriales de lutter à armes égales contre des fraudeurs, toujours plus rapides et plus inventifs. Nous vous présenterons ultérieurement chacun de nos amendements, mais ils sont au service d'une vision d'ensemble de la lutte contre la fraude. Notre conviction, c'est que la nature de la fraude sociale a évolué, qu'elle est entrée dans une nouvelle ère, plus complexe, plus systématique, plus lucrative aussi et que le législateur doit en tenir compte pour adapter les outils à disposition des services en conséquence.
Il s'agit d'abord de jouer à armes égales avec les fraudeurs. Les auditions des services de France Travail nous ont montré que les fraudeurs tirent profit des outils numériques, se jouent des frontières et, peut-être, de la naïveté de notre système de sécurité sociale. Nous vous proposerons donc d'aller plus loin que le texte du Gouvernement, et de répondre aux demandes de France Travail et de certaines caisses, en vue d'obtenir des moyens à la hauteur des enjeux. Pour cela, nous leur permettrons, afin d'identifier les manoeuvres frauduleuses, d'interroger le fichier des compagnies aériennes, d'obtenir un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie ou encore de traiter les données de connexion des assurés. Un amendement permettra par ailleurs à la CDC de recevoir les informations qui lui manquent, de la part des greffes des tribunaux de commerce ou des banques, pour identifier les entreprises éphémères qui piratent le marché de la formation.
Ensuite, il convient de tirer les leçons de nos échecs. Pour reprendre l'analyse de l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI), « c'est le système déclaratif français, de contrôle a posteriori, du versement d'une prestation sociale qui est à l'origine de la fraude [...]. » Or le texte du Gouvernement ne revient pas sur cette logique, et les fraudeurs prennent donc de court la puissance publique. C'est pourquoi nous vous proposerons de supprimer l'effet suspensif des contraintes que peut délivrer la CDC pour recouvrer, avant qu'il ne soit trop tard, les sommes indues versées à des sociétés fraudeuses. Dans la même logique, nous vous proposerons de permettre aux organismes de protection sociale de suspendre à titre conservatoire le versement d'une allocation en cas d'indices sérieux de fraudes.
Enfin, les sanctions à la main de l'administration doivent évoluer avec les usages des fraudeurs. Nous vous proposerons notamment de créer un motif de sanction contre les organismes de formation professionnelle relevant de logiques d'emprise, d'entrisme ou de charlatanisme. De même, nous renforcerons l'application de la « liste noire » du ministère du travail, sur laquelle est diffusé le nom des entreprises condamnées pour travail dissimulé. Enfin, nous vous proposerons le déremboursement des prescriptions des professionnels de santé déconventionnés pour fraude.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Vous l'aurez compris, l'exercice que nous vous proposons consiste, pour reprendre une métaphore sportive, à « muscler le jeu » face à des fraudeurs qui n'ont aucun état d'âme. En effet, dans cette course inégale, seul le rapport de force prévaut, et la naïveté nous semble coupable.
Pour terminer, il nous revient de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Nous considérons que ce périmètre comprend des dispositions relatives aux échanges d'informations dont bénéficient les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés du service de prestations sociales pour lutter contre la fraude ; aux obligations incombant aux organismes de protection sociale en matière de lutte contre la fraude, au traitement et à l'échange de données entre organismes obligatoires et d'autres services de l'État, ainsi qu'avec les organismes complémentaires de protection sociale ; aux dispositifs de contrôle relatifs au transport sanitaire ; à la lutte contre la fraude dans le champ des risques professionnels ; aux moyens de lutte contre la fraude dévolus à l'opérateur France Travail ; à l'identification, à la taxation et à la prise en compte des revenus illicites dans le versement de prestations ; à la lutte contre la fraude dans le domaine de la formation professionnelle et contre le travail dissimulé ; à la régulation des professionnels de santé, des centres de santé et des plateformes de téléconsultations commettant des manquements ; aux sanctions en matière de fraude sociale, et notamment à l'encontre des professionnels de santé ayant des agissements frauduleux ; au recouvrement de cotisations et contributions sociales, de prestations sociales ou d'allocations indûment versées en raison d'une fraude ; aux échanges d'informations entre administrations, autorités administratives indépendantes et autorités judiciaires, en matière de lutte contre la fraude fiscale ; aux règles d'assujettissement des professionnels aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; à la procédure judiciaire et aux sanctions applicables aux infractions se rapportant aux délits de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale, au délit de fraude fiscale, aux délits comptables et au délit d'escroquerie aux finances publiques ; aux obligations déclaratives des assujettis à l'égard de l'administration fiscale ; aux délais de reprise de l'administration fiscale ; aux moyens de contrôle et d'enquête des services compétents en matière de lutte contre la fraude fiscale ; aux procédures et moyens de contrôle et de sanction destinés à lutter contre les faux professionnels et le travail dissimulé dans le secteur des transports publics particuliers de personnes (T3P) et, en conséquence, contre la fraude sociale et fiscale dans ce secteur ; aux obligations de vigilance applicables aux plateformes d'emploi dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC) à l'égard des exploitants VTC et aux procédures de contrôle et de sanction afférentes à ces obligations.
Mme Corinne Bourcier. - Merci aux deux rapporteurs pour leurs propos. Alors que les débats budgétaires recentrent l'attention sur la dette et la nécessaire réduction des dépenses publiques, ce texte est bienvenu. Il semble aller dans le bon sens : lutter contre la fraude sociale contribue à assurer une égalité des citoyens devant la charge publique et à une juste répartition de l'effort, ce qui est primordial dans le contexte actuel.
Le chapitre Ier facilite la lutte contre la fraude en favorisant la mise en commun et l'exploitation des informations par les administrations douanières, fiscales, et les organismes de protection sociale. Il conviendrait également de donner aux professionnels de santé les moyens de jouer pleinement leur rôle. L'article 5 vise à améliorer la coordination des actions entre les organismes de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. Par ailleurs, un volet spécifique traite des comportements abusifs en matière de santé.
À titre d'exemple, des pharmaciens ne peuvent vérifier si certains médicaments ont déjà été délivrés à des bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME). Malgré la réforme de la carte AME fin 2019, sécurisée par hologramme, celle-ci ne bénéficie pas encore des moyens de contrôle offerts par la carte vitale. À ce titre, je regrette que mon amendement visant à instaurer une carte de bénéficiaire de l'AME au format « carte à puce » ait été jugé irrecevable. Je prévois de le retravailler en vue de le redéposer en séance.
M. Jean-Luc Fichet. - Merci pour ce rapport, réalisé dans des délais très contraints. Les auditions ont été de qualité et permettent de disposer d'un projet intéressant en matière de fraudes fiscales et sociales. La fraude fiscale reste beaucoup plus importante que la fraude sociale, entre 80 milliards et 100 milliards d'euros, contre 15 milliards d'euros pour la fraude sociale, mais aucune fraude n'est excusable.
La question des moyens humains et matériels se pose : les contrôleurs sont-ils suffisamment nombreux pour identifier les fraudes ? Et le cas échéant, comment y remédier ? Embaucher des fonctionnaires coûterait entre 500 millions et 1 milliard d'euros, mais si ce travail permet de récupérer 5 à 15 milliards, l'opération est alors largement rentable. Sur le plan des équipements, la dématérialisation reste insuffisante, comme le montre le traitement encore manuel des feuilles de soins à la CPAM, limitant le suivi des fraudes et l'efficacité des médecins.
Concernant les professionnels et les centres de santé, certaines fraudes importantes, notamment à Rennes - de l'ordre de 5 millions à 6 millions d'euros -, ont récemment été sanctionnées. Toutefois, c'est le centre de santé, en tant que personne morale, qui est sanctionné, tandis que les professionnels peuvent continuer à exercer leur activité ailleurs. Cette question mérite d'être réexaminée, comme l'a admis la caisse d'assurance maladie.
Sur le travail dissimulé, la question est réelle. La sous-traitance de premier, deuxième ou troisième rang, parfois nécessaire en raison de cahiers des charges lourds, entraîne des abus et complique le suivi des embauches. Pour le troisième sous-traitant, la marge bénéficiaire est souvent proche de zéro, et certains personnels ne sont pas déclarés. La responsabilité du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre est donc importante. La vérification sur les chantiers ne nécessiterait pas de moyens disproportionnés et pourrait être améliorée si chacun s'impliquait.
Les allocataires sont souvent mis à l'index, alors qu'ils ne représentent pas la majeure partie des fraudes, qui sont parfois involontaires. Les sommes indûment perçues, notamment au titre du RSA, doivent être restituées, mais des personnes en grande précarité se retrouvent alors à devoir rembourser des montants importants. Des erreurs peuvent également provenir de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME) utilisant des équipements de dématérialisation insuffisants, ce qui conduit à de mauvaises déclarations.
Il est donc essentiel d'examiner massivement la question des fraudes, d'y consacrer les moyens nécessaires, car des sommes importantes pourraient être récupérées pour contribuer à la réduction de la dette publique.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Merci aux rapporteurs pour leur travail. Parallèlement à une fraude fiscale qui s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'euros, il existe une fraude sociale qui se compose pour 56 % de fraudes à la cotisation, c'est-à-dire un manque de recettes pour la sécurité sociale. Sur les 44 % restants, 10 % des fraudes concernent des prestations données à des professionnels de santé, tandis que d'autres ont trait à la fraude de prestations telles que les allocations familiales.
Force est de constater que le nombre d'articles est inversement proportionnel au poids respectif de chaque type de fraudes, et que les moyens dédiés à la lutte contre la fraude fiscale, la fraude aux cotisations et la fraude des professionnels sont moindres que ceux qui sont mobilisés pour s'attaquer à la fraude au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité.
Je suis d'accord avec Jean-Luc Fichet : toute fraude est à condamner, y compris celle que je viens d'évoquer, mais nous donnons-nous les moyens de lutter efficacement contre toutes les fraudes ? Il semble bien que non, et la fraude fiscale, qui représente entre 60 milliards d'euros et 100 milliards d'euros, pourra continuer à prospérer assez tranquillement alors que les moyens seront démultipliés pour récupérer 1 milliard d'euros en bout de course.
Vous avez déclaré irrecevables, en vertu de l'article 45 de la Constitution, une série d'amendements, y compris ceux qui visaient à enfin appliquer les recommandations de la commission d'experts relatives à la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dont acte, mais il faudra bien qualifier un jour de « fraude » cette sous-déclaration, qui représente entre 2,7 milliards d'euros à 3,2 milliards d'euros : elle aboutit en effet à une sous-sinistralité et à un sous-taux d'accidents du travail, ce qui entraîne un manque à gagner pour la branche AT-MP.
Loin de tomber du ciel, cette sous-déclaration est intentionnelle, d'autant que les salariés peuvent, dans certaines entreprises, percevoir de l'intéressement au cas où l'objectif « zéro accident » est atteint : une pression s'exerce alors pour que l'arrêt de travail ne soit pas déclaré au titre de l'AT-MP.
Il serait pourtant nécessaire d'évaluer, chaque année, l'application des recommandations de la commission, afin d'en terminer avec ces pratiques, mais je peux que constater l'absence de volonté politique en ce sens, ce que je déplore : un projet de loi ad hoc serait sans doute nécessaire afin de contrer ce qui constitue bien, à mes yeux, une fraude.
Par ailleurs, l'extension du droit de communication tous azimuts pose un problème dans la mesure où des données sensibles, telles que les données de santé, peuvent être en jeu. Par le passé, seuls les directeurs disposaient de ce droit, mais il est désormais question de l'accorder à tous les agents, ce qui m'a conduite à déposer un amendement visant à ce que seuls des agents agissant sur délégation du directeur bénéficient de ce droit à communication, toujours sous la responsabilité de ce dernier.
Il paraît en effet risqué d'accorder ce droit à des agents qui ne sont pas toujours formés au bon usage des données sensibles. De surcroît, cette extension pose question alors que certains assureurs privés font déjà du tri parmi les bénéficiaires, pratique qui ne saurait que s'aggraver s'ils disposent de davantage d'informations. Il n'est donc pas raisonnable d'étendre ce droit de communication de manière aussi large.
J'en arrive au titulaire du CPF, en rappelant que ce dernier bénéficie en quelque sorte d'un droit de tirage après une année de travail, et qu'il génère ce droit à la formation, désormais comptabilisé en unités monétaires et non plus en heures, ce qui traduit selon moi un certain recul. Quoi qu'il en soit, il est question d'un droit porté par le travail du salarié et qui lui est attaché.
Si la preuve d'une collusion avec un faux organisme de formation doit bien évidemment aboutir à des remboursements, demander à un titulaire de rembourser l'ensemble des frais pour ne pas s'être présenté à un examen me paraît à la fois peu justifié et difficile à mettre en oeuvre.
Si nous convergeons pour lutter contre toutes les fraudes, la problématique des moyens reste posée, notamment pour les fraudes aux cotisations, qui représentent la majeure partie des comportements répréhensibles. À ce titre, il est difficile d'entendre que seule une partie des montants est récupérée au motif que le travail est par définition dissimulé : embauchez des inspecteurs de travail qui iront sur les chantiers et dans les restaurants, ce qui permettra d'intervenir en amont pour lutter contre le travail dissimulé, et non pas a posteriori ! Je note d'ailleurs que vous regrettez une intervention qui se serait trop tardive pour les autres prestations.
En conclusion, je trouve proprement incroyable que les professionnels de santé - à l'origine de 10 % des fraudes, ce qui est loin d'être négligeable - ayant reçu un procès-verbal pour fraude puissent obtenir de l'administration, s'ils déposent un recours, un certificat leur signifiant qu'ils sont à jour de leurs cotisations. En comparaison, un bénéficiaire du RSA ou un usager de France Travail s'expose à des sanctions immédiates en cas de fraude. Je pense donc qu'il faut se borner à autoriser un échéancier de paiement, en ne délivrant pas un tel certificat.
Mme Florence Lassarade. - Le médecin déconventionné est-il considéré d'emblée comme un fraudeur, ou est-il déconventionné à la suite d'une fraude ? Pourquoi prévoir une rubrique particulière pour cette catégorie ?
M. Martin Lévrier. - Je remercie les rapporteurs. Si des moyens juridiques considérables sont accordés à la lutte contre les fraudes, qu'en est-il des moyens opérationnels ?
Par ailleurs, j'ai cru comprendre que l'une de nos collègues avait déposé une proposition de loi sur le même sujet et qu'elle avait l'air agacée par ce texte, qui comporte selon elle de nombreux points aveugles. Vous êtes-vous inspirés de son texte pour combler d'éventuels « trous dans la raquette » ?
Mme Annick Petrus. - Madame le rapporteur, le projet de loi dote l'Urssaf d'un nouvel outil, la flagrance sociale, qui lui permettra, en cas de constat de travail dissimulé, de geler immédiatement les avoirs d'une entreprise soupçonnée de fraude, avant même toute décision judiciaire. Si l'objectif de ce dispositif, à savoir rendre la lutte contre la fraude plus rapide et dissuasive, est légitime, son application soulève de réelles interrogations dans les territoires ultramarins où les moyens humains, techniques et logistiques des organismes de recouvrement - Urssaf, France Travail, CAF - sont limités. Dans des contextes économiques fragiles dominés par de très petites entreprises, la saisie immédiate des avoirs pourrait de plus placer des employeurs de bonne foi dans des situations critiques.
Comment éviter les dérives administratives et garantir le respect du contradictoire ? Une adaptation territoriale pourrait-elle être envisagée pour les outre-mer afin de tenir compte des contraintes locales ? Le Gouvernement a-t-il apporté des garanties concrètes en termes d'effectifs, d'outils numériques ou de coordination inter-services pour rendre cette mesure réellement applicable et équilibrée dans nos collectivités ?
Mme Anne-Sophie Romagny. - Je salue à mon tour le travail des rapporteurs, ainsi que celui de notre collègue Nathalie Goulet - M. Lévrier y fait sans doute référence -, qui s'attaque depuis plusieurs années au sujet de la fraude.
Dans un contexte de difficultés budgétaires et de tensions dans l'opinion, cet appel à la responsabilité individuelle est essentiel. Toute fraude doit être punie, en allouant les moyens requis à la détection comme au contrôle, et en bannissant le travail en silos qui aboutit notamment à ce que la sécurité sociale et les ordres professionnels oeuvrent de manière séparée, l'absence d'interface de discussions limitant la détection des fraudes.
Il ne faut pas non plus, au nom des libertés individuelles et de la protection des données, laisser se développer un certain laxisme qui s'est inséré dans notre société depuis de nombreuses années, ni s'en servir comme d'une excuse pour ne pas se donner les moyens de lutter contre la fraude. Le groupe de l'Union Centriste est très favorable à ce texte.
Mme Céline Brulin. - Je souscris à l'opinion selon laquelle toute fraude doit être empêchée et, à défaut, condamnée. Si nous parvenions à enrayer la fraude fiscale industrialisée, qui est dix fois supérieure au montant estimé de la fraude sociale, nos débats budgétaires prendraient une tout autre allure. Alors que des contre-vérités, voire de fausses informations, circulent sur le sujet dans l'opinion publique, chacun d'entre nous doit faire un effort pour être clair et précis sur la réalité des chiffres.
Madame et monsieur les rapporteurs, vous avez évoqué la volonté du Gouvernement de rendre acceptables, par le biais de ce projet de loi, les efforts demandés dans le PLF et le PLFSS : ce texte serait ainsi un gage prouvant que l'on va lutter contre la fraude et ne pas se limiter à demander des efforts aux Français. Or comme vous l'avez rappelé, le Gouvernement envisage de récupérer 1,5 milliard d'euros au titre de la fraude fiscale et 800 millions d'euros au titre de la fraude sociale, soit des montants bien moindres que ceux des efforts qui sont demandés aux Français dans les deux textes budgétaires.
J'estime d'ailleurs que nous devrions aussi mettre ces chiffres en perspective avec le non-recours à certains droits, dans le cadre d'un raisonnement budgétaire global. On estime, par exemple, que le non-recours au RSA est d'environ 30 %.
Si j'avais l'esprit retors - mais vous savez bien que ce n'est pas le cas -, je pourrais penser que le Gouvernement escompte, avec ce troisième texte, orienter le regard vers certains dispositifs censés répondre aux besoins de résorption de la dette et du déficit. Or, même si nous traquions les fraudeurs dans les moindres recoins, nous ne serons pas en mesure de remédier à la situation budgétaire que nous connaissons.
Un exemple peut être choquant : nous connaissons tous les délais de traitement dans les MDPH, les familles exprimant souvent la souffrance qui en résulte. Compte tenu de cet état de fait, je doute que ces structures puissent s'impliquer davantage dans la lutte contre la fraude.
Enfin, s'il est question d'agir à armes égales contre les fraudeurs, nous serons toujours très éloignés de cet objectif, même après l'adoption de ce texte. En effet, la DGFiP a subi plusieurs dizaines de milliers de suppressions de postes, tandis que les contrats d'objectifs et de moyens (COM) des CPAM comportent chaque année des suppressions d'emplois.
Ce texte est-il donc uniquement une opération d'affichage idéologique, ou est-il question de lutter sérieusement contre la fraude ? Si tel est le cas, cela ne se fera pas, à notre avis, à moyens constants, qu'ils soient humains, techniques ou informatiques.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Ce texte est guidé par deux objectifs, à commencer par celui consistant à casser les silos et à éviter les injonctions paradoxales. Nous demandions en effet aux administrations de lutter contre la fraude, mais sans leur accorder les moyens appropriés. À la suite de nos auditions, nous avons répondu à leurs demandes. Certes, il n'est pas question de moyens humains - débattus dans le cadre du PLF et du PLFSS -, mais des moyens techniques permettant une communication entre administrations.
Par ailleurs, nous n'avons épargné personne : toute fraude, fiscale ou sociale, qu'elle soit commise par des assurés, des médecins ou des entreprises, est une fraude que nous entendons combattre en donnant les moyens aux administrations d'échanger les informations et de lutter efficacement contre ces pratiques. Néanmoins, deux limites subsistent. Premièrement, l'usage des données doit rester encadré par la loi ou par le règlement, un agent lambda - la formule n'a rien de péjoratif - n'ayant pas vocation à aller vérifier n'importe quelle donnée relevant d'une autre administration ; deuxièmement, le respect du contradictoire doit être garanti, exigence que nous entendons porter par le biais d'une série d'amendements.
Concernant le travail dissimulé, la sous-traitance en cascade qui a pu être observée dans le cadre du déploiement de la fibre optique, avec des entreprises qui n'étaient pas au niveau et qui devaient agir dans des délais restreints, a entraîné un véritable laisser-aller sur les chantiers. Un renforcement des règles est donc nécessaire et nous sommes allés plus loin que le texte initial, en essayant de faire respecter jusqu'au bout de la chaîne la responsabilité du maître d'ouvrage, ce qui nous a valu quelques critiques de la part des organisations patronales (OP).
Quant à la branche AT-MP, j'estime que nous mènerons cette discussion dans le cadre du PLFSS si le sujet revient régulièrement.
Pour ce qui est du CPF, qui correspond en effet à des droits générés, je rappelle qu'il est question de 16 milliards d'euros d'argent public depuis la monétisation du dispositif. Il ne s'agit pas du premier texte sur le sujet, et heureusement ! Après les mesures prises contre les appels téléphoniques de démarchage, nous proposons d'aller plus loin, en respectant les dispositifs existants : inciter les personnes à se présenter aux examens certifiants fait déjà partie des règles en vigueur, les conditions générales d'utilisation de « Mon compte formation » imposant de se présenter à la certification.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Il est question de sortir d'un certain déni, la fraude fiscale comme sociale ayant longtemps été sous-estimée, ce qui a pu valoir des critiques, à tort, à notre collègue Nathalie Goulet.
S'il existe effectivement un déséquilibre entre les 100 milliards d'euros de fraude fiscale et les 16 milliards d'euros de la fraude sociale, nous avons souhaité aborder ces problèmes « en même temps », en nous gardant de tout écart de traitement qui aura pu nous ramener à la formule bien connue de la fable Les animaux malades de la peste : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Au contraire, les statuts et les diplômes n'ont rien changé à notre regard.
Plus largement, nous sommes en quelque sorte en mission sur ces sujets. En sortant d'une réunion de la commission des finances, notre collègue Jean-François Rapin indiquait que 1 euro de déficit en 2007 coûte aujourd'hui à la Nation 2,50 euros, ce qui nous oblige à adopter une approche rigoureuse en matière de déficit.
Madame Bourcier, le consentement à l'impôt et à la cotisation est une réelle question et des progrès restent à accomplir en matière d'AME, en se gardant de construire des usines à gaz et en recherchant le juste équilibre.
Pour ce qui est des effectifs de contrôleurs, monsieur Fichet, nous avons été marqués par l'audition de la DGFiP, exposée à des injonctions contradictoires. Pour sa part, la Cnam fournit des efforts puisqu'elle compte désormais 1 612 agents affectés à la fraude, contre 1 438 personnels en 2022. Dans le même temps, l'article 10 vise à leur faciliter la tâche.
J'ajoute qu'il n'est pas question tant du montant de la fraude que de l'intentionnalité, qui a bien plus guidé notre réflexion que la question du statut : être bénéficiaire du RSA, par exemple, ne rend pas plus ou moins fraudeur que d'autres acteurs.
Madame Poncet Monge, les agents qui disposent du droit de communication agissent sous la responsabilité de leur directeur et ils ne disposent pas de pouvoirs d'enquête sans être assermentés.
Madame Lassarade, nous ne faisons pas la confusion, seuls certains médecins sont déconventionnés par la CPAM à la suite d'une fraude : notre amendement vise cette catégorie, qui ne représente que 0,4 % de la profession.
Sur un autre point, monsieur Lévrier, le travail de notre collègue Nathalie Goulet a effectivement été une source d'inspiration.
Madame Pétrus, vous avez raison de soulever la problématique des moyens humains, que je relie à celle d'une meilleure utilisation des outils technologiques.
Madame Romagny, notre philosophie en matière de fraude sociale a consisté à calquer les moyens alloués aux administrations sur ceux dont les services disposent déjà pour lutter contre la fraude fiscale. France Travail, notamment, a insisté en ce sens, nos amendements visant à garantir l'effectivité du triptyque « Détecter, récupérer, sanctionner ».
Enfin, madame Brulin, il ne me semble pas qu'il s'agisse de détourner le regard de certains enjeux, mais plutôt d'adopter le point de vue le plus large possible.
De surcroît, la misère sociale concerne à la fois la personne qui perçoit une aide, mais aussi celui qui paye et qui cotise, qui est souvent un travailleur modeste ou un artisan qui peine à boucler ses fins de mois. Nous devons donc avoir la même rigueur et la même exigence morale à l'égard de celui qui perçoit et de celui qui cotise.
Mme Pascale Gruny. - Merci à nos rapporteurs pour cet excellent travail. La fraude est un vol, qu'elle soit le fait d'entreprises ou de bénéficiaires des prestations, et empêche par exemple d'accompagner correctement les personnes en situation de handicap.
Une meilleure information devrait être garantie, même si le droit à l'erreur existe heureusement. Il m'est arrivé, au cours de ma vie professionnelle en entreprise, d'avoir connaissance de la présence de faux salariés détachés, et sur des sujets particuliers tels que celui-ci, les administrations centrales devraient parfois communiquer davantage, et autrement que par des mails qui inondent nos boîtes de réception.
M. Jean Sol, président. - Je propose que la commission prenne acte des résultats des travaux de la commission des finances sur les articles qui lui ont été délégués, et adopte les articles 1er, 3 tel que modifié par l'amendement COM-98, 9, 15, 18, 19, 20 et 23 dans la rédaction qu'elle propose, ainsi que les amendements portant articles additionnels, à savoir l'amendement COM-99 portant article additionnel après l'article 3 et les amendements COM-103 rectifié, COM-100 et COM-101 portant articles additionnels après l'article 20.
De la même manière, je propose que la commission prenne acte des résultats des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et adopte l'article 8, tel que modifié par les amendements COM-111, COM-112, COM-113 et COM-114.
Article 1er
L'article 1er est adopté sans modification.
Après l'article 1er
L'amendement COM-2 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Les amendements COM-19 et COM-40 ne sont pas adoptés.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-115 prévoit l'extension de l'accès aux bases de données de l'administration fiscale au bénéfice des départements, des MDPH et de la Cnaf. S'agissant de l'amendement COM-26, qui vise à étendre l'accès aux mêmes bases de données patrimoniales au bénéfice des agents diplomatiques et consulaires, l'avis est défavorable, car nous ne maîtrisons pas suffisamment la question. Cependant, nous pourrions reconsidérer cet avis au vu des informations que le Gouvernement pourra nous donner, si l'amendement est redéposé en séance.
L'amendement COM-115 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-8 devient sans objet. L'amendement COM-26 n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Dans la même logique, nous émettons un avis défavorable à ce stade à l'amendement COM-76 qui concerne la formation des agents habilités à consulter les bases de données de la DGFiP.
L'amendement COM-76 n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-27 concerne également la communication d'informations nominatives détenues par l'administration fiscale au bénéfice des agents diplomatiques et consulaires. Notre avis est défavorable à ce stade et nous pourrons demander l'avis du Gouvernement ultérieurement.
L'amendement COM-27 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-29.
L'amendement COM-81 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 3
L'amendement COM-98 est adopté. L'amendement COM-5 n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 3
L'amendement COM-99 est adopté et devient article additionnel.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-77 vise à supprimer les programmes de contrôle et de lutte contre la fraude mis en place par les organismes de sécurité sociale, soit exactement l'inverse de ce que voulons faire. Avis défavorable.
L'amendement COM-77 n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-9 alourdit à notre sens la procédure malgré une intention louable, d'où un avis défavorable.
L'amendement COM-9 n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-116 vise à supprimer certaines imprécisions du texte.
L'amendement COM-116 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-117 prévoit l'extension de la dispense de consignation des organismes nationaux à la citation directe des auteurs présumés de fraude devant les tribunaux.
L'amendement COM-117 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 4
L'amendement COM-1 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 5
L'amendement rédactionnel COM-118 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-102 rectifié vise à restreindre l'accès aux données de santé aux seuls médecins-conseils, ce qui réduirait l'efficacité des actions menées afin de lutter contre la fraude. Cela reviendrait notamment à exclure les pharmaciens-conseils ainsi que les chirurgiens-dentistes-conseils du dispositif, alors même que la fraude en la matière est réelle. Avis défavorable.
L'amendement COM-102 rectifié n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-32 rectifié quater prévoit la consultation des organismes de représentants des professionnels de santé pour la prise des décrets. S'il est vrai que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) est la mieux à même de prendre en compte la sécurité des données de santé des assurés sociaux, l'avis des professionnels de santé permettra également d'avoir une vision opérationnelle sur les traitements informatiques rendus nécessaires par le présent article. Avis favorable.
L'amendement COM-32 rectifié quater est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-10 vise à préciser les modalités encadrées par le décret d'application. Avis favorable également.
L'amendement COM-10 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-119 vise à mieux assurer le niveau de sécurité des données personnelles de santé, en renvoyant à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, la détermination des garanties demandées aux intermédiaires de traitement employés par les organismes d'assurance maladie complémentaire.
L'amendement COM-119 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-120 prévoit une information par l'employeur de l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance de l'entreprise lors de la suspension du versement des indemnités journalières (IJ).
Si le code de la sécurité sociale prévoit une information de l'employeur par la CPAM lorsqu'elle suspend le versement d'IJ pour cause d'arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, cette dernière n'est tenue de transmettre aucune information à l'organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance de l'entreprise. Ce défaut de transmission s'explique par la méconnaissance des contrats couvrant les entreprises des assurés.
En revanche, l'employeur ayant souscrit ce contrat semble être à même de transmettre cette information à l'organisme complémentaire concerné. Cette transmission permet à la fois de lutter contre les abus et les fraudes aux arrêts de travail en limitant les indus versés au titre des garanties de prévoyance, et indirectement, à terme, de limiter les primes de contrat versées par l'employeur.
L'amendement COM-120 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-30, car le traitement des données de santé prévu par l'article 5 fait déjà l'objet d'un encadrement très restrictif, dans la mesure où il sera uniquement effectué par des professionnels de santé, dans l'unique but de lutter contre la fraude. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) est déjà couverte dans ce cadre, puisqu'elle n'est qu'un moyen de traitement parmi d'autres. L'amendement est donc satisfait.
L'amendement COM-30 n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Je ne suis pas favorable aux amendements identiques COM-82 et COM-39 rectifié bis, qui risquent d'affaiblir les contrôles.
Les amendements identiques COM-82 et COM-39 rectifié bis ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-83 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 6
L'article 6 est adopté sans modification.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-85 prévoit de supprimer l'obligation, pour les transporteurs sanitaires et les taxis, d'utiliser un dispositif de géolocalisation et un système électronique de facturation intégré. Une fois encore, la proposition va à l'encontre de nos objectifs, d'où un avis défavorable.
Je tiens à souligner que les dépenses engagées pour les transports ont atteint 6,7 milliards d'euros en 2024 et ont plus que doublé en l'espace de deux ans : il paraît donc indispensable de les réguler.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Il me semblait que cette obligation était déjà prévue à l'horizon 2027. Est-il question d'accélérer le calendrier ?
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'entrée en vigueur est bien prévue pour 2027, mais encore faut-il le préciser dans le texte. Cette obligation figurait dans les conventions, mais pas dans la loi : en procédant ainsi, nous lui conférons une force supérieure.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Il me semble que les médecins préfèrent que l'on respecte les conventions et que le législateur ne s'immisce pas dans ce type de dispositions.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Soit, mais notre choix permettra de décourager les éventuels contrevenants.
L'amendement COM-85 n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-11 ne nous semble pas utile dans la mesure où l'utilisation des données est déjà détaillée.
L'amendement COM-11 n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté sans modification.
Article 8
Les amendements COM-111 et COM-112 sont adoptés.
L'amendement COM-12 n'est pas adopté.
L'amendement COM-113 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-150 rectifié devient sans objet.
L'amendement COM-151 est retiré.
L'amendement COM-114 est adopté.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 8
L'amendement COM-33 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 9
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
L'amendement COM-97 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
L'article 9 est adopté sans modification.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-121 donne la possibilité aux agents chargés du contrôle du dispositif d'activité partielle de se voir transmettre des données relatives au chiffre d'affaires des entreprises concernées, sans se voir opposer le secret des affaires.
L'amendement COM-121 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Dans la même logique, l'amendement COM-122 vise à étendre le bénéfice du droit de communication aux agents des CAF qui accomplissent des actions de contrôle et de lutte contre la fraude sociale.
L'amendement COM-122 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-86 vise à restreindre le droit de communication aux seuls agents des CPAM, des Urssaf et des caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) ayant reçu une délégation expresse.
Or le présent article vise à renforcer ce droit de communication, les échanges d'informations étant importants, d'où un avis défavorable.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Il est bien question de responsabilité : auparavant, seuls les directeurs disposaient de ce droit de communication, et une délégation expresse paraît pertinente en ce qu'elle permet un contrôle. Pouvez-vous préciser ce que recouvre la formule « agents assermentés » ?
M. Olivier Henno, rapporteur. - Il s'agit d'agents « habilités » par les administrations, qui ne peuvent échanger qu'avec d'autres agents habilités d'autres services. Tel que rédigé, votre amendement limiterait ces échanges de données.
L'amendement COM-86 n'est pas adopté.
L'article 10 est adopté sans modification.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-59 prévoit de remplacer la possibilité de recouvrer la participation de l'assurance maladie au financement des cotisations du professionnel de santé frauduleux par une obligation.
Je ne suis pas opposé au principe de cet amendement, qui a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2024 afin de mieux sanctionner les professionnels de santé fraudeurs, mais il convient toutefois de laisser un pouvoir d'appréciation à l'assurance maladie.
L'amendement COM-59 n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-123 vise à consacrer expressément la mission de lutte contre la fraude de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), ainsi qu'à conférer à des agents - dûment habilités par le directeur général - un droit de communication autonome permettant à l'AGS d'obtenir tout renseignement et information.
L'amendement COM-123 est adopté et devient article additionnel.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-124 reprend la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité du droit de communication des juridictions financières qui avait été déposée par Philippe Mouiller. La Cour des comptes, habilitée à effectuer un certain nombre de contrôles, rencontre des difficultés dès lors qu'il est question de maisons-mères, comme dans l'affaire Orpea.
Notre amendement prévoit donc la création d'une sanction spécifique en cas d'obstacle à l'exercice du droit de communication.
L'amendement COM-124 est adopté et devient article additionnel.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-125 prévoit d'étendre à l'ensemble des agents susceptibles d'exercer une mission de contrôle d'un organisme de formation professionnelle la possibilité de recourir à l'anonymat dans le cas d'enquêtes concernant des formations en ligne. Il concerne particulièrement les agents de la Caisse des dépôts et consignations.
L'amendement COM-125 est adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-14 prévoit la création d'une habilitation spécifique des agents utilisant une identité d'emprunt dans le cadre de contrôles de la formation professionnelle. Il est selon nous satisfait, d'où un avis défavorable.
L'amendement COM-14 n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 12
L'amendement rédactionnel COM-126 est adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-127 vise à supprimer les alinéas relatifs à la dématérialisation de la notification d'AT-MP. Si l'absence de dématérialisation de la notification d'accident du travail ou de maladie professionnelle est dommageable, elle peut d'ores et déjà entraîner des sanctions. Ce mécanisme nous paraît préférable à la surcotisation prévue par l'article 12, qui induit une complexité inutile ; de plus, disposer d'un format papier permet aux agents des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) de faire preuve de discernement selon la situation de l'employeur, certaines entreprises n'étant pas en mesure de recourir à la dématérialisation dans les zones blanches du territoire.
L'amendement COM-127 est adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-20 prévoit la mise en place d'un délai d'instruction du recours en cas de surcotisation AT-MP pour absence de notification dématérialisée. Nous n'y sommes pas favorables, car il est satisfait.
L'amendement COM-20 n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-16 vise à préciser le délai dans lequel une preuve peut être apportée contre les constats des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité. Cet amendement est contraire à la volonté de son auteur, puisqu'il conduirait à limiter à dix jours seulement la possibilité de contester les constats des ingénieurs -conseils et des contrôleurs de sécurité, alors que la rédaction actuelle la permet sans limite de temps. Avis défavorable.
L'amendement COM-16 n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-17, là encore, est contraire à la volonté de son auteur, d'où un avis défavorable.
L'amendement COM-17 n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-13 prévoit la création d'une obligation de déclaration à la charge des entreprises dont il existe des indices qu'elles pourraient être éphémères. S'il est intéressant, nous considérons que cette discussion pourra avoir lieu en séance. Avis défavorable.
Les amendements COM-13 et COM-61 ne sont pas adoptés.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-58 conduirait à interdire aux employeurs de contracter avec d'autres acteurs économiques dans le cas où ils ont contesté le montant de leurs cotisations par voie de recours contentieux, ce qui nous semble assez rigide : des recours sont déposés, car des erreurs sont possibles, et un tel dispositif pourrait être préjudiciable pour un certain nombre d'entreprises. Avis défavorable.
L'amendement COM-58 n'est pas adopté.
Les amendements COM-65, COM-66, COM-67 et COM-68 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Je ne suis pas favorable à l'amendement COM-69, qui concerne une demande de rapport relatif à l'évaluation des procédures déclaratives des AT-MP.
L'amendement COM-69 n'est pas adopté.
Les amendements COM-70, COM-71 et COM-72 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-73 vise à doter la Cnam d'une nouvelle compétence en matière de contrôle et de sanction de la non-déclaration des AT-MP. Or nous pensons que les Carsat jouent ce rôle, d'où un avis défavorable.
L'amendement COM-73 n'est pas adopté.
Les amendements COM-74 et COM-75 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-91 rectifié vise à préciser la périodicité des contrôles en cas d'affection de longue durée (ALD). Si nous partageons l'objectif poursuivi au travers de cet amendement, nous préférons cependant privilégier une logique de ciblage à une généralisation. Avis défavorable.
L'amendement COM-91 rectifié n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-104 rectifié s'inscrit dans la même logique d'instauration de contrôles périodiques obligatoires, qui contreviennent à la logique de ciblage.
L'amendement COM-104 rectifié n'est pas adopté.
Article 13
L'amendement rédactionnel COM-128 est adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-79 prévoit l'instauration d'une pénalité décomptée des droits inscrits au CPF en cas d'absence aux examens de certification, tandis que l'amendement COM-78 vise à supprimer l'absence de prise en charge au titre du CPF des formations pour lesquelles le stagiaire ne se présente pas à l'examen de certification.
Si nous souhaitons préserver le bénéficiaire, il faut que la personne qui ne se présente pas à l'examen paye sa formation, et nous ne sommes donc pas favorables à ces deux amendements.
Les amendements COM-78 et COM-79 ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-129 vise, d'une part, à préciser que les « motifs légitimes » dont pourront se prévaloir les stagiaires absents à l'examen de la certification devront être précisés par décret, afin de prendre en compte tous les cas de force majeure qui exonéreront naturellement le stagiaire. D'autre part, il vise à clarifier que le titulaire du CPF ne se présentant pas à l'examen reste tenu de payer l'organisme de formation.
L'amendement COM-129 est adopté.
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-130 rectifié vise à renforcer les moyens de lutte contre les fraudes liées au CPF en renforçant le niveau d'information dont dispose la CDC.
D'une part, l'amendement donne la possibilité aux greffes des tribunaux de commerce de communiquer les renseignements utiles à la Caisse des dépôts ; d'autre part, l'amendement crée un dispositif de signalement pour les établissements bancaires teneurs des comptes des organismes de formation.
L'amendement COM-130 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-131 vise à réprimer le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle (CEP) sans avoir été habilité par France compétences.
L'amendement COM-131 est adopté et devient article additionnel.
Avant l'article 14
L'amendement COM-34 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-132 vise à étendre à l'ensemble des aides et des prestations sociales versées sous condition de ressources le principe selon lequel les revenus illicites doivent être pris en compte dans le calcul de l'aide par l'organisme le versant. Pour cela, il prévoit une communication des sommes identifiées par l'administration fiscale.
Initialement, le texte ne prévoyait d'intégrer les revenus illicites que pour le calcul des allocations liées au retour à l'emploi - allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) -, mais nous étendons avec cet amendement la disposition à l'ensemble des prestations. Certaines actions sont déjà envisageables, mais ne sont pas entreprises par l'administration, d'où notre volonté d'inscrire ces changements dans le texte.
L'amendement COM-132 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-133.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 15
L'amendement COM-18 est retiré.
L'article 15 est adopté sans modification.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-22 renvoie à un décret la précision des conditions de transmission des données comptables. Il est selon nous satisfait, et nous émettons un avis défavorable.
L'amendement COM-22 n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-134 prévoit de préciser que la suspension de la déclaration d'activité d'un organisme de formation en cas de manoeuvres frauduleuses soupçonnées est permise pour l'ensemble des contrôles menés par les agents de contrôle de la formation professionnelle.
L'amendement COM-134 est adopté, de même que l'amendement de précision rédactionnelle COM-135.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-23 prévoit la possibilité d'effectuer un recours contre les sanctions administratives, mais il nous semble qu'il est satisfait par l'amendement précédent.
L'amendement COM-23 n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-136 vise à lutter contre certains organismes qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d'emprise, d'entrisme ou conduire des bénéficiaires à l'exercice illégal d'activités professionnelles réglementées.
Afin d'exclure de l'accès aux financements publics de ces organismes, il est proposé de préciser que donnent lieu à remboursement les actions de formation conduisant à l'exercice d'une activité réglementée, notamment médicale, sans que les formateurs ainsi que les bénéficiaires ne disposent des diplômes, titres et qualités requis ; les formations au cours desquelles les organismes ne respectent pas les principes fondamentaux, en prévoyant par exemple des formations réservées uniquement aux hommes.
L'amendement COM-136 est adopté et devient article additionnel.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-137 vise à renforcer le contrôle a priori des structures déposant une déclaration d'activité afin de dispenser des actions de formation. Il est ainsi proposé de refuser l'enregistrement des organismes de formation ayant été sévèrement sanctionnés par les services de contrôle moins de quatre ans avant la nouvelle demande d'activité ; des organismes ayant fait l'objet d'un contrôle de leurs dépenses ou de leurs activités et n'ayant pas acquitté la sanction financière ; enfin, des organismes se présentant comme des centres de formation d'apprentis (CFA), mais qui ne disposent pas de locaux permettant de justifier de leur capacité à réaliser ces actions de formation.
L'amendement COM-137 est adopté et devient article additionnel.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-87 vise à supprimer l'alignement du contrôle de la surprescription entre les professionnels de santé et les structures collectives, alors que le rapport de la Cour des comptes souligne des pratiques discutables de certaines plateformes de téléconsultation. L'adoption de cet amendement conduirait à renoncer à un contrôle équivalent entre les structures de téléconsultation et les praticiens traditionnels, ce qui serait aberrant.
Les amendements identiques COM-15 rectifié bis et COM-88 rectifié bis suppriment la possibilité, pour l'assurance maladie, de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO) pour les médecins surprescripteurs. Or la MSO, issue d'une procédure contradictoire, est un outil efficace et proportionné : elle permet une réduction moyenne de 30 % des prescriptions sans sanction, tout en respectant les droits du praticien - 30 % des procédures sont ainsi abandonnées après les observations du médecin.
Elle ne sanctionne pas une faute, mais une pratique objectivement surprescriptive, identifiée à partir d'un taux de prescription deux fois supérieur à la moyenne. Depuis septembre 2025, le ciblage est plus fin : il prend en compte la typologie de la patientèle, les caractéristiques socio-économiques et l'offre de soins locale.
De plus, la mesure ne concerne qu'une infime minorité de praticiens - moins de 0,4 % en 2024 - suivis individuellement par un pair. Enfin, ce dispositif a généré 160 millions d'euros d'économies en 2023-2024 et ne heurte pas, à notre sens, la liberté de prescrire. Avis défavorable.
L'amendement COM-87 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques COM-15 rectifié bis et COM-88 rectifié bis.
L'amendement de correction COM-138 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-84 a pour objet de dérembourser l'ensemble des prescriptions émises par les médecins déconventionnés, mais, une fois encore, un médecin déconventionné n'est pas nécessairement un fraudeur, d'où un avis défavorable.
À l'inverse, l'amendement COM-139 renforce la cohérence et l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude à l'assurance maladie. Aujourd'hui, un professionnel de santé déconventionné pour fraude voit ses consultations être remboursées sur la base d'un tarif d'autorité d'environ un euro selon la spécialité. Toutefois, ses prescriptions continuent d'être remboursées, ce qui crée une incohérence majeure. Ces praticiens échappent ainsi à tout contrôle de la régulation des prescriptions, contrairement à leurs confrères conventionnés.
L'amendement COM-84 n'est pas adopté. L'amendement COM-139 est adopté.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 17
L'amendement COM-28 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Nous émettons un avis défavorable à l'amendement COM-35 rectifié bis avant une éventuelle autre rédaction, car son intention nous semble intéressante.
L'amendement COM-35 rectifié bis n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-37 rectifié bis vise à suspendre le tiers payant à l'encontre des professionnels de santé pour lesquels une décision de déconventionnement a été prise par la CPAM en raison d'une fraude à l'assurance maladie. Cependant, cet amendement ne respecte pas le droit à un délai de recours, d'où un avis défavorable.
L'amendement COM-37 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-60 prévoit d'augmenter la majoration applicable aux redressements pour travail dissimulé. Déjà présenté lors du précédent PLF, il avait reçu un avis défavorable de la commission puisqu'il prévoit de lourdes majorations - de 90 % au lieu de 45 % et de 120 % au lieu de 60 % -, ce qui semble exagéré.
En revanche, l'amendement COM-62 prévoit porter de 25 % à 35 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 40 % à 50 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d'une personne mineure, ce qui m'amène à émettre un avis favorable.
L'amendement COM-60 n'est pas adopté. L'amendement COM-62 est adopté et devient article additionnel.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-64 vise à abroger l'article du code de la sécurité sociale qui encadre la durée des contrôles réalisés par les organismes de recouvrement. Or nous soutenons cet article et émettons donc un avis défavorable.
L'amendement COM-64 n'est pas adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-38 rectifié bis prévoit la suspension du tiers payant pour les assurés ayant commis une fraude à l'assurance maladie pour une durée temporaire. Avis favorable.
L'amendement COM-38 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Je ne suis pas favorable à l'amendement COM-21, qui a pour objet une demande de rapport.
L'amendement COM-21 n'est pas adopté.
Article 18
L'amendement COM-110 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
L'article 18 est adopté sans modification.
Après l'article 18
Les amendements COM-3, COM-109, COM-108, les amendements identiques COM-44 et COM-105, les amendements identiques COM-45 et COM-106 et les amendements identiques COM-46 et COM-107 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 19
L'article 19 est adopté sans modification.
Après l'article 19
L'amendement COM-4 n'est pas adopté.
Avant l'article 20
Les amendements COM-41, COM-42 et COM-93 ne sont pas adoptés.
Article 20
L'article 20 est adopté sans modification.
Après l'article 20
L'amendement COM-94 n'est pas adopté.
Les amendements COM-7 rectifié, COM-43 et COM-95 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
L'amendement COM-103 rectifié est adopté et devient article additionnel.
L'amendement COM-92 n'est pas adopté.
Les amendements COM-100 et COM-101 sont adoptés et deviennent articles additionnels.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Nous ne sommes pas favorables à l'amendement COM-24, qui n'apporte pas de valeur ajoutée par rapport aux dispositions qui figurent déjà dans le code de la sécurité sociale.
L'amendement COM-24 n'est pas adopté.
L'amendement de coordination COM-140 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-141 prévoit l'extension du caractère immédiat de la contrainte aux infractions constitutives de travail illégal.
L'amendement COM-141 est adopté.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-31 dont l'objectif est louable. L'administration fiscale utilise déjà des méthodes de datamining, qui croisent des données issues des fichiers suivants : fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (Ficovie), compte fiscal des professionnels (Adélie), systèmes d'information des impôts (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe foncière, impôt sur la fortune immobilière...), base nationale de données patrimoniales (BNDP).
L'usage de l'IA en matière de fraude sociale est cependant complexe en ce qu'il peut concerner des données de santé. Le dispositif de cet amendement mériterait d'être sécurisé juridiquement, et nous ne pouvons en tout état de cause nous passer d'une expertise de la Cnil pour nous assurer de la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD).
L'amendement COM-31 n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-142 vise à préciser les circonstances dans lesquelles les maîtres d'ouvrage devront s'assurer de l'authenticité des documents, c'est-à-dire si un doute est permis au vu des informations que le maître d'ouvrage ne peut ignorer. Cette précision évitera les vérifications systématiques, mais exigera des maîtres d'ouvrage de mener les contrôles nécessaires.
L'amendement COM-142 est adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-143 vise à renforcer le nouveau devoir de vigilance imposé au maître d'ouvrage pour éviter l'infraction au travail dissimulé chez un sous-traitant.
Il prévoit d'abord d'obliger les maîtres d'ouvrage à remettre aux agents de contrôle les documents justifiant que l'entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de tous ses sous-traitants.
Ensuite, il vise à étendre aux maîtres d'ouvrage le risque d'encourir l'annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, en cas de méconnaissance de son devoir de vigilance et d'infraction chez le sous-traitant.
L'amendement COM-143 est adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-63 prévoit de supprimer le taux réduit de majoration appliqué aux personnes commettant une infraction de travail dissimulé lorsque ces personnes s'acquittent dans un certain délai de leurs cotisations redressées. Il s'agit d'un mécanisme qui facilite le recouvrement, d'où un avis défavorable.
L'amendement COM-63 n'est pas adopté.
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-144 vise à renforcer le dispositif dit de « liste noire », en vertu duquel un employeur reconnu coupable de travail dissimulé peut être condamné à une peine complémentaire de diffusion de sa condamnation sur un site internet du ministère du travail.
Ce dispositif étant somme toute peu utilisé, il est proposé de simplifier les trois régimes applicables en harmonisant, d'une part, les régimes de diffusion, avec une durée maximale unique de deux ans ; d'autre part, en supprimant, dans tous les cas, l'exigence d'une amende à titre principal pour permettre la condamnation à cette diffusion.
L'amendement COM-144 est adopté et devient article additionnel.
Article 23
L'article 23 est adopté sans modification.
Article 24
L'amendement de coordination COM-145 est adopté.
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement COM-146 prévoit d'exclure des indus frauduleux de RSA de la recevabilité du rétablissement personnel et de limiter dans le temps le cumul avec les revenus d'auto-entrepreneur.
L'amendement COM-146 est adopté et devient article additionnel.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-147 vise à supprimer l'effet suspensif de l'opposition à la contrainte en cas de manoeuvre frauduleuse des organismes de formation, afin de permettre à la CDC de mieux recouvrer les sommes indûment versées.
L'amendement COM-147 est adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-89 prévoit l'instauration d'un délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut former opposition à la contrainte. Avis défavorable, car ce point relève du domaine réglementaire.
L'amendement COM-89 n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-25 vise à préciser les conditions dans lesquelles une contrainte peut être délivrée à l'encontre d'un titulaire du CPF : là encore, cet aspect relève du domaine réglementaire.
L'amendement COM-25 n'est pas adopté.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-90 vise à préciser que l'opposition formée par le titulaire du compte n'entraîne aucun frais à sa charge. Avis défavorable, car ce point a vocation à être traité par voie réglementaire.
L'amendement COM-90 n'est pas adopté.
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 26
L'article 26 est adopté sans modification.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous sommes défavorables à l'amendement de suppression COM-80.
L'amendement COM-80 n'est pas adopté.
L'article 27 est adopté sans modification.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement COM-148 vise à donner à France Travail les moyens de remplir sa mission de lutte contre la fraude, en conférant à ses agents la possibilité d'interroger le fichier des compagnies aériennes, un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie, la possibilité d'interroger le registre des Français établis hors de France et, enfin, la possibilité de traiter les données de connexion des inscrits à France Travail à la seule fin de lutte contre la fraude.
En outre, cet amendement permet au directeur général de France Travail de suspendre, à titre conservatoire, le versement d'une allocation en cas d'indices sérieux de fraude. Cette suspension serait possible sous des garanties, notamment de respect du contradictoire.
L'amendement COM-148 est adopté et devient article additionnel.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Suivant la même logique que l'amendement précédent, l'amendement COM-149 vise à permettre aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire les prestations en cas de doute sérieux de fraude.
L'amendement COM-149 est adopté et devient article additionnel.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est close à 11 h 30.
TABLEAU DES SORTS
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
TITRE Ier : AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE |
|||
|
Chapitre Ier : Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude |
|||
|
Articles additionnels après l'article 1er |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
2 |
Création d'une amende forfaitaire pour deìtention sans motif leìgitime de marchandises preìsenteìes sous une marque contrefaisante |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme Nathalie GOULET |
19 |
Création d'un mécanisme prévoyant que la liquidation de la TVA soit réalisée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services, dès lors que ces livraisons sont réalisées dans des secteurs identifiés comme exposés à des risques élevés de fraude à la TVA |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
40 |
Demande de rapport sur l'opportunité de fusionner le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (COLB) et la mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF) |
Rejeté |
|
Article 2 |
|||
|
M. HENNO, rapporteur |
115 |
Extension de l'accès aux bases de données de l'administration fiscale au bénéfice des départements et des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et de la caisse nationale des allocations familiales |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
26 |
Extension de l'accès aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale au bénéfice des agents diplomatiques et consulaires |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
8 |
Renforcement des garanties quant à l'accès aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale |
Satisfait ou sans objet |
|
Mme PONCET MONGE |
76 |
Renforcement de la formation des agents habilités des organismes de protection sociale quant à la protection des données accessibles dans les fichiers de l'administration fiscale |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 2 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
27 |
Communication d'informations nominatives détenues par l'administration fiscale au bénéfice des agents diplomatiques et consulaires |
Rejeté |
|
M. KHALIFÉ |
29 rect. |
Recours par les organismes à des systèmes d'intelligence artificielle |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
81 |
Instauration d'un régime de nullité des décisions administratives fondées sur un algorithme sans information de l'intéressé |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Article 3 |
|||
|
M. DELCROS, rapporteur pour avis |
98 |
Amendement de clarification rédactionnelle |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
5 |
Information de l'entreprise concernée par la décision de radiation d'office du RNE |
Rejeté |
|
Article) additionnels après l'article 3 |
|||
|
M. DELCROS, rapporteur pour avis |
99 |
Possibilité pour l'administration fiscale et l'administration des douanes de demander aux établissements de crédit et assimilés des informations sous format dématérialisé |
Adopté |
|
Article 4 |
|||
|
Mme PONCET MONGE |
77 |
Suppression des programmes de contrôle et de lutte contre la fraude diligentés par les organismes de sécurité sociale |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
9 |
Précision du dispositif de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour assurer la traçabilité des échanges |
Rejeté |
|
M. HENNO, rapporteur |
116 |
Amendement de sécurisation du dispositif de plainte pénale unique |
Adopté |
|
M. HENNO, rapporteur |
117 |
Extension de la dispense de consignation des organismes nationaux à la citation directe des auteurs présumés de fraude devant les tribunaux |
Adopté |
|
Articles additionnel(s) après Article 4 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
1 |
Conditions d'authenticité des actes d'état civil étranger |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Article 5 |
|||
|
M. HENNO, rapporteur |
118 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme MICOULEAU |
102 rect. |
Restriction de l'accès aux données de santé aux seuls médecins conseils |
Rejeté |
|
M. MILON |
32 rect. quater |
Consultation des organismes de représentants des professionnels de santé pour la prise des décrets |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
10 |
Précision des modalités encadrées par le décret d'application |
Adopté |
|
M. HENNO, rapporteur |
119 |
Précision par décret des garanties de sécurité relatives au traitement des données de santé par un tiers |
Adopté |
|
M. HENNO, rapporteur |
120 |
Information par l'employeur de l'organisme complémentaire en charge du contrat de prévoyance de l'entreprise lors de la suspension du versement d'indemnités journalières |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 5 |
|||
|
M. KHALIFÉ |
30 rect. |
Encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le traitement des données de santé par les organismes complémentaires |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
82 |
Mise en place d'un système de signalement commun à l'assurance maladie obligatoire et complémentaire |
Rejeté |
|
Mme DEMAS |
39 rect. bis |
Mise en place d'un système de signalement commun à l'assurance maladie obligatoire et complémentaire |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
83 |
Interdiction de publicité pour les équipements optiques et les aides auditives |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Article 7 |
|||
|
Mme PONCET MONGE |
85 |
Suppression de l'obligation pour les transporteurs sanitaires et les taxis d'utiliser un dispositif de géolocalisation et un système électronique de facturation intégré |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
11 |
Précision quant à la finalité des données récoltées par le biais de la géolocalisation et à la procédure en cas d'utilisation de ces données pour sanctionner l'entreprise |
Rejeté |
|
Article 8 |
|||
|
M. DUFFOURG, rapporteur pour avis |
111 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
12 |
Application d'un principe contradictoire dans la mise en oeuvre des sanctions administration de radiation du registre des exploitants VTC et d'interdiction de s'y réinscrire |
Rejeté |
|
M. DUFFOURG, rapporteur pour avis |
112 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
M. DUFFOURG, rapporteur pour avis |
113 |
Rehaussement du plafond annuel de l'amende visant les plateformes ne respectant pas l'obligation de vigilance |
Adopté |
|
M. FERNIQUE |
150 rect. |
Rehaussement de l'amende visant les plateformes ne respectant pas l'obligation de vigilance et de son plafond annuel |
Satisfait ou sans objet |
|
M. FERNIQUE |
151 |
Interdiction pour les plateformes ne respectant pas leur devoir de vigilance de contractualiser avec des exploitants pendant une durée pouvant aller jusqu'à un an |
Retiré |
|
M. DUFFOURG, rapporteur pour avis |
114 |
Rehaussement du quantum des peines en matière d'exercice illicite des professions du T3P |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 8 |
|||
|
M. JACQUIN |
33 |
Interdiction des prêts de compte pour les livreurs des plateformes numériques |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Article 9 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
6 |
Possibilité de recours auprès du président de la chambre de l'instruction en cas d'avis défavorable du juge d'instruction à la transmission de pièces de la procédure pénale à l'Autorité des marchés financiers |
Rejeté |
|
M. CANÉVET |
97 |
Partage par les sociétés mères bancaires à leurs filiales sociétés de financement des informations contenues dans le fichier national créé par la loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Chapitre II : Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle |
|||
|
Article 10 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
121 |
Extension du droit de communication aux agents en charge du contrôle du dispositif d'activité partielle |
Adopté |
|
M. HENNO, rapporteur |
122 |
Extension du droit de communication aux agents des caisses d'allocations familiales (CAF) qui accomplissent des actions de contrôle et de lutte contre la fraude sociale |
Adopté |
|
Mme PONCET MONGE |
86 |
Restriction du droit de communication aux seuls agents ayant reçu une délégation expresse |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 10 |
|||
|
Mme PONCET MONGE |
59 |
Obligation pour l'assurance maladie de recouvrer sa participation au financement des cotisations du professionnel frauduleux |
Rejeté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
123 |
Consécration législative des missions de contrôle et du droit de communication du régime de garantie des salaires |
Adopté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
124 |
Renforcement de l'effectivité du droit de communication des juridictions financières |
Adopté |
|
Article 11 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
125 |
Extension des agents pouvant recourir à l'anonymat dans leurs enquêtes concernant des organismes de formation en ligne |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
14 |
Création d'une habilitation spécifique des agents utilisant une identité d'emprunt dans le cadre de contrôles de la formation professionnelle |
Rejeté |
|
Article 12 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
126 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
127 |
Maintien de la sanction financière en cas d'absence de dématérialisation de la notification d'AT-MP par l'employeur |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
20 |
Mise en place d'un délai d'instruction du recours en cas de surcotisation AT-MP pour absence de notification dématérialisée |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
16 |
Précision du délai dans lequel une preuve peut être apportée contre les constats des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
17 |
Précision du délai dans lequel une preuve peut être apportée contre les constats des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 12 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
13 |
Création d'une obligation de déclaration à la charge des entreprises dont il existe des indices qu'elles pourraient être éphémères. |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
61 |
Création d'une obligation de déclaration à la charge des entreprises dont il existe des indices qu'elles pourraient être éphémères. |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
58 |
Refus de délivrance d'attestation relative aux obligations déclarative et de paiement |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
65 |
Demande de rapport relatif au coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
66 |
Formation des internes de médecine générale aux enjeux des accidents du travail et maladies professionnelles |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
67 |
Prise en compte des accidents du travail et maladie professionnelle par la triennale de développement professionnel continu |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
68 |
Prise en compte des accidents du travail et maladie professionnelle dans le plan de compétence des établissements publics de santé |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
69 |
Demande de rapport relatif à l'évaluation des procédures déclaratives des AT-MP |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
70 |
Inclure les déclarations d'AT-MP dans l'espace numérique de santé |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
71 |
Élargissement d'une expérimentation de santé publique relative à l'exposition aux facteurs de risques professionnels |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
72 |
Modification du contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
73 |
Ajout d'une compétence de la Caisse nationale d'assurance maladie en matière de contrôle et sanction de la non-déclaration des AT-MP |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
74 |
Précision par décret des examens requis aux fins de diagnostic des maladies professionnelles |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme PONCET MONGE |
75 |
Mise en place d'une révision des tableaux de maladies professionnelles après un avis de l'Agence nationale de sécurité alimentaire |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. ROCHETTE |
91 rect. |
Précision de la périodicité des contrôles en cas d'affection de longue durée |
Rejeté |
|
M. ROCHETTE |
104 rect. |
Précision de la périodicité des contrôles en cas de mi-temps thérapeutique |
Rejeté |
|
TITRE II : ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS |
|||
|
Chapitre Ier : Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires |
|||
|
Article 13 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteur |
128 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme PONCET MONGE |
78 |
Suppression de l'absence de prise en charge au titre du CPF des formations pour lesquelles le stagiaire ne se présente pas à l'examen de certification |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
79 |
Instauration d'une pénalité décomptée des droits inscrits au CPF en cas d'absence aux examens de certification |
Rejeté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
129 |
Précision par décret des motifs légitimes justifiant une absence à un examen et garantie du paiement à l'organisme de formation |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 13 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
130 rect. |
Instauration d'échanges d'information entre les greffiers des tribunaux de commerce et les établissements bancaires |
Adopté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
131 |
Création d'une amende réprimant de le fait de se prévaloir faussement de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle |
Adopté |
|
Articles additionnels avant l'Article 14 |
|||
|
M. JACQUIN |
34 |
Présomption légale de salariat des travailleurs de plateforme en cas d'utilisation d'un algorithme |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Article 14 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
132 |
Extension de la prise en compte des revenus illicites pour le calcul de l'ensemble des prestations sous condition de ressources |
Adopté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
133 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 15 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
18 |
Suppression de l'article 15 concernant l'extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux transactions réalisées par tout moyen de paiement auprès d'un commerçant de biens de haute valeur |
Retiré |
|
Article 16 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
22 |
Renvoi à un décret la précision des conditions de transmission des données comptables |
Rejeté |
|
Mme PUISSAT, rapporteur |
134 |
Extension de la possibilité de suspendre la déclaration d'activité d'un organisme de formation en cas de manoeuvres frauduleuses |
Adopté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
135 |
Amendement de précision rédactionnelle et d'harmonisation de la procédure contentieuse des sanctions |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
23 |
Possibilité d'effectuer un recours contre les sanctions administratives |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 16 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
136 |
Création d'obligations de respect des principes républicains et de compétence professionnelle pour les organismes de formation professionnelle |
Adopté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
137 |
Renforcement du contrôle a priori des structures déposant une une déclaration d'activité |
Adopté |
|
Article 17 |
|||
|
Mme PONCET MONGE |
87 |
Suppression de l'extension du périmètre de contrôle de la sur-prescription pour les centres de santé et les plateformes de téléconsultation, ainsi que de la possibilité d'imposer la mise sous objectif |
Rejeté |
|
M. HENNO, rapporteur |
138 |
Correction d'une erreur matérielle |
Adopté |
|
M. MILON |
15 rect. bis |
Suppression de la transformation de la mise sous objectif en obligation |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
88 rect. bis |
Suppression de la possibilité d'imposer la mise sous objectif par la Cpam |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
84 |
Déremboursement des prescriptions de l'ensemble des médecins déconventionnés |
Rejeté |
|
M. HENNO, rapporteur |
139 |
Déremboursement des prescriptions des médecins déconventionnés pour fraude |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 17 |
|||
|
M. KHALIFÉ |
28 rect. |
Création d'un ordre national des audioprothésistes |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme DEMAS |
35 rect. bis |
Transmission de la liste de l'ensemble des professionnels de santé ayant exercé ou exerçant dans un centre de santé suspendu ou fermé pour fraude à la Cnam et aux ordres |
Rejeté |
|
Mme DEMAS |
37 rect. bis |
Suspension du tiers payant à l'encontre des professionnels de santé dès la notification de la décision de déconventionnement pour fraude |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
60 |
Augmentation de la majoration applicable aux redressements pour travail dissimulé |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
62 |
Augmentation de la majoration opérée pour un premier redressement pour travail dissimulé |
Adopté |
|
Mme PONCET MONGE |
64 |
Suppression de l'article qui encadre la durée des contrôles réalisés par les organismes de recouvrement |
Rejeté |
|
Mme DEMAS |
38 rect. bis |
Suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour une fraude à l'assurance maladie. |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
21 |
Demande de rapport sur sur la situation du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et sur le nombre de contrôles effectués |
Rejeté |
|
Article 18 |
|||
|
M. KHALIFÉ |
110 |
Inclusion du trafic de tabac parmi les dispositions dans le champ de l'article de la la procédure applicable pour les crimes les plus graves |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Articles additionnels après l'article 18 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
3 |
Rehaussement des peines encourues pour les deìlits de contrefacon les plus graves |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. KHALIFÉ |
109 |
Confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. KHALIFÉ |
108 |
Introduire des circonstances aggravantes spécifiques applicables aux délits douaniers portant sur les produits du tabac |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. CANÉVET |
44 |
Conditionner l'accès aux aides publiques à une attestation d'expert-comptable. |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. KHALIFÉ |
105 |
Conditionner l'accès aux aides publiques à une attestation d'expert-comptable. |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. CANÉVET |
45 |
Communication par l'administration fiscale à l'ordre des experts-comptables les informations nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. KHALIFÉ |
106 |
Communication par l'administration fiscale à l'ordre des experts-comptables les informations nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. CANÉVET |
46 |
Alourdir les sanctions pénales en cas d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. KHALIFÉ |
107 |
Alourdir les sanctions pénales en cas d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Articles additionnels après l'article 19 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
4 |
Diminution du seuil au delà duquel les entreprises sont soumises aux obligations de documentation relatives aux prix de transfert |
Rejeté |
|
Articles additionnels avant l'article 20 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
41 |
Interdiction de révéler l'identité des agents de la Direction Générale des Finances Publiques affectés à l'Office national anti-fraude |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
42 |
Garantir l'anonymat des huissiers et agents de recouvrement |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
93 |
Demande de rapport au Parlement sur l'opportunité de la création d'une "plateforme nationale des interceptions judiciaires" bancaire |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 20 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
94 |
Élaboration d'un référentiel national de vigilance et de conformité des domiciliataires agréés |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
7 rect. |
Interdiction de la vente d'or au déballage |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. CANÉVET |
43 |
Renforcement de la lutte contre la dégradation des compteurs d'électricité ou de gaz |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
M. SOL |
95 |
Renforcement de la lutte contre la dégradation des compteurs d'électricité ou de gaz |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Mme Nathalie GOULET |
103 rect. |
Droit de copie de l'administration fiscale dans le cadre du contrôle des organismes délivrant des reçus fiscaux |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
92 |
Obligation pour les agents de la DGFiP d'élaborer les procès-verbaux sous forme dématérialisée dans le cadre des perquisitions fiscales |
Rejeté |
|
M. DELCROS, rapporteur pour avis |
100 |
Possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques de contrôler les terminaux de paiement électronique des professionnels |
Adopté |
|
M. DELCROS, rapporteur pour avis |
101 |
Demande d'évaluation du dispositif de collecte de la taxe sur les transactions financières |
Adopté |
|
TITRE III : GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE |
|||
|
Article 21 |
|||
|
Mme Nathalie GOULET |
24 |
Définition de la flagrance sociale dans le code de la sécurité sociale |
Rejeté |
|
M. HENNO, rapporteur |
140 |
Amendement de coordination légistique |
Adopté |
|
M. HENNO, rapporteur |
141 |
Extension du caractère immédiatement de la contrainte aux infractions constitutives de travail illégal |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 21 |
|||
|
M. KHALIFÉ |
31 rect. |
Introduction d'outils de ciblage d'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude. |
Rejeté |
|
Article 22 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
142 |
Précision des circonstances dans lesquelles le maître d'ouvrage procède à la vérification de l'authenticité des documents reçus dans le cadre de son devoir de vigilance |
Adopté |
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
143 |
Renforcement du devoir de vigilance imposé au maître d'ouvrage pour éviter l'infraction au travail dissimulé chez un sous-traitant |
Adopté |
|
Mme PONCET MONGE |
63 |
Suppression du taux réduit de majoration appliqué aux personnes commettant une infraction de travail dissimulé |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 22 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
144 |
Renforcement et harmonisation des peines complémentaires de diffusion des condamnations pour travail illégal |
Adopté |
|
Article 24 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
145 |
Amendement de coordination légistique |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 24 |
|||
|
M. HENNO, rapporteur |
146 |
Exclusion des indus frauduleux de RSA de la recevabilité du rétablissement personnel et limitation dans le temps du cumul avec les revenus d'auto-entrepreneur |
Adopté |
|
Article 25 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
147 |
Suppression de l'effet suspensif des contraintes délivrées par la Caisse des dépôts contre des organismes fraudeurs |
Adopté |
|
Mme PONCET MONGE |
89 |
Instauration d'un délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut former opposition à la contrainte |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
25 |
Précision des conditions dans lesquelles une contrainte peut être délivrée à l'encontre d'un titulaire du CPF |
Rejeté |
|
Mme PONCET MONGE |
90 |
Précision selon laquelle l'opposition formée par le titulaire du compte n'entraîne à sa charge aucun frais |
Rejeté |
|
Article 27 |
|||
|
Mme PONCET MONGE |
80 |
Amendement de suppression |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 27 |
|||
|
Mme PUISSAT, rapporteure |
148 |
Création de prérogatives de France travail pour mieux détecter et traiter les cas de fraude aux allocations |
Adopté |
|
M. HENNO, rapporteur |
149 |
Possibilité pour les organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire les prestations en cas de doute sérieux de fraude |
Adopté |
RÈGLES RELATIVES
À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44
BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »204(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie205(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte206(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial207(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 5 novembre 2025, le périmètre indicatif du projet de loi n° 24 (2025-2026) relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- aux échanges d'informations dont bénéficient les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés du service de prestations sociales pour lutter contre la fraude ;
- aux obligations incombant aux organismes de protection sociale en matière de lutte contre la fraude ;
- au traitement et à l'échange de données entre organismes obligatoires et d'autres services de l'État, ainsi qu'avec les organismes complémentaires de protection sociale ;
- aux dispositifs de contrôle relatifs au transport sanitaire ;
- à la lutte contre la fraude dans le champ des risques professionnels ;
- aux moyens de lutte contre la fraude dévolus à l'opérateur France Travail ;
- à l'identification, à la taxation et à la prise en compte des revenus illicites dans le versement de prestations ;
- à la lutte contre la fraude dans le domaine de la formation professionnelle ;
- à la lutte contre le travail dissimulé ;
- à la régulation des professionnels de santé, des centres de santé et des plateformes de téléconsultations commettant des manquements ;
- aux sanctions en matière de fraude sociale, et notamment à l'encontre des professionnels de santé ayant des agissements frauduleux ;
- au recouvrement de cotisations et contributions sociales, de prestations sociales ou d'allocations indûment versées en raison d'une fraude ;
- les dispositions relatives aux échanges d'informations entre administrations, autorités administratives indépendantes et autorités judiciaires, en matière de lutte contre la fraude fiscale ;
- aux règles d'assujettissement des professionnels aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
- à la procédure judiciaire et aux sanctions applicables aux infractions se rapportant aux délits de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale, au délit de fraude fiscale, aux délits comptables et au délit d'escroquerie aux finances publiques ;
- aux obligations déclaratives des assujettis vis-à-vis de l'administration fiscale ;
- aux délais de reprise de l'administration fiscale ;
- aux moyens de contrôle et d'enquête des services compétents en matière de lutte contre la fraude fiscale ;
- aux procédures et moyens de contrôle et aux procédures de sanction destinées à lutter contre les faux professionnels et le travail dissimulé dans le secteur des transports publics particuliers de personnes (T3P) et, en conséquence, contre la fraude sociale et fiscale dans ce secteur ;
- aux obligations de vigilance applicables aux plateformes d'emploi dans le secteur des VTC vis-à-vis des exploitants VTC et aux procédures de contrôle et de sanction afférentes à ces obligations.
LISTE DES
PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Auditions
· Mission interministérielle de coordination anti-fraude (Micaf)
Eric Belfayol, chef de la MICAF
· Direction générale du travail (DGT)
Sacha Reingewirtz, adjoint à la sous directrice des relations du travail
Elodie Boceno, adjointe au chef de bureau des relations individuelles du travail
· Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
Rachel Becuwe, cheffe de service et adjointe du délégué général
Chloé Boyaval, conseillère relations extérieures et élus
· Mouvement des entreprises de France (Medef)
France Henry-Labordère, responsable du Pôle social
Nathalie Buet, directrice de la protection sociale
Antoine Bessière, chargé de mission protection sociale
Marie David, chargée de mission affaires publiques
· Confédération des petites et moyennes entreprise (CPME)
Gilles Bonnefond, chef de file de la CPME au Conseil de la CNAM
Philippe Chognard, responsable du pôle condition de travail
Claire Richier, juriste affaires sociales
Adrien Dufour, responsable affaires publiques
· Force Ouvrière (FO)
Patricia Drevon, secrétaire confédérale en charge de l'organisation, des affaires juridiques et de l'Outre-Mer
Olivier Brunel, secrétaire du syndicat de la direction générale des finances publiques (DGFIP)
· Caisse des dépôts et consignations
Pierre Chevalier, directeur des affaires juridiques, conformité et déontologie, déontologue
Gwenola Martin, directrice de la formation professionnelle - direction des politiques sociales
Dorian Boujon, responsable du département contentieux, règlement amiable et consignations - direction des affaires juridiques, conformité et déontologie
Giulia Carré, directrice des relations institutionnelles
· France compétences
Hugues de Balathier-Lantage, directeur général adjoint
· Direction de la sécurité sociale (DSS)
Delphine Champetier, adjointe au directeur
Cécile Martin, chargée de mission
Charles Boriaud, adjoint au sous-directeur du financement de la Sécurité sociale
Silvère Ghesquière, adjoint à la cheffe du bureau du recouvrement
Maroussia Perehinac, adjointe à la sous-directrice de l'accès aux soins des prestations familiales et des AT-MP
· France Travail
Frédéric Toubeau, directeur général adjoint opérations
Hachémi Lamari, responsable du département prévention et lutte contre la fraude
Elisabeth Gueguen, directrice de l'indemnisation et de la réglementation
· Fédération française du bâtiment (FFB)
Séverin Abbatucci, secrétaire général
Magali Sagny, juriste à la direction des affaires sociales
Léa Ligneres, chargée d'études
· Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR)
Catherine De Bruyne, directrice de la négociation collective et de la protection sociale
· Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH)
Philippe Carrion, directeur général
Contributions écrites
· Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
· Union nationale des taxis (UNT)
· Direction générale des Finances publiques (DGFiP)
· Fédération Nationale de la mobilité sanitaire (FNMS)
· Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS)
· Fédération nationale du taxi (FNDT)
· Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP)
· Départements de France (DF)
· Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI)
· Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
· Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
· Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI)
· Union des entreprises de proximité (U2P)
· Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA-Ambulances)
· Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf)
· Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
· Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-024.html
* 1 Articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
* 2 Article 6 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
* 3 Article 189 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020.
* 4 Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales ».
* 5 Arrêté du 13 septembre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PATRIM »
* 6 Arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie.
* 7 Les infractions sont celles énumérées à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.
* 8 Cet accès des agents de France Travail au fichier Ficovie a été ajouté par la LFI pour 2021.
* 9 Articles R. 135 ZK-1 et R. 134 D-1 du livre de procédure fiscale.
* 10 Avis de l'Assemblée générale du Conseil d'État, p.3.
* 11 Conseil constitutionnel, décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.
* 12 Cela se matérialise par une décision dite de « classement sans suites ».
* 13 Amendement n° 449 portant article additionnel après l'article 8 quinquies au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 14 La consignation en cas de citation directe est prévue à l'article 392-1 du code de procédure pénale.
* 15 Rapport d'information n° 770 (2023-2024), déposé le 24 septembre 2024, Hausse des tarifs des complémentaires santé : l'impact sur le pouvoir d'achat des Français.
* 16 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 17 Amendement n° 154.
* 18 Il faut souligner que, compte tenu du rendement envisageable d'une telle mesure, et donc des moindres dépenses induites pour l'AMO, cette jurisprudence du Conseil constitutionnel peut être entendue comme limitant durablement les mesures de lutte contre la fraude pouvant être inscrites en PLFSS.
* 19 Au h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
* 20 Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et libertés ».
* 21 L'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit le principe général de respect de la vie privée et du secret des informations relatives aux données de santé.
* 22 Article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
* 23 Article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
* 24 C'est notamment le cas de l'AEEH, l'AJPA, l'AVPF et l'AVA.
* 25 C'est principalement le cas concernant l'APA et la PCH.
* 26 Article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 27 Article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles.
* 28 Rapport Igf-Igas, mai 2025, Divergences territoriales dans les modalités d'attribution des aides sociales légales (AAH, AEEH, PCH, APA, ASH) et panorama des aides extralégales.
* 29 Idem.
* 30 Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
* 31 Article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale.
* 32 Article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
* 33 Article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.
* 34 Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
* 35 Article 69 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 appliqué par le décret n° 2025-202 du 28 février 2025 relatif aux conditions de mise en oeuvre des transports partagés de patients.
* 36 Article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale.
* 37 Article 59 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 38 Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
* 39 Arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'Assurance maladie.
* 40 Arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés
* 41 Arrêté du 3 mai 2023 portant approbation de l'avenant no 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l'assurance maladie signée le 26 décembre 2002
* 42 Article 1er de l'avenant n° 11 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, signé le 13 avril 2022.
* 43 Arrêté du 29 septembre 2025 portant approbation du protocole d'accord sur la maîtrise des dépenses de transports sur le champ du transport sanitaire
* 44 Protocole mis en oeuvre sur le fondement de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale issu de l'article 41 de la LFSS pour 2025.
* 45 Article 7.6
* 46 Article 7.5
* 47 Sur proposition du Conseil d'Etat lequel, dans son avis, estime que la nature des données personnelles en cause justifie ces précisions apportées par voie règlementaire.
* 48 L'article 60 en question avait été introduit par un amendement non défendu de la sénatrice Nathalie Goulet, finalement repris par la commission des affaires sociales.
* 49 Décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025
* 50 P. ?
* 51 Article 115 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
* 52 Article 98 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022.
* 53 Article 26 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 54 Décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019.
* 55 Amorcée dans la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.
* 56 Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
* 57 Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023, n°20-17.433
* 58 En application combinée des articles L. 114-10 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
* 59 Étude d'impact annexée au projet de loi, p. 95.
* 60 Article L. 411-11 du code des juridictions financières.
* 61 Article L. 141-5, L. 272-48 et L. 411-11 du code des juridictions financières.
* 62 Les infractions pour lesquelles les ministres ou les élus exerçant une fonction exécutive sont justiciables de la Cour des comptes sont plus restreints.
* 63 Article L. 131-1 du code des juridictions financières.
* 64 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
* 65 Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 66 Article L. 142-1-1 du code des juridictions financières.
* 67 Idem.
* 68 Article L. 411-1 du code des juridictions financières.
* 69 Article L. 6361-1 du code du travail.
* 70 Article L. 6361-3 du code du travail.
* 71 Article L. 6361-2 du code du travail.
* 72 Article L. 6361-5 du code du travail.
* 73 Article L. 6362-10 du code du travail.
* 74 Article L. 6362-8 du code du travail.
* 75 Article L. 6362-12 du code du travail.
* 76 Page 102.
* 77 Article L. 512-16 du code de la consommation et L. 450-3-2 du code de commerce.
* 78 Article L. 512-7 du code de la consommation et L. 450-3-2 du code de commerce.
* 79 HCFiPS, 2024, Lutte contre la fraude sociale état des lieux et enjeux.
* 80 Exposé des motifs.
* 81 Article L.221-1-5 du code de la sécurité sociale.
* 82 Article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
* 83 Article L.422-5 du code de la sécurité sociale.
* 84 Article 4 f)
* 85 Circulaire n° 2022- 11 sur l'allocation du travailleur indépendant.
* 86 Article 25 § 2 du Règlement général annexé à la convention.
* 87 Unédic, Rapport sur la gestion des risques, le contrôle et l'audit, juillet 2025.
* 88 Étude d'impact, p. 122.
* 89 Idem, p. 123.
* 90 Article 8 des conditions générales d'utilisation
* 91 Cécile Ballini, Johanna Bismuth, Pierre Carloni, Marc-Antoine Estrade, Alix Gauthier, Alexandra Louvet, Chloé Tavan et Mathilde Valer, « Quels sont les usages du compte personnel de formation ? », Dossier, 17 février 2023.
* 92 La zone comprend les 27 pays membres de l'UE, auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Vatican, le Monténégro et l'Albanie.
* 93 Article 212 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 94 Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.
* 95 Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
* 96 Au titre du a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
* 97 Au 2, de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
* 98 Page 136.
* 99 Chapitre V du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.
* 100 Article L. 6355-23 du code du travail.
* 101 Article L. 6355-24 du code du travail.
* 102 Article L. 6363-1 du code du travail.
* 103 Article L. 6231-4 du code du travail.
* 104 Page 166.
* 105 Articles L. 6352-6 à L. 6352-10 du code du travail.
* 106 Article L. 6351-2 du code du travail.
* 107 Peuvent également être touchés par cette pénalité financière le bénéficiaire de l'assurance maladie et l'employeur.
* 108 Rapport n° 424, tome I (2003-2004) de M. Alain Vasselle sur le projet de loi relatif à l'assurance maladie, déposé le 21 juillet 2004.
* 109 Arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025.
* 110 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016, M. Stéphane R. et autre.
* 111 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, M. Nicolas S.
* 112 Caisse nationale d'assurance maladie, Rapport charges et produits pour 2026, 2025.
* 113 Ibid.
* 114 Cour des comptes, Les téléconsultations. Une place limitée dans le système de santé, une stratégie à clarifier pour améliorer l'accès aux soins, avril 2025.
* 115 Tribunal des conflits, du 14 février 2000, n° 00-02.929.
* 116 Conseil constitutionnel, décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.
* 117 Mesure encadrant les prescriptions par un objectif préalablement établi sur un champ déterminé.
* 118 Subordination de la prescription médicale, donnant lieu à une prise en charge de l'assurance maladie, à un accord préalable du service du contrôle médicale de cette dernière pour une durée maximale de six mois.
* 119 Réponse au questionnaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
* 120 Articles R. 148-1 à R. 148-9 du code de la sécurité sociale.
* 121 Réponse au questionnaire de la Caisse nationale d'assurance maladie.
* 122 Caisse nationale d'assurance maladie, « MSO-MSAP 2025-2026 : toutes les informations sur le dispositif qui débutera en septembre », 27 juin 2025.
* 123 L'infraction de travail dissimulé est définie à l'article L. 8221-3 du code du travail. Sa matérialité est établie par le fait de se soustraire intentionnellement à ses obligations d'immatriculation au registre national des entreprises, de déclaration aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, ou le fait de se prévaloir frauduleusement de dispositions applicables au détachement de salariés lorsque leur activité est réalisée sur le territoire nationale.
* 124 Selon l'article 53 du code de procédure pénale, les cas d'ouverture d'une enquête de flagrance pénale sont le crime ou le délit qui se commet actuellement, le crime ou le délit qui vient de se commettre, la poursuite d'une personne par la clameur publique dans un temps très voisin de l'action, et le constat, dans un temps très voisin de l'action, d'une personne en possession d'objets ou qui présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
* 125 Les titres exécutoires sont définis aux articles L. 111-3 et L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, et recouvrent notamment les jugements et actes notariés. Ils permettent d'effectuer des mesures d'exécution forcées pour obtenir l'attribution immédiate et définitive de sommes afin de recouvrir une créance.
* 126 Les dispositions de l'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale régissant la procédure de flagrance sociale ont été abrogées au 1er janvier 2017 par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
* 127 Il s'agit des procédures de saisie conservatoire mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* 128 Un procès-verbal pour travail dissimulé fait foi jusqu'à preuve du contraire.
* 129 Il s'agit de l'autorisation prévue à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* 130 Le détail des garanties de paiement attendues a été précisé par le décret n° 2017-1409 du 25 janvier 2017 aux articles R. 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
* 131 Source : réponse de l'URSSAF Caisse nationale au questionnaire des rapporteurs de la commission des affaires sociales.
* 132 Les titres exécutoires, dont la liste figure à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution 133, sont des actes sur le fondement desquels le créancier peut contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard, en recourant à une procédure civile d'exécution sur ses biens.
* 134 Article R. 133-1 du code de la sécurité sociale.
* 135 Article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales
* 136 Comme le prévoit l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
* 137 Ces propos ont été tenus par la Ministre chargée des comptes publics Amélie de Montchalin lors de son audition du 23 octobre 2025 devant la commission des affaires sociales du Sénat.
* 138 Par donneur d'ordre, il faut entendre un cocontractant passant commande directement auprès d'un sous-traitant. Le maître d'ouvrage, qui engage le marché et en est le destinataire final, se trouve dans une position unique dans la chaine de sous-traitance.
* 139 Article L. 8211-1 du code du travail.
* 140 Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France
* 141 Article L. 8221-1 et ancien article L. 324-9 du code du travail.
* 142 Article R. 8222-1 du code du travail.
* 143 CE 9e-10e, 22 mars 2023, Société Bovendis, no 456631, mentionné aux Tables.
* 144 Étude d'impact du projet de loi, p. 238.
* 145 Cass. Civ. 2e, 4 sept. 2025, no 23-14.121 B.
* 146 Article R. 2888-2 du code du travail.
* 147 Compte rendu de l'audition du 26 mars 2025.
* 148 HCFiPS, données de fin juin 2023.
* 149 Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
* 150 Article L. 8271-9 du code de la sécurité sociale.
* 151 Commentaire de l'article 22.
* 152 Article 102.
* 153 Compte rendu de l'audition du mercredi 2 avril 2025 devant la commission des affaires sociales du Sénat.
* 154 S'agissant des auteurs de l'infraction.
* 155 S'agissant des personnes morales responsables pénalement.
* 156 Article L. 8234-1 et article L. 8234-2.
* 157 Article L. 8243-1 et article L. 8243-2.
* 158 Article L. 8256-3 et article L. 8256-7.
* 159 Article L. 168 du livre des procédures fiscales.
* 160 Article L. 186 du livre des procédures fiscales.
* 161 Article L. 169 du livre des procédures fiscales.
* 162 Article L. 176 du livre de procédures fiscales.
* 163 Article L. 187 du livre de procédures fiscales.
* 164 Article L. 188 A du livre de procédures fiscales.
* 165 Article L. 188 B du livre de procédures fiscales.
* 166 Article L. 188 C du livre de procédures fiscales.
* 167 Article L. 169 du livre des procédures fiscales.
* 168 Article L. 176 du livre de procédures fiscales.
* 169 Au titre de l'article 235 ter D du code général des impôts (abrogé).
* 170 Décret n° 2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des dispositions réglementaires relatives à la déclaration fiscale des employeurs en matière de formation professionnelle.
* 171 Loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
* 172 Respectivement le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail pour les centres de formation à l'apprentissage, et le titre V du même livre pour les organismes de formation.
* 173 Article L. 6362-7-2 du code du travail.
* 174 Décision n° 461606.
* 175 Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
* 176 Amendement n° 26 rect. identique 34 rect. quinquies.
* 177 Décision n° 2025-887 DC du 26 juin 2025.
* 178 Article 3 de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.
* 179 Article 34 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
* 180 Art. L. 6333-7-2 du code du travail.
* 181 Le titulaire disposera d'un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte.
* 182 Les titres exécutoires, dont la liste figure à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution 183, sont des actes sur le fondement desquels le créancier peut contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard, en recourant à une procédure civile d'exécution sur ses biens.
* 184 L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice a fusionné les professions d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires. Auparavant, les contraintes étaient signifiées par voie d'huissier.
* 185 L'article 26 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a remplacé le mot « sommes » par le mot « prestations » pour désigner les créances « indûment versées » que les organismes peuvent recouvrer via la procédure d'opposition à tiers détenteur.
* 186 L'article L. 133-4-9 précise ainsi que l'effet d'attribution immédiate porte sur les créances y compris conditionnelles ou à terme, que détient le débiteur à l'encontre du tiers, quelle que soit la date à laquelle elles deviennent exigibles.
* 187 Articles L. 211-3 et R. 133-9-8 du code des procédures civiles d'exécution.
* 188 Article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
* 189 Cette procédure est prévue aux articles L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d'exécution.
* 190 Aux termes d'un arrêt du 2 juillet 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré impossible, pour l'administration de recourir à une procédure d'avis à tiers détenteur sur les sommes placées sur un contrat d'assurance vie.
* 191 Cet article a été abrogé par l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 mais ces dispositions figurent désormais à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
* 192 Article L. 287 bis du code des douanes
* 193 Notamment au titre de l'article L. 5429-1 du code du travail pour les allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi.
* 194 Allocation de retour à l'emploi, allocation de solidarité spécifique, allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers.
* 195 Article L. 5426-8-1 du code du travail.
* 196 Article R. 5426-19 du code du travail.
* 197 Article L. 5428-1 du code du travail.
* 198 Article L. 3252-2 du code du travail.
* 199 Études et analyses budgétaires de France Travail produites par l'étude d'impact, p. 285.
* 200 Article L. 262 du livre des procédures fiscales.
* 201 Page 13.
* 202 Décision n° 2025-887 DC du 26 juin 2025.
* 203 Articles L. 114-10 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
* 204 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 205 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 206 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 207 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.