Rapport général n° 77 (1995-1996) fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 1995
Disponible au format Acrobat (4,5 Moctets)
-
INTRODUCTION
-
CHAPITRE PREMIER - L'ARCHITECTURE D'ENSEMBLE DU
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1996
-
CHAPITRE II - LE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE DU
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1996
-
CHAPITRE III - L'ÉVOLUTION DES FINANCES
PUBLIQUES DANS LA PERSPECTIVE DE LA MONNAIE UNIQUE
-
CHAPITRE IV - QUELLE POLITIQUE BUDGÉTAIRE
POUR LA FRANCE ?
-
I. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
-
II. QUELLE STRATÉGIE POUR LE
PARLEMENT ?
-
A. LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES SUPPOSE UNE
RÉFLEXION PRÉALABLE SUR LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE
L'ÉTAT
-
B. LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES IMPLIQUE UN
ARBITRAGE DIFFICILE ENTRE DES OBJECTIFS POLITIQUES CONTRADICTOIRES
-
C. LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES REND
INDISPENSABLE UNE REMISE EN CAUSE DES DISPOSITIFS PUBLICS
D'ÉVALUATION
-
A. LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES SUPPOSE UNE
RÉFLEXION PRÉALABLE SUR LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE
L'ÉTAT
-
-
III. LE NÉCESSAIRE REMODELAGE DE NOTRE
SYSTÈME DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
-
I. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
-
EXAMEN EN COMMISSION
N°77
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1995.
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 1996, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur, Rapporteur général.
TOME I
LE BUDGET DE 1996 ET SON CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(10ème législ.) 2222, 2270 à 2275 et T.A.
413.
Sénat : 76 (1995-1996)
Lois de finances.
Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, vice-présidents ; Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Emmanuel Hamel, René Régnault, François Trucy, secrétaires , Alain Lambert, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Philippe Marini, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Alain Richard, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.
INTRODUCTION
Appréciée sur le moyen terme, l'évolution de nos finances publiques est marquée par l'intervention croissante du budget de l'État dans des domaines situés à la périphérie de ses compétences traditionnelles.
Qu'il s'agisse des collectivités locales, des régimes sociaux, de l'Europe ou des entreprises publiques, l'État est appelé à apporter sa contribution.
Quelques chiffres rendent compte de cette évolution :
- les contributions publiques aux régimes sociaux atteignent 225 milliards de francs (+50 % entre 1991 et 1994),
- l'ensemble des concours de l'État aux collectivités locales s'établit à 223 milliards de francs (+30 % entre 1989 et 1994),
- les dotations en capital aux entreprises publiques sont de l'ordre de 15,5 milliards de francs par an en 1995-1996 contre 9,8 milliards par an sur la période 1989-1994,
- les versements au budget de l'Union Européenne ont doublé depuis 1986 et sont inscrits à hauteur de 89 milliards de francs dans le Projet de loi de finances pour 1996.
Ces contributions de l'État, s'appliquant à des secteurs qui ne sont certes pas directement comparables, présentent toutefois une caractéristique commune : elles connaissent un rythme propre de croissance rapide sur lequel l'État n'a que peu de prise. En forçant le trait, on constate une dissociation entre le rôle de l'État "payeur" et le rôle de l'État "décideur". Cette dissociation, contestable dans son principe, n'est plus supportable dès lors que la priorité doit être réservée à la diminution des déficits publics. Le Gouvernement est donc conduit à proposer au Parlement une nouvelle politique financière. Cette politique, sous des formes diverses, s'assigne deux objectifs : mettre un terme aux dérives financières, renforcer le rôle de l'État "décideur" :
- le plan de réforme de la Sécurité Sociale vise à rétablir l'équilibre du régime général à l'horizon 1997 et à conférer au Parlement des pouvoirs tant sur la fixation du taux d'évolution des dépenses que sur le niveau des recettes fiscales affectées,
- le pacte de stabilité entre l'État et les collectivités locales, directement inspiré par des considérations d'ordre budgétaire, a pour objectif de contenir l'évolution des concours de l'État.
- la gestion des entreprises publiques appelle à l'évidence une réforme d'ensemble. La multiplication des situations inquiétantes (Air France, SNCF, Crédit Lyonnais...) appelle l'État à se comporter enfin en bon actionnaire et en bon gestionnaire. Le premier rapport sur la situation économique et financière du secteur public témoigne de l'ampleur de la tâche à entreprendre.
Le projet de budget pour 1996 se situe clairement dans cette perspective de rigueur financière et de réaffirmation du rôle de l'État.
Inscrite dans le cheminement vertueux du "5-4-3", la loi de finances traduit un réel effort de maîtrise de la dépense : les charges augmenteront moins vite que l'inflation prévisible. Cette décélération résulte de choix difficiles, qu'il s'agisse des rémunérations de la fonction publique, des coupes dans le budget d'équipement des armées ou du pacte de stabilité entre l'État et les collectivités locales. Ces choix ont été assumés. Aller plus loin est un exercice redoutable. En effet, le budget est pris en tenailles entre deux tendances lourdes : la tendance à l'affaiblissement des recettes, le contenu de la croissance se révélant pauvre en impôts, et la tendance à l'augmentation des dépenses, la "réhabilitation de la dépense publique" d'hier se traduisant par la dette d'aujourd'hui.
Malgré une amélioration certaine, la situation de l'emploi demeure critique : l'affectation de 138 milliards de francs de crédits à la politique de l'emploi prend donc toute sa signification dans cet environnement budgétaire devenu structurellement difficile.
Après avoir décrit les grands équilibres du projet de loi de finances pour 1996, le présent rapport s'attachera à esquisser une problématique de la maîtrise de la dépense publique.
L'analyse des exemples étrangers, les enseignements de la théorie économique et l'examen du degré de "compressibilité" des dépenses de l'État conduisent votre Commission des Finances à suggérer une nouvelle stratégie pour le Parlement. Cette stratégie peut se résumer en trois étapes : une réflexion préalable sur les missions de l'État, un arbitrage entre des objectifs politiques contradictoires, une remise en cause des dispositifs publics d'évaluation. Cette approche se situe dans le prolongement direct des travaux de l'Assemblée nationale.
La légitime ambition de l'Assemblée nationale de contribuer activement à la recherche d'économies doit, en effet, être saluée. Elle renforce le rôle du Parlement dans la procédure budgétaire. Elle a permis de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de maîtriser à tout prix les dépenses publiques. Elle nous contraint à réfléchir, pour l'avenir, sur la meilleure méthode à retenir pour opérer les choix les plus judicieux.
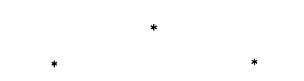
Au terme de l'analyse à laquelle elle s'est livrée, votre Commission des Finances estime que le projet de budget soumis à son examen est le "seul" budget possible au regard du réseau de contraintes dans lequel nos finances publiques sont aujourd'hui enserrées.
Maîtrise des finances publiques. Maîtrise de la dépense sociale. Ambition pour l'emploi. Ce projet de budget répond à une urgence sociale et à une nécessité économique.
Il recueille, à ce double titre, l'avis favorable de votre Commission des Finances. Quoi qu'il en coûte, cet effort de maîtrise de la dépense devra être poursuivi, voire amplifié, dans les années à venir pour reconquérir une marge de manoeuvre économique.
C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que la France pourra conserver son rang et son rôle dans la construction de l'Europe.
CHAPITRE PREMIER - L'ARCHITECTURE D'ENSEMBLE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1996
I. LES ÉLÉMENTS CLEFS DU PROJET DE LOI DE FINANCES
A. L'ÉQUILIBRE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
Trois tableaux résumés retracent l'architecture du projet de loi de finances, avant son adoption définitive par l'Assemblée nationale.
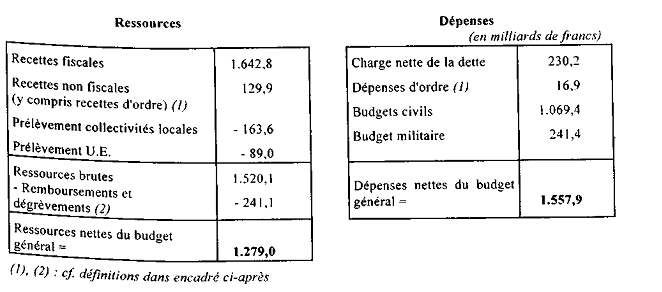
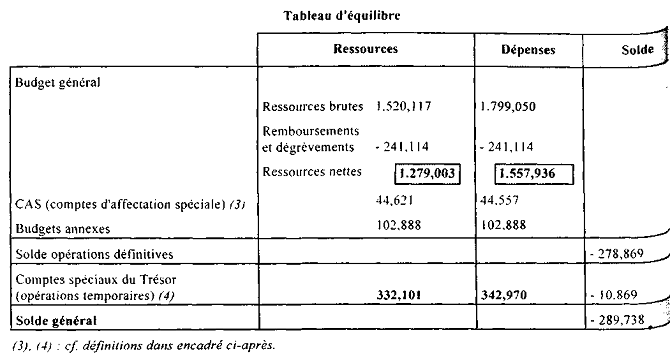
Ces trois tableaux mettent en évidence :
- la part considérable de la charge de la dette (près de 18 % des ressources nettes -soit encore près de 78 % de l'impôt sur le revenu perçu en 1995) :
- la persistance d'un solde primaire déficitaire (déficit moins charge de la dette) à hauteur de 60 milliards de francs (63,3 milliards de francs si l'on considère la charge nette de la dette) ;
- l'importance traditionnelle des prélèvements sur recettes
(252 milliards de francs) qui minorent en présentation le poids des "dépenses".
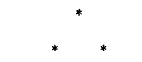
Ces données instantanées doivent bien entendu être replacées dans une perspective plus longue afin de mettre en évidence les continuités et les ruptures.
De quelques définitions du droit budgétaire
1. Dépenses d'ordre et recettes d'ordre
La gestion active de la dette depuis 1985 fait apparaître des recettes de coupons courus (15 milliards de francs) qui constituent la plus grande part des recettes dites d'ordre (16,9 milliards de francs). Par principe, la comptabilité publique n'admet pas -pour des raisons évidentes- la contraction de recettes et de dépenses. En recettes figureront donc des recettes d'ordre et en dépenses la charge brute de la dette : en solde n'apparaît plus que la charge nette de la dette. Plus précisément, on peut faire apparaître la décontraction suivante :
|
charge de la dette dont : |
247,1 milliards de francs |
|
|
dépenses d'ordre |
16.9= 226,4 (dette nette au sens de |
|
|
|
la présentation traditionnelle) + 2,0 |
|
|
|
1.8= 230,2 (dette nette au sens du |
|
|
tableau d'équilibre). |
2. Remboursements et dégrèvements
Pour des raisons analogues de non contraction des ressources et des dépenses, les "dépenses en atténuation de recettes" figurent dans les deux colonnes du tableau d'équilibre. Ces dépenses regroupent les remboursements sur produits indirects (TVA,...), les dégrèvements sur contributions directes et taxes assimilées ainsi que les remboursements forfaitaires aux exploitants agricoles non soumis à la TVA. Elles figurent au titre premier en dépenses, à côté de la charge de la dette.
3. Comptes d'affectation spéciale
Les comptes d'affectation spéciale, qui représentent une partie des comptes spéciaux du Trésor, sont alimentés par des ressources spécifiques (taxes, produit des privatisations) et financent des dépenses définitives qui, pour la plupart, sont de même nature que celles figurant au budget général. Ils ont donc pour unique objet d'organiser un circuit de financement autonome et d'affecter des recettes à certaines dépenses.
4. Comptes spéciaux du Trésor (opérations temporaires)
Les opérations temporaires recouvrent pour l'essentiel les flux de recettes et de dépenses liées aux avances à des tiers, ou aux opérations de prêts consenties par l'État. Ces dépenses ont donc vocation à revenir sous forme de recettes, à l'issue d'un délai très variable suivant la nature de chaque opération.
B. LA MISE EN ÉVIDENCE D'INFLEXIONS
1. Le choix d'une référence
Pour mesurer l'évolution du budget de l'État d'une année sur l'autre, il convient de prendre un certain nombre de précautions méthodologiques -rendues cette année plus nécessaires encore par le vote d'un collectif, la loi de finances rectificative du 4 août 1995, qui a modifié très sensiblement l'architecture de la loi de finances initiale pour 1995 :
Équilibre du collectif
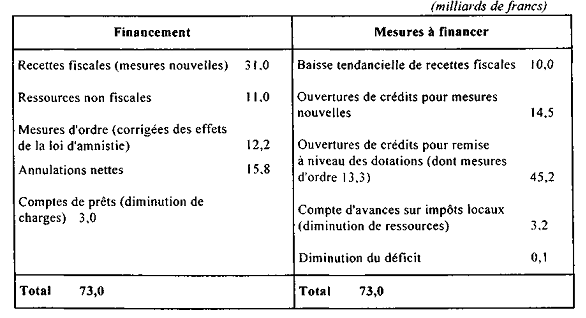
Il est donc opportun, comme votre commission des finances l'avait estimé nécessaire en 1993, de prendre ce collectif ( ( * )1) comme base de comparaison des évolutions même si la loi de finances initiale pour 1995 n'a que peu de rapports avec le "budget virtuel" que représentait la loi de finances pour 1993.
Il convient toutefois de ne pas choisir -pour les besoins de la démonstration- alternativement l'une ou l'autre référence.
Du bon usage d'une référence
Les quatre pages de l'exposé général des motifs du PLF 1996 illustrent à leur manière les délices sans cesse renouvelées de l'analyse budgétaire. On peut notamment y découvrir d'intéressantes variations sur le choix d'une référence :
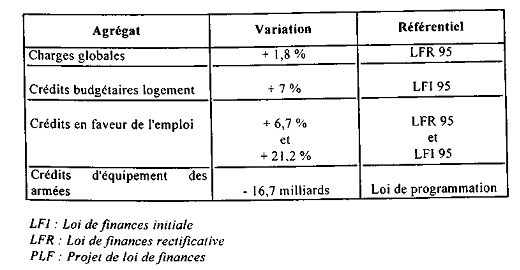
2. L'évolution des dépenses
L'évolution des charges peut être ainsi retracée :
|
PLF 96 |
% LFR 95 |
% LF1 95 |
||
|
Dépenses nettes du budget général Total des charges (1) Total des charges définitives et du solde des opérations temporaires (2) Charges définitives - dépenses d'ordre + solde des opérations temporaires |
1.557,93 1.551.86 1.613,36 1.596,48 |
+ 1,7 % + 1,8% + 0,3 % + 0,7 % |
+ 4,3 % + 4 % + 4,9 % + 5% |
(1) Le total des charges correspond aux dépenses nettes du budget général diminuées des dépenses d'ordre et augmentées du solde des comptes spéciaux du Trésor (opérations temporaires. Les opérations des comptes d'affectation spéciale et celles des budgets annexes n'y figurent pas. En présentation 1995, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1994, les chiffres respectifs seraient de (hors BAPSA) : + 1.4 % et + 4,4 % contre 1,8 % et + 4 %. Ce concept de " total des charges" est traditionnellement retenu en présentation du PLF.
(2) Dépenses nettes du budget général augmentées des dépenses des C.A.S. et du solde des C.S.T. (opérations temporaires).
Ces quatre indicateurs possèdent chacun leur "part de vérité". Si l'on cherche à "solliciter" les chiffres, il est possible d'opposer un scénario gris (+1,8 %) à un scénario rose (+ 0,3 %). Le projet de loi de finances retient d'ailleurs le pourcentage gris. L'indicateur "total des charges" est en effet traditionnellement retenu par le gouvernement. Il fait apparaître une progression de 1,8 % -inférieure à la hausse prévisible des prix soit 2 %-, ce qui constitue une inflexion remarquable. D'autant plus remarquable que la charge de la dette connaît une forte croissance (+ 17,3 milliards de francs).
Cette inflexion apparaît plus clairement à l'examen des derniers exercices clos 1 ( * ) .
|
Charges définitives nettes + |
|||
|
PIB aux prix courants |
solde des opérations temporaires - recettes d'ordre |
||
|
1988 |
+ 7,5 |
-4,5 |
|
|
1989 |
+ 7,4 |
+ 6,0 |
|
|
1990 |
+ 5,7 |
+ 4,1 |
|
|
1991 |
+ 4,1 |
+ 5,4 |
|
|
1992 |
+ 3,5 |
+ 6,2 |
|
|
1993 |
+ 1,0 |
+ 7,0 |
|
|
1994 |
+ 4,1 |
+ 3,0 |
Ce tableau retrace, à grands traits, les épisodes récents de notre histoire budgétaire :
- les "années cigale" de 1989-1992 où la croissance est utilisée à financer de nouvelles dépenses publiques "réhabilitées" et qui lancent une dynamique difficilement maîtrisable ;
- la crise de 1993 qui contraint les finances publiques à jouer un rôle contracyclique et qui met crûment en évidence la dynamique ainsi enclenchée ;
- l'amorce d'une sagesse retrouvée en 1994.
Dépenses 1996 : un véritable effort de maîtrise
1. Fonction publique
La non revalorisation du "point" pour 1996, qui ne pourra pas être reconduite à identique les années suivantes, exerce un effet très sensible sur la progression des dépenses. Une majoration de 1 % du point représente, en effet, un coût de l'ordre de 6 milliards de francs en année pleine pour la fonction publique de l'État et 11 à 12 milliards de francs pour 1'ensemble des fonctions publiques de l'État, des collectivités locales et du secteur hospitalier ( ( * )1)
En revanche l'accroissement de 0,17% des effectifs (3.557 créations nettes hors personnels appelés) mérite d'être souligné. Il exerce un effet psychologique des plus fâcheux. En Allemagne, les effectifs de l'administration fédérale doivent décroître de 1 % par an jusqu'en 1998.
2. "Train de vie de l'État"
Les dépenses de fonctionnement courant du titre III progressent de 1,4 milliard de francs pour atteindre 43,95 milliards de francs. Compte tenu des régulations qui perturbent la bonne marche des services et de nombreuses dépenses qui n'ont rien de somptuaires (dépenses de santé des détenus, modernisation des moyens d'action de la police, fonctionnement des juridictions), cette augmentation ne saurait susciter de passion excessive. D'autant moins que cette dotation est stable en francs constants depuis deux ans. Il convient donc de trouver un juste milieu entre la thèse de la paupérisation de l'État, brillamment défendue par le nouveau commissaire général au plan, et celle de la "chasse au gaspi" qui ne devrait pas apparaître comme une politique d'économies de bouts de chandelle, fortement médiatisée.
3. Défense nationale
Le gouvernement a décidé de ne pas appliquer la loi de programmation qui prévoyait 105 milliards de francs d'investissements. Les 89 milliards de francs retenus Permettent une économie de 2,3 milliards de francs par rapport à la LFR 1995 et de 4 milliards de francs par rapport à la LFI 1995. Selon les industriels du secteur, descendre au-dessous de 90 milliards de francs de crédits d'équipement aurait des conséquences graves sur les industries d'armement dont la situation n'est guère brillante en ce moment de notre histoire.
4. UNEDIC
La prise en compte du redressement financier de l'UNEDIC permet à l'État une réduction de dépenses de 5 milliards de francs par rapport à 1995, alors qu'il s'était engagé à lui verser 10 milliards de francs par an jusqu'en 1996. La somme des versements atteint 19,3 milliards de francs à ce titre, soit à peu près la dette contractée par cet organisme en février 1994 (22 milliards de francs). Les excédents de l'UNEDIC en 1994 (+ 8,7 milliards de francs) et 1995 (+ 19 milliards de francs) justifient cette décision.
5. Révision des services votés
Elle s'établit à 36,6 milliards de francs (par rapport à la LF1 1995) dont une part provient de la consolidation de la régulation budgétaire 1995 (1,9 milliard de francs). Est considérée comme révision de services votés la prise en charge par le FSV de certaines dépenses du BAPSA à hauteur de 1,943 milliard de francs, ce qui ne constitue pourtant qu'un jeu d'écritures au sein de l'ensemble des dépenses publiques. La prise en compte de la suppression de la "balladurette" est un peu curieuse puisque, mesure non reconductible, elle aurait dû figurer en ajustement aux besoins. En sens inverse, les effets de la baisse des dépenses liée à la réduction de la rémunération de la créance TVA des entreprises n'est pas considérée comme une mesure de réduction des services votés.
Au total, les principales mesures des services votés sont les suivantes :
(en milliards de francs)
. Economie UNEDIC 5 (voir ci-dessus)
. Fusion de la réduction dégressive et de l'exonération
de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires ... 14,132
. Modification du barème de l'aide au logement 2,3
. Réaménagements de divers dispositifs de
formation
et de soutien à l'emploi 5,603
6. Pacte de stabilité entre l'État et les collectivités locales
La limitation au niveau des prix de la progression, en 1996 et sur les deux années suivantes, des concours de l'État aux collectivités locales, dans le cadre d'un pacte de stabilité financière, conduit à ce que les subventions de l'État aux collectivités locales bénéficieront pour les trois années à venir d'une garantie de maintien de pouvoir d'achat, et évolueront selon la même norme que les dépenses de l'État dans leur ensemble. Excellent dans son principe, ce pacte contient toutefois des dispositions que l'on peut soumettre à la critique (voir chapitre IV et Tome II - Commentaire des articles).
|
L'effort de maîtrise des dépenses peut se décliner en cinq priorités :- réduction des dépenses militaires - annulation de la subvention à l'Unedic - gel des traitements des fonctionnaires - stabilisation des transferts aux collectivités locales - arrêt de la montée en puissance de la budgétisation des cotisations familiales. |
3. La progression des ressources
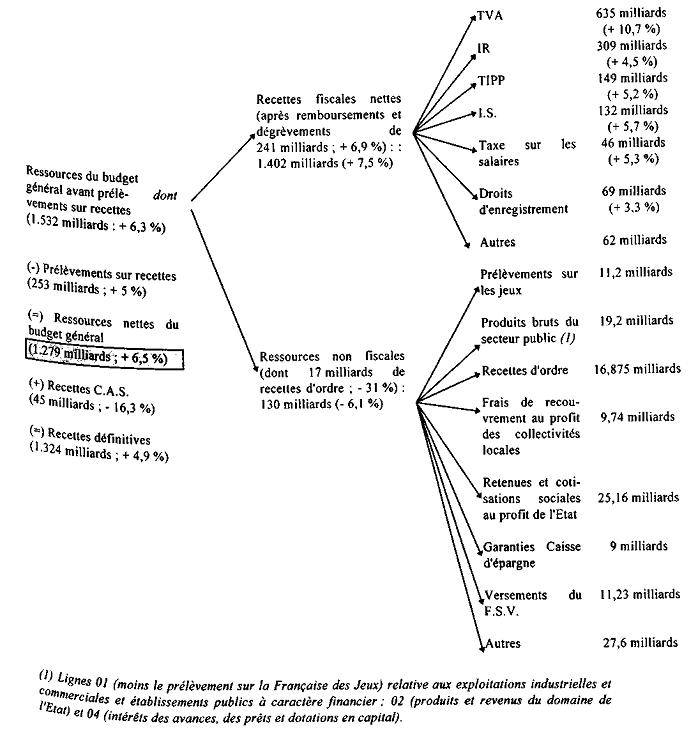
|
Part des différents impôts dans les recettes |
||||
|
fiscales totales |
||||
|
TVA |
45,3 % |
|||
|
I.R. |
22,0 % |
|||
|
TIPP |
10.6% |
|||
|
I.S. |
9,4 % |
|||
|
Autres |
12,7% |
|||
Les catégories de recettes sont fort diverses (recettes fiscales, revenus du patrimoine, ressources de privatisation, prélèvements sur organismes publics, part "agents" des cotisations sociales,...) et font l'objet d'évolutions contrastées. Elles pourraient faire l'objet de longs commentaires poste par poste. Elles seront analysées au chapitre II (révision de la base 1995) et au chapitre IV (évolution à moyen terme). A cette étape de l'analyse, trois observations appellent toutefois un développement spécifique.
a) Une croissance "pauvre en impôt"
L'exposé général des motifs du projet de loi de finances précise que "l'essentiel du redressement en recettes ayant été effectué en collectif 1995, le PLF 1996 ne retient que quelques mesures nouvelles, à la fois limitées et ciblées".
En effet, l'impact sur les recettes fiscales des mesures contenues dans le PLF 1996 n'est que de 9,7 milliards de francs alors que l'effet total des mesures du collectif est de 70,1 milliards de francs. Sans ces mesures de "redressement", le produit des recettes fiscales s'établirait à 1.322 milliards de francs environ.
Le contenu en impôts de la croissance s'étiole. Pour 1995, par rapport aux estimations de la loi de finances rectificative du 4 août, les moins-values fiscales s'établiraient, selon les estimations révisées de septembre, à près de 25 milliards de francs.
b) Une loi de finances "modeste" en termes de mesures fiscales.
• S'agissant des
recettes fiscales,
le produit supplémentaire attendu résulte des mouvements
suivants :
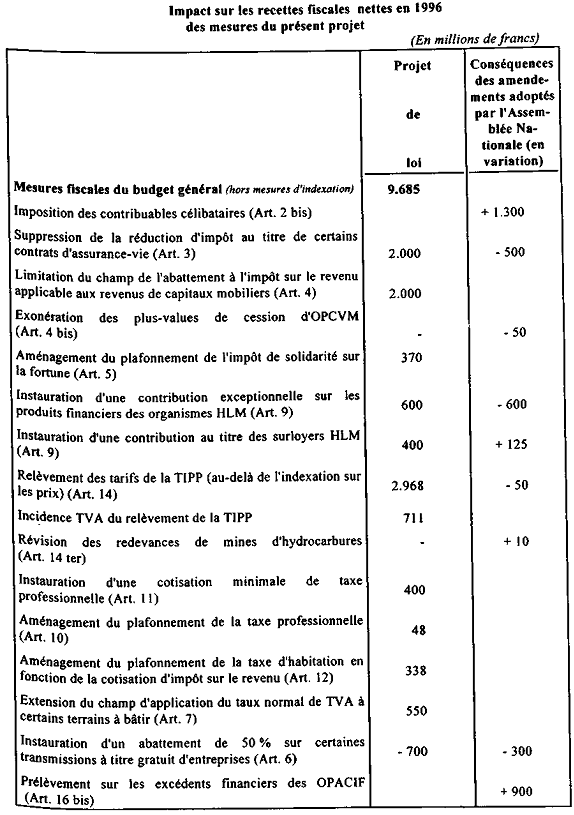
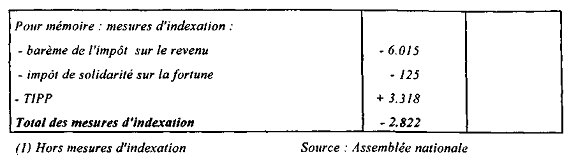
Les décisions prises par l'Assemblée nationale ont modifié les prévisions de recettes fiscales en les majorant de 625 millions de francs.
• Les
prélèvements sur
recettes,
présentation comptable peu satisfaisante (qui appelle
des observations récurrentes de la Cour des Comptes), atteignent 252,66
milliards de francs. En forte croissance globale (+ 5 %), ces
prélèvements atteignent 89 milliards de francs au profit de
l'Union européenne (+ 7,2%) et 163,66 milliards de francs en faveur des
collectivités locales (+ 4,1 %).
• Les
comptes spéciaux du
Trésor
connaissent des évolutions contrastées en
raison des modifications d'imputation des recettes de privatisation et de leur
baisse sensible. Les comptes d'affectation spéciale sont dotés de
44,621 milliards de francs en prévision de ressources, soit 22,621 hors
recettes de privatisation (en hausse sensible de 8,3 %).
|
L'augmentation importante de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes (+ 1,13 milliard de francs) au profit du fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables ainsi que la reconduction du fonds pour 1'accession à la propriété (0,9 milliard de francs), créés tous les deux cette année ne sauraient être hâtivement assimilées à des débudgétisations. Toutefois, cette tendance un peu fréquente à la "spécialisation" est contraire au principe d'unité du budget et a pour effet de minorer les présentations traditionnelles du total des ressources et du total des dépenses (seul le solde apparaît). |
c) Un retour à la "normale " ?
Si l'on prend en considération, comme le Rapporteur général de l'Assemblée nationale, les ressources brutes 2 ( * ) , il est possible de mettre en évidence deux phénomènes :
- la croissance concomitante du PIB (4,9 %) et des ressources (+ 6,3%) pour 1996 ;
- le retour à un écart positif entre les ressources et le PIB après trois années d'écart négatif.
|
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 (1) |
1995 (2) |
1996 (3) |
||
|
Ressources brutes |
+ 7,8 |
+ 8,1 |
+ 6,2 |
+ 5,9 |
+ 4,1 |
- 1,1 |
+ 3,9 |
+ 0,1 |
+ 6,3 |
|
|
PIB marchand (valeur) |
+ 8 |
+ 7,8 |
+ 5,7 |
+ 3,5 |
+ 2,9 |
+ 0,5 |
+ 4,1 |
+ 5,1 |
+ 4,9 |
|
|
Écart (en valeur absolue) |
-0,2 |
+ 0,3 |
+ 0,5 |
+ 2 |
+ 1,2 |
- 1,6 |
-0, |
-5 1+1,4 |
+ 1,4 |
|
|
(1) Jusqu'en 1994 en exécution (2) Estimations révisées de septembre (3) PLF 1996 ? |
||||||||||
Pour maintenir "en ligne" la croissance du PIB et celle des ressources globales, une aggravation de 81 milliards de francs (LFR95 + LF1 96) du produit fiscal a été ainsi nécessaire. Cette inflexion des recettes appelle une réflexion en profondeur. Le temps n'est plus, comme en 1989, quand la plus-value tendancielle des recettes fiscales s'établissait à 92 milliards de francs, avant prise en compte de 25 milliards de francs d'allégements fiscaux.
C. L'ÉVOLUTION DU SOLDE BUDGÉTAIRE
Réduit de 322 à 290 milliards de francs, le déficit décroît de près de 0,6 point de PIB. Il faut remonter à 1976 pour trouver une amélioration de plus grande ampleur en pourcentage.
La variation des différents soldes budgétaires entre le collectif de 1995 et le projet de loi de finances pour 1996 peut être ainsi retracée :
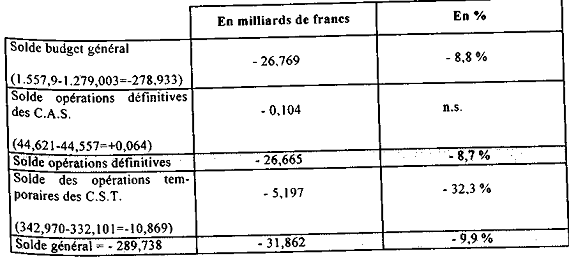
1) En matière de dépenses ( ( * )1) l'accroissement de 33,2 milliards de francs résulte de deux mouvements de sens contraire dans la présentation retenue par le ministre de l'économie et des finances.
(en milliards de francs)
|
Accroissement des dépenses |
Charges "incompressibles" (*) |
Autres charges |
|
|
+ 33,2 |
+ 59,8 |
-26,6 |
|
|
Dont : dette + 17,3 personnel + 15,1 emploi + 27,4 |
(*) Ce concept sera précisé dans le chapitre IV. Les charges en faveur de l'emploi sont présentées comme "incompressibles" alors même que des économies considérables sont effectuées (19,132 milliards de francs au titre des charges communes et 5,6 milliards de francs au titre du budget du travail), qui illustrent notamment une politique "active" de l'emploi.
2) En matière de ressources, la progression globale est de 59,9 milliards de francs hors recettes d'ordre, qui se décomposent comme suit :
|
(en milliards de francs) |
||
|
Recettes fiscales |
+ 98,4 |
|
|
Ressources non fiscales (y compris recettes d'ordre) |
-8,5 |
|
|
Prélèvements sur recettes |
- 12,1 |
|
|
Recettes d'ordre |
- 16,9 |
|
3) Le déficit du budget général est ainsi réduit de 26,7 milliards de francs (+ 33,2 - 59,9).
Le solde des comptes spéciaux du Trésor, est réduit de 5,2 milliards de francs.
Ce solde, ajouté à celui du budget général conduirait donc à un solde général amélioré de 31,9 milliards de francs par rapport aux 321,6 milliards de francs de la loi de finances rectificative d'août 1995.
Cette réduction de 10 % du déficit témoigne de la volonté de maîtrise des finances publiques du gouvernement.
II. LE CADRE ÉVOLUTIF DU BUDGET DE L'ÉTAT
A. DES RELATIONS MULTIPLES ENTRE LES ACTEURS PUBLICS
L'analyse des débats tenus à l'Assemblée nationale, comme celle des articles parus dans la presse, illustre la difficulté d'un exercice limité au seul examen des fascicules budgétaires.
Le financement croissant des dépenses sociales sur fonds budgétaires ne permet plus d'isoler l'analyse de la loi de finances de celle des régimes sociaux. Par voie de conséquence, le débat sur les prélèvements obligatoires prend le pas sur l'analyse traditionnelle des recettes budgétaires.
Les relations croisées, sans cesse plus complexes et plus serrées, entre l'État et les collectivités locales interdit de se borner à une étude qui ferait abstraction des débats récurrents sur l'autonomie, les charges indues et les dépenses nécessairement orientées à la hausse de ces collectivités territoriales.
La situation des entreprises publiques vient également obscurcir cette situation. Les privatisations créent des ressources immédiates mais tarissent les flux de dividendes. Les "canards boiteux" consomment des subventions qui n'ont peut être pas atteint leur apogée. Les catastrophes du Crédit Lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs viennent grever les finances publiques de charges qu'il faut bien qualifier de considérables. La discussion du projet de loi de finances est rendue plus profuse et plus diffuse.
Quelques chiffres permettent de rendre compte, fût-ce imparfaitement, de ce "puzzle public", qui contribue à étendre toujours plus loin les limites de l'exercice budgétaire.
B. UN ENGAGEMENT CROISSANT DE L'ETAT
1. Les régimes sociaux
Le premier rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale, établi par la Cour des comptes, permet de rendre compte des contributions publiques aux régimes sociaux.
Le tableau ci-dessous est particulièrement éclairant. Il met en évidence une croissance de 50 % en 3 ans des contributions publiques et des impôts et taxes affectés.
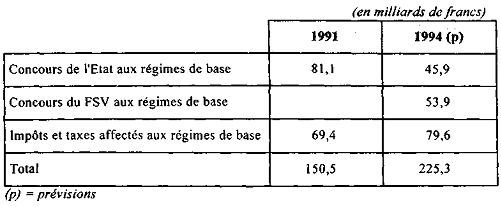
Ce tableau, que la Cour des comptes estime encore incomplet 3 ( * ) illustre la pluralité des actions de l'État qui :
- subventionne directement certains régimes (BAPSA, mines,...),
- prend en charge des prestations autrefois assurées par les régimes de base (allocation adultes handicapés),
- compense des exonérations de cotisations,
- attribue le produit d'impôts (cotisation TVA pour le BAPSA) ou affecte certaines taxes (contribution sociale de solidarité des sociétés).
Ce tableau permet enfin de mettre en évidence le caractère incomplet des données strictement budgétaires qui évaluent à 126 milliards de francs les concours de l'État aux régimes sociaux en 1994.
2. Les collectivités locales
Les concours de l'État, pour des raisons multiples faisant l'objet d'interprétations contrastées, se sont accrus de 30 % entre 1989 et 1994. Si l'on compare les prévisions pour 1996 aux réalisations pour 1989, le taux de croissance dépasse 36 %.
Évolution des concours de l'État aux collectivités locales (en exécution)
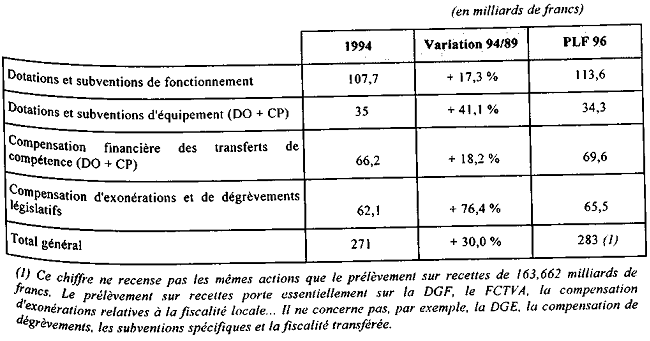
3. Les entreprises publiques
Les relations entre l'État et ses entreprises publiques sont également fortement entrecroisées. L'État perçoit des produits de ses participations, verse des subventions diverses et apporte des dotations en capital qui lui procurent des recettes d'intérêt. Il cède en tout ou partie certaines de ses participations (privatisations).
Pour 1996, les données principales sont les suivantes :
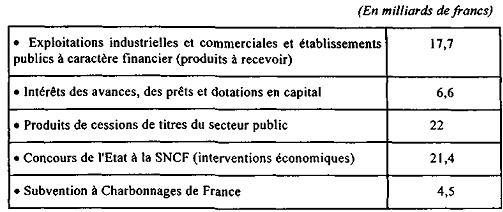
Si l'on ne considère que les dotations en capital, qui correspondent assez souvent à des appels en provenance d'entreprises en difficulté, on peut mettre en évidence une accélération certaine.
En effet, si ces dotations cumulées ont atteint 59 milliards de francs de 1989 à 1994 (sur 6 ans), elles devraient s'établir à 31 milliards pour les seuls exercices 95 et 96. Des opérations lourdes comme Air France (20 milliards de francs) et le Crédit Lyonnais (7,5 milliards de francs), expliquent cette accélération que l'on peut juger inquiétante.
Elle se cumule en effet avec une détérioration sensible des dividendes perçus par l'État actionnaire. Au titre de ses participations dans des entreprises financières, l'État recevait 9,4 milliards de francs en 1990 contre 3 milliards en 1995 (estimation). Au titre des entreprises non financières (hors France Telecom), les produits sont restés plus stables : ils ont décru de 4,4 à 3,5 milliards de francs. La poursuite des privatisations et la situation du secteur banques-assurances expliquent cette évolution.
La Caisse des dépôts et la Française des jeux demeurent, fort opportunément pour l'État, de gros contributeurs.
4. La contribution au budget communautaire
Les prélèvements sur recettes au profit des Communautés européennes devraient atteindre 89 milliards de francs en 1996 contre 83 milliards de francs en 1995. Ils renouent ainsi avec la forte croissance qui les caractérise sur longue période. Les versements effectués ont dépassé 30 milliards de francs en 1984, 40 milliards de francs en 1986, 50 milliards de francs en 1988, 80 milliards en 1992 et 90 milliards de francs en 1994.
Quels que soient les "retours" qui apparaissent sous des formes diverses (fonds de concours, crédits budgétaires, versements directs hors budget), une fraction croissante du budget est ainsi consacrée au financement des politiques communautaires.
C QUELQUES CONCLUSIONS D'ÉTAPE
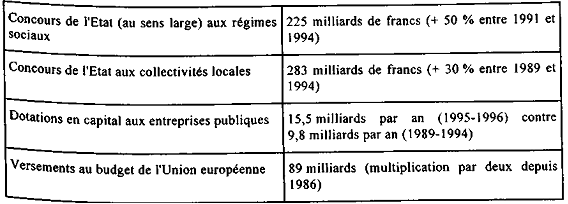
Ce tableau, très schématique, livre cependant plusieurs enseignements :
- la pertinence des objectifs que s'est assigné le gouvernement :
- remettre en ordre les finances sociales, notamment en supprimant sur 2 ans le déficit des régimes de base,
- conclure un pacte de stabilité avec les collectivités locales,
- améliorer la gestion des entreprises publiques et accélérer leur privatisation,
- appliquer au budget communautaire la rigueur financière que les États de l'Union sont contraints de s'appliquer à eux-mêmes,
- l'adaptation de la discussion parlementaire du budget
La tradition d'un débat sur les finances communautaires est maintenant bien ancrée, grâce à un article spécifique de première partie (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés Européennes). Par ailleurs, un "rendez-vous" est désormais prévu en matière de finances sociales, débat que notre collègue Jacques Oudin souhaiterait voir institutionnalisé. Votre commission des Finances estime depuis de nombreuses années qu'un débat spécifique sur les collectivités locales serait particulièrement opportun. Les problèmes rencontrés par les entreprises publiques, qui se traduisent par des dotations budgétaires croissantes, ne sont pas sans justifier un débat organisé de même nature. Le suivi des opérations de "défaisance" du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs militerait en faveur de cette thèse.
La multiplication de ces débats, dont la nécessité de chacun d'entre eux -pris isolément-emporte la conviction, imposerait toutefois une remise à plat de l'ensemble de la procédure d'examen des lois de finances, procédure qui n'a pas évolué quand la nature des finances publiques a profondément changé.
- la nécessité d'une réflexion en profondeur sur les missions de l'État
Les développements du chapitre IV mettent en évidence la difficulté de réduire des dépenses budgétaires dont la croissance ne provient pas uniquement d'une crise conjoncturelle mais largement d'une dérive structurelle ; dépenses dont la maîtrise exige une réflexion d'ensemble plutôt qu'un échenillage incertain.
• Il rend plus que jamais nécessaire une
vision consolidée des budgets publics à laquelle nous incite
opportunément par ailleurs le Traité de Maastricht. Le chapitre
III du présent rapport s'attachera ainsi à situer le cheminement
des comptes publics sur le
sentier vertueux
des
"5-4-3".
III. LES INFLEXIONS DE LA POLITIQUE FISCALE
Trois domaines font l'objet d'amorces de réformes dans le projet de loi de finances pour 1996 : l'épargne, les transmissions d'entreprises et la taxe professionnelle.
A. LA FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE
Anticipant sur la grande réforme de l'impôt sur le revenu annoncée par le Gouvernement, le présent projet de loi amorce, dans un contexte marqué par la nécessité de réduire les déficits publics, un changement important d'orientation en matière de fiscalité de l'épargne. Toutefois, les mesures qu'il propose reposent sur une cohérence discutable et nécessitent d'être complétées.
1. Vers une nouvelle politique fiscale de l'épargne
Les politiques fiscales de l'épargne menées depuis le début des années 1990 et plus encore depuis mars 1993 reposaient sur un certain nombre de postulats à partir desquels pouvaient être déduits des principes d'action.
En premier lieu, il était généralement admis que l'épargne jouait un rôle fondamental dans la réalisation de l'équilibre économique et qu'il n'était pas d'économie forte sans une épargne abondante.
En second lieu, il était également admis que le degré de complexité de notre législation, dans le but de favoriser l'épargne, finissait par la rendre contre-productive.
A la suite des travaux récents du Conseil National du Crédit ( ( * )1) la "neutralité" est apparue comme un objectif central en matière d'épargne afin, d'une part, d'assurer un traitement identique aux produits d'épargne présentant des caractéristiques voisines et, d'autre part, de ne pas perturber l'apparition d'une hiérarchie normale des rendements, notamment en fonction du niveau de risque assumé par l'épargnant.
Enfin, il était encore admis que l'épargne stable, concept plus large que celui d'épargne longue, était préférable pour le financement de l'économie, à l'épargne liquide et qu'il convenait d'en favoriser le développement.
Sur la base de ces principes, et avant même la publication du rapport du Conseil national du Crédit, un grand nombre de mesures fiscales avait été adoptées dans les lois de finances rectificative de juin 1993 et de finances pour 1994 et 1995 afin d'orienter la fiscalité de l'épargne vers plus de neutralité et de cohérence, tout en maintenant un régime fiscal globalement favorable.
C'est ainsi, en ne citant que les mesures les plus significatives, que dans le projet de loi de finances pour 1994, l'abattement de 8.000 francs pour un célibataire et de 16.000 francs pour un couple marié applicable aux revenus d'actions et d'obligations avait été étendu aux intérêts de bons de caisse, bons du Trésor et bons d'épargne, aux intérêts de titres de créances négociables, aux intérêts de comptes à terme dans les établissements bancaires et aux plus-values de cession d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation. Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 1995, le taux du prélèvement libératoire applicable aux intérêts des bons de caisse, bons d'épargne, dépôts à vue ou à terme avait été abaissé de 39,4 % à 19,4 %. Enfin, le seuil des OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation était passé à 100.000 francs pour 1994 et 50.000 francs pour 1995.
Au regard de ces précédentes orientations, les mesures du projet de loi de finances relatives à la fiscalité de l'épargne traduisent une double inflexion. D'une part, elles ont pour objet de privilégier, au sein de l'épargne financière, les placements en fonds propres par rapport aux autres placements ; c'est le retour à une certaine forme de volontarisme fiscal, sans pour autant renoncer complètement à l'objectif de neutralité. D'autre part, elles visent à rééquilibrer la fiscalité du travail par rapport à la fiscalité de l'épargne, en réduisant sensiblement les avantages fiscaux de celle-ci ; c'est, dans une certaine mesure, la fin d'un traitement de faveur pour l'épargne.
a) Privilégier les placements en fonds propres par rapport aux autres placements sans remettre en cause la neutralité fiscale
"Afin d'encourager l'investissement en fonds propres des entreprises", l'article 4 du projet de loi propose un aménagement du champ d'application de l'abattement de 8.000 / 16.000 F applicable aux revenus de capitaux mobiliers.
Désormais, le bénéfice de cet abattement serait réservé aux revenus d'actions et de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou d'entreprise unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ainsi qu'aux intérêts des sommes inscrites en compte courant bloqué d'associé qui sont destinées à être incorporées au capital dans le délai de cinq ans.
La neutralité est donc préservée pour tous les revenus de titres de créance (obligations et assimilées) puisque, si cette proposition est adoptée, ils seront tous taxés au premier franc.
En revanche, les produits des titres de propriété, devraient bénéficier à l'avenir d'un avantage fiscal d'autant plus fort qu'il se superpose à l'avantage déjà accordé par le truchement des plans d'épargne en actions.
C'est là une nouvelle cohérence, partiellement en rupture avec les politiques antérieures.
L'avantage fiscal relatif accordé aux actions résultant non pas d'un avantage nouveau, mais du maintien d'un avantage existant, cette nouvelle orientation se traduit, mécaniquement, par un alourdissement de la fiscalité de l'épargne.
b) Rééquilibrer la fiscalité de l'épargne par rapport à la fiscalité du travail
L'alourdissement de la fiscalité de l'épargne résulte, en premier lieu, de la taxation au premier franc des revenus des placements qui, jusqu'à présent, bénéficiaient de l'abattement de 8.000 et 16.000 francs. Mais d'autres dispositions du projet de loi concourent à cet objectif.
Ainsi, l'article 3 du projet de loi prévoit, sous certaines conditions et réserves, la disparition de l'avantage fiscal "à l'entrée" qui existait jusqu'à présent pour les contrats d'assurance vie.
A elles seules, ces deux mesures devraient se traduire par un surcroît de recettes de l'ordre de 4 milliards de francs pour le budget 1996 et de 6 milliards de francs en année pleine, dont 2,5 au titre de l'article 4 et 3,5 au titre de l'article 3.
"Afin de mieux répartir l'effort contributif sur l'ensemble des revenus", l'article 54 propose d'adopter une double modification des seuils de cession au-delà desquels les gains réalisés sur les valeurs mobilières sont imposables :
- abaissement à 200.000 francs pour les opérations réalisées en 1996 et à 100.000 francs pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1997 ;
- imposition au premier franc des plus-values de cessions des parts ou actions d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation intervenues à compter du 1 er janvier 1996.
Cette mesure devrait rapporter environ 500 millions de francs au budget de l'État pour 1997.
Par ailleurs deux autres mesures concourent également à l'alourdissement de la fiscalité de l'épargne dans le but affiché "d'adapter certaines règles fiscales à la réalité économique des revenus".
Il s'agit tout d'abord de l'article 53 qui tend à réformer la fiscalité des options de souscription ou d'achat d'actions ("stock options").
Actuellement, les modalités de taxation des gains réalisés dans le cadre de tels plans sont différentes selon que le délai de 5 ans entre la date d'attribution des options et la date de cession est ou non respectée. Les modalités de cession ne seraient pas modifiées lorsque la cession intervient à l'intérieur du délai de 5 ans. En revanche, lorsque la cession intervient après ce délai, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des titres à la date de leur acquisition et la valeur d'attribution serait taxé au taux de 30 % au lieu de celui de 16 %. La plus-value acquise postérieurement à la levée de l'option continuerait d'être imposée selon le droit commun des plus-values. Cette mesure s'appliquerait aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995.
D'autre part, l'article 55 propose de modifier les modalités d'imputation sur le revenu net global des déficits relevant des bénéfices industriels et commerciaux.
La possibilité de déduire des déficits non professionnels relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du revenu net global aurait en effet donné lieu au développement de montages d'optimisation fiscale très coûteux pour le Trésor et source de disparités choquantes entre personnes ayant le même niveau de revenu. Le présent projet de loi propose donc de ne permettre l'imputation sur le revenu global des déficits que s'ils résultent d'une activité exercée à titre professionnel. Dans le cas contraire, ceux-ci seraient reportables pendant cinq ans sur des bénéfices tirés d'activités semblables. Cette modification ne concerne pas les investissements agréés, réalisés Outre-mer dans le cadre de la loi Pons.
Compte tenu des aléas dont elles dépendent, ces deux mesures n'ont fait l'objet d'aucun chiffrage budgétaire.
D'un point de vue théorique, cet alourdissement de la
fiscalité de l'épargne répond à la
préoccupation, exprimée par le Président de la
•
République, lors de la campagne présidentielle, de ne pas
favoriser "l'argent qui dort". Plus prosaïquement, il a pour effet
d'augmenter les recettes de l'État dans le but affiché de
réduire les déficits publics.
2. Des mesures qui reposent sur une cohérence discutable et qu'il serait souhaitable de compléter.
a) Une cohérence discutable
S'agissant tout d'abord de la cohérence de la nouvelle politique fiscale de l'épargne, trois remarques s'imposent.
D'un point de vue économique, tout d'abord, force est de constater que l'épargne des ménages bénéficiait jusqu'à présent d'un régime fiscal très favorable. Le rapport de la Commission d'études des prélèvements fiscaux et sociaux des ménages (rapport Ducamin) mettait ainsi en exergue qu'en 1992, 35 % des revenus de l'épargne mesurés par la comptabilité nationale étaient exonérés de l'impôt sur le revenu. Ce pourcentage a eu tendance à augmenter puisqu'il n'était que de 31 % en 1988. Si l'on y ajoute les revenus non imposés et ceux soumis à abattement c'étaient ainsi 227 milliards, soit 46 % des revenus mesurés par la comptabilité nationale qui ne supportaient aucun prélèvement.
Par ailleurs, des simulations menées par le ministère de l'économie, des finances et du plan montrent que pour un couple marié avec deux enfants, l'ensemble des revenus de l'épargne financière Pouvant être perçus en franchise d'impôt atteint actuellement 108.700 francs. Si on y ajoute les produits exonérés sous condition de blocage tels que les plans d'épargne logement, les plans d'épargne populaire et les plans d'épargne en actions c'est, au total, 326.100 francs de revenus qui peuvent ainsi être perçus par famille en totale franchise d'impôt.
Il est possible, pour reprendre les conclusions du rapport Ducamin Précité, que cet allégement de la taxation des revenus du capital, alors que l'augmentation des prélèvements obligatoires prenait essentiellement la forme d'une taxation accrue du travail, en raison notamment de l'augmentation des cotisations sociales, ait pesé défavorablement sur l'emploi de la main d'oeuvre non qualifiée.
Enfin, un tout récent rapport du Fonds Monétaire International vient conforter la volonté du Gouvernement de réorienter les prélèvements fiscaux. En effet, selon ce rapport, la France devrait revoir de fond en comble son imposition de l'épargne et des revenus financiers, "dépassée" en raison des bouleversements intervenus sur les marchés financiers depuis une dizaine d'années. Ces experts soulignent que le système français de taxation de l'épargne est d'une "complexité excessive", produisant des recettes inférieures à celles des autres grands pays et n'encourageant pas réellement l'épargne. Toujours selon cette étude, en 1990, 46 % des recettes fiscales françaises provenaient de l'imposition du revenu du travail, contre une moyenne de 27 % pour les autres pays du "Groupe des 7". Plus de 27 % de ces recettes étaient des contributions patronales, la proportion la plus élevée des pays industrialisés. Ces chiffres doivent être interprétés avec précaution, car ils ne semblent pas tous cohérents avec ceux calculés par l'OCDE (cf. rapport du Conseil des Impôts de 1990).
Quoi qu'il en soit, il eût été sans aucun doute préférable d'organiser un rééquilibrage des deux fiscalités par un allégement de la fiscalité du travail et non par un alourdissement de la fiscalité de l'épargne. En faisant valider, dès cette loi de finance, des choix sur lesquels il sera difficile de revenir par la suite, le Gouvernement préjuge en fait des choix qui pourront être effectués ultérieurement.
On peut admettre par ailleurs que les effets de la fiscalité sont sans doute plus importants sur la structure de l'épargne que sur son volume, ce qui peut laisser espérer que, dans le court terme, les mesures proposées par le présent projet de loi n'auront pas trop d'effets négatifs sur la propension de nos concitoyens à épargner.
Cependant, on ne saurait oublier, dans une optique de long terme, que le niveau de croissance est directement fonction du niveau de l'épargne et de l'investissement. C'est précisément parce qu'au cours des années 1980 le taux d'épargne des Français avait dangereusement chuté, que les législateurs successifs ont, toutes tendances politiques confondues, mis en place des dispositifs fiscaux en faveur de l'épargne. Il faut donc éviter de passer d'une politique dont la stratification aboutit désormais à une générosité hors de nos moyens, à une "non politique" de l'épargne, dont les effets sur l'économie nationale pourraient se révéler, à terme, inadéquats.
De ce point de vue, il est important de rappeler les recommandations du rapport du Conseil national du Crédit précité :
"L'épargne nationale résulte des comportements de l'ensemble des secteurs de l'économie. Elle dépend donc, non seulement de la propension des ménages à consommer leur revenu, mais également de l'équilibre des finances publiques et de la capacité des entreprises à générer de l'autofinancement. (...)Les propositions avancées ici visent essentiellement à améliorer la structure du patrimoine financier des ménages et à accroître le volume de leurs flux d'épargne. Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que le redressement du taux d'épargne national à un niveau compatible avec des objectifs de croissance économique plus soutenue suppose également de rééquilibrer le solde budgétaire en modérant les dépenses publiques "
Les prévisions relatives au taux d'épargne des ménages, établies par la Direction de la prévision et annexées au rapport économique et financier (tome II p. 31) anticipent une légère diminution de ce taux pour la France en 1996.
D'un point de vue fiscal ensuite, force est de constater que si la réforme soumise à l'examen du Parlement laisse intacte une certaine forme de neutralité entre produits de même catégorie, en revanche, elle établit au profit de l'épargne liquide une incitation fiscale inversement proportionnelle à l'utilité économique qui lui est généralement reconnue.
En effet, si l'on excepte les revenus d'actions et assimilés, l'épargne stable bénéficie désormais du seul avantage du prélèvement libératoire à 19,4 %, alors que l'épargne liquide continue au travers des livrets A, CODEVI et autres Comptes d'épargne Logement, de bénéficier, sous condition de plafond (860.000 francs pour un couple marié avec deux enfants) d'une totale exemption d'impôts. Il y à là une fragilité dans la cohérence du dispositif proposé.
Enfin, d'un point de vue sociologique, il convient de rappeler que la fiscalité de l'épargne constitue, pour nos concitoyens un sujet extrêmement sensible.
Les Français estiment en effet que l'épargne subit déjà un prélèvement fiscal lorsqu'elle est générée et que la taxation de ses revenus constitue, en quelque sorte, une double imposition. C'est là un élément de sociologie fiscale, dont aucun Gouvernement ne peut s'abstraire totalement.
Par ailleurs, les études économiques, aussi bien que l'observation empirique, montrent que l'acte d'épargne répond à une vision de long terme, dont l'horizon peut dépasser le cycle de vie et s'étendre aux transferts entre générations. Les décisions d'affectation de l'épargne reposent donc en partie, non seulement sur le système fiscal courant, mais également sur les anticipations des agents quant à son état futur. En ce sens, une évolution par trop erratique et difficilement prévisible des modes d'imposition risque d'entraîner des perturbations importantes des comportements d'épargne. Il est donc important, d'une part, que le Gouvernement affiche plus clairement qu'il ne l'a fait le schéma visé à terme et, d'autre part, que le Parlement évite ou atténue les dispositions à effet rétroactif, de nature à entamer gravement la confiance des épargnants.
Dans un monde où la liberté des capitaux est établie, cette confiance apparaît plus que jamais indispensable.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre Commission des finances aurait préféré instituer, à la place de la réduction du champ d'application de l'abattement des 8.000 / 16.000 francs, une augmentation du taux de prélèvement libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers. Cependant, afin d'arriver à un rendement budgétaire comparable à celui de la mesure proposée, il aurait fallu augmenter ce taux d'environ 8 points.
b) Une réforme inachevée
Telle qu'elle a été commencée, l'inflexion de la politique de l'épargne doit être poursuivie dans deux directions.
La première consiste à envisager de réduire les avantages de la taxation de l'épargne liquide, au moins au niveau des produits de taux, faute de quoi, l'épargne stable se trouverait durablement pénalisée au détriment de l'épargne liquide, contrairement aux enseignements les plus établis de la théorie économique.
Le livret A, et les CODEVI sont sans aucun doute des placements financiers pertinents permettant de faire bénéficier certains secteurs économiques jugés prioritaires d'un flux régulier d'épargne à un coût inférieur au coût du marché. Mais ils ne sauraient constituer, à eux seuls, l'avenir de l'épargne française.
La seconde réside dans la mise en place de fonds de pension, réforme depuis longtemps annoncée, mais toujours reportée.
Un tel instrument, dont il convient de rappeler que notre Haute assemblée fut la première à suggérer la mise en place 1 ( * ), devrait permettre, en s'appuyant sur le motif d'épargne en vue de la retraite, de créer un nouveau réflexe d'épargne à très long terme et contribuer ce faisant au développement d'une épargne stable, particulièrement favorable au financement des fonds propres des entreprises.
Selon les engagements pris par le ministre de l'économie, des finances et du plan, la mise en place de cet instrument devrait intervenir à l'issue du grand débat social et de la réforme des prélèvements obligatoires.
Ce n'est que dans ces conditions que la réforme fiscale amorcée pourra trouver une cohérence d'ensemble.
B. LA FISCALITÉ DES TRANSMISSIONS
Il s'agit du deuxième grand domaine dans lequel le projet de loi de finances propose d'innover. En effet, pour assurer la pérennité des entreprises, et donc des emplois qui s'y rattachent, l'article 6 du projet de loi prévoit de réduire de façon significative les droits de mutation exigibles en cas de donation anticipée de tels actifs.
Sur le fond, il faut se féliciter que le gouvernement décide d'ouvrir cet épineux dossier, et envisage d'atténuer le poids de la fiscalité lors d'une phase critique de la vie de l'entreprise.
Mais il est cependant regrettable que la réforme envisagée reste timide. Complexe et contraint, le dispositif proposé a en réalité une portée modeste. Il illustre ainsi à nouveau un des travers habituels de notre démarche fiscale : organiser un régime dérogatoire, et donc source potentielle d'effets pervers, pour éviter de remettre en cause un taux d'imposition excessif, mais ayant valeur de symbole aux yeux de l'opinion.
1. Un obstacle fiscal clairement identifié
En préalable, il importe de rappeler que les problèmes relatifs à la transmission du patrimoine entre générations s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus vaste que la simple approche fiscale. Ils font en effet intervenir les règles de dévolution successorale fixées par le code civil, et dans certains cas, peuvent être liés à la personnalité, ou aux capacités, des héritiers.
Toutefois, et même s'il est secondaire, le rôle de la fiscalité est cependant loin d'être neutre. Il est d'ailleurs d'autant plus sensible que le niveau des taux d'imposition reste, dans ce domaine plus que dans d'autres, un sujet lourd de symbole et de contenu idéologique. Mais cette vision philosophique de l'impôt ne devrait pas occulter les contraintes économiques. Le patrimoine ainsi taxé lors de sa transmission regroupe en effet certains biens ou actifs dont la création et le développement sont par ailleurs encouragés par l'État pour des motifs économiques, industriels ou sociaux. Il devient alors préférable que le niveau de l'imposition ne suscite pas leur disparition ou transformation à l'occasion d'un changement de génération.
Or cet impératif semble avoir été perdu de vue au début des années quatre-vingt.
a) Une réforme teintée d'idéologie
Depuis longtemps, notre législation connaît des tarifs particulièrement élevés pour les transmissions à titre gratuit effectuées au profit de collatéraux (45 %), de parents éloignés (55 %) ou de tiers (60 %).
Cette sévérité a récemment été étendue aux successions en ligne directe. L'article 19 de la loi de finances pour 1984 a en effet ajouté, à l'ancienne tranche supérieure de 20 %, trois nouvelles strates assorties respectivement d'un taux de 30 %, 35 % et de 40 %. Désormais, cette imposition maximale s'applique pour la fraction de l'actif net par part qui excède 11 millions de francs. A titre de comparaison, nos voisins allemands connaissent certes un taux comparable, mais qui joue au-delà d'un seuil équivalent à 300 millions de francs.
En fait, et comme dans de nombreux autres domaines, notre fiscalité cumule ainsi des taux lourds associés à une progressivité excessive du barème.
Or c'est depuis cette réforme, mise en oeuvre pour des raisons idéologiques qui ressortent clairement à la lecture des débats de l'Assemblée nationale, que le problème de la transmission des entreprises de taille moyenne se pose en des termes aigus.
b) Un problème ciblé, mais économiquement très sensible
Par construction, le problème du taux maximum n'intervient que pour les successions d'importance. De fait, il ne concerne généralement pas la transmission des entreprises individuelles ou artisanales en raison de leur faible valeur.
En outre, le niveau du taux d'imposition maximum n'a en soi pas de conséquences économiques majeures lorsque les biens transmis sont suffisamment liquides ou facilement négociables : créances bancaires, titres de sociétés cotées, oeuvres d'art. Ainsi, la pérennité d'une entreprise cotée n'est-elle pas menacée lors du décès d'un de ses dirigeants, même s'il est un actionnaire important.
En revanche, la situation est tout autre si les actifs sont peu liquides, alors qu'ils peuvent représenter un fort potentiel économique. C'est le cas notamment des entreprises de taille moyenne non cotées dont les héritiers sont contraints de choisir entre deux solutions peu favorables en termes d'efficacité économique :
- soit prélever sur l'entreprise les sommes nécessaires au paiement des droits, accentuant ainsi sa fragilité dans une phase déjà délicate, et obérant pour longtemps sa capacité de développement ;
- soit céder l'entreprise à un tiers. Dans cette hypothèse la solution n'est pas nécessairement antiéconomique, et elle peut même s'avérer favorable quand les héritiers naturels n'ont pas les qualités requises Pour reprendre l'affaire. Mais encore faut-il que le marché existe, et que le repreneur ne soit pas un concurrent -français ou étranger- dont la première démarche sera de restructurer l'activité pour l'intégrer dans son propre processus de production. Or, de nombreux exemples témoignent que cet enchaînement est souvent le plus probable. A l'occasion d'une transmission, les entreprises moyennes les plus performantes sont souvent rachetées par une société étrangère, qui paye ainsi son "ticket d'entrée" sur le marché national.
Certes, différentes procédures permettent de préparer la transmission et d'en atténuer de près de moitié le coût fiscal. Il en est ainsi :
- de la donation partage avec réserve d'usufruit, qui suppose toutefois l'existence d'au moins deux héritiers en ligne directe ;
- du recours à une société holding constituée entre le propriétaire de l'entreprise et ses ayant-droits.
Mais il faut évidemment que le chef d'entreprise décide d'anticiper la transmission de son entreprise et en organise les modalités.
Il n'y a aucune place pour l'hésitation ou l'imprévu.
2. Un projet contraint et donc timide
En fait, la seule solution susceptible de résoudre de façon satisfaisante le problème précédent serait de revenir sur une partie de la réforme de 1984. Le coût d'une telle mesure ne serait d'ailleurs pas excessif au regard des enjeux : 0,9 milliard de francs dans l'hypothèse ou le taux maximum applicable en ligne directe serait ramené à 25 %.
Cette approche apporterait une solution au cas des successions non préparées, tout en maintenant un avantage pour les transmissions anticipées. En revanche, il est certain qu'elle n'opère aucune distinction selon la nature des biens transmis.
Au moment où tous les Français sont sollicités pour aider à réduire les déficits publics, une telle mesure susciterait sans nul doute l'incompréhension ; cette situation démontre ainsi à nouveau les difficultés que soulève la remise en cause d'une mesure démagogique à connotation sociale, même si ses conséquences sur l'économie sont désastreuses.
Le projet du gouvernement prend acte de cette situation ambiguë et propose donc d'instaurer un dispositif centré sur la transmission effectuée dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise, cet objectif étant essentiel pour légitimer l'avantage accordé au regard des règles constitutionnelles.
Mais, à partir de ce choix, les contraintes s'enchaînent et conduisent à enserrer le dispositif dans un corset de règles qui lui enlève une partie de son efficacité.
a) Trois impératifs particulièrement contraignants qui conditionnent l'ensemble du dispositif
• Compte tenu de l'objectif poursuivi,
l'avantage doit être essentiellement réservé aux
transmissions volontaires
qui doivent donc être
effectuées suffisamment tôt par voie de donation.. En effet, d'une
part, la transmission anticipée, et donc préparée, est un
gage important pour la survie de l'entreprise. D'autre part, une extension de
l'avantage au cas des successions aurait un effet pervers en supprimant
implicitement une large partie de l'attrait des dispositifs actuels
d'incitation à la transmission anticipée. L'Assemblée
nationale a toutefois décidé d'élargir ce champ au cas des
entreprises transmises par succession lorsque le décès du
dirigeant intervient trop tôt pour qu'il ait eu l'occasion de
préparer la transmission.
ï Faute de définition précise et reconnue, il faut en outre cerner la notion d'entreprise. Tout à fait logiquement, il est prévu de s'appuyer sur les règles retenues pour qualifier un bien de "professionnel" au regard de l'ISF. Mais, il est évident que cette définition présente des aspects arbitraires et suscite de multiples problèmes de "frontière" qui sont à l'origine de différences de traitement difficilement compréhensibles, ou même injustes.
ï Enfin, et sous peine de rupture du principe d'égalité devant l'impôt, l'avantage fiscal ne peut être accordé à une simple opération patrimoniale. Il faut alors impérativement le réserver aux transmissions consacrant un véritable transfert du pouvoir sur l'entreprise.
Dans le texte du gouvernement, cette contrainte essentielle se traduit par une condition rigoureuse : un transfert en pleine propriété portant sur la moitié du capital ou des biens affectés à l'entreprise.
b) Une réponse partielle
Par construction, le nouveau dispositif présente les inconvénients qui découlent des contraintes imposées par le choix initial. Cadré sur la base incertaine des biens professionnels au sens de l'ISF, il s'expose aux critiques que suscite cette définition. En dépit de l'apport de l'Assemblée nationale, il reste largement centré sur le cas des donations et laisse en suspens le problème des successions non préparées, qui constituent pourtant l'événement le plus grave pour la pérennité de l'entreprise. Toutefois, lever ces contradictions suppose un changement d'orientation difficilement envisageable dans l'immédiat.
En revanche, il est certain que, dans son principe, le nouveau dispositif complète fort opportunément le champ des actuels régimes d'incitation à la transmission anticipée. Ayant une portée générale, il pourra ainsi potentiellement s'appliquer au cas de donation d'entreprise à un enfant unique, à des collatéraux ou à des tiers, et donc aux situations aujourd'hui non concernées par la donation-partage. Combiné avec ce dernier régime, il offre enfin la possibilité de transmettre à ses enfants le contrôle de l'entreprise dans des conditions fiscales avantageuses, mais en leur imposant de préserver cet outil économique durant cinq ans.
Toutefois, il est à craindre qu'en l'état actuel du texte, une partie de ces attraits reste, pour l'instant, assez théorique. En effet, il n'est pas évident que de nombreux chefs d'entreprises envisagent, sans hésitation, de transmettre, avant 65 ans et en pleine propriété, une part substantielle de leur participation au capital, se privant ainsi pour l'avenir d'une source de revenus pourtant indispensable. Les solutions qui doivent être apportées à ce problème concret vont, à l'évidence, conditionner l'efficacité réelle du nouveau régime.
C. VERS UNE NOUVELLE TAXE PROFESSIONNELLE ?
Le présent projet de loi de finances contient deux dispositions relatives à la taxe professionnelle : l'article 10 pérennise le relèvement du plafond de la cotisation à 3,8 % ou 4 % de la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 140 millions de francs ou 500 millions de francs ; l'article 11 institue une cotisation minimale de taxe professionnelle égale à 0,35 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs.
L'exploration de la "piste" de la cotisation minimale assise sur une fraction de la valeur ajoutée avait été suggérée par le Sénat lui-même qui, à l'initiative de votre commission des finances, avait inséré dans la loi de finances pour 1995 le principe d'une simulation par le gouvernement des conséquences de l'institution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 %, 1 %, 1,5 % ou 2% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs.
1. La cotisation minimale
L'article 11 pourrait être conçu comme l'aboutissement d'un très long processus de réflexion, qui a commencé -pour ainsi dire...- avec la mise en place de la taxe professionnelle elle-même.
En effet, la loi du 10 janvier 1980 avait, la première, posé le principe d'un changement d'assiette de la taxe professionnelle :
- s'inscrivant dans les travaux parlementaires préparatoires à cette loi, le rapport de la commission présidée par notre ancien collègue, André-Georges Voisin, avait attribué à l'assiette indiciaire la responsabilité essentielle de ce qui était considéré comme l'échec de la taxe professionnelle et il avait conclu à l'adoption de la valeur ajoutée comme nouvelle assiette de la taxe professionnelle. La loi du 10 janvier 1980 en avait retenu le principe ;
- cependant, il avait été prévu de faire précéder sa mise en oeuvre par des études et simulations. Celles-ci ayant mis en évidence l'importance des transferts de charge qui en résulteraient, le gouvernement renonça alors à appliquer la nouvelle assiette et instaura un mécanisme de plafonnement.
De l'aveu même de l'actuel gouvernement, l'objectif poursuivi n'est pourtant pas d'entamer le "grand virage" attendu depuis 15 ans mais, plus prosaïquement "de contribuer à stabiliser le coût net pour l'État des dégrèvements de taxe professionnelle" (exposé des motifs de l'article 11). Dans la version initiale du projet de loi de finances, la différence entre la cotisation de 0,35 % de la valeur ajoutée et la cotisation "normale" de taxe professionnelle telle qu'elle résulte de l'application des textes en vigueur devait, en effet, être reversée à l'État.
La cotisation minimale de taxe professionnelle aurait ainsi un statut similaire :
- à la taxe de 3,60 % du montant des impôts directs locaux prélevée par l'État en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge ;
- à la majoration de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle reversée par le FNPTP au budget général de l'État afin de compenser une partie du coût de l'abaissement de 5 % à 4,5 %, en 1989, du plafonnement de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée ;
- au prélèvement assis sur les bases nettes de taxe d'habitation que l'État opère en contrepartie d'une partie des dégrèvements de taxe d'habitation qu'il prend à sa charge ;
- implicitement, à la majoration de 0,4 point de la taxe pour frais d'assiette et de recouvrement des impôts directs locaux que l'article 13 du présent projet de loi de finances propose de pérenniser.
L'Assemblée nationale a certes imposé le principe d'un reversement du gain procuré par la cotisation minimale de taxe professionnelle en ressource du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et donc au profit des collectivités locales. Toutefois, l'État réduit à due concurrence (400 millions de francs) sa propre participation au financement du FNPTP.
La cotisation minimale de taxe professionnelle apparaît donc bien, dans ce contexte, comme une modalité, aussi minime soit-elle, de détermination de l'équilibre budgétaire de l'État.
2. Le choix d'une assiette nouvelle ?
L'inflexion de la taxe professionnelle vers une assiette "réelle" par opposition à sa composition actuelle qui laisse une large place aux éléments indiciaires (valeur locative des immobilisations) apparaît ainsi très largement étrangère aux interrogations qui l'ont précédée. Or, celles-ci méritent d'être rappelées tant il paraît souhaitable de ne pas opérer "à l'aveugle" des choix lourds de conséquences pour les collectivités locales et les entreprises.
- Du point de vue des collectivités locales : la cotisation minimale de taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte marqué par la substitution progressive d'une ressource centralisée et redistribuée par l'État au mécanisme normal de perception immédiate par les collectivités locales de leurs quatre taxes directes. En effet :
- près du quart des quatre taxes confondues est aujourd'hui pris en charge par l'État ;
- cette proportion atteint pratiquement le tiers s'agissant de la taxe professionnelle.
Charge nette pour l'État de la fiscalité directe locale
(Compensations + coût des dégrèvements - taxe pour frais de dégrèvement, reversement d'une fraction de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle et prélèvement sur les valeurs locatives de la taxe d'habitation)
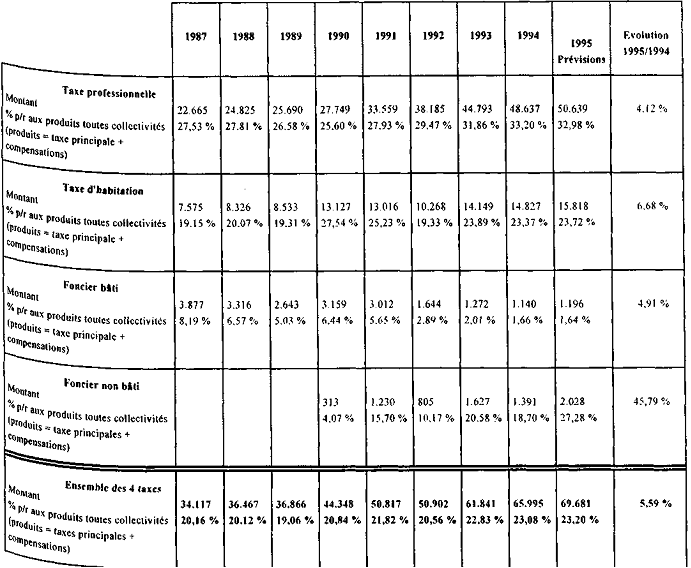
Jusqu'à présent, cette accentuation de la "centralisation-redistribution" de la recette fiscale par l'échelon central était justifiée par "aggravation du caractère inadapté des bases indiciaires sur lesquelles sont essentiellement assises les "quatre vieilles" ainsi que, pour la taxe professionnelle, par la concentration relative de cet impôt sur les entreprises industrielles.
Avec la cotisation minimale de taxe professionnelle s'ajoute à ces motifs l'impossibilité d'isoler la valeur ajoutée structure par structure lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements. La remontée de l'impôt à l'échelon central obéit alors à un impératif pour ainsi dire mécanique.
Son impact est toutefois encore renforcé par le fait que non seulement l'assiette, mais également le taux, sont déterminés par l'État seul alors que les compensations de dégrèvements ou d'exonérations reflètent encore, plus ou moins lointainement, les politiques fiscales menées, ou qui ont été menées antérieurement, par les collectivités locales.
Le dispositif de l'article 10 du projet de loi de finances n'enclenche-t-il pas la mise en place du schéma initialement envisagé par le précédent gouvernement dans le cadre du projet de loi d'orientation pour l'aménagement du territoire qui prévoyait que la taxe professionnelle serait divisée en deux tranches ? La première tranche était calculée sur la base d'un taux d'imposition fixé au niveau national et venait alimenter un fonds national de péréquation. La deuxième tranche restait calculée sur la base d'un taux d'imposition fixé librement par les collectivités territoriales.
Rappelons que les deux assemblées, voici un an, avaient rejeté la mention explicite de cette solution comme de celle tendant à faire de la taxe professionnelle toute entière un impôt national redistribué ultérieurement aux collectivités locales.
- Du point de vue des entreprises : dès le début des années 1980, l'argument positif avancé pour justifier un passage à une taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, le rééquilibrage de l'assiette, était concomitamment présenté comme un inconvénient majeur dès lors qu'étaient mis en avant les transferts de charges induits par ce même rééquilibrage.
Au cas présent, le gouvernement a certes prévu deux verrous permettant d'écarter des transferts massifs de charges vers des petites et moyennes entreprises :
- en instituant un plancher de chiffre d'affaires (50 millions de francs) ;
- en plafonnant le gain de la mesure à deux fois la cotisation "normale" de taxe professionnelle qui résulterait de l'application des textes actuellement en vigueur 4 ( * ) .
Il apparaît toutefois qu'à l'instar du relèvement du plafond de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, l'institution de la cotisation minimale devrait affecter prioritairement des secteurs soumis à la concurrence internationale ou à des prélèvements fiscaux spécifiques, notamment les entreprises de location et de crédit-bail immobilier, les sociétés d'assurance, les services marchands et les organismes financiers.
En conclusion, l'institution d'une cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée comme le déplafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée sont des mesures trop lourdes de conséquences pour n'obéir qu'à des considérations liées au rétablissement de l'équilibre budgétaire de l'État, aussi indispensable ce rétablissement fût-il.
CHAPITRE II - LE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1996
Retour sur 1993 et 1994
"De la récession à la reprise de la croissance"
Après la récession constatée en 1993 avec un repli du produit intérieur brut de 1,5 % par rapport à 1992, la reprise économique a été en 1994 plus vive que prévu.
Au terme des révisions des comptes nationaux, la croissance réelle en 1994 est évaluée à 2,9 % pour un PIB de 7.383,3 milliards de francs à la fin de l'année.
En 1993, la récession est provenue de deux causes majeures :
- un net repli de l'investissement en général et de l'investissement des entreprises en particulier, celui-ci exerçant un effet dépressif sur l'activité de l'ordre de 0,7 %.
- les variations de stocks, la politique de déstockage des entreprises ayant à elle seule conduit à une décroissance du PIB de l'ordre de 2 %.
Seules deux variables ont pu soutenir l'activité en 1993 :
ï la demande des administrations publiques à hauteur de 0,6 % ;
ï le commerce extérieur pour 0,8 % grâce davantage au repli des importations -+ 0,9 % du PIB- qu'à l'essor des exportations - 0,1 % du PIB.
La reprise de la croissance en 1994, avec pour toile de fond une reprise modérée de la consommation des ménages, est venue de l'investissement, mais surtout des variations des stocks des entreprises.
Contributions à la croissance du PIB en 1993 et en 1994 (prix de 1980) (en %)
|
1993 |
1994 |
||
|
Consommation des ménages Consommation Finale des administrations Investissement dont : - SQS et EI - Ménages hors EI - Administrations Publiques - Autres Solde extérieur Variations de stocks |
0,1 0,6 - 1,3 -0,7 -0,4 0,0 -0,1 0,8 - 1,8 |
0,9 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,3 1,7 |
|
|
PIB |
-1,5 |
2,9 |
|
|
Source : Comptes nationaux - INSEE |
|||
Deux phénomènes importants :
L'importance prise par les mouvements de stocks dans les évolutions conjoncturelles observées en 1993 et 1994 doit être soulignée. Hors effets de stocks, la croissance aurait été de 0,2 % en 1993 et de 1,1 % en 1994.
La reprise de l'activité en 1994, bien réelle, est donc moins due au dynamisme des composantes traditionnelles et "lourdes" de la croissance qu'à la variation d'une de ses composantes considérée en générale comme l'une des moins significatives.
L'une des importantes conséquences du rythme de la reprise de l'activité en 1994 -avec une accélération du taux de croissance au second semestre- est d'avoir dégagé un important acquis de croissance pour l'année 1995 puisque, au début de 1995, l'acquis pouvait être évalué à 2 %.
L'acquis de croissance mesure ce que serait le taux de croissance en moyenne annuelle qu'on obtiendrait si le niveau du PIB restait stable.
Il s'agit d'un indicateur avancé de la croissance annuelle.
Exemple : si le PIB des troisième et quatrième trimestres de 1995 restait au niveau atteint au deuxième trimestre -1.928,7 milliards de francs- la croissance réalisée en 1995 serait de 4,2 %, soit le rapport entre la somme des PIB trimestriels en 1995 : 1.908.7 + 1.928,7 + 1.928,7+ 1.928,7 = 7.694,8 et le niveau du PIB en 1994 = 7.383,4 milliards de francs.
Une autre importante conséquence de la croissance de l'année 1994 est qu'elle a permis à l'économie française de récupérer une part de l'écart entre sa production effective et sa production potentielle, qui s'était creusé dans la phase de dépression de l'activité.
Apprécier la production potentielle dans une économie n'est pas simplement un luxe de prévisionniste mais permet de disposer d'un indicateur avancé de l'évolution de grandes variables -salaires, prix, croissance- et de porter un diagnostic sur les problèmes auxquels une économie est confrontée : croissance prévisible du revenu, degré de flexibilité des facteurs de production, compétitivité extérieure...
L'estimation du taux de croissance potentiel est, depuis Malthus, un vieux problème de la science économique, mais il prend une acuité particulière dans une économie de sous-emploi durable.
La croissance potentielle est, en première analyse, celle qui résulterait d'un plein emploi des facteurs de production corrigé par la prise en compte des gains de productivité. Mais, compte tenu des rigidités structurelles ou des tensions sur les prix des facteurs qu'occasionnerait ledit plein emploi, le taux de croissance durable est, malheureusement, inférieur à celui qui en résulterait.
Le consensus -l'opinion moyenne des experts- établit le taux de croissance potentielle de l'économie française à 2,5 %.
La croissance réalisée en 1994 -2,9%- excède ainsi le rythme de la croissance potentielle.
Cependant, compte tenu de l'écart entre la production effective et la production potentielle qui s'était creusé au cours de la récession, la croissance réalisée en 1994 n'a permis de regagner que 8 % de cet écart.
Dans ces conditions, d'importantes marges de croissance restent disponibles.
Le projet de loi de finances pour 1996 est bâti sur une hypothèse de croissance du PIB de 2,8 % qui est le chiffre médian d'une fourchette allant de 2,5 % à 3 % de croissance.
Cette prévision comporte un certain nombre d'aléas qu'on ne doit sans doute pas cumuler mais dont la probabilité de réalisation s'est quelque peu renforcée entre le moment où ont été élaborées les prévisions économiques pour 1996 et celui où est rédigé ce rapport.
En atteste le glissement de la tonalité des débats économiques entre septembre et octobre 1995 vers un optimisme plus mesuré, voire vers une certaine inquiétude.
I. LES ENCHAÎNEMENTS MACROÉCONOMIQUES
A. LA PRÉVISION ASSOCIÉE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1996
Contributions à la croissance du PIB
(Contributions à la croissance du PIB en points)
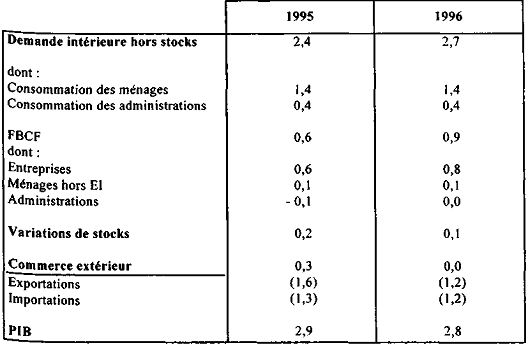
La croissance serait de 2,8 % en 1996.
Quelle confiance accorder aux prévisions économiques ?
"L'erreur de prévision est inhérente à tout exercice de prospective.
Les années récentes ont été marquées par d'importantes révisions en baisse des prévisions de croissance. Ainsi, pour 1991, la prévision associée à la loi de finances tablait sur une évolution du PIB de 2,7 % pour une réalisation de 0,6 % dans les comptes semi-définitifs de l'INSEE ; pour 1993, l'écart est plus fort encore entre les 2,6 % du rapport économique, social et financier et l'estimation actuelle d'une baisse de 1,5%. Ces corrections, pour importantes qu'elles soient, ne sont pas tout à fait exceptionnelles : l'année 1975 a vu une erreur de 3,9 points (entre 4,2 % prévus et 0,3 % réalisés) ; d'importantes erreurs en sens inverse ont été commises : 2,9 points en 1969 (entre 5 % prévus et 7,9 % réalisés) et, plus près de nous, 2,1 points en 1988 (entre 2,2 % prévus et 4,3 % réalisé).Mais nombre d'années ont été plus satisfaisantes pour les prévisionnistes.
Au total, la précision moyenne de prévision à un an a pu être estimée sur la période 191990 à environ 1 à 1,5 point ; elle est encore comprise entre 0,5 et 1 point pour une prévision réalisée à l'été de l'année considérée. En effet, d'une part, le compte provisoire de l'INSEE apparaît lui-même comme une estimation du compte définitif à 0,5 point près pour le PIB. D'autre part, les budgets économiques soutiennent la comparaison avec les différents organismes et aucun n'apparaît systématiquement meilleur que les autres.
Enfin, si le "consensus" combinant les prévisions disponibles paraît en moyenne un meilleur prédicateur que chacun des organismes pris isolément, il paraît toujours possible d'obtenir un meilleur résultat que lui."
Source : Notes bleues n° 34 - mars 1994.
1. L'environnement international
La contribution du commerce extérieur à la croissance serait nulle après avoir été positive -0,3 point- en 1995.
L'environnement international serait marqué par une croissance de 2,7 % dans les pays de l'OCDE contre 2,5 % en 1995. L'économie américaine réussirait son atterrissage en douceur et l'activité reviendrait au niveau de la croissance potentielle, soit 2,8 %. En Europe, après la pause observée en 1995, une reprise se dessinerait en particulier en Allemagne où la croissance serait de 2,9 % en 1996.
La demande mondiale adressée à la France s'accroîtrait de 7,5 % contre 8,9% en 1995.
Le solde des échanges extérieurs passerait d'un niveau record en 1995 de 100,4 milliards de francs à un niveau toujours élevé de 92,8 milliards de francs.
La prévision est construite à partir d'une hypothèse conventionnelle de gel des parités à leur niveau moyen du 21 au 25 août 1995.
Entre le mois de décembre 1994 et le mois de juillet 1995, le cours du franc a été affecté par des turbulences sur le marché des changes. Face à notre monnaie, le dollar et la lire italienne se sont dépréciés de façon importante (-19%), ainsi que la livre anglaise (-8,6%) et la peseta (- 0,9 %) dans une moindre mesure. A l'inverse, au cours de la même période, d'autres monnaies sont restées à peu près stables vis-à-vis du franc : le yen (1,2 %), le mark (0,2 %), le franc suisse (1,2 %), le florin (0,2 %), le franc belge (0,2 %).
Dans l'ensemble, ces mouvements de parité dont certains s'apparentent à de réelles dévaluations compétitives écornent la compétitivité de nos produits.
Certains secteurs sont plus touchés que la moyenne. C'est le cas pour l'aéronautique à cause de la concurrence américaine, du textile et des cuirs et chaussures à cause de la concurrence des pays d'Asie, dont la monnaie est liée au dollar, de l'Italie ainsi que de l'Espagne. En revanche, d'autres branches ont peu ressenti les derniers mouvements de change comme les métaux ferreux, les matières plastiques et le transport terrestre (notamment le secteur automobile où les effets de la dépréciation du dollar, de la lire et de la peseta ont été compensés par l'appréciation du mark et du yen).
Compte tenu de la volatilité observable sur le marché des changes et de la stratégie de dépréciation du dollar conduite par l'administration américaine, l'hypothèse d'un gel des parités apparaît fragile mais raisonnable.
Fragile, parce que le creusement sans précédent du déficit extérieur aux États-Unis provoque une baisse conséquente du dollar et des pertes de compétitivité en Europe, et parce que l'orientation du commerce extérieur américain reste hypothétique.
Raisonnable, parce que les mouvements du dollar sont susceptibles de modifier les parités entre les autres monnaies dans un sens qui peut compenser les effets sur la compétitivité de la France de la dépréciation du dollar.
On ne peut cependant pas ignorer les conséquences associées à ce dernier scénario qui pourrait accentuer les tensions entre les monnaies européennes et orienter dans un sens non souhaitable les politiques monétaires en Europe.
2. La demande intérieure
Hors stocks, la contribution de la demande intérieure à la croissance du PIB s'élèverait à 2,7 points.
La consommation des ménages s'accroîtrait de 2,3 % en volume.
Cette progression serait obtenue malgré une inflexion de gains de pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages qui n'augmenterait que de 1,6 % en 1996.
Les revenus d'activité resteraient bien orientés avec un gain de 1,3 % du salaire par tête et une progression de l'emploi salarié non financier non agricole de 2,1 %. Toutefois l'hypothèse d'un rééquilibrage progressif des comptes sociaux qui a été posée conduit à une économie de dépenses de l'ordre de 32 milliards de francs qui correspond à une amputation du même montant du revenu disponible brut des ménages.
La croissance de la consommation proviendrait donc, pour beaucoup, d'une baisse du taux d'épargne des ménages qui se replierait de 0,6 point, passant de 13.8 à 13,2 % entre 1995 et 1996 après une progression de 0,4 point l'an dernier.
L'investissement total augmenterait de 5,1 %, ce qui proviendrait d'une accélération du rythme d'investissement des entreprises (+ 8 % en 1996 contre + 6,3 % en 1995). Cette évolution résulterait d'une situation de solvabilité des entreprises plus favorable (les frais financiers absorbent le quart du bénéfice d'exploitation contre le tiers il y a trois ans) et de forts besoins d'augmenter les capacités de production installées.
L'inflation resterait maîtrisée malgré une accélération en 1995 de l'inflation sous-jacente de 1 à 1,9%.
B. DES ALÉAS QUI SE PRÉCISENT
A l'occasion de la réunion du groupe technique de la commission des comptes et des budgets économiques de la Nation du 3 octobre 1995, le consensus des instituts de prévision -leur opinion moyenne- s'est établi à 2,5 %, soit le bas de la fourchette de la prévision gouvernementale.
Quelques semaines plus tard, lors de la table ronde organisée par la commission des finances du Sénat, le 19 octobre 1995, la tonalité des interventions des prévisionnistes avait changé et l'optimisme semblait plus mesuré.
Le changement de ton provenait :
ï d'une part, des dernières informations conjoncturelles connues qui mettaient en lumière un infléchissement plus marqué que prévu de l'activité en 1995 ;
ï d'autre part, des tensions monétaires avec le relèvement du taux interbancaire à trois mois qui, ramené du niveau de 8 % du début mai à 6 % en août, a été remonté le 9 octobre à 7,2 %.
L'évolution conjoncturelle en 1995
La prévision initiale de croissance en 1995 s'élevait à 3,1 %. Elle a été ramenée en cours d'année à 2,9 %.
Le taux de croissance du PIB est passé de 4 % en glissement annuel à la fin de 1994 à 3 % à la fin du premier semestre de 1995 et serait proche, selon l'INSEE, de 2,5 % en fin d'année.
Le ralentissement de l'activité est donc plus marqué que prévu.
Il provient, pour l'essentiel, d'un arrêt dans le comportement de restockage des entreprises et d'une inflexion de l'investissement, la consommation des ménages restant, elle, sur un rythme haussier modéré.
Cependant, l'acquis de croissance étant à la fin du premier semestre de 1995 de 2,5 % pour l'ensemble de l'année, une croissance de seulement 0,55 % du PIB au second semestre par rapport au PIB réalisé pendant la même période en 1994 permettrait d'enregistrer un rythme de croissance de 2,9 % au cours de l'année.
1. L'investissement
Initialement fixée à 8 % la prévision de croissance de l'investissement des entreprises a été ramenée à 5,5 % par l'INSEE au début de l'automne.
Le taux de marge ( ( * )1) qui mesure la part de la valeur ajoutée oui "revient" aux entreprises reste à un niveau élevé -31,8 %- tandis que le taux d'épargne ( ( * )2) des entreprises qui traduit leur aisance financière se redresse vivement -18,4 %-.
L'amélioration des capacités de financement des entreprises ( ( * )3) s'accompagne d'un niveau élevé de leur taux d'autofinancement -112,8 %-.
Mais, celui-ci provient, pour beaucoup, du faible niveau de l'investissement, car, bien qu'allant en s'allégeant, les charges financières supportées par les entreprises restent à un niveau élevé et absorbent près de 10 % de leurs ressources.
Le désendettement est resté, pour les entreprises, une priorité : le niveau élevé des taux d'intérêt est, sans doute, un facteur puissant expliquant cette stratégie.
Mais la croissance modérée de l'investissement résulte sans doute également de l'atonie des perspectives.
Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie qui mesure les tensions exercées sur les facteurs de production par la demande se redresse quelque peu en 1994 mais demeure à un niveau modéré -82 %-.
Ceci se traduit par une dérive très modeste des prix de production et indique que la demande n'exerce guère d'influence marquée sur l'investissement des entreprises.
Cette analyse est confortée par le dépouillement des enquêtes menées auprès des entrepreneurs au terme desquelles se dégage le sentiment d'une dégradation et de leurs perspectives personnelles et des perspectives générales.
2. La consommation des ménages
De façon assez réconfortante, c'est la consommation des ménages qui, au premier semestre de 1995, s'est le moins éloignée des prévisions.
Cependant, son rythme de croissance reste modéré : + 2,3 %.
Le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages devrait s'accroître en moyenne annuelle de 2,7 % en 1995 après une hausse de 1,1 % en 1994.
Cette accélération provient d'une série d'évolutions contradictoires.
La composante "revenus directs" de l'activité y contribue fortement.
L'accroissement de la masse salariale provient de deux facteurs :
- une progression du nombre des emplois, dynamique depuis la moitié de l'année 1994, de l'ordre de 1,5 % en glissement annuel ;
- une accélération du niveau du salaire moyen par tête.
Évolution du taux de salaire horaire et du salaire moyen par tête (entreprises non financières hors GEN )
(en moyenne annuelle en %)
|
1991 |
l992 |
1993 |
1994 |
1995 |
||
|
Salaire moyen par tête : |
||||||
|
|
4,6 |
3,8 |
1,6 |
2,2 |
3,1 |
|
|
|
1,2 |
1,3 |
-0,7 |
0,5 |
1,2 |
Source : INSEE, DP.
En revanche, si l'on excepte les revenus de la propriété, de l'entreprise et d'assurance dont la progression est très vive, les autres composants du revenu disponible brut des ménages -les transferts nets- exercent une influence à peine positive sur le pouvoir d'achat des ménages en 1995 après avoir eu un impact négatif en 1994.
Selon l'INSEE, l'accélération de la consommation observable au deuxième trimestre de 1995 aurait été "principalement liée à la suppression à la fin juin de la prime à la casse des véhicules de plus de dix ans qui a entraîné une vague d'acquisitions de dernière minute".
En outre, les enquêtes sur la confiance des ménages, favorables pendant l'été, ont enregistré à la rentrée une sensible dégradation du climat de confiance.
Taux d'épargne des ménages
(En % du revenu disponible brut)
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
||
|
Épargne économique dont : Épargne financière |
13,2 4,8 |
13,7 6.2 |
13,8 6,1 |
13,4 5,5 |
13,8 5,6 |
Source : INSEE, DP
"In fine", l'année 1995 devrait enregistrer une hausse de 0,4 point du taux d'épargne des ménages qui viendrait atténuer les effets favorables sur leur consommation de leurs gains de pouvoir d'achat.
Au-delà de leurs conséquences immédiates sur le sentiment des prévisionnistes, ces deux catégories d'événements illustrent la nature et l'ampleur des aléas qui entourent la prévision gouvernementale :
• le "triomphe des marchés" pour reprendre le
titre de la projection de l'économie mondiale à l'horizon 2002,
présentée par le CEPII et l'OFCE à l'initiative de la
Délégation pour la planification du Sénat ;
• l'incertitude quant aux variables centrales du
scénario gouvernemental.
1. Le "triomphe des marchés"
Le mouvement de globalisation économique internationale a accru les interdépendances économiques et accentué la vitesse de propagation des effets des déséquilibres survenus ici ou là vers les autres économies.
Certains affirment que les marchés ne dictent pas leur politique économique aux gouvernements n'ayant pas les yeux rivés sur quelques indicateurs, mais sur les chances de réussite des politiques économiques. Mais ils admettent que la pire erreur est de vouloir s'opposer aux marchés quand un gouvernement a tort à leurs yeux.
Ce faisant, ils reconnaissent, semble-t-il, qu'un "bras de fer" existe entre les marchés et les gouvernements.
En fait, l'incidence des marchés sur l'économie réelle est potentiellement très déstabilisante.
Le risque d'éclatements de bulles spéculatives est bien de plus en plus important comme l'ont montré depuis 1987 :
• deux crises boursières de grande
ampleur,
• les crises immobilières au Japon, en
Grande-Bretagne et en France,
• la crise mexicaine.
Si les effets patrimoniaux de certaines de ces crises ont été moins importants qu'il n'était redouté, leurs effets sur les évolutions monétaires et sur la croissance réelle ont été, la plupart du temps, très négatifs.
Tout se passe comme si les désordres que connaissent périodiquement les marchés augmentaient tendanciellement la prime de risque demandée par les prêteurs.
A cet égard, la situation de l'économie américaine ne laisse d'inquiéter.
L'interdépendance économique entre l'Europe et les États-Unis ne provient pas, pour l'essentiel, des courants d'échange entre les économies des deux continents.
Le très fort découplage constaté ces dernières années entre les conjonctures américaine et européenne a sans doute soutenu l'activité en Europe, mais dans de faibles proportions compte tenu du niveau modeste d'ouverture réciproque des économies concernées (autour de 10 %).
A l'inverse, les besoins de financement de l'économie américaine provoquent des effets très défavorables en Europe.
Ils provoquent une baisse conséquente du dollar et le maintien de taux d'intérêt à un niveau élevé. Les pertes de compétitivité et les tensions monétaires qui s'ensuivent en Europe obligent les économies européennes à dégager de forts gains de productivité afin de défendre leur compétitivité et d'échapper à l'effet des taux d'intérêt. Comme conséquence, la croissance en Europe est bridée par une "sur-épargne".
L'insuffisance d'épargne dégagée par l'économie américaine agit comme une cause structurelle expliquant le niveau des taux d'intérêt.
Elle suscite, en outre, une inquiétude supplémentaire. Un temps suspendue, l'asymétrie des effets sur les monnaies européennes de la dépréciation du dollar semble se manifester à nouveau.
Ces phénomènes sont très préoccupants et illustrent à quel point les économies européennes se trouvent fragilisées par leur "polycentrisme monétaire" face à la monnaie unique américaine.
Le monde va-t-il manquer d'épargne ?
Selon les participants au Forum économique, qui s'est tenu le 12 juin 1995 au siège du FMI sur le thème de l'épargne mondiale, de fortes ponctions sur les ressources financières disponibles dans le monde peuvent nuire à la croissance et à la santé de l'économie mondiale. "L'épargne mondiale, qui était relativement faible au XIXe siècle, a progressé constamment après 1945. Depuis le début des années 80, toutefois, l'ampleur des déficits budgétaires des principaux pays industrialisés a réduit sensiblement le taux d'épargne".
S'il est difficile de déterminer le sens de la relation de causalité, la progression de l'épargne accroît indiscutablement la production en intensifiant la formation de capital même si là où la croissance est plus rapide, l'épargne est plus forte.
Or, le changement mondial majeur a été la chute du taux d'épargne publique des pays industrialisés (en moyenne 4 % du PIB entre 1960 et 1972 mais 1/2 % seulement de 1981 à 1993) alors que leur épargne privée est restée de l'ordre de 20 % du PIB durant les trois décennies écoulées.
Il apparaît que la hausse des taux d'intérêt réels de 1960 à 1972 tient surtout à la dette publique -qui est passée de 45 % du PIB mondial pendant cette période à plus de 55 % de 1981 à 1993. On estime que chaque fois que le ratio dette publique/PIB augmente au niveau mondial de 100 points de base, le taux d'intérêt réel mondial à long terme s'accroît de 14 points de base.
Malgré son attrait, les pays doivent prendre garde au montant qu'ils empruntent à l'étranger car un pays ne peut recourir indéfiniment à l'épargne des autres. Une telle stratégie provoque de graves problèmes de balance des paiements et exige des efforts d'ajustement économique douloureux.
Compte tenu de leur position dominante, les États-Unis échappent à cette logique. Ils ont absorbé à eux seuls près de 25 % de l'épargne mondiale entre 1989 et 1993. Leur responsabilité dans le niveau des taux d'intérêt est ainsi clairement établie.
Tout se passe comme si le comblement des déséquilibres de l'économie américaine était reporté sur les autres pays.
2. Les incertitudes sur le comportement des agents
La prévision gouvernementale repose sur la réalisation d'un certain nombre d'enchaînements vertueux qui est soumise à quelques aléas.
La prévision repose d'abord sur une réorientation de la combinaison des politiques économiques. Le besoin de financement des administrations publiques serait ramené de 5 à 4 points de PIB. Ce résultat suppose un déficit de l'État limité à 3,5 % du PIB et un retour du déficit de la sécurité sociale à un niveau de 0,4 point de PIB (0,8 point en 1995) dont on a supposé qu'il serait atteint grâce à des économies de dépenses de l'ordre de 32 milliards de francs.
La politique monétaire enregistrerait une baisse des taux courts.
Malgré le scepticisme de quelques-uns, on ne peut douter de la réduction des déficits publics. De la même manière, il n'est guère douteux que le surcroît de crédibilité gagné par la politique budgétaire déterminée du gouvernement devrait amener les autorités monétaires à assouplir leur politique.
Cependant, les effets de cette recombinaison des politiques économiques restent quelque peu incertains à court terme.
Le financement de l'économie française est très sensible au niveau des taux d'intérêt à long terme. Selon une étude de la Banque de France, ceux-ci conditionnent :
• 85 % des crédits aux ménages,
• 66 % des prêts aux administrations
publiques,
• 50 % des crédits aux entreprises.
Or, l'effet d'une baisse des taux à court terme sur les taux à long terme n'est ni automatique ni univoque.
Dans l'ensemble toutefois, moyennant quelques délais, la maîtrise du taux d'inflation et la compétitivité fondamentale de l'économie française devraient permettre à une politique monétaire assouplie de produire une inflexion des taux à long terme.
•
La prévision du gouvernement repose
également sur une accélération de la consommation des
ménages
sous l'effet des gains de pouvoir d'achat de leur
revenu mais aussi d'une inflexion du taux d'épargne.
L'amélioration du revenu des ménages est attendue d'une évolution modérée du taux de salaire par tête -+ 1,3 %- et d'une forte progression du nombre d'emplois dans l'économie - 280 à 300.000 emplois devraient être créés en 1996-.
Ce dernier phénomène traduit un enrichissement de la croissance en emplois sans précédent à ce stade du cycle en général caractérisé par des effets de productivité accusés.
L'explication principale de cette évolution se trouverait dans la baisse (-15 % depuis deux ans) des charges grevant le coût du travail peu qualifié.
Hormis les effets de cette politique sur les comptes publics, la question se pose de la pérennité de ses effets sur les créations d'emplois.
Le rythme de créations d'emplois permet une diminution annuelle de 130.000 chômeurs, si bien qu'en août 1995, le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 11,4% de la population active contre 12,2% l'année précédente.
Compte tenu des caractéristiques du marché du travail en France, la poursuite de cette évolution semble incertaine.
A priori, une modération du rythme de la réduction du taux de chômage ne devrait pas provenir d'un accroissement plus important qu'escompté de la population active.
La progression de la population active (+ 142.000 personnes entre mars 1994 et mars 1995) est désormais modérée.
Toutefois, on ne peut exclure que la relance des offres d'emplois suscite une demande supplémentaire d'autant que les taux d'activité aux deux extrémités de la vie active sont particulièrement faibles dans notre pays.
Un obstacle plus sérieux que pourrait rencontrer la poursuite du mouvement d'enrichissement de la croissance en emplois pourrait provenir de l'insuffisance du travail qualifié en France.
A ce propos, il convient d'observer qu'à la fin des années 80, malgré un taux de chômage de 9 %, la reprise de l'emploi avait provoqué des tensions salariales dues, pour l'essentiel, à des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée.
Une telle évolution constituerait, à l'évidence, un facteur d'inflexion de la croissance prévue tandis que sa perspective milite pour une politique structurelle d'amélioration des qualifications.
Un dérapage des salaires consécutif à des pénuries d'emplois qualifiés provoquerait une dégradation du chômage, un assombrissement des perspectives des agents économiques et, partant, un ralentissement de la croissance et un surcroît de difficultés pour rééquilibrer les comptes publics.
II s'accompagnerait sans doute d'une hausse de l'épargne de précaution et éloignerait de la réalisation d'une inflexion du taux d'épargne des ménages qui est l'une des variables clefs déterminant la bonne orientation de la consommation prévue par le gouvernement.
Dans la prévision associée au projet de loi de finances pour 1996 la baisse du taux d'épargne des ménages - - 0,6 point- explique pour beaucoup le dynamisme de leur consommation.
Elle s'expliquerait par un retour à un comportement normal d'épargne motivé par la baisse des taux d'intérêt, le ralentissement des gains de pouvoir d'achat, la poursuite d'une maîtrise de l'inflation et l'amélioration des perspectives d'emplois.
Son influence est grande sur les perspectives de croissance.
Si, au lieu de la baisse prévue, le taux d'épargne des ménages devait, comme en 1995, s'apprécier de 0,4 point le rythme de la croissance ne serait guère supérieur à 2 % l'an prochain.
C LES INCIDENCES DU RYTHME DE LA CROISSANCE SUR LES FINANCES PUBLIQUES.
Un récent rapport de notre collègue Bernard Barbier réalisé au nom de la Délégation du Sénat pour la Planification 5 ( * ) illustre les incidences sur les finances publiques d'une croissance plus forte.
Deux variantes par rapport à un compte central ont été réalisées grâce au modèle "Mosaïque" de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
Dans chaque cas, il s'agit de simuler les effets sur les comptes des administrations publiques d'une croissance supérieure de 1 % par an par rapport au rythme de croissance du compte central.
La construction de deux variantes répond au souci de différencier l'impact sur les comptes publics de surcroîts de croissance résultant de facteurs différents.
On a testé ainsi, successivement :
- une hypothèse d'augmentation plus rapide de la croissance de nos partenaires, donc de la demande étrangère adressée à la France,
- et une hypothèse ou la croissance est supérieure du fait d'une baisse du taux d'épargne des ménages, qui se traduirait par une progression plus forte de la consommation des ménages.
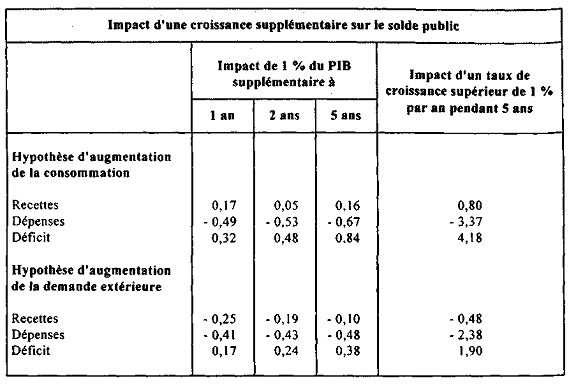
Les résultats du tableau ci-dessus sont présentés à 1 an, 2 ans et 5 ans pour un niveau de PIB supérieur de 1 % à la situation de référence pour chacune de ces trois dates. La dernière colonne donne l'impact au terme de cinq ans dans l'hypothèse d'un taux de croissance supérieur d'un point chaque année tout le long de la période.
On peut en déduire que 1 % du PIB supplémentaire à cinq ans entraîne une baisse de 0,8 point du ratio déficit public/PIB si la croissance est due à une relance de la consommation des ménages.
L'augmentation de la consommation des ménages majore les recettes de TVA et profite au secteur des services, ce qui, les services étant relativement plus riches en main d'oeuvre que l'industrie, améliore sensiblement l'emploi et le montant des cotisations sociales.
Lorsque le supplément de croissance provient d'un surcroît de la demande extérieure, la baisse du ratio déficit public/PIB est plus faible -0,4 point- car les exportations ne supportent pas la TVA, tandis que la demande étrangère profite au secteur industriel moins riche en main d'oeuvre.
Enfin, il faut souligner qu'un taux de croissance supérieur de un point par an pendant cinq ans permet une réduction d'environ 4 points du ratio déficit public/PIB quand la croissance est "tirée" par la consommation et de deux points quand elle est dynamisée par la demande étrangère.
Les modèles économétriques étant, pour l'essentiel, linéaires on peut estimer que les résultats d'une moindre croissance sur les déficits publics sont les mêmes au signe près. Les économistes de la Caisse des dépôts et Consignations estiment en effet qu'une révision à la baisse de 0,5 point de croissance se traduirait par une dégradation du solde des administrations publiques de 0,2 point.
Si tous les éléments objectifs d'une croissance de 2,5 à 3,0 % du PIB sont réunis, l'opinion favorable des chefs d'entreprise semble se dégrader en novembre. A titre d'exemple, deux grands patrons (1) écrivent :
"Premièrement, la rentrée n'est pas banne. Dans la plupart des secteurs industriels ou de services, nous constatons un ralentissement de l'activité, qui laisse mal augurer de l'année 1996. Les moteurs possibles de la croissance s'essoufflent tous : nous sommes moins tirés par l'étranger ; la reconstitution des stocks est achevée ; les budgets d'investissement 1996 sont en train d'être revus à la baisse ; la consommation n'est jamais vraiment repartie. (...) Notre sentiment de chef d'entreprise est qu'aujourd'hui les conditions d'une croissance soutenue pour 1996 ne sont pas réunies. "
Ils fondent en revanche des espoirs sur un assouplissement de la politique monétaire.
(1) MM. Henri Lachmann et Jean Marie Messier - Le Monde du 4 novembre.
Résumé
La prévision de croissance associée au projet de loi de finances pour 1996 est de 2,8 %.
Elle repose sur :
• une contribution nulle du commerce
extérieur à la croissance compensée par une meilleure
orientation de la demande intérieure avec un accroissement de la
progression de l'investissement et de la consommation des ménages. Elle
s'inscrit dans un contexte de recombinaison des politiques
économiques :
- la politique budgétaire et des finances sociales se resserrent et les déficits publics n'excèdent pas 4 % du PIB en 1996 :
- la politique monétaire devient moins rigoureuse.
Sans qu'il faille les cumuler, les aléas entourant la prévision ne doivent pas être sous-estimés.
Il faut toutefois observer que l'économie française n'étant pas dans une phase de retournement cyclique l'ampleur de ces aléas est probablement modeste.
Toutefois, deux catégories de risques existent :
• l'instabilité des marchés
ajoutée à la situation de l'économie américaine
font peser une hypothèque sur le repli ordonné des taux
d'intérêt en Europe sur la compétitivité des
économies européennes et sur la stabilité des
parités entre les devises européennes ;
• l'accélération de la consommation des
ménages pourrait être moindre que prévue si leur taux
d'épargne ne se réduisait pas comme escompté, ce qui
pourrait être le cas si l'enrichissement de la croissance en emplois
venait buter sur les causes structurelles du chômage ou si les taux
d'intérêt s'infléchissaient moins que prévu.
Compte tenu de l'incidence du rythme de croissance sur les finances publiques, une croissance plus mesurée se traduirait par une dégradation relative des soldes publics.
II. LA CONTRAINTE DES TAUX D'INTÉRÊT
Le niveau des taux d'intérêt est un déterminant important de l'équilibre budgétaire. Côté recettes, il a une influence sur la croissance économique et donc sur les rentrées fiscales. Côté dépenses, il a une influence sur le niveau de la charge de la dette et sur le coût de dépenses qui dépendent directement du taux d'intérêt, telles que les bonifications d'emprunt.
A. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DES COURBES DE TAUX D'INTÉRÊT
Depuis le début de 1995, l'évolution des taux d'intérêt des titres libellés en francs a été très différente selon que l'on se place sur le segment court ou sur le segment long des échéances.
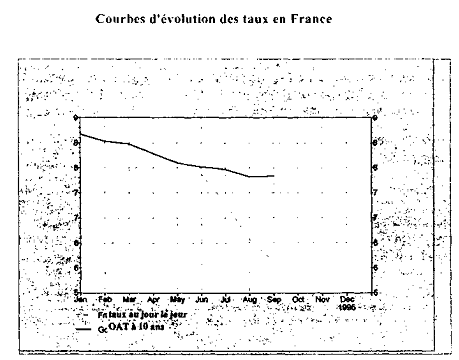
Sur une tendance globalement stable, voire légèrement baissière dans le sillage des taux allemands, les taux à court terme ont subi deux périodes de relèvement brutal suivies de décrues lentes, en février/mars et en septembre/octobre.
Les taux à long terme ont connu une décrue modérée mais continue, qui a vu le rendement des emprunts d'État à dix ans passer d'un niveau de 8 % en janvier à 7,3 % à la fin octobre. A cet égard l'année 1995 n'aura pas été l'antithèse de 1994, qui avait vu les taux à long terme s'envoler d'un niveau inférieur à 6 % pour atteindre 8 % en fin d'année.
Cette différence de comportement des rendements provient d'une relative indépendance des facteurs déterminant les taux d'intérêt selon les différentes durées.
Les taux d'intérêt à court terme
Les taux d'intérêt à court terme sont directement influencés par les décisions de la Banque de France sur les taux directeurs. Ces décisions dépendent elles-mêmes de la nécessité de maintenir la parité du franc vis-à-vis du deutschemark. C'est ce qui explique le caractère heurté de l'évolution récente des taux français. Elle contraste avec celle, beaucoup plus continue, des taux des autres principales devises : ces dernières ne subissent pas de contrainte de taux de change.
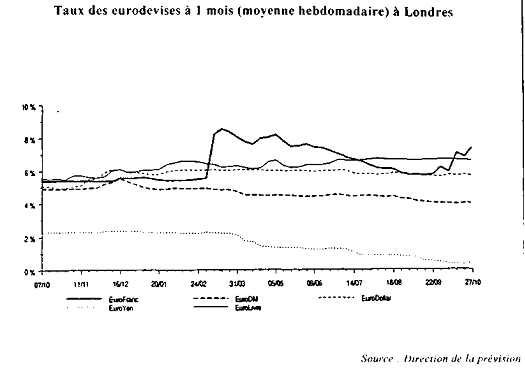
L'année 1995 a ainsi connu deux crises de change qui se sont immédiatement répercutées sur le franc, qui n'a pourtant jamais été directement en cause. Ces deux crises ont entraîné les deux relèvements brutaux qui s'observent sur la courbe ci-dessus.
La première, qui s'est déroulée de fin janvier à fin mars, a vu le dollar faiblir considérablement à cause d'une nouvelle crise de paiements au Mexique - un des principaux partenaires des États-Unis - et des déficits persistants voire aggravés, des finances publiques et des transactions courantes américains. L'attitude des cambistes a consisté à se reporter sur les placements en deutschemark. La devise allemande s'est appréciée contre toutes devises, particulièrement les devises les plus faibles du SME, l'escudo et la peseta, qui durent être dévaluées respectivement de 3,5 % et 7 % le 6 mars. Alors que le dollar continuait de baisser jusqu'aux alentours de 1,40 dollar par deutschemark, le franc n'était pas épargné et baissait jusqu'à 3,58 pour un deutschemark le 7 mars.
Ce contrecoup d'une situation à laquelle la tenue du franc lui-même était étrangère contraignait la Banque de France à suspendre le 8 mars son guichet des pensions de cinq à dix jours (alors à 6.4 %) pour ouvrir un guichet à 24 heures au taux de 10 %. Cette méthode désormais classique est destinée à renchérir le coût de la spéculation qui se finance par emprunts à court terme en francs. Dès le 7 avril la Banque de France ramenait ce taux à 7,75 %, niais la décrue ne devait être que très progressive.
La seconde crise de change a débuté récemment vers la mi-octobre suivant un scénario analogue à la première. Le dollar a ainsi chuté de 1,48 pour un deutschemark vers la mi-septembre à 1,38 pour un deutschemark à la mi-octobre. La préférence des investisseurs internationaux pour le deutschemark (et accessoirement le franc suisse) peut s'expliquer par les caractéristiques moins attractives du yen : le taux d'escompte de la banque du Japon a été ramené le 9 septembre à 0,5 %, et l'archipel connaît un marasme persistant. Le deutschemark reste au contraire rémunérateur dans une économie en croissance.
L'appréciation de la monnaie allemande a entraîné à nouveau l'affaiblissement du franc, (3,54 F pour un deutschemark le 9 octobre). La Banque de France, qui avait pu rétablir les pensions de cinq à dix jours le 22 juin et en réduire le taux jusqu'à 6,15 % le 31 août fut contrainte de remettre en place un dispositif de crise en fermant le guichet des pensions de cinq à dix jours le 6 octobre et en relevant le taux des pensions à 24 heures à 7.25 % le 9 octobre. Avec la résorption progressive de la crise, le taux des pensions à 24 heures put être ramené à 6,60 % le 2 novembre, puis à 6,10 % le 16 (sur 5 à 10 jours).
Les taux d'intérêt à long terme
Le marché des échéances longues n'est influencé directement ni par la Banque de France, ni par la situation des parités au sein du système monétaire international.
Dans la période récente, on a pu observer que l'ensemble des taux à long terme européen subissait les effets de la politique monétaire américaine. Cela fut particulièrement sensible en 1994 : les marchés obligataires européens avaient alors surréagi aux sept relèvements successifs du taux d'objectif des fonds fédéraux à partir de février 1994. Le relèvement des taux directeurs mettait fin à quatre ans de politique monétaire expansionniste.
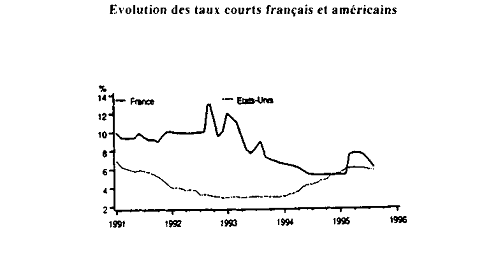
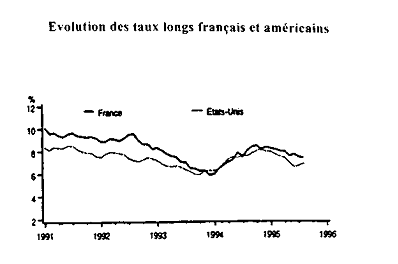
La stabilisation du niveau des taux à court terme américains autour de 6 % (contre 3 % début 1994) à partir de janvier 1995 et jusqu'à maintenant 6 ( * ) a autorisé une détente modérée des taux à long terme en Europe et notamment en France. L'Europe a ainsi bénéficié du ralentissement de la conjoncture aux États-Unis.
B. LES HYPOTHÈSES RETENUES PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES : PERTINENCE OU INFLEXIONS
Le Gouvernement anticipe une baisse modeste des taux d'intérêt en 1996, de l'ordre de 0,62 point en moyenne, portant davantage sur le court terme que sur le moyen-long terme.
1. La courbe des taux anticipée pour 1996 est caractéristique d'une économie en croissance
Les hypothèses officielles du Gouvernement sur les taux d'intérêt moyens pour 1996 comportent deux éléments :
Ø une courbe des taux à pente positive :
Ø un net fléchissement du niveau général par rapport à 1995 (janvier à août) mais une stabilité par rapport aux taux actuellement constatés.
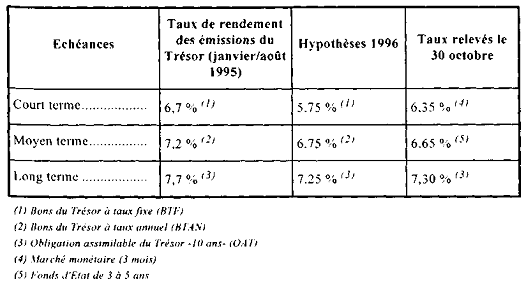
Les taux d'intérêt anticipés sont croissants avec l'éloignement des échéances, ce qui est caractéristique d'une courbe des taux normaux.
La courbe des taux de 1996 conserverait ainsi la physionomie actuelle.
Courbe des taux d'intérêt le 12 octobre 1995
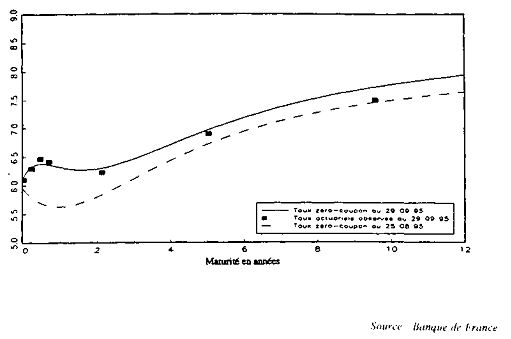
Au-delà du niveau absolu des taux nominaux, le sens de la courbe a son importance : une courbe des taux de pente positive permet de prédire que l'économie sera en croissance alors qu'une courbe inversée précède et accompagne généralement les récessions comme ce lut le cas des courbes observables de juillet à mai 1975 et de novembre 1991 à décembre 1993. La courbe inversée traduit en effet à la fois une politique monétaire destinée à décourager le crédit et une appétence limitée des agents économiques pour le crédit à long terme qui finance les investissements.
S'agissant de la prévision de la baisse générale du niveau des taux, il faut remarquer que la justesse de cette anticipation est d'une grande importance : le niveau des taux d'intérêt conditionne la charge de la dette publique et le montant de certaines dépenses, telles que la bonification de la nouvelle mesure d'accession à la propriété. L'hypothèse de 5,75 % sur les taux à court terme devrait permettre une économie de 700 millions de francs sur les charges des BIT. Une erreur d'un point pourrait se traduire par une charge supplémentaire de 4,5 milliards de francs en 1995. L'impact d'une erreur sur les taux longs serait faible sur la charge de la dette en 1996, car les OAT sont souscrites coupon couru inclus.
En revanche, il n'en va pas de même du coût de l'avance à taux nul sur lequel une erreur d'un point sur le rendement des OAT à 10 ans pourrait avoir un impact d'1,3 milliard de francs environ, à moins d'en réduire de façon importante le pouvoir solvabilisateur.
2. Les taux à court terme demeureront sous la contrainte du taux de change
Comme en 1995, et jusqu'à l'avènement de la monnaie unique européenne, le niveau des taux d'intérêt à court terme restera dicté par la contrainte de maintien de la parité avec le deutschemark.
Évolution des taux à court terme en France et en Allemagne
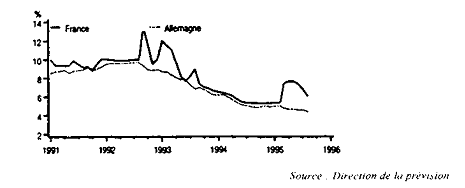
La devise allemande restera en 1996 une monnaie de réserve internationale ; l'évolution des taux d'intérêt français restera donc conditionnée par celle des taux allemands. Dès lors, deux questions peuvent se poser : quelle sera l'évolution des taux allemands, y a t il une marge de réduction de l'écart de taux entre les deux pays ?
Taux directeurs français et allemands le 2 novembre 1995
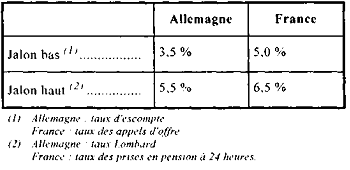
Bien que les taux allemands soient actuellement à un niveau historiquement bas, on peut penser qu'ils ne seront pas relevés au cours de l'année 1996 pour deux raisons principales. D'une part la croissance outre-Rhin pourrait être modérée 7 ( * ) . D'autre part et surtout les évolutions nominales de salaires et de prix devraient rester contenues à un niveau de l'ordre de 2 %, ne contraignant pas la Bundesbank à restreindre les conditions du crédit.
Dès lors à défaut de fièvres spéculatives imprévisibles mais toujours possibles, la Banque de France pourrait maintenir des taux relativement bas, compatibles avec la prévision du Gouvernement sur les taux courts.
L'existence d'une marge de réduction par rapport aux taux allemands est plus difficile à affirmer. L'écart de taux à court terme se situe aux alentours de 2,2 points le 2 novembre. Ce différentiel est exagéré au regard de l'écart d'inflation entre les deux pays, mais il traduit une prime de risque sur la devise française qui provient de deux facteurs : le premier est que le franc n'a pas le statut de monnaie de réserve ; le second est que le niveau élevé et persistant du chômage laisse penser aux opérateurs qu'une remise en cause de la rigueur monétaire peut intervenir à tout moment en France. Cependant, l'affirmation réitérée par le Gouvernement du maintien de l'orthodoxie monétaire devrait permettre un retour progressif de l'écart des taux à court ternie vers une norme de 0.4 à 0,5 points (comme en 1992, ou de la fin 1993 au début 1995).
Dans ces conditions, la prévision gouvernementale de 5,75 % pour les taux courts paraît raisonnable et peut-être même un peu pessimiste si l'on considère que les titres à trois mois libellés en deutschemark offrent actuellement un rendement d'environ 4 %, et qu'ils devraient rester stables en 1996 2 ( * ) .
3. Les taux à moyen et long terme devraient être orientés favorablement
L'essoufflement de la croissance américaine en 1996 3 ( * ) permet de penser que la Réserve fédérale poursuivra la politique suivie en 1995, à . savoir une stabilité ou une décrue lente des taux directeurs. Dans ces conditions, les marchés obligataires européens ne devraient pas craindre de subir à nouveau le choc de 1994. Il est en effet peu probable que la banque centrale américaine utilise l'arme des taux pour soutenir le dollar ce qu'elle n'a jamais fait.
Dès lors les taux d'intérêt à long terme européens et parmi eux les taux français, devraient pouvoir se maintenir à un niveau proche de celui qu'on observe actuellement.
Taux des emprunts d'État à 10 et 30 ans le 30 octobre 1995
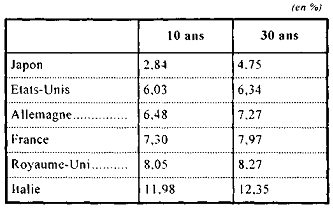
Cependant, la prévision en ce domaine est toujours extrêmement délicate, et les surprises sont fréquentes. On ne peut donc exclure un mouvement d'ensemble des taux d'intérêt des grands États industriels vers le haut ou vers le bas.
Plus pertinente est la question de la place relative de la France dans cet ensemble. D'ores et déjà, elle bénéficie des taux les moins élevés d'Europe, à l'exception des pays de la zone deutschemark (Allemagne. Pays-Bas, Belgique, Autriche) et de la Suisse. Ses marges de progression dépendent essentiellement de trois facteurs : l'inflation le déficit public et la balance des transactions courantes. Les graphiques suivants illustrent parfaitement l'étroite corrélation entre le niveau à moyen terme de certains grands équilibres et celui des taux d'intérêt à long terme.
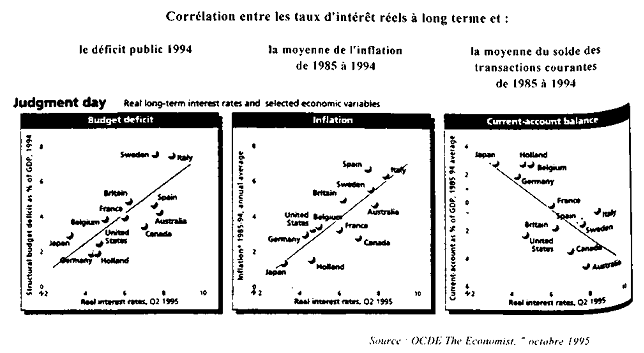
En ce qui concerne l'inflation, la France fait partie des pays les plus vertueux du monde, à l'exception du Japon, du fait d'une politique monétaire intransigeante sur le niveau général des prix. De ce point de vue, elle ne bénéficie pas des taux réels à long terme qu'elle mérite, ainsi que l'illustre la courbe centrale. L'inflation restera modérée en 1996, aux alentours de 2 %. Aucun progrès sur le front des taux d'intérêt n'est à attendre de ce facteur, ni aucune détérioration à craindre.
Inflation : écart à la moyenne de l'Union européenne
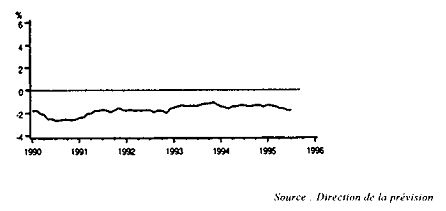
Plus préoccupante -et souvent mise en avant- est la situation des déficits publics. Un quasi-consensus parmi les économistes s'est fait jour pour reconnaître l'influence de ce facteur en l'occurrence néfaste pour la France dans la période récente 8 ( * ). I1 est incontestable que, par rapport à l'Allemagne notamment, les taux d'intérêt à long terme ont souffert en France d'une tenue relativement plus mauvaise des finances publiques.
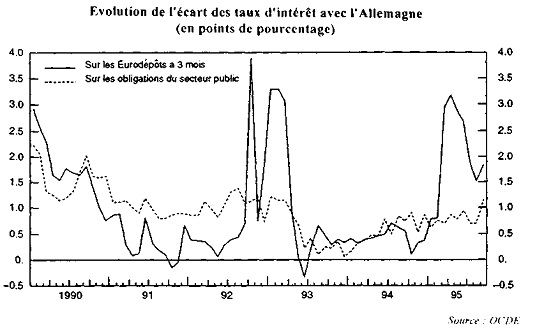
Le graphique suivant illustre les effets d'une détérioration des déficits publics sur la croissance des taux d'intérêt à long terme. On y voit que l'Allemagne est payée de son effort d'assainissement, alors que la France paie l'absence d'un tel effort.
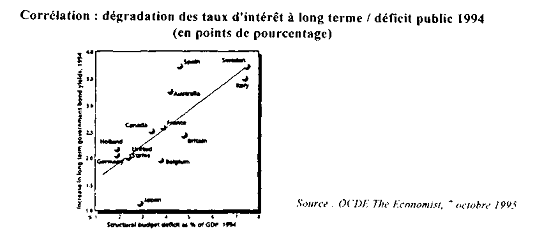
Les mécanismes à l'oeuvre dans cette détérioration sont de deux natures.
D'une part, l'accroissement du besoin de financement des administrations entraîne une sollicitation accrue de l'épargne disponible qu'il faut donc rémunérer davantage. D'autre part, l'aggravation de la dette publique qui résulte de déficits importants fait craindre un retour de l'inflation aux marchés financiers.
L'inflation, provoquée par un financement monétaire des déficits publics est en effet un moyen commode d'effacer la dette. Les États impécunieux sont toujours tentés de l'employer. Les marchés incorporent donc ce risque dans le niveau des rendements exigés des titres de ces États.
L'influence de la balance des transactions courantes est en revanche généralement négligée. Pourtant, le salut des taux d'intérêt français pourrait bien en provenir. La balance courante traduit en effet davantage que les déficits publics le besoin ou la capacité de financement de la nation tout entière.
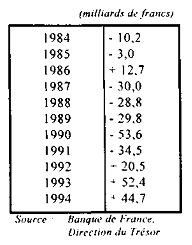
Sur les sept premiers mois de l'année 1995, la Banque de France a constaté un excédent de 71 milliards de francs, ce qui est un record, et l'exercice 1995 se terminera sur un quatrième excédent consécutif, ce qui est un autre record. L'année 1996 sera vraisemblablement moins flamboyante, mais les comptes extérieurs de la France resteront positifs 9 ( * ) .
De ce point de vue, notre pays est dans une meilleure situation que l'Allemagne, qui connaît depuis la réunification un déficit persistant de ses comptes courants.
Le déséquilibre s'établit à 5,4 milliards de deutschemark sur les six premiers mois de 1995. Les excédents commerciaux ne parvenant pas à compenser le déficit des services et l'accroissement de la charge des intérêts d'emprunts versés à l'étranger.
C'est pourquoi l'écart des taux à long terme entre la France et l'Allemagne est beaucoup plus étroit que celui des taux à court terme (0,8 point contre 2,5 point le 30 octobre). Et pour les mêmes raisons, on peut supposer qu'il va se réduire en 1996 10 ( * ) . L'écart en faveur de l'Allemagne se maintient parce que la France reste débitrice à l'égard du monde, l'Allemagne bénéficiant des excédents accumulés avant la réunification.
Le très bas niveau des taux d'intérêt à long terme de la Suisse et du Japon ne s'explique pas autrement : ils sont créditeurs nets vis-à-vis du reste du monde. Peu à peu, la France s'approche de cette situation, et finira par en recevoir les fruits sur le niveau de ses taux d'intérêt. Cependant, lorsqu'un pays est initialement endetté, la route est souvent longue avant d'atteindre une position nette créditrice et c'est pourquoi l'effet sur les taux tarde à se manifester.
L'inflation maîtrisée, les déficits publics résolument combattus, et la balance des transactions courante positive, la France devrait progresser encore au sein du peloton de tête des pays dont les taux à moyen et à long terme sont les plus bas. La prévision du Gouvernement paraît donc réaliste. Il est cependant plus facile de situer la France en termes relatifs que d'anticiper un niveau absolu de taux. Ce dernier dépend de la situation d'ensemble des marchés obligataires mondiaux. Ceux-ci sont toujours très sensibles à des chocs par nature imprévisibles.
III. LES ENSEIGNEMENTS DE L'EXÉCUTION DU BUDGET EN 1995
A. UNE CROISSANCE SANS RECETTES QUI CONDUIT A DES RÉVISIONS SÉVÈRES
Après avoir intégré les résultats définitifs de 1994, et les premiers éléments disponibles de l'année en cours, le collectif budgétaire de juillet dernier tablait sur une progression de recettes fiscales de l'État de 5,8 %, l'évolution spontanée liée à la croissance économique se trouvant accentuée par l'adoption de deux mesures conjoncturelles : le relèvement de deux points du taux normal de la TVA et l'institution d'une contribution exceptionnelle de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés.
Au plan économique, la croissance est certes au rendez-vous. La progression du PIB devrait s'établir à 2,9 % en volume et à 5,1 % en valeur cette année. Mais l'activité se développe sans alimenter le budget de l'État.
En effet, l'analyse des recettes effectivement perçues au 31 août dernier fait clairement apparaître que les prévisions avancées lors de l'élaboration du collectif ne pourront être respectées, et met en évidence les postes sur lesquels des ajustements deviennent inévitables.
Recettes fiscales brutes
Comparaisons entre les prévisions retenues en loi de finances rectificative et les encaissements au 31 août
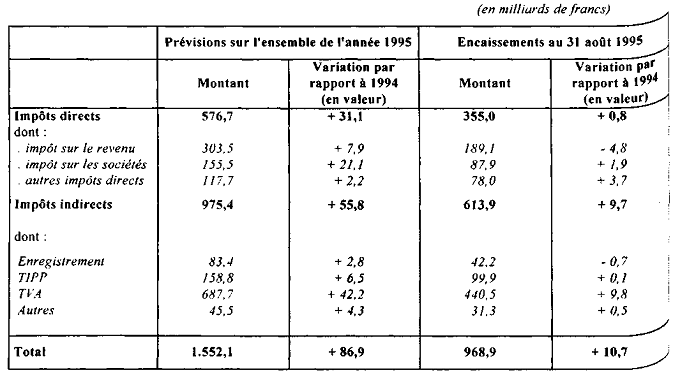
Ces données doivent certes être interprétées avec précaution, car elles n'intègrent pas les remboursements et dégrèvements afférents à la TVA et à l'impôt sur les sociétés. Mais elles font cependant ressortir de façon très nette les grandes tendances qui s'affirment depuis le début de l'année :
. Ainsi, les encaissements au titre de l'impôt sur le revenu se révèlent très décevants. A la fin du mois d'août, le solde n'a pas encore été acquitté, mais les sommes déjà versées sous forme d'acompte restent inférieures à l'année précédente et 90 % des avis d'imposition ont été calculés. Dans ces conditions, le produit total de cet impôt devrait s'avérer comparable à celui de 1994, soit 296 milliards de francs, alors qu'une croissance de 2,7 % était attendue.
•
S'agissant de l'impôt sur les
sociétés, la situation est également peu favorable.
Le solde a été acquitté en mai, et les
encaissements réels n'augmentent que de 2,2 % par rapport à ceux
de l'année précédente. Le mois de septembre sera certes
marqué par le versement de la contribution exceptionnelle, soit 12
milliards de francs, mais dans l'ensemble, le produit brut effectivement
perçu en 1995 ne devrait pas excéder 150 milliards de francs,
soit 5 milliards de francs de moins que ce qui était prévu.
. Enfin, la TVA connaît cette année encore une dynamique peu soutenue. A la fin du mois d'août, les effets du relèvement du taux normal n'ont pas encore de traduction dans les comptes de l'État, et les encaissements témoignent de l'absence de vigueur de la consommation au cours du premier semestre. La situation devrait se redresser quelque peu au cours des derniers mois, mais les 687 milliards de francs de TVA brute escomptés pour 1995 ne seront à l'évidence pas atteints. La moindre progression des remboursements et dégrèvements devrait cependant éviter que ce mouvement se répercute sur la TVA nette.
D'autres postes moins importants enregistrent d'ailleurs eux aussi de mauvaises nouvelles. Le produit des droits d'enregistrement reste inférieur à celui de l'année précédente, alors qu'une plus-value de 2,8 milliards de francs avait été envisagée. De même, le rendement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers souffre notamment de la déformation de la consommation d'hydrocarbure au profit du gazole.
Votre rapporteur constate que les évaluations révisées de 1995, associées au présent projet de loi de finances, prennent intégralement acte de ces évolutions défavorables.
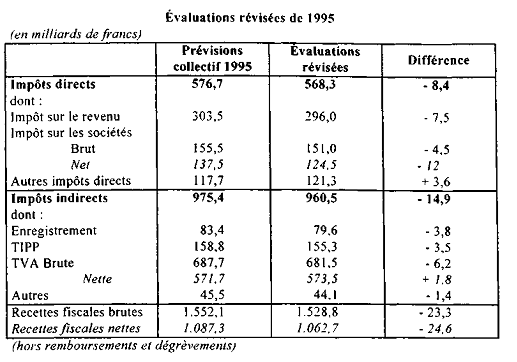
Elles intègrent donc une moins-value de 23,3 milliards de francs par rapport aux estimations de recettes fiscales brutes du collectif, cette moins-value étant portée à 25 milliards de francs sous l'effet d'un léger accroissement des remboursements et dégrèvements d'impôts.
Cet effort de sincérité mérite d'être souligné. Il témoigne du souci de ne pas occulter la situation réelle de nos finances publiques à la fin de cette année 1995, et permet donc de fonder les prévisions pour l'année à venir sur une base crédible, au vu des éléments actuellement disponibles.
B. UNE PROGRESSION DES DÉPENSES DÉLICATE A INTERPRÉTER MAIS QUI SEMBLE MAÎTRISÉE
L'analyse des données relatives aux dépenses, telles qu'elles ressortent de la situation provisoire des opérations du Trésor, se heurte d'emblée à d'importants problèmes méthodologiques.
• En effet, le rythme de progression des
dépenses avancé lors de la discussion budgétaire concerne
habituellement les
dépenses nettes,
après
déduction des remboursements et dégrèvements
d'impôts et des
mesures d'ordre
et
n'intègre pas l'effet des fonds de concours perçus en cours
d'exercice.
• En revanche, les données figurant dans la
situation résumée des opérations du Trésor
permettent seulement d'isoler les dégrèvements et remboursements,
et non les dépenses d'ordre ou les crédits ouverts sur fonds de
concours.
• Enfin, il est évident que le profil infra
annuel d'engagement des dépenses peut être différent selon
les exercices toute anticipation sur le début de l'année ayant
alors pour effet de gonfler provisoirement le taux de progression
constaté en milieu de période. A contrario, le gouvernement a
toujours la faculté de limiter les engagements sur certains postes
modulables.
De fait, ces données doivent donc être maniées avec la plus extrême prudence mais elles fournissent toutefois des indications utiles sur le déroulement de l'exécution budgétaire.
Dépenses du budget général
(En
milliards de francs)
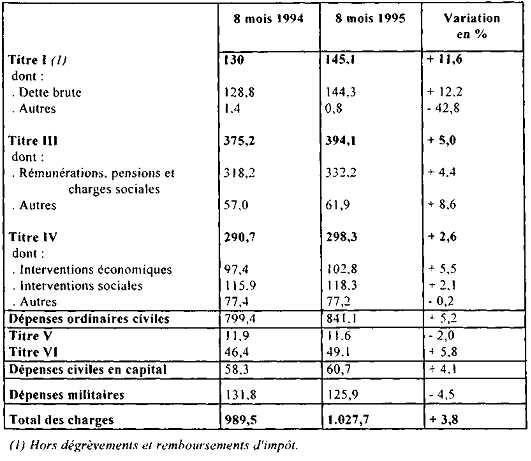
A la fin du mois d'août, les dépenses du budget général excédaient donc de 38,2 milliards de francs le niveau atteint à la même période de 1994, ce qui correspond à une progression de 3,8 %. A la fin du premier semestre, ce même taux était de 3 %.
A titre de comparaison, le rythme prévu de progression des dépenses, tel qu'il ressort de la confrontation entre les données figurant dans le collectif 1995 et de la loi de finances rectificative pour 1994, s'établit à 3,1 %.
De fait, il semble que l'exécution 1995 demeure certes tendue, mais elle ne fait pas apparaître de réel dérapage, et reste donc compatible avec les plafonds de dépenses votés en loi de finances rectificative. La pression qu'exerce la charge de la dette, et les rémunérations publiques trouvent ainsi leur contrepartie dans la rigueur qui pèse sur les dépenses militaires et les investissements directs de l'État, mais aussi dans une sélectivité accrue pour les interventions publiques n'ayant pas de lien avec l'emploi.
Toutefois, il est certain que la contrainte pesant sur les recettes rend désormais inévitable un nouvel et important effort d'économies que le traditionnel collectif de fin d'année devrait bientôt matérialiser.
Réponse du Ministère à une question de votre Rapporteur Général sur l'exécution du Budget 1995 (octobre 1995)
"L'exécution du budget 1995 se caractérise à ce stade pour l'essentiel par des moins-values de recettes fiscales de l'ordre de 25 milliards de francs par rapport au collectif du 4 août.
Ces moins-values sont localisées principalement sur l'impôt net sur les sociétés (13 milliards de francs) l'impôt sur le revenu (7,5 milliards de francs) et la TIPP (2 milliards de francs).
Au-delà, certains besoins en dépenses tels que l'allocation de rentrée scolaire sont apparus depuis le vote du collectif. Un certain nombre d'ouvertures de crédits devront par ailleurs être effectuées en collectif de fin d'année au titre des régularisations traditionnelles (DGD, transports en commun, opérations extérieures de la Défense) ainsi que de décisions prises en cours d'année (Grand stade).
L'ensemble de ces ouvertures seront couvertes en LFR par des annulations d'un montant au moins équivalent. Par ailleurs, un certain nombre de recettes non fiscales seront mobilisées (par prélèvement sur des trésoreries dormantes de divers organismes par exemple). Au total, le collectif budgétaire qui sera présenté au Parlement au mois de novembre prochain n'augmentera pas le déficit affiché dans la loi de finances rectificative du 4 août 1995, de plus, le projet de collectif ne devrait pas aggraver le niveau des charges par rapport au collectif de printemps 1995.
Une vision plus précise de l'exécution budgétaire pour 1995 est conditionnée par les décisions qui seront prises dans le collectif de fin d'année : la présentation du collectif au mois de novembre devrait donc permettre de répondre de manière complète à la question posée."
CHAPITRE III - L'ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES DANS LA PERSPECTIVE DE LA MONNAIE UNIQUE
I. L'APPROCHE THÉORIQUE
A. L'INDISPENSABLE MAÎTRISE DES DÉFICITS PUBLICS
La question de la réduction des déficits publics est l'objet d'un débat passionné entre les économistes.
Trois écoles de pensée peuvent être clairement identifiées qui défendent chacune des positions très tranchées.
Cette exacerbation des thèses invite naturellement les décideurs à dépasser les conflits théoriques en réconciliant les points de vue.
En outre, peut-être plus que pour les théoriciens, s'imposent au décideur des considérations pragmatiques qui dictent ses choix.
1. Le nécessaire dépassement des débats théoriques
Dans l'approche keynésienne, l'accent est mis sur les "effets revenu" d'un accroissement de la fiscalité ou d'une réduction des dépenses publiques destinés à réduire le déficit public.
On en conclut qu'une telle orientation de la politique budgétaire comporte un coût en croissance et donc en chômage.
Cette conclusion est illustrée par la projection de l'économie française à l'horizon 2002 récemment réalisée par l'équipe MIMOSA pour la Délégation du Sénat pour la Planification.
Une approche keynésienne tempérée
Une politique budgétaire rigoureuse
L'hypothèse retenue est que la politique budgétaire sera centrée dans les années à venir sur l'objectif de réduction du déficit public. Du côté des dépenses, l'investissement des administrations n'augmenterait que de 1,2 % l'an ; les dépenses en biens et services de 1,7% l'an ; les effectifs de 0,25% ; les salaires des fonctionnaires augmenteraient moins vite que ceux du secteur privé, de 0,8 % par an ; la sécurité sociale serait gérée avec rigueur (strict maintien du pouvoir d'achat des retraites et des allocations, contrôle des dépenses de santé) ; les subventions aux entreprises seraient réduites. Dans ces conditions, la croissance des dépenses publiques (hors intérêts et prestations sociales) serait de 1 % l'an (en pouvoir d'achat), celle des prestations sociales de 1,4%. Du côté des recettes, le compte incorpore, outre la hausse de la TVA de l'été 1995, une hausse de 1 point de la CSG en janvier 1996 et un alourdissement de la fiscalité sur les revenus du capital des ménages. Le taux des prélèvements obligatoires passe de 43,9 % en 1994 à 45,9 en 2002.
Cette rigueur budgétaire permet une forte réduction du déficit des administrations qui passe de 6,1 % du PIB en 1994 à 5,2 en 1995, 3,7 en 1996, 3,4 en 1997, puis 2,7 en 2000 et 1,2 en 2002. Le rétablissement des finances publiques est fortement ralenti dans les années 1997-99, années de faible croissance économique selon la projection. Le ratio de la dette publique sur le PIB augmente de 50,4 % en 1994 à 61 % en 2000, puis se stabilise. Avec un taux d'intérêt à long terme de 6,5 % et un taux de croissance du PIB nominal de 5 %, un excédent primaire de l'ordre de 0,6 point de PIB est nécessaire pour stabiliser le poids de la dette. Or, la France part d'un déficit primaire de 2,7 points en 1994. L'effort à fournir représente donc 3,3 points de PIB ; il pèse sur la croissance à moyen terme.
Une croissance cyclique et médiocre
La croissance de l'économie française serait relativement médiocre à moyen terme : 2 % en moyenne de 1995 à 2002. Après un essor au rythme de 2,7 % en 1994-96, la croissance s'essoufflerait et serait de l'ordre de 1,5% en 1997-99 ; elle retrouverait un rythme de 2,3 % en 2000-2002. En 1995-96, la croissance est fortement impulsée par l'investissement des entreprises, mais dès 1996, la politique budgétaire pèse sur le revenu des ménages, donc sur leur consommation. En 1997, le ralentissement du boom de l'investissement ne trouve pas de relais dans la consommation des ménages ou l'exportation. Il faut attendre la reprise de l'investissement en 2000 pour voir repartir la croissance.
Le compte décrit donc les fluctuations endogènes de l'économie, fluctuations que la politique économique, prise dans ses contraintes propres, n'amortit guère.
Source : XIè colloque de réflexion économique. Délégation pour la Planification du Sénat. Une projection de l'économie mondiale à l'horizon 2002 présentée par l'équipe MIMOSA. 27 septembre 1995.
Dans l'approche néoclassique, l'accent est mis sur les effets d'éviction des déficits publics et, donc, sur les bénéfices qu'apportera leur réduction via la baisse des taux d'intérêt.
Ce courant de pensée peut être combiné avec la théorie des anticipations rationnelles. Celle-ci consiste à affirmer que les agents adoptent en toutes occasions un comportement rationnel obéissant à ce qu'ils observent, mais également à ce qu'ils anticipent. Les agents ne sont pas sujets à l'illusion du temps.
Face à un déficit public, ils anticipent, par exemple de futures hausses d'impôt et un supplément d'inflation et ajustent leur épargne en conséquence.
C'est sur une combinaison de ces deux approches que reposent, en tout ou en partie, un nombre important de simulations s'accompagnant d'une politique budgétaire restrictive qui démontrent que celle-ci n'a pas d'effets défavorables.
Il convient tout d'abord d'évoquer à ce propos la prévision associée au projet de loi de finances pour 1996 où le rééquilibrage des comptes publics ne s'accompagne pas d'une dégradation de la croissance car il est compensé par un supplément de la demande des agents privés rendu possible par une baisse de leur épargne elle-même favorisée par une inflexion des taux d'intérêt.
Ce scénario, au demeurant encore plus accusé, est également celui de la Commission des Communautés européennes.
Le scénario de la Commission des Communautés européennes
La problématique retenue par la Commission est la suivante : comment améliorer le potentiel de croissance en Europe qui s'établit autour de 2,25/2,5 % l'an ?
La combinaison des politiques économiques le permettant consiste en :
- une politique salariale où les gains de productivité ne sont pas entièrement distribués aux salariés tant que le taux d'investissement des entreprises doit être accru ;
- une politique de réduction substantielle du déficit budgétaire afin de libérer de l'épargne au profit de l'investissement et de la consommation ;
- une politique monétaire adaptée aux efforts budgétaires.
Moyennant ces orientations, la croissance pourrait être de l'ordre de 3,3 % l'an jusqu'en 2000, le déficit public moyen dans la Communauté serait réduit de cinq points du PIB, moitié grâce aux stabilisateurs automatiques, moitié sous l'effet de mesures discrétionnaires, et les taux d'intérêt baisseraient fortement.
En 1997, neuf des quinze États de l'Union auraient un déficit inférieur à trois points de PIB et quatre États une dette publique inférieure à 60 % du PIB.
Trancher entre des approches si opposées n'est pas une tâche aisée pour les décideurs.
Les évaluations empiriques fournies par les modèles macroéconomiques concluent en général à la prépondérance des enchaînements keynésiens.
Mais il faut observer, d'une part, que ces modèles, construits sur des séries d'équations économiques calibrées à partir de données statistiques appartenant à un passé plus ou moins proche, ignorent les effets de seuil -à cet égard, il est significatif que la récente réestimation du modèle MIMOSA, d'inspiration keynésienne, se soit traduite par un surcroît d'instabilité- et d'autre part, que de nombreux modèles d'équilibre général calculable valident mieux que les modèles keynésiens les enchaînements associant à une réduction des déficits publics des effets économiques favorables.
Cependant, l'essentiel est peut être ailleurs.
Aujourd'hui, c'est en tenant compte de la situation financière des administrations publiques davantage que de considérations économiques qu'il faut raisonner pour orienter la politique budgétaire.
Et, de ce point de vue, la réduction des déficits publics est une ardente obligation.
2. Les délices du déficit, les poisons de la dette
a) Les délices du déficit
Les composantes du déficit public
On peut décomposer le déficit public en :
ï une part due à l'évolution conjoncturelle qui représente les conséquences pour les finances publiques des fluctuations de la croissance économique et est estimée à partir du solde entre le déficit constaté et le déficit qu'on aurait obtenu si la croissance avait été égale à son potentiel ;
ï une part structurelle qui indique l'orientation de la politique budgétaire des pouvoirs publics et est obtenu comme un solde du déficit constaté et du déficit conjoncturel.
Enfin, le solde structurel peut être décomposé entre :
ï un solde structurel total
ï et un solde structurel primaire qui est égal au précédent moins les charges d'intérêt dont l'évolution échappe dans une large mesure aux décideurs.
D'une analyse des composantes du déficit public conduite par le Service des Études Économiques et Financières de la Caisse des Dépôts et Consignations, il ressort qu'en Europe :
- les charges d'intérêt ont augmenté continûment de 1978 à 1995 (de 1,6 % du PIB en 1978 à 4,9 % en 1995) ;
- le solde conjoncturel a suivi l'évolution de la conjoncture : déficitaire (- 1,4% du PIB) en 1983, lors de la phase basse du cycle. excédentaire à la fin de la période d'expansion 1986-1991, déficitaire à nouveau après la récession de 1993 (- 1,6 %) ;
- le solde structurel primaire s'est redressé de 1978 (-2,7% du PIB) à 1995 (- 1 % selon la prévision OCDE) presque sans interruption, excepté une dégradation en 1989-1990 dans laquelle l'impact de la réunification sur les finances publiques allemandes a joué un rôle important.
D'une comparaison de l'évolution en France et en Allemagne, il ressort quelques différences.
- Ces deux pays connaissent en 1987 un excédent structurel primaire identique (1,7 % du PIB).
- Celui-ci se dégrade en France en 1988, 1992 et 1993 conduisant à cette date à un déficit structurel primaire (- 0,7 % du PIB) qui se résorbe en partie par la suite.
- En Allemagne, le solde structurel primaire devient déficitaire en 1990 et 1991 (-2,9% du PIB) sous l'effet des dépenses liées à la réunification ; par la suite, un fort resserrement budgétaire permet de retrouver un excédent structurel primaire en 1994 (0,9 % du PIB).
Quelles conclusions tirer ?
ï Il paraît établi que l'accroissement des déficits publics en Europe est plus le fait de l'accroissement des charges d'intérêt que le résultat des politiques budgétaires délibérément poursuivies.
ï Toutefois, la politique budgétaire discrétionnaire ne s'est pas suffisamment adaptée à son environnement économique et aux contraintes résultant du niveau des taux d'intérêt.
Car s'il est vrai que l'orientation donnée à la politique budgétaire est allée en général dans le sens d'un resserrement, on a laissé le solde public évoluer au gré de la conjoncture.
Ce faisant, la politique qui a été pratiquée a été une politique budgétaire laissant jouer les stabilisations automatiques.
Mais, différence essentielle avec les politiques semblables menées dans les années 60 et 70, on a conduit cette politique budgétaire dans un contexte où :
•
l'endettement supplémentaire d'une
année réduit les marges de manoeuvre budgétaire de
l'année suivante ;
• s'ajoutent aux effets sur le solde public
du jeu des stabilisateurs automatiques la dérive endogène des
charges d'intérêt.
Il faut d'ailleurs observer une différence significative entre les politiques budgétaires menées en France et en Allemagne.
Alors que le niveau des taux d'intérêt allemand plus bas que les taux en France aurait permis une politique budgétaire moins stricte en Allemagne il en est allé autrement.
En effet, alors qu'en France le déficit structurel primaire s'est dans l'ensemble maintenu, le fort resserrement budgétaire conduit en Allemagne a permis à ce pays de retrouver un excédent structurel primaire en 1994 (0,9 % du PIB).
Ayant goûté aux délices du déficit, il apparaît comme une conséquence que l'on "avale"...
b) Les poisons de l'endettement
- Une dynamique redoutable
La dette publique recèle une redoutable dynamique. L'accroissement du pourcentage de la dette publique dans le PIB combiné à des taux d'intérêt nominaux supérieurs au taux de croissance du PIB engendre une croissance des dépenses d'intérêt sensiblement plus vive que celle du PIB. Dans cette situation, la dérive des charges d'intérêt entraîne en elle-même une progression des dépenses publiques plus rapide que celle du PIB.
Or, une telle évolution n'est pas souhaitable car elle se traduit soit par un accroissement du déficit qui lui-même engendre spontanément une dérive des dépenses publiques, soit par une hausse des prélèvements obligatoires.
- L'effet d'éviction sur les dépenses publiques.
Une seule solution s'impose alors qui est de modérer l'évolution des dépenses publiques autres que les dépenses d'intérêt.
Cet impératif est d'ailleurs l'un des premiers poisons de la dette publique : son effet d'éviction sur les autres dépenses publiques.
La part des dépenses consacrées par les administrations publiques au paiement des charges d'intérêt a plus que doublé entre 1980 et 1994.
Pour l'État, ses dépenses d'intérêt ont fait plus que doubler entre 1987 et 1994 et leur part dans le total des dépenses a connu une évolution du même ordre.
La stabilisation du pourcentage de la dette publique dans le PIB suppose que le déficit des administrations publiques conduise à une progression de la dette publique strictement parallèle à celle du PIB.
Si les taux d'intérêt nominaux sont supérieurs au taux de croissance du PIB, les dépenses d'intérêt croissent davantage que ce dernier. Dans cette situation, le seul équilibre du solde des recettes et des dépenses hors intérêts 11 ( * ) s'accompagne d'un déficit public égal au montant des intérêts qui provoque une croissance du ratio dette publique/PIB égale au différentiel entre le taux d'intérêt de la dette et le taux de croissance du PIB. Cette hausse ne peut être évitée que si le solde primaire est excédentaire d'un même montant.
Ceci implique -à recettes inchangées- que les dépenses publiques soient strictement maîtrisées.
Comment stabiliser la dette de l'État dans le PIB ?
Moyennant une dette de l'État de 3 211 milliards en 1995 et un coût de la dette de 7,05 % (charges d'intérêt/montant de la dette), la stabilisation du ratio dette de l'État/PIB en 1996 supposerait compte tenu d'un taux de croissance de 2,8% que le déficit de l'État n'excède pas un montant de l'ordre de 160 milliards de francs.
Comme les charges d'intérêt s'élèvent à 226,4 milliards de francs, il conviendrait de dégager un excédent primaire de 66,4 milliards de francs.
Ce chiffre est à comparer avec le déficit primaire de la loi de finances qui est égal à 63,7 milliards de francs.
A recettes inchangées, l'effort d'économies sur les dépenses de l'État requis par une stabilisation de la part de la dette de l'État dans le PIB à son niveau de 1995 -41,4 %- s'élève ainsi à quelques 130 milliards de francs.
- De quelques effets secondaires indésirables :
Les dépenses d'intérêt de l'État participent à la formation du revenu des autres agents. On doit d'ailleurs observer que le gonflement de la dette publique s'est accompagné d'une progression :
ï des intérêts reçus par les sociétés et quasi-sociétés non financières qui sont passées de 44,9 à 87,44 milliards de francs entre 1988 et 1994 (+ 94,7 %) ;
ï des intérêts reçus par les ménages passés de 149,4 à 202,4 milliards de francs entre 1987 et 1994 (+ 35,5 %).
ï et des intérêts reçus par le reste du monde passés de 139,7 à 417,2 milliards de francs entre 1987 et 1994 (soit presque un triplement).
La corrélation entre la progression des intérêts reçus par ces agents et l'explosion de la dette publique, à défaut d'être exclusive, est étroite.
Or, il semble d'abord que les agents consomment moins les revenus d'intérêt que leurs autres revenus si bien que la hausse des taux d'épargne des ménages en particulier pourrait provenir de l'augmentation de la part relative des intérêts dans leurs revenus.
En outre, la progression des intérêts payés à l'extérieur qui vient de la croissance de la dette publique détenue par des agents extérieurs, si elle témoigne d'une certaine confiance de l'étranger dans la signature de la France, fragilise les finances de l'État.
Les opérateurs étrangers sont plus exigeants et plus réactifs dans leurs arbitrages que les opérateurs nationaux.
En outre, l'emploi qu'ils font des intérêts qu'ils reçoivent peut être défavorable à nos intérêts s'ils les convertissent dans une devise étrangère -effets sur le change- pour les employer hors de nos frontières -effets revenu-.
B. COMMENT MAÎTRISER LES DÉFICITS PUBLICS ?
Les conditions de réussite d'un rééquilibrage des comptes publics ont fait l'objet de plusieurs études récentes d'où l'on peut tirer quelques conclusions fortes pour l'action si l'on en combine les résultats avec la situation économique et financière de la France.
1. Le rééquilibrage des comptes publics suppose une politique déterminée de réduction du déficit public
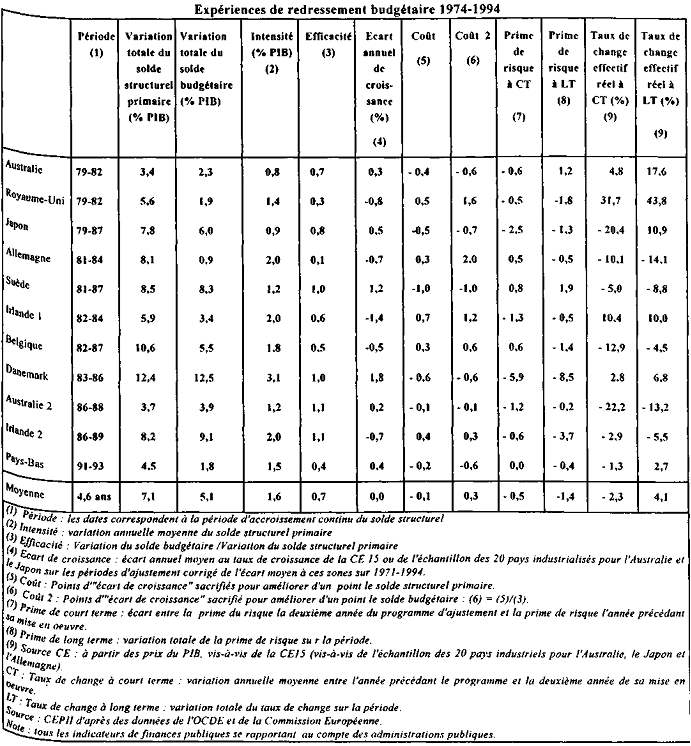
Le tableau ci-dessus résume les données relatives aux redressements budgétaires de grande ampleur réalisés depuis 1974 dans les pays de l'OCDE. Le CEPII a analysé chacune de ces opérations.
Il s'agit des épisodes au cours desquels le solde structurel primaire des administrations publiques -c'est-à-dire le solde corrigé des influences conjoncturelles et hors charge de la dette- a été réduit de manière ininterrompue d'au moins trois points de PIB au cours d'une période de trois ans ou plus.
Lorsque la dette publique connaît une évolution incontrôlée, la menace d'un prélèvement massif prend corps, qui peut prendre la forme d'un défaut, d'une monétisation de la dette ou d'une taxation exceptionnelle. Les auteurs de l'étude jugent qu'en pareil cas, une réorientation budgétaire est tout autre chose qu'une ponction marginale sur le revenu des agents privés. Elle est le signal d'une bifurcation dans la politique économique, d'une restauration de ce que les économistes nomment la "soutenabilité" de la dette publique. Elle écarte la perspective de la monétisation comme celle d'une ponction fiscale massive à venir. C'est pourquoi elle met en jeu d'autres types d'effets que la "fine tuning" (régulation fine) budgétaire et fiscal.
Ils soulignent que les ajustements opérés ont souvent été massifs avec, en moyenne, une variation du solde structurel de sept points de PIB à raison de 1,6 point par an pendant quatre ans.
Ils estiment que
•
ces politiques ont, en
général, atteint leur objectif qui était de redresser le
solde des administrations et de restaurer la soutenabilité, un point de
redressement du solde structurel primaire a, en moyenne, produit 0,7 point de
solde public,
mais que la variance est grande.
Enfin, ils jugent que :
•
Le coût en croissance (et donc en
emplois) de ces efforts apparaît globalement faible. Pour les
redressements achevés, l'écart annuel moyen entre le taux de
croissance du pays et celui d'une zone de référence (UE 15 pour
les pays européens, OCDE pour les autres) corrigé de
l'écart tendanciel est, en moyenne, nul au cours de la période
d'ajustement.
• Les taux d'intérêt à
long terme ont baissé, rarement dès le début du programme
de redressement -le cas du Danemark, où l'écart de taux long avec
l'Allemagne est passé de 12,5 points en 1982 à 4 points en 1986,
apparaît ici encore comme singulier -, mais assez
généralement dans la durée si bien qu'au total, à
l'achèvement du programme, la baisse de la prime de risque est pour
l'ensemble des expériences achevées de 1,4 point.
Malgré quelques nuances, -telles que la prise en compte des caractéristiques structurelles des pays- on sait qu'une inflexion budgétaire a moins d'effets sur la croissance dans une économie très ouverte sur l'extérieur, comme le Danemark, que dans une économie plus autocentrée comme l'Allemagne-, ou l'évolution du change -les effets récessifs des redressements budgétaires, ont pu être compensés par la politique monétaire-, les conclusions de cette étude sont nettes.
Les redressements budgétaires ont d'autant plus de succès et d'autant moins d'effets négatifs sur l'économie qu'ils sont de grande ampleur.
Mais, pour atteindre cette ampleur, il est nécessaire que le redressement entrepris s'inscrive dans la durée.
L'affichage d'un objectif de réduction progressive des déficits publics permet en effet d'adresser un message clair aux agents économiques. Celui-ci est d'autant plus crédible que la réduction du déficit est étalée dans le temps. Or, l'expérience des redressements budgétaires démontre amplement qu'une réduction brutale du déficit a des effets contraires à ceux qu'on en attend. Elle prive brusquement l'activité économique d'un soutien important alors que les comportements des agents privés ne se modifient que progressivement.
Ainsi, en programmant son effort budgétaire, l'État délivre un message clair aux agents privés tout en ménageant du temps pour que ceux-ci relaient la demande des administrations publiques.
A ce propos, on ne peut que juger pertinente la règle du "5-4-3" retenue par le gouvernement consistant à programmer la réduction des déficits publics dans le temps.
Cette persévérance doit être mieux comprise par chacun. Dès lors que cela sera le cas, nul doute qu'il en sera récompensé.
2. Le redressement budgétaire doit reposer essentiellement sur une maîtrise des dépenses publiques
a) Considérations théoriques
D'une étude 12 ( * ) analysant les politiques budgétaires menées de 1960 à 1992 dans une vingtaine de pays de l'OCDE, les auteurs concluent que peuvent exister les différents types de politique budgétaire discrétionnaire suivants :
|
Type de politique budgétaire |
Variation dans l'année du déficit |
|
|
primaire structure (1) (2) |
||
|
Neutre |
entre + 0,5 et + 1,5 % du PIB |
|
|
Fortement expansive |
supérieure à 1,5 % du PIB |
|
|
Rééquilibrage faible |
entre - 1,5 et - 0,5 % du PIB |
|
|
Fort rééquilibrage |
supérieur à - 1,5 % du PIB |
(1) Le déficit primaire est le solde des recettes et des dépenses hors charges d'intérêt et des recettes
(2) Les variations mentionnées éliminent les causes conjoncturelles ou cycliques qui agissent sur les finances publiques
Sur les quelque 547 observations disponibles, l'échantillon compte un nombre presque égal de politiques faiblement expansives - 124- et de politiques de rééquilibrage faible - 121 -. Il en va de même pour les politiques très expansives (65 cas) et les politiques de fort rééquilibrage (66 cas).
Dans la plupart des cas, les politiques budgétaires expansionnistes sont menées par l'intermédiaire d'une augmentation des dépenses tandis que les politiques d'ajustement du déficit passent par un accroissement des impôts.
En moyenne, les politiques budgétaires fortement expansionnistes se traduisent par une augmentation des dépenses de 2,25 points de PIB alors que les baisses d'impôt ne s'élèvent qu'à 0,17 % du PIB. Inversement, dans les politiques de fort ajustement les impôts s'élèvent de 1,2 point de PIB, les dépenses régressant de 0,79 % du PIB.
Le rapprochement de ces résultats suggère que les augmentations de dépenses qui interviennent lors des phases expansives de la politique budgétaire tendent à être permanentes et font le lit des hausses d'impôts que nécessitent les phases de rééquilibrage des finances publiques.
Une précision supplémentaire peut être fournie : dans les périodes de politique de soutien par les finances publiques, les dépenses publiques qui s'accroissent le plus sont les dépenses salariales et de transferts, tandis que dans les périodes d'ajustement des finances publiques l'investissement supporte l'essentiel des inflexions.
Sous l'effet de l'ensemble des évolutions décrites, la structure des finances publiques se déforme au profit d'un accroissement de la part des transferts.
Hormis cet effet structurel, le choix généralement opéré par les gouvernements de redresser les comptes publics en augmentant les prélèvements n'apparaît pas judicieux.
Dans les cas de réussite de la politique de rééquilibrage, 80 % de la réduction du déficit résulte d'une baisse des dépenses (les dépenses baissent en moyenne de 2,19 points de PIB alors que les impôts ne s'élèvent que de 0,5 point de PIB) tandis que, dans les échecs, l'augmentation des impôts est trois fois supérieure à celle des réductions de dépenses.
En outre, il apparaît que lorsque l'essentiel des diminutions des dépenses provient de baisses des transferts et des salaires publics l'ajustement connaît la réussite alors que dans les cas d'échecs ces dépenses se maintiennent, les investissements accusant eux une chute importante.
Tout rééquilibrage réussi des finances publiques suppose de réduire les prestations sociales, les traitements et l'emploi publics.
Les auteurs mentionnent cependant quelques cas d'ajustements réussis provenant d'une hausse des impôts. Mais alors ; c'est de la hausse de l'impôt sur les sociétés que provient le succès tandis qu'accroître les impôts sur les ménages provoque l'échec.
b) Données empiriques
Recettes et dépenses totales des
administrations publiques
en pourcentage du PIB
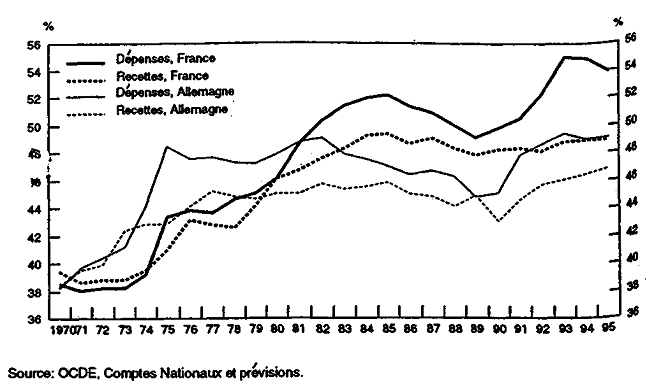
Le graphique ci-dessus illustre l'importance du niveau des dépenses et des recettes publiques en France en les comparant avec l'Allemagne.
Il est instructif de constater que si les dépenses publiques étaient en France au niveau allemand, en points de PIB, il n'y aurait pas dans notre pays de déficit public.
Le haut niveau des dépenses publiques combiné avec l'importance des prélèvements obligatoires invite à rechercher les moyens d'optimiser la dépense publique sans alourdir encore les prélèvements.
La croissance de la part des dépenses publiques dans le PIB est, pour l'essentiel, provenue de l'augmentation des dépenses sociales.
Dépenses publiques pour la protection sociale en pourcentage du PIB
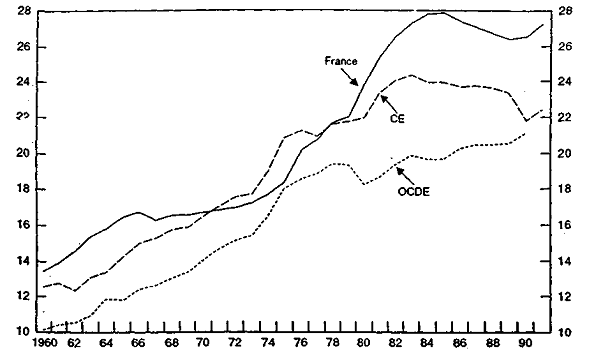
A cet égard, la part prise en France par les dépenses de protection sociale ainsi que leur évolution apparaissent tout à fait exceptionnelles.
Structure des dépenses sociales
ï vieillesse : 12,6 % du PIB, au lieu de 6 % il y a 20 ans ;
ï santé : 9,6 % du PIB (6 à 7 % du PIB au Japon et en Grande- Bretagne et 8,5 % en Allemagne) ;
ï famille : 3,5 % du PIB ;
ï chômage : 3 % du PIB
La progression des dépenses de protection sociale étant plus rapide que celle du PIB et, du fait du chômage et des modalités du partage de la valeur ajoutée, la masse salariale sur laquelle sont assis l'essentiel des prélèvements sociaux, évoluant moins vite que le PIB, les déficits sociaux s'accumulent.
Ils se traduisent à terme par des prélèvements supplémentaires. On doit d'ailleurs observer à ce sujet que depuis 10 ans, les salaires nets de cotisations sociales sont pratiquement restés stables. A l'évidence, la maîtrise des dépenses sociales est un impératif.
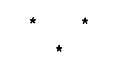
Controversée en théorie, la maîtrise des déficits publics est un impératif absolu pour la France, compte tenu de sa situation financière.
Dans le passé, la politique budgétaire n'a pas suffisamment contrecarré les influences de la conjoncture et de l'explosion des dépenses résultant de l'endettement.
Il s'en est suivi une progression continue de la dette publique qui, combinée avec le niveau des taux d'intérêt, a provoqué un doublement des charges d'intérêt dans le total des dépenses de l'État.
Cette évolution provoque une éviction des autres dépenses publiques, explique sans doute le haut niveau du taux d'épargne en France et, compte tenu de la part de la dette publique détenue par l'extérieur, fragilise la situation économique et financière du pays.
La réussite du redressement des comptes publics suppose une programmation de l'effort de réduction du déficit et que la politique entreprise repose essentiellement sur une maîtrise des dépenses publiques dont la part dans le PIB doit être diminuée.
Compte tenu du niveau des dépenses sociales dans le PIB et de leur responsabilité dans le niveau de l'ensemble des dépenses publiques, c'est l'effort de maîtrise des dépenses sociales qui s'impose comme une priorité.
II. LE BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Le maintien d'un besoin de financement des administrations publiques inférieur à 3 % du PIB est le seul des cinq critères de convergence du traité de Maastricht que la France ne respecte pas. La dette publique française est en effet en-dessous du seuil maximal de 60 % du PIB, second indicateur de référence en matière de finances publiques.
Situation des États membres de l'Union européenne au regard du respect des critères de convergence en matière de finances publiques
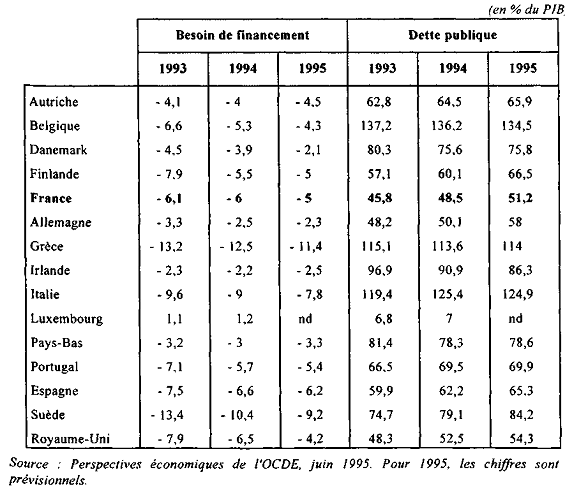
Seuls deux États membres, l'Allemagne et le Luxembourg, respectent actuellement les deux critères. Deux pays -dont la France- respectent le critère "dette publique" et deux autres pays respectent le critère "déficit public".
La France n'est donc pas dans une situation plus mauvaise que la majorité des autres États membres de l'Union européenne.
Toutefois, la rapidité de la progression de la dette publique française est inquiétante. Celle-ci pourrait même rapidement dépasser le seuil de 60 % du PIB en raison de l'effet "boule-de-neige", mécanisme aujourd'hui bien connu d'une dette qui s'accroît d'elle-même, par le poids de la charge des intérêts, du simple fait de l'écart entre taux d'intérêt et taux de croissance.
La maîtrise de la progression de la dette publique, en cours dans la plupart des autres pays où l'on constate une stabilisation, voire une réduction de la part de la dette dans le PIB, est donc indispensable. Or, cette maîtrise passe nécessairement par une réduction des déficits.
Il s'agit d'ailleurs bien de la priorité du gouvernement, énoncée à travers "la règle des 5-4-3", c'est-à-dire l'objectif d'un niveau de déficits publics égal à 5 % du PIB en 1995, 4 % en 1996 et 3 % en 1997. On observera que, compte tenu de l'importance de l'effort à accomplir, ce cheminement retarde d'une année l'objectif inscrit dans le traité de Maastricht et précédemment adopté dans la loi du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques, soit un déficit public égal à 3 % du PIB en 1996.
L'effort à accomplir est important puisqu'à la fin de 1994, le besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques (État et administrations publiques centrales, administrations locales et administrations de sécurité sociale) est encore de 442,1 milliards de francs, soit 6 % du PIB, en retrait d'à peine 0,1 point de PIB par rapport à 1993.
Besoin de financement des administrations publiques
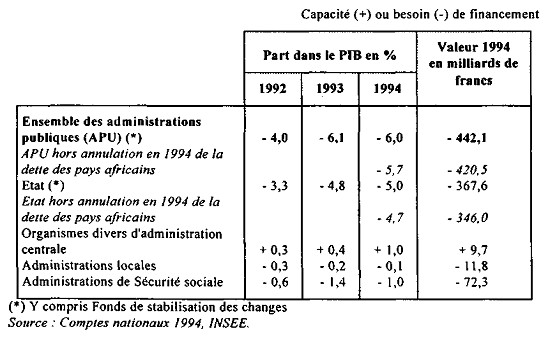
La brutale aggravation de ce besoin de financement en 1992, puis à nouveau en 1993, est le résultat de l'écart accru entre le niveau des prélèvements obligatoires et la part des dépenses publiques au sein du PIB. En effet, si le taux des prélèvements obligatoires a peu varié au cours des 10 dernières années, oscillant entre un minimum de 43,7% et un maximum de 44,6 %, la part des dépenses publiques s'est considérablement accrue, passant de 50 à 55,8 % du PIB au cours des cinq dernières années.
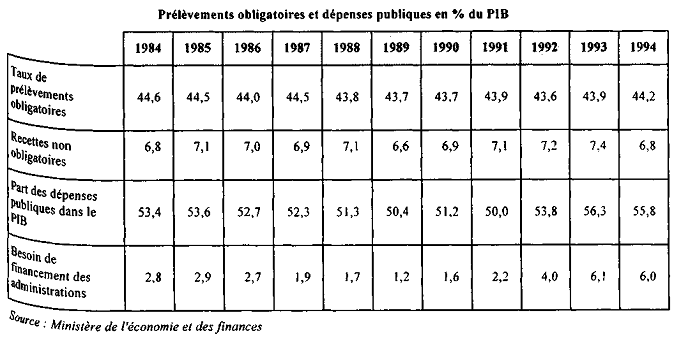
Ce tableau fait apparaître que si l'on souhaite réduire le niveau des déficits en maintenant le taux actuel des prélèvements obligatoires (ou du moins sans trop l'accroître), il convient de réduire de façon sensible la part prise par les dépenses publiques dans le PIB.
A. LE BUDGET DE L'ÉTAT
La loi du 18 janvier 1994 relative à la
maîtrise
des finances publiques
Adoptée au lendemain de la loi de finances pour 1995, la loi relative à la maîtrise des finances publiques s'appuyait sur la nécessité de retrouver des marges de manoeuvre budgétaires, autant que sur l'objectif de respecter, à partir de 1997, le critère de déficit public global, pour proposer un scénario de réduction du déficit de l'État.
Les trois principes du redressement
Le rapport annexé à la loi du 18 janvier 1994 précisait fort justement : "l'apurement des déficits n'aurait pas de sens s'il reposait uniquement sur l'augmentation des prélèvements obligatoires. Nécessaire pendant la phase d'assainissement, une telle politique ne serait pas soutenable à long terme. "
Dès lors, la stratégie de redressement des finances publiques reposait sur trois principes :
1) Le redressement du budget de l'État devait prendre place dans la remise en ordre des comptes des autres administrations publiques. Il était également utilement précisé : "Compte tenu de la structure budgétaire très dégradée, la programmation quinquennale impose que le redressement de la sécurité sociale soit réalisée sans contribution de l'État".
2) Le redressement du budget de l'État devrait nécessiter plusieurs années d'efforts, en vue d'atteindre un plafond de déficit de 2,5 % du PIB en 1997.
3) La programmation pluriannuelle reposant sur l'hypothèse -ouvertement optimiste- de progression des recettes fiscales parallèle à celle de la richesse nationale à partir de 1995, l'objectif de réduction du déficit imposait de stabiliser les dépenses en francs courants dès 1994. Compte tenu de la progression mécanique de la charge nette de la dette, cette stabilisation des dépenses impliquait une réduction des charges hors dette à partir de 1995.
Projection quinquennale du budget de l'État
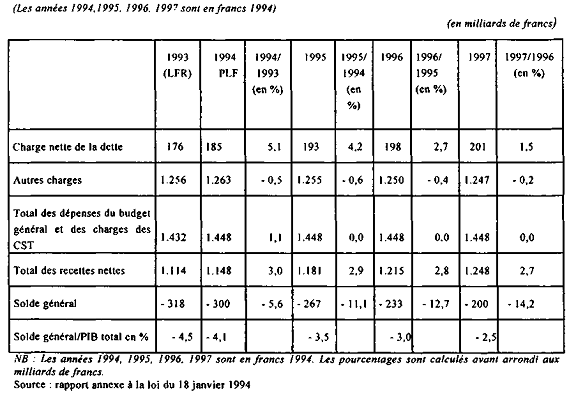
La loi de finances rectificative du 4 août 1995 a substantiellement modifié l'équilibre du budget, compte tenu de la dégradation spontanée du solde, notamment du fait de l'érosion des recettes de l'État.
En outre, il a été décidé -conformément aux prescriptions expresses du Traité de Maastricht- de ne plus affecter les recettes de privatisation à des dépenses courantes, ce qui a eu pour effet mécanique d'augmenter le déficit budgétaire du montant des recettes réaffectées au désendettement de l'État et aux dotations en capital des entreprises publiques.
Compte tenu de ces changements, une nouvelle programmation quinquennale a été élaborée, prenant comme point de départ le collectif du printemps 1995, excluant les recettes de privatisation du financement des dépenses courantes.
L'hypothèse de croissance retenue est de + 2,8 % par an, les taux d'intérêt correspondent par convention à ceux prévus pour 1996, la progression des recettes est supposée égale à celle du PIB en valeur.
L'actualisation de la projection quinquennale figure dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.
Étant donné la contrainte d'une progression de la charge de la dette supérieure à 4 % au cours des prochains exercices, seule une compression des autres dépenses peut permettre la réduction du déficit budgétaire.
Le rapport le souligne ainsi :
"L'importance de cet effet d'éviction de la charge de la dette [sur les autres dépenses de l'État et sur les marchés financiers empêchant une baisse des taux d'intérêt] nécessitera un effort de redressement structurel qui devra porter tant sur les dépenses d'intervention et d'équipement que, en raison de leur dynamisme propre et de leur part dans le total des charges de l'État, sur les dépenses de personnel".
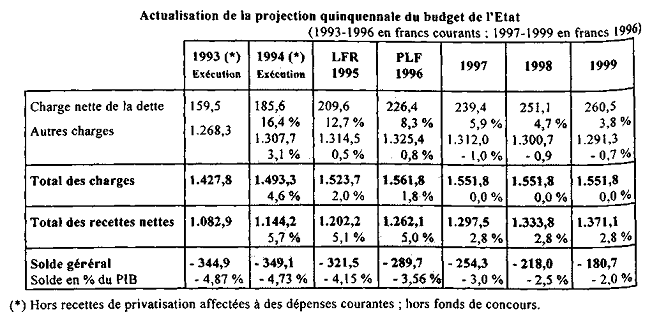
B. LES FINANCES SOCIALES
1. Des prévisions de déficits aggravées
Les comptes définitifs du régime général pour 1994 présentés dans le rapport de la Commission des comptes du mois d'octobre 1995 font apparaître un solde négatif global un peu moindre que celui affiché par les comptes provisoires présentés dans le rapport de juillet 1995 : -54,8 milliards de francs contre -55,9 milliards de francs. La différence concerne essentiellement la branche famille, dont le déficit pour 1994 est réduit d'environ 1,1 milliard de francs.
En revanche, le nouveau compte prévisionnel pour 1995 fait apparaître un déficit global aggravé d'environ 2,5 milliards de francs par rapport à la prévision présentée en juillet : -64,5 milliards de francs contre -62 milliards de francs. Avec un déficit de -36,6 milliards de francs, la branche maladie représente plus de la moitié du déficit global du régime général. La différence entre les prévisions d'octobre et celles de juillet s'explique par la révision à la baisse des recettes, à concurrence de 2,5 milliards de francs : alors que la masse salariale devrait s'accroître de + 5,1 % en 1995, l'assiette déplafonnée des cotisations sociales ne progresserait que de + 4,6 %, en raison d'un "effet de structure" lié aux exonérations de cotisations.
Pour 1996, le nouveau compte prévisionnel d'octobre retient un déficit global de -60,5 milliards de francs, s'inscrivant dans la fourchette de -56,5 à 63,2 milliards présentée en juillet. Les dépenses prévisionnelles de la branche famille ne prévoient pas la reconduction de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, décidée en 1993, puis prorogée en 1994 et 1995, ce qui explique leur évolution modérée (+ 1,4 % en 1996 contre + 4,3 % en 1995). Le rythme de croissance des dépenses de la branche vieillesse amorcerait une lente décélération, en raison de l'amplification des effets de la réforme des retraites de 1993 (+ 5,3 % en 1996 contre + 5,0% en 1995). Les dépenses de santé retrouveraient leur rythme modéré de 1994, permettant aux dépenses de la branche maladie de progresser moins vivement, en dépit d'un alourdissement des charges de transferts de compensation (+ 3,9 % en 1996 contre + 4,9 % en 1995).
La nouvelle prévision intègre les conséquences de toutes les décisions gouvernementales déjà rendues publiques, notamment celles concernant le taux directeur d'évolution des budgets hospitaliers, fixé à + 2,1%, et la majoration du forfait hospitalier, relevé de 55 à 70 francs. En revanche, elle n'anticipe la mise en oeuvre d'aucune des mesures qui devraient être annoncées à la fin de 1995.
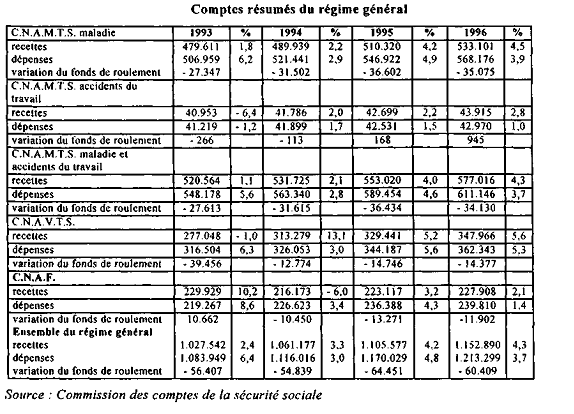
En ce qui concerne les autres régimes, les prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont également préoccupantes. Elles font apparaître en 1996 une détérioration du solde des opérations courantes de la quasi totalité d'entre eux.
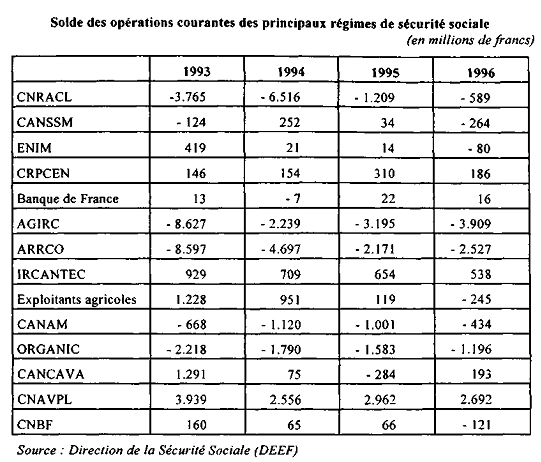
L'amélioration, toute relative, du solde de la CNRACL en 1995 et 1996 résulte du relèvement de 3,8 points du taux de la cotisation employeur intervenu au 1er janvier 1995.
L'amélioration, tout aussi relative, des soldes de la CANAM, de l'ORGANIC et de la CANCAVA résulte de l'élargissement du taux et de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés réalisé par la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 août dernier.
2. Une progression sensible des concours de l'État à la sécurité sociale
En 1996, les concours financiers de l'État aux régimes de sécurité sociale s'élèveront à 187,7 milliards de francs, soit une augmentation de 11,2% par rapport à 1995 (crédits ouverts en loi de finances initiale, modifiés en loi de finances rectificative).
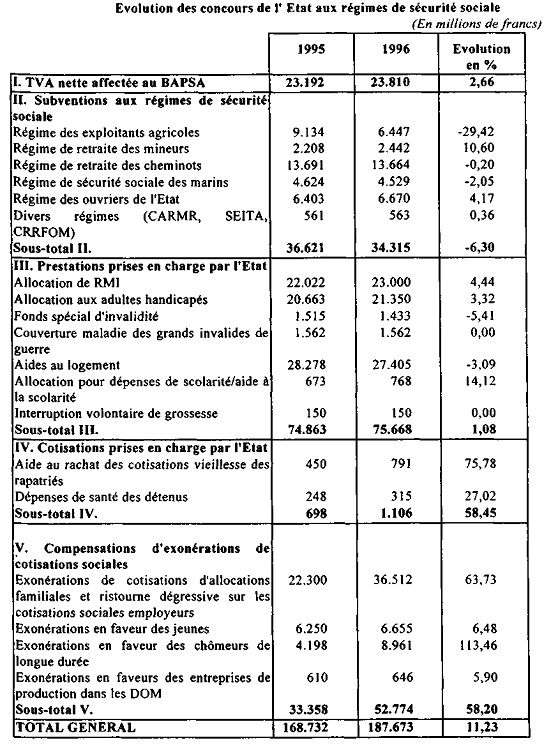
La diminution de la subvention d'équilibre au régime des exploitants agricoles explique à elle seule la baisse de - 6,3 % de l'ensemble des subventions d'équilibre aux régimes de sécurité sociale. Elle est rendue possible par la mesure d'extension des attributions du FSV aux majorations de pensions pour enfants des exploitants agricoles votée en première lecture par l'Assemblée nationale (article 17 bis nouveau) : les transferts de compensation dont bénéficie le BAPSA s'en trouveront accrus de 1,9 milliard de francs, et la subvention d'équilibre de 1' État diminuée d'autant.
Toutefois, en volume, ce sont les compensations d'exonérations de cotisations sociales qui expliquent l'essentiel de l'augmentation des concours de l'État à la sécurité sociale : les remboursements dus à ce titre s'accroissent de 19,4 milliards de francs par rapport à 1995, pour atteindre 52,8 milliards de francs.
Cette forte hausse, de 58,2 %, résulte de la création de deux exonérations nouvelles par la loi du 4 août 1995 relative aux mesures d'urgence pour l'emploi : le Contrat initiative emploi (CIE), auquel est attachée une exonération totale des cotisations patronales, et la ristourne dégressive de 800 francs par mois pour les salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC, qui sera fusionnée à compter du 1er juillet 1996 avec l'abattement sur les cotisations d'allocations familiales.
La dégradation de la situation financière des régimes de sécurité sociale va ainsi de pair avec une progression sensible des concours de l'État à leur financement. Dans les années à venir, la réduction du déficit budgétaire pourra difficilement être acquise sans un rétablissement parallèle des comptes sociaux.
3. Le plan du gouvernement pour réformer la protection sociale
a) Un préalable : le cantonnement de la dette sociale
Le régime général de sécurité sociale est entré depuis 1991 dans une spirale d'endettement que n'a pas interrompu la reprise de sa dette par l'État à la fin de 1993, à hauteur de 110 milliards de francs. Faute d'un retour à l'équilibre financier en gestion, les déficits de trésorerie ont continué de se creuser et devraient atteindre de nouveau en cumulé 120 milliards de francs à la fin de cette année.
Les charges d'intérêt s'accroissent en conséquence : d'un montant de 4,5 milliards de francs en 1995, elles s'élèveraient à 8,2 milliards de francs en 1996. Ce poids croissant de la dette fait obstacle à toute tentative de rétablissement financier de la sécurité sociale.
Préalablement à toute mesure nouvelle, le plan de réforme de la protection sociale présenté par le Premier ministre le 15 novembre 1995 propose une opération de cantonnement de la dette passée de la sécurité sociale.
Une caisse d'amortissement de la dette sociale prendra à sa charge la dette cumulée du régime général depuis 1992, soit 230 milliards de francs, son déficit prévisionnel pour 1996, soit 17 milliards de francs, et le déficit de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie, soit 3 milliards de francs. La caisse devra donc amortir au total 250 milliards de francs, en principal.
En conséquence, le fonds de solidarité vieillesse n'aura plus à contribuer au remboursement de la dette du régime général reprise par l'État en 1993, qui sera transférée à la nouvelle caisse d'amortissement. Le FSV pourra ainsi se recentrer entièrement sur ses missions de financement des prestations de retraite non contributives et, à compter de 1997, de la prestation d'autonomie en faveur des personnes âgées dépendantes. Jusqu'à présent, les versements du FSV à l'État au titre du remboursement de la dette du régime général ont absorbé un peu plus de 10 % de ses ressources.
La caisse d'amortissement de la dette sociale sera alimentée par le produit des cessions immobilières des caisses, par le remboursement des créances de soins de santé détenues par la France sur les pays étrangers et surtout par une contribution exceptionnelle au Remboursement de la Dette Sociale.
Avec une assiette plus large que celle de la CSG et un taux de 0,5 %, ce RDS rapportera annuellement 25 milliards de francs, ce qui devrait suffire pour rembourser sur 13 ans le capital et les intérêts de la dette sociale.
b) Les réformes structurelles
Le plan de réforme du gouvernement ouvre des voies de réformes structurelles extrêmement ambitieuses :
- révision constitutionnelle, qui permettra au Parlement de se prononcer par un vote annuel sur l'équilibre prévisionnel des recettes et des dépenses des régimes de base de sécurité sociale ;
- réforme institutionnelle des caisses nationales de sécurité sociale, dont les conseils d'administration seront élargis et doublés de comités de surveillance auxquels participeront des parlementaires ;
- institution d'un régime universel d'assurance maladie ;
- réforme de l'hôpital (régionalisation du financement sur la base de contrats d'objectifs avec les établissements, évaluation des services hospitaliers par une agence indépendante, coordination au plan local entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée) ;
- renforcement de la maîtrise médicalisée des dépenses de médecine de ville (ajustement automatique des rémunérations des médecins en fonctions du respect des objectifs, développement d'outils de bonne pratique médicale) ;
- rationalisation des prestations familiales, qui deviendront imposables en contrepartie d'un aménagement du quotient familial ;
- redéfinition des conditions d'équilibre des régimes spéciaux de retraite ;
- création d'une caisse autonome des fonctionnaires distincte du budget de l'État ;
- réforme du financement de la protection sociale dans un sens moins défavorable à l'emploi.
L'ensemble de ces réformes de structure devrait créer à moyen terme les conditions durables d'une maîtrise des évolutions financières du système de protection sociale.
A court terme, le gouvernement prévoit de réduire dès 1996 le déficit prévisionnel du régime général (hors charges d'intérêts, puisque la dette aura été préalablement transférée) de - 53,3 milliards de francs à - 16 milliards de francs.
Cette réduction du déficit de 36,6 milliards de francs sera acquise grâce à 27,1 milliards de francs d'économies et de mesures de gestion et à 9,6 milliards de francs de prélèvements nouveaux (2,5 milliards au titre d'une contribution de 6 % des entreprises sur les primes d'assurance de groupe et 7,1 milliards de francs au titre d'un relèvement de 1,2 point des cotisations d'assurance maladie sur les revenus de transferts).
Le régime général devrait retrouver une situation légèrement excédentaire en 1997, avec un solde des opérations courantes positif de 3 milliards de francs.
C. LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Le besoin de financement des administrations publiques locales (APUL) représente traditionnellement une part très faible du besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques. En outre, cette part ne cesse de diminuer depuis le début des années 1990.
Le besoin de financement des APUL s'est ainsi établi à 11,8 milliards en 1994 contre 17 milliards de francs en 1993 et 24,7 milliards de francs en 1992. Le secteur public local ne représente plus que 2,7% du besoin total de financement public et 0,1 % du produit intérieur brut contre 0,2 % en 1993 et 0,3 % en 1992.
Le secteur des APUL comprend lui-même deux sous-secteurs :
• les "collectivités locales" sous une
acceptation assez large (communes, groupements, départements,
régions, régies, services communaux et
départementaux) ;
• les organismes divers d'administration locale
(ODAL) parmi lesquels figurent notamment les chambres consulaires et les
agences de l'eau.
Les extrapolations effectuées par le Crédit local de France à partir du sous-compte "collectivités locales "( 13 ( * ) ) confirment globalement le constat selon lequel l'évolution des budgets locaux ne constitue pas un obstacle au respect des critères fixés par le traité de Maastricht.
Les collectivités locales n'ont certes jamais, autant qu'en 1994, recouru à l'emprunt pour financer leurs investissements : les sommes collectées auraient, en effet, atteint 86,6 milliards de francs l'an dernier. Mais le taux de progression des flux d'endettement, 4,8 %, n'était pas sensiblement supérieur à celui du PIB en valeur (+ 4,1 %).
En 1995, en outre, la baisse du recours à l'emprunt devrait être importante (entre -10% et -15%). Cette diminution résulte de trois facteurs principaux :
• La compression des programmes d'investissement,
traditionnellement observée une année d'élections
municipales, alors que l'exercice qui précède est, en
règle générale, l'occasion d'accélérer les
dépenses d'équipement.
• La volonté des élus locaux de
maintenir les équilibres fondamentaux dans un contexte marqué par
une diminution sensible de l'autofinancement (de 93 milliards de francs en 1994
à 87 milliards de francs en 1995).
De ce point-de-vue, il est clair que les collectivités locales ont subi, cette année, un effet de ciseau accentué : l'augmentation des dépenses de gestion (+ 7,3 %), dopées par la hausse significative de la cotisation employeur à la CNRACL, serait ainsi plus élevée que celle des recettes courantes (+ 4,0 %).
• Plus accessoirement, la possibilité accrue
des collectivités locales de mobiliser leur trésorerie pour
financer leurs investissements.
Le solde de trésorerie des collectivités locales aurait crû de près de 13 % au cours de l'exercice 1994, passant de 62,7 milliards de francs à 70,8 milliards de francs.
En conséquence, non seulement le besoin de financement devrait diminuer mais encore le poids de la dette des administrations publiques locales comme celui de la dette des collectivités locales "stricto sensu" dans le produit intérieur brut devraient régresser cette année alors que ce poids s'était accru d'un point depuis 1989.
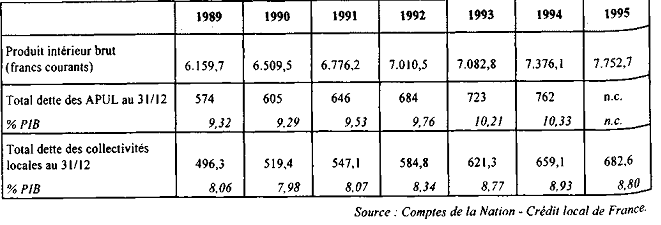
En 1996, les collectivités locales devraient continuer de subir les effets d'une très faible progression des transferts de l'État et d'un taux encore élevé d'évolution des annuités d'emprunt. Dans ces conditions, la variable d'ajustement est le niveau de l'investissement (- 6,1 % en 1995), les élus préférant dans l'ensemble réduire leur effort d'équipement plutôt que de dégrader leurs comptes par un recours accru à l'emprunt.
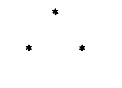
Ainsi, du fait des efforts accomplis en 1995 et prévus pour 1996 et 1997, le besoin de financement des administrations publiques pourrait s'élever à 5 % en 1995, 4 % en 1996 et 3 % en 1997.
Prévisions du gouvernement sur le besoin de
financement
des administrations publiques
(en % du PIB)
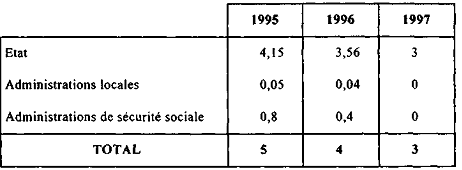
On observera que, pour 1995, il apparaît déjà vraisemblable que le seuil de 5 % du PIB sera dépassé puisque le déficit des comptes de la sécurité sociale s'annonce supérieur aux prévisions sur lesquelles le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances a été construit.
III. L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE AU RENDEZ-VOUS DE 1998 ?
L'Allemagne apparaît en bonne position pour entrer dans l'Union économique et monétaire.
ï En 1989, l'Allemagne a choisi de financer la réunification par l'endettement au prix d'une aggravation du déficit public consolidé, qui est passé de 1989 à 1993 de 0,4 % à 5,4 % du PIB et de l'accroissement de la charge de la dette. L'Allemagne est devenue emprunteuse nette sur le marché international des capitaux
ï Deux programmes vigoureux de consolidation ont permis de ramener le pourcentage du déficit du secteur public, au sens large, de 4 % du PIB en 1994 à 2,3 % en 1995 et 2,2 % en 1996, permettant ainsi à l'Allemagne de répondre dès cette année aux critères posés par le Traité de Maastricht.
En outre, les reprises de dette des divers fonds créés pour financer la réunification ont contribué à une nette augmentation du ratio de la dette publique rapportée au PIB, qui est passé de 51,4 % à 60,3 % de 1994 à 1995. Au total, le stock de la dette publique aura doublé de 1989 à 1995, passant de 920 milliards de DM à 2100 milliards. La réduction globale des déficits devrait cependant permettre de stabiliser ce ratio à 59,6 % en 1996 et à moins de 58 % du PIB au delà de 1996.
L'Italie se trouve, en revanche, dans une situation très critique au regard des critères de Maastricht.
Le déficit de l'État devait être ramené de 9,9 % du PIB, en 1993 (472 milliards de francs 14 ( * ) ), à 8,7 % du PIB (496 milliards de francs 15 ( * ) ), en 1994 mais le déficit réel s'est finalement élevé, à 10,6 % du PIB, soit 627 milliards de francs. En 1995, le budget adopté a ramené le déficit de l'État à 8 % du PIB, environ 425 milliards de francs, alors que le déficit tendanciel qui aurait été obtenu en l'absence de mesures de redressement aurait pu atteindre 10,8 % du PIB. L'exécution de ce budget de 1995 devrait toutefois se traduire par un dépassement des objectifs prévus en matière de déficit. L'OCDE table donc, pour 1996 et les années suivantes, pour un rythme d'assainissement des finances publiques plus lent que prévu. Le besoin d'emprunt des administrations publiques devrait baisser très légèrement pour s'établir à 9 % du PIB en 1995 et tomber à 7 3 / 4 % en 1996.
Ce déficit masque toutefois un solde primaire en excédent, de 4 % du PIB en 1993, 1 % en 1994, 3,4 % en 1995 et prévu à 4,2 % en 1996.
Pour 1996, la présentation des données budgétaires n'est pas, en Italie, d'une transparence évidente. Cette situation n'est sans doute pas sans lien avec le débat lancé par l'Allemagne, sur la capacité de l'Italie à répondre aux critères de Maastricht et à réintégrer le SME.
En effet, si l'on prend les chiffres officiellement communiqués dans le « Document de programmation économique et financière », qui permet d'établir le déficit du secteur d'État, le besoin de financement programmé pour 1996 de l'État italien s'élève à 109 400 milliards de lires (environ 337 milliards de francs) et le service de la dette à 189 400 milliards de lires (environ 580 milliards de francs).
En revanche, le déficit du budget de l'État, tel qu'on peut -difficilement- le relever dans un « cadre de synthèse », (document n° 2156 du Sénat italien, p. 119) fait apparaître les données relatives à l'exercice 1996 (« competenza 1996 ») intégrant les services votés et l'ajustement supplémentaire (« manovra »). D'après ce document, le solde net à financer s'élèvera en 1996 à 148 000 milliards de lires, soit environ 450 milliards de francs 16 ( * ) , le service de la dette étant établi à 201 000 milliards de lires, soit 615 milliards de francs.
En outre, et malgré ces intentions d'assainissement et de rigueur, la dette publique italienne s'est aggravée. Elle a doublé entre 1987 et 1993, en passant de 910,5 billions de lires à 1 862,9 billions (environ 5 700 milliards de francs). Elle a atteint en 1994 2 039 billions (environ 7 014 milliards de francs). En 1993, le ratio dette/PIB a augmenté de 6 points pour s'établir à 120 %. Il devrait baisser d'un point symbolique en 1995, et être ainsi ramené de 124,27 % en 1994 à 123,84 %, en 1995, mais le dérapage dans l'exécution de la loi de finances de 1995 rend cette baisse incertaine.
A. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'ALLEMAGNE
1. Une réunification à crédit
En 1989, l'Allemagne a choisi de financer la réunification par l'endettement. Il s'en est suivi une aggravation du déficit public consolidé, qui est passé de 1989 à 1993 de 0,4 % à 5,4 % du PIB et de la charge de la dette, l'Allemagne devenant emprunteuse nette sur le marché international des capitaux. Par ailleurs, la « lisibilité » des finances publiques allemandes, de nature complexe par le caractère fédéral de l'État, a été considérablement amoindrie et l'existence de nombreux budgets annexes a rendu les comptes publics allemands opaques.
Évolution de l'endettement allemand
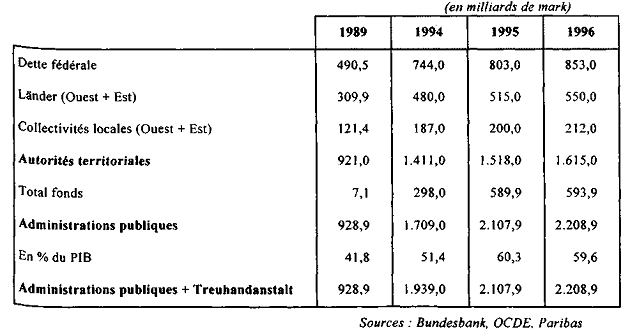
2. Une atmosphère « d'Union Nationale »
L'effort s'est donc porté, depuis 1993, sur la diminution de l'endettement de l'État et la consolidation des comptes publics. Ces nouvelles orientations fiscales ont été décidées à la suite de négociations menées à Bonn du 11 au 13 mars 1993 et traduites dans un Pacte de solidarité conclu entre le gouvernement fédéral, dominé par la coalition CDU-FDP, et les Länder, en majorité gouvernés par les sociaux-démocrates, et tendant au rééquilibrage des financements publics. Pour inverser la tendance à la dégradation des finances de l'État, un premier Programme fédéral de consolidation de 1993 s'est avéré rapidement insuffisant et a été suivi du Programme d'économie, de consolidation et de croissance de 1994.
3. Une ambition à méditer
L'objectif du gouvernement fédéral est de ramener la part des dépenses publiques dans le PIB à son niveau d'avant la réunification d'ici l'an 2000. Ce ratio est passé d'un peu moins de 46 % en 1989 à 50 % en 1994 et 57,6 % en 1995, en raison de la remise en ordre des comptes publics. Pour atteindre cet objectif, il est prévu de réduire les dépenses publiques en 11998 d'un montant équivalent à 4% du PIB, afin d'alléger la charge fiscale, tout en maintenant le déficit budgétaire à peu près stable autour de 2 %.
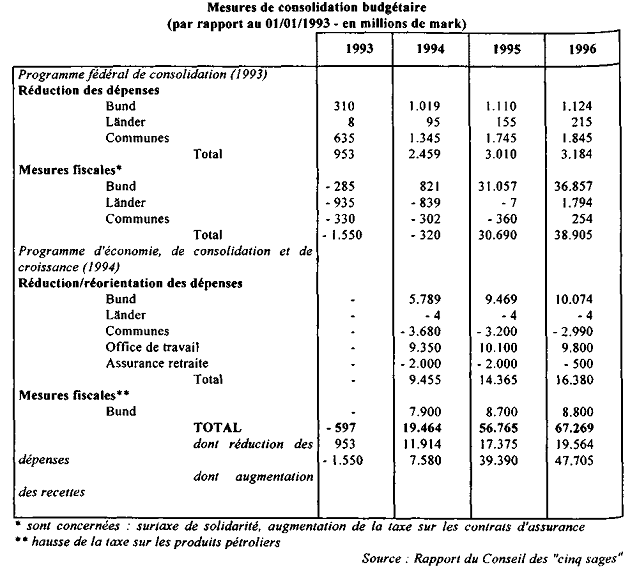
4. Un financement original des collectivités locales
Depuis le 1er janvier 1995, les règles transitoires mises en oeuvre pour la réunification se sont achevées et les aides financières aux nouveaux Länder versées jusqu'à présent par le biais du Fonds de l'Unité ont disparu. Les nouveaux Länder sont désormais intégrés à la constitution financière fédérale, c'est à dire au processus de péréquation financière global. Aux termes du Pacte de solidarité, l'État fédéral a obtenu 20 milliards de DM d'impôts supplémentaires mais céderait 7 % du produit de la TVA aux Länder, dont la part passerait de 37 à 44 %, cette augmentation de ressources étant affectée dans sa quasi-totalité aux nouveaux Länder.
5. La reprise des dettes parapubliques
Le Pacte de solidarité se traduit également par l'intégration au sein de la dette publique fédérale des différents fonds créés pour financer la reconstruction économique des Länder de l'Est. Un Fonds des dettes héritées prend désormais en charge les dettes de la Treuhandanstalt, créée pour mener à bien les privatisations, et liquidée depuis le 1er janvier 1995, celles du Fonds de crédit, regroupant les dettes de l'ex-RDA, ainsi qu'une partie des dettes du secteur public du logement de l'Allemagne orientale. Il sera alimenté par des transferts de l'administration fédérale d'un montant annuel équivalent à 7,5 % de l'encours de la dette, estimée en 1995 à 346 milliards de DM, et par les bénéfices de la Bundesbank. Outre ce fonds, l'administration fédérale prend également en charge la dette et le service de la dette du Fonds des chemins de fer et du Fonds ERP, qui accorde des crédits bonifiés en faveur des petites entreprises et des investissements d'infrastructures, principalement dans les Länder de l'Est. Le service de la dette du Fonds pour l'Unité est pour sa part, réparti entre l'administration fédérale et les anciens Länder, qui en assurent 3/4 des versements. Ces quatre fonds représentent, fin 1995, 550 milliards de DM de dettes et 26 milliards pour le service de la dette pour la seule année 1995.
6. L'art de présenter les comptes publics
Le critère de Maastricht portant sur un déficit de 3% du PIB fait en effet référence à la comptabilité nationale. Or, les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité nationale diffèrent fortement en Allemagne. Ainsi, le déficit en termes de comptabilité nationale se montait-il, en 1993, à 101 milliards de DM, correspondant à 3,3 % du PIB, soit 30 milliards de moins que selon les statistiques financières. De manière générale, on estime que la différence entre les deux définitions avoisine les 1 % du PIB. La décision de retenir, pour les critères de Maastricht, l'optique de la comptabilité nationale a été qualifié par la Bundesbank de « choix en faveur d'une morale financière plus relâchée ».
De même, les soldes financiers du secteur public calculés par l'OCDE excluent des transferts de capitaux le rachat par l'administration fédérale des dettes de la Treuhandanstalt (d'un montant de 230 milliards de DM) et celles du secteur public du logement en Allemagne orientale (30 milliards de DM) : si ces éléments étaient pris en compte, le déficit de l'ensemble des administrations publiques représenterait entre 9 et 10 % du PIB pour 1995.
En outre, les reprises de dette ont contribué à une nette augmentation du ratio de la dette publique rapportée au PIB, qui est passé de 51,4 % à 60,3 % de 1994 à 1995. Au total, le stock de la dette publique aura doublé de 1989 à 1995, passant de 920 milliards de DM à 2100 milliards. La réduction globale des déficits devrait cependant permettre de stabiliser ce ratio à 59,6 % en 1996 et à moins de 58 % du PIB au delà de 1996.
7. Moins de dépenses mais aussi plus de dettes
Après deux ans de stabilité en 1994 et 1995 (respectivement -50,6 et -49,2 milliards de DM), le déficit de l'administration fédérale devrait augmenter fortement en 1996 (-60 milliards). Ce déficit représente une part croissante de celui des autorités territoriales (44 % en 1994, 51,9 % en 1995, 57,7 % en 1996).
Pour l'exercice budgétaire 1995, le financement de la réunification par l'endettement s'étant avéré insuffisant, une surtaxe de solidarité de 7 1/2 % en sus de l'impôt sur le revenu -très brièvement introduite au début de la réunification- a été rétablie le 1er janvier 1995. Elle devrait rapporter 28,5 milliards de DM. Le taux de l'impôt sur le patrimoine a été doublé et le prélèvement au titre de l'assurance a augmenté. La rigueur s'est traduite, dans les dépenses, par une baisse des effectifs dans le secteur public et une modération des progressions de salaires respectant l'objectif du maintien de la croissance des dépenses globales à moins de 3 %. Le projet de budget prévoyait un déficit de 69 milliards de DM, qui a été finalement fixé par le Parlement à 49,5 milliards de DM.
Le déficit de l'administration fédérale s'élèverait en 1996 à 60 milliards de DM. Pour le projet de loi de finances pour 1996, la politique budgétaire allemande devra prendre en compte les conséquences financières des décisions de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a en effet estimé que l'impôt sur le revenu ne pourrait plus désormais être appliqué à des revenus égaux ou inférieurs au seuil de subsistance. Cette décision aurait un coût de 15 1/2 milliards de DM, que le gouvernement pourrait chercher à compenser partiellement par l'élargissement de la base fiscale. La Cour a par ailleurs jugé que le prélèvement sur l'électricité, d'un montant de 8 milliards de DM, devait être aboli. En 1996, le budget de l'État sera donc soumis à des tensions beaucoup plus fortes, d'autant que le gouvernement souhaite réduire les charges fiscales pesant sur les entreprises. La réforme de l'impôt sur les sociétés aurait un coût budgétaire de 7 1/2 milliards de DM. En outre, la nouvelle politique familiale coûtera 6 1/2 milliards. Le budget fédéral présente une diminution des dépenses (452 milliards de DM contre 477,7 milliards en 1995) et des recettes (392,2 milliards de DM contre 428,6 milliards en 1995). Cette contraction budgétaire doit toutefois être relativisée car elle est due en grande partie à la suppression des dépenses budgétaire d'aide à la famille qui sont remplacées par des abattements fiscaux. Cependant, même corrigées de ce facteur, les dépenses budgétaires diminueront de 1,3 %, soit la première décroissance nominale des dépenses fédérales depuis 1953. L'effort de consolidation budgétaire devra donc se poursuivre à travers les coupes sombres effectuées dans le train de vie de l'État de 12 milliards de DM en 1994, 17 milliards en 1995 et 20 milliards en 1996. En intégrant les mesures fiscales, on arrive à une consolidation budgétaire de 56 milliards de DM en 1995 et de 67 milliards en 1996. Les cessions d'actifs envisagés (Lufthansa, Deutsche Telekom, Deutsche Aerospace) vont également contribuer à la réduction de l'endettement de l'État.
Ces programmes de consolidation auront permis de ramener le pourcentage du déficit du secteur public au sens large de 4 % du PIB en 1994 à 2,3 % en 1995 et 2,2 % en 1996, permettant ainsi à l'Allemagne de répondre d'ores et déjà aux critères posés par le Traité de Maastricht.
8. Des orientations à moyen terme
Pour le moyen terme, l'objectif de réduction de la part des dépenses publiques dans le PIB s'est traduit par la décision de réduire les effectifs de l'administration fédérale de 1 % par an en moyenne jusqu'en 1998. Cette mesure d'économie n'apparaissait pas suffisante, l'OCDE estime qu'il incombera à l'État allemand d'entreprendre « une action déterminée sur un large éventail de programmes de dépenses », en matière de santé, de mesures passives et actives du marché du travail, de subventions et de dépenses fiscales, de retraite, qui représentent à eux seuls environ la moitié des dépenses publiques. La croissance des dépenses publiques, globales ou hors intérêts, devrait se maintenir aux environs de 3%. Étant donné les pressions démographiques et les autres facteurs de poussée des dépenses de sécurité sociale, l'augmentation des dépenses des collectivités locales devra être inférieure à ce chiffre. Compte tenu du gonflement actuel de la dette et des versements d'intérêts, pour que le ratio des dépenses globales revienne à son niveau de 1989, il faudra que les dépenses hors intérêts soient inférieures d'environ 1 point de PIB aux chiffres de cette année là. La part des dépenses publiques à l'exclusion des intérêts et du système de sécurité sociale devra être bien plus réduite qu'en 1989. A plus long terme, les finances publiques allemandes devront affronter les conséquences du vieillissement de la population, qui menacera la stabilité budgétaire du pays, mais pas avant l'an 2020.
B. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'ITALIE
1. Une réduction des dépenses engagée dès 1993
La réduction du déficit structurel pendant la récession de 1993 s'est opéré plus rapidement que dans les autres grands pays de l'OCDE. Le budget de 1993 a constitué un tournant dans l'histoire budgétaire de l'Italie. Ayant obtenu des pouvoirs spéciaux, le Gouvernement a réduit les dépenses primaires dans quatre grands domaines : l'emploi dans le secteur public, les pensions, la santé et le financement des collectivités locales. Le déficit de l'État a ainsi pu baisser, se réduisant de 155 900 milliards de lires en 1992 à 154 400 milliards en 1993 (472 milliards de francs 17 ( * ) ), soit 9,9 % du PIB, malgré une contraction de celui-ci de 0,7 %. Ce déficit masque en réalité un solde primaire en excédent, en 1992 comme en 1993, de 4 % du PIB cette année-là, soit le meilleur résultat de l'Italie depuis plus de 20 ans. Il cache également une exécution en dérapage. En 1994, le besoin de financement de l'État devait être ramené à 144 200 milliards de lires, soit 8,7 % du PIB (496 milliards de francs 2 ). Toutefois, le déficit réel s'est élevé, après ajustement budgétaire de 38 500 milliards de lires, à 182 500 milliards, ou 10,6 % du PIB, soit 627 milliards de francs.
2. Un « programme de convergence » fondé sur une vigoureuse progression de l'excédent primaire...
L'Italie s'est donc engagée dès 1994 dans un programme de réduction des dépenses publiques, comprenant une réduction des investissements, des transferts aux collectivités locales, aux établissements publics et aux entreprises publiques, une diminution des pensions publiques, une importante réforme des marchés publics, une réduction des dépenses de santé -constituée par une diminution globale du remboursement du prix des médicaments-, et enfin des mesures de freinage des rémunérations dans le secteur public : réduction des traitements réels des fonctionnaires et gel des embauches. Au titre des nouvelles mesures fiscales on pouvait relever une augmentation du taux intermédiaire de la TVA.
Le retournement conjoncturel menaça cependant dès mars 1994 de creuser le déficit plus qu'il n'était prévu. En juillet 1994, des mesures complémentaires de rigueur budgétaire vinrent contenir le déficit à 154 000 milliards de lires, soit un dépassement de moins de 10 000 milliards de l'objectif initial -soit environ 30 milliards de francs-. Ce « programme de convergence », établi pour une période de trois ans, vise à ramener le déficit du budget de l'État à 138 600 milliards de lires en 1995 (environ 424 milliards de francs 2 ( * ) ), 120 900 milliards en 1996 et 107 milliards en 1997, où il atteindrait 5,6 % du PIB. Afin de réaliser ce programme, l'Italie devra dégager un excédent primaire considérable. Celui-ci devrait augmenter continûment de 1994 à 1996 et passer de 8 000 milliards de lires en 1994 à 37 000 milliards en 1995 et 54 400 milliards en 1996.
3. ...Que le dérapage du budget en 1995 pourrait remettre en cause
Le budget adopté pour 1995 a ramené le déficit de l'État à 139 000 milliards de lires (8 % du PIB, environ 425 milliards de francs), alors que le déficit tendanciel qui aurait été obtenu en l'absence de mesures d'économie et de modification de la législation fiscale aurait pu atteindre 189 000 milliards (578 milliards de francs). Les économies ont porté sur une nouvelle réforme des pensions publiques, avec notamment la suppression de la retraite anticipée et l'allongement de la période requise pour bénéficier des prestations à taux plein (l'Italie ayant des dispositions très généreuses, les agents publics ayant droit à des prestations de retraite après 20 ans, pour les fonctionnaires, et 25 ans, pour les agents des collectivités locales, de service), par une réduction des dépenses de santé avec, cette fois, la fermeture ou la vente des petits établissements hospitaliers, une reconduction du gel des embauches dans le secteur public. Côté ressources, le budget a prévu des relèvements d'impôts et des recettes de privatisation estimées à 10 000 milliards.
L'exécution du budget de 1995 devrait toutefois se traduire par un dépassement des objectifs prévus en matière de déficit de 13 à 17 000 milliards de lires. L'inflation sera tout d'abord plus forte que prévue (6 % contre 3,5 %). Le programme de la « condono » rencontre ensuite des difficultés d'exécution. Il s'agit d'une vaste transaction fiscale entre l'État et les particuliers, les contribuables pouvant, par un paiement forfaitaire, bénéficier d'une amnistie pour les fraudes fiscales qu'ils auraient pu commettre. Malgré la souscription -exemplaire- de la « condono » par le ministre des Finances en personne, cette transaction rencontre un succès plus que mitigé. Enfin, les dépenses courantes pourraient, comme pour les exercices budgétaires antérieurs, déraper et les salaires de la fonction publique, gelés en 1992/1993, indexés sur une inflation prévue à 6 % pour 1994/1995 mais qui a été en réalité supérieure de trois points, pourraient bénéficier d'un rattrapage. En outre, et compte tenu du niveau élevé des taux d'intérêt, le coût du service de la dette sera plus élevé que prévu.
L'OCDE table donc, pour 1996 et les années suivantes, pour un rythme d'assainissement des finances publiques plus lent que prévu. Le besoin d'emprunt des administrations publiques devrait baisser très légèrement pour s'établir à 9 % du PIB en 1995 et tomber à 7 3/4 % en 1996.
4. Malgré une gestion vertueuse de sa dette, l'Italie ne remplit toujours pas les critères de Maastricht
Malgré cet effort d'assainissement, la dette publique s'est aggravée. Elle a doublé entre 1987 et 1993, en passant de 910,5 billions de lires à 1 862,9 billions (environ 5 700 milliards de francs). Elle a atteint en 1994 2 039 billions (environ 7 014 milliards de francs). En 1993, le ratio dette/PIB a augmenté de 6 points pour s'établir à 120 %. Il devrait baisser d'un point symbolique en 1995, et être ramené de 124,27% en 1994 à 123,84 %, en 1995, mais le dérapage dans l'exécution de la loi de finances de 1995 rend cette baisse incertaine. Au demeurant, cette annonce ne serait pas sans lien avec le débat lancé par l'Allemagne, sur la capacité de l'Italie à répondre aux critères de Maastricht et à réintégrer le SME.
Pour stabiliser le niveau de la dette publique, l'excédent primaire aurait dû, dès 1993, atteindre 3,5 % du PIB -soit 66 000 milliards de lires, plus de 200 milliards de francs-, dans la mesure où le service de la dette tendrait automatiquement à lui seul à gonfler dans cette proportion la dette rapportée au PIB. Le service de la dette représentant 12 % du PIB, la situation budgétaire de l'Italie est restée ingérable, même après la réduction du déficit budgétaire. Ce dernier est, au demeurant, difficile à appréhender.
Le déficit public de l'Italie peut être appréhendé à un triple niveau : celui de l'État, celui du « settore statale », secteur d'État, qui comprend outre l'État, les administrations des Ponts et chaussées, l'office des forêts, la Caisse des dépôts et consignations, et enfin celui du secteur public.
Le déficit du budget de l'État, tel qu'on peut difficilement le relever dans un « cadre de synthèse », annexe 8, (document n° 2156 du Sénat italien, p. 119) fait apparaître les données relatives à l'exercice 1996 (« competenza 1996 ») intégrant les services votés et l'ajustement supplémentaire (« manovra »). D'après ce document, le solde net à financer s'élèvera en 1996 à 148 000 milliards de lires, soit environ 450 milliards de francs 18 ( * ) , le service de la dette étant établi à 201 000 milliards de lires, soit 615 milliards de francs. Cette hypothèse, optimiste, se fonde sur une baisse des taux d'intérêts en 1996. Or, depuis 4 ans, cette variable, volontariste, ne s'est vérifiée qu'une fois.
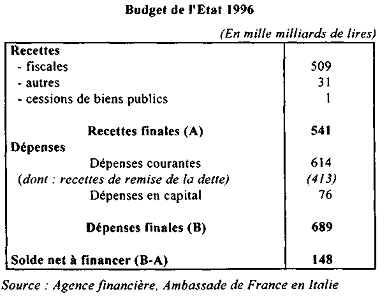
En revanche, si l'on prend les chiffres officiellement communiqués dans le « Document de programmation économique et financière » du 2 juin 1995, qui permet d'établir le déficit du secteur d'État, le besoin de financement programmé pour 1996 de l'État italien s'élève à 109 400 milliards de lires (environ 337 milliards de francs), soit 5,9 % du PIB, et le service de la dette à 189 400 milliards de lires (environ 580 milliards de francs).
Comment expliquer cet écart ? Selon l'usage en Italie, les chiffres publiés ne sont pas relatifs aux recettes et charges à caractère définitif de l'année 1996, mais à des prévisions de "mouvements de caisse". Les données relatives aux recettes et charges à caractère définitif de l'exercice 1996 ne seront donc connues que beaucoup plus tard et seront présentées comme secondaires par rapport aux mouvements de trésorerie. Or, seuls les résultats définitifs permettraient de juger de manière valide le redressement effectif des finances publiques italiennes.
En quelque sorte, l'Italie se comporte comme un ménage qui ne chercherait pas à prouver sa solvabilité en affichant le salaire figurant à son contrat de travail -le loyer figurant à son bail et ses frais de subsistance découlant des factures de ses fournisseurs- mais en présentant un solde de trésorerie déterminé par l'état des avances accordés par son employeur, des reports de loyer consentis par son propriétaires et des arrangements conclus avec ses autres créanciers.
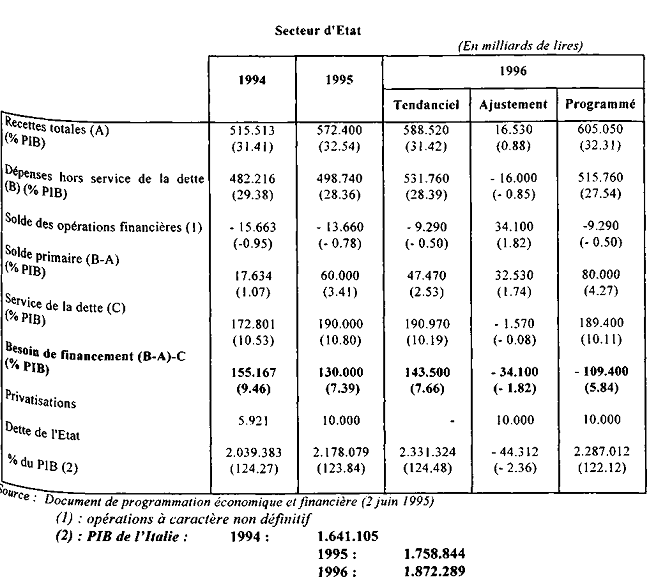
Le déficit du secteur public , le plus proche des critères de Maastricht, comprend, outre celui de l'État et des administrations autonomes, les collectivités locales, les régimes sociaux et l'ENEL, entreprise publique d'électricité. Dans ce document du 2 juin 1995, le ratio de la dette publique/ PIB diminue effectivement, si l'on prend le secteur d'État (supra) ou le secteur public. Dans le premier cas, il diminuerait de 123,84, en 1995, à 122,12, en 1996, et, dans le second, de 127,5, en 1995, à 126,03, en 1996. Mais, une fois encore, les hypothèses retenues pour 1996 et l'évolution défavorable de l'exécution budgétaire en 1995 doivent conduire à appréhender cette évolution, en apparence satisfaisante, avec circonspection.
De même, on ne manquera pas de s'interroger sur les capacités de l'Italie de réaliser en 1996 un ajustement de 32.500 milliards de lires, soit-en valeur absolue- le triple de l'effort prévu par le projet de budget français, sans réforme fiscale significative ni plan d'ensemble en matière de santé et en garantissant aux fonctionnaires la compensation intégrale de l'inflation.
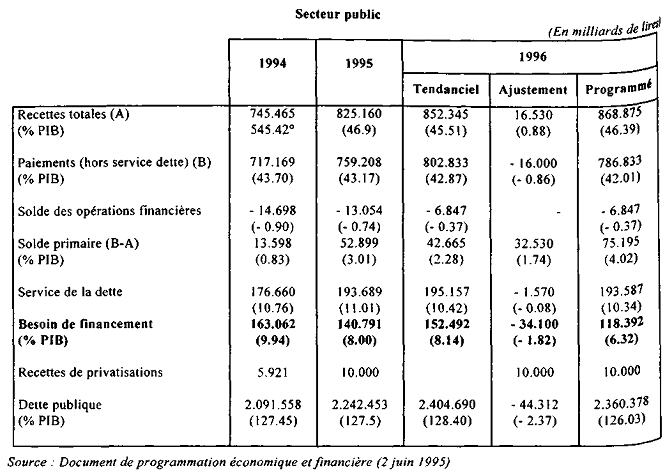
Le gonflement de la dette aurait cependant pu devenir encore plus important sans le vaste effort de privatisation qui a produit plus de 17.000 milliards de lires de recettes, soit 1,2 % du PIB en 11994, et sa « gestion vertueuse », 7 000 milliards ayant été affectés à la réduction de la dette publique et le solde, à des mesures de restructuration des entreprises publiques en difficulté. Le programme de privatisation a toutefois marqué une pause en 1995. Une caisse d'amortissement de la dette a été créée et est alimentée non seulement par les ventes d'actifs mais également par les dividendes des sociétés anonymes publiques et par les bénéfices d'entités publiques, comme les profits de la Banque d'Italie.
La gestion de la dette publique est essentiellement axée, depuis le début des années quatre vingt dix, sur l'allongement des échéances. Jusqu'en 1990, la moitié de la dette publique de l'Italie était à court et moyen terme, le rythme auquel elle progresse dépendait très étroitement des taux d'intérêt. Cette situation a radicalement changé en 1993 : les titres à moyen et long terme représentent désormais 90 % de la dette, et la part des bons du Trésor a chuté de 29 % en 1991 à 2,9 % en 1993.
CHAPITRE IV - QUELLE POLITIQUE BUDGÉTAIRE POUR LA FRANCE ?
I. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
La nécessité absolue de réduire les déficits publics et l'impossibilité objective d'augmenter significativement les prélèvements obligatoires conduisent le Parlement à s'interroger sur les possibilités de réaliser des économies budgétaires. L'Assemblée nationale a adopté une démarche d'économie forfaitaire -2 milliards de francs- sur l'ensemble des dépenses, à charge pour les rapporteurs spéciaux de proposer les réductions de dépenses idoines lors de l'examen de chaque budget. Toutefois, la difficulté est apparue de réaliser des économies suffisantes pour atteindre l'objectif de 2 milliards de francs. Le gouvernement a donc été appelé à compléter les réductions de dépenses par un amendement proposé à l'Assemblée nationale en deuxième délibération sur l'ensemble du budget.
La réflexion sur les économies est indispensable, pour des raisons d'équilibre budgétaire mais aussi au nom de la cohésion sociale, le citoyen acceptant de plus en plus mal l'incapacité apparente de l'État à réduire le poids des prélèvements obligatoires. Ces deux impératifs rendent la réflexion urgente, même si aucune obligation de résultat n'est officiellement fixée.
Votre rapporteur général souhaite rappeler les quelques grandes caractéristiques des dépenses du budget de l'État, avant d'évaluer leur flexibilité, pour mieux explorer enfin les possibilités de réduction des charges.
A. APPARENCES ET RÉALITÉS DES DÉPENSES DE L'ÉTAT
L'évolution des fonctions de l'État au cours des dernières décennies a abouti à une profonde modification de la structure budgétaire.
1. Un équilibre apparent
a) - Du "régalien" à l'universel
L'évolution depuis 20 ans, des fonctions du budget, reflète la juxtaposition, aux missions régaliennes, d'interventions de plus en plus diversifiées dans le secteur économique et social, et le poids grandissant de l'endettement public.
LES FONCTIONS DE L'ÉTAT
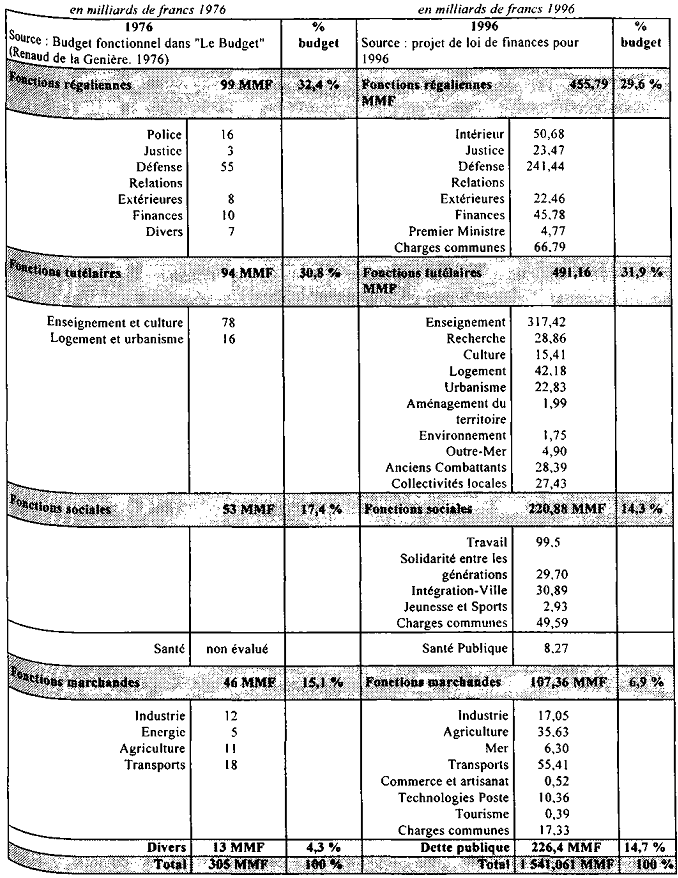
b) L'État "régulateur"
La photographie des dépenses de l'État en 1996 illustre l'aboutissement de l'évolution des dernières décennies budgétaires.
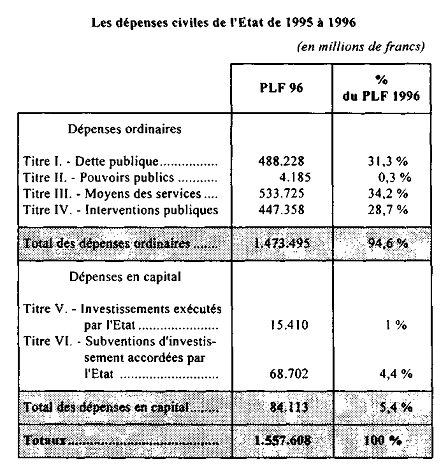
L'État supporte une charge d'endettement née du poids grandissant de ses dépenses.
L'État assume les dépenses de personnel et matériel de l'administration dont le poids est devenu supérieur à 1/3 du budget.
L'État se réserve une marge consistante d'interventions dans l'économie, même si cette marge est moins importante en volume que celle de la charge de la dette.
Enfin, le budget civil d'investissement de l'État est proportionnellement faible : 84,11 milliards de francs, soit 5,4% du total (trois fois inférieur à celui des collectivités locales). En effet, l'État accompagne l'effort d'équipement mais le prend rarement totalement à sa charge, comme le montre la part assez faible des investissements réalisés par l'État : 15,4 milliards de francs en 1996 par rapport aux subventions d'investissement : 68,7 milliards de francs 19 ( * ) .
Cette répartition des fonctions budgétaires de l'État recouvre en fait une prédominance absolue des dépenses à caractère social.
2. La prédominance du social
a) Un équilibre apparent
L'analyse du budget par titre et par partie, ou bien par ministère, donne une place équilibrée aux dépenses sociales dans le budget de l'État.
•
Les interventions de
l'État
. Au sein des interventions publiques (titre IV) qui s'élèvent à 447,4 milliards de francs, les interventions dites "sociales" représentent 173,4 milliards de francs, alors que les interventions économiques s'établissent à 158,3 milliards de francs, les autres interventions (politiques, culturelles...) s'élevant à 115,7 milliards de francs. Le "social" représenterait donc un peu plus d'un tiers des interventions.
• Les budgets par
ministère
L'évolution des budgets par ministère montre une progression très nette en volume des "fonctions sociales" mais une régression de leur part dans le budget de l'État, de 17,3 à 14,3 % (voir tableau page 19).
b) Une prééminence effective
L'analyse des charges de l'État par destination montre en fait une large prééminence des dépenses à caractère social.
En effet :
au sein du titre III (moyens des services) :
La part des pensions et cotisations sociales des agents de l'État représente 151,19 milliards de francs, soit 28,3 % des moyens des services.
(en milliards de francs PLF96)
|
Charges sociales |
64,06 |
|
|
Pensions |
87,13 |
|
|
Total Titre III |
533,72 |
Parmi les subventions de fonctionnement versées aux établissements publics, les dotations destinées à des organismes à caractère social représentent plus de 10 % du total.
Travail 5,446 MMF (dont 5,326 MMF pour l'ANPE)
Anciens combattants 0,266 MMF (Office national des Anciens
Combattants, Institution Nationale des Invalides)
Santé 0,246 MMF (hôpitaux, école nationale
de la Santé)
Solidarité entre
les générations 0,085 MMF (Instituts pour jeunes
aveugles et jeunes sourds,
institut de l'enfance et de
la famille)
Total : 6,043 MMF, soit 10,9 % des subventions
de fonctionnement
au sein du titre IV (Interventions publiques), la prédominance des interventions à caractère social est absolue.
En effet, les interventions à caractère social sont nettement prépondérantes, et beaucoup plus étendues que les dépenses officiellement regroupées sous les 6e et 7e parties du titre soit :
- 6e partie - Action sociale-assistance et solidarité : 147,29 MMF en 1996 (+ 3,8 %)
- 7e partie -Action sociale-prévoyance : 26,11 MMF en 1996 (+ 4,3 %).
En fait, des dotations à caractère social apparaissent à la 3e partie (action éducative et culturelle), à la 4e partie (action économique-encouragements et interventions), à la 5e partie (action économique, subventions aux entreprises d'intérêt général).
Ainsi :
- au sein de la 3e partie, "Action éducative et culturelle" :
- au budget du travail, 19,59 MMF sont consacrés à la formation professionnelle dans les entreprises et au crédit formation individualisé pour les jeunes décentralisé aux régions, ces formations étant directement axées vers un souci d'insertion professionnelle.
- au budget de l'enseignement supérieur, 6,3 milliards de francs (+ 8,6 %) sont consacrés aux bourses et secours d'études.
- au budget de la jeunesse et des sports, 573,5 millions de francs sont destinés à la jeunesse et à la vie associative.
- au sein de la quatrième partie : "action économique-encouragements et interventions"
- au budget du travail, 58,08 milliards de francs (+ 21,5 %) sont consacrés aux interventions en faveur de l'emploi (mesures d'accompagnement des licenciements, emplois aidés, mesures pour les chômeurs de longue durée...)
- Au budget des charges communes, 38,81 milliards de francs (+ 55%) sont destinés aux dépenses d'allégement du coût du travail.
- Au sein de la cinquième partie, "Action économique - subventions aux entreprises d'intérêt général", 4,55 milliards de francs constituent la subvention à Charbonnages de France au nom du "Pacte charbonnier" qui accompagne socialement l'extinction progressive de l'activité des mines.
On peut donc estimer qu'au total, les interventions à caractère social représentent :
à la 3e partie : 26,46 milliards de francs
à la 4e partie : 96,89 milliards de francs
à la 5e partie : 4,55 milliards de francs
à la 6e partie : 147,29 milliards de francs
à la 7e partie : 26,11 milliards de francs
soit au total 301,3 milliards de francs, ou 67,4 % de l'ensemble des interventions publiques.
Le poids des dépenses sociales dans le budget de l'État est donc beaucoup plus lourd que ne le laisse entrevoir la présentation officielle des dépenses : il représente en fait 30 % des dépenses du budget.
B. UN BUDGET MALLÉABLE ?
Le poids de l'endettement, des charges de personnel, des dépenses sociales laissent mal présager des marges de manoeuvre du budget de l'État. Une analyse plus détaillée s'impose pour aller, là encore, au-delà des apparences.
En effet, la difficulté de réduire les dépenses de l'État est le plus souvent présentée à partir du poids des charges dites "incompressibles" soit la charge de la dette publique, les dépenses de personnel, les interventions pour l'emploi.
Cette analyse n'est pas inexacte mais elle reste incomplète : ces charges certes importantes représentent quelques 900 milliards sur un total de dépenses supérieur à 1 500 milliards de francs, et laissent donc une marge -théorique- d'action sur 600 milliards de francs.
La réalité est autre, et appelle à un examen des contraintes qui s'appliquent à l'État, afin de mieux apprécier les différentes possibilités de réduire la dépense.
Une clé de lecture des contraintes pesant sur les dépenses est fournie par la nature du cadre dans lequel ces dépenses s'opèrent, et permet d'apprécier la flexibilité des charges de l'État 20 ( * )
1. Les dépenses "imposées"
Les dépenses intégralement imposées à l'État sont rares : au-delà des prélèvements sur recettes affectés à l'Union Européenne (qui apparaissent en moindres recettes et non pas en dépenses), des contributions obligatoires aux organisations internationales ou des frais de justice prescrits par les magistrats, les dépenses inéluctables peuvent en fait être modulées à la marge par l'État.
Il s'agit des dépenses ayant un caractère de dette : dette publique, rémunérations et pensions des fonctionnaires -dues à leur statut-pensions des anciens combattants, indexées sur les traitements des fonctionnaires.
a) la dette publique
Les charges de la dette de l'État, conditionnées par le niveau des déficits antérieurs et l'évolution des taux d'intérêt, sont des dépenses auxquelles l'État ne peut bien sûr se soustraire, une action étant seulement possible sur le calendrier des émissions de titres. Ces dépenses s'élèvent en 1996 à 226,4 milliards de francs, en augmentation de 8,2 %.
b) Les pensions et rémunérations des fonctionnaires
Les charges de personnel dépendent du taux fixé pour la revalorisation du point de la fonction publique, du niveau des effectifs, et de l'évolution des carrières. L'État conserve la maîtrise du point de la fonction publique, peut agir -assez marginalement- sur l'évolution des carrières, et maîtriser, à la marge, les effectifs de fonctionnaires, mais pas ceux des pensionnés.
En 1996, la non revalorisation du point est un facteur de freinage des dépenses de personnel. Toutefois, les charges de rémunérations augmentent de 3,2 % et s'établissent à 352,8 milliards de francs, sous l'effet de l'augmentation du point décidée en 1994, des protocoles de revalorisation de la fonction publique antérieurs à 1995, et d'un solde positif net de 3 557 créations d'emplois. Parallèlement, les charges de pensions progressent de 11,9 % et s'établissent à 87,13 milliards de francs, sous l'effet de l'augmentation des effectifs.
On peut assimiler aux charges de pensions des fonctionnaires les dépenses de pensions des anciens combattants, indexées sur l'évolution du point de la fonction publique, dont l'évolution est toutefois freinée spontanément par la diminution naturelle du nombre des ayant-droits : la dépense est de 21,37 milliards de francs en 1996 au lieu de 21,7 milliards de francs en 1995.
2. Les dépenses de structures
Dans l'ordre de 1' "inéluctable" décroissant, les dépenses liées au fonctionnement des structures occupent la deuxième place. Sauf à bloquer l'activité d'une administration ou d'un établissement public, voire à en supprimer l'existence, la réduction des dépenses de fonctionnement s'avère difficile à manier même si les exercices de régulation et d'annulation des crédits imposés en cours d'année par la Direction du Budget y ont régulièrement recours.
a) Le matériel et le fonctionnement de l'administration
Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 1996, les dépenses de matériel et fonctionnement des services progressent de 0,65 %, alors que la norme imposée par la lettre de cadrage envoyée le 8 juin 1995 par le Premier Ministre aux ministres dépensiers imposait une diminution de 8 % des dépenses de fonctionnement hors personnel.
b) Les subventions de fonctionnement aux établissements publics.
Elles devraient théoriquement être plus facilement modulables, l'établissement pouvant être sommé de procéder à des redéploiements de dépenses, voire de renoncer à certaines opérations. Toutefois, là encore, c'est une progression des dépenses de 3,3 % qui est prévue en 1996, certaines augmentations accordées à des établissements compensant les quelques diminutions opérées.
Ainsi :
- à la culture, les subventions de fonctionnement progressent de 17,9% et atteignent 3,35 milliards de francs, dont :
587,37 millions de francs pour la Bibliothèque nationale de France, soit + 7 %,
619,2 millions de francs pour l'Opéra de Paris, soit + 6,5 %,
355,0 millions de francs pour le Centre Georges Pompidou, soit + 1 %.
Les difficultés rencontrées par l'Assemblée nationale pour diminuer la subvention à la Bibliothèque nationale illustrent la nécessité de pouvoir disposer d'une information complète sur les établissements, leurs programmes et l'adéquation de la nature et du montant de leurs moyens, afin de cibler les possibilités d'économies.
- à la recherche, les subventions de fonctionnement augmentent de 3,5 % et atteignent 19,960 milliards de francs.
La subvention au CNRS progresse de 500,3 millions de francs et atteint 10,676 milliards de francs.
L'exemple du CNRS illustre une autre difficulté à réaliser des économies sur les subventions de fonctionnement : en effet, l'augmentation brutale des moyens de 1996 rattrape les diminutions de crédits des années antérieures, qui n'avaient pas été intégrées dans les programmes de recherche : les économies supposent en effet une évaluation préalable des établissements, et notamment de leurs capacités de redéploiement interne.
c) Les subventions d'équilibre
On peut rapprocher des subventions de fonctionnement les subventions versées par l'État afin d'assurer l'équilibre financier de divers régimes, qu'elles interviennent -ou non- dans un cadre contractuel.
Ainsi, les subventions aux régimes de sécurité sociale (BAPSA). Caisse des mines, ENIM, retraites de la SNCF, SEITA) atteignent 28,45 milliards de francs en 1996 (-6,7 %).
De même la subvention au Fonds de solidarité, qui finance l'indemnisation des chômeurs ayant épuisé leurs droits aux allocations de chômage s'établit à 7,53 milliards de francs (+ 19,2 %).
3. Les dépenses contractuelles
L'État est aussi lié à des organismes par des liens contractuels qui prédéterminent sa contribution financière.
Il en est ainsi pour :
- le financement de l'enseignement privé sous contrat : 36,91 milliards de francs en 1996,
- les subventions à la SNCF, intervenant dans le cadre d'un contrat de plan,
- le transport gratuit de la presse, prévu dans le cadre d'un contrat avec la Poste : 1,9 milliard de francs en 1996.
On peut sans doute y ajouter d'ores et déjà les dotations de décentralisation (32,5 milliards de francs) dans la mesure où elles sont appelées à s'inscrire dans le pacte de stabilité qui devrait être conclu avec l'État.
4. Les dépenses "à guichet ouvert"
Une grande part des dépenses d'intervention correspond à des prestations dont l'accès est subordonné à des conditions objectives, fixées par voie législative et réglementaire, qui doivent elles-mêmes être modifiées si l'on veut infléchir la dépense.
Il en est ainsi en 1996 pour :
- L'allégement du coût du travail sur les plus bas salaires : 38,8 milliards de francs,
- les aides au logement versées aux personnes : 27,72 milliards de francs,
- le revenu minimum d'insertion : 23 milliards de francs,
- l'allocation aux adultes handicapés : 20,86 milliards de francs,
- les bourses scolaires et universitaires : 9,39 milliards de francs,
- l'aide juridique : 1,1 milliard de francs.
5. Les dépenses conditionnelles
Proches de la catégorie précédente, ces dépenses sont toutefois subordonnées :
- à l'intervention d'un tiers (par exemple un employeur pour déclencher l'aide au contrat d'apprentissage) ;
- ou à un examen en opportunité de la situation par l'administration.
Entrent dans cette catégorie :
- Les actions du Fonds national de l'Emploi : 33,54 milliards de francs dont :
* l'incitation au retrait d'activité (préretraites...) : 15,42 milliards de francs
* les contrats emploi solidarité : 10,84 milliards de francs
- Les exonérations de charges sur certains contrats de travail (apprentissage...) : 16,12 milliards de francs
- Les aides à l'agriculture : 12,16 milliards de francs
- Le reclassement des travailleurs handicapés : 4,99 milliards de francs.
- Les actions pour la promotion de l'emploi : 1,457 milliards de francs -dont 900 millions de francs pour l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise.
6. Les dépenses "flexibles"
Il est rare qu'une dépense échappe à toute contrainte législative, réglementaire ou contractuelle.
On doit toutefois considérer que l'État peut agir plus librement sur certains postes de dépenses qui sont, au moins en théorie, quasi discrétionnaires, comme le montrent les économies pratiquées dans le budget de 1996 :
* L'action internationale
Les contributions non obligatoires aux organisations internationales : ainsi, la France diminue-t-elle cette année sa participation à l'Unicef, au Haut commissariat aux réfugiés, au programme alimentaire mondial, ...
En ce qui concerne l'aide au développement, les actions de coopération civile et militaire sont réduites en 1996, respectivement à 2,11 milliards de francs (-200 millions de francs) et à 776 millions de francs (- 7 millions de francs).
* La politique économique
L'État garde la maîtrise, en opportunité, du volume des dépenses de bonification industrielle : 6,94 milliards de francs, ou encore des aides "à la pierre" au logement : 7,43 milliards de francs.
* La lutte contre les fléaux sociaux
L'État est également maître d'interventions d'intérêt général, telles que la lutte contre le SIDA (0,45 milliard de francs), contre la drogue (0,67 milliard de francs), la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme (0,18 milliards de francs).
* La politique culturelle
Au sein du budget de la culture, les actions de "développement culturel et formation" (2,465 milliards de francs), de "soutien" (3,206 milliards de francs), de "recherche "(762 millions de francs), restent très largement discrétionnaires, étant le plus souvent versées sous forme de subvention aux associations.
On peut considérer qu'il en est de même pour les actions en faveur de la jeunesse, de la vie associative du sport, qui diminuent de 10 millions de francs et s'établissent à 1,101 milliards de francs en 1996 au sein du budget de la jeunesse et des sports.
Les dépenses ordinaires civiles de l'État par ordre de flexibilité croissante (énumération non exhaustive)
(en milliards de francs
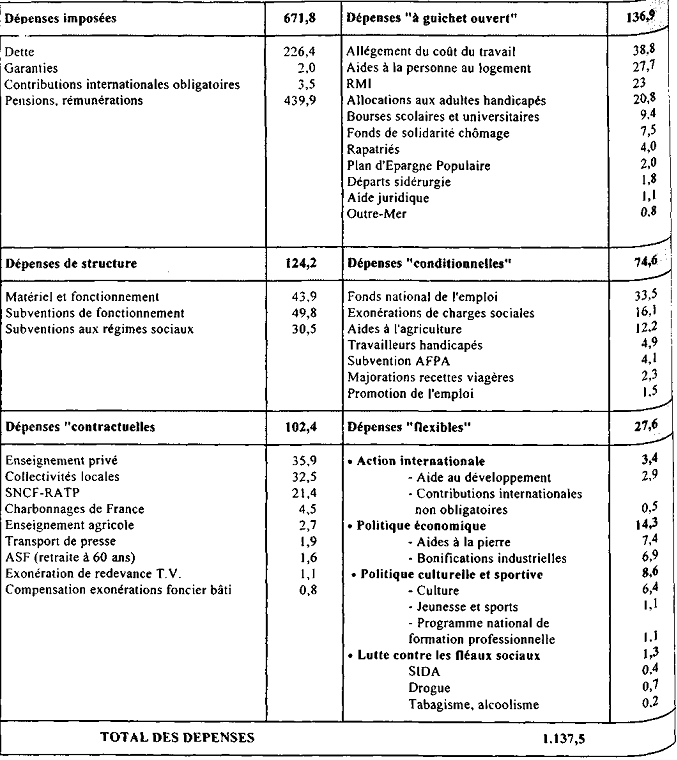
Cette classification s'applique à 1.137,5 milliards de francs, soit 87,5 % des dépenses civiles ordinaires.
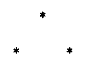
Cette présentation -inévitablement un peu théorique- des dépenses permet de mieux apprécier la faible marge de manoeuvre dévolue aux économies, à champ d'intervention constant. Cette contrainte implique :
1) que soit revu le mode de gestion de certaines dépenses. Ainsi, l'ampleur de la subvention de fonctionnement à certains organismes pose un problème d'évaluation de leurs résultats. A cet égard, la gestion confiée au service privé des nouveaux établissements pénitentiaires peut constituer un bon exemple d'économies potentielles.
2) que soit apprécié le bien-fondé même de l'intervention de l'État dans certains secteurs. En effet, la répartition des dépenses montre qu'il n'y a pas a priori d'intervention inutile, et que l'État doit choisir de confier certaines dépenses à d'autres acteurs, s'il entend y renoncer. Ainsi devrait être revu le mode de fonctionnement de la formation professionnelle entre l'État, l'entreprise, les régions, ou bien le poids et la répartition des dépenses de l'État en matière de recherche, par rapport aux interventions du secteur privé.
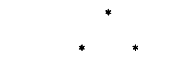
II. QUELLE STRATÉGIE POUR LE PARLEMENT ?
Le succès d'une politique de maîtrise des déficits publics exige une action déterminée sur les dépenses. Mais ces dépenses ne sont pas si facilement ajustables, comme en témoignent les développements qui précèdent. Le parallèle souvent établi entre une entreprise qui sait "tailler dans les dépenses" pour rétablir sa compétitivité et un État qui n'y parvient qu'à grand peine, n'est guère convaincant.
Toutefois cette rigidité des dépenses publiques ne saurait ni conduire à accepter le statu quo ni à se satisfaire de mesures ponctuelles.
Elle nous enseigne toutefois qu'une politique d'économies ne peut faire l'économie d'une politique.
Cette politique nouvelle doit dégager des orientations claires, faisant l'objet d'un consensus "à l'allemande". Elle impose une redéfinition des compétences entre les grands acteurs du jeu économique (Europe, collectivités locales, régimes sociaux, initiative privée). Elle suppose une meilleure efficacité des "grandes machines" que sont l'Éducation nationale ou le système de santé. Il ne sera pas longtemps supportable que l'effort collectif en matière d'enseignement ou de soins ait un rapport performances/coût inférieur à celui de nos grands partenaires, même si les statistiques comparées sont à interpréter avec précaution. Elle implique des mutations en termes de revenus distribués, d'emploi et d'aménagement du territoire, dont les conséquences sont potentiellement considérables. Elle appelle une méthode adaptée qui tienne compte des inerties inévitables et qui se situe dans une perspective temporelle suffisamment longue.
Elle devrait enfin rendre caduques les procédures détestables de la régulation budgétaire qui, soit rend les responsables de services incapables de gérer convenablement leurs dotations, soit les conduit à prendre des libertés avec les exigences formelles de la comptabilité budgétaire.
A. LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES SUPPOSE UNE RÉFLEXION PRÉALABLE SUR LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉTAT
Comme nous l'avons observé dans le chapitre premier, l'État est tenu d'intervenir massivement en direction des collectivités locales, des régimes sociaux, de l'Europe et des entreprises du secteur public. Le rapport Picq (l'État en France -Servir une Nation ouverte sur le monde -mai 1994) en tire une conséquence que votre rapporteur général ne peut que partager.
"L'État doit distinguer les domaines respectifs de l'initiative privée et de l'intervention publique. Il doit surtout clarifier la répartition des compétences entre les différentes collectivités publiques (collectivités locales, État, Union européenne). "
Cette affirmation est partagée par les rédacteurs de l'ouvrage "La France de l'an 2000", plus communément appelé "Rapport Mine" qui écrivent "Une double tension doit donc présider au redéploiement de l'État : le restaurer dans sa vocation, le soumettre au principe d'efficacité".
Optimiser la dépense publique
"Cela implique naturellement que l'État sache mieux distinguer l'essentiel de l'accessoire... Cette capacité dépend à l'évidence de sa faculté de programmation budgétaire à moyen terme, qui ne peut elle-même s'effectuer de manière cohérente et claire que si des choix politiques ambitieux permettent d'opérer un redéploiement des grandes masses financières... Le desserrement de la contrainte financière, seul à même de permettre à l'État de remplir ses grandes fonctions collectives, est à ce prix. " (rapport Minc)
L'examen du projet de loi de finances pour 1996 conduit à penser que la mise en oeuvre de ces orientations n'est pas particulièrement aisée. A titre d'illustration, il est possible de rendre compte de cette difficulté en analysant sommairement deux dossiers.
1. Le budget de la culture
Le rapport Picq remet en question le rôle central de l'État en matière de culture.
"Mais doit-il garder le rôle central, qu'il a aujourd'hui ? Si les collectivités locales ont considérablement accru leurs dépenses culturelles depuis vingt ans (elles consacrent aujourd'hui à la culture entre deux et trois fois plus d'argent que l'État), l'État demeure le "grand maître des cérémonies" : il définit les règles applicables, mais il est aussi le principal opérateur artistique ; il est enfin le banquier de beaucoup d'activités dans ce domaine. Les excès de ce tout-État culturel ont été souvent dénoncés. Leur conséquence est connue : développement d'un art officiel et liste d'abonnés" aux subventions de l'État. C'est pourquoi le comité considère que les responsabilités culturelles de l'État doivent être beaucoup mieux hiérarchisées et ses modalités d'intervention profondément revues. "
Les débats de l'Assemblée nationale consacrés à l'examen du budget de la culture semblent démontrer que cette remise en cause du "tout État" est une oeuvre de longue haleine que l'affichage d'un objectif de "1%" du budget, malgré quelques acrobaties budgétaires, ne viendra pas accélérer.
2. La fonction publique
Le rapport Picq met fortement en évidence que l'État ne connaît pas le nombre de ses fonctionnaires et qu'il n'est pas doté d'instruments de gestion prévisionnelle des effectifs. Il estime toutefois que le statut de la fonction publique n'est pas fondamentalement incompatible avec une modernisation des structures et des comportements. Le rapport Minc est plus cinglant. Il estime que "la fonction publique a le choix entre évoluer aujourd'hui avec intelligence ou subir demain un séisme statutaire".
Malgré quelques initiatives intéressantes, l'évolution des effectifs n'est pas encore maîtrisée (3.557 créations nettes d'emplois en 1996, y compris les appelés) et nous en sommes restés plus au stade de l'analyse qu'à celui des propositions. L'excellent rapporteur spécial de l'Assemblée nationale, M. Charles de Courson, note en effet dans son rapport qu'"il lui semble que toutes les administrations devraient être appelées à se livrer à un examen très approfondi des missions dévolues aux services compte tenu, notamment, des décentralisations intervenues et des changements introduits par l'Union européenne et qu'elles devraient en outre étudier toutes les possibilités de réorganisation de structures pour les adapter aux évolutions démographiques, mais aussi aux évolutions des techniques et des modes de gestion. Ainsi, il deviendrait possible de supprimer les structures faisant double emploi et de rationaliser les dispositifs d'intervention redondants.
De surcroît, une norme de réduction des emplois calquée sur les gains de productivité générés dans les entreprises privées par l'utilisation de l'informatique (de l'ordre de 0,8 % par an) pourrait être transposée aux administrations publiques ».
Sur la base du flux de départs en retraite observé en 1994 et du coût moyen d'un agent évalué sur la même année, l'économie budgétaire en année pleine qui résulterait du non remplacement d'un départ à la retraite sur trois peut être estimé à 2,8 milliards de francs (charges patronales comprises) pour l'ensemble des budgets civils et militaires (hors budgets annexes).
B. LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES IMPLIQUE UN ARBITRAGE DIFFICILE ENTRE DES OBJECTIFS POLITIQUES CONTRADICTOIRES
Plusieurs exemples peuvent être fournis.
1. La permanence de particularismes
Sans reprendre le dossier édifiant de l'utilisation des fonds publics dans les départements et territoires d'outre-mer, les libertés prises avec l'application des normes légales en Corse se traduisent par des gaspillages que l'on peut supposer non négligeables. Deux illustrations récentes peuvent être rappelées.
Notre collègue Jacques Oudin spécialiste des problèmes de la Corse, nous conduit -dans son rapport sur la prestation autonomie- à observer que le taux de bénéficiaires de l'allocation compensatrice est, par rapport à la moyenne nationale :
- 4,5 fois plus élevé en Haute Corse ;
- 6,5 fois plus élevé en Corse du Sud.
Et notre collègue Paul Girod, dans son rapport sur le projet de loi relatif au statut fiscal de la Corse a rappelé que les droits de succession sur les biens immobiliers situés sur le sol corse n'étaient pas recouvrés et que la perception des impôts était très différente de celle observée sur le "continent", même en tenant compte des recouvrements ultérieurs.
|
Écart à la moyenne nationale |
|||
|
Corse du Sud |
Haute Corse |
||
|
Impôts directs (% de paiements à l'échéance Impôts directs (% de paiements à l'échéance |
-24,1 - 11,1 |
- 18,3 8,66 |
|
2. La prise en compte de l'aménagement du territoire
• Les opérations de dissolution ou de
regroupements d'unités conduites dans le cadre du
plan
Armées 2000,
ont pour objet de limiter les dépenses
militaires de la France. Mais elles se heurtent à des oppositions bien
compréhensibles. Notre collègue Christian Bonnet vient de
déplorer l'insuffisance du plan de charge des arsenaux de Lorient et le
départ de Vannes de deux unités d'élite d'infanterie. Au
ministre qui déclarait :
"Je compte donc sur le sens de
l'État de tous les parlementaires, quelles que soient leurs
appartenances politiques, pour soutenir le plan de restructuration de
l'armée française qui vise à améliorer l'outil
militaire tout en réduisant les dépenses publiques",
notre
collègue répondait :
"Monsieur le ministre de la
Défense, vous me connaissez assez pour savoir que je suis prêt
à voter les décisions les plus impopulaires qu'exige l'ampleur
des déficits publics, mais vous savez aussi que je ne puis laisser
passer sans réagir des mesures tellement inéquitables
qu'elles apparaissent comme discriminatoires à l'encontre du
département dont je suis l'élu. "
"La contraction des crédits de la défense s'impose. Je suis cent fois, mille fois d'accord. Mais qu'elle frappe deux fois, coup sur coup, le Morbihan, voilà qui ne me convient plus".
• La rationalisation de l'offre de soins hospitaliers
pose de manière aiguë le problème de la
fermeture ou
de la reconversion de maternités rurales et d'hôpitaux
installés dans des villes moyennes (annonce de la fermeture de
22.000 lits). Les légitimes crispations locales, freinent la
réflexion indispensable. En juillet 1994, la mission
interministérielle sur les hôpitaux avait pourtant établi
une problématique pertinente ("la logique d'aménagement du
territoire").
On distinguera quatre objectifs :
- l'accessibilité sur l'ensemble du territoire à un service de qualité. Cette accessibilité évaluée en unité temps, doit être chiffrée en suivant une méthodologie nationale homogène et variable suivant le niveau de spécialisation du service ;
- le maintien sur place de la population : il s'agit du maintien sur place des personnes âgées essentiellement mais aussi des malades chroniques et des personnes en phase terminale ;
- le développement des activités et le maintien d'une population jeune : c'est bien sûr le problème de l'emploi, extérieur au domaine sanitaire, dont la prise en compte imposerait, en tout cas en milieu rural et semi urbain, des reconversions et non des fermetures. Il pourrait s'agir d'une contrainte insupportable si l'objectif précédent et l'évolution de la démographie ne donnaient une considérable opportunité de reconversion avec la gestion de la situation des personnes âgées ;
- le désenclavement des zones rurales qui suppose une réflexion en termes de transports, sanitaires ou non.
3. La politique de l'emploi
Le poids de l'État et des régimes sociaux est tel dans l'activité économique de la Nation que la recherche d'économies de dépenses fiscales ou de dépenses budgétaires a un très fort contenu en emplois.
"Dans une conjoncture particulièrement difficile -avec le véritable choc pétrolier que représente l'escalade du prix du papier- une telle aggravation des charges ne pourrait qu'entraîner des conséquences extrêmement dommageables dans le domaine de l'emploi : ce serait de plus contradictoire avec la volonté affichée de ne pas alourdir les prélèvements obligatoires.
Quant aux bénéficiaires de l'abattement eux-mêmes, ils verront leurs charges sociales et fiscales augmenter de façon importante, et ce de manière d'autant plus douloureuse que les salaires sont modestes. Il est aisé d'imaginer les tensions sociales qu'entraînerait une amputation du pouvoir d'achat des journalistes. "
• La menace de la suppression de la déduction
fiscale supplémentaire pour frais professionnels des journalistes
entraîne légitimement la réaction suivante :
• La modification du régime des B.I.C.
inquiète la fédération des industries nautiques.
"Tout en étant solidaires de l'action gouvernementale pour remédier aux abus qui ont pu exister, nous ne pouvons comprendre la mise en cause de ce dispositif fiscal qui mettra un point d'arrêt au secteur de la location maritime si important lorsqu'on souhaite développer le tourisme nautique pour répondre aux attentes de nos compatriotes, sans parler des inévitables conséquences sur les chantiers et les équipementiers qui construisent ces bateaux".
•
Le président de la F.N.T.P.
répète dans les colonnes des journaux :
"gare
à l'emploi"
en réaction à certaines dispositions
du PLF 1996 et met en cause les "coupes dans le budget de la Nation".
"Le budget 1996 des routes prépare une année au moins aussi mauvaise, même si le montant des crédits d'entretien devrait se situer au niveau de 1995. En effet, les crédits pour travaux neufs devraient diminuer de 10 % par rapport à la loi de finances rectificative pour 1995 ...au doublement des taxes prélevées par l'État sur les sociétés d'autoroutes ; sans augmentation possible des tarifs de péage, étant tenues à l'autofinancement, celles-ci pourraient être conduites à étaler leurs programmes dans le temps.
Autre facteur d'austérité : la réduction annoncée des dotations globales de l'État à des collectivités dont les charges s'accroissent et dont les recettes diminuent. "
•
Les coupes budgétaires sur les
crédits de la
Défense
pourraient
menacer
10.000 emplois
aussi bien dans le secteur privé que dans le
secteur public. Le groupe Aérospatiale a ainsi annoncé un
sureffectif de 4.000 personnes.
L'exemple le plus spectaculaire en la matière est, sans doute, celui des industries de l'armement terrestre, dont les effectifs, à hauteur de 45.100 en 1990, passeront sous la barre des 30.000 personnes en 1995. GIAT-Industries connaît des difficultés graves qui expliquent que -faute de commandes de chars Leclerc et de munitions en volume suffisant par l'armée française et à l'exportation- elle devrait perdre 1,9 milliard de francs en 1995, étudier la fermeture de deux sites sur la dizaine qu'elle entretient, et mettre en chantier un plan de redressement portant sur de nouveaux départs.
4. La reconnaissance du rôle économique des collectivités locales et sa remise en cause au travers des modalités du Pacte de stabilité
En 1994, le secteur public local a été relativement dynamique en matière d'investissement avec 179 milliards de francs pour la formation brute de capital fixe, soit 13,4 % de la FBCF nationale et 70 % de la FBCF publique.
L'effort des collectivités locales est toutefois étroitement corrélé à l'évolution des dotations que l'État leur verse et qui représentent aujourd'hui près du tiers de leurs ressources.
A ce sujet, l'article 18 du projet de loi de finances initiale pour 1996 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dispose : "Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'État au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement), forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances"
Cette masse, qui comprend l'ensemble des concours déjà indexés en vertu de dispositions de précédentes lois de finances, ne doit ainsi progresser, à structure constante, que de 2,1 % en 1996 par rapport à 1995, de 2,2 % en 1997 par rapport à 1996 et en 1998 par rapport à 1997, alors que son évolution tendancielle est estimée entre + 3,7 % et + 4 % par an.
Ces taux globaux d'évolution résulteraient de l'application combinée de trois régimes distincts :
- Les règles d'indexation fixées par les précédentes lois de finances sont respectées pour l'ensemble des dotations précédemment énumérées à l'exception de celles applicables à la première part de la DGE des communes et à la dotation de compensation de la taxe professionnelle hors réduction pour embauche et investissement.
En particulier, l'indexation de la DGF sur les prix et sur la moitié du taux d'évolution du PIB de l'année en cours est préservée.
- La première part de la dotation globale d'équipement des communes est supprimée à compter du 1er janvier 1996 au détriment des communes de plus de 20.000 habitants et des groupements de communes de plus de 35.000 habitants, dans la version de l'article 19 du projet de loi de finances initiale votée par l'Assemblée nationale.
- La dotation de compensation de la taxe professionnelle, hors remboursement au titre de la réduction pour embauche et investissement, devient, dans cette configuration, la "variable d'ajustement" permettant de limiter, au franc près, au taux prévisionnel d'évolution des prix hors tabac la progression des concours financiers de l'État inscrits dans le périmètre du pacte de stabilité.
L'enveloppe normée doit ainsi passer de 150,5 milliards de francs à 153,7 milliards de francs en 1996 au lieu de 156,3 milliards de francs si les règles d'indexation actuellement en vigueur avaient intégralement été préservées.
Réduit à sa plus simple expression le "pacte de stabilité" peut se résumer en fait à la suppression d'une dotation, la première part communale de la DGE pour les communes de plus de 20.000 habitants et les groupements de plus de 35.000 habitants, et à une nouvelle amputation de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, déjà particulièrement affectée par les dispositions de l'article 54 de la loi de finances initiale pour 1994.
Force est ainsi de constater que le "pacte de stabilité", unilatéralement imposé par le gouvernement, reflète avant tout une fois de plus sa volonté d'utiliser les concours qu'il verse aux collectivités locales comme simple variable d'ajustement de son propre budget, sans véritable souci d'assurer la pérennité et la lisibilité des flux financiers.
D'une façon plus générale, fixer l'évolution de l'enveloppe des concours de l'État par référence aux prix est une remise en cause indirecte du rôle économique joué par les collectivités locales.
La commission des finances du Sénat qui s'était très largement investie pour que la DGF soit à nouveau indexée sur une fraction de l'évolution du PIB à compter de 1996 doit reconnaître que les dispositions de l'article 18 du présent projet de loi de finances n'ont d'autre objet que de confisquer, au cours des trois prochaines années, la part de la croissance de la dotation globale de fonctionnement provenant de l'expansion économique via une diminution à due concurrence de la DCTP.
Une seule nuance peut être apportée à cet amer constat : les concours de l'État dont l'évolution n'est pas déterminée par une indexation établie par les précédentes lois de finances sont, en effet, placés hors du périmètre du pacte de stabilité.
Il en est ainsi du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), le gouvernement ne fixant aucun objectif à son évolution. En d'autres termes, après la "crise"' qui avait opposé l'exécutif et les élus lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1994, il a été décidé de ne plus modifier la législation relative aux remboursements du FCTVA et de le laisser progresser sans contrainte.
Votre commission n'en est pas moins inquiète des conséquences de la rigueur imposée aux collectivités locales à travers le "Pacte de stabilité" dont le périmètre est évidemment plus large que celui du FCTVA (de l'ordre de 150 milliards de francs contre une vingtaine de milliards de francs).
Elle note, en particulier, que selon le Crédit local de France, leurs dépenses d'équipement, tous niveaux de collectivités confondus, devraient déjà chuter de plus de 6 % en 1995.
C. LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES REND INDISPENSABLE UNE REMISE EN CAUSE DES DISPOSITIFS PUBLICS D'ÉVALUATION
1. La modernisation des administrations
Les difficultés propres à l'activité ministérielle ne permettent pas, sauf exception, au ministre en poste de conduire une réflexion sur la réorganisation de ses services, aussi ambitieuse qu'il serait souhaitable. Il est donc indispensable de lancer une politique de 1 '"autoévaluation permanente" que les rapports Picq et Minc appellent par ailleurs de leurs voeux.
Le ministre de l'agriculture, quels que soient par ailleurs ses éminents mérites, se voit épinglé par la Cour des comptes qui relève que :
"L'organisation de l'administration centrale souffre de nombreuses incohérences", que "le trop grand nombre d'acteurs a pour conséquence la lenteur des décisions et que "les services chargés de l'application des politiques soient extrêmement dispersés".
2. La reconfiguration du dispositif public d'évaluation
Le dispositif actuel est disparate. Le Conseil économique et social, la Cour des comptes, le Commissariat général au Plan, le comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, le comité interministériel de l'évaluation, les corps d'inspection, les services spécifiques à certains ministères, les instances d'évaluation ad hoc (comité national de l'évaluation des universités, commission nationale d'évaluation du RMI) possèdent, à des titres divers, une compétence d'évaluation des politiques publiques.
Ce dispositif est caractérisé par la prépondérance de l'exécutif dans la mise en oeuvre des procédures, par une certaine forme d'autocontrôle (les fonctionnaires sont alternativement contrôleurs et contrôlés), par la confidentialité et par une synergie que l'on pourrait qualifier d'incertaine.
Toutefois, la réforme en cours du Commissariat général au Plan et la mise en oeuvre, par le Premier ministre, d'une ambitieuse réforme de l'État, témoignent d'une prise de conscience qu'il convient de saluer.
Le souci de l'évaluation permanente n'est pas, par ailleurs, le réflexe spontané de toutes les administrations. Quels que soient les contrôles externes ou internes, la recherche de la "meilleure adéquation entre le coût et l'efficacité des dépenses" n'est pas la préoccupation première d'un ministre, naturellement plus enclin à privilégier d'autres actions. L'abandon de la procédure de rationalisation des choix budgétaires (RCB) ainsi que la qualité inégale et la périodicité incertaine des budgets de programme ("blancs") en témoignent.
3. L'opportunité de la création d'un office parlementaire
L'absence d'un office parlementaire chargé d'évaluer les choix budgétaires a été avancée pour expliquer la difficulté de "tailler dans les dépenses". La relative impréparation des coupes envisagées ne saurait être discutée. En imputer la cause à l'absence d'un organisme ad hoc peut être prise en considération. Le Sénat aura à en débattre prochainement.
Sans préjuger la teneur de ce débat, votre rapporteur général croit pouvoir l'enrichir en amont en rappelant les conclusions d'ensemble auxquelles est parvenue la commission des finances qui en a délibéré à plusieurs reprises.
Elle juge prioritaire le renforcement de ses moyens en personnel parlementaire, en capacité d'expertise, en moyens techniques, en instruments juridiques.
Elle estime que la ligne de partage des compétences doit être nettement tracée pour respecter l'esprit et la lettre des textes en vigueur et éviter ainsi les concurrences stériles et les conflits potentiels. La création d'un office ne doit pas avoir par ailleurs pour conséquence une banalisation des compétences des rapporteurs spéciaux qui doivent rester les "piliers" du contrôle budgétaire.
Conclusions
La maîtrise de la dépense publique suppose une politique ambitieuse, conduite dans la durée et préparée par une réflexion approfondie. Votre rapporteur général partage sans réserve les conclusions auxquelles est parvenu M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale :
•
Sur la détermination du
gouvernement :
"Toutefois la démarche traditionnelle d'économie rencontre ses limites. Conformément aux engagements du Président de la République, il importe d'entreprendre une réforme en profondeur de l'action publique. Les instances de décision ont été mises en place. Mais cinq mois à peine se sont écoulés depuis la rationalisation, le présent projet porte surtout la marque de la détermination du gouvernement à endiguer la croissance de la dépense. " (Tome I, volume 2, page 11)
• Sur la difficulté de la révision des
services votés :
"L'infléchissement de la dépense est réel. Au regard de l'impératif de réduction des déficits publics, il n'est cependant pas interdit de penser que le gouvernement aurait pu aller plus loin dans la révision des services votés. Il ne faut cependant pas sous-estimer la difficulté de l'exercice, après bien des années de pratique de la régulation budgétaire, et alors que les annulations atteindront sans doute cette année un niveau comparable à celui de 1993. Le véritable allégement budgétaire doit venir de réformes de structure issues de la réflexion en profondeur engagée par le gouvernement. " (Ibidem, page 25).
•
Sur le rôle du
Parlement :
"Dès lors, si le Parlement souhaite apporter sa contribution à la recherche d'économies, ce ne peut être que par une démarche concertée avec les rapporteurs spéciaux, s'appuyant sur une analyse approfondie des budgets. Des mesures d'annulation purement forfaitaires auraient toutes chances d'être irréalistes, donc inopérantes. La réduction significative du budget passe par un véritable réexamen en profondeur des conditions de l'action publique. "
III. LE NÉCESSAIRE REMODELAGE DE NOTRE SYSTÈME DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
A. LE CONSTAT DU PASSÉ : UNE DÉFORMATION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PRÉJUDICIABLE À L'ÉCONOMIE ET À L'ÉTAT
Les difficultés éprouvées pour réduire les déficits publics dans un contexte de reprise conduisent à s'interroger sur l'adéquation de nos prélèvements obligatoires, et de leur structure.
Ceux-ci figurent toujours parmi les plus élevés du monde industriel, et, depuis près de dix ans, oscillent autour de 44 % du PIB. La période récente se caractérise d'ailleurs par une nouvelle accentuation de leur poids et l'an prochain, le précédent record de 1984 (soit 44,6 % du PIB) devrait être dépassé de 0,1 point.
Mais cette évolution d'ensemble masque en outre une nette inflexion dans la structure de nos prélèvements obligatoires.
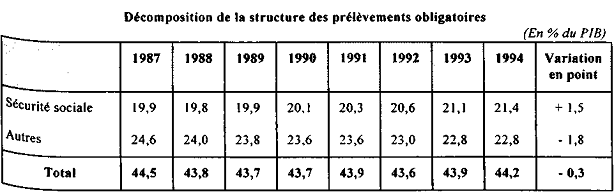
Or, ces évolutions ont accentué l'un des travers fondamentaux de notre système, et expliquent pour partie les difficultés éprouvées par l'État pour bénéficier pleinement des recettes liées à la reprise économique.
1. Le rôle déterminant des prélèvements sociaux
Sur l'ensemble de cette période, la rigidité à la baisse dont font preuve nos prélèvements obligatoires provient exclusivement de la sécurité sociale.
Or, dans le même temps, le lancinant problème du déséquilibre de nos comptes sociaux n'a pas été réglé et demeure entier pour l'avenir.
Ce constat illustre tout d'abord l'échec des multiples plans de redressement de la sécurité sociale mis en oeuvre successivement durant cette période et qui, d'une manière générale, ont eu plus d'effet sur les recettes que sur le rythme de progression des dépenses.
Mais, en outre, ces multiples plans n'ont pas amorcé de véritable réforme du mode de financement de nos régimes sociaux, mouvement pourtant indispensable en raison des mutations profondes du monde économique. En dépit de la création récente de contribution sociale généralisée, les recettes de ces régimes demeurent à plus de 92 % assises sur les revenus professionnels des actifs, et pèsent donc très directement sur l'emploi.
Certes, au plan macro-économique, cet enchaînement désastreux a pu être atténué par une moindre progression des salaires directs. Dans un monde de plus en plus ouvert à la concurrence, notre pays a ainsi pu rester compétitif en terme de coût global du travail au regard de ces principaux concurrents européens. Mais cette réponse s'est aussi payée d'un moindre dynamisme de la consommation des ménages actifs, et surtout de l'apparition de véritables barrières à l'emploi pour les postes les moins qualifiés.
De ce point de vue, notre système de prélèvements obligatoires est donc devenu pénalisant pour l'activité économique et l'emploi.
Une telle situation conduit désormais à des réponses inquiétantes pour le Budget de l'État. En effet, il est amené à prendre en charge une partie des cotisations sociales pesant sur les salaires les moins élevés, ce qui à l'évidence rend encore plus difficile l'indispensable effort de maîtrise de ses dépenses.
2. L'appauvrissement de l'État fiscal
La seconde grande tendance qui s'est manifestée au cours des dernières années apparaît comme la diminution régulière du taux des prélèvements obligatoires revenant à l'État. Entre 1987 et 1994, il est en effet revenu de 17,3 % à 14,7 %, expliquant ainsi à lui seul le recul du taux global de prélèvement des administrations autres que les régimes sociaux.
Un tel recul trouve en fait ses origines dans deux grandes tendances de fonds.
a) Des impôts au rendement amoindri
Entre 1987 et 1994, période qui recouvre une phase d'accélération de l'économie, puis une véritable crise économique, les recettes fiscales nettes ( 21 ( * ) ) de l'État seront passées de 1.043,8 milliards de francs à 1.254,4 milliards, soit une progression globale de 20,2 %. Dans le même temps, le produit intérieur brut marchand a augmenté de 37,7 %.
Une partie de ce décalage s'explique certes par des facteurs économiques, les composantes les plus dynamiques de la croissance n'étant pas nécessairement les plus riches en recettes fiscales pour l'État. La période récente illustre d'ailleurs ce phénomène -de façon exemplaire-. Depuis la fin de 1993, la reprise de l'activité est largement due aux exportations qui ne génèrent pas de TVA.
Mais, deux autres facteurs plus structurels se sont combinés pour peser sur l'évolution des recettes fiscales réellement perçues par l'État :
1- Des allégements d'impôts imposés par les circonstances, mais sans réelle contrepartie sur les autres ressources de l'État.
Depuis le milieu des années 80, notre système fiscal a sensiblement évolué dans quelques grands domaines.
•
Le taux de l'impôt sur les
sociétés a été ramené de 50
%
à 33 1/3
%, ce reflux étant indispensable pour
assurer la compétitivité de nos entreprises et attirer les
investisseurs étrangers. Malgré des élargissements de
l'assiette, le rendement de l'impôt a bien évidemment
été affecté : en 1987, son produit net
représentait 108 milliards de francs ; sept ans plus tard il est de
113 milliards.
• Dans le même temps,
les
impératifs européens nous conduisaient à supprimer le taux
majoré de TVA.
Mais les gouvernements d'alors ont cru
nécessaire d'accompagner ce mouvement d'une diminution
du taux
réduit, démarche
qui, elle, ne se justifiait pas par nos
engagements communautaires.
Or, ces ajustements dont les plus importants étaient inévitables, n'ont pas été l'occasion d'amorcer la rénovation de notre impôt sur le revenu. Plus grave, les modifications introduites dans ce domaine ont généralement eu pour effet d'accentuer les aspects les plus atypiques de cet instrument fiscal : faiblesse du nombre assujetti, concentration de l'impôt et multiplication des dispositifs dérogatoires. Aussi, l'allégement est là encore le phénomène majeur qui caractérise l'évolution récente de cet impôt : le taux moyen d'imposition s'établit désormais à 13,52 %, contre 15,3 % en 1991.
De fait, l'État s'est progressivement appauvri, et ne bénéficie plus aussi rapidement qu'avant d'une reprise de l'activité. Pour plus de 54 %, contre 51 % en 1991, ses recettes reposent sur la seule consommation, aggravant ainsi l'interdépendance entre la dynamique de cette composante économique et l'aisance budgétaire de l'État.
2- La montée en puissance des dégrèvements d'impôts locaux pris en charge par l'État
Au côté des remboursements et dégrèvements afférents aux impôts qu'il perçoit pour son propre compte, l'État a accepté d'assumer ses propres ressources, des dégrèvements portant sur des impôts revenant aux collectivités locales.
Résultant de dispositions législatives d'ordre général, cette ponction s'est considérablement accrue au cours des dernières années. En 1994, elle représente 44 milliards de francs, dont 24 milliards au titre du plafonnement de la taxe professionnelle. En l'espace de 6 ans, la charge liée à ce dernier mécanisme a été multiplié par huit.
Accentuée par les aléas conjoncturels, cette progression spectaculaire trouve toutefois structurellement son origine dans un véritable "effet de ciseau" :
- d'une part, la réduction progressive du taux de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, démarche qui, là encore, était justifiée par la nécessité d'accroître la compétitivité des entreprises françaises dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
- d'autre part, l'augmentation régulière des taux votés par les collectivités locales, ces dernières étant elles-mêmes confrontées à une progression importante de leurs dépenses.
De fait l'État s'est substitué au contribuable local et supporte des dégrèvements représentant 23 % du total des émissions de taxe professionnelle de l'année.
b) L'évolution "autonome " des prélèvements sur recettes
Déjà bridé par l'évolution de sa principale source de recettes, l'État est, en outre, tenu de prélever, sur l'ensemble de ces ressources, les sommes qu'il s'est engagé à verser, tant à l'Union européenne qu'aux collectivités locales, au titre des compétences transférées.
Or, ces deux prélèvements évoluent suivant des logiques autonomes, qui s'avèrent largement indépendantes des autres contraintes pesant sur l'État. Soutenable en période de croissance économique, cette procédure a cependant relevé toute sa rigidité au cours du passé récent.
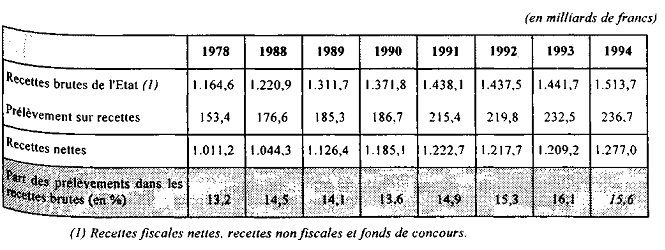
Le tableau précédent met en évidence l'effet "d'accélérateur" suscité par cette contrainte lorsque la croissance économique a commencé à s'essouffler. Entre 1991 et 1993, les recettes brutes de l'État n'ont pratiquement pas évolué. Dans le même temps, les prélèvements sur recettes progressaient de 7,9 %, suscitant ainsi une baisse non négligeable des ressources nettes du Budget général.
La ventilation de ces prélèvements fait ressortir le poids respectif des différents facteurs.
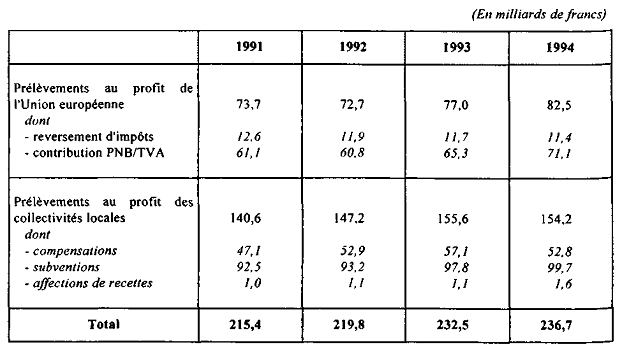
Évolution des prélèvements sur recettes
Encore faut-il souligner que l'État a régulièrement tenté de ralentir cette progression, en modulant les critères de calcul des principales dotations versées aux collectivités locales, et notamment les règles d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
B. L'AMORCE D'UN CHANGEMENT DE CAP
De fait, la situation est devenue difficilement tenable. Alors que le poids des cotisations sociales bride l'emploi et que le budget de l'État ne bénéficie plus pleinement de la reprise, la réduction rapide des déficits publics devient extrêmement difficile, malgré des efforts récents en matière de maîtrise des dépenses.
Aussi l'État s'est-il récemment engagé dans la voie d'une reconstitution de ces marges en matière de recettes budgétaires, et il est probable qu'une démarche identique sera bientôt retenue pour nos régimes sociaux.
Si elle reste donc un objectif à atteindre, la baisse de nos prélèvements obligatoires n'a cependant pas d'actualité immédiate, et ne pourra être enclenchée qu'une fois résolu le problème des déficits publics.
1. Trois orientations pour desserrer progressivement les contraintes pesant sur les recettes du Budget
Cette inflexion trouve sa traduction directe dans l'évolution récente du taux des prélèvements obligatoires opérée par l'État. Après avoir atteint un point bas en 1993 (14,6 %), celui-ci amorce désormais une lente remontée et devrait ainsi s'établir à 14,9 % l'an prochain, se rapprochant ainsi du niveau de 1992 (15,2 %).
Amorcée dès 1994, cette démarche s'articule autour de trois grands axes qui, tous, ont trouvé une nouvelle dimension dans un passé récent et marquent le volet recettes du projet de loi de finances pour 1996.
a) Vers un encadrement des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales
•
Dès la loi de finances pour 1994,
deux mesures importantes ont été mises en
oeuvre :
- d'une part une modification du mode d'indexation de la dotation globale de fonctionnement, dans un sens évidemment moins favorable que le dispositif antérieur :
- d'autre part, une modulation des versements effectués au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, afin de tenir compte de l'évolution des bases depuis 1987.
ï En principe ponctuel, ce dernier mécanisme a toutefois été pérennisé par la loi de finances pour 1995.
ï Le projet de loi de finances pour 1996 propose désormais une approche encore plus contraignante. Son article 18 organise en effet un véritable "pacte de stabilité" avec les collectivités locales. Il suggère que l'ensemble des dotations indexées qui leur sont versées par l'État -soit 105,5 milliards de francs en 1995- progresse durant une période de trois ans au seul rythme de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Dès 1996, l'application de ce pacte évite à l'État une charge supplémentaire de 2,4 milliards de francs.
b) Une stabilisation des dégrèvements de taxe professionnelle
Deuxième axe de la politique récemment mise en oeuvre, cette préoccupation s'est concrétisée par l'adoption de l'article 17 de la loi de finances pour 1995 qui a permis :
- de relever de 3,5 % à 4 % -pour la seule année 1995- le taux de plafonnement de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée,
- de réduire de 1 milliard de francs à 500 millions de francs le montant maximum du dégrèvement susceptible d'être obtenu par une entreprise au titre de ce mécanisme.
Mais, le présent projet de loi de finances poursuit dans cette voie. Tout en proposant de pérenniser le taux du plafonnement à 4 %, il envisage désormais deux adaptations complémentaires :
- d'une part, un gel des taux de taxe professionnelle retenus pour calculer la cotisation susceptible de bénéficier d'un dégrèvement ;
- d'autre part, la création d'une cotisation minimum de taxe professionnelle, calculée par référence à la valeur ajoutée et orientée vers le Budget général.
De fait, l'économie attendue à ce titre pour l'année à venir atteint 3,6 milliards de francs. Mais surtout, l'État est désormais en mesure de stabiliser durablement sa participation financière à ce mécanisme, renvoyant ainsi face à face les entreprises et les collectivités locales.
c) Le recours à de nouvelles ressources
Initialement limitée à un relèvement du barème de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (1994), puis à une majoration du taux d'imposition des plus-values à long terme des sociétés (1995), cette démarche s'est considérablement renforcée avec l'adoption de la loi de finances rectificative pour 1995.
Devant la nécessité de conforter la politique en faveur de l'emploi sans aggraver le déficit budgétaire, il a, en effet, été fait appel à trois ressources "provisoires" :
- d'une part, un relèvement de deux points du taux normal de la TVA à compter du 1er août 1995,
- d'autre part, l'institution d'une contribution exceptionnelle de 10% assise sur l'impôt sur les sociétés ;
- enfin, la création d'une contribution additionnelle de 10 % sur la cotisation due au titre de l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes.
Ces mesures, dont le terme n'est pas fixé, représentent à elles seules un apport budgétaire de 70,4 milliards de francs en année pleine.
L'importance de l'effort ainsi demandé récemment aux contribuables interdisait à l'évidence toute sollicitation supplémentaire trop forte à l'occasion de la loi de finances pour 1996. Toutefois, s'il se contente dans l'immédiat de la traditionnelle adaptation du barème de la TIPP, le gouvernement prévoit d'ores et déjà d'adapter ponctuellement les règles d'assiette de l'impôt sur le revenu pour supprimer certains avantages fiscaux jusqu'alors accordés à des produits d'épargne sans risques. Sous cet aspect, il semble ainsi poser les premiers jalons d'une réforme plus vaste.
2. Une traduction directe dans les recettes du budget pour 1996
L'impact de ce changement de cap se retrouve bien évidemment dans l'évolution des recettes budgétaires attendues pour 1996. Évaluées à 1.262,1 milliards de francs 22 ( * ) , celles-ci devraient donc enregistrer l'an prochain une progression de 7,2 % par rapport aux évaluations révisées de 1995, soit un rythme nettement supérieur à celui du PIB en valeur.
a) Recettes fiscales : une progression liée aux majorations d'impôts décidées en juillet dernier
Avant remboursements et dégrèvements, les recettes fiscales brutes escomptées pour 1996 ressortent à 1.642.8 milliards de francs, et connaissent ainsi une progression de 7,4 % par rapport aux évaluations révisées de l'année en cours. Les recettes fiscales nettes 23 ( * ) s'établissent, quant à elles, à 1.401,7 milliards de francs, ce qui correspond à une croissance de 7,5 % ou 98,4 milliards de francs en un an.
Mais, cette évolution résulte largement des mesures de redressement votées dans le collectif du 4 août dernier. En effet, si l'on diminue leur impact, la progression tendancielle des recettes fiscales nettes revient alors à 3,9 %, confirmant ainsi l'existence d'un décrochage structurel avec l'évolution du PIB en valeur (+ 4,9 %). De fait, la nécessité des mesures fiscales, certes peu agréable, voté en août dernier, trouve à nouveau toute sa justification.
Dans ce contexte, le gouvernement a en outre su résister à l'optimisme, et les évaluations avancées pour 1996 restent empreintes d'une certaine prudence.
Alors que des incertitudes commencent à apparaître sur l'hypothèse de croissance retenue pour 1996, il faut se féliciter de cette prudence initiale qui réduit assez sensiblement les risques de déconvenues massives en cours d'exécution.
Le tableau suivant retrace l'évolution du produit attendu des principaux impôts, et met en lumière les principaux facteurs de variation.
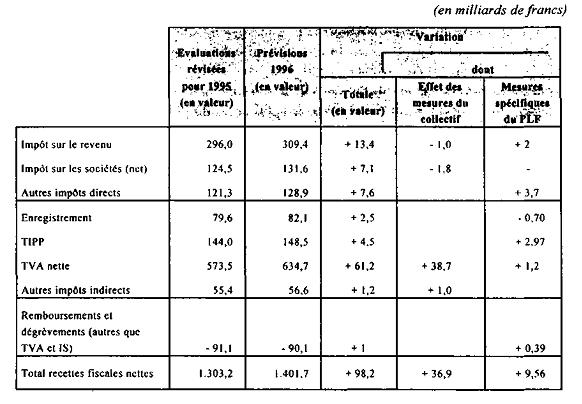
Une progression modeste de l'impôt sur le revenu
En 1996, son produit devrait croître de 4,5 % pour atteindre 309,4 milliards de francs, soit un niveau à peu près identique à celui constaté en 1993.
Modérée, cette évolution découle essentiellement de l'augmentation de 4,2 % prévue pour le revenu imposable des ménages, cette dernière hypothèse étant elle-même prudente si on la compare au taux de progression du PIB de 1995 (+ 4,9 %).
Au-delà de la traditionnelle actualisation du barème, le rendement spontané devrait être affecté de façon marginale par deux séries de dispositions : d'une part la suppression de la réduction d'impôt pour les versements effectués au titre des contrats d'assurance-vie (économie de 2 milliards) et, d'autre part, l'impact des mesures prises dans le collectif de l'été, et dont la plus importante est l'augmentation de 10 % à 13 % du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers.
Impôt sur les sociétés : une progression raisonnable.
Dans un contexte marqué par le maintien de la contribution supplémentaire exceptionnelle de 10 %, le rendement net de l'impôt sur les sociétés est estimé à 131,6 milliards de francs, soit un montant supérieur de 5,7 % à celui de l'année en cours.
Toutefois, cette base de référence pourrait se révéler anormalement faible, deux facteurs ayant manifestement pesé sur le rendement de l'impôt :
- d'une part, un provisionnement massif, lié à la crise de l'immobilier ;
- d'autre part, l'utilisation des reports déficitaires hérités des années de crise économique.
La prévision pour 1996 évite tout excès d'optimisme et s'appuie essentiellement sur une progression de 4,5 % de l'excédent brut d'exploitation des sociétés. A l'inverse, elle intègre strictement les conséquences sur le résultat imposable de l'augmentation du taux de la C3S décidée dans le cadre du collectif.
TVA : une progression imputable aux mesures du collectif.
Pour 1996, la plus-value attendue de la TVA s'établit à 61,2 milliards de francs (+ 10,7 %), dont 38,7 milliards liés à l'extension en année pleine du relèvement de deux points du taux normal, décidé à compter du 1er août 1995.
En revanche, l'évolution spontanée due au développement de l'activité économique demeure beaucoup plus timide. Elle repose sur une hypothèse de progression des emplois taxable de 3,8 %, et donc légèrement inférieure à celle envisagée pour la consommation des ménages (+ 4.6 %).
Autres impôts : des évolutions largement dictées par des aménagements de droits.
S'agissant des autres impôts directs, on relèvera la stabilisation du produit du prélèvement libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers.
La décroissance tendancielle du rendement de cet impôt se trouve en effet enrayée par les conséquences indirectes des dispositions de l'article 4 du projet de loi, qui exclut les revenus d'obligations et de créances du champ de l'abattement annuel sur les revenus mobiliers. De fait, les titulaires de ces revenus devraient désormais opter plus massivement pour le prélèvement libératoire, suscitant ainsi un apport immédiat de deux milliards dans les recettes du budget général.
En ce qui concerne les autres impôts indirects, la plus-value la plus significative ressort sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers, mais résulte là encore uniquement d'un relèvement du barème.
Alors que l'application stricte des règles d'indexation du barème dégage spontanément un produit supplémentaire de 3,3 milliards de francs, les mesures prévues à l'article 14 permettent de compléter cet apport à hauteur de 2,9 milliards de francs. Mais les prévisions tenant à la structure du marché des hydrocarbures intègrent bien une nouvelle déformation au bénéfice du gazole.
- Une stabilisation des dégrèvements et remboursements afférents aux impôts autres que la TVA et l'IS.
Représentant 90,1 milliards de francs, ces dégrèvements et remboursements d'impôt restent pratiquement stables entre 1995 et 1996.
Cette absence d'évolution résulte essentiellement des conséquences du relèvement du taux de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, décidé dans le cadre de la loi de finances initiale pour 1995. Cette mesure évite ainsi à l'État une charge de dégrèvement représentant 3,8 milliards de francs 24 ( * ) . Plus ponctuellement, la modification des règles de plafonnement de la taxe d'habitation par rapport à l'impôt sur le revenu, prévue par l'article 12 du projet de loi, autorise une économie supplémentaire de 330 millions de francs.
De fait, ces adaptations donnent aujourd'hui à l'État les moyens de faire face aux premières demandes de remboursement portant sur les créances de crédit d'impôt recherche nées à partir de 1993.
b) Une progression légèrement ralentie des prélèvements sur recettes
Dans le projet de loi de finances pour 1996, ces prélèvements sont évalués à 252,6 milliards de francs, en progression de 5 % par rapport à l'évaluation révisée de 1995.
•
Représentant 89 milliards de
francs, les prélèvements sur recettes au profit des
communautés européennes enregistrent une hausse de 7,2 %,
comparable à celle du budget de l'Union.
Ce mouvement traduit essentiellement une forte revalorisation (+ 14%) de la contribution assise sur le PNB, qui atteindra ainsi 31,7 milliards de francs. Cette inflexion résulte des décisions prises dans le domaine des ressources propres, en 1994, lors du Sommet d'Édimbourg, mais également d'une révision des "clés" de contribution opérée à la suite de l'élargissement de l'Union vers la Suède, l'Autriche et la Finlande.
Parallèlement, la contribution assise sur la TVA recule de 1,4% pour revenir à 45,8 milliards de francs.
•
Les prélèvements au
bénéfice des collectivités locales augmentent de 3,9 %,
soit 6,1 milliards de francs, pour s'établir à 163,7 milliards de
francs.
L'effet dû à 1 'augmentation naturelle de la DGF (+ 3,7 %) se trouve en effet amplifié par la montée en puissance des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité locale, poste qui enregistre désormais les sommes versées par l'État au titre de la compensation des droits de mutation à titre onéreux (2,3 milliards de francs en 1996).
Encore faut-il souligner que cette évolution d'ensemble se trouve bridée par les dispositions prévues au titre du "pacte de stabilité".
L'ajustement effectué à ce titre s'opère sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) dont le montant se trouve écrêté de 2,4 milliards de francs en application des dispositions de l'article 18 du projet de loi. A défaut, la progression globale des prélèvements effectués au bénéfice des collectivités locales aurait alors atteint 5,3 %.
c) Recettes non fiscales : un retour à la normale
Après avoir atteint le niveau exceptionnel de 200 milliards de francs en 1994, les recettes non fiscales reviennent désormais à un niveau plus conforme à leur évolution tendancielle. Pour 1996, elles s'élèveront à 129,9 milliards de francs (y compris recettes d'ordre), soit un chiffre inférieur de 6,1 % aux données figurant dans la loi de finances rectificative pour 1995.
1- Les conséquences du collectif
L'inflexion sensible constatée entre 1994 et l'exécution 1995 traduit les conséquences de la décision de principe prise lors du collectif, c'est-à-dire l'arrêt de l'affectation, au budget général, d'une partie du produit des privatisations. Désormais, l'intégralité de ces sommes se retrouve en recettes des comptes d'affectation spéciale, et concourt à deux objectifs exclusifs : des apports en fonds propres aux entreprises du secteur public et le désendettement de l'État.
L'an prochain, le produit attendu des privatisations est estimé à 22 milliards de francs, contre 55 milliards de francs envisagés lors de la loi de finances initiale pour 1995 et 40 milliards retenus dans le cadre du collectif d'août dernier. Prenant acte de la morosité du contexte boursier, le gouvernement se propose donc de ralentir le rythme de ces cessions d'actifs.
Le produit attendu pour 1996 se répartira donc entre deux comptes, selon la "clé" fixée par l'article 23 du présent projet de loi.
ï 16,5 milliards de francs seront orientés par priorité sur le compte n° 902-24 afin de pourvoir aux besoins en fonds propres des entreprises publiques. Cette décision consacre donc un nouvel effort de l'État actionnaire (+ 13,7 % par rapport au collectif et un doublement par rapport au budget initial de 1995) pour respecter les engagements pris à l'occasion du plan de restructuration d'Air France, et consolider la situation financière des sociétés publiques les plus fragiles, notamment dans les secteurs de l'armement ou de l'aéronautique.
ï Le solde, soit 5,5 milliards de francs, sera affecté au désendettement de l'État, par l'intermédiaire du compte n° 902-27. Une telle somme s'avère donc nettement inférieure aux 25,5 milliards de francs prévus pour 1995.
2- Autres recettes : un tassement lié aux recettes d'ordre.
Pour 1996, le recul de 6,1 % constaté par rapport à la loi de finances rectificative pour 1995 est largement dû aux recettes d'ordre -qui ne représentent plus que 16,8 milliards de francs au lieu de 24,4 milliards de francs-.
En revanche, les autres recettes s'établissent à 113,1 milliards de francs, et marquent donc un repli limité (- 0,8 %) par rapport aux évaluations révisées.
Cette apparente stabilité recouvre toutefois des ajustements significatifs entre les différents types de recettes non fiscales.
•
Représentant 17,7 milliards de
francs, les versements du secteur public se redressent
légèrement.
Ce mouvement provient des entreprises non financières et concrétise l'augmentation attendue du dividende versé par France Telecom, mais aussi le retour d'un résultat bénéficiaire pour la Caisse des dépôts et consignations.
• La croissance des taxes, redevances, et
recettes assimilées demeure robuste (+ 10,5 %), leur produit
étant évalué à 21,9 milliards de francs l'an
prochain.
Au-delà de la pérennisation du prélèvement spécifique de 0,4 % pour frais d'assiette et de recouvrement (article 13), cette accélération traduit une reprise dans le recouvrement des amendes, après une année 1995 marquée par les effets de l'amnistie. A cet égard, le mouvement de fond se trouve d'ailleurs accentué par la forfaitisation, à compter du 1er septembre 1995, des contraventions routières de quatrième classe.
ï Les retenues et cotisations sociales au profit de l'État sont majorées de 6,1 %, l'effet dû à l'augmentation globale des rémunérations étant accentué par la suppression de la remise forfaitaire de 42 francs sur les cotisations d'assurance maladie.
ï En revanche, les recettes diverses accusent une baisse de 9,4 % pour revenir à 38,5 milliards de francs, mouvement qui retrace d'ailleurs deux ajustements contrastés :
- d'une part, une importante progression des versements du fonds de solidarité vieillesse, en application de l'échéancier associé à l'article 105 de la loi de finances pour 1994 ;
- d'autre part, une réduction très significative des divers prélèvements opérés sur les fonds gérés par la Caisse des dépôts et consignations (18 milliards de francs en 1996, soit - 22,7 %), et qui se manifeste par une diminution de moitié des sommes prélevées au titre de la rémunération de la garantie accordée par l'État aux Caisses d'épargne.
Un tel reflux traduit ainsi un certain épuisement des sources de recettes ponctuelles largement sollicitées au cours du passé.
3. Une question longtemps en suspens : quel complément de ressource pour la sécurité sociale en 1996 ?
Si les mesures correctrices ont bien été prises pour le budget de l'État, et commencent à faire sentir leurs effets, en revanche, la question du financement de la sécurité sociale pour l'année à venir est restée longtemps ouverte.
Dès le rapport économique et financier associé au présent projet de loi de finances, le gouvernement a toutefois clairement annoncé l'imminence de mesures en ce domaine :
"Afin de respecter l'objectif de 4 % du PIB pour le déficit total des administrations, la prévision intègre en 1996 des mesures de redressement des comptes sociaux permettant de réduire d'environ 0,4 point de PIB leur besoin de financement. Ces mesures n'ayant pas encore été arrêtées, elles ont été, à titre strictement conventionnel, comptabilisées en moindres dépenses. Il convient toutefois de rappeler que l'impact macro-économique de telles mesures de rééquilibrage ne dépend, à court terme et en première approximation, que de leur montant, et non de leur répartition entre économies de dépenses et suppléments de recettes" 25 ( * )
Certes, d'ores et déjà, de nouvelles et sévères mesures de maîtrise de dépenses avaient été annoncées dernièrement, notamment en matière d'assurance maladie.
Toutefois, ces efforts indispensables étaient à eux seuls insuffisants pour atteindre rapidement l'objectif fixé, et surtout pour apporter une solution au lancinant problème de la dette accumulée par notre principal régime de protection sociale.
De fait, des mesures en matière de recettes étaient devenues inévitables à brève échéance. Elles ont enfin été annoncées lors du débat sur la sécurité sociale qui s'est déroulé devant le Parlement du 13 au 16 novembre dernier, et qui a défini les grands axes d'une réforme structurelle de la sécurité sociale.
Au-delà des efforts importants demandés en matière de dépenses, l'avenir sera ainsi marqué par la création d'une contribution au remboursement de la dette sociale (RDS), l'élargissement de l'assiette de la CSG dès 1997 et une majoration progressive des cotisations maladie de certains retraités et chômeurs.
Certes, votre commission comprend l'impérieuse nécessité d'assainir rapidement nos finances sociales. Mais, elle regrette toutefois qu'il soit envisagé de mettre en oeuvre des mesures aussi lourdes, avant même que le Parlement ait eu l'occasion de se prononcer sur le projet de loi d'orientation des prélèvements obligatoires que le gouvernement s'est engagé à présenter.
C. L'URGENCE D'UNE LOI D'ORIENTATION SUR LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
En matière sociale, comme en matière budgétaire, la situation est évidemment dominée par l'urgence. Aussi, le gouvernement propose-t-il, de façon un peu éparse, des mesures de financement qui conduisent à modifier sensiblement l'importance relative de certains prélèvements et à solliciter de façon plus directe certains revenus jusqu'alors relativement épargnés.
Sur le fond, ces orientations sont sans doute inéluctables.
L'ensemble de notre système de prélèvement obligatoire doit en effet être repensé afin de neutraliser ses effets les plus pénalisants pour l'activité et l'emploi, tout en assurant à l'État et aux régimes sociaux des ressources assises sur une base plus large et plus réactive aux différentes composantes de la croissance.
Mais il est évident que l'enjeu est énorme et mérite pour le moins que le Parlement soit associé à la définition du schéma à atteindre. Tel est d'ailleurs en principe l'objet de la loi d'orientation des prélèvements obligatoires que votre commission avait réclamée dès l'examen du projet de loi de finances pour 1995, et que 1'actuel gouvernement s'est engagé à proposer au début de l'année prochaine.
Toutefois, il est profondément regrettable que le Parlement soit amené à se prononcer sur les premières mesures, sans avoir encore eu à débattre du cadre général et des orientations à retenir.
Dès 1993, votre commission des finances avait d'ailleurs souhaité apporter sa contribution à ce débat fondamental pour l'avenir. Affinée lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1995, cette analyse reste plus que jamais d'actualité. Aussi, se propose-t-elle d'en rappeler à nouveau les grandes lignes.
• Pour votre commission, la clé de la
réforme reste la rénovation de notre système de
prélèvements sociaux. Dans cette optique, elle préconise
de
déplacer vers les revenus et la consommation une partie des
charges sociales grevant les salaires.
L'objectif poursuivi est double : abaisser la barrière à l'emploi, mais aussi accroître la part du salaire direct dans le coût global du travail.
Pour y parvenir, il convient, d'une part, d'accélérer le mouvement d'allégement des charges patronales pesant sur les bas-salaires et, d'autre part, de transférer sur la CSG le financement des dépenses sociales de solidarité aujourd'hui couvertes grâce à des cotisations sociales salariées.
Un appel plus important à la CSG est au coeur de ce dispositif et doit logiquement s'accompagner d'un élargissement de l'assiette de cet instrument fiscal. Il devient dès lors nécessaire de revoir son articulation avec les autres impositions pesant sur le revenu.
• Le deuxième axe essentiel reste la
réforme de l'impôt sur le revenu.
Déjà impérative en soi, la nécessité de cette réforme ne peut qu'être renforcée dans un contexte marqué par une montée en puissance de la CSG.
Il s'agirait de faire de la CSG la "première tranche" du dispositif de prélèvement sur les revenus et d'y superposer un barème progressif comportant des tranches larges et plus nombreuses avec des taux modérés, le taux marginal supérieur ne devant pas excéder 40 %. Il conviendrait en outre d'homogénéiser les règles d'assiette des revenus professionnels non salariaux et de supprimer les très nombreux abattements ou dispositifs spécifiques à l'exception toutefois du quotient familial, de l'abattement de 10 % pour frais professionnels et de la réduction d'impôt pour emploi à domicile.
Cette réforme devrait s'accompagner d'une réorganisation de la fiscalité de l'épargne en se fondant sur un principe simple : proportionner l'avantage accordé aux contraintes d'immobilisation acceptées par l'épargnant.
• Enfin, au-delà de cette priorité de
la réforme des prélèvements sur le revenu, la loi
d'orientation fiscale devra également programmer une
réforme des droits de mutation
et poser les jalons
d'une
réforme de la fiscalité locale,
notamment
de la taxe professionnelle où, là encore, le souci de ne pas
pénaliser l'emploi doit constituer le principal objectif.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 8 novembre 1995 sous la présidence de M. Christian Poncelet, président, la commission a procédé à l'examen des principaux éléments de l'équilibre du projet de loi de finances pour 1996, sur le rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général.
Après avoir rappelé que la commission avait auditionné à deux reprises le ministre de l'économie et des finances, M. Alain Lambert, rapporteur général, a souhaité que cette réunion soit l'occasion de répondre aux interrogations que suscite l'actualité économique. Il a ainsi souligné la nécessité pour la commission d'adopter une attitude constructive, et de réaliser un véritable effort de pédagogie en direction des Français.
Évoquant l'évolution de la conjoncture, M. Alain Lambert, rapporteur général, a mis en évidence un certain décalage entre les données économiques, qui sont favorables dans de nombreux cas, et la relative morosité de nos concitoyens, qui semblent anticiper un ralentissement de l'activité. Il a alors insisté sur le caractère déterminant du cadrage économique initial pour le déroulement de l'exécution de la loi de finances de l'année.
Dans ce contexte, M. Alain Lambert, rapporteur général, s'est déclaré convaincu que le projet de budget pour 1996 reposait sur une analyse sincère et objective de la situation, et a émis le voeu que la commission soit en mesure de faire partager cette conviction. Il a d'ailleurs estimé que la fin des interrogations sur le financement des régimes sociaux devrait contribuer à dissiper une source légitime d'inquiétude pour les Français.
Le rapporteur général, a ensuite rappelé la rapidité des mouvements économiques, qui contraste avec l'inertie des procédures budgétaires.
Puis M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé que le projet de budget pour 1996 se caractérise par un réel effort de maîtrise des dépenses, avec une progression des charges inférieure à celle de l'inflation. A cet égard, il a fait valoir que l'évolution des dépenses devait s'apprécier par rapport au collectif de 1995, et regretté que le Gouvernement retienne ponctuellement une autre référence pour les besoins de la démonstration statistique.
Le rapporteur général a alors noté que l'effort d'économie budgétaire proposé pour 1996 provenait essentiellement de quatre ajustements principaux :
- la non revalorisation des rémunérations de la fonction publique, qui s accompagne toutefois de la création nette de 3.557 emplois dont l'effet d'"affichage" est fâcheux ;
- une rigueur accrue pour le budget d'équipement militaire, dont le montant s'avère inférieur de 16 milliards de francs aux prévisions figurant dans la loi de programmation ;
- l'élaboration d'un pacte de stabilité avec les collectivités locales qui, dans son principe répond à un voeu des élus locaux, mais dont certaines modalités sont critiquables ;
- enfin, une économie de 19 milliards de francs, liée au non versement de la contribution de l'État à l'UNEDIC et à un décalage temporel dans le processus de budgétisation des allocations familiales.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a ainsi constaté que ce projet courageux marquait une rupture et permettait de s'engager résolument dans une ère du "refus" de l'endettement public.
Rappelant brièvement l'expérience du passé, le rapporteur général, a mis en évidence les mauvaises habitudes engendrées par l'aisance budgétaire, dont les conséquences s'avéraient lourdes lorsque la conjoncture ralentissait. Il a notamment évoqué la période 1989-1992, marquée par une progression des dépenses plus rapide que celle du PIB, puis souligné les efforts réalisés depuis 1994 pour corriger cette dérive. Il a toutefois fait valoir l'extrême difficulté d'un tel exercice en relevant que l'État assumait aujourd'hui des charges assez éloignées du coeur de ses interventions traditionnelles, et qui, de surcroît, ont connu au cours du passé récent une croissance soutenue et autonome. Il s'est alors inquiété de cette situation, qui enserre le budget dans un réseau de contraintes particulièrement fort.
Abordant les mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances, M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé qu'elles font apparaître l'amorce d'une inflexion dans trois grands domaines :
- la fiscalité de l'épargne, secteur dans lequel les dispositions proposées ont certes un objectif immédiat de rendement, mais qui organisent également une certaine redistribution des avantages fiscaux au bénéfice de l'épargne à risque ;
- la transmission des entreprises, le Gouvernement préférant toutefois une mesure ciblée à la remise en cause du barème des droits de mutation issu de la réforme de 1984 ;
- la taxe professionnelle, qui fait l'objet de trois mesures importantes, ayant notamment pour effet de stabiliser le coût supporté par l'État au titre des dégrèvements afférents à cet impôt.
Rappelant que des mesures devront également être prises pour assurer le financement des régimes sociaux, M. Alain Lambert, rapporteur général, a alors regretté que de telles dispositions interviennent avant que le Parlement ait eu à débattre du projet de loi d'orientation sur les prélèvements obligatoires.
Au plan strictement budgétaire, M. Alain Lambert, rapporteur général, a toutefois noté que l'ensemble du dispositif fiscal de la loi de finances suscitait peu de ressources nouvelles, les mesures les plus importantes ayant été prises dans le cadre du collectif du mois d'août. Il a d'ailleurs précisé que ces mesures correctrices expliquaient plus des trois quarts de l'évolution des ressources fiscales attendues entre 1995 et 1996, tandis que l'effet lié à la croissance économique était extrêmement faible. 11 s'est vivement inquiété de cette dernière tendance, qui se manifestait depuis plusieurs années, et qui témoignait d'un décalage persistant entre le dynamisme de l'économie et l'aisance fiscale de l'État.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a alors constaté qu'un tel contexte appelait à l'évidence une nouvelle réflexion sur la politique de maîtrise des dépenses, et souhaité que la commission participe pleinement à ce débat. A cet effet, il a fait état des enseignements des expériences étrangères, puis analysé la marge de flexibilité qu'offraient les différents types de dépenses du budget de l'État.
En conclusion, M. Alain Lambert, rapporteur général, a souhaité que la commission puisse élaborer une doctrine d'action et s'est efforcé d'en dessiner les premiers contours, en indiquant quatre pistes de réflexion :
- la relative faiblesse des dépenses dites "de train de vie de l'État", qui ne représentent en fait que 2,8 % des dépenses nettes du budget ;
- l'intérêt d'un débat d'orientation budgétaire donnant au Parlement l'occasion d'indiquer ses souhaits à l'exécutif ;
- la nécessité d'ouvrir de nouvelles perspectives, en réfléchissant notamment aux possibilités de substitution aux interventions de l'État ;
- enfin, l'utilité pour le Parlement de disposer d'une capacité d'expertise, lui permettant d'élaborer une nouvelle méthodologie en matière de politique active de recherche d'économies.
A l'issue de cette présentation, M. Maurice Blin s'est interrogé sur la compatibilité des lois de programme pluriannuelles avec le principe d'un budget annuel dont l'architecture est d'ailleurs régulièrement modifiée en cours d'exercice. Après s'être inquiété de l'évolution récente des recettes fiscales de l'État, il a estimé qu'en matière de déficit public, le déséquilibre de nos comptes sociaux reste le véritable problème et suppose des réformes exigeantes que la France mettrait en oeuvre avec un certain retard par rapport à ses principaux voisins européens.
Il a enfin souligné les conséquences économiques et sociales d'une révision de la loi programmation militaire sur une industrie d'armement qui connaît déjà des difficultés structurelles graves.
Ayant rappelé que le "train de vie" de l'administration était finalement modeste, M. Jacques Oudin a fait valoir qu'une part importante des dépenses de l'État étaient "ordonnées" par des centres de décision extérieurs à l'État, comme les collectivités locales ou l'Europe, ce qui ne facilite pas la mise en place d'une politique cohérente.
S'agissant de la taxe professionnelle, il a estimé que la stabilisation de la participation financière de l'État n'était pas anormale car les mécanismes de compensation automatique n'apparaissaient pas compatibles avec une logique de rigueur budgétaire. Il a cependant souligné la nécessité de préserver les dépenses publiques les plus riches en emploi tels les investissements autoroutiers. Enfin, il a précisé que l'évolution décevante des recettes fiscales trouvait sans doute une partie de son origine dans une adaptation du comportement des agents économiques, induite par le poids excessif des impôts.
Après avoir rappelé que l'opinion publique ne partageait pas les critiques récemment adressées aux fonctionnaires, Mme Maryse Bergé-Lavigne a souhaité connaître l'importance des charges de rémunération et de pension dans l'ensemble du budget de l'État.
M. Alain Richard a tout d'abord estimé que la réduction du déficit annoncée pour 1996 présentait un caractère largement comptable, car elle reposait sur deux éléments discutables : une hypothèse de croissance fragile et une économie de 19 milliards de francs partiellement due au non respect des engagements de l'État à l'égard de l'UNEDIC.
Constatant que la situation était préoccupante, il s'est inquiété d'un certain décalage entre les ambitions affichées par le Gouvernement et la méthode retenue. Il a alors estimé que cette situation traduisait une certaine ambiguïté sur le rôle réel de l'État. Rappelant qu'une diminution des dépenses supposait de renoncer à des interventions ou prestations publiques, il s'est étonné que personne n'annonce les postes concernés.
Il a défendu les choix budgétaires effectués entre 1988 et 1992, et a souhaité connaître ceux qui pouvaient être remis en cause aujourd'hui.
Il s'est déclaré favorable à la création d'un office parlementaire d'évaluation, qui selon lui, doit éviter au Parlement d'être un simple "commentateur" de l'action du Gouvernement.
Enfin, il a reconnu que le décrochage entre l'évolution des recettes fiscales et celle de la croissance constituait un phénomène particulièrement inquiétant, tout en constatant que les explications généralement avancées n'étaient guère satisfaisantes.
Après avoir émis des doutes sur la vigueur de la croissance en 1996, Mme Marie-Claude Beaudeau s'est élevée contre une politique de réduction du déficit qui nourrit de nouvelles perspectives de chômage et d'austérité. Elle a vivement regretté l'effort d'économie supplémentaire souhaité par l'Assemblée nationale, en constatant que les moyens budgétaires étaient insuffisants dans de nombreux domaines. Elle a refusé la perspective d'une aggravation de la fiscalité sur les salaires en 1996, et préconisé une taxation accrue des revenus financiers.
M. Roland du Luart s'est félicité de l'effort de maîtrise des dépenses réalisé dans le cadre du projet de budget, tout en regrettant les créations d'emplois publics envisagées pour 1996. Il s'est toutefois interrogé sur la possibilité de respecter les objectifs fixés en termes de réduction des déficits publics d'ici à 1997, et a souhaité obtenir des précisions sur la politique monétaire conduite par la France.
M. René Régnault a demandé des informations sur le coût réel du chômage pour l'État, puis il a fait valoir que l'augmentation du nombre des fonctionnaires a accompagné le développement des missions publiques. Il s'est élevé contre le pacte de stabilité proposé par l'État aux collectivités locales, qui intervient après plusieurs années marquées par des ponctions importantes sur les dotations concernées.
Il a enfin regretté que le produit de la cotisation minimum de taxe professionnelle alimente le budget, en estimant que l'État sollicite ainsi l'assiette de l'impôt des collectivités locales.
M. Henri Collard a constaté que la France vivait au-dessus de ses moyens depuis plusieurs années, puis il a insisté sur l'opportunité d'assurer une programmation pluriannuelle des dépenses d'investissement de l'État.
M. René Trégouët a estimé que la politique de maîtrise des dépenses supposait une véritable mobilisation des Français et avancé quelques pistes de réflexion pour tenter de maîtriser les dépenses sociales.
M. Joël Bourdin s'est interrogé sur les relations entre le taux de change et les taux d'intérêt.
Après avoir constaté que l'activité de la commission était loin d'être celle d'un simple "commentateur", M. Philippe Marini a souligné l'intérêt d'un projet de loi d'orientation sur les prélèvements obligatoires. Il a estimé indispensable d'assurer le développement d'une épargne de long terme, puis s'est interrogé sur l'efficacité réelle de la mesure proposée en matière de transmission des entreprises, compte tenu de la rigidité des conditions posées par le texte.
Enfin, il s'est déclaré favorable à la mise en place, au sein du Parlement, de procédures d'évaluation des politiques publiques.
Après s'être félicité de la qualité du débat de la matinée, M. Alain Lambert, rapporteur général, a répondu aux différents intervenants.
S'agissant de la fonction publique, il a indiqué que le coût total des rémunérations et pensions atteignait 567 milliards de francs, soit un tiers des dépenses de l'État.
Après avoir rappelé que 50.000 fonctionnaires partaient à la retraite chaque année, il a insisté sur la nécessité de rénover le mode de gestion des effectifs, et d'évaluer les besoins réels de chaque ministère tout en recherchant une plus grande mobilité au sein de l'administration. Il a rappelé que la France disposait d'ailleurs d'une excellente fonction publique, mais que celle-ci devait impérativement s'adapter aux défis du monde moderne.
S'agissant de la politique de l'emploi, M. Alain Lambert, rapporteur général, a précisé que l'État lui consacre 138 milliards de francs sous forme de crédits budgétaires, mais que son coût total atteint 250 milliards de francs environ lorsqu'on tient compte de son impact en termes de parts de recettes fiscales ou sociales.
Il a reconnu la nécessité de préserver les dépenses les plus riches en emploi, mais s'est interrogé sur les méthodes à mettre en oeuvre pour évaluer ce contenu.
En revanche, il a fait valoir que la suppression de la subvention destinée à l'UNEDIC ne pouvait être assimilée à un artifice comptable, cet organisme paritaire dégageant désormais des excédents significatifs qui supprimaient toute justification aux versements de l'État.
Répondant aux interrogations portant sur la réforme fiscale, M. Alain Lambert, rapporteur général, a reconnu la nécessité de développer l'épargne longue, et d'améliorer le dispositif prévu pour favoriser la transmission des entreprises.
Il a constaté que le décalage entre l'évolution des recettes et celle du PIB n'était pas encore totalement expliqué, mais que quelques facteurs importants avaient déjà été identifiés. Il a cependant souligné le caractère préoccupant de cette évolution, qui rendait d'autant plus indispensable la maîtrise des dépenses, et posait clairement le problème de la structure de nos prélèvements obligatoires.
Puis, M. Alain Lambert, rapporteur général, a relevé que les nombreuses questions concernant le pacte de stabilité trouveraient une nouvelle dimension lors de l'examen des crédits des collectivités locales. Il a rappelé que le principe du pacte répondait à un souhait de nombreux élus, mais que les modalités envisagées permettaient d'habiller de façon un peu différente les pratiques habituelles, et regrettables, constatées ces dernières années. Il s'est toutefois interrogé sur les solutions alternatives qui pourraient être envisagées.
Détaillant les dispositions envisagées en matière de taxe professionnelle, M. Alain Lambert, rapporteur général, a admis qu'il fallait mettre un terme à des dispositifs alimentant de façon automatique les dépenses de l'État. Il a ensuite rappelé l'initiative prise par l'Assemblée nationale, en vue d'affecter le produit de la cotisation minimale au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
En réponse aux interrogations portant sur les problèmes monétaires, M. Alain Lambert, rapporteur général, a reconnu que l'incidence des taux de change sur taux d'intérêt ne pouvait être niée, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt à court terme. Il a constaté que la pression exercée sur la parité franc-mark conduisait notre pays à maintenir une prime de risque relativement élevée par rapport à la monnaie allemande. Mais il s'est déclaré convaincu que seule l'union monétaire européenne permettrait de faire disparaître ce phénomène.
Puis M. Alain Lambert, rapporteur général, a rappelé l'importance du problème financier posé par la sécurité sociale, dont la dette représente aujourd'hui 4.000 francs par Français. Il a estimé nécessaire de réexaminer le rôle de l'État, qui en ce domaine était plus souvent un payeur qu'un décideur.
Enfin, s'agissant de maîtrise des dépenses publiques, M. Alain Lambert, rapporteur général, a réaffirmé le caractère obligatoire de cette démarche, en rappelant que la réduction du déficit était devenu un impératif en soi, indépendamment de nos engagements européens. Il a relevé la complexité des mécanismes budgétaires, l'extension progressive du domaine d'intervention de l'État, et l'inégale flexibilité des dépenses publiques.
Il a alors conclu en observant que la remise en cause de certaines dépenses supposait au préalable que soit résolue la question de l'évaluation des interventions budgétaires.
* (1) Outre l'impact des mesures d'ajustement en recettes (10 milliards de francs) et en dépenses (45,2 milliards), le collectif a pris en considération les effets d'une nouvelle présentation des recettes de privatisation qui majore le solde de la loi de finances de 47 milliards de francs et les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel qui a annulé l'article 34 de la LFl qui réduisait de 6,731 milliards les crédits de pension devant être pris en charge par le FSV. Par ailleurs, l'ampleur des mesures nouvelles (31 milliards en recettes et 14,5 milliards en dépenses) ainsi que la prise en compte d'ajustements traditionnellement opérés par le collectif de fin d'année ne permettent pas de comparer valablement le PLF 1996 à la LFl 1995.
* 1 C'est-à-dire notamment y compris les fonds de concours, pour environ 60 milliards de francs en 1994. L'excellent rapport de l'Assemblée nationale n° 2270 (volume II du tome I présente une analyse détaillée de ces évolutions (pages 20 et suivantes).
* (1) Assemblée nationale
* 2 Avant prélèvements et hors fonds de concours pour les exercices clos.
* (1) En termes de budget général, c'est-à-dire hors dépenses d'ordre et hors solde des C.S.T., cet indicateur se situe donc entre les dépenses nettes du budget général et le total des charges.
* 3 Ce tableau ne retrace pas l'intégralité des versements financiers de l'Etat aux régimes : ne sont pas pris en compte dans ce total les versements de l'Etat au titre du RMI, de l'allocation du fonds spécial d'invalidité et des aides personnelles au logement. Pour les deux premières, il s'agit de prestations dont le Parlement a confié la gestion aux organismes de sécurité sociale pour le compte de l'Etat ; pour les troisièmes il s'agit d'un financement partagé avec le régime général. Ces allocations ne relèvent pas du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne figurent pas dans les comptes des organismes. La différence de traitement entre les deux catégories de prestations s'explique essentiellement par des raisons historiques : prestations assurées à l'origine par les régimes de base puis prises en charge par l'Etat comme l'AAH, prestations récentes créées par l'Etat dont la gestion est confiée aux CAF, comme le RMI.
* (1) Rapport du Conseil National du Crédit ; mars 1994
* 1 Proposition de loi n° 222 de MM. Philippe Marini, Jacques Bimbenet, Maurice Blin, Jean Chérioux, Jean Clouet, André Fosset et Bernard Seillier tendant à permettre la création de fonds de pension de décembre 1992, rapportée au fond par la Commission des Affaires sociales (rapport n° 288 annexé au procès-verbal de la séance du 29 avril 1993) et pour avis par la Commission des finances (avis n° 361. annexé au procès-verbal de la séance du 15 juin 1993).
* 4 Ce plafonnement a été toutefois limité à l'exercice 1996 par l'Assemblée nationale, qui l'a relevé au triple de la cotisation "normale" pour 1997 et l'a supprimé pour les années suivantes.
* (1) Excédent brut d'exploitation/Valeur ajoutée
* (2) Epargne brute/Valeur ajoutée
* (3) Epargne/Formation brute de capital fixe
* 5 Pour parler du moyen terme" Rapport n° 127 - 1994-1995. Bernard Barbier. Délégation du Sénat pour la Planification.
* 6 Le taux au jour le jour américain s'est maintenu à 6% de mars à juin avant de descendre jusqu'à 5,7% en août.
* 7 Aux alentours de 2,3 % selon l'OFCE et le CEPII, prévision effectuée pour le Sénat le 27 septembre 1995
* 2 Le Crédit Lyonnais anticipe 3,8 % sur l'eurodeutschemark 3 mois et 5,5 % sur l'eurofranc 3 mois fin 1995.
* 3 L'OFCE et le CEPII anticipent un repli : de 3,7 % en 1995 à 2,9 % en 1996.
* 8 Voir l'audition des principaux instituts de prévision pour la commission des finances le jeudi 19 octobre 1995. Bulletin des commissions n° 3 du samedi 21 octobre 1995 pp 243 à 295.
* 9 Le Crédit Lyonnais anticipait début octobre 65 milliards de francs d'excédent courant en 1996, le Gouvernement 63 milliards de francs.
* 10 Le Crédit Lyonnais anticipe une hausse des taux allemands à dix ans en 1996, et une réduction de l'écart avec la France, qui passerait de 0,9 point en décembre 1995 à 0,8 en mars 1996 et 0,65 en septembre 1996.
* 11 Solde communément appelé « solde primaire »
* 12 Fiscal Expansions and Ajustements in OECD Countries par Alberto Alesina et Roberto Perrotti, Economie Policy, octobre 1995.
* 13 Crédit local de France - "Note de conjoncture sur les finances locales" -juillet 1995.
* 14 Au taux de change moyen pour 1993 de 0.00307 lires pour 1 franc.
* 15 Au taux de change moyen pour 1994 de 0.00344 lires pour 1 franc.
* 16 Au taux de change Chancellerie du 31/10/1995 de 0,00306 lires pour 1 franc
* 17 Au taux de change moyen pour 1993 de 0.00307 lires pour 1 franc.
* 2 Au taux de change moyen pour 1994 de 0.00344 lires pour 1 franc.
* 18 Au taux de change Chancellerie du 31/10/1995 de 0,00306 lires pour 1 franc
* 19 Toutefois, le budget de la défense comporte traditionnellement un effort d'équipement important, naturellement lié à la spécificité des nécessités militaires : en 1996, les dépenses ordinaires militaires diminuent à 152,5 milliards de francs (soit -207 millions de francs), alors que les dépenses en capital restent inchangées à 88,94 milliards de francs
* 20 De manière illustrative et non exhaustive.
* 21 après remboursements et dégrèvements.
* 22 Hors recettes d'ordre, et à 1.279 milliards de francs avec recettes d'ordre (+ 6,5 %).
* 23 Après déductions des remboursements et dégrèvements, soit 241,1 milliards de francs (+ 6,9%).
* 24 Proposée par l'article 10 du présent projet, la pérennisation de ce dispositif n'a pas de conséquences immédiates sur le montant des dégrèvements d'impôts. Mais, dans un premier temps, elle conduit à majorer les recettes du compte d'avances aux collectivités locales, atténuant d'autant le déficit structurel de ce compte. Par ce biais, son impact se retrouve donc bien dans le solde global du budget de l'Etat.
* 25 Rapport économique et financier. P. 78. Tome II.







