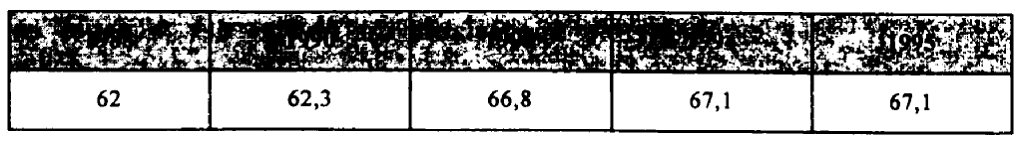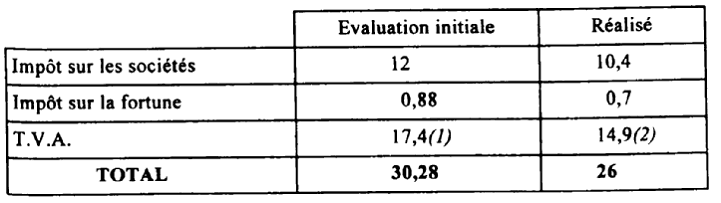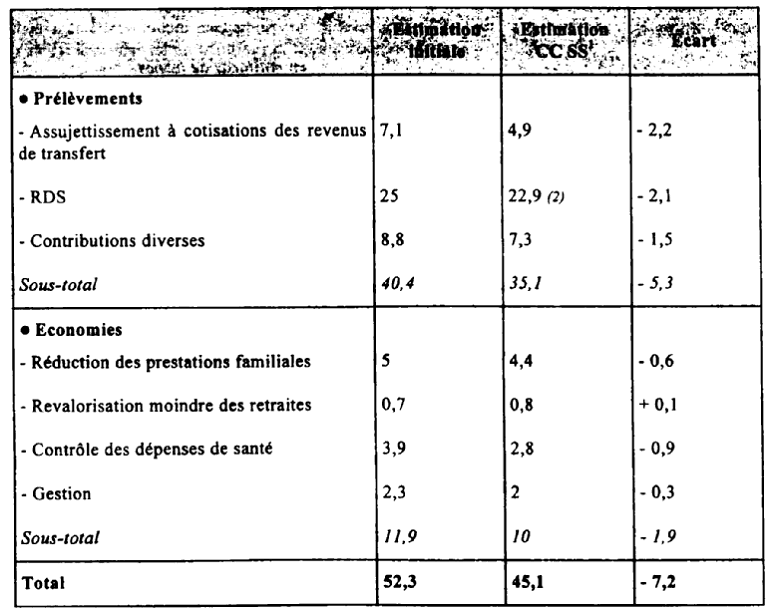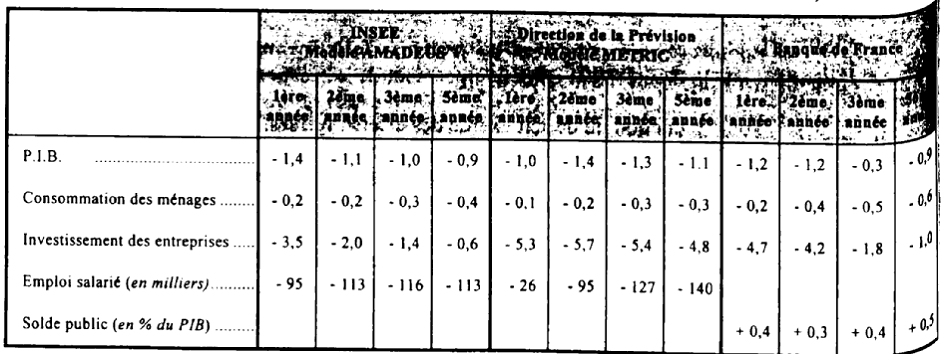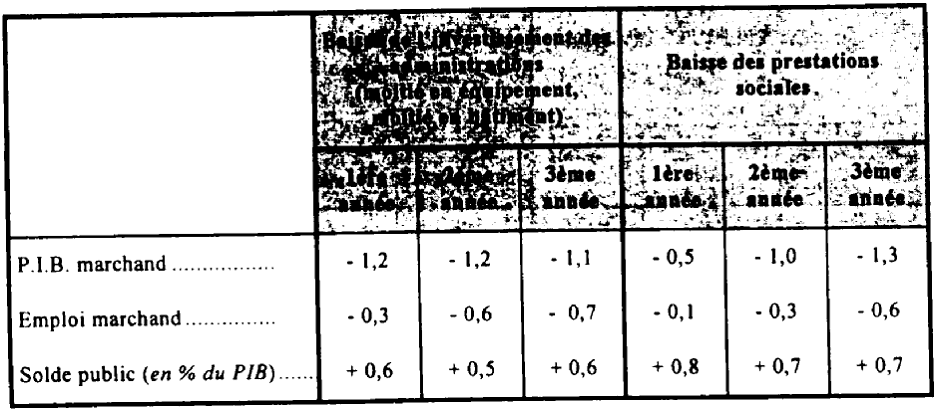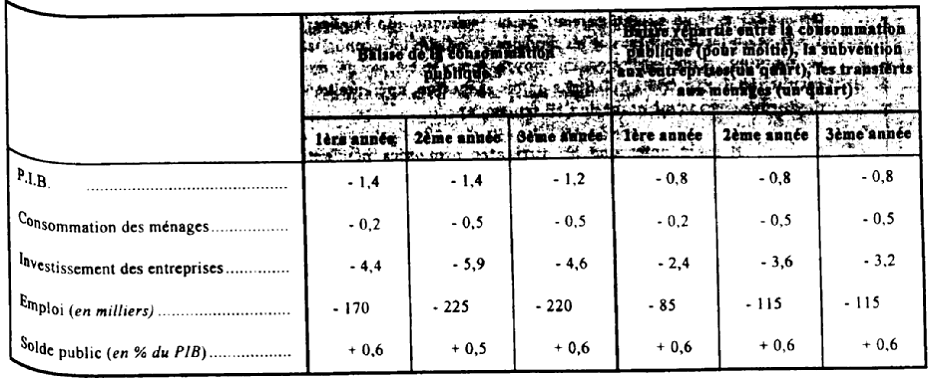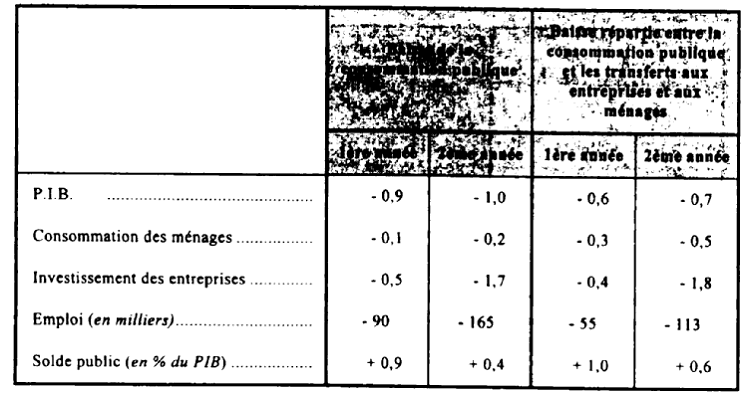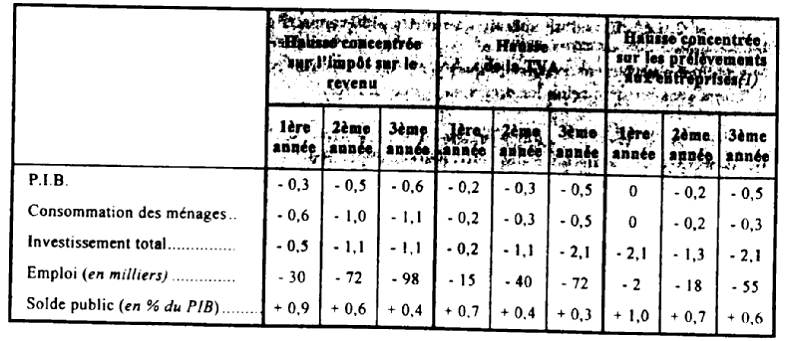Rapport général n° 86 (1996-1997) fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 1996
Disponible au format Acrobat (4,1 Moctets)
-
INTRODUCTION
-
CHAPITRE PREMIER UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE QUI
TEND À S'AMÉLIORER
-
CHAPITRE II LA RÉDUCTION DES DÉFICITS
PUBLICS : UN IMPÉRATIF DURABLE
-
I. LA SITUATION DE L'ENDETTEMENT DE L'ETAT
NÉCESSITE UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE RIGOUREUSE
-
II. LES CONTREPARTIES DE L'ENDETTEMENT DE L'ETAT
APPARAISSENT GLOBALEMENT NÉGATIVES
-
I. LA SITUATION DE L'ENDETTEMENT DE L'ETAT
NÉCESSITE UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE RIGOUREUSE
-
CHAPITRE III L'ÉQUILIBRE DU PROJET DE LOI DE
FINANCES
-
I. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
-
II. LA PROGRESSION DES RECETTES
-
III. LA RÉDUCTION DU DÉFICIT
-
I. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
-
CHAPITRE IV LA REFORME DU SYSTEME FISCAL
-
I. POUR UN SYSTÈME DE
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PLUS LISIBLE
-
II. POUR UN MEILLEUR USAGE DE LA DÉPENSE
FISCALE
-
III. POUR UNE MEILLEURE APPROCHE DE LA
COMPÉTITION FISCALE INTERNATIONALE
-
A. LES DONNEES DU PROBLÈME
-
B. UNE INFLUENCE CERTAINE SUR LES
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
-
C. L'ENCADREMENT DE LA COMPETITION FISCALE
INTERNATIONALE
-
A. LES DONNEES DU PROBLÈME
-
I. POUR UN SYSTÈME DE
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PLUS LISIBLE
N° 86
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1996.
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation(1) sur le projet de loi de finances pour 1997, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME I
LE BUDGET DE 1997
ET SON CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
1 Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10ème législ.) : 2993, 3030 à 3035 et T.A. 590.
Sénat : 85 (1996-1997).
Lois de finances.
INTRODUCTION
La loi de finances pour 1997 revêt un caractère historique : du succès de son exécution dépend la qualification de la France pour le groupe des pays de l'Union européenne qui auront une monnaie unique en 1999.
Les enjeux de la maîtrise des finances publiques ont été clairement mis en évidence, au printemps dernier, lors du débat d'orientation budgétaire. Cette maîtrise conditionne tant la prospérité de notre économie que la cohésion sociale de notre pays.
Les engagements pris par le gouvernement lors de ce débat d'orientation budgétaire sont tenus : le projet de loi de finances soumis à notre examen se traduit par une baisse simultanée des dépenses, des prélèvements obligatoires et du déficit.
Ce projet propose également une réforme ambitieuse de l'impôt sur le revenu. La baisse de son produit atteindra 25 milliards de francs en 1997 et près de 75 milliards dans cinq ans. Au terme de cette réforme plus de 95 % des contribuables verront leur impôt sur le revenu allégé de plus de 10 %.
Partagée entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale (pour ce qui concerne le transfert de 1,3 point de cotisation maladie sur 1 point de C.S.G. déductible), la réforme nécessaire de notre système de prélèvements obligatoires est enfin mise en oeuvre.
Cette première étape, qui en appelle d'autres, justifie que soient apportées des réponses claires à des questions délicates :
- Comment améliorer la lisibilité d'un système de prélèvements complexe et obscur, dont on connaît mal les aspects redistributifs,
- Comment accroître l'efficacité d'un système de prélèvements coûteux en termes de dépense fiscale,
- Comment s'assurer de la compétitivité de ce système de prélèvements au regard de la concurrence qui s'exerce entre toutes les économies nationales.
Après avoir décrit les contraintes d'une conjoncture en amélioration modeste (chapitre premier) et analysé les conditions du succès d'une politique de réduction du déficit public (chapitre II), le présent rapport s'attache à décrire les choix opérés en matière de dépenses et les perspectives de rentrées fiscales, qui conduisent à une amélioration du solde du budget de l'Etat en 1997 (chapitre III). Il propose enfin d'approfondir la réflexion sur la redistributivité, l'efficacité et la compétitivité de notre système de prélèvements obligatoires (chapitre IV).
CHAPITRE PREMIER UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE QUI TEND À S'AMÉLIORER
Le projet de loi de finances pour 1997 est construit sur la base d'une croissance de 1,3 % en 1996 et 2,3 % en 1997.
Ces perspectives sont partagées par la quasi-totalité des instituts de prévision.
I. UNE ACTIVITÉ EN QUÊTE DE RESSORTS
A. UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE PAR LE RESTOCKAGE
1. L'hypothèse d'un rebond en 1996
Le scénario économique qui sous-tend le projet de loi de finances pour 1997 retient une hypothèse de reprise de la croissance au second semestre de 1996, qui amplifierait un peu son rythme au long de l'année 1997.
La croissance en volume du PIB au cours du premier trimestre de 1996 navigue sur un rythme annuel de 0,6 %. L'hypothèse retenue pour 1996 suppose qu'au second semestre la croissance annuelle du PIB s'accélère sensiblement.
Évolution du PIB sous-jacente à la prévision du gouvernement
(en milliards de francs)
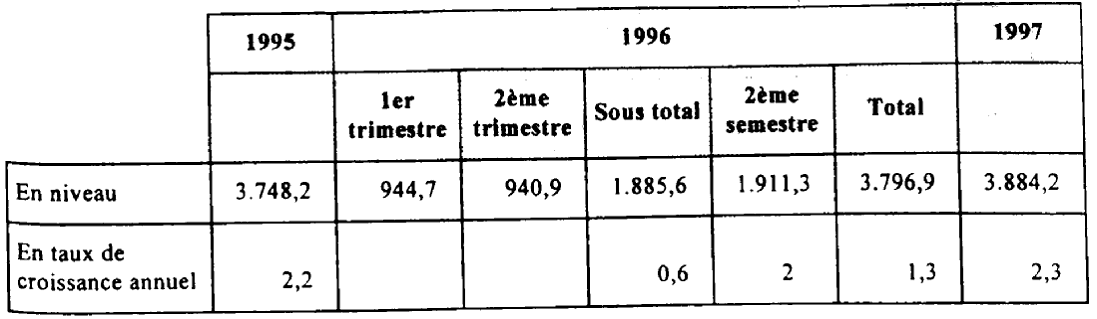
Le tableau qui précède illustre l'ampleur du rebond nécessaire pour atteindre le rythme de croissance retenu par la prévision associée au projet de loi de finances.
2. Le rôle-clé des entreprises
Le scénario de cette reprise repose sur le maintien d'un rythme de croissance modéré de la consommation des ménages, sur une contribution quasiment nulle du solde du commerce extérieur à l'activité, mais sur une modification très favorable du comportement des entreprises.
Les estimations de la contribution à la croissance des différents éléments de la demande confirment cette analyse.
Contributions à la croissance du PIB
(contributions à la croissance du PIB en points)
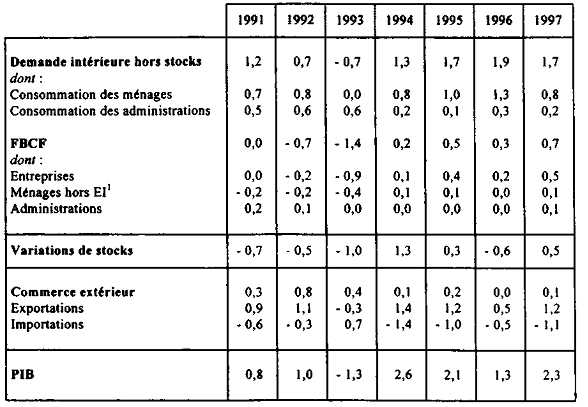
1. Entreprises individuelles
|
L'environnement international de la prévision La prévision retient l'hypothèse d'une reprise modérée de l'activité chez nos partenaires de l'OCDE.
La croissance allemande serait de 1,2 % en 1996, puis 2,2 % en 1997, ce qui suppose une évolution conjoncturelle en phase avec celle de l'économie française.
Au Japon, la croissance ralentirait en 1997 (2 % après 4,5 % en 1996). Parmi les pays émergents, ceux d'Asie resteraient les plus dynamiques. Ils seraient suivis des pays d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, alors que l'Afrique noire demeurerait une zone de faible croissance.
Les effets restrictifs de ces ajustements budgétaires seraient ainsi sensibles surtout en 1996 et moins en 1997 1 ( * ) . Il faut toutefois noter que les effets négatifs en Europe de la récession de 1993 (que l'on peut mesurer par l'écart entre le niveau effectif du PIB et le niveau qu'il aurait atteint s'il avait suivi sa trajectoire d'évolution tendancielle) seraient loin d'être effacés. Le scénario ainsi décrit, prolongé à moyen terme, peut être considéré comme une moyenne entre deux scénarios opposés : - celui d'une forte reprise cyclique, favorisée par la baisse des taux d'intérêt, et qui permettrait à terme d'effacer complètement les effets négatifs de la récession de 1993 ; - un scénario plus pessimiste, dans lequel la reprise de la demande privée ne serait pas suffisamment soutenue, ce qui freinerait l'évolution des recettes fiscales et conduirait à de nouvelles restrictions budgétaires pour réaliser le redressement des finances publiques. |
a) Une baisse du taux d'épargne des ménages
La consommation des ménages, à elle seule, expliquerait 1,3 point de croissance en 1996 et, seulement 0,8 point l'an prochain.
Le chiffre retenu pour 1996 est compatible avec une stabilité du niveau de la consommation des ménages au cours des deux derniers trimestres de l'année.
La consommation des ménages devrait ainsi s'accroître de l'ordre de 2 % en 1996 alors que l'acquis de croissance à la fin du premier trimestre s'élevait à 2,6 %.
|
L'acquis de croissance L'acquis est le taux de croissance annuel qui serait observé si la variable concernée restait au niveau atteint au dernier trimestre connu. Il ne s'agit pas d'un élément permettant d'établir une prévision sûre mais d'un outil au service de la prévision et de l'analyse des phénomènes conjoncturels. L'ampleur et le caractère erratique des variations de la consommation des ménages en 1996 illustrent la fiabilité relative de l'instrument. |
En 1995, la croissance de la consommation des ménages s'était établie à 1,8 %. L'année 1996 reproduirait ainsi à peu près le rythme de croissance observé l'an dernier tandis qu'en 1997 une nette inflexion se produirait puisque cet élément de la demande ne progresserait que de 1,4 % en volume.
Le lien entre consommation et revenu des ménages est évidemment très fort mais, ces dernières années, la montée du taux d'épargne des ménages l'avait singulièrement perturbé.
Ainsi, la croissance du revenu disponible brut des ménages en 1995 de 2,6 % s'était accompagnée cette année-là d'une progression de la consommation limitée à 1,8 % du fait du gonflement du taux d'épargne des ménages passé de 13,6 à 14,3 % entre 1994 et 1995.
La prévision pour 1996 et 1997 suppose, compte tenu des estimations portant sur l'évolution du revenu des ménages, que leur taux d'épargne baisse significativement -de 1,7 point entre 1995 et 1996- et se stabilise en 1997.
b) Une accélération du restockage
La composante la plus dynamique des "contributions" à la croissance proviendrait des entreprises.
L'investissement expliquerait 0,7 point de croissance en 1997 et les stocks 0,5 point.
L'investissement des entreprises s'accroîtrait de 2 % en 1996 puis de 5 % en 1997.
Quant aux variations de stocks, après avoir exercé une influence négative sur la croissance en 1996 à hauteur de 0,6 point, leur contribution serait favorable en 1997 (+ 0,5 point).
En bref, l'accélération de la croissance en 1997 proviendrait pour l'essentiel du comportement des entreprises en matière de stocks.
Hors variation des stocks, la croissance se serait élevée en 1996 à 1,9 % et serait en 1997 de 1,8 %.
Le tableau qui suit illustre l'influence de l'évolution des stocks sur la croissance entre 1991 et 1997.
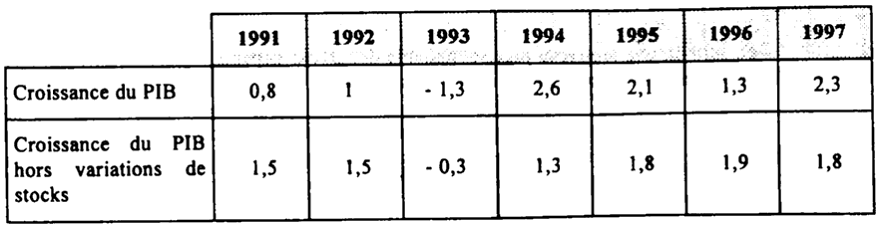
Hors accident conjoncturel de 1993, la croissance, calculée comme si les stocks ne variaient pas, évolue le plus souvent dans une fourchette de 1,5 à 1,9 % alors que, compte tenu des stocks, la fourchette des taux de croissance est beaucoup plus large : 0,8
Les mouvements des stocks sont à l'évidence une variable pesant très significativement sur l'activité.
|
Stocks et activité Dans la définition qu'en donne le système élargi de comptabilité nationale, "les stocks comprennent tous les biens autres que les biens de capital fixe, détenus à un moment donné par les unités productrices résidentes". Dans les comptes de patrimoine des secteurs institutionnels, le montant des stocks est estimé à 1.817,4 milliards de francs pour 1995 -dont 1.557,6 milliards de francs pour les sociétés et quasi-sociétés non financières- en diminution de 2,2 % par rapport à 1994 (- 41,1 milliards de francs). Les stocks constituent une production non vendue. Leur niveau résulte donc d'un décalage entre l'offre et la demande de produits. Lorsque celle-ci augmente moins que celle-là, le niveau des stocks s'accroît mécaniquement puis se résorbe à mesure que les producteurs s'adaptent à la demande. Mais, si les variations de stocks résultent de la croissance, elles l'influencent aussi. Les phénomènes de déstockage amortissent la croissance de l'activité dès lors que la progression de la demande peut être satisfaite par la production déjà réalisée que sont les stocks. A ces relations mécaniques, il faut ajouter deux phénomènes qui revêtent une certaine actualité. Le niveau des stocks ne dépend en effet pas que de réglages automatiques ; il résulte aussi de comportements des entreprises. A ce propos il convient de souligner : - que les entreprises ont adopté ces dernières années un comportement de plus en plus marqué de réduction de leurs stocks, popularisé sous la dénomination de politique de "zéro stock" ou encore de "flux tendus" ; ce comportement structurel pourrait expliquer la tendance au déstockage observée sur moyenne période ; - et, surtout, que le niveau jugé souhaitable des stocks dépend de l'appréciation que se forment les entreprises d'une série de variables économiques. Celles-ci peuvent être objectives : le coût financier de détention des stocks dépend du niveau du coût de l'argent. Elles peuvent être plus conjecturales lorsqu'il s'agit d'estimer la croissance future de la demande ou encore l'évolution prévisible du prix de vente de leurs secteurs d'activités. Les relations entre les stocks et l'activité emprunteront donc deux voies : - les stocks contribuent, par leur variation, à expliquer le rythme de croissance ; - le rythme de croissance escompté et la valeur attendue des biens expliquent les variations des stocks. |
La contribution des stocks à la croissance a été faiblement positive en 1995 et serait très négative en 1996 du fait du déstockage intervenu dans les secteurs des biens intermédiaires et d'équipement.
Le rebond escompté pour 1997 serait lui très conséquent.
B. UNE CROISSANCE PEU DISTRIBUTRICE DE REVENUS
A la prévision de croissance de 2,3 % serait associée une progression du revenu disponible brut des ménages limitée à 1,4 %.
1. Une augmentation appréciable du revenu des ménages en 1995
En 1995 la croissance du PIB s'est établie à 2,1 % et celle du revenu disponible brut des ménages à 2,6 %.
Le revenu des ménages en 1995
Principales composantes du revenu de l'ensemble des ménages
(Variations en %, francs courants, moyenne annuelle)
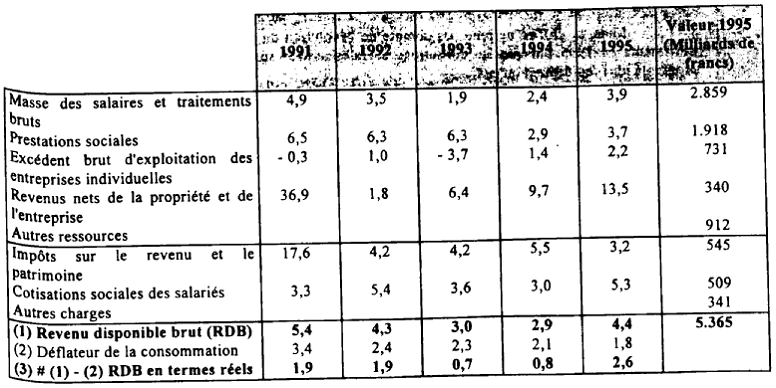
Source : Comptes de la Nation 1995
Le revenu des ménages a progressé en 1995 de 2,6 % en termes réels.
Le revenu disponible brut des ménages est la différence entre diverses ressources et diverses charges.
Les salaires et traitements contribuent pour un peu plus de 40 % à la formation des revenus bruts des ménages tandis que les prestations sociales en représentent 28 %, l'excédent brut d'exploitation des entreprises individuelles 10,8 % et les revenus nets de la propriété et de l'entreprise 5 %.
|
Rapport des prestations sociales/salaires et traitements
Pour la première fois depuis 1988, la progression des prestations sociales a été un peu moins rapide que celle des revenus d'activité. Il en résulte que le mouvement lent mais continu de rattrapage des revenus d'activité par les revenus de transfert s'est interrompu et que les revenus de transfert s'élèvent comme en 1994 à 67,1 % des revenus d'activité. Ce phénomène est cependant intervenu dans le contexte d'une accélération du rythme d'accroissement des prestations sociales -+ 3,7 % en 1995 contre + 2,9 % en 1994- mais celle-ci n'a pas été aussi forte que celle des salaires et traitements. Ceux-ci ont augmenté de 3,9 % en 1995 contre 2,4 % en 1994. En termes réels ils ont ainsi gagné 2 % l'année dernière. Mais, ce chiffre ne rend pas compte de l'évolution du pouvoir d'achat des salaires et traitements en 1995 puisque les cotisations sociales assises sur ces éléments de revenu ont progressé plus rapidement qu'eux. Les cotisations sociales des salariés ont augmenté de 5,3 %. La masse salariale nette s'est ainsi établie à 2.347 milliards de francs, augmentant de 3,6 % en francs courants et de 1,8 % en pouvoir d'achat. Il faut dans cet ensemble distinguer l'évolution des salaires publics et celle des salaires privés. Les salaires et traitements publics se sont élevés en 1995 à 776,7 milliards de francs et ont progressé de 4,5 % par rapport à 1994. Ce total se décompose lui-même en : - 411,4 milliards de francs payés par les administrations publiques centrales (+ 4,1 %) dont 374,6 milliards de francs payés par l'Etat (+ 4,1 %) ; - et 186,2 milliards de francs payés par les administrations publiques locales (+ 5,3 %). Ainsi la progression de la masse des traitements publics a été plus rapide que celle des autres salaires. Ceux-ci n'ont progressé que de 3,7 % entre 1994 et 1995. Source : Comptes de la Nation |
2. Un ralentissement en 1996-1997
Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages progresserait à peine en 1996 (+ 0,2 %) et modérément en 1997 (+ 1,4 %).
Les gains de pouvoir d'achat du salaire par tête seraient nuls en 1996 et de 1 % l'année prochaine.
Ces évolutions poursuivraient la tendance d'une progression des salaires inférieure à celle de la productivité du travail qui résulte elle-même très largement, semble-t-il, des caractéristiques d'un marché du travail déprimé.
La stabilité du nombre des effectifs salariés en 1996 (+ 15.000 emplois salariés marchands) et sa progression en 1997 (entre 160.000 et 190.000 créations nettes d'emplois) contribuent à expliquer l'accroissement des gains de pouvoir d'achat du revenu des ménages entre ces deux années.
Les effets nets des processus de redistribution seraient défavorables en 1997 et pèseraient sur la progression du pouvoir d'achat des ménages.
Évolution des revenus salariaux et sociaux (en gain de pouvoir d'achat)
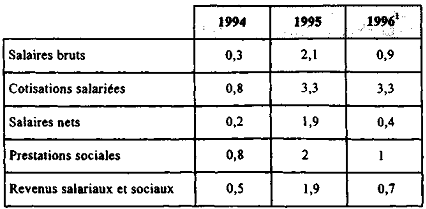
1 Acquis (L'acquis mesure le taux de croissance d'une variable au cours d'une période si sa valeur demeurait inchangée au long de la durée restant à couvrir).
Les gains de pouvoir d'achat des revenus salariaux et sociaux, après s'être accélérés en 1995 sous l'effet d'une progression sensible des salaires bruts et du rythme de croissance élevé des prestations sociales, s'infléchissent significativement en 1996.
La progression des salaires bruts et des versements de prestations sociales se ralentit fortement. En revanche, sous l'effet des mesures de rééquilibrage des comptes sociaux, l'augmentation des cotisations salariées se poursuit sur un rythme élevé et nettement plus rapide que celui de la croissance des salaires bruts.
Les hypothèses sous-jacentes à la prévision économique pour 1997 reproduisent des enchaînements semblables mais moins accusés qu'en 1996.
|
Les prélèvements fiscaux et sociaux décidés en 1995 L'évaluation des suppléments nets de prélèvements obligatoires et de leurs répercussions sur les entreprises et les ménages doit être conduite avec objectivité. On doit répondre à l'affirmation selon laquelle le gouvernement aurait prélevé 120 milliards de francs sur les ménages. |
L'accusation se fonde sur le cumul des nouveaux prélèvements fiscaux de la loi de finances rectificative du 4 août 1995, et sociaux décidés en novembre 1995 pour financer le déficit de la sécurité sociale.
1. Les hausses d'impôts de la loi de finances rectificative du 4 août 1995
Trois hausses d'impôts sont en cause qui ont porté sur :
- la TVA,
- l'impôt sur les sociétés,
- l'impôt sur la fortune.
Leur montant avait été évalué initialement à 65,08 milliards de francs en année pleine. Une évaluation révisée à partir des recettes constatées les évalue à 55,8 milliards de francs.
|
Évaluation pour 1995 des hausses d'impôts
de la loi de finances
(en milliards de francs)
En réalité, le supplément de recettes fiscales perçues par l'Etat en 1995 provenant de ces mesures nouvelles s'est élevé à 26 milliards de francs. C'est ce chiffre qui est représentatif des transferts entre l'Etat et les autres agents économiques issus des relèvements d'impôts examinés au cours de l'année 1995. En première analyse, cette année là, les ménages ont versé 15,6 milliards de francs de plus à l'Etat que ce qu'ils lui auraient versé à législation constante et les entreprises 10,4 milliards de francs. Ainsi, les ménages ont, apparemment, assumé 60 % des nouveaux prélèvements, les 40 % restant étant payés par les entreprises. Cette estimation doit cependant être nuancée. Si le relèvement de l'impôt sur la fortune peut être considéré comme intégralement à la charge des ménages, il en va autrement de la majoration de la TVA. (1) 52,2 milliards en année pleine (2) 44,7 milliards en année pleine |
|
On peut considérer qu'un relèvement de la TVA n'est entièrement supporté par les ménages que moyennant quatre conditions qui ne sont, dans les faits, jamais remplies. Première condition : Il faudrait que tous les emplois taxables à la TVA proviennent des ménages. Or, même si les emplois taxables à la TVA proviennent, pour l'essentiel, des ménages à travers leur consommation ou leurs investissements, une part non négligeable d'entre eux est issue des administrations et des institutions de crédit et d'assurance. Deuxième condition : Il faudrait que la part des emplois des ménages taxable à la TVA dans le total de leurs emplois demeure inchangée. Or, tel ne semble pas être le cas. La hausse du taux d'épargne des ménages ainsi que la déformation de leur consommation en direction de biens ou services peu ou non taxés constatées ces dernières années aboutit à atténuer les effets sur les ménages d'une hausse du taux normal de la TVA. Ces phénomènes structurels mériteraient sans doute un examen approfondi pour que soient mieux appréhendés le rendement et l'impact redistributif de toute mesure portant sur cet impôt. Troisième condition : Il faudrait que les entreprises répercutent dans leur prix la majoration des taux de TVA. Dans le cas de la hausse intervenue en août, il semble bien que tel ait été le cas et que les entreprises l'aient répercutée progressivement. Mais, comme ceci s'est réalisé dans le contexte d'une inflation sous-jacente réduite on peut établir que la ponction ainsi opérée sur le pouvoir d'achat des ménages a été largement compensée par une inflexion de la hausse tendancielle des prix. Quatrième condition : Il faudrait qu'il n'y ait pas d'indexation des revenus sur les prix. Les nombreux travaux économétriques consacrés à cette question démontrent le contraire. L'augmentation du niveau général des prix déclenche une indexation des salaires, certes un peu retardée, mais qui, s'agissant de cette catégorie de revenus, vient effacer les effets de hausse des prix sur son pouvoir d'achat. Pour les autres catégories de revenus, cet enchaînement dépend pour les revenus de substitution "administrés" (prestations sociales, indemnités de chômage) de mesures volontaristes et, pour les revenus financiers, de liaisons complexes. Même si les variations des prix et des salaires enregistrées en 1995 et au début de 1996 ne favorisent pas, en raison de leur très faible amplitude, l'identification d'un phénomène d'indexation, celui-ci a très certainement joué -il faut rappeler, à cet égard, l'augmentation importante du SMIC, + 4 %, en juillet 1995- si bien que l'effet sur les ménages de la hausse de la TVA a été probablement largement transféré sur les entreprises même si une partie de la mesure a pu affecter les revenus des catégories sociales ne bénéficiant pas d'une indexation salariale. Au total, il est inexact de considérer que le prélèvement supplémentaire opéré par l'Etat à travers la hausse de la TVA a affecté les ménages dans sa totalité. |
Les expériences passées démontrent au contraire qu'on serait plus proche de la vérité en affirmant que cette mesure a plutôt affecté le revenu des entreprises et que les ménages l'ont, pour une grande part, évitée grâce au déclenchement des quatre types de comportement analysés ci-dessus.
Ces enchaînements devraient également se vérifier en 1996, année pour laquelle on peut, sur la base des prévisions de la loi de finances initiale, évaluer comme suit l'impact des mesures fiscales d'août 1995.
Évaluation de l'impact des mesures fiscales d'août 1995 en 1996
en milliards de francs
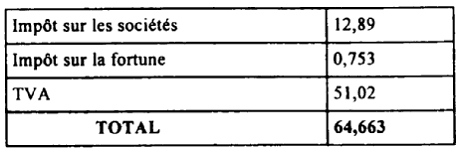
Cependant, il est établi que les hausses de TVA renchérissent le coût du travail ce qui, dans une période de chômage, peut être jugé défavorable.
2. Les mesures de redressement des comptes de la sécurité sociale (Plan Juppé du 15 novembre 1995)
Le plan de redressement de la sécurité sociale de novembre 1995 comprenait des prélèvements supplémentaires et un volet d'économies portant sur diverses dépenses sociales.
L'Observatoire français des conjonctures économiques -OFCE- en avait donné les évaluations suivantes pour 1996 et 1997.
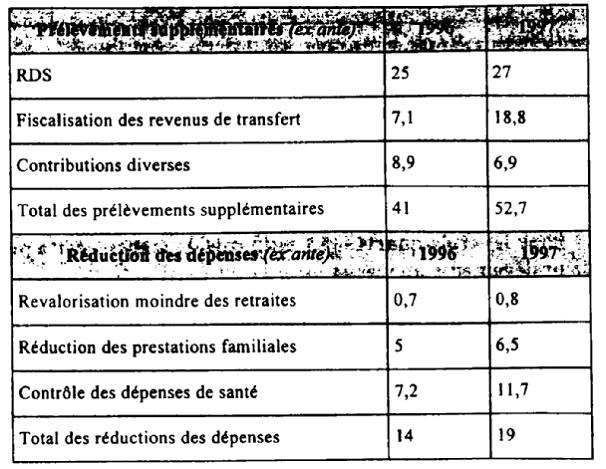
|
Les évaluations mentionnées reposaient sur un ensemble de mesures dont certaines ne se sont pas traduites dans les faits.
(1) Commission des comptes de la sécurité sociale (2) Non estimés par la Commission des comptes de la sécurité sociale Le plan de novembre 1995 se serait traduit en 1996 par une ponction sur les revenus des ménages et des entreprises, de l'ordre de 45 milliards de francs, contre un montant initialement estimé à 52,3 milliards de francs. Pour les trois-quarts -35,1 milliards de francs-, cette ponction a résulté de prélèvements nouveaux. La cotisation pour le remboursement de la dette sociale s'élèverait à 22,9 milliards de francs, contre une ressource évaluée à l'origine à 25 milliards de francs. L'écart provient, pour une faible part, d'un dynamisme de l'assiette moindre que prévu et, pour l'essentiel, des retards d'application d'une mesure qui n'a joué que sur 11 mois en 1996. Le rendement des contributions diverses a lui-même été décevant du fait de l'absence de recouvrement de la contribution des médecins aux frais de gestion et à l'informatisation. Il est à noter que pour l'essentiel -5,1 milliards de francs- ces contributions sont acquittées par des entreprises. Quant à l'assujettissement à cotisations des revenus de transferts, son produit s'élèverait à 4,9 milliards de francs, soit une moins-value de 2,2 milliards par rapport aux prévisions. On observe que l'essentiel des nouveaux prélèvements a porté sur le revenu des ménages qui, à ce titre, ont supporté en 1996 environ 30 milliards de charges nouvelles. S'agissant des économies, elles s'élèveraient à 10 milliards de francs, soit 1,9 milliard de moins que prévu. Elles proviennent, pour un peu moins de la moitié, d'économies sur les dépenses de la politique familiale et, en particulier, du gel de la base mensuelle des allocations familiales. Cette dernière mesure aurait permis d'économiser 2,6 milliards de francs. Hors les économies de gestion des caisses qui contribuent cependant au cinquième environ des économies réalisées, le deuxième poste contribuant à celles-ci est le poste santé. Le contrôle des dépenses de santé se traduirait par une économie de l'ordre de 2,8 milliards de francs, soit près de 1 milliard de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Cette dérive s'explique par une progression plus soutenue qu'escompté des dépenses de médecine de ville. La quasi-totalité des mesures étudiées a reposé sur les ménages. Mais, deux précisions s'imposent : D'abord, le montant des économies de gestion finalement imputées aux ménages ne peut être en l'état évalué. On rappellera qu'elles se sont élevées à près du cinquième des 10 milliards d'économies réalisées. Mais, surtout, les autres quatre-cinquièmes des économies effectuées proviennent, pour l'essentiel, d'une désindexation des prestations qui ne s'est pas traduite par une amputation des prestations, mais bien par une inflexion de leur croissance. De ce point de vue, le plan de novembre 1995 ne peut être compris que comme un freinage du rythme de progression des prestations sociales, une part importante de l'effort de maîtrise consistant d'ailleurs à aligner la croissance des prestations sur l'évolution des prix. Au total, il faut bien distinguer entre les véritables prélèvements nouveaux qui ont amputé le revenu des ménages de 30 milliards de francs et le cantonnement de la progression des prestations qui est, lui, de l'ordre de 8 milliards. Car, s'il est vrai que les effets de ces deux catégories de mesures sur le revenu des ménages sont identiques, ils n'ont pas du tout la même signification. L'un réduit les revenus acquis par ailleurs, l'autre infléchit la progression de ressources tirées de transferts, dont certaines -les dépenses de santé- ont un caractère simplement éventuel. Considérer un ralentissement de la progression des dépenses sociales quelles qu'elles soient, comme un prélèvement sur le revenu des ménages revient à estimer que ceux-ci ont un droit acquis à une progression tendancielle des prestations sociales. * * * A supposer une indexation seulement partielle (de la moitié de la hausse de la TVA) des revenus des ménages sur le supplément de prix issu du relèvement de la hausse de la TVA, l'ensemble des prélèvements bruts nouveaux sur les ménages résultant des mesures décidées en 1995 s'élèverait à quelque 65,5 milliards de francs en 1996. |
Face à ce faible dynamisme des ressources des ménages, seule une inflexion de leur taux d'épargne en 1996 de 14,3 à 12,6 %, soit - 1,7 point -et un maintien en 1997 de ce taux au niveau atteint- permet de rendre compte des prévisions portant sur la croissance de la consommation des ménages (+ 2,1 et + 1,4 % en 1996 et 1997 respectivement).
II. LE MAINTIEN D'UN "ÉCART DE CROISSANCE" DÉFAVORABLE
Le scénario de croissance retenu prolongerait donc l'écart entre croissance potentielle et croissance effective.
Le taux de croissance serait de 2,3 %.
Hors effet des stocks, la croissance ne dépasserait pas 1,8 % en 1997 contre une croissance potentielle généralement estimée à 2,5 %.
L'économie française continuerait donc à ne pas employer "normalement" les facteurs de production disponibles en 1997.
Toutefois, ce phénomène s'atténuerait.
|
L'écart à la croissance potentielle : "l'écart de croissance" Le taux de croissance potentielle de l'économie française est estimé depuis plusieurs années à 2,5 % par an. Le taux de croissance potentielle est celui qui serait atteint si les facteurs de production -le travail et le capital pour l'essentiel- étaient normalement utilisés. L'écart entre le taux de croissance potentielle et le taux effectif de croissance -"l'écart de croissance"- permet de rendre compte lorsque le second est plus élevé que le premier des phénomènes de rareté et d'inflation. Lorsque la situation inverse se présente, il permet de rendre compte de phénomènes de sous-utilisation des facteurs de production (chômage, sous-investissement). Cependant, l'observation d'un "écart de croissance" n'a guère de portée explicative en tant que telle, parce que la mesure de la croissance potentielle suppose que soient résolues des questions aussi importantes que celle du niveau normal d'utilisation des facteurs ou encore celle du niveau de leur productivité. Partant, l'observation d'un "écart de croissance" n'a une valeur opératoire efficace que pour autant que ces questions soient correctement résolues. Pour illustrer la signification de ces deux observations, on peut raisonner sur l'exemple de l'emploi. La croissance potentielle dépend d'une utilisation normale du facteur travail disponible. La population active détermine quantitativement les disponibilités. Mais la question des acteurs déterminant qualitativement l'utilisation "normale" de la population active se pose en de tout autres termes. La réponse donnée à cette question suppose un jugement normatif et passe généralement par l'idée qu'une utilisation normale de la population active est celle qui n'engendre pas de tensions inflationnistes ou de tensions salariales. On remarquera d'abord que l'une et l'autre de ces deux conditions ne sont pas entièrement assimilables -tensions salariales et inflationnistes ne vont de pair qu'à partage inchangé des gains de productivité entre profits et salaires. On remarquera surtout que l'évaluation du taux de chômage nécessaire pour que lesdites tensions soient contenues est conjoncturelle et très certainement variable en fonction de multiples paramètres : le coût du travail bien sûr mais aussi la qualité de la main d'oeuvre ou encore l'organisation des relations de travail. Ainsi le rapprochement de la croissance effective et de la croissance potentielle suppose de résoudre des problèmes méthodologiques considérables et en même temps de prendre parti sur les raisons -du même ordre- qui expliquent l'écart entre les deux grandeurs. |
A cette situation serait associé un effet plutôt positif : l'absence de risque inflationniste continuerait à prévaloir.
Mais deux phénomènes, défavorables, perdureraient :
• la poursuite d'une conjoncture peu propice
à la réduction du chômage ;
• le maintien d'une situation peu favorable
à l'investissement.
A. UNE CONJONCTURE PEU PROPICE À LA RÉDUCTION DU CHÔMAGE
1. L'enrichissement de la croissance en emplois
L'accumulation des "écarts de croissance" observés ces dernières années peut être présentée comme étant à l'origine de la hausse du chômage, celui-ci expliquant à son tour les écarts de croissance.
Pour dépasser le débat récurrent sur les causes profondes du sous-emploi, il faut faire état d'une évolution importante déjà soulignée dans le rapport général de l'année dernière : l'enrichissement de la croissance en emplois.
Alors qu'entre 1974 et 1989 il fallait en moyenne un taux de croissance de 2,3 % pour que des emplois soient créés, le rythme de croissance à partir duquel l'économie crée désormais des emplois serait de l'ordre de 1,6 %.
Pour expliquer ce phénomène on avance deux motifs essentiels : la baisse de la durée du travail et surtout celle de la productivité du travail.
L'explication souvent donnée de ce dernier phénomène insiste sur l'impact des différents dispositifs d'aides à l'emploi qui seraient favorables à la création d'emplois peu qualifiés.
Il faut en tout cas insister sur trois facteurs très importants :
• le développement du travail à temps
partiel qui a progressé de 27 % entre mars 1992 et mars 1996 (+
757.000 emplois à temps partiel) et agit sur la durée du
travail ;
• le développement de l'emploi public (+
414.000 emplois publics non marchands entre 1990 et 1995)
2
(
*
) ;
• et l'inflexion de la productivité dans les
services cumulée avec la tertiarisation de l'économie.
2. Les limites du phénomène
Selon le gouvernement , ces évolutions devraient permettre la création de 150.000 à 190.000 emplois en 1997, ce qui, compte tenu de l'évolution de la population active, serait insuffisant pour stabiliser le taux de chômage 3 ( * ) .
Mais, l'évaluation précise de la croissance du taux de chômage, qui est fonction de la déformation des taux d'activité, dépend aussi de la poursuite du processus d'enrichissement de la croissance en emplois.
Celle-ci pourrait rencontrer plusieurs obstacles :
• la baisse des créations nettes d'emplois
publics ;
• l'arrivée à maturité d'un
certain nombre de dispositifs d'aide à l'emploi ;
• les réticences de plus en plus grandes
exprimées par les personnes employées à temps partiel qui
ressortent de l'enquête de l'INSEE sur l'emploi de mars 1996 ;
Personnes travaillant à temps partiel
recherchant un emploi à temps complet
ou un temps partiel
supplémentaire
(en milliers)
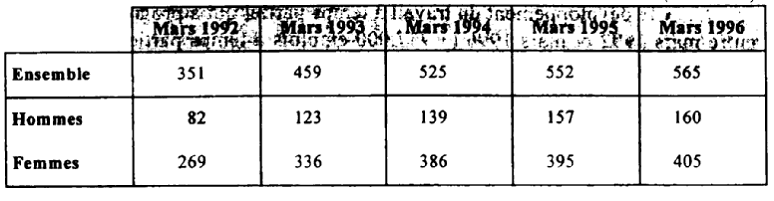
• l'insuffisance du travail qualifié en
France, à propos duquel il convient d'observer qu'à la fin des
années 80, malgré un taux de chômage de 9 %, la
reprise de l'emploi avait provoqué des tensions salariales dues, pour
l'essentiel, à des pénuries de main d'oeuvre qualifiée.
Pour conclure sur l'emploi, si les effets de "l'écart de croissance" sur son évolution étaient atténués grâce à l'enrichissement de la croissance en emplois, il y a lieu de souligner que celui-ci correspond à un processus de créations d'emplois fragmentés plutôt qu'à une capacité retrouvée de notre économie à créer un volume d'emplois supérieur.
Quelle que soit la pérennité de cette situation, il y a lieu d'éclairer ses conséquences.
|
La baisse de la productivité des facteurs de
production :
Évolution de la productivité horaire du travail par branche Valeur ajoutée en volume par heure de travail en % par rapport à l'année précédente
L'inflexion des gains de la productivité des facteurs de production suit une tendance continue depuis les années 70. Entre 1959 et 1973, la productivité apparente du travail croissait de 5,5 % par an. Après le premier choc pétrolier, ce rythme s'est ralenti à 2,4 % l'an puis, après s'être redressé entre 1983 et 1989 (+ 3,6 % en moyenne), s'est à nouveau infléchi (+ 1,8 % depuis 6 ans). La productivité apparente du capital a plus fortement baissé, de faibles gains de productivité succédant à des années de perte de productivité. Dans une période de chômage, le ralentissement des gains de productivité du travail est parfois considéré comme une évolution souhaitable. Le raisonnement qui sous-tend cette appréciation consiste à faire valoir qu'à production donnée un ralentissement des gains de productivité du travail permet d'employer davantage de personnes. Il y a "enrichissement de la croissance en emplois". Les limites de ce raisonnement doivent être mises en évidence. Tout d'abord, il faut souligner que le ralentissement des gains de productivité est synonyme d'infléchissement du rythme de croissance et donc de création de richesses. Le surplus de productivité partageable s'étiole avec toutes les conséquences de ce phénomène en termes de revenu et donc d'entretien de la croissance. Ensuite, il faut indiquer que le ralentissement des gains de productivité s'accompagne d'une réduction d'efficacité des facteurs employés. Celle-ci ne peut être jugée favorable que pour autant qu'on pose comme hypothèse qu'elle est inéluctable. Il faudra alors considérer que les emplois susceptibles d'être créés dans l'économie ne peuvent être en l'état que peu productifs ou que l'efficacité de l'investissement est durablement moindre qu'auparavant. Enfin, il faut observer que le ralentissement de la productivité horaire du travail n'est évidemment pas le seul remède au sous-emploi. La diminution de la durée du travail a les mêmes effets. |
B. LES DÉTERMINANTS CONTRASTÉS DE L'INVESTISSEMENT
1. L'absence de tension sur les capacités de production
L'écart entre le taux effectif de croissance et la croissance potentielle constitue une situation peu favorable au dynamisme de l'investissement.
Il implique en effet que les entreprises ne soient pas contraintes au cours de la période sous revue par leurs capacités de production installées.
L'évolution du taux d'utilisation des capacités de production montre les marges disponibles.
Taux d'utilisation des capacités de production de 1990 à 1995
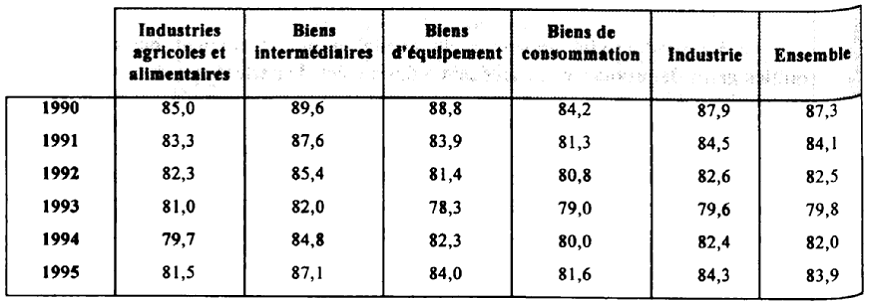
2. Un retard accumulé de l'investissement
Le taux d'investissement des entreprises a sérieusement faibli au cours des cinq dernières années 4 ( * ) .
Le taux d'investissement des entreprises entre 1990 et 1995 1
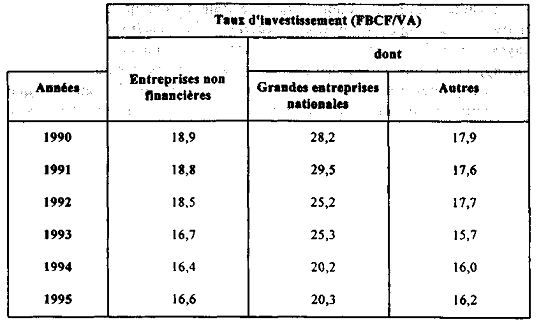
1. Rapport de l'investissement à la valeur ajoutée
L'évolution très alarmante du taux d'investissement des entreprises au cours des cinq années écoulées a certainement créé une situation où les besoins de renouvellement des équipements sont importants.
L'amélioration de la situation financière des entreprises et de la profitabilité des investissements, grâce à la baisse des taux d'intérêt, devrait également favoriser une reprise de l'investissement.
III. DEUX SCÉNARIOS À MOYEN TERME
Un exercice de projection à moyen terme -horizon 2001- de l'économie française a été réalisé par l'Observatoire français des conjonctures économiques -OFCE- pour le Sénat.
Le tableau ci-dessous en décrit les principaux résultats.
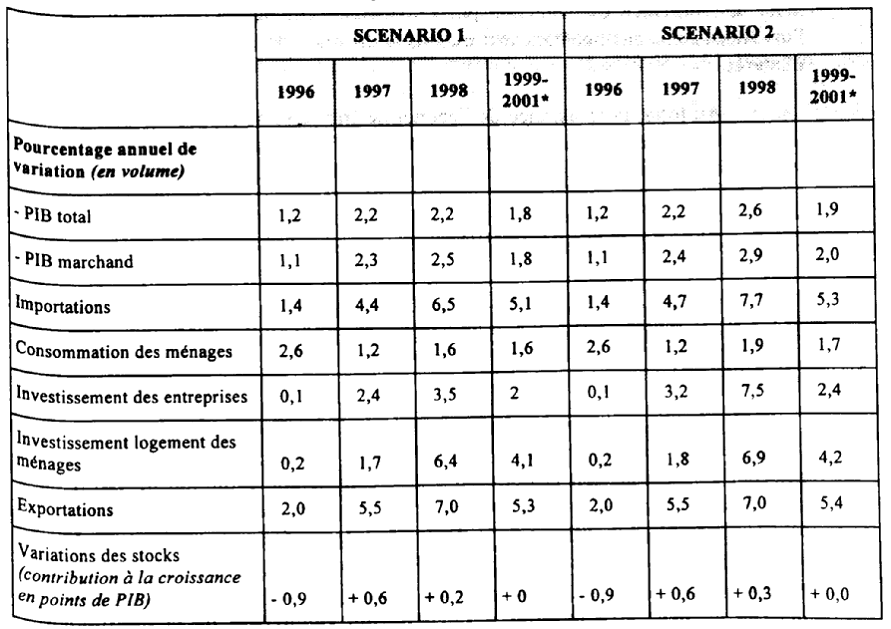
* Taux de croissance annuel moyen pour les années 1999, 2000 et 2001
A. DES SCENARIOS CONTRASTES
Le scénario 1 doit être interprété comme un scénario de nature tendancielle, en ce qu'il prolonge les évolutions actuellement à l'oeuvre dans l'économie française, qui se caractérisent par la faiblesse de la demande interne : les gains salariaux sont trop limités pour soutenir le revenu des ménages et la consommation, ce qui finit par peser sur l'investissement des entreprises.
Le scénario 2 repose sur l'hypothèse que la baisse des taux d'intérêt aurait des effets plus importants sur les comportements de dépenses des agents privés que ce qu'indique spontanément le modèle. Le profil de la croissance ainsi obtenue est plus marqué que dans le scénario 1. La croissance du PIB marchand serait ainsi de 2,4 % en 1997, puis 2,9 % en 1998 (contre 2,5 % dans le scénario 1), avant de se tasser en fin de période (2 % par an en moyenne contre 1,8 % dans le scénario 1).
Certes, la consommation progresse là aussi moins vite que le PIB, mais la croissance est soutenue par l'investissement des entreprises et par l'investissement en logement des ménages, en réaction à la baisse des taux d'intérêt.
Au total, la croissance de l'économie française se rapproche de celle de ses partenaires, notamment en début de période, ce qui donne plus de vraisemblance aux évolutions simulées dans ce scénario 2.
B. DES TENDANCES COMMUNES
Les grandes tendances de l'économie française, telles qu'elles sont illustrées par les deux scénarios peuvent se résumer de la manière suivante :
• Même dans le scénario optimiste, la
croissance de l'économie française sur le moyen terme est
inférieure à celle de ses principaux partenaires. Ceci ne doit
pas être considéré comme une évolution
probable,
mais plutôt comme une
indication
fournie par le modèle sur une tendance lourde : le
faible dynamisme de la demande interne freine la croissance, de telle
sorte que l'économie française a des difficultés à
suivre le rythme de ses partenaires. Or, cette absence de moteur au niveau de
la demande interne ne peut être imputée à l'orientation
rigoureuse de la politique budgétaire :
celle-ci ne
produirait en effet ses effets restrictifs qu'en début de
période, alors que c'est en
fin de période
(1999
à 2001) que
l'essoufflement
de la croissance
française est le plus manifeste.
• Les raisons de l'atonie de la demande interne
doivent être trouvées du côté du
revenu des
ménages,
qui en raison de la faiblesse des évolutions
salariales, ne peut contribuer au soutien de la consommation. Celle-ci
progresse ainsi en projection à un rythme moyen inférieur
à 2 % par an et moins vite que le PIB. Ceci explique
qu'après un cycle assez bref, l'investissement des entreprises ralentit
en fin de période en raison des perspectives médiocres de
débouchés.
• L'économie française croît
ainsi durablement à un rythme inférieur à son potentiel,
de telle sorte que
le nombre de chômeurs continuerait à
augmenter
(de 40.000 à 50.000 par an environ d'ici 2001).
• Elle continuerait par ailleurs
à
accumuler des excédents extérieurs.
En effet, la
compétitivité-prix des produits français s'améliore
et, de plus, la demande intérieure française progresse moins vite
que celle de ses partenaires. Ainsi, la projection met-elle en évidence
la poursuite d'un scénario de "désinflation compétitive",
effectivement à l'oeuvre depuis le milieu des années 1980, et
seulement interrompu sur la période 1992-1995 par les mouvements de
change intra-européens.
• Enfin, il a été souligné qu'en
projection le pouvoir d'achat du salaire par tête progressait moins vite
que la productivité.
On pourrait en déduire que le pouvoir d'achat de la masse salariale (soit le pouvoir d'achat du salaire par tête que multiplie les effectifs occupés) augmente moins vite que le PIB en volume (soit la productivité "multipliée" par les effectifs), prolongeant ainsi la tendance, observée sur la dernière décennie, de la déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salaires. Toutefois, ceci ne s'observe pas en projection : la masse salariale en valeur progresse comme le PIB en valeur, ce qui se vérifie par la stabilité du taux de marge des entreprises. Ceci s'explique par le fait que les prix à la consommation (déflateur utilisé pour obtenir le pouvoir d'achat de la masse salariale) progressent sensiblement plus vite que les prix du PIB (déflateur utilisé pour obtenir le PIB en volume).
Au-delà de cette complexité technique, il convient néanmoins de retenir que le faible dynamisme des salaires -qui servent d'assiette aux cotisations sociales- ne facilite pas en projection le rééquilibrage des comptes sociaux.
RAPPEL
Principales estimations produites lors de la
réunion
de la Commission des Comptes de la Nation
Equilibre des biens et services
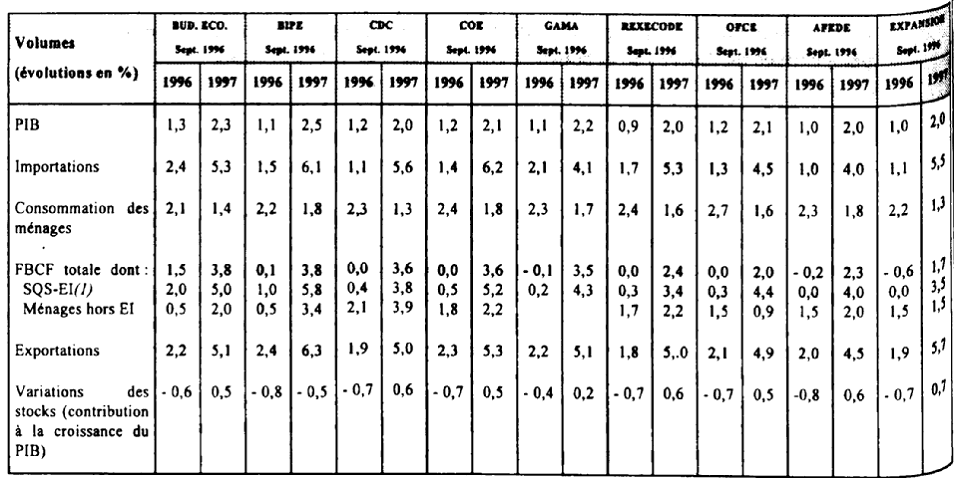
(1) Sociétés et quasi-sociétés - entreprises individuelles.
Prix, salaires, emploi
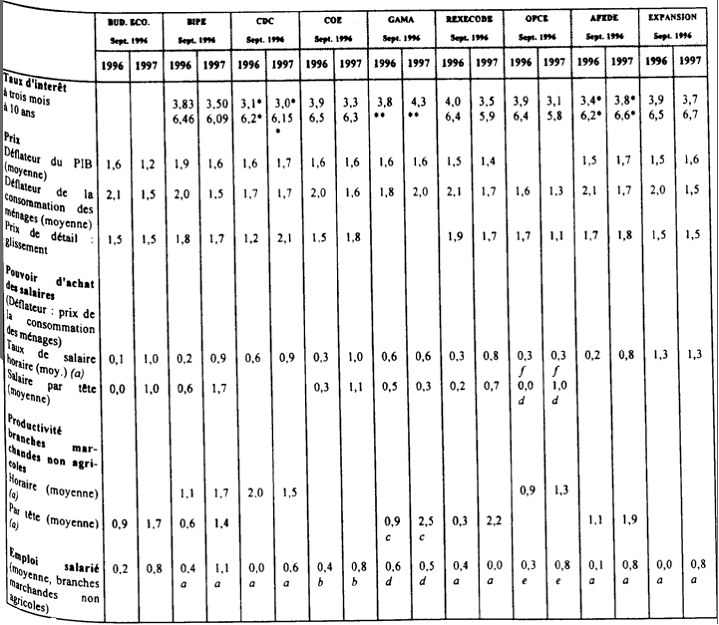
* Hypothèses en fin d'année
** Au jour le jour
a : Non financiers non agricoles, hors grandes entreprises nationales (GEN)
b : Secteur marchand hors GEN
c : Branches marchandes
d : Salarié total
e : Secteur marchand non agricole y/c GEN
f : Marchand non agricole
Les comptes d'agents
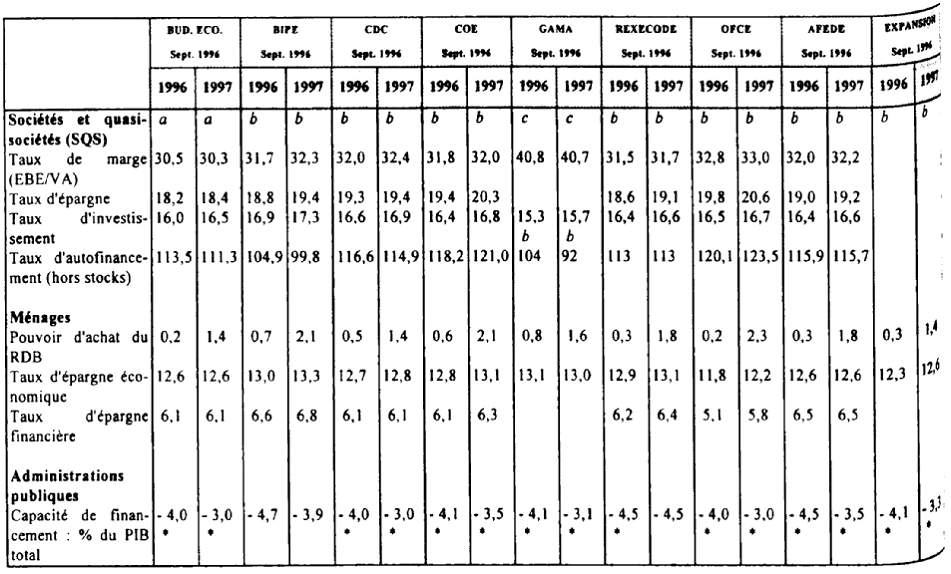
a Pour les budgets économiques : Sociétés et quasi sociétés non agricoles hors GEN, taux d'autofinancement au sens strict
(épargne brute/FBCF)
b SQS
c SQS + El
* En comptabilité européenne
CHAPITRE II LA RÉDUCTION DES DÉFICITS PUBLICS : UN IMPÉRATIF DURABLE
Il existe désormais un large consensus sur la nécessité de réduire les déficits publics.
A cet égard, le débat d'orientation budgétaire a très opportunément permis de clarifier les enjeux :
Cet effort apparaît indispensable compte tenu du niveau atteint par l'endettement public devenu, en termes économiques, "insoutenable".
La voie de l'endettement étant récusée, l'efficacité théorique des déficits publics est, sinon entièrement contestée, au moins sérieusement remise en cause.
La réduction des déficits publics doit donc être poursuivie, mais cet effort doit, pour être efficace, obéir à certains principes et sans doute s'accompagner d'actions complémentaires.
I. LA SITUATION DE L'ENDETTEMENT DE L'ETAT NÉCESSITE UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE RIGOUREUSE
A. L'AUGMENTATION DE LA DETTE DE L'ETAT
Fin décembre 1995, l'endettement de l'Etat s'élevait, selon le ministère de l'économie et des finances, à 3.251 milliards de francs et s'était accru en glissement de 11,9 % par rapport à son niveau de décembre 1994. Il représentait 42,4 % du PIB.
En 1987, la dette de l'Etat s'élevait à 1.282 milliards de francs, soit 24 % du PIB.
En huit ans, la part de la dette de l'Etat dans le PIB a ainsi presque doublé.
Ce résultat provient de l'accumulation des besoins de financement de l'Etat qui, sur cette période, se sont élevés à 1.969 milliards de francs, soit une moyenne annuelle de 246,1 milliards de francs.
Depuis 1987, la dette de l'Etat s'est accrue au rythme de 12,3 % l'an contre une croissance du PIB en moyenne annuelle de 4,6 %.
B. UN EFFET PARALYSANT POUR LES FINANCES DE L'ETAT
a) La hausse de l'endettement réduit les marges de manoeuvre de l'Etat.
L'accroissement de la dette de l'Etat, conjugué à un haut niveau des taux d'intérêt a provoqué une explosion des dépenses d'intérêt. Elles s'élevaient en 1988 à 97,6 milliards de francs (1,7 % du PIB) et en 1995 à 225,6 milliards de francs (2,9 % du PIB).
Elles ont donc connu une progression de 230 % en sept ans et ont été un facteur autonome de croissance de la part des dépenses de l'Etat dans le PIB.
Hors charges d'intérêt, la part des dépenses de l'Etat dans le PIB se serait repliée de 1,22 point entre 1988 et 1995, alors qu'elle s'est stabilisée entre ces deux dates, passant de 21,36 à 21,34 points de PIB. Moyennant une stabilité de la part des dépenses d'intérêt dans le PIB, la capacité de financement de l'Etat aurait été améliorée de 1,2 point de PIB par rapport à la situation observée en 1995.
La part des dépenses consacrée par les administrations publiques au paiement des charges d'intérêt a plus que doublé entre 1980 et 1994.
b) Les dépenses d'intérêt exercent donc un fort effet d'éviction sur les dépenses publiques elles-mêmes.
Cet effet d'éviction possède une dynamique propre pernicieuse.
L'accroissement du pourcentage de la dette publique dans le PIB combiné à des taux d'intérêt nominaux supérieurs au taux de croissance du PIB engendrent une augmentation des dépenses d'intérêt sensiblement plus vive que celle du PIB. Dans cette situation, la dérive des charges d'intérêt entraîne en elle-même une progression des dépenses publiques plus rapide que celle du PIB.
Une telle évolution se traduit soit par un accroissement du déficit, qui lui-même engendre spontanément une dérive des dépenses publiques, soit par une hausse des prélèvements obligatoires, soit par une inflexion à due concurrence des autres dépenses publiques.
La situation d'endettement de l'Etat recèle donc un véritable effet de paralysie des dépenses publiques autres que celles correspondant à des versements d'intérêts.
II. LES CONTREPARTIES DE L'ENDETTEMENT DE L'ETAT APPARAISSENT GLOBALEMENT NÉGATIVES
A. L'ENDETTEMENT DE L'ETAT POURRAIT EXERCER UN EFFET D'ÉVICTION
Endettement intérieur total (EIT)
(Encours en milliards de francs - variation annuelle en pourcentage)
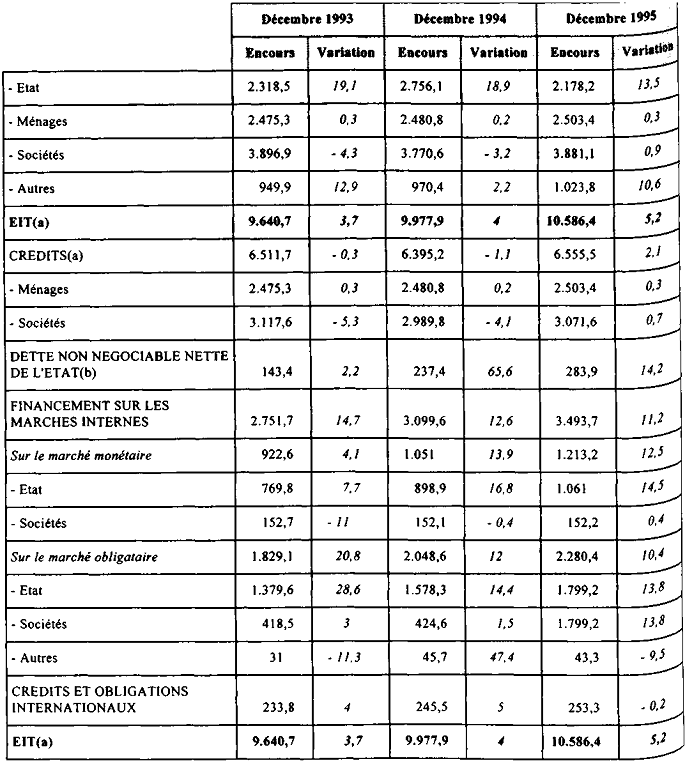
(a) Les Variations tiennent compte des opérations de défaisance.
(b) La dette non négociable nette de l'Etat correspond à la composante "Autres créances nettes" de la contrepartie de M3 "Créances sur l'Etat" (total des monnaies divisionnaires, des ressources liées au circuit du Trésor et du net des comptes à la Banque de France, après déduction des opérations sur titres avec les institutions financières).
(Source : Banque de France)
Le besoin de financement de l'Etat suppose que celui-ci trouve dans l'emprunt des ressources pour le couvrir.
La voie du financement monétaire du déficit de l'Etat est, depuis la loi du 4 août 1993 sur la Banque de France, entièrement fermée. Cette solution impliquée par nos engagements européens et par la crainte d'une inflation monétaire a probablement contribué à la très faible augmentation de la masse monétaire observée en France ces dernières années 5 ( * ) . Elle a en tout cas banalisé les conditions de financement du déficit de l'Etat et ôté à celui-ci une partie importante de ses potentialités inflationnistes.
Mais, elle conduit l'Etat à se présenter sur les marchés financiers et, par la demande qu'il manifeste sur ces marchés, à drainer un volume significatif de l'épargne et à contribuer pour beaucoup à la formation des prix de ces marchés, c'est-à-dire des taux d'intérêt.
|
L'écart entre le déficit de l'Etat et ses appels au marché Il existe un important écart entre le déficit de la loi de finances et l'appel au marché exercé par l'Etat. Ainsi, en 1997, avec un déficit de l'Etat de 283,7 milliards de francs, le recours de l'Etat aux marchés financiers serait proche de 620 milliards de francs, soit 2,4 fois le besoin de financement résultant des opérations budgétaires annuelles. Cet écart provient des besoins de refinancement de la dette passée. Qu'en conclure ? Il apparaît tout d'abord que l'appel de l'Etat aux marchés est partiellement indépendant des besoins de financement de ses opérations budgétaires une année donnée. Deux leçons doivent être tirées :
Cette dernière observation a une résonance particulière si l'on se réfère à la signification des critères de convergence du Traité de Maastricht. Si l'on considère que la justification économique essentielle d'une maîtrise des déficits publics sous les 3 % du PIB résulte de l'impact des déficits sur les taux d'intérêt et l'orientation de l'épargne, il est loisible de montrer que, dans l'hypothèse où tous les Etats ramèneraient leur déficit à 3 % du PIB, il subsisterait d'importants écarts entre les montants exprimés en points de PIB national que chacun demanderait aux marchés financiers (1) . En un mot, l'appréciation du redressement des finances publiques dans les pays européens doit s'apprécier en combinant l'évaluation de l'impact du niveau de déficit et du niveau d'endettement. Il apparaît ensuite qu'une politique d'acceptation de l'endettement suppose l'acceptation d'efforts de gestion budgétaire considérables ultérieurs puisqu'il faut des excédents budgétaires pour amortir l'endettement passé ou l'acceptation de risques financiers puisque les conditions de refinancement de la dette sont, par hypothèse, inconnues au moment où celle-ci est constituée. A cet égard, il est presque "miraculeux" que le niveau des taux d'intérêt soit aujourd'hui inférieur à ce qu'il était lors de la période d'endettement courant maximum. (1) Il serait, à ce propos, très souhaitable de réfléchir en profondeur à la signification de la coexistence de références nationales de bonne gestion des finances publiques et d'une européanisation des marchés. |
En 1993, la part de l'Etat dans l'endettement intérieur total s'élevait à 24,1 % ; elle était de 30 % en 1995.
Au cours de cette période, l'endettement intérieur total s'est accru de 4,8 % l'an, contre une croissance de 17,1 % de l'endettement de l'Etat. Celui-ci absorbe 87,4 % des créances monétaires et près de 79 % des créances obligataires. L'Etat a ainsi absorbé 93 % du développement et du "compartiment" obligataire entre 1993 et 1995. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas lui reconnaître une responsabilité essentielle sur les orientations du marché financier.
Pour autant, il n'existe pas de preuve incontestable d'un effet d'éviction direct de l'endettement de l'Etat sur les capacités d'endettement des autres agents.
L'effet de l'endettement de l'Etat sur le niveau des taux d'intérêt n'est pas mécanique. Le gonflement de l'appel de l'Etat aux marchés financiers au cours des deux dernières années s'est accompagné d'une réduction du niveau des taux d'intérêt. Ce phénomène paradoxal peut s'expliquer de bien des manières : la sensibilité des marchés à l'évolution du besoin de financement courant est plus grande qu'aux conséquences de l'endettement passé, les anticipations favorables du fait des perspectives offertes par la constitution d'une monnaie unique en Europe, la décrue de l'endettement dans l'économie mondiale, le niveau d'autofinancement des entreprises.
En toute hypothèse, il convient de prendre en considération les comportements d'endettement de l'ensemble des agents économiques nationaux et du reste du monde pour comprendre le niveau des taux d'intérêt nationaux.
L'effet de l'endettement de l'Etat sur les quantités de financement disponibles pour les autres agents doit, pour être évalué correctement, être apprécié avec les mêmes précautions.
A défaut de pouvoir produire un diagnostic incontestable, les fortes suspicions pesant sur la responsabilité de l'endettement de l'Etat sur l'environnement financier des autres agents conduisent à recommander un effort déterminé de réduction de la dette de l'Etat.
B. L'ENDETTEMENT DE L'ETAT EXERCE PROBABLEMENT UN EFFET DÉPRESSIF INDIRECT SUR L'ACTIVITÉ.
1. Les justifications théoriques d'une politique d'endettement ne manquent sans doute pas.
Dans l'approche keynésienne, le déficit permet de distribuer des revenus dont l'effet multiplicateur autorise une hausse de la production et des revenus distribués qui, à leur tour, accélèrent le rythme de croissance
Ces mécanismes viennent réduire le niveau du déficit constaté "ex post".
En théorie, ils possèdent un pouvoir d'entraînement d'autant plus important que le financement du déficit provient de la création monétaire.
Toute réduction du déficit exerce des effets inverses.
Les modèles macro-économiques keynésiens confirment ces analyses.
|
Les effets d'une politique budgétaire restrictive selon les résultats de simulations réalisées à l'aide de modèles macro-économiques (1) 1. Les effets d'une réduction des dépenses publiques A titre d'illustration, les tableaux suivants présentent les résultats (2) de variantes de réduction de 1 % du PIB (environ 80 milliards de francs courants) des dépenses publiques. Ces résultats doivent être interprétés avec la plus grande prudence : ils ne sont en aucun cas une « prévision » des effets d'une politique budgétaire restrictive, mais seulement une estimation de son impact « mécanique » sur l'activité. (1)Les développements de l'encadré sont issus d'une note de synthèse de la division des études macro-économiques du service des études du Sénat. (2)Ces résultats ne sont pas strictement comparables. En effet, les périodes de départ de la simulation sont distinctes : les variantes du COE et du Crédit Lyonnais ont été réalisées à partir d'un compte de référence en « prévision » pour la période 1997-1999, tandis que les variantes de l'OFCE, de l'INSEE, de la Direction de la Prévision et de la Banque de France ont été établies par rapport aux évolutions réelles constatées sur des périodes passées (1988-1990 pour l'OFCE, 1986-1988 pour les autres institutions). Toutefois, pour les variantes retenues, le choix de la période de référence n'affecte pas l'ordre de grandeur des résultats. Tableau 1 EFFETS D'UNE BAISSE DURABLE DES DÉPENSES PUBLIQUES D'INVESTISSEMENT DE 1 % DU PIB (0,8 % POUR LES DÉPENSES DE PRODUITS MANUFACTURÉS ET 0,2 % POUR LE BTP) (EN % D'ÉCART PAR RAPPORT AU NIVEAU QUI AURAIT ÉTÉ ATTEINT SANS CETTE BAISSE)
Tableau 2
EFFETS D'UNE BAISSE DURABLE DES DÉPENSES
PUBLIQUES DE 1 % DU PIB, SELON LE TYPE DE
(EN % D'ÉCART PAR RAPPORT AU NIVEAU QUI AURAIT ÉTÉ ATTEINT SANS CETTE BAISSE)
Tableau 3
EFFETS D'UNE BAISSE DURABLE DES DÉPENSES
PUBLIQUES DE 1 % DU PIB « EX ANTE »,
Tableau 4 C.O.E. (1) (modèle O.E.F.)
EFFETS D'UNE BAISSE DURABLE DES DÉPENSES
PUBLIQUES DE 1 % DU PIB « EX-ANTE »,
(1) Centre d'Observations Economiques de la Chambre de
Commerce et d'industrie de Paris.
Dans l'ensemble, les modèles macroéconomiques suggèrent ainsi qu'une baisse initiale des dépenses publiques de 1 % du PIB a en France pour impact mécanique de court terme (2-3 ans) un ralentissement de la croissance de l'ordre de 1 point de PIB (0,8 % à 1,3 % selon les hypothèses et les modèles), - ce que les économistes traduisent en écrivant que le « multiplicateur keynésien de moyen terme » est voisin de 1 -, la non-création ou la destruction de 100.000 à 200.000 emplois et, in fine, une amélioration du solde public effectif de l'ordre d'un demi-point de PIB seulement. Il est à noter que les variantes proposées peuvent naturellement être lues à l'envers, et permettre, par symétrie, d'estimer l'impact mécanique d'un accroissement des dépenses publiques. Par ailleurs, les effets récessifs de la baisse des dépenses publiques sont d'autant plus importants que cette baisse s'effectue au détriment des dépenses d'investissement, en particulier, au détriment des dépenses en infrastructures et en bâtiments (l'impact sur la demande est alors maximum car le contenu en importations de ces dépenses est très faible). Toutefois, l'utilisation de modèles multinationaux suggère que l'impact des politiques budgétaires restrictives serait moindre en France que chez ses principaux partenaires : |
Tableau 5
EFFETS À TROIS ANS D'UNE BAISSE DES
INVESTISSEMENTS PUBLICS DE 1 POINT DE PIB,
(À TAUX DE CHANGE ET TAUX
D'INTÉRÊT NOMINAUX CONSTANTS),
SELON LE MODÈLE MIMOSA
(OFCE - CEPII)
(EN % D'ECART PAR RAPPORT A UN SCENARIO SANS CETTE
HAUSSE)
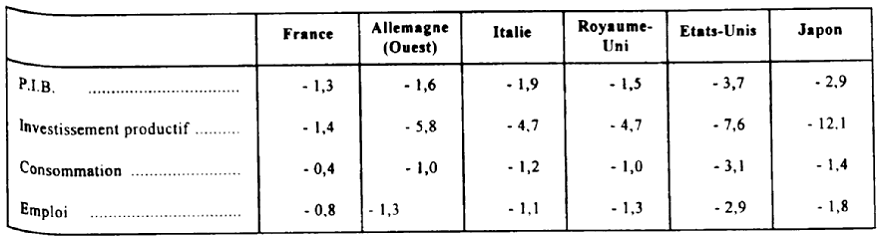
En effet, les effets multiplicatifs des dépenses publiques sont d'autant plus importants :
- que le degré d'ouverture de l'économie est faible ;
- que l'investissement est sensible à l'évolution des débouchés ;
- enfin, que l'emploi (donc les revenus salariaux) s'ajuste rapidement à la production.
L'impact récessif d'une baisse de l'investissement public sera donc plus élevé aux Etats-Unis, ceux-ci cumulant faible degré d'ouverture et ajustement très rapide de l'emploi.
2. Les effets d'un accroissement des prélèvements publics
Les effets macroéconomiques d'un relèvement des prélèvements fiscaux ou sociaux diffèrent sensiblement selon les prélèvements considérés.
? Par exemple, l'augmentation des cotisations sociales à la charge des employeurs ou la hausse de la fiscalité des entreprises (impôts sur les sociétés, taxe professionnelle), accroissent les coûts des entreprises. Celles-ci peuvent alors théoriquement ou bien maintenir leurs prix inchangés en réduisant leurs marges et leurs profits, ou bien répercuter intégralement la hausse de leurs coûts sur leurs prix de vente. En pratique, les entreprises ont un comportement de marge intermédiaire entre ces deux extrêmes ; cependant, elles ne peuvent augmenter leurs prix de vente qu'après un certain délai.
|
Il s'ensuit que l'augmentation des prélèvements sur les entreprises a deux effets principaux : à très court terme une dégradation de leur situation financière, susceptible de ralentir leur effort d'investissement ; d'autre part, après un délai d'ajustement, une hausse du niveau des prix. Ce surcroît d'inflation réduit la compétitivité-prix des entreprises : il en résulte une contraction des exportations et éventuellement une augmentation des importations. En outre, l'accélération de l'inflation pèse doublement sur la consommation des ménages : par un effet dit « d'encaisses réelles » (lorsque l'inflation augmente, les ménages cherchent à préserver la valeur réelle de leur capital en augmentant leur épargne) et par un effet-revenu (parce que l'évolution des salaires ne suit la hausse de l'inflation qu'avec un certain délai, ce qui réduit temporairement le pouvoir d'achat). ? Si les entreprises ne les répercutent que partiellement ou progressivement, les augmentations de la fiscalité indirecte (TVA, TIPP, droits sur le tabac et l'alcool) ont des effets semblables à ceux d'un accroissement des prélèvements sur les entreprises. ? En revanche, une hausse de la fiscalité indirecte immédiatement répercutée sur les prix à la consommation ou une augmentation de l'impôt sur le revenu ont un impact direct sur la demande des ménages et affectent ainsi a priori l'activité selon les mêmes mécanismes qu'une baisse des dépenses publiques. A titre d'illustration, le tableau ci-dessous présente les résultats de « variantes » d'augmentation ex-ante de 1 % du PIB des prélèvements sociaux ou fiscaux. Ces résultats peuvent évidemment être lus à l'envers pour estimer l'impact mécanique d'une baisse des prélèvements obligatoires. Tableau 6
EFFETS SELON LE MODÈLE O.E.F. DU C.O.E. D'UNE
HAUSSE DES PRÉLÈVEMENTS
(1) Impôts sur les sociétés et taxe professionnelle notamment. Il est à noter que les modèles macroéconomiques suggèrent que l'impact récessif d'une hausse des prélèvements obligatoires est moindre que celui d'une baisse des dépenses publiques. En effet, l'accroissement de l'impôt s'effectue pour partie au détriment de l'épargne des ménages : il pèse moins sur la consommation totale des agents qu'une baisse de la consommation publique de 1 % du PIB. |
2. Mais de nombreux travaux récents conduisent à remettre en cause l'efficacité économique des déficits publics
a) La plupart des études récentes relatives aux effets macroéconomiques des politiques budgétaires restrictives s'accordent sur les conclusions suivantes :
1. Les effets des politiques budgétaires restrictives sur l'activité sont extrêmement variables : un ajustement budgétaire peut s'accompagner aussi bien d'un ralentissement que d'une accélération de la croissance.
2. Les politiques budgétaires "modérément ou moyennement" restrictives ont en moyenne un effet récessif de l'ordre de grandeur de celui suggéré par les modèles macroéconomiques.
3. En revanche, les ajustements budgétaires les plus rigoureux (une réduction du déficit structurel de 3 % du PIB en deux ans pour le CEPII) ont en moyenne un impact sur la croissance d'ampleur similaire à celui des ajustements moins rigoureux. L'impact récessif est donc moins important en proportion des efforts consentis (« le multiplicateur keynésien » est beaucoup plus faible). En particulier, il existe un nombre significatif (une dizaine) d'expériences d'ajustement budgétaire accompagnées d'une accélération de la croissance, dont les plus spectaculaires sont celles de l'Irlande entre 1986 et 1989 et du Danemark entre 1983 et 1986 :
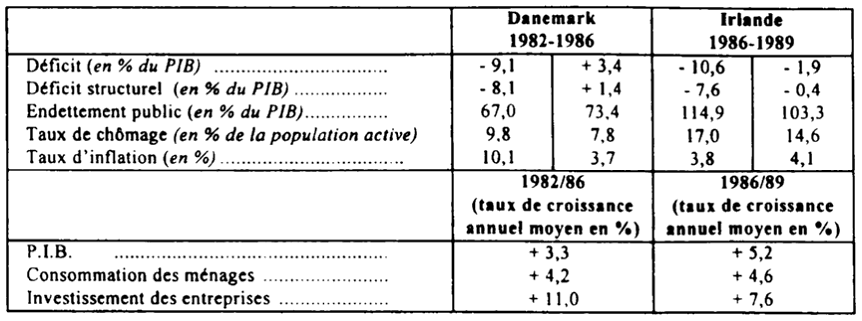
Source : OCDE.
4. La principale caractéristique des épisodes d'ajustement budgétaire « drastiques » réussis semble être l'évolution de la consommation des ménages, dont l'accroissement a contrebalancé la diminution de la consommation publique : à ce titre, ces épisodes sont « non keynésiens » . En revanche, même si certains des pays concernés ont bénéficié d'une dévaluation, les indices de conditions monétaires, qui reflètent de manière synthétique les évolutions des taux d'intérêt et des taux de change, sont en moyenne demeurés quasiment inchangés.
La réalisation d'un ajustement budgétaire « indolore » reposerait donc sur le rôle des anticipations des ménages et non sur celui des taux d'intérêt.
Il est donc essentiel de programmer dans le temps les efforts d'assainissement budgétaire, d'afficher en ce domaine une politique claire et d'éviter d'en troubler la lisibilité par des mesures susceptibles d'en remettre en cause la logique.
En conclusion :
- les politiques budgétaires "normales" seraient le plus souvent keynésiennes, c'est-à-dire qu'en moyenne une politique budgétaire restrictive réduirait la demande (donc la croissance) ;
- les politiques budgétaires très restrictives auraient une efficacité supérieure, tandis qu'on relèverait une perte d'efficacité des politiques les plus expansionnistes.
b) Ces résultats viennent confirmer une partie des présupposés théoriques selon lesquels les politiques budgétaires restrictives seraient économiquement efficaces.
Deux variables clés seraient à l'oeuvre : les taux d'intérêt et les anticipations.
- Les taux d'intérêt : un rôle à ne pas surestimer.
La mise en oeuvre d'une politique budgétaire restrictive est susceptible de conduire à une baisse des taux d'intérêt :
- la réduction du besoin de financement des administrations publiques permet une réduction du montant net des émissions de titres publics. Il en résulte a priori une baisse du prix du capital - le taux d'intérêt - sur les marchés obligataires (ce que certains économistes traduisent en évoquant une réduction de l'"effet d'éviction") ;
- l'assainissement de la politique budgétaire réduit « l'effet boule de neige » de l'endettement public, donc le risque de répudiation de sa dette par l'Etat (soit directement par défaut de paiement, soit indirectement grâce à une relance de l'inflation ou grâce à une dévaluation si la dette est libellée en monnaie nationale). Ceci diminue la prime de risque de change et la prime de risque inflationniste attachées aux titres publics ou privés émis en monnaie nationale (en particulier à long terme).
- plus généralement, si la situation budgétaire est fortement dégradée, une politique de réduction des déficits publics est de nature à améliorer la crédibilité de la politique économique d'ensemble, ce qui peut également permettre aux autorités monétaires de réduire les taux d'intérêt directeurs ;
- enfin, lorsque la politique budgétaire restrictive exerce un impact récessif sur l'activité économique, ce phénomène est en lui-même susceptible de favoriser une baisse de l'ensemble des taux d'intérêt : d'une part, la diminution de l'investissement privé concourt avec la baisse des émissions de titres publics à une détente des taux de marché ; d'autre part, la contraction de la demande ralentit l'inflation, ce qui peut permettre aux autorités monétaires de réduire les taux d'intérêt de court terme.
La baisse des taux d'intérêt est favorable à la croissance.
La détente des taux d'intérêt stimule la demande privée : elle favorise l'investissement logement, elle enrichit les ménages (détenteurs nets d'actifs obligataires), ce qui accroît leur consommation, puis, en augmentant aussi bien la demande adressée aux entreprises que leur profitabilité (c'est-à-dire l'écart entre leur rentabilité et les taux d'intérêt), elle développe l'investissement.
Cependant, l'impact des taux d'intérêt ne doit pas être surestimé.
Les effets favorables d'une baisse des taux d'intérêt n'interviennent qu'après un délai d'ajustement (entre un an et un an et demi environ en France), au contraire des effets récessifs d'une baisse des dépenses publiques. En outre, l'ampleur de ces effets est a priori relativement modeste, comme l'illustrent les tableaux suivants :
Effets d'une baisse de 1 % de l'ensemble des taux
d'intérêt
selon le modèle Mosaïque de
l'OFCE
(en % d'écart par rapport au niveau qui aurait
été atteint sans cette baisse)
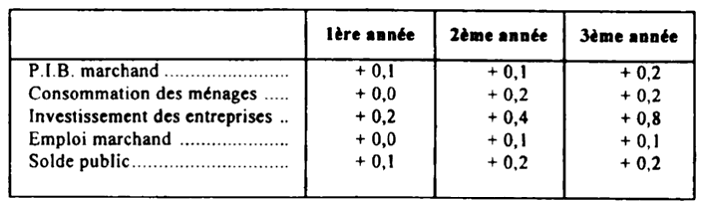
Effets d'une baisse de taux d'intérêt de
court terme de 1 % la première année
et 1,75 % la
deuxième année selon le modèle du C.O.E.
(en %
d'écart par rapport au niveau qui aurait été atteint sans
cette baisse)
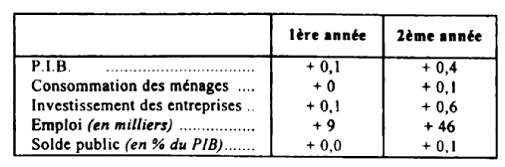
Les effets favorables de la détente des taux peuvent être plus importants dans deux configurations :
- pour des pays où la dette publique est très importante et libellée essentiellement à court terme : ainsi, une baisse de 1 % des taux d'intérêt réduit-elle le déficit public italien d'environ ½ point de PIB ;
- si la détente des taux exerce un « effet de signal » sur les anticipations des agents.
Les études empiriques entreprises par l'OCDE ou le CEPII sur l'ensemble des expériences d'ajustement budgétaire entreprises dans les pays de l'OCDE au cours des trente dernières années invitent au contraire à relativiser le rôle des taux d'intérêt : les taux d'intérêt nominaux se sont en moyenne peu modifiés dans les expériences étudiées.
Au contraire, compte tenu de l'impact désinflationniste parfois important des politiques budgétaires restrictives, les taux d'intérêt réels se sont en moyenne accrus durant les épisodes d'ajustement budgétaire recensés par ces institutions, même si cette évolution moyenne reflète des évolutions extrêmement divergentes.
Enfin, il est à noter que certains des mécanismes précédents, de nature à favoriser une détente des taux d'intérêt (accroissement de la crédibilité de la politique économique, réduction des risques inflationnistes) sont simultanément susceptibles de susciter une appréciation du taux de change, dont les effets sur l'activité contrebalanceraient partiellement ceux de la baisse des taux d'intérêt (cf. par exemple l'Italie en 1995-96).
- Les anticipations
Plusieurs arguments théoriques suggèrent que la mise en oeuvre d'une politique budgétaire restrictive pourrait dans certaines circonstances ne pas entraîner de contraction de la demande totale (donc de l'activité) : la baisse de la consommation et des investissements publics serait contrebalancée par une hausse de la consommation privée (c'est-à-dire une baisse du taux d'épargne des ménages).
En effet, dès lors que les agents ont le « souci du futur » , c'est-à-dire que leur consommation ne dépend pas de leur seul revenu courant, mais aussi de leurs anticipations de revenus futurs - leur « revenu permanent » -, et que le système financier leur permet d'effectuer aisément des arbitrages entre leur consommation actuelle et leur consommation future, une réduction des dépenses ou des déficits publics peut accroître la consommation privée selon les mécanismes suivants :
- Si les agents sont convaincus qu'une hausse des prélèvements fiscaux est inéluctable à moyen terme (pour stabiliser la dette publique), ils se sont déjà constitués une épargne supplémentaire en vue de ces impôts futurs. Inversement, l'annonce que l'ajustement budgétaire ne sera pas différé non seulement ne réduit pas la consommation (les agents puisent dans cette épargne accumulée), mais peut même l'accroître si la résolution aujourd'hui des difficultés budgétaires les rassure pour l'avenir ;
- De manière similaire, si une politique budgétaire restrictive réduit le risque d'une répudiation prochaine de la dette publique (par l'inflation ou la dévaluation) et d'une crise financière, cela augmente la probabilité d'une croissance saine à moyen terme, donc les revenus futurs des agents ; cette « bonne nouvelle » les incite à accroître immédiatement leur consommation ;
- En outre, si la politique budgétaire restrictive s'accompagne d'une diminution des dépenses publiques perçues comme improductives, les agents anticipent une meilleure allocation des ressources de la Nation et une augmentation de l'ensemble de leurs revenus disponibles futurs (c'est-à-dire de leur « revenu permanent »), ce qui est de nature à accroître immédiatement leur consommation.
Il est à noter que ces anticipations favorables sont en partie « autoréalisatrices » : si une majorité des agents estiment qu'une politique budgétaire « trop laxiste » était la cause principale des difficultés économiques et augmentent leur consommation à l'annonce d'une politique budgétaire restrictive, cette dernière est alors susceptible d'avoir un impact favorable sur la croissance.
Inversement, si une majorité d'agents est convaincue que la dégradation du solde budgétaire était seulement la conséquence de difficultés économiques, une réduction des dépenses et des transferts publics peut accroître leur pessimisme et augmenter leur épargne de précaution, ce qui amplifierait l'impact récessif de la politique budgétaire.
3. Les déficits publics nuisent à une allocation efficace des ressources.
Dans une approche dont le caractère théorique ne doit pas être dissimulé, les prélèvements obligatoires représentent une sorte de prix payé pour accéder aux dépenses publiques.
En cas de déficit public, le prix des biens publics est inférieur à leur coût.
Dans cette situation, la demande de services collectifs n'est pas aussi contrainte qu'elle le devrait et peut être considérée comme "insincère".
Tout se passe comme si les agents se comportaient en "passagers clandestins" : ils obtiennent des biens ou services sans en supporter le coût.
Les prélèvements obligatoires ne jouent plus leur rôle de révélateur des préférences. Dans une hypothèse extrême, l'offre de biens collectifs se développe sous l'effet d'une demande non contrainte jusqu'à ce que la contrainte de solvabilité se manifeste. Il peut y avoir alors transfert entre générations du fardeau du financement.
L'économie de la santé démontre le caractère pratique de telles approches 6 ( * ) . Mais de nombreux autres exemples pourraient être cités (niveau des pensions publiques, garanties des dettes des entreprises publiques...).
Rapprocher la dépense et le prix payé apparaît nécessaire pour améliorer l'allocation des ressources.
Les pays européens ont tous entrepris la nécessaire mise en ordre de leurs finances publiques.
Ces efforts ont sans doute un coût -à l'encontre de la situation des Etats-Unis, ce redressement n'est guère favorisé par un contexte économique dynamique-, mais le niveau devenu insoutenable de l'endettement public les impose.
La question de l'accompagnement de ces politiques budgétaires se pose toutefois.
Seule une meilleure coordination des politiques économiques en Europe, qu'elle s'exerce dans le domaine monétaire ou dans celui des revenus, permettra de lui donner une réponse appropriée.
De ce point de vue aussi la création prochaine d'une monnaie européenne unique et d'une politique monétaire européenne est, à l'évidence, une étape historique.
CHAPITRE III L'ÉQUILIBRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
Compte tenu de la subtilité des conventions budgétaires, trois tableaux simplifiés sont nécessaires pour résumer l'architecture du projet de loi de finances pour 1997 et permettre une analyse fine des dépenses, des recettes et du solde.
1. L'article d'équilibre
Sous forme simplifiée, l'article d'équilibre résulte du tableau suivant :
(en millions de francs)
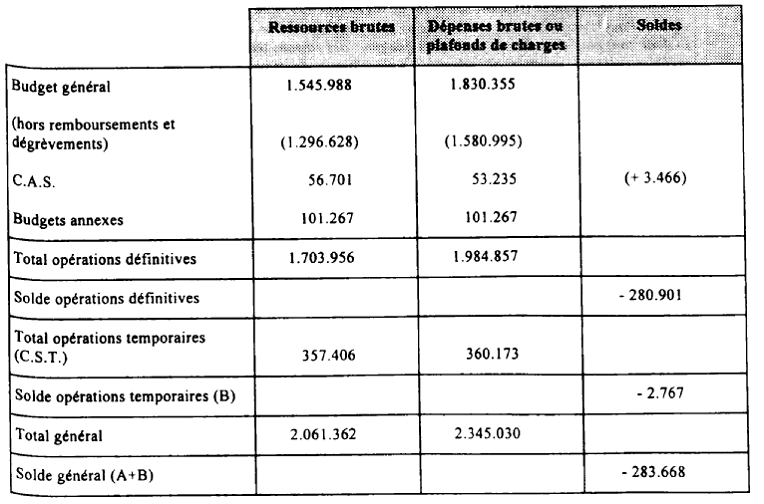
Ce tableau indique déjà que le budget de l'Etat, au sens large, dépasse 2.000 milliards de francs. Il est même encore supérieur à ce montant symbolique si l'on réintègre les prélèvements sur recettes pour 252,2 milliards de francs et les fonds de concours (pour mémoire : 61,3 milliards de francs en 1995 pour les fonds de concours "stricto sensu"). Si l'on additionne ces deux masses financières, le total du budget dépasse 2.300 milliards de francs. Il n'est pas douteux que cette agrégation confond des opérations de nature différente (dépenses et prêts par exemple) et comprend des "doubles comptes" (subvention BAPSA du ministère de l'agriculture en dépenses du budget général et en recettes du BAPSA) Il n'en demeure pas moins que deux observations générales en résultent :
|
? Contrairement à une opinion courante, le budget de l'Etat retracé dans le projet de loi de finances lato sensu est nettement supérieur au budget de la sécurité sociale tel que figurant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (1.684,9 milliards de francs de dépenses en 1997), et ce d'autant plus que 133,6 milliards de francs de ressources du budget de la sécurité sociale proviennent de concours de l'Etat. De surcroît, et grâce à un amendement de votre commission des finances sur le projet de loi de règlement pour 1994, on peut pour la première fois estimer pour l'année n+1 le produit des impositions de toutes natures affectées à des organismes de sécurité sociale, soit 224,635 milliards de francs en 1997. ? La non prise en compte des prélèvements sur recettes (au profit des collectivités locales et du budget européen) n'est guère satisfaisante au plan des principes comptables élémentaires, même si la formule est plus souple au regard de la portée du droit d'amendement. Comme à l'accoutumée (rapport sur la loi de règlement 1995), la Cour des Comptes persiste et signe : "Pour l'ensemble des prélèvements qui viennent d'être analysés, la Cour réitère son souhait, tant pour des raisons juridiques que pour des raisons techniques, de voir la formule de prélèvements sur recettes abandonnée, sous réserve de trouver un mode de présentation apportant des améliorations significatives à l'information parlementaire et à l'exercice des contrôles". |
2. La présentation synthétique
L'équilibre du projet de loi de finances s'établit comme suit :
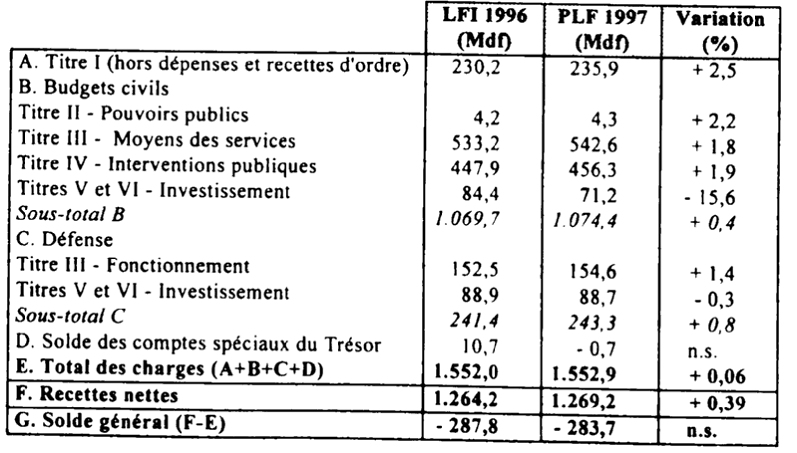
Cette présentation synthétique, qui fonde la plupart des débats de chiffres sur le budget, met en exergue trois points clefs du projet de loi de finances pour 1997 :
- la stabilisation des charges à 1.552,9 milliards de francs (+ 0,06 %),
- l'amélioration de plus de 4 milliards de francs du déficit budgétaire,
- les conséquences de la rebudgétisation des pensions de France Télécom (pour 9,41 milliards de francs).
3. La présentation détaillée
Charges budgétaires :
Les agrégats et leur taux d'évolution
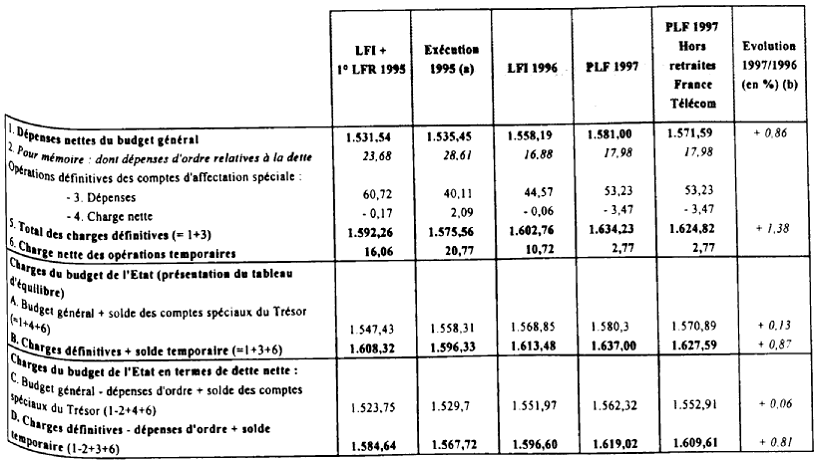
(a) Hors FMI et hors fonds de concours (égaux à 61,32 milliards de francs en 1995). Dépenses nettes du budget général y compris fonds de concours : 1.595, 77 milli ards de francs.
(b) PLF 1997 hors retraites France Télécom/LFI 1996
Les principales opérations de concordance sont les suivantes :
a) Les charges de la dette
Titre I Dette publique brute et garanties 253,8
- recettes d'ordre 17,98
= Titre I hors dépenses et recettes d'ordre = 235,9
- garanties et dépenses diverses 3,2
= Charges nettes de la dette = 232,6
b)Les dépenses nettes du budget
Dépenses nettes du budget général (art. d'équilibre) 1.581,00
- Effet France Télécom 9,41
- Dépenses d'ordre relatives à la dette 17,98
= 1.571,59
+ Solde des opérations définitives des C.A.S. - 3,47
+ Solde des opérations temporaires + 2,77
= Total des charges (présentation simplifiée) = 1.552,91
I. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
A. A LA RECHERCHE DE L'INDICATEUR PERTINENT
1. Malgré la nécessité d'une modernisation comptable...
La complexité des "tuyauteries" budgétaires ne permet guère de résumer en un seul chiffre l'évolution des dépenses d'une année sur l'autre. De plus, le caractère encore rustique des conventions comptables affecte la fiabilité de l'instrument de mesure. L'imprécision, évidente ou sollicitée, des opérations tantôt classées en trésorerie tantôt remontées "au-dessus de la ligne" complique encore l'analyse. Enfin, les imputations variables en dépenses budgétaires stricto sensu ou en dépenses de comptes spéciaux du Trésor affectent parfois sensiblement l'appréciation de l'évolution des charges de l'Etat.
Par la force des choses, deux budgets successifs sont rarement présentés "à structure constante" 7 ( * ) . Cette structure est d'autant plus déformée que la conjoncture se retourne ou qu'une alternance politique se produit. Lorsque ces deux phénomènes se conjuguent, l'exercice de comparaison peut relever simultanément de la mécanique de haute précision et de l'acte de foi, ainsi qu'en témoigne l'encadré ci-après.
|
Rapport de la Cour des comptes sur la loi de règlement 1994 "Toutefois, l'usage habituel, auquel la Cour se réfère généralement, consiste à comparer, en montant brut, c'est-à-dire sans contraction des masses, les crédits ouverts en projet de loi de finances initiale de l'année n à ceux de la loi de finances initiale de l'année n-1 (soit le taux de progression de 4,1 % des prévisions de dépenses brutes du budget général en 1994 signalé plus haut). La méthode adoptée par le gouvernement en 1994 s'est écartée de cet usage sur trois points : le projet de loi de finances 1994 a été comparé non pas au projet de loi de finances 1993, mais à la loi de finances rectificative de juin 1993 ; l'évaluation des charges budgétaires totales a été présentée en additionnant les dépenses brutes du budget général et le solde (dépenses-recettes) des comptes spéciaux du Trésor ; les documents de présentation ont fait apparaître pour la première fois des montants de recettes "hors recettes d'ordre" ce qui, par symétrie, conduit à ne tenir compte, pour les dépenses, que de la dette nette. La combinaison de ces trois points de méthode a permis d'aboutir à une présentation de l'évolution des dépenses, limitée a 1,1 % , conforme à celle de la loi d'orientation quinquennale". |
Ces difficultés récurrentes appellent deux observations :
a) La reconnaissance de l'utilité de la contribution apportée par la Cour des comptes au Parlement dans l'analyse précise et complète des exercices clos. A cet égard, le précédent de la "contribution" préalable à la tenue du débat d'orientation budgétaire doit être renouvelé. Par ailleurs, la réflexion sur un éventuel remplacement de la déclaration générale de conformité par une "certification" des comptes de l'Etat mériterait probablement d'être relancée.
b) Cette relance pourrait utilement compléter les travaux d'expertise commandés fort judicieusement par le ministre de l'économie et des finances.
|
Depuis la communication faite au conseil des ministres du 29 mai dernier par le ministre de l'économie et des finances, deux séries de travaux sont en cours pour élaborer des propositions tendant à intégrer dans la gestion de l'Etat les apports de la comptabilité patrimoniale : - un comité d'experts présidé par M. André Giraud, ancien ministre, a mené une large réflexion prospective dont le rapport sera remis au ministre en décembre ; - une mission interne au ministère de l'économie et des finances, animée par M. Guy Delorme, inspecteur général des finances, a coordonné les travaux conduits par les directions concernées du ministère (Budget, Trésor, Comptabilité publique, Direction générale des impôts). Son rapport sera remis au ministre en novembre. Il ressort de ces premiers travaux que les apports de la comptabilité patrimoniale sont d'un très grand intérêt dans deux directions : - La création d'une image fidèle de la situation des finances publiques. Les progrès dans ce domaine nécessiteront une coordination étroite avec nos partenaires européens. La consolidation des comptes des principaux groupes publics, en cours de réalisation, est une composante de cet axe d'amélioration qui vise à disposer d'une estimation plus complète et plus fiable du bilan et des engagements de l'Etat et du secteur public, compte tenu de leurs spécialités. - L'amélioration de la gestion publique. L'objectif est de progresser de la simple régulation par les autorisations de dépenses à un mode de gestion plus efficace fondé sur la connaissance des coûts complets des services publics qui puissent être rapportés à la mesure des services rendus. La modification du système comptable doit être intégrée par tous les décideurs publics, politiques ou administratifs, dans leur processus de décision. (Source : Ministère de l'économie et des finances) |
2. ...les indicateurs confirment l'inflexion remarquable de 1997
a) De manière traditionnelle, deux indicateurs principaux sont utilisés :
L'indicateur retenu par le gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances (dépenses du budget général + solde des opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale), hors effet "France Télécom" 8 ( * ) , affiche 1.552,9 milliards de francs de charges pour 1997 contre 1.551,97 en loi de finances initiale pour 1996. Il y a donc bien une stabilisation des charges, pour la première fois dans l'histoire budgétaire de la Vème République.
L'indicateur élaboré par l'Assemblée nationale, qui prend en compte non pas le solde mais le montant des dépenses à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale, affiche 1.609,6 milliards de francs pour 1997 contre 1.596,6 milliards de francs pour 1996, soit une variation de + 0,8 %, inférieure à la hausse des prix prévisible. Il y a donc toujours stabilité, et même régression en francs constants.
b) D'autres instruments de mesure peuvent être envisagés.
A partir des deux indicateurs ci-dessus évoqués, il demeure possible de construire des variantes, prenant -par exemple- en compte ou non les recettes de privatisation affectées à des dotations en capital.
Sur l'initiative heureuse du ministre de l'économie et des finances, il est en outre dorénavant envisageable de créer une "troisième famille" d'indicateurs de progression des dépenses fondée sur la présentation du budget en section de fonctionnement et section d'investissement. Sur la base de cette nouvelle présentation, les dépenses de la section de fonctionnement passeraient de 1.643 milliards de francs en 1996 à 1.655 milliards de francs en 1997, celles de la section d'investissement de 442 à 568 milliards de francs (y compris les opérations financières).
B. LA TRADUCTION FINANCIÈRE DE CHOIX POLITIQUES COURAGEUX
1. Une stabilisation générale qui préserve les priorités du gouvernement
Ainsi que le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, après une période de forte augmentation des dépenses (+ 5,5 % en moyenne annuelle entre 1988 et 1995), le projet de loi de finances pour 1997 prévoit une stabilité des dépenses en francs courants.
a) L'effort de maîtrise des dépenses concerne l'ensemble du budget
Une douzaine de budgets, soit un tiers du total, augmenteront en 1997, conformément aux priorités fixées par le gouvernement. Il s'agit notamment des budgets du Travail, de la Justice, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de l'Action sociale et solidarité, de l'Outre-mer, de l'Environnement, de la Recherche. Le budget de la Défense est également en augmentation, en application de la loi de programmation militaire.
Les deux-tiers des budgets (plus d'une vingtaine) diminueront en 1997. De même, la charge nette des comptes spéciaux du Trésor est réduite de près de 10 milliards de francs. Outre les mesures d'économie spécifiques à chaque budget, des mesures générales ont été appliquées. Il s'agit des réductions d'effectifs (notamment dans les administrations centrales), de l'étalement sur une année supplémentaire des contrats de plan Etat-régions, de l'étalement des lois de programmation civiles (justice, police, patrimoine) et de la consolidation partielle de la régulation budgétaire de 1996.
b) L'évolution des charges liées à la dette et au personnel est infléchie
La charge nette de la dette s'établit à 232,6 milliards de francs, en progression de 2,8 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1996 et de 5 % environ par rapport à l'exécution prévisible du budget 1996. Cette prévision, qui marque un ralentissement de la progression de la charge de la dette par rapport aux évolutions des dernières années, est permise essentiellement par la baisse des taux d'intérêt à court terme enregistrée en 1996.
Les dépenses de personnel s'élèvent à 583,1 milliards de francs, en progression de 16 milliards de francs (+ 2,8 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 1996. Les effectifs de la fonction publique civile sont en diminution de 5.600 postes budgétaires par rapport à 1996, ce qui représente une économie de 0,8 milliard de francs et contribue à une maîtrise structurelle des dépenses.
c) Les dépenses d'intervention les plus lourdes sont recentrées sur les priorités du gouvernement
Les dépenses pour l'emploi atteignent 150,3 milliards de francs, en progression de 8 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1996.
Toutefois cette progression est nettement ralentie par rapport aux tendances de 1996, et ce grâce à plusieurs mesures de recentrage : accès du contrat initiative emploi réservé aux publics connaissant les difficultés les plus graves (- 5,3 milliards de francs), renégociation des conditions de cofinancement avec l'UNEDIC de l'allocation formation reclassement (- 2,6 milliards de francs), modification des critères d'éligibilité à l'allocation de solidarité spécifique (- 470 millions de francs)...
Au total, les économies pratiquées sur la masse tendancielle du budget du travail -soit la "révision des services votés"- atteignent 13,5 milliards de francs.
d) L'effort budgétaire de l'Etat en faveur du logement.
Cet effort s'élèvera en 1997 à 53,3 milliards de francs, en hausse de 1,5 % 9 ( * ) . Une partie de cet effort (4,5 milliards de francs en crédits de paiement) est retracée sur trois comptes d'affection spéciale pour le financement de l'accession à la propriété, le logement des personnes en difficultés et l'aménagement de la région Ile-de-France. Le projet de loi de finances prévoit en effet de mobiliser des ressources nouvelles (7 milliards de francs) issues de la collecte du "1 % logement" pour financer l'accession à la propriété qui a été profondément réformée en 1995 avec la mise en place du prêt à taux zéro, et d'affecter 450 millions de francs issus du prélèvement sur les surloyers de solidarité en faveur du logement des plus démunis. Par ailleurs, les subventions pour les prêts locatifs aidés neufs seront supprimées, en contrepartie de l'application du taux réduit de TVA, au lieu du taux normal, aux travaux de construction de logements locatifs sociaux.
2. Les engagements pris lors du débat d'orientation budgétaire sont respectés
a) Faire fondre les "boules de neige"
Dans le rapport déposé par le gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire, un tableau mettait en évidence la nécessité de dégager 61,4 milliards de francs d'économies sur les dépenses non inscrites dans la catégorie "boule de neige" aux fins de stabiliser le total des charges nettes du budget entre 1996 et 1997. Ce montant est le résultat de la différence entre 311 milliards, soit le total des "autres dépenses" inscrites pour 1996, et 249,6 milliards, soit l'objectif à atteindre pour les "autres dépenses" en 1997 pour stabiliser la progression des charges nettes du budget.
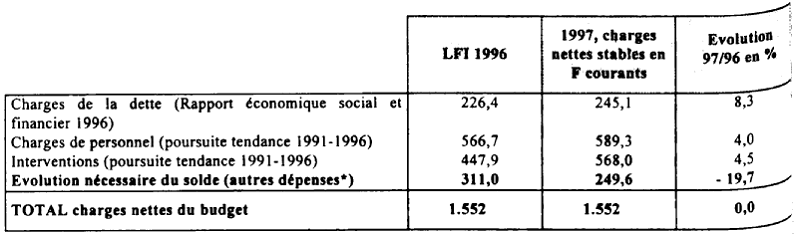
* Les autres dépenses comprennent certaines dépenses de fonctionnement et l'équipement civil et militaire.
Le tableau ci-après permet de comparer les réalisations aux objectifs :
(en milliards de francs)
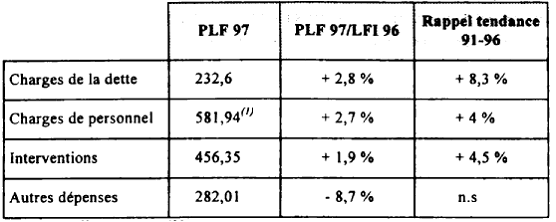
(1) Hors effet France Télécom
Ce tableau met clairement en évidence les inflexions apportées à la dérive tendancielle des dépenses. L'effort sur les "autres dépenses", de près de 29 milliards de francs (311 - 282,01), provient pour une bonne part de la baisse de l'effort d'investissement (- 13,2 milliards), mais aussi de l'effet positif des comptes spéciaux du Trésor (- 11,4 milliards) et des économies sur certaines dépenses de fonctionnement du titre III (- 4,7 milliards de francs).
b) L'objectif ambitieux que s'était assigné le gouvernement a été atteint grâce à trois types de mesures :
- freinage sur le "tendanciel" (dette, personnel, interventions) ;
- économies sur les autres dépenses ;
- modification d'imputation comptable de certains postes.
Il est toutefois difficile de différencier, par poste, l'effet du freinage sur le tendanciel, des économies diverses et des crédits supplémentaires qui se sont révélés nécessaires.
c) Les principales modifications d'imputation comptable consistent dans la création de deux comptes d'affectation spéciale dans le secteur du logement (CAS n° 902-29 et 902-30 pour des dépenses de l'ordre de 4 milliards de francs en 1997). Elles résultent aussi de substitutions de dotations en capital à des crédits budgétaires comme, par exemple, à l' industrie. Dans ce second cas, le rapporteur spécial, notre collègue Bernard Barbier observe à juste titre que :
"Dans le seul budget de l'industrie, trois postes voient leurs dotations réduites au motif que des dotations en capital, inscrites sur compte d'affectation spéciale, viendront en compenser la baisse : la subvention de fonctionnement à Charbonnages de France, avec une dotation en capital promise de 2,44 milliards de francs, la subvention d'investissement au Commissariat à l'énergie atomique, avec une dotation prévue de 350 millions de francs, les crédits de reconversion des zones minières, avec une dotation annoncée de 160 millions de francs. Ces trois "débudgétisations" permettent une économie proche de 2 milliards de francs sur le budget de l'industrie.
Or, le versement effectif des dotations en capital annoncées sera très fortement lié au produit des privatisations qui seront réalisées en 1997, ainsi qu'à leur rythme d'encaissement. Aussi, votre rapporteur regrette cette procédure et le caractère aléatoire qui s'attache de ce fait à la disponibilité de crédits qu'il considère importants".
Au total, ces modifications comptables sont toutefois d'une portée modeste au regard des économies réellement enregistrées.
Les mesures d'économie du projet de loi de finances pour 1997 peuvent être présentées selon deux méthodes :
- Les mesures peuvent être présentées par rapport à la reconduction des crédits. Cette notion, qui a été retenue au moment du débat d'orientation budgétaire, correspond aux crédits nécessaires pour les dépenses inéluctables (personnel, dette, ...) et la poursuite à structure constante des politiques publiques. Dans ce cadre, le montant total des économies est de 59,9 milliards de francs sans prendre en compte les prélèvements sur les recettes de l'Etat 10 ( * ) .
Présentation fonctionnelle des mesures d'économie
(En milliards de francs)
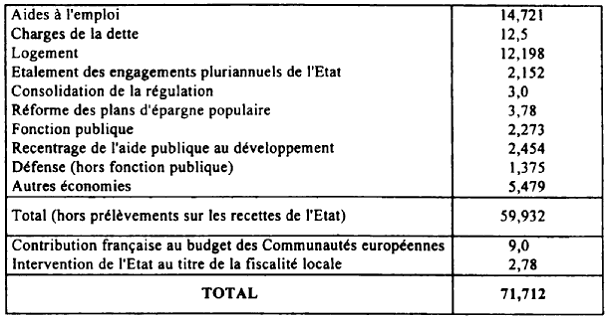
- La présentation peut également être effectuée selon les catégories juridiques de mesures utilisées pour le projet de loi de finances. Hors prélèvement sur les recettes de l'Etat, les économies sont chiffrées à 60,25 milliards de francs. L'écart par rapport au mode de présentation précédent tient notamment à un recensement plus exhaustif des révisions de services votés.
Présentation par catégorie d'économies
(En millions de francs)
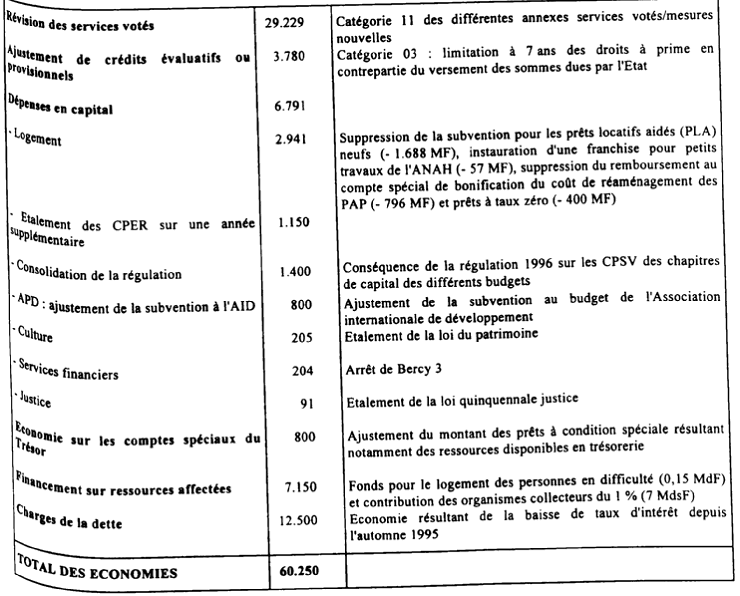
Source : Ministère de l'économie et des finances
C. L'ART DIFFICILE DU PILOTAGE BUDGÉTAIRE
1. Le maintien d'un cap
La faiblesse de la conjoncture, la révision de la politique de défense, l'évolution rapide des dépenses d'intervention sociale, le poids de la dette et la nécessité d'un assainissement prononcé des finances publiques conduisent à reconfigurer plusieurs objectifs pluriannuels ou structurels. Sans prétendre à l'exhaustivité, quelques points peuvent être mis en évidence :
a) La programmation des crédits militaires
Les tableaux ci-après témoignent des écarts significatifs observés tant entre la programmation et la loi de finances initiale qu'entre la loi de finances votée et la loi de finances exécutée pour le titre V du budget de la défense. La complexité des mécanismes de reports, de fonds de concours et d'annulations ne saurait occulter le fait que le budget de la défense peut apparaître comme une variable d'ajustement du budget de l'Etat. La nouvelle loi de programmation militaire devrait mettre un terme à ces pratiques de régulation. La Cour des Comptes s'est montrée peu amène dans ses observations sur la gestion des crédits militaires en 1995.
TITRE V - BUDGET DE LA DEFENSE
Évolution
1990
-
1996
Ecarts programmations - LFI
CP en millions de francs courants
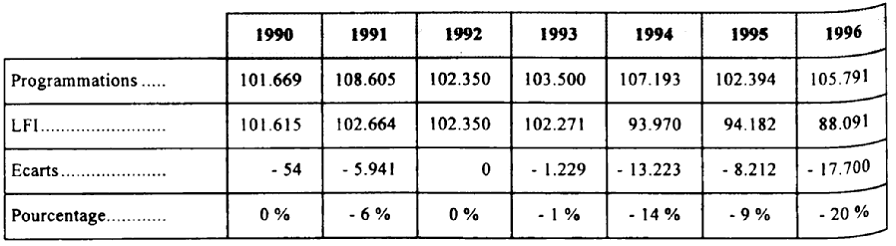
(Pour 1992-1994, projet de loi de programmation, resté à l'état de projet)
Ecarts LFI - Crédits consommés
CP en millions de francs courants
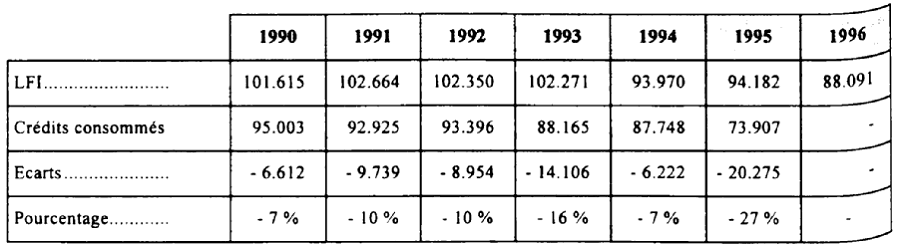
Annulations
CP en millions de francs courants
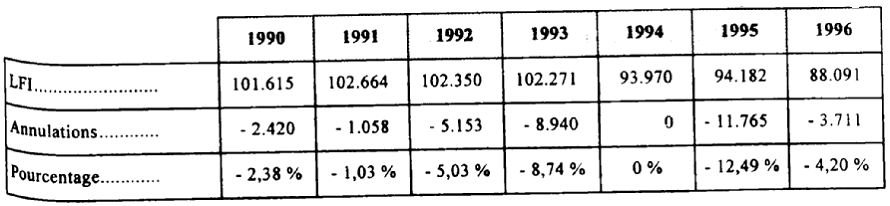
Reports
CP en millions de francs courants
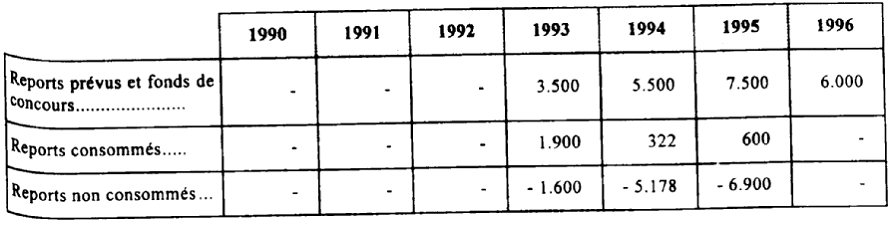
b) Les lois de programmation civiles
L'économie permise par l'étalement de la loi de programmation sur le patrimoine serait de 205 millions de francs, par celui de la loi de programmation sur la justice de 101 millions de francs et par celui de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité de 320 millions de francs (au total : 626 millions de francs).
Pour la loi de programmation sur la justice, l'étalement sur un an complémentaire de la programmation 1995-1999 implique que, dans le projet de loi de finances pour 1997, les mesures nouvelles soient inférieures au cinquième des mesures préconisées par le programme pluriannuel.
Ainsi, le montant total des autorisations de programme pour 1997 est de 1.357 millions de francs, correspondant au sixième du montant total des autorisations de programme prévues par la loi de programme.
Par ailleurs, le déficit de créations d'emplois par rapport à la programmation quinquennale permet de réaliser une économie de 31,5 millions de francs.
En ce qui concerne la loi de programme sur le patrimoine (1993-1998), la baisse des dotations des titres V et VI pour 1997 (- 34 % en autorisations de programme), soit 1.077,52 millions de francs, au lieu de 1.647,77 millions de francs en 1996, traduit la répartition sur une période de trois ans de l'effort budgétaire prévu au titre des deux dernières années de la loi de programme sur le patrimoine 11 ( * ) .
c) L'objectif du "1 % culturel"
L'objectif d'un budget de la culture à 1 % du budget de l'Etat est globalement atteint en 1996 et 1997, mais après des rattachements de crédits qui rendent malaisée l'interprétation des évolutions. Toutefois une analyse plus fine des concours de diverses natures (dépense fiscale, notamment en faveur des SOFICA, modalités de calcul des prestations chômage des "intermittents du spectacle") mettrait mieux en lumière l'importance du financement public et assimilé de la politique culturelle de la France.
Le premier "jaune" 12 ( * ) sur l'effort financier de l'Etat en matière culturelle évalue à plus de 50 milliards de francs cet effort, soit largement plus de 1 %. La lecture de ce document de synthèse vient, et au-delà, compenser les conclusions moroses qui pourraient résulter de la lecture de l'encadré ci-après.
|
L'effort financier de l'Etat en matière culturelle PLF 1996 : DO + CP (dépenses ordinaires + crédits de paiement) : 15,54 milliards de francs, soit 1 % du budget général PLF 1997 : DO + CP : 15,077 milliards de francs, soit 0,97 % du budget général Mais : en 1996 : Transfert au ministère de la Culture pour 1,9 milliard de francs : - de l'architecture (724 millions de francs), - des orchestres de Radio France (357 millions de francs), - de l'INA (70 millions de francs), - de la Sept/Arte (265 millions de francs), - de la Cité des Sciences et de l'industrie (542 millions de francs). Hors transfert de compétences, le budget Culture n'était que de 13,640 milliards de francs, soit moins de 1 %. en 1997 : Transfert au ministère de la Culture pour 900 millions de francs des bibliothèques des collectivités territoriales. Hors transfert de compétences, le budget Culture ne serait que de 14,177 milliards de francs en 1997, soit moins de 0,97 %. |
d) L'étalement des contrats de plan Etat-régions (CPER)
Cet étalement porte sur 376 millions de francs (dont 176 millions de francs sur le budget de l'Agriculture et 186 millions de francs sur celui du ministère du Travail) en révision de services votés et sur 1.150 millions de francs en "économies" sur mesures nouvelles. L'effet global de l'étalement d'un an des CPER est donc de 1,526 milliard de francs.
2. L'appréciation de l'évaluation de certaines dotations
La conjonction de mécanismes infra annuel (régulation budgétaire) et supra annuelle (programmation budgétaire) témoigne de la difficulté du pilotage des finances publiques.
L'évaluation de l'adéquation des crédits inscrits en projet de loi de finances aux besoins prévisibles est un exercice d'une difficulté comparable. Le projet soumis à notre examen ne souffre d'aucune critique de fond relative à une sous-évaluation manifeste de certaines dotations. Toutefois, il ne saurait être exclu que des tensions se manifestent sur les postes suivants :
a) La fonction publique
L'arbitrage est délicat à réaliser entre la sincérité budgétaire et l'efficacité de l'Etat dans la négociation. On notera que la "marge de manoeuvre" apparente de 2 milliards de francs permet déjà de financer une augmentation de 0,33 point d'indice en année pleine.
b) Les dotations en capital aux entreprises publiques
Si l'on raisonne globalement sur les deux exercices 1996 et 1997, l'adéquation entre les recettes de privatisation et les dotations en capital peut sembler problématique. Les recettes disponibles s'établissent, à la fin septembre, à 2,8 milliards de francs pour 1996 et sont estimées à 25,65 milliards de francs pour 1997 (27 milliards de francs en intégrant le montant des commissions), hors cession éventuelle de participations minoritaires.
Les dépenses sont liées aux privatisations après recapitalisation (Thomson, CGM, SFP, SMC...), à la dotation Réseau Ferré National, aux changements de mode de financement (Charbonnages de France...), aux besoins des entreprises de défense, aux difficultés rencontrées par les entreprises du secteur public financier (GAN, Crédit lyonnais...), au rachat des actions du Crédit foncier de France à la Caisse des dépôts et consignations.
Lors de son audition devant votre commission des finances, le ministre de l'économie et des finances a indiqué que les 27 milliards de francs inscrits constituaient une indication prévisionnelle et qu'il était encore prématuré de se préoccuper de trouver d'autres moyens pour financer un éventuel surcroît de dotations aux entreprises publiques.
En tout état de cause, les dotations en capital absorberont la totalité des recettes de privatisations dont aucune part ne pourra être affectée au désendettement de l'Etat.
c) L'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement sociale
Comme c'est le cas depuis que les allocations sont accordées sous seule condition de ressources, les crédits inscrits (29,7 milliards de francs) sont inférieurs à ceux qui ont été effectivement consommés au cours de l'exercice précédent (29,9 milliards de francs). La modification du barème de ces aides peut néanmoins justifier en partie le niveau des dotations prévues.
d) Les aides à l'emploi
La loi dite " de Robien " du 26 juin 1996 sur l'aide à la réduction du temps de travail voit ses effets budgétaires estimés à 0,8 milliard de francs, ce qui pourrait se révéler "juste" au regard du succès rencontré par ce dispositif. De même, la diminution du nombre d'entrées en contrat emploi-solidarité de 70.000 en 1997 suppose que les candidats aux CES soient orientés vers de nouveaux dispositifs tels que les emplois de ville.
II. LA PROGRESSION DES RECETTES
A. LA PROGRESSION GÉNÉRALE DES RECETTES
1. L'évolution différenciée des recettes fiscales et non fiscales
Les recettes nettes du budget général s'élèveraient à 1.296,6 milliards de francs et s'accroîtraient de 1,3 % par rapport aux recettes nettes pour 1996 révisées par rapport aux évaluations de la loi de finances initiale.
Les recettes fiscales nettes progresseraient de 1,1 % à 1.394 milliards de francs, sous l'effet d'une croissance des recettes fiscales brutes de 1,2 % et d'une augmentation des remboursements et dégrèvements qui viennent en diminution de ce montant, de 1,6 %.
Les recettes non fiscales connaîtraient une croissance plus rapide, de + 5,4 %, et atteindraient 155 milliards de francs. Leur part dans le total des recettes nettes varierait positivement, passant de 10,7 à 11,1 %.
Les prélèvements sur les recettes de l'Etat s'élèveraient à 252 milliards de francs, en augmentation de 2,9 %, sous l'effet d'un accroissement des prélèvements au profit des Communautés européennes (+ 5,4 %), plus important que celui des prélèvements au profit des collectivités locales (+ 2,9 %)
2. Une faible révision apparente des évaluations de recettes en 1996
Les révisions apportées aux estimations de la loi de finances initiale pour 1996 conduisent à réduire le montant des recettes nettes totales du budget général de 800 millions de francs. Cette révision minime cache des réestimations de plus grande ampleur, dont l'encadré ci-après rend compte.
|
Révision des évaluations de recettes pour 1996 Les recettes fiscales brutes devraient dégager une moins-value de 18,7 milliards de francs, l'essentiel venant de la TVA dont le produit s'établirait à 730,6 milliards de francs contre une prévision de 761,6 milliards de francs (- 31 milliards de francs). Cette moins-value annoncée dans le rapport réalisé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire serait compensée par des recettes d'impôts directs -impôt sur le revenu et surtout impôt sur les sociétés- supérieures aux estimations initiales. En ce qui concerne les remboursements et dégrèvements, ils seraient inférieurs de 4,1 milliards de francs aux prévisions initiales en raison d'une surestimation des remboursements de TVA. Les recettes non fiscales produiraient plus que prévu : 147,1 milliards de francs, soit un écart de 14,7 milliards de francs. Enfin, les prélèvements sur recettes auraient été surestimés de 7,6 milliards de francs, situation résultant pour l'essentiel du prélèvement au profit des Communautés européennes pour lequel la surestimation s'élèverait à 4,5 milliards de francs. Avec 1.378 milliards de francs en 1996 (1.401,1 milliards de francs avaient été initialement prévus), les recettes fiscales nettes représenteraient 17,45 % du PIB contre 16,95 % du PIB en 1995 (+ 0,5 point du PIB). La tendance à l'infléchissement de la pression fiscale de l'Etat serait ainsi suspendue en 1996. De même, les recettes fiscales disponibles pour financer les dépenses de l'Etat -recettes fiscales nettes moins prélèvements- s'élèveraient à 14,35 % du PIB au lieu de 13,9 % en 1995. Les recettes totales de l'Etat (fiscales et non fiscales) passeraient, elles, de 16 % du PIB à 16,2 % du PIB. En conséquence, la contribution pour 1996 des recettes fiscales nettes à la réduction du déficit public s'élève à 0,45 point de PIB. La baisse de la part des recettes non fiscales dans le PIB réduit toutefois la contribution de l'ensemble des recettes de l'Etat à la diminution du déficit budgétaire qui ne serait plus que de 0,2 point de PIB. Quoi qu'il en soit, avec une progression de 5,9 % des recettes fiscales en 1996 contre 3,9 % pour le PIB, l'élasticité des impôts par rapport au PIB 13 ( * ) serait en 1996 largement supérieure à l'unité (1,9). Toutefois, ce phénomène proviendrait exclusivement des hausses d'impôts décidées à l'été 1995, sans lesquelles la pression fiscale de l'Etat aurait poursuivi sa décrue. |
B. LA PROGRESSION DES RECETTES FISCALES
Évolution des recettes fiscales par rapport aux estimations révisées pour 1996
(En milliards de francs)
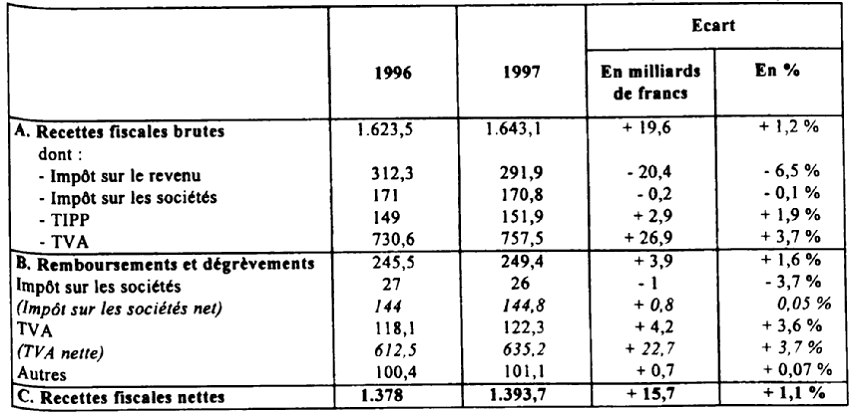
Exprimées en points de PIB, les recettes fiscales passeraient, entre 1996 et 1997, de 20,6 à 20,1 % pour les recettes fiscales brutes et de 17,45 à 17,05 % pour les recettes fiscales nettes.
La pression fiscale de l'Etat reprendrait donc son mouvement d'atténuation et l'élasticité des recettes fiscales par rapport au PIB serait inférieure à 1.
Si la part des dépenses publiques dans le PIB devait rester inchangée, l'évolution des recettes fiscales se traduirait ainsi par un creusement spontané du déficit public.
1. La diminution sensible du produit de l'impôt sur le revenu
Le produit de l'impôt sur le revenu (291,9 milliards de francs) diminuerait de 20,4 milliards de francs (- 6,5 %) par rapport à 1996. Il ne représenterait plus que 20,1 % des recettes fiscales nettes contre 22,7 % en 1996, sa part dans le PIB déclinant de 3,95 à 3,57 %.
Hors effet des aménagements de droits, la progression du produit de l'impôt sur le revenu serait de 9,6 milliards de francs (+ 3,1 %).
Mais, les mesures prises avant 1997 ajoutées aux mesures du projet de loi de finances pour 1997 se traduiraient par rapport à cette tendance par une réduction nette du produit de l'impôt sur le revenu de 30 milliards de francs. Hors effets de l'indexation du barème, la réduction nette du produit de l'impôt par rapport à sa tendance s'élèverait à environ 23,3 milliards de francs.
L'ensemble des émissions de rôles au titre des revenus perçus en 1996 dont l'évaluation tient compte des effets des modifications législatives importantes apportées cette année devrait progresser de 2,1 % par rapport à celles correspondant aux revenus perçus en 1995.
Cette évaluation peut être jugée assez soutenue -même si l'on tient compte d'une légère sous-indexation (0,2 point) des tranches du barème- si l'on prend en compte que le revenu disponible des ménages devrait croître de 2,5 % en 1996 (+ 0,4 % en pouvoir d'achat soit + 134,6 milliards de francs) et que les réformes législatives pèseront sur la progression du produit de l'impôt (- 23,3 milliards de francs). Elle suppose une élasticité fiscale légèrement supérieure à l'unité.
|
Une variante réalisée pour le Sénat par l'Observatoire français des conjonctures économiques illustre l'impact économique de la mesure d'allègement de l'impôt sur le revenu. On suppose l'annulation de la mesure de réduction sur cinq ans de l'impôt sur le revenu. (On raisonne donc en écart par rapport à la projection centrale qui intègre cette réduction sur cinq ans de l'I. R.). ? Impact sur l'activité et l'emploi : On constate qu'en 1998 le PIB serait inférieur de 0,4 % et en 2001 de 0,9 %. Autrement dit, l'impact positif de la mesure de réduction de l'I. R. peut être évalué à 0,2 point de croissance par an à partir de 1997. L'impact positif sur l'emploi total en 2001 est évalué, par le modèle, à 77.000 nouveaux emplois (ce qui correspond à une diminution de 49.000 du nombre de chômeurs). ? Impact sur les finances publiques Le coût total de la mesure d'allègement représente 0,8 % du PIB en 2001. Toutefois, compte tenu de son incidence positive sur l'activité et les rentrées fiscales, le solde public ex post n'est dégradé que de 0,5 % du PIB à cette date (0,3 % en 1997). Sans cette mesure, le solde public en 2001 tel qu'on peut le déduire des scénarios réalisés par l'OFCE serait de 2,3 % du PIB (au lieu de 2,8 %) dans un scénario de croissance faible et de 1,9 % (au lieu de 2,4 %) dans un scénario de croissance plus dynamique. |
2. La stabilité du produit de l'impôt sur les sociétés
Le produit de l'impôt sur les sociétés resterait stable par rapport à 1996. Le produit net s'élèverait à 144,8 milliards de francs et passerait de 1,82 à 1,78 % du PIB.
L'évaluation initiale du produit de l'impôt sur les sociétés pour 1996 avait considérablement sous-estimé (de près de 10 %) les recettes que devrait dégager cet impôt en réalité.
L'estimation pour 1997 doit donc être considérée avec précaution. Elle tient compte d'une évolution spontanée du produit de l'impôt modérément dynamique (+ 5,1 %) et de mesures d'aménagement fiscal qui pèseraient sur son niveau.
3. La progression modérée du produit de la TIPP
Le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers s'accroîtrait de 1,9 %.
A législation inchangée, malgré un accroissement global de la consommation de supercarburant, de gazole et de fioul domestique de 3,2 %, le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers resterait stable. Ce résultat proviendrait de la poursuite de la modification de la structure des consommations en faveur des produits relativement moins taxés. La consommation de gazole et de fioul domestique passerait ainsi de 70,6 % à 72 % du total.
Le relèvement proposé des tarifs de la taxe permettrait d'accroître son produit de 1,9 % et viendrait donc compenser partiellement les effets de la déformation de la base taxable sur l'élasticité de l'impôt.
4. La progression sensible du produit net de la TVA
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée s'accroîtrait de 3,7 %.
En 1996 les recettes nettes de TVA s'accroîtraient de 8,7 %, passant de 563,6 à 612,5 milliards de francs.
Hors effet du relèvement du taux normal de TVA, l'évolution des recettes nettes de TVA aurait été négative en 1996. Pour expliquer ce résultat qui surviendrait dans un contexte de croissance de la base taxable (+ 2,7 %), il faut tenir compte :
- de la forte progression des remboursements de TVA entre 1995 et 1996 (+ 12,5 milliards de francs) qui correspondent à la part de la TVA déductible supérieure à la taxe facturée (crédits non imputables aux crédits des exportateurs sur l'Etat) ;
- et de l'effet négatif de l'évolution de la base taxable au mois de décembre 1995 sur les recettes de TVA du mois de janvier 1996.
Pour 1997 la progression de la base taxable à la TVA est bâtie sur les hypothèses suivantes :
- consommation des ménages : + 2,9 % ;
- formation brute de capital fixe des ménages : + 2,5 % ;
- consommation intermédiaire des administrations : + 2,8 % ;
- formation brute de capital fixe des administrations : + 2,3 % ;
- formation brute de capital fixe des institutions de crédit et assurances : + 21,8 %.
La reprise de l'investissement des entreprises se traduirait, elle, par une augmentation importante des remboursements de TVA.
La part de la TVA dans le PIB s'élèverait à 7,77 % contre 7,76 % en 1996. Elle serait donc stabilisée.
Ce résultat reste cependant un peu aléatoire.
Ainsi en 1995, la part de la TVA dans le PIB s'est élevée à 7,34 %. En faisant abstraction du relèvement du taux normal, elle se serait élevée en 1996 à 7,1 % du PIB et se serait donc infléchie de 0,33 point de PIB spontanément. Or, la composition de la croissance en 1996 se révélerait plus porteuse de recettes de TVA que celle de 1997.
En toute hypothèse, l'essentiel en ce domaine dépendra de la croissance de la consommation des ménages dont le profil en 1997 dépend du maintien de leur taux d'épargne à un niveau historiquement bas.
|
Les résultats d'une variante fiscale
réalisée par l'Observatoire français
La variante a consisté à substituer à l'allègement de l'impôt sur le revenu une diminution à due concurrence de la T.V.A. Les principaux résultats seraient les suivants : L'effet sur l'activité serait positif : le niveau du PIB en 2001 serait supérieur de 0,3 % (et l'emploi de 12.000) par rapport à un scénario avec allègement de l'I. R. Cela porterait à 1,2 % l'augmentation du niveau du PIB en 2001, à 90.000 l'augmentation de l'emploi et à 60.000 la diminution du chômage, par rapport à un scénario sans aucun allègement de fiscalité. Les canaux par lesquels transitent les effets positifs sur l'activité d'une baisse de la TVA sont les suivants : - la baisse des prix, donc l'augmentation de la compétitivité et des exportations ; - la baisse du taux d'épargne (en raison de la désinflation), donc le surcroît de consommation ; - enfin le surcroît d'investissement des entreprises, comme conséquence des deux facteurs précédents. La mesure est enfin légèrement plus favorable pour le solde public (0,1 % du PIB en 2001) que la mesure d'allègement de l'impôt sur le revenu, en raison de son impact un peu plus favorable sur l'activité. Ces résultats, qui font apparaître un impact d'une baisse de la TVA plus favorable que celui d'un allègement de l'impôt sur le revenu, doivent cependant être considérés avec une grande prudence. Les comportements de marge des entreprises nationales, les réponses apportées par les concurrents internationaux à une dégradation de leur compétitivité ou encore les effets d'une telle mesure sur le taux d'épargne des ménages sont autant de variables centrales dont l'orientation ne peut guère être maîtrisée et est susceptible de changer du tout au tout le diagnostic relatif à la mesure envisagée. |
C. L'ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
Évolution des prélèvements sur les recettes de l'Etat
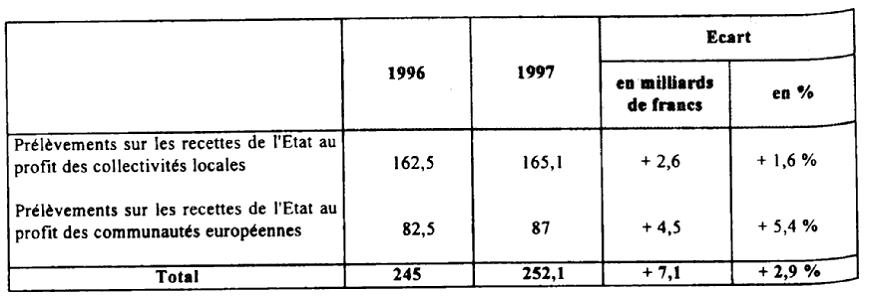
Les prélèvements sur les recettes de l'Etat progresseraient de 2,9 % soit davantage que l'ensemble des recettes disponibles (+ 1,5 %).
1. Les prélèvements au profit des collectivités locales
Pour près de 65 %, les prélèvements sur recettes sont composés de prélèvements au profit des collectivités locales. Ils s'accroîtraient de 1,6 % soit légèrement plus que les recettes nettes de l'Etat.
Parmi eux, le prélèvement au titre de la dotation globale de fonctionnement représente plus de 63 % de l'ensemble et s'accroîtrait de 1,26 %. La très faible croissance du volume du PIB en 1996 freinerait la progression du prélèvement. Le mode d'indexation choisi qui conduit à un décrochage structurel de la DGF par rapport au PIB amplifie cet effet en période de reprise économique et conduit à dissocier l'évolution de la ressource et celle de l'activité économique.
Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle diminuerait de 1,3 milliard de francs sous l'effet de la disposition projetée en matière de compensation de la réduction pour embauche et investissement consistant à en limiter le champ d'application (1,62 milliard de francs).
2. Le prélèvement au profit du budget des Communautés européennes
Le prélèvement au profit du budget des Communautés européennes augmenterait de 4,5 milliards de francs dans un contexte de stabilisation des dépenses du budget européen. Sa progression serait toute entière le résultat d'une exécution 1996 inférieure aux prévisions du fait des difficultés d'exécution du budget communautaire et d'une surestimation des recettes communautaires provenant d'un écart entre la prévision des bases PNB et TVA et leur évolution constatée.
D. L'ÉVOLUTION DES RECETTES NON FISCALES
Évolution des recettes non fiscales
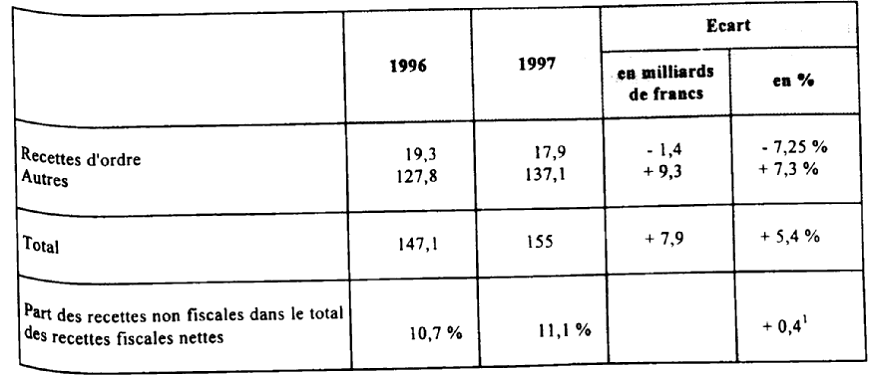
1. En points
1. Un accroissement très sensible
Le montant des recettes non fiscales s'accroîtrait de 7,9 milliards de francs et atteindrait 155 milliards de francs (1,9 % du PIB et 11,1 % des recettes fiscales nettes).
Le produit des recettes non fiscales en 1996 serait plus élevé que prévu initialement (+ 14,7 milliards de francs) mais en baisse par rapport à 1995 (- 17,6 milliards de francs).
Évolution des recettes non fiscales
(En millions de francs)
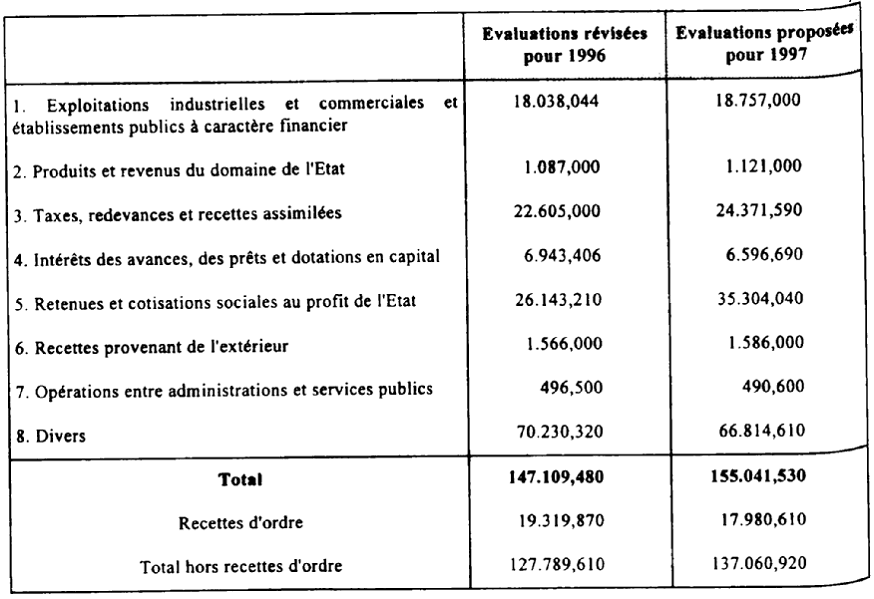
2. Une déformation de structure
L'essentiel de la progression des recettes non fiscales proviendrait de celle des retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat (+ 9,2 milliards de francs) sous l'effet de la transformation du fonds de concours relatif aux parts agent et employeur des cotisations de France Télécom en recette non fiscale (+ 8,81 milliards de francs) et du versement de 1 milliard de francs de l'organisme chargé de gérer la contribution de 37,5 milliards de francs de France Télécom aux charges de pension de ses agents publics.
Sans cet effet, les recettes non fiscales hors recettes d'ordre seraient stabilisées en niveau, leurs divers mouvements s'annulant les uns les autres.
III. LA RÉDUCTION DU DÉFICIT
A. LA LENTE DÉCROISSANCE À MOYEN TERME DU DÉFICIT
1. La mesure délicate du solde pour 1997
Affiché à 283,67 milliards de francs avant discussion à l'Assemblée nationale, le solde n'enregistre qu'une amélioration modeste, de l'ordre de 4 milliards de francs. Pour établir une comparaison solide, il convient toutefois de prendre en compte deux biais importants : la baisse décidée du produit de l'impôt sur le revenu (-25 milliards) et la non intégration de la soulte France Télécom (37,5 milliards de francs). Une présentation "volontariste" mettrait en évidence un solde en considérable amélioration.
2. L'amélioration constante du déficit rapporté au produit intérieur brut
Le tableau ci-après met en valeur la diminution tendancielle du déficit budgétaire, calculé par rapport au PIB.
Déficit général corrigé des privatisations
(en milliards de francs)
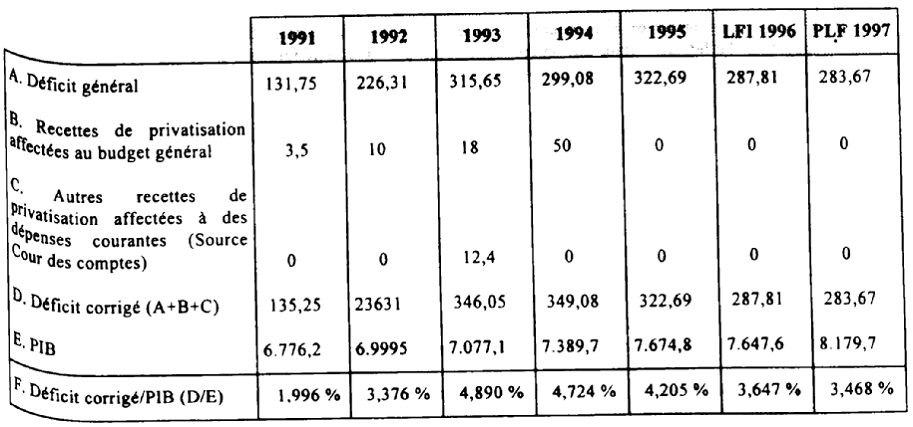
(Source : Assemblée nationale).
|
L'écart entre déficit budgétaire
et besoin
Il existe un écart entre le déficit budgétaire -le solde d'exécution de la loi de finances-et le besoin de financement de l'Etat qui est le critère retenu par les dispositions du traité de Maastricht. L'explicitation du passage de l'un à l'autre des soldes est traditionnellement présentée dans le rapport sur les comptes de la Nation. Le besoin de financement de l'Etat une année donnée varie en fonction des flux nets de dettes et des flux nets de créances. C'est pourquoi une opération de privatisation n'a, par exemple, pas d'incidence sur le besoin de financement au sens du traité de Maastricht. Son solde du point de vue de la capacité de financement de l'Etat est nul : elle se traduit par une recette que vient compenser une diminution des créances de l'Etat. Ainsi, lorsque le solde des opérations financières inscrit en loi de finances est négatif, le besoin de financement de l'Etat est inférieur au déficit de la loi de finances. S'agissant de la soulte versée par France Télécom, son impact sur le besoin de financement de l'Etat est, par convention, faible. L'engagement a en en effet été pris d'en affecter le produit à un établissement public. Mais, les établissements publics font partie des administrations publiques. Ils sont, en France, considérés comme des organismes d'administration centrale (les O.D.A.C.) auxquels seules s'appliquent les stipulations du traité de Maastricht 14 ( * ) . Le versement en question se traduit donc schématiquement par une augmentation immédiate des ressources des ODAC non compensées par une variation immédiate de leurs dettes. Ce deuxième phénomène a un contenu essentiellement comptable : il provient de ce qu'en comptabilité "nationale" européenne, les charges futures des systèmes de retraite par répartition n'ont pas la nature d'une dette. Au terme de cette opération, si le besoin de financement de France Télécom 15 ( * ) est dégradé, l'effet du versement opéré se traduit par une amélioration nette du besoin de financement des administrations publiques en 1997 16 ( * ) |
B. L'AMÉLIORATION CONSTANTE MAIS INSUFFISANTE DU SOLDE PRIMAIRE
1. L'amélioration du solde primaire
Les dépenses publiques résultant du paiement des intérêts dus par l'Etat en raison de sa dette sont des dépenses quasi-automatiques sur lesquelles peu de marges de manoeuvre existent. C'est pourquoi on recourt souvent, plutôt qu'au concept de déficit stabilisant la charge de la dette, à la notion de solde primaire stabilisant la dette. Le solde primaire est en effet l'écart entre les recettes et les dépenses hors charges d'intérêt, c'est-à-dire l'écart entre deux grandeurs sur lesquelles on estime qu'il est possible d'agir.
Autrement dit, le solde primaire est un meilleur indicateur de l'orientation donnée à la politique budgétaire que le solde global qui est contraint par les dépenses d'intérêt.
Solde primaire du budget de l'Etat
(en milliards de francs)
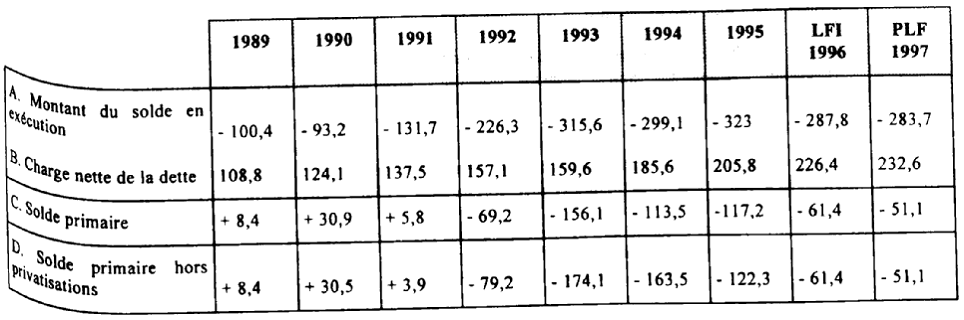
2. L'effort à consentir pour stabiliser le poids de l'endettement
|
Un effet paralysant sur les dépenses de l'Etat Pour illustrer l'ampleur de la réduction des dépenses publiques nécessaire pour stabiliser la dette de l'Etat dans le PIB, on peut raisonner à partir du projet de loi de finances pour 1997. En 1996, la dette de l'Etat s'élèvera à 3.538 milliards de francs (44,8 % du PIB). En 1997, elle s'accroîtrait comme le déficit budgétaire et passerait à 3.821,7 milliards de francs, soit une variation de 8 %. Dans le même temps, le PIB en valeur connaîtrait une croissance de 3,5 %. De la différence entre le rythme de croissance de la dette et du PIB, il résultera une hausse de la part de la dette dans le PIB : celle-ci passerait de 44,8 à 46,8 % du PIB. Pour obtenir une stabilisation de la part de la dette dans le PIB, il aurait fallu que le stock de dette s'élève en 1997 à 3.660,2 milliards de francs (44,8 % du PIB de l'année 1997). Autrement dit, il aurait fallu que le déficit soit de 122,2 milliards de francs. Si le solde primaire -solde des recettes et des dépenses hors charges d'intérêt- était équilibré, le déficit s'accroîtrait du montant des charges d'intérêt en 1997 (232,6 milliards de francs), soit plus que nécessaire. Une stabilisation de la part de la dette dans le PIB suppose donc de dégager un excédent primaire. Son montant devrait être de 232,6 - 122,2 milliards de francs = 110,4 milliards de francs. Dans le projet de loi de finances pour 1997, le solde primaire est négatif : - 51,1 milliards de francs. Il faudrait donc, pour stabiliser la part de la dette de l'Etat dans le PIB, améliorer le solde primaire de l'Etat de 51,1 + 110,4 = 161,5 milliards de francs. Si tout le poids de l'ajustement devait reposer sur les dépenses, cela impliquerait que celles-ci s'infléchissent de 10,4 % par rapport à leur niveau prévisible en 1997. Le déficit du budget de l'Etat, au lieu d'être de 3,47 % du PIB, devrait être en excédent de 1,5 % du PIB. |
C. LA PRÉSENTATION DU SOLDE SELON LES CRITÈRES DE LA COMPTABILITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES
1. La nouvelle présentation budgétaire
Cette nouvelle présentation, dont le débat d'orientation budgétaire avait fourni la première maquette, se présente comme suit :
Section de fonctionnement
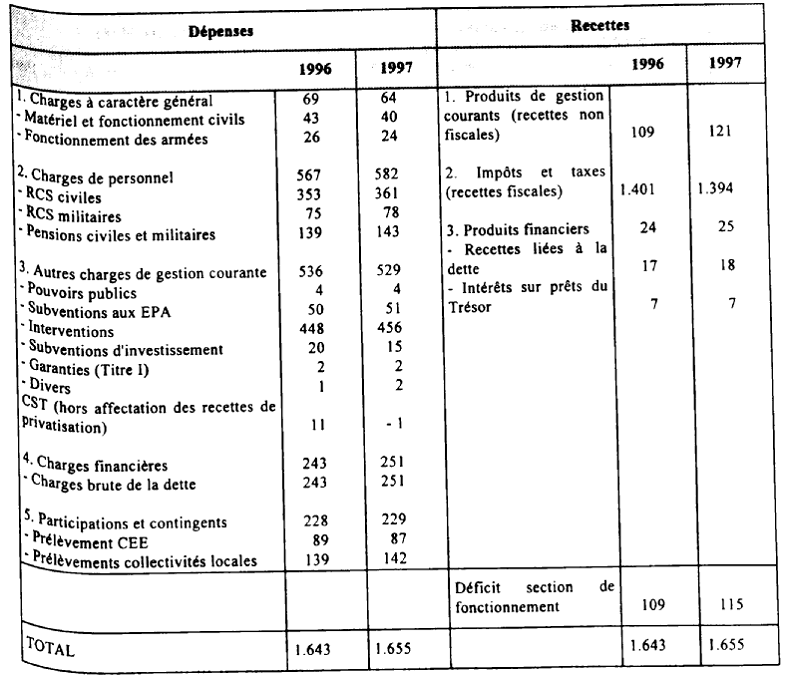
En 1997, les dépenses de la section de fonctionnement progressent de 12 milliards de francs, et les recettes de 6 milliards de francs. Le déficit de la section de fonctionnement augmenterait donc de 6 milliards de francs. Sans l'allégement de l'impôt sur le revenu, le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement serait ramené à 90 milliards de francs, contre 109 milliards de francs en 1996. Comme l'indique le rapport du Gouvernement : "Il doit être clairement établi que l'urgence vise désormais à réduire le plus rapidement possible ce déficit et à dégager progressivement des capacités de remboursement des emprunts souscrits antérieurement et venant à échéance. Ce besoin de financement correspond à l'amortissement des investissements en capital fixe".
Section d'investissement
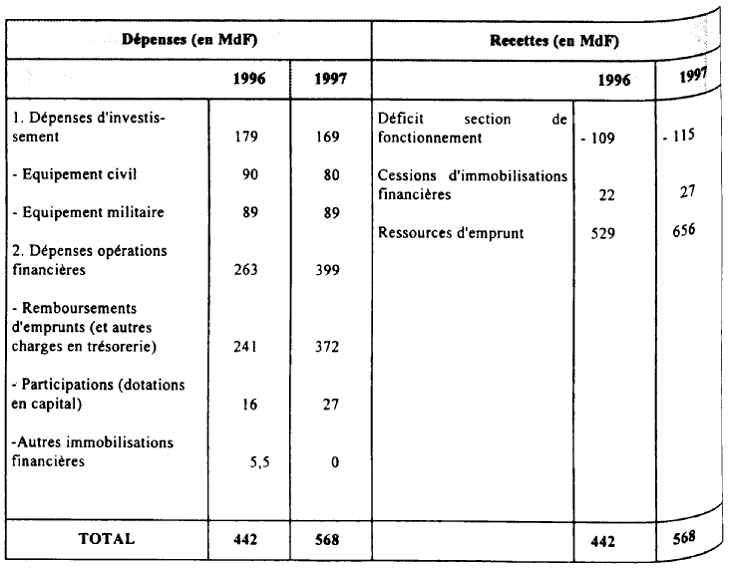
Par rapport à 1996, la forte progression des remboursements d'emprunts (+ 131 milliards de francs) correspond principalement à l'arrivée à échéance en juillet 1997 de l'emprunt d'Etat à 6 % émis en juillet 1993. Pour faire face à cette échéance, l'Etat devra accroître le recours à l'emprunt. Comme l'indique également le Gouvernement :
"L'effort pluriannuel de maîtrise des dépenses publiques doit donc être poursuivi pour que le budget de l'Etat soit en mesure de respecter la règle de l'équilibre réel, qui s'impose aux collectivités locales. Le projet de loi de finances pour 1997 constitue, avec la stabilisation des dépenses en francs courants, un progrès sans précédent en ce sens. Il permettra de respecter les engagements européens du Gouvernement, tout en favorisant l'activité, et donc l'emploi. Ces constatations soulignent la nécessité de réformer l'Etat pour mieux équilibrer les crédits de fonctionnement et d'investissement. Il s'agit de recentrer l'Etat sur ses missions essentielles."
2. Les enseignements qu'elle livre
Sans revenir sur les développements précédents, cette présentation livre plusieurs enseignements majeurs :
- les dépenses de fonctionnement s'accroissent de 0,73 % et les dépenses de la section d'investissement de 28,5 % ;
- les dépenses d'équipement civil accusent une forte baisse, de 11,2 %, ce qui -pour une part seulement- revient un peu à les considérer comme une variable d'ajustement. De plus, les subventions d'investissement accusent aussi une forte baisse (- 20 %) ;
- malgré une croissance significative en 1997, les impôts et taxes accusent un rendement en baisse (en raison essentiellement de la réforme de l'impôt sur le revenu) ;
- les économies proviennent principalement des charges de fonctionnement (- 5 milliards), des comptes spéciaux du Trésor en raison de jeux d'écritures multiples (- 12 milliards) et de la baisse du prélèvement C.E.E. (- 2 milliards de francs).
Au total, le déficit de la section de fonctionnement s'accroît de 6 milliards pour atteindre 115 milliards de francs, soit autant de dépenses de consommation courante financées par l'emprunt. Après 109 milliards en 1996, ce sont 115 milliards de dettes supplémentaires pour 1997 que les contribuables de demain auront à rembourser au titre de notre consommation d'aujourd'hui. En termes de démocratie "intergénérationnelle", il s'agit d'un défi majeur.
|
Les comptes spéciaux du Trésor en 1997 La charge nette des comptes spéciaux du Trésor, qui s'élevait à 10.805 millions de francs en loi de finances initiale pour 1996, présente un excédent de 699 millions de francs en projet de loi de finances pour 1997. Cette évolution résulte : ? d'une augmentation forte de l'excédent des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, qui passe de (-) 65 millions de francs en 1996 à (-) 3.465 millions de francs en 1997. Cela résulte de la création du compte "fonds pour le financement de l'accession à la propriété" qui gère les prêts à taux zéro désormais financés par la contribution du 1 % logement. Les recettes attendues sont supérieures aux dépenses qui seront supportées en 1997 sur ce compte, puisque les engagements du compte se soldent sur deux ans. Les organismes collecteurs verseront à ce compte 7 milliards de francs et la dépense s'élèvera la première année à 3,5 milliards de francs ; ? d'une baisse de la charge des prêts des comptes d'affectation spéciale ( - 34 millions de francs en 1997 contre - 41 millions de francs en 1996) et de celle des comptes de commerce ( - 33 millions de francs en 1997 contre - 39 millions de francs en 1996) ; ? d'une baisse de 4.507 millions de francs, par rapport à la loi de finances initiale pour 1996, de la charge des comptes d'avances, laquelle s'établit à 2.122 millions de francs en 1997 grâce, en particulier, à la diminution du déficit du compte d'avances aux collectivités locales ; ? d'une forte diminution par rapport à la loi de finances initiale pour 1996 de la charge des comptes de prêts (3.790 millions de francs). Cette diminution résulte pour l'essentiel de l'ajustement aux besoins des crédits de rééchelonnement de la dette des Etats étrangers ; ? d'une quasi stabilité de la charge des comptes d'opérations monétaires ( - 200 millions de francs) et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ( - 40 millions de francs). Source : Ministère de l'économie et des finances |
CHAPITRE IV LA REFORME DU SYSTEME FISCAL
La réforme de l'impôt sur le revenu constitue l'un des éléments majeurs du projet de loi de finances pour 1997. Elle amorce en effet la rénovation de notre système de prélèvements obligatoires. Celui-ci devra désormais être amélioré dans le sens d'une plus grande lisibilité, d'une meilleure efficacité et d'une compétitivité renforcée.
I. POUR UN SYSTÈME DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PLUS LISIBLE
Le système français de prélèvements obligatoires -impôts perçus par l'Etat et les collectivités locales et cotisations sociales versées par les assurés sociaux et leurs employeurs- se distingue des systèmes de prélèvements étrangers à la fois par son niveau et par sa structure. Une analyse de ces différences ne peut toutefois être complète qu'en y associant la mesure des contreparties de ces prélèvements qui, d'une façon générale, sont plus étendues en France que dans la plupart des pays industrialisés.
L'évolution récente du système de prélèvements obligatoires français se traduit par ailleurs par une sensible modification des lignes de partage entre impôts et cotisations, entre impôts d'Etat et impôts locaux, entre prélèvements affectés et prélèvements non affectés. En conséquence, l'ensemble du système est aujourd'hui devenu confus, peu lisible, source d'interrogation et de méfiance. Il est aussi devenu plus difficile à réorganiser ou rénover.
Une vue d'ensemble est donc nécessaire pour pouvoir ensuite tracer les lignes directrices et les orientations souhaitables d'une réforme du système de prélèvements obligatoires français.
A. LES CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGA TOIRES FRANÇAIS
Par rapport aux pays étrangers développés, la France se caractérise à la fois par un montant de prélèvements obligatoires élevé et par une structure de prélèvements originale.
Ces deux particularités traduisent les choix effectués depuis 50 ans pour financer un grand nombre de dépenses de façon collective.
|
Extrait du Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances "En France, actuellement, les prélèvements obligatoires (fiscaux et sociaux) ont atteint un niveau excessif. Ils présentent les caractéristiques suivantes : - ils atteignent un niveau très élevé de plus de 45 % du PIB en 1996, supérieur à celui des autres grands pays industrialisés, à l'exception de l'Italie ; - les revenus du travail sont plus lourdement taxés que les revenus de transfert ou les revenus du capital ; - les taux marginaux d'imposition sont très élevés pour les revenus modestes et les revenus les plus élevés (notamment pour ces derniers, le taux marginal d'imposition est très supérieur à celui de nos principaux partenaires) ; - enfin, un certain nombre de mécanismes de calculs de l'impôt (décote) et d'avantages fiscaux spécifiques (demi-part supplémentaire, abattements, réductions d'impôt) rendent l'impôt sur le revenu peu lisible et sont préjudiciables tant à l'équité qu'à l'efficacité économique." |
1. Un montant de prélèvements élevé
Avec un taux voisin de 44 % du PIB depuis 1983 et aujourd'hui supérieur à 45 %, la France présente un niveau de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés des pays de l'OCDE. Seuls le Danemark et la Suède ont des taux de prélèvements supérieurs à 50 % du PIB. En moyenne, le taux de prélèvement français dépasse de dix points le taux moyen de l'OCDE et de sept points le taux moyen de l'Union européenne.
Le tableau ci-après fournit les taux de prélèvements obligatoires mesurés en 1994 dans les principaux pays de l'OCDE. Il retrace également l'évolution de ces taux depuis trente ans. Il en ressort que, malgré un taux déjà très élevé en 1965, la France a connu une progression de ses prélèvements obligatoires légèrement supérieure à la moyenne de celle observée, tant dans les pays de l'OCDE que de l'Union européenne, au cours de la période.
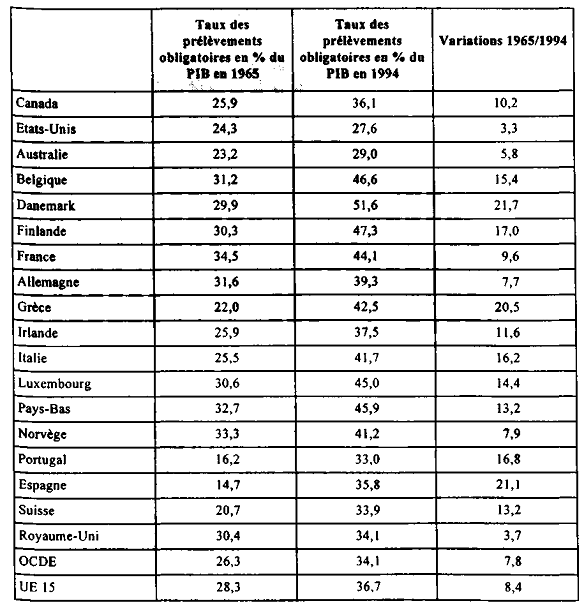
Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques (1965-1995) - 1996
S'agissant plus particulièrement de la France, le graphique ci-après montre la forte progression du taux des prélèvements obligatoires constaté depuis 1973, puis la relative stabilisation, à un niveau proche de 44 %, depuis 1983.
Taux des prélèvements obligatoires (en % du PIB)
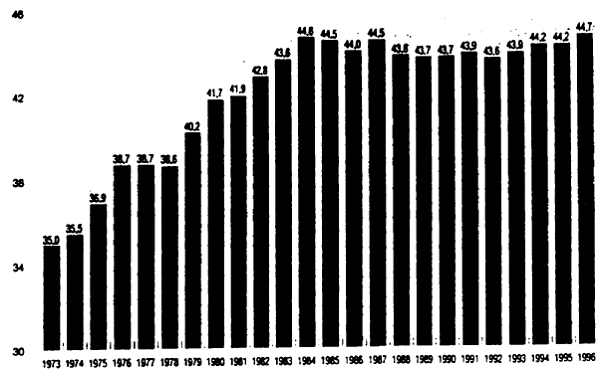
Or, une telle situation bride l'initiative privée et limite le champ des arbitrages économiques individuels, rendant de ce fait indispensable, sinon une baisse, du moins une stabilisation du poids global de ces prélèvements. En tout état de cause, un accroissement du poids des prélèvements obligatoires serait aujourd'hui économiquement insupportable.
2. Une structure de prélèvements originale mais pénalisante
En France, la part des prélèvements destinés aux administrations de sécurité sociale est très élevée alors que la part des impôts d'Etat est beaucoup plus faible que dans la plupart des autres pays.
Le tableau ci-après fournit la répartition des prélèvements en fonction des catégories d'administrations bénéficiaires dans un certain nombre de pays de l'OCDE. La France y apparaît très nettement comme un pays atypique . En effet, les impôts d'Etat y sont relativement faibles et cette situation n'est pas compensée par un taux d'impositions locales élevé, comme cela est le cas en Suède ou au Japon. En revanche, la France est le pays où le poids des cotisations et charges sociales est de loin le plus élevé.
Répartition des prélèvements obligatoires entre catégories d'administrations
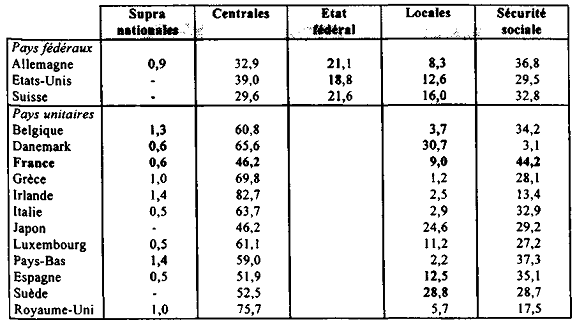
Source : OCDE statistiques des recettes publiques 1992.
Cette particularité française -une faiblesse relative des impôts d'Etat au profit des cotisations et charges sociales et, dans une moindre mesure, des impositions locales- s'inscrit dans une tendance de long terme qui s'est sensiblement accentuée au cours des dernières années, ainsi que le montrent le tableau et le graphique ci-après.
Prélèvements obligatoires rapportés au produit intérieur brut total
(en pourcentage du PIB)
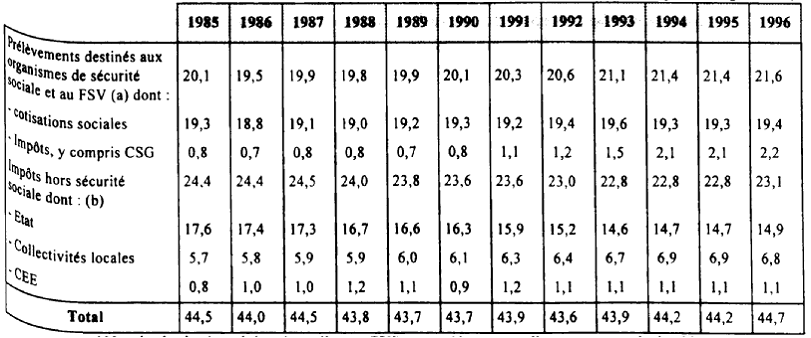
a) A partir de 1994, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) est créé et recueille une partie de la CSG (contribution sociale généralisée) ainsi que les droits sur les alcools.
b) Cette décomposition ne prend pas en compte les prélèvements destinés aux organismes divers d'administration centrale (hors FSV), qui représentent selon les années 0,2 à 0,3 point de PIB.
Répartition des prélèvements
obligatoires
(En % du total des prélèvements obligatoires
nets des allégements de cotisations sociales)
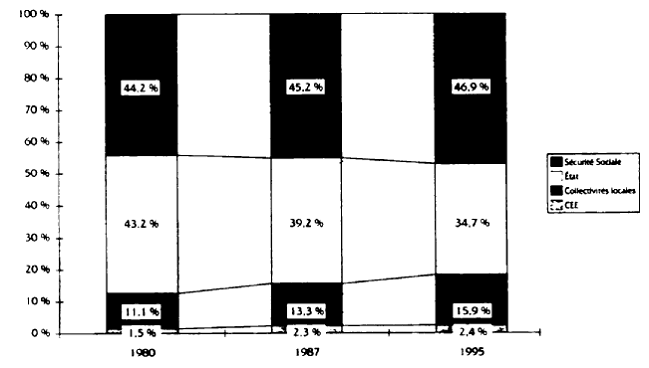
Ainsi, si la part des prélèvements obligatoires au sein du PIB a peu varié depuis 10 ans, la structure de ces prélèvements a beaucoup évolué. La part des impôts d'Etat a baissé de 2,7 points de PIB depuis 1985. Elle a été compensée par une hausse de 1,5 point des prélèvements destinés aux organismes de sécurité sociale et par une hausse de 1,1 point des impôts locaux ; la progression des prélèvements au profit de l'Union européenne explique le complément.
Cette évolution a contribué à alourdir le poids des prélèvements pesant sur les revenus du travail puisque les cotisations et charges sociales, qui représentent désormais près de la moitié des prélèvements obligatoires, pèsent essentiellement sur le travail.
Ainsi, si l'on prend en compte l'ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux, les revenus du travail apparaissent nettement plus taxés que les revenus de transfert et que, surtout, les revenus du capital.
Or, une telle situation pénalise lourdement l'emploi, en constituant un obstacle à l'embauche en particulier pour les postes les moins qualifiés. Plus globalement, elle nuit à la croissance. Enfin, elle place la France dans une position défavorable par rapport à ses principaux partenaires.
Le graphique ci-après en témoigne en montrant les écarts de taux effectif de taxation du travail entre la France et ses principaux partenaires de l'Union européenne.
Taux effectif de taxation du travail
(Source : Ministère de l'économie et des finances, Commission Européenne)
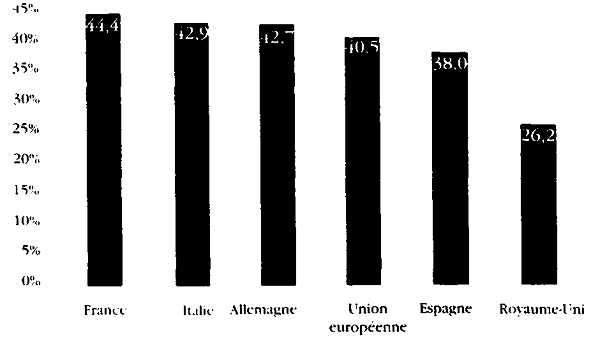
3. Des contreparties importantes
S'il apparaît ainsi nécessaire de réduire le poids global des prélèvements obligatoires et, en particulier, d'alléger le poids de la taxation du travail, deux aspects doivent au préalable être rappelés pour mesurer l'ampleur des enjeux :
- bien que très élevé, le niveau actuel des prélèvements obligatoires français est insuffisant pour financer toutes les dépenses : l'écart actuel entre la part des dépenses publiques et celle des prélèvements obligatoires au sein du PIB est de l'ordre de 10 points.
Cette situation signifie avant tout qu'une baisse des prélèvements obligatoires doit sinon être précédée -si l'on souhaite réduire les déficits- du moins être accompagnée d'une réduction de la dépense publique.
- les prélèvements obligatoires ont en effet pour contrepartie de nombreuses dépenses financées de façon collective
L'importance des prélèvements obligatoires -et donc des dépenses publiques- est la traduction d'un choix de société. Cela signifie que même si l'on pouvait, par une meilleure organisation du système de dépenses collectives, dégager quelques économies, un mouvement significatif d'allégement des prélèvements obligatoires nécessiterait des arbitrages importants et difficiles dans le montant et la répartition des dépenses, et conduirait à une inévitable remise en cause de certaines fonctions collectives.
Aussi, pour tenter d'approfondir l'analyse, expliquer les différences constatées avec les systèmes étrangers, mesurer les marges de manoeuvre disponibles et repérer les dépenses qui pourraient être financées d'une autre manière, il paraît nécessaire de procéder à une classification des dépenses.
Plusieurs classifications sont possibles. Elles aboutissent généralement à séparer ce qui ressort de la responsabilité directe de l'Etat de ce qui peut être assumé par d'autres acteurs économiques ou ce qui relève de la solidarité de ce qui relève de la simple assurance.
En retenant quatre catégories de dépenses , on parvient à mettre en évidence ces grandes lignes de partage, que justifient des considérations juridiques, économiques, sociales, voire idéologiques.
Ces quatre catégories regroupent :
a) Les dépenses régaliennes
Il s'agit des dépenses d'administration, de police, de justice, de défense, de politique étrangère ou d'intervention économique. Elles sont au coeur des missions de l'Etat.
Ces dépenses sont destinées à accroître le bien-être de la nation tout entière mais ne profitent pas directement aux ménages. Elles représentent actuellement environ 18 % du PIB.
b) Les dépenses correspondant à des prestations offertes à tous les ménages mais fournies seulement en fonction de leurs besoins
Il s'agit des dépenses publiques d'éducation, de culture, de santé, ainsi que les dépenses en équipements collectifs. Elles représentent environ 14,5 % du PIB.
c) Les dépenses de transfert et de solidarité
Ces dépenses comprennent les transferts effectués, au titre de la solidarité nationale, au profit de certains ménages, soit en raison du bas niveau de leurs revenus (RMI, minimum vieillesse, allocations logement), soit en raison de situations et de besoins particuliers (allocations familiales). Elles représentent environ 6,5 % du PIB.
Les dépenses effectuées n'ont aucun lien avec les cotisations versées.
d) Les dépenses liées aux systèmes d'assurances publiques
Il s'agit des retraites, des indemnités d'assurance chômage et des indemnités journalières maladie et maternité. Elles représentent un peu plus de 15 % du PIB. Elles ont en principe un lien proportionnel avec les cotisations versées.
La France a un haut niveau de dépenses publiques car elle a choisi de financer, de façon collective, par l'impôt et par des cotisations ces quatre catégories de dépenses.
Un nombre particulièrement élevé de prestations et de systèmes d'assurance ont en effet un caractère public en France.
Or, d'autres pays ont adopté des systèmes différents. Ainsi, dans certains cas, les prestations fournies sont en partie ou même en totalité payantes ou bien encore effectuées par des entreprises privées qui facturent le service rendu aux ménages concernés. Par exemple, selon les pays, l'enseignement peut être public ou privé, gratuit ou payant. De même, les dépenses de santé peuvent être prises en charge par la collectivité ou rester du domaine des décisions privées.
Ces différences expliquent la grande disparité de niveaux de prélèvements obligatoires dans les pays de l'OCDE. Si, dans le cas de la France, on retirait du montant des prélèvements obligatoires les cotisations sociales correspondant à de simples primes d'assurance, on obtiendrait un taux de prélèvements par rapport au PIB inférieur d'environ dix points, à ce qu'il est aujourd'hui, soit un taux plus proche de celui de la moyenne des pays de l'OCDE.
B. UNE NÉCESSAIRE CLARIFICA TION
Les travaux statistiques menés tant sur le plan interne que par l'Union européenne ou l'OCDE fournissent des éléments précis sur la répartition des prélèvements : entre impôts et cotisations ou entre impôts d'Etat et impôts locaux. La classification juridique de ces prélèvements est donc privilégiée.
Or , les affectations de ces différents prélèvements sont moins nettes. Ceux-ci ne sont pas toujours utilisés -du moins en partie- par ceux qui en sont juridiquement bénéficiaires.
Ce "brouillage" entre les grandes masses des dépenses publiques, récemment accru, appelle à l'évidence une clarification. En effet, une situation par trop illisible ne peut qu'accroître l'irresponsabilité des acteurs concernés.
1. L'affectation complexe des prélèvements obligatoires
Le budget de l'Etat, dont les recettes proviennent notamment d'impôts nationaux, est mis à contribution, de plus en plus largement, pour financer à la fois des dépenses locales et des dépenses sociales.
- La prise en charge budgétaire de dépenses locales
S'agissant des dépenses des collectivités locales, les concours financiers de l'Etat s'élèvent à 243,66 milliards de francs dans le projet de loi de finances pour 1997, ce qui représente un peu plus de 15 % des charges du budget général.
Ils comprennent, d'une part, des dotations, le plus souvent représentatives de compétences transférées par l'Etat aux collectivités locales, et, d'autre part, des compensations d'exonérations ou de dégrèvements liés à la fiscalité locale.
- La prise en charge budgétaire de dépenses sociales
La prise en charge des dépenses sociales par le budget de l'Etat est d'une analyse plus complexe, en raison de la variété des charges concernées. Selon certains calculs, elle pourrait approcher 350 milliards de francs, en incluant les charges sociales de l'Etat employeur.
Si l'on considère simplement les allégements de cotisations et charges sociales, le budget de l'Etat intervient à hauteur de 62,9 milliards de francs dans le projet de loi de finances pour 1997, dont plus de 40 milliards au titre de l'allégement général des charges sur les bas salaires et plus de 10 milliards au titre du contrat initiative-emploi.
On peut y ajouter les subventions d'équilibre versées par l'Etat pour le financement de certains régimes sociaux, soit 36 milliards de francs, dont 13,9 milliards pour la SNCF, 7,3 milliards pour le BAPSA, 4,6 milliards pour l'ENIM, 7,3 milliards pour les ouvriers de l'Etat, 2,3 milliards pour le régime des mines.
S'y ajoutent enfin 49 milliards de francs de remboursements de prestations gérées pour le compte de l'Etat par les organismes de sécurité sociale (revenu minimum d'insertion, allocation aux adultes handicapés, allocations d'aide à la scolarité, allocations du fonds spécial d'invalidité).
- La fiscalisation progressive des dépenses sociales
Depuis l'institution de la contribution sociale généralisée (CSG) par la loi de finances pour 1991, "la protection sociale a dépassé la stricte logique professionnelle pour évoluer vers celle d'une solidarité générale", comme le souligne le Conseil des Impôts dans son 14ème rapport, publié en 1995 et précisément consacré à la CSG.
En effet, le lien contributif entre cotisations versées et prestations reçues s'est affaibli. Cela résulte, d'une part, du développement des prestations accordées, soit sous conditions de ressources, soit sans contrepartie de cotisation, et, d'autre part, de l'importance des prestations à caractère universel (prestations familiales, assurance maladie).
Toutefois, le financement de la sécurité sociale repose encore majoritairement sur des cotisations puisque celles-ci représentent les deux tiers des recettes de la branche famille et les trois quarts de celles de la branche maladie.
Or, cette situation est critiquée car elle pénalise les revenus d'activité et, notamment, les revenus du travail salarié.
C'est pourquoi, il est prévu de poursuivre dans la voie de la fiscalisation, tracée par l'institution de la CSG, celle-ci ayant permis de solliciter d'autres revenus pour le financement de la sécurité sociale.
De fait, le montant des impositions affectées à des organismes de sécurité sociale s'est considérablement accru depuis quelques années puisqu'il est passé de moins de 50 milliards en 1990 à près de 225 milliards de francs en 1997.
|
Un nouveau "jaune" :
En application de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994, le gouvernement a déposé, pour la première fois cette année, en annexe du projet de loi de finances, un document retraçant "le produit pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant de chacune des impositions de toutes natures affectées à des organismes de sécurité sociale". Ce document comporte le descriptif de 17 impositions avec un rappel des textes institutifs, de l'organisme gestionnaire et des organismes bénéficiaires. Le produit total de ces impositions pour 1997 est évalué à 224,6 milliards de francs. Il inclut notamment la CSG pour 148,5 milliards de francs, la contribution pour le remboursement de la dette sociale pour 25,6 milliards de francs, la contribution sociale de solidarité sur les sociétés pour 15 milliards de francs, divers droits et taxes sur les alcools pour 19,5 milliards de francs. |
Les nombreux liens existant désormais entre les dépenses financées soit par impôts, soit par cotisations, rendent la lisibilité et la cohérence de l'ensemble du système de dépenses publiques français moins évidentes.
C'est pourquoi, afin de permettre une réduction du poids total des prélèvements obligatoires, et donc une réduction du niveau de la dépense publique, il convient de mettre en oeuvre une réforme ayant pour objectif principal de clarifier le système.
2. Les lignes directrices de la réforme
Pour envisager une clarification du mode de financement de la dépense publique, il apparaît nécessaire de bien déterminer au préalable ce qui doit relever d'un financement par l'impôt et ce qui doit être financé par cotisations ou -ce qui devrait revenir au même- ce qui relève de la solidarité nationale et ce qui peut être pris en charge par un système d'assurance.
Un débat national de clarification devrait dès lors intervenir car il s'agit de choix de société.
A plus court terme, cela signifie qu'il faut chercher à corriger la taxation excessive du travail et à tirer les conséquences du poids accru, au sein des dépenses publiques, des dépenses de solidarité -liées à la crise, au chômage et à l'exclusion- par rapport aux dépenses d'assurance.
La réforme du financement de la sécurité sociale actuellement mise en oeuvre par le gouvernement va, à cet égard, dans le bon sens. Elle permet en effet :
? de faire contribuer les revenus du capital au financement de la sécurité sociale par l'élargissement de l'assiette de la CSG,
? d'alléger le poids du financement de la sécurité sociale sur les actifs, en basculant 1,3 point de cotisation salariale maladie sur 1 point de CSG déductible.
Cette réforme doit être poursuivie dans le sens d'une plus grande clarification. C'est en effet uniquement dans ces conditions que les prochains arbitrages pourront être pris et les responsabilités des différents acteurs concernés bien définies.
II. POUR UN MEILLEUR USAGE DE LA DÉPENSE FISCALE
La nécessité de réduire les déficits publics a mis en lumière l'impératif de maîtrise des dépenses budgétaires.
En revanche, la "dépense fiscale" , qui peut se définir comme le coût pour le budget de l'Etat des mesures fiscales dérogatoires, n'est pas appréhendée dans la réduction programmée des charges publiques, alors qu'elle influence directement le déficit budgétaire.
C'est en fait la réforme de l'impôt sur le revenu qui conduit aujourd'hui à se pencher sur la dépense fiscale, compte tenu de l'importance des allégements existants sur la fiscalité des personnes ; souvent appelées abusivement "niches fiscales", terme qui évoque une incitation pure et simple à l'évasion, ces dépenses ont acquis un poids suffisant pour éveiller la vigilance du législateur.
C'est ainsi que l'article 32 de la loi de finances pour 1980, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, a institué l'obligation annuelle pour le gouvernement de présenter, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des dépenses fiscales définies comme les "dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en oeuvre entraîne pour l'Etat une perte de recettes et donc pour les contribuables un allégement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l'application de la norme, c'est-à-dire des principes généraux du droit fiscal français "
Le tome II du fascicule "Évaluation des voies et moyens" annexé au projet de loi de finances présente donc chaque année un rappel de la nature et une estimation du coût des dispositions dérogatoires en matière fiscale qui impliquent une perte de recettes pour le budget de l'Etat. Ces mesures sont successivement classées par impôt, par objectif, enfin par bénéficiaire.
Comme le souligne l'avant-propos du fascicule "Evaluation des voies et moyens", les montants indiqués ne sont pas, pour la plupart d'entre eux des résultats constatés, mais seulement des estimations. Toutes les mesures ne peuvent pas être chiffrées, en l'absence d'éléments suffisants. Enfin, les interactions entre les mesures ne sont pas chiffrées, ce qui enlève toute véritable signification à la totalisation de l'ensemble des dépenses fiscales.
Sous ces réserves, la dépense fiscale chiffrée se répartit entre les impôts suivants :
|
- Impôt sur le revenu |
262,47 milliards de francs |
|
|
- Impôt sur les sociétés |
12,53 milliards de francs |
|
|
- Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à |
||
|
l'impôt sur les sociétés |
21,09 milliards de francs |
|
|
- Impôt de solidarité sur la fortune |
1,18 milliard de francs |
|
|
- Droits d'enregistrement et de timbre |
1,77 milliard de francs |
|
|
- Taxe sur les salaires |
3,84 milliards de francs |
|
|
- Taxe sur la valeur ajoutée |
35,51 milliards de francs |
|
|
- Taxe intérieure de consommation sur les produits |
||
|
Pétroliers |
21,69 milliards de francs |
|
|
- Autres droits indirects |
0,06 milliard de francs |
L'ensemble des dépenses fiscales a très nettement augmenté depuis le début des années 80.
Ainsi, comme le souligne par exemple le rapport Ducamin, l'ensemble des déductions du revenu et réductions d'impôt pratiquées en matière d'impôt sur le revenu a progressé de près de 80 % entre 1982 et 1992 en francs courants, passant de 11,7 milliards de francs à 21 milliards de francs.
Évolution des déductions et réductions d'impôt sur le revenu
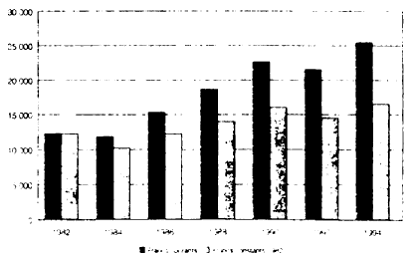
Source : Rapport Ducamin
A. UN CONTEXTE DE PLUS EN PLUS FAVORABLE À LA DÉPENSE FISCALE
1. De la sécurité à la prolifération juridique
a) A l'origine : un cadre stable
Contrairement aux subventions budgétaires, dont seule l'enveloppe maximale est fixée par la loi de finances, les allégements fiscaux supposent une intervention expresse du législateur, la loi fixant "les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature" (art. 34 de la Constitution). Compte tenu de l'interdiction faite au Parlement d'aggraver une charge publique (art. 40 de la Constitution), le débat sur les dépenses fiscales s'est considérablement développé, rendu possible par le "gage" des allégements.
En toute rigueur, les allégements devraient être réservés aux lois de finances, qui déterminent "la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat (...)" (art. 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959).
De fait, jusqu'à une période récente, les dépenses fiscales étaient exclusivement instituées par lois de finances : ce cadre juridique était le gage d'une certaine stabilité, favorisant des décisions économiques prises par les ménages ou par les entreprises dans des conditions clairement préétablies.
b) Une multiplication des normes
L'orientation de la dépense fiscale vers des incitations de plus en plus ciblées a généré des dispositions législatives de plus en plus rapprochées, destinées à ajuster progressivement ces mesures.
|
La réduction d'impôt pour dons aux oeuvres : huit modifications en dix ans
|
|
|
•
La volonté d'assortir les
politiques sectorielles d'encouragements fiscaux a suscité une
multiplication des allégements de plus en plus souvent contenus
dans des lois ordinaires,
comme en témoignent les textes les
plus récents examinés par votre commission des
finances
.
|
Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations Extension des mesures d'allégements fiscaux prévus en faveur des dons : - Dons aux oeuvres d'intérêt général : déduction de l'IRPP pour 50 % du montant du don dans la limite de 1,75 % du revenu imposable - Dons aux associations et fondations reconnues d'utilité publique et assimilées : déduction de l'IRPP pour 50 % du montant du don dans la limite de 6 % du revenu imposable - Dons aux associations "Coluche" et assimilées : déduction de l'IRPP pour 60 % du montant du don dans la limite de 2000 F Coût estimé des mesures en année pleine : 600 millions de francs Loi n° 96-607 du 27 juin 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce. Déduction du revenu (IRPP) ou de l'impôt sur les sociétés, du montant des parts souscrites dans le cadre d'un quirat. - Pour les personnes, plafond de 500.000 F - Pour les sociétés, absence de plafond Coût estimé de la mesure en année pleine : 400 millions de francs , |
|
Projet de loi relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la pollution de l'air Exploitants de transports publics de voyageurs : - Remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour utilisation du gaz de pétrole liquéfié - Remboursement partiel de la taxe de consommation pour utilisation du gaz naturel véhicules Exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés : - de 100 % pour les véhicules utilisant l'énergie électrique - de 50 % pour les véhicules utilisant le GPL ou le GNV Création d'une prime de 8000 F par véhicule pour l'installation d'un filtre antipollution diesel pour les bus et les autocars (coût estimé : 100 millions de francs). |
|
Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville Extension de l'exonération de plein droit de la taxe professionnelle aux établissements préexistants dans les zones de redynamisation urbaine, dans la limite de 500 000 francs de bases nettes ; Coût estimé de la mesure : 400 millions de francs Exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines ; Coût estimé de la mesure : 180 millions de francs Exonération de taxe professionnelle pour les établissements créés, étendus ou existants dans les zones franches urbaines ; Coût estimé de la mesure : 219 à 252 millions de francs Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux à usage industriel ou commercial ; Coût estimé de la mesure : 80 millions de francs |
2. Un contexte budgétaire favorable aux allégements fiscaux.
Même si la dépense fiscale a un coût en termes de moindres recettes, et donc un impact direct sur le creusement du déficit budgétaire, elle présente deux avantages :
- la dépense fiscale ne pèse pas sur la progression des dépenses publiques, dont la maîtrise constitue depuis 1993 l'objectif subsidiaire à celui de la réduction programmée du déficit budgétaire ;
- la dépense fiscale est un facteur d'allégement des prélèvements obligatoires, dont le poids dans l'économie a atteint 45 % du produit intérieur brut, et dont la réduction constitue également un objectif à moyen terme.
B. DE L'ALLÉGEMENT À L'ARME FISCALE
1. Une évolution de la dépense fiscale
Prenant en compte, à l'origine, la diversité des situations sociales, la dépense fiscale a progressivement évolué, en effet, vers l'incitation aux comportements.
Les allégements fiscaux ont d'abord pris la forme de déduction des charges réelles du revenu global, ou de demi-parts supplémentaires de quotient familial attribuées aux catégories de contribuables défavorisées.
Puis, à partir de 1983, les réductions d'impôt ont progressivement remplacé la plupart des déductions : la déduction permet de soustraire une somme du revenu imposable, alors que la réduction d'impôt porte sur la cotisation obtenue après application du barème 17 ( * ) .
A partir de ce nouveau ciblage des allégements fiscaux, les réductions d'impôts se sont multipliées en direction d'objectifs sectoriels : réparations dans la résidence principale, acquisition de logements neufs destinés à la location, sommes investies dans les sociétés nouvelles, le cinéma, les fonds salariaux, cotisations aux syndicats ou centres de gestion agréés, pertes en capital subies par les créateurs d'entreprises.
2. Deux types de dépenses fiscales
Aujourd'hui, la dépense fiscale recouvre deux types de dispositions relativement distinctes :
- certains allégements ont une vocation redistributive,
- d'autres ont des objectifs clairement affichés de politique économique ou sociale.
On peut ainsi distinguer, vis-à-vis de l'impôt sur le revenu, les allégements que l'on peut considérer comme quasiment intégrés au barème destinés à compenser des situations, de ceux qui affichent clairement un objectif d'incitation.
a) Impôt sur le revenu : les mesures "redistributives" Ces mesures se répartissent de la façon suivante en 1996 :
|
|
72.000 millions de francs |
|
|
- dont octroi d'une demi-part supplémentaire pour les personnes isolées ayant en charge un enfant, les anciens combattants, invalides |
25.800 millions de francs |
|
|
|
||
|
- Pensions et retraites |
13.800 millions de francs |
|
|
- Autres |
2.525 millions de francs |
|
|
|
||
|
- Prestations sociales |
15.860 millions de francs |
|
|
- Autres |
11.651 millions de francs |
|
|
|
||
|
certaines professions |
2.650 millions de francs |
|
|
TOTAL |
118.486 millions de francs |
b) Impôt sur le revenu : les mesures "incitatrices"
Leur volume chiffré dépasse celui des mesures précédentes en 1996 :
|
Déductions |
5.420 millions de francs |
|
|
Réductions d'impôt |
32.242 millions de francs |
|
|
Mesures pour l'épargne |
||
|
Exonérations |
54.280 millions de francs |
|
|
Abattements |
20.915 millions de francs |
|
|
Plus-values particuliers |
15.870 millions de francs |
|
|
Taxation réduite des plus-values à long terme |
9.200 millions de francs |
|
|
Crédits d'impôts (1) |
||
|
- crédit impôt recherche |
4.000 millions de francs |
|
|
- crédit impôt formation |
300 millions de francs |
|
|
TOTAL |
142.227 millions de francs |
|
|
(1) Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés |
C. DE LA DÉPENSE FISCALE À L'ABUS DE DÉPENSES FISCALES
1. Les inconvénients des allégements fiscaux
De par sa nature, la dépense fiscale présente des inconvénients difficilement contournables.
a) Pour le contribuable
•
La dépense fiscale ne
s'adresse qu'aux contribuables imposés.
Ainsi, par définition, les foyers non imposés à l'impôt sur le revenu ne bénéficient pas de cette dépense : or, près d'un foyer sur deux n'acquitte pas d'impôt sur le revenu. - 111 -
•
Nul n'est censé ignorer les
règles de la dépense fiscale
Outre les obligations liées au caractère déclaratif de l'impôt -qui supposent que le contribuable connaisse les dizaines de possibilités d'allégement- les règles de la dépense fiscale sont censées être suffisamment connues du contribuable pour influencer efficacement son comportement.
Or, le ciblage d'une mesure suppose l'édiction de règles assez nombreuses (nature des dépenses prises en compte pour une réduction d'impôt, plafonnement de ces dépenses, plafonnement de la réduction d'impôt...) pour être difficiles à connaître.
Par ailleurs, ces règles sont censées influencer le contribuable largement en amont de sa décision, l'avantage en impôt se concrétisant l'année suivant celle-ci, pour l'impôt sur le revenu comme pour l'impôt sur les sociétés.
•
Le contribuable prend un
risque.
En l'absence de décision préalable expresse de l'administration, le contribuable prend le risque, en engageant des dépenses, de voir son accès aux allégements fiscaux contesté a posteriori à l'occasion d'un contrôle : certains dispositifs complexes, tels que le crédit d'impôt recherche, ont pu susciter de telles difficultés.
b) Pour l'administration
•
Par nature, la dépense
"éludée" est mal connue de l'administration fiscale,
ce
qui rend son chiffrage difficile. Comme le souligne le tome II du fascicule
"Evaluation des voies et moyens",
"les opérations économiques
exonérées sont largement ignorées" :
dès
lors les montants de dépenses fiscales indiqués
"ne sont pas,
la plupart du temps, des résultats constatés, mais seulement des
estimations"
. Par ailleurs, seules 236 mesures sur un total de 445 sont
chiffrées en 1996.
De même, ces estimations ne portent que sur une année donnée, même si la mesure produit ses effets sur plusieurs années : ainsi, le régime de l'intégration fiscale des résultats des groupes de sociétés françaises qui produit des effets sur plusieurs exercices, n'est pas chiffré pour 1995-1996 afin d'éviter une estimation trop parcellaire.
Enfin, les chiffrages sont "directs" et ne peuvent pas prendre en compte les interactions entre les mesures, ou les effets indirects de celles-ci : une incitation à la consommation provoque par exemple une rentrée supplémentaire de TVA...
|
Un exemple de chiffrage incertain : la dépense fiscale en faveur de l'agriculture 1. Compte tenu du mode de calcul de l'assiette des cotisations sociales agricoles, les mesures spécifiques réduisant le revenu professionnel imposable ont un coût en matière de moindres cotisations sociales. Il y a donc effet multiplicateur de la dépense fiscale, d'autant plus significatif pour les finances publiques que l'Etat assure mécaniquement l'équilibre du BAPSA grâce à une subvention du ministère de l'agriculture. 2. La nomenclature retenue n'est pas insusceptible de critiques méthodologiques sérieuses. Jusqu'en 1995, le fascicule Voies et Moyens retenait le coût de la franchise d'impôt accordée aux bouilleurs de cru (390 millions de francs) comme une aide à l'agriculture, ce qui relève d'une simplification hâtive. En sens inverse, l'exonération de TIPP pour les biocarburants (1,050 milliard de francs en 1996) n'est pas considérée comme une dépense fiscale en faveur de l'agriculture. 3. Ces travaux de réflexion sur la dépense fiscale en agriculture ne semblent pas relever directement de la compétence de la Cour des comptes, ou ne pas susciter d'intérêt particulier chez les magistrats compétents. En réponse à une question de votre rapporteur général, il lui a été indiqué que : "La Cour s'est limitée à citer quelques exemples de "dépenses fiscales" qu'il conviendrait de prendre en compte. "Elle ne sous-estime pas les difficultés d'un recensement exhaustif en la matière. Il est par exemple difficile de chiffrer le coût de certaines mesures fiscales propres à l'agriculture. Il peut en outre s'avérer impossible d'isoler la part de l'agriculture, dans le coût de mesures qui bénéficient également à d'autres secteurs etc... "Il serait souhaitable et il est sans doute possible, au moins en partie, que le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le service de la législation fiscale du ministère de l'économie et des finances, tentent de préciser l'analyse. Ainsi le Service de législation fiscale a-t-il établi la liste des mesures fiscales prises en faveur de l'agriculture et de la pêche depuis la fin de 1993. Certes, le service n'a pas été en mesure d'évaluer le coût de toutes les mesures. Mais outre que des progrès doivent être recherchés dans ce domaine, un tel recensement présente un intérêt certain pour l'information, notamment celle du Parlement. Il serait également souhaitable que l'analyse ne se limite pas aux seules mesures nouvelles, mais s'étende au droit existant. " 4 . Hors biocarburants, la dépense fiscale en faveur de l'agriculture s'établit à 5,99 milliards de francs (7 milliards de francs avec la mesure TIPP), soit près de 20 % des crédits du ministère de l'agriculture pour 1997. Après prise en compte de l'effet cotisations sociales, ce pourcentage pourrait atteindre 25 %. 5 . La dépense fiscale en faveur de l'agriculture tant par le nombre de mesures qu'elle comprend (31) que par son coût devrait devenir un élément central de la discussion du budget de l'agriculture. |
•
Les effets "d'aubaine" peuvent être
importants
Intervenant de manière indifférenciée pour des catégories entières de contribuables, à partir de décisions déjà prises par eux, la dépense fiscale peut susciter des effets d'aubaine importants : la réduction d'impôt pour emploi de salariés à domicile a ainsi été souvent dénoncée comme un moyen de "blanchir" des emplois déjà existants avant même d'être un moyen de créer des emplois.
c) D'un point de vue économique
•
La dépense fiscale "incitatrice"
présente l'inconvénient de poursuivre deux objectifs à la
fois : encourager une dépense, mais aussi avantager plus ou moins
certaines catégories de contribuables, par la fixation d'un taux de
réduction d'impôt, d'un montant de dépenses prises en
compte, d'un plafonnement de l'avantage en impôt... Or, ces deux
objectifs peuvent se révéler difficiles à concilier.
• La dépense fiscale est difficile à
supprimer : même si les conditions qui ont justifié sa
création ont disparu, l'avantage en impôt reste acquis aux yeux
des contribuables, comme le montre le projet de suppression de l'abattement
supplémentaire pratiqué sur le revenu de certaines professions
salariées.
• Enfin, la dépense fiscale peut être un
moyen de différer des réformes de fond : ainsi la
multiplication des allégements d'impôt sur le revenu à
certainement permis de renvoyer à plus tard l'aménagement
indispensable de l'assiette et des taux.
De même, la commission des finances du Sénat a été amenée à proposer un aménagement du régime des transmissions dans le cadre de l'examen du dernier projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission constatait en effet que les difficultés constatées sur la transmission d'entreprises provenaient du relèvement des taux en 1984, et que la réponse la plus adaptée aurait été d'élargir des tranches ou d'abaisser le taux maximum applicable en ligne directe. Toutefois, la commission des finances constatait aussi qu'une telle démarche était délicate à mettre en oeuvre dans l'immédiat et proposait donc une nouvelle "dépense fiscale" : "Face à ce constat, et convaincue de la nécessité d'agir, votre commission vous propose donc une approche prenant la forme d'une réduction plus substantielle des droits en cas de transmission anticipée : à cet effet, elle suggère de majorer de six points le taux de réduction de droit associé au régime fiscal de la donation-partage ".
2. Les effets de l'abus de dépenses fiscales
Au-delà de ces inconvénients "incontournables", les principaux défauts de la dépense fiscale viennent aujourd'hui du recours abusif qui en a incontestablement été fait.
a) L'apparition d'effets pervers
L'abus de dépenses fiscales porte en germe deux risques majeurs :
- l'apparition de distorsions de concurrence, telles que l'avantage procuré par la réduction d'impôt "assurance-vie" par rapport aux autres produits d'épargne, ou les différences de rendement entre les investissements dans le logement neuf ou ancien, créées au détriment de celui-ci par les aides fiscales telles que le "Quilès-Méhaignerie" :
- l'apparition d'un "cercle vicieux" qui veut que l'abus de dépenses fiscales prive l'impôt de son rendement : ainsi l'impôt sur le revenu paraît actuellement suffisamment criblé d'allégements fiscaux pour que son produit s'érode, et ce malgré des taux élevés, car ceux-ci ont précisément privilégié ces allégements.
b) Des risques de contradictions
L'accumulation de dépenses fiscales porte en elle des risques de contradictions, l'emploi du revenu des contribuables étant sollicité dans plusieurs directions à la fois : grosses réparations, dons aux oeuvres, emplois à domicile...
Mais, ces contradictions peuvent apparaître aussi entre deux dépenses fiscales qui n'interviennent pas au même stade d'imposition et dont les effets se contrarient. Un des meilleurs exemples a été fourni dans ce domaine par le Conseil des Impôts en 1990 par la comparaison de l'imposition d'une personne âgée isolée ayant des enfants majeurs par rapport à un célibataire jeune, en fonction du revenu déclaré : le cumul de la déduction de 10 % pour salaires et pensions, de l'abattement spécifique aux personnes âgées, de la demi-part supplémentaire plafonnée aux veufs ayant eu des enfants, les anomalies de la minoration -aujourd'hui supprimée- provoquaient une égalité de traitement jusqu'à 50.490 francs de revenu, puis un avantage au veuf, augmentant irrégulièrement, puis diminuant, s'annulant et se transformant en désavantage...
Comme le soulignait le Conseil des impôts, "On ne distingue finalement plus très bien l'intention du législateur. A force de distribuer des avantages, et de corriger ce qu'ils peuvent avoir d'excessif, la loi fiscale, parfois, s'égare".
Cette contradiction, qui affecte les allégements à vocation redistributive, peut s'exercer également entre des dépenses fiscales ayant le même objectif sectoriel. Ainsi les aides fiscales au logement adoptées depuis 1993 ont pu avoir des effets directement antagonistes :
|
Le logement et la politique fiscale entre 1993 et 1996
"
Source : "Pour une évaluation politique fiscale du logement". Rapport du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité immobilière - 20 juin 1996. |
D. POUR UN MEILLEUR USAGE DE LA DÉPENSE FISCALE
1. La dépense fiscale peut s'avérer plus efficace que la dépense budgétaire
a) Un instrument souple
La dépense fiscale est par nature plus souple, car elle n'exige pas de décision expresse préalable de l'administration -sauf régime exceptionnel d'agrément-. On peut dès lors considérer que son remplacement par une subvention budgétaire tarirait, dans beaucoup de cas, ses effets, une subvention supposant la constitution d'un dossier et un délai d'attente. La modernisation de l'administration dans le cadre de la réforme de l'Etat devrait encourager ce type de simplification des décisions.
b) Un facteur d'équité
En agissant sur l'impôt, la dépense fiscale, bien utilisée, devrait pouvoir être plus équitable que la dépense budgétaire, par utilisation du taux de réduction d'impôt, des règles de plafonnement...
c) Des mesures pour le long terme
Enfin la dépense fiscale permet -à condition de ne pas trop varier- de programmer une décision économique sur plusieurs années : ainsi le crédit d'impôt-recherche "récompense" une augmentation des dépenses de recherche d'une année sur la précédente ; de même le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés est pris en compte dans les décisions de l'entreprise pour ses résultats sur plusieurs exercices.
2. Une rationalisation est indispensable
a) L'incorporation au barème de l'impôt ?
La réforme de l'impôt sur le revenu met en lumière la nécessité d'une réflexion sur la dépense fiscale "redistributrice", et son incorporation, le cas échéant, au barème contenu dans la réforme de l'impôt sur le revenu. Le projet de suppression de la décote fait suite, ainsi, à l'analyse exposée dans le rapport Ducamin :
"La décote a pour justification de compenser pour les célibataires de condition modeste, l'incidence favorable du quotient familial pour les familles.
"Le groupe de travail, pour sa part, croit équitable de souligner que cette compensation comporte trois conséquences également inacceptables :
"- elle contribue à rendre le barème de l'impôt sur le revenu illisible pour plusieurs millions de contribuables ;
"- elle affecte d'une manière insidieuse et difficilement mesurable l'incidence d'un des principes fondamentaux de notre impôt sur le revenu à savoir la familiarisation ;
"- elle réserve le plein bénéfice du quotient familial aux familles dont les cotisations excèdent 4.320 francs en raison du niveau relativement élevé de leurs revenus.
"En conséquence, le groupe recommande la suppression de la décote et suggère qu'une priorité soit donnée, dans le cadre de l'allégement du barème, à la mise en oeuvre des dispositions qui permettraient d'obtenir que cette suppression ne comporte aucune surcharge pour les personnes de condition modeste.
"La réalisation de ces aménagements entraînerait une perte de recettes de l'ordre de 22 milliards de francs et apporterait donc aux familles une réduction de charges qui représenterait environ quatre fois l'incidence que pourrait comporter l'imposition des allocations actuellement exonérées."
b) Une évaluation indispensable
•
La nécessité de
l'évaluation
L'absence d'évaluation explique très largement l'accumulation de dépenses fiscales successives sur un même sujet.
En même temps, elle prive de son sens une partie du débat budgétaire, les parlementaires se voyant opposer à leurs propositions d'aménagements fiscaux l'argument d'un coût excessif, sans que les éléments objectifs du chiffrage soient toujours connus, et sans que l'efficacité de la mesure proposée ne puisse se référer à aucun précédent vérifié.
•
Les possibilités
d'évaluation
L'évaluation de la dépense fiscale a été effectuée jusqu'à présent à travers son coût : le rapport du Conseil des impôts de 1990 a ainsi étudié de manière très détaillée le montant moyen des allégements d'impôt sur le revenu, par bénéficiaire et par tranche d'impôt. A travers cette analyse, le conseil des impôts concluait à une efficacité incertaine de la dépense fiscale : "D'une efficacité douteuse sur le plan social, la dépense fiscale l'est également pour la réalisation d'objectifs économiques : elle suscite des transferts d'épargne d'un type de produit à un autre, elle crée des rentes de situation pour le gestionnaire de certains placements, mais son effet incitatif global n'est pas démontré. Dirigée sur un nombre limité d'interventions précises, au lieu d'être éparpillée en avantages fiscaux, la dépense publique serait plus utile".
A nouveau le rapport Ducamin s'est récemment prononcé sur l'opportunité de certaines dépenses fiscales à travers un coût moyen : ainsi la réduction d'impôt pour souscription au capital des SOFICA qui a bénéficié à 2.500 contribuables en 1993, pour un montant moyen de 45.000 francs, a été jugée "disproportionnée" au regard d'un coût total de 100 millions de francs.
En sens inverse, la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'habitation principale, qui ne représenterait qu'une économie moyenne de 3 à 4.000 francs par an par bénéficiaire était jugée trop faible pour être efficace.
•
Aller plus loin
Le rapport précité sur "l'évaluation des politiques fiscales du logement" a souligné la nécessité d'aller plus loin dans l'évaluation, en étudiant les coûts et les effets de la politique fiscale.
En ayant recours à des travaux d'experts extérieurs, en l'occurrence l'Observatoire foncier et immobilier du Crédit foncier de France, le groupe de travail sur la fiscalité du logement constitué par la commission des finances du Sénat a mis en lumière l'impératif d'approfondir l'évaluation des coûts de la dépense fiscale, en étudiant des scénarios alternatifs.
Le groupe de travail a également souligné les lacunes actuelles des dispositifs d'étude des comportements et la nécessité absolue de combler ces lacunes. "La connaissance des effets comportementaux de la fiscalité est donc un élément capital, qui devrait en principe précéder toute décision. Or, les connaissances dans ce domaine se révèlent extrêmement pauvres".
Le groupe de travail se référait alors à un modèle américain permettant d'apprécier l'impact sur le comportement des agents économiques des différentes mesures fiscales et de leurs incidences budgétaires, et concluait au développement possible d'un outil de simulation comparable en France, "la principale interrogation portant sur la disponibilité des données statistiques nécessaires à l'alimentation du modèle ".
En tout état de cause, dans le cadre de la suppression programmée d'allégements d'impôts sur le revenu, une étude approfondie, "monographique", de chaque dépense fiscale s'avère nécessaire. L'article 34 de la loi du 24 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit d'ailleurs la remise au Parlement, à l'automne 1996, d'un rapport sur les conditions d'application des réductions d'impôt sur le revenu, qui devrait éclairer le débat sur la réforme de cet impôt.
Outre le coût total, le coût moyen de la dépense fiscale, et le revenu moyen des contribuables en bénéficiant, des indicateurs devraient être fournis sur l'efficacité présumée de la mesure : résultats sur l'objectif affiché, évolution de la dépense fiscale depuis son origine, impact éventuel des modifications intervenues, comparaison des résultats avec ceux de mesures budgétaires... Sans être scientifique, une évaluation de ce type permettrait au législateur de disposer d'éléments de décision indispensables.
III. POUR UNE MEILLEURE APPROCHE DE LA COMPÉTITION FISCALE INTERNATIONALE
Notre système de prélèvements obligatoires a connu ces dernières années de considérables modifications.
Les principaux impôts ont été réaménagés et la structure des prélèvements s'en est trouvée modifiée.
L'élasticité des prélèvements par rapport à l'activité a diminué.
La question de l'influence du contexte international sur ces deux tendances se pose de plus en plus.
Domaine de souveraineté nationale par excellence, le prélèvement public n'échappe-t-il pas dans les faits à la maîtrise des Etats ?
Quelles sont les conséquences de cette éventuelle perte de souveraineté fiscale ?
Comment en combattre les incidences indésirables ?
A ces questions d'une redoutable complexité, le présent rapport n'a pas la prétention d'apporter des réponses définitives.
Mais il faut accomplir la première étape d'un travail qu'il conviendra de reprendre en "stylisant" les problèmes et les questions et en appelant à ce qu'un véritable élan politique soit donné à leur résolution.
A. LES DONNEES DU PROBLÈME
1. Deux questions distinctes : compétitivité et attractivité fiscales
La compétition fiscale internationale a au moins deux aspects :
- le premier consiste à adopter le système fiscal le plus à même d'assurer la compétitivité économique d'un pays ;
- le second consiste à attirer des activités et des facteurs de production.
Ces deux aspects sont bien entendu liés entre eux mais ils sont séparables.
La question de l'attractivité concerne la localisation des facteurs de production et des activités. Elle a un caractère fortement micro-économique et suppose de traiter le problème des coûts des entreprises ou des agents. La localisation des activités dépend du comportement d'optimisation des coûts. Quel est l'impact du système fiscal sur ces comportements ?
La première question est en revanche plus macro-économique. Il faut mesurer la compétitivité économique d'un pays et la part du système fiscal dans ce niveau global de compétitivité.
Les problèmes qu'elle pose sont inégalement complexes. Le plus "simple" consiste à identifier des phénomènes directs d'utilisation du système fiscal destinés à s'assurer un avantage concurrentiel, autrement dit d'apprécier si l'impôt est utilisé comme un droit de douane pénalisant les importations ou une subvention favorisant les exportations.
Mais d'autres problèmes sont beaucoup plus ardus. Ils renvoient tous à la question du système fiscal optimal.
Celle-ci oppose une vision libérale où, le marché allouant efficacement les facteurs, l'impôt est nécessairement producteur de sous-compétitivité à une vision "régulatrice".
Dans cette seconde vision, le marché ne fonctionne pas toujours très bien et l'impôt est aussi le moyen de financer la régulation sociale, qui semble aujourd'hui être un facteur essentiel de compétitivité. En bref, il peut exister des "distorsions fiscales compétitives" lorsque le marché n'alloue pas bien les facteurs.
Compte tenu du niveau atteint par les recettes fiscales, la réflexion sur l'adoption d'un système fiscal économiquement efficient mérite d'occuper une place centrale dans le débat économique.
Les problèmes plus circonscrits de l'utilisation de l'arme fiscale pour attirer les activités s'intègrent certes dans cette réflexion plus vaste mais peuvent en être distingués.
L'attractivité d'un pays dépend sans doute -de la qualité -de la compétitivité- de son système fiscal.
C'est vrai lorsque le système fiscal concilie mieux qu'ailleurs neutralité et efficacité économique. C'est également vrai lorsque le système fiscal est manié de telle sorte qu'il procure un avantage concurrentiel direct aux biens et services produits dans le pays.
Mais, l'attractivité fiscale peut provenir de dispositions fiscales susceptibles d'être contreproductives sur le plan économique, soit à l'échelle du pays qui en joue soit à l'échelle internationale.
C'est une conclusion forte que de souligner :
- qu'attractivité fiscale et compétitivité économique ne riment pas toujours ;
- et que l'attractivité fiscale est susceptible d'éloigner de l'efficience économique, soit directement soit par ses effets sur les autres composantes du système fiscal.
L'approche des phénomènes de compétition fiscale qui découle de cette conclusion en ressort nuancée.
2. Des effets potentiellement déstabilisateurs
La compétition fiscale n'est pas, par principe, une mauvaise chose. Si ses résultats conduisent à mettre en oeuvre des législations fiscales plus efficaces sur le plan économique, elle est source d'amélioration.
La capacité des Etats à répondre aux défis de la compétition fiscale est alors une question centrale.
Il faut toutefois noter dès ce stade que les Etats ne sont pas dans des situations égales pour manifester cette capacité.
L'aptitude de chacun à adopter le meilleur système fiscal possible varie en fonction de la situation d'origine de son système fiscal, des conditions économiques et sociales qui prévalent et de son système de préférences collectives.
Autrement dit, le passage d'un système fiscal peu économique à un système fiscal économiquement supérieur est plus ou moins douloureux selon les pays.
La désagrégation complète du système de prélèvements soviétiques offre un exemple spectaculaire des coûts d'adaptation d'un système fiscal non économique vers un système fiscal contraint par la concurrence économique mais aussi fiscale. A cet exemple extrême, on peut ajouter bien d'autres illustrations (en particulier, la très forte irritation américaine face aux pressions exercées sur le système fiscal intérieur qui se nourrit beaucoup de l'appréciation portée sur le rôle international des Etats-Unis) qui toutes renvoient à la fragilisation du rôle de l'impôt comme financeur de biens publics.
Mais, au-delà, il est à craindre que la compétition fiscale ne produise des effets surdéterminés.
Le champ de la compétition fiscale internationale "a priori" très vaste doit être apprécié au regard de l'influence fiscale.
La charge fiscale n'est qu'un élément du coût d'une activité sur laquelle elle pèse. De plus, des coûts bruts il faut déduire les avantages liés à une implantation donnée.
En ce qui concerne ces derniers, il est d'ailleurs remarquable qu'ils influencent souvent la valeur prise par la variable fiscale.
Dans les faits, on doit même penser que la variable fiscale prend une valeur dépendant de la valeur d'autres variables. Un exemple emprunté au prix des logements aide à le comprendre : les prix des logements varient selon les aménités du voisinage ; plus elles sont grandes, plus le prix des logements augmente.
Des phénomènes semblables se produisent certainement pour les impôts.
D'autres considérations doivent être prises en compte. La mobilité en constitue une de première importance. L'attractivité réelle d'un système fiscal dépend de ses caractéristiques mais aussi de la propension des activités ou des facteurs à en saisir les opportunités.
Dans ces conditions, il apparaît que la compétition fiscale
- doive porter principalement sur les revenus et facteurs les plus mobiles et les moins concernés par les contreparties de l'impôt ;
- et qu'elle n'est susceptible de contrebalancer les avantages nets d'une localisation concurrente que pour autant qu'elle les égale.
Pour s'en tenir à la première observation, il y a d'abord lieu de l'étayer un peu plus en faisant remarquer l'une des caractéristiques importantes des régimes fiscaux qui est leur mouvance.
Les coûts fiscaux sont en effet des coûts institutionnels susceptibles de variations brutales au gré de décisions politiques.
La mobilité est donc bien l'une des caractéristiques essentielles qu'empruntent les activités et revenus susceptibles d'être la cible de la compétition fiscale internationale.
Le degré de mobilité des facteurs et des richesses qui est susceptible de varier dans le temps à l'intérieur d'une même catégorie est donc le prisme à travers lequel doit se lire le degré de la compétition fiscale internationale.
Le sens de la compétition fiscale internationale doit lui-même être précisé.
Il diffère selon l'impact de l'impôt.
Les impôts "douaniers", c'est-à-dire ceux qui, renchérissant les biens et services importés pouvant être utilisés pour s'assurer un avantage compétitif direct, sont destinés à être augmentés.
En revanche, la diminution de la charge fiscale sera recherchée s'il s'agit d'attirer les activités.
Certains Etats peuvent, de ce point de vue, être tentés de pratiquer une politique fiscale réservant les avantages fiscaux aux non-résidents. Mais cette inégalité de traitement a ses propres limites. Si chacun agit ainsi, l'attraction réciproque des non-résidents risque de se traduire par des gains économiques nuls au prix d'une perte fiscale sèche.
Et c'est l'une des caractéristiques majeures de la compétition fiscale que d'être peu maîtrisable si elle n'est pas régulée.
Le risque de surenchère qui s'y attache est immense.
Les effets de la compétition fiscale, asymétriques selon les Etats, sont susceptibles d'être extrêmement déstabilisateurs.
La structure des prélèvements est susceptible d'être sensiblement modifiée par elle.
Les facteurs les plus mobiles peuvent être "inimposables", ce qui se traduit alors par un transfert de la charge fiscale sur les facteurs captifs.
Cette déformation structurelle, socialement contestable, n'est pas nécessairement injustifiée économiquement. Certains pays qui manquent d'épargne ou bien de technologies de l'épargne -puisque les activités financières étant les plus mobiles sont les plus concernées par la compétition fiscale internationale- peuvent trouver à cette situation des avantages.
Mais, pour les pays dans lesquels l'emploi n'est pas suffisamment développé -en un mot les pays où le chômage est un problème économique et social- le transfert d'imposition sur le travail est l'une des conséquences les plus négatives de la compétition fiscale internationale.
B. UNE INFLUENCE CERTAINE SUR LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
1. Les écarts de taux de prélèvements obligatoires entre pays se sont réduits
Les prélèvements obligatoires dans les pays industrialisés
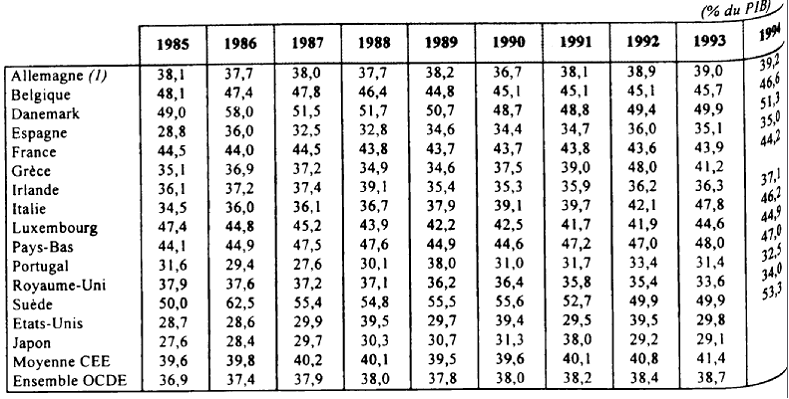
La compétition fiscale internationale n'a pas eu pour conséquence une réduction des prélèvements obligatoires dans le PIB des pays industrialisés.
A l'exception du Royaume-Uni où des prélèvements obligatoires se sont repliés de 3,9 points de PIB, ils ont partout ailleurs, soit stagné, soit légèrement augmenté entre 1985 et 1994.
En moyenne, ils sont passés pour la CEE de 39,6 à 41,4 points du PIB entre 1985 et 1993 et pour l'ensemble des pays de l'OCDE de 36,9 à 38,7 % du PIB.
En 1985, la moyenne des prélèvements dans les pays de l'OCDE était de 36,9 % du PIB, la Suède avec + 13,1 points et le Japon avec - 9,3 points par rapport à cette moyenne étaient les deux pays qui connaissaient les taux de prélèvements les plus contrastés.
En 1993, cette même moyenne étant de 38,7 %, l'écart des deux pays à cette moyenne s'est globalement réduit (+ 11,2 points pour la Suède ; -9,6 points pour le Japon).
Pour la France, l'écart à la moyenne est passé de 7,6 à 5,2 points entre 1985 et 1993.
Un phénomène de convergence du niveau des prélèvements obligatoires doit donc être notée.
Mais des écarts substantiels demeurent. Cependant, la signification du poids des prélèvements obligatoires dans le PIB ne doit pas être exagérée.
a) Les prélèvements obligatoires sont un concept flou
Les comparaisons internationales sur le poids de la fiscalité reposent sur le calcul d'un taux de prélèvements obligatoires rapporté au PIB.
L'Organisation pour la coopération et le développement économique -OCDE- définit les impôts comme " l'ensemble des versements obligatoires effectués sans contrepartie au profit des administrations publiques".
Cette définition pose une série de problèmes :
•
Le départ entre les administrations
publiques et certains organismes est parfois ambigu :
ainsi en
va-t-il pour les organismes de sécurité sociale dont la nature
publique ou privée ne va pas toujours de soi.
Soit l'exemple des systèmes de pensions : certains pays (Royaume-Uni, Allemagne) ont institué un régime de versements obligatoires mais qui peuvent être libérés auprès d'un organisme privé ou public. Dans le premier cas le versement n'est pas comptabilisé comme prélèvement obligatoire tandis qu'il l'est dans l'autre hypothèse alors même que la charge provient d'une même obligation.
•
La frontière entre le "facultatif et
l'obligatoire n'est pas entièrement nette.
Par exemple, en
France, certains versements obligatoires attachés à la
consommation d'un bien sont considérés comme des
prélèvements obligatoires -la TVA- alors que d'autres ne le sont
pas -les redevances de navigation aérienne-.
De la même manière certains versements facultatifs sont en réalité obligatoires : ainsi en Allemagne ou aux Pays-Bas où, au-dessus d'un certain niveau de salaire, l'adhésion aux régimes publics de sécurité sociale est facultative mais, en pratique, presque toujours réalisée.
• Le taux de prélèvements obligatoires
n'est pas indifférent aux modalités institutionnelles de
l'intervention de l'Etat. Que celui-ci pratique la dépense fiscale, les
prélèvements obligatoires seront réduits du montant de
celle-ci. Qu'il choisisse plutôt d'intervenir par la dépense
publique, les prélèvements obligatoires et les dépenses
publiques seront relativement plus élevés.
Ces considérations sont loin d'être théoriques comme le montre d'abord un exemple tiré de deux estimations des prélèvements obligatoires en RFA en 1987 réalisées par l'OCDE. Dans l'une, ceux-ci étaient estimés à 37,6 % du PIB tandis que dans l'autre récapitulatif les recettes fiscales en RFA à partir des comptes nationaux étaient de 41,2 % du PIB.
b) La signification économique du concept n'est que relative
Au-delà de ces difficultés de délimitations statistiques, on doit souligner combien la notion de prélèvements obligatoires peut occulter les réalités économiques. Ainsi, la progression des dépenses de santé est un phénomène qui se rencontre dans les pays développés, même inégalement. Mais la socialisation des dépenses de santé diffère selon les pays si bien que l'impact de leur accroissement en termes de prélèvements obligatoires varie considérablement alors qu'exprimé en termes économiques et sociaux il est sinon identique du moins analogue.
La signification du taux de prélèvements obligatoires est donc souvent moins économique qu'institutionnelle.
En outre, et ceci est lié à cela, les prélèvements obligatoires ne sont pas des prélèvements sans contreparties.
A côté d'un raisonnement sur l'amputation des revenus que provoquent les prélèvements, il faut procéder à un raisonnement sur les revenus qu'ils financent.
L'appréciation de l'effet de la fiscalité sur la compétitivité économique ne peut donc être menée indépendamment de l'appréciation de l'effet sur la compétitivité économique des dépenses publiques.
2. Les structures des prélèvements obligatoires demeurent contrastées
En matière de compétition fiscale internationale, la structure des prélèvements obligatoires compte plus que leur niveau global.
Compte tenu de l'inégale élasticité des revenus et des facteurs à l'attraction fiscale internationale, c'est le poids des prélèvements sur les bases les plus mobiles qui doit être envisagé avant tout.
La structure par catégorie de prélèvements diffère fortement selon les pays.
Les impôts sur le revenu des personnes physiques
Ils représentent en moyenne 27,5 % des prélèvements obligatoires des pays de l'OCDE (26,5 % pour les pays de l'Union européenne).
Trois groupes de pays peuvent être distingués :
- les pays où le poids de cet impôt est supérieur à 30 % des recettes fiscales totales : les pays Scandinaves sauf la Norvège, la Belgique, l'Irlande, l'Islande ainsi que les pays anglo-saxons non européens ;
- les pays où le poids de l'IRPP est proche ou supérieur à 20 % .
Il s'agit de sept pays de l'Union européenne (Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal et Royaume-Uni), ainsi que le Japon, la Norvège, la Pologne et la Turquie ;
-
les pays où cet impôt représente
moins de 15 %
des recettes
fiscales :
la
Hongrie, la Grèce, la République tchèque et la France.
Ainsi, bien que la France se caractérise par un taux de pression fiscale parmi les plus élevées des pays de l'OCDE, son impôt sur le revenu se distingue par un produit est très faible qui la rapproche des pays les moins avancés sur le plan économique.
Ce poids très différencié de l'impôt sur le revenu est compensé par la faiblesse ou l'importance relative d'autres prélèvements, notamment les cotisations sociales.
Les cotisations sociales
Les cotisations sociales représentent 25,9 % des prélèvements obligatoires des pays de l'OCDE (29,2 % pour l'Union européenne).
Elles sont très élevées en France, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Allemagne.
A l'autre extrême, elles sont très faibles (3,2 % des recettes totales) au Danemark, voire inexistantes en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison de la fiscalisation des dépenses sociales.
Les impôts sur la consommation des biens et services
Ils se sont fortement accrus depuis le début des années 70 et constituent plus de 35 % des recettes fiscales au Mexique, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Turquie, au Portugal, en Norvège et en Islande.
A l'exception de ces deux derniers pays, il apparaît donc que les pays les moins développés favorisent les impôts indirects.
En France, la part des impôts sur la consommation s'élève à 26,2 % des prélèvements obligatoires, ce qui situe notre pays légèrement en-dessous de la moyenne aussi bien des pays de l'OCDE (30,2 % des prélèvements obligatoires) que des pays de l'Union européenne (30,0 %).
Face à cet alourdissement des impôts sur la consommation, les Etats-Unis, le Japon et la Suisse se distinguent puisque la part de leurs impôts sur la consommation est inférieure à 16 % des prélèvements obligatoires contre 30,2 % en moyenne pour les pays de l'OCDE.
Cependant, certains points communs existent :
Les impôts sur les bénéfices
Ils représentent une faible part des prélèvements et du PIB dans tous les pays de l'OCDE (respectivement 7,5 % et 2,9 %) à l'exception notable de l'Australie, du Japon et du Luxembourg.
Les impôts sur le patrimoine
Leur part est très réduite au sein des pays de l'OCDE puisqu'ils s'élèvent à 5,2 % de l'ensemble des prélèvements obligatoires et à 1,9 % du PIB.
Il faut toutefois noter l'importance relative des impôts sur le patrimoine au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon, où ils représentent plus de 10 % des prélèvements obligatoires.
Répartition des prélèvements
obligatoires
par catégorie (en %
)
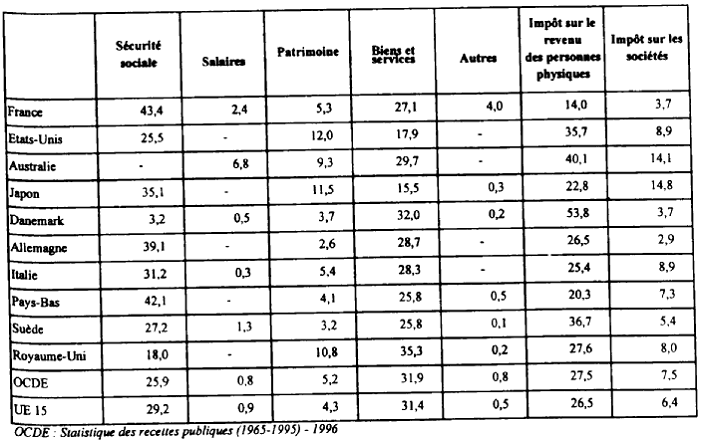
La structure par administration bénéficiaire varie elle-même fortement.
On peut distinguer cinq catégories d'administrations aptes à percevoir des prélèvements obligatoires :
- l'administration centrale,
- les administrations d'Etat quand il s'agit d'un Etat fédéral,
- les administrations locales,
- les administrations de sécurité sociale,
- les autorités supranationale (la CEE pour les pays en faisant partie).
Les prélèvements obligatoires reviennent généralement aux administrations qui les collectent mais il faut, dans certains cas, tenir compte des transferts de recettes effectués entre administrations.
En France, depuis 1970 (voir tableau page 95), le poids relatif des administrations publiques centrales n'a cessé de se réduire au profit de celui des administrations locales et de la sécurité sociale. Elle est, parmi les pays à structure unitaire, celui qui consacre le moins de ressources à l'Etat central (46,2 %), la moyenne étant de plus de 60 %. Le poids des cotisations sociales, au profit des administrations de sécurité sociale, en est la raison essentielle.
C'est la part des cotisations qui varie le plus entre les pays, cette hétérogénéité reflétant la diversité des modes de financement de la protection sociale. Elle va de 3,2 % au Danemark où la fiscalisation est presque totale à 43,4 % en France où, au contraire, la protection sociale est en majorité financée par les cotisations sociales.
La pression fiscale locale augmente depuis trente ans en France, mais sa part relative est beaucoup plus faible que dans certains pays (30,7 % au Danemark, 28,8 % en Suède, 24,6 % au Japon). Dans d'autres pays (Belgique, Pays-Bas, Italie, Grèce, Irlande), la fiscalité locale est marginale. La contribution des Etats membres de la Communauté européenne aux recettes communautaires reste faible.
3. La structure des prélèvements obligatoires s'est modifiée
Ainsi, selon une étude présentée par la Commission des Communautés européennes, "entre 1980 et 1994, le taux moyen d'imposition implicite du travail salarié en Europe s'est accru à un rythme soutenu, passant de 34,7 % à 40,5 %. Pour les autres facteurs de production (capital, travailleurs indépendants, énergie, ressources naturelles), ce taux est tombé de 44,1 % à 35,2 %. Le taux d'imposition de la consommation est resté relativement stable (il n'a augmenté que légèrement, de 13,1 % à 13,8 %)". - 131 -
Évolution des prélèvements obligatoires en France entre 1985 et 1994
(en points de PIB)
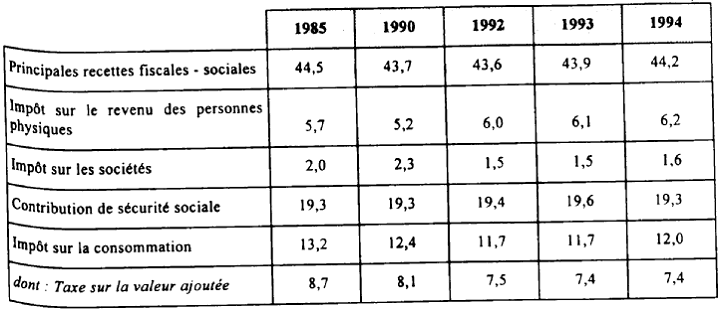
L'évolution des prélèvements obligatoires en France est de ce point de vue symptomatique.
La part des différents prélèvements n'a pas été bouleversée mais la structure des prélèvements s'est progressivement modifiée.
Les prélèvements dont la part dans le total s'est accrue sont les prélèvements assis sur les revenus des ménages : l'impôt sur le revenu (+ 1,2 point ; 12,8 % du total en 1985, 14 % en 1994) et les contributions de sécurité sociale (+ 0,4 % ; 43,4 % du total en 1985, 43,7 % en 1994).
A l'inverse, la proportion dans le total des impositions relevant de l'impôt sur les sociétés et des impôts sur la consommation s'est infléchie.
L'impôt sur les sociétés représentait en 1985 4,5 % des prélèvements, il n'en représentait plus que 3,6 % en 1994.
La part des impôts sur la consommation dans le total des prélèvements est elle-même passée de 29,7 à 27,1 %, celle de la TVA reculant entre ces mêmes dates de 19,6 à 16,7 %.
Ces évolutions proviennent des mesures prises au cours des années récentes pour des motifs divers au premier rang desquels a figuré le souci d'adapter le système de prélèvement au contexte international.
|
L'impôt sur les sociétés Le taux de l'impôt sur les sociétés qui était resté remarquablement stable durant de nombreuses années a été nettement abaissé à partir du milieu des années 80. De 45 % en 1986 -soit cinq points de moins que son taux historique- il est passé par étapes à 33,33 %. Évolution du taux de l'impôt sur les sociétés 1980 50 1981 50 1982 50 1983 50 1984 50 1985 50 1986 45 1987 45 1988 42 1989 39/42 1 1990 37/42 1 1991 34/42 1 1992 34 1993 33,33 (1) Le premier taux s'applique aux bénéfices mis en réserve. Le second aux bénéfices distribués. Source : Service de la législation fiscale Entre 1980 et 1993, le produit de l'impôt sur les sociétés a progressé moins vite que le PIB. En 1980, l'impôt sur les sociétés en représentait 2,1 % ; en 1993 il ne s'élevait plus qu'à 1,6 % du PIB. Sa part dans les prélèvements obligatoires de 5 % en 1980 n'était plus que de 3,6 % en 1993. L'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières ayant progressé de 14,7 % entre 1990 et 1995, le produit de l'impôt sur les sociétés s'est lui contracté de 11 % (-15,4 milliards de francs courants). Sur la base de la variation de l'excédent brut d'exploitation entre ces deux années, il est possible d'estimer la perte de recettes fiscales résultant des aménagements de droits pour 1995 à 36,2 milliards de francs. Une telle estimation doit cependant être prise avec d'infinies précautions dans la mesure où l'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières n'est qu'un indicateur très grossier du bénéfice fiscal des entreprises 18 ( * ) qui, par ailleurs, est influencé dans son niveau par le poids de l'imposition des bénéfices 19 ( * ) . |
Un processus identique a concerné la TVA dont le taux majoré de 33,33 % a été supprimé par étapes par la loi du 26 juillet 1991.
Il est intéressant à ce stade de noter que les adaptations concernant l'un et l'autre des prélèvements examinés n'ont pas obéi à une logique identique même si l'influence du contexte international a été, dans l'un et l'autre cas, déterminante.
Pour l'impôt sur les sociétés, il s'est agi pour l'essentiel, d'améliorer la position de compétitivité de notre pays alors que pour la TVA il s'est agi principalement de consentir à un désarmement fiscal et de renoncer à une organisation du prélèvement favorable à la compétitivité de nos produits.
4. Les régimes préférentiels se sont développés
a) Les mesures fiscales françaises d'attraction des investissements étrangers
(1) le régime des quartiers généraux : un mode de détermination des bénéfices adapté à la spécificité des quartiers généraux
Un quartier général est un établissement stable ou une filiale d'un groupe étranger qui exerce au seul profit du groupe dont il fait partie des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle, en principe dans un secteur géographique déterminé.
Il résulte de cette définition que :
a) l'activité du quartier général consiste en des prestations de service qui correspondent à des fonctions de nature "administrative" (ex. fonctions de gestion, de coordination, de contrôle ou de recherche), et non susceptibles de donner lieu à une commercialisation à des tiers ;
b) le quartier général agit exclusivement pour le compte de l'ensemble des entreprises du groupe ;
c) les fonctions exercées par le quartier général se situent en amont de l'activité commerciale du groupe dont le quartier général fait partie (loin du produit) ; de ce fait, elles sont regroupées dans une structure individualisée (le quartier général), distincte du reste du groupe.
L'application des règles de droit commun aux quartiers généraux conduirait ces derniers à déterminer la valeur marchande de chaque service rendu et à la ventiler en fonction de l'intérêt que ce service présente pour chacune des entités bénéficiaires.
Afin de tenir compte de la nature des services rendus par un quartier général, un régime spécifique a été mis en place pour :
- simplifier le mode de détermination des résultats imposables ;
- garantir une sécurité juridique.
Ce régime consiste à déterminer les bénéfices du quartier général de façon forfaitaire, en fonction des deux éléments suivants :
- l'ensemble des charges d'exploitation courante ;
- une marge bénéficiaire admise par avance, pour l'ensemble des activités qui relèvent des fonctions "quartier général" calculée en appliquant un pourcentage donné au montant des charges visées ci-avant (régime de "cost plus").
La marge est déterminée par une cellule de spécialistes du ministère de l'économie et des finances.
La marge admise n'est pas intangible pour toute la durée d'existence du quartier général. Elle est susceptible d'être modifiée en fonction des changements intervenus dans les conditions d'exercice des activités. La base d'imposition ainsi déterminée reflète le bénéfice susceptible d'être réalisé dans des conditions de pleine concurrence.
Le taux d'imposition est le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, soit actuellement 33,33 % (plus une majoration de 10 % de cet impôt).
En outre, les salariés expatriés des sociétés étrangères admises au régime des quartiers généraux bénéficient, pour une durée maximale de six ans, d'un traitement fiscal favorable de certains frais liés à leur expatriation.
La question de l'attractivité relative du régime fiscal français des quartiers généraux est posée.
•
En termes de niveau de fiscalité
Seule une analyse globale de l'évaluation comparative du poids de l'impôt dû d'un pays à l'autre, à bénéfice égal, permettrait de démontrer que le régime français apparaît compétitif.
La fiscalité des quartiers généraux implantés en France ne se comparerait favorablement avec celle qui leur est applicable dans les principaux Etats qui ont institué un régime particulier pour ce type d'entités que si par son champ d'application, le taux de l'impôt, le montant de la marge bénéficiaire forfaitaire qui est retenue et le traitement des expatriés, le poids de l'impôt dû en France était inférieur à celui dû chez nos concurrents.
•
En termes de sécurité
juridique
Le régime français donne l'assurance aux quartiers généraux que le montant de leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ne sera pas remis en cause s'ils le déterminent en fonction de la marge bénéficiaire déterminée par l'administration fiscale.
•
Les mesures prises pour améliorer le
régime des quartiers généraux
Le régime des quartiers généraux est désormais élargi :
- la compétence des quartiers généraux est étendue à l'ensemble des sociétés du groupe sur une base mondiale.
La compétence des quartiers généraux est, à l'heure actuelle, limitée à un secteur géographique déterminé (l'Europe occidentale par exemple).
Cette limitation n'étant plus adaptée à l'évolution du fonctionnement des groupes qui repose souvent, au niveau de la prise de décision, sur une organisation par directions sectorielles plutôt que géographiques, il sera désormais possible aux groupes de créer en France des quartiers généraux à vocation mondiale.
L'extension de la compétence géographique, qui correspond à un véritable besoin des grands groupes internationaux, ne doit bien entendu pas conduire à dénaturer la vocation du quartier général. En tant que démembrement du siège social du groupe, le quartier général ne devra pas disposer de pouvoirs complets quant à la gestion quotidienne des sociétés d'exploitation. Le quartier général devra continuer à intervenir tout au plus comme préparateur puis relais d'une décision prise à l'échelon décisionnel du groupe auquel l'actionnaire a dévolu des pouvoirs exclusifs quant à la décision.
-
le régime des quartiers
généraux est étendu aux
groupes
français
Il convient en effet de prendre en compte la tendance marquée des groupes français à développer les créations de sociétés à l'étranger pour exercer des missions similaires à celles exercées en France par les quartiers généraux.
- le régime des quartiers généraux s'applique désormais aux centres de distribution
(2) le régime de l'entrepôt fiscal
Afin de favoriser les opérations internationales réalisées sur le territoire français, notamment dans ses zones portuaires, un régime d'entrepôt fiscal a été mis en place.
Outre l'entrepôt national d'importation, l'entrepôt national d'exportation et les régime du perfectionnement actif national, deux catégories nouvelles d'entrepôts fiscaux ont été créées. Il s'agit de l'entrepôt de matières premières cotées sur un marché à terme et de l'entrepôt abritant des productions internationales coordonnées.
Les transactions et prestations réalisées sur les biens placés sous ces entrepôts bénéficient d'un régime suspensif de TVA jusqu'à la sortie du bien de ces régimes.
Enfin, cette mesure a été l'occasion de la mise en place d'une représentation fiscale allégée pour les opérateurs étrangers qui choisissent la France comme lieu de dédouanement ou comme lieu de stockage dans les entrepôt fiscaux de marchandises destinées à quitter le territoire national.
(3) la procédure du "rescrit" fiscal
Le champ de la procédure du "rescrit" vient d'être élargi. L'obligation a été imposée à l'administration fiscale de répondre, dans un délai maximum de trois mois, à toute demande tendant au bénéfice d'un régime d'amortissement exceptionnel ou du régime des entreprises nouvelles. Sans réponse dans ce délai, l'accord de l'administration est réputé obtenu et devient opposable par l'entreprise lors de contrôles ultérieurs.
Par ailleurs, l'administration peut être consultée par un contribuable sur sa situation fiscale, et ce, dans un grand nombre de cas qui concernent la vie des entreprises. C'est le cas des procédures d'agrément, mais c'est aussi le cas de la procédure de répression des abus de droits qui ne s'applique pas lorsque le contribuable a, préalablement à la conclusion d'un contrat, consulté l'administration et recueilli son accord sur l'opération. Par ailleurs, l'administration fiscale publie régulièrement des instructions pour préciser la portée des textes fiscaux qui lui sont en effet opposables.
(4) la mise en place d'un régime spécifique aux centres de distribution
En complément au régime des quartiers généraux, un mécanisme similaire de détermination forfaitaire du bénéfice au profit des centres de distribution spécialisés dans des fonctions de logistique exercées au bénéfice exclusif des entités d'un groupe est institué.
(5) les stipulations favorables des conventions fiscales internationales
Dans les conventions fiscales internationales conclues par la France, un certain nombre de dispositifs favorisent le développement des investissements étrangers dans notre pays.
Il en va ainsi lorsque nous acceptons de transférer l'avoir-fiscal à des non résidents ou encore lorsque nous consentons à des taux de retenue à la source inférieurs à ceux recommandés par la convention-modèle de l'OCDE.
b) Des exemples étrangers peu acceptables
Certains pays sont allés plus loin que nous dans ce domaine. Ils ont développé des régimes fiscaux préférentiels qui peuvent favoriser des abus.
|
Quelques régimes fiscaux préférentiels
Les sociétés holding ont pour objet principal l'acquisition ou la détention d'actions d'autres sociétés. Leur localisation ne suppose pas d'implantation locale lourde -ni investissement physique, ni main d'oeuvre substantielle. Certains pays européens (Luxembourg, quelques cantons suisses) leur appliquent un régime spécial d'imposition alors que dans les autres, elles sont soumises au régime normal d'imposition des bénéfices des sociétés. Il s'agit, sous certaines conditions, de leur accorder le bénéfice d'une exonération totale au partielle d'imposition sur les dividendes perçus par elles ou sur des plus-values en capital qu'elles réalisent en revendant les actions détenues.
Ils rendent, pour le compte d'un groupe auquel ils sont liés, des services variés (services administratifs, d'assistance, d'achats, de distribution...). Tout comme les sociétés holding, ils sont par nature très mobiles. Certains pays européens -la Belgique, la Suisse- leur appliquent différents avantages fiscaux. Le risque majeur découlant d'un tel traitement préférentiel est que les sociétés qui recourent aux services du quartier général ou du centre de coordination paient un prix excessif les prestations fournies pour minorer leurs bénéfices dans les Etats d'imposition normale où elles sont implantées. Théoriquement, le contrôle des prix de transfert devrait permettre de combattre efficacement ces manoeuvres. Mais l'utilisation de ces structures pour financer les opérations internationales d'une société peut être également attrayant lorsqu'elle permet d'échapper aux systèmes d'imputation nationaux.
Il s'agit de territoires accueillant des structures dont l'objet est de réaliser des opérations financières internationales importantes dont certains sont sans lien avec le pays d'accueil. Initialement cantonnés dans les paradis fiscaux, ces territoires ont gagné les économies dynamiques d'Asie et les pays occidentaux développés. Les avantages fiscaux qui sont offerts vont de l'exonération totale de certaines activités à l'application de taux réduits. Leur essor traduit des phénomènes importants de concurrence fiscale entre Etats destinés à attirer les activités de services financiers. Ils sont susceptibles de susciter des mouvements d'évasion lorsqu'ils se combinent avec des pratiques de secret bancaire ou de réticences à accepter les échanges de renseignements entre administrations fiscales.
Destinés à la gestion collective de l'épargne, ils sont fréquemment transparents fiscalement, soit qu'ils soient exonérés d'impôt, soit qu'ils soient imposés aux taux zéro. Il est à noter que, dans le premier cas, les fonds ne sont en général pas couverts par les conventions fiscales internationales alors que, dans le second, ils bénéficient des régimes conventionnels et en particulier des stipulations relatives aux retenues à la source ou aux transferts des crédits d'impôt. Comme pour les centres financiers extra-territoriaux, ces structures peuvent favoriser l'évasion fiscale lorsque les actionnaires non-résidents peuvent bénéficier d'un défaut de coopération fiscale de la part des autorités administratives de l'Etat de localisation de ces structures. |
C. L'ENCADREMENT DE LA COMPETITION FISCALE INTERNATIONALE
La compétition fiscale internationale n'est pas par principe une mauvaise chose.
Mais, sa logique propre est dangereuse si, se traduisant par des surenchères, elle aboutit à priver les Etats de la possibilité de financer les biens publics ou à surtaxer certains revenus en exonérant plus ou moins complètement les revenus mobiles.
Il est extrêmement ardu de faire le tri entre les phénomènes de compétition fiscale acceptables et ceux qui ne le sont pas.
A ce stade de l'analyse, une chose est sûre : les régimes fiscaux favorisant l'évasion ou la fraude fiscale ne sont pas admissibles.
Mais, dans ce domaine il faut savoir distinguer la responsabilité des régimes fiscaux de celle des agents qui pratiquent l'optimisation fiscale.
On reconnaîtra alors que deux questions différentes se posent :
- celle de l'opportunité de réduire les écarts fiscaux entre Etats ;
- celle des mesures à prendre pour prévenir une utilisation par les agents économiques de ces écarts si elle n'est pas jugée désirable.
Ces deux questions renvoient clairement au problème de savoir comment organiser la compétition fiscale internationale et en particulier si une coopération internationale n'est pas nécessaire pour cela.
1. Les mesures de protection contre l'évasion et la fraude fiscale internationale en droit interne : une efficacité limitée
a) Les mesures disponibles...
1. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est le fondement légal de la procédure de répression des abus de droit.
Il dispose que "les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention" ne peuvent être opposés à l'administration, qui est alors "en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse".
De portée très générale, la procédure peut être utilisée pour lutter contre l'évasion fiscale internationale.
2. La lutte contre la manipulation des prix de transferts.
L'article 57 du Code général des impôts, récemment modifié, dispose que "pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre (Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 publiée au J.O. du 13).
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement."
Il s'agit de lutter contre les possibilités offertes à des entités dépendantes de localiser leurs bénéfices dans les pays où elles sont implantées à fiscalité relativement légère par des procédés de manipulation des prix des opérations réalisées entre elles.
3. La lutte contre l'évasion par la localisation de structures dans des Etats à fiscalité privilégiée
L'article 238 A du Code général des impôts prévoit que certaines sommes, payées ou dues par une personne résidant en France à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France, et qui y bénéficient d'un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié si elles ne sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
Ce dispositif qui vise un large champ de charges (intérêts, redevances...) s'applique tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière d'impôt sur le revenu.
Il représente une première arme anti "paradis fiscaux" et permet de combattre des transferts de bénéfices ou de revenus vers les pays à fiscalité privilégiée par l'intermédiaire de versements correspondants à des charges fictives ou anormalement évaluées.
4. La lutte contre l'évasion fiscale mettant en jeu des sociétés étrangères dépendantes
L'article 209-B du CGI est la deuxième arme anti "paradis fiscaux".
Il a pour objet de dissuader les entreprises françaises de localiser leurs bénéfices dans des pays ou territoires à fiscalité privilégiée et de combattre certains abus nés de l'application combinée des règles de territorialité en matière d'impôt sur les sociétés et du régime des sociétés-mères et filiales prévu par les articles 145 et 216 du CGI.
Il dispose que, sous certaines réserves, l'entreprise française est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société établie dans un pays ou territoire à fiscalité privilégiée, dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.
b) ... sont d'une efficacité limitée :
(1) Des procédures qui ne corrigent que les abus
Qu'il s'agisse de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ou des articles 57, 238 A et 209 B du Code général des impôts, les situations visées ne sont que des situations où un abus, une simulation ou une dissimulation sont en cause.
Les exceptions apportées au principe de territorialité de l'impôt ne sont donc justifiées que par l'existence de pratiques fictives destinées à délocaliser la base imposable.
Aucun des dispositifs examinés n'est utilisable lorsque la délocalisation de la base imposable correspond à des opérations réelles même lorsque celles-ci sont menées vers des "paradis fiscaux".
Ils ne permettent donc que de lutter contre une dégradation fiscale artificielle.
(2) Des procédures rarement utilisées... :
Résultats du contrôle fiscal au titre de l'article 57 du CGI
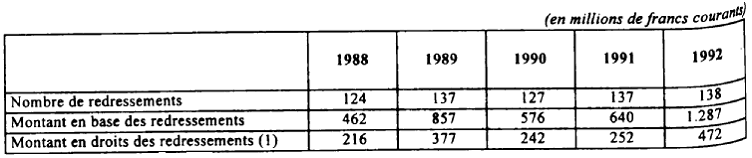
(1) Estimation obtenue à partir du montant de base.
Source : direction générale des impôts.
Le 13ème rapport du Conseil des impôts relevait à propos de l'application de l'article 57 du CGI qu'on pouvait observer "une assez forte augmentation des montants en base au cours de l'année 1992 mais une stabilité, sur la période 1988-1992, du nombre d'opérations ayant donné lieu à des redressements sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts". Il estimait le montant total des redressements entre 200 et 500 millions de francs environ. Il comparaît ces chiffres à ceux de l'IRS américain pour 1992 : 1,3 milliard de dollars de redressements envisagés (soit environ 7,2 milliards de francs). Il concluait : "Au regard de ces résultats, les redressements opérés en France au titre de l'article 57, s'ils ne sont pas d'un montant négligeable, n'en apparaissent pas moins modestes".
Résultats du contrôle fiscal au titre de l'article 238-A du CGI
(en millions de francs courants)
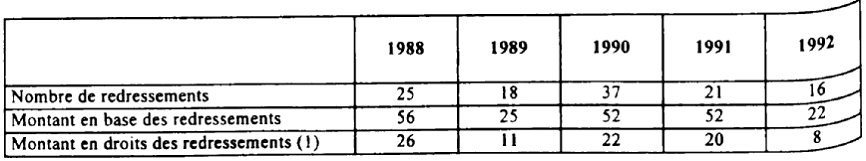
(1) Estimation.
Source : direction générale des impôts.
Le même rapport du Conseil des impôts notait à propos de l'application de l'article 238-A : "Les redressements sont rares et leur montant, en base, faible. Pour l'année 1992, le montant en droit des redressements, au titre de cet article, peut être estimé à la modeste somme de 8 MF" .
Résultat du contrôle fiscal au titre de l'article 209-B du CGI
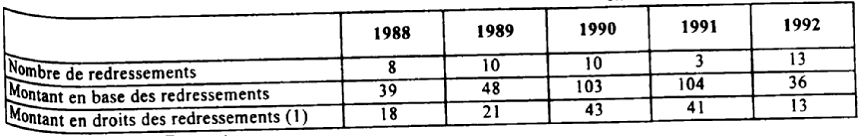
(1) Estimation
Source : direction générale des impôts.
L'application de l'article 209-B suscitait les mêmes commentaires : "Le nombre d'opérations effectuées, ainsi que le montant des redressements opérés, apparaissent modestes".
2. Le nécessaire développement des dispositifs internationaux
Les mesures internes ont pour vocation de combattre les phénomènes d'évasion fiscale. Elles ne peuvent y parvenir que moyennant une coopération internationale qui fait trop souvent défaut. Un code international de bonne conduite s'impose.
Mais les mesures strictement internes n'ont pas vocation à lutter contre les effets des écarts de fiscalité entre Etats.
En ce qui concerne ce problème, c'est la question de l'harmonisation des fiscalités internationales qui se pose.
a) Le nécessaire code international de bonne conduite
La multiplication des régimes préférentiels, l'essor des paradis fiscaux combinés à l'internationalisation des opérations financières, laissent planer des doutes sur la loyauté de la compétition fiscale internationale.
Un Etat ne peut rien contre ces phénomènes sans la coopération des autres.
Un code international de bonne conduite s'impose.
Il n'entre pas dans le cadre de ce rapport de dresser la liste des mesures qui devraient y figurer.
Cependant, tout ce qui favorise l'opacité des opérations de transferts internationaux de revenus peut être réputé suspect.
Il est donc souhaitable d'exercer une pression pour que :
- les régimes de secret bancaire soient levés ;
- les systèmes de coopération administrative et judiciaire internationale fonctionnent mieux ;
- et qu'une véritable responsabilité des Etats dans le domaine de la poursuite de leurs justiciables coupables de favoriser la fraude fiscale à l'égard d'autres Etats soit instituée.
b) La question épineuse de l'harmonisation fiscale internationale
L'harmonisation fiscale internationale soulève des questions de principe très fortes mais aussi des problèmes de définition de son champ ou de son degré. Un réel regain d'intérêt pour cette question semble voir le jour. Il y a lieu de s'en féliciter très vivement et, en particulier, de saluer les initiatives prises au cours de l'année par l'Organisation de coopération et de développement économiques, par le G7 et par l'Union européenne dans ce domaine.
(1) L'impôt sur les sociétés : un cas type des problèmes posés par l'harmonisation fiscale.
Rentabilité avant impôt nécessaire
pour obtenir
une rentabilité de 5 % après
impôt
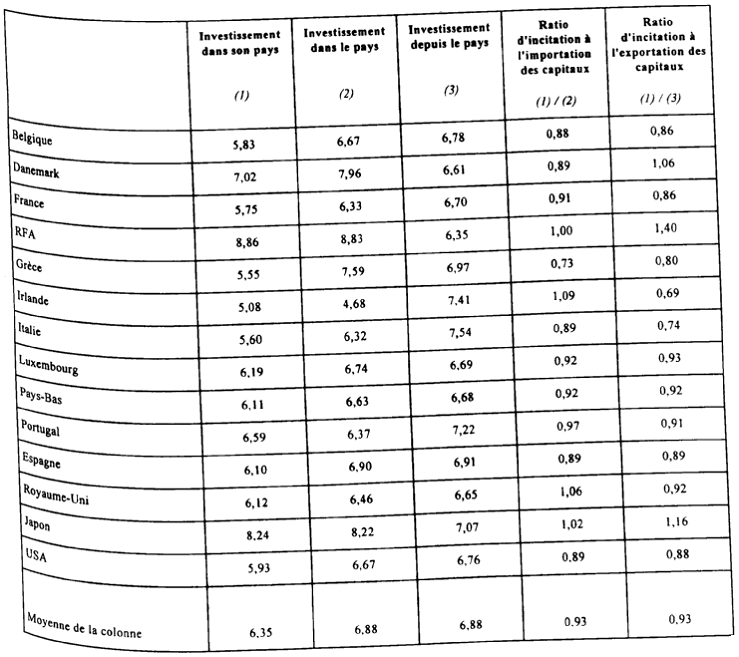
Source : Devereux et Pearson (1989)
Le tableau ci-dessus est issu d'une étude assez ancienne -elle a été publiée en 1989- mais qui illustre assez bien les différents aspects des problèmes posés par l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés.
Le tableau est construit à partir des taux effectifs d'imposition des investissements et indique quelle doit être la rentabilité d'un investissement avant imposition pour que celui-ci dégage une rentabilité après impôt de 5 %.
Dans la première colonne cette donnée est indiquée pour les investissements réalisés dans le pays de l'investisseur ; dans la deuxième colonne, pour les investissements réalisés dans le pays à partir de l'ensemble des pays considérés ; dans la troisième colonne, pour les investissements réalisés dans l'ensemble des pays considérés à partir du pays indiqué en ligne.
Le ratio d'incitation à l'importation -quatrième colonne- mesure le rapport entre le taux de rentabilité nécessaire pour un investisseur national et celui nécessaire pour un investisseur d'un autre pays. Plus ce ratio est faible, moins le pays se montre accueillant pour les visiteurs étrangers.
Le ratio d'incitation à l'exportation -cinquième colonne- est un indicateur qui mesure l'incitation à exporter son capital du fait des poids relatifs de l'impôt intérieur et étranger.
Les résultats produits sont périmés en raison des phénomènes de convergence intervenus depuis en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois, plusieurs observations intéressantes peuvent en être tirées :
•
Le taux effectif de l'impôt sur les
sociétés diffère très sensiblement du taux nominal.
L'étude réalisée le montre bien. A la date de sa
réalisation, la France appliquait en matière d'impôt sur
les sociétés un taux nominal fortement supérieur à
celui de la plupart des autres pays.
Il apparaît pourtant que, s'agissant des investisseurs nationaux, la France était l'un des pays où le niveau de rentabilité nécessaire avant impôt était l'un des plus bas de l'échantillon.
Il y a au demeurant dans ce constat l'expression d'un doute sur les motifs réels de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés en France postérieure à 1990.
• Les investissements transnationaux sont en
général plus lourdement taxés que les investissements
nationaux.
Il n'y a donc pas neutralité de l'imposition sur
l'investissement. Les frontières fiscales existent bel et bien.
Seuls l'Allemagne -alors, la RFA-, l'Irlande, le Portugal et le Japon réservaient aux investissements étrangers un traitement fiscal plus favorable qu'aux résidents.
Seuls les investisseurs danois, allemands et japonais se voyaient inciter à délocaliser leurs capitaux pour des motifs fiscaux.
Il est tout à fait remarquable dans ces conditions que investissement direct international se soit tant développé et ce sans que la part de chacun des pays dans le total des investissements directs paraisse corrélée avec les réalités fiscales nationales.
Flux des investissements directs
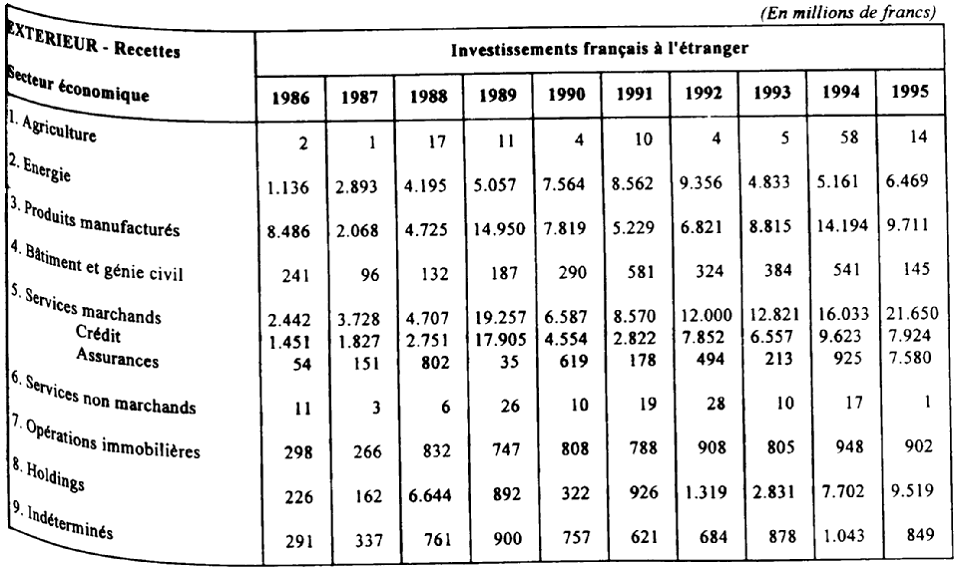
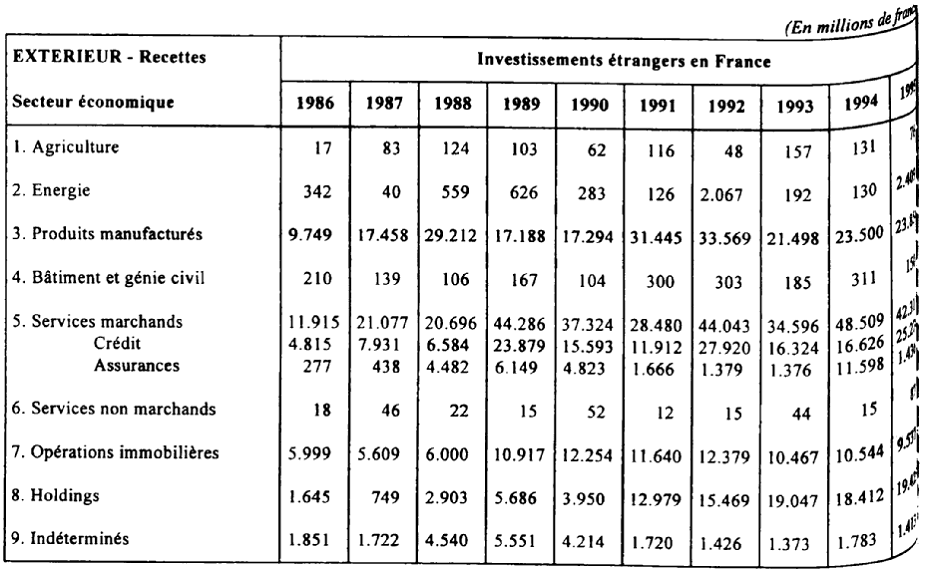
Source : Banque de France
•
La logique d'harmonisation fiscale
sous-jacente à l'étude est ambiguë à l'image des
questions posées en général par ce
problème.
Tout d'abord, il pourrait s'agir d'indiquer que les disparités d'imposition des sociétés seraient à l'origine de problèmes de compétitivité pour les économies où l'effet de l'impôt serait le plus pénalisant pour les investisseurs nationaux.
Les résultats mentionnés démontrent amplement le caractère erroné d'une telle approche en matière d'impôt sur les sociétés. Les prélèvements obligatoires ne sont pas tout. Le niveau d'un prélèvement peut être compensé par celui d'un autre.
Ensuite, il pourrait s'agir d'indiquer que certains pays pénalisent les investissements étrangers du fait du niveau de l'impôt sur les sociétés -on retrouve alors l'objection citée ci-dessus- ou alors que certains pays traitent de façon discriminatoire les investissements étrangers par rapport aux investissements nationaux, soit qu'ils les favorisent soit qu'ils les pénalisent.
En réalité, il apparaît que rares sont les pays qui se trouvent dans le premier cas -dans les cas relevés, on ne peut dire que l'incitation fiscale à importer les capitaux soit efficace globalement- et que presque tous les pays pénalisent relativement les investissements étrangers.
Mais, dans cette hypothèse, il n'y a manifestement pas volonté de leur part de prévenir l'importation de capitaux et, plutôt que d'évoquer une pénalisation volontaire de l'investissement étranger de la part du pays d'accueil, il vaudrait mieux faire état d'une pénalisation systématique résultant du cumul des règles fiscales des Etats de provenance et de destination de l'investissement.
La dernière logique identifiable est, de loin, plus complexe : il s'agirait de prôner une entière neutralité de l'impôt sur les choix d'investissement.
La base du raisonnement est la suivante : un investissement n'est optimal que s'il est influencé par des facteurs économiques, à l'exclusion de tout facteur institutionnel.
Lorsque des différences de rentabilité d'un investissement proviennent d'écarts d'imposition, la localisation des activités correspond moins au niveau relatif des coûts de production qu'à des considérations d'opportunité fiscale. Un ensemble économique donné gagnerait à éliminer ces distorsions : il produirait alors à moindre coût et davantage.
Poussée à l'extrême, cette logique conduirait à adopter un système unique de prélèvements sur les revenus de l'entreprise -sans doute même, d'ailleurs, un système unique de prélèvements-. Une version plus modeste de l'harmonisation consisterait à éliminer les facteurs de variation de l'imposition de l'investissement national en fonction de son implantation. Il s'agirait dans cette hypothèse de démanteler les retenues à la source imposées par les pays d'accueil en laissant à l'Etat de provenance de l'investissement la pleine maîtrise de l'impôt sur les sociétés.
L'harmonisation maximum paraît irréaliste et serait sans doute dangereuse et inutile.
Irréaliste parce qu'elle heurterait la souveraineté des Etats.
Dangereuse parce que l'harmonisation d'un prélèvement doit tenir compte des autres prélèvements et du niveau des dépenses publiques et donc du souhait de socialisation des revenus exprimé dans chacun des Etats.
Inutile parce que l'élasticité globale de la localisation des investissements à l'impôt sur les sociétés, pas plus que l'influence de ce dernier sur la localisation des investissements, ne semble avérée.
L'harmonisation minimum laisserait subsister des écarts importants de pression fiscale et atténuerait la source de distorsion fiscale d'ores et déjà la moins puissante.
Elle conduirait à priver de recettes fiscales les Etats d'accueil des investissements étrangers et renforcerait l'incitation à délocaliser les productions des pays à niveau d'imposition relatif élevé.
(2) Les questions posées par l'imposition des revenus des particuliers
L'évolution des prélèvements s'est caractérisée -voir supra- par un alourdissement relatif des prélèvements pesant sur le revenu des ménages.
Sans qu'il soit possible d'attribuer la cause de ce phénomène à un transfert des impositions des facteurs les plus mobiles vers des facteurs "captifs", il y a lieu d'en redouter l'éventualité.
Mais, évoquer la fiscalité pesant sur les ménages ne suffit pas. Les ménages sont dans des situations variables ; le secteur n'a pas l'unité apparente qu'on lui attribue. Une partie des ménages tire l'essentiel de ses revenus de leur travail ; d'autres bénéficient essentiellement de revenus de transfert ou de leurs actifs. La mobilité des ménages est elle-même variable, certains étant plus que d'autres sujets au nomadisme fiscal.
Comme pour les autres aspects de la compétition fiscale internationale, deux problèmes distincts au moins se posent :
• celui de l'effet sur la compétitivité
économique du système de prélèvement sur les
ménages ;
• celui des distorsions induites par la
compétition fiscale internationale.
Ils se recouvrent partiellement.
En ce qui concerne les distorsions induites par la compétition fiscale internationale, il y a lieu de s'inquiéter :
• des perspectives d'alourdissement relatif de la
pression fiscale sur le revenu des ménages consécutives à
l'érosion des prélèvements opérés sur
d'autres revenus ;
• d'une relative déformation de la structure
de la fiscalité sur les ménages, les éléments les
plus mobiles de leur revenu étant "détaxés" au
détriment des revenus moins mobiles ;
• de phénomènes éventuels de
nomadisme fiscal résultant d'arbitrages fiscaux.
Ce dernier phénomène, pour résiduel qu'il apparaisse, semble susceptible de concerner pour l'essentiel des contribuables à revenus importants. Il est d'autant plus susceptible de prendre de l'ampleur qu'à l'inverse des Etats-Unis, la France n'impose ses citoyens que pour autant qu'ils résident sur le territoire national ou que, résidant à l'étranger, ils perçoivent des revenus de source française.
On rappelle en effet que la citoyenneté américaine est exigeante sur le plan fiscal, puisque les Etats-Unis taxent leurs citoyens quelles que soient leur résidence et la source de leurs revenus.
Il y a d'ailleurs lieu d'observer que des projets existent aux Etats-Unis visant à combattre l'exode fiscal des non-résidents qui, au travers de leur assujettissement à une "expatriation tax" se verraient imposer à l'occasion d'une délocalisation fiscale à raison des plus-values, même latentes, de leur patrimoine américain.
S'agissant des deux autres motifs de préoccupation soulignés ci-dessus, s'ils semblent encore largement virtuels, on ne peut que relever l'existence d'un phénomène d'inflexion de la taxation de l'épargne parallèle avec un renforcement des prélèvements sur les revenus salariaux.
En tout état de cause, les réactions suscitées en Allemagne par l'introduction d'une retenue à la source de 30 % sur les revenus mobiliers illustrent le poids de la contrainte internationale dans ce domaine.
On mesure à ce stade les inconvénients résultant de l'absence de traduction réelle de l'engagement pris au moment de la libération des mouvements de capitaux en Europe d'assortir celle-ci d'une harmonisation des fiscalités les concernant.
En ce qui concerne l'effet sur la compétitivité économique du système de prélèvements sur les ménages il s'agit, compte tenu du poids relatif des prélèvements en question et de la situation de sous-emploi qui prévaut d'une question cruciale dont l'approfondissement dépasserait le cadre de ce rapport. Mais, il va de soi que, même corrigée des évolutions récentes de notre système de prélèvement fiscal et social, l'observation traditionnelle selon laquelle les prélèvements sur le travail sont d'un poids excessif dans notre pays ne peut être que renouvelée.
3. L'harmonisation fiscale en Europe
Le processus d'harmonisation de la fiscalité en Europe illustre les principes retenus en ce domaine par les Etats européens et les choix privilégiés par eux.
Les compétences communautaires en matière fiscale sont inégalement développées
a) Les compétences communautaires en fiscalité directe sont réduites
Le chapitre du Traité de Rome consacré aux règles fiscales ne traite pas des impôts directs.
Les fondements juridiques de l'intervention de la Communauté en la matière sont donc les suivants :
•
Non discrimination selon la
nationalité
Le Traité comporte des dispositions visant à assurer la libre circulation des travailleurs (article 48) et des capitaux (article 67) et le libre établissement des entreprises (article 52).
La Cour de Justice des Communautés européennes interprète ces dispositions générales comme ayant une portée fiscale. Elle leur donne ainsi une interprétation extensive : ainsi estime-t-elle que les discriminations en matière de "rémunération", interdites par l'article 48, incluent les discriminations dans le traitement fiscal des rémunérations.
Ces dispositions ne permettent cependant pas de fonder une véritable harmonisation des fiscalités nationales. Elles n'interdisent que les différences de traitement fondées sur la nationalité.
La Cour peut certes aller encore plus loin dans l'extension de ce concept.
Encore faut-il observer que le seul véritable enjeu d'une telle extension est le maintien ou non de la distinction entre résident et non-résident, opérée pour des raisons objectives par toutes les fiscalités.
Or le Traité de Maastricht a conforté cette distinction en introduisant un article 73 D : ce texte prévoit que les Etats membres peuvent appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables ne se trouvant pas dans la même situation quant à leur résidence ou quant au lieu où leurs capitaux sont investis, sous réserve que ces distinctions ne constituent pas une restriction déguisée à la libre circulation.
La France est assez exemplaire en matière de non discrimination parmi les Etats membres. Elle se distingue de plusieurs de ses partenaires en donnant une portée effective au principe de traitement national prévu par le Traité (bénéfice de l'avoir fiscal et du régime mère/fille accordé aux établissements stables en France d'entreprises d'autres Etats membres). Par ailleurs, la législation fiscale française ne connaît pas de dispositions discriminatoires telles que celles qui ont été récemment attaquées devant la CJCE dans les affaires Commerzbank (refus du Royaume-Uni d'accorder aux non-résidents les intérêts moratoires accordés aux résidents) ou Schumackers (refus de l'Allemagne d'accorder aux non-résidents la prise en compte des charges de famille).
•
L'article 100
Cet article stipule que "le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun".
Il a été admis que cette disposition générale pouvait concerner la fiscalité. Mais elle comporte plusieurs limites :
- cet article ne peut être mis en oeuvre que pour modifier les dispositions nationales qui ont une incidence directe sur le marché commun ;
- ce rapprochement ne peut s'opérer que par la voie de directives (définies par l'article 189 du Traité), à l'exclusion de règlements, ce qui vise à garantir aux Etats membres la maîtrise des modalités d'application du principe retenu au niveau communautaire ;
- la directive ne peut être adoptée qu'à l'unanimité des Etats membres.
L'Acte unique, pour remédier aux difficultés créées par la règle d'unanimité, a prévu à l'article 100 A la possibilité d'adopter certaines directives à la majorité qualifiée. Mais le paragraphe 2 de cet article exclut expressément les dispositions fiscales de cette procédure.
Aux conditions déjà posées par l'article 100, s'ajoute désormais le principe de subsidiarité.
• Le principe de
subsidiarité
L'article 3 B du Traité sur l'Union européenne dispose :
"La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.
"Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
"L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité ".
Dès lors que, pour l'essentiel, la fiscalité directe relève de la compétence nationale, mais que la Communauté a, en ce domaine, une compétence en vertu de l'article 100, même si cette compétence est subsidiaire et conditionnelle, la fiscalité directe peut être considérée comme un domaine "qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté", soumis en tant que tel au principe de subsidiarité (deuxième et troisième alinéas de l'article 3 B).
La Communauté n'est donc fondée à agir en cette matière que lorsque l'objectif peut être mieux réalisé à son niveau qu'à celui des Etats membres agissant unilatéralement ou par la voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Les moyens qu'emploie la Communauté doivent, de surcroît, être proportionnés à l'objectif poursuivi.
•
L'article 220
L'article 220 est la seule disposition du Traité qui vise expressément la fiscalité directe. Il prévoit l'obligation pour les Etats membres d'engager entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer en faveur de leurs ressortissants l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la Communauté.
Encore est-il difficile de considérer comme juridiquement contraignante une obligation formulée en termes aussi peu impératifs : il y a obligation de négocier mais non de conclure, et encore seulement "en tant que de besoin". Ainsi la Cour n'a-t-elle jamais sanctionné de manquement de la part de la Grèce, du Luxembourg, du Portugal et de l'Irlande, qui n'ont pourtant pas une convention fiscale avec chacun des autres Etats membres. Au demeurant, la France, quant à elle, a un réseau de conventions complet avec les autres Etats membres.
C'est sur cette base qu'a été adoptée la convention d'arbitrage européenne du 23 juillet 1990, qui prévoit un dispositif destiné à résoudre les conflits de double imposition en matière de redressement de bénéfices entre entreprises associées d'Etats membres différents.
b) Les compétences en matière de fiscalité indirecte sont plus étendues
Le traité relatif au Marché commun comportait un chapitre, toujours en vigueur, composé de cinq articles (articles 95 à 99) intitulé "Dispositions fiscales".
Seul l'article 99 peut être considéré comme servant de base à un éventuel processus d'harmonisation européenne.
Les autres articles contiennent en effet des mesures classiques de désarmement fiscal inspirées du principe du traitement national des biens et produits.
L'article 99 stipule :
"Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 7 A."
Il est à observer que l'harmonisation est encadrée par la nécessité d'assurer l'établissement et du fonctionnement du marché extérieur".
Cette réserve d'usage est cependant moins contraignante que les conditions de vote requises pour procéder à l'harmonisation. L'unanimité est exigée.
Cette condition restrictive n'a pas empêché que des progrès considérables soient réalisés dans le sens de l'harmonisation en matière de TVA.
Bref rappel du processus d'harmonisation en matière de TVA
Lors de l'établissement du Marché commun, seule la France pratiquait un système de TVA, les autres Etats-membres appliquant un système de taxe sur le chiffre d'affaires en cascade.
Cette modalité d'imposition permettait aux Etats de fausser la concurrence. Comme le montant de l'impôt frappant un bien ou un service ne pouvait être déterminé avec précision, il suffisait à l'Etat de l'exportateur de surévaluer l'imposition à ristourner à son entreprise et à l'Etat d'importation de surévaluer lui-même l'imposition à appliquer au bien ou service importé.
Pour pallier ces difficultés, deux directives du 11 avril 1967 ont été adoptées suivies dix ans plus tard par la directive du 17 mai 1977 qui harmonisait l'ensemble des règles relatives à la TVA, excepté les taux.
Ceux-ci s'étageant de façon disparate, les Etats-membres s'engagèrent en décembre 1989 à ne pas aggraver les disparités de leurs taux de TVA.
Cet objectif fiscal est aujourd'hui juridiquement encadré par la directive n° 92/77/CEE du 19 octobre 1992 qui fixe les règles d'harmonisation des taux de TVA entre les Etats-membres.
En vertu de cette directive, les Etats peuvent appliquer :
- un taux normal, qui ne peut être inférieur à 15 % ;
- un ou deux taux réduits, qui ne peuvent être inférieurs à 5 % et qui ne peuvent s'appliquer qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories énumérées en annexe H de la directive.
Pendant la période transitoire précédant la mise en oeuvre du régime définitif de TVA intra-communautaire, c'est-à-dire en théorie jusqu'au 31 décembre 1996, une tolérance existe en faveur des taux dérogatoires existant dans certains Etats-membres :
- le maintien du taux zéro, ouvrant au remboursement de la TVA facturée en amont, pour les pays qui appliquaient un tel taux avant le 1er janvier 1991 (Belgique, Danemark, Irlande, Royaume-Uni) ;
- le maintien des taux super réduits, inférieurs à 5 %, quand ils existaient avant le 1er janvier 1991 (Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg).
L'harmonisation en matière de TVA est incomplète :
• les taux sont inégaux selon les
Etats ;
• les règles de déduction, les
exonérations et les régimes particuliers sont disparates.
Le système concernant la TVA intracommunautaire est donc essentiellement transitoire.
La Commission des Communautés européennes a, dans la perspective du passage à un régime définitif, présenté, le 22 juillet 1996, un document intitulé "Un système commun de TVA. Un programme pour le marché unique".
Il propose une harmonisation des taux laissant subsister un système de fourchettes et évoque des mesures d'harmonisation concernant les divers autres éléments du régime de TVA en Europe.
Mais, surtout, il propose d'abandonner l'attribution directe des recettes des TVA par le système de taxation et d'y substituer un mécanisme de réattribution des recettes.
Les projets de la commission modifient profondément l'impact de notre régime de TVA sur la compétitivité économique nationale puisqu'ils s'accompagneraient de la suppression des mécanismes de détaxation-taxation des échanges entre Etats membres.
En outre, voir supra, ils supposent une harmonisation beaucoup plus poussée des régimes de TVA des Etats membres et une harmonisation concernant les variables essentielles du régime proposé.
En effet, comme celui-ci se fonderait sur une attribution des recettes de TVA en fonction de la consommation taxable dans chaque Etat, il conviendrait de parvenir à une complète harmonisation des conditions de définition de cette variable et donc à une transparence et une sincérité égales à son évaluation statistique.
*
* *
Le processus d'harmonisation fiscale est semé d'embûches.
La souveraineté des Etats s'oppose à une harmonisation décidée en dehors d'eux.
Mais elle milite pour que soit menée une harmonisation négociée afin d'éviter qu'une harmonisation imposée à eux ne l'emporte.
Deux dossiers sont prioritaires en matière d'impôts directs :
- l'élimination de la double imposition des revenus transfrontaliers. Cet objectif ne saurait être atteint sans que les revenus en cause ne soient imposés au moins une fois ;
- la question des incitations fiscales en faveur des capitaux à forte mobilité internationale.
La résolution des problèmes posés implique un fort engagement des Etats qu'il convient de soutenir.
* 1 Une simulation réalisée à l'aide du modèle multinational MOSAÏQUE, commun à l'OFCE et au CEPII, montre que l'impact restrictif des politiques budgétaires rigoureuses menées de manière concomitante en Europe représenterait 1,2 point de croissance pour l'ensemble de l'Europe en 1996 et 0,8 point en 1997. On déduit de cette simulation que (sans ces ajustements budgétaires) la croissance européenne aurait été de 2,4 % en 1995, puis 2,6 % en 1996 et 3,1 % en 1997, soit une évolution plus conforme aux reprises cycliques observées par le passé à la suite d'un épisode récessif.
* 2 Ces deux évolutions ne peuvent pas être cumulées car elles concernent des données partiellement communes.
* 3 L'évolution de la population active est difficile à prévoir. L'an dernier on avait souligné le risque d'une accélération de la population active en France sous l'effet du très faible niveau des taux d'activité aux deux extrémités de la vie active dans notre pays. Ce risque s'est réalisé puisque la population active s'est accrue de 312.000 personnes entre mars 1995 et mars 1996 contre 150 000 personnes dans la période antérieure.
* 4 Le taux d'investissement moyen au début des années 70 approchait 22 %. Ainsi, en dépit d'une baisse de la valeur réelle des investissements des entreprises entre 1990 et 1995 l'activité économique ne devrait pas en elle-même susciter une reprise des investissements.
* 5 Il faut cependant rappeler que le montant des créances de la Banque de France au Trésor était plafonné depuis 1973.
* 6 Même si l'explication des déficits de ce secteur ne peut instituer une réponse univoque.
* 7 Pour l'exercice 1997, plusieurs modifications de présentation des dépenses sont mises en oeuvre dont l'imputation des charges de retraite de France Télécom et la suppression de la charge de l'Etat liée à l'écrêtement des départements surfiscalisés.
* 8 "Le changement de statut de France Télécom conduit, à partir de 1997, à retracer dès la loi de finances initiale des charges qui, jusqu'en 1996, n'y figurent pas :
- les retraites de ses agents fonctionnaires, inscrites dans le chapitre général des pensions des fonctionnaires et jusqu'à présent rattachées en cours d'exercice par voie de fonds de concours Leur montant est évalué à 7,98 milliards de francs en 1996 et 8,36 milliards de francs en 1997 ;
- les charges de compensation et surcompensation au titre de ces retraites, jusqu'ici directement versées par l'opérateur public sur le compte de gestion de la compensation auprès de la Caisse des dépôts. Elles figureraient désormais sur le chapitre budgétaire retraçant la part de l'Etat employeur dans ces dépenses. Ces charges représenteraient 1,15 milliard de francs, en 1996 comme en 1997.
La comparaison entre 1995 et 1996 se doit d'écarter ces deux chefs de dépense, qui déforment la structure du budget en loi de finances initiale. Du point de vue des dépenses effectives, rien n'est changé pour les charges de pensions. Les charges de 1997, à structure constante 1996, sont réduites de 9,41 milliards de francs".
(Source : Assemblée nationale)
* 9 Alors que l'effort public (budgétaire, fiscal, social) total passe de 141,9 à 139,5 milliards de francs, soit une diminution de 1,7 %.
* 10 Soit 71,7 milliards de francs après prise en compte des prélèvements sur les recettes de l'Etat.
* 11 En tout état de cause, il serait vivement souhaitable que le gel des 316 millions de francs décidé l'été dernier ne se transforme pas en annulation car, selon certains experts, ce manque à gagner, conjugué à la baisse de 34 % des autorisations de programme pourrait entraîner mécaniquement la disparition de 3.600 emplois dans un secteur fragilisé (les entreprises qui travaillent sur les chantiers de monuments historiques) qui représente plus de 1.000 entreprises et 9.000 emplois.
* 12 Encore que sa couverture soit blanche, ce qui témoigne peut-être d'une "exception culturelle".
* 13 Ratio de la variation des recettes fiscales rapportée à la variation du PIB en valeur.
* 14 Pour des raisons institutionnelles, ce traité retient comme champ pertinent de la gestion des finances publiques l'ensemble des administrations publiques.
* 15 Qui, du fait du statut de l'organisme, n'entre pas dans la définition du besoin de financement des administrations publiques.
* 16 Le besoin financier pour les administrations publiques de cette opération dépendra à terme de l'évolution des ressources acquises et des charges de pension à financer.
* 17 Les taux adoptés pour les réductions d'impôt n'ont pas eu, en général, d'incidence sur le coût des mesures fixés à 20 ou 25 %, ils ont avantagé les contribuables dont le taux marginal d'imposition était inférieur ou égal à ce taux, soit des revenus modestes à moyens.
* 18 Il faut tenir compte au minimum de la variation de l'excédent brut d'exploitation des entreprises financières et des paiements d'intérêt.
* 19 Il convient en particulier de souligner l'influence du niveau de la pression fiscale sur le développement des activités