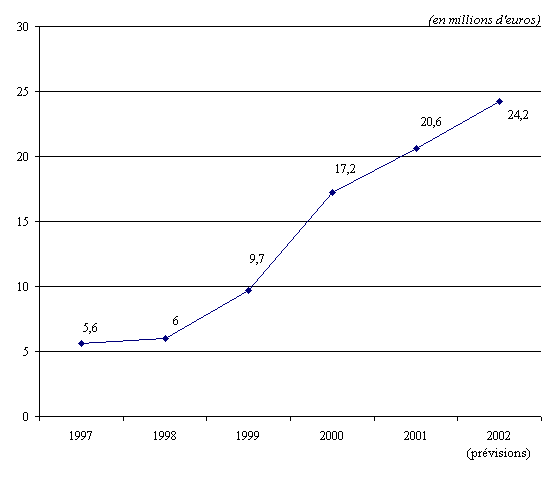IV. PRINCIPALES OBSERVATIONS
Le projet de budget du ministère de la jeunesse et des sports pour 2001 s'inscrit dans la continuité des années précédentes, et souligne la permanence de l'action de ce ministère depuis 1997.
A. UNE CONCEPTION SOCIALE DU SPORT
1. La démocratisation de l'accès à la pratique sportive
Depuis
son arrivée au ministère de la jeunesse et des sports, madame
Marie-Georges Buffet a développé une conception du sport comme
vecteur d'intégration des jeunes et des populations
défavorisées.
Cette conception s'est caractérisée par la mise en oeuvre de
plusieurs actions en faveur de
l'accès aux pratiques sportives pour
tous
. Ainsi, le développement des « coupons
sport » a permis à des jeunes issus de familles
défavorisés d'adhérer à un club sportif, et a
rencontré un succès considérable depuis sa
création. Le développement et la généralisation des
contrats éducatifs locaux (CEL) traduit également la
volonté de mieux intégrer la pratique sportive dans les rythmes
de vie et les rythmes scolaires des élèves.
Par ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports a pris plusieurs
mesures en faveur de la pratique sportive des handicapés, des femmes et
de la pratique sportive en entreprise.
Votre rapporteur se félicite de la volonté constante du
ministère de démocratiser l'accès aux pratiques
sportives
. Il remarque que les actions menées par le
ministère en faveur du sport handicapé et du sport féminin
ont d'ores et déjà permis d'assurer une meilleure
visibilité à ces pratiques sportives, et est encouragée
par les bons résultats des équipes de France féminines et
handisport dans les compétitions internationales.
2. Les aides aux clubs et aux associations
S'agissant des clubs sportifs, le ministère a
souhaité
développer les aides aux petits clubs, notamment dans le cadre du
FNDS : l'accroissement de la part régionale, la redistribution du
boni de liquidation du fonds « Fernand Sastre » et la mise
en oeuvre de la taxe de 5 % sur les droits de retransmission
télévisée des manifestations sportives permettent
d'accroître les aides versées aux petits clubs et aux associations
sportives. Celles-ci bénéficient également des
emplois-jeunes, pour lesquels le ministère de la jeunesse et des sports
s'est particulièrement impliqué afin d'assurer soit une
pérennisation des emplois créés, soit une formation des
jeunes concernés. D'autres dispositifs comme les emplois FONJEP (Fonds
de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire)
permettent également d'abaisser le coût des emplois pour les
associations, en versant une aide destinée à la
rémunération d'un animateur permanent. Dans le cadre du
dispositif FONJEP, le ministère de la jeunesse et des sports a ainsi
favorisé la création de nouveaux emplois et majoré
à plusieurs reprises le taux de prise en charge de ceux-ci.
Le soutien accordé aux associations s'est traduit par le renforcement
des aides à l'emploi, ce qui souligne la volonté du
ministère de la jeunesse et des sports de contribuer à la
diminution du chômage et à l'insertion sociale. Votre rapporteur
considère que les modalités de cette aide aux associations
constituent une alternative intéressante au
« saupoudrage » de subventions, dont l'usage est parfois
difficile à contrôler. Le recours aux conventions pluriannuelles
d'objectifs pour le versement de subventions aux associations, dont le
développement a été confirmé par une circulaire du
1
er
décembre 2000, devra permettre la mise en oeuvre d'un
véritable partenariat avec les associations.
3. L'accent mis sur la formation
Le
développement de la formation a constitué un
élément important de l'action du ministère de la jeunesse
et des sports depuis plusieurs années. Ainsi,
le dispositif des
établissements publics en charge de la formation aux métiers du
sport est en voie de modernisation et de rationalisation
. La loi
n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, a introduit la reconnaissance de la fonction sociale du
sport et a introduit la
validation des acquis
pour l'obtention des
diplômes délivrés par le ministère de la jeunesse et
des sports.
Enfin, en 2001, dans le cadre du programme de lutte contre les exclusions, le
ministère de la jeunesse et des sports a décidé
d'attribuer des
bourses
individuelles d'un montant de 305 euros aux
jeunes issus de milieux défavorisés préparant le brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA) et le brevet d'aptitude aux
fonctions de directeurs de centres de vacances et de loisirs (BAFD).
Votre rapporteur est très favorable au développement des
mesures en faveur de la formation des jeunes et des personnels du
ministère de la jeunesse et des sports. Il souligne l'importance des
efforts engagés tant pour moderniser les formations encadrées par
le ministère que pour ouvrir celles-ci à de nouveaux publics.
B. LA PROTECTION DES SPORTIFS ET LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
La
lutte contre le dopage constitue un axe fort de la politique mise en oeuvre par
le ministère de la jeunesse et des sports depuis 1997.
La loi du 23 mars 1999, codifiée dans le Code de la Santé
Publique, est aujourd'hui largement entrée en vigueur, puisque une
grande partie des textes d'application ont été publiés (11
sur 17), et que des moyens financiers importants ont été
dégagés par le ministère de la jeunesse et des
sports : pour
moderniser le laboratoire national de lutte contre le
dopage
, pour
permettre aux fédérations sportives de mettre
en oeuvre leur pouvoir disciplinaire en matière de dopage et la
surveillance médicale de leurs licenciés
(environ 3.500
sportifs ont bénéficié d'un suivi médical complet
ou partiel sur les 6.000 sportifs de haut niveau inscrits ; en 2002, cette
surveillance médicale sera étendue à l'ensemble des
sportifs de haut niveau, et en 2003, à tous les licenciés
inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau), et
pour mettre en place les antennes médicales de lutte contre le dopage
destinées à
suivre au plus près l'abus de produits
dopants par les sportifs
. Enfin, le ministère a mis en place un
numéro vert gratuit, confidentiel et anonyme, « Ecoute
dopage », afin d'aider et d'
orienter efficacement les personnes en
difficulté face au dopage
. Environ 1.000 appels sont
réceptionnés chaque mois, soulignant l'importance du
fléau qui touche des sportifs de tous les âges, de toutes les
disciplines et pas seulement les sportifs de haut niveau
.
L'année 2000 a été marquée par une forte
accélération des contrôles inopinés
qui sont
passés de plus de 20 % en 1999 à 45 % en 2000 ; 80
% de ces contrôles ont été réalisés à
l'initiative du ministère de la jeunesse et des sports. Au total, pour
l'année 2000, les procès verbaux reçus par le
ministère de la jeunesse et des sports font état de 7.967
prélèvements sur le territoire français. Le nombre
d'analyse positives sur le nombre total d'analyses effectuées s'est
élevé à 3,7 % en 2000, contre 3,5 % en 1999. On
notera cependant que 46 % des personnes contrôlées ont
déclaré avoir pris un médicament ou une substance au sens
large (vitamines, etc...) les sept derniers jours précédant le
contrôle. Par ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports
souligne que «
une variété importante de substances
interdites ou autorisées sous conditions peut être relevée
en cyclisme, athlétisme haltérophilie et natation
».
Entre 1997 et 2002, les crédits destinés à la lutte
contre le dopage ont été multipliés par 4,2.
L'effort budgétaire en faveur de la lutte contre le dopage depuis 1997
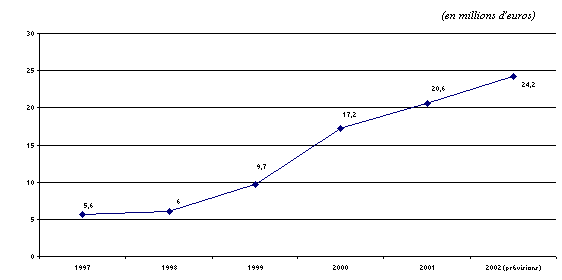
C. UNE ACTION INTERNATIONALE AMBITIEUSE
L'action menée par le ministère de la jeunesse et des sports dans
le cadre de la lutte contre le dopage se traduit, au niveau international, par
des prises de position très fermes tant dans le cadre de l'Union
européenne qu'au niveau mondial, afin de mieux coordonner les
législations relatives au dopage et de développer les
méthodes de détection des produits dopants.
Ces
prises de position
sont souvent
courageuses
et vont parfois
à l'encontre des positions défendues par les
fédérations sportives internationales et par le comité
international olympique. Le bras de fer ayant opposé le président
de l'Union cycliste internationale et la ministre de la jeunesse et des sports
concernant les contrôles des cyclistes sur le Tour de France
témoigne des difficultés d'impliquer tous les acteurs du sport
dans la lutte contre le dopage.
A l'occasion de la présidence française de l'Union
européenne,
la France a oeuvré en faveur d'une meilleure prise
en compte des caractéristiques spécifiques du sport et de ses
fonctions sociales dans l'Union européenne
. En effet, si
le sport
ne fait pas partie des compétences communautaires, il
est souvent
affecté par les décisions des instances européennes
,
notamment s'agissant des règles relatives à la concurrence et
à la libre circulation des personnes, des biens et des services (de ce
point de vue, la décision de la cour de Justice de la Communauté
Européenne du 15 juillet 1995 au sujet de la situation du
footballeur professionnel Jean-Marc Bosman a eu un retentissement et un impact
considérable dans le monde du sport professionnel, et en premier lieu,
celui du football).
La France a réussi à obtenir, après de longues
négociations avec la Commission européenne, le
maintien de la
possibilité pour les collectivités locales de verser des
subventions aux clubs sportifs professionnels
, dans la limite d'un montant
de 2,3 millions d'euros, et pour les seules missions
d'intérêt général prises en charge par ces clubs,
dont l'énumération figure dans le décret
n° 2001-828 du 4 septembre 2001, publié au Journal Officiel le
12 septembre 2001.
De même, un accord est intervenu le 5 mars 2001 entre la Commission
européenne et la Fédération internationale de football
association (FIFA), sur la question du
transfert des footballeurs
professionnels
. Le nouveau régime des transferts permettra
d'
assurer la protection des joueurs et de pérenniser le
système des clubs formateurs « à la
française
», et répond donc aux attentes de la
France.
Le Conseil européen de Nice du 7-9 décembre 2000 a pris une
double décision unanimement saluée en Europe. Il a
été décidé que l'Union européenne
participerait aux travaux et au financement de l'Agence Mondiale Antidopage
(AMA)
1(
*
)
. D'autre part, une
déclaration a été adoptée en faveur
«
des caractéristiques spécifiques du sport et de
ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte dans la
mise en oeuvre des politiques communes
».
La France défend la dimension sociale et les valeurs humanistes du sport
à l'échelle internationale.
Votre rapporteur considère
qu'il s'agit là d'un acquis important de l'action de Marie-Georges
Buffet depuis son arrivée à la tête du ministère de
la jeunesse et des sports, la voix de la France étant largement entendue
au niveau européen et mondial. Il tient à saluer l'action
courageuse et, quand cela s'avérait nécessaire, intransigeante,
de la ministre de la jeunesse et des sports sur la question du dopage.
D. LA SOUS-CONSOMMATION CHRONIQUE DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENT
Le
ministère de la jeunesse et des sports a souhaité
améliorer, au cours des dernières années, la programmation
et le rythme d'engagement de ses opérations d'investissement. Des
progrès ont été réalisés afin
d'améliorer la budgétisation des opérations
d'investissement, notamment en rapportant le taux de couverture des
autorisations de programme de 100 % à 50 %.
Plusieurs efforts doivent être signalés notamment l'association
des collectivités locales, principaux financeurs des équipements
sportifs, à la réflexion sur l'évolution des normes
définies par les fédérations sportives, et
l'élaboration d'un projet de schéma des services collectifs du
sport (SSCS) devant permettre de mieux planifier les investissements en
matière d'équipements sportifs
.
Enfin, le ministère de la jeunesse et des sports a
amélioré les conditions de financement des investissements sur le
FNDS. Cependant, le montant des crédits du FNDS reporté d'une
année sur l'autre demeure important, compte tenu du la couverture des
autorisations de programme à 100 %, règle applicable aux
comptes d'affectation spéciale, qui n'est cependant pas conforme au
rythme constaté de réalisation des investissements. Ce
phénomène s'est accru au cours des dernières
années, dès lors que la part des dépenses d'investissement
au sein du FNDS a fortement augmenté : les moyens d'engagement sont
passés d'environ 200 à 300 millions de francs (soit,
respectivement, 30,5 et 45,7 millions d'euros) entre 2001 et 2002.
Les autorisations de programme qui sont reportées correspondent
généralement à des opérations programmées
par le conseil de gestion du FNDS, mais dont l'engagement n'a pu intervenir
avant la fin de l'exercice. Sur ce point, des progrès ont
été effectués : un décret de décembre
1999 prévoit que les opérations d'investissement ne peuvent
désormais être programmées que lorsque le dossier
correspondant est complet.
Votre rapporteur spécial reconnaît que des retards peuvent
intervenir lorsque les investissements sont effectués dans le cadre de
politiques partenariales, qui impliquent d'autres acteurs. En revanche, il
déplore l'existence de décalages dans le temps pour des
opérations qui sont programmées et mises en oeuvre par le seul
ministère de la jeunesse et des sports. Ainsi, des autorisations de
programme correspondant à des équipements de l'Etat ont
été reportées de l'année 2000 vers l'année
2001 pour un montant de 123 millions de francs.
La
surabondance structurelle de trésorerie
du FNDS est
mécaniquement vouée à s'aggraver, compte tenu de la
couverture excessive des autorisations de programme par des crédits de
paiement. Elle résulte également des recettes
excédentaires par rapport aux prévisions, conséquence de
la sous-évaluation chronique des recettes du FNDS en loi de finances
initiale.
Votre rapporteur déplore le fait que la sous-évaluation
systématique des recettes du FNDS permette au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie de réguler les
dépenses au moment ou il prend la décision de reporter les
crédits correspondant aux recettes excédant le montant des
dépenses autorisé par la dernière loi de finances.
E. LE FINANCEMENT DU STADE DE FRANCE : UN ÉTERNEL PROBLÈME ?
De
1998 à 2001, sans tenir compte du financement de sa construction,
l'exploitation du Stade de France a coûté 36 millions d'euros
à l'Etat
. Les montant annuellement versés par l'Etat au
consortium exploitant le Stade de France représentent, selon les
années, entre 15 et 25 % des dépenses d'intervention
sportives figurant sur le chapitre 43-91 « sport de haut niveau et
développement de la pratique sportive ».
Pour
l'année 2002, le projet de loi de finances prévoit le versement
d'une indemnité de 12 millions d'euros.
Il convient de noter que, au cours de l'année 2000, l'indemnité
versée par l'Etat a atteint, pour la première fois, la
première place au titre de la marge contributive du résultat
d'exploitation du consortium, devant celle due à l'activité de
location des loges et des sièges « premiers ». Dans
son rapport, la SANEM note qu'
« il paraît discutable
que l'Etat verse intégralement cette indemnité de 78 millions de
francs lorsque le résultat brut d'exploitation de l'exercice
(168,9 millions de francs) est largement supérieur (de 49,2
millions de francs) à celui prévu (...) ».
Le résultat brut d'exploitation « indemnité
compensatrice » est devenu la première source de
rentabilité commerciale du consortium. Par conséquent,
le
risque financier devant être supporté par le concessionnaire
n'existe plus
. Le directeur général du consortium pouvait
donc qualifier la gestion du Stade de France de « durablement
bénéficiaire » lors de la présentation des
comptes, en juin 2000.
La garantie de l'Etat constitue une lourde charge pour les finances
publiques
. Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et la
ministre de la Jeunesse et des Sports ont, le 24 novembre 2000, chargé
M. Claude Villain, inspecteur général des finances,
d'engager des discussions avec le consortium Stade de France en vue de trouver
« un accord durable et équilibré » dans le
cadre d'une évaluation globale de la concession et de proposer des
solutions aux différentes demandes formulées par le consortium
depuis la mise en oeuvre du contrat de concession. M. Villain a
récemment remis ses conclusions aux ministres intéressés.
Votre rapporteur regrette que ces conclusions ne lui aient pas
été communiquées
.
Votre rapporteur considère que la situation actuelle est d'autant plus
dommageable que
le consortium n'a pas respecté toutes les obligations
qui s'imposent à lui dans le cadre du contrat de concession
(notamment, le programme d'animation permanente sur le site du Stade de France,
l'installation d'activités commerciales, en particulier dans le secteur
de la restauration, certaines prestations techniques...). Enfin, si le
consortium sponsorise trois événements forts de la vie locale
(meeting international d'athlétisme, festival de musique et
semi-marathon de Saint-Denis), il n'a pas mis en oeuvre toutes les actions
prévues par le contrat de concession pour soutenir les jeunes sportifs
locaux de haut niveau et favoriser la découverte par les jeunes des
métiers d'avenir pratiqués dans les groupes constituant le
consortium.
*
* *
Votre
rapporteur constate que le projet de budget du ministère de la jeunesse
et des sports pour l'année 2002 s'inscrit dans la continuité de
l'action conduite par Madame Marie-Georges Buffet depuis son arrivée
à la tête de ce ministère, marquée par un
développement du soutien au milieu associatif et à
l'éducation populaire, des actions en faveur de l'emploi et de la
formation, la mise en oeuvre de dispositifs visant à faciliter
l'accès de tous aux activités sportives, et un combat incessant
contre le dopage.
Depuis 1997, le ministère de la jeunesse et des sports a mis en oeuvre
une politique cohérente, axée autour des valeurs humanistes et
sociales du sport. La politique de la jeunesse a également
été relancée avec une volonté de permettre aux
jeunes de bénéficier d'un accès à internet, de
connaître leurs droits et de prendre part aux débats politiques
dans le cadre des conseils de la jeunesse.
Le ministère de la jeunesse et des sports conduit une politique
ambitieuse et exigeante. S'agissant du sport professionnel, certaines
initiatives ont pu sembler de nature à accroître le
décalage de la France vis-à-vis de ses partenaires
européens, et à provoquer une délocalisation des
manifestations sportives vers l'étranger (instauration d'une taxe sur
les droits de retransmission télévisée des manifestations
sportives, agrément obligatoire d'une fédération sportive
pour l'organisation d'une manifestation en France donnant lieu à remise
de prix, lutte contre le dopage...). Il n'en a rien été, et la
France a permis, par ses prises de position courageuses au niveau
européen et mondial, de faire avancer la réflexion sur la place
du sport dans nos sociétés.
Quelques écueils et défis demeurent cependant pour l'avenir. Il
s'agit, en premier lieu, de la question du Stade de France, dont la permanence
est flagrante. Votre rapporteur émet le souhait que la mission
confiée à M. Villain, inspecteur des finances, permettra de
dégager des pistes intéressantes afin de soulager le budget du
ministère de la jeunesse et des sports. Les investissements en faveur de
la rénovation des équipements sportifs et des centres de
vacances et de loisirs pourraient utilement bénéficier de
crédits supplémentaires, tant les besoins en la matière
sont importants.