DEUXIÈME PARTIE :
PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR
A. LE POIDS CROISSANT DES DÉPENSES SOCIALES
1. La disparition de la « créance de proratisation »
L'alignement en deux ans du niveau du revenu minimum
d'insertion
(RMI) outre-mer se traduit par la disparition, à compter de 2002, de la
« créance de proratisation ». Cette
« créance » était une enveloppe
financière dont le montant correspondait aux sommes
« économisées » par l'Etat en raison du
niveau plus faible du RMI outre-mer. En cours d'exercice, ses crédits
venaient alimenter pour un quart le FEDOM et pour le reste les aides au
logement.
Les inconvénients de l'alignement du niveau du RMI sont connus,
même si le secrétariat d'Etat à l'outre-mer a
indiqué à votre rapporteur que «
l'alignement ne
devrait pas avoir un effet déstabilisant sur le contexte
socio-économique des DOM, dans la mesure où le gain de pouvoir
d'achat n'est pas dissuasif vis à vis de la recherche d'un
emploi
».
Le gouvernement s'est engagé à ce que la disparition de la
créance de proratisation ne s'accompagne pas d'une diminution des moyens
des actions au financement desquelles elle participait. En matière de
logement, où les besoins sont énormes, il est difficilement
concevable de réduire les sommes disponibles.
La non disparition de la créance de proratisation se traduit
néanmoins par une augmentation des dépenses de l'Etat de l'ordre
de 122 millions d'euros (800 millions de francs), à laquelle il faut
ajouter l'augmentation des dépenses des conseils généraux
liées à l'augmentation mécanique du coût du volet
« insertion » du RMI.
Pour que les conséquences budgétaires de cette mesure soient
véritablement apparentes, il conviendrait que les crédits du RMI,
ainsi que ceux consacrés au nouveau revenu de solidarité
créé par l'article 27 de la loi d'orientation pour
l'outre-mer, figurent au sein du budget de l'outre-mer, et non à celui
de l'emploi et de la solidarité.
Il est particulièrement révélateur qu'aucun des deux
« jaunes » budgétaires consacrés à
l'outre-mer ne retrace, ni ne mentionne, les dépenses liées au
RMI.
2. Les dépenses du FEDOM augmentent toujours plus vite que celles du secrétariat d'Etat
Le
budget du secrétariat d'Etat à l'outre-mer augmente de 39
millions d'euros entre 2001 et 2002. Dans le même temps, les
crédits des aides à l'emploi, regroupées au sein du FEDOM,
progressent de 102 millions d'euros. A structure constante, elle augmentent de
71 millions d'euros.
Les dépenses du FEDOM ont progressé de 58 % en trois ans et
leur part dans les dépenses du secrétariat d'Etat est
passée du tiers à près de la moitié.
Le principal facteur d'augmentation de la dépense sont les
emplois-jeunes, dont le coût prévu pour 2002 s'élève
à
145 millions d'euros
. Cependant, l'année 2002 marque
aussi la montée en puissance des dispositifs créés par la
loi d'orientation pour l'outre-mer, qui coûtent
77,3 millions
d'euros
. Le coût des nouveaux dispositifs en faveur de Mayotte
s'établit à
18,2 millions d'euros
.
Le financement de ces nouvelles priorités est très
partiellement financé par redéploiement et réduction des
sommes consacrées aux dispositifs plus anciens.
Le montant des
dépenses qui leur sont consacrées a diminué de 20 millions
d'euros depuis 1999 alors que celui des nouveaux dispositifs a progressé
de 173 millions d'euros.
L'amélioration relative de la conjoncture économique au cours
de la période n'a pas permis de faire reculer le montant des sommes
consacrées aux emplois aidés. Cependant, elle conduit les
services de l'Etat à réorienter les crédits vers les
dispositifs en faveur des publics les plus en difficulté.
Ainsi, en
2001 des créations de contrats emploi solidarité (CES), de
contrat d'insertion par l'activité (CIA) et de contrats emploi
consolidés (CEC) ont été
« gagées » par la suppression de contrats
d'accès à l'emploi et d'emplois jeunes.
S'agissant des emplois-jeunes, qui ont toujours connu des problèmes de
recrutement outre-mer comme en témoignent d'importants reports de
crédits, on observera que l'accent porte désormais moins sur la
création de nouveaux emplois-jeunes que sur la reconversion des
titulaires des emplois existants. Dans cette perspective la création par
la loi d'orientation sur l'outre-mer du projet initiative jeunes, qui
prévoit des aides à la création d'entreprise, va dans le
bon sens.
B. DEUX SPÉCIFICITÉS CONTRADICTOIRES DE L'OUTRE-MER
1. Des avantages fiscaux et sociaux qui pourraient améliorer la compétitivité de l'outre-mer
Le
budget du secrétariat d'Etat à l'outre-mer s'élève
à 1.079 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2002.
Dans le même temps
,
l'Etat consacrera un montant très
supérieur au financement des différents avantages fiscaux et
sociaux dont bénéficient les contribuables implantés
outre-mer, qui se répartissent en
1.988 millions d'euros d'avantages
fiscaux (13 milliards de francs)
et
533 millions d'euros
d'exonérations de charges sociales
(dont environ 300 millions
d'euros liés aux mesures instaurées par la loi d'orientation sur
l'outre-mer).
2. Une régime de rémunérations des emplois publics fortement pénalisant
L'outre-mer ne retire pas de ses avantages fiscaux tous le
bénéfice que l'on pourrait espérer. La
compétitivité des entreprises reste modérée,
notamment du fait de la concurrence de pays voisins où les salaires sont
très inférieurs, et les prix (notamment les loyers) sont
élevés. La croissance démographique absorbe les marges de
manoeuvre dégagées là où le dynamisme
économique est réel.
Les handicap des économies utramarines sont accentués par le
régime de rémunération des fonctionnaires, dont les
inconvénients ont été mis en évidence par le
rapport « Fragonard », remis au Premier ministre en 1999.
Le rapport Fragonard pointait les inconvénients du système
actuel :
- «
l'importance des sur-rémunérations dans la
sphère publique pèse sur les prix et exerce une influence
à la hausse dans le secteur privé
».
- «
il est très vraisemblable qu'elles dissuadent les
employeurs publics de recruter à hauteur des
besoins
» ;
- «
une partie de ce pouvoir d'achat est recyclé en
métropole sous forme d'importations ou
d'épargne
» ;
- «
l'éclatement de la société des DOM entre
un secteur à garantie d'emploi et forte rémunération et un
secteur exposé à salaires inférieurs, et enfin, à
la marge de la société, une population en sous emploi ou en
chômage massif est profondément malsain
» ;
- «
les budgets
[ des collectivités locales]
sont
exposés à la pression de demandes de titularisation d'un nombre
élevé d'agents qui demandent que celle-ci se fasse à la
valeur majorée actuelle des titulaires
».
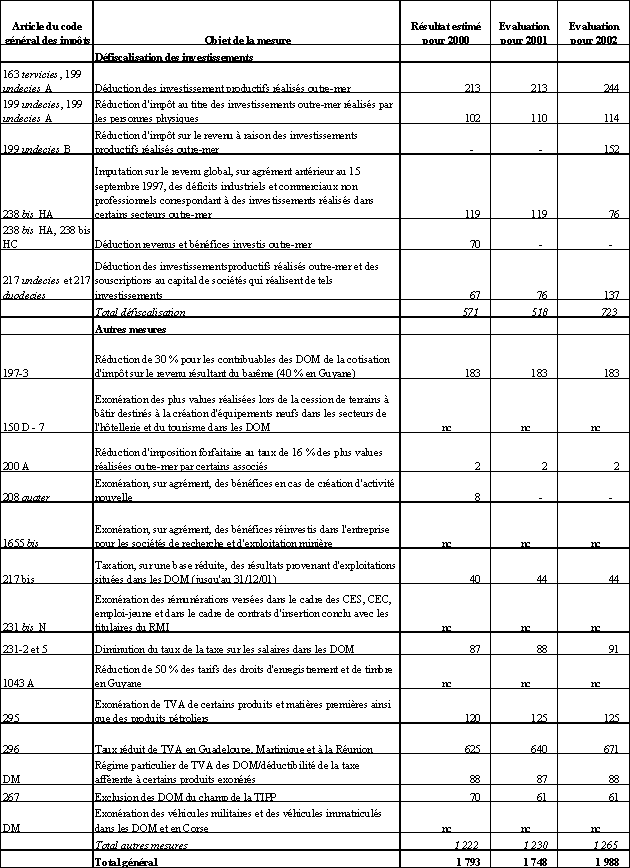
Votre
rapporteur spécial a demandé au secrétariat d'Etat
à l'outre-mer de lui communiquer le coût pour l'Etat des
spécificité de l'outre-mer en matière de
rémunération des fonctionnaires. Il lui a été
répondu qu'il n'était «
pas possible de
répondre à cette question pour les autres départements
ministériels concernés par les affectations outre-mer, faute de
disposer de leur consommation des crédits aux paragraphes d'imputation
budgétaire
».
Votre rapporteur observe que cette information devrait légitimement
figurer dans les « jaunes » budgétaires relatifs
à l'outre-mer et constate que, l'année dernière, le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avait
été en mesure de fournir des indications s'agissant des
personnels civils :
Coût des surrémunérations outre-mer pour la fonction publique d'Etat en 1999
(en millions de francs)
Les
montants des dépenses du ministère de l'éducation
nationale et du ministère de l'économie et des finances
proviennent de l'agence centrale comptable centrale du trésor. Les
autres montants ont été fournis par les ministères. Les
données relatives aux militaires sont manquantes.
Source : ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie.
L'article 26 de la loi n° 2000-1027 du 13 décembre
2001
d'orientation pour l'outre-mer prévoit que, «
dans un
délai de trois mois suivant la promulgation de la présente
loi
», un décret devra supprimer le titre Ier du
décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, qui fixe le
régime des primes d'éloignement des fonctionnaires
exerçant leur activité outre-mer.
Près d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, le
décret n'est pas encore paru.
Il est dommage que la loi ait pris le parti de supprimer les
indemnités d'éloignement, versées pendant les
premières années d'installation d'outre-mer et qui correspondent
à la prise en charge de frais indéniables, plutôt que les
surrémunérations proprement dites.
C. LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE FONDS D'INVESTISSEMENT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM)
Votre
rapporteur, s'inscrivant dans une démarche initiée par notre
collègue Henri Torre, a procédé au cours de l'année
2001 à un contrôle du fonctionnement du FIDOM.
Les résultats de ce contrôle feront l'objet d'une communication
spécifique. Les principales conclusions sont d'une part que les
dépenses d'investissement outre-mer ne font l'objet d'aucune
évaluation de leur efficacité et que, d'autre part, le
fonctionnement du FIDOM déroge aux textes qui le régissent. Il en
résulte la nécessité soit de réformer le
fonctionnement du FIDOM, soit de modifier les textes.
D. LA MISE EN oeUVRE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES INTERVENUES DEPUIS QUATRE ANS
1. Le nouveau dispositif d'aide fiscale à l'investissement en attente de décrets d'application
L'article 19 de la loi de finances pour 2001 a mis fin au
dispositif
dit de la « loi Pons » et l'a remplacé par un
crédit d'impôt sur le revenu et une réduction du
bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les
sociétés.
Le dispositif de crédit d'impôt sur le revenu créé
à cette occasion semble avoir particulièrement séduit le
gouvernement puisque le crédit d'impôt proposé dans le
cadre du projet de loi sur la Corse en est un décalque.
Malheureusement, près d'un an après le vote de la loi, le nouveau
dispositif d'aide fiscale à l'investissement n'est toujours pas
entré en vigueur, faute d'accord des autorités communautaires.
En 2001, le coût de la « défiscalisation » a
légèrement diminué, de 571 millions d'euros à
518 millions d'euros, car aucun projet nouveau n'a pu être pris en
compte.
Le projet de loi de finances pour 2002 anticipe un succès prochain des
négociations avec la Commission européenne puisqu'il
prévoit une forte augmentation du coût de la
« défiscalisation » des investissements outre-mer.
Celui-ci passerait de 518 millions d'euros à 723 millions
d'euros.
On notera que le nouveau dispositif est considéré par le
gouvernement comme susceptible d'avoir un coût supérieur de
25 % à celui de l'ancien.
2. Les ratés des transferts de compétence en Nouvelle Calédonie
La mise
en oeuvre des dispositions du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie
semble se dérouler de façon paisible sur le plan politique mais
se heurter à des difficultés techniques.
Fin 2001, les crédits ouverts depuis 2000 au titre de la dotation de
compensation des transferts de charges n'ont toujours pas été
dépensés.
De plus, il apparaît que les clefs de répartition des
crédits de la dotation de construction et d'équipement des
collèges sont inadaptés à la réalité de
l'évolution de la population scolarisée dans les trois provinces
calédoniennes. Cette dotation est répartie, selon des
modalités fixées par le décret n° 2000-578 du 22 juin
2000, en fonction de la population scolarisable, de la superficie des
établissements scolaires et des effectifs scolarisés.
Toutefois, la pondération accordée à ce dernier
critères est faible, ce qui se traduit par un manque à gagner
pour la province sud, dans laquelle sont scolarisés des enfants
résidant dans d'autres provinces. La province sud doit donc consentir un
effort financier sans rapport avec les crédits qu'elle reçoit de
l'Etat.
3. Le recours abusif à la procédure des ordonnances
Peu
après son arrivée au pouvoir, le gouvernement a demandé au
Parlement de l'habiliter à modifier par ordonnance le droit applicable
outre-mer dans un grand nombre de domaines.
Une première loi d'habilitation est intervenue et a été
suivie par le dépôt de projets de loi de ratification, qui ont
été examinés et adoptés par les deux
assemblées dans des conditions qui auguraient bien de l'avenir.
Malheureusement, les habilitations intervenues par la suite n'ont plus jamais
été suivies de l'examen par le Parlement des projets de loi de
ratification. Dix-huit ordonnances sont en instance de ratification. Treize
nouvelles devraient intervenir en 2002.
La banalisation du recours aux ordonnances ne s'accompagnant pas d'une
ratification ultérieure par le Parlement est un phénomène
inquiétant. L'outre-mer n'a pas vocation à devenir le domaine
réservé du pouvoir exécutif, qui déciderait seul,
en dehors de tout contrôle parlementaire, du droit auquel sont soumis nos
compatriotes ultramarins.







