III. OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR
A. UN DÉFICIT INADMISSIBLE D'INFORMATION
1) A
huit jours du passage de ce budget en commission, 27 réponses au
questionnaire de votre rapporteur étaient manquantes.
2) A ce jour, il n'a toujours pas été répondu à 22
questions dont certaines très importantes concernant :
- l'évolution depuis 10 ans de l'effort de recherche
français ;
- l'emploi des crédits du FRT (un milliard de francs en AP)
- les mesures prises pour rattraper le retard français dans le domaine
des biotechnologies
-
la politique de l'emploi scientifique
- l'exécution des contrats de plan Etat-Régions
- Le
financement des grands équipements
3) L'annexe jaune au projet de loi de finances sur « l'état de
la recherche et du développement technologique » n'a toujours
pas été publiée !
B. L'ÉVOLUTION GLOBALE DU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN FRANCE LAISSE À DÉSIRER
1. Le montant des dépenses : rester objectif
Dans sa
présentation du BCRD pour 2002, le ministère de la recherche fait
valoir que la progression prévue l'an prochain des crédits
correspondants représenterait :
- une « rupture par rapport à la stagnation de l'effort public
en faveur de la recherche civile de 1993 à 1997 » ;
- une accélération du rythme d'augmentation des dépenses
enregistré sous son prédécesseur.
S'il est exact que la part de la DIRD (dépense intérieure de
recherche et développement) dans le PIB s'est mise à
décroître à partir de 1993, aucun infléchissement
dans cette tendance n'a été constaté depuis 1997, comme le
montre le graphique qui suit, mis à part un faible sursaut en 1999.
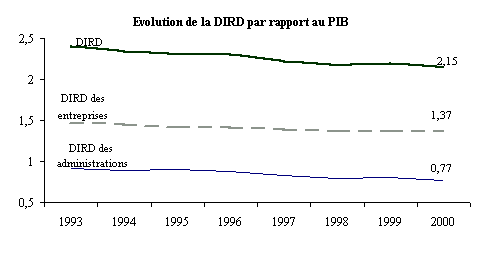
La progression du BCRD a constamment été inférieure
à la croissance dont la recherche devrait constituer, pourtant, l'un des
principaux moteurs.
Ce décalage s'est cependant réduit après la prise de
fonctions de l'actuel ministre.
Il convient, en effet, de mettre au crédit de ce dernier :
- un effort sensible en faveur de l'équipement des laboratoires et de la
recherche universitaire (c.f. p.3) ;
- une évolution des moyens de la recherche qui, sans faire de cette
dernière une priorité nationale (comme l'environnement, la
justice ou l'intérieur), s'avère toutefois plus favorable que
sous son prédécesseur.
Comme le montre le tableau qui suit, l'augmentation du BCRD a ainsi
été en 2001 nettement supérieure à celle du total
des budgets civils de l'Etat dès la loi de finances initiale et plus
encore, en tenant compte des crédits supplémentaires
accordés aux investigations concernant les maladies à prions.
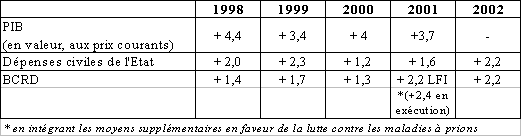
Cependant l'efficacité des dépenses budgétaires en faveur
de la recherche importe autant que leur montant.
2. L'efficacité des dépenses : une appréciation difficile
Le
morcellement de la recherche publique française : (15
ministères, plus de 25 organismes, sans compter les unités de
recherche des universités et les grandes écoles) et de son
dispositif de valorisation (création d'entreprises innovantes,
transferts de connaissances et de technologies) rend difficile
l'évaluation de l'efficacité de l'ensemble.
Par rapport aux principaux pays de l'OCDE, la France se signale par :
- un pourcentage de la DIRD effectué en entreprise inférieur,
mise à part l'Italie ;
- en conséquence, une part des organismes publics plus importante ;
- une proportion supérieure à l'exception des Etats-Unis, des
dépenses de recherche des entreprises financées par le budget de
la défense.
Notre situation cependant a tendu, dans les années 90, à se
rapprocher de la norme.
- La part de l'Etat dans le financement de la DIRD a ainsi baissé
davantage en France que dans d'autres pays et y est désormais conforme
à la moyenne de l'Union européenne (39,1 %) ;
- La recherche des entreprises se trouve désormais moins
subventionnée chez nous qu'aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne ;
- Le recul dans la DIRD des dépenses militaires a été
très marqué aussi dans les pays qui s'imposent un effort de
défense important (Etats-Unis, Grande-Bretagne), mais
légèrement moins cependant qu'en France.
Ce phénomène explique en partie la tendance constatée dans
l'ensemble des pays de l'OCDE (y compris le nôtre) à une
réduction de la part de la DIRD financée par les pouvoirs publics.
Dans ce contexte, le CNRS (26.410 emplois dont 11.769 de chercheurs et 35 % du
budget du ministère de la recherche) demeure cependant une
curiosité française probablement unique en son genre
4(
*
)
.
Mais sa création, en 1939, s'explique par le fait que les
universités françaises, encore imprégnées du
modèle napoléonien, ne faisaient pas ou très peu de
recherche à l'époque.
On peut tenter d'apprécier l'efficacité du système
français de recherche en analysant les indicateurs relatifs à
l'évolution :
- des publications scientifiques
- des dépôts de brevets
- ou, enfin, des créations d'entreprises issues de l'activité des
chercheurs.
Les indicateurs 2000 de l'OST (observatoire des sciences techniques), dernier
document disponible, contiennent des données dont les plus
récentes remontent seulement hélas à 1997.
La situation de la France y apparaît comme ne faisant pas exception
à la médiocrité européenne et au déclin de
notre continent par rapport aux Etats-Unis et au Japon.
Nous devançons le Royaume-Uni (pays dont le PIB est comparable au
nôtre) en part mondiale de brevets mais sommes derrière pour les
publications. Les performances allemandes sont bien meilleures que les
nôtres en ce qui concerne les brevets.
Les indicateurs de résultats du « bleu » relatifs
aux organismes publics de recherche font état d'une légère
augmentation du nombre de brevets et de licences déposés par ces
dernières depuis 1999.
Mais comment cela se traduit-il en terme de compétitivité
internationale ?
Un récent document de la Commission européenne établit un
bilan comparatif de l'évolution de l'effort de recherche des
différents pays européens à plusieurs égards peu
flatteur pour notre pays (même en tenant compte de ce qu'il avantage ceux
de nos partenaires qui ont répondu à un besoin de rattrapage
particulier...)
Nous figurons, en particulier, au dernier rang pour le taux de croissance de
1995 à 2000, du nombre de brevets déposés aux Etats-Unis,
et en mauvaise place pour la part des fonds publics de recherche et
développement allouée aux entreprises petites et moyennes (avec
une diminution ces cinq dernières années...).
Concernant les créations d'entreprises par les chercheurs, elles
auraient atteint, selon le ministère, la centaine en 2000, contre 20
seulement en moyenne pour les années précédentes,
grâce à l'application de la loi sur l'innovation et la recherche
du 12 juillet 1999.
Selon la cinquième édition du tableau de bord de l'innovation,
5.370 entreprises auraient été crées en semestre 2000
dans les secteurs technologiquement innovants, soit une quasi stabilité
par rapport au premier semestre 2000, mais une forte progression (+ 33 %) par
rapport au second semestre 1999.
Un effort particulier devrait être consenti pour que l'on puisse
disposer d'un « tableau de bord de la recherche
française » permettant des comparaisons internationales
à partir de données plus récentes et plus
fréquemment actualisées que celles publiées par l'OST.
Cela contribuerait, en facilitant l'appréciation de leur
efficacité globale, à réduire le
« déficit dévaluation » des dépenses
de recherche déploré chaque année par votre rapporteur.
Celles relatives à la technologie (sélection et surtout suivi de
la réalisation des projets aidé) continuent de le
préoccuper particulièrement.
C. SAISIR LES OCCASIONS ACTUELLES DE RÉFLEXION SUR LES STRUCTURES DE LA RECHERCHE FRANÇAISE
M.
Claude Allègre avait déclaré vouloir faire de la
réforme des structures de la recherche publique un préalable
à une augmentation significative de ses crédits. Votre rapporteur
lui avait répondu qu'une telle augmentation pouvait constituer une
incitation aux réformes souhaitables.
En fait, il n'y a eu ni progression vraiment majeure des moyens, ni
réformes en profondeur (si ce n'est des aménagements somme toute
limités apportés à l'organisation interne du CNRS l'an
dernier ou la création par certains organismes d'incubateurs ou de
filiales chargés de transferts de technologie).
Or, deux occasions de réflexion sur les missions et les moyens de la
recherche publique française se présentent :
- la nouvelle loi organique relative aux lois de finances qui implique une
rénovation du cadre budgétaire des établissements de
recherche ;
- le « choc démographique » des départs
massifs à la retraite de chercheurs dans la prochaine décennie
qui n'appelle pas seulement une réponse quantitative mais conduit
à s'interroger sur l'évolution de leur statut et les moyens de
corriger les défauts du système actuel (notamment le manque de
mobilité).
1. La répartition des tâches entre différents acteurs
La lutte
contre le morcellement de la recherche publique et le cloisonnement excessif de
ses organismes mobilise l'énergie du ministère de la recherche.
Elle a entraîné la création d'une multitude de structures
ou de modes de coordination :
- actions concertées incitatives (ACI)
- réseaux nationaux de recherche dans différents domaines
(télécommunications, santé, etc...)
- programmes de recherche interdisciplinaires (transports terrestres,
composants...)
- GIS (groupement d'intérêt scientifique) comme l'institut de
la longévité qui vient d'être créé ;
- IFR (instituts fédératifs de recherche)
- CNRT (centres nationaux de recherche technologique) pour coordonner les
efforts publics et privés de recherche par exemple sur les piles
à combustible (Belfort), le génome humain (Evry) ou les
micro-nanotechnologies (Grenoble).
Le FNS et le FRT sont également utilisés pour la promotion
d'actions nouvelles ou à caractère pluridisciplinaire.
Le dispositif de valorisation de la recherche (transferts de technologie,
développement de l'innovation, aides à la création) est
tout aussi foisonnant.
Concernant les EPST, leur budget apparaît comme un budget de moyens et
non de programmes, qui ne fait pas ressortir les moyens dévolus à
leurs principaux thèmes de recherche et à leurs
différentes fonctions.
Le moment n'est-il pas venu de s'interroger, afin de la rationaliser
éventuellement, sur la répartition des compétences et des
missions entre les différents acteurs de la recherche (EPST, EPIC,
universités, grandes écoles, entreprises...) ?
Les activités du nouveau service des technologies de l'information et de
la communication du CNRS, par exemple, se différencient-elles
suffisamment de celles de l'INRIA ? Les progrès de la recherche
universitaire ne doivent-elles pas conduire à repenser le rôle de
cet établissement ?
2. L'emploi scientifique
L'effort
d'anticipation dont témoignent les créations d'emplois depuis
2001 et le plan décennal de gestion prévisionnelle de l'emploi
scientifique présenté le 24 octobre, est louable.
Mais selon la très bonne expression de notre collègue Yves
Fréville, il est nécessaire d'aller au-delà du défi
du nombre.
Comment améliorer la mobilité des chercheurs ? Faut-il
placer tous les jeunes recrutés aujourd'hui par les organismes publics
sous le statut actuel de chercheur à vie et à temps complet ?
Si tel n'est pas le cas, il convient de développer des passerelles vers
le monde de l'enseignement ou de l'industrie et de prendre en compte,
au-delà de l'excellence scientifique, les qualités
pédagogiques, l'aptitude au travail en équipe et à la
communication, et un certain esprit d'entreprise parmi les critères
déterminant la sélection et l'évaluation des chercheurs.
Chez beaucoup de personnes, les facultés de créativité,
d'imagination et de découverte commencent à décliner
à partir de quarante ans. Comment l'ignorer ?
a) Une mobilité insuffisante
Dans son
dernier rapport public, la Cour des comptes observe que la mobilité des
chercheurs est particulièrement faible dans les EPST (à
l'exception de l'INRIA qui a su profiter du dynamisme du secteur des STIC pour
faciliter les départs vers l'entreprise ou l'enseignement
supérieur).
Le ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la
technologie admet, en réponse, que « le statut adopté
en 1983 n'a pas eu d'effet positif sur la mobilité des personnels, ni en
ce qui concerne la mobilité inter-établissement, ni en ce qui
concerne la mobilité vers l'industrie. »
De fait, le taux d'accueil de chercheurs extérieurs n'a
été, en 2000, que de 0,16 pour le CNRS, 0,57 à l'INRA,
0,15 à l'INSERM, selon l'une des réponses au questionnaire
budgétaire de votre rapporteur.
b) Statut des chercheurs : faut-il maintenir l'exception française ?
Le 4
novembre 1999, a eu lieu une conférence débat sur le bilan du
« modèle français » institué par la
loi d'orientation et de programmation du 15 juillet 1982 pour la
recherche et le développement technologique de la France (LOP).
Y participait notamment le directeur de l'OST, M. Rémi Barré,
récemment entendu par votre commission dans le cadre des travaux du
comité d'évaluation des politiques publiques sur la politique de
recrutement et la gestion des enseignants-chercheurs et des chercheurs.
Ont été rappelés à l'occasion de cette
réunion :
- les ambitions initiales de la LOP : priorité à la
recherche (
publique et privée
) pour sortir de la crise ;
- ses excellentes intentions, toujours actuelles : réponse à
la demande sociale, rajeunissement des équipes, mobilité (entre
les différents métiers de la recherche, les organismes, avec les
entreprises...) ;
- mais aussi ses lacunes et ses échecs : absence de prise en compte
de la recherche universitaire, d'implication des entreprises dans la formation
à et par la recherche, de progrès dans la mobilité, de
programmation budgétaire réelle, etc...
Imputant à une défaillance des acteurs et à un
problème de gouvernance les déceptions causées par
l'application de la loi, M. Barré :
- constatait son incapacité à permettre à la recherche
française de s'adapter de façon satisfaisante à
l'évolution de son environnement (marquée par l'avènement
d'une société de la connaissance plus exigeante vis-à-vis
des activités concernées et qui tend à les
contractualiser, à les banaliser, à promouvoir
l'interdisciplinarité) ;
- s'interrogeait sur le point de savoir s'il convient de refonder le
système français ou d'en bâtir un nouveau de type
anglo-saxon (tout mélange entre les deux étant à ses yeux
voué à l'échec).
Concernant le statut des chercheurs, la LOP avait cherché à ce
qu'il :
- constitue une sorte de consécration du rôle social
éminent des intéressés (garantie de carrière) ;
- tienne compte des singularités de la recherche, notamment de la
diversité de ses métiers (y compris la formation, l'information,
la valorisation et l'administration...), des nécessités de
favoriser la mobilité (qui devait être favorisée par des
dispositions statutaires communes) et de déroger, sur certains points
(recrutement sur titre, évaluation par les pairs...) aux règles
de la fonction publique.
Or :
- l'immersion de la recherche dans une société de la connaissance
crée un nouveau contexte dans lequel cette activité s'apparente
moins à une sorte de sacerdoce faisant du chercheur « le
dépositaire d'une mission exigeant des conditions spécifiques de
travail et de statut » (cf. M. Barré).
- n'y a-t-il pas contradiction (M. Barré
ibid
) entre la place
limitée des contractuels dans la recherche publique et la
généralisation du contrat dans le monde (y compris dans les
programmes européens ou pour tout ce qui touche aux transferts ou
à la valorisation...) ?
- l'insuffisance, dans les faits, de la mobilité des chercheurs freine
leur reconversion, lorsqu'elle s'impose, vers les métiers
associés à la recherche (tâches administratives,
enseignement...).
Votre rapporteur compte, dans son rapport écrit, approfondir sa
réflexion sur ces questions pertinentes en s'inspirant :
- de l'excellent travail de notre collègue M. Yves Fréville (en
ce qui concerne notamment les enseignants chercheurs, les
déficiences
5(
*
)
de leurs
modalités de recrutement, d'évaluation, de déroulement de
carrière...) ;
- des observations de la Cour des comptes (qui déplore l'insuffisante
souplesse de gestion des EPST, le manque d'autonomie financière des
universités, les carences du ministère en ce qui concerne la
coordination des activités de recherche ou le financement des aides aux
sciences du vivant...) ;
- enfin, de l'analyse d'exemples étrangers.
3. Quelques premiers éléments de comparaisons internationales
Le
tableau de la page 6 démontre que les moyens budgétaires
dévolus à la recherche universitaire sont, à
l'évidence, bien inférieurs en France à ceux dont
bénéficient les organismes publics de recherche.
Ainsi, les universités françaises, même si elles disposent
par ailleurs d'autres ressources (subventions de collectivités
territoriales, participations d'entreprises privées...) ou peuvent
compter sur la collaboration des organismes susvisés, ont moins d'argent
que ces derniers à consacrer à la recherche.
En outre, beaucoup de soi-disant enseignants chercheurs n'effectuent, en
réalité, aucun travail de recherche.
Or, comme l'a souligné M. Claude Allègre, lors de son audition
par la commission, dans le cadre des travaux précités du
comité d'évaluation des politiques publiques, il semble pourtant
que les universités obtiennent, généralement, de meilleurs
résultats que les institutions entièrement dédiées
à la recherche. Peut-être, le fait de se consacrer aussi à
l'enseignement leur donne-t-il une plus grande ouverture sur la
société ou une meilleure aptitude à mobiliser des
ressources humaines ?
Aux Etats-Unis, les activités de transfert de technologie des
universités sont ainsi dix fois supérieures à celles,
pourtant moins académiques et davantage finalisées, des
laboratoires fédéraux.
En recherche fondamentale, l'université de Chicago a vu 73 de ses
anciens élèves, professeurs ou chercheurs se voir attribuer le
prix Nobel et le MIT (Massachussets Institute of Technology) 46.
Cependant beaucoup des conditions du succès des universités
américaines apparaissent difficilement transposables en France :
- compétition entre établissements, sélection à
l'entrée (limitées chez nous aux grandes écoles),
disparité des moyens, droits d'inscription élevés
(difficilement compatibles avec les principes d'égalité
républicaine) ;
- liens beaucoup plus développés avec les entreprises
(contributions dans le cadre de recherches parrainées, stages en
entreprises et envoi d'élèves ingénieurs dans les
start-ups, transmission d'une culture
« entrepreneu-riale »...).
Au total, en ajoutant aux droits d'inscription et aux contributions des
entreprises, les versements des anciens élèves, les apports en
capital ou sous d'autres formes de différents donateurs, les
financements fédéraux (subventions et contrats) et les revenus de
brevets et licences, les universités américaines disposent,
notamment pour le financement de la recherche, de moyens sans commune mesure
avec ceux des universités françaises.
Concernant ces dernières, une étude de l'OCDE datant de 1999 ( se
référant hélas à des données de 1991)
aboutit aux conclusions suivantes :
- performances moyennes en terme de coût-efficacité sans prise en
compte des activités de recherche (les critères retenus,
étant les ressources consacrées à l'enseignement
supérieur, le taux d'accès et les résultats en terme
d'obtention d'un diplôme et d'un emploi sur le marché du
travail) ;
- détérioration sensible de nos résultats lorsqu'entrent
en considération des mesures quantitatives ou qualitatives des
activités de recherche (nombre de publications, dépenses,
situation des diplômés sur le marché du travail...).
Le meilleur moyen pour les universités françaises de mener des
travaux de recherche de qualité demeure l'association avec le CNRS ou
d'autres organismes publics.
Sans préjuger des conclusions complètes de son rapport
écrit, il paraît, à ce stade de son analyse, difficile
à votre rapporteur de transposer entièrement en France le
modèle américain mais possible de s'en inspirer :
- en recourant davantage aux contrats dans la recherche publique ;
-en prenant en compte des critères autres qu'académiques, et non
corporatistes, dans l'évaluation et le recrutement ;
- en dotant, enfin, les universités de l'autonomie réelle qui
doit leur permettre de choisir librement leurs enseignants chercheurs, selon
leur propre stratégie, mais qui implique de créer entre elles une
certaine émulation ;
- d'éviter, dans le financement de la recherche publique, les
redondances en ce qui concerne les établissements publics et le
saupoudrage, s'agissant des universités.
D. LES TGE : DES BESOINS CROISSANTS À SATISFAIRE AU MOINDRE COÛT
Le
ministère n'ayant pas encore répondu à la
question n° 51 de son questionnaire budgétaire relative
aux grands équipements transversaux pluridisciplinaires
nécessaires à la recherche française, votre rapporteur,
qui compte insister sur ce sujet dans son rapport écrit, ne peut,
à ce stade de ses travaux, que réitérer les observations
qui figurent dans l'étude sur les TGE (très grands
équipements), dont il est co-auteur, publiée par l'OPECST (office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques).
Les principales conclusions, sur les suites desquelles votre rapporteur avait
interrogé le ministère, étaient les suivantes :
- distinguer les TGE d'infrastructure, devant faire l'objet d'urgence d'un plan
d'équipement de la France, des TGE de grands programmes et des TGE
thématiques ;
- améliorer les conditions d'organisation et de valorisation des travaux
réalisés au moyen de ces équipements de façon
à rentabiliser les investissements correspondants et à en
maximiser les effets d'entraînement ;
- proposer la prise en charge communautaire (qui améliorerait la
coordination des investissements sur notre continent) des frais d'étude
des futurs TGE, d'une quote-part de leurs dépenses de fonctionnement et
de leur amortissement ainsi que des frais d'accès des chercheurs
européens ;
- renforcer les puissances de calcul et les réseaux à hauts
débits dans l'Union européenne.
Il ne semble pas que les 900 millions d'euros prévus par le
6
ème
PCRD (programme communautaire de recherche et
développement), pour les infrastructures de recherche permettent de
financer la réalisation de ces deux derniers objectifs.
La forte progression des besoins de la science en TGE, en traitement,
échange et stockage de données est, en tout état de cause,
un phénomène irréversible.
Les chercheurs français, et on en peut que s'en réjouir, sont en
train d'être équipés de nouveaux supercalculateurs :
- au CINES (centre informatique national de l'enseignement supérieur)
à Montpellier ;
- à l'IDRIS (institut du développement et des ressources en
informatique scientifique), qui dépend du CNRS, à Orsay ;
- enfin à la direction des applications militaires du CEA à
Bruyères-le-Châtel (Essonne).







