M. Claude BELOT
COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS
« AVANCES
À L'AUDIOVISUEL PUBLIC »
Le compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » est formé d'un unique programme 822 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public »
I. PRÉSENTATION DE LA MISSION : UNE PROGRESSION DE 3 % EN 2006 DE LA RESSOURCE PUBLIQUE ISSUE DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
A. LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE : 74 % DU BUDGET DU SECTEUR AUDIOVISUEL PUBLIC
Créé par l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le compte d'avances aux organismes de l'audiovisuel public retrace les opérations de recettes et de dépenses relatives à la redevance audiovisuelle.
En recettes, outre le produit de la redevance audiovisuelle, le compte d'avances reçoit une dotation du budget général de l'Etat au titre du remboursement des exonérations de redevance audiovisuelle.
En dépenses, le montant des avances mensuelles effectivement mises à la disposition des organismes de l'audiovisuel public correspond aux recettes du compte, minorées des frais d'assiette et de recouvrement et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée au taux de 2,1 %.
1. Des prévisions de progression des ressources publiques liées principalement à la réforme de la redevance audiovisuelle
Compte tenu d'une modeste prévision de progression des encaissements de redevance (2,31 milliards d'euros, soit une hausse de 1,7 %) dans un contexte de maintien des taux de la redevance audiovisuelle 10 ( * ) , l'augmentation de 3,0 % des ressources du compte (à 2,72 milliards d'euros) s'explique principalement par la diminution des frais d'assiette et de recouvrement (de 65 à 24 millions d'euros). Les gains attendus proviennent de l'adossement du recouvrement de la redevance audiovisuelle à la taxe d'habitation, opérée pour la première fois en 2005 11 ( * ) .
Les contestations nées de la réforme du recouvrement sont par ailleurs présentées dans l'encadré ci-dessous.
|
Une mise en oeuvre contestée de la réforme de la redevance audiovisuelle Votre rapporteur spécial se fait l'écho des réclamations - semblant devoir se chiffrer au moins en milliers - de personnes qui estiment avoir été indûment imposées à la redevance audiovisuelle, notamment après avoir déclaré sur l'honneur que leur foyer n'était pas équipé d'un poste de télévision. Ces erreurs potentielles font suite à l'incompréhension d'une partie des contribuables sur les modalités de déclaration de la non-détention d'un poste de télévision, lors de la réception des avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2004 au printemps 2005. Il convenait en effet de cocher une case pour déclarer sur l'honneur ne pas habiter une résidence dotée d'un poste de télévision : une importante minorité de contribuables aurait coché cette case en croyant qu'il s'agissait de déclarer au contraire la détention d'un appareil récepteur de télévision. Pour l'avenir, votre rapporteur spécial estime que la possibilité de répondre « oui » ou « non » à cette même question devrait réduire les risques d'erreur . Votre rapporteur spécial prend acte des informations qui lui ont été transmises par la direction de la législation fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, selon lesquelles il n'aurait été nullement procédé à des envois systématiques d'avis d'imposition. En tout état de cause, lorsque seront connues les données définitives sur le nombre de comptes de la redevance audiovisuelle en 2005, il sera difficile de distinguer la progression naturelle du parc, l'efficacité de la lutte contre la fraude (aux moyens juridiques renforcés) et l'inclusion erronée de personnes qui n'auraient pas dû être assujetties mais n'auront pas effectué de réclamation. |
A plus long terme, votre rapporteur spécial observe que la définition du fait générateur de la redevance audiovisuelle n'a pas pris en compte les évolutions technologiques récentes qui permettent la réception de chaînes sans disposer d'un appareil de télévision. Compte tenu du refus d'augmenter le taux de la redevance qui reste à un des plus bas niveaux d'Europe, le dynamisme de la ressource est directement affecté.
Les crédits budgétaires affectés au remboursement des exonérations s'élèvent à 440 millions d'euros , sans changement par rapport à la loi de finances initiale pour 2005.
D'ores et déjà, cette prévision n'apparaît pas sincère , compte tenu du niveau du remboursement opéré par l'Etat en 2004 (soit 489,91 millions 12 ( * ) ), très supérieur à 440 millions, et des nouvelles exonérations de redevance audiovisuelle accordées en 2005 au profit d'environ un million de contribuables (soit un manque à gagner de 116 millions d'euros) : votre rapporteur spécial estime que le remboursement par l'Etat pourrait ainsi dépasser 600 millions d'euros dès 2005 .
Enfin, selon les premières informations disponibles, les encaissements disponibles en 2005 devraient être supérieurs de 10 à 43 millions d'euros aux prévisions effectuées en loi de finances initiale. A l'instar de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, rapporteur spécial du budget des médias, votre rapporteur spécial s'interroge sur l'affectation envisagée de ces recettes supplémentaires dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2005 .
2. Les autres ressources de l'audiovisuel public : des prévisions de ressources publicitaires en nette hausse
Hors redevance audiovisuelle, RFI bénéficie également d'une dotation du ministère des affaires étrangères de 72,13 millions d'euros, examinée par notre collègue Adrien Gouteyron dans son rapport spécial sur la mission « Action extérieure de l'Etat ». Les ressources publiques totales des cinq organismes de l'audiovisuel public financés par la redevance audiovisuelle s'élèvent ainsi à 2,73 milliards d'euros (après déduction de la TVA de 2,1 %), en hausse de 2,9 % par rapport à 2005.
Les organismes de l'audiovisuel public bénéficient enfin de ressources propres , correspondant principalement aux recettes de publicité et de parrainage, évaluées à 858 millions d'euros dans le présent projet de loi de finances, dont la progression est une fois de plus supérieure (+ 3,9 %) à celle des ressources publiques (+ 2,9 %) en phase actuelle d'expansion du marché publicitaire.
Votre rapporteur spécial observe toutefois que la prévision de ressources propres dépasse celle prévue dans le projet de loi de finances pour 2005 (3,4 %), alors même que les objectifs initiaux de France Télévisions - qui draine l'essentiel des ressources publicitaires de l'audiovisuel public - n'étaient pas atteints à la fin du premier semestre 2005. Selon les informations fournies à votre rapporteur spécial, les moindres recettes publicitaires de France 3 doivent être compensées par des recettes publicitaires plus élevées pour France 2 et France 5 d'ici décembre 2005. En outre, il serait envisagé un contexte favorable en 2006.
Au total, le budget total du secteur audiovisuel public , détaillé dans le tableau ci-dessous, s'élève à 3,595 milliards d'euros, en hausse de 3,1 % par rapport à 2005.
Ressources du secteur audiovisuel public
(en millions d'euros)
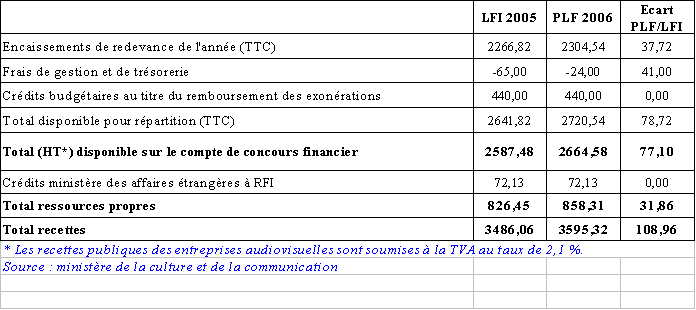
3. Une progression des ressources provenant de la redevance comprise entre 2,7 % et 4,1 % selon les organismes de l'audiovisuel public
Comme le fait apparaître le tableau ci-dessous, la progression moyenne de 3,0 % des ressources issues de la redevance audiovisuelle n'est pas homogène selon les organismes de l'audiovisuel public.
Ces ressources n'incluent pas un nouveau prélèvement de 1,3 million d'euros sur le fonds de roulement d'ARTE France.
Répartition et évolution par organisme de
la ressource publique
issue de la redevance audiovisuelle
(en millions d'euros)
|
LFI 2005 |
PLF 2006 |
Ecart PLF/LFI |
En % |
|
|
France Télévisions |
1 781,08 |
1 833,68 |
52,60 |
3,0 % |
|
Arte France |
197,98 |
204,20 |
6,22 |
3,1 % |
|
INA |
72,74 |
75,75 |
3,01 |
4,1 % |
|
Radio France |
481,97 |
495,09 |
13,12 |
2,7 % |
|
RFI |
53,71 |
55,86 |
2,15 |
4,0 % |
|
Total |
2 587,48 |
2 664,58 |
77,10 |
3,0 % |
Source : bleus budgétaires
France Télévisions bénéficie d'une progression de 3,0 %, dans le cadre notamment de la mise en place de la télévision numérique terrestre (TNT). Le groupe présidé par M. Patrick de Carolis, lequel sera auditionné par votre commission des finances et la commission des affaires culturelles le 9 novembre, reçoit 68,8 % du montant des ressources publiques issues de la redevance audiovisuelle, soit 1.833,7 millions d'euros 13 ( * ) . France Télévisions a décidé d'accroître son soutien à la production de documentaires et au secteur de l'animation 14 ( * ) . Une autre priorité consiste à porter à 50 % en 2006 la part des programmes sous-titrés, conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Votre rapporteur spécial se félicite que le prochain contrat d'objectifs et de moyens (COM) de France Télévisions, qui doit couvrir la période 2006-2010, conforte la relocalisation des tournages en France ( cf. annexe sur les COM dans l'audiovisuel public ).
La dotation d' ARTE France (204,2 millions d'euros) augmente de 3,1 % 15 ( * ) , dans un contexte d'élargissement de l'offre de programmes suite au déploiement de la TNT 16 ( * ) .
Radio France (495,1 millions d'euros ; + 2,7 %) poursuit son plan de numérisation et continue d'étendre sa couverture en stations locales conformément au « Plan bleu ». Les principaux travaux de financement de la nouvelle maison de la Radio commenceront en 2007 17 ( * ) , selon un cadre budgétaire restant à définir lors de la négociation avec l'Etat du futur COM. Le coût total du projet d'investissements s'élève à 210 millions d'euros sur la période 2004-2012.
L'augmentation de 4,1 % de la dotation de l' Institut national de l'audiovisuel (INA), à 75,8 millions d'euros, traduit la volonté de poursuivre le plan de sauvegarde et de numérisation de notre patrimoine audiovisuel et radiophonique 18 ( * ) .
Radio France Internationale (RFI) doit disposer de 55,9 millions d'euros (+ 4,0 %) au titre de la redevance audiovisuelle et de 72,1 millions d'euros (+ 0,0 %) provenant du budget du ministère des affaires étrangères. La chaîne internationale doit continuer la numérisation de sa production et poursuivre sa réflexion en termes d'implantation géographique.
Votre rapporteur spécial déplore le lent désengagement continu du ministère des affaires étrangères du budget de RFI : la dotation du Quai d'Orsay progresse une fois de plus moins rapidement que celle provenant de la redevance audiovisuelle.
B. L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉMARCHE DE PERFORMANCE DANS L'AUDIOVISUEL PUBLIC
1. Des objectifs et indicateurs de performance à inscrire dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens
La définition d'objectifs et d'indicateurs de performance dans le secteur de l'audiovisuel public peut prendre appui sur les contrats d'objectifs et de moyens (COM) entre l'Etat et les opérateurs de l'audiovisuel public (cf. annexe sur les COM dans l'audiovisuel public) :
- les COM avec France Télévisions et ARTE France prennent l'un et l'autre fin en 2005 : la mise en place de la TNT a rendu partiellement caduques ces deux contrats ; France Télévisions a mis en oeuvre dans ce cadre un plan de gestion de 170 millions d'euros sur l'ensemble de la période du contrat (2001-2005) ;
- l'INA devrait signer d'ici la fin de l'année 2005 un nouveau COM, après la période d'interruption de deux ans ayant suivi la fin du précédent COM (2001-2003), mettant l'accent sur les deux missions principales de l'INA (archivage et dépôt légal) ;
- la finalisation du COM de Radio France est renvoyée au printemps 2006, dans l'attente notamment de l'achèvement des négociations sur le financement de la Maison de Radio France ;
- un COM est envisagé avec RFI pour la période 2006-2008, après l'assainissement financier préalable de la chaîne.
2. Les objectifs et indicateurs de performance du présent projet de loi de finances : un effort globalement satisfaisant
Si les différents objectifs proposés traduisent fidèlement les priorités de l'audiovisuel public, l'objectif n° 1 (« S'adresser au public le plus large, en proposant une programmation diversifiée »), trop large, devrait être scindé .
De fait, le nombre d'indicateurs associés à cet objectif (7) est trop élevé, regroupant à la fois la diversité de la programmation, la nécessité d'adapter l'offre de programmes au public sourd et malentendant et de purs indicateurs de contexte fondés sur la mesure de l'audience.
En effet, la progression de l'audience répond à un besoin économique des sociétés publiques, son évolution dépend autant du contexte que des moyens alloués aux différentes sociétés ; cette information doit trouver sa place dans les nouveaux documents budgétaires à titre d'information, mais pas dans l'analyse de la performance. S'agissant des chaînes publiques de télévision, il est en outre peu lisible d'avoir privilégié l'audience cumulée plutôt que les parts d'audience, détaillées tant pour les chaînes de télévision que pour Radio France en annexe à la présente note.
Des objectifs de performance en termes d'audience devraient cibler davantage les publics, au regard du contenu et du coût de la programmation . Par exemple, afin d'apprécier l'action des opérateurs publics sur l'éducation des enfants et des adolescents, un indicateur pourrait mesurer l'audience des émissions éducatives par les publics les plus jeunes, au regard du budget d'approvisionnement en programmes de culture et de connaissances en ce domaine.
En outre, la diversité de la programmation de Radio France ne se réduit pas à la part des chansons d'expression française et des nouveaux talents (respectivement, indicateurs n° s 3 et 4 de l'objectif n° 1), mais devrait également prendre en compte le nombre de genres d'émission diffusés.
Votre rapporteur spécial salue le choix d'avoir retenu un objectif spécifique ( n° 2 ) pour l'INA compte tenu de la particularité de ses missions, « Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel ». Il observe cependant que l'indicateur n° 1 mesurant le coût d'une heure de programmation sauvegardée ne permet pas d'effectuer des comparaisons à moyen et long termes, en raison de l'hétérogénéité des supports et de l'état de conservation des documents, comme le montre d'ailleurs un écart de un à deux entre le coût prévisionnel pour 2006 et la cible proposée la même année.
L' objectif n° 3 , proprement budgétaire, consiste à améliorer la gestion des fonds publics, en accroissant notamment la part des dépenses de programmes des chaînes de télévision (France-Télévisions : indicateur n° 1, ARTE France : indicateur n° 2, RFO : indicateur n° 3) et en diminuant corrélativement la part des dépenses de personnel (dont le suivi correspond à l' objectif n° 4 ). Il s'agit de très bons objectifs et indicateurs, clairs et lisibles.
Votre rapporteur spécial déplore toutefois que les indicateurs n° s 1 à 3 associés à l'objectif n° 3-822 n'aient pas été étendus à Radio France 19 ( * ) et RFI.
Il observe en outre que la maîtrise des frais de personnel doit être conjuguée avec un recours plus rigoureux à l'intermittence à France Télévisions, dans la continuité du rapport remis le 14 janvier 2004 par M. Bernard Gourinchas à M. Jean-Jacques Aillagon, alors ministre de la culture et de la communication 20 ( * ) .
Votre rapporteur spécial regrette enfin que l'évolution de la part des ressources propres ne constitue pas un objectif en tant que tel , sauf pour l'INA. Il faudrait préalablement justifier la cible retenue : soit une diminution des ressources propres, en considérant que les chaînes publiques ont vocation à être financées essentiellement, sinon exclusivement (comme la BBC), par des fonds publics ; soit une augmentation de ces ressources, afin de diversifier les ressources des organismes de l'audiovisuel public 21 ( * ) .
Le bleu budgétaire reste par ailleurs lacunaire s'agissant de nombreuses données prévisionnelles pour 2006, alors que sont généralement définies les cibles à atteindre l'an prochain.
|
Les principales observations de votre rapporteur
spécial
- Les ressources publiques de l'audiovisuel public provenant de la redevance atteignent 2,7 milliards d'euros, en progression de 3 %, en raison principalement de la réforme du recouvrement de la redevance. - Le montant du remboursement par l'Etat des exonérations de redevance audiovisuelle, inscrit en crédits évaluatifs (soit 440 millions d'euros), sous-évalué d'un tiers par rapport aux besoins effectifs de financement : il devrait en effet s'élever à au moins 600 millions d'euros. - Votre rapporteur spécial s'interroge sur l'affectation des excédents d'encaissements en 2005 (de l'ordre de 20 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale). - Le budget de RFI est financé par la redevance audiovisuelle pour une part toujours croissante, faute de progression identique de la dotation du ministère des affaires étrangères. - Il convient de dissocier les objectifs de diversification des publics et des contenus. - Le niveau des ressources propres des opérateurs de l'audiovisuel public doit donner lieu à des objectifs et indicateurs de performance spécifiques. |
* 10 Le taux de la redevance s'élève à 116 euros par foyer équipé d'un poste de télévision en France métropolitaine, et à 74 euros dans les départements et territoires d'outre-mer. La progression attendue résulte d'une augmentation du taux d'équipement et d'une diminution du taux de fraude, compte tenu notamment de la possibilité nouvelle pour l'administration d'interroger les établissements diffusant ou distribuant des services payants de télévision.
* 11 Cette économie de gestion a conduit au reclassement de 964 agents du service de la redevance (sur un effectif global de 1.400 agents), dont 465 agents dans un autre service du réseau du Trésor public et 499 agents dans de nouvelles activités créées sur les sites où était implanté le service de la redevance audiovisuelle. Votre rapporteur spécial juge regrettable que, a contrario , il n'ait manifestement pas été pris en compte le coût des actions de communication sur la réforme de la redevance audiovisuelle.
* 12 Ce montant s'élève à 437,44 millions au titre du remboursement des exonérations, auxquels s'ajoutent 52,47 millions concernant le remboursement des aides gracieuses.
* 13 Cette dotation est répartie comme suit entre les différentes chaînes du groupe France Télévisions : France 2, 631,1 millions d'euros ; France 3, 815,4 millions d'euros ; France 4, 17,7 millions d'euros ; France 5, 149,5 millions d'euros ; Réseau France Outre-Mer (RFO), 220,0 millions d'euros.
* 14 France Télévisions a signé, le 2 novembre 2004, un accord pluriannuel avec l'Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA) et le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), aux termes duquel le groupe s'engage à poursuivre une programmation diversifiée en matière de documentaires de création et à améliorer le financement horaire de ce genre spécifique, à hauteur de 10 millions d'euros par an entre 2005 et 2007. Cet accord vise expressément l'amélioration des conditions d'emploi et de respect du code du travail. De même, afin d'améliorer les conditions de financement du secteur de l'animation, France Télévisions a signé un accord en avril 2005 avec le syndicat des professionnels français de l'animation (SPFA) : le groupe public s'engage à maintenir le volume de diffusion d'oeuvres d'animation sur une période de six ans à raison d'un minimum de 2.100 heures par an.
* 15 Votre rapporteur spécial rappelle que ARTE France et ARTE Deutschland financent paritairement le budget d'ARTE GEIE (Groupement Européen d'Intérêt Economique).
* 16 Votre rapporteur spécial rappelle que, suite au démarrage de la TNT le 31 mars 2005, 50 % de la population française a accès à la TNT depuis octobre 2005. Cette proportion doit atteindre 85 % d'ici le printemps 2007 puis 100 % (grâce à une couverture satellitaire pour les 15 % de la population habitant dans les zones d'ombre). A cet effet, le ministre de la culture et de la communication a annoncé, le 26 octobre dernier à l'Assemblée nationale, la création dès 2006 d'un fonds d'accompagnement pour le numérique doté de 15 millions d'euros . Cette dotation pourrait être proposée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2005 , peut-être sur les crédits de l'agence nationale des fréquences, en l'absence de tout financement dans le présent projet de loi de finances.
* 17 Le besoin de financement en investissements est évalué à 21,2 millions d'euros en 2006, réparti entre une redevance d'investissement (5,8 millions d'euros), des redéploiements de crédits (7,2 millions d'euros) et des reports de crédits de l'exercice 2005 (8,2 millions d'euros).
* 18 L'INA estime à 176 millions d'euros le besoin de financement sur la période 2005-2015 pour sauvegarder l'intégralité du fonds de l'INA, dont elle escompte que 83 millions d'euros soient pris en charge par l'Etat - soit une dotation supplémentaire de 7,5 millions d'euros par an correspondant à 10,5 % du budget annuel pour l'année 2005.
* 19 A cet égard, l'indicateur n° 4 (« Coût de l'heure produite et diffusée par Radio France ») n'est pas comparable, car incluant également des dépenses de personnel, et peut conduire à divers biais (privilégier les rediffusions par rapport aux programmations nouvelles ou les émissions à moindre coût et répondant à des normes de qualité moins élevées).
* 20 Après que le rapport précité n'eut reconnu la pertinence du recours à l'intermittence que pour certaines activités, France Télévisions a mis en place un plan de diminution du recours à l'intermittence de l'ordre de 25 % à 30 % entre 2004 et 2008. Pourtant, selon le « jaune » budgétaire, le nombre d'intermittents a encore augmenté (de 0,4 %) en 2004, ce que France Télévisions a justifié par l'actualité sportive et politique. Votre rapporteur spécial observe que cette information est contradictoire avec les données (p. 244) du « bleu » relatif aux comptes spéciaux du Trésor quant à l'évolution de la part de l'emploi intermittent par rapport à l'emploi total à France Télévisions (16 % en 2003, 13,9 % en 2004, prévision : 13 % en 2005).
* 21 Votre rapporteur spécial rappelle que, selon le « jaune » budgétaire, la part des ressources publiques dans le chiffre d'affaires des différents organismes s'élevait en 2004 à 71,2 % à France Télévisions (et non 61,2 %, comme inscrit par erreur dans le « jaune ») ; 68,5 % à l'INA ; 89,0 % à Radio France ; 96,4 % à RFI et 96,9 % à ARTE France. Les ressources propres correspondent au différentiel entre les ressources totales et les ressources publiques.







