Rapport d'information n° 55 (2003-2004) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 5 novembre 2003
Disponible au format Acrobat (1014 Koctets)
-
RAPPORT D'INFORMATION
-
AVANT-PROPOS
-
CHAPITRE PREMIER
LA SITUATION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES EN FRANCE
-
I. DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
STRUCTURELLEMENT TRÈS ÉLEVÉS
-
II. DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES QUI
SERVENT DE PLUS EN PLUS À FINANCER LES COMPTES SOCIAUX
-
III. LA STRUCTURE IMPARFAITE DE NOTRE
SYSTÈME FISCAL
-
A. LA FISCALITÉ FRANÇAISE DANS LE
CONTEXTE EUROPÉEN
-
B. TAUX NOMINAUX ÉLEVÉS ET
FISCALITÉ DÉROGATOIRE
-
C. UNE IMPOSITION DU CAPITAL ÉCONOMIQUEMENT
INADAPTÉE
-
A. LA FISCALITÉ FRANÇAISE DANS LE
CONTEXTE EUROPÉEN
-
I. DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
STRUCTURELLEMENT TRÈS ÉLEVÉS
-
CHAPITRE II :
LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
-
I. LES DÉFIS À RELEVER
-
A. FAIRE LE CHOIX DE L'ATTRACTIVITÉ
FISCALE
-
B. FAIRE FACE À LA DYNAMIQUE DES
DÉPENSES SOCIALES
-
C. ASSURER LA NEUTRALITÉ DE
« L'ACTE II » DE LA DÉCENTRALISATION SUR LE TAUX
GLOBAL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
-
D. TROUVER DES ALTERNATIVES AUX
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
-
A. FAIRE LE CHOIX DE L'ATTRACTIVITÉ
FISCALE
-
II. DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LA POLITIQUE
FISCALE
-
A. FISCALITÉ DES PERSONNES : QUELS
PRÉLÈVEMENTS SUR LES REVENUS ?
-
B. ENCOURAGER LA COMPÉTITIVITÉ ET
L'EMPLOI
-
C. RÉFLEXIONS SUR LA DÉPENSE FISCALE
À PARTIR DU XXIÈME RAPPORT DU CONSEIL DES IMPÔTS
-
D. À ÉNERGIE RENOUVELABLE,
FISCALITÉ RENOUVELÉE : LE CAS DES BIOCARBURANTS
-
1. Un régime à la fois fruste dans
ses principes mais complexe à mettre en oeuvre
-
2. Une aide qui ne satisfait pas les nouvelles
exigences, communautaires en particulier, de développement des
carburants d'origine végétale
-
3. De nouvelles propositions à
étudier
-
4. Une solution concevable pour l'industrie
pétrolière
-
1. Un régime à la fois fruste dans
ses principes mais complexe à mettre en oeuvre
-
E. METTRE EN PERSPECTIVE NOTRE POLITIQUE
FISCALE
-
A. FISCALITÉ DES PERSONNES : QUELS
PRÉLÈVEMENTS SUR LES REVENUS ?
-
I. LES DÉFIS À RELEVER
-
EXAMEN EN COMMISSION
N° 55
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 2003
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur les prélèvements obligatoires et leur évolution ,
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur,
Rapporteur général.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.
|
Impôts et taxes. |
AVANT-PROPOS
L'article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, issu d'un amendement présenté au Sénat, conjointement par notre ancien collègue Charles Descours, alors rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du projet de loi de financement de la sécurité sociale et par votre rapporteur général, dispose que, « en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution .
« Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le gouvernement .
« Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat ».
La tenue d'un tel débat est essentielle pour améliorer la lisibilité de nos finances publiques . Nos concitoyens, qui sont également contribuables, ne distinguent pas entre leurs contributions au budget de l'Etat et au financement de la sécurité sociale. Il est important de leur restituer une image fidèle de la réalité des prélèvements dont ils s'acquittent.
Ce débat doit également nous permettre d'avoir une vision prospective de l'évolution de nos prélèvements obligatoires , afin de nous positionner pour décider si les tendances spontanées nous paraissent acceptables ou devoir être modifiées. Dans la seconde hypothèse, le débat sur les prélèvements obligatoires doit servir de « révélateur », et les conséquences sur le niveau des recettes comme des dépenses doivent en être tirées lors de l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Mais le présent débat sur les prélèvements obligatoires doit également être l'occasion de nous interroger sur la structure de notre système de prélèvements , et à la lumière de « l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le gouvernement » qui devrait être fournie dans le rapport du gouvernement, sur ses perspectives d'évolution.
Lors du débat d'orientation budgétaire pour 2004 tenu au Sénat le 18 juin 2003, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, M. Alain Lambert, avait noté avec intérêt les propositions de votre rapporteur général pour « améliorer la discussion sur l'évolution du système fiscal. Le rapport sur les prélèvements obligatoires prescrit par la loi organique constitue un progrès réel, avec la consolidation des comptes publics. Peut-être pourrait-il nous fournir l'occasion d'un débat d'orientation fiscale ? Le Parlement ferait part au gouvernement de ses propositions pour faire évoluer les structures fiscales - ce qui est décisif pour l'avenir de notre pays ».
C'est dans cette optique que le présent rapport d'information s'attache à tracer des pistes pour modifier la structure de notre système de prélèvements dans le sens d'une meilleure lisibilité, d'une amélioration de l'emploi et de la compétitivité, d'une fiscalité plus écologique et pour tenir compte des besoins nouveaux et croissants en matière de financement de la protection sociale.
CHAPITRE PREMIER
LA
SITUATION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES EN FRANCE
Le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution remis par le gouvernement à l'ouverture de la présente session en application de l'article 52 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances évalue à 702,8 milliards d'euros le montant des prélèvements obligatoires en 2004, contre 683,4 milliards d'euros en 2003, soit une augmentation de 2,8 %.
En pourcentage du produit intérieur brut (PIB), les prélèvements obligatoires devraient cependant diminuer, passant de 43,8 % en 2003 à 43,6 % en 2004.
Le graphique ci-dessous retrace la répartition des prélèvements obligatoires entre les différentes catégories d'administrations publiques, telle qu'elle est envisagée par le gouvernement :
Répartition des prélèvements obligatoires en 2004
(en milliards d'euros et en pourcentage du total)
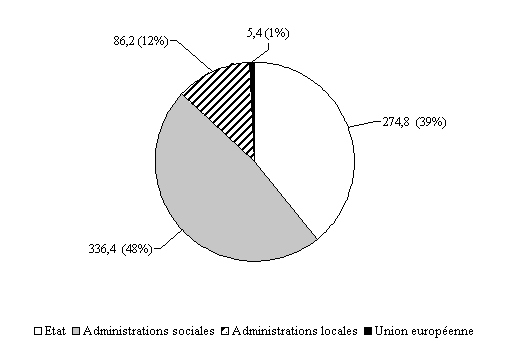
Source : rapport du gouvernement sur les prélèvements obligatoires et leur évolution
I. DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES STRUCTURELLEMENT TRÈS ÉLEVÉS
A. UNE SITUATION FRANÇAISE ORIGINALE
1. Une situation particulière de la France dans l'Union européenne
La France se situe dans le peloton de tête des pays de l'Union européenne pour son taux de prélèvements obligatoires. Cette situation n'est pas nouvelle puisqu'elle était déjà vraie en 1975 . Depuis cette date, comme l'ensemble de l'Union européenne, la France a vu ses prélèvements augmenter.
Le taux de prélèvements obligatoires dans l'Union européenne 1975-2002
(en % du PIB)
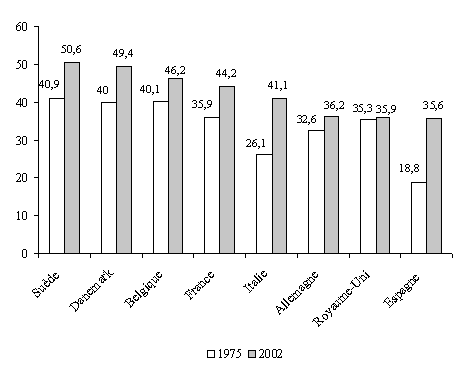
Source : statistiques des recettes publiques de l'OCDE 2002
2. Une situation particulière de l'Union européenne dans la zone OCDE
La France connaît un niveau de prélèvements obligatoires élevé. Elle s'inscrit elle-même dans un ensemble, l'Union européenne, qui détient depuis plus de vingt-cinq ans le « record » de taux de prélèvements obligatoires dans la zone OCDE.
Les prélèvements obligatoires : la course en tête de l'Union européenne, le décrochage avec la zone Amérique de l'OCDE
(en % du PIB)
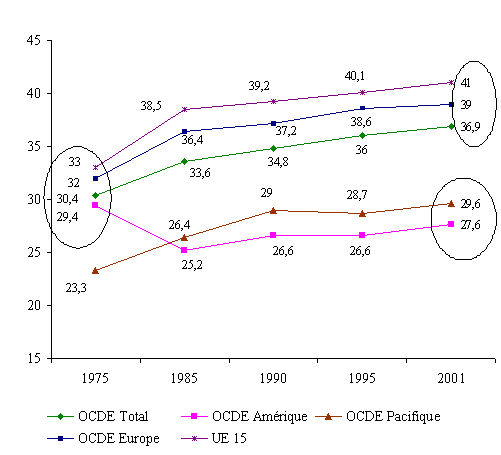
Alors qu'en 1975, les taux de prélèvements obligatoires étaient relativement proches entre l'Union européenne et l'ensemble de la zone OCDE, y compris la zone américaine, l'écart s'est creusé au point d'atteindre plus de 10 points de PIB en 2001.
Les prélèvements obligatoires ont connu une hausse continue sur 25 ans, à l'exception des prélèvements dans la zone OCDE Amérique, qui sont restés contenus.
B. UNE ÉVOLUTION RÉCENTE À LA BAISSE
1. La « chute » des prélèvements obligatoires en 2002
Dans son rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances pour 2003, le gouvernement annonçait, pour 2002, un taux de prélèvements obligatoires des administrations publiques ramené de 45,0 % à 44,6 % du PIB, soit une baisse de 0,4 point de PIB.
En réalité, le taux de prélèvements obligatoires s'est réduit deux fois plus vite que prévu en 2002 , de 0,8 point de PIB, pour atteindre 43,9 % du PIB 1 ( * ) . Les prélèvements obligatoires ont progressé de + 1,3 % alors que le PIB augmentait de 3,1 % aux prix courants.
Evolution du taux de prélèvements obligatoires 1996-2002
(en % du PIB)
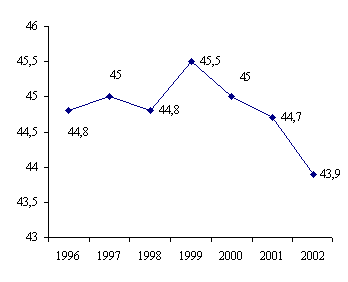
Source : INSEE - comptes nationaux
Même si elle ne contredit pas la tendance à l'augmentation des prélèvements obligatoires sur longue période, cette diminution est la plus forte enregistrée en une année depuis quinze ans.
Il faut considérer que ce résultat inattendu est imputable aux effets de la conjoncture déprimée sur les rentrées fiscales : la baisse de l'élasticité de ces dernières par rapport à la croissance explique ce phénomène, de même que la « cagnotte » de 1999-2000 s'était traduite, en phase de haute conjoncture, par un « pic » des prélèvements obligatoires.
L'évolution des prélèvements obligatoires en France depuis 1978
(en % du PIB)
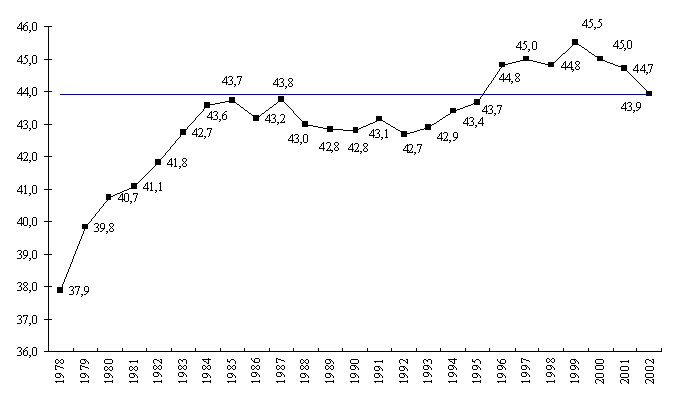
Source : Insee
2. Une consolidation prévue pour 2003 et 2004
Pour 2003, le gouvernement prévoit une légère décrue des prélèvements obligatoires (- 0,1 point de PIB), qui traduirait les évolutions suivantes :
- une baisse sensible des prélèvements de l'Etat (- 0,3 point de PIB) compensée par une hausse équivalente des prélèvements sociaux (+ 0,3 point de PIB) ;
- une stabilité des prélèvements des collectivités locales ;
- une légère réduction du prélèvement au profit de l'Union européenne (- 0,1 point de PIB) ;
Pour 2004, le gouvernement fait l'hypothèse d'une réduction du taux de prélèvements obligatoires de 0,2 point de PIB supplémentaire 2 ( * ) .
Les prélèvements obligatoires 2002-2004
|
En milliards d'euros |
2002 |
2003 |
2004 |
|
État + organismes divers d'administration centrale |
256,6 |
258,1 |
274,8 |
|
Administrations publiques locales |
75,6 |
77,8 |
86,2 |
|
Administrations de sécurité sociale |
328,3 |
340,7 |
336,4 |
|
Union européenne |
7,1 |
6,8 |
5,4 |
|
Total |
667,6 |
683,4 |
702,8 |
|
PIB en valeur |
1520,8 |
1559,0 |
1612,3 |
|
En points de PIB |
|
|
|
|
Etat + organismes divers d'administration centrale |
16,9 |
16,6 |
17,0 |
|
Administrations publiques locales |
5,0 |
5,0 |
5,3 |
|
Administrations de sécurité sociale |
21,6 |
21,9 |
20,9 |
|
Union européenne |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
|
Taux de prélèvements obligatoires |
43,9 |
43,8 |
43,6 |
Source : rapport économique, social et financier pour 2004
3. Des choix qui correspondent à une évolution générale dans l'OCDE
Selon les dernières informations de l'OCDE, rendues publiques le 22 octobre 2003, la charge fiscale a baissé en 2002 dans 16 des 27 pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles . La plupart de ces pays font partie de l'Union européenne, où les recettes fiscales se sont élevées à 40,5 % du PIB, au lieu de 41 % en 2001. Cela représente la seconde année consécutive de baisse incontestable après une période de cinq ans de croissance des charges fiscales et constitue une nette inversion de la tendance à la hausse.
Les variations diffèrent d'un pays à l'autre, le rapport impôt/PIB diminuant de plus d'un point dans sept pays : Autriche, Hongrie, Royaume-Uni, Canada, Irlande, Grèce et Turquie. Il a augmenté de plus d'un point dans seulement trois pays : Luxembourg, République slovaque et Nouvelle Zélande.
Une « vague » de baisses d'impôts depuis 2000 explique en partie cette baisse générale de la charge fiscale :
- 15 pays de l'OCDE ont réduit leur taux maximal d'impôt sur le revenu depuis 2000 ;
- 12 pays ont abaissé leurs principaux taux d'impôt sur les sociétés.
L'OCDE note également que la mauvaise conjoncture économique constitue l'autre raison principale de la baisse .
La période récente de croissance lente a eu un effet négatif sur les bénéfices des entreprises. La même chose s'est produite avec l'impôt sur le revenu des personnes physiques en raison de la progressivité des barèmes d'imposition : une baisse des revenus s'accompagne du passage d'un grand nombre de personnes dans des tranches moins élevées.
La diminution des recettes de l'impôt sur le revenu explique en grande partie la réduction du rapport impôt/PIB en Autriche, au Canada, en Grèce, en Irlande, en Turquie et au Royaume-Uni .
Le graphique ci-après montre l'évolution, en pourcentage du PIB de l'imposition des bénéfices et des revenus. La France, relativement bien placée en 1975, est fortement remontée dans la période 1995-1999 avant de connaître de nouveau des mesures de baisse de la fiscalité.
Impôts sur les revenus et les bénéfices
(en % du PIB)
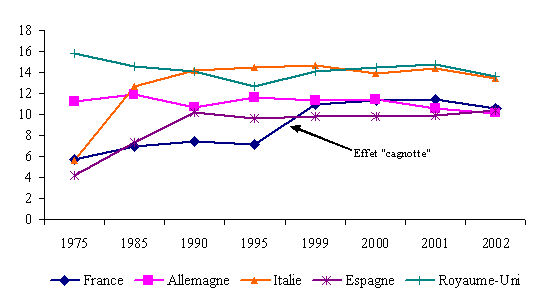
II. DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES QUI SERVENT DE PLUS EN PLUS À FINANCER LES COMPTES SOCIAUX
A. LA CROISSANCE CONTINUE DES DÉPENSES SOCIALES
1. Une tendance lourde depuis plus de vingt ans
La hausse des dépenses sociales est une tendance générale depuis le début des années 1990.
Part des dépenses des administrations de sécurité sociale dans le PIB
(en %)
|
Année |
Total des dépenses sociales |
Dont prestations sociales et transferts sociaux |
|
1990 |
21,9 |
17,2 |
|
1991 |
22,4 |
17,6 |
|
1992 |
23,2 |
18,1 |
|
1993 |
24,2 |
18,8 |
|
1994 |
24,1 |
18,7 |
|
1995 |
24,3 |
18,7 |
|
1996 |
24,4 |
19,0 |
|
1997 |
24,4 |
19,0 |
|
1998 |
24,0 |
18,7 |
|
1999 |
23,7 |
18,5 |
|
2000 |
23,5 |
18,3 |
|
2001 |
23,8 |
18,5 |
|
2002 |
24,5 |
19,0 |
Source : rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2004
Il faut en particulier souligner la forte progression de la part des dépenses d'assurance maladie dans le PIB : l'ONDAM 3 ( * ) représentait en effet 7,3 % du PIB en 1997 et 7,7 % en 2002, contre 6,1 % en 1981.
Dans son rapport sur la sécurité sociale datant de septembre 2003, la Cour des comptes souligne que « l'écart de croissance entre le PIB et la consommation finale des ménages d'une part, les dépenses d'assurance maladie d'autre part, se creuse nettement en 2001 et 2002. L'écart annuel moyen de croissance entre PIB et dépenses d'assurance maladie est de 1,47 point entre 1990 et 2002 et de 3,1 points en 2001-2002. D'environ 15 points entre 1996 et 2000, l'écart cumulé passe de 20 points en 2001 à 28 points en 2002 ».
Dès lors, elle en conclut que « la marche d'escalier observée dans la croissance des dépenses d'assurance maladie depuis 2000 constitue un échec du système de régulation actuel ».
Evolution comparée en monnaie courante des dépenses d'assurance maladie et du PIB
(en %)
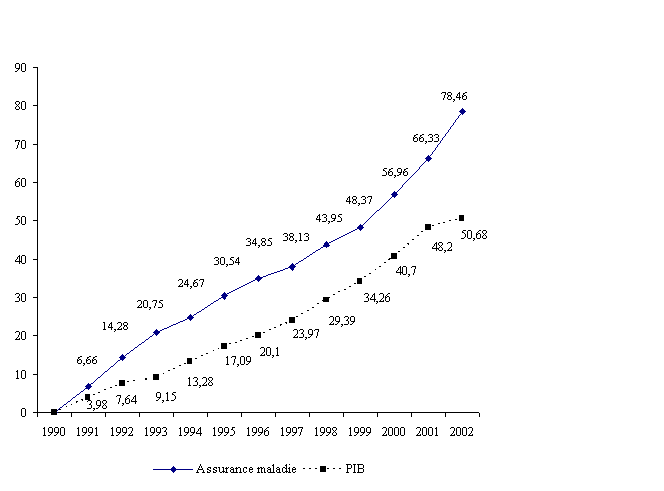
Source : Cour des comptes
Plus récemment, il faut noter également une hausse des dépenses consacrées au risque vieillesse , passées de 7,7 % du PIB en 1981 à 8,8 % en 1997 et près de 9 % en 2002. Le vieillissement de la population française ainsi que l'arrivée massive de générations à l'âge de la retraite devraient encore alourdir les dépenses de la branche vieillesse de la sécurité sociale.
Dans son rapport de septembre 2003, la Commission des comptes de la sécurité sociale note ainsi que « si la dégradation se poursuit au rythme des années précédentes pour la branche maladie, le fait nouveau de l'année 2004 est qu'elle touche à présent aussi les autres grandes branches, vieillesse et famille, qui voient disparaître en 2004 les excédents qu'elles avaient conservés jusque là. Cette situation est vraisemblablement liée à la mauvaise conjoncture. Elle annonce des difficultés plus durables pour la branche vieillesse dont les dépenses seront accrues dès 2004 par certaines dispositions de la réforme des retraites et qui subira à partir de 2006 un afflux de nouveaux retraités ».
Evolution des résultats de la sécurité sociale par branche depuis 2001
(en milliards d'euros)
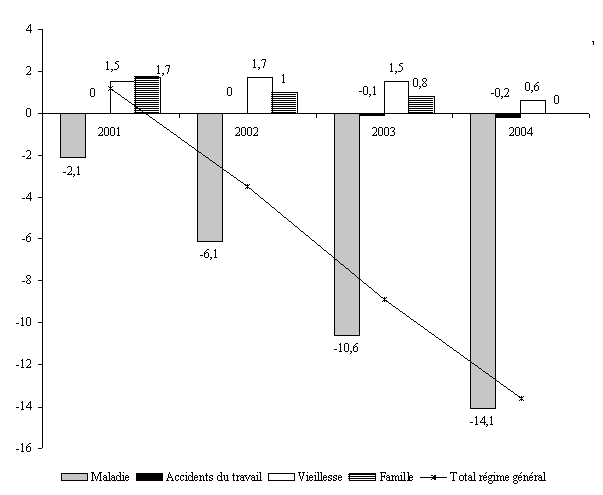
Source : commission des comptes de la sécurité sociale
2. Des finances sociales qui fragilisent les finances publiques
Alors que, au cours de la période 1999-2001, les administrations de sécurité sociale avaient apporté une contribution positive à la réduction du déficit public, elles concourent depuis 2002 à sa dégradation, à hauteur de 0,3 point de PIB en 2002, les prévisions pour 2003 et 2004 s'établissant respectivement à un besoin de financement de 0,6 point de PIB et de 0,5 point de PIB.
Cette situation, conjuguée aux dérapages budgétaires de l'Etat, conduit à reporter toujours plus loin l'objectif de retour à l'équilibre des finances publiques. L'accélération des réformes structurelles dans le domaine social est donc une condition essentielle du redressement de nos finances publiques.
Capacité ou besoin de financement des administrations sociales depuis 1990
(en points de PIB)
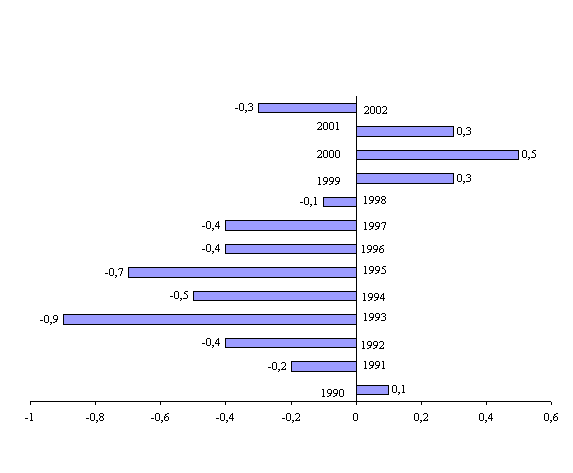 Source : rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour 2004
Source : rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour 2004
Dans le programme de stabilité 2004-2006 transmis par la France à la Commission européenne en décembre 2002, le rythme de progression annuelle moyenne des dépenses d'assurance maladie était fixé par le gouvernement à 2,5 % sur la période 2004-2006.
Dans sa programmation pluriannuelle des finances publiques 2005-2007, le gouvernement a révisé cette prévision et s'est fixé deux nouveaux objectifs :
- sur la durée de la programmation, les dépenses d'assurance maladie ne devraient pas progresser plus vite que le PIB potentiel, soit 2,25 % par an en termes réels, corrigés de l'inflation ;
- à l'horizon 2007, les comptes des administrations de sécurité sociale devraient revenir à l'équilibre.
Capacité ou besoin de financement des administrations de sécurité sociale à l'horizon 2007
(en points de PIB)
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
- 0,3 |
- 0,6 |
- 0,5 |
- 0,1 |
- 0,1 |
0,0 |
Source : rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2004 : Programmation pluriannuelle des finances publiques 2005-2007
M. Jean-François Mattéi, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a parfaitement résumé la problématique applicable à l'évolution des prélèvements sociaux lors de sa présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, le 8 octobre dernier, en soulignant que « la dégradation des comptes est préoccupante. Le retour à l'équilibre est impossible sans aboutir sur la modernisation de la sécurité sociale. Certains proposent d'augmenter les recettes. Mais qui peut réussir à remplir un tonneau percé ? Faire 14 milliards d'économies en une année n'est pas non plus une solution envisageable ».
B. L'AUGMENTATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
La hausse des dépenses sociales s'est accompagnée d'une augmentation continue du taux de prélèvements obligatoires affectés aux organismes de sécurité sociale.
1. L'augmentation de la part des prélèvements sociaux dans le PIB
Ainsi, la part des prélèvements sociaux dans le PIB est passée de 20,5 % en 1997 à 21,3 % en 2000 et 21,6 % en 2002, soit un montant de 328,3 milliards d'euros en 2002. Les prévisions fournies par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2004 indiquent que ce taux devrait s'élever à 21,9 % du PIB en 2003 et redescendre à 20,9 % en 2004.
Evolution comparée des
prélèvements obligatoires affectés
aux administrations
de sécurité sociale
(en % du PIB)
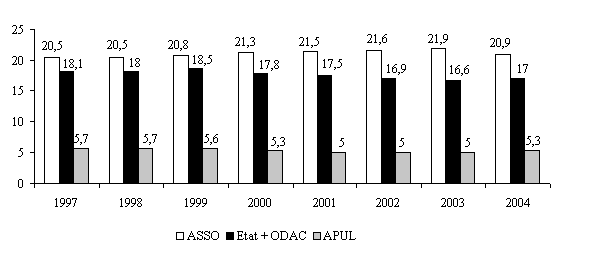
2. La place prépondérante des prélèvements sociaux au sein des prélèvements obligatoires
En outre, au sein de l'ensemble des prélèvements obligatoires, les prélèvements sociaux sont aujourd'hui majoritaires et occupent une place de plus en plus prépondérante.
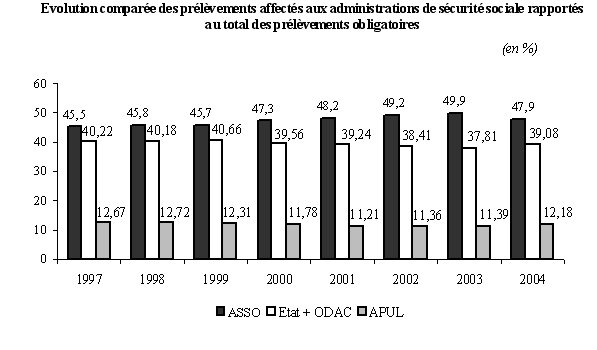
A ce titre, il convient d'ailleurs de souligner la singularité française puisque, si, en 2000, 47,3 % des prélèvements obligatoires étaient perçus au profit des organismes de sécurité sociale, ce taux s'élevait à 24 % en moyenne dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Cet écart reflète largement les différents choix de société en matière de financement de la protection sociale.
Evolution comparée du taux de prélèvements obligatoires affectés à l'Etat et aux administrations de sécurité sociale
(en % du PIB)
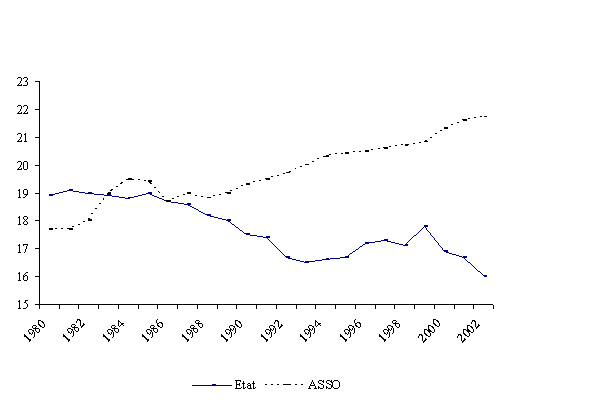
Source : rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2004
Au sein des prélèvements sociaux, la part des cotisations sociales effectives s'élève, en 2002, à 73,9 % du total, contre 73,3 % en 2001, et celle des impôts et taxes affectés à 26,1 % du total, contre 26,7 % en 2001.
3. Le faible niveau d'endettement de la sécurité sociale
Cette part prépondérante des prélèvements sociaux dans l'ensemble des prélèvements obligatoires permet notamment d'expliquer le faible niveau d'endettement des administrations de sécurité sociale.
Lors du débat sur les prélèvements obligatoires au Sénat l'année dernière, notre collègue Alain Vasselle, intervenant en qualité de rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avait ainsi souligné qu'« au cours des vingt dernières années, les dépenses de la sécurité sociale ont été financées par l'ajustement parallèle des prélèvements sociaux. Au cours de la même période, les dépenses de l'Etat ont été financées par l'endettement ».
En 2002, la dette des administrations de sécurité sociale au sens du traité de Maastricht s'élevait à 14,9 milliards d'euros, soit 1,7 % de l'ensemble de la dette des administrations publiques en 2002.
Dette comparée de l'Etat et des administrations de sécurité sociale depuis 1995
(en % du PIB)
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Etat |
40,2 |
42,5 |
44,2 |
46,0 |
45,9 |
45,2 |
45,4 |
48,2 |
|
Administrations de sécurité sociale |
2,8 |
1,6 |
2,0 |
1,1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
Source : rapport économique, social et financier, annexé au projet de loi de finances pour 2004
III. LA STRUCTURE IMPARFAITE DE NOTRE SYSTÈME FISCAL
Ainsi que notre collègue Joël Bourdin et votre rapporteur général l'ont récemment souligné dans un rapport d'information 4 ( * ) , sur presque tous les points - que ce soit le taux de prélèvements obligatoires, la fiscalité du revenu, celle de l'épargne, celle des entreprises, celle du travail -, la France figure parmi les Etats les plus mal placés en Europe.
En effet, si la structure de la fiscalité française est proche de la moyenne européenne, sauf pour l'imposition des salaires , il faut garder à l'esprit que cette apparence de normalité provient de taux nominaux élevés et d'assiettes réduites par une multiplicité de régimes dérogatoires.
A. LA FISCALITÉ FRANÇAISE DANS LE CONTEXTE EUROPÉEN
1. La structure de la fiscalité française est proche de la moyenne européenne, si l'on excepte une forte imposition des salaires
a) Selon les catégories d'impôts
La structure de la fiscalité française est peu différente de celle de ses partenaires européens, comme l'indique le graphique ci-après.
Prélèvements obligatoires : la France et ses partenaires (2000)
(en points de PIB)
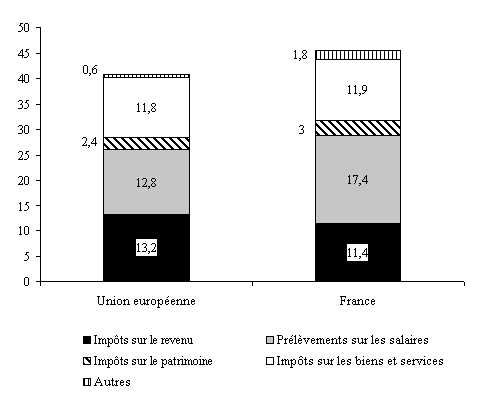
Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques, 2001, in Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343, Sénat (2002-2003)
La structure de la fiscalité française se distingue cependant sur deux points :
- une imposition du revenu plus faible (11,4 % du PIB au lieu de 13,2 %) ;
- surtout, une imposition des salaires (c'est-à-dire les charges sociales) nettement plus lourde (17,4 % du PIB, au lieu de 11,8 %), qui explique un taux de prélèvements obligatoires globalement plus élevé.
Le recours aux impôts indirects est en revanche analogue (de l'ordre de 12 % du PIB).
b) Selon la répercussion économique immédiate des impôts
Cette analyse est confirmée si l'on prend en compte la répercussion économique immédiate des impôts, comme l'indique le graphique ci-après.
Structure des recettes fiscales selon leur répercussion économique immédiate (1999)
(en % du PIB)
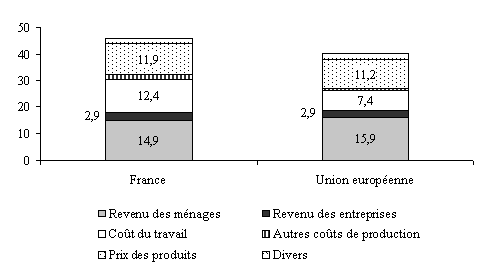
Source : OCDE, in Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343, Sénat (2002-2003)
2. Des taux nominaux élevés
La France se distingue surtout de ses partenaires par le recours à des taux nominaux élevés, l'écart généralement modeste constaté au niveau des recettes provenant de l'existence de nombreuses exonérations et « niches » fiscales. Ce phénomène concerne en particulier l'imposition des sociétés et du revenu.
a) L'imposition des sociétés
En ce qui concerne l'imposition des sociétés , la France est, avec la Belgique, le pays qui pratique les taux nominaux les plus élevés , comme l'indique le graphique ci-après.
L'imposition des sociétés
(en %)
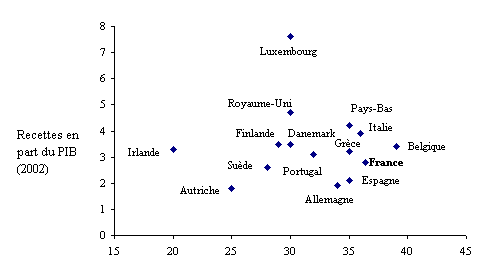
Taux d'imposition nominal (2001)
Source : d'après les données de l'OCDE et de la Commission européenne, in Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343, Sénat (2002- 2003)
Pourtant, cet impôt représente une part relativement faible du PIB. En sens inverse, certains pays, situés en haut du graphique, ont une imposition des sociétés importante en part du PIB, qui s'accompagne de taux proches de la moyenne (Luxembourg, Royaume-Uni), alors qu'en Irlande le très faible taux d'imposition nominal n'empêche pas une imposition normale en part du PIB.
b) L'imposition du revenu
Un phénomène analogue s'observe dans le cas de l'imposition du revenu.
On peut schématiquement distinguer deux modèles, comme l'indique le graphique ci-après :
- un premier modèle, où la désincitation à maximiser son revenu est faible , correspondant aux pays où une faible proportion des ménages (correspondant à ceux gagnant au moins 5 fois le salaire ouvrier moyen) est soumise au taux maximum, qui est inférieur à 50 % (Europe du sud, Etats-Unis, Japon) ;
- un second modèle, où la désincitation à maximiser son revenu est élevée, correspondant aux pays où le taux maximum concerne une forte proportion des ménages (ceux gagnant de 1,5 à 2 fois le salaire ouvrier moyen), et est supérieur à 55 % (Scandinavie).
La France se rapproche de ce second modèle (avec un taux marginal maximal d'imposition de 53,25 % en 2001, à partir de trois fois le revenu moyen ouvrier environ). L'imposition du revenu y est donc plus désincitative que dans la plupart des autres pays européens.
Le pays où la désincitation est la plus faible est les Etats-Unis . Dans ce pays, le taux maximal d'imposition (de 40 %) ne concerne que les personnes gagnant au moins 10 fois le salaire moyen ouvrier, ce qui correspond à un seuil bien plus élevé que ce que l'on peut observer dans l'Union européenne (en Grèce, pays européen où ce seuil est le plus élevé, il est de 5 fois le salaire moyen ouvrier). Au Royaume-Uni et en Irlande, la désincitation à travailler est plus forte qu'aux Etats-Unis puisque si le taux d'imposition maximal est faible (de l'ordre de 40 %), il concerne une proportion importante de ménages (à partir de 1,5 ou 2 fois le salaire moyen ouvrier).
Les taux d'imposition dans l'Union européenne (2001)
Seuil d'imposition du taux maximum (en % du salaire moyen ouvrier)
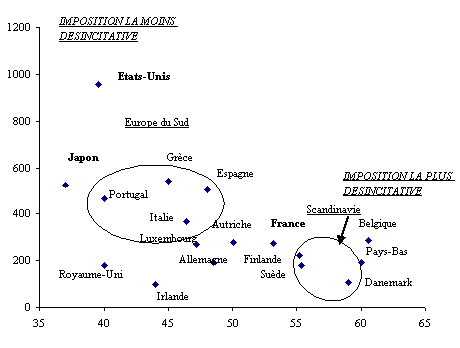
Taux maximum (en % du revenu)
Source : d'après l'OCDE, in Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343, Sénat (2002-2003)
B. TAUX NOMINAUX ÉLEVÉS ET FISCALITÉ DÉROGATOIRE
L'importance de la fiscalité dérogatoire, que souligne opportunément le 21 ème rapport du Conseil des impôts publié en septembre 2003, illustre les difficultés de notre système fiscal à s'organiser selon des options claires.
1. Un facteur de complexité
Cette propension à l'accumulation des dérogations a pour première conséquence d'accroître la complexité de notre législation, au point de la rendre parfois illisible et, donc, largement inefficace.
Indépendamment même du coût anormalement élevé de perception de l'impôt, on a toutes les raisons de croire que, globalement, le système est plus dissuasif que véritablement incitatif dans la mesure où les agents ont du mal à obtenir les informations pertinentes et où les différentes mesures ont tendance à se neutraliser.
C'est en particulier le cas des incitations fiscales à l'épargne, qui concernent aussi bien les actions ou les obligations que l'épargne réglementée, au sujet desquelles on peut penser, à la suite du Conseil des impôts, que « la pluralité des objectifs poursuivis a parfois compromis la cohérence de l'ensemble du dispositif » .
Le Conseil des impôts estime que dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu, de la fiscalité des sociétés ou de l'imposition du patrimoine, on dénombre une variété de dispositifs « sans doctrine d'emploi » .
L'opacité du système vient, notamment, de la sédimentation de régimes incitatifs , qui se surajoutent les uns aux autres, sans que l'on songe, à de rares exceptions près, à supprimer parmi les mécanismes existants ceux qui ne sont guère utilisés ou qui n'ont pas fait leurs preuves.
Un exemple caractéristique de cette propension à la superposition des régimes dérogatoires peut être donné avec les aides fiscales en faveur de la création ou de la transmission d'entreprises ou celles en faveur des zones prioritaires d'aménagement du territoire.
La multiplication de régimes dérogatoires de faible portée en matière d'aide à la création ou à la transmission d'entreprises
Après avoir souligné que leur complexité et leur instabilité étaient source d'insécurité juridique tout en les rendant finalement peu utiles aux entreprises en raison de leurs coûts d'accès à l'information, le 21 ème rapport du Conseil des impôts relatif à la fiscalité dérogatoire relevait que dix-huit des dispositifs en faveur de la création ou de la transmission d'entreprises identifiés dans le cadre du fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003 avaient un coût très faible ou inconnu , « ce qui jetait un doute sur l'utilité de certaines mesures, compte tenu de la complexité qu'elles introduisent dans la loi fiscale et dans la gestion de l'impôt », d'autant plus que ces aides « ne représentaient plus que 10 à 15 % des aides publiques à la création ou à la transmission d'entreprises ».
Ce diagnostic concorde avec celui du rapport établi en juillet 2001 par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'industrie et du commerce sur les dispositifs publics d'aide à la création et à la reprise d'entreprises qui soulignait de même le caractère « relativement confidentiel » de la plupart des 24 dépenses fiscales examinées, en montrant que ces mesures ne concernaient finalement (hors exonérations de taxe professionnelle) que 2,2 % des créations ou des reprises d'entreprises, pour conclure que se « posait clairement la question du maintien » d'un certain nombre de ces dispositifs qui « en raison de la modestie de leur format, ne peuvent influer sérieusement sur le phénomène de création d'entreprises ».
Dans ces conditions, on peut regretter que la loi sur l'initiative économique adoptée en 2003 5 ( * ) n'ait pas fait oeuvre de simplification, puisqu'elle n'a supprimé aucun régime fiscal en faveur de la création ou de la transmission d'entreprises, tout en en modifiant une dizaine et en en créant trois nouveaux.
S'agissant du doublement du plafond de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle (article 163 octodecies A du code général des impôts), qui a concerné 1.973 foyers fiscaux en 2001, la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner ce texte observait d'ailleurs 6 ( * ) : « on peut s'interroger à bon droit, au regard du très faible montant de la dépense fiscale correspondante (3 millions d'euros par an selon le fascicule des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003), sur la pertinence d'un dispositif occupant 79 lignes du code général des impôts renvoyant elles-mêmes à 21 autres articles de ce même code et du code de commerce, ainsi qu'à un décret en Conseil d'Etat, de sorte que sa lecture est d'une rare complexité ».
Ces réserves rejoignent les « réticences » récemment exprimées par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, à propos de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2004 7 ( * ) proposant des mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes selon lui « d'une complexité excessive (...) d'autant plus dommageable que [ces] mesures ont vocation à concerner quelques centaines d'entreprises seulement ».
2. Instabilité et multiplicité des dispositifs
Cette complexité se double d'une très grande instabilité des dispositifs dans le temps. Le Conseil des impôts analyse un certain nombre de cas typiques de ce phénomène. Celui-ci concerne en particulier les fiscalités en faveur de l'immobilier locatif neuf, l'outre-mer et les crédits d'impôt recherche, qui ont fluctué au gré des majorités politiques et des nécessités de l'heure.
Certes ces analyses ne sont pas nouvelles ; elles rejoignent celles développées par votre commission des finances, notamment lorsqu'elle s'est appuyée sur les travaux de la commission d'études sur les prélèvements obligatoires de 1995 présidée par M. Bernard Ducamin.
Le constat général du rapport n'a d'ailleurs pas vieilli : « le niveau jugé élevé des taux d'imposition a entraîné la floraison de mécanismes en tous genres (...) qui entachent gravement la progressivité, provoquent des ruptures d'égalité entre les contribuables car seuls les plus avertis bénéficient de ces mécanismes et peuvent avoir des effets pervers sur le fonctionnement de l'économie ».
Si votre commission revient ainsi presque dix ans en arrière, c'est parce que cette prédilection pour les « régimes fiscaux d'exception » dépasse largement les clivages politiques : le perfectionnisme fiscal fait ainsi partie intégrante de notre culture nationale ; il en est de même de la passion de l'égalité, qui se traduit par la nécessité d'afficher des régimes fiscaux particulièrement progressifs, alors même que la révolution libérale partie des États-Unis et propagée de l'autre côté de l'Atlantique depuis la Grande-Bretagne, n'épargne aucun pays européen.
De ce point de vue, l'augmentation de plus d'une centaine du nombre de mesures dérogatoires depuis le début des années 1980, qui se monte aujourd'hui à 418, est, au delà de leur montant global estimé à plus de 50 milliards d'euros par le Conseil des impôts -chiffre dont le mode de calcul et surtout la portée sont toutefois sujets à caution-, significatif de cette exception fiscale française.
3. La traduction d'une tradition d'interventionnisme économique
La France se caractérise par une pléiade de dispositifs correspondant à des populations extrêmement restreintes voire nulles. Est-ce simplement parce que les pouvoirs publics seraient nettement plus sensibles que dans autres pays aux pressions catégorielles ? Si toutes les exceptions ont pu paraître légitimes, c'est bien parce que, au moment de leur instauration, il paraissait s'y attacher un intérêt en termes de justice sociale ou d'efficacité économique.
L'égalité devant l'impôt est, et doit demeurer, une notion essentielle du système fiscal français. Le Conseil constitutionnel a été amené, à plusieurs reprises, à préciser la portée de ce principe et a sanctionné des mesures qui lui paraissaient ne pas le respecter. En ce sens, il ne fait que conforter le souci de voir pris en compte tous les éléments reflétant la capacité contributive des agents.
Chaque situation est particulière et mérite un traitement spécifique. On ne se pose que rarement la question des effets pervers ou de la neutralisation à terme de la mesure par le jeu d'une sorte d'échelle de perroquet fiscale entre les différentes catégories sociales . Bref, le législateur français se satisfait mal des cotes mal taillées pour préférer des régimes fiscaux sur mesure.
Un exemple très significatif de cette propension au perfectionnisme fiscal peut être donné en matière d'impôt sur le revenu : c'est parce que le système du quotient familial corrigé de toutes les demi-parts supplémentaires données à partir du troisième enfant, aboutissait à surtaxer les célibataires, qu'a été mis en place le système de décote. Or il en est résulté mécaniquement une progressivité accrue des prélèvements à l'entrée du barème, dont un des effets secondaires est la diminution de l'incitation à la reprise du travail salarié.
Mais le souci de justice sociale n'est pas le seul facteur à l'origine de la prolifération des régimes dérogatoires, qui s'alimente aussi largement de la tradition française toujours vivace d'interventionnisme économique . Aujourd'hui encore, en dépit du recul du colbertisme, les aides sectorielles ont tendance à se multiplier, ne serait-ce que parce que chaque nouveau ministre est, pour ainsi dire, contraint de mettre en oeuvre un plan d'action comportant un volet fiscal, et qui, bien sûr, doit porter son nom.
En définitive, on assiste donc à une sédimentation de mesures nouvelles sans jamais, ou du moins rarement, que l'on songe à supprimer les mécanismes d'aides antérieurs. Tel est notamment le cas des aides aux entreprises dont on peut dire qu'elles se caractérisent par une grande instabilité et une extrême complexité, comme l'illustre l'exemple du crédit d'impôt recherche.
La complexité et l'instabilité du crédit d'impôt recherche
Le 21 ème rapport du Conseil des impôts relatif à la fiscalité dérogatoire souligne que le crédit d'impôt recherche a connu depuis sa création en 1983 « d'incessantes modifications portant sur son assiette, son taux, la période de référence ou le plafonnement de ses effets, qui en ont fait l'un des dispositifs les plus complexes à utiliser pour les entreprises ». En particulier, partageant des observations déjà exprimées par votre commission des finances, le Conseil des impôts constate que « le périmètre des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche présente des ambiguïtés, sources de contentieux entre les entreprises et l'administration fiscale ». Enfin, « par delà les perfectionnements qu'elles cherchent à introduire, [les] modifications successives [issues notamment de la loi de finances pour 1999 et de la loi sur l'innovation et la recherche de 1999] paraissent peu compatibles avec l'orientation des entreprises en matière de recherche, qui relèvent davantage de stratégies de long terme ». L'article 62 du projet de loi de finances pour 2004 propose une nouvelle modification du régime du crédit d'impôt recherche.
Mais les démons du perfectionnisme fiscal se sont révélés, ces dernières années, d'autant plus puissants qu'il a fallu gérer la divergence croissante entre la France et ses principaux concurrents étrangers .
Tel est le cas de l'imposition des personnes. Tandis que l'Allemagne s'est lancée dans une réforme fiscale ambitieuse consistant à diminuer le taux marginal pour le porter à 43 % mais s'accompagnant de mesures pour limiter les pertes d'assiette - on peut citer par exemple la suppression de l'exonération des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail -, la France poursuit une politique d'allègement des prélèvements obligatoires à deux niveaux :
- d'abord, timidement avec le précédent gouvernement et de façon plus déterminée aujourd'hui, est mise en oeuvre une politique de réduction des taux du barème, étant noté que, compte tenu de la faiblesse des marges de manoeuvres budgétaires, l'on se garde bien pour l'instant de toucher aux limites des tranches elles-mêmes ;
- ensuite, cette tendance est accentuée par l'octroi ou l'extension d'avantages fiscaux qu'il s'agisse du mécénat, de l'aide à la création d'entreprises ou du plan d'épargne retraite.
A court terme, la méthode choisie reflète une préférence de structure des Français pour les systèmes fiscaux caractérisés par des taux élevés atténués par une multiplicité d'exceptions .
A plus long terme, il conviendra sans doute de s'orienter progressivement pour chaque grand type de fiscalité vers une remise à plat d'ensemble de nature à réduire le décalage entre pression fiscale nominale et pression fiscale réelle .
C. UNE IMPOSITION DU CAPITAL ÉCONOMIQUEMENT INADAPTÉE
1. Les trois-quarts de l'épargne française ne sont pas fiscalisés
En ce qui concerne la fiscalité de l'épargne, il convient tout d'abord de rappeler que les trois quarts de l'épargne française sont investis dans des produits et placements partiellement ou totalement défiscalisés. Ceci est le cas, tant pour l'épargne liquide que pour l'épargne longue.
Le graphique ci-après permet de mettre en évidence cette situation dans le cas de l'épargne longue.
L'épargne longue fiscalisée et défiscalisée (France métropolitaine, 31 mars 2003)
(en milliards d'euros)
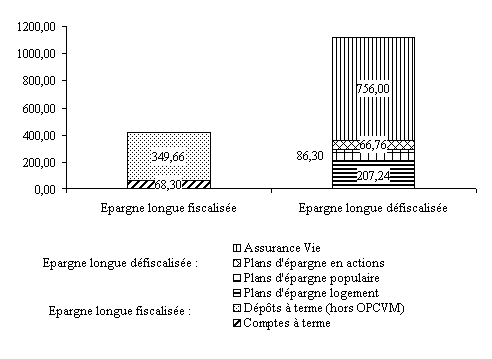
Source : d'après des données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Cette défiscalisation de la majeure partie de l'épargne en France contribue à expliquer la taxation parfois excessive de l'épargne taxée.
2. Les dividendes sont trop taxés
Si l'on excepte l'épargne défiscalisée, les dividendes seraient taxés en France de manière particulièrement lourde, comme l'indique le graphique ci-après.
L'imposition des dividendes en Europe (2001)
Taux marginal de
prélèvement, au taux supérieur de l'impôt sur le
revenu
(en %)
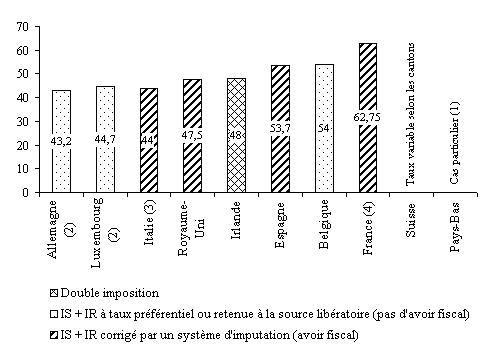
(1) Base d'imposition de 4 % de la valeur de marché des actifs (actions ou obligations), taux d'imposition de 30 %
(2) Sans tenir compte des systèmes d'abattements
(3) Participations non qualifiées
(4) 52,75 % + prélèvements sociaux de 10 %
Source : d'après l'OFCE, in Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343, Sénat (2002-2003)
La fiscalité des revenus financiers a donc des effets pervers , en infléchissant la structure de détention de l'épargne dans un sens économiquement non optimal . Cette tendance préoccupante risquerait d'être renforcée si le projet gouvernemental de suppression de l'avoir fiscal figurant dans le projet de loi de finances pour 2004 devait être adopté sans de sérieuses modifications de nature à préserver la situation des actionnaires personnes physiques.
3. Une imposition des plus-values inadaptée tant par son taux que par sa structure
En ce qui concerne l'imposition des plus-values , il convient de considérer, outre le taux généralement pratiqué, sa structure générale et les choix économiques qui la sous-tendent.
La France est dans une situation comparativement défavorable, par son taux , mais aussi par sa structure.
Tout d'abord, parmi les pays étudiés par l'OFCE (qui il est vrai ne comprennent pas ici la Suède), elle a le taux de taxation des plus-values réalisées sur les participations non substantielles 8 ( * ) de long terme le plus élevé ( 26 % avec les prélèvements sociaux), comme l'indique le graphique ci-après.
La taxation des plus-values non substantielles de long terme en Europe (2001)
(en %)
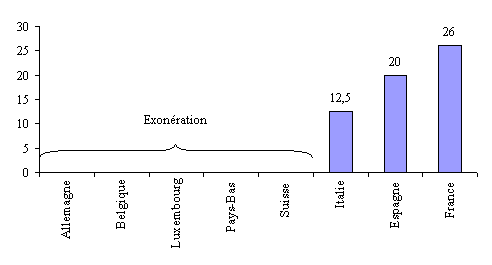
Source : Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport n° 343, Sénat (2002-2003)
Ensuite, la France est également dans une situation défavorable du fait de la structure de sa fiscalité des plus-values. De nombreux Etats distinguent différents types de plus-values, selon deux critères :
- le caractère spéculatif de la plus-value ;
- le montant de participation, les plus-values substantielles étant dans certains cas davantage taxées.
La France est l'un des rares Etats à appliquer un taux uniforme , ce qui l'empêche d'orienter le marché des actions dans un sens qu'elle jugerait optimal. On peut rappeler à cet égard que, selon le sixième principe défini par le « rapport Lambert » de 1997 9 ( * ) , « la fiscalité de l'épargne doit prendre en compte la durée de l'engagement d'épargne ».
Les différentes logiques de taxation des plus-values en Europe (2001)
|
|
Plus-values de court terme (« spéculatives ») davantage taxées que les plus-values de long terme |
||
|
Oui |
Non |
||
|
Plus forte taxation des plus-values portant sur des cessions de participations importantes |
Oui |
Allemagne*, Luxembourg*, Belgique* (1) (plus-values de long terme exonérées) |
Pays-Bas, Italie |
|
Non |
Espagne, Royaume-Uni* (imposition décroissante en fonction de la durée de détention) |
Suisse (exonération totale) France (taux uniforme de 26 %) (2) |
|
* Pays soumettant les plus-values au barème de l'impôt sur le revenu
Pays fiscalement le plus intéressant selon l'OFCE (phénomènes de fraude exceptés)
(1) En Belgique, choix entre IR et taux de 33 % pour les cessions d'opérations « spéculatives »
(2) Imposition au taux de 16 %, soit 26 % avec les prélèvements sociaux
Source : d'après les données de l'OFCE, in Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343 (2002-2003)
Ainsi, selon l'étude de l'OFCE annexée au rapport d'information précité de votre rapporteur général et de notre collègue Joël Bourdin, « la Suisse et les pays où la non déclaration permet la fraude sont les pays les plus favorables en ce qui concerne ce type d'imposition ». En revanche, la situation de la France est défavorable pour les plus-values réalisées sur les participations non substantielles de long terme.
CHAPITRE II :
LA
NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
I. LES DÉFIS À RELEVER
A. FAIRE LE CHOIX DE L'ATTRACTIVITÉ FISCALE
Les déterminants de la compétitivité d'une nation sont suffisamment complexes pour aborder la question de l'attractivité fiscale avec prudence. Néanmoins, un « cavalier seul » fiscal, niant l'évidence d'une concurrence fiscale entre pays européens, refusant de regarder en face les singularités françaises, serait trompeur et dangereux : dans un marché unique, capitaux et individus ont toujours la tentation de voter avec leurs pieds. De plus, pour nos voisins, au-delà des critères classiques de compétitivité-prix et coût, qui, à l'échelle internationale, résultent des différentiels de coût du travail, d'inflation et de taux de change, l'attractivité d'un territoire constitue désormais le résultat d'une stratégie offensive consistant à attirer et à retenir, de manière volontariste, les entreprises, les capitaux et les compétences, par une politique adaptée à une économie européenne et mondiale qui laisse s'opérer le jeu de la libre concurrence fiscale.
1. Une compétitivité du « site France » affaiblie par le manque d'avantage comparatif en matière de fiscalité
Sur la base des stocks d'investissements directs à l'étranger, la France apparaît à la quatrième place mondiale, une place cohérente avec son poids économique réel. De nombreux rapports et études ont, du rapport Lavenir « l'entreprise et l'hexagone » au rapport de nos collègues Denis Badré et André Ferrand « Mondialisation : réagir ou subir » 10 ( * ) , mis en exergue en revanche la trop forte spécialisation de la France dans des activités à faible valeur ajoutée, liée à une fiscalité dissuasive pour attirer et retenir les talents qui fonderont, à moyen terme, la compétitivité d'un pays développé.
a) Un classement en termes d'investissements directs étrangers faussement rassurant
Les investissement directs étrangers (IDE) entrant en France en 2002 se sont élevés à 52,4 milliards d'euros, en recul certes par rapport à l'année 2001, mais d'un montant désormais supérieur à la plupart de nos principaux concurrents européens. De ce point de vue, la situation en termes d'attractivité de la France paraît bonne. Celle-ci ne manque pas d'atouts : sa situation géographique est exceptionnelle et la taille de son marché constitue une incitation forte pour une implantation commerciale. L'indicateur « IDE », s'il constitue une approche intéressante pour tenter de mesurer la compétitivité d'un pays, ne peut dispenser, dans le cas de la France, d'une analyse plus qualitative. Sur le plan micro-économique, les multiples exemples de sociétés européennes qui ne retiennent pas la France pour la localisation de leurs activités incitent à nuancer le jugement positif qui pourrait être tiré du stock d'investissements directs étrangers . Certains pays proches, de taille pourtant plus modeste, sont aujourd'hui en mesure de rivaliser avec la France : la position de la Belgique dans le classement est ainsi exemplaire.
Investissements directs
(en milliards d'euros)
|
|
Entrants |
Sortants |
||||
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
France |
46,6 |
58,8 |
52,4 |
- 190,5 |
- 92,5 |
- 70,9 |
|
Allemagne |
220,4 |
37,9 |
40,4 |
- 61,7 |
-47,0 |
- 26,1 |
|
Etats-Unis |
336,1 |
146,2 |
32,4 |
- 192,2 |
- 143,2 |
- 131,6 |
|
Pays-Bas |
65,5 |
56,8 |
30,7 |
- 79,7 |
- 54,1 |
- 28,9 |
|
Royaume-Uni |
129,2 |
69,1 |
26,1 |
- 275,0 |
- 75,7 |
- 43,3 |
|
Canada |
73,0 |
30,8 |
23,4 |
- 51,5 |
- 39,9 |
- 29,2 |
|
Espagne |
40,7 |
31,3 |
22,5 |
- 59,3 |
- 37,0 |
- 19,6 |
|
Belgique et Luxembourg 11 ( * ) |
242,7 |
98,6 |
20,5 |
- 23,6 |
- 112,5 |
- 14,5 |
|
Italie |
14,5 |
16,6 |
16,9 |
- 13,4 |
- 24,0 |
- 20,9 |
|
Japon |
9,0 |
6,9 |
10,0 |
- 34,9 |
- 42,7 |
- 33,5 |
Source : rapport sur la compétitivité du conseil d'analyse économique - octobre 2002
Les investissements directs étrangers masquent en effet les faiblesses françaises en ce qui concerne la localisation de sièges sociaux et d'activités de services à forte valeur ajoutée . Ainsi, l'accroissement des investissements directs étrangers est, d'une certaine façon, un indicateur de performance à l'égard des centres de décision situés à l'extérieur. En cas de crise, ce sont en général les sites implantés hors du pays d'origine d'un groupe industriel qui subissent les premiers ajustements nécessaires. Or, les récentes localisations de sièges sociaux de grands groupes européens, nés de la fusion de sociétés françaises avec leurs partenaires étrangers, ont toutes évité la France : Dexia a implanté son siège social en Belgique ; EADS s'est installé aux Pays-Bas, tout comme Euronext.
Pour ces implantations stratégiques, la fiscalité, tant celle de l'entreprise que celle du cadre supérieur ou de l'entrepreneur, joue un rôle majeur.
b) Un impact avéré de la fiscalité sur la localisation de facteurs de production de plus en plus mobiles
Des études consacrées aux déterminants de la localisation des entreprises, trois leçons peuvent être retenues en matière fiscale :
- la fiscalité ne joue pas sur le choix entre exporter et investir à l'étranger, mais influence la localisation une fois que la décision d'investir à l'étranger est prise ;
- en moyenne, une hausse de l'impôt sur les sociétés de 1 point réduit l'investissement direct étranger entrant de 3,3 % et cet effet se renforce au cours de la période récente ;
- les investissements ex nihilo sont plus sensibles aux différences de fiscalité.
Comme votre rapporteur général en exprimait la crainte dans son rapport d'information consacré à « La concurrence fiscale en Europe » 12 ( * ) , l'adoption de l'euro favorise les comparaisons de prix et, du même coup, dissipe l'illusion monétaire qui pouvait dissimuler les écarts de taxation. Un pays doté d'un grand marché et à fiscalité élevée constitue donc une aubaine pour un voisin de plus petite taille, surtout en ce qui concerne la mobilité des personnels les plus qualifiés et celle des entreprises. Les deux mobilités vont d'ailleurs de pair pour les activités les plus innovantes ou à très haute valeur ajoutée.
Le rapport du conseil d'analyse économique relatif à la compétitivité 13 ( * ) évalue l'importance du facteur « fiscalité » : « bien que la France dispose de nombreux atouts (infrastructures, tissu industriel, qualification de la main d'oeuvre, accès au marché européen) la plaçant parmi les destinations d'investissements directs étrangers privilégiées en Europe et dans le monde, plusieurs rapports ont stigmatisé la position de la France, sur un ton souvent alarmiste : trop fortement régulée, dotée d'un marché du travail excessivement rigide, décourageant l'effort en raison de prélèvements publics démesurés et poussant les firmes à la délocalisation en raison d'un impôt sur les sociétés la plaçant parmi les cancres européens, la France serait peu attractive, donc peu compétitive. Concernant les entreprises, la position relative de la France en matière d'impôt sur les sociétés est en effet très mauvaise. Et le principe même de la taxe professionnelle, qui n'est pas un impôt assis sur le résultat, aggrave ce constat. Et même si la question de la fiscalité n'est pas centrale dans les choix de localisation, l'impact de ce déterminant est avéré. L'existence d'effets d'agglomération 14 ( * ) peut de surcroît enclencher un phénomène cumulatif de désintérêt pour le « site France », passé un certain seuil ».
Comme le montre l'étude de l'OFCE réalisée à l'appui du rapport d'information sur les réformes fiscales en Europe entre 1992 et 2001 15 ( * ) , les pratiques d'optimisation fiscale sont omniprésentes dans la localisation des holdings et des sièges sociaux . Cette localisation dépend non d'un niveau global de prélèvements obligatoires mais de paramètres bien ciblés, liés au traitement fiscal des opérations de restructuration : entrent en ligne de compte l'imposition des plus-values de cessions d'actifs et les systèmes de compensation de la double imposition pour les actionnaires personnes physiques.
La conclusion du rapport, celui d'une France à la traîne, ne peut qu'inquiéter : les réformes fiscales réalisées par nos voisins ont une conséquence négative en termes d'attractivité du « site France » car elles élèvent le taux de pression fiscale relatif de notre pays.
Taux légal de l'impôt sur les sociétés en Europe
|
|
1986 |
1991 |
1995 |
1998 |
2001 |
Différence 1986-2001 |
|
Allemagne |
56,0 |
50/36 |
45/30 |
45/25 |
25,0 |
-31,0 |
|
Autriche |
50,0 |
30,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
-16,0 |
|
Belgique |
45,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
-6,0 |
|
Danemark |
50,0 |
38,0 |
34,0 |
34,0 |
30,0 |
-20,0 |
|
Espagne |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
-0,0 |
|
Finlande |
33,0 |
23,0 |
25,0 |
28,0 |
29,0 |
-4,0 |
|
France |
45,0 |
42,0 |
33,3 |
41,6 |
36,4 |
-8,6 |
|
Grèce |
49,0 |
46,0 |
35/40 |
35/40 |
35,0 |
-14,0 |
|
Irlande |
50,0 |
43,0 |
40,0 |
32,0 |
20,0 |
-30,0 |
|
Italie |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
37,0 |
36,0 |
-0,0 |
|
Luxembourg |
40,0 |
33,0 |
33,0 |
30,0 |
30,0 |
-10,0 |
|
Pays Bas |
42,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
-7,0 |
|
Portugal |
42/47 |
36,0 |
36,0 |
34,0 |
32,0 |
-15,0 |
|
Royaume-Uni |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
31,0 |
30,0 |
-5,0 |
|
Suède |
52,0 |
30,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
-24,0 |
|
Moyenne UE |
44,3 |
36,7 |
35,1 |
34,9 |
32,0 |
-12,3 |
|
Etats Unis |
46,0 |
34,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
-11,0 |
|
Japon |
50,0 |
50,0 |
47,5 |
46,4 |
46,4 |
-3,6 |
Source : OCDE
c) Une expatriation des patrimoines et des hauts revenus bien réelle
Votre rapporteur général, au cours des débats en séance publique sur le projet de loi pour l'initiative économique, a communiqué le 27 mars 2003 les résultats d'une étude réalisée à partir de chiffres de la direction générale des impôts qui montre l'impact de la fiscalité du patrimoine sur les délocalisation des personnes et de capitaux . L'exemple de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est particulièrement éclairant pour mesurer les effets de la fiscalité du site « France » sur ses propres contribuables.
Les chiffres habituellement communiqués, qui raisonnent en nombre annuel de contribuables délocalisés, ou même en pertes annuelles en droits, ne permettent pas de prendre en compte l'ampleur du phénomène, et, en fait le minimisent volontairement.
Plus de 300 redevables à l'ISF se délocalisent chaque année. Ce chiffre, qui parait minime par rapport au nombre global de redevables à l'ISF, correspond tout de même sur cinq ans (1997-2001) à un total de 1.792 contribuables ayant choisi de quitter le territoire national. Néanmoins il ne permet pas de se faire une idée complète du phénomène des délocalisations liées à l'ISF car, en ce domaine, une approche qualitative est nécessaire : tous les départs n'ont pas le même impact fiscal ou économique.
Nombre de redevables à l'ISF délocalisés
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (1) |
Total |
|
370 |
383 |
350 |
359 |
330 |
1.792 |
(1) 2001 : chiffres non encore définitifs
Les pertes annuelles en droits paraissent également relativement limitées puisqu'elles ne représentent annuellement que 10 à 20 millions d'euros. En cinq ans, le budget de l'Etat a perdu 70 millions d'euros en raison de ces délocalisations. Mais un tel indicateur ne rend pas compte de la réalité économique : la perte en droits n'est rien si on la compare avec la perte en capital enregistrée par l'économie française en raison des délocalisations liées à l'ISF. C'est davantage à l'aune des délocalisations de capitaux qu'à l'aune du nombre de départs annuels de redevables à l'ISF ou à l'aune de la perte en droits pour le budget de l'Etat que doit être évalué l'impact économique de l'ISF.
Les pertes en capital pour l'économie française liées à la délocalisation de redevables à l'ISF sont importantes. Le cumul sur cinq ans laisse apparaître a minima des pertes en bases imposables à cause de l'ISF de 7,3 milliards d'euros . Une étude précise de l'année 2001 montre que les capitaux réellement expatriés sont bien supérieurs, d'au moins 50 %, ce qui correspond à la valeur des biens professionnels transférés, aux autres éléments du capital non taxable à l'ISF, aux patrimoines délocalisés avant d'avoir atteint le seuil de taxation, etc. Par rapport au chiffre « bases imposables », la réalité des délocalisations de capitaux doit donc être réévaluée de +50 %. En 5 ans, 11 milliards d'euros de capitaux détenus par des redevables à l'ISF ont été délocalisés.
Pertes annuelles en bases imposables liées aux délocalisations ISF
(en millions d'euros)
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (1) |
Total |
|
2.022,8 |
2.021,4 |
1.163,8 |
1.107,1 |
978,4 |
7.300 |
(1) 2001 : chiffres non encore définitifs
Les contribuables qui sortent du territoire ne rentrent pas : les retours de capitaux enregistrés annuellement et pris en compte pour l'ISF n'excèdent guère les 100 millions d'euros.
Une typologie des contribuables à l'ISF qui se délocalisent fait apparaître en outre deux traits saillants. Le patrimoine des contribuables ISF délocalisés est en moyenne près de 2,5 fois plus élevé que celui des autres redevables ISF. Ces personnes ont en moyenne 52 ans contre 67 ans pour la moyenne de l'ensemble des redevables de l'ISF : elles sont encore actives au moment où elles quittent la France. Ce sont donc les contribuables les plus dynamiques qui quittent le territoire national.
Les destinations géographiques privilégiées restent les Etats-Unis pour 16 % des personnes, la Belgique pour 16 %, le Royaume-Uni pour 15 % et la Suisse pour 13 % où n'existe pas d'impôt de solidarité sur la fortune.
2. La nécessaire adaptation de la France à la concurrence fiscale
Votre rapporteur général ne peut que prendre acte de l'absence d'harmonisation fiscale en Europe. La recherche de la convergence fiscale est ainsi la grande absente de la conférence intergouvernementale sur la Constitution de l'Union européenne. Ce constat exige que la France adopte une stratégie fiscale cohérente et offensive , en réformant en conséquence la fiscalité des bases taxables les plus mobiles, et en premier lieu la fiscalité du patrimoine, et en envoyant des signaux clairs et positifs aux « impatriés » étrangers éventuels.
a) L'absence d'harmonisation fiscale à l'échelle de l'Union européenne
La pluralité des régimes d'imposition en Europe, et l'adoption par certains Etats membres de régimes dérogatoires explicitement destinés à attirer des investissements étrangers, fait craindre un renforcement de la concurrence fiscale dans une Union européenne de 25 membres. Si la Commission européenne a pris conscience des risques liés à une absence d'harmonisation fiscale, le Conseil n'en a pas encore tiré toutes les conséquences.
Les efforts réalisés pour éliminer, d'une part, les sources de concurrence fiscale déloyale et pour, d'autre part, élaborer une directive relative à la fiscalité de l'épargne montrent les difficultés inhérentes à tout processus d'harmonisation fiscale.
Le Conseil ECOFIN de décembre 1997 a adopté une série de mesures visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable. Elles ont conduit à la négociation d'un « code de bonne conduite » pour la fiscalité des entreprises, adopté le 3 juin 2003, qui prévoit que les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'instaurer toute mesure fiscale dommageable et à modifier les lois ou pratiques réputées préjudiciables en appliquant les principes du code. Les critères qui permettent de déceler des mesures potentiellement dommageables sont les suivants :
- un niveau d'imposition effective nettement inférieur au niveau général du pays concerné ;
- des facilités réservées aux non-résidents ;
- des incitations fiscales en faveur d'activités qui n'ont pas trait à l'économie locale, de sorte qu'elles n'ont pas d'impact sur l'assiette fiscale nationale ;
- l'octroi d'avantages fiscaux même en l'absence de toute activité économique réelle ;
- des règles pour la détermination des bénéfices des entreprises faisant partie d'un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment de celles approuvées par l'OCDE.
Ceci n'empêche en rien qu'un Etat membre pratique une imposition très basse, mais généralisée. Aucune proposition n'est à l'étude pour fixer un taux minimum en-dessous duquel aucun pays ne serait autorisé à baisser sa fiscalité sur les entreprises.
En matière d'harmonisation fiscale, l'Union européenne a néanmoins accompli des progrès significatifs en 2003. Outre l'adoption du « code de bonne conduite » sur la fiscalité des entreprises, le paquet fiscal adopté par le Conseil ECOFIN de Luxembourg du 3 juin 2003 a permis d'aboutir à un accord sur la directive relative à la fiscalité de l'épargne.
Cette directive entrera en vigueur le 1 er janvier 2005. Elle concerne :
- les intérêts de titres de créance de toute nature, y compris les dépôts d'espèces et les obligations privées et publiques et autres titres d'emprunt négociables ;
- les intérêts courus et capitalisés ;
- les intérêts issus de placements indirects effectués par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif.
En vertu de la directive, chaque Etat membre devra informer les autres des intérêts versés à partir de cet Etat membre à des particuliers résidant dans d'autres États membres. Pendant une période transitoire le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique seront toutefois autorisés, au lieu de communiquer des informations, à appliquer une retenue à la source. Ainsi à partir du 1 er janvier 2005, 12 des 15 Etats membres de l'Union européenne appliqueront un échange automatique d'informations sur les revenus de l'épargne des non-résidents.
Pendant une période transitoire non définie, le Luxembourg, la Belgique et l'Autriche appliqueront sur les revenus de l'épargne une retenue à la source fixée à 15 % pour les trois premières années 2005-2007, 20 % pour les trois années suivantes 2008-2010 et 35 % à partir de 2011. Le produit de la retenue à la source prélevée au Luxembourg, en Autriche et en Belgique ainsi que dans les pays tiers respectifs sera versé, à concurrence de 75 %, à l'Etat de résidence de l'épargnant.
Cet accord illustre les difficultés de la coopération en matière de fiscalité de l'épargne : le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique passeront à l'échange automatique d'informations lorsque l'Union européenne parviendra, le cas échéant, à un accord, approuvé à l'unanimité par le Conseil, avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre ...
b) Une prise de conscience encourageante
Face à cette situation, le gouvernement a pris conscience de la nécessité d'adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité de la fiscalité française.
La loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003 contient ainsi un certain nombre de dispositions fiscales relatives à la fiscalité du patrimoine de l'entrepreneur de nature à diminuer les « frottements fiscaux » en matière de transmission des entreprises et à supprimer certains effets pervers liés à l'ISF au sujet desquels votre commission des finances avait formulé des propositions visant notamment à reconnaître les pactes d'actionnaires.
En matière de transmission de patrimoines professionnels, la loi relève des deux-tiers les seuils d'exonération des plus-values professionnelles à long terme. Elle encourage la transmission anticipée d'entreprise en étendant aux donations en pleine propriété l'abattement de 50 % qui existe pour les successions, sous condition de signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée d'au moins six ans.
Elle apporte quelques améliorations au régime des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune. Elle introduit un abattement de 50 % au titre de l'ISF pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans. Elle exonère de l'ISF les titres reçus en contrepartie d'apports en numéraire au capital de PME. Elle prévoit que les dirigeants d'entreprises ne détenant pas les 25 % du capital de leur entreprise leur ouvrant droit à exonération automatique au titre de l'ISF, bénéficient de l'exonération dès lors que leurs parts représentent plus de 50 % de la valeur brute de leur patrimoine imposable.
Représentant une approche encore très partielle et présentant une grande complexité, ces mesures de bon sens constituent une avancée en attendant une réforme de la fiscalité du patrimoine plus globale, comprenant une révision fondamentale tant de l'ISF que des droits de succession.
B. FAIRE FACE À LA DYNAMIQUE DES DÉPENSES SOCIALES
1. Les facteurs de croissance des dépenses sociales
a) La sécurité sociale confrontée, avant tout, à une crise des dépenses
La dégradation rapide du solde du régime général de la sécurité sociale est le résultat d'une conjonction de plusieurs facteurs défavorables et avant tout d'une progression accélérée des dépenses sociales bien plus que d'une progression ralentie des recettes.
D'après le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2003, cette accélération des dépenses sociales crée des risques importants, notamment « celui d'une dérive financière et d'une perte durable de la maîtrise du système ; celui aussi d'être contraint, si d'autres solutions n'étaient pas mises en oeuvre, à des hausses de prélèvements qui seraient d'autant plus massives qu'elles auraient été différées ».
L'analyse des facteurs explicatifs de l'accélération de la hausse des dépenses sociales permet toutefois de faire la part entre les causes structurelles de ce phénomène et ses causes conjoncturelles. Cette analyse conduit dès lors à se demander s'il est judicieux et souhaitable de faire reposer tout le poids de la régulation des dépenses sociales, et notamment des dépenses d'assurance maladie, sur le seul instrument financier que constituent les prélèvements obligatoires .
Il faut souligner que l'assurance maladie n'a jamais connu un déficit équivalent à celui d'aujourd'hui. En outre, quelle que soit la situation économique, ce déficit persiste, ce qui conduit à penser que le système de protection sociale est confronté à une crise de dépenses et non à une crise de recettes et que la priorité doit être donnée à la maîtrise des dépenses de santé, d'autant plus qu'il ne faut pas s'attendre à un ralentissement spontané de leur dynamique, compte tenu des besoins croissants liés à l'évolution de la société (allongement de la durée de la vie, progrès médicaux, débat récurrent sur la création d'un cinquième risque pour la dépendance).
Déficit de la Caisse nationale d'assurance
maladie rapporté
aux recettes de cotisations et d'impôts
affectés
(en %)
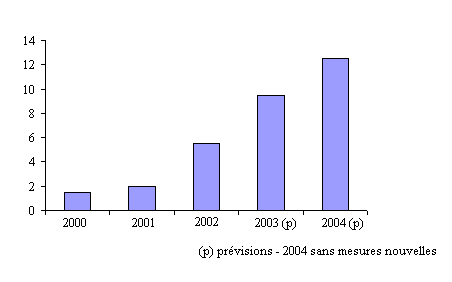
Source : commission des comptes de la sécurité sociale
b) Les facteurs structurels à l'origine de l'accélération de l'augmentation des dépenses d'assurance maladie
Le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale de septembre 2003 souligne l'existence de deux types de facteurs expliquant l'accélération régulière de l'évolution des dépenses d'assurance maladie : des facteurs structurels , d'une part - surprescription de médicaments, progression forte des dépenses d'indemnités journalières, accès croissant de certains assurés au bénéfice de l'affection de longue durée (qui concerne aujourd'hui six millions de personnes) - des facteurs plus conjoncturels , d'autre part, tels que certaines décisions récentes, qu'il s'agisse de la succession des protocoles hospitaliers ou des revalorisations substantielles d'honoraires qui ont accéléré les dépenses et dégradé les comptes.
La consommation de soins a connu une augmentation rapide depuis 1997 : cette augmentation est liée à des facteurs structurels - le vieillissement de la population - qui se traduit par une hausse du nombre de personnes âgées dont la consommation médicale est élevée ; le progrès technique qui met à disposition des patients des traitements plus efficaces mais aussi plus coûteux.
Les études disponibles mesurant l'impact du vieillissement de la population sur l'évolution des dépenses de santé
Comme l'a rappelé M. Jean-François Mattéi, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, il faut « accepter d'assumer une part inéluctable d'augmentation des dépenses de santé, liée au vieillissement de nos sociétés et au progrès médical ».
Le vieillissement a en effet aujourd'hui un coût : les dépenses de santé des plus de 60 ans sont trois fois plus élevées que celle des trentenaires et les personnes âgées de plus de 70 ans consomment 30 % des dépenses totales.
D'après une étude réalisée par la DREES 16 ( * ) , les facteurs démographiques seraient tendanciellement à l'origine d'environ 1 point par an de croissance des dépenses totales de santé en volume, dans la plupart des pays d'Europe occidentale. En outre, au sein de ces facteurs démographiques structurels, l'impact du vieillissement serait de l'ordre de 0,7 % par an sur la période 2000-2020 .
A l'avenir, la croissance du nombre de personnes âgées devrait induire une croissance des dépenses d'assurance maladie. Selon les projections démographiques publiées par l'INSEE en 2001, la France compterait en 2020 par rapport à 2000, 1,4 fois plus de personnes de 60 ans et plus, et 1,8 fois plus de personnes de 80 ans et plus, (et 3,2 fois plus en 2040). Ainsi en 2020, la France compterait 17 millions de personnes de 60 ans et plus et près de 4 millions de personnes de 80 ans et plus. A l'horizon 2040, il y aurait près de 7 millions de personnes de 80 ans et plus.
A cet égard, la DREES 17 ( * ) a réalisé des projections du nombre de personnes âgées dépendantes à l'horizon 2020 puis 2040 , afin d'appréhender les effets des évolutions démographiques futures en fonction de différents scénarii possibles d'évolution de la dépendance aux âges élevés.
A l'horizon 2040, le vieillissement de la population devrait conduire, dans les trois hypothèses, à une augmentation tendancielle du nombre de personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans . Une première accélération aurait lieu à partir de 2010 et une seconde à partir de 2030. Sur la période 2000-2020, la hausse serait de l'ordre de 16 % dans le scénario optimiste, 25 % dans le scénario central et de 32 % dans le scénario pessimiste. Entre 2020 et 2040, le nombre de personnes âgées dépendantes augmenterait dans des proportions légèrement supérieures. Au total, sur les quarante années, l'augmentation serait de 35 % dans le scénario optimiste, 55 % dans le scénario central ou de 80 % dans le scénario pessimiste. Cette hausse serait en outre concentrée sur les 80 ans et plus .
La croissance tendancielle est également favorisée, d'après le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2003, par « la grande liberté dont l'ensemble des acteurs disposent dans le système de soins. Les gains potentiels du système de soins en termes d'efficacité sont sans doute très importants. On peut ainsi simplement rappeler que la France est selon l'OCDE le premier consommateur de médicaments par habitant, au-delà même des Etats-Unis, sans que le bénéfice en termes de santé soit démontré ».
A l'augmentation de la consommation, s'ajoute une croissance régulière du taux moyen de remboursement : le nombre des assurés exonérés du ticket modérateur augmente très rapidement et celui des patients admis en « affection longue durée » ouvrant droit à l'exonération totale du ticket modérateur s'accroît d'environ 6 % par an.
c) Des facteurs plus conjoncturels
Les années 2002-2003 ont du supporter l'impact de mesures financières exceptionnelles dont l'incidence a été simultanée :
- les créations d'emplois dans la fonction publique hospitalière liées aux programmes de santé publique et à la mise en place de la réduction du temps de travail s'ajoutant à des revalorisations salariales importantes négociées à partir de l'année 2000 dans le secteur public et à partir de l'année 2002 dans les cliniques ;
- les revalorisations tarifaires accordées aux professionnels de santé libéraux en 2002 et 2003 ;
- la montée en charge des plans de développement dans le secteur médico-social ;
- le transfert sur l'assurance maladie de charges financées antérieurement par le budget de l'Etat.
Le coût pour l'assurance maladie des mesures exceptionnelles intervenues depuis 2000
La mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique hospitalière doit s'accompagner de la création de 45.000 emplois personnels non médicaux et de 3.500 emplois médicaux (dont les postes correspondant à l'intégration des gardes dans le temps de travail) pour un coût de 1,9 milliard d'euros en année pleine. Les 45.000 emplois non médicaux se répartissent en 37.000 emplois dans le champ sanitaire et 8.000 emplois dans le champ médico-social. Compte tenu du temps nécessaire pour pourvoir les emplois créés, la mise en place de l'ARTT s'est accompagnée au cours des exercices 2002 et 2003 de l'introduction d'un compte épargne temps (CET) destiné à « stocker » les congés non utilisés et du paiement d'heures supplémentaires.
Au plan financier, le coût global prévisionnel de la création, échelonnée sur la période 2002-2005, des 34.600 emplois non médicaux (hors unités de soins longue durée) et des 3.500 emplois médicaux dans les établissements publics de santé s'élève à 1,624 milliard d'euros. Ce montant est porté à 1,865 milliard d'euros pour 45.000 emplois créés (hors médecins), si l'on tient compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Il convient d'y ajouter les crédits non pérennes consacrés au financement du CET, soit 1,256 milliard d'euros pour les établissements publics de santé (1,364 milliard d'euros si l'on ajoute les établissements sociaux et médicaux sociaux publics). Ces crédits sont destinés à financer, pour la période 2002-2004 pour les médecins et 2002-2003 pour les personnels non médicaux, les droits à congé non pris ou portés dans un CET du fait de l'étalement sur trois ans des créations d'emplois au titre de la réduction du temps de travail. Ce financement permettra aux établissements de remplacer les agents qui utiliseront ces droits, qui représentent un volume de plus de 30.000 équivalents temps plein sur la période 2002-2004.
D'après le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale datant de septembre 2003, les conséquences financières de la réduction du temps de travail à l'hôpital sont évaluées pour 2004 et 2005 à, respectivement, 881 millions d'euros et 355 millions d'euros, ces coûts étant essentiellement liés au CET.
Au total, les protocoles hospitaliers signés en 2000 et 2001 et la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail majorent de près de 3,4 milliards d'euros les dépenses de l'ONDAM par rapport à 1999, avec le bénéfice de la création de 43.000 emplois.
En outre, la revalorisation des honoraires des généralistes en 2002 s'est traduite par un coût en année pleine de 690 millions d'euros.
L'effet net cumulé sur 2003 de l'ensemble des décisions publiques intervenues depuis 2000 en termes d'assurance maladie est de 5 à 5,5 milliards d'euros par rapport à 2000 d'après les calculs de la Cour des comptes. Ce montant mérite d'être rapproché des déficits des régimes obligatoires d'assurance maladie de 2002 (6,1 milliards d'euros) et 2003 (10,6 milliards d'euros).
2. La hausse des prélèvements sociaux, signe d'une impossibilité de contenir la dépense ?
a) Le rendement parfois aléatoire des prélèvements sociaux
Le recours à l'instrument financier que constituent les prélèvements obligatoires pour équilibrer les comptes sociaux n'est pas toujours fiable. Le creusement du déficit des comptes sociaux en 2002 et 2003 résulte en effet, en partie, d'une progression nettement ralentie des recettes de la sécurité sociale.
Deux exemples illustrant le caractère parfois aléatoire du rendement des prélèvements affectés à la sécurité sociale peuvent être cités.
En 2002, les prélèvements sur les revenus du patrimoine et de placement ont subi les conséquences de la crise boursière . L'ensemble des prélèvements sociaux assis sur les revenus du capital (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %) s'est élevé à 9 milliards d'euros en 2002, soit près de 3 % du total des recettes de la sécurité sociale , 60 % provenant de l'assiette patrimoine et 40 % de l'assiette placement. En outre, la CSG représentait 75 % de ces prélèvements en 2002, soit 6,7 milliards d'euros.
L'année 2002 s'est caractérisée par une première diminution du produit de ces prélèvements depuis 1995 , d'environ 7 % par rapport à 2001, soit plus de 600 millions d'euros, la baisse étant plus marquée sur les revenus du patrimoine que sur les produits de placement. Ce premier recul des prélèvements sociaux sur l'assiette capital a résulté principalement de la dégradation de la situation des marchés financiers en 2001 et 2002 .
A titre de comparaison, cette baisse du rendement des prélèvements sociaux assis sur les revenus du capital entre 2001 et 2002 représentait l'équivalent de 10 % du déficit de l'assurance maladie et plus de 17 % du déficit de l'ensemble du régime général de la sécurité sociale en 2002 .
Evolution des prélèvements sociaux assis sur les revenus du capital depuis 1995
(en milliards d'euros 2002)
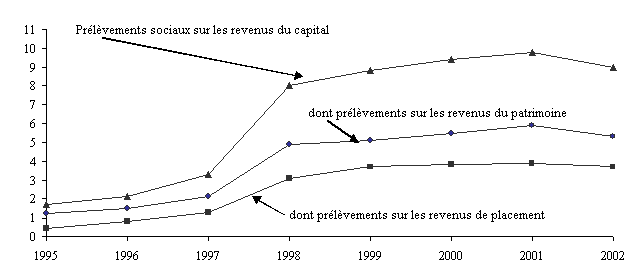
Source : commission des comptes de la sécurité sociale
De même, s'agissant des prélèvements sur les tabacs affectés à la sécurité sociale , la commission des comptes de la sécurité sociale révèle dans son rapport de septembre 2003 que « la croissance du rendement des prélèvements sur le tabac en 2003 se révèle très inférieure à celle qui était initialement prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 . Pour la première fois, une hausse des prix du tabac (celle intervenue au début de l'année 2003) a eu un impact sensible sur la consommation, dont la baisse a pratiquement annulé l'augmentation des droits. L'impact financier a été considérable. Alors que la hausse prévue des droits sur les tabacs était de 1 milliard d'euros, le rendement ne devrait être que de 200 millions d'euros, soit une perte de recettes de 800 millions d'euros par rapport à la prévision ».
Le caractère aléatoire du rendement de certains prélèvements affectés au régime de sécurité sociale incite donc à s'interroger sur les limites de certaines taxes. En matière de droits sur les tabacs, il apparaît ainsi de plus en plus que « l'impôt tue l'impôt ».
b) Agir sur les dépenses pour inscrire les prélèvements sociaux dans une dynamique de baisse des prélèvements obligatoires
(1) L'échec des mécanismes de maîtrise des dépenses sociales
Il ressort du rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale de septembre 2003 que c'est l'échec des mécanismes de maîtrise des dépenses sociales qui a conduit à ce que tout le poids de la régulation des dépenses d'assurance maladie soit reporté sur le seul instrument financier que constituent les prélèvements obligatoires .
Le président de la sixième chambre de la Cour des comptes, a ainsi indiqué, lors de son audition par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale le 18 septembre 2003, que l'échec des différents systèmes de régulation des dépenses d'assurance maladie avait conduit tous les gouvernements à avoir recours à des solutions fiscales ou parafiscales pour équilibrer les comptes et qu'il semblait désormais nécessaire d'agir plutôt sur la structure de l'offre de soins et les comportements des usagers .
En outre, l'augmentation des prélèvements sociaux ne permettra pas de rétablir durablement l'équilibre de la sécurité sociale. Un renforcement des mécanismes de régulation des dépenses est nécessaire afin notamment d'éviter un recours trop systématique à cet instrument financier.
Des mécanismes de régulation obsolètes
Dans le domaine des mécanismes de régulation mis en oeuvre depuis les années 1970, trois leviers d'actions existent mais n'ont pas produit les effets escomptés :
- l'ajustement par les prélèvements obligatoires et les déremboursements est contrebalancé par le fait que 90 % de la population bénéficie d'une complémentaire santé et que six millions de malades en affection de longue durée bénéficient d'une prise en charge à 100 % ;
- la limitation des dépenses par la détermination d'enveloppes ou de lettres-clés flottantes a été largement obérée par l'impossibilité de mettre en application des dispositifs instables et contestés sur le plan juridique ;
- la politique conventionnelle avec les professions de santé aurait dû constituer le support de la maîtrise médicalisée des dépenses. Divers instruments, malheureusement peu opératoires, ont ainsi été mis en place, tels l'accréditation de seulement 400 établissements sur 3.000, la formation médicale continue obligatoire mais sans texte d'application, l'évaluation des pratiques médicales fondée sur le volontariat qui ne concerne que 180 praticiens sur 130.000 en exercice.
Source : Cour des comptes
Le déficit actuel de l'assurance maladie ne résulte pas essentiellement du fléchissement des recettes, contrairement à ce qui avait été observé en 1992-1993, mais de l' accélération des dépenses , tenant à un ensemble de décisions publiques et aux dysfonctionnements plus profonds de la régulation. Il en résulte que, même le retour d'une croissance forte ne suffirait pas à rétablir l'équilibre : au-delà des mesures immédiates d'ajustement, des progrès dans la régulation, tant de court que de long termes, sont indispensables .
(2) Les pistes de réforme envisageables
La valorisation du vote de la loi de financement par le Parlement et la fixation d'objectifs de dépenses réalistes doivent aujourd'hui figurer parmi les priorités de la réforme de notre système de santé : la sous-estimation des dépenses en loi de financement a en effet été si forte qu'elle a dispensé de prévoir dans la loi des mesures de nature à financer les dépenses ou à les limiter.
A ce sujet, la Cour des comptes propose une modification de l'architecture de la loi de financement de la sécurité sociale et des conditions dans lesquelles elle est préparée, discutée et, le cas échéant, révisée, car « la part des décisions de l'Etat et de l'assurance maladie dans l'accélération récente des dépenses montre la nécessité d'améliorer le cadre dans lequel elles interviennent ».
En outre, à moyen et à long termes, la mise en oeuvre d'une réelle politique de régulation des dépenses sociales , notamment des dépenses de santé, devrait permettre, en partie, de contourner le recours à l'instrument « prélèvements obligatoires ».
Certes des éléments structurels et inéluctables, tels le vieillissement de la population ou l'amélioration des techniques médicales, contribuent sans équivoque à la dynamique de croissance des dépenses sociales. Toutefois, comme l'a rappelé le rapporteur général chargé du rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale lors de son audition par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale le jeudi 18 septembre 2003, « quand on regarde des pays, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, qui connaissent un vieillissement plus rapide que la France, on ne constate pas d'accélération similaire des dépenses de santé ».
Sans présager du diagnostic et des pistes de réforme qui seront définis par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, installé par le Premier ministre le 13 octobre 2003, il est possible de tracer aujourd'hui quelques pistes de réformes structurelles s'agissant de la maîtrise des dépenses de santé.
Dans un premier temps, il convient de s'appuyer sur la réflexion menée par les trois groupes de travail constitués au sein de la commission des comptes de la sécurité sociale par M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en septembre 2002.
Le premier groupe, présidé par Mme Rolande Ruellan, conseiller maître à la Cour des comptes, constitué en vue d'établir un état des lieux partagé des relations entre l'Etat et l'assurance maladie , n'avait pas vocation à faire des propositions concrètes mais à amorcer un processus de concertation entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie et notamment d'insister sur la nécessité d'en revenir à une gestion paritaire de l'assurance maladie.
Le second groupe, présidé par M. Jean-François Chadelat et ayant vocation à réfléchir à une nouvelle répartition des rôles entre régimes obligatoires et organismes complémentaires , a rendu son rapport en avril 2003 et a notamment proposé de créer une couverture maladie généralisée, par l'intervention conjointe des régimes de base et de l'assurance complémentaire. Cette proposition intéressante a eu le mérite de relancer le débat sur le partage des rôles entre assurance maladie de base et assurance complémentaire. Dans ce schéma, une aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire devrait faciliter l'accès à une telle couverture généralisée de ceux ne bénéficiant pas de la CMU sans percevoir toutefois des revenus suffisants pour financer l'adhésion à une mutuelle ou la souscription d'un contrat d'assurance. En outre, le rapport insistait sur la possibilité de définir certains actes ou certaines catégories d'actes pour lesquelles les assurances maladie complémentaires pourraient devenir les acteurs pilotes du dispositif, sans pour autant être les acteurs uniques. Dès lors on pourrait envisager un partage des compétences entre l'assurance maladie obligatoire, ayant plutôt vocation à améliorer la prise en charge des affections de longue durée, et les assurances complémentaires, ayant plutôt vocation à prendre en charge certains risques santé, tels l'optique, le dentaire ou le domaine de l'appareillage au sens large.
Enfin, le troisième groupe de travail, présidé par M. Alain Coulomb, directeur général de l'ANAES, avait pour mission de rechercher les moyens de médicaliser l'ONDAM . Les principales conclusions de ce groupe ont porté sur l'impossibilité de se référer à la seule notion de « besoin de santé » pour déterminer l'objectif de dépenses des régimes. En effet, les besoins sont illimités du fait du caractère subjectif de la santé et ils sont difficiles à quantifier. Si certaines causes prédéterminent assez précisément le niveau de la dépense, des actions correctrices, orientées vers le bon usage des soins, permettent de peser sur l'évolution de la dépense pour la rendre compatible avec les moyens de financement.
Au-delà de la réflexion menée par ces trois groupes de travail, le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie , installé le 13 octobre 2003, doit permettre d'engager les réformes structurelles de l'assurance maladie en établissant notamment un diagnostic partagé.
Les six pistes de réflexion du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, définies par le Premier ministre
1- L'amélioration de la gestion des dépenses
Elle passe par un renforcement des outils de gestion, notamment la mise en place d'un corps de contrôle puissant destiné à lutter contre les abus, la mise en oeuvre du dossier médical électronique partagé visant à une meilleure coordination des soins ainsi que le décloisonnement de l'offre de soins et une meilleure gestion de cette offre sur le territoire.
2- Le principe de la « gouvernance » des soins
Sans étatiser ni privatiser la sécurité sociale, il s'agit d'aboutir à une clarification des responsabilités respectives de l'Etat et des partenaires sociaux, notamment par le biais du renouveau de la gestion paritaire de l'assurance maladie.
3- La généralisation de la couverture complémentaire santé
Il s'agit d'améliorer l'accès de tous à un régime d'assurance maladie complémentaire en créant à cette fin une aide spécifique pour les personnes disposant de revenus insuffisants.
4- Le développement des informations de pilotage
Les statistiques des dépenses d'assurance maladie ne peuvent suffire et doivent être complétées en temps réel par des indicateurs d'activités, de qualité et de coût. Cette piste recouvre la réflexion relative au contenu de l'ONDAM et au rapport qualité/prix des soins prodigués.
5- Une meilleure organisation de l'offre de soins
Les difficultés de recrutement dans les hôpitaux et les cliniques, le manque de médecins et d'infirmières dans certaines zones rurales ou de banlieue masquent une forte densité médicale et une mauvaise répartition des professionnels de santé sur le territoire. Dans cette perspective, la démographie médicale et la carte hospitalière constituent des chantiers majeurs. La réflexion doit dès lors porter sur les mesures d'incitation à l'installation des professionnels de santé dans les zones désertées, la nécessité d'orienter la liberté d'installation des professionnels sur le territoire ou encore la clé de répartition des différents établissements de santé sur le territoire.
6- La question du juste équilibre entre la solidarité collective et la responsabilité individuelle
L'assurance maladie repose sur l'idée que le remboursement social garantit l'accès aux soins de tous. Aujourd'hui, cette protection étendue couvre une grande part de la demande de santé, faite de besoins essentiels et de besoins plus subjectifs. La réflexion doit aujourd'hui porter sur une plus grande responsabilisation de tous les acteurs du système de santé, en incluant notamment les assurés sociaux eux-mêmes. En outre, la question de la distinction entre les frais devant être pris en charge par la solidarité collective et ceux pouvant relever de la responsabilité individuelle se pose. Ainsi, des mécanismes personnalisés et individuels pourraient venir renforcer l'assurance maladie dans sa gestion des mécanismes de solidarité.
La mise en oeuvre de réformes structurelles de l'assurance maladie ainsi que la définition et l'application de nouveaux outils de régulation des dépenses devraient permettre de maîtriser, en partie, l'évolution des dépenses sociales, tout au moins de ne pas ajouter à la croissance tendancielle et inéluctable des dépenses de santé, une croissance injustifiée, fruit de l'échec des mécanismes de régulation mis en place au cours des dix dernières années.
Dès lors, il est possible d'envisager qu'à long terme, même les prélèvements sociaux pourront s'inscrire dans une stratégie globale de baisse des prélèvements obligatoires .
C. ASSURER LA NEUTRALITÉ DE « L'ACTE II » DE LA DÉCENTRALISATION SUR LE TAUX GLOBAL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
Les prélèvements obligatoires dont le produit revient aux collectivités locales se sont élevés à 75,6 milliards d'euros en 2002, soit 11,3 % du total des prélèvements obligatoires et 5 % du PIB, une proportion stable par rapport à l'année 2001 . Ainsi que l'indique le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, « cette stabilité est le résultat de deux tendances opposées : d'une part, la poursuite de la réforme de la taxe professionnelle contribue à limiter la progression de ces prélèvements ; d'autre part, les taux de la fiscalité locale tendent à remonter en raison de l'existence de nouvelles dépenses à la charge des collectivités (allocation personnalisée d'autonomie) et de l'impact sur les dépenses de personnel de la réduction du temps de travail ».
Sur longue période, le gouvernement rappelle que « la croissance de la part des prélèvements obligatoires au profit des collectivités locales reflète l'incidence des transferts successifs de compétences accordés aux collectivités locales depuis les lois de décentralisation au début des années 80 ». Or, le Parlement a commencé à discuter le projet de loi relatif aux responsabilités locales, qui prévoit des transferts de compétences et des ressources correspondantes au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, pour un montant total évalué entre 11 et 13 milliards d'euros. Dès 2004, une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), correspondant à la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion (RMI), devrait être transférée aux départements pour un montant d'environ 5 milliards d'euros 18 ( * ) .
Cette nouvelle étape de la décentralisation conduira donc à accroître de manière significative les prélèvements obligatoires perçus par les collectivités locales, en contrepartie d'une diminution de ceux perçus par l'Etat , ce qui contribuera à rapprocher la structure française des prélèvements obligatoires de la moyenne des Etats non fédéraux. Il est important, pour la réussite de cet « acte II » de la décentralisation, qu'à l'augmentation des prélèvements obligatoires au profit des collectivités locales corresponde une diminution au moins équivalente de ceux perçus par l'Etat. Le respect de plusieurs règles permettra d'assurer une diminution du taux global de prélèvements obligatoires :
- les collectivités locales doivent disposer d'une véritable liberté de gestion des compétences qui leur sont transférées ;
- l'Etat doit compenser loyalement aux collectivités locales les charges correspondant aux compétences transférées ;
- l'Etat doit éviter de recourir aux transferts de charges non compensés aux collectivités locales ;
- enfin, les ministères concernés par les transferts de compétences et de personnels doivent adapter leurs administrations à ce nouveau contexte, et engager les réformes structurelles qui s'imposent.
1. Une liberté de gestion des compétences transférées
Le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, soulignait, lors de la synthèse des assises des libertés locales, à Rouen, le 28 février dernier : « je crois aux vertus de la proximité : les Français ont besoin de lien, ils ont besoin d'humanité pour être plus forts devant les évolutions parfois trop rapides de nos sociétés. Et ce sont les collectivités territoriales et les élus, l'ensemble des corps intermédiaires qui peuvent être à cet égard, les relais efficaces. Je crois que cette proximité est source d'efficacité. Si on n'administre bien que de près, c'est parce que pour bien administrer, il faut bien connaître. Il y a là, soyez en sûrs, des économies possibles et surtout, une meilleure affectation des ressources. L'argent public est rare. L'argent public est précieux. Sa meilleure utilisation est un facteur d'efficacité économique. Il y a des marges de croissance prisonnières dans notre système centralisé. Il faut les libérer ! ».
Ce qui justifie « l'acte II » de la décentralisation, c'est le constat que les collectivités locales ont exercé de manière plus efficace et efficiente les compétences auparavant prises en charge par l'Etat . Toutefois, pour que cela soit le cas et que la décentralisation permette une diminution du taux de prélèvements obligatoires global, il faut que les collectivités territoriales disposent des moyens d'être plus efficaces que l'Etat dans la gestion des compétences qui leur sont transférées . Trop souvent, par le passé, l'Etat a décentralisé des compétences en conservant la définition des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en oeuvre. Or, on voit mal comment les collectivités territoriales pourraient être plus efficaces que l'Etat si elles exercent leurs compétences dans un cadre juridique tellement contraint qu'elles ne disposent pas d'une réelle marge d'appréciation. Cette décentralisation est en réalité davantage une « sous-traitance », destinée à alléger l'Etat de compétences coûteuses, qu'il n'est plus en mesure d'exercer convenablement. Une telle dérive a été constatée par exemple avec la prise en charge par les départements des coûts croissants des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Le projet de loi relatif aux responsabilités locales contraste heureusement avec cette approche, et accepte de faire confiance aux collectivités territoriales dans leur manière de mettre en oeuvre les compétences qui leur sont transférées . Outre qu'une véritable liberté de gestion est une condition essentielle pour réduire le niveau global des prélèvements obligatoires, c'est également un élément indispensable pour que « l'acte II » de la décentralisation soit un processus pleinement consentis par les élus locaux.
2. Une compensation loyale des compétences transférées
La question de la compensation des transferts de compétences est particulièrement sensible : la hausse des impôts locaux en 2003 et la situation dégradée des finances de l'Etat, dont on pourrait craindre qu'il soit tenté de réaliser des économies au détriment des collectivités territoriales, justifient une certaine inquiétude de la part des élus locaux.
La procédure de compensation des transferts de compétences est pourtant prévue par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, introduits par les lois de décentralisation du début des années 1980, et n'a pas posé de problèmes particuliers quant à son application. Toutefois, ces dispositions n'ont pas empêché que les compensations versées par l'Etat aux collectivités territoriales ne leur permettent pas d'exercer convenablement les compétences transférées. C'est le cas, par exemple, de la compensation du transfert aux régions de compétences en matière ferroviaire, réalisé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui ne tenait pas compte de toutes les charges 19 ( * ) . Par ailleurs, l'évaluation des charges avait été effectuée sur la base d'un audit réalisé plusieurs années avant le transfert. On notera au passage que le projet de loi relatif aux responsabilités locales innove par rapport au droit existant en prévoyant notamment que les charges d'investissement seront évaluées sur une durée de cinq années au minimum.
Outre les dispositions législatives susmentionnées, la juste compensation des charges résultant des transferts de compétences de l'Etat aux collectivités locales constitue désormais une obligation constitutionnelle. En effet, le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, dispose que « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
La portée de cette garantie constitutionnelle ne peut être connue aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'ayant pas encore été conduit à se prononcer sur des dispositions législatives au regard de cette nouvelle norme. En tout état de cause, il est évident que celle-ci ne saurait constituer une garantie absolue pour les collectivités territoriales , ne s'appliquant pas aux transferts de charges ne résultant pas de transferts de compétences. Il convient, en effet, de bien distinguer les transferts de compétences, dont la compensation est prévue par des dispositions législatives et constitutionnelles, des transferts de charges, pour lesquels le gouvernement n'est juridiquement astreint à aucune compensation .
Par ailleurs, on notera que si ce système assure, à la date du transfert, une neutralité pour le niveau global de prélèvements obligatoires en organisant une compensation intégrale des transferts de compétences, il ne préjuge pas, pour les années suivantes, des décisions des assemblées locales , s'agissant du niveau de dépense consacré à la compétence transférée et des modalités de son financement. Or, bien souvent, les collectivités territoriales, du fait de la proximité avec les citoyens, souhaitent élever le niveau des prestations offertes par rapport à celui, souvent insuffisant, qui était offert par l'Etat avant le transfert . A titre d'exemple, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales indique dans son dossier de présentation du projet de loi relatif aux responsabilités locales, s'agissant des lycées et des collèges, transférés aux régions et aux départements à compter de 1986, que, « en dix-sept ans, l'effort des régions en faveur des lycées a été sept fois plus important que celui de l'Etat » et que « sur la [même] période, l'effort consenti par les départements en faveur des collèges a (...) été six fois plus important que celui de l'Etat ».
3. Les transferts de charges non compensés
Ainsi que cela est indiqué plus haut, les normes, tant législatives que résultant du nouvel article 72-2 de la Constitution, ne constituent pas une garantie absolue pour les collectivités territoriales, loin s'en faut. Ainsi, les dispositions relatives à la compensation des transferts de compétences figurant dans le code général des collectivités territoriales et issues des lois de 1982 n'ont pas empêché les transferts de charges vers les collectivités territoriales ou les modifications de normes dont les conséquences financières ne sont pas compensées par l'Etat.
Il s'agit en particulier, des contributions des collectivités locales au financement des SDIS, du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de l'évolution des dépenses de personnel, qui expliquent, pour une très large part, les augmentations de la fiscalité locale constatées en 2003. Sur ce dernier point, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avait considéré, lors de son audition par votre commission des finances, le 29 octobre 2002, qu'il était choquant que les élus locaux soient les seuls employeurs de France à apprendre par la presse le taux d'augmentation des traitements de leurs agents, souhaitant que cette situation puisse évoluer. La consultation du « collège des employeurs publics » par M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le 14 octobre dernier 20 ( * ) , constitue un pas dans la bonne direction. Le ministre a indiqué que ce collège serait réuni avant chaque rencontre salariale avec les organisations syndicales.
Toutefois, le transfert de charges vers les collectivités territoriales reste un moyen pour l'Etat de satisfaire des revendications sans que cela ne lui coûte ; les nombreuses mesures réglementaires relatives à la gestion des sapeurs-pompiers sont, de ce point de vue, particulièrement éclairantes. Or, si le coût de ces mesures est à la charge des collectivités territoriales et non de l'Etat, il ne contribue pas moins à accroître le poids des prélèvements obligatoires.
4. La nécessaire adaptation des services de l'Etat
Afin que la décentralisation contribue à une diminution du taux global de prélèvements obligatoires, il est indispensable que l'Etat confie aux collectivités territoriales l'intégralité des personnels chargés de la mise en oeuvre des compétences qu'il leur transfère. A défaut, des doublons inutiles et coûteux existeraient entre les services de l'Etat et ceux des collectivités .
Par ailleurs, les ministères directement concernés par les transferts de compétences et de personnels prévus par le projet de loi relatif aux responsabilités locales doivent saisir cette occasion pour réformer leur organisation et réaliser des économies structurelles .
La circulaire du Premier ministre du 25 juin 2003 relative aux stratégies ministérielles de réforme rappelle que la décentralisation est un des chantiers de la réforme de l'Etat. Le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, y insiste tout particulièrement pour que les ministres s'attachent à « tirer toutes les conséquences pour [leur] administration de la décentralisation et de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances ».
Ainsi que l'a souligné le Président de la République, M. Jacques Chirac, à l'occasion de la délibération par le Conseil des ministres du projet de loi relatif aux responsabilités locales, la décentralisation « n'a de sens que si elle améliore les services et les infrastructures mis à la disposition de nos compatriotes, si elle apporte souplesse, adaptation et maîtrise des coûts dans l'action publique ». Elle doit donc « impérativement s'accompagner d'une réorganisation profonde des administrations de l'Etat, au niveau national comme au niveau local ».
Votre commission des finances estime que les réformes successives relatives aux compétences locales (transfert de compétences de l'Etat vers les communes, prise en charge de certaines de ces compétences par les établissements publics de coopération intercommunale avec le développement de l'intercommunalité) doivent être effectuées avec une grande vigilance quant à la réorganisation des structures chargées de la mise en oeuvre de ces compétences. Il s'agit d'éviter les « doublons » entre les différents niveaux de compétence, alors que la volonté que les décisions soient prises « le plus près possible des citoyens », doit également faire en sorte que les prestations rendues aux citoyens soient les plus efficaces en termes de coût. La mise en oeuvre de réformes dans les ministères dont une partie des missions sera exercée par les collectivités locales et leurs groupements à compter de 2005 constitue donc, à l'évidence, un élément indispensable pour permettre une réduction du niveau global des prélèvements obligatoires .
D. TROUVER DES ALTERNATIVES AUX PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
1. Des prélèvements obligatoires qui doivent se justifier par une plus grande efficience de la sphère publique
a) Mieux arbitrer entre l'efficacité de la dépense publique et celle de la dépense privée
Le taux de prélèvements obligatoires est directement lié au montant des dépenses publiques.
La question est de savoir si la France doit maintenir un niveau de dépense publique aussi important qu'aujourd'hui, et notamment si certaines activités assumées aujourd'hui par l'Etat ne pourraient pas l'être plus efficacement par le secteur privé. Dans ce cas, les prélèvements obligatoires levés pour ces actions seraient supprimés.
Il s'agit de bien identifier l'avantage de la dépense publique par rapport au marché . Certaines dépenses publiques sont justifiées parce qu'elles ne pourraient être assumées par le marché dans des conditions satisfaisantes pour la société. En revanche, quand le secteur privé se développe et devient efficient au point de pouvoir prendre en charge certaines actions, il n'y a pas lieu de maintenir la dépense publique.
Or, si l'on fait le rapport entre le montant de la dépense publique dans un pays et son taux de croissance, il apparaît que sur les vingt dernières années, la France détient à la fois un record en termes de dépenses publiques mais également en matière de faible croissance du PIB.
Relation croissance économique - dépenses publiques
(en %)
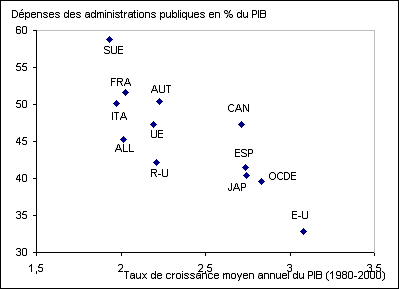
Source : OCDE
b) Un moindre recours au citoyen contribuable
(1) Mieux identifier les coûts : faire payer davantage l'usager
L'usager doit contribuer au financement des services collectifs qu'il utilise.
Les mécanismes de financement par péages ou redevances sont ainsi centraux dans l'économie des transports. Ils déterminent la part de l'usager dans le financement de l'infrastructure par rapport à celle du contribuable.
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie souhaite que les péages et redevances deviennent le mode normal de prise en charge par l'usager des coûts d'infrastructures de transport.
Mais tous les chiffres montrent que le recours aux péages et redevances est encore très limité et inégal.
Si la part de l'usager dans le financement des autoroutes concédées atteint 92 % 21 ( * ) , elle descend à 76 % pour le contrôle aérien, 63 % pour les aéroports, et 56 % pour les ports. Elle est très réduite pour le transport ferroviaire (25 %) et les voies navigables (9 %) et nulle pour les routes nationales.
Le péage reste donc un modèle d'exception pour la plupart des modes de transport , à l'exception des autoroutes concédées, alors même que toutes les réflexions menées dans le cadre européen préconisent le développement du péage.
Effort de l'usager dans le financement des infrastructures
(en millions d'euros)
|
|
Etat |
Fiscalité affectée |
Collectivités locales |
dette du gestionnaire |
Effort de l'usager |
Total |
part de l'usager |
|
Autoroutes concédées |
|
|
|
457 |
4 939 |
5 397 |
92 % |
|
Routes nationales |
1 486 |
233 |
762 |
0 |
0 |
2 481 |
0 % |
|
Total |
1 486 |
233 |
762 |
457 |
4 939 |
7 878 |
63 % |
|
Réseau ferré national |
3 859 |
352 |
122 |
305 |
1 508 |
6 146 |
25 % |
|
Contrôle aérien |
32 |
192 |
0 |
76 |
946 |
1 246 |
76 % |
|
Aéroports |
0 |
252 |
12 |
46 |
521 |
831 |
63 % |
|
Voies navigables |
0 |
76 |
30 |
0 |
10 |
117 |
9 % |
|
Ports |
104 |
45 |
91 |
-15 |
291 |
517 |
56 % |
Source : rapport de M. Jacques Oudin sur le financement des infrastructures de transports n° 42 (2000-2001), données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Ces chiffres montrent que les autoroutes concédées sont financées presque exclusivement par les usagers et non par les contribuables. Les aéroports et les ports sont également majoritairement financés par l'usager. En revanche, c'est essentiellement le contribuable national ou local (particulièrement dans le cas des routes nationales) qui finance le réseau ferré, les routes nationales, et les voies navigables.
Le fait que le contribuable paye le coût d'un service qu'il n'utilise pas toujours alors que l'usager bénéficie d'un service sous-tarifé a des conséquences.
Ainsi, en matière de transports publics, le paiement du ticket en-dessous du coût de revient a pu conduire à un comportement des voyageurs parfois peu respectueux des équipements mis à leur disposition : l'usager n'assume pas l'intégralité du coût, qu'il délègue au contribuable. La subvention publique, contrepartie de l'impôt, distend le lien entre le service et l'usager, celui-ci étant moins exigeant qu'un client normal et l'entreprise ayant une politique commerciale moins attentive. Pour cette raison, la répartition du financement entre impôt et « redevance pour service rendu » doit évoluer.
(2) La nécessité de la responsabilisation des assurés sociaux : l'exemple de l'assurance maladie
Dans le domaine de l'assurance maladie, la question de la responsabilisation des assurés sociaux se pose avec acuité dans un contexte de déficit record (10,6 milliards d'euros pour la branche maladie du régime général en 2003 et 14,1 milliards d'euros en 2004 en l'absence de mesures nouvelles) et de poids prépondérant des prélèvements sociaux dans le PIB.
Deux questions principales s'agissant du financement des dépenses de santé et du partage des responsabilités entre acteurs du système de santé se posent : d'une part, la question de la répartition des rôles entre régimes obligatoires et organismes complémentaires, d'autre part, la question de la prise en charge par les assurés eux-mêmes de certains frais jusqu'ici supportés par la collectivité.
En France aujourd'hui, 76 % des dépenses de santé sont financés par des fonds publics, un niveau plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE qui se situe à 72 %. Le reste des dépenses de santé est assuré à hauteur de 14 % par les assurances privées et de 10 % par les versements nets des ménages, alors qu'aux Etats-Unis, par exemple, 35 % du total des dépenses de santé sont pris en charge par les assurances privées et 15 % par les consommateurs, et qu'en Suisse, 10 % seulement des dépenses totales de santé sont financées par les assurances privées tandis que 33 % sont payées directement par les consommateurs.
S'agissant de la répartition des rôles entre régimes obligatoires et organismes complémentaires , des propositions existent pour une plus grande rationalisation de ce partage. Ainsi, le groupe de travail de la commission des comptes de la sécurité sociale sur la « répartition des interventions entre les assurances maladie obligatoires et complémentaires en matière de dépenses de santé », présidé par M. Jean-François Chadelat, avait proposé, dans son rapport datant du mois d'avril 2003, la création d'une couverture maladie généralisée, consacrant l'existence d'un mécanisme de prise en charge à deux étages, le premier correspondant aux assurances maladie obligatoires, le second aux assurances maladie complémentaires. Le rapport préconisait notamment de faire des assurances maladie complémentaires un acteur à part entière de la couverture maladie et de définir certains actes ou certaines catégories d'actes pour lesquelles les complémentaires santé pourraient devenir les acteurs pilotes du dispositif. Parmi ces actes, on peut penser notamment aux soins optiques, dentaires ou encore au domaine de l'appareillage au sens large.
La piste d'une redéfinition des champs d'intervention respectifs de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance complémentaire mérite donc d'être creusée.
S'agissant de la question de la responsabilisation des assurés sociaux , une réelle réflexion sur la définition des actes qui relèvent de la prise en charge par la collectivité, au nom du principe de solidarité, et de ceux qui relèvent de la responsabilité individuelle de l'assuré, doit aujourd'hui être menée.
Sans anticiper sur les conclusions qui seront rendues avant la fin de l'année par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, installé par le Premier ministre le 13 octobre 2003, il est aujourd'hui nécessaire de remettre en perspective l'idée selon laquelle le remboursement social est seul garant de l'accès aux soins et de trouver le juste équilibre entre solidarité collective et responsabilité individuelle. Comme le soulignait le Premier ministre lors de l'installation du Haut conseil : « Faut-il couvrir dans les mêmes conditions une fracture du bras causée par une chute dans la rue ou par un accident de ski ? ».
La responsabilisation des assurés sociaux peut dès lors prendre différentes formes : l'acceptation du déremboursement des médicaments à service médical rendu insuffisant ou des médicaments « princeps » trouvant leur équivalent dans des groupes génériques, le développement des assurances privées et une participation accrue des patients eux-mêmes s'agissant de la couverture de pathologies résultant de conduites à risque imputable au seul assuré (comme par exemple, la pratique d'un sport à haut risque). Ainsi, il est possible d'envisager que des mécanismes d'assurance personnalisée prennent le relais de l'assurance maladie pour la couverture de certains frais accessoires ou relevant directement de la responsabilité individuelle du patient.
2. Le financement privé des investissements publics
a) Le partenariat public-privé
Une plus grande implication du secteur privé peut être une solution pour limiter la hausse des prélèvements obligatoires, notamment en matière de financement et de gestion des infrastructures utiles à la collectivité.
Les ressources budgétaires devenant plus rares, l'Etat est confronté à des problèmes croissants pour réaliser les infrastructures dont notre pays a besoin. Les collectivités territoriales prennent le relais mais elles ne peuvent avoir la charge des infrastructures nationales.
Une bonne utilisation des ressources publiques nécessite une gestion moderne. Le partenariat public-privé peut incontestablement redevenir une voie de financement pour les infrastructures. Ce partenariat permettrait de transférer une partie des risques vers le privé, d'accélérer la réalisation d'infrastructures, de réduire les coûts à qualité au moins égale, d'optimiser la gestion des infrastructures, de permettre un financement par l'usager adapté au service rendu.
Pour que le partenariat réussisse, il faudra que la puissance publique laisse une certaine flexibilité au privé dans les modalités de réalisation de l'infrastructure, tout en fixant clairement les performances à en attendre, notamment en termes de qualité de service. Le recours au secteur privé sera utilisé pour sa souplesse, sans sacrifier aux objectifs de performance et de qualité.
Il faut souligner que cette idée n'est pas nouvelle, puisque notre pays a déjà une expérience utile de partenariat avec le secteur privé , notamment pour le financement des infrastructures publiques, par le biais des concessions. Le modèle des concessions était même le modèle de référence au début du siècle dernier, pour l'équipement de la France en réseaux de communication, dans le domaine des transports ou de l'énergie.
La différence tient essentiellement aux nouvelles utilisations qui pourraient être faites du recours au secteur privé.
En effet, le partenariat devrait concerner la réalisation de grandes infrastructures (TGV, autoroutes, transports collectifs de grandes agglomérations) mais aussi des projets d'immobilier public, et surtout il devrait concerner tant la réalisation que, dans les cas où il cela s'avèrerait plus performant, la gestion de l'infrastructure.
En effet, l'Etat a du mal à appréhender la valeur de son patrimoine 22 ( * ) et donc à assurer son entretien et sa valorisation. Le patrimoine immobilier de l'Etat se dégrade faute de moyens consacrés à l'entretien courant et d'une gestion de long terme. L'entretien des infrastructures est insuffisant, comme en témoigne le rapport de la Cour des comptes sur l'entretien du réseau routier national ou les crédits relativement faibles en matière de régénération du réseau ferroviaire. S'agissant du parc de logements détenu par l'Etat (logements de fonction, logements de service, etc), il relève de modes de gestion divers qui conduisent à des politiques d'entretien et d'occupation très variables, mais incontestablement insuffisantes. Les logements sont mal connus et mal recensés, et ne répondent que très imparfaitement aux besoins des utilisateurs. L'Etat a donc besoin de mettre en oeuvre une gestion dynamique de son patrimoine.
b) Les partenariats public-privé dans le domaine régalien
L'effort massif que l'Etat doit consentir dans l'urgence en matière d'investissement et de fonctionnement dans les domaines régaliens hors défense nationale (sécurité et justice), est de nature à peser sur les prélèvements obligatoires, et ce d'autant plus qu'il s'agit de rattraper le temps perdu pendant le quinquennat précédent. C'est cette hausse, à laquelle les contribuables ne sont pas prêts, qui a d'ailleurs pu conduire à différer trop longtemps l'effort nécessaire. En lissant la charge financière dans le temps, le partenariat public-privé permettrait à l'Etat de faire face rapidement à ses obligations de service public.
La loi du 22 juin 1987 a déjà permis à l'administration pénitentiaire d'externaliser certaines des missions concourrant au fonctionnement de ses établissements en recourant à la gestion mixte. Ce mode de gestion consiste à confier à des entreprises privées mises en concurrence les fonctions de soutien logistique (restauration, cantine, hôtellerie, maintenance, transport, formation professionnelle et travail) pour lesquelles l'administration ne dispose pas de ressources humaines suffisantes, l'Etat conservant l'intégralité de ses missions régaliennes de surveillance. Cette « gestion mixte », dont le premier initiateur a été le garde des sceaux M. Albin Chalandon, a été mise en oeuvre dans le cadre du programme « 13.000 places » entre 1988 et 1992, puis plus récemment pour le nouveau programme « 4.000 places ».
La loi d'orientation et de programmation pour la justice et la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ont permis d'aller plus loin, en externalisant la maîtrise d'ouvrage vers des opérateurs privés. L'Etat pourra autoriser un opérateur privé à construire sur le domaine public pour les besoins de la police ou de la justice, puis prendre en bail le bâtiment avec, à son profit, une option d'achat. L'Etat transfère ainsi la charge du financement de l'investissement initial à l'opérateur privé. Il assume sur longue période le coût de l'investissement augmenté de la marge de l'opérateur 23 ( * ) .
L'entreprise privée, responsable du bâti sur une longue période, a intérêt à réaliser des équipements de qualité et à en assurer l'entretien.
Bien entendu, en contrepartie l'Etat devra financer des frais d'intermédiation et faire face à une dépense annuelle récurrente et peu modulable. La réalisation de telles opérations suppose, à l'évidence, que des économies soient opérées sur d'autres frais de fonctionnement, si l'on veut éviter que la rigidité du budget ne progresse encore.
II. DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LA POLITIQUE FISCALE
A. FISCALITÉ DES PERSONNES : QUELS PRÉLÈVEMENTS SUR LES REVENUS ?
Parce qu'elle est, plus que jamais, engagée dans l'économie mondiale, la France est en train de perdre une bonne part de son autonomie fiscale.
Le phénomène n'est pas nouveau mais il trouve une autre ampleur avec le virage libéral pris par la plupart des grandes économies. Hier la compétitivité était tout autant une question d'inflation que de poids des prélèvements obligatoires ; aujourd'hui, avec l'intégration croissante des marchés financiers et la gestion de plus en plus mondialisée des grandes entreprises, la question des charges et de la fiscalité devient centrale.
On a pris conscience que, d'une part, les capitaux, qu'il s'agisse des flux financiers ou des investissements directs et surtout les compétences étant de plus en plus mobiles, il ne faut pas décourager l'initiative ; d'autre part, les produits français et donc l'emploi sont pénalisés par la lourdeur des charges sociales.
Ainsi, le modèle social français paraît-il menacé « par les deux bouts » : les compétences - on aurait dit naguère les « capacités » - sont tentées d'aller s'exercer ailleurs, du fait d'un barème de l'impôt sur le revenu sensiblement plus lourd que dans la plupart des autres pays de même niveau de développement, tandis que l'emploi, surtout non qualifié - mais pas exclusivement comme l'ont montré les travaux de Paris Europlace relayés par la mission sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises présidée par notre collègue Denis Badré 24 ( * ) -, est handicapé, contribuant à une certaine désindustrialisation du territoire.
Et pourtant, le financement du modèle social mais aussi, des infrastructures économiques, dont le rapport précité rappelle l'importance du point de vue de la compétitivité, exige que l'on continue à lever des ressources.
Toute la question est alors de définir l'assiette des différents prélèvements qui permette de faire face à l'ampleur des besoins sans compromettre la compétitivité et en assurant un lisibilité pour les agents économiques tant nationaux qu'étrangers.
1. Les différences de potentiel entre les différentes assiettes
Depuis des années, on assiste, du fait de la concurrence fiscale internationale, à l'atténuation de la progressivité de l'impôt sur le revenu et ce quelle que soit « la couleur politique » des gouvernements successifs, ainsi que, corrélativement, et à la réduction, sous des formes diverses, des prélèvements sociaux pesant sur les bas salaires en vue de restaurer la compétitivité de l'industrie et d'augmenter l'incitation au travail.
Il en résulte une tendance lourde à l'affaiblissement du potentiel de l'impôt sur le revenu tel qu'il résulte du barème progressif classique , mais également des cotisations sociales traditionnelles, dont une part du produit de plus en plus importante est prise en charge par l'Etat en compensation des différents allégements dont bénéficient leurs redevables. Cette tendance s'est traduite par une montée en puissance des prélèvements sui generis que constitue l'ensemble CSG-CRDS.
Désormais, le principal impôt sur le revenu acquitté par les Français est un impôt proportionnel, la contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle il convient d'adjoindre la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Le produit de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble CSG-CRDS
(en milliards d'euros)
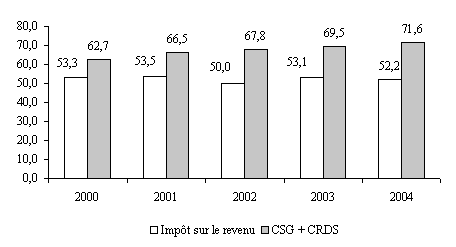
On a toutes les raisons de croire que cette tendance devrait se poursuivre en l'absence de maîtrise des besoins de santé. Votre commission des finances estime que, si une telle évolution se poursuivait, elle devrait aboutir, à terme, à la fusion, ou du moins à la juxtaposition, de l'ensemble CSG-CRDS avec l'impôt sur le revenu.
a) Les limites de l'impôt sur le revenu
Depuis le début des années 1980, on assiste, dans les pays de l'OCDE, à une diminution des taux marginaux de l'impôt sur le revenu. A côté bien sûr du Royaume-Uni qui le premier a ouvert la voie en faisant passer son taux supérieur de 60 à 40 %, on trouve la plupart des grands pays qu'il s'agisse de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie ou même de la Suède. Seuls les pays du Benelux semblent encore résister à cette tendance.
La France a rejoint tardivement le mouvement mais son taux marginal est quand même passé de 65 % en 1986 à 48 % aujourd'hui.
Cette évolution présente néanmoins dans notre pays un certain nombre de caractéristiques spécifiques dans la mesure où elle ne s'est pas encore accompagnée d'une simplification de son mode de prélèvement et de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les niches fiscales.
Il en résulte une certaine faiblesse du potentiel contributif de cet impôt, dont le produit tend à plafonner aux alentours de 50 milliards d'euros. En pourcentage de recettes fiscales, l'impôt sur le revenu occupe une place de plus en plus limitée.
L'IR est donc un impôt à faible potentiel du fait de l'étroitesse de son assiette - 50 % des foyers fiscaux ne sont pas imposables -, et de son extrême concentration - 1/10 ème de contribuables les plus aisés paient presque les trois quarts de l'impôt sur le revenu.
b) Les atouts de la CSG
Les prélèvements proportionnels à assiette large que sont la CSG et la CRDS, sont devenus en quelques années, à côté des cotisations traditionnelles, le moyen de financement par excellence des dépenses sociales.
Le rôle croissant de ces prélèvements résulte de leur simplicité : simplicité du mode de calcul, au moins relative, avec une assiette large et un nombre de taux relativement restreint, simplicité de gestion avec le prélèvement à la source.
L'attachement des Français à une certaine progressivité de l'impôt ne constitue pas une objection de poids s'agissant du financement de prestations. Ainsi, un régime de financement proportionnel au revenu, non plafonné, est en lui-même suffisamment progressif pour manifester la solidarité entre les Français face aux risques sociaux. La progressivité d'un prélèvement ne s'apprécie pas seulement en regardant la part du revenu prélevé, encore faut-il s'intéresser aux prestations dont ces prélèvements sont la contrepartie, et, de ce point de vue, on a des raisons de penser que la consommation des services sociaux diminue en pourcentage du revenu au fur et à mesure que celui-ci s'élève.
2. Vers une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG ?
L'imposition des revenus résulte de la sédimentation de diverses initiatives qui en ont affecté la lisibilité et donc la légitimité.
Une façon de réconcilier les Français avec l'impôt direct serait de mettre un terme à certaines incohérences et notamment d'articuler pour les fusionner ensuite l'impôt sur le revenu et l'ensemble CSG/CRDS.
a) Une question de cohérence politique
L'assiette de l'impôt proportionnel devrait être aussi large que possible, à l'égal de ce qu'elle est aujourd'hui pour l'ensemble CSG-CRDS, et peut-être même, à la marge, plus large pour englober un certain nombre de revenus, actuellement exonérés.
L'objectif est d'aboutir à un impôt vraiment « général », susceptible de faire l'objet d'un seul et même avertissement, ce qui devrait renforcer la conscience fiscale des Français. Cette idée fait du chemin même dans l'opposition, puisque l'on a vu récemment notre collègue député Didier Migaud, ancien rapporteur général du budget, souhaiter cette fusion :
« La fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, avec, en corollaire, la retenue à la source, doit figurer au premier plan de notre réflexion. Cette réforme peut mettre fin à la fiction qui sépare les Français en deux : imposables et non imposables. Chaque Français, aussi modeste soit-il, paie un impôt. Cette réforme doit améliorer l'efficacité de notre système de prélèvement et la justice, en permettant de mettre fin à l'existence de nombreuses niches fiscales injustifiées et de pratiquer la vérité et la transparence des taux » 25 ( * ) .
Il convient en effet de dissiper l'illusion selon laquelle l'impôt n'est pas payé par tout le monde. Le fait que 50 % des foyers fiscaux puissent avoir le sentiment qu'ils ne paient pas d'impôt n'est pas dépourvu d'effet pervers. Quel que soit leur revenu, tous les Français paient la CSG et la TVA. Faute d'avoir conscience de payer l'impôt, nombre d'eux sont en fait incités à réclamer plus de prestations publiques. C'est une des raisons du « toujours plus », qui fait que, parfois même au sein des assemblées, un bon budget est un budget qui augmente.
En tout état de cause, il ne serait pas question, dans le schéma d'une éventuelle fusion, de revenir sur les différences de mode de perception de la CSG et de l'impôt sur le revenu, et en particulier sur le prélèvement à la source de la CSG.
Il ne serait pas question non plus de modifier l'affectation de la CSG à la sécurité sociale, car la configuration actuelle d'affectation d'un impôt à fort rendement au secteur le plus dynamique d'évolution des dépenses publiques présente une cohérence certaine, même s'il convient de ne pas céder à la facilité que constitue une augmentation de la CSG pour repousser les efforts de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la hausse de la CSG doit être plutôt une résultante, un complément de financement, qu'un remède miracle apparemment indolore.
A l'inverse, l'extension à l'impôt sur le revenu de la méthode indolore du prélèvement à la source n'est pas forcément une bonne chose au regard de la prise de conscience par tous les Français de la nécessité d'une maîtrise de la croissance des prélèvements obligatoires.
b) Des mesures d'ajustement réciproque nécessaires
La fusion de l'ensemble CSG-CRDS avec l'impôt sur le revenu soulève à la fois de faux problèmes de principe et de vraies difficultés techniques.
Ainsi le problème de la non-déductibilité partielle de la CSG au regard de l'impôt sur le revenu devrait trouver une solution naturelle dans l'unification à terme du barème. On ne peut imposer deux fois le même revenu mais dans le cadre d'un impôt unique, il ne pourrait bien sûr plus y avoir déductibilité.
L'autre question de principe est plus générale et a trait à la façon dont on va mettre en bout à bout deux impôts qui jusqu'à présent procèdent d'une philosophie différente. D'un côté, la CSG est un impôt simple à assiette large, relativement peu différencié selon la nature des revenus ; au contraire, l'impôt sur le revenu est un impôt à assiette étroite, très concentré, très différencié selon la nature des revenus et comportant un nombre considérable d'exceptions. En outre, on va devoir articuler un impôt éminemment « familialisé » par le jeu des quotients conjugal et familial avec un impôt qui ne prend pas en compte les caractéristiques du foyer fiscal.
Il ne faut pas se dissimuler le risque de voir la CSG « contaminée » par ce phénomène de personnalisation excessive qui a affecté le rendement et la cohérence de l'impôt sur le revenu. Mais il faut aussi compter sur la volonté politique qui sous-tendrait une telle réforme fiscale pour en prolonger l'esprit en remettant en cause un certain nombre de « niches » fiscales injustifiées.
Cette volonté d'unification de l'imposition des personnes rejoint tout à fait la volonté des fondateurs de la V ème République lorsque par la loi du 28 décembre 1959, ils ont créé un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques.
Sur le plan technique, on retrouverait l'architecture à deux étages voulue à la Libération par les réformateurs de la IV ème République, puisque l'on aurait, au moins dans un premier temps, un impôt sur le revenu des personnes physiques qui se diviserait en deux branches : une taxe proportionnelle et une surtaxe progressive .
Il ne faut pas se dissimuler les difficultés techniques à résoudre pour parvenir à un système unifié d'imposition des personnes. IR et CSG n'ont ni la même assiette ni le même mode de recouvrement. D'un côté, on impose le revenu net, de l'autre le revenu brut, tandis que l'un est recouvré par la comptabilité publique et l'autre l'est par les URSSAF.
En raison des problèmes rencontrés, cette réforme fiscale, nécessaire dans son principe, doit à présent être étudiée en détail. Cela justifie que votre commission des finances soit favorable, comme cela a été le cas à l'Assemblée nationale, à ce que soit examinées avec les services du ministère de l'économie et des finances les modalités de la fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu.
En tout état de cause, l'affichage sur les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du montant acquitté au titre de la CSG, quand bien même cet impôt relèverait de la loi de financement de la sécurité sociale tandis que les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu figurent chaque année en tête de la loi de finances, procurerait à nos concitoyens une vision consolidée de l'imposition de leurs revenus, dans le même esprit que celui qui préside à l'organisation du présent débat sur l'évolution des prélèvements obligatoires.
B. ENCOURAGER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI
1. Conforter le succès de la formule de baisse simultanée de l'impôt sur le revenu et des charges sociales
Dans la perspective du débat d'orientation budgétaire pour 2001 26 ( * ) , votre commission des finances avait demandé au Centre d'observation économique (COE) de simuler une diminution des prélèvements obligatoires de 2,9 points de PIB à l'horizon 2003, assortie d'un retour à l'équilibre des comptes publics à cette même date 27 ( * ) .
Il était ressorti de cette étude que l'impact le plus favorable sur la croissance était obtenu par la combinaison « baisse de l'impôt sur le revenu + baisse des cotisations sociales des employeurs ».
Cette étude permettait de dégager deux enseignements :
- une réduction des prélèvements obligatoires est extrêmement favorable en termes de croissance et d'emploi, dès lors qu'on y intègre une baisse des cotisations sociales des employeurs 28 ( * ) ;
- la simulation du COE montre qu'il est possible de conduire une baisse des prélèvements obligatoires financée par une baisse des dépenses publiques sans détérioration du solde public, tout en favorisant la croissance et l'emploi.
C'est donc fort opportunément que la politique du gouvernement, depuis l'été 2002, a consisté à mettre en oeuvre la formule recommandée par votre commission des finances :
- la baisse de 5 % de l'impôt sur le revenu en 2002, pour 2,55 milliards d'euros, a été poursuivie en 2003 (- 771 millions d'euros) et amplifiée en 2004 (- 1,76 milliard d'euros) ;
- les allègements sur les bas salaires prévus par la loi dite « Fillon » prévoient, à compter du 1 er juillet 2003, une atténuation des charges à hauteur de 6,9 milliards d'euros en 2003 et 15,7 milliards d'euros en 2004.
2. Alléger la charge sur les assiettes délocalisables
Le rapport du Conseil d'analyse économique sur la compétitivité se montre particulièrement lucide sur les raisons qui pourraient conduire la France à se doter d'un régime fiscal d'exception pour attirer les « talents étrangers » : « (...) la situation réservée aux cadres impatriés est certainement moins avantageuse qu'à l'étranger (notamment concernant les frais déductibles). Cette situation pose un problème d'image : la vitrine fiscale de la France est bien terne. Que contient la vitrine de nos concurrents ? Le Royaume-Uni et l'Irlande fonctionnent sur le principe dit de « remittance basis », tandis que le Danemark a un taux marginal réduit pour les «impatriés », tout comme la Finlande. Plus généralement, neuf États européens sur quinze ont un régime spécifique pour les cadres « impatriés » : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. La France ne dispose pour sa part que du régime des « quartiers généraux », autorisant le remboursement par l'employeur des surcoûts de logement, d'excédent d'impôt ou de cotisations sociales. (...) C'est en ce sens que les propositions du rapport Charzat ou celle de Paris Europlace doivent être comprises : la mise en place d'un régime spécial pour les « impatriés », à l'image de ce qui existe pour les expatriés, relève du « produit d'appel », c'est-à-dire de la concurrence fiscale. Un tel régime ne se justifie que par son existence dans les pays concurrents et se heurte en France au principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt ».
Le tableau ci-dessous montre en effet les avantages consentis à ceux qui sont source de croissance à moyen terme :
Avantages fiscaux accordés aux « impatriés »
|
|
Types d'activité |
Nature des avantages fiscaux |
|
Belgique |
Cadres supérieurs
|
Exonération d'impôt sur le revenu du remboursement par l'employeur des dépenses d'expatriation |
|
Luxembourg |
Cadres et dirigeants d'entreprises nouvelles |
Abattement mensuel en distinguant les résidents (60 mois) des non résidents (36 mois) |
|
Pays-Bas |
Haute qualification professionnelle |
Indemnité pour frais, exonérée
d'impôt sur le revenu de 30 % au plus, de la
rémunération globale
|
|
Royaume-Uni, Irlande |
Toutes activités |
Non-imposition des rémunérations versées par les employeurs non résidents tant que les revenus ne sont pas transférés dans l'Etat du domicile |
Source : Conseil d'analyse économique
Le gouvernement a entrepris une réflexion sur ce thème. Dans son discours du 27 juin 2003 lors de la Conférence mondiale pour les investissements nationaux à La Baule, M. Jean-Pierre Raffarin a ainsi indiqué : « conformément aux recommandations de nombreux rapports récents, dont le rapport Charzat de juillet 2001, sous la précédente majorité, j'ai demandé à Francis Mer de proposer des premières mesures adaptant leur situation fiscale avec comme objectif de rapprocher le statut du cadre impatrié de celui de nos expatriés. » Il a par ailleurs confié une mission à notre collègue député Sébastien Huygue visant à formuler des propositions pour favoriser la localisation en France des sièges sociaux et des centres de décision des entreprises internationales.
Au-delà de ces mesures de « vitrine fiscale », qui pourraient comprendre, en ce qui concerne l'ISF, l'allongement de la période, actuellement fixée à cinq ans, durant laquelle un résident étranger n'est pas taxé sur ses biens sis en dehors de notre territoire et des mesures d'amnistie pour les capitaux revenant en France, des dispositions structurelles doivent être prises pour attirer et retenir les qualifications les plus élevées et les entrepreneurs les plus dynamiques. Ceci passe par un allègement déterminé de la fiscalité des « facteurs mobiles », qui est par excellence celle du patrimoine, aujourd'hui dissuasive.
En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, que ne connaissent pas dix pays sur les quinze de l'Union européenne, une réflexion en termes d'attractivité conduit, sinon à sa suppression, du moins à une réforme du barème, en diminuant le nombre de tranches, et en réduisant le taux marginal d'imposition.
En ce qui concerne les droits de mutation, auxquels votre rapporteur général a consacré un rapport d'information 29 ( * ) , une réforme diminuant le nombre de tranches, les élargissant et remontant l'abattement à la base coûterait 2,6 milliards d'euros pour les successions, et un milliard d'euros supplémentaire pour les donations, soit un montant du même ordre que la baisse de 6 points de l'impôt sur le revenu.
L'ensemble des réformes structurelles visant à renforcer l'attractivité du « site France », en allégeant la fiscalité des facteurs de production les plus mobiles, ne doit pas avoir pour effet de créer de nouvelles distorsions économiques, en particulier au détriment du travail non qualifié, qui ne doit pas voir son coût augmenter sous peine de freiner l'emploi. Une réflexion sur les assiettes non délocalisables doit ainsi être menée.
3. Une TVA sociale pour dynamiser l'emploi ?
Dans une économie globalisée, il importe d'alléger les prélèvements sur les assiettes délocalisables. Dans notre pays, le niveau élevé du coût du travail joue un rôle négatif sur les décisions des entreprises en matière de localisation de leurs implantations. En revanche, la consommation constitue, avec le foncier, l'assiette non délocalisable par excellence.
C'est dans ce contexte qu'il convient d'étudier l'éventualité de la création d'une « TVA sociale », autrement dit la substitution de recettes de TVA à des recettes provenant des cotisations sociales.
Les effets économiques d'une telle évolution de la structure de nos prélèvements obligatoires restent à évaluer avec précision. Toutefois, une telle mesure serait de nature à enrichir le contenu de la croissance en emploi :
- selon la même logique qui a présidé à la suppression de la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires, on assisterait à une déformation de la structure des prélèvements obligatoires en faveur des biens et des modes de production intensifs en travail ;
- selon une logique comparable à celle de la prime pour l'emploi, cela se traduirait par un accroissement des revenus des salariés, et encouragerait la consommation.
Compte tenu du fait, d'une part, que les hausses de TVA se répercutent plus rapidement sur les prix à la consommation que les évolutions des cotisations sociales et, d'autre part, que la hausse de la TVA s'appliquerait à tous les biens consommés alors que la baisse des cotisations sociales n'aurait d'impact en France que sur les prix de ceux qui ne sont pas importés, la « TVA sociale » pourrait se révéler être un facteur d'accélération de l'inflation. Toutefois, le problème aujourd'hui serait plutôt d'atteindre un « plancher d'inflation » que de dépasser un plafond.
En ce sens, la mesure permettrait de freiner les tendances déflationnistes encore présentes dans notre économie et de soutenir ainsi une politique monétaire de la Banque centrale européenne encore trop centrée sur l'objectif de ne pas dépasser la cible d'inflation, sans se soucier suffisamment des conséquences d'un niveau d'inflation inférieur à la cible.
La TVA nette devrait rapporter 109 milliards d'euros au budget de l'Etat en 2003 et 113 milliards d'euros, à structure constante, en 2004. Si l'on prend comme référence le seul taux normal de 19,6 %, un point de TVA représente donc en moyenne 5,7 milliards d'euros.
En 2004, les cotisations sociales effectives, versées par les employeurs et les salariés, devraient représenter 188 milliards d'euros. A titre d'illustration, une augmentation de deux points de TVA correspondrait donc à une diminution de 6 % du montant total des charges patronales et salariales.
Cette augmentation pourrait être répartie pour moitié entre les charges patronales et les charges pesant sur les salariés 30 ( * ) , de manière à ce que, outre les effets sur la consommation des créations d'emplois, les augmentations de salaire net qui résulteraient de cette baisse des charges compensent l'impact sur la consommation de l'augmentation de la TVA.
Si l'on prend cette hypothèse, la hausse du taux de TVA de deux points permettrait de diminuer de 11,7 % le montant des cotisations salariales et de 4,1 % le montant des cotisations patronales 31 ( * ) .
Votre commission des finances souhaite lancer la réflexion sur ce sujet en 2004, afin que les effets économiques d'une telle réforme puissent être bien appréhendés.
C. RÉFLEXIONS SUR LA DÉPENSE FISCALE À PARTIR DU XXIÈME RAPPORT DU CONSEIL DES IMPÔTS
Comme l'on sait, « trop d'impôt tue l'impôt » ; mais il faudrait aussi ne pas oublier que trop d'exceptions sapent la règle, qui finit alors par perdre sa cohérence et sa légitimité. C'est ce type de considérations qui a conduit le Conseil des impôts à souhaiter une remise à plat des dépenses fiscales dérogatoires « d'un coût mal maîtrisé et d'une utilité rarement démontrée ».
Faut-il pour autant condamner la dépense fiscale ? Si l'on peut adhérer à la démarche du Conseil des impôts lorsqu'il encourage les pouvoirs publics à mieux connaître, mieux encadrer et réexaminer les régimes dérogatoires existants en vue d'améliorer l'équité et l'efficacité du système fiscal, il ne faut pas pour autant les récuser par principe.
Une politique raisonnable tenant compte du contexte international d'allègement des prélèvements obligatoires mais aussi des caractères propres du débat politique national doit au contraire chercher à optimiser la dépense fiscale.
1. Que recouvre la notion de dépense fiscale ?
Quantitativement, la France ne présente pas les pertes de recettes fiscales les plus importantes ; ce qui la caractérise, c'est seulement le nombre, la variabilité et la complexité des régimes fiscaux dérogatoires.
L'examen auquel nous invite le Conseil des impôts, tel que le comprend votre commission des finances, doit simplement déboucher sur un système fiscal plus stable, plus simple et, surtout, plus transparent.
Le rapport du Conseil des impôts considère que l'estimation du coût des dépenses fiscales est très imparfaite. Seul un quart des dépenses fiscales sont estimées de façon précise, la moitié d'entre elles n'étant d'ailleurs même pas chiffrées. Il note d'ailleurs qu'en 2003 sur 418 mesures recensées, 56 % seulement faisaient l'objet d'un chiffrage. Il y a là, d'une façon générale la manifestation de l'incapacité des administrations de procéder à des estimations faute pour elles de disposer de données suffisantes.
Il ne faut pas d'ailleurs accorder un crédit trop absolu aux estimations : d'une part, l'indication « å » est systématiquement apposée pour les dépenses fiscales dont le coût est inférieur à 0,5 million d'euros ; d'autre part, certaines estimations - qui peuvent d'ailleurs faire l'objet de débats internes à l'administration - sont relativement peu précises, surtout lorsqu'elles s'appuient sur une reconstitution de base taxable.
Les totalisations en matière de dépenses fiscales au niveau de l'ensemble du budget sont donc à considérer avec précaution, même si l'on peut considérer que les marges d'erreurs ne s'additionnent pas nécessairement.
Une raison supplémentaire de limiter la portée des données globales est à trouver dans l'arbitraire du mode de calcul. La dépense fiscale se définit par la part de recettes non perçues ; elle correspond pour les contribuables à l'allègement de leur charge fiscale par rapport à ce qui résulterait de l'application de la norme. Toute la question est alors de savoir comment définir cette norme.
Le Conseil des impôts distingue, à juste titre, dans les pertes de recettes ce qui relève d'allègements structurels et ce qui constitue un instrument de politique publique. Les allègements structurels s'analysent, selon le Conseil, comme les mesures consubstantielles à l'impôt mises en place lors de sa création. Plus généralement, appartiendraient à cette catégorie les mesures de répartition de la charge fiscale dans une logique de progressivité ou d'équité voire celles tendant à assurer la neutralité fiscale ou une simplification du recouvrement de l'impôt.
En revanche, les vraies dépenses fiscales dérogatoires ont pour caractéristique d'être propres à une catégorie de bénéficiaires et de pouvoir être rattachées à une politique publique non exclusivement fiscale : ce sont des aides sectorielles ciblées.
Le Conseil des impôts propose de mieux faire la part entre ces deux types de dépenses fiscales. Si l'on peut aisément adhérer à l'objectif, sa mise en oeuvre paraît relativement difficile. La lecture du rapport démontre que selon le point de vue et la place dans le temps la même mesure peut passer d'une catégorie à l'autre. Ainsi, la diminution du taux de TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans relève aujourd'hui de la première catégorie. Mais à terme, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas partie intégrante des biens soumis au taux réduit, auquel cas c'est à bon droit que l'on supprimera la dépense fiscale correspondante.
2. Les dépenses fiscales : « niches » ou condition de l'équilibre du système fiscal ?
Aussi, lorsque le rapport du Conseil des impôts estime que le montant total des dépenses fiscales dépasse 50 milliards d'euros - ce qui correspond, soit dit en passant, au déficit de la France pour 2003 -, il peut donner l'impression qu'il existerait une sorte de « cagnotte » qu'il suffirait de supprimer pour retrouver immédiatement des ressources supplémentaires. Un tel point de vue serait aussi injustifié qu'irréaliste.
A cet égard, votre commission des finances se rapproche dans une certaine mesure de l'analyse que fait le MEDEF du rapport du Conseil des impôts. Pour l'organisation patronale, il ressort implicitement du rapport que « les avantages fiscaux sont coûteux et donc d'une certaine façon illégitimes ». Or précise-t-elle, « il n'est pas normal que les allègements d'impôt soient considérés comme des exceptions à la norme, alors que c'est le niveau actuel de la fiscalité en France qui nous paraît anormal ». La conclusion est d'ailleurs intéressante dans sa logique : « les dispositifs d'aide fiscale doivent donc être interprétés comme des sortes de rustines sur un système globalement insatisfaisant et beaucoup trop lourds pour les entreprises et plus généralement pour l'ensemble de l'économie, qui traduit la nécessité d'adaptation du régime fiscal français. (...) Les dépenses fiscales (...) sont donc indispensables comme élément de régulation d'un système globalement déficient ».
Au delà d'une formulation polémique, il y a une vérité difficilement contestable : l'importance et surtout le nombre des régimes fiscaux dérogatoires sont indissolublement liés au niveau élevé des prélèvements, qui ne seraient sans doute pas supportables sans les soupapes que constituent les dépenses fiscales . Un certain nombre d'entre elles sont d'ailleurs « d'origine », tandis que d'autres se sont ajoutées au fil du temps dans un phénomène d'entropie fiscale.
La tendance à la prolifération des dérogations est une sorte de fatalité, qui tend à brouiller l'architecture initiale d'un régime fiscal, surtout lorsque celui-ci comporte, dès sa création, des mesures spécifiques. On peut tenter de développer une métaphore parlante qui illustre cette fatalité française : la machine fiscale, surtout lorsqu'elle est dotée de soupapes d'origine, a tendance, sous la pression des évènements, à s'en voir adjoindre de nouvelles, qui tendent à faire baisser la pression fiscale effective, alors même que la pression nominale reste apparemment très élevée.
Avec le temps, de telles mesures ciblées ne sont parfois plus vraiment justifiées. Le Conseil des impôts le fait ainsi remarquer pour le régime fiscal des retraites, dont il est clair qu'il a été défini à un moment où les retraites étaient plus faibles et le barème plus lourd.
Le Conseil des impôts suggère d'abord de procéder à un toilettage de toutes les dérogations de faible portée ou dont le coût est inconnu , estimant que les régimes spéciaux qui ne concernent qu'une poignée de contribuables ne peuvent avoir un impact suffisant pour justifier la place qu'ils occupent dans le code général des impôts. La démarche du Conseil paraît justifiée même si l'on a des raisons de croire que certains dispositifs dérogatoires ne pourront être abrogés pour des raisons de principe : est-il ainsi défendable, sous prétexte que les dons se font de plus en plus rares - les collectionneurs ou les héritiers préfèrent la dation - de supprimer l'exonération de droits de mutation dont bénéficient les dons d'oeuvres d'art à l'Etat ?
Aller au-delà et réexaminer les dispositifs dérogatoires peu cohérents ou dont les effets sont insuffisants, est une démarche ambitieuse et sans doute trop audacieuse à en juger par les exemples fournis dans le rapport du Conseil des impôts.
Le Conseil des impôts met d'abord en question la cohérence d'un certain nombre de dispositifs notamment en matière de fiscalité de l'épargne. Pour lui, une première voie possible de rationalisation de cette fiscalité serait de limiter le nombre des régimes applicables sans exception possible et de remettre en cause les dérogations injustifiées. Ainsi, le nombre des dispositifs d'imposition pourrait être limité à trois - en laissant le cas échéant la possibilité d'un droit d'option - correspondant soit à une imposition au barème de l'impôt sur le revenu, soit à un prélèvement libératoire à taux unique, soit à une exonération complète y compris de CSG et de CRDS. Une fois encore, on ne peut que souscrire aux objectifs affichés, tout en restant sceptique sur la possibilité de les mettre en oeuvre. Indépendamment du lancinant problème de l'équilibre entre les différents circuits de collecte, il restera toujours à régler la question des bons anonymes ...
En outre, est-il vraiment réaliste de remplacer certaines dérogations, en l'occurrence les dispositifs destinés à aider certaines zones géographiques ou certains secteurs d'activités, outre-mer, SOFICA, SOFIPECHE, « peu justifiées » par des subventions ? L'expérience de la suppression des petites taxes parafiscales doit inciter à la prudence en la matière. En outre, inciter et assister représentent des choix politiques différents. Le Conseil des impôts ne semble pas en être conscient.
Un autre exemple de fiscalité dérogatoire à réformer est donné par le régime fiscal des personnes âgées. Pour le Conseil des impôts, la question du maintien de l'exonération partielle ou complète de CSG ou de CRDS spécifique aux pensions, dont le coût approchait 4 milliards d'euros en 2001, pourrait notamment être soulevée. Là également, on peut s'interroger sur la faisabilité d'une telle réforme, qui ne peut être envisagée que dans le cadre d'une remise à plat du problème de la déductibilité de la CSG et de la CRDS.
Enfin, le Conseil des impôts remet en cause la demi-part supplémentaire pour les contribuables seuls ayant eu un ou plusieurs enfants à charge. Cette mesure, adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, et qui sera certainement impopulaire, peut se comprendre en raison du choix de modes d'intervention considérés comme plus efficaces en termes de politique familiale, telle l'allocation unique de garde du jeune enfant.
3. Peut-on supprimer les dépenses fiscales sans réforme d'ensemble du système fiscal ?
Le Conseil des impôts écarte en revanche l'idée d'une vaste réforme de la fiscalité à l'allemande, comportant la suppression d'un grand nombre de niches conjuguée à la baisse concomitante des taux d'imposition, considérée comme « intellectuellement satisfaisante » mais comme comportant des inconvénients « lourds » :
Le Conseil des impôts souligne les avantages des fiscalités à assiette large : « la fiscalité peut reposer sur un impôt à base large (peu d'exonérations) et à taux faible, avec peu d'aménagements (abattements, réductions...). Dans cette situation, la simplicité des règles facilite la gestion de l'impôt et garantit sa bonne application. L'assiette large et le taux moyen (ou le taux marginal) faible sont des gages d'équité et de civisme fiscal ».
Pourtant, le basculement du système fiscal français vers cette logique lui paraît « entrer en contradiction avec l'objectif de simplification recherché » . Celui-ci estime en effet qu'une telle orientation risquerait de se traduire par :
« - la remise en cause d'allégements structurels de l'impôt, dont la plupart sont anciens (demi-parts supplémentaires, abattement de 10 % sur les retraites...) ;
« - des transferts de charges toutes choses égales par ailleurs - au détriment des familles, des personnes âgées, des invalides et des foyers aux revenus les plus modestes - soit une remise en cause significative du caractère personnalisé de l'impôt sur le revenu ;
« - une atténuation de la progressivité de l'imposition des revenus ».
Votre commission des finances ne peut adhérer à cette argumentation d'une part, parce que la différence que le Conseil des impôts fait entre allégements structurels et mesures dérogatoires, ne lui paraît pas avoir la clarté souhaitable ; d'autre part, parce qu'on ne peut considérer que la progressivité actuelle est une donnée intangible dans un contexte de concurrence fiscale.
En dépit de l'opinion du Conseil des impôts, votre rapporteur général estime, que, sans vouloir s'attaquer à tous les impôts et à tous les niveaux, et en se concentrant sur quelques points essentiels, il n'est d'autre façon de lutter contre l'illisibilité de la politique fiscale que de rebâtir une nouvelle architecture.
Telle serait bien l'ambition d'une réforme fiscale tendant à fusionner l'ensemble CSG/CRDS avec l'impôt sur le revenu pour aboutir à un système vraiment général d'imposition des personnes, retrouvant les ambitions du législateur du début de la cinquième République. Mettre sur un seul et même avis d'imposition la partie proportionnelle et la partie progressive de l'impôt - qu'elles soient ou non prélevées à la source - constituerait une mesure de clarification de nature à faire prendre conscience au citoyen du coût de l'Etat.
Il est entendu que, s'agissant de rendre le nouveau régime acceptable, on doit préserver les intérêts acquis. Il est indispensable de disposer d'une réserve budgétaire pour s'assurer qu'il ne soit guère de contribuables qui sortent « perdants » de la réforme. Telle avait été la démarche entreprise avec la grande réforme Juppé de 1995, qui avait été interrompue en 1997 avec le changement de majorité politique.
4. Y a-t-il des alternatives au recours à la dépense fiscale ?
La recherche d'une plus grande vérité des barèmes ne doit pas conduire à l'élimination par principe de toute dépense fiscale. L'affirmation du MEDEF selon laquelle il pèserait une sorte de présomption d'illégitimité sur les régimes dérogatoires n'est effectivement pas totalement dépourvue de fondement. On n'en veut pour preuve que l'analyse éminemment critiquable que le Conseil fait de la réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile.
Le Conseil des impôts, partant du constat que seul le crédit d'impôt peut avoir des effets redistributifs en faveur des plus faibles revenus et des foyers fiscaux comptant peu de parts, évoque une réforme du régime fiscal favorable attaché à l'emploi d'un salarié à domicile. La substitution d'un crédit d'impôt à l'actuelle réduction aurait pour effet d'étendre l'avantage fiscal aux foyers qui ne sont pas imposables, ainsi qu'à ceux qui ne pouvaient pas, compte tenu de leur niveau d'imposition, bénéficier de l'intégralité de l'avantage fiscal 32 ( * ) .
Votre commission des finances ne peut en aucune façon souscrire à cette démarche. Il ne faut pas oublier que la mesure s'inscrit dans une triple logique d'aide à la famille, de lutte contre le travail clandestin et d'allégement de la pression fiscale sur les cadres.
Si le Conseil des impôts a pris le soin de développer la logique alternative du crédit par rapport à la réduction d'impôt, c'est sans doute parce qu'il a privilégié l'objectif d'aide aux familles sur les deux autres, dont l'importance ne doit pas être sous-estimée. D'une part, il est plus efficace de centrer la lutte contre le travail « au noir » sur les emplois à temps plein, qui sont essentiellement offerts par les ménages disposant de revenus élevés, ce qui est notamment le cas des couples de cadres dont les deux conjoints travaillent ; d'autre part, on ne peut pas négliger la diminution de la charge fiscale, qui, contrairement à d'autres mesures alternatives, est jugée plus acceptable, dès lors qu'elle est « affectée » à la famille et à l'emploi.
Bref, il ne faudrait pas, selon votre commission des finances, mettre en place un mécanisme aboutissant à encourager les familles qui ne sont pas en mesure de donner du travail aux autres, et à décourager les vrais employeurs potentiels.
Cette observation n'altère pas l'intérêt de la démarche du Conseil lorsqu'il propose d'instaurer un débat systématique sur la pertinence du choix d'une disposition fiscale dérogatoire par rapport à d'autres modes d'intervention publics telles la réglementation ou la dépense budgétaire .
Votre commission des finances rejoint pleinement le Conseil des impôts sur le plan des principes lorsque, par sa proposition n° 2, il suggère de rendre plus transparente l'estimation du coût des dépenses fiscales.
Ainsi, il serait tout à fait légitime de remplacer l'article 32 de la loi de finances pour 1980 33 ( * ) par un nouveau dispositif pris en application du 4°) de l'article 51 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, qui dispose qu'est jointe au projet de loi de finances de l'année, « une annexe explicative analysant chaque prévision budgétaire et présentant les dépenses fiscales » .
Le Conseil des impôts attire l'attention sur toute une série de précautions de caractère méthodologique. L'annexe devrait indiquer explicitement la ou les méthodes d'estimation utilisées - simulation ou reconstitution de base taxable - ainsi que le degré de fiabilité des estimations. Elle pourrait également effectuer des totalisations par impôt et par programme, du coût des dépenses fiscales.
Enfin, le Conseil des impôts préconise d'instaurer une procédure contradictoire entre ministères pour l'estimation de la dépense fiscale. Votre commission des finances insiste tout particulièrement sur ce point car il faut que les calculs procèdent d'une approche pluraliste et ne soient pas laissés uniquement entre les mains des fonctionnaires du ministère des finances.
Le choix entre fiscalité et dépenses directes gagnerait à être davantage explicité et documenté, comme le souligne le Conseil des impôts, notamment dans les études d'impact qui accompagnent les projets de loi comportant des dépenses fiscales.
Le tableau comparatif ci-dessous établi par le Conseil des impôts, est techniquement intéressant car il détaille les différents niveaux auxquels l'on doit apprécier l'intérêt d'une mesure.
Choix d'une dépense fiscale plutôt que budgétaire
|
|
Intérêt de recourir à une dépense fiscale plutôt qu'à une dépense budgétaire |
Intérêt de recourir à une dépense budgétaire plutôt qu'à une dépense fiscale |
|
Maîtrise budgétaire |
Faible : L'aide peut être à guichet ouvert (sauf agréments) |
Forte : Le coût de l'aide peut rester en deçà d'un plafond donné |
|
Etendue des bénéficiaires |
L'aide concerne un grand nombre de bénéficiaires |
L'aide concerne un nombre restreint de bénéficiaires |
|
Conditions d'obtention |
Les conditions d'attribution sont objectives et ne nécessitent pas l'intervention d'une administration spécialisée |
L'attribution de l'aide nécessite l'intervention d'une administration spécialisée |
|
Détermination du montant de l'aide |
La détermination du montant de l'aide ne dépend que de données déclaratives fiscales |
La détermination du montant de l'aide dépend d'informations non contenues dans les déclarations fiscales |
|
Distribution |
Il n'existe pas d'administration en charge de distribuer ce type d'aide |
Il existe déjà une administration en charge de distribuer ce type d'aide |
|
Gestion |
Complexité et coût faibles pour les services fiscaux |
Complexité et coût élevés pour les services fiscaux |
|
Calendrier d'attribution |
L'aide peut être accordée ex post |
L'aide doit être accordée ex ante |
|
Niveau des contrôles |
Le niveau usuel des contrôles effectués par les services fiscaux est adapté |
L'aide nécessite la mise en oeuvre de contrôles spécifiques en raison d'un risque de fraude élevé |
Deux critères essentiels font pourtant défaut, qui plaident , selon votre commission des finances, en faveur de la dépense fiscale par rapport à la subvention budgétaire : la nécessité d'abaisser le niveau affiché de prélèvements obligatoires et celle d'augmenter l'acceptabilité du prélèvement .
Choisir la dépense fiscale par rapport à d'autres modes d'action n'est pas forcément cette solution de facilité, d'autant plus pernicieuse que contrairement à la dépenses budgétaire elle est invisible et donc peu susceptible d'être remise en cause.
Parce qu'elle relève d'une logique d'impôt choisi et qu'elle est particulièrement incitative, la dépense fiscale doit certainement, elle aussi, être réhabilitée. Loin d'encourager une certaine forme de passivité comme la subvention que l'on a tendance à attendre avant d'agir, la dépense fiscale incite à l'action et à prendre l'initiative.
Plus efficace que la subvention dans de nombreux domaines, la dépense fiscale doit cependant rester lisible.
Ainsi, lorsqu'il n'est pas réaliste de supprimer une dépense fiscale et que l'on n'est pas en mesure de rebâtir une nouvelle architecture fiscale, il convient de réformer les mécanismes pour garantir une meilleure transparence de l'avantage accordé aux contribuables.
En premier lieu, d'une façon générale, une plus grande homogénéité des mécanismes fiscaux utilisés est souhaitable . L'opacité du système fiscal français est accrue du fait de l'utilisation à des degrés divers de toutes les techniques d'allègement d'impôt : exonération de l'assiette d'imposition, déduction et abattement tendant à soustraire de l'assiette taxable une part forfaitaire ou proportionnelle, réduction d'impôt ou crédit d'impôt, taux différencié, indépendamment même, enfin, des dispositifs spécifiques comme les amortissements exceptionnels en matière d'impôt sur les sociétés ou les quotients familial et conjugal en matière d'impôt sur le revenu.
Une des premières tâches consiste à mettre en place des régimes assurant la quantification de l'avantage. De ce point de vue, on peut estimer que, d'une façon générale, les réductions d'assiette - exonération totale ou déductibilité, dont la logique interne n'est certes pas contestable s'agissant de déduire du revenu certaines charges qui lui sont associées - sont moins adaptées que les réductions d'impôts dans la mesure où elles dépendent de la tranche d'imposition où se situe le contribuable et ne peuvent être mesurées qu'en faisant des hypothèses sur le taux marginal moyen appliqué aux foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure.
Sur le plan de la justice fiscale et en liaison avec le souci constant des récents gouvernements d'atténuer les effets de seuil, il conviendrait également de repérer les interdépendances entre dépenses fiscales et prestations sociales .
Le Conseil des impôts souligne que les dépenses fiscales comportent des effets indirects importants et mal connus. Une mesure peut n'avoir qu'une incidence directe faible, mais permettre aux bénéficiaires d'accéder à certaines prestations. Il s'agit d'une question budgétaire car cela accroît la dépense sociale, mais reflète aussi un enjeu de justice sociale.
A titre d'exemple, on peut rappeler que la Cour des comptes, dans son rapport au Parlement sur la sécurité sociale de 2001, a mis l'accent sur ce phénomène, la non imposition du minimum vieillesse ayant pour conséquence de majorer les aides au logement des personnes âgées concernées car cette ressource n'est pas incluse dans l'assiette fiscale de référence.
Plusieurs dépenses fiscales ont un impact sur la CSG, la CRDS et la taxe d'habitation, ainsi que sur les aides au logement et la redevance télévisuelle.
Dans le système actuel, la référence aux revenus imposables pour l'attribution des prestations de droits sociaux est critiquable dans la mesure où la non imposabilité reflète également l'impact d'aide sectorielle par le jeu d'exonérations comme c'est le cas de l'épargne réglementée ou de déductions de l'assiette imposable.
Les interactions entre dépenses fiscales et prestations sociales sont éminemment complexes. Elles mériteraient d'être étudiées sur des cas concrets pour repérer des effets de seuils qui peuvent constituer un frein au retour de certaines personnes sur le marché du travail.
Parmi les bonnes pratiques en matière de dépenses fiscales, il faut mentionner la réalisation périodique d'études approfondies - tous les cinq ou six ans par exemple - sur les effets des régimes dérogatoires , qui pourraient effectivement être associées aux rapports de performances issus de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances comme le suggère le Conseil des impôts.
C'est à cette condition que des systèmes généreux comme celui qui vient d'être mis en place dans le cadre de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations peut s'inscrire utilement et harmonieusement dans notre système fiscal français.
Le développement du mécénat individuel est bien l'une des voies à explorer pour concilier la nécessité d'une diminution des prélèvements obligatoires dans un monde ouvert et celle de satisfaire un nombre toujours plus diversifié de besoins sociaux sans augmenter et même en diminuant les dépenses publiques.
Il s'agit à terme de développer une culture du mécénat individuel, comme il en existe aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon en général, où l'on voit les hommes d'affaires reconnaissants à la société de leur avoir permis de réussir, doter généreusement leurs universités ou leurs laboratoires de recherche.
Les universités, les centres de recherche, les hôpitaux, les oeuvres charitables, le patrimoine monumental et artistique, les musées et beaucoup d'autres domaines, notamment dans le domaine économique, auraient beaucoup à gagner pour pouvoir élargir leurs moyens d'actions, qui en dotant une chaire ou un laboratoire, qui en achetant une oeuvre d'art ou en construisant un centre d'accueil. L'enjeu est aussi qualitatif, car cela rendrait possible le contournement de certaines rigidités administratives en permettant notamment à certains organes de recherche et d'enseignement, d'être pleinement compétitifs pour attirer les talents exceptionnels.
Nul doute que cette nouvelle loi devrait contribuer à faire évoluer la société française vers plus de responsabilité et de solidarité individuelles en favorisant le remplacement d'une fraction - certes quantitativement limitée mais marginalement significative - des prélèvements obligatoires par des contributions volontaires, donnant un contenu concret à l'idée qu'un contribuable puisse, pour une petite partie de sa cotisation, préférer l'impôt choisi à l'impôt subi.
De ce point de vue la dépense fiscale peut jouer un rôle essentiel pour réhabiliter l'impôt et diminuer la pression fiscale effective dans un pays qui comme la France marquera, pour un certain temps encore, sa différence en préférant afficher des taux d'imposition relativement élevés.
D. À ÉNERGIE RENOUVELABLE, FISCALITÉ RENOUVELÉE : LE CAS DES BIOCARBURANTS
Dans le réexamen d'ensemble qui s'impose de la fiscalité de l'énergie afin de la rendre écologiquement plus cohérente, le cas des biocarburants mérite, compte tenu la croissance rapide du secteur des transports, d'être examiné en priorité.
1. Un régime à la fois fruste dans ses principes mais complexe à mettre en oeuvre
Le soutien à la production et à l'utilisation des biocarburants repose, en France, sur une compensation, grâce à une réduction de TIPP, de la différence entre le prix à la pompe des carburants végétaux et celui des carburants fossiles.
Le régime de la production et de la commercialisation des biocarburants est, en contrepartie, étroitement encadré et contrôlé :
- les produits bénéficiant de l'aide fiscale considérée sont fabriqués sous surveillance douanière permanente 34 ( * ) , dans une quantité limitée, fixée annuellement par un agrément accordé pour une certaine durée ;
- en ce qui concerne les produits à base d'éthanol, l'article 265 bis A du code des douanes n'accorde de réduction de TIPP qu'à l'ETBE 35 ( * ) ;
- chaque producteur agréé doit verser une caution égale à 20 % du montant de la réduction de taxe dont il est prévu qu'il bénéficie d'après la quantité de biocarburant qu'il est autorisé à fabriquer ;
- cette réduction est effectivement accordée, sur production d'un certificat de production et d'un certificat de mélange, lors de la mise à la consommation des carburants combustibles concernés, mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage, situés en France ou dans la Communauté européenne.
On le voit, le système français est à la fois fruste dans ses principes (contrôle étroit et limitation stricte par l'Etat du manque à gagner résultant de l'avantage fiscal accordé) et relativement lourd et sophistiqué dans son application car il faut :
- chaque année déterminer les quantités concernées, les réductions d'accises octroyées ;
- mettre en oeuvre le système de délivrance de certificat, de fonctionnement des entrepôts fiscaux, de surveillance de la production ;
- enfin, et surtout, tenir compte du cours des différentes matières premières pétrolières et agricoles à prendre en considération, afin qu'il n'y ait pas « surcompensation » du surcoût de production des biocarburants.
Le manque à gagner pour le budget de l'Etat dû aux réductions de TIPP consenties aux biocarburants était estimé, par le gouvernement, à environ 180 millions d'euros pour 2001 et 140 millions d'euros en 2002. Il est évalué, pour 2004, à 165 millions d'euros (hors effet TVA) par le tome I (recettes) du fascicule « voies et moyens » du projet de loi de finances.
2. Une aide qui ne satisfait pas les nouvelles exigences, communautaires en particulier, de développement des carburants d'origine végétale
Les biocarburants cumulent de très nombreux avantages aux niveaux :
- écologique (réduction facile et rapide des émissions de gaz à effet de serre, conforme à nos engagements internationaux, dans le secteur des transports où elles tendent le plus à augmenter) ;
- économique (développement des débouchés de l'agriculture et d'autres activités, diminution d'importations de pétrole et de produits pour l'alimentation du bétail, créations d'emplois...).
Aussi, leur utilisation dans les transports est-elle désormais encouragée par deux directives européennes qui prévoient une augmentation progressive de leur part dans les ventes d'essence et de gazole ainsi que des réductions d'accises en leur faveur.
De plus, la directive du 8 mai 2003, suppose un doublement de notre production 36 ( * ) , d'ici au 31 décembre 2005.
Le système d'aides fiscales actuel, sur-administré et contingenté, ne semble pas pouvoir s'accommoder d'une croissance aussi forte et rapide.
En outre, se pose le problème de sa compatibilité avec le droit communautaire, actuel et futur.
Aujourd'hui, le code des douanes dispose que les carburants combustibles, fossiles et végétaux, doivent être mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage qui peuvent être situés dans la Communauté européenne. Mais, dans la pratique, à une exception (allemande) près, cette opération n'est effectuée qu'en France, pour des raisons pratiques évidentes tendant à montrer que notre réglementation en la matière est sans doute conforme plus à la lettre qu'à l'esprit des principes européens de libre établissement des entreprises.
En outre, le fait d'exclure l'éthanol du bénéfice des réductions de TIPP, prévues par l'article 265 bis A du code des douanes, pour le réserver au seul ETBE, semble en pleine contradiction avec la directive précitée, du 8 mai 2003, relative à la promotion de l'utilisation des biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.
Quant au texte, qui vient d'être adopté (directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003) sur la taxation des produits énergétiques, il permet d'opter soit pour une imposition réduite, soit pour une exonération, mais maintient la modulation 37 ( * ) des avantages accordés en fonction de l'évolution des cours des matières premières concernées (produits pétroliers ou servant à fabriquer l'éthanol ou le diester).
Ces avantages peuvent être accordés à des opérateurs autorisés, dans le cadre de programmes pluriannuels. Les nouvelles directives européennes sont donc plus souples et plus ouvertes que le régime français en vigueur dans la mesure où elles tendent à une croissance rapide de la consommation de carburants verts.
Dans ces conditions, il semble inévitable de changer de système d'aide à la production de biocarburants.
3. De nouvelles propositions à étudier
Afin de sortir des contraintes du régime actuel et de compenser le surcoût croissant, malgré les économies d'échelle et les gains de productivité du secteur, lié à la forte augmentation des volumes produits, il paraît difficile de ne pas songer à mettre à contribution les consommateurs de carburants dans leur ensemble.
De la même façon, ce sont les consommateurs d'électricité qui, dans leur globalité, financent aujourd'hui l'énergie éolienne.
Les biocarburants :
une énergie
particulièrement éco-vertueuse
1. Un secteur prioritaire
Les biocarburants sont la seule énergie renouvelable utilisable dans le secteur des transports.
Or, :
- ce secteur est le premier émetteur de gaz carbonique (CO 2 ) dans l'atmosphère (26,4 % du total des émissions françaises en 2002) ;
- les rejets qui lui sont imputables continuent d'augmenter en France de 2 à 3 % par an, ce qui est incompatible avec le respect des engagements que nous avons pris à Kyoto ;
- pourtant, les biocarburants ne représentent, pour le moment, que 2 % de notre production totale d'énergies renouvelables ;
- la demande de pétrole continue de croître dans le secteur des transports, qui l'utilisent comme carburant dans la proportion de 97,5 %. La part des transports représentait ainsi 54 % de la consommation de pétrole en 2002, contre 27 % en 1973. Or, le pétrole, particulièrement polluant, représente encore, malgré la progression du nucléaire et du gaz, environ 34 % de notre consommation d'énergie primaire aujourd'hui.
En raison de leurs vertus écologiques et de leur facilité d'usage (il n'est pas nécessaire de changer la technologie des moteurs), qui s'ajoutent à leurs bienfaits économiques, il est urgent d'accroître massivement la production et l'utilisation des biocarburants.
2. Les exemples étrangers
L'attribution exclusive d'avantages (fiscaux ou autres) à l'ETBE n'existe qu'en France.
L'idée de faire mettre les consommateurs à contribution par les distributeurs pour financer le surcoût de production des biocarburants est déjà en cours d'application en Italie et en Grande-Bretagne.
Par ailleurs, les ventes de biocarburants sont totalement défiscalisées en Allemagne, et leur fabrication largement subventionnée en Espagne.
Des obligations d'incorporation de bioéthanol existent
dans la province chinoise de Jilin et sont envisagées au Japon.
Il pourrait être ainsi envisagé d'imposer aux opérateurs pétroliers, dans la prochaine loi d'orientation sur l'énergie, une obligation globale d'incorporation de biocarburants dans leurs produits, dont la charge serait répercutée par les distributeurs sur l'usager.
Cela entraînerait la disparition des appels d'offres et des quotas de production actuels peu compatibles - on l'a vu - avec la libre circulation des biocarburants en Europe et susceptibles de brider le développement de l'offre.
Selon certains, il serait souhaitable de maintenir, en outre, une aide fiscale (de l'ordre de 8 à 10 euros par hectolitre) en vue de protéger nos produits (dont la compétitivité est bonne au niveau européen) de la concurrence d'importations moins chères en provenance, par exemple, du Brésil (éthanol) ou de Malaisie (ester de Palme).
Cette aide devrait naturellement bénéficier pas seulement à l'ETBE mais aussi à l'éthanol pur. Elle pourrait être accordée moyennant un coût, au total, inchangé, malgré l'augmentation des quantités produites (la dépense fiscale par hectolitre se trouvant fortement réduite puisqu'elle atteint, actuellement 38 euros pour l'éthanol et 35 euros pour le biodiesel).
Sans doute serait-il cependant nécessaire de prévoir un mécanisme pour arbitrer les négociations avec les producteurs, nécessairement déséquilibrées par l'obligation d'achat faite aux opérateurs.
D'autres envisagent de financer l'accroissement de l'aide, découlant de celui du volume de biocarburants produits, par une taxe additionnelle à la TIPP dont le produit bénéficierait à des producteurs agréés, en beaucoup plus grand nombre, de façon plus libérale. Mais on resterait dans la logique d'un système administré, lourd à gérer et auquel votre rapporteur général n'est pas favorable.
Les bonnes solutions seraient peu coûteuses.
Il faudrait, de toute façon, pouvoir comparer le coût de « l'avantage » fiscal (réduction de TIPP) actuellement accordé aux biocarburants à celui des aides dont bénéficient d'autres moyens de locomotion faisant appel à des technologies (GPL, véhicule électrique...) dont la mise en oeuvre est plus onéreuse ou, s'agissant de l'utilisation du gazole par les moteurs diesel, beaucoup moins propres.
Or :
- pour le maintien d'une aide fiscale à 8 euros/hectolitre, destinée à contenir les importations d'origine extracommunautaire, le surcoût, pour le consommateur, ne serait que de 0,5 centime par litre, dans l'hypothèse du respect de nos obligations européennes qui supposent de doubler notre consommation en deux ans (d'ici décembre 2005). Quant à la dépense fiscale correspondante, après avoir diminué à court terme, elle serait en 2010 la même qu'aujourd'hui (170 millions d'euros) pour un pourcentage passé à 5,75 % des ventes totales de carburants ;
- les partisans d'un financement de l'aide aux biocarburants par une taxe additionnelle à la TIPP pensent qu'il en résulterait une augmentation de 2 à 3 centimes par litre (en réalisant, là aussi, les objectifs de la directive européenne de mai 2003).
Par comparaison, les charges résultant de l'obligation d'achat d'énergies renouvelables par EDF représentent 1.052 millions d'euros en 2003. Lors de son audition par votre commission des finances, le 19 mars 2002, le président de la commission de régulation de l'électricité (CRE), M. Jean Syrota, avait estimé que la réalisation des projets envisagés de construction d'éoliennes entraînerait, dans quelques années, un doublement des charges du Fonds de péréquation du service public de l'électricité, conduisant à une augmentation supérieure à 20 % du prix payé par les plus gros consommateurs.
4. Une solution concevable pour l'industrie pétrolière
L'industrie nationale du raffinage ne s'est pas assez adaptée à la modification rapide de la demande, privilégiant le gazole 38 ( * ) , dont la production est déficitaire, aux dépens du super, en excédent, qu'il faut pouvoir exporter.
Or, l'utilisation d'éthanol pur, mélangé aux essences, diminuerait, d'une part, les débouchés de l'ETBE (qui comprend un résidu du raffinage, l'isobutylène), mais augmenterait surtout aussi, d'autre part, les surplus de super et d'ordinaire à vendre à l'étranger.
Mais, en revanche, l'accroissement de la production de diester, mélangé au gazole, en ferait décroître la consommation, donc le déficit et, par conséquent, les importations.
La véritable solution est donc d'intéresser l'industrie pétrolière française au développement de la fabrication de gazole vert, tout en veillant à maintenir cette activité ouverte à la concurrence.
E. METTRE EN PERSPECTIVE NOTRE POLITIQUE FISCALE
1. Une loi d'orientation fiscale pour fixer un cadre cohérent
Aujourd'hui, la loi fiscale peut être modifiée non seulement dans le cadre des lois de finances, mais également dans tous les textes de lois examinés par le Parlement.
Il résulte de cette possibilité une extraordinaire dispersion des mesures fiscales, une méconnaissance de leur impact réel sur les finances publiques, et parfois un manque de lisibilité pour nos concitoyens , qui ont le sentiment que la politique fiscale est faite « au fil de l'eau », au fur et à mesure de l'examen des textes législatifs dans des domaines particuliers. Les commissions des finances de l'Assemblée nationale ou du Sénat n'étant pas saisies pour avis de l'ensemble des projets de loi, il ne leur est matériellement pas possible d'examiner toutes les dispositions à caractère fiscal introduites par voie d'amendements 39 ( * ) en cours du débat parlementaire.
Or, il est nécessaire de replacer toute mesure fiscale, aussi ciblée soit-elle, dans un cadre d'ensemble cohérent.
Pour prendre l'exemple de l'année écoulée, de nombreuses dispositions fiscales ont été prises en cours d'année (loi pour l'initiative économique, loi d'orientation pour l'outre-mer, loi urbanisme et habitat, loi sur le mécénat et loi sur la rénovation urbaine). L'ensemble de cette législation se traduit par un coût global important, puisqu'il peut être chiffré à 430 millions d'euros en 2004 40 ( * ) .
Ces mesures s'inscrivent dans un cadre cohérent puisqu'elles visent toutes à faciliter la création d'entreprise, l'investissement, l'innovation ou l'attractivité du territoire français. Cependant, la lisibilité de la démarche du gouvernement a été compromise par une présentation parcellaire .
Le présent débat annuel sur les prélèvements obligatoires doit être l'occasion pour le gouvernement de présenter ses orientations de politique fiscale, au moins pour les années à venir, sinon dans un cadre pluriannuel.
Il est indispensable d'aller plus loin. Au-delà de ce débat annuel sur les orientations fiscales, qui n'a pas de valeur normative, votre rapporteur général pense qu'une loi d'orientation fiscale, pour une période pluriannuelle, serait nécessaire, pour formaliser les orientations fiscales du gouvernement et fixer un cadre clair pour nos concitoyens. Cette loi définirait les évolutions de structure que nous souhaitons apporter à notre système fiscal et les objectifs poursuivis. Elle préciserait également le calendrier de réforme.
D'une certaine manière, les orientations définies par le Président de la République en 2002 concernant l'impôt sur le revenu s'inscrivaient dans cette démarche, avec un objectif, valoriser le travail, un calendrier de cinq ans, et des préconisations très précises pour atteindre l'objectif souhaité. En restant constant dans sa décision de diminuer progressivement l'imposition des revenus du travail, le gouvernement respecte cette loi fiscale non écrite. Cette démarche doit être étendue à tous les secteurs de notre politique fiscale, et faire l'objet d'un réel débat parlementaire.
2. Renforcer la capacité d'expertise du Parlement en matière fiscale
Pour donner un contenu à la volonté partagée de votre rapporteur général et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de conférer au présent débat sur les prélèvements obligatoires le caractère d'un « débat d'orientation fiscale », au cours duquel le Parlement ferait part de ses propositions pour faire évoluer la structure de notre fiscalité, il est indispensable que le Parlement nourrisse sa réflexion d'études sur les différents aspects de notre système fiscal.
Ce souci anime de longue date votre commission des finances. Au cours des années récentes, elle a consacré plusieurs de ses travaux à l'analyse d'ensemble de notre système de prélèvements obligatoires et à sa place par rapport à nos principaux partenaires :
- un rapport d'information sur la fiscalité de l'épargne 41 ( * ) ;
- un rapport d'information sur les règles applicables en matière de taux de TVA 42 ( * ) ;
- un rapport d'information relatif à « L'incidence des charges fiscales et sociales sur la localisation d'activité » 43 ( * ) , auquel était annexée une étude réalisée par l'institut REXECODE sur « l'incidence des différents prélèvements obligatoires dans les pays de l'Union européenne sur la compétitivité des entreprises » ;
- un rapport d'information consacré à « La concurrence fiscale en Europe » 44 ( * ) , fondé sur une étude commandée à l'OFCE ;
- des simulations de l'impact de différents scénarios de baisses de prélèvements obligatoires, réalisées par le COE et annexées au rapport sur le débat d'orientation budgétaire pour 2001 45 ( * ) ;
- un rapport d'information sur la taxe sur les salaires fondé sur une étude commandée au cabinet Andersen-Legal 46 ( * ) ;
- un rapport d'information consacré aux droits de mutations à titre gratuit, auquel était annexée une étude sur « l'état du droit positif français des mutations à titre gratuit à la lumière du droit comparé européen », réalisée par le cabinet Archibald International (réseau Ernst & Young) 47 ( * ) ;
- un rapport d'information, réalisé conjointement avec la délégation pour la planification, sur les réformes fiscales en Europe entre 1992 et 2001, fondé sur une étude commandée à l'OFCE 48 ( * ) .
Par ailleurs, la réflexion de votre commision des finances est richement nourrie par le rapport annuel au Président de la République établi par le Conseil des impôts en application de l'article premier du décret n° 71- 142 du 22 février 1971 portant création du Conseil des impôts.
L'article 2 de ce décret dispose que « le Conseil des impôts peut être chargé, à la demande du ministre de l'économie et des finances, d' études relatives à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de certains aspects de la politique fiscale ».
Cette faculté est peu utilisée par les ministres de l'économie et des finances. En revanche, il fait peu de doute que, si elle était étendue aux commissions des finances des assemblées, celles-ci ne manqueraient pas d'avoir recours à cette capacité d'expertise. Votre commission des finances souhaite donc que le gouvernement modifie le décret précité pour permettre une saisine parlementaire du Conseil des impôts .
Le Parlement doit-il se doter d'une capacité
d'expertise autonome
en matière de fiscalité
locale ?
Lors de la présentation de son rapport sur les dégrèvements d'impôts locaux devant la commission des finances, le 15 octobre dernier, notre collègue Yves Fréville, rapporteur spécial des crédits des charges communes, a souhaité que le Parlement puisse se doter d'une expertise pour analyser et exploiter les données d'un fichier commun entre la direction générale des collectivités locales, la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et l'INSEE, sur le modèle de celui qu'il l'avait lui-même créé pour son étude. Il a remarqué que le comité des finances locales, parce qu'il était adossé à la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur, manquait d'une vision synthétique qui inclurait la vision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et a regretté que l'administration française n'ait pas de vision globale en matière de fiscalité locale, jugeant que le Sénat devait trouver les moyens d'y remédier.
Par ailleurs, à l'occasion de l'audition par la commission des finances de notre collègue Jean François-Poncet, président du groupe de travail sur la péréquation interdépartementale, constitué au mois de juin 2003 à la demande conjointe de la commission des finances, de la commission des affaires économiques et de la délégation pour l'aménagement du territoire, le 22 octobre dernier, le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis, a considéré que le Sénat devait se constituer une base de données relative aux finances locales. Notre collègue Jean François-Poncet a également jugé que l'information du Sénat en matière de finances locales était insuffisante.
Le Premier ministre avait, dans son discours tenu lors des synthèses des assises des libertés locales à Rouen, le 28 février dernier, indiqué qu'il fallait « une évaluation performante et pertinente, parce que c'est la contrepartie de l'exercice des responsabilités ». Il avait estimé : « la décentralisation est une source d'économies. Elle rationalise. Elle simplifie. Elle supprime les structures redondantes. Il y a des gains de productivité à trouver et je suis sûr que les collectivités les utiliseront pour financer leurs priorités et leurs projets.
« La pression fiscale ne sera donc pas accrue du fait de la décentralisation. Je pense même qu'à terme, elle pourra la faire baisser.
« Pour le vérifier, je propose que le Parlement crée un observatoire pluraliste ouvert également aux élus locaux et aux forces vives, qui sera chargé de veiller au respect de cet engagement ».
Cette déclaration va d'ailleurs dans le sens de la volonté du Président du Sénat, notre collègue Christian Poncelet, de faire en sorte que le Sénat joue pleinement son rôle de « maison des collectivités locales ».
Source : rapport pour avis n° 41 (2003-2004) au nom de la commission de finances de Michel Mercier, sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 5 novembre 2003, sous la présidence de M. Jean Arthuis, la commission des finances a entendu une communication de M. Philippe Marini, rapporteur général, sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
Procédant à l'aide d'une vidéo-projection, M. Philippe Marini, rapporteur général, après avoir rappelé le cadre dans lequel s'inscrivait le prochain débat sur les prélèvements obligatoires, issu de l'article 52 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), a tout d'abord établi deux constats :
- l'Union européenne était en tête des grands ensembles régionaux de l'OCDE en termes de taux de prélèvements obligatoires (PO), 41 % du PIB pour 36,9 % du PIB en moyenne dans l'OCDE ;
- au sein de l'Union européenne, la France était elle-même parmi les pays connaissant les taux de PO les plus élevés (44,2 % du PIB en 2002).
Il a ensuite montré qu'à la faveur du cycle baissier que connaissait la France depuis 2002, le taux de PO était revenu en-dessous de 44 % du PIB, alors qu'il était de plus de 45 % du PIB entre 1998 et 2000, lorsque la conjoncture économique était favorable. Il a indiqué que cette diminution récente du taux de PO en France était en phase avec l'ensemble de l'OCDE, où 16 des 27 pays la composant avaient connu une baisse de leur charge fiscale en 2002, en partie grâce à des politiques de baisses d'impôts et, en partie, sous l'effet de la décélération économique.
M. Philippe Marini, rapporteur général, a ensuite indiqué que les PO en France finançaient principalement les administrations sociales (48 % du total) et l'Etat (39 %), et minoritairement les administrations locales (12 %) et l'Union européenne (1 %). Il a relevé que la part des prélèvements affectés aux administrations de sécurité sociale n'avait cessé d'augmenter depuis 1986.
Il a ensuite détaillé la structure de la fiscalité française, proche de la moyenne européenne, à l'exception de l'imposition du travail, qui était, en France, de 12,4 % du PIB, contre 7,4 % en moyenne dans le reste de l'Union européenne. S'agissant de l'imposition des revenus des ménages (14,9 % du PIB en France et 15,9 % du PIB en moyenne dans l'Union européenne), il a indiqué que la France se caractérisait, avec un taux d'imposition maximal élevé et un seuil d'imposition au taux maximal assez faible, par une imposition relativement désincitative au travail. S'agissant de l'imposition des revenus des entreprises (2,9 % du PIB en France, comme dans l'Union européenne), il a considéré que la France était marquée par des taux nominaux élevés et un rendement relativement moyen en part de PIB. S'agissant de l'imposition de l'épargne longue, il a indiqué que celle-ci était défiscalisée aux trois quarts. Quant à l'imposition des dividendes, il a montré que la France, avec un taux marginal de prélèvement au taux supérieur de l'impôt sur le revenu de 62,75 %, était largement devant l'Allemagne (43,2 %).
M. Philippe Marini, rapporteur général, a ensuite souligné l'importance de la fiscalité dérogatoire avec, selon le XXI e rapport du Conseil des impôts, 418 mesures dérogatoires, pour un coût annuel total de 50 milliards d'euros. Il a estimé que la contrepartie d'une préférence pour des taux nominaux élevés était, ainsi, la création de « niches fiscales ».
Il a considéré que quatre défis devaient être relevés : celui de l'attractivité du territoire, celui du coût croissant des dépenses sociales, celui de la neutralité fiscale globale des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales et celui des alternatives au recours aux PO (qu'il s'agisse du recours à l'usager ou du développement de partenariats public-privé).
M. Philippe Marini, rapporteur général, a ensuite fait quatre séries de propositions.
Il a souhaité qu'une réflexion soit menée sur un possible rapprochement de l'impôt sur le revenu (IR) et de la contribution sociale généralisée (CSG) et notamment sur la mise en place d'un avis d'imposition unique qui conférerait une vision consolidée de l'imposition personnelle ; par ailleurs, il a souhaité que la CSG demeure affectée à la sécurité sociale, au motif que les dépenses sociales constituaient le facteur le plus « dynamique » d'évolution de la dépense publique.
Afin d'encourager la compétitivité et l'emploi, il a estimé que le « cocktail gagnant » demeurait une baisse simultanée de l'IR et des charges sociales patronales. Il a ajouté qu'il convenait d'alléger la charge fiscale pesant sur les assiettes délocalisables, avec notamment la création d'un statut fiscal pour les impatriés, la rénovation de la fiscalité du patrimoine et la réforme de l'impôt sur la fortune (ISF). Il a également suggéré la piste d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sociale afin de dynamiser l'emploi.
S'agissant de la fiscalité de l'énergie, il a témoigné de son intérêt pour les biocarburants dont le régime fiscal lui était apparu archaïque. La récente publication d'une directive européenne sur le sujet, qui fixait d'ambitieux objectifs en termes de production de biocarburants, lui est apparue comme l'occasion d'une adaptation du cadre fiscal français. Il a, en conséquence, souhaité que le ministre de l'agriculture soit saisi de cette question lorsqu'il viendrait au Sénat présenter le budget pour 2004 de son département ministériel.
Enfin, il a souhaité qu'une « loi d'orientation fiscale » confère une meilleure visibilité à la politique fiscale menée par le gouvernement et que le Parlement puisse faire appel en tant que de besoin à l'expertise du Conseil des impôts.
Rappelant que M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'était récemment interrogé sur l'utilité du débat sur les prélèvements obligatoires, M. Jean Arthuis, président, a estimé que la présentation qui venait d'être faite par le rapporteur général était bien la preuve de l'intérêt de ces questions. Il l'a félicité pour la clarté et la pédagogie dont il avait, à nouveau, fait preuve dans la présentation de ces matières, éminemment complexes. Il a ensuite posé la question de la compatibilité des prélèvements obligatoires français avec la mondialisation, dans un contexte marqué par une accélération des délocalisations. Il a estimé qu'un impôt à la consommation à vocation sociale constituait, selon lui, une intéressante piste de réflexion.
Un large débat s'est alors instauré.
M. Jean-Philippe Lachenaud s'est déclaré favorable à l'idée d'un rapprochement entre l'IR et la CSG, mais a rappelé que l'actuel ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire avait soulevé un certain nombre d'objections. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur la faisabilité d'une loi d'orientation fiscale telle que la proposait le rapporteur général, rappelant que l'histoire fiscale française avait toujours été extrêmement chaoteuse, que les cycles économiques ne permettaient que rarement le respect d'engagements de moyen terme, que l'instrument fiscal était l'un des seuls instruments encore aux mains des gouvernements nationaux et que la définition d'une politique fiscale équilibrée était un exercice particulièrement difficile.
M. René Trégouët a obtenu une confirmation du fait que le projet de « TVA sociale », qu'il jugeait intéressant, était euro-compatible. Il a également marqué son intérêt pour la proposition de rénovation du régime fiscal des biocarburants et a indiqué que des recherches sur l'énergie issue de l'hydrogène étaient actuellement en cours, pour la produire soit à partir du pétrole, soit à partir de la biomasse.
Rappelant que la complexité fiscale ne profitait qu'à ceux qui avaient « les moyens de se faire conseiller », M. Philippe Adnot a plaidé pour une imposition sur le revenu à taux unique avec prélèvement à la source. Il a également rappelé que la commission avait voté en 2002 la modulation de l'allègement fiscal en faveur des biocarburants et s'est donc félicité de l'intervention de M. Jean Arthuis, président, lui indiquant que les biocarburants constituaient depuis le début de l'année 2003 l'un des sujets de réflexion prioritaires de la commission, ainsi que son bureau en avait décidé.
En revanche, M. Aymeri de Montesquiou a émis quelques doutes sur l'avenir des biocarburants compte tenu de leur coût de production prohibitif. Il a par ailleurs souhaité des précisions sur l'attractivité du territoire français au regard du flux des investissements nationaux.
M. Yves Fréville a estimé qu'il fallait, au regard de l'évolution des PO, étudier également l'évolution des dépenses publiques car le déficit était une source de PO futurs. S'agissant de l'instauration d'une « TVA sociale » qui engendrerait une certaine inflation, il s'est interrogé sur sa compatibilité avec le fonctionnement de la monnaie unique. Enfin, il a estimé que les avantages fiscaux accordés à l'épargne longue permettaient de financer la dette publique, notamment via la souscription d'obligations au travers de contrats d'assurance-vie.
M. Paul Girod a dit craindre qu'un document global retraçant l'imposition personnelle du contribuable n'ait un effet « dévastateur » et constitue alors un « encouragement efficace » à l'expatriation. Il s'est dit favorable à l'instauration d'une TVA sociale à condition qu'elle remplace la CSG. Il a déploré que la France, auparavant chef de file en matière de biocarburants, soit aujourd'hui dépassée par l'Allemagne.
M. François Marc s'est dit favorable aux biocarburants dans une optique de développement durable. Il a indiqué qu'une récente étude du cabinet Ernst & Young montrait que la France demeurait attractive et que la fiscalité ne constituait pas un élément dissuasif pour les investisseurs étrangers. Il a estimé que la récente diminution du taux de PO en France devait beaucoup à la politique de l'emploi du précédent gouvernement. Il s'est montré dubitatif quant aux chiffres avancés par le rapporteur général relatifs à l'imposition des dividendes. Enfin, il s'est déclaré hostile à un impôt sur le revenu à taux unique, rappelant que la fiscalité contribue à renforcer la solidarité entre les citoyens.
M. Michel Sergent, tout en relevant la clarté de la présentation faite par le rapporteur général, a également affirmé son attachement à la progressivité de l'impôt, rappelant que la France se caractérisait, déjà, par le faible poids de ses PO progressifs. S'agissant de la question de l'attractivité des territoires, il a estimé que la Grande-Bretagne était « moins bien lotie » que la France en termes de services publics.
M. Claude Belot a estimé que les comparaisons internationales devaient s'attacher aux taux de PO, mais aussi aux contreparties de ces impôts. S'agissant des biocarburants, il a estimé, compte tenu du coût de production de cette énergie, qu'un véritable choix politique devait être fait. Il a par ailleurs, regretté que la France se caractérise par une fiscalité défavorable aux réseaux de chaleur. Enfin, il a estimé que la défiscalisation de l'épargne longue constituait un gaspillage compte tenu du taux d'épargne très élevé des ménages en France.
Après avoir souligné la qualité de la présentation faite par le rapporteur général , M. Jacques Oudin a déploré « l'instabilité fiscale » dont la France était « championne ». Il a, toutefois, considéré que la diminution de l'attractivité de la France s'expliquait, avant tout, par les 35 heures et la rigidité du droit du travail. Il s'est dit inquiet de la dérive des dépenses sociales et a souhaité que le recours à l'usager se fasse dans la transparence.
M. Roland du Luart s'est dit sceptique quant à l'opportunité d'une loi d'orientation fiscale. Il a appelé de ses voeux une réforme de la fiscalité du patrimoine et de l'épargne, en déplorant que « les Français qui réussissent quittent le pays ». Enfin, il a indiqué que les biocarburants ne pourraient se développer qu'au prix de fortes subventions.
M. Marc Massion a évoqué la situation de la Suède, où le taux de PO était supérieur à 50 %, mais ne suscitait pas autant de débats qu'en France. S'appuyant sur l'exemple des cantines scolaires, il s'est montré opposé au transfert systématique du financement des services publics du contribuable vers l'usager.
A cet égard, M. Jean Arthuis, président , a estimé que la question du partage du coût entre l'usager et le contribuable était cruciale.
En réponse aux différents intervenants, M. Philippe Marini, rapporteur général, a indiqué, s'agissant du rapprochement entre l'IR et la CSG, que l'année 2004 devait être mise à profit par la commission pour avancer sur cette question, estimant qu'il était indispensable que tous les Français se sentent contribuables.
Au sujet de la loi d'orientation fiscale, il a indiqué qu'elle était déjà en germe dans le débat sur les PO prévu par l'article 52 précité de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), et en particulier son deuxième alinéa. Il a reconnu qu'il s'agissait d'un exercice difficile, mais auquel le gouvernement et le Parlement devaient s'astreindre, sauf à placer la politique fiscale entre les mains des « techniciens » de cette matière.
S'agissant des biocarburants, il s'est félicité de l'intérêt des commissaires sur ce sujet. Il s'est dit confiant dans les différentes options techniques et économiques envisageables et a souhaité que la France retrouve sa place de chef de file.
Sur le niveau optimal des PO, il a reconnu qu'il fallait considérer les dépenses publiques qui en étaient la contrepartie. Il a évoqué la Suède, où le pacte national repose sur un taux de PO élevé et un contrôle fiscal beaucoup plus fouillé qu'en France. Il a par ailleurs souhaité qu'une analyse de l'évolution structurelle, et non pas conjoncturelle, du taux de PO puisse être faite, rappelant les théorèmes de « DSK » (les impôts baissent mais les PO augmentent, en période de forte croissance) et de « Lambert » (les impôts baissent et les PO baissent encore plus, en période de faible croissance). Il a considéré que la France demeurait en « cohabitation fiscale », compte tenu de l'accumulation des réformes.
Enfin, il a estimé que le courage politique de cerner les problèmes et d'y porter remède pouvait parfois être récompensé par l'opinion publique.
Puis la commission des finances a donné acte au rapporteur général de sa communication et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information .
DÉBAT SUR LES PRÉLÈVEMENTS
OBLIGATOIRES
ET LEUR ÉVOLUTION : PRÉPARER
LA FRANCE DE DEMAIN
Ce rapport d'information a été établi en vue du débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, prévu par l'article 52 de notre « Constitution financière », la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
Ce débat est essentiel.
Il constitue un « facteur commun » à la discussion annuelle du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale en procurant une vision consolidée des prélèvements supportés par les Français, qu'ils alimentent le budget de l'Etat ou la sécurité sociale.
Ce débat doit également être conçu comme un « débat d'orientation fiscale », permettant de s'interroger sur la structure des prélèvements obligatoires et d'envisager les inflexions qu'il faudrait lui apporter.
* 1 S'agissant de l'écart de taux de prélèvements obligatoires entre les données françaises et les données de l'OCDE (soit 43,9 % du PIB dans un cas et 44,2 % du PIB dans l'autre), il faut remarquer que l'OCDE retient comme approche les « recettes fiscales », ce que fait aussi le FMI. Sont donc exclues les recettes non fiscales. Le système comptable SEC utilisé par l'Union européenne et la France prend en compte l'ensemble des recettes mais avec des distinctions suivant qu'il existe, ou non, un service en contrepartie de l'imposition, si bien que toutes les recettes fiscales et non fiscales ne sont pas prises en compte dans la notion de prélèvement obligatoire. Ces différences méthodologiques expliquent les écarts de taux.
* 2 L'augmentation de 0,3 point de PIB des prélèvements des administrations publiques locales correspondant environ au montant de la fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) qui devrait être transférée aux départements en compensation des charges liées à l'exercice de la compétence « RMI ».
* 3 Objectif national des dépenses d'assurance maladie.
* 4 Philippe Marini, Joël Bourdin, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », commission des finances et délégation pour la planification, rapport d'information n° 343, Sénat (2002-2003).
* 5 Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003.
* 6 Cf. le rapport du Sénat n° 217, 2002-2003, page 146.
* 7 Rapport de l'Assemblée nationale n° 1110 tome 2, XII ème législature.
* 8 Une participation est dite substantielle à partir d'une certaine proportion du capital.
* 9 Alain Lambert, rapport d'information du Sénat n° 82 sur la fiscalité de l'épargne (1997-1998).
* 10 Rapport du Sénat n° 386 (2000-2001).
* 11 Belgique à partir de 2002.
* 12 Rapport du Sénat n° 483 (1998-1999).
* 13 Rapport de Michèle Debonneuil et Lionel Fontagné pour le conseil d'analyse économique en octobre 2002.
* 14 « La mobilité des facteurs de production et la baisse des coûts de transaction peuvent entraîner l'agglomération des activités dans les localisations déjà les plus attractives et les plus efficaces. »
* 15 Joël Bourdin et Philippe Marini, « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », Rapport du Sénat n° 343 (2002-2003).
* 16 Direction de la recherche, des études et de l'évaluation statistiques (DREES) - Etudes et résultats n° 175, juin 2002, Comparaison internationale des dépenses de santé.
* 17 DREES - Etudes et résultats n° 160, février 2002, Personnes âgées dépendantes et aidants potentiels : une projection à l'horizon 2040.
* 18 L'article 40 du projet de loi de finances pour 2004 portant sur les « modalités de compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI) » prévoit ainsi que chaque département recevra une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui représente, appliqué aux quantités de carburant vendues en 2003 sur l'ensemble du territoire, le montant des dépenses exposées par l'Etat au titre du RMI et du revenu de solidarité dans le département concerné. Le produit reçu par les départements évoluera ainsi en fonction des consommations de carburants, et ce dès 2004.
* 19 Il s'agit notamment de l'absence de prise en compte des charges liées à la nécessaire modernisation des gares régionales et du « manque à gagner » résultant pour les régions des tarifs sociaux décidés et mis en oeuvre par l'Etat.
* 20 Etaient représentés à cette réunion : l'Association des Maires de France, l'Association des Régions de France, l'Association des Départements de France, l'Association des Grandes Villes de France, la Fédération Hospitalière de France, la direction générale de l'administration et de la fonction publique, la direction générale des collectivités locales, la direction du budget et la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
* 21 On rappellera que le système autoroutier français a été construit non grâce à l'impôt des contribuables mais grâce à un système de concessions autoroutières où l'usager, par le péage, finance la réalisation de l'infrastructure.
* 22 La mise en place d'une comptabilité patrimoniale dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances sera une novation essentielle et doit pouvoir susciter la prise de conscience nécessaire à une meilleure gestion de l'Etat.
* 23 Celle-ci sera probablement supérieure au taux d'intérêt que l'Etat aurait acquitté s'il s'était endetté pour réaliser l'investissement.
* 24 « Mondialisation : réagir ou subir ? La France face à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises ». Rapport de la Mission commune d'information chargée d'étudier l'ensemble des questions liées à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises - n° 386 (2000-2001).
* 25 Les Echos du 15 octobre 2003 .
* 26 « Débat d'orientation budgétaire pour 2001 : comment être crédible en Europe ? », n° 373 (2000-2001).
* 27 Plus précisément, elle avait demandé au COE de simuler trois modalités de baisse des prélèvements obligatoires :
- une baisse de 1 point de TVA accompagnée d'une baisse de l'impôt sur le revenu de 8 % environ ;
- une baisse de l'impôt sur le revenu de 8 % associée à une baisse des cotisations sociales employeurs de l'ordre de 6,10 milliards d'euros ;
- une baisse de 1,5 point de TVA combinée à une réduction de l'impôt sur les sociétés de 5 %.
* 28 Celle-ci a en effet un impact direct sur l'emploi et le chômage (grâce à une diminution du coût du travail), un impact désinflationniste qui permet d'améliorer la compétitivité et un effet accélérateur sur l'investissement des entreprises.
* 29 « Successions et donations : des mutations nécessaires », n° 65 (2002-2003).
* 30 Dans le régime général, qui perçoit environ 90 % du total des cotisations sociales, environ 80 % des cotisations proviennent des employeurs et environ 20 % des cotisations sont acquittées par les salariés.
* 31 Le montant global des cotisations des actifs s'élèvera en 2004 à 186 milliards d'euros, dont 137,4 milliards d'euros pour la part patronale, 36,4 milliards d'euros pour la part salariale et 12,1 milliards d'euros pour les cotisations des actifs non-salariés.
* 32 Le Conseil des impôts a calculé qu'à dépenses constantes, ce changement de méthode entraînerait un transfert de charges de 410 millions d'euros soit 30 % du montant de la mesure. Le nombre de foyers bénéficiaires du nouveau régime atteindrait près du million tandis que ceux qui verraient leur situation se détériorer seraient au nombre de 400.000. Les 4/5 e des perdants appartiennent au dernier décile et subiraient une augmentation de cotisations d'impôts de 1.100 euros.
* 33 Le IV de l'article 32 de cette loi prévoit : « Chaque année dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances, le gouvernement retracera l'évolution des dépenses fiscales en faisant apparaître, de manière distincte, les évaluations initiales, les évaluations actualisées, ainsi que les résultats constatés. Les dépenses fiscales seront ventilées, de manière détaillée, par nature de mesures, par catégories de bénéficiaires et par objectifs ».
* 34 Chaque usine (3 pour l'ETBE, 4 pour le diester) est placée sous un régime suspensif douanier, la réduction de TIPP a lieu effectivement juste avant le mélange, en raffinerie, avec les carburants traditionnels d'origine fossile (essence et gazole).
* 35 ETBE : Ethyl Tertio Butyl Ether : mélange d'éthanol et d'isobutylène (résidu du raffinage des produits pétroliers) qui peut être ajouté à l'essence dans une proportion allant jusqu'à 15 %. Les raffineries de Feyzin, Dunkerque et du Havre produisent 100 % de l'ETBE français.
* 36 Qui devrait représenter 2 %, à cet horizon, au lieu de 1 % aujourd'hui de notre consommation de carburants fossiles (directive du 8 mai 2003).
* 37 Le principe de cette modulation avait été introduit, à la demande de la France, dans la décision du Conseil de l'Union européenne du 25 mars 2002, nous autorisant, par dérogation, à aider fiscalement nos producteurs, bien que leurs unités de fabrication, de par leur nombre et leur importance, ne puissent plus être considérées comme des « sites pilotes ».
* 38 Les véhicules équipés d'un moteur diesel ont représenté, en 2001, 56 % des immatriculations de voitures neuves en France. Chaque année, la consommation de gazole croît de 2,5 %, tandis que celle des essences (ordinaire et super) diminue de 1,5 %.
* 39 Ce fut le cas, par exemple, du nouveau dispositif en faveur de l'investissement privé locatif, présenté par amendement du gouvernement au cours de l'examen de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat.
* 40 A noter que ce chiffre est sensiblement différent de la somme des évaluations faites à l'occasion de l'examen des textes, selon les indications données par les différents ministères.
* 41 N° 82 (1997-1998).
* 42 N° 474 (1998-1999).
* 43 N° 118 (1997-1998).
* 44 N° 483 (1998-1999).
* 45 « Débat d'orientation budgétaire pour 2001 : comment être crédible en Europe ? », n° 373 (1999-2000).
* 46 N° 8 (2001-2002).
* 47 « Successions et donations : des mutations nécessaires », n° 65 (2002-2003).
* 48 « Une décennie de réformes fiscales en Europe : la France à la traîne », n° 343 (2002-2003).







