II. POUR UNE RÉFORME FISCALE D'ENVERGURE, EN FAVEUR DE NOS ACTEURS ÉCONOMIQUES
Les rapports appelant à une réforme fiscale d'envergure se succèdent ces derniers mois. Le rapport 28 ( * ) de MM. Christian Saint-Etienne et Jacques Le Cacheux consacré à la réforme fiscale, au nom du Conseil d'analyse économique, préconise ainsi une réforme du triptyque « impôt sur les sociétés - taxe sur les salaires - taxe professionnelle » pesant sur les entreprises, autour d'un taux d'impôt sur les sociétés unifié à 18 %, une taxe professionnelle à 2-2,75 % de la valeur ajoutée et une taxe sur les salaires plafonnée. Ce rapport 29 ( * ) présente d'une part le mérite de tracer la voie de la réforme fiscale en montrant qu'il est plus facile de procéder à une réforme fiscale globale qu'à une action impôt par impôt . Il appelle, d'autre part, à réfléchir à
l'impact d'un nouveau régime fiscal sur les recettes de l'Etat en adoptant un modèle économique dynamique : selon les travaux 30 ( * ) des économistes Mankiw et Weinzierl, professeurs à l'université de Harvard, une baisse du taux d'imposition des bénéfices des sociétés peut s'autofinancer partiellement dans des délais raisonnables. Selon les calculs de ces auteurs pour l'économie américaine, 50 % de la perte initiale de recettes fiscales est récupérée.
L'OCDE, dans son « Etude économique de la France 2005 », préconise également, selon des modalités différentes, des réformes fiscales profondes.
Votre commission des finances a acquis la conviction que dans une économie globalisée, la mobilisation d'impôts assis sur la production afin de financer des dépenses de cohésion sociale constitue un facteur particulièrement aggravant en matière de délocalisations d'activités. Ceci commande une réforme fiscale en faveur des assiettes d'imposition les plus mobiles, visant à décourager le nomadisme des activités et des emplois. Il s'agirait donc, en quelque sorte, de déplacer le centre de gravité des prélèvements de la production vers les produits.
Consciente du rôle de signal que joue l'impôt sur les sociétés en matière d'attractivité économique au sein d'une Union européenne à 25, votre commission des finances, si elle pense qu'une convergence à moyen terme, dans certaines limites, n'est pas inenvisageable, considère qu'un travail sur l'harmonisation des bases d'imposition est, à la fois nécessaire à l'échelle européenne, et favorable à la France.
A. A L'ÉCHELLE FRANÇAISE, LA FIN NÉCESSAIRE DES IMPÔTS DE PRODUCTION
Selon la terminologie actuelle, les ménages financent aujourd'hui 40,7 % du régime général de la sécurité sociale alors que les entreprises (y compris les entreprises individuelles) en assurent le financement à 46,5 % 31 ( * ) .
Certes, la tendance sur longue période est à la réduction de la contribution des entreprises (hors entreprises individuelles : elle est passée de 54 % en 1989, 46 % en 1995 et à 41,4 % en 2004). Il est en effet apparu que l'accroissement continu des dépenses de sécurité sociale depuis trente ans ne pouvait être financé par un effort à due concurrence des entreprises et qu'il convenait d'y associer davantage les citoyens, grâce à la création de nouvelles
impositions (CSG, CRDS..) ou à la prise en charge, via le budget de l'Etat, d'une partie des exonérations de charges mises en oeuvre en faveur des employeurs 32 ( * ) . Les exonérations de charges, dans leurs modalités actuelles, constituent néanmoins des « trappes à bas salaires » redoutables.
L'effort est donc encore inabouti, alors que les cotisations sociales, tout comme la taxe professionnelle et la taxe sur les salaires, sont directement intégrées dans les coûts de production : les produits français sur le marché mondial ont ainsi une part de leur prix dédié au financement de la sécurité sociale, ce qui n'est évidemment pas le cas des produits étrangers consommés en France. Alors que les facteurs de production sont de plus en plus mobiles, il est permis de considérer que le système de prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises est historiquement daté.
Prélèvements pesant sur les entreprises et intégrés dans les coûts de production 33 ( * )
(en milliards d'euros, impositions nettes en 2004)
|
Cotisation sociales patronales
|
116,0
|
|
Impôts « entreprises » affectés à la sécurité sociale : CSSS |
3,4 |
|
Taxe professionnelle |
15,6 |
|
Taxe sur les salaires |
8,7 |
|
Total |
143,7 |
Source : commission des finances du Sénat
Le poids des cotisations sociales dans les coûts de production est ainsi majeur.
Dans ce contexte, l'augmentation sur moyenne période de la part des prélèvements obligatoires affectée aux administrations de sécurité sociale est particulièrement inquiétante, d'autant qu'il s'agit d'une spécificité française.
Si, en 2000, 47,3 % des prélèvements obligatoires étaient perçus au profit des organismes de sécurité sociale, ce taux s'élevait à 24 % en moyenne dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Cet écart reflète largement les différents choix de société en matière de financement de la protection sociale.
Votre commission des finances préconise ainsi un partage des rôles en matière de fiscalité entre les entreprises et les citoyens , et une substitution d'autres impositions, établies sur des assiettes moins mobiles, aux impôts de production .
1. Un nécessaire partage des rôles entre les citoyens et l'entreprise
Dans une économie globale, dans le libre échange, il n'est plus possible de demander aux entreprises de prendre en charge la solidarité édictée par les Etats pour faire vivre la cohésion sociale. Aux entreprises, la responsabilité de l'activité, et donc de la création d'emplois. Aux citoyens le financement de la solidarité. Ce partage des rôles est essentiel, il permet aux citoyens de se déterminer sur le niveau de prise en charge collective des risques sociaux qu'ils souhaitent assumer. Il permet de dissiper une illusion : quel impôt prélevé sur les entreprises n'est pas in fine à la charge des consommateurs et des ménages ?
a) Aux citoyens, le financement des dépenses de cohésion sociale
Si l'assurance vieillesses et les accidents du travail sont indissociables du contrat de travail, il n'en est pas de même de l'assurance maladie et des allocations familiales. Le financement de ces deux prestations ne saurait incomber aux seuls entreprises et salariés. Il relève de la solidarité de l'ensemble des Français. Un financement par les entreprises et les salariés, dans des proportions aussi importantes, des dépenses d'assurances maladie et des allocations familiales, dont le niveau relève d'un choix de société opéré par les citoyens eux-mêmes, est ainsi contestable sur le plan des principes et constitue sur un plan économique un danger.
En transférant le financement de l'assurance maladie et de la branche famille aux citoyens, de manière plus large qu'aujourd'hui, la collectivité nationale se verrait investie d'un débat nécessaire sur le niveau des risques sociaux ayant à être assumé, sur un plan financier, par la solidarité publique. Ce transfert aurait un pouvoir de responsabilisation des citoyens sur l'évolution des dépenses de cohésion sociale.
Il aurait un effet favorable sur la stabilisation de ces dépenses de cohésion sociale, la maîtrise de celles-ci constituant un élément majeur dans la réussite d'une réforme fiscale. En son absence, l'évolution des déficits publics ne peut être que défavorable, puisque votre commission des finances fait le constat selon lequel « la crise de la sécurité sociale » est surtout une « crise de la dépense », chaque assuré social étant, en quelque sorte, ordonnateur de la dépense publique.
b) Aux entreprises, la création d'activités et d'emploi
Dans le partage proposé par votre commission des finances, les entreprises retrouveraient leur mission première, celle de créer de l'activité et des emplois. Ceci suppose un choix fiscal différent de celui opéré aujourd'hui.
La fiscalité française se caractérise en effet par une imposition du travail nettement plus lourde que celle des autres pays européens, avec un taux d'imposition implicite du travail de 41,8 %, contre 36,3 % pour l'Union européenne, comme l'indique le graphique ci-après.
Taux d'imposition implicites par type d'activité économique (2002) 34 ( * )
(en %)
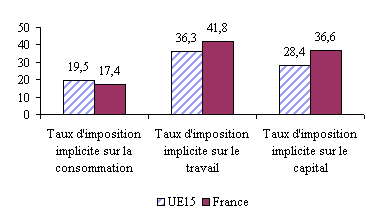
Source : Commission européenne
L'abaissement du coût des prélèvements pesant sur le travail est considéré de manière unanime par les analyses économiques comme favorisant l'emploi. Ainsi, selon les chiffres disponibles, une baisse des cotisations employeurs de 15 milliards d'euros , soit 1 % du PIB environ, augmenterait le
PIB de 0,6 point et réduirait le taux de chômage de 1,8 point , et serait neutre pour le solde public à partir de la quatrième année.
* 28 Non encore publié, mais votre commission a tenu à auditionner ses auteurs.
* 29 La réforme, conçue pour maintenir inchangé le niveau global des prélèvements obligatoires, diminuerait l'imposition des entreprises à hauteur d'un point de PIB, soit 15 milliards d'euros, et augmenterait d'autant celle des ménages.
* 30 Gregory Mankiw, et Mathew Weinzierl « Dynamic Scoring : A Back-of-the-Envelope Guide ». Janvier 2005.
* 31 L'Etat contribue à hauteur de 12,8 %.
* 32 D'un certain point de vue, une « petite TVA sociale » existe donc déjà puisque la TVA (45 % des recettes fiscales nettes de l'Etat) contribue au financement de ces exonérations de charges (18,7 milliards d'euros compensés par l'Etat en 2004), sans incidence notable sur la consommation.
* 33 L'impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices, n'est pas intégré dans ce calcul.
* 34 Les taux d'imposition implicites mesurent la charge fiscale moyenne réelle imposée aux différents types de revenus ou d'activités économiques. Ils expriment les recettes fiscales cumulées, en pourcentage de la base d'imposition potentielle pour chaque domaine.







