II. L'ÉCOLE À DEUX ANS : UNE QUESTION DE SOCIÉTÉ
L'enjeu d'une scolarisation précoce en France dépasse le seul questionnement autour du bien-être du jeune enfant ; il participe d'un débat de société qui s'inscrit dans une dimension d'ordre social, économique et territorial. S'interroger sur l'entrée à l'école maternelle à deux ans renvoie à la question de ses modalités et de ses objectifs. Deux questions doivent être abordées : où sont les enfants de deux ans aujourd'hui dans notre pays ? Pourquoi ce débat surgit-il avec autant d'acuité ?
L'école maternelle offre à l'heure actuelle un espace entre éducation familiale et éducation scolaire . Elle est d'ailleurs en situation de quasi monopole pour l'accueil spécifique des enfants de deux à cinq ans. La découverte de la vie en société dans une structure collective s'effectue pour le plus grand nombre d'enfants lors de l'entrée à l'école maternelle.
A. L'ÉCOLE MATERNELLE, UNE OPPORTUNITÉ DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE
Dans les deux décennies précédentes, l'éducation nationale a pu répondre à une demande sociale et l'école maternelle a représenté une opportunité nouvelle. Ce rôle joué par l'institution scolaire est d'autant plus prégnant aujourd'hui que les données socio-démographiques pèsent fortement sur les capacités d'accueil des différents modes de garde des enfants de moins de trois ans .
On peut considérer que l'école maternelle fournit un service aux parents avec la prise en charge des jeunes enfants. Elle est en quelque sorte d'un point de vue social et économique un mode d'accueil particulier à destination des deux-trois ans, âge de transition pour lequel des structures innovantes ou spécifiques sont quasi-inexistantes . Il convient de noter que les différents rapports, récemment parus, sur les modes de garde de la petite enfance intègrent effectivement l'école maternelle.
1. La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle
En France, le dynamisme démographique et le taux d'activité féminine élevé influent fortement sur la politique de la petite enfance et conditionnent les besoins en mode de garde. Cette politique familiale mobilise des moyens financiers importants et de nombreux acteurs publics et privés, même si elle ne permet pas de satisfaire l'ensemble des besoins.
a) Le dynamisme de la natalité
Au 1 er janvier 2007, la France compte un peu plus de 4,8 millions d'enfants de moins de six ans, qui se répartissent selon le graphique ci-après. La répartition par âge des enfants de moins de six ans montre une forte progression des moins de trois ans , désormais plus nombreux que les trois-cinq ans et témoigne d'une vitalité démographique propre à notre pays . En 2007, 783 500 naissances ont été comptabilisées en France métropolitaine et 33 000 dans les départements d'outre-mer, soit un total de 816 500. En 2006, on a atteint un niveau très élevé avec 830 900 naissances.
En effet, la France est un des pays les plus féconds de l'Union européenne avec un nombre de naissances actuellement inégalé depuis vingt-cinq ans. Certes, le nombre de femmes de 20 à 40 ans continue de diminuer, mais les femmes ont plus d'enfants qu'auparavant : l'indicateur conjoncturel de fécondité augmente. Il atteint deux enfants par femme en 2006, niveau le plus haut depuis trente ans.
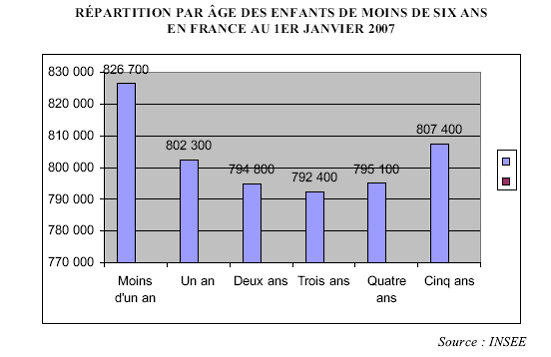
Après une décroissance constante durant les années 1980, le nombre d'enfants de moins de six ans augmente chaque année depuis 2000 .
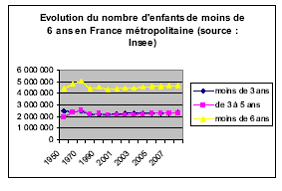
Un tel dynamisme démographique a un effet d'impact substantiel et pose avec acuité pour les années à venir la question de l'offre d'accueil en termes de modes de garde. La pression démographique sur les modes de garde se combine avec le travail des femmes de plus en plus développé.







