III. LA NOUVELLE LUTTE DES CLASSES ET L'OBSOLESCENCE DÉMOCRATIQUE
«
C'est la lutte des classes. Ma classe est en
train de la gagner.
Elle ne devrait pas
. »
Warren
Buffett
73
(
*
)
«
Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de
défaire méthodiquement
le programme du Conseil national de la
Résistance.
»
Denis Kessler
74
(
*
)
Les deux citations en exergue rappellent que la mutation idéologique qui a guidé la reconstruction de l'Empire américain sur des bases nouvelles après la rupture des accords de Bretton Woods était non pas le pur produit d'une illumination intellectuelle mais une arme politique au service d'intérêts matériels et sociaux puissants bien précis.
Le plus intéressant, c'est la réserve du milliardaire américain Warren Buffett sensible aux risques de déstabilisation sociale et politique liés à cette reprise de la lutte des classes sur les ruines des compromis de l'après-guerre - New Deal aux États-Unis, programme du CNR en France et Welfare state en Grande-Bretagne -, face à l'enthousiasme militant de l'ex-maoïste et actuel P-DG du groupe de réassurance Scor.
Cette conversion, parmi beaucoup d'autres, au nouvel ordre mondial est significative d'un fait politique majeur : la neutralisation du corps électoral, l'alternance au pouvoir, dans chaque pays, des deux camps d'accord sur l'essentiel interdisant toute remise en cause démocratique de l'ordre libéral. Le problème, c'est que cette indéniable facilité a rendu très difficile, sinon impossible, la réforme paisible d'un système que seules des crises de plus en plus graves semblent pouvoir ébranler faute de pouvoir le faire évoluer.
Tout aussi préoccupant, le fait que ce nouvel ordre se traduit non pas seulement par une répartition plus inégalitaire des revenus et des patrimoines mais par une dissociation du corps social tout entier, sur le modèle des pays autrefois qualifiés de sous-développés. Tel est le propos du livre de Christopher Lasch La Révolte des élites 75 ( * ) : « Naguère, c'était la "révolte des masses" qui était considérée comme la menace contre l'ordre social et la tradition civilisatrice de la culture occidentale. De nos jours, cependant, la menace principale semble provenir de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale et non pas des masses [...]
« L'évolution générale de l'histoire récente ne va plus dans le sens d'un nivellement des distinctions sociales, mais de plus en plus vers une société en deux classes où un petit nombre de privilégiés monopolisent les avantages de l'argent, de l'éducation et du pouvoir [...] De nos jours, la démocratisation de l'abondance - l'attente de chaque génération de se voir bénéficier d'un niveau de vie qui était hors de portée de ses prédécesseurs - a cédé la place à un retournement où des inégalités séculaires commencent à se réinstaurer, quelques fois à une vitesse terrifiante, et parfois si progressivement que nous ne nous en rendons pas compte. »
Et pour finir, cette observation de Lasch sur la vie politique des États-Unis, il y a plus de vingt ans mais d'une actualité brûlante : « On assiste à des batailles idéologiques furieuses sur des questions annexes. Les élites qui définissent ces questions ont perdu tout contact avec le peuple. Le caractère irréel et artificiel de notre vie politique reflète à quel point elle s'est détachée de la vie ordinaire, en même temps que la conviction secrète que les vrais problèmes sont insolubles. »
Sans l'expliquer à lui seul, ce désenchantement s'enracine dans un double mouvement caractéristique de l'après-Bretton Woods : une régression de la part des revenus du travail face à ceux du capital et une augmentation des inégalités qu'il s'agisse des revenus du travail ou des patrimoines.
Jusqu'à la crise de 2007, les effets économiques et sociaux de ces évolutions seront masqués par un remède miracle qui, à l'usage excessif qui en sera fait, se révélera catastrophique : l'endettement, endettement public et plus encore privé.
A. DÉFLATION DES REVENUS DU TRAVAIL ET ENDETTEMENT
Selon la théorie, le marché du travail, comme les autres marchés, est autorégulé : quand les salaires sont trop hauts, l'activité ralentit, le chômage augmente et cette pression entraîne un retour des salaires à leur niveau d'équilibre. Cette autorégulation suppose donc l'absence de grains de sable comme les syndicats et une absence d'encadrement par un code du travail ou l'existence d'un niveau de salaire minimum.
Ce sera le thème des innombrables « réformes du marché du travail » qui se succéderont dans tous les pays, tout particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne mais aussi ailleurs en Europe, encouragées par Bruxelles et la BCE, au nom de la croissance économique et de la lutte contre le chômage.
Ce retour à la politique de l'offre marquera aussi une rupture du « pacte fordiste », du nom de l'industriel bien connu qui pensait qu'en payant correctement ses ouvriers il créait la demande qui lui permettrait d'écouler les voitures qu'il produisait.
1. La « modernisation » du marché du travail
Moderniser le marché du travail signifie empêcher une augmentation des salaires au-delà de ce que les gestionnaires d'entreprises et leurs actionnaires jugent acceptable au regard de la concurrence et de leurs exigences. Au nom, une fois encore, de la lutte contre le chômage et l'inflation. Plusieurs méthodes vont être mises en oeuvre, des plus brutales au plus subtiles.
• La répression syndicale sera la méthode Reagan (11 000 licenciements lors du conflit des contrôleurs aériens), Bush et Thatcher, mais, dès les années 1970, une offensive patronale se déploie aux États-Unis contre les syndicats, avec notamment des licenciements illégaux de syndicalistes. Entre 1960 et 1990, le taux de syndicalisation y passe de 30,4 % à 13,5 %.
En Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, sortie victorieuse des conflits violents avec les puissants syndicats des mineurs, des dockers et des imprimeurs, limite les droits syndicaux et de grève. Son offensive est relayée par les employeurs. Les effectifs syndicaux britanniques passent de 13,2 millions en 1979 à 8,9 millions en 1989 puis 7,4 millions en 2003.
Bien qu'il n'y ait eu aucune répression syndicale en France, on y observe aussi une baisse très importante des effectifs, qui passent de 3,6 millions en 1979 à 2,2 millions en 1989, pour se stabiliser autour de 1,8-1,9 million à partir des années 1990 76 ( * ) .
• La précarisation de l'emploi et le travail à temps partiel sont une autre méthode. Partout, le travail à temps partiel augmente :
- il passe de 16,7 % de l'emploi total en 1996 en Allemagne, à 26 % en 2007 ;
- en 2007, il représente 46,8 % de l'emploi aux Pays-Bas, 25 % en Grande-Bretagne et en Suède, 19,7 % pour l'ensemble de la zone euro ;
- à 17,2 %, contre 16,3 % en 1996, la France résiste plutôt mieux.
En même temps, le nombre de personnes ayant un deuxième travail en plus de leur emploi principal augmente. Entre 1983 et 2007, il est multiplié par 3,1 en Allemagne, 3,3 aux Pays-Bas, 3,2 en Espagne, 2 en Grande-Bretagne. Il varie peu dans une France qui renâcle à se laisser moderniser. Cela représente plus de 1,4 million de personnes en Allemagne et plus d'un million au Royaume-Uni.
• Plus indirectes sont l'arme de la concurrence internationale et la crainte des délocalisations, ou l'arme de l'immigration , particulièrement de l'immigration temporaire, voire illégale. Très utilisée aux États-Unis et en Grande-Bretagne, plus l'Europe s'agrandira, plus elle jouera à plein jusqu'à la crise.
• La « désinflation compétitive » française puis allemande est aussi à mettre au rang des moyens utilisés pour peser sur le coût du travail :
- désindexation des salaires sur l'inflation (suppression de « l'échelle mobile des salaires », 1982-1983) en France, tout en maintenant une forme d'indexation, à géométrie variable, pour le Smic ;
- invention de la « désinflation compétitive » que l'Allemagne portera à son point de perfection. C'est Gerhard Schröder et Hans Eichel qui imposent aux travailleurs allemands une réforme drastique du système d'assurance maladie et des retraites et qui parviennent, avec le soutien des entreprises industrielles exportatrices, à une réforme de la rémunération de la main-d'oeuvre aboutissant à ce que les Allemands travaillent beaucoup plus pour le même revenu, voire pour gagner moins.
L'établissement d'une monnaie européenne unique sera le levier rendant présentable cette politique. C'est officiellement, en effet, pour éviter une sortie du franc du « serpent monétaire » que François Mitterrand remplace la politique de relance économique des débuts de la gauche au pouvoir par la rigueur. Comme le montre l'encadré ci-dessous - « Un Américain à Paris » -, la réalité est probablement plus complexe et la dimension idéologique de la décision évidente.
|
Un Américain à Paris : Robert Eisner Le « tournant de la rigueur » vu par un Keynésien Rober Eisner, professeur d'économie à l'Université Northwestern, est l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Il présidera l'Association américaine d'économie en 1988-1989. Durant l'hiver 1982-1983, professeur invité à l'Université de Paris-Nanterre, il rédige, à la demande du Commissariat général du Plan un rapport sur les travaux des commissions constituées dans le cadre de l'élaboration du IX e Plan et sur les documents préliminaires à celui-ci 77 ( * ) . Le document est aujourd'hui introuvable mais nous en connaissons la substance au travers d'un article publié dans le revue Challenge (juillet-août 1983) : « Which way for France » (Quelle voie pour la France). Cette disparition du rapport des rayons des bibliothèques et la faible publicité donnée aux positions de Robert Eisner sont bien évidemment sans rapport avec le fait qu'elles n'étaient guère favorables à la manière dont le « tournant de la rigueur » avait été pris. Pour lui, le changement à 180 degrés de la politique économique du gouvernement Mauroy s'est imposé d'abord pour des raisons non pas objectives, mais culturelles : l'obsession des élites et de la classe politique française de la « monnaie forte ». En effet, écrit-il : « Le déficit extérieur français n'a rien d'exceptionnel et, surtout, résulte pour l'essentiel des nouvelles importations de pétrole. Les chiffres l'attestent : pour 1981, le déficit extérieur total s'élevait à 46 MF, pour 62 MF de déficit envers les pays de l'OPEP, compensé largement par un excédent d'exportations militaires de 45 MF. « Il est impossible de faire comprendre aux Français que, tant qu'existe le cartel des pays de l'OPEP dont la balance des paiements est excédentaire, il est impossible d'éviter que les autres nations ne soient pas déficitaires. Comment faire comprendre aux responsables français que la situation actuelle s'analyse comme l'échange par les pays pétroliers de leur capital enterré sous forme de pétrole, en capital sous forme d'investissements dans les autres pays ? La France n'a ni raison, ni intérêt, à refuser cette loi, à refuser de prendre sa part des dettes à l'égard de l'étranger, dettes qui sont la simple contrepartie des actifs, des pays de l'OPEP. « Allons plus loin : les déficits commerciaux et l'emprunt à l'étranger peuvent fort bien persister très longtemps dans les pays en forte croissance, comme en témoignent les États-Unis depuis une centaine d'années. Si vraiment les Français croient qu'un investissement massif est nécessaire pour soutenir la productivité et la croissance, ils ne devraient avoir ni crainte ni honte à emprunter à l'étranger pour financer cet investissement. Le fruit attendu de cette croissance devrait largement financer le remboursement des intérêts puis du capital. Si, en revanche, on a des doutes sur la capacité des investissements à générer les revenus qui permettront de rembourser l'emprunt, alors il ne faut pas le contracter, indépendamment de toute considération sur la balance des paiements. « On doit observer que, même à son niveau jugé élevé de 93 milliards de francs en 1982, le déficit commercial français n'a jamais dépassé 3 % du PIB. L'OCDE a estimé la dette extérieure française en 1982 à 14,5 milliards de dollars, soit aussi 3 % du PIB. Le ministre français Jacques Delors a admis une augmentation de la dette extérieure de 8,8 milliards de dollars, soit moins de 2 % du PIB. L'ensemble de la dette extérieure française, nette, a été estimé par l'OCDE à 45 milliards de dollars, environ 9 % du PIB. Au taux d'intérêt réel de 5 %, le coût du service de la dette extérieure représente seulement 0,45 % du PIB annuel et un peu moins de 2 % des exportations en valeur. Si le taux réel d'intérêt était deux fois plus élevé (c'est-à-dire 10 %) et la dette extérieure deux fois plus élevée également, le coût du service de la dette ne représenterait que 1,8 % du PIB et environ 9 % des exportations. Ces chiffres justifient-ils un tel ralentissement de l'économie française ? » La réponse est évidemment « non » et rigueur ne signifie pas forcément « stagnation » avec son cortège de chômeurs. Le gouvernement de la gauche, ne manque, en effet, pas de moyens. Robert Eisner précise : « On avance avec raison que le talon d'Achille d'un marché libre, d'une économie capitaliste est le chômage : il y est souvent élevé et, dans les périodes de récession, insupportablement élevé. Il en résulte un énorme gâchis, tant des ressources humaines que du capital. Mais, s'il est vrai que dans une économie mixte, les socialistes ne peuvent défier les lois et rapports économiques fondamentaux, ne peuvent-ils pas, tout en les respectant, au moins éliminer le chômage involontaire ? « Avec la nationalisation du système bancaire, des industries clés et sa solide majorité parlementaire, le gouvernement [socialiste] dispose de tous les instruments d'une politique budgétaire et monétaire de [soutien de la demande en vue du] plein emploi. Pour un gouvernement de gauche, soutenu par les travailleurs et leurs syndicats, il devrait être possible de faire accepter une limitation des hausses du coût du travail résultant du plein emploi. De fait, il a déjà réduit l'indexation qui avait beaucoup contribué à l'inflation. « Le gouvernement peut aussi se servir des nationalisations, en respectant les règles du marché, pour orienter la production vers les types d'investissement et de consommation, tant du secteur public que du secteur privé, correspondant le mieux aux préférences sociales et individuelles. Il n'est pas nécessaire de réarmer, comme l'avait fait l'Allemagne nazie, pour rétablir le plein emploi ; ni comme Keynes l'avait facétieusement suggéré il y a un demi-siècle de [payer la moitié des chômeurs à déterrer ce que l'autre moitié avait été payée à enterrer pour relancer la consommation et rétablir le plein emploi !] Les plans ambitieux de révolution technologique en France permettent, peut-être pour la première fois, de concevoir des politiques de plein emploi parfaitement productives. » Quand bien même l'obsession du déficit extérieur, de l'équilibre budgétaire et du franc fort serait politiquement incontournable, il y a d'autres moyens que celui qui a été choisi - la mise au ralenti de l'appareil économique - pour y parvenir. Le remède de fond est de rendre la France moins dépendante de ses exportations, en orientant plus l'économie nationale vers le marché intérieur. Ce qui fait dire à Robert Eisner : « L'obsession de la balance extérieure commerciale risque d'être très dangereuse pour l'économie française. Elle repose sur le postulat d'une croissance par les exportations industrielles, qui met la France à la merci du reste du monde. Une chose est de viser l'excellence technologique, une autre d'espérer être tellement en avance sur le reste du monde qu'il acceptera d'échanger ses produits peu coûteux contre nos produits de haute technologie. Cela revient à subordonner son avenir à la capacité et à la volonté du reste du monde d'acquérir sa production. Un régime socialiste peut contrôler son propre marché. Si ce marché produit efficacement des biens utiles, les citoyens les achèteront. Il est plus sûr de produire directement pour la consommation intérieure que de s'en remettre excessivement à l'exportation pour assurer la consommation des ménages. Certes, il ne faut pas négliger l'importance du commerce extérieur, l'allocation des ressources ne doit pas être biaisée en sa faveur. Elle ne doit pas être supérieure à ce qu'elle serait si le libre jeu des avantages comparatifs et de la spécialisation internationale jouait. » Robert Eisner évoque alors un remède, les taux de change flottants, qui permet de regagner la compétitivité qu'une monnaie surévaluée fait perdre : « Maintenir une monnaie surévaluée pour s'assurer des avantages à l'échange n'est pas une bonne chose. Cela crée inéluctablement des déficits [...] Le franc était probablement surévalué par rapport au mark et au florin hollandais et les dévaluations du 21 mars pourraient bien ne pas avoir été suffisantes pour le corriger [totalement]. La France aurait eu meilleur compte à menacer de sortir du SME tout en laissant le franc flotter [...] L'indépendance économique, sans protectionnisme, signifie pour la France miser sur la croissance économique, la réduction du chômage et s'affranchir de la déflation allemande [...] Une monnaie surévaluée engendre un déficit commercial que l'on tente de corriger par une conversion de la production intérieure vers l'exportation et l'importation des produits que l'on ne fabrique plus. Cette façon de voir dispose de solides soutiens en France. « C'est pourtant un gaspillage des ressources du pays. Cela revient, en effet, à importer à un prix sous-évalué, du fait du taux de change, de plus en plus de produits, payés l'exportation d'une production interne coûteuse. Cela revient à mobiliser les ressources nationales vers l'exportation pour permettre aux riches Français d'acheter de coûteuses Mercedes à des prix artificiellement bas. » À défaut de mise en flottement du franc, Robert Eisner prône « une dévaluation partielle ou déguisé [...] Celle-ci pourrait prendre la forme d'une surtaxe générale sur toutes les importations et, si les pays étrangers l'acceptent sans représailles, de subventions à l'exportation. » Cette solution ne va pas sans inconvénients, mais, pour le professeur d'économie américain, serait « préférable de très loin à la solution classique adoptée par le gouvernement français : réduire le déficit extérieur au prix d'un ralentissement de l'économie française. » Robert Eisner évoque ensuite d'autres mesures sur lesquelles il serait trop long de revenir, qu'il juge préférable à la déflation. Ultime concession de sa part, si le gouvernement maintient son objectif de déflation, « celle-ci ne saurait être qu'une aberration temporaire, permettant ensuite de tout jouer sur la maximisation de la croissance et de l'emploi. [...] Une fois qu'on saurait ce que la France " peut" faire et doit faire, les forces du marché et l'initiative individuelle pourraient alors être libérées avec pour objectif la croissance la plus élevée possible et le véritable plein emploi. « Telle serait la preuve et la seule du succès de l'expérience socialiste française. » Ce ne fut pas le cas. Pour l'heure, constate Robert Eisner : « Le 25 mars [1983], le cours de l'économie française a brutalement changé, au moins à court terme [comme on sait, ce sera pour longtemps], si ce n'est pour les cinq prochaines années du Plan. La rigueur, malgré les démentis répétés du gouvernement, s'est traduite en austérité. [...] Remarquons l'extraordinaire brutalité des mesures d'austérité du gouvernement socialiste : il retire deux fois plus à la demande interne qu'il n'avait injecté dans son premier programme de croissance. » Or, ces mesures ne s'imposent que si le rétablissement de la balance des paiements devient l'objectif essentiel de la politique économique et si les prévisions très pessimistes quant à la croissance mondiale et à l'évolution du prix du pétrole se vérifient. Robert Eisner fait observer : « Ce que les Français ne semblent pas voir, c'est que la réalisation de leurs prévisions pessimistes quant à l'évolution de l'économie mondiale, conjuguée au maintien de la réduction du déficit de la balance des paiements comme objectif prioritaire, aurait pour conséquence d'imposer à leur économie une cure de déflation toujours plus grande [...] Si, en revanche, comme nous le pensons et ce que justifient toutes les prévisions, les prix du pétrole continuent à baisser alors qu'une reprise se manifeste aux États-Unis, comme dans le reste du monde, la France aura brisé pour rien le rêve socialiste. » |
C'est aussi au nom des engagements de Maastricht, l'euro créé, que la BCE impose des taux d'intérêt directeurs plus élevés que ceux de nos concurrents et des politiques budgétaires restrictives.
2. Les conséquences de la « déflation » des revenus du travail
a) Régression de la part des salaires dans la répartition de la valeur ajoutée des entreprises
Au vu de la difficulté de l'évaluation du phénomène, de l'importance des conventions adoptées par les chercheurs, il n'est pas étonnant que les estimations du phénomène varient d'un pays à l'autre et d'une étude à l'autre. Mais, d'une manière générale, on peut s'accorder sur les points suivants :
- de la fin des années 1950 à 1975/1980-1983, selon les pays, la part des salaires dans la valeur ajoutée croît, légèrement au cours des années 1960, avec une accélération au début des années 1970 ;
- à partir du point d'inflexion, elle baisse, de l'ordre de 7 % à 12 % selon les études et les pays.
En Europe, d'après la Commission européenne 78 ( * ) , depuis 1975, la part du travail dans la valeur ajoutée aurait baissé de 12 %. En France, l'inflexion se situe en 1982-1983 pour atteindre un niveau nettement inférieur à ce qu'il était en 1960 : « Dans l'Europe des quinze, la période 1960-1980 est caractérisée par l'augmentation régulière de la part des revenus du travail dans la plupart des pays de la zone, tandis que la période de 1981 à 2006 est caractérisée par un déclin de cet indicateur. »
Pour la période 2000-2005, il apparaît qu'elle continue à diminuer pour l'ensemble des pays de l'OCDE, en particulier l'Allemagne, alors qu'elle reste stable en France.
Variation de la part des revenus du travail dans le partage de la valeur ajoutée des entreprises, moyenne de 15 pays de l'OCDE
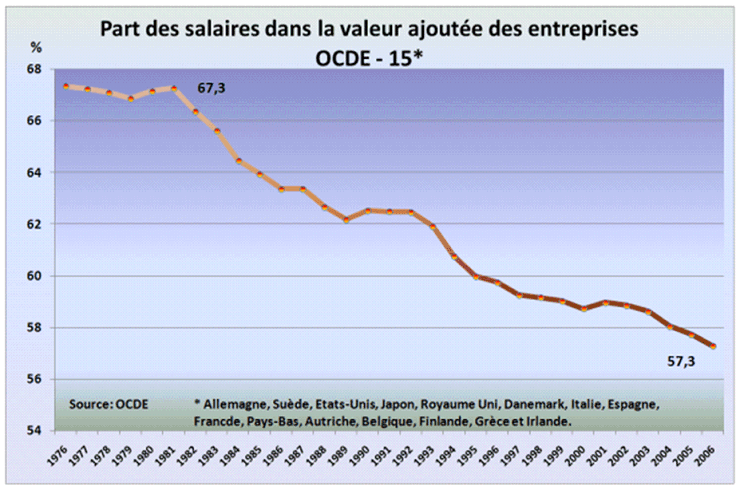
b) Régression des revenus du travail en général par rapport à ceux du capital
Les travaux de Thomas Piketty 79 ( * ) permettent d'apprécier, sur l'exemple du Royaume-Uni et de la France, l'évolution des revenus du travail par rapport à ceux du capital (loyers, profits, dividendes, intérêts), sur le long terme.
Les deux graphiques suivants montrent que, tendanciellement, les revenus du travail augmentent et ceux du capital baissent en France jusqu'en 1980 et au Royaume-Uni jusqu'en 1970. Au point haut, les revenus du travail atteignent 70 % du revenu national en France (plus de 85 % durant la Seconde Guerre mondiale) et 80 % au Royaume-Uni, contre respectivement 20 % pour les revenus du capital. Par référence au point haut, la baisse de la part des revenus du travail par rapport à ceux du capital est de 7 % à 8 %.
On verra un peu plus loin, en étudiant l'évolution des inégalités de revenus, qu'aux États-Unis aussi les revenus du capital prendront de plus en plus de place dans la croissance des hauts revenus.
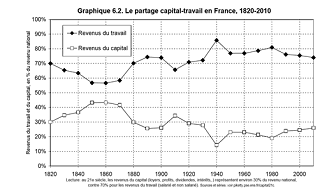
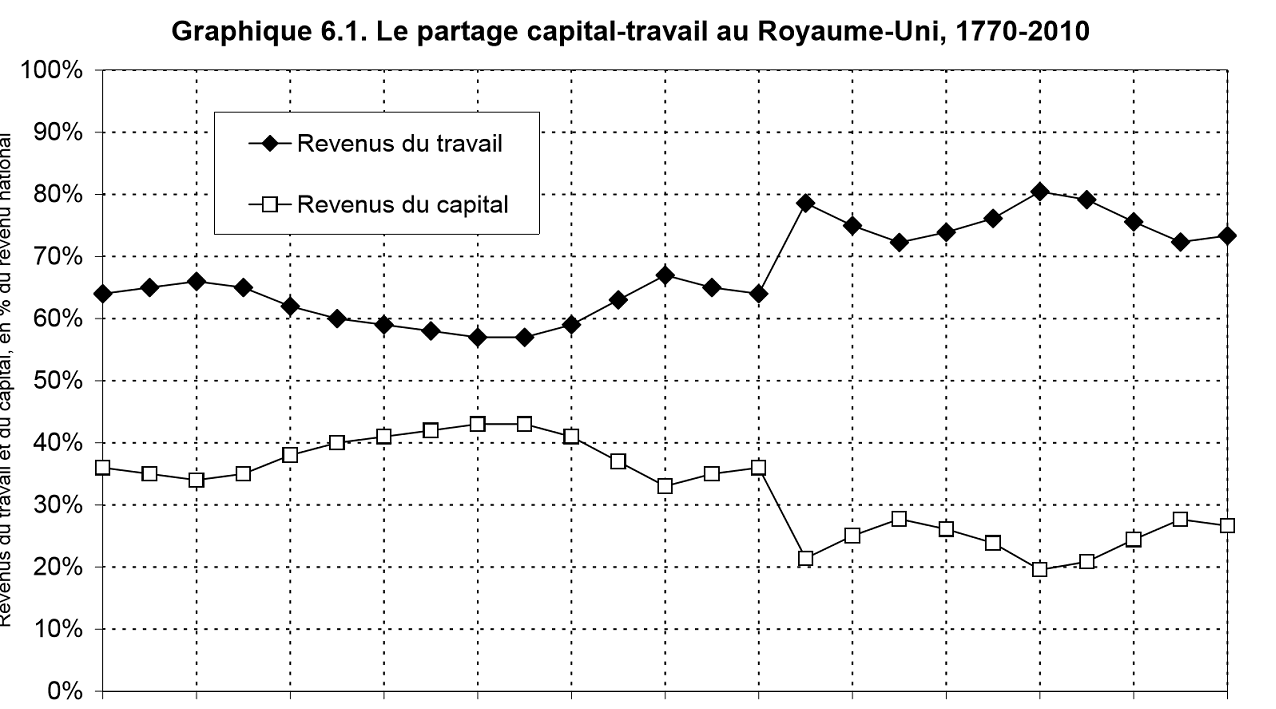
Source : Thomas Piketty - Le Capital au XXI e siècle - Seuil -2013
3. L'endettement, moteur de la croissance
C'est donc une véritable « déflation salariale », pour reprendre l'expression de l'économiste français Jean-Luc Gréau, et plus largement une « déflation des revenus du travail », qui s'est opérée dans tous les pays développés depuis le tournant 1975-1983.
a) Un endettement général
La solution pour y remédier - aux antipodes des principes libéraux -, ce qui ne manque pas de saveur, sera l'endettement privé (entreprises et ménages) et public (États, institutions sociales, collectivités territoriales). Engagée aux États-Unis, diffusée par les pays anglo-saxons ou sous influence anglo-saxonne, la recette a été appliquée, plus ou moins ouvertement, dans tous les pays. Là où elle le sera modérément, comme en France et en Allemagne, la croissance sera moins forte.
À partir des années 1980, le taux global d'endettement va augmenter dans tous les pays de l'OCDE, avec, jusqu'à récemment, deux variantes :
- le modèle anglo-saxon marqué par des États plutôt moins endettés que la moyenne et des ménages très endettés. Avec la crise, il cumulera forte dette des ménages (dont une partie insolvable) et explosion de la dette publique ;
- le modèle européen continental, ou plutôt « maastrichtien », marqué par une dette publique plus forte et un endettement des ménages plus faible. En France, dans la polémique sur l'endettement public, les zélotes de l'équilibre budgétaire oublient soigneusement ce point. La crise a montré qu'à tout prendre l'endettement incontrôlé des ménages était plus dangereux que celui de l'État. Les exemples irlandais et espagnol sont là pour le montrer si subsistait encore un doute là-dessus.
b) La dette des ménages, principal moteur de la croissance
Aux États-Unis, la dette des ménages aura progressé de 80 % sous l'ère Bush, passant de 5 919 milliards de dollars en 1998 à 13 827 milliards de dollars en 2007, soit pratiquement l'équivalent du PIB (14 545 milliards de dollars) et plus que la dette de l'État.
En Europe, la Grande-Bretagne bat des records aussi. La barre des 100 % du PIB est franchie en 2006.
L'Espagne suit : 78 % du PIB en 2006.
L'Allemagne se situe autour de 60 %, en baisse par rapport à la flambée qui avait suivi la réunification.
La France est encore à 43 % du PIB en 2006.
En termes de pourcentage du revenu disponible, autre manière de mesurer l'endettement des ménages, les États-Unis atteignent les 140 % en 2008, la Grande-Bretagne, 180 % et la zone euro, 80 %. Au début de 2009, l'endettement des ménages espagnols atteint 130 % du revenu disponible brut !
Cet endettement s'est développé à partir de deux types de crédit : le crédit immobilier principalement mais aussi le crédit à la consommation, les deux étant liés dans les « prêts hypothécaires rechargeables ».
Le crédit à la consommation, notamment sous la forme de cartes de crédit autorisant des découverts, joue un rôle essentiel aux États-Unis mais aussi au Canada, en Grande-Bretagne, au Danemark, etc. Aux États-Unis, son volume était, en 2007, supérieur à celui des crédits hypothécaires subprimes à l'origine immédiate de la crise.
À cela s'ajoute, notamment aux États-Unis toujours, l'endettement pour financer des études qui atteint des proportions considérables.
Le croisement des courbes de l'endettement des ménages et du chômage montre clairement le rôle du premier dans la croissance.
Exemple sur la période 1995-2002
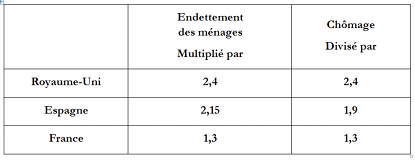
A contrario , et très clairement, le déclenchement de la crise est dû à une inversion de la tendance, le désendettement des ménages aux États-Unis et en Grande-Bretagne en 2008. « L'arrêt de la hausse des taux d'endettement des ménages (aux États-Unis, dans la zone euro hors Allemagne, au Royaume-Uni) est la cause essentielle de la crise. » 80 ( * )
* 73 CNN - 19 juin 2005.
* 74 Challenges - 4 octobre 2007.
* 75 La Révolte des élites et la trahison de la démocratie - Christopher Lasch - Éditions Climats - 1999.
* 76 1,8 million de syndiqués, c'est 8 % des salariés. Selon une étude de la Dares de mai 2016, ce taux serait de 11 %.
* 77 « Le IX e Plan : compte rendu et évaluation des rapports sur la première phase » (Commission nationale du Plan, Paris).
* 78 Rapport sur l'emploi 2007 - Commission européenne.
* 79 Le Capital au XXI e siècle - Seuil - 2013.
* 80 Patrick Artus - Flash économie - Natixis - février 2009.







