D. UN OLIGOPOLE BANCAIRE TOUJOURS « TROP GROS POUR FAIRE FAILLITE » ET TOUJOURS AUSSI PEU RASSURANT
«
Les banques qui sont trop importantes pour faire
faillite
sont trop importantes pour exister.
»
Mervyn
King,
ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre.
«
On est loin d'être dans un monde
libéral au sens littéral du terme,
le secteur bancaire
européen est au contraire assis
sur une formidable rente qu'il
cherche à préserver. »
Jézabel
Couppey-Soubeyran,
maître de conférences en sciences
économiques
à l'université Paris I.
Sans l'interconnexion planétaire des grandes banques, la carambouille immobilière étasunienne, au départ relativement localisée, ne serait pas devenue le krach général et mondial que l'on sait. Dix ans après, constatons que, si, globalement, la profitabilité des grandes banques systémiques n'a pas faibli, la stabilité de quelques-unes est problématique et que la plupart, malgré des progrès, reste encore sous-capitalisée. Quant aux interconnexions entre elles, elles sont toujours aussi nombreuses et difficiles à mettre à jour. Autant dire, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Naulot, que l'« énorme centrale nucléaire bâtie en dehors de toutes normes de sécurité » est toujours là.
1. Banques en péril
L'hypothèse de la défaillance d'un établissement bancaire européen systémique n'est pas qu'une vue de l'esprit. Actuellement, HSBC, Crédit Suisse et, surtout, la plus grande banque d'Allemagne, Deutsche Bank, connaissent de graves difficultés.
a) Les tribulations de la Deutsche Bank
Avec un bilan de 2 200 milliards d'euros (73 % du PIB allemand), la Deutsche Bank est à la fois la plus grande banque d'Europe et la plus exposée au risque « produits dérivés » : entre 54 000 milliards d'euros (dix-huit fois le PIB de l'Allemagne) et 75 000 milliards d'euros (vingt-cinq fois le PIB de l'Allemagne) selon les estimations ! Même si, en cas de crise, la facture ne sera pas de ce niveau au terme de la compensation des gains et des pertes, celle-ci risque quand même d'être salée et surtout, entre-temps, elle aura entraîné dans sa chute beaucoup d'autres établissements bancaires.
Le problème, c'est que la Deutsche Bank ignore le montant de toutes ses contreparties sur le marché des dérivés. En cas de défaillance, de problème, elle perdrait sa couverture et devrait assumer le risque sur ses fonds propres, ce qui, au vu de l'interconnexion du système, créerait un choc systémique. Telle était la situation d'AIG en 2008 avant d'être sauvé par l'État américain.
Comme les entreprises allemandes ont compensé l'atonie de la croissance interne du pays après 2000 par l'exportation, la Deutsche Bank est allée chercher fortune dans des aventures extérieures plus juteuses mais plus risquées. Ayant acquis Morgan Grenfell en Grande-Bretagne et Bankers Trust aux États-Unis, le marché des taux fixes devient sa principale source de profit. Elle sera aussi, selon l'expression de Romaric Godin, une « immense machine à recycler les excédents allemands » 147 ( * ) .
Tout lui a été bon : immobilier (titrisation des subprimes américains, immobilier espagnol et irlandais), prêts à la Grèce, spéculation sur les matières premières et le pétrole, marché des devises et scandale du Libor, marché des certificats de CO 2 et surtout produits dérivés, la Deutsche Bank est de toutes les aventures et de tous les scandales. Série de scandales qui l'amènera progressivement à réduire la voilure. L'appui du gouvernement allemand et de la BCE lui permettra « d'éviter une restructuration de la dette irlandaise, et de repousser suffisamment celle de la dette grecque pour que la Deutsche Bank puisse vendre ses titres (en grande partie, du reste, à la BCE, dans le cadre du programme appelé SMP en 2010-2011). » 148 ( * )
Au début de 2014, elle se retire du processus de fixation du prix de l'or et de l'argent qui sert de référence pour les échanges de métaux précieux et réduit son activité sur le marché des métaux.
En mai 2015, elle se voit infliger une pénalité de 55 millions par la Sec 149 ( * ) pour avoir minimisé ses pertes éventuelles liées à des produits structurés en 2008. Les dirigeants ne seront pas mis en cause ce qui amènera, en 2016, le lanceur d'alerte qui avait permis à l'enquête d'aboutir à refuser sa prime de 8,25 millions de dollars en signe de protestation. 150 ( * )
En 2015, elle doit verser une amende de 2,2 milliards d'euros au Royaume-Uni et aux États-Unis pour échapper aux poursuites dans l'affaire du Libor. Rien que depuis 2012, cela lui a coûté 12,7 milliards d'euros en frais juridiques !
Nouveau revers, en septembre 2016, les États-Unis réclament 14 milliards de dollars à la Deutsche Bank pour solde de tout compte de sa contribution à la crise des subprimes 151 ( * ) . Une transaction à hauteur de 7,2 milliards de dollars sera finalement conclue.
Même si les soutiens ne lui manquent pas - ainsi le gendarme des marchés financiers allemand BaFin a-t-il finalement renoncé à poursuivre la banque au terme d'une enquête suscitée par cette accumulation d'affaires et de mauvais résultats -, la dégringolade est sévère. Cotée 113,15 euros à la veille de la crise, le 31 mai 2007, l'action Deutsche Bank valait 12,32 euros dix ans plus tard, le 20 août 2016. Au cours des douze derniers mois, elle a encore perdu la moitié de sa valeur.
En 2008, Josef Ackermann, alors président suisse du directoire de la Deutsche Bank, plastronnait. « J'aurais honte si nous acceptions de l'argent public pour faire face à la crise ». La banque, qui se targuait de viser une rentabilité de 25 % des fonds propres, venait d'acheter Postbank (11 millions de clients). Aujourd'hui, des bruits de vente de cette filiale ont couru avant d'être démentis.
En avril 2014, la Deutsche Bank doit augmenter ses fonds propres de 1,5 milliard d'euros et enregistre une perte de 6,8 milliards d'euros en 2015.
Au terme d'une analyse de la solidité des plus grandes banques de la planète, le FMI conclut que « les liens de la Deutsche Bank avec les plus grandes banques mondiales en font le principal facteur de risque pour le système financier dans son ensemble » 152 ( * ) .
Au même moment, la Fed annonce que la branche américaine de la banque allemande avait échoué au deuxième round des stress tests CCAR pour la deuxième année de suite. D'après le régulateur américain, les préparatifs de Deutsche Bank en cas de krach ne sont ni appropriés, ni raisonnables d'où le refus de son plan d'investissement. À la suite de cette nouvelle, le titre s'est retrouvé au niveau le plus bas depuis trente ans.
La Deutsche Bank est arrivée en dernière position du classement de la capacité de résistance publié en juillet 2016 par l'Agence bancaire européenne (ABE).
La Deutsche Bank est « un colosse aux pieds d'argile, et ce fait est en grande partie le fruit du modèle économique allemand dit de "stabilité" » 153 ( * ) . La Deutsche Bank est un Lehman Brothers en puissance que l'État allemand ne pourra laisser tomber.
La conclusion de l'étude fouillée de Romaric Godin est édifiante : « Reste une question : comme on l'a vu, Deutsche Bank n'est qu'un symptôme, celui d'un modèle économique néfaste et dangereux, mais pourtant érigé en référence dans la zone euro. Et celui d'un système financier européen qui n'a pas été aussi maîtrisé qu'on le croyait et qui continue à s'appuyer sur la garantie implicite des États. Si l'on en finit avec Deutsche Bank, une autre banque prendra le relais. La menace sur la stabilité n'est pas toujours où Wolfgang Schäuble et Jens Weidmann voudraient qu'elle soit. Tant que les excédents allemands ne se réduiront pas, c'est la stabilité économique de l'Europe qui sera en danger. » 154 ( * )
b) HSBC
La seconde banque systémique la plus fragile, selon le FMI, c'est la britannique HSBC, dont les difficultés (baisse du chiffre d'affaires, des bénéfices, des effectifs...) remontent à 2008. Née voilà cent cinquante ans à Hong Kong du trafic de l'opium, la banque s'établira en Grande-Bretagne et essaimera dans le monde entier : Amérique latine, Mexique, Turquie, France, États-Unis, Suisse... Ses effectifs atteindront jusqu'à 330 000 salariés.
La valeur de l'action de HSBC Holding est passée de 14,89 euros en août 2006 à 6,26 euros dix ans plus tard. Entre temps la banque se trouve mêlée à différents scandales : organisation d'évasion fiscale à grande échelle (« Swissleaks ») par sa filiale suisse, manipulation des changes avec six autres grandes banques, scandale du blanchiment d'argent appartenant au cartel mexicain de la drogue... En 2013, HSBC sera condamnée à 2,46 milliards de dollars d'amende par la justice étasunienne pour infraction à la réglementation boursière.
c) Crédit Suisse
Établissement parmi les plus interconnectés du monde, Crédit Suisse est le troisième sur la liste du FMI. En difficulté, le Crédit Suisse (ainsi que la Deutsche Bank) a été retiré au début du mois d'août 2016 du panel de banques retenues pour l'indice Stoxx Europe 50, lequel regroupe les cinquante principales capitalisations boursières européennes.
Il faut dire que sa valorisation ne cesse de baisser : de 29,76 dollars en octobre 2013, l'action du CS est passée à 11,9 dollars en août 2016, en chute de 45 % depuis le début de l'année.
Question scandales, le Crédit Suisse, à côté des établissements déjà cités, fait figure d'enfant de coeur, son nom apparaissant seulement dans celui de la Fifa (blanchiment d'argent) et des « Panama Papers ».
2. Une solvabilité pour temps calme
Nous l'avons vu, le G20 de Cannes des 3 et 4 novembre 2011 avait pris la résolution de réduire la dangerosité de la centrale atomique constituée par l'oligopole d'énormes banques systémiques (50 341 milliards de dollars d'actifs en 2012, soit 70 % du PIB mondial), qui, dominant les marchés interbancaires, obligataires et financiers, ceux des taux d'intérêts, des changes, des matières premières et des métaux précieux, des produits dérivés, est à l'origine du krach de 2007-2008.
« Nous sommes convenus , déclare le communiqué final, d'un ensemble de mesures qui visent à ce qu'aucun établissement financier ne puisse être considéré comme "trop important pour pouvoir faire faillite" et à éviter au contribuable d'assumer le coût de la résolution des banques. »
Il publiait en même temps, une liste de vingt-neuf banques systémiques, dont cinq françaises : BNP Paribas, Dexia, Groupe Crédit Agricole, BPCE et Société Générale.
Si ces établissements bancaires sont sûrs d'être sauvés par la puissance publique et par le contribuable en dernier ressort, c'est que les volumes des créances et des dettes inscrites à leurs bilans sont si énormes, l'écheveau de leurs engagements et contreparties réciproques de leurs hors-bilans si considérable, que la chute de l'un d'entre eux entraînerait, de proche en proche, celle des autres, la paralysie de la machine économique, la ruine des épargnants et des déposants.
Après dix ans de crise et cinq ans après Cannes, où en sommes-nous ? Les établissements bancaires sont-ils moins interconnectés, leur solvabilité s'est-elle améliorée significativement, le volume des dérivés de crédits et de produits structurés moins considérables ?
Malgré les restructurations et les évolutions législatives dans tel ou tel pays, malgré l'évolution de la réglementation internationale, malgré même l'amélioration des ratios de solvabilité officiels, la réponse n'est toujours pas vraiment rassurante. Voyons cela.
a) Le besoin de recapitalisation des banques systémiques
Ce qui a rendu si dangereuses les trop grosses banques, c'est d'avoir pu gonfler leurs actifs en s'endettant au point que leurs capitaux propres censés permettre de faire face aux défaillances ne représentent presque plus rien.
Rappelons que, voilà une centaine d'années, des taux de 15 % à 20 % de fonds propres étaient fréquents, notamment aux États-Unis, où, en 1840, ils atteignaient même, voire dépassaient, 50 %. Ce taux était plutôt de 3 % au début des années 2000, voire de 1,5 % en 2007.
Un ratio de fonds propres de 3 %, cela signifie que 97 % des actifs sont financés à crédit. Autrement dit, chaque euro de capital propre a permis d'emprunter 32,3 euros et donc de produire un actif de 33,3 euros, sources de revenus. C'est ce qu'on appelle, dans le patois financier, « l'effet de levier ».
L'intérêt des banquiers et de pouvoir disposer d'un effet de levier maximum, ce qui, on l'aura compris, signifie, en cas de problème, un risque d'insolvabilité maximum aussi. Trois raisons à cela.
• La rémunération des dirigeants dépend généralement de l'évolution du ratio bénéfices-capitaux propres. Plus on peut emprunter et moins les capitaux propres sont importants, plus la rémunération est forte.
• Ceux qui financent cette dette bancaire en achetant des obligations pensent qu'une banque systémique ne peut faire faillite, peu leur importe donc leurs ratios d'endettement réel. D'autant que cette garantie implicite de l'État-sauveur permet un endettement à moindre coût.
• L'intérêt de la dette est déductible de l'impôt sur les bénéfices, ce qui n'est pas le cas des dividendes sur les fonds propres.
On comprend donc le peu d'enthousiasme du lobby bancaire pour des exigences en fonds propres plus contraignantes.
Ainsi, en 2015, le groupe Crédit Agricole, avec un capital de 49,3 milliards d'euros, présente-t-il un actif de 1 723 milliards d'euros, soit près de trente-cinq fois la mise. Ce qui signifie aussi que la défaillance de moins de 3 % de ses débiteurs suffirait à le placer en situation de faillite. On comprend l'acharnement mis par le Gouvernement français (et allemand, le problème étant le même pour lui) à retarder le plus possible une restructuration de la dette grecque. Loin aussi du prêchi-prêcha sur le thème : « Quand on fait des dettes, on les rembourse. »
Améliorer la stabilité du système financier passe donc, soit par une augmentation des capitaux propres obligatoires, soit par une diminution des actifs et plus probablement par les deux.
Comme on pouvait s'y attendre, c'est surtout la première méthode qui a été privilégiée mais en embrouillant les choses de telle manière que l'on se met à douter des résultats.
b) Bâle III ou comment sauver les apparences
Lors des négociations internationales dites de Bâle III, tout s'est joué sur la définition des « fonds propres » et sur la construction de l'indice censé mesurer la solvabilité des établissements.
Le ratio le plus significatif est « capital propre réellement disponible/montant de l'endettement (ou de l'actif) ». Selon Alan Greenspan, ex-mage de la Fed et grand magicien de la planche à billets, le levier d'endettement doit être inférieur à 10. Autrement dit les « fonds propres » doivent représenter au moins 10 % de l'endettement. C'est cet indice qui, sous le nom de Core Tiers 1, est généralement pris pour référence. Mais avec des aménagements tels, lors des accords de Bâle III (2010) qui servent aujourd'hui de référence, qu'il en perd sa signification.
Ces accords ont, en effet, compliqué les choses, non seulement en distinguant des capitaux propres de différentes qualités au lieu de s'en tenir au seul « capital réellement disponible » mais surtout en remplaçant la dette à prendre en compte (passif) par un actif pondéré, pondération laissée à l'appréciation des banques s'agissant des établissements systémiques.
Même le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a trouvé le tour de passe-passe un peu gros : « Nous avons besoin d'un ratio de levier simple - le montant des capitaux nécessaires pour une quantité donnée du total des actifs - afin de contrôler le problème des banques ayant un capital trop faible. Les règles de Bâle ont malheureusement donné aux banques de grandes possibilités pour éviter de telles limites via la soi-disant "optimisation de la pondération", ceci ayant pour résultat le fait que les banques n'ont pas toujours les capitaux nécessaires pour faire des affaires en toute sécurité. Cela est particulièrement vrai en Europe, où 700 milliards d'euros seraient nécessaires pour mettre les banques en conformité. » 155 ( * )
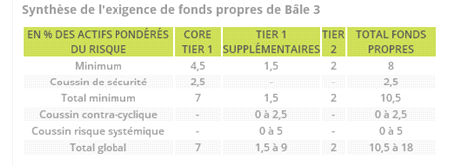
Bâle III impose donc aux banques un minimum de « total capital » de 8 % de l'actif auquel est ajouté un « coussin de sécurité » de 2,5 %, le tout pondéré en fonction du risque. Les établissements systémiques, pour leur part, devront progressivement y ajouter jusqu'à 5 %, soit au total 15,5 % maximum, d'ici au 1 er janvier 2019. L'objectif est d'atteindre de 11,5 % à 13 % pour les banques systémique et 10,5 % pour les autres, d'ici le 1 er janvier 2019.
De leur côté, les États-Unis imposent, depuis juillet 2015, un supplément de capital propre à huit de leurs établissements systémiques : JP Morgan (+ 4,5 % de ses actifs pondérés du risque), Citigroup (+ 3,5 %), Goldman Sachs (+ 3 %), Morgan Stanley (+ 3 %), Bank of America (+ 3 %), Wells Fargo (+ 2 %), State Street (+ 1,5 %), Bank of New York Mellon (+ 1 %). Ces banques doivent donc, soit réduire leurs actifs, notamment les plus risqués, soit augmenter leur capital propre.
Le comité de suivi des accords de Bâle peut donc annoncer en 2015 que, à la fin de décembre 2014, la moyenne du « total capital » en pourcentage du capital pondéré pour les banques d'ampleur systémique était de 13,1 %, contre quelque 7,5 % en 2011, voire un peu plus pour les banques de plus petite taille. Beau progrès !
Sauf qu'on le doit plus à la magie de la pondération qu'à une recapitalisation significative. Le mode de calcul du besoin de capitaux propres laisse pantois.
Dans son rapport de 2015, la BRI, commentant le graphique ci-dessous - dans un patois financier dont on vous fera grâce -, explique qu'entre mi-2011 et mi-2014, si les actifs, une fois pondérés baissent, ce qui permet de faire apparaître une amélioration de 45 % du ratio CET1 de solvabilité, les actifs réels, eux, augmentent. En réalité les banques sont toujours aussi fragiles.
« Pour économiser sur les fonds propres réglementaires, les banques sont incitées à biaiser leurs estimations du risque à la baisse » conclut la BRI 156 ( * ) .
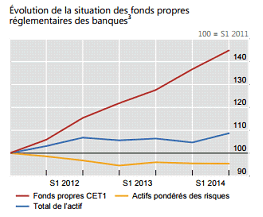
Le graphique ci-dessus montre que, si les fonds propres « officiels » (CET1) ont pu augmenter de 45 % (courbe du haut), c'est que la pondération des actifs (courbe du bas) a fait baisser des actifs réels qui augmentaient de 10 % (courbe du milieu).
Particulièrement édifiante, la latitude laissée aux dirigeants des très grandes banques, dont la rémunération, à actifs équivalents, augmente quand baissent les fonds propres, d'effectuer eux-mêmes cette pondération ! Est-il excessif de parler de favoritisme des pouvoirs publics en faveur des établissements systémiques, par ailleurs les plus dangereux ?
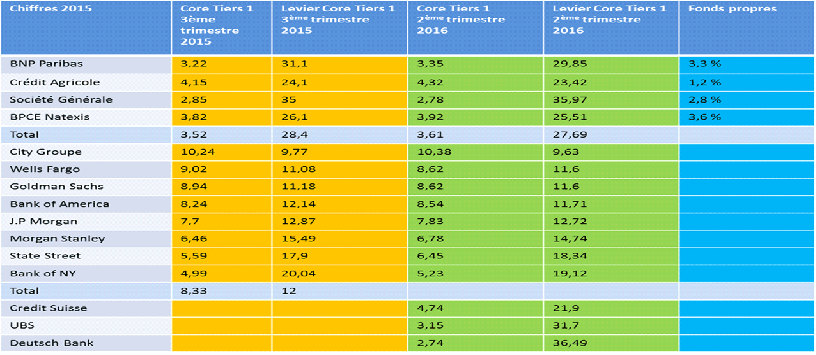
Le tableau ci-dessus nous donne une bonne radiographie de la centrale atomique : au deuxième trimestre 2016, une seule des banques systémiques mondiales sur les quinze étudiées présente un ratio de levier d'endettement inférieur à 10 ou un ratio Core T1 réel supérieur à 10, la banque étasunienne Citigroup. Beaucoup d'autres et tout particulièrement les banques européennes, au rang desquelles les quatre banques systémiques françaises, en sont très loin.
Au final, s'il y a un progrès de la solvabilité de l'oligopole systémique par rapport à 2007, il est très relatif s'agissant des banques européennes dont les ratios de solvabilité réelle se situent toutes au-dessous de 5 %. Certes, 3 % ou 4 %, c'est mieux que 2 %, mais l'augmentation est-elle pour autant significative ?
Quant aux banques étasuniennes, il faut y regarder à deux fois. Leur mode de comptabilisation des produits dérivés à l'actif de leur bilan, pour ne rien dire de leurs engagements en cas de problème repris au hors-bilan, en minimise considérablement le montant.
Une fois traduit en normes européennes, aucune banque en 2012 ne présentait un levier d'endettement inférieur à 13 et deux seulement un ratio de solvabilité réelle supérieur à 6 %. Pas de quoi être rassuré, donc, malgré l'intense communication sur le thème de l'amélioration de la solvabilité des grandes banques et les déclarations des optimistes fonctionnels, dont la première préoccupation est de calmer le jeu.
L'avis des observateurs moins directement intéressés est nettement plus réservé.
Pour le Parlement européen, en juin 2015 : « L'augmentation des fonds propres réels n'a que très peu augmenté depuis la crise. »
La Commission Vickers (responsable de la réforme britannique) et les chercheurs du Comité de Bâle pensent qu'un ratio de 16 % à 20 % de fonds propres par rapport à l'actif pondéré serait préférable aux 10,5 %-13 %.
Christophe Nijdam précise 157 ( * ) : « Avant la crise, les fonds propres, c'était 1,5 % du bilan non pondéré par les risques, notamment pour certaines banques britanniques systémiques comme RBS, donc 98,5 % étaient empruntés (inclus les dépôts des clients). Avec la réglementation, on monte à 3 % en 2018. Si l'on voulait se débarrasser de cette fragilité particulière des banques systémiques, françaises et autres européennes, il leur faudrait 6 % de fonds propres supplémentaires. »
Ce qui fait hurler les gardiens du temple pour qui les banques universelles françaises sont un modèle de stabilité.
Commentant le mode de calcul du ratio de solvabilité des banques européennes, Jézabel Couppey-Soubeyran 158 ( * ) explique : « Les banques calibrent au mieux leurs modèles internes pour minimiser le poids du risque de leurs actifs et la charge en fonds propres qui va avec. En clair, les banques sous-estiment les risques de leurs actifs. Le système fonctionne encore comme cela aujourd'hui. Certes, les exigences ont été renforcées, les fonds propres redéfinis, mais l'utilisation des modèles internes des banques ou des ratios pondérés par les risques n'a pas été remise en cause.
« Une solution anglo-saxonne aurait pu être envisagée : la mise en place d'un ratio très simple rapportant les fonds propres au total des actifs, soit la part des fonds propres dans le bilan. Ce ratio dit de levier est certes fruste comparé au ratio pondéré et certains voient dans le renoncement à ajuster le ratio en fonction des risques des actifs une forme de "paresse intellectuelle". Ce serait toutefois un bon moyen de couper court aux manipulations de risques. »
Commentant les résultats des stress tests auxquels la BCE a soumis cent trente banques européennes en 2014, après avoir rappelé que vingt-cinq d'entre elles ont été recalées (essentiellement italiennes), elle note que si le ratio retenu (au moins 5 % de fonds propres) avait été celui qui vient être indiqué (ratio de levier), elles auraient été soixante-quinze, dont vingt banques allemandes, y compris évidemment la Deutsche Bank, à être identifiées comme insuffisamment capitalisées.
Ayant aussi noté que la BCE a réévalué de 20 %, par rapport aux estimations antérieures, le volume des créances douteuses dans le bilan des banques, Jézabel Couppey-Soubeyran conclut 159 ( * ) : « Fin 2014, la BCE s'est bien gardée de communiquer des résultats qui pouvaient être inquiétants. La capacité de résistance des banques européennes à un choc éventuel a été surestimée. Si un choc survenait, les banques ne seraient sans doute pas en capacité de l'absorber, tout dépend de l'ampleur du choc. On ne peut pas considérer que les banques européennes sont solides aujourd'hui. »
3. Pas de séparation pour les banques
«
Les banques croissent à
l'international
mais elles reviennent toujours chez elles pour
mourir.
»
Mervyn King,
ancien gouverneur de la Banque
d'Angleterre.
«
Les idées qui ont été mises
sur la table par Michel Barnier
sont des idées, je pèse mes
mots, qui sont irresponsables
et contraires aux intérêts de
l'Union européenne.
»
Christian Noyer,
gouverneur
de la Banque de France.
a) Ce pourrait être une obligation de morale politique
L'un des moyens les plus efficaces de réduire la taille des banques et d'éviter le chantage à l'intervention de l'État en cas de faillite au nom du sauvetage des déposants, c'est de séparer banques de dépôts et banques d'affaires . Comme le dit crûment Maurice Allais : « il faut empêcher les banques de spéculer avec l'argent qu'elles créent comme il faut empêcher les filiales des banques ou les fonds d'investissement de spéculer avec de l'argent prêté par les banques. On n'empêchera jamais la spéculation mais il faut que les spéculateurs spéculent avec leur argent, pas avec celui des autres. » Autrement dit, il faut supprimer la garantie publique au casino bancaire, garantie qui lui permet par ailleurs de s'endetter à un coût inférieur à celui des établissements non systémiques.
Il faut empêcher la confusion entre la gestion prudente des banques de dépôts pour assurer la sécurité des fonds qui leur ont été confiés et la gestion « active », pour ne pas dire risquée, d'établissements dont le but est l'enrichissement, au prix du risque, de leurs clients. Il faut empêcher les conflits d'intérêts qui naîtront de cette dualité d'objectifs.
Des établissements bancaires plus petits, aux activités spécifiques bien distinguées, c'est aussi plus de transparence et de meilleurs contrôles. Accessoirement, c'est réduire le besoin de fonds propres des banques de dépôts dont les activités sont moins risquées, les bilans plus transparents et donc réduire pour eux le risque infondé d'illiquidité. C'est raréfier les occasions d'embolie du réseau interbancaire.
Il est significatif que le Banking Act ou Glass-Steagall Act, du nom du sénateur Carter Glass et du représentant Henry Steagall qui défendirent la loi au Congrès, fut la toute première mesure importante de Roosevelt après son arrivée à la Maison-Blanche en mars 1933. Adoptée par la Chambre des représentants à 262 voix contre 19 et par acclamation au Sénat, la loi Glass-Steagall sera signée dès le 16 juin 1933 par le Président Roosevelt. Elle instituait une incompatibilité rigoureuse entre les activités de banque de dépôts ( commercial banking ) et celles de banque d'affaires ( investment banking ). Une banque de dépôts ne peut posséder une banque d'affaires ni, inversement, une banque d'affaires posséder une banque de dépôts. Une banque de dépôts ne peut acheter, vendre ou négocier des titres financiers, ni une banque d'affaires accepter des dépôts. Le but est de protéger les dépôts, d'empêcher la spéculation à partir de dépôts, pratique alors mise en évidence par la commission des affaires bancaire et monétaire du Sénat. Particulièrement concernée, la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs.
Un fonds fédéral de garantie des dépôts bancaires sera par ailleurs créé. L'État fédéral garantit les dépôts bancaires individuels, intégralement jusqu'à 10 000 dollars, à 75 % entre 10 000 dollars et 50 000 dollars, 50 % au-delà.
Au terme de plusieurs tentatives, il sera définitivement mis fin au Glass-Steagall Act sous la présidence Clinton en 1999. Les banquiers d'affaires pourront de nouveau utiliser les dépôts de leurs clients pour investir et spéculer sur les marchés.
Sur ce chapitre, plus moderne que les États-Unis, la France reviendra dès 1984 sur la séparation entre banques de dépôts et d'affaires via la loi bancaire. Il lui faudra cependant une dizaine d'années pour voir le triomphe du modèle de « banque universelle » qui en sera l'aboutissement.
b) Les illusions perdues
La crise de 2007-2008 faisant apparaître les conséquences du privilège accordé aux banquiers de pouvoir spéculer avec l'argent des déposants, la question de la séparation des catégories de banques redevient d'actualité. Le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, fait remarquer : « Comme nous l'avons d'abord proposé au sommet du G20 en 2009, la séparation de la banque commerciale de celle des activités de titres, notamment celle des produits dérivés, est essentielle pour éviter l'interfinancement des prises de risque excessives liées au phénomène du too-big-to-fail. » 160 ( * ) Mais, comme d'ordinaire, devant l'opposition du lobby bancaire, on complexifiera le problème pour éviter de le régler vraiment.
Trois solutions étaient possibles :
- la seule vraiment efficace, la séparation totale. Personne n'en voudra ;
- la holding coiffant deux entités distinctes, ce à quoi revient la solution britannique, solution qui maintient un lien financier entre banque de dépôts et banque d'investissement ;
- la solution européenne du transfert à une filiale des activités jugées spéculatives ou, selon la loi française de séparation bancaire, des activités qui « ne sont pas utiles à l'économie » . Dans ce cas, non seulement les liens sont maintenus mais l'efficacité du dispositif dépend de la nature et du volume de ce qui sera transféré. En l'espèce, pas grand-chose.
Les premiers à réagir et à le faire sérieusement ont été les Britanniques particulièrement échaudés par la crise qui coûtera au final 67 milliards de livres sterling (120 milliards de livres sterling au départ) à l'État et à la Banque d'Angleterre. Leur système sera réorganisé sur deux points : réforme de la régulation et surtout, à la suite du rapport Vickers (2011), la séparation à horizon 2019 des activités liées aux dépôts et celles d'investissement. Il ne s'agit donc pas d'une séparation des établissements selon leurs activités mais, à l'intérieur d'un même établissement, de la séparation des activités.
La solution étasunienne, en passe de mourir étouffée sous le papier, était nettement plus light. « Était » car il semble que Donald Trump veuille mettre fin au « Dodd-Frank Act » adopté en juillet 2010. Ce qui nous dispensera de rentrer dans les détails. S'il faut y voir évidemment le pouvoir du lobby bancaire, force est aussi de constater que comparativement à la Grande-Bretagne et à la France, le système bancaire étasunien est nettement moins oligo-monopolistique, donc moins vulnérable à la faillite de l'un de ses constituants.
Quant à la solution européenne, après un départ brillant avec le rapport Liikanen et le projet de réforme de Michel Barnier alors commissaire européen, on l'attend toujours. Entre autres mesures, le projet Barnier interdisait aux banques de dépôts de spéculer pour leur propre compte sur les produits financiers s'échangeant sur les marchés (actions, obligations, produits financiers complexes...), ainsi que sur les matières premières. Il donnait le pouvoir aux autorités de contrôle d'imposer le cantonnement, dans une filiale séparée, des activités de marché jugées à hauts risques pour le compte de tiers : négoce de produits dérivés complexes, l'essentiel des opérations de titrisation, « tenue de marché » (nécessaire à garantir la liquidité des produits achetée, autrement dit garantie de pouvoir les revendre). La réforme est toujours bloquée au Parlement européen.
c) La « banque universelle » fait de la résistance
Défendant bec et ongle son modèle de « banque universelle », la France ne sera pas pour rien dans cet enlisement du projet européen. Prenant les devants, elle adoptera un placebo sous le nom de loi de « séparation et de régulation des activités bancaires », un projet qui pourtant visait rien moins qu'à « remettre la finance au service de l'économie réelle » . Présentée à la fin de 2012 au Parlement par Pierre Moscovici, la loi sera publiée le 27 juillet 2013.
Poser ainsi le problème, c'était vider dès le départ la réforme de tout contenu. Tout simplement parce que, le système bancaire de la France étant une pièce essentielle de son économie (rôle, poids économique, emploi), tout ce qui est bon pour lui est forcément bon pour la France et parce que toutes les activités financières peuvent être utiles ou spéculatives selon l'usage qu'on en fait, voire sont toujours à deux faces.
Comme prévu, au final, les activités devant être filialisées ne représentent pas grand-chose : 1 % des revenus de la Société Générale, reconnaît Frédéric Oudéa, son P-DG, lors de son audition par la commission des finances de l'Assemblée nationale, à la surprise des députés présents et de la rapporteure du projet, Karine Berger, persuadés de son caractère avant-gardiste. Ne sont concernés ni les prêts aux hedge funds , ni le trading haute fréquence, ni les opérations sur produits dérivés. « Avec la définition que le projet de loi donne du market making, les positions sur produits dérivés de crédits qui ont entraîné la faillite de la banque AIG à Paris auraient été qualifiées d'utiles » juge le secrétaire général de Finance Watch de l'époque, Thierry Philipponnat, lors de son audition à l'Assemblée nationale le 5 février 2013.
Selon Christophe Nijdam : « Sur une banque spécifique comme la BNP, Liikanen aurait séparé 13 % des activités en termes de produit net bancaire (chiffre d'affaires d'une banque). La proposition, qui est entrée en vigueur de M. Moscovici, prévoyait 0,5 % du chiffre d'affaires, par rapport à l'activité totale. Le projet français était beaucoup moins ambitieux que le projet européen, vingt-six fois moins ambitieux dans le cas d'espèce. »
Encore une fois, rien d'étonnant puisque l'essentiel était de préserver le modèle de « banque universelle » patiemment et opiniâtrement construit depuis la loi de 1984 et qui devait assurer à la France une place de premier plan en Europe, faute d'un appareil industriel aussi puissant que celui de l'Allemagne. « Ce qui m'a encore plus marqué, nous dira Gunther Capelle-Blancard lors de son audition 161 ( * ) , c'est l'argument selon lequel le secteur financier allait devenir une spécialité de la France, non pas juste parce qu'il s'agit d'activités à forte valeur ajoutée, donc que c'est très rémunérateur, mais parce que c'est non polluant, c'est formidable, c'est "très créatif". »
Dominé par les « grands corps », pratiquant intensément le « revolving doors » entre les sommets de l'État et ceux de la haute finance, un aussi bel outil de pouvoir et de carrière devait être à tout prix conservé.
Ce choix politique essentiel ne pouvait être remis en cause, quels qu'en soient les risques et les interrogations - de plus en plus nombreuses - sur l'efficacité réelle de ce modèle bancaire « made in France ».
D'où les propos politiquement incorrects, inhabituels dans la bouche d'un des gardiens du temple, rappelés en exergue. Christian Noyer récidivera d'ailleurs dans un entretien au nouveleconomiste.fr 162 ( * ) : « Je suis absolument convaincu, certain, que la séparation est une fausse bonne idée. C'est une idée qui ne résout rien et qui crée des risques considérables pour le financement de l'économie, donc pour la croissance. » Suit un long plaidoyer qui aurait été plus convainquant s'il avait apporté une réponse au problème posé par un système aussi oligopolistique : l'existence de liens si nombreux et si entremêlés entre des établissements d'une telle taille que l'un ne peut tomber sans entraîner les autres.
Conclusion de Jézabel Couppey-Soubeyran 163 ( * ) : « Cette loi bancaire ne satisfait ni les partisans de la séparation ni les plus réticents. Il ne faut pas seulement se contenter d'isoler les activités spéculatives utiles au financement de l'économie, il faut les décourager. »
4. Touche pas à mon industrie financière !
L'une des transformations majeures du système financier ce dernier quart de siècle a été l'apparition et le développement d'une véritable industrie financière aux mains des plus grosses banques, les seules à pouvoir assumer les investissements intellectuels et matériels qu'elle appelle. Se croyant dotées des outils lui permettant de prendre des risques - donc de gagner plus d'argent -, sinon en toute sécurité, du moins à un niveau de risque défini et assumé, elles vont en user et abuser, comme la crise le montrera. Ces outils permettront d'élever la « finance casino », non seulement au rang de machine à cash mais d'une mystique. Le mot du P-DG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, à l'occasion d'un entretien au Sunday Times 164 ( * ) - « Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu. » -, est révélateur de ce sentiment de toute-puissance de la finance.
Deux produits se sont retrouvés particulièrement sur la sellette, compte tenu de leur rôle dans la crise des subprimes : les produits dérivés type CDS et la titrisation.
a) Les produits dérivés type CDS
Deux effets sont particulièrement en cause : la possibilité de déstabiliser n'importe quelle valeur par la spéculation à la baisse, l'interconnexion des membres de l'oligopole bancaire par le jeu des garanties et garanties de garanties, supprimant toute cloison étanche entre eux. Comme le rappelle Angel Gurría 165 ( * ) , l'interfinancement des prises de risque excessives liées au phénomène du too-big-to-fail est largement dû aux produits dérivés et à la titrisation. Ce sont ces activités de titrisation et l'industrie des produits dérivés logées dans les très grandes banques, cet enchevêtrement de financements réciproques tout autant que la taille de leur bilan, qui les rendent systémiques et dangereuses.
Un interfinancement qui n'apparaît pas dans les bilans et très mal dans le hors-bilan, ce qui pousse à la panique. Ainsi, en octobre 2008, on estimait que les établissements qui avaient vendu des CDS devraient débourser 400 milliards de dollars, ce qui a largement contribué à nourrir la panique financière mondiale. Finalement, une fois toutes les compensations réalisées entre ventes et achats de CDS, il en aurait coûté de 6 milliards à 8 milliards ; 6 à 8 milliards de dollars « seulement », mais parce que les plus grosses banques et les réassureurs ont été sauvés de la faillite par les États et les banques centrales 166 ( * ) .
Pour Christophe Nijdam : « C'est une grenade dégoupillée, ce qui ne veut pas dire qu'elle va exploser. » 167 ( * )
Comme rappelé plus haut, le G20 de Cannes en 2011 s'était engagé à mettre sous contrôle les marchés dérivés de gré à gré, « les transactions à haute fréquence et la liquidité opaque ». Qu'en a-t-il été ?
Constatons que leur production se développe à un rythme plus allègre que celui de la régulation, qui avance à pas comptés.
En 2007-2008, 90 % des produits dérivés étaient échangés sur les marchés de gré-à-gré, donc non réglementés. Désormais, le règlement sur les marchés d'instruments financiers (règlement Mifir sur la base de la directive Mifid 2), voté par le Parlement européen le 15 avril 2014, obligera les produits dérivés standardisables et suffisamment liquides à être négociés sur une plateforme de négociation et à passer par des chambres de compensation, chargées de s'interposer entre l'acheteur et le vendeur. Cette chambre enregistrant le contrat et valant contrepartie, elle contrôlerait ipso facto la qualité de la demande.
Alors que des chambres de compensation sont déjà partiellement en place aux États-Unis, la Commission de Bruxelles en est encore à la finalisation de sa réglementation. Elle étudie, en particulier, la mise en place d'une taxe de 0,01 % sur les transactions des produits dérivés ; étude particulièrement complexe à en juger par sa longueur.
Selon Christophe Nijdam, « cette taxe réduirait de 75 % les volumes d'échange de ces instruments, d'après une estimation faite par la Commission européenne au moment du lancement de l'idée d'une taxe sur les transactions financières (TTF), c'est-à-dire l'essentiel de la part spéculative ». À condition qu'elle soit un jour appliquée, ce qui est loin d'être gagné d'avance.
Pour les produits les plus risqués, il est, en outre, envisagé de demander à ces chambres de mettre de côté un pourcentage de la valeur notionnelle des contrats pour faire face aux défaillances éventuelles.
b) La titrisation
Pas question non plus d'interdire la titrisation, bien au contraire. L'Europe notamment entend la relancer mais en rendant ces produits plus transparents, par le biais d'une sorte de standardisation. La Banque des règlements internationaux note : « Cela étant, l'évaluation des risques que présente ce type de lots restera empreinte d'une incertitude considérable, dont il ne faudrait pas faire abstraction, sous peine d'augmenter fortement la probabilité d'une grave sous-capitalisation pour certaines tranches. » 168 ( * )
Si personne ne met en doute l'intérêt de la titrisation, nécessaire notamment au recyclage des obligations sécurisées émises par les banques pour augmenter leur passif et pouvoir continuer à prêter, le désaccord porte sur ce qu'il serait licite de titriser et comment, jusqu'à quel degré de sophistication. Ainsi, Finance Watch conteste la titrisation sans transfert de la propriété des créances objets de la titrisation, ou « titrisation synthétique » admise par la Commission européenne. Dans ce cas, seul le risque est transféré, risque lui-même couvert par un CDS.
Pour Jérôme Glachant 169 ( * ) , la titrisation ne crée pas en elle-même de risque systémique tant qu'elle est associée à des investissements et des placements de long terme (par exemple, le crédit immobilier ou aux entreprises). Le problème apparaît, comme en 2007, lorsque ces produits deviennent le support d'une spéculation à crédit.
Cela dit, comment éviter le mésusage d'un produit financier puisque c'est devenu la règle ?
c) Le trading haute fréquence
En ce domaine, la régulation avance aussi mais sans vraiment traiter le fonds du problème ; l'argument de l'obligation d'assurer la liquidité des marchés domine toujours.
Pour Martin Merlin, directeur des marchés financiers au sein de la DG Fisma 170 ( * ) de la Commission européenne 171 ( * ) , ce sont les besoins de liquidité qui expliquent qu'on ne l'interdise pas malgré son intérêt strictement nul pour la collectivité. « Je ne pense pas que ces firmes puissent penser à l'intérêt général ou du moins l'avoir pour première motivation. La proportion des ordres passés par ces firmes sur une journée est massive, deux tiers des ordres sont passés par ces firmes. Cette activité ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, cela risquerait d'assécher le marché et poser un problème de liquidité massif. »
La directive et le règlement Mif 2 apportent un début d'encadrement des négociations dites « algorithmiques » puisque, à ce niveau de rapidité, seuls des automates algorithmiques peuvent prendre les décisions.
On en est encore à la consultation afin de définir les paramètres des ordres et leur encadrement : largeur des pas de cotation (intervalle minimum entre deux cotations), prix enclenchant la décision, niveau de liquidité du produit, manière de gérer l'ordre après sa soumission, coupe-circuits permettant de geler les marchés électroniques en cas d'emballement du dispositif, etc.
La question de la possibilité ou non de taxer les annulations d'ordres a été posée.
* 147 Romaric Godin - « De quoi la Deutsche Bank est-elle le nom ? » - La Tribune - 27 septembre 2016.
* 148 Ibid.
* 149 Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la bourse » américain.
* 150 L'Express - 21 août 2016.
* 151 Les Échos - 18 septembre 2016.
* 152 Reuter - 30 juin 2016.
* 153 Romaric Godin - « De quoi la Deutsche Bank est-elle le nom ? » - La Tribune - 27 septembre 2016.
* 154 Ibid.
* 155 Article paru dans l'édition Europe du Wall Street Journal - 7 novembre 2012.
* 156 85 e rapport annuel - 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 - 28 juin 2015.
* 157 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 158 Audition du 18 février 2016.
* 159 Ibid.
* 160 Article paru dans l'édition Europe du Wall Street Journal - 7 novembre 2012.
* 161 Audition du 28 janvier 2016.
* 162 11 janvier 2016.
* 163 Audition du 18 février 2016.
* 164 8 novembre 2009.
* 165 Article paru dans l'édition Europe du Wall Street Journal - 7 novembre 2012.
* 166 Christian Chavagneux - « Lehman Brothers : les véritables dessous d'une faillite » - alternatives-economiques.fr - 18 mars 2016.
* 167 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 168 85 e rapport annuel - 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 - 28 juin 2015.
* 169 Professeur des Universités en sciences économiques - Audition du 31 mars 2016.
* 170 Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'Union des marchés de capitaux.
* 171 Audition du 6 avril 216 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.







