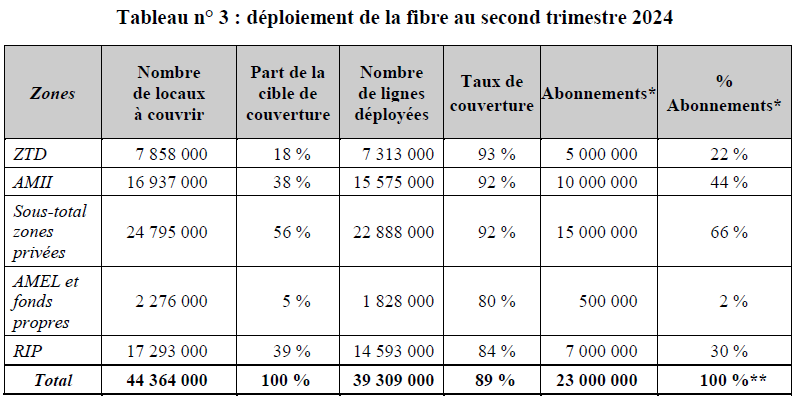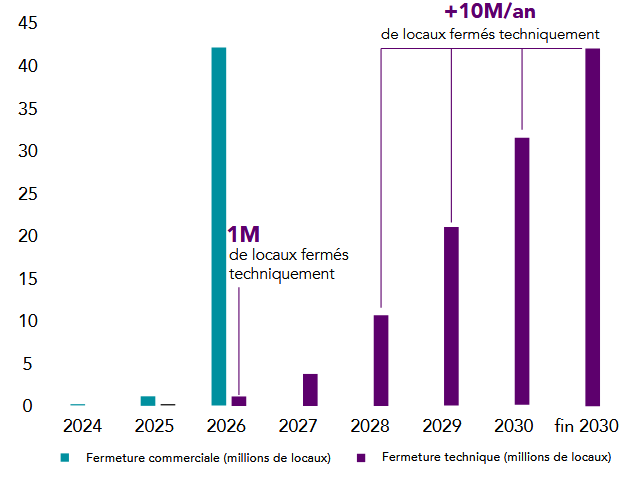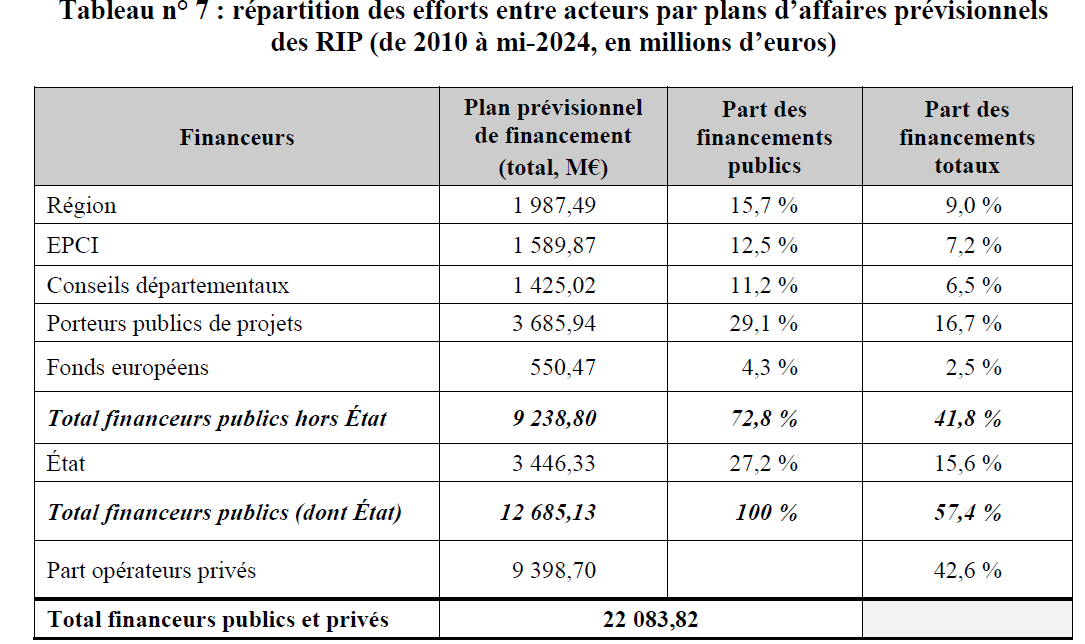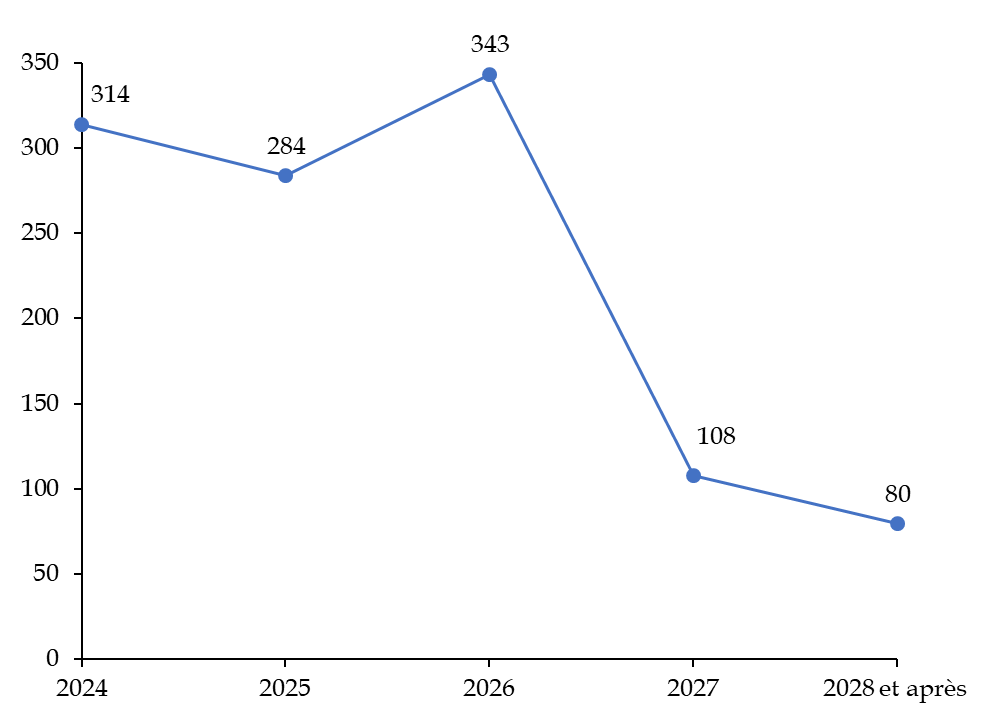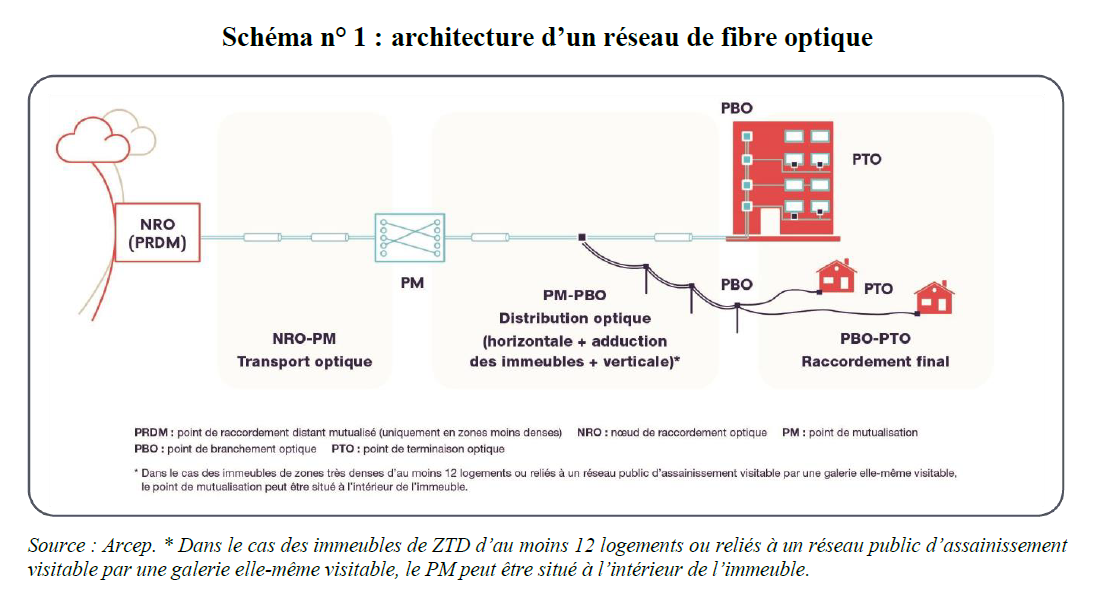- AVANT-PROPOS
- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS
SPÉCIAUX
- LES PRINCIPALES OBSERVATIONS
DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX
- I. UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU DE LA FIBRE
MAIS EN VOIE D'ESSOUFFLEMENT, ALORS QUE LA FERMETURE DU RÉSEAU CUIVRE SE
PROFILE
- A. UN TAUX DE DÉPLOIEMENT IMPORTANT QUI
MASQUE TOUTEFOIS DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES ET DES
DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENTS POUR CERTAINS LOCAUX
- 1. La mise en oeuvre du plan France très
haut débit repose sur un découpage zonal complexe
- 2. Un déploiement rapide qui place la France
au premier rang des pays européens en matière de couverture
très haut débit fixe
- 3. Une couverture territoriale
hétérogène et un déploiement qui tend à
s'essouffler
- 4. Les difficultés spécifiques
liées aux raccordements dits « complexes »
- 1. La mise en oeuvre du plan France très
haut débit repose sur un découpage zonal complexe
- B. LE CHANTIER DE LA SORTIE DU RÉSEAU
CUIVRE : UN TOURNANT À NE PAS MANQUER POUR RÉUSSIR LA
TRANSITION VERS LA FIBRE
- A. UN TAUX DE DÉPLOIEMENT IMPORTANT QUI
MASQUE TOUTEFOIS DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES ET DES
DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENTS POUR CERTAINS LOCAUX
- II. LES FRAGILITÉS DU MODÈLE
ÉCONOMIQUE DES RÉSEAUX D'INITIATIVE PUBLIQUE NÉCESSITENT
UNE RÉACTION RAPIDE DU RÉGULATEUR ET UN SOUTIEN BUDGÉTAIRE
DE L'ÉTAT RÉAFFIRMÉ
- III. LA QUALITÉ ET LA RÉSILIENCE DES
RÉSEAUX DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ATTENTION RENFORCÉE À
MESURE QUE LA GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE SE RAPPROCHE
- A. LE RECOURS AU MODE STOC POUR LE RACCORDEMENT
FINAL A PERMIS UN TAUX DE PÉNÉTRATION PLUS RAPIDE DE LA FIBRE
MAIS PRÉSENTE PLUSIEURS FACTEURS DE FRAGILISATION DE LA QUALITÉ
DES RÉSEAUX
- 1. Le mode STOC a permis une
pénétration rapide de la fibre jusqu'à
l'abonné
- 2. Les lacunes du mode STOC font apparaitre des
fragilités quant à la qualité des réseaux qui
plaident pour de nouvelles mesures contraignantes à l'égard des
opérateurs
- 3. Vers une remise en cause du mode STOC, à
mesure de l'amélioration du taux de pénétration de la
fibre ?
- 1. Le mode STOC a permis une
pénétration rapide de la fibre jusqu'à
l'abonné
- B. LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE DES
RÉSEAUX DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE RÉFLEXION PLUS
ABOUTIE
- A. LE RECOURS AU MODE STOC POUR LE RACCORDEMENT
FINAL A PERMIS UN TAUX DE PÉNÉTRATION PLUS RAPIDE DE LA FIBRE
MAIS PRÉSENTE PLUSIEURS FACTEURS DE FRAGILISATION DE LA QUALITÉ
DES RÉSEAUX
- I. UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU DE LA FIBRE
MAIS EN VOIE D'ESSOUFFLEMENT, ALORS QUE LA FERMETURE DU RÉSEAU CUIVRE SE
PROFILE
- TRAVAUX DE LA COMMISSION :
AUDITION POUR SUITE À DONNER
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES
DÉPLACEMENTS
- ANNEXE :
COMMUNICATION DE LA COUR DES COMPTES À LA COMMISSION DES FINANCES
N° 510
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 avril 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les soutiens publics en faveur de la fibre optique,
Par M. Thierry COZIC et Mme Frédérique ESPAGNAC,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La commission des finances du Sénat a demandé à la Cour des comptes, par courrier daté du 16 janvier 2024, la réalisation d'une enquête sur le déploiement de la fibre optique sur le territoire, au titre du 2° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf).
L'objectif d'une couverture totale du territoire par la fibre à l'horizon 2025 est porté par le Plan France très haut débit. La mise en oeuvre de ce projet, présentée par la Cour des comptes comme un succès, a favorisé le déploiement de la fibre dans plus de 90 % du territoire. Ce chiffre reluisant masque toutefois de très fortes disparités territoriales, ainsi qu'un relatif ralentissement de la dynamique de déploiement dans les poches de basse densité situées dans les zones dites « très denses ». Afin de réussir la généralisation du déploiement de la fibre, la Cour des comptes souligne la nécessité d'une remobilisation de l'ensemble des acteurs du plan notamment par la définition de nouveaux engagements contraignants avec les opérateurs d'infrastructures dans les zones très denses.
La Cour s'est également intéressée au financement des « réseaux d'initiative publique » (RIP), qui sont les projets de déploiement de la fibre co-financés par les collectivités locales dans les zones moins denses, où l'investissement est par essence moins rentable pour les opérateurs privés. Après avoir rappelé le haut niveau de soutien financier dont ont bénéficié les RIP de la part des pouvoirs publics, la Cour met en évidence les faiblesses de leur modèle économique, qui fragilisent leur pérennité. En effet, les lignes directrices tarifaires établies par l'Arcep en 2015, sur lesquelles sont basées les plans d'affaires des RIP, sont aujourd'hui inadaptées à la réalité des coûts qu'ils doivent supporter. Il en résulte un déséquilibre structurel du modèle de financement de certains RIP, qui plaide pour une actualisation dès 2025 des lignes directrices tarifaires de l'Arcep.
Enfin, les travaux de la Cour insiste sur les risques pesant sur la qualité et la résilience des réseaux de fibre optique. Le modèle de sous-traitance à l'opérateur commercial des raccordements finals jusqu'aux abonnés - le mode STOC - a certes permis une pénétration rapide de la fibre dans les foyers, mais il présente plusieurs dysfonctionnements qui entrainent des malfaçons sur les réseaux, des câbles emmêlés, des débranchements injustifiés et des coupures internet répétées pour les usagers.
Pour donner suite à la remise de cette enquête, la commission des finances a organisé, le 2 avril 2025, une audition réunissant Mme Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes, Mme Laure de la Raudière, présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), M. Antoine Jourdan, sous-directeur des communications électroniques et des postes à la direction générale des entreprises (DGE) et M. Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX
Les rapporteurs spéciaux rejoignent les préoccupations de la Cour des comptes, et reprennent les recommandations qu'elle formule. Ils présentent par ailleurs les recommandations suivantes :
Recommandation n° 1 : Sanctuariser les crédits budgétaires dédiés au financement du réseau d'initiative publique de Mayotte, conformément à la volonté exprimée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)
Recommandation n° 2 : Définir un calendrier et une méthodologie clairs pour les travaux d'objectivation des coûts observés dans les réseaux d'initiative publique menés par l'Arcep, afin de favoriser la remontée d'informations fiables par les opérateurs d'infrastructures (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)
Recommandation n° 3 : Renforcer les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet, en instaurant une suspension du paiement de l'abonnement, une indemnisation du consommateur et un droit de résiliation sans frais de l'abonnement (Législateur)
Recommandation n° 4 : Encourager et accompagner les collectivités locales dans leurs initiatives d'expérimentations de pratiques alternatives au mode STOC (sous-traitance à l'opérateur commercial) pour les raccordements finals à la fibre (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation)
LES PRINCIPALES OBSERVATIONS
DES RAPPORTEURS
SPÉCIAUX
I. UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU DE LA FIBRE MAIS EN VOIE D'ESSOUFFLEMENT, ALORS QUE LA FERMETURE DU RÉSEAU CUIVRE SE PROFILE
A. UN TAUX DE DÉPLOIEMENT IMPORTANT QUI MASQUE TOUTEFOIS DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES ET DES DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENTS POUR CERTAINS LOCAUX
1. La mise en oeuvre du plan France très haut débit repose sur un découpage zonal complexe
Le plan « France très haut débit » (PFTHD), annoncé en 2013, porte l'objectif d'une couverture totale du territoire par la fibre optique à l'horizon 2025. Il s'appuie sur l'articulation entre initiatives privées et publiques au sein de catégories de zones dont le découpage est relativement complexe :
- les zones très denses relèvent de l'initiative privée. Aucun engagement contraignant ne s'impose aux opérateurs dans ces zones, les pouvoirs publics ayant anticipé que la libre concurrence devait permettre d'y garantir le déploiement de la fibre. Elles comptent 106 communes et représentent près de 6,5 millions de locaux.
- les zones dites « moins denses » (ZMD) sont les zones dans lesquelles l'initiative privée n'est pas réputée rentable pour les opérateurs privés. Ces derniers peuvent néanmoins y mener également des projets sans financement public, et prennent dans ce cadre des engagements contraignants. Définies « en creux » par rapport aux zones très denses, elles représentent environ 30,7 millions de locaux.
La ZMD se décompose donc elle-même en une ZMD d'initiative privée et une ZMD d'initiative publique :
- dans la ZMD d'initiative privée, le déploiement de la fibre optique est effectué aux frais des opérateurs sur la base d'engagements pris avec l'État. Il s'agit des zones d'appel à manifestation d'intentions d'investissement (AMII) ;
- dans la ZMD d'initiative publique, les collectivités doivent s'associer dans leur projet de déploiement à l'échelle au moins départementale pour bénéficier d'un soutien de l'État, dans le cadre de réseaux d'initiative publique (RIP). Il existe par ailleurs des zones pour lesquelles le Gouvernement a autorisé, à compter de 2018, les collectivités territoriales à accélérer les déploiements de la fibre optique via des appels à manifestation d'engagement local (AMEL) afin que des opérateurs privés déploient, sur leurs fonds propres, la fibre optique, dans le cadre d'engagements qui leur sont opposables, sur le modèle des engagements en zones AMII. Sans la création des zones AMEL, les déploiements en question auraient dû être à la charge des collectivités, via la création d'un RIP.
2. Un déploiement rapide qui place la France au premier rang des pays européens en matière de couverture très haut débit fixe
Le taux de couverture du territoire par la fibre optique s'élève en 2024 à près de 90 %, ce qui conduit la Cour des comptes à présenter le PFHDT comme un succès. Les rapporteurs se félicitent de cette large couverture, qui place aujourd'hui la France comme le premier pays européen en termes de taux de couverture, alors qu'un juin 2015, elle se positionnait au 26ème rang avec seulement 45 % des foyers couverts en très haut débit fixe.
Par ailleurs le nombre d'abonnements à la fibre optique s'établit désormais à 23,7 millions, alors que les juridictions financières relevaient, dans un premier bilan du PFTHD réalisé en janvier 2017, que les bénéficiaires finaux, qui s'élevaient à l'époque à 4,8 millions, restaient très peu nombreux1(*).
Déploiement de la fibre au second trimestre 2024
* abonnements souscrits à fin juin 2024
** total arrondi
Source : Cour des comptes d'après les données de l'ARCEP
3. Une couverture territoriale hétérogène et un déploiement qui tend à s'essouffler
Le haut niveau de couverture masque toutefois de fortes disparités en fonction des territoires. En zone dense, le déploiement atteint, à la fin du premier semestre 2024, un niveau de 93 %, légèrement supérieur à celui de la zone AMII, qui s'élève à 92 %. Le taux de déploiement en zone d'initiative privé dépasse donc substantiellement celui des zones AMEL qui s'élève à 80 %, et celui des RIP, qui atteint 84 %.
En outre, la forte dynamique initiale du déploiement de la fibre tend à s'essouffler, en particulier dans les zones les plus denses, pourtant les plus rentables pour les opérateurs privés. La Cour des comptes met en évidence l'existence de poches de basse densité dans ces zones, faute d'engagements contraignants opposables aux opérateurs d'infrastructures chargés de réaliser les déploiements. D'après la Cour, « la présence forte d'immeubles de petite taille, interdisant l'implantation des points de mutualisation à l'intérieur des bâtiments, ou le caractère plus diffus de l'habitat », conduirait à ce que « l'opérateur d'infrastructures dépriorise le déploiement, en l'absence d'engagement sanctionné par l'Arcep ». Cette situation entraîne des délais de déploiement plus importants et difficilement compréhensibles par la population de ces territoires.
Dans ce contexte, il apparait nécessaire que les pouvoirs publics disposent des leviers contraignants pour inciter les opérateurs à relancer la dynamique de déploiement dans les zones denses. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à la recommandation de la Cour des comptes, selon laquelle « une nouvelle concertation ouverte par l'État avec les opérateurs concernés » doit être prévue dans le but de « renforcer leurs obligations sur ces territoires bien délimités, en associant les représentants des collectivités territoriales. » À défaut, « une modification du cadre législatif permettant à l'Arcep d'imposer des obligations dans ces zones pourrait s'avérer nécessaire ».
En tout état de cause que l'Arcep devrait se saisir de ses prérogatives pour faire respecter pleinement les engagements contraignants des opérateurs, quelles que soient les zones concernées. Il ressort en effet des auditions des rapporteurs spéciaux que l'Arcep ferait preuve d'une certaine réticence à mobiliser pleinement son pouvoir de sanction à l'égard des opérateurs. Celui-ci n'a en effet été mobilisé qu'à deux reprises en zone AMII en 2024, à l'égard d'Orange et d'XpFibre, qui ont reçu de la part de l'Arcep une injonction de respecter leurs obligations de complétude des déploiements de fibre optique d'ici au 31 décembre 2025. En zone AMEL, deux procédures de mise en demeure sont à l'instruction pour la Nièvre et la Savoie.
4. Les difficultés spécifiques liées aux raccordements dits « complexes »
L'existence de raccordements dits « complexes » est également, dans toutes les zones, un facteur de ralentissement du déploiement. L'effectivité de l'accès à la fibre se heurte parfois à des lacunes des infrastructures rendant difficile voire impossible le raccordement à la fibre de certains usagers. D'après la Cour des comptes, ces raccordements complexes ont pour principaux points communs l'absence de traitement aisé et industrialisable, en raison d'anomalie sur le génie civil, les difficultés à coordonner des travaux entre le domaine public et le domaine privé, ou le refus de tiers privés ou publics.
Les raccordements complexes sont par essence particulièrement couteux puisqu'ils nécessitent souvent des travaux de génie civil importants, que les opérateurs sont peu enclins à réaliser. La Cour des comptes considère qu'une « estimation du nombre et du coût total de ces raccordements est délicate en l'absence de recensement systématique par les opérateurs commerciaux ». Toutefois, le Conseil général de l'économie a estimé le coût des raccordements complexes en domaine privé entre 758 à 991 millions d'euros. En ce qui concerne le domaine public, la Banque des territoires évalue le coût de ces raccordements entre 600 millions et 2 milliards d'euros.
Une enveloppe de 16,1 millions d'euros - modeste au regard des montants évoqués supra - a été votée dans la loi de finances initiale pour 2025 sur le programme 343 « Plan France très haut débit » afin de financer un dispositif expérimental de soutien budgétaire aux travaux de génie civil relatifs aux raccordements complexes dans le domaine privé. D'après les informations transmises par la direction générale des entreprises (DGE) aux rapporteurs spéciaux, les travaux de définition des paramètres de cette expérimentation seraient actuellement en cours et devraient aboutir avant la fin de l'année 2025. Il est essentiel que cette expérimentation puisse se concrétiser dès cette année, afin que l'opportunité d'une généralisation d'un tel dispositif soit rapidement étudiée.
S'agissant de la zone d'initiative publique, une enveloppe de 150 millions d'euros a été inscrite en 2021 sur la mission « Plan de relance », afin de financer des raccordements finals nécessitant des travaux de génie civil pour garantir des possibilités de raccordement des locaux sur le domaine public. Ces crédits sont mobilisés dans le cadre d'un appel à projet « Création d'infrastructures de génie civil nécessaires aux raccordements finals », pilotés par l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Ce dispositif propose un soutien financier à hauteur de 12,5 % des coûts d'étude et de travaux portées par les collectivités. L'engagement de ces crédits a été réalisé en deux temps, à hauteur de 88,7 millions d'euros en 2022 et de 61,3 millions d'euros en 2023. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à cette initiative, mais s'étonnent du très faible niveau de consommation des crédits près de quatre ans après la création de dispositif. En effet seuls neufs dossiers ont été instruits par l'ANCT à ce stade, pour un montant total de 18,6 millions d'euros effectivement consommés. Lors de la présentation du rapport de la Cour devant la commission des finances le 2 avril 2025, le directeur général de l'ANCT a indiqué que ce faible taux de consommation s'explique surtout par le fait qu'« il s'agit de dossiers délicats, puisque l'opérateur et les collectivités doivent négocier pour obtenir une participation du privé à ces raccordements, ce qui rallonge les délais ». L'ANCT a toutefois constaté qu'un certain nombre de territoires potentiellement concernés ne l'avait pas encore saisie pour bénéficier de cette enveloppe. Les rapporteurs spéciaux invitent donc l'ANCT à sensibiliser de nouveaux les collectivités concernées, afin de s'assurer qu'elles aient pleinement connaissance de l'existence de ce dispositif. En tout état de cause, et comme le souligne la Cour des comptes, une nouvelle impulsion de l'ensemble des acteurs du PFTHD sera nécessaire pour traiter la question des raccordements complexes dans les domaine public et privé et mieux communiquer sur les dispositifs d'aides existants.
En résumé, s'il convient de se féliciter du volontarisme affiché par les pouvoirs publics pour le déploiement rapide de la fibre sur le territoire, les rapporteurs spéciaux estiment qu'il est bien trop tôt pour donner un satisfécit au PFTHD. Il n'est en effet pas acceptable, dans un contexte de numérisation croissante des services publics, que des pans entiers de la population soient privées d'accès à la fibre, faute d'engagement de déploiement contraignant à l'égard des opérateurs ou de possibilité de raccordement effectif à la fibre, alors même que l'État s'est engagé à un déploiement de la fibre sur 100 % du territoire à l'horizon fin 2025.
Les rapporteurs spéciaux relèvent par ailleurs que le recours à la technologie satellite est souvent avancé comme un moyen d'attendre la mise en service de la fibre ou de fournir un accès effectif au très haut débit, faute de possibilité de raccordement. Cette technologie alternative ne peut toutefois constituer qu'une solution transitoire. Elle ne présente en effet pas les mêmes garanties que la fibre en matière de qualité du débit, et pose un vrai problème de souveraineté, ce marché étant aujourd'hui dominé par des entreprises étrangères telles que Starlink.
B. LE CHANTIER DE LA SORTIE DU RÉSEAU CUIVRE : UN TOURNANT À NE PAS MANQUER POUR RÉUSSIR LA TRANSITION VERS LA FIBRE
Le déploiement de la fibre sur le territoire implique, en parallèle, la fermeture du réseau cuivre par Orange, opérateur historique de ce réseau. Orange a en effet prévu un plan visant à permettre la migration progressive vers les réseaux de fibre afin qu'à l'horizon 2030, plus aucun utilisateur n'ait accès à internet depuis le réseau cuivre. La fermeture de ce réseau suit un processus structuré en une première étape de fermeture commerciale à partir de laquelle Orange ne commercialise plus de nouveaux accès à sa boucle locale cuivre, et une seconde étape de fermeture technique qui correspond à l'interruption définitive des produits et services existants sur le réseau.
Orange a donc présenté à l'Arcep un plan de fermeture du réseau cuivre en février 2022, qui prévoit :
- une phase dite de « transition » jusqu'à début 2026, avec des expérimentations sur des territoires circonscrits, au sein de trois lots de communes. Ces expérimentations doivent permettre de tester et faire évoluer les modalités opérationnelles des processus de fermeture ;
- une phase d'industrialisation de la fermeture du réseau cuivre concernant l'ensemble du pays, jusqu'en 2030.
Le plan d'Orange repose sur une montée en puissance progressive du nombre de locaux techniquement fermés, avec en ligne de mire un objectif de 10,5 millions de fermetures de locaux chaque année en 2029 et 2030.
Calendrier de fermeture du réseau cuivre par Orange
(en millions de locaux fermés)
Source : Infranum
L'évaluation de ces expérimentations par la Cour des comptes témoigne de résultats globalement positifs. Toutefois, elle met en évidence plusieurs difficultés dans le processus de fermeture du réseau cuivre.
Tout d'abord, elle fait état de décalages calendaires dans la fermeture de certains locaux. Alors que la fermeture commerciale dans les trois premiers lots doit théoriquement s'achever le 31 janvier 2026, des reports ont été annoncés par Orange concernant 245 communes.
Par ailleurs, elle considère que les expérimentations « ont révélé la nécessité d'une clarification des parties prenantes auprès des particuliers, des professionnels mais également auprès d'élus locaux », Orange étant encore parfois perçu « comme unique responsable du déploiement de la fibre optique, aussi bien en termes d'infrastructures qu'en termes d'abonnement commercial. »
La Cour déplore également une communication sur la fermeture prochaine du réseau cuivre très limitée à l'échelle nationale. Ce constat est partagé par les rapporteurs spéciaux, qui ont été alertés par plusieurs auditionnés sur le manque criant d'information de l'État sur cette question. Or, le travail de pédagogie à réaliser auprès des citoyens sur les enjeux de la fermeture ne peut uniquement reposer sur les élus de terrains, qui sont, dans le même temps, en première ligne pour justifier les éventuels retards de déploiement de la fibre auprès des usagers. Les rapporteurs spéciaux rejoignent donc la recommandation de la Cour invitant l'État à relayer plus activement la communication de l'opérateur Orange sur le calendrier de fermeture du réseau cuivre.
II. LES FRAGILITÉS DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DES RÉSEAUX D'INITIATIVE PUBLIQUE NÉCESSITENT UNE RÉACTION RAPIDE DU RÉGULATEUR ET UN SOUTIEN BUDGÉTAIRE DE L'ÉTAT RÉAFFIRMÉ
A. L'ÉTAT DOIT MAINTENIR SON ENGAGEMENT FINANCIER EN FAVEUR DU PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT MALGRÉ LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT
1. Un soutien public important entre 2010 et 2024 qui a eu un effet levier indéniable sur le déploiement des RIP
L'effort financier global consenti pour la construction des réseaux de fibre optique s'établit à plus de 22 milliards d'euros pour les seuls réseaux d'initiative publique (RIP). Ils ont bénéficié d'un soutien public important, principalement par les collectivités locales, à hauteur de 8,7 milliards d'euros, mais aussi par l'État, à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Ces financements publics ont eu un véritable effet levier sur l'investissement privé, puisque les opérateurs déclarent avoir consacré plus de 13 milliards d'euros au déploiement des RIP.
Répartition des efforts entre acteurs par
plan d'affaires prévisionnels
de 2010 à
mi-2024
(en millions d'euros et %)
Source : Cour des comptes
2. Les coupes budgétaires successives depuis 2024 soulèvent des interrogations sur l'engagement financier de l'État en faveur des RIP dans la durée
Les rapporteurs spéciaux se félicitent de l'ampleur des financements engagés, qui traduit le volontarisme des pouvoirs publics en faveur du Plan France très haut débit. Toutefois, les coupes budgétaires successivement réalisées depuis plus d'un an sur le programme 343 « Plan France Très Haut débit » soulèvent des interrogations sur les perspectives de soutien financier de l'État à ce projet, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint.
En effet, l'année 2024 a été marquée en cours de gestion par une annulation de 116,8 millions d'euros en crédits de paiement (CP) par le décret du 21 février 20242(*), ainsi qu'une annulation de 85 millions d'euros en CP par la loi de finances de fin de gestion pour 20243(*). La Cour des comptes souligne que, malgré ces baisses de crédits, l'ensemble des décaissements nécessaires au financement des RIP ont pu être assurés en 2024 par l'ANCT, grâce à sa trésorerie excédentaire et à une sous-exécution des crédits. Toutefois, certains auditionnés ont fait état auprès des rapporteurs spéciaux de contrôles zélés réalisés par l'ANCT au moment des versements des soldes de subventions aux RIP, qui ralentiraient de facto le rythme des décaissements des crédits, et expliqueraient ces sous-exécutions. L'ANCT s'est défendue en audition d'avoir réalisé un pilotage des crédits par un renforcement de ces contrôles, en insistant par ailleurs sur le fait que les audits réalisés au moment du versement des soldes contribuent surtout à garantir le respect des cahiers des charges imposés aux opérateurs en matière de qualité des réseaux.
Cette dynamique de coupes budgétaires semble se poursuivre pour l'année 2025. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2025, les rapporteurs spéciaux avaient émis des doutes sur les ambitions du pouvoir exécutif à l'égard du PFTHD, au regard de la baisse de 52 % des crédits du programme 343 par rapport à l'année 2024. Ils avaient également déploré le dépôt et l'adoption en séance publique au Sénat d'un amendement « rabot » du Gouvernement de baisse de 21,6 millions d'euros des autorisations d'engagement (AE) et CP sur ce même programme, traduisant les annonces gouvernementales de rétablissement des finances publiques. Par ailleurs, le décret d'annulation du 25 avril 2025 a priver le programme 343 de 12,5 millions d'euros de CP supplémentaires.
Le rapport de la Cour indiquait dans son rapport que le montant des crédits de paiement disponibles sur l'action 1 du programme 343 destinée au financement des RIP, serait, pour l'année 2025, inférieur aux besoins des collectivités, de l'ordre de 84 millions d'euros, à moins d'un report de crédits et d'une éventuelle mobilisation de la trésorerie excédentaire.
Le DGE a néanmoins affirmé, lors de la présentation du rapport de la Cour devant la commission des finances, que les crédits effectivement disponibles seraient suffisants pour répondre à ces besoins. D'après les éléments transmis aux rapporteurs spéciaux, le montant des CP consacrés à l'action 1 « RIP » du programme 343, qui était estimé à seulement 200 millions d'euros dans les documents budgétaires annexés au PLF 2025, aurait été porté à 276 millions d'euros grâce à des reports de crédits4(*) résultant de la suppression du programme 364 « Cohésion » de la mission « Plan de relance » et, dans une moindre mesure, à un report résultant d'une sous-exécution des crédits sur l'exercice 2024. Ces reports de crédits, associés à la possibilité de mobiliser les 50,7 millions d'euros de trésorerie excédentaire de l'ANCT, permettraient ainsi de couvrir les besoins de décaissements des collectivités pour le financement des RIP, qui sont estimés à 284 millions d'euros en 2025.
La Cour des comptes a également souligné que la disponibilité des AE consacrées au RIP de Mayotte, introduit à l'initiative de la commission des finances dans le texte, n'était serait pas garantie, et dépendrait des arbitrages qui seront réalisés concernant la ventilation des économies résultant de l'amendement « rabot » du Gouvernement. Les rapporteurs spéciaux estiment que les AE destinés au financement de ce projet, dont le lancement a été acté en mars dernier, doivent être sanctuarisés, conformément à l'intention clairement exprimée par le Parlement.
Recommandation n° 1 : Sanctuariser les crédits budgétaires dédiés au financement du réseau d'initiative publique de Mayotte, conformément à la volonté exprimée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique).
En tout état de cause, le rapport de la Cour montre que les prochains exercices budgétaires devraient être marqués par un pic de demande de versement de la part des RIP au fur et à mesure de leur achèvement. Or, si l'État décide dans le même temps de réduire la voilure sur le plan budgétaire, les collectivités seront contraintes de s'y substituer, ce que leur situation financière ne leur permet pas. Cette situation se répercutera in fine sur les opérateurs et leurs sous-traitants, fragilisant ainsi les tissus économiques locaux.
Besoins prévisionnels de versements des
crédits du PFTHD
aux porteurs des projets de RIP anticipés par
l'ANCT
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après le rapport de la Cour des comptes
B. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES RIP EST AUJOURD'HUI FRAGILISÉ ET DOIT ÊTRE ACTUALISÉ AU PLUS VITE
1. La Cour fait le constat d'une inadéquation du modèle économique des RIP par rapport à la réalité des coûts qu'ils doivent supporter
La Cour des comptes a également mis en évidence dans son rapport une situation de déséquilibre du modèle économique des RIP. En effet, les plans d'affaires des RIP ont été construits sur la base de lignes directrices tarifaires établies par l'Arcep en 2015. Toutefois, ces lignes directrices, basées sur le modèle des zones denses, sont inadaptées à la réalité des coûts que doivent supporter les RIP. D'après la Cour des comptes, « 9 RIP sur 10 indiquent avoir constaté des surcoûts par rapport au plan d'affaires initial, concernant pour la plupart tant l'exploitation du réseau que le niveau des investissements ». Les coûts d'exploitation sont en effet significativement plus élevés en zone publique qu'en zone dense, et plusieurs auditionnés ont indiqué que les tarifs d'accès à la fibre sur le marché de gros ne leur permettrait pas de les compenser.
Le modèle économique des RIP a été construit sur la base de lignes tarifaires de l'Arcep non contraignantes mais largement suivies
L'Arcep a défini en 2015 des lignes directrices indiquant des niveaux de tarifs à pratiquer entre opérateurs d'infrastructures et opérateurs commerciaux et visant à ce qu'ils soient homogènes entre RIP et zones d'initiative privée. Les RIP ont ainsi été invités, pour les investissements initiaux, à calibrer leur demande de subvention à l'État pour assurer leur viabilité économique à partir de ces tarifs.
Les lignes tarifaires de 2015 précisent qu'il existe un risque de constater des variations dans les coûts de déploiement par rapport aux anticipations. De même, les coûts d'exploitation, potentiellement proportionnels à la longueur des lignes, pourraient être supérieurs en zone d'initiative publique et générer des surcoûts pénalisant les projections de marges financières de l'opérateur d'infrastructures. Or, ces coûts d'exploitation ne peuvent faire l'objet d'un soutien de l'État et pourraient ainsi déséquilibrer les finances des RIP sur le long terme, en cas de recettes d'exploitation insuffisantes. Ainsi, il est prévu que le régulateur examine au cas par cas les éventuelles demandes d'ajustement à la hausse des tarifs de gros et valide ou non leur justification.
Le document publié par l'Arcep, dépourvu de toute portée prescriptive et contraignante, vise « à guider l'action des collectivités locales » pour fixer des tarifs à appliquer aux opérateurs commerciaux dans des conditions « objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées ». Il précise qu'il sera envisageable de réviser ces préconisations en cas « de modifications significatives des conditions de marché » ou de « changement législatif ou règlementaire » sous réserve d'éléments de justification suffisants.
Malgré leur caractère non contraignant, les lignes directrices de l'Arcep ont été largement suivies par les RIP pour établir leurs plans d'affaires initiaux. Ainsi, sur la base des réponses au sondage réalisé par la Cour des comptes, 80 % des RIP interrogés déclarent avoir utilisé exactement le tarif de l'Arcep, à 15 % légèrement au-dessus et à 5 % légèrement en-dessous.
Source : rapport de la Cour des comptes
2. Des travaux d'objectivation des coûts d'exploitation des RIP à faire aboutir dès 2025
Face à ce constat, les collectivités territoriales, les opérateurs d'infrastructures, mais aussi les opérateurs commerciaux, attendent de la part de l'Arcep un travail d'objectivation des coûts supportés par le RIP, afin d'établir les écarts de coûts constatés entre les modèles initiaux et la réalité. Ce travail permettra, d'après la Cour des comptes, d'envisager d'éventuelles révisions des modèles d'affaires des RIP, voire une mobilisation supplémentaire de fonds publics pour les soutenir.
Pourtant, l'Arcep tarde à faire évoluer ses lignes directrices et refuse pour le moment des hausses tarifaires demandées par certaines collectivités locales, qui doivent dès lors compenser le déficit d'exploitation par des subventions. Certains opérateurs d'infrastructures ont par ailleurs alerté les rapporteurs spéciaux sur l'absence de méthodologie fixée par l'Arcep pour la remontée des informations nécessaires à ces travaux d'actualisation.
Les rapporteurs spéciaux rejoignent la recommandation de la Cour sur le nécessité de faire aboutir ces travaux d'objectification dès 2025. À défaut, les collectivités pourraient être contraintes, au fur et à mesure du renouvellement des délégations de service public, d'assumer seules les charges d'exploitation du réseau. En effet, faute de possibilité pour les RIP de faire évaluer ces tarifs, les collectivités risquent d'être confrontées à un défaut de candidat, puisqu'aucun opérateur d'infrastructures ne souhaitera s'engager dans un modèle ne leur permettant pas de couvrir leurs coûts d'exploitation. Les rapporteurs spéciaux ont été alertés sur le fait que, face à cette impasse, certaines collectivités pourraient être contraintes de céder leurs RIP à vil prix à des opérateurs.
Recommandation n° 2 : Définir un calendrier et une méthodologie clairs pour les travaux d'objectivation des coûts observés dans les réseaux d'initiative publique menés par l'Arcep, afin de favoriser la remontée d'informations fiables par les opérateurs d'infrastructures (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).
III. LA QUALITÉ ET LA RÉSILIENCE DES RÉSEAUX DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ATTENTION RENFORCÉE À MESURE QUE LA GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE SE RAPPROCHE
A. LE RECOURS AU MODE STOC POUR LE RACCORDEMENT FINAL A PERMIS UN TAUX DE PÉNÉTRATION PLUS RAPIDE DE LA FIBRE MAIS PRÉSENTE PLUSIEURS FACTEURS DE FRAGILISATION DE LA QUALITÉ DES RÉSEAUX
1. Le mode STOC a permis une pénétration rapide de la fibre jusqu'à l'abonné
Le raccordement final désigne plus particulièrement la construction du dernier segment du réseau, reliant le point de mutualisation (PM) à la prise terminale optique (PTO) située dans le local à raccorder.
Architecture d'un réseau de fibre opitque
Source : rapport de la Cour des comptes
Dans une décision du 2 juillet 2015, l'Arcep a validé le principe de la sous-traitance par l'opérateur d'infrastructures à un opérateur commercial, de la réalisation du raccordement final, conformément au souhait exprimé par les acteurs du marché. Ce mode de raccordement - couramment appelé mode STOC (sous-traitance à l'opérateur commercial) - est retenu dans la quasi-totalité des cas en France, l'ensemble de la filière s'étant organisée autour de cette partition des rôles entre opérateur d'infrastructures et opérateur commercial. Ce mode de raccordement est unique en Europe, ce dernier étant généralement effectué par le constructeur du réseau dans les autres pays.
Le recours au mode STOC a eu pour principal avantage de permettre une pénétration plus rapide de la fibre dans les territoires, les opérateurs commerciaux qui réalisent les raccordements pouvant alors démarcher directement les usagers.
2. Les lacunes du mode STOC font apparaitre des fragilités quant à la qualité des réseaux qui plaident pour de nouvelles mesures contraignantes à l'égard des opérateurs
La Cour des comptes met toutefois en évidence dans son rapport les dysfonctionnements du recours au mode STOC ainsi que leurs conséquences néfastes sur la qualité du réseau. Les rapporteurs spéciaux ont également porté une attention particulière à ce sujet lors de leurs travaux. D'après les personnes auditionnées, le recours au mode STOC se traduirait bien souvent par de la sous-traitance en cascade, impliquant le recours à une main-d'oeuvre peu qualifiée et exerçant dans des conditions de sécurité parfois désastreuses, ce qui nuit grandement à la qualité des réseaux.
D'après la Cour des comptes, ces problèmes de qualité se concentrent sur un nombre limité de réseaux, représentant environ 2 % des lignes. Ils occasionnent toutefois des désagréments importants pour les usagers, en provoquant des malfaçons sur les réseaux, des câbles emmêlés, des débranchements injustifiés et des coupures internet répétées. La Cour fait le constat d'un échec de la régulation du mode STOC, fondée sur la capacité de l'opérateur d'infrastructures à contrôler les opérateurs commerciaux intervenant sur son réseau. Cette régulation serait en effet inopérante faute d'outils permettant d'identifier l'auteur des dégradations. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à la recommandation de la Cour visant à confier à l'Arcep « un pouvoir de sanction en cas de non-respect de ces prescriptions par les opérateurs commerciaux ».
La Cour des comptes rappelle toutefois la responsabilité pesant sur les opérateurs d'infrastructures, qui demeurent les premiers responsables de la qualité de leurs réseaux. Elle souligne à cet égard l'intérêt des audits réalisés par l'ANCT concernant le respect des exigences de qualité demandées aux opérateurs. Elle estime que l'Arcep devrait pouvoir réaliser ce type d'audits dans l'ensemble des zones, aux frais des opérateurs, comme elle le fait déjà pour les réseaux mobiles. Dans le cadre de leur déplacement à Clermont-Ferrand au RIP Auvergne numérique, les rapporteurs spéciaux ont constaté que la mise en place de tels audits de qualité pouvait également être réalisée directement par l'opérateur d'infrastructures à destination des opérateurs commerciaux, avec un certain succès.
Par ailleurs, les difficultés posées par le recours au mode STOC en termes de qualité des réseaux font également écho à plusieurs dispositions de la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize5(*), adoptée par le Sénat en mai 2023, mais dont l'examen par l'Assemblée nationale se fait toujours attendre. Plusieurs dispositions de cette proposition de loi s'inscrivent dans la même philosophie que les recommandations de la Cour, ce qui plaide d'autant plus pour une inscription rapide de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Compte tenu de l'ampleur des désagréments impliqués par le dysfonctionnement du mode STOC pour les usagers, les rapporteurs spéciaux souscrivent plus particulièrement à la disposition de cette proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet.
Recommandation n° 3 : Renforcer les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet, en instaurant une suspension du paiement de l'abonnement, une indemnisation du consommateur et un droit de résiliation sans frais de l'abonnement (Législateur).
3. Vers une remise en cause du mode STOC, à mesure de l'amélioration du taux de pénétration de la fibre ?
Face aux dysfonctionnements impliqués par le recours au mode STOC, la possibilité d'une remise en cause de ce modèle pourrait davantage être explorée. Compte tenu de la progression du taux de pénétration de la fibre, l'activité de raccordement se réduira à terme aux seuls cas où l'abonné changera d'opérateur commercial (opération de churn) et au raccordement des locaux neufs. L'opérateur d'infrastructures pourrait ainsi devenir le principal acteur intervenant sur son réseau.
La Cour des comptes ouvre la voie à la réintroduction progressive d'un raccordement final effectué par l'opérateur d'infrastructures pour les opérations de churn et les raccordements en zone entièrement fibrées, et par conséquent à une extinction progressive du mode STOC. Dans cette même logique, le Sénat a adopté, à l'article 3 de la proposition de loi précitée, une interdiction du recours au mode STOC dans les zones fibrées - c'est-à-dire les zones dans lesquelles 100 % des locaux sont déjà raccordables à la fibre.
D'après le rapport de la Cour, plusieurs collectivités ont déjà mis en place des expérimentations afin de tester des alternatives au mode STOC, tels que le recours au « mode opérateur d'infrastructures » (mode OI) - comme c'est par exemple le cas à Angres dans le département du Pas-de-Calais et à Le Mesnil-Saint-Denis dans le département des Yvelines - ou à des raccordements dits de service public. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à ces initiatives, qui pourraient davantage être encouragées et accompagnées par l'État auprès des collectivités.
Recommandation n° 4 : Encourager et accompagner les collectivités locales dans leurs initiatives d'expérimentations de pratiques alternatives au mode STOC (sous-traitance à l'opérateur commercial) pour les raccordements finals à la fibre (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation).
B. LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE DES RÉSEAUX DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE RÉFLEXION PLUS ABOUTIE
Les réseaux de fibre optique sont amenés à devenir, avec la fermeture du réseau cuivre annoncée, le réseau support des usages numériques liés à l'internet fixe. Leur rôle va devenir d'autant plus essentiel que les usages progressent, ce qui pose la question de leur résilience, c'est-à-dire de leur capacité à résister à des aléas et à retrouver rapidement un mode de fonctionnement normal. Or, d'après le rapport de la Cour des comptes, la question de la résilience des réseaux fait l'objet d'une réflexion très peu aboutie de la part des pouvoirs publics.
Les spécificités des réseaux en fibre optique et du PFTHD révèlent en effet des difficultés potentielles pour l'avenir tel que la multiplicité des modes d'intervention et des schémas de responsabilité, la forte dépendance des réseaux en fibre optique envers le réseau électrique, ou encore, la mobilisation à terme de 16 millions d'appuis aériens d'Orange et d'Enedis, qui sont soumis aux aléas climatiques et dont l'avenir est incertain dans le contexte de fermeture du réseau de cuivre d'Orange. Par ailleurs, les opérateurs de communications électroniques peuvent être confrontés à une multiplication des actes de vandalisme, au risque climatique et au risque d'attaque cyber. Enfin, la densification de certains territoires et le développement du télétravail devraient mécaniquement engendrer des besoins de raccordements supplémentaires, qui mettront à l'épreuve des infrastructures dont le dimensionnement n'a pas forcément été anticipé en conséquence.
D'après la Cour des comptes, une minorité de RIP a pris des initiatives en matière de résilience des réseaux, tels que des schémas locaux de résilience, des plans d'investissements dédiés, ou un rapprochement avec les services en charge de la planification et de la gestion de crises. Elle estime que « dans les zones d'initiative privée, rien n'incite les opérateurs, ni économiquement, ni comptablement, à consentir des investissements coûteux pour prévenir des risques futurs. En outre « le morcellement des intervenants sur les réseaux de fibre optique complexifie le cadre juridique relatif aux obligations de continuité des réseaux et à la sécurisation des activités d'importance vitale, conçu pour les grands monopoles d'infrastructures. »
Face à ce constat, les rapporteurs spéciaux souscrivent pleinement aux recommandations de la Cour des comptes plaidant d'une part, pour l'élaboration d'une stratégie nationale de résilience des réseaux de fibre optique, et d'autre part, pour l'intégration des réseaux de fibre optique dans les dispositifs locaux de planification et de gestion des crises.
TRAVAUX DE LA
COMMISSION :
AUDITION POUR SUITE À DONNER
Réunie le mercredi 2 avril 2025, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a procédé à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique.
M. Claude Raynal, président. - Nous procédons ce matin à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, réalisée à la demande de notre commission en application du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), portant sur les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique.
L'objectif d'une couverture totale du territoire par la fibre à l'horizon 2025 est porté par le plan France Très Haut Débit (THD). Ce projet se traduit notamment par le subventionnement des réseaux d'initiative publique (RIP), au sein des zones les moins denses, dans lesquelles le déploiement de la fibre n'est pas rentable pour les opérateurs. Ces RIP sont mis en oeuvre dans le cadre de projets menés et financés par les collectivités territoriales.
Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances (PLF), nos rapporteurs spéciaux Thierry Cozic et Frédérique Espagnac ont fait part à notre commission de leurs inquiétudes quant à l'atteinte de l'objectif fixé, dans les zones RIP comme ailleurs. Ils nous ont notamment alertés au sujet de l'hétérogénéité du taux de déploiement, au détriment des territoires les plus enclavés.
Sans anticiper la présentation qui nous en sera faite, je note que le rapport d'enquête de la Cour des comptes, après avoir dressé le constat d'un haut niveau de déploiement global, fait état de disparités territoriales importantes. Il pointe également les faiblesses du modèle de financement des RIP et met en lumière des fragilités affectant la qualité et la résilience des réseaux.
Pour aborder tous ces sujets, nous recevons ce matin Mme Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes, qui va nous présenter les principales observations et recommandations issues de cette enquête.
Thierry Cozic et Frédérique Espagnac prendront ensuite la parole pour indiquer les enseignements qu'ils retiennent de ce travail et exposer leurs réflexions.
Pour prolonger nos échanges, nous éclairer et répondre aux observations de la Cour des comptes et des rapporteurs spéciaux, je donnerai ensuite la parole à Mme Laure de La Raudière, présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ; à M. Antoine Jourdan, sous-directeur des communications électroniques et des postes à la Direction générale des entreprises (DGE) ; ainsi qu'à M. Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
La parole sera ensuite à M. le rapporteur général et à l'ensemble des collègues qui souhaiteront intervenir.
À cet égard, je salue la présence de M. Sébastien Fagnen, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
À l'issue de notre réunion, je demanderai aux membres de la commission des finances leur accord pour la publication de l'enquête remise par la Cour des comptes et l'adoption des recommandations des rapporteurs spéciaux, qui leur ont été distribuées.
Je vous indique enfin que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est retransmise sur le site internet du Sénat.
Mme Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes. - Avant tout, je tiens à vous remercier de m'avoir invitée à vous présenter le rapport de la Cour des comptes relatif au soutien public en faveur du déploiement de la fibre optique.
Je me dois également de saluer les différents membres de l'équipe qui m'ont accompagnée dans ce travail et qui sont présents ce matin : Pauline Odile, Antoine Gobelet et Mathilde Lignot-Leloup, qui préside la section.
Monsieur le président, ce rapport répond à la saisine que vous avez adressée à M. le Premier président et dont la Cour a accepté le principe en février 2024. Un certain nombre d'échanges ont dès lors eu lieu avec les rapporteurs spéciaux. Ils ont permis de fixer les axes de l'enquête, arrêtés conjointement.
Avant tout, un point de méthode me semble nécessaire. Si vous nous avez demandé il y a un an d'étudier ce sujet, c'est sans doute, entre autres raisons, parce que la généralisation des réseaux de fibre optique sur l'ensemble du territoire à la fin de l'année 2025 vous inspirait un certain nombre d'inquiétudes.
Cette échéance a été annoncée par le Gouvernement il y a cinq ans. L'accès au très haut débit par la fibre optique est d'autant plus important pour nos concitoyens que l'opérateur Orange a annoncé la fermeture du réseau cuivre, dont il est propriétaire, d'ici à 2030. Certaines opérations de fermeture sont d'ailleurs engagées.
Le rapport qui vous est présenté dresse donc un état des lieux, à la fin de l'année 2024, du déploiement de la fibre optique sur le territoire national. Il identifie également les enjeux de sa finalisation et de sa pérennité, qu'il s'agisse de la qualité du service, de sa résilience ou de sa viabilité économique.
Pour réaliser cette enquête, les rapporteurs ont mené soixante-huit entretiens, auprès du régulateur, des administrations, des opérateurs et des associations d'élus, notamment l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (Avicca) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Nous nous sommes également entretenus avec M. le sénateur Patrick Chaize.
Les juridictions financières ont également tenu à fonder leurs constats sur de nombreux exemples territoriaux. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec les chambres régionales des comptes (CRC) de Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays-de-la-Loire et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca).
Les contrôles effectués par ces CRC ont donné lieu à diverses observations portant sur des exemples territoriaux, lesquelles sont retracées dans le rapport. Par ailleurs, l'équipe a procédé à un certain nombre de visites de terrain, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, département dont Mme Espagnac est l'élue. En outre, un sondage a été réalisé auprès des RIP. Le taux de réponse atteignant 80 %, ce qui est très satisfaisant, nous disposons à cet égard d'un retour étayé.
J'en viens au fond de ce rapport. En premier lieu, j'évoquerai l'avancement du déploiement de la fibre optique en France : où en est la mise en oeuvre du plan France THD ? En deuxième lieu, je reviendrai sur la viabilité des réseaux financés par les fonds publics dans les zones de notre territoire considérées comme moins rentables pour les opérateurs privés. En troisième lieu, j'aborderai la qualité de service et la résilience des réseaux de fibre optique, enjeux qui deviennent prioritaires et appellent des actions rapides. Et, en conclusion, j'énumérerai les recommandations que nous avons formulées à l'issue de cette enquête.
Je rappelle que la France a fait le choix d'une méthode originale pour se doter d'une infrastructure numérique de très haut débit dans un délai relativement court. Il ressort de notre enquête que ce choix a permis d'atteindre l'objectif de large couverture du territoire en très haut débit.
Le plan lancé en 2013 par le Gouvernement repose sur une coopération forte entre les opérateurs privés et publics, entre l'État et les collectivités territoriales.
Les territoires les plus rentables, ou zones denses, ont été laissés aux opérateurs privés de télécommunications. On est parti du principe que ces derniers y avaient un intérêt économique pour développer la meilleure couverture possible.
Pour les zones les moins denses, les opérateurs ont pris des engagements contraignants de couverture, envers l'État dans les zones d'appel à manifestation d'intention d'investissement (Amii) et envers les collectivités territoriales dans les zones d'appel à manifestation d'engagements locaux (Amel).
Enfin, dans les zones où les opérateurs privés ne souhaitaient pas investir, que ce soit librement ou sur la base d'engagements contraignants, les collectivités territoriales se sont saisies, avec l'appui financier de l'État, de la compétence d'aménagement numérique. Le plus souvent, les travaux ont été confiés à des délégations de service public.
En 2020, à la suite de l'annonce par Orange de sa volonté de fermer le réseau cuivre, pour des raisons d'obsolescence et d'augmentation des coûts de maintenance, l'État a annoncé « la généralisation de la fibre optique partout sur le territoire ». En zone moins dense, le régulateur, à savoir l'Arcep, contrôle le respect des engagements contraignants de déploiement.
Au vu de l'enquête menée par les juridictions financières, le modèle de déploiement retenu par la France a porté ses fruits. Notre pays, qui, en la matière, était classé vingt-sixième sur vingt-huit en 2015, se trouve désormais en tête des classements européens. Ainsi, au troisième trimestre 2024, 90 % des locaux identifiés par les opérateurs privés ont été rendus raccordables à la fibre optique. Le nombre d'abonnements effectifs est passé de 4,8 millions en 2017 à 23,7 millions au troisième trimestre 2024. On a donc assisté à leur quasi-quintuplement en sept ans.
Ce succès masque évidemment des situations disparates, pour nos territoires comme pour nos concitoyens. L'analyse des données complètes, disponibles auprès de l'Arcep, fait état d'une meilleure couverture dans les zones les plus rentables, confiées aux opérateurs privés, 92 % de locaux y étant raccordables contre 84 % dans les RIP. Mais, si l'on observe le rythme de déploiement, les résultats sont peu ou prou inversés. Au cours du dernier trimestre 2024, la progression de la couverture est deux fois moins rapide dans les zones très denses que dans les zones RIP. Ce ralentissement du déploiement dans les territoires les plus denses traduit incontestablement un choix des opérateurs : porter les efforts où ils doivent respecter des objectifs contraignants, sous peine de faire l'objet de sanctions de la part du régulateur. Ce fut le cas pour Orange en 2024.
En zone dense, les pouvoirs publics sont, du moins à ce stade, privés de moyens contraignants envers les opérateurs.
À ce titre, je citerai deux exemples illustrant tout particulièrement les difficultés observées.
Le premier exemple figure dans le rapport : c'est celui de la commune de Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, qui, malgré l'implication très forte des élus locaux et de leurs administrés, n'a pas réussi à obtenir un taux de raccordement suffisant. Bien sûr, cette commune n'est pas la seule concernée. Dans les agglomérations particulièrement denses se trouvent ce que l'on appelle des poches de basse densité.
Le second exemple illustre les effets de seuils constatés entre les zones denses et les zones soumises au contrôle du régulateur. Dans l'agglomération niçoise, la zone dense de Nice pourrait présenter, dans certaines unités territoriales, un déploiement de 71 % seulement, 16 points sous le taux de déploiement de la commune limitrophe de Colomars.
Les juridictions financières établissent ainsi, au terme de l'enquête, que si la plupart des Français auront effectivement accès à la fibre optique en 2025 certains territoires n'atteindront pas l'objectif de généralisation fixé par les pouvoirs publics à cette échéance. Il est donc nécessaire de remobiliser rapidement l'ensemble des acteurs, nationaux et territoriaux, privés et publics, pour atteindre cet objectif.
Les raccordements les plus difficiles ou les plus chers, dont le coût peut être estimé entre 600 millions et 2 milliards d'euros, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Qu'il s'agisse de la fibre ou des technologies alternatives, les aides publiques susceptibles d'être mobilisées doivent disposer d'une meilleure visibilité.
Face à ces constats, nous formulons trois recommandations. Premièrement, l'Arcep pourrait synthétiser chaque trimestre, de façon lisible et facilement accessible, l'avancement du déploiement par opérateur et par zone, dans une logique de régulation par la donnée qu'elle met du reste déjà en oeuvre. Deuxièmement, nous appelons le Gouvernement et le régulateur à une concertation avec les opérateurs d'infrastructures (OI), pour négocier des objectifs contraignants en zone dense, si nécessaire en modifiant la loi. Troisièmement et enfin, nous soulignons la nécessité de relayer plus activement la communication d'Orange relative à la fermeture du réseau cuivre. Cette décision reste assez largement méconnue par nos concitoyens ; elle peut légitimement les inquiéter, puisque son échéance approche.
J'en viens à présent au financement du plan France THD et à la viabilité des modèles économiques des RIP.
L'analyse des financements montre que ce plan a su combiner fonds publics et fonds privés. Cela étant, les RIP devront faire l'objet d'une vigilance particulière dès cette année : il convient de finaliser et de sécuriser le financement des infrastructures considérées.
L'important effort consenti par l'ensemble des acteurs a été supporté à 57 % par les pouvoirs publics. Au total, les financements apportés au cours de la période 2010-2024 s'élèvent à 22 milliards d'euros. Ils proviennent des opérateurs privés pour 43 % du total, des collectivités territoriales pour 42 % et de l'État pour un peu plus de 15 %.
À l'échelle de chaque RIP, on observe toutefois une grande variabilité des financements et de leur répartition entre public et privé. Ce constat s'explique en général par le montage choisi et par la date de construction du réseau. Les dernières concessions ont été négociées dans des conditions plus favorables aux collectivités territoriales que les premières - on constate, en somme, un coût d'apprentissage.
S'agissant de l'investissement privé dans les zones laissées à l'initiative des opérateurs, il est difficile d'établir le montant exact des financements. Je rappelle que les juridictions financières n'ont pas compétence sur les opérateurs privés.
Au total, malgré des ajustements à la hausse relativement limités, le plan France THD aura respecté sa trajectoire budgétaire au cours de la période.
L'État a honoré ses engagements : sur 3,5 milliards d'euros déployés au titre des décisions d'attribution des RIP, 2,5 milliards d'euros avaient été consommés à la fin de l'année 2024. Les demandes de versements de tranches additionnelles et de soldes devraient s'élever à 734 millions d'euros entre 2025 et 2027. Il conviendra de suivre avec attention les besoins persistant pour s'assurer de la disponibilité effective des crédits.
Permettez-moi de présenter rapidement les observations relatives à la fiabilité des modèles économiques des RIP.
Les plans d'affaires ont été conçus sur la base des lignes directrices tarifaires établies en 2015 par l'Arcep. Or les modèles économiques initialement envisagés ne sont plus totalement en adéquation avec les recettes et les charges effectivement constatées.
Au titre des recettes, le niveau de cofinancement par les opérateurs commerciaux est moins rémunérateur qu'initialement prévu par les RIP. De plus, les coûts des raccordements les plus difficiles n'ont pas toujours été correctement anticipés. Leur nombre et leur nature n'étaient pas encore connus lorsque le déploiement de ces réseaux a commencé. De leur côté, les opérateurs ont peut-être eu tendance à minimiser les coûts pour emporter les mises en concurrence.
L'enquête met en avant un degré variable de sensibilisation aux risques financiers auxquels ils sont exposés. Certains concentrent en effet prioritairement leurs efforts sur le déploiement de ces réseaux. Nous recommandons de confier à l'ANCT une mission d'accompagnement des RIP pour mettre à jour leur plan d'affaires et de faire aboutir dès cette année les travaux menés par l'Arcep pour objectiver les coûts observés dans les RIP et revoir les lignes directrices tarifaires.
L'enquête s'est enfin attachée aux enjeux de qualité et de résilience des réseaux. D'abord, on relève, de façon localisée, des problèmes importants de qualité, qui affectent 2 % des lignes en France et occasionnent des désagréments très importants pour les usagers concernés, pendant, parfois, de longues années. Les plans de reprise des réseaux pilotés par l'Arcep permettent d'enregistrer des améliorations notables, mais les performances de ces réseaux sont encore en-deçà des standards de qualité du marché. Aussi, nous recommandons une intervention plus contraignante du régulateur en matière de qualité, d'une part en sanctionnant les opérateurs d'infrastructures si des défauts de qualité graves et persistants font obstacle à l'accès effectif aux réseaux, d'autre part en permettant à l'Arcep d'auditer les réseaux fixes de télécommunication, comme elle le fait déjà pour les réseaux mobiles.
Ensuite, le choix du mode « Stoc » (« sous-traitance à l'opérateur commercial »), c'est-à-dire par les opérateurs commerciaux (OC), pour la totalité des raccordements finaux, se traduit souvent par des malfaçons qui peuvent dégrader les infrastructures et provoquer des pannes pour les usagers. Il n'y a pas, à ce jour, d'indicateur fiable pour mesurer ces dysfonctionnements et ces derniers devraient être publiés dans les meilleurs délais par le régulateur.
Les problèmes de qualité constituent un irritant local très important, notamment parce que les élus locaux sont interpellés directement sur ces sujets. Les actions déployées par la filière depuis 2019 pour maîtriser la sous-traitance, notamment en faveur de la qualité des interventions, de la formation des intervenants et du contrôle de la qualité des interventions, se heurtent parfois à la difficulté d'identifier l'opérateur responsable. C'est pourquoi nous recommandons d'introduire une obligation légale d'indemnisation de l'abonné par l'opérateur commercial en cas d'interruption longue du service et de confier à l'Arcep un pouvoir de sanction des opérateurs commerciaux en cas de non-respect des niveaux de qualité attendus pour les raccordements finaux.
Enfin, la résilience des réseaux est un chantier qui reste largement à réaliser, mais qui devrait devenir prioritaire. En effet, seulement 11 % des RIP qui ont répondu à notre sondage ont commencé à disposer d'un schéma de résilience, alors que les événements météorologiques de plus en plus intenses peuvent endommager les réseaux de fibre. Il n'existe pas à ce jour de cadrage national suffisant et les initiatives de renforcement de la résilience des réseaux, coûteuses, sont menées en ordre dispersé. Nous recommandons donc d'élaborer, sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) une stratégie de résilience des réseaux de fibre optique qui intègre les problématiques techniques, juridiques et opérationnelles. L'enquête a mis en évidence que, en cas de crise, le morcellement des acteurs impose une coordination que les schémas opérationnels de gestion de crise n'ont pas encore totalement intégrée. Les épisodes d'intempéries intenses dans les Alpes-Maritimes en 2020 ou en Bretagne en 2023 ont révélé un réel point de fragilité. Nous préconisons donc, sous l'égide des préfets, de s'assurer de la bonne intégration des réseaux de fibre optique dans les dispositifs locaux de planification et de gestion de crise.
Mme Frédérique Espagnac, rapporteure spéciale. - Je remercie les équipes de la Cour des comptes pour cette enquête. Conduite à notre demande, elle nous apporte un bilan éclairant sur le déploiement du plan France Très Haut Débit. Si nous pouvons nous féliciter du volontarisme affiché sur cette politique publique, nous constatons toutefois plusieurs fragilités, mises en lumière dans le rapport de la Cour des comptes, qui portent à la fois sur la dynamique de déploiement de la fibre, sur le modèle de financement des RIP ainsi que sur la qualité et la résilience des réseaux.
Le plan France Très Haut Débit a favorisé le déploiement de la fibre dans plus de 90 % du territoire. Ce chiffre reluisant masque toutefois de très fortes disparités territoriales. Pour nos concitoyens des territoires les plus enclavés, le déploiement de la fibre n'est pour l'instant qu'un mirage. Comment justifier, à l'heure de la dématérialisation des services publics, que des pans entiers de la population soient privés d'accès à la fibre ?
Les derniers kilomètres de déploiement de cette technologie seront à la fois les plus coûteux et les plus complexes à réaliser. C'est pourquoi il nous semble un peu tôt pour donner un satisfecit à ce projet. L'enquête de la Cour des comptes fait en effet état d'un ralentissement du déploiement, particulièrement dans les zones très denses. Nous souscrivons à la recommandation de la Cour qui vise à ce que des engagements contraignants soient pris par les opérateurs dans les zones denses. Cependant, nous constatons que l'Arcep ne mobilise pas suffisamment son pouvoir de sanction pour faire respecter les obligations de déploiement dans les zones où c'est déjà le cas. Madame la présidente de l'Arcep, nous insistons sur la nécessité que le régulateur se saisisse pleinement de ses prérogatives.
De plus, l'enveloppe de 16,1 millions d'euros consacrée aux raccordements complexes en zone privée votée dans le PLF 2025 ne sera évidemment pas suffisante, puisque le coût global de ces raccordements est estimé entre 640 millions d'euros et plus d'un milliard d'euros. Où en est le lancement de cette expérimentation ? Qu'en est-il des raccordements complexes en zone publique ? Une enveloppe de 150 millions d'euros a été prévue en 2021, mais n'a, à ce jour, été que très peu consommée. Les collectivités locales sont-elles suffisamment informées sur l'existence de ce dispositif ? Quel premier bilan peut-on en tirer ?
Il n'est pas acceptable que certains de nos concitoyens soient privés d'accès à la fibre faute d'infrastructure de génie civil pour réaliser les raccordements. Le recours au satellite est régulièrement présenté par les opérateurs comme une solution, mais cette technologie alternative ne peut constituer qu'une solution transitoire, puisqu'elle ne présente pas les mêmes garanties que la fibre en matière de qualité du débit et pose un vrai problème de souveraineté, ce marché étant dominé par des entreprises étrangères telles que Starlink.
Enfin, le déploiement ne peut être réalisé dans de bonnes conditions si le décommissionnement du réseau cuivre d'Orange, prévu d'ici à 2030, n'est pas correctement anticipé. Or, l'ensemble des acteurs que nous avons entendus en audition constatent un manque criant d'information de la part de l'État sur cette question. La communication ne peut pas reposer uniquement sur les élus de terrain, qui sont, dans le même temps, en première ligne pour justifier les retards de déploiement auprès des citoyens... Nous souscrivons donc à la recommandation de la Cour : il est grand temps qu'une campagne de communication d'ampleur nationale soit réalisée sur cette question. Certains nous répondront que, contrairement à ce qui avait été mis en oeuvre au moment de la création de la TNT, l'intérêt économique de l'État est limité. Mais il y va de l'intérêt de nos concitoyens.
J'en viens maintenant à la question du financement des RIP. Ces projets ont bénéficié d'un soutien public important, principalement des collectivités locales, à hauteur de 8,7 milliards d'euros, mais aussi de l'État, à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Ces financements ont eu un vrai effet levier sur les investissements privés, et nous nous en félicitons.
Nous avions toutefois alerté notre commission lors de l'examen du PLF 2025 sur le risque impliqué par les coupes budgétaires successives décidées par le Gouvernement sur le programme 343 « Plan France Très Haut Débit ». On décompte en effet depuis près d'un an : 116,8 millions d'euros annulés par le décret d'avance du 21 février 2024 ; 85 millions d'euros annulés par la loi de finances de fin de gestion pour 2024 ; 21,6 millions d'euros supprimés par un amendement de rabot du Gouvernement dans le PLF 2025 ; enfin, le gel de crédit annoncé il y a deux semaines par la ministre des comptes publics au titre de la réserve de précaution devrait priver le programme de 12,5 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires.
La Cour des comptes souligne que l'ensemble des décaissements nécessaires ont pu être assurés en 2024 par l'ANCT, grâce à sa trésorerie excédentaire et à une sous-exécution des crédits. On peut toutefois s'interroger sur les raisons de cette sous-exécution. Certaines remontées du terrain font état de contrôles zélés de l'ANCT, qui ralentiraient de facto le rythme des décaissements. Y-a-t-il eu un pilotage des crédits par un renforcement des contrôles réalisés par l'ANCT au moment des versements des soldes de subventions aux RIP ?
Le rapport de la Cour des comptes souligne également que le montant des crédits de paiement actuellement disponibles pour 2025 serait largement inférieur aux besoins des collectivités, de 84 millions d'euros. Comment comptez-vous gérer cette situation ? Par ailleurs, la Cour nous alerte sur le fait que la disponibilité des autorisations d'engagement consacrées au RIP de Mayotte, introduites sur l'initiative de notre commission dans le PLF 2025, ne serait pas garantie. Cette situation n'est pas acceptable puisque le Parlement a clairement exprimé son intention sur le sujet. Pouvez-vous confirmer que ce projet, dont le déploiement vient d'être lancé, pourra se concrétiser et que les crédits seront disponibles en temps utile ? Ces crédits doivent être sanctuarisés. C'est l'objet de notre première recommandation.
Les prochains exercices budgétaires devraient concentrer un volume important de demandes de versement de la part des RIP au fur et à mesure de leur achèvement. Or, si l'État décide dans le même temps de réduire la voilure sur le plan budgétaire, les collectivités seront contraintes de s'y substituer, alors que leur situation financière ne le permettra pas. Cela se répercutera in fine sur les opérateurs et leurs sous-traitants, fragilisant le tissu économique local.
M. Thierry Cozic, rapporteur spécial. - Je compléterai les propos de ma collègue en évoquant le déséquilibre du modèle économique des RIP mis en évidence par la Cour des comptes. En effet, les plans d'affaires des RIP ont été construits sur la base de lignes directrices tarifaires établies par l'Arcep en 2015. Toutefois, ces lignes directrices, basées sur le modèle des zones denses, sont inadaptées à la réalité des coûts que les RIP doivent supporter. Les coûts d'exploitation sont en effet significativement plus élevés en zone publique qu'en zone dense et plusieurs des personnes que nous avons entendues en audition nous ont indiqué que les tarifs d'accès à la fibre sur le marché de gros ne permettaient pas de les compenser.
Pourtant, l'Arcep tarde à faire évoluer sa doctrine et refuse pour le moment des hausses tarifaires demandées par certaines collectivités, qui doivent dès lors compenser le déficit d'exploitation par des subventions. À défaut de pouvoir faire évoluer les tarifs, les collectivités risquent d'être confrontées, lors du renouvellement des délégations de service public, à un défaut de candidat, puisqu'aucun opérateur d'infrastructures ne souhaitera s'engager dans un modèle dans lequel les coûts d'exploitation ne seront pas couverts. Les collectivités pourraient ainsi se trouver contraintes d'assumer seules les charges d'exploitation du réseau, et face à cette impasse, devoir les céder à des opérateurs. Madame la présidente de l'Arcep, quelle est votre stratégie pour éviter que les collectivités n'en arrivent là ? Constatez-vous un intérêt de la part de certains opérateurs pour le rachat de réseaux aux collectivités ? Quel est le calendrier envisagé par l'Arcep pour faire aboutir ces travaux d'actualisation des lignes tarifaires ?
Par ailleurs, certains opérateurs d'infrastructures nous ont alertés sur l'absence de méthodologie fixée par l'Arcep pour la remontée des informations nécessaires à ces travaux d'actualisation. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ? Notre deuxième recommandation plaide pour la définition d'un calendrier et d'une méthode clairs pour que ces travaux soient menés dans les meilleures conditions.
En outre, la qualité des raccordements devient un véritable enjeu au fur et à mesure de l'avancée du déploiement de la fibre. La Cour des comptes a mis en évidence les problèmes posés par la sous-traitance aux opérateurs commerciaux du raccordement final jusqu'à l'abonné.
Je fais ici référence au recours au mode « Stoc », modèle unique au monde, qui a eu pour principal avantage d'accélérer la pénétration de la fibre dans nos territoires, en permettant aux opérateurs commerciaux qui réalisent les raccordements de démarcher directement les consommateurs. Toutefois le recours au mode « Stoc » présente plusieurs écueils : recours à la sous-traitance en cascade ; main d'oeuvre peu qualifiée ; conditions de sécurité parfois désastreuses pour les sous-traitants. Cette situation engendre de nombreuses malfaçons dans les raccordements et des débranchements de ligne injustifiés. Il est grand temps que le Gouvernement, le législateur et le régulateur agissent concrètement pour régler ces problèmes, dans l'intérêt des consommateurs, qui sont les premiers à pâtir de la dégradation des réseaux et de la répétition des coupures d'internet.
L'Arcep a publié la semaine dernière les chiffres grâce auxquels on peut identifier les opérateurs mauvais élèves en matière de qualité des réseaux. On y apprend que Free et dans une moindre mesure SFR affichent les taux de malfaçons les plus élevés. Madame la présidente de l'Arcep, le name and shame des opérateurs commerciaux présente un certain intérêt mais ne suffira pas à enrayer le phénomène. Il faudra à l'avenir que l'Arcep soit dotée d'un pouvoir de sanction contre les opérateurs commerciaux peu scrupuleux et qu'elle s'en saisisse pleinement.
Le sujet de la qualité des réseaux fait également écho aux dispositions de la proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de notre collègue Patrick Chaize, adoptée par le Sénat en octobre 2023. Je pense notamment au renforcement des droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée de l'accès à internet, que nous mettons en avant dans notre troisième recommandation. Espérons que cette proposition de loi soit prochainement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, face aux difficultés pratiques posées par le mode « Stoc », nous estimons que la possibilité d'une remise en cause de ce modèle devrait être davantage explorée, compte tenu de la progression du taux de pénétration de la fibre. En effet, l'activité de raccordement se réduira, à terme, aux seuls cas où l'abonné changera d'opérateur commercial et au raccordement des locaux neufs. L'opérateur d'infrastructures pourrait ainsi devenir le principal acteur intervenant sur son réseau. D'après le rapport de la Cour, plusieurs collectivités ont mis en place des expérimentations afin de tester des alternatives au mode « Stoc ». C'est une initiative intéressante que l'État devrait davantage encourager et accompagner. C'est le sens de notre quatrième et dernière recommandation.
Enfin, d'après la Cour, la résilience des réseaux fait l'objet d'une réflexion assez peu aboutie. Nous avons identifié, dans le cadre de nos travaux, plusieurs facteurs de fragilisation des réseaux :la multiplication des actes de vandalisme, les risques climatiques face auxquels les territoires ne sont pas tous égaux, mais aussi la densification de certaines zones et le développement du télétravail qui impliqueront des besoins de raccordement supplémentaires et auront donc mécaniquement un impact sur le dimensionnement des infrastructures existantes.
Face à ce constat, ma collègue Frédérique Espagnac et moi-même souscrivons à la recommandation de la Cour : une stratégie nationale de résilience des réseaux de fibre optique doit être mise en oeuvre. Je souhaite d'ailleurs vous entendre sur ce sujet : le Gouvernement a-t-il engagé des travaux pour renforcer la résilience de nos réseaux ?
M. Sébastien Fagnen, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, permettez-moi au préalable de vous remercier de votre invitation. Au regard de l'exhaustivité de la présentation effectuée par Mme la présidente de la première chambre de la Cour des comptes et des deux rapporteurs spéciaux, je serai bref.
Tout d'abord, je tiens à saluer les recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par les rapporteurs spéciaux, auxquels je souscris sans réserve, d'autant qu'il s'agit de thématiques que nous avons évoquées à plusieurs reprises dans nos travaux respectifs, aussi bien au sein de la commission des finances qu'au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je pense à ce titre à la table ronde organisée le 6 novembre 2024 au Sénat, à l'initiative du président Jean-François Longeot, sur le déploiement de la fibre optique dans notre pays.
J'insisterai sur deux recommandations en particulier.
En premier lieu, je m'arrêterai sur la communication faite auprès du grand public, aussi bien des collectivités locales que de nos concitoyens, sur la fermeture du réseau cuivre qui représentera une révolution dans le quotidien de beaucoup de nos concitoyens ainsi que pour les collectivités locales. Il est indispensable que nous puissions déployer nos efforts en direction de nos concitoyens les plus fragiles et les plus éloignés des usages de l'internet.
En second lieu, je souhaite souligner l'importance de la stratégie nationale de résilience des réseaux de fibre optique, dont la mise en oeuvre sera essentielle voire vitale pour la pérennité de nos infrastructures. Je pense évidemment aux actes de sabotage que nous avons subis en marge des derniers jeux Olympiques, car si le réseau ferroviaire a été touché, le réseau de fibre optique a lui aussi été visé durant l'été 2024. Bien entendu, le contexte géopolitique actuel implique que nous redoublions de vigilance à cet égard.
Je conclurai en évoquant la situation mahoraise, dans la mesure où le déploiement de la fibre optique dans le département de Mayotte a connu quelques vicissitudes budgétaires. De ce point de vue, les rapporteurs spéciaux ont parfaitement raison de vouloir sanctuariser les crédits budgétaires qui lui sont dédiés. Peut-être serait-il intéressant que l'on fasse de Mayotte la tête de pont de la mise en oeuvre de cette stratégie nationale de résilience des réseaux de fibre optique, non seulement pour assurer la pérennité opérationnelle dudit réseau et son redéploiement rapide en cas d'aléa climatique - c'est fondamental dans le contexte malheureux du passage du cyclone Chido sur l'île ; cela l'est tout autant dans nombre de territoires appelés à subir ce type de catastrophes dans l'avenir -, mais aussi pour garantir la souveraineté de nos infrastructures - nous avons tous à l'esprit la mésaventure qu'a représenté le recours à Starlink et les délicates relations qui en ont découlé avec l'un de nos opérateurs historiques.
Mme Laure de La Raudière, présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). - Je tiens tout d'abord à remercier Mme la présidente de la première chambre de la Cour des comptes, ainsi que son équipe, pour ce rapport très intéressant et complet, qui permet de faire le point sur cet enjeu majeur pour nos concitoyens qu'est le déploiement de la fibre optique. Ce sujet est crucial, parce qu'internet est à la fois au coeur de notre vie quotidienne et facteur de développement économique. C'est aussi important pour nous, parce que le développement d'infrastructures numériques partout, pour tous, et pour longtemps, s'inscrit pleinement dans notre stratégie, laquelle implique de prendre en compte l'équilibre financier de ces réseaux ainsi que la qualité de service et la bonne couverture du territoire.
Votre première recommandation porte sur l'équilibre économique des RIP. À ce titre, il est demandé à l'Arcep de faire aboutir en 2025 les travaux d'objectivation des coûts observés dans les RIP. C'est une priorité que nous avions d'ores et déjà bien identifiée. Nous travaillons en ce sens depuis plus d'un an : nos travaux d'analyse, engagés sous la forme d'ateliers, avec la participation des opérateurs d'infrastructure volontaires, visent à objectiver les surcoûts constatés à la fois en termes de construction et d'exploitation des réseaux et à en identifier les causes.
Ces travaux devront aboutir en 2025 : ils permettront de donner aux différents acteurs, et notamment aux RIP, davantage de visibilité sur les coûts des réseaux FTTH (Fiber to the Home - fibre jusqu'à l'abonné) et sur leurs perspectives économiques, ce qui devrait faciliter la discussion avec les opérateurs commerciaux lors des négociations ayant trait aux tarifs d'accès. L'objectif de notre travail est d'offrir un horizon aux acteurs quant aux coûts des réseaux FTTH ; à charge ensuite aux opérateurs d'infrastructures qui les exploitent de les traduire en tarifs, notamment dans le cadre des contrats entre ces opérateurs et les opérateurs commerciaux.
Ces travaux comprennent deux volets. Le premier consiste à établir une grille de catégorisation des coûts des opérateurs d'infrastructures, laissant apparaître pour chaque poste la définition et, lorsque cela est possible, l'inducteur de coûts. Le second volet est d'enrichir cette grille de coûts unitaires indicatifs permettant d'élaborer des fourchettes de valeurs. Vous le savez, les tarifs sur les réseaux d'initiative publique comme sur les autres réseaux doivent respecter plusieurs principes légaux : le principe de non-discrimination ; le principe d'objectivité, c'est-à-dire que ces tarifs doivent être établis à partir de critères clairs et opposables ; le principe de pertinence, c'est-à-dire qu'ils doivent reposer sur un partage à la fois des coûts et des revenus ultérieurs ; et le principe d'efficacité des investissements.
Dans notre travail de recensement de ces coûts, en partenariat avec les collectivités ou les opérateurs d'infrastructures volontaires, nous avons observé des schémas, des modèles économiques ou des comptes d'exploitation assez différents d'un territoire à l'autre. Certains d'entre eux ont prévu un amortissement sur quinze ans, ce qui nous paraît un terme assez court pour amortir une infrastructure de cette nature ; de notre côté, nous avions plutôt prévu une durée d'amortissement de l'ordre de vingt-cinq ans...
Nous constatons aussi de grandes variations en termes de frais de siège ou de frais de structure - cela peut varier du simple au triple -, au sujet desquelles nous avons beaucoup de mal à trouver des explications. Nous avons évidemment besoin d'éléments objectifs pour pouvoir disposer d'une fourchette de coûts englobant l'ensemble des coûts d'exploitation. Ces éléments objectifs peuvent résulter des différences observées d'un territoire à l'autre, notamment leur degré de ruralité, l'ampleur des zones à couvrir, mais nous continuons à nous interroger sur certains écarts de coûts.
En la matière, nous avons également besoin d'un partenariat renforcé avec l'ensemble des RIP pour pouvoir disposer de données directement exploitables, qui nous permettent d'avancer rapidement. En tout cas, vous pouvez compter sur ma vigilance, sur mon engagement sur cette question, tant l'économie des RIP et l'économie de tous ces réseaux de fibre optique sont importantes pour permettre à nos concitoyens d'avoir un accès à l'internet très haut débit dans la durée.
J'en profite pour répondre à l'une des questions que vous m'avez posées, monsieur le rapporteur spécial : non, je n'ai pas été saisie de demandes d'opérateurs souhaitant racheter des RIP. Je sais que la rumeur circule et je ne dis pas que cela n'existe pas, mais nous n'avons pas été saisis sur ce point particulier.
Le deuxième sujet que vous avez abordé, qui est au coeur de nos préoccupations et de mon attention depuis ma nomination à la présidence de l'Arcep en 2021, est celui de l'objectif de qualité de service. Durant un certain temps, je me suis refusée à dire que le déploiement de la fibre était un succès tant l'Arcep recevait des plaintes concernant la qualité des réseaux. Des difficultés persistent, certains agents d'intervention sur le terrain continuent de recourir à des pratiques non appropriées, mais nous notons des améliorations, qui doivent bien sûr s'apprécier dans le temps. Le plan qualité mis en place en 2022 par la filière à la demande du ministre et de moi-même porte ses fruits.
La Cour des comptes propose que soient engagées des procédures de sanction à l'égard des opérateurs d'infrastructures lorsque des défauts de qualité graves et persistants font obstacle à l'accès effectif à leurs réseaux.
Pour ma part, je n'hésiterai pas à lancer de telles procédures ; cela me donne d'ailleurs l'occasion de répondre à une autre de vos questions, monsieur le rapporteur spécial : en 2022, l'Arcep a sanctionné Free Caraïbe pour non-respect de ses obligations de déploiement du réseau mobile dans la zone Antilles-Guyane ; en 2024, nous avons sanctionné Orange pour non-respect de ses engagements en zone Amii, lui infligeant une amende d'un montant de 26 millions d'euros. Plus récemment encore, l'Arcep a lancé des procédures de sanction pour non-respect des obligations de complétude du déploiement à l'encontre de 900 000 locaux en France, tous gérés par Orange ou SFR. Les échéances de ces mises en demeure sont à venir : nous verrons le moment venu si les opérateurs ont respecté ou non les injonctions que nous leur avons adressées.
Le pouvoir de sanction est l'un des outils que nous utilisons pour faire cesser des manquements aux règles auxquelles sont assujettis les opérateurs. C'est un outil puissant, mais assez contraignant, parce qu'il implique d'être en mesure de constater ces manquements sur le terrain, de les objectiver, et de disposer des bons indicateurs pour nous garantir une assise juridique solide.
Comme vous l'avez dit, madame la présidente de la première chambre de la Cour des comptes, en matière de qualité de service, il convient de prendre l'opérateur sur le fait. Or un régulateur n'a pas forcément des agents sur le terrain pour aller constater les défauts en matière de qualité de service. En réalité, c'est un processus assez long et contradictoire : nous devons laisser un certain délai aux opérateurs pour respecter les mises en demeure avant de passer à la phase de notification des griefs. À ce stade, je ne suis donc pas convaincue que la procédure de sanction soit le meilleur outil pour améliorer rapidement la qualité des réseaux de fibre optique.
Nous souhaitons tous que les réseaux fonctionnent pour longtemps. Aussi, nous avons privilégié une approche systémique de mise sous tension de la filière.
Cela passe d'abord par la reprise des réseaux en difficulté : je pense aux plans concernant XpFibre, Altitude et Free, dont on observe les résultats positifs au sein des observatoires de qualité de service. Il faut vérifier que cela fonctionne dans la durée et nous resterons très vigilants sur ce point.
Nous veillons ensuite à ce que les opérateurs d'infrastructures assurent un contrôle effectif des intervenants en mode « Stoc », autrement dit des sous-traitants des opérateurs commerciaux qui interviennent sur leur réseau. Ont été mises en place un certain nombre de procédures, comme les comptes rendus d'intervention avec photos, les applications d'e-intervention ou la labellisation des sous-traitants. Nous venons de publier il y a une quinzaine de jours, dans le cadre de notre dernière édition de l'observatoire de la qualité de service, des indicateurs pour refléter les pratiques des différents opérateurs commerciaux. D'une certaine manière, nous avons anticipé la recommandation de la Cour en mettant les opérateurs sous pression.
La publication annuelle d'une enquête de qualité de service, qui met en avant les résultats obtenus par chacun des opérateurs, incite ces derniers à investir pour approcher la perfection. Nous sommes assez convaincus qu'un tel travail portera ses fruits. Pour ce qui concerne la reprise des réseaux en difficulté, le taux moyen de panne sur ces réseaux est passé, en six mois, de 0,5 % à 0,3 %. La cible que nous visons en la matière se situe entre 0,05 % et 0,1 %.
Nous soutenons en revanche la recommandation qui consiste à prévoir, dans le droit de la consommation, une indemnisation de l'abonné en cas d'interruption durable du service ou la possibilité pour celui-ci de résilier son accès si l'interruption de service dure longtemps. Nous pensons que cette piste est préférable à celle de sanctions mises en oeuvre par l'Arcep à l'encontre des opérateurs commerciaux.
J'ajouterai un dernier mot sur la dynamique des déploiements : aujourd'hui, certains RIP et certains territoires très ruraux sont en avance par rapport aux zones très denses. Nous considérons l'obligation de généraliser la fibre dans les zones très tendues et moyennement denses comme un préalable à la fermeture du réseau cuivre. Nous pensons par conséquent que le projet de fermeture du réseau cuivre incitera les opérateurs à poursuivre leurs efforts dans ce domaine - nous sommes assez confiants sur ce point. Ce qui peut sembler étrange, c'est que, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer au départ, quand le plan France Très Haut Débit a été lancé, de très grandes communes comme Marseille, Montpellier ou Lille sont en retard par rapport à certains territoires ruraux. Nous estimons qu'à ce jour il n'y a pas matière à légiférer particulièrement sur le sujet : le plan de fermeture du réseau cuivre et l'intérêt économique qu'a Orange de fermer ce réseau accéléreront la complétude du déploiement de la fibre dans ces zones très denses.
M. Antoine Jourdan, sous-directeur des communications électroniques et des postes à la direction générale des entreprises (DGE). - Tout d'abord, je souhaite remercier la Cour des comptes pour son rapport, qui permet de mettre en évidence les réussites du plan France Très Haut Débit. L'essentiel de mon propos portera sur ce qui pose encore problème et ce qui reste à faire, mais je pense qu'il est essentiel de rappeler le succès impressionnant de ce plan. Aujourd'hui, en France, plus de 90 % des locaux sont raccordables et le taux d'abonnement à la fibre est parmi les plus élevés en Europe. Les progrès sont phénoménaux, sachant que tout cela s'est passé en moins de dix ans. Le dernier projet industriel d'une envergure comparable qui ait été lancé en France était le déploiement du réseau cuivre, et celui-ci a pris plus de trente ans...
Cette politique publique est donc un véritable succès ; elle nous a permis d'obtenir des résultats beaucoup plus probants que chez la plupart de nos voisins. Bien sûr, le déploiement de la fibre n'est pas achevé partout sur le territoire, mais nous avions pour objectif de l'achever d'ici à la fin de 2025. Certains territoires sont certes en retard, mais, globalement, il faut reconnaître que c'est une réussite.
J'en viens aux questions qu'il nous reste à traiter.
La première a trait à la complétude, c'est-à-dire l'achèvement du déploiement de la fibre. À cet égard, je reviendrai sur les concertations qu'il convient d'organiser auprès des opérateurs, en particulier en zone très dense, ainsi que sur la fermeture du réseau cuivre et la migration de celui-ci vers la fibre optique.
La seconde concerne la nécessité de nous assurer de la viabilité des réseaux, d'un point de vue tant économique que physique, pour assurer la qualité de service durant les décennies à venir. Je serai bref sur ce point, Mme la présidente de l'Arcep en ayant déjà longuement parlé.
Tout d'abord, en matière de complétude du réseau, je tiens à remercier de nouveau la Cour des comptes et les rapporteurs spéciaux du Sénat d'avoir mis en exergue les disparités qui peuvent exister. Nous sommes en train d'achever le déploiement de la fibre sur le territoire. Lorsque dans une commune, personne n'est raccordé à la fibre, il semble que ce soit plus facile de l'accepter que lorsque son voisin d'en face y est raccordé alors que l'on ne peut pas l'être - il n'y a rien de plus insupportable. Les élus avec qui nous échangeons quotidiennement nous confirment d'ailleurs être davantage sollicités par des personnes qui se trouvent dans cette situation. C'est bien pour cela qu'il nous faut aller au bout de ce déploiement.
En zones très denses, nous avons d'ores et déjà engagé un premier round de concertations en 2023, car nous sommes très vigilants pour éviter qu'il y ait des oubliés de la fibre dans certains territoires. Des promesses d'engagements contraignantes ont ainsi été signées par Orange dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, ce qui a relancé la dynamique du déploiement de la fibre, en particulier en zones très denses et dans plusieurs zones Amii qui sont en retard.
Toutefois, nous avons pris bonne note de vos remarques et nous relancerons une concertation avec les différents opérateurs en 2025. Comme vous avez pu le constater à la lecture de la presse économique, le paysage économique des quatre opérateurs commence à se stabiliser. Je pense en particulier à SFR, qui a engagé une restructuration de sa dette. Nous espérons que cette concentration nous permettra de définir un calendrier du déploiement de la fibre dans les zones très denses.
Comme l'a rappelé la présidente de l'Arcep, il convient évidemment de tenir compte de la corde de rappel liée à la fermeture du réseau cuivre : alors que le régulateur insiste sur le fait qu'il est impossible de le fermer tant que la fibre n'est pas déployée, Orange incite fortement à le faire.
Un autre frein est lié au raccordement complexe. Vous m'avez interrogé sur le calendrier de l'expérimentation pour le financement de ces raccordements dans le domaine privé. Les crédits ont été votés dans la loi de finances pour 2025 et nous avons déterminé en interne à quoi allait ressembler le dispositif. A priori, l'Agence de services et de paiement (ASP) sera chargée de l'aspect opérationnel, mais les discussions se poursuivent. Nous espérons lancer ce dispositif dans quelques mois. En tout état de cause, il est certain que de premiers éléments seront mis en oeuvre en 2025.
J'en profite pour vous remercier d'avoir voté les crédits finançant ce nouveau dispositif, qui améliorera sérieusement la connectivité à la fibre, car je sais que la situation budgétaire est tendue.
En ce qui concerne la migration des abonnés en amont de la fermeture du cuivre, il a beaucoup été question de la nécessité de communiquer sur la fermeture de ce réseau. Si l'État s'attache à ce que tout citoyen soit bien informé sur le sujet, le pilotage doit respecter un tempo assez fin. En effet, rien ne sert de réaliser une grande campagne de communication dans une commune en 2025 sur le fait que le réseau cuivre fermera en 2030, car l'information risque d'être oubliée en 2026, sans que les habitants aient agi.
Aussi, à moins de mener une communication nationale d'envergure sur le sujet en permanence jusqu'en 2030 - ce qui paraît peu souhaitable au vu de l'excès général d'informations qui peuvent circuler - l'État doit communiquer de manière ciblée, d'un point de vue à la fois géographique et temporel. Nous sommes actuellement en train de peaufiner ce ciblage.
Si la communication institutionnelle de l'État a vocation à prévenir les usagers, à les accompagner et à limiter les risques de fraude et de démarchage abusif, elle ne saurait se substituer à la responsabilité des opérateurs eux-mêmes. Il appartient à ces derniers d'inciter leurs clients à migrer vers le réseau fibre. Du reste, ils ont un intérêt économique à le faire : la migration vers la fibre améliore la qualité du service fourni à leurs clients et leur permet parfois de facturer un tarif premium.
Ensuite, la résilience des réseaux est une préoccupation que nous partageons tous. Je salue les recommandations de la Cour des comptes et du Sénat à cet égard. Le SGDSN s'est d'ores et déjà saisi du sujet et des travaux interministériels sont en cours.
Nous avons dressé un premier diagnostic à l'issue de la tempête qui a eu lieu en Bretagne il y a un an et demi et l'enjeu est davantage organisationnel que physique. En effet, il ne convient pas nécessairement d'enterrer tous les réseaux, car en cas d'aléa climatique ou de tremblement de terre, il est bien plus difficile de réparer un réseau enterré qu'un réseau aérien. Il faut s'adapter aux zones géographiques.
En revanche, il est nécessaire de structurer les plans Orsec (organisation de la réponse de sécurité civile) pour savoir comment agir en cas d'accident et accélérer la remise en état des réseaux sur le terrain. Le SGDSN s'est saisi du sujet et ces plans doivent être mis à jour d'ici à la fin de l'année 2025, de manière à ce que nous disposions d'un plan d'action global et concret en la matière.
M. Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). - Je reconnais et salue le travail réalisé par la Cour des comptes à la demande du Sénat, qui a abouti à un rapport très complet, donnant une photographie précise de la situation à l'instant t. Ce rapport consacre la réussite du plan France Très Haut Débit, qui a permis un déploiement rapide de la fibre sur l'ensemble du territoire.
Il s'agit pour l'ANCT d'un sujet très important en matière d'aménagement du territoire, car il permet de réduire la fracture numérique dont souffraient il y a dix ans les territoires ruraux, rendant alors très difficiles le développement économique, le télétravail et l'accès à certains loisirs. À l'heure où tout est numérisé, l'accès à la fibre représente un enjeu fondamental de développement des territoires.
Le taux de déploiement de la fibre dans les zones rurales a quasiment rattrapé celui des zones urbaines : il atteint désormais 88 %, contre 93 % dans les zones très denses - au lieu de respectivement 30 % et 80 % à la fin de 2020. L'accélération est considérable : cinq fois plus de locaux y sont raccordables par rapport à 2017.
Le succès de ce plan tient pour beaucoup à sa gouvernance originale. Dans les zones RIP, le déploiement de ce plan a été décentralisé et confié aux départements, aux régions, aux syndicats mixtes et aux structures locales qui se sont organisés, l'État assurant un soutien financier - à hauteur de 3,5 milliards d'euros -, de mise en cohérence et d'appui aux quatre-vingts projets qui ont été menés.
Au-delà de son rôle en matière de gestion des fonds au nom de l'État, l'ANCT joue un rôle de conseil et d'accompagnement dans la mise en oeuvre des projets, face à des difficultés techniques, organisationnelles, financières ou contractuelles.
Dans la situation actuelle, il convient de lever les derniers obstacles pour atteindre le niveau final de couverture dans la perspective de la fermeture du réseau cuivre. Si la généralisation dans les zones privées n'est pas la compétence de l'ANCT, nous développons, en lien avec tous les acteurs, des outils spécifiques pour accompagner les collectivités qui sont à la manoeuvre.
Nous travaillons ainsi sur trois thématiques faisant l'objet de recommandations de la part de la Cour des comptes : la qualité de service, la résilience et l'équilibre économique.
En ce qui concerne la qualité de service, l'agence contrôle l'ensemble des réseaux qui font l'objet d'une subvention de l'État en lien avec le plan France Très Haut Débit. Elle peut même mandater des audits de bon déploiement et de qualité de service lorsque cela est nécessaire, en lien avec les collectivités responsables. Nous l'avons déjà fait et nous continuons de le faire.
Ces contrôles ont permis à des collectivités de demander à leurs opérateurs des reprises de travaux pour garantir la qualité de service. Les délégataires sont alors sollicités. Nous y reviendrons, mais cela explique des versements de subventions légèrement différés, qui sont des moyens de faire respecter le cahier des charges.
Pour ce qui est de la résilience, nous apportons un appui technique par le biais des services déconcentrés de l'État. Comme vous le savez, les délégués territoriaux de l'agence sont les préfets, lesquels, au regard de leurs compétences en matière de sécurité publique, peuvent être concernés par les questions de résilience des réseaux.
Nous oeuvrons également, en lien avec le SGDSN, à informer et à donner tous les outils nécessaires aux comités de concertation locaux, qui ont été les bras armés du déploiement du plan d'action dans chaque département.
En matière d'équilibres économiques, le rapport préconise de confier à l'ANCT une mission d'accompagnement des RIP pour mettre à jour les plans d'affaires. Nous y sommes tout à fait favorables. En effet, nous avons constaté des fragilités économiques au sein de certains RIP, qui se traduisent par des tensions de trésorerie de certains opérateurs et des difficultés pour faire face à l'amortissement des emprunts contractés.
Pour autant, il nous semble que nous devons porter un regard plus global en la matière : au-delà du plan d'affaires de la collectivité porteuse de projet, il convient de se pencher sur les conditions de mise en oeuvre par le délégataire exploitant, les deux sujets étant intimement liés.
Sur la question des raccordements complexes en RIP et dans le domaine public - cela ne concerne pas l'expérimentation de la DGE sur le domaine privé -, l'agence est opératrice d'une enveloppe de 150 millions d'euros. Dans ce cadre, neuf dossiers de conventionnement ont déjà été validés et une trentaine d'autres sont en cours d'instruction. Il s'agit de dossiers quelque peu délicats, puisque l'opérateur et les collectivités doivent négocier pour obtenir une participation du privé à ces raccordements, ce qui rallonge les délais.
Nous constatons qu'un certain nombre de territoires potentiellement concernés ne nous ont pas encore saisis. Peut-être faudra-t-il les solliciter à nouveau.
Madame la rapporteure spéciale, notre méthode n'est pas de ralentir le décaissement par des opérations comptables du fait des moyens disponibles. Si tel était le cas, nous le dirions. Nous veillons scrupuleusement - peut-être est-ce du zèle - à ce que les cahiers des charges signés par les délégataires et les collectivités locales soient respectés avant d'accorder les subventions. Or ceux-ci prévoient des clauses sur la qualité et les conditions du déploiement de la fibre. Nous voulons tous achever le déploiement de la fibre sur tout le territoire le plus rapidement possible, mais il convient de ne pas aller trop vite. Sinon, nous nous heurtons à des problèmes de qualité.
La raison des délais de versement n'est pas liée à un manque de trésorerie ; nous avons simplement pris le temps de discuter pour obtenir des avancées très importantes des opérateurs. Je pense notamment à un opérateur qui ne voulait pas faire d'effort. En effet, par une action collective, les représentants nationaux et locaux de l'État et la collectivité concernée peuvent mettre la pression nécessaire sur l'opérateur pour qu'il réalise les travaux de reprise nous permettant ensuite de verser la subvention. Nous ne disposons pas du pouvoir de contrôle de l'Arcep, mais nous disposons de ce levier pour mettre un peu de pression dans le système.
Ainsi, nous avons pu décaisser 314 millions d'euros en 2024 et nous veillerons à décaisser tous les moyens qui seront mis à notre disposition pour répondre aux factures que nous recevrons en 2025.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je m'associe aux félicitations et aux remerciements adressés à Mme la présidente de la première chambre de la Cour des comptes et aux différents responsables du déploiement du plan France Très Haut Débit.
Il est rare qu'un plan aussi ambitieux soit couronné d'un tel succès. Alors que nous étions en queue de classement, nous faisons désormais figure de bon élève en matière de déploiement de la fibre, grâce à une mosaïque de dispositifs. Je découvre d'ailleurs l'existence de dispositifs répondant à des situations complexes.
En une décennie, nous sommes parvenus à régler une question suscitant autant d'irritants que d'attentes, en mêlant le privé et le public, avec leurs qualités et leurs défauts respectifs. Il n'est pas si courant que les élus, les acteurs économiques et les usagers - c'est-à-dire des Français- trouvent tous leur compte dans une politique publique. Je me réjouis d'une telle satisfaction compte tenu du degré d'engagement de chacune des parties.
Ma première question porte sur la qualité des prestations générales offertes par les opérateurs, les commerciaux et les gestionnaires d'infrastructures. Je pensais que l'Arcep était davantage concernée, mais il semble que l'ANCT le soit également. Dans mon département, la ville de Toul, qui est une sous-préfecture, se bat au sujet de la qualité des prestations des sous-traitants, qui ne respectent pas le cahier des charges quant à la pose de matériel ou les changements d'opérateurs. Ils travaillent souvent vite, pas toujours bien, et il est difficile de les retrouver pour les sanctionner. Le maire a donc pris un arrêté municipal, non sans une certaine efficacité.
Je prends cet exemple pour illustrer le fait que la situation n'est pas satisfaisante partout. ''De quels leviers disposent l'Arcep et l'ANCT pour améliorer les choses ? L'élaboration d'un cahier des charges complémentaire ou l'ajustement des cahiers des charges existants pour répondre aux contraintes spécifiques à un territoire sont-ils envisageables ?
Ma deuxième question est de portée très générale et s'adresse surtout à la présidente de la première chambre de la Cour des comptes. Quel est selon vous, madame la présidente, le dispositif le plus efficace pour déployer la fibre dans les territoires en fonction du nombre d'habitants concernés et du coût des opérations ? Je pense non seulement au coût de l'investissement et du déploiement, mais aussi à celui de la maintenance et de l'entretien.
Si vous avez identifié une formule pour concilier de la manière la plus efficace possible temps de déploiement, coût de l'investissement et frais de maintenance, celle-ci serait particulièrement utile à la commission des finances du Sénat et aux territoires qui ne sont pas encore raccordés à la fibre.
M. Hervé Maurey. - Je serai moins euphorique que le rapporteur général, car je fais partie de ceux qui ont contesté le modèle qui a consisté à donner ce qui était rentable au privé et à laisser aux collectivités locales ce qui ne l'était pas. Le rapport montre bien que près de 9 milliards d'euros ont déjà été prélevés sur le budget des collectivités locales et qu'il reste encore des investissements à réaliser, qui seront sans doute onéreux puisque le déploiement est dans sa dernière étape. Or compte tenu des contraintes budgétaires, nous aurons des difficultés à trouver ce financement. Je rappelle que l'un des coups de rabot porté dans le PLF 2025 avait consisté à sabrer les crédits destinés à financer la fin du déploiement du numérique.
Le sujet de la résilience dans le cadre de l'extinction du réseau cuivre reste assez peu abordé. J'ai adressé un courrier à la présidente de l'Arcep, il y a un mois, pour lui faire part du souhait des élus d'être informés le plus en amont possible sur la situation du raccordement des foyers à la fibre. Les élus voudraient en effet pouvoir communiquer sur la fermeture du réseau cuivre.
Sur la résilience à proprement parler, l'Arcep semble considérer que la qualité du réseau livré était meilleure en 2024 que lors des années précédentes. L'Avicca l'explique par le fait qu'il y a eu moins de réseau déployé en 2024. Vous pourrez nous dire ce qu'il en est.
La Cour considère qu'il faudrait plus de sévérité de la part de l'Arcep sous la forme d'« interventions plus coercitives en modifiant, si nécessaire, le cadre législatif. » J'aimerais savoir ce qu'il faudrait modifier et, surtout, quelles possibilités de sanction le cadre législatif actuel offre à l'Arcep. Il me semble en effet que l'Arcep ne souhaite pas privilégier la piste des sanctions. Par exemple, dans l'Eure, l'opérateur d'infrastructures XpFibre refuse de faire de l'enfouissement alors qu'il est tenu de le faire - vous nous l'avez confirmé -, mais l'Arcep ne le sanctionne pas.
Enfin, il existe de grandes disparités d'un département à l'autre. Le recours à l'échange de bonnes pratiques n'est pas assez exploité. Comment donc faire en sorte que le réseau soit le plus cohérent possible et que le taux de résilience soit à peu près satisfaisant dans tous les départements ?
M. Jean-Raymond Hugonet. - Je partage les réserves de notre collègue Maurey. Il faut en effet toujours étayer la vision à grande échelle par la situation telle qu'elle se présente sur le terrain.
À l'instar des particuliers, de plus en plus de collectivités sont confrontées à la problématique du raccordement final de la fibre. Trois cas de figure existent. Quand les fourreaux exploitables sont présents, il n'y a pas de problème. Si tel n'est pas le cas, la fibre suit le cuivre par voie aérienne, ce qui est un moindre mal. Mais, de plus en plus souvent, quand des fourreaux existent, ils sont inutilisables parce qu'ils sont très anciens, et personne ne souhaite financer leur débouchage, surtout pas les sous-traitants qui sont myriades. À ce moment-là, à l'image de ce qui se fait dans les ruelles napolitaines, les sous-traitants font passer de manière sauvage des câbles en aérien. Comment les communes peuvent-elles se prémunir contre de telles pratiques qui deviennent de plus en plus fréquentes, notamment dans mon département de l'Essonne, à 35 kilomètres de Paris ?
M. Victorin Lurel. - Ce rapport est très informatif, mais j'aurais aimé qu'il soit davantage documenté sur les outre-mer. La Cour a mené son enquête en consultant les chambres régionales des comptes, mais pas celles des outre-mer. Pourtant, il existe un rapport des chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, des Antilles et de la Guyane assez décapant sur les câbles sous-marins. Dans ces territoires, il faut en effet recourir plus qu'en métropole à des câbles sous-marins ou au satellitaire - on a vu ce qu'a fait Starlink à Mayotte -, ce qui pose certains problèmes en matière de souveraineté nationale. Comment connecter l'arrière-pays de la Guyane autrement que par la voie satellitaire, dès lors que cela implique d'aller au fin fond de l'Amazonie ?
Les RIP font souvent du FTTB (Fiber to building) alors que dans le privé, on privilégie le FTTLA (Fiber to the last amplificator). Dans le premier cas, la fibre provient du noeud de raccordement optique (NRO), alors que dans le second, une connexion par câble prend le relais jusqu'au domicile. C'est le privé qui paie le raccordement jusqu'au domicile et les collectivités qui financent les RIP. En Guadeloupe, par exemple, la région a passé un contrat de concession avec XpFibre pour un réseau dont la qualité ne semble pas très bonne. Pourriez-vous me renseigner sur ce point ?
Enfin, vous avez mentionné des travaux d'objectivation des coûts observés par les RIP. J'ai le même avis que mon collègue sur ce sujet. On a laissé les zones non rentables aux collectivités, selon un arbitrage qui peut sembler étrange. J'aimerais savoir si ce qui figure sur la facture que je reçois en Guadeloupe relève de ces coûts objectivés.
M. Arnaud Bazin. - Dans mon département de la Seine-Maritime, le déploiement de la fibre a été effectué depuis longtemps, mais il reste deux sujets importants à traiter.
L'un porte sur la complétude en zone de déploiement d'initiative privée, en particulier dans les cas où l'opérateur n'est pas Orange. En effet, il m'avait semblé comprendre, quand j'étais président de ce département, que les engagements de complétude de ces opérateurs ne couvraient pas 100 % des locaux. Or, dans la mesure où la perspective d'extinction du cuivre commence à se concrétiser, il va falloir donner des réponses aux gens qui sont dans des zones de déploiement SFR, par exemple, dont le raccordement n'était pas prévu dans le cadre de la complétude de l'engagement initial. En effet, la situation risque d'être intolérable pour les personnes concernées.
L'autre concerne la qualité du raccordement par les opérateurs commerciaux qui ont fait le choix du mode « Stoc », catastrophique dans certains endroits, puisqu'il donne lieu notamment au sabotage du raccordement de personnes déjà bénéficiaires du service. Pourquoi donc ne pas confier la responsabilité du raccordement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau, en les laissant se répartir la charge ? Ce serait à mon avis le seul moyen d'obtenir une garantie de qualité. Comment en effet pourrait-on sanctionner les opérateurs quand il y a des interruptions de services, alors qu'il est difficile de savoir dans quelle proportion cela leur est imputable, puisque la défaillance peut aussi relever d'un autre opérateur commercial qui aurait des pratiques condamnables en matière de raccordement, en massacrant notamment le service des voisins ?
M. Bernard Delcros. - Je voudrais évoquer une question financière qui n'est pas sans conséquence sur les ressources des collectivités. Pour accélérer le déploiement de la fibre optique, on a accordé un avantage fiscal aux opérateurs à travers une exonération totale, à 100 %, de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) sur une période de cinq ans. J'approuve cette décision qui s'est révélée efficace.
À l'issue de la période d'exonération de cinq ans, à la fin des premières installations, la loi de finances pour 2024 a prolongé l'avantage fiscal sous la forme d'un plafonnement du produit total de l'Ifer fixe à hauteur de 400 millions d'euros, à compter de 2024 et pour une période illimitée. Même s'il est prévu que le produit soit indexé sur l'inflation, il n'empêche que la perte pour les collectivités a été évaluée entre 2024 et 2030 à environ 300 millions d'euros. Que pensez-vous de cette mesure ? Ne faudrait-il pas fixer une échéance pour limiter dans le temps cet avantage fiscal, dès lors que le déploiement de la fibre sera atteint ou en passe de l'être ?
M. Pierre Barros. - Il faudrait faire un bilan de l'ouverture à la concurrence. Le privé participe à 40 % au déploiement du réseau alors que l'État et les collectivités territoriales le financent à 60 %, de sorte qu'il reste une forte empreinte publique. La réussite est donc pour beaucoup attribuable à l'État et aux collectivités. Arnaud Bazin le sait bien pour avoir mis en oeuvre le déploiement du réseau dans son département du Val-d'Oise : l'engagement des collectivités est fort, au quotidien et pas seulement au niveau financier, et les négociations avec les opérateurs sont âpres.
Par conséquent, la question du financement ne se pose pas seulement pour l'investissement, mais également pour le coût de fonctionnement, au quotidien. Le mode « Stoc », par exemple, donne beaucoup de travail aux mairies, dans l'ensemble des collectivités, car il faut gérer les mécontentements des uns et des autres et passer du temps au téléphone, à la fois avec les usagers et les fournisseurs d'accès à internet, ce qui représente du temps et de l'argent.
À cela s'ajoute le coût lié à la nécessité de tirer les infrastructures jusqu'au bout dans certains cas particuliers comme les copropriétés ou les réseaux privés qui passent par des espaces publics. Ces sujets donnent lieu à des négociations compliquées avec les opérateurs d'infrastructures et, à la fin, c'est la collectivité qui paye car les habitants font pression sur elle. En effet, pour les particuliers, il ne s'agit pas seulement de pouvoir regarder Netflix, mais surtout de pouvoir travailler et télétravailler. En outre, un certain nombre de PME sont raccordées sur le réseau fibre.
Les outils de sanction représentent également un coût supplémentaire, qu'ils passent par l'Arcep ou par d'autres structures de contrôle. Il doit donc être possible de rationaliser ces coûts, ce qui permettrait de mieux travailler.
Quand les fournisseurs d'accès à internet estiment que le taux de panne ne dépasse pas 1 %, c'est très peu. Cela signifie que le système fonctionne bien et que l'argent des abonnements rentre. Pourquoi donc faudrait-il aller plus loin dans le développement du réseau, alors qu'il est tout à fait productif ?
Comment obliger les opérateurs d'infrastructures à mener jusqu'au bout le déploiement du réseau et à sortir du mode « Stoc » ? Je suis tout à fait d'accord avec la proposition d'Arnaud Bazin : personne, hormis les opérateurs d'infrastructures, ne doit mettre les mains dans les points de mutualisation.
De plus, comment faire en sorte qu'ils assurent la responsabilité de leur réseau ? En effet, à chaque fois, les collectivités doivent contribuer pour faire en sorte que cela fonctionne, ce qui n'est pas acceptable.
M. Michel Canévet. - Nous nous réjouissons tous du déploiement accéléré du réseau de fibre optique. Les recommandations de la Cour des comptes ainsi que celles des rapporteurs spéciaux sont pertinentes et montrent qu'il reste de nombreux points sur lesquels nous devons travailler.
En Bretagne, nous ne serons pas desservis à l'échéance de 2025, puisqu'il est prévu que le déploiement du réseau s'étale sur un calendrier plus long, mais l'avancement est bon. Nous constatons toutefois des défaillances liées notamment au recours à la sous-traitance qui n'a pas forcément organisé les travaux dans de bonnes conditions, ce qui risque de perturber la qualité des réseaux.
En outre, comme l'a dit mon collègue Hugonet, le recours accru au déploiement aérien risque d'être préjudiciable dans une région qui est fortement soumise aux aléas climatiques. Il faudra que les autorités de régulation puissent mettre en oeuvre des mesures de sanction visant à ce que les travaux soient réalisés rapidement et à ce que les usagers ne soient pas pénalisés, comme c'est le cas pour ceux d'Orange depuis la tempête qui a sévi il y a un an et demi. Certains foyers ne sont toujours pas raccordés et il n'y a pas de raison qu'ils continuent à payer leur facture. Je souscris aux recommandations des rapporteurs spéciaux et j'espère que l'Arcep sera vigilante sur le sujet.
M. Christian Bilhac. - Je souhaite à mon tour revenir sur le financement de la fibre. Le privé a payé 9 milliards d'euros pour la partie rentable et le contribuable - car c'est bien lui dont il s'agit - a payé près de 13 milliards d'euros pour le reste. Il y a un temps où l'on parlait des « autoroutes de l'information ». On pourrait creuser l'idée : l'A75 dans sa partie gratuite dépend de l'État, mais elle rapporte à Vinci dans la partie où elle est payante. Il faudrait revoir ce mode de fonctionnement étant donné l'état de nos finances.
La troisième recommandation du rapport porte sur la fermeture du réseau cuivre. Toutefois, il n'est nulle part question de la dépose. Depuis des années, Orange a tissé de véritables toiles d'araignées aériennes dans nos villages, en tirant des fils dans tous les sens, mais personne ne semble se préoccuper de la manière dont on va supprimer ce réseau cuivre. Nul doute qu'Orange ne fera rien, de sorte que les propriétaires qui voudront supprimer cet embrouillamini de fils devant leurs fenêtres le feront tout simplement à coups de pince, à moins que le brave employé communal, croyant bien faire, ne se précipite pour sortir la tenaille. Il y a donc de fortes chances, dans la mesure où les câbles de la fibre sont souvent aériens et passent donc au milieu de ces câbles de cuivre, que l'on se retrouve avec des pannes qui auront un certain coût, compte tenu de la complexité du système.
Par conséquent, je pose la question non pas de la fermeture du réseau cuivre, mais de sa suppression. Comment va-ton opérer ?
M. Stéphane Sautarel. - Le plan du déploiement de la fibre a quelque chose de paradoxal. Je me réjouis de son accélération, qui montre la qualité d'une activité décentralisée quand elle est permise. Mais il faut reconnaître qu'il incombe aux pouvoirs publics de financer ce plan dans les territoires où les opérateurs ont considéré qu'il n'y avait pas de marché suffisant pour déployer la fibre. Je me félicite donc du pragmatisme qui a prévalu, mais je regrette que le coût du déploiement n'ait pas été mutualisé.
J'aimerais également faire une remarque sur la notion de raccordé et de raccordable. Il me semble en effet que l'on constate, là où les RIP sont mis en oeuvre, une vraie difficulté dans l'approche des notions de raccordé et de raccordable. Autrement dit, jusqu'où vont les engagements des opérateurs privés qui déclarent raccordables certains foyers, pour lesquels le coût de la prise en charge se révèle ensuite difficile à assumer ? Ce sujet ne me semble pas avoir été assez documenté et vous pourriez nous apporter des précisions utiles, car plus on approche de la fin du déploiement, plus cet écart entre raccordé et raccordable prend de l'importance.
Je m'inquiète moi aussi du déploiement aérien de la fibre qui a été souvent mis en oeuvre dans un souci d'accélération et d'économie. Je m'interroge sur le futur plan d'enfouissement du réseau qui représentera un coût public supplémentaire. Que ce soit pour des raisons esthétiques ou de fiabilité et de continuité du service, ce déploiement aérien de la fibre pose de vraies difficultés en Bretagne comme en Auvergne.
Ma dernière question portera sur la fermeture du réseau cuivre. En effet, Orange bénéficiera d'un avantage compétitif, car l'opérateur n'aura plus à exploiter son réseau cuivre et n'utilisera plus que les réseaux publics qui auront été déployés en substitution. Je m'interroge sur la manière dont l'équilibre économique peut être pris en compte dans ce cadre.
M. Jean-Marie Mizzon. - Un paradoxe règne dans notre pays en ce qui concerne le haut débit. Nous avons investi des milliards d'euros pour déployer le réseau partout en France et nous y arrivons progressivement, mais nous n'avons pas investi les mêmes moyens pour que les gens puissent maîtriser le sujet. Un phénomène d'illectronisme très fort empêche ceux qui pourraient bénéficier du très haut débit d'y accéder. Cette injustice insoutenable ne concerne pas seulement les personnes âgées, mais 13 millions de personnes, issues de tous les publics. Par conséquent, je regrette que nous n'ayons pas consacré davantage de moyens depuis le plan de relance à la lutte contre l'illectronisme, pour l'inclusion numérique. Cela aurait permis que davantage de gens puissent profiter de l'effort national.
M. Stanislas Bourron. - Pour favoriser la qualité de déploiement du réseau, nous disposons de deux leviers.
Tout d'abord, le levier systémique, qui n'est pas le plus facile à mettre en oeuvre, mais qui reste efficace, consiste à attribuer une subvention à la collectivité porteuse du projet, en la chargeant de faire respecter le cahier des charges. L'ANCT travaille avec elle et fait pression sur l'opérateur pour qu'il améliore la qualité des réseaux principaux.
Ensuite, sur les sujets complémentaires, comme celui de réseaux parfois anciens qui méritent d'être repris ou celui de déploiements par certains opérateurs qui peuvent poser ponctuellement problème, nous pouvons déclencher des audits qui nous permettront de nous assurer du bon déploiement du réseau. Nous l'avons fait notamment dans la région Grand Est.
Sur la résilience et les bonnes pratiques, nous considérons qu'il faut faire un travail d'information à l'échelle du département. Nous avons travaillé avec la Banque des territoires qui intervient sur ce type de sujet ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de l'État. Nous voudrions aller plus loin, en déployant notamment des schémas locaux de résilience.
Le déploiement aérien des réseaux est un sujet qui revient souvent. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais il me semble que l'aérien n'est pas nécessairement un obstacle. En revanche, il faut prévoir la possibilité d'une défaillance, par exemple si les câbles tombent et provoquent l'arrêt du réseau de la fibre. Autrement dit, il faut prévoir une mécanique d'organisation de gestion de crise, à l'échelle de chaque département, en lien avec les acteurs concernés. Nous pouvons valoriser les bonnes pratiques à l'échelle nationale et des initiatives existent déjà en ce sens : nous devons continuer à déployer ce type de schéma de façon générale.
Nous sommes très sensibles aux enjeux qui caractérisent les outre-mer. Les situations sont très variables : ainsi, à Mayotte, le déploiement n'a pas démarré, alors qu'à La Réunion, il est effectif à 100 %, ce que nous pouvons saluer. En Guyane, il faudra en effet trouver des solutions alternatives. Néanmoins, l'ANCT et l'État appuient ces territoires et restent attentifs au bon déploiement du réseau. C'est une logique d'aménagement du territoire que le ministère que je représente défend.
Enfin, l'inclusion numérique est un sujet qui nous préoccupe. La numérisation de notre société va de pair avec la nécessité d'accompagner nos concitoyens vers les nouveaux usages. En effet, il ne servira à rien d'avoir la fibre si l'on ne sait pas utiliser l'internet. Avec la DGE, nous mettons en oeuvre une politique d'inclusion numérique qui repose sur l'intervention de conseillers numériques : cela représente 4 000 postes, dont 3 500 personnes présentes sur le terrain pour accompagner les gens. Nous offrons également un soutien à travers le réseau France services dont le rôle est de faciliter l'accès aux démarches administratives, notamment dématérialisées. Nous faisons donc en sorte de garantir la bonne cohérence du déploiement du réseau, en prenant en compte la nécessité absolue de prévoir un accompagnement des personnes vers les nouveaux usages. Sinon, nous n'aurons fait que la moitié du chemin.
M. Antoine Jourdan. - Sur la programmation budgétaire, les besoins de décaissement prévisionnels des collectivités territoriales sont estimés à 280 millions d'euros en 2025. L'ANCT dispose pour y faire face d'une trésorerie de 50 millions d'euros en plus de la dotation actuelle de 276 millions d'euros, de sorte que nous pourrons couvrir l'ensemble des besoins, voire un peu plus. Il n'y aura donc pas de difficulté pour décaisser en 2025. L'État n'a d'ailleurs jamais eu de retard dans ses décaissements au profit des collectivités.
Sur l'Ifer fixe, la situation est infiniment complexe et il faudrait du temps pour l'expliquer. Le plafonnement du produit de l'IFER a été créé en anticipation de l'intégration progressive des lignes de fibre optique dans l'assiette de l'impôt. Sans action du législateur, son rendement aurait mécaniquement explosé au fur et à mesure du déploiement de ces lignes, et aurait ainsi doublé en l'espace de deux à trois ans. Il convient de relever que l'explosion de cet impôt aurait été en partie supportée par les RIP, qui sont financés par les collectivités locales.
La dépose du cuivre est un sujet très important chez Orange. L'opérateur a d'ailleurs lancé un appel d'offre pour trouver un partenaire susceptible de l'accompagner dans le recyclage du cuivre. L'enjeu est économique, car Orange devrait faire des bénéfices. Il est aussi de sécurité nationale, car la ressource est critique. Le processus est en cours et nous avons encore cinq ans pour traiter le problème. Nous devrons nous assurer de ne pas laisser des fils de cuivre qui pendent sur les toits. Les incitations économiques existent pour que la dépose du cuivre se fasse. Nous interviendrons dans un deuxième temps si cela se révèle insuffisant.
La différence entre raccordable et raccordé est un sujet majeur que nous prenons en compte. C'est d'ailleurs la clé de voûte du dispositif qui a été négocié avec Orange sur les zones Amii, l'an dernier, dans le cadre d'un accord juridiquement opposable. Un délai de six mois entre la demande de raccordement par l'abonné et le raccordement effectif par l'opérateur a été fixé, à partir du 1er janvier 2026'. Pour le raccordement dans les autres zones, la Cour des comptes a émis une recommandation qui vise à généraliser au maximum ce dispositif pour que l'ensemble des Français puisse bénéficier de cette garantie de raccordement en moins de six mois.
Sur les câbles sous-marins en outre-mer, l'enjeu est celui de la collecte. Il s'agit de savoir comment raccorder l'ensemble des foyers au réseau internet. Les enjeux sont liés à des problématiques de résilience et de souveraineté nationale, que la guerre en Ukraine a mis en lumière, notamment dans le nord de l'Europe.
Mme Laure de La Raudière. - L'opérateur d'infrastructures est responsable de la qualité de son réseau. Nous l'avons rappelé dans une recommandation récente. À ce titre, il doit mettre en place des procédures de contrôle des interventions des opérateurs commerciaux et de leurs sous-traitants sur son réseau. La filière s'est organisée autour du mode « Stoc » et ce sont les sous-traitants des opérateurs commerciaux qui font les raccordements. Pour autant, cela n'exclut pas la responsabilité de l'opérateur d'infrastructures sur la qualité du réseau.
L'Arcep est favorable à d'autres modes de raccordement que le mode « Stoc ». Je l'ai toujours dit et nous avons poussé les opérateurs à mettre en place des expérimentations en mode « opérateur d'infrastructures » (« OI »). La redéfinition est en cours au sein de la filière, notamment dans le cadre que vous citiez, monsieur le rapporteur général, c'est-à-dire quand il y a un changement de fournisseur. Les opérateurs commerciaux et l'opérateur d'infrastructures Orange sont en train de définir les conditions d'une expérimentation du mode « OI ». Nous suivons cela avec intérêt et nous avons aussi sollicité les opérateurs afin qu'ils nous proposent une expérimentation en mode « OI » dans certains réseaux très accidentogènes, quand nous estimons que leur architecture très spécifique et les comportements extrêmes de certains sous-traitants, en particulier dans l'Essonne, justifient que nous fassions ces tests. Nous sommes donc ouverts à toutes ces propositions pour progresser sur le sujet de la qualité du réseau.
En matière de sanction, nous avons ouvert des enquêtes administratives à l'encontre d'XpFibre et de Free, et nous avons des plans de reprise sur ces réseaux. Ces plans de reprise se déroulent dans le calendrier présenté par les opérateurs d'infrastructures et nous constatons des améliorations sur les réseaux les plus accidentogènes qui vont bien au-delà de la baisse des déploiements ou des raccordements et qui doivent être consolidées dans la durée. Nous n'avons donc pas ouvert de procédures de sanction à l'encontre de ces opérateurs.
Comme je vous l'ai dit précédemment, il est très compliqué d'ouvrir des procédures de sanction à l'encontre des opérateurs commerciaux parce qu'il faut les prendre la main dans le sac sur le terrain. Les opérateurs d'infrastructures mettent en place des outils de système d'information pour aller contrôler les opérations des opérateurs commerciaux sur le terrain, mais nous n'avons pas accès, bien évidemment, à ces informations.
En revanche, nous soutenons la mesure qui permet à un client de résilier son accès auprès d'un opérateur commercial ainsi que la mesure d'indemnisation que recommande la Cour des comptes et qui figure d'ailleurs à l'article 5 de la proposition loi du sénateur Chaize que vous avez citée.
Sur la fermeture du réseau cuivre, l'une de vos questions visait le partage d'informations concernant les lignes cuivre encore actives. Nous avons imposé à Orange l'obligation de partager ces lignes avec tous les opérateurs commerciaux, l'opérateur d'infrastructures et les collectivités, au moins douze mois avant la date de la fermeture technique. Par ailleurs, Orange partage les informations sur les communes qui seront concernées par ces fermetures bien en amont, en général trois ou quatre ans avant la fermeture technique. Ainsi, Orange a partagé entre juin et octobre 2024 le contenu du lot 4 qui représente 8,5 millions de lignes et dont la fermeture technique est prévue entre le 30 janvier et le 30 octobre 2028. Nous avons considéré que ces délais de prévenance étaient suffisants, mais nous sommes favorables à ce qu'il y ait beaucoup de communication sur l'enjeu majeur pour les Français que représente la fermeture du réseau cuivre.
Je tiens aussi à vous livrer un retour d'expérience sur la fermeture du lot 1, qui représente environ 190 000 lignes et qui couvre 160 communes. Grâce à l'implication des collectivités et à l'engagement des élus, dont je souligne qu'il a eu une importance majeure, grâce aussi à l'engagement des opérateurs, cette fermeture technique n'a été suivie d'aucune réclamation, même si des lignes ont été coupées, dont certaines faisaient l'objet d'une rationalisation, par exemple quand les usagers privilégiaient la fibre ou n'utilisaient plus ces lignes cuivre. Ce retour d'expérience est donc plutôt positif.
Les Français sont seulement 45 % à avoir entendu parler de la fermeture du réseau cuivre. Il reste un long chemin à parcourir pour aboutir à une bonne connaissance généralisée de ce projet. Les procédures qui sont mises en place entre les opérateurs aujourd'hui n'appellent pas d'alerte particulière.
Mme Carine Camby. - Je me limiterai à répondre à la question de M. le rapporteur général sur les modèles les plus efficaces. En effet, nous n'avons pas étudié les plans d'affaires des RIP dans le détail. Les travaux de l'Arcep et l'accompagnement de l'ANCT aideront certainement les réseaux d'initiative publique à éclaircir ces questions. Un tableau qui montre la typologie des RIP figure dans le rapport, qui établit que les caractéristiques locales, géographiques et financières sont des critères importants tout comme la date à laquelle ces conventions ont été passées. Ainsi, les délégations de service public les plus récentes ont bénéficié des leçons tirées de celles qui avaient été conclues initialement, notamment en Bretagne.
Ce qui est certain, c'est que la délégation de service public reste le modèle le plus souvent choisi et qu'il semble efficace pour les finances locales. Les dernières délégations de service public qui ont été conclues dans le Jura ou en Haute-Saône n'ont pas nécessité d'apport d'argent public et ont donc eu un effet plutôt positif.
M. Thierry Cozic, rapporteur spécial. - Pour revenir sur la question qu'a posée Christian Bilhac sur la suppression du réseau cuivre, nos auditions ont montré que les opérateurs d'infrastructures souhaitent pouvoir supprimer les câbles de cuivre quand ils déploient le réseau. C'est une proposition plutôt pertinente qu'il faudrait étudier, même si cela peut paraître compliqué puisque c'est Orange qui est propriétaire du réseau cuivre.
Pour conclure, je fais miens les propos du rapporteur général : nous étions les derniers de la classe et nous sommes désormais en tête dans le classement européen. Nous sommes partis de loin, mais la difficulté est devant nous, notamment sur les derniers raccordements. C'est la raison pour laquelle nous devrons nous montrer très attentifs dans les années à venir.
Mme Frédérique Espagnac, rapporteure spéciale. - Selon la Cour des comptes, il nous manquait 84 millions d'euros pour couvrir les besoins des collectivités pour le financement des RIP en 2025. 'La DGE et l'ANCT pourront nous fournir des éléments écrits pour clarifier ce sujet.
En outre, si nos propos ont pu être durs, ils correspondent à ce que nous avons entendu sur le terrain. La demande de sanctions est là et nous savons que vous avez prévu un certain nombre de pénalités hautes. Les élus, notamment, souhaitent que l'Arcep soit davantage à leurs côtés. Ils en ont besoin, indéniablement, et nous l'avons ressenti partout.
Sur la communication en ce qui concerne la fermeture du réseau cuivre, nous comprenons votre volonté de l'échelonner. Toutefois, nos concitoyens sollicitent très souvent les élus locaux sur la différence entre le raccordé et le raccordable. Si le taux affiché de 90 % est en effet très positif et nous place en tête du classement, il faut tout de même tenir compte d'abord de la satisfaction du citoyen et de la réalité de ce qu'il vit : est-il raccordé et est-ce que cela fonctionne ?
Enfin, je comprends ce que vous nous avez dit sur la qualité des réseaux et sur les sanctions, mais je veux redire que les collectivités n'auront pas la capacité de prendre en charge ce que l'État ne paierait pas. En outre, compte tenu de la période récessive dans laquelle nous sommes, il faut préserver les savoir-faire dans les territoires et éviter que les entreprises locales ne mettent la clé sous la porte.
La commission a autorisé la publication de l'enquête de la Cour des comptes ainsi que du compte rendu de la présente réunion en annexe au rapport d'information de M. Thierry Cozic et Mme Frédérique Espagnac. Elle a adopté également les recommandations des rapporteurs spéciaux qui figureront dans le rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES DÉPLACEMENTS
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep)
- M. Ghislain HEUDE, directeur Fibre, Infrastructures et Territoires.
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
- M. Laurent ROJEY, directeur général au numérique ;
- M. Bastien COLLET, directeur par intérim, Programme France très Haut Débit.
Direction générale des entreprises (DGE)
- M. Antoine JOURDAN, sous-directeur des communications électroniques et des postes ;
- M. Martin CASSOUX, chargé de projet - couverture réseaux fixes.
Fédération française des télécoms
- M. Olivier RIFFARD, directeur général adjoint ;
- Mme Marie LHERMELIN, secrétaire générale adjointe Altice-SFR ;
- M. Laurentino LAVEZZI, directeur des affaires publiques Orange Groupe ;
- M. Stéphane DE BOYSSON, responsable des affaires règlementaires fibre optique de Bouygues Telecom ;
- Mme Marie-Amélie LECOQ, directrice marketing et stratégie Orange Concessions ;
- M. Lionel RECORBET, président d'XP Fibre.
InfraNum
- Mme Ilham DJEHAICH, présidente ;
- M. David EL FASSY, vice-président du groupe Altitude ;
- M. Mathieu DENOIS, secrétaire général de Lumière ;
- Mme Marie LAMOUREUX, directrice de la BU Infra de Axione ;
- Mme Marlène KURZ, chargée des affaires publiques et internationales d'InfraNum.
Déplacement à Clermont-Ferrand le 24 mars 2025
Réseau d'initiative publique « Auvergne numérique »
- M. Frédéric MÜLLER, directeur général des services ;
- Mme Bénié KODJO, directeur général adjoint ;
- M. François TEPPAZ-MISSON, directeur général adjoint.
Préfecture du Puy-de-Dôme
- Mme Stéphanie DEJAMMET-DUCHET, sous-préfète ;
- Mme Emmanuelle FOURMONT, chargée de mission.
Région Auvergne-Rhône-Alpes
- M. Vincent MAILLARD, responsable de service.
Conseil Départemental
- M. Michel SAUVADE, vice-président ;
- Mme Valérie ESCOT, responsable de service.
Représentants des opérateurs commerciaux et d'infrastructure
- M. Laurent WILD, directeur général d'Auvergne très haut débit ;
- M. Laurent PICARD, directeur général adjoint d'Auvergne très haut débit ;
- Mme Floriane GIROD, directrice des relations régionales et du patrimoine de Bouygues Télécom ;
- M. Pascal BÉRARD, consultant pour Bouygues Télécom ;
- M. Thierry GODARD, responsable de l'aménagement numérique du territoire de Free ;
- M. Olivier DONDAIN, délégué régional Auvergne d'Orange ;
- M. Hervé BOURSIN, responsable client zone Auvergne d'Orange ;
- M. Cyril HONEGGER, délégué régional Centre Est de SFR ;
- Mme Camille BALL, responsable des relations institutionnelles et de l'engagement de SFR-Altice ;
- M. Jean-Yves NOVELLA, chargé d'affaires fibre Centre Est pour SFR.
ANNEXE :
COMMUNICATION DE LA COUR DES COMPTES
À LA COMMISSION DES FINANCES
Consultable uniquement au format PDF
* 1 Cour et chambres régionales des comptes, Les réseaux fixes de haut et très haut débit : un premier bilan, rapport public thématique, janvier 2017.
* 2 Décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits.
* 3 Loi n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion pour 2024.
* 4 Au total, 124,7 millions d'euros en CP supplémentaires ont été reportés sur l'ensemble des actions du programme 343 par l'arrêté du 7 mars 2025 portant report de crédits, dont 120 millions d'euros au titre de la suppression du programme 364 de la mission Plan de relance, et 4,7 millions d'euros au titre des reports de crédits non-exécutés en 2024.
* 5 Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, adopté par le Sénat le 2 mai 2023.