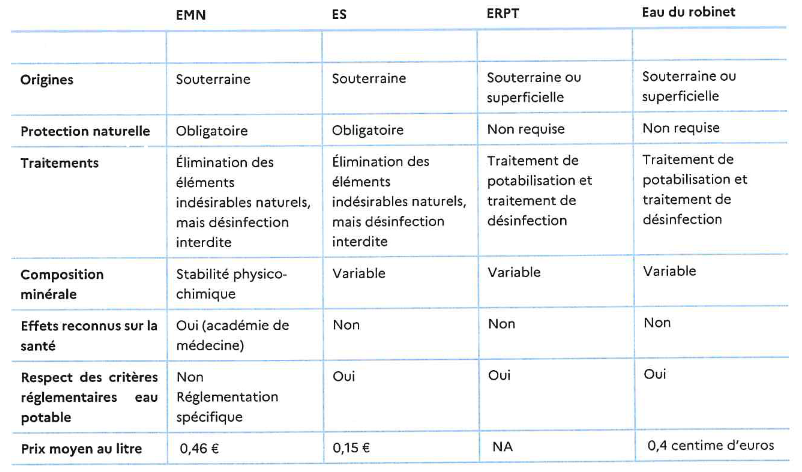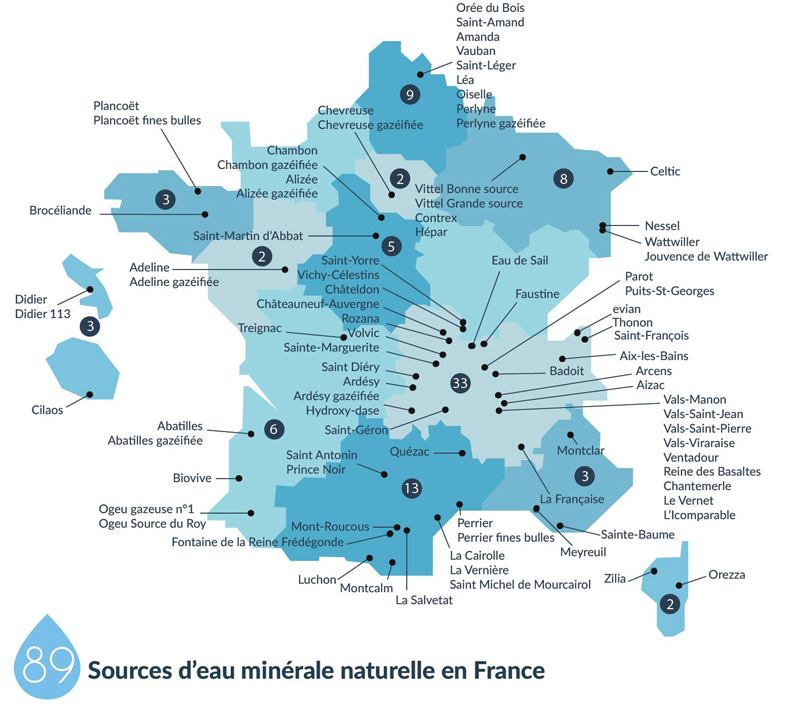- L'ESSENTIEL
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
- INTRODUCTION
- CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
LES EAUX MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE,
UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE, FRAGILE ET PÉRISSABLE
- I. QUE SONT LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX DE
SOURCE ?
- A. LES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX
MINÉRALES NATURELLES
- B. LES EAUX DE SOURCE NE SE VOIENT PAS IMPOSER
D'OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMPOSITION MINÉRALE ET DE
STABILITÉ
- C. LES AUTRES TYPES D'EAUX DISPONIBLES À LA
VENTE SUR LE MARCHÉ APPARTIENNENT À LA CATÉGORIE DES
BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES SANS ALCOOL
- A. LES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX
MINÉRALES NATURELLES
- II. DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
PRÉSENTES PARTOUT SUR LE TERRITOIRE ET À L'HISTOIRE GRAVÉE
DANS LA ROCHE
- III. LES EAUX MINÉRALES NATURELLES
REPRÉSENTENT UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR POUR LES TERRITOIRES
CONCERNÉS
- A. UN SECTEUR DOMINÉ PAR TROIS GRANDS
GROUPES, MAIS QUI COMPREND ÉGALEMENT DE NOMBREUX PRODUCTEURS
INDÉPENDANTS
- B. UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ESSENTIELLE POUR DES RÉGIONS RURALES
- C. POUR LES COMMUNES SUR LESQUELLES EST
SITUÉE UNE SOURCE D'EAU MINÉRALE NATURELLE, L'ENJEU FINANCIER
MAJEUR DE LA CONTRIBUTION SUR CES EAUX
- A. UN SECTEUR DOMINÉ PAR TROIS GRANDS
GROUPES, MAIS QUI COMPREND ÉGALEMENT DE NOMBREUX PRODUCTEURS
INDÉPENDANTS
- IV. L'ENJEU CRUCIAL DE LA PURETÉ ORIGINELLE
DE L'EAU
- I. QUE SONT LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX DE
SOURCE ?
- PARTIE I
LE SCANDALE DES EAUX MINÉRALES :
CONTRÔLES MIS EN ÉCHEC, LOBBYING DÉCOMPLEXÉ, LES PRATIQUES INTERDITES DE CERTAINS INDUSTRIELS
ET LEUR DISSIMULATION PAR L'ÉTAT ONT MIS À MAL
LA CONFIANCE DANS LE SECTEUR
- I. UNE DÉCOUVERTE FORTUITE DE PRATIQUES
ILLÉGALES
- A. LA RÉVÉLATION DES TRAITEMENTS PAR
UN SALARIÉ CHEZ UN PREMIER INDUSTRIEL ET L'ENQUÊTE DU SNE
- B. LA PREMIÈRE CONSÉQUENCE : LE
LANCEMENT D'UNE ENQUÊTE DE LA DGCCRF ET LA MISE À JOUR DE
DISPOSITIFS DISSIMULÉS
- C. LA DEUXIÈME CONSÉQUENCE :
L'AVEU DE NESTLÉ WATERS AUPRÈS DU CABINET DE LA MINISTRE DE
L'INDUSTRIE
- D. LA TROISIÈME CONSÉQUENCE : LE
LANCEMENT D'UNE INSPECTION DE L'IGAS
- A. LA RÉVÉLATION DES TRAITEMENTS PAR
UN SALARIÉ CHEZ UN PREMIER INDUSTRIEL ET L'ENQUÊTE DU SNE
- II. UNE RÉACTION DE L'ÉTAT TARDIVE,
INADAPTÉE ET NON TRANSPARENTE, QUI PÈCHE PAR UNE SÉRIE DE
DYSFONCTIONNEMENTS
- A. UN PREMIER DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE OU
LE RETARD DE SIGNALEMENT DES DÉLITS PRÉSUMÉS
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
- B. UN DEUXIÈME DYSFONCTIONNEMENT : LA
MINIMISATION DU RISQUE SANITAIRE À L'ÉCHELON NATIONAL
- C. UN TROISIÈME DYSFONCTIONNEMENT :
LES ÉCHECS DE L'INTERMINISTÉRIEL ET LE TRAVAIL EN SILO
- D. UN QUATRIÈME DYSFONCTIONNEMENT :
L'ABSENCE DE SANCTION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIEL
- E. UN CINQUIÈME DYSFONCTIONNEMENT :
L'INVERSION DE LA RELATION ENTRE L'ÉTAT ET L'INDUSTRIEL EN
MATIÈRE D'ÉDICTION DE LA NORME
- F. UN SIXIÈME DYSFONCTIONNEMENT : DES
AUTORITÉS LOCALES PEU, VOIRE PAS, ASSOCIÉES AUX DÉCISIONS
PRISES PAR L'ÉCHELON CENTRAL
- G. UN SEPTIÈME DYSFONCTIONNEMENT : LA
DISSIMULATION PAR L'ÉTAT DES INFORMATIONS ET DÉCISIONS CONCERNANT
NESTLÉ WATERS
- H. UN HUITIÈME DYSFONCTIONNEMENT : DES
DÉLAIS EXCESSIFS QUI FAVORISENT L'ENRACINEMENT DES INFRACTIONS EN
MATIÈRE DE TROMPERIE DU CONSOMMATEUR ET DE SURVENANCE DE RISQUES
SANITAIRES
- 1. Délais entre l'aveu de Nestlé
Waters et l'information du ministère de la santé
- 2. Délais entre l'information de
l'État et le déclenchement de la mission de l'Igas
- 3. Délais entre le déclenchement de
la mission de l'Igas et la constatation des pratiques interdites sur les sites
Nestlé des ARS Grand Est et Occitanie
- 4. Délais entre la réalisation des
inspections et les retraits de traitements interdits ou le signalement au titre
de l'article 40
- 5. Délais de régularisation
éventuelle des arrêtés préfectoraux
- 6. Délais entre la connaissance des
infractions et leur traitement judiciaire
- 1. Délais entre l'aveu de Nestlé
Waters et l'information du ministère de la santé
- I. UN NEUVIÈME DYSFONCTIONNEMENT :
L'ABSENCE DE VÉRIFICATIONS ET DE SUIVI DU DOSSIER PAR
L'ÉTAT
- J. UN DIXIÈME DYSFONCTIONNEMENT :
L'ABSENCE DES MINISTRES DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL
- K. DES DÉFICIENCES STRUCTURELLES ? LA
DÉCOUVERTE DE « L'AFFAIRE MAYOTTE »
- L. LES LIAISONS DANGEREUSES ÉTAT -
NESTLÉ : OÙ COMMENT ÉDULCORER UN RAPPORT OFFICIEL
À LA DEMANDE D'UN INDUSTRIEL
- A. UN PREMIER DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE OU
LE RETARD DE SIGNALEMENT DES DÉLITS PRÉSUMÉS
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
- I. UNE DÉCOUVERTE FORTUITE DE PRATIQUES
ILLÉGALES
- PARTIE II
COMPRENDRE LES DESSOUS D'UNE CRISE
- I. DES TRAITEMENTS INTERDITS À LA
MICROFILTRATION :
LE POURQUOI D'UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE DEVOYÉE
- A. LES TRAITEMENTS INTERDITS : UNE
RÉPONSE NON GÉNÉRALISÉE DE CERTAINS INDUSTRIELS
CONFRONTÉS À UNE DÉGRADATION DE LA RESSOURCE ET/OU
À DES PROCESSUS DE PRODUCTION DÉFICIENTS ?
- B. LA MICROFILTRATION, OU COMMENT TORDRE LA
RÈGLEMENTATION ET LE BRAS DE L'ÉTAT POUR REMPLACER DES
TRAITEMENTS INTERDITS PAR UN TRAITEMENT NON AUTORISÉ
- 1. La filtration n'est possible que dans certains
cas limitativement énumérés par le droit
européen...
- 2. Tout mise en place d'un autre type de
filtration doit faire l'objet d'une procédure spécifique
- 3. La filtration n'est possible que si elle ne
modifie pas le microbisme de l'eau
- 4. Or, la microfiltration à 0,2 micron
est un outil visant à décontaminer les eaux des usines
Nestlé
- 5. La procédure spécifique
prévue par les textes n'a jamais été mise en oeuvre pour
la microfiltration
- 1. La filtration n'est possible que dans certains
cas limitativement énumérés par le droit
européen...
- C. LA MICROFILTRATION EST POURTANT LA CLÉ
DE VOÛTE DU « PLAN DE TRANSFORMATION » QUE
NESTLÉ WATERS DEMANDE AUX AUTORITÉS DE VALIDER DÈS
2021
- D. UNE PERPLEXITÉ DE L'ÉTAT
VIS-À-VIS DE LA MICROFILTRATION QUI DEMEURE ENCORE AUJOURD'HUI
- 1. Un déplacement du débat de
l'absence de désinfection vers la question du seuil de
microfiltration
- 2. Un dossier mystérieux de Nestlé
sur la microfiltration qui se transforme en un simple feuillet
- 3. Malgré les tentatives
d'instrumentalisation de Nestlé Waters, l'absence encore aujourd'hui de
norme autorisant la microfiltration à 0,2 micron
- 1. Un déplacement du débat de
l'absence de désinfection vers la question du seuil de
microfiltration
- A. LES TRAITEMENTS INTERDITS : UNE
RÉPONSE NON GÉNÉRALISÉE DE CERTAINS INDUSTRIELS
CONFRONTÉS À UNE DÉGRADATION DE LA RESSOURCE ET/OU
À DES PROCESSUS DE PRODUCTION DÉFICIENTS ?
- II. UN ÉTAT CENTRAL DIVISÉ ET
TIRAILLÉ QUI FAIT PRÉVALOIR L'INTÉRÊT D'UN
INDUSTRIEL SUR CELUI DES CONSOMMATEURS
- A. UN DIALOGUE BIAISÉ ENTRE
MINISTÈRES DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTÉ ?
- 1. Une perception faussée du risque
sanitaire au départ imputable à Nestlé Waters et au
ministère de l'économie
- 2. Le ressaisissement de la DGS sur le risque
sanitaire
- 3. Le risque sanitaire à nouveau
minimisé
- 4. La DGS tente d'écarter la
microfiltration malgré la pression de l'industriel, soutenu par le
cabinet du ministre de l'industrie
- 5. La DGS battue par le cabinet de son propre
ministère
- 1. Une perception faussée du risque
sanitaire au départ imputable à Nestlé Waters et au
ministère de l'économie
- B. L'ANSES : UN REMPART QUI AURAIT PU FAIRE
DAVANTAGE
- C. L'ABSENCE REMARQUÉE DES
MINISTÈRES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA
CONSOMMATION
- D. LE FORCING DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
EN FAVEUR DE NESTLÉ
- E. L'ARBITRAGE FAUTIF AU SOMMET DE
L'ÉTAT
- A. UN DIALOGUE BIAISÉ ENTRE
MINISTÈRES DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTÉ ?
- III. UN ÉTAT LOCAL LAISSÉ
LIVRÉ À LUI-MÊME ET MAL ARMÉ FACE À L'AMPLEUR
DES PRÉOCCUPATIONS SANITAIRES, ENVIRONNEMENTALES ET ÉCONOMIQUES
LIÉES AUX PRATIQUES FRAUDULEUSES
- A. LE DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT
CENTRAL DE LA MISE EN oeUVRE CONCRÈTE DU PLAN DE TRANSFORMATION DE
NESTLÉ WATERS
- B. LA TRADUCTION CONCRÈTE DU PLAN DE
TRANSFORMATION DE NESTLÉ WATERS PAR LES AUTORITÉS LOCALES
- C. CE PLAN DE TRANSFORMATION N'ÉVACUE PAS
TOUTES LES PRÉOCCUPATIONS, NOTAMMENT SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES,
À L'ÉGARD DES ACTIVITÉS DE NESTLÉ WATERS
- D. PLAN DE TRANSFORMATION INACHEVÉ ;
INDUSTRIEL NI EN CONFORMITÉ NI SANCTIONNÉ : L'ENTRE-DEUX
INCONFORTABLE DES SERVICES DE L'ÉTAT
- E. UN ENJEU POUR L'AVENIR : MIEUX ENCADRER
LES CONDITIONS D'UTILISATION D'UNE CONVENTION JUDICIAIRE D'INTÉRÊT
PUBLIC EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (CJIPE)
- A. LE DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT
CENTRAL DE LA MISE EN oeUVRE CONCRÈTE DU PLAN DE TRANSFORMATION DE
NESTLÉ WATERS
- I. DES TRAITEMENTS INTERDITS À LA
MICROFILTRATION :
- PARTIE III
PRÉSERVER L'AVENIR
DES EAUX MINÉRALES ET DE SOURCE EN FRANCE
- I. PROTÉGER LES AQUIFÈRES DES EAUX
MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE POUR RENFORCER LA CONFIANCE DANS LE
SECTEUR
- II. RÉNOVER UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE
TROP COMPLEXE
- A. UN CONTRÔLE TROP DISPERSÉ À
UNIFIER RAPIDEMENT
- 1. La nécessité d'un dialogue
renforcé entre administrations formalisé dans un protocole
tripartite
- 2. Les moyens consacrés aux eaux en
bouteille doivent être renforcés
- 3. Responsabiliser les autorités
chargées du contrôle et laisser moins de place aux
considérations d'opportunité dans les suites à
donner
- 1. La nécessité d'un dialogue
renforcé entre administrations formalisé dans un protocole
tripartite
- B. UNE RÉGLEMENTATION À
RESTRUCTURER
- C. UN CONTRÔLE DES COMPOSANTS DE L'EAU
À ÉLARGIR D'URGENCE EN RAISON DES POLLUTIONS
ÉMERGENTES
- A. UN CONTRÔLE TROP DISPERSÉ À
UNIFIER RAPIDEMENT
- III. ASSURER LA TRANSPARENCE ET RENFORCER LES
MOYENS D'ACTIONS DU CONSOMMATEUR
- A. PRÉCISER L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
SUR LE CONTENU DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DE SOURCE
- 1. Informer le consommateur sur le recours
à des traitements de microfiltration et sur les demandes de mises en
conformités formulées auprès des exploitants
- 2. Mieux préciser le contenu des eaux de
boisson et des eaux « atypiques » sucrées sur les
étiquettes
- 3. Informer le consommateur sur les
évènements relatifs aux aquifères et aux forages
- 1. Informer le consommateur sur le recours
à des traitements de microfiltration et sur les demandes de mises en
conformités formulées auprès des exploitants
- B. VERS UN RENFORCEMENT DES VOIES D'ACTION EN
JUSTICE OUVERTES AUX CONSOMMATEURS ?
- A. PRÉCISER L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
SUR LE CONTENU DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DE SOURCE
- I. PROTÉGER LES AQUIFÈRES DES EAUX
MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE POUR RENFORCER LA CONFIANCE DANS LE
SECTEUR
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- CONTRIBUTION DU GROUPE ÉCOLOGISTE -
SOLIDARITÉS ET TERRITOIRES
- ANNEXE 1
UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE COMPLEXE
- ANNEXE 2
ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE
- ANNEXE 3
DOCUMENTS TRANSMIS PAR L'ÉLYSÉE
N° 628
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Rapport remis à M. le Président du Sénat le 14 mai 2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission d'enquête (1) sur les
pratiques des
industriels
de l'eau en
bouteille et les
responsabilités des pouvoirs
publics
dans les défaillances
du contrôle de leurs
activités et la gestion
des risques économiques,
patrimoniaux, fiscaux,
écologiques et
sanitaires associés,
Président
M. Laurent
BURGOA,
Rapporteur
M. Alexandre OUIZILLE,
Sénateurs
Tome I - Rapport
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Burgoa, président ; M. Alexandre Ouizille, rapporteur ; Mmes Anne Ventalon, Françoise Dumont, Audrey Linkenheld, Jocelyne Antoine, Marie-Lise Housseau, MM. Saïd Omar Oili, Jean-Pierre Grand, Jean-Pierre Corbisez, Mmes Antoinette Guhl, Mireille Jouve, vice-présidents ; Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Frédéric Buval, Marc-Philippe Daubresse, Mme Élisabeth Doineau, MM. Hervé Gillé, Daniel Gremillet, Loïc Hervé, Olivier Jacquin, Mmes Else Joseph, Florence Lassarade, M. Khalifé Khalifé.
L'ESSENTIEL
Eaux minérales : préserver la pureté
Le 14 mai 2025, la commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille, présidée par Laurent Burgoa (Les Républicains - Gard), a adopté le rapport d'Alexandre Ouizille (Socialiste, Écologiste et Républicain - Oise).
Entre décembre 2024 et mai 2025, elle a mené 73 auditions de ministres, de membres de cabinets ministériels, de directeurs d'administration, de dirigeants d'entreprises, de préfets et services de l'État au niveau local, de directeurs d'Agences régionales de santé ou encore de chercheurs et d'associations.
Elle formule 28 propositions destinées à sécuriser la qualité des eaux minérale et de source.
I. EAU MINÉRALE, EAU DE SOURCE : UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
Conformément à la définition prévue par le droit européen et sa transposition nationale, les eaux minérales naturelles et les eaux de source doivent être microbiologiquement saines et être embouteillées telles qu'elles sont à l'émergence, sans traitement susceptible d'altérer leurs caractéristiques. D'origine souterraine, se distinguant par leur pureté originelle, elles ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une désinfection.
Ces caractéristiques uniques liées à leur terroir et qui, pour certaines, voient leurs effets favorables à la santé reconnus par l'Académie nationale de médecine, justifient une dénomination spécifique revendiquée par les exploitants et un prix de vente de 100 à 400 fois plus élevé que celui de l'eau du robinet.
La France compte 104 sites d'exploitation d'eau minérale naturelle et d'eau de source, répartis sur le territoire, au sein de 59 départements et 18 régions.
Le secteur est dominé par trois groupes qui se partagent 80 % du marché, dont deux multinationales du secteur de l'agroalimentaire, Danone et Nestlé, mais compte également de nombreux autres minéraliers de taille plus modeste. Le marché, en croissance depuis 20 ans, représente un total de 2,7 milliards d'euros en termes de chiffres d'affaires cumulé.
Recettes fiscales
en 2024 au titre
de la
contribution sur les eaux minérales naturelles
Les sites de production d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source ont souvent une empreinte économique très forte sur leur territoire, sont parfois l'un des principaux employeurs locaux et sont toujours une source de richesse pour les habitants comme pour les collectivités territoriales. La filière représente ainsi 11 000 emplois directs en France, dont 8 000 dans la filière des eaux minérales naturelles et 3 000 dans la filière des eaux de source, et 30 000 emplois indirects.
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales naturelles bénéficient d'une contribution dont le rendement total était de 18,4 millions d'euros en 2024 : il s'agit là d'une ressource fiscale essentielle pour les collectivités concernées.
II. LE SCANDALE DES EAUX MINÉRALES : ENTRE CONTRÔLES MIS EN ÉCHEC ET LOBBYING DÉCOMPLEXÉ, CERTAINES PRATIQUES ET LEUR DISSIMULATION PAR L'ÉTAT ONT MIS À MAL LA CONFIANCE
A. UNE DÉCOUVERTE FORTUITE DE PRATIQUES ILLÉGALES
Le scandale du traitement des eaux minérales naturelles commence fin 2019 par un signalement d'un salarié de Sources Alma, qui commercialise notamment Vichy Célestins, St-Yorre, Cristaline, Thonon et Châteldon, concernant des traitements non autorisés. Une enquête du service national d'enquête (SNE) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) met alors en lumière le recours, chez plusieurs industriels, à des microfiltrations inférieures au seuil de 0,8 micron, pourtant considéré depuis 2001 par les autorités comme « seuil limite » afin d'éviter un impact sur la composition de l'eau.
Le 31 août 2021, Nestlé Waters rencontre, à sa demande, le cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, en présence de la DGCCRF. Muriel Liénau, PDG de Nestlé Waters, reconnaît alors l'utilisation dans ses usines des Vosges et du Gard (Vittel, Hépar, Contrex, Perrier) de filtres à charbon actif et de traitements ultraviolets qui sont des mesures de désinfection, strictement interdites. Lors de cet entretien :
ð Nestlé Waters fait valoir, sans preuve, que ces traitements n'ont pas affecté la sécurité alimentaire ni la composition de l'eau ;
ð Nestlé Waters présente aux autorités un « plan de transformation » visant à remplacer ces traitements par une filtration à un seuil de 0,2 micron, dont la conformité au cadre juridique régissant les eaux minérales naturelles n'est pourtant pas assurée.
Malgré la fraude aux consommateurs que représente la désinfection de l'eau, les autorités ne donnent pas de suites judiciaires à ces révélations. Le 14 octobre 2021, il est décidé d'une saisine de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). Cette mission est lancée le 19 novembre 2021, les agences régionales de santé n'en étant informées que le 28 janvier 2022. Ce choix d'une mission de l'Igas, alors exclusive de toute saisine de l'autorité judiciaire ou de mesure administrative de suspension des forages incriminés, a retardé la réponse publique aux révélations de Nestlé.
B. UNE RÉACTION DE L'ÉTAT TARDIVE, INADAPTÉE ET NON TRANSPARENTE QUI PÈCHE PAR UNE SÉRIE DE DYSFONCTIONNEMENTS
1
L'absence ou le retard de signalement des délits présumés au Procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Dès le 31 août 2021, les membres des cabinets de l'industrie et de la DGCCRF étaient informés du recours par Nestlé à des traitements interdits, susceptibles d'induire la qualification pénale de tromperie. Pour autant, seul Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a souhaité réaliser un tel signalement, dès le 13 octobre 2021. Il en a été dissuadé par sa direction des affaires juridiques au motif que les infractions ne relevaient pas de la compétence de sa direction. Le rapporteur le déplore, l'article 40 étant clairement de portée générale. Trois signalements ont finalement été effectués : le premier, en octobre 2022, par la directrice générale de l'ARS Grand Est. Les deux autres beaucoup plus tardivement et après constitution de la commission d'enquête, par la DGCCRF, le 19 février 2025, et le directeur général de l'ARS Occitanie, le 18 avril 2025, soit près de 4 ans après les révélations du 31 août 2021 !
2
La minimisation du risque sanitaire à l'échelon national. Dans un premier temps, l'affirmation de Nestlé Waters selon laquelle la sécurité sanitaire n'était pas un sujet n'a pas été questionnée et a été relayée telle quelle par le ministère de l'industrie. Seule la direction générale de la santé a évoqué le risque sanitaire en octobre 2021. Pourtant, l'exploitant avait démontré son manque de transparence par le passé : parmi les contaminations bactériologiques intervenues sur le site de Perrier dès juin 2020, certaines n'avaient pas été signalées à l'ARS. Par la suite, le risque de contamination des eaux brutes à la source - avant les traitements de désinfection - s'est vérifié : l'Anses a préconisé, en octobre 2023, la mise en place d'un « plan de surveillance renforcé » sur les eaux de Nestlé Waters, incluant le risque virologique, confirmant que l'État avait sous-estimé le risque sanitaire.
3
Les échecs de l'interministériel et le travail en silo. Le contrôle des eaux minérales naturelles fait intervenir, au niveau central, les administrations des ministères de la santé, de la consommation, de l'agriculture et de la transition écologique et, au niveau local, les préfets, les directions départementales interministérielles et les ARS : il en résulte un véritable éclatement de compétences, source de coûts de coordination considérables. Le constat de la Commission européenne à la suite de son audit de mars 2024 était déjà accablant, pointant une « mauvaise collaboration » entre autorités compétentes. La commission d'enquête le confirme : absence de contrôle renforcé ou d'actions coordonnées après la révélation des fraudes, absence de prise de connaissance du rapport de l'Igas de 2022 par la DGCCRF ou par l'Anses avant sa publication en février 2024, manque de communication patent entre administrations centrales, entre administrations centrales et locales, entre administrations locales elles-mêmes... La règlementation semble donner l'occasion à chaque administration de se replier derrière une vision étroite de ses compétences. La volonté de conserver l'affaire confidentielle le plus longtemps possible a en outre nui à la circulation de l'information. Le travail en interministériel n'a de surcroît pas été bien coordonné : d'une part, les ministères de la consommation et de la transition écologique ont été écartés des réunions interministérielles et du processus décisionnel et, d'autre part, l'opposition constante de la direction générale de la santé à l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron n'a pas été relayée par le cabinet de son ministère de tutelle à Matignon.
4
L'absence de suspension de la production d'eau minérale naturelle non-conforme. Malgré l'absence de doute, dès le 31 août 2021, sur l'illégalité des traitements pratiqués par Nestlé, aucune autorité politique ou administrative ne montre sa volonté de faire cesser la commercialisation des produits non-conformes à leur étiquetage. Pourtant, les administrations disposent de ce pouvoir : indépendamment de poursuites pénales, le non-respect du cadre juridique des eaux minérales naturelles peut justifier une mise en demeure, éventuellement assortie d'une suspension de la production ou de la distribution jusqu'à exécution. La commission d'enquête peine toujours à comprendre que la DGCCRF n'ait pas fait usage de ses pouvoirs administratifs pour faire cesser dès 2021 la fraude massive de Nestlé à l'égard des consommateurs. De fait, les traitements interdits ne seront retirés dans les Vosges qu'à la fin de l'année 2022 et dans le Gard qu'en août 2023, soit respectivement près d'un an et demi et deux ans après les aveux de Nestlé. Mais il leur est substitué une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité est elle aussi contestable.
5
L'inversion de la relation entre l'État et les industriels en matière d'édiction de la norme. Dès le 31 août 2021, Nestlé Waters adopte une attitude transactionnelle, posant explicitement l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron comme condition à l'arrêt de traitements pourtant illégaux, via ce qui est pudiquement appelé un « plan de transformation ». Il est donc d'emblée question de mettre en conformité le droit avec la pratique de l'exploitant, dans une logique totalement dévoyée par rapport à ce que devraient être les relations entre l'État qui édicte la norme et l'industriel qui l'applique. Pire, les rares arguments scientifiques transmis par Nestlé Waters pour démontrer le caractère non-désinfectant d'une filtration à 0,2 micron ont été invalidés par les services du ministère de la santé. Enfin, sa stratégie d'influence menée via son lobbying témoigne à chaque étape d'une impatience non dissimulée et d'une volonté d'imposer son tempo à l'État, en faisant notamment état d'un risque de suppressions d'emplois sur le site des Vosges en cas de refus d'autoriser la filtration à 0,2 micron, et ce dans un contexte de perte du marché allemand. Cet argument a été interprété par la direction générale de la santé comme un véritable « chantage » auquel se livrait l'industriel.
Bien que l'Anses, en 2023 et 2024, ait rappelé que la microfiltration ne devait pas corriger une qualité insuffisante des eaux brutes, ses avis auraient gagné à être plus directs et explicites pour éviter de laisser subsister une forme d'ambiguïté que l'industriel n'a pas manqué d'exploiter et qui a laissé trop de marges décisionnelles aux cabinets ministériels par ailleurs directement soumis aux sollicitations pressantes de l'industriel.
6
Des autorités locales peu, voire pas, associées aux décisions prises par l'échelon central et parfois au plus haut sommet de l'État. Dès octobre 2021, les cabinets donnent consigne de ne pas impliquer les services déconcentrés sur le dossier, pourtant responsables du contrôle des eaux minérales. Cela les place dans une situation d'ignorance pendant plusieurs mois, entraînant, de manière stupéfiante, l'absence d'inspection, dans le cadre de la mission de l'Igas, du site de Perrier dans le Gard. En outre, l'échelon central sollicite peu, voire pas, l'avis de l'échelon local au moment de décider, seul, sous la pression de Nestlé Waters. Enfin, l'État central n'accompagne pas l'échelon local dans la mise en oeuvre de ses décisions : la concertation interministérielle dématérialisée (CID) de février 2023, dont découle la possibilité d'autorisations de microfiltations inférieures à 0,8 micron, ne précise aucun calendrier et reste floue, à dessein.
7
La dissimulation par l'État des informations et décisions concernant Nestlé Waters. Outre le manque de transparence de Nestlé Waters, il faut souligner celui de l'État, à la fois vis-à-vis des autorités locales et européennes et vis à vis des Français. Comme le grand public, c'est par la voie des articles publiés Le Monde et France Info en janvier 2024 que les autorités européennes ont pris connaissance des traitements interdits. Entre le 31 août 2021 et le 29 janvier 2024, la Commission européenne n'a jamais été mise au courant des pratiques de Nestlé Waters alors qu'une directive européenne impose de l'informer en cas de difficultés sur un eau minérale naturelle. Cette dissimulation, y compris à l'égard des autorités locales, relève d'une stratégie délibérée, abordée dès la première réunion interministérielle sur les eaux minérales naturelles le 14 octobre 2021. Près de quatre ans après, la transparence n'est toujours pas faite.
8
Des délais excessifs qui favorisent l'enracinement des infractions en matière de tromperie du consommateur et de survenance de risques sanitaires. Des délais excessifs, de réaction aux révélations effectuées par Nestlé le 31 août 2021 se sont cumulés :
- un mois entre l'aveu de Nestlé le 31 août 2021 au cabinet de la ministre de l'industrie et l'information du ministère de la santé le 27 septembre 2021 ;
- près de 3 mois entre l'information de l'État le 31 août 2021 et le déclenchement de la mission de l'Igas le 19 novembre 2021 ;
- deux mois entre la lettre de mission de novembre et la première réunion de travail de la mission Igas avec la direction générale de la santé, le 18 janvier 2022 ;
- plus de trois ans entre la connaissance des infractions par l'autorité judiciaire et leur début de traitement ;
- respectivement 8 mois et plus de 3 ans entre l'information, fin janvier 2022, des ARS Grand Est et Occitanie par l'Igas sur les pratiques de Nestlé Waters (sur l'existence d'une l'enquête de nature pénale du service national des enquêtes de la DGCCRF et les révélations de Nestlé waters au cabinet de la ministre de l'Industrie) et leurs signalements au titre de l'article 40 du code de procédure pénale (octobre 2022 pour l'ARS Grand Est et avril 2025 pour l'Occitanie) ;
- Un délai excessif de régularisation de certains arrêtés préfectoraux, avec des procédures d'instruction toujours pendantes.
o Parmi les conséquences de ces délais : l'industriel a pu continuer à commercialiser comme eau minérale naturelle une eau qui n'aurait pas dû avoir droit à cette appellation. Dans les Vosges, pour un total évalué à environ 440 000 m3, le tout pouvant être valorisé à environ 220 millions d'euros à raison de 0,5 €/litre.
o Dans le Gard, pour un total évalué à environ 755 500 m3 d'eau, le tout pouvant être valorisé à environ 375 millions d'euros, à raison de 0,5 €/litre.
9
L'absence de suivi du dossier par l'État. Elle se traduit notamment par l'absence, encore à ce jour, de vérifications exhaustives par les autorités déconcentrées de l'absence de traitements interdits sur tous les sites de production d'eau conditionnée. Dans nombre de départements, les autorités locales sont restées comme immobiles jusqu'à aujourd'hui. Les modalités de contrôle n'ont pas évolué, alors même que les traitements interdits constatés chez Alma Sources ou avoués par Nestlé Waters n'auraient jamais été décelés en l'absence de signalement. Il n'y a eu aucune instruction claire aux préfectures pour vérifier de manière exhaustive l'absence de traitements interdits sur les sites de production. Il a fallu le déplacement de la commission d'enquête en Haute-Savoie, où se trouve le site d'Évian, pour que les services de l'État du département communiquent avec ceux du Gard, qui bénéficiaient de l'expérience du cas Perrier de Nestlé Waters. Bien sûr, la fragilité des moyens des préfectures et des ARS n'est pas pour rien dans cette absence de réactivité. Tous ces éléments témoignent néanmoins d'une absence de culture du suivi des actions de l'État.
10
L'absence des ministres dans le processus décisionnel. L'absence de l'autorité politique est particulièrement marquante pour les ministres chargés de la consommation et de la santé. S'agissant de la consommation, les ministres n'apparaissent jamais dans la documentation. Leurs cabinets sont peu présents, rapidement exclus du processus de décision. S'agissant de la santé, la plupart des titulaires de la fonction semble n'avoir gardé qu'un souvenir lointain d'un dossier pourtant éminemment sensible. La faible mobilisation de l'autorité politique chargée de la santé se poursuit même après les révélations de presse sur le scandale en janvier 2024. Dans ces cas, comme dans celui de Matignon, les cabinets ministériels prennent les décisions et arbitrages sans même parfois informer le ministre. Le cas de l'industrie est différent : ce ministère, porte d'entrée de Nestlé au sein de l'État, a assumé un soutien fort à l'égard des exigences de Nestlé. Son cabinet n'a cessé de relayer les exigences de l'industriel.
11
L'arbitrage fautif au sommet de l'État. En définitive, c'est au plus haut niveau de l'État que s'est jouée la décision d'autoriser une microfiltration sous le seuil de 0,8 micron. Dans la continuité des arbitrages pris par le cabinet de la Première ministre, Elisabeth Borne, mais sans que celle-ci ne semble informée, la concertation interministérielle dématérialisée (CID) de février 2023 valide, de manière implicite, mais claire la filtration à 0,2 micron. De son côté, la présidence de la République, loin d'être une forteresse inexpugnable à l'égard du lobbying de Nestlé, a suivi de près le dossier. Des documents recueillis par ses soins, et mis à disposition des citoyens, la commission conclut que la présidence de la République savait, au moins depuis 2022, que Nestlé trichait depuis des années, avait conscience que cela créait une distorsion de concurrence avec les autres minéraliers et avait connaissance des contaminations bactériologiques, voire virologiques sur certains forages.
DES DÉFICIENCES STRUCTURELLES ?
LA
DÉCOUVERTE DE « L'AFFAIRE MAYOTTE »
À la suite de signalements d'odeurs d'hydrocarbures ou de moisissures sur des bouteilles de la marque Cristaline (groupe Alma) acheminées et stockées à Mayotte lors de la crise de l'eau connue par ce territoire en 2023-2024, il a été constaté que les conditions de stockage en conteneurs (humidité, forte chaleur) au port de Longoni et à l'aéroport de Pamandzi avaient favorisé le développement de moisissures sur les packs d'eau. Environ 700 000 bouteilles stockées dans ces lieux ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais 1,4 million de bouteilles avaient déjà été distribuées. Après d'autres signalements, cette fois dans l'hexagone, les services de l'État ont mis en lumière une dégradation des intercalaires utilisés pour la palettisation des lots en sortie d'usine, ce qui occasionnait un développement de moisissures altérant le goût et l'odeur de l'eau. Ce nouvel exemple montre que les délais d'intervention des services de l'État, même en cas d'urgence, sont encore trop importants. Il montre aussi que les conditions de fourniture, le conditionnement et le stockage des réserves d'eau de l'État doivent être réexaminées, dans la mesure où elles peuvent ne pas être idéales en termes de résilience.
LES LIAISONS DANGEREUSES ÉTAT-NESTLÉ : OÙ COMMENT ÉDULCORER UN RAPPORT OFFICIEL À LA DEMANDE D'UN INDUSTRIEL
La commission d'enquête a été saisie à la toute fin de ses travaux par un lanceur d'alerte sur un épisode qui illustre parfaitement les dysfonctionnements de l'action de l'État et les pratiques d'un industriel.
Tout commence fin 2023 alors que se prépare la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) du Gard qui doit donner un avis sur l'autorisation d'exploiter les eaux de Vergèze pour la nouvelle marque d'eau désinfectée « Maison Perrier ». Nestlé Waters intervient pour faire modifier le rapport soumis au Coderst en supprimant notamment certaines mentions de bactéries contaminant les eaux, de crainte de fuites et d'informer les associations de consommateurs membres du conseil. Après contacts entre le cabinet de la ministre de la santé (Agnès Firmin Le Bodo), le directeur général de l'ARS et le préfet du Gard, les autorités acceptent d'édulcorer le rapport et de substituer à certains paragraphes ceux rédigés par l'industriel lui-même.
III. COMPRENDRE LES DESSOUS D'UNE CRISE : UNE RÉPONSE DE CERTAINS INDUSTRIELS À LA DÉGRADATION DE LA RESSOURCE ET/OU À DES PROCESSUS DE PRODUCTION DÉFICIENTS ?
A. LE POURQUOI DES PRATIQUES : ENTRE DÉGRADATION DE LA RESSOURCE, VÉTUSTÉ DES INSTALLATIONS, VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE
Pour expliquer le recours aux traitements non-conformes des industriels, le rapport de l'Igas remis en 2022 formule trois hypothèses : une dégradation des ressources, un vieillissement des installations et la sécurisation du processus industriel. Ces hypothèses sont confirmées par les travaux de la commission, qui en ajoute une quatrième.
La dégradation de la qualité de la ressource en eau en raison de pollutions anthropiques ou naturelles est une première hypothèse, confirmée par exemple pour certains forages Hépar ou pour Perrier. Autre source de vulnérabilité, mise en évidence par les directeurs de sites de Nestlé Waters : la vétusté des installations. Nestlé Waters a en outre justifié la nécessité de traiter ses eaux avec une microfiltration à 0,2 micron pour sécuriser son processus industriel en raison de la formation de « biofilm », amas de micro-organismes qui se déposent à l'intérieur des canalisations. Néanmoins, cette analyse n'est pas partagée par d'autres industriels qui estiment que la formation de biofilm est tout simplement prévenue par... des nettoyages réguliers. Il apparaît donc que la microfiltration pourrait être un outil pour réduire la fréquence des nettoyages qui impliquent des arrêts de la production.
B. LA MICROFILTRATION, UN TRAITEMENT AU CoeUR DU PLAN DE TRANSFORMATION DE NESTLÉ
À plusieurs reprises, le statut juridique entourant la microfiltration a été présenté comme flou ou incertain par un certain nombre d'acteurs, en particulier de Nestlé, qui en a fait l'un de ses arguments centraux pour demander à l'État un seuil de coupure à 0,2 micron. Pour autant, la règlementation apparaît très claire à d'autres opérateurs majeurs, comme Danone, par exemple. Le coeur de cette règlementation est la pureté originelle : le principe est qu'une eau minérale naturelle ne subit pas de traitements. Ces derniers ne sont qu'une exception. La directive européenne de 2009 précise qu'une eau minérale naturelle ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que ceux qui sont listés par la directive, à moins d'une autorisation au terme d'une procédure spécifique.
En tout état de cause, afin de préserver la pureté originelle de l'eau, un traitement ne doit pas modifier le microbisme de l'eau. À la suite d'un avis de l'AFSSA de 2001, l'ANSES a confirmé en 2022 et 2023, s'est référé à un seuil de coupure de 0,8 micron en la matière. Il est résulté de cet avis une tolérance des autorités vis-à-vis de filtration à un seuil de coupure de 0,8 micron. Les avis de l'Anses ne donnent absolument aucun blanc-seing pour une filtration inférieure.
La microfiltration à 0,2 micron est pourtant la clé de voûte du plan de transformation que Nestlé Waters demande aux autorités de valider dès 2021 : elle est la contrepartie de l'arrêt des traitements au charbon actif et aux UV, pudiquement appelés « barrières de protection » :
ð dans les Vosges, le plan présenté aux agents de l'ARS lors de l'inspection du 6 avril 2022 prévoit le maintien des filtrations à 0,2 micron, l'arrêt de l'utilisation du charbon actif le 12 avril 2022 et l'arrêt de l'utilisation des traitements UV fin mai ou début juin 2022 ;
ð dans le Gard, le plan présenté le 3 novembre 2022 à l'ARS Occitanie prévoit le maintien des « barrières de protection » à titre transitoire pendant la durée du plan de transformation, et à titre permanent pour la production à destination des Etats-Unis, en parallèle du maintien des microfiltres à 0,2 micron.
Sans attendre la position des autorités et l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron, ce sont près de 95 millions d'euros qui ont été investis au cours des cinq dernières années sur le site des Vosges et 150 millions d'euros sur le site de Vergèze pour mettre en oeuvre ce plan de transformation.
Pour autant, ce « plan de transformation » n'évacue pas toutes les préoccupations, notamment sanitaires et environnementales. Dans les Vosges, il s'accompagne d'une surveillance renforcée par l'ARS face aux risques de contaminations. Dans le Gard, des doutes persistent quant à la traçabilité de l'eau minérale naturelle et à la maîtrise du risque sanitaire avec la mise en place trop tardive d'un contrôle sanitaire renforcé. Pourtant il s'imposait sur un site où l'avis des hydrogéologues mandatés par le préfet met clairement en doute la pureté originelle de la nappe Perrier sur de nombreux forages. À la date de publication du rapport, Nestlé Waters n'est toujours pas en conformité avec la règlementation, plus de trois ans et demi après ses aveux au cabinet de la ministre de l'industrie. Mais il aura fallu attendre le 7 mai 2025 pour que le préfet du Gard, en quelque sorte « piégé » par les résultats de la concertation interministérielle dématérialisée (CID) de février 2023, mette en demeure Nestlé Waters de retirer ses filtres à 0,2 micron.
C. UN BESOIN URGENT DE CLARIFICATION DE LA POSITION DE L'ÉTAT SUR LA MICROFILTRATION
Le besoin de clarification ne s'arrête pas au Gard et aux Vosges : des industriels d'autres départements demandent à recourir à une microfiltration à 0,2 micron. La clarification de la norme était d'ailleurs une des recommandations du rapport de l'Igas.
Cette clarification attendue par les autorités locales depuis 2022 n'est jamais vraiment intervenue. Entre octobre et décembre 2024, le directeur général de la santé a expliqué aux ARS, sous la forme d'une simple lettre, que la microfiltration n'était autorisée qu'à deux conditions : d'une part sous réserve que l'exploitant apporte la preuve de l'absence de modification du microbisme de l'eau, et d'autre part, que le seuil de coupure soit supérieur à 0,45 micron, en cohérence avec les autres États membres de l'Union européenne. Cette prise de position, bienvenue, n'a pas pour autant conduit à la prise d'une norme de « droit dur ».
Elle s'est en outre traduite par des réactions hétérogènes des autorités préfectorales et des ARS, certaines demandant une simple démonstration de l'absence de modification du microbisme de l'eau, d'autres se référant au seuil de 0,8 micron tandis que d'autres faisant référence à celui de 0,45 micron. Face à ces différences qui portent autant sur les procédures que sur le contenu des demandes adressées aux industriels, le rapporteur estime urgent de clarifier la règlementation en se fondant sur un avis scientifique de l'Anses.
IV. PRÉSERVER L'AVENIR DES EAUX MINÉRALES ET DE SOURCE EN FRANCE
A. UNE RESSOURCE À PROTÉGER
Le suivi quantitatif du niveau des aquifères, qui sont des formations géologiques poreuses dans lesquelles circulent les eaux souterraines exploitables, doit être renforcé afin d'améliorer le suivi en temps réel du niveau de la ressource en eau.
Ce suivi est assuré pour le compte de l'État par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la direction de l'eau et de la biodiversité, via l'exploitation de piézomètres1(*) répartis sur le territoire. Il est également dressé un inventaire exhaustif des émergences d'eau souterraine et d'eau minérale naturelle, contenu dans la base de données SISE-EAUX. Or, les ARS, qui sont chargées depuis 2007 la base SISE-EAUX le font de manière hétérogène au regard de leur manque de personnel hydrogéologue, de sorte que de nombreux forages restent non déclarés. Les piézomètres sont inégalement répartis sur le territoire, et notamment en outre-mer, de sorte que ce suivi n'est pas suffisamment fin pour renseigner l'évolution du niveau d'une nappe précise et de l'ensemble de la ressource.
Le suivi qualitatif de la ressource en eau doit être repensé afin de mieux protéger les zones sensibles à la pollution que sont l'impluvium, qui correspond à la zone de surface dans laquelle l'eau s'infiltre dans les nappes, et la zone d'émergence sur laquelle se situent les captages d'eau. Actuellement, les arrêtés d'autorisation d'exploitation fixent un périmètre sanitaire d'émergence matérialisé par un grillage pour protéger les captages des pollutions anthropiques. A ce mécanisme obligatoire s'ajoute un outil juridique facultatif qu'est la déclaration d'intérêt public, qui permet à un industriel de demander au préfet de définir un périmètre de protection plus large, à l'intérieur duquel toute activité humaine de nature à nuire à la qualité des eaux est soumise à autorisation. Cette règlementation pourrait être renforcée en élargissant la zone de périmètre sanitaire d'émergence de façon à ce qu'elle inclue l'impluvium et l'ensemble du gisement d'eau et permette aux autorités locales d'interdire sur ces zones l'usage de produits phytosanitaires de nature à affecter la qualité des nappes, comme cela est le cas en Belgique. Il convient enfin d'instaurer un suivi qualitatif des nappes et des gisements au niveau national sur le modèle du suivi quantitatif qui existe déjà.
Une meilleure gestion de la ressource en eau passe également par un contrôle effectif du niveau de prélèvement réalisé par les industriels minéraliers au regard des seuils maximum de débit autorisés dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, afin que l'autorité préfectorale ait une connaissance générale de l'eau prélevée.
B. RÉNOVER ET CLARIFIER LA RÈGLEMENTATION ET LES CONTRÔLES, COMPLEXES ET ILLISIBLES
1) Un dispositif de contrôle dispersé à unifier en renforcer les moyens et le dialogue entre administrations
Le dispositif d'autorisation et de contrôle des eaux minérales naturelles est dispersé et fractionné. L'autorisation de la production d'eaux minérales naturelles et de source associe un volet environnemental et un volet sanitaire. Le contrôle dépend quant à lui de quatre autorités administratives centrales et fragmenté tout au long du processus de production.
La commission d'enquête recommande de renforcer la fréquence des contrôles, les moyens et la coopération entre les autorités. Un protocole tripartite entre les ministères chargés de la santé (la DGS), de la consommation (la DGCCRF) et de l'agriculture (DGAL), à finaliser dans les meilleurs délais, précisera les rôles des trois autorités compétentes et devra garantir une plus grande coordination entre les différentes autorités centrales et locales et un chef de filât clairement identifié.
Les administrations centrales devront mettre en place une véritable animation de leurs réseaux déconcentrés sur cette thématique et la coopération entre les services déconcentrés chargés du contrôle des eaux conditionnées devra devenir la règle grâce à la création de groupes de suivi dédiés dans chaque département associant les inspecteurs territorialement compétents des ARS, les services déconcentrés de la DGCCRF, de la DGAL et du ministère de l'écologie.
2) Une règlementation à restructurer sur deux sujets majeurs : la microfiltration et la traçabilité
Si la réglementation relative à la microfiltration est apparue claire au rapporteur, force est de constater que de nombreux acteurs se sont retranchés derrière un flou supposé pour justifier leurs actes ou leur immobilisme.
Par conséquent, la commission d'enquête souhaite que la France saisisse la Commission européenne, qui n'a pas cherché jusqu'à présent à prendre d'initiative, pour obtenir une révision de la directive sur les eaux minérales naturelles afin de consolider la notion de pureté originelle, notamment en fixant un seuil de microfiltration suffisamment haut pour garantir sa préservation.
A plus brève échéance et au niveau national, il s'agira de diffuser rapidement une instruction et de modifier la règlementation pour écarter la microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron et conditionner la microfiltration avec des seuils compris entre 0,45 et 0,8 micron à la démonstration d'une absence d'impact sur le microbisme naturel de l'eau, sur la base d'un avis de l'Anses.
Autre sujet majeur, celui de la traçabilité de l'eau, alors que les sites assurant la production de plusieurs types d'eau sont de plus en plus automatisés. Il est proposé que l'État établisse un cahier des charges de traçabilité des eaux qui impose des règles précises d'auditabilité informatique des dispositifs de gestion des flux d'eau et que, parallèlement, le ministère de l'économie consente un effort de recrutement, de rémunération et de formation de personnels en capacité de procéder à des audits informatiques des programmes de production.
3) Élargir d'urgence le contrôle des composants de l'eau en raison de pollutions émergentes, PFAS et micro/nanoplastiques
Produites depuis de nombreuses décennies, les PFAS sont désormais très largement répandues dans l'environnement et se révèlent bioaccumulables. Certaines sont toxiques ou « CMR », c'est à dire cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, mais leur toxicité demeure encore insuffisamment documentée.
La commission d'enquête soutient la volonté exprimée par la DGS de demander aux ARS de vérifier au cours de l'année 2025 la qualité des eaux brutes des eaux minérales naturelles et des eaux de source afin de s'assurer que celle-ci ne contiennent pas de PFAS ou à des quantités inférieures au seuil de 0,1 ng/l pour les 20 PFAS listés par la directive de 2020 sur les eaux destinées à la consommation humaine.
Pour s'assurer que les processus de production n'augmentent pas l'exposition des eaux aux PFAS, la commission recommande de mener des campagnes de tests sur la présence de PFAS dans les eaux embouteillées.
La commission d'enquête estime indispensable qu'un point soit fait sur les risques de pollution par les processus industriels de production des eaux minérales et de source et recommande à la DGS de saisir l'Anses sur ce sujet. Elle estime que les résultats de cette étude devront être rendus publics.
S'agissant des microplastiques et nanoplastiques, les travaux scientifiques démontrent l'ubiquité de la contamination dans l'environnement : on les détecte actuellement, partout dans le monde, dans presque toutes les ressources aquatiques, qu'elles servent à l'obtention de l'eau du robinet ou pour les eaux embouteillées.
Une étude américaine, publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences le 8 janvier 2024, décompte ainsi près de 240 000 fragments de micro et nanoplastiques par litre d'eau en bouteille, avec une variation allant de 110 000 à 370 000 particules par litre.
En conséquence, les travaux de recherche sur les micro et nanoplastiques doivent faire désormais l'objet d'une priorisation claire et porter sur l'ensemble des eaux consommées par les humains, mais sans oublier les eaux conditionnées souvent recommandées pour la consommation des jeunes enfants, dont on a pu constater qu'elles n'avaient pas toujours été au coeur des préoccupations des autorités sanitaires.
C. ASSURER LA TRANSPARENCE ET RENFORCER LES MOYENS D'ACTIONS DU CONSOMMATEUR
Afin de remédier aux manquements révélés par les révélations effectuées par Nestlé, il pourrait être envisagé de renforcer l'information du consommateur sur le recours éventuel à la microfiltration lorsqu'elle est autorisée par des arrêtés préfectoraux, grâce à une information sur l'étiquette.
La bonne information sanitaire du consommateur passe également par une publicité renforcée du contenu des eaux qu'il achète, et notamment des eaux qui, pour être à base d'eau minérale, contiennent des quantités de sucre assimilables à des boissons de type soda.
La commission propose de renforcer la transparence sur le suivi de la ressource en eau et les contrôles réalisés par les autorités locales. Les différents épisodes de contamination recensés par la commission ont donné lieu à des décisions de suspension de certains forages qui n'ont pas été rendues publiques. L'amélioration du suivi quantitatif et qualitatif de l'eau contenue dans les nappes pourrait également donner lieu à une publicité accrue afin de sensibiliser le grand public à leur vulnérabilité.
D. UN ENJEU POUR L'AVENIR : MIEUX ENCADRER LES CONDITIONS D'UTILISATION DES CONVENTIONS JUDICIAIRE D'INTÉRÊT ENVIRONNEMENTALE (CJIPE)
Plusieurs infractions constatées dans les Vosges ont donné lieu à la conclusion d'une CJIPE entre le procureur d'Épinal et Nestlé Waters le 2 septembre 2024, validée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Épinal le 10 septembre 2024. La décision de recourir à cette convention n'a pas été comprise par une partie du grand public et soulève des interrogations. En particulier, le montant de l'amende d'intérêt public infligée à Nestlé Waters, qui aurait pu, selon les textes, être beaucoup plus élevée, jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires annuel, n'a pas fait l'objet d'explications étayées. Cette absence de précision peut donner l'impression d'un manque de transparence et d'une atténuation de la sanction. Aussi la commission estime-t-elle nécessaire que la chancellerie établisse des Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public environnementale, à l'instar de celles publiées en janvier 2023 par le parquet national financier pour les CJIP « financières ».
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET
DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
|
Recommandations |
||||
|
N° Par ordre d'apparition dans le rapport |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
Préserver la ressource |
||||
|
7 Page 171 |
Renforcer le suivi du niveau des aquifères sur le territoire et Instaurer un suivi national de la qualité de la ressource des aquifères sur le territoire |
Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité Autorités de contrôle déconcentrées (Préfectures et DDT) |
2030 |
Processus |
|
8 Page 173 |
Revoir les dispositifs des périmètres sanitaires d'émergence (PSE), rendre obligatoires les périmètres de protection à l'échelle de l'ensemble du gisement d'eau minérale naturelle en s'inspirant de la loi belge de 1991 et instaurer des restrictions d'usage de produits de nature à altérer la pureté originelle de l'eau sur la zone de périmètre encadrant les gisements |
Ministère chargé de l'environnement, direction générale de la prévention des risques et direction de l'eau et de la biodiversité |
2nd semestre 2025 |
Dispositions législatives et réglementaires |
|
Conforter la fiscalité locale sur les eaux minérales naturelles |
||||
|
9 Page 177 |
Revoir le régime fiscal des eaux minérales naturelles : - en étendant la contribution à toute exploitation d'eau souterraine, eau minérale naturelle, eau de source ou eau de boisson - en supprimant le plafond de 0,58 € par hectolitre - en supprimant l'exonération de contribution pour l'eau vendue à l'exportation |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
2nd semestre 2025 |
Dispositions fiscales |
|
Renforcer le dispositif de contrôle |
||||
|
2 Page 55 |
Rappeler le caractère général de l'article 40 du code de procédure pénale |
Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
Immédiat |
Instruction |
|
3 Page 81 |
Donner instruction aux préfets, en lien avec les ARS, de vérifier, sur la base de l'expérience acquise dans les établissements Nestlé Waters et Alma, l'absence de traitements interdits sur les sites minéraliers de France |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
Immédiat |
Instruction |
|
4 Page 82 |
Animer régulièrement le réseau des contrôleurs des eaux minérales (préfets et services départementaux de l'État, ARS) pour partager, enjeux, évolutions et expériences |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
Immédiat |
Conduite |
|
5 Page 111 |
Rappeler aux autorités locales (préfets, ARS) les textes en vigueur en matière de traitements des eaux et notamment l'existence d'une procédure spécifique en matière de traitements nouveaux à l'instar de la microfiltration à seuil bas |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
Immédiat |
Instruction |
|
10 Page 181 |
Instaurer, pour les contrôles un chef de filât clairement identifié par le protocole tripartite entre les ministères chargés de la santé, de la consommation et de l'agriculture pour la réalisation des contrôles et pour la gestion des alertes et soumettre à une validation politique ce protocole |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
1er semestre 2025 |
Protocole interministériel |
|
11 Page 181 |
Créer dans chaque département un groupe de suivi des eaux conditionnées associant les inspecteurs territorialement compétents des ARS, les services déconcentrés de la, de la DGAL, de la DGCCRF et de la DGALN et Systématiser la présence des agents de la répression des fraudes lors des inspections déclenchées par les ARS |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
2nd semestre 2025 |
Protocole |
|
12 Page 183 |
Renforcer par redéploiements les effectifs des services de l'État consacrés au contrôle des eaux minérales naturelles et des eaux de source et Renforcer la professionnalisation de ces agents en les formant notamment aux risques de fraude informatique en matière de traçabilité des eaux |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
2nd semestre 2025 idem |
Redéploiement d'effectifs Programme |
|
13 Page 185 |
Concevoir et mettre en oeuvre un plan de contrôle des eaux conditionnées fondé sur les risques et la probabilité de comportements frauduleux et multiplier les inspections inopinées |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité |
2nd semestre 2025 |
Stratégie nationale spécifique |
|
14 Page 185 |
Mettre en place une véritable animation par les administrations centrales de leurs réseaux déconcentrés sur le thème du contrôle des eaux embouteillées |
idem |
idem |
Conduite administrative |
|
17 Page 190 |
Mettre en place un cahier des charges de traçabilité des eaux qui impose des règles précises d'auditabilité informatique des dispositifs de gestion des flux d'eau |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |
2nd semestre 2025 |
Cahier |
|
18 Page 190 |
Créer un groupe de réflexion interservices pour instituer un programme de recrutement et de formation d'agents capable de réaliser des audits des dispositifs informatisés de production et concevoir un plan d'audit de la traçabilité des eaux conditionnées |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |
Immédiat |
Instruction |
|
19 Page 190 |
Mener une campagne d'inspection des sites de production d'eau embouteillée portant spécifiquement sur la traçabilité des eaux minérales naturelles et/ou des eaux de source avant d'envisager une évolution ou, a minima, une clarification de la règlementation |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |
Immédiat |
Instruction |
|
Clarifier la règlementation |
||||
|
15 Page 188 |
Solliciter à nouveau la Commission européenne, y compris au niveau politique, pour obtenir une révision de la directive sur les eaux minérales naturelles afin de consolider la notion de pureté originelle, notamment en fixant un seuil de microfiltration suffisamment haut pour garantir sa préservation puis Engager une négociation au niveau européen pour réviser la directive de 2009 sans altérer la protection de la pureté originelle de l'eau minérale |
Premier ministre, secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de l'Europe |
2025 |
Sollicitation puis négociation diplomatique |
|
16 Page 188 |
Diffuser rapidement l'instruction interdisant la microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron et conditionnant la microfiltration à des seuils compris entre 0,45 et 0,8 micron à la démonstration d'une absence d'impact sur le microbisme naturel de l'eau, sur la base d'un avis de l'Anses puis Modifier l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnée pour y insérer le même niveau de seuils |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
1er semestre 2025 |
Instruction Arrêté |
|
Évaluer les nouveaux risques |
||||
|
20 Page 195 |
Saisir l'Anses aux fins d'établir un avis complet sur les risques de contamination des processus de production d'eau minérale et de source par les PFAS et rendre public cet avis |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
1er semestre 2025 |
Saisine au titre de l'article L1313-3 du code de la santé publique |
|
21 Page 198 |
Renforcer le contrôle sur la présence des PFAS dans les eaux embouteillées en menant une campagne de tests en 2025 |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé |
2nd semestre 2025 |
Instruction |
|
22 Page 198 |
Vérifier l'absence d'adjonction de PFAS au cours des processus d'embouteillage |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé |
2nd semestre 2025 |
Instruction |
|
23 Page 201 |
Proposer une programmation sur 5 ans de recherche en matière de contamination des eaux embouteillées : - par les microplastiques - par les PFAS des eaux et de leur processus de production |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Anses |
2026-2030 |
Programmation |
|
24 Page 201 |
Déterminer une méthodologie de mesure de la quantité des microplastiques dans l'eau et de la manière de prévenir leur présence dans les processus d'embouteillage |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Anses |
2nd semestre 2025 |
Instruction |
|
Mieux protéger le consommateur |
||||
|
25 Page 203 |
Préciser parmi les mentions devant figurer sur l'étiquette des eaux minérales naturelles le recours à des traitements de filtration |
Ministère de l'économie pour porter une telle demande devant la Commission européenne et les États membres |
Modification |
|
|
26 Page 203 |
Communiquer sur les demandes de mise en conformité effectuées par la DGCCRF |
DGCCRF |
Instruction |
|
|
27 Page 204 |
Préciser parmi les mentions devant figurer sur l'étiquette des eaux aromatisées le fait qu'elles ne peuvent s'apparenter à des eaux minérales naturelles et ne pas commercialiser ces eaux dans les rayons d'eau minérale naturelle |
Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |
Dispositions réglementaires |
|
|
28 Page 205 |
Mettre en oeuvre une information des consommateurs sur la qualité et la quantité d'eau disponible dans les aquifères via un site internet cogéré par les administrations compétentes |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité |
2nd semestre 2025 |
Site internet |
|
6 Page 168 |
Mieux encadrer la mise en oeuvre de la CJIP en matière environnementale en l'alignant sur celle de la CJIP financière et en ajustant certains de ses aspects |
Parlement Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces |
2025-2026 |
Dispositions législatives et instruction sous forme de Lignes directrices adressées aux Parquets |
|
Renforcer le pouvoir des commissions d'enquête |
||||
|
1 Page 29 |
Renforcer les moyens des commissions d'enquête |
Parlement |
2025 |
Dispositions législatives |
INTRODUCTION
En janvier 2024, la presse révélait un scandale inimaginable : depuis des années, certains industriels désinfectaient, au mépris de la règlementation, leurs eaux vendues avec l'appellation « minérales naturelles ». Et, pire, l'État, qui était au courant depuis au moins 3 ans, l'avait caché. Ainsi avait-il dissimulé l'existence d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) visant à faire le point sur ces pratiques et transmis aux ministres de l'économie, de l'industrie et de la santé en juillet 2022.
Une question fondamentale se posait : pourquoi cette tricherie ? Et, contrairement à ce que certains tenteraient de faire croire, elle n'appelait qu'une seule réponse : au coeur de cette affaire se trouvait un problème sur la pureté originelle de l'eau vendue comme eau minérale naturelle. Car, s'il y avait eu, à l'évidence, tromperie du consommateur, c'était parce que les industriels concernés, Nestlé Waters au premier chef, ne pouvaient plus vendre une eau sans traitement compte tenu de la dégradation de sa qualité.
Si la qualité de l'eau était en cause, cela signifiait qu'à la tromperie s'ajoutait un enjeu sanitaire, en d'autres termes que l'eau vendue ne pouvait être consommable sans des dispositifs de désinfection permettant de détruire les germes la contaminant. Certes, à la connaissance de la commission d'enquête, ce risque sanitaire ne s'est pas réalisé, en tout cas pas au point de causer des lésions graves à des consommateurs. Mais qui peut dire combien de désagréments intestinaux ou d'intoxications alimentaires non létales ont pu se produire à la suite de la consommation de ces eaux ? Qui peut faire confiance, encore aujourd'hui, à l'autocontrôle sanitaire d'un industriel qui se refuse à faire toute la transparence sur ses agissements passés devant la représentation nationale ?
Cet enjeu, en effet, a été latent jusqu'à la découverte des traitements de désinfection interdits et il est devenu beaucoup plus fort ensuite, à partir de 2022-2023. Car, alors que l'État aurait dû exiger le déclassement des eaux contaminées, ce qui aurait autorisé leur traitement, il a préféré, avec un industriel, choisir la solution la plus équivoque : maintenir l'appellation d'eau minérale naturelle pour des eaux qui ne la méritaient plus, car traitées par un dispositif non autorisé, et qui n'offrait pas de garantie absolue de désinfection. Chacun comprendra l'objectif de l'industriel : car l'eau minérale se vend cher, parfois très cher, en tout cas beaucoup plus cher que l'eau du robinet. Par ailleurs, dans le secteur des eaux, être producteur d'eau minérale naturelle vous donne une sorte de brevet de qualité, de pureté, gage de marge importante pour toute votre gamme de produits.
Le Sénat ne pouvait rester indifférent à cette situation qui engageait la confiance des Français, la protection du consommateur, la loyauté du commerce et l'avenir de tout le secteur minéralier qui est un des points forts de l'industrie alimentaire française. Une affaire qui engageait aussi la responsabilité de l'État, garant de l'intérêt général. Ainsi, en octobre 2024, sa commission des affaires économiques a adopté le rapport signé de notre collègue Antoinette Guhl, qui faisait un premier point de la situation2(*). Puis il a créé, le 20 novembre 2024, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics.
La commission d'enquête s'est très rapidement mise au travail. Elle a requis la transmission et exploité des milliers de pages de documentation et a réalisé un très intense programme d'auditions publiques3(*) lui permettant d'entendre :
- des spécialistes des eaux et aquifères : le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), des universitaires et des chercheurs, responsables de laboratoires publics, ainsi que les laboratoires privés effectuant les contrôles de qualité de l'eau pour le compte des industriels ;
- les directeurs et conseillers de cabinets des ministères responsables (santé, industrie, consommation) et de la Première ministre ;
- les responsables des principales administrations centrales impliqués dans le dossier : Anses, Igas, direction générale de la santé (DGS), direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- les responsables des administrations locales : préfets, agences régionales de santé (ARS), directions départementales des territoires (DDT), directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)... ;
- les dirigeants des activités minéralières des groupes et entreprises les plus importants : Danone (Évian, Volvic, Badoit...), Alma (Cristaline, Thonon, Châteldon, Vichy-Saint-Yorre...), Ogeu (Plancoët, Quézac...), Mont-Roucous et Nestlé (Perrier, Vittel, Hépar...) ;
- les élus locaux des principales zones de production ;
- une lanceuse d'alerte, ancienne responsable de la sécurité alimentaire du groupe Nestlé ;
- les anciens ministres en charge du dossier : Agnès Firmin Le Bodo, ancienne ministre de la santé4(*), Aurélien Rousseau, ancien ministre de la santé mais aussi ancien directeur de cabinet de la Première ministre5(*), Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de l'industrie6(*), et Roland Lescure, ancien ministre de l'industrie7(*). Les années 2022-2024 ayant vu se succéder un grand nombre de ministres, certains pour quelques mois, il a été transmis un questionnaire à Brigitte Bourguignon, François Braun, Frédéric Valletoux, et Geneviève Darrieussecq, pour le ministère de la santé, à Olivia Grégoire, Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Griset, pour le ministère de la consommation ;
- le directeur général du groupe Nestlé, Laurent Freixe.
La commission a par ailleurs demandé à la division de législation comparée du Sénat une étude de droit comparé sur la réglementation des eaux en bouteille portant sur six pays (Allemagne, Belgique, Espagne, États Unis, Italie et Suisse) qui est annexée au rapport. Dans le cadre de la concertation interministérielle dématérialisée de février 2023, le cabinet du Premier ministre avait demandé « au Secrétariat général des affaires européennes de conduire une analyse de la situation de la microfiltration et des pratiques existantes dans les autres pays de l'Union (...) ». À la connaissance de la commission d'enquête, cette analyse n'a jamais été réalisée. Il est piquant de remarquer que le Sénat a produit en moins de trois mois ce que le SGAE n'a pas été en mesure de faire en plus de deux ans.
Il est apparu au cours de nos recherches que la présidence de la République avait été impliquée dans cette affaire. Aussi, conformément à l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en ma qualité de rapporteur de la commission d'enquête, j'ai réclamé un certain nombre de documents illustrant les échanges avec Nestlé Waters ou à propos de l'affaire des eaux minérales. Ceux qui m'ont été transmis démontraient la justesse de notre intuition : l'Élysée savait beaucoup de choses. Aussi, en complète harmonie avec le président de la commission, nous avons souhaité entendre Alexis Kohler, alors secrétaire général de la présidence de la République. Ayant transmis des documents dont il reconnaissait lui-même qu'ils n'avaient pas eu pour « finalité d'éclairer le président de la République en vue d'une prise de position de sa part, ni ayant été la transcription par ses collaborateurs d'une telle prise de position » et qu'il pouvait, par conséquent, « au regard du principe de séparation des pouvoirs », nous les adresser, il aurait dû, en toute logique, accepter de s'expliquer sur ces documents. Le secrétaire général de l'Élysée a préféré se dérober, semble-t-il en accord avec le chef de l'État, ce qui ne laisse pas d'interroger sur leur respect à l'égard de la représentation nationale.
Qu'à cela ne tienne ! La présidence de la République ne voulait pas plus de transparence sur cette affaire aujourd'hui que le Gouvernement hier ? Le Sénat a décidé de la faire au profit de tous nos concitoyens. Telle est la raison pour laquelle nous avons décidé de publier de manière inédite, en annexe de ce rapport et sur le site internet du Sénat, l'intégralité des 74 documents qui nous ont été transmis par l'Élysée.
Ce refus de déposer nous a aussi été opposé, de façon moins brutale, par les dirigeantes de Nestlé Waters. Certes, elles se sont déplacées et ont été entendues par la commission, mais pour ne rien dire ou presque. Dûment chapitrées par leurs avocats, elles se sont bornées à répéter les mêmes éléments de langage, à savoir l'existence d'une instruction judiciaire pour ne rien dire des agissements de leur société. Cette stratégie en matière de communication était désastreuse pour le groupe Nestlé tout entier qui donnait ainsi l'impression d'avoir encore à cacher des turpitudes et elle n'a pas fait obstacle, en définitive, à ce que la commission collecte suffisamment d'éléments par ailleurs pour se faire une idée précise des responsabilités des uns et des autres. Au surplus, comme le rapporteur a eu l'occasion de le leur rappeler, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme8(*) préserve le droit des personnes auditionnées devant une commission d'enquête à ne pas s'auto-incriminer dans la mesure où le juge pénal ne peut fonder une condamnation sur les seuls propos tenus devant elle. Le risque judiciaire encouru était donc limité.
Cependant, cette attitude était une marque de mépris pour le Parlement et les Français et, dans d'autres cas, elle pourrait être un sérieux obstacle à la manifestation de la vérité. En l'espèce, les responsables de Nestlé Waters pouvaient jouer de l'ambigüité des termes de l'article 6 de l'ordonnance de 1958, et en particulier de ses alinéas 3 et 7. L'alinéa 3 dispose : « Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ». Nestlé Waters et ses avocats en ont inféré jusqu'à l'illégitimité de la commission d'enquête ! Quant au 7ème alinéa, il prévoit que le rapporteur d'une telle commission est habilité à se faire communiquer « tous les renseignements de nature à faciliter (sa) mission » et « tous documents de service », « à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ». Ici Nestlé Waters prétendait que nous allions à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs, rien que cela !
Au-delà de la stratégie d'obstruction dérisoire de cette entreprise, il faut avouer que les termes de l'ordonnance de 1958 sont à la fois trop larges et imprécis. Suffisamment pour que même une administration de l'État, en l'espèce la DGCCRF, refuse des documents à la commission. Il y avait bien une procédure judiciaire dans notre affaire, voire deux, mais elles étaient bien loin de couvrir le vaste champ de notre commission. Par ailleurs, en réalité, en quoi informer la commission d'enquête sur les agissements passés de cette société, ou d'une autre, pouvait-il affecter le principe de séparation des pouvoirs ? À l'évidence, la disposition de l'alinéa 7 vise à éviter que l'un des pouvoirs ne fasse pression sur le pouvoir judiciaire et n'altère l'indépendance des juges. Elle n'a pas pour objet de rendre aveugle le Parlement en le privant non d'un pouvoir d'action, mais d'une simple information. Ajoutons que, par mesure de précaution, les informations jugées nécessaires pas une commission d'enquête pourraient lui être communiquées à la condition de ne pas faire l'objet d'une publication si cette dernière était de nature à fragiliser l'enquête pénale en cours.
De ces épisodes, ressort la conviction qu'il nous faut, parlementaires, reprendre la rédaction de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 pour éviter que d'autres commissions, à l'avenir, ne soit entravées dans leur action.
À cet égard, trois objectifs devraient nous guider : il faut d'abord préciser et réduire le champ de l'alinéa 3 qui ne doit avoir à jouer que si le champ des poursuites judiciaires épouse parfaitement celui d'une commission d'enquête.
Une deuxième nécessité est de permettre la complète information des commissions d'enquête parlementaires sur des faits n'ayant pas donné lieu à poursuites. Lorsque que des documents lui ont été refusés par la DGCCRF, la commission a eu la surprise de découvrir que les mêmes documents avaient été auparavant transmis à l'Igas. Une inspection administrative avait accès à davantage d'informations que les membres du Parlement ! Le fondement juridique de cette différence de traitement réside dans l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, qui précise notamment : « Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'État et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions (...).
Les administrations de l'État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, organismes ou professionnels mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ». Si ces dispositions permettent d'informer une inspection sur des procédures en cours, il n'y a aucune raison justifiant qu'elles ne soient pas transposées aux commissions d'enquête.
Toujours aux fins d'information du Parlement, on comprend mal que ne soit pas autorisé aux commissions d'enquête ce qui l'est désormais aux maires. Ainsi, l'article L.132-3 du code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs niveaux d'information du maire par le procureur de la République sur les infractions intervenues sur le territoire de la commune ou sur les suites réservées par la justice à ces infractions. Il serait légitime que l'ordonnance de 1958 prévoie de même l'information des commissions d'enquête ou, à tout le moins, de leur rapporteur, sur les procédures en cours ou clôturées dans leur champ d'investigation, dans un délai compatible avec le bon déroulement de leurs travaux.
Il faut enfin faire en sorte qu'une commission d'enquête ayant requis une déposition ait la garantie qu'il lui sera donné satisfaction avant la fin de ses travaux, ce qui suppose une modification du 8ème alinéa de l'article 6. Pourquoi, par exemple, ne pas instituer un « référé-vérité », à l'image du référé pénal environnemental, qui permettrait dans l'urgence à un juge de contraindre une personne à s'exprimer devant une commission d'enquête, sauf cas manifeste où l'indépendance de la justice serait menacée ? Une autre solution pourrait être de faire trancher rapidement les litiges relatifs à un refus de déposition ou de transmission de documents dans le cadre d'une procédure du type comparution immédiate. Dans le sillage des travaux de la commission, le rapporteur et le président ont convenu d'engager ce travail de réécriture qui s'impose. Les commissions d'enquête sont devenues ces dernières années une composante essentielle de la vie démocratique de la Nation. Il faut que leur cadre juridique soit sécurisé et leurs pouvoirs confortés.
S'agissant du résultat de ses investigations, la commission d'enquête a d'abord souhaité rappeler l'enjeu du secteur des eaux en bouteille (Chapitre préliminaire). Elle a ensuite mis au jour, de manière synthétique, les contours de ce qu'il est convenu d'appeler le « scandale des eaux minérales », en insistant sur les dysfonctionnements qu'il révélait en matière d'action de l'État (Partie I). Elle s'est efforcée d'expliquer les « dessous » de cette crise (Partie II) en analysant les ressorts des agissements des industriels fautifs, au premier chef Nestlé Waters, mais aussi les incohérences et les biais dans l'action de l'État central et les fragilités de l'État local. Enfin, pour éviter qu'une telle dérive de l'action publique ne se reproduise, elle a souhaité avancer un certain nombre de propositions visant en particulier à préserver l'avenir des eaux minérales et de source en France (Partie III).
Au moment de clore ses travaux, la commission souhaite rendre hommage aux lanceurs d'alerte, qui ont permis le dévoilement des agissements de certains industriels ou des incohérences de l'action de l'État, et aux journalistes qui, grâce à leurs investigations, ont su montrer au public l'importance de cette affaire. Elle est consciente de l'inquiétude des salariés du secteur, en particulier de Perrier, et appelle, par ses recommandations, les pouvoirs publics à restaurer la confiance dans une industrie cruciale, gage de la préservation des emplois.
Elle veut aussi alerter nos concitoyens comme les acteurs politiques. Ce scandale témoigne d'une fragilisation de l'État sans précédent. Fragilisation matérielle, certes, avec des services étrillés par des réductions d'effectifs, mais aussi fragilisation organisationnelle, avec une culture du travail en silo, dont on connaît la prégnance, mais qui a pris, en l'espèce, des proportions inquiétantes.
Plus profondément, c'est d'une fragilisation morale ou philosophique qu'il s'agit. La soumission aux exigences d'un industriel, alors même qu'elles étaient contraires aux intérêts des consommateurs français et de l'ensemble du secteur minéralier, illustre une vision biaisée de l'équité à laquelle l'action de l'État devrait être soumise. La vision parfois dévoyée de l'intérêt général, de la part des ministères et de leurs cabinets reflète l'affaissement du rôle de protecteur des citoyens et de la nation que l'État devrait jouer. L'incapacité quasi générale, enfin, des hauts fonctionnaires et des ministres entendus - à quelques rares mais notables exceptions - à se remettre en cause symbolise une attitude qui vise moins à comprendre qu'à se justifier. C'est au fond aujourd'hui la principale préoccupation du rapporteur, car elle laisse craindre qu'un même scandale puisse encore se reproduire, si ce n'est dans les eaux minérales, dans un autre secteur.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
1 |
Renforcer les moyens des commissions d'enquête |
Parlement |
2025 |
Dispositions législatives |
CHAPITRE
PRÉLIMINAIRE
LES EAUX MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE,
UNE
RESSOURCE PRÉCIEUSE, FRAGILE ET PÉRISSABLE
I. QUE SONT LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX DE SOURCE ?
Comme le rappelait devant la commission Marie-Pierre Sauvant Rochat, responsable du laboratoire santé publique et environnement à l'université Clermont Auvergne : « à la fin du XIXe siècle, on associait aux eaux minérales naturelles le thermalisme, l'idée d'une eau qui soigne, d'une eau miraculeuse. C'était à part entière un produit de santé ».
Par la suite, au cours du XXe siècle, ces eaux sont devenues des produits alimentaires de grande consommation, mais auxquels s'applique une réglementation précise et contraignante, destinée à garantir la sécurité sanitaire des produits et la confiance des consommateurs, qui les achètent, à des prix élevés, pour leurs qualités perçues sur leur santé.
Conformément à la définition prévue par le droit européen et sa transposition nationale, les eaux minérales naturelles et les eaux de source doivent être microbiologiquement saines et être embouteillées telles qu'elles sont à l'émergence, sans traitement susceptible d'altérer leurs caractéristiques9(*). Naturellement pures, elles ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une désinfection.
Ces deux types d'eau se distinguent des eaux rendues potables par traitement, lesquelles sont également des denrées alimentaires et peuvent faire l'objet d'un conditionnement (mise en bouteilles ou en bombonnes), mais ne sauraient être présentées et vendues comme des eaux minérales naturelles ou des eaux de source, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet des mêmes traitements que l'eau du robinet, y compris subir une désinfection. Encadrées par les articles R.1321-91 à R.1321-93 du code de la santé publique, ce sont classiquement des eaux de réseaux publics mises en bouteille. Il en existe quatre en France (une à Mayotte, deux en Guadeloupe et une dans le Doubs).
En France, la consommation d'eau embouteillée était de 135 litres par habitant en 2018, soit une consommation de 9 milliards de litres pour l'ensemble de la population française, qui se partage pour moitié entre les eaux minérales naturelles et les eaux de source, les eaux rendues potables par traitement étant très peu commercialisées dans notre pays.
Les habitants du Nord de la France sont les plus grands consommateurs d'eau en bouteille en France. Ils privilégient la consommation d'eau minérale naturelle en raison de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface causée par les pesticides et les nitrates (notamment en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Bretagne).
La gestion de la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et des eaux de source repose avant tout sur la directive européenne 2009/54/CE sur les eaux minérales naturelles et, dans une moindre mesure, sur la directive 2020/2184. Cette dernière concerne principalement les eaux destinées à la consommation humaine, mais elle s'applique également pour partie aux eaux de source.
Ces directives sont transposées en droit français par des dispositions législatives et réglementaires, complétées par sept arrêtés d'application.
|
Textes européens et nationaux applicables aux eaux conditionnées Au niveau européen, plusieurs textes réglementaires encadrent les eaux conditionnées, dont : - la directive européenne 2009/54/CE (définition de l'eau minérale naturelle, exigences de qualité microbiologique à la ressource et sur l'eau conditionnée pour l'eau minérale naturelle et l'eau de source, conditions d'exploitation de la ressource, traitements autorisés pour l'eau minérale naturelle et l'eau de source, mentions d'étiquetage) ; - la directive européenne 2003/40/CE (limites de qualité physicochimique pour 16 constituants naturellement présents dans les eaux minérales naturelles) ; - la directive 98/83/CE (modifiée par la directive (UE) 2015/1787) qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), dont les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées (limites de qualité microbiologiques et physicochimiques) ; - les règlements du « Paquet Hygiène » (règlements européens N° 178/2002, N° 852/2004 et N° 882/2004) applicables aux denrées alimentaires (règles d'hygiène, surveillance par l'exploitant, contrôles officiels exercés par les États membres, etc.). Les directives européennes spécifiques aux eaux conditionnées ainsi que la réglementation européenne en vigueur pour les denrées alimentaires ont été traduites dans le droit national. Les dispositions édictées par ces textes ont été intégrées au code de la santé publique. En outre, plusieurs arrêtés ministériels, constituant le corpus réglementaire national régissant ces eaux, ont été adoptés, dont : - l'arrêté du 22 octobre 2013 modifié qui porte sur le contrôle sanitaire mis en oeuvre par les ARS et sur la surveillance par l'exploitant ; - l'arrêté du 14 mars 2007 modifié qui porte sur les exigences de qualité, les traitements autorisés et les mentions d'étiquetage ; - l'arrêté du 5 mars 2007 qui porte sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'une ressource à des fins de conditionnement en eau minérale naturelle ou de distribution d'une eau minérale naturelle en buvette publique ; - l'arrêté du 20 juin 2007 qui porte sur les demandes d'autorisation d'exploiter d'une ressource à des fins de conditionnement en eau de source ou en eau rendue potable par traitements ; - l'arrêté du 4 mai 2007 qui porte sur les demandes d'autorisation d'importation d'une eau conditionnée ou de glace alimentaire étrangères. Source : direction générale de la santé (DGS) |
A. LES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
1. Des eaux issues de nappes souterraines, qui se caractérisent par leur teneur en minéraux et par leur pureté originelle
Les eaux minérales naturelles sont définies aux articles R.1322-1 à R.1322-4 du code de la santé publique.
Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou de plusieurs émergences naturelles ou forées constituant la source.
Une eau minérale naturelle doit témoigner, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de sa composition et de sa température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
- par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants ;
- par sa pureté originelle.
Ces deux caractéristiques doivent, par construction, avoir été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution. Elles doivent en outre avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique.
Quelles qu'elles soient, les eaux minérales naturelles, dont l'origine est souterraine, ont une composition liée à leur provenance et aux roches avec lesquelles elles ont été en contact. Elles contiennent dans des proportions variables huit minéraux, quatre cations majeurs - sodium, potassium, calcium, magnésium - et quatre anions majeurs - chlorures, sulfates, bicarbonates, carbonates -, qui en constituent le « faciès hydrochimique », c'est-à-dire la composition minérale. On y trouve également des éléments présents en plus petites quantités, dont des oligoéléments, qui donnent à ces eaux leur signature particulière. S'y ajoute enfin toute la flore microbienne, ou plus précisément bactérienne, qui caractérise la ressource dont elles proviennent.
Les eaux minérales naturelles doivent enfin témoigner d'une stabilité de leurs caractéristiques essentielles : celles-ci doivent être stables dans le temps (tel n'est pas nécessairement le cas des eaux de source).
La Commission européenne tient à jour la liste de toutes les sources d'eau minérale naturelle reconnues comme telles par les États membres et qui peuvent être commercialisées sur le marché de l'Union européenne après notification par les autorités françaises. En France, c'est la direction générale de la santé (DGS) qui tient à jour cette liste.
2. Des eaux qui ne peuvent subir que des traitements très limités
La notion de pureté originelle est au coeur de ce qui fait une eau minérale naturelle.
Elle justifie une dénomination spécifique revendiquée par les exploitants et le prix de vente de 100 à 400 fois plus élevé que celui de l'eau du robinet.
C'est la raison pour laquelle les traitements que les eaux minérales naturelles peuvent subir sont extrêmement limités. Ciblés, ils doivent répondre à un objectif particulier. Ils ont pour objet d'éliminer certains composants pour des raisons sanitaires ou esthétiques - la présence de fer ou de manganèse peut, par exemple, provoquer une coloration de l'eau.
Ces traitements sont définis à l'article 4 de la directive 2009/54/CE relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Ils sont transposés en droit français par l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées.
Celui-ci prévoit que l'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent ainsi faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :
- la séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels. La filtration, en particulier, est autorisée uniquement pour agir sur la suppression des particules en suspension et non sur les paramètres microbiologiques ;
- l'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
- l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;
- la séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
- la séparation de constituants indésirables, à savoir l'élimination de l'arsenic et du manganèse par adsorption sélective sur support de filtration recouverts d'oxyde métallique.
Cet article 5 précise très clairement que ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
3. Des eaux qui présentent des bienfaits pour la santé, variables selon leurs caractéristiques
La concentration en minéraux présents dans les eaux minérales naturelles plates ou gazeuses, représentée par le résidu sec, est très variable.
Quand une eau comme celle de Mont Roucous ne contient que quelques milligrammes de sels minéraux, une eau telle qu'Hépar en renferme plus de 2,5 grammes par litre. L'eau minérale gazeuse d'Hydroxydase est actuellement, en France, l'eau embouteillée la plus minéralisée, avec plus de 9 grammes par litre.
Chaque eau présente de ce fait des caractéristiques uniques liées à son terroir d'origine et certaines d'entre elles voient leurs effets favorables à la santé reconnus par l'Académie nationale de médecine.
Évian et Mont Roucous, faiblement minéralisée, sont recommandées pour les bébés. Contrex, dont la teneur en calcium et en magnésium est élevée, est conseillée pour ses vertus diurétiques et ses bénéfices pour la perte de poids. Badoit est reconnue pour ses teneurs en bicarbonate. La forte teneur en magnésium de l'eau Hépar est utilisée pour favoriser la digestion et le transit. La Salvetat est très faible en sodium tandis que Vittel est recommandée pour le traitement des troubles digestifs et urinaires.
Le corps humain a besoin des minéraux : l'alimentation ou les eaux embouteillées les lui apportent. Ceux des eaux sont pris en compte lorsque sont définies les références nutritionnelles pour la population française. Cependant, consommées très régulièrement, les eaux très minéralisées peuvent conduire à des surcharges de certains minéraux dans l'organisme et, le cas échéant, à des effets néfastes sur la santé. Il est donc important que des professionnels de santé accompagnent par des messages de prévention le choix des eaux minérales naturelles consommées au quotidien.
B. LES EAUX DE SOURCE NE SE VOIENT PAS IMPOSER D'OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMPOSITION MINÉRALE ET DE STABILITÉ
En vertu des articles R.1321-84 et suivants du code de la santé publique, une eau de source est également une eau d'origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.
Exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées, elle fait l'objet d'un conditionnement à la source.
Contrairement à une eau minérale naturelle, la composition minérale d'une eau de source peut varier au fil du temps en fonction des saisons et de l'environnement géologique.
Il n'y a donc pas d'obligation de stabilité physico-chimique, même si une eau de source doit respecter ou satisfaire des limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Sans effets particuliers reconnus sur la santé, elle se voit appliquer les mêmes exigences réglementaires relatives à l'eau potable que l'eau du robinet.
C. LES AUTRES TYPES D'EAUX DISPONIBLES À LA VENTE SUR LE MARCHÉ APPARTIENNENT À LA CATÉGORIE DES BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES SANS ALCOOL
Outre bien sûr l'eau du robinet, qui subit des traitements de potabilisation et de désinfection, il convient enfin de signaler que l'on trouve de plus en plus de nouveaux types d'eaux sur le marché telles que des eaux aromatisées qui peuvent, le cas échéant, être produites à partir d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source, mais ne sont plus considérées comme telles, des eaux qualifiées d'enrichies ou de supplémentées, voire des eaux purifiées reconstituées, à savoir des eaux chargées artificiellement en minéraux dans des quantités définies.
Certaines de ces boissons, en particulier les eaux aromatisées, peuvent renfermer des quantités importantes de sucres potentiellement néfastes pour la santé, notamment celle des jeunes enfants qui les consomment.
Ces eaux sont considérées comme des « boissons », notion qui recouvre tout aliment qui contient comme base principale de l'eau à laquelle est ajouté un ou des ingrédients pour un usage alimentaire (outre les eaux aromatisées, entrent dans cette catégorie les sodas et les boissons énergisantes par exemple).
Les eaux de Nestlé Waters produites depuis fin 2023 sous la marque « Maison Perrier », marque nouvelle déposée en 2021, dont il sera question infra, entrent dans cette catégorie des « boissons ».
On trouve enfin dans le commerce des eaux atypiques aux provenances très diverses : eau des nuages, eau de pluie, eau obtenue à partir d'icebergs, eaux dites « fossiles » de couleur noire du fait de la présence naturelle d'acides fulviques. L'Ôdeep est ainsi une particularité française : c'est une eau de mer pompée en Méditerranée à plus de 300 mètres de profondeur, déminéralisée puis reconstituée avec une partie de ses sels minéraux.
Ces eaux restent encore mal connues et difficiles à classer d'un point de vue réglementaire, ce qui conduit là aussi à les considérer comme des boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA).
Récapitulatif des eaux destinées à la consommation humaine
Source : rapport Igas
II. DES EAUX MINÉRALES NATURELLES PRÉSENTES PARTOUT SUR LE TERRITOIRE ET À L'HISTOIRE GRAVÉE DANS LA ROCHE
Chacune des sources d'où émergent les eaux minérales naturelles conditionnées dans notre pays possède une histoire et des origines géologiques propres qui lui confèrent des propriétés différentes.
A. UNE HISTOIRE GÉOLOGIQUE CHAQUE FOIS SINGULIÈRE QUI EXPLIQUE LES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES PROPRES À CHAQUE EAU MINÉRALE NATURELLE
Chacune des sources, dont sont issues les eaux minérales naturelles, possède sa propre histoire géologique, ce qui apparaît clairement au travers des trois exemples que sont les eaux de Volvic, de Perrier ou bien encore d'Évian.
Ainsi, s'agissant de l'eau de Volvic, sa composition est directement liée à l'origine géologique de son bassin, c'est-à-dire au volcanisme. L'ancienne vallée de Volvic, qui a été comblée par des éruptions volcaniques, constitue aujourd'hui le lieu d'infiltration et de circulation des eaux de pluie. La nappe de Volvic n'est pas stagnante : elle est dynamique et s'écoule de l'amont vers l'aval. L'eau minérale est puisée dans son sous-sol le plus profond (de 50 à 100 mètres de profondeur).
S'agissant de Perrier, son eau est alimentée par un hydrosystème autour de la région de Vergèze. Elle provient de différentes roches calcaires du sous-sol situées dans le massif des Garrigues. L'eau de pluie se minéralise progressivement au cours de son chemin à travers ces roches, donnant ainsi naissance à une eau minérale naturelle. Elle est puisée grâce à trois forages dans les calcaires de l'Hauterivien, formés il y a cent vingt millions d'années, et à deux forages dans les calcaires du Burdigalien, formés il y a vingt millions d'années.
En ce qui concerne l'eau d'Évian, l'impluvium se situe entre 600 et 1000 mètres d'altitude, au plateau du Gavot, et les gouttes d'eaux issues des neiges ou des pluies sont filtrées naturellement à travers des roches et des sables glaciaires pendant plus de 15 ans tout en étant protégées par le manteau morainique du Würm récent, avant d'émerger à la source Cachat.
B. UNE EXPLOITATION QUI COMMENCE LE PLUS SOUVENT DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE OU AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Comme rappelé supra, la commercialisation des eaux minérales naturelles et des eaux de source est souvent liée à l'essor, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des stations thermales, mais parfois même plus tôt encore comme dans le cas de l'eau d'Évian dont la réputation d'eau bénéfique pour la santé a été assurée par le marquis de Lessert dès 1789 et dont l'embouteillage a commencé dès 1826 sur le site de la source Cachat.
Il s'agit donc, pour les territoires concernés, d'une activité économique souvent ancienne (parfois plus de 150 ans) et profondément ancrée dans l'identité collective locale, avec un attachement très fort aux produits et aux marques concernés.
C'est notamment le cas dans les Vosges avec de premières stations thermales nées à Vittel dès 1855. L'embouteillage a permis de valoriser ces eaux bien au-delà du territoire local, dès 1875, avec une première ligne de production dans des bouteilles de grès. À Contrexéville, l'activité thermale débute en 1861 et les activités de mise en bouteille en 1908.
Autre exemple, celui de l'eau minérale Perrier sur le site de Vergèze dans le Gard, exploité depuis plus de cent soixante ans. Connue depuis l'Antiquité, la source des Bouillens a elle aussi d'abord servi au thermalisme, puis Napoléon III a autorisé, en 1863, l'exploitation de la source.
III. LES EAUX MINÉRALES NATURELLES REPRÉSENTENT UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR POUR LES TERRITOIRES CONCERNÉS
La France compte aujourd'hui 104 sites d'exploitation d'eau minérale naturelle et d'eau de source, répartis inégalement sur le territoire, au sein de 59 départements et 18 régions de métropole ou d'outre-mer, la région Auvergne-Rhône-Alpes étant celle qui compte le plus de sites de conditionnement.
Les sources d'eaux minérales naturelles en France
Source : maison des eaux minérales
Selon le recensement opéré par la direction générale de la santé, sont ainsi aujourd'hui exploitées en France 186 eaux : 99 eaux minérales naturelles, 83 eaux de source et 4 eaux rendues potables par traitements. De fait, plusieurs eaux de qualité différente peuvent être embouteillées sur le même site.
Le marché, en croissance depuis 20 ans, représente un total de 2,7 milliards d'euros en termes de chiffres d'affaires cumulé.
Les deux grands circuits de distribution sont la grande distribution alimentaire et la restauration hors foyer.
Si les industriels réalisent la majeure partie de leurs ventes en France, ils génèrent environ 30 % de leur activité sur les marchés extérieurs, dont plusieurs sont aujourd'hui en forte croissance grâce à une demande dynamique.
A. UN SECTEUR DOMINÉ PAR TROIS GRANDS GROUPES, MAIS QUI COMPREND ÉGALEMENT DE NOMBREUX PRODUCTEURS INDÉPENDANTS
Le secteur des eaux minérales naturelles et des eaux de source est dominé en France par trois groupes qui se partagent 80 % du marché, dont deux multinationales du secteur de l'agroalimentaire, les groupes Danone et Nestlé, mais compte également de nombreux autres minéraliers de taille plus modeste.
Le groupe Sources Alma, premier producteur français, dispose de 36 sites répartis sur 23 départements et 11 régions et commercialise notamment l'eau Cristaline.
Le groupe Danone, numéro deux mondial du secteur, possède quatre eaux minérales naturelles en France : Évian, captée en Haute-Savoie ; Badoit, prélevée dans la Loire ; Volvic, captée dans les volcans d'Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme ; enfin, La Salvetat, située dans l'Hérault, dans la région Occitanie. Les deux premières ont été acquises par Danone en 1970, tandis que Volvic et La Salvetat l'ont été respectivement en 1992 et 1990.
Le groupe Nestlé est, quant à lui, présent depuis 1992 dans les Vosges, avec les sites de production des eaux minérales naturelles de Vittel, Hépar et Contrex, ainsi que dans le Gard avec le site de production de Perrier à Vergèze.
Le secteur compte également quelques entreprises de taille intermédiaire tel que le groupe Ogeu qui exploite six sites de production en France, avec des sources telles que Quézac en Loire-Atlantique, Plancoët en Bretagne et Ogeu dans les Pyrénées.
Les marques de distributeur, telles que celle d'E. Leclerc, tentent également de se faire une place sur le marché.
Le secteur compte enfin des sociétés disposant d'un unique site d'exploitation, tel que celui de la Société des eaux de Mont Roucous captées sur le territoire de Lacaune dans le Tarn.
B. UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ESSENTIELLE POUR DES RÉGIONS RURALES
Selon le Syndicat des eaux minérales naturelles et des eaux de source, la filière représente 11 000 emplois directs, dont 8 000 dans la filière des eaux minérales naturelles et 3 000 dans la filière des eaux de source, et 30 000 emplois indirects.
En termes d'activité et d'emploi, les sites de production d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source ont souvent une empreinte économique très forte dans leur territoire de rattachement, puisqu'ils sont l'un des principaux employeurs locaux et une source de richesse majeure pour les habitants comme pour les collectivités territoriales.
Sans prétendre à l'exhaustivité, les exemples présentés ci-dessous attestent du caractère essentiel de l'activité d'embouteillage d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source dans ces régions souvent rurales.
Pour ce qui concerne le groupe Alma, celui-ci emploie au total 1 800 personnes, dont 80 % habitent aux alentours des sources, elles-mêmes situées à proximité de villes de moins de 5 000 habitants, cette répartition étant notamment due au fait que l'eau doit être embouteillée sur le lieu de pompage.
Autre exemple, le site des eaux d'Évian10(*), appartenant au Groupe Danone, constitue le premier employeur privé de l'arrondissement de Thonon-les-Bains, avec plus de 1 000 salariés à l'usine d'embouteillage de Publier et 200 salariés au siège de la filiale « eaux » du groupe, situé à Évian-les-Bains.
Nestlé Waters dans les Vosges se compose, pour sa part, de deux unités distinctes situées sur les communes de Contrexéville et de Vittel. Y sont embouteillées les eaux minérales naturelles de Vittel, Contrex et Hépar, à partir de treize forages. Quelque 576 salariés et 27 alternants et stagiaires travaillent sur ces sites, ce qui en fait le deuxième employeur privé du département11(*).
Dans le département du Puy-de-Dôme, sont présentes six usines d'embouteillage d'eau minérale naturelle et deux d'embouteillage d'eau de source, parmi lesquels le site de Volvic (propriété de Danone, numéro deux mondial du secteur) qui comprend une usine de conditionnement d'eau minérale naturelle et une usine de production d'eau aromatisée, compte 830 salariés et dégage un chiffre d'affaires annuel de 259 millions d'euros.
Le département compte également des sites du groupe Alma, avec deux usines d'embouteillage d'eau minérale naturelle, Rozana et Châteldon et une usine d'embouteillage d'eau de source avec SMDA Mont-Dore, qui compte pour sa part au total environ 100 salariés.
Avec plus de 1 000 salariés sur soixante-dix hectares, le site de Perrier12(*) est quant à lui un acteur économique majeur du Gard, ce que la commission a pu constater elle-même lors de son déplacement.
D'autres entreprises peuvent disposer d'effectifs beaucoup plus limités, par exemple Mont Roucous avec 67 salariés ou bien encore Hydroxydase qui ne compte pour sa part que 5 salariés.
C. POUR LES COMMUNES SUR LESQUELLES EST SITUÉE UNE SOURCE D'EAU MINÉRALE NATURELLE, L'ENJEU FINANCIER MAJEUR DE LA CONTRIBUTION SUR CES EAUX
À l'instar des autres boissons non alcooliques, les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement se voient appliquer une contribution obligatoire de 0,54 euros par hectolitre en application de l'article 1613 quater du code général des impôts. Le produit de cette contribution est affecté au financement de la branche « assurance vieillesse et veuvage » du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles. Les livraisons de produits imposables par le redevable expédiés ou transportés à l'étranger sont exonérées.
Par ailleurs, l'article 1582 du code général des impôts prévoit que les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales naturelles peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux, souvent appelée « droit de col », instaurée à l'origine en 1920 au profit des villes thermales.
Cette contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux qu'il réalise, quel que soit leur conditionnement, y compris lorsqu'il a préalablement incorporé ces dernières à d'autres produits (par exemple, pour produire une boisson aromatisée à base d'eau minérale naturelle). La circonstance qu'une eau perde le bénéfice de la qualification d'« eau minérale naturelle » au cours du circuit économique, par exemple lorsqu'elle est mélangée à d'autres produits, est donc sans incidence sur l'application de la contribution. Elle est assise sur le volume des eaux et la commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 euro par hectolitre13(*).
Sont exonérées les livraisons à l'exportation, c'est-à-dire les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'exploitant de la source, ou pour son compte, à l'extérieur du territoire fiscal national.
Le produit de la contribution est collecté par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et reversé aux communes sur le territoire desquelles est située une source d'eau minérale naturelle et qui ont fait le choix de l'instaurer, ce qui, d'après les informations de la commission, paraît être le cas de la quasi-totalité des communes concernées.
Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
La somme des contributions perçues par l'ensemble des communes concernées représente au total une vingtaine de millions d'euros et peut représenter un enjeu budgétaire majeur à l'échelle de certaines d'entre elles.
Produit de la taxe sur les eaux minérales
en millions d'euros
|
201914(*) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
21,8 |
21,7 |
22,2 |
20,0 |
18,4 |
Source : rapports OFGL de 2021 à 2024
Le tableau ci-dessous, transmis par la DGFiP, montre que les montants sont particulièrement significatifs pour les dix communes qui concentrent à elles seules, suivant les années, entre 75 % et 80 % du produit de cette taxe sur les eaux minérales naturelles.
On note ainsi que la commune de Volvic est de loin le premier bénéficiaire avec un montant de 3,8 millions d'euros qui se maintient d'année en année. Vittel a perçu un niveau élevé de 2,3 millions d'euros en 2024, mais la baisse est forte comparée aux 3,8 millions d'euros de 2022. Évian-les-Bains est relativement stable avec un montant compris entre 2,0 et 2,3 millions d'euros suivant les années.
On remarque également que certaines communes ont vu leurs recettes fortement chuter ces dernières années. Outre Vittel déjà cité, c'est le cas de Vergèze qui a vu le produit perçu passer de 1,6 million d'euros en 2021 à 460 000 euros en 2024 ou, dans une moindre mesure, de Contrexéville qui a vu le produit perçu passer de 1,5 million d'euros en 2021 à 900 000 euros en 2024.
|
Année |
ordre de classement |
Communes |
Département |
Produit en € |
|
2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
VOLVIC VITTEL EVIAN-LES-BAINS SALVETAT-SUR-AGOUT LA SAINT-GALMIER LACAUNE CONTREXEVILLE UCHAUD PUBLIER VERGEZE |
063 088 074 034 042 081 088 030 074 030 |
3 780 241 2 287 665 2 047 579 1 006 522 992 468 904 480 902 547 854 346 629 238 460 247 |
|
2023 |
1 |
VOLVIC |
063 |
3 750 992 |
|
2 |
VITTEL |
088 |
2 692 915 |
|
|
3 |
EVIAN-LES-BAINS |
074 |
2 089 249 |
|
|
4 |
SAINT-GALMIER |
042 |
1 228 061 |
|
|
5 |
SALVETAT-SUR-AGOUT LA |
034 |
1 127 148 |
|
|
6 |
CONTREXEVILLE |
088 |
1 089 609 |
|
|
7 |
VERGEZE |
030 |
997 350 |
|
|
8 |
LACAUNE |
081 |
775 383 |
|
|
9 |
PUBLIER |
074 |
642 045 |
|
|
10 |
UCHAUD |
030 |
481 920 |
|
|
2022 |
1 |
VITTEL |
088 |
3 848 039 |
|
2 |
VOLVIC |
063 |
3 846 254 |
|
|
3 |
EVIAN-LES-BAINS |
074 |
2 276 455 |
|
|
4 |
CONTREXEVILLE |
088 |
1 490 103 |
|
|
5 |
VERGEZE |
030 |
1 317 888 |
|
|
6 |
SAINT-GALMIER |
042 |
1 192 459 |
|
|
7 |
SALVETAT-SUR-AGOUT (LA ) |
034 |
1 078 336 |
|
|
8 |
LACAUNE |
081 |
806 812 |
|
|
9 |
UCHAUD |
030 |
742 351 |
|
|
10 |
PUBLIER |
074 |
699 574 |
|
|
2021 |
1 |
VOLVIC |
063 |
3 863 107 |
|
2 |
VITTEL |
088 |
3 759 672 |
|
|
3 |
EVIAN-LES-BAINS |
074 |
2 328 313 |
|
|
4 |
VERGEZE |
030 |
1 587 318 |
|
|
5 |
CONTREXEVILLE |
088 |
1 519 144 |
|
|
6 |
SAINT-GALMIER |
042 |
1 169 375 |
|
|
7 |
SALVETAT-SUR-AGOUT (LA ) |
034 |
1 047 932 |
|
|
8 |
LACAUNE |
081 |
754 329 |
|
|
9 |
PUBLIER |
074 |
715 508 |
|
|
10 |
UCHAUD |
030 |
588 045 |
Source : DGFiP
Ces montants étant très importants et le produit de la taxe étant essentiel à la santé financière des communes concernées, le maintien de l'activité d'embouteillage sur leur territoire constitue un enjeu essentiel. Nous verrons infra que ce régime fiscal crée des distorsions qu'il convient de supprimer.
IV. L'ENJEU CRUCIAL DE LA PURETÉ ORIGINELLE DE L'EAU
La pureté originelle de l'eau signifie qu'à l'émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d'une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination.
L'eau doit donc impérativement avoir été conservée intacte en raison de son origine souterraine qui l'a tenue à l'abri de tout risque de pollution. Cette pureté originelle est qualifiée à partir de la surveillance des indicateurs microbiologiques.
Selon la direction générale de la santé15(*), ces critères de pureté originelle permettent de recenser et de tenir à jour un inventaire des masses d'eau dont les eaux brutes sont encore dans un excellent état, c'est-à-dire non exposées à un risque de pollutions microbiologique et physico-chimique attribuables aux activités anthropiques ou l'aménagement du territoire.
Il est donc essentiel que cette notion de pureté originelle des eaux minérales naturelles, donc sans traitement, ne soit pas remise en cause pour favoriser la protection environnementale des ressources malgré une raréfaction dans un contexte de potentielle surexploitation et de réchauffement climatique qui conduit certaines régions a d'ores et déjà connaître des périodes de sécheresse inconnues jusqu'alors.
Ainsi, la surveillance et le contrôle de la production des eaux minérales naturelles doivent être extrêmement rigoureux pour garantir leur sécurité sanitaire et l'absence de toute fraude aux consommateurs qui sont prêts à payer cent à quatre cents fois plus cher pour se procurer ces eaux originellement pures et aux propriétés bénéfiques à la santé.
Pour assurer la protection de la pureté originelle de l'eau, qui ouvre droit à l'appellation « eau minérale naturelle », l'État a mis en place un dispositif de protection et de contrôle en théorie exigeant. Cependant, sa complexité et sa fragmentation entre plusieurs administrations le rendent d'une mise en oeuvre malaisée (cf. ANNEXE 1 : un dispositif de protection et de contrôle complexe). Pour le voir et le comprendre il nous faut désormais basculer dans ce qu'il convient d'appeler le scandale des eaux minérales naturelles.
PARTIE I
LE SCANDALE DES
EAUX MINÉRALES :
CONTRÔLES MIS EN ÉCHEC, LOBBYING
DÉCOMPLEXÉ, LES PRATIQUES INTERDITES DE CERTAINS
INDUSTRIELS
ET LEUR DISSIMULATION PAR L'ÉTAT ONT MIS À
MAL
LA CONFIANCE DANS LE SECTEUR
La commission et son rapporteur ont mené l'enquête pour comprendre ce qui avait permis l'existence de ce scandale des eaux minérales. C'est d'abord fortuitement que les premières pratiques illégales sont découvertes (I). Mais en analysant les origines de l'affaire, force est de constater que la mise au jour de ces pratiques a révélé une impressionnante série de dysfonctionnements, pour certains structurels, et qui conduisent à s'interroger sur les capacités d'actions de l'État (II).
I. UNE DÉCOUVERTE FORTUITE DE PRATIQUES ILLÉGALES
Chronologie des débuts de l'affaire
27 Janvier 2020 : Ouverture d'une enquête du service national d'enquête (SNE) de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'un signalement effectué par un salarié du groupe Alma portant sur le recours à des traitements non autorisés de l'eau minérale naturelle sur deux sites d'embouteillage du groupe.
Décembre 2020 : Perquisition par le SNE qui met en évidence les traitements dénoncés (adjonction de gaz carbonique à une eau naturellement gazeuse, injection illicite de sulfate de fer dans l'objectif de faire baisser le taux d'arsenic naturel présent dans les sources), et conduit le SNE à investiguer le recours à des mélanges d'eaux non autorisés, à des filtres à charbon actif et aux UV interdits ainsi qu'au traitement de l'eau par air enrichi en ozone.
Été 2021 : Dans le cadre de son enquête, le SNE interroge les fabricants de filtres qui lui transmettent la liste de leurs clients ainsi que les preuves d'achats de filtres.
31 août 2021 : Muriel Liénau, directrice de Nestlé Waters, est reçue à sa demande par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, afin de révéler aux pouvoirs publics le recours à des traitements de filtration au charbon actif et aux lampes à ultraviolets (UV) sur les sites d'eau minérale naturelle de Nestlé en France, dans le Gard (Perrier) et dans les Vosges (Vittel, Contrex, Hépar). Elle sollicite également la validation des plans de transformation visant à remplacer ces traitements par une microfiltration à 0,2 micron, qui ne figure toutefois pas sur la liste des traitements explicitement autorisés par la commission européenne.
19 novembre 2021 : Saisine conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) par les ministres de l'économie et de la santé ainsi que par la ministre déléguée chargée de l'industrie, afin d'inspecter les usines de conditionnement d'eaux minérales naturelles et de source pour y déceler les pratiques contraires à la règlementation, et d'expertiser la justification de ces traitements et l'impact de leur arrêt sur la qualité des eaux conditionnées. Le rapport, attendu sous trois mois, sera finalement livré en juillet 2022 et gardé secret.
Février 2024 : À la suite des révélations de presse de la fin janvier, publication du rapport de l'Igas sur les eaux minérales naturelles et eaux de source.
A. LA RÉVÉLATION DES TRAITEMENTS PAR UN SALARIÉ CHEZ UN PREMIER INDUSTRIEL ET L'ENQUÊTE DU SNE
À la fin de l'année 2019, un salarié du groupe Alma16(*) a signalé auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Allier le recours à des traitements non autorisés sur au moins un des sites de production du groupe.
Ce signalement a ensuite été transmis au service national des enquêtes (SNE) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a ouvert une enquête le 27 janvier 2020. Les agents du SNE disposent de pouvoirs d'officiers de police judiciaire qui leur permettent de dresser procès-verbal d'infractions et de mener des enquêtes préliminaires sous le contrôle du procureur de la République. Si la DGCCRF n'est pas chargée de la sécurité sanitaire des eaux embouteillées, elle est toutefois responsable de la loyauté des produits, ce qui suppose qu'elle s'assure de la conformité des caractéristiques des eaux embouteillées aux mentions qui figurent sur leur étiquetage, afin que le consommateur ne soit pas trompé.
B. LA PREMIÈRE CONSÉQUENCE : LE LANCEMENT D'UNE ENQUÊTE DE LA DGCCRF ET LA MISE À JOUR DE DISPOSITIFS DISSIMULÉS
Le 10 décembre 2020, après presque un an d'enquête, le SNE a procédé, sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention, à une perquisition sur deux sites d'embouteillage du groupe Alma. Cette perquisition a mis au jour l'utilisation, sur le site de Saint-Yorre, de sulfate de fer afin de faire baisser le taux d'arsenic (traitement autorisé pour les eaux rendues potables par traitement, mais non pour les eaux minérales naturelles), et de filtres à charbon actif ayant notamment pour objectif de retenir des traces de résidus de pesticides, ainsi que, sur le site de Châteldon, le stockage de sphères de gaz carbonique pour carbonatation de l'eau embouteillée de la marque Châteldon.
À la suite de cette intervention, l'usine de Saint-Yorre a arrêté sa production et réalisé une mise à l'égout de ses stocks.
Les pratiques constatées lors de l'opération de visite et de saisine par les agents de la DGCCRF consistaient en :
- l'injection illicite de sulfate de fer dans l'objectif de faire baisser le taux d'arsenic naturel présent dans les sources, ce qui est interdit pour les eaux minérales naturelles ;
- l'adjonction masquée de CO2, interdit pour les eaux disposant de la dénomination « eau minérale naturellement gazeuse » ;
- la modification des résultats d'analyse non-conformes des eaux.
Une note confidentielle de la DGCCRF datée du 15 décembre 2020 souligne que l'injection illicite de sulfate de fer est pratiquée depuis les années 1980.
L'annexe 1 du rapport de l'Igas a, quant à elle, mentionné l'utilisation de filtres à charbon sur le site de Saint-Yorre.
Des investigations ont ensuite été menées auprès de six autres usines du groupe Alma et de 14 fournisseurs, et elles ont mis en lumière un recours important, chez plusieurs industriels, à des traitements de microfiltration inférieurs à 0,8 micron, qui est le seuil de filtration minimal considéré depuis 200117(*) par l'ex-agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) comme n'ayant pas d'impact avéré sur la composition de l'eau et dès lors toléré par les autorités sanitaires.
L'enquête du SNE s'est ensuite intéressée aux fournisseurs de filtres, qui lui ont transmis les listes de leurs clients et les preuves d'achat de filtres ayant un seuil de coupure inférieur à 0,8 micron.
C. LA DEUXIÈME CONSÉQUENCE : L'AVEU DE NESTLÉ WATERS AUPRÈS DU CABINET DE LA MINISTRE DE L'INDUSTRIE
Le 31 août 2021, Nestlé Waters, représenté par sa présidente Muriel Liénau, a rencontré à sa demande le cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, en présence d'un représentant de la DGCCRF. Cette réunion a été organisée par les responsables des affaires publiques de Nestlé France18(*).
Selon les déclarations concordantes de François Rosenfeld, alors directeur de cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, et de Muriel Liénau, Nestlé Waters aurait fait état de l'utilisation de filtres à charbon et de traitements ultraviolets dans ses usines d'eaux minérales naturelles des Vosges et du Gard, traitements qui peuvent s'apparenter à des mesures de désinfection. Muriel Liénau a déclaré devant la commission d'enquête avoir pris connaissance de l'existence de ces traitements fin 2020 lors de sa prise de fonction en qualité de présidente de Nestlé Waters. Ils seraient, selon ses dires, « hérités du passé », sans qu'elle accepte de répondre aux questions relatives à leurs dates d'installation. Les autres responsables de Nestlé ont, eux aussi, refusé de répondre aux questions du rapporteur et des membres de la commission d'enquête sur ce point.
Virginie Cayré, directrice générale de l'ARS Grand Est de 2020 à juin 2024, a déclaré à la commission d'enquête que l'installation des filtres sur charbon actif daterait de 1993, et que les lampes à ultra-violet auraient été remplacées en 2000. Ces informations lui auraient été fournies par Nestlé Waters en réponse au questionnaire de l'Igas, et réitérées lors de la visite d'inspection diligentée par l'ARS le 6 avril 2022.
Lors de la réunion du 31 août 2021, Nestlé Waters a reconnu la non-conformité de tels traitements au cadre européen19(*). Ses représentants ont toutefois déclaré, sans apporter le moindre commencement de preuve, que ces filtres n'avaient ni mis en cause la sûreté alimentaire, ni modifié le microbisme de l'eau, de sorte que la composition de cette dernière aurait été toujours conforme aux critères de minéralité figurant sur l'étiquetage. Le compte rendu à la ministre de l'industrie établi le lendemain, le 1er septembre, par son directeur de cabinet, François Rosenfeld, précise cependant que, « selon (Nestlé), (son plan de transformation) suppose de la part de l'État (...) une interprétation plus large de la directive, car ils auront toujours besoin de méthodes de microfiltration dont la validité n'est pas établie ».
Il apparaît donc que, dès ce moment-là, Nestlé Waters bien sûr, mais aussi un cabinet ministériel et sa ministre savaient que l'eau embouteillée sur deux sites parmi les plus importants en France présentait un problème.
La réunion du 31 août 2021 est aussi la première apparition du sujet de la microfiltration. Du compte rendu de François Rosenfeld il ressort clairement que Nestlé Waters savait que sa validité n'était « pas établie » et que l'objet de la sollicitation de l'industriel était d'obtenir « une interprétation plus large de la directive ».
Enfin, Muriel Liénau aurait, lors de cet entretien, sollicité auprès de ses interlocuteurs l'autorisation de contacter les autorités locales que sont l'ARS, chargée du contrôle sanitaire, et la préfecture, qui délivre des arrêtés d'autorisation d'exploitation. François Rosenfeld, de son côté, indique qu'elle a demandé un appui pour coordonner la réponse à apporter aux autorités locales de contrôles, en mettant en avant un manque de cohérence dans l'interprétation des normes par les arrêtés préfectoraux, notamment au regard de la microfiltration à 0,2 micron. En d'autres termes, Nestlé Waters tente d'agir sur les deux extrémités des administrations publiques : au sommet, pour obtenir un blanc-seing sur sa microfiltration au niveau national et européen, et à l'échelon local pour que les arrêtés préfectoraux valident l'exploitation des nappes avec cette microfiltration.
D. LA TROISIÈME CONSÉQUENCE : LE LANCEMENT D'UNE INSPECTION DE L'IGAS
Paradoxalement, l'entretien du 31 août n'associe pas le ministère de la santé, pourtant responsable du cadre juridique des eaux conditionnées. À la suite de cet entretien, le cabinet de la ministre chargée de l'industrie, en la personne de Lucile Poivert, conseillère santé et biens de consommation, informe par courriel le cabinet du ministre de la santé des révélations effectuées par Nestlé Waters, mais près d'un mois plus tard, soit le 24 septembre 2021 - et à la suite d'une relance de l'industriel.
Le cabinet santé a transmis l'information à la direction générale de la santé, dont les équipes se sont entretenues dès le 27 septembre 2021 avec la DGCCRF afin de prendre connaissance de l'enquête du SNE et de l'étendue des manquements constatés. Jérôme Salomon, alors directeur général de la santé, a saisi le 13 octobre 2021 sa direction des affaires juridiques afin d'apprécier l'opportunité d'un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, et contacté en parallèle la directrice générale de la CCRF, Virginie Beaumeunier, pour apporter une réponse commune aux révélations de Nestlé.
La question de l'évaluation du risque sanitaire est posée, mais elle est - trop rapidement - écartée dans un premier temps, au motif que la présence des filtres à charbon et lampes à UV s'apparente à de la désinfection et écarte tout risque microbiologique.
Une réunion interservices et intercabinets, réunissant les cabinets de de l'industrie, de la santé, la DGCCRF, le SNE et la DGS s'est ensuite tenue le 14 octobre 2021. Le SNE y a retracé ses constats et a relevé que plusieurs industriels embouteilleurs semblaient recourir à des traitements non autorisés. Il a été décidé une saisine conjointe, par les ministères de l'économie, de l'industrie et de la santé, de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), afin qu'elle recense les pratiques de traitement non autorisées dans les usines d'eau minérale naturelle et de source, qu'elle en expertise la justification et leur impact sanitaire, qu'elle évalue le risque lié à leur arrêt soudain et qu'elle dresse un état des lieux de la ressource en eau. Si la lettre de mission, datée du 19 novembre 2021, précise que cette mission sera conduite avec l'appui des ARS concernées et le concours du SNE et de la DGCCRF, la commission d'enquête constate que ce choix d'une mission de l'Igas, à ce stade exclusive de toute saisine de l'autorité judiciaire ou décision administrative de déclassement des eaux ou de suspension des forages incriminés, a retardé la réponse publique aux révélations de Nestlé.
Comme l'a relevé Thomas Breton, sous-directeur du contentieux à la direction des affaires juridiques des ministères sociaux, dans un courriel du 13 octobre 2021 adressé à Jérôme Salomon, il aurait également été envisageable d'informer directement les ARS Grand Est et Occitanie, respectivement compétentes sur les sites des Vosges et du Gard détenus par Nestlé, des traitements révélés par l'industriel, afin que soient diligentées des enquêtes administratives. Les agents des ARS peuvent en effet prendre des mesures administratives20(*), allant de la mise en demeure de l'industriel responsable de la production et de la distribution de l'eau au public de régulariser sa situation au regard des dispositions du même code, à la suspension de la production ou de la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.
Les ARS n'ont toutefois été informées de l'existence de la mission de l'Igas que le 28 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, la mission a ensuite sollicité les ARS Auvergne Rhône Alpes, Occitanie et Grand Est pour constituer un groupe « contact » destiné à « ancrer la mission sur le terrain ». C'est seulement à cette date que ces ARS ont été informées de l'existence de l'enquête du SNE, qui portait sur des sites d'Alma relevant de la compétence de l'ARS Auvergne Rhône Alpes, et des révélations effectuées par Nestlé Waters.
II. UNE RÉACTION DE L'ÉTAT TARDIVE, INADAPTÉE ET NON TRANSPARENTE, QUI PÈCHE PAR UNE SÉRIE DE DYSFONCTIONNEMENTS
C'est une série de dix dysfonctionnements qu'identifie la commission d'enquête et qu'elle souhaite dénoncer, car ils témoignent de difficultés structurelles dans l'action de l'État.
A. UN PREMIER DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE OU LE RETARD DE SIGNALEMENT DES DÉLITS PRÉSUMÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
L'article 40 du code de procédure pénale
L'article 40 du code de procédure pénale, précité, comporte deux alinéas. Le premier énonce les attributions du procureur de la République, qui « reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner », à savoir l'opportunité ou non de poursuivre les faits devant un tribunal, opportunité dont il détient le monopole.
Le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale en définit le champ d'application, en précisant que l'obligation de dénonciation au procureur des crimes et délits incombe à l'ensemble des agents publics que sont « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire » dans l'exercice de leurs fonctions. Le texte précise qu'il est tenu « d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de [lui] transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Cet article, issu originellement du code pénal de Brumaire an IV, a ensuite traversé les codes d'instruction criminelle et figure dans le code de procédure pénale depuis la loi du 31 décembre 1987. Son objectif premier est de prévenir toute tentative de dissimulation d'infractions. Il impose ainsi aux fonctionnaires et, plus généralement, selon la jurisprudence, aux agents publics21(*), de signaler immédiatement (« sans délai ») au procureur de la République toute information sur une infraction dont ils auraient connaissance dans le cadre de leurs fonctions. La célérité imposée permet, d'une part, d'assurer la cessation rapide de l'infraction éventuelle, et donc d'un potentiel trouble à l'ordre public et, d'autre part, de préserver la charge de la preuve matérialisée par les renseignements et actes objets du signalement, ou recueillie par les procès-verbaux.
L'article 40 s'applique à toutes les infractions pénales et ne fait pas de distinction entre les crimes et les délits.
Si le fait d'être en possession de telles informations et de s'abstenir d'effectuer un signalement n'est pas susceptible de sanctions pénales, en revanche, la non-dénonciation d'un crime constitue un délit réprimé à l'article 431-1 du code pénal.
La lettre de l'article 40 est donc très large et s'impose également à tous les agents publics. Si le principe hiérarchique dans la fonction publique est élevé au rang de principe général du droit, la Cour de cassation comme le Conseil d'État ont rappelé que ce signalement n'imposait aucun formalisme préalable. Pour le Conseil d'État, la circonstance de transmettre un tel signalement sans en avertir sa hiérarchie n'est pas constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire22(*). La Cour de cassation a elle rappelé qu'un agent dénonçant des faits délictueux au procureur n'avait pas besoin d'une quelconque autorisation, et ne faisait qu'observer les prescriptions de l'article 4023(*).
L'aveu fait par Nestlé Waters à la ministre de l'industrie le 31 août 2021 du recours à des traitements illégaux24(*), est susceptible de recouvrir la qualification pénale de tromperie dans la mesure où les produits concernés ne sont pas conformes aux mentions qui figurent sur l'étiquetage.
Ces éléments étaient nécessairement connus des membres des cabinets et des fonctionnaires des ministères de l'industrie, de l'économie, de la santé et de la DGCCRF qui ont eu connaissance de ces révélations. Pourtant, une seule personne semble s'être réellement posé la question d'effectuer un tel signalement : le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Le 13 octobre 2021, il saisit sa direction des affaires juridiques en écrivant que « la DGS envisage[ait] un signalement au procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale ». Malheureusement, le directeur des affaires juridiques, Charles Touboul Moracchini, lui répond le jour même que les infractions susceptibles d'être retenues relèveraient du domaine de la tromperie du consommateur, et plus généralement du droit de la consommation, donc de la compétence de Bercy et de la DGCCRF. Il en déduit que l'opportunité de ce signalement par la DGS n'était pas « évident[e] ».
Pour expliquer son raisonnement, Charles Touboul a d'abord fait valoir que le point d'entrée de Nestlé Waters était le cabinet du ministère de l'industrie, aux côtés de la DGCCRF, et que la saisine de la DGS n'est advenue qu'au « cinquième ou sixième » maillon de la chaîne, via le cabinet de la santé. Il en déduit qu'il revenait au ministère de l'industrie et à la DGCCRF, directement saisis et dont le champ de compétence relève du droit de la consommation, d'effectuer ce signalement, tout en reconnaissant qu'il ne s'était pas assuré que ledit signalement avait bien été effectué.
Le rapporteur de la commission d'enquête déplore une telle analyse, dont il craint qu'elle ne soit largement partagée dans l'administration, et dont Charles Touboul lui-même relève qu'elle est contraire au texte même de l'article 40, de portée générale. S'il est loisible de concevoir que certains fonctionnaires puissent bénéficier de connaissances plus approfondies que d'autres sur la teneur de manquements observés, il ne peut être envisagé de leur laisser la priorité dans la mise en oeuvre d'un tel signalement à la justice qu'après s'être effectivement assuré qu'un tel signalement a été effectué.
La pratique qui consiste à prévoir arbitrairement une priorité de certains acteurs sur d'autres dans le déclenchement d'un signalement au titre de l'article 40 peut également donner lieu à des interprétations contradictoires. Et, en l'espèce, c'est bien ce qui s'est passé, chaque administration estimant qu'un article 40 relevait de l'autre.
Le rapporteur n'ignore pas qu'une « doctrine administrative » conduit à ce que les directions d'administration centrale et leurs unités locales estiment ne pas avoir à faire de signalement dès lors qu'un fait ne relève pas de leurs attributions. À cela se conjugue la posture inverse pour les administrations qui disposent de compétences judiciaires, comme c'est le cas pour la DGCCRF. Sarah Lacoche, directrice générale, déclare ainsi nettement à la commission d'enquête que « nous transmettons au titre de l'article 40 des infractions lorsqu'elles ne relèvent pas de notre champ de compétences. »
Le résultat global de ces positionnements est, dans le cas des eaux minérales, que le signalement de l'article 40 n'a été effectué que tardivement et dans un seul ressort, celui d'Épinal, négligeant ainsi le cas du Gard.
S'agissant des sites Nestlé des Vosges, un signalement n'a été transmis par la directrice générale de l'ARS Grand Est au procureur de la République d'Épinal qu'en octobre 2022, soit plus d'un an après les aveux de l'industriel au cabinet de la ministre de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. S'agissant du site Nestlé du Gard, ce signalement par la DGCCRF n'est intervenu que le 19 février 2025, soit près de quatre ans plus tard !
Le rapporteur estime utile que la Chancellerie rappelle le caractère très large de l'article 40 qui vise à éviter qu'il ne soit neutralisé par des pressions hiérarchiques ou des logiques de fonctionnement en silo. A minima, le bon usage de l'article devrait être rappelé aux directions compétentes en matière de contrôle sanitaire des eaux. Il pourrait également être opportun de prévoir que l'autorité administrative qui diligente un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale soit systématiquement informée par le procureur de la République compétent de l'existence ou de l'absence de poursuites pénales.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
2 |
Rappeler le caractère général de l'article 40 du code de procédure pénale et prévoir l'information systématique, par le procureur de la République territorialement compétent, de l'existence ou de l'absence de poursuites pénales |
Ministère de la justice Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
Immédiat |
Instruction |
B. UN DEUXIÈME DYSFONCTIONNEMENT : LA MINIMISATION DU RISQUE SANITAIRE À L'ÉCHELON NATIONAL
Lors de la réunion du 31 août 2021, les représentants de Nestlé Waters affirment au cabinet de la ministre chargée de l'industrie que les traitements pratiqués, certes interdits, n'ont jamais remis en cause la sécurité sanitaire des produits commercialisés. Le compte-rendu de François Rosenfeld, directeur de cabinet de la ministre de l'industrie et présent au rendez-vous, reprend cette affirmation sans la discuter. La ministre elle-même, Agnès Pannier-Runacher, répond au compte-rendu de la réunion établi par François Rosenfeld en écrivant, entre autres : « Si je comprends bien on est plutôt sur de la tromperie commerciale que sur un sujet de sécurité alimentaire ? »
Certes, les traitements interdits ne sont pas facteurs de risque sanitaire en eux-mêmes. Cependant, leur utilisation dissimule une dégradation de la qualité de l'eau qui, elle, peut être source d'un risque sanitaire non maîtrisé : le rapporteur rappelle que les eaux rendues potables par traitement (autrement dit l'eau du robinet) font non seulement l'objet de traitements au charbon actif et aux UV, mais aussi de traitements au chlore afin d'éliminer tout risque virologique !
Une fiche « ministre » en date du 14 septembre 2021 signée de Virginie Beaumeunier, alors directrice générale de la CCRF25(*), mentionne bien l'hypothèse selon laquelle ces traitements découlent d'une dégradation de la qualité de l'eau, sans toutefois aborder la question d'un risque sanitaire.
Le rapporteur s'étonne que l'affirmation de l'industriel quant à l'absence de risque sanitaire lié à l'utilisation et au retrait des traitements interdits soit reprise telle quelle par les autorités politiques et administratives, sans précaution ni vérification.
La prise de contact de Lucile Poivert, conseillère de la ministre de l'industrie, avec le ministère de la santé fin septembre 2021 concernant les pratiques de Nestlé Waters reprend en effet ces éléments. Joëlle Carmes, alors sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation à la DGS, en fait alors état par courriel à Jérôme Salomon, directeur général de la santé, le 27 septembre 2021 et indique qu'« il ne me semble pas y avoir de préoccupation d'ordre sanitaire, car les EMN en question sont exemptes de problèmes de qualité biologique, mais bien une infraction aux dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de ces traitements et un problème de loyauté. ».
Joëlle Carmes élabore néanmoins un projet de courriel de la part de Jérôme Salomon à Virginie Beaumeunier, directrice générale de la CCRF, qui n'évacue pas totalement ce risque sanitaire. Ce courriel, envoyé le 1er octobre 2021, indique que, « compte tenu de ces pratiques frauduleuses au vu des informations transmises, et des enjeux politiques, économiques, juridiques, et potentiellement sanitaires posés, des échanges interministériels sont effectivement nécessaires en vue de prendre une décision collégiale pour répondre à la demande. Afin d'apprécier la situation rencontrée, il est essentiel que la société Nestlé Waters communique avec toute la transparence nécessaire sur (...) les éventuelles difficultés rencontrées d'un point de vue sanitaire (non-conformité de la qualité de leurs eaux, problème d'hygiène, etc.). »
Le compte rendu dressé par Norbert Nabet le 5 octobre 2021 à la suite de son échange avec Lucile Poivert évoque bien la « nécessité d'évaluer la pratique, le risque sanitaire et le caractère ponctuel ou systématique : mission Igas +/- DGCCRF immédiate ? »
Malgré un vocabulaire plus prudent au sein du ministère de la santé concernant l'absence de risque sanitaire, aucune action - à l'instar d'une saisine de l'Anses ou des ARS - n'est entreprise afin d'en avoir le coeur net.
Le rapporteur déplore d'autant plus ce positionnement que des contaminations bactériologiques étaient intervenues sur le site de Perrier dès 2020, et qu'elles ont été abordées lors de l'entretien du 31 août 2021. En effet, l'ARS Occitanie dénombre au moins 3 épisodes de contaminations en juin 2020, septembre 2020 et janvier 2021. Certaines ont été détectées dans le cadre de la surveillance de l'exploitant, mais n'ont pas fait l'objet d'un signalement à l'ARS, ce qui interroge quant à la volonté de transparence de l'exploitant et le degré de confiance que les pouvoirs publics peuvent lui accorder.
En juin 2020, des courriels de l'ARS Occitanie à l'Anses mettent en évidence des contaminations microbiologiques des eaux de Perrier, qui ont donné lieu au blocage de certaines unités. Les traitements de désinfection n'étaient alors pas connus des services. La responsable de la cellule Environnement de l'ARS Occitanie, Christelle Duclos, se demande par exemple, dès le 9 février 2021, « comment imaginer que de telles contaminations mesurées juste avant l'embouteillage, au niveau de la soutireuse, ne se retrouvent pas dans le produit fini ? cela interroge. Et comment une entreprise agroalimentaire comme NWSS peut ne pas s'être préoccupée d'une contamination qui apparaît comme dépasser largement le cadre de la ligne d'embouteillage ? Les contaminations sont mesurées après traitement par microfiltration, il n'y a donc pas d'autre étape de traitement qui permettrait de les maîtriser avant embouteillage. » Bien que ces non-conformités ne présentent pas, selon l'ARS, de risques sanitaires, la DGS estime à l'époque qu'une vigilance était justifiée : « L'absence de non-conformités sur les autres paramètres microbiologiques faisant l'objet d'un contrôle sanitaire semble indiquer une absence de manquements aux règles d'hygiène, mais les non-conformités répétées, sur un laps de temps relativement court, témoignent néanmoins d'un dysfonctionnement dans l'usine qu'il conviendra d'identifier et de supprimer26(*) ».
Pour le rapporteur, le simple fait que des non-conformités microbiologiques sur les eaux aient pu être dissimulées aux autorités locales aurait dû interroger les administrations quant à la transparence de Nestlé Waters et justifier une vérification méticuleuse de toutes ses affirmations.
Les échanges conduits par la suite entre les ARS et la DGS confirment d'ailleurs l'intérêt qu'il y aurait eu à approfondir cette question du risque sanitaire.
Dans une note du 8 novembre 2022 à la directrice de cabinet de la ministre déléguée à l'organisation territoriale et aux professions de santé, Isabelle Epaillard, la directrice générale de l'ARS Grand Est, Valérie Cayré, résume toute l'ambivalence de ces traitements interdits qui, s'ils n'emportent pas en eux-mêmes de risque sanitaire, peuvent en dissimuler : « Dans l'hypothèse où l'eau serait contaminée, la substitution des UV par des filtres à 0,2 um ne traiterait qu'une partie des micro-organismes potentiellement pathogènes (les virus passent la barrière des filtres). Le contrôle sanitaire rendu inopérant, car ne détectant plus les bactéries indicatrices d'une contamination fécale et son cortège de micro-organismes pathogènes, ne permettrait plus d'évaluer les risques sanitaires pour le consommateur. Il faudrait alors imposer un suivi au-delà des paramètres réglementaires classiques avec l'appui scientifique de l'Anses pour détecter de telles pratiques. »
Dès lors, une contamination des eaux brutes pourrait être masquée par les traitements interdits et donc entraîner un risque sanitaire à l'arrêt des traitements, les seuls traitements maintenus - les microfiltres à 0,2 micron - ne permettant pas de maîtriser ce risque. Pour cette raison, l'ARS Grand Est a exigé de l'industriel qu'il réalise des analyses virologiques.
Confortant ces doutes, la note d'appui scientifique de l'Anses du 16 octobre 2023 a, quant à elle, recommandé la mise en place d'un plan de surveillance renforcée sur les sites de Nestlé Waters en Occitanie et dans le Grand Est en raison du « niveau de confiance insuffisant dans l'évaluation de la qualité des ressources ». Ce plan de surveillance renforcée prévoit notamment l'inclusion de paramètres de surveillance virologique.
Pour le rapporteur, ces constats de l'ARS Grand Est en novembre 2022 et de l'Anses en octobre 2023 démontrent que l'État ne s'est pas posé les bonnes questions en août 2021 et a sous-estimé le risque sanitaire et notamment virologique.
C. UN TROISIÈME DYSFONCTIONNEMENT : LES ÉCHECS DE L'INTERMINISTÉRIEL ET LE TRAVAIL EN SILO
Comme rappelé supra, le contrôle des eaux minérales naturelles fait intervenir de nombreuses administrations : direction générale de la santé, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et direction générale de l'alimentation (DGAL) au niveau central ; agences régionales de santé, préfectures ou directions départementales de protection des populations (DDPP) au niveau local. L'Anses, la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) en particulier via sa direction de l'eau et de la biodiversité (DEB), l'Office français de la biodiversité (OFB) ou les directions départementales des territoires (DDT) peuvent, à des titres divers, jouer un rôle.
Il en résulte un véritable éclatement des compétences qui engendre des coûts de coordination considérables.
Or, au cours de ses auditions, la commission d'enquête a malheureusement constaté que ces différentes administrations ou agences avaient trop souvent travaillé chacune de leurs côtés, en silo, en ne livrant pas aux autres structures des informations qui auraient pu être s'avérer extrêmement utiles pour leurs propres investigations.
Les services de l'État ont ainsi connu de grandes difficultés pour se coordonner, avec des interventions souvent très insuffisantes voire lacunaires, ce que la Commission européenne a souligné dans son rapport final de l'audit qu'elle a réalisé en France du 11 au 22 mars 2024 afin d'évaluer le système de contrôles officiels relatifs aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source, puisqu'elle relève « une mauvaise collaboration entre autorités compétentes et au sein de celles-ci, tant à l'échelle centrale qu'à l'échelle locale ».
Comme la Commission européenne avant elle, la commission d'enquête a pu effectivement constater de multiples dysfonctionnements : absence d'instauration d'un contrôle renforcé ou d'actions coordonnée après la révélation des fraudes, absence de prise de connaissance du rapport de l'Igas par la DGCCRF ou par l'Anses avant sa mise en ligne en février 2024, alors qu'il avait été remis à ses commanditaires en juillet 2022, manque de communication patent entre les administrations centrales, entre les administrations centrales et les administrations locales, des administrations locales entre elles, etc.
Les regrettables palinodies constatées autour du recours, ou plutôt de l'absence de recours, à l'article 40 sont une autre illustration malheureuse de ce fonctionnement en silo.
La communication entre les cabinets ministériels industrie et santé a été intense, mais leur volonté de conserver l'affaire confidentielle le plus longtemps possible a beaucoup nui à la circulation de l'information vis-à-vis des directions d'administrations centrales (DGS, DGCCRF), des agences centrales (Anses) et, surtout, des préfectures et des agences régionales de santé (ARS). Le jeu de rapport de forces entre ces deux ministères, conjugué à une difficulté à apprécier l'intérêt général a par ailleurs biaisé certaines de leurs décisions.
Il faut ajouter à cela une règlementation qui, par elle-même, fragmente l'intervention de l'État et donne l'occasion à chaque administration de se replier derrière une vision stricte de ses compétences. C'est particulièrement le cas s'agissant des champs d'intervention respectifs des ARS et de la DGCCRF.
La commission d'enquête peine par exemple toujours à comprendre que la DGCCRF n'ait pas fait usage de ses pouvoirs administratifs pour faire cesser au plus vite la fraude massive de Nestlé à l'égard des consommateurs, au moins en Occitanie dès lors que le site de Vergèze n'a pas été concerné par une procédure judiciaire jusqu'en février 2025. L'ancienne directrice générale de la DGCCRF, Virginie Beaumeunier, note que : « en l'absence d'éléments formellement établis et portés à la connaissance de la DGCCRF, de nature à remettre en cause le bien-fondé des mentions d'étiquetage prévues par l'arrêté préfectoral, la DGCCRF, qui n'est pas chargée d'exercer le contrôle des installations de production confié à l'ARS, ne disposait pas d'éléments pour motiver une suite en ce qui concerne la commercialisation, dès lors que les mentions d'étiquetage présentes sur les produits respectaient celles prévues par l'arrêté, en l'absence de modification de celui-ci. ». Pourtant, à compter du 31 août 2021, en tout cas du 14 septembre 202127(*), la DGCCRF sait que les mentions d'étiquetage « eau minérale naturelle » ne correspondent plus à la réalité.
De son côté, interrogé par écrit par la commission, le directeur général de l'ARS, Didier Jaffre relève : « si la question est de savoir si l'ARS Occitanie informe systématiquement les services locaux de la DGCCRF (les 13 DDPP ou équivalents) des contrôles réalisés sur les eaux embouteillées et de leurs conséquences, la réponse est oui sans aucune ambiguïté, n'en déplaise à la DGCCRF, dont les représentants ont semblé découvrir le sujet lors de leur audition devant votre commission. Et dans le cas présent de Perrier, ils ont participé au contrôle réalisé sur le site à la demande du préfet du Gard. Et ils sont au courant de la situation de Perrier au moins depuis ma visite sur site en novembre 2022 et de ses constats, et notamment via la préfecture du Gard, mais également via mes services directement. »
La question demeure donc : pourquoi la DGCCRF n'a-t-elle pas fait usage de ses pouvoirs de police administrative figurant aux articles L521-128(*) et suivants du code de la consommation ? Le plus inquiétant aux yeux du rapporteur est qu'à aucun moment les services concernés ne se sont révélés capables de remettre en cause leur fonctionnement et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Dès lors, on peut se demander si un scandale similaire ne pourrait pas à nouveau intervenir.
C'est à bon droit que dans son audit de 2024, la Commission européenne a pu noter « Les AC29(*) locales de la DGCCRF et de la DGS ont été informées de soupçons d'activités frauduleuses concernant un exploitant du secteur des EMN. Bien qu'ayant connaissance de ces pratiques frauduleuses, les AC à l'échelle nationale ou locale (dans d'autres départements) n'ont instauré aucun contrôle renforcé ni aucune activité coordonnée. »30(*) ou encore : « Bien que les ACC31(*) et les AC locales aient été informées de cas de non-respect des dispositions de la directive 2009/54/UE et du règlement (UE) nº 1169/2011, en l'absence de risque sanitaire pour les consommateurs, elles n'ont pas demandé aux exploitants de retirer du marché, de rappeler ou de réétiqueter les produits non conformes. Aucune information n'a été fournie aux consommateurs et aux autorités des autres États membres à cet égard. »32(*) La Commission européenne a déduit de cette affaire à raison que « le système de contrôles officiels en vigueur en France n'est ni conçu pour détecter ou atténuer la fraude dans le secteur des eaux minérales naturelles et des eaux de source ni correctement appliqué, ce qui rend possible la présence sur le marché de produits non conformes et potentiellement frauduleux »33(*).
Il convient donc d'urgence de remédier à ce constat accablant.
D. UN QUATRIÈME DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE DE SANCTION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIEL
Après l'entretien entre Nestlé Waters et le cabinet du ministère de l'industrie le 31 août 2021, les échanges entre les cabinets et les administrations centrales ne font état d'aucune volonté de faire cesser le manquement de l'industriel.
Pourtant, il n'existe aucun doute quant à ce manquement, avoué par l'industriel lui-même. Un courriel de Joëlle Carmes, sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation à Jérôme Salomon, directeur général de la santé et du 27 septembre 2021 mentionne d'ailleurs « une infraction aux dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de ces traitements et un problème de loyauté ».
Le compte-rendu de l'échange inter-cabinets du 5 octobre 2021 mentionne quant à lui une « interrogation selon les résultats [de la mission Igas] sur d'éventuelles sanctions, accompagnement voire évolution de la règlementation ».
Le rapporteur est surpris que, dès le départ, la prise de sanctions n'ait été considérée que comme « éventuelle » et mise au même plan que l'accompagnement de l'industriel vers sa mise en conformité. Il déplore que la mise en conformité de la règlementation aux pratiques de l'industriel ait été même évoquée : c'est la logique inverse qui doit prévaloir.
Indépendamment des poursuites pénales, l'inobservance des dispositions relatives aux eaux minérales naturelles pouvait justifier a minima une mise en demeure de l'autorité administrative compétente, éventuellement assortie d'une perte de la mention « eau minérale naturelle », voire, en l'absence de mise en conformité, d'une suspension de la production ou de la distribution jusqu'à exécution des mesures imposées34(*).
En l'espèce, l'autorité administrative compétente pour assurer le respect de la règlementation est le préfet, sur proposition de l'ARS. Le compte rendu de la première réunion interministérielle sur le sujet des eaux minérales naturelles du 14 octobre 2021 le confirme : « la DGCCRF n'interviendra pas en police administrative pour la remise en conformité des installations de production, car cela relève des ARS. »
Côté DGCCRF, nous avons vu plus haut que l'abstention a été privilégiée. Le résultat c'est l'immobilisme des deux grandes administrations et la poursuite de la commercialisation d'une eau avec l'appellation « minérale naturelle » qu'elle aurait dû perdre.
Les autorités locales n'ont pas non plus agi avec la célérité requise pour faire cesser le manquement de l'exploitant, en particulier en Occitanie.
Dans le Gard, Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie, écrit à la directrice de cabinet de la ministre chargée de l'organisation territoriale et des professionnels de santé, Agnès Firmin-Le Bodo le 12 décembre 2022 en sollicitant un arbitrage du ministère concernant deux options pour réagir aux pratiques constatées par l'ARS au sein de Nestlé Waters le 29 novembre :
- soit le retrait immédiat des traitements avec pour conséquence l'arrêt de l'exploitation ;
- soit la gestion d'une dérogation en 2023 dans l'attente de la mise en conformité ;
Il prend alors parti pour la seconde option : « d'un point de vue sécurité sanitaire, pour ma part en tant que DG ARS, je suis favorable au maintien des traitements de filtration au CA et de désinfection UV, tout comme la microfiltration. Je suis donc favorable à l'octroi d'une dérogation pour l'année 2023, le temps que les travaux planifiés par NW soient réalisés. Si tel n'était pas le cas, nous serions dans l'obligation de stopper l'exploitation pour être en conformité avec la réglementation sur les eaux minérales. » Le même jour, il transmet ce message à la préfète en indiquant « Moi je ne prendrai pas la responsabilité vous l'imaginez bien d'envisager l'arrêt de l'exploitation. Mais encore faut-il que le ministère se prononce. » En d'autres termes, l'ARS laisse commercialiser une eau qui n'est plus minérale naturelle. Elle n'évoque pas même une mise en demeure ou une possible perte de la mention « eau minérale naturelle ».
De fait, les traitements interdits ne seront retirés dans les Vosges qu'à la fin de l'année 2022 et dans le Gard qu'en août 2023.
Devant la commission, l'ancienne préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, a le mérite d'émettre des regrets : « Après la réception du bleu de Matignon35(*) concernant la microfiltration inférieure à 0,8 micron, j'aurais dû officiellement signifier à Perrier que les autres dispositifs utilisés, à l'exception de ceux pour le marché américain représentant la moitié de la production, devaient être retirés. J'aurais dû les mettre en demeure. (...) Je reconnais avoir mal évalué la situation. Dès que nous avons eu la certitude de l'infraction début novembre, confirmée par le compte rendu du directeur général de l'ARS le 12 décembre, j'aurais dû agir. »36(*)
Pour le rapporteur, il ne fait pas de doute que l'absence de mesures de police administrative à l'encontre de l'exploitant a contribué à ralentir sa mise en conformité et donc à permettre la pérennisation de la tromperie à l'égard des consommateurs.
À la connaissance de la commission d'enquête, la seule évocation d'une suspension de la production provient du cabinet de la ministre de la santé, Agnès Firmin-Le Bodo à l'égard des sites de Nestlé Waters dans les Vosges et a rapidement été écartée, non sans lien avec les projets d'annonce de suppression d'emplois de Nestlé Waters en mai 2023.
Le 26 janvier 2023, une note du cabinet santé est transmise au cabinet du Premier ministre et note : « Compte tenu des enjeux sanitaires et réglementaires rendant impossible d'accepter une microfiltration inférieure à 0,8 micron, la proposition du cabinet OTPS est de suspendre immédiatement l'autorisation d'exploitation et de conditionnement de l'eau pour les sites Nestlé dans les Vosges. »
Mais, le 16 février 2023, une note du cabinet industrie transmise par Mathilde Bouchardon, conseillère de Roland Lescure, au cabinet du Premier ministre préconise à l'inverse de ne pas suspendre l'autorisation d'exploitation, car « une suspension immédiate de l'autorisation aurait des impacts sociaux et industriels majeurs. » Elle précise qu'« un plan social est prévu en raison de la baisse de consommation de Vittel sur le marché allemand [...]. NWSE attend de savoir si un plan social plus important doit ou non être annoncé (en fonction de la position de l'État sur le sujet filtration). »
Cette note convient néanmoins qu'en ce qui concerne Hépar, la situation est différente, car « l'eau est contaminée en amont par des eaux usées d'origine anthropique (sans risque sanitaire grâce à la filtration mise en place). L'eau à l'émergence n'est pas microbiologiquement saine : l'eau ne peut donc pas être considérée comme une EMN. Le cabinet Industrie propose de suspendre l'autorisation d'exploiter, ou de la modifier pour la restreindre à la commercialisation vers des marchés ayant des exigences différentes (ex : le marché américain). »
Les deux forages contaminés destinés à la production de l'EMN Hépar, Essar et Hépar Nord sont finalement suspendus à l'initiative de Nestlé Waters le 4 mai 2023.
Le rapporteur déplore que les autorités de l'État aient renoncé à prononcer des mesures de suspension, même dans les cas où la non-conformité des eaux brutes à la pureté originelle était avérée comme pour Hépar. En définitive, seul le forage Romaine VIII sur le site de Vergèze dans le Gard a fait l'objet, à ce jour, d'un arrêté de suspension de l'exploitation en raison de risques sanitaires37(*).
E. UN CINQUIÈME DYSFONCTIONNEMENT : L'INVERSION DE LA RELATION ENTRE L'ÉTAT ET L'INDUSTRIEL EN MATIÈRE D'ÉDICTION DE LA NORME
Dès l'entretien du 31 août 2021, Muriel Liénau présente à l'administration un « plan de transformation » censé permettre à l'industriel de se conformer à la règlementation. D'emblée, il est question de modifier la règlementation, en y intégrant la microfiltration à 0,2 micron, afin de la mettre en conformité avec la pratique de l'industriel, dans une logique totalement dévoyée par rapport à ce que devraient être les relations entre, d'une part, l'État qui édicte la norme et, d'autre part, l'industriel qui l'applique.
Les actions de lobbying déclarées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique traduisent cette conception de Nestlé Waters. Elles s'intitulent : « Refléter dans les arrêtés préfectoraux d'exploitation les évolutions des modalités d'application des réglementations pour le site des Vosges » ou « Refléter dans les arrêtés préfectoraux d'exploitation les évolutions des modalités d'application des réglementations pour le site de Vergèze », témoignant d'une inversion de la relation entre l'industriel et la norme.
Le compte-rendu de l'entretien dressé par François Rosenfeld, alors directeur du cabinet de la ministre chargée de l'industrie, mentionne très clairement : « ce plan [de transformation] exige de maintenir la microfiltration. Elle est tolérée en Angleterre ou en Espagne. » La fiche-ministre rédigée par la DGCCRF le 14 septembre 2021 mentionne quant à elle que : « La DGS devra également expertiser la demande de la société Nestlé concernant la possibilité d'utiliser la microfiltration en lieu et place des filtres que l'entreprise utilise actuellement, qui, selon elle, est indispensable pour garantir la sécurité des eaux mises sur le marché ».
Les documents transmis à la commission d'enquête montrent même que Nestlé Waters a interprété la mission de l'Igas comme l'occasion de faire changer la règlementation ou, du moins, comme un moyen de gagner du temps. En effet, à la suite d'une inspection menée le 6 avril 2022, où elle constate le recours à des traitements interdits par Nestlé Waters, l'ARS Grand Est indique, dans son rapport final, que « des informations complémentaires exhaustives, attendues sous 3 mois, sont nécessaires et demandées pour statuer définitivement sur la situation. ». Or, la directrice générale de l'ARS explique, dans une note adressée à la directrice de cabinet du ministère de la santé, au directeur général de la santé et au chef de l'Igas, le 27 juin 2022 : « Nestlé estime que le dépôt de dossier, demandé sous 3 mois, permettant d'évaluer les éventuelles modifications des caractéristiques de l'eau est prématuré compte tenu du fait que [...] l'Igas devrait faire évoluer le cadre national permettant le recours à ces traitements. » Nestlé Waters aurait donc utilisé la mission en cours de l'Igas pour remettre en cause et contourner les conclusions de l'autorité compétente en matière de contrôle des eaux embouteillées.
Dans une note datée du 26 septembre 2022 destinée à Matignon et à l'Élysée, transmise notamment au secrétaire général de la présidence de la République, pour préparer un entretien avec les dirigeants de Nestlé, les cabinets industrie et santé notent que : « L'industriel a indiqué être en mesure de suspendre les traitements par charbon actif et par UV s'il était autorisé à continuer une microfiltration à 0,2 micron ». En d'autres termes, Nestlé Waters pose explicitement l'autorisation du maintien de la microfiltration à 0,2 micron comme condition à l'arrêt de traitements pourtant illégaux.
Pour le rapporteur, cette attitude transactionnelle témoigne du peu de cas que fait l'industriel de la règlementation, pourtant censée s'appliquer à tous. La seule mention de cette demande aurait dû, selon le rapporteur, faire réagir les lecteurs de cette note transmise au secrétariat général de la présidence de la République !
En outre, Nestlé Waters a anticipé l'autorisation des filtres à 0,2 micron par l'administration sans disposer d'aucune autorisation à ce titre. Son plan de transformation ne mentionne aucune alternative, aucun « plan B » en cas de refus de l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron.
La présentation du plan de transformation aux services de l'État dans le Gard et à l'ARS Occitanie en date du 29 novembre 2022 consacre une page à cette pratique et affirme que les filtres à 0,2 micron sont compatibles avec la règlementation, ne désinfectent pas l'eau et a un effet similaire à d'autres traitements autorisés sur les caractéristiques microbiologiques de l'eau, sans convoquer des références scientifiques.
Pourtant, les administrations estiment peu convaincants les rares arguments - sur lesquels nous reviendrons - transmis par Nestlé Waters pour démontrer le caractère non-désinfectant de la microfiltration à 0,2 micron.
Le 10 novembre 2022, dans un courriel, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, disqualifie en quelques lignes le contenu d'une note transmise par Nestlé Waters sur le sujet, en indiquant que : « Concernant la « note relative à la filtration à 0,2ìm » fournie par NWSE, celle-ci se base uniquement sur 2 études scientifiques et aucun résultat d'analyse sur l'EMN avant et après filtration à 0,2 um n'est présenté. Le résumé de la 1ère publication accessible sur internet indique que l'étude a montré que « jusqu'à 10 % de la charge microbiologique de l'eau brute a pu passer à travers la filtration », donc 90 % de cette charge est retenue par la filtration, qui constitue bien un traitement de désinfection. Contrairement à ce qu'indique NWSE dans cette note, un traitement de désinfection n'a pas pour objectif d'éliminer la totalité de la charge microbiologique de l'eau (l'ARS GE partage cette position). » Il conclut son courriel par ces mots, qui traduisent une volonté de ne plus laisser l'industriel dicter les règles du débat : « Afin de trancher de manière scientifique et technique, je saisis l'Anses sur l'impact de la filtration à 0,2 um sur la qualité d'une EMN. »
Au demeurant, la stratégie d'influence que mène Nestlé Waters par l'intermédiaire du lobbyiste Nicolas Bouvier pour obtenir l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron relève davantage d'une mise sous pression des administrations en usant d'enjeux économiques et sociaux, que d'un dialogue argumenté sur la base de faits scientifiques.
Nicolas Bouvier écrit par exemple le 6 octobre 2022, à Victor Blonde, conseiller au cabinet de la Première ministre et à l'Élysée : « Suite à notre rendez-vous de la semaine dernière, nous avions noté que vous reviendriez vers vous dans la semaine. Avez-vous pu rendre les derniers arbitrages attendus ? Comme vous l'avez compris, l'entreprise a besoin de pouvoir avancer vite maintenant, en particulier vis-à-vis des autorités préfectorales ». Le 17 octobre, soit moins de quinze jours plus tard, il écrit à nouveau : « mon client est en attente de vos arbitrages pour pouvoir avancer sur différents aspects du dossier localement, vis-à-vis des autorités préfectorales comme des représentants du personnel. » Nestlé Waters ne craint pas de faire montre d'impatience à l'égard de l'État.
Pire, comme en témoigne un courriel du 10 novembre 2022 du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, à Pierre Breton, conseiller au cabinet de la ministre déléguée à la santé : « NWSE38(*) semble faire du chantage à l'ARS Grand Est (...), NWSE attend un « alignement » sur leurs propositions avant de nous transmettre la localisation exacte des points de prélèvements d'eau brute (sans prétraitement) en vue de réaliser notre contrôle (...). NWSE temporise pour donner les points de prélèvement des eaux sans aucun traitement préalable, car l'industriel attend d'abord la position de l'ARS sur le maintien des filtres à 0,2 micron. » En effet, l'ARS n'a toujours pas eu accès à l'eau brute pour en contrôler la qualité à l'aune du critère de pureté originelle, alors que sa situation dégradée est connue depuis l'inspection du 6 avril 2022. En clair, l'industriel se permet de dicter ses conditions à son contrôleur.
De manière générale, les sollicitations pressantes du lobbyiste de Nestlé Waters au niveau du cabinet de la Première ministre témoignent d'une volonté de l'entreprise d'outrepasser les canaux traditionnels de décision dont ses interlocuteurs sont conscients. Cédric Arcos, a ainsi indiqué à la commission n'avoir rencontré les représentants de Nestlé Waters qu'une seule fois, le 29 novembre 2022 : « J'ai refusé ces rencontres pour plusieurs raisons : j'avais déjà entendu les arguments de l'entreprise ; une procédure article 40 était en cours, avec des arbitrages prévus pour février 2023 ; je ne souhaitais pas donner l'habitude à cette entreprise de court-circuiter les différents responsables, qu'ils soient locaux ou ministériels. »
Le rapporteur condamne ces méthodes qui vont bien au-delà de la représentation d'intérêts, mais constituent des tentatives de l'industriel d'imposer son tempo et ses priorités aux autorités de contrôle. Il regrette tout autant que certaines autorités de l'État, au plus haut niveau, aient donné prise à ce qui doit s'analyser comme une véritable mise sous pression.
Une autre forme d'inversion des positionnements est caractérisée au sein du cabinet de l'industrie, dont la conseillère chargée du dossier, Mathilde Bouchardon, reprend les arguments Nestlé de manière caricaturale et sans aucune prise de distance. Deux exemples : le premier concerne une note du 30 novembres 2022 « à l'attention des cabinets Élysée et Matignon » où la conseillère pose trois questions : « Considère-t-on que ces filtres aient été installés dans un but technologique ? », « Considère-t-on que ces filtres ont pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ? » et « Quel risque prend-on à autoriser la filtration à 0,2 ìm ? ». À ces questions, la conseillère du ministre de l'industrie apporte les réponses du seul... industriel. Mieux, un dernier point est abordé : « Sur la possibilité d'autoriser Nestlé à filtrer pour continuer à appeler ses eaux Hépar EMN malgré la contamination à la source ». En soi cet intitulé, à lui seul, est stupéfiant puisqu'il s'agit clairement pour l'État de valider une illégalité.
Seconde exemple : dans une note du 16 février 2023 destiné au cabinet de Matignon, la même conseillère, répercute purement et simplement les éléments de langage de Nestlé Waters sur l'objet de la microfiltration à 0,2 micron : « NSWE utilise une microfiltration à 0,2 ìm dans un but technologique, c'est-à-dire pour maîtriser les dangers potentiels dans le procédé (et non à la source, sauf sur Hépar) ». On se désole de la précision sur le but technologique puisque la même conseillère indiquera devant la commission d'enquête : « Aujourd'hui encore, je ne saurais vous dire exactement ce que recouvre une microfiltration dans un but technologique. ».
Le rapporteur ne peut que déplorer que des cabinets ministériels, loin de chercher l'intérêt général en documentant sérieusement les sujets, se contentent de reprendre les argumentaires biaisés d'un industriel dont on savait par ailleurs la propension à tricher.
Il relève que cet industriel n'a pris aucune mesure interne (audit, sanctions...) permettant de rechercher les responsabilités en matière de non-respect de ses obligations légales. Ce faisant, il a non seulement mis en risque l'ensemble de ses salariés mais engage sa propre responsabilité de personne morale.
F. UN SIXIÈME DYSFONCTIONNEMENT : DES AUTORITÉS LOCALES PEU, VOIRE PAS, ASSOCIÉES AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ÉCHELON CENTRAL
Malgré le caractère déconcentré du dispositif de contrôle des eaux minérales naturelles et de source, les administrations centrales n'informent pas (a) et ne sollicitent pas l'avis des autorités locales avant de prendre des décisions concernant le plan de transformation de Nestlé Waters (b). Une fois ces décisions prises, l'échelon central se « dessaisit » du dossier et livre les autorités locales à elles-mêmes dans le cadre de la mise en oeuvre concrète du plan de transformation de Nestlé Waters (c).
1. L'échelon national n'informe pas les autorités locales, qui souffrent d'un déficit d'informations
Dès le 5 octobre 2021, un courriel de la cheffe de bureau de la qualité des eaux de la DGS fait état de la décision prise par les cabinets des ministères chargés de l'économie et de la santé de ne pas informer les services déconcentrés de l'État, et a fortiori les ARS, ni des pratiques avouées par Nestlé Waters le 31 août 2021 ni de la mission de l'Igas. Elle indique : Les cabinets ne sont a priori pas favorables pour mobiliser les services déconcentrés sur cet aspect, ne souhaitant pas partager trop largement des éléments sur ce dossier pour l'instant et ils envisageraient ainsi de passer par nos services d'inspection centraux. »
Cela a pour conséquence de placer les autorités locales dans une situation d'ignorance pendant un certain temps.
Ce manque de clarté de l'échelon central aura une seconde conséquence stupéfiante : tous les sites de Nestlé Waters ne feront pas l'objet d'une inspection dans le cadre de la mission de l'Igas.
Dans les Vosges une inspection a bien lieu, le 6 avril 2022. Certes, elle est tardive, mais a le mérite d'exister. Notons qu'elle intervient à la suite des réponses en date du 25 mars 2022 de Nestlé Waters au questionnaire de l'Igas dans lequel l'exploitant reconnaît pratiquer des traitements interdits.
En revanche, en ce qui concerne les installations à Vergèze, aucune inspection n'est diligentée avant le 29 novembre 2022. Pourtant, le questionnaire de l'Igas a bien été envoyé à l'exploitant par le biais de l'ARS, qui a validé ses réponses le 30 mars 2022.
D'après l'Igas, les réponses des exploitants ont ensuite été transmises aux ARS « sur demande ». L'Igas a indiqué à la commission d'enquête ne pas trouver trace d'envoi du questionnaire relatif au site de Vergèze à l'ARS Occitanie, « soit que le message n'ait pas été envoyé soit qu'il ait été effacé à la fin des travaux ». L'Igas a néanmoins précisé qu'« en tout état de cause [...], les ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitane (qui constituaient le groupe « contact » sur lequel la mission s'est appuyée tout au long de ses travaux) disposaient de la lettre de mission depuis le 31 janvier 2022. Ladite lettre mentionnait les pratiques illégales (UV et charbon actif) de Nestlé Waters. »
Les 32 sites inspectés par les ARS dans le cadre de la mission de l'Igas ont été choisis par les ARS sans intervention de la mission. Or, dans le Gard, le site de Vergèze n'est pas retenu par l'ARS ! Il faudra attendre que l'industriel lui-même saisisse l'ARS pour qu'elle lance enfin une vite du site.
Le rapporteur s'interroge sur les raisons de ce dysfonctionnement majeur, qui a fait perdre plusieurs mois aux autorités locales dans le Gard : rupture de la chaîne d'information au sein de l'ARS Occitanie, erreur de transmission d'informations entre l'Igas et l'ARS Occitanie, volonté de ne pas perturber un acteur économique majeur du territoire ?
Comment, de son côté, la mission Igas a-t-elle pu écrire, dans la synthèse de son rapport, que « d'autres écarts plus graves ont été mis au jour [...]. Il s'agit de ceux révélés par le groupe Nestlé Waters aux membres de la mission et à l'ARS Grand Est à l'occasion d'un contrôle sur site », sans s'interroger sur l'absence d'information des autorités locales en Occitanie ?
Comble de la situation, Nicolas Bouvier, lobbyiste pour le compte de Nestlé Waters, a indiqué à la commission d'enquête que ce décalage d'information entre les deux ARS était une préoccupation de Nestlé Waters, qui a posé la question lors des rendez-vous avec les autorités nationales entre juillet et octobre 2022. Ce n'est qu'après une visioconférence entre la préfète du Gard, le directeur général de l'ARS Occitanie et la directrice de cabinet de la ministre déléguée Agnès Firmin-Le Bodo, que le directeur général de l'ARS Occitanie est mis en contact avec Nestlé Waters qu'il rencontre le 3 novembre 2022.
2. L'échelon national sollicite peu ou pas l'avis de l'échelon local au moment de décider
La demande de Nestlé Waters d'autoriser la microfiltration à 0,2 micron est en fait tranchée au niveau national dès le 17 février 2023, au cours d'une réunion « intercabinets » associant Isabelle Epaillard, directrice de cabinet d'Agnès Firmin-Le Bodo, Adrienne Brotons, directrice de cabinet de Roland Lescure et Pierre Breton et Mathilde Bouchardon, respectivement conseillers des mêmes cabinets, ainsi que Cédric Arcos, conseiller au cabinet d'Élisabeth Borne et Victor Blonde, conseiller à la fois à Matignon et à l'Élysée.
Le relevé de décision de cette réunion mentionne notamment l'autorisation de la prise d'arrêtés préfectoraux incluant une autorisation de microfiltration avec un seuil de coupure inférieur à 0,8 micron. Il mentionne également : « compte tenu de la sensibilité du sujet, il nous paraît préférable de « bleuir » ce relevé de décisions avant transmission aux autorités déconcentrées ». Le terme « bleuir » renvoie ici à la prise d'un « bleu » interministériel, compte-rendu officiel de la couleur du papier utilisé pour ce type de document traduisant un arbitrage interministériel tranché au niveau du cabinet de la Première ministre. En l'occurrence, ce « bleu » sera pris à la suite d'une concertation interministérielle dématérialisée (CID) des différents cabinets concernés tenue le 22 et 23 février 2023 et présidée par Cédric Arcos et Victor Blonde.
Cette position est le fruit de plusieurs semaines d'aller-retour par courriers électroniques entre les cabinets des ministères de la santé et de l'industrie, d'une part, et de la Première ministre, d'autre part, les conseillers de cette dernière semblant être les uniques arbitres, à l'exclusion des ministres, de la confrontation entre la vision du ministère de la santé et celle de la santé.
Entre juillet 2022, moment où le cabinet de la Première ministre a été informé des pratiques de Nestlé Waters, et octobre 2022, le dossier semble même être géré directement au niveau de son cabinet, sollicité, de manière insistante, par le conseil de Nestlé Waters.
Le 6 octobre 2022, Cédric Arcos paraît prendre la mesure du problème et indique à son collègue Victor Blonde, après que ce dernier lui a transféré une énième sollicitation de Nicolas Bouvier : « Je pense vraiment qu'il faut revenir à un process normal : échanges avec les Préfets et les ARS qui seuls sont en capacité d'apprécier ce qu'ils font et les conséquences sur la qualité de l'eau avec éventuellement un suivi par les deux [cabinets] ». Résultat : dans la note des deux conseillers au directeur de cabinet de la Première ministre, Aurélien Rousseau, en date du 6 octobre 2022, ils préconisent : « demander à l'industriel de travailler directement et en transparence avec les préfets et ARS ». C'est ainsi que le 13 octobre 2022, une fois la note validée par Aurélien Rousseau, Cédric Arcos et Victor Blonde adressent aux deux cabinets un message leur « passant complètement la main », leur proposant d'inviter Nestlé Waters à travailler directement avec les préfets et ARS concernées. Notons que, ce faisant, les conseillers de Matignon induisent au moins partiellement en erreur et les autorités locales et Nestlé Waters. Ils omettent en effet d'engager l'entreprise à saisir le ministre de la santé pour faire examiner la microfiltration à 0,2 micron, comme cela est prévu par les textes39(*).
En tout état de cause, tout se décide à Paris et jamais ni les préfets ni les directeurs généraux d'ARS ne sont véritablement consultés avant ces décisions.
3. L'échelon national n'accompagne pas l'échelon local pour la mise en oeuvre de ses décisions
La concertation interministérielle dématérialisée, utilisée pour « bleuir » la décision du 17 février 2023, officialise la validation par le cabinet de la Première ministre des orientations suivantes :
« 1/ Concernant le site des Vosges de Nestlé Waters, un plan d'action devra être sollicité sans délai auprès de l'industriel de nature à recouvrir la qualité de l'eau à l'émergence Hépar « Essar ». Ce plan devra être présenté à la Préfète des Vosges et à la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est et comporter un calendrier précis de mise en oeuvre des actions amélioratives. Parallèlement, des contrôles de qualité devront être menés par les services de l'ARS, étant entendu que la Préfète et la Directrice générale de l'ARS pourront décider de toutes les mesures nécessaires à la préservation de la qualité de l'eau, pouvant aller, si nécessaire, jusqu'à la suspension de l'autorisation d'exploitation d'une émergence. »
Ce point ne donne aucune indication aux autorités locales concernant le calendrier qui serait acceptable pour les « actions amélioratives » envisagées et ne fait qu'opérer un rappel à la loi lorsqu'il mentionne la possibilité pour la préfète d'aller jusqu'à la suspension de l'autorisation d'exploitation.
« 2/ En réponse aux demandes de l'industriel et aux interrogations des autorités préfectorales et de l'ARS, et au regard d'une part des autres autorisations déjà accordées en France et, d'autre part, de l'absence de norme empêchant ce niveau de filtration, confirme la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 ìm. »
La formulation de ce deuxième point est floue, à dessein. Mais, ici encore, les services locaux devront faire avec. De l'aveu de Victor Blonde, sous la coprésidence duquel cette CID a été menée : « nous aurions été, à Matignon, dans le cadre d'un bleu, bien incapables de fixer précisément une norme en-deçà de 0,8 micron. C'est pour cela que nous avons renvoyé vers les autorités compétentes (préfectures et ARS). »40(*)
« 3/ Demande à l'ARS Grand Est de mettre en place une surveillance renforcée (bactériologique et virologique) de la qualité de l'eau aux différentes émergences, quel que soit le débit de prélèvement en amont et en aval de la microfiltration. »
Ce point est peut-être le seul sur lequel l'administration centrale a accompagné l'échelon local puisque la DGS a saisi à cette fin le laboratoire d'hydrologie de Nancy (LHN) de l'Anses le 28 avril 2023. Cette saisine omet néanmoins la situation très similaire que rencontre l'ARS Occitanie à Vergèze, ce qui a poussé cette dernière à solliciter le DGS, le 7 juin 2023, pour bénéficier elle-aussi de l'appui scientifique et technique du LHN. La note d'appui scientifique et technique de l'Anses est rendue le 16 octobre 2023.
« 4/ Concernant le Site de Vergèze dans le Gard, le cabinet de la Première ministre demande à la préfète du Gard et au Directeur général de l'Agence régionale de santé d'Occitanie de prendre en compte l'autorisation de microfiltration évoquée ci-dessus et de définir une démarche d'accompagnement et de contrôle de la qualité de l'eau aux différentes émergences dans le cadre du plan de transformation du site prévu par l'industriel Nestlé Waters. »
Le rapporteur tient à souligner deux points, qui témoignent des lacunes de la décision consacrée par la CID, en totale déconnexion avec la réalité concrète du terrain.
D'abord, le « bleu » tend, sur le fond, à demander aux autorités locales d'autoriser la microfiltration à 0,2 micron tout en veillant consciencieusement à ne pas mentionner ce seuil de coupure dont les cabinets connaissent le caractère non-conforme à la règlementation.
Comme Victor Blonde, Cédric Arcos a indiqué à la commission d'enquête : « il est important de souligner que nous ne nous prononçons pas sur le 0,2 micron. Il n'y a donc rien qui nous amène à cette valeur. »41(*) Le rapporteur estime pourtant claire la mention, certes indirecte, de cette valeur, emportée par les termes « dans le cadre du plan de transformation du site prévu par l'industriel Nestlé Waters ». En effet, ce plan évoque depuis 2021, avec constance, un seuil de coupure à 0,2 micron.
Cette formulation floue témoigne donc de toute l'ambivalence de ministères qui savent que la microfiltration à 0,2 micron ne peut être autorisée, mais qui pour autant, autorisent les préfets à prendre des arrêtés pour tenir compte de la demande d'un industriel... d'être autorisé à filtrer l'eau à 0,2 micron.
Une conséquence du flou entretenue au sommet de l'État : à ce jour, à la connaissance de la commission d'enquête, malgré la validation de la CID, aucune ARS n'a recommandé la prise de tels arrêtés et aucun préfet n'a autorisé la microfiltration à 0,2 micron dans les départements mentionnés - les Vosges et le Gard.
Les suites données au « bleu » témoignent aussi d'un manque de clarté des administrations sur la gestion de la période « transitoire ».
Dans le Gard, le plan de transformation n'est transmis que très tardivement aux autorités locales42(*), et postérieurement à la tenue de la CID. Les autorités locales n'ont donc jamais pu se préparer à cette décision qui les concernait au premier chef.
Du reste, des points demeurent non résolus malgré l'arbitrage rendu par cette CID : Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie, écrit en effet à Isabelle Epaillard le 7 avril 2023, soit plusieurs semaines après la CID, pour souligner que Nestlé Waters ne sera pas en conformité avec la règlementation durant la phase « transitoire » : « Pendant cette période transitoire de réalisation des travaux du plan de transformation qui va durer entre 12 et 18 mois, NWSE n'envisage en aucun cas de retirer les traitements par charbon actif et par UV ». Il mentionne plusieurs alternatives : produire uniquement à destination du marché américain, modifier l'étiquetage, mettre en vente l'eau sous la marque Maison Perrier. À la connaissance de la commission d'enquête, aucune de ces options n'a été retenue et c'est le maintien des traitements interdits qui a perduré.
« 5/ Demande au Secrétariat général des affaires européennes de conduire une analyse de la situation de la microfiltration et des pratiques existantes dans les autres pays de l'Union afin, le cas échéant, d'envisager de solliciter la commission pour une évolution de la réglementation communautaire ou en vue d'une saisine de l'EFSA. »
À la connaissance de la commission d'enquête, ce point n'a quant à lui pas jamais été suivi d'effet si bien que les autorités locales sont toujours, en avril 2025, dépourvues d'éléments sur lesquels s'appuyer sans risque concernant le seuil acceptable de microfiltration.
G. UN SEPTIÈME DYSFONCTIONNEMENT : LA DISSIMULATION PAR L'ÉTAT DES INFORMATIONS ET DÉCISIONS CONCERNANT NESTLÉ WATERS
Si le manque de transparence de Nestlé Waters ne fait pas de doute pour la commission d'enquête, elle a aussi constaté celui dont a fait preuve l'État tout au long de la séquence, à la fois vis-à-vis des autorités locales et européennes et vis-à-vis des Français.
Ce sont les articles publiés dans Le Monde et France Info par Stéphane Foucart et Marie Dupin à compter du 29 janvier 2024 qui ont révélé au public les pratiques interdites des industriels embouteilleurs et leur information des services de l'État depuis le 31 août 2021.
C'est également par cette voie que les autorités européennes ont pris connaissance de ces pratiques. Entre le 31 août 2021 et le 29 janvier 2024, la Commission européenne n'a jamais été informée des pratiques de Nestlé Waters alors même que ses produits circulaient sur le marché intérieur et que le cadre juridique applicable est régi par une directive européenne qui impose d'informer la Commission européenne en cas de difficultés sur une eau minérale naturelle43(*).
Cette dissimulation aux autorités européennes relève d'une stratégie délibérée, abordée dès la première réunion interministérielle sur les eaux minérales naturelles le 14 octobre 2021 : son compte rendu indique que la question d'un éventuel contact au niveau UE a été soulevée, la DGS demandant si « le sujet ne pouvait pas être mis à l'ordre du jour du prochain comité permanent de la chaîne alimentaire où siège la DGCCRF », mais que la DGCCRF a répondu ne pas y être favorable « car cela risque d'ébruiter l'affaire avant qu'un diagnostic solide n'ait été établi ».
Le pire est que cet esprit de dissimulation a joué aussi à l'encontre des autorités locales. Elles ne sont sciemment pas informées des pratiques de Nestlé Waters remettant en cause l'étiquetage des bouteilles. Dès le 5 octobre 2021, un courriel de Corinne Feliers, cheffe du bureau de la qualité des eaux à la DGS, à Joëlle Carmes, sous-directrice, duquel est en copie Jérôme Salomon, le confirme : « Pour les cabinets (MSS et MEFR44(*)), le premier enjeu est de qualifier et de quantifier l'irrégularité : Les cabinets ne sont a priori pas favorables pour mobiliser les services déconcentrés sur cet aspect, ne souhaitant pas partager trop largement des éléments sur ce dossier pour l'instant et ils envisageraient ainsi de passer par nos services d'inspection centraux. »
Cette volonté de ne pas informer les autorités locales a conduit à maintenir les préfectures - et les ARS - concernées dans l'ignorance.
Aujourd'hui encore, malgré la divulgation de ces pratiques, largement documentées par les journalistes, l'État n'a pas fait toute la transparence sur cet épisode.
Les notes d'appui scientifique et les avis de l'Anses rendus au sujet de la microfiltration ne sont toujours pas accessibles sur le site de l'Anses. L'avis de l'Anses du 16 octobre 2023 préconisant une surveillance renforcée sur les sites de Nestlé Waters ne l'est pas non plus.
Quant au rapport de la mission menée par l'Igas, transmis aux ministres en juillet 2022, il n'a finalement été publié qu'en février 2024, à la suite des révélations de la presse.
H. UN HUITIÈME DYSFONCTIONNEMENT : DES DÉLAIS EXCESSIFS QUI FAVORISENT L'ENRACINEMENT DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TROMPERIE DU CONSOMMATEUR ET DE SURVENANCE DE RISQUES SANITAIRES
1. Délais entre l'aveu de Nestlé Waters et l'information du ministère de la santé
Alors que Nestlé a révélé au cabinet de la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runnacher, son recours à des traitements illégaux le 31 août 2021, cette information n'a été transmise au cabinet du ministre de la santé, Olivier Véran, que le 27 septembre 2021, soit presque un mois plus tard45(*).
Or, si le recours à ces traitements s'analyse en un premier temps comme une tromperie du consommateur, il n'en demeure pas moins que seul le ministère de la santé était en capacité d'apprécier la réalité des déclarations de Nestlé sur l'absence de risque sanitaire.
Le rapporteur s'interroge sur les raisons de ce manque de diligence : lenteurs bureaucratiques, faible prise de conscience des enjeux, poids du contexte marqué par le Covid, volonté de retarder cette transmission par complaisance à l'égard de l'industriel ?
2. Délais entre l'information de l'État et le déclenchement de la mission de l'Igas
C'est ensuite un délai de presque deux mois qui s'avère nécessaire pour missionner l'Igas.
La décision de saisir l'Igas est prise le 14 octobre 2021, soit un mois et demi après les aveux de Nestlé Waters, lors d'une réunion interministérielle à laquelle participaient les cabinets santé et industrie, d'une part, et la DGCCRF et la DGS, d'autre part.
Le jour-même, à la suite de cette réunion, Jérôme Salomon transmet à Norbert Nabet, conseiller santé d'Olivier Véran, un projet de lettre de saisine de l'Igas rédigé par ses services. Ce projet a mis plus d'un mois à être amendé par les ministères de l'économie et de l'industrie. La lettre de mission n'a été signée, en définitive, que le 19 novembre 2021.
Une fois signée, reste à lancer la mission. Or, il faut attendre trois semaines, le 7 décembre 2021, pour qu'une réunion se tienne aux fins de repréciser, avec le cabinet santé et la DGS, les contours de l'intervention de l'Igas.
Il résulte de cette cascade de délais que les inspecteurs n'ont reçu leur ordre de mission officiel que le 16 décembre 2021. Et eux-mêmes n'organisent leur première réunion de travail avec la direction générale de la santé que le 18 janvier 2022, soit deux mois après la lettre de mission. Enfin, le directeur général de la santé n'informe les directeurs généraux d'ARS de l'existence de cette mission que le 28 janvier 2022.
Ce sont donc près de cinq mois qui ont été nécessaires pour le démarrage de la mission.
3. Délais entre le déclenchement de la mission de l'Igas et la constatation des pratiques interdites sur les sites Nestlé des ARS Grand Est et Occitanie
La lettre de mission de l'Igas, datée du 19 novembre 2021, précise ensuite que sa mission sera conduite « sur l'ensemble des usines de conditionnement d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source implantées sur le territoire français, et en priorité sur les usines de conditionnement identifiées par le SNE dans le cadre de son enquête actuelle. Elle sera conduite avec l'appui des ARS concernées. »
De l'analyse des documents reçus par la commission, il ressort que les sites de Nestlé des Vosges ont été inspectés le 6 avril 2022, permettant aux services de l'ARS de constater les pratiques interdites dévoilées par l'exploitant dans ses réponses au questionnaire de l'Igas. Nous sommes donc 7 mois après la réunion au cabinet de la ministre de l'industrie.
S'agissant du site Nestlé du Gard, l'ARS Occitanie est informée dès le 31 janvier 2022, du fait de son appartenance au groupe de contact des ARS créé par la mission Igas, du contenu de la lettre de mission qui mentionne l'enquête de nature pénale du service national des enquêtes (SNE) et des révélations faites par Nestlé waters au cabinet de la ministre de l'industrie. Pourtant, elle ne constatera les pratiques interdites que le 29 novembre 2022, 14 mois après les aveux de l'industriel, au cours d'une visite -et non d'une inspection à proprement parler - organisée à la suite de l'information de Nestlé Waters au directeur général de l'ARS Occitanie le 3 novembre.
4. Délais entre la réalisation des inspections et les retraits de traitements interdits ou le signalement au titre de l'article 40
- Dans les Vosges
L'inspection du site de Nestlé Waters dans les Vosges a été diligentée le 6 avril 2022, et le rapport définitif rendu le 1er juillet 2022, au terme d'une période d'échanges contradictoires. À cette date, Nestlé a été mis en demeure par l'ARS Grand Est de retirer sous trois mois les traitements interdits. Nestlé Waters s'est dans un premier temps montré réticent à respecter ce délai de trois mois pour une partie de ses forages.
Le retrait des traitements interdits a été constaté le 17 avril 2022 pour Grande Source captage (Vittel), le 28 novembre 2022 pour Belle Lorraine, Anger Lorraine, Great Source, Reine Lorraine et Thierry Lorraine (Contrex)46(*). Quant aux traitements sur les forages Essar et Hépar Nord (Hépar), ils s'arrêtent seulement le 5 mai 2023, date de leur mise à l'arrêt.
Parallèlement, la directrice générale de l'ARS Grand Est a échangé en juillet 2022 avec le cabinet du ministre de la santé qui lui a « donné son feu vert » pour effectuer un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Elle a également pris l'attache du procureur d'Épinal à l'été 2022, avant de formaliser son signalement en octobre 2022.
Sur le fond, pour avoir effectué ce signalement alors que l'ARS d'Occitanie ne l'a jamais fait et avoir pris des décisions visant à imposer le retrait des traitements interdits, l'ARS Grand Est fait figure de bonne élève. Le rapporteur regrette toutefois que le SNE n'ait été missionné par le procureur d'Épinal qu'en octobre 2022, soit plus d'un an après les révélations de Nestlé, pour enquêter sur le site des Vosges, alors que cette enquête aurait dû être lancée un an plus tôt, en octobre 2021.
- Dans le Gard
Sur le site de Vergèze, l'arrêt des traitements interdits n'a été constaté par l'ARS Occitanie que le 9 août 2023.
Par ailleurs, l'ARS Occitanie, bien qu'informée le 31 janvier 2022 par l'Igas des révélations de traitements interdits chez Nestlé Waters, prétend n'avoir eu connaissance de ces traitements à Vergèze que le 3 novembre 2022 lors d'un échange téléphonique qui s'est tenu entre Nicolas Bouvier, lobbyiste de Nestlé Waters, et Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie. Elle a ensuite réalisé une visite de l'usine Perrier le 29 novembre 2022 au terme de laquelle Nestlé a montré à ses agents les traitements dissimulés dans des armoires.
Le directeur général de l'ARS Occitanie n'a toutefois pas jugé utile de porter ces faits à la connaissance de l'autorité judiciaire, pendant de très longs mois, au motif étrange que les administrations centrales et l'Igas en étaient déjà informées. Il a indiqué lors de son audition devant la commission avoir concentré son action sur l'accompagnement du plan de transformation et le retrait des traitements interdits, qui n'a cependant eu lieu qu'en août 2023. Le directeur général de l'ARS Occitanie atout de même fini par procéder à un signalement le...18 avril 2025.
Il en résulte que si dans le Grand Est, les traitements interdits ont perduré un peu plus d'un an après l'aveu de Nestlé au ministère de l'industrie, en Occitanie, ils sont restés en place 2 ans. Par ailleurs, si 8 mois se sont écoulés entre l'information de l'ARS Grand Est par la mission Igas des pratiques de Nestlé Waters et le signalement au procureur d'Épinal par sa directrice générale, il a fallu plus de trois ans au directeur général de l'ARS Occitanie pour procéder au même signalement au procureur de Nîmes.
5. Délais de régularisation éventuelle des arrêtés préfectoraux
Lors de la visite d'inspection du 6 avril 2022, l'ARS Grand Est a relevé le recours à des traitements de filtration à 0,2 ou 0,45 micron sur les sources « Peulin » (Hépar), « Ermitage » (Hépar) et « Grande Source captage référence « (Vittel)47(*).
Ces traitements n'étaient pas autorisés pas les arrêtés préfectoraux régissant ces sources en vigueur à la date du contrôle48(*).
Ils ont été régularisés pour les seules sources de Vittel par des arrêtés préfectoraux modificatifs du 4 juillet 2023, qui autorisent le recours à des filtres allant de 1,2 et à 0,45 micron49(*).
Nestlé Waters a également déposé une demande de modification des arrêtés préfectoraux régissant Hépar pour autoriser le recours à la filtration à 0,2 micron. Cette demande est en cours d'instruction par les services de l'ARS Grand Est, comme l'a indiqué à la commission Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l'ARS depuis juin 2024.
Dans le Gard, Nestlé a déposé une demande de révision complète de l'autorisation d'exploitation de la source « Perrier » le 13 octobre 2023. Celle-ci est toujours en cours d'instruction par les services de l'ARS et de la préfecture plus d'un an et demi plus tard, et ce alors même que de nombreux épisodes de pollution sporadique ont été mis au jour depuis la mise en oeuvre le 23 mai 2024 par l'ARS Occitanie de la surveillance renforcée préconisée par l'Anses.
6. Délais entre la connaissance des infractions et leur traitement judiciaire
Aux délais excessifs résultant du manque de réactivité de l'administration centrale, puis locale s'agissant de l'ARS Occitanie, s'ajoutent les délais de traitement judiciaire des informations qui ont été portées à la connaissance des parquets.
L'enquête du SNE de la DGCCRF ouverte le 27 janvier 2020 à la suite d'un signalement opéré par un salarié du groupe Alma a été transmise au procureur de la République de Cusset le 7 juillet 2022, soit deux ans et demi plus tard.
Le 3 avril 2025, la procureure générale de la Cour d'appel de Riom a indiqué par écrit à la commission que le parquet de Cusset n'y avait apporté aucune suite judiciaire, alors même qu'il envisageait d'orienter les poursuites vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)50(*). Selon la procureure générale, le procureur de la République de Cusset s'est finalement dessaisi au profit d'un juge d'instruction du pôle santé publique de Paris désigné le 13 février 2025 pour enquêter sur ces faits.
Le rapporteur fait part de son vif étonnement à l'égard du fait qu'une telle procédure de CRPC, qui a pour utilité première de juger rapidement l'auteur d'une infraction par lui reconnue, n'ait pas pu être mise en place entre le 7 juillet 2022 et le 13 février 2025. En tout état de cause, plus de cinq ans après l'ouverture la procédure Alma, son traitement judiciaire n'a encore rien donné.
La seconde enquête du SNE portant sur les faits signalés par l'ARS Grand Est au procureur d'Épinal le 3 octobre 2022 a donné lieu à une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale (CJIPE), conclue le 2 septembre 2024 entre le procureur de la République d'Épinal et la SAS Nestlé Waters Supply Est. Si cette convention ne vaut pas reconnaissance de culpabilité de Nestlé et ne clôt les poursuites qu'une fois les obligations dûment exécutées, le rapporteur s'interroge également sur le délai de 2 ans entre la connaissance des infractions et la conclusion de cette convention.
I. UN NEUVIÈME DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE DE VÉRIFICATIONS ET DE SUIVI DU DOSSIER PAR L'ÉTAT
Parmi les étapes importantes difficiles à ignorer de cette affaire figurent le déclenchement de la mission d'inspection Igas en novembre 2021, la concertation interministérielle dématérialisée de février 2023, la révélation de l'affaire par la presse en janvier 2024 et le début des travaux de la commission d'enquête en décembre 2024.
Et pourtant, la commission d'enquête n'a pu que constater avec stupéfaction que, dans un certain nombre de départements où se trouvent des sites de mise en bouteille d'eaux minérales, les autorités locales sont restées comme immobiles jusqu'à aujourd'hui.
Les auditions confirment cet immobilisme. S'agissant du Puy-de-Dôme, département de production de Volvic, par exemple, aux questions du rapporteur et du président sur la prise en compte des révélations sur l'affaire pour renforcer les contrôles, le préfet, Joël Mathurin, reconnaît ne jamais avoir échangé avec les préfets du Gard et des Vosges sur le sujet et indique en se retranchant derrière l'existence d'une procédure judiciaire, dont on a vu qu'elle n'avait rien donné en 5 ans : « je n'ai pas engagé de mesures particulières ni reçu d'instructions en ce sens, visant à renforcer les contrôles. Au demeurant, selon ma compréhension du dossier, les enjeux sanitaires sont seconds, puisqu'il est essentiellement question d'une tromperie du consommateur. Les services continuent ainsi d'assurer leurs contrôles de droit commun et m'en rendent compte si nécessaire ». Interrogé à nouveau par le président de la commission d'enquête qui marque son étonnement, le préfet confirme : « (...) pour préciser mon propos, je n'ai pas pris d'initiative de renforcement des contrôles. »
Yves Le Breton, préfet de Haute-Savoie, département dans lequel se trouvent les sites Évian du groupe Danone et une usine du groupe Alma (Thonon) reconnaît de la même façon ne pas avoir demandé d'accentuation des contrôles ni même de vérification de l'absence de traitements interdits dans les usines concernées. Ainsi répond-t-il au rapporteur : « À ma connaissance et jusqu'à présent, les contrôles ont été menés régulièrement et conformément aux pratiques en vigueur, sans manquement signalé. Dans ce contexte, nous n'avons identifié aucune situation justifiant une modification des modalités de contrôle. »
Or si les traitements ont pu perdurer pendant plusieurs décennies, c'est bien qu'ils étaient indécelables par les contrôles réguliers. Il résulte de ces éléments que les services de l'État sont à ce jour, dans l'incapacité de certifier que les traitements interdits sont éliminés dans la totalité du secteur des eaux minérales.
Comment expliquer cette situation, alors même que le rapport Igas, rendu public en 2024, évoquait, il est vrai dans une catégorie fourre-tout, plus de 30 % de non-conformité au sein des eaux minérales et de source commercialisées ?
L'échelon central semble, d'abord, n'avoir donné aucune instruction claire aux préfectures pour vérifier de manière exhaustive l'absence de traitements interdits dans les sites de production.
La direction générale de la santé n'a pas pris de mesures d'animation du réseau des préfets et des directeurs généraux d'ARS sur le sujet des eaux minérales pour purger la crise.
Cette abstention, conjuguée à un défaut d'initiative flagrant des préfectures et des ARS, a conduit à l'inexistence de partage d'expériences entre préfectures. Si les préfets du Gard et des Vosges ont, trop rarement, pris la peine de se joindre sur le sujet des eaux minérales, leurs collègues des autres départements à sites de production ne paraissent pas avoir pris l'initiative de les contacter, ne serait-ce que pour mieux apprécier les méthodes de dissimulation de Nestlé. Il aura ainsi fallu attendre le déplacement de la commission en Haute-Savoie et sa suggestion pour que les services de l'État de Haute-Savoie communiquent avec ceux du Gard. Dès lors, chaque préfecture, méconnaissant les techniques de tromperie, pouvait se sentir « à l'aveugle » sur ce sujet.
Il est probable que la fragilité des moyens des préfectures et des ARS n'est pas pour rien dans cette absence de réactivité.
Enfin, tout le dossier démontre, au niveau national comme local, une faille en termes de culture professionnelle : l'absence de culture du suivi des actions de l'État. Deux exemples très significatifs suffisent à s'en convaincre. Le 13 octobre 2022, en réponse à une note des conseillers au cabinet de la Première ministre, Victor Blonde et Cédric Arcos, le directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, indique : « accord pour préconisations, signaler grande sensibilité aux ARS et préfectures ». Parmi ces préconisations, il y a celle de « demander à l'industriel de fournir sous un mois aux ARS toutes les données permettant d'évaluer l'effet du filtrage à 0,2 micron sur la qualité microbiologique de l'eau ». Lors de son audition du 30 avril 2025, interrogé sur ce point, Aurélien Rousseau reconnaît n'avoir jamais eu de retour sur ces données qui devaient être fournies sous un mois, alors même que de cette information dépendait tout le reste, et notamment l'autorisation d'user de la microfiltration.
Deuxième exemple, le bleu de Matignon de février 2023 « demande au Secrétariat général des affaires européennes de conduire une analyse de la situation de la microfiltration et des pratiques existantes dans les autres pays de l'Union afin, le cas échéant, d'envisager de solliciter la commission pour une évolution de la réglementation communautaire ou en vue d'une saisine de l'EFSA. ». Cette analyse ne sera jamais réalisée.
Dans les deux cas, nous sommes face à une décision du cabinet de la Première ministre. Dans les deux cas, la réponse peut avoir une influence déterminante sur les suites du dossier des eaux minérales. Et, dans les deux cas, la demande de Matignon ne fait l'objet d'aucun suivi. Elle est purement et simplement ignorée.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
3 |
Donner instruction aux préfets, en lien avec les ARS, de vérifier, sur la base de l'expérience acquise dans les établissements Nestlé Waters et Alma, l'absence de traitements interdits, sur les sites minéraliers de France |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
Immédiat |
Instruction |
|
4 |
Animer régulièrement le réseau des contrôleurs des eaux minérales (préfets et services départementaux de l'État, ARS) pour partager, enjeux, évolutions et expériences |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
Immédiat |
Conduite de l'action administrative |
J. UN DIXIÈME DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE DES MINISTRES DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL
L'un des enjeux de notre commission était de connaître le niveau auquel s'était jouée l'affaire des eaux minérales. L'un de ses constats les plus notables est celui de la quasi-absence des ministres dans le processus décisionnel.
L'absence de l'autorité politique est particulièrement marquante pour les ministres chargés de la consommation et de la santé.
S'agissant de la consommation, les ministres n'apparaissent jamais dans la documentation. Leurs cabinets sont peu présents, rapidement exclus du processus de décision et n'évoquent jamais l'autorité ministérielle.
Loïc Tanguy, conseiller consommation et pratiques commerciales auprès des ministres chargés de la consommation entre juillet 2020 et mai 2022, Alain Griset51(*) et Jean-Baptiste Lemoyne52(*), n'est ainsi pas convié à la réunion du 31 août au cabinet de la ministre de l'industrie et ne semble informé du dossier qu'à la mi-septembre 2021, par la réception de la note du 14 septembre adressée par la directrice générale de la DGCCRF à la ministre chargée de l'industrie. Le ministre de la consommation, au contraire de sa collègue de l'industrie, n'est même pas convié à signer la lettre de mission de l'Igas, le 19 novembre 2021, alors même qu'elle évoque clairement une « tromperie du consommateur ». Si l'on s'en tient à ses réponses écrites à la commission d'enquête, Alain Griset n'a été ni informé de la réunion du 31 août 2021, ni associé à la décision de lancer la mission Igas, ni informé de son lancement. Entendu par la commission, Loïc Tanguy a affirmé que les ministres avec lesquels il avait travaillé n'avaient été amenés à prendre aucun arbitrage politique.
Ni arbitrage, ni même information si l'on en croit Alain Griset qui indique par écrit à la commission : « Entre le 06 juillet 2020, date de ma nomination, et le 09 décembre 2021, date de mon départ du ministère, je n'ai eu d'aucune façon connaissance de ce dossier. Ni M. Le Maire, mon ministre de tutelle, ni Mme Pannier-Runacher ne m'ont parlé de ce dossier et je n'ai eu aucune information en provenance de leurs cabinets. »
Interrogé par écrit par la commission, Jean Baptiste Lemoyne, qui lui succède, relève : « Ce n'est qu'avec les travaux de la commission d'enquête sénatoriale que j'ai pris connaissance du dossier Nestlé Waters ». Il ajoute : « Je n'ai pas eu connaissance d'éléments spécifiques à ce dossier pendant les 6 mois au cours desquels j'ai exercé (...) ». Il note que : « Lors de la passation de pouvoir, au lendemain de ma nomination intervenue le 8 décembre 2021, à aucun moment ce dossier n'a été évoqué par mon prédécesseur ni par le ministre de tutelle, ministre de l'économie, des finances et de la relance, ni par ma collègue ministre déléguée à l'industrie, ni par leurs cabinets respectifs. ». De manière significative, il fait valoir que le « dossier ministre » qui lui a été remis à son entrée en fonction ne comportait pas, selon son souvenir « d'éléments spécifiques à ce sujet ».
Jérôme Vidal, qui occupait les mêmes fonctions que Loïc Tanguy au cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée de la consommation entre juillet 2022 et juin 2024, confirme la non-implication de sa ministre. À la question « Votre ministre s'est-elle positionnée à un moment ou à un autre sur ce dossier ? », la réponse est nette : « Non, ma ministre ne s'est pas positionnée sur ce sujet en raison du contexte dans lequel il s'inscrivait, à savoir l'existence d'enquêtes en cours menées par la DGCCRF. ». Il indique qu'il n'a pas informé la ministre de l'affaire Nestlé, et qu'elle n'a été destinataire d'aucune information spécifique sur ce dossier ni n'a rendu aucun arbitrage à son sujet. À la question « En définitive, toutes les décisions se sont prises au niveau des cabinets ministériels, en excluant le vôtre », la réponse est tout aussi nette : « Entre juillet 2022 et juin 2024, oui. » Ces éléments sont confirmés par les réponses de l'ancienne ministre au questionnaire de la commission : « Je n'ai, en tant que ministre déléguée, pas été informée d'un dossier « Nestlé Waters », ni par mon cabinet, ni par l'entreprise, ni par un autre ministre. Je n'ai reçu aucun élément de la part de mon prédécesseur. »
S'agissant de la santé, la plupart des titulaires de la fonction semble n'avoir gardé qu'un souvenir lointain d'un dossier pourtant éminemment sensible. Si Olivier Véran, ministre chargé des solidarités et de la santé de février 2020 à mai 2022, reconnaît avoir été informé du sujet le 27 septembre 2021 par une note transmise par la DGS, ses réponses écrites à la commission laissent entendre qu'il s'est contenté de valider les propositions de son administration pendant la période, en particulier la saisine de l'Igas.
Brigitte Bourguignon qui lui succède brièvement53(*) indique de son côté : « Dans le cadre de mes fonctions de ministre de la santé et de la prévention du 20 mai au 4 juillet 2022, je n'ai pas été amenée à traiter du dossier des eaux minérales naturelles. D'ailleurs dans le dossier ministre de la direction générale de la santé, ce dossier n'était pas mentionné ».
François Braun54(*), qui lui succède, note : « Je n'ai reçu aucune information de la part de ma prédécesseure sur ce dossier. Mon équipe en a été informée, pour sa part, quelques jours après ma prise de fonctions, au début du mois de juillet 2022, par une sollicitation de l'ARS Grand Est. Puis par la communication du rapport de l'Igas. » Il ajoute « je ne crois pas avoir identifié de point de vigilance particulier à ce sujet dans les différents dossiers » du « dossier ministre » reçu à son entrée en fonctions au ministère de la santé.
Plus significatif encore, il affirme n'avoir donné aucune instruction sur ce sujet ni à son cabinet, ni à la DGS ni à sa ministre déléguée, Agnès Firmin Le Bodo. S'agissant des informations portées à sa connaissance, il souligne : « Les éléments qui m'ont été transmis à l'époque étaient factuels : inspection en cours à la suite des révélations intervenues avant ma prise de fonctions, mobilisation conjointe de l'Igas et des ARS. Il nous a été précisé que le sujet ne portait pas sur un risque sanitaire, mais sur une tromperie du consommateur, justifiant la saisine du Parquet au titre de l'article 40. Le dossier ayant été rapidement confié à la ministre déléguée Agnès Firmin Le Bodo, je n'en ai pas su davantage à mon niveau ».
Pour Aurélien Rousseau55(*) en sa qualité de ministre de la santé, le dossier était comme réglé par la concertation interministérielle de février 2023, intervenue alors qu'il était directeur de cabinet de la Première ministre.
Agnès Firmin Le Bodo56(*) affirme avoir été informée du dossier par sa directrice de cabinet Isabelle Epaillard « au début du mois de septembre 2022, lors d'un échange préparatoire aux travaux de la semaine à venir. ». Elle relève néanmoins n'avoir participé à aucune réunion de ministres sur le sujet, en la justifiant par le fait que sa directrice de cabinet faisait « régulièrement le point, à chaque évolution ou lorsque ma directrice de cabinet estimait qu'une mise à jour était nécessaire ». En fait, au cours de son audition, si elle affirme avoir été « informée de ce dossier de manière très régulière » par sa directrice de cabinet, l'ancienne ministre reconnaît que l'essentiel du dossier a été géré par Isabelle Epaillard : « Ce dossier a été géré avec la plus grande rigueur par ma directrice de cabinet, en qui j'avais toute confiance ». Elle précise : « je n'ai effectivement pas exercé d'arbitrage politique, dans la mesure où le risque sanitaire était inexistant. ». Comme on l'a vu, cette appréciation sur l'absence de risque sanitaire est très contestable.
De son côté, Isabelle Epaillard est encore
plus nette quant à la faible implication de la ministre. En
témoigne l'échange suivant avec le
rapporteur : « M. Alexandre Ouizille,
rapporteur. - Oui, l'administration propose et les politiques
décident, mais avez-vous des échanges avec votre
ministre ?
Mme Isabelle Epaillard. - Non, je n'ai pas eu
d'échange avec la ministre.
M. Alexandre Ouizille,
rapporteur. - À aucun moment, sur ce
dossier ?
Mme Isabelle Epaillard. - Compte tenu de la
façon dont je travaillais avec Mme Firmin Le Bodo, j'ai dû
aborder le dossier, mais les arbitrages sont restés à mon
niveau.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Il n'y a jamais eu
d'arbitrage à son niveau ?
Mme Isabelle Epaillard. -
Non. »
La faible mobilisation de l'autorité politique en charge de la santé se poursuit même après les révélations de presse sur le scandale en janvier 2024. Frédéric Valletoux57(*), interrogé par la commission, note : « Le dossier Nestlé Waters a été prioritairement suivi par mon cabinet. Dès mon arrivée, et par souci de transparence, je m'inscris favorablement à la publication du rapport Igas de 2022 sur les eaux embouteillées, maintenu confidentiel jusqu'alors. Bien que la direction générale de la santé, en tant qu'administration en charge des sujets liés à l'eau, ait assuré la coordination globale du dossier et son pilotage opérationnel, je restais destinataire ponctuellement de points d'étape sur ce sujet. Pour autant, je n'ai jamais participé à une réunion spécifique sur ce sujet. »
Geneviève Darrieussecq58(*) adopte le même positionnement : « Dans l'exercice de mes fonctions, je ne suis pas amenée à me prononcer directement sur le dossier des eaux conditionnées. Mon cabinet est saisi par le cabinet du Premier ministre en octobre 2024 afin de faire un état des lieux du dossier « Nestlé Waters ». Dans la perspective de l'échange, qui s'est tenu à Matignon le 31 octobre 2024, mon cabinet produit une note reprenant les éléments saillants du dossier. »
Enfin, s'agissant de Matignon, Cédric Arcos, conseiller santé d'Élisabeth Borne, affirme avec netteté : « en ce qui nous concerne, à aucun moment la Première ministre n'a été tenue informée. Nous avons estimé à notre niveau qu'il n'était pas nécessaire de faire remonter le dossier. En revanche, nous informons régulièrement notre directeur de cabinet sur les différents dossiers. ». Aurélien Rousseau, alors directeur de cabinet de la Première ministre, confirme ce point devant la commission : « Dans la période où j'étais directeur de cabinet, je n'ai jamais évoqué ce sujet avec la Première ministre ».
En bref, les cabinets ministériels prennent les décisions et arbitrages, produisent des notes et les transmettent aux ministres qui, éventuellement, les lisent.
Le cas de l'industrie est différent. D'abord, parce que ce ministère a été la porte d'entrée de Nestlé au sein de l'État. L'industriel escomptait un intérêt ou, au moins une certaine attention et une indulgence, de la part des ministres de l'industrie. Il n'a pas été déçu.
Le lendemain de la réunion du 31 août 2021 à son cabinet, la ministre de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, reçoit un compte-rendu de son directeur de cabinet. En retour, le 6 septembre, la ministre donne pour seules instructions : « me tenir au courant » ; « ça vaudrait le coup de vérifier que des pratiques équivalentes n'existent pas chez leurs concurrents »59(*). S'y ajoute surtout, une minimisation du risque sanitaire qui suivra cette affaire pendant toute sa durée : « Si je comprends bien on est plutôt sur la tromperie commerciale que sur un sujet de sécurité alimentaire ? ». Par la suite, les interventions de la ministre se résumeront à deux faits saillants :
- sa participation à une des réunions mensuelles avec la directrice générale de la DGCCRF où le sujet sera évoqué et où, selon Lucile Poivert, alors conseillère santé et biens de consommation à son cabinet, « il a été décidé de prendre contact avec le ministère de la santé, de mon côté au niveau du cabinet et du côté des services avec la DGS. »
- la signature de la lettre de mission de l'Igas, le 19 novembre 2021.
En revanche, la ministre ne donne aucune instruction visant, soit à la saisine immédiate de la Justice au titre de l'article 40, soit à l'arrêt conservatoire de production, soit à une mise en demeure de l'industriel de cesser les traitements interdits. Entendue par la commission, la ministre affirme : « J'ai mis la police (la DGCCRF) sur le coup ». Or, s'il s'agit de la DGCCRF dans ses compétences administratives, il ne s'est rien passé. Et s'il s'agit de la DGCCRF (et de son service national d'enquêtes) dans ses compétences judiciaires, l'activer ne relevait pas de la ministre, mais de l'autorité judiciaire.
Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie du 4 juillet 2022 au 8 janvier 2024 puis du 8 février 2024 au 5 septembre 2024, et donc en fonctions pendant une large part de « l'affaire » indique : « Sur Nestlé Waters, j'ai été sollicité par mon équipe pour valider la position, commune avec le ministère de la santé qui remonterait à l'arbitrage de Matignon, à partir de décembre 2022. C'est en décembre 2022 que mon équipe demande à me voir pour évoquer ce dossier et préparer la position du ministère en vue d'une réunion organisée par Matignon. Mes collaborateurs viennent d'apprendre par le ministère de la santé que l'eau du principal forage d'Hépar n'est pas pure à l'émergence. ». Pour le reste, Roland Lescure assume l'ensemble des décisions prises par son cabinet, mais son nom n'apparaît pratiquement pas dans les documents reçus par la commission. De fait, la quasi-totalité du dossier est traitée de cabinet à cabinet.
K. DES DÉFICIENCES STRUCTURELLES ? LA DÉCOUVERTE DE « L'AFFAIRE MAYOTTE »
1. Une affaire qui paraît d'abord concerner uniquement Mayotte...
Au cours de ses travaux, alerté par notre collègue Saïd Omar Oili, sénateur de Mayotte et membre de la commission, le rapporteur a eu connaissance d'une autre affaire relative aux eaux en bouteille distribuées à Mayotte qui l'a conduit à s'interroger sur l'existence d'éventuelles déficiences structurelles dans les contrôles. Il a aussitôt saisi Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins et Manuel Valls, ministre d'État, ministre des outre-mer.
Des informations recueillies, il ressort que des signalements ont été effectués faisant état d'odeurs d'hydrocarbures ou de moisissures sur des bouteilles acheminées et stockées à Mayotte dans le cadre de la gestion de la crise de l'eau qu'a connue ce territoire en 2023-2024, notamment les bouteilles de la marque Cristaline, produites par le groupe Alma. Or, la majorité des 11 millions de bouteilles envoyées depuis la métropole, La Réunion ou l'île Maurice pendant cette crise ont été distribuées à la population par l'État.
Depuis le 10 mars 2024, la distribution et l'importation ont été arrêtées. Il restait alors environ 1,4 million de bouteilles, stockées principalement au port de Longoni, à l'aéroport de Pamandzi et à l'hôpital de Pamandzi sur Petite-Terre.
Pourtant, dès le mois de janvier 2024, l'ARS de Mayotte avait été destinataire de plusieurs signalements oraux ou par courriels (plus d'une dizaine) concernant les bouteilles d'eau Cristaline distribuées par l'État se plaignant d'une eau avec un goût de « moisi » ou d'hydrocarbure. Plus grave encore, un signalement effectué en février 2024 par la Sécurité civile a fait état, en plus des problèmes organoleptiques, d'une contamination bactérienne en lien avec la présence de coliformes fécaux sur des lots Cristaline du même stock.
À la suite de ces signalements, l'ARS de Mayotte a fait analyser ces échantillons par des laboratoires et ceux-ci ont confirmé la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur plus de cinq lots de la marque Cristaline analysés. Selon l'ARS, ces analyses ont également montré des taux très élevés de bactéries revivifiables à 36°C et 22°C, là encore sur cinq lots de la marque Cristaline, sans relever toutefois de présence de bactéries coliformes fécales.
Saisie par l'ARS Mayotte, la direction générale de la santé a lancé une enquête en lien avec Alma, producteur de l'eau Cristaline et les ARS concernées par ses sites de production. Selon la DGS, ces investigations n'ont relevé aucun problème sur la ressource, le traitement, le conditionnement et le stockage sur les sites de production en lien avec les contaminations (hydrocarbure ou bactériologique). Il a donc été décidé, d'un commun accord entre la DGS et l'ARS Mayotte, d'élaborer un plan d'échantillonnage des eaux embouteillées sur les différents sites de stockage à Mayotte, afin de poursuivre les investigations sur les eaux stockées sur le territoire.
Il a alors été constaté que les conditions de stockage en conteneurs (humidité, forte chaleur) au port de Longoni et à l'aéroport de Pamandzi avaient favorisé un développement conséquent de moisissures sur les packs d'eau. Par conséquent, environ 700 000 bouteilles stockées dans ces deux lieux ont été déclarées impropres à la consommation humaine. Les tests réalisés sur les bouteilles stockées à l'hôpital de Pamandzi ont fait l'objet de tests organoleptiques et d'analyses pour la recherche d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui se sont pour leur part révélés négatifs et ces bouteilles ont pu être distribuées, notamment à la suite du passage du cyclone Chido.
Cette découverte témoigne indiscutablement de la nécessité d'améliorer la gestion des stocks d'eau de l'État et des commerces dans les outre-mer.
Si les services de l'État ont accompli leurs diligences rapidement, il n'en reste pas moins que, selon de nombreux témoignages, de grandes quantités de bouteilles ont pu être distribuées sur place avant leur intervention.
Par ailleurs, il s'est rapidement avéré que le problème n'était pas uniquement dû au stockage de ces bouteilles dans des conditions inadaptées d'humidité et de forte chaleur et que le producteur Alma avait également une forte part de responsabilité.
2. ... et qui révèle finalement un problème à l'échelon national
À la suite d'un signalement de consommateur transmis par l'ARS de la région Auvergne Rhône Alpes en septembre 2024 - soit neuf mois après les signalements à Mayotte ! - concernant la mauvaise odeur d'une bouteille d'eau Cristaline, la DGS a interrogé la totalité des ARS afin de recenser de manière exhaustive les plaintes de consommateurs d'eau de source de la marque. Sollicité également, le groupe Alma a alors avoué qu'il avait reçu plusieurs centaines de signalement, notamment depuis le mois d'août 2024, ce qu'il s'était abstenu de faire de sa propre initiative.
La commission d'enquête note donc que le groupe Alma s'est une nouvelle fois abstenu de révéler aux autorités des informations importantes qui remettaient en cause la qualité de ses produits.
Toutes les ARS ayant fait état d'analyses du contrôle sanitaire conformes et n'ayant pas été informées d'incidents dans la chaîne de production des eaux, les investigations se sont portées sur les phases ultérieures de stockage, sous l'égide de la DGCCRF. Celles-ci ont conduit à mettre en lumière une dégradation des intercalaires utilisés pour la palettisation des lots en sortie d'usine de conditionnement, ce qui occasionnait un développement de moisissures pouvant altérer le goût et l'odeur de l'eau.
Ces intercalaires de mauvaise qualité du fournisseur d'Alma ont probablement amplifié les phénomènes de moisissure qui peuvent survenir pendant les phases logistiques de transport et de stockage de ces palettes avant la mise en rayons des bouteilles Cristaline.
À la suite de cette découverte, le groupe Alma a mis en place une communication auprès de ses clients de la grande distribution et des consommateurs et les lots stockés ont fait l'objet d'un retrait.
Ces nouvelles difficultés apparues avec le groupe Alma démontrent qu'il est essentiel que les producteurs d'eau en bouteille veillent à l'adéquation entre les conditions de stockage des eaux embouteillées et les matériaux utilisés pour les bouteilles, le conditionnement très fin des bouteilles de la marque Cristalline constituant vraisemblablement une source de fragilité.
Il faudra donc qu'Alma prouve dans les mois à venir à la direction générale de la santé que sa bouteille garantit la conformité et la stabilité de l'eau contenue, en fonction des conditions de stockage et de transports optimales et prévisibles et cela jusqu'à la Date de Durabilité Minimale (DDM) annoncée par l'opérateur sur chacune des bouteilles (date de fabrication du lot + 2 ans).
Ce nouvel exemple montre, en premier lieu, que les délais d'intervention des services de l'État même en cas d'urgence, consistant à stopper la distribution d'une eau présentant des problèmes, sont encore trop importants et, en second lieu, que les mesures ultérieures consistant à s'assurer structurellement de la qualité de l'eau et de son contenant, mettent trop de temps à être accomplies.
Il montre aussi que les conditions de fourniture, le conditionnement et le stockage des réserves d'eau de l'État doivent être réexaminées, dans la mesure où elles peuvent ne pas être idéales en termes de résilience.
L. LES LIAISONS DANGEREUSES ÉTAT - NESTLÉ : OÙ COMMENT ÉDULCORER UN RAPPORT OFFICIEL À LA DEMANDE D'UN INDUSTRIEL
|
La commission d'enquête a été saisie à la toute fin de ses travaux par un lanceur d'alerte dont elle a vérifié l'identité sur un épisode qui illustre parfaitement les dysfonctionnements de l'action de l'État et les pratiques d'un industriel. Compte tenu de la gravité des révélations faites, le rapporteur a souhaité les présenter de manière complète. · La préparation d'un Coderst important pour Nestlé Waters et sa nouvelle marque « Maison Perrier » Tout commence fin 2023 alors que se prépare la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du Gard. Présidé par le préfet ou son représentant, le Coderst est composé de membres issus des services de l'État, des collectivités territoriales, d'associations de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, d'experts et de personnalités qualifiées. Il est chargé d'émettre des avis sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, d'eaux destinées à la consommation humaine et de police de l'eau et des milieux aquatiques. En l'espèce, le Coderst doit, à la mi-décembre 2023, examiner un rapport de l'ARS relatif à deux demandes de Nestlé Waters : - la première pour autoriser l'utilisation de l'eau prélevée sur les captages Romaine III et Romaine V, qui ne sont plus en capacité de produire de l'eau minérale naturelle faute de pureté suffisante, pour produire exclusivement de l'eau destinée à la consommation humaine à des fins alimentaires, pour la préparation de boissons. Il s'agit de l'eau de « Maison Perrier » qui est traité et aromatisée ; - la seconde demande porte sur l'évolution du mélange d'eau de la source d'eau minérale naturelle Perrier et le retrait du mélange Source Perrier des eaux issues des forages Romaine III et Romaine V. · La volonté de Nestlé Waters de faire modifier le rapport La 29 novembre 2023, le directeur général de l'ARS reçoit de Muriel Lienau, présidente de Nestlé Waters, un courriel lui faisant part de la préoccupation de l'industriel à l'égard du rapport préparé par les services de l'État et sollicite un entretien sur le sujet. Dans un premier temps, le même jour, le directeur général de l'ARS réagit logiquement et écarte la demande de Muriel Lienau. · La réaction de l'État : la chaîne décisionnelle reprend les exigences de l'industriel Tout bascule le 1er décembre. Ce jour-là, à la suite de sollicitations de Nestlé Waters, le cabinet de la ministre de la santé, par la voix de Pierre Breton, s'inquiète. Voici le récit qu'en fait Didier Jaffre, le directeur général de l'ARS : « En date du vendredi 1er décembre 2023, par téléphone, le conseiller de la Ministre déléguée OTPS, Monsieur Pierre Breton a demandé à me joindre pour échanger sur Nestlé, m'indiquant qu'apparemment il y avait un sujet sur un document qui devait être communiqué en vue du CODERST. Je lui ai fait part de mes échanges avec Madame Lienau en indiquant ses préoccupations sur le projet de rapport et que nous étions en train d'analyser sa demande de modification. » Des réponses fournies par Isabelle Epaillard, ancienne directrice de cabinet de la ministre déléguée, supérieure hiérarchique de Pierre Breton, on déduit que ce dernier a été informé par Mathilde Bouchardon, conseillère au cabinet du ministre délégué chargé de l'Industrie, d'un échange avec Nestlé Waters, le 30 novembre 2023 à propos du futur Coderst. Isabelle Epaillard s'efforce de minimiser le rôle du cabinet qu'elle dirigeait alors : « il n'y a pas eu d'instruction passée à l'ARS Occitanie » indique-t-elle à la commission. À tout le moins Pierre Breton l'informe-t-il de la situation après avoir contacté les autorités locales. Il lui écrit le 1er décembre à 15h11 : « Tu verras dans les échanges ci-après que j'ai demandé à Didier, que le groupe souhaite que ne soit pas fait état de ces résultats. ». Pierre Breton poursuit : « Après avoir eu au téléphone Didier, je comprends, à la différence de son mail ci-après que ces équipes ne feront pas état de ces mesures dans le document qui sera transmis en amont du CODERST.». Le lecteur comprend donc que le cabinet s'est effectivement inquiété de la teneur du projet de rapport auprès du directeur général de l'ARS, mais que celui-ci l'a rassuré : le projet va être modifié dans le sens souhaité par l'industriel. Parallèlement, des courriels reçus par la commission indiquent que le préfet a contacté l'ARS. Cristelle Duclos, responsable de sa cellule environnementale en rend compte à Guillaume Dubois, directeur de l'ARS pour le Gard, par un courriel du 1er décembre à 11h54 et propose quelques modifications pour « édulcorer » le rapport. De son côté, Guillaume Dubois répercute à Didier Jaffre et évoque une discussion - non-confirmée - entre le préfet et l'industriel : « Bonjour j'ai eu le préfet au téléphone ce matin qui m'a interrogé sur les trois points ci-dessous en exigeant une réponse ce jour, je me suis voulu rassurant sur les analyses de la qualité de l'eau et le point sur lequel il a insisté lourdement est le dernier point à savoir les éléments antérieurs portant atteinte à l'image de Perrier ; nous proposons cette version en rouge, mais on ne peut pas aller au-delà. Si cela ne convient pas au préfet il faudra que tu l'appelles, il a dû avoir les dirigeants du groupe au téléphone et je crains qu'il ait pris des engagements un peu à la va vite. Rien ne part auprès du préfet tant que tu n'as pas validé bien sûr les éléments de réponse, mais je pense quand même qu'un coup de fil ta part soit nécessaire au regard de la pression que j'ai constatée de sa part. » À 12h21, le directeur général de l'ARS indique à son directeur départemental du Gard : « Pour ma part, j'ai eu le cabinet de la ministre (Pierre Breton au cabinet d'Agnès Firmin Le Bodo), la présidente (Muriel Lienau) et le Préfet (Jérôme Bonet). Nous regardons les documents avant envoi. ». Le directeur général de l'ARS, interrogé sur ce sujet, minimise la portée de cet échange et affirme ne pas avoir reçu de demandes du cabinet de la ministre. Il minimise aussi la portée des modifications. Pourtant, les faits sont là : le rapport est amendé. Les premières modifications proposées par Cristelle Duclos ne doivent cependant pas suffire à Nestlé Waters, car l'industriel revient à la charge en fin d'après-midi, cette fois sans risque d'être contredit par l'État. À 18h25, c'est donc le directeur industriel de Nestlé Waters lui-même, Ronan Le Fanic, qui transmet tout bonnement à l'ARS une série de nouveaux paragraphes à substituer à ceux qui étaient initialement prévus. Objectif : il s'agit pour Nestlé Waters de dissimuler la contamination par des bactéries E. Coli et Entérocoques intestinaux, mais aussi par des herbicides et des métabolites de pesticides, fongicides, et herbicides, parfois interdits depuis des années. Par ailleurs, des paragraphes sont ajoutées pour valoriser... le bon comportement de l'industriel. Le 4 décembre 2023, l'un des fonctionnaires chargés de la rédaction du rapport s'émeut dans un courriel à Catherine Choma, directrice de la santé publique de l'ARS Occitanie : « Je n'ai pas d'avis sur cette contre-proposition du rapport CODERST qui va pouvoir être transmis à la préfecture, à la seule précision qu'il ne correspond plus vraiment aux éléments rapportés dans le dossier par le pétitionnaire et repris par l'expert hydrogéologue agréé, et à la synthèse que je rapportais. Dans ce cas, je souhaite retirer ma signature du rapport, signature non indispensable et qui n'est pas bloquant pour la suite. ». Du côté des représentants de l'État, le dossier semble clos à la satisfaction de tous. En témoignent les courriels de Didier Jaffre au préfet et à Pierre Breton. Au premier, le directeur général de l'ARS écrit, le 4 décembre à 16h33 : « Bjr Jérôme, Je confirme que j'ai eu la présidente de NW ce we pour valider ensemble le document présenté au CODERST ; il n'y a donc plus de sujet sur le document, on peut l'envoyer aux membres du CODERST. Je lui ai aussi demandé leurs EDL pour la suite que je partage avec toi. De manière à être bien raccord pour la suite des évènements ». Au second, il précise quelques minutes plus tard, à 16h36 : « Rebjr Pierre, Donc ci-dessous mes échanges avec le Préfet, et avec la Pdte de NW ; nous avons modifié ensemble le document qui sera envoyé au CODERST, et donc plus de sujet sur le document ; passage en CODERST le 12 décembre prochain. Ensuite j'ai demandé à la prdte ses EDL pour qu'on les partage et qu'on soit raccord pour la suite (...) ». Le 13 décembre, de fait, le rapport présenté en Coderst ne mentionne ni la signature du fonctionnaire instructeur ni les éléments qui chagrinaient Nestlé Waters. Et cela semble satisfaire le directeur général de l'ARS qui informe Pierre Breton le jour même : « Encore une étape de franchie concernant Perrier. » Les modifications du rapport sont présentées dans le tableau comparatif ci-après : · Comment en est-on arrivé là ? Tous les dysfonctionnements décrits dans ce rapport sont présents : pression de l'industriel, porosité du cabinet ministériel à ses exigences, faiblesse de la direction de cabinet, qui a minima laisse faire, absence de résistance de l'État local. Au départ, on note, comme souvent dans cette affaire, une sollicitation pressante de Nestlé Waters, retransmise par Mathilde Bouchardon, du cabinet de l'industrie, qui renvoie, sans doute avec des arguments pesants, au cabinet de la santé qui répercute à l'ARS et au préfet, lesquels s'alignent rapidement sur les volontés de l'industriel. · Quels sont les mobiles ? Pour Nestlé Waters, il s'agit d'éviter les fuites du Coderst et notamment de dissimuler la situation de ses forages aux représentants des associations de consommateurs. On peut s'interroger sur cette attitude s'agissant de forages dont on connaissait la contamination, raison de leur basculement de l'eau minérale naturelle « Perrier » vers l'eau traitée et désinfectée, « Maison Perrier ». Elle illustre une culture professionnelle de l'absence de transparence et une volonté constante de dissimulation. Pour l'État, la réponse nous est donnée par Pierre Breton, à Isabelle Epaillard : « À ce stade, le risque serait qu'on nous reproche d'avoir autorisé pendant 3 ans l'exploitation en EMN de ces forages alors qu'il y avait une contamination qui était circonscrite par des traitements non réglementairement autorisés. Aussi, à partir du moment où il n'est réglementairement pas obligatoire de rentrer dans ces détails pour le CODERST (qui s'intéresse surtout à la quantité de la ressource), je suis d'avis de ne pas trop faire sortir d'informations sur ce sujet. Par ailleurs, une deuxième attaque est à craindre concernant la disponibilité de la ressource. En effet, dans un contexte de sécheresse mais également au regard des sorties de Didier (consommer des eaux en bouteille au lieu du robinet), nous pouvons craindre que le projet de Nestlé « maison Perrier » consistant à produire une eau rendu potable par traitement (eau de boisson) à destination des USA soit fortement critiqué par les médias. Quant à l'État il pourrait être accusé de cautionner sans rien faire... ». Tout est dit. |
PARTIE II
COMPRENDRE LES
DESSOUS D'UNE CRISE
Au-delà des dysfonctionnements identifiés, la commission d'enquête s'est efforcée de comprendre les logiques ayant permis à l'affaire des eaux minérales d'exister et de perdurer. Elle a analysé les raisons de la mise en place de traitements interdits et de l'insistance de Nestlé Waters sur la microfiltration à 0,2 micron (I) et constaté que l'État central, divisé sur le sujet, avait fini par faire prévaloir l'intérêt d'un industriel sur celui des consommateurs (II). Ce même État central a laissé les services locaux de l'État, mal armés, livrés à eux-mêmes et confrontés à des injonctions contradictoires (III).
I. DES
TRAITEMENTS INTERDITS À LA MICROFILTRATION :
LE POURQUOI D'UNE
STRATÉGIE INDUSTRIELLE DEVOYÉE
A. LES TRAITEMENTS INTERDITS : UNE RÉPONSE NON GÉNÉRALISÉE DE CERTAINS INDUSTRIELS CONFRONTÉS À UNE DÉGRADATION DE LA RESSOURCE ET/OU À DES PROCESSUS DE PRODUCTION DÉFICIENTS ?
1. Le cas particulier de deux industriels
À la connaissance de la commission d'enquête, deux industriels des eaux minérales naturelles et de source ont utilisé des traitements strictement interdits par la règlementation : Alma Sources et Nestlé Waters.
a) Le cas d'Alma Sources
Comme mentionné précédemment, la société commerciale des eaux du bassin de Vichy, filiale du groupe Alma, a fait l'objet d'une enquête du SNE à partir de janvier 2020, à la suite d'une alerte dès octobre 2019 d'un salarié du groupe aux services de l'ARS de l'Allier. Des opérations de visite et de saisie simultanées ont eu lieu le 10 décembre 2020 dans les usines de St-Yorre et de Châteldon.
Les pratiques constatées lors de l'opération de visite et de saisine par les agents de la DGCCRF consistaient en l'injection illicite de sulfate de fer60(*) dans l'objectif de faire baisser le taux d'arsenic naturel présent dans les sources, l'adjonction masquée de CO2, la modification des résultats d'analyses non-conformes des eaux.
Interrogé sur l'intérêt de l'injection de sulfate de fer lors de son audition par la commission d'enquête le 12 février 2025, Luc Baeyens, directeur général de Sources Alma a indiqué : « Cela va sans doute vous paraître ridicule, mais ce procédé ne servait à rien. J'ai immédiatement fait retirer ce dispositif dont j'ignorais totalement l'existence, respectant ainsi l'arrêté préfectoral et permettant à l'usine de redémarrer sans problème particulier. ». Le procureur de Cusset, à qui la DGCCRF, via le SNE, avait transmis des éléments dans le cadre de son enquête, a indiqué à la commission d'enquête n'avoir pas donné suite au dossier.
La commission d'enquête a visité, avec les services de l'État, l'usine du groupe Alma située à Thonon-les-Bains, productrice de l'eau « Thonon ». Il en ressort, sauf vérifications plus approfondies à mener par lesdits services, que cette usine ne faisait usage ni des traitements interdits ni de la microfiltration à 0,2 micron.
b) Le cas de Nestlé Waters
L'entreprise Nestlé Waters s'est, quant à elle, présentée au cabinet de la ministre de l'industrie le 31 août 2021 pour l'informer de l'utilisation sur ses sites de Vergèze, de Vittel et de Contrexéville de traitements interdits, filtres à charbon actif, lampes à UV, ainsi que de microfiltres à 0,2 micron dont la légalité n'était pas assurée et, en tout état de cause, non autorisés par l'arrêté préfectoral d'exploitation.
Dans le Grand Est, les traitements interdits étaient les suivants : filtres à charbon actif à Vittel Grande Source61(*), traitement par lampe à UV sur la source Essar d'Hépar62(*), traitement par lampe à UV sur les sources Belle-Lorraine et Thierry Lorraine pour Contrex63(*). S'y ajoutait, ici encore, des microfiltrations à 0,2 ou 0,45 micron sur les émergences Peulin, Ermitage pour Hépar et Grande Source pour Vittel.
Le rapport d'intervention du SNE daté du 12 avril 2023 indique que, selon les responsables de Nestlé, les filtres à charbon étaient antérieurs à leur rachat des installations d'eau conditionnée dans les Vosges en 1992. Les preuves matérielles montrent que certains filtres à charbon ont été installés en 1993 et les lampes à UV changées en 2000.
Dans le Gard, étaient utilisés des filtres à charbon actif et des lampes à UV ainsi qu'une microfiltration à 0,2 micron.
2. Le pourquoi des pratiques : entre dégradation de la ressource, vétusté des installations, vulnérabilité au changement climatique
Pour expliquer le recours aux traitements non conformes des industriels, le rapport de l'Igas remis en 2022 a formulé trois hypothèses : une dégradation des ressources, un vieillissement des installations de captage et d'embouteillage et la sécurisation d'un processus industriel de production de denrées alimentaires. Ces hypothèses sont confirmées par les travaux de la commission qui en a analysé une quatrième, la réduction des temps de nettoyage des tuyauteries et cuves.
a) La dégradation de la ressource
La dégradation de la qualité de la ressource en raison de pollutions est possible. Christophe Poinssot, directeur général délégué au BRGM, expliquait à la commission d'enquête64(*) : « certaines nappes, très réactives, sont assez rapidement contaminées par toute pollution anthropique. La contamination prendra beaucoup plus de temps sur d'autres, à l'inertie beaucoup plus grande. Inversement, il sera plus facile de dépolluer une nappe réactive qu'une nappe inertielle. »
La vulnérabilité d'une nappe à la pollution dépend donc beaucoup de caractéristiques physiques, exogènes à l'activité de production d'eau conditionnée. Comme indiqué par M. Pfund : « À Évian, par exemple, l'impluvium est dans les hauteurs, sur les massifs, et les zones d'émergence sont plutôt dans la plaine. Aussi, l'impluvium est plutôt protégé des activités humaines. En outre, les surfaces agricoles entourant la zone d'émergence sont plutôt petites. La protection est ainsi facilitée. À Vittel-Contrexéville, la configuration est totalement différente : la zone d'émergence est comprise dans la zone des impluviums, en plaine, les émergences ne sont pas toujours très profondes, si bien que la protection naturelle est relativement faible, et les exploitations agricoles sont assez nombreuses. C'est plus compliqué à gérer65(*). »
Les aléas climatiques sont aussi fréquemment mentionnés comme sources de contaminations par les industriels, dont Nestlé Waters pour le site Perrier.
b) La vétusté des installations
Philippe Fehrenbach, ancien directeur du site de Nestlé Waters à Vergèze, a indiqué à la commission d'enquête, s'agissant des forages Romaine III et V (déclassés en « eau de boisson), que « pour les ouvrages eux-mêmes, leur localisation, leur sensibilité, je dois dire que ce sont des forages qui datent. » Sur la « vétusté de l'outil industriel », évoquée par le rapporteur, M. Fehrenbach a précisé : « Je ne parlerais pas de vétusté, mais plutôt de sensibilité. La sensibilité peut être liée à la localisation - il s'agit de karst -, à une fissure, à une pénétration, à n'importe quoi, à une réaction à des phénomènes cévenols qui surviennent une ou deux fois dans l'année, mais tout de même plus fréquemment ces vingt dernières années que par le passé. »
Sur cette question relative à la vétusté de certains forages pouvant potentiellement être une source de contamination de la ressource, David Vivier, ancien directeur industriel de Nestlé Waters et, à ce titre, supérieur hiérarchique des directeurs des usines des Vosges et du Gard, a répondu : « Exactement. Nous avons des forages d'âges variés, certains d'une vingtaine d'années, d'autres d'une dizaine. La vétusté dépend réellement de la manière dont on opère le forage. »
Dans les Vosges, la vétusté des installations était connue de l'ARS, dont la directrice générale écrivait dans une note du 8 novembre 2022 : « Si la contamination est liée à l'ancienneté des ouvrages, l'appellation ne serait pas remise en question, mais les travaux nécessaires impliqueraient des coûts et des délais très importants. »
c) Des processus de production déficients
Nestlé Waters a justifié auprès des autorités la nécessité de « sécuriser » son processus de production à l'aide d'une microfiltration à 0,2 micron. Il s'agirait de prévenir la formation du « biofilm » lié aux installations actuelles, et notamment à leur longueur. Le « biofilm » est un amas structuré de micro-organismes qui se déposent sur la surface interne des canalisations.
Ronan Le Fanic, directeur de l'usine Nestlé Vosges de juin 2019 à avril 2023, a indiqué : « (...) nous voulons (...) pouvoir gérer le biofilm de manière efficace. L'avis de l'Afssa est très clair, la céramique à 0,8 micron que nous vous avons montrée sert à retirer le fer et le manganèse, mais n'élimine pas le biofilm. Or des dossiers techniques justifient que la microfiltration que nous utilisons permet de gérer ce biofilm, qui fait en effet partie de particules relarguées ».
Néanmoins, tous les industriels ne partagent pas ce point de vue sur le traitement du « biofilm ». En Haute-Savoie, la commission d'enquête a constaté que des sites de concurrents utilisant des longueurs de tuyaux analogues, mettent l'accent sur le nettoyage des tuyaux pour prévenir sa formation. Devant la commission d'enquête, Frédéric Lebas, directeur de l'usine d'Évian, a confirmé cette analyse : « Concernant le biofilm, les conduites, depuis l'émergence jusqu'à l'usine, font l'objet de nettoyages réguliers précisément pour éliminer ces dépôts et garantir la qualité de l'eau. »66(*)
d) La réduction des temps de nettoyage des tuyauteries et cuves
Compte tenu, d'une part, de la minéralité des eaux et, d'autre part, du fait que peuvent y subsister des bactéries, les installations des usines d'eau en bouteille doivent faire l'objet de nettoyages fréquents. Dans des sites comme ceux de Nestlé Waters, le programme de nettoyage est automatisé.
Sur les nettoyages pratiqués par Nestlé, David Vivier affirme : « En réalité, nous effectuons énormément de nettoyages sur nos sites. Permettez-moi d'expliquer les raisons qui vont au-delà de la microbiologie. Sur le site des Vosges, nous avons affaire à des eaux très chargées en minéraux. Nous passons beaucoup de temps à nettoyer, car les dépôts minéraux créent du calcaire, formant des structures irrégulières qui sont des pièges parfaits pour les bactéries. Chaque eau et chaque site hydrologique est unique. Nos nettoyages sont très fréquents. Nous avons des cycles de nettoyage déclenchés par des modèles mathématiques. Nous mesurons la teneur en bactéries dans nos tuyaux et déclenchons le nettoyage en fonction de seuils prédéfinis de charge microbienne. Le filtre à 0,2 micron est seulement l'un des éléments qui nous aident à piloter la qualité de l'eau. »
À la question du rapporteur : « Si je comprends bien, ce filtre est intégré dans le modèle mathématique. Il permet probablement de retarder le déclenchement du nettoyage, puisqu'il joue un rôle dans la gestion hydrologique. », David Vivier répond, en forme de confirmation : « Peut-être, mais je tiens à souligner que nous effectuons énormément de nettoyages, particulièrement sur le site des Vosges. »
Il apparaît donc que la microfiltration pourrait être un outil de l'industriel pour réduire la fréquence des nettoyages qui nécessitent des arrêts de production.
3. Il est essentiel de ne pas dénoncer tout un secteur
a) L'analyse par extrapolation de l'Igas
Contrairement à une analyse trop rapide d'un passage dont la rédaction a pu induire en erreur de nombreux lecteurs, le rapport de l'Igas n'affirme pas qu'un tiers des productions d'eaux minérales naturelles et de source en France ont recours à des traitements interdits. Les auteurs de la mission ont mis en évidence les spécificités de leur méthode et certains de ses biais. Malgré des non-conformités entre les pratiques déclarées par les industriels et les conditions d'exploitation prévues par arrêté estimées à 30 % des cas, certains éléments peuvent conduire à atténuer ce constat.
La mission mentionne notamment deux « biais » qui ont pu augmenter le taux facial de non-conformités parmi les 32 inspections menées sur 40 désignations commerciales (DC) :
- d'abord, « pour le traitement des données, la mission a globalisé les traitements pour une dénomination commerciale donnée. » Ainsi, alors que les dénominations commerciales peuvent être issues d'un mélange de ressources, cette globalisation, opérée dans un souci de simplification, a conduit à considérer des ressources ne faisant l'objet d'aucun traitement comme traitée car certaines eaux de la désignation commerciale faisait, elles, bel et bien l'objet d'un traitement67(*) ;
- en outre, l'achat de filtres dont le seuil de coupure est inférieur à 0,8 micron par certains industriels a été communiqué à la mission par la DGCCRF : la mission en conclut que les industriels ayant acheté des filtres réalisaient des pratiques non-conformes. Néanmoins, l'utilisation de ces filtres dans les usines concernées n'a pas été vérifiée par la DGCCRF ni par l'Igas, alors qu'ils peuvent être utilisés, dans le respect de la règlementation, pour traiter des eaux commercialisées à l'export hors de l'Union européenne, à l'instar du marché américain où ils sont autorisés pour les eaux de source ou les eaux minérales, ou pour traiter les eaux industrielles, comme c'est le cas, par exemple, dans l'usine d'Évian.
Lorsqu'elle a pris connaissance de la liste des industriels ayant procédé à l'achat de tels filtres aux seuils de coupure inférieurs à 0,8 micron, la commission d'enquête s'est posé la même question que l'Igas. Elle a néanmoins interrogé certains industriels concernés qui lui ont répondu que ces filtres étaient utilisés pour le traitement des eaux industrielles. La commission d'enquête note par ailleurs, conformément à ce que relevait l'Igas, que « les inspections qui ont eu lieu dans les usines pour lesquelles la DGCCRF avait connaissance d'achats de filtres inférieurs à 0,8 micron en question n'ont rien révélé ». Toujours selon la mission de l'Igas, cela concernait 23 désignations commerciales.
b) La fraude n'est pas inéluctable
Plusieurs acteurs auditionnés ont affirmé à la commission d'enquête avoir pris acte de la dégradation de la qualité d'une partie de leur ressource, rendant impossible la continuité de l'exploitation.
C'est le cas par exemple de Sources Alma, qui a fermé un site à Lucheux, dans les Hauts-de-France. Interrogé par le rapporteur sur le lien entre l'absence de garantie de la pureté originelle et la fermeture d'un forage, Luc Baeyens, directeur général a précisé : « Ce n'était pas le seul motif. Il est également arrivé que des pratiques ne correspondent plus aux critères de qualité de notre société, que des méthodes d'analyse de plus en plus précises nous permettent d'identifier. Nous autorisons par exemple l'appellation « biberon » pour autant que la teneur en nitrates soit inférieure à 5 milligrammes par litre, quand la norme est à 50 milligrammes par litre. Des mesures de l'ordre de 18 ou 19 milligrammes par litre n'entrent ainsi plus dans le cadre de notre politique qualitative et, quand nous les atteignons, décision est prise de fermer le site concerné, bien que nous puissions le laisser ouvert. »68(*)
De même, Cécile Courrèges, directrice générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, a indiqué à la commission d'enquête : « Nous avons néanmoins rencontré quelques situations de non-conformité. Nous avons eu des problèmes bactériologiques et plus récemment, un cas de contamination par des pesticides. Ces problématiques ont pu aboutir à l'abandon d'un forage, généralement à l'initiative de l'exploitant lui-même. Il est important de noter que la plupart des situations de non-conformité sont gérées en collaboration avec l'exploitant, sans nécessiter l'utilisation d'outils administratifs contraignants.
En 2024, nous avons rencontré un cas d'abandon de captage en raison de la présence de pesticides. Nous avons également rencontré des situations de non-conformité dues à une mauvaise maîtrise du processus de traitement de l'eau, entraînant par exemple des teneurs élevées en nickel ou en manganèse. Ces problèmes sont généralement résolus en remettant en ordre la filière de traitement. »69(*)
B. LA MICROFILTRATION, OU COMMENT TORDRE LA RÈGLEMENTATION ET LE BRAS DE L'ÉTAT POUR REMPLACER DES TRAITEMENTS INTERDITS PAR UN TRAITEMENT NON AUTORISÉ
À plusieurs reprises, le statut de la microfiltration a été présenté comme vague, flou ou incertain par un certain nombre d'acteurs entendus par la commission d'enquête. Cela a été le cas en premier lieu de certains groupes minéraliers, en particulier de Nestlé, qui en a fait l'un de ses arguments centraux pour imposer à l'État un seuil de coupure à 0,2 micron.
De manière plus surprenante, certains représentants des services de l'État au niveau national ou territorial ont repris la même antienne. L'actuel directeur général de la santé a ainsi affirmé : « La réglementation n'est pas assez claire sur la microfiltration ». De leur côté, les corédacteurs du rapport de l'Igas sur les eaux conditionnées ont indiqué : « Nous avons également constaté que la réglementation applicable aux eaux manquait de clarté, chacun des types d'eau étant encadré par une directive européenne ensuite transposée en droit français. ». Ils confirmaient ainsi le propos de leur rapport qui comprenait un chapitre intitulé : « la réglementation applicable aux eaux conditionnées est peu claire et induit des risques qui nécessitent son actualisation ». Le cas le plus net est celui du préfet du Gard et du directeur général et l'ARS Occitanie qui ont cosigné, le 14 janvier 2025, une lettre au ministre de la santé récusant l'analyse du directeur général de la santé, qui demandait en conséquence au préfet de mettre en demeure l'industriel de supprimer les éventuels dispositifs de microfiltration à 0,2 micron.
Pour autant, la règlementation apparaît très claire à d'autres opérateurs majeurs, comme Danone, par exemple. Ainsi la directrice des sources d'eaux minérales du groupe français a-t-elle indiqué lors de son audition : « Nous n'avons jamais eu le besoin d'utiliser un seuil de microfiltration inférieur à 0,8 micron et la réglementation nous paraît suffisamment claire du point de vue de la gestion de nos ressources et du respect de la qualité des nappes. ». Le directeur général du groupe Alma était du même avis : « La réglementation me semble claire, malgré l'absence de seuil. Selon nous, le principe fondamental est qu'une éventuelle microfiltration ne doit pas modifier le milieu microbiologique et rendre potable une eau qui ne le serait pas : une telle utilisation ne serait pas acceptable. »
Alors, qu'en est-il ? En réalité, s'il est vrai qu'ils ne fixent pas de seuil de coupure pour la filtration, la directive de 2009 sur les eaux, comme l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, n'en demeurent pas moins clairs.
Le coeur de cette règlementation est le concept de pureté originelle de l'eau minérale naturelle. En d'autres termes, tout de ce qui éloigne de cette pureté naturelle, éloigne aussi de l'appellation « eau minérale naturelle ».
Le principe est donc qu'une eau minérale naturelle ne subit pas de traitements. Ces derniers ne peuvent être qu'une exception à la règle.
C'est la raison pour laquelle ces textes précisent que la liste des traitements autorisés est limitative (1), que si un État souhaite ajouter un traitement non expressément prévu par les textes, il doit en faire la demande selon une procédure spécifique (2), et enfin que ces traitements ne doivent pas modifier le microbisme de l'eau (3). Or, la microfiltration à 0,2 micron est un outil visant à décontaminer les eaux des usines Nestlé (4) et la procédure spécifique prévue par les textes n'a jamais été mise en oeuvre pour cette microfiltration (5). Au total, comme le résume Jérôme Salomon devant la commission : « nous avions deux procédés non autorisés [filtres sur charbon actif et ultraviolets] et on nous proposait en remplacement un procédé (la microfiltration à 0,2 micron) qui n'était pas non plus autorisé. »
1. La filtration n'est possible que dans certains cas limitativement énumérés par le droit européen...
À son article 4, la directive européenne de 2009 précise deux points essentiels :
1er point : une eau minérale naturelle ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que ceux qui sont listés par la directive. Elle précise nettement : « tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle est interdit ».
2e point : la directive ne prévoit de séparation, notamment par filtration, que dans quelques cas, pour « la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre ». Elle autorise aussi « l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. »
Tous les autres traitements sont interdits, sauf à mettre en oeuvre une procédure spécifique sur laquelle nous allons revenir.
L'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, qui transpose la directive en droit français, n'est pas moins clair et reprend la notion de liste limitative de traitements autorisés au profit, s'agissant des cas de filtration, de :
« 1. La séparation des éléments instables ». Il s'agit des composés du fer et du soufre.(...)
« 5. La séparation de constituants indésirables. ». Il s'agit principalement de l'arsenic et du manganèse. Certes, l'arrêté ne fixe pas la liste des « constituants indésirables », mais les Lignes directrices pour l'évaluation des eaux minérales naturelles au regard de la sécurité sanitaire, publiées par l'Afssa (devenue Anses) en 2008, sont claires en la matière.
2. Tout mise en place d'un autre type de filtration doit faire l'objet d'une procédure spécifique
La directive (art 4, 1, c) précise que « la séparation des constituants indésirables autres » que ceux mentionnés plus haut est conditionnée à :
- la fixation de « conditions d'utilisation » par la Commission européenne après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ;
- la notification du traitement envisagé aux autorités compétentes ;
- la mise en place d'un contrôle spécifique de la part des autorités compétentes.
De son côté, l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées précise, quant à lui : « La demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l'article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n'a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. »
Pour justifier le fait qu'il n'ait jamais fait de demande sérieuse auprès des autorités sanitaires, Nestlé joue sur les mots et prétend ne pas vouloir imposer un nouveau traitement en utilisant la microfiltration à 0,2 micron. Pourtant, la structure même des textes laisse clairement comprendre que les traitements autorisés sont très limités et que toute adaptation supposerait de passer par la procédure décrite plus haut. Du reste, le rapport de l'Igas rappelle bien cette procédure (page 32).
Par ailleurs, s'il ne s'agissait pas d'un nouveau traitement, pourquoi faire le siège pendant des années des cabinets ministériels pour faire inscrire cette microfiltration dans la réglementation ? Car tel était bien l'objet du lobbying de Nestlé, comme la note lors de son audition Cédric Arcos, à l'époque conseiller santé de la Première ministre : « Des industriels (Nestlé) nous demandaient l'autorisation d'appliquer une microfiltration inférieure à 0,8 micron ».
Les sollicitations très insistantes de Nestlé Waters démontrent sans le moindre doute que le groupe avait conscience du caractère discutable de la microfiltration à 0,2 micron dans le cadre des traitements autorisés. Du reste, ce sera l'enjeu réel de la concertation interministérielle dématérialisée de février 2023. Dès lors, rien ne justifiait que Nestlé contourne la procédure prévue par les textes. Cette procédure s'imposait d'autant plus que la microfiltration pose d'évidence la question d'une potentielle modification du microbisme de l'eau.
Du reste, la lecture des avis de l'Anses de 2022 et 2023 lève tout doute, s'il devait en rester, puisque l'agence conclut : « l'Agence souligne que conformément à l'arrêté du 14 mars 2007 modifié, la demande visant à ajouter un traitement à la liste de ceux déjà autorisés devrait être transmise, via le ministère, à la Commission européenne qui solliciterait l'Efsa à cet effet. »
3. La filtration n'est possible que si elle ne modifie pas le microbisme de l'eau
Dans tous les cas, selon la directive, la filtration ne doit pas modifier « la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés », ce que l'arrêté de 2017 transpose ainsi : les traitements listés (article 5), comme ceux dont l'autorisation est demandée (article 6), ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle « dans ses constituants essentiels » ni avoir pour but de « modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau ».
La finalité de ces précisions est là aussi très claire : il s'agit de préserver le concept de pureté originelle de l'eau minérale naturelle. Cette eau ne peut être à la fois naturellement pure et altérée quant à sa composition.
Dans ses avis de 2022 et 202370(*), l'Anses confirme la nécessité de préserver la pureté originelle de l'eau en se reportant à un précédent avis de l'Afssa de 2001 suivant lequel : « le dispositif de filtration tangentielle ayant un seuil de coupure de 0,8 micron peut être utilisé pour le traitement d'eau de source et d'eau minérale naturelle avec l'objectif de retenir des particules présentes naturellement dans l'eau au captage ou celles résultant d'un traitement d'oxydation du fer ou du manganèse dissous, mais qu'il ne doit pas être utilisé pour rendre les caractéristiques microbiologiques des eaux conformes aux dispositions réglementaires ».
Il est résulté de cet avis une tolérance des autorités vis-à-vis de la mise en oeuvre de dispositifs de filtration à un seuil de coupure de 0,8 micron. Cependant, contrairement à ce qui a été affirmé, aussi bien par Nestlé que par certains responsables de l'administration, les avis de l'Anses ne donnent absolument aucun blanc-seing pour une filtration inférieure. En 2022, l'Anses considère que « que les remarques et recommandations générales formulées dans l'avis (de 2001) sont toujours valables ». Elle rappelle notamment que les procédés de filtration utilisés ne doivent pas être installés avec l'objectif de modifier les caractéristiques microbiologiques des eaux.
L'Anses ajoute dans sa note de décembre 2023 une annexe qui porte notamment sur la situation de l'Espagne et relève : « Après une recherche complémentaire, l'Anses a identifié un document datant de 2009 qui émane de l'Aesan (agence homologue de l'Anses). Ce document indique en conclusion que la filtration avec un seuil de coupure inférieur à 0,4 micron ne peut avoir d'autre but que la désinfection de l'EMN. »
4. Or, la microfiltration à 0,2 micron est un outil visant à décontaminer les eaux des usines Nestlé
Dès le départ, le groupe Nestlé tente d'imposer la microfiltration précisément pour « modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau ».
Le propos des dirigeants du groupe est cependant ambigu, au moins dans les débuts, car ils s'évertuent à faire croire que cette microfiltration n'est nécessaire que « dans un but technologique ». C'est ce que note Cédric Arcos devant la commission : « Les représentants de Nestlé ont remis un document présentant leur plan de transformation et leur analyse de la microfiltration, confirmant qu'il s'agissait d'un traitement mis en place à des fins technologiques ». Mathilde Bouchardon, conseillère au cabinet du ministre de l'industrie, Roland Lescure, ne dit pas autre chose : « L'industriel nous a indiqué que, même si l'eau était microbiologiquement pure à la source, une microfiltration pouvait être nécessaire dans un but dit technologique. »
Ces termes obscurs de « buts technologiques » visent en fait à faire croire que la microfiltration a un simple objectif d'amélioration du processus de production et cachent le fait que la finalité de la microfiltration est, en réalité, sanitaire. La manoeuvre fonctionne puisque les membres des cabinets ministériels reprennent le terme dans leurs échanges sans s'interroger sur son contenu, mais pour en retenir l'innocuité supposée. Devant la commission, la même conseillère indique : « Aujourd'hui encore, je ne saurais vous dire exactement ce que recouvre une microfiltration dans un but technologique. »
Pour rassurer leurs interlocuteurs et, d'une manière d'ailleurs contradictoire qui n'est malheureusement pas relevée par ces derniers, les dirigeants de Nestlé Waters laissent entendre avec un vocabulaire volontairement euphémisé que la microfiltration permet simplement de « sécuriser la sécurité sanitaire » des eaux en question.
C'est ce qu'affirme Muriel Liénau devant la commission d'enquête : « J'ai donc constitué une équipe afin conforter de la sécurité alimentaire grâce à la microfiltration ». Cédric Arcos relève lui que : « Le 1er décembre 2022, j'ai organisé avec mon collègue en charge de la consommation une nouvelle réunion de suivi. Nous avons reçu une note du cabinet industrie présentant un plan d'action sur les cinq points, évoquant une saisine de l'Anses et mentionnant une contamination de la source Hépar que l'industriel sécuriserait par une microfiltration à 0,2 micron (...) ».
Le 9 septembre 2022, Adrienne Brotons, directrice de cabinet du ministre de l'industrie, Roland Lescure, rencontre la direction du groupe Nestlé Waters. Ce jour-là les choses sont très claires. Pierre Breton, conseiller au cabinet de la santé, informé le 12 septembre de cette rencontre envoie à la direction générale de la santé, avec copie à sa directrice de cabinet, Isabelle Epaillard, un courriel sur la teneur l'entretien. À l'évidence, ces informations lui viennent du cabinet de l'industrie : « Je reviens vers vous concernant le sujet Nestlé Waters. Le cabinet industrie a rencontré la direction du groupe vendredi dernier. Il semblerait que leur seule requête à ce stade serait d'autoriser la microfiltration à 0,2 micron dans leurs usines. Cela leur permettrait d'arrêter le traitement par UV, celui par charbon aurait déjà été interrompu. L'industriel a informé le cabinet industrie qu'une rivière contaminée en proximité de leur point de captage polluerait la qualité de leur eau et imposerait donc les mesures de traitement... ».
Nous sommes ici en présence d'une des dissonances cognitives qui marquent ce dossier. Les cabinets ministériels sont informés d'une contamination, de traitements destinés à y remédier, mais ne prennent pas conscience, ou écartent l'idée volontairement, que l'objet de la microfiltration ne peut être qu'à visée hygiénisante et décontaminante de l'eau.
Comme nous le verrons plus tard, cependant, dès le 5 octobre 2021, la direction générale de la santé, dans un courriel de la cheffe du bureau de la qualité des eaux d'alors, Corinne Feliers, à sa sous-directrice, Joëlle Carmès, pressent que l'enjeu est bien celui de la désinfection de l'eau : « il faudrait s'intéresser au « pourquoi de tels traitements sont apparus nécessaires ? » et demander au groupe Nestlé d'être transparent sur les risques identifiés sur leurs ressources ou sur leurs chaines d'embouteillage. ». Le 14 septembre 2022, informée par Pierre Breton de l'entretien d'Adrienne Brotons avec Nestlé, Joëlle Carmès alerte à nouveau et présente ce qui devrait conduire son interlocuteur à prendre de la distance à l'égard des propos du cabinet de l'industrie : « Attention, d'après les éléments du cabinet industrie, « il semblerait que leur seule requête [de Nestlé] à ce stade serait d'autoriser la microfiltration à 0,2 micron dans leurs usines. Cela leur permettrait d'arrêter le traitement par UV ». Le traitement UV est un traitement de désinfection permettant de réduire la concentration en microorganismes (bactéries, mais aussi certains virus et certains protozoaires comme Cryptospridium et Giardia), ce traitement est interdit pour les EMN et ES. Si Nestlé a recours à ce traitement et souhaite le remplacer par de la microfiltration à 0,2 micron, c'est sans doute qu'il y a un problème de qualité microbiologique de la ressource en eau : une ressource dont la qualité n'est pas conforme aux dispositions réglementaires ne peut pas être reconnue comme une EMN. De plus, l'existence de risques sanitaires liés à la présence de virus entériques d'origine hydrique (voire d'autres micro-organismes pathogènes) ne peut être exclue si ce traitement de microfiltration était assimilé à tort à une désinfection par Nestlé (la microfiltration n'a pas la même efficacité que le traitement UV).
En outre, si l'un (ou plusieurs) captage est influencé par la pollution dans une rivière, cela confirme que la ressource n'est pas assez bien protégée et que l'eau ne répond donc pas à la définition d'une EMN au titre de la réglementation européenne et française :
Il convient donc de connaître la véritable qualité de l'eau dès son émergence (en particulier microbiologique, y compris virus et bactériophages) et l'impact de la pollution de la rivière afin de savoir si ces ressources en eau peuvent encore être reconnues comme des EMN. »
Dans une note datée du 26 septembre 2022 destinée à Matignon et à l'Élysée, et transmise notamment au secrétaire général de la présidence de la République, pour préparer un entretien avec les dirigeants de Nestlé, les cabinets industrie et santé notent un point qui aurait dû faire réagir l'ensemble des acteurs : « L'industriel a indiqué être en mesure de suspendre les traitements par charbon actif et par UV s'il était autorisé à continuer une microfiltration à 0,2 micron ». En d'autres termes, la microfiltration est clairement un substitut indispensable aux traitements décontaminants interdits que Nestlé doit retirer.
La situation de la ressource paraît alors tellement dégradée que l'exploitation de certaines nappes semble ne plus se faire sans microfiltration. C'est ce que l'on déduit par exemple de l'un des nombreux messages de Mathilde Bouchardon qui peuvent s'analyser comme une pression en faveur de la thèse de l'industriel. Dans un courriel aux directrices des cabinets de la santé et de l'industrie (Isabelle Epaillard et Adrienne Brotons), en date du 24 octobre 2022, la conseillère du ministre de l'industrie insiste : « À noter, il est important de trancher rapidement, car l'impossibilité pour Nestlé de poursuivre avec des filtres à 0,2 micron pourrait avoir des impacts industriels et en termes d'emplois non négligeables. ».
En résumé, il est donc clairement établi, dès 2022, que pour les ministères compétents, le cabinet de la Première ministre et la présidence la République, la microfiltration à 0,2 micron est :
1) un substitut aux traitements interdits aux UV et charbon actif ;
2) le moyen de décontaminer une eau qui donc, au moins par périodes, est contaminée et donc insusceptible d'être une eau minérale naturelle.
Il en résulte l'évidence que ne veulent pas voir les cabinets ministériels : le microbisme de l'eau est nécessairement affecté par la microfiltration à 0,2 et c'est d'ailleurs son objet.
Que le pouvoir désinfectant de cette microfiltration ne soit pas total et absolu est une autre affaire qui, d'ailleurs, aggrave son cas, car, comme le relève le rapport de l'Igas, la microfiltration est alors une « fausse sécurisation » : « la microfiltration peut aussi être perçue comme une fausse sécurisation, la littérature scientifique indiquant que même un seuil à 0,2 micron ne peut être considéré comme un mécanisme de suppression de toute flore notamment virale.
En clair, la mise en place d'une filtration à 0,2 micron sur des eaux non conformes pourrait exposer les consommateurs à un risque sanitaire en lien avec l'ingestion de virus -- qui ne seraient pas retenus par un filtre à 0,2 micron -- voire de bactéries comme en atteste un épisode survenu en Espagne. »
Il est important de relever que la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN), syndicat représentatif des minéraliers français71(*), a pris une position claire sur la microfiltration72(*) : « S'agissant de l'utilisation de la microfiltration à 0,2 ìm pour la rétention particulaire (fer, manganèse...), les membres de la MEMN ne considèrent pas qu'il soit nécessaire d'en faire une priorité pour la catégorie.
Les membres de la MEMN n'ont pas identifié de besoin pour l'utilisation d'une telle microfiltration dans un objectif sanitaire ou de maintien en hygiène des installations. ».
La MEMN rappelle que la filtration est une technique de séparation prévue par la réglementation pour la rétention de particules pouvant être présentes naturellement dans l'eau, notamment d'argile et d'hydroxyde de fer ou de manganèse et, qu'en revanche, l'utilisation de la microfiltration pour sécuriser la qualité microbiologique de l'eau ou le maintien en hygiène des installations, dans un objectif de purification, ne constitue pas une attente des professionnels fédérés au sein de la MEMN dans la mesure où, précisément, « Par définition, une eau minérale naturelle est naturellement protégée et ne présente pas de contamination microbiologique. »
5. La procédure spécifique prévue par les textes n'a jamais été mise en oeuvre pour la microfiltration
Cette procédure, rappelée plus haut ainsi qu'à la page 32 du rapport Igas, est connue. Elle a du reste été utilisée à deux reprises :
- pour l'ozonation (en 1996-2003) ;
- pour l'élimination des fluorures par l'alumine activée (en 2010).
En revanche, elle ne l'a jamais été pour une filtration générale à seuil de coupure bas - c'est bien pour cela d'ailleurs que la microfiltration à 0,8 micron n'est qu'une « tolérance » des autorités, seulement dans la mesure où elle ne modifie pas le microbisme de l'eau. Ponctuellement, des microfiltrations inférieures à 0,8 micron ont pu être autorisées, à des fins « technologiques », dans le but, mentionné par l'Anses, de retenir certaines particules présentes dans l'eau. À la connaissance de la commission d'enquête, 17 arrêtés préfectoraux autorisent la microfiltration à 0,2 micron pour ces motifs. C'est le cas par exemple de l'eau minérale naturelle Hydroxydase dans le Puy-de-Dôme.
À rebours de la procédure officielle, Nestlé s'est engouffré dans cette brèche. Devant la commission d'enquête, Ronan Le Fanic, directeur industriel de Nestlé Waters, s'est encore abrité derrière l'existence de ces 17 arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de la procédure prévue par la directive pour justifier l'abstention du groupe. Mais l'argument est spécieux. D'abord, parce que l'objet de la microfiltration par Nestlé Waters n'est pas, à l'instar des arrêtés précités, de retenir des particules minérales indésirables, mais bien de désinfecter l'eau. Dès lors, c'est un nouveau processus de traitement de l'eau, non prévu par la directive, que Nestlé tente d'imposer. Ensuite, parce que si ces arrêtés préfectoraux avaient autorisé de nouveaux traitements pris en dehors des textes, leur seule existence ne justifiait pas la perpétuation de l'irrespect de la procédure normale.
Nestlé Waters n'est pas seul fautif en la matière puisque c'est l'administration elle-même qui reprend cet argument de l'existence des arrêtés préfectoraux à 0,2 micron pour justifier une autorisation générale. Il est présent dans une note de Mathilde Bouchardon « à l'attention des cabinets Élysée et Matignon » en date du 1er décembre 2022. La conseillère du ministre de l'industrie ne cite alors qu'un exemple à 0,45 micron73(*). Mais elle reprendra l'argument avec de nouveaux exemples, à 0,2 micron cette fois, pour préparer la concertation interministérielle de février 2023. Ainsi affirme-t-elle dans une note du 16 février 2023 destinée à Cédric Arcos et à Victor Blonde : « En tout état de cause, certains arrêtés existants relatifs à des usines de production d'eau minérale naturelle prévoient bien l'utilisation des filtres à 0,2 ìm ». Un argument spécieux, on l'a vu, mais qui finira dans le bleu de Matignon autorisant la microfiltration à moins de 0,8 micron « au regard (...) des autres autorisations déjà accordées en France ».
Il n'en reste pas moins que Nestlé Waters a en permanence privilégié une voie parallèle à la procédure normale. Une voie qui passe par la pression sur les cabinets ministériels pour obtenir, en toute discrétion, le droit d'user de la microfiltration au niveau local.
C'est bien l'objet du long et intense lobbying de Nestlé qui finit par payer : la concertation interministérielle dématérialisée de février 2023 autorise, en contournant la réglementation, la microfiltration à moins de 0,8 micron, tout en demandant aux autorités locales, préfets et ARS, d'accompagner les plans de transformation de Nestlé, qui prévoient clairement un seuil à 0,2 micron.
Pourquoi cette attitude du groupe qui prend le risque de dépenser des dizaines de millions d'euros dans le cadre de « plans de transformation » dont un volet essentiel, la microfiltration, est contestée et contestable ?
Face à son refus constant de s'expliquer, il est seulement possible de faire des hypothèses qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres :
- première hypothèse, celle de la méconnaissance des textes et de la procédure. Elle est possible si l'on se réfère aux nombreuses inexactitudes exprimées par les dirigeants de Nestlé Waters. Elle reste peu plausible, car on doute qu'un groupe aussi puissant ne dispose pas en interne, ou par des conseils externes, des compétences juridiques nécessaires ;
- deuxième hypothèse : le mépris d'une multinationale pour l'État et pour nos lois, la certitude de « tordre le bras » de nos administrations qui lui fait choisir « sa » procédure ? Le comportement de Nestlé à l'égard de la commission, mobilisant force avocats et contestant sa légitimité dès sa création donne quelque crédibilité à cette hypothèse ;
- troisième hypothèse : l'industriel a obtenu des garanties, ou du moins des assurances, ou une espérance, voire une promesse, selon lesquelles cette microfiltration à 0,2 serait validée ? De fait, le moins que l'on puisse dire est que les cabinets des ministères ont manqué de sagacité, de clarté et de fermeté dans cette affaire, en particulier celui de l'industrie qui a agi comme le passe-plat de l'industriel et que ce dernier a pu s'en sentir conforté.
Y-a-t-il eu davantage de compromissions, par exemple au niveau politique ? La documentation écrite exploitée par la commission ne permet pas de trancher avec certitude. Du reste, les décideurs politiques apparaissent très peu dans ce dossier.
Il n'y a pas nécessairement lieu de s'en féliciter, car l'impression profonde que l'on peut retirer de tous les documents, lettres, courriels, notes analysées, ainsi que des auditions, est que les ministres sont absents et que tout, ou l'essentiel, se joue entre cabinets ministériels, dans un dialogue d'administration qui se passe de légitimité politique.
Ce qui est certain, c'est d'abord que la décision d'autoriser la microfiltration à 0,2 micron ne relevait pas d'un préfet ou d'un directeur général d'ARS. Et c'est bien pourquoi Nestlé a fait le siège des administrations centrales. C'est ensuite que la problématique de la microfiltration a été exposée, et mal comprise, au plus haut niveau de l'État. C'est enfin que la thèse de l'industriel a été reprise avec un manque de prudence et de discernement par certains acteurs, au ministère de l'industrie, au cabinet de la Première ministre et à la présidence de la République.
Encore aujourd'hui, sur la lancée du lobbying des années 2021-2024, Nestlé prétend obtenir un blanc-seing de l'État en négligeant la procédure normale, en s'appuyant sur une certaine incompréhension des textes par les administrations locales, et en faisant peser tout le poids de sa conviction et de ses emplois sur les préfets et les ARS des lieux d'implantation de ses usines. C'est ce que le groupe tente actuellement de faire dans le Gard. Il est désormais important que les autorités centrales reprennent ce dossier en main et ne laissent plus l'échelon local seul et livré à lui-même.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
5 |
Rappeler aux autorités locales (préfets, ARS) les textes en vigueur en matière de traitements des eaux et notamment l'existence d'une procédure spécifique en matière de traitements nouveaux à l'instar de la microfiltration à seuil bas |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
Immédiat |
Instruction |
C. LA MICROFILTRATION EST POURTANT LA CLÉ DE VOÛTE DU « PLAN DE TRANSFORMATION » QUE NESTLÉ WATERS DEMANDE AUX AUTORITÉS DE VALIDER DÈS 2021
Le « plan de transformation » de Nestlé Waters est le document par lequel l'entreprise a projeté, dès 2020, les étapes de sa mise en conformité progressive avec la règlementation.
Muriel Liénau, alors responsable Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord de Nestlé Waters, l'a confirmé à la commission d'enquête lors de son audition sous serment le 17 mars 2025, où elle s'est présentée comme « architecte de la transformation de Nestlé Waters depuis 2020. » Elle a indiqué à la commission d'enquête : « C'est à la suite de ma prise de poste que, à la fin de l'année 2020, j'ai appris la présence de traitements non autorisés - ultraviolets et charbons actifs - sur nos sites du Gard et des Vosges [...] Dès que j'en ai été informée, j'ai souhaité engager un plan de transformation à différents niveaux afin de sortir de cette situation de non-conformité, d'arrêter ces traitements et de trouver des solutions nous permettant de produire en totale conformité avec la réglementation en vigueur. »
Bien que conçu dès 2020, les grandes lignes de ce plan de transformation ne sont portées à la connaissance des administrations centrales qu'en 2021. Les préfectures et les ARS sont, quant à elles, informées de ce plan de transformation lorsqu'elles sont mises au courant par l'exploitant de ses pratiques interdites. Ce plan de transformation est la pierre angulaire des relations entre Nestlé Waters et les administrations pendant près de deux ans. Il remonte même jusqu'au cabinet de la Première ministre : le 27 septembre 2022, Nicolas Bouvier, lobbyiste de Nestlé Waters, adresse les propositions du plan de transformation des deux sites, en prévision de l'échange à Matignon du jeudi 29 septembre 2022, à Mathilde Bouchardon, conseillère au cabinet de la ministre de l'industrie, qui les transmet à Cédric Arcos et Victor Blonde.
Que ce soit à Vergèze ou dans les Vosges, le plan de transformation repose sur une microfiltration plus fine que celle actuellement tolérée (à 0,8 micron) en contrepartie de l'arrêt des traitements interdits au charbon actif et aux UV, appelés « barrières de protection » :
- dans les Vosges, le plan présenté aux agents de l'ARS lors de l'inspection du 6 avril 2022 prévoit le maintien des filtrations à 0,2 micron, l'arrêt de l'utilisation du charbon actif le 12 avril 2022 et l'arrêt de l'utilisation des traitements UV fin mai ou début juin 2022 ;
- dans le Gard, le plan présenté le 3 novembre 2022 à l'ARS Occitanie prévoit le maintien des « barrières de protection » (lampes à UV et filtres à charbon actif, désinfectants), à titre transitoire pendant la durée du plan de transformation, et à titre permanent pour la production à destination des Etats-Unis, en parallèle du maintien des microfiltres à 0,2 micron.
Dans le Gard, le plan ne propose pas seulement une mise en conformité, mais une évolution des conditions d'exploitation du site : il prévoit en outre de séparer la production en deux flux : un pour la production française, dépourvue de traitements au charbon actif et aux UV, et un flux pour la production destinée au marché américain, pour laquelle ces traitements seraient maintenus.
Selon Muriel Liénau, ce sont effectivement près de 95 millions d'euros qui ont été investis au cours des cinq dernières années sur le site des Vosges et 150 millions d'euros sur le site de Vergèze.
Sauf à anticiper avec un degré élevé de certitude la légalité à venir de cette pratique de microfiltration sur laquelle repose le plan de transformation, comment expliquer qu'une entreprise, investisseur avisé, dépense des centaines de millions d'euros dans un plan de transformation qui repose essentiellement sur cette pratique encore non autorisée ?
Le compte-rendu d'une réunion entre les cabinets des ministres de la santé et de l'industrie le 24 octobre 2022 prend d'ailleurs en compte cette variable financière en précisant : « l'installation de filtres représente un investissement important, alors même que NWSE n'a pas la certitude de pouvoir utiliser ces filtres par la suite. »
Pour le rapporteur, le rôle central de la microfiltration dans le plan de transformation de Nestlé Waters soulève deux questions :
- comment expliquer que l'arrêt des traitements de désinfection, strictement interdits, au charbon actif et aux lampes à UV, soit compensé par le maintien de la microfiltration, sinon par le fait que la microfiltration constitue elle aussi une désinfection ?
- à l'inverse, comment s'assurer a priori de la sécurité sanitaire des eaux dès lors que la microfiltration ne constitue pas une barrière de protection totale à l'égard des bactéries, et n'agit pas contre le risque virologique ? L'autocontrôle a posteriori peut-il être considéré comme suffisant ?
D. UNE PERPLEXITÉ DE L'ÉTAT VIS-À-VIS DE LA MICROFILTRATION QUI DEMEURE ENCORE AUJOURD'HUI
1. Un déplacement du débat de l'absence de désinfection vers la question du seuil de microfiltration
Toute filtration autre que celle déjà prévue par les textes est interdite dans la mesure où elle serait susceptible de modifier le microbisme de l'eau. Seule existe une tolérance pour un seuil 0,8 micron, à la suite à l'avis de l'ex-Afssa du 29 novembre 2001, ainsi que des tolérances ponctuelles, extrêmement limitées, pour des objectifs « technologiques » mentionnés ci-dessus.
Or, les cabinets et administrations centrales qui ont eu à connaître du dossier Nestlé, à l'exception de la direction générale de la santé, ont suivi l'argumentation de l'industriel, qui consistait à déplacer la question de l'interdiction de tout traitement de filtration s'apparentant à de la désinfection sur celle du seuil à partir duquel la microfiltration pourrait être autorisée, Nestlé arguant notamment du fait que la microfiltration à 0,45 micron était autorisée en Espagne.
Dès le 31 août 2021, la présentation par Nestlé Waters de son plan de transformation au cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie a insisté sur la nécessité de mettre en place une filtration à 0,2 micron au lien des traitements interdits. À l'évidence, cette microfiltration a pour objet de se substituer à la désinfection autrefois réalisée via les traitements interdits et illustre la dégradation de la ressource de Nestlé Waters en termes de pureté originelle. Pourtant, les cabinets ministériels se laissent piéger et entrent dans le débat en fixant comme seule condition que l'industriel apporte la preuve de l'absence d'altération du microbisme de l'eau, preuve qui ne sera jamais apportée.
2. Un dossier mystérieux de Nestlé sur la microfiltration qui se transforme en un simple feuillet
À plusieurs reprises, les représentants de Nestlé Waters ont affirmé avoir apporté aux autorités de l'État la preuve que la filtration à 0,2 micron ne modifiait pas le microbisme de l'eau. Cela avait déjà été le cas lors de la visite de l'usine de Vergèze par la commission d'enquête.
Dans une unanimité manifestement organisée, les directeurs d'usine ont tous affirmé à la commission que des dossiers avaient été transmis aux autorités. Ronan Le Fanic, directeur de l'usine Nestlé Vosges de juin 2019 à avril 2023, a indiqué que Nestlé avait fourni plus de 1 200 pages de documentation technique et scientifique à l'Igas et aux ARS, et aurait transmis un dossier technique à l'Igas le 4 mai 2022. Un dossier de 60 pages aurait été envoyé au préfet du Gard et à l'ARS Occitanie en avril 2024. Son successeur, Luc Desbrun, renchérit : « Nous avons fourni à ce sujet de nombreuses études aux administrations, nationales ou locales ». Philippe Fehrenbach, directeur de l'usine Nestlé de Vergèze de février 2021 à janvier 2025, a lui affirmé : « Nos experts ont d'ores et déjà transmis plusieurs études aux administrations, aux autorités ».
Lors de son audition, la présidente de Nestlé Waters, Muriel Lienau, insiste « Je peux vous faire parvenir les documents extrêmement complets que nous avons transmis à l'Igas, dont une étude prouvant, pour le site des Vosges, que le microfiltre 0,2 cartouche préserve la flore naturelle de l'eau qui se redéveloppe ensuite dans la bouteille. Nous avons partagé ce dossier, très complet, non seulement avec l'Igas, mais aussi avec les ARS Grand Est et Occitanie. »
Étrangement, en matière d'argumentaire en faveur de la microfiltration à 0,2 micron, la commission n'a jamais eu connaissance que d'une note blanche non signée, un recto-verso extrêmement succinct, difficile à considérer comme un dossier. Il semble que cette note ait été transmise le 4 novembre 2022 par Nicolas Bouvier, lobbyiste de Nestlé Waters, à Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie, puis au cabinet du ministre de la santé, qui l'a renvoyée pour expertise à la DGS.
Face aux affirmations répétées des représentants de Nestlé Waters, la commission d'enquête a interrogé les administrations compétentes pour savoir ce qu'elles avaient reçu de cette entreprise.
La direction générale de la santé répond : « je vous confirme que Nestlé Waters n'a jamais adressé de dossier technique à la DGS. Les seuls documents en lien avec cette firme dont nous disposons nous ont été transmis par l'ARS Occitanie le17 novembre 2022. Il s'agit du plan de transformation de l'industriel assorti d'un argumentaire d'un acteur économique, non daté, non signé, portant sur la microfiltration à 0.2 micron. » Le directeur général, Grégory Emery poursuit : « Il ne s'agit pour moi ni d'un dossier technique ni d'une note scientifique. Ce document n'a par ailleurs jamais fait l'objet d'échange entre l'industriel et les services de la DGS ». Il faut ajouter que, dès sa réception, le professeur Salomon, alors directeur général de la Santé, avait écarté cette note pour manque de sérieux.
La réponse de l'Anses est éclairante : « Dans le cadre des saisines qui nous ont été adressées, nous n'avons jamais eu de relations directes avec des représentants de Nestlé Waters (NW). À la question « NW a-t-il formellement transmis un ou des dossiers à l'Anses ? », la réponse est non. À la question « l'Anses a-t-elle des informations de NW sur la microfiltration ? », la réponse est oui, postérieurement à la clôture de la saisine traitant de filtration, et dans un large lot d'informations relatives à l'analyse des différentes ressources. (...) Nous tenons à ajouter, pour éviter toute confusion, que les termes « dossier » ou « étude » utilisés par les représentants de NW durant leurs auditions nous paraissent abusifs pour désigner une présentation de type powerpoint ou fichiers excel et ne sauraient constituer les éléments suffisants pour répondre aux termes de dossier constitué ; (...) Si NW avait réellement souhaité que son dossier soit évalué et instruit, le groupe aurait pu faire valoir cette volonté au niveau adéquat auprès des commanditaires habilités à saisir l'agence. Cela aurait conduit à une saisine complémentaire, un amendement du contrat d'expertise ou une réouverture de l'expertise de 2022. »
Aucun élément écrit porté à la connaissance de la commission ni aucune déclaration des auteurs du rapport de l'Igas ne confirme que celle-ci ait effectivement réceptionné une telle preuve d'absence de modification du microbisme de l'eau.
Très récemment cependant, le 20 mars 2025, Nestlé a fait parvenir au préfet du Gard un dossier au soutien de ses demandes de modifications d'arrêtés préfectoraux afin d'autoriser le recours à la microfiltration à 0,2 micron. Le préfet du Gard a indiqué le faire expertiser par l'ARS. En tout état de cause, comme cela a été exposé plus avant, jamais Nestlé Waters n'a suivi la procédure prévue pour faire valider une nouvelle filtration.
3. Malgré les tentatives d'instrumentalisation de Nestlé Waters, l'absence encore aujourd'hui de norme autorisant la microfiltration à 0,2 micron
Face aux demandes des industriels, les autorités locales sont en attente d'un positionnement national sur la microfiltration, qui tarde à arriver. La clarification de la norme était d'ailleurs une des recommandations du rapport de l'Igas, rendu dès l'été 2022, compte tenu de la généralisation de la microfiltration à des seuils inférieurs.
Pourtant, ni la concertation interministérielle dématérialisée (CID) de février 2023 ni le rapport d'audit de la commission européenne de mars 202474(*) ne mentionnent un seuil à partir duquel la microfiltration serait réputée autorisée. Tandis que la CID autorise les préfets à prendre des arrêtés autorisant une microfiltration inférieure à 0,8 micron, sans préciser de seuil limite, le rapport de la commission européenne se contente de rappeler la non-conformité au droit européen de la microfiltration à 0,2 micron, sans pour autant prescrire un autre seuil qui, lui, serait conforme.
Des précisions ont récemment été données par la direction générale de la santé, sans pour autant conduire à la prise d'une norme de « droit dur ».
Le 21 octobre 2024, la directrice générale de l'ARS Grand Est a ainsi interrogé le directeur général de la santé, Grégory Emery, quant aux conditions d'usage de la microfiltration à un seuil de coupure inférieur à 0,8 micron. Ce dernier lui a répondu par un courrier du 31 octobre 2024, que cet usage n'est autorisé qu'à deux conditions :
- d'une part, sous réserve que l'exploitant démontre au préfet l'absence de modification du microbisme de l'eau ;
- d'autre part, en cohérence avec les autres États membres comme l'Espagne qui a fixé un seuil minimal à 0,45 micron, il n'est pas opportun d'autoriser des filtres ayant des seuils de coupure inférieurs.
Le 8 novembre, le directeur général de l'ARS Occitanie, à laquelle la réponse mentionnée ci-dessus avait été également transmise, a lui aussi demandé confirmation au directeur général de la santé. Ce dernier lui répond, le 28 novembre 2024, qu'aucun dispositif de microfiltration inférieur à 0,45 micron ne peut être utilisé pour la production d'eau minérale naturelle ou d'eau de source conditionnée, conformément à la règlementation européenne et française : lorsque des dispositifs de microfiltration avec seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron sont utilisés, le préfet met en demeure l'exploitant de régulariser ses installations.
Une note de l'ARS Grand Est, en date du 11 décembre 2024, dédiée au dossier « Nestlé Waters Supply East » en vue d'une session de travail conjointe avec la préfecture des Vosges en présence du procureur de la République, le 13 décembre, explicite ce flou juridique. La note indique que l'ARS tire les conséquences de la prise de position du directeur général de la santé le 31 octobre puis le 28 novembre 2024, quant à la non-conformité d'une microfiltration inférieure à 0,45 micron : « les nouvelles demandes d'autorisation à 0,2 ne pourront donc pas être honorées, celles existantes doivent être retirées : il convient dès lors d'informer l'exploitant et de fixer un délai de retrait » ;« il conviendra de se coordonner avec l'Ars Occitanie sur ce point ». Selon l'ARS Grand Est, la préfète des Vosges a ainsi demandé à l'exploitant le retrait des filtres inférieurs à 0,2 micron sur le site d'Hépar le 13 décembre 2024.
Cependant, dans le Gard, au terme d'une étrange valse-hésitation, le préfet et le directeur général de l'ARS font preuve d'une réticence étonnante à appliquer strictement les instructions du directeur général de la santé vis-à-vis de l'absence de norme interdisant ou autorisant la microfiltration à un certain seuil.
Le 16 décembre 2024, l'ARS Occitanie transmet au préfet ses prescriptions et ses recommandations définitives à la suite de son inspection du site de Perrier le 30 mai 2024. Reprenant l'analyse du directeur général de la santé transmise le 28 novembre, le directeur général de l'ARS écrit alors au préfet : « je me permets d'attirer votre attention, à nouveau, particulièrement sur l'écart n° 4 qui avait conduit la mission d'inspection à considérer que les traitements de microfiltration à 0,2 micron utilisés sur l'ensemble du réseau de distribution d'eau minérale naturelle Perrier étaient non conformes aux exigences réglementaires. Ces traitements ont pour effet de modifier la composition de l'eau minérale naturelle. ». L'ARS propose donc un courrier au préfet afin qu'il demande le retrait, sous deux mois, des microfiltrations à 0,2 micron utilisées par Nestlé Waters dans le Gard, sur le site de Perrier.
Pourtant, dans une lettre commune du 14 janvier 2025, le préfet et le directeur général de l'ARS informent le directeur général de la santé que, sauf contre-indication, ne pouvant se fonder sur une note positive pour demander le retrait de la microfiltration à 0,2 micron, ils prévoient de demander à l'exploitant non pas de retirer les filtres à 0,2 micron, mais seulement de prouver qu'ils ne modifient pas le microbisme de l'eau. Ils écrivent ainsi : « en l'état actuel du droit et à la lecture des textes, les unités de microfiltration de 0,2 micron utilisées par Nestlé Waters ne sont nullement interdites. En effet, les traitements de l'eau minérale naturelle sont autorisés tant qu'ils sont connus des autorités compétentes (nationales et européennes), qu'ils ne présentent pas de danger pour la consommation, qu'ils sont efficaces et qu'ils ne modifient pas les caractéristiques microbiologiques de l'eau. Aucun seuil n'est mentionné par les textes nationaux et européens ».
Cette position est surprenante, car, à l'inverse, « les textes nationaux et européens » n'autorisent pas une microfiltration à 0,2 micron, mais sont fondés sur la logique de l'absence de traitement des eaux minérales. Par ailleurs, nous avons vu, à de multiples reprises, que cette filtration était repoussée, par la direction générale de la santé, l'Anses, l'ARS Grand Est et la Commission européenne.
Par ailleurs, pourquoi avoir attendu janvier 2025 pour demander à l'exploitant de justifier que la microfiltration ne modifie pas le microbisme de l'eau, alors même que c'est l'argument qui est utilisé depuis 2021 pour justifier de sa conformité avec la règlementation ?
La valse-hésitation s'est prolongée puisque le 7 mai le préfet, revenant sur sa lettre du 14 janvier, a enjoint Nestlé de retirer sous deux mois les filtres à 0,2 micron : « Il ressort en effet des analyses de l'ARS Occitanie que ces traitements modifient les caractéristiques microbiologiques de l'eau, en contradiction avec la réglementation applicable à la production d'eau minérale naturelle ». La commission prend acte de cette décision en relevant qu'elle ne signifie pas la fin de Perrier. Il est de la responsabilité du groupe Nestlé de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses eaux soient à nouveau en capacité de recevoir l'appellation d'eau minérale naturelle en étant, cette fois, transparent sur ses modes de production. L'expérience de « Maison Perrier », à base d'eau traitée et qui n'a donc plus le droit à cette appellation mais manifestement prospère, montre qu'un avenir existe pour le site de Vergèze.
Le besoin de clarification de la réglementation ne s'arrête en outre pas au Gard et aux Vosges. Dans d'autres départements et régions, des industriels demandent à recourir à une microfiltration à 0,2 micron. L'attitude des autorités à ce sujet est loin d'être homogène, traduisant un besoin urgent de précision de la règlementation.
La directrice générale de l'ARS Bretagne, Élise Noguera, a ainsi affirmé devant la commission d'enquête75(*) qu'en 2021, l'exploitant de la société des eaux de source de Paimpont (SESP) du Groupe Intermarché a déclaré l'utilisation d'un micro filtre à 0,2 micron, malgré l'absence de mention d'un tel traitement dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation. Au lieu de demander le retrait du filtre à cette date, l'ARS a alors « sollicité la direction générale de la santé sur l'utilisation et la possibilité d'utiliser cette microfiltration à 0,2 micron ». C'est seulement le 14 février 2025 qu'il a été demandé à l'exploitant, par un courrier du directeur départemental d'Ille-et-Vilaine, de « repenser » sa filière de traitement de l'eau : dans le cas où le seuil de microfiltration utilisée devait être inférieur à 0,8 micron, le dossier déposé devrait notamment « apporter les éléments démontrant l'absence de modification du microbisme de l'eau, par la production d'analyses physico-chimiques et microbiologiques au point de captage de l'eau d'une part et, avant et après le module de filtration d'autre part. »
Comme le préfet du Gard, l'ARS Bretagne s'est appuyée, non pas sur le seuil de 0,45 micron mentionné par le directeur général de la santé le 28 novembre 2024, mais sur la notion de pureté originelle qui suppose l'absence de modification du microbisme de l'eau. Pourtant, la même ARS Bretagne a indiqué à la commission d'enquête lors de la même audition être dans l'incapacité de contrôler elle-même l'absence de modification de ce microbisme, ne disposant pas des données « amont/aval ».
À l'inverse, dans le Puy-de-Dôme, la délégation départementale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a tiré les conséquences de la position prise par la direction générale de la santé, même en présence d'une autorisation d'exploitation mentionnant cette microfiltration à 0,2 micron : le 27 janvier 2025, elle a demandé à l'entreprise Hydroxydase, qui utilise des filtres à 0,2 micron, de remplacer ses filtres par des filtres au seuil minimal de coupure de 0,45 micron. Le courrier de l'ARS mentionne néanmoins que « si cette décision venait à remettre en question votre activité, il vous appartient de justifier, au travers d'une demande d'autorisation spécifique, de la mise en oeuvre d'autres procédés en documentant notamment l'impact d'une microfiltration à 0,45 micron sur le microbisme de l'eau et sa nécessité dans le cadre de votre process. Votre dossier justificatif sera soumis à l'appréciation de la direction générale de la santé. »
En Savoie, également le 27 janvier 2025, c'est cette fois-ci le préfet qui a adressé, non pas un simple courrier, mais une mise en demeure à l'exploitant de la société des eaux d'Aix les Bains (SEAB) à Grésy-sur-Aix de retirer tous les microfiltres inférieurs à 0,45 micron - non mentionnés dans l'arrêté d'autorisation -et de justifier l'utilisation de filtrations inférieures à 0,8 micron.
Face à ces différences notables, qui portent autant sur les procédures que sur le contenu des demandes adressées par les autorités aux industriels, il est temps, aux yeux du rapporteur, de clarifier la situation en inscrivant dans la règlementation les préconisations en termes de seuil du directeur général de la santé.
II. UN ÉTAT CENTRAL DIVISÉ ET TIRAILLÉ QUI FAIT PRÉVALOIR L'INTÉRÊT D'UN INDUSTRIEL SUR CELUI DES CONSOMMATEURS
Toute l'affaire Nestlé Waters illustre l'incapacité de l'État à se saisir correctement du dossier. Dès le départ, son analyse est biaisée par le rapport de force entre ministère de l'économie et ministère de la santé (A). L'Anses use de circonlocutions qui obscurcissent le sens de ses avis et permettent des interprétations divergentes (B). Les ministères de l'environnement et de la consommation sont totalement écartés du processus de décision (C). Le ministère de l'industrie fait le forcing au profit de l'industriel sans se soucier de l'intérêt général ni même de celui du secteur dans son ensemble (D). Enfin, au plus haut niveau de l'État, c'est finalement un arbitrage fautif qui s'impose sous la pression de Nestlé Waters (E).
A. UN DIALOGUE BIAISÉ ENTRE MINISTÈRES DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTÉ ?
1. Une perception faussée du risque sanitaire au départ imputable à Nestlé Waters et au ministère de l'économie
Dès le départ, Nestlé tente d'orienter le dossier vers un simple sujet de « conformité », dans lequel il n'y aurait ni fraude ni risque sanitaire. À l'issue de la fameuse réunion du 31 août 2021, le directeur de cabinet d'Agnès Pannier-Runacher à l'industrie, François Rosenfeld, répercute les propos des dirigeants de l'industriel : « Nestlé a bien précisé que ces non-conformités i) n'ont jamais mis en cause la sûreté alimentaire, et ii) n'ont pas affecté la composition minérale des eaux (et donc la conformité de l'étiquetage par rapport au contenu des bouteilles...) ». La ministre, en retour, note : « Si je comprends bien, on est plutôt sur de la tromperie commerciale que sur un sujet de sécurité alimentaire ? ».
Il est dommage que la perception du risque sanitaire ait été à ce point faussée. Du reste, après coup, devant la commission, Lucile Poivert, qui participait à la réunion, reconnaît : « Leur eau de source n'était pas consommable directement sans traitement. Il y avait un risque sanitaire. »
Mais, à l'époque, il apparaît que ce risque sanitaire a été minimisé. Le ministère de la Santé est informé le 24 septembre 2021 des révélations de Nestlé par un courriel de Lucile Poivert, conseillère santé et biens de consommation auprès de la ministre chargée de l'industrie, à Clément Lacoin, directeur adjoint du cabinet du ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran. Mais ce courriel n'est guère explicite et n'évoque aucun risque sanitaire. Surtout, devant la commission, Lucile Poivert affirme avoir informé la DGS via la « fiche ministre » de la DGCCRF du 14 septembre 2021 déjà évoquée. Or, cette fiche est ambiguë. Certes, elle évoque à trois reprises la possibilité d'un risque sanitaire, mais en termes euphémisés et sans jamais prononcer ces mots. En introduction, elle note « il pourrait être difficile de poursuivre l'exploitation de certaines sources d'eaux minérales naturelles si aucun traitement n'était autorisé sur ces eaux ». Plus loin, elle émet l'hypothèse d'une « dégradation de la qualité des eaux qui ne permettrait plus l'exploitation des sources en l'absence d'un système de filtration » et, en conclusion, elle relève que « la DGS devra (...) expertiser la demande de la société Nestlé concernant la possibilité d'utiliser la microfiltration en lieu et place des filtres que l'entreprise utilise actuellement qui, selon elle, est indispensable pour garantir la sécurité des eaux mises sur le marché ».
Pourtant, comme en écho aux désirs de l'industriel, l'une des premières conclusions de la DGCCRF est : « Une telle situation nécessiterait peut-être de réinterroger la pertinence de la réglementation UE ». Autrement dit, la réglementation est exigeante, réduisons ses contraintes. C'est ce que reconnaît devant la commission Thomas Pillot, chef du service de la protection des consommateurs et régulation des marchés de la DGCCRF : « Si aucun exploitant ne parvient à respecter la réglementation, on peut effectivement s'interroger sur l'opportunité d'une évolution de la réglementation ». Aux yeux de la DGCCRF, le sujet n'est plus le fait générateur, les risques de dégradation de la ressource et leur origine, mais une réponse de circonstance : acceptons un moindre encadrement sur l'exploitation et donc la protection de cette ressource.
D'un côté, donc, les signaux d'alerte auraient dû être clairs pour la DGS avec une lecture approfondie de la fiche ministre. De l'autre, sa rédaction pouvait induire en erreur ses destinataires.
De fait, le lundi 27 septembre 2021, Joëlle Carmès adresse à sa hiérarchie, dont Jérôme Salomon, directeur général de la santé, un compte-rendu d'un entretien avec Norbert Nabet et la DGCCRF. Elle indique l'existence de traitements ultra-violets et au charbon actif pour traiter les eaux minérales naturelles de Nestlé, mais précise de suite : « Il ne semble pas y avoir de préoccupation d'ordre sanitaire, car les EMN en question sont exemptes de problème de qualité microbiologique, mais bien en infraction aux dispositions du CSP sur l'interdiction de ces traitements, et un problème de loyauté. ».
2. Le ressaisissement de la DGS sur le risque sanitaire
Après cette première approche, biaisée par les informations dont elle dispose, la DGS se ressaisit rapidement. Le 1er octobre 2021, Jérôme Salomon prend l'attache de la directrice générale de DGCCRF, Virginie Beaumeunier. Il appelle également à interroger Nestlé sur la justification sanitaire et commerciale du recours à ces traitements, à savoir, d'une part, évaluer la qualité des eaux brutes et les conditions d'exploitation et, d'autre part, examiner s'ils posent un problème de loyauté à l'égard du consommateur.
Le 5 octobre 2021, Corinne Féliers, cheffe du bureau de la qualité des eaux à la DGS, rend compte à sa sous-directrice Joëlle Carmès d'un échange qu'elle a eu avec Norbert Nabet, du cabinet santé, et rapporte lui avoir conseillé de demander au service national d'enquêtes de la DGCCRF de s'intéresser au groupe Nestlé afin de disposer rapidement d'informations sur ses pratiques. Elle pose la bonne question : « L'utilisation de ces traitements non autorisés pour conditionner de l'eau n'apporte probablement pas de risque supplémentaire pour le produit final puisque ces dispositifs sont sans doute identiques à ceux utilisés pour traiter l'eau du réseau d'eau potable.
Cependant il faudrait s'intéresser au « pourquoi de tels traitements sont apparus nécessaires ? et demander au groupe Nestlé d'être transparent sur les risques identifiés sur leurs ressources ou sur leurs chaînes d'embouteillage ».
3. Le risque sanitaire à nouveau minimisé
Dans un second temps, le 13 octobre 2021, Jérôme Salomon interroge sa direction des affaires juridiques, notamment sur la pertinence et les modalités d'un signalement au procureur de la République. Il pose explicitement la question de la prise de mesures administratives par les autorités de contrôle locales, afin de mettre Nestlé en demeure de se conformer aux dispositions du code de la santé publique dans un délai déterminé, ou de suspendre son activité d'exploitation d'eau minérale naturelle jusqu'à l'exécution de mesures de nature à faire cesser toute situation d'infraction. Thomas Breton, sous-directeur du contentieux, lui répond en citant toutes les voies de droit qui s'offre à l'administration, et en précisant notamment qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la mise en oeuvre parallèle d'une enquête judiciaire et d'une enquête administrative, et que dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle administratif, les ARS ou l'Igas pourraient effectuer un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.
Toutefois, dans le message du DGS réapparaît l'antienne issue des informations transmises par Nestlé : il n'y aurait pas de risque sanitaire et l'essentiel du problème porterait sur une déloyauté au consommateur. Le directeur général de la santé note dans son message au directeur des affaires juridiques : « La mise en place de ces traitements illégaux au regard de la réglementation ne représente pas nécessairement un risque sanitaire en soi, mais elle constitue une fraude ».
De son côté, la direction des affaires juridiques, par la voix de Thomas Breton répond : « Après confirmation par la DGS EA76(*), il semblerait en première analyse que la fraude que reconnait Nestlé Waters ne soit pas du domaine de la santé publique, mais que les éventuelles infractions pouvant être retenues soient du domaine de la tromperie du consommateur, de la compétence directe du MEFR/ DGCCRF. »
Les premières velléités d'action de la DGS vont par ailleurs se heurter à l'arbitrage interministériel du 14 octobre 2021 qui fait le choix d'une simple saisine de l'Igas afin de dresser un état des lieux du recours à ces traitements sur l'ensemble du territoire français, de la qualité des eaux minérales naturelles et de source, et de la règlementation en vigueur. Comme l'a reconnu Jérôme Salomon devant la commission d'enquête, le signalement article 40 a été suspendu dans l'attente du retour de l'Igas.
La décision de ne pas solliciter directement des ARS Grand Est et Occitanie le contrôle sanitaire des sites de Nestlé dans les Vosges (Vittel-Contrex-Hépar) et le Gard (Perrier) accentue l'orientation de l'affaire vers le droit de la consommation et peut s'analyser à tout le moins en un premier choix de ne pas sanctionner immédiatement les pratiques illégales révélées par Nestlé, et de ne pas approfondir la question de la qualité des eaux minérales naturelles traitées.
Pourquoi cette minimisation du risque sanitaire qui fragilisera ce dossier tout au long de son parcours ? Charles Touboul, alors directeur des affaires juridiques, relève que la DGS dépendait du ministère de l'industrie pour ses premières informations : « Pourquoi sommes-nous partis sur le terrain non sanitaire, si j'ose dire ? Je m'en tiendrai aux faits. Nous sommes partis des éléments que nous a communiqués la DGS qui, à ce moment-là, les découvre tels qu'ils lui ont été communiqués par Bercy. ».
Une deuxième explication à la faible pression de la DGS quant à l'examen du risque sanitaire est qu'elle a probablement, au moins au début, été rassurée par la présence des traitements interdits qui désinfectaient l'eau. Ainsi, selon Jérôme Salomon, les traitements aux ultraviolets et charbon actifs permettaient de potabiliser l'eau et de garantir sa sécurité sanitaire, de sorte que « la qualité sanitaire des eaux n'était pas remise en cause », et celle-ci « ne présentait pas de danger avéré pour le consommateur ». En revanche, le risque sanitaire se posait dans un second temps qui était celui du retrait de ces traitements. Devant la commission, Jérôme Salomon relève qu'à l'époque, « selon l'analyse de la DG santé, le dossier Nestlé Waters n'est pas une alerte de sécurité sanitaire, mais un sujet de fraude », et ajoute « Les minéraliers ont mis en place des traitements non autorisés, mais ce faisant, en filtrant les eaux, en les traitant plus que ce que les textes permettaient ou toléraient, ils n'ont pas altéré la sécurité sanitaire de ces eaux. ». En d'autres termes, la préoccupation de court terme a masqué le problème de long terme.
4. La DGS tente d'écarter la microfiltration malgré la pression de l'industriel, soutenu par le cabinet du ministre de l'industrie
En septembre 2022, après le changement de gouvernement consécutif aux élections présidentielle puis législatives, Nestlé Waters demande au cabinet de la ministre chargée de l'industrie l'autorisation du recours à la microfiltration à 0,2 comme alternative aux traitements ultraviolets. Cette demande est transmise à la DGS par le cabinet santé le 12 septembre 2022, et Jérôme Salomon répond dès le 22 septembre 2022 n'y être pas favorable.
Comme il l'a lui-même expliqué à la commission d'enquête, la microfiltration « n'a (en principe) aucune visée microbiologique, mais minérale. Sa finalité consiste à enlever des particules « problématiques » dans l'eau (fer, soufre, arsenic). Plus les mailles du filtre sont fines, plus elles tendent à bloquer les bactéries, ce qui modifie le microbisme de l'eau »77(*).
De son côté, on l'a vu, le rapport de l'Igas, transmis aux commanditaires en juillet 2022 met en garde contre la « fausse sécurisation » que pourrait constituer la microfiltration. Et la directrice générale de l'ARS Grand Est, Virginie Cayré, fait part à la DGS de ses inquiétudes sur le fait que la filtration opérée faussait le contrôle sanitaire ciblant des bactéries indicatrices de contamination fécale, sans pour autant exclure tout risque sanitaire de nature virale78(*). Dans une note du 8 décembre 2022, elle indique que « dans l'hypothèse où l'eau serait contaminée, la substitution des UV par des filtres à 0,2 micron ne traiterait qu'une partie des micro-organismes potentiellement pathogènes (les virus passent la barrière des filtres). Le contrôle sanitaire serait rendu inopérant, car ne détectant plus les bactéries indicatrices d'une contamination fécale, et son cortège de micro-organismes pathogènes ne permettrait plus d'évaluer les risques sanitaires pour le consommateur. Il faudrait alors imposer un suivi au-delà des paramètres réglementaires classiques avec l'appui scientifique de l'Anses pour détecter de telles pratiques. »
Comme le résume Jérôme Salomon, « nous avions deux procédés non autorisés [filtres sur charbon actif et ultraviolets] et on nous proposait en remplacement un procédé qui n'était pas non plus autorisé. »
Face au constat de la nécessité d'un suivi renforcé, l'ARS Grand Est saisit le 28 mars 2023 la DGS afin de solliciter son appui pour une saisine de l'Anses aux fins d'évaluer « l'opportunité et la faisabilité d'un suivi particulier de la microbiologie de l'eau », autrement dit de rechercher les virus présents avant et après filtration éventuelle sur les eaux de Nestlé dans les Vosges.
L'Anses est saisie par la DGS le 28 avril 2023, puis, par avenant, le 10 juillet 2023, des deux questions suivantes :
- « En dessous de quel seuil la microfiltration a-t-elle un impact sur le microbisme de l'eau ? ;
- « La microfiltration avec un seuil de coupure de 0,2 microns a-t-elle un effet de désinfection de l'eau ? ».
5. La DGS battue par le cabinet de son propre ministère
Pour consolider la position du ministère de la santé à l'égard de la microfiltration, Jérôme Salomon propose au cabinet du ministre de la santé d'autoriser Nestlé Waters à utiliser la filtration à un seuil de 0,8 micron, et d'inscrire ce traitement dans la règlementation française79(*).
Cette solution est toutefois écartée par Pierre Breton, conseiller au cabinet de la ministre déléguée à l'organisation territoriale et aux professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, le 27 septembre 2022. À la place, Pierre Breton soumet à la relecture des services de la DGS une note rédigée de concert avec son homologue du cabinet du ministre délégué en charge de l'industrie, proposant d'autoriser le recours à la filtration à 0,2 micron si Nestlé démontre l'absence de changement du microbisme de l'eau. Le lendemain matin, Jérôme Salomon lui renvoie la note réécrite par ses équipes en lui expliquant que la DGS maintient son opposition à l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron.
Pourtant, le 28 septembre 2022, la note est transmise par Isabelle Epaillard à Cédric Arcos, au cabinet Matignon, avec le seuil de 0,2 micron. Interrogée par Cédric Arcos : « Concernant la préconisation finale sur la technique de filtration, me confirmes-tu que la DGS est bien en phase ? », Isabelle Epaillard répond : « Oui c'est vu avec eux ». Devant la commission la directrice de cabinet de la ministre déléguée à l'organisation territoriale et aux professions de santé, a plaidé l'erreur sur l'identité de la note dont elle parlait. Erreur ou pas, le résultat est là : l'opposition claire de la DGS à la microfiltration à 0,2 micron n'a pas été relayée par Isabelle Epaillard auprès du cabinet de la Première ministre.
Intrigués par cette apparence de changement de pied de la DGS, le président et le rapporteur de la commission ont interrogé Jérôme Salomon, alors directeur général de la santé. Voici un extrait de cet échange :
« M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Je reformule notre question : Quand Mme Epaillard dit « Oui, c'est vu avec eux », en fait, cela n'a pas été vu vous.
M. Jérôme Salomon. - Ce n'est pas vu avec moi, c'est la seule chose que je peux dire. (...) je me souviens d'avoir effectivement très bien travaillé avec le cabinet pour leur donner notre point de vue. Lorsque les services donnent un avis, les cabinets peuvent décider autrement. Heureusement que c'est la vie quotidienne des cabinets. En tout cas, nous n'avons pas changé de position du jeudi après-midi au vendredi matin. »
B. L'ANSES : UN REMPART QUI AURAIT PU FAIRE DAVANTAGE
Depuis août 2021, Nestlé Waters s'emploie à convaincre les administrations de la conformité à la règlementation de la microfiltration à 0,2 micron. Cela se traduit notamment par l'envoi de notes, dont la faiblesse des arguments scientifiques est soulignée par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon dans un courriel du 10 novembre 2022 mentionné supra, qu'il conclut par la phrase suivante : « Afin de trancher de manière scientifique et technique, je saisis l'Anses sur l'impact de la filtration à 0,2 um sur la qualité d'une EMN. »
La direction générale de la santé sollicite donc l'avis de l'Anses le 23 novembre 2022 dans un courrier intitulé « Demande d'évaluation de l'impact d'une microfiltration avec un seuil de coupure inférieur à 0,8 micron sur le microbisme naturel d'une eau minérale naturelle ou eau de source ».
Plus précisément, comme indiqué supra, l'Agence est interrogée par Jérôme Salomon sur deux questions : « En dessous de quel seuil la microfiltration a-t-elle un impact sur le microbisme de l'eau ? Et la microfiltration avec un seuil de coupure de 0,2 micron a-t-elle un effet de désinfection de l'eau ? »
L'Anses répond à cette demande par un premier courrier du 16 décembre 2022 suivi d'un complément le 13 janvier 2023.
Bien que mis au courant du contexte de cette demande, et en particulier de l'insistance de Nestlé Waters à faire valider la microfiltration avec un seuil de coupure de 0,2 micron, l'Anses n'a pas validé une telle pratique.
Dans le courrier en réponse qu'elle adresse au directeur général de la santé le 16 décembre 2022, l'Anses rappelle que sur la base d'un avis de l'Afssa80(*) publié en 2001 qui résultait de l'analyse d'un dossier spécifique, les autorités avaient considéré comme acceptable la mise en oeuvre de dispositifs de filtration à un seuil de coupure de 0,8 micron dans les usines de conditionnement.
Après expertise du dossier, l'Afssa avait alors estimé que « le dispositif de filtration tangentielle ayant un seuil de coupure de 0,8 micron peut être utilisé pour le traitement d'eau de source et d'eau minérale naturelle avec l'objectif de retenir des particules présentes naturellement dans l'eau au captage ou celles résultant d'un traitement d'oxydation du fer ou du manganèse dissous, mais qu'il ne doit pas être utilisé pour rendre les caractéristiques microbiologiques des eaux conformes aux dispositions réglementaires ». Les administrations ont déduit de ces propos une « tolérance » à l'égard de la microfiltration à 0,8 micron.
Comme l'Igas dans son rapport, l'Anses alerte sur la fausse sécurisation procurée par une microfiltration à un seuil de coupure inférieur : « d'après les termes de la saisine de [la DGS], l'utilisation de dispositifs de filtration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,8 micron est présentée par les industriels comme permettant d'assurer la sécurité sanitaire de l'eau embouteillée, sans qu'aucun élément de preuve ne soit apporté en support à cette affirmation ».
En conclusion, l'Anses considère, « en l'absence de dossier constitué que « les remarques et recommandations générales formulées dans l'avis (de 2001) sont toujours valables ». Elle rappelle à ce titre notamment que « les procédés de filtration ne doivent pas être installés avec l'objectif de modifier les caractéristiques microbiologiques des eaux. En particulier, ils ne devraient pas viser à corriger une insuffisance de qualité initiale ».
Pour autant, l'Anses n'a pas demandé que soit constitué un dossier lui permettant d'analyser tous les aspects de cette question et, de ce fait, est contrainte de répondre sur la base d'un avis vieux de plus de vingt ans. Selon Matthieu Schuler, directeur général délégué du pôle « Sciences pour l'expertise » de l'Anses, entendu par la commission, « dans le courrier du 16 décembre 2022, nous exploitons des connaissances existantes, nous n'avons pas, comme l'Afssa en 2001, réuni un collectif d'experts, nous avions un temps court pour travailler et peu de données pour documenter la question scientifique consistant à déterminer si, en dessous de 0,8 micron, il existerait un seuil de coupure qui n'affecterait pas le microbisme de l'eau.
« Ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est rappeler d'une part les travaux de 2001, indiquant qu'à 0,2 micron, voire déjà à 0,4 micron, l'absence d'impact était tout à fait douteuse et, d'autre part, l'existence, depuis l'entrée en vigueur de la directive européenne de 2009, d'une liste des traitements compatibles avec l'appellation d'eau minérale naturelle ainsi que d'un mécanisme pour autoriser de nouveaux traitements. »
Sur la question de la microfiltration à 0,2 micron, l'avis de l'Anses indique, en évoquant un cas qui lui a été soumis par le cabinet santé, « que l'eau brute d'un des captages présente une contamination en bactéries coliformes et en entérocoques, laquelle n'apparaît plus après une microfiltration à 0,2 micron, ce qui constitue une action assimilable à une désinfection ». Ce constat « qu'une microfiltration si fine peut s'apparenter à une désinfection » a été réitéré par le directeur général de l'Anses, Benoît Vallet, lors de son audition par la commission d'enquête.
L'Anses évoque également dans son avis, mais seulement en annexe, un document datant de 2009 qui émane de l'Aesan (agence espagnole homologue de l'Anses). Ce document indique en conclusion que la filtration avec un seuil de coupure inférieur à 0,4 micron ne peut avoir d'autre but que la désinfection d'une eau minérale naturelle.
L'avis de l'Anses rappelle, nous l'avons vu, que les procédés de microfiltration ne doivent pas être installés avec l'objectif de modifier les caractéristiques microbiologiques des eaux. En particulier, ils ne doivent pas viser à corriger une insuffisance de qualité initiale des eaux brutes, à savoir le critère de « pureté originelle » sur laquelle se fonde l'autorisation préfectorale d'exploiter et conditionner une source d'eau minérale naturelle.
Toutefois, il aurait gagné à être beaucoup plus direct et explicite pour éviter de laisser subsister une forme d'ambiguïté que l'industriel n'a pas manqué d'exploiter.
Ainsi, Matthieu Schuler, directeur général délégué du pôle « Sciences pour l'expertise » de l'Anses, interrogé sur le fait de savoir si une microfiltration à 0,2 micron était assimilable à une désinfection et, de ce fait, interdite sur les eaux minérales naturelles, a répondu à la commission d'enquête que « le fait de trancher entre l'interdiction ou l'autorisation relève de l'autorité de gestion du risque, donc du ministère de la santé. Ce que nous indiquons dans notre avis, c'est qu'en dessous de 0,4 micron, nous ne sommes plus dans une situation où l'on peut affirmer qu'il n'y a pas d'impact sur le microbisme de l'eau ».
Relancé sur la question de savoir si une telle eau pouvait encore être considéré comme un eau minérale naturelle, il a indiqué : « c'est difficile de répondre par oui ou par non, cela dépend des délimitations que l'on fixe au champ des eaux minérales naturelles, de la définition de cette eau. La directive européenne de 2009 liste les traitements autorisés. Ensuite, l'Afssa s'est prononcée en 2001 pour dire qu'à 0,8 micron, l'impact était limité, et nous considérons aussi qu'en dessous de 0,4 micron, l'impact n'est plus limité ».
Ce refus de s'engager de manière plus explicite, de dire les choses avec plus de forces et de clarté a laissé trop de marges aux cabinets ministériels qui, soumis au chantage à l'emploi de l'industriel, n'ont pas tiré toutes les conséquences de l'avis de l'Anses, voire en ont adopté une lecture biaisée.
Benoît Vallet tend à minimiser lui-même la valeur de l'avis de son agence, puisqu'il a indiqué à la commission que « quand l'autorité administrative nous a sollicités sur l'impact d'une microfiltration, nous avons répondu non pas avec des données nouvelles, mais avec des données anciennes qui avaient été proposées à l'époque pour un dispositif très spécifique, et l'autorité administrative en a fait l'usage qu'elle souhaitait en faire ». Autant dire que le sentiment du rapporteur est que si l'Anses a bien rappelé sa position historique sur la microfiltration, elle aurait pu faire davantage, eu égard à la gravité du sujet, en demandant notamment la constitution d'un dossier, et des délais supplémentaires pour donner plus de force à son avis.
Dans les faits, ce dernier a clairement été interprété abusivement au ministère de l'industrie dans un sens favorable à l'industriel.
Adrienne Brotons, directrice de cabinet du ministre de l'industrie Roland Lescure, a ainsi affirmé à la commission : « nous comprenons de ces avis que l'impact sur le microbisme de l'eau doit être étudié au cas par cas, puisque l'Anses ne donne pas une réponse de portée générale sur l'impact d'une filtration inférieure à 0,8 micron. Nous avons cherché à établir une règle nationale générale en nous appuyant sur l'expertise de l'Anses. Nous nous sommes rendus compte, à la suite de ses avis, que l'analyse de la désinfection ne pouvait être faite que localement, au cas par cas, par les ARS et, le cas échéant, avec l'appui de l'Anses ».
Ainsi, le cabinet industrie s'est appuyé sur la prudence excessive de l'Anses pour expliquer que, certes, l'Anses avait mis en évidence un cas où la microfiltration à 0,2 micron désinfectait l'eau, mais qu'il n'était soi-disant pas possible de généraliser ce constat, véritable sophisme qui conduisait le cabinet industrie à préconiser l'autorisation de la microfiltration en dessous de 0,8 micron et, dans les faits, à 0,2 micron !
Par la suite, l'Anses n'a pas été tenue au courant des suites données à ses avis. Puisque Benoît Vallet indiquait lui-même lors de son audition que « nous n'avons pas été informés de cette concertation interministérielle dématérialisée, et je ne sais pas s'il y a eu une préparation des services pour aider les ministères. La concertation interministérielle, ses conclusions, les éléments qui seront utilisés ensuite, tout cela nous échappe et nous n'en avons pas eu connaissance. Nous sommes informés beaucoup plus tardivement que cette réunion a eu lieu, mais nous n'en connaissons pas les conclusions écrites ni les conséquences sur les sites - personnellement, je ne le sais toujours pas ».
Et pourtant, cet arbitrage a eu des conséquences très importantes.
Les éléments recueillis par la commission conduisent à regretter que l'Anses n'ait pas adopté une position plus affirmée, quitte à demander un nouveau délai pour rendre son avis à son commanditaire. Interrogée sur ce point l'agence donne la réponse suivante : « L'Anses n'a pas sollicité de délai complémentaire, car elle n'a pas identifié qu'un prolongement limité du délai aurait permis une réponse plus complète. Formuler un avis documenté et sur une analyse plus approfondie, par ex. pour préparer une sollicitation européenne du caractère conforme d'un traitement aurait nécessité un travail long, mobilisateur de moyens, et non définitif au regard de la directive EMN. De plus, à cette même période, le plan de travail de l'unité d'évaluation des risques liés à l'eau était lourdement chargé par d'autres saisines ayant trait à la sécurité sanitaire des eaux. ». En admettant qu'une étude approfondie nécessite davantage de temps et de moyens, il eut fallu que l'agence affirme nettement qu'elle n'était pas en mesure de répondre dans le délai fixé pour éviter que ceux qui y avait intérêt ne se servent de ses avis comme d'un blanc-seing.
Le plus troublant est probablement la phrase de conclusion de l'avis : « Au final, les éléments présentés ci-dessus conduisent à vous proposer la clôture de cette saisine ». Ceci alors même que l'Anses notait quelques lignes plus haut : « L'Agence considère de plus qu'une approche plus approfondie nécessiterait de disposer (...) d'informations concernant les dispositifs actuellement utilisés dans les usines de conditionnement, des conclusions de l'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes menée en 2021 (...), ainsi que de celles de la mission de l'Inspection générale des affaires sociales qui avait auditionné l'Agence au cours du premier semestre 2022. ». À l'évidence le dossier n'était pas clos. Il ne l'est d'ailleurs toujours pas, l'impact de la microfiltration à 0,2 microns ne faisant pas l'unanimité.
C. L'ABSENCE REMARQUÉE DES MINISTÈRES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA CONSOMMATION
Si certains acteurs se sont sans doute plus impliqués dans ce dossier qu'ils ne l'auraient dû d'autres ministères ont, au contraire, brillé par leur absence.
1. Le ministère de la consommation inexistant au sein de Bercy
S'agissant d'un dossier portant sur une fraude massive au consommateur, il aurait paru logique que le ministère chargé de la consommation s'empare de ce dossier au sein du ministère de l'économie.
Pourtant, il n'en a rien été.
Nestlé Waters a fait le choix de s'adresser au ministère de l'industrie, qu'il pensait certainement -et à raison- plus réceptif à ses arguments, et ce choix initial de l'industriel, que personne n'a songé à contester, a eu des effets majeurs, puisque c'est bien par la suite le ministère de l'industrie qui a eu continuellement la charge de ce dossier, plaidant avec constance dans le sens de l'industriel, comme cela a été montré précédemment.
Lors de son audition, Loïc Tanguy, conseiller en charge du dossier au cabinet des ministres de la consommation Alain Griset81(*) et Jean Baptiste Lemoyne82(*), a confirmé qu'il n'avait pas été associé à la réunion du 31 août 2021 et n'avait été informé de celle-ci qu'en prenant connaissance de la note de la DGCCRF en date du 14 septembre 2021.
Le cabinet du ministre en charge de la consommation assiste par la suite en spectateur aux échanges entre les ministères de l'industrie et de la santé et « valide », sans y être associé, le choix d'une saisine de l'Igas, car il s'agissait, selon Loïc Tanguy d'« approfondir la question du risque sanitaire, même si aucun risque ne semblait apparaître a priori », de « créer un cadre d'intervention conjoint des ARS, de l'Igas et du SNE de la DGCCRF » et de « faire un large diagnostic de l'ensemble du secteur ». Selon lui, la DGCCRF suspectait que les pratiques frauduleuses pouvaient être généralisées et « il était donc particulièrement opportun de faire toute la lumière sur cette affaire et qu'une mission puisse couvrir les différentes entreprises du secteur et dresser un panorama complet de la situation ».
Ainsi donc, le ministère chargé de la consommation, apprenant qu'il existait des fraudes, attestées et même signalées par l'industriel lui-même, fait le choix exclusif de l'enquête confidentielle et absolument pas le choix de l'information du public.
L'option qui prévaut est donc de continuer à faire boire aux Français pendant de longs mois et même plusieurs années, de manière dissimulée, de l'eau dont les pouvoirs publics savaient désormais qu'elle n'était pas de l'eau minérale naturelle puisqu'elle était traitée, comme l'eau du robinet.
Par la suite, une fois le rapport Igas remis et les échanges interministériels sur le dossier Nestlé Waters relancé à l'automne 2022 autour de la question de la microfiltration, le ministère chargé de la consommation disparaît totalement des radars, le dossier n'étant plus traité que par le ministère de l'industrie et celui de la santé.
Ainsi, Jérôme Vidal, qui a remplacé Loïc Tanguy, cette fois auprès d'Olivia Grégoire83(*), a indiqué à la commission d'enquête qu'il avait participé à la réunion interministérielle du 21 juillet 2022, tenue après le contact Nestlé-secrétaire général de l'Élysée, mais que « depuis cette réunion (...), je n'ai eu aucun autre échange avec d'autres cabinets ministériels, ni avec l'entreprise Nestlé elle-même, à l'exception d'un unique rendez-vous organisé au printemps 2023, dans le cadre du dossier relatif à la baisse des prix devant bénéficier aux consommateurs et à la grande distribution, lors de la réouverture des négociations commerciales, sur le volet Egalim ».
Les réponses d'Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge de la consommation de juillet 2022 à septembre 2024, au questionnaire de la commission d'enquête sont accablantes : « Je n'ai, en tant que ministre déléguée, pas été informée d'un dossier « Nestlé Waters », ni par mon cabinet, ni par l'entreprise, ni par un autre ministre. Je n'ai reçu aucun élément de la part de mon prédécesseur. »
C'est ainsi que ni la ministre chargée de la consommation, ni son cabinet, n'ont été associés à la concertation interministérielle dématérialisée (CID) des 22 et 23 février 2023. Le plus surprenant est que l'ancienne ministre ne s'en étonne pas. Interrogé sur les raisons qui pouvaient justifier son exclusion du dossier, elle répond : « Je crois que dans ce dossier, dans la mesure où les enquêtes étaient en cours, le volet « consommation » était bien traité. S'il s'agit d'une fraude massive au détriment du consommateur, la Justice est ou sera saisie et comme dans toute fraude avérée, les responsables seront sanctionnés. »
Au final, alors qu'il avait une responsabilité de défense du consommateur plus importante que celle du ministère de l'industrie, le ministère chargé de la consommation a systématiquement semblé absent ou à la remorque du dossier, mis en copie de mails, sans arbitrage politique des ministres successivement en charge de ce portefeuille.
Si l'absence des ministres de la consommation interroge sur leur capacité de décision, mais aussi de discernement sur la gravité d'un dossier, cette situation déplorable conduit aussi à s'interroger d'un point de vue structurel sur le positionnement du ministre de la consommation au sein de Bercy, où il court le risque de voir sa mission, protéger et défendre le consommateur, être parasitée par d'autres considérations, comme les intérêts des industriels, portées par des branches plus puissantes ou plus actives du ministère.
2. Une direction de l'eau et de la biodiversité déconnectée
Au cours de ses auditions, la commission d'enquête a pu constater à son grand étonnement que le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'avait jamais, à aucune étape, été associé aux travaux menés en interministériel sur le dossier Nestlé Waters.
Pourtant, la direction de l'eau et de la biodiversité de ce ministère est la direction d'administration centrale chargée de la conception des politiques publiques en matière de protection de l'eau et de la biodiversité. Elle est à la tête du réseau déconcentré des directions départementales des territoires (DDT) et de la mer (DDTM), qui officient auprès des préfets de département au titre de la police de l'eau.
Comme le rappelait sa directrice, Célia de Lavergne, lors de son audition, elle porte « deux enjeux majeurs liés au sujet [de la commission d'enquête]. Le premier est celui du forage, la qualité de réalisation d'un forage garantissant la protection de la ressource en eau. Le second est celui du prélèvement, avec la fixation de plafonds maximum de volumes autorisés pour garantir la soutenabilité des prélèvements ».
Pourtant, personne n'a songé à informer la direction de l'eau et de la biodiversité de l'entretien du 31 août 2021 entre Nestlé Waters et des membres du cabinet de la ministre de l'industrie de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, ni à associer le ministre de la transition écologique à la signature de la lettre de mission de l'Igas signée le 19 novembre 2021.
Et, par la suite, ce ministère et sa direction de l'eau n'ont jamais participé aux échanges entre cabinets ou entre directions sur ce dossier, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'ayant même pas été destinataire de la concertation interministérielle dématérialisée des 22 et 23 février 2023 sur la qualité des eaux embouteillées dans les Vosges et le Gard, ce qui témoigne d'un travail en silo particulièrement préoccupant alors qu'il s'agissait d'une thématique qui le concernait très directement. En l'espèce, le rapporteur est frappé par un distinguo entre un volet quantitatif de la ressource en eau, qui relèverait de la direction de l'eau et de la biodiversité, et un volet qualitatif, qui dépendrait de la santé, les deux étant considérés comme n'ayant pas de rapport, ce qui est évidemment intenable.
De même, le rapporteur n'a pu qu'être surpris par le faible intérêt qu'a semblé marquer cette administration pour le contrôle concret, sur le terrain, des prélèvements dans les nappes. Interrogé sur son association à la gestion du dossier des eaux minérales, la directrice de l'eau et de la biodiversité avait seulement répondu : « Nous avons un rôle d'animation des services de police, plutôt autour de la mise en oeuvre du cadre réglementaire. Nous n'intervenons pas dans le traitement au cas par cas effectué au niveau départemental. À l'échelon national, la stratégie de contrôle a également compris la mise en place d'un comité interministériel, mais le sujet sur lequel vous travaillez n'y a pas été abordé. »
D. LE FORCING DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE EN FAVEUR DE NESTLÉ
Si la consommation et l'environnement sont des ministères absents, il n'en va pas de même de l'industrie, pour le coup très présent, mais qui donne surtout l'impression d'avoir faites siennes les volontés de Nestlé.
1. Insuffisamment distant du groupe Nestlé et uniquement intéressé par la question économique...
a) La révélation de la fraude de Nestlé Waters le 31 août 2021 et ses suites immédiates
Comme indiqué supra, les ministères découvrent l'existence de l'utilisation de traitement non autorisés et d'une fraude massive par un rendez-vous qui se tient le 31 août 2021 au ministère de l'industrie, à la demande de l'industriel Nestlé Waters. On l'a vu cette porte d'entrée sera très utile à l'industriel, car, d'emblée, elle semble orienter l'affaire vers une question économique et industrielle et conduit à minimiser le risque sanitaire et même les pratiques frauduleuses à l'égard des consommateurs.
b) Les inquiétudes économiques faussent la vision de l'État
La lecture des documents collectés par la commission démontre que le cabinet de l'industrie aura pour principale ligne de conduite l'intérêt de l'industriel et sera en quelque sorte piégé par ce qui ressemble fort à un chantage à l'emploi de Nestlé. On l'a vu, le 10 novembre 2022, Jérôme Salomon directeur général de la santé, s'inquiète ainsi auprès de Pierre Breton, conseiller au cabinet de la ministre déléguée : « NWSE semble faire du chantage à l'ARS Grand Est (...) »
Mais l'industrie a ses propres canaux d'information : les préfets. Comme l'indique l'ancienne préfète du Gard84(*), Marie Françoise Lecaillon, après avoir fait valoir qu'elle rendait compte de ses réunions avec l'industriel à Mathilde Bouchardon : « Il est intéressant de noter que le directeur général de l'ARS était davantage focalisé sur les aspects sanitaires, tandis que je me concentrais sur les enjeux industriels ». On peut d'ailleurs regretter ce partage -informel- des tâches, alors que le préfet devrait être comptable de l'ensemble de la politique de l'État et non pas seulement de celle de l'un de ses départements ministériels.
Le document peut-être le plus emblématique est une note du préfet des Vosges de l'époque, Yves Séguy, en date du 8 juillet 2022, trouvée parmi les éléments issus de l'Élysée et dont nous savons qu'elle a été transmise à Bercy. La note, intitulée « Vives interrogations sur le devenir de Nestlé Waters Supply Est et risques sociaux associés - 800 emplois directs - Vosges », décrit sur 4 pages l'importance économique de Nestlé Vosges pour le département. Il s'agit clairement d'une alerte à l'égard des pouvoirs publics qui évoque « le climat social ambiant (...) très sensible », des « mouvements syndicaux », un « conflit social (qui) n'est pas à exclure », les risques de « vives réactions des acteurs du territoires en cas de remise en question du site Nestlé à Vittel.
Le contexte global est donc celui d'une crainte de suppressions d'emplois chez Nestlé Vosges. Ce contexte restera constamment en arrière fond des décisions de l'État. L'inquiétude est vive au sommet de l'État que Nestlé ne fasse porter la responsabilité de licenciements à venir sur les décisions de l'État et un éventuel refus de la microfiltration à 0,2 micron.
Cet argument massue est clairement avancé dans la note conjointe des cabinets santé et industrie, rédigée par Mathilde Bouchardon et Pierre Breton, destinée à Matignon, transmise le 28 septembre 2022 par Isabelle Epaillard à Cédric Arcos : « Comme annoncé, tu trouveras, en pièce jointe, la note sollicitée en vue de l'entretien demain Élysée / Matignon avec les représentants de Nestlé Waters. (...) Il est à noter que NWSE85(*) prévoirait un plan social dans ses usines des Vosges de 120 emplois (2000 emplois environ sur le secteur). Il serait compliqué de ne pas autoriser ou de suspendre leur autorisation d'exploitation sur un argument de filtration à 0,2um pour les raisons évoquées plus haut (arrêté manquant de précision sur ce qui est autorisé ou non), ainsi nous risquerions un recours. Par ailleurs, nous pourrions penser que l'industriel profiterait de sa perte d'autorisation pour justifier son plan et éventuellement tenir l'État pour responsable. Le groupe ne s'étant dévoilé que très tard sur des pratiques qui sont de toute évidence anciennes, il est possible que leur demande ne soit qu'un alibi pour se séparer de la source et appliquer leur plan social. »
La lecture des messages échangés au sommet de l'État illustre l'inquiétude croissante. Le 2 octobre 2022, Victor Blonde, conseiller industrie à Matignon et à l'Élysée, écrit à Cédric Arcos son collègue de Matignon en charge des dossiers santé : « (...) je sens qu'on va perdre encore du temps et qu'ils (Nestlé) vont engager des licenciements supplémentaires qu'ils vont nous mettre sur le dos. Les ministères ont mis un temps fou à les voir (quand ils les ont vus) et à nous remonter leurs préconisations. Franchement vu la sensibilité du dossier ce n'est pas normal. On s'en parle en interministériel depuis plus de 3 mois ». Du reste, lors de son audition par la commission d'enquête, le directeur de cabinet de la Première ministre, Aurélien Rousseau, n'a pas caché que l'enjeu économique était une donnée fondamentale de la réflexion de l'État.
Cet enjeu économique ne peut être négligé avec ses conséquences potentiellement lourdes en termes d'emplois. À cet égard, le rapporteur considère que les choix de Nestlé, à savoir une fraude massive et de longue durée et une action insuffisante en matière de préservation de la ressource en eau ont fait peser sur les travailleurs de sa branche eaux, en particulier à Vergèze une menace réelle à court et à long terme. Il apparaît aujourd'hui avec beaucoup de force que la voie empruntée d'une solution technique aux marges de la légalité, proposée par un industriel qui parvient aux termes d'un lobbying intense à mettre dans sa roue les pouvoirs publics, a augmenté les risques encourus par les salariés et ne les a pas protégés. Un plan de restauration des aquifères assorti d'un déclassement, organisée, en bonne et due forme, pour préserver les droits des consommateurs en l'attente d'un éventuel retour à meilleure fortune eut été nettement préférable pour l'emploi.
2. ...le ministère de l'industrie fait constamment pression pour que l'État satisfasse les exigences de l'industriel
a) Le dossier rebondit à l'été 2022 avec la communication aux nouveaux cabinets ministériels du rapport de l'Igas
A l'instar des autres principaux protagonistes du dossier, le cabinet industrie est renouvelé à l'été 2022 et ce sont donc un nouveau ministre, Roland Lescure, et une nouvelle équipe, en particulier Adrienne Brotons, directrice de cabinet, et Mathilde Bouchardon, conseillère technique agroalimentaire, qui découvrent le dossier Nestlé Waters à compter du mois d'août.
Selon la conseillère, « le 2 août 2022, soit une semaine après mon arrivée au sein du cabinet industrie, la directrice générale de Nestlé Waters sollicite un entretien avec celui-ci, par un mail adressé à sa directrice, comme le font des dizaines d'acteurs industriels chaque jour. Ce mail de prise de contact évoquant un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et ma directrice et moi-même n'ayant jusque-là pas été informés de son existence, nous souhaitons recueillir un maximum d'éléments avant de rencontrer l'industriel. Les cabinets des ministres en charge de l'économie et de la consommation nous fournissent quelques éléments de contexte ».
Adrienne Brotons et Mathilde Bouchardon récupèrent le rapport de l'Igas auprès du cabinet santé le 6 septembre 2022. Selon Mathilde Bouchardon, à sa lecture « nous comprenons que les manquements constatés par les inspecteurs relèvent de trois catégories : la présence de traitements clairement interdits (UV et charbon actif) ; un contrôle sanitaire réglementaire des eaux faussé par la présence en amont du point de prélèvement de traitements interdits ; et la présence de traitements reposant sur des filtres à 0,2 ou 0,45 micron, dont la présence n'est pas en soi un obstacle à la délivrance de l'appellation d'eau minérale naturelle, à condition que ces traitements soient préalablement déclarés et que l'exploitant démontre qu'ils ne constituent pas un processus de désinfection (ce que l'industriel n'a pas fait) ». Toujours selon elle, « nous comprenons également que les textes juridiques européens ou nationaux ne sont pas suffisamment clairs - ni la directive ni l'arrêté du 14 mars 2007 n'indiquant de seuil de microfiltration autorisé, laissant une marge d'interprétation ».
Sur ces entrefaites, Adrienne Brotons et Mathilde Bouchardon rencontrent les représentants de Nestlé Waters, dont Muriel Liénau, le 9 septembre 2022. Selon Adrienne Brotons, « l'équipe de Nestlé Waters nous expose la situation suivante : elle reconnaît l'existence de traitements illégaux aux rayons ultraviolets (UV) et au charbon actif, mais considère qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Elle affirme même être en train de retirer ces traitements illégaux, en les remplaçant par des filtres inférieurs à 0,8 micron. Du reste, l'équipe précise que ces filtres seraient autorisés en Espagne et au Royaume Uni et ne désinfecteraient pas l'eau ».
Les représentants de Nestlé Waters prétendent également que la microfiltration à 0,2 micron n'a pas pour but de modifier la composition microbiologique de l'eau, mais est nécessaire « dans un but dit « technologique », pour limiter le risque de formation d'un biofilm pouvant être à l'origine de déviations microbiologiques ponctuelles - le groupe mettant en avant un tel risque en cas de tuyauteries longues ».
Le 28 septembre 2022, les cabinets industrie et santé envoient conjointement la note déjà citée au cabinet du Premier ministre, contenant plusieurs préconisations. Sur le sujet de la microfiltration, les cabinets préconisent d'autoriser Nestlé Waters à utiliser des filtres à 0,2 micron, sous réserve de la transmission d'une preuve de la qualité microbiologique de l'eau, y compris au plan virologique, et d'une preuve de l'absence d'impact de cette filtration sur les paramètres microbiologiques de l'eau. Selon Adrienne Brotons et Mathilde Bouchardon, entendues par la commission, il s'agissait de prendre en compte les constats établis par l'Igas sur la nécessité de renforcer la maîtrise du risque sanitaire.
b) Le cabinet industrie s'aligne sur les revendications de l'industriel
Dans la deuxième quinzaine d'octobre 2022, le cabinet industrie reste en contact étroit avec Nestlé Waters et relaie ses demandes à Matignon et au cabinet santé. Le 28 septembre 2022, jour de la transmission à Matignon de la note conjointe industrie-santé à Matignon, Adrienne Brotons enfonce le clou dans un courriel à Victor Blonde et Cédric Arcos : « Sujet signalé, même si nous avons bien convergé ces dernières semaines avec le cab Firmin Le Bodo et Nestlé Waters.
Le point urgent à trancher c'est d'autoriser Nestlé à utiliser des filtres 0,2, pour poursuivre la production.
Notre compréhension c'est que c'est possible si Nestlé démontre qu'ils n'altèrent pas la qualité biologique de l'eau, ce qu'ils pensent pouvoir démontrer. » Suit une série de statistiques pour souligner l'importance de Nestlé dans les Vosges et dans le Gard. Le message est clair : 1°) la santé est d'accord, en tout cas aux yeux de l'industrie : « nous avons bien convergé ces dernières semaines avec le cab Firmin Le Bodo », 2°) il faut autoriser rapidement la microfiltration à 0,2 micron, 3°) il n'y a pas d'autre solution sinon arrêter la production, alors que le déclassement de l'eau aurait pu être proposée ou encore une suspension de commercialisation, le temps d'y voir plus clair...4°) il faut faire confiance à Nestlé pour démontrer ex post la non altération du microbisme de l'eau, 5°) un grand nombre d'emplois est à la clé.
Quelques jours plus tard, dans un courriel du 13 octobre 2022 à Victor Blonde, conseiller à Matignon et à la présidence de la République, Mathilde Bouchardon affirme : « le 0,2 micron nous semble vraiment la piste à privilégier ».
Le 24 octobre 2022, à la suite d'un entretien avec Nestlé Waters tenu la veille, dans un compte rendu transmis aux deux directrices de cabinet, Isabelle Epaillard et Adrienne Brotons, elle insiste à nouveau « (...) A noter, il est important de trancher rapidement, car l'impossibilité pour Nestlé de poursuivre avec des filtres à 0,2 pourrait avoir des impacts industriels et en termes d'emplois non négligeables. »
Le lendemain, 25 octobre 2022, c'est Adrienne Brotons qui saisit Cédric Arcos et Victor Blonde et se fait manifestement le porte-parole de Nestlé à l'encontre des exigences des ARS : « Victor, Cédric, Pour info, ça avance difficilement sur NWSE.
La position des ARS consiste à demander à l'entreprise d'installer les filtres, pour ensuite analyser le résultat du filtrage et leur dire si on accepte qu'ils continuent / gardent leur qualification d'eau minérale.
Ils peuvent le faire pour les Vosges sans gros surcoût ; cela semble plus compliqué dans le Gard. »
Trois jours plus tard, Mathilde Bouchardon relance le sujet dans un courriel du 28 octobre 2022 sur la nécessité « de trancher rapidement, car l'impossibilité pour Nestlé de poursuivre avec des filtres à 0,2 pourrait avoir des impacts industriels et en termes d'emplois non négligeables ».
Elle reconnaît lors de son audition devant la commission qu'elle s'est faite le porte-voix de l'industriel, reconnaissant qu'elle n'a pas véritablement cherché à remettre en cause la légitimité de ses demandes et qu'elle n'était qu'une « porte d'entrée » de Nestlé Waters dans l'appareil d'État : « le cabinet industrie s'est ainsi attaché à faire le lien entre l'industriel et les services compétents de l'État et des autres ministères. Il était important d'expliquer la vision de l'industriel, sans porter dessus une analyse. Aujourd'hui encore, je ne saurais vous dire exactement ce que recouvre une microfiltration dans un but technologique. Nous avons donc toujours insisté sur la nécessité d'une contre-expertise par les agences sanitaires. Le cabinet industrie n'était qu'une porte d'entrée pour l'industriel. Nous avons relayé les informations transmises, en demandant une pleine transparence à l'industriel ».
Or, une note du 8 novembre 2022 de la directrice de l'ARS Grand Est dont le cabinet industrie prend connaissance à l'instar du cabinet santé et de Matignon indique clairement en réponse à la demande de Nestlé Waters de voir autorisée la microfiltration à 0,2 micron que « si la filtration à 0,2 micron n'enlève pas tous les microorganismes, la flore microbienne est indéniablement fortement diminuée : il s'agirait donc bien d'une désinfection, ce qui n'est pas autorisé ».
Toujours dans la même note du 8 novembre 2022, la directrice de l'ARS écrit « L'argument des filtres nécessaires à la sécurité sanitaire est incohérent avec une eau qui serait exempte de contamination (ce qui est le cas par définition d'une eau minérale naturelle) » ou bien encore « Les UV sont enlevés, mais sont systématiquement remplacés par des filtres à 0,2 micron. Là encore, au motif de la sécurité sanitaire. Cette démarche de substitution interroge sur la qualité de la ressource elle-même et/ou des installations de prélèvement et notamment sur la nécessité de désinfecter l'eau ».
Et pourtant, alors qu'une réunion interministérielle est convoquée à Matignon le 1er décembre 2022 pour faire le point sur le dossier, le cabinet industrie adresse aux autres participants une note écrite par Mathilde Bouchardon et validée par Adrienne Brotons et le ministre Roland Lescure qui témoigne d'un alignement complet avec les positions de l'industriel :
- elle reprend, sans jamais les discuter, tous les arguments de Nestlé en faveur de la microfiltration à 0,2 micron alors qu'ils sont écartés par la direction générale de la santé ;
- elle minimise le risque de condamnation par la Commission européenne qui, selon le cabinet industrie, « semble peu élevé dans la mesure où la directive est juridiquement floue » ;
- elle minimise le risque sanitaire en écrivant « il ne semble y avoir aucun risque pour la sécurité sanitaire », alors même que la raison de la mise en place des traitements par UV et charbon actif n'est toujours pas éclaircie ;
- elle insiste en revanche sur « un risque fort de fermeture du site des Vosges très important si Nestlé Waters ne peut plus filtrer à 0,2 micron ; de plan social beaucoup plus important que celui prévu actuellement (lié à la fermeture de Vittel en Allemagne). Et risque que Nestlé Waters instrumentalise l'interdiction de filtrer à 0,2 micron pour justifier l'ensemble du plan social » ; le chantage à l'emploi de Nestlé Waters semble donc caractérisé.
Selon Roland Lescure, ministre de l'industrie, « sur Nestlé Waters, j'ai été sollicité par mon équipe pour valider la position, commune avec le ministère de la santé qui remonterait à l'arbitrage de Matignon, à partir de décembre 2022. C'est en décembre 2022 que mon équipe demande à me voir pour évoquer ce dossier et préparer la position du ministère en vue d'une réunion organisée par Matignon ».
La position présentée dans la note du 1er décembre 2022 et celles qui ont été portées par son cabinet ont donc bien été validée par lui, en particulier sur la microfiltration. Roland Lescure l'assume du reste clairement en affirmant devant la commission « nous préconisons, en adéquation avec le ministère de la santé et son cabinet, de laisser les agences sanitaires locales analyser l'effet des filtrations et autoriser, si la démonstration est faite qu'il n'y a pas de désinfection, Nestlé Waters à installer des filtres inférieurs à 0,8 micron » ou bien encore « il est possible d'autoriser une filtration inférieure à 0,8 micron si vous constatez que l'eau n'est pas désinfectée par cette filtration » .
Au mois de janvier 2023, comme le cabinet santé et Matignon, le cabinet industrie prend connaissance de l'avis de l'Anses, qui avait été saisie par le directeur général de la santé, sur la question de la microfiltration à 0,2 micron.
Or celui-ci indique clairement que « l'utilisation de dispositifs de filtration avec des seuils de coupure inférieures à 0,8 micron est présentée par les industriels comme permettant d'assurer la sécurité sanitaire de l'eau embouteillée, sans qu'aucun élément de preuve ne soit apporté en support à cette affirmation » et, plus loin, qu'« une microfiltration à 0,2 micron constitue une action assimilable à une désinfection ».
Alors que Nestlé Waters s'avère incapable de prouver que la filtration à 0,2 micron n'a pas d'impact sur le microbisme de l'eau, que les avis scientifiques exprimées par l'ARS Grand Est et l'Anses vont clairement dans le sens contraire, le cabinet industrie continue à pousser au maximum dans le sens de l'industriel.
Selon Adrienne Brotons, « un élément nouveau nous est communiqué par l'Igas, le 9 février 2023. Nous découvrons alors qu'un grand nombre d'arrêtés en France autorise une filtration inférieure à 0,8 micron et que certains arrêtés autorisent même explicitement la filtration à 0,2 micron ».
Le cabinet industrie décide immédiatement de valoriser cette information dans un sens favorable à la demande de Nestlé Waters, alors qu'il aurait dû plutôt se demander si les arrêtés autorisant une filtration inférieure à 0,8 micron n'étaient pas illégaux ou justifiés par des raisons particulières comme, par exemple, la nécessité de retenir des particules spécifiques.
Lors de son audition, Adrienne Brotons indique que, selon elle, si le choix avait été fait d'interdire la filtration à 0,2 micron, « l'industriel aurait été en droit de nous reprocher d'avoir appliqué une règle non conforme à la directive européenne et de ne pas lui avoir laissé la possibilité de démontrer qu'il ne désinfectait pas l'eau » ce qui revient manifestement à renverser la charge de la preuve.
E. L'ARBITRAGE FAUTIF AU SOMMET DE L'ÉTAT
1. Le cabinet de la Première ministre arbitre en faveur de l'industriel contre la direction générale de la santé
À Matignon, le dossier Nestlé Waters est suivi de très près par Victor Blonde, conseiller technique participations publiques, consommation et concurrence au cabinet du Premier ministre et à la Présidence de la République, ainsi que par le conseiller santé de la Première ministre, Cédric Arcos.
Le dossier est signalé en préparation d'un entretien que le Secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, accompagné de Victor Blonde, doit avoir, dans le cadre du sommet Choose France, avec le PDG de Nestlé Mark Schneider, le 11 juillet 2022.
Selon Victor Blonde, le dossier est alors présenté à Matignon et à l'Élysée dans les termes suivants par un mail de la directrice générale de la DGCCRF daté du 8 juillet 2022 : « Usine Nestlé Waters dans les Vosges ayant fait l'objet d'un audit par la mission Igas (production Vittel, Contrex et Hépar) ; constat de la pratique de filtration et discussions avec l'industriel sur la mise en conformité. La mission ne relève aucun enjeu de sécurité sanitaire. »
À la suite de l'entretien de Choose France une réunion interministérielle, qui se tient le 21 juillet 2022, est organisée par Victor Blonde pour partager largement l'information, alors que les nouveaux cabinets se constituent à la suite des élections présidentielles et législatives, et que le rapport Igas est sur le point d'être remis.
Lors de son audition, le conseiller santé de la Première ministre Cédric Arcos indique que « cette réunion a permis d'aborder divers sujets, dont celui de Nestlé Waters, sous un angle principalement industriel. J'ai alors appris que l'affaire remontait à 2021, qu'une enquête de la DGCCRF et du service national des enquêtes avait été diligentée, et qu'une mission de l'Igas était en cours. Nous avons également été informés qu'un article 40 était en préparation par l'ARS Grand Est au motif de fraude ».
Selon Cédric Arcos, cette réunion et les suivantes auquel il a participé ont toujours écarté l'existence d'un possible risque sanitaire.
Il a ainsi expliqué lors de son audition que : « dès ce premier échange, il est apparu que ce dossier n'était pas nouveau et qu'il ne s'agissait pas d'un problème de risque sanitaire. Il s'agissait plutôt un dossier de fraude d'un industriel concernant l'eau vendue dans les bouteilles » ou bien encore « je tiens à insister sur un point crucial qui a guidé notre approche. À chaque étape, dans tous les documents et discussions, il n'a jamais été question d'un risque sanitaire pour les consommateurs. Au contraire, la filtration aurait même pour effet de renforcer la sécurité sanitaire des eaux. Le problème résidait dans le fait que le produit ne correspondait pas à ce qui était qualifié aux consommateurs. »
À la lecture du rapport de l'Igas, qu'ils se procurent en marge de la réunion du 21 juillet, les conseillers de Matignon estiment qu'il existe un flou juridique résultant de la législation en vigueur sur le sujet précis des microfiltrations, et constatent que l'ampleur réelle des pratiques non réglementaires des minéraliers est estimée à au moins 30 %.
Matignon identifie également, comme le ministère de l'industrie, un risque sur le plan de l'emploi, à savoir que l'entreprise utilise cette crise pour justifier une restructuration en cours de son site des Vosges - cette restructuration impliquant alors une réduction d'effectifs de 130 personnes, en raison du ralentissement du marché allemand des eaux minérales. Toujours selon Victor Blonde, « nous avons eu des remontées du ministère sur le potentiel impact. La première alerte à ce sujet est venue du Préfet des Vosges, à travers un courrier du 8 juillet 2022 adressée à la Première ministre et à son cabinet, au ministère de l'intérieur et au ministère de l'économie. Il s'agissait, dès le début, d'une donnée du dossier ».
En revanche, les conseillers ont manifestement une lecture cursive du rapport de l'Igas s'agissant du risque sanitaire, lequel rapport notait : « la microfiltration peut aussi être perçue comme une fausse sécurisation, la littérature scientifique indiquant que même un seuil à 0,2 micron ne peut être considéré comme un mécanisme de suppression de toute flore notamment virale.
En clair, la mise en place d'une filtration à 0,2 micron sur des eaux non conformes pourrait exposer les consommateurs à un risque sanitaire en lien avec l'ingestion de virus -- qui ne seraient pas retenus par un filtre à 0,2 micron -- ou de bactéries comme en atteste un épisode survenu en Espagne ».
Lors de deux rencontres avec les représentants de Nestlé Waters, dont Muriel Liénau, qui se tiennent le 2 août 2022 avec Victor Blonde, puis le 28 septembre en compagnie de son collègue en charge de la santé, Cédric Arcos, l'entreprise plaide en faveur de la filtration à 0,2 micron. Le 28 septembre 2022, toujours, les conseillers de Matignon reçoivent la note commune des cabinets industrie et santé, qui préconise d'autoriser Nestlé Waters à utiliser des filtres à 0,2 micron, sous réserve de la transmission d'une preuve de la qualité microbiologique de l'eau, y compris au plan virologique, et d'une preuve de l'absence d'impact de cette filtration sur les paramètres microbiologiques de l'eau. Preuve, soit dit en passant, qui ne sera jamais fournie.
Mais le 2 octobre 2022, Cédric Arcos reçoit une nouvelle note, cette fois ci émanant exclusivement du cabinet santé. Selon lui, celle-ci « modifiait sensiblement ses recommandations. Le niveau de filtration recommandé passait de 0,2 à 0,8 micron ». Tout se passe comme si le cabinet santé regrettait de s'être laissé entraîner par le cabinet industrie vers l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron.
Constatant ce revirement du cabinet santé, Cédric Arcos écrit à son collègue Victor Blonde que le cabinet santé « pense vraiment que quelque chose n'est pas clair dans l'attitude de l'industriel qui couplait un traitement UV et charbon avec un filtrage à 0,2 micron. Du coup, ils pensent qu'a minima il faut que l'industriel donne tous les éléments à l'ARS et que des contrôles soient réalisés pour s'assurer que les propriétés bactériologiques de l'eau sont bien intactes ».
À la suite de leur deuxième rendez-vous du 28 septembre avec Nestlé Waters et sur la base différentes notes communes ou séparées que leur avaient transmis les cabinets industrie et santé, les deux conseillers de Matignon Victor Blonde et Cédric Arcos adressent alors une note au directeur de cabinet de la Première ministre, Aurélien Rousseau, le 6 octobre 2022, dans laquelle sont rappelés les développements précédents du dossier Nestlé Waters avant d'en arriver à la question clef de la filtration à 0,2 micron que réclame Nestlé Waters pour mettre fin au traitement de ses eaux par charbon actif et par UV.
Les deux conseillers résument ainsi la position des ministères : « si le ministère de l'industrie est sensible aux difficultés économique rencontrés par les sites de Nestlé Waters (...) dès lors qu'aucun risque pour la santé n'a été identifié, le ministère délégué à l'organisation territoriale du système de santé considère pour sa part qu'une autorisation de filtration à 0,2 micron ne saurait être autorisée en l'état des données fournies par l'industriel et qu'elle constituerait par ailleurs un précédent national qui en serait pas sans effet collatéral ».
En conséquence, les deux conseillers préconisent justement de « demander à l'industriel de fournir sous un mois aux ARS concernées toutes les données permettant d'évaluer l'effet des mesures mises en place et notamment du filtrage à 0,2 micron sur la qualité microbiologique de l'eau ».
Et, effectivement, à la suite de la validation de cette note par le directeur de cabinet de la Première ministre, consigne sera donnée par les deux conseillers le 13 octobre 2022 aux ministères de l'industrie et de la santé de « demander à l'industriel de fournir sous un mois aux ARS concernées toutes les données permettant d'évaluer l'effet des mesures mises en place et notamment du filtrage à 0,2 micron sur la qualité microbiologique de l'eau ».
Comme il a été indiqué supra, l'industriel ne fournira jamais ces données, tandis que l'ARS Grand Est, la DGS et l'Anses affirmeront explicitement que la filtration à 0,2 micron a un effet sur la qualité microbiologique de l'eau et peut être assimilée à une désinfection.
Selon Victor Blonde, lors de son audition par la commission, « selon le ministère de la santé, les experts évoquaient un pouvoir désinfectant de la microfiltration en dessous de 0,2 micron. Entre 0,2 et 0,8 micron, il subsistait une part de flou et d'interprétation. Les autorités belges et espagnoles appliquaient un seuil de 0,4 ou 0,45 micron. En France, un certain nombre de dérogations préfectorales permettaient de descendre en deçà de 0,8 micron ».
Il en déduit qu'« il n'existe pas de mesure de droit positif interdisant formellement la microfiltration à 0,8 micron. Cette pratique n'était ni claire ni mise en oeuvre de manière uniforme ». Certes, mais les conseillers au cabinet de la Première ministre savaient qu'il n'existait pas davantage de « mesure du droit positif » autorisant une telle microfiltration, laquelle par nature ne pouvait que fragiliser la pureté originelle des eaux concernées, qui est au coeur de la définition d'une eau minérale naturelle.
Une première réunion de suivi du dossier avec les cabinets santé et industrie est organisée par les deux conseillers de Matignon Victor Blonde et Cédric Arcos le 1er décembre 2022. Elle donne lieu à la note du cabinet industrie présentée supra qui soutient sans nuance les positions de Nestlé Waters.
Après un nouveau retournement du cabinet santé, lors d'une réunion organisée le 16 février 2023, les ministères de l'industrie et de la santé expriment ensuite des avis convergents, qui vont dans le sens d'une autorisation de la microfiltration sous le seuil de 0,8 micron. Ce que confirme Victor Blonde : « personne n'a gagné ou perdu un arbitrage. La solution retenue a été élaborée conjointement avec les deux ministères concernés ». Sur cette base, les conseillers de Matignon font de cette position celle de l'État et prennent la décision d'autoriser une microfiltration sous le seuil de 0,8 micron.
Selon eux, ils ont été l'ultime niveau d'arbitrage sur ce dossier, la direction de cabinet étant tenue informée, mais pas la Première ministre, en revanche, qui ignorera donc l'existence d'irrégularités qui allaient affecter des millions de consommateurs depuis, puisque sont aujourd'hui encore vendues comme eaux minérales naturelles des eaux qui ne devraient pas avoir droit à cette appellation, en particulier du fait d'une microfiltration non prévue dans les arrêtés préfectoraux d'exploitation.
Cette décision importante ne fait donc l'objet d'aucune validation politique. Selon le conseiller santé Cédric Arcos, « aujourd'hui, avec l'ampleur prise par l'affaire et votre commission d'enquête, je comprends qu'il soit possible de s'interroger sur notre gestion du dossier. Cependant, à l'époque, nous n'avions pas le sentiment qu'il s'agissait d'une affaire nécessitant une intervention politique directe », notamment parce que les ministères avaient abouti, in fine, à une position commune.
La position validée par les deux conseillers de Matignon est ensuite « bleuie » pour clairement fixer la ligne de conduite à tenir par les administrations au cours d'une concertation interministérielle dématérialisée (CID) des 22 et 23 février 2023 dont le compte-rendu précise : « en réponse aux demandes de l'industriel et aux interrogations des autorités préfectorales et de l'ARS, et au regard d'une part des autres autorisations déjà accordées en France, et, d'autre part, de l'absence de norme empêchant ce niveau de filtration, confirme la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 micron ».
Lors de leurs auditions respectives, par un raisonnement spécieux, les deux conseillers techniques ont soutenu que cette décision n'autorisait pas Nestlé à recourir à la microfiltration à 0,2 micron alors qu'elle faisait référence à la possibilité de descendre en dessous de 0,8 micron et de valider un plan de transformation intégrant une filtration à 0,2 micron.
Ce bleu de CID constituait donc bien de toute évidence une validation implicite, mais transparente de la filtration à 0,2 micron. À la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas eu recours à un outil simple pour rétablir l'ordre immédiatement, à savoir le déclassement des eaux, ce qui aurait permis de rétablir les droits de chacun et d'assurer la transparence requise, les deux conseillers ont répondu que telle n'avait pas été le point qu'ils avaient eu à trancher. Ils ont donc uniquement pris en compte la question que l'industriel leur posait, sans réellement s'interroger sur la meilleure solution à apporter du point de vue de l'intérêt général.
2. Que savait la présidence de la République ?
Compte tenu notamment du rôle dans le dossier des eaux minérales d'un conseiller partagé entre Matignon et Élysée, Victor Blonde, et de la découverte de courriels pouvant démontrer une intervention de la présidence de la République, le rapporteur a demandé, le 18 février 2025, au secrétaire général de l'Élysée les documents relatifs au traitement de ce dossier par la présidence. La commission a reçu un total de 74 pages de documents, ce qui démontre la densité des échanges Nestlé-Élysée. Le premier document dont nous ayons connaissance date du 8 juillet 2022 et le dernier du 17 janvier 2025.
Il apparaît à la lecture de ces documents que la présidence de la République a été approchée à plusieurs reprises par le groupe Nestlé et que le secrétaire général de la présidence la République a rencontré les dirigeants du groupe Nestlé et a été en contact avec eux sur la question des eaux en bouteille.
Ce niveau d'implication dans ce dossier justifiait pleinement la convocation du secrétaire général de l'Élysée par la commission d'enquête.
Mais celui-ci a fait le choix de se dérober, alors même que dans sa lettre de transmission des documents, en date du 19 mars dernier, il indiquait « ces documents n'ayant pas eu pour finalité d'éclairer le Président de la République en vue d'une prise de position de sa part, ni ayant été la transcription par ses collaborateurs d'une telle prise de position nous pouvons, au regard du principe de séparation des pouvoirs, vous les adresser ». En toute logique, s'expliquer sur des documents dont la communication n'allait pas à l'encontre de la séparation des pouvoirs ne pouvait altérer davantage cette séparation.
La commission d'enquête a considéré que la meilleure réponse à faire à la dérobade du secrétaire général de l'Élysée, était de rendre publics les documents sur lesquels il refuse de s'expliquer.
Leur diffusion sur internet, leur insertion en annexe de ce rapport ainsi que la lecture des principaux éléments lors de la réunion du 8 avril dernier, permettent de se contenter ici d'un résumé.
Ainsi qu'il a été indiqué supra, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, semble découvrir le dossier des fraudes de Nestlé Waters à l'occasion d'une rencontre avec le directeur général de Nestlé SA86(*) Mark Schneider, le 11 juillet 2022 à Versailles dans le cadre du sommet Choose France.
Victor Blonde, qui l'accompagnait et qui, rappelons-le, est conseiller à la fois à Matignon et à l'Élysée, réalise pour ses collègues du cabinet du président de la République un bref compte rendu par mail : « Nous avons vu le patron de Nestlé lundi à Choose France avec le Secrétaire général. Deux sujets de préoccupations : [...] le dossier Nestlé Waters (remise d'un rapport Igas cette semaine après enquête de la DGCRF mettant en évidence un usage trop important de traitement de filtration pour corriger la qualité des eaux Vittel Contrex et Hépar - avec de potentiels impacts sur les sites concernés et un enjeu de communication pour bien gérer la séquence ». Victor Blonde propose en conséquence d'organiser une réunion avec les ministères concernés « pour faire le point sur le dossier et bien coordonner l'action des ministères », réunion qui se tiendra le 21 juillet.
D'après les documents transmis à la commission d`enquête, c'est ensuite lui qui suit le dossier à Matignon en lien avec Cédric Arcos, ses collègues de la présidence de la République renvoyant vers lui lorsqu'ils sont sollicités.
Le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet du président de la République sont destinataires d'abord du projet de compte-rendu puis du compte-rendu final de la concertation interministérielle dématérialisée (CID) qui se tient les 22 et 23 février 2023 et qui valide les orientations issues de la réunion interministérielle du 16 février 2023.
Le dossier rebondit à l'Élysée le 23 janvier 2024 quand Nicolas Bouvier sollicite le secrétariat d'Alexis Kohler pour que celui-ci joigne téléphoniquement, « dès que possible », Mark Schneider, directeur général du du groupe Nestlé, rencontré un an et demi plus tôt lors du sommet Choose France. La concomitance avec les premières révélations de la presse sur le dossier Nestlé Waters est flagrante. Alexis Kohler interroge les membres du cabinet sur les motifs de cette demande d'appel urgent et Victoire Vandeville lui répond « qu'après échange avec leurs équipes, le PDG de Nestlé souhaite évoquer avec toi son plan de transformation et l'impact de ce dernier sur les deux sites français, dans le contexte de l'enquête qui a été lancée par Le Monde et Radio France, et suite aux discussions que vous aviez eu ensemble lors de Choose France 2022 ».
Dans son courriel, Victoire Vandeville précise « Le Monde et Radio France mènent une enquête sur les eaux embouteilles et notamment sur Nestlé Waters qui s'était manifesté pour signaler des traitements non-conformes sur leurs sites en 2021. Les cabinets santé et industrie ont préparé des réponses pour rappeler la rigueur de la réponse de l'État (mission Igas, contrôle ARS, article 40, mission Anses sur les seuils de filtration à appliquer, demande de mise en conformité de l'entreprise) étant entendu que le sujet n'est pas d'ordre sanitaire, mais plutôt de tromperie au consommateur puisque les traitements non conformes (qui en l'espèce renforcent la filtration de l'eau) posent la question de l'appellation « eau minérale naturelle ».
Ce contact téléphonique entre Alexis Kohler et le directeur général de Nestlé a très vraisemblablement eu lieu, mais aucun compte-rendu n'a été transmis à la commission d'enquête. La présidence de la République a en tout état de cause été associée à très haut niveau à la réaction de Nestlé Waters aux révélations des journalistes du Monde et de France Info.
Le 30 janvier 2024, Victor Blonde informe ses collègues de l'Élysée, et en premier lieu le secrétaire général, que « comme attendu France Info et Le Monde ont sorti une enquête sur les eaux embouteillées et plus précisément sur le cas de Nestlé Waters. Elle met en lumière les pratiques de traitement non conformes de l'entreprise sur certains de ses sites dont Nestlé nous avait fait part à l'été 2021 (craignant sans doute une inspection après l'enquête administrative et les contrôles qui avaient eu lieu fin 2020 chez Alma après un signalement de la part d'un ancien employé) et qui a fait l'objet à compter de cette date d'un suivi très fin de la part des ministères et des services déconcentrés ». Victor Blonde précise également à l'attention de ses collègues que « contrairement à ce qu'affirme France Info, nous avons bien saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 », faisant ainsi référence à la procédure introduite par la directrice générale de l'ARS Grand Est. Ce faisant, il oublie de noter, à l'instar de la communication gouvernementale, que ce ne sont pas les ministres, ni les cabinets ministériels ni les administrations centrales qui ont fait ce signalement et que, par ailleurs, il ne porte que sur ce qui s'est passé dans les Vosges : le Gard (Nestlé) et l'Allier (Alma) sont oubliés. Victor Blonde fournit ensuite à ses collègues les « éléments de langage » transmis par les ministères de l'industrie et de la santé pour présenter, dans un sens évidemment très favorable aux décisions gouvernementales, les actions menées par l'État sur le dossier depuis 2021.
Le 10 octobre 2024, le secrétaire général de l'Élysée rencontre Laurent Freixe, nommé directeur général de Nestlé le 1er septembre 2024. Il est accompagné ce jour-là par Muriel Lienau, directrice générale de Nestlé France et de Nestlé Waters, preuve que le sujet des eaux minérales naturelles est au coeur des échanges.
Dans la note que lui préparent les conseillers du cabinet, il est rappelé les éléments suivants concernant le dossier Nestlé Waters : « des plaintes visant Nestlé ont été déposées en février 2024 pour des forages illégaux et le traitement frauduleux d'eaux minérales. Pendant de nombreuses années, des eaux vendues comme « de source » ou « minérales » ont en effet subi des techniques de purification interdites pour traiter des contaminations d'origine bactérienne ou chimique. En juillet dernier, la Commission a publié un rapport d'audit ciblant l'incapacité des autorités françaises à enrayer les fraudes de l'entreprise. Une convention judiciaire d'intérêt public a été validée le 10 septembre, moyennant le versement d'une amende de 2 millions d'euros à l'État et aux associations plaignantes. Une nouvelle plainte a toutefois été déposée fin septembre 2024 contre X avec constitution de partie civile pour « tromperie » devant le tribunal judiciaire de Paris par l'association Foodwatch ».
Dans un message transmis à Nicolas Bouvier à la suite du rendez-vous avec Laurent Freixe, Alexis Kohler précise que : « comme indiqué à Laurent Freixe, outre le cabinet du Premier ministre, les interlocuteurs les plus utiles dans les ministères sont les directeurs de cabinet de la ministre de la santé et du ministre de l'industrie ». Sont en copie de ce mail « les adresses des équipes de l'Élysée en charge du suivi », preuve que la présidence de la République entend conserver un regard très attentif sur ce dossier sensible.
Le 17 décembre 2024, le lobbyiste de Nestlé, Nicolas Bouvier, écrit une nouvelle fois au secrétariat d'Alexis Kohler en indiquant que « Madame Lienau, Présidente de Nestlé France, avec qui Monsieur Kohler a échangé plusieurs fois ces derniers mois, aurait souhaité pouvoir s'entretenir brièvement avec lui le plus rapidement possible, en lien avec l'arbitrage interministériel de 2023 qui avait été rendu sur l'eau ». C'est donc la question de la microfiltration qui est au coeur des échanges entre Nestlé et la Présidence de la République.
En préparation de cet appel, plusieurs conseillers de la Présidence de la République établissent des synthèses du dossier à l'attention d'Alexis Kohler.
Après avoir rappelé brièvement la différence entre les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement, le conseiller énergie, environnement, transports et agriculture, Benoît Faraco, indique notamment dans un courriel du 18 décembre 2024 s'agissant du « problème de Perrier » que : « comme d'autres groupes (notamment Volvic qui nous en a parlé) le changement climatique, mais aussi l'artificialisation des sols, les nappes dont dépendent les sources sont de plus en plus régulièrement polluées, notamment de sources bactériologiques (et en partie des matières fécales). Cela disqualifie donc régulièrement les eaux qui doivent être traitées pour pouvoir être rendues propres à la consommation, ce qui constitue une grosse perte de valeur pour les entreprises, car ils ne peuvent plus vendre à 50 centimes le litre, mais en théorie qu'à 10-15 centimes le litre. C'est cette situation qui a conduit Perrier (et d'autres) à dissimuler des traitements réalisés ces derniers temps ».
Dans un courriel également daté du 18 décembre 2024, la conseillère industrie, innovation et numérique, Claire Vernet Garnier, qui avait assisté au rendez-vous du 10 octobre avec Laurent Freixe, rappelle que lors de cet entretien « nous étions revenues sur le sujet des eaux vendues par Nestlé comme dites « de source » ou « minérales » alors qu'elles avaient subi des techniques de purification interdits pour traiter des contaminations d'origine bactérienne ou chimique ».
Après avoir rappelé les grandes étapes du dossier, elle rappelle l'arbitrage interministériel de février 2023 et le justifie en expliquant que des filtres d'une coupure inférieure à 0,8 micron pouvaient être autorisés « leur présence n'étant pas, en soi, un obstacle à la délivrance de l'appellation « eau minérale naturelle », à condition qu'ils ne modifient pas la qualité et la composition de l'eau et notamment les caractéristiques microbiologiques de l'eau embouteillée », mais également « au regard de l'absence de norme interdisant explicitement ce niveau de filtration ».
Or, comme indiqué précédemment, la preuve de l'absence de modification des caractéristiques microbiologiques de l'eau n'a jamais été apportée par Nestlé Waters et les recommandations tant de la direction générale de la santé que de l'Anses étaient de ne pas autoriser de microfiltration inférieure à 0,8 micron, et en particulier une filtration à 0,2 micron.
Claire Vernet Garnier relève enfin que « plusieurs articles de presse sont parus ces dernières 24 heures, faisant état du rapport daté d'août 2024 de l'ARS Occitanie qui suggérait à Nestlé d'envisager un arrêt de sa production d'eau minérale Perrier dans le Gard, raison certainement de la sollicitation de la Présidente de Nestlé ».
Le 20 décembre 2024, après avoir visiblement été sollicité en ce sens par Alexis Kohler, Benoît Faraco lui adresse un point de situation à la suite d'un échange qu'il a eu avec Grégory Emery, directeur général de la santé. Il indique qu'en premier que « nous avons appris que sur le site de l'est de la France, des perquisitions étaient en cours, ainsi que des demandes d'accès à des documents administratifs (échanges entre les cabinets et les services), ce qui rend nos interlocuteurs très prudents sur un sujet sur lequel ils considèrent que l'approche politique ne l'a pas toujours été ».
Sur le fond du dossier, Benoît Faraco explique qu'il ressort de sa conversation avec Grégory Emery qu'« il y a une pression forte sur les nappes dont la qualité se dégrade, rendant difficile à terme le maintien de l'appellation « eau minérale naturelle » sur de nombreux acteurs, Perrier étant malheureusement l'un des premiers pour lesquels cela arrive ». Il précise également que la direction générale de la sante considère que « le droit européen est très strict, et que même si la Commission commence à être sensible aux enjeux soulevés par certains acteurs du secteur, le principe juridique est clairement énoncé : pour garantir l'appellation d'eau minérale naturelle, il y a plusieurs conditions strictes et des dérogations très encadrées ». Benoît Faraco rappelle alors l'état du droit sur les traitements extrêmement limités autorisés pour les eaux minérales naturelles.
Sur la microfiltration, il indique, en faisant référence à la possibilité de solliciter la Commission européenne pour obtenir l'autorisation d'un traitement « j'en déduis qu'il existe une possibilité de dérogation, et que nous pouvons donc les aider à la porter au niveau européen, sauf à ce que les techniciens compétents disqualifient le processus, pour une raison ou une autre (en gros si les filtres changent la composition, ce que Nestlé réfute, mas là il faut une expertise que je n'ai pas ». Il relève cependant que la question a déjà été abordée au niveau européen, citant l'audit de la Commission européenne de mai 2024, sans avoir l'air d'avoir pleinement conscience que celui-ci précise bien que la filtration à 0,2 micron n'est pas conforme à la législation européenne.
Les documents transmis par la Présidence de la République s'arrêtent à cette date. Ils montrent clairement que :
1. La présidence de la République était loin d'être une forteresse inexpugnable à l'égard du lobbying de Nestlé. Au contraire, les contacts sont fréquents et l'Élysée ouvre les portes de certains ministères au groupe suisse ;
2. La présidence de la République savait, au moins depuis 2022, que Nestlé trichait depuis des années ;
3. Elle avait conscience que cela créait une distorsion de concurrence avec les autres minéraliers ;
4. Elle avait connaissance des contaminations bactériologiques, voire virologiques sur certains forages.
Mais ces documents, sur lesquels Monsieur Kohler n'a pas voulu s'expliquer, conduisent aussi à des questions aujourd'hui sans réponses :
- pourquoi ne pas avoir donné des instructions simples de respect de la loi aux ministères, instructions qui auraient évité les palinodies de la concertation interministérielle de février 2023 qui aboutit tout de même à ce que le Gouvernement autorise une microfiltration à un industriel, Nestlé, qui est « hors des clous », microfiltration qui, de surcroît, ne règle pas vraiment le problème des contaminations ;
- Pourquoi personne au sein de l'exécutif, et surtout pas la présidence, ne prend-t-il ce dossier à bras le corps pour en dégager le véritable enjeu : protéger nos ressources en eaux minérales naturelles et aboutir à une réglementation européenne davantage harmonisée ?
- Enfin, pourquoi avoir donné tant de place à Nestlé dans les discussions, alors que les autres groupes minéraliers comme Danone ou Alma, pourtant français, ne font l'objet d'aucune sollicitude particulière et ne sont même pas consultés lorsqu'il s'agit de modifier la réglementation ? Pourquoi cette position privilégiée de Nestlé, alors que l'Élysée sait que ce groupe triche depuis des années ?
III. UN ÉTAT LOCAL LAISSÉ LIVRÉ À LUI-MÊME ET MAL ARMÉ FACE À L'AMPLEUR DES PRÉOCCUPATIONS SANITAIRES, ENVIRONNEMENTALES ET ÉCONOMIQUES LIÉES AUX PRATIQUES FRAUDULEUSES
A. LE DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT CENTRAL DE LA MISE EN oeUVRE CONCRÈTE DU PLAN DE TRANSFORMATION DE NESTLÉ WATERS
1. Dans les Vosges
Dans les Vosges, les orientations de la CID des 22 et 23 février 2023 ne répondent que partiellement aux interrogations des autorités locales.
D'une part, la suspension des forages « Thierry Lorraine » et « Belle Lorraine » de Contrex fin novembre 2022, et la décision de suspendre le forage Essar d'Hépar du 16 février 2023, ont toutes deux résolu la nécessité de recourir à des traitements de microfiltration de nature à s'apparenter à de la désinfection.
La question restait toutefois pendante au 22 février 2023 pour les sources « Peulin » (Hépar), « Ermitage » (Hépar) et « Grande Source captage référence « (Vittel)87(*), où la microfiltration à 0,2 n'était pas autorisée dans les arrêtés préfectoraux en vigueur à la date du contrôle diligenté par l'ARS Grand Est88(*).
Des arrêtés préfectoraux modificatifs du 4 juillet 2023 ont finalement autorisé le recours à des filtres à 1,2 et à 0,45 microns pour les seules sources de Vittel89(*).
S'agissant d'Hépar, Nestlé a également déposé une demande de modification des arrêtés préfectoraux pour autoriser le recours à la filtration à 0,2 microns, qui est toujours en cours d'instruction par les services de l'ARS Grand Est, comme l'a indiqué à la commission Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l'ARS, depuis juin 2024.
2. Dans le Gard
Dans le Gard, les orientations de la CID des 22 et 23 février 2023 ne répondent pas non plus aux interrogations des autorités locales.
Ces dernières avaient pourtant déjà été exprimées par Didier Jaffre, directeur général de l'ARS : dès le 12 décembre 2022, il sollicite par courriel le cabinet de la ministre Agnès Firmin-Le Bodo, en vue d'un positionnement sur la microfiltration à 0,2 micron et d'un arbitrage sur le retrait immédiat des traitements interdits ou la gestion d'une dérogation en 2023.
Or, à l'issue d'une réunion du 28 mars 2023 organisée spécifiquement sur le thème des suites données au compte-rendu de la CID, il réitère, le 30 mars, avec la préfète du Gard, ses interrogations auprès des cabinets des ministres chargés de la santé et de l'industrie. Directeur général de l'ARS et préfète indiquent tous deux à la directrice de cabinet de la ministre déléguée chargée de la santé, Isabelle Epaillard, qu'ils ne préconiseront pas de dérogation à la règlementation. Ils sollicitent des propositions de scénarii de la part de l'échelon central.
La préfète du Gard demande également à Mathilde Bouchardon, conseillère au cabinet de la ministre de l'industrie, la communication du plan de transformation de Nestlé Waters - qu'elle n'avait pas encore obtenu, alors que c'est sur ce document que se fondent les actions tranchées dans le cadre de la CID. Ce plan de transformation soulève alors de nouvelles interrogations de la part des autorités locales.
Le 7 avril 2023, Didier Jaffre relève, dans un courriel à Isabelle Epaillard, que le plan de transformation transmis aux services déconcentrés et à l'ARS n'a pas été revu depuis septembre 2022. Il note : « si à la fin de leur plan de transformation ils seront conformes à la réglementation et au bleu, il n'en est rien pour la phase intermédiaire. Pendant cette période transitoire de réalisation des travaux du plan de transformation qui va durer entre 12 et 18 mois, [Nestlé Waters] n'envisage en aucun cas de retirer les traitements par charbon actifs et par UV. » Didier Jaffre en conclut : « Dès lors [Nestlé Waters] n'est pas en conformité avec la réglementation européenne et ne peut pas vendre une eau dite minérale naturelle, à l'exception des Etats-Unis. »
Pour autant, à la connaissance de la commission d'enquête, la poursuite de la production de Nestlé Waters pendant le maintien de ces traitements interdits s'est confirmée. Aucun scénario alternatif n'a été étudié ; aucune mesure n'a été prise pour assurer la conformité de l'exploitant à la règlementation durant la période dérogatoire.
Le rapporteur s'interroge : les cabinets à l'oeuvre dans la préparation de la CID pensaient-ils que Nestlé retirerait les traitements du jour au lendemain ? Ou ont-ils tacitement autorisé une dérogation sur plusieurs mois en laissant les autorités locales en première ligne ?
Le 21 avril 2023, à la demande de la préfète du Gard, Nestlé Waters lui transmet le plan de transformation du site complété par rapport à sa version de septembre 2022. Une réunion sur ce plan a alors lieu le 2 juin 2023 à la délégation départementale du Gard de l'ARS Occitanie, impliquant les services de l'État, l'ARS, mais aussi Nestlé Waters. Cette réunion acte la transformation de l'exploitation en reprenant toutes les étapes prévues par Nestlé Waters.
La production serait bien séparée en deux flux :
- d'une part, les forages Romaine III et Romaine V seront dédiés à la production de boisson rafraîchissante sans alcool, à partir d'une eau traitée, sous la désignation commerciale « Maison Perrier », commercialisée sans la mention d'étiquetage d'eau minérale naturelle - en effet selon l'Anses90(*), entre janvier à fin mai 2023, les forages Romaine III et V ont présenté des taux de non-conformité de 23 et 27 % ;
- d'autre part, un nouveau mélange d'eau minérale naturelle sera exploité à partir des forages Romaine IV, IV bis, VI, VII et VIII - bien que l'ARS exprime ses réserves sur la qualité des eaux brutes de Romaine VIII.
Dans son principe, l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron est également accordée. Il est alors écrit noir sur blanc dans le compte-rendu de la réunion : « les traitements de microfiltration à 0,2 micron seront intégrés dans les nouveaux arrêtés d'autorisation ».
Tandis que la microfiltration serait mise en place sur les deux flux de production, les traitements au charbon actif et les lampes UV seraient maintenus exclusivement pour les eaux utilisées dans le cadre de la production des boissons « Maison Perrier ».
Ce qui est appelé sobrement la « gestion de la période intermédiaire » désigne en réalité la période transitoire pendant laquelle Nestlé Waters continue d'être en infraction par rapport à la règlementation. Durant cette période, il est demandé à Nestlé Waters de transmettre les éléments suivants :
- un suivi de la qualité des eaux brutes des trois dernières années,
- les dates retenues pour le retrait des traitements de désinfection au charbon actif et aux lampes à UV, et pour le déploiement des microfiltres à 0,2 micron,
- l'analyse des paramètres du nouveau mélange d'eau minérale naturelle,
- l'inclusion du risque virologique dans les paramètres de surveillance - puisqu'il n'est pas maîtrisé par les filtres.
Enfin, il est prévu que d'ici 2027, Nestlé Waters explore le recours à de nouveaux forages, sous réserve de l'accord de principe de la DDTM et de la Dreal.
B. LA TRADUCTION CONCRÈTE DU PLAN DE TRANSFORMATION DE NESTLÉ WATERS PAR LES AUTORITÉS LOCALES
1. Dans les Vosges, la régularisation tardive des arrêtés préfectoraux a permis la commercialisation d'eau minérale naturelle qui n'en était pas pendant plusieurs mois
Sollicitée par la commission d'enquête, la préfecture des Vosges a estimé qu'entre la découverte des traitements interdits au charbon actif et aux UV, le 6 avril 2022 et leur retrait par l'exploitant, les volumes suivants d'eaux avaient été prélevés :
- pour Essar (Hépar), 30 550 m3 d'eau traitée aux lampes à UV ont été exploités entre le 6 avril 2022 et le 5 mai 2023, date de la mise à l'arrêt d'Essar et d'Hépar Nord ;
- pour Belle-Lorraine, Anger-Lorraine, Great Source, Reine Lorraine et Thierry Lorraine (Contrex), 394 907 m3, 105 780 m3 pour Belle-Lorraine, 45 155 m3 pour Thierry-Lorraine, 158 030 m3 pour Anger Lorraine, 48 358 m3 pour Great Source et 37 584 pour Reine Lorraine. d'eau ont été prélevés entre le 6 avril 2022 et le 28 novembre 2022, date de retrait des traitements interdits aux lampes à UV par Nestlé Waters ;
- pour Grande Source captage (Vittel), 15 000 m3 d'eau ont été traités aux filtres à charbon actif entre le 6 avril 2022 et le 17 avril 2022, date de leur retrait par l'exploitant.
Soit un total de 439 857 m3 qui ont été commercialisés en tant qu'« eau minérale naturelle » sans pour autant en respecter les caractéristiques. Le tout pouvant être valorisé à environ 220 millions d'euros à raison de 0,5 €/litre.
a) Dans le Gard, le plan de transformation repose sur le déclassement de deux forages et le lancement d'une nouvelle gamme de boissons en contrepartie de l'arrêt des traitements interdits
Une réunion sur la mise en oeuvre du plan de transformation de Nestlé Waters a lieu le 26 juin 2023 à la délégation départementale de l'ARS Occitanie, en présence de Nestlé Waters. Il y est évoqué le retrait des traitements interdits d'ici le 17 juillet 2023. Le compte-rendu mentionne que « le retrait des barrières de protection sera compensé par les étapes de filtration à 0,2 micron » - conformément à ce qui a été acté durant la réunion du 2 juin 2023.
En vue de sécuriser son utilisation de la marque « Maison Perrier » pour commercialiser une eau qui ne serait désormais plus « minérale naturelle », Nestlé Waters sollicite le cabinet du ministère de l'industrie en vue d'obtenir un entretien avec la DGCCRF sur les risques juridiques associés. Cet entretien a lieu le 29 juin 2023.
Les conclusions de la DGCCRF sur ce sujet sont résumées dans une note-ministre de la DGCCRF du 6 octobre 2023. La DGCCRF estime « peu convaincants, compte tenu de la formulation des questions posées » les résultats de l'étude menée auprès de 77 consommateurs pour attester de l'absence de risque de confusion entre les marques « Perrier » et « Maison Perrier ». Elle estime que « le risque d'induire en erreur le consommateur sur la qualité des boissons de la marque Forever ne semble pas pouvoir être totalement écarté ». La note rappelle que « la création d'un biais de perception conduisant au final à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques des produits est susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale restrictive au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation (...) » Toujours dans cette note, la DGCCRF propose de suggérer à Nestlé Waters de minimiser ce risque en adaptant le packaging de cette gamme : « le risque ne résidant pas tant dans les contrôles de la DGCCRF que dans d'éventuels contentieux ou campagnes de communication par des concurrents ou associations de consommateurs ».
Lors d'une réunion d'étape du 24 juillet 2023 entre l'ARS, la préfecture et Nestlé Waters, l'ARS Occitanie propose d'intégrer la mention des traitements de microfiltration à 0,2 micron dans les nouveaux arrêtés d'autorisation d'exploitation qui seront proposés à la signature du préfet « fin 2023/début 2024 ».
À noter que l'ARS prévoit de s'affranchir de la consultation en amont du Coderst. Cette absence d'information a été actée lors de la réunion du 2 juin 2023 à laquelle participe Nestlé Waters, « compte tenu des enjeux commerciaux et de confidentialité liés au plan de transformation ». Dans la note du 24 juillet, l'ARS justifie cette procédure spécifique en minimisant la modification induite par la mention d'une microfiltration à 0,2 micron : « D'autres sites de conditionnement d'eau de la région utilisent ces traitements de microfiltration à 0,2um et les arrêtés préfectoraux ne les mentionnent pour le moment pas, dans l'attente de la clarification du ministère chargé de la santé sur l'usage de ces traitements et au regard des conclusions de la mission Igas qui n'ont pas été encore rendues publiques. De plus, les services juridiques de l'ARS Grand Est et de l'ARS Occitanie considèrent que la consultation du CODERST n'est pas réglementairement nécessaire dès lors que la modification n'est pas considérée comme notable : les arrêtés préfectoraux Perrier mentionnent déjà les traitements de microfiltration, mais avec des seuils de rétention plus élevés [...] ». L'argumentaires laisse perplexe : l'ARS GE, on l'a vu, a alerté sur le risque à la fois de désinfection par microfiltration et de sécurisation insuffisante. Comment, dans ces conditions, parler d'une modification qui ne serait pas notable ?
La demande d'autorisation d'exploitation des forages Romaine III et Romaine V pour la production d'une boisson rafraichissante sans alcool est déposée le 31 juillet 2023.
L'arrêt des traitements interdits a été constaté sur le site de Vergèze par l'ARS Occitanie le 9 août 2023, soit environ trois semaines après la date initialement envisagée par Nestlé Waters et communiquée à la préfète.
Des microfiltres à 0,2 micron sont alors installés tout au long du cycle de production. Sur les forages Romaine III et V, est installée une nouvelle filière de traitement par UV et charbon actif, destinée à la production des boissons « Maison Perrier ». Elle est mise en service fin décembre 2023. Pour les forages Romaine IV, IV bis, VI, VII et VIII, les traitements par UV et charbon actif sont bien retirés sauf pour les productions d'eau minérales naturelle Perrier destinée à l'exportation vers les Etats-Unis.
Le 22 décembre 2023, le préfet du Gard prend deux arrêtés de reconfiguration de l'exploitation des eaux minérales naturelles « Sources Perrier » :
i) L'arrêté du 22 décembre 2023 autorise provisoirement l'exploitation des forages Romaine IV, IV bis, VI, VII et VIII pour la production de l'eau minérale naturelle de la « Source Perrier » le temps de déposer une nouvelle demande d'autorisation ;
ii) L'arrêté du 22 décembre 2023 déclasse les forages Romaine III et V en « eau de boisson », retirée du mélange « Source Perrier » et commercialisée sous la désignation commerciale « Maison Perrier », avec interdiction d'utiliser la dénomination « eau minérale naturelle ».
Si la microfiltration à 0,2 micron est bien mentionnée dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des forages Romaine III et V, il n'en est rien pour l'autorisation - provisoire - de la source Perrier qui mentionne toujours les filtres entre 1 et 3 microns malgré l'installation de filtres à 0,2 micron tout au long du processus de production.
La demande de révision complète de cet arrêté, intégrant une microfiltration à 0,2 micron, est quant à elle déposée le 13 octobre 2023.
Globalement, selon la préfecture du Gard entre la découverte des traitements interdits et leur retrait 139 000 m3 d'eau auraient été produits. Entre la découverte des microfiltration non autorisés par l'arrêté préfectoral et le 1er février 2025, plus de 410 000 m3 ont été produits auxquels il faut ajouter 206 500 m2 pour les forages Romane III et V pour la période allant de la découverte des microfiltrations non autorisées au passage en eau de boisson « Maison Perrier ».
Au total, ce serait donc plus de 755 500 m3 d'eau vendus comme eau minérale naturelle qui n'auraient pas dû avoir droit à cette appellation91(*). Le tout pouvant être valorisé à environ 375 millions d'euros, à raison de 0,5 €/litre.
C. CE PLAN DE TRANSFORMATION N'ÉVACUE PAS TOUTES LES PRÉOCCUPATIONS, NOTAMMENT SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES, À L'ÉGARD DES ACTIVITÉS DE NESTLÉ WATERS
1. Dans les Vosges : une surveillance renforcée
Le retrait des traitements interdits posait de façon saillante l'existence d'un risque sanitaire, surveillé par des contrôles opérés par des laboratoires privés pour le compte de Nestlé.
Le 16 novembre 2022, le suivi de l'eau brute a révélé la contamination par des matières fécales du forage Essar, l'un des quatre forages de la source Hépar92(*). La qualité de l'eau était alors assurée uniquement après filtration, de sorte que le traitement opéré s'apparentait à de la désinfection.
L'ARS a alors demandé à Nestlé d'interrompre les captages concernés. Si l'exploitation des forages Contrex « Thierry Lorraine » et « Belle Lorraine » a bien été suspendue le 28 novembre 2022, les deux forages contaminés Essar l'ont été seulement en mai 2023, à la suite d'un arbitrage rendu le 16 février 2023 par les cabinets des ministres délégués chargés de l'industrie d'une part, de l'organisation territoriale et des professions de santé d'autre part, ainsi que de la Première ministre. Cette position a été transmise de manière informelle à Nestlé dans les jours suivants93(*).
La directrice générale de l'ARS Grand Est Virginie Cayré a également fait part en interne à la DGS de ses inquiétudes sur le fait que la filtration opérée faussait le contrôle sanitaire ciblant des bactéries indicatrices de contamination fécales, sans pour autant exclure tout risque sanitaire de nature virale94(*). Dans une note du 8 décembre 2022, elle indique : « dans l'hypothèse où l'eau serait contaminée, la substitution des UV par des filtres à 0,2 micron ne traiterait qu'une partie des micro-organismes potentiellement pathogènes (les virus passent la barrière des filtres). Le contrôle sanitaire serait rendu inopérant, car ne détectant plus les bactéries indicatrices d'une contamination fécale, et son cortège de micro-organismes pathogènes ne permettrait plus d'évaluer les risques sanitaires pour le consommateur. Il faudrait alors imposer un suivi au-delà des paramètres réglementaires classiques avec l'appui scientifique de l'Anses pour détecter de telles pratiques. »
Face à ce constat de la nécessité d'un suivi renforcé, l'ARS Grand Est a saisi le 28 mars 2023 la DGS afin de solliciter son appui pour une éventuelle saisine de l'Anses pour évaluer « l'opportunité et la faisabilité d'un suivi particulier de la microbiologie de l'eau », autrement dit de rechercher les virus présents avant et après filtration éventuelle sur les ressources en eau du site de Nestlé dans les Vosges. Dans l'attente de son retour, l'ARS Grand Est a soumis Nestlé à l'obligation de réaliser des analyses virologiques, qui n'ont toutefois révélé aucune contamination virale de l'eau, comme l'a déclaré Virginie Cayré devant la commission d'enquête.
La surveillance renforcée préconisée par l'Anses en octobre 2023 n'a pas relevé de risque sanitaire avéré depuis cette date.
Par un avis rendu en octobre 2023, l'Anses a préconisé à l'ARS Grand Est un protocole d'intervention en trois étapes, décrit comme suit par Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice de l'ARS Grand Est depuis juin 2024 : « La première étape concerne la vérification de la qualité de l'eau par les analyses bactériologiques du contrôle réglementaire. La deuxième étape, en cas de non-conformité, consiste en la réalisation d'une analyse de bactériophages, qui sont des proxys de virus pathogènes. Enfin, dans une troisième étape, si ces proxys sont retrouvés, l'Anses recommande l'analyse de virus pathogènes en tant que telle, c'est-à-dire une analyse ciblée, comme l'hépatite A ou le norovirus par exemple. » Comme elle l'a expliqué devant la commission d'enquête, seule la première étape de vérification de la qualité de l'eau est actuellement mise en oeuvre, l'absence de non-conformité n'ayant pas nécessité que la deuxième étape soit déclenchée.
2. Dans le Gard, des doutes persistants sur les questions de loyauté et de sécurité sanitaire des produits ainsi qu'au plan environnemental
Dans le Gard, ni les doutes sur la pureté originelle des eaux minérales de Perrier ni les préoccupations quant à la sécurité sanitaire des eaux conditionnées ne sont levées par le plan de transformation.
Ø Avant l'arrêt des traitements au charbon actif et aux lampes à UV : l'impossibilité de contrôler la pureté originelle de l'eau
Dès le 7 juin 2023, le directeur général de l'ARS Occitanie demande au directeur général de la santé de bénéficier, au même titre que l'ARS Grand Est, de l'appui de l'appui technique et scientifique du Laboratoire d'hydrologie de Nancy (LHN) dans l'analyse de la qualité microbiologique de l'eau et dans le suivi des micropolluants émergents. Il signale notamment une dégradation de la qualité des ressources, qui se manifeste par des contaminations bactériologiques régulières. Cette demande se traduit par un avenant à la saisine du LHN par le directeur général de la santé le 10 juillet 2023.
Pendant ce temps, les traitements que Nestlé Waters appelle les « barrières de protection » sont toujours utilisées sur le site de Vergèze. L'ARS est donc toujours dans l'incapacité de contrôler la pureté originelle des eaux brutes puisque les prélèvements du contrôle sanitaire sont réalisés, au moins en partie, sur une eau traitée.
C'est ce que rappelle explicitement le compte-rendu dressé par l'ARS de la réunion d'étape associant la préfecture et Nestlé Waters le 24 juillet 2023 qui prévoit d'autoriser l'industriel à reconfigurer son exploitation et à utiliser une microfiltration à 0,2 micron : « Mais avant d'instruire tout dossier, la connaissance de la qualité réelle de l'eau brute reste un préalable ! Les avis des hydrogéologues sont indispensables ! La vérification de la pureté également ! À ce jour, tout ou partie des prélèvements du contrôle sanitaire de l'ARS ont été réalisés sur de l'eau traitée. L'ARS ne dispose pas de données, ou partielles, sur la qualité réelle de l'eau brute. »
Pourtant, dans un courrier du 28 juin à la préfète, le directeur de Nestlé Waters dans le Gard s'était engagé à transmettre à l'ARS les données de qualité d'eau brute des sept captages d'eau minérale exploités à Vergèze et de lui donner l'accès aux « vrais » robinets d'eau brute afin qu'elle puisse réaliser ses prélèvements en vue du contrôle sanitaire.
L'ARS mentionne également des doutes sur la pureté originelle de l'eau du forage Romaine VIII, censé être inclus au mélange d'eau minérale naturelle de la « Source Perrier ». Il anticipe déjà une dégradation liée aux épisodes pluvieux - qui sera vérifiée en avril 2024 : « La période pluvieuse, propice aux épisodes cévénols, de fin d'été/automne, est une période la plus à risque pour les captages. En témoigne, l'historique des données qualité sur 2021 et 2022. Il conviendra d'être très regardant sur la période. ». De fait, ce forage est actuellement suspendu.
Ø Des doutes quant à la soutenabilité de l'exploitation du site telle que prévue par le plan de transformation
À l'issue de la réunion du 24 juillet 2023, le compte-rendu par l'ARS exprime ses doutes quant à la soutenabilité de l'exploitation de nouveaux forages d'ici 2027, prévue par le plan de transformation : elle mentionne un risque de « surexploitation ». En effet, Perrier prévoit la réalisation de trois forages pour remplacer les forages Romaine III et V. Les pompages d'essais devraient démarrer en novembre 2023 pour envisager une autorisation d'exploitation au sein du mélange de la « Source Perrier » à partir d'octobre 2025. Si l'industriel indique qu'ils n'entraîneront pas d'augmentation des volumes prélevés et qu'il s'agit d'une « spatialisation » des prélèvements, l'ARS est dubitative : « pour autant, la moitié des produits conditionnés seront exportés via porte-conteneurs vers les Etats-Unis ».
Le préfet du Gard, Jérôme Bonet, a quant à lui confirmé par écrit à la commission d'enquête que Nestlé Waters dans le Gard poursuit des recherches de nouveaux forages sur trois sites depuis 2019, qu'il souhaite utiliser à terme dans le mélange de la Source Perrier : F18-2 (Uchaud), autorisé en 2019 et F16-1 et F16-2 (Vestric-Candiac), autorisés en 2016. Les autorisations de ces forages ont été prorogées jusqu'en 2025. Selon le préfet du Gard, leur exploitation pourra avoir lieu dans la limite des volumes actuellement autorisés par son arrêté d'autorisation du 14 mai 2024, qui tient compte du plan de transformation de Nestlé Waters visant à réduire ses prélèvements en eau pour atteindre 2 500 000 m3 en 2027.
Néanmoins, en plus des trois forages d'essai en cours, Nestlé Waters a demandé en octobre 2023 à disposer de nouveaux forages d'essai. La DDTM du Gard lui a répondu en novembre 2023 « qu'il était préférable d'attendre la conclusion des études sur l'hydrosystème »95(*). En effet, les services préfectoraux ont demandé dès 2019 à Nestlé Waters la conduite d'une étude de connaissance de l'hydrosystème « Perrier » afin d'évaluer la soutenabilité des prélèvements dans la nappe.
Les premiers résultats, rendus en 2021, se sont révélés incomplets : selon Sébastien Ferra, directeur départemental des territoires du Gard96(*) : « L'expertise a souligné la qualité du travail de collecte de données, mais aussi les conclusions fragiles de l'étude, notamment sur les questions relatives aux périodes de sécheresse. Nous avons jugé que cette étude n'était pas suffisante. Par conséquent, nous avons recommandé la poursuite de l'étude, qui est actuellement en cours avec l'université de Nîmes et l'institut technologique d'Alès et dont les résultats sont attendus en 2025 ».
Selon Jérôme Bonet, préfet du Gard, cette étude permettra de faire un point sur les prélèvements de Nestlé Waters et la soutenabilité des prélèvements actuels et envisagés. De manière générale, les services de la DREAL ont indiqué dès le 22 décembre 2021 par courrier à Nestlé Waters qu'une augmentation des prélèvements ne pourra être envisagée que si est assurée une stabilité du niveau des nappes sur cinq et que si les conclusions de l'étude de l'hydrosystème sont validées.
Ø Après l'arrêt des traitements interdits : des doutes persistants quant à la maîtrise du risque sanitaire
À compter du 1er septembre 2023, sont mis en place des prélèvements hebdomadaires portant sur les paramètres microbiologiques de l'eau brute sur les forages de Vergèze.
La note d'appui scientifique de l'Anses, issue des travaux du LHN, est transmise le 16 octobre 2023 au directeur général de la santé. Elle préconise la mise en place d'un plan de surveillance renforcée sur les sites de Nestlé Waters en Occitanie et dans le Grand Est, en raison du niveau de confiance insuffisant dans l'évaluation de la qualité des ressources. Ce plan de surveillance renforcé inclut des paramètres virologiques.
Néanmoins, la campagne d'analyse mensuelle des paramètres complémentaires virologiques sur la base des recommandations de l'Anses n'est lancée par l'ARS Occitanie que le 23 mai 2024, soit plus de six mois après la transmission de la note de l'Anses.
Le rapporteur déplore cette mise en oeuvre différée de la surveillance renforcée des eaux de Nestlé Waters. Les auditions de la commission d'enquête n'ont pas permis d'écarter avec certitude l'absence de risque sanitaire d'origine virologique entre le retrait des traitements de désinfection en août 2023 et la mise en oeuvre de cette surveillance.
Conformément aux doutes de l'ARS, la qualité microbiologique du forage Romaine VIII s'est dégradée dans la nuit du 9 au 10 mars 2024 à la suite d'un épisode pluvieux intense. Le 19 avril 2024, l'ARS Occitanie soumet à la signature du préfet une proposition d'arrêté de fermeture du forage Romaine VIII, ainsi qu'un courrier demandant la destruction des lots produits du 10 au 14 mars sur la ligne 34, concernée par les contaminations. Plusieurs prescriptions techniques, notamment la mise en place de recherches virologiques, apparaissent dans ce courrier.
En outre, en juin 2024, à la suite de la tempête « Monica », les forages Romaine VI et VII ont été suspendus par l'exploitant. Cette suspension a été dévoilée par le quotidien Le Monde le 14 juin 2024. Lors de son audition par la commission d'enquête le 19 mars 2025, Muriel Lienau, présidente de Nestlé Waters a justifié cette mise à l'arrêt par « une déviation sporadique » « à la suite d'un événement climatique extrême ». Elle a reconnu que « ce forage est toujours suspendu », près d'un an après la survenance de cet événement climatique extrême.
Enfin, le 9 juillet 2024, en raison de divergences d'interprétation entre le laboratoire mandaté par l'ARS - Eurofins - et le laboratoire d'autosurveillance de Nestlé Waters, l'ARS Occitanie saisit à nouveau le LHN concernant l'interprétation des données microbiologiques d'autosurveillance de Nestlé et demande à Nestlé de fournir des précisions quant aux écarts entre ces résultats.
Ø Des préoccupations concernant la traçabilité de l'eau minérale naturelle
À la demande du préfet, une inspection conjointe ARS-DGCCRF est menée le 30 mai 2024 à la suite d'un nouvel épisode de contamination microbiologique. Parmi les constats dressés par les inspecteurs le 13 juin 2024, figure un doute sur la traçabilité de l'eau minérale naturelle. Les inspecteurs notent : « s'agissant de la traçabilité, il a pu être soulevé un point critique de loyauté ». En effet, la traçabilité entre les lignes produisant les « eaux de boisson », faisant l'objet de désinfection, et les eaux minérales naturelles, normalement non traitées, n'est pas assurée alors même qu'elles sont produites sur les mêmes lignes de production.
Si des eaux minérales peuvent être conditionnées sur les mêmes lignes que d'autres eaux - à l'instar des eaux de source - c'est uniquement en contrepartie de l'apport par l'industriel de la preuve, à tout moment, de la traçabilité de l'eau commercialisée.
Or comme le constatent les inspecteurs : « Mme Arzul [directrice qualité de NWSS] n'a pas été en mesure de nous présenter en temps réel la traçabilité en amont de la ligne 28. Cette scission de la traçabilité est d'autant plus problématique depuis le déclassement de deux forages en eau destinée à la consommation humaine [Romaine III et Romaine V] et représente un point critique de loyauté ».
En outre, le code de la santé publique prévoit que des eaux de natures différentes puissent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, mais exclusivement s'agissant d'une eau minérale naturelle et d'une eau de source97(*). Or, la production de l'eau « Maison Perrier » et de l'eau minérale naturelle « Source Perrier » à Vergèze, ne relève pas de ce cas de figure, puisque sont conditionnées sur la même ligne de production une eau minérale naturelle exempte de traitement et une eau de boisson traitée, qui n'a donc pas la qualité d'eau de source. Le processus de production de l'usine de Vergèze, ne semble donc pas, en toute rigueur de termes, conforme à la règlementation.
À l'aune des constats dressés lors de l'inspection du 30 mai 2024, le rapporteur estime problématique qu'un dispositif industriel d'une telle envergure ait pu être réalisé dans le cadre du plan de transformation de Nestlé Waters sans que la traçabilité de l'eau ne soit assurée : il faut rappeler que sa mise en oeuvre intervenait dans le contexte d'une tromperie de grande ampleur aux consommateurs ; cela aurait dû pousser les services de l'État à la vigilance !
D. PLAN DE TRANSFORMATION INACHEVÉ ; INDUSTRIEL NI EN CONFORMITÉ NI SANCTIONNÉ : L'ENTRE-DEUX INCONFORTABLE DES SERVICES DE L'ÉTAT
1. Dans les Vosges, seule subsiste la demande de révision d'autorisation d'exploitation d'Hépar
La mise en oeuvre du plan de transformation de Nestlé s'avère moins complexe dans les Vosges que dans le Gard. Seule demeure à ce jour non tranchée la demande de modification des arrêtés préfectoraux autorisant le recours à la microfiltration à 0,2 micron pour Hépar.
Par arrêtés modificatifs du 4 juillet 2023, la préfète des Vosges a autorisé le recours à des filtres à 1,2 et à 0,45 micron pour les seules sources de Vittel98(*).
Par courrier du 31 octobre 2024 en réponse à la directrice générale de l'ARS Grand Est, Grégory Emery, directeur général de la santé, a indiqué qu'aux yeux du ministère de la santé la microfiltration à un seuil de coupure inférieur à 0,8 micron n'était autorisé qu'en présence d'une démonstration de l'absence de modification du microbisme de l'eau, afin que ce traitement ne s'apparente pas à de la désinfection. Enfin, dans un souci de cohérence avec les autres États-membres, le directeur général de la santé a préconisé de ne pas autoriser des filtres ayant des seuils de coupure inférieurs à 0,45 um.
2. Dans le Gard, l'instruction de la demande de révision d'autorisation d'exploitation de la source Perrier est toujours officiellement en cours
À ce jour, la demande de révision complète de l'autorisation d'exploitation de la source « Perrier » est toujours en cours d'instruction par les services de l'ARS. Elle est conditionnée à deux éléments :
- le respect par les eaux brutes de la source de la notion de « pureté originelle » ;
- la validité juridique de la demande de Nestlé Waters d'utiliser une microfiltration à 0,2 micron.
La microfiltration à 0,2 micron pose un double problème. Comme on l'a vu plus haut, il ne s'agit pas d'une pratique autorisée, mais tout au plus tolérée, dans les conditions très contestables qui ont été exposées. Au surplus, s'agissant du Gard, elle n'a pas été inscrite dans les arrêtés préfectoraux d'exploitation. Il en résulte que son usage est contraire à la réglementation. La simple application de cette dernière doit nous conduire à considérer que l'eau « Perrier » qui sort actuellement de l'usine de Vergèze ne devrait pas bénéficier de l'appellation « eau minérale naturelle ».
Nestlé Waters a déposé une demande de révision complète de l'arrêté d'autorisation le 13 octobre 2023. Après la prise de l'arrêté d'autorisation « provisoire » le 22 décembre 2023, les services de l'ARS se consacrent en janvier et février 2024 à l'étude du dossier et à cette fin, à l'exploitation des données de qualité des eaux brutes.
Le 6 février 2024, une réunion interne à l'ARS Occitanie et aux services préfectoraux aborde l'exploitation de données du contrôle sanitaire renforcé sur les sept forages de Vergèze depuis le retrait des traitements : son compte-rendu mentionne qu'« au regard de ces résultats, seul le captage Romaine VII répondrait à la définition d'une eau minérale naturelle au sens de la pureté originelle »99(*). En effet, l'ARS indique : « au regard des résultats d'analyses sur les 5 forages (..), l'eau ne peut répondre à la définition d'une eau minérale naturelle (...). La pureté ne peut être vérifiée et validée à partir des données présentées ce qui ferait perdre la reconnaissance d'eau minérale naturelle pour au moins 4 forages. Le retrait des dispositifs de traitement, aux robinets de prélèvements, a mis en lumière la présence de contaminations microbiologiques régulières des forages (...). La présence de traces de micropolluants confirment également une forme de vulnérabilité des aquifères captés (burdigaliens et hauteriviens) même si les résultats restent inférieurs aux valeurs limites réglementaires (métabolites de pesticides, PFAS, chlorate). »
Ces conclusions sont transmises au préfet le 20 mars 2024 par le biais d'une note du directeur général de l'ARS Occitanie. D'après le préfet du Gard, « L'ARS [l]'informe qu'en l'état, la nouvelle autorisation pour le mélange Perrier ne recevra sans doute pas une suite favorable. »
L'ARS préconise, après validation de la direction générale de la santé, de poursuivre l'instruction pour laisser l'opportunité à Nestlé Waters dans le Gard d'expliquer ces résultats, de nommer un hydrogéologue pour obtenir son avis et de mettre en oeuvre la surveillance renforcée préconisée le 16 octobre 2023. Le 22 mars, l'ARS demande, via un courrier du préfet, des éléments complémentaires concernant l'instruction de la demande d'autorisation en cours. Ces éléments ne sont transmis que le 7 mai 2024. C'est donc seulement à cette date que l'ARS a considéré comme complet le dossier de demande de révision de Nestlé Waters.
Le 15 juillet 2024, le préfet indique à Nestlé la poursuite de l'instruction administrative de sa demande, notamment avec la réquisition d'un hydrogéologique - compte tenu de la grève en cours- afin d'émettre un avis sanitaire règlementaire sur le dossier déposé en octobre 2023.
Le 6 septembre 2024, le rapport d'observations provisoires de l'ARS et des services préfectoraux à la suite de l'inspection menée sur le site de Vergèze le 30 mai 2024 met en évidence des écarts concernant la microfiltration et le non-respect des critères de pureté originelle. La note de synthèse indique néanmoins qu'en l'absence de texte, le retrait de la microfiltration ne peut être ordonné. Il est même écrit que ce retrait ferait peser un risque sanitaire. On retrouve ici l'inversion de normes déjà signalée. C'est l'industriel qui choisit un mode de production qui crée le risque en usant d'une eau régulièrement contaminée, mais sans la traiter pour que soit éradiquées les contaminations bactériologiques et virologiques, afin de conserver, pour des raisons économiques et financière, l'appellation d'eau minérale naturelle. Et ce sont les services de l'État qui s'interdisent d'imposer à cet industriel de respecter les textes.
Le 18 décembre 2024, le rapport définitif de l'ARS et des services préfectoraux à la suite de l'inspection menée sur le site de Vergèze le 30 mai 2024 met en évidence plusieurs écarts, notamment, comme l'écrit le directeur général de l'ARS Occitanie au préfet : « l'écart n° 4 qui avait conduit la mission d'inspection à considérer que les traitements de microfiltration à 0,2 micron utilisés sur l'ensemble du réseau de distribution d'eau minérale naturelle Perrier étaient non conformes aux exigences réglementaires. Ces traitements ont pour effet de modifier la composition de l'eau minérale naturelle ». »
Après plusieurs interrogations concernant la base juridique d'une demande de retrait de la microfiltration à 0,2 micron - en l'absence de texte mentionnant ce seuil de coupure -, le préfet du Gard demande, le 20 janvier 2025, à Nestlé Waters de démontrer sous deux mois que la microfiltration utilisée ne modifie pas le microbisme de l'eau de la « Source Perrier ».
Deux mois plus tard, le 20 mars 2025, Stefano Piscitelli, directeur de l'usine Perrier, transmet au préfet du Gard une note et une série de documents tendant à démontrer que la microfiltration à 0,2 micron est conforme à la règlementation et a des effets similaires à celle déjà autorisée avec 0,8 micron. Il transmet également un courrier en date du 7 mars demandant la saisine du Nestlé Research Center pour démontrer que la microfiltration à 0,2 micron ne modifie pas le microbisme de l'eau, conformément à l'injonction du préfet du Gard.
Comme on l'a vu plus haut, le processus proposé par le préfet, même s'il a le mérite d'imposer une clarification à l'industriel, ne correspond pas aux exigences de la directive de 2009. En d'autres termes, à supposer que les arguments de l'industriel soient validés par l'ARS, cela ne suffirait pas à autoriser la microfiltration à 0,2 microns en l'absence de saisine de la Commission européenne.
En outre, sur le fond, l'avis sanitaire des hydrogéologues concernant la demande de révision complète de l'autorisation d'exploitation de la « Source Perrier » rendu le 4 avril 2025 est défavorable à une exploitation en tant qu'eaux minérales naturelles et, selon toute vraisemblance, fait perdre son intérêt à ce débat sur la microfiltration, en tout cas pour le site Perrier. Il établit en effet clairement que les forages Romaine IV, IV bi, VI, VII et VIII ne satisfont pas aux exigences de pureté originelles fixées par l'arrêté du 14 mars 2007100(*). Leur qualité microbiologique ne permet pas, en effet, de respecter les limites règlementaires spécifiques aux eaux minérales naturelles, qui sont supposées pures à la source et protégées de toute pollution.
À la date où la commission d'enquête adopte ce rapport, Nestlé Waters n'est toujours pas en conformité avec la règlementation, plus de trois ans et demi après ses aveux au cabinet de la ministre de l'industrie. Pour autant, Nestlé n'a jamais été notifié d'un rejet de sa demande d'autorisation d'exploitation. Cela interroge quant à la temporalité de l'action publique, qui a validé un plan de transformation avant de disposer des analyses portant sur l'impact de la microfiltration demandée sur le microbisme de l'eau et avant de diligenter des analyses sur la pureté originelle des eaux de l'industriel.
E. UN ENJEU POUR L'AVENIR : MIEUX ENCADRER LES CONDITIONS D'UTILISATION D'UNE CONVENTION JUDICIAIRE D'INTÉRÊT PUBLIC EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (CJIPE)
1. La mise en oeuvre d'une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale relative aux activités de Nestlé dans les Vosges
Plusieurs infractions, constatées, d'une part, à la suite d'une enquête de l'office français de la biodiversité, et d'autre part, par l'ARS Grand Est lors de sa visite d'inspection du 6 avril 2022 de l'usine Nestlé dans les Vosges, ont donné lieu à la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public entre le procureur d'Épinal et Nestlé Waters le 2 septembre 2024, validée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Épinal le 10 septembre 2024.
La convention judiciaire d'intérêt
public
en matière financière et en matière
environnementale
La convention judiciaire d'intérêt public a été créée par la loi du 9 décembre 2016 dite loi Sapin 2. Elle permet au procureur de la République qui n'a pas encore décidé d'exercer des poursuites judiciaires, de conclure une convention avec une personne morale mise en cause pour un plusieurs délits dont la liste figure à l'article 41-1-2 du code de procédure pénale101(*), en lui imposant un certain nombre d'obligations au titre desquelles figure l'obligation de verser une amende d'intérêt public au Trésor public.
Le procureur informe les victimes identifiées au terme de l'enquête pénale, de sa décision de conclure une CJIP et du fait qu'elles peuvent en être parties afin de bénéficier d'une indemnisation de leur préjudice civil préjudice civil résultant de la commission des délits visés par la CJIP. Si elles le souhaitent, elles doivent alors transmettre au procureur tout élément permettant d'apprécier la matérialité et le montant de ce préjudice. L'indemnisation de ce préjudice peut ensuite figurer au titre des obligations conventionnelles qui incombent à la personne morale, la convention prévoyant le montant et les modalités de réparation de ce préjudice dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
L'avantage pour la personne morale co-contractante de conclure une CJIP est que l'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité, ni n'a les effets d'un jugement. Cela a pour conséquence première que la personne morale n'est pas condamnée pénalement et n'a donc pas de casier judiciaire. Cette absence de condamnation fait obstacle à ce qu'elle puisse se voir exclure de la procédure de passation de marchés publics, qui est une peine complémentaire assortie à certaines infractions de délits financiers qui peuvent relever du cadre de la CJIP102(*). L'ordonnance de validation, la convention et le montant de l'amende d'intérêt public sont rendues publiques. La décision de validation par le tribunal n'est pas susceptible de recours, mais la personne morale dispose toutefois d'un délai de rétractation de dix jours.
L'achèvement de l'exécution des obligations de la convention entraîne l'extinction de l'action publique, mais cela ne fait pas obstacle à l'indemnisation des victimes devant le juge civil, notamment dans le cadre d'une action de groupe ouverte aux consommateurs. La prescription pénale est suspendue tant que les obligations ne sont pas exécutées. En revanche, si la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale de ses obligations, le procureur de la République lui notifie l'interruption de l'exécution de la convention et peut alors décider de poursuivre les faits litigieux devant un tribunal.
Le champ de la CJIP a été étendu par la loi du 24 décembre 2020103(*) notamment à un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement, ce qui a donné lieu à un nouvel outil juridique qu'est la convention judiciaire d'intérêt public environnementale qu'est la CJIPE.
Selon Nicolas Jeanne104(*), professeur de droit pénal et de sciences criminelles à l'université de Tours, la CJIPE permet une « accélération du traitement des infractions environnementales en favorisant la réparation rapide du préjudice » tant écologique que civil en résultant, tout en exerçant sur l'entreprise un « contrôle renforcé de ses programmes de mise en conformité et la possibilité de lui infliger des amendes dissuasives ».
La CJIPE conclue entre Nestlé et le procureur de la République d'Épinal porte sur des faits résultant de deux enquêtes distinctes.
La première, diligentée par l'Office français de la biodiversité (OFB), a mis en avant le fait que 9 forages de la société NSWE ne disposaient pas, entre janvier 1992 et septembre 2019, des autorisations prévues par le code de l'environnement. Cette absence d'autorisation était susceptible de constituer une infraction pénale.
La seconde, diligentée par le service national d'enquêtes (SNE) de la DGCCRF saisi à la suite du signalement au titre de l'article 40 effectué par l'ARS Grand Est auprès du procureur de la République d'Épinal le 3 octobre 2022, conclut notamment que le recours à des traitements ultra-violets et au charbon actif ainsi qu'à des traitements de filtration allant de 0,2 à 0,45 micron, peut revêtir la qualification de « tromperie »105(*) sur le caractère « naturel » de l'eau minérale.
S'agissant de la période retenue, le SNE a relevé que des appareils ultra-violets avaient été achetés par NSWE dès 2005, et que les filtres à charbon actif étaient utilisés au moins depuis 2010.
Aux termes de la convention d'intérêt public, Nestlé Waters est tenu au paiement d'une amende d'intérêt public de 2 millions d'euros, et à la réparation de de l'infraction, sous le contrôle et l'appui technique de l'OFB, pour des travaux de renaturation et de remédiation écologique d'un montant total d'un million d'euros. Ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux ans Par ailleurs, Nestlé doit indemniser les victimes identifiées pour un montant total de 516 800 euros.
L'article 41-1-3 du code de procédure pénale définit le montant de l'amende d'intérêt public comme devant être fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, mais peut atteindre jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel de la société, calculé à partir des trois derniers chiffres d'affaires annuels à la date du constat du manquement.
Le montant de l'amende est justifié, selon la CJIP, par la prescription d'une partie des faits, la cessation des irrégularités, les autorisations requises pour les forages ayant été régularisées en 2020 et les traitements illicites retirés en 2022, l'absence de risque sanitaire identifié, et de lien de causalité entre les manquements relevés au code de l'environnement et une atteinte effective à l'environnement.
Par ailleurs, le recours à la CJIP est justifié par l'ordonnance de validation du président du tribunal judiciaire d'Épinal par l'absence de réitération et coopération volontaire de l'entreprise, critères prévus par les circulaires du 11 mai 2021 et du 9 octobre 2023106(*), comme l'a relevé Vincent Filhol, magistrat, lors de son audition par la commission d'enquête.
a) Les interrogations sur le recours à la CJIPE et sa mise en oeuvre
La décision de recourir à une convention judiciaire d'intérêt public n'a pas été comprise par une partie du grand public et soulève des interrogations du rapporteur.
Tout d'abord, l'amende d'intérêt public n'a pas fait l'objet d'explications étayées au sein de la convention, notamment sur le calcul de de son montant, qui aurait pu, selon les textes, être beaucoup plus élevée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel.
Lors de la table ronde organisée par la commission sur la CJIPE, Vincent Filhol, magistrat actuellement en détachement ayant exercé des fonctions de vice-procureur au parquet national financier, et Nicolas Jeanne, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université de Tours, ont relevé, au contraire de ce qui existe en matière financière, l'absence de lignes directrices encadrant le montant de l'amende d'intérêt public fixée dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public environnementale. En matière financière, le parquet national financier a prévu un cadre rigoureux, intégrant des facteurs minorants et majorants au sein d'une équation lisible, qui sont détaillées dans les Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public publiées le 16 janvier 2023107(*).
Cette absence de précision peut donner l'impression d'un manque de transparence et d'une atténuation de la sanction infligée à Nestlé. En effet, même si le montant de 2 millions d'euros reste à ce jour le plus élevé pour une amende d'intérêt public pour une affaire relative à l'environnement, les montants retenus dans le cadre de conventions judiciaires d'intérêt public en d'autres domaines peuvent être bien plus élevés : Airbus s'est ainsi engagée à s'acquitter d'une amende de 2,08 milliards d'euros108(*). Comme le relève Vincent Filhol, il pourrait être utile de rédiger une nomenclature d'indemnisation du préjudice écologique, à l'image de celle du préjudice corporel dite « Dintilhac ». Dans le silence de la loi, qui confère au juge judiciaire un pouvoir souverain d'indemnisation, ces référentiels qui n'ont aucune valeur contraignante pour les magistrats permettent néanmoins de fixer des barèmes d'indemnisation de certains postes de préjudice afin d'unifier la jurisprudence, pour une grande lisibilité et une sécurité juridique renforcée.
La seconde critique relative au manque de lisibilité de la convention judiciaire d'intérêt public environnementale consiste en la complexité du critère de rattachement d'infractions financières, qui relèvent de la CJIP, à une CJIPE, laquelle porte normalement sur les seules infractions environnementales. Ce rattachement est actuellement opéré sur le fondement de la notion de connexité entre des infractions, définie à l'article 203 du code de procédure pénale et la jurisprudence. La technicité de cette notion et son vaste champ d'application peuvent alimenter des critiques quant à l'opportunité de recourir à une CJIPE pour régler des infractions financières, alors que la CJIP est un mécanisme plus ancien dont le caractère contraignant peut être interprété comme supérieur à celui de la CJIPE eu égard aux montants de l'amende d'intérêt public évoqués ci-avant.
La lisibilité des conventions judiciaires d'intérêt public environnementales pourrait ainsi être améliorée à travers la rédaction de circulaires visant à harmoniser les pratiques entre les parquets.
Le rapporteur constate également que l'article L. 41-1-2 du code de procédure pénale, qui régit la convention judiciaire d'intérêt public financière, prévoit une peine complémentaire de mise en conformité, au titre de laquelle le procureur peut imposer certaines obligations à l'entreprise. Cette peine complémentaire ne figure pas, en revanche, au titre des mesures prévues pour la convention judiciaire d'intérêt public environnementale à l'article 41-1-3 du code de procédure pénale. Enfin, à l'inverse des délits financiers, une condamnation d'une personne morale pour une infraction environnementale n'est pas un motif d'exclusion des marchés publics, de sorte que cela ne constitue pas une incitation à conclure une CJIP environnementale pour ces personnes morales mises en cause. Le rapporteur préconise qu'il y soit remédié, afin que cela constitue un levier supplémentaire pour recourir à une CJIP.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
6 |
Mieux encadrer la mise en oeuvre des CJIP en matière environnementale en l'alignant sa mise en oeuvre sur celle de la CJIP financière et en ajustant certains de leurs aspects |
Parlement Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces |
2025-2026 |
Dispositions législatives et instruction sous forme de Lignes directrices adressées aux Parquets |
PARTIE
III
PRÉSERVER L'AVENIR
DES EAUX MINÉRALES ET DE SOURCE EN
FRANCE
La leçon première de l'affaire des eaux minérales est celle de la fragilité de la ressource qu'il faut donc protéger (I). Elle montre par ailleurs la nécessité de rénover un dispositif de contrôle trop complexe (II) et de donner au consommateur davantage de transparence (III).
I. PROTÉGER LES AQUIFÈRES DES EAUX MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE POUR RENFORCER LA CONFIANCE DANS LE SECTEUR
A. LA NÉCESSITÉ DE MIEUX PROTÉGER LA RESSOURCE
1. Mieux connaître les aquifères
Un gisement d'eau se décompose en trois entités que sont l'impluvium, territoire de surface dans lequel s'infiltrent les eaux de pluie, la zone souterraine de transit des eaux minérales naturelles, et la zone des émergences dans laquelle se situent les captages d'eau. Les zones d'impluvium et d'émergence, qui sont en surface, sont les plus vulnérables à la pollution anthropique.
Selon la définition du bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), les aquifères désignent les formations géologiques poreuses dans lesquelles circulent les eaux souterraines exploitables de façon significative. Les aquifères dépendent de la nature des nappes souterraines. Selon qu'elles se situent en surface et qu'elles sont composées de roches poreuses, l'eau y pénètre vite, mais s'évapore également à la sécheresse. À l'inverse, certaines nappes sont plus profondes, avec une porosité moins importante, de sorte que l'eau y est plus inerte et s'écoule doucement.
Le BRGM assure le suivi pour le compte de l'État de la ressource en eaux souterraines au niveau principalement quantitatif, via le recours à un réseau de 2 300 piézomètres109(*) répartis sur le territoire. Parmi ceux-ci, entre 1600 et 1650 piézomètres sont gérés par le BRGM, les autres le sont par des associations et des organismes publics ou privés. Ce suivi permet de disposer d'informations sur des ensembles de nappes, mais il n'est toutefois pas suffisamment fin pour vérifier le niveau d'une seule nappe qui serait à la fois prélevée pour de l'eau embouteillée, mais également pour des activités agricoles ou industrielles qui ne sont pas toujours déclarées.
Le suivi du niveau de ces nappes passe également par l'inventaire exhaustif des émergences d'eau souterraine ou d'eau minérale, lequel était réalisé par le BRGM depuis l'arrêté du 5 mars 2007, et l'est désormais par les dix-huit agences régionales de santé, via la base de données SISE-EAUX. Or, comme le relève Guillaume Pfund, docteur en géographie économique et chercheur à l'université Lumière Lyon II, les ARS renseignent cette base de données de manière hétérogène, et ce notamment en raison de la raréfaction des hydrogéologues parmi leurs personnels.
Ce manque de connaissance exhaustive du nombre de forages participe des difficultés à suivre le niveau des nappes et accentue leur vulnérabilité à la pollution, dans la mesure où les forages se révèlent des points d'entrée de celle-ci dans la nappe.
À la surveillance du niveau des nappes exercée par le BRGM s'ajoute celle assurée par le réseau des 3 369 piézomètres mis en place par la direction de l'eau et de la biodiversité dans le cadre de la directive 2000/60/CE, dite directive cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui a imposé aux autorités nationales de recenser les bassins hydrographiques sur leur territoire national.
Cette surveillance a pour objectif de repérer les zones nécessitant une attention prioritaire dans la gestion de la ressource en eau. Elle peut toutefois être renforcée, comme l'a relevé Célia de Lavergne, directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de la transition écologique, qui explique que : « le réseau de piézomètres [...] donne une photographie assez claire de l'état de la ressource - c'est le cas surtout en métropole, mais nous renforçons le dispositif en outre-mer. En revanche, la nappe n'appartient pas à un embouteilleur donné. Nous suivons toutes les masses d'eau, non pas en fonction de leur usage, mais sous l'angle du milieu. »
Il apparaît que cette surveillance pourrait être renforcée localement sur certains territoires, et affinée dans son détail de manière à établir un éventuel lien de causalité entre une activité de forage par un ou plusieurs acteurs et l'évolution du niveau d'un gisement d'eau.
Le rapporteur recommande d'adjoindre aux modélisations d'évolution des nappes opérées par le BRGM, notamment dans le cadre de la surveillance météorologique et du réchauffement climatique, des modélisations localisées de l'évolution d'un bassin d'eau qui permettent aux autorités locales détentrice du pouvoir d'autorisation de l'exploitation d'affiner leur connaissance de ces bassins. Enfin, le rapporteur relève qu'aucun suivi de la qualité des nappes et des gisements n'est opéré à l'échelle national, comme c'est le cas pour le suivi de la quantité.
|
Recommandations |
||||
|
N |
Libellé |
Destinataires |
Échéancier |
Support |
|
7 |
Renforcer le suivi du niveau des aquifères sur le territoire et Instaurer un suivi national de qualité de la ressource des aquifères sur le territoire |
Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité Autorités de contrôle déconcentrées (Préfectures et DDT) |
2030 |
Processus de transmission d'informations à échéances régulières |
2. Protéger les impluviums et les captages
La préservation de la ressource en eau passe également par la préservation de la pureté originelle de l'eau minérale naturelle. À ce titre, il est essentiel de protéger l'eau de pluie des pollutions qu'elle pourrait absorber avant et lors de son infiltration dans les sols, puis lors de son captage.
Depuis 1937, chaque arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle s'accompagne de la détermination d'un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) qui accompagne chaque émergence pour lesquelles le propriétaire dispose de la pleine propriété, ou de servitudes qui garantissent sa protection110(*). Le PSE est un périmètre matérialisé par une clôture, à l'intérieur duquel les forages sont préservés par un abri fermé placé sous surveillance, au sein d'un périmètre grillagé.
Cet outil juridique comporte néanmoins certaines limites dans la mesure il s'agit en réalité d'un périmètre très restreint qui se mesure en mètres carrés. Il ne couvre donc pas toujours le gisement dans son intégralité, ce qui alimente le constat de son obsolescence dressé devant la commission par Guillaume Pfund, docteur en géographie économique et chercheur à l'Université Lumière Lyon II.
Les situations diffèrent par ailleurs grandement selon les sites d'exploitation des eaux minérales naturelles et de source. À Évian, l'impluvium est dans les hauteurs des massifs, dans une zone préservée de l'activité anthropique, alors que les points d'émergence sont dans les plaines. À Vittel-Contrexéville, la zone d'impluvium et les zones d'émergences sont contenues dans une plaine qui est plus vulnérable aux activités agricoles.
Pour pallier les limites des zones de PSE, les minéraliers ont pu créer des partenariats avec les communes concernées et les exploitations agricoles locales, afin de mettre en place des politiques zéro pesticides visant à contrôler les pollutions anthropiques. Ces partenariats, tels qu'Agrivair pour Nestlé dans les Vosges, et l'Apieme à Évian, fonctionnent toutefois sur la base du volontariat.
La préservation des impluviums de
Vittel-Contrexéville et d'Évian :
les exemples d'Agrivair
et de l'Apieme
Afin de préserver la pureté originelle de l'eau minérale naturelle, les minéraliers peuvent également contribuer à la mise en oeuvre de partenariats entre les communes concernées par la ressource en eau et les exploitants agricoles.
Tel est le cas d'Agrivair, filiale de Nestlé Waters Vosges, et de l'Apieme (Association pour la Protection de l'Impluvium de l'Eau minérale naturelle Évian), toutes deux fondées en 1992.
Agrivair est gestionnaire du patrimoine foncier sur un périmètre de 11 400 hectares, regroupant 17 communes et plus d'une centaine d'exploitation agricoles, et dispose d'un budget annuel de 2 millions d'euros.
L'Apieme est une association issue d'un partenariat entre la société Évian (Danone) et 13 communes dont 9 sont situées sur l'impluvium, d'une surface de 35 km², et 4 sur la zone d'émergence de l'eau minérale naturelle d'Évian.
Elles ont toutes deux pour objectif de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, en promouvant des pratiques d'agriculture régénératrice (suppression de l'usage des pesticides, recours à la fertilisation raisonnée, préservation de la biodiversité). En contrepartie, Agrivair met gratuitement des terres à disposition des agriculteurs et offre aux exploitants un accompagnement humain et matériel.
La politique « zéro pesticides » s'étend également aux communes limitrophes de la zone d'impluvium : l'hippodrome et les trois golfs de Vittel, ainsi que les voies de chemin de fer, sont entretenues par désherbage thermique, et les 13 communes participant à l'Apieme s'engagent à supprimer le recours aux pesticides sur les espaces communaux.
Agrivair et l'Apieme participent également de la préservation des zones forestiers à travers leur collaboration respective avec l'Office national des forêts et l'association de gestion forestière de Larringes.
Le rapporteur relève toutefois que si Agrivair procède à des travaux de renaturation et de restauration de cours d'eau et de ruisseaux, et notamment du Petit Vair, situé à deux kilomètres en aval de Vittel, de tels travaux figurent parmi les obligations de réparation du préjudice écologique qui incombent à Nestlé dans le cadre de la convention judiciaire d'intérêt public conclue le 2 septembre 2024 entre la SAS Nestlé Waters Supply Est et le procureur de la République d'Épinal.
Il existe un second outil juridique de protection de la zone d'émergence : la déclaration d'intérêt public (DIP) de la source d'eau minérale naturelle. Elle permet d'assigner un périmètre de protection plus large que le périmètre sanitaire d'émergence111(*). Elle doit être demandée par l'industriel minéralier au préfet. Il s'agit d'un périmètre de protection à l'intérieur duquel la réalisation de travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux est soumise à autorisation. Cet outil juridique est toutefois facultatif et il semble qu'il y soit rarement recouru dans les faits. Il existe ainsi 158 DIP en France dont 111 ont été attribuées entre 1857 et 1898112(*).
Ce périmètre de protection n'est pas obligatoire et n'est élaboré que sur la base du volontariat. Il est beaucoup plus large que le périmètre sanitaire d'émergence (PSE) et prend normalement en compte une partie du gisement d'eau minérale naturelle. Or, en France, seulement 11 % des émergences d'eaux minérales naturelles en exploitation bénéficient d'une DIP et 8 % des émergences d'eaux minérales naturelles en exploitation bénéficient d'un périmètre de protection institués par décret, ce qui est très insuffisant.
Le rapporteur préconise de réformer la règlementation des périmètres sanitaires d'émergence et des périmètres de protection afin de les étendre à des zones identifiées en fonction du risque de pollution anthropique. À ce titre, il pourrait être envisagé de redéfinir des périmètres de protection obligatoires qui s'étendent à l'ensemble du gisement d'eau minérale naturelle. La cartographie précise des périmètres de protection pourrait être établie par un hydrogéologue afin de bien prendre en compte les spécificités locales.
Cette proposition s'inspire notamment de la règlementation belge qui règlemente plus amplement le périmètre d'émergence, en le découpant en quatre zones, et qui y impose de surcroît des restrictions d'usage de produits phytosanitaires de nature à détériorer la qualité de l'eau. Les engrais azotés et les pesticides ne doivent pas dépasser une limite réglementaire.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
8 |
Revoir les dispositifs des périmètres sanitaires d'émergence (PSE) et rendre obligatoires les périmètres de protection à l'échelle de l'ensemble du gisement d'eau minérale naturelle en s'inspirant de la loi belge de 1991 et instaurer des restrictions d'usage de produits de nature à altérer la pureté originelle de l'eau sur la zone de périmètre encadrant les gisements |
Parlement Ministère chargé de l'environnement, direction générale de la prévention des risques et direction de l'eau et de la biodiversité |
2nd semestre 2025 |
Dispositions législatives et réglementaires |
3. Encadrer davantage les prélèvements
L'un des enjeux majeurs de la gestion de la ressource en eau consiste en l'anticipation des phénomènes de sécheresse liés au réchauffement climatique, et de préservation d'une ressource qui ira en se raréfiant dans certains territoires. Selon les prévisions de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, « dans les 5 ans qui viennent, [...] certaines communes majeures [...] n'auront plus d'eau. À l'été prochain, on pourrait envoyer des camions-pompes ou des packs d'eau minérale. »
Si cet enjeu ne concerne pas les seuls minéraliers, mais l'ensemble des acteurs (industriels et agricoles notamment) qui utilisent la ressource, la part que représentent les prélèvements autorisés aux minéraliers parmi l'ensemble des prélèvements effectués justifie que leur impact sur les nappes soit parfaitement renseigné.
Comme cela a été vu, la directive 2000/60/CE, dite directive cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, a imposé aux autorités nationales de recenser l'état de chaque type de masse d'eau, ce qui a conduit les agences de l'eau et l'office français de la biodiversité à réaliser un état des lieux des 12 bassins hydro-géographiques, qui sert de diagnostic initial sur lequel est élaboré un premier outil de planification de la gestion de l'eau que sont les schémas directeurs d'aménagement et gestion des eaux (SDAGE). Ces SDAGE fixent des objectifs de qualité et de quantité à atteindre à l'échéance d'un cycle de gestion. Ils sont adoptés dans des instances délibératives associant les parties prenantes au comité de bassin que sont les usagers économiques, les collectivités, l'État ainsi des associations de protection de l'environnement. Le Préfet coordonnateur du bassin définit les actions à réaliser pour atteindre ces objectifs.
À l'échelle du sous-bassin, le SDAGE peut se décliner en schémas d'aménagement de la gestion de l'eau (SAGE), qui reposent sur une démarche de concertation volontaire avec les élus locaux afin de concilier la gestion commune de l'eau entre les différents usages que sont l'eau potable, l'industrie ou encore l'agriculture, ainsi que la protection de la ressource et des milieux aquatiques.
Depuis 2021, les préfets coordonnateurs de bassin sont compétents pour encadrer les mesures à prendre pour concilier les autorisations d'exploitation du bassin et la capacité de renouvellement de la ressource.
Les autorisations d'exploitation, étudiées précédemment dans le rapport et qui comprennent des prescriptions relatives aux débits maximaux, sont accordées par le préfet de département qui s'appuient notamment sur les arrêtés du préfet coordonnateur de bassin arrêtant les volumes prélevables lorsque ceux-ci existent, ainsi que sur des études d'exploitation des volumes prélevables.
D'une part, il apparaît que les volumes maximaux de prélèvement autorisés fixés par le préfet coordinateur de bassin ne sont pas nécessairement revus à l'aune des périodes de sécheresse climatique. D'autre part, quand bien même ils le sont, les arrêtés sécheresse imposent des restrictions de prélèvements sur les seules eaux industrielles et l'extraction de CO2, qui sont les eaux destinées à l'entretien des tuyaux ou du nettoyage des bouteilles. Les restrictions de prélèvement d'eau en période de sécheresse qui s'imposent aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'appliquent ainsi pas aux installations nécessaires au captage, traitement et distribution d'eau conditionnée113(*). L'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, qui fixe ce principe, prévoit toutefois que l'autorité administrative compétente en matière de police des installations ICPE puisse en adapter les dispositions en modifiant la liste des installations qui en sont exclues. Les préfectures peuvent ainsi prendre par arrêté départemental des mesures de restriction des usages de l'eau destinées à la production d'eau minérale naturelle. Cela a notamment été fait, dans le cadre d'un plan de sobriété hydrique, par la préfecture de Haute-Savoie afin de limiter les prélèvements effectués dans le lac Léman par la société anonyme d'exploitation d'Évian (SAEME) pour alimenter ses procédés industriels de production, et notamment le nettoyage des tuyaux et installations114(*).
Enfin, certains préfets promeuvent également des initiatives de réduction échelonnée des prélèvements d'eau industrielles autorisés aux minéraliers, et ce avec leur accord.
Tel est le cas dans le Puy de Dôme dont le Préfet, Joël Mathurin, a déclaré prévoir de réduire « l'autorisation de prélèvement de l'eau en 2025, 2026 et 2027, successivement de 10 %, 20 % et 25 %. ».
Comme il le décrit, « L'intérêt de ce dispositif, voulu par le préfet de région, repose précisément sur son caractère volontaire. Les entreprises et les opérateurs économiques sont invités à s'engager volontairement dans une démarche de qualité. Pour Volvic, il s'agit d'améliorer progressivement sa fonction de production pour consommer moins d'eau. Compte tenu des décrets parus l'an dernier sur la réutilisation de l'eau dans l'industrie agroalimentaire, l'entreprise pourra investir pour économiser l'eau dans son processus interne de nettoyage des bouteilles. »
La principale limite de ce dispositif réside toutefois dans le fait que l'objectif de réduction des prélèvements est pensé indépendamment de l'évolution réelle du niveau de la nappe, ce qui en relativise la portée.
Le rapporteur insiste sur le fait que les abaissements de prélèvements doivent nécessairement être corrélés à des connaissances sur le niveau effectif de la nappe, et les risques éventuels auxquels elle est soumise, de façon à en assurer effectivement la protection.
Le second enjeu du contrôle des prélèvements et la préservation de la ressource consiste en la lutte contre les prélèvements illégaux, à l'image de ceux qui étaient pratiqués par Nestlé Waters dans les Vosges115(*). Lors d'une enquête diligentée par le parquet d'Épinal, les enquêteurs du service départemental de la biodiversité ont ainsi constaté que neuf forages de la société NWSE ne disposaient pas d'autorisation au titre du code de l'environnement entre janvier 1992 et septembre 2019.
Le rapporteur rappelle que l'encadrement des prélèvements passe par un renforcement des contrôles de police administrative et judiciaire relative à l'eau et par une bonne coordination des différents services compétents. Il s'interroge sur l'effectivité du contrôle des arrêtés d'exploitation de forages fixant des niveaux maxima de prélèvements autorisés, ainsi que sur l'autorité désignée pour les effectuer. S'il pourrait s'agir des ARS, il semble toutefois dans les faits qu'un tel contrôle soit rarement effectué, de sorte que le niveau de prélèvement d'eau minérale effectué par les minéraliers dans les nappes est rarement renseigné.
Si l'application des arrêtés règlementant les installations classées pour la protection de l'environnement, dits ICPE, est effectué par la DREAL, la DDT est également amenée à exercer un contrôle des prélèvements d'eau au regard des compétences qui lui sont dévolues dans le domaine de la loi sur l'eau. L'articulation de ces contrôles pourrait être clarifiée.
Afin d'améliorer le suivi de l'ensemble des prélèvements d'eau effectués par les minéraliers, le rapporteur encourage les préfectures à détailler dans un seul et même arrêté ICPE le volume global d'eau pouvant être prélevé sur les différents forages, comme cela est actuellement à l'étude par la Préfecture de Haute-Savoie, ainsi qu'à titre industriel.
B. LIBÉRER LES COMMUNES DES RISQUES DE PERTE DE L'APPELLATION « EAU MINÉRALE NATURELLE »
Malgré tous les efforts déployés, certains aquifères évolueront et l'eau qui en est prélevée peut ne plus mériter l'appellation d'eau minérale naturelle en raison de la mise en place de traitements qui font perdre cette appellation. C'est le cas pour l'eau de « Maison perrier ».
Or, le régime fiscal des eaux minérales crée, nous l'avons vu, une distorsion qui tient à ce que la contribution sur les eaux minérales n'est versée aux communes que pour la production d'eau minérale stricto sensu, c'est-à-dire sans traitements. Il est important de libérer les communes de cette crainte d'une perte substantielle de revenus, mais aussi l'autorité de contrôle qui peut hésiter à faire des choix drastiques en matière d'appellation compte tenu des impacts prévisibles. C'est la raison pour laquelle la commission juge nécessaire d'étendre cette contribution à toute exploitation d'eau souterraine, eau minérale naturelle, eau de source ou eau de boisson.
Par ailleurs, face aux aléas climatiques, les minéraliers peuvent être dans l'obligation de baisser leur production. Il en résulte alors une baisse des recettes perçues par les communes. La commission propose donc de supprimer le plafond de 0,58 € par hectolitre imposé dans le code général des impôts afin de permettre aux communes concernées de choisir un taux supérieur.
Enfin, l'exonération de la contribution pour la production exportée n'a guère de sens et peut inciter des industriels à privilégier l'export pour se libérer de cette fiscalité. La commission propose de supprimer cette exonération.
|
Recommandation |
||||
|
N |
Libellé |
Destinataires |
Échéancier |
Support |
|
9 |
Revoir le régime fiscal des eaux minérales naturelles - en étendant la contribution à toute exploitation d'eau souterraine, eau minérale naturelle, eau de source ou eau de boisson - en supprimant le plafond de 0,58 € par hectolitre - en supprimant l'exonération de contribution pour l'eau vendue à l'exportation |
Parlement Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
2nd semestre 2025 |
Instruction inter- ministérielle |
II. RÉNOVER UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE TROP COMPLEXE
A. UN CONTRÔLE TROP DISPERSÉ À UNIFIER RAPIDEMENT
1. La nécessité d'un dialogue renforcé entre administrations formalisé dans un protocole tripartite
La gestion du dossier Nestlé Waters a clairement montré des défaillances importantes dans le contrôle des eaux embouteillées, puisqu'une fraude massive a pu perdurer pendant de longues années et aurait pu se prolonger encore davantage si l'industriel, craignant d'être découvert à la suite des investigations lancées par le service national d'enquête (SNE) de la DGCCRF, n'était pas venu se dénoncer de lui-même.
Les services de l'État ont par la suite connu de grandes difficultés pour se coordonner, avec des interventions souvent insuffisantes laissant subsister des « trous dans la raquette » et des délais beaucoup trop longs qui ont permis à l'industriel de poursuivre, dans les faits, sa fraude encore de longs mois au détriment des consommateurs, qui achetaient cher une eau désinfectée alors qu'ils pensaient boire de l'eau minérale naturelle.
Dans son rapport final de l'audit qu'elle a réalisé en France du 11 au 22 mars 2024 afin d'évaluer le système de contrôles officiels relatifs aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source, la Commission européenne souligne que cet audit « a mis en évidence de graves lacunes qui nuisent à la mise en oeuvre du système de contrôle officiels ».
Elle relève en particulier « une mauvaise collaboration entre autorités compétentes et au sein de celles-ci, tant à l'échelle centrale qu'à l'échelle locale ».
Comme la Commission européenne avant elle, la commission d'enquête a pu effectivement constater de multiples dysfonctionnements détaillés supra : absence d'instauration d'un contrôle renforcé ou d'actions coordonnée après la révélation des fraudes, absence de prise de connaissance du rapport de l'Igas par la DGCCRF ou par l'Anses avant sa mise en ligne en février 2024 alors qu'il avait été remis à ses commanditaires en juillet 2022, manque de communication patent entre les administrations centrales, entre les administrations centrales et les administrations locales, entre les administrations locales entre elles, etc.
La communication entre les cabinets ministériels industrie et santé paraissait relativement efficace, quoique biaisé par des intérêts divergents et des rapports de force fluctuants, mais leur culture du secret et leur volonté de conserver l'affaire confidentielle le plus longtemps possible a beaucoup nui à la circulation de l'information vis-à--vis des directions d'administration centrales (DGS, DGCCRF), des agences centrales (Anses) et, surtout, des préfectures et des Agences régionales de santé (ARS).
La Commission européenne, nous l'avons vu, a eu, dans on audit de 2024 des conclusions très sévères qui doivent impérativement conduire les administrations, leurs ministres de tutelle et leurs cabinets à se remettre en question.
À la suite de ce constat accablant, le directeur général de la santé a indiqué lors de son audition devant la commission qu'une action d'ampleur nationale serait conduite en 2025 dans l'ensemble des établissements d'exploitation et de production d`eaux minérales naturelles et d'eaux de source. Il s'agira de procéder à une visite d'inspection de l'ensemble des sites pour s'assurer de la qualité de la ressource, rappeler aux ARS, les principes fondamentaux de la réglementation sur les eaux conditionnées et préciser la doctrine en matière de microfiltration. Ces rappels de la doctrine seront effectués par une instruction de la DGS aux ARS.
La commission ne peut se que se féliciter de cette perspective, mais doit relever qu'elle intervient plus de quatre ans après le déclenchement de l'affaire, et après de nombreuses révélations de presse, un rapport de la commission des affaires économiques du Sénat et le déclenchement des travaux de la commission d'enquête.
Cette visite d'inspection de l'ensemble des sites et ces rappels de la réglementation est indispensable car comme la Commission européenne l'avait noté et comme la commission d'enquête l'a encore consté en 2025 les modalités de contrôles des eaux en bouteille n'ont pas été renforcées.
Une police unique en charge de la sécurité sanitaire des aliments a été créée au sein du ministère chargé de l'agriculture le 1er janvier 2024. Cette nouvelle mission a conduit à transférer au ministère chargé de l'agriculture, les missions de sécurité sanitaire des aliments précédemment poursuivies par le ministère chargé de l'économie, ce transfert de compétences étant sans impact sur les missions poursuivies par le ministère chargé de la santé. Les eaux minérales naturelles et les eaux de source, en tant que denrées alimentaires, sont concernées par cette réforme.
L'arrivée de ce nouvel acteur, en l'occurrence la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (DGAL), chargée de veiller à la sécurité et à la qualité des aliments à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, ainsi qu'à la santé et à la protection des animaux et des végétaux, en coordination avec les services de l'État en régions et départements et avec les différents acteurs concernés : professionnels du monde agricole, associations, consommateurs, peut constituer une bonne nouvelle si elle permet véritablement un renforcement de la mobilisation des services de l'État sur le contrôle des eaux en bouteille.
Selon le directeur général de la santé, un protocole tripartite entre les ministères chargés de la santé (c'est-à-dire la DGS), de la consommation (la DGCCRF) et de l'agriculture (DGAL) est en cours de rédaction afin de définir les modalités de coopération entre services compte tenu des compétences partagées pour les contrôles officiels et d'information de la Commission européenne. Ce protocole devra préciser les rôles et responsabilités des trois autorités compétentes et la façon dont elles interagissent entre elles afin de garantir une plus grande coordination entre les différentes autorités centrales et locales compétentes et obtenir des résultats beaucoup plus probants que ceux constatés ces dernières années. Ce protocole visera notamment à préciser les modalités de coopération entre services pour la réalisation des contrôles et pour la gestion des alertes, de sorte que ne puissent plus se produire des fraudes massives comme celles dont s'est rendu coupable Nestlé Waters avec la désinfection de ses eaux minérales naturelles aux UV et au charbon actif.
Selon Sarah Lacoche, directrice générale de la DGCCRF pendant son audition, « ce protocole fait suite à l'avis de la Commission européenne qui recommande de voir comment on peut améliorer la coordination entre les différentes autorités compétentes. Il n'existait pas de protocole pour formaliser la coordination. On essaye de le faire aujourd'hui de façon assez systématique, car il est très fréquent que les champs de compétences se chevauchent. Cela permet de formaliser une coopération qui existait déjà en pratique. Le cadre écrit permet de réduire le risque d'actions divergentes et de sécuriser le dispositif ».
La commission d'enquête ne peut que souscrire à l'impérieuse nécessité de faire aboutir ce protocole tripartite dans les meilleurs délais, car elle partage pleinement le constat de la Commission européenne selon lequel « la coopération insuffisante entre les administrations centrales et l'absence de formalisation de celle-ci ont une incidence sur l'efficacité du système de contrôles officiels », lesquels se sont avérés incapables de détecter des pratiques frauduleuses qui ont lourdement pénalisé les consommateurs d'eaux minérales naturelles pendant de trop longues années.
Cela étant, le rapporteur met en garde sur la déception que pourra susciter un tel protocole si les cultures professionnelles et les logiques de travail en silo n'évoluent pas. Il souhaite insister sur l'absolu nécessité d'établir un chef de file clairement identifié en matière de contrôle des eaux en bouteille qui serait en capacité d'établir une programmation des contrôles, au niveau régional ou national, et de mobiliser l'ensemble des services compétents, au premier chef, la DGCCRF.
Par ailleurs, il estime que la coopération et la coordination entre les services déconcentrés chargés du contrôle des eaux conditionnées doit devenir la règle. Ce ne sera le cas que si elle est intégrée à leur mode de fonctionnement. Il préconise à cet effet la création de groupes de suivi des eaux conditionnées au niveau de chaque département associant les inspecteurs territorialement compétents des ARS, les services déconcentrés de la DGCCRF, de la DGAL et de la DGALN. Par ailleurs, la présence des agents de la répression des fraudes doit être systématisée lors des inspections déclenchées par les ARS, non seulement parce qu'ils disposent de pouvoirs spécifiques, mais aussi parce qu'ils ont, en principe, la compétence pour détecter les fraudes dans les systèmes industriels complexes116(*).
À ses yeux, le protocole précité doit faire l'objet d'un suivi régulier, précisément défini, et d'une présentation au moins annuelle de ses résultats dans la plus grande transparence.
Enfin, au-delà d'un protocole entre administrations, l'enjeu du retour de la confiance à l'égard du secteur exige que les autorités ministérielles reprennent les choses en mains et se saisissent du dossier.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
10 |
Instaurer, pour les contrôles, un chef de filât clairement identifié par le protocole tripartite santé, consommation et agriculture pour la réalisation des contrôles et pour la gestion des alertes et soumettre ce protocole à une validation politique |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
1er semestre 2025 |
Protocole interministériel |
|
11 |
Créer dans chaque département un groupe de suivi des eaux conditionnées associant les inspecteurs territorialement compétents des ARS, les services déconcentrés de la, de la DGAL et de la DGALN et Systématiser la présence des agents de la répression des fraudes lors des inspections déclenchées par les ARS |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation. |
2nd semestre 2025 |
Protocole |
2. Les moyens consacrés aux eaux en bouteille doivent être renforcés
Lors de son audition par la commission d'enquête, Mathilde Merlo, cheffe du bureau de la qualité des eaux à la direction générale de la santé, a indiqué que son bureau, chargé de définir les politiques publiques pour garantir la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine - c'est-à-dire l'eau qui coule de nos robinets -, conditionnées, dont les eaux minérales naturelles et les eaux de source, et de loisirs, piscines et baignades, ne comptait que 13 agents, ce qui paraît tout à fait insuffisant compte tenu de l'ampleur du champ que ce bureau est chargé de couvrir à l'échelon national.
Plus grave, au sein de ce bureau, seulement 0,75 ETP est consacré à la gestion du dossier des eaux conditionnées, ce qui paraît rendre impossible un véritable suivi et un contrôle effectif de l'activité des minéraliers.
La situation est au moins aussi problématique au niveau déconcentré, puisqu'environ 10 ETP seulement sont dédiés en ARS aux missions de contrôle des eaux minérales naturelles et eaux de source conditionnées, pour une centaine de sites répartis dans une cinquantaine de départements ! Ce qui donne le chiffre rachitique de seulement 0,2 ETP par site en moyenne...
Les seules denrées alimentaires sur lesquelles les ARS exercent un contrôle sont précisément les eaux conditionnées. Elles pâtissent par conséquent d'un manque d'expertise en matière d'hygiène alimentaire, ce que souligne l'audit de la Commission européenne.
Dans son rapport final de l'audit qu'elle a réalisé en France du 11 au 22 mars 2024 afin d'évaluer le système de contrôles officiels relatifs aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source, elle relève en effet : « le manque d'expérience des inspecteurs des ARS en ce qui concerne certains aspects des contrôles officiels, notamment les processus et la vérification du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise, associé à des problèmes en matière de personnel et de ressources, qui représentent un frein à l'organisation et à la réalisation des contrôles officiels des eaux minérales naturelles ». Et aucun système de supervision des performances des inspecteurs effectuant les contrôles n'existe.
La situation est tout aussi préoccupante côté DGCCRF avec seulement 10,7 ETP pour contrôler la production, le commerce de gros et la distribution des boissons rafraîchissantes et des eaux minérales naturelles.
En outre, comme l'indique la Commission européenne dans son audit, « les inspecteurs de la DGCCRF n'ont pas reçu de formation spécifique sur les eaux minérales naturelles depuis 2020. Les contrôles officiels s'inscrivent dans un cadre méthodologique général applicable aux contrôles de la métrologie et de l'étiquetage ».
Alors que l'inspection générale des services de la DGCCRF met en oeuvre des programmes d'audits internes afin de vérifier l'adéquation entre les ressources dédiées à un type de produit et l'importance de ce produit, aucun n'a été diligenté ces dernières années sur les eaux minérales naturelles, alors même que le contrôle sur celles-ci s'est avéré défaillant.
Les constats de la Commission européenne, que la commission d'enquête ne peut malheureusement que partager, démontre la nécessité de renforcer considérablement les équipes chargées du contrôle des eaux minérales naturelles et des eaux de source en France.
Il paraîtrait nécessaire à cet égard de doubler les effectifs consacrés au contrôle des eaux minérales naturelles en France, c'est-à-dire de prévoir au moins 2 ETP entièrement dédié dans chacune des trois administrations centrales associés au futur protocole tripartite. Sur le terrain, les effectifs devraient au moins doubler, avec 20 ETP dans les ARS et 20 ETP dans les services déconcentrés de la DGCCRF, par création de postes ou par redéploiement d'effectifs.
Au-delà de leur nombre, ces agents devront être beaucoup mieux formés aux contrôles des eaux embouteillées afin de pouvoir détecter les fraudes ou le cas échéant, les risques sanitaires, engendrés par les pratiques de certains minéraliers peu scrupuleux. Nous avons vu, s'agissant des agents de la consommation et de la répression des fraudes qu'ils devraient notamment disposer de compétences en audit informatique pour contrôler la traçabilité des eaux dans les process industriels.
Alors que le rapport de force a jusqu'ici été extrêmement défavorable à l'État face à ces industriels, celui-ci s'étant progressivement affaibli alors que ceux-là concentraient les compétences et l'expertise la plus pointue, il faut que cette situation s'inverse rapidement, que l'État reprenne le contrôle pour restaurer la confiance des consommateurs dans un secteur auquel ils sont très attachés.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
12 |
Renforcer par redéploiements les effectifs des services de l'État consacrés au contrôle des eaux minérales naturelles et des eaux de source et Professionnaliser ces agents en les formant à la détection des fraudes et aux pratiques susceptibles de mettre en péril la sécurité sanitaire des eaux |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |
2e semestre 2025 idem |
Redéploiement d'effectifs Programme de formation |
3. Responsabiliser les autorités chargées du contrôle et laisser moins de place aux considérations d'opportunité dans les suites à donner
Au long de ses travaux, la commission d'enquête a pu constater que, jusqu'à ce que l'affaire Nestlé Waters soit rendu publique, la question des contrôles des eaux minérales naturelles et des eaux de source n'était pas une véritable priorité pour la direction générale de la santé, dans la mesure où, de son point de vue, ces produits ne posaient pas de difficultés significatives en matière de sécurité alimentaire.
Devant la commission d'enquête, le directeur général de la santé Gregory Emery s'était ainsi livré à un véritable autosatisfecit : « de manière générale, la qualité sanitaire des eaux conditionnées produites en France est très satisfaisante. Plus de 150 000 analyses sont réalisées chaque année dans le cadre du contrôle sanitaire des ARS et le taux de conformité aux limites de qualité réglementaires est supérieur à 99 % pour les paramètres microbiologiques et physico chimiques. En 2022, plus de 50 inspections (sur un total de 104 sites présents sur le territoire) et plus de 1 900 visites ont ainsi été réalisées par les ARS. Ce niveau de conformité constaté, traduisant un risque maîtrisé (bien que ne pouvant jamais être considéré comme nul), explique pourquoi nous avons considéré, jusqu'en 2021, qu'il n'était pas nécessaire de renforcer la surveillance des eaux conditionnées. »
Ce sentiment trompeur que tout allait bien, que tout était sous contrôle, n'a pas peu joué dans la capacité de certains minéraliers de frauder pendant de trop longues années.
La DGS le reconnaît du reste elle-même dans une réponse au questionnaire que lui avait adressé la commission d'enquête lorsqu'elle écrit : « ce sujet, contrairement à d'autres comme l'eau potable, n'était pas prioritaire pour la DGS et les ARS. Il n'y avait pas de coordination nationale régulière des ARS sur le sujet ».
Ainsi, selon l'audit de la Commission européenne, « aucune approche fondée sur les risques n'est appliquée et la probabilité de comportements frauduleux et trompeurs n'est pas prise en compte pour déterminer la fréquence appropriée des contrôles. Les installations ne font pas l'objet d'inspections officielles régulières. La décision de procéder à une inspection officielle d'une installation est prise à l'échelon local ».
En outre, lors des inspections des ARS, le plus souvent annoncées à l'avance, alors que des visites inopinées sont indispensables, les inspecteurs se contentaient de prendre note des informations fournies par les exploitants.
Face à ce constat, le directeur général de la santé a bien voulu reconnaître au cours de son audition que « la coordination des autorités compétentes mérite d'être améliorée. Sur le terrain, les services en charge des contrôles sont dans l'incapacité de déceler des pratiques frauduleuses. Enfin, les consommateurs n'ont pas été suffisamment informés ».
Le constat n'est guère plus reluisant pour la DGCCRF, puisque celle-ci, même en cas d'antécédents peu satisfaisants de minéraliers en matière de comportements frauduleux et trompeurs, tendait à prévoir au mieux des contrôles tous les deux ou trois ans, ce délai pouvant aller jusqu'à cinq ans.
En outre, elle a laissé l'eau traitée aux UV et au charbon actif être commercialisée en tant qu'eau minérale naturelle pendant de longs mois, ce que souligne la Commission européenne lorsqu'elle écrit « pendant que les traitements étaient toujours en place et connus des administrations centrales, l'eau produite a continué à être commercialisée en tant qu'EMN, alors qu'elle ne pouvait plus être considérée comme telle » ou bien encore « l'eau traitée a continué à être commercialisée et étiquetée en tant qu'EMN, alors qu'elle ne répondait pas aux exigences de la législation de l'UE pour être qualifiée comme telle ».
C'est pourquoi il apparaît essentiel de veiller à ce que les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels des exploitants d'eaux minérales naturelles de façon beaucoup plus régulières, en fonction des risques présentés par chaque site et des pratiques passées des minéraliers et à une fréquence adéquate.
Il est tout aussi indispensable que les administrations centrales mettent enfin en place une véritable animation de leurs réseaux déconcentrés sur cette thématique, ainsi que s'y est engagée le directeur général de la santé devant la commission d'enquête : « Une coordination nationale a été mise en oeuvre avec les ARS Occitanie et Grand Est et sera étendue aux autres ARS en 2025 ».
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
13 |
Concevoir et mettre en oeuvre un plan de contrôle des eaux conditionnées fondé sur les risques et la probabilité de comportements frauduleux et multiplier les inspections inopinées |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité |
2e semestre 2025 |
Stratégie nationale spécifique |
|
14 |
Mettre en place une véritable animation par l'administration centrale de ses administrations déconcentrées sur le thème du contrôle des eaux embouteillées, comme dans le cas de la DGS avec les ARS |
idem |
idem |
Conduite administrative |
B. UNE RÉGLEMENTATION À RESTRUCTURER
1. Mettre en place un seuil normé pour la microfiltration
a) Porter la demande d'une modification juridique au niveau européenne auprès de la Commission européenne
Si la réglementation relative à la microfiltration est apparue claire au rapporteur, force est de constater que de nombreux acteurs se sont retranchés derrière un flou supposé pour justifier leurs actes.
La direction générale de la santé relevait ainsi que « la directive européenne 2009/54/CE repose sur des principes généraux et anciens qui ne permettent pas de déterminer, sans ambiguïté, la légalité de ce type de traitement d'autant que le seuil de coupure autorisé pour ces filtrations n'est pas défini réglementairement. Cette incertitude réglementaire rend plus complexe la mise en oeuvre de mesures coercitives tant que ce point n'est pas clarifié ».
Une fois ce constat posé, il convient de porter résolument au niveau européen sa modernisation, ce que le Gouvernement de 2021 à 2024 s'est bien gardé de faire avec vigueur en dépit de la volonté des administrations compétentes.
Par conséquent, la commission d'enquête souhaite que la France porte auprès des institutions communautaires des demandes de révision de la directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
Les demandes de révision devront porter sur :
- les critères de qualification de la pureté originelle qui pourraient être précisés ;
- le statut et le seuil acceptable de la microfiltration qui doivent être précisés.
Ces demandes ont été évoquées par les autorités françaises au niveau administratif à l'occasion de l'audit de la Commission européenne en mars 2024 puis lors des séances du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale (CPVADAAA) des 30 avril et 8 novembre 2024, ce comité réunissant la Commission et les représentants de l'ensemble des États membres.
Elles doivent désormais être portées au niveau politique. En effet, selon la direction générale de la santé, la Commission a répondu qu'elle ne prendrait pas l'initiative d'une révision de la directive. Une telle prise de position de la Commission est regrettable.
Selon la direction générale de la santé, une action commune visant à questionner de nouveau la Commission est en cours de construction associant la France à l'Espagne et à la Belgique qui souhaitent également une clarification du statut de la microfiltration.
La commission d'enquête ne comprend pas la réponse faite à ce stade par la Commission européenne et soutient par conséquent fortement l'initiative française consistant à l'interroger de nouveau pour faire avancer les indispensables révisions du droit de l'Union européenne dans le sens d'une consolidation de la notion de pureté originelle, notamment en fixant un seuil de microfiltration suffisamment haut pour garantir sa préservation.
b) Limiter le seuil de coupure à 0,45 micron au niveau national dans l'attente d'une clarification de la réglementation européenne
Dès lors que la Commission européenne paraît, à ce stade, réticente à se saisir à brève échéance de cette question, il convient d'adopter rapidement des règles claires au niveau national.
La clarification rapide de la réglementation et des procédures à mettre en oeuvre par les industriels minéraliers est cruciale car d'elle dépend la sécurité ex ante des eaux produites. Sans cette clarification, l'État en est réduit à adopter un mode de régulation ex post fondé sur le repérage et la destruction des lots de bouteilles contaminées. Ce mode est très insatisfaisant, non seulement car il présente le risque que des bouteilles contaminées ne passent entre les mailles du filet et soient commercialisées, mais aussi parce qu'il conduit à produire puis détruire de la production, ce qui est, écologiquement et économiquement, absurde.
La direction générale de la santé prépare à cet égard un projet d'instruction aux ARS et aux préfets qui fixerait ainsi la doctrine française sur la microfiltration en l'absence de règle harmonisée au niveau européen :
- « Pour le conditionnement d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source, le recours à des dispositifs de microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron est interdit. Comme en Espagne ou en Belgique, en-dessous de ce seuil, ces technologies sont assimilées à des traitements de désinfection au sens de l'article 4 de la directive 2009/54/CE ;
- « L'industriel du conditionnement d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source qui souhaite utiliser des dispositifs de microfiltration avec des seuils de coupure compris entre 0,45 et 0,8 micron doit le déclarer au préfet et démontrer que le traitement n'a aucun impact sur le microbisme naturel de l'eau de la source autorisée eau minérale naturelle ou eau de source ».
À cet égard, plutôt que de laisser chaque préfet et chaque ARS à nouveau seul face à la nécessité de recueillir les preuves de l'absence d'impact de la microfiltration entre 0,45 et 0,8 micron, la bonne démarche consisterait à solliciter un avis documenté par l'Anses.
Toutefois, il pourra toujours être opposé aux autorités qu'une instruction ne crée pas de droit. Par conséquent, dans l'attente d'une décision au niveau européen, la commission considère qu'une instruction, pour être bienvenue, ne suffit pas et qu'il revient au Gouvernement de prendre l'initiative et de clarifier l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnée.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
15 |
Solliciter à nouveau la Commission européenne, y compris au niveau politique, pour obtenir une révision de la directive sur les eaux minérales naturelles afin de consolider la notion de pureté originelle, notamment en fixant un seuil de microfiltration suffisamment haut pour garantir sa préservation puis Engager une négociation au niveau européen pour réviser la directive de 2009 sans altérer la protection de la pureté originelle de l'eau minérale |
Premier ministre, Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de l'Europe |
2025 |
Sollicitation puis négociation diplomatique |
|
16 |
Diffuser rapidement l'instruction interdisant la microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron et conditionnant la microfiltration à des seuils compris entre 0,45 et 0,8 micron à la démonstration d'une absence d'impact sur le microbisme naturel de l'eau, sur la base d'un avis de l'Anses puis Modifier l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnée pour y insérer le même niveau de seuils |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
1er |
Instruction |
2. Garantir la traçabilité de l'eau
Lors de leur visite du site de Vergèze, les membres de la commission d'enquête ont pris la mesure d'un enjeu essentiel, particulièrement perceptible sur ce site assurant la production de plusieurs types d'eau : celui d'assurer la traçabilité de l'eau.
De fait, trois types d'eau sont désormais produits à Vergèze : de l'eau minérale naturelle « Source Perrier », de l'eau de boisson qui peut subir des traitements aux UV et au charbon actif vendue sous la nouvelle marque « Maison Perrier » et de l'eau traitée pour l'exportation vers les Etats-Unis selon des méthodes exigées par les autorités américaines et qui ne correspondent pas aux normes européennes. Or, ces eaux utilisent, au moins en partie, des installations communes (cuves, canalisations, etc.).
Selon les explications des responsables du site, la production d'un type d'eau est programmée pendant plusieurs jours, avant une phase de nettoyage, puis la production d'un autre type d'eau, ces phases d'alternance se produisant à intervalles réguliers au fil du temps, mais étant gérées informatiquement.
Il est donc essentiel que les industriels se dotent des dispositifs de suivi et de traçabilité informatique nécessaires pour être capables d'indiquer aux services de contrôle quel était très précisément le type d'eau produite sur une ligne de production donnée à un moment donné.
Or, la lecture du rapport d'inspection des services de la DGCCRF en date du 13 juin 2024 sur le site de Vergèze, comme la visite de l'usine par la commission montrent ce contrôle reste très complexe. Lors de l'inspection, par exemple, les personnels de l'usine n'ont pas été en mesure de présenter en temps réel la traçabilité en amont d'une ligne de production. Comme l'écrivent à juste titre les inspecteurs, « cette scission de la traçabilité est d'autant plus problématique depuis le déclassement de deux forages en eau destinée à la consommation humaine et représente un point critique de loyauté ».
Des entretiens tenus, lors du déplacement à Vergèze, avec les services de l'État présents, le rapporteur retire la conclusion que la question de la traçabilité mérite une réflexion approfondie quant aux méthodes de contrôles à déployer. En effet, l'orientation, sur des lignes de production identiques, des flux des différentes qualités d'eaux dans une usine comme celle de Perrier est gérée de manière totalement informatisée. Dès lors, la traçabilité ne peut être contrôlée que grâce à des processus d'audit solides des systèmes d'information déployés dans l'usine. Or, il ne semble pas que les services de l'État disposent des compétences et de l'expérience nécessaires en ce domaine.
Face à l'évolution rapide des process industriels, il est désormais impératif que les services de contrôle de l'État, DGCCRF et ARS notamment, mettent en place rapidement des programmes de recrutement et de formation d'agents capable de réaliser des audits des dispositifs informatisés de production pour vérifier qu'une « murailles de Chine » numérique existe à même d'assurer l'étanchéité des différentes filières de production et d'écarter le risque de réitération de la fraude. Une seconde étape sera de concevoir un plan d'audit de la traçabilité des eaux conditionnées dans les sites de production en France.
Comme on l'a vu, le code de la santé publique, à son article R. 1322-37-1, précise qu'une eau minérale naturelle (EMN) et une eau de source (ES) peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage. Un raisonnement a contrario laisse penser qu'à l'inverse une même chaîne ne peut conditionner deux eaux dont l'une ne serait ni EMN ni ES. C'était d'ailleurs sans doute la volonté des auteurs de l'article eu égard à la proximité des caractéristiques de ces deux catégories d'eau du point de vue des exigences de qualité microbiologique auxquelles elles doivent répondre. Pour autant, le code de la santé publique n'interdit pas formellement une même chaîne de conditionnement pour une eau minérale et une eau de boisson. On relèvera d'ailleurs à cet égard que les services de l'État n'ont pas fait valoir une telle interdiction pour l'usine de Vergèze alors que « Maison Perrier », eau de boisson qui n'est ni eau minérale ni eau de source qui partage la même ligne de conditionnement que l'eau minérale naturelle Perrier.
Pour renforcer la traçabilité de l'eau dans les installations de production, la commission propose que l'État établisse un cahier des charges de traçabilité des eaux qui impose des règles précises d'auditabilité informatique des dispositifs de gestion des flux d'eau et que, parallèlement, le ministère de l'économie consente un effort de recrutement, de rémunération et de formation de personnels en capacité de procéder à des audits informatiques des programmes de production.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
17 |
Mettre en place un cahier des charges de traçabilité des eaux qui impose des règles précises d'auditabilité informatique des dispositifs de gestion des flux d'eau |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |
2nd |
Cahier des charges |
|
18 |
Créer un groupe de réflexion interservices pour instituer un programme de recrutement et de formation d'agents capable de réaliser des audits des dispositifs informatisés de production et concevoir un plan d'audit de la traçabilité des eaux conditionnées |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |
2nd semestre 2025 |
Décision inter- ministérielle |
|
19 |
Mener une campagne d'inspection des sites de production d'eau embouteillée portant spécifiquement sur la traçabilité des eaux minérales naturelles et/ou des eaux de source avant d'envisager une évolution, ou a minima une clarification, de la règlementation |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |
Immédiat |
Instruction |
3. Renforcer le contrôle des prélèvements
Compte tenu des enjeux en termes sanitaires, mais aussi financiers, la commission est étonnée de constater qu'un concept de base du contrôle interne, à savoir la séparation des tâches, ne soit pas mis en oeuvre dans l'activité de prélèvement des échantillons d'eaux dans les sites des minéraliers.
En effet, à l'heure actuelle, c'est un agent du laboratoire privé retenu par appel d'offres par l'ARS qui se rend, seul, sur place pour prélever un échantillon d'eau. Cette solitude est évidemment une faille en termes de protection contre la fraude et les erreurs.
Aussi apparaît-il nécessaire de mettre en place un dispositif permettant l'accompagnement de l'agent préleveur par un second personnel, qui pourrait relever des services de l'État. Le cas échéant, cette intervention serait à financer par l'industriel. Sans doute faut-il par ailleurs s'interroger sur la pertinence d'imposer aux industriels des dispositifs de forage conçus de telle sorte qu'ils soient aisément contrôlables.
C. UN CONTRÔLE DES COMPOSANTS DE L'EAU À ÉLARGIR D'URGENCE EN RAISON DES POLLUTIONS ÉMERGENTES
Les eaux minérales naturelles et les eaux de source font aujourd'hui l'objet de contrôles très précis, et en particulier microbiologique et virologique pour détecter toute contamination potentielle susceptible de mettre en danger leur sécurité sanitaire. Cependant, se pose de plus en plus la question, qui concerne également les autres denrées alimentaires, de la présence dans ces eaux de PFAS, d'une part, de micro et de nano plastiques, d'autre part.
Il y a là un enjeu de santé publique qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens et qui doit conduire tant les minéraliers que les pouvoirs publics à se mobiliser pour garantir des eaux minérales naturelles et des eaux de source exemptes de PFAS et de résidus plastiques.
1. Les PFAS, une pollution omniprésente
a) Les PFAS sont présents partout dans notre environnement, y compris dans les eaux conditionnées
Les PFAS, substances per- ou polyfluoroalkylées, sont des composés chimiques qui présentent des propriétés particulières (antiadhésives, imperméabilisantes ou bien encore résistantes aux fortes chaleurs), ce qui a encouragé leur fabrication puis leur utilisation par de multiples secteurs industriels depuis les années 1950.
Même s'il ne s'agit pas à proprement parler de « polluants éternels », il s'agit de molécules très persistantes, puisqu'elles se dégradent ou se biodégradent très difficilement dans l'environnement, sur des durées pouvant se chiffrer en dizaines voire en centaines d'années. Elles peuvent toutefois être détruites par une incinération à haute température.
Produites depuis de nombreuses décennies, les PFAS sont désormais très largement répandues dans l'environnement et se révèlent bioaccumulables. Certaines sont toxiques ou « CMR », c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, mais leur toxicité ou leur cancérogénicité demeurent encore insuffisamment documentée.
Pour mieux cerner la présence de ces PFAS dans les eaux conditionnées et la façon de la limiter ou bien d'y remédier, la commission d'enquête a entendu Alby Schmitt, inspecteur général de l'environnement et du développement durable, co-auteur du rapport « Analyse des risques de PFAS dans l'environnement » daté de 2022.
Celui-ci a rappelé que ces molécules d'origine industrielle sont présentes partout dans notre environnement : « on les retrouve dans les mousses de lutte contre les incendies, dans les batteries de véhicules électriques, dans les ustensiles de cuisine - on a beaucoup parlé des poêles antiadhésives, notamment de la marque Tefal -, les vêtements de sport, le fart de ski, les semelles de fer à repasser, les boîtes à pizza, etc. On en retrouve aussi dans les médicaments, tant dans les principes actifs - par exemple le Prozac - que dans les excipients et les boîtes. Nous n'avons découvert que récemment que les industriels utilisaient aussi des PFAS dans les pesticides ; le TFA en est l'exemple type ».
Ainsi qu'Alby Schmitt l'a signalé lors de son audition, il est clair que sans action forte et raisonnée, la présence de PFAS dans l'environnement et, en particulier dans les eaux de surface ne peut que se maintenir ou ne diminuer que très lentement, voire croître dans les eaux souterraines.
b) Un risque de contamination qui paraît limité pour les eaux en bouteilles, mais qui doit être contrôlé
Selon Alby Schmitt, il est possible d'identifier trois types de pollutions des eaux souterraines par des PFAS : ponctuelles, linéaires ou diffuses.
Dans le cas de pollutions ponctuelles, celles-ci peuvent provenir de percolations sous les terrains pollués aux PFAS : il peut s'agir d'anciens sites d'incendies d'hydrocarbures, d'anciens sites d'entrainement de pompiers ou bien encore d'anciens sites industriels produisant ou utilisant des PFAS ; la pollution est alors limitée, restreinte au seul « tube de courant » (secteur de circulation d'eau dans la nappe entre le point de pollution et le point d'émergence ou d'exploitation de la nappe).
Dans ce cas, une étude hydrogéologique doit permettre de déterminer où et comment pomper pour éviter de pomper une eau polluée.
Si de telles situations peuvent se présenter en France s'agissant de l'eau du robinet, Alby Schmitt a indiqué à la commission ne pas connaitre de site de production d'eau minérale naturelle ou d'eau de source sur lesquels le bassin versant comprendrait une usine ou un site pollué par des PFAS. Cette source de contamination paraît donc devoir être écartée.
Dans le cas de pollutions linéaires, il s'agit de la pollution des nappes alluviales par des cours d'eau pollués dans les secteurs où il y a recharge de ces nappes par la rivière. Beaucoup de captages d'eau potable exploitent des nappes alluviales et, en pratique, l'eau du cours d'eau ne fait que transiter de la rivière vers le captage par la nappe alluviale. Ce transit permet une filtration et l'élimination d'une partie des polluants, mais vraisemblablement pas d'une majorité de PFAS. Il est donc important de s'assurer pour tous ces captages d'eau potable en nappe alluviale que le cours d'eau n'est pas pollué par les PFAS et sinon, de rechercher l'origine de la pollution du cours d'eau et de la traiter.
Là encore, si cette situation existe pour des captages d'eau potable utilisés pour l'eau du robinet, tel n'est pas encore le cas des eaux minérales naturelles ou des eaux de source exploitées en France.
Dans le cas de pollutions diffuses, enfin, il s'agit de la pollution des nappes par les épandages de pesticides et de fertilisants, dont les boues d'épuration, lorsqu'ils contiennent des PFAS ou sont pollués par des PFAS.
Il s'agit là d'une pollution généralisée à l'ensemble des zones concernées et donc difficile à maîtriser au niveau d'un captage situé à l'aval. En dehors du traitement de l'eau les principales pistes envisageables sont la suppression des pesticides contenant des PFAS ou l'arrêt des épandages de fertilisants pollués par les PFAS.
Pour autant, selon Alby Schmitt lors de son audition : « pour les eaux minérales, le bassin de captage est en général bien protégé grâce à des conventions entre l'exploitant et les agriculteurs, qui prévoient de ne pas utiliser ou d'utiliser de manière raisonnée des intrants. C'est pourquoi, à mon sens, mais je n'ai pas de données en la matière, l'eau qui arrive à l'usine ne doit pas contenir de PFAS. Pour autant, il faut aussi prendre en compte les délais entre la décision de ne pas utiliser des intrants et le résultat que l'on souhaite obtenir. A priori, les eaux minérales devraient donc être beaucoup moins polluées à l'entrée de l'usine qu'une eau qui est puisée dans un autre captage moins protégé. »
De fait, les captages d'eaux minérales naturelles paraissent relativement protégés de ces pollutions d'origine agricole puisque les exploitants contractualisent fréquemment avec les agriculteurs situés sur le bassin versant de la source ou des forages pour qu'ils adoptent des pratiques respectueuses de la qualité de l'eau (réduction ou suppression des intrants).
Cathy Le Hec, directrice des eaux de Danone, indiquait ainsi lors de son audition : « quant à la protection des impluviums, notre programme lié à l'activité agricole comprend notamment l'agriculture régénératrice, qui vise à préserver les sols et à limiter l'utilisation des intrants. Sur les territoires où nous sommes implantés, agricultures conventionnelle et biologique se côtoient, mais 96 % des surfaces étaient sans pesticides en 2023 ».
Le risque de pollution des eaux brutes par les PFAS semble ainsi être limité même s'il doit, bien sûr, faire l'objet d'une surveillance attentive.
Si la protection des impluviums peut être une garantie, une pollution peut aussi apparaître dans l'usine d'embouteillage et le réseau de tuyauterie du process de production : cela est dû à la présence quasi-systématique de joints dans les process industriels, dont beaucoup contiennent des PFAS, PFAS également présentes dans les réseaux d'eau (canalisations, pompes, équipements de régulation...).
Lors de son audition, Alby Schmitt rappelait ainsi « qu'on utilise beaucoup les PFAS dans les procédés industriels. Je vais citer deux principaux exemples : la majorité des joints, un produit présent partout, en particulier dans l'industrie qui traite l'eau, qu'elle soit minérale ou destinée au robinet, contient des PFAS. Dans ces cas, quel est le risque de transfert ? Cela est encore peu connu. »
On peut donc raisonnablement estimer qu'il existe un risque de pollution par les PFAS dans les tuyauteries et les pompes des usines d'eau minérale naturelle.
Alby Schmitt indique ainsi « les traitements de l'eau sont a priori réduits pour l'eau minérale, mais restent variables selon les sites : élimination de l'arsenic et des éléments radioactifs pour certaines eaux, dégazage et regazéification pour les eaux gazeuses... En l'absence d'informations sur les analyses effectuées sur les eaux minérales en cause, il m'est difficile de conclure, mais il est vraisemblable que la pollution par les PFAS provient des usines et non des eaux brutes, surtout dans le cas de bassins versants bien protégés comme ceux de Vittel ou Contrexéville ».
En l'état actuel des connaissances scientifiques, il paraît donc établi que les PFAS susceptibles d'être présents dans les eaux minérales naturelles ou dans les eaux de source sont davantage susceptibles d'avoir été ajoutées au cours du processus de production que d'avoir été présents dans l'eau brute à l'émergence, en principe très bien protégée.
La commission estime indispensable qu'un point soit fait sur les risques de pollution par les processus industriels de production des eaux minérales et de source et recommande à la direction générale de la santé de saisir l'Anses sur ce sujet. Elle estime que les résultats de cette étude devront être rendus publics.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
20 |
Saisir l'Anses aux fins d'établir un avis complet sur les risques de contamination des processus de production d'eau minérale et de source par les PFAS et rendre public cet avis |
Ministère de la santé, direction générale de la santé |
1er |
Saisine au titre de l'article L1313-3 du code de la santé publique |
c) Le contrôle de la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
À l'heure actuelle, les contrôles obligatoires des eaux destinées à la consommation humaine, qu'il s'agisse des autocontrôles des exploitants ou des contrôles des ARS, portent sur des paramètres autres que les PFAS.
Néanmoins, en vertu de la directive de 2020 sur les eaux destinées à la consommation humaine (DEDCH)117(*) dont font partie les eaux minérales naturelles et les eaux de source, transposée en droit français par ordonnance et par des textes réglementaires, ces contrôles s'élargiront à 20 PFAS à compter du 1er janvier 2026.
Ces contrôles portent sur l'eau distribuée et les eaux brutes, qu'elles soient de surface ou souterraines.
Ce contrôle a du reste déjà en partie commencé puisque Alby Schmitt lors de son audition indiquait : « indépendamment de la réglementation, à peu près la moitié des agences de l'eau se sont mises, dès 2019, à mesurer dans les eaux souterraines et de surface les vingt PFAS listés dans la directive de 2020 ; les autres agences ne mesurent que les eaux souterraines et uniquement quatre PFAS pour les eaux de surface. Nous avons recommandé d'étendre à l'ensemble des eaux ce suivi des vingt PFAS et, le cas échéant, de le faire pour leurs précurseurs, c'est-à-dire les molécules qui se transforment, en se dégradant, en l'un de ces vingt PFAS. »
La directive permet de choisir entre une norme sur la somme des 20 PFAS et une norme sur le total des PFAS, ou encore de retenir les deux limites. La France a choisi de retenir les deux limites, dont une seule, la somme des 20 PFAS sera effective au 1er janvier 2026, en l'absence des lignes directrices attendues de la Commission sur le total des PFAS.
Une limite est déjà imposée aux eaux brutes destinées à la consommation humaine (2 ug/l pour les 20 PFAS). Il est indispensable de les surveiller, y compris celles destinées à être embouteillées.
Cette mesure amont permettra également de vérifier si la pollution est liée aux eaux brutes ou plutôt au process de traitement et de mise en bouteille (pollution par les PFAS pouvant être présents dans le process).
Comme toute norme, elle doit pouvoir être contrôlée, par un autocontrôle régulier par l'exploitant auquel vient s'ajouter un contrôle aléatoire et raisonné de la police sanitaire.
L'eau distribuée ou l'eau en bouteille ne doit pas dépasser une concentration et 0,1 ng/l pour les 20 PFAS (« Somme des 20 PFAS ») et 0,5 ng/l pour la totalité des PFAS.
Selon Cathy Le Hec, directrice des sources d'eaux minérales chez Danone Waters Europe, lors de son audition par la commission : « concernant les PFAS, ou polluants éternels, la réglementation a été adaptée en 2023 par rapport à l'arrêté de 2007, qui a été modifié. Elle définit, pour les eaux destinées à la consommation humaine, une liste de vingt PFAS et un seuil. Elle ne s'applique pas directement aujourd'hui, puisqu'elle entrera en vigueur en 2026. Cela étant, nous nous efforçons d'anticiper les évolutions réglementaires et, surtout, d'être en capacité d'analyser la ressource et les risques pensant sur elle. C'est pourquoi nous avons sérieusement examiné la question des PFAS, avec plusieurs campagnes de contrôle, par différents laboratoires, sur nos produits finis. »
« Selon nos observations, dans la majorité des cas, nous ne détectons pas de PFAS dans nos produits finis. Lorsque c'est le cas, nous sommes très proches du seuil à partir duquel les laboratoires sont en mesure de les quantifier. Ce seuil de quantification est de l'ordre d'un à deux nanogrammes par litre. Nos eaux sont donc préservées quant à cette problématique des PFAS. »
Les autres minéraliers interrogés sur cette question ont fait des réponses analogues, affirmant de pas avoir trouvé de PFAS dans leurs eaux ou dans des quantités très inférieures aux seuils prévus par la directive DEDCH. C'est ce qu'ont notamment expliqué Luc Bayens, directeur général de Sources Alma et Didier Ramos, directeur général de la Société des eaux de Mont Roucous. Ces présentations optimistes doivent cependant être prises avec prudence si l'on en juge par la succession de révélations de presse récentes sur la présence de PFAS dans certaines eaux minérales en France, en Belgique ou en Suisse. La presse a ainsi évoqué les eaux de Villers (Alma), Vittel (Nestlé), ou Hennez (Nestlé)118(*).
De façon générale, il existe trois techniques d'élimination des PFAS dans l'eau : l'osmose inverse, les colonnes échangeuses et les filtres à charbon actif. Ces trois traitements ne sont pas spécifiques et peuvent éliminer à la fois les PFAS et tous les autres polluants ou une partie des autres polluants.
Mais ces traitements ne sont clairement pas compatibles avec la définition d'une eau minérale naturelle pure à l'émergence.
L'enjeu est donc bien de s'assurer qu'il n'y a pas de PFAS dans les eaux brutes à l'émergence et que des PFAS de sont pas ajoutées l'eau au cours du processus d'embouteillage.
Selon Alby Schmitt, « indépendamment de leur pertinence dans l'absolu, l'obligation de mesures de la pollution des eaux par les PFAS liée à cette réglementation va permettre de disposer d'informations bien plus étendues que précédemment, ce qui devrait permettre d'engager des suivis épidémiologiques qui amélioreront nettement notre connaissance des relations entre niveau de pollution par un PFAS donné et effets sur la santé ».
La commission d'enquête soutient donc la volonté exprimée par la direction générale de la santé de demander aux ARS de vérifier au cours de l'année 2025 la qualité des eaux brutes des eaux minérales naturelles et des eaux de source afin de s'assurer que celle-ci ne contiennent pas de PFAS ou que les quantités concernées demeurent inférieures au seuil de 0,1 ng/l pour les 20 PFAS. Il conviendra de mener également des campagnes de tests pour s'assurer que les eaux une fois conditionnées ne contiennent pas des PFAS à un niveau au-dessus de ce seuil de 0,1 ng/l.
Interrogée sur ses actions en matière de PFAS, l'Anses a indiqué : « (...) les études de l'alimentation totale (EAT) sont reconnues comme l'une des méthodes les plus pertinentes d'un point de vue coût-bénéfice pour évaluer les expositions alimentaires chroniques d'une population à un grand nombre de substances, et mener à bien des évaluations des risques sanitaires (ERS).
Ces études constituent l'une des principales sources d'information sur les concentrations de nombreuses substances dans l'alimentation et sur l'estimation des expositions alimentaires. Les résultats de ces études sont notamment un bon indicateur de la contamination de l'environnement par les produits chimiques et sont, de ce fait, un outil efficace permettant l'évaluation de l'efficacité des mesures de gestion des pouvoirs publics pour réduire l'exposition des populations à ces substances.
Les EAT reposent sur la combinaison de données de consommation individuelles, représentatives des habitudes alimentaires de la population, avec des données de contamination estimées sur les aliments prêts à consommer. A la différence d'études d'exposition plus théoriques s'appuyant sur les valeurs réglementaires (telles que les limites maximales de résidus (LMR)) ou sur la contamination des matières premières (issues des plans de surveillance et de contrôle de l'administration), ces études permettent une estimation plus réaliste du risque.
Dans le cadre de l'EAT 3, pilotée par l'agence, prêt de 260 paramètres appartenant à différentes classes chimiques (PFAS, mycotoxines, éléments traces métalliques, contaminants issus de matériaux en contact des aliments, résidus de pesticides, phytoestrogènes, etc.) sont recherchés dans différentes matrices alimentaires dont les eaux conditionnées (eau de source et eau minérale naturelle). Cette étude est en cours. »
La commission d'enquête estime que l'Anses doit prioriser les analyses relatives à la présence des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine et dans les eaux en bouteille et proposer une programmation sur 5 ans en la matière.
Le rapporteur ne saurait trop souligner la nécessité de pousser les feux sur les PFAS pour en maîtriser la diffusion dans les eaux, ce qui suppose d'en réduire la production, d'en connaître les concentrations, d'améliorer les modes de traitements. En la matière, comme sur les micro et nanoplastiques dont ils sera questions infra, il attend du Gouvernement qu'il soit très proactif au sein de l'Union européenne pour compléter et durcir la réglementation visant à protéger les consommateurs.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
21 |
Renforcer le contrôle sur la présence des PFAS dans les eaux embouteillées en menant une campagne de tests en 2025 |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé |
2d semestre 2025 |
Instruction |
|
22 |
Vérifier l'absence d'adjonction de PFAS au cours du processus d'embouteillage |
Ministère de la santé, direction
générale |
2d semestre 2025 |
Instruction |
2. Les micro et les nanoplastiques, un problème particulièrement prégnant dans le secteur de l'eau conditionnée
Lors des auditions de la commission d'enquête, la question des micro et nanoplastiques est clairement apparue comme un nouvel enjeu prioritaire en matière de santé publique.
Initialement, la contamination par les microplastiques était principalement associée aux milieux aquatiques, notamment avec les déchets plastiques se déversant dans les mers et océans. Par la suite, les études ont montré leur présence dans les autres compartiments de l'environnement (air et sol) puis dans les aliments et le corps humain.
Les microplastiques sont des particules de matériaux plastiques définies principalement par leur taille. Celle-ci est comprise entre 1 micromètre et 5 micromètres, selon la communauté scientifique. Les nanoplastiques font pour leur part moins d'1 micromètre.
Alors que les objets en plastique sont présents partout dans notre environnement, ils se dégradent sous l'effet de l'action de bactéries ou par photo-oxydation avec les rayons ultraviolets (UV) solaires, mais dans tous les cas de manière très lente. Cette lenteur du processus peut conduire à un fractionnement et à l'apparition de microplastiques, terme utilisé pour les fragments inférieurs à 5 millimètres.
La seconde origine des microplastiques est leur production à cette échelle. Les plasturgistes produisent des matériaux plastiques de taille inférieure à 5 millimètres, comme des billes de plastique qui pouvaient être utilisées auparavant dans des produits exfoliants ou certains produits ménagers.
Les travaux scientifiques démontrent l'ubiquité de la contamination des microplastiques et des nanoplastiques dans l'environnement : on les détecte actuellement, partout dans le monde, dans presque toutes les ressources aquatiques, qu'elles servent à l'obtention de l'eau du robinet ou pour les eaux embouteillées.
Une étude américaine, publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences le 8 janvier 2024, décompte ainsi près de 240 000 fragments de micro et nanoplastiques par litre d'eau en bouteille, avec une variation allant de 110 000 à 370 000 particules par litre.
Les dernières études réalisées soulignent en outre une fréquence et des quantités plus importantes de micro et nanoplastiques dans les eaux embouteillées que dans l'eau du robinet.
Plusieurs origines sont suspectées, sans que leurs parts respectives ne soient encore clairement établies.
Selon Johnny Gaspéri, directeur de recherche au laboratoire « eau et environnement » de l'université Gustave Eiffel, lors de son audition devant la commission d'enquête : « certaines études affirment que c'est le PET ou le polypropylène du bouchon qui sont les principaux polymères retrouvés dans les eaux embouteillées, tandis que d'autres soulignent que ce sont d'autres polymères présents dans ces eaux. Il existe alors deux manières de raisonner. Soit la contamination provient des polymères des contenants. Il est alors simple d'établir le lien avec le contenant. Si les polymères ne sont pas liés aux contenants, cela signifie que le processus de contamination est intervenu lors de la mise en bouteille ».
La première source de contamination des eaux minérales naturelles paraît bien être les bouteilles qui les contiennent, les plastiques les plus employés pour l'embouteillage des eaux étant le polyéthylène téraphtalate (PET) et les polyéthylènes. Ils contiennent en outre des adjuvants de fabrication, qui sont des plastifiants, tels que le phtalate et le bisphénol, des colorants ou des adjuvants de synthèse, comme l'antimoine (Sb).
La manipulation de la bouteille par le consommateur paraît également de nature à contribuer à la diffusion des microplastiques. Comme le soulignait Johnny Gaspéri lors de son audition, l'attention porte plus particulièrement sur les bouchons de bouteille utilisés. De fait, certaines études ont montré que la succession d'ouverture-fermeture générait des microplastiques.
Le process d'entretien des lignes d'embouteillage doit également être surveillé de près, y compris la présence de microplastiques dans l'air. Lors de son audition, Cathy Le Hec, directrice des sources d'eaux minérales chez Danone Waters Europe a ainsi précisé que « dans les sites d'embouteillage, des actions sont menées pour limiter ce risque, de l'aspiration des microparticules au rinçage des bouteilles ».
Enfin, la contamination potentielle de la ressource ne peut être écartée, même si, les eaux minérales naturelles et les eaux de source étant puisée dans des nappes profondes, cette origine de la contamination paraît la moins probable. Ainsi, lorsque la question lui a été posée, Cathy Le Hec a indiqué que « les analyses à la source, aux points de captage, ne révèlent pas la présence de microplastiques ».
En ce qui concerne les effets de ces contaminants sur la santé, les scientifiques en sont encore à la phase de constat de la présence de microplastiques dans le sang et dans la plupart des organes du corps humain. De premiers travaux, qui demandent encore à être confirmés, ont relié cette présence à des phénomènes de thrombose. Quant à d'autres effets sur la santé humaine, en particulier sur le placenta chez la femme enceinte, sur les reins et le cerveau, ils demeurent inconnus et animent les débats dans le monde scientifique.
Interrogée par la commission sur ses actions en la matière, l'Anses a indiqué : « Au sein de l'Anses, c'est le laboratoire de sécurité des aliments de Boulogne qui a l'expertise et les moyens analytiques nécessaires à la conduite d'études, développements de méthodes sur les nano plastiques et microplastiques. Une animation interne est mise en place au sein de l'agence sur le sujet des microplastiques au sens large. Par ailleurs, des échanges spécifiques sont organisés entre l'unité en charge de cette thématique et le LHN. Le LHN est impliqué dans les groupes de normalisation NF et ISO visant à développer les méthodes de mesure harmonisées en lien avec les besoins règlementaires notamment. (...)
Le Programme de travail du laboratoire (le LHN) est établi pour des périodes de 2 ans en lien avec sa tutelle la DGS. Depuis plusieurs années, les priorisations des travaux ont conduit à orienter les travaux sur les EDCH et eaux de baignade : matrices pour lesquelles des enjeux forts et besoins étaient exprimés. (...) Le Laboratoire est impliqué dans la troisième étude de l'alimentation totale (EAT 3) en cours. Il est en charge de l'analyse de pesticides dans les eaux de consommation dont certaines eaux conditionnées (conformément au plan d'échantillonnage de l'étude).
Enfin, à noter que des échanges sont en cours avec la DGS pour conduire de nouvelles actions sur les eaux conditionnées, notamment eau minérale naturelle, mais ces échanges sont à un stade préliminaire. Ils nécessiteront une priorisation au regard des ressources disponibles et allouées au laboratoire pour la conduite de ces actions ou impliquer de mobiliser des crédits spécifiques119(*). »
L'Anses précise par ailleurs que : « Le laboratoire de sécurité des aliments de l'Agence intervient dans des projets de recherche sur les microplastiques (une thèse, actuellement en cours, a évalué la contamination dans différentes boissons dont l'eau en bouteille). Il intervient également dans des travaux d'expertise nationale (Afnor, GT DGAL, appui aux ministères, Sénat...) et internationale (FAO, OMS, ISO...).
Le LHN est impliqué dans les groupes de normalisation français et internationaux visant à mettre en place un cadre méthodologique et métrologique harmonisé indispensable à la conduite d'action de surveillance et ou contrôle des eaux. Il réalise une activité de veille scientifique et des missions d'appui à la DGS dans le cadre des travaux de préfiguration européens.
Enfin, un groupe de travail interne Micro-Nanoplastique a été mis en place pour permettre aux différentes entités de l'Anses d'échanger sur ce sujet transversal ».
Il ressort de ces éléments qu'aux yeux de la commission les travaux de recherche sur les micro et nano plastiques doivent, à l'instar de ceux portant sur les PFAS, faire désormais l'objet d'une priorisation claire et porter sur l'ensemble des eaux consommées par les humains, mais sans oublier les eaux conditionnées, dont on a pu constater qu'elles n'avaient pas toujours été au coeur des préoccupations des autorités sanitaires.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
23 |
Proposer une programmation sur 5 ans de recherche en matière de contamination des eaux embouteillées - par les microplastiques - par les PFAS des eaux et de leur processus de production |
Ministère de la santé, direction générale de la santé, Anses |
2026-2030 |
Programmation |
|
24 |
Déterminer une méthodologie de mesure de la quantité des microplastiques dans l'eau et de la manière de prévenir leur présence dans les processus d'embouteillage |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Anses |
2nd semestre 2025 |
Instruction |
III. ASSURER LA TRANSPARENCE ET RENFORCER LES MOYENS D'ACTIONS DU CONSOMMATEUR
A. PRÉCISER L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LE CONTENU DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DE SOURCE
1. Informer le consommateur sur le recours à des traitements de microfiltration et sur les demandes de mises en conformités formulées auprès des exploitants
Comme le rappelle Antoinette Guhl dans son rapport120(*), l'information du consommateur sur le contenu des eaux minérales naturelles et de source est régie par le règlement UE° n° 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, directement applicable en droit interne.
À ce cadre général s'ajoutent des règles définies par la directive 2009/54/CE relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. L'article 7 de cette directive précise ainsi la dénomination de vente des eaux minérales naturelles et les mentions obligatoirement contenues sur son étiquetage, parmi lesquelles figure l'indication des traitements éventuels.
Le rapporteur estime indispensable de renforcer l'information du consommateur par la DGCCRF via la communication sur son site internet, et par des affichages en magasin, sur les demandes de mise en conformité qu'elle forme auprès des exploitants d'eau minérale naturelle.
Une telle proposition est actuellement à l'étude parmi les services de la DGCCRF, comme en témoigne une note rédigée le 13 décembre 2024 par Sarah Lacoche, directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à destination du ministre de l'économie, et transmise au directeur de cabinet de ce dernier, Emmanuel Monnet.
Sarah Lacoche relève la difficile « articulation des conclusions des ARS à l'issue de leurs contrôles [...] avec les mesures que la DGCCRF est susceptible de prendre pour la protection des consommateurs. En effet, un fois le contrôle réalisé par l'ARS, une phase contradictoire s'ouvre avec l'opérateur contrôle et un délai parfois long s'écoule avant que l'ARS adopte des constats définitifs et décide, le cas échéant, des suites effectives à donner en conséquence. Pendant ce délai, les eaux, dont le statut peut être interrogé continuent d'être mises sur le marché, sans qu'une non-conformité soit formellement établie par l'ARS bien que le contrôle ait déjà eu lieu. La longueur de ce délai est d'autant plus sensible que la presse s'est emparée de l'affaire ».
Il pourrait ainsi être envisagé qu'une fois qu'un contrôle sanitaire d'une usine de captage et d'embouteillement a été diligenté par une ARS, comme cela a été le cas dans les Vosges et le Gard pour les usines de Nestlé Waters, et qu'un premier rapport relève des difficultés qui seraient susceptibles de donner lieu à de demandes de mise en conformité, la DGCCRF en informe le public lorsqu'elle en formule effectivement, dans la limite toutefois du respect du principe du contradictoire et du caractère non définitif du contrôle.
|
Recommandations |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
25 |
Préciser parmi les mentions devant figurer sur l'étiquette des eaux minérales naturelles le recours à des traitements de filtration |
Ministère de l'économie pour porter une telle demande devant la Commission européenne et les États membres |
Modification de la directive 2009/54/CE |
|
|
26 |
Communiquer sur les demandes de mise en conformité effectuées par la DGCCRF |
DGCCRF |
Instruction |
|
2. Mieux préciser le contenu des eaux de boisson et des eaux « atypiques » sucrées sur les étiquettes
Pour les minéraliers qui ne sont plus en mesure de commercialiser une eau en tant qu'eau minérale naturelle, une des solutions peut être la commercialisation de cette eau sans l'appellation « eau minérale naturelle », sous la forme d'une « eau de boisson » qui peut faire l'objet de traitements.
Ce constat a toutefois amené la commission d'enquête à s'intéresser plus avant aux différentes difficultés qui se posent relativement à la bonne information du consommateur de l'eau embouteillée, qu'elle soit minérale, de source, de boisson, ou encore une eau dite « atypique ».
Elle s'est notamment intéressée aux eaux qui ne sont ni minérales naturelles, ni de source sans pour autant être des eaux traitées embouteillées : ces eaux entrent dans la catégorie des BRSA, présentée dans la première partie de ce rapport.
Les BRSA relèvent du contrôle sanitaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, alors même que, comme le relève Marie-Pierre Sauvant-Rochat, responsable du laboratoire santé publique et environnement à l'université Clermont-Auvergne121(*), elles peuvent avoir un effet néfaste sur la santé, notamment des jeunes enfants, eu égard aux quantités de sucre présentes dans les eaux aromatisées qui peuvent s'apparenter à celles présentes dans les sodas.
Le rapporteur préconise en conséquence de préciser très explicitement sur l'étiquette des eaux aromatisées le fait qu'elles ne peuvent s'apparenter à de l'eau minérale naturelle, même si cette dernière en est un composant, dans la mesure où elles contiennent de fortes quantités de sucre. En effet, elle peut induire le consommateur en erreur en lui faisant miroiter les bénéfices de l'eau minérale et oublier les effets néfastes du sucre et autres additifs. Il pourrait être également décidé de ne pas commercialiser ces eaux dans les rayons d'eau minérale naturelle, mais de les regrouper avec les sodas.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
27 |
Préciser parmi les mentions devant figurer sur l'étiquette des eaux aromatisées le fait qu'elles ne peuvent s'apparenter à des eaux minérales naturelles et ne pas commercialiser ces eaux dans les rayons d'eau minérale naturelle |
Ministère de l'économie, |
Dispositions réglementaires |
|
3. Informer le consommateur sur les évènements relatifs aux aquifères et aux forages
Les différentes contaminations qui ont été mises en lumière par les travaux de la commission d'enquête ont donné lieu à des décisions de suspension qui n'avaient jusqu'à ce jour pas fait l'objet de publicité et étaient méconnues du grand public122(*).
Or, même si le risque sanitaire sur les eaux commercialisées sous ces dénominations ne s'est pas réalisé, il apparaît nécessaire à la commission d'enquête que les consommateurs d'eau minérale naturelle, attachés à la notion de sa pureté originelle, qui justifie la différence de prix entre l'eau minérale naturelle et l'eau du robinet, soient informés de tels évènements.
La bonne information des consommateurs passe par une transparence accrue sur la qualité et la quantité d'eau disponible dans les aquifères, afin d'encourager la responsabilisation dans la gestion de la ressource, et par une publicité des décisions prises par les autorités nationales et locales de suspension momentanée ou définitive d'exploitation de certains forages.
|
Recommandation |
||||
|
N° |
Libellé |
Destinataire |
Échéancier |
Support |
|
28 |
Mettre en oeuvre une information des consommateurs sur la qualité et la quantité d'eau disponible dans les aquifères via un site internet cogéré par les administrations compétentes |
Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité |
Second semestre 2025 |
Site internet |
B. VERS UN RENFORCEMENT DES VOIES D'ACTION EN JUSTICE OUVERTES AUX CONSOMMATEURS ?
Le consommateur lésé dispose déjà en droit français de moyens d'actions pour faire valoir ses droits.
En matière pénale, le fait pour un industriel minéralier de commercialiser sous l'appellation d'eau minérale naturelle une eau qui subit des traitements qui ne sont pas expressément autorisés par la réglementation pourrait être constitutif du délit de tromperie, défini à l'article L.441-1 du Code de la consommation.
Le délit de tromperie sanctionne toute personne qui, de mauvaise foi, induit ou tente d'induire en erreur un cocontractant (en l'espèce, le consommateur) sur les caractéristiques essentielles d'un bien ou d'un service (en l'espèce, la minéralité de l'eau) lors d'un contrat à titre onéreux, notamment une vente.
Ce délit, de nature intentionnelle, est puni de deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, peines aggravées en cas de circonstances particulières. Il vise à garantir la loyauté des transactions et la protection des contractants contre toute forme de manipulation frauduleuse.
Tout consommateur qui s'estimerait lésé peut agir suivant les différents modes de saisines prévus par le code de procédure pénale.
Il peut ainsi déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie d'une part, ou directement du procureur de la République d'autre part. Il reviendra alors à ce dernier de décider de poursuivre ou non les faits devant un tribunal.
Il peut également saisir directement le tribunal en citant l'auteur présumé des faits devant la juridiction compétente (en l'espèce, comme il s'agit d'un délit de tromperie, le tribunal correctionnel). La citation directe permet d'engager l'action publique sans passer par le procureur de la République.
Si la plainte n'aboutit pas, soit que le procureur de la République ait fait connaître au consommateur son intention de ne pas poursuivre l'infraction dénoncée ou qu'un délai de trois mois se soit écoulé depuis sa saisine, alors le consommateur est recevable à se constituer directement partie civile devant le doyen des juges d'instruction compétent123(*).
En matière civile, le mécanisme de l'action de groupe, introduit en droit de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, peut être exercé par des associations qui remplissent certaines conditions posées par le législateur, au nom de plusieurs personnes, placées dans une même situation et qui subissent un dommage causé par une même personne, résultant d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles.
Le régime de l'action de groupe est défini aux articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de ces dispositions, seules les associations représentatives des consommateurs au niveau national et agréées selon des modalités précisées par le législateur peuvent agir devant une juridiction civile au nom des consommateurs lésés pour obtenir réparation de leur préjudice individuel. Jusqu'à la loi n° n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses adaptations au droit de l'Union européenne, l'indemnisation du consommateur se limitait aux préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis dans le cadre d'une vente de biens ou de la fourniture de services.
Concrètement, cela signifiait que cette action de groupe en droit de la consommation ne pouvait être exercée que lorsque le manquement reproché a causé un dommage aux biens des consommateurs, ce qui excluait la réparation du préjudice corporel des consommateurs d'une part, et de leur préjudice moral d'autre part. Elle fonctionne selon le régime de l'opt-in, à savoir que pour y participer, chaque consommateur doit manifester son adhésion dans un certain délai fixé par le juge124(*).
En l'espèce, le préjudice matériel subi individuellement par les consommateurs apparaît réduit si le juge devait estimer que celui-ci correspond à la différence de prix entre une eau minérale naturelle et une eau rendue potable par traitement.
Aux termes de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses adaptations au droit de l'Union européenne, le législateur a élargi l'objet de l'action de groupe en matière de droit de la consommation à la réparation de tous les préjudices, quelle que soit leur nature. Les consommateurs lésés pourront désormais voir indemniser leur préjudice moral et corporel et non plus seulement matériel. Par ailleurs, ils pourront désormais être représentés par des associations agréées dont l'objet comporte la défense d'intérêts plus large que les seuls intérêts économiques qui étaient jusqu'alors retenus.
EXAMEN EN
COMMISSION
M. Laurent Burgoa, président. - Mes chers collègues, nous procédons aujourd'hui à l'examen du projet de rapport de notre commission d'enquête. Je vous présenterai ensuite les différents éléments de notre position en matière de saisine de la justice.
Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de cette commission pour leur disponibilité, chacun s'étant investi dans la mesure de ses possibilités. Je vous salue également, monsieur le rapporteur, une certaine complicité s'étant établie entre nous alors que nos points de vue initiaux divergeaient.
Nous avons ainsi mené un travail pluraliste, sans a priori, animé par la recherche du consensus et du pragmatisme, au service de l'intérêt de nos concitoyens, en essayant de nous tenir à l'écart des pressions. Je tiens ici à saluer le travail des administrateurs à nos côtés.
Nos travaux ont été très suivis par la presse et le grand public : par exemple, l'extrait de l'audition de la présidente de Nestlé Waters a été vu plus de 500 000 fois - dont 242 000 fois sur YouTube, 226 000 fois sur TikTok et 44 000 fois sur Instagram.
Sur Linkedin, la publication extraite de l'audition de Christophe Poinssot, directeur scientifique du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), est la plus vue de l'histoire de la page du Sénat, avec 144 000 vues.
Au total, nous avons entendu près de 120 personnes - anciens ministres, hauts fonctionnaires, dirigeants du secteur des eaux minérales, experts et scientifiques - au cours de 73 auditions, dont la quasi-totalité a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux du Sénat.
Le droit de communication de documents, qui appartient au rapporteur, a été largement exercé. Ainsi, plusieurs milliers de pages ont été reçus et exploités de la part d'entreprises et d'administrations qui ont, dans l'ensemble, bien joué le jeu, à une réserve que vous connaissez bien, c'est-à-dire Nestlé Waters. Je le regrette profondément, deux des auditions de ses responsables ayant donné une image catastrophique du groupe. Certes, le directeur général a donné ensuite une image un peu plus positive, mais il n'est pas étonnant que les ventes de l'entreprise aient chuté tant les prestations précédentes n'ont pas été dignes d'un groupe de cette taille.
Nous avons effectué deux déplacements pour visiter trois usines. Dans le Gard d'une part, où nous avons visité de l'usine Perrier de Vergèze et plusieurs sites de captage ; nous avons organisé des tables rondes et des rencontres avec vingt-trois personnes, élus locaux, salariés du site, représentants de l'administration locale. En Haute-Savoie, d'autre part, nous avons visité l'usine Évian du groupe Danone à Publier et un site de captage, puis l'usine des eaux de Thonon à Thonon-Les-Bains qui appartient au groupe Sources Alma. Nous avons rencontré vingt personnes sur place - élus locaux, salariés du site, représentants de l'administration locale.
Enfin, nous avons sollicité auprès la division de la législation comparée du Sénat une note de droit comparé sur la réglementation des eaux en bouteille portant sur six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie et Suisse.
Avant de donner la parole au rapporteur, il me revient de vous rappeler les règles de procédure applicables à la présente réunion. Nous devons respecter la parfaite confidentialité de nos échanges, à l'instar d'un conclave. Il est du devoir de chacun d'entre vous de contribuer au secret de nos travaux jusqu'à la publication de nos conclusions. Ces règles strictes permettent de ne pas risquer de voir le contenu de nos réflexions divulgué de manière anticipée.
Le rapport est donc sous embargo strict pendant vingt-quatre heures à compter de la fin de cette réunion. Durant cette période, il ne peut être consulté qu'aux fins de solliciter la réunion du Sénat en comité secret, c'est-à-dire une réunion à huis clos pour statuer sur la publication ou la non-publication de l'ensemble du texte ou de certains passages.
Notre rapport sera publié le 19 mai prochain, date à laquelle les résultats de nos travaux seront présentés en conférence de presse, qui aura lieu à 11 h 00 et à laquelle vous êtes cordialement conviés. D'ici là, rien ne doit filtrer à l'extérieur, ce qui proscrit toute communication à la presse, à des tiers ou sur les réseaux sociaux.
Tous ceux qui contreviendraient à cette règle s'exposeraient à des sanctions fondées sur le code pénal, dont l'article 226-13 prévoit des peines d'emprisonnement en cas de divulgation, dans les vingt-cinq ans, de toute information relative à une partie non publique des travaux d'une commission d'enquête, et sur notre règlement. Le président Larcher a rappelé à plusieurs reprises l'interdiction absolue d'une publicité anticipée, même de quelques minutes, sur les rapports ou les conclusions des commissions d'enquête.
Veillons à respecter ces règles, pour des raisons à la fois juridiques et institutionnelles. En effet, les fuites amoindriraient la portée de nos travaux.
La consultation du rapport a eu lieu les 5, 6, et 7 mai derniers. Des exemplaires nominatifs vous ont été distribués contre émargement et il vous sera demandé de les restituer à la fin de la réunion.
Après l'exposé du contenu du rapport, je céderai la parole à ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'exprimer. Nous procéderons ensuite à l'examen des éventuelles propositions de modifications. Après le vote sur ces éventuelles propositions de modification, nous voterons sur les recommandations, puis sur le titre du rapport. Nous voterons enfin sur son adoption et sa publication.
Il est possible pour les groupes politiques de présenter une contribution qui sera annexée au rapport : celle-ci doit être d'une longueur raisonnable, c'est-à-dire une dizaine de pages maximum. Le délai limite pour leur dépôt est fixé au 15 mai, c'est-à-dire demain, à 17 h 00.
Enfin, je vous propose que le compte rendu de la présente réunion soit, lui aussi, annexé au rapport de la commission d'enquête.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Ce moment mêle à la fois joie et nostalgie, car cheminer ensemble pendant de longs mois a été un véritable plaisir, et je tiens également à saluer le président : initialement, j'ai pensé que la désignation du sénateur Les Républicains du Gard visait à me placer sous surveillance, mais il n'en a rien été et nous avons recherché la vérité sincèrement.
Notre rapport s'articule autour de quatre grands axes et de vingt-huit propositions destinées à sécuriser la qualité des eaux minérales et de source. Le premier axe vise à rappeler l'importance de production de l'eau minérale - notamment économique et fiscale - pour les communes ; le deuxième axe consiste en la description de l'affaire elle-même et des dysfonctionnements découverts ; le troisième axe correspond à l'explication des dessous de la crise et du rôle des uns et des autres ; le quatrième axe, enfin, liste une série de propositions pour préserver l'avenir des eaux minérales et de source en France.
Je rappelle que nous avons tenu à accumuler le plus grand nombre de verbatims afin d'éviter de nous voir reprocher toute surinterprétation.
S'agissant de l'importance économique et fiscale pour les communes de production de l'eau minérale, la France compte 104 sites d'exploitation d'eau minérale naturelle et d'eau de source, répartis sur le territoire au sein de 59 départements et de 18 régions.
Le secteur est dominé par trois groupes qui se partagent 80 % du marché, dont deux multinationales du secteur de l'agroalimentaire, Danone et Nestlé. Le marché représente un total de 2,7 milliards d'euros en termes de chiffres d'affaires cumulé, la France étant une grande exportatrice d'eaux minérales dans le monde.
Les sites de production d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source ont souvent une empreinte économique forte dans les territoires et sont parfois l'un des principaux employeurs locaux. La filière représente ainsi 11 000 emplois directs en France, dont 8 000 emplois dans la filière des eaux minérales naturelles et 3 000 emplois dans la filière des eaux de source, et plus de 30 000 emplois indirects.
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales naturelles bénéficient d'une contribution fiscale de ces sites dont le rendement total était de 18,4 millions d'euros en 2024 : il s'agit d'une ressource fiscale essentielle pour les collectivités concernées.
Nous avons constaté, au cours de nos travaux, qu'une distorsion s'était installée pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que la contribution sur les eaux minérales n'est versée aux communes que pour la production d'eau minérale stricto sensu. Par conséquent, les déclassements entraînent des pertes sèches extrêmement importantes pour les communes, d'où notre souhait de corriger cette injustice.
Par ailleurs, l'exonération de la contribution pour la production exportée n'a guère de sens et peut inciter des industriels à privilégier l'export, au détriment de la consommation sur place.
J'en viens au deuxième axe, c'est-à-dire à la description de l'affaire elle-même et des dysfonctionnements découverts.
Le scandale du traitement des eaux minérales naturelles commence fin 2019 par un signalement d'un salarié de Sources Alma, qui commercialise notamment Vichy Célestins, Saint-Yorre, Cristaline, Thonon et Châteldon, concernant des traitements non autorisés. Une enquête du service national d'enquête (SNE) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) met alors en lumière le recours, chez plusieurs industriels, à des microfiltrations inférieures au seuil de 0,8 micron, pourtant considéré depuis 2001 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) comme « seuil limite ».
Le 31 août 2021, Nestlé Waters rencontre, à sa demande, le cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, en présence de la DGCCRF. Muriel Lienau, PDG de Nestlé Waters, reconnaît alors l'utilisation dans ses usines des Vosges et du Gard - Vittel, Hépar, Contrex, Perrier - de filtres à charbon actif et de traitements ultraviolets, c'est-à-dire de pratiques interdites.
Lors de cet entretien, Nestlé Waters fait valoir, sans preuve, que ces traitements n'ont pas affecté la sécurité alimentaire ni la composition de l'eau, et présente aux autorités un « plan de transformation » qui est encore au coeur de l'actualité aujourd'hui : en dépit du « bleu » interministériel, les préfets ont décidé de constater le caractère non réglementaire de la filtration à un seuil de 0,2 micron.
Malgré la fraude aux consommateurs que représente la désinfection de l'eau, les autorités ne donnent pas de suites judiciaires à ces révélations. Le 14 octobre 2021, il est décidé d'une saisine de l'inspection générale des affaires sociales (Igas). Cette mission est lancée un mois plus tard, le 19 novembre, les agences régionales de santé (ARS) n'en étant informées que le 28 janvier 2022. Ce choix d'une mission de l'Igas, alors exclusive de toute saisine de l'autorité judiciaire ou de mesure administrative de suspension des forages incriminés, a retardé la réponse publique aux révélations de Nestlé.
À l'examen du dossier et de ses multiples pièces, le rapport présente une série de dysfonctionnements. Premièrement, l'absence ou le retard de signalement des délits présumés au procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, puisque les cabinets ministériels et directions d'administrations centrales n'ont pas bougé dans un premier temps.
In fine, trois signalements ont été effectués : le premier, en octobre 2022, par la directrice de l'ARS Grand Est ; les autres, après constitution de la commission d'enquête, le deuxième par la DGCCRF dans le Gard, le 19 février 2025, soit près de quatre ans après les révélations du 31 août 2021 ; le dernier par le directeur général de l'ARS Occitanie, le 18 avril 2025.
Deuxièmement, une minimisation du risque sanitaire a été à l'oeuvre à l'échelon national. Certes, à notre connaissance, le risque sanitaire ne s'est pas réalisé, mais il a existé, en particulier à partir du moment où Nestlé a dû retirer ses traitements interdits de désinfection. Ce point est selon moi central : avec une eau qui n'est plus originellement pure, les problèmes ont été traités a posteriori par la destruction. Deux millions de bouteilles ont ainsi été détruites chez Perrier en 2021.
Le troisième dysfonctionnement renvoie aux échecs de l'interministériel et du travail en silo, et le quatrième à l'absence de suspension de la production d'eau minérale naturelle non conforme.
S'y ajoute l'inversion de la relation entre l'État et les industriels en matière d'édiction de la norme, soit la « capture réglementaire » que j'ai évoquée au cours des auditions. Dès le 31 août 2021, Nestlé Waters adopte en effet une attitude transactionnelle en posant explicitement l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron comme condition à l'arrêt de traitements pourtant illégaux, via ce qui est pudiquement appelé un « plan de transformation ».
Il est donc d'emblée question de mettre en conformité le droit avec la pratique de l'exploitant, dans une logique dévoyée par rapport à ce que devraient être les relations entre l'État, qui édicte la norme, et l'industriel, qui l'applique.
S'agissant de l'Anses qui, en 2023 et 2024, a rappelé que la microfiltration ne devait pas corriger une qualité insuffisante des eaux brutes, nous considérons que ses avis auraient gagné à être plus directs et explicites pour éviter de laisser subsister une forme d'ambiguïté que l'industriel n'a pas manqué d'exploiter et qui a laissé trop de marges aux cabinets ministériels.
Par ailleurs, les autorités locales n'ont été que peu, voire pas, associées aux décisions prises par l'échelon central, parfois au plus haut sommet de l'État. Cela les a placées dans une situation d'ignorance pendant plusieurs mois, entraînant, de manière stupéfiante, l'absence d'inspection, dans le cadre de la mission de l'Igas, du site de Perrier dans le Gard.
J'en arrive aux délais excessifs, qui favorisent l'enracinement des infractions : il s'est ainsi écoulé respectivement six mois et quatorze mois entre le déclenchement de la mission de l'Igas et l'information de l'ARS Grand Est, le 6 avril 2022, et celle de l'ARS Occitanie, le 3 novembre 2022. S'agissant de cette dernière, je rappelle que Nestlé l'a prévenue de l'illégalité et lui a proposé une visite « touristique » du site afin de lui montrer les procédés utilisés pour tricher, ce qui assez stupéfiant.
De la même manière, plus de trois ans se sont écoulés entre la connaissance des infractions par l'autorité judiciaire et leur début de traitement, tandis que huit mois et trois ans séparent respectivement l'information par l'Igas de l'ARS Grand Est et de l'ARS Occitanie quant à la lettre de mission mentionnant l'enquête - de nature pénale - du service national d'enquête (SNE) et leurs signalements à la justice. Parmi les conséquences de ces délais, l'industriel a pu continuer à commercialiser comme eau minérale naturelle une eau qui n'aurait pas dû avoir droit à cette appellation : la valeur des ventes correspondantes a été estimée à environ 220 millions d'euros dans les Vosges et à 375 millions d'euros dans le Gard.
Un autre dysfonctionnement concerne l'absence de suivi de la mise en oeuvre de ses décisions par l'État : aucune instruction claire n'a été envoyée aux préfectures pour vérifier de manière exhaustive l'absence de traitements interdits sur les autres sites de production ; dans nombre de départements, les autorités locales sont restées comme immobiles et les modalités de contrôle n'ont pas évolué. Il a fallu le déplacement de la commission d'enquête en Haute-Savoie, où se trouve le site d'Évian, pour que les services de l'État du département communiquent avec ceux du Gard, qui bénéficiaient de l'expérience du cas Perrier de Nestlé Waters.
L'absence des ministres dans le processus décisionnel nous a également marqués, les directeurs et conseillers de cabinet prenant des décisions importantes et aux marges de la légalité, pour le dire pudiquement. Le cas de l'industrie est différent : ce ministère a assumé d'emblée un soutien fort à l'égard des exigences de Nestlé.
Ajoutons à cette liste l'arbitrage fautif au sommet de l'État : le fait qu'une concertation interministérielle dématérialisée (CID) ait validé une solution qui n'était pas conforme à la réglementation - la filtration à 0,2 micron - aboutit à ce que les préfets aillent à l'encontre d'un bleu de Matignon, ce qui contrevient au fonctionnement régulier de l'administration.
De son côté, la présidence de la République a suivi de près le dossier et ouvert les portes de certains ministères au groupe suisse. La présidence savait, au moins depuis 2022, que Nestlé trichait depuis des années ; elle avait conscience que cela créait une distorsion de concurrence avec les autres minéraliers. Ces derniers ont d'ailleurs publié une tribune dans Les Échos pour affirmer que leur métier ne consiste pas à restaurer l'eau et pour rappeler leur attachement au critère - fondamental et fondateur - de la pureté originelle de l'eau minérale naturelle.
M. Laurent Burgoa, président. - Il s'agit de l'édition du 13 mai, qui contient un dossier consacré au sujet des eaux minérales.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Au cours des travaux de la commission, nous avons aussi découvert le problème des eaux distribuées à Mayotte, grâce notamment à notre collègue Saïd Omar Oili. Nous avons donc enrichi le rapport des événements survenus dans l'archipel, en constatant là aussi un certain nombre de lenteurs dans l'action publique.
J'en viens à la troisième partie, consacrée à l'explication des dessous de la crise et du rôle des uns et des autres. Nous avons voulu comprendre pourquoi certains industriels avaient trahi la confiance du consommateur et mis en risque leurs propres outils de production, comme on le voit aujourd'hui à Vergèze.
Quatre hypothèses s'imposent, à commencer par la dégradation de la qualité de la ressource en eau en raison de pollutions anthropiques ou naturelles, hypothèse confirmée pour certains forages tels que Hépar. Une autre source de vulnérabilité, mise en évidence par les directeurs de sites de Nestlé Waters, réside dans la vétusté des installations, qui a été explicitement mentionnée.
Nestlé Waters a en outre justifié la nécessité de traiter ses eaux avec une microfiltration à 0,2 micron pour sécuriser son processus industriel en raison de la formation de « biofilm », c'est-à-dire un amas de micro-organismes qui se déposent à l'intérieur des canalisations. Néanmoins, cette analyse n'est pas partagée par d'autres industriels qui estiment que la formation de biofilm est tout simplement prévenue par... des nettoyages réguliers.
Une quatrième hypothèse est donc plus crédible : la microfiltration pourrait être un outil pour réduire la fréquence des nettoyages qui impliquent des arrêts de production.
S'agissant de la microfiltration, qui est devenue un axe majeur de la stratégie de Nestlé, le rapport montre que contrairement aux allégations de nombreux acteurs, il n'existe pas de base légale solide - ni européenne ni nationale - à la microfiltration à 0,2 micron, raison pour laquelle d'ailleurs, les préfets du Gard et des Vosges viennent de demander à Perrier de la retirer.
Pour autant, nous demandons une clarification d'urgence de la position de l'État sur la microfiltration : jusqu'à 0,8 micron, aucun problème ne se pose ; pour ce qui est d'une microfiltration comprise entre 0,8 micron et 0,45 micron, l'Anses doit régler cette question scientifiquement le plus vite possible, afin d'arrêter de bâtir des règlements sur du sable. Le président et moi-même écrirons à Catherine Vautrin en ce sens.
Le rapport comporte aussi une série de propositions pour préserver l'avenir des eaux minérales et de source en France. Nos propositions pour l'avenir portent sur cinq thèmes : mieux protéger la ressource ; rénover un dispositif de contrôle trop complexe ; restructurer la réglementation ; élargir le contrôle des composants de l'eau en raison des pollutions émergentes ; assurer la transparence et renforcer les moyens d'action du consommateur.
Tout d'abord, mieux protéger la ressource suppose d'améliorer le suivi en temps réel du niveau quantitatif de la ressource en eau. Le suivi qualitatif de la ressource en eau doit être repensé afin de mieux protéger les zones sensibles à la pollution que sont l'impluvium, qui correspond à la zone de surface dans laquelle l'eau s'infiltre dans les nappes, et la zone d'émergence sur laquelle se situent les captages d'eau. Si ces périmètres ne sont pas suffisamment protégés, les eaux minérales naturelles seront menacées.
Ensuite, il convient de rénover un dispositif de contrôle trop complexe : une meilleure gestion de la ressource en eau passe par un contrôle effectif du niveau de prélèvement réalisé par les industriels minéraliers, au regard des seuils maximum de débit autorisé dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle.
Rénover les contrôles implique de renforcer leur fréquence, les moyens et la coopération entre les autorités responsables, notamment via un protocole tripartite entre les ministères chargés de la santé - la direction générale de la santé (DGS) -, de la consommation - la DGCCRF - et de l'agriculture - la direction générale de l'alimentation (DGAL) -, à finaliser dans les meilleurs délais.
Le président de la commission s'était ainsi agacé de constater que les uns et les autres se renvoyaient systématiquement la responsabilité des dysfonctionnements du contrôle.
M. Laurent Burgoa, président. - J'avais été agacé par l'attitude nonchalante de certaines personnes auditionnées qui, plongées dans leurs ordinateurs, ne répondaient pas à des questions aussi importantes que celle de savoir si elles avaient reçu le rapport de l'Igas, alors qu'il existait un sérieux problème de remontée d'informations au niveau national.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Le rapport préconise également de restructurer et de clarifier la réglementation. Celle-ci doit être restructurée autour de deux sujets majeurs : la microfiltration et la traçabilité.
Le rapport prévoit que la France saisisse la Commission européenne, qui n'a pas cherché jusqu'à présent à prendre d'initiative, pour obtenir une révision de la directive sur les eaux minérales naturelles afin de clarifier les critères de qualification de la pureté originelle, ainsi que le statut et le seuil acceptable de la microfiltration.
À plus brève échéance et au niveau national, il s'agira de diffuser rapidement une instruction et de modifier la réglementation écartant la microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron et conditionnant la microfiltration avec des seuils compris entre 0,45 micron et 0,8 micron à la démonstration d'une absence d'impact sur le microbisme naturel de l'eau.
Plutôt que de laisser chaque préfet et chaque ARS à nouveau seuls face à la nécessité de recueillir les preuves de l'absence d'impact de la microfiltration entre 0,45 micron et 0,8 micron, la bonne démarche consiste selon nous à solliciter un avis documenté par l'Anses.
Toutefois, il pourra toujours être opposé aux autorités qu'une instruction ne crée pas de droit. Par conséquent, dans l'attente d'une décision au niveau européen, une instruction, pour être bienvenue, ne suffit pas et il revient au Gouvernement de prendre l'initiative et de clarifier l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées.
Autre sujet majeur, celui de la traçabilité de l'eau, alors que les sites assurant la production de plusieurs types d'eau - c'est le cas à Vergèze avec Perrier et Maison Perrier, c'est-à-dire une eau minérale naturelle d'un côté et une eau rendue potable par traitement de l'autre côté - sont de plus en plus automatisés.
Il est proposé que l'État établisse un cahier des charges de traçabilité des eaux, car nous avons été marqués par son incapacité à se doter des outils informatiques permettant de procéder aux vérifications requises. Les services sur place nous ont ainsi indiqué qu'ils étaient prisonniers des présentations de l'industriel, et il faudra que le ministère de l'économie consente un effort de recrutement, de rémunération et de formation de personnels capables de procéder à des audits des programmes de production.
Quatrièmement, il importe d'élargir d'urgence le contrôle des composants de l'eau afin d'intégrer les pollutions émergentes, substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (Pfas) et les microplastiques : nous proposons un programme de recherche en ce sens.
Cinquièmement, il convient d'assurer la transparence et de renforcer les moyens d'action du consommateur. Afin de remédier aux manquements révélés par les révélations effectuées par Nestlé, il est proposé de renforcer l'information du consommateur sur le recours éventuel à la microfiltration lorsqu'elle est autorisée par des arrêtés préfectoraux, grâce à une information sur l'étiquette.
La bonne information sanitaire du consommateur passe également par une publicité renforcée du contenu des eaux qu'il achète, notamment des eaux qui, pour être à base d'eau minérale, contiennent des quantités de sucre assimilables à des boissons de type soda.
De plus, le rapport prévoit de renforcer la transparence sur le suivi de la ressource en eau et les contrôles réalisés par les autorités locales.
Enfin, un enjeu pour l'avenir est de mieux encadrer les conditions d'utilisation des conventions judiciaires d'intérêt public (CIJP) en matière environnementale. Dans les Vosges, en particulier, le montant de l'amende d'intérêt public infligée à Nestlé Waters, qui aurait pu, selon les textes, être beaucoup plus élevé pour atteindre jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires annuel, n'a pas fait l'objet d'explications étayées et a été très contesté.
Le rapport recommande que la Chancellerie établisse des lignes directrices sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public environnementale, à l'instar de celles qui ont été publiées en janvier 2023 par le parquet national financier (PNF) pour les CJIP « financières ».
J'en termine avec certains points ajoutés au rapport : tout d'abord, la mention des travaux de Mme Guhl dans l'introduction, car son rapport d'information consacré aux politiques publiques en matière de contrôle des traitements des eaux minérales naturelles et de source, présenté devant la commission des affaires économiques, a été le point de départ des travaux de cette commission.
A été ajoutée, en outre, la mention de la demande d'une étude droit comparé à la division de la législation comparée du Sénat sur la réglementation des eaux en bouteille portant sur six pays - Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie et Suisse. Il est important de placer ce document en annexe puisque l'une des demandes du « bleu » visait à ce que le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) mène une enquête pour établir l'état de la réglementation, tâche qui n'a pas toujours pas été accomplie alors que les services du Sénat s'en sont acquittés en l'espace de quelques mois : il y avait donc une volonté de ne pas effectuer ce travail.
Le dernier ajout fait suite aux informations transmises entre les 9 et 12 mai par un lanceur d'alerte dont nous avons vérifié l'identité. Nous vous proposons d'ajouter un encadré relatif à la modification d'un rapport officiel sous la dictée de Nestlé.
M. Laurent Burgoa, président. - Nous ne disposions plus du temps suffisant pour organiser de nouvelles auditions sur ce point. L'intégration d'un encadré permet néanmoins de faire figurer les informations les plus récentes.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Enfin, nous ajoutons un paragraphe afin de tenir compte de la contribution officielle à nos travaux de la Maison des eaux minérales naturelles (MEMN).
Par ailleurs, M. Gillé m'a fait parvenir un amendement relatif à l'absence d'enquête interne au sein de Nestlé, point qui ne figurait effectivement pas dans le rapport : nous procédons donc à un ajout pour rendre compte de ce dysfonctionnement interne majeur.
Une fois encore, merci à tous pour votre participation à cette passionnante commission d'enquête. Le travail a été long et exigeant, mais le rapport touche la vérité du dossier.
M. Jean-Pierre Corbisez. - Le tandem entre le rapporteur et le président a en effet bien fonctionné, car la fougue du premier, qui a poussé les personnes auditionnées dans leurs retranchements, a été complétée par la rondeur du second, ce qui a permis d'obtenir des réponses lorsque celles-ci éludaient les questions ou ne s'exprimaient pas clairement.
Ce rapport ne constitue qu'une première étape et la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ne manquera pas de s'emparer de certaines thématiques afin d'améliorer la réglementation.
Sur un plan plus politique, des procédés ont été validés au plus haut sommet de l'État, en passant parfois par-dessus certaines administrations ou en leur demandant de revoir leur copie. Alors que la chasse aux agences de l'État est ouverte depuis plusieurs mois, certaines s'avèrent indispensables pour protéger la santé de nos enfants et les nappes phréatiques, qui sont un bien commun.
Par ailleurs, je pense qu'il faudra suivre le dossier et se pencher sur les propositions émanant des diverses commissions du Sénat : demander à la ministre de saisir l'Anses ne suffit pas et nous devrons agir, en tant que législateurs, afin de revoir la réglementation applicable et notamment de modifier une contribution fiscale sur l'eau dont les distorsions interrogent.
Ce rapport est en tout état de cause excellent et fournit une très bonne base de travail pour l'avenir.
Mme Antoinette Guhl. - Je tiens à vous remercier pour la rédaction de ce rapport, marquée par un travail pointilleux que je salue à mon tour. De la même manière, je remercie le rapporteur et le président pour les auditions de qualité qui ont été menées dans le prolongement du travail que j'avais entrepris en avril 2024.
J'ai cependant un regret dans la mesure où ne disposons pas de tous les éléments s'agissant de l'implication des ministres, car nous ne savons pas qui a donné les consignes visant à ne pas remettre en cause la production de Nestlé. Quelques entretiens supplémentaires nous auraient peut-être permis de faire toute la lumière sur ce point.
Mon groupe a rédigé une contribution rappelant notamment qu'un risque sanitaire a bien été pris sur le site de Vergèze pendant plusieurs mois, le soin de réaliser les tests viraux ayant été laissé à Nestlé. Si aucune répercussion sur les consommateurs n'est connue à ce jour, il n'est pas exclu que des épidémies de gastro-entérites se soient produites sans que le lien ait été établi avec la consommation de Perrier.
Ensuite, je ne partage pas tout à fait votre vision de la traçabilité : je suis pour ma part favorable à l'interdiction de la coexistence, sur le même site, de deux lignes de production d'eaux de qualité à ce point différentes, car aucun contrôleur ne sera en mesure d'avoir évalué le bon produit. Nous nous exposerions donc à un risque d'opacité.
Enfin, je tiens à saluer l'intégration des Pfas et des microplastiques dans le rapport, car il s'agit de sujets que nous aurons à traiter dans les années à venir.
Mme Florence Lassarade. - J'avais été sensibilisée à la question de la qualité des eaux de boisson au travers de mon métier de pédiatre. Lorsqu'étais en exercice, Nestlé était une entreprise modèle en matière d'hygiène et de contrôle de la qualité du lait infantile, le moindre problème déclenchant une enquête. Les travaux de cette commission ont montré que nous étions loin d'une telle rigueur en matière d'eaux.
À l'instar de Mme Guhl, je suis préoccupée par la qualité de l'eau du robinet. Par ailleurs, nous devrons continuer à étudier les causes de la présence de microplastiques dans les bouteilles, qui semblerait liée aux filtres plus qu'au stockage.
Enfin, je regrette que nous n'ayons pas pu interroger le lanceur d'alerte et je m'interroge sur le fait qu'il ne se soit pas manifesté plus tôt.
Mme Audrey Linkenheld. - Je salue à mon tour la qualité de l'animation de cette commission d'enquête par le rapporteur et le président, et me réjouis que nous ayons pu mener cette commission d'enquête jusqu'au bout, en complément du travail initial de Mme Guhl.
Nous avons parfois pu entendre que les faits étudiés n'étaient pas si graves, mais cet argument ne tient pas : il fallait lancer des investigations, quand bien même une seule prise de risque sanitaire a été recensée. Il me semble en effet essentiel, dans une démocratie telle que la nôtre, d'identifier la chaîne de responsabilité, d'où mon appréciation positive du rapport, puisque nous nous sommes penchés, au-delà de l'organisation politique, sur la conduite administrative des contrôles, point sur lequel portent une série de recommandations.
De plus, la mention des autres polluants est bienvenue, tout comme la proposition concernant les informations à faire figurer sur l'étiquette : même en l'absence de risque sanitaire avéré, il faut éviter toute tromperie commerciale. Du reste, la proposition visant à saisir l'Anses est pertinente, ainsi que l'appel à approfondir la réflexion sur les règles régissant les commissions d'enquête : l'actualité de l'Assemblée nationale prouve également qu'il existe un besoin de réviser certaines règles relatives aux convocations.
Enfin, cette commission d'enquête a prouvé que l'on pouvait être à la fois respectueux et incisif au cours des auditions, en évitant l'écueil qui aurait consisté à opposer l'administration et les entreprises privées.
Mme Marie-Lise Housseau. - Il s'agissait de ma première participation à une commission d'enquête et l'exercice a été passionnant, car il a permis de découvrir de nombreux éléments grâce à des questions incisives.
La chaîne de responsabilité gouvernementale interroge dans la mesure où les ministres n'ont pas été mis au courant de certaines décisions, tandis que l'échelon local, abandonné à lui-même, n'a découvert certaines décisions qu'au bout de plusieurs mois. Ce manque de rigueur, dommageable, concerne d'ailleurs sans doute d'autres ministères et l'État gagnerait à mettre en oeuvre des procédures qualité qui sont appliquées dans les entreprises.
J'apprécie, par ailleurs, la clarté des recommandations, mais je m'interroge sur les moyens dont nous disposerons pour suivre leur mise en oeuvre et éviter de voir ce type de situations se reproduire.
Enfin, je salue votre proposition d'élargir la contribution sur les eaux minérales aux produits exportés : j'avais déposé un amendement en ce sens, mais il avait été retoqué.
M. Khalifé Khalifé. - Je souscris aux propos précédents quant à la très grande qualité du travail de cette commission d'enquête. Les normes applicables à la filtration sont-elles applicables quel que soit le terrain de forage ?
M. Hervé Gillé. - Je m'associe aux propos de mes collègues, la complémentarité entre les responsables de la commission ayant été exemplaire, ce qui a permis d'aboutir à des résultats significatifs. Ces travaux mettent en lumière - c'est heureux - l'utilité des commissions d'enquête, dont le rôle devrait être renforcé.
L'État a clairement souhaité protéger l'industriel Nestlé et rester dans le flou, en n'anticipant aucunement les difficultés évidentes des différents producteurs à court, moyen et long terme : cette responsabilité en matière de normes et de règlements pose de vraies questions, à tous les niveaux.
Nous pourrions aussi nous interroger sur la faiblesse juridique de la CJIP et la pertinence de négocier une amende de 2 millions d'euros alors que les éléments disponibles, déjà significatifs, auraient dû amener une approche prudentielle bien plus forte. Il s'agit selon moi d'un aspect important du dossier, car ladite CIJP mettait en théorie fin à toutes les poursuites, d'autres plaintes ayant relancé le processus.
De la même manière, des procédures de certification interne doivent être questionnées, alors qu'il est en théorie nécessaire de faire appel à des organismes suffisamment neutres. Je remercie le rapporteur d'avoir pris en considération le fait que la responsabilité morale et juridique de Nestlé Waters est profondément engagée par son inaction en matière d'enquête interne.
Ce point renvoie d'ailleurs aussi au droit du travail : un groupe de cette importance doit informer les partenaires sociaux des incidents les plus graves qui peuvent être constatés en interne et qui peuvent aussi avoir des conséquences en matière d'emplois. Un irrespect des règles est donc à relever sur plusieurs plans.
Ce rapport clôture un parcours, mais l'affaire n'est certainement pas terminée et je suis persuadé qu'un certain nombre de travaux parlementaires s'inspireront des recommandations et des conclusions du rapport.
M. Olivier Jacquin. - Outre la qualité du duo formé par le président et le rapporteur, je salue le travail pionnier d'Antoinette Guhl. Les médias ont joué un rôle tout à fait particulier dans cette enquête, le rapporteur s'étant fort bien servi de ce levier pour obtenir des renseignements nouveaux. Ce rapport met en exergue la qualité du pouvoir de contrôle du Sénat, et j'ai l'impression que nous sommes parfois plus efficaces en commission d'enquête que lorsque nous adoptons des lois dont les décrets d'application ne paraissent pas toujours.
Au-delà du vaudeville des relations entre l'État et une multinationale, cette plongée en eaux troubles met en valeur la qualité de l'eau du robinet, bien moins chère que l'eau minérale naturelle et véritable trésor. J'apprécie donc particulièrement les recommandations visant à protéger la ressource, qui serviront à protéger toutes les eaux.
J'ai été particulièrement sensible aux problèmes posés par l'agriculture conventionnelle, ayant exercé moi-même cette profession en maniant des pesticides au détriment de ma propre santé. J'espère donc que la recommandation visant à ne plus utiliser de produits dangereux dans les périmètres de captage, ainsi que celle relative aux nouveaux risques, prospérera.
M. Daniel Gremillet. - Ce qui est proposé en matière de traçabilité est important et je tiens à rassurer Mme Guhl : il est tout à fait possible de contrôler la traçabilité lorsque des lignes de production différentes coexistent sur un même site, dès lors que l'on utilise une méthodologie adaptée.
Par ailleurs, veillons à ce que l'embouteilleur ne devienne pas le plus important propriétaire foncier sur le périmètre de protection de la ressource : il doit être en mesure d'apporter cette protection dans le cadre d'un schéma de développement associant les acteurs économiques, qu'ils soient agricoles ou industriels.
M. Olivier Jacquin. - Cela ne fonctionne pas.
M. Daniel Gremillet. - J'en parle en connaissance de cause : sur le site de Vittel-Contrex, Nestlé est propriétaire de centaines d'hectares, ce qui n'est pas satisfaisant. Pour le dire autrement, l'argent ne doit pas être le seul levier utilisé et la commission d'enquête doit proposer d'autres solutions.
En outre, le rapport opère parfois une confusion sur l'évolution des réglementations européenne et nationale : auparavant, les services de l'État étaient responsables de la libération des lots et de la mise en marché, mais la réglementation européenne a confié à l'acteur qui met en marché la responsabilité du contrôle. Il appartient donc à l'État de vérifier que lesdits contrôles sont bien mis en oeuvre dans les entreprises. Veillons donc à la clarté des recommandations, afin de ne pas créer une usine à gaz qui n'apporterait pas davantage de sécurité.
M. Laurent Burgoa, président. - Je vous propose de voter en bloc les vingt-huit recommandations.
Les recommandations sont adoptées.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Je vous propose le titre « Eaux minérales : scandale à la source ».
M. Jean-Pierre Grand. - Autant tuer directement les sociétés ! Personne n'achètera plus d'eau minérale avec une telle formulation. Des emplois sont en jeu dans notre département, et ce titre est politique, pas technique.
M. Daniel Gremillet. - Je ne le comprends pas non plus : par nature, l'eau qui sort de la source ne pose pas problème et il ne faudrait pas semer le doute sur ce point.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Tel n'était pas mon objectif. Je ne souhaite pas faire de la question du titre un problème entre nous et accepterai une modification, car je tiens avant tout à ce que ce rapport arrive à son terme de manière consensuelle. Mon idée était de souligner que nous revenions sur la source du scandale, mais si vous pensez que ce titre est susceptible de jeter le discrédit sur l'ensemble du secteur, j'accepterai une formulation plus neutre.
Mme Marie-Lise Housseau. - Le scandale concerne Nestlé Waters, mais pas les eaux minérales en général.
Mme Florence Lassarade. - Les traitements sont en cause.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Que penseriez-vous du titre « Eaux minérales naturelles : préserver la pureté pour les générations futures » ?
M. Jean-Pierre Grand. - Il faut préserver la santé publique dès à présent.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Faire référence à la santé publique aurait une dimension inquiétante.
M. Jean-Pierre Grand. - La notion de pureté inquiétera la population.
Mme Antoinette Guhl. - La pureté originelle est l'une des caractéristiques des eaux minérales naturelles.
M. Jean-Pierre Grand. - Prenons garde à ne pas nous faire plaisir médiatiquement.
Mme Antoinette Guhl. - La préservation de la pureté originelle est au coeur de notre travail.
M. Laurent Burgoa, président. - Nos préfets et nos ARS se sont retrouvés seuls et il faudrait que l'État prenne ses responsabilités en édictant une norme claire en matière de microfiltration, dans la foulée d'une saisine de l'Anses. Mentionner la pureté de l'eau me semble intéressant et n'a rien de choquant.
Mme Antoinette Guhl. - Nestlé Waters voulait justement que l'on considère qu'une atteinte à la pureté originelle n'était pas si grave, d'où l'utilisation de certains traitements. Notre objectif consiste bien à rappeler cette exigence de pureté, car la réglementation l'exige.
M. Laurent Burgoa, président. - Pourquoi ne pas envisager « Eaux minérales naturelles : renforcer le contrôle pour restaurer la confiance » ? La perte de confiance des consommateurs est réelle.
Mme Antoinette Guhl. - Je trouve que ce titre remet en cause les contrôleurs, alors que les fonctionnaires concernés se sont, dans l'ensemble, acquittés de leurs missions. Je préférerais viser davantage les mauvaises décisions politiques.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Nous vous proposons donc le titre « Eaux minérales naturelles : préserver la pureté à la source. »
M. Daniel Gremillet. - Non, car cela laisse trop de champ à l'interprétation.
M. Laurent Burgoa, président. - Certains ne manqueraient pas de s'engouffrer dans la brèche en mettant de côté toute intervention survenant hors forage.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Êtes-vous sûrs de ne pas souhaiter mentionner les « générations futures », ce qui implique l'existence d'un risque durable pour la ressource ?
M. Laurent Burgoa, président. - Qu'en est-il des générations actuelles ?
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Il s'agit d'évoquer un horizon d'action.
Mme Antoinette Guhl. - Je rappelle que la « pureté originelle » est bien la formule à employer pour ces eaux.
M. Laurent Burgoa, président. - Soyons prudents, car les problèmes de contamination ne sont pas survenus à la source, mais au niveau de l'embouteillage. Or un industriel pourrait s'appuyer sur la notion de pureté originelle pour indiquer qu'aucun problème n'était à signaler à cette étape : nous nous retrouverions alors piégés.
M. Daniel Gremillet. - Je partage cette opinion : en nous limitant à la source, nous risquons d'amoindrir la portée de l'important travail qui a été accompli.
M. Laurent Burgoa, président. - Nous vous proposons donc le titre suivant : « Eaux minérales naturelles : préserver la pureté. »
Le titre du rapport, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.
La commission d'enquête adopte le rapport ainsi modifié, ainsi que les annexes, et en autorise la publication.
Il est décidé d'insérer le compte rendu de cette réunion dans le rapport.
M. Daniel Gremillet. - Disposerons-nous d'un rapport écrit à l'issue de l'embargo ?
M. Laurent Burgoa, président. - Nous vous communiquerons d'abord L'Essentiel, puis le rapport complet.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Je partage la frustration de Mme Guhl quant aux interrogations qui subsistent : nous ne savons ainsi pas qui a décidé de ne pas publier le rapport de l'Igas, alors qu'il y a là une intention de dissimulation.
Pour ce qui concerne la traçabilité, je suis persuadé qu'il est possible d'effectuer des contrôles de qualité informatique et que les systèmes d'information doivent pouvoir être audités : je ne peux pas croire que l'État est incapable de scruter ce niveau.
Par ailleurs, Mme Linkenheld a évoqué les attributions de la commission d'enquête. Je rappelle que nous avons reçu des courriers réguliers nous invitant à ne pas poursuivre nos travaux et que M. Kohler ne s'est pas présenté devant nous, tandis que certaines déclarations sous serment ont été problématiques.
Selon moi, les suites doivent prendre, d'une part, la forme d'une proposition de loi transpartisane sur les questions de fiscalité et de protection des périmètres, accompagnée d'un rendez-vous avec les ministres concernés pour entreprendre des actions dans le champ réglementaire.
D'autre part, compte tenu de l'importance croissante des commissions d'enquête dans la vie démocratique de la Nation - dont celle portant sur Bétharram -, il me semble que nous devons sécuriser la manière dont elles fonctionnent. Nous avons formulé plusieurs propositions, dont des procédures de comparution immédiate, mais ces pistes devront être affinées en lien avec la direction de l'initiative parlementaire et des délégations.
S'agissant de la confusion autour de la réglementation, monsieur Gremillet, nous souhaitons simplement améliorer la manière dont le contrôle sanitaire s'opère, l'autocontrôle restant la règle en vertu du droit européen.
Enfin, l'encadré que je vous propose concerne l'ARS Occitanie : dans le cadre d'une procédure d'instruction, l'un de ses rapports a été modifié à la demande de l'industriel. Il ne s'agit pas d'allégations, mais de faits étayés par des courriels : des parties de ce document ont été retirées et cette intervention directe mérite d'être mentionnée.
M. Laurent Burgoa, président. - Je tiens à souligner que nous avons reçu le soutien du président du Sénat à deux reprises. Il a en effet défendu, face à Nestlé, la légalité et la légitimité de la commission d'enquête ; il nous a aussi soutenus après avoir été interpellé par le Président de la République, qui ne comprenait pas pourquoi nous avions divulgué des informations concernant son ancien secrétaire général, Alexis Kohler.
M. Daniel Gremillet. - J'hésitais entre m'abstenir et voter pour l'adoption du rapport, mais je ne regrette pas de l'avoir finalement soutenu. Je vous remercie de nous avoir entendus ; je craignais que nos recommandations ne laissent croire que tout le monde avait triché et que le système de contrôle interne était partout défaillant. Ne semons pas le trouble : il y a des équipes qui travaillent bien, alors que ce n'est pas simple dans les entreprises. J'approuve le choix qui a été fait de donner des perspectives et des responsabilités. Les nouvelles réglementations européennes ont représenté une révolution à laquelle on n'était pas prêt, y compris dans les administrations. Je vous recommande de rappeler, lors de la conférence de presse, qu'il y a des gens qui travaillent bien ! Merci encore au président et au rapporteur pour leur travail.
M. Laurent Burgoa, président. - Il n'a pas été simple pour moi d'assurer la présidence de cette commission d'enquête alors que je suis élu d'un département où l'une des installations en cause est implantée, mais je ne regrette pas d'avoir accepté cette responsabilité : en tant que parlementaires, nous avons le devoir de contrôler. J'ai aussi eu du plaisir à améliorer ma connaissance de ce milieu, à entendre les salariés nous dire qu'eux aussi ont besoin de transparence, de ce rapport.
Il faut rassurer les élus locaux ; l'harmonisation de la fiscalité entre eaux minérales naturelles et eaux de boisson, recommandée dans le rapport, devrait contribuer à les tranquilliser. L'important, pour tous les élus, est de ne pas tomber dans le populisme ; certains élus de mon département sont inquiets au sujet de l'emploi. Au-delà de nos différences politiques, nous voulons tous que nos départements soient prospères et offrent des emplois, mais notre responsabilité est aussi d'assurer le contrôle et de ne pas fermer les yeux lorsque quelque chose ne va pas.
Or, en l'occurrence, j'ai vu des hommes et des femmes bien seuls quand ils devaient prendre des décisions, sans soutien national. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, fixe clairement les règles, en confiant aux préfets et aux ARS le soin de les appliquer.
M. le rapporteur et moi-même présenterons le rapport lors d'une conférence de presse organisée le 19 mai prochain à 11 heures.
J'en viens à la question de la saisine de la justice. Comme nous tous, avec le rapporteur, nous nous sommes interrogés sur deux types de saisines.
Le premier cas était celui du refus de déposer de M. Alexis Kohler.
Notre souci, depuis le début de cette affaire et de nos travaux, est d'établir une véritable transparence sur un dossier qui n'a cessé de faire l'objet de dissimulations au public, à certaines administrations, voire à la représentation nationale.
Dans ce cadre, il nous a semblé que la meilleure réponse à apporter à la dérobade du secrétaire général de l'Élysée était de vous proposer de rendre publics les documents sur lesquels il refusait de s'expliquer.
Le 8 avril dernier, la commission a donc voté le principe de ne pas saisir la justice, mais, d'une part, de donner communication publique par le rapporteur du contenu des documents de l'Élysée, lecture retransmise sur le site du Sénat, et, d'autre part, de les insérer en annexe de notre rapport et de les mettre ultérieurement à disposition des internautes sur la page internet de la commission. Les reprises de presse ont été considérables.
Par ailleurs, nous craignions que la justice ne nous aide pas. Nous ne voulions pas affaiblir notre position ni celle des commissions d'enquête à venir.
La récente décision de la procureure de Paris, Mme Laure Beccuau, sur le refus de déposer du même Alexis Kohler devant la commission des finances de l'Assemblée nationale confirme que notre analyse était bonne. La procureure de Paris a en effet rejeté le signalement effectué par le président de cette commission, M. Éric Coquerel, par le motif suivant : « Le principe de la séparation des pouvoirs et la combinaison des articles 20, 24 et 51-2 de la Constitution ne permettent pas en l'espèce de caractériser l'infraction. »
Le rapporteur, en parfait accord avec moi, a par ailleurs préféré se concentrer sur des recommandations qui pourront nourrir une proposition de loi visant à renforcer les pouvoirs que les commissions d'enquête tirent de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il y a là un champ d'action pour nos groupes et nous proposerons la rédaction d'une proposition de loi transpartisane sur le sujet.
Le deuxième cas était celui des éventuels faux témoignages devant la commission d'enquête.
Avec le rapporteur, nous nous sommes interrogés sur trois cas : les auditions de Mmes Dubois et Lienau, et celle de M. Le Fanic, directeur industriel du groupe Nestlé Waters.
Il est certain que les deux premières, compte tenu de leur attitude lors des auditions, nous donnaient l'envie d'une forme de sanction. Mais il ne suffit pas d'avoir envie ! Nous avons revu avec minutie les comptes rendus et, si certains propos étaient ambigus, ils l'étaient justement trop pour étayer un signalement ayant des chances de prospérer devant la justice.
En revanche, il nous a semblé, après cet examen, que les propos de M. Le Fanic, qui, le 26 mars, écartait toute idée de contamination sur les chaînes Perrier, étaient en contradiction claire avec les documents dont nous disposions. Nous avons donc saisi la procureure de Paris. Vous avez tous reçu le communiqué de presse afférent.
Dans le prolongement de nos travaux, nous allons désormais travailler à trois textes : une proposition de loi visant à renforcer les pouvoirs que les commissions d'enquête tirent de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; une proposition de loi reprenant les recommandations du rapport sur la protection et les contrôles des eaux en bouteille ; enfin, une proposition de résolution pour les aspects réglementaires de nos recommandations. Nous allons rapidement prendre l'attache des ministres compétents pour que nos recommandations prennent effet rapidement.
M. Hervé Gillé. - Les éléments portés à notre connaissance par le rapporteur sur le rapport qui a été modifié sur intervention expresse de Nestlé Waters ne pourraient-ils pas donner lieu à des poursuites ?
M. Laurent Burgoa, président. - Pour que ce soit le cas, nous aurions dû auditionner une nouvelle fois sous serment les personnes concernées.
M. Hervé Gillé. - Nous avons aujourd'hui clairement connaissance de cette modification d'un rapport. Cela pose la question des responsabilités non seulement de l'administration, mais aussi de l'entreprise, y compris pénalement.
M. Laurent Burgoa, président. - En tant que président de la commission d'enquête, j'ai conduit les débats et me suis concentré sur l'occurrence ou non de faux témoignages. Concernant les éléments que vous mentionnez, vous avez toute liberté de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, comme tout membre de la commission d'enquête, mais ce n'est pas mon rôle.
M. Alexandre Ouizille, rapporteur. - Nous examinerons ces éléments et pourrons en discuter ensemble encore, mais nos mandats de président et de rapporteur de la commission d'enquête prendront de toute façon fin dans une minute, dès que cette réunion sera close.
M. Laurent Burgoa, président. - Merci encore à tous pour le travail réalisé ensemble.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Les réunions plénières
Mardi 10 décembre 2024
- Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) : MM. Christophe POINSSOT, directeur général délégué et directeur scientifique, et Alain DUPUY, directeur du programme « Eaux souterraines et changement global ».
- Unité mixte de recherches Gestion de l'eau, acteurs, usages (UMR G-EAU) : M. Sylvain BARONE, chercheur en sciences politiques à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).
Mercredi 11 décembre 2024
- Université de Perpignan : M. Nicolas MARTY, professeur des universités en histoire contemporaine, auteur de « L'invention de l'eau embouteillée » (2013).
- Université Lumière Lyon II : M. Guillaume PFUND, docteur en géographie économique, chercheur.
Mardi 14 janvier 2025
- Journalistes : Mmes Marie DUPIN, membre de la cellule investigation de France Info, et Pascale PASCARIELLO, journaliste au pôle « Enquêtes » de Médiapart.
Mercredi 15 janvier 2025
- Université Clermont Auvergne (UCA) : Mme Marie-Pierre SAUVANT-ROCHAT, professeur, directrice du Laboratoire santé publique et environnement.
Jeudi 16 janvier 2025
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : Mme Sarah LACOCHE, directrice générale, MM. Thomas PILLOT, chef du service Protection des consommateurs et régulation des marchés, Romain GUEGAN-BERTIN, directeur adjoint du service national des enquêtes (SNE), et Mme Odile CLUZEL, sous-directrice Produits et marchés agroalimentaires.
- Inspection générale des affaires sociales (Igas) : M. Charles DE BATZ DE TRENQUELLÉON, ancien inspecteur général des affaires sociales, et Mme Frédérique SIMON-DELAVELLE, inspectrice générale des affaires sociales, co-auteurs du rapport « Les eaux minérales naturelles et eaux de source : autorisation, traitement et contrôle ».
- Table ronde sur les risques de pollution des sols et des nappes : M. Vincent BESSONNEAU, directeur du laboratoire d'étude et de recherche en environnement et en santé de l'École des hautes études en santé publique (EHESP), Mme Pauline ROUSSEAU-GUEUTIN, responsable des enseignements en hydrologie-hydrogéologie à l'École des hautes études en santé publique (EHESP), M. Jean-Luc BOUDENNE, professeur des universités à l'université d'Aix-Marseille.
Mardi 21 janvier 2025
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) : MM. Benoît VALLET, directeur général, Matthieu SCHULER, directeur général délégué du pôle sciences pour l'expertise, et Mme Sophie LARDY-FONTAN, directrice du laboratoire d'hydrologie de Nancy.
- Audition commune du groupe Carso et d'Eurofins hydrologie : Mme Caroline PAQUET, responsable technique des marchés « Agences régionales de santé » et « Eaux minérales » (Carso), et M. Yann LE HOUEDEC, directeur général des activités pour la France (Eurofins).
Mercredi 22 janvier 2025
- Ministère de la transition écologique - Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) : Mmes Célia DE LAVERGNE, directrice de l'eau et de la biodiversité, et Julie PERCELAY, sous-directrice adjointe de la coordination, de l'appui, de la stratégie et du pilotage des politiques de protection et de restauration des écosystèmes.
- Office français de la biodiversité (OFB) : MM. Olivier THIBAULT, directeur général, et Marc COLLAS, chef du service départemental des Vosges, technicien de l'environnement.
- Direction générale de la santé (DGS) : M. Grégory EMERY, directeur général de la santé.
Mardi 28 janvier 2025
- Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) : M. Alby SCHMITT, inspecteur général, co-auteur du rapport « Analyse des risques de présence de per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans l'environnement ».
- Audition sur le thème de la pollution de l'eau par les microplastiques : MM. Johnny GASPERI, directeur de recherche au laboratoire Eau et Environnement de l'université Gustave Eiffel, Guillaume DUFLOS, directeur de recherche au laboratoire de sécurité des aliments de l'Anses, et Stéphen KERCKHOVE, délégué général d'Agir pour l'environnement.
Mercredi 29 janvier 2025
- Audition d'associations de défense de l'environnement dans les Vosges : MM. Bernard SCHMITT, porte-parole et président de Vosges Nature Environnement, Jean-François FLECK, porte-parole et vice-président de Vosges Nature Environnement, et Mme Maïthé MUSCAT, co-présidente de Lorraine nature environnement.
- Audition d'associations de consommateurs : Mme Ingrid KRAGL, directrice de l'information de Foodwatch ; M. François CARLIER, directeur général, et Mme Selma AMIMI, chargée de mission « alimentation et développement durable », de Consommation logement et cadre de vie (CLCV) ; M. Claude RICO, vice-président du Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal).
Jeudi 30 janvier 2025
- Audition sur l'écosystème des eaux dans le Gard : M. Sébastien FERRA, directeur départemental des territoires et de la mer du Gard (DDTM), Mme Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS, maire de Vergèze ; M. Thierry AGNEL, président, et Mme Sophie RESSOUCHE, responsable du pôle « eaux souterraines » de l'établissement public territorial de bassin Vistre Vistrenque.
- Audition sur l'écosystème des eaux dans les Vosges : M. Laurent MARCOS, directeur départemental des territoires des Vosges, Mme Régine BEGEL, conseillère départementale, présidente de la commission locale de l'eau des Vosges, MM. Franck PERRY, maire de Vittel, et Luc GERECKE, maire de Contrexéville.
- Audition sur l'écosystème des eaux dans le Puy-de-Dôme : MM. Jean-Pierre LUNOT, conseiller départemental du Puy-de-Dôme, Alexandre VERDIER, président de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) Allier Aval, Laurent THEVENOT, maire de Volvic, Guilhem BRUN, directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme, Joseph KUCHNA, maire de Saint-Yorre, et Mme Lucile MAZEAU, animatrice de la commission locale de l'eau Allier Aval.
Mardi 4 février 2025
- Audition sur les caractéristiques locales d'exploitations des eaux minérales naturelles et des eaux de source en Bretagne : MM. Jean-Pierre OMNÈS, président de la commission locale de l'eau Arguenon-Baie de la Fresnaye, Michel RAFFRAY, président du syndicat mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP), Patrick BARRAUX, maire de Plancoët, et Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor (DDTM).
Mercredi 5 février 2025
- Mme Virginie CAYRÉ, inspectrice générale des affaires sociales, ancienne directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est.
- Agence régionale de santé du Grand Est : Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, directrice générale, et M. Laurent CAFFET, responsable du département « santé environnementale ».
- Préfecture des Vosges : Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète.
Jeudi 6 février 2025
- Agence régionale de santé d'Occitanie : MM. Didier JAFFRE, directeur général, et Julien KRAMARZ, directeur de cabinet.
- Préfecture du Gard : M. Jérôme BONET, préfet du Gard.
Mardi 11 février 2025
- Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes : Mme Cécile COURRÈGES, directrice générale, M. Gilles BIDET, responsable du pôle santé environnement, et Mme Christel LAMAT, responsable de la cellule bassins hydrographiques Rhône Méditerranée Corse.
- Préfecture du Puy-de-Dôme : M. Joël MATHURIN, préfet.
Mercredi 12 février 2025
- Groupe OGEU : M. Jean-Hervé CHASSAIGNE, président.
- Sources Alma : M. Luc BAEYENS, directeur général.
- Société des Eaux de Mont Roucous : MM. Jean-Claude LACAZE, président, et Didier RAMOS, directeur général.
Jeudi 13 février 2025
- Danone Waters Europe : Mmes Cathy LE HEC, directrice des sources d'eaux minérales, et Marion BOUISSOU-THOMAS, directrice des affaires publiques de Danone France.
- Audition conjointe : MM. Emmanuel GERARDIN, directeur de la société des eaux de Volvic, et Frédéric LEBAS, directeur de l'usine d'Évian.
- Préfecture de Haute-Savoie : M. Yves LE BRETON, préfet.
Mardi 18 février 2025
- M. Pierre RICORDEAU, ancien directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Mercredi 19 février 2025
- Mme Marie-Françoise LECAILLON, ancienne préfète du Gard.
- M. Yves SÉGUY, ancien préfet des Vosges.
- Direction des affaires juridiques des ministères sociaux : M. Thomas BRETON, sous-directeur du contentieux.
Jeudi 20 février 2025
- M. Charles TOUBOUL MORACCHINI, ancien directeur des affaires juridiques des ministères sociaux.
- M. Norbert NABET, ancien conseiller chargé de la santé publique au cabinet du ministre des solidarités et de la santé.
- Direction générale de la santé (DGS) : Mmes Mathilde MERLO, cheffe du bureau de la qualité des eaux, et Joëlle CARMÈS, ancienne sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation.
Mardi 4 mars 2025
- Agence régionale de santé de Bretagne : Mmes Élise NOGUERA, directrice générale, Carole CHERUEL, responsable du département « ingénierie du génie sanitaire », et Anne SERRE, directrice adjointe santé environnement.
Mercredi 5 mars 2025
- M. Jérôme SALOMON, ancien directeur général de la santé.
Jeudi 6 mars 2025
- Nestlé Waters Gard : M. Philippe FEHRENBACH, ancien directeur du site Nestlé Waters Gard.
- Nestlé Waters Supply Est : M. Luc DESBRUN, directeur du site Nestlé Waters Vosges.
Mardi 11 mars 2025
- Mme Mathilde BOUCHARDON, ancienne conseillère du ministre déléguée à l'industrie (M. Roland Lescure).
- M. Guillaume DU CHAFFAUT, ancien directeur de cabinet adjoint du ministre de la santé (Mme Brigitte Bourguignon, MM. François Braun et Aurélien Rousseau).
Mercredi 12 mars 2025
- M. François ROSENFELD, ancien directeur de cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie (Mme Agnès Pannier-Runacher).
- M. Victor BLONDE, ancien conseiller technique participations publiques, consommation et concurrence au cabinet de la Première ministre (Mme Élisabeth Borne) et à la présidence de la République.
- Mme Lucile POIVERT, ancienne conseillère santé et biens de consommation au cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie (Mme Agnès Pannier-Runacher).
Jeudi 13 mars 2025
- M. Cédric ARCOS, ancien conseiller technique santé au cabinet de la Première ministre (Mme Elisabeth Borne).
Mardi 18 mars 2025
- Nestlé Waters France : Mme Sophie DUBOIS, directrice générale d'avril 2018 à janvier 2025, actuelle présidente de Nestlé France.
Mercredi 19 mars 2025
- Mme Adrienne BROTONS, ancienne directrice de cabinet du ministre de l'industrie (M. Roland Lescure).
- Nestlé Waters : Mme Muriel LIENAU, actuelle présidente-directrice générale de Nestlé Waters, responsable de la zone EMENA (Europe, Middle East and North Africa) de Nestlé Waters de 2020 à 2023, présidente de Nestlé France de 2023 à 2025.
Jeudi 20 mars 2025
- Mme Isabelle EPAILLARD, ancienne directrice adjointe de cabinet du ministre de la santé (François Braun) et ancienne directrice de cabinet de la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé (Mme Agnès Firmin-Le Bodo).
- La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) : MM. Vincent FILHOL, ancien magistrat, avocat, et Nicolas JEANNE, professeur de droit pénal à l'université de Tours.
Mardi 25 mars 2025
- Cabinet Brunswick : M. Nicolas BOUVIER, consultant en relations publiques, représentant d'intérêts du groupe Nestlé.
Mercredi 26 mars 2025
- Nestlé Waters : M. Ronan LE FANIC, responsable technique et opérations, ancien directeur de Nestlé Waters Vosges.
- Nestlé Waters : M. David VIVIER, ancien directeur industriel.
Jeudi 27 mars 2025
- Société Agrivair (chargée des mesures de protection des impluviums de Nestlé dans les Vosges) : M. Julien DIDELOT, directeur.
- M. Loïc TANGUY, ancien conseiller « consommation et pratiques commerciales » aux cabinets de MM. Alain Griset et Jean-Baptiste Lemoyne, successivement ministres délégués aux petites et moyennes entreprises.
- M. Jérôme VIDAL, ancien conseiller « consommation et pratiques commerciales » au cabinet de Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.
Mardi 1er avril 2025
- Mme Agnès FIRMIN LE BODO, ancienne ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, puis ministre de la santé.
- M. Roland LESCURE, ancien ministre délégué chargé de l'industrie.
Mercredi 2 avril 2025
- Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ancienne secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, puis ministre déléguée chargée de l'industrie.
- Mme Yasmine MOTARJEMI, ancienne directrice monde de la sécurité alimentaire chez Nestlé.
Mercredi 9 avril 2025
- Groupe Nestlé : M. Laurent FREIXE, directeur général monde.
Mercredi 30 avril 2025
- M. Aurélien ROUSSEAU, ancien directeur de cabinet de la Première ministre (Élisabeth Borne), ancien ministre de la santé et de la prévention.
Réunion au format rapporteur
Lundi 24 mars 2025
- MM. Adrien BALVET, secrétaire de l'association PREVA (Préservation de l'environnement des volcans d'Auvergne), Édouard de FÉLIGONDE, propriétaire de la « pisciculture des Riomois », Didier THOUVENIN, agriculteur près de Vittel, Robert DURAND, hydrogéologue, ingénieur de l'environnement, spéléologue, et Me François ZIND, avocat spécialiste en droit de l'environnement.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENT DANS LE GARD - VERGÈZE ET NÎMES
Vendredi 7 février 2025
- Visite du site de Nestlé Waters dans le Gard en présence de :
· Mme Muriel LIENAU, présidente de Nestlé France
· M. Fabio BRUSA, directeur des affaires publiques
· M. Philippe FEHRENBACH, ancien directeur du site Nestlé Waters Gard
· M. Sébastien TELLIER, service eau et risques, mission politique de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard
· Mmes Clémence CAYRIER et Isabelle ESTOURNET, inspectrices de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de la protection des populations du Gard
· MM. Julien KRAMARZ, directeur de cabinet, Julien FECHEROLLE, ingénieur référent régional Eaux minérales naturelles, et Yannick DURAND, responsable de la cellule mutualisée Eaux, à l'agence régionale de santé d'Occitanie
- Entretien avec M. Jérôme BONET, préfet du Gard.
- Rencontre avec les représentants du personnel de l'usine Perrier
· MM. Olivier ALMERAS, représentant du syndicat CGT, Mathieu SAPEDE, représentant du syndicat FO, et Xavier SALAUN, représentant du syndicat CFE-CGC au sein de Nestlé Waters Supply Sud
- Rencontre avec les élus locaux :
· M. Philippe GRAS, maire de Codognan, président de la communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle
· Mme Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS, maire de Vergèze
· M. Joffrey LEON, maire de Uchaud
· M. Jalil BENABDILLAH, vice-président de conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en charge de l'économie, de l'emploi, de l'innovation et de la réindustrialisation
· Mme Audrey PORTERON, conseillère presse au cabinet de la présidente du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
· M. Patrick BENESECH, maire de Mus
· M. Jean-François LAURENT, maire de Vestric et Candiac
- Rencontre avec les acteurs économiques locaux :
· M. Philippe CAVALIER, élu à la chambre d'agriculture du Gard, en charge de l'eau
· M. Bertrand COOL, directeur du site O-I de Vergèze
· M. Christophe BACHELET, direction industrielle France-Espagne du groupe O-I.
- Point presse en préfecture de Nîmes.
DÉPLACEMENT EN HAUTE-SAVOIE - EVIAN, PUBLIER ET THONON
Vendredi 21 mars 2025
- Visite du site de Danone à Évian, d'un forage et de l'hydrothèque, et explications sur l'impluvium d'Évian et la politique de préservation en présence de :
· Mme Cathy LE HEC, directrice des sources d'eaux minérales Danone Waters
· M. Frédéric LEBAS, directeur de l'usine d'Évian
· Mme Cécile LE BERRE, responsable qualité
· M. Fabien MOREL-VULLIEZ, responsable fontainiers
· M. Stéphane DEPARDON, hydrogéologue
· M. Killian ZARSHENAS, chargé affaires publiques
· M. Reynald LEMAHIEU, directeur de la délégation départementale de l'ARS
· M. Jean-Baptiste LALECHERE, technicien sanitaire et de sécurité sanitaire
· Mme Christel LAMAT, responsable de la cellule bassins hydrographiques Rhône Méditerranée Corse
· M. Sébastien RIU, directeur départemental de la protection des populations de la Haute-Savoie
· M. Jérôme BOUGET, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
· Mme Ludivine CHATEAU, adjointe au chef du service eau environnement de la direction départementale des territoires (DDT)
· Mme Céline MONTERO, adjointe à la cheffe de l'unité départementale des deux Savoie de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
- Déjeuner de travail à Évian-les-Bains en présence de Mme Sabine OPPILLIART, sous-préfète de Thonon-les-Bains, M. Christophe ARMINJON, maire de Thonon-les-Bains, et Mme Josiane LEI, maire d'Évian-les-Bains.
- Visite du site des eaux de Thonon du groupe Sources Alma en présence de :
· M. Manuel DE ALMEIDA, directeur
Services de l'État
· MM. Reynald LEMAHIEU, directeur de la délégation départementale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Baptiste LALECHERE, technicien sanitaire et de sécurité sanitaire, et Mme Christel LAMAT, responsable de la cellule bassins hydrographiques Rhône Méditerranée Corse
· M. Sébastien RIU, directeur départemental de la protection des populations de la Haute-Savoie
· M. Jérôme BOUGET, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
· Mme Ludivine CHATEAU, adjointe au chef du service eau environnement de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie
· Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) : Mme Céline MONTERO, adjointe à la cheffe de l'unité interdépartementale.
· - Point presse en sous-préfecture de Thonon-les-Bains.
CONTRIBUTION DU GROUPE ÉCOLOGISTE - SOLIDARITÉS ET TERRITOIRES
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires tient avant tout à saluer le travail rigoureux et approfondi mené par la commission d'enquête du Sénat. Pendant ces quatre mois d'auditions, elle a permis de mettre en lumière des pratiques industrielles qui posent de graves questions, tout en respectant les procédures judiciaires en cours.
Ce rapport marque une étape importante pour rétablir la vérité, évaluer les responsabilités et restaurer la confiance des citoyens dans un secteur essentiel à notre santé, notre économie et notre souveraineté environnementale : celui des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère que la situation révélée est particulièrement préoccupante. La pureté originelle de certaines eaux a été mise à mal. Si le rapport ne conclut pas à un risque sanitaire immédiat, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère que le risque sanitaire a été pris, notamment à Vergèze où les contrôles virologiques de l'État n'ont été effectifs qu'en juillet 2024, soit 12 mois après l'arrêt des traitements. Toutefois, le rapport pointe un affaiblissement préoccupant des exigences de traçabilité, notamment lorsque des installations techniques permettent le croisement d'eau potable et non potable. De plus, les pollutions aux PFAS, aux pesticides, aux microplastiques ou encore aux matières fécales ne relèvent pas de cas isolés. Ce sont là des vulnérabilités majeures pour la santé publique.
Les services décentralisés ont globalement fait leur travail - particulièrement l'ARS des Vosges et les préfets, qu'il faut saluer. Mais les décisions politiques n'ont pas suivi. On retrouve ici les mêmes constats que ceux révélés par la mission “flash” menée par Antoinette Guhl, sénatrice écologiste de Paris, et adoptée à l'unanimité le 16 octobre 2024 : un contrôle fragmenté, où les alertes existent, mais où elles sont tues ou bloquées. Il faut aussi rappeler le rôle de la Direction générale de la santé, seule à avoir exprimé une opposition claire aux dérives qui se sont produites à Vergèze, alors que, pendant douze mois, les traitements UV et au charbon actif ont été suspendus sans qu'un suivi sanitaire précis ait été assuré. Ce flou est d'ailleurs inacceptable.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires adhère pleinement aux grandes orientations du rapport visant à renforcer les capacités de contrôle de l'État, garantir la qualité des eaux minérales, et établir des règles claires et équitables pour l'ensemble des opérateurs.
Nous soutenons notamment :
- l'obligation de transparence sur les procédés de traitement,
- la fin des dérogations discrétionnaires et opaques,
- le renforcement de la gouvernance publique sur cette ressource, qui doit être considérée comme un bien commun.
Ces orientations vont dans le sens de l'intérêt général et permettent de restaurer la confiance, tout en anticipant les défis à venir liés à la raréfaction et à la pollution des eaux souterraines.
En complément, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires regrette vivement que les pratiques de certaines multinationales aient été tolérées aussi longtemps, malgré des alertes internes et des constats accablants. La commission d'enquête a clairement montré comment une multinationale s'est comportée comme si elle était au-dessus des lois. Elle a continué à vendre une eau qui n'était plus pure, mais traitée, avec une dérogation gouvernementale secrète, allant des ministères jusqu'à l'Élysée. Il est temps de sortir d'une logique où l'on ferme les yeux pour préserver une image de marque ou des intérêts industriels.
Ces pratiques frauduleuses constituent également une forme de concurrence déloyale. Elles entachent l'ensemble du secteur, y compris les producteurs d'eau minérale réellement pure, respectant les normes et apportant véritablement des bienfaits en oligoéléments ou en minéraux. En trichant, certains industriels affaiblissent ceux qui travaillent sérieusement et ternissent la crédibilité de toute la filière. Les consommateurs, véritables victimes de cette opacité, doivent retrouver une place centrale. Leur information ne peut plus dépendre de choix commerciaux ou d'arrangements politiques.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires porte de longue date plusieurs propositions concrètes :
- renforcer la police de l'eau et les moyens des agences sanitaires,
- sanctuariser les nappes phréatiques les plus vulnérables,
- protéger l'appellation « eau minérale naturelle » de toute dérive.
Nous appelons également :
- à un moratoire sur les prélèvements industriels dans les zones en tension hydrique,
- à une révision complète des conditions d'exploitation des marques d'eau en bouteille.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estime que la préservation durable de la ressource face aux pollutions diffuses et au changement climatique méritait d'être davantage développée. Une politique de long terme est nécessaire pour protéger nos eaux souterraines, véritable patrimoine écologique de notre pays.
Par ailleurs, il existe un enjeu territorial fort. Derrière cette crise, il y a un bassin d'emploi, une ressource locale, un territoire qu'il faut accompagner dans la transition. La transformation du site de Vergèze pour produire des bouteilles de "Maison Perrier", une eau potable traitée, peut représenter une voie acceptable pour maintenir l'emploi tout en sortant d'un modèle qui n'est plus viable.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estime que ce rapport expose, à nouveau, des dérives graves, identifie des responsabilités et propose des pistes concrètes. Mais il doit maintenant être suivi d'effets. Car la santé publique, la transparence démocratique, la protection du consommateur et la préservation de l'eau ne peuvent plus attendre. Nous appelons à une politique publique structurelle sur l'eau, qui protège la ressource à la source, garantisse une information honnête, et mette fin à l'impunité de celles et ceux qui se croient au-dessus des lois.
C'est une question de justice environnementale, de démocratie sanitaire et d'éthique économique.
ANNEXE 1
UN DISPOSITIF DE
CONTRÔLE COMPLEXE
Pour assurer la protection de la pureté originelle de l'eau, qui ouvre droit à l'appellation « eau minérale naturelle », l'État a mis en place un dispositif de protection et de contrôle en théorie exigeant (A). Cependant, sa complexité et sa fragmentation entre plusieurs administrations le rendent d'une mise en oeuvre malaisée (B).
A. UN PROCESSUS D'AUTORISATION ASSIS SUR DES RÈGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES EXIGEANTES
Le cadre juridique régissant l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle mêle deux volets principaux :
- un volet environnemental en ce qui concerne l'autorisation de forer et la fixation des volumes de prélèvements, qui relève du ministère chargé de l'environnement. Cette règlementation, qui n'est pas spécifique aux eaux minérales naturelles ni aux eaux de source, correspond plutôt à une approche quantitative de la ressource en eau ;
- un volet sanitaire, spécifique aux eaux minérales naturelles et de source, en ce qui concerne l'autorisation de produire de l'eau à des fins d'embouteillage sous une dénomination particulière, « eau minérale naturelle » ou « eau de source », qui relève du ministère chargé de la santé. Cette règlementation, qui figure au code de la santé publique, correspond plutôt à une approche qualitative.
1) L'approche environnementale et quantitative : des prélèvements en eau encadrés
Conformément à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, une autorisation environnementale est nécessaire pour prélever de l'eau souterraine au-delà de 200 000 mètres cubes par an, quel que soit l'usage de l'eau prélevée : les industriels embouteilleurs y sont donc soumis. En deçà de ce volume total annuel, seule une déclaration est nécessaire125(*). En 2023, on recense en France 262 captages destinés à la production d'eau conditionnée. La production est très concentrée : 10 sites de conditionnement produisent 50 % des volumes d'eaux conditionnées EMN et ES. Seules 14,8 % des 180 unités de conditionnement d'eau126(*) produisent plus de 500 m3 d'eau par jour en 2023.
Cette autorisation est délivrée par le préfet de département au titre de la police de l'eau. Elle inclut un volume maximal de prélèvements autorisés, déterminé en cohérence avec le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) ainsi qu'avec les volumes prélevables fixés par le préfet coordinateur de bassin.
Le préfet coordinateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables sur des sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements127(*).
Il s'agit du volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux128(*).
Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
Les demandes d'autorisation sont instruites par les directions départementales des territoires (DDT) au sein des préfectures de département et/ou par les unités départementales des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal).
À titre d'exemple, les prélèvements de Nestlé Waters dans le Gard sont autorisés par l'arrêté d'autorisation environnementale n° 19.008N du 16 janvier 2019. Ce dernier fixe des plafonds de prélèvements maximaux autorisés, en m3/h et en m3 par an, pour chaque forage et pour chaque usage - il en existe trois différents : la production d'eaux conditionnées, les eaux industrielles et l'extraction de gaz carbonique. Ces plafonds ont été actualisés à la baisse par l'arrêté préfectoral n° 2024-022-DREAL du 14 mai 2024.
L'exemple des droits à prélèvement de Perrier
Jusqu'en 2023, Nestlé Waters Supply Sud était autorisé à prélever 1 620 800 m3 d'eau par an pour la production d'eau minérale, 3 153 400 pour l'extraction du CO2 gazeux et 600 000 m3 par an pour les eaux industrielles soit un total de 5 374 200 m3.
D'après les données transmises par Nestlé Waters à la commission d'enquête, en 2024, les prélèvements pour l'eau conditionnée (forages Romaines III, IV, IV bis, V, VI, VII et VIII) s'élèvent à 874 078 m3. En 2023, ils s'élevaient à 1 051 814 m3. Cela représente 15,3 % de la production d'eau minérale naturelle française en 2023. Cette dernière s'élevait à 6,758 millions de m3 pour les eaux minérales naturelles et 6,875 millions pour les eaux de source pour un total de 13,67 millions de m3 d'eau conditionnée produite.
L'arrêté du 14 mai 2024 précité a réduit les volumes maximaux autorisés à un niveau qui reste supérieur aux prélèvements effectifs de 2023. Le prélèvement maximal autorisé s'élève à 3 413 800 m3 pour les eaux industrielles, 1 350 000 m3 pour l'extraction du CO2 gazeux et 1 570 800 m3 pour les eaux conditionnées. Une trajectoire baissière est prévue jusqu'en 2027 où les prélèvements totaux devront atteindre 2 500 000 m3, dont 1 350 000 m3 pour les eaux conditionnées - valeur qui était déjà respectée en 2023.
Des prescriptions spécifiques peuvent être énoncées par l'arrêté préfectoral en matière de suivi quantitatif de la ressource en eau. L'arrêté de 2019 concernant Nestlé dans le Gard prescrit par exemple la réalisation d'une étude sur le fonctionnement de « l'hydrosystème Perrier » et sur les interactions entre les différents aquifères mobilisés avant le 31 juillet 2020.
L'arrêté du 14 mai 2024 prévoit, quant à lui, des mesures spécifiques en cas de sécheresse, qui portent notamment sur une programmation des prélèvements en dehors de périodes identifiées comme sensibles et sur une réduction des prélèvements pour les eaux industrielles et d'extraction du CO2 , les eaux destinées à la consommation humaine et les eaux conditionnées étant hors du champ de ces mesures de restriction, conformément à l'arrêté ministériel du 30 juin 2023.
Outre ces aspects quantitatifs, les seules prescriptions liées à la qualité de l'eau, prises par le préfet au titre de la police de l'environnement, sont non-contraignantes : il s'agit de la délimitation, par arrêté préfectoral, d'une aire d'alimentation de captage (AAC)129(*) au sein de laquelle est instaurée un programme d'actions de protection de la ressource contre les protections diffuses.
2) L'approche sanitaire et qualitative : l'autorisation d'exploiter de l'eau en tant qu'eau minérale naturelle ou de source répond à des critères stricts
a) Une procédure censée garantir la qualité intrinsèque aux eaux minérales naturelles et de source
Lorsque le forage et les prélèvements en eau associés sont destinés à la production d'eau en bouteille, l'industriel doit obtenir une autorisation d'exploitation du préfet du département.
Les demandes d'autorisation d'exploitation d'une source en vue de la production d'eau destinée à la consommation humaine, qu'elle soit minérale naturelle ou non, sont instruites par les Agences régionales de santé (ARS) pour le compte des préfets. L'exploitation est autorisée par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)130(*).
L'autorisation d'exploitation porte sur une « source », qui peut être constituée d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Le recours à plusieurs émergences s'explique à la fois par les conditions d'exploitation des différents captages - le débit maximal autorisé pour une émergence étant limité - et par les besoins en eau - la possibilité de produire à partir de plusieurs émergences permet d'augmenter la production131(*). Le recours à un mélange est strictement encadré, notamment lorsque les concentrations physicochimiques des eaux des captages sont différentes132(*).
Conformément au droit européen133(*) et au même titre que tous les industriels produisant des denrées alimentaires, l'embouteilleur doit garantir la traçabilité de l'eau conditionnée tout au long du processus de production. Le code de la santé publique précise ainsi qu'une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage134(*).
Le dossier de la demande d'autorisation d'exploitation d'une source en eau minérale naturelle inclut notamment135(*) :
- une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de l'aquifère concerné, ayant une incidence sur les caractéristiques de l'eau ;
- les résultats d'analyses chimiques, physico-chimiques et microbiologiques de l'eau permettant d'évaluer sa pureté et sa stabilité ;
- la justification des produits et des procédés de traitement éventuels ;
- la description des installations de production et de distribution et notamment leur capacité et leurs matériaux en contact avec l'eau, dont la conformité sanitaire doit être attestée ;
- l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, désigné par le directeur général de l'ARS. Cet avis est remis au préfet et à l'industriel et porte sur les conditions de la stabilité des caractéristiques de l'eau et sur le débit maximum d'exploitation, le périmètre sanitaire d'urgence proposé ainsi que les vulnérabilités de la ressource et les mesures de protection à mettre en oeuvre136(*) ;
- la description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.
C'est à l'ARS qu'il appartient de vérifier la complétude du dossier de l'industriel, de proposer la nomination d'un hydrogéologique agréé, de consulter les services de l'État - notamment les directions départementales de la protection des populations137(*) concernant les mentions d'étiquetage, de rédiger le rapport de synthèse présenté au Coderst ou encore le projet d'arrêté préfectoral motivé.
Une fois l'autorisation obtenue, l'ARS réalise une visite de récolement règlementaire et définit le programme des analyses de vérification de la qualité de l'eau. Si les résultats sont conformes, l'exploitant est informé par le préfet de l'obtention de l'autorisation d'exploitation.
b) Des périmètres de protection pour préserver la pureté originelle des sources
L'arrêté inclut des mesures de protection. Elles découlent de servitudes liées à la délimitation de périmètres, souvent facultatifs, qui ne couvrent qu'une partie minoritaire de la zone d'impluvium.
Le cas échéant, ces périmètres sont complémentaires de l'aire d'alimentation du captage (AAC).
Pour les eaux de source, lorsque les installations sont déclarées d'utilité publique, sont délimités, d'une part, un périmètre de protection immédiate autour du point de prélèvement, dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et, d'autre part, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Si le périmètre de protection immédiate recouvre en règle générale quelques centaines de mètres, la surface d'un périmètre de protection rapprochée peut aller de quelques hectares à plusieurs centaines d'hectares.
Lorsque les résultats d'analyse de la qualité de l'eau ne satisfont pas aux critères de qualité, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau, un périmètre de protection éloignée peut également être délimité au sein duquel peuvent être règlementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols et dépôts138(*).
En ce qui concerne les eaux minérales naturelles, l'autorisation d'exploitation de la source détermine un périmètre sanitaire d'émergence pour lequel le propriétaire doit disposer de la peine propriété ou acquérir des servitudes garantissant sa protection contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles139(*). Ce périmètre, de faible superficie, n'a pour objectif que d'éviter les intrusions et de supprimer le risque de déversement de produits polluants à proximité immédiate du captage pouvant entraîner une contamination de l'eau140(*).
À titre d'exemple, l'arrêté préfectoral141(*) d'autorisation d'exploitation de la source Perrier prévoit que le périmètre sanitaire d'émergence des captages correspond à des rectangles d'une dizaine de mètres de long et de large.
L'industriel peut également demander au préfet la déclaration d'intérêt public (DIP) de la source d'eau minérale naturelle, qui permet de lui assigner un périmètre de protection, plus large que le périmètre sanitaire d'émergence142(*). Il s'agit d'un périmètre à l'intérieur duquel aucun travail souterrain ne peut être réalisé sans autorisation préalable du préfet. Un périmètre de protection permet d'encadrer les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Il est donc facultatif.
Ces périmètres sont néanmoins relativement restreints par rapport à la zone d'impluvium, où les eaux de pluie pénètrent dans le sol et alimentent l'aquifère - cette zone pouvant représenter plusieurs milliers d'hectares. Guillaume Pfund, docteur en géographie économique et chercheur à l'Université Lumière Lyon II, a ainsi souligné à la commission d'enquête les limites du périmètre de protection : « Le périmètre de protection, outil juridique facultatif, ne correspond pas aujourd'hui à 100 % du gisement, que ce soit l'impluvium ou la zone d'émergence ; donc il y a un décalage entre l'outil juridique et la surface à protéger. Cet outil, qui permet d'imposer aux tiers des limitations d'activité, est néanmoins assez vieillissant. »143(*)
B. UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE FRAGMENTÉ MALGRÉ LA TRANSVERSALITÉ DES ENJEUX
1) Quatre autorités administratives différentes interviennent à des stades différents de la chaîne de production pour contrôler l'action des embouteilleurs
Au niveau central, les eaux minérales naturelles et de source relèvent de quatre autorités administratives différentes :
- la direction générale de la santé (DGS), chargée de la règlementation et de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
- la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de police de l'eau ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), compétente en matière d'étiquetage et de loyauté des produits ;
- la direction générale de l'alimentation (DGAL), responsable de la sécurité sanitaire des produits alimentaires commercialisés.
Si les administrations centrales définissent la réglementation, le contrôle du respect de son application relève principalement des autorités locales : cela inclut les ARS, mais aussi les services déconcentrés de l'État, notamment les directions départementales de protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) au sein des préfectures.
Les contrôles reposent, au moins en partie, sur des informations détenues par les industriels. L'efficacité des contrôles suppose par conséquent une relation constructive entre industriels et autorités compétentes et une attitude loyale de la part des industriels.
a) Les contrôles en matière environnementale
Sur le volet environnemental, les embouteilleurs sont soumis aux mêmes contrôles que les autres catégories d'utilisateurs d'eau (autres industriels, agriculteurs, etc.).
Les directions départementales des territoires ou les inspecteurs des installations classées des DREAL exercent des contrôles sur place ou sur pièce au titre de la police administrative de l'eau afin de s'assurer du respect des volumes de prélèvements maximum autorisés et du respect des conditions d'exploitation, éventuellement en complémentarité avec les agents de l'office français de la biodiversité (OFB) qui interviennent au titre de la police administrative et judiciaire144(*) à la demande du Parquet.
Les contrôles des volumes prélevés peuvent être sur pièce via la vérification des données déclaratives, ou sur place pour vérifier la présence de compteurs ou de registres des volumes prélevés.
Le contrôle des prélèvements en eau repose, au moins en partie, sur des données détenues par les industriels. Les données des piézomètres des industriels des eaux conditionnées ne sont transmises à l'administration que si le préfet l'impose dans les prescriptions de l'autorisation environnementale. En principe, le préfet peut définir les données de suivi requises pour assurer les impacts du prélèvement. Mais en l'absence de demande, les industriels ne sont pas tenus de transmettre les données des piézomètres.
b) Les contrôles en matière sanitaire
Conformément à la législation alimentaire de l'Union européenne145(*), les exploitants sont responsables de la sécurité alimentaire des denrées qu'ils placent sur le marché et doivent dès lors exercer une surveillance de la qualité et de la sécurité des produits commercialisés. Les contrôles des services de l'État n'interviennent qu'à un second niveau. Cette surveillance, parfois appelée « autosurveillance » comprend une partie principale146(*) assurée par un programme d'analyses, et une partie complémentaire définie par l'exploitant en fonction des dangers identifiés147(*).
Les analyses sont réalisées par des laboratoires accrédités pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent. Dans certaines conditions, il peut aussi s'agir du laboratoire de surveillance de l'industriel situé dans l'usine de conditionnement148(*).
Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance doivent être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin149(*). L'exploitant doit porter immédiatement à la connaissance du directeur général de l'ARS, qui en informe aussitôt le préfet, tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de son aménagement, les conditions de transport et de sa conservation150(*).
Conformément au cadre européen, les autorités compétentes au niveau national sont quant à elles tenues d'exercer en matière sanitaire des contrôles officiels151(*). Ces contrôles officiels correspondent à :
- l'inspection des installations : selon la DGS, 19 inspections ont été réalisées en 2021, 52 en 2022 et 16 en 2023 ;
- le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en oeuvre par l'exploitant (autocontrôles, traçabilité de tous les lots produits, etc.).
En France, la règlementation ajoute à la surveillance de l'exploitant un contrôle sanitaire de la qualité des eaux conditionnées mis en place par l'ARS, qui n'est pas requis par le cadre européen, mais permet à l'administration de disposer de sa propre source d'information sur les performances des installations de conditionnement et le respect de l'arrêté préfectoral.
Ce contrôle sanitaire, exercé par les ARS, comprend la réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau à la ressource, au niveau des eaux brutes, en cours de production et lors du conditionnement de l'eau. Ces prélèvements et analyses sont réalisés par les ARS ou par un laboratoire agréé par l'Anses152(*).
La fréquence des prélèvements au titre du contrôle sanitaire requise par la règlementation est de 4 contrôles annuels153(*).
À titre d'exemple, le laboratoire CARSO-LSHEHL, auditionné par la commission d'enquête, a indiqué être titulaire du marché public du contrôle sanitaire de tous les embouteilleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que de celui d'un ou deux embouteilleurs de la région Hauts-de-France et d'un autre en région Bourgogne-Franche-Comté, soit environ 38 sites d'embouteillage sur l'ensemble du territoire. La responsable technique, Caroline Paquet, a également indiqué à la commission d'enquête qu'« en plus du contrôle sanitaire, de nombreux petits embouteilleurs nous confient par ailleurs leurs analyses internes, ce que l'on nomme « l'autocontrôle. Ils ne disposent pas forcément eux-mêmes de gros laboratoires et ont besoin de nous pour réaliser leurs analyses d'autocontrôle. »154(*)
La liste des polluants - comme les pesticides - recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire mis en oeuvre par les ARS est identique quel que soit le type d'eau.
En 2023, le contrôle sanitaire des eaux brutes (émergences) des eaux minérales naturelles et eaux de source a représenté 1 317 prélèvements d'échantillons et 48 840 résultats d'analyses de paramètres microbiologiques et physico-chimiques, permettant de vérifier le respect des critères de pureté originelle prévus par la directive de 2009. Tous ces prélèvements et analyses sont en principe réalisés sur les eaux brutes.
Lors de son audition155(*), le directeur général de la santé, Grégory Emery, a indiqué que « plus de 150 000 analyses sont réalisées chaque année dans le cadre du contrôle sanitaire des ARS [à la fois sur les eaux brutes et les eaux conditionnées] et le taux de conformité aux limites de qualité réglementaires est supérieur à 99 % pour les paramètres microbiologiques et physico chimiques ».
Néanmoins, il convient de relativiser ces statistiques puisque, sur certains de ses captages, Nestlé Waters plaçait des filtres à charbon actif et des traitements aux lampes à UV en amont des points de prélèvements du contrôle sanitaire des eaux brutes, ce qui avait pour conséquence de biaiser les analyses effectuées.
c) Les contrôles au titre de la loyauté des produits
La DGCCRF est l'autorité chargée d'assurer le respect de la loyauté des produits distribués sur le territoire national : il s'agit de veiller à ce que les caractéristiques des produits commercialisés soient conformes à leurs mentions d'étiquetage afin que le consommateur ne soit pas trompé.
À ce titre, les agents CCRF contrôlent les mentions d'étiquetage des eaux conditionnées prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation : dénomination, mentions d'étiquetage relatives aux traitements, nom de la source, du lieu d'exploitation, déclaration des teneurs en certains constituants et, le cas échant, avertissements s'y rapportant.
Tout changement dans les mentions d'étiquetage est soumis à la validation des préfets.
Les agents CCRF contrôlent également toutes les autres mentions d'étiquetage obligatoires ou facultatives comme les allégations nutritionnelles ou de santé.
d) Les contrôles au titre de la sécurité sanitaire des produits après leur embouteillage
La direction générale de l'alimentation (DGAL) et ses agents au sein des DDPP sont chargées de la sécurité sanitaire des eaux embouteillées distribuées sur le territoire français depuis la mise en oeuvre de la police sanitaire unique, achevée le 1er janvier 2024. À ce titre, ils contrôlent les conditions de transport, d'entreposage et de distribution des eaux embouteillées.
Les auditions de la commission d'enquête ont souligné le caractère morcelé du dispositif de contrôle des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Outre l'autorité compétente en matière environnementale, trois autorités interviennent à différents stades de la chaîne de production : les ARS de l'émergence à l'embouteillage, la DGCCRF après embouteillage et la DGAL après commercialisation.
Le rapporteur ne peut que constater que les préfets, pour le compte desquels ces différentes autorités exercent leurs missions, n'interviennent qu'en bout de chaîne avec une faible capacité d'orientation des services. La rationalisation de ce dispositif est un des enjeux pour l'avenir, qui est abordé plus loin.
2) La transversalité des enjeux et l'enchevêtrement des compétences imposent une coopération entre autorités
En matière environnementale, les administrations ont mis en oeuvre plusieurs instances pour articuler pouvoirs de police administrative et judiciaire. Les contrôles effectués en matière de police de l'eau et de la nature et les dossiers traités par les services préfectoraux sont mis en cohérence dans le cadre d'une mission interservices de l'eau et de la nature (Misen), qui regroupe les acteurs autour du préfet de département et du procureur de la République. Il existe également une stratégie des contrôles en matière de police de l'eau et de la nature (SNCPEN)156(*) depuis 2020 qui s'appuie sur les « comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (Colden) pour mieux articuler police administrative et police judiciaire157(*).
Les orientations des contrôles sont définies par le plan de contrôle départemental qui décline les priorités de la stratégie nationale des contrôles en matière de police de l'eau et de la nature. Ce plan est piloté par le préfet et validé lors d'une réunion des membres permanents de la Misen et du Colden. Cette validation permet aux titulaires des pouvoirs de police administrative et judiciaire de partager l'information sur les contrôles susceptibles d'être programmés dans l'année. Il est à regretter que cette stratégie de contrôle ne comporte pas de volet « eaux minérales et eaux de source », en dépit de l'affaire apparue depuis 2021.
En matière de sécurité sanitaire et de loyauté des produits, les compétences respectives des ARS et des agents de la DGCCRF imposent une coopération.
Il n'appartient pas aux agents de la CCRF de s'assurer de l'adéquation des pratiques effectives des opérateurs avec les exigences des arrêtés d'autorisation d'exploitation. Une telle vérification relève de l'inspection des installations et des contrôles avant embouteillage et donc de la compétence des ARS. Néanmoins, des résultats non-conformes des contrôles des installations réalisés par les ARS peuvent avoir des implications sur les mentions d'étiquetage des produits : dans ce cas, il revient aux agents de la CCRF d'engager les suites appropriées au stade de la mise sur le marché.
Les agents de la CCRF peuvent également être sollicités par les agents des ARS pour mettre en oeuvre des pouvoirs d'enquête extraordinaires dont ne disposent pas les ARS. Il s'agit notamment d'« opérations de visites et de saisies » (OVS), équivalentes à une perquisition. Ces pouvoirs sont mis en oeuvre sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention (JLD), et nécessitent une impossibilité de collecter les preuves des pratiques prohibées par les moyens ordinaires. Tel pourrait être le cas dans un dossier ayant pour origine des éléments transmis par un lanceur d'alerte, qui décrirait un système de fraude sophistiqué, dont les preuves sont bien dissimulées.
La DGCCRF peut également être saisie ou cosaisie par le procureur de la République pour réaliser, par exemple, une enquête préliminaire. Tel a été le cas dans le dossier ayant conduit à la conclusion, avec l'entreprise Nestlé Waters Supply Est, d'une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale. Le procureur de la République d'Épinal, saisi par l'ARS Grand Est au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, a lui-même saisi le Service national des enquêtes (SNE) de la DGCCRF pour mener l'enquête pénale sur les faits constatés par l'ARS.
En matière de traçabilité des eaux conditionnées, la coopération entre les agents des ARS et les agents de la CCRF est particulièrement pertinente : si la traçabilité des eaux et les règles entourant la possibilité de conditionner plusieurs eaux sur une même ligne découlent du code de la santé publique, de même que l'inspection des installations relève des ARS, il n'en demeure pas moins que la traçabilité s'apprécie en comparant la nature de l'eau conditionnée et la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage - ce qui a trait à la loyauté des produits, compétence de la DGCCRF.
Néanmoins, les échanges ne sont pas systématisés. Comme l'a indiqué la préfecture de Haute-Savoie à la commission d'enquête, « il y a des échanges d'informations ponctuels entre agents de la DDPP et de l'ARS, notamment lors des instructions de dossiers ou des incidents de fabrication. Cependant, il n'y a pas de coordination formalisée à une fréquence donnée. (...) Au niveau départemental, il serait également intéressant d'instaurer une rencontre a minima annuelle entre les agents de l'ARS et de la DDPP pour faire un point régulier concernant le contrôle des sites d'embouteillage. »158(*)
Enfin, les enjeux qualitatifs et quantitatifs de la ressource sont parfois si liés qu'il est difficile de les dissocier dans le cadre de l'instruction des dossiers, bien qu'ils relèvent de plusieurs autorités.
Sébastien Ferra, DDTM du Gard, a ainsi évoqué devant la commission d'enquête la préoccupation de son administration sur « la relation entre la quantité d'eau disponible et sa qualité ». L'arrêté d'autorisation préfectorale d'exploitation de la source Perrier de 2019 demandait ainsi à Nestlé Waters de réaliser une étude de l'hydrosystème Perrier pour évaluer l'impact potentiel de l'exploitation sur les circulations d'eau, la stabilité des sols et, in fine, la qualité de l'eau - sans pour autant que la DDTM n'ait été associée aux travaux de l'ARS sur la qualité de la ressource à l'aune du principe de pureté originelle, dont le rapport définitif de décembre 2024 questionne la possibilité de continuer à exploiter les eaux minérales naturelles de la source Perrier159(*).
ANNEXE 2
ÉTUDE DE
LÉGISLATION COMPARÉE
INTRODUCTION
À la demande du secrétariat de la commission d'enquête sur « les pratiques des industriels de l'eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités et la gestion des risques économiques, patrimoniaux, fiscaux, écologiques et sanitaires associés », la division de la Législation comparée du Sénat a réalisé une étude de droit comparé portant sur six pays (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie et Suisse).
La présente étude aborde diverses questions intéressant la commission d'enquête, à savoir les définitions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source, les traitements autorisés sur ces eaux d'origine naturelle, les modalités de reconnaissance officielle, les procédures d'autorisation d'exploitation, les modalités de contrôle et de surveillance des sites d'exploitation ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction. Elle mentionne également les débats présents dans l'opinion publique et les éventuels projets d'évolution des cadres juridiques.
Il ressort de cette analyse :
- l'existence d'une divergence d'approche majeure entre, d'une part, les États-Unis et d'autre part, les pays de l'Union européenne et la Suisse. Aux Etats-Unis, l'eau minérale (qui n'est pas qualifiée de « naturelle » dans la réglementation) et l'eau de source sont soumises aux mêmes normes de qualité que l'eau embouteillée provenant d'autres sources (puits artésien, réseau d'eau potable public) et peuvent, voire doivent, faire l'objet de traitements, y compris à des fins de désinfection, en vue de leur commercialisation. Le cadre juridique applicable dans l'Union européenne et en Suisse repose quant à lui sur le concept de « pureté originelle » de l'eau minérale naturelle. Les traitements autorisés y sont strictement encadrés et la désinfection est interdite ;
- en dépit d'un cadre juridique relativement strict au sein de l'Union européenne et en Suisse, la subsistance d'une certaine marge d'appréciation des autorités concernant les « autres traitements autorisés ». La microfiltration est ainsi strictement interdite en Allemagne, en Italie et en Suisse, tandis qu'elle est tolérée à partir d'un certain seuil et sous certaines conditions en Belgique et en Espagne. Dans tous les pays, les contrôles reposent à la fois sur les industriels (autocontrôle) et les autorités compétentes en matière sanitaire qui peuvent adapter leur programme de surveillance en fonction du niveau de risque.
TABLEAU DE SYNTHÈSE
|
États-Unis |
Suisse |
Allemagne |
Belgique |
Espagne |
Italie |
|
|
Consommation d'eau en bouteille (2023) |
176 litres/hab./an |
104 litres/hab./an |
140 litres/hab./an |
128 litres/hab./an |
135 litres/hab./an |
249 litres/hab./an |
|
Cadre juridique |
Réglementation fédérale sous la supervision de la FDA et réglementation spécifique des États |
Ordonnance fédérale sur les boissons alignée sur la directive 2009/54/CE |
Directive 2009/54/CE transposée dans le décret du 1er août 1984 |
Directive 2009/54/CE transposée dans l'arrêté royal de 1999. Code de l'eau en Wallonie |
Directive 2009/54/CE transposée par le décret royal n° 1798/2010 |
Directive 2009/54 transposée par le décret législatif n° 176 du 8 octobre 2011 |
|
Définitions de l'eau minérale
naturelle (EMN) et de l'eau |
L'eau minérale doit contenir au moins 250 ppm de solides dissous. L'eau de source provient d'une formation souterraine |
Définitions identiques à celles de l'UE, pureté originelle strictement encadrée |
Définitions identiques à celles de la directive 2009/54/CE |
Définitions identiques à celles de la directive 2009/54/CE |
Définitions identiques à celles de la directive 2009/54/CE |
Définitions identiques à celles de la directive 2009/54/CE, avec la mention d'éventuelles propriétés bénéfiques pour la santé des EMN |
|
Traitements autorisés |
« Traitement minimal » autorisé pour les EMN et les ES (microfiltration, ozonation ou autres traitements désinfectants) |
Traitements autorisés identiques à ceux de la directive 2009/54/CE. Interdiction des traitements désinfectants et des traitements visant à éliminer des substances anthropiques (ie. filtres à charbon) |
Traitements autorisés identiques à ceux de la directive 2009/54/CE. Microfiltration possible en tant que méthode de contrôle et d'analyse, mais pas comme procédé de traitement continu |
Traitements autorisés identiques à ceux de la directive 2009/54/CE. Microfiltration > 0,45 ìm tolérée sauf pour corriger une contamination. Ultrafiltration et osmose inverse interdites |
Traitements autorisés identiques à ceux de la directive 2009/54/CE. Microfiltration > 0,4 ìm, tolérée à des fins autres que la désinfection |
Traitements autorisés identiques à ceux de la directive 2009/54/CE. Tout traitement de « potabilisation » y compris la microfiltration interdit |
|
Reconnaissance des eaux |
Pas de procédure de reconnaissance, les États approuvent les sources |
Reconnaissance préalable par les autorités cantonales obligatoire |
Reconnaissance préalable par les autorités compétentes des Länder obligatoire |
Reconnaissance préalable par le SPF Santé publique obligatoire |
Reconnaissance préalable par les communautés autonomes obligatoire |
Reconnaissance préalable par le ministère de la santé obligatoire, renouvelable chaque année |
|
Autorisation d'exploitation |
Permis d'exploitation délivrés par les États |
Autorisation délivrée par les cantons |
Autorisation délivrée par les autorités compétentes des Länder |
Permis d'environnement requis en Wallonie |
Autorisation délivrée par les communautés autonomes |
Autorisation délivrée par les régions |
|
Contrôles et surveillance |
Autocontrôle des industriels, inspections de la FDA et des États |
Autocontrôle des industriels, inspections officielles cantonales |
Autocontrôle des exploitants et contrôles des autorités des Länder |
Autocontrôles des exploitants et contrôle par l'AFSCA et le SPF Santé publique |
Autocontrôles des exploitants et inspections régulières des autorités régionales |
Autocontrôles des exploitants et inspections régulières des autorités régionales |
|
Sanctions et mesures |
Infractions classées comme falsification avec amendes et possibles poursuites pénales |
Sanctions administratives et pénales, jusqu'à trois ans de prison en cas de mise en danger de la santé |
Sanctions en cas de non-conformité, retrait possible des autorisations |
Sanctions administratives et pénales en cas d'infractions |
Sanctions graduées selon la gravité, retrait de l'autorisation possible |
Sanctions administratives (amendes) voire peine de prison de 3 à 10 ans en cas de falsification de l'eau |
A. AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE, UN CADRE JURIDIQUE COMMUN, MAIS DES APPROCHES PLUS OU MOINS STRICTES
1. La directive 2009/54/CE du 18 juin 2009, relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
La directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009160(*) établit le cadre général concernant l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles et des eaux de source dans les États membres de l'Union européenne.
L'annexe I de la directive définit l'eau minérale naturelle comme « une eau microbiologiquement saine, au sens de l'article 5, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. L'eau minérale naturelle se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire :
« a) par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets ;
« b) par sa pureté originelle ;
« l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution ».
« La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau minérale naturelle doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles ; en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit ».
Selon l'article 9, « les termes « eau de source » sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source », qui satisfait aux conditions d'exploitation établies par la directive, aux exigences microbiologiques applicables aux eaux minérales naturelles et n'a pas subi de traitements autres que ceux autorités à l'article 4.
L'article 4 de la directive interdit « tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit » et l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source. Il liste cependant certains traitements autorisés, à condition qu'ils n'affectent pas la composition des éléments essentiels de l'eau, à savoir :
- « a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés ;
- « b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que : i) le traitement satisfasse à des conditions d'utilisation à fixer par la Commission après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments [...], ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci ;
- « c) la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point a) ou au point b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que : i) le traitement satisfasse à des conditions d'utilisation à fixer par la Commission après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ; ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci ;
- « d) l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ».
Face à l'absence d'harmonisation européenne concernant la définition du concept de « pureté originelle » et de limites maximales de contaminants dans les eaux minérales naturelles, le comité permanent des plantes, des animaux, des denrées alimentaires présidé par la Commission européenne a adopté en 2017 une liste de contaminants autorisés avec des valeurs seuils161(*).
2. L'Allemagne
Principalement sur le décret du 1er août 1984 sur l'eau minérale naturelle, l'eau de source et l'eau du robinet, qui encadre leur production, leur traitement et leur commercialisation. Ce texte transpose les exigences du droit européen, notamment la directive 2009/54/CE, et précise les critères de reconnaissance des eaux minérales naturelles et de source. La circulaire générale relative à la reconnaissance et à l'autorisation d'exploitation de l'eau minérale naturelle de 2001 détaille les démarches administratives nécessaires à l'exploitation des sources, incluant des analyses géologiques, physico-chimiques et microbiologiques. L'exploitation est soumise à une autorisation officielle garantissant la qualité et la stabilité des eaux.
Les traitements autorisés sont strictement encadrés afin de préserver les caractéristiques essentielles des eaux embouteillées. L'article 6 du décret de 1984 liste les procédés admissibles, notamment la séparation des composants instables comme le fer et le soufre par filtration ou décantation, l'élimination des composés indésirables à l'aide d'air enrichi en ozone, ainsi que l'ajout ou la suppression du dioxyde de carbone. La microfiltration est permise uniquement pour des analyses de contrôle et non comme un traitement continu. Les eaux de source peuvent également être soumises à ces traitements, sous réserve de respecter les mêmes exigences de qualité.
Les contrôles des sites d'exploitation sont assurés conjointement par les exploitants et les autorités publiques. Les producteurs doivent effectuer des analyses régulières pour garantir la stabilité physico-chimique et l'absence de contaminants microbiologiques. Les autorités des Länder supervisent le respect des conditions d'exploitation et de conditionnement, avec des contrôles périodiques et des exigences strictes en matière de protection contre les contaminations extérieures. En cas d'infractions, des mesures correctives peuvent être imposées, allant jusqu'à la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.
L'Allemagne est l'un des plus grands consommateurs d'eau en bouteille en Europe. En 2023, la consommation moyenne par habitant était de 140 litres par an, plaçant le pays au quatrième rang européen. Le marché allemand de l'eau en bouteille est l'un des plus importants au monde, avec une préférence notable pour les emballages en plastique. Dès les années 1990, l'Allemagne a été un pays pionnier en matière de recyclage, avec un système de consigne généralisée (le Pfand).
Si le cadre général de la réglementation des eaux en bouteille relève du droit fédéral, les Länder sont responsables de l'application et du contrôle de cette réglementation (délivrance des autorisations d'exploitation, contrôles sanitaires).
a) Les définitions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source
En Allemagne, les eaux en bouteille sont régies principalement par le décret du 1er août 1984 sur l'eau minérale naturelle, l'eau de source et l'eau du robinet162(*). Le décret fixe les règles applicables à la production, au traitement et à la commercialisation des eaux minérales naturelles, des eaux de source et des eaux de table. La réglementation, qui date de 1984, a intégré les exigences successives du droit européen. Par ailleurs, la circulaire générale du 9 mars 2001 relative à la reconnaissance et à l'autorisation d'exploitation de l'eau minérale naturelle163(*) précise les critères administratifs pour l'octroi de la reconnaissance officielle et de l'autorisation d'exploitation des sources d'eau minérale naturelle. Ces textes définissent notamment les caractéristiques requises pour qu'une eau soit qualifiée de « naturelle », les conditions de son extraction et de son conditionnement, ainsi que les obligations des producteurs en matière de qualité et de sécurité sanitaire.
La définition de l'eau minérale naturelle reproduit in extenso celle de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009164(*). Les articles 2 et 3 du décret de 1984 définissent l'eau minérale naturelle comme une eau ayant son origine dans des nappes souterraines protégées contre les pollutions, extraite d'une ou plusieurs sources naturelles ou forées. Elle est caractérisée par sa pureté originelle et son contenu en minéraux, oligo-éléments ou autres composants conférant éventuellement des effets nutritionnels spécifiques. Sa composition, sa température et ses caractéristiques essentielles doivent rester constantes dans les limites des variations naturelles et ne pas être modifiées par des fluctuations du débit.
L'article 10 du décret de 1984 définit l'eau de source comme une eau ayant son origine dans des nappes souterraines et prélevée à partir d'une ou plusieurs sources naturelles ou forées et qui n'a été soumise, lors de sa production, à aucun traitement ou uniquement aux procédés de traitement autorisés à l'article 6 du même décret pour les eaux en bouteille (cf. infra). Contrairement à l'eau minérale naturelle, l'eau de source ne doit pas nécessairement avoir une composition stable en minéraux, oligo-éléments et autres composants, bien qu'elle soit également soumise à des exigences de qualité microbiologique et chimique strictes.
En 2013, l'Allemagne reconnaissait près de 850 eaux minérales naturelles, dont un peu plus de 800 issues de sources allemandes165(*).
b) Les traitements autorisés
Le décret de 1984 prévoit des traitements autorisés pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source, encadrés afin de préserver leurs caractéristiques essentielles.
L'article 6 du décret de 1984 énumère de façon exhaustive les traitements autorisés pour l'eau minérale naturelle, reproduisant in extenso les dispositions de la directive de 2009. En l'espèce, les traitements autorisés sont :
- la séparation des composants instables tels que le fer et le soufre par filtration ou décantation, y compris après aération, à condition que la composition essentielle du produit ne soit pas altérée ;
- l'élimination des composés de fer, de manganèse, de soufre et d'arsenic à l'aide d'air enrichi en ozone, sous réserve que cette opération ne modifie pas la composition du produit dans ses éléments caractéristiques ;
- l'extraction partielle ou totale du dioxyde de carbone dissous par des procédés exclusivement physiques ;
- l'adjonction ou la réintroduction de dioxyde de carbone.
Le même article prévoit que la filtration fait partie des traitements autorisés à des fins de séparation de certaines substances indésirables, « à condition que la composition et les propriétés essentielles et déterminantes de l'eau minérale naturelle ne soient pas modifiées ».
Selon le ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture166(*), la microfiltration de l'eau minérale naturelle est strictement considérée comme une méthode d'analyse et de contrôle, et non comme un procédé de traitement autorisé. Aucune réglementation spécifique ne définit les modalités de cette filtration au-delà des dispositions de la directive de 2009. De plus, aucun seuil minimal n'a été fixé pour la filtration, contrairement à d'autres États membres. L'annexe 2 du décret de 1984 prévoit toutefois l'utilisation de la microfiltration (> 0,20 ìm) à des fins de vérification microbiologique, mais cette technique ne peut être employée en continu par les exploitants dans le cadre du conditionnement de l'eau minérale naturelle.
Concernant les eaux de source, selon l'article 10 du décret, elles peuvent être soumises aux mêmes procédés de traitement que les eaux minérales naturelles, notamment pour l'élimination des composés instables comme le fer, le manganèse, le soufre et l'arsenic.
c) La reconnaissance d'une eau souterraine comme eau minérale naturelle ou eau de source
La reconnaissance officielle (amtliche Anerkennung) d'une eau souterraine en tant qu'eau minérale naturelle ou eau de source repose sur une procédure distincte de l'autorisation d'exploitation. Cette reconnaissance est une condition préalable à la commercialisation et vise à garantir que l'eau répond aux critères définis par le décret de 1984.
S'agissant de l'eau minérale naturelle, l'article 3 du décret dispose qu'elle ne peut être mise sur le marché que si elle a fait l'objet d'une reconnaissance officielle délivrée sur demande par l'autorité compétente du Land où se situe la source. Cette reconnaissance est accordée dès lors que l'eau répond aux exigences fixées à l'article 2 du décret (cf. supra). L'évaluation repose sur des analyses approfondies, qui doivent être effectuées selon des méthodes scientifiques reconnues.
L'eau de source est également soumise à une procédure de reconnaissance officielle, conformément à l'article 10 du décret. Comme pour l'eau minérale naturelle, l'origine souterraine et l'absence de contamination anthropique doivent être démontrées (cf. supra).
La reconnaissance repose sur un dossier de demande présenté par l'exploitant. Ce dossier doit contenir des informations détaillées sur l'origine de l'eau, ses caractéristiques analytiques et les mesures de protection mises en place autour de la source. La circulaire générale de 2001 précise que l'évaluation est menée par l'autorité compétente, qui s'appuie sur des rapports géologiques, hydrogéologiques, physico-chimiques et microbiologiques. Cette reconnaissance est formalisée par une décision administrative qui atteste du statut d'eau minérale naturelle ou d'eau de source et conditionne sa mise sur le marché.
L'autorité compétente du Land dans lequel la source est située est responsable de la vérification de la conformité de l'eau aux prescriptions réglementaires avant l'octroi de la reconnaissance officielle. La désignation de cette autorité relève de l'organisation administrative propre à chaque Land. Dans certains cas, elle est assurée par un organisme de protection des consommateurs ou de santé publique rattaché au gouvernement régional. L'évaluation repose sur des analyses physico-chimiques et microbiologiques, dont les résultats sont soumis par l'exploitant à l'autorité compétente. L'article 4 du décret fixe les exigences microbiologiques auxquelles doit répondre l'eau minérale naturelle, en imposant notamment l'absence de germes pathogènes. L'annexe 2 du texte précise quant à elle les concentrations minimales requises pour certaines substances minérales afin de garantir leur mention sur l'étiquetage.
La liste des eaux officiellement reconnues est publiée par l'Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - BVL) au Journal officiel, avec mention du nom de la source et du lieu d'exploitation.
d) L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement
L'exploitation d'une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement est strictement encadrée par le décret de 1984. Conformément à l'article 5, une eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut être prélevée et conditionnée qu'à partir d'une source disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (Nutzungsgenehmigung).
Cette autorisation repose sur une évaluation préalable du captage et de la nappe phréatique concernée. La circulaire générale de 2001 précise que la demande doit comporter des analyses géologiques, hydrogéologiques, physico-chimiques et microbiologiques, permettant de démontrer la conformité de l'eau aux exigences réglementaires. L'exploitation ne peut être autorisée que si l'eau souterraine est reconnue comme eau minérale naturelle ou eau de source et si son captage est conçu de manière à garantir sa qualité et sa stabilité. Un modèle de la description du cadre de l'exploitation est fourni dans l'annexe 4 de la circulaire générale de 2001.
L'autorisation d'exploitation est également conditionnée au respect des prescriptions techniques et sanitaires définies dans l'annexe 1 du décret de 1984. L'annexe impose des exigences relatives à la protection du site de captage contre les risques de pollution et à la conception des infrastructures destinées à acheminer l'eau jusqu'à son site de conditionnement. L'eau doit être protégée contre toute contamination extérieure, et les installations doivent être conformes aux normes en vigueur pour éviter toute altération de sa composition naturelle.
L'eau minérale naturelle qui n'est pas consommée immédiatement après son prélèvement ou après un traitement autorisé doit obligatoirement être mise en bouteille à la source, sans possibilité de transport préalable dans d'autres récipients avant son conditionnement définitif destiné au consommateur final, conformément à l'article 7 du décret de 1984.
e) Le retrait de la reconnaissance et/ou de l'autorisation d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou eau de source
Le retrait de l'autorisation d'exploitation d'une source, qu'il s'agisse d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source, intervient dès lors que l'autorité compétente constate une modification des conditions initiales ayant justifié son octroi. Cela peut inclure une pollution avérée de la source, une modification de la qualité de l'eau ne permettant plus de respecter les critères réglementaires ou encore un non-respect des obligations imposées à l'exploitant.
À ce titre, la jurisprudence administrative valide une application stricte du droit.
La Cour administrative du Bade-Wurtemberg, dans sa décision du 20 juin 2013167(*), a confirmé qu'une contamination par des métabolites de pesticides, même en quantité infime, pouvait justifier le retrait de la reconnaissance d'une eau minérale naturelle. L'absence d'une norme explicite pour ces substances ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de garantir la pureté originelle de l'eau. Ce retrait peut être fondé sur l'interprétation stricte des exigences réglementaires et sur l'application du principe de précaution.
La Cour administrative supérieure de Berlin-Brandebourg, dans sa décision du 27 mai 2008168(*), a quant à elle statué sur le retrait d'une autorisation d'exploitation en raison de l'incapacité de l'exploitant à garantir la conformité permanente de l'eau aux normes en vigueur.
Enfin, les annexes au décret de 1984 précisent que toute modification de l'environnement de la source ou toute découverte de nouveaux éléments susceptibles d'altérer la qualité de l'eau peuvent conduire à un réexamen de son statut. Si la conformité aux critères initiaux ne peut être garantie, la reconnaissance ou l'autorisation d'exploitation peut être retirée.
f) Les modalités de contrôle et de surveillance des sites d'exploitation
Le contrôle et la surveillance des sites d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source reposent sur une responsabilité partagée entre les exploitants et les autorités publiques. Cette surveillance vise à garantir la qualité sanitaire des eaux exploitées, à vérifier le respect des conditions de captage et de conditionnement, et à prévenir toute contamination pouvant altérer la conformité de l'eau aux critères réglementaires.
Les exploitants sont tenus d'assurer un suivi rigoureux de la qualité de l'eau qu'ils prélèvent et conditionnent. Ils doivent réaliser des analyses régulières pour vérifier la stabilité de la composition physico-chimique et l'absence de contaminants microbiologiques. L'article 4 du décret de 1984 impose ainsi des exigences strictes en matière de qualité microbiologique, notamment en interdisant la présence de germes pathogènes et en fixant des seuils limites pour certaines bactéries indicatrices (cf. supra).
En parallèle, les autorités compétentes des Länder exercent une supervision indépendante pour garantir que les conditions d'exploitation et de captage sont conformes aux exigences réglementaires. L'article 5 du décret prévoit que l'exploitation d'une source est soumise à des contrôles périodiques afin de s'assurer du respect des critères réglementaires. Cette surveillance porte notamment sur la stabilité de la qualité de l'eau au point de prélèvement, la conformité des infrastructures de captage et la mise en oeuvre des mesures de protection contre les risques de contamination extérieure.
À l'échelle fédérale, le code des denrées alimentaires et de l'alimentation pour animaux169(*) encadre la sécurité alimentaire, y compris la surveillance des eaux embouteillées. En vertu de l'article 42, le ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture est habilité à légiférer par voie réglementaire pour préciser les qualifications et les exigences de formation des experts en charge des contrôles sanitaires sur l'eau embouteillée. Toutefois, l'application concrète des contrôles relève des autorités des Länder, qui sont généralement des offices régionaux rattachés aux ministères régionaux de la santé ou de la protection des consommateurs170(*).
Les annexes au décret précisent les paramètres qui doivent être contrôlés régulièrement, en particulier la stabilité de la composition de l'eau, le suivi des niveaux de contamination chimique et la conformité aux seuils réglementaires pour divers éléments présents dans l'eau. Ces annexes détaillent également les conditions de surveillance des infrastructures et les mesures de prévention à appliquer pour garantir l'intégrité des captages et éviter toute altération de la qualité de l'eau.
Toute anomalie constatée lors des contrôles peut donner lieu à des mesures correctives imposées à l'exploitant. Ces mesures peuvent inclure des obligations de mise en conformité, la suspension temporaire de l'exploitation de la source ou, en cas de manquements graves ou persistants, le retrait de l'autorisation d'exploitation.
g) Les sanctions administratives et/ou judiciaires
En Allemagne, les sanctions administratives et judiciaires applicables en cas de dysfonctionnements dans l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle ou d'une eau de source peuvent prendre la forme de mesures administratives correctives, de sanctions financières, de restrictions d'exploitation ou, dans les cas les plus graves, de poursuites pénales.
(1) Les sanctions administratives
Les autorités compétentes des Länder disposent de plusieurs leviers d'intervention en cas de non-respect des obligations réglementaires par un exploitant. En vertu de l'article 16 du décret de 1984, la mise sur le marché d'une eau ne remplissant pas les critères légaux ou ne respectant pas les conditions de production et de conditionnement est interdite. Les autorités peuvent ainsi suspendre temporairement la commercialisation d'une eau concernée ou, en cas de non-conformité persistante, exiger la cessation de l'exploitation de la source.
En cas d'irrégularités affectant la reconnaissance officielle d'une eau ou l'autorisation d'exploitation d'une source, l'administration peut prendre deux types de décisions sur le fondement de la loi sur les procédures administratives171(*) :
- d'une part, le retrait de l'acte administratif si celui-ci était illégal dès l'origine, notamment s'il a été accordé sur la base d'informations erronées ou incomplètes (article 48) ;
- et, d'autre part, la révocation de l'acte administratif lorsqu'il était initialement légal, mais que des faits nouveaux, tels qu'une contamination ou un risque pour la santé publique, justifient son annulation pour des raisons d'intérêt général (article 49).
Les annexes au décret de 1984 précisent les circonstances pouvant justifier une intervention des autorités sanitaires. Elles établissent que toute altération de la qualité de l'eau liée à un défaut d'exploitation peut entraîner la suspension de l'autorisation d'exploitation et la mise en place d'un plan d'action correctif. Si les non-conformités ne sont pas corrigées dans les délais imposés, la révocation de l'autorisation peut être décidée.
Enfin, en cas de non-conformité détectée après la mise sur le marché, les autorités sanitaires des Länder peuvent imposer des mesures correctives à l'exploitant. L'article 5 du code des denrées alimentaires et de l'alimentation pour animaux (LFGB)172(*) impose aux exploitants du secteur alimentaire l'obligation de garantir la sécurité des produits qu'ils commercialisent. En cas de détection d'un risque lié à un produit déjà distribué, l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un danger pour la santé publique, notamment en procédant au retrait ou au rappel des lots concernés.
Conformément à l'article 39 du LFGB173(*), les autorités de surveillance alimentaire des Länder sont habilitées à ordonner des mesures appropriées pour remédier aux infractions constatées. Ces mesures peuvent inclure l'interdiction de la commercialisation d'une eau non conforme, l'obligation pour l'exploitant de retirer du marché les produits concernés et, si nécessaire, d'organiser un rappel officiel des lots distribués afin d'informer les consommateurs du risque potentiel. Si l'exploitant ne respecte pas ces mesures administratives imposées par les autorités compétentes des Länder en cas d'infractions (cf. supra), il s'expose aux sanctions prévues par l'article 60 du LFGB. Ces sanctions peuvent inclure une amende ou, en cas d'infraction grave mettant en danger la santé publique, une peine d'emprisonnement.
(2) Les sanctions judiciaires
Le non-respect des obligations réglementaires en matière d'exploitation et de commercialisation des eaux embouteillées peut également entraîner des sanctions pénales. L'article 17 du décret de 1984 prévoit que la commercialisation intentionnelle d'une eau ne respectant pas les normes légales est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement, assortie d'une amende. En cas de négligence simple, l'exploitant encourt principalement une amende, sauf si la mise en danger de la santé publique est avérée, auquel cas des poursuites pénales peuvent être engagées. La jurisprudence montre une application effective de ces sanctions (cf. supra).
h) Mesures récentes et actualité du sujet
Les débats allemands autour des eaux en bouteilles concernent principalement ses enjeux environnementaux. La présence de polluants persistants dans l'eau potable.
Parallèlement, la qualité de l'eau potable en Allemagne est questionnée en raison de la présence de polluants persistants, notamment les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces « polluants éternels » sont utilisés dans divers produits industriels et ménagers en raison de leur résistance à la chaleur et à l'eau. Cependant, leur persistance dans l'environnement et leur accumulation dans les organismes posent des risques pour la santé174(*).
Des études ont révélé des concentrations de PFAS dans plusieurs sources d'eau potable en Allemagne. Bien que les niveaux détectés respectent généralement les normes actuelles, leur présence soulève des inquiétudes quant aux effets à long terme sur la santé humaine. Certaines organisations environnementales appellent à des réglementations plus strictes et à une responsabilité accrue des fabricants pour la contamination par les PFAS175(*). Un autre contaminant préoccupant est l'acide trifluoroacétique (TFA), un sous-produit de certains pesticides et produits pharmaceutiques. Le TFA est extrêmement stable et difficile à éliminer de l'eau potable. Des concentrations notables de TFA ont été détectées dans certaines régions, notamment en Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Bien que les niveaux actuels soient inférieurs aux seuils de sécurité, la persistance et l'accumulation potentielles du TFA nécessitent une surveillance continue176(*).
Les recherches n'ont pas mis en évidence de modification récente ou à venir de la réglementation, liée à de nouveaux enjeux sanitaires.
2. La Belgique
En Belgique, la réglementation des eaux en bouteille repose principalement sur un arrêté de 1999, qui fixe les critères de reconnaissance, les conditions d'exploitation et les traitements autorisés. Ce cadre a été complété par d'autres arrêtés de 2003 et 2021 pour aligner la législation belge sur les évolutions européennes. La gestion de l'eau étant régionalisée, la Wallonie applique en complément un code de l'eau, qui encadre les prélèvements, les volumes autorisés et les mesures de protection des captages. L'exploitation d'une source nécessite un permis d'environnement, classé en fonction de l'impact de l'installation, et une autorisation de commercialisation délivrée par le SPF Santé Publique.
Les traitements autorisés sont strictement encadrés afin de préserver la composition originelle des eaux embouteillées. La réglementation interdit toute modification chimique et ne permet que des procédés physiques comme la séparation des composants instables (fer, soufre, arsenic) par filtration ou décantation. L'usage d'air enrichi en ozone est autorisé pour éliminer certaines substances sous conditions strictes. La microfiltration est tolérée à partir de 0,45 um, mais ne peut être utilisée pour corriger une contamination. Toute technique susceptible d'altérer la composition minérale, comme l'ultrafiltration ou l'osmose inverse, est interdite.
Le contrôle des eaux en bouteille est assuré par le SPF Santé publique et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Les exploitants doivent effectuer des analyses régulières à la source et sur les produits finis, tandis que l'AFSCA réalise des inspections et des prélèvements systématiques. Les établissements doivent disposer d'un système d'autocontrôle validé pour espacer les contrôles officiels. En cas de non-conformité, des mesures peuvent être imposées, allant du simple avertissement au retrait du marché des produits concernés.
La Belgique est l'un des plus grands consommateurs d'eau en bouteille en Europe, avec une consommation moyenne estimée à 128 litres par an et par habitant en 2023177(*). Les Belges privilégient largement l'eau minérale et l'eau de source, qui représentent 98,2 % de la consommation178(*).
L'État fédéral y régule la mise sur le marché et la qualité sanitaire des eaux embouteillées, tandis que les régions sont responsables de l'exploitation des sources et de la gestion des ressources en eau.
a) Les définitions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source
La directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009179(*) établit le cadre général que les États membres doivent suivre.
Au niveau national, les eaux en bouteille sont régies principalement par l'arrêté royal du 8 février 1999180(*). Cet arrêté établit les critères de reconnaissance des eaux minérales naturelles et des eaux de source, ainsi que les conditions d'exploitation des sources. Des modifications ultérieures ont été apportées, notamment par l'arrêté royal du 15 décembre 2003 et l'arrêté royal du 2 avril 2021. Les modifications apportées par ce dernier visaient à aligner la législation belge sur les évolutions européennes et à intégrer de nouvelles dispositions concernant la reconnaissance, l'exploitation et l'étiquetage des EMN et des ES.
Sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté de 1999, les autorités belges définissent les EMN et les ES de la façon suivante :
- les eaux minérales naturelles se distinguent par leur pureté originelle et leur composition minérale stable, pouvant avoir des effets bénéfiques sur la santé. Elles doivent être reconnues par le Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique181(*) ;
- les eaux de source proviennent également de nappes souterraines et doivent être potables à l'état naturel. Contrairement aux eaux minérales naturelles, la stabilité de leur composition n'est pas requise182(*).
En Belgique, la gestion de l'eau est en grande partie régionalisée, notamment en ce qui concerne l'exploitation des ressources en eau. En Wallonie, la gestion de l'eau est encadrée par le code de l'eau183(*), qui constitue le livre II du code de l'environnement. Celui-ci encadre les conditions d'exploitation des eaux souterraines, y compris les EMN et ES, les mesures de protection des captages, le respect des volumes de prélèvement autorisés et les sanctions en cas d'infraction aux réglementations environnementales, notamment son article D.2.
b) Les traitements autorisés
(1) Au niveau fédéral
Les eaux minérales naturelles ne peuvent subir que des traitements limités, tels que l'élimination des éléments instables par des procédés physiques, la séparation des composés instables comme le fer, le manganèse, le soufre et l'arsenic, ainsi que la séparation des particules en suspension par filtration ou décantation184(*).
Les eaux de source peuvent également être traitées, mais uniquement par des procédés physiques autorisés, tels que la séparation des matières en suspension et des composés instables185(*).
C'est l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source qui établit les normes de qualité, les conditions d'exploitation, les traitements autorisés, les exigences d'étiquetage et les procédures d'autorisation pour la mise sur le marché des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Il prévoit notamment :
- que les eaux minérales naturelles et les eaux de source doivent être microbiologiquement pures à l'émergence et protégées contre toute contamination (article 2, annexe II) ;
- l'interdiction de tout traitement chimique susceptible de modifier leur qualité originelle et n'autorise que certains procédés physiques, à condition qu'ils ne modifient pas la composition essentielle de l'eau (article 4, annexe IV) ;
- que seuls quelques traitements sont permis, notamment la séparation des éléments instables, tels que le fer, le manganèse, le soufre et l'arsenic, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation. Ces traitements doivent être réalisés sans altérer les caractéristiques essentielles de l'eau (annexe IV, point 1) ;
- que l'usage de l'air enrichi en ozone est autorisé pour éliminer certains composés, comme le fer et l'arsenic, mais uniquement si ce traitement ne modifie pas la composition minérale essentielle et s'il est déclaré aux autorités compétentes. De plus, le ministre chargé de la Santé publique peut déterminer les conditions précises que doit respecter ce traitement (annexe IV, point 2) ;
- que toute modification chimique de la composition originelle de l'eau est interdite. Les techniques visant à éliminer certaines substances spécifiques, comme l'alumine activée pour la réduction du fluor, ne sont pas mentionnées comme autorisées dans l'arrêté, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être utilisées que si la législation européenne les prévoit explicitement (annexe IV) ;
- que l'ajout de substances désinfectantes ou tout procédé de stérilisation chimique est formellement interdit. L'eau doit conserver ses propriétés naturelles, sans ajout d'éléments bactériostatiques ni toute autre méthode visant à modifier son équilibre microbiologique (article 4, annexe IV).
Selon une communication du SPF Santé publique186(*), la microfiltration est tolérée à condition qu'elle n'entraîne pas une modification significative de la microflore naturelle de l'eau. La réglementation impose que la porosité des membranes de filtration ne soit pas inférieure à 0,45 um. Ce seuil est fixé pour éviter tout effet assimilable à une désinfection, qui est strictement interdite. En conséquence, les filtres validés comme stérilisants selon les directives ASTM F-838 sont prohibés, car ils pourraient réduire la charge microbienne de manière excessive. De plus, il est interdit d'utiliser la microfiltration pour corriger une contamination de l'eau après son émergence. Ce procédé ne peut pas être employé pour éliminer des coliformes ou d'autres bactéries pathogènes, ni pour prévenir la formation de biofilms bactériens dans les installations. L'exploitant doit être en mesure de prouver, par des documents et analyses, que l'application de la microfiltration ne modifie pas la composition de l'eau en éléments essentiels. Le SPF Santé publique indiquait, au 16 mai 2024, n'avoir « reçu aucune notification en ce qui concerne l'utilisation de ce traitement, donc son utilisation n'est pas autorisée ».
Au-delà de la microfiltration, la législation belge interdit d'autres techniques de traitement, comme l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse, qui pourraient altérer la composition minérale de l'eau. Toute eau ayant subi un traitement non autorisé ne peut être commercialisée et peut être retirée du marché en cas de non-conformité aux exigences légales.
(2) En Wallonie
L'article D.2 du code de l'eau187(*) définit les principes de protection des eaux souterraines et fixe les règles applicables aux prélèvements d'eau.
L'article R.214 prévoit que « les titulaires d'une autorisation de prélèvement d'eau sont tenus de réaliser des analyses périodiques de la qualité de l'eau prélevée et de transmettre les résultats à l'administration ». Il définit donc un régime de contrôle renforcé des sources exploitées pour la production d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source, en imposant des analyses régulières pour garantir le respect des normes de qualité et des conditions d'exploitation définies par l'arrêté royal du 8 février 1999.
c) La reconnaissance d'une eau souterraine comme eau minérale naturelle ou eau de source
· Les eaux minérales naturelles
L'article 2 (§1er), de l'arrêté royal du 8 février 1999 pose l'exigence selon laquelle « Toute eau souterraine destinée à être commercialisée sous l'appellation d'eau minérale naturelle doit obtenir une autorisation préalable délivrée par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ».
L'autorisation de commercialisation d'une eau minérale naturelle est accordée par le ministre en charge de la Santé publique, après évaluation par l'Inspection générale des Denrées alimentaires, qui tient compte de l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène. Le dossier soumis doit démontrer que l'eau respecte les critères définis à l'article 1er (2°) de l'arrêté royal du 8 février 1999, à savoir : une origine souterraine protégée contre les risques de pollution, une composition minérale stable dans le temps malgré les fluctuations naturelles, ainsi qu'une pureté originelle exempte de toute contamination chimique ou bactériologique.
La démonstration de ces critères repose sur des analyses chimiques et microbiologiques détaillées visant à garantir la stabilité de la composition et l'absence de contaminants. L'annexe II de l'arrêté du 8 février 1999 fixe ces critères microbiologiques, en exigeant notamment l'absence de micro-organismes pathogènes et en limitant strictement le nombre de bactéries revivifiables après embouteillage. L'annexe III impose des contrôles réguliers sur la composition analytique de l'eau, incluant des analyses détaillées des constituants chimiques et des oligo-éléments. Ces dispositions assurent que seules les eaux répondant aux normes de pureté et de stabilité les plus strictes puissent être reconnues comme eaux minérales naturelles et mises sur le marché.
· Les eaux de source
Concernant les eaux de source, leur reconnaissance suit une procédure différente. L'article 2 (§3) de l'arrêté du 8 février 1999 prévoit que la mise dans le commerce d'une eau de source est subordonnée à la fourniture d'une attestation délivrée par les autorités sanitaires compétentes du pays d'origine. Cette attestation doit certifier que l'eau remplit les critères requis et doit préciser le nom et l'emplacement de la source ainsi que la composition chimique et microbiologique de l'eau. Contrairement aux eaux minérales naturelles, les eaux de source ne sont pas soumises à l'exigence de stabilité de composition. Toutefois, elles doivent être propres à la consommation humaine dans leur état naturel, sans nécessiter de désinfection ou de modification chimique. Elles doivent également être conditionnées directement sur le lieu de captage, comme l'exige l'article 4 (3°) du même arrêté.
d) L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement
En Wallonie, l'exploitation d'une source d'eau souterraine destinée au conditionnement, est également régie par le code de l'eau.
Selon l'article D.1er (§1er), « l'eau fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable et en prenant en compte les adaptations au changement climatique ».
Conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement188(*), pour exploiter une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement, il est impératif d'obtenir un « permis d'environnement ». Les modalités d'obtention de ce permis sont définies à l'article 3, lequel classe les installations en trois catégories, en fonction de leur impact environnemental :
- classe 1 : installations à impact élevé, nécessitant un permis délivré par le fonctionnaire délégué ou le collège communal après enquête publique ;
- classe 2 : installations à impact modéré, requérant un permis délivré par le collège communal, généralement sans enquête publique ;
- classe 3 : installations à impact faible, soumises à une simple déclaration auprès de l'administration communale.
La classification spécifique d'une installation de captage d'eau souterraine dépend de critères tels que le volume prélevé et l'usage de l'eau. Par exemple, le forage (rubrique 45.12.02) et l'exploitation d'un captage d'eau souterraine (rubrique 41.00) sont soumis à permis d'environnement et peuvent aussi nécessiter un permis d'urbanisme, notamment pour le forage et l'équipement du puits189(*).
Une fois le permis obtenu, l'exploitant doit se conformer aux conditions sectorielles définies par l'arrêté du 12 février 2009190(*), qui établit les conditions intégrales relatives aux installations de prise d'eau souterraine. Ces conditions incluent, entre autres, l'obligation d'installer un panneau conforme visible depuis tous les accès à la zone de prise d'eau et la mise en place d'une enceinte de protection contre les intrusions.
De plus, l'exploitant est tenu de déclarer annuellement les volumes d'eau prélevés et leurs usages au Service Public de Wallonie, au plus tard le 31 mars de chaque année. Cette déclaration permet de calculer la taxe relative au prélèvement d'eau, conformément aux dispositions fiscales du code de l'eau191(*).
En Wallonie, le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables192(*), complété par l'arrêté du 14 novembre 1991193(*), établit des zones de protection autour des captages d'eau. Ces zones, classées en zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, imposent des restrictions d'activités pour prévenir toute contamination des ressources en eau. Les exploitants doivent respecter ces zones et les mesures associées pour protéger la nappe phréatique contre les sources potentielles de pollution. La réglementation définit trois zones de protection autour d'un captage d'eau souterraine : une zone de prise d'eau (10 m autour des installations, une zone de prévention rapprochée (jusqu'à 24 h de temps de transfert, soit 35 m pour les puits et 25 m pour les galeries) et une zone de prévention éloignée (jusqu'à 50 jours de temps de transfert, ajustable selon les études hydrogéologiques). Ces zones permettent d'assurer une protection progressive contre les risques de contamination en fonction de la vitesse de déplacement de l'eau souterraine vers le captage194(*).
e) Le retrait de la reconnaissance et/ou de l'autorisation d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou eau de source
L'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1999 précise que les eaux mises sur le marché en violation des règles établies peuvent être déclarées nuisibles. Cela concerne notamment les eaux provenant d'une source non autorisée, celles dont l'autorisation d'exploitation a été retirée ou encore celles qui ne respectent pas les critères de qualité définis à l'article 4. Dans ces cas, leur commercialisation est interdite.
L'article 3 (§3) prévoit que l'autorisation de mise dans le commerce d'une eau minérale naturelle peut être retirée si certaines obligations ne sont pas respectées, notamment l'exigence de conditionnement sur le lieu de captage et le respect des critères de qualité établis dans l'annexe du présent arrêté.
f) Les modalités de contrôle et de surveillance des sites d'exploitation
Le contrôle des eaux en bouteille est assuré par le SPF Santé publique et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).
Les producteurs d'eau minérale naturelle doivent prélever des échantillons directement à la source ainsi que sur les produits finis en bouteille. Ces prélèvements sont ensuite envoyés à des laboratoires agréés, qui analysent la présence de diverses substances dans l'eau195(*). Les résultats obtenus sont transmis au SPF Santé publique, qui assure un suivi annuel de l'évolution des composants présents dans l'eau minérale naturelle196(*).
L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) assure un contrôle strict des eaux embouteillées en Belgique à travers des inspections régulières et un programme d'analyse rigoureux. Chaque année, près de 300 échantillons sont prélevés pour évaluer divers paramètres, notamment les substances chimiques, les contaminants biologiques et les résidus de polluants, avec un accent particulier sur les pesticides, bactéries pathogènes et parasites. Entre 2021 et 2023, plus de 1 000 échantillons ont été analysés dans le cadre du programme de contrôle, affichant un taux de conformité supérieur à 99 %. En 2024, 267 échantillons ont été examinés, avec un taux de conformité de 99,6 %197(*).
Les contrôles se déclinent en un échantillonnage aléatoire et des inspections systématiques auprès des producteurs d'eau belges. Chaque établissement de la chaîne alimentaire doit être enregistré auprès de l'AFSCA et fait l'objet de contrôles dont la fréquence dépend du niveau de risque de l'activité : un fabricant d'eau potable conditionnée est inspecté tous les deux ans en fréquence de base, ou tous les quatre ans en fréquence réduite s'il dispose d'un système d'autocontrôle validé. Par ailleurs, l'AFSCA intervient en réponse aux plaintes et notifications des consommateurs, laboratoires et autres acteurs du secteur198(*).
Le programme de contrôle, mis à jour annuellement, repose sur des critères objectifs et statistiques, complétés par des actions spécifiques et des contrôles inopinés. Toutefois, la conformité aux normes réglementaires relève en premier lieu de la responsabilité des opérateurs, qui doivent établir et suivre un plan de contrôle interne, incluant des analyses adaptées à leurs conditions de production. Ils doivent notamment identifier les pesticides pertinents à surveiller en fonction de leur environnement et des spécificités du sous-sol, ce qui peut aller au-delà des exigences du programme de l'AFSCA.
La répartition des compétences entre l'AFSCA et le SPF Santé Publique s'appuie sur un protocole général régulièrement actualisé pour assurer une surveillance cohérente du secteur des eaux embouteillées.
L'AFSCA veille au respect des exigences relatives au traitement des eaux minérales naturelles par les exploitants. En cas d'infraction, le SPF Santé publique est informé et l'entreprise concernée doit procéder aux ajustements nécessaires. Lorsque des non-conformités présentant un risque pour la santé des consommateurs sont détectées, des mesures immédiates peuvent être prises, notamment le retrait du marché ou le rappel des produits concernés.
Les inspections de l'AFSCA peuvent entraîner différentes mesures en fonction de la gravité des infractions : un avertissement (AV) pour des infractions mineures, un procès-verbal (PV) en cas d'infraction grave, la saisie définitive des produits (SD) ou encore la fermeture temporaire (FT) de l'établissement. Les procédures de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation sont définies par l'arrêté royal du 16 janvier 2006199(*), notamment ses articles 13 à 16. Toutefois, aucune suspension ni retrait d'autorisation n'a été enregistré ces dernières années pour les fabricants d'eau. Les retraits d'agréments, quant à eux, relèvent du SPF Santé publique200(*).
En Wallonie, le Service public de Wallonie (SPW) exerce un rôle de surveillance des prélèvements d'eau et de leur impact environnemental. Selon le site officiel de l'État de l'environnement wallon, en 2020, la Wallonie a prélevé environ 1 430 millions de m d'eau dans ses cours d'eau et nappes souterraines. Ces données sont collectées et analysées par le SPW, qui évalue les volumes prélevés et leur utilisation, notamment pour la distribution publique, les industries et l'agriculture. Cette surveillance permet d'assurer une gestion durable des ressources en eau et de limiter les impacts environnementaux liés aux prélèvements201(*).
g) Les sanctions administratives et/ou judiciaires
L'arrêté royal du 8 février 1999 prévoit plusieurs sanctions administratives et judiciaires en cas de dysfonctionnements constatés dans l'exploitation :
- en vertu de l'article 11, toute infraction aux dispositions relatives aux conditions d'exploitation et aux obligations des exploitants (articles 2 à 9) est recherchée, poursuivie et punie conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en matière de denrées alimentaires et autres produits. Cette loi prévoit des sanctions pouvant inclure des amendes et des poursuites judiciaires en cas de manquement grave mettant en danger la santé publique ;
- l'article 12 prévoit que les infractions liées aux pratiques commerciales et aux obligations d'étiquetage (article 10) sont également poursuivies et sanctionnées conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur.
Par ailleurs, le code de l'eau wallon prévoit également plusieurs types d'infractions :
- l'article D.396 dispose que toute infraction à un règlement ou une mesure d'interdiction pris en vertu des articles D.167 et D.173 constitue une infraction de deuxième catégorie202(*). Cela inclut les forages non autorisés et les infractions relatives aux interdictions de rejets directs dans les eaux souterraines ;
- l'article D.397 qualifie de troisième catégorie les infractions consistant à ne pas fournir les renseignements requis par les autorités compétentes dans le cadre de l'application du code de l'eau ;
- l'article D.402 mentionne que toute violation de l'obligation de contribution prévue par l'article D.328 du code de l'environnement est considérée comme une infraction de troisième catégorie ;
- concernant les dommages liés aux prélèvements d'eau souterraine, l'article D.402 précise que les infractions relatives aux obligations de contribution en cas de pompage sont sanctionnées, et le non-respect des prescriptions établies peut entraîner des sanctions administratives et judiciaires ;
- le code prévoit enfin un régime de sanctions en cas d'atteintes aux eaux de surface et à la qualité de l'eau, notamment en ce qui concerne les infractions aux obligations de traitement et d'assainissement.
h) Mesures récentes et actualité du sujet
Ces dernières années, la Belgique, et plus particulièrement la Région wallonne, a pris des mesures spécifiques en matière de réglementation des eaux en bouteille à la suite de préoccupations liées à la contamination par des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces substances chimiques, largement utilisées dans l'industrie pour leurs propriétés antiadhésives et hydrofuges, sont particulièrement préoccupantes en raison de leur persistance dans l'environnement et de leurs effets potentiellement nocifs sur la santé humaine.
En 2024, une étude a révélé que 40 zones de distribution d'eau potable de Wallonie dépassaient les recommandations du Conseil supérieur de la Santé en matière de PFAS. Cette contamination a été détectée dans plusieurs communes et a suscité une réaction des autorités régionales203(*).
Face à cette situation, le gouvernement wallon a lancé une série de tests biomédicaux afin de mesurer l'imprégnation des populations locales aux PFAS, en comparant les concentrations sanguines relevées avec celles issues du biomonitoring de 2021204(*). L'objectif était d'identifier les zones nécessitant une intervention prioritaire et de déterminer si des restrictions supplémentaires devaient être imposées aux exploitants de sources embouteillant l'eau en Wallonie. Le Gouvernement wallon a précisé que les autorités envisageaient d'établir des normes plus strictes pour les eaux destinées à la consommation humaine.
En parallèle, le Conseil supérieur de la Santé a décidé d'examiner l'opportunité de fixer des limites précises de PFAS dans les eaux en bouteille, une question jusqu'ici peu réglementée. Actuellement, les normes belges et européennes encadrant la qualité des eaux embouteillées fixent des seuils pour divers contaminants chimiques et microbiologiques, mais les PFAS n'y figurent pas encore de manière spécifique205(*). Ce vide juridique a conduit le Conseil supérieur de la Santé à publier en février 2024 un avis recommandant la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, en cohérence avec les recommandations scientifiques les plus récentes206(*).
Des évolutions sont attendues sur le plan réglementaire, avec l'objectif d'intégrer des paramètres liés aux PFAS dans la liste des contaminants surveillés, avec des seuils similaires à ceux proposés pour l'eau potable dans le cadre de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
En Région wallonne, cette directive a été transposée par le décret du 20 avril 2023207(*) et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1?? juin 2023, qui prévoient qu'au plus tard le 12 janvier 2026, des mesures seront mises en place pour garantir que la teneur en PFAS dans l'eau ne dépasse pas 100 ng/l208(*). Bien que cette réglementation vise principalement l'eau potable, elle témoigne d'une volonté d'encadrer strictement la présence de PFAS dans les ressources hydriques et pourrait servir de base pour une réglementation similaire concernant les eaux embouteillées. Dans cette optique, l'avis publié en février 2024 par le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) recommande l'établissement de valeurs limites pour les PFAS et le perchlorate dans l'eau en bouteille. Il propose d'introduire, au niveau national, une valeur limite de 13 ug/L pour le perchlorate dans l'eau embouteillée afin de protéger la santé des consommateurs, en particulier des populations sensibles209(*).
Par ailleurs, la question de la pollution aux PFAS a fait l'objet de débats au Parlement wallon. En novembre 2023, un débat extraordinaire a été organisé au sein de la commission Environnement, auquel était associée la ministre de l'environnement, Mme Céline Tellier. Ce débat a mis en lumière les préoccupations croissantes des autorités et des citoyens quant à l'impact sanitaire et environnemental de ces substances et a conduit à une réflexion sur la nécessité d'adopter des mesures réglementaires plus strictes210(*).
4) L'Espagne
La réglementation espagnole sur les eaux en bouteille repose sur la directive européenne 2009/54/CE et le décret royal n° 1798/2010 du 30 décembre 2010. Ce cadre définit précisément l'eau minérale naturelle et l'eau de source, toutes deux issues de gisements souterrains et protégées contre la contamination. L'eau minérale naturelle se distingue par sa composition stable et sa pureté originelle, tandis que l'eau de source doit conserver ses caractéristiques naturelles sans traitement chimique.
Les traitements des eaux en bouteille sont strictement encadrés afin de préserver la composition originelle de l'eau. Sont autorisées uniquement les interventions énumérées par la directive 2009/54/CE. Toute modification chimique susceptible d'altérer la nature de l'eau est interdite. En 2009, le ministère de la santé espagnole a ainsi précisé que la microfiltration avec un filtre d'une taille inférieure à 0,4 micromètre est interdite, en ce qu'elle est assimilable à une désinfection. Les traitements doivent être contrôlés par les autorités sanitaires, qui veillent à ce qu'aucune altération ne compromette la qualité et la pureté de l'eau. En cas de non-respect, l'exploitation peut être suspendue ou révoquée.
Les exploitants doivent réaliser des autocontrôles réguliers : analyses quotidiennes sur la qualité microbiologique, contrôles trimestriels des composants chimiques et audits approfondis tous les cinq ans. Les autorités compétentes effectuent également des contrôles afin de vérifier la conformité des installations et le respect des normes sanitaires. En cas de manquement, des sanctions administratives et financières peuvent être appliquées, pouvant aller jusqu'au retrait définitif de l'autorisation d'exploitation.
En 2023, la consommation d'eau en bouteille en Espagne était de plus de 6 500 millions de litres, soit 135 litres/habitant, faisant de l'Espagne le cinquième plus gros consommateur d'eau en bouteille par habitant au sein de l'Union européenne211(*).
Si l'État fixe les règles générales sur les eaux en bouteille, les communautés autonomes sont compétentes pour reconnaître les eaux minérales et de source, délivrer les autorisations d'exploitation et assurer les contrôles sur le terrain.
a) Les définitions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source
Les définitions juridiques de l'eau minérale naturelle (agua mineral natural) et de l'eau de source (agua de manantial) sont strictement alignées sur celles de la directive 2009/54/CE.
En droit interne, l'eau minérale naturelle et l'eau de source sont définies par le décret royal n° 1798/2010 du 30 décembre 2010212(*), qui régule leur exploitation et leur commercialisation en Espagne.
Selon l'article 2, l'eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, provenant d'un gisement ou d'une couche souterraine, et qui jaillit à la surface de manière naturelle ou peut être captée artificiellement par forage, puits, tranchée ou galerie. Elle se distingue des autres eaux de boisson par sa composition spécifique, caractérisée par la présence de minéraux, d'oligo-éléments et d'autres composants, par sa constance chimique et par sa pureté originelle, garantie par son origine souterraine qui la protège naturellement contre toute contamination. L'utilisation de cette dénomination est soumise au respect des caractéristiques établies dans la partie A de l'annexe I du décret et nécessite une déclaration et une autorisation conformément à l'article 3.
L'eau de source est définie, par le même article, comme une eau d'origine souterraine qui émerge spontanément à la surface ou qui peut être captée par des aménagements spécifiques. Elle doit présenter des caractéristiques naturelles de pureté permettant sa consommation directe et conserver cette pureté intacte grâce à la protection naturelle de l'aquifère contre toute contamination. Pour être commercialisée sous cette appellation, elle doit répondre aux exigences établies dans la partie B de l'annexe I du décret et satisfaire aux conditions de déclaration et d'autorisation prévues à l'article 3.
b) Les traitements autorisés
Les traitements autorisés en Espagne pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source s'inscrivent également dans le cadre fixé par la directive 2009/54/CE, qui vise à préserver l'intégrité chimique et microbiologique de ces eaux. Seules des interventions strictement encadrées, telles que l'élimination de certains éléments indésirables comme le soufre ou le fer, par filtration, décantation ou le traitement par air enrichi en ozone et l'ajustement du gaz carbonique, sont permises. Toute autre manipulation susceptible de modifier la composition originelle de l'eau est interdite, conformément à l'exigence de pureté imposée par la réglementation européenne. Les dispositions de la directive 2009/54/CE ont ainsi été reprises à l'identique dans le droit espagnol par le décret de 2010, qui impose également un contrôle spécifique des autorités sanitaires compétentes sur ce type de traitement.
La microfiltration des eaux minérales naturelles a fait l'objet d'un examen approfondi dans une note officielle publiée en mai 2009 par la sous-direction générale de gestion des risques alimentaires du ministère de la santé213(*). Constatant des pratiques divergentes dans plusieurs communautés autonomes, ce document visait à clarifier la réglementation applicable à cette technique de filtration. Il rappelait que le précédent décret en vigueur214(*) interdisait tout traitement destiné à désinfecter ou à modifier le contenu microbiologique des eaux en bouteille. Une consultation menée auprès de la Commission européenne215(*) avait alors conclu que la microfiltration pouvait être autorisée, sous réserve qu'elle ne soit pas utilisée à des fins de désinfection et que l'exploitant prouve que les caractéristiques microbiologiques de l'eau ne sont pas altérées par le processus. Après discussion au sein du groupe de consensus technique (Grupo de Consenso Técnico), la note de 2009 a conclu que tout filtre dont la taille des pores est inférieure à 0,4 ìm ne pouvait avoir d'autre finalité que la désinfection, ce qui le rendait contraire à la réglementation en vigueur. Ainsi, le traitement par microfiltration est autorisé uniquement à des fins autres que la désinfection et avec un filtre dont la taille des pores est supérieure à 0,4 ìm. Cette position a été confirmée par l'Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition (AESAN) et reste applicable aujourd'hui216(*). Depuis l'abrogation du décret de 2002, l'interdiction a été reprise dans l'article 8, point 4, du décret de 2010, qui prohibe tout traitement modifiant la charge microbiologique des eaux minérales naturelles
c) La reconnaissance d'une eau souterraine comme eau minérale naturelle ou eau de source
L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement ainsi que la reconnaissance d'une eau souterraine comme eau minérale naturelle ou eau de source sont régies par le même décret de 2010, notamment son article 3, complété par les exigences détaillées dans l'annexe II.
La procédure débute par une demande de reconnaissance adressée à l'autorité minière compétente de la communauté autonome où se situe la source. Conformément à l'article 3 (1°), cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique comprenant des études géologiques et hydrogéologiques, ainsi que des analyses physiques, chimiques et microbiologiques démontrant la stabilité de sa composition et son absence de contamination. Si nécessaire, des études pharmacologiques et cliniques peuvent être requises afin d'évaluer les effets sur l'organisme de l'eau, conformément aux dispositions de l'annexe II, point 1.2.
L'autorité compétente217(*) examine la demande et évalue la stabilité chimique et la pureté microbiologique de l'eau avant de statuer. Si ces critères sont satisfaits, elle procède à la déclaration officielle de l'eau en tant qu'eau minérale naturelle ou eau de source. En application de l'article 3 (1°), cette déclaration est publiée au Bulletin officiel de l'État (BOE) ainsi que dans le bulletin officiel de la communauté autonome concernée.
d) L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement
L'obtention de la reconnaissance de la qualité d'eau de source ou d'eau minérale naturelle ne permet pas à elle seule l'exploitation de la source. Une autorisation distincte doit être sollicitée pour procéder à l'extraction et au conditionnement de l'eau. Conformément à l'article 3 (3°), cette autorisation d'exploitation est soumise à une nouvelle évaluation par l'autorité minière compétente, qui vérifie que l'exploitation projetée respecte les exigences environnementales et sanitaires. Lorsqu'elle est accordée, elle fait également l'objet d'une publication officielle. L'exploitation est ensuite soumise à des contrôles réguliers réalisés par l'Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition (AESAN)218(*) afin d'assurer le respect des conditions d'exploitation et des caractéristiques initiales de l'eau.
Concernant les eaux en bouteille importées de l'étranger, l'article 3 (3°) prévoit que celles provenant d'un État membre de l'Union européenne sont automatiquement reconnues si elles figurent au Journal officiel de l'Union Européenne. Pour les eaux provenant de pays tiers, l'article 3 (2°) impose qu'elles soient certifiées conformes aux normes espagnoles par une autorité compétente du pays d'origine. Cette certification atteste que l'eau respecte les critères définis dans l'annexe I et que son exploitation fait l'objet d'un contrôle permanent. La validité de cette certification ne peut excéder cinq ans, et son renouvellement est obligatoire afin de garantir la persistance des conditions initiales de reconnaissance.
e) Le retrait de la reconnaissance et/ou de l'autorisation d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou eau de source
Le décret de 2010 prévoit la possibilité de retirer la reconnaissance d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source ainsi que la possibilité de révoquer l'autorisation d'exploitation dans plusieurs cas.
En vertu de l'article 3 (2°), une eau minérale naturelle ou une eau de source peut perdre sa reconnaissance si elle ne remplit plus les critères exigés, notamment en cas de modification de sa composition chimique ou microbiologique compromettant son statut. L'évaluation de ces critères relève de l'autorité minière compétente, qui vérifie si l'eau continue de satisfaire aux exigences réglementaires applicables. En cas de non-conformité et d'absence de mesures correctives, la reconnaissance est révoquée et cette décision doit être publiée au BOE ainsi que dans le Journal officiel de la communauté autonome concernée. Par ailleurs, selon l'article 3 (5°), les autorités sanitaires des communautés autonomes doivent notifier à l'AESAN toute modification affectant les eaux reconnues, y compris les décisions de retrait de reconnaissance.
Concernant l'autorisation d'exploitation, l'article 3 (4°) dispose qu'elle peut être révoquée si l'exploitant ne respecte pas les exigences réglementaires du décret, notamment en matière d'hygiène et de préservation de la qualité de l'eau. Si l'exploitation ne garantit pas la pureté et la stabilité de l'eau, l'autorisation peut être suspendue temporairement ou retirée définitivement.
Pour les eaux issues de pays tiers, l'article 3 (2°) impose que le certificat de conformité délivré par l'autorité compétente du pays d'origine soit renouvelé tous les cinq ans. À défaut, l'eau perd automatiquement sa reconnaissance en Espagne.
f) Les modalités de contrôle et de surveillance des sites d'exploitation
Les contrôles et la surveillance des sites d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source sont régis par les articles 14 et 15 du décret de 2010.
Selon l'article 14, l'exploitant est tenu de mettre en place des autocontrôles réguliers afin de garantir la conformité de l'eau à toutes les étapes de la production et de la distribution. Ces contrôles incluent des analyses quotidiennes des paramètres microbiologiques et physico-chimiques sur des échantillons du produit fini, des analyses trimestrielles portant sur les caractéristiques essentielles de l'eau, notamment ses principaux cations et anions, ainsi que des analyses approfondies tous les cinq ans, réalisées directement au niveau des points d'émergence de l'eau. En cas de contamination ou de non-conformité aux normes définies dans l'annexe I, l'exploitant est tenu de suspendre immédiatement l'exploitation, en particulier le conditionnement, jusqu'à ce que la situation soit corrigée et que l'eau retrouve les caractéristiques requises.
L'article 15 confie aux autorités compétentes la responsabilité d'effectuer des contrôles officiels périodiques afin de vérifier que les exploitants respectent bien les exigences légales. Ces contrôles portent sur plusieurs aspects : la qualité de l'eau, la prévention des contaminations, le respect des périmètres de protection autour des captages et l'application des autocontrôles prévus à l'article 14. De plus, les autorités doivent assurer une surveillance spécifique des eaux importées de pays tiers, afin de vérifier qu'elles respectent bien les critères établis par le décret.
g) Les sanctions administratives et/ou judiciaires en cas de manquement
Les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations d'exploitation sont définies au chapitre V (articles 17 et 18) du décret de 2010.
Selon l'article 17, l'exploitant est responsable de la conformité de l'eau commercialisée et de son conditionnement. Il doit garantir l'identité, l'intégrité, la qualité et la composition de l'eau contenue dans des emballages fermés et non détériorés. Une fois l'emballage ouvert, la responsabilité des éventuelles détériorations et altérations de l'eau incombe au détenteur du produit.
Selon l'article 18, les exploitants qui ne respectent pas les exigences de qualité, de sécurité sanitaire ou les obligations d'autocontrôle prévues aux articles 14 et 15 du même décret s'exposent à des sanctions administratives. Ces sanctions sont régies par les dispositions du chapitre VI, titre I de la loi n° 14/1986 du 25 avril 1986219(*), qui fixe les principes généraux de la responsabilité administrative en matière de santé publique et au décret royal législatif n° 1/2007 du 16 novembre 2007 relatif à la protection des consommateurs220(*). Conformément à l'article 35 de la loi de 1986, les infractions sont classées selon trois niveaux de gravité : légères (infracciones leves), graves (infracciones graves) et très graves (infracciones muy graves), en fonction de la nature du manquement et de ses conséquences sur la santé des consommateurs :
- les infractions graves comprennent le non-respect des normes d'hygiène, l'absence d'autocontrôles obligatoires, l'utilisation de traitements non autorisés susceptibles d'altérer la composition de l'eau et la violation des conditions d'exploitation définies par le décret de 2010 ;
- les infractions très graves comprennent les modifications non autorisées de la composition de l'eau, la mise sur le marché d'un produit ne respectant pas les critères établis dans l'annexe I du décret de 2010, ainsi que tout manquement compromettant directement la sécurité sanitaire des consommateurs.
L'article 36 de la loi de 1986 prévoit que les infractions en matière de santé sont sanctionnées par des amendes selon le niveau de gravité de l'infraction (de 3 005,06 euros pour les infractions légères à 601 012,10 euros pour les infractions très graves). En cas d'infractions très graves, le Conseil des ministres ou les Conseils de gouvernement des Communautés autonomes disposant de la compétence en la matière peuvent ordonner la fermeture temporaire de l'établissement, de l'installation ou du service concerné, pour une durée maximale de cinq ans.
L'article 18 du décret de 2010 prévoit également que, dans les cas les plus graves, l'autorisation d'exploitation peut être retirée de manière définitive.
D'autres mesures complémentaires peuvent être appliquées en cas d'infractions graves ou très graves. Selon l'article 12 du décret royal n° 1945/1983 du 22 juin 1983221(*), qui définit les infractions et sanctions en matière de défense du consommateur et de la production agroalimentaire, en cas d'infraction très grave, le Conseil des ministres peut supprimer ou suspendre les aides publiques accordées à l'entreprise sanctionnée. Les entreprises fautives peuvent aussi être privées de quotas de marchandises et interdites de contracter avec l'administration jusqu'à cinq ans. Les sanctions sont immédiatement exécutables avec l'appui des administrations publiques.
Les autorités compétentes disposent également de moyens d'exécution spécifiques pour assurer l'application des sanctions. L'article 18 du décret de 2010 permet à l'autorité compétente d'imposer la fermeture temporaire d'un établissement jusqu'à ce que l'exploitant apporte les garanties nécessaires à la conformité de son activité. Si une infraction représente un danger immédiat pour la santé publique ou si une entreprise est en situation de récidive, l'administration peut décider de publier la sanction infligée dans le BOE et dans d'autres médias, en application de l'article 14 du décret de 1983.
h) Mesures récentes et actualité du sujet
Ces dernières années, l'Espagne a été confrontée à plusieurs préoccupations sanitaires concernant les eaux en bouteille. En 2016, des milliers de cas de gastro-entérites ont été signalés dans les régions de Barcelone et de Tarragone, liés à la consommation d'eau minérale contaminée par des matières fécales, ce qui a conduit à la faillite d'un producteur espagnol222(*). Par ailleurs, des études ont révélé la présence de pesticides à faibles concentrations dans certaines marques d'eau minérale embouteillée vendues dans le pays. Bien que ces niveaux respectent les limites légales, la détection de plusieurs pesticides dans une même marque suscite des inquiétudes quant à la qualité de ces eaux223(*). Ces incidents ont alimenté le débat public sur la sécurité sanitaire des eaux embouteillées et ont conduit à une réflexion sur les pratiques de consommation et les réglementations en vigueur. Toutefois, sur le plan sanitaire, les recherches n'ont pas établi d'évolutions législatives ou réglementaires majeures récentes concernant spécifiquement les eaux en bouteille.
Le principal sujet d'actualité est la mise en place prochaine d'un système de consigne obligatoire pour les bouteilles en plastique à usage unique. Le décret royal n° 1055/2022 du 27 décembre 2022 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages224(*) impose l'instauration d'un système de dépôt, de retour et de remboursement (SDDR) si le taux de collecte sélective des bouteilles en plastique n'atteint pas 70 % d'ici fin 2023. Or, en 2023, ce taux était de 41,3 %, bien en dessous de l'objectif fixé225(*).
Le ministère de la transition écologique a confirmé en novembre 2024 que la consigne deviendrait obligatoire dans un délai de deux ans. Ce système obligera les consommateurs à payer un dépôt d'au moins 10 centimes d'euro par bouteille, récupérable lors du retour de l'emballage en magasin. Il concernera les bouteilles en plastique jusqu'à trois litres, incluant les eaux minérales, sodas, jus et alcools, et s'étendra aux canettes et briques alimentaires.
5. L'Italie
Les définitions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source sont quasi identiques à celles de la directive 2009/54/CE. L'eau minérale naturelle est notamment définie par son origine souterraine, sa pureté originelle et sa teneur en minéraux. Le droit italien ajoute que ces eaux peuvent éventuellement présenter des propriétés bénéfiques pour la santé.
Comme la directive 2009/54/CE, le droit italien énonce un principe d'interdiction des traitements sauf pour certains limitativement énumérés (notamment la séparation par filtration ou décantation de certains composants comme le fer ou le soufre, le traitement à l'air enrichi en ozone et l'ajout de gaz carbonique), identiques à ceux mentionnés dans la directive, à condition qu'ils ne modifient pas la composition essentielle et qu'ils soient notifiés lors de la procédure de reconnaissance. Tout traitement visant à rendre l'eau minérale naturelle ou l'eau de source « potable » est interdit - ce qui comprend la microfiltration.
Le contrôle et la surveillance des sources et sites d'exploitation d'eau embouteillée reposent, d'une part, sur les entreprises dans le cadre de l'autocontrôle, et d'autre part, sur les autorités régionales compétentes en matière sanitaire qui conduisent des contrôles officiels (au moins quatre fois par an pour les sources et une fois par mois pour les installations d'embouteillage, voire davantage selon la capacité de production). Des amendes administratives peuvent être prononcées en cas de non-respect de la réglementation, voire des poursuites judiciaires pénales en cas de mise en danger de la santé humaine.
Avec une production d'environ 16 500 millions de litres (dont 98 % d'eau minérale naturelle) et plus de 200 marques d'eau en bouteille, l'Italie est le deuxième pays européen exportateur d'eau en bouteille derrière la France226(*). Le pays est également le premier pays européen consommateur d'eau en bouteille avec 249 litres par habitant en 2023227(*).
Le cadre juridique italien concernant la production d'eau en bouteille est principalement régi par le décret législatif n° 176 du 8 octobre 2011 transposant la directive 2009/54/CE relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles228(*). Les régions, responsables de l'octroi des permis d'exploitation des eaux minérales et de source, disposent également chacune de leur propre loi en la matière.
a) Les définitions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source
Le décret législatif 176/2011 transposant la directive européenne 2009/54/CE relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles reprend largement les définitions de l'eau minérale naturelle (acqua minerale naturale) et de l'eau de source (acqua di sorgente) prévues par le droit européen, notamment le concept de « pureté originelle ». Il diffère principalement sur un point : l'ajout d'une mention concernant les éventuels bénéfices pour la santé des eaux minérales naturelles.
Ainsi, selon l'article 2 de ce décret législatif :
- « sont considérées comme des eaux minérales naturelles les eaux qui, provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, sont issues d'une ou de plusieurs sources naturelles ou forées et qui présentent des caractéristiques hygiéniques particulières et, éventuellement, des propriétés bénéfiques pour la santé ;
- « les eaux minérales naturelles se distinguent de l'eau potable ordinaire par leur pureté originelle et leur conservation, leur teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, éventuellement, certains effets. Elles doivent être préservées de tout risque de pollution ;
- « la composition, la température et les autres caractéristiques essentielles des eaux minérales naturelles doivent rester constantes à la source dans l'intervalle des variations naturelles, même à la suite de modifications éventuelles du débit ».
L'article 20 du décret législatif 176/2011 définit l'eau de source comme une « eau destinée à la consommation humaine, à l'état naturel et embouteillée à la source, qui, provenant d'une nappe ou d'un réservoir souterrain, est issue d'une source ayant un ou plusieurs exutoires naturels ou forés ». Les eaux de source doivent répondre aux critères physiques et chimiques applicables à l'eau potable (article 20, alinéa 4) ainsi qu'aux critères microbiologiques des eaux minérales naturelles (article 20, alinéa 5).
b) Les traitements autorisés
Les articles 8 et 24 du décret législatif 176/2011 énoncent les opérations de traitement autorisées et interdites, respectivement sur l'eau minérale naturelle et l'eau de source. Comme la directive 2009/54/CE, ils posent le principe d'une interdiction des traitements autres que ceux explicitement autorisés par dérogation, à savoir notamment la séparation par filtration ou décantation de certains composants (fer, soufre, arsenic, manganèse) et l'élimination ou l'incorporation de gaz carbonique, à condition que ces traitements ne modifient pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés.
La liste des traitements autorisés pour l'eau minérale naturelle et l'eau de source est identique à celle de la directive 2009/54/CE. Par ailleurs, l'article 3 du décret du ministère de la santé du 10 février 2015229(*) prévoit une procédure de notification préalable au ministère de la santé de l'utilisation de tout traitement à l'air enrichi en ozone d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source. En particulier, l'exploitant doit démontrer que la composition chimique et physico-chimique de l'eau justifie un traitement, que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer l'innocuité et l'efficacité du traitement, que les composants chimiques et physico-chimiques caractéristiques de l'eau ne sont pas altérés par le traitement, que l'eau avant le traitement remplissait les conditions microbiologiques et que le traitement n'entraîne pas la formation de résidus à une concentration supérieure aux limites maximales fixées à l'annexe III du présent décret ou de résidus pouvant présenter un danger pour la santé publique.
Le décret du ministère de la santé du 10 février 2015 ne mentionne pas la microfiltration. Cependant, les derniers alinéas des articles 8 et 24 du décret législatif 176/2011 interdisent explicitement « les traitements de potabilisation, l'ajout de substances bactéricides ou bactériostatiques et tout autre traitement susceptible d'altérer le microbisme » de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source. La législation italienne retient le terme de « potabilisation » (potabilizzazione) et non « désinfection » (desinfezione), figurant dans la directive 2009/54/CE. Or, selon le ministère de la santé italien, les procédés de potabilisation sont plus larges que la simple désinfection et incluent la filtration sur membrane230(*), y compris la microfiltration. La microfiltration, en ce qu'elle consiste en un procédé visant à rendre l'eau potable, est donc interdite par le droit italien.
c) La reconnaissance d'une eau souterraine comme eau minérale naturelle ou eau de source
Les procédures de reconnaissance du statut d'eau minérale naturelle ou d'eau de source sont régies respectivement par les articles 4 et 5 et l'article 21 du décret législatif 176/2011.
Préalablement à la demande de reconnaissance, les demandeurs doivent détenir une concession minière ou un permis d'exploration délivré par les autorités régionales compétentes (cf. infra).
La reconnaissance de la qualification de l'eau minérale naturelle prélevée à la source ou d'eau de source est effectuée par le ministère de la santé, après avis du Conseil supérieur de la santé (articles 4 et 21 DL 176/2011). Elle doit être accompagnée d'une documentation complète permettant d'évaluer si l'ensemble des caractéristiques, notamment géologiques, physiques et microbiologiques, définissant l'eau minérale naturelle ou l'eau de source sont remplies. Sont notamment exigées des analyses chimiques et physico-chimiques saisonnières et des analyses microbiologiques effectuées par un laboratoire agréé, un rapport hydrogéologique, le permis d'exploration ou de concession minière et, le cas échéant, une documentation pharmacologique et clinique231(*). La demande doit également indiquer le nom de la source, sa localité, la dénomination commerciale de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source et, le cas échéant, le recours à tout traitement autorisé à l'article 8 du décret législatif 176/2011.
Après obtention de l'avis favorable du Conseil supérieur de la santé , le ministère de la santé adopte une décision de reconnaissance indiquant, pour l'eau minérale naturelle : la dénomination de l'eau, le nom de la source, les caractéristiques sanitaires particulières ainsi que les éventuelle propriétés favorables pour la santé, les indications et éventuelles contre-indications devant figurer sur l'étiquette et éventuellement, les traitements réalisés à l'air enrichi en ozone ou l'ajout de gaz carbonique. La décision de reconnaissance d'une eau minérale naturelle est publiée au Journal officiel de la République italienne (Gazzetta Ufficiale) et transmise à la Commission européenne (article 5 DL 176/2011). La décision de reconnaissance d'une eau de source indique uniquement le nom et le lieu de la source, les éventuels traitements autorisés effectués et est publiée au Journal officiel.
Pour les eaux minérales naturelles, le décret du ministère de la santé du 10 février 2015 (article 7) prévoit en outre une procédure annuelle de déclaration sur l'honneur afin de maintenir la reconnaissance. Les titulaires de la reconnaissance doivent adresser chaque année au ministère de la santé une déclaration, tenant lieu de déclaration sur l'honneur, concernant le maintien des caractéristiques de l'eau minérale naturelle sur lesquelles se fondent la reconnaissance ainsi que des analyses chimique, physique, organoleptique et microbiologique effectuées au cours de la même année civile. Le défaut d'envoi de la déclaration et de ces analyses, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence, entraîne la suspension immédiate de la décision de reconnaissance.
d) L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement
Après la délivrance du décret de reconnaissance, une entreprise souhaitant exploiter une source d'eau minérale ou d'eau de source doit obtenir une autorisation de la part des autorités régionales compétentes en matière sanitaire (articles 6, 7 et 23 DL 176/2011). En Toscane, il s'agit par exemple des directions en charge de la prévention du service sanitaire régional232(*).
L'autorisation est accordée après avoir constaté que les installations destinées à être utilisées sont construites de manière à exclure tout danger de pollution et à préserver les propriétés de l'eau existant à la source. Plus précisément, les autorités régionales doivent s'assurer du respect des conditions suivantes :
- la source ou le point d'émergence est protégé contre tout danger de pollution ;
- le captage, les canalisations et les réservoirs sont constitués de matériaux adaptés à l'eau minérale naturelle ou à l'eau de source, de manière à éviter toute altération chimique, physico-chimique et bactériologique de cette eau ;
- les conditions d'utilisation et notamment les installations de lavage et d'embouteillage répondent aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter l'altération des caractéristiques bactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ou les eaux de source et les récipients et les dispositifs de fermeture doivent être conformes à la législation en vigueur sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
- le traitement éventuel de l'eau, autorisé à l'article 8, correspond à celui indiqué dans l'arrêté de reconnaissance.
La législation et la réglementation de chaque région précisent les documents nécessaires à l'appui de la demande233(*). À titre indicatif, dans la région des Abruzzes, l'autorité régionale compétente doit rendre sa décision dans un délai de 60 jours234(*).
Une copie de l'autorisation est transmise par l'autorité régionale au ministère de la santé.
e) Le retrait de la reconnaissance et/ou de l'autorisation d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou eau de source
S'agissant de la reconnaissance des eaux minérales naturelles, comme mentionné précédemment, le défaut de transmission annuelle des analyses permettant de vérifier le maintien des caractéristiques de l'eau entraîne automatiquement la suspension de la reconnaissance. Cette suspension peut durer plusieurs années sans nécessairement entraîner un retrait définitif. Par exemple, l'eau minérale naturelle Benaglia, dans la province de Vérone, a vu la validité de son décret de reconnaissance suspendue en 2012 pour défaut de déclaration annuelle et a ensuite été rétablie en 2025.
En cas de non-respect des normes relatives aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source ou de danger pour la santé, la reconnaissance peut être définitivement révoquée235(*).
L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle ou d'eau de source peut également être suspendue et, dans les cas les plus graves, révoquée par les autorités régionales compétentes si des infractions persistantes sont détectées (articles 16 et 29 DL 176/2011). Les procédures varient selon les régions.
f) Les modalités de contrôle et de surveillance des sites d'exploitation
Le contrôle et la surveillance des sites d'exploitation d'eau embouteillée et de leurs produits sont exercés, d'une part, par les entreprises elles-mêmes, et d'autre part, par les autorités régionales compétentes en matière sanitaire.
A minima, selon deux circulaires du ministère de la santé236(*), les entreprises doivent elles-mêmes réaliser les contrôles suivants :
- au niveau du point de captation de la source, des analyses microbiologiques saisonnières (soit au moins quatre par an) et des analyses chimiques tous les deux mois ;
- au niveau du site d'exploitation, des contrôles microbiologiques quotidiens, à la fois sur le produit fini à la fin de la chaîne d'embouteillage et dans au moins deux points différents de l'usine, ainsi que des analyses chimiques quotidiennes sur le produit fini.
Les résultats doivent être consignés dans un registre spécial, tenu à la disposition de l'autorité sanitaire compétente.
De plus, conformément au droit de l'UE en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, la fédération des entreprises italiennes du secteur des eaux minérales et de source a adopté un système d'autocontrôle (Hazard analysis and critical control points, HACCP)237(*) Sur la base de ce guide, les entreprises effectuent des analyses physico-chimiques et microbiologiques et, ainsi que des milliers de contrôles annuels pour chaque source individuelle, qui peuvent avoir lieu à la source, à l'usine d'embouteillage, sur les conteneurs et dans les entrepôts de l'usine d'embouteillage avant la distribution. Les contrôles internes vont au-delà des contrôles officiels afin d'être certain de distribuer sur le marché un produit sûr du point de vue de l'hygiène et de la santé238(*).
Les articles 16 et 29 du décret législatif 176/2011 confient aux autorités sanitaires régionales un rôle de surveillance en matière d'utilisation et de commerce des eaux minérales naturelles et de source, « en particulier en ce qui concerne les éventuels traitements visés à l'article 8 ». Selon ces mêmes articles, le personnel chargé de la surveillance peut procéder à tout moment à des inspections et à des prélèvements d'échantillons dans n'importe quelle partie des installations d'exploitation, dans les entrepôts et dans les lieux où les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont commercialisées ou distribuées. Lorsque des irrégularités sont constatées, les services en charge de la surveillance doivent en informer les organes compétents de la région qui veillent à ce que le titulaire de l'autorisation d'exploitation remédie aux causes de l'irrégularité.
Chaque région adopte son propre plan de contrôle239(*). Selon les deux circulaires du ministère de la santé précitées, les autorités régionales compétentes doivent respecter les fréquences suivantes en matière de contrôles :
- au niveau du point de captation de la source, des contrôles chimiques et microbiologiques saisonniers (soit quatre fois par an), avec inspection simultanée des ouvrages de captage, des ouvrages d'adduction, des zones de protection hygiénique, des dépôts de stockage et de l'usine d'embouteillage ;
- au niveau du site d'exploitation, la fréquence des contrôles augmente avec le volume de production. Les analyses chimiques et microbiologiques sur le produit fini doivent être réalisées de façon hebdomadaire lorsque la production journalière est supérieure à 500 000 bouteilles, selon une fréquence bimensuelle si la production journalière est comprise entre 200 000 et 500 000 bouteilles et selon une fréquence mensuelle lorsque la production journalière est inférieure à 200 000 bouteilles.
Outre le respect des valeurs limites fixées par le décret du 10 février 2015, les contrôles doivent attester de la conformité de la composition de l'eau avec ce qui est déclaré sur l'étiquette de la bouteille.
g) Les sanctions administratives et/ou judiciaires
Selon l'article 33 du décret législatif 176/2011, sauf dans les cas où le fait constitue une infraction pénale, les faits suivants sont passibles d'une sanction administrative, prenant la forme d'une amende :
- de 52 000 à 110 000 euros pour quiconque utilise une source d'eau minérale naturelle ou d'eau de source reconnue, sans autorisation d'exploitation régionale ;
- de 38 000 euros à 90 000 euros pour quiconque enfreint les obligations prévues en matière d'étiquetage des eaux minérales naturelles et de source ;
- de 38 000 euros à 90 000 euros pour quiconque commercialise des eaux potables en ne respectant pas l'interdiction visée à l'article 18, c'est-à-dire l'interdiction pour les eaux potables soumises à des procédés de filtrage et vendues par des restaurants, d'utiliser des dénominations, des indications ou des illustrations pouvant prêter à confusion avec les eaux minérales naturelles ;
- de 38 000 euros à 90 000 euros pour quiconque ne respecte pas les interdictions prévues en matière de publicité par l'article 19. La même sanction pécuniaire est infligée à quiconque fait de la publicité pour des eaux minérales naturelles sans l'autorisation préalable du ministère de la santé.
Les régions sont compétentes pour prononcer ces sanctions administratives.
En outre, en application de l'article 440 du code pénal240(*), quiconque corrompt ou falsifie de l'eau ou des substances destinées à l'alimentation, avant qu'elles ne soient prélevées ou distribuées pour la consommation, en les rendant dangereuses pour la santé publique, est punissable d'une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.
h) Mesures récentes et actualité du sujet
En Italie, la consommation d'eau en bouteille est très importante et le niveau de confiance des consommateurs semble assez élevé. Certaines études indépendantes récentes ont toutefois montré la présence de traces de pesticides dans des eaux minérales naturelles ou de source, mais sous les seuils réglementaires de 0,1 microgramme par litre pour un pesticide individuel et de 0,5 microgramme par litre pour la somme de tous les pesticides présents241(*). La question de la présence de PFAS dans les eaux en bouteille est également présente dans le débat public, mais les tests conduits jusqu'ici mettaient principalement en cause des eaux embouteillées produites à l'étranger.
Les recherches n'ont pas mis en évidence de projet de modification de la réglementation italienne à court terme.
B. DEUX EXEMPLES EXTRA-COMMUNAUTAIRES
1. La Suisse
Le cadre juridique suisse relatif à l'eau minérale naturelle et l'eau de source est largement aligné sur le droit de l'UE. Les grands principes de la directive 2009/54/CE sont repris dans l'ordonnance fédérale sur les boissons afin que les eaux en bouteille suisses puissent circuler sur le marché intérieur.
Les traitements autorisés sont strictement encadrés et correspondent à ceux permis par la directive européenne. À l'instar du droit de l'UE, le droit suisse proscrit tout traitement ayant pour effet de désinfecter l'eau minérale naturelle ou de source. À la suite de la détection d'un traitement illicite (filtre à charbon) pour éliminer des résidus de pesticides dans l'eau minérale naturelle suisse Henniez produite par Nestlé Waters, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a explicité le fait que les traitements liés à l'élimination de substances anthropiques sont interdits, pour ne pas induire en erreur les consommateurs en ce qui concerne la pureté originelle de l'eau minérale naturelle.
Selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires, les contrôles sont effectués à titre principal par les industriels via l'autocontrôle et à titre subsidiaire par les autorités publiques via des contrôles officiels ponctuels. Cette même loi prévoit, en cas d'infraction des sanctions administratives et des sanctions pénales, que le fait de commercialiser de l'eau minérale naturelle non conforme aux dispositions légales peut caractériser, selon le degré de mise en danger de la santé humaine, une contravention, un délit ou un crime entraînant des peines privatives de liberté, le cas échéant assorties de sanctions pécuniaires.
a) Les définitions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source
En Suisse, le cadre juridique relatif aux eaux minérales naturelles et de source est établi par l'ordonnance du Département fédéral de l'Intérieur (DFI) sur les boissons du 16 décembre 2016242(*), dernièrement modifié en 2024.
Cet acte réglementaire dispose d'un chapitre premier consacré à l'eau minérale naturelle. Son article 5 la définit comme « une eau microbiologiquement irréprochable, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain. Elle provient d'une ou plusieurs sources, exploitées par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. [...]. Si une eau minérale naturelle provient de plusieurs sources, la composition physicochimique de cette eau doit rester constante. » L'article 6 précise les exigences de qualité auxquelles doit répondre l'eau minérale naturelle : « l'eau minérale naturelle doit se distinguer par sa provenance géologique particulière, par la nature et la quantité de ses composants minéraux, par sa pureté originelle et par une composition, une température et un débit constants dans les limites des variations naturelles ». De plus, l'eau minérale naturelle doit, lors de son conditionnement, être conforme aux valeurs maximales (critères microbiologiques et chimiques) prévues à l'annexe 2.
En somme, la définition de l'eau minérale naturelle telle que prévue par le droit suisse est quasiment identique à celle de la directive européenne 2009/54/CE. Cet alignement juridique permet à la Suisse de commercialiser ses eaux minérales naturelles sur le marché intérieur de l'UE.
Le chapitre 2 de l'ordonnance est consacré à l'eau de source. Celle-ci est définie à l'article 12 comme « une eau d'origine souterraine commercialisée en respectant son état originel ». Selon l'article 13, l'eau de source doit satisfaire aux exigences physico-chimiques applicables à l'eau potable243(*) et, au surplus correspondre aux propriétés microbiologiques de l'eau minérale naturelle ; figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance. Contrairement à l'eau minérale naturelle, des eaux de sources différentes peuvent être mises sur le marché sous la même désignation commerciale (article 14). En revanche, le nom de la source et le nom du lieu de son exploitation doivent être mentionnés (article 15).
En avril 2022, dans une lettre d'information244(*) adressée aux autorités cantonales chargées de l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), rattaché au Département fédéral de l'Intérieur, a apporté des précisions quant à la définition du concept de « pureté originelle ». Il y a défini des valeurs indicatives pour certaines classes de substances en se fondant sur les recommandations de la Commission européenne.
b) Les traitements autorisés
L'article 8 de l'ordonnance sur les boissons traite la question des traitements autorisés sur les eaux minérales naturelles. L'alinéa 1er crée un principe selon lequel « l'eau minérale naturelle ne peut subir aucun traitement ni aucune adjonction ». Cependant, l'alinéa suivant dispose que, à titre dérogatoire, des traitements peuvent être effectués, à savoir :
- « la décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l'air hygiéniquement irréprochable ou de l'air enrichi en ozone, en vue d'éliminer des composants indésirables ou d'en diminuer la quantité, pour autant que ce traitement ne modifie pas les composants essentiels de l'eau minérale naturelle ;
- - « l'élimination complète ou partielle du dioxyde de carbone par des procédés purement physiques ;
- - « l'adjonction de dioxyde de carbone ;
- - « le traitement par l'alumine activée pour éliminer les fluorures ou en diminuer la quantité ;
- - « d'autres traitements pour autant : qu'ils soient impérativement nécessaires, qu'ils ne modifient pas l'eau minérale naturelle dans ses composants essentiels, et qu'ils ne servent pas à améliorer la qualité hygiénique d'une eau minérale naturelle qui n'est pas irréprochable à la source ».
Enfin, l'alinéa 3 de l'article 8 précise qu'est interdit « tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement visant à modifier le microbisme ».
Ainsi, le cadre juridique suisse quant aux traitements autorisés des eaux minérales naturelles et de source est très similaire à celui de la directive européenne 2009/54/CE. Bien que l'ordonnance suisse autorise explicitement, à l'article 8 alinéa 2, tout autre traitement que ceux prévus, pourvu que les caractéristiques de l'eau n'en soient pas changées, le fait qu'il soit précisé à l'alinéa 3 que les traitements s'apparentant à une désinfection sont interdits suppose que la microfiltration l'est aussi. Toutefois, celle-ci n'étant pas explicitement mentionnée, l'enjeu est de savoir dans quelle mesure la microfiltration s'apparente à une désinfection.
Dans la lettre d'information d'avril 2022 citée précédemment, l'OSAV a apporté des précisions concernant les « autres traitements » autorisés (article 8 alinéa 2 e.), en proscrivant les traitements liés à l'élimination de substances anthropiques (liées à l'activité humaine) en raison du fait que cela contreviendrait directement au critère de pureté originelle de l'eau minérale naturelle : « l'élimination des substances anthropiques telles que les pesticides et leurs métabolites par exemple, n'est pas prévue dans le cadre de la production d'eau minérale pour ne pas induire en erreur les consommateurs en ce qui concerne la pureté originelle de l'eau minérale naturelle. La législation sur les denrées alimentaires n'autorise pas le recours à des méthodes d'élimination de substances anthropiques dans l'eau minérale naturelle et ne prévoit aucune exception à cette règle »245(*). Par conséquent, les traitements par filtre à charbon auxquels Nestlé Waters a recouru pour traiter sa source suisse Henniez (située dans le canton de Vaud) qui avait été polluée par des pesticides n'étaient pas autorisés (cf. description de l'affaire infra).
En vertu de l'article 13 relatif à l'eau de source, les dispositions de l'article 8 susmentionné valable pour l'eau minérale naturelle, s'appliquent mutatis mutandis à l'eau de source.
c) La reconnaissance d'une eau souterraine comme eau minérale naturelle ou eau de source
Toute personne qui entend mettre sur le marché de l'eau sous la dénomination eau minérale naturelle doit en faire la demande auprès des autorités cantonales d'exécution compétentes, conformément à l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance du DFI. L'annexe 1 de cette ordonnance précise les documents à fournir à l'appui de cette demande :
- sur les aspects géologiques et hydrogéologiques : un plan de situation, un rapport hydrogéologique, les plans détaillés et la description du captage, les plans des zones de protection et des données sur le débit de la source ou du forage ;
- sur les aspects physiques et chimiques : des informations concernant les caractéristiques et composants de l'eau (débit de la source, évolution de la température de l'eau, pH, contenants principaux et secondaires...) ;
- sur les aspects microbiologiques : des rapports d'analyses, qui doivent respecter les exigences microbiologiques positives et négatives détaillées à l'annexe 2.
d) L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau souterraine à des fins de conditionnement
En Suisse, l'autorisation d'exploitation des eaux souterraines relève de la responsabilité de chaque canton246(*).
L'ordonnance fédérale sur les boissons prévoit également des conditions relatives au captage et au conditionnement des eaux minérales naturelles et de source. L'article 7 dispose tout d'abord que le captage et le transport de l'eau doivent être neutres, de sorte que les caractéristiques de l'eau soient constantes à toutes les étapes de l'exploitation : « le captage d'une eau minérale naturelle et son transport jusqu'au lieu de conditionnement doivent être effectués de façon que les propriétés chimiques et microbiologiques qui caractérisent l'eau à l'émergence de la source soient conservées dans une très large mesure. La source devra en particulier être protégée à son point d'émergence contre toute impureté. ». Pour garantir cette neutralité, l'alinéa 2 précise ensuite que les matériaux et infrastructures utilisés doivent être compatibles avec cet impératif de neutralité : « les matériaux utilisés pour le captage, les conduites et les réservoirs doivent être appropriés pour l'eau minérale naturelle et de nature à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et microbiologique de l'eau. ».
Concernant l'étape de mise en bouteille, l'alinéa 3 ajoute enfin que « l'eau minérale naturelle doit être amenée de la source au lieu de conditionnement uniquement par conduites. Le transport par camions-citernes n'est admis que pour l'utilisation de l'eau minérale naturelle comme ingrédient d'une denrée alimentaire » ; autrement dit, l'eau minérale naturelle destinée à être consommée en tant que telle doit être stockée dans le même récipient que celui destiné au consommateur final, et ce dès l'étape du captage. En ce sens, le droit suisse converge avec la directive européenne 2009/54/CE.
En vertu de l'article 13 relatif à l'eau de source, les dispositions de l'article 7 susmentionné, relatif à l'eau minérale naturelle, sont applicables mutatis mutandis à l'eau de source.
e) Le retrait de la reconnaissance et/ou de l'autorisation d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou eau de source
Les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine, sont considérées comme des denrées alimentaires régies au titre de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0)247(*). L'exécution de la législation alimentaire incombe aux autorités cantonales248(*).
L'article 7 de cette loi dispose que seules les « denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché » (alinéa 1), c'est-dire qu'elles ne peuvent pas être « préjudiciables à la santé » ou « impropres à la consommation humaine » (alinéa 2), et ce « à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution » (alinéa 3).
Aussi l'autorisation d'exploitation en tant qu'eau minérale naturelle ou eau de source doit-elle être retirée lorsque la nature de l'eau exploitée n'est plus conforme aux exigences légales de sûreté. S'agissant de l'eau, ces dispositions représentent un enjeu particulièrement important puisque, si l'on dispose de techniques efficaces pour séparer les substances indésirables de l'eau, ces traitements sont limités et strictement réglementés, de sorte qu'une eau trop polluée ne pourra pas faire l'objet d'une désinfection, sauf à être commercialisée sous la simple dénomination de « boisson » en abandonnant la reconnaissance officielle « eau minérale naturelle. »
La loi fédérale suisse prévoit en outre un « principe de précaution » dans son article 22 en vertu duquel, si une incertitude scientifique sur les éventuels effets nocifs sur la santé apparaît à l'occasion d'un contrôle officiel effectué par l'autorité fédérale compétente, celle-ci prend des mesures provisoires pour assurer un niveau de protection de la santé élevé en attendant que de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'effectuer une évaluation plus complète. Ces mesures provisoires prennent la forme d'une suspension de l'autorisation de mise sur le marché.
Enfin, nonobstant le fait qu'un produit satisfasse aux exigences de la législation en vigueur, l'article 23 de la loi sur les denrées alimentaires habilite l'autorité fédérale compétente - à savoir l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) - à donner l'ordre aux autorités cantonales d'exécution de limiter immédiatement, par la prise de mesures de protection, la mise sur le marché d'un produit (dont une eau minérale naturelle ou de source) ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
f) Les modalités de contrôle et de surveillance des sites d'exploitation
Selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0), les industriels et les autorités publiques (OSAV et autorités cantonales chargées de l'exécution de la législation alimentaire) concourent au contrôle et à la surveillance des sites d'exploitation. Les contrôles sont effectués à titre principal par les industriels au moyen de l'autocontrôle et à titre subsidiaire par les autorités publiques par l'intermédiaire de contrôles officiels.
En vertu de l'article 26 de cette loi, il incombe aux producteurs d'eau minérale de veiller, au moyen de l'autocontrôle, à ce que les exigences légales soient toujours respectées : « Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d'autocontrôle », et ce indépendamment du fait qu'il existe parallèlement un contrôle officiel.
La loi sur les denrées alimentaires prévoit en outre des contrôles dits officiels réalisés par les autorités publiques, en vertu de son article 30 relatif aux contrôles et prélèvements d'échantillons : « Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. » Ainsi les autorités cantonales chargées de l'exécution de la législation alimentaire249(*) procèdent-elles à des inspections régulières pour, d'une part, vérifier l'autocontrôle et, d'autre part, vérifier que les dispositions juridiques sur les eaux minérales naturelles et de source sont respectées. Pour ce faire, les cantons chargés du contrôle d'une source située sur leur territoire gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons (article 48 LDAl).
En vertu de son article 3, l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl, 817.042)250(*) précise le cadre des contrôles officiels : ceux-ci doivent être effectués régulièrement et à une fréquence adéquate et de façon indépendante, c'est-à-dire que les autorités d'exécution n'entretiennent aucun lien personnel avec les établissements qu'elles inspectent ou contrôlent. Dans l'exercice de ces tâches, les cantons sont sous la surveillance des autorités publiques à l'échelle de la Confédération : « La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons » (article 42 loi LDAl).
Pour les fabricants d'eau de source, d'eau potable ou d'eau minérale en bouteille, l'ordonnance fédérale du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP, 817.032)251(*) fixe l'intervalle maximal entre deux inspections des processus de fabrication à 4 ans.
g) Les sanctions administratives et judiciaires
De manière générale, lorsqu'une autorité d'exécution cantonale relève des infractions au droit alimentaire, elle « prononce une contestation, impose des mesures correctives et perçoit des émoluments. Suivant la gravité de l'infraction, qui s'évalue de cas en cas, [elle] dénonce pénalement l'infraction ».
En matière de sanctions administratives, les dysfonctionnements identifiés de l'exploitation sont sanctionnés par des « contestations » (article 33 LDAl) prononcées par les autorités d'exécution à l'égard de l'eau en bouteille non conforme. Ces contestations prennent la forme de « mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit » (article 34 LDAl) ; il peut s'agir notamment d'une autorisation d'utilisation assortie de charges, d'une élimination du produit ou toute autre mesure appropriée à la remise en conformité. En cas de violation répétée, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit.
En matière de sanctions pénales, la loi LDAl réprime deux types d'infractions :
- dans les cas les plus graves, l'article 63 relatif aux crimes et délits prévoit une privation de liberté d'au moins trois ans en cas de commercialisation de denrées alimentaires mettant la santé en danger dans des conditions normales d'utilisation, le cas échéant assortie d'une peine pécuniaire ;
- dans certains cas moins graves, l'article 64 relatif aux contraventions punit d'une amende de 40 000 francs suisses (42 700 euros) ou plus le fait de commercialiser des denrées alimentaires non conformes à la législation et réglementation applicables, notamment le fait de recourir à des procédés interdits ou d'enfreindre les prescriptions relatives à la protection contre la tromperie. Dans tous les cas, le fait de s'être rendu coupable de telles infractions par négligence est un motif de réduction de peine.
h) Mesures récentes et actualité du sujet
En octobre 2024, alors que le scandale Nestlé Waters avait déjà éclaté en France, des députés du parlement cantonal vaudois (le Grand Conseil) ont interpellé le gouvernement cantonal (le Conseil d'État) afin que celui-ci éclaircisse la situation de la marque d'eau minérale Henniez, produite dans la commune vaudoise du même nom par Nestlé Waters Suisse.
En effet, en 2020, l'Office de la consommation (OFCO) du canton de Vaud avait détecté une installation illicite et constaté une pratique trompeuse par Nestlé Waters, en l'occurrence l'usage de filtres à charbon dans le traitement de l'eau minérale Henniez. Le Conseil d'État du canton de Vaud, dans sa réponse aux députés du Grand Conseil253(*), résume le processus de mise en conformité qui a eu lieu dès que les pratiques illicites ont été constatées : l'OFCO a exigé de Nestlé Waters qu'elle entre en contact avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui a refusé la demande de l'entreprise de dérogation au principe d'interdiction des traitements par filtres à charbon en raison de l'impératif de pureté originelle de l'eau minérale naturelle. Elle l'a, en outre, enjointe à prendre toute mesure nécessaire à la mise en conformité avec les dispositions applicables de ses sites d'exploitation litigieux. Finalement, en avril 2022, aux termes d'échanges techniques avec des minéraliers suisses et des représentants d'autorités cantonales d'exécution, l'OSAV a publié une lettre d'information (cf. supra) reprenant les seuils européens en matière de résidus de substances organiques dans les eaux minérales naturelles et définissant la notion actualisée de pureté originelle, faisant désormais référence pour tous les minéraliers suisses.
Par ailleurs, une étude récente conduite en Suisse (et publiée par la Radio Télévision Suisse - RTS - en janvier 2025) a analysé la composition de treize bouteilles d'eaux minérales naturelles différentes ; dix d'entre elles se sont avérées contenir de l'acide trifluoroacétique (TFA) - un micropolluant de la famille des PFAS. Autant de preuves que l'idéal d'eaux minérales d'une pureté parfaite est de plus en plus difficile à atteindre. Dans son article du 22 janvier 2025254(*), RTS précise : « Aujourd'hui, le danger du TFA pour la santé humaine reste méconnu. La recherche et la législation à ce sujet sont moins avancées qu'avec d'autres micropolluants. Si les normes concernant les résidus de pesticide chlorothalonil sont aujourd'hui très strictes en Suisse, elles n'existent pas encore pour le TFA. Les chimistes cantonaux ont demandé l'année dernière des directives à la Confédération. Mais celle-ci, via son Office des affaires alimentaires et vétérinaires (OSAV), attend les décisions européennes pour prendre position. L'OMS devrait également publier des recommandations. Pour l'heure, il n'y a que quelques valeurs indicatives qui circulent en Europe. Des ONG, comme PAN Europe, militent fortement pour la précaution. L'Office fédéral allemand de l'environnement quant à lui opte pour une valeur limite haute, 60 microgrammes par litre. C'est le chiffre que les distributeurs d'eau minérale suisses Migros, Aldi et Lidl citent volontiers dans leurs réponses. ».
Le Conseil fédéral suisse a d'ores et déjà présenté, le 6 décembre 2024, un projet de révision de l'ordonnance relative à la réduction des risques liés aux produits chimiques, restreignant davantage le recours à des fluides frigorigènes synthétiques à l'origine de la formation du TFA pour protéger les eaux souterraines255(*).
2. Les États-Unis
La législation fédérale définit l'eau minérale comme une eau ayant une teneur minimale en minéraux (au moins 250 parties par million de matières totales dissoutes) provenant d'une source souterraine et l'eau de source comme une eau recueillie à la source ou par un forage qui capte la formation souterraine alimentant la source. Ces définitions ne retiennent pas l'adjectif « naturel », ni le concept de « pureté originelle » présent dans la législation européenne.
Les normes de qualité de l'eau en bouteille sont les mêmes quelle que soit l'origine de l'eau (source souterraine, puits artésien, eau potable publique). La réglementation autorise tout traitement efficace pour respecter ces normes, à condition de ne pas « altérer » le produit mis en bouteille. S'agissant des eaux minérales et des eaux de source, un « traitement minimal » est accepté (par exemple, la filtration, l'ozonation ou un traitement désinfectant équivalent) afin d'éliminer les éléments indésirables, mais cette notion est appréciée de façon plus restrictive par certains États.
Il n'existe pas de procédure de reconnaissance de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source. Les sources d'eau souterraine et les usines d'embouteillage doivent toutefois faire l'objet d'une autorisation d'exploitation par les autorités compétentes des États, d'une durée d'un an renouvelable.
Les sources et sites d'exploitation sont contrôlés par les industriels eux-mêmes (notamment dans le cadre de l'autorégulation du secteur), par les autorités compétentes de chaque État et, éventuellement, par la Food and Drug Administration. En cas d'infractions, des sanctions administratives peuvent être prises par les États et la FDA. Des poursuites judiciaires, y compris pénales, sont possibles, mais très rares.
La consommation d'eau embouteillée étant un phénomène relativement récent aux États-Unis, les premières normes fédérales de qualité de l'eau en bouteille ont été adoptées en 1973 et une réglementation complète n'est apparue que dans les années 1990256(*). Désormais, les activités de l'industrie de l'eau en bouteille sont encadrées à trois niveaux :
- au niveau fédéral, en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FDC Act)257(*), l'administration des États-Unis chargée des aliments et des médicaments (Food and Drug Administration, FDA) réglemente les eaux embouteillées et veille à ce qu'elles puissent être consommées en toute sécurité (titre 21 du code des réglementations fédérales)258(*). L'eau potable municipale relève quant à elle de la responsabilité de l'agence de protection de l'environnement (Environmental protection agency, EPA). En principe, lorsque l'EPA établit une norme pour une substance, la FDA doit estimer si elle doit être transposée pour l'eau en bouteille ou si celle-ci n'est pas nécessaire259(*) ;
- au niveau des États, ceux-ci sont responsables de l'octroi des permis d'exploitation des eaux souterraines à des fins de conditionnement. Ils établissent les normes pour les eaux en bouteille produites sur leur territoire et peuvent également imposer des exigences supplémentaires allant au-delà des normes définies au niveau fédéral pour les eaux provenant d'autres États ou importées de l'étranger, notamment en matière d'étiquetage et de tests260(*) ;
- et, enfin, au niveau des associations professionnelles. L'association internationale de l'eau en bouteille (International Bottled Water Association, IBWA), qui regroupe 1 200 entreprises couvrant près de 85 % de l'eau embouteillée vendue aux États-Unis, est le principal organisme d'autorégulation de l'industrie261(*). Le Code of practice de l'IBWA (Model Code)262(*) vise à garantir la sécurité et la qualité des eaux en bouteille et établit sur certains aspects des normes plus strictes que les réglementations fédérales et étatiques263(*). Les entreprises d'eau embouteillée peuvent volontairement se soumettre à une certification supplémentaire, établie par la Fondation nationale pour l'assainissement (National Sanitation Foundation, NSF), un organisme privé spécialisé dans la certification des produits agroalimentaires et de santé (cf. infra).
La consommation d'eau en bouteille a fortement progressé aux États-Unis ces vingt dernières années (d'environ 26 milliards à 61 milliards de litres entre 2014 et 2024)264(*). Cette croissance s'explique principalement par le choix de certains consommateurs de remplacer la consommation de boissons conditionnées sucrées par une alternative plus saine265(*).
a) Les définitions des eaux minérales naturelles et de source
Le titre 21, article 165.110 du code des réglementations fédérales (CRF)266(*) prévoit un ensemble de normes spécifiques aux eaux en bouteille :
- les normes d'identité (standard of identity), qui définissent les différents types d'eau en bouteille ;
- et les normes de qualité (standard of quality), qui fixent les niveaux maximaux de substances contaminantes - y compris les éléments chimiques, physiques, microbiens et radiologiques - autorisés dans l'eau en bouteille.
Aux termes des dispositions précitées, l'eau en bouteille est définie comme « une eau destinée à la consommation humaine et scellée dans des bouteilles ou d'autres récipients sans ingrédients ajoutés, à l'exception d'éventuels agents antimicrobiens sûrs et appropriés »267(*). Du fluor peut être ajouté à titre facultatif dans les limites fixées par la FDA.
La réglementation fédérale classe les eaux en bouteille en fonction de leur origine et distingue quatre catégories principales en matière d'eaux souterraines268(*) :
- l'eau de puits artésien (artesian water). Cette eau provient d'un puits qui exploite un aquifère (couches de roche poreuse, de sable et de terre qui contiennent de l'eau) soumis à la pression des couches supérieures de roche ou d'argile qui l'entourent. Lorsqu'elle est exploitée, la pression de l'aquifère, communément appelée pression artésienne, pousse l'eau au-dessus du niveau de l'aquifère, parfois jusqu'à la surface. D'autres moyens peuvent être utilisés pour amener l'eau à la surface. Sur demande, les usines de production doivent démontrer aux autorités compétentes que le niveau de l'eau se situe à une certaine hauteur au-dessus du sommet de l'aquifère ;
- l'eau minérale (mineral water). Elle est définie comme une eau contenant au moins 250 parties par million (ppm) de matières totales dissoutes (total dissolved solids, TDS), provenant d'une source captée par un ou plusieurs forages ou de sources, issue d'une source d'eau souterraine géologiquement et physiquement protégée. « L'eau minérale se distingue des autres types d'eau par la constance de la teneur et des proportions relatives des minéraux et des oligo-éléments au point d'émergence de la source, compte tenu des cycles de fluctuations naturelles. Aucun minéral ne peut être ajouté à cette eau. ». Si la teneur en TDS de l'eau minérale est inférieure à 500 ppm ou supérieure à 1 500 ppm, les mentions « faible teneur en minéraux » ou « teneur élevée en minéraux » doivent respectivement figurer sur l'étiquette de la bouteille ;
- l'eau de source (spring water) est dérivée d'une formation souterraine d'où l'eau s'écoule naturellement vers la surface ; cette eau doit être recueillie uniquement à la source ou par un forage qui capte la formation souterraine alimentant la source. L'emplacement de la source doit être identifié. Si une force extérieure est utilisée pour collecter l'eau par un forage, l'eau doit avoir la même composition et la même qualité que l'eau qui s'écoule naturellement à la surface ;
- l'eau de puits (well water). Il s'agit de l'eau provenant d'un trou foré dans le sol, qui s'écoule dans un aquifère.
En outre, aux États-Unis, les eaux en bouteille peuvent provenir de « sources municipales » - c'est-à-dire de l'eau potable publique (eau du robinet) - qui peut elle-même provenir d'eaux de surface (rivière par exemple). Dans ce cas, l'eau municipale est généralement traitée avant d'être mise en bouteille (cf. infra) afin de respecter la norme de qualité269(*). L'eau en bouteille qui a été traitée par des procédés autorisés peut être étiquetée, selon les cas de figure en tant qu'« eau purifiée », « eau déminéralisée » ou « eau distillée ». Si l'eau provient d'un système d'approvisionnement en eau public et n'a pas été traitée pour répondre à la définition de l'eau « purifiée » ou « stérile » de la FDA, l'étiquette doit indiquer que l'eau provient d'un réseau public.
b) Les traitements autorisés
La réglementation fédérale ne distingue pas les traitements autorisés selon l'origine de l'eau en bouteille, ni ne fournit une liste exhaustive de ces traitements. De plus, les normes de qualité définies au niveau fédéral sont identiques pour tous les types d'eau en bouteille.
Selon l'article 129.80 de la réglementation relative aux bonnes pratiques de fabrication (current good manufacturing practice, CGMP)270(*) sont notamment autorisés au niveau fédéral pour le traitement des eaux en bouteille : la distillation, l'échange d'ions, la (micro)filtration, le traitement aux ultraviolets, l'osmose inverse, la carbonatation et l'ajout de minéraux (pour ce dernier, sauf pour les eaux minérales).
S'agissant de la microfiltration, l'agence fédérale de protection de l'environnement (EPA) indique que ce procédé consiste à filtrer l'eau à travers des tamis microscopiques. Plus les trous du filtre sont petits, plus la quantité de contaminants que le filtre peut contenir est importante. Un filtre absolu d'un micron est nécessaire pour éliminer le protozoaire cryptosporidium271(*). L'EPA cite également l'ozonation (agent antimicrobien utilisé en lieu et place du chlore pour désinfecter l'eau) parmi les procédés régulièrement utilisés pour traiter l'eau en bouteille.
La réglementation fédérale indique que tout traitement selon les procédés énoncés ci-dessous ou « tout autre procédé, doit être effectué de manière à atteindre efficacement l'objectif visé et conformément à la section 409 de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques »272(*). De plus, « ces procédés doivent être mis en oeuvre dans et par un équipement et avec des substances qui n'altéreront pas le produit mis en bouteille »273(*). Il en résulte que les eaux minérales naturelles et les eaux de source peuvent être traitées, y compris par microfiltration, à condition qu'elles ne soient pas significativement altérées et respectent les normes d'identité. La FDA peut être consultée par les industriels afin de savoir si certains procédés modifient sensiblement la composition chimique de l'eau en bouteille274(*).
Cette interprétation est confirmée par le code de pratique de l'association professionnelle des producteurs d'eau en bouteille IBWA qui considère qu'une eau minérale ou une eau de source peut être qualifiée de « naturelle » si elle provient d'une formation souterraine ou de l'eau de surface, ne nécessite qu'un traitement minimal (minimal processing), ne provient pas d'un réseau public d'eau potable et n'est pas modifiée, sauf pour un « traitement limité » (par exemple, la filtration, l'ozonation ou un traitement désinfectant équivalent). La FDA a en effet reconnu « l'élimination sélective des éléments indésirables » comme une forme de traitement limité275(*).
Ainsi, la norme de performance (performance standard) définie par l'IBWA considère qu'« un procédé visant à éliminer tout élément indésirable (par exemple, le bromure, l'arsenic) de l'eau en bouteille doit être sélectif et ne pas altérer l'eau de manière significative. Tant qu'un tel traitement est sélectif et conforme aux politiques de la FDA sur l'utilisation du terme « naturel », ce traitement n'empêche pas l'étiquetage du produit comme étant « naturel ». Le traitement minimal de l'eau de source, de l'eau minérale, de l'eau artésienne ou de l'eau de puits afin d'éliminer ou de réduire de manière sélective la concentration d'éléments indésirables d'origine n'empêche pas l'étiquetage du produit en tant qu'« eau de source », « eau minérale », « eau artésienne » ou « eau de puits », selon le cas, pour autant que toutes les autres exigences de la norme d'identité applicable soient respectées ».
Cependant, certains États fédérés définissent de façon plus restrictive la notion de « traitement minimal ». C'est le cas notamment de l'État du Massachussetts qui définit le traitement minimal comme « le traitement de l'eau à des fins de désinfection, limité à l'utilisation de filtres (papier, charbon actif et/ou particules), à l'ozonation et/ou à l'utilisation de rayons ultraviolets. Toute autre activité de traitement, y compris, mais sans s'y limiter, l'échange d'ions et l'osmose inverse, est considérée comme allant au-delà d'un traitement minimal »276(*).
c) Les permis d'exploitation des sources d'eau souterraine et des usines d'embouteillage
Selon l'article 129.3 de la réglementation relative aux bonnes pratiques de fabrication, une « source approuvée » désigne une source d'eau, qu'il s'agisse d'une source naturelle, d'un puits artésien, d'un puits foré, d'un système municipal d'approvisionnement en eau ou de toute autre source, qui a été inspectée et dont l'eau a été échantillonnée, analysée et jugée d'une qualité sûre et répondant aux exigences sanitaires, conformément aux lois et réglementations fédérales et locales. La présence dans l'usine de certificats d'autorisation ou de permis en cours de validité émanant de la FDA ou des agences compétentes atteste de l'approbation de la source d'approvisionnement en eau. Les bonnes pratiques de fabrication définissent également les normes de sécurité et les conditions sanitaires des installations de production d'eau en bouteille, qui sont précisées par la réglementation propre à chaque État.
La délivrance des autorisations d'exploitation des sources d'eau souterraine et des usines d'embouteillage relève de la compétence des États fédérés. En règle générale, la demande d'autorisation d'exploitation de la source d'eau et de l'installation de production peut être effectuée simultanément. Il n'existe pas de procédure distincte de reconnaissance du statut d'eau minérale naturelle ou d'eau de source. Les entreprises produisant de l'eau en bouteille autorisées dans un État, mais souhaitant vendre leurs produits dans un ou plusieurs autres États doivent également obtenir une autorisation de la part du ou des États concernés277(*).
Dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une source d'eau souterraine, les documents suivants sont généralement exigés : le formulaire de demande complété, le paiement d'une redevance, les résultats d'analyses chimiques, physiques, bactériologiques et radiologiques de chaque source d'eau et les résultats d'analyses du produit final effectuées par un laboratoire certifié par les autorités compétentes de l'État, une copie des étiquettes prévues et, s'agissant des eaux étiquetées comme « eau de source » ou « eau artésienne », des rapports hydrogéologiques indépendants permettant de vérifier la conformité à la réglementation. L'État de Géorgie précise par exemple que « l'eau de source prélevée directement à la source ou acheminée par gravité vers un réservoir doit être vérifiée par écrit par l'autorité d'inspection de l'État ou de la municipalité où se trouve la source »278(*).
La réglementation de certains États prévoit des dispositions spécifiques de protection des sources d'eau souterraine naturelle, comme par exemple dans l'État de New York : « Toutes les sources (spring sources) doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes : (1) Une paroi étanche doit entourer complètement la source [...] ; (2) Un couvercle étanche et verrouillé doit être installé au sommet du mur d'enceinte [...] ; (4) Un fossé ou une berme doit être construit et régulièrement entretenu pour détourner les eaux de surface de la source [...] ; (5) L'eau de source ne peut être captée qu'à l'orifice naturel de la source ou par un forage adjacent à l'orifice naturel. L'eau de source captée à l'aide d'une force extérieure ou par un trou de forage [...] doit conserver les mêmes propriétés physiques, la même composition et la même qualité que l'eau qui s'écoule naturellement à la surface de la terre »279(*).
Pour l'autorisation des installations de production d'eau embouteillée, des plans détaillés de l'installation et des plans d'analyse des risques décrivant les différentes étapes du processus de production sont habituellement soumis avant le début de la construction. Une inspection sur place est aussi réalisée avant le démarrage de l'installation280(*).
Dans la plupart des États, les autorisations d'exploitation de sources d'eau embouteillée et d'usine d'embouteillage sont délivrées pour une durée d'un an et doivent être renouvelées à cette fréquence pour continuer à opérer. Ces autorisations peuvent être retirées ou suspendues par les autorités compétentes en cas de manquement avéré à la réglementation ou encore en cas de fraude281(*).
d) Les modalités de contrôle et de surveillance des sites d'exploitation
Les sources et sites d'exploitation des eaux en bouteille sont contrôlés à trois niveaux : par les industriels eux-mêmes en vertu de la réglementation et s'ils participent à d'éventuels programmes de certification facultatifs, par les autorités compétentes de chaque État et, éventuellement, par la FDA.
Afin de s'assurer de la conformité de l'eau en bouteille produite aux lois et réglementations applicables - en particulier au standard de qualité - le cadre juridique fédéral exige que l'opérateur de chaque usine réalise les contrôles suivants :
- concernant la ou les sources d'eau, des échantillons d'eau provenant de chaque source utilisée par l'usine doivent être prélevés et analysés par l'usine « aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an pour les contaminants chimiques et une fois tous les quatre ans pour les contaminants radiologiques ». En outre, l'eau provenant d'une source autre qu'un réseau public doit être échantillonnée et analysée pour les coliformes totaux au moins une fois par semaine (article 129.35, bonnes pratiques de fabrication)282(*) ;
- concernant le produit fini, à des fins bactériologiques, prélever et analyser au moins une fois par semaine, pour les coliformes totaux, un échantillon représentatif d'un lot ou d'un segment d'une production continue pour chaque type d'eau potable embouteillée produite au cours d'une journée de production. Si des organismes coliformes sont détectés, des analyses complémentaires doivent être effectuées pour déterminer s'il s'agit d'Escherichia coli et, à des fins chimiques, physiques et radiologiques, prélever et analyser au moins une fois par an un échantillon représentatif d'un lot ou d'un segment d'une production continue pour chaque type d'eau potable embouteillée produite au cours d'une journée de production (article 129.80 des bonnes pratiques de fabrication).
Ces échantillons doivent être analysés selon des méthodes et par des laboratoires agréés par les autorités compétentes. Chaque usine doit tenir un registre indiquant la date de l'échantillonnage, le type de produit, le code de production et les résultats de l'analyse ; ces informations doivent être conservées pendant au moins deux ans (article 129.80 des bonnes pratiques de fabrication).
Certains États prévoient une fréquence d'échantillonnage de contrôle plus importante. Par exemple, dans l'État de New York, la fréquence des tests augmente avec le volume de production283(*).
Si les résultats d'analyse d'un échantillon dépassent les limites fixées par la réglementation concernant certaines substances (standard de qualité), l'exploitant doit prélever et analyser des échantillons supplémentaires (par exemple, trois échantillons supplémentaires dans les 24 heures). Si les résultats de ces nouveaux échantillons confirment le dépassement des valeurs limites, l'infraction est confirmée. Cependant, la législation fédérale n'impose pas explicitement à l'opérateur de signaler cette infraction à la FDA ou à l'autorité compétente. Les infractions sont donc souvent constatées lors des programmes d'inspection de la FDA ou des États284(*).
La FDA supervise les inspections des usines d'embouteillage. L'agence inspecte elle-même certains sites d'exploitation dans le cadre de son programme général de sécurité alimentaire et confie aux États la réalisation de certaines inspections de sites d'exploitation dans le cadre de contrats285(*). Les tâches d'inspection comprennent la vérification que l'eau utilisée provient d'une source approuvée, la vérification que l'étiquetage de l'eau embouteillée est conforme à la réglementation, l'inspection des zones de nettoyage et d'assainissement de l'installation, l'inspection des opérations de remplissage, capsulage et scellage des bouteilles et la vérification que les entreprises analysent les sources d'eau et les produits selon la fréquence prévue. En général, les inspecteurs ne prélèvent des échantillons d'eau que « pour un motif valable »286(*).
La plupart des États prévoient également des obligations de reporting annuel, voire mensuel. À titre d'illustration, dans le Minnesota, chaque opérateur doit fournir un rapport d'exploitation mensuel indiquant notamment l'eau produite quotidiennement, les produits chimiques ajoutés quotidiennement, les opérations d'entretien de l'installation et les problèmes opérationnels détectés et résolus287(*). Sur cette base, les autorités compétentes des États peuvent décider de réaliser des inspections sur site.
Enfin, les entreprises d'eau embouteillée peuvent volontairement se soumettre à une certification par l'intermédiaire de leur fédération professionnelle IBWA ou de la Fondation nationale pour l'assainissement (NSF). Le programme de certification de l'eau embouteillée de la NSF prévoit notamment des inspections annuelles inopinées de l'usine et des tests annuels approfondis des produits pour plus de 160 substances chimiques, radiologiques et microbiologiques. Les entreprises qui satisfont à toutes les exigences peuvent apposer le logo de la NSF sur leurs produits288(*).
Dans un rapport publié en 2009, l'organisme d'audit et d'évaluation des comptes publics du Congrès des États-Unis (Government Accountability Office) relevait que les usines d'eau en bouteille avaient une faible priorité dans le cadre du programme d'inspection de la FDA, compte tenu de l'approche fondée sur les risques de l'agence et des bons résultats de ce secteur en matière de sécurité (en moyenne, l'agence avait consacré 2,6 postes équivalents temps plein à l'inspection des usines d'eau en bouteille entre 2000 et 2008)289(*). Par ailleurs, les inspections, dont la fréquence était estimée à l'époque par l'organisme d'audit à une inspection par usine tous les deux ou trois ans, reposent de façon croissante sur les autorités compétentes des États290(*).
e) Les sanctions administratives et/ou judiciaires
Les eaux en bouteille non conformes contenant des substances dépassant les normes de qualité peuvent être considérées comme « falsifiées » (adulterated)291(*), ce qui constitue une infraction en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FDC Act)292(*).
Si elle constate une infraction, la FDA peut décider de sanctions administratives : inspections, lettres dites « sans titres » notifiant une infraction non en matière d'étiquetage ou de processus de fabrication, lettres d'avertissement, demandes de destruction volontaire ou encore rappels de produits293(*). Des poursuites civiles (notamment en vue de saisies ou d'injonctions), voire pénales peuvent également être entamées294(*). En vertu de l'article 303 du FDC Act, les violations pénales sont généralement traitées comme des délits, ce qui signifie qu'elles sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 dollars (960 euros) ou d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an. Néanmoins, certaines violations peuvent constituer un crime s'il s'agit d'un deuxième délit ou d'un délit mineur commis avec « l'intention de frauder ou d'induire en erreur »295(*) et sont alors passibles d'une amende de 10 000 dollars (9 600 euros) ou d'une peine d'emprisonnement jusqu'à trois ans. Par ailleurs, en tant qu'agence exécutive, la FDA n'a pas un droit de poursuite autonome et doit se coordonner avec le ministère de la justice (DOJ)296(*).
La doctrine relève que les poursuites pénales au titre du FDC Act sont rares : seul 1 % des inspections conduites par la FDA déboucheraient sur des poursuites pénales. Selon le manuel de procédure de la FDA, l'agence donne généralement aux individus et aux entreprises la possibilité de se conformer volontairement à la loi avant d'engager des poursuites pénales, à condition que la violation n'entraîne pas de conséquences graves pour la santé publique297(*).
Les États peuvent également imposer des sanctions administratives en cas d'infractions aux procédures et règles d'autorisation d'exploitation (par exemple, une amende allant jusqu'à 2 000 dollars (environ 1 900 euros) ou la révocation de l'autorisation d'exploitation peuvent être décidées par l'autorité compétente de l'État de New York en cas d'infraction298(*)).
f) Mesures récentes et actualité du sujet
Les recherches n'ont pas mis en évidence l'existence de projets d'évolutions législatives ou réglementaires au niveau fédéral concernant la production d'eau embouteillée.
ANNEXE 3
DOCUMENTS
TRANSMIS PAR L'ÉLYSÉE
Les documents sont accessibles en ligne sur la page internet de la commission d'enquête.
* 1 Il s'agit de puits contenant des instruments permettant de mesurer le niveau de l'eau.
* 2 Sénat, Politiques publiques en matière de contrôle des traitements des eaux minérales naturelles et de source, Rapport d'information n° 42 (2024-2025), déposé le 16 octobre 2024.
* 3 Le rapporteur a aussi entendu, en auditions-rapporteur, ouvertes aux membres de la commission, plusieurs personnes qui avaient souhaité s'exprimer à propos des prélèvements d'eau à Volvic ou des activités de la société Agrivair, filiale de Nestlé, dans les Vosges.
* 4 Ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé du 4 juillet 2022 au 18 décembre 2023, puis ministre de la santé et de la prévention du 19 décembre 2023 au 11 janvier 2024.
* 5 Directeur de cabinet de la Première ministre du 17 mai 2022 au 17 juillet 2023, puis ministre de la santé et de la prévention du 20 juillet au 20 décembre 2023.
* 6 Ministre déléguée chargée de l'industrie du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022.
* 7 Ministre délégué chargé de l'Industrie du 4 juillet 2022 au 8 janvier 2024 puis ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie du 8 février 2024 au 5 septembre 2024.
* 8 CEDH, Corbet et autres contre France, 16 juin 2015.
* 9 Sauf de rares exceptions limitativement énumérées.
* 10 Sa production annuelle atteint 1,5 milliard de litres, soit 6 millions de cols par jour, et le chiffre d'affaires 207 millions d'euros. Évian figure parmi les eaux les plus reconnues mondialement, puisqu'elle exporte 64 % de sa production.
* 11 En 2024, y ont été embouteillées près de 767 millions de bouteilles sur neuf lignes de production, dont une ligne verre et une ligne de boissons aromatisées.
* 12 Perrier est distribué dans plus de cent quarante pays et occupe une place de leader sur plusieurs marchés stratégiques. En France, la marque est notamment leader sur le marché des eaux gazeuses. En 2024, le site a produit 1,251 milliard de bouteilles.
* 13 Cette limite est portée à 0,70 euro par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.
* 14 Aucune donnée globale n'est disponible avant l'année 2020.
* 15 Réponse écrite au questionnaire de la commission d'enquête.
* 16 Le groupe Sources Alma, dont le siège est dans l'Orne, numéro 1 en France sur le marché des eaux plates en bouteille, commercialise des eaux minérales naturelles sous les appellations Vichy Célestins, St-Yorre, Thonon ou encore Châteldon, ainsi que des eaux de source (Cristaline) et des boissons aromatisées. Il détient 17 filiales qui exploitent 19 marques d'eau en bouteille.
* 17 Avis de l'ex-Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à une demande d'approbation d'un procédé de traitement pour les eaux de source et les eaux minérales naturelles.
* 18 Audition de Nicolas Bouvier, représentant d'intérêts de Nestlé Waters à compter de mai 2022, par la commission d'enquête.
* 19 Directive européenne 2009/54/ CE relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
* 20 Prévues à l'article L. 1324-1 A du code de la santé publique.
* 21 La Cour de cassation a même étendu cette obligation aux personnes investies d'un mandat public qui concourent à la gestion des affaires de l'État ou d'une collectivité territoriale.
* 22 CE, 15 mars 1996, Guigan.
* 23 Cass, Crim, 19 septembre 2000, n° 99-83 960.
* 24 Pour mémoire, il s'agit de traitements ultraviolets, de filtres à charbon actifs et de microfiltres à 0,2 micron.
* 25 Fiche-ministre intitulée « Suite de l'entretien avec la société Nestlé Waters - informations sur les traitements autorisés sur les eaux conditionnées sur les investigations conduites par le SNE de la DGCCRF dans le secteur ».
* 26 Courriel de Sabrina Mekhous du bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé du 2 mars 2021 aux services de l'ARS Occitanie et à l'Anses à la suite de signalements de non-conformité sur les eaux de Perrier.
* 27 Date de la « fiche ministre » établie par la DGCCRF à la suite de la réunion du 31 août 2021.
* 28 1er alinéa de l'article L521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. »
* 29 Autorité(s) compétente(s).
* 30 P.7 point 14.
* 31 Autorité centrale compétente.
* 32 P.16 point 70.
* 33 P.21 Conclusions générales.
* 34 Article L. 1324-1 A du code de la santé publique.
* 35 Ce « bleu » est le compte-rendu de la concertation interministérielle dématérialisée des 22 et 23 février 2023 qui autorisera notamment Nestlé Waters à pratiquer la microfiltration à 0,2 microns.
* 36 Audition du 18 février 2025.
* 37 D'autres forages de Nestlé Waters ont été mis à l'arrêt par l'exploitant, après discussion avec les services de l'État, dans les Vosges en raison de non conformités microbiologiques : Hépar Nord et Essar (Hépar), Thierry Lorraine et Belle Lorraine (Contrex).
* 38 Il s'agit en fait de Nestlé Waters dans les Vosges.
* 39 Voir dans la partie II La microfiltration ou comment tordre la règlementation et le bras de l'État pour remplacer des traitements interdits par un traitement non autorise.
* 40 Audition du mercredi 12 mars 2025.
* 41 Audition du jeudi 13 mars 2025.
* 42 La préfète du Gard ne transmet au directeur général de l'ARS et à la DREAL que le 6 avril 2023 le plan de transformation de Nestlé Waters Supply South. Plan qui n'a été remis à la préfète, à sa demande, que le 28 mars par Mathilde Bouchardon, conseillère santé du ministre de l'industrie.
* 43 Directive 2009/54/ce du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, article 11.
* 44 MSS : ministère de la santé, MEFR : ministère de l'économie.
* 45 Le courriel de Lucile Poivert, conseillère santé et biens de consommation auprès de la ministre chargée de l'Industrie, à Clément Lacoin, directeur adjoint du cabinet du ministre des solidarités et de la santé, date du 24 septembre 2024, et indique même que cette transmission intervient après une relance de Nestlé qui a interrogé le cabinet industrie sur les suites apportées à ses révélations !
* 46 Une inspection a été diligentée par l'ARS Grand Est en novembre 2022 afin de s'assurer du retrait de ces traitements, et un suivi virologique renforcé a été mis en place.
* 47 Rapport établi à la suite de la présentation par NWSE de son plan de transformation par l'ARS Grand Est en date du 1er juillet 2022, p. 5 et 6.
* 48 Soit l'arrêté préfectoral n° 365/2012/ARSDT88/VSSE du 30 novembre 2012 portant autorisation d'exploiter l'eau du captage « Bonne Source » sous la dénomination Vittel, l'arrêté préfectoral n° 2013-0270 du 19 avril 2013 portant autorisation d'exploiter les captages « Grande Source » sous la dénomination Vittel.
* 49 Arrêté n° 2023-3461/ ARS/ DT88/ VSSE concernant Vittel « Bonnes sources », arrêté préfectoral n° 2023-3460/ARS/DT88/VSSE concernant Vittel « Grandes sources ».
* 50 Procédure au terme de laquelle la personne mise en cause, qui reconnaît les faits, se voit proposer une peine par le parquet qu'il est libre d'accepter ou de refuser. S'il l'accepte, elle doit ensuite être homologuée par un juge. S'il la refuse, il est alors convoqué devant le tribunal correctionnel.
* 51 De juillet 2020 à décembre 2021.
* 52 Entre décembre 2021 et mai 2022.
* 53 Ministre de la santé et de la prévention du 20 mai au 4 juillet 2022.
* 54 Ministre chargé de la santé et de la prévention du 4 juillet 2022 au 20 juillet 2023.
* 55 Ministre de la santé et de la prévention du 20 juillet 2023 au 20 décembre 2023.
* 56 Ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé du 4 juillet 2022 au 18 décembre 2023, puis ministre de la santé et de la prévention du 19 décembre 2023 au 11 janvier 2024.
* 57 Ministre de la santé et de la prévention du 8 février au 21 septembre 2024.
* 58 Ministre de la santé et de l'accès aux soins du 21 septembre 2024 au 23 décembre 2024.
* 59 Ce qui est une évidence puisque le courriel évoque l'enquête sur le groupe Alma.
* 60 Une note confidentielle de la DGCCRF datée du 15 décembre 2020 souligne que l'injection illicite de sulfate de fer est pratiquée depuis les années 1980.
* 61 Constaté par l'ARS lors de son inspection du 6 avril 2022.
* 62 Idem.
* 63 Déclarés par Nestlé Waters dans son questionnaire transmis dans le cadre de la mission de l'Igas.
* 64 Audition du mardi 10 décembre 2024.
* 65 Ibid.
* 66 Audition du jeudi 13 février 2025.
* 67 Rapport de l'Igas n° 2021-108R, page 25.
* 68 Audition du mercredi 12 février 2025.
* 69 Audition du mardi 11 février 2025.
* 70 16 décembre 2022 et 13 janvier 2023.
* 71 La MEMN regroupe Bonneval Waters (Savoie), Danone, La Compagnie des Pyrénées (Eau Neuve en Haute Ariège), Mont-Roucous, Spadel (groupe belge présent en Alsace avec les sources minérales de Wattwiller et Carola de Ribeauvillé).
* 72 Commission d'enquête du Sénat, Maison des eaux minérales naturelles, Contribution aux travaux de la Commission - Avril 2025.
* 73 « En France, l'autorité administrative a, pour au moins un forage, autorisé l'utilisation de filtres à 0,45 ìm ».
* 74 Rapport final d'un audit réalisé en France du 11 au 22 mars 2024 afin d'évaluer le système de contrôles officiels relatifs aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source, DG(SANTE)2024-8144, 13 août 2024.
* 75 Audition du mardi 4 mars 2025.
* 76 Sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation à la DGS.
* 77 Audition du 3 mars 2025.
* 78 Note signée par Virginie Cayré, alors directrice générale de l'ARS Grand Est à destination de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, rédigée le 28 mars 2023 et transmise à la commission d'enquête.
* 79 Une telle modification aurait toutefois dû être notifiée à la Commission européenne, ce qui obligeait alors au respect d'un statu quo de 3 mois minimum pendant lequel la Commission et les États membres se seraient prononcés sur son opportunité.
* 80 L'agence française de sécurité sanitaire des aliments - laquelle a fusionné avec l'Afset, en 2010, pour donner naissance à l'Anses.
* 81 De juillet 2020 à décembre 2021.
* 82 Entre décembre 2021 et mai 2022.
* 83 Entre juillet 2022 et juin 2024.
* 84 Du 8 mars 2021 au 20 août 2023.
* 85 Nestlé Vosges.
* 86 Structure faîtière du groupe Nestlé qui comporte un directeur général, aujourd'hui Laurent Freixe, et un président du conseil d'administration, Paul Bulcke, lui-même directeur général de 2008 à 2016.
* 87 Rapport établi à la suite de la présentation par NWSE de son plan de transformation par l'ARS Grand Est en date du 1er juillet 2022, p. 5 et 6
* 88 Soit l'arrêté préfectoral n° 365/2012/ARSDT88/VSSE du 30 novembre 2012 portant autorisation d'exploiter l'eau du captage « Bonne Source » sous la dénomination Vittel, l'arrêté préfectoral n° 2013-0270 du 19 avril 2013 portant autorisation d'exploiter les captages « Grande Source » sous la dénomination Vittel.
* 89 Arrêté n° 2023-3461/ ARS/ DT88/ VSSE concernant Vittel « Bonnes sources », arrêté préfectoral n° 2023-3460/ARS/DT88/VSSE concernant Vittel « Grandes sources ».
* 90 Note d'appui scientifique et technique de l'Anses, 16 octobre 2023, transmise à la commission d'enquête.
* 91 A raison d'un volume journalier >500m3 selon l'hypothèse de la préfecture, il faudrait ajouter encore plus de 50 000 m3 à la date de publication du rapport.
* 92 Note du 30 novembre 2022 rédigée par le cabinet du ministre de la santé au cabinet de la Première ministre.
* 93 Note intitulée « Compte rendu de la décision NSWE 20 230 216 » transmise à la commission par les services de Matignon.
* 94 Note signée par Virginie Cayré, alors directrice générale de l'ARS Grand Est à destination de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, rédigée le 28 mars 2023 et transmise à la commission d'enquête.
* 95 Réponse par écrit au questionnaire de la commission d'enquête par Jérôme Bonet, préfet du Gard.
* 96 Audition du jeudi 30 janvier 2025.
* 97 Article R.1322-37-1 du code de la santé publique.
* 98 Arrêté n° 2023-3461/ ARS/ DT88/ VSSE concernant Vittel « Bonnes sources », arrêté préfectoral n° 2023-3460/ARS/DT88/VSSE concernant Vittel « Grandes sources ».
* 99 Pour rappel, la « Source Perrier » est alors exploitée à partir des forages Romaine IV, IV bis, VI, VII et VIII.
* 100 Rapport des hydrologues, 4 avril 2025, p. 109.
* 101 Il s'agit de délits sanctionnant des faits d'atteinte à la probité.
* 102 Cette peine complémentaire est prévue à l'article L.2141-1 du code de la commande publique
* 103 Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
* 104 Propos tenus lors de son audition par la commission d'enquête le 20 mars 2025.
* 105 Infraction prévue à l'article L. 441-1 du code de la consommation et sanctionnée aux articles L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.
* 106 Circulaire du 11 mai 2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale et circulaire du 9 octobre 2023 de politique pénale en matière de justice environnementale du 9 octobre 2023.
* 107 https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2023-01/Lignes %20directrices %20sur %20la %20mise %20en %20oeuvre %20de %20la %20convention %20judiciaire %20d %27int %C3 %A9r %C3 %AAt %20public_PNF_16 %20janvier %202 023 %20liens %20actifs.pdf
* 108 Convention judiciaire d'intérêt public conclue entre la société Airbus SE et le procureur de la République financier le 29 janvier 2020, homologuée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2021.
* 109 Il s'agit de puits contenant des instruments permettant de mesurer le niveau de l'eau.
* 110 Article R. 1322-16 du code de la santé publique.
* 111 Articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique.
* 112 Informations transmises par Guillaume Pfund à la commission d'enquête en réponse au questionnaire du rapporteur.
* 113 Article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement.
* 114 L'arrêté-cadre départemental du 7 mai 2024 instaure ainsi des exemptions spécifiques aux établissements disposant d'un plan de sobriété hydrique, comme c'est le cas de la société anonyme d'exploitation d'Évian (SAEME), et ce en fonction du niveau de gravité des périodes de sécheresse.
* 115 Ils figurent dans la convention judiciaire d'intérêt public environnementale signée entre Nestlé Waters Supply Est SAS (NWSE) et le procureur de la République d'Épinal.
* 116 Sous réserve des éléments sur les besoins en formation informatique évoqués supra.
* 117 Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020.
* 118 Voir par exemple : https://www.quechoisir.org/actualite-pfas-le-tfa-pourrait-rendre-nos-eaux-potables-non-conformes-n132 438/ ; https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/12/04/pfas-le-polluant-eternel-tfa-contamine-aussi-les-eaux-minerales-en-bouteille_6428 664_3244.html ; https://www.letemps.ch/economie/pfas-plastiques-ou-pesticides-les-eaux-minerales-suisses-ne-sont-pas-pures ?srsltid=AfmBOoquJpdbkTUnEh7eR8cWwagwcqwMszm6Gfrg5X2QizWtCGige0iR
* 119 Le LHN a inscrit dans ses activités des études méthodologiques citées ci-dessous : Étude de la migration de l'acétaldéhyde, du 2 methyl 1,3 dioxolane, du 1,3 dioxolane et du 1,4 dioxane des bouteilles en poly(éthylène) téréphtalate (PET) vers l'eau embouteillée. Étude en cours.
Influence potentielle de la gazéification (ajout de gaz carbonique) sur la flore aérobie revivifiable dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source. Étude en cours.
* 120 Rapport d'information de Mme Antoinette Guhl, Sénatrice, sur les politiques publiques en matière de contrôle et de traitement des eaux minérales naturelles et de source, p.57.
* 121 Audition du 15 janvier 2025.
* 122 Par exemple, l'arrêté de suspension de l'exploitation du forage Romaine VIII sur le site de Vergèze dans le Gard ainsi que de la suspension par Nestlé des forages Thierry Lorraine et Belle Lorraine (Contrex) fin novembre 2022 à la demande de l'ARS Grand Est et de deux forages Hépar Nord et Essar (Hépar) en mai 2023, à la suite d'une décision conjointe des ministères de l'industrie et de Matignon le 16 février 2023.
* 123 Article 85 du code de procédure pénale.
* 124 Article L. 623-9 du code de la consommation.
* 125 Article R. 214-1 du code de l'environnement.
* 126 Les unités de conditionnement désignent les chaînes de conditionnement d'eau de qualité homogène - à distinguer des sites de conditionnement, qui peuvent comporter plusieurs unités de conditionnement. Bilan de la qualité des eaux conditionnées en France, Direction générale de la santé, décembre 2024.
* 127 Article R. 214-3 du code de l'environnement.
* 128 Article R. 211-21-1 du même code.
* 129 Article L. 211-3 du code de l'environnement.
* 130 Article R.1321-7 du code de la santé publique pour les eaux de sources et article R.1322-6 pour les eaux minérales naturelles.
* 131 Lignes directrices pour l'évaluation des eaux minérales naturelles au regard de la sécurité sanitaire, Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), 2008.
* 132 À titre d'exemple, l'eau minérale de la « Source Contrex », commercialisée sous la désignation commerciale « Contrex » est un mélange qui provient de cinq captages : Anger-Lorraine et Belle-Lorraine situés sur la commune de Crainvilliers (Vosges) et Reine-Lorraine, Grande Source et Thierry-Lorraine situés sur la commune de Contrexéville. De même, la « Source Perrier » est issue des captages Romaine IV et Romaine IV bis à Vergèze et Romaine VI, Romaine VII et Romaine VIII à Uchaud (actuellement suspendu).
* 133 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire.
* 134 Article R. 1322-37-1 du code de la santé publique.
* 135 Article R. 1322-5 du code de la santé publique.
* 136 Arrêté du 5 mars 2007relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle pour le conditionnement, l'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique.
* 137 Qui accueillent les agents locaux de la DGCCRF.
* 138 Article L. 1321--2 du code de la santé publique.
* 139 Article R. 1322-16 du code de la santé publique.
* 140 Lignes directrices pour l'évaluation des eaux minérales naturelles au regard de la sécurité sanitaire, Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), 2008.
* 141 Arrêté préfectoral n° 30-2023-12-22-00 009 modifiant l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif à l'exploitation de l'eau minérale de la source Perrier embouteillée sur le site sis au lieu-dit « Les Bouillens » sur la commune de Vergèze (Gard).
* 142 Articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique.
* 143 Audition du mardi 11 décembre 2024.
* 144 Audition de Célia de Lavergne, directrice de l'eau et de la biodiversité, mercredi 22 janvier 2025.
* 145 « Paquet hygiène » : règlement CE n° 178/2002 ; règlement CE n° 852/2004 ; règlement CE n° 863/2004 ; règlement CE n° 183/2005 ; règlement UE n° 2017 /625.
* 146 Article R. 1322-43 du code de la santé publique.
* 147 Article R. 1322-29 du code de la santé publique.
* 148 Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
* 149 Article R. 1322-44 du code de la santé publique.
* 150 Article R. 1322-44-1 du code de la santé publique.
* 151 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
* 152 Article L. 1321-5 du code de la santé publique.
* 153 Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
* 154 Audition du mardi 21 janvier 2025.
* 155 Audition du mercredi 22 janvier 2025.
* 156 Instruction du Gouvernement du 2 janvier 2024 relative à la stratégie des contrôles en matière de police de l'eau et de la nature (SNCPEN).
* 157 Audition de Célia de Lavergne, mercredi 22 janvier 2025.
* 158 Réponse au questionnaire écrit de la commission d'enquête.
* 159 Audition du jeudi 30 janvier 2025.
* 160 La directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 régit l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles au sein de l'Union européenne. Elle harmonise les conditions de vente des EMN et garantit leur conformité pour la consommation humaine. Selon cette directive, une eau minérale naturelle est définie par sa pureté originelle et sa composition minérale stable, pouvant avoir des effets bénéfiques sur la santé. Les eaux de source, quant à elles, doivent être potables à l'état naturel, mais ne nécessitent pas une composition minérale stable.
* 161 https://food.ec.europa.eu/system/files/2017-11/reg-com_gfl_20 171 016_sum.pdf (consulté le 7 mars 2025)
* 162 Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineral- und Tafelwasser-Verordnung).
* 163 Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Anerkennung und Nutzungsgenehmigung von natürlichem Mineralwasser.
* 164 Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
* 165 Journal officiel de l'Union européenne, liste des eaux minérales naturelles reconnues par les états membres (2013/C 95/03), avril 2013.
* 166 Réponse en date du 24 février 2025 à un courriel de la division de la législation comparée.
* 167 Cour administrative du Bade-Wurtemberg, décision n° 9 S 2883/11 du 20 juin 2013.
* 168 Cour administrative supérieure de Berlin-Brandebourg, décision n° OVG 5 B 7.05 du 27 mai 2008.
* 169 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB.
* 170 Exemples : l'Autorité de la justice et de la protection des consommateurs (Behörde für Justiz und Verbraucherschutz) à Hambourg et l'Office régional pour la protection du travail, la protection des consommateurs et la santé (Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit - LAVG) dans le Brandebourg.
* 171 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG.
* 173 LFBG, article 39.
* 174 Frankfurter Allgemeine Zeitung, article « Umweltschützer finden Chemikalien im Trinkwasser », avril 2024 (consulté le 20 février 2025).
* 175 Süddeutsche Zeitung, article « BUND und BDEW : PFAS-Belastung - Hersteller sollen zahlen / BUND findet Ewigkeits-Chemikalien in Mineral- und Leitungswasser », avril 2024 (consulté le 21 février 2025).
* 176 Bildzeitung, article « Wie steht es um unser Trinkwasser ? », octobre 2024. (consulté le 21 février 2025).
* 177 Acquitalia, Natural Mineral Water Industry 2024-2025.
* 178 Food in Action, article « L'importance de s'hydrater : les Belges boivent plus d'eau » (consulté le 6 mars 2025).
* 179 La directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 régit l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles au sein de l'Union européenne. Elle harmonise les conditions de vente des EMN et garantit leur conformité pour la consommation humaine. Selon cette directive, une eau minérale naturelle est définie par sa pureté originelle et sa composition minérale stable, pouvant avoir des effets bénéfiques sur la santé. Les eaux de source, quant à elles, doivent être potables à l'état naturel, mais ne nécessitent pas une composition minérale stable.
* 180 Arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source.
* 181 Site internet du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, page sur les eaux minérales naturelles (consulté le 5 février 2025).
* 182 Site internet du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, page sur les eaux de source (consulté le 5 février 2025).
* 183 Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du code de l'Environnement constituant le code de l'eau.
* 184 Site internet du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, page sur les eaux minérales naturelles (consulté le 5 février 2025).
* 185 Site internet du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, page sur les eaux de source (consulté le 5 février 2025).
* 186 SPF Santé publique, Communication relative aux traitements des eaux minérales naturelles et des eaux de source, mai 2024.
* 187 Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le code de l'eau.
* 188 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
* 189 Cellule Environnement (service public régional), page sur le captage d'eau souterraine & prévention (consulté le 5 février 2025).
* 190 Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable (...).
* 191 Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, notice explicative de la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée en 2024.
* 192 Décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
* 193 Arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine.
* 194 Protect'eau, page sur les zones de prévention (consulté le 7 février 2025).
* 195 Selon les services de l'AFSCA, contactés dans le cadre de l'étude, « il existe une circulaire relative à l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui est communiquée aux opérateurs belges concernés. Cette circulaire [prévoit] notamment que l'exploitant doit envoyer annuellement ses analyses de l'eau au SPF ».
* 196 RTBF, article « Fraude à l'eau minérale naturelle chez Nestlé : est-ce que cela pourrait arriver chez nous ? Comment contrôle-t-on ? », décembre 2024 (consulté le 7 février 2025).
* 197 Informations fournies par l'AFSCA dans le cadre de l'étude.
* 198 Ibid.
* 199 Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
* 200 Informations fournies par l'AFSCA dans le cadre de l'étude.
* 201 État de l'environnement wallon, page sur les prélèvements en eau (consulté le 7 février 2025).
* 202 L'article D. 178. § 2. de la partie décrétale du code de l'environnement de Wallonie prévoient quatre catégories d'infractions environnementales : 1° Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins 100 000 euros et au maximum de 10 000 000 euros ou d'une de ces peines seulement ; 2° Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1 000 000 euros ou d'une de ces peines seulement ; 3° Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois [et d'une amende] d'au moins 100 euros et au maximum 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement ; 4° Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1 000 euros.
* 203 RTBF, article « PFAS : 40 zones de distribution d'eau en Wallonie dépassent la recommandation du Conseil supérieur de la Santé », mai 2024 (consulté le 6 février 2025).
* 204 Conseil supérieur de la Santé (Région wallonne), avis n° 9791 : « PFAS et perchlorate dans l'eau en bouteille et l'eau utilisée pour la fabrication de denrées alimentaires », février 2024.
* 205 Site internet de la Région Wallonie, page Pollution aux PFAS : état de la situation, novembre 2023 (consulté le 6 février 2025).
* 206 Conseil supérieur de la Santé (Région wallonne), avis n° 9791 : « PFAS et perchlorate dans l'eau en bouteille et l'eau utilisée pour la fabrication de denrées alimentaires », février 2024.
* 207 Décret du 20 avril 2023 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
* 208 Wallonie environnement SPW, PFAS (consulté le 6 février 2025).
* 209 Conseil supérieur de la Santé (Région wallonne), avis n° 9791.
* 210 RTBF, article « Pollution aux PFAS : un débat extraordinaire lors de la prochaine commission Environnement du parlement wallon », novembre 2023 (consulté le 6 février 2025).
* 211 Acquitalia, Natural Mineral Water Industry 2024-2025.
* 212 Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano.
* 213 Ministerio de Sanidad y Política social (Subdirección General de Gestión de Riesgos Alimentarios), Tratamientos de aguas minerales naturales : microfiltración, mai 2009.
* 214 Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.
* 215 Réunion du groupe d'experts sur les eaux minérales naturelles de la Commission européenne tenue à Bruxelles le 6 mars 2009.
* 216 Dans le cadre de l'étude, les services du ministère de la santé ont été interrogés et ont confirmé que l'application des conclusions de la note de 2009 restaient d'actualité.
* 217 Chaque communauté autonome dispose de sa propre autorité minière compétente pour traiter ces demandes, conformément à la législation nationale. Par exemple, dans la communauté de Castille-et-León, cette compétence relève de la Direction générale de l'Énergie et des Mines.
* 218 Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
* 219 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
* 220 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
* 221 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria.
* 222 La Dépêche, article « Eaux minérales : comment des contaminations par des matières fécales ont provoqué la faillite d'un producteur espagnol » (consulté le 28 février 2025).
* 223 Huffington Post España, article « Examinan los pesticidas de 18 aguas minerales y una bastante consumida en España pasa la prueba con nota » (consulté le 28 février 2025).
* 224 Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
* 225 ABC Sociedad, article « España implantará un sistema para devolver botellas de plástico a cambio de dinero » (consulté le 28 février 2025).
* 226 Dans le cadre de l'étude, les services du ministère de la santé ont été interrogés et ont confirmé que l'application des conclusions de la note de 2009 restaient d'actualité.
* 227 Ibid., p. 31.
* 228 Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
* 229 Ministero della Salute, Decreto 10 febbraio 2015, Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. (15A01 419).
* 230 https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp ?lingua=italiano&id=4413&area=acque_potabili&menu=acque (consulté le 3 mars 2025).
* 231 https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp ?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=AM&idAmb=AMN&idSrv=RQ&flag=P (consulté le 3 mars 2025).
* 232 https://www.regione.toscana.it/-/dipartimenti-di-prevenzione-delle-aziende-usl (consulté le 7 mars 2025).
* 233 Voir par exemple, en Ombrie : https://leggi.alumbria.it/mostra_atto_stampabile.php ?&file=reg2019-003.xml&datafine=20 190 314 (consulté le6 mars 2025).
* 234 https://trasparenza.regione.abruzzo.it/servizi-erogati/carta-servizi/autorizzazione-allutilizzo-delle-sorgenti-di-acqua-minerale-naturale (consulté le 6 mars 2025)
* 235 Voir par exemple, ce retrait de reconnaissance en raison de la radioactivité élevée d'un eau minérale naturelle : Decreto 16 giugno 1999, n. 3309, Revoca del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fonte Garbarino di Lurisia in comune di Roccaforte Mondovi per la bibita in situ e per l'imbottigliamento e la vendita.
* 236 Circolare Ministero della Sanità del 13 settembre 1991 n. 17, Analisi microbiologiche di acque minerali naturali et Circolare Ministero della Sanità del 12 maio 1993 n. 19, Vigilanza sulla Utilizzazione e la Commercializzazione delle Acque Minerali.
* 237 HACCP, Manuale di corretta prassi operativa per l'igiene nel settore dell'acqua confezionata in Europa (consulté le 6 mars 2025).
* 238 https://www.acquando.it/it/i-controlli-sull-acqua-minerale (consulté le 6 mars 2025).
* 239 Voir par exemple le plan de contrôle 2023-2027 de la région des Marches : https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/programmazione-dellattivita-di-controllo-ufficiale/attivita-autorizzativevalidazioni-155-controllo-acque-minerali-e-acque-di-sorgente (consulté le 6 mars 2025).
* 240 Regio decreto, 19 ottobre 1930, n. 1398, Approvazione del testo definitivo del Codice Penale, art. 440.
* 241 https://ilsalvagente.it/2024/11/28/18-acque-minerali-in-laboratorio-ecco-le-4-senza-tracce-di-pesticidi/ (consulté le 6 mars 2025).
* 242 Ordonnance RS 817.022.12 du Département fédéral de l'Intérieur du 16 décembre 2016 sur les boissons.
* 243 Ordonnance RO 2017 1023 du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD), voir annexes 2 et 3.
* 244 Lettre d'information 2022/1 : Gestion des substances anthropiques dans l'eau minérale naturelle, du 19 avril 2022 :
------ https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/informationsschreiben.html (consulté le 27 février 2025).
* 245 La lettre d'information précise également que « Hormis l'adaptation de la teneur en dioxyde de carbone, les traitements admis au sens de l'article 8 de l'ordonnance sur les boissons se limitent à la décantation et à la filtration, éventuellement après aération, en vue d'éliminer des substances géogènes pouvant surtout détériorer le goût et l'odeur de l'eau minérale. Cela comprend également l'élimination partielle ou totale de substances telles que le fer ou le manganèse. En outre, l'élimination partielle ou totale du fluorure ou de l'arsenic est admise pour des raisons liées à la santé ».
* 246 Voir par exemple, dans le canton de Vaud, la loi 721.03 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal.
* 247 Loi fédérale RS 817.0 sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014.
* 248 Réponse du Conseil fédéral du 22 mai 2024 à une question parlementaire, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft ?AffairId=20 243 065 (consulté le 27 février 2025).
* 249 En règle générale, les chimistes cantonaux en application de l'article 49 LDAl.
* 250 Ordonnance OELDAl 817.042 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires.
* 251 252 Ordonnance OPCNP 817.032 du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP).
* 253 Ordonnance OPCNP 817.032 du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP).
* 254 RTS, 22 janvier 2025 : https://www.rts.ch/info/sante/2025/article/tfa-dans-les-eaux-minerales-suisses-une-purete-remise-en-question-28 765 032.html (consulté le 27 février 2025).
* 255 -- https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft ?AffairId=20 247 919 (consulté le 27 février 2025).
* 256 Joyce S. Ahn, Uncapping the Bottle : A Look Inside the History, Industry, and Regulation of Bottled Water in the United States, Journal of Food Law and Policy, Volume 3, Number 2, 2007.
* 257 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA), Title 21 United States Code §§ 301 et seq.
* 258 Code of Federal regulations, Title 21, Part 165, Beverages.
* 259 https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/bottled-water-everywhere-keeping-it-safe (consulté le 6 février 2025)
* 260 https://thefactsaboutwater.org/regulations/bottled-water/ (consulté le 6 février 2025).
* 261 https://bottledwater.org/about-ibwa/ (consulté le 6 février 2025)
* 262 https://bottledwater.org/ibwa-code-of-practice/ (consulté le 6 février 2025).
* 263 Joyce S. Ahn, op. cit., p. 23
* 264 IBWA, https://bottledwater.org/bottled-water-consumption-shift/ (consulté le 24 février 2025).
* 265 Ibid
* 266 Code of Federal regulations, Title 21, Part 165, § 165.110 Bottled water.
* 267 Ibid.
* 268 Ibid.
* 269 https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/bottled-water-everywhere-keeping-it-safe (consulté le 6 février 2025).
* 270 Title 21, Code of Federal Regulations, Part 129 Processing and bottling of bottled mineral water.
* 271 Voir fiche d'information de l'EPA, Health water series, Bottled Water basics (consulté le 6 février 2025).
* 272 Title 21, Code of Federal Regulations, Part 129 Processing and bottling of bottled mineral water.
* 273 Ibid.
* 274 IBWA, https://bottledwater.org/ibwa-comments-on-massachusetts-proposed-bottled-water-regulations/ (consulté le 24 février 2025).
* 275 IBWA, Code of practice, Rule 1 Definitions.
* 276 Code of Massachussets Regulations (CMR), 105 CMR 500.00: Good manufacturing practices for food.
* 277 Voir par exemple le formulaire de demande d'autorisation de l'État de l'Illinois : https://dph.illinois.gov/content/dam/soi/en/web/idph/forms/topics-services/food-safety/bottled-water-program/bottled-water-application-2024.pdf (consulté le 24 février 2025).
* 278 https://agr.georgia.gov/bottled-water-certification (consulté le 25 février 2025).
* 279 https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/bulk_bottle/docs/subpart5_6.pdf (consulté le 26 février 2025).
* 280 Voir par exemple la procédure dans l'État de l'Idaho : https://www.siphidaho.org/environmental-health/bottle-water.php (consulté le 25 février 2025).
* 281 Voir par exemple dans l'État du Minnesota : http://txrules.elaws.us/rule/title25_chapter229_sec.229.91 (consulté le 25 février 2025)
* 282 Des dérogations à la fréquence des tests à la source peuvent être autorisées si l'eau provient d'un système public d'eau potable conforme à la loi fédérale sur l'eau potable (Safe Drinking Water Act).
* 283 https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/bulk_bottle/docs/subpart5_6.pdf (consulté le 26 février 2025).
* 284 U.S. Government Accountability Office, Bottled Water: FDA Safety and Consumer Protections Are Often Less Stringent Than Comparable EPA Protections for Tap Water, 2009.
* 285 https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/bottled-water-everywhere-keeping-it-safe (consulté le 25 février 2025).
* 286 U.S. GAO, Ibid., p. 9.
* 287 https://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pabull?file=/secure/pabulletin/data/vol29/29-17/689b.html&d=reduce (consulté le 26 février 2025).
* 288 https://www.nsf.org/consumer-resources/articles/bottled-water (consulté le 26 février 2025)
* 289 U.S. GAO, Ibid., p. 10.
* 290 Ibid
* 291 Code of Federal regulations, Title 21, Part 165, § 165.110 Bottled water.
* 292 Title 21 U.S.Code § 331 - Prohibited acts.
* 293 FDA, https://www.fda.gov/food/compliance-enforcement-food (consulté le 26 février 2025). Pour plus de détail, voir le manuel de procédures : https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/compliance-manuals/regulatory-procedures-manual#_top (consulté le 26 février 2025).
* 294 FDA, https://www.fda.gov/media/71 837/download (consulté le 26 février 2025) et Title 21 U.S. Code §332 et §333.
* 295 Congressional Research Service, Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act: Select Legal Issues, 2018, p. 18.
* 296 Ibid
* 297 Ibid.
* 298 https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/bulk_bottle/docs/subpart5_6.pdf (consulté le 26 février 2025).