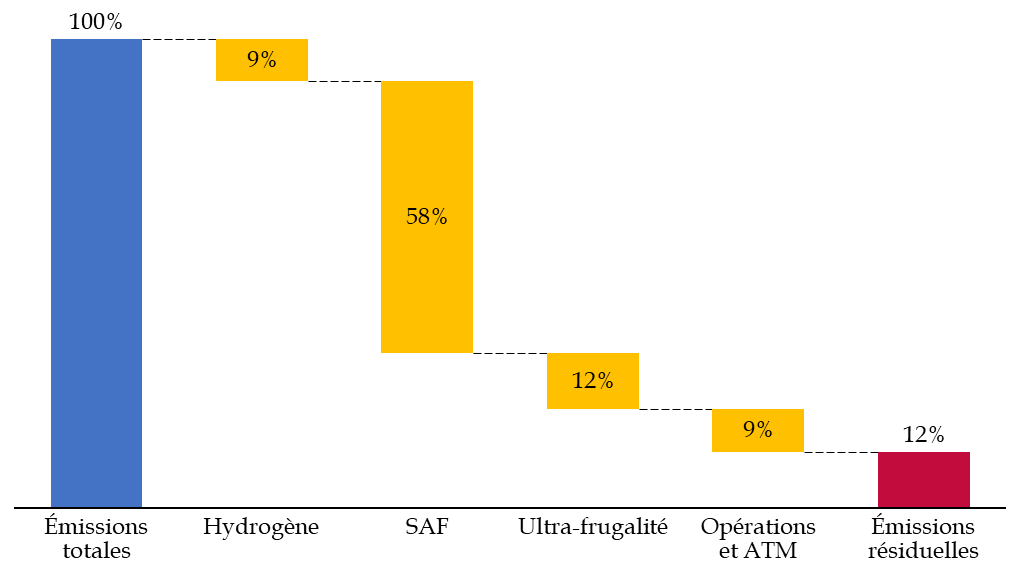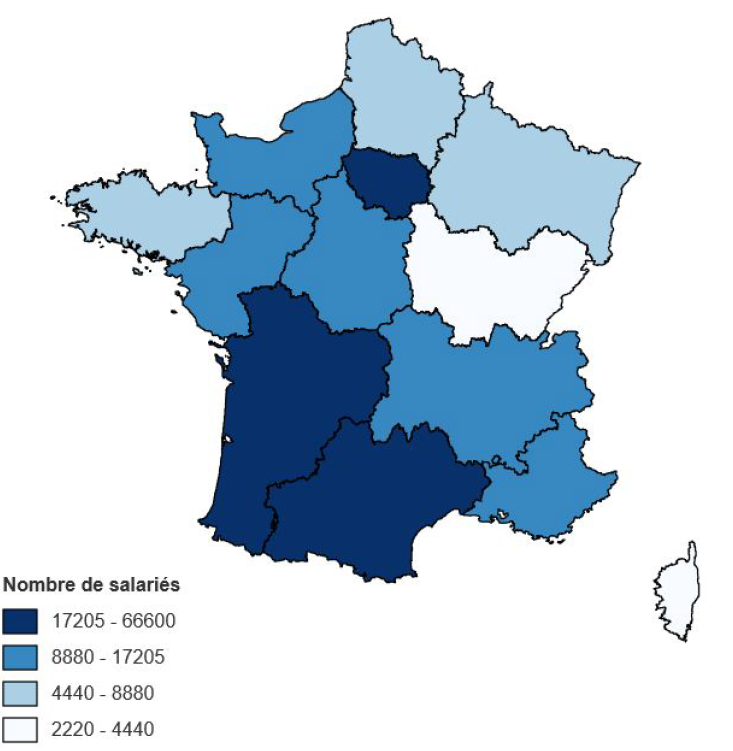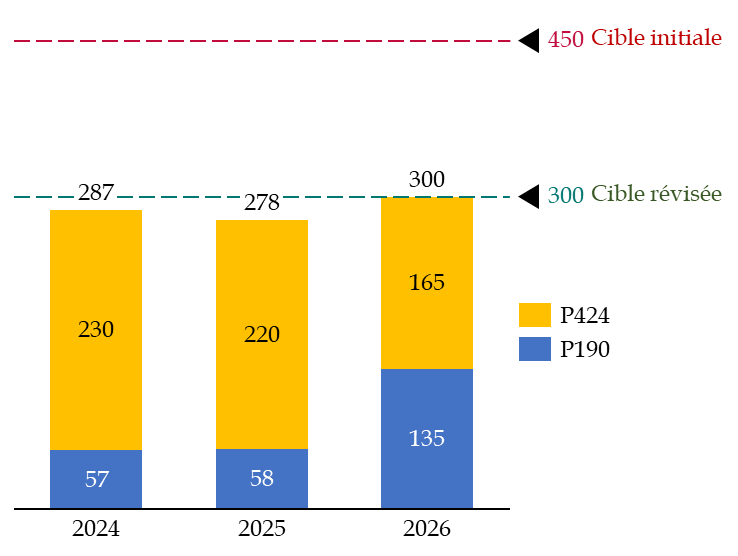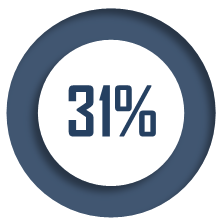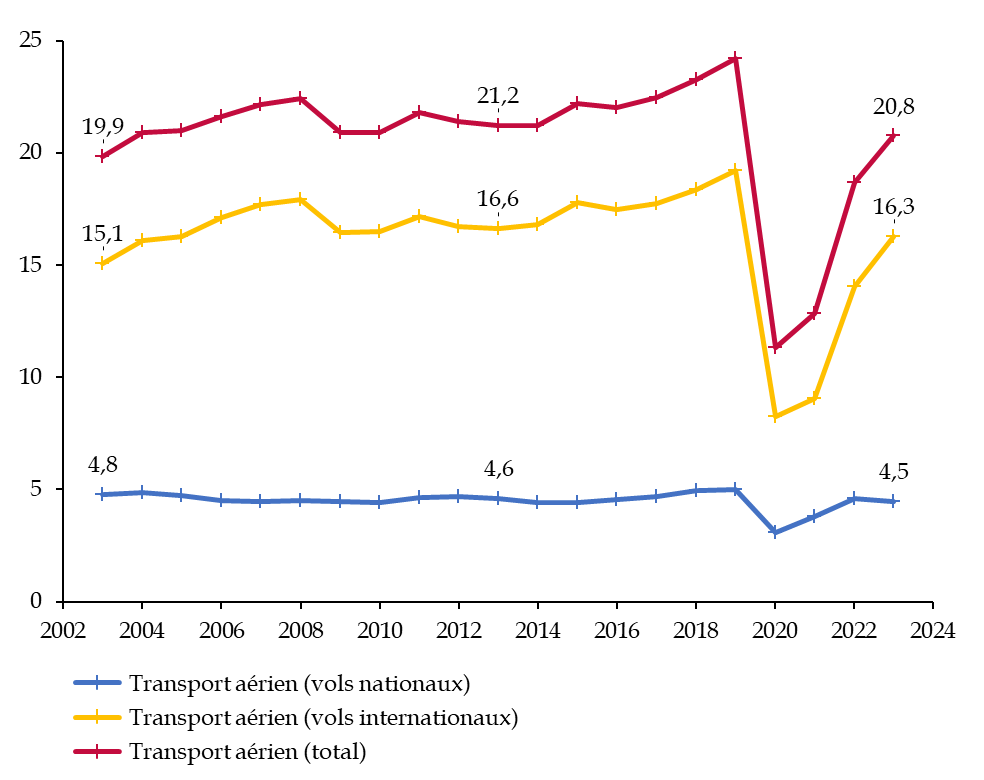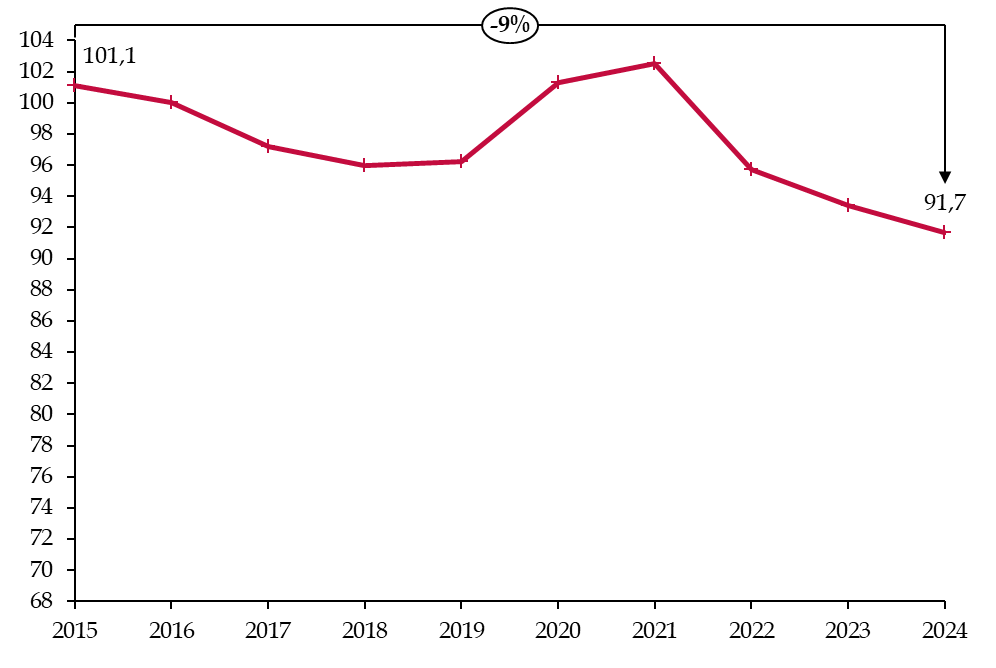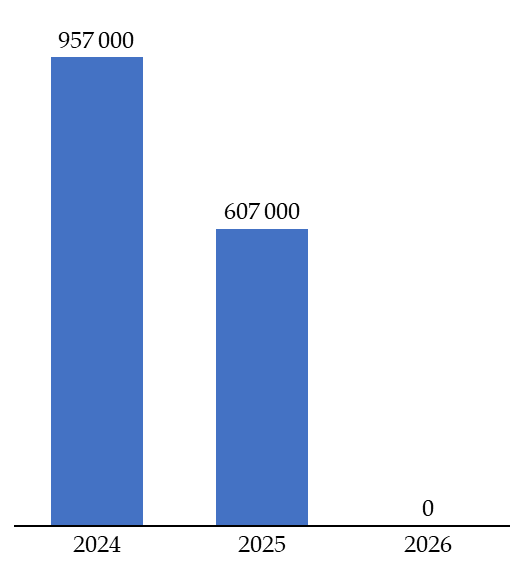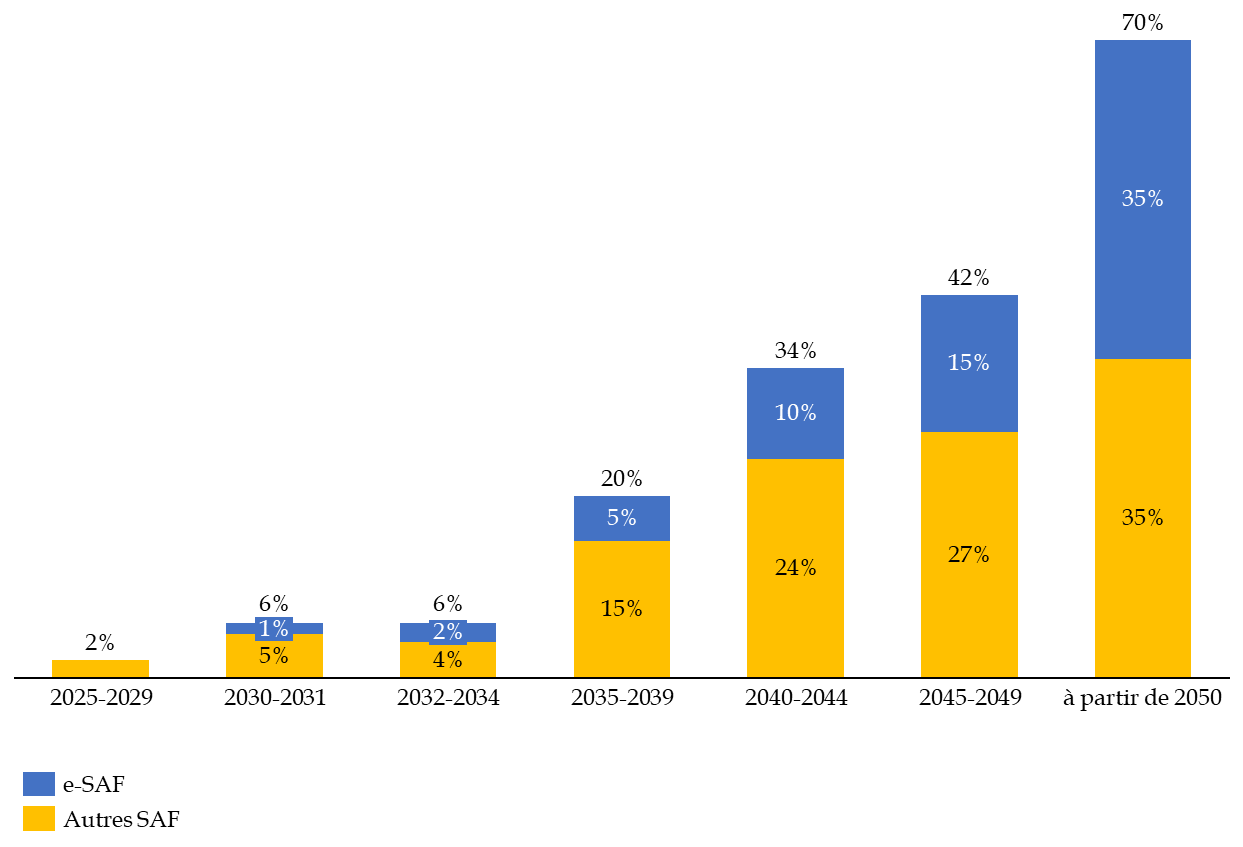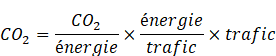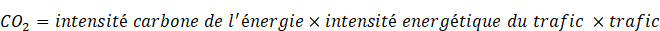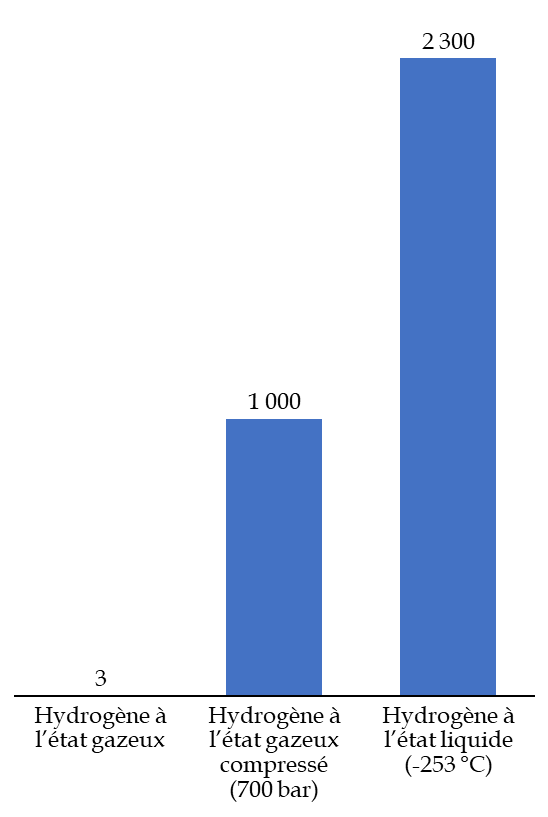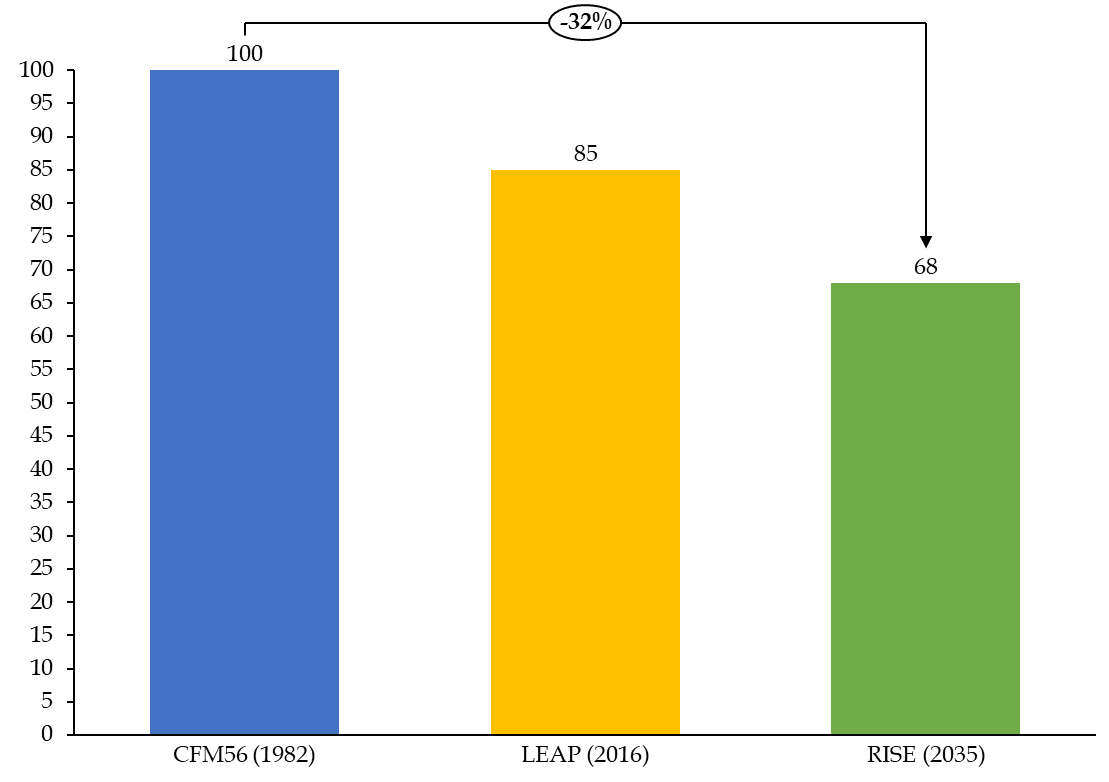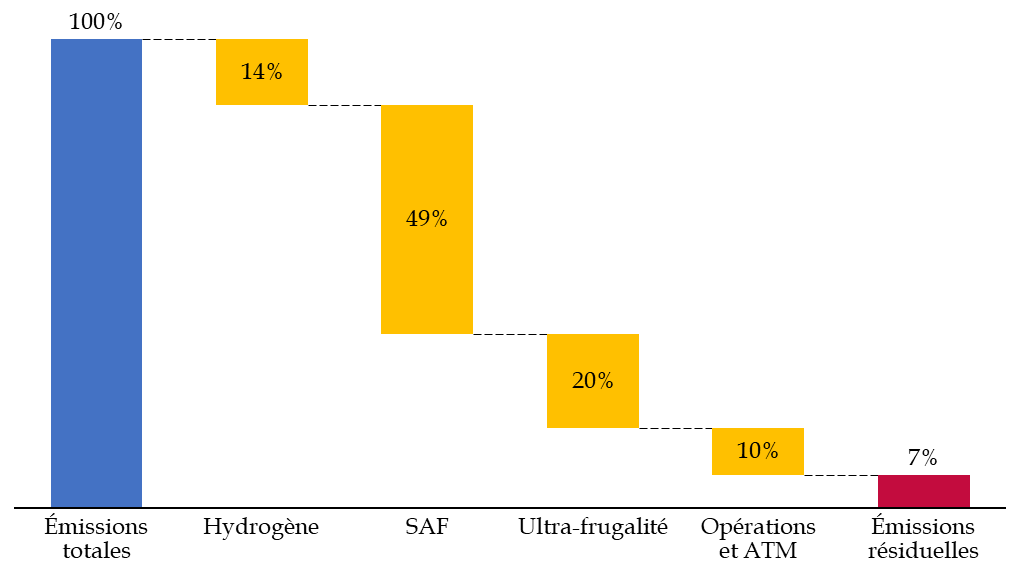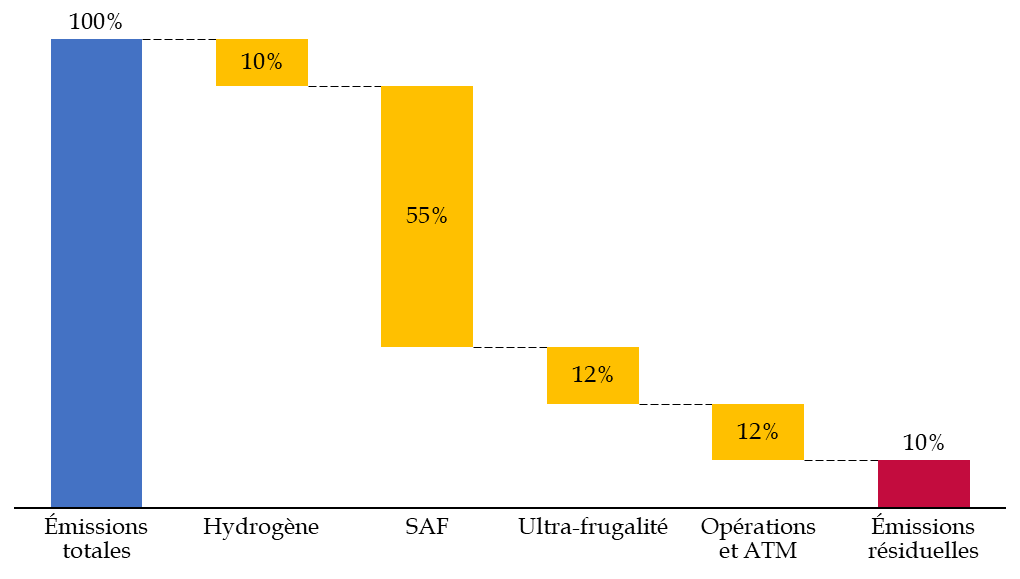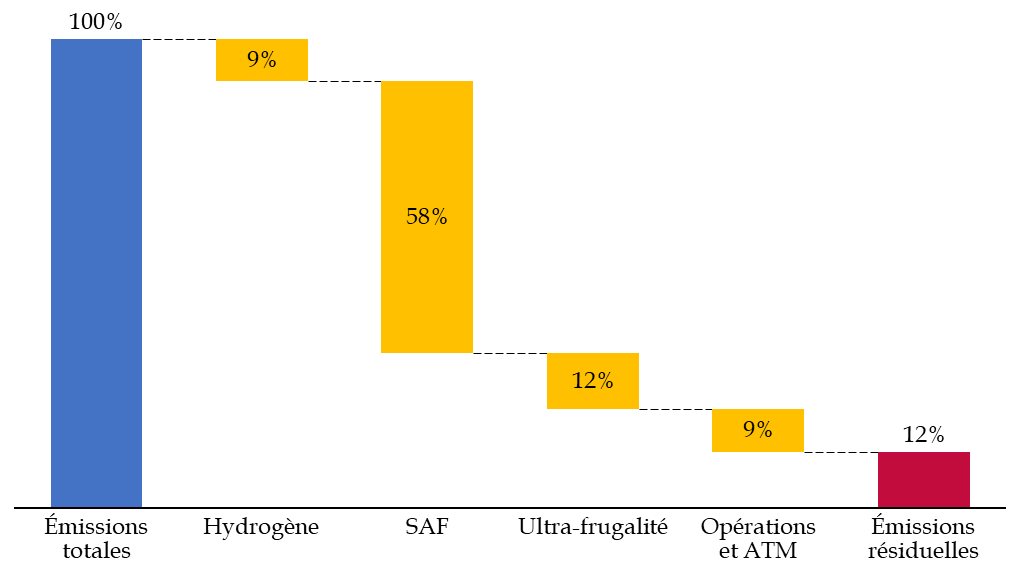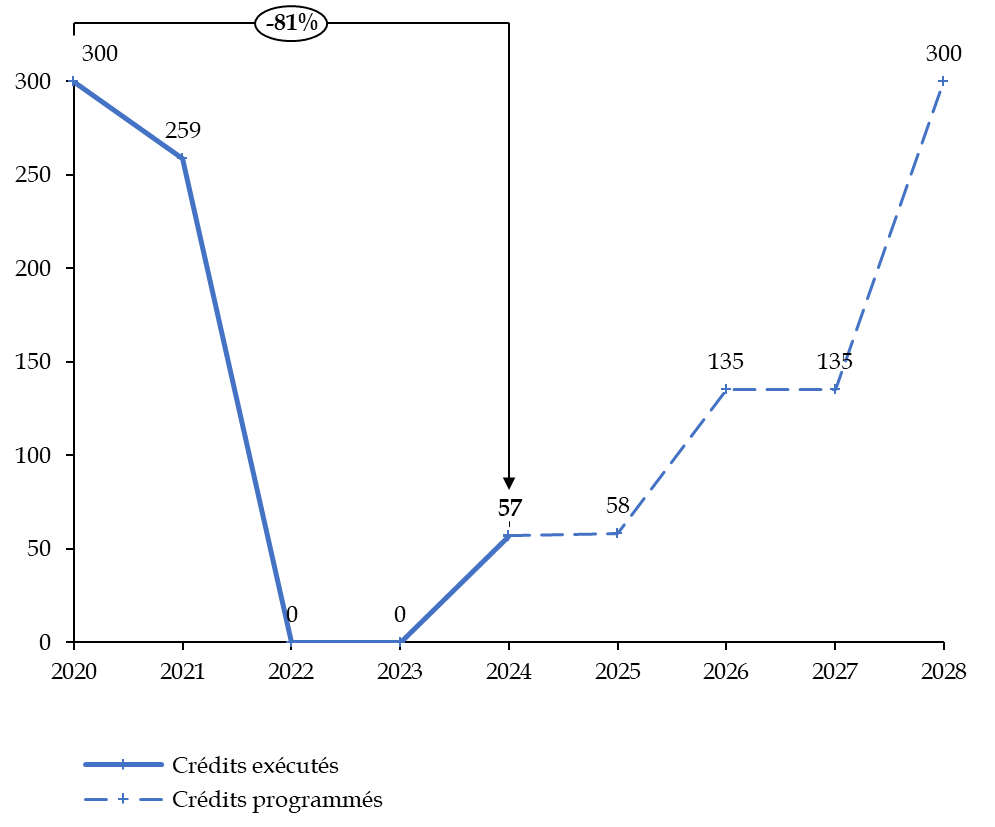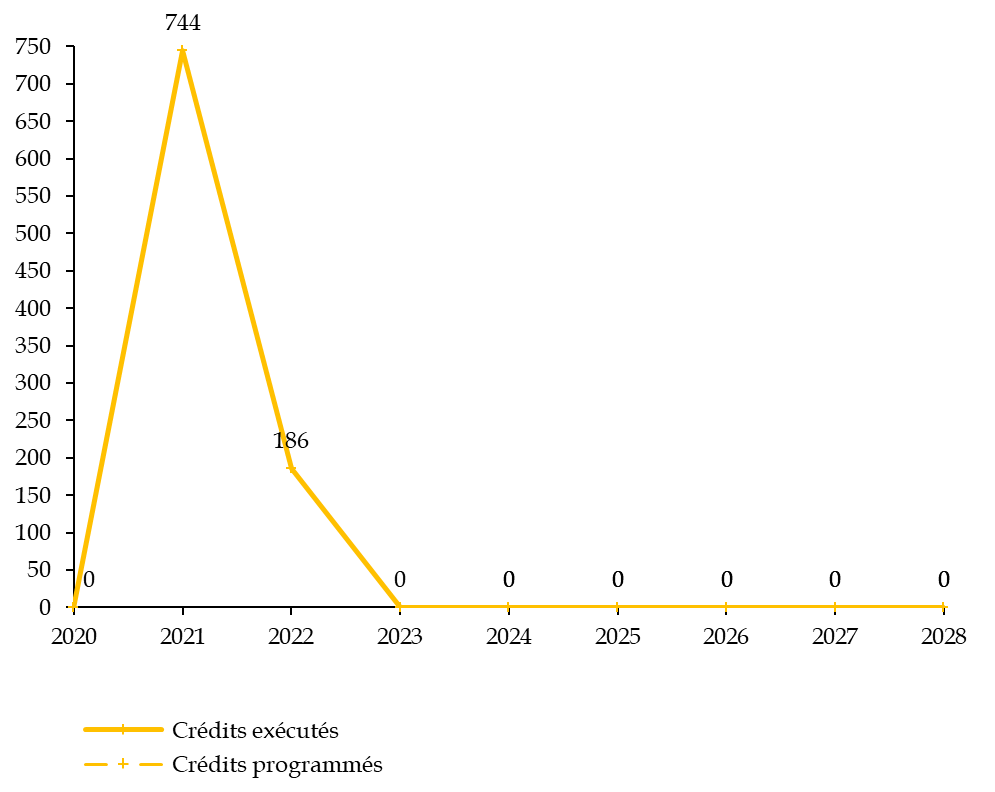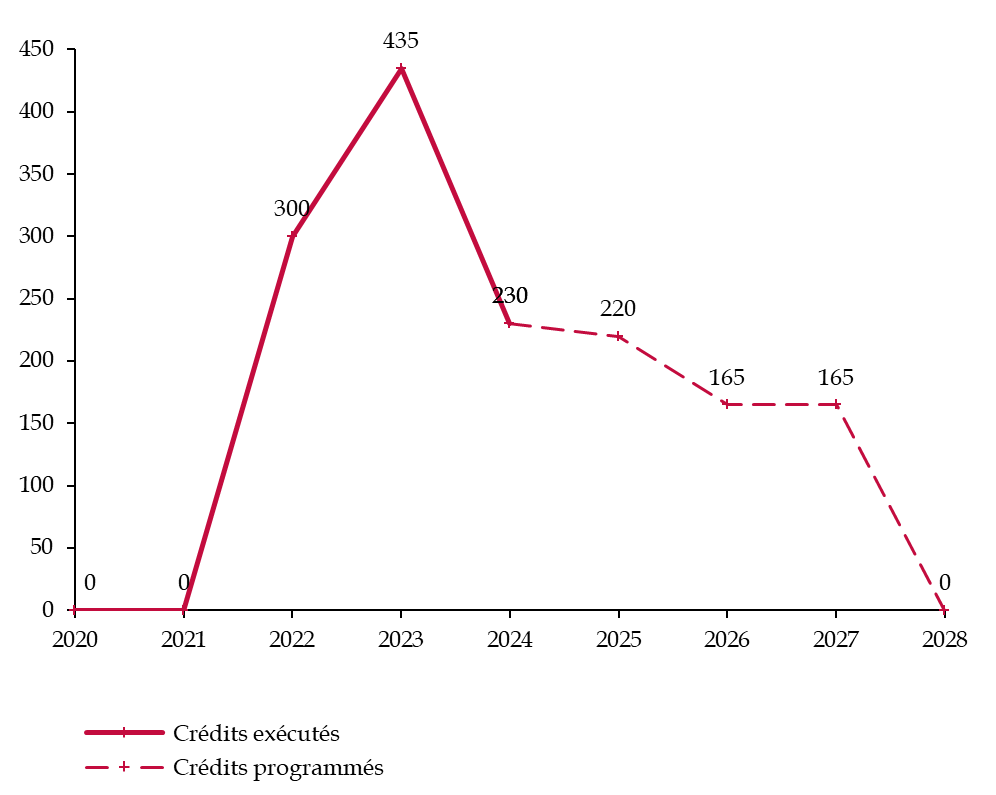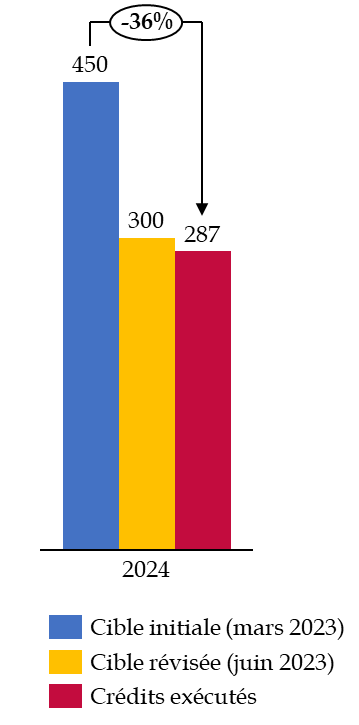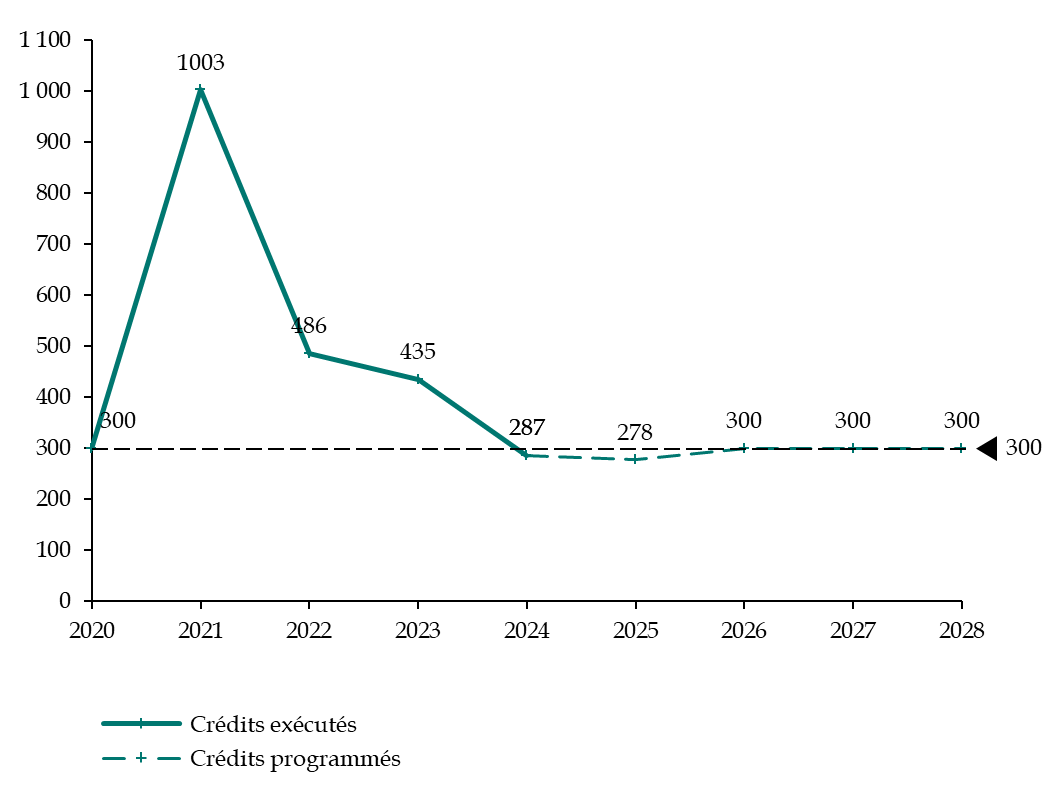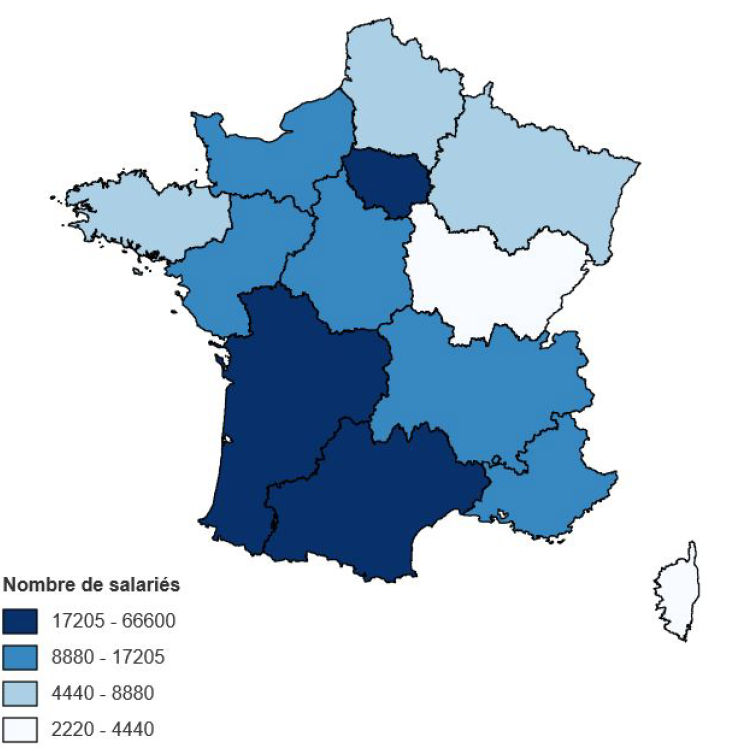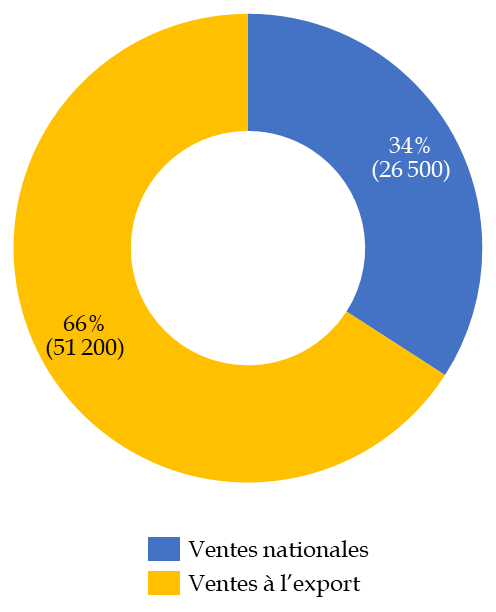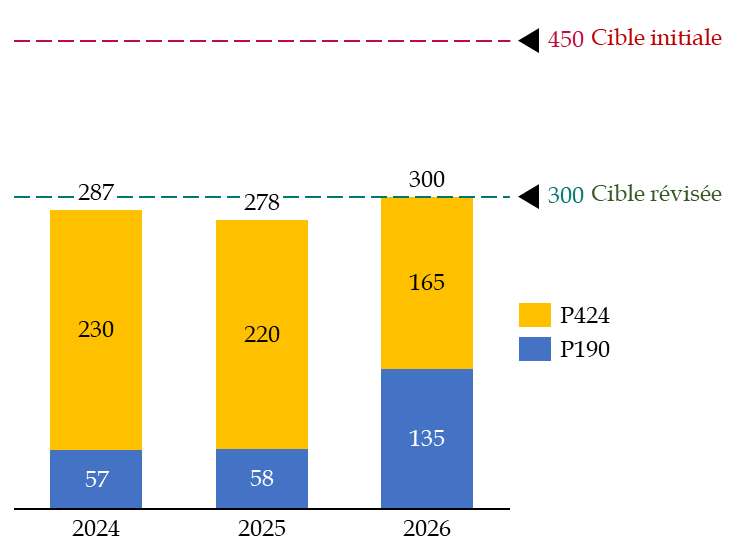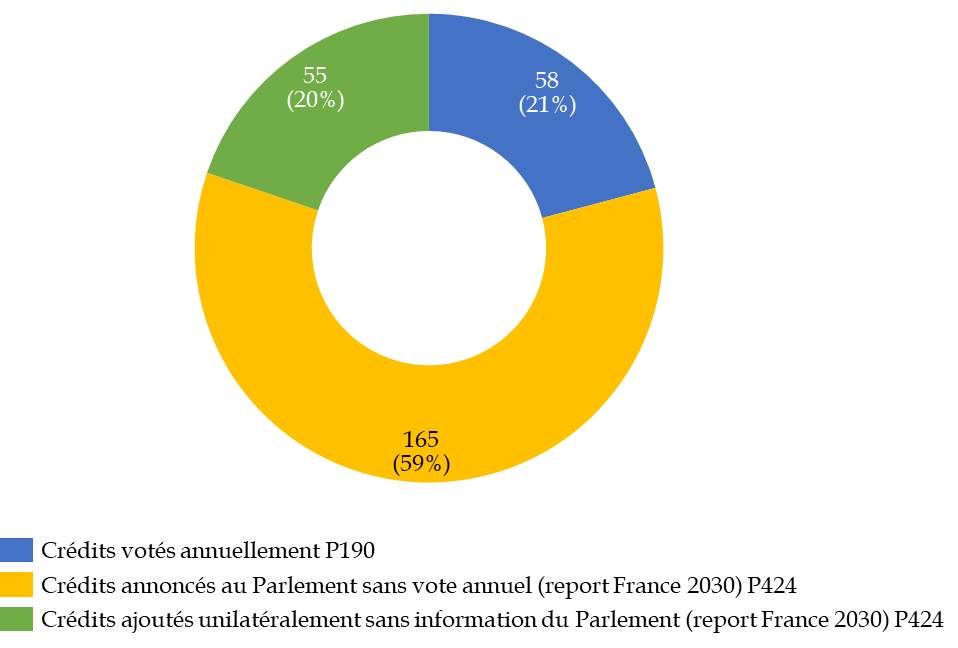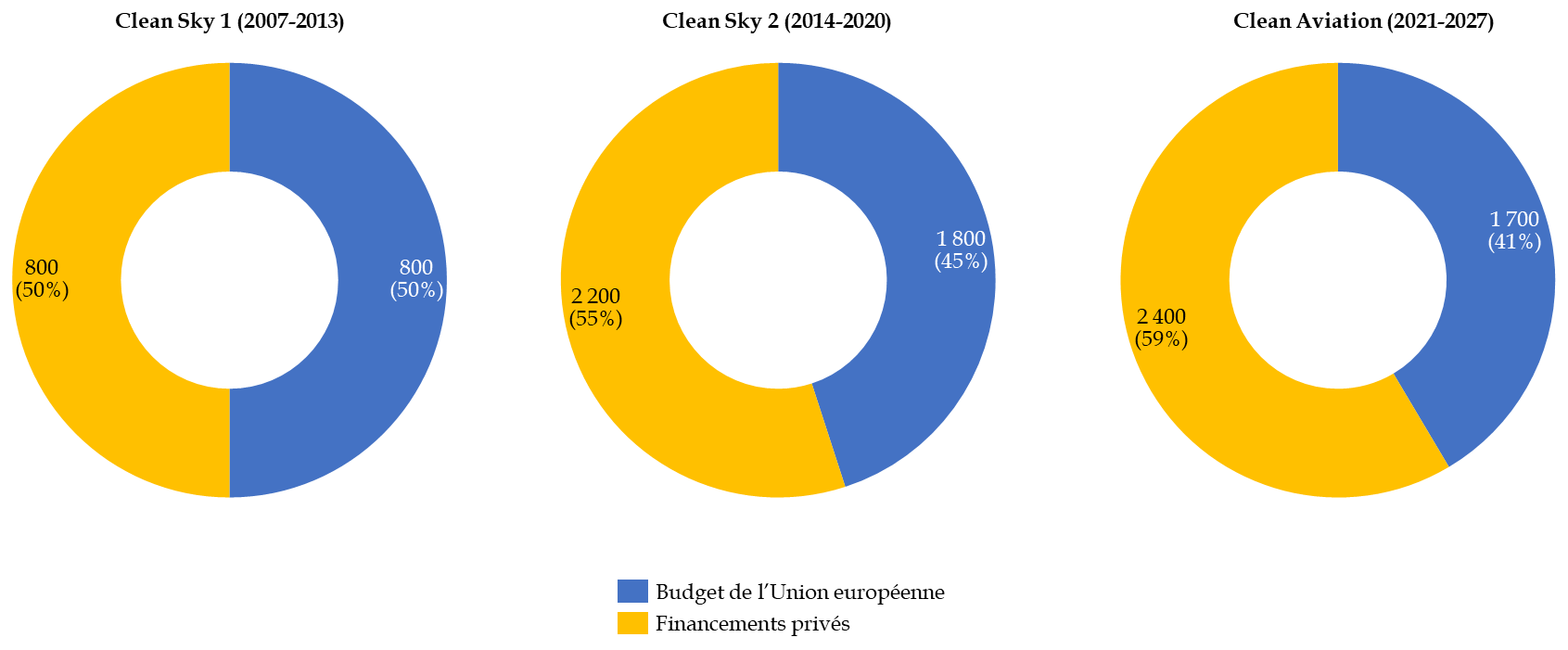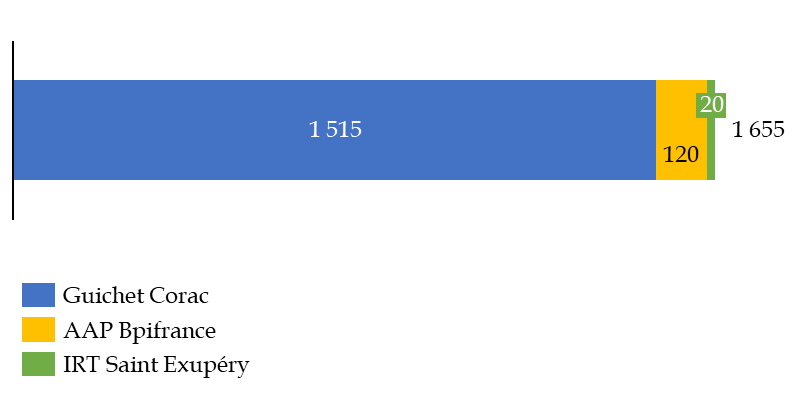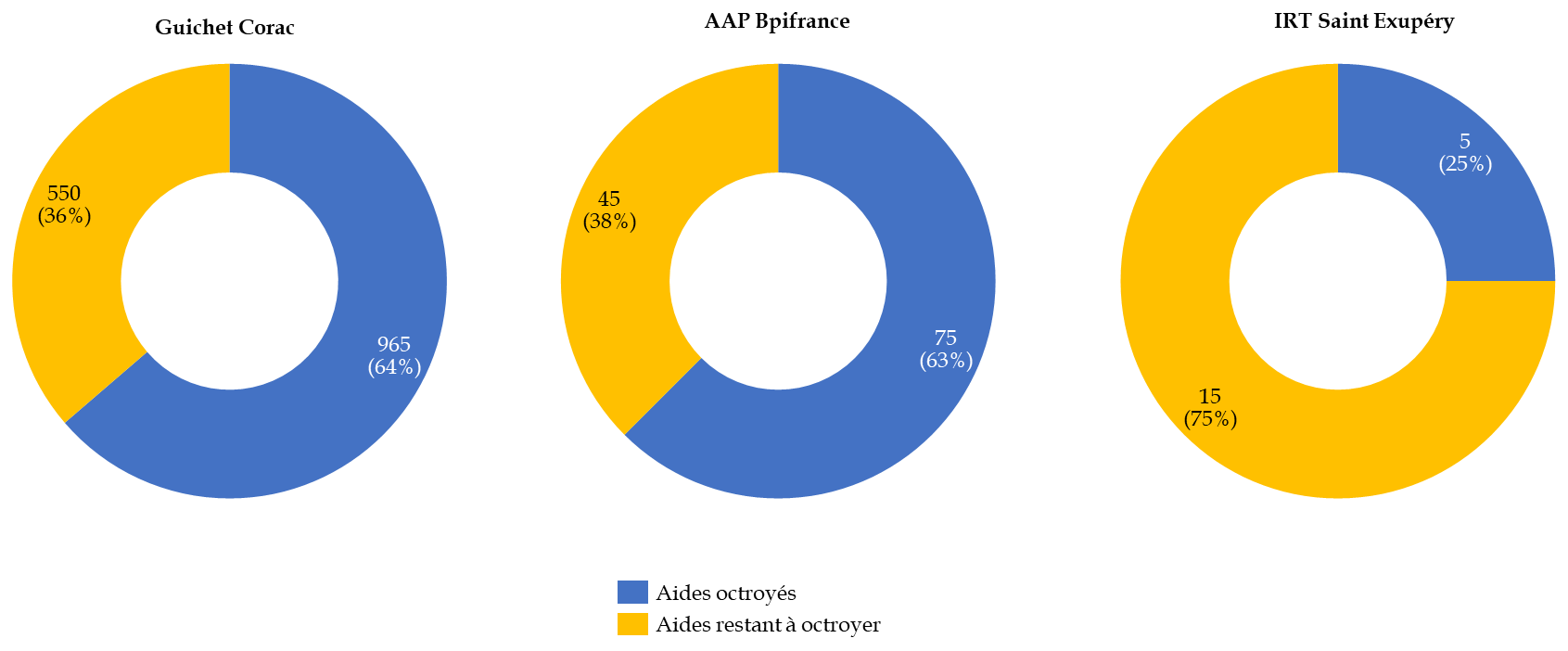- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- I. AU REGARD DES ÉMISSIONS ASSOCIÉES
AU TRANSPORT AÉRIEN, LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
FRANÇAISE S'EST ENGAGÉE DANS UNE TRAJECTOIRE DE
DÉCARBONATION AVEC L'APPUI D'AIDES PUBLIQUES DONT LE MONTANT EST
SOUS-CALIBRÉ DEPUIS L'EXERCICE 2024
- A. LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE A
ADOPTÉ EN 2023 UNE TRAJECTOIRE POUR DÉCARBONER PAR
L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE LE SECTEUR DU TRANSPORT AÉRIEN
- 1. Le cadre normatif applicable au sein de l'Union
européenne au transport aérien incite à une
décarbonation progressive de ce secteur qui représente 2 %
des émissions mondiales de gaz à effet de serre
- a) Les émissions énergétiques
de gaz à effet de serre associées au transport aérien
représentent 6 % des émissions à l'échelle de
la France et 2 % des émissions à l'échelle mondiale
- b) Plusieurs leviers normatifs ont
été mis en place à l'échelle de
l'Union européenne pour inciter à la décarbonation du
transport aérien
- (1) Le système d'échange de quotas
d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) inclut le secteur
aérien depuis 2012
- (2) Les vols depuis le territoire de l'Union
européenne seront soumis à des mandats d'incorporation de
carburants d'aviation durable (SAF) à partir de 2025
- a) Les émissions énergétiques
de gaz à effet de serre associées au transport aérien
représentent 6 % des émissions à l'échelle de
la France et 2 % des émissions à l'échelle mondiale
- 2. La filière aéronautique a
construit une trajectoire intégrée de décarbonation
à horizon 2050 fondée sur la mobilisation de quatre leviers
technologiques
- a) La filière aéronautique a
identifié quatre leviers technologiques principaux pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien
- (1) L'intensité carbone des carburants
d'aviation peut être réduite par deux leviers principaux à
court et moyen terme : les carburants d'aviation durables (SAF) et
l'utilisation de l'hydrogène
- (2) L'intensité énergétique du
trafic aérien peut être réduite par deux leviers
principaux : le perfectionnement technologique des aéronefs
(ultra-frugalité) et la rationalisation de la gestion du trafic
aérien (ATM)
- b) Le Gouvernement a publié en
mars 2023, après concertation avec la filière, une
trajectoire intégrée pour que le transport aérien atteigne
la neutralité carbone en 2050
- a) La filière aéronautique a
identifié quatre leviers technologiques principaux pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien
- 1. Le cadre normatif applicable au sein de l'Union
européenne au transport aérien incite à une
décarbonation progressive de ce secteur qui représente 2 %
des émissions mondiales de gaz à effet de serre
- B. LES AIDES PUBLIQUES À LA RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE SONT
SOUS-CALIBRÉES DEPUIS L'EXERCICE 2024 EN DÉPIT D'UN CONTEXTE
DE CONCURRENCE INTERNATIONALE AIGUË
- 1. Les aides publiques à la recherche et
développement de la filière aéronautique, pilotées
avec le soutien du Corac, sont dispersées entre trois programmes
budgétaires distincts
- a) Le programme 190 « Recherche
dans les domaines de l'énergie, du développement et de la
mobilité durables », support de droit commun des aides
à la filière aéronautique, ne représente que
20 % des aides attribuées en 2024 à travers le guichet
Corac
- b) Le programme 362
« Écologie » de la mission « Plan de
relance » a constitué un support budgétaire temporaire
correspondant aux aides exceptionnelles versées à la
filière aéronautique à travers le guichet Corac en 2021 et
2022
- c) Le programme 424 « Financement
des investissements stratégiques », par lequel transite les
aides du plan France 2030, alimente le guichet Corac, géré
par la direction générale de l'aviation civile, en contradiction
avec les principes de fonctionnement des investissements d'avenir
- a) Le programme 190 « Recherche
dans les domaines de l'énergie, du développement et de la
mobilité durables », support de droit commun des aides
à la filière aéronautique, ne représente que
20 % des aides attribuées en 2024 à travers le guichet
Corac
- 2. Le sous-calibrage des aides à la
recherche et développement aéronautique depuis 2024 risque
de fragiliser la filière au regard de la pression concurrentielle
internationale
- a) La cible de soutien annuel à la recherche
et développement aéronautique civile, qui a été
ramenée à 300 millions en 2023, est
sous-exécutée depuis 2024
- b) La filière aéronautique civile,
qui constitue l'un des fleurons industriels du tissu économique
français, se trouve affrontée une concurrence aiguë en vue
du lancement d'un programme structurant de nouvel avion court et moyen-courrier
(SMR)
- a) La cible de soutien annuel à la recherche
et développement aéronautique civile, qui a été
ramenée à 300 millions en 2023, est
sous-exécutée depuis 2024
- 1. Les aides publiques à la recherche et
développement de la filière aéronautique, pilotées
avec le soutien du Corac, sont dispersées entre trois programmes
budgétaires distincts
- A. LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE A
ADOPTÉ EN 2023 UNE TRAJECTOIRE POUR DÉCARBONER PAR
L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE LE SECTEUR DU TRANSPORT AÉRIEN
- II. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ASSOCIÉS
AU MAINTIEN EN FRANCE ET EN EUROPE D'UNE INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
INNOVANTE JUSTIFIENT QUE LE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE
AÉRONAUTIQUE CIVILE SOIT CONSOLIDÉ
- A. LA STRATÉGIE DE SOUTIEN PUBLIC À
LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE PEUT ÊTRE EXÉCUTÉE,
SIMPLIFIÉE ET CRÉDIBILISÉE AU SERVICE DU MAINTIEN DANS LA
DURÉE DE L'EXCELLENCE DE CETTE FILIÈRE INDUSTRIELLE
- 1. La mise en oeuvre effective de la feuille de
route technologique de la filière et de la trajectoire de
décarbonation en résultant nécessite de tenir la
trajectoire pluriannuelle de soutien public à la recherche
aéronautique civile
- 2. L'unification du financement des aides du
guichet Corac par le programme 190 constitue un levier de
simplification
- 3. La déclinaison opérationnelle des
solutions à déployer pour assurer l'approvisionnement en
carburants d'aviation durables (SAF) des aéronefs civils est un levier
de crédibilisation de la trajectoire de décarbonation de
l'aérien
- 1. La mise en oeuvre effective de la feuille de
route technologique de la filière et de la trajectoire de
décarbonation en résultant nécessite de tenir la
trajectoire pluriannuelle de soutien public à la recherche
aéronautique civile
- B. LE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE
AÉRONAUTIQUE CIVILE PEUT ÊTRE DIVERSIFIÉ EN MOBILISANT DES
INSTRUMENTS D'AIDES EN FONDS PROPRES ET EN CONSOLIDANT LES AIDES DE L'UNION
EUROPÉENNE
- 1. La création d'un instrument de soutien
en fonds propres dédié à la filière
aéronautique est un levier de consolidation des startups industrielles
du secteur
- 2. Les aides de l'Union européenne à
la recherche aéronautique civile peuvent être consolidées
en réaffirmant le caractère stratégique de cette
filière industrielle et en segmentant les aides de l'Innovation Fund
- 1. La création d'un instrument de soutien
en fonds propres dédié à la filière
aéronautique est un levier de consolidation des startups industrielles
du secteur
- A. LA STRATÉGIE DE SOUTIEN PUBLIC À
LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE PEUT ÊTRE EXÉCUTÉE,
SIMPLIFIÉE ET CRÉDIBILISÉE AU SERVICE DU MAINTIEN DANS LA
DURÉE DE L'EXCELLENCE DE CETTE FILIÈRE INDUSTRIELLE
- I. AU REGARD DES ÉMISSIONS ASSOCIÉES
AU TRANSPORT AÉRIEN, LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
FRANÇAISE S'EST ENGAGÉE DANS UNE TRAJECTOIRE DE
DÉCARBONATION AVEC L'APPUI D'AIDES PUBLIQUES DONT LE MONTANT EST
SOUS-CALIBRÉ DEPUIS L'EXERCICE 2024
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- ANNEXE : DÉCOMPOSITION
SYNTHÉTIQUE DES AIDES DE L'OBJECTIF N° 4
« AVION BAS-CARBONE »
DU PLAN FRANCE 2030
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 846
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur le
financement public
de la recherche
aéronautique civile,
Par MM. Jean-François RAPIN, Laurent SOMON et Thomas DOSSUS,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
La construction aéronautique constitue l'un des secteurs industriels à forte valeur ajoutée dans lesquels la France dispose d'un instrument productif performant et compétitif qui lui procure une position centrale dans la production mondiale d'avions commerciaux.
Les grands groupes industriels aéronautiques ainsi que l'ensemble des sous-traitants de la chaîne de valeur (supply chain) sont actuellement en train d'investir massivement dans des projets de recherche et développement (R&D) pour préparer les évolutions à venir dans le secteur.
M. Jean-François Rapin, rapporteur spécial des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », et MM. Laurent Somon et Thomas Dossus, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 », ont présenté le 9 juillet 2025 leur contrôle conjoint sur le soutien public à la recherche aéronautique civile.
I. LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE CONSTITUE UNE FILIÈRE TECHNOLOGIQUE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE ENGAGÉE DANS UN PROCESSUS DE TRANSFORMATION POUR RESPECTER L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050
A. LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE A FIXÉ UNE TRAJECTOIRE DE DÉCARBONATION SECTORIELLE POUR ATTEINDRE LA CIBLE DE LONG TERME DE NEUTRALITÉ CARBONE ADOPTÉE À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
Le secteur du transport aérien représente 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et 6 % des émissions sur le territoire français. Elles résultent de la forte intensité en carbone des carburants d'aviation actuellement utilisés et sont fortement concentrées dans les vols internationaux qui représentaient 81 % des émissions de l'aviation sur le territoire français en 20241(*).
À l'échelle mondiale, les États-membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont adopté en octobre 2022 une cible de long terme (LTAG2(*)) de neutralité carbone du secteur aérien à l'horizon 2050.
Pour atteindre cette cible, la France et l'Union européenne ont mis en place plusieurs leviers normatifs ayant pour objectif de réduire les émissions du transport aérien. En premier lieu, les vols à l'intérieur de l'Espace économique européen (EEE) sont soumis depuis 2012 au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE « Aviation ») et seront affectés par la suppression en 2026 du mécanisme d'attribution de quotas gratuits. En second lieu, le règlement « RefuelEU Aviation »3(*) a prévu la mise en place à partir de l'exercice 2025 de mandats d'incorporation de carburants d'aviation durables (SAF4(*)) avec une trajectoire croissante qui atteindra 70 % d'incorporation minimale de SAF à partir de 2050.
Parallèlement à la mise en place de ces leviers normatifs, les acteurs industriels de la filière aéronautique ont identifié quatre leviers technologiques de décarbonation de l'aérien.
Les deux premiers leviers technologiques reposent sur l'adoption d'une énergie primaire moins carbonée en alimentant les aéronefs soit grâce à l'hydrogène (H2) soit grâce à des carburants d'aviation durables (SAF), produit à partir de biomasse (bio-SAF) ou d'hydrogène décarboné et de dioxyde de carbone capté dans l'atmosphère (e-SAF).
Les deux autres leviers reposent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des trajets soit grâce au perfectionnement des aéronefs, notamment en réduisant leur masse ou en améliorant le rendement des moteurs (ultra-frugalité), soit grâce à la rationalisation de la gestion du trafic aérien (ATM5(*)).
Trajectoire technologique de décarbonation du transport aérien
(en pourcentage)
Note de lecture : données du scénario « Accélération » de la feuille de route de décarbonation de l'aérien (mars 2023)
Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC
L'État et la filière aéronautique ont adopté, en mars 2023, une trajectoire concertée inscrite dans la feuille de route de décarbonation de l'aérien6(*). Elle prévoit de réduire de 88 % les émissions du secteur pour les vols internationaux au départ de la France à horizon 2050. Aujourd'hui, il nous a été impossible d'évaluer la crédibilité de la feuille de route de production et d'incorporation de ces sources d'énergie décarbonée.
Les émissions résiduelles pourront être compensées, en vue d'atteindre la cible de neutralité carbone, en ayant recours à des mécanismes de « crédits carbone » sur le modèle des dispositifs existants à l'échelle internationale (Corsia7(*)) et française8(*).
B. LA PRÉPARATION DU FUTUR PROGRAMME D'AÉRONEF COURT ET MOYEN COURRIER (SMR) ULTRA-FRUGAL CONSTITUE UN IMPÉRATIF IMPÉRIEUX POUR PRÉSERVER LA PROSPÉRITÉ DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE
La filière aéronautique française constitue une filière industrielle de haute technologie qui contribue positivement et de manière substantielle à la balance commerciale nationale. La filière dans son ensemble correspond en 2024 à un chiffre d'affaires total de 77,7 milliards d'euros dont les deux tiers résultent de ventes à l'export.
Ce secteur industriel représente par surcroît 222 000 emplois en 2024, dont 46 % de cadres et ingénieurs, répartis sur l'ensemble du territoire avec une concentration dans les régions Île-de-France et Occitanie.
Répartition géographique des emplois de la filière aéronautique et spatiale
(en nombre de salariés et en 2024)
Source : commission des finances, d'après les données du Gifas
La seconde moitié de la décennie 2020 et la première moitié de la décennie 2030 sera marquée pour les grands intégrateurs de la filière et pour leurs sous-traitants par la mise en oeuvre de la trajectoire de décarbonation de l'aérien, qui prévoit notamment la mise en service au milieu de la décennie 2030 du futur avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR9(*) ultra-frugal).
Au regard de la place occupée actuellement par la « famille A320 » - qui représente 79 % des livraisons d'avions commerciaux du groupe Airbus en 2024 - dans la filière aéronautique, la préparation du programme du futur SMR ultra-frugal est une priorité absolue qui donne un caractère urgent et incompressible aux importants investissements privés en recherche et développement (R&D) mis en oeuvre par les entreprises de ce secteur.
II. LA CONSOLIDATION DU SOUTIEN PUBLIC À L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE CONSTITUE UN LEVIER POUR PRÉSERVER LA POSITION ÉMINENTE DE LA FRANCE ET DE L'EUROPE DANS CE SECTEUR STRATÉGIQUE
A. LES POUVOIRS PUBLICS ONT SOUS-EXÉCUTÉ EN 2024 ET EN 2025 LA CIBLE DE 300 MILLIONS D'EUROS DE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE
La construction aéronautique constitue une filière industrielle structurée qui dialogue avec les pouvoirs publics au sein du Conseil pour la recherche aéronautique (Corac) lequel réunit les administrations compétentes, les intégrateurs et les sous-traitants du secteur.
Le dialogue au sein du Corac permet aux industriels de suivre une feuille de route technologique partagée et à l'administration de limiter le risque de dispersion du soutien public.
Ce dialogue structuré est un levier majeur de cohérence et de synchronisation des projets de recherche menés au sein de la filière grâce à l'établissement d'un « Masterplan », c'est-à-dire d'une feuille de route technologique partagée au sein du Corac.
Aides publiques à la recherche aéronautique civile (guichet Corac)
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances
En cohérence avec les priorités du Masterplan 2020-2029, l'État et la filière ont estimé le soutien public nécessaire à l'atteinte des objectifs technologiques à 450 millions d'euros par an entre 2024 et 2027. Cette cible annuelle a été ramenée à 300 millions d'euros en juin 2023.
Les aides aux projets de recherche industrielle de la filière sont octroyées de gré à gré à travers le « guichet Corac », géré de manière autonome par la DGAC en tenant compte de la cohérence des projets soutenus avec le Masterplan du Corac. Le financement de ces aides repose actuellement sur un schéma de financement multicanal inutilement complexe que les rapporteurs proposent de simplifier.
Depuis l'exercice 2024, la cible de 300 millions d'euros de soutien public annuel est sous-exécutée à hauteur de 18 millions d'euros en moyenne, soit 6 % de la cible. Ce sous-calibrage des aides publiques à la recherche aéronautique civile a des conséquences directes en matière de préparation des acteurs de la filière au programme prioritaire du futur SMR ultra-frugal et en matière d'éviction des projets de recherche sans lien avec ce programme, notamment dans le domaine des technologies liées à l'hydrogène et du développement d'une nouvelle génération d'hélicoptères.
B. LE CARACTÈRE STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE POUR L'INDUSTRIE EUROPÉENNE DOIT ÊTRE RÉAFFIRMÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DU PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP)
Les aides françaises à la recherche aéronautique civile sont complétées à l'échelle de l'Union européenne par le programme « Clean Aviation », qui cible d'autres projets de recherche de manière complémentaire aux guichets nationaux. Il est financé à hauteur de 2,4 milliards d'euros par le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027.
L'omission de la filière aéronautique dans la « Boussole de compétitivité » de janvier 2025 est incompréhensible au regard du caractère stratégique de cette industrie pour l'Union européenne.
Alors que le programme « Clean Aviation » prendra fin en 2027 et dans le contexte des négociations actuelles sur le futur cadre financier pluriannuel (CFP) qui entrera en vigueur à partir de 2028, le maintien d'un instrument spécifique dédié au soutien à la recherche aéronautique civile doit constituer une priorité pour les autorités françaises. Le caractère stratégique de la filière aéronautique doit ainsi être réaffirmée à l'occasion des investissements massifs réalisés au service de sa décarbonation.
|
Le programme « Clean Aviation »
représente |
Le taux de retour de la France atteint |
Ce qui fait de la France le |
|
réparti sur sept ans |
des aides publiques octroyées |
pays de l'UE à bénéficier des aides du programme |
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1. Respecter la cible de 300 millions d'euros de soutien public annuel à la recherche aéronautique civile (Gouvernement, Parlement).
Recommandation n° 2. Simplifier le circuit de financement du soutien public à la recherche aéronautique civile en le rebudgétisant intégralement au sein du programme 190 (DB, DGAC, SGPI).
Recommandation n° 3. Crédibiliser la trajectoire de décarbonation du transport aérien en l'articulant avec une feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) (DGAC, DGEC).
Recommandation n° 4. Créer au sein du Corac un format « Corac SAF », élargi aux représentants des énergéticiens et de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), chargé de l'élaboration et du suivi de la feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (Corac, DGEC).
Recommandation n° 5. Accélérer le développement des startups aéronautiques industrielles en créant un instrument thématique d'investissement en fonds propres financé par France 2030 (SGPI, Bpifrance).
Recommandation n° 6. Défendre le caractère stratégique de la construction aéronautique à l'échelle européenne en maintenant un programme sectoriel dans le futur cadre financier pluriannuel (CFP) et en intégrant ce secteur à la « Boussole pour la compétitivité » lors de sa prochaine mise à jour (Commission européenne, RP UE).
Recommandation n° 7. Diversifier le financement du soutien à la recherche aéronautique civile à l'échelle européenne en créant un appel à projet sectoriel dédié à la construction aéronautique dans le cadre de l'Innovation Fund (Commission européenne, RP UE).
I. AU REGARD DES ÉMISSIONS ASSOCIÉES AU TRANSPORT AÉRIEN, LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE S'EST ENGAGÉE DANS UNE TRAJECTOIRE DE DÉCARBONATION AVEC L'APPUI D'AIDES PUBLIQUES DONT LE MONTANT EST SOUS-CALIBRÉ DEPUIS L'EXERCICE 2024
A. LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE A ADOPTÉ EN 2023 UNE TRAJECTOIRE POUR DÉCARBONER PAR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE LE SECTEUR DU TRANSPORT AÉRIEN
1. Le cadre normatif applicable au sein de l'Union européenne au transport aérien incite à une décarbonation progressive de ce secteur qui représente 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre
a) Les émissions énergétiques de gaz à effet de serre associées au transport aérien représentent 6 % des émissions à l'échelle de la France et 2 % des émissions à l'échelle mondiale
La contribution du transport aérien au changement climatique est liée en premier lieu à la consommation énergétique du secteur et aux émissions de dioxyde de carbone associées. En effet les aéronefs actuellement en service utilisent principalement du kérosène, qui est un carburant fossile ayant notamment pour caractéristiques physiques une forte densité massique d'énergie qui atteint 43 MJ/kg, une forte densité volumique d'énergie qui atteint 35 MJ/l ainsi qu'un point de congélation maximal très bas qui atteint - 47°C - ce qui constitue un avantage comparatif structurel au regard de la température extérieure qui se situe à environ - 60°C à l'altitude optimale de croisière qui est proche de 11 kilomètres.
Lors de sa combustion dans les moteurs d'avion, chaque litre de kérosène émet 2,520 kilogrammes de CO2 ainsi que d'autres gaz à effet de serre (GES) dont notamment du protoxyde d'azote (N2O) et du méthane (CH4) dont les émissions sont estimées à 25 grammes d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2éq) par litre de kérosène consommé. Les émissions énergétiques de l'aviation sont donc estimées à 2 545 grammes par litre de kérosène consommé selon le référentiel de référence tenu par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)10(*) ; elles atteignent 3 075 grammes par litre de kérosène consommé en intégrant les émissions de la « phase amont » (well-to-tank), c'est-à-dire les émissions associées à l'extraction, au raffinage, au transport et la distribution du kérosène. À ces émissions énergétiques, s'ajoute une contribution du transport aérien au changement climatique qualifiée « d'effets hors CO2 », qui correspondent à des phénomènes physiques en lien avec la vapeur d'eau et les aérosols contenus dans les gaz d'échappement des moteurs d'aviation11(*). Du fait de l'absence de consensus scientifique sur l'ampleur de ces effets qui ne peuvent pas être mesurés comme des émissions par une grandeur exprimée en équivalent de dioxyde de carbone, il n'existe pas d'estimation quantitative robuste et faisant l'objet d'un suivi systématique de la contribution des « effets hors CO2 » du transport aérien au changement climatique.
Évolution des émissions de gaz
à effet de serre du transport aérien en France
(vols nationaux
et internationaux)
(en MtCO2éq)
Source : commission des finances, d'après les données du Citepa
À l'échelle nationale, l'inventaire de référence des émissions sur le territoire français, tenu par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa)12(*), fait apparaître que les émissions du transport aérien sont stables depuis dix ans avec le passage de 19,9 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (MtCO2éq) émis en 2013 à 20,8 MtCO2éq émis en 2023. Les émissions globales de gaz à effet de serre sur le territoire ayant reculé pendant la même période, la proportion représentée par le transport aérien a légèrement augmenté, passant de 4 % en 2013 à 6 % en 2023.
Décomposition des émissions de gaz
à effet de serre du transport aérien
en France
(en MtCO2éq en 2024)
|
Catégories de vols |
Émissions de gaz à effet de serre |
|
Vols intérieurs métropolitains |
2 |
|
Vols intérieurs ultramarins |
3,2 |
|
Vols internationaux moyens-courriers |
8,4 |
|
Vols internationaux longs-courriers |
13,8 |
|
TOTAL |
27,4 |
Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC
Note de lecture : Les vols entrant dans le périmètre correspondent à l'ensemble des vols au départ des aéroports français, indépendamment de la compagnie aérienne concernée.
La décomposition des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, qui sont suivie de manière détaillée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) qui a développé à cet effet le calculateur « Traitements et analyses des rejets émis dans l'atmosphère par l'aviation civile » (Tarmaac), fait apparaître le fait que les émissions du secteur sont très largement concentrées sur les vols internationaux. En effet, les rapporteurs relèvent que les vols intérieurs en métropole ne représentent que 7 % des émissions totales en 2024. À l'inverse, les vols internationaux représentent 81 % des émissions, dont 50 % pour les vols longs-courriers - c'est-à-dire d'une distance supérieure à 3 500 kilomètres.
Évolution des émissions unitaires de
gaz à effet de serre du transport aérien
en France (vols
nationaux et internationaux)
(en gCO2éq/PéqKT)
Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC
Note de lecture : Les vols entrant dans le périmètre correspondent à l'ensemble des vols au départ des aéroports français, indépendamment de la compagnie aérienne concernée.
Les rapporteurs relèvent enfin que si la masse globale des émissions du secteur aérien est restée stable depuis deux décennies, cette stabilité relative masque en réalité deux mouvements contradictoires qui se sont compensés : d'une part le volume du trafic a fortement augmenté, en passant de 146 millions de passagers aérien en France en 2015 à 173 millions de passagers en 2024 ; d'autre part l'efficacité énergétique des aéronefs a été constamment améliorée13(*) par le perfectionnement technologique des appareils, ce qui a permis de réduire de 9 % les émissions unitaires de gaz à effet de serre dans le transport aérien en France entre 2015 et 2024, pour atteindre 91,7 grammes d'équivalent de dioxyde de carbone par équivalent passager-kilomètre transporté14(*) (gCO2éq/PéqKT)
À l'échelle mondiale, la contribution du secteur du transport aérien dans son ensemble au changement climatique est plus difficile à évaluer avec précision étant donnée la nécessité de tenir compte d'une multiplicité d'inventaires nationaux d'émissions. Pour autant, il existe un consensus scientifique autour d'un ordre de grandeur entre 2 % et 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées au transport aérien15(*). Selon les estimations publiées en décembre 2024 par le Air Transport Action Group (ATAG), groupe de réflexion de référence collaborant avec les Nations unies, les émissions du secteur du transport aérien ont représenté en 2023 des émissions de gaz à effet de serre de 882 MtCO2 soit 2 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone d'origine anthropique qui atteignent 43 Gt16(*).
Au regard des émissions mondiales associées au transport aérien, les vols au départ ou vers la France ne représentent que 3 % des émissions mondiales du transport aérien. Pour autant, le rôle pionnier et la position dominante de la filière aéronautique française et européenne dans le monde constitue un levier majeur en matière de décarbonation des transports. En effet, le groupe Airbus représente 50 % de la flotte mondiale des aéronefs en service17(*). Par suite, et en raisonnant par ordre de grandeur sans entrer dans le détail des évaluations d'émissions associées aux différentes catégories d'aéronefs, la filière aéronautique française et européenne dispose d'un outil dont le potentiel de décarbonation est de l'ordre de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit 441 MtCO2 chaque année, c'est-à-dire plus que les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre sur le territoire français (373 MtCO2éq en 2023).
La France dispose à ce titre d'une forte opportunité de décarbonation par rapport à son poids dans les émissions mondiales du secteur aérien qui sont limitées à 3 %.
b) Plusieurs leviers normatifs ont été mis en place à l'échelle de l'Union européenne pour inciter à la décarbonation du transport aérien
Dans le contexte des engagements internationaux pris pour lutter contre le changement climatique, notamment dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015, le secteur du transport aérien s'est engagé dans une réflexion à l'échelle internationale pour réduire substantiellement les émissions associées à ce secteur.
La consécration d'objectifs globaux de décarbonation de l'aviation civile à l'échelle mondiale est intervenue à l'initiative de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui a adopté en octobre 2010 lors de la 37e session de l'assemblée de l'OACI un objectif de stabilisation des émissions de l'aviation internationale à partir de 202018(*).
À l'occasion de la 41e session de l'assemblée de l'OACI qui s'est tenue en octobre 2022, cette organisation internationale a réhaussé ses objectifs en matière de décarbonation en adoptant une cible de long terme (LTAG19(*)) de neutralité carbone du secteur aérien en 205020(*).
Avant d'étudier la feuille de route technologique du secteur et des investissements publics et privés associés, les rapporteurs rappellent que ces investissements s'inscrivent dans un contexte global d'incitation à la décarbonation du transport aérien qui repose sur plusieurs leviers normatifs dont notamment le système d'échange de quotas d'émission (SEQE-UE) à l'échelle de l'Union européenne pour les vols intra-européens et la mise en place depuis 2022 d'une trajectoire de mandats d'incorporation des carburants d'aviation durables (SAF21(*)) à l'échelle française, complétée depuis 2025 par une trajectoire à l'échelle européenne.
(1) Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) inclut le secteur aérien depuis 2012
Au sein de l'Union européenne, l'un des instruments principaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre est la création d'un « marché du carbone » avec la création du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 200322(*), ou directive « ETS23(*) ». Le SEQE-UE s'est appliqué à partir de 2005 aux principales installations industrielles, avant d'être étendu à partir de 2012 aux exploitants d'aéronefs (SEQE-UE « Aviation » »)24(*).
Le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission repose sur un principe de plafonnement et d'échange : un plafond d'émissions est fixé dans la limite duquel les opérateurs économiques peuvent échanger leurs quotas pour favoriser l'adoption des mesures les plus rentables permettant de respecter l'objectif global de réduction des émissions. Dans le cadre du SEQE-UE, les exploitants d'aéronefs sur le territoire de l'Union européenne ont l'obligation de restituer aux autorités chaque année un nombre de quotas d'émission équivalent à leurs émissions25(*). La réglementation actuelle, qui résulte d'un tempérament du périmètre d'application du SEQE-UE mis en oeuvre en premier lieu par la décision n° 377/2013/UE dite « stop the clock » du 24 avril 201326(*) puis confirmé par plusieurs décisions postérieures dont en dernier lieu la directive (UE) 2023/958 du 10 mai 202327(*), prévoit un périmètre d'application du SEQE-UE « Aviation » aux seuls vols effectués à l'intérieur de l'Espace économique européen (EEE)28(*). Si les vols entre le territoire français métropolitains et les territoires français d'outre-mer sont exclus du SEQE-UE, le mécanisme inclut depuis 2024 les vols effectués entre des territoires français classés comme « région ultrapériphérique » (RUP) de l'Union européenne et le territoire d'un autre État-membre29(*).
Les actes législatifs adoptés par l'Union européenne dans le cadre du paquet « Fit for 55 » présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021, pris en application du « Pacte vert européen » présenté par la première Commission von der Leyen (2019-2024) le 11 décembre 2019, et en particulier la directive (UE) 2023/958 du 10 mai 202330(*), ont réformé le système SEQE-UE « Aviation » en prévoyant la mise en extinction progressive entre 2024 et 2026 du mécanisme d'attribution de quotas gratuits pour les compagnies aériennes.
Cette mise en extinction aura un effet direct sur les exploitants d'aéronefs qui bénéficiaient depuis la création de SEQE-UE « Aviation » de quotas gratuits qui représentaient 85 % des quotas globaux des personnes assujetties en 2023. Après une première réduction de 25 % pour l'année 2024, le montant des quotas gratuits a été réduit de 50 % pour l'année 2025 et sera réduit à zéro en 2026.
Trajectoire de réduction des quotas d'émission gratuits en France
(en tCO2éq)
Source : commission des finances
Parallèlement à la disparition des quotas gratuits, le nombre total de quotas mis aux enchères suivra une trajectoire décroissante en application de l'article 9 de la directive « ETS » avec une réduction de 4,3 % par an entre 2025 et 2027 puis une réduction annuelle de 4,4 % à partir de 202831(*). Cette trajectoire a pour objet de rehausser progressivement le coût du transport aérien pour tenir compte des externalités négatives associées aux émissions de gaz à effet de serre.
(2) Les vols depuis le territoire de l'Union européenne seront soumis à des mandats d'incorporation de carburants d'aviation durable (SAF) à partir de 2025
Parallèlement à l'assujettissement des exploitants d'aéronefs à une trajectoire décroissante de quotas d'émission pour les vols intérieurs au sein de l'EEE, les autorités publiques à l'échelle de l'Union européenne ont mis en place un deuxième pilier structurant d'incitation à la décarbonation avec la mise en oeuvre à partir de l'exercice 2025 de mandats d'incorporation obligatoire de carburants d'aviation durables (SAF) pour les vols au départ de l'Union européenne.
Les rapporteurs relèvent que ces mandats mis en oeuvre à l'échelle de l'Union européenne sont cohérents avec les objectifs fixés à l'échelle nationale depuis 2017 notamment à travers d'une part un « engagement pour la croissance verte » (ECV) conclu en décembre 2017 entre l'État et cinq entreprises privées (Airbus, Air France, Safran, Total et Suez) ayant produit une étude de faisabilité concertée en novembre 201932(*) et d'autre part la « feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aéronautique durables » publiée par l'État en janvier 2020 et qui fixait des objectifs d'incorporation des SAF en France à hauteur de 2 % en 2025 et de 5 % en 2030.
Trajectoire des mandats d'incorporation de
carburants d'aviation durable (SAF)
dans les aéroports de l'Union
européenne
(en pourcentage)
Source : commission des finances
Le mécanisme européen de mandats d'incorporation de SAF a été consacré par le règlement (UE) 2023/2405 du 18 octobre 202333(*), ou règlement « RefuelEU Aviation », qui créé à partir de 2025 une obligation pour les fournisseurs de carburants d'aviation dans les aéroports de l'Union d'incorporer une part minimum de carburants d'aviation durables (SAF). Le mécanisme « RefuelEU », dont les mandats impératifs entrent en vigueur à partir de l'exercice 2025, distingue par surcroît entre un mandat global qui inclut l'ensemble des SAF et un sous-mandat applicable aux électrocarburants (carburants d'aviation synthétique ou e-SAF) qui sont produits à partir d'hydrogène décarboné et ont par conséquent des émissions associées plus faibles que les biocarburants d'aviation durables (bio-SAF).
Les obligations induites par le règlement « Refuel EU Aviation » sont applicables aux fournisseurs de carburant d'aviation dans l'ensemble des aéroports de l'Union européenne dont le nombre de passagers annuels dépasse 800 000, ce qui correspond en France aux 17 principaux aéroports qui concentrent 92 % du trafic. Les rapporteurs relèvent enfin que le règlement prévoit une obligation pour les exploitants d'aéronefs de se ravitailler pour l'ensemble du vol, de manière à faire obstacle aux tentatives de contournement des mandats d'incorporation.
2. La filière aéronautique a construit une trajectoire intégrée de décarbonation à horizon 2050 fondée sur la mobilisation de quatre leviers technologiques
a) La filière aéronautique a identifié quatre leviers technologiques principaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien
Pour comprendre les enjeux soulevés par la décarbonation du secteur du transport aérien, les émissions associées au transport aérien peuvent être décomposées en utilisant « l'équation de Kaya ». Cette identité mathématique, proposée au début des années 1990 par l'économiste japonais Yoichi Kaya34(*), peut être appliquée au secteur des transports et permet de décomposer les émissions du secteur.
C'est-à-dire :
La décomposition des émissions de gaz à effet de serre selon l'identité de Kaya permet de dégager trois catégories de leviers pour réduire les émissions du secteur aérien : une réduction de l'intensité carbone des carburants d'aviation ; une amélioration de l'intensité énergétique du trafic c'est-à-dire une amélioration du rendement des aéronefs ; une réduction du trafic.
Eu égard au dynamisme international actuel du trafic aérien, et dès lors que les crédits des missions « Recherche et enseignement supérieur » et « Investir pour la France de 2030 » n'ont pas pour vocation directe de modifier les comportements des consommateurs, les rapporteurs spéciaux se sont concentrés dans leur travaux sur les deux premiers leviers.
(1) L'intensité carbone des carburants d'aviation peut être réduite par deux leviers principaux à court et moyen terme : les carburants d'aviation durables (SAF) et l'utilisation de l'hydrogène
La réduction de l'intensité carbone des sources d'énergie utilisée dans le secteur du transport aérien constitue la première catégorie de leviers de décarbonation du secteur aéronautique. Au regard du manque de maturité technologique des autres solutions dont notamment l'hypothèse de la construction d'avion électrique, les deux leviers significatifs à moyens terme dans cette catégorie sont d'une part les carburants d'aviation durables (SAF) et d'autre part les avions à hydrogène.
En premier lieu, les carburants d'aviation durables (SAF) désignent plusieurs sources d'énergie qui ont trois caractéristiques communes : être compatibles avec les moteurs d'aviation existant (drop-in fuel) ; être d'origine non fossile ; permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L'ensemble des SAF ont en commun de mobiliser des sources de dioxyde de carbone captées dans l'atmosphère dans le cadre d'un cycle court. Par conséquent, le CO2 émis lors de la combustion des SAF est regardé comme ayant un caractère biogénique. À la différence du dioxyde de carbone d'origine fossile, le dioxyde de carbone biogénique est sans effet sur la concentration de CO2 atmosphérique et ne contribue pas à renforcer l'effet de serre. Pour autant, si les émissions correspondant à la combustion des SAF sont neutralisées en raison de leur caractère biogénique, l'usage des SAF est associé à d'autres émissions qui correspondent à la production de ces carburants, c'est-à-dire aux émissions de la « phase amont » (well-to-tank) qui correspondent notamment à la production et à la récolte de la biomasse consommée ainsi qu'à l'énergie électrique mobilisée pour produire de l'hydrogène.
Les carburants d'aviation durables peuvent être obtenus selon des procédés physico-chimiques différents et correspondent à deux catégories principales.
Premièrement, les biocarburants d'aviation durables (bio-SAF) correspondent aux SAF obtenus à partir de biomasses d'origine végétale ou animale. Parmi les filières de bio-SAF les deux filières les plus matures industriellement sont d'une part la filière correspondant au procédé « HEFA »35(*) qui peut consommer des huiles et graisses usagées ou des cultures d'huiles végétales - qui devrait représenter 80 % de la production mondiale de SAF d'ici à 2030 - et d'autre part la filière correspondant au procédé « AtJ »36(*) qui peut consommer des résidus agricoles, de la canne à sucre ou du miscanthe. Les émissions directes liées à la production de bio-SAF, qui sont inférieures à la valeur de référence de 89 gCO2/MJ pour le kérosène fossile37(*), varient selon la matière première utilisée pour produire le bio-SAF.
Deuxièmement, les électrocarburants d'aviation durables (e-SAF) correspondent aux SAF obtenus à partir de dioxyde de carbone capté dans l'atmosphère et d'hydrogène décarboné produit par électrolyse. La synthèse directe d'e-SAF (PtL) en combinant le CO2 et l'H2 est aujourd'hui la filière la plus mature sur le plan industriel. Sous réserve de disposer d'une source d'électricité bas-carbone, les émissions associées à la production d'e-SAF peuvent être réduite à un niveau proche de zéro.
Caractéristiques de plusieurs filières de production de bio-SAF
(en gCO2éq/MJ)
|
Procédé |
Matière première |
Émissions directes |
|
HEFA |
Huiles usagées et graisse animale |
18 (80 % de réduction par rapport au kérosène fossile) |
|
HEFA |
Huile de soja |
65 (27 % de réduction par rapport au kérosène fossile) |
|
AtJ |
Résidus agricoles |
40 (55 % de réduction par rapport au kérosène fossile) |
|
AtJ |
Canne à sucre |
33 (63 % de réduction par rapport au kérosène fossile) |
Source : commission des finances, d'après les données de l'OACI
En second lieu, un autre levier de décarbonation structurelle du transport aérien est constitué par l'usage de l'hydrogène (H2) comme source d'énergie directe des aéronefs. L'utilisation de l'hydrogène comme carburant d'aviation a comme avantage principal que sa combustion n'émet pas de dioxyde de carbone (CO2) ni d'autre gaz à effet de serre. L'avion à hydrogène constitue à ce titre une solution de transport aérien neutre en carbone, sous réserve que l'hydrogène consommé ait bien été produit par une énergie bas-carbone. À la différence des carburants d'aviation durables (SAF), l'hydrogène utilisé comme carburant pour les aéronefs n'est pas un carburant compatible avec les technologies des moteurs thermiques standards actuels (drop-in fuel) et nécessite de développer de nouvelles technologiques fondées soit sur des moteurs thermiques à hydrogène soit sur des moteurs électriques alimentées par une des piles à combustible à hydrogène.
Le caractère décarboné des avions à hydrogène justifient d'importants projets d'innovation pour les développer. Pour autant, la recherche industrielle actuelle se heurte à un verrou technologique majeur lié à la faible densité volumique d'énergie de l'hydrogène. En effet, l'hydrogène a pour caractéristique physique d'avoir une forte densité massique d'énergie, de 120 MJ/kg soit 2,8 fois plus que le kérosène. Pour autant, l'hydrogène gazeux, dans les conditions normales de températures et de pression, est très peu dense en conséquence de quoi sa densité volumique d'énergie est de seulement 0,003 kWh par litre38(*), soit 0,03 % de la densité volumique énergétique du kérosène qui est de 9,7 kWh/l - cela signifie en pratique qu'il faudrait embarquer un volume d'hydrogène gazeux 323 fois plus important dans les réservoirs d'un avion à hydrogène pour produire la même énergie qu'un avion à kérozène comparable.
Pour répondre à ce verrou technologique, les deux principales solutions de stockage envisagée sont le stockage sous forme de gaz compressé ou le stockage sous forme liquide. Le stockage sous forme de gaz compressé nécessite de porter et de stocker l'hydrogène à une pression de 700 bar. S'il permet d'atteindre une densité volumique d'énergie de 1 kWh/l soit 10 % de celle du kérosène, cela soulève le problème de la construction d'un réservoir dont les parois résistent à la pression ce qui se traduit par un alourdissement du réservoir qui limite l'intérêt pratique de cette solution. Le stockage sous forme d'hydrogène liquide nécessite quant à lui de porter et de stocker l'hydrogène à une température de - 253 °C soit 20 K. La liquéfaction de l'hydrogène permet d'atteindre une densité volumique d'énergie de 2,3 kWh/l soit 24 % de celle du kérosène. Elle présente l'avantage de nécessiter des réservoirs moins lourds que ceux utilisés pour l'hydrogène gazeux compressé mais le désavantage de consommer beaucoup d'énergie pour maintenir l'hydrogène à l'état liquide.
Densité volumique d'énergie de l'hydrogène selon son mode de stockage
(en Wh/l)
Source : commission des finances, d'après les données de l'Académie des sciences
Parallèlement aux verrous technologiques liés aux difficultés de stockage de l'hydrogène dans un aéronefs - en conséquence desquels les projets d'avions à hydrogène correspondent actuellement à des projets d'aéronefs régionaux ou moyens-courriers d'une portée d'au plus 3 500 kms - le développement des avions à hydrogène est affronté à un défi logistique lié au déploiement d'infrastructure d'approvisionnement en hydrogène dans les aéroports. Le caractère systémique de la création d'une nouvelle solution technologique pour alimenter les aéronefs implique la réalisation d'investissements massifs et coordonnés dans les infrastructures aéroportuaires pour permettre l'acheminement ou la production d'hydrogène bas-carbone vers les aéroports.
Le principal projet industriel de développement d'un avion bas-carbone est le projet « ZEROe » lancé par le groupe Airbus en 2020. Si le groupe Airbus a envisagé dans un premier temps une mise en service d'un premier avion, régional ou moyen-courrier, à hydrogène à horizon 2035, le groupe a annoncé en février 2025 que la mise en service serait repoussée eu égard aux retard pris dans le développement de cet avion et au manque de maturité de l'écosystème de production et de distribution de l'hydrogène pour l'aviation.
(2) L'intensité énergétique du trafic aérien peut être réduite par deux leviers principaux : le perfectionnement technologique des aéronefs (ultra-frugalité) et la rationalisation de la gestion du trafic aérien (ATM)
La seconde catégorie de leviers de décarbonation du transport aérien est constituée des solutions technologiques permettant de réduire l'intensité énergétique du trafic c'est-à-dire de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour réaliser un trajet. Les deux leviers technologiques significatifs dans cette catégorie dont d'une part et principalement le développement d'aéronefs « ultra-frugaux » bénéficiant de gains d'efficacité grâce notamment à leur masse, à leur aérodynamisme et au rendement de leur moteur et d'autre part, et de manière moins significative, la rationalisation de la gestion du trafic aérien (ATM39(*)).
En premier lieu, les industriels du secteur aéronautique - aussi bien les avionneurs que les équipementiers - poursuivent un travail continu de perfectionnement des aéronefs pour réduire la consommation de carburant des avions sur l'ensemble des liaisons aériennes. Dans la perspective de décarbonation du transport aérien à horizon 2050, les entreprises industrielles de la filière concentrent leurs efforts sur cette amélioration de l'efficience énergétique des trajets dans le but de développer des avions « ultra-frugaux », c'est-à-dire des aéronefs représentant un gain significatif d'intensité énergétique. Les rapporteurs relèvent que les investissements en recherche et développement (R&D) pour développer des appareils ultra-frugaux ont pour avantage de permettre un alignement complet entre les intérêts économiques des industriels et les objectifs environnementaux de la filière. En effet, comme il a été rappelé, les émissions du secteur sont essentiellement des émissions énergétiques liées à l'usage des aéronefs. Par conséquent, le fait de développer un avion ayant une moindre consommation de carburant est à la fois un levier structurel de décarbonation du secteur et une dimension déterminante pour la compétitivité des produits des avionneurs et de leurs sous-traitants.
Le développement d'avions ultra-frugaux repose sur une combinaison de plusieurs facteurs dont notamment le poids de l'appareil, son aérodynamisme et l'efficacité énergétique de son moteur. Premièrement, pour ce qui concerne le poids de l'appareil, les rapporteurs relèvent que les avionneurs et les équipementiers de la filière investissent en recherche et développement pour alléger les avions en développement la substitution de matériaux composites à des métaux pour la fabrication du fuselage, des ailes et de certaines pièces.
Deuxièmement, pour ce qui concerne l'aérodynamisme de l'appareil, les industriels investissent dans des projets de recherche et développement ayant pour objet d'imaginer des configurations innovantes pour la voilure, comme par exemple la possibilité d'équiper l'avion d'ailes à fort allongement pliables pour réduire la traînée.
Enfin troisièmement, pour ce qui concerne l'efficacité énergétique du moteur, le groupe Safran, motoriste de référence en France et en Europe, a engagé des travaux en coopération avec General Electric dans le cadre de la co-entreprises paritaire CFM à travers le programme de moteur non caréné « RISE »40(*) pour améliorer le rendement global d'un futur avion ultra-frugal. L'objectif de ce programme de recherche est d'améliorer de 20 % le rendement global du moteur par rapport au modèle actuel LEAP, qui équipe notamment une partie des avions Airbus de la famille A320 (LEAP-1A). En tenant compte des gains d'efficacité réalisés lors du lancement des moteurs LEAP, la mise au point du moteur RISE pourrait représenter un gain total d'environ un tiers du rendement pour les moteurs d'avion de CFM entre la mise en service du moteur CFM5641(*) en 1982 et la mise en service du futur moteur RISE à horizon 2035. Le développement de ces moteurs perfectionnés se traduit donc concrètement par une réduction potentielle de 32 % des émissions associées au secteur à long terme.
Évolution de la consommation des moteurs CFM
(en base 100 pour le moteur CFM56)
Source : commission des finances, d'après les données de Safran
En deuxième lieu, l'amélioration de l'intensité énergétique du trafic peut également s'appuyer sur un levier complémentaire et moins structurant qui correspond à la rationalisation des opérations au sol et de la gestion du trafic aérien (ATM). La mise en oeuvre de ce levier suppose une évolution des pratiques, au-delà des caractéristiques techniques des avions construits par les industriels, pour réduire la consommation associée à un vol donné. Cette réduction pourrait notamment être permise par l'adaptation des trajectoires de vol aux conditions externes, par l'adoption de profil de descente optimisée plutôt que par paliers ou encore par une rationalisation de la gestion du trafic et des procédures d'approche pour assurer qu'une piste soit immédiatement libre pour chaque avion approchant de son aéroport de destination.
b) Le Gouvernement a publié en mars 2023, après concertation avec la filière, une trajectoire intégrée pour que le transport aérien atteigne la neutralité carbone en 2050
Dans le contexte mondial de mise en oeuvre de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en application de l'accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015, les industriels de la filière aéronautique et les services de l'État ont réalisé plusieurs travaux de planification ayant pour objectif de fixer une trajectoire permettant d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 pour le secteur aérien, ce qui correspond à la cible de long terme (LTAG) adoptée par l'OACI en octobre 2022.
En premier lieu, les acteurs économiques de la filière aéronautique, réunis au sein du Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac), ont réalisé en décembre 2021 une trajectoire de décarbonation du transport aérien42(*) pour fixer les priorités du secteur, notamment en matière de recherche et développement (R&D). Au regard du rôle structurant de la filière française dans le transport aérien mondial qui a été rappelé, la planification proposée par le Corac retient un périmètre planétaire incluant l'ensemble de la flotte mondiale - en faisant l'hypothèse que les progrès technologiques seront adoptés par l'ensemble des exploitants d'aéronefs dans le monde.
Pour construire sa trajectoire de référence, le Corac retient comme hypothèse de référence une croissance de la demande mondiale pour le transport aérien de 3 % par an en moyenne entre 2019 et 2050, en cohérence avec le scénario central de référence établi à l'échelle internationale par le groupe de réflexion ATAG43(*). Sur le plan technologique, les principales hypothèses retenues par le Corac concernent la mise en service en 2035 d'un avion court et moyen-courrier (SMR44(*)) à hydrogène et d'un avion régional à hydrogène ainsi que la mise en service d'un SMR ultra-frugal (30 % de gains d'efficacité) en 2035 et d'un long-courrier ultra-frugal (20 % de gains d'efficacité) en 2037.
En retenant ces différentes hypothèses, le scénario du Corac permet une décarbonation brute du transport aérien à hauteur de 93 % des émissions. L'atteinte de la neutralité carbone du secteur pourrait être atteinte par la compensation des émissions restantes. La réduction des émissions de GES peut être décomposée selon les différents leviers technologiques d'amélioration de l'intensité carbone de l'énergie ou d'amélioration de l'efficacité énergétique des trajets présentés ci-avant : l'avion à hydrogène ; les carburants d'aviation durables (SAF) ; l'ultra-frugalité, en incluant le renouvellement des flottes ; l'améliorations des opérations au sol et de la gestion du trafic aérien (ATM).
Contributions des leviers technologiques à
la décarbonation
dans la trajectoire du Corac (décembre
2021)
(en pourcentage)
Source : commission des finances, d'après les données du Corac
La trajectoire élaborée par la filière et la feuille de route technologique associée ont servi à alimenter les travaux menés par le Gouvernement en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de la filière aérienne dans le cadre de la publication en mars 2023, en application de l'article 301 de la loi « climat et résilience » du 22 août 202145(*), de la feuille de route de décarbonation de l'aérien46(*). Ce document a fait l'objet d'une validation par le Gouvernement et constitue la trajectoire de référence de décarbonation du transport aérien.
À la différence de la trajectoire du Corac, la feuille de route de décarbonation de l'aérien est construite en adoptant deux périmètres distincts qui couvrent uniquement les émissions en lien avec la France. D'une part, le périmètre « France », ou domestique, mesure les émissions associées aux vols intérieurs en métropole et outre-mer. D'autre part, le périmètre « International » mesure les émissions associées aux vols internationaux au départ de la France vers un pays étranger.
Périmètre France (scénario
« Accélération ») - Contributions des
leviers technologiques à la décarbonation dans feuille de
route
de décarbonation de l'aérien (mars 2023)
(en pourcentage)
Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC
En dehors de ces différences liées aux périmètres retenus, la feuille de route de décarbonation de l'aérien distingue deux scénarios selon le niveau d'ambition technologique retenu. Le scénario « Accélération » est le plus proche des objectifs fixés par le Corac dans sa trajectoire de décembre 2021.
Principales hypothèses retenues dans le
scénario « Accélération »
de la
feuille de route de décarbonation de l'aérien (mars
2023)
|
Paramètre |
Hypothèse retenue |
|
Croissance du trafic |
0,8 % par an sur le périmètre « France » 1,1 % par an sur le périmètre « International » |
|
Fréquence de renouvellement de la flotte |
20 ans |
|
Mise en service des avions à hydrogène |
Avion régional en 2035 Avion court et moyen-courrier (SMR) en 2035 |
|
Mise en service des avions ultra-frugaux |
Avion régional (20 % de gains d'efficacité) en 2035 Avion SMR (30 % de gains d'efficacité) en 2035 Avion long-courrier (20 % de gains d'efficacité) en 2037 |
Source : commission des finances
Le scénario « Accélération » de la feuille de route de décarbonation de l'aérien permet, pour le périmètre « International », une réduction de 88 % des émissions du secteur en mobilisant les quatre leviers technologiques de perfectionnement du secteur. Le niveau de réduction brute des émissions par le développement de nouvelles technologies atteint 90 % sur le périmètre « France ».
Périmètre International
(scénario « Accélération ») -
Contributions des leviers technologiques à la décarbonation dans
la feuille de route de décarbonation
de l'aérien (mars
2023)
(en pourcentage)
Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC
Les rapporteurs relèvent qu'indépendamment du périmètre retenu et du choix des paramètres pour tracer une trajectoire de décarbonation, aucun des scénarios ne prévoit d'atteindre à horizon 2050 des émissions brutes nulles pour le transport aérien. En effet, l'objectif de neutralité carbone concerne les émissions nettes du secteur, c'est-à-dire les émissions compte tenu des « émissions négatives » générées par des projets de captation du carbone financés par les acteurs du transport aérien.
Par suite, la neutralisation des émissions résiduelles du transport aérien repose sur la mise en oeuvre et le suivi de mécanismes de compensation qui existent actuellement à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale.
En premier lieu, à l'échelle internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a pris l'initiative en 2018 de la création du mécanisme « Corsia » (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) qui a pour objet d'assurer une compensation des émissions excédant un seuil de référence (baseline) par les exploitants d'aéronefs.
Les États-membres de l'Union européenne dont la France participent au mécanisme Corsia depuis le début de sa phase pilote en 2021. Le mécanisme couvre tous les vols internationaux entre deux États-participants au mécanisme. Pour compenser les émissions qui excèdent la baseline, les exploitants d'aéronefs doivent disposer de « crédits carbone » correspondant à leurs investissements dans des projets de reforestation, de captation et de séquestration du carbone. Les crédits carbones éligibles au mécanisme Corsia doivent correspondre à un « standard de compensation » exigeant et agrées par l'OACI. L'ensemble des standards de compensation éligibles agréés par l'OACI se trouvent actuellement en dehors de l'Union européenne ; le prix des crédits carbone éligibles au mécanisme Corsia se situe actuellement autour de 5 euros par tonne de CO2.
La première phase du mécanisme Corsia, entre 2024 et 2026, est fondée sur le volontariat des États. Pendant cette phase, dans les pays volontaires, les exploitants d'aéronefs ont l'obligation de compenser toutes leurs émissions pour vols internationaux dans le périmètre du dispositif qui excèdent un seuil (baseline) fixé à 85 % des émissions de l'année de référence 2019. La deuxième phase du dispositif à partir de 2027 prévoit son application à l'ensemble des États membres de l'OACI à l'exception de certains pays exemptés en raison de leur niveau de développement ou de leur insularité.
En second lieu, à l'échelle nationale, l'article 147 loi « climat et résilience » du 22 août 202147(*) a créé un mécanisme national de compensation qui couvre les émissions des vols domestiques, qui se situent en dehors du périmètre du mécanisme Corsia.
Le dispositif national de compensation a prévu une montée en charge progressive avec une compensation de 50 % des émissions pour l'exercice 2022, de 70 % pour l'exercice 2023 et de 100 % des émissions depuis l'exercice 2024. Pour l'exercice 2024, le coût du dispositif national de compensation à atteint 45 millions d'euros pour les exploitants d'aéronefs.
Pour remplir leurs obligations vis-à-vis du dispositif national, les exploitants utilisent des crédits carbones qui doivent répondre à des exigences spécifiques en soutenant des projets de décarbonation mesurables, vérifiables, permanents et additionnels. Les crédits éligibles au mécanisme Corsia et les crédits certifiés par le label bas-carbone du ministère chargé de l'environnement peuvent être utilisés pour répondre aux obligations fixées par le dispositif national de compensation.
B. LES AIDES PUBLIQUES À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE SONT SOUS-CALIBRÉES DEPUIS L'EXERCICE 2024 EN DÉPIT D'UN CONTEXTE DE CONCURRENCE INTERNATIONALE AIGUË
1. Les aides publiques à la recherche et développement de la filière aéronautique, pilotées avec le soutien du Corac, sont dispersées entre trois programmes budgétaires distincts
La politique de soutien à la recherche et développement (R&D) dans le secteur aéronautique relève, sur le plan administratif, de la responsabilité de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) depuis 1976. Si la DGAC s'appuie depuis 2008 sur une instance de dialogue avec les acteurs de la filière, le Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac), elle demeure responsable de la conception et de la mise en oeuvre de la politique de soutien à la recherche et développement de l'industrie aéronautique48(*). Le Corac ne constitue pas à cet égard une instance de sélection des projets ni de détermination des montants d'aide attribués. Il fonctionne comme conseil de la DGAC dans la mise en oeuvre de la politique de soutien à la R&D de la filière aéronautique et il ne dispose ni de la personnalité morale ni d'une structure administrative autonome49(*).
Créé en juillet 2008 dans le cadre du « Grenelle de l'environnement » organisé par le ministre chargé de l'environnement, le Corac a pour objet de réunir au sein d'une instance de concertation l'ensemble des acteurs de la filière du transport aérien. Il permet de recueillir le point de vue des grands intégrateurs de la filière (Airbus, Dassault, Safran, Thales), du Groupement des industries françaises et aéronautiques et spatiales (Gifas), des petits et moyennes entreprises (PME) de la filière représentées par le comité Aéro-PME, des équipementiers représentées par le groupe des équipementiers aéronautiques, de défense et spatiaux (GEADS), des administrations chargées de la politique industrielle trans-sectorielle (DGE), de la politique industrielle de défense (DGA), de la politique de recherche publique (DGRI), des opérateurs aéroportuaires (ADP, UAF) et des compagnies aériennes (Air France-KLM, Fnam). Pour assurer un dialogue constant entre ces différents acteurs de la filière et garantir la cohérence de la politique de soutien à la R&D avec l'évolution de la situation de la filière, le Corac se réunit chaque mois dans un format de « comité de pilotage » (Copil) qui réunit vingt-deux entités. Parallèlement à ce suivi mensuel de l'évolution de la filière, le Corac organise également une à deux fois par an une réunion plénière ou « Corac ministériel » co-présidé par les ministres chargés du transport et de l'industrie qui permet de fixer les grandes orientations de la politique de soutien à la R&D aéronautique.
Le Corac, qui exerce une fonction de conseil auprès de la DGAC, a pour principale fonction d'établir une feuille de route partagée par l'ensemble de la filière qui fixe des objectifs technologiques et des échéances associées pertinentes au regard des futurs programmes d'aéronefs programmés par les avionneurs de la filière. Cette feuille de route partagée fait l'objet d'un suivi en continu et d'une actualisation si nécessaire dans le cadre des travaux du Corac. Elle constitue un levier pour permettre la synchronisation des efforts de recherche entre les entreprises de la filière et leur cohérence, pour éviter le risque de dispersion des dépenses de R&D des acteurs publics et privés. Par surcroît, l'identification d'une feuille de route claire des domaines de recherche dans lesquels les industriels disposent d'un dispositif de soutien national permet également d'assurer la complémentarité de ces domaines avec les dispositifs de soutien existant à l'échelle de l'Union européenne.
Sur le plan administratif, les aides du budget de l'État à la recherche et développement (R&D) dans la filière aéronautique sont unifiées au sein d'un « guichet unique » géré par la DGAC avec le soutien du Corac. À la différence d'autres dispositifs publics de soutien à l'innovation, le « guichet Corac » de la DGAC ne repose pas sur des procédures d'appel à projets (AAP) mais sur des attributions d'aide en gré à gré. En effet, le dialogue permanent entre les acteurs de la filière au sein du Corac a également pour objet de favoriser une synchronisation entre les demandes d'aide déposées par les industriels tenant compte de la maturité du projet de recherche et développement (R&D) et de sa cohérence avec la feuille de route technologique de la filière.
En pratique, la DGAC établit une programmation annuelle des aides à attribuer dans le cadre du « guichet Corac » et sélectionne les projets dans un processus de gré à gré tenant compte de son dialogue avec l'ensemble de la filière dans le cadre du Corac. La décision d'attribution de l'aide aux porteurs de projets est formalisée par l'adoption d'une convention entre la DGAC et le porteur de projet qui fixe le montant maximum de l'aide et les conditions associées, c'est-à-dire les jalons techniques à atteindre pour recevoir l'aide attribuée. Les versements effectifs de l'aide, concrètement des acomptes et du solde final, sont opérés par la DGAC sous réserve de la réception des justificatifs prévus par la convention.
a) Le programme 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables », support de droit commun des aides à la filière aéronautique, ne représente que 20 % des aides attribuées en 2024 à travers le guichet Corac
Le programme budgétaire n° 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durable », rattaché à la mission « Recherche et enseignement supérieur » et placé sous la responsabilité du commissaire général au développement durable, a pour objet de financer la politique publique de soutien à la recherche dans les domaines de l'énergie, du transport et de la construction, des risques et de l'aéronautique civile. Il constitue à ce titre le programme budgétaire de droit commun pour financer les aides à la recherche et développement dans le secteur aéronautique octroyées à travers le guichet Corac.
En pratique, les crédits dédiés à la recherche aéronautique civile au sein du programme 190 sont retracés dans le budget opérationnel de programme (BOP) « recherche aéronautique » piloté par la direction générale de l'aviation civile. Ce budget opérationnel de programme est subdivisé en plusieurs enveloppes budgétaires correspondant soit au versement de subventions pour les projets de recherche en amont, c'est-à-dire présentant un niveau de maturité inférieur au niveau TRL650(*), soit au versement d'avances remboursables pour les projets suffisamment matures, l'aide étant dans cette hypothèse assimilable à une forme de prêt accordé par l'État pour permettre aux industriels de faire porter à l'État une partie des risques liés à la phase de mise en service d'une innovation. L'absence de programme d'avion d'ampleur actuellement en phase d'entrée en service imminente rend marginal les aides versées sous forme d'avance remboursables dans la période récente.
Trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 190
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances, d'après les données de la DGAC
Note de lecture : La programmation des crédits au-delà de 2025 correspond à la trajectoire prévisionnelle transmise par la DGAC.
La trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 190 illustre le manque de cohérence dans le choix des instruments budgétaires de soutien à la recherche et développement de la filière aéronautique.
Pour l'exercice 2020 le programme 190 représentait l'intégralité des aides octroyées à travers le guichet Corac, en combinant une enveloppe initialement programmée de 135 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) soit 45 % des crédits du guichet Corac et une enveloppe additionnelle de 165 millions d'euros, soit 55 % des aides, ouverte dans le cadre du plan « France Relance » par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020 (LFR3 2020)51(*), avant la création de la mission « Plan de relance ».
Pour l'exercice 2024, le programme 190 ne représente plus que 20 % des aides octroyées dans l'année soit 57 millions d'euros.
Les rapporteurs relèvent que la situation actuelle fragilise la crédibilité du soutien public apporté à la recherche industrielle dans le secteur aéronautique : d'une part l'enveloppe budgétaire de droit commun représente seulement un cinquième du budget total, le reste étant abondé par des crédits ayant un caractère exceptionnel, et d'autre part le respect de la trajectoire de soutien suppose une hausse de 77 millions d'euros des crédits du BOP « Recherche aéronautique » entre les exercices 2025 et 2026.
b) Le programme 362 « Écologie » de la mission « Plan de relance » a constitué un support budgétaire temporaire correspondant aux aides exceptionnelles versées à la filière aéronautique à travers le guichet Corac en 2021 et 2022
Pour poursuivre le déploiement du plan « France Relance » lancé en septembre 2020 et d'un montant total de 100 milliards d'euros, la loi de finances initiale pour 202152(*) a créé une nouvelle mission au sein du budget général, la mission « Plan de relance ». Cette mission, structurée en trois programmes, a pour objet de retracer les financements associés aux dispositifs créés ou abondés dans le cadre du plan « France Relance ». Le programme 362 « Écologie » a été mobilisé à ce titre pour abonder le guichet Corac à hauteur de 930 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) en deux ans répartis entre 744 millions d'euros en 2021 et 186 millions d'euros en 2022.
Le schéma budgétaire global retenu par le Gouvernement pour la mise en oeuvre du plan « France Relance », qui correspond à la création artificielle de programmes budgétaires sans autre vocation que d'alimenter des politiques publiques financées par d'autres programmes du budget général de l'État, a fait l'objet de critiques constantes de la part de la commission des finances du Sénat et de son rapporteur général au regard de la confusion résultant de la création de la mission « Plan de relance ». Les rapporteurs rejoignent les constats formulés antérieurement par le rapporteur général de la commission des finances qui a eu l'occasion de dénoncer un « contournement de l'autorisation parlementaire » et une « opacité budgétaire préjudiciable au contrôle parlementaire »53(*).
Dans le cas particulier du soutien à la recherche et développement de l'industrie aéronautique, la mobilisation du programme 362 illustre parfaitement le risque d'illisibilité dénoncé par la commission des finances, ce programme ayant eu pour seul objet de retracer dans une mission distincte au moment des débats parlementaires sur le budget des crédits étant par la suite transférés vers le programme 190 et exécutés sur ce programme en gestion.
En pratique, le programme 362 a eu pour unique effet de réduire « visuellement » la hausse des crédits disponibles sur le programme 190 en 2021 et 2022, la gestion des aides par la DGAC à travers le guichet Corac n'étant pas affectée par ce circuit budgétaire.
Trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 362
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances, d'après la documentation budgétaire
Le financement du guichet Corac par le programme 362 a permis à ce titre d'apporter un complément de financement ponctuel substantiel pendant les deux années ayant suivi immédiatement le déclenchement de la crise économique et sanitaire de 2020. Pour autant, si ce complément d'aide a permis aux industriels de préserver les emplois dans le domaine de la recherche et développement en dépit de la perturbation de leur activité représentée par la crise sanitaire, cette enveloppe complémentaire a eu pour conséquence incidente une réduction des crédits conventionnels du programme 190 dédiés à la recherche aéronautique qui ont été entièrement neutralisés en 2022 et 2023 et dont le niveau de 2024 est inférieur de 81 % à leur niveau de 2019.
c) Le programme 424 « Financement des investissements stratégiques », par lequel transite les aides du plan France 2030, alimente le guichet Corac, géré par la direction générale de l'aviation civile, en contradiction avec les principes de fonctionnement des investissements d'avenir
Le plan France 2030, lancé le 12 octobre 2021 et qui intègre les investissements du quatrième volet du programme d'investissement d'avenir (PIA 4), constitue un plan d'investissement public de grande ampleur d'un montant pluriannuel total de 54 milliards d'euros. Il a pour objectifs principaux le rehaussement de la croissance potentielle et la décarbonation de l'appareil productif français. Conformément aux principes applicables aux investissements d'avenir depuis le lancement du premier volet du programme d'investissement d'avenir (PIA 1) par la loi de finances rectificative du 9 mars 201054(*), le plan France 2030 a pour vocation de financer des projets de transformation ayant un caractère additionnel et distinct des activités relevant de la gestion courante de l'administration.
Le caractère additionnel et distinct de l'administration courante des projets financés par le plan France 2030 se traduit par une architecture de pilotage et de déploiement spécifique, extérieure aux services administratifs des différents départements ministériels. Cette architecture de pilotage repose :
- d'une part sur la centralisation des informations relatives au déploiement du plan par un service dédié, le secrétariat général pour l'investissement (SGPI), rattaché aux services du Premier ministre ;
- d'autre part sur une gestion décentralisée des aides du plan qui mobilise quatre opérateurs principaux, à savoir l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), l'Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d'investissement (Bpifrance) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
À la différence des dépenses d'administration courante, les aides du plan France 2030 sont octroyées puis décaissées selon une procédure ad hoc qui implique à la fois un opérateur chargé de la gestion opérationnelle du guichet d'aide concerné55(*), un comité de pilotage ministériel opérationnel (CPMO) thématique chargé d'examiner les projets retenus par l'opérateur à l'issue de la phase d'instruction ainsi enfin que les services du SGPI qui prépare la décision finale d'octroi qui est prise directement par le Premier ministre. Cette « comitologie » propre au déploiement du plan France 2030 a pour vocation de garantir la sélectivité des aides et d'assurer leur cohérence avec la stratégie interministérielle dans le secteur concerné.
Dans le cadre du plan France 2030, l'enveloppe pluriannuelle de 54 milliards d'euros est répartie en dix-sept sous-enveloppes qui correspondent à dix objectifs et sept leviers identifiés comme les verticales prioritaires d'investissement. Une des sous-enveloppes du plan, celle de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone », est dédiée au financement de la recherche aéronautique civile. Alors que son montant initial était de 800 millions d'euros, il a été réabondé de 660 millions d'euros porté à 1 460 millions d'euros lors de la reprogrammation des aides du plan effectuées en octobre 2023. Une nouvelle reprogrammation réalisée le 1er avril 2025 a porté le montant total de cette sous-enveloppe à 1 515 millions d'euros en ajoutant un complément de financement à hauteur de 55 millions d'euros pour l'exercice 2025.
Les rapporteurs relèvent que si l'objectif n° 4 ne se limite pas au financement des aides du guichet Corac56(*), l'abondement du guichet Corac constitue la finalité principale de l'objectif n° 4 et représente 1,5 milliards d'euros, soit 92 % de la sous-enveloppe totale dédiée à l'avion bas-carbone.
Trajectoire de financement des aides du guichet Corac par le programme 424
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances, d'après les données du SGPI
Les rapporteurs relèvent que la chronique du financement du guichet Corac par les crédits du programme 424 illustre le fait que la sous-enveloppe de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » a été mobilisée en substitution des crédits conventionnels du programme 190 puis pour compenser la fin du plan « France Relance » dans un second temps. En effet, le plan France 2030 a commencé à financer le guichet Corac pendant l'exercice 2022, pendant lequel les crédits conventionnels du programme 190 avait été neutralisés, et à partir de 2023 il prend le relai du programme 362 sur lequel aucune nouvelle autorisation d'engagement (AE) n'a été ouverte pour les aides à la recherche aéronautique civile à partir de la fin de l'exercice 2022.
Les rapporteurs relèvent que le circuit de double abondement du guichet Corac par des crédits conventionnels du programme 190 et par des crédits exceptionnels du programme 424 constitue un artifice illégitime qui rigidifie et complexifie inutilement la gestion des aides à la recherche aéronautique civile distribuées à travers le guichet Corac. Si la signature d'une convention de délégation de gestion entre le SGPI et la DGAC57(*) permet de confier à cette dernière la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des crédits finançant le guichet Corac, indépendamment de leur circuit budgétaire de financement, le double abondement budgétaire de ce dispositif nuit à la fois à la simplicité de gestion de ce guichet et à la lisibilité de la politique de soutien public à la recherche aéronautique civile.
En premier lieu, les rapporteurs relèvent que la situation actuelle voit se combiner deux régimes de suivi administratif et de reddition de compte dont la superposition se traduit par une bureaucratisation des aides sans valeur ajoutée pour les objectifs poursuivis par cette politique publique. À ce titre la DGAC est tenue, en qualité de gestionnaire unitaire du guichet Corac, de rendre des comptes non seulement directement à son ministre de tutelle et à la représentation nationale à travers les instruments conventionnels de suivi de la performance du programme 190, mais également indirectement auprès du SGPI qui dispose de ses propres instruments de suivi du déploiement des aides du plan France 2030.
Les rapporteurs relèvent également, en rejoignant un constat fait lors de plusieurs auditions menées dans le cadre de ce contrôle budgétaire, que la connaissance fine de la filière aéronautique dont dispose la DGAC et sa capacité autonome d'analyse et de choix des projets soutenus à travers le guichet Corac dont elle assure la gestion ont pour effet de rendre artificielle, voire superfétatoire, l'application de la comitologie du plan France 2030 en impliquant notamment le CPMO « Transports » pour superviser l'octroi d'aides par la DGAC.
En second lieu, les rapporteurs relèvent qu'alors même que le guichet Corac est géré de manière unitaire par la DGAC, qui poursuit les mêmes objectifs et adoptent les mêmes critères de sélection indépendamment du circuit budgétaire concerné, les crédits mis à la disposition de la DGAC pour abonder le guichet ne sont pas fongibles. Par conséquent, chaque aide attribuée par le guichet Corac doit être artificiellement catégorisée comme relevant soit du programme 190 soit du programme 424. Cette catégorisation artificielle rigidifie le cadre de gestion du guichet et se traduit par des retards qui auraient pu être évités comme dans le cadre de la fin de gestion de l'exercice 2024 qui a donné lieu à des reports de versements pour des aides du programme 424 sur lequel aucun crédit de paiement n'était disponible alors même que des crédits de paiements étaient disponibles et n'ont pas été mobilisés sur le programme 190.
2. Le sous-calibrage des aides à la recherche et développement aéronautique depuis 2024 risque de fragiliser la filière au regard de la pression concurrentielle internationale
a) La cible de soutien annuel à la recherche et développement aéronautique civile, qui a été ramenée à 300 millions en 2023, est sous-exécutée depuis 2024
Concomitamment à l'élaboration de la trajectoire de décarbonation58(*) de décembre 2021 puis de la feuille de route de décarbonation de l'aérien59(*) en mars 2023, les industriels réunis au sein du Corac ont établi en mai 2020 une feuille de route technologique, ou « Master plan 2020-2029 », qui fixe les grandes orientations de la filière en matière de recherche et technologie (R&T) et qui identifie à la fois les objectifs et les verrous technologiques à lever pour les atteindre. Les cibles technologiques retenues dans cette feuille de route rejoignent les quatre leviers de décarbonation décrits dans la feuille de route de décarbonation (H2, SAF, ultra-frugalité, opérations et ATM). Le Master plan 2020-2029 a été mis à jour par la filière en mai 2023 sans rupture majeure relative aux options technologiques retenues.
La feuille de route de décarbonation de l'aérien s'appuie sur une première estimation des investissements en recherche et technologie (R&T) de la filière à hauteur de 10 milliards d'euros en dix ans. Plus particulièrement, entre 2024 et 2029, le besoin total d'investissements annuels en R&T est estimé à 900 millions d'euros par an.
Cette feuille de route conjointe, préparée avec le soutien technique de la DGAC et adoptée avec le soutien politique du Gouvernement, fixe expressément une cible financière de soutien à la filière pour ses activités de recherche et développement civile à hauteur de 450 millions d'euros par an jusqu'en 202960(*), ce qui correspond à un taux de soutien de l'État à hauteur de 50 % au regard de la première estimation des investissements en R&T des industriels de 900 millions d'euros par an entre 2024 et 2029.
Cette cible initiale de 450 millions d'euros par an de soutien public à la recherche aéronautique civile a été révisée dès 2023, au regard du contexte budgétaire contraint. Symétriquement, les rapporteurs relèvent que les estimations d'investissements en R&T des industriels ont été revues à la hausse par les entreprises de la filière et qu'elles atteignent, au regard de l'analyse des plans à moyen terme (PMT) des entreprises, un montant annuel estimé à 2 118 millions d'euros d'investissements en moyenne entre 2024 et 2027. En tenant compte de ce niveau d'investissement, le taux de soutien de l'État atteint 21 % avec la cible initiale de 450 millions d'euros d'aides par an et 14 % avec la cible révisée de 300 millions d'euros.
La cible révisée, annoncée par le Président de la République le 16 juin 2023 à l'occasion d'un discours prononcé à la 54e édition du salon du Bourget, a été fixée à 300 millions d'euros de soutien public à la recherche aéronautique civile entre 2024 et 203061(*). Elle a été consacrée par le Premier ministre à l'occasion d'une réunion interministérielle le 11 juillet 202362(*) qui a confirmé la cible révisée de 300 millions d'euros de soutien annuel entre 2024 et 2027 et fixé une trajectoire de répartition du soutien entre le programme 190 et le programme 424.
En dépit de l'engagement du Président de la République et du Premier ministre, la trajectoire révisée de soutien annuel à la recherche aéronautique civile à hauteur de 300 millions d'euros entre 2024 et 2027 n'a pas été tenue.
Pour l'exercice 2024, le montant total du soutien public a atteint 287 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE), soit 4 % de sous-exécution par rapport à la cible révisée et 36 % de sous-exécution par rapport à la cible initiale.
Pour l'exercice 2025, en tenant compte du redéploiement du 1er avril 2025, le montant total du soutien public atteint 278 millions d'euros en AE, soit 7 % de sous-exécution par rapport à la cible révisée.
Soutien public à la recherche aéronautique civile en 2024
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances
Les rapporteurs relèvent que la révision de la cible en juin 2023 a eu des conséquences directes sur les programmes de recherche et technologie (R&T) mis en chantier par les industriels du secteur aérien. En effet, la cible révisée de 300 millions d'euros correspond à une réduction d'un tiers par rapport à la cible initiale en termes de soutien public annuel.
Au regard des enjeux économiques associés, le programme de développement d'un nouvel avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR ultra-frugal) constitue la première priorité des avionneurs et équipementiers de la filière et les projets de recherche liés à ce programme sont financés de manière préférentielle avec le soutien des aides distribuées à travers le guichet Corac.
En revanche, la révision à la baisse de la cible de soutien public a eu pour effet de concentrer les projets de recherche dans le domaine du futur SMR ultra-frugal et donc d'évincer d'autres domaines de recherche concernant d'autres technologies ou d'autres leviers de décarbonation. Les rapporteurs relèvent en particulier que les projets de recherche dans le secteur des hélicoptères et dans le domaine des technologies liées à l'hydrogène connaissent actuellement un ralentissement imputable à cette réévaluation à la baisse du soutien public à la recherche aéronautique civile.
Les rapporteurs relèvent également qu'en additionnant les enveloppes allouées au guichet Corac par ses trois canaux de financement budgétaire distincts (programme 190, programme 362 et programme 424), la cible révisée de 300 millions d'euros par an en autorisations d'engagement (AE) n'a pas été atteinte pour les deux premiers exercices suivant son entrée en vigueur, c'est-à-dire les exercices 2024 et 2025.
Trajectoire de financement des aides du guichet Corac
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances
Note de lecture : La programmation des crédits au-delà de 2025 correspond à la trajectoire prévisionnelle transmise par la DGAC.
b) La filière aéronautique civile, qui constitue l'un des fleurons industriels du tissu économique français, se trouve affrontée une concurrence aiguë en vue du lancement d'un programme structurant de nouvel avion court et moyen-courrier (SMR)
La filière de la construction aéronautique civile est un domaine industriel dans lequel la France dispose d'un tissu économique innovant et compétitif à l'échelle mondiale. La capacité des entreprises françaises à développer des aéronefs de haute technologie, depuis le Blériot type XI à bord duquel Louis Blériot réalisa la première traversée de la Manche en avion le 25 juillet 1909 à l'Airbus A320 mis en service en 1988, a donné à la France un avantage compétitif en Europe et dans le monde pour capter les investissements productifs dans la filière aéronautique.
Le secteur de la construction aéronautique, structuré autour de grands intégrateurs (Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales) bénéficiant d'une chaîne de valeur intégrée largement présente sur le territoire national. Le nombre d'emplois directs total représentés par le secteur atteint 222 000 salariés en 2024, dont 46 % de cadres et ingénieurs.
Si les régions Occitanie et Île-de-France sont les deux principaux pôles de localisation des entreprises du secteur, la filière est également présente sur le reste du territoire et représente plus de 15 000 emplois dans plusieurs autres régions dont les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les rapporteurs relèvent à ce titre, à la suite des auditions menées dans le cadre de ce contrôle, que le groupe Safran est présent sur le territoire métropolitain dans toutes les régions, dans 40 départements différents, et constitue le premier employeur privé dans plus de 20 départements.
Répartition géographique des emplois de la filière aéronautique et spatiale
(en nombre de salariés et en 2024)
Source : commission des finances, d'après les données du Gifas
Il est également à relever que la filière aéronautique se distingue au sein du tissu économique et industriel national par sa contribution positive significative à la balance commerciale. En effet, alors que la balance commerciale pour les biens atteint un solde négatif de - 81 milliards d'euros en 2024, le secteur aéronautique dans son ensemble y contribue positivement avec un solde sectorielle positif à hauteur de 29 milliards d'euros. Cette contribution positive au solde commercial pour les biens s'explique par les succès commerciaux déterminants à l'export des entreprises de la filière depuis plusieurs années illustrées par les ventes internationales du groupe Airbus qui a livré, à l'échelle mondiale, 766 avions commerciaux en 2024 et qui dispose d'un carnet de commande de 8 658 avions à la fin de l'exercice 2024, soit plus de dix années de commande à la cadence de 2024.
Ces succès commerciaux se traduisent par une place déterminante de la filière dans les exportations de biens du tissu économique : pour l'exercice 2024, les exportations de la filière aéronautique ont représenté 57,2 milliards d'euros soit 11 % des exportations totales de produits manufacturés à l'échelle du territoire national63(*).
Répartition du chiffre d'affaires de la
filière aéronautique
entre les ventes nationales et les ventes
à l'export en 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données du Gifas
Parallèlement, les rapporteurs relèvent que la filière aéronautique est fortement structurée et que les grandes entreprises intégratrices animent une chaîne de valeur composée de nombreux sous-traitants dont la bonne marche est déterminante pour la capacité de l'ensemble des acteurs de la filière à poursuivre leurs programmes d'innovation et à atteindre leurs objectifs d'accélération de la cadence de production.
Les entreprises sous-traitantes des avionneurs et donneurs d'ordre de taille critique du secteur se sont organisées au sein du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) en constituant le « comité Aéro-PME », créé en juin 1996, qui est directement représenté au sein du comité de pilotage du Corac et qui est chargé de défendre les intérêts des 233 petites et moyennes entreprises adhérentes du comité64(*). La représentation des intérêts spécifiques des équipementiers est par surcroît assurée par la présence au sein du comité de pilotage de représentants du groupe des équipementiers aéronautiques, de défense et spatiaux (GEADS), qui sont souvent des PME et des entreprises de taille intermédiaires (ETI), dont la coordination opérationnelle est assurée par le Gifas.
Parallèlement, pour garantir l'ouverture du guichet de soutien à la recherche aéronautique civile et au regard de la sélection des projets de gré à gré, la DGAC a créé avec le soutien du Gifas le dispositif « Corac PME » ayant vocation à servir de point d'accès unique aux dispositifs de soutien public à la recherche aéronautique civile pour les PME de la filière. Ce dispositif, qui s'appuie notamment sur le réseau territorial des adhérents du Gifas et sur les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), a permis d'élargir le périmètre des entreprises de la chaîne de valeur (supply chain) bénéficiant des aides du guichet Corac avec 160 nouvelles entreprises bénéficiaires entre 2021 et 2024. Les rapporteurs relèvent enfin que ce dispositif a permis une hausse tendancielle de la part des aides du guichet Corac dédié aux PME et ETI qui est passé de 13 % pour la période 2020-2030 à 23 % pour l'exercice 2024.
Les rapporteurs relèvent toutefois qu'au regard de la concurrence internationale, la place centrale de la France dans l'industrie aéronautique mondiale ne constitue pas un acquis intangible et les échéances de mises en service de nouveaux aéronefs, probablement dans la seconde moitié de la décennie 2030 selon la programmation actuelle, constituent un défi majeur pour le maintien de la position dominante des avionneurs français et européens.
Les rapporteurs insistent en particulier sur la place particulière occupée par le programme d'avion court et moyen-courrier (SMR) Airbus A320. En effet, sur les 766 avions commerciaux livrés par Airbus en 2024, les avions de la « famille A320 » représentent 602 appareils livrés soit 79 % des livraisons. La prospérité de la filière française est à ce titre étroitement liée à ce succès commercial et la famille A320 représente à elle seule 150 000 emplois directs en France65(*).
La très forte sensibilité de la filière aéronautique civile française au succès de ces modèles d'avion a pour conséquence de rendre crucial le maintien d'une position forte des entreprises françaises sur le marché des avions courts et moyens-courriers. Or la décennie 2030 pourrait marquer un tournant sur ce segment au regard de l'entrée en service d'une nouvelle génération d'aéronefs. Cette nouvelle génération, dont l'entrée sur le marché est envisagée à partir du milieu de la décennie 2030 selon les hypothèses retenues dans la construction de la feuille de route de décarbonation de l'aérien66(*), correspondra au nouvel avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR ultra-frugal) qui constitue l'un des leviers significatifs de décarbonation identifiés pour le secteur avec une contribution à hauteur de 20 % à l'atteinte de l'objectif de neutralité à horizon 2050 selon la trajectoire du Corac de décembre 202167(*).
La phase actuelle de la feuille de route technologique partagée par les entreprises de la filière correspond à une phase de montée en maturité et de démonstration des technologies qui équiperont le futur SMR ultra-frugal. Le maintien d'un niveau élevé d'investissements en recherche et technologie par les entreprises de la chaîne de valeur est déterminant pour assurer une bonne préparation de ces entreprises au lancement de ce programme majeur.
À titre illustratif, la première position mondiale du groupe Safran sur le marché des moteurs d'avions civils courts et moyens-courriers repose sur les moteurs construits par CFM, la coentreprise paritaire créée en 1974 entre le groupe français Safran et le groupe américain General Electric (GE). Si ce partenariat fonctionne sur le principe d'un partage égalitaire d'une part de la conception, du développement et de la production et d'autre part des revenus entre les deux groupes, schéma adopté pour les moteurs CFM56 et LEAP, ce partenariat égalitaire suppose que le groupe Safran maintienne sa parité de capacité technologique par rapport à GE en vue du lancement d'un futur moteur non-caréné (programme RISE) ayant vocation à équiper le futur SMR ultra-frugal.
Les investissements que la puissance publique soutient actuellement dans le domaine de la recherche aéronautique civile ont donc pour objet de maintenir à moyen terme non seulement l'excellence des avionneurs français et européen et leur place sur le marché international, mais également la capacité de l'ensemble des sous-traitants de la filière à continuer à être intégrés à un niveau élevé à la chaîne de valeur (supply chain) du futur SMR ultra-frugal qui structurera les performances économiques du secteur dans les décennies à venir.
II. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ASSOCIÉS AU MAINTIEN EN FRANCE ET EN EUROPE D'UNE INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE INNOVANTE JUSTIFIENT QUE LE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE SOIT CONSOLIDÉ
A. LA STRATÉGIE DE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE PEUT ÊTRE EXÉCUTÉE, SIMPLIFIÉE ET CRÉDIBILISÉE AU SERVICE DU MAINTIEN DANS LA DURÉE DE L'EXCELLENCE DE CETTE FILIÈRE INDUSTRIELLE
1. La mise en oeuvre effective de la feuille de route technologique de la filière et de la trajectoire de décarbonation en résultant nécessite de tenir la trajectoire pluriannuelle de soutien public à la recherche aéronautique civile
Le mécanisme de soutien public à la recherche aéronautique civile, à travers le guichet Corac géré par la DGAC selon un fonctionnement de gré à gré, constitue une singularité du secteur du transport aérien en matière d'aides publiques.
Les rapporteurs relèvent que l'efficacité de ce système intégré fait l'objet d'un large consensus partagé aussi bien par l'administration que par les entreprises industrielles du secteur. La capacité des différentes parties prenantes à adopter une feuille de route technologique unique et cohérente partagée par l'ensemble de la filière est à ce titre un catalyseur puissant de la recherche aéronautique. Elle évite en particulier la dispersion des ressources et permet de synchroniser les programmes de recherche entre les nombreuses composantes de la chaîne de valeur d'un aéronef.
Dans ce contexte, il est toutefois à relever que le bon fonctionnement de ce mécanisme suppose que les aides octroyées à travers le guichet Corac soit adossées sur une programmation budgétaire à la fois pluriannuelle et crédible.
En premier lieu, la visibilité donnée aux industriels sur le soutien pluriannuel accordé à la recherche aéronautique civile est une condition déterminante du succès des programmes de recherche. En effet les entreprises industrielles engagent des investissements lourds dans leurs principaux programmes de recherche et leur capacité de projection au-delà de douze mois est déterminante pour inciter à l'investissement de long terme sur le territoire. Les rapporteurs saluent à ce titre que l'engagement pris par le Président de la République puis par le Gouvernement en 2023 de tenir une trajectoire de soutien public annuel à la recherche aéronautique à hauteur de 300 millions d'euros.
En second lieu, la crédibilité des engagements pluriannuels pris en matière de soutien public est également une condition déterminante du succès de la filière dans la mise en oeuvre de sa feuille de route technologique et de la trajectoire de décarbonation associée. En effet la capacité du Corac - comme lieu de dialogue entre les acteurs de la filière - et de la DGAC - comme gestionnaire du guichet Corac - à synchroniser les projets de recherche portés par différents intégrateurs et sous-traitants repose sur la confiance que les industriels accordent à l'engagement de l'État dans la durée qui a pour conséquence qu'un projet qui ne fait immédiatement l'objet d'un soutien public au regard de son manque de maturité technologique pourra bénéficier d'un soutien public accordé postérieurement, dans l'intérêt de la filière. À cet égard, la sous-exécution répétée des engagements de l'État en matière de soutien public à la recherche aéronautique civile risque de fragiliser la crédibilité de ces engagements et, partant, de nuire à l'efficacité du soutien public à la filière aéronautique en matière de recherche.
Aides publiques à la recherche aéronautique civile (guichet Corac)
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances
Les rapporteurs estiment par surcroît que ce risque de fragilisation de la crédibilité du soutien public à la recherche aéronautique civile doit être appréhendé en tenant compte des mécanismes de soutien existant dans les principaux pays partenaires de la France disposant d'un tissu économique compétitif dans le domaine aéronautique.
Il est en particulier à relever que l'Allemagne, principale nation partenaire de la France au sein du groupe Airbus68(*), dispose d'un programme spécifique dédié au soutien de la recherche aéronautique civile, le programme « LuFo » (Luftfahrtforschungsprogramm), dont le budget annuel atteint 300 millions d'euros pour le programme LuFo VII couvrant la période 2025-2030. Par voie de conséquence, les sous-exécutions de la cible française de soutien à la recherche aéronautique civile risque de se matérialiser par un désavantage compétitif de la France par rapport à l'Allemagne pour la localisation des activités de recherche du groupe Airbus et des sous-traitants de la filière. Les rapporteurs relèvent également que d'autres pays en dehors de l'Union européenne dispose d'industries compétitives dans le domaine aéronautique au premier rang desquels le Royaume-Uni, qui soutient la recherche notamment à travers les aides pilotées par l'Aerospace Technology Institute (ATI), et les États-Unis, qui financent des programmes massifs de soutien public à la recherche aéronautique civile gérés notamment par la Nasa69(*) et la FAA70(*).
Enfin, les entreprises de la filière, qu'il s'agisse des intégrateurs ou des sous-traitants, sont soumises à des échéances étroitement liées à la stratégie des grands avionneurs mondiaux et au calendrier de mise sur le marché du futur avion court et moyen-courrier ultra-frugal (SMR ultra-frugal). Son entrée en service prévue aux alentours de 2035, qui dépend de l'analyse globale faite par les avionneurs de l'évolution du marché du transport aérien, impose de tenir la trajectoire actuelle et fait obstacle au report dans le temps des investissements en recherche et technologie associés.
Recommandation n° 1. Respecter la cible de 300 millions d'euros de soutien public annuel à la recherche aéronautique civile (Gouvernement, Parlement).
2. L'unification du financement des aides du guichet Corac par le programme 190 constitue un levier de simplification
Comme il a été exposé préalablement, le guichet Corac a été financé depuis l'exercice 2021 par trois programmes budgétaires différents : le programme 190, programme budgétaire de droit commun destiné au financement des aides à la recherche aéronautique civile ; le programme 362, support budgétaire du complément de financement apportés dans le cadre du plan « France Relance » ; le programme 424, véhicule budgétaire des aides du plan France 2030, dont le déploiement repose sur une procédure extra-budgétaire mise en place dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir (PIA).
Cette situation de financement multicanal complexifie inutilement le schéma de financement public des aides à la recherche aéronautique civile et nuit à la lisibilité budgétaire du guichet Corac et à son contrôle par le Parlement.
En premier lieu, la situation actuelle aboutit à une superposition des strates de pilotage administratif sans motif légitime. En effet, l'ensemble des aides du guichet Corac sont actuellement gérées « comme un tout » par la DGAC en tant que gestionnaire de ce dispositif d'aide, selon une procédure unique de gré à gré entre les industriels porteurs de projet de recherche et le service instructeur de la DGAC qui recueille les propositions au fil de l'eau, étudie leur éligibilité puis sélectionne dans le cadre de sa programmation budgétaire annuelle les projets soutenus en tenant compte de la maturité technologique des projets et de leur cohérence avec la feuille de route partagée de la filière. L'octroi de l'aide est consacré par l'adoption par la DGAC d'un acte attributif qui fixe le montant de l'aide et les critères de versement tenant compte de l'atteinte de jalons techniques spécifiques. En application de la convention de délégation de gestion liant le SGPI et la DGAC71(*), cette procédure est applicable à l'ensemble des aides attribuées à travers le guichet Corac indépendamment du programme budgétaire de financement de l'aide, c'est-à-dire y compris pour les aides financées par les crédits du plan France 2030 qui dérogent dans cette circonstance à la procédure spécifique d'octroi des aides du plan France 2030 faisant intervenir un opérateur-instructeur et une décision d'attribution du Premier ministre (DPM).
Pour autant, le financement d'une partie des aides du guichet Corac par le plan France 2030 a pour conséquence d'imposer à la DGAC de catégoriser artificiellement une partie des aides comme relevant du droit commun (programme 190) et une partie des aides comme relevant du plan France 2030 (programme 424). La DGAC a ensuite l'obligation de soumettre les aides catégorisées « France 2030 » à la comitologie spécifique du plan dont notamment une présentation mensuelle de ces aides au CPMO « Transports » - alors même qu'une partie substantielle des membres de ce CPMO siègent déjà au sein du Corac - ou encore le suivi selon des indicateurs de performance ad hoc qui ne correspondent pas aux indicateurs de performance de droit commun suivis dans le cadre du programme 190.
Si cette superposition des strates administratives ne fait pas obstacle à une gestion unifiée du guichet Corac par la DGAC, elle induit une complexité bureaucratique illégitime qui dans certains cas peut provoquer des retards dans le paiement des aides, en raison de la non-fongibilité entre les crédits décaissés au profit des bénéficiaires finaux selon que l'aide qui leur a été attribuée ait été catégorisée ou non comme relevant du plan France 2030.
En deuxième lieu, la situation actuelle de financement multicanal du guichet Corac contrevient au principe de non-substitution applicable aux aides du plan France 2030. Cette situation aboutit à une architecture dans laquelle, en contradiction avec les principes ayant présidés à la mise en place des investissements d'avenir, le canal de financement du programme 424 constitue une voie de contournement du vote annuel du budget qui permet de financer des guichets d'aides publiques de droit commun sans se soumettre au vote annuel des crédits dans le cadre de la loi de finances initiale.
Pour éviter ce risque de substitution et garantir l'étanchéité entre les dispositifs d'aides conventionnels, financés par les crédits budgétaires de droit commun, et les dispositifs d'aide exceptionnels, financés par les investissements d'avenir, le rapport Investir pour l'avenir de novembre 2009 - sur le fondement duquel les investissements d'avenir ont été mis en place - précisait expressément que les investissements d'avenir doivent être « gérés de manière étanche par rapport au reste du budget »72(*). Le schéma de financement multicanal du guichet Corac méconnait manifestement ce principe essentiel régissant les investissements d'avenir.
Les rapporteurs relèvent à ce titre que l'exercice 2025 constitue une illustration éloquente de ce risque de contournement du vote du Parlement. En effet lors du vote de la loi de finances initiale pour 2025, les données qui avait été transmises au Parlement faisaient état, au sein du programme 424, d'un montant de crédits prévisionnels de 165 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) pour 2025. Par suite, le vote d'un montant de 58 millions d'euros de crédits en AE sur le programme 190 dédié au guichet Corac ne représentait que 26 % du montant total des crédits programmés pour ce dispositif au début de l'exercice 2025. Or le Gouvernement a décidé lors d'une réunion interministérielle le 1er avril 2025 de procéder à une réallocation des crédits du plan France 2030 de manière à augmenter de 55 millions d'euros en AE les crédits du plan France 2030 dédiés au guichet Corac pour l'année 2025. Cette décision de consommation en 2025 de crédits reportés depuis le lancement du plan France 2030 a pour effet de modifier unilatéralement et en cours d'année, quelques mois après l'adoption de la loi de finances initiale et sans en informer le Parlement, le schéma financier du guichet Corac pour l'exercice 2025.
Contrôle du Parlement sur les crédits du guichet Corac pour l'exercice 2025
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances
Enfin en troisième lieu, les rapporteurs font remarquer que le schéma de financement multicanal du guichet Corac présente un risque de non-conformité avec le principe de spécialité budgétaire. En effet, dans une logique de lisibilité des débats budgétaires au Parlement et de plein contrôle des parlementaires sur le budget de l'État, conformément au principe d'annualité, le principe de spécialité prévoit que le Parlement doit pouvoir se prononcer par un vote sur un ensemble cohérent de crédits qui concourent à une politique publique donnée.
Ce principe de spécialité a été consacré au niveau organique par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 200173(*) dont l'article 7 dispose : « Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation ».
Le schéma de financement multicanal du guichet Corac, qui scinde le financement d'un même dispositif entre plusieurs programmes budgétaires, méconnaît le principe de spécialité budgétaire en faisant obstacle à ce que le Parlement se prononcer par un vote unique sur les crédits concourant à la politique publique de soutien à la recherche aéronautique civile pilotée par la DGAC.
En conclusion, les rapporteurs constatent que le schéma de financement multicanal du guichet Corac contrevient à la fois aux principes de déploiement des investissements d'avenir et aux principes d'exécution des crédits de droit commun. Par suite, ils estiment que ce schéma doit être simplifié en étant unifié au profit d'un financement unique par le programme 190, ce qui renforcerait la lisibilité de cette politique publique et la portée du contrôle parlementaire.
Recommandation n° 2. Simplifier le circuit de financement du soutien public à la recherche aéronautique civile en le rebudgétisant intégralement au sein du programme 190 (DB, DGAC, SGPI).
3. La déclinaison opérationnelle des solutions à déployer pour assurer l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) des aéronefs civils est un levier de crédibilisation de la trajectoire de décarbonation de l'aérien
La diffusion de l'usage des carburants d'aviation durables (SAF) comme énergie primaire pour le secteur du transport aérien civil constitue l'une des clés de voûte de la décarbonation du secteur aérien. Le levier technologique des SAF contribuent en effet massivement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur dans l'ensemble des scénarios prospectifs établis par les industriels et l'administration. Selon le document de référence - trajectoire de décarbonation du Corac de décembre 202174(*) ou scénario « Accélération » de la feuille de route de décarbonation de l'aérien de mars 202375(*) - et le périmètre retenu - flotte mondiale, périmètre « France » ou périmètre « International » - l'utilisation des SAF représente entre 49 % et 58 % de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien en vue d'atteindre la cible de long terme (LTAG) fixée par l'OACI de neutralité carbone en 2050. La crédibilité des trajectoires de décarbonation du transport aérien repose par conséquent largement sur la crédibilité de la diffusion large à moyen terme des SAF dans le secteur, le scénario « Accélération » de la feuille de route de mars 2023 prévoyant par exemple un taux d'incorporation des SAF à hauteur de 85 %, dont 50 % d'électrocarburants, en 2050.
Le développement d'une filière de production de SAF en mesure de répondre aux besoins massifs que représenterait une conversion, même progressive, de l'ensemble du secteur au SAF soulève plusieurs défis d'ordre industriels, économiques et énergétiques. Sans être exhaustif sur ces défis, auxquels doivent être intégrés la difficulté de garantir l'existence d'un modèle économique équilibré, les rapporteurs relèvent notamment deux défis structurels liés au développement de la filière de production de SAF récemment mis en lumière par l'association Aéro Décarbo76(*). D'une part, le déploiement massif des SAF nécessite de garantir la disponibilité d'une biomasse suffisante pour assurer la production des biocarburants tout en respectant la hiérarchie des usages de la biomasse77(*). D'autre part, le déploiement massif des SAF et en particulier des électrocarburants nécessite de garantir la disponibilité d'une électricité bas-carbone à un niveau suffisant pour assurer la production des e-SAF qui constitue une activité électro-intensive.
Les rapporteurs ont constaté à l'occasion des auditions menées dans le cadre de ce contrôle que la politique publique de soutien au développement d'une filière de production de SAF mobilise des instruments distincts de la politique publique de soutien à la recherche aéronautique civile. Par voie de conséquence, les aides du guichet Corac ne sont que marginalement mobilisées sur des projets de recherche en lien avec les SAF. Ceci correspond au fait que, du point de vue des industriels de la filière, la responsabilité des avionneurs et de leurs sous-traitants, en particulier les motoristes, est d'assurer la compatibilité des aéronefs avec l'usage de SAF. Les questions énergétiques et logistiques liées à la montée en puissance d'une filière de production de SAF en France et en Europe ont des conséquences indirectes sur les entreprises de production d'aéronefs ou de composantes d'aéronefs mais sont intégrées de manière marginale au Master plan 2020-2029 du Corac.
La structuration des aides du plan France 2030 donne une autre illustration de cette séparation. Alors que les enveloppes de financement complémentaires du guichet Corac sont rattachées à l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » du plan France 2030, les dispositifs de soutien à la filière SAF sont rattachés au levier n° 1 « Matières premières ». À ce titre, l'appel à projets (AAP) « Carb Aéro » opéré par l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (Ademe) qui a donné lieu à l'octroi de 100 millions d'euros d'aides en avril 2025 à quatre projets de sites78(*) pour soutenir le développement en France d'une filière de production de SAF n'est pas intégré à l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone ».
Au regard de l'importance dimensionnante des SAF dans la feuille de route de décarbonation de l'aérien, l'enjeu de leur disponibilité à horizon 2050 doit être appréhendé dans le cadre d'un dialogue partagé entre les administrations chargés de l'aviation civile et de l'énergie et les principaux acteurs des secteurs aéronautiques et énergétiques.
Recommandation n° 3. Crédibiliser la trajectoire de décarbonation du transport aérien en l'articulant avec une feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) (DGAC, DGEC).
Les rapporteurs relèvent par surcroît que la nécessité de garantir une pleine appropriation par l'ensemble des acteurs de la filière aéronautique de l'enjeu de la disponibilité des SAF suppose un élargissement du périmètre dans lequel les travaux de planification de la filière se tiennent. En effet, l'espace transversal de dialogue constitué par le Corac est centré exclusivement sur les entreprises du secteur aéronautique civile sans faire intervenir l'administration chargée de la politique énergétique et environnementale ni les principaux acteurs du secteur énergétique.
La création d'un format « Corac SAF », incluant des représentants de l'administration chargée de la politique énergétique et des principaux énergéticiens, permettrait de dresser un constat partagé par les représentants de la construction aéronautique, des services aéroportuaires, des compagnies aériennes, des énergéticiens et des administrations compétentes de la situation actuelle et à venir en matière d'accès au SAF. L'élaboration de la feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) évoquée ci-dessus serait faite sous l'autorité de ce format « Corac SAF » en confiant à cette instance de dialogue un rôle de suivi de la mise en oeuvre de cette feuille de route et de conseil aux administrations de l'État pour en atteindre les jalons successifs.
Les rapporteurs notent qu'en tout état de cause, au regard de l'importance de tenir l'objectif de 300 millions d'euros de soutien public annuel à la recherche aéronautique civile, la création de ce format de dialogue élargi n'implique pas la création d'un guichet d'aide « Corac SAF » dédié à la production de SAF et que ce format ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de réduire le montant des aides du guichet Corac consacré à la recherche aéronautique civile.
Recommandation n° 4. Créer au sein du Corac un format « Corac SAF », élargi aux représentants des énergéticiens et de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), chargé de l'élaboration et du suivi de la feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (Corac, DGEC).
B. LE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE AÉRONAUTIQUE CIVILE PEUT ÊTRE DIVERSIFIÉ EN MOBILISANT DES INSTRUMENTS D'AIDES EN FONDS PROPRES ET EN CONSOLIDANT LES AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE
1. La création d'un instrument de soutien en fonds propres dédié à la filière aéronautique est un levier de consolidation des startups industrielles du secteur
Le secteur de la construction aéronautique connaît, comme l'ensemble des secteurs économiques, un phénomène de création de nouveaux acteurs économiques innovants (startups) qui ont pour objectif de créer de la valeur en renouvelant les modes de production ou les modèles économiques existants.
Plusieurs interlocuteurs auditionnés par les rapporteurs dans le cadre de ce contrôle ont insisté sur la distinction à opérer entre deux catégories de startups dans la filière aéronautique. Premièrement, les startups aéronautiques technologiques ayant pour objet le développement d'une nouvelle solution ou brique technologique en vue de son intégration dans les grands programmes industriels actuels ou à venir79(*). Deuxièmement, les startups aéronautiques industrielles ayant pour objet d'adopter un modèle d'intégrateur et d'avionneur en mesure d'organiser leur propre chaîne de valeur (supply chain) ayant des composantes externes et internes en vue de produire, à l'échelle industrielle, des aéronefs80(*).
Les conditions d'accès aux capitaux propres diffèrent selon la catégorie de startup concerné. En effet, les startups aéronautiques technologiques ont des besoins en capitaux limités à la phase de développement et de démonstration de leurs briques technologiques. Le marché actuel de la levée de fonds, et en particulier les fonds d'investissements dédiés aux technologies de rupture (fonds « Deep Tech »), permettent de répondre aux besoins de capitaux propres de ces entreprises qui dans certains cas bénéficient également des investissements des fonds de capital-risque internes (corporate VC) des grands groupes de la filière dont notamment Airbus81(*) et Safran82(*).
En revanche, les enjeux industriels associés à la conduite d'un programme de construction d'un aéronef impliquent de mobiliser un niveau élevé de fonds propres pour les startups aéronautiques industrielles. La DGAC et le SGPI ont indiqué aux rapporteurs que les besoins d'investissements pour développer, certifier et construire les infrastructures industrielles d'usinage d'aéronefs atteignaient un ordre de grandeur d'un milliard d'euros. Les instruments d'intervention en capitaux propres de la puissance publique financés par le plan France 2030 et mis en oeuvre par la Banque publique d'investissement (Bpifrance) ne sont pas adaptés à ce type de besoins.
En particulier, si le plan France 2030 finance des véhicules d'investissements généralistes en matière industrielle, il n'a pas prévu à ce stade le financement d'un fonds thématiques dédiés aux startups aéronautiques industrielles. De tels instruments ont pourtant été créés dans le secteur des métaux critiques83(*) et, plus récemment, dans le secteur agricole84(*).
Au regard des spécificités technologiques et réglementaires du secteur de l'aviation civile, et en particulier des processus particulièrement longs et complexes de certification en matière de sécurité qui augmente le risque externe associé à ces investissements, les rapporteurs estiment qu'il serait pleinement pertinent de constituer un instrument en fonds propres dédié aux startups aéronautiques industrielles. Ce nouvel instrument pourrait par surcroît être créé à enveloppe constante pour le plan France 2030 dès lors que l'intégralité des aides en fonds propres du plan n'ont pas été programmées.
Recommandation n° 5. Accélérer le développement des startups aéronautiques industrielles en créant un instrument thématique d'investissement en fonds propres financé par France 2030 (SGPI).
2. Les aides de l'Union européenne à la recherche aéronautique civile peuvent être consolidées en réaffirmant le caractère stratégique de cette filière industrielle et en segmentant les aides de l'Innovation Fund
Les aides publiques à la recherche aéronautique civile octroyées par l'État français sont complétées par des dispositifs de soutien financés directement par le budget de l'Union européenne.
Depuis 2007 et la mise en oeuvre du septième programme-cadre pour la recherche et l'innovation (7e PCRI) pour la période 2007-2013, le Conseil de l'Union européenne a créé85(*) un partenariat public-privé (Joint Undertaking) chargé de piloter les aides co-financées par l'Union européenne en matière de recherche aéronautique civile. Depuis 2021, pour la mise en oeuvre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et du 9e programme-cadre pour la recherche et l'innovation (9e PCRI) « Horizon Europe », le programme « Clean Aviation » (2021-2027) a succédé aux programmes « Clean Sky 1 » (2007-2013) et « Clean Sky 2 » (2014-2020). Le programme « Clean Aviation » dispose d'un budget pluriannuel de 4,1 milliards d'euros pour sept ans, dont 1,7 milliards d'euros financés par le budget de l'Union européenne (programme « Horizon Europe »).
Financement des programmes de soutien de l'Union
européenne
à la recherche aéronautique
civile
(en millions d'euros)
Source : commission des finances
Les partenariats publics-privés (JU86(*)) pluriannuels successifs financés par l'Union européenne fonctionnent sur le principe d'un cofinancement et d'un copilotage des aides entre la Commission européenne, les États-membres de l'Union et les entreprises membres du partenariat. Les projets de recherche et développement (R&D), qui doivent être présentés par des consortiums respectant des règles spécifiques en matière de répartition géographique de leurs membres, sont sélectionnés à travers un mécanisme d'appels à projets (Calls) en tenant compte de leur qualité technique et de leur cohérence avec la feuille de route technologique (Strategic Research & Innovation Agenda) fixée par le partenariat CAJU87(*).
Pour la période 2021-2027, la feuille de route technologique (SRIA88(*)) du partenariat CAJU est centrée sur trois axes : le développement des technologiques du futur SMR ultra-frugal ; le développement d'un avion à hydrogène ; le développement d'un avion régional hybridé. Les programmes cofinancés par le partenariat CAJU doivent notamment permettre de réaliser des essais en vol des démonstrateurs de moteurs non-carénés (programme RISE mené par Safran) et de pile à combustible hydrogène (programme ZEROe mené par Airbus).
Il est également à relever que les programmes aidés par le partenariat CAJU sont complémentaires des projets soutenus à l'échelle nationale à travers le guichet Corac.
Les rapporteurs remarquent enfin qu'au regard de la position centrale de la filière aéronautique française sur le continent européen, les taux de retour de la France au sein du partenariat CAJU sont particulièrement élevés et atteignent 31 % entre 2021 et 2024, ce qui place la France en tête des États-membres en matière de perception des aides du partenariat CAJU.
En vue de la présentation en juillet 2025 par la Commission européenne de sa proposition de cadre financier pluriannuel (CFP), les États-membres entrent actuellement dans une phase de pré-négociation relative au prochain budget pluriannuel qui devrait couvrir la période 2028-2034. Dans ce contexte, les rapporteurs insistent - dans le domaine du soutien public à la recherche aéronautique civile - sur deux objectifs pour les autorités françaises dans le cadre de ces négociations.
En premier lieu, le maintien d'un programme dédié au soutien à la recherche aéronautique civile est déterminant pour garantir un soutien durable du budget de l'Union européenne à la filière industrielle française et européenne des fabricants d'aéronefs et de leurs sous-traitants. Le maintien d'un instrument dédié à la recherche aéronautique civile devra être concilié avec les intentions de la Commission européenne qui a annoncé sa volonté d'une part de créé un Fonds européen pour la compétitivité regroupant l'ensemble des aides financées par l'Union européenne « de la recherche à la fabrication en passant par l'expansion et le déploiement industriel » et d'autre part d'assouplir « les rigidités inhérentes au cadre financier pluriannuel »89(*).
Le maintien d'un partenariat public-privé (JU90(*)) spécifique en matière de recherche aéronautique civile, successeur du programme « Clean Aviation », permettrait de maintenir une sanctuarisation des aides à la recherche aéronautique civile et de faire obstacle à un risque de marginalisation de la filière dans les soutiens publics financés par le budget de l'Union européenne.
Ce maintien d'un partenariat spécifique défendu par les rapporteurs rejoint les réserves formulées par la commission des affaires européennes du Sénat dans un récent avis politique relatif à la préparation du cadre financier pluriannuel (CFP) post-2027 qui formule expressément des réserves sur la proposition de « fusionner l'ensemble des programmes dédiés à la recherche et l'innovation »91(*).
En second lieu, l'affirmation du caractère stratégique de la filière aéronautique civile européenne permettrait de consolider le soutien apporté par l'Union européenne aux avionneurs et à leurs sous-traitants. En effet, comme il a été rappelé, l'Union européenne dispose grâce au groupe Airbus du premier groupe mondial de construction d'avions commerciaux. L'industrie aéronautique représente par suite l'une des filières de haute technologie les plus prospères au sein de l'Union européenne et représente en 2023 un chiffre d'affaires de 119 milliards d'euros et 387 000 emplois dans l'Union européenne92(*).
Malgré ce poids économique déterminant, la construction aéronautique ne fait pas partie, à la différence de l'industrie automobile ou de la sidérurgie, des secteurs industriels expressément mentionnés comme étant stratégiques dans la « Boussole pour la compétitivité »93(*), adoptée par la Commission européenne en janvier 2025. Or, cette feuille de route a pour objet de mettre en oeuvre les recommandations du rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne remis en septembre 2024 par Mario Draghi94(*). Les acteurs de la filière aéronautique auditionnés par les rapporteurs à l'occasion de ce contrôle leur ont fait part de leur incompréhension vis-à-vis de cette omission, qui fragilise la position du secteur en vue des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel.
Les rapporteurs, qui estiment que les fleurons industriels de l'Union européenne doivent être préservés et que la Commission européenne ne saurait se borner à désigner comme stratégiques les secteurs traversant des difficultés économiques, font remarquer que la construction aéronautique pourrait en conséquence être intégrée à la « Boussole pour la compétitivité » à l'occasion de sa prochaine mise à jour et que ce secteur devrait en tout état de cause être regardé comme stratégique dans le cadre des négociations sur le futur cadre financier pluriannuel.
Recommandation n° 6. Défendre le caractère stratégique de la construction aéronautique à l'échelle européenne en maintenant un programme sectoriel dans le futur cadre financier pluriannuel (CFP) et en intégrant ce secteur à la « Boussole pour la compétitivité » lors de sa prochaine mise à jour (Commission européenne, RP UE).
Parallèlement aux différents instruments d'aides publiques sectorielles, dont notamment les aides dans le domaine de la recherche aéronautique civile préalablement décrites, l'Union européenne a institué depuis 2019 un « Fonds pour l'innovation » (Innovation Fund) qui fait partie des instruments financiers financés par les recettes perçues par l'Union européenne lors de la vente des quotas d'émission du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE)95(*).
Les aides de l'Innovation Fund sont gérées directement par la Commission européenne qui a confié le déploiement de ces aides à l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA96(*)). Ces aides ont pour objectif de soutenir des projets industriels d'innovation au service de la transition écologique. Elles sont octroyées sous forme d'appels à projet publiés par la Commission européenne.
Les aides de l'Innovation Fund ont représenté 6 milliards d'euros entre 2021 et 2023. La Commission européenne estime le montant total de ces aides à 40 milliards d'euros pour la période 2020-2030, en se fondant sur une estimation du prix des quotas d'émission de 75 euros par tonne de dioxyde de carbone (CO2).
Les projets d'innovation dans le domaine de l'aéronautique civile peuvent être éligibles aux aides de l'Innovation Fund, comme en témoigne l'aide d'un montant total de 95 millions d'euros obtenues en octobre 2024 par la startup française Aura Aéro pour développer son activité de développement d'un aéronef régional hybride-électrique.
Pour autant, les rapporteurs relèvent également que le taux de retour par habitant de la France pour les aides de l'Innovation Fund atteint seulement 7,5 euros pour la période 2021-2023 soit près de deux fois moins que le taux de retour par habitant moyen au sein de l'Union européenne qui est de 13,4 euros97(*).
Ils notent à ce titre qu'un levier de renforcement, à budget constant, des aides à la recherche aéronautique civile à l'échelle européenne serait de segmenter les aides de l'Innovation Fund en prévoyant la mise en place d'un appel à projet sectoriel dédié au secteur de la construction aéronautique. Alors que la Commission européenne organise déjà des appels à projet thématiques dans le cadre de l'Innovation Fund, par exemple dans le secteur des batteries pour les véhicules électriques, la création d'un appel à projet dédié à l'aéronautique serait justifiée par les enjeux associés au maintien d'une industrie aéronautique européenne innovante et par la contribution du secteur du transport aérien aux recettes du SEQE-UE à travers son volet SEQE-UE « Aviation ».
Recommandation n° 7. Diversifier le financement du soutien à la recherche aéronautique civile à l'échelle européenne en créant un appel à projet sectoriel dédié à la construction aéronautique dans le cadre de l'Innovation Fund (Commission européenne, RP UE).
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 9 juillet 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de MM. Jean-François Rapin, Laurent Somon et Thomas Dossus, rapporteurs spéciaux, sur le soutien public à la recherche aéronautique civile.
M. Claude Raynal, président. - Nous terminons nos travaux par la communication de M. Thomas Dossus et de M. Laurent Somon, rapporteurs spéciaux du programme « Investir pour la France de 2030 », sur le financement public de la recherche aéronautique civile. M. Jean-François Rapin, rapporteur spécial des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », a également participé à ce contrôle budgétaire mais n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui.
M. Thomas Dossus, rapporteur spécial. - Nous vous présentons, aux côtés de Laurent Somon, les résultats du contrôle conjoint que nous avons mené avec notre collègue Jean-François Rapin sur les aides publiques à la recherche aéronautique civile.
La politique de soutien à la recherche industrielle dans ce secteur est financée à la fois par un programme budgétaire de la mission « Investir pour la France de 2030 » et par un programme budgétaire de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
Au-delà des questions d'opportunité soulevées par ce double financement, qui seront détaillées par mon collègue, il nous a semblé souhaitable de pouvoir mener un contrôle budgétaire conjoint pour être en mesure de porter une appréciation sur cette politique publique dans son ensemble.
Je commencerai par rappeler les enjeux essentiels représentés par la décarbonation du secteur aérien d'un point de vue environnemental - en insistant sur la dimension énergétique de cette décarbonation - avant de laisser mon co-rapporteur présenter les voies que nous avons identifiées pour consolider et diversifier le soutien public dans ce domaine de recherche appliquée.
En premier lieu, il faut rappeler les ordres de grandeur d'émissions de gaz à effet de serre (GES) représentées par le transport aérien. À l'échelle mondiale, il existe un consensus pour estimer que le transport aérien représente entre 2 et 3,5 % des émissions de GES.
Pour autant, ces émissions sont très inégalement réparties selon les régions du monde et les populations concernées : rappelons que seulement 10 % de la population mondiale prend l'avion chaque année et que, en 2018, 1 % de la population mondiale était responsable de 50 % des émissions de l'aviation.
En se restreignant aux émissions sur le territoire français et en adoptant les conventions de calcul de l'administration française, les émissions du secteur ont atteint 27,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2024, soit environ 7 % des émissions sur le territoire national.
Il est également à relever que ces émissions sont concentrées dans les vols internationaux qui représentent 81 % des émissions du secteur, dont 50 % pour les vols internationaux long-courriers, c'est-à-dire couvrant une distance supérieure à 3 500 kilomètres.
Ce bref rappel des ordres de grandeur en jeu ne signifie pas pour autant que le secteur aéronautique ne tient pas compte des enjeux de transition pour lutter contre le changement climatique.
Il faut rappeler ici que le secteur du transport aérien fait partie des secteurs dans lesquels, en application de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, une feuille de route de décarbonation a été établie conjointement par les acteurs de la filière et les administrations compétentes.
À l'occasion de l'établissement de cette feuille de route, publiée en mars 2023, l'État et l'administration ont établi une trajectoire de décarbonation du secteur par le progrès technologique qui prévoit de réduire les émissions du secteur de 88 % sur le périmètre des vols internationaux au départ de la France.
Cette feuille de route de décarbonation de l'aérien identifie quatre leviers technologiques qui constituent le cadre méthodologique des différents projets de recherche et technologie (R&T) soutenus par la puissance publique dans le secteur.
Les deux premiers leviers technologiques concernent l'efficacité énergétique des vols. Il s'agit, d'une part, de produire des avions plus sophistiqués qui consomment moins de carburant en étant plus légers ou en disposant d'un moteur plus efficace. D'autre part, les émissions peuvent être réduites en améliorant les instruments de gestion du trafic aérien.
Les deux autres leviers technologiques concernent la transition énergétique des aéronefs. En effet, les avions actuels utilisent le kérosène, c'est-à-dire une énergie primaire intense en émissions de GES.
La transition vers une autre source d'énergie primaire constitue donc une voie majeure de décarbonation du secteur. Le premier levier énergétique de décarbonation concerne le développement d'un avion à hydrogène, ce qui suppose néanmoins de répondre à des défis technologiques et logistiques encore très difficiles à surmonter.
Le second levier énergétique de décarbonation concerne la diffusion des carburants d'aviation durables, ou SAF (Sustainable Aviation Fuel) selon leur acronyme anglophone, qui sont des carburants compatibles avec la motorisation actuelle, mais qui présentent des émissions de GES très faibles lors de leur utilisation.
Ce dernier levier a particulièrement retenu notre attention dans la mesure où il représente, selon le périmètre retenu, entre 49 % et 58 % du chemin à parcourir dans les trajectoires de décarbonation construites par la filière.
Le règlement européen « Refuel EU aviation », adopté en 2023, constitue un dispositif central dans la stratégie de décarbonation du secteur aérien : son objectif consiste à accélérer le déploiement des SAF en fixant des objectifs d'incorporation croissants pour les fournisseurs de kérosène et les aéroports européens. À partir de 2025, le taux d'incorporation de SAF exigé est de 2 % ; cette proportion augmentera régulièrement pour atteindre 6 % en 2030, 20 % en 2035, 34 % en 2040, 42 % en 2045, puis 70 % en 2050.
L'Union européenne a également défini un sous-mandat d'incorporation spécifique pour ce que l'on appelle les « e-SAF », de 0,7 % en 2030 jusqu'à 35 % en 2050, soit la moitié des carburants d'aviation durables requis. Pour comprendre le chemin à parcourir, voici quelques ordres de grandeur. Sur la base d'une consommation énergétique de 30 mégawattheures (MWh) d'électricité par tonne d'e-SAF produite, la substitution complète du kérosène fossile utilisé aujourd'hui à l'échelle mondiale demanderait près de 10 000 térawattheures (TWh) d'électricité, soit l'équivalent de près de vingt fois le parc nucléaire français actuel. Si l'on se concentre sur la France, il faudrait, pour remplacer l'ensemble du kérosène consommé dans notre pays, 200 TWh d'électricité, soit 40 % de la production électrique nationale : l'équivalent de vingt réacteurs nucléaires serait donc exclusivement dédié au remplacement du kérosène.
Pour autant, les nombreux interlocuteurs industriels que nous avons interrogés nous ont répondu que leurs travaux se concentraient exclusivement sur la compatibilité des futurs avions avec les SAF.
Il est légitime que les avionneurs et motoristes se concentrent sur cet objectif. Pour autant, au regard de l'importance desdits SAF dans les trajectoires de décarbonation du secteur, il nous a semblé important d'insister sur la nécessité, pour l'ensemble de la filière, de s'approprier les défis liés au développement d'une filière de production de SAF en France et à la sécurisation de l'approvisionnement en SAF.
Les ordres de grandeur - qu'il s'agisse de la hausse du trafic aérien, des besoins induits par la trajectoire des mandats d'incorporation de carburants alternatifs du règlement européen ou de la faiblesse actuelle de la filière de production des SAF - fragilisent la crédibilité de la trajectoire de décarbonation de l'aviation civile. C'est pourquoi nous avons intégré au rapport les recommandations nos 3 et 4, qui prévoient de compléter la politique de recherche aéronautique civile par un exercice de planification mené au sein de la filière, pour établir une feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables.
M. Laurent Somon, rapporteur spécial. - Monsieur le président, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de notre collègue Jean-François Rapin. Nous avons souhaité mener ce contrôle et rédiger un rapport en commun, puisqu'il s'agissait de la recherche et du soutien à l'investissement en aéronautique civile.
Je reprends la présentation en insistant sur le niveau élevé de structuration de la filière industrielle de la construction aéronautique, et en livrant notre appréciation sur les aides à la recherche actuellement déployées.
En premier lieu, il faut insister sur la qualité du dialogue qui existe actuellement entre les acteurs industriels de la filière aéronautique et l'administration chargée de mener notre politique industrielle, qui est en l'espèce la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
La qualité de ce dialogue est largement liée à une instance spécifique, créée en 2008 dans le sillage du Grenelle de l'environnement : le Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac). Cette instance de dialogue État-filière, sans réel équivalent dans les autres secteurs industriels, est un lieu d'échange et de concertation qui permet de réunir régulièrement, en présence de l'administration, les principales parties prenantes du secteur, dont notamment les grands intégrateurs - Airbus, Dassault, Safran, Thalès -, mais aussi les représentants des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur, des équipementiers, des opérateurs aéroportuaires et des compagnies aériennes.
Cette capacité de réunir l'ensemble des acteurs de la filière représente un avantage stratégique majeur pour l'État dans le cadre de sa politique industrielle, puisqu'il permet d'orienter cette stratégie vers des priorités partagées par l'ensemble de la filière.
Par conséquent, si le principal guichet d'aide publique à la recherche de la filière, appelé « guichet Corac », est bien géré de manière souveraine et autonome par la DGAC, l'administration peut tenir compte, dans le processus d'attribution des aides aux projets de recherche, de l'alignement de ces projets avec les priorités de la filière.
Ce mécanisme d'alignement et de synchronisation des projets de recherche entre les différents acteurs du Corac est un levier majeur d'efficacité des aides publiques qui a été salué par tous nos interlocuteurs, qu'ils représentent des acteurs industriels ou administratifs.
Cette brève présentation m'amène aux deux remarques principales que nous avons formulées sur les aides du « guichet Corac ».
En premier lieu, sur la forme, la procédure actuelle de financement des aides du guichet Corac est une anomalie budgétaire qui n'est pas justifiée par la nature de ces aides. En effet, depuis 2021, le guichet Corac a été financé par trois programmes budgétaires différents : le programme 190, rattaché à la mission « Recherche et enseignement supérieur » ; le programme 362, rattaché à la mission « Plan de relance » ; et le programme 424, rattaché à la mission « Investir pour la France de 2030 ».
Pour autant, ces aides sont gérées comme un tout par l'administration, qui emploie les crédits indépendamment de leur programme de financement. Ce schéma de financement multicanal, qui constitue un écart avec les règles applicables au budget de l'État, méconnaît à la fois le principe de spécialité budgétaire applicable aux dépenses du budget général et le principe de non-substitution applicable aux aides du plan France 2030.
Cette anomalie budgétaire a deux conséquences néfastes qui pourraient être évitées. D'une part, elle impose à l'administration, de manière complètement artificielle, de catégoriser les aides selon leur mode de financement - soit par le programme 190, soit par le programme 424 -, ce qui représente un coût de gestion entièrement évitable. Elle impose également à l'administration de superposer deux strates administratives non coordonnées en appliquant la comitologie du plan France 2030 à une partie des aides, alors même que le secrétariat général pour l'investissement (SGPI) n'intervient pas dans leur déploiement.
D'autre part, elle prive le Parlement de son droit de regard annuel sur les crédits finançant une politique publique. Pour l'exercice 2025 par exemple, seulement 21 % des crédits du guichet Corac ont fait l'objet d'un vote annuel, le reste des crédits étant reportés depuis des années antérieures dans le cadre du plan France 2030. Il faut d'ailleurs relever que ces reports ont été effectués dans une relative opacité, puisqu'ils excèdent de 33 % le montant qui avait été annoncé au Parlement au moment du vote du budget.
En second lieu, sur le fond, nous constatons que l'État s'est révélé incapable de tenir l'objectif de 300 millions d'euros par an de soutien à la recherche aéronautique civile.
Il faut d'abord souligner que cette cible est dégradée par rapport à l'objectif initial de 450 millions d'euros établi pour suivre la trajectoire technologique de décarbonation à l'horizon 2030, puis à l'horizon 2050.
Il faut ensuite tenir compte du fait que la filière industrielle se situe dans un moment crucial qui correspond à la préparation du programme du futur avion court et moyen-courrier ultra-frugal, qui est un impératif pour maintenir sa compétitivité dans la décennie à venir.
En 2024 et en 2025, les aides du guichet Corac ont été sous-calibrées avec un montant annuel moyen de 283 millions d'euros, soit 17 millions d'euros en dessous de la cible.
Au regard de l'importance du maintien d'une filière aéronautique compétitive et de l'impératif d'accompagner les donneurs d'ordre et les sous-traitants dans leur montée en compétence industrielle et technologique, nous proposons, avec la recommandation n° 1, de réaffirmer notre attachement au respect de la cible annuelle de 300 millions d'euros de soutien public.
Nous serons donc attentifs à ce que cette cible soit atteinte en 2026 à l'occasion des débats budgétaires de l'automne, afin que les efforts nécessaires de redressement de nos comptes publics ne se fassent pas au prix de la fragilisation de nos filières d'excellence industrielle.
Permettez-moi de vous faire part de l'exposé de notre collègue Jean-François Rapin.
Au-delà des différents programmes budgétaires du budget général qui soutiennent la recherche aéronautique civile, nous nous sommes également intéressés aux dispositifs d'aide qui existent à l'échelle de l'Union européenne pour financer la recherche appliquée dans le domaine de l'aéronautique civile.
Nos travaux sur ce point nous ont conduits à formuler dans le rapport à la fois le constat qu'il existe actuellement un dispositif sectoriel efficace et parfaitement complémentaire avec le dispositif national, et un avertissement relatif à la nécessaire vigilance de la France dans ce domaine. En effet, notre pays a vu grandir les entreprises parmi les plus performantes et les plus compétitives au monde dans le domaine de la construction aéronautique : nous devons donc nous battre, au niveau de l'Union européenne, pour que ce secteur reste une priorité dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) qui entrera en vigueur après 2027.
En premier lieu, il faut rappeler le caractère original et efficace du dispositif actuel. Depuis 2021, les aides à la recherche aéronautique civile à l'échelle de l'Union européenne sont pilotées par une structure ad hoc, le partenariat public-privé « Clean Aviation », qui prend le relais des deux partenariats précédents, « Clean Sky 1 » puis « Clean Sky 2 ».
Ce mécanisme de partenariat public-privé permet de soutenir des projets de recherche et d'innovation de grande ampleur au service de la transformation du secteur aéronautique civile, au premier rang de laquelle l'atteinte de ses objectifs technologiques pour respecter la trajectoire de décarbonation.
Il permet également de combiner les sources de financements avec, pour la période 2021-2027, un montant d'aide total de 4,1 milliards d'euros, dont 59 % sont financés directement par les industriels et 41 % sont financés de manière complémentaire par le budget de l'Union européenne, au travers du programme-cadre pour la recherche et l'innovation (PCRI) « Horizon Europe ».
Comme nous l'ont expliqué les responsables administratifs et industriels, la Commission européenne et les membres du programme Clean Aviation mènent un travail de concertation préalable afin que les projets de recherche soutenus par le programme soient complémentaires des projets soutenus à l'échelle nationale. Par exemple, le fait que le guichet Corac finance peu de projets dans le domaine de la gestion du trafic aérien s'explique par l'existence d'un volet important de financement à l'échelle européenne dans ce domaine.
Il faut également souligner que le programme Clean Aviation présente la particularité d'être un dispositif d'aide européenne pour lequel la France bénéficie d'un bon taux de retour, ce qui est assez rare pour être souligné. En effet, pour la période 2021-2024, la France a réussi à obtenir des aides du programme Clean Aviation pour un montant atteignant 31 % des aides distribuées. Cela fait de la France le premier pays bénéficiaire des aides de ce programme.
Ces résultats encourageants justifient que nous restions mobilisés pour défendre le maintien d'un instrument spécifique de soutien à la recherche aéronautique civile, au-delà de 2027.
Notre attention a été attirée sur plusieurs signaux négatifs dans le cadre de ce contrôle. Tout d'abord, les acteurs de la filière estiment que l'absence de mention du secteur aéronautique dans la « boussole pour la compétitivité » présentée par la Commission européenne en janvier 2025 est de nature à fragiliser la position de ce secteur industriel.
Nous partageons la surprise qu'ont exprimée nos interlocuteurs et il est incompréhensible que le secteur aéronautique civile ne soit pas clairement affiché comme un secteur stratégique par la Commission européenne, alors même qu'il s'agit d'un secteur industriel à haute valeur ajoutée dans lequel figure le premier groupe mondial, Airbus, qui est un groupe européen.
Ensuite, les premiers éléments de communication de la Commission européenne sur le prochain CFP sont relativement flous sur la structuration du prochain budget pluriannuel, et évoquent notamment la fusion de l'ensemble des programmes d'aides économiques au sein d'un « fonds pour la compétitivité ». La commission des affaires européennes a récemment eu l'occasion d'exprimer son scepticisme sur ce projet au travers d'un avis politique relatif à la préparation du CFP, adopté le 12 juin dernier et rapporté par les sénatrices Christine Lavarde et Florence Blatrix Contat.
Pour ces différentes raisons, nous avons souhaité intégrer au rapport une recommandation expresse sur le maintien, au sein du futur CFP post-2027, d'un instrument de soutien sectoriel dédié à la recherche aéronautique civile.
Le maintien d'un tel instrument sera en effet la meilleure preuve du caractère stratégique de la filière, au service de la prospérité et de la compétitivité de l'Union européenne.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. -Ce travail synthétise bien une problématique concrète liée à la transition écologique : comment accompagner la transformation d'un secteur industriel tel que celui de l'aéronautique, à la fois en gérant les problèmes actuels et en s'assurant du respect d'une trajectoire d'avenir ?
Une telle démarche ne paraît envisageable qu'à l'échelle européenne, en tâchant d'articuler le mieux possible les différents niveaux de décision et de responsabilité. À cet effet, il convient tout d'abord de coordonner les efforts ; ensuite, de consolider l'avance historiquement prise par l'Europe - plus précisément par la France et l'Allemagne - en continuant à nous inscrire dans une trajectoire de décarbonation.
Il est profondément regrettable de constater que nous n'arrivons pas à respecter ladite trajectoire, la France créant elle-même de la complexité alors qu'il faudrait disposer d'un outil de pilotage commun.
Vous avez énuméré les difficultés, dont un manque de lisibilité. Quelles sont, selon vous, les chances de pouvoir remédier à ces dysfonctionnements ?
M. Michel Canévet. - Comment la recherche aéronautique militaire pourrait-elle concourir au développement de la recherche civile ? Des synergies sont-elles envisageables ?
M. Vincent Capo-Canellas. - Selon les chiffres de 2023, les émissions de GES du secteur ont été inférieures à celles de 2019 et il faudra accompagner cette nouvelle révolution du transport aérien, après la dernière mutation d'ampleur qu'a été sa démocratisation.
Si l'on en croit la feuille de route, il subsisterait 10 % à 12 % d'émissions résiduelles, un point sur lequel il faudrait questionner les industriels.
Je rejoins par ailleurs le rapporteur général lorsqu'il critique la superposition des normes et des échelons entre le niveau français et l'échelon européen. S'y ajoute une taxation assez lourde qui est perçue par le secteur comme n'alimentant ni la recherche ni la décarbonation.
Concernant les SAF, le Président de la République avait annoncé que 200 millions d'euros y seraient consacrés lors de sa visite au Bourget en 2023, mais seule la moitié de cette somme a été apportée dans les faits.
Enfin, je rappelle que le Sénat avait voté un amendement que j'avais présenté : ce dernier portait sur l'incorporation des SAF et prévoyait un crédit d'impôt plafonné à 50 millions d'euros. J'attire l'attention du rapporteur général quant à la nécessité de faire preuve de vigilance sur ce point, car Bercy entend retirer cette disposition alors même qu'elle n'est pas encore mise en oeuvre.
M. Claude Raynal, président. - Je remercie les rapporteurs pour leur travail et souhaite formuler plusieurs observations et propositions de correction.
Tout d'abord, le maintien d'un objectif de 300 millions d'euros est essentiel, car le Corac est l'un des rares systèmes intégrateurs dont le fonctionnement est satisfaisant : à l'inverse, les deux grandes entreprises industrielles du secteur des satellites ne parviennent pas à établir des programmes communs et à intégrer l'ensemble des prestataires.
Dans le cadre du Corac, la filière détermine les grandes orientations en accord avec l'État et les entreprises de taille moyenne bénéficient en général de fonds pour s'adapter. Ce système est vertueux et considéré comme tel par l'État comme par les entreprises, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Ce soutien public doit donc être maintenu pour une filière dont nous sommes le leader mondial - elles ne sont pas si nombreuses...
Je suis plus perplexe sur la recommandation n° 2 et la simplification des circuits de financement. À l'heure actuelle, l'État, qui ne dispose que de peu de moyens, s'appuie sur l'enveloppe de France 2030 pour compléter son financement. Si ce n'est certes pas glorieux, il faudrait aussi éviter que la simplification préconisée débouche sur une diminution du financement.
Concernant la recommandation n° 4, j'ajouterai, au sujet de la création d'un format « Corac SAF », une précision sur le fait que la création de ce format restera sans effet sur l'enveloppe d'aides publiques distribuées à travers le guichet Corac. J'estime en effet que le soutien à la filière des SAF ne devrait pas s'effectuer au détriment du reste du programme, et qu'il est essentiel de mentionner la recherche de financements complémentaires, notamment alors que parallèlement, les taxes sur l'aviation ne cessent d'augmenter et qu'une partie de leurs recettes pourraient être utilisées à cet effet.
Je m'interroge sur la recommandation n° 5 : vous évoquez une accélération du développement des start-up aéronautiques industrielles en créant un instrument thématique d'investissement en fonds propres « financé par France 2030 ».
Le plan France 2030 est un instrument de décarbonation du tissu économique et de soutien à l'innovation. Pouvez-vous me confirmer qu'il peut financer des aides en fonds propres, c'est-à-dire des prises de participation, à travers ses opérateurs comme Bpifrance ?
M. Thomas Dossus, rapporteur spécial. - Bpifrance est bien un opérateur de France 2030 qui mobilise des fonds du plan France 2030 pour procéder à des prises de participation dans le cadre de fonds thématiques voire, dans certains cas, de « fonds de fonds ».
M. Claude Raynal, président. - Dans ce cas, il me semble nécessaire de faire figurer Bpifrance afin de clarifier la recommandation. Actuellement, dans le domaine de l'aéronautique, les aides en fonds propres poursuivent un objectif de renforcement de la filière, c'est-à-dire des sous-traitants, afin de s'assurer que la supply chain sera capable de suivre la montée en charge du secteur.
M. Thomas Dossus, rapporteur spécial. - Cette filière est structurée d'une manière efficace, avec un partenariat public-privé dont le fonctionnement donne - pour une fois - satisfaction. Contribuant effectivement au budget de l'État au travers d'un certain nombre de taxes, le secteur a besoin de stabilité et d'un appui pour financer la recherche afin de réaliser des économies d'énergie.
Néanmoins, nous avons observé que le volet relatif à l'énergie n'est pas aussi bien structuré que l'ensemble de la filière, d'où la volonté, au travers de la recommandation n° 4, d'associer les énergéticiens au sein de du Corac : ces derniers ne fournissent pas, pour l'instant, les efforts nécessaires au respect de la trajectoire. Pour autant, notre objectif est bien de créer une nouvelle instance de dialogue et non de réorienter les aides à la recherche aéronautique civile. La création d'un format « Corac SAF » n'a ni pour objet ni pour effet de réduire l'enveloppe des aides à la recherche aéronautique civile octroyées par le guichet Corac.
Comme l'a indiqué le rapporteur général, il importe de s'en tenir à la trajectoire fixée, car nous risquons de nous heurter à de fortes contraintes financières si nous nous en éloignons. Il est donc temps de lancer l'alerte quant à la cadence de production des carburants alternatifs et de renforcer la structuration de la filière par le biais de cette recommandation n° 4.
Au rythme actuel, je nourris de sérieux doutes quant à la crédibilité de cette trajectoire, ces carburants alternatifs en étant encore à un stade plus théorique que pratique. Je suis d'ailleurs favorable au fait de rendre plus visible le rapport entre les recettes générées par la fiscalité sectorielle et les aides publiques en faveur de la production de SAF. Selon moi, la fiscalité écologique serait rendue plus acceptable si l'État soutenait clairement la production de SAF.
Rappelons, enfin, que la filière est concurrencée par des pays étrangers qui n'hésitent pas à subventionner très largement la recherche et leurs avionneurs, dont les États-Unis et la Chine, cette dernière montant en puissance. Il importe donc de maintenir un soutien équivalent pour cette filière d'excellence, mais qui est confrontée à de réelles inconnues dans sa trajectoire de décarbonation.
M. Laurent Somon, rapporteur spécial. - Monsieur Canévet, les grands opérateurs industriels tels qu'Airbus n'accordent plus la priorité aux projets de recherche qui ne concernent pas le futur avion court et moyen-courrier ultra-frugal - notamment ceux qui portent sur les hélicoptères - compte tenu de la nécessité de développer ce futur avion programme et de faire face à la concurrence chinoise qui se profile.
Pour autant, l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera) remplit la fonction d'opérateur dual en couvrant les domaines militaire et civil : certains aspects, tels que l'acoustique, présentent un intérêt pour les deux secteurs, et les synergies existent.
M. Capo-Canellas a évoqué la question des 10 % à 12 % d'émissions résiduelles, dont le traitement dépendra de l'avancement de la recherche sur le moteur à hydrogène. Une décarbonation totale sera envisageable si nous parvenons à développer, à terme, un moteur de ce type. Comme l'a indiqué le président d'Airbus, le projet n'est pas abandonné, mais les échéances ont été reportées.
Par ailleurs, nous avons été étonnés que les SAF ne soient pas intégrés dans le Corac, la moitié des efforts de décarbonation reposant sur les carburants. Nous ne comprenons donc pas pourquoi les énergéticiens ne participent pas à cette instance, d'où notre recommandation n°4. Il s'agit donc bien d'ouvrir le dialogue en y intégrant les énergéticiens, et non de réduire les aides à la recherche aéronautique civile en ajoutant des objectifs aux aides du guichet Corac.
Les moteurs actuels permettant déjà d'incorporer des SAF, mais la production de carburants ne suit pas, et les compagnies aériennes ne sont pas incitées à les incorporer si cela ne leur permet pas d'être compétitives. Un coup de pouce tel que celui qui a été accordé aux compagnies aériennes pour intégrer davantage de SAF est donc indispensable, les exonérations devant permettre d'engager une production industrielle, puis une baisse de prix garantissant une compétitivité suffisante.
Pour en revenir aux moyens financiers, il faut bien tâcher d'atteindre un montant de 300 millions d'euros de soutien public annuel si l'on entend atteindre les objectifs de décarbonation de l'aéronautique civile.
Je serais en revanche plus dubitatif concernant l'hypothèse d'affectation d'une partie de la fiscalité sectorielle. Comme l'a rappelé M. Capo-Canellas, l'annonce du Président de la République relative à un soutien à l'utilisation des SAF à hauteur de 200 millions d'euros n'a été tenue qu'à moitié : mieux vaudrait respecter les engagements pris, ce qui permettrait d'éviter d'avoir à rechercher des financements supplémentaires en alourdissant la fiscalité.
Je terminerai par un sentiment personnel : ne faudrait-il pas resserrer le périmètre de France 2030 sur des objectifs prioritaires, afin de se concentrer sur des secteurs d'avenir tels que l'aéronautique civile ?
M. Claude Raynal, président. - Je vous propose donc de procéder aux ajustements rédactionnels appelés par nos échanges.
La commission a adopté les recommandations des rapporteurs spéciaux ainsi ajustées et a autorisé la publication de leur communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Direction du budget
- Mme Alicia SAOUDI, sous-directrice de la 3e sous-direction du budget.
Cabinet du ministre chargé des transports
- M. Thibaud FIGUEROA, conseiller transport aérien du cabinet du ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports.
Commission européenne
- M. Filip CORNELIS, directeur chargé du transport aérien à la DG MOVE de la Commission européenne.
Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
- M. Damien CAZÉ, directeur général ;
- M. Clément MAITRE, chef du bureau de la politique de soutien à la sous-direction de la construction aéronautique de la direction du transport aérien.
Secrétariat général pour l'investissement (SGPI)
- M. Bruno BONNEL secrétaire général.
Safran
- M. Éric DALBIÈS, directeur Stratégie, R&T et Innovation du groupe, membre du comex ;
- Mme Suzanne KUCHAREKOVA, SVP Director of Public Affairs Group.
Airbus
- M. Karim MOKADDEM, directeur recherche et technologie d'Airbus commercial (avions civils) ;
- Mme Nathalie DONNARD, directrice des affaires civiles ;
- M. Olivier MASSERET, directeur des relations parlementaires et politiques.
Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac)
- M. Frédéric PARISOT, délégué général du GIFAS ;
- M. Baptiste VOILLEQUIN, directeur R&D, espace et environnement du GIFAS ;
- M. Jérôme JEAN, directeur des affaires publiques.
GIFAS - Comité Aéro-PME et Groupe des équipementiers aéronautiques, de défense et spatiaux (GEADS)
- Mme Clémentine GALLET, présidente du Comité Aéro-PME, présidente directrice générale de Coriolis Composites ;
- M. Didier KAYAT, président du comité directeur du GEADS du GIFAS ;
- M. Romain BRIGNON, VP Communications & Corporate Affairs de DAHER.
GIFAS - StartAir
- M. Jérémy CAUSSADE, CEO d'Aura Aéro ;
- M. Antoine BLIN, directeur de cabinet de M. Jérémy CAUSSADE, président de la société Aura Aéro ;
- M. Jean-Christophe LAMBERT, CEO d'Ascendance Flight Technologies, président du bureau StartAir by GIFAS.
Association « Aéro Décarbo »
- M. Clément JARROSSAY ;
- M. Olivier DEL BUCCHIA.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Déplacement à Toulouse le 23 mai 2025
- visite du site industriel du groupe Airbus ;
- visite du centre de Toulouse de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera).
Déplacement à Villaroche le 27 mai 2025
- visite du site industriel du groupe Safran.
ANNEXE :
DÉCOMPOSITION SYNTHÉTIQUE DES AIDES DE
L'OBJECTIF N° 4 « AVION BAS-CARBONE »
DU
PLAN FRANCE 2030
|
Dispositif |
Opérateur |
Aides programmées |
Aides attribuées98(*) |
|
Guichet Corac |
DGAC |
1 515 M€ |
965 M€ |
|
Produire en France des aéronefs bas-carbone |
Bpifrance |
120 M€ |
75 M€ |
|
Programme « FILAE » |
ANR |
20 M€ |
5 M€ |
|
TOTAL |
1 655 M€ |
1 045 M€ |
|
Source : commission des finances, d'après les données du SGPI
Les rapporteurs relèvent que, si le guichet Corac représente 92 % des aides programmées dans le cadre de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » du plan France 2030 à travers le schéma de financement multicanal présenté dans le corps du rapport, les aides du plan France 2030 au développement d'un avion bas-carbone ne se limitent pas au guichet Corac et reposent également sur deux dispositifs d'aide complémentaires.
Aides de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » du plan France 2030
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données du SGPI
En premier lieu, la Banque publique d'investissement (Bpifrance) a piloté le dispositif « Produire en France des aéronefs bas-carbone » doté d'une enveloppe totale de 120 millions d'euros. Un premier appel à projets (AAP) a été organisé entre avril et décembre 2022 et un second appel à projets (AAP) devrait être organisé dans le courant de l'exercice 2025. Le premier AAP « Produire en France des aéronefs bas-carbone », qui a donné lieu à l'attribution de 75 millions d'euros d'aides, a permis d'identifier 14 projets d'innovation dans le domaine de la construction aéronautique bas-carbone suffisamment matures pour envisager une industrialisation du procédé concerné à l'issue du projet.
En second lieu, l'Agence nationale de la recherche (ANR) a piloté le financement du programme « Filière aéronautique électrique » (FILAE) qui est un programme de recherche collaboratif dans le domaine de l'électrification de l'aviation qui associe 80 chercheurs et différents projets de recherche coordonnés par l'institut de recherche technologique Saint Exupéry (IRT Saint Exupéry). Alors que l'enveloppe totale de ce programme est de 20 millions d'euros, trois projets de recherche pilotés par l'IRT Saint Exupéry ont bénéficié d'aides octroyés en 2024 et 2025 pour un montant total de 5 millions d'euros.
État de déploiement des aides de
l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone »
du plan
France 2030
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données du SGPI
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Respecter la cible de 300 millions d'euros de soutien public annuel à la recherche aéronautique civile |
Gouvernement Parlement |
2e semestre 2025 |
Loi de finances initiale |
|
2 |
Simplifier le circuit de financement du soutien public à la recherche aéronautique civile en le rebudgétisant intégralement au sein du programme 190 |
Direction du budget Direction générale de l'aviation civile (DGAC) Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) |
2028 |
Loi de finances initiale |
|
3 |
Crédibiliser la trajectoire de décarbonation du transport aérien en l'articulant avec une feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) |
DGAC Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) |
2e semestre 2026 |
Publication d'une feuille de route détaillée |
|
4 |
Créer au sein du Corac un format « Corac SAF », élargi aux représentants des énergéticiens et de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), chargé de l'élaboration et du suivi de la feuille de route de sécurisation de l'approvisionnement en carburants d'aviation durables |
Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac) DGEC |
2e semestre 2025 |
Tous moyens |
|
5 |
Accélérer le développement des startups aéronautiques industrielles en créant un instrument thématique d'investissement en fonds propres financé par France 2030 |
SGPI Bpifrance |
2e semestre 2025 |
Convention prise en application du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010 |
|
6 |
Défendre le caractère stratégique de la construction aéronautique à l'échelle européenne en maintenant un programme sectoriel dans le futur cadre financier pluriannuel (CFP) et en intégrant ce secteur à la « Boussole pour la compétitivité » lors de sa prochaine mise à jour |
Commission européenne Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (RP UE) |
2e semestre 2027 |
Cadre financier pluriannuel |
|
7 |
Diversifier le financement du soutien à la recherche aéronautique civile à l'échelle européenne en créant un appel à projet sectoriel dédié à la construction aéronautique dans le cadre de l'Innovation Fund |
Commission européenne RP UE |
1er semestre 2026 |
Appel à projet sectoriel |
* 1 Données DGAC, calculateur « Tarmaac ».
* 2 Long-term aspirational goal.
* 3 Règlement (UE) 2023/2405 du 18 octobre 2023.
* 4 Sustainable Aviation Fuels.
* 5 Air Traffic Management.
* 6 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023.
* 7 Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Corsia).
* 8 Article 147 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021.
* 9 Short and Medium Range (SMR).
* 10 Ademe, base « carbone » 2020.
* 11 Aéro Décarbo et The Shift Project, mars 2021, Pouvoir voler en 2025. Quelle aviation dans un monde contraint ?, partie 5.7.2.
* 12 Le Citepa publie chaque année, à la demande du ministère chargé de l'environnement, un inventaire des émissions des émissions de gaz à effet de serre au format « Secten » (par secteur émetteur et par énergie).
* 13 La hausse des émissions unitaires observée en 2020 et 2021 est liée à un taux de remplissage plus faible des aéronefs en période de crise sanitaire.
* 14 Le « passager-kilomètre transporté » (PKT) est une unité de mesure usuelle du trafic aérien qui tient compte du nombre de passagers multiplié par la distance parcourue. L'« équivalent passager-kilomètre transporté » (PéqKT) est une mesure plus large qui permet de tenir compte du fret aérien avec la convention : 100 kg de fret = 1 passager.
* 15 Ademe, septembre 2022, Élaboration de scénarios de transition écologique du secteur aérien.
* 16 ATAG, décembre 2024, Aviation and Climate Change, Fact Sheet #2.
* 17 Les aéronefs commerciaux d'Airbus représentent une flotte de 12 000 appareils pour une flotte totale de 24 000 appareils selon les données publiées par Airbus.
* 18 OACI, Résolution A37-19, point 6.
* 19 Long-term aspirational goal.
* 20 OACI, Résolution A41-21, point 7.
* 21 Sustainable Aviation Fuels (SAF).
* 22 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
* 23 Emissions Trading System (ETS).
* 24 Le SEQE-UE s'applique également depuis 2024 au transport maritime.
* 25 En appliquant la convention : 1 quota = 1 tonne de CO2éq émis.
* 26 Décision n° 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
* 27 Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial.
* 28 L'EEE réunit les 27 États-membres de l'Union européenne ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.
* 29 Par exemple, un vol Fort-de-France à Amsterdam entre dans le champ du SEQE-UE à partir du début de l'exercice 2024.
* 30 Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial.
* 31 Art. 9 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
* 32 ECV, novembre 2019, Mise en place d'une filière de biocarburants aéronautiques durables en France.
* 33 Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable.
* 34 K. Yamaji, R. Matsuhashi, Y. Nagata, Y. Kaya, février 1993, « A study on economic measures for CO2 reduction in Japan », Energy Policy, volume 21, n° 2
* 35 Hydroporcessed Esters and Fatty Acids (HEFA).
* 36 Alcool-to-Jet (AtJ).
* 37 Aéro Décarbo, juin 2025, SAF : Quels carburants non fossiles pour voler d'ici 2050 ? (rapport intermédiaire).
* 38 Académie des sciences, avril 2024, L'hydrogène aujourd'hui et demain.
* 39 Air Traffic Management.
* 40 Revolutionary Innovation for Sustainable Engines.
* 41 Le moteur CFM56 équipe notamment les aéronefs Boeing 737.
* 42 Corac, décembre 2021, Décarbonation du transport aérien.
* 43 ATAG, septembre 2020, Waypoint 2050.
* 44 Short and Medium Range.
* 45 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 46 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023.
* 47 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 48 Article 6 du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer.
* 49 En pratique, le secrétariat des réunions du Corac est assuré par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) en lien avec la DGAC.
* 50 L'échelle de maturité technologique (Technology Readiness Level ou TRL), est un référentiel de mesure de la maturité des projets technologique allant de TRL1 (principes de base observés) à TRL9 (système réel éprouvé dans un environnement opérationnel) qui a été développé dans les années 1970 par la Nasa et qui est a été adopté par de nombreuses institutions publiques, dont la Commission européenne, pour structurer leur politique de soutien à l'innovation.
* 51 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 52 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 53 Sénat, compte-rendu intégral de la séance publique du 16 janvier 2025.
* 54 Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
* 55 C'est-à-dire d'une part de la réception et de l'instruction des demandes d'aide en amont de leur attribution ; et d'autre part de la contractualisation et du versement des aides en aval de leur attribution.
* 56 La décomposition détaillée des aides de l'objectif n° 4 « Avion bas-carbone » figure à l'annexe n° 1 du présent rapport.
* 57 Convention du 17 juin 2022 de délégation de gestion portant sur les crédits France 2030 dédiés à la recherche et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile entre le Premier ministre et le ministre chargé des transports.
* 58 Corac, décembre 2021, Décarbonation du transport aérien.
* 59 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023.
* 60 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023, p. 24.
* 61 Discours du Président de la République depuis Safran Aircraft Engines sur la souveraineté et la planification écologique de la filière aéronautique française, 16 juin 2023.
* 62 Secrétariat général du Gouvernement, Compte rendu de la concertation interministérielle dématérialisée réalisée du lundi 10 juillet 2023 au mardi 11 juillet 2023 (« bleu » RIM).
* 63 DGDDI, février 2025, Les chiffres du commerce extérieur (analyse annuelle 2024).
* 64 Les PME du comité Aéro-PME doivent être indépendantes des grands groupes de la filière.
* 65 Réponses de la DGAC au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 66 Le scénario « Accélération » de la feuille de route fait l'hypothèse d'une entrée en service en 2035 pour le SMR ultra-frugal. Cf. Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023, p. 48.
* 67 Corac, décembre 2021, Décarbonation du transport aérien.
* 68 Le capital du groupe Airbus est codétenu par la France et l'Allemagne à hauteur de 10,8 % pour chaque pays, ainsi que par l'Espagne à hauteur de 4,1 %.
* 69 National Aeronautics and Space Administration.
* 70 Federal Aviation Administration.
* 71 Convention du 17 juin 2022 de délégation de gestion portant sur les crédits France 2030 dédiés à la recherche et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile entre le Premier ministre et le ministre chargé des transports.
* 72 A. Juppé, M. Rocard, novembre 2009, Investir pour l'avenir.
* 73 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 74 Corac, décembre 2021, Décarbonation du transport aérien.
* 75 Feuille de route de décarbonation de l'aérien (article 301 - Loi « climat et résilience »), mars 2023.
* 76 Aéro Décarbo, juin 2025, SAF : quels carburants non fossiles pour voler d'ici 2050 ? (rapport intermédiaire).
* 77 Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, publiée par arrêté interministériel le 26 février 2018. La hiérarchie retenue depuis le « Grenelle de l'environnement » de 2007 est la suivante : aliments, puis biofertilisants, puis matériaux, puis molécules, puis carburants liquides, puis gaz, puis chaleur, puis électricité.
* 78 Le Havre, Saint-Nazaire, Rouen, bassin de Lacq.
* 79 Par exemple, la startup Turbotech développe des turbomoteurs innovants pour l'aviation légère et les drones.
* 80 Par exemple, la startup Aura Aero développe des aéronefs bas-carbone dont notamment le programme ERA d'avions régionaux à propulsion hybride électrique (en cours de certification).
* 81 Airbus Ventures.
* 82 Safran Corporate Ventures.
* 83 Le fonds « Métaux critiques » a été créé en avril 2023.
* 84 Le fonds « Entrepreneurs du vivant » a été créé en avril 2024.
* 85 Règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil du 18 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky.
* 86 Joint Undertaking (JU).
* 87 Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU).
* 88 Strategic Research & Innovation Agenda (SRIA).
* 89 Commission européenne (communication), 11 février 2025, COM(2025) 46 final, La voie vers le prochain cadre financier pluriannuel.
* 90 Joint Undertaking (JU).
* 91 Sénat, commission des affaires européenne, 12 juin 2025, Avis politique relatif à la préparation du cadre financier pluriannuel (CFP) post-2027, au rapport de Mme Florence Blatrix Contat et Christine Lavarde, point 57.
* 92 Données de l'ASD (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe) pour le secteur de l'aéronautique civile.
* 93 Commission européenne (communication), 29 janvier 2025, Une boussole pour la compétitivité de l'UE, COM(2025) 30 final.
* 94 M. Draghi, septembre 2024, The future of European competitivness.
* 95 Les recettes du SEQE-UE financent également notamment le Fonds de modernisation géré par la Banque européenne d'investissement (BEI).
* 96 European Climate, Infrastructure and Environment Agency (CINEA).
* 97 Projet de loi de finances pour 2025, annexe générale (jaune), Relations financières avec l'Union européenne.
* 98 Au 31 mars 2025.