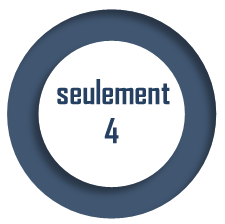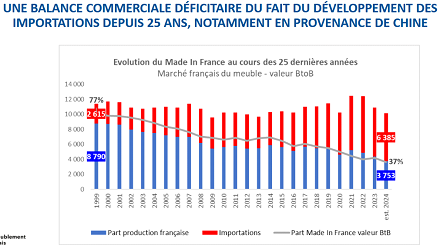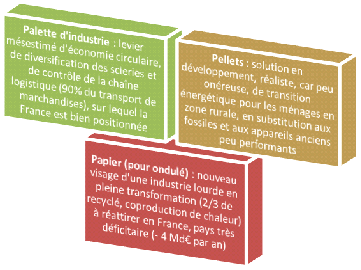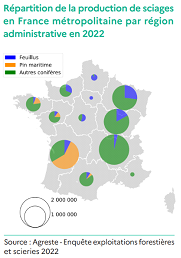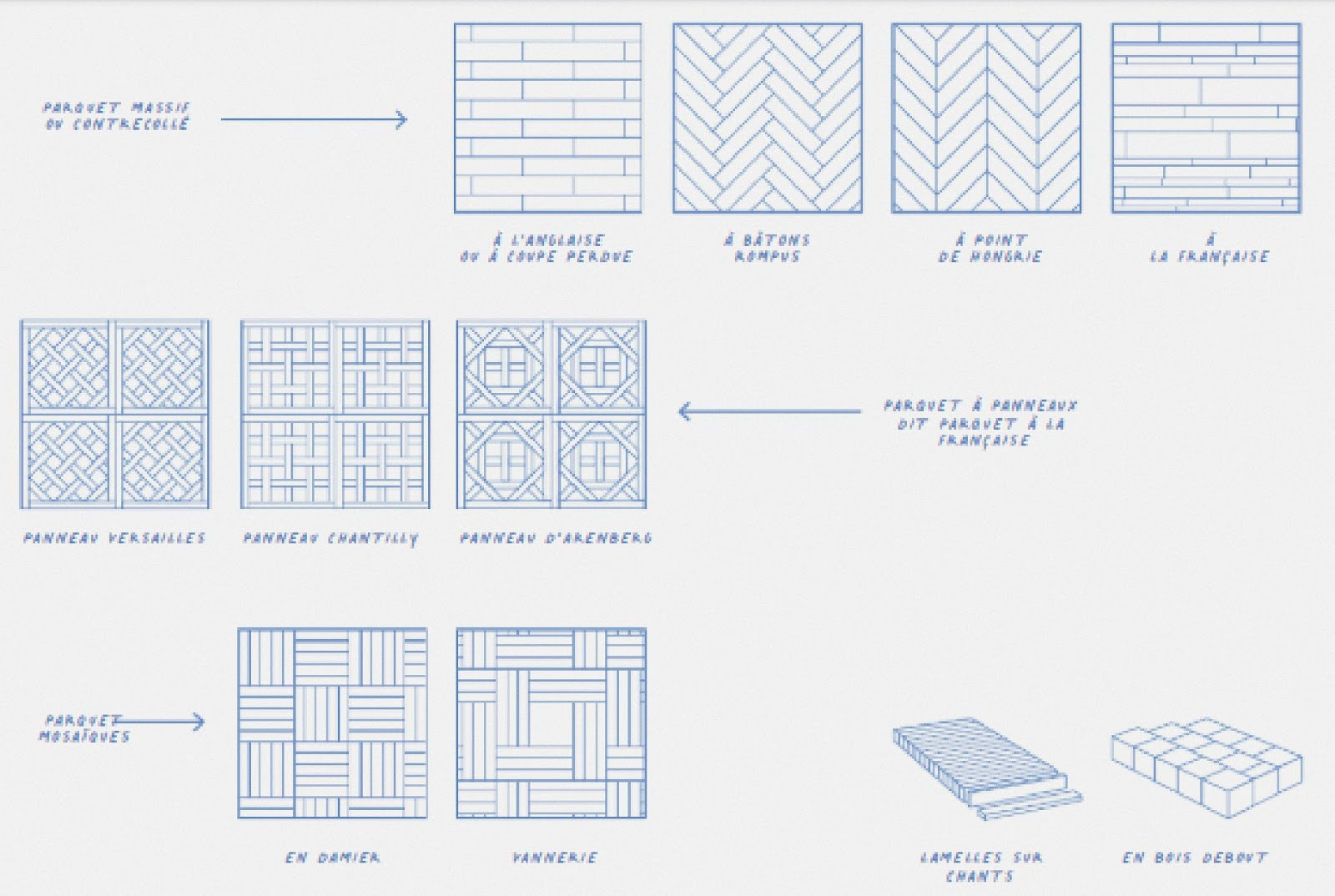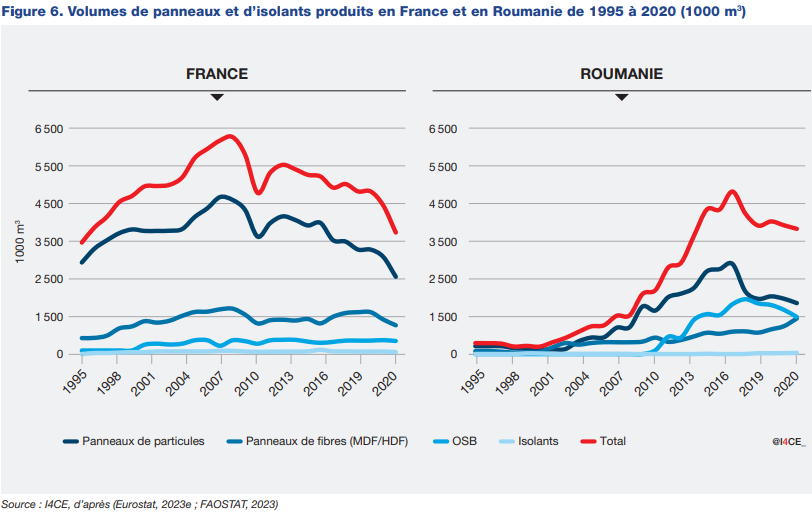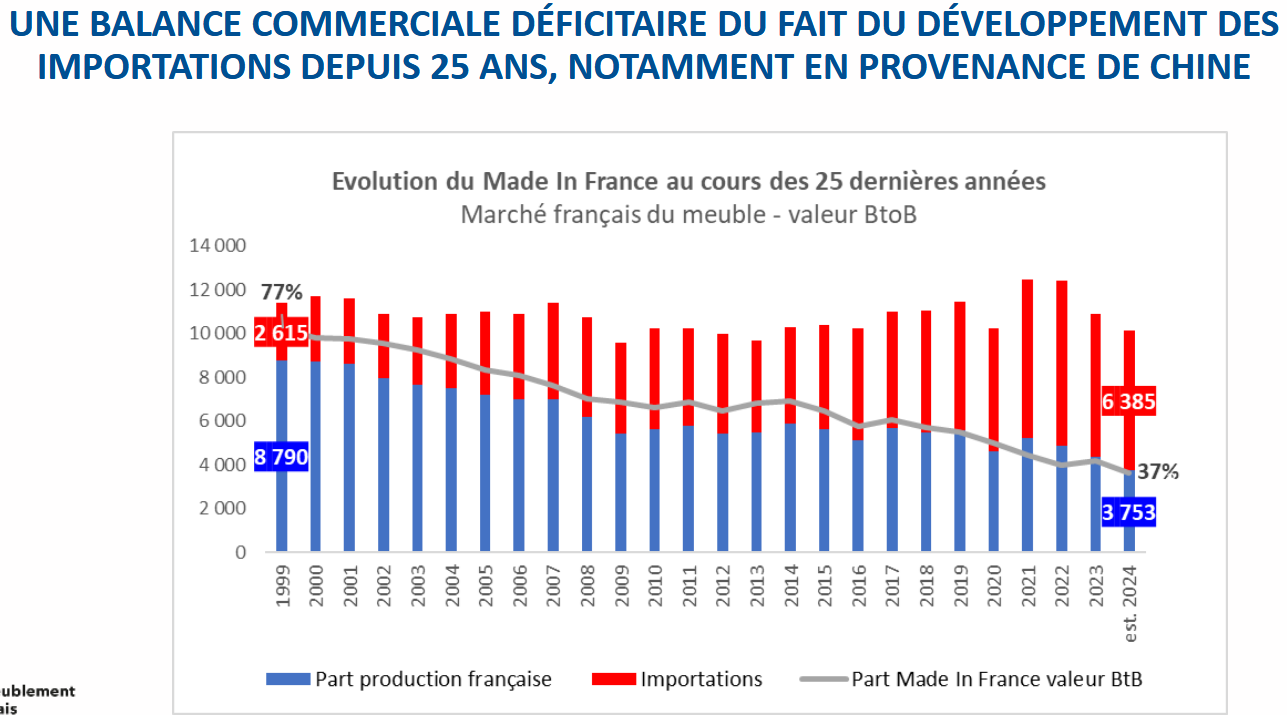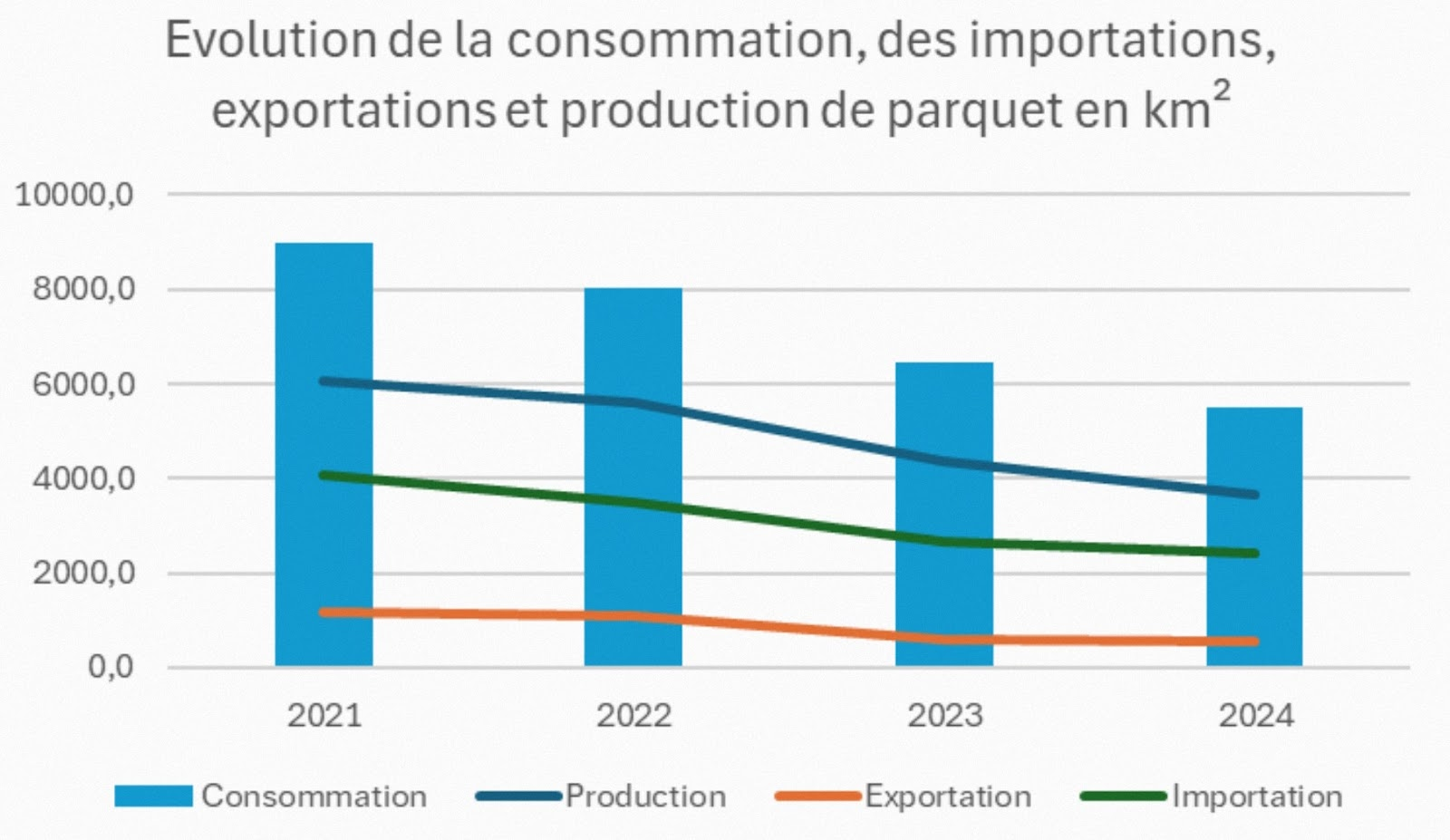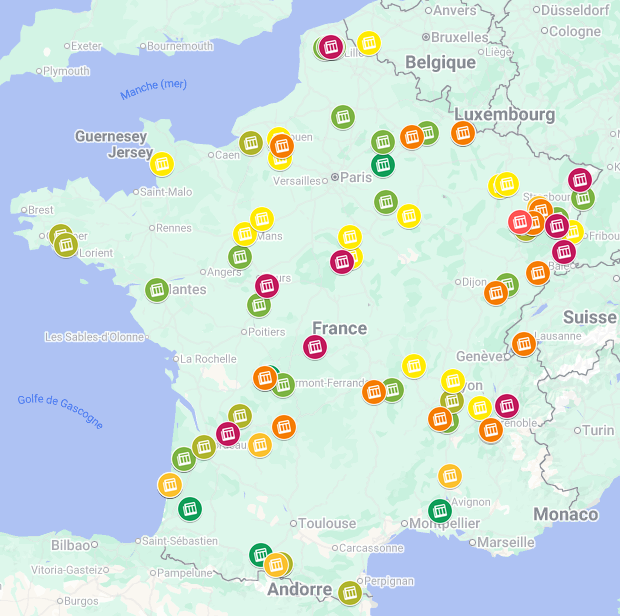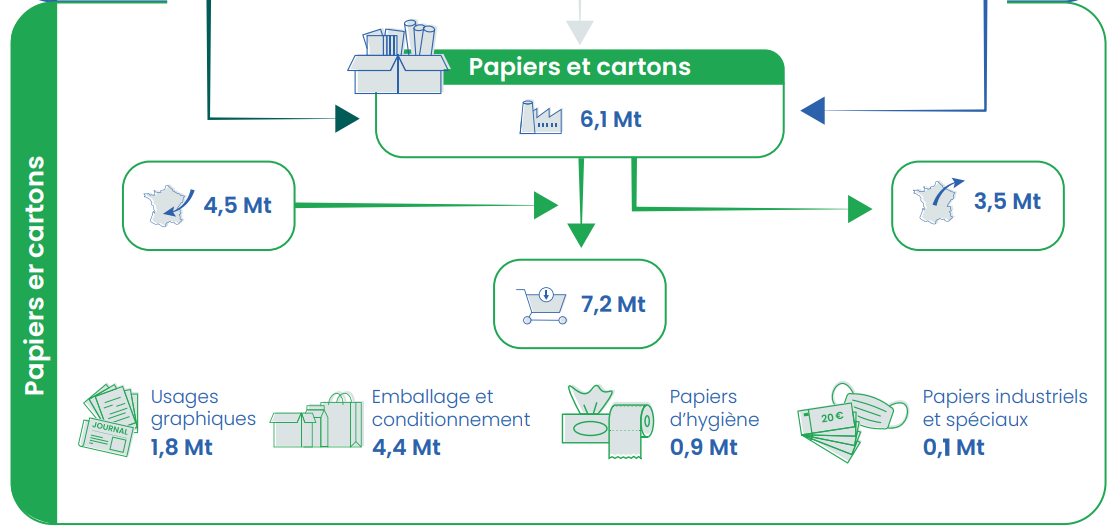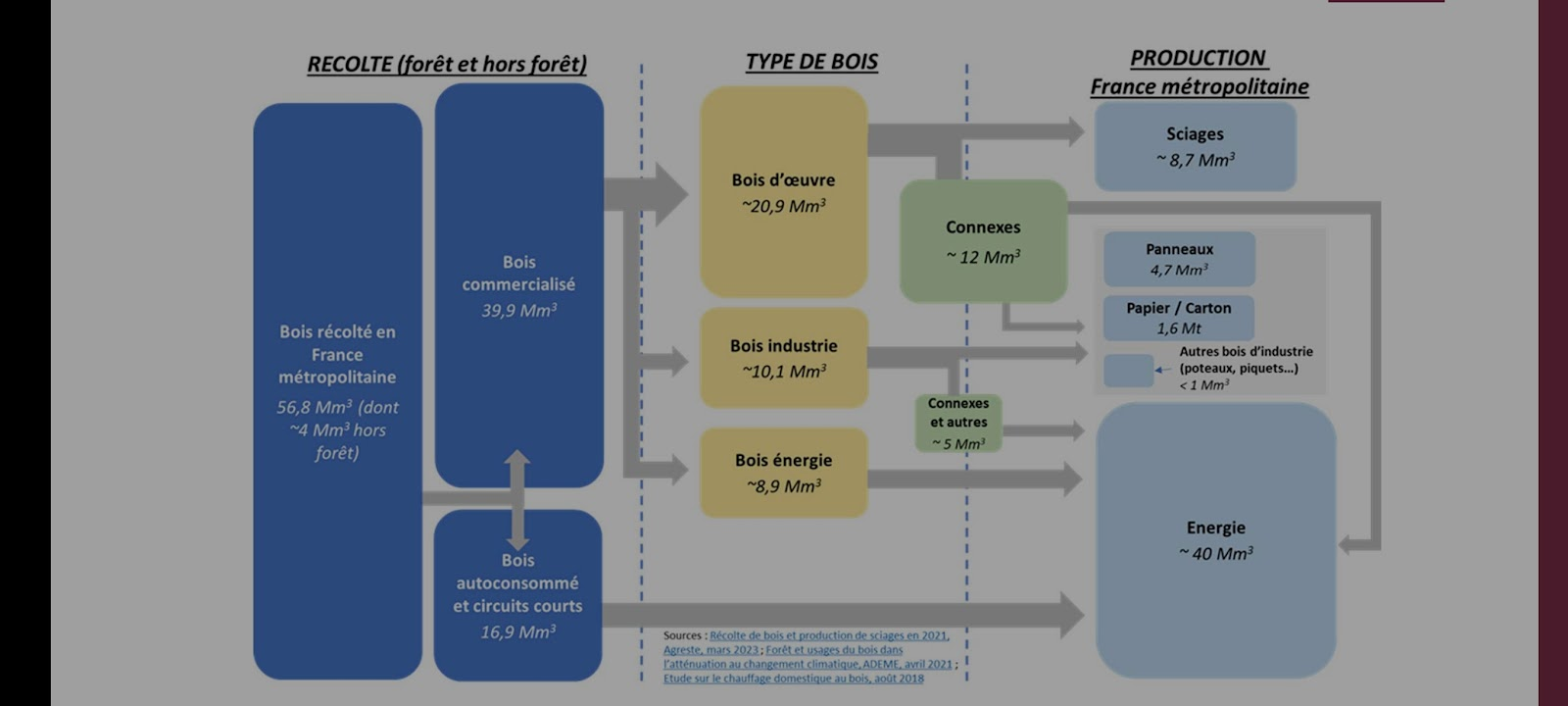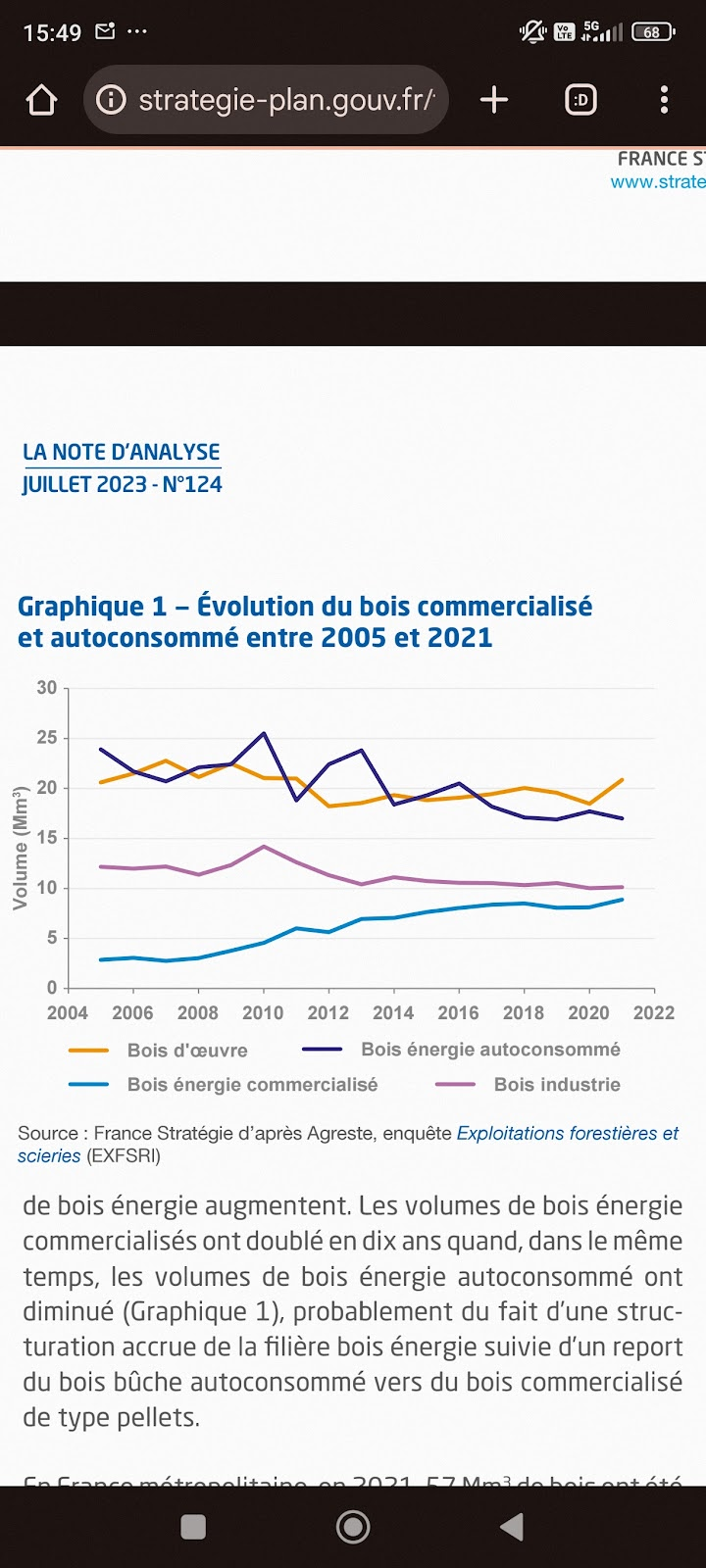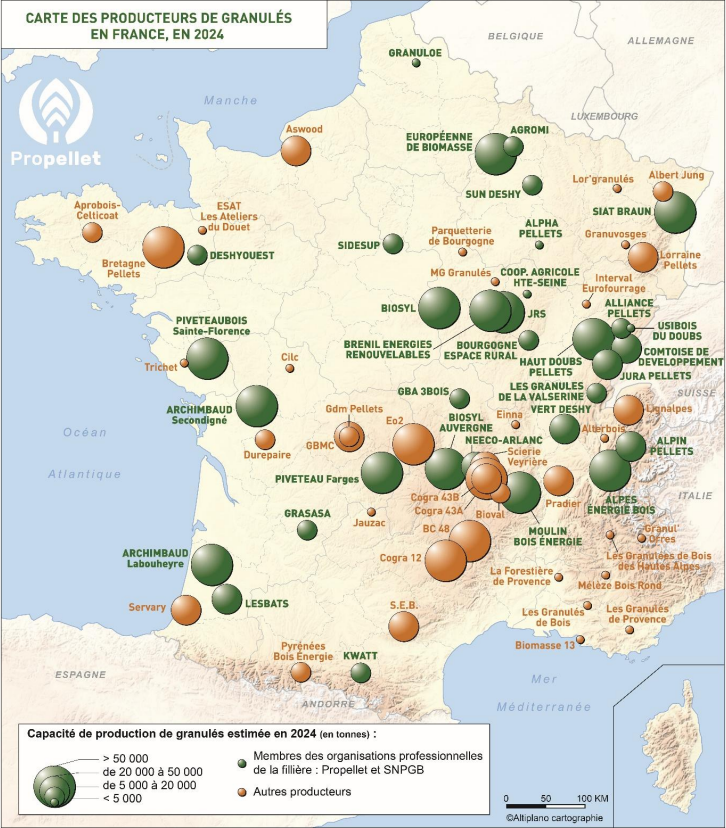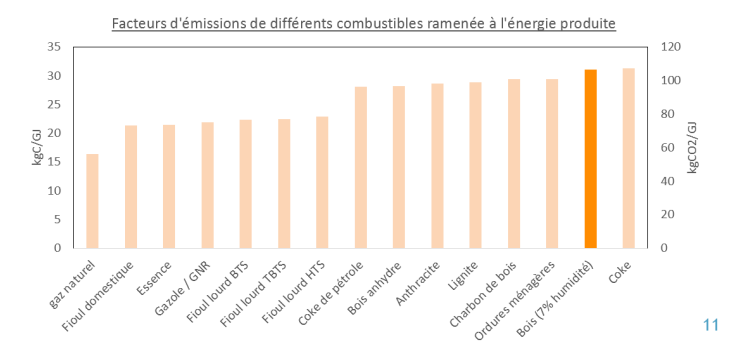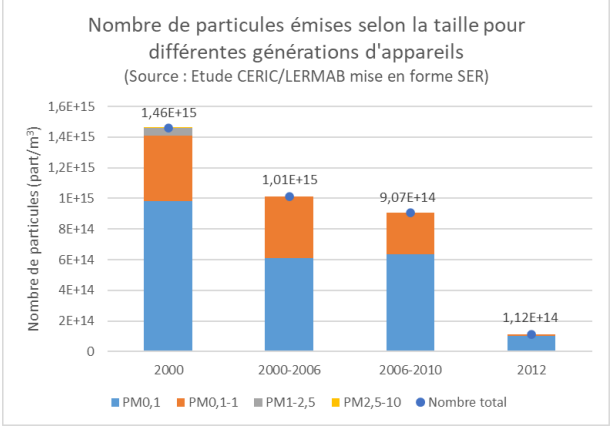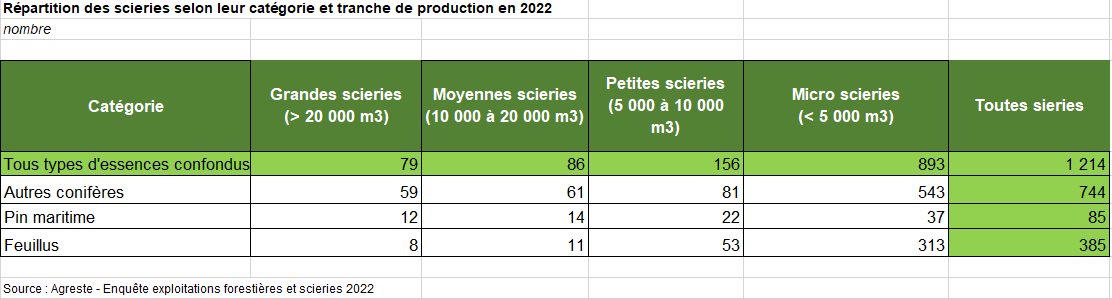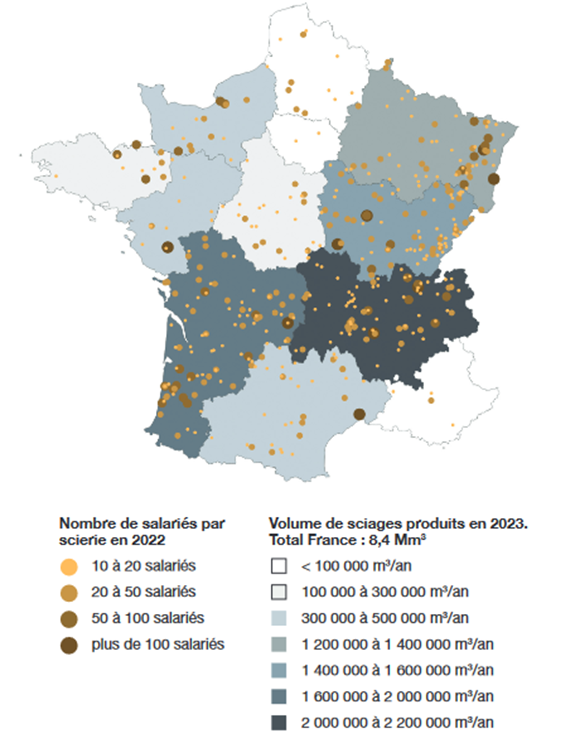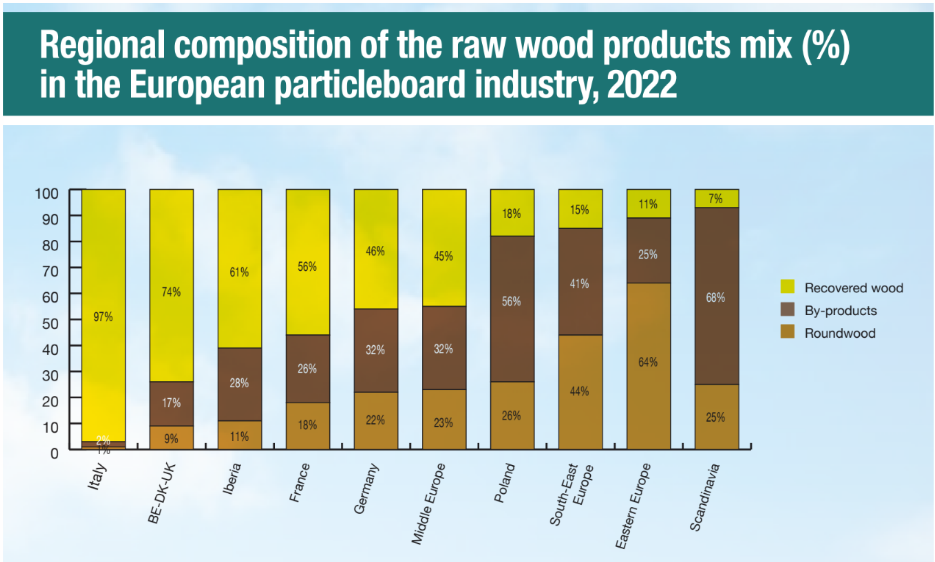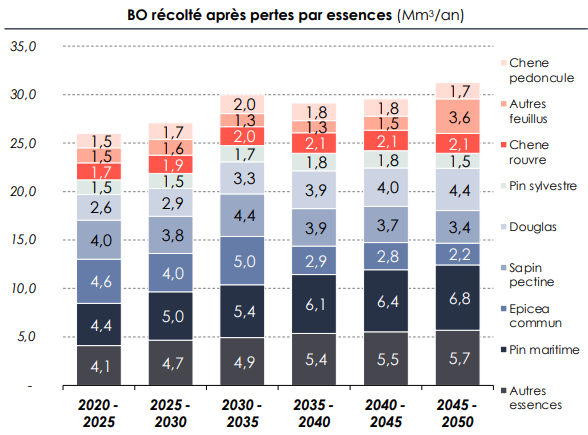- L'ESSENTIEL
- I. CINQ FAMILLES DE PRODUITS BOIS, UN
MATÉRIAU À VALORISER POUR SON POTENTIEL UNIQUE DE
COMPÉTITIVITÉ PROPRE
- A. BOIS CONSTRUCTION : UNE HAUTE VALEUR
AJOUTÉE QUI DÉCARBONE DANS LA DURÉE ET QUI CHARPENTE TOUTE
LA FILIÈRE
- B. PARQUET, ÉTAGÈRES : SAUVER
LES MEUBLES FRANÇAIS FACE À LA « FAST
DÉCO » CHINOISE
- C. PALETTE, CARTON, PELLETS : TROIS USAGES DU
BOIS ET AUTANT DE LEVIERS DE RELOCALISATION ET DE SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE
- A. BOIS CONSTRUCTION : UNE HAUTE VALEUR
AJOUTÉE QUI DÉCARBONE DANS LA DURÉE ET QUI CHARPENTE TOUTE
LA FILIÈRE
- II. DES DÉFIS TRANSVERSAUX À RELEVER
POUR LIBÉRER L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS EN FRANCE
- A. UN CADRE PEU INCITATIF EN FRANCE POUR LA
PRODUCTION INDUSTRIELLE EN GÉNÉRAL ET CELLE DU BOIS EN
PARTICULIER
- B. UNE PROLIFÉRATION NORMATIVE PARALYSANTE
AVANT, PENDANT ET APRÈS L'ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION
- C. INVESTIR DANS LES SCIERIES POUR PASSER À
L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE, MAIS SANS PERDRE DE VUE L'IMPÉRATIF DE
FLEXIBILITÉ
- A. UN CADRE PEU INCITATIF EN FRANCE POUR LA
PRODUCTION INDUSTRIELLE EN GÉNÉRAL ET CELLE DU BOIS EN
PARTICULIER
- III. LA « RUÉE VERS LE
BOIS » : UN ESSOR D'USAGES PARFOIS CONCURRENTS, POUR UNE
RESSOURCE BEL ET BIEN FINIE
- A. UNE « CASCADE DES USAGES »
SENS DESSUS DESSOUS, ALORS QU'ELLE RÉPOND À UNE LOGIQUE
ÉCONOMIQUE DE COMPLÉMENTARITÉ
- B. UN BESOIN DE PLANIFICATION ET DE
RÉGULATION POUR ASSURER LE « BOUCLAGE BIOMASSE »
À L'ÉCHELLE TERRITORIALE ET NATIONALE
- C. UNE MOBILISATION DU BOIS EN FORÊT À
AJUSTER AU PROFIT D'OBJECTIFS PLUS PERTINENTS DE TRANSFORMATION ET DE PUITS DE
CARBONE
- A. UNE « CASCADE DES USAGES »
SENS DESSUS DESSOUS, ALORS QU'ELLE RÉPOND À UNE LOGIQUE
ÉCONOMIQUE DE COMPLÉMENTARITÉ
- IV. LA FORÊT FRANÇAISE N'EST PAS QU'UN
« GRENIER À BOIS » ET SA RESSOURCE N'EST PAS
ILLIMITÉE
- A. UN POTENTIEL DU BOIS DES FORÊTS
FRANÇAISES DÉPENDANT DES QUALITÉS REQUISES PAR L'INDUSTRIE
ET DES MODES DE COMMERCIALISATION
- B. UNE DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE EN BOIS
TRIBUTAIRE DE LA MISE EN GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE DE NOS
FORÊTS
- C. NE PAS TIRER DE « PLANTS »
SUR LA COMÈTE : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE IMPOSE D'ADAPTER L'AVAL
À L'AMONT ET PAS L'INVERSE
- A. UN POTENTIEL DU BOIS DES FORÊTS
FRANÇAISES DÉPENDANT DES QUALITÉS REQUISES PAR L'INDUSTRIE
ET DES MODES DE COMMERCIALISATION
- I. CINQ FAMILLES DE PRODUITS BOIS, UN
MATÉRIAU À VALORISER POUR SON POTENTIEL UNIQUE DE
COMPÉTITIVITÉ PROPRE
- RAPPORT
- INTRODUCTION
- I. CINQ FAMILLES DE PRODUITS BOIS, UN
MATÉRIAU À VALORISER POUR SON POTENTIEL UNIQUE DE
COMPÉTITIVITÉ PROPRE
- A. BOIS CONSTRUCTION : UNE HAUTE VALEUR
AJOUTÉE QUI DÉCARBONE DANS LA DURÉE ET QUI CHARPENTE TOUTE
LA FILIÈRE
- 1. Un horizon consensuel en faveur de la
transformation du bois d'oeuvre à préserver tant du
côté de l'offre que de la demande...
- 2. ... mais une dynamique qui tarde à se
concrétiser...
- 3. Une réflexion sur l'extension de cette
dynamique, au-delà du neuf, à la rénovation, pour stimuler
la demande d'isolants biosourcés
- 1. Un horizon consensuel en faveur de la
transformation du bois d'oeuvre à préserver tant du
côté de l'offre que de la demande...
- B. PARQUET, ÉTAGÈRES : SAUVER
LES MEUBLES FRANÇAIS FACE À LA « FAST
DÉCO » CHINOISE
- 1. De façon structurelle, des freins
à la valorisation de la ressource « noble »
française
- 2. Des difficultés d'approvisionnement en
panneaux pour le parquet contrecollé et l'ameublement
- 3. Redescendre le long de la pente de la valeur
ajoutée pour éviter de toucher le fond
- 4. Un phénomène plus récent
de dumping chinois, destructeur pour une filière
désarmée
- 1. De façon structurelle, des freins
à la valorisation de la ressource « noble »
française
- C. PALETTE, CARTON, PELLETS : TROIS USAGES DU
BOIS ET AUTANT DE LEVIERS DE RELOCALISATION ET DE SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE
- 1. Palette : un levier
mésestimé de contrôle de la chaîne logistique et de
souveraineté industrielle pour la France
- a) De bonnes performances commerciales de la
France sur cet usage du bois coeur de gamme
- (1) Un secteur très concurrentiel dans
laquelle la France maintient 75 % d'autoapprovisionnement
- (2) Un segment qui a su trouver sa place dans la
filière bois malgré un manque de considération et des
tensions sur l'approvisionnement
- b) Trois atouts dans la fabrication d'emballages
et notamment de palettes, dont il convient de tirer pleinement parti
- (1) Un maillon essentiel de la chaîne
logistique et donc un levier de souveraineté
- (2) Un exemple abouti d'intégration
verticale et de diversification de l'activité des scieries
- (3) Une filière pionnière du
réemploi, du reconditionnement et du recyclage
- a) De bonnes performances commerciales de la
France sur cet usage du bois coeur de gamme
- 2. Papier, carton : relocaliser la papeterie,
premier poste de déficit commercial en produits bois, qui a
entamé une transformation vertueuse
- a) Une industrie internationalisée, qui
procède à des arbitrages sur les choix de localisation en
prêtant attention aux coûts de production, notamment de
l'énergie
- (1) Une industrie à capitaux
étrangers, dans laquelle la France est très
déficitaire
- (2) Une attention portée à
l'attractivité du site de production France en général et
à l'énergie en particulier
- b) Une industrie lourde qui a connu plusieurs
transformations vertueuses de ses procédés et est devenue
multiproduit
- (1) Une industrie lourde devenue exemplaire en
matière de coproduction d'énergie
- (2) Des usages tirés par le carton
d'emballage, au risque bientôt de surcapacités ?
- (3) Une filière qui s'approvisionne
désormais aux deux tiers en papier recyclé, pour un tiers
seulement de bois
- a) Une industrie internationalisée, qui
procède à des arbitrages sur les choix de localisation en
prêtant attention aux coûts de production, notamment de
l'énergie
- 3. Pellets : une solution réaliste,
car peu onéreuse, de transition énergétique pour les
ménages
- 1. Palette : un levier
mésestimé de contrôle de la chaîne logistique et de
souveraineté industrielle pour la France
- A. BOIS CONSTRUCTION : UNE HAUTE VALEUR
AJOUTÉE QUI DÉCARBONE DANS LA DURÉE ET QUI CHARPENTE TOUTE
LA FILIÈRE
- II. DES DÉFIS TRANSVERSAUX À RELEVER
POUR LIBÉRER L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS EN FRANCE
- A. UN CADRE PEU INCITATIF EN FRANCE POUR LA
PRODUCTION INDUSTRIELLE EN GÉNÉRAL ET CELLE DU BOIS EN
PARTICULIER
- B. UNE PROLIFÉRATION NORMATIVE PARALYSANTE
AVANT, PENDANT ET APRÈS L'ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION
- C. INVESTIR DANS LES SCIERIES POUR PASSER À
L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE, MAIS SANS PERDRE DE VUE L'IMPÉRATIF DE
FLEXIBILITÉ
- 1. Un besoin d'investissement pour remettre
à niveau notre outil de transformation vis-à-vis des scieries
allemandes
- a) Le maintien d'appels à projets
présentant un fort effet de levier pour la dépense privée
et un faible coût d'abattement de la tonne de CO2
évitée
- b) À défaut, la mise en place d'une
provision pour investissements, pompe aspirante pour le développement de
la transformation, très peu coûteuse pour la puissance
publique
- a) Le maintien d'appels à projets
présentant un fort effet de levier pour la dépense privée
et un faible coût d'abattement de la tonne de CO2
évitée
- 2. La scierie du futur reposera sur une
complémentarité entre de petites « scieries de
service » et une grande scierie industrielle par massif
- 1. Un besoin d'investissement pour remettre
à niveau notre outil de transformation vis-à-vis des scieries
allemandes
- A. UN CADRE PEU INCITATIF EN FRANCE POUR LA
PRODUCTION INDUSTRIELLE EN GÉNÉRAL ET CELLE DU BOIS EN
PARTICULIER
- III. LA « RUÉE VERS LE
BOIS » : UN ESSOR D'USAGES PARFOIS CONCURRENTS, POUR UNE
RESSOURCE BEL ET BIEN FINIE
- A. UNE « CASCADE DES
USAGES » SENS DESSUS DESSOUS, ALORS QU'ELLE RÉPOND À
UNE LOGIQUE ÉCONOMIQUE DE COMPLÉMENTARITÉ
- B. UN BESOIN DE PLANIFICATION ET DE
RÉGULATION POUR ASSURER LE « BOUCLAGE BIOMASSE »
À L'ÉCHELLE TERRITORIALE ET NATIONALE
- 1. Une filière victime de son succès
et un bouclage biomasse menacé par des « appels
d'air » : Gardanne, carburants d'aviation durable (SAF),
50 grands sites industriels
- 2. Conforter le rôle de régulation
des cellules biomasse régionales, en lien avec les professionnels,
à travers le levier des contrats d'approvisionnement
- 1. Une filière victime de son succès
et un bouclage biomasse menacé par des « appels
d'air » : Gardanne, carburants d'aviation durable (SAF),
50 grands sites industriels
- C. UNE MOBILISATION DU BOIS EN FORÊT
À AJUSTER AU PROFIT D'OBJECTIFS PLUS PERTINENTS DE TRANSFORMATION ET DE
PUITS DE CARBONE
- A. UNE « CASCADE DES
USAGES » SENS DESSUS DESSOUS, ALORS QU'ELLE RÉPOND À
UNE LOGIQUE ÉCONOMIQUE DE COMPLÉMENTARITÉ
- IV. LA FORÊT FRANÇAISE N'EST PAS
QU'UN « GRENIER À BOIS » ET SA RESSOURCE N'EST PAS
ILLIMITÉE
- A. UN POTENTIEL DU BOIS DES FORÊTS
FRANÇAISES DÉPENDANT DES QUALITÉS REQUISES PAR L'INDUSTRIE
ET DES MODES DE COMMERCIALISATION
- B. UNE DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE EN
BOIS TRIBUTAIRE DE LA MISE EN GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE DE NOS
FORÊTS
- C. NE PAS TIRER DE
« PLANTS » SUR LA COMÈTE : LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE IMPOSE D'ADAPTER L'AVAL À L'AMONT ET PAS L'INVERSE
- A. UN POTENTIEL DU BOIS DES FORÊTS
FRANÇAISES DÉPENDANT DES QUALITÉS REQUISES PAR L'INDUSTRIE
ET DES MODES DE COMMERCIALISATION
- INTRODUCTION
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
N° 847
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires
économiques (1) sur la
compétitivité
de la
filière bois
française,
Par Mme Anne-Catherine LOISIER et M. Serge MÉRILLOU,
Sénatrice et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
L'ESSENTIEL
Comment expliquer qu'un dixième du déficit commercial de la France (8,5 milliards d'euros) soit imputable aux produits bois, alors qu'un tiers de la superficie hexagonale est recouverte de forêts (17,5 millions d'hectares) ? « Malédiction des matières premières », « modèle économique de pays en développement » (Sénat, 2015) ou simple problème de diagnostic et de méthode ?
En deux mois, la mission d'information a entendu plus de 60 acteurs et s'est déplacée dans 5 sites industriels en Alsace et en Allemagne, pour comprendre les leviers à activer et obstacles à lever pour renforcer la compétitivité de l'aval de la filière.
La commission des affaires économiques a adopté 24 recommandations ainsi que le présent rapport, organisé en 4 temps, de l'aval (produit) à l'amont (forêt) :
1. atouts et diversité du matériau bois à travers 5 produits emblématiques ;
2. moyens de libérer l'industrie du bois, face à des contraintes transversales ;
3. besoin de régulation pour garantir cascade des usages et bouclage biomasse ;
4. leviers pour la mobilisation du bois en forêt et besoin d'adapter l'aval à l'amont.
|
part des produits bois dans le déficit commercial de la France (surtout papier et meuble) |
prix d'un meuble à chaussures repéré sur Temu, un dumping destructeur de la « fast déco » chinoise |
nombre d'États tiers classés à « risque élevé » de déforestation au regard du règlement européen sur la déforestation |
effet de levier sur la dépense privée de 1 € de dépense publique via l'appel à projets systèmes constructifs bois (France 2030) |
la part des appels à projets bois depuis 2020 qui auraient financé un usage énergétique par opposition à un usage matière |
I. CINQ FAMILLES DE PRODUITS BOIS, UN MATÉRIAU À VALORISER POUR SON POTENTIEL UNIQUE DE COMPÉTITIVITÉ PROPRE
A. BOIS CONSTRUCTION : UNE HAUTE VALEUR AJOUTÉE QUI DÉCARBONE DANS LA DURÉE ET QUI CHARPENTE TOUTE LA FILIÈRE
Lors des Assises de la forêt et du bois organisées en 2021-22, les pouvoirs publics ont réaffiché leur priorité pour le triptyque scier-sécher-transformer, indispensable pour rattraper quinze ans de retard par rapport à l'Allemagne, du côté de l'offre, sur le créneau des bois d'ingénierie (bois abouté, lamellé-collé, lamellé-croisé, façade et mur ossature bois...), sur lequel la France reste déficitaire. Du côté de la demande, la RE2020 impose une part de matériaux biosourcés dans la construction neuve selon plusieurs paliers, dont un en 2028. Les contraintes budgétaires, réelles, et l'aspiration louable à la simplification ne doivent pas être le prétexte à l'abandon de ce double horizon mobilisateur pour la filière.
Pour les normes incendie, des solutions d'effet équivalent avec une obligation de résultat plutôt que de moyens devraient pouvoir être présentées même après le dépôt du permis (reco n° 1). La dynamique pourrait être étendue progressivement à la rénovation dans l'ancien - 80 % de la ville de 2050 étant déjà construite -, pour stimuler la demande en isolants biosourcés par des bonus de collectivités à MaPrimeRénov' en fonction des ressources disponibles localement (reco n° 2).
B. PARQUET, ÉTAGÈRES : SAUVER LES MEUBLES FRANÇAIS FACE À LA « FAST DÉCO » CHINOISE
Source : L'Ameublement français
Le secteur français de l'ameublement constitue le deuxième poste de déficit commercial de la filière avec un solde négatif de 3 Md€ en 2024. Depuis 2000, la part du « fait en France » s'est écroulée sur le marché domestique, passant de 77 à 37 %, tant en raison d'une baisse de la production nationale que de la hausse des importations - l'Italie, par exemple, fait bien mieux. Récemment, le dumping de la fast déco des places de marché chinoises s'est accentué, à l'instar de ce que subit déjà le parquet.
Communication sur les non-conformités de ces produits pour créer un bruit de fond négatif, contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), frais de 2 € sur les colis inférieurs à 150 €, transparence sur l'écocontribution (PJL simplification) sont autant de mesures à prendre d'urgence (reco n° 3). À moyen et long terme, il faut aider la filière meuble à se coordonner au niveau européen pour déposer une plainte antidumping et réviser le règlement pour élargir la notion de « produit concerné » et accélérer les mesures provisoires de protection (reco n° 4).
C. PALETTE, CARTON, PELLETS : TROIS USAGES DU BOIS ET AUTANT DE LEVIERS DE RELOCALISATION ET DE SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE
D'autres produits, correspondant à la qualité bois d'industrie-bois énergie (BI-BE), illustrent la diversité des usages recouverts par le bois ainsi que son potentiel de relocalisation : concurrence européenne à soutenir et place à tenir sur la palette ; attractivité du site de production à renforcer pour la papeterie par un coût de l'énergie post-accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) avantageux (reco n° 5) ; retour du chauffage domestique au pellet au taux normal de MaPrimeRénov' lorsqu'il remplace un foyer non performant (qualité de l'air) dans les zones rurales sans raccordement au gaz (reco n° 6).
II. DES DÉFIS TRANSVERSAUX À RELEVER POUR LIBÉRER L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS EN FRANCE
A. UN CADRE PEU INCITATIF EN FRANCE POUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN GÉNÉRAL ET CELLE DU BOIS EN PARTICULIER
Pour que le cadre socio-fiscal français incite davantage à la production industrielle (reco n° 7), les impôts sur le travail et la production pourraient basculer vers une taxation du carbone, y compris aux frontières (MACF), un avantage relatif pour le bois, peu carboné ; les exonérations de cotisations sociales pourraient être recentrées ( rapport Bozio-Wasmer) sur les emplois intermédiaires et donc industriels (1,2 à 1,9 Smic) alors que la filière subit une pénurie de main-d'oeuvre dans les métiers du bois mais aussi de la maintenance. Face à des compétences de plus en plus spécifiques, recentrer les formations sur la connaissance du matériau bois serait gage d'attractivité et faciliterait, en sus, le transfert de compétences d'un maillon l'autre (reco n° 8).
B. UNE PROLIFÉRATION NORMATIVE PARALYSANTE AVANT, PENDANT ET APRÈS L'ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION
Système intégré de ligniculture de l'eucalyptus au Brésil
La mission souhaite corriger le tir sur deux obligations nouvelles portant sur l'origine (règlement sur la déforestation et la dégradation des forêts, RDUE) et la fin de vie du bois (responsabilité élargie du producteur produits et matériaux de construction du bâtiment, REP PMCB) qui ratent malheureusement leur cible. Mesure miroir, la première crée des obligations de diligence pour 100 % des producteurs européens, quand seuls les exportateurs des États tiers, comme le Brésil, y sont tenus. Quatre aménagements dans la mise en oeuvre du RDUE sont proposés (reco n° 9), dont le calcul de l'origine par « bilan massique », plus simple, et le classement d'un plus grand nombre d'États tiers en « risque élevé », à défaut de pouvoir s'auto-classer en « risque nul » au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La REP PMCB, pour ne pas créer une distorsion de concurrence défavorable au bois, devrait inclure l'abattement sur les matériaux performants en matière de valorisation des déchets et sur les produits biosourcés, voté au Sénat, pour réduire l'écocontribution sur les déchets bois (reco n° 10).
Autres sujets brûlants pour les scieries : les normes de sécurité appliquées parfois sans discernement par les Dreal et, surtout, des difficultés croissantes d'assurabilité en l'absence d'un système coûteux de sprinklage, les assureurs désertant le secteur. La mission propose des rendez-vous territoriaux de la simplification avec les élus locaux dans le premier cas (reco n° 11), captives d'assurance (grands groupes) et recherche de solutions à effet équivalent (PME) dans le second (reco n° 12).
C. INVESTIR DANS LES SCIERIES POUR PASSER À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE, MAIS SANS PERDRE DE VUE L'IMPÉRATIF DE FLEXIBILITÉ
Sciages par région en m3 (2022)
Source : Agreste
Entre mi-2021 et mi-2024, 500 M€ de fonds publics via trois appels à projets (systèmes constructifs bois, SCB ; biomasse chaleur industrie bois, BCIB ; industrialisation performante des produits bois, IPPB) ont provoqué plus de 2 Md€ d'investissements, témoignant du fort besoin de modernisation de la première transformation. Compte tenu des 3 000 emplois induits en trois ans et du faible coût d'abattement du CO2 associé, il serait avisé de les maintenir (reco n° 13).
En complément, ou à défaut si l'option n'était pas retenue, une provision pour investissements sur le modèle de l'Allemagne, avec des conditions simples de décarbonation et d'intégration verticale, serait, pour des recettes fiscales simplement décalées, une véritable pompe à investissements permettant de toucher l'ensemble des scieries, dont près de 900 « micro-scieries » (reco n° 14). Si ces investissements pourront permettre de massifier les volumes transformés, les experts prédisent qu'une complémentarité s'installera entre consolidation de grandes scieries industrielles, plutôt de résineux, et le maintien de plus petites scieries de service, de proximité, plus souvent de feuillus, équipées de lignes « ruban » flexibles.
III. LA « RUÉE VERS LE BOIS » : UN ESSOR D'USAGES PARFOIS CONCURRENTS, POUR UNE RESSOURCE BEL ET BIEN FINIE
A. UNE « CASCADE DES USAGES » SENS DESSUS DESSOUS, ALORS QU'ELLE RÉPOND À UNE LOGIQUE ÉCONOMIQUE DE COMPLÉMENTARITÉ
Principe européen, la « cascade des usages » s'inscrit dans une logique d'abord économique de complémentarité : le bois d'oeuvre est mieux valorisé que le bois d'industrie, lui-même mieux valorisé que le bois énergie. Seulement, 40 % du bois d'oeuvre scié engendrent des coproduits (sciure, copeaux), l'« épluchure », valorisée à son tour en panneaux ou énergie.
La France est en retard pour transposer la directive RED III, ce qu'elle doit faire rapidement pour sécuriser, sans « surtransposer » - en n'assujettissant à ces règles que les sites nouveaux et bénéficiaires d'aides publiques - pour ne pas rigidifier au-delà de ce que font nos voisins (reco n° 15). Elle devrait plutôt agir sur le signal-prix du marché, en tendant au moins à un équilibre à 50-50 % entre usage matière et énergétique dans les appels à projets (reco n° 16) là où depuis 2020, selon une étude à paraître du think tank I4CE, près de 75 % du financement pourrait être allé à des usages énergétiques, au travers notamment de l'appel à projets biomasse chaleur pour l'industrie, l'agriculture et le tertiaire (BCIAT).
B. UN BESOIN DE PLANIFICATION ET DE RÉGULATION POUR ASSURER LE « BOUCLAGE BIOMASSE » À L'ÉCHELLE TERRITORIALE ET NATIONALE
Les nombreux atouts du bois font qu'il suscite de nombreuses convoitises. Or, la ressource est finie et ne croît qu'à un rythme lent. Dans ce contexte, il est à craindre que certains appels d'air actuels (tranche biomasse de Gardanne à accompagner jusqu'à extinction dans 8 ans) ou potentiels (carburants d'aviation durable (SAF), annonces du ministre de l'industrie sur la décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs) déstabilisent massivement l'approvisionnement des secteurs préexistants, enfermant durablement dans certains choix technologiques, alors que l'Ademe a montré en 2023 que l'ensemble de la ressource trouvait déjà preneur.
Il convient donc d'objectiver ces appels d'air, grâce au rôle d'éclairage du GIS biomasse, pour ensuite mieux les maîtriser, par exemple en ne leur accordant qu'une place limitée dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en cours de définition (reco n° 17). Les avis des cellules régionales biomasse, trop peu suivis par le préfet, mériteraient de devenir conformes à condition que professionnels et élus locaux y soient plus étroitement associés, pour réguler les plans d'approvisionnement (reco n° 18).
C. UNE MOBILISATION DU BOIS EN FORÊT À AJUSTER AU PROFIT D'OBJECTIFS PLUS PERTINENTS DE TRANSFORMATION ET DE PUITS DE CARBONE
L'objectif très ancien de 12 M de m3 de récolte supplémentaire de bois en dix ans, figurant encore dans le programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016-2026, gagnerait à être ajusté (reco n° 19) car il n'est ni réaliste au regard des trajectoires passées, ni pertinent (un objectif de bois d'oeuvre (sciage, déroulage) et de bois industrie transformé sur le territoire national, et donc générateur de valeur ajoutée, aurait plus de sens), ni forcément cohérent à horizon 2050 (le puits de carbone sur pied se dégradant rapidement). Ce changement d'approche implique de faire à l'aval « plus de produits avec moins de bois » (optimisation matière) et de financer davantage l'amont en massifiant le recours au label bas carbone et aux certifications volontaires pour les absorptions de carbone (CRCF).
IV. LA FORÊT FRANÇAISE N'EST PAS QU'UN « GRENIER À BOIS » ET SA RESSOURCE N'EST PAS ILLIMITÉE
A. UN POTENTIEL DU BOIS DES FORÊTS FRANÇAISES DÉPENDANT DES QUALITÉS REQUISES PAR L'INDUSTRIE ET DES MODES DE COMMERCIALISATION
Pour l'industrie du bois, toutes les forêts ne se valent pas. Aux yeux du scieur, les comparaisons de surfaces forestières (17,5 M d'hectares en France contre 11,5 M d'hectares en Allemagne et 12 M d'hectares en Italie) comptent moins que le volume et la qualité du bois. Il ne faut pas s'y tromper : la forêt allemande, composée de résineux, plus dense, à la croissance et aux cycles de récolte plus rapides et avec des conditions climatiques plus propices à la végétation que le sud de la France, compte plus de bois potentiel que la forêt française. Ce bois est en outre réputé adapté à l'industrie (bois droit, cernes resserrés). L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), avec l'inventaire forestier national, fournit une image précise et a produit, avec l'institut technologique Forêt, cellulose, bois-construction, ameublement (FCBA) différents scénarios, devant cependant être complétés par la perception qu'ont les professionnels de la ressource (cf. ce réajustement à la baisse de 30 % du BO potentiel de chêne en Bourgogne-France-Comté en 2018).
De plus, le bois allemand est davantage vendu façonné bord de route, dans le cadre de contrats d'approvisionnement, que le bois français, plus vendu sur pied et de gré à gré ou par adjudication. Cette prévisibilité facilite l'approvisionnement des industries et garantit une bonne valorisation des bois de qualité, non mélangés à de moins bons lots - ce surcoût restant néanmoins marginal dans les coûts de revient de l'aval. En France, hormis pour le bois commercialisé par l'ONF voire celui vendu par les coopératives, il règne une certaine opacité sur la construction du prix, dilapidant l'énergie de scieurs, plus préoccupés par leur amont que par leur aval. La comparaison entre coopératives forestières, transformant encore peu le matériau bois, et coopératives agricoles, à l'origine d'une grande partie de la transformation agroalimentaire en France, témoigne aussi d'une filière très, sans doute trop tournée vers son amont. Les efforts de contractualisation et de transparence en forêt domaniale (70 % de bois façonné) et communale (35 %) doivent se poursuivre en forêt privée (20 %) (reco n° 20), la vente au mieux-disant pouvant favoriser les exportations (ex. du chêne vers la Chine dans les années 2010 ou vers nos voisins européens depuis).
B. UNE DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE EN BOIS TRIBUTAIRE DE LA MISE EN GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE DE NOS FORÊTS
La conversion du potentiel en disponibilité de la ressource est plus difficile en France - où les forêts sont davantage mélangées et pas toujours accessibles - qu'en Allemagne, où la forêt résineuse monospécifique plantée en plaine prédomine. Sans égaler l'approche très conservationniste de la forêt en Italie (protégée par le ministère de la culture et au titre de la restauration des terrains en montagne), la forêt française répond davantage au principe de gestion durable et multifonctionnelle. Maillon économique fragile, les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) font face à un défi de sécurisation de leur activité au regard de la directive Habitats, faune, flore. Plutôt que par une caisse d'assurance « espèces protégées », cela doit se régler sous l'égide du préfet qui préside la mission interservices de l'eau et de la nature (Misen), en définissant des cahiers des charges a priori de réduction des risques d'infraction sur les chantiers (reco n° 21).
Pour faire face à la saisonnalité croissante de leur activité, les ETF demandent en outre l'extension du TO-DE ou une caisse d'assurance « intempéries », à laquelle les scieurs ont peur de contribuer ; une solution plus pérenne pour conforter leur équilibre économique serait de diversifier leurs activités (méthodes plus légères, élagage bord de route, taille de haies agricoles...) - mais pour quel impact sur le bois récolté ?
S'ajoute l'obstacle organisationnel ancien du morcellement de la propriété, que les rapporteurs proposent de traiter par des incitations à la gestion collective (poursuite de l'instruction des plans simples de gestion entre 25 et 20 ha, maintien d'un taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles, bonification du DEFI travaux dans le cas d'une gestion collective contre un taux normal de 25 %, gestion coordonnée par massif grâce à un surcroît de coordination gestionnaires privés-ONF indépendamment du régime de propriété) plutôt que par un hypothétique remembrement forestier, trop long et coûteux (reco n° 22).
C. NE PAS TIRER DE « PLANTS » SUR LA COMÈTE : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE IMPOSE D'ADAPTER L'AVAL À L'AMONT ET PAS L'INVERSE
Comparée à la forêt allemande, la remarquable diversité génétique inter- et intraspécifique de la forêt française est son meilleur atout face au changement climatique. En complément, le très attendu plan de renouvellement forestier, structurant pour la filière, a permis l'amélioration de trois types de peuplements dans le cadre de son premier véhicule, France Relance... pas de quoi cependant métamorphoser la forêt française dans son ensemble (47 000 ha, soit 0,3 % de la forêt hexagonale). D'autant que l'ensemble des engagements « planification écologique » pour la forêt et le bois ont été ramenés de plus de 509 M€ en 2024 à 194 M€ puis 130 M€ après gel en 2025, et que les négociations budgétaires actuelles tourneraient autour de 50 M€ pour 2026, un stop-and-go ne pouvant qu'inciter les propriétaires à reporter les travaux... ce qui finira en effet par tarir la demande. La mission préconise donc de maintenir 130 M€ d'engagements dont une partie suffisante sur le renouvellement forestier et, en tout état de cause, de sauvegarder des dépenses « sans regret » d'un montant modeste (aides à l'aval, à la filière graines et plants, au suivi sanitaire ou au renouvellement des forêts dépérissantes - par exemple, 20 % des épicéas et sapins du Jura ont été scolytés ou prélevés en cinq ans -, quitte à faciliter en parallèle le recours des communes forestières et propriétaires privés concernés) (reco n° 23).
Ligne de sciage ruban du groupe Siat pour du débit sur liste
La forêt, soumise à des stress hydrique, thermique et donc parasitaire, doit en priorité s'adapter au changement climatique, ce qui peut l'éloigner des besoins normalisés de l'industrie. Il convient en effet de rester humble et pragmatique sur le choix d'« essences d'avenir » à planter, notamment en promouvant la diversification et en se gardant d'une sélection en vue d' usages du siècle prochain aujourd'hui impossibles à prédire. C'est donc à l'industrie qu'il revient de s'adapter à la forêt de demain (reco n° 24), d'abord en se réorganisant pour anticiper les afflux plus imprévisibles de coupes accidentelles ou sanitaires via la mise en oeuvre du plan « bois de crise » (stockage, transport) lancé par Marc Fesneau. Ensuite, les scieries doivent innover pour mieux valoriser les gros et très gros bois (> 60 cm de diamètre), de plus en plus nombreux dans nos forêts, ainsi que les essences dites « secondaires », notamment feuillues (déroulage du peuplier, érable...). C'est le but de l'AAP industrialisation performante des produits bois (IPPB), dans la lignée de l'étude « scieries de feuillus du futur ». Au-delà, les fonds européens devraient être mobilisés pour développer les trop rares programmes de recherche sur l'aval et le matériau bois.
RAPPORT
INTRODUCTION
TROIS CONVICTIONS FORTES POUR ABORDER CES TRAVAUX
Avant la conduite de leurs travaux sur la compétitivité de la filière bois, les rapporteurs Anne-Catherine Loisier et Serge Mérillou se sont accordés sur trois idées fortes.
Ø Le premier parti pris de ce rapport a trait à son champ d'étude : il est de se concentrer davantage sur l'aval que sur l'amont de la filière, avec une approche explicitement économique, propre à leur commission de rattachement.
L'amont, c'est-à-dire la forêt, fait l'objet de toutes les attentions, en raison d'un besoin chronique de financement public, ce qui dispose ses parties prenantes (propriété forestière privée, communes forestières) à se tourner plus spontanément vers la puissance publique que l'aval.
De plus, confrontée désormais à l'immense défi tant de l'adaptation que de l'atténuation au changement climatique, la forêt est de plus en plus « saisie » par les approches environnementales, alors qu'elle était traditionnellement perçue comme un actif économique à faire fructifier - en atteste le fait que les forêts, appartenant au domaine royal, étaient rattachées au trésor, du fait des recettes qui en étaient tirées. La vocation productive de la forêt, au coeur du code forestier, est concurrencée par la montée des enjeux environnementaux (biodiversité, puits de carbone).
Cette tension entre deux logiques donne lieu à une politisation de la forêt - longtemps plus préservée que l'agriculture -, se traduisant par des débats de plus en plus conflictuels, sur fond de défiance réciproque entre la filière et certaines associations. Ce contexte de tension qui pèse sur l'amont, combiné à une incertitude scientifique élevée sur ce qu'il conviendrait de faire, fait que chacun campe sur ses positions.
Cela se prête moins à l'esprit de « mobilisation générale », transpartisan, que les rapporteurs veulent insuffler avec ce rapport, qu'il a par conséquent été décidé de centrer sur l'aval.
Ø Le second parti pris des rapporteurs, en lien avec le précédent, relève d'une conviction commune : le bois dispose de toutes les qualités pour constituer un levier à la fois de compétitivité et de décarbonation de l'économie française.
L'aval de la filière fait face en réalité à un défi d'ingénieur, celui de l'optimisation du rendement matière du bois, afin d'améliorer sa valorisation. Une meilleure organisation de la filière est de nature à (ré)concilier économie et écologie, aidant à faire comprendre que l'industrie n'est pas forcément l'ennemie de la décarbonation mais peut au contraire être sa meilleure alliée.
Dans la logique du rapport Draghi - au sein duquel il n'est pourtant pas mentionné une seule fois -, le bois, qui représente 10 % du déficit commercial de la France, est un exemple typique du gisement de valeur ajoutée et de décarbonation que pourrait receler la relocalisation de la transformation industrielle, en l'occurrence du bois, en Europe et en France.
Cela se prête là encore davantage à l'approche constructive et transpartisane qui préside à la conduite de ces travaux.
Ø Le troisième et dernier parti pris de la mission a trait à la méthode : il est d'éviter les approches globalisantes et de privilégier les approches fines, par « produits » emblématiques de la filière (partie I) ou par « dossiers » transversaux (partie II).
Les généralités sur « la forêt et la filière bois » ont déjà fait l'objet d'un si grand nombre de rapports que le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) a publié en 2015 une synthèse de « plus de 250 rapports rédigés depuis 1984 », dont les auteurs ont tiré trois enseignements : « les constats sont généralement faits depuis longtemps. Les recommandations sont souvent assez proches d'un rapport à l'autre. Certaines de ces recommandations ont été mises en oeuvre plus ou moins rapidement ».
Le présent rapport ne prétend donc pas faire mieux que ces nombreux rapports mais à tout le moins les actualiser, et si possible apporter un éclairage complémentaire, à la fois stratégique et opérationnel, sur l'industrie de transformation du bois en France, ses forces et ses faiblesses.
LE CONSTAT INITIAL : UN TABLEAU COMMERCIAL TRÈS OMBRAGÉ, MAIS UNE TIMIDE ÉCLAIRCIE
8,5 % : c'est en 2023 la part du déficit commercial de la France (près de 100 Md€) imputable au bois (environ 8,5 Md€).
Comment expliquer qu'un dixième du déficit commercial de la France (8,5 milliards d'euros) soit imputable aux produits bois, alors qu'un tiers de la superficie hexagonale est recouverte de forêts (17,5 millions d'hectares) ?
À l'amont, la ressource, abondante (autour de 3 milliards de mètres cubes de bois en forêt), continue de croître malgré une mortalité et des prélèvements en hausse. Soumise à un principe de gestion durable et multifonctionnelle qui fait l'originalité de son modèle, elle est plus diverse (composée à 65 % de feuillus) que celle de ses voisins allemands ou de Scandinavie.
La France serait-elle donc sujette à la « malédiction des matières premières » ?
La filière bois française ne parvient traditionnellement pas à sortir du schéma « exportation de grumes, importation de produits finis », qui rapproche la France d'un « modèle économique de pays en développement » (Sénat, 2015) ou d'une économie de rente.
Deux catégories de produits, les meubles et sièges en bois (- 3 Md€) et les pâtes, papiers et cartons (- 4 Md€), expliquent la presque totalité de son déficit.
Il ne faut pas se voiler la face : un déficit commercial d'une telle ampleur, un tel déclin de nos parts de marché, est le révélateur d'un problème structurel de compétitivité, qui n'est d'ailleurs pas propre à l'industrie du bois, mais à l'ensemble de l'économie française.
La filière bois a néanmoins entrepris des efforts de structuration sur la période récente, a fait l'objet d'un soutien public en faveur de sa modernisation depuis 2020 et dispose maintenant d'une feuille de route avec les conclusions des Assises de la forêt et du bois de 2022. Ces actions concourent toutes au renforcement de la compétitivité de la filière bois.
Or, il semble qu'un frémissement soit perceptible. En effet, selon les données de la DGDDI, sur les trois dernières années, la France a à la fois réduit ses importations de produits transformés/ouvragés à base de bois (passées de 1 Md€ en 2022 à 850 M€ en 2024) et réduit ses exportations de bois brut (passées de 409 M€ à 345 M€ sur la même période), tout en maintenant au même niveau les exportations de produits transformés et les importations de bois brut. Cela s'expliquerait autant par une augmentation de la capacité de production sur le sol national, dans la suite des Assises de la forêt et du bois, que par des parts de marché regagnées à l'Allemagne, ce pays s'étant tourné vers le commerce à plus longue distance et le marché américain.
Cependant, l'éclaircie est timide et reste fragile. Le marché du bois est un marché international, et par conséquent les bouleversements récents de l'ordre mondial ont, et auront, une incidence sur le marché du bois en France. À cet égard, il convient de relever :
Ø l'interdiction d'importer des produits du bois russe, depuis juillet 2022, qui a obligé les producteurs européens à compenser la perte de ce débouché par une réorientation de leurs exportations vers le marché intérieur ;
Ø l'ouverture d'une enquête des États-Unis, pour des motifs de « sécurité nationale1(*) », sur 1,8 Md€ d'importations de bois d'oeuvre et de bois et ses produits dérivés depuis l'Europe, sur lesquelles des droits de douane de 25 % représenteraient un surcoût de 450 M€ pour la filière bois européenne, de nature à provoquer un report supplémentaire des exportations allemandes vers le marché intérieur ;
Ø la fermeture du marché américain aux produits chinois, qui pourrait provoquer le report de produits chinois vers le marché européen, et ainsi accentuer le dumping déjà perceptible de la Chine frappant les meubles et aménagements intérieurs en bois.
I. CINQ FAMILLES DE PRODUITS BOIS, UN MATÉRIAU À VALORISER POUR SON POTENTIEL UNIQUE DE COMPÉTITIVITÉ PROPRE
A. BOIS CONSTRUCTION : UNE HAUTE VALEUR AJOUTÉE QUI DÉCARBONE DANS LA DURÉE ET QUI CHARPENTE TOUTE LA FILIÈRE
« Dans quelle direction va la poutre2(*) »
1. Un horizon consensuel en faveur de la transformation du bois d'oeuvre à préserver tant du côté de l'offre que de la demande...
a) Une priorité au triptyque scier-sécher-transformer réaffichée par les pouvoirs publics lors des Assises de la forêt et du bois
Si les Assises de la forêt et du bois organisées entre octobre 2021 et mars 2022 n'ont pas constitué l'an zéro de la politique forestière, cet exercice de concertation, associant notamment des professionnels et des parlementaires, a eu pour mérite de remettre à l'agenda certaines priorités poursuivies plus discrètement et avec moins de moyens par les pouvoirs publics depuis plusieurs années - avec, par exemple, quatre plans bois-construction successifs depuis 2009.
Le troisième groupe de travail des Assises, que co-pilotait la rapporteure Anne-Catherine Loisier avec le scieur Pierre Piveteau, a conclu, en ce sens, au besoin d'« investir massivement pour assurer l'innovation et la compétitivité de la filière industrielle bois ». La principale action associée à ce pilier a consisté à « [mobiliser nouvellement] « plus de 400 millions d'euros avec France 2030 pour développer une industrie du bois souveraine ».
En effet, de l'aveu de la filière elle-même, la France présente environ quinze ou vingt ans de retard sur les filières bois allemande ou autrichienne, en particulier sur la fabrication de produits d'ingénierie - des produits techniques reconstitués à partir du matériau bois pour atteindre des caractéristiques auquel un produit en bois massif ne pourrait prétendre, en termes par exemple de longueur (bois massif abouté), de courbure (bois lamellé-collé) ou de résistance mécanique (bois massif reconstitué).
Les rapporteurs ont ainsi été impressionnés d'apprendre que la scierie Streit située dans le Bade-Wurtemberg, qu'ils ont visitée dans le cadre de la mission, exportait 45 % de sa production vers la France, et notamment en Bretagne et au Pays basque, sans tirer d'avantage comparatif, manifestement, de sa proximité géographique avec ses clients.
Or, non content d'être l'usage de masse3(*) qui crée le plus de valeur ajoutée, le bois d'oeuvre destiné à la construction est une locomotive qui tracte dans son sillage l'intégralité de la filière, grâce à ses coproduits (environ 40 % d'une grume).
Selon Pierre Piveteau, le chiffre d'affaires de la filière bois polonaise a dépassé celui de la filière bois française en raison d'investissements dans la transformation qui permettent désormais la commercialisation de bois plus élaborés (bois séché, raboté...). La France commercialiserait 75 à 80 % de produits frais de sciage, tandis que la Pologne, qui produit pourtant moins de sciages, ne vendrait, elle, que peu de bois brut.
Dans la lignée des Assises, nombre d'appels à projets (AAP) ont donc visé, soit indirectement - appel à projets biomasse-chaleur industrie-bois (BCIB), pour financer l'installation d'unités de biomasse dans les scieries selon une logique d'autoconsommation énergétique et de montée en gamme pour développer le séchage du bois - soit directement - notamment par un appel à projets « Systèmes constructifs bois » -, à améliorer la valorisation de la ressource, en respectant le triptyque consensuel : scier, sécher, transformer.
Les premiers résultats ont été très encourageants (cf. détail des financements engagés infra, partie II, C, 1). Alors que la France importait vers 2020 3,2 à 3,3 millions de mètres cubes de ces produits bois techniques pour la construction (bois raboté sec, bois lamellé-collé, bois lamellé-croisé (ou CLT, pour cross-laminated timber)), elle n'en importerait désormais plus que 2 à 2,5 millions.
La présidente de France Bois Forêt, Anne Duisabeau l'a rappelé devant la commission des affaires économiques : « Notamment grâce aux investissements massifs dans le séchage, les produits sont désormais bien plus finis, compétitifs et au niveau de ceux de nos partenaires autrichiens et allemands. Un exemple concret : le CLT (panneaux de bois lamellés croisés), un produit à forte valeur ajoutée destiné à la construction bois. Pour la première fois, les importations de bois autrichien ont reculé de plus de 24 % en France. Cela prouve que, en l'espace de dix ans, nous avons su bâtir une filière compétitive. »
Cette réduction de notre dépendance aux importations sur ces sciages majoritairement résineux s'expliquerait également par un report du bois allemand, délaissant le marché français pour le marché américain, qui a toujours été prescripteur pour les cours mondiaux du bois, et qui était alors dynamique.
Les fabricants français en ont tiré parti, sous l'impulsion du comité stratégique de filière bois (CSF Bois). De façon emblématique, le nouveau siège de l'Office national des forêts (ONF) à Maisons-Alfort, construit en 2022 en bois par l'entreprise alsacienne Mathis, intègre près de 600 m2 de lamellé-collé, près de 1 100 m2 de façade ossature bois et plus de 2 600 m2 de lamellé-croisé (CLT).
Ces bois techniques pourraient être particulièrement valorisés en France grâce à certains atouts organisationnels. Les façades à ossature bois et murs à ossature bois (FOB-MOB) sont désormais souvent construits hors sites et livrés presque montés, ce qui limite le temps de chantier. La France est également, aux dires du CSF Bois, un leader mondial du Building Information Modeling (BIM), qui permet de modéliser la faisabilité de projets d'ouvrages.
Orientation : maintenir l'horizon défini par les Assises de la forêt et du bois misant en priorité sur le sciage, la transformation et le séchage du bois, afin de fournir des bois techniques à forte valeur ajoutée pour la construction, susceptible de tracter l'ensemble de la filière.
b) La réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020) : un horizon mobilisateur à préserver...
Au sein de l'Union européenne, les matériaux biosourcés dont, à titre principal, le bois, ne représentent que 3 % de la masse totale des matériaux de construction. Malgré cela, « la construction en bois constitue un élément clé de la chaîne de valeur des industries forestières, couvrant plus de 30 % de la demande du marché en bois rond, qu'il s'agisse de sciages ou de panneaux », à l'échelle de l'Europe, selon la Commission.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'utilisation du bois dans les immeubles était interdite en Suède jusqu'en 1994, avant qu'une stratégie des pouvoirs publics (mise à jour des règles de construction, promotion de la construction hors site, stratégie nationale comprenant des mesures de R&D et de formation) porte le taux de bois dans la construction à environ 20 % en 2019. Dans une étude comparative avec l'Allemagne, la Suède et la Roumanie parue en 2023, le think tank I4CE insiste sur le fait que cette politique très volontariste a mis trente ans à produire ses effets, malgré des atouts évidents du côté de l'offre de bois et une longue expérience sur le marché de la maison individuelle, ce qui souligne la lenteur du marché à s'adapter.
D'où l'importance de la « RE2020 », une politique de la demande plutôt volontariste en comparaison européenne. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la réglementation environnementale des bâtiments neufs, dite « RE2020 », dans ses objectifs de décarbonation, doit conduire progressivement à un recours accru aux matériaux biosourcés, dont le bois, dans la construction neuve - cette dernière incluant, par exemple, la surélévation de bâtiments préexistants, fréquente en milieu urbain. Une politique de la demande qui pénalise les constructeurs ne respectant pas les cibles de matériaux biosourcés exigées à la date voulue.
Voulue par le législateur, elle est la traduction réglementaire d'une demande sociétale croissante de bois afin notamment de renforcer le stockage de carbone par la construction, en s'inspirant en particulier des modèles allemand et scandinave, pays qui recourent près de trois fois plus au bois que la France (autour de 20 %).
Son esprit n'est pas d'encourager la construction de bâtiments 100 % en bois mais, bien plutôt, de promouvoir un mix de matériaux laissant toute sa part au bois.
Le béton bas-carbone a amélioré ses performances plus rapidement que prévu, si bien que même le seuil à venir de 2028 de la règlementation environnementale ne devrait pas avoir pour effet de faire basculer systématiquement les choix des maîtres d'ouvrage en faveur du bois. Les espoirs du bois construction reposent désormais sur le seuil 2031.
Cependant, un rapport confié à M. Robin Rivaton sur la réglementation environnementale 2020, dont les conclusions ont été rendues juste après l'adoption du présent rapport par la commission des affaires économiques, a suscité, tout au long des travaux de la mission, beaucoup d'inquiétudes chez les professionnels de la filière bois, quant au risque d'une révision à la baisse de l'ambition initiale.
Afin de maintenir un horizon prévisible pour le secteur et de maintenir l'incitation à intégrer du bois dans la construction, les seuils de 2028 et de 2031 de la RE2020 ne devraient pas être modifiés, et les ajustements pris ne devraient l'être qu'à la marge, pour ne pas déstabiliser tout le modèle économique de ce secteur. M. Rivaton, dans ses conclusions, s'en tient à cet équilibre.
Du reste, un premier ajustement réglementaire technique a eu lieu il y a quelques semaines, après concertation de l'Union des industriels de la construction bois (UICB).
Un dossier sous-jacent de la RE2020 devrait cependant faire l'objet d'un second ajustement, car la France y est tenue par une directive européenne : il s'agirait, dans les fiches techniques par produit, de ne plus calculer le contenu carbone des produits en analyse de cycle de vie (ACV) dynamique, une méthode qui diffère des ACV plus classiques par la prise en compte de l'origine et de la fin de vie du bois, et qui favorisait le bois par rapport à d'autres produits. Tous les produits seront légèrement pénalisés, mais le bois plus que d'autres.
Orientation : rester ferme sur le maintien des seuils prévus de matériaux biosourcés dans la construction de la RE2020, au moins pour le palier 2028, et rester vigilant sur les effets de la modification des « fiches techniques » (ACV dynamique ou non) afin de ne pas pénaliser outre mesure le bois.
2. ... mais une dynamique qui tarde à se concrétiser...
a) Une dynamique qui peine à s'enclencher par un défaut d'acculturation des maîtres d'ouvrage et un défaut de commande publique
Malheureusement, l'UICB a présenté aux rapporteurs des chiffres en demi-teinte sur les progrès dans la part du matériau bois dans la construction neuve (entre 6,2 et 6,6 % tous logements confondus).
L'UICB s'est inquiétée d'un double contexte, d'une part, de crise de la construction neuve, et d'autre part, de la stagnation de la part de l'usage du bois dans ces constructions.
En valeur absolue, le bilan mitigé du bois pourrait s'expliquer par la crise globale du logement et de l'« acte de construire », ainsi que par des contraintes de pouvoir d'achat pour les ménages et des contraintes budgétaires pour les acteurs publics. Cela n'épuise toutefois pas le sujet, car les performances du bois en valeur relative n'ont pas, non plus, progressé. Du reste, alors que sa part avait augmenté entre 2005 et 2015, elle aurait plutôt stagné depuis.
Une première difficulté a tenu à ce que, de l'aveu même de l'UICB, les effets à court terme de la RE2020 ont pu être surestimés (cf. supra).
En deuxième verrou majeur à l'utilisation du matériau bois, figure en bonne place le besoin d'acculturation des maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et architectes à ce « nouveau » matériau... qui ne l'est en fait pas tellement puisque, par exemple à Paris, une large partie de l'ossature du parc haussmannien est en bois (escaliers, parquet, lambris...), ce que l'on a aujourd'hui tendance à oublier. Il est vrai cependant que depuis les années 1950, la reconstruction a eu lieu en béton ou en briques et que, depuis lors, trois générations d'ingénieurs ont été habituées à construire sans le bois. Cela pose un même problème de manque de compétences, une filière industrielle ne se mettant pas en place en quelques années.
En lien avec ce deuxième verrou, la représentation du bois comme un matériau source de surcoûts importants est un troisième verrou. Le bois a la réputation d'être un matériau plus cher, qui obligerait à rogner sur d'autres prestations, ce à quoi les maîtres d'ouvrage seraient réticents. Pourtant, ainsi que l'explique la filière, la majeure partie des surcoûts provient d'un recours au bois décidé au dernier moment, tandis qu'un bâtiment dont l'intégration de bois a été conçue dès la conception coûtera, tout au plus, de 5 à 10 % plus cher.
La commande publique, notamment locale, prend là toute son importance, afin de garantir un flux d'affaires aux fournisseurs contribuant à structurer et professionnaliser ces derniers. Afin d'encourager les collectivités territoriales à recourir au bois dans les bâtiments publics en tant que maîtres d'ouvrage, un levier consiste à augmenter la part de ressource locale dans l'approvisionnement, et à garantir sa traçabilité. C'est le rôle des interprofessions régionales Fibois en région, que de sensibiliser les donneurs d'ordre aux atouts du matériau bois, par exemple en termes de retombées économiques pour le territoire.
Sans même parler d'événements ponctuels tels que les jeux Olympiques (JO), la France s'illustre dans les constructions bois de grande hauteur. M. Klaus Henne, scieur en Allemagne, a témoigné de son admiration pour ce qu'il considère comme une avance de la France dans ce domaine. L'organisation EGF a précisé qu'en ne considérant que les habitations plus hautes que la maison individuelle, la France était moins en retard que ce que l'on pouvait croire sur ses voisins scandinaves ou germaniques. Le lycée Gergovie de Clermont-Ferrand ou encore les immeubles Perspective, Hyperion et Silva à Bordeaux, témoignent de cette performance française.
Lycée Gergovie à Clermont-Ferrand
À l'échelle nationale, les événements publics importants, tels que les JO de Paris 2024 ou les JO d'hiver 2030, sont une opportunité unique pour employer le levier de la commande publique et mobiliser des moyens adéquats, ce qui permet de créer une vitrine pour la construction bois. La France ne mesure pas assez, en effet, à quel point elle dispose de fleurons dans le domaine de la construction, qui remportent régulièrement des marchés publics et des concours à l'international, de plus en plus grâce à l'argument de la mixité.
Le bois dans le village olympique pour les JO de Paris 2024
Le village olympique construit à Saint-Denis pour accueillir les athlètes dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques d'été 2024 à Paris a constitué un test grandeur nature pour la filière bois, afin de vérifier si l'offre de bois français était suffisante pour approvisionner les maîtres d'oeuvre compte tenu des seuils très élevés de bois prévus dans ces bâtiments
M. Georges-Henri Florentin, président de la structure ad hoc France Bois 2024, a indiqué en audition que la part du bois avait finalement atteint 28 %. À l'intérieur du village olympique, pour l'île et le continent, un taux de 65 % a même été atteint, ce qui témoigne des marges de progrès pour la construction neuve en général. M. Florentin indique que l'appui de la maîtrise d'ouvrage publique de la Solideo et des collectivités territoriales a été déterminant pour atteindre ces seuils.
S'agissant de la part de bois français, alors qu'un objectif de 50 % d'approvisionnement en bois de France avait été fixé à la filière, la Solideo n'avait cependant admis qu'un seuil de 30 % - par crainte de marchés infructueux avec le délai à tenir de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques. Le taux final constaté a été de 45 %, avec des difficultés constatées pour suivre et contrôler l'origine des bois.
b) Et des obstacles administratifs, s'agissant en particulier des normes incendie
Comme l'a déclaré le président de la Fédération nationale du bois devant la commission des affaires économiques, « le bois a comme défaut de brûler, donc il faut être prudent et on aura toujours un mélange entre des matériaux minéraux et des matériaux combustibles ». Cependant, comme indiqué supra, l'intégration de bois dans la construction n'a pas pour effet de remettre en cause le principe de mixité des matériaux, mais vise au contraire à aller en ce sens, en introduisant des matériaux biosourcés, en plus du béton.
En outre, le bois, sous forme de poutre, semble pouvoir se montrer plus résistant que certains métaux, en raison d'une combustion lente qui ne remettrait pas immédiatement en cause ses qualités mécaniques, à la différence de l'acier qui aurait tendance à s'effondrer sur lui-même. Il convient cependant de relever que la majeure partie de l'usage du bois dans la construction relève de l'ossature (façade ossature bois, mur ossature bois, FOB-MOB), qui est beaucoup plus fragile vis-à-vis du risque incendie.
Les discussions n'ayant pas abouti entre professionnels du bois (Adivbois) et spécialistes de la sécurité incendie dans le cadre de la préparation de l'accueil des JO 2024 sur le village olympique, la préfecture de police de Paris a publié, en juillet 2021, une doctrine « risque incendie et construction des immeubles en matériaux biosourcés » en s'appuyant notamment sur l'expertise de son laboratoire central, de ses architectes de sécurité et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Or, comme l'a souligné l'interprofession France Bois Industries Entreprises (FBIE) dès les Assises de la forêt et du bois, cette publication freine les projets en bois construction, en particulier de bâtiments R+ 6 (7 étages et plus) mais aussi, par effet de halo, sème le doute sur les projets de construction en bois de taille inférieure.
Cette doctrine entend assurer la sécurité des personnes en limitant « la contribution du bois à la combustion lors d'un sinistre en tant que potentiel calorifique », un objectif pleinement partagé par l'ensemble de la filière, pour la bonne raison que la médiatisation d'un sinistre de grande ampleur pourrait significativement et durablement faire chuter la demande de construction en matériau bois. L'incendie d'un centre de tri de déchets parisien du Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (Syctom), en avril 2025, a sonné comme une alerte à ce sujet.
Il paraît, du reste, légitime d'actualiser une législation et une réglementation anciennes au contexte nouveau de la massification de la construction en bois planifiée par la RE2020.
Cette mise à jour est d'ailleurs la tâche à laquelle un groupe de travail interministériel, piloté par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Logement, s'est attelé depuis 2021, associant entre autres la préfecture de police de Paris et les professionnels de la construction bois.
Les conclusions de ces concertations devaient être rendues en début d'année 2022 pour aboutir à moyen terme à un renforcement des exigences de sécurité des bâtiments, mais ont été reportées faute de pouvoir trouver un terrain d'entente.
Or, le document de la préfecture de police de Paris est paru à peine à mi-étape des travaux de ce groupe de travail. S'il n'a pas valeur réglementaire, il a emporté des conséquences tangibles, puisqu'à l'occasion de révisions de permis de construire, certains décisionnaires sont revenus sur la première instruction qu'ils avaient faite des dossiers. La doctrine est vectrice d'insécurité juridique, conduisant les maîtres d'ouvrage à remettre en question la viabilité de certains projets, devant la perspective de surcoûts liés aux exigences de la doctrine.
La préfecture de police et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont une influence qui va bien au-delà de leur périmètre de compétence (Paris et proche couronne). Leurs prises de position sont d'abord fortement prescriptrices en Île-de-France, qui représente un quart du marché de la construction neuve en France, mais sont aussi largement reprises par les autres préfectures et service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de France, illustration de l'importance du pouvoir de diffusion des normes.
La rapporteure Anne-Catherine Loisier estime que les exigences de l'administration en la matière vont plus loin que dans n'importe quel autre pays au monde.
Il semble qu'en Suède (p. 57), les restrictions sont très faibles en dessous de 8 mètres de hauteur et que le sprinklage peut permettre de déroger à bon nombre d'entre elles jusqu'à 28 m de hauteur.
Grâce notamment à l'impulsion du délégué interministériel Jean-Michel Servant, et après plusieurs études du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le centre technique du ministère du logement, des principes directeurs ont été définis au printemps 2025.
Trois arrêtés, préparés par trois administrations différentes, ont été soumis à consultation, avec pour but de définir des règles qui soient, autant que possible, harmonisées, d'un type de bâtiment à l'autre, pour anticiper les éventuels cas de réversibilité (ministère de l'intérieur pour les établissements recevant du public (ERP), direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) pour les habitations, direction générale du travail (DGT) pour les bureaux).
Les règles seraient les mêmes selon la densité de population, mais diffèreraient selon la taille des bâtiments, devant naturellement être plus strictes pour les bâtiments de grande hauteur.
Une attention particulière serait par ailleurs portée à la phase du chantier, qui représente un incendie sur trois, en raison de la présence de masses combustibles non protégées et de points chauds (soudure, bouteilles de gaz, etc.).
Enfin, un seuil de 25 % de bois apparent semble avoir été retenu pour les murs porteurs. Cette règle suscitait une forte l'attention de la filière car les maîtres d'ouvrage pourraient se montrer réticents à intégrer du bois dans leurs projets, si cela occasionnait un léger surcoût sans pour autant pouvoir être visible à cause de l'encapsulage.
À ce sujet, les rapporteurs préconisent de faire preuve de plus de souplesse dans le recours aux « solutions d'effet équivalent » introduites dans la suite de la loi dite « Essoc4(*) » (État au service d'une société de confiance). Il s'agit de solutions alternatives, justifiées au cas par cas, pouvant se substituer à des règles édictées par l'État dans la mesure où elles ont un effet équivalent. Il s'agirait de se focaliser sur l'esprit de ces règles, plutôt que sur les règles elles-mêmes, en encourageant une logique performancielle plutôt que d'imposer des obligations de moyens, ce qui, du reste, est de nature à encourager l'innovation.
Recommandation n° 1 : s'agissant des normes incendie des bâtiments incluant du bois, modifier la notion de « solutions d'effet équivalent » en permettant de présenter de telles solutions a) plus tard que dès l'étape du permis de construire et b) avec une obligation de résultats plutôt que de moyens (logique performancielle plutôt que de process).
3. Une réflexion sur l'extension de cette dynamique, au-delà du neuf, à la rénovation, pour stimuler la demande d'isolants biosourcés
Le champ d'application de la RE2020 est encore incomplet en ce qu'il est limité aux bâtiments neufs, alors que, ainsi que l'a rappelé en audition Thibault Terrier, responsable des achats bois du groupe Vinci, 80 % de la ville de demain est déjà bâtie.
C'est pourquoi les rapporteurs préconisent d'étendre la dynamique de la RE2020 à la rénovation, en fixant à terme des objectifs de part de matériaux biosourcés dans la rénovation de l'ancien.
Une telle politique présenterait un double bénéfice carbone : d'une part, par l'effet de substitution des isolants biosourcés par rapport aux isolants minéraux ; d'autre part, par son effet important sur l'allongement du stockage du carbone des ressources bois d'industrie et bois-énergie (BI-BE) (bien que ces isolants soient considérés comme des panneaux non structurels dans la comptabilité carbone). Si elle permettait d'accélérer l'atteinte de nos objectifs de rénovation thermique des bâtiments, elle comporterait même un troisième atout en termes de décarbonation.
L'Ademe constate, dans une étude de marché sur les produits biosourcés parue en février 2025, tout le potentiel de croissance de ces produits, tant du point de vue de l'offre (accrue grâce au financement d'unités de production par l'appel à projets SCB) que du point de vue de la demande, en particulier si des politiques dédiées venaient encore la stimuler.
Cela ne pourra être mis en place que de façon très progressive, et en prenant garde à ne pas complexifier la politique de rénovation, en prêtant en particulier attention à deux verrous qui pourraient venir freiner le développement de ces produits :
Ø le premier est le coût de production et de vente des isolants biosourcés, qui doit non seulement soutenir la concurrence des usages énergétiques des coproduits du bois, mais encore rester compétitif par rapport à d'autres isolants dans laquelle la France est bien positionnée, comme la laine de verre. En tout état de cause, un soutien à la demande de ces isolants biosourcés ne devra être mis en place qu'une fois que la lumière aura été faite sur la flambée des coûts de la rénovation (+ 7,5 % récemment, soit bien plus que le simple niveau de l'inflation), faute de quoi les isolants biosourcés seraient durablement associés à cette hausse des prix ;
Ø un second chantier est celui de la recherche pour réduire les risques fongiques ou les risques incendie (pour ce dernier, en particulier pendant les chantiers de rénovation). Les majors de la construction ont en effet émis des doutes, à ce stade, sur le rapport coût-bénéfice de l'intégration de l'isolation biosourcée, au regard de l'atteinte des objectifs de la RE2020, compte tenu du faible volume que l'isolation représente et des contraintes techniques et financières associées.
Une première étape pourrait consister à faire connaître, pour mieux l'exploiter, la possibilité, ouverte depuis 2025, de cumuler une subvention octroyée par le guichet MaPrimeRénov' avec toute autre aide, émanant par exemple de collectivités territoriales, avec un écrêtement relevé voire sans écrêtement. Grâce à la territorialisation, le dispositif serait moins rigide, tout en donnant une direction, sans crainte des ruptures d'approvisionnement.
Les collectivités territoriales devraient s'emparer de cette possibilité d'abondement, en mettant en place des bonifications territoriales, pouvant en effet tenir compte des ressources spécifiques de chaque territoire, pour les isolants biosourcés. La ministre du logement Valérie Létard a donné l'exemple de l'entreprise Gatichanvre (produisant, en l'espèce, un produit biosourcé autre que le bois), qui pourrait ainsi être aidée par les collectivités du Parc naturel régional du Gâtinais français dans le cadre du premier pacte territorial France Rénov'.
La Commission européenne encourage la mise en place de « marchés publics écologiques, de normes ou de labels de consommation qui permettent une comparaison équitable entre les matériaux fossiles et les matériaux biosourcés », dans le cadre de sa stratégie bioéconomie.
Le volontarisme de l'Allemagne a été mis en avant dans l' étude comparative entre l'Allemagne, la Suède et la Roumanie mentionnée supra. Le think tank I4CE y souligne que ce pays « a subventionné l'usage d'isolants biosourcés (y compris à base de bois) à hauteur de la moitié du surcoût de leur surcoût initial. Elle a obtenu de la Commission européenne une dérogation pour accorder cette aide d'État, au titre de l'intérêt environnemental. Durant les vingt ans qui ont suivi la mise en oeuvre de cette subvention, le volume d'isolants biosourcés transitant sur le marché allemand a été multiplié par 50. Et le coût pour les finances publiques est resté modéré : les économies d'échelles réalisées par les fabricants d'isolants biosourcés ont permis d'arrêter la subvention tout en maintenant leur production ».
Recommandation n° 2 : mettre en place des bonus territoriaux en faveur des isolants biosourcés en complément de MaPrimeRénov', afin de préparer une extension, selon des modalités souples, de la dynamique de la RE2020 à la rénovation dans l'ancien.
B. PARQUET, ÉTAGÈRES : SAUVER LES MEUBLES FRANÇAIS FACE À LA « FAST DÉCO » CHINOISE
1. De façon structurelle, des freins à la valorisation de la ressource « noble » française
Alors que le bois a longtemps disposé d'un monopole de fait sur l'ameublement, d'autres matériaux sont peu à peu venus concurrencer ce matériau.
Selon Jean-Pascal Archimbaud, président de la Fédération nationale du bois, « le bois feuillu, historiquement utilisé pour l'ameublement et le parquet, a vu ses débouchés se réduire, notamment sous l'effet d'un basculement vers des produits composites. Le meuble, autrefois constitué de bois massif, s'est transformé : on y trouve désormais de moins en moins de bois, remplacé par du verre, de l'aluminium ou du plastique. Ce bouleversement du marché a conduit à un rétrécissement des débouchés, et nos outils industriels ont dû s'adapter à la pression de la compétitivité, de la productivité et aux exigences environnementales ».
Le meuble en kit a par ailleurs profondément bouleversé le marché du meuble bas de gamme et milieu de gamme (cf. partie 2 infra). Cela correspond, du reste, à l'évolution des modes de vie.
Comme l'a indiqué Mme Anne Duisabeau, présidente de France Bois Forêt, devant la commission des affaires économiques, « le bois massif est plus onéreux que le panneau, c'est un sujet quand le pouvoir d'achat baisse et qu'il devient difficile d'acheter un meuble massif en chêne ou merisier, les gens achètent dans de grandes surfaces des meubles tout-venant qui auront une durée de vie moins importante, mais qui correspond à la mobilité et aux modes de vie d'aujourd'hui. Le bois massif a son avenir, mais comme un produit haut de gamme, c'est une niche qui a ses contraintes de coût mais qui a aussi ses réussites. »
Revêtement du sol en bois, relevant davantage de l'aménagement intérieur, et à ce titre plutôt rattaché à la construction qu'à l'ameublement, le parquet est lui aussi un produit signature de la filière bois, qui habille avec chaleur les intérieurs. Il a également connu une mutation importante, puisque le parquet en bois massif a dû faire de la place à deux autres grandes familles de parquets, qui diffèrent par la technique employée (parquet contrecollé, désormais majoritaire, et parquet mosaïque, résiduel). Tous types confondus, trois millions de mètres carrés s'en vendent chaque année en France.
Alors que 85 % environ des lames en bois massif utilisées pour le décor des parquets contrecollés sont en chêne, et que la France dispose d'une forêt aux deux tiers feuillus, les entreprises françaises du secteur importent leur ressource de grandes futaies d'Europe balkanique ou orientale, principalement de Croatie, de Roumanie, mais aussi de Pologne et auparavant d'Ukraine. Selon eux, ce choix n'est pas dicté par des raisons de coûts - car les coûts de transport rendent ces bois importés plus chers que le bois français - mais en raison de leur qualité.
En sens inverse, une part de la ressource française est exportée en Chine pour y être transformée avant de revenir, réimportée, sous forme de produits pas nécessairement bas de gamme, et parfois même vendus à des prix très élevés.
Cette configuration, qui voit la France positionnée sur les segments de la fourniture de matière première et de la commercialisation, mais pas sur celui « ennoblissant » de la transformation, a défrayé la chronique au milieu des années 2010 et a présidé à la mise en oeuvre du label « transformation UE » puis au renforcement de la contractualisation sur le chêne dans les forêts publiques et au-delà.
Parquet, meuble : le goût de l'ailleurs ?
De nombreux motifs de parquets existent, témoignant de l'histoire longue et raffinée de ce revêtement, en particulier en France.
Source : L'Ameublement français
Il s'observe pourtant une incapacité croissante de la filière bois française à valoriser la ressource forestière feuillue présente sur le territoire national à des fins d'ameublement et d'aménagement intérieur.
M. Sylvain Angerand de l'association Canopée évoque certaines évolutions des goûts peu favorables à la valorisation de bois massif, par exemple le développement des lames plus larges de parquet, qui sont par nature plus difficiles à produire en masse que les lames plus fines, à plus forte raison si les consommateurs désirent des bois sans noeuds pour des raisons d'apparence.
L'évolution des goûts en faveur de bois plus clairs, plus souvent issus de résineux, a également pu jouer dans le sens du déclin de la valorisation du feuillu en produits d'ameublement. Il convient cependant de rappeler que l'ameublement avait déjà recours par le passé à des bois d'importation, exotiques, tels que le teck ou le palissandre, prisés pour l'ameublement haut de gamme, et dont la vente est désormais interdite. Le bois de manguier est aujourd'hui à la mode.
2. Des difficultés d'approvisionnement en panneaux pour le parquet contrecollé et l'ameublement
S'inscrivant dans le mouvement général de rationalisation des instances de la filière, les fabricants français de parquet, auparavant réunis dans l'organisation ad hoc parquetfrançais.org, sont désormais représentés par la commission « parquets » de la Fédération nationale du bois. Ils restent toutefois disjoints des fabricants de panneaux, l'Union des industries de panneaux de process (UIPP) ayant intégré l'Ameublement français en 2022. La mission d'information a choisi d'entendre tous ces acteurs au cours d'une même audition.
À l'instar, on le verra, de nombreux segments de la filière bois étudiés au fil des travaux de la mission, la question de l'articulation avec les étapes antérieures de transformation du matériau bois est en effet cruciale.
À l'image de la construction bois elle-même, force est de reconnaître que le parquet compte aujourd'hui, parmi ses principales composantes, de plus en plus de panneaux et non plus seulement du bois massif.
Alors que la ressource feuillue est présente et même exportée pour être transformée, les fabricants français de parquet déplorent des difficultés d'approvisionnement s'agissant du parquet contrecollé*, qui intègre des panneaux et deux lames de bois « noble » dans sa fabrication.
Or, les fabricants jugent difficile sinon impossible de se fournir en panneaux d'origine française. Ainsi, un seul acteur en France, l'entreprise autrichienne Kronospan, implantée dans l'Yonne et en Saône-et-Loire, produit des panneaux de fibres à haute densité (HDF, pour High-Density Fiberboard), qui représentent les volumes les plus importants pour ce type de parquet. Les parquetiers admettent devoir s'approvisionner à l'étranger pour les panneaux de fibres à densité moyenne (autrement appelé medium ou MDF, pour Medium-Density Fiberboard).
Sans doute un approfondissement de l'intégration verticale, en particulier entre première et seconde transformation (respectivement scieries et usines à panneaux), permettrait-il des gains de compétitivité et accroîtrait la part d'approvisionnement en panneaux français. Le think tank I4CE a mis en évidence dans une étude de 2023 que cette organisation industrielle était monnaie courante en Allemagne, permettant de réduire les coûts de transaction et de transport.
Cette même étude met en évidence la chute de la fabrication de panneaux en France depuis 2010, la France étant passée derrière la Roumanie en termes de volumes produits de panneaux et d'isolants.
La faiblesse de la France sur ce maillon est certes ancienne : M. Archimbaud a rappelé en audition l'histoire de ces « usines de panneaux réunies sous l'enseigne ROL, Rougier, Océan, Landex, partiellement cédées à un industriel autrichien, Egger, aujourd'hui leader européen, tandis que l'autre partie a été vendue à son voisin autrichien Kronospan, devenu lui aussi un géant du secteur ». Pour autant, c'est d'autant plus regrettable que la filière de la fabrication de panneaux est vertueuse, en ce sens qu'elle permet « d'allonger le stockage de carbone des ressources de type Bibe, les panneaux présentant une durée de vie équivalente à celle des sciages lorsqu'ils sont utilisés dans la structure des bâtiments, et une durée de vie toujours plus longue que celles du papier et du bois énergie quand ils sont utilisés dans des ouvrages non structurels (aménagement intérieur, revêtement des sols et des murs ».
Une meilleure articulation avec la filière vertueuse du panneau serait de bon aloi. Dans ce but de retenir la valeur ajoutée et de diversifier l'activité des scieries, il serait pertinent d'intégrer autant que possible, et sans complexification, dans les dispositifs de soutien public à la filière, des critères d'intégration verticale de la filière, afin de renforcer l'articulation amont-aval et de réduire les coûts de transaction entre première et deuxième transformation. La mise en place d'une provision pour investissements pourrait donner le prétexte à l'introduction d'un tel critère (cf. infra, recommandation n° 12).
3. Redescendre le long de la pente de la valeur ajoutée pour éviter de toucher le fond
Responsable du deuxième déficit commercial de la filière derrière le papier, le carton et les pâtes à papier, avec plus de 3 Md€ de déficit annuel, le segment de l'ameublement est fragilisé de longue date par la concurrence de l'Asie de l'Est (Chine, Vietnam), pour des raisons aisément compréhensibles de coûts de production, s'agissant d'une production relevant de longue date de l'industrie manufacturière.
Ce secteur (literie, étagères, tables, chaises...) ainsi que celui de l'aménagement intérieur (parquets, cuisines...) ont par ailleurs connu de profondes mutations sur les quarante dernières années, sous l'effet d'une innovation pourtant assez simple, venue de Suède : les produits livrés en kit. Il en résulte que des pays comme la République tchèque ou encore la Roumanie sont devenus des acteurs majeurs de ce secteur.
Mme Anne Duisabeau, présidente de l'interprofession France Bois Forêt, a confirmé que « le secteur du meuble, profondément transformé au cours des vingt dernières années, a connu une réindustrialisation marquée en Europe centrale. Aujourd'hui, les importations proviennent à la fois d'Europe et du grand export. Le déficit y est structurel et spécifique. »
En effet, les graphiques fournis par la filière ameublement laissent à voir un effondrement des parts du meuble « fait en France » sur le marché domestique, passées de 77 % en 1999 à 37 % en 2024 - des chiffres qui ont stupéfait les rapporteurs. Non seulement les importations ont été multipliées par 2,5, mais la production a été divisée d'autant. C'est le reflet d'une désindustrialisation accélérée.
Or, selon le rapporteur Serge Mérillou, il existe des seuils critiques en dessous desquels le risque est de ne pouvoir se redresser, de façon définitive.
Évolution de la part de meuble français sur le marché domestique
Source : L'Ameublement français
S'ajoute à cette tendance de long terme un contexte économique peu porteur à court et moyen terme, l'ameublement et le parquet étant dépendants des cycles de la construction. Le marché du parquet est en attrition depuis la crise liée au Covid-19 (cf. graphique infra).
Bpifrance, qui a aidé plusieurs entreprises de ce segment de l'ameublement/agencement dans le cadre du deuxième fonds bois au milieu des années 2010, constate qu'il est aujourd'hui très mal en point, avec des procédures collectives à signaler. De nombreux acteurs de la filière entendus par la mission ont parlé de ce secteur en des termes assez fatalistes, jugeant que l'ameublement français était « fini », déjà un « souvenir » ou du moins un segment voué à péricliter, pour lequel il serait peine perdue de lutter.
Les rapporteurs ne sont pas de cet avis : ils ne se résolvent pas à la fin du « fait en France » sous les assauts de la concurrence internationale. Ils rappellent que quelques entreprises familiales ont su se démarquer sur des segments spécifiques. La France garde une bonne position, par exemple, en matière de literie. Elle compte des cuisinistes, notamment le groupe Fournier Habitat en Savoie (Mobalpa, Perene, SoCoo'c), ou Schmidt Groupe en Alsace (Schmidt, Cuisinella), positionnés sur toutes les gammes, avec une plus-value reconnue en matière de personnalisation de leur offre et d'accompagnement du client.
Une entreprise alsacienne, Alsapan, la seule en France à fournir la multinationale Ikea, produit les panneaux pour la commercialisation par l'enseigne de deux millions de dressings de la référence « Pax ». Elle montre que la France peut soutenir la concurrence et s'est par ailleurs diversifiée dans le parquet.
S'agissant précisément des parquets, l'activité de certaines marques coeur de gamme (Berrywood) témoigne de ce que la France n'est pas condamnée à rester cantonnée sur le très haut de gamme (à l'exemple des parquets Beausoleil, disposés à Versailles ou dans l'haussmannien)
Par ailleurs, le modèle italien, se caractérisant par un tissu d'entreprises industrielles dense dans le nord du pays et un sens aigu du design et du marketing (salon du design à Milan), doit nous inspirer. L'Italie est parvenue à se faire une place dans le marché de l'ameublement, sans rester limitée au seul très haut de gamme, puisqu'elle est aussi présente dans le milieu-haut de gamme.
Ce sont autant de témoignages du fait que reconstruire une filière française de l'ameublement est tout à fait possible, si elle lutte à armes égales avec la concurrence européenne et internationale.
4. Un phénomène plus récent de dumping chinois, destructeur pour une filière désarmée
Paroxysme d'une longue descente aux enfers pour la filière ameublement, à l'image de ce qu'a pu connaître par le passé l'industrie textile, un dumping de la fast déco des places de marché chinoises s'est accentué dans les années récentes. Après la chute au cours des années 2000 et le plateau du début des années 2010, les parts de marché françaises se sont de nouveau dégradées depuis 2020, et plus encore depuis 2024 sous l'effet du dumping de la fast déco chinoise. Cette pratique commerciale déloyale induit une hausse immédiate des importations depuis la Chine ainsi que, plus grave, une baisse, à moyen terme, des capacités de production françaises, par un effet d'éviction durable (cf. graphique supra).
À dire d'experts, cela répond à une stratégie délibérée des autorités chinoises, dans le cadre d'une volonté de conquête industrielle dans un certain nombre de secteurs jugés critiques. À cette intention, pourrait s'ajouter rapidement un effet de déport des marchandises chinoises aujourd'hui exportées vers les États-Unis, la fermeture de ce dernier marché risquant d'accentuer encore le problème.
Les fabricants de parquets ont été les premiers, au sein de la filière bois, à s'organiser et à déposer en 2024 une plainte antidumping au titre du règlement 2016/1036 dit « antidumping », sur le parquet multicouche (multilayered wood flooring). Il a été d'autant plus facile de démontrer le dumping que les produits chinois étaient vendus à 80 % du prix de la matière première... qui partait de France.
Des droits compris entre 26 et 37 % (alors que 46 % étaient attendus) sont donc actuellement appliqués aux produits chinois, ce qui ne semble toujours pas suffire à compenser le différentiel de prix de vente. L'organisation parquetfrançais.org avait lancé une labellisation concernant une douzaine d'entreprises, mais force a été de constater que le prix de vente est resté le facteur prédominant pour les consommateurs.
C'est désormais l'ameublement qui est victime de ce même dumping. Ainsi, un meuble à chaussures repéré par L'Ameublement français sur la place de marché chinoise Temu, coûtait seulement... 9,12 €. Très proche dans son esprit et dans ses procédés du phénomène de fast fashion, la « fast déco » pose dans son modèle économique même des problèmes de durabilité - a ainsi été rapportée la livraison de chiliennes (des chaises de jardin), réitérée d'une année sur l'autre pour les mêmes personnes, les clients faisant valoir la garantie plusieurs fois de suite, en raison de produits systématiquement défectueux. Cela induit en outre des risques pour la sécurité - les non-conformités ayant été démontrées par l'institut technologique FCBA après des tests en laboratoire.
En désespoir de cause, la filière de l'ameublement français et les grandes surfaces de bricolage (GSB) en sont venues à échafauder une proposition consistant à autoriser le déblocage d'une partie des dépôts sur un plan-épargne logement (PEL), à hauteur de 10 000 € pendant deux ans, dans l'idée qu'en débloquant des sommes potentiellement plus importantes, les consommateurs s'inscriraient dans une démarche non de consommation, mais d'investissement, et donc d'achat plus durable et responsable, avec plausiblement plus de chances d'acheter français.
Une option qui, de l'aveu même de la filière, n'aurait que de faibles effets, d'autant qu'il n'est en rien garanti que cet argent débloqué irait réellement au « fait en France » dans la mesure où il n'est pas possible au regard du principe européen de non-discrimination de cibler les seuls produits faits en France - à plus forte raison que la caractérisation de l'origine d'un meuble, un produit composé, ne va pas de soi.
Recommandation n° 3 : à court terme, mettre sur pied des mesures d'urgence pour temporiser sur la concurrence déloyale des places de marché chinoises en :
- accroissant la pression de contrôle et en entretenant par des campagnes de communication un bruit de fond négatif sur les non-conformités de la « fast déco » chinoise ;
- s'assurant de l'application de frais de gestion de 2 € par colis d'une valeur inférieure à 150 € ;
- pérennisant l'écocontribution visible pour l'ameublement au-delà du 31 décembre 2025, afin de lutter contre la fraude à l'écocontribution sur les produits importés.
À moyen et long terme, il convient d'aider la filière de l'ameublement européenne à se coordonner. Plusieurs difficultés se cumulent :
Ø d'abord, comme pour le parquet, le caractère d'entreprises familiales de nombre des acteurs du secteur ne facilite pas la coordination, a fortiori avec des entreprises d'un autre pays. Or le règlement européen antidumping prévoit un seuil minimal d'éligibilité des plaintes fixé à 25 % de la production totale du produit concerné dans l'UE ;
Ø ensuite, il ne semble pas évident de rallier les producteurs allemands, moins compétitifs sur le segment de l'ameublement que sur d'autres segments de la filière bois, à la démarche française. L'audition de l'administration et des professionnels allemands a montré leur grande prudence quant à la perspective de mettre en place des droits antidumping, compte tenu de la forte extraversion de l'industrie du bois allemande, très dépendante des exportations vers le reste du monde et en particulier vers les États-Unis ;
Ø enfin, s'agissant en particulier de l'ameublement, un obstacle vient de ce que l'appréciation du dumping doit se faire au niveau du seul « produit concerné » (art. 4), ce qui imposera de monter un dossier pour chaque produit (table, chaise, bureau, étagère), voire à un niveau potentiellement encore fin.
Des guides à l'intention des PME sont disponibles, et la difficulté technique à monter un dossier antidumping peut être surmontée par l'appui de cabinets d'avocats spécialisés. Cependant, les entreprises de la Fédération européenne du parquet (FEP), qui ont suivi la procédure, indiquent que le coût de la démarche en plus du temps consacré aux différents audits (des comptes et sur place) de la Commission européenne ont davantage constitué un obstacle.
Si des mesures provisoires peuvent être déclenchées dans les sept mois après le déclenchement d'une enquête, il est à déplorer qu'elles ne soient pas plus automatiques, sur le modèle de « clauses de sauvegarde », quitte à ce que le secteur à l'initiative de la plainte rende des comptes par la suite en cas de plainte infondée. Le niveau de ces droits, qui sont à l'appréciation de la Commission, devrait par ailleurs pouvoir être plus dissuasif.
Recommandation n° 4 : accompagner l'ameublement français et européen pour riposter à la concurrence déloyale des places de marché chinoises :
- à moyen terme, en aidant le secteur de l'ameublement français à se coordonner avec ses homologues européens par des actions diplomatiques, et à démontrer l'existence d'un dumping, au besoin par un appui technique de l'administration pour le montage du dossier de plainte ;
- à long terme, en modifiant le règlement dit « antidumping » pour permettre son application à une typologie de produits au-delà de l'appréciation du dumping au niveau du seul produit et faciliter la mise en place de mesures provisoires dès l'ouverture d'une enquête.
C. PALETTE, CARTON, PELLETS : TROIS USAGES DU BOIS ET AUTANT DE LEVIERS DE RELOCALISATION ET DE SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE
1. Palette : un levier mésestimé de contrôle de la chaîne logistique et de souveraineté industrielle pour la France
a) De bonnes performances commerciales de la France sur cet usage du bois coeur de gamme
(1) Un secteur très concurrentiel dans laquelle la France maintient 75 % d'autoapprovisionnement
À la différence des secteurs de l'ameublement et de la papeterie, la France enregistre de bonnes performances commerciales sur le segment coeur de gamme qu'est l'emballage bois.
Le secteur, qui représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, se répartit entre trois sous-segments : la palette (plus de 2 Md€), l'emballage industriel (600 M€) et enfin l'emballage léger (un peu plus de 300 M€). Au total, près de 18 000 ETP, sur l'ensemble du territoire, et pas moins de 25 % des sciages réalisés chaque année en France (200 Mm3 de bois) seraient liés à cette activité, pourtant peu visible dans le quotidien des Français.
Sur environ 200 millions de palettes sur le marché en France, près de 150 sont fabriquées neuves ou reconditionnées en France, environ 50 étant importées, notamment d'Europe de l'Est (y compris de l'Ukraine jusqu'à un passé récent).
Ces chiffres peuvent s'interpréter comme le témoignage de ce que le maintien d'un tissu industriel dans la fabrication de masse sur un marché européen très compétitif, de « centimiers », reste possible.
La répartition des coûts de revient entre la palette neuve et la palette reconditionnée diffère assez largement :
- pour la palette neuve, environ 70 % du coût est lié à la matière première - essentiellement des résineux, mais également souvent du peuplier, notamment pour le dé des palettes -, 20 % à la main-d'oeuvre et le reste aux charges annexes (fiscalité, assurance, etc.) ;
- pour la palette reconditionnée, le poids de la matière première tombe à 20 ou 30 % des coûts, tandis que la main-d'oeuvre en vient à représenter 50 % des coûts.
(2) Un segment qui a su trouver sa place dans la filière bois malgré un manque de considération et des tensions sur l'approvisionnement
L'activité de fabrication de palette s'est développée en France quand bien même elle a longtemps été perçue comme le « parent pauvre de l'industrie du bois et du sciage » voire, comme va jusqu'à le dire Jean-Pascal Archimbaud, président de la Fédération nationale du bois et lui-même un des premiers fabricants de palettes en France, comme un « métier de `beauf', pas très noble ». Ce défaut de considération se retrouverait dans les cahiers des charges des appels à projets successifs depuis 2020, qui auraient peu bénéficié au bois d'industrie et, plus spécifiquement, aux entreprises fabriquant de la palette, les pouvoirs publics misant davantage sur le bois d'oeuvre et son coproduit, le bois-énergie, qui ne représente que 15 à 20 % des sciages en France.
Les performances de la France en matière de fabrication de palette ont-elles pour revers nos médiocres performances en matière de valorisation de la ressource de qualité bois d'oeuvre ? À en croire le scieur Pierre Piveteau, spécialisé dans la construction, les bonnes performances commerciales de la France en matière de palettes pourraient bien être aussi le reflet de trop faibles performances en matière de production de bois pour la construction. Il s'agirait selon lui de la contrepartie d'un retard de la France par rapport à l'Allemagne sur les bois techniques de construction (ossature bois, lamellé-collé, etc.) utilisés dans la construction, que la France gagnerait à développer davantage que le bois d'emballage, pour capter plus de valeur ajoutée sur le territoire national. Le think tank I4CE considère également que « la diversification des ressources mobilisées pour les emballages, en utilisant aussi des résineux de petit diamètre et des feuillus, permettrait de libérer des résineux de diamètre moyen pour des usages à plus longue durée de vie ».
La rapporteure Anne-Catherine Loisier rappelle toutefois que ni les propriétaires ni les scieurs n'ont d'intérêt économique à sous-valoriser des ressources d'une telle qualité. Aussi, à ses yeux, le rôle de l'Office national des forêts dans la commercialisation prémunit la forêt publique - domaniale et communale - de tels mésusages de la ressource. La petite propriété forestière, surtout dans les régions où il n'y a pas suffisamment de volumes récoltés pour les intégrer à des contrats d'approvisionnement (par exemple dans le Grand Ouest), pourrait cependant davantage être exposée à ce risque.
Les progrès dans la contractualisation pourraient remédier à cet écueil, et permettraient aussi de sécuriser les approvisionnements des entreprises. La scierie Feidt de Molsheim, visitée par les rapporteurs, a mentionné cette problématique comme étant la plus contraignante pour son développement. L'achat de bois des Vosges par la concurrence allemande, mais aussi le développement de projets de bois-énergie, engendreraient une pression sur les bois de moindre qualité, qui peuvent être achetés à très bon prix pour des usages pourtant moins longs. Ainsi, une sorte de cascade des usages inversée se mettrait en place, qui pourrait expliquer le recours à des bois de meilleure qualité.
b) Trois atouts dans la fabrication d'emballages et notamment de palettes, dont il convient de tirer pleinement parti
(1) Un maillon essentiel de la chaîne logistique et donc un levier de souveraineté
Omniprésente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le quotidien des entreprises - 90 % des marchandises transportées dans le monde le sont par palettes -, la palette représente 70 % de l'activité de l'emballage en France.
Il s'agit d'un maillon essentiel de la chaîne logistique, et notamment de la chaîne logistique des produits de première nécessité, dont le caractère stratégique est sans doute sous-estimé, car peu visible. Un exemple caractéristique est celui du statut administratif des palettes lorsque les activités économiques ont été mises à l'arrêt durant la pandémie de Covid-19 : un camion de palettes avait été arrêté au motif que la cargaison n'entrait pas dans la catégorie des produits essentiels, alors que ces palettes étaient destinées... au transport de gel hydroalcoolique. Au-delà de cet exemple ponctuel, la palette est un élément clé pour le transport des productions des industries agroalimentaires.
(2) Un exemple abouti d'intégration verticale et de diversification de l'activité des scieries
À la différence, par exemple, de celle des panneaux, la fabrication d'emballages bois et notamment de palettes a souvent directement lieu sur le site des scieries. Cette intégration verticale permet aux scieurs de capter plus de valeur ajoutée (par exemple en mettant en place des lignes de cloutage) et surtout de réduire les coûts liés aux intermédiaires ou au transport, ce qui est crucial dans cette activité très concurrentielle. Ainsi, 80 % des fabricants de palettes neuves maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur, un certain nombre d'entre elles ajoutant même à leur activité de sciage-palette celle de l'exploitation forestière - c'est le cas par exemple, dans le domaine de l'emballage industriel, de la société NS Gerbois en Haute-Saône.
Témoignage de cette intégration, c'est désormais la Fédération nationale du bois (FNB) et plus particulièrement sa commission emballage qui représente les deux sous-segments de la palette et de l'emballage léger. Pour les emballages industriels (caisserie), le Syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée (Seila) reste, lui, indépendant.
Cette maîtrise d'un segment de plus de la chaîne de valeur permet d'abord aux scieries concernées, souvent de taille moyenne - moins de 50 employés, moins de 20 000 m2 de bois scié, 5 à 10 M€ de chiffre d'affaires - de capter un peu plus de valeur ajoutée, quand bien même le prix moyen d'une palette ne se situe qu'autour de 12 euros.
Elle est également source de progrès dans le rendement matière (taux de planche à partir d'un bois rond) et permet, autrement dit, de faire plus de planches avec moins de bois.
Cette maîtrise est aussi source d'innovation. Outre le marché de la palette standard, aux marges réduites car très concurrentiel, le produit étant écoulé dans le cadre d'appels d'offres européens, les entreprises françaises ont beaucoup investi le sur-mesure (tailles et caractéristiques spécifiques) pour répondre aux attentes de clients. La relation humaine établie entre le fournisseur de palettes et l'industriel qui en a l'usage est, dans ces marchés de niche, un élément plus important. 'Ce lien de confiance tranche avec les relations avec les gros donneurs d'ordre, qui ne respectent pas toujours la loi de modernisation de l'économie sur les délais de paiement, entraînant des problèmes de trésorerie récurrents pour les fournisseurs concernés.
Scieries - emballage bois : mêmes combats
Les fabricants d'emballages industriels étant en grande majorité des scieurs, ils sont par ailleurs confrontés aux obstacles auxquels fait face la première transformation (cf. infra, partie III) : coût de l'énergie, difficultés d'assurabilité des sites de production, normes environnementales et de sécurités aux coûts prohibitifs demandées par les Dreal, problèmes d'accès au financement pour des investissements très capitalistiques. Au sujet des normes incendie, la famille Feidt, à Molsheim, dont la scierie a pourtant subi un incendie au début des années 2000, s'est montrée particulièrement affectée par les obligations anti-incendie jugées disproportionnées qui leur ont été imposées pour l'un de leurs entrepôts de stockage de bois (mur anti-incendie).
Les conflits de voisinage - poussières, bruits - sont une problématique récurrente, pour des groupes qui se sont bien souvent développés à partir de petits ateliers de sciage ou de rabotage au coeur de villages. La scierie Lamarque, dans le Lot-et-Garonne, a connu une fermeture administrative de six mois pour nuisances sonores en 2023.
(3) Une filière pionnière du réemploi, du reconditionnement et du recyclage
En matière de réemploi, une palette peut être réutilisée jusqu'à sept ou huit fois, ce qui allonge d'autant sa durée de vie et réduit considérablement son empreinte carbone.
Cela fait par ailleurs plus de trente ans que les palettes sont reconditionnées. Cette opération désormais bien maîtrisée par la filière permet de réduire les coûts de revient et d'amortir sur une durée plus longue les coûts de fabrication. 70 % des palettes mises sur le marché sont réemployées (réparées ou recyclées).
La filière est aussi vertueuse sur le plan du recyclage. À titre d'exemple, les dés - partie centrale de la palette - peuvent être constitués de bois aggloméré, permettant d'utiliser de la matière pouvant sinon être destinée à des usages énergétiques.
Une responsabilité élargie du producteur « emballages industriels et commerciaux » est entrée en vigueur en 2025, mais elle semble moins poser de difficultés à la filière que la REP produits et matériaux de la construction et du bâtiment.
Il y aurait déjà en effet 20-25 % de bois recyclé en moyenne dans une palette (dans le dé en particulier).
Le prix moyen d'une palette recyclée serait autour de 6 euros, soit deux fois moins cher qu'une palette neuve.
2. Papier, carton : relocaliser la papeterie, premier poste de déficit commercial en produits bois, qui a entamé une transformation vertueuse
a) Une industrie internationalisée, qui procède à des arbitrages sur les choix de localisation en prêtant attention aux coûts de production, notamment de l'énergie
(1) Une industrie à capitaux étrangers, dans laquelle la France est très déficitaire
Les papetiers ne sont pas représentés au sein de l'interprofession France Bois Forêt, mais disposent de leur propre organisation, Copacel. Au sein de la filière bois, les acteurs ont une nette conscience que ce secteur est détenu en majeure partie par des capitaux étrangers et ne manquent pas de le rappeler, pour souligner qu'elles répondent à des logiques différentes des scieries, plus financières, moins ancrées dans les territoires.
En audition devant la commission des affaires économiques, le président de la Fédération nationale du bois a rappelé les circonstances historiques ayant conduit au passage sous pavillon étranger de plusieurs sites, avec l'exemple des papeteries de Facture et de Tartas, nationalisées en 1981 et placées sous l'égide de Saint-Gobain, avant que cette branche papetière, non viable, soit « vendue à un petit groupe irlandais, Smurfit, qui est devenu aujourd'hui un leader européen du papier-carton. [...] Ainsi [avec ce secteur et celui du panneau], nous avons perdu la maîtrise d'une part essentielle de notre industrie lourde de transformation du bois, celle qui valorise les bois de trituration, les bois secondaires et les plaquettes de scierie. »
Le secteur des pâtes à papier, papiers et cartons représente, devant celui de l'ameublement (- 3,5 Md€), le principal poste de déficit commercial pour les produits fabriqués à base de bois, avec en 2023 un solde négatif de 4 Md€. Depuis de nombreuses années, c'est donc, à lui seul, près de la moitié du déficit commercial total de la filière, et environ 4 % du déficit commercial de la France. La France est importatrice nette de pâte vierge, mais aussi de produits finis (papier blanc, papiers techniques, papiers hygiéniques, emballage).
En l'espèce, ce n'est pas tant parce que l'industrie papetière française était trop propre qu'elle n'était pas parvenue à maintenir sa production sous pavillon français. Elle demeurait alors, en France et ailleurs, une industrie lourde, très consommatrice en ressources naturelles. C'est plutôt que l'industrie papetière s'est, depuis lors, et majoritairement en dehors du territoire national, considérablement transformée - coproduction d'énergie, utilisation de matière première recyclée - pour devenir plus propre. Elle continue par ailleurs de représenter plus de 60 000 emplois. Cela rend pour la France la relocalisation de la papeterie d'autant plus stratégique.
(2) Une attention portée à l'attractivité du site de production France en général et à l'énergie en particulier
Le commerce international est limité par le coût du transport, qui représenterait rapidement une part disproportionnée des coûts de revient - la papeterie étant une industrie de volume et de « centimier », davantage qu'une industrie à haute valeur ajoutée. Le déficit de la France provient donc de ses échanges intra-européens et notamment avec l'Allemagne. Cela souligne d'autant plus cruellement le défaut de compétitivité du site de production France.
L'industrie papetière étant très capitalistique et très concentrée (79 sites en France, cf. cette carte), elle prête une attention marquée aux coûts de production, et procède donc à des arbitrages réglementaires.
Source : Copacel
Les industries à forte intensité énergétique - dont les usines de pâte et de papier - sont dans le coeur de cible du Clean Industrial Deal publié en février 2025, visant à la relocalisation industrielle, notamment par une simplification des autorisations environnementales. Elles sont également dans le coeur de cible d'opérations telles que Choose France, l'enjeu de ce secteur n'étant pas tant la densification du tissu industriel que l'attractivité d'un grand site de production.
L'énergie représente une part non négligeable du coût de revient d'une tonne de pâte, en particulier pour les sites qui sont alimentés par du papier recyclé. La fin programmée de l'Arenh était donc un motif d'inquiétude pour la filière. Son remplacement par le Contrat d'approvisionnement pluriannuel nucléaire (CAPN), ciblant les électro-intensifs à partir du 1er janvier 2026, est de nature à donner de la visibilité aux investisseurs, qui comparent la situation française à celle de l'Allemagne ou de la Belgique.
Recommandation n° 5 : définir un cadre post-Arenh attractif pour la compétitivité énergétique du site de production France en général, et des papeteries et usines de pâte à papier en particulier.
b) Une industrie lourde qui a connu plusieurs transformations vertueuses de ses procédés et est devenue multiproduit
(1) Une industrie lourde devenue exemplaire en matière de coproduction d'énergie
Visitée par les rapporteurs, l'usine Blue Paper est désormais un producteur d'énergie à part entière. Depuis 2019, alimente 100 % de son séchage vapeur en combustibles issus de ses propres déchets, remplaçant deux chaudières gaz, qui ne sont maintenues que par sécurité. Elle dispose d'une unité de méthanisation, d'une unité de cogénération.
Ce modèle permet à la fois de réduire les coûts de revient, mais il comporte également des cobénéfices en termes climatiques, comparé à l'utilisation du gaz.
Par ailleurs, les résidus de la fabrication de papier (liqueurs noires, refus de criblage, boues) font l'objet de recherches pour leur valorisation, en tant que coproduit, en usage énergétique (recherches sur des carburants d'aviation du futur valorisant ces déchets).
(2) Des usages tirés par le carton d'emballage, au risque bientôt de surcapacités ?
L'industrie papetière est, aujourd'hui plus que jamais, multiproduit : cartons plats, papiers pour emballage souple, papiers pour ondulé, papiers d'hygiène, papier journal, papiers d'impression-écriture, papiers industriels et spéciaux, pâtes de cellulose.
Depuis les années 2000, la croissance du e-commerce a soutenu la croissance des emballages et du conditionnement, qui représentent aujourd'huiun tonnage consommé 2,5 fois plus élevé que celui des papiers graphiques.
Source : rapport statistique 2023 de Copacel
L'usine Stracel (Strasbourg Cellulose), rachetée par un Belge et un Allemand pour être renommée Blue Paper, a fait l'objet d'une conversion totale de sa presse, passée en 2013 du papier magazine au papier pour ondulé (PPO) - la couche interne comme les couches externes étant fabriquées à peu de choses près selon le même procédé.
Dans ce cas, de façon intéressante, la production est verticalement intégrée, puisqu'à peu près 40 % de la production de papier pour ondulé sur ce site est destiné à l'approvisionnement des deux groupes actionnaires de l'entreprise. Pour autant, ces sites de cartonnage sont situés en Belgique et en Allemagne, et non France, ce qui témoigne de la difficulté à soutenir la concurrence sur l'ensemble des maillons de la chaîne.
Par ailleurs, la conversion d'une machine de l'usine Norske Skog de Golbey dans les Vosges en 2025 fait craindre aux acteurs établis le risque de surcapacités dans la région, avec la possibilité d'une baisse du prix de vente.
(3) Une filière qui s'approvisionne désormais aux deux tiers en papier recyclé, pour un tiers seulement de bois
En 2024, deux tiers des fibres utilisées par l'industrie française proviennent de papiers-cartons recyclés (PCR), soit davantage que la moyenne européenne. La filière papetière s'est donc, en apparence, en grande partie extraite de la filière, de ses problématiques d'approvisionnement et de flux matière.
Elle dépend de deux responsabilités élargies du producteur (REP), l'une sur les emballages ménagers, l'autre sur les papiers graphiques, qui ont depuis 2023 fusionné, une nouvelle devant bientôt s'ajouter (textiles sanitaires à usage unique).
Pour autant, le tiers restant tient une place importante dans la filière. Ainsi, le rayon d'approvisionnement de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, s'étend sur une grande partie de la France. Sa mise en redressement judiciaire, en 2020, suscitant les craintes de nombreux propriétaires forestiers, a montré la dépendance de la filière à une telle usine pour la valorisation du petit bois, destiné à la trituration.
En outre, pour les sites alimentés en fibre vierge, le coût de revient reste dépendant à 70 % du coût de la matière première, c'est-à-dire du bois. C'est ce qui explique qu'historiquement les papeteries exerçaient également des activités d'exploitation forestière, comme l'entreprise Sylvamo dans le massif des Landes de Gascogne. Dans le cas de la fibre vierge, la papeterie prête une attention particulière à la certification des parcelles dont est issu le bois.
3. Pellets : une solution réaliste, car peu onéreuse, de transition énergétique pour les ménages
a) Une fraction encore très réduite du bois énergie, qui combine économie circulaire et haut rendement énergétique
Matériau longtemps privilégié pour se chauffer (en atteste par exemple la pratique de l'affouage, remontant au Moyen Âge), le bois ou biomasse solide reste aujourd'hui en France la première énergie renouvelable dans un contexte où la chaleur (qui représente 45 % de la consommation d'énergie en France) demeure carbonée aux deux tiers.
Au total, 7 millions de foyers ont recours au chauffage bois individuel ainsi qu'un équivalent de 1 million de foyers en collectif (foyers ouverts, poêles à granulés ou à bûches, chaudières à granulés ou à bûches), à quoi il faut ajouter un développement important des usages par les entreprises ou les collectivités (unités biomasse dans l'industrie, réseaux de chaleur...), représentant désormais un tiers de la consommation primaire de bois énergie5(*).
L'usage énergétique du bois représente de loin la majeure partie des débouchés des 57 millions de m3 de bois prélevés par an en France (39 Mm3 de bois, soit 68 % de ce total selon le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan) si l'on additionne le bois énergie autoconsommé, échappant aux circuits de commercialisation (17 Mm3, soit 30 % du bois prélevé), les coproduits du sciage (10 Mm3, soit 18 %), le bois énergie prélevé pour être commercialisé en tant que tel (9 Mm3, soit 16 %) et les coproduits du bois d'industrie (3 Mm3, soit 5 %) (cf. graphique ci-dessous).
La tendance à la substitution du bois énergie autoconsommé (passé de 24 à 17 Mm3 par an) par le bois énergie commercialisé (passé de 3 à 9 Mm3 par an) est notable depuis le début des années 2000, signe d'une filière en voie de professionnalisation et de structuration (cf. graphique ci-dessous).
Source : Haut-Commissariat à la stratégie et au plan
Le bois peut être utilisé comme combustible sous trois formes :
Ø le bois bûche (commercialisé ou autoconsommé), qui représente environ deux tiers des volumes de bois énergie, essentiellement pour des usages domestiques ;
Ø les plaquettes forestières (ou bois déchiqueté), qui constitue entre un cinquième et un quart des volumes, essentiellement pour des usages dans le tertiaire ou l'industrie ;
Ø et les granulés (ou pellets), qui représentent environ un cinquième des volumes de bois énergie, pour des usages essentiellement domestiques - l'exemple britannique de conversions de centrales électriques du charbon à la biomasse, qu'il a été envisagé de suivre pour la centrale de Cordemais, a été écarté pour des raisons techniques (cf. partie III, infra).
Cette dernière technologie est en plein développement et demeure largement minoritaire, comparée notamment au bois bûche. Elle permet de valoriser des coproduits du sciage, qui sont compactés sous forme de granulés - selon une technique assez simple empruntée à la production de granulés pour l'alimentation animale. Elle a pour avantage d'être une énergie dense, avec un faible taux d'humidité, et donc un pouvoir calorifique important.
Il existe trois types de producteurs de granulés en France :
- les scieurs, qui ont pour avantage de disposer de la matière première (60 % du volume) ;
- les indépendants, qui se fournissent en sciure et copeaux au fil de l'eau (plus de 30 % du volume) ;
- les coopératives agricoles, hors saison agricole, afin d'optimiser le temps de fonctionnement de leurs machines destinées à l'aliment pour bétail (moins de 10 % du volume).
Une part importante de la production de granulés semble concentrée dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, dans lesquelles les sciages sont importants. Au total, vingt-deux sites présentent une production supérieure à 50 000 t de granulés en 2024, certains sites étant plus proches des 200 000 t (les deux sites de scieries Piveteaubois) ou de 100 000 t (les deux sites de scieries Archimbaud, le site de Brenil géré notamment par la scierie Fruytier).
Source : Propellet
Une décomposition approximative des coûts de revient des producteurs de pellets, fournie par Propellet, est la suivante :
- 50 % dans la matière première ;
- 20 % dans l'énergie ;
- 10 à 15 % dans le conditionnement des granulés ;
- et 15 à 20 % dans la main-d'oeuvre, l'amortissement et la maintenance.
Cette répartition peut cependant varier, principalement en fonction de deux facteurs : d'une part, l'évolution conjoncturelle du coût de la matière première et, d'autre part, la typologie des sites de production telle que présentée ci-dessus.
b) Une technologie à encourager, notamment en zone peu dense et en substitution aux appareils peu performants, au fioul ou au gaz
Pour son potentiel de substitution aux énergies carbonées et importées que sont le fioul et le gaz, le bois énergie en général et le pellet en particulier ont fait l'objet d'un soutien public important, au travers du fonds chaleur et de MaPrimeRénov'. Les appareils seraient par ailleurs davantage fabriqués en France que les pompes à chaleur.
Le bois énergie cumule ainsi plusieurs avantages, le premier d'entre eux étant son faible coût, de l'ordre de trois fois inférieur à l'électricité pour le pellet. De ce fait, il est une solution réaliste de transition énergétique pour les ménages, qui présente en outre un coût d'abattement de la tonne de CO2 réduit.
La rapporteure Anne-Catherine Loisier insiste sur le fait que les pompes à chaleur ne sont pas nécessairement une solution optimale dans tous les contextes du point de vue du pouvoir d'achat et de l'efficacité énergétique, notamment pour de grands bâtiments connaissant une forte amplitude de température.
Il s'agit en outre d'une source d'énergie flexible, pouvant être stockée, dont l'utilisation permet l'effacement des pointes de consommation électrique.
Après avoir fait l'objet d'un soutien public important au travers notamment de MaPrimeRénov', l'installation d'appareils de chauffage bois a subi en 2024, en huit mois, deux diminutions successives de ces aides, de 30 % chacune (c'est-à-dire de 50 % au total par rapport à la situation de départ).
Les rapporteurs conviennent que la mobilisation de l'outil EnR'Choix développé par l'Ademe devrait être systématisée pour établir, au cas par cas, quelle est la meilleure option.
En revanche, cette baisse des aides, qui s'explique par des considérations budgétaires mais également par des préoccupations des pouvoirs publics pour le bouclage biomasse (cf. partie III, infra), traduit aux yeux des rapporteurs une priorisation défaillante des projets de biomasse chaleur.
La baisse des aides MaPrimeRénov' est préjudiciable pour la filière, qui s'était organisée pour soutenir une demande croissante - les appareils sont en grande partie fabriqués en France -, car, comme elle l'indique, l'aide permet de « déclencher le geste de rénovation pour les ménages modestes et très modestes ». Il résulte de cette révision des barèmes que le bois est désormais désavantagé par rapport aux pompes à chaleur. Or, comme ces dernières, le bois affiche un coût d'abattement de la tonne de CO2 évitée très avantageux.
Deux critiques récurrentes ont cependant contribué à affaiblir le soutien public à la filière bois énergie. Il convient de les nuancer.
La première a, précisément, trait aux émissions de CO2 liées au bois énergie. Cette source d'énergie bénéficie d' une convention comptable en vertu de laquelle les émissions liées à la combustion du bois sont imputées au secteur Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCAFT) et non au secteur énergétique. Pour autant, l'efficacité énergétique du bois, même séché, est moins bonne que celle de combustibles fossiles.
Source : annexe au rapport Secten du Citepa (2020)
L'avantage majeur du bois énergie est que le carbone qu'il contient est dit « biogénique », par opposition au carbone « fossile », c'est-à-dire qu'il est produit par des cycles plus courts. Ainsi, bien que le puits de carbone forestier ait fortement diminué depuis 2010, et bien que 48 % du bois énergie soit issu de la gestion forestière (par opposition au bois bocager et aux coproduits de l'industrie ou au bois fin de vie), « la pertinence de la valorisation énergétique des bois issus d'éclaircies [...] est facilement démontrable, car il s'agit de co-produits de l'activité sylvicole », comme l'indique le Citepa. L'amélioration du rendement énergétique des nouveaux appareils a en outre pour conséquence de réduire progressivement les besoins en bois pour une même quantité d'énergie produite.
La seconde critique a trait à l'impact de la combustion du bois sur la qualité de l'air, qui a notamment été relayé par la presse.
Dans une note transmise aux rapporteurs, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) insiste sur le fait que les émissions de particules fines (PM2,5) et ultrafines (PM0,1) ont considérablement diminué pour les appareils commercialisés après 2012, par rapport aux foyers ouverts ou appareils d'ancienne génération. Ainsi, « les foyers ouverts et appareils de plus de vingt ans représentent 30 % du parc installé mais émettent près des trois quarts des PM2,5 », les appareils plus modernes émettant essentiellement des particules ultrafines, et seulement de façon résiduelle des particules fines.
Source : étude fournie par le Syndicat des énergies renouvelables
Ainsi, pour les acteurs du bois énergie, les préoccupations relatives à la qualité de l'air ne doivent pas être un prétexte à l'abandon du soutien à l'équipement en chauffage bois, mais doit au contraire conduire à accélérer le renouvellement des équipements actuels.
C'est fort de ces constats que les rapporteurs appellent à rétablir un soutien plus clair à la conversion des foyers ouverts et poêles à bois anciens, au profit d'appareils plus performants du point de vue de la qualité de l'air, en priorisant les dossiers portant sur des habitations en zone rurale, non raccordées aux réseaux, à enveloppe budgétaire constante.
Recommandation n° 6 : rétablir le taux normal de MaPrimeRénov' pour les appareils à pellets ou à bûche remplaçant du fioul, des foyers ouverts ou des appareils antérieurs à 2012 en zone rurale hors gaz.
II. DES DÉFIS TRANSVERSAUX À RELEVER POUR LIBÉRER L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS EN FRANCE
La première transformation du bois fait face à des défis transversaux, qui trouvent leur origine à la fois dans des maux classiques de la production industrielle en France et dans la multiplication de normes, spécifiques ou non ou à la filière bois française, qui désavantagent ou risquent de la désavantager par rapport à ses concurrents européens. Dans ce contexte, la modernisation de l'outil de production, impliquant de lourds investissements pour cette industrie très capitalistique, apparaît indispensable.
A. UN CADRE PEU INCITATIF EN FRANCE POUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN GÉNÉRAL ET CELLE DU BOIS EN PARTICULIER
1. Un cadre fiscal et réglementaire similaire à celui qui pèse sur l'ensemble de la production industrielle française
Le tableau décrit ici n'est pas très original et ne fera donc, par conséquent, pas l'objet de longs développements.
Le contexte réglementaire et fiscal dans son ensemble, le coin fiscalo-social trop élevé en particulier ou encore les impôts de production, font que l'économie française n'est pas propice à la production industrielle, comparée à ses voisins européens.
Ce poids est d'autant plus difficile à absorber pour les entreprises de la filière bois qu'il s'agit souvent de petites et moyennes entreprises (PME) ou d'entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Afin de libérer le potentiel productif du site France et de favoriser le bois en tant que matériau décarboné, les impôts de production restants, voire certaines cotisations sociales, pourraient basculer vers une taxation du carbone, en suivant l'exemple de ce qu'a fait la Suède il y a plusieurs décennies Cela constituerait un avantage relatif certain pour le bois, en tant que matériau peu carboné.
Pour aller plus loin, il faudrait plaider pour une extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) aux produits bois, ce qui suppose préalablement d'étendre le système d'échanges de quotas d'émission (SEQE) à ces mêmes produits bois. Cette proposition est nécessairement prospective, car ce serait une première que d'étendre ce mécanisme à des produits finis (et non à des matières premières). Il conviendrait également de demander pour l'inclusion dans ce mécanisme du contenu carbone lié au transport de marchandises, au-delà du seul contenu carbone de leur fabrication. Au total, le parquet transformé en Chine émet quatorze fois plus que le parquet fabriqué en France, en comptabilisant les émissions liées au transport et à la transformation, et aucun cadre ne vient compenser cet état de fait.
Par ailleurs, en France, à dépense sociale constante, les exonérations de cotisations sociales pourraient être recentrées ( rapport Bozio-Wasmer) sur les salaires intermédiaires et donc industriels (1,2 à 1,9 Smic), alors que la filière subit une pénurie de main-d'oeuvre dans les métiers du bois, mais aussi de la maintenance. Cela se justifie d'autant plus que ces emplois industriels sont, davantage que les emplois dans le commerce au niveau du Smic, soumis à la concurrence internationale.
L'ensemble des entreprises visitées par les rapporteurs ont cité la main-d'oeuvre comme l'une des principales composantes des coûts de revient. Dans les comparaisons avec l'Allemagne, est souvent revenue par ailleurs l'évocation de la réduction du temps de travail et des 35 h, génératrice de surcoûts pour les entreprises, d'autant plus que l'industrie, notamment de la deuxième transformation, tourne dans certains cas en « 3x8 ».
Recommandation n° 7 : Modifier le cadre socio-fiscal français et européen pour qu'il favorise davantage la transformation industrielle sur notre territoire, et celle du bois en particulier, en :
- veillant à ne pas concentrer excessivement les exonérations de cotisations sociales au niveau du Smic, pour donner un coup de pouce aux emplois intermédiaires entre 1,2 et 1,9 Smic (1 700 à 2 700 € nets par mois), plus fréquents dans l'industrie ;
- plaidant au niveau européen pour une extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) aux produits transformés et notamment au bois et aux produits bois.
2. Le verrou des ressources humaines et des compétences, dans les métiers du bois et les autres
a) Un déficit d'image propre à la filière, toujours associée à la pénibilité et dont le potentiel innovant et écologique reste trop méconnu
L'ensemble des dirigeants d'entreprise rencontrés à l'occasion du déplacement de la mission en Alsace ont déploré des difficultés de recrutement et de fidélisation de la main-d'oeuvre. C'est le cas des scieries Feidt à Molsheim, Siat à Urmatt et de la papeterie Blue Paper à Strasbourg.
Le caractère hautement technologique des métiers du bois semble méconnu, si bien que la filière suscite moins l'enthousiasme que d'autres. Dans le premier cas énuméré, le relatif déficit d'attractivité de la filière bois se mesure à la rapidité avec laquelle les entreprises d'autres secteurs industriels - par exemple aéronautique (Safran) - présentes dans la même commune, recrutent.
Les professionnels pointent également un problème d'attractivité liée à l'image sociétale de la filière, désormais davantage associée à la déforestation plutôt qu'au jardinage de la forêt, en raison de simplifications hâtives par des relais d'opinion ou, plus encore, d'une méconnaissance de la sylviculture, ce qui se répercuterait en chaîne sur l'ensemble de la filière. De fait, les difficultés de recrutement sont transversales, de l'amont à l'aval, des bûcherons aux charpentiers en passant par les scieurs.
Par ailleurs, la filière resterait associée à une image de pénibilité.
Or, s'il est vrai que certains postes dans le secteur continuent d'exposer les employés à des facteurs de pénibilité - bruit dans l'ensemble des sites visités, odeur dans la papeterie, poussière dans la scierie, charges lourdes et vibrations... - et demeurent sujets des accidents du travail - scies, foyers, chute d'objets volumineux - voire à certaines maladies professionnelles, les rapporteurs ont pu constater que les conditions de travail s'étaient notablement améliorées. Un certain nombre de postes sont désormais entièrement automatisés ce qui, au sein d'une scierie, permet aux employés de travailler dans des cabines insonorisées et à l'abri de la poussière, derrière des écrans d'ordinateur.
Un mouvement identique de mécanisation est d'ailleurs à relever à l'amont, notamment pour les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF), les controverses autour des incidences sur les habitats d'espèces protégées étant d'ailleurs le revers de ce progrès pour les conditions de travail des bûcherons. Malgré cela, la forte proportion de travailleurs d'Europe de l'Est en forêt témoigne d'une désaffection pour ces métiers qui demeurent parmi ceux le plus soumis à des accidents graves voire mortels - pour des raisons également de difficulté d'accès.
Cette industrialisation, avec les protocoles de sécurité qu'elle induit, peut cependant « déshumaniser » le travail en contrepartie.
En plus des traditionnels salons et journées portes ouvertes, l'interprofession France Bois Forêt a conduit une campagne de promotion des métiers du bois appelée « Very Wood Métiers », en ciblant les jeunes sur les réseaux sociaux, à l'aide de slogans tels que : « si vous cherchez du boulot, y'en a dans les bois ! »
b) Dans le bois comme ailleurs, des emplois intermédiaires non pourvus, avec des conséquences regrettables pour la filière
S'agit-il pour autant d'un frein spécifique à la compétitivité de la filière bois française ? Rien n'est moins sûr.
D'une part, le dirigeant de la scierie Streit, outre-Rhin, a indiqué faire face aux mêmes difficultés de recrutement dans son Land du Bade-Wurtemberg, pourtant le plus prospère d'Allemagne.
D'autre part, les chefs d'entreprise rencontrés6(*) constatent un avant et un après-Covid et, rappelant les salaires élevés qu'ils sont en capacité de proposer, comme du reste dans l'industrie en général, mettent leurs difficultés sur le compte d'un système social qui n'inciterait pas suffisamment au travail en France (minima sociaux, indemnisation des contrats courts).
Le problème ne serait donc pas propre à la filière. De fait, la Fédération nationale du bois insiste sur le fait que les postes les plus difficiles à pourvoir ne sont pas nécessairement ceux spécifiques aux métiers du bois, mais, bien souvent, ceux relatifs à la maintenance des très lourds équipements utilisés : postes d'électromécaniciens, de techniciens de maintenance, etc.
La filière bois, comme du reste l'ensemble de l'industrie, fait face à un déficit grandissant de compétences dans les métiers touchant à la maintenance (mécanique, électrotechnique, automatisme, robotique). Il conviendrait de susciter davantage l'intérêt des jeunes pour les formations menant à ces métiers, qui souffrent de désaffection, par exemple en communiquant sur les très bons niveaux d'insertion et sur les rémunérations semble-t-il très intéressantes auxquelles ces compétences permettent de prétendre.
Le phénomène peut aussi être appréhendé de manière plus optimiste. Ainsi, selon le dirigeant de scierie Pierre Piveteau, les difficultés des entreprises de la filière bois à pourvoir les postes, communes à tous les secteurs industriels, seraient plutôt à analyser comme un signe de bonne santé de l'économie et de retour du chômage à un niveau plus bas.
Toujours est-il que ce « verrou » de la main-d'oeuvre qualifiée est d'autant plus regrettable que la première et la deuxième transformation sont en grande majorité composées d'unités très capitalistiques. Cela a pour effet que les investissements massifs dans des outils de transformation plus performants mettent plus de temps avant d'être amortis, car ils ne tournent pas au maximum de leur capacité.
Le caractère de plus en plus capitalistique des industries du bois n'est pas une parade face à cette pénurie : il ne réduit pas tant le nombre d'hommes par unité de bois produite qu'il ne change la nature et la qualification des emplois. Dans une scierie moderne, l'intensité en travail reste la même, mais pour sept employés autour d'une ligne de sciage, on en compte autant pour la maintenance des machines, dans les bureaux, derrière les ordinateurs.
Les rapporteurs ont pu constater à l'occasion du déplacement que certains de ces postes étaient pourtant extrêmement stratégiques pour optimiser la valorisation de la ressource et pour un rendement matière intéressant, indicateur clé pour la rentabilité de la transformation du matériau bois. À titre d'exemple, l'expertise humaine reste essentielle chez un scieur de tête.
Or, les entreprises visitées indiquent en être rendues à recruter des employés sans aucune formation pour les postes auxquels ils sont recrutés, quitte à les former ensuite en interne, processus qui peut prendre plusieurs mois et qui ne peut être sans impact sur la productivité au sein de l'entreprise, non seulement pour la personne à former, mais aussi pour le formateur.
Le directeur général de BerryWood, Jean-Marc Legrand, déplore, lui, le renoncement à des formations plus transversales sur les métiers du bois. En tant qu'acteur de la seconde transformation, il constate une dégradation, au sein de la filière, de la connaissance du matériau et y voit l'une des raisons d'une détérioration permanente du rendement matière sur les quinze dernières années, faute de parler un langage commun.
Cela permettrait de faire plus de place aux compétences générales transférables, par opposition aux compétences spécifiques propres à un poste, et de redonner plus de sens aux métiers, ce qui serait peut-être de nature à en accroître l'attractivité. Le succès du livre La Vie Solide (2019) du philosophe Arthur Lochman, qui a abandonné ses études pour suivre un CAP en charpente, témoigne du pouvoir de fascination que peuvent avoir les métiers manuels. C'est d'autant plus le cas pour des métiers extrêmement spécifiques comme la charpente dans la batellerie (pour faire du bateau à façon)
Il conviendrait, selon Mme Loisier, de capitaliser, pour ce faire, sur les campus des métiers et qualifications du bois, qui se sont mis en place à Metz ou encore à Cluny, ou sur les CAP - qui ne semblent pas nécessairement faire le plein, à entendre Mme Rochatte, de la société NS Gerbois.
Recommandation n° 8 : Recentrer les formations autour de la connaissance de la matière, de son travail et de ses usages, afin de faciliter le dialogue entre différents maillons de la filière et de donner plus de perspectives aux jeunes en leur ouvrant un spectre plus large d'emplois.
B. UNE PROLIFÉRATION NORMATIVE PARALYSANTE AVANT, PENDANT ET APRÈS L'ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION
Dans un contexte de compétitivité déjà dégradée du site de production « France », dont la filière bois française pâtit, de nouvelles normes environnementales, souvent d'origine européennes, constituent « des gouttes d'eau qui font déborder le vase ». Elles focalisent d'autant plus l'attention de la filière qu'il s'agit de mesures nouvelles, dont l'application semble pouvoir être plus facilement retardée voire annulée que ne peut être modifié l'environnement fiscal et réglementaire français, après de nombreuses années de sédimentation.
Ce que les entreprises craignent, donc, ce ne sont pas les motivations écologiques de ces réglementations, c'est davantage une « surcouche » de normes à respecter, ayant un effet cumulatif avec les formalités administratives déjà nombreuses dont elles doivent s'acquitter dès à présent.
1. Corriger le tir sur des normes nouvelles de traçabilité sur l'origine et la fin de vie du bois, qui ratent leur cible
a) Aménager le règlement européen sur la déforestation et la dégradation des forêts, pour qu'il ne se trompe plus de cible
La mise en oeuvre prochaine du règlement de l'Union européenne sur la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE7(*)) est évoquée avec beaucoup d'appréhension par les organisations professionnelles entendues.
Ce règlement introduit une obligation de traçabilité des approvisionnements tout au long de la chaîne de valeur de sept filières concernées8(*), dont la filière bois.
Proposé par la Commission européenne en 2021 et ayant fait l'objet d'un accord entre États membres au Conseil et Parlement européen au premier semestre 2022, sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, ce texte revêt une forte charge symbolique dans le contexte de négociations de plus vingt ans avec le Mercosur en vue d'un accord de libre-échange. C'est la raison pour laquelle la France a été le seul pays à plaider pour le maintien du texte en l'état lors d'un Conseil Agriculture de mai 2025.
Le bois n'est pas le seul dans l'équation, d'autres filières jugées plus sensibles plaidant pour le maintien d'une certaine ambition. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, le principal produit visé par ce règlement n'était originellement pas le bois, ajouté au dernier moment à la liste des six autres produits agricoles visés. Ce règlement était davantage présenté un ensemble de mesures miroirs destinées à limiter notamment les importations de viande bovine ou de soja cultivé pour l'alimentation animale issus de conversion de forêts.
Le règlement impose la géolocalisation des parcelles de production puis transmission d'informations sur l'exemption de déforestation ou de dégradation des forêts à chaque maillon de la chaîne, via un numéro de déclaration de diligence raisonnée. L'innovation de ce règlement réside dans la traçabilité matière depuis la récolte jusqu'à la consommation par un client final.
Après un premier report d'un an au plus fort de la crise agricole, les obligations de diligence prévues par ce règlement entreront en vigueur au 1er janvier 2026 pour les plus grandes entreprises et au 1er juillet 2026 pour les autres. Les contrôles et sanctions associées s'appliqueront un an après.
Il convient de remettre certains éléments en contexte pour la bonne compréhension de ce texte et de son impact sur la compétitivité de la filière bois.
En premier lieu, il est juste de souligner que dans la mesure où le texte n'est pas encore mis en oeuvre, il n'a pu avoir une quelconque incidence sur la compétitivité de la filière bois européenne jusqu'à présent. Si des coûts de mise en conformité commencent à apparaître pour les entreprises assujetties, ils ne sauraient expliquer les piètres performances commerciales de la filière sur les dernières décennies, et y compris sur les dernières années.
En deuxième lieu, dans l'absolu, il ne peut non plus être à l'origine de distorsions de concurrence pénalisant la filière bois française vis-à-vis de ses partenaires européens puisqu'il s'agit d'un règlement, d'application directe et uniforme dans l'ensemble du marché intérieur. Son impact relatif peut en revanche différer selon, entre autres, ces critères :
- la taille des entreprises, les plus petites pouvant peiner, davantage que de grandes entreprises disposant de capacités d'ingénierie pour s'adapter à ce nouveau corpus de normes, modifier leurs pratiques et intégrer des outils numériques. Or, comme indiqué supra, les entreprises françaises de la filière sont de plus petite taille que leurs voisines européennes, du moins si l'on compare les scieries françaises aux allemandes ;
- la faible connaissance de leur foncier par les entreprises s'approvisionnant en France pourrait créer un désavantage compétitif pour la France, par opposition par exemple au Brésil, qui dispose d'usines de pâte de cellulose très intégrées, avec une parfaite connaissance de leur foncier, sur des sols agricoles pauvres ayant fait l'objet de plantations ;
- le degré de préparation aux nouvelles obligations et de conformité avant même que le texte ait été adopté. À cet égard, les associations de protection de la nature entendues ont plaidé pour l'application du règlement tel qu'adopté, avec l'argument que le fossé serait plus facile à combler pour les entreprises françaises - celles-ci critiquant toutefois le règlement, il est permis d'en douter ;
- enfin, le règlement crée de fait un risque supplémentaire pour les filières qui s'approvisionnent dans des pays objectivement à risque de déforestation. Ce biais est a priori plutôt favorable à la relocalisation de l'approvisionnement, puisqu'aucun État membre de l'UE n'est concerné par la déforestation - la France déclare ainsi l'absence de déforestation chaque année à la Food and Agriculture Organization (FAO).
Pour autant, et c'est là où le bât blesse, il convient en troisième lieu de rappeler que ce règlement est, par essence, une mesure miroir. À ce titre, l'ensemble de la production européenne, qu'elle soit mise en marché au sein de l'UE ou destinée à l'exportation, est assujettie aux obligations de diligence raisonnée du RDUE, quand dans le même temps les États tiers ne sont concernés que pour la part de leurs exportations qui est destinée à l'Union européenne. Les professionnels européens déplorent un « deux poids, deux mesures », d'autant que, d'après l'administration, une certification programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou Forest Stewardship Council (FSC) ne suffirait pas à s'affranchir des obligations de diligence. Ils anticipent le développement de filières « premium » dans les pays exportateurs, qui permettraient de ne pas fondamentalement changer les pratiques dans les pays à risque.
Or, la liste de risque publiée en avril 2025 ne classe que quatre États en « risque élevé » (la Biélorussie, la Birmanie, la Corée du Nord et la Russie), quand d'autres comme le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo ou la Bolivie, les quatre États où la déforestation est la plus élevée sont classés « à risque standard ». Il semble que des considérations diplomatiques et commerciales aient présidé à ce classement timoré de la part de la Commission européenne, dans un contexte de dislocation du bloc occidental et à l'approche de la COP 30 à Belém. C'est cependant se priver d'un levier dans la négociation avec l'Amérique du Sud sur le Mercosur et c'est, plus fondamentalement, se tromper de cible.
C'est pourquoi certains États, à l'image du Luxembourg, souhaiteraient rouvrir les discussions sur le règlement et y introduire une quatrième catégorie, dite « à risque nul » ou « négligeable », dans laquelle entreraient notamment les États européens. Le Parti populaire européen (PPE) a également déposé une motion en ce sens, examinée le 9 juillet en séance plénière. La conformité d'une telle catégorie au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) resterait toutefois à démontrer. En outre, en tout état de cause, une réouverture du règlement ne pourrait aboutir avant plusieurs mois. Cette piste doit plutôt être regardée comme un moyen de pression pour obtenir un changement du classement de certains États tiers.
C'est pourquoi le levier de la simplification par l'interprétation du texte a été privilégié jusqu'ici et doit rester la piste à privilégier. Ainsi, la foire aux questions (FAQ) de la Commission européenne a été actualisée pour la troisième fois, en avril 2025, donnant lieu à publication d'une quatrième version.
Le principal assouplissement dans l'interprétation du règlement, adopté à l'initiative de la France, consiste à raisonner pour la traçabilité selon une approche probabiliste par la méthode du bilan massique (mass balance). En effet, à titre d'exemple, dans les sites industriels de panneaux, le bois en fin de vie, les plaquettes et la sciure sont mélangés, ce qui rendrait quasi impossible une traçabilité « lot par lot » voire « copeau par copeau ». La difficulté est la même dans les sites de production de pâte à papier. Les chaînes de contrôle basées sur le bilan massique, qui permettent de mélanger des matières premières sans déforestation avec des matières premières d'origine inconnue, ne sont pourtant pas autorisées dans le texte, car cela ne garantit pas de façon certaine l'exemption de déforestation ou de dégradation, avec une traçabilité jusqu'à la parcelle.
Un effet pervers des obligations de diligence raisonnée sur la traçabilité du bois provient de ce que la distribution, dont les grandes surfaces de bricolage (GSB), chercheraient à entrer en contact directement avec les fournisseurs pour contourner le maillon de la deuxième transformation (ameublement notamment), soit en s'approvisionnant auprès de ces fournisseurs, soit en obtenant communication des prix. Pour remédier à cet écueil, les lignes directrices de la Commission européenne autorisent, dans leur dernière version, à anonymiser les données transmises d'un maillon à l'autre.
Un point particulier délicat a trait à la notion de dégradation, qui figure dans le règlement et qui désigne la conversion de forêts primaires en forêts de plantation ou en cultures, d'un moindre intérêt environnemental. Cette notion a été ajoutée tardivement au texte. Nos voisins européens ont déclaré à la Commission européenne qu'il n'y avait pas de dégradation des forêts sur leur sol. La France devrait faire de même, en plaidant pour une la présomption de « non-dégradation » des forêts dès lors qu'il s'agit de parcelles assujetties à un document de gestion durable.
Enfin, un cas particulier est celui des régions ultrapériphériques. Leur statut au regard de ce règlement est stratégique pour la France, qui compte un tiers de sa surface forestière dans les Outre-mer, en particulier en Guyane (8 millions d'hectares), dont le territoire se situe en forêt amazonienne. La forêt guyanaise a été classée à « faible risque », mais n'a pas bénéficié d'une mesure supplémentaire de proportionnalité que la France demandait au niveau européen pour assurer l'autosuffisance alimentaire de ce territoire, recouvert à 95 % par de la forêt primaire.
Recommandation n° 9 : aménager le règlement de l'UE sur la déforestation importée sur quatre volets en :
- procédant de façon plus objective et moins diplomatique et commerciale pour le classement des pays à risque de déforestation ou de dégradation, pour intégrer davantage d'États tiers dans la catégorie « risque élevé », sans attendre la prochaine révision annuelle du classement ;
- allant au plus efficace et au plus rapide, en jouant sur l'interprétation du règlement via les orientations et foires aux questions de l'Union européenne, plutôt que de miser sur une réouverture du texte, incertaine au regard des règles de l'OMC et source d'insécurité juridique ;
- donnant une définition de la « dégradation » des forêts qui exempte les forêts françaises par défaut, en tant qu'elles sont soumises à une gestion durable et multifonctionnelle ;
- faisant reconnaître dans un prochain règlement omnibus une logique de proportionnalité pour les régions ultrapériphériques, dont la Guyane, recouverte à 95 % de forêt primaire, pour favoriser l'autosuffisance alimentaire de ce territoire et la structuration d'une filière bois pour des usages locaux, sans remettre en cause la crédibilité de nos engagements vis-à-vis des États tiers et notamment d'Amérique du Sud.
b) Gare aux effets contreproductifs de la responsabilité élargie du producteur pour un secteur déjà exemplaire en matière de recyclage
Une filière REP produits et matériaux de la construction et du bâtiment a été mise en 2023 et a suscité beaucoup d'émoi au sein de la filière. Le président de la Fédération nationale du bois Jean-Pascal Archimbaud a carrément indiqué en audition devant la commission des affaires économiques que le bois n'avait pas sa place dans une filière de responsabilité élargie du producteur, au motif qu'elle est particulièrement vertueuse. Une position maximaliste qui n'est pas nécessairement partagée par l'ensemble des acteurs.
Pour autant, des débats se sont fait jour sur le montant de l'écocontribution due par tel ou tel matériau et sur le risque de distorsion que cela pourrait induire. Comme le rappelle la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE), « la FNB estime que l'écocontribution de la REP (avant le moratoire) était très défavorable au matériau bois, le coût de l'écocontribution étant de 4,90 €/m3 de bois contre 0,4 €/m3 de métal et 0,8 €/m3 de béton. La FNB estime par ailleurs qu'un tiers du gisement de déchets bois du bâtiment part vers l'export. », créant une perte de ressource pour la France.
Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi « produits du bois et filière REP PMCB », deux abattements au montant de l'écocontribution ont été adoptés, à l'initiative de la rapporteure Anne-Catherine Loisier :
Ø le premier, avec avis de sagesse du Gouvernement - la réserve n'étant pas liée au fond mais liée au fait que cette mesure relève du règlement -, prévoit la mise en place d'un abattement sur l'écocontribution pour les produits bois en tant que matériaux performant en termes de recyclage ;
Ø le second, avec double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoit la mise en place d'un autre abattement, concernant le même produit, au motif qu'il s'agit d'un matériau biosourcé.
Enfin, la filière souhaiterait rendre visible le montant de l'écocontribution sur les factures entre professionnels, afin de garantir que celle-ci n'est pas répercutée avec marge.
Recommandation n° 10 : appliquer un abattement à l'écocontribution sur les produits bois tel que voté dans le cadre de l'examen de la proposition de loi dite « REP bâtiment », en articulant celui institué au profit des matériaux les plus performants en termes de taux de valorisation des déchets et celui prévu pour les matériaux biosourcés renouvelables.
Comme indiqué plus haut, il convient de noter que le secteur de la papeterie est, lui, sujet à deux responsabilités élargies du producteur, désormais fusionnées, et qu'une troisième est en cours de mise en place.
S'agissant de la responsabilité élargie du producteur (REP) emballages industriels et commerciaux, une filière déjà vertueuse sur la sortie du statut de déchet, les obligations viennent d'un règlement n° (UE) 2025/40, ce qui limite les risques de couche supplémentaire de réglementation de la part de la France.
Dans les deux cas, la REP ne semble pas poser de difficultés aux acteurs concernés.
2. Des difficultés de mise aux normes et d'assurabilité qui posent un défi existentiel pour des entreprises de la filière bois qui sont majoritairement des PME et des ETI
a) Des normes de sécurité pour les employés ou les riverains que les entreprises de la filière bois, majoritairement des PME et ETI, peines à intégrer
Si les organisations professionnelles concentrent leurs critiques sur les normes « macro », souvent d'origine européenne - RDUE, RED III -, les acteurs de terrain ont également témoigné des contraintes que peuvent représenter les normes, à une échelle plus « micro », pour leur activité au quotidien.
La scierie Feidt, en Alsace, pourtant victime d'un incendie qui a détruit l'ensemble de son site a témoigné de son désarroi sur les normes de sécurité appliquées à leurs yeux sans discernement par les Dreal : mur coupe-feu, sprinklage...
Les rapporteurs ont pu constater, chez l'ensemble des professionnels qu'ils ont visités, un grand professionnalisme et une attention notable aux questions de sécurité. Il a cependant semblé aux rapporteurs, lors de leur déplacement en Alsace et en Allemagne, une approche de la sécurité légèrement plus marquée côté français.
Une représentante de l'entreprise Schilliger Bois, située en Alsace à proximité de la frontière, a également pointé un différentiel entre normes françaises et allemandes de qualité de l'air : jusqu'à 3 % de poussières de bois seraient tolérées dans les usines outre-Rhin tandis que ce plafond serait fixé à 1 % en France, un seuil selon elle difficile à atteindre en pratique.
Conscients des surcoûts que ces normes peuvent engendrer, les rapporteurs jugent pour autant que l'on ne doit pas tirer prétexte des faiblesses structurelles de la France en matière de compétitivité, qui trouvent leur source dans d'autres causes bien identifiées, pour faire de la sécurité des employés et des riverains une variable d'ajustement. À force d'avoir trop laissé se développer des normes à propos de l'accessoire, il ne faudrait pas que germe l'idée d'affaiblir les normes sur l'essentiel.
Il en va, aux yeux des rapporteurs, de l'attractivité des métiers du bois mais aussi, plus largement, de l'acceptabilité des activités de transformation du bois dans les territoires. Les accidents, surtout s'ils sont mortels, sont évidemment dévastateurs pour l'image de la filière.
À entendre les acteurs de terrain visités par la mission, c'est surtout le manque de discernement dans l'application de certaines de ces normes, par certaines administrations, qui serait source de difficultés, plus que les normes en elles-mêmes, dont les entreprises partagent l'objectif.
À l'unisson avec ces entrepreneurs, les rapporteurs déplorent que des obligations de résultats ne soient pas préférées, autant que possible, à des obligations de moyens ou de process souvent plus difficiles à respecter.
Certaines obligations de moyens impliquent des dépenses aux montants prohibitifs qui, en prime sont improductives, et de ce fait difficilement absorbables pour des entreprises de la filière bois entrant souvent dans la catégorie des PME ou des ETI familiales. En outre, elles ne laissent pas suffisamment de place à l'innovation des entreprises, qui peuvent mettre sur pied des systèmes aussi protecteurs selon des modalités différentes.
Avec leur expérience d'élus de terrain, les deux rapporteurs jugent que, sur le modèle de ce qu'a entrepris la ministre de l'agriculture Annie Genevard à l'échelle nationale, des « rendez-vous territoriaux de la simplification » devraient se tenir régulièrement dans les départements afin de formaliser une enceinte de dialogue entre administrations (Dreal notamment) et entreprises, pour qu'elles parlent un même langage et comprennent mieux leurs attentes réciproques. Organisées sous l'autorité du préfet et en la présence d'élus locaux, ces réunions seraient de nature à remettre à plat d'éventuels irritants et à envisager toute solution à effet équivalent, dans le respect du droit. En ultime recours, le pouvoir de dérogation aux normes du préfet pourrait être mobilisé, si une analyse des mesures au regard du critère de la proportionnalité conduisait à écarter ces normes.
Recommandation n° 11 : Apporter des solutions aux contraintes du quotidien des entreprises de transformation du bois en réunissant régulièrement élus locaux, administrations déconcentrées et entreprises de la filière bois, pour échanger sur les écueils rencontrés dans certaines mises aux normes, dans le cadre de « rendez-vous territoriaux de la simplification », et envisager d'autres voies d'atteindre les mêmes objectifs, sous la supervision du préfet.
b) Les difficultés d'assurabilité pour les entreprises de la première transformation pèsent sur leur rentabilité et leur posent un défi existentiel
L'un des dossiers les plus brûlants pour la première transformation est celui des difficultés d'assurabilité croissantes de leur outil productif, y compris auprès des assureurs historiques, ce qui est particulièrement inquiétant pour un secteur à la fois très capitalistique et composé d'entreprises familiales de taille petite ou moyenne, sans la trésorerie nécessaire pour se relever en cas de sinistre. Ce sujet est « un grave problème » (P. Piveteau) « puisque sans assurance, une entreprise ne peut pas emprunter. Notre filière a besoin d'investissements, on ne pourra pas avancer sans régler la partie assurancielle » (A. Duisabeau).
Les assureurs désertent peu à peu le secteur de la première transformation du bois, au motif que les risques d'accident y seraient trop élevés. Les deux scieries visitées par la mission en Alsace ayant subi une ou des destructions de grande ampleur à cause d'incendies, les rapporteurs en ont déduit, en effet, que la question n'était pas tant de savoir si un départ de feu allait intervenir, que de savoir quand il allait intervenir.
Pour autant, les conditions posées par les assurances - systématisation de systèmes de sprinklage, murs coupe-feu et autres normes ou équipements visant la même finalité -, aussi justifiées soient-elles en principe - activité industrielle, présence de combustible -, semblent présenter des coûts disproportionnés. Le sprinklage coûte en effet de l'ordre de 1,2 millions d'euros pour 10 000 m2.
S'agissant des primes d'assurance en elles-mêmes, la scierie Piveteau explique qu'elle s'acquittait d'environ 1,5 millions d'euros par an pour s'assurer et qu'on lui en demande désormais 2,5 millions, tandis qu'un incendie d'ampleur, qui peut survenir en moyenne environ tous les dix ou quinze ans, coûterait 2 à 4 millions d'euros par incident. Sur une même période, le rapport peut donc aller, dans le cas le plus extrême, jusqu'à 1 pour près de 40 ! Or, ce poste de dépenses pèse sur la rentabilité et ne peut aisément être répercuté sur le prix de vente.
Lorsqu'une scierie souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments pour profiter de son importante emprise au sol, cas soulevé par la sénatrice Annick Jacquemet lors de l'audition de lancement de la mission, le problème devient tout bonnement insoluble : les assurances refusent catégoriquement, semble-t-il au motif que les pompiers ne pourraient intervenir sans danger, faute de pouvoir déconnecter la production électrique des panneaux.
Selon Marc Siat, la problématique est peut-être moins aiguë pour les plus grands groupes, qui n'ont, comme les autres, d'autre choix que de suivre les prescriptions posées par les assurances, mais, à la différence des autres, disposent des moyens pour ce faire.
S'agit-il donc seulement d'une question de mise à l'échelle des scieries françaises ? Il semble que non, car même les plus grands groupes ne sont pas épargnés, à commencer par le groupe Siat lui-même, qui confirme ne plus être assuré sur la totalité de son site de production d'Urmatt. Pour la première fois, en 2025, le groupe Archimbaud envisage de ne pas assurer la totalité de son site de production, en prenant le risque d'exclure son stock de bois.
La modernisation des scieries ne devrait pas suffire non plus à estomper cette problématique, car elle va de pair avec davantage de sites multi-activités en lien avec la production de chaleur, et davantage de présence de bois transformé et de bois séché sur site - or, ce dernier a un potentiel calorifique plus important.
Enfin, si l'assurance ne saurait constituer l'alpha et l'omega de l'adaptation au changement climatique, force est de constater que l'augmentation des températures accroîtra les risques, contre lesquels il faudra bien se couvrir.
Le bureau des marchés et des produits d'assurance de la direction générale du Trésor a assuré à la filière que l'État ne pouvait être d'une quelconque aide, la question relevant des relations contractuelles entre deux acteurs privés. Reste la possibilité pour les sociétés de saisir le médiateur des entreprises, des discussions préliminaires en ce sens étant engagées avec la filière.
Pour les plus grands groupes, une solution pourrait consister à développer des captives d'assurance, structures d'auto-assurance ad hoc. Encore faudrait-il que les assureurs, qui sont juges et parties dans cette affaire, consentent à leur accorder l'agrément pour exercer cette activité. Pour les plus petits groupes, un même système de caisse d'assurance ne serait envisageable qu'adossé à une provision défiscalisée.
En réalité, ce système constituerait surtout unlevier de négociation avec les assureurs. Dans la discussion avec ces derniers, un point particulier sera de faire admettre aux assureurs l'efficacité des technologies de détecteurs précoces.
Recommandation n° 12 : apporter une solution aux difficultés d'assurabilité des entreprises de transformation du bois en :
- développant les captives d'assurance, adaptées pour les plus grands groupes, au besoin en encourageant ces dispositifs par une défiscalisation des montants provisionnés.
- s'efforçant, pour les plus petits groupes, de faire reconnaître aux assureurs, avec l'appui du médiateur des entreprises, des solutions d'effet équivalent au sprinklage, telles que les technologies de détection précoce des départs d'incendie.
C. INVESTIR DANS LES SCIERIES POUR PASSER À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE, MAIS SANS PERDRE DE VUE L'IMPÉRATIF DE FLEXIBILITÉ
1. Un besoin d'investissement pour remettre à niveau notre outil de transformation vis-à-vis des scieries allemandes
a) Le maintien d'appels à projets présentant un fort effet de levier pour la dépense privée et un faible coût d'abattement de la tonne de CO2 évitée
Alors que l'Allemagne dispose d'un réseau bancaire avec un ancrage territorial fort qui le prédispose à une bonne connaissance de son tissu industriel, les PME et ETI françaises de la filière bois peuvent connaître plus de difficultés de financement.
Dans le cadre de France Relance puis de France 2030 et désormais de France Nation Verte, entre mi-2021 et mi-2024, 530 M€ de fonds publics ont bénéficié à environ 150 projets au sein de la filière bois via trois appels à projets particuliers :
Ø systèmes constructifs bois (SCB) (2021-23) : 71 projets aidés à hauteur de 203 M€ pour 1,3 Md€ d'investissement total ;
Ø biomasse chaleur industrie bois (BCIB) (2022-24) : 40 projets aidés à hauteur de 198 M€ d'aide pour 533 M€ d'investissement ;
Ø industrialisation performante des produits bois (IPPB) (2024) : 76 M€ d'aide pour 288 M€ d'investissement.
Directement ou indirectement, ces trois appels à projets témoignent de la priorité des pouvoirs publics, déjà évoquée supra (cf. partie I, A, 1), pour le bois-construction :
Ø le premier vise la construction de façon très explicite et permettra d'augmenter de 15 % les capacités de sciage et de production de panneaux dans le but de pouvoir couvrir l'intégralité de nos besoins en bois-construction - par exemple, un investissement de 100 M€ du groupe Thebault, leader du contreplaqué, permet de construire la première usine de lamibois de France, en Haute-Loire, ou encore l'investissement du groupe Siat dans sa nouvelle ligne de production. Cet appel à projets, désormais éteint, correspondait à une logique capacitaire ;
Ø le deuxième permettra d'augmenter de 7 points la part des volumes de bois faisant l'objet de séchage en France (le niveau étant de 15 % aujourd'hui contre 80 % en Allemagne), un procédé indispensable pour que le bois construction ne se déforme pas à l'humidité. Par ailleurs, cet appel à projets vise l'amélioration de l'autonomie énergétique des scieries, leur permettant de dégager de la rentabilité et donc d'investir, ainsi qu'une diversification de l'activité des scieries grâce à la fabrication et à la commercialisation de granulés ;
Ø le troisième cible les scieries de feuillus, pour les moderniser afin d'améliorer la valorisation d'essences secondaires ou de bois de crise.
Selon le CSF Bois, ces AAP auraient permis de créer environ 3 000 emplois (2 700 pour SCB et 300 pour IPPB) sur tout le territoire et provoqué plus de 2 Md€ d'investissements supplémentaires, ce qui témoigne d'un fort effet de levier, justifiant l'intervention de la puissance publique. Pour SCB, l'effet de levier a été supérieur à 6, et pour IPPB il est de près de 4 - légèrement plus faible en raison d'un cahier des charges et notamment de seuils d'éligibilité plus bas, des scieries de plus petites tailles étant visées. Pour BCIB, l'administration n'a pas souhaité communiquer sur cet indicateur de l'effet de levier et ne l'a d'ailleurs pas communiqué, mais il est possible de le calculer à hauteur de 2,5 environ.
L'administration nie l'existence d'un « coup d'arrêt » en 2025, tout en communiquant un montant de la ligne « aval » de France Nation Verte ramené à 14,8 M€, qui s'ajoute à un reliquat de 30 M€, contre 118 M€ de besoins exprimés, ce qui laisse présager une prochaine relève d'IPPB « très sélective ». Le nombre élevé de projets non lauréats, restés orphelins, témoigne, du reste, du fort appétit de modernisation de la première transformation.
À ces trois guichets spécifiques à la filière bois, opérés par l'Ademe, s'ajoutent d'autres guichets ouverts aux entreprises industrielles. Cependant, il a été relevé en audition que les entreprises de la filière bois, souvent des PME ou des ETI, pouvaient connaître des difficultés pour candidater à ces appels à projets transversaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'accès de l'industrie du bois à l'AAP BCIAT (biomasse chaleur pour l'industrie, l'agroalimentaire et le tertiaire) a cessé, au profit de la mise en place de l'AAP spécifique, BCIB.
De son côté, l'équipe du Fonds bois de Bpifrance constate également « un nombre très faible de projets malgré des fonds disponibles pour être déployés » et déplore que, « sur une quarantaine de projets instruits chaque année, un trop faible nombre se concrétise ». Cette réticence s'expliquerait notamment par la baisse d'activité et les incertitudes dans le secteur du bâtiment depuis 2023. Au-delà de cette crise conjoncturelle, la banque craint l'émergence de situations de « non-finançabilité » en lien avec « des cycles d'activité de plus en plus forts, rendant toute levée de fonds (dette ou fonds propres) particulièrement difficile, au détriment d'autres secteurs moins cycliques, préférés par les investisseurs ».
Des possibilités complémentaires de financement européen
En ce qui concerne les formes possibles de soutien public, la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen d'investissement (EIF) financent des aides en faveur du soutien aux investissements forestiers productifs et technologiques, y compris dans la transformation et la commercialisation. La Banque européenne d'investissement a prêté 15 milliards d'euros en faveur du secteur forestier durant les 10 dernières années. Pour la période 2023-2027, la politique agricole commune a alloué 4,2 milliards d'euros en faveur du soutien au secteur forestier dont 400 millions d'euros en faveur du soutien aux investissements forestiers productifs et technologiques.
Source : DGPE
Coordinateur du Comité stratégique de filière bois, Jean-Luc Dunoyer, rappelle que les investissements en « base » (hors AAP) de la filière bois sont de l'ordre de 4,2 Md€ et que la transition écologique devrait nécessiter un surinvestissement de l'ordre de plus de 10 %, correspondant à peu près au montant des appels à projet.
Il convient aux yeux des rapporteurs de resituer la place du bois, relativement réduite, dans l'ensemble des dépenses publiques du pays. Il conviendrait en outre de recourir aux critères de l'effet multiplicateur de la dépense publique sur la dépense privée et de l'abattement de la tonne de CO2 évitée pour juger de l'opportunité de maintenir des dépenses publiques d'investissement, afin de sauvegarder le plus possible de dispositifs orientés sur la filière bois, souvent performants au regard de ces deux critères.
Recommandation n° 13 : au regard des 3 000 emplois induits en trois ans, du fort effet de levier sur la dépense privée et du faible coût d'abattement du CO2 associé, maintenir les principaux appels à projets destinés à la filière bois (industrialisation performante des produits bois (IPPB), biomasse chaleur industrie bois (BCIB)).
b) À défaut, la mise en place d'une provision pour investissements, pompe aspirante pour le développement de la transformation, très peu coûteuse pour la puissance publique
En complément, ou à défaut si l'option précédente n'était pas retenue, il serait utile de mettre en place une provision pour investissements. Cette proposition était parmi les recommandations phares des Assises de la forêt et du bois et figurait déjà dans un rapport sur la valorisation par les scieries des gros et très gros bois (CGAAER, 2020).
La filière a manifesté de façon unanime son intérêt pour ce mécanisme, sur le modèle de ce qui existerait en Allemagne ou, sous une forme différente, en Belgique. À vrai dire, selon Pierre Piveteau, cela fait vingt ans qu'elle est demandée, depuis que l'Allemagne, alors déficitaire en bois-construction a mis en place un tel dispositif avec succès. La scierie Streit visitée en Allemagne a insisté sur la part des subventions publiques dans ses investissements, mais la FNB n'a pas manqué de rappeler que ce dispositif avantageux pour les investissements n'avait pas d'équivalent en France.
Ce dispositif devrait respecter le cadre européen relatif aux aides d'État, tel que décrit ci-après.
Le cadre européen relatif aux aides d'État
Les mesures concernant des investissements en faveur des entreprises opérant dans le secteur forestier constituent des aides d'État, aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (i) la mesure doit être imputable à l'État et financée par des ressources d'État ; (ii) elle doit conférer un avantage à son bénéficiaire ; (iii) cet avantage doit être sélectif, et (iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres.
En ligne avec ce principe, les investissements dans ce secteur constituent des aides d'État. Pour être déclaré compatible avec le marché intérieur, les régimes d'aides ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En conséquence, l'État membre concerné doit démontrer que ces effets négatifs seront aussi limités que possible compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d'aide individuels et cumulés, des bénéficiaires ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés. À cet égard, les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État prévoient les conditions spécifiques qui doivent être respectées afin que ces aides soient compatibles avec le marché intérieur. Plus précisément les Lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales et le Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur (Aber) prévoient les conditions spécifiques pour l'octroi des aides d'État au secteur forestier.
En ce qui concerne les aides aux scieries, les Lignes directrices et l'Aber prévoient la possibilité d'octroyer des aides d'État à des conditions spécifiques et exclusivement pour des « opérations qui précèdent la transformation industrielle ». De telles opérations selon la définition du point (33)(41) des lignes directrices et de l'article 33(40) de l'Aber incluent : l'abattage, le démembrement, l'effeuillage, le découpage, le stockage, le traitement de protection et le séchage du bois, et toutes les autres opérations de travail préalables au sciage industriel du bois dans une scierie, ainsi que le sciage lorsque la capacité de transformation annuelle maximale est de 20 000 m3 de bois rond entrant destiné à être scié.
Enfin, dans le cas où les Lignes directrices et/ou l'Aber ne s'appliquent pas (pour les scieries uniquement dans le scénario mentionné), le Règlement général d'exemption par catégorie prévoit la possibilité d'octroyer diverses formes d'aides, poursuivant des objectifs variés, telles que des aides à l'investissement, des aides à la formation, des aides en matière de protection de l'environnement, sans notification préalable à la Commission.
Les États membres peuvent aussi octroyer des aides de minimis sur la base du Règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une seule entreprise ne dépasse pas 300 000 € sur une période de 3 ans.
Source : Commission européenne
Comparé aux appels à projets, ce dispositif aurait certains avantages.
D'abord, pour l'État, il se traduirait par un simple décalage de recettes fiscales, de l'ordre de 100 M€ (taux de l'impôt sur les sociétés (IS) à 25 % sur 400 M€ d'investissement annuel des scieries), sur lequel il ne faudrait payer que les intérêts. Les recettes seraient récupérées après 5 ans, avec des pénalités de rattrapage si tout n'a pas été utilisé pour investir sur la période.
Ensuite, pour le secteur, ce serait une véritable pompe à investissements permettant de toucher l'ensemble des scieries, dont près de 900 « micro-scieries » de moins de 5 000 m3 de sciages par an, là où les appels à projets ont bénéficié à plus de 150 acteurs sur 1 200 scieries.
Enfin, si des conditions simples de décarbonation et d'intégration verticale devraient être mises en place pour continuer de flécher, dans une certaine mesure, les dépenses, les contraintes des appels à projets (avances remboursables au début, cahiers des charges complexes) disparaîtraient.
Bpifrance précise toutefois que cette mesure « stratégique pour restaurer notre compétitivité face à nos voisins, ne résoudra pas tout ».
Recommandation n° 14 : si l'abondement des appels à projets bénéficiant à la filière bois venait à diminuer, mettre en place une provision pour investissement centrée sur la première et la deuxième transformation du bois, mobilisable pendant une durée de cinq ans pour des investissements respectant deux grands principes - la décarbonation et l'intégration verticale - déclinés de la façon la plus simple possible.
2. La scierie du futur reposera sur une complémentarité entre de petites « scieries de service » et une grande scierie industrielle par massif
Ces investissements pourront permettre de massifier les volumes transformés, sur le modèle de l'Allemagne, qui s'est beaucoup modernisée au début des années 2000. Les scieries allemandes, reposant sur la massification, peuvent transformer jusqu'à 1 Mm3 de bois, et produisent 2,5 fois plus de sciages que la France, pour une récolte similaire.
En effet, selon la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE), « le nombre de scieries a diminué de 75 % en près de quarante ans (1 308 en 2019 (source Agreste), contre 5 241 en 1980 (source Cour des Comptes) », et « le tissu industriel français est majoritairement constitué de petites unités de transformation (< 5 000 m3), en milieu rural, avec des difficultés de recrutement et de reprise des scieries. L'âge moyen des dirigeants (autour de 60 ans) n'est pas toujours propice à l'innovation. » Elle ajoute que « la catégorie des petites scieries feuillues semble être la plus fragilisée, en particulier celles qui n'ont pas pu faire les investissements nécessaires pour se moderniser et qui ont un taux de marge sur production faible et en diminution ».
La concentration devrait donc se poursuivre, en particulier au moment des transmissions. La France compte 79 grandes scieries (> 20 000 m3) quand l'Allemagne semble en compter plus de 300, soit l'essentiel de ses entreprises, certaines atteignant des volumes transformés incomparablement plus élevés que les plus grandes scieries françaises (Monnet-Sève, Piveteau, Siat, Archimbaud...). Pourtant, en France c'est d'ores et déjà 60 % de la production qui est assurée par ces grandes scieries, quand bien même elles ne représentent que 7 % des scieries.
Répartition des scieries sur le territoire français
Source : memento FCBA 2024
M. Marc Siat, le président-directeur général du groupe Siat, prédit qu'il y aura demain une grande scierie par massif forestier et bassin de production (comme il s'y emploie par exemple avec la scierie de Brassac, dans le Tarn).
Pour autant une complémentarité pourrait s'installer entre une grande scierie industrielle par massif (capacitaire) et le maintien de petites « scieries de service » (M. Maurice Chalayer), souvent de feuillus, avec « un savoir-faire artisanal », équipées de lignes « ruban » flexibles (optimisation de la matière9(*)). L'AAP IPPB vise spécifiquement à moderniser ces dernières scieries. La FNB indique en effet que les scieries françaises ne sont pas si mal préparées au changement climatique, en comparaison avec les unités industrielles standardisées moins flexibles de l'Allemagne.
L'entreprise LBL Brenta, fabricant de matériels de scierie pour petites et moyennes scieries, confirme cette idée de complémentarité. Si la logique d'appels à projets persistait, il serait intéressant d'en ouvrir un spécifique aux machines utilisées dans les scieries, à la numérisation et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de production. Ainsi que l'a rappelé Mme Laëtitia Rochatte, de l'entreprise NS Gerbois, la France dispose d'un leadership en matière d'IA, et pourtant c'est l'entreprise italienne Microtech qui a réussi le mieux à intégrer cette technologie dans les matériels de scierie.
III. LA « RUÉE VERS LE BOIS » : UN ESSOR D'USAGES PARFOIS CONCURRENTS, POUR UNE RESSOURCE BEL ET BIEN FINIE
A. UNE « CASCADE DES USAGES » SENS DESSUS DESSOUS, ALORS QU'ELLE RÉPOND À UNE LOGIQUE ÉCONOMIQUE DE COMPLÉMENTARITÉ
1. Une « cascade des usages » du bois qui répond à une logique économique et, normalement, se met en place d'elle-même
Le bois est classé en trois catégories qui correspondent à la fois à des qualités et à des usages différents : bois d'oeuvre, bois d'industrie et bois énergie. Dans un monde d'appariement optimal entre ressources et emplois, le bois de qualité bois d'oeuvre (diamètre supérieur à 20-25 cm) seraient destinés à des usages bois d'oeuvre, les bois de qualité industrie (entre 7-8 et 20-25 cm) destinés à des usages industriels (emballage, poteaux, trituration...) et le bois de qualité énergie (petit bois, issu de dépressage, rémanents, houppier) destinés à un usage énergétique (sous diverses formes).
Chimie du bois : des produits à haute valeur ajoutée à partir des résidus de la filière
La Commission européenne affirme qu'il est important d'imposer l'utilisation en cascade du bois. Cela ne peut se faire que dans une chaîne de valeur où les résidus sont effectivement utilisés, par exemple dans de nouvelles bioraffineries. Ou par le biais de symbioses industrielles où des industries traditionnelles comme l'industrie du papier et de la pâte à papier collaborent avec des secteurs en aval comme l'industrie chimique pour créer des produits à haute valeur ajoutée à partir des résidus de la filière bois.
Les processus de transformation/raffinage de bois en ses composants de base, tels que la cellulose, la lignine, l'hémicellulose et les matières extractibles, offrent de grandes possibilités de création de valeur. L'UE doit mettre sur le marché des produits à base de bois plus innovants et augmenter la production.
Le Circular Bio-based Europe (CBE-JU), un partenariat public-privé entre la Commission et le consortium des industries biosourcées, est l'un de nos principaux instruments politiques pour développer l'innovation et mettre la recherche sur le marché. Elle accomplit un travail précieux en faisant progresser les industries biologiques circulaires compétitives en Europe et en développant de nouveaux produits et solutions circulaires et durables pour le marché.
Le projet SylPlant à Roussillon, en France, en est un exemple. Il a bénéficié d'un financement de 14 millions d'euros pour la construction d'une bioraffinerie commerciale pour produire 10 000 tonnes par an d'ingrédients riches en protéines pour l'alimentation humaine et animale à partir de résidus agricoles ou forestiers locaux.
Source : Commission européenne
Dans une grume, l'essentiel de la valeur provient de ce qui peut être valorisé en bois d'oeuvre (charpente, menuiserie...), les 40 % restants (copeaux, sciure, chutes de sciage...) constituant les connexes pouvant être valorisés dans d'autres usages et notamment dans le bois d'industrie (emballage, panneaux, papeterie) et le bois énergie (plaquette forestière, pellets...).
La biomasse est, selon l'Insee, « l'ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie ». Le bois est une source de biomasse dite « solide », sous diverses formes : bois bûche, bois fin de vie, plaquettes forestières, pellets... L'usage énergétique n'est jamais prioritaire.
Seulement, le bois énergie fait aussi partie de l'équilibre économique de la filière, dans une logique d'optimisation du rendement matière. Ainsi, selon Jean-Michel Servant, environ 45 % d'un feuillu à maturité ne peut faire autre chose que du bois énergie. La filière aime à résumer cet enjeu par la comparaison avec la pomme et son épluchure.
L'analyse de cycle de vie (ACV) conventionnelle du bois énergie
Le carbone stocké dans le bois - à l'image de celui qui compose les êtres humains, animaux, les plantes ou le sol - est appelé carbone « biogénique », par opposition au carbone fossile, qui n'est plus en contact avec la biosphère avant son extraction et sa combustion. Par convention, il est considéré comme n'émettant pas de CO2 lors de sa combustion. Pour autant, il est préférable de viser un usage long du bois, pour un stockage plus durable du CO2.
Les directives européennes sur les énergies renouvelables, et la dernière en date, RED III11(*) (renewable energy directive), intègrent ce principe de « cascade » ou de « hiérarchie » des usages. Cela est doublé par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), mais sans valeur juridiquement contraignante via cet instrument.
À peine la directive RED II entrée en vigueur en 2024, avec déjà un retard important, la directive RED III aurait dû être transposée avant le 21 mai 2025. Ce n'est pas encore le cas de certains pays, dont la France, les concertations de l'automne 2024 ayant été interrompues par le changement de Gouvernement. Or, là où la Commission avait fait preuve d'indulgence pour la précédente directive en ne formant pas de recours en manquement, elle aurait envoyé une instruction semblant indiquer qu'elle souhaitera une transposition plus rapide pour RED III.
Les entreprises du bois-énergie déplorent ce retard, source d'insécurité juridique, d'autant que le seuil d'application des critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre a été abaissé : alors que, s'agissant des combustibles ou carburants issus de la biomasse, seules les installations produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid « pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW » étaient assujetties à RED II, c'est désormais le cas de toutes les installations au-dessus de 7,5 MW (article 29 modifié), soit environ trois fois plus de sites pour RED III.
Le respect des « critères de durabilité » pour la ressource fournie aux chaufferies, notamment s'agissant des plaquettes forestières, issues directement de l'exploitation forestière, ne serait plus garanti. L'opérateur énergétique devrait pourtant remplir un audit de certification garantissant la traçabilité de la ressource à chaque étape.
La direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) se montre toutefois rassurante, et écarte le risque de vide juridique, en évoquant une clause grand-père tardivement annoncée, qui protégerait les entreprises concernées, garantissant l'application de la directive RED II jusqu'en 2030 au plus tard. Elle évoque, pour la transposition de RED III, la perspective d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue) à l'automne 2025.
Néanmoins, le débat n'est toujours pas clos en interministériel entre la DGEC et la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) d'un côté, et la DGPE et la direction générale des entreprises (DGE) de l'autre, pour définir le degré de profondeur de la transposition.
S'agissant du champ d'application du principe de cascade des usages, les rapporteurs sont d'avis que :
- pour les installations dépassant le seuil de la directive, seules celles bénéficiant de subventions publiques devraient faire l'objet d'un contrôle au regard de ce critère, et non pas toute installation (dans cette seconde hypothèse, ce contrôle serait inclus dans l'autorisation environnementale) ;
- par ailleurs, seules les nouvelles installations devraient faire l'objet de ce contrôle, et non pas l'ensemble du parc existant.
Recommandation n° 15 : transposer rapidement la directive RED III et ne pas la « surtransposer », tant sur le champ des sites soumis à la cascade des usages (n'y assujettir que les sites nouveaux et les sites bénéficiant de fonds publics) et sur les critères de « durabilité » (en faisant reconnaître la gestion durable et multifonctionnelle à la française comme suffisante au regard de la définition européenne de cette notion).
S'agissant des critères de durabilité, les rapporteurs ne souhaitent pas exclure de cette catégorie de « biomasse durable » le bois issu d'une gestion forestière impliquant des pratiques telles que les coupes rases ou le dessouchage, dans la mesure où, par exemple, la Suède a fourni une définition de la forêt primaire la préservant de cette réglementation.
2. Pourtant, une certaine concurrence des usages s'est fait jour en raison de signaux économiques contradictoires, perturbant cette cascade
En dépit de la logique économique, des zones de recouvrement entre différents usages ont toujours existé dans une certaine mesure, comme le rappelle le délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages Jean-Michel Servant. Ces recoupements peuvent s'expliquer par des modalités de vente ne permettant pas la bonne valorisation des bois selon la classe à laquelle ils appartiennent, par la présence à proximité d'un massif forestier d'un site industriel majeur ou à même de donner de la prévisibilité aux propriétaires par de la contractualisation ou encore par une insuffisance de l'outil de transformation à absorber le bois d'une certaine classe.
Cependant, sur la période récente, ces chevauchements auparavant ponctuels se sont étendus, au point, dans certains cas, de donner lieu à une véritable inversion de la logique économique normale. L'inflation énergétique de 2022-23 a indéniablement contribué à brouiller le signal-prix envoyé par le marché, conduisant dans certains cas le bois, du moins provisoirement, à être acheté plus cher pour un usage énergétique que pour un usage industriel. Une logique d'accumulation de pellets par provision et crainte de pénurie, ayant tourné semble-t-il à la spéculation, a entraîné une forte hausse du prix de ce combustible, qui s'est résorbée depuis.
Au-delà de ces perturbations momentanées, la situation deviendrait réellement problématique si elle venait à verrouiller durablement la filière dans certains usages en raison de choix technologiques passés. Le rapporteur Serge Mérillou, qui indique être originaire d'« une région où les projets de biomasse se multiplient », affirme que « l'ampleur de certains d'entre eux [l'ont] d'ailleurs quelque peu surpris, compte tenu du contexte actuel de tension sur la ressource en biomasse, qu'elle soit forestière ou non ». Le risque est que cela nous enferme dans des choix technologiques.
La multiplication de projets de fabrication de pellets dans nombre de territoires, semblant répondre à une logique financière court-termiste, a suscité l'inquiétude de nombreux acteurs. Il en est ainsi, par exemple d'une usine à pellets du groupe Biosyl à Guéret, dans la Creuse, qui a fait l'objet d'une opposition d'associations environnementales mais aussi d'élus locaux, au motif que son approvisionnement induirait localement une pression excessive, en privant potentiellement les autres usages de cette ressource. Il en est de même pour les nombreux projets de chaudières biomasse de moyenne ou grande taille ou de cogénération qui ont vu le jour ces dernières années.
Des tensions se font jour sur la ressource biomasse, avec la multiplication de projets notamment énergétiques.
Selon une étude du think tank I4CE, « en Allemagne, les énergéticiens emploient du bois recyclé et les panneautiers du bois brut, alors qu'en France ce sont les énergéticiens qui ont la capacité de payer le bois brut et les panneautiers qui se sont repliés sur le bois recyclé, moins onéreux ». Cette étude explique également que « la politique française de forte subvention du bois énergie, y compris à partir de ressources primaires, place sans doute la France dans une situation moins favorable que les trois pays étudiés en termes de disponibilité des bois de faible diamètre et qualité pour les usages longs ».
Selon une étude du cabinet Carbone 4 commandée par la filière bois française, en France, « seuls 20 à 25 % de la consommation de bois correspondent en 2019 à des usages matière à longue durée de vie. L'augmentation de cette proportion d'utilisation de bois pour des usages à longue durée de vie demandera un effort industriel important. »
Un levier aisément mobilisable pour freiner l'accélération des projets de biomasse, dans un contexte où ils ont été largement encouragés par des fonds publics sur la période récente, consisterait à rééquilibrer ces financements, afin de tendre au moins à une neutralité de la puissance publique entre les usages.
Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan cite, dans une note, des chiffres de la Cour des comptes de 2018 selon lesquels la filière bois énergie bénéficiait de six fois plus de soutiens publics que la filière transformation en matériau et pour l'utilisation en construction.
Une étude à paraître du think tank I4CE estimerait en outre que, depuis 2020, environ 75 % des montants des appels à projets auraient été destinés au bois énergie, contre 25 % seulement pour les matériaux et ce malgré le recentrage, par exemple, du cahier des charges de l'appel à projets Industrialisation performante des produits bois (IPPB), sur les produits bois à durée de vie longue12(*). Ainsi, sur 1,2 Md€ de fonds :
Ø plus de 300 M€ de fonds ont été destinés à la construction et plus largement aux usages matières (IPPB 75 M€, SCB 200 M€) ;
Ø plus de 800 M€ de fonds ont été destinés à la chaleur (biomasse chaleur pour l'industrie, l'agriculture et le tertiaire, BCIAT 600 M€, BCIB 200 M€).
Il convient de redonner plus de place au signal-prix du marché, en tendant au moins à un équilibre à 50-50 % entre usage matière et énergétique dans les appels à projets.
Recommandation n° 16 : dans les financements par appels à projets destinés à la filière bois, se fixer pour objectif de viser un équilibre 50 % énergie - 50 % usages longs, plutôt que 70 % énergie - 30 % usages longs, afin de ne pas favoriser un usage par rapport à d'autres autres et de rétablir le signal du marché.
B. UN BESOIN DE PLANIFICATION ET DE RÉGULATION POUR ASSURER LE « BOUCLAGE BIOMASSE » À L'ÉCHELLE TERRITORIALE ET NATIONALE
1. Une filière victime de son succès et un bouclage biomasse menacé par des « appels d'air » : Gardanne, carburants d'aviation durable (SAF), 50 grands sites industriels
En tant que coproduit de la photosynthèse, le bois est une ressource finie, dépendant des cycles naturels. S'ajoute à cette contrainte physique la problématique de la disponibilité du stock du bois sur pied.
Or, le matériau qu'est le bois compte de nombreux atouts en matière de compétitivité, de décarbonation et de relocalisation. En fonction des usages, le bois permet la séquestration, le stockage du carbone ainsi que la substitution à d'autres matériaux plus carbonés. Un exemple caractéristique est l'usage du bois-énergie local et issu de forêts gérées durablement, qui est à la fois une énergie peu chère et présentant de multiples gains environnementaux dans le cas, par exemple, de la substitution au fioul.
C'est la raison pour laquelle de nombreuses politiques publiques soutiennent la filière bois et son potentiel en matière de compétitivité et de décarbonation (objectifs contraignants de la RE2020, subventions du fonds chaleur, des appels à projets BCIAT...). Au-delà des politiques existantes, il pourrait être tentant pour de nouveaux secteurs de miser sur le bois pour avancer de pair dans ces deux dimensions.
Seulement, le bois peut-il à lui seul constituer un levier de compétitivité et de décarbonation pour tous les autres secteurs de l'économie ? La réponse est évidemment négative, et cela a commencé à se ressentir dans les discussions sur le bouclage biomasse. À cause d'une approche sans doute trop en silo, l'administration a admis avoir été dépassée, et est en train de réduire progressivement la voilure sur l'ambition des projets biomasse. L'ancien adjoint au Secrétariat général pour la planification écologique, M. Frédérick Jobert, a alerté dans une note sur la nécessité d'un développement raisonné du bois énergie.
Par ailleurs, l'Ademe utilise désormais l'outil d'aide à la décision EnR'Choix dans les appels à projets qu'elle opère, afin de s'assurer, pour chaque projet, de l'absence d'alternative (récupération de chaleur fatale, géothermie, solaire thermique). Une logique de plafonnement de la quantité d'énergie produite par projet a également été mise en place et gagnerait à être approfondie.
Un cas particulier historique est celui de l'ancienne centrale à charbon de Gardanne, qui a été convertie en 2021 par GazelEnergie pour produire de l'électricité à partir de biomasse solide, c'est-à-dire de bois. Le projet de conversion au pellet de l'ancienne centrale à charbon de Cordemais, en Loire-Atlantique, a en revanche été abandonné. De fait, la combustion du bois pour la production d'électricité est, de l'avis unanime des spécialistes, jugée inefficace, la production d'électricité ne pouvant être considérée au mieux comme un coproduit de la production de chaleur, dans le cadre de la cogénération.
La centrale biomasse de Gardanne :
une
épine dans le pied de la filière bois-énergie
La tranche restant en fonctionnement, Provence 4 Biomasse, produit 150 MW d'électricité par an, pour un rendement énergétique médiocre, de seulement 30 à 35 %, soit un quart d'une tranche fonctionnant au charbon.
Les acteurs de la filière bois énergie entendus par la mission ont déploré le dommage que ce site porte à l'image de leur activité. Il a fait l'objet, en effet, d' un documentaire, sur le service public, à une heure de grande écoute, pointant les approvisionnements, s'agissant tant de la qualité du bois brûlé, jugée trop bonne, que de l'origine de ce bois, aux deux tiers importés du Portugal, de l'Espagne et même... du sud du Brésil, semble-t-il en raison de la recherche, par GazelEnergie, d'équilibres sociaux subtils entre la centrale de Gardanne et le port de Fos-sur-Mer, par lequel transite ce bois importé.
La conclusion, fin 2024, d'un nouveau contrat de rachat d'électricité de 8 ans avec EDF, pour un montant de 800 millions d'euros pour l'État, a semblé répondre principalement à des considérations d'accompagnement social, afin de trouver des relais de croissance dans des délais ne mettant pas en péril les 90 emplois directs du site.
L'autorisation d'exploiter a été suspendue par le tribunal administratif de Marseille au motif que le contrat d'approvisionnement de GazelEnergie déséquilibrerait le marché compte tenu des usages actuels, l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Tarascon (également coproducteur de chaleur) et la chaufferie biomasse Idex à Brignoles s'estimant en particulier menacées sur la ressource BI-BE du quart Sud-Est. GazelEnergie vise en effet à inverser son ratio approvisionnement local-importé, confondant sans doute le potentiel de biomasse avec sa disponibilité.
Il convient donc d'accompagner en douceur la fin de l'activité de la tranche biomasse de la centrale de Gardanne à horizon 8 ans, en prévoyant une relocalisation graduelle de son approvisionnement, en fondant cet approvisionnement sur la ressource disponible et non potentielle, et préparer une prise de relais des usages par de la production de chaleur.
Un autre « appel d'air » potentiel pourrait être celui des carburants d'aviation durable (SAF). La filière et les administrations ont fait part de leurs plus grandes réserves sur le développement de ces carburants, en particulier pour le bouclage après 2030.
L'idée que l'on pourrait décarboner l'industrie par la biomasse solide paraît tout aussi fantaisiste à la mission. Aux yeux des deux rapporteurs, et en particulier d'Anne-Catherine Loisier, les annonces du ministre de l'énergie et de l'industrie en faveur de la décarbonation de l'industrie et en particulier des cinquante sites les plus émissifs sont de nature à déstabiliser la filière.
Il conviendrait d'objectiver ce que représenterait l'utilisation de la ressource de biomasse solide (bois) pour la décarbonation des 50 sites industriels les plus émissifs de gaz à effet de serre, cette perspective ayant fait l'objet de certaines déclarations publiques non chiffrées, potentiellement déstabilisatrices pour la filière.
Le ministre s'est montré rassurant sur cette perspective, indiquant que les leviers de décarbonation de la plupart de ces sites relevaient davantage de l'électrification.
Il semble qu'un seul des sites serait potentiellement finalement ainsi décarbonée.
Recommandation n° 17 : objectiver les « appels d'air » sur la demande de bois énergie, grâce au rôle d'éclairage du GIS biomasse, pour ensuite mieux les maîtriser, par exemple en :
- pérennisant l'outil d'aide à la décision EnR'Choix dans l'appel à projet BCIAT opéré par l'Ademe, ainsi que la logique de plafonnement de la quantité d'énergie produite par projet ;
- accompagnant en douceur la fin de l'activité de la tranche biomasse de la centrale de Gardanne à horizon 8 ans, en prévoyant une relocalisation graduelle de son approvisionnement, en fondant cet approvisionnement sur la ressource disponible et non potentielle, et en préparant une prise de relais des usages par de la production de chaleur ;
- n'accordant qu'une place très réduite aux carburants d'aviation durable (SAF) issus de biomasse solide et à la pyrogazéification du bois dans la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ;
- envisageant seulement au cas par cas le choix de décarboner certains des 50 plus grands sites industriels par la biomasse solide.
2. Conforter le rôle de régulation des cellules biomasse régionales, en lien avec les professionnels, à travers le levier des contrats d'approvisionnement
Les avis des cellules régionales biomasse, trop peu suivis par le préfet, mériteraient de devenir conformes à condition que professionnels et élus locaux y soient plus étroitement associés, pour réguler les contrats d'approvisionnement.
Ces cellules, mises en place en 2006, animées par les directions territoriales de l'Ademe, les Dreets, les Draaf et les Dreal, ont pour mission d'instruire les nouveaux projets d'importance et d'émettre un avis à leur sujet, au regard de l'objectif de « prévention des conflits d'usage ». Ces avis ne sont, en revanche, pas toujours suivis par les préfets.
Leur expertise doit d'abord être fiabilisée, en particulier s'agissant des flux inter-régionaux, qui peuvent aujourd'hui échapper à la vigilance de ces structures tributaires des déclarations des professionnels.
Depuis une instruction du 18 juillet 2024, les cellules peuvent « consulter des acteurs économiques », un rapprochement avec les professionnels bienvenu et qui gagnerait à se systématiser.
Recommandation n° 18 : renforcer les cellules régionales biomasse en fiabilisant leurs données notamment par une meilleure coordination inter-régionale, et en donnant un avis conforme à ces structures, après consultation des acteurs forestiers amont et bois aval, sur les décisions du préfet relatives aux contrats d'approvisionnement des nouveaux projets bois énergie
C. UNE MOBILISATION DU BOIS EN FORÊT À AJUSTER AU PROFIT D'OBJECTIFS PLUS PERTINENTS DE TRANSFORMATION ET DE PUITS DE CARBONE
1. L'objectif de 10 M de m3 de prélèvements supplémentaires à horizon 2030 n'est ni réaliste, ni pertinent au regard de l'objectif de création de valeur ajoutée
Le programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016-26, qui s'est imposé comme document-cadre de la politique forestière depuis la loi d'avenir de 2014, fixait dans sa première version (2016-2025) un objectif de récolte de 12 millions de mètres cubes supplémentaires de bois en dix ans. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation indiquait alors que « le renforcement de la mobilisation de la ressource [était] un axe structurant du PNFB ».
Or, les années 2018 à 2020 ont été marquées par les sécheresses, qui ont créé un terrain propice aux attaques de parasites tels que les scolytes, conduisant, directement à cause du dépérissement des arbres ou indirectement via des coupes préventives, à mettre sur le marché 6 millions de mètres cubes supplémentaires de bois.
Pour certaines régions, notamment dans le quart nord-est de la France, les objectifs fixés au niveau national par le PNFB, et déclinés au niveau régional dans les PRFB, n'auraient pu être tenus qu'au prix d'une pression excessive sur les écosystèmes forestiers et d'une dégradation du bilan carbone de la forêt.
C'est pourquoi l'article 57 de la loi Climat-résilience demandait une révision à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois13(*) (PNFB)... qui n'a finalement jamais eu lieu, en dehors de la publication, par ailleurs, d'une feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Bien que la procédure de révision du PNFB, fruit de larges concertations au sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), soit relativement lourde, une telle révision s'imposait.
Le WWF a suggéré en audition, de façon générale, d'introduire davantage de suivi et de révision à mi-parcours des grands documents d'orientation et grandes trajectoires de la politique forestière
Un regard rétrospectif sur les objectifs précédemment assignés à la politique forestière en termes de prélèvements conduit à appréhender ces trajectoires avec une grande circonspection. Si un horizon mobilisateur est souhaitable, faut-il rappeler qu'en 1978, le rapport Meo-Bétolaud préconisait, déjà, une augmentation de 12 M de m3 de récolte de bois d'oeuvre en dix ans ?
L'interprofession nationale France Bois Forêt a commandé au cabinet Carbone 4 une étude d'ampleur, cofinancée par le Codifab (union professionnelle de l'ameublement en bois) et Copacel (union professionnelle du carton, du papier et de la cellulose) sur la trajectoire carbone de la filière, en termes de puits de carbone forestier, de séquestration et de stockage du carbone dans les produits bois, et de substitution pour le bois-énergie.
Les auteurs de l'étude confirment que le scénario n'a déjà pas été réalisé pour les premières années - ce qui rend d'ores et déjà hors d'atteinte l'objectif fixé à horizon 2030. L'Office national des forêts (ONF) confie également que, s'agissant du moins de la forêt domaniale, déjà plus intensivement exploitée14(*) que le reste de la forêt française - communale ou privée -, les possibilités de récolte supplémentaire paraissent peu plausibles.
Pour la forêt communale et la petite propriété forestière privée, les rapporteurs jugent la prise en compte de l'acceptabilité sociétale de ces prélèvements très insuffisante, si ce n'est négligée, dans la fixation de cet objectif.
Du reste, plutôt qu'un objectif purement quantitatif de prélèvement de bois en m3 ou même de sciages en m3 - ce qui témoigne au moins de l'effort de transformation -, il serait plus approprié de se fixer un objectif de valeur ajoutée créée.
Recommandation n° 19 : ajuster l'objectif de 12 millions de m3 de prélèvement de bois supplémentaire en forêt à horizon 2030 et fixer un objectif plus pertinent de transformation de bois d'oeuvre et de bois d'industrie sur notre territoire, à des fins d'augmentation de la valeur ajoutée.
2. Des besoins d'optimisation du rendement matière et d'allongement de la durée de vie des produits bois pour répondre à la demande
Dans ce contexte de contraintes sur la disponibilité de la ressource (cf. pour plus de détail la partie IV infra), la filière doit donc apprendre à faire « plus de produits avec moins de bois », en progressant dans l'optimisation du rendement matière.
Cette approche implique en parallèle de financer davantage les aménités de l'amont (valorisées à 970 € par hectare et par an, selon le rapport de M. Chevassus-au-Louis de 200915(*)) en massifiant le recours au label bas carbone et aux certifications volontaires pour les absorptions de carbone (CRCF). Le président de la République a précisé, lors d'un conseil de planification écologique début 2025, que « des dispositifs existent et pourraient éventuellement être amplifiés » et a évoqué « la simplification du cadre de la finance durable et le développement de nouveaux instruments pour aider à l'orientation des investissements privés et financements vers l'économie verte ».
À l'aval, le think tank I4CE identifie « des marges de progression pour mieux valoriser les ressources de qualité bois d'oeuvre, en particulier des bois résineux d'un diamètre non standard (petits, gros et très gros diamètres), et des bois feuillus de façon générale, aujourd'hui peu valorisées dans des usages longs pour des raisons de compétitivité ou de méconnaissance technique ».
Cela constitue un défi technique d'ingénieur à relever pour la filière, qui nécessite « un effort industriel important en termes d'investissement dans les outils de transformation et d'innovation sur les débouchés » (I4CE).
Sur le premier point en particulier, la transformation, la modernisation des scieries en général, et en particulier l'équipement croissant de certaines d'entre elles en appareils à rayons X pour évaluer a priori d'éventuels défauts des billes (fentes, noeuds) et ainsi les orienter vers les usages les plus indiqués pour cette qualité, constituent en outre un appui technologique dans cette direction.
Sur le second point, les débouchés, « le développement des produits d'ingénierie (type lamellés-collés, contrecollés...), plus tolérants sur la qualité et la dimension des bois utilisés [...] perme[t] d'intégrer des bois de faible qualité visuelle ou des sections non standard (pour les bois qui comporteraient des défauts par exemple) ».
Le think tank I4CE indique cependant que les ressources Bibe pourraient être mobilisées pour la production de panneaux et d'isolants « sans contrainte technique majeure (sauf pour les sciures trop fines et les écorces, exclues pour la production de panneaux et isolants), à condition de disposer de capacités de production et de débouchés suffisants ».
C'est pourquoi il préconise « aussi un accompagnement de la demande et des habitudes du marché » et insiste sur l'intérêt des subventions à ces usages longs.
En parallèle, un effort particulier sur le recyclage est à poursuivre. Si « la valorisation, soit par recyclage soit par production d'énergie, est largement développée, [elle] peut encore être améliorée pour réduire la consommation de matières premières vierges en réintroduisant le bois recyclé dans la fabrication de nouveaux produits et remplacer les énergies fossiles grâce à l'utilisation du bois comme source d'énergie renouvelable » (DGPE).
Selon l'Ademe, la France produit chaque année 8,7 millions de tonnes de déchets de bois (emballage, mobilier, matériaux de construction, coproduits industriels) :
Ø 1 million sont autoconsommés par l'industrie ;
Ø 7,4 millions sont collectés :
o 5,8 millions sont valorisés en France et à l'export :
§ 3,2 M de tonnes sont recyclées (valorisation matière) ;
§ 2,6 M de tonnes sont utilisées pour la production d'énergie ;
o 1,6 million sont enfouis.
Il conviendrait de viser la réduction au minimum de ce dernier flux, si ce n'est de l'avant-dernier, pour orienter davantage de ressources en valorisation matière, ce qui irait de pair avec un allongement de la durée du stockage de carbone dans les produits bois.
Les panneautiers à particule français présentent des taux d'incorporation d'environ 50 % (selon l'éco-organisme Ecomaison) et visent 70 % à horizon 2035, tandis que l'Italie présente un taux encore largement supérieur, de l'ordre de 97 %.
Source : L'Ameublement français
Les appels à projets SCB et IPPB financent des projets en ce sens, et en particulier des process de prétri amont qui permettent de distinguer le bois déchet A du bois déchet B et des bois indésirables : les bois A ou B1 peuvent être incorporés, les bois B2 et indésirables ne pouvant qu'alimenter une chaudière biomasse sur place16(*). Le FCBA s'est également vu confier un travail sur la détection et la caractérisation des substances de traitement du bois, qui peuvent faire obstacle au recyclage. S'agissant des matériaux issus de la démolition ou de la rénovation, la DHUP coordonne la mise en place d'un diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD) qui devrait permettre de mettre en avant les possibilités de réemploi ou, à défaut, de valorisation.
IV. LA FORÊT FRANÇAISE N'EST PAS QU'UN « GRENIER À BOIS » ET SA RESSOURCE N'EST PAS ILLIMITÉE
Les constats sur l'amont de la filière, c'est-à-dire sur la forêt française et sa ressource en bois ne sont plus à faire : moindre adéquation aux exigences de l'industrie, modalités de vente archaïques et insuffisance de la contractualisation, ressource moins facilement exploitable pour des raisons physiques et sociétales, morcellement de la propriété et faible mise en gestion, imprévisibilité croissante sur la forêt de demain liée au changement climatique. Si une meilleure organisation à l'amont est de nature à améliorer la mobilisation du bois, c'est surtout à l'aval qu'il reviendra de s'adapter à ces contraintes, la plupart ne pouvant être facilement surmontées.
A. UN POTENTIEL DU BOIS DES FORÊTS FRANÇAISES DÉPENDANT DES QUALITÉS REQUISES PAR L'INDUSTRIE ET DES MODES DE COMMERCIALISATION
1. L'amont vu de l'aval : pour l'industrie du bois, toutes les forêts ne se valent pas
Il convient d'abord de battre en brèche l'idée selon laquelle la ressource en bois serait si abondante que ce qu'on en dit dans les forêts françaises.
Il est vrai que la surface forestière est de 17,5 millions de m2, sans compter les 8 millions de m2 de la forêt des Outre-mer, en particulier de Guyane, tandis que la forêt allemande n'en compte que 11,5 millions et la forêt italienne 12 millions.
En apparence, la France serait donc en capacité non seulement d'approvisionner la première transformation nationale, mais serait également en état d'être le « grenier à bois de l'Europe » par l'exportation de volumes importants de bois ronds sans priver son appareil productif de la ressource nécessaire. De fait, les Allemands, les Belges, les Italiens ou les Espagnols, et même les Chinois, ne manquent pas de venir se fournir en France.
Pourtant, les constats de plusieurs maillons de la filière sur les tensions d'approvisionnement évoquées supra témoignent de ce qu'il n'en est rien. La France elle-même ne parvient pas à exploiter sa ressource, qui est pour partie transformée à l'étranger.
En apparence, la situation italienne serait le miroir inversé de la France : ce pays, qui dispose d'une ressource non négligeable, déploie une approche très conservationniste de sa forêt, protégée par le ministère chargé de l'environnement au titre de la restauration des terrains de montagne, mais également, en vertu de la Constitution, par des autorisations délivrées par le ministère de la culture, en tant que composante du patrimoine ; pour autant, son industrie de transformation du bois, largement approvisionnée par une matière première importée, enregistre de bien meilleures performances commerciales que l'industrie française du bois.
La France serait-elle donc victime de cette « malédiction des matières premières » qui conduirait, selon certains économistes, les États disposant de ressources naturelles importantes, à dilapider leur patrimoine, notamment par l'installation progressive d'une économie de rente ? Des billes issues de forêts plantées grâce aux subventions du fonds forestier national (FFN) sont exportées, emportant avec elles leurs connexes. Un comble : du bois français est transformé à l'étranger avant d'être réimporté - c'est par exemple le cas du bois transformé par la scierie Streit, celle-ci s'approvisionnant pour partie en France et y écoulant 45 % de sa production.
C'est en réalité plus compliqué que cela. Tout est une question d'unité de mesure : aux yeux de l'industriel, c'est en m3 et donc en volume de bois qu'il faut compter et non en m2 et donc en surface forestière.
Or, à cet égard, si la filière bois allemande, malgré de moindres surfaces forestières, surpasse la filière française en volumes transformés et en valeur ajoutée, c'est aussi que la forêt allemande contient beaucoup plus de volumes de bois que les 3 milliards de mètres cubes de la forêt française.
Il y a plusieurs raisons à cela :
Ø d'abord, la forêt allemande est davantage publique que la forêt française, ce qui réduit les coûts de coordination, par opposition à la forêt française, davantage privée et morcelée ;
Ø ensuite, la forêt allemande est, davantage que la forêt française, composée de résineux, qui permettent une sylviculture deux fois plus dense et des cycles de récolte jusqu'à trois fois plus rapides - ainsi, pour un chêne approchant de la maturité, vers environ 120 ans, une sylviculture relativement intensive peut compter jusqu'à trois cycles de récolte, d'environ 40 ans ;
Ø enfin, les conditions climatiques sont plus propices à la croissance en volume en Allemagne par opposition à la forêt du quart sud-est en France ou la forêt italienne.
Ce bois est en outre réputé plus adapté à l'industrie (bois droit, cernes resserrés). Les rapporteurs ont en effet été impressionnés d'observer la conformation en « baguettes » longilignes des épicéas de Forêt-Noire, approvisionnant la scierie Streit. De notre côté de la frontière, bien qu'il ait investi dans une ligne ruban moderne à même de valoriser des gros et très gros bois, Marc Siat a insisté sur le fait que pour optimiser la valorisation matière, l'industrie avait besoin avant tout « de bois droits », une exigence qui paraît bien simple en apparence mais qu'il n'est pas si aisé de retrouver, du moins dans les volumes souhaités, dans la forêt française.
Il en résulte que deux tiers des sciages réalisés chaque année en France le sont à partir de bois résineux contre un tiers à partir de bois feuillu, une proportion inverse à la part respective de résineux-feuillus dans la forêt française.
L'Institut géographique national (IGN), qui réalise en France l'inventaire forestier national, fournit une image précise de la ressource française. Elle a en outre produit avec l'institut technique Forêt, cellulose bois ameublement (FCBA) une projection de la ressource disponible à horizon 2030, 2050 et 2080 avec différents scénarios, trente-six pour l'amont (trois de taux de prélèvement, trois de volume de récolte, deux de renouvellement) et vingt pour la filière dans son ensemble (trois pour les effets du climat, dix pour l'allocation de la récolte). La démarche d'appariement de la ressource de la forêt française avec les usages du bois qui en sont faits est nouvelle et fort utile pour toute la filière.
Ces données, aussi indispensables soient-elles, doivent néanmoins être complétées par la perception qu'ont les professionnels de la ressource et de son adéquation à leurs besoins. La rapporteure Anne-Catherine Loisier appelle en outre à la prudence sur les données disponibles au sujet du potentiel de récolte. À titre d'exemple, elle rappelle que la ressource en bois d'oeuvre potentiel de chêne en Bourgogne-Franche-Comté, après des protestations de la filière, a fini par être réévaluée en 2018 (avec des hypothèses de catégorisation différentes (en fonction du diamètre fin bout et du diamètre à 1 m 30)) : l'IGN et le FCBA avaient conclu à une surestimation d'environ 30 % des estimations de bois d'oeuvre potentiel17(*) (BO-P), « que ce soit dans le stock sur pied, les prélèvements récents, ou les disponibilités futures ». Cette réévaluation, conduisant à des résultats plus proches de l'enquête annuelle de branche (EAB), faisait suite à « des critiques importantes des professionnels locaux, qui jug[eai]ent les définitions du BO-P utilisées en routine par l'IGN inadaptées ». Cela montre qu'il ne faut pas négliger les retours de terrain.
La forêt d'outre-mer :
une
spécificité de la France par rapport à ses voisins
européens
Une particularité de la forêt française est que près d'un tiers de sa surface est localisée dans les outre-mer, et plus particulièrement en Guyane. Au-delà de l'autoconsommation, le prélèvement de bois y est aujourd'hui très faible (80 Mm3), la collectivité ne disposant pas d'un outil de transformation adéquat et d'une filière suffisamment structurée pour transformer la ressource si elle était prélevée. Les rapporteurs souhaiteraient pouvoir mobiliser davantage cette ressource (cf. supra, partie II, B, 1, pour un aménagement du RDUE en ce sens) pour le développement de l'économie locale (conversion de terres pour assurer l'autosuffisance alimentaire, prélèvement du bois pour les besoins locaux en énergie et en construction bois) ou de celle des Antilles voisines, ce d'autant plus que la Martinique importe aujourd'hui une quantité semble-t-il importante de granulés de bois d'Amérique du Nord pour alimenter la centrale thermique Galion 2.
Pour autant, la forêt guyanaise est en grande partie une forêt primaire, dans la continuité de l'Amazonie, avec des enjeux éminemment stratégiques en termes de biodiversité et de stockage du carbone biogénique. Pour cette raison, le président de la Fédération nationale du bois Jean-Pascal Archimbaud va jusqu'à considérer qu'« exploiter la forêt guyanaise, cela paraît une mauvaise idée. Qu'on en utilise localement des ressources, d'accord, mais pourquoi aller au-delà, en détruisant cette réserve écologique importante, alors que nous pouvons faire du bois ailleurs ? En plus, le bois de Guyane ne flotte pas, ce qui pose des problèmes évidents d'acheminement. »
Quelles que soient les options retenues, un prérequis est de suivre l'évolution de la forêt guyanaise par la réalisation d'un inventaire forestier outre-mer, demandé de longue date par la commission des affaires économiques, et initié seulement en 2024 dans le cadre de la planification écologique (la forêt guyanaise stocke à elle seule autant de carbone que la forêt hexagonale) et qui nécessitera encore un travail de quatre ou cinq ans.
2. Des modes de vente du bois qui ne sécurisent pas l'approvisionnement de la filière bois française
La commercialisation est une étape clé articulant l'amont de la filière et son aval, du moins la première transformation. Or, entre France et Allemagne, les modalités de vente sont très différentes.
Le bois des forêts françaises demeure en grande partie vendu sur pied (avant d'être coupé), puis de gré à gré ou par adjudication, c'est-à-dire, en pratique, au plus offrant. À l'inverse, le bois allemand est davantage vendu façonné et bord de route (après avoir été coupé et trié par lots), dans le cadre de contrats d'approvisionnement.
La prévisibilité offerte par cette dernière modalité de vente facilite l'approvisionnement de la filière, d'une part parce qu'elle la sécurise et d'autre part parce qu'elle la dispense de coûteuses et laborieuses démarches auprès des propriétaires pour trouver une ressource équivalente. Par contraste, une demande récurrente de la Fédération nationale du bois (FNB) est d'accéder aux données du cadastre, ce qui supposerait d'étendre aux scieurs les possibilités ouvertes par la loi en 2022 aux gestionnaires forestiers, afin de démarcher les propriétaires - une logique que la rapporteure Anne-Catherine Loisier ne juge pas optimale.
M. Pierre Piveteau souligne que la plupart des scieries sont issues du monde de l'exploitation forestière, à l'inverse de son groupe, qui est né d'une petite entreprise de charpente. En France, encore près de la moitié des scieries en activité (537 sur 1 214) exercent une activité d'exploitation forestière, pour 70 % de la production nationale de sciages.
Hormis pour le bois commercialisé par l'ONF voire celui vendu par les coopératives, l'énergie des scieurs, plus préoccupés par leur amont que par leur aval, est dilapidée dans la gestion de l'approvisionnement.
La comparaison entre coopératives forestières, transformant très peu le matériau bois, et coopératives agricoles, à l'origine d'une grande partie de la transformation agroalimentaire en France, témoigne aussi d'une filière très, sans doute trop tournée vers son amont.
Les scieurs exercent même une activité de négoce en revendant toute une partie de la ressource achetée sur pied, car elle ne correspondait pas à leur outil de transformation ou aux besoins du marché.
Il règne par ailleurs une certaine opacité sur la construction du prix, les modalités de vente rémunérant sans doute insuffisamment les propriétaires. La vente bord de route garantit une bonne valorisation des bois de qualité, non mélangés à de moins bons lots - ce surcoût restant néanmoins marginal dans les coûts de revient de l'aval.
Les efforts de contractualisation en forêt domaniale (70 % de bois façonné) et communale (35 %) doivent se poursuivre, et s'étendre à la forêt privée (20 %). Une sensibilisation auprès des propriétaires privés sur l'enjeu de contractualisation pour les territoires et pour faire connaître le cas allemand serait de bon aloi.
La vente au mieux-disant pouvant favoriser les exportations (ex. du chêne vers la Chine dans les années 2010 ou vers l'Europe depuis), le calcul est souvent mauvais pour la filière.
Recommandation n° 20 : poursuivre les efforts de contractualisation en forêt privée et communale et ainsi accroître la part de bois façonné bord de route, pour sécuriser la première transformation en matière d'approvisionnement.
B. UNE DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE EN BOIS TRIBUTAIRE DE LA MISE EN GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE DE NOS FORÊTS
1. Pour les travaux forestiers, des limites liées à l'accessibilité des massifs et au choix d'une gestion multifonctionnelle, protectrice de la biodiversité
La différence entre la disponibilité et l'exploitabilité de la ressource est un aspect crucial, souvent négligé, de l'analyse de la ressource forestière. Afin d'établir la ressource réellement mobilisable pour approvisionner l'outil de transformation, il convient en effet de tenir compte des conditions d'exploitabilité de la forêt ainsi que de son équilibre économique.
Les données physiques ont là leur importance : les forêts françaises sont, à l'instar des forêts italiennes des Apennins, situées dans des zones montagneuses, les pentes pouvant compliquer l'accès aux abatteuses ou débusqueuses, rendant, de ce fait techniquement plus difficile l'exploitation forestière. À l'inverse, la forêt allemande est majoritairement une forêt de plantation, en plaine.
Pour sa région du Bade-Wurtemberg, M. Henne date les forêts monospécifiques d'épicéa plantées en futaie régulière du milieu du XXe siècle, la ressource ayant dû être reconstitué après le prélèvement de la ressource par la France dans l'immédiat après-guerre. Ce trait caractéristique de la sylviculture allemande est cependant bien plus ancien et trouve finalement assez peu d'équivalent en France, si ce n'est dans le massif des Landes de Gascogne, où une pinède a été plantée au XIXe siècle sur une plaine sableuse.
À la lisière entre géographie physique et humaine, la desserte forestière est également une donnée cruciale, tant pour intervenir dans un massif que pour en extraire le bois. Or, avec la déprise en zone rurale, ces infrastructures peuvent être mal entretenues. Cet enjeu du transport se recoupe également avec celui de la sécurité des entrepreneurs de travaux forestiers (intervention rapide des secours) et notamment avec le risque croissant d'incendie.
L'extension et l'intensification du risque incendie, en lien avec le changement climatique, est en lui-même de nature à limiter l'accès aux massifs forestiers. Des arrêtés interdisant l'accès aux massifs sur certaines plages horaires ou certains jours de l'année en raison d'un risque élevé d'incendie peuvent être pris par les préfets.
Autant la forêt du quart sud-est du pays, surtout soumise à la problématique de l'intensification du risque, n'était déjà pas une forêt à vocation productive compte tenu de sa faible croissance biologique, autant certaines forêts plus productives, comme le massif des Landes de Gascogne et certaines forêts du centre de la France, pourront y voir une contrainte supplémentaire : si le risque a toujours existé, les coûts associés en matière de création de pistes de défense des forêts contre l'incendie (DFCI), de mesures de surveillance (associations syndicales agréées), voire en termes d'assurance pour les propriétaires forestiers, pourraient peu à peu venir perturber l'équilibre économique de la gestion forestière, sans compter .
La multiplication des intempéries et notamment la concentration des pluies l'hiver, en lien avec le changement climatique, sont un phénomène naturel encore plus handicapant pour l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers. Ainsi, lors de l'année 2024, particulièrement pluvieuse, les ETF sont restés à l'arrêt pendant une partie importante de l'année.
Combiné aux restrictions d'accès en forêt au printemps et l'été pendant les périodes de nidification, le maillon économique fragile des ETF fait donc face à un défi de sécurisation de son activité ou devra affronter la saisonnalité croissante de son activité, ce qui limite l'amortissement de leurs lourds achats de machines.
Pour y faire face, les ETF demandent l'extension du TO-DE ou une caisse d'assurance « intempéries », à laquelle les scieurs ont peur de contribuer ; une solution plus pérenne serait de diversifier leur activité (méthodes plus légères, débardage aérien, élagage bord de route, taille de haies agricoles...) - mais pour quel impact sur le bois récolté ?
S'agissant de la forêt, une feuille de route du ministère de la transition écologique n'a semble-t-il pas résolu les difficultés de conciliation entre exploitation forestière et préservation des espèces.
Plutôt que par une caisse d'assurance « espèces protégées », cela doit se régler sous l'égide du préfet qui préside la mission interservices de l'eau et de la nature (Misen), par la définition de cahiers des charges a priori de réduction des risques d'infraction sur les chantiers, en complément d'actions de formation aux enjeux de biodiversité. En effet, l'article 31 de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture n'apporte aucune solution aux entrepreneurs de travaux forestiers en ce que la dépénalisation des atteintes aux habitats naturels a été cantonnée, dans le texte de la commission mixte paritaire, aux « personnes physiques ».
La Commission européenne a cependant fourni un guide, en 2021, pour l'application des dispositions de la directive Habitats, un autre étant en préparation pour l'application de la directive Oiseaux. La note précitée de l'ancien adjoint au Secrétariat général pour la planification écologique met en avant des progrès possibles en matière de formation des effectifs des ETF, dont 50 % viennent de l'étranger.
Recommandation n° 21 : confier aux préfets de région, dans le cadre des missions inter-services de l'eau et de la nature (Misen), en lien avec l'OFB et les professionnels, la définition de cahiers des charges a priori pour sécuriser les entrepreneurs de travaux forestiers face au risque d'atteinte aux habitats d'espèces protégées et de condamnation pénale à ce titre.
2. Des obstacles organisationnels liés au morcellement de la propriété, à lever par plus de gestion collective et par massif
Le diagnostic d'un morcellement excessif de la forêt française, en particulier de la forêt privée, hormis dans quelques grands massifs comme les Landes de Gascogne, n'est plus à faire. Avec plus de trois millions de propriétaires, la France est confrontée, à l'instar de plusieurs pays du sud de l'Europe, à un problème de taille des parcelles, celle-ci étant insuffisante pour assurer un équilibre économique satisfaisant à la gestion forestière. Comme évoqué supra (cf. partie III, C, 2), ces freins organisationnels rendent plus qu'incertaines les perspectives de mobilisation supplémentaire de bois, qui repose sur cette forêt privée non gérée.
Un rapport inter-inspections remis début 2024 rappelle que seulement 27 % de la forêt privée est aujourd'hui dotée de plans de gestion et estime à 700 000 hectares les surfaces qui pourraient être mises en gestion durable par le seul respect des obligations en matière d'obligation de plan simple de gestion (PSG).
La loi du 10 juillet 2023 relative à la prévention et à la lutte contre l'extension et à l'intensification du risque incendie a prévu, à l'initiative du Sénat et notamment de la rapporteure Anne-Catherine Loisier, un abaissement du seuil de surface au-dessus duquel les parcelles sont soumises à l'obligation PSG, passé de 25 à 20 hectares. Cette mesure relativement consensuelle est de nature à mettre en gestion environ 500 000 hectares de forêts supplémentaires, détenues par plus de 200 000 propriétaires.
Aux yeux des rapporteurs, il ne serait pas opportun d'abaisser encore le seuil au-dessus duquel les documents de gestion durable sont obligatoires. D'une part, plus ce seuil est abaissé et plus les frais de gestion administratifs sont importants, puisque par définition il y a plus de documents de gestion durables à agréer pour des surfaces plus faibles. Il y aurait par exemple près de deux fois plus de propriétaires forestiers concernés par un abaissement de 20 à 15 ha, que de propriétaires concernés par l'abaissement à 20 ha, pour une surface totale à peu près comparable ( cf. p. 86 de ce rapport).
D'autre part, Fransylva et le Centre national de la propriété forestières suggéraient, au moment de l'examen de ce texte, de miser plutôt sur les plans simples de gestion concertés, une démarche volontaire et plus souple pour les propriétaires demeurant en dessous des seuils d'obligation.
S'il ne convient donc pas d'aller plus loin, les engagements pris par le Gouvernement en termes de créations de poste au Centre national de la propriété forestière (CNPF), pour assurer l'instruction et l'agrément des documents de gestion durable, doivent être tenus. L'établissement public ne pourra assurer de missions supplémentaires sans moyens ad hoc ( cf. p. 88 du même rapport). Or, les diverses lois de finances depuis le vote de la loi en 2023 ont donné lieu à des tentatives gouvernementales de limiter l'étendue de cet engagement voire de revenir dessus.
Si des économies devaient être réalisées, elles seraient plus sûrement à trouver dans un rapprochement de l'action du CNPF et de l'ONF dans les territoires, pour tendre à une gestion forestière plus cohérente, par massif, par-delà les délimitations administratives entre propriété publique et propriété privée, à l'exemple de ce qui peut exister en Allemagne avec le Conseil allemand de la forêt (Deutscher Forstwirtschaftsrat, DFWR), association qui regroupe propriétaires forestiers publics et privés.
Par ailleurs, plusieurs outils de régulation du foncier - droit de préférence du propriétaire voisin pour les petites surfaces, droit de préemption des communes forestières limité aux parcelles à enjeu de DFCI - existent dans le code forestier.
Pour autant, davantage qu'en un hypothétique remembrement de la petite propriété forestière, les rapporteurs croient aux incitations, qui peuvent être de diverses natures (cf. les seize actions proposées par le président de la Fédération nationale des communes forestières et la présidente du Centre national de la propriété forestière fin 2023).
À cet effet, le levier fiscal est tout particulièrement indiqué. Ce n'est pas tant le levier fiscal pour le remembrement (« allègement de la taxe foncière permettant d'encourager les fusions de parcelle », action 16) qui attire l'attention des rapporteurs, que le levier fiscal pour la gestion collective (« Mettre en place des incitations financières aux outils de regroupement de gestion (aides au renouvellement forestier, dispositifs de défiscalisation) », action 13)
Les rapporteurs souhaitent une évolution différenciée du taux du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt, dans son volet « travaux » (DEFI travaux), dont l'existence a été prolongée par le projet de loi de finances pour 2023 puis renforcé par la loi du 10 juillet 2023 précitée. Si la rapporteure Anne-Catherine Loisier s'est précédemment opposée, au nom de l'équité, à la mise en place d'un taux de 25 % sur les dépenses afférentes à l'entretien, au reboisement ou à l'aménagement de dessertes pour les seuls adhérents de coopératives forestières - contre 18 % pour les autres propriétaires forestiers -, les rapporteurs conviennent de l'intérêt qu'il y aurait à accorder un tel taux bonifié, plus largement, à tous travaux forestiers dans le cadre d'une gestion collective.
Recommandation n° 22 : afin d'accroître la récolte de bois, traiter le morcellement de la propriété par des incitations à la gestion collective, en :
- poursuivant l'instruction des plans simple de gestion entre 25 et 20 ha ;
- prolongeant au-delà de 2025 le taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux sylvicoles ;
- gérant davantage la forêt par massif grâce à un surcroît de coordination gestionnaires privés-ONF indépendamment du régime de propriété ;
- bonifiant le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (Defi) « travaux » dans le cas d'une gestion collective (coopératives, experts...), par rapport au taux normal.
C. NE PAS TIRER DE « PLANTS » SUR LA COMÈTE : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE IMPOSE D'ADAPTER L'AVAL À L'AMONT ET PAS L'INVERSE
1. Le renouvellement forestier ne survivrait pas à un stop-and-go, en particulier pour certaines actions peu coûteuses, ce qui laisserait les communes forestières démunies
Comparée à la forêt allemande, la remarquable diversité génétique inter- et intraspécifique de la forêt française est son meilleur atout face au changement climatique. La politique volontariste de renouvellement a, à ce titre, fait l'objet de certaines réserves quant à la part réservée aux plantations en plein, notamment de la part de l'ancien adjoint au Secrétariat général pour la planification écologique, dans la note précitée.
Ce très attendu plan de renouvellement forestier, structurant pour la filière, a permis l'amélioration de trois types de peuplements dans le cadre de son premier véhicule, France Relance - pas de quoi cependant métamorphoser la forêt française dans son ensemble (47 000 ha, soit 0,3 % de la forêt hexagonale). Des besoins de renouvellement ou d'enrichissement ont été identifiés pour 10 % des surfaces forestières du pays à horizon 2032 dans le rapport « Objectif forêt », qui est la traduction opérationnelle de l'engagement du Président de la République de planter un milliard d'arbres en dix ans. Pourtant, l'ensemble des engagements « planification écologique » pour la forêt et le bois ont été ramenés de plus de 509 M€ en 2024 à 194 M€ puis 130 M€ après gel en 2025, et que les négociations budgétaires actuelles tournaient lors de la rédaction du présent rapport autour de 50 M€ pour 2026, un stop-and-go ne pouvant qu'inciter les propriétaires à reporter les travaux et finir, en effet, par tarir la demande...
La mission préconise donc de maintenir 130 M€ d'engagements dont une partie suffisante sur le renouvellement forestier et, en tout état de cause, de sauvegarder des dépenses « sans regret » d'un montant modeste (aides à l'aval, à la filière graines et plants, au suivi sanitaire ou au renouvellement des forêts dépérissantes - par exemple, 20 % des épicéas et sapins du Jura ont été scolytés ou prélevés en cinq ans -, quitte à agir en parallèle sur le non-recours des communes forestières concernées).
Au-delà, il est important de faire comprendre aux ministères économiques et financiers que le stop-and-go et les rabots peuvent avoir un coût financier encore plus important in fine que si une certaine stabilité dans le temps était garantie.
Recommandation n° 23 : Maintenir en 2026, comme en 2025, 130 M€ d'engagements sur les sous actions 29.06 à 29.10 du programme 149, dédiées à la « planification écologique » en forêt (après 509 M€ en 2024), et :
- sanctuariser tout du moins les lignes peu coûteuses levant des verrous de la filière (filière graines et plants, appel à projets ESPR pour les entrepreneurs de travaux forestiers) ;
- favoriser le recours au plan de renouvellement forestier pour les communes forestières et propriétaires forestiers privés dont les parcelles ont subi des dépérissements, par une simplification à leur égard des cahiers des charges et un accompagnement dans l'ingénierie.
2. Une ressource de plus en plus diversifiée et imprévisible, à laquelle l'aval devra s'adapter et non l'inverse
Il est clair cependant que la forêt, soumise au stress hydrique, thermique et donc parasitaire, ne pourra mener de front adaptation au changement climatique et normalisation pour les besoins de l'industrie, dont les horizons diffèrent (100-200 ans vs 20-30 ans).
Ainsi que le rappelle le Département santé des forêts, « la mortalité des arbres forestiers a doublé en dix ans, et de plus la moitié des arbres feuillus vivants présente aujourd'hui un net déficit foliaire (plus de 35 %). [...] Il en résulte une baisse d'activité photosynthétique avec une baisse de de 10 % en sept ans de la croissance nette en volume. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'ampleur et la vitesse d'évolution de ces dépérissements des essences autochtones mais il est très probable que cette tendance à la hausse ne s'inversera pas. La surface en perte de vitalité est estimée à 670 000 ha soit 4 % des forêts de production selon la définition de l'IGN. »
Il convient ainsi de rester humble sur le choix d'« essences d'avenir » à planter, notamment en promouvant la diversification et en se gardant d'une sélection en vue d' usages du siècle prochain aujourd'hui impossibles à prédire.
Sans bien sûr opposer l'amont et l'aval de la filière - une vision qui serait trop réductrice et sans doute stérile -, c'est plutôt à l'industrie qu'il revient de s'adapter à la forêt de demain, d'abord en anticipant les afflux plus imprévisibles de coupes accidentelles ou sanitaires via la mise en oeuvre du plan national d'actions « Scolytes et bois de crise » (aires de stockage, transport) lancé par Marc Fesneau.
Source : étude de Carbone 4 (décembre 2023)
Ensuite, les scieries doivent innover pour mieux valoriser les gros et très gros bois (> 60 cm de diamètre), de plus en plus nombreux dans nos forêts, ainsi que les essences dites « secondaires », notamment feuillues (déroulage du peuplier, érable...).
C'est tout le but de l'AAP industrialisation performante des produits bois (IPPB), dans la lignée de l'étude « scieries de feuillus du futur ». La DGPE convient que l'on peut progresser sur « la caractérisation technique d'un plus grand nombre d'essences, celle-ci se limitant aujourd'hui aux principales essences résineuses et feuillues ».
Enfin, les rapporteurs ont été surpris de constater le relativement faible investissement de la recherche sur l'aval de la filière bois et la bioéconomie (à la différence des nombreux travaux sur les écosystèmes forestiers). Les moyens de l'institut technologique FCBA pour les actions collectives (11 millions d'euros en 2024) sont, comparés à ceux des instituts techniques des filières agricoles, extrêmement réduits.
Au-delà, les fonds européens devraient être mobilisés pour développer les trop rares programmes de recherche sur l'aval et le matériau bois. Le sixième cluster (« Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement ») du programme Horizon Europe, ou encore le projet Timberhaus, « qui vise à exploiter les technologies avancées de transformation du bois, grâce à l'apprentissage automatique et à l'IA, afin de créer des prototypes de produits de construction innovants à partir de bois sous-utilisé et post-consommation ».
Recommandation n° 24 : mettre en oeuvre le plan national d'actions « Scolytes et bois de crise » (aires de stockage, transport...) et investir dans la R&D pour l'amélioration de la valorisation des essences d'avenir et des essences dites « secondaires ».
EXAMEN EN COMMISSION
Audition de
Mme Anne Duisabeau, présidente de France Bois Forêt,
MM. Jean-Pascal Archimbaud, président de la
Fédération nationale
du bois, et Mathieu Fleury,
président du Comité interprofessionnel
du bois-énergie
(Cibe)
(Mercredi 30 avril 2025)
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir ce matin : Anne Duisabeau, présidente de l'interprofession France Bois Forêt, forte d'une carrière dans les entreprises de panneaux en bois ; Jean-Pascal Archimbaud, président de la Fédération nationale du bois, qui rassemble les entreprises de la première transformation et président du groupe Archimbaud, producteur de palettes et de granulés dans les Deux-Sèvres ; et Mathieu Fleury, président du Comité interprofessionnel du bois énergie (Cibe), organisme compétent pour le chauffage collectif et industriel - je rappelle que deux tiers du bois récolté en France sont utilisés en bois énergie, en comptant les coproduits et l'autoconsommation.
Votre venue inaugure les travaux de la mission d'information sur la compétitivité de la filière forêt-bois. Par « compétitivité », il faut bien sûr entendre l'ambition de mener de front la création de valeur et la décarbonation sans jamais sacrifier l'une à l'autre, dans l'esprit du rapport Draghi. La filière forêt-bois se prête pleinement à cette logique en tant que puits de carbone, d'une part, et parce qu'elle fait face au défi de l'adaptation au changement climatique, d'autre part.
Nos collègues Anne-Catherine Loisier, du groupe Union Centriste, et Serge Mérillou, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, seront les rapporteurs de cette mission.
Ils essaieront de résoudre un paradoxe bien connu : la France dispose d'une ressource forestière abondante et croissante, avec plus de 17 millions d'hectares de forêt, contre 11 millions d'hectares en Allemagne, mais la filière française bois-forêt affiche un déficit commercial chronique de 7 milliards d'euros par an, quand l'Allemagne, elle, dégage un excédent de 3 milliards d'euros.
Nous connaissons tous le constat d'une mauvaise valorisation de la ressource : « on exporte des grumes, on importe des meubles ». Malgré les recommandations de nombreux rapports sur la gestion plus dynamique de la forêt privée, la solidarité accrue des maillons de la filière, l'allongement de la durée de vie des produits bois, l'adaptation de l'outil de transformation aux essences d'avenir, ou la bonne valorisation des coproduits, les résultats sur la balance commerciale tardent à se concrétiser.
Madame la présidente, messieurs les présidents, quels sont selon vous les leviers prioritaires à activer et les verrous majeurs à lever pour renforcer la compétitivité de la filière forêt-bois ? Pourriez-vous les classer par ordre d'importance et nous aider à distinguer l'essentiel de l'accessoire ?
Il nous a paru opportun, en cette année 2025, de dresser le bilan des politiques publiques conduites en faveur de la filière, au terme de cinq années marquées par une mobilisation financière inédite dans le cadre de France Relance, de France 2030 et de la planification écologique, lointains héritiers du Fonds forestier national.
L'année 2024 a aussi été marquée par les jeux Olympiques de Paris et la réouverture au public de Notre-Dame de Paris, deux événements mondiaux qui devaient être des vitrines pour le matériau bois, à travers la charpente de la cathédrale et le village olympique.
Enfin, alors que l'actualité politique des derniers temps risque de nous enfermer dans le court-termisme, cette mission d'information sur la forêt et la filière bois, qui s'inscrivent par nature dans le temps long, peut nous aider à retrouver le sens de la durée.
Je vous donne sans plus tarder la parole, après quoi la parole sera donnée aux rapporteurs pour de premières questions puis aux autres sénateurs de la commission.
Je rappelle que cette table ronde est retransmise en direct sur le site du Sénat.
Mme Anne Duisabeau, présidente de l'interprofession France Bois Forêt. - Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, en préambule, planter rapidement le décor et rappeler quelques chiffres concernant notre filière. Aujourd'hui, la filière bois française emploie 419 000 personnes, soit à peu près autant que la filière automobile française. Elle demeure pourtant peu visible, alors même qu'elle constitue un atout majeur pour la structuration des territoires. Il est évident que la transformation du bois ne se fait pas place de la Concorde, à Paris. Elle s'inscrit dans une dynamique territoriale concrète, ce qui, dans le contexte actuel, revêt une importance capitale pour notre pays.
Deuxième élément : la filière génère une valeur ajoutée considérable, de l'ordre de 30 milliards d'euros, en progression constante ces dernières années. Les politiques publiques, en particulier les investissements industriels soutenus par l'État, ont permis d'accroître cette valeur ajoutée de près de 3 milliards d'euros.
Mme la présidente a évoqué tout à l'heure le déficit chronique de notre balance commerciale. Lorsqu'on l'analyse en détail, ce déficit tient essentiellement à deux postes : le meuble, d'une part, et la papeterie, d'autre part. Le secteur du meuble, profondément transformé au cours des vingt dernières années, a connu une réindustrialisation marquée en Europe centrale. Aujourd'hui, les importations proviennent à la fois d'Europe et du grand export. Le déficit y est structurel et spécifique. Quant à la papeterie, elle demeure également très déficitaire en matière de commerce extérieur.
Si l'on se concentre sur la transformation du bois en France - c'est-à-dire la scierie et la valorisation des bois d'oeuvre -, l'évolution est positive depuis cinq à six ans. La balance commerciale s'est améliorée de 1,7 milliard d'euros, signe clair d'un mouvement de réindustrialisation de la scierie en France.
Ce redressement repose sur deux leviers principaux.
Le premier, c'est la valorisation du bois. La forêt française, morcelée et à 75 % privée, présente une grande diversité d'essences. Son principal défi réside dans la mobilisation du bois. Tout investissement, petit ou grand, nécessite une ressource disponible, stable et sécurisée sur quinze à vingt ans. Il est impossible de s'engager sur l'avenir sans visibilité sur l'approvisionnement. La massification de la ressource constitue donc un enjeu stratégique.
Le second levier, ce sont les débouchés et l'évolution des cadres réglementaires. Ce qui tire aujourd'hui la forêt française, c'est bien sûr le bois d'oeuvre, destiné en priorité à la construction. Ce segment a profondément évolué ces quinze dernières années. Les premières transformations françaises produisaient des matériaux peu élaborés, à faible valeur ajoutée. Notamment grâce aux investissements massifs dans le séchage, les produits sont désormais bien plus finis, compétitifs et au niveau de ceux de nos partenaires autrichiens et allemands.
Un exemple concret : le CLT (panneaux de bois lamellés croisés), un produit à forte valeur ajoutée destiné à la construction bois. Pour la première fois, les importations de bois autrichien ont reculé de plus de 24 % en France. Cela prouve que, en l'espace de dix ans, nous avons su bâtir une filière compétitive.
Cette dynamique positive s'incarne également dans des réalisations emblématiques. Mme la présidente l'a rappelé, la filière a été fortement mobilisée pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame, un chantier mené en cinq ans. Ce projet a nécessité une coordination rigoureuse et un engagement collectif, démontrant que la filière est désormais structurée, professionnelle et apte à tenir ses engagements.
Certes, des progrès restent à accomplir, mais la dynamique est enclenchée, et c'est ce qui compte aujourd'hui.
Je voulais poser ces éléments de contexte avant de céder la parole à mes deux compagnons de route, qui vous parleront plus précisément de la scierie française et de l'activité bois énergie.
Je tiens à rappeler que la filière bois ne se résume pas à la seule scierie, ni au bois énergie ni à la papeterie, pris isolément. La filière est une chaîne de valeur intégrée, composée de maillons successifs. Un morceau de bois, dès son entrée dans la chaîne, peut alimenter de multiples marchés.
Il y a deux ans, France Bois Forêt a lancé, en partenariat avec d'autres acteurs de la filière et le cabinet Carbone 4, une étude visant à cartographier les flux de bois au sein de la filière. Ce travail, très illustratif, met en lumière les liens étroits entre les différents segments. Il n'existe pas, d'un côté, le bois énergie, et de l'autre, la scierie : tout est lié. Une intervention sur un segment a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne.
Autre difficulté majeure : la ressource bois est, par nature, finie. Certes, elle est renouvelable, mais chacun connaît le temps long de la forêt. Une plantation effectuée aujourd'hui ne produira ses effets que dans trente, quarante, voire cent ans pour certaines essences comme le chêne. L'industrie, elle, fonctionne sur un horizon de dix à quinze ans. Ce décalage de temporalités impose une capacité d'anticipation à très long terme.
Le bois exploité aujourd'hui est issu d'arbres plantés il y a cinquante ou soixante ans. L'outil industriel actuel répond donc à des choix passés. Les décisions prises aujourd'hui en matière de replantation ou de gestion forestière ne porteront leurs fruits que dans plusieurs décennies. Les règles mises en oeuvre aujourd'hui s'appliquent à une réalité héritée, qu'elles ne peuvent transformer que pour le futur.
C'est une donnée que nul ne peut ignorer : nous ne disposons pas d'une marge de manoeuvre infinie. On ne compense pas une pénurie de matière en achetant dix machines supplémentaires. Sans matière mobilisable, l'outil industriel reste à l'arrêt. C'est là un point capital qu'il convient de garder à l'esprit.
M. Jean-Pascal Archimbaud, président de la Fédération nationale du bois. - Je commencerai par un bref rappel historique, afin de mieux comprendre d'où nous venons. Quant à savoir où nous allons... cela reste à déterminer.
La Fédération nationale du bois a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de la reconstruction de la France. Il fallait alors reconstruire les chemins de fer, les bâtiments détruits, et mobiliser du bois en quantité importante. À cette époque, chaque commune comptait une petite scierie. Avec le temps, ces scieries communales sont devenues cantonales, puis départementales, et, aujourd'hui, quasiment régionales. Nous avons donc connu une forme de concentration, à l'image de celle observée dans le secteur agricole, où l'on est passé de dix hectares à vingt hectares, avant d'assister à une croissance exponentielle. Cette évolution nous confronte aujourd'hui à certaines difficultés : les usines, devenues très importantes, ne trouvent plus localement les ressources nécessaires à leur fonctionnement et se retrouvent, dans certains cas, dans une impasse.
Il convient également de rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, le Fonds forestier national a été créé pour reboiser une partie du territoire en résineux. La France était alors très pauvre en résineux, contrairement à nos voisins et amis allemands. Pour mener à bien ce reboisement, on fit appel à des prisonniers allemands. À Verdun, par exemple, des plants autrichiens furent mis en terre par des Allemands. Résultat : un siècle plus tard, la forêt est détruite, ces plants étant inadaptés aux conditions locales.
L'évolution de la filière a également été marquée par un tournant politique important en 1981. Une grande partie de l'industrie du bois, alors moribonde à la suite des chocs pétroliers, a été nationalisée. On a ainsi créé, sous l'égide de Saint-Gobain, une filière bois qui regroupait l'essentiel des grandes industries de transformation, notamment les papeteries - celles de Facture et de Tartas - et les usines de panneaux. Ces dernières furent réunies sous l'enseigne ROL, acronyme de Rougier, Océan, Landex. On a ainsi créé un « monstre », qui a tenu quelques années. Mais le système s'est révélé non viable, et, à terme, l'ensemble de nos industries a été cédé à des groupes étrangers.
La branche papetière a ainsi été vendue à un petit groupe irlandais, Smurfit, qui est devenu aujourd'hui un leader européen du papier-carton. Les usines de panneaux ont été partiellement cédées à un industriel autrichien, Egger, aujourd'hui également leader européen, tandis que l'autre partie a été vendue à son voisin autrichien, Kronospan, devenu lui aussi un géant du secteur. Ainsi, nous avons perdu la maîtrise d'une part essentielle de notre industrie lourde de transformation du bois, celle qui valorise les bois de trituration, les bois secondaires et les plaquettes de scierie.
Jusqu'aux années 2000, un certain équilibre régnait entre les scieries de feuillus et celles de résineux. Puis, les volumes importants de résineux plantés après-guerre sont arrivés à maturité, et de grandes scieries de l'Est de la France se sont équipées de machines industrielles allemandes leur permettant de traiter des quantités industrielles de bois.
Parallèlement, le bois feuillu, historiquement utilisé pour l'ameublement et le parquet, a vu ses débouchés se réduire, notamment sous l'effet d'un basculement vers des produits composites. Le meuble, autrefois constitué de bois massif, s'est transformé : on y trouve désormais de moins en moins de bois, remplacé par du verre, de l'aluminium ou du plastique.
Ce bouleversement du marché a conduit à un rétrécissement des débouchés, et nos outils industriels ont dû s'adapter à la pression de la compétitivité, de la productivité et aux exigences environnementales.
Les contraintes pesant sur nos entreprises industrielles sont nombreuses. La plupart des sites sont classés. Bien entendu, ces installations font du bruit, génèrent de la poussière, provoquent des nuisances et suscitent des plaintes, voire des fermetures administratives. Le cas typique : une petite scierie installée au coeur d'un village, puis encerclée par un lotissement. La poussière dérange, les plaintes affluent, et la scierie finit par fermer ou par déménager - un déplacement qui n'est pas toujours simple à opérer.
Voilà donc, en quelque sorte, un aperçu de notre filière de deuxième transformation, vue dans le rétroviseur. Quant à l'avenir, il faudrait sans doute revenir à un meilleur équilibre entre feuillus et résineux. Le feuillu, en particulier, pose problème. Depuis une dizaine d'années, nous exportons massivement nos grumes à l'étranger, pour les réimporter sous forme de produits finis.
M. Mathieu Fleury, président du Comité interprofessionnel du bois énergie (Cibe). - Je suis président du Comité interprofessionnel du bois énergie (Cibe), un organisme créé voilà une vingtaine d'années pour structurer une filière alors naissante. J'interviendrai plus spécifiquement sur le développement de cette jeune filière.
Le Cibe regroupe les chaufferies collectives et industrielles. Nous parlons ici de bois déchiqueté, de produits connexes de scierie, de broyats d'emballages, de tous les sous-produits issus de l'entretien des milieux naturels, des industries, et de notre propre consommation : les palettes, par exemple. Cette activité économique valorise les ressources locales, au plus près des territoires.
Aujourd'hui, dans 8 000 installations de toute taille réparties sur l'ensemble du territoire national, cette ressource trouve un débouché. Elle se substitue aux usages industriels plus anciens, à une époque où l'industrie du papier et celle du panneau ne sont plus dans une dynamique de croissance.
Le bois énergie a donc pris le relais en matière de valorisation de ces produits secondaires. Les scieries ont pu développer des unités de granulation, qui améliorent les rendements énergétiques, la qualité de l'air des installations de chauffage domestique et collectif et densifient une matière initialement peu dense, bien moins que les combustibles fossiles, pour l'acheminer au plus près des lieux de consommation.
Il faut rappeler que le bois ne pousse pas là où vivent les hommes ni là où s'installent les industries. La logistique reste un enjeu. À ce titre, il y a lieu de regretter l'abandon progressif du fret ferroviaire. Dans les grandes industries papetières, les flux étaient historiquement organisés par train. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faudra pourtant remettre en place ces chaînes logistiques pour que le bois atteigne efficacement les lieux de consommation.
Sur le plan de la compétitivité, si l'on considère ensemble le chauffage collectif, le chauffage industriel et le chauffage domestique, c'est l'équivalent de 6 milliards d'euros que nous n'achetons pas chaque année à l'étranger en produits pétroliers. Ce sont 3 milliards d'euros réinjectés dans nos territoires, dans des circuits économiques courts, créateurs d'emplois locaux.
Le bois énergie, dans sa composante de chaufferie collective et industrielle, représente à lui seul 10 % des emplois de la filière forêt-bois. Ce sont environ 40 000 emplois créés ces vingt dernières années. Il s'agit d'emplois liés à l'entretien et à l'exploitation des forêts, à la gestion des chaufferies, à la maintenance des installations, qui, contrairement aux systèmes à bouton pression, comme le fioul ou le gaz, exigent de la technicité et de la main-d'oeuvre. Ce sont également des emplois pour la fabrication des chaudières, pour les bureaux d'études, pour tout un ensemble d'activités industrielles et de services.
Je souhaite également revenir sur des événements plus récents. Lors de la crise énergétique, l'État a engagé 65 milliards d'euros dans les boucliers tarifaires. Pendant cette période, la filière bois a pleinement joué son rôle. Elle a garanti la stabilité des prix et apporté une réponse compétitive aux besoins énergétiques des industriels et des usagers des réseaux de chaleur.
Certes, le bois n'est pas toujours l'énergie la moins chère à l'instant t, mais sur le temps long, il demeure, de manière incontestable, la solution la plus compétitive. Or la filière bois ne peut se concevoir que dans une logique de temps long. On ne lance pas un projet bois énergie simplement parce que le gaz est momentanément à 120 ou 200 euros le mégawattheure, alors qu'il tombera peut-être à 30 mégawattheures le mois suivant. Ce type de projet requiert une vision durable.
Le bois énergie permet aux industries, aux réseaux de chaleur, aux habitants, d'accéder à une énergie stable, compétitive et ancrée dans le territoire. Il convient de rappeler que ces réseaux de chaleur desservent les logements sociaux, les hôpitaux, les collèges, les lycées. En valorisant une ressource locale, nous offrons à l'ensemble de la collectivité un prix de la chaleur maîtrisé sur le long terme.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la mission d'information sur la compétitivité de la filière forêt-bois. - Je me réjouis que nous puissions, ce matin, concentrer notre attention sur l'aval de la filière bois. Jusqu'à présent, nous avons reçu à plusieurs reprises l'Office national des forêts (ONF), ainsi qu'un certain nombre d'acteurs de l'amont, mais, à ma connaissance, ce n'était pas encore le cas pour l'aval.
Comme l'a justement souligné Mme la présidente de France Bois Forêt, l'amont et l'aval sont naturellement étroitement liés. Je tiens à insister sur le fait que cette filière est très présente sur l'ensemble de nos territoires. Elle représente 420 000 emplois et maintient une activité structurante en matière d'aménagement du territoire, grâce à un maillage local dense. Elle permet à de nombreux villages et espaces ruraux de conserver une dynamique : elle offre des perspectives aux jeunes professionnels, permet de maintenir des familles sur place et participe à l'entretien de nos campagnes. Je pense notamment aux entreprises de travaux forestiers, qui connaissent actuellement beaucoup de difficultés.
Il ressort des interventions précédentes qu'une hiérarchie des usages s'impose naturellement pour les matériaux bois. En priorité, le bois de grume est destiné à des usages longs : la construction, le mobilier. Ensuite, les sections les plus petites issues de la même grume peuvent être valorisées, par exemple pour fabriquer des palettes. On parle peu des palettes, et pourtant elles jouent un rôle central dans le transport mondial, notamment maritime. La crise sanitaire liée à la covid l'a démontré : sans palette, les chaînes logistiques internationales se retrouvent paralysées.
Le bois, c'est donc à la fois la maison, la charpente, la palette, le carton, la papeterie. En dernier recours, lorsque le matériau ne peut plus être transformé, il devient bois énergie : c'est la première énergie renouvelable (EnR) en France. Un foyer sur quatre y recourt aujourd'hui pour se chauffer. Grâce aux avancées technologiques, les émissions de particules et les nuisances environnementales ont pu être significativement réduites.
Notre industrie du bois a souffert d'un manque d'investissement pendant plusieurs années. Pendant ce temps, nos voisins allemands et autrichiens continuaient à innover et à moderniser leurs outils de production. Résultat : ces dernières années, de nombreuses industries venues d'Allemagne et d'Autriche se sont implantées en France. Élue locale, j'ai moi-même été témoin de ce mouvement. Si nous disposons d'une ressource abondante, de qualité, nous n'avions pas, en revanche, un tissu industriel suffisamment solide pour la transformer.
Aujourd'hui, cette ressource est convoitée. Elle est sous tension. Tout le monde la réclame, dans un contexte de transition écologique et énergétique. Le bois est recherché à la fois pour ses qualités de matériau renouvelable, pour son excellent bilan carbone, mais aussi pour le bois énergie, sans parler des projets portés par le ministre de l'industrie pour décarboner une partie de l'appareil productif grâce à la biomasse.
Cette situation engendre un conflit d'usage qui doit nous interpeller, car qui dit conflit d'usage, dit tension sur la ressource, et, partant, hausse des prix.
Pour conclure, j'aimerais, madame, messieurs, que vous nous éclairiez sur les trois grands domaines d'usage du bois - bois construction, bois matériau au sens large, bois énergie. Quels défis identifiez-vous pour chacun de ces secteurs ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ? Et quelles préconisations formulez-vous quant à l'évolution de vos activités ?
M. Serge Mérillou, rapporteur de la mission d'information sur la compétitivité de la filière forêt-bois. - Je suis originaire d'un département et d'une région - la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine -, où la forêt occupe une place centrale et où l'industrie du bois joue un rôle majeur en matière d'emploi. C'est aussi une région où les projets de biomasse se multiplient. L'ampleur de certains d'entre eux m'a d'ailleurs quelque peu surpris, compte tenu du contexte actuel de tension sur la ressource en biomasse, qu'elle soit forestière ou non.
Je souhaiterais connaître votre regard sur ces projets, en particulier les projets de pyrogazéification, qui soulèvent encore davantage d'interrogations. Comment garantir, dans ce cadre, que la valorisation énergétique ne se fasse pas au détriment d'une transformation locale, génératrice de davantage de valeur ajoutée pour nos territoires ruraux, qui doivent rester au coeur d'une transition écologique juste et orientée vers les populations locales ?
Plus largement, quelles sont vos réflexions sur la hiérarchie des usages - ce que l'on appelle parfois la « cascade des usages » -, et sur l'objectif, unanimement reconnu dans les différents rapports, d'allonger la durée de vie des produits bois ? Il y aura toujours des coproduits à valoriser sous forme de bois énergie, mais il reste préférable, tant du point de vue économique qu'environnemental, que cette valorisation intervienne en dernier recours.
Faut-il, selon vous, envisager de recourir à des outils contractuels ou réglementaires pour encadrer plus fermement cette hiérarchie des usages, afin de sanctuariser les usages de long terme du bois et de réserver aux usages énergétiques ce qui relève véritablement du coproduit ou du rebut ?
La meilleure valorisation des coproduits, par exemple pour la fabrication de panneaux isolants, constitue avant tout un défi d'ingénierie. Encore faut-il que la puissance publique définisse un cadre incitatif adapté, notamment par le biais des financements publics. Est-ce, selon vous, suffisamment le cas ? Ce cadre est-il aujourd'hui à la hauteur non seulement pour encourager l'innovation industrielle, mais aussi pour structurer des filières locales résilientes, capables de résister aux aléas climatiques et aux pressions économiques internationales ?
Toutes ces questions renvoient aux trajectoires de mobilisation du bois à l'horizon 2035-2050, car, nous le savons, nous travaillons sur un temps long. Les trois scénarios les plus récents - ceux du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), de Carbone 4 pour France Bois Forêt, et de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), avec l'Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) - prévoient, à des degrés divers, une augmentation des prélèvements. Il s'agit d'adapter la forêt au changement climatique, de produire davantage de bois d'oeuvre et, ainsi, de stocker plus de carbone.
Mais encore faut-il que chaque segment de la filière progresse au même rythme. Ces scénarios impliquent également une augmentation du volume de coproduits, qu'il faudra bien valoriser, y compris sous forme de bois énergie. Comment la filière que vous représentez se prépare-t-elle à ces trajectoires ? Y a-t-il des maillons faibles dans la filière qu'il faudrait renforcer ? La forêt s'inscrit dans un temps long, alors que l'urgence climatique, elle, s'accélère. Comment comptez-vous piloter son développement, sans répéter les erreurs du passé, en pensant le renouvellement des peuplements forestiers à l'horizon 2050 et au-delà ?
Mme Anne Duisabeau. - Je souhaite d'abord revenir sur la modélisation des flux réalisée dans le cadre de l'étude menée par le cabinet Carbone 4, lancée voilà deux ans. Celle-ci a permis de réaliser un bouclage matière. Vous l'avez tous rappelé, la ressource en bois disponible est aujourd'hui finie. Il y a certes un stock, c'est-à-dire la forêt, mais, à un instant donné, sa capacité de production reste limitée. Nous ne multiplierons pas par deux notre consommation de bois, car la forêt actuelle est le fruit d'événements survenus voilà quinze ou vingt ans. Les marges de manoeuvre concernent non plus le présent, mais bien l'avenir. À présent, il faut faire avec ce que l'on a sur pied. La manière dont cette ressource est mobilisée devient donc essentielle.
L'étude Carbone 4 montre que le bois constitue un matériau idéal pour le stockage du carbone. C'est une évidence : la filière bois a un rôle stratégique à jouer dans la transition énergétique. L'enjeu consiste désormais à engager une gestion dynamique de cette filière, car la forêt sera de plus en plus soumise à des aléas : incendies dans le Sud-Ouest, pullulations de scolytes dans l'Est ... Autant d'événements difficiles à anticiper, mais face auxquels il faut être capables de réagir rapidement. Cela suppose la mise en place de cellules de crise, l'activation de leviers d'optimisation, et surtout d'éviter de laisser le bois dépérir sur pied, libérant ainsi inutilement du carbone dans l'atmosphère. C'est dans cette optique que des dispositifs sont en cours de lancement. Le travail s'organise en filière, en communauté, mais sur des bases locales, car les événements auxquels nous faisons face restent le plus souvent géographiquement circonscrits.
La gestion dynamique suppose également de considérer le stock forestier existant comme une opportunité. Le transformer en bois de construction, l'intégrer dans des poutres, des charpentes, des structures visibles ou invisibles, c'est prolonger le stockage du carbone dans le temps. Une charpente ne se change pas tous les week-ends ; elle est là pour trente, quarante, cinquante, parfois soixante ans. Ce stockage vient en compensation de la baisse de performance du puits de carbone forestier.
Chacun le sait, la forêt subit des attaques, sa croissance ralentit et la situation s'impose désormais à nous. Des efforts sont entrepris pour renouveler les peuplements, adapter les plantations, moderniser les méthodes de récolte. La stratégie de la filière repose aussi sur un changement des usages : en dix à quinze ans, il devient possible de faire évoluer les mentalités. Une porte en bois stocke du carbone pendant vingt à trente ans. Il s'agit ni plus ni moins de créer un second stock carbone au sein même des habitations.
Aujourd'hui, en France, la part du bois dans la construction s'élève à 6 % ou 7 %. Je ne dis pas qu'il faut construire uniquement en bois. Nous défendrons toujours une approche multimatériaux, qui intègre également les efforts réalisés dans d'autres filières, comme le béton, dont l'empreinte carbone est également en diminution. Pour autant, en quinze ans, la France pourrait atteindre les niveaux observés en Allemagne ou en Autriche, où le bois représente 21 % dans la construction.
Cette ambition nécessite bien sûr de la ressource. C'est pourquoi notre scénario prévoit une hausse progressive des prélèvements. Il ne s'agit pas, bien entendu, de raser la forêt française. Tel n'est pas, et n'a jamais été l'objectif. La filière comme l'industrie ont démontré depuis trente ou quarante ans leur extrême vigilance quant à la préservation de la ressource. Preuve en est, la surface forestière française s'étend aujourd'hui sur 17,5 millions d'hectares et le volume de bois sur pied a augmenté de 50 % en trente ans. Il n'y a pas de déforestation. Il y a, en revanche, une dégradation, due au changement climatique, qui rend la situation plus instable.
C'est pourquoi il faut miser sur des cycles courts, produire des biens durables, réutilisables, capables de créer ce second stock carbone. C'est cette trajectoire que nous avons amorcée avec l'État depuis six ou sept ans : investir dans l'industrie, valoriser les produits, augmenter la valeur ajoutée, transformer sur place, structurer des filières locales. Autant de leviers pour faire des territoires les piliers d'un développement cohérent et résilient.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Plusieurs interventions ont porté sur la hiérarchie des usages. Lorsque l'on entre dans une forêt et que l'on y coupe un arbre, la première chose à faire est de valoriser le tronc, ou du moins la partie principale, en bois de sciage. Ce sciage permet de produire pour moitié des planches, et pour l'autre moitié des sous-produits : écorces, plaquettes, sciures, qui représentent environ 50 % du volume initial. Autrefois, ces sous-produits allaient à la fabrication de panneaux ou de papier. Aujourd'hui, la plupart des scieries les valorisent en granulés de bois. C'est une excellente chose : cela permet une utilisation sur site, évite des transports inutiles et simplifie le stockage.
Quant au bois transformé en planche, on le retrouve très souvent dans des panneaux de particules. Le bois de sciage est broyé, réutilisé dans ce que l'on appelle les panneaux de process, ce qui lui donne une seconde vie. Et ce recyclage peut être répété plusieurs fois.
Enfin, l'énergie constitue le dernier niveau dans cette hiérarchie. Elle arrive après tous les autres usages industriels. On y recourt notamment avec le bois issu des rémanents de coupe, des travaux d'amélioration des peuplements, ou encore des catastrophes naturelles.
Je travaille dans le secteur depuis une trentaine d'années. J'ai connu trois tempêtes majeures et un premier grand incendie. Après une tempête majeure, il nous faut parfois stocker le bois durant sept ans. En trente ans d'activité, environ 30 % du bois que nous avons utilisé provenait d'événements climatiques extrêmes. Nous sommes désormais très bien organisés pour faire face à ces situations : dépérissements, accidents naturels, etc.
La clé est d'intervenir vite. Aussi, l'État doit nous aider à déplacer les masses. Lorsqu'un accident survient dans une région, un afflux massif de bois sature le marché local, les prix chutent et cela perturbe tout le secteur. Pour rééquilibrer, il est impératif de déplacer les stocks vers d'autres zones. Cela a été très bien fait après la tempête Klaus. À l'époque, des trains, des bateaux, des convois entiers de bois ont été réacheminés vers d'autres régions, permettant aux forêts de ces zones d'épargner leur propre ressource sur pied et de laisser les arbres continuer à croître. Le marché s'est ainsi stabilisé.
En ce qui concerne la pyrogazéification, le principe est simple : il s'agit non pas de brûler le bois, mais de le chauffer pour en extraire les gaz, puis de séparer l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Nous avons développé un petit dispositif de pyrolyse permettant de produire de l'hydrogène à partir de granulés de bois. On introduit une tonne de bois et on obtient 80 kilogrammes d'hydrogène pur, utilisable dans des piles à combustible. Ce système fonctionne très bien. Nous envisageons d'ailleurs de l'utiliser en interne pour devenir entièrement autonomes sur le plan énergétique.
Aujourd'hui, nous transformons chaque année environ 500 000 mètres cubes de bois dans nos usines, que nous devons sécher. Cela représente quelque 250 000 tonnes d'eau à évaporer, soit un volume considérable. Pour cela, nous utilisons nos propres sous-produits. Grâce à des turbines à vapeur, nous produisons notre électricité. Nous sommes donc autonomes. Demain, nous irons plus loin encore : avec une partie de nos sous-produits, nous fabriquerons nos propres carburants pour alimenter nos camions, nos engins, bref tout ce que nous n'aurons pas pu passer à l'électrique.
Notre filière est donc aujourd'hui complètement autonome en énergie. Aucune autre filière industrielle n'en est capable. Même l'agriculture ne l'est plus. Je ne connais pas beaucoup d'exploitations agricoles capables d'assurer elles-mêmes toute leur production énergétique, de la graine au produit fini.
Il a également été question des carburants d'aviation durables, ou SAF (Sustainable Aviation Fuels). Il s'agit des futurs carburants destinés à l'aviation. Le procédé consiste à gazéifier du bois, extraire l'hydrogène et le dioxyde de carbone, puis à recombiner ces éléments pour former un hydrocarbure liquide, miscible avec les carburants fossiles. On pourrait ainsi continuer à faire voler les avions.
L'idée mérite d'être explorée et il ne faut pas s'opposer à l'innovation, mais, pour l'instant, ces projets ne sont pas tous aboutis. Cela fait dix ans que nous travaillons sur le sujet. Nous avons réussi à faire fonctionner un petit modèle, mais les mégaprojets annoncés, notamment dans le Sud-Ouest, ne sont pas encore totalement opérationnels. Il reste des incertitudes sur la qualité des carburants produits. Et pour l'aviation, on ne peut se permettre aucune erreur.
Autre point : les usines de granulés. Le secteur du bois énergie attire, depuis une dizaine d'années, de nombreuses convoitises extérieures à notre profession. On a vu arriver des fonds d'investissement, des promoteurs qui ont bâti des modèles économiques en tablant sur un prix de vente élevé de la tonne de granulés. Ils s'implantent dans une région, obtiennent des autorisations d'exploitation, obtiennent un prêt vert de la banque puis rasent la zone autour de leur usine.
Certaines usines ont été implantées dans des zones sans bois, au milieu de champs de betteraves. On s'interroge : pourquoi de tels projets ? La moitié provient de produits déjà passés par des scieries. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec ces projets, qui sont pourtant subventionnés. Certaines installations suscitent des mobilisations locales importantes. Face à cela, nous évitons les polémiques, mais les questions sont légitimes.
J'ajoute une remarque sur l'innovation. L'innovation ne naît pas toujours de grands programmes financés à coups de centaines de millions d'euros. Elle vient souvent d'erreurs, d'observations, d'adaptation, de bon sens. Dans notre métier, nous avons encore ce bon sens paysan. Et je fais plus confiance au bon sens paysan qu'aux discours de certains grands docteurs des institutions.
Enfin, un dernier sujet mérite réflexion : la déprise agricole. Selon des rapports publiés en 2023, quelque 20 000 hectares devraient sortir de l'agriculture dans les prochaines années. Ce serait une excellente chose que d'y planter des arbres.
Mme Anne Duisabeau. - Sur le conflit d'usage, vous l'avez bien compris, la filière bois valorise d'abord la matière en tant que matériau. Ensuite, au fil des transformations successives, elle cherche à en tirer le meilleur parti, jusqu'à aboutir à une valorisation énergétique lorsque plus aucun autre usage n'est possible.
Le SAF suscite une vive inquiétude au sein de notre filière. La ressource étant limitée, l'organisation actuelle fonctionne selon un équilibre précis, et les avancées techniques viendront en leur temps. En revanche, une chose est claire : le développement de nouvelles filières ne saurait se faire au détriment des filières existantes. Toute ouverture vers de nouveaux usages doit donc se faire avec discernement, en évitant toute concurrence directe. Vous avez évoqué le terme de « compétition des usages ». De notre point de vue, il s'agit plutôt d'une succession logique de maillons. Il n'existe pas de conflit intrinsèque ; certains souhaiteraient en créer un, mais, en réalité, il n'y en a pas.
Toutefois, si l'État devait créer un nouvel appel d'air au moyen de subventions massives, dans un modèle de compétition totalement différent, les équilibres seraient bouleversés. La valeur d'une planche de bois n'a rien à voir avec celle d'un combustible destiné à l'aviation. Ce type de dispositif reviendrait à transférer du pouvoir d'achat d'un secteur vers un autre, sans considération pour la réalité du terrain.
Il ne faut pas imaginer que l'on puisse engager des chaînes de production sur quatre-vingts ans pour produire du carburant destiné à faire voler des avions sans conséquence. Cela créerait une distorsion de valeur sur le marché, provoquerait des tensions et ferait mécaniquement chuter la compétitivité de toute la filière.
Nous avons donc, sur ce sujet, une position très ferme. Le législateur fixe les orientations, indique des directions, mais comment garantit-il, dans un système contraint par la rareté de la ressource, que les autres filières continueront à fonctionner ? Voilà la vraie question.
M. Mathieu Fleury. - On parle souvent de hiérarchisation ou de compétition des usages. En réalité, il s'agit plutôt d'une articulation des usages. Chacun se respecte, et les valeurs économiques ne sont pas comparables : le bois énergie, acheté sur pied en forêt, n'a rien à voir avec le bois acheté par les scieries sous forme de mètres cubes entrant dans leurs usines. Chacun travaille à sa façon, que ce soit pour le bois énergie ou pour les scieries. Aujourd'hui, une intelligence collective territoriale prévaut, sans conflit ni hiérarchie imposée : le marché régule naturellement.
L'équilibre est rompu dès lors qu'un nouvel opérateur, régi par des règles différentes et créant une valeur ajoutée fortement subventionnée, entre dans le jeu. C'est notamment le cas pour la filière des carburants aéronautiques durables (SAF). Un tel schéma présente un risque réel de perturbation et de conflits entre les différents débouchés du bois.
Sur le sujet de la pyrogazéification, il convient de s'interroger. Des objectifs très ambitieux ont été fixés en matière de développement de gaz renouvelable, et il a été demandé à Gaz réseau distribution France (GRDF) et à GRTgaz de porter cette croissance d'injection dans le réseau. Leur réponse s'est appuyée sur les méthaniseurs agricoles, mais aussi sur la pyrogazéification, présentée comme une solution miracle. Ils annoncent 50 térawattheures injectés à l'horizon 2030, alors même qu'aucun démonstrateur industriel ne fonctionne à ce jour.
En Normandie, le projet Salamandre, porté par le groupe Engie, visait un modèle industriel à 50 000 tonnes de biomasse ; il a été abandonné. On est encore loin des usines industrielles traitant plusieurs millions de tonnes de bois. Nous nous faisons collectivement peur pour rien.
Ce contexte interroge aussi le modèle de financement de GRDF et GRTgaz, rémunérés partiellement par des primes fixes pour l'entretien du réseau, mais aussi au volume de molécules circulant dans celui-ci. Ne faudrait-il pas revoir ce mode de financement pour éviter une course à la croissance sans lien avec la réalité du gaz renouvelable disponible ? Cette question mérite un examen sérieux.
S'agissant de l'accompagnement des filières, je tiens à saluer l'action du programme Biomasse chaleur pour l'industrie du bois (BCIB). Il permet de créer de la valeur ajoutée directement dans les scieries, en installant notamment des outils pour sécher le bois au plus près de la ressource. Ces unités se développent et tirent l'ensemble de la filière vers le haut. Quand les scieries fonctionnent, toute la filière suit.
Le bois énergie ne peut fonctionner seul. Aujourd'hui, 50 % du bois énergie provient des forêts. Le reste vient du bocage, des bois en fin de vie, des produits connexes. Lorsqu'on coupe un arbre destiné à une scierie, notamment un feuillu, 40 % du volume est constitué de houppiers utilisés pour le bois énergie, en bûches notamment. Sans abattage pour les scieries, cette ressource disparaît. Par ailleurs, pour faire croître les arbres, il faut éclaircir, créer des cloisonnements, ce qui génère du bois d'industrie et du bois énergie.
Je salue également les efforts accomplis via le fonds chaleur, souvent salué par la Cour des comptes. C'est l'une des méthodes les plus efficaces et les moins coûteuses pour développer les énergies renouvelables. En 2024, 800 millions d'euros d'aides ont été maintenus, contre 1,3 milliard d'euros sollicités et déjà mobilisables sur les territoires. Il serait préjudiciable de briser cette dynamique.
Si des ajustements doivent être faits, alors qu'ils soient cohérents. On ne peut supprimer les aides au chauffage au bois, pourtant performant et en forte amélioration ces quinze dernières années, tout en les maintenant pour les pompes à chaleur. Si les aides sont supprimées, alors qu'elles le soient pour tous les types de chauffage individuel. Favoriser uniquement l'électricité au nom de la relance du nucléaire serait une erreur magistrale. Le signal envoyé serait négatif. Dire que l'on arrête le bois énergie reviendrait à affirmer que cette filière est mauvaise, alors qu'elle chauffe 8 millions de foyers, qu'elle représente l'énergie la plus résiliente et la moins chère du marché, et qu'elle offre de véritables perspectives. Le fonds chaleur a permis de garantir la visibilité du secteur et de préserver sa compétitivité.
Je rappelle que le bouclier tarifaire sur le gaz a coûté 64 milliards d'euros à la collectivité. Face à cela, les 800 millions d'euros du fonds chaleur apparaissent dérisoires.
Enfin, rappelons que les chaufferies collectives et industrielles à bois énergie sont nées dans les industries du bois. Les premières chaudières ont été installées dans les scieries pour sécher les grumes. Cette logique garde tout son sens et doit être développée, pérennisée, renforcée. Elle favorise des produits à plus forte valeur ajoutée et soutient une filière bois en bonne santé. Elle s'étend à présent à l'industrie agroalimentaire, ce qui est tout aussi pertinent.
En revanche, les carburants aéronautiques durables (SAF) posent question. L'étude menée par le cabinet Carbone 4 l'affirme : ce n'est pas une voie pertinente. Au regard des besoins colossaux de l'aviation en kérosène, il serait absurde de mobiliser la forêt. Notre contribution y serait anecdotique. Il faut faire preuve de lucidité et écarter collectivement cette option.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Je regarde, avec une certaine admiration mêlée de perplexité, ce tableau, sur le mur de cette salle, et cette photographie d'un paysage rural vidé de ses villages, de ses repères humains, entièrement transformé pour produire de l'énergie. On y voit des éoliennes produisant de l'électricité et des champs de colza destinés à la fabrication de biofuel. Ces paysages se multiplient aujourd'hui.
En Poitou-Charentes, nous militons pour reconstituer des linéaires de haies, pour recréer du bocage. Nous avons l'impression que le monde du bois et le monde agricole sont pris dans une spirale d'industrialisation.
Il y a soixante-dix ans, dans les Deux-Sèvres, il n'y avait pas de forêt structurée. On utilisait les arbres du bocage pour se chauffer, pour la construction. Ce débat mérite d'être remis sur la table. Il faut aussi replacer les populations au coeur des enjeux, car les ruraux, aujourd'hui, ne se reconnaissent plus dans ces paysages déshumanisés.
M. Matthieu Fleury. - On parle de ressource abondante, mais s'il n'y a plus d'entreprise ni de gens pour aller ramasser le bois, on ne sera pas plus avancé...
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Vous avez parlé des haies, nous y sommes très sensibles ici - nous avons examiné une proposition de loi sur les haies, présentée par notre collègue Daniel Salmon.
M. Yannick Jadot. - Vous rappelez l'accélération de la demande de bois, qui est positive, qu'en est-il de la construction ? Le PLU bioclimatique de Paris prévoit l'usage de beaucoup de bois, allez-vous pouvoir répondre à cette demande ?
Ensuite, il y a les contraintes d'adaptation de l'offre, car la forêt soumise au dérèglement climatique change plus vite qu'on ne l'imaginait, il y a beaucoup d'efforts à faire.
Enfin, une question sur la communication autour de vos métiers. Je suis surpris d'entendre dire qu'en France, on fait surtout des coupes rases, ou qu'on couperait le bois pour l'expédier en Chine ou en faire du bois énergie : vous avez un bon ancrage territorial, vos pratiques sont très éloignées de ces caricatures - n'y a-t-il pas ici un problème de communication ?
M. Franck Montaugé. - L'exploration par satellite de la surface du globe permet de s'intéresser à ce qui se passe dans le sol et il semble, sous réserve de confirmation scientifique, que notre sol perde de sa capacité de séquestration du carbone, et que cela aurait à voir avec la partie forestière du territoire : le confirmez-vous ? Quels en sont les facteurs d'explication - et quels liens avec la gestion de la forêt ?
Lorsqu'on parle de bois énergie, on laisse de côté l'utilisation qui pourrait être faite de biogaz pour l'équilibrage du système de production-consommation d'électricité. Aujourd'hui, on utilise du gaz naturel, du méthane, pour faire fonctionner les centrales dites marginales qui dictent, par ailleurs, le prix du marché de gros, et ce gaz naturel est importé. Cela nous prive de toute souveraineté. J'ai toujours pensé que la biomasse utilisée sous forme de biogaz pourrait faire tourner ces centrales, nous faisant gagner en souveraineté tout en diminuant le prix du marché. On m'a toujours répondu que la biomasse était insuffisante pour le faire, et que c'était la raison pour laquelle on ne l'utilisait pas à ce type d'emploi - cette réponse ne me convainc pas. L'étude de Carbone 4 ne mentionne pas cet aspect : qu'en pensez-vous ?
M. Daniel Gremillet. - L'évolution de la ressource forestière va dépendre des essences en forêt : l'industrie du bois sera-t-elle en mesure de s'adapter - par exemple pour scier le hêtre qu'on utilise désormais pour les charpentes, alors qu'on utilisait surtout du chêne jusqu'à encore récemment ?
Je partage votre analyse sur le monde des scieurs. Dans le massif des Vosges, je connais une petite scierie en pleine forêt, dont l'unique voisin... se plaint du bruit qu'elle fait : la scierie était là avant que le propriétaire de la maison ne s'installe, mais il se plaint du bruit... ce n'est pas raisonnable.
Le recyclage, ensuite, connaît un véritable essor, on redonne vie à du matériau qu'on envoyait hier à la chaudière, la déconstruction est un gisement de ressources pour les panneautiers qui va aussi valoriser la filière.
Sur le dossier énergétique, il faut être prudent, parce que quand on réutilisera beaucoup de bois, il n'en restera pas beaucoup pour l'énergie. Cependant, il y a l'effet du prix, on l'a vu pendant la crise sanitaire, où le prix des granulés bois s'était envolé, alors qu'on a de la ressource et que des granulés canadiens étaient apparus bien moins chers, cela a perturbé bien des gens - on y a vu de la spéculation, il faut faire attention.
Comment utiliser davantage les bois dépérissant ? Certains bois restent utilisables, des expériences l'ont montré pour du lamellé-collé.
Que pensez-vous, enfin, de la chimie verte forestière ?
Mme Anne Duisabeau. - L'usage du bois dans la construction se développe ces dernières décennies, et le marché de la réhabilitation connaît aussi un véritable essor, avec en particulier l'adaptation des logements collectifs au changement climatique, notre filière a développé des systèmes d'isolation pour répondre à ce défi. Nous avons prouvé la fiabilité et le professionnalisme de la filière dans les jeux Olympiques de Paris. Nous avons construit des bâtiments emblématiques, nous avons tenu les délais, montré l'industrialisation, l'usage du bois en structure - par exemple au village des athlètes. La réglementation RE2020 va donner de la visibilité à la construction bois, elle est évolutive avec des seuils 2025, 2028, 2031, des obligations en matière de construction, c'est le moteur pour l'usage du bois dans la construction française.
Le ministère du logement a lancé une mission sur l'impact économique de la construction bois, c'est un sujet sociétal important. Les évolutions en cours ne sont pas liées seulement à la réglementation, l'enjeu n'est pas de mettre un peu de bois sur les murs pour les isoler, mais de construire désormais en intégrant le bois, donc construire différemment et non plus seulement à partir d'une structure en béton comme on sait si bien le faire - cela suppose de former les professionnels, cela va prendre des années, de grandes entreprises comme Vinci ont déjà commencé et nous travaillons avec elles.
Sur la communication, nous sommes victimes d'imprécisions sur nos pratiques et même de fausses informations. Nous avons lancé cette année une campagne de communication filière pour montrer qui nous sommes.
Il nous est apparu très important de rapprocher notre filière et nos industries de la société. Aujourd'hui, tout le monde aime les poutres dans son salon, dans sa maison, mais personne n'aime couper un arbre et personne ne fait le lien entre cet arbre qu'il faut couper parce qu'il arrive à maturité, et la poutre qu'il aime voir. Nous sommes dans de la sylviculture, nous dépendons de décisions prises il y a 30 ou 40 ans, et quand il y a des coupes rases, cela correspond à un mode de sylviculture qui n'a plus cours mais qui existait par le passé, nous devons couper les arbres qui arrivent à maturité en même temps - cependant, ces coupes rases ne représentent que 2 % de l'ensemble, c'est très faible, cela retient l'attention de réseaux sociaux mais c'est très marginal. L'industrie française n'est pas alimentée par des coupes rases, c'est un fait.
Les évolutions climatiques dégradent la forêt et nous obligent à nous adapter, nous le faisons. La forêt a été plantée par Colbert il y a plus de 300 ans, elle a eu de mauvais passages, mais on a repris la main et désormais elle croît, elle embellit ; le forestier d'aujourd'hui sait très bien que la forêt est un patrimoine qu'il transmettra, qu'il travaille aujourd'hui pour les générations futures. Nous sommes sur des schémas de longue durée et l'industrie n'a pas intérêt à raser la forêt française, sachant que l'investissement porte sur des décennies ; on nous accuse d'une gestion qui ne serait pas patrimoniale, alors qu'elle l'est : si nous voulons pérenniser nos produits, nos débouchés, et que notre pays arrive à la neutralité carbone en 2050, un objectif où la filière bois dans la construction a tout son rôle à jouer, nous devons nous assurer de la ressource, dans la durée. Nos décisions d'aujourd'hui auront un impact sur le climat en 2070, en 2080 et ce qu'on peut faire également, c'est mettre plus de bois dans notre vie autour de nous, parce que c'est un matériau qui stocke le carbone et qui a une capacité de substitution forte par rapport à d'autres produits issus de procédés industriels qui, eux, libèrent du carbone. C'est tout cela que nous allons faire passer dans notre campagne de communication, qui va durer toute cette année.
Nous travaillons aussi sur l'attractivité des métiers du bois. Nous avons créé 35 000 emplois en sept ans, nous voulons en créer autant dans les cinq prochaines années. La pénibilité de nos métiers est souvent mise en avant, nous travaillons avec un programme que nous avons appelé Very Wood Métiers sur la connaissance de ces métiers, qui comprend aussi un objectif de féminisation.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Notre ressource en bois est et restera suffisante pour les besoins dans la construction puisque dans tous les cas, on ne construira jamais entièrement en bois - le bois a comme défaut de brûler, donc il faut être prudent et on aura toujours un mélange entre des matériaux minéraux et des matériaux combustibles.
Dans la société de communication où nous vivons, bien des messages sur les réseaux sociaux sont caricaturaux, ils sont faits pour choquer et nous ne l'avons pas anticipé, nous vivions sur le temps long où la communication était plus naturelle. Des gens disent qu'on ne fait que des coupes rases, ce n'est pas vrai - mais il y a des coupes rases, dans les parcelles qui ont été plantées pour qu'il y en ait, comme cela s'est fait par le passé et il faut le faire, ou bien on aura encore plus de bois dépérissant. Il y a aussi le cas de petites parcelles où l'on va moins facilement qu'avant, elles ont été plantées quand le matériel était plus petit, c'est aussi un problème.
Les photos satellites, ensuite, sont effectivement très puissantes, on peut aujourd'hui reconnaître les essences d'une façon très précise et on peut recoller le cadastre - nous aimerions d'ailleurs que les entreprises puissent accéder plus librement au cadastre, l'accès n'a été étendu qu'aux coopératives et aux experts forestiers. Quant aux mesures sur la capacité de séquestration de carbone par le sol, je n'ai jamais compris comment elles étaient faites. La moitié de la masse d'un arbre se trouve dans les racines et quand on le coupe, on ne retire que la partie du tronc, les feuilles et les petites branches sont laissées en forêt - cela compte dans le calcul du carbone, me semble-t-il.
Sur la partie énergie, ensuite, injecter de la biomasse sous forme de gaz dans les réseaux, c'est une bonne idée, de même que la méthaniser ; cependant, le faire pour, ensuite, retransformer cette biomasse en chauffage, c'est une mauvaise idée, car le rendement est mauvais : mieux vaut prendre le bois, le déshydrater, le granuler, pour le brûler.
M. Franck Montaugé. - Cela dépend de comment vous le faites...
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Attention, c'est un problème de rendement. Quand vous fabriquez de l'électricité avec une turbine à vapeur, le rendement est de 25 à 30 %, donc avec 100 % d'énergie thermique, vous n'extrayez que 25 % d'électricité. Si cette électricité est utilisée pour refaire du chauffage derrière, c'est une très mauvaise idée. C'est de la physique élémentaire...
M. Franck Montaugé. - Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) n'est pas comparable...
Mme Anne Duisabeau. - Les étapes de transformation de la matière ont chacune une efficacité propre et si les pertes sont trop importantes, les rendements ne suffisent plus. Les procédés existent pour transformer un gaz, la technique est là, mais quand la rentabilité devient trop faible, ce n'est pas utilisable.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Il faut évidemment prendre en compte les rendements. Produire du gaz pour fabriquer de l'électricité, qui servira ensuite au chauffage en période froide, puisqu'il faudra la stocker pour alimenter les turbines lorsque les éoliennes ne fonctionneront pas, ça peut être une bonne idée, mais qui ne fonctionne pas. Mieux vaut utiliser de la biomasse que l'on stockera, puis que l'on utilisera lors des pointes de froid, avec des délestages sur les réseaux électriques.
M. Franck Montaugé. - C'est aussi un choix politique, pas seulement une question de physique...
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Les réseaux électriques ne supporteraient pas la demande d'électricité dont nous aurions besoin - nous ne sommes pas d'accord sur le sujet, manifestement.
Mme Anne Duisabeau. - La question de fond concernant l'étude Carbone 4, c'est qu'elle est devenue un outil de simulation de la filière. Vous dites que le bois énergie n'a pas été pris en compte, mais il l'a été ; en revanche, la gazéification ne l'a pas été, parce que le modèle de Carbone 4 a été construit sur les chiffres de 2017 et 2018, quand la gazéification était anecdotique dans notre pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, la gazéification peut être prise en compte pour évaluer son impact dans la valeur ajoutée, mais elle n'est pas dans Carbone 4.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Un mot sur le prix du granulé. Il est influencé par une consommation importante au Royaume-Uni : les Britanniques consomment 8 millions de tonnes de granulés pour fabriquer de l'électricité, depuis qu'ils en utilisent dans leurs anciennes centrales à charbon - c'est le cas aussi de compagnies belges et allemandes. La Russie nous fournissait du gaz, mais aussi des granulés ; lorsque cet approvisionnement a été coupé, le prix de l'électricité s'est envolé, pour atteindre jusqu'à 1 000 euros le mégawattheure, les Anglais et les Allemands se sont mis à acheter des granulés à n'importe quel prix, et il y a eu un temps, assez court, une envolée folle du prix des granulés. Cela a été un problème - Paris est chauffé avec des granulés de bois : 180 000 tonnes sont nécessaires pour chauffer Paris, intégralement importées de l'étranger via le port de Rouen et une ligne ferroviaire chez CPCU à Saint-Ouen, entreprise qui a dû acheter très cher son granulé pendant cette crise, l'idée étant qu'il n'y avait plus de gaz et que sans granulés, on ne pourrait plus chauffer la capitale.
Ce n'est donc pas nous qui avons fait le prix du marché ; nous aurions pu vendre nos granulés plus chers aux Britanniques ou aux Allemands, nous ne l'avons pas fait. Du reste, la fièvre est vite retombée, et les prix avec elle, ils sont même très bas aujourd'hui.
M. Matthieu Fleury. - La communication est essentielle, nous ne sommes pas visibles, ni audibles : nous avons vécu cachés et heureux pendant de longues années, il est temps que nous sortions du bois.
Il faut rétablir un lien entre la société et nos métiers, parce que l'exode rural est passé par là et qu'aujourd'hui, presque plus personne ne prend sa tronçonneuse pour faire du bois énergie ou du bois d'oeuvre. Le contact avec la forêt productrice, avec le bocage producteur, a disparu : il nous faut le recréer de diverses manières.
France Bois Forêt va engager un vaste plan de communication, c'est urgent - cela montre qu'on a pris conscience du sujet. Il y a aussi les interprofessions locales sur les territoires qui font ce travail quotidien pour diffuser les usages du bois et faire le lien avec l'arbre.
Sur le stockage du carbone dans les sols, les études scientifiques montrent effectivement une dégradation, liée aux aléas climatiques, au stress hydrique de ces dernières années sur les massifs forestiers, donc à une croissance moindre, aux maladies comme les scolytes, l'encre du châtaignier ou la chalarose du frêne. Nous avons de la chance, en France, d'avoir des équipes de chercheurs qui essaient de modéliser les évolutions, pour identifier les essences qui résisteront mieux au changement climatique, il y a une forme de pari puisqu'on ne sait pas avec quelle vitesse le changement climatique va s'opérer sur notre territoire.
Le sujet du recyclage est déjà largement abordé, les usines sortent de terre, nous valorisons au mieux le recyclage du bois dans le panneau et en envoyant les résidus dans des chaudières, qui vont produire leur propre électricité. Nous sommes sur des modèles très intégrés ; ils ne sont pas complètement opérationnels, mais ils le seront d'ici quelques mois, et alors la filière valorisera le moindre petit morceau de bois sur notre territoire et nous serons un modèle d'économie circulaire. Il faut que nous sachions le communiquer et diffuser cette culture du recyclage, ce modèle du zéro perte et de la diversité de notre filière.
La chimie verte, c'est un vrai sujet, il est devant nous. La chimie est le premier consommateur de produits pétroliers, que le bois ne saurait remplacer entièrement, c'est évident ; mais l'arbre peut faire beaucoup, en particulier la forêt tropicale, dont le feuillage contient des molécules extrêmement recherchées dans la pharmacie, c'est une piste à explorer, d'autant que nous serons plus compétitifs en la matière que sur la production de palettes...
Mme Annick Jacquemet. - Dans le cadre d'une mission d'information sur l'avenir de la filière automobile, j'ai visité un équipementier dans mon département qui m'a dit que, pour éviter la taxe carbone, il avait choisi de planter des arbres... au Brésil, et il m'a demandé pourquoi le mécanisme de compensation ne lui permettait pas d'en planter plutôt en France : avez-vous la réponse ?
Les forêts dans le département du Doubs et plus largement en Bourgogne-Franche-Comté, sont décimées par le scolyte. Il faudra replanter, mais on ne sait pas encore avec quelles essences, l'Office national des forêts (ONF) fait des essais. M. Archimbaud nous a donné l'exemple des forêts replantées par les Allemands avec des pins autrichiens, on se rend compte après 80 ans que ces pins ne sont pas adaptés : il ne faudrait pas faire la même erreur dans notre département. Quelle est votre approche sur le sujet ?
Enfin, une scierie proche de chez moi voulait installer des panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments, mais son assureur refuse alors de couvrir le risque : avez-vous un conseil en la matière ?
Mme Marie-Lise Housseau. - Dans le Tarn, où il y avait beaucoup de feuillus, des résineux ont été plantés après la deuxième guerre, mais les scieries ont perdu de l'activité faute de débouchés : Revel, ville du meuble d'art, a perdu la plupart de ses emplois dans cette spécialité, avec l'effondrement de cette filière d'ameublement d'art. Nous sommes envahis de panneaux de particules, de medium, d'Ikea, de même que dans la menuiserie, le lobbying du PVC est partout - je l'ai expérimenté lorsque j'avais déposé un amendement pour valoriser les menuiseries de fenêtre en bois : j'avais aussitôt été assaillie par les lobbyistes du PVC qui me présentaient toutes les qualités environnementales de cette filière, sans mentionner, bien sûr, le fait que le PVC ne stocke pas le carbone...
Cependant, les métiers du bois attirent les jeunes, notre lycée professionnel fait le plein, nous avons les compétences en matière de design : pensez-vous qu'il y a toujours une place pour une filière de l'ameublement français ? Est-ce que vous avez des entreprises de cette filière parmi vos adhérents ?
M. Alain Chatillon. - Revel comptait une trentaine d'entreprises d'ameublement d'art il y a quelques décennies encore, j'y ai créé en 2012 le lycée des métiers d'art du bois, 200 jeunes en sortent et c'est un succès, nous mettons en place une pépinière d'entreprises pour soutenir l'installation de jeunes : nous continuons à agir pour cette filière passionnante.
M. Gilbert Favreau. - Un scieur de mon département, les Deux-Sèvres, m'a interpellé sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) : il estime, en tant que scieur, ne pas produire de déchets, et donc que l'application de la REP à son activité ne se justifie pas - qu'en pensez-vous ?
Mme Anne Duisabeau. - L'État met en place des labels bas carbone pour planter en France, des systèmes qui permettent, avec un financement privé, de replanter des arbres en forêt pour compenser les émissions de carbone : pas besoin de planter au Brésil, c'est possible en France, il faut se rapprocher de nous pour une information plus juste.
L'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits empêche les pompiers d'intervenir s'il y a un incendie dans le bâtiment, donc l'assurance ne couvre pas : cela concerne tous les bâtiments, pas seulement les scieries. C'est un problème puisque sans assurance, une entreprise ne peut pas emprunter. Notre filière a besoin d'investissements, on ne pourra pas avancer sans régler la partie assurancielle - la question se pose aussi pour la forêt, par exemple sur la responsabilité du propriétaire pour les dégâts causés par des branches qui tombent. L'assurance se désengage de pans entiers de l'activité, alors que le changement climatique accentue les risques, c'est un vrai problème dans nos métiers.
La filière française de l'ameublement d'art est bien vivante, elle croît et s'embellit. Le bois massif est plus onéreux que le panneau, c'est un sujet quand le pouvoir d'achat baisse et qu'il devient difficile d'acheter un meuble massif chêne ou merisier, les gens achètent dans de grandes surfaces des meubles tout-venant qui auront une durée de vie moins importante, mais qui correspond à la mobilité et aux modes de vie d'aujourd'hui. Le bois massif a son avenir, mais comme un produit haut de gamme, c'est une niche qui a ses contraintes de coût mais qui a aussi ses réussites.
Mme Marie-Lise Housseau. - On le voit avec les meubles portugais.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Oui, mais les meubles portugais sont faits à partir d'arbres du Brésil, qui est une ancienne colonie portugaise et qui dispose d'un potentiel forestier énorme, il y a dans le nord du Brésil plus de 200 millions d'hectares de pâturage pauvre que les autorités cherchent à reconvertir dans l'agroforesterie. Nous-mêmes, nous avons une entreprise au Brésil, j'étais à Sao Paulo il y a quelques mois, on m'y a interrogé sur des méthodes qu'utilisaient nos arrière-grands-parents...
Les panneaux photovoltaïques sur les bâtiments posent un problème sérieux ; les pompiers ne peuvent pas arroser un matériel électrique en cas d'incendie, parce qu'ils risquent de s'électrocuter, on ne peut pas déconnecter la production électrique de panneaux posés sur un toit - donc les assureurs ne couvrent pas le risque sur ce qui se trouve dans le bâtiment, c'est vrai dans tous les domaines d'activité.
Dans le Tarn, effectivement, il faut considérer les cycles : on a beaucoup planté après la guerre, on a installé des scieries, ces arbres ont été coupés et comme il n'y a pas eu assez de replantations, l'activité a diminué. Il y a des zones, aussi, où l'on a planté des arbres sans penser à ce qu'on allait en faire, et où personne n'est très motivé pour aller implanter une scierie sachant que l'activité ne durera pas plus de dix ans - surtout si c'est sur des essences comme le pin douglas, qui est fort critiquée.
Concernant la sensibilisation à la forêt, je crois qu'il faut commencer très tôt, sensibiliser les enfants à aller dans la forêt, à couper un arbre, à le débiter - en intégrant d'emblée toute la chaîne. C'est comparable à ce qui se passe pour la formation en cuisine, aujourd'hui un cuisiner doit s'intéresser à la manière dont on cultive les plantes qu'il cuisine ou à la manière dont on élève les animaux qu'il utilisera, il faut intégrer cette formation à la forêt dès le plus jeune âge.
Mme Anne Duisabeau. - La REP vient d'une réglementation européenne et concerne toute la filière, mais il ne s'applique qu'en France pour la partie sciage. L'intention est bonne, puisque ce levier financier incite à recycler le bois et à le réutiliser, mais il a un coût, qui pénalise le bois par rapport à d'autres matériaux, c'est une perte de compétitivité dommageable.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Le bois n'a rien à faire dans la REP. Cette taxe a été mise en place pour recycler des matériaux polluants, comme le plastique - on en arrive à ce que le bois finance le recyclage du plastique, c'est absurde. Mon arrière-grand-père, qui était menuisier, a fabriqué des fenêtres en bois il y a un siècle, mes enfants vont devoir payer une taxe pour que des industries du plastique reposent des fenêtres en PVC - les taxes défavorisent le bois. Est-ce que le bois pollue la nature ? Non, il se dégrade tout seul, il est tout à fait recyclé. En réalité, nous n'avons pas besoin de subventions pour faire fonctionner notre recyclage, nous y parvenons très bien. Pourquoi aller mettre de l'argent dans un système pour exporter nos déchets de bois en Finlande ou au Portugal... ceci pour fabriquer des panneaux et importer des meubles en France ? Cela n'a aucun sens.
M. Daniel Salmon. - Dès qu'on parle de bois, il y a de l'émotion, car avec le bois il y a l'arbre, la haie, la forêt, c'est ce qui accompagne l'humanité depuis la nuit des temps et ce qui accompagne chacun de nous, du berceau au cercueil... Le citoyen est désormais éloigné des réalités, on en a fait un citoyen hors sol qui ne comprend plus grand-chose aux flux dont il bénéficie, il faut le reconnecter. Il y a effectivement une sorte de sacralisation de l'arbre, parce qu'il abrite de la biodiversité, nous procure des aménités, on voit tout ce qu'il nous donne aussi quand il disparaît du paysage ; cependant, nous en avons besoin pour la construction et pour bien d'autres choses, dont l'énergie.
Les petits propriétaires forestiers sont très nombreux. Nous avons adopté il y a deux ans une loi pour que les experts forestiers accèdent aux données cadastrales : a-t-elle facilité leur capacité d'intervention auprès de propriétaires trop dispersés, pour des actions à plus grande échelle ?
Pour le séchage du bois, on parle du photovoltaïque, il y a aussi le solaire thermique, c'est le grand oublié, alors qu'il peut être utile quand nous avons besoin de sécher beaucoup de bois : qu'en pensez-vous ?
Qu'en est-il, de même, du risque incendie, qui ne peut être qu'affecté par l'usage plus important du bois dans la construction ?
Je vous rejoins sur la REP, le mécanisme est déséquilibré, les palets bretons en bois se retrouvent à devoir payer pour des pièces en plastique fabriquées en Chine, il faut changer ces mécanismes.
M. Philippe Grosvalet. - Dans un monde où tout s'accélère, nous avons la chance d'avoir un Office national des forêts (ONF), qui développe des pépinières expérimentales pour rechercher les effets du réchauffement climatique sur les feuillus de plaine, c'est extrêmement important pour savoir quels seront ceux qui tiendront dans les conditions climatiques à venir - l'une de ces pépinières est en Loire-Atlantique. Or, l'ONF subit des coupes sombres, il serait menacé : quelles sont vos relations avec lui, comment le soutenez-vous ?
Mme Micheline Jacques. - À Nuku Hiva, dans l'archipel des Marquises, une forêt de pins caraïbes a été plantée dans les années 1980, elle arrive à maturité et elle est donc prête à être exploitée ; malheureusement, ces pins ne correspondent plus aux normes de construction apparues depuis, c'est un problème. Il se pose aussi pour le bois en Guyane, la filière forestière a un grand besoin d'être structurée. Quelles sont vos relations avec les forestiers de Guyane, de Polynésie, des Antilles ? En Guadeloupe, on a installé des usines de production d'énergie à base de bagasse de canne à sucre, mais il n'y a toujours pas d'agrément pour que cette biomasse remplace le charbon, c'est plus que surprenant : qu'en pensez-vous ?
M. Pierre Cuypers. - Une question sur la réutilisation des traverses de chemin de fer : avant, on pouvait les réutiliser, c'est désormais interdit - comment les recyclez-vous ?
M. Lucien Stanzione. - Quelle est votre position sur l'exploitation de la forêt en Guyane, qui est le premier département forestier de France ?
Mme Anne Duisabeau. - La propriété forestière est excessivement morcelée, ce qui en complique la gestion « massifiée » telle qu'elle a désormais cours et qui est un facteur de compétitivité - à ce titre, l'ouverture du cadastre aux experts forestiers marque un progrès.
En tant que filière, nous soutenons pleinement l'ONF, il est adhérent à France Bois Forêt et fait partie du premier collège, avec notamment les propriétaires forestiers, nous soutenons en particulier ses pépinières expérimentales et la sélection des essences de demain.
Le séchage par solaire thermique n'a pas le même niveau de compétitivité que les procédés que nous utilisons, c'est une limite.
Enfin, la réutilisation des traverses est compliquée, elles sont brûlées dans des chaudières particulières, dites de classe 2, elles sont un déchet bois dangereux.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - On devrait autoriser plutôt qu'interdire la réutilisation des traverses, c'est un produit stable, imputrescible, qui dégage effectivement des gaz polluants quand on le brûle, mais qui peut être utilisé.
M. Daniel Salmon. - Attention, cependant, on en arrive à trouver dans les cours d'école des taux d'arsenic supérieurs à ceux qui sont mortels pour les rats... On peut utiliser ces matériaux, mais avec prudence, en les noyant par exemple dans le béton...
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Il faudrait élargir davantage l'accès au cadastre. Lorsque nous gérons nos propres exploitations forestières, nous sommes contraints de recourir à des artifices pour obtenir nos numéros de parcelles, c'est une complication, même si nous comprenons qu'il faille protéger les données.
Nos relations avec l'ONF sont excellentes. L'office joue un rôle essentiel pour l'ouverture de la forêt au public, sur tout le territoire, en particulier sur le littoral.
Les capacités futures qu'aura l'offre de répondre à la demande, dépendent de ce que nous faisons aujourd'hui et les choses sont très claires : il faut planter, planter, planter. Le débat entre la monoculture et la mixité des essences est secondaire. Dans les Landes, nous ne créerons jamais de forêts cultivées à sous-étage, ce n'est pas possible. En Bretagne, des reboisements ont été réalisés dans des vallons, c'est une réussite, cela donne un très beau maillage, il a changé le paysage de la région. Quant aux haies, les choses ne vont pas assez vite, on parle depuis deux décennies de replanter des kilomètres de haies mais sans poser la question de la rentabilité. Aujourd'hui, plutôt que de mettre des hectares et des hectares de culture en jachère, mieux vaudrait consacrer aux arbres des bandes de terre le long des chemins ruraux, quitte à indemniser l'agriculteur pour perte de récolte - alors qu'aujourd'hui, on lui a fait tout retirer et il laboure jusqu'aux chemins, pour cultiver des plantes qui ne sont pas toujours bien utilisées.
Nous avons des contacts avec les forestiers aux Marquises, comme dans les autres territoires ultramarins, je crois qu'il faut laisser l'usage de leur bois aux habitants de ces territoires. En réalité, les normes françaises ne sont guère adaptées à la construction locale faite dans les usages de l'art avec de la ressource locale.
Mme Micheline Jacques. - Mais alors, nos maisons ne sont pas couvertes par les assurances, en particulier contre le risque sismique...
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Il faut faire comme un charpentier qui calcule sa charpente. Il construit une maison, elle s'écroule ; il en construit une deuxième, elle ne s'écroule pas, et c'est cette façon de faire qu'il emploie par la suite, quand il a trouvé la bonne solution pour construire la maison qui résiste.
Mme Anne Duisabeau. - Ce problème de validation des essences va s'étendre puisque le développement de l'utilisation des feuillus va nous contraindre à modéliser et à évaluer ces bois sur leur qualité physique et technique dans les usages.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Si l'on doit détailler l'analyse jusqu'à telle ou telle essence très particulière qu'on ne trouve que dans une seule région, on ne va pas y arriver...
Mme Micheline Jacques. - C'est bien pourquoi nous avons un problème à régler.
M. Jean-Pascal Archimbaud. - Exploiter la forêt guyanaise, cela me paraît une mauvaise idée. Qu'on en utilise localement des ressources, d'accord, mais pourquoi aller au-delà, en détruisant cette réserve écologique importante, alors que nous pouvons faire du bois ailleurs ? En plus, le bois de Guyane ne flotte pas, ce qui pose des problèmes évidents d'acheminement.
Quant au remplacement du charbon en Guadeloupe, le modèle est celui qui a été mis en place en Martinique et à La Réunion, où l'entreprise Albioma a installé des usines de production d'électricité qui tournent avec des granulés... d'importation : aucun granulé ne vient d'Europe, tous proviennent des États-Unis, du Canada, du Vietnam ou d'Australie. Albioma étant une entreprise dont les capitaux sont américains, on pouvait s'attendre à ce qu'elle achète plutôt des granulés américains...
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Merci pour toutes ces informations et pour votre disponibilité.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Examen en
commission
(Mercredi 9 juillet 2025)
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - J'invite Mme Anne-Catherine Loisier et M. Serge Mérillou à nous présenter leur rapport sur la compétitivité de la filière bois française.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. - Madame la présidente, je vous remercie de nous avoir confié la rédaction de ce rapport, pour lequel nous avons réalisé un important travail et auditionné une soixantaine de personnes.
Mes chers collègues, dans les travaux de notre commission sur les contraintes à lever pour redresser notre économie, nous avions exploré l'agriculture, l'énergie, et nous explorerons bientôt l'automobile et le logement. Nous ne nous étions pas encore penchés sur la compétitivité de la filière bois.
Discrète mais stratégique, cette filière représente 440 000 emplois, soit davantage que l'industrie automobile, et irrigue l'ensemble du territoire. Comme les filières industrielles que j'ai citées, la filière bois va au-devant de grandes mutations. Elle pèse à elle seule pour 10 % du déficit commercial de notre pays, soit 8,5 milliards d'euros, tandis que l'agriculture et l'agroalimentaire, pourtant jugés en difficulté, restent excédentaires à hauteur de 5 milliards d'euros.
Un rapport sénatorial de 2015 évoquait, sur ce point, un « modèle de pays en développement » : la France, riche de 17,5 millions d'hectares de forêts métropolitaines - auxquels s'ajoutent 8 millions d'hectares en Guyane - exporte sa matière première pour la voir revenir sous forme de produits finis - je pense notamment à l'ameublement et au parquet.
Comment une forêt plus étendue que celle de l'Allemagne peut-elle générer un déficit aussi important ? Comment optimiser la valorisation de la ressource bois issue de nos forêts au bénéfice de notre économie ? Ce sont les questions auxquelles nous avons voulu répondre, et qui nous conduisent à formuler vingt-quatre recommandations.
M. Serge Mérillou, rapporteur. - Mes chers collègues, trois partis pris ont guidé notre démarche.
Premièrement, nous avons centré notre approche sur l'économie de la filière bois, c'est-à-dire essentiellement l'aval, alors que nous avons pour habitude de parler beaucoup de l'amont. Le point de vue que nous adoptons est donc, en quelque sorte, celui des transformateurs de bois.
Deuxièmement, nous croyons que le bois, matériau bas carbone, est un levier pour réconcilier écologie et économie. L'optimisation du rendement matière est à la fois une exigence environnementale, pour allonger la durée de vie des produits bois, et un défi de compétitivité, pour créer plus de valeur ajoutée, qui doit tous nous mobiliser.
Troisièmement, nous avons préféré une approche ciblée à un énième rapport global. Ainsi, cinq produits emblématiques nous ont servi de portes d'entrée.
Le rapport est structuré en quatre parties. Nous présentons, tout d'abord, ces cinq produits. Ensuite, nous revenons sur les défis transversaux de la première transformation. Nous abordons, pour suivre, la question du bouclage biomasse, qui agite toute la filière, avant de conclure sur les leviers de mobilisation du bois en forêt.
Je commence donc par notre première partie et notre approche par produit.
Le premier produit est la façade et le mur à ossature bois. Le bois d'oeuvre charpente toute la filière par sa forte valeur ajoutée. Or la France accusait un retard important sur le volume de bois séché et sur les bois techniques par rapport à l'Allemagne ou à l'Autriche. Avec l'accent mis sur le triptyque scier-sécher-transformer, nous avons rattrapé une petite partie du chemin depuis 2020. À titre d'exemple, la première usine de lamibois de France est en train de sortir de terre en Haute-Loire. La part de bois dans la construction neuve reste cependant faible - moins de 7 % -, freinée non tant par le coût que par un manque d'acculturation des maîtres d'ouvrage.
Nous recommandons notamment de faciliter la reconnaissance des solutions d'effet équivalent aux normes incendie, un dossier qui nous a fait prendre du retard.
Nous voudrions aussi encourager les collectivités à bonifier les isolants biosourcés en complément de MaPrimeRénov', ce que préconisait déjà le rapport de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique de Guillaume Gontard et Dominique Estrosi Sassone. À terme, il faudra sans doute élargir la réglementation environnementale 2020 (RE2020) à la rénovation, car 80 % de la ville de demain est déjà construite.
J'en viens au deuxième produit, l'ameublement et le parquet. Plus de 3 milliards des 8,5 milliards d'euros de déficit proviennent du seul ameublement. La part du meuble français sur notre marché est passée de 77 % à 37 % en vingt-cinq ans. Ce recul s'amplifie aujourd'hui avec la « fast déco » importée à bas coût. Nous préconisons des mesures d'urgence pour temporiser - frais de 2 euros par colis, contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), communication négative sur les non-conformités constatées - et surtout le recours à la réglementation antidumping européenne, qui devrait devenir plus automatique, pour riposter.
Le troisième produit est la palette, segment où la France est bien positionnée. Elle constitue aussi un bon levier de diversification pour les scieries et un vecteur de contrôle de la chaîne logistique pour notre industrie.
Concernant le quatrième produit, le papier pour carton ondulé, la papeterie est le premier poste de déficit bois, à hauteur de 4 milliards d'euros. L'exemple du site de production Blue Paper à Strasbourg, que nous avons visité avec Anne-Catherine Loisier, montre qu'il est possible de maintenir ce type de site en France. Mais dans ce secteur, très internationalisé, les arbitrages dépendent beaucoup des coûts de production, et notamment du coût de l'énergie. Le cadre post-Arenh, c'est-à-dire après l'instauration du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, sera donc déterminant.
J'en viens enfin au cinquième et dernier produit, les granulés bois. Trois fois moins chers que l'électricité, ils sont une solution réaliste de transition énergétique, notamment dans les zones non raccordées au gaz et pour remplacer des foyers peu performants à des fins d'amélioration de la qualité de l'air. Une meilleure reconnaissance des projets respectant ces deux conditions dans MaPrimeRénov' nous paraîtrait bienvenue.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. - J'en viens au deuxième volet, celui des défis transversaux de la première transformation.
Le bois souffre des maux classiques de l'industrie française : fiscalité peu incitative, voire discriminante, et charges sociales élevées. Un basculement vers une fiscalité plus environnementale bénéficierait à ce matériau. Une taxe carbone aux frontières permettrait aussi de limiter l'importation de produits beaucoup plus émissifs, à l'instar du parquet transformé en Chine, qui émet quatorze fois plus de CO2 que celui qui est transformé en France.
La question des compétences est également cruciale. Il y a pénurie dans les métiers du bois, mais aussi, et surtout, dans la maintenance et l'électromécanique. Les propositions du rapport Bozio-Wasmer sur la « désmicardisation », dont les syndicats nous ont parlé la semaine dernière, devraient permettre de mieux cibler les exonérations sur l'emploi intermédiaire et donc industriel.
Plus spécifiques à la filière, deux grands types de normes entravent ou risquent d'entraver la compétitivité du bois français.
Tout d'abord, sur la traçabilité, le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), entrera en vigueur le 30 décembre 2025. La France continue seule contre vingt-quatre États membres à le défendre, car il s'agissait d'une mesure miroir adoptée sous présidence française de l'Union européenne. Une proposition de résolution européenne discutée aujourd'hui même au Parlement européen vise à créer une catégorie « risque nul » réservée aux pays européens. En effet, le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud sont classés en « risque standard ». Or ce différentiel très faible entre eux et nous sera préjudiciable à nombre de pays européens, notamment la France. Alors qu'il s'agissait de lutter contre la déforestation importée et l'huile de palme, nous risquons d'imposer plus de contraintes à nos entreprises : nous marchons sur la tête... En effet, 100 % de nos entreprises seront assujetties à ces normes, mais seules les filières exportatrices des États tiers le seront. L'incidence sur la compétitivité de nos productions sera majeure. Sans rouvrir le texte en tant que tel pour ne pas créer d'insécurité juridique, nous formulons donc quatre propositions d'aménagement de ce règlement, en complément de la motion discutée aujourd'hui.
Ensuite, il existe des normes sur le bois en fin de vie, qui représente une ressource importante en volume pour satisfaire aux nombreuses demandes. Nous sommes les seuls au monde à avoir soumis le bois à la responsabilité élargie du producteur (REP) du bâtiment. Nous espérons que les amendements que j'ai fait adopter en séance au Sénat sur l'écocontribution réduiront ce poids qui met en difficulté nos producteurs.
Au-delà de ces deux dossiers, il y a les normes du quotidien, qui imposent parfois une forme de harcèlement administratif à certaines de nos industries. Je pense par exemple aux murs coupe-feu exigés par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). D'expérience, des rendez-vous territoriaux de simplification, sous l'égide des préfets, et en présence des élus locaux, pourraient aplanir bien des difficultés.
Le sujet de l'assurabilité devient existentiel pour les scieries. Certaines ne sont aujourd'hui que partiellement assurées : c'est une véritable épée de Damoclès qui pèse sur leur activité au quotidien. Pour les grands groupes, des captives, formes d'autoassurance, peuvent exister et pourraient être accompagnées par les pouvoirs publics. Mais pour les petites et moyennes entreprises (PME), il faudrait faire reconnaître aux assureurs la validité de solutions alternatives au sprinklage, de moindre envergure et donc moins coûteuses, comme les détecteurs de fumée précoces.
Enfin, la modernisation des outils industriels est essentielle. Les appels à projets France 2030 centrés sur l'industrie du bois ont permis, avec 500 millions d'euros d'argent public, de générer 2 milliards d'euros d'investissements privés et de créer 3 000 emplois en l'espace de trois ans. Ce fort effet de levier témoigne d'un besoin d'investissements majeur dans cette industrie et justifie la poursuite du dispositif.
Dans un contexte budgétaire contraint, à défaut, une alternative serait la provision pour investissement, sur le modèle allemand. L'ensemble des acteurs pousse fortement en ce sens. Elle préserverait une dynamique d'investissement, pour les grandes comme pour les petites scieries, lesquelles sont souvent hors d'atteinte des appels à projets, avec des critères beaucoup plus simples. Bercy freinera mais, en fin de compte, la provision pour investissement, grâce à son effet de levier, ne fera que reporter les recettes. Pour nous, c'est un élément essentiel pour que la filière poursuive sa modernisation.
J'en viens au troisième volet de notre rapport, qui concerne le bouclage biomasse.
Le principe européen de « cascade des usages » correspond d'abord à un bon usage économique de la ressource. Naturellement, la charpente est mieux payée que la palette, elle-même mieux payée que le bois de chauffage. Dans la transposition de la directive dite RED III du 18 octobre 2023, nous préconisons donc de ne pas aller au-delà de ce que font nos voisins. Si nous imposons des contraintes supplémentaires, nos industries auront du mal à résister.
Si l'essor du bois-énergie prive d'approvisionnement d'autres usages, il faut plutôt agir sur le signal-prix. Par exemple, nous pourrions rééquilibrer, dans l'ensemble des appels à projets bénéficiant au bois, le financement qui va aux usages « matière » : il n'est aujourd'hui que de 25 %, en raison notamment du poids de l'appel à projets « biomasse chaleur pour l'industrie, l'agriculture et le tertiaire » (BCIAT), qui subventionne des unités de biomasse pour décarboner l'industrie. Nous préconisons de rééquilibrer ces financements publics et de tendre à 50 % afin d'éviter que l'usage pour le bois-énergie ne soit mieux rémunéré qu'un usage long.
Par ailleurs, nous demandons de faire preuve de vigilance sur certains appels d'air qui devraient être objectivés et mieux encadrés, en se penchant mieux sur la question des volumes dans le temps. Ainsi, la centrale de Gardanne doit être accompagnée en douceur vers l'arrêt de son activité dans huit ans. Il faut être clair quant au fait que la filière ne pourra durablement fournir les volumes suffisants pour les carburants d'aviation durables, dits SAF (Sustainable Aviation Fuel), à base de bois, au-delà de 2030. Enfin, le choix de décarboner certains des cinquante plus grands sites industriels par la biomasse solide doit être envisagé au cas par cas. Il faut bien faire la part des choses.
Les cellules régionales biomasse doivent être renforcées, et leur expertise consolidée. La régulation des projets nouveaux, en lien avec les professionnels des territoires, par des avis conformes de ces cellules sur les décisions du préfet portant sur les plans d'approvisionnement, permettrait à la fois de sécuriser la filière et de valoriser les usages matière, plus créateurs de valeur.
Enfin, la très ambitieuse trajectoire d'augmentation de 12 millions de mètres cube par an du programme national de la forêt et du bois, élaboré en 2016, n'a pas été respectée, pour plusieurs raisons. Elle doit donc être réajustée. Plutôt qu'un volume de bois à sortir de forêt, il serait plus pertinent de se fixer des objectifs de volume de bois d'oeuvre - sciage, déroulage - et de bois d'industrie transformé sur le territoire national et donc générateur de valeur ajoutée. L'acceptabilité sociétale de l'exploitation du bois et de la transformation du bois en sera renforcée.
M. Serge Mérillou, rapporteur. - J'en viens au dernier axe de ce rapport. Une fois qu'une trajectoire plus réaliste et pertinente de mobilisation est adoptée, comment atteindre l'objectif et valoriser mieux le bois de nos forêts ?
Contrairement aux idées reçues, la France n'est pas le grenier à bois de l'Europe. La forêt allemande, qui est deux fois plus dense, connaît trois cycles de récolte quand la France n'en connaît qu'un, car elle est plus résineuse. Elle est par ailleurs plus adaptée aux prérequis de l'industrie.
L'exploitation y est plus facile, car la forêt allemande est une forêt de plantation en plaine. En France, seulement 13 % de la surface est issue de plantations, et la géographie physique ou encore la desserte compliquent la donne.
Les entreprises de travaux forestiers, qui sont plus fragiles en France, car plus isolées, souffrent d'une saisonnalité accrue, avec les intempéries en automne et la nidification au printemps. Les missions interservices de l'eau et de la nature (Misen), sous l'autorité du préfet, pourraient contribuer à limiter les risques d'infraction sur les chantiers, en définissant avec les professionnels des cahiers des charges a priori.
Sur le terrain, deux freins organisationnels subsistent.
Le premier, bien connu, est le morcellement de la propriété : il faut encourager la gestion collective, via les coopératives ou les experts forestiers, par une bonification à leur avantage du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement (Defi) « travaux » et par une meilleure coordination entre l'Office national des forêts (ONF) et les gestionnaires privés par massif, plutôt que d'entreprendre un hypothétique remembrement forestier, qui serait trop long et coûteux.
Le second est le manque de contractualisation : en sécurisant les flux, la vente de bois façonné « bord de route », trié en lots homogènes, permettrait à nos scieries, sur le modèle de l'Allemagne, de se concentrer sur leur coeur de métier, à savoir la transformation, et par ailleurs de limiter l'export de nos meilleurs chênes.
Reste enfin le sujet de l'adaptation au changement climatique.
Les crédits en faveur de la planification écologique pour la forêt, dont fait partie le plan de renouvellement forestier, doivent être maintenus à 130 millions d'euros pour donner de la visibilité aux parties prenantes. Dans les forêts scolytées, notamment communales, l'absence de renouvellement forestier est d'autant plus regrettable que les coupes et replantations sont bénéfiques même à très court terme du point de vue du puits de carbone. Certaines lignes du plan, peu coûteuses, mais éminemment stratégiques, doivent être sanctuarisées : je pense en particulier au soutien à la filière graines et plants et aux mesures en faveur de l'aval.
Surtout, il faut cesser de vouloir adapter la forêt à l'industrie. C'est à l'industrie de s'adapter à la forêt. Cela implique, tout d'abord, la mise en oeuvre rapide du plan « Scolytes et bois de crise », pour faciliter le stockage et le transport face à des afflux qui seront de plus en plus imprévisibles avec la multiplication des coupes accidentelles et sanitaires. Ensuite, il faut soutenir les efforts de recherche et développement pour transformer les gros et très gros bois, car notre forêt vieillit, et mieux valoriser les essences dites « secondaires », car notre forêt est diversifiée et va l'être de plus en plus.
En ce sens, le maillage français de petites scieries de feuillus, certes aujourd'hui peu compétitives, est peut-être bien adapté à la forêt de demain, car il est plus flexible que les grandes unités industrielles allemandes. Il nous semble donc raisonnable de maintenir un équilibre entre grandes scieries industrielles et scieries de service, de proximité, sûrement plus orientées sur les feuillus et une diversité d'usages.
On connaît l'importance de la forêt dans l'adaptation au changement climatique : mais celle-ci contribue également à l'atténuation et à la politique de préservation de la biodiversité. À ce titre, la gestion durable, pour peu qu'elle soit accompagnée de quelques mesures de financement novatrices, par exemple européennes, à l'exemple des mesures agroenvironnementales et climatiques de la politique agricole commune, pourrait encourager ceux qui s'y engagent.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. - Pour conclure ce rapport sur une note d'espoir, nous croyons que la filière bois française bénéficie de deux atouts phares.
Tout d'abord, elle dispose d'une forêt d'une richesse exceptionnelle et d'un matériau unique pour son potentiel de création de valeur et de décarbonation, et qui, sous ses multiples formes, ne demande qu'à être davantage valorisée sur le territoire national.
Ensuite, nous avons la chance d'avoir des acteurs économiques engagés, qui prennent des risques, et qui ne demandent que deux choses : être aidés pour investir et se moderniser et ne pas être entravés dans leur activé par une couche supplémentaire de normes administratives, plus contraignante que celles auxquelles doivent se soumettre leurs voisins européens.
Depuis 2020 puis, grâce, notamment, aux Assises de la forêt et du bois de 2022, un élan a été donné, notamment du point de vue des financements publics. Mais l'ensemble des acteurs entendus nous ont fait part d'une demande de cohérence et de continuité. La forêt est un investissement à long terme : l'effort a commencé il y a quelques années. Chers collègues, continuons à soutenir cette forêt pleine d'avenir !
M. Daniel Gremillet. - Je remercie les rapporteurs pour ce travail, dont je partage les conclusions.
Je vous rejoins totalement sur la recommandation n° 8 : nous formons trop de personnes sur la dimension environnementale de la forêt, mais nous manquons terriblement de compétences pour ce qui est de la production et de la connaissance du matériau, tant dans les exploitations forestières que dans les entreprises. Il est essentiel d'y remédier : sans cela, tous les moyens investis dans la forêt - qui ont atteint un niveau bien supérieur à tout ce que nous avions connu les années précédentes - se solderont par un gâchis monstrueux. Il ne suffit pas de planter : il faut aussi que des hommes et des femmes soient formés en sylviculture et en transformation du bois.
Sur la REP, je vous rejoins également : il y a une forme de distorsion concernant l'utilisation du bois dans le paysage normatif français par rapport à nos concurrents européens, notamment allemands.
La contractualisation, sur laquelle vous insistez dans la recommandation n° 20, est en effet clé. La spéculation ne peut apporter une réponse pour valoriser le bois : en temps de crise, ce ne sont pas les Chinois, mais bien les entreprises locales, qui soutiennent la filière. Il faut que tout le monde l'entende.
Concernant la recommandation n° 21, n'aurions-nous pas intérêt à confier la compétence de définir les cahiers des charges pour la réduction des risques d'infraction au code de l'environnement aux préfets de département ? L'échelle régionale me paraît en effet trop vaste pour embrasser la réalité de chaque territoire.
Quant à la recommandation n° 24, à laquelle je souscris, je vous propose d'instaurer, dans nos différentes régions, en lien avec les entreprises et les collectivités, des aires de stockage. Lors de la tempête de 1999, nous avions financé des aires de stockage. Mais lorsque le bois qui y était conservé a été transformé, elles ont été détruites. La région Grand Est, dont je suis vice-président sur les questions agricoles et forestières, a créé des aires de stockage qui ont vocation à durer, en lien avec les entreprises. Cela permet d'utiliser en priorité les bois malades ou provenant des dégâts d'une tempête.
Enfin, il y aurait beaucoup à gagner à développer une véritable politique sanitaire de la forêt, comme celle qui existe pour l'élevage. Les scolytes en sont l'éternel exemple : une intervention précoce aurait permis d'éviter la propagation de la maladie, sachant que de nouvelles attaques se profilent désormais. Il y a soixante ans, lorsqu'un arbre était attaqué par le bostryche, le préfet ordonnait qu'il soit coupé et brûlé : c'est ainsi que la propagation des scolytes a été évitée.
Mme Marie-Lise Housseau. - Nous pouvons sans doute faire mieux sur la communication, un aspect que ne semble pas traiter votre rapport. Il faudrait communiquer sur le fait que la forêt est aussi un outil de production. Dans mon département, les coupes font l'objet de nombreuses critiques, au motif qu'elles dévasteraient les paysages. Les forestiers en viennent parfois à interdire l'accès aux massifs. Il faudrait donc rappeler que la forêt sert à produire du bois.
Je crois par ailleurs qu'aujourd'hui, le plus gros risque qui menace la forêt, ce sont les incendies, et plus seulement sur le pourtour méditerranéen. Or les forêts ne sont pas suffisamment équipées pour répondre à ce risque.
Mme Micheline Jacques. - Je sais l'attachement que porte Anne-Catherine Loisier à la forêt ultramarine, notamment guyanaise. Nous proposerons à la délégation aux outre-mer, que je préside, de travailler sur l'exploitation de cette forêt, à la rentrée.
Plus largement - pardonnez-moi si ma question n'est pas pertinente -, j'aimerais savoir si l'on parvient à valoriser le bois abîmé par les incendies ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. - Monsieur Gremillet, je suis d'accord avec vous sur la recommandation n° 21. Il est dans la logique des choses de confier à chaque préfet de département la définition du cahier des charges.
Concernant les aires de stockage, il est en effet dommage qu'elles soient seulement construites en période de crise puis abandonnées.
La politique sanitaire de la forêt commence à se mettre en place. Dans mon département, par exemple, les acteurs commencent à travailler en réseau pour détecter les cas de scolyte sur les sapins de Douglas.
Concernant l'acceptabilité de la production, plutôt que de continuer sur un objectif national de prélèvement de bois de nos forêts, nous proposons de fixer des objectifs en bois d'oeuvre, bois d'industrie et, accessoirement en bois-énergie : c'est ainsi que les personnes qui fréquentent les forêts comprendront l'usage économique et sociétal qui est fait du bois prélevé.
Sur le volet incendie, j'invite notre collègue à se pencher sur la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, issue des travaux de notre commission et de ceux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et que j'avais rapportée avec MM. Rietmann et Martin, sous la présidence de M. Bacci. Ce texte très complet porte à la fois sur le volet assurantiel, sur la gestion forestière - diversification des essences -, sur le débroussaillement, et traite de l'usage des bois issus des parcelles incendiées, qui, je vous le confirme, peuvent conserver leurs propriétés mécaniques et être réutilisés à certaines conditions.
M. Serge Mérillou, rapporteur. - Il y a un véritable besoin de formation, non seulement pour l'exploitation de la forêt, mais également pour la transformation du bois, en lien avec ce matériau et avec les équipements qui permettent sa transformation. Je pense notamment aux techniciens, aux électromécaniciens et même aux ingénieurs.
Concernant la communication, il est vrai que la forêt est devenue un enjeu sociétal. Les gens ont un fort attachement à la dimension paysagère de la forêt et en parlent parfois comme s'ils en étaient propriétaires !
Je crois aussi que les incendies sont l'un des principaux risques qui menacent la forêt, outre les scolytes. Il arrive que des milliers d'hectares disparaissent d'un coup, même si, comme l'a dit Anne-Catherine, une partie du bois peut être récupérée.
Concernant la recommandation n° 21, nous avons considéré que rien n'empêcherait les préfets de région de faire le point avec leurs préfets de département.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je vous propose de voter les recommandations.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mercredi 14 mai 2025
- Table ronde
· Agreste, service statistique ministériel de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire : M. Vincent MARCUS, chef de service à l'Agreste, service statistique ministériel de l'agriculture ;
· Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) : M. Yann AMBACH, chef du bureau de la politique tarifaire et commerciale ;
· Veille économique mutualisée (VEM) Filière forêt bois : M. Eric TOPPAN, coordinateur de l'Observatoire économique de France Bois Forêt et responsable de la Veille économique mutualisée (VEM) de la filière forêt bois, et Mme Céline BOISSET, responsable économique du Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (Codifab).
Mardi 20 mai 2025
- Table ronde « trajectoires de mobilisation du bois »
· Carbone 4 : MM. Hughes-Marie AULANIER, directeur, responsable de la pratique stratégique, et Gabriel FOLLIN-ARBELET, manager ;
· Institut technologique Forêt cellulose bois-construction ameublement (FCBA) : M. Marin CHAUMET, directeur adjoint du pôle Ressources forestières des territoires ;
· Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) : MM. Guillaume MELLIER, directeur des programmes et de l'appui aux politiques publiques, et Antoine COLIN, chef adjoint du service de l'information forestière ;
· Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) : M. Joseph HAJJAR, directeur de programme Énergie et climat ;
· M. Frédérik JOBERT, ancien adjoint du secrétaire général à la planification écologique (SGPE).
- Table ronde « gestion forestière »
· Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (Cnefaf) : M. Jean-Luc BARTMANN, vice-président ;
· Comité des forêts : MM. François TOUBER, président, et François BACOT, président honoraire ;
· Experts forestiers de France (EFF) : M. Marc VERDIER, expert forestier ;
· Office national des forêts (ONF) : M. Benoît FRAUD, directeur commercial Bois et services, et Mme Claire THOLANCE, adjointe à la directrice des relations institutionnelles ;
· Pro Silva France : M. Antoine CADORET, directeur.
Mardi 27 mai 2025
- Contributeurs pendant les Assises de la forêt et du bois : MM. Jean-Luc DUNOYER, directeur de projet au Contrat stratégique de filière (CSF) Bois, et Michel HERMELINE, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER).
- Union des coopératives forestières françaises (UCFF) : M. Tammouz Eñaut HELOU, secrétaire général.
- Table ronde « commission scientifique des essences d'avenir »
· Office national des forêts : Mme Brigitte MUSCH, coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières ;
· Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (Masa) : Mme Milène GENTILS, cheffe du département Santé des forêts ;
· Groupement d'intérêt public (GIP) Écosystèmes forestiers (Ecofor) : M. Nicolas PICARD, directeur ;
· Réseau mixte technologique (RMT) Adaptation des FORêts au Changement climatiquE (RMT Aforce) : M. François MORNEAU, directeur de l'Institut pour le développement forestier (IDF) du Centre national de la propriété forestière, coordinateur du RMT Aforce ;
· Syndicat national des pépiniéristes forestiers (SNPF) : MM. Pierre NAUDET, vice-président, et Samuel LEMONNIER, vice-président.
- Table ronde « propriétaires forestiers »
· Centre national de la propriété forestière (CNPF) : M. Frédéric DELPORT, directeur général adjoint ;
· Fédération nationale des communes forestières (FNcofor) : M. Philippe CANOT, président, et Alain LESTURGEZ, directeur général ;
· Fédération des syndicats de forestiers privés de France (Fransylva) : MM. Antoine d'AMÉCOURT, président, et M. Laurent de BERTIER, directeur général ;
· Conseil de soutien de la forêt (FSC) : M. Aurélien SAUTIÈRE, directeur exécutif ;
· Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) : M. Paul-Emmanuel HUET, directeur exécutif.
- Table ronde « instances générales de la filière »
· Comité stratégique de filière (CSF) bois : MM. Dominique WEBER, président, et Jean-Luc DUNOYER, directeur de projet ;
· Institut technologique Forêt cellulose bois-construction ameublement (FCBA) : M. Ludovic GUINARD, directeur général ;
· Fibois France : M. Jean-Marc MEYER, président ;
· France Bois Forêt : M. Maxime CHAUMET, directeur général.
Mardi 3 juin 2025
- Table ronde « bois-construction »
· France Bois 2024 : M. Georges-Henri FLORENTIN, membre de l'Académie d'agriculture de France, président de France Bois 2024 de 2018 à 2024 ;
· Association Ingénierie, bois, construction (IBC) : MM. Gaëtan GENÈS, président, Sylvain ROCHET, vice-président, et Yves-Marie LIGOT, ancien président ;
· Union des industriels et constructeurs bois et biosourcés (UICB) : MM. Frédéric CARTERET, président, et Dominique COTTINEAU, délégué général.
Mardi 10 juin 2025
- Table ronde « papier, carton »
· Comité français de l'emballage papier carton (Cofepac) : Mme Kareen DESBOUIS, déléguée générale ;
· Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel) : MM. Paul-Antoine LACOUR, délégué général et Stéphane CORÉE, membre du conseil d'administration, directeur général des Comptoirs des bois de Brive.
Mercredi 11 juin 2025
- Table ronde « think tanks »
· Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan : M. Nicolas RIEDINGER, directeur du département Développement durable et numérique, et Mme Hélène ARAMBOUROU, directrice adjointe au département Développement durable et numérique ;
· Institut de l'économie pour le climat (I4CE) : Mmes Julia GRIMAULT, directrice de programme Forêt, agriculture et climat, et Océane LE PIERRÈS, chargée de recherche au sein du programme Forêt-bois.
Jeudi 12 juin 2025
- Table ronde « emballage bois »
· Syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée (Seila) : M. Thierry GODARD, président, Mmes Laëtitia ROCHATTE, vice-présidente, Véronique VLAHAKIS, secrétaire générale, et M. Sélim DENOYELLE, délégué général ;
· Fédération nationale du bois (FNB) : MM. Christophe BÉNÉTON, président du pôle Emballage et de la commission Palettes, Jean-Pascal ARCHIMBAUD, président du pôle Emballage, et Nicolas DOUZAIN-DIDIER, délégué général.
- Table ronde « exploitation forestière / première transformation »
· Fédération nationale du bois (FNB) : MM. Jean-Pascal ARCHIMBAUD, président, et Nicolas DOUZAIN-DIDIER, délégué général ;
· Fédération nationale entrepreneurs des territoires (FNEDT) : MM. Michel BAZIN, vice-président, président de la commission Forêt, et Aldric de SAINT-PALAIS, chargé des services forestiers et ruraux ;
· Syndicat des exploitants de la filière bois (SEFB) : M. David CAILLOUEL, président, et Mme Annabelle JACQUEMIN-GUILLAUME, déléguée générale.
- Groupement d'intérêt scientifique (GIS) Biomasse : MM. Jérôme MOUSSET, directeur Bioéconomie et énergies renouvelables à l'Ademe, Adrien de COURCELLES, ingénieur Ressources et usages de la biomasse à l'Ademe, co-animateur du GIS Biomasse, et Antoine COLIN, coordinateur de l'Observatoire des forêts françaises à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
Lundi 16 juin 2025
- Table ronde « ameublement, panneaux, parquet »
· Ameublement français : M. Arnaud VISSE, président, Mme Cathy DUFOUR, déléguée générale, et M. Baptiste de SUTTER, directeur général de la société Linex et membre de l'Ameublement français ;
· Meubles Celio : M. Alain LIAULT, membre de l'Ameublement Français et président des Meubles Celio ;
· Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (Codifab) : M. Audoin de GOUVION SAINT-CYR, délégué général ;
· Fédération nationale du bois : M. Jean-Marc LEGRAND, président de la commission Parquet, et Mme Maud NAVET, chargée de mission Produits bois et normalisation, seconde transformation.
- Table ronde « associations de protection de la nature »
· France nature environnement (FNE) : M. Christophe CHAUVIN, pilote du réseau Forêt ;
· Solagro : M. Florin MALAFOSSE, chargé de mission Stratégies territoriales et expertise Forêt-bois ;
· World Wide Fund for Nature (WWF) France : Mmes Julie MARSAUD, responsable du plaidoyer Forêt, et Inès BELKACEM DE LOMAS, stagiaire en politiques publiques.
- Table ronde « bois énergie »
· Comité Interprofessionnel du Bois-Énergie (Cibe) : M. Mathieu FLEURY, président ;
· Fédération des services énergie environnement (Fedene) : M. Dominique KIEFFER, co-président de la commission Bioénergies, Mmes Élodie SCHGOUNN, co-président de la commission Bioénergies, et Marie DESCAT, responsable de la commission Bioe'nergies et territoires ;
· Propellet : M. Éric VIAL, délégué général ;
· Syndicat des énergies renouvelables (SER) : MM. Jules NYSSEN, président, et Jérémy SIMON, délégué général adjoint.
- Table ronde « appels à projets »
· Agence de la transition écologique (ATE-Ademe) : M. Jérôme MOUSSET, directeur Bioéconomie et énergies renouvelables, et Mme Émilie MACHEFAUX, cheffe du service Chaleur renouvelable et de la cellule Bois biosourcés et biocarburants ;
· Bpifrance : Mme Vanessa GIRAUD, directrice des fonds Impact environnement et directrice de la stratégie de la direction du capital développement, MM. Pierre-Eddy SASTRE, directeur d'investissement, et Jean-Baptiste MARIN LAMELLET, directeur des relations institutionnelles ;
· Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - direction générale des entreprises (DGE) : MM. Angel PRIETO, directeur de projets Décarbonation au sein de la sous-direction de la politique industrielle, Stéphane BERGER, directeur de projets Matériaux, et Mme Anne MENEZ, chargée de mission Filière Bois et papier ;
· Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) : M. Mathieu BRANDIBAT, conseiller Matériaux durables.
- France Valley : MM. Arnaud FILHOL, directeur général et co-fondateur, et Clément ROCHE, directeur des investissements et de la gestion des actifs forestiers.
- Audition conjointe :
· Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) : Mme Marie-Aude STOFER, sous-directrice Filières forêt-bois, cheval et bioéconomie ;
· M. Jean-Michel SERVANT, délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages.
Mercredi 18 juin 2025
- Entreprises générales de France (EGF) Bâtiments travaux publics : M. Thibault TERRIEN, responsable de projet, chargé des relations avec la filière bois de Vinci construction, et Nicolas VOLCKAERT, directeur juridique et affaires institutionnelles.
Lundi 23 juin 2025
- Table ronde « Allemagne » :
· Ministère (allemand) de l'agriculture, de l'alimentation et des territoires :
o Unité politique forestière internationale et européenne : MM. Thomas BALDAUF, chef de l'unité et Steven DÖRR, conseiller politique ;
o Unité Gestion durable des forêts, chaîne de valeur du bois : MM. Hermann LUTTMANN, conseiller politique et Jan FOCKE, conseiller politique.
· Fédération allemande de l'industrie du bois : M. Lukas FREISE, directeur général du groupe de travail sur le bois brut.
- Table ronde « Italie » :
· Ministère (italien) des entreprises et du made in Italy (Mimit), direction générale de la politique industrielle, de la reconversion et de la crise industrielle, de l'innovation, des PME et du made in Italy : MM. Paolo CASALINO, directeur général, Carlo GHIA, secrétaire du directeur général, Marco SEBA, secrétaire du directeur général, Giacomo VIGNA, directeur de la division XII (Agro-industrie, industries culturelles et créatives, industrie du tourisme), Daniele TORSIELLO, fonctionnaire de la division X (Systèmes domestiques, industrie de la construction et chaîne d'approvisionnement en appareils électroménagers), Evair Marcello Diego LAVIERI, fonctionnaire de la section IV (Politiques pour les petites et moyennes entreprises, les start-ups, le mouvement coopératif et l'économie sociale) ;
· Cluster national ItaliaForestaLegno (Italie Forêt Bois) : Mme Alessandra STEFANI, présidente et M. Carlo PIEMONTE, directeur ;
· Federlegnio Italia (fédération italienne des industries du bois et de l'ameublement) : M. Filippo BENEDETTI, responsable des relations institutionnelles.
- LBL Brenta : M. Hervé LAURIOT, directeur général.
- Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : MM. Mickaël THIERY, sous-directeur de l'action climatique, Julien VIAU adjoint au sous-directeur et Luca IZZO, chargé de mission.
- Ministère chargé du logement : Mme Valérie LÉTARD, ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, M. Romain BORDIER, conseiller construction et transition écologique et Mme Lou LE NABASQUE, conseillère parlementaire, chargée des Outre-mer.
- Ministère chargé des forêts : Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, M. François VILLEREZ, conseiller économie circulaire et risques, Mmes Audrey GROSS, conseillère attractivité, filières économiques du bois et de la mer et consommation durable et Lisa BROUTTÉ, conseillère parlementaire.
- Ministère de l'industrie et de l'énergie : M. Marc FERRACCI, ministre de l'industrie et de l'énergie, MM. Louis CULOT, conseiller industries de santé, biens de consommation et agroalimentaire et Boris MAZEAU, conseiller chargé du Parlement et des élus locaux.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENT EN ALSACE ET EN ALLEMAGNE
Jeudi 5 juin 2025
- Visite de la papeterie Blue paper en compagnie de Mme Karima CHAKRI, responsable Qualité, hygiène, sécurité, environnement (QHSE).
- Visite de la scierie Streit en compagnie de :
· M. Klaus HENNE, propriétaire de la scierie ;
· M. Bertrand BUISSON, président d'Agibois ;
· Mme Heike MARX, responsable des achats Bois, commerciale Produits connexes de la scierie Schilliger Bois.
- Visite de la chaufferie Arsea avec :
· Mme Nathalie GANTZER, directrice, M. Patrice BOULANGER, responsable Gestion des risques, Mme Pascale ANDLAUER, cadre, et M. Sébastien STOLL, agent technique, du site ;
· M. Éric VIAL, délégué général de Propellet France ;
· M. Denis SCHULTZ, directeur de KWB France ;
· MM. Yves STIHLÉ, dirigeant, et Thomas SCHAAF, technico-commercial, du groupe Stihlé.
Vendredi 6 juin 2025
- Visite de la scierie Feidt avec :
· MM. Christian et Matthieu FEIDT, directeurs généraux, et Mme Marie-Laure FEIDT, administratrice, de la scierie ;
· M. Nicolas DOUZAIN-DIDIER, délégué général de la Fédération nationale du bois ;
· Mme Anne DUISABEAU, présidente, et M. Maxime CHAUMET, directeur général, de France Bois Forêt.
- Visite de la scierie Siat
· MM. Marc SIAT, directeur général et Stéphane GIBON, directeur des achats Matières premières ;
· M. Nicolas DOUZAIN-DIDIER, délégué général de la Fédération nationale du bois ;
· Mme Anne DUISABEAU, présidente, et M. Maxime CHAUMET, directeur général, de France Bois Forêt.
- Rencontre avec M. Sébastien SCHMITT, président de l'Association des entrepreneurs de travaux forestiers du Grand Est.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
des principales recommandations de la mission
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
AXE 1 - TIRER PARTI DU POTENTIEL UNIQUE DE COMPETITIVITE ET DE DECARBONATION DE CINQ PRODUITS BOIS |
||||
|
1 |
S'agissant des normes incendie des bâtiments incluant du bois, modifier la notion de « solutions d'effet équivalent » en permettant de présenter de telles solutions a) plus tard que dès l'étape du permis de construire et b) avec une obligation de résultats plutôt que de moyens (logique performancielle plutôt que de process). |
Parlement |
Dès 2025 |
Modification des articles L. 112-9 et L. 141-3 du code de la construction et de l'habitation (créés par ordonnance après la loi pour un État au service d'une société de confiance), puis décret d'application |
|
2 |
Mettre en place des bonus territoriaux en faveur des isolants biosourcés en complément de MaPrimeRénov', afin de préparer une extension, selon des modalités souples, de la dynamique de la RE2020 à la rénovation dans l'ancien. |
Collectivités territoriales |
Dès 2025 |
Subventions |
|
3 |
À court terme, mettre sur pied des mesures d'urgence pour temporiser sur la concurrence déloyale des places de marché chinoises en : - accroissant la pression de contrôle et en entretenant par des campagnes de communication un bruit de fond négatif sur les non-conformités de la « fast déco » chinoise ; - s'assurant de l'application de frais de gestion de 2 € par colis d'une valeur inférieure à 150 € ; - pérennisant l'écocontribution visible pour l'ameublement au-delà du 31 décembre 2025, afin de lutter contre la fraude à l'écocontribution sur les produits importés. |
DGGCRF Union européenne Parlement |
Dès 2025 |
Plan de contrôle de la DGCCRF Campagne de communication Mise en oeuvre de la révision du code des douanes de l'Union Article 21 quater du PJL de simplification de la vie économique |
|
4 |
Accompagner l'ameublement français et européen pour riposter à la concurrence déloyale des places de marché chinoises : - à moyen terme, en aidant le secteur de l'ameublement français à se coordonner avec ses homologues européens par des actions diplomatiques, et à démontrer l'existence d'un dumping, au besoin par un appui technique de l'administration pour le montage du dossier de plainte ; - à long terme, en modifiant le règlement dit « antidumping » pour permettre son application à une typologie de produits au-delà de l'appréciation du dumping au niveau du seul produit et faciliter la mise en place de mesures provisoires dès l'ouverture d'une enquête. |
DG Trésor, Direction générale des entreprises Union européenne |
2025-2026 |
Dossier de plainte antidumping Articles 4 et 7 du règlement (UE) n° 2016/1036 |
|
5 |
Définir un cadre post-Arenh attractif pour la compétitivité énergétique du site de production France en général, et des papeteries et usines de pâte à papier en particulier. |
EDF, DGEC, Commission de régulation de l'énergie (CRE) |
2026 |
Contrats d'allocation de production nucléaire |
|
6 |
Rétablir le taux normal de MaPrimeRénov' pour les appareils à pellets ou à bûche remplaçant du fioul, des foyers ouverts ou des appareils antérieurs à 2012 en zone rurale hors gaz. |
Parlement DHUP |
2026 |
Loi de finances Arrêté du 14 janvier 2020 |
|
AXE 2 - LIBERER L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS EN FRANCE FACE A DES DEFIS TRANSVERSAUX |
||||
|
7 |
Modifier le cadre socio-fiscal français et européen pour qu'il favorise davantage la transformation industrielle sur notre territoire, et celle du bois en particulier, en : - veillant à ne pas concentrer excessivement les exonérations de cotisations sociales au niveau du Smic, pour donner un coup de pouce aux emplois intermédiaires entre 1,2 et 1,9 Smic (1 700 à 2 700 € nets par mois), plus fréquents dans l'industrie ; - plaidant au niveau européen pour une extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) aux produits transformés et notamment au bois et aux produits bois. |
Parlement Union européenne |
À partir de 2026 |
Loi de financement de la sécurité sociale Règlement (UE) n° 2023/956 |
|
8 |
Recentrer les formations autour de la connaissance de la matière, de son travail et de ses usages, afin de faciliter le dialogue entre différents maillons de la filière et de donner plus de perspectives aux jeunes en leur ouvrant un spectre plus large d'emplois. |
France Bois Forêt, Codifab Régions |
À partir de 2026 |
Référentiels de formation |
|
9 |
Aménager le règlement de l'UE sur la déforestation importée sur quatre volets en : - procédant de façon plus objective et moins diplomatique et commerciale pour le classement des pays à risque de déforestation ou de dégradation, pour intégrer davantage d'États tiers dans la catégorie « risque élevé », sans attendre la prochaine révision annuelle du classement ; - allant au plus efficace et au plus rapide, en jouant sur l'interprétation du règlement via les orientations et foires aux questions de l'Union européenne, plutôt que de miser sur une réouverture du texte, incertaine au regard des règles de l'OMC et source d'insécurité juridique ; - donnant une définition de la « dégradation » des forêts qui exempte les forêts françaises par défaut, en tant qu'elles sont soumises à une gestion durable et multifonctionnelle ; - faisant reconnaître dans un prochain règlement omnibus une logique de proportionnalité pour les régions ultrapériphériques, dont la Guyane, recouverte à 95 % de forêt primaire, pour favoriser l'autosuffisance alimentaire de ce territoire et la structuration d'une filière bois pour des usages locaux, sans remettre en cause la crédibilité de nos engagements vis-à-vis des États tiers et notamment d'Amérique du Sud. |
Commission européenne État |
À partir de 2025 |
Règlement d'exécution Lignes directrices et foire aux questions Déclaration à la Commission européenne Règlement omnibus sur les outre-mer |
|
10 |
Appliquer un abattement à l'écocontribution sur les produits bois tel que voté dans le cadre de l'examen de la proposition de loi dite « REP bâtiment », en articulant celui institué au profit des matériaux les plus performants en termes de taux de valorisation des déchets et celui prévu pour les matériaux biosourcés renouvelables. |
DGPR |
Dès 2025 |
Arrêté |
|
11 |
Apporter des solutions aux contraintes du quotidien des entreprises de transformation du bois en réunissant régulièrement élus locaux, administrations déconcentrées et entreprises de la filière bois, pour échanger sur les écueils rencontrés dans certaines mises aux normes, dans le cadre de « rendez-vous territoriaux de la simplification », et envisager d'autres voies d'atteindre les mêmes objectifs, sous la supervision du préfet. |
Préfet, administrations déconcentrées, élus locaux, entreprises de la filière bois |
Dès 2025 |
Concertation Pouvoir de dérogation du préfet |
|
12 |
Apporter une solution aux difficultés d'assurabilité des entreprises de transformation du bois en : - développant les captives d'assurance, adaptées pour les plus grands groupes, au besoin en encourageant ces dispositifs par une défiscalisation des montants provisionnés. - s'efforçant, pour les plus petits groupes, de faire reconnaître aux assureurs, avec l'appui du médiateur des entreprises, des solutions d'effet équivalent au sprinklage, telles que les technologies de détection précoce des départs d'incendie. |
Médiateur des entreprises, entreprises de la filière bois, assureurs |
À partir de 2025 |
Concertation Éventuellement loi de finances |
|
13 |
Au regard des 3 000 emplois induits en trois ans, du fort effet de levier sur la dépense privée et du faible coût d'abattement du CO2 associé, maintenir les principaux appels à projets destinés à la filière bois (industrialisation performante des produits bois (IPPB), biomasse chaleur industrie bois (BCIB)). |
Parlement |
2026 et au-delà |
Loi de finances Nouvelles relèves des appels à projets IPPB et BCIB |
|
14 |
Si l'abondement des appels à projets bénéficiant à la filière bois venait à diminuer, mettre en place une provision pour investissement centrée sur la première et la deuxième transformation du bois, mobilisable pendant une durée de cinq ans pour des investissements respectant deux grands principes - la décarbonation et l'intégration verticale - déclinés de la façon la plus simple possible. |
Parlement |
Le cas échéant, à partir de 2026 |
Le cas échéant, loi de finances |
|
AXE 3 - GARANTIR LE « BOUCLAGE BIOMASSE » PAR PLUS DE PLANIFICATION ET DE REGULATION |
||||
|
15 |
Transposer rapidement la directive RED III et ne pas la « surtransposer », tant sur le champ des sites soumis à la cascade des usages (n'y assujettir que les sites nouveaux et les sites bénéficiant de fonds publics) et sur les critères de « durabilité » (en faisant reconnaître la gestion durable et multifonctionnelle à la française comme suffisante au regard de la définition européenne de cette notion). |
Parlement |
Second semestre 2025 |
Loi DDADUE |
|
16 |
Dans les financements par appels à projets destinés à la filière bois, se fixer pour objectif de viser un équilibre 50 % énergie - 50 % usages longs, plutôt que 70 % énergie - 30 % usages longs, afin de ne pas favoriser un usage par rapport à d'autres autres et de rétablir le signal du marché. |
Parlement SGPI Ademe |
2026 |
Loi de finances Gestion budgétaire (BCIAT, BCIB, IPPB) |
|
17 |
Objectiver les « appels d'air » sur la demande de bois énergie, grâce au rôle d'éclairage du GIS biomasse, pour ensuite mieux les maîtriser, par exemple en : - pérennisant l'outil d'aide à la décision EnR'Choix dans l'appel à projet BCIAT opéré par l'Ademe, ainsi que la logique de plafonnement de la quantité d'énergie produite par projet ; - accompagnant en douceur la fin de l'activité de la tranche biomasse de la centrale de Gardanne à horizon 8 ans, en prévoyant une relocalisation graduelle de son approvisionnement, en fondant cet approvisionnement sur la ressource disponible et non potentielle, et en préparant une prise de relais des usages par de la production de chaleur ; - n'accordant qu'une place très réduite aux carburants d'aviation durable (SAF) issus de biomasse solide et à la pyrogazéification du bois dans la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ; - envisageant seulement au cas par cas le choix de décarboner certains des 50 plus grands sites industriels par la biomasse solide. |
GIS biomasse, Ademe, délégué interministériel à l'accompagnement des territoires en transition énergétique, EDF, Fibois, DGEC, DGE |
Dès 2025 |
Études Contrats de rachat d'électricité SNBC, PPE |
|
18 |
Renforcer les cellules régionales biomasse en fiabilisant leurs données notamment par une meilleure coordination inter-régionale, et en donnant un avis conforme à ces structures, après consultation des acteurs forestiers amont et bois aval, sur les décisions du préfet relatives aux contrats d'approvisionnement des nouveaux projets bois énergie. |
DGEC |
Dès 2025 |
Instruction du 18 juillet 2024 sur les cellules régionales biomasse |
|
19 |
Ajuster l'objectif de 12 millions de m3 de prélèvement de bois supplémentaire en forêt à horizon 2030 et fixer un objectif plus pertinent de transformation de bois d'oeuvre et de bois d'industrie sur notre territoire, à des fins d'augmentation de la valeur ajoutée. |
DGPE |
Dès 2025 |
Programme national de la forêt et du bois 2026-2036 |
|
AXE 4 - ATTEINDRE NOS OBJECTIFS DE MOBILISATION ET DE VALORISATION DU BOIS |
||||
|
20 |
Poursuivre les efforts de contractualisation en forêt privée et communale et ainsi accroître la part de bois façonné bord de route, pour sécuriser la première transformation en matière d'approvisionnement. |
Propriétaires forestiers privés et communes forestières, Fransylva, FNCofor, ONF |
Dès 2025 |
Contrats d'approvisionnement |
|
21 |
Confier aux préfets de région, dans le cadre des missions inter-services de l'eau et de la nature (Misen), en lien avec l'OFB et les professionnels, la définition de cahiers des charges a priori pour sécuriser les entrepreneurs de travaux forestiers face au risque d'atteinte aux habitats d'espèces protégées et de condamnation pénale à ce titre. |
Préfet, OFB, Misen |
Dès 2025 |
Concertation, cahiers des charges |
|
22 |
Afin d'accroître la récolte de bois, traiter le morcellement de la propriété par des incitations à la gestion collective, en : - poursuivant l'instruction des plans simple de gestion entre 25 et 20 ha ; - prolongeant au-delà de 2025 le taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux sylvicoles ; - gérant davantage la forêt par massif grâce à un surcroît de coordination gestionnaires privés-ONF indépendamment du régime de propriété ; - bonifiant le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (Defi) « travaux » dans le cas d'une gestion collective (coopératives, experts...), par rapport au taux normal. |
CNPF, ONF Parlement |
2025 et au-delà |
Action administrative Loi de finances (6 septies de l'article 279 et V de l'article 200 quindecies du code général des impôts) |
|
23 |
Maintenir en 2026, comme en 2025, 130 M€ d'engagements sur les sous-actions 29.06 à 29.10 du programme 149, dédiées à la « planification écologique » en forêt (après 509 M€ en 2024), et : - sanctuariser tout du moins les lignes peu coûteuses levant des verrous de la filière (filière graines et plants, dynamisation de l'aval, appel à projets ESPR pour les entrepreneurs de travaux forestiers) ; - favoriser le recours au plan de renouvellement forestier pour les communes forestières et propriétaires forestiers privés dont les parcelles ont subi des dépérissements, par une simplification à leur égard des cahiers des charges et un accompagnement dans l'ingénierie. |
Parlement DGPE, Ademe |
2026 |
Loi de finances Cahiers des charges du plan de renouvellement forestier Accompagnement par l'Ademe |
|
24 |
Mettre en oeuvre le plan national d'actions « Scolytes et bois de crise » (aires de stockage, transport...) et investir dans la R&D pour l'amélioration de la valorisation des essences d'avenir et des essences dites « secondaires ». |
Préfet, entreprises de la filière Filière |
Dès 2025 |
Plans régionaux Mobilisation de programmes de recherche européens |
* 1 Au titre de l'article 232 du Trade Expansion Act de 1962 - base juridique contestée par l'Union européenne.
* 2 Nom traduit en français de l'album Which Direction Goes the Beam (2025, label Tough Love) du groupe de musique anglais Index for Working Musik.
* 3 En mettant de côté des marchés plus restreints en volume tels que l'ébénisterie, la lutherie, ou la chimie du bois à des fins de valorisation de la cellulose dans des produits cosmétiques, par exemple.
* 4 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.
* 5 Selon les chiffres clés des énergies renouvelables 2024, 64 % du bois énergie est consommé par le résidentiel, et le reste par la branche énergie (passée de 8 à 22 % entre 2013 et 2023), l'industrie (9 %), l'agriculture (2 %) et le tertiaire (3 %).
* 6 Il est à noter que les employés de ces branches professionnelles n'ont pu être entendus par la mission.
* 7 Règlement (UE) n° 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts.
* 8 Il s'agit de la viande bovine, du cacao, du café, du palmier à huile, du caoutchouc, du soja et du bois.
* 910 À la différence d'une ligne canter, plus industrielle et à flux continu, une ligne ruban est capable de traiter des bois de différentes essences et tailles. Cette ligne de production est cependant moins rentable. La scierie Siat d'Urmatt vient de s'équiper d'une ligne ruban qui combine cette flexibilité et une efficacité industrielle.
* 11 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (« RED II ») relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 12 Ce calcul met de côté les petits appels à projets non spécifiques à la filière bois.
* 13 Approuvé par le décret n° 2017-155 du 8 février 2017.
* 14 Ainsi, la statistique souvent évoquée du taux de prélèvement rapporté à la croissance biologique des arbres, qui est de 67 % toutes forêts en France, s'élève à 80 % en forêt domaniale.
* 15 « Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes », rapport du groupe de travail présidé par Bernard Chevassus-au-Louis, Centre d'analyse stratégique, avril 2009.
* 16 Bois A : palettes cassées non colorées, cagettes, planches de bois massif, touret, bois de calage. Bois B1 : bois faiblement traités, peints ou vernis. Bois B2 : bois non dangereux mais davantage traité que le bois B1.
* 17 Au sens de cette étude, est réputé appartenir à cette catégorie le bois sain, purgé et sans patte, d'un diamètre fin bout minimal de 30 cm sur écorce, d'un diamètre à 1,30 m minimal de 40 cm sur écorce et d'une longueur minimale de fût de 3 m.