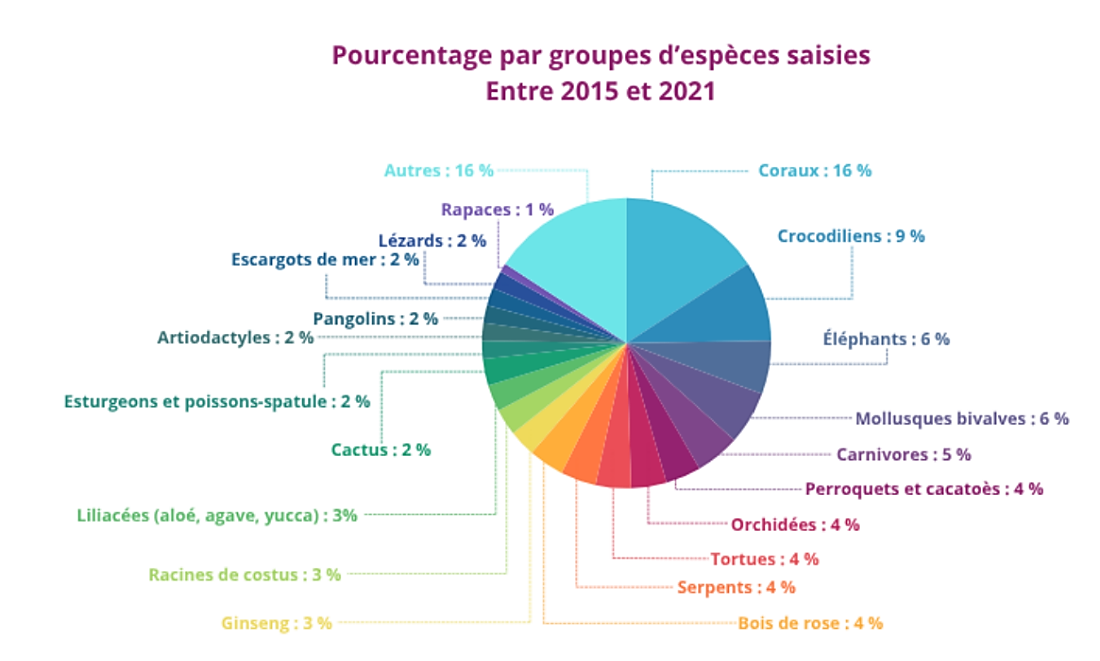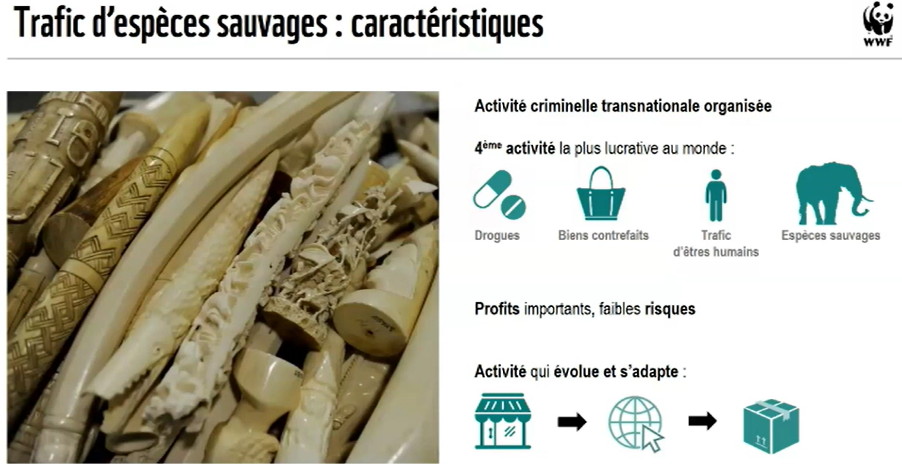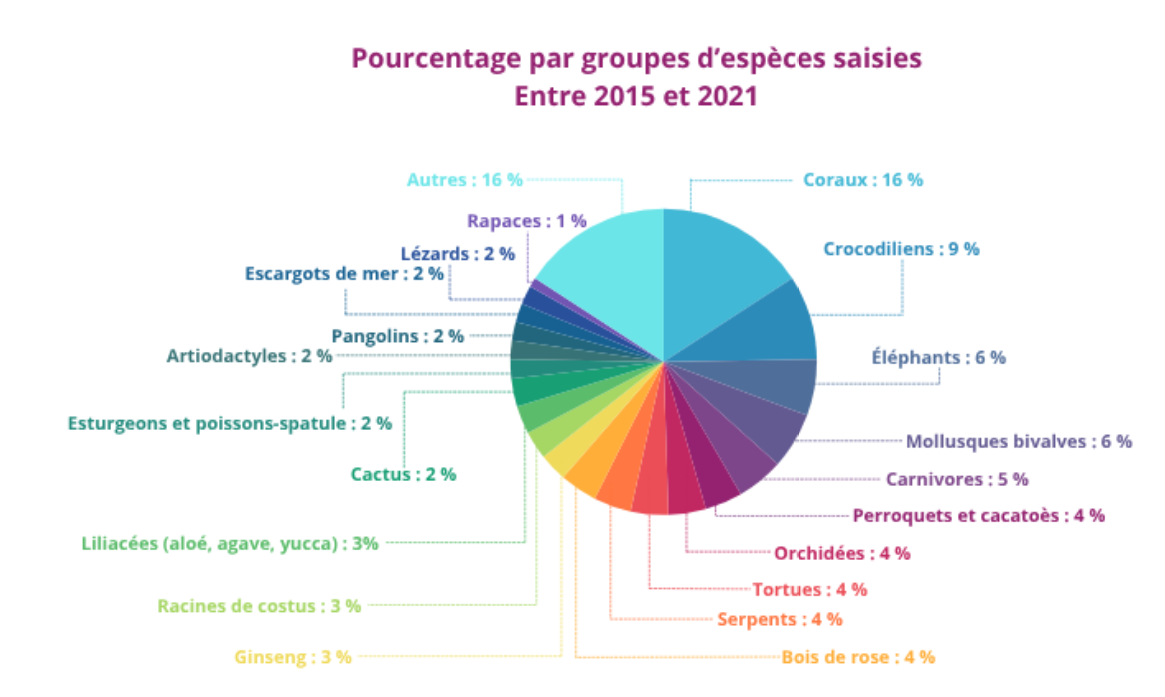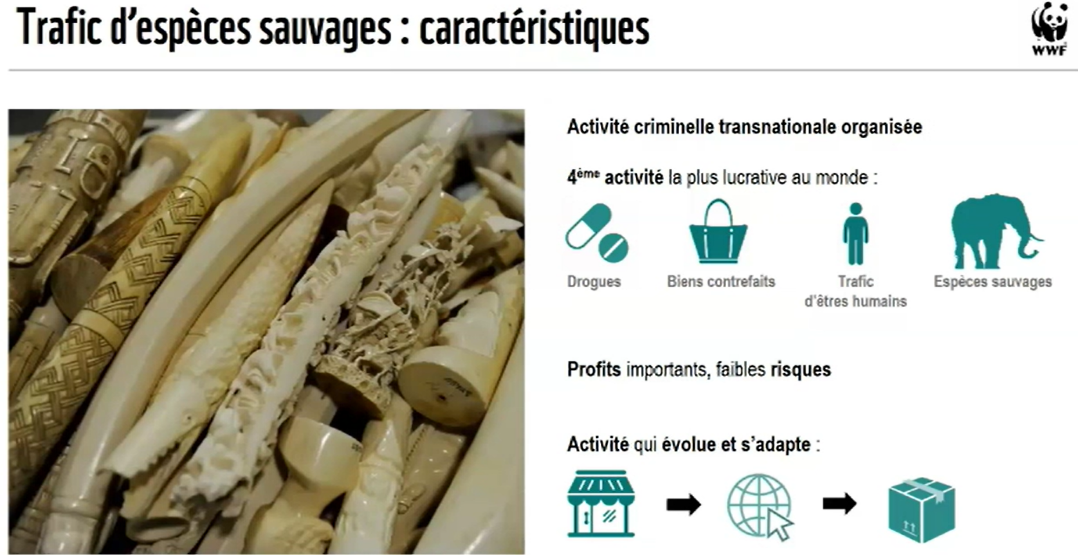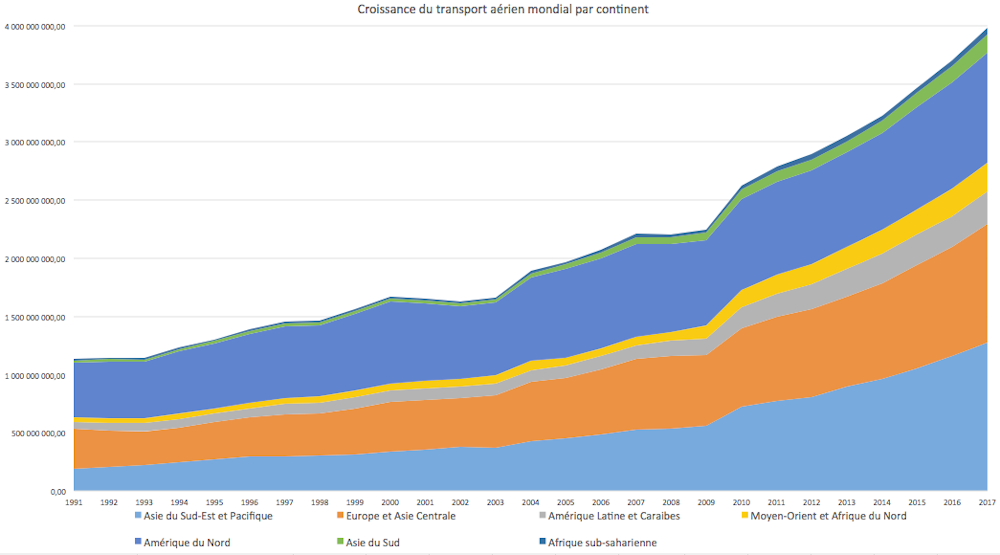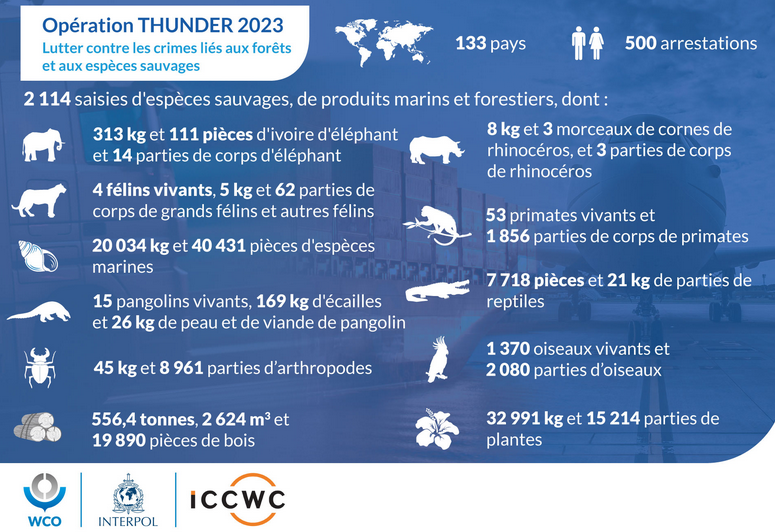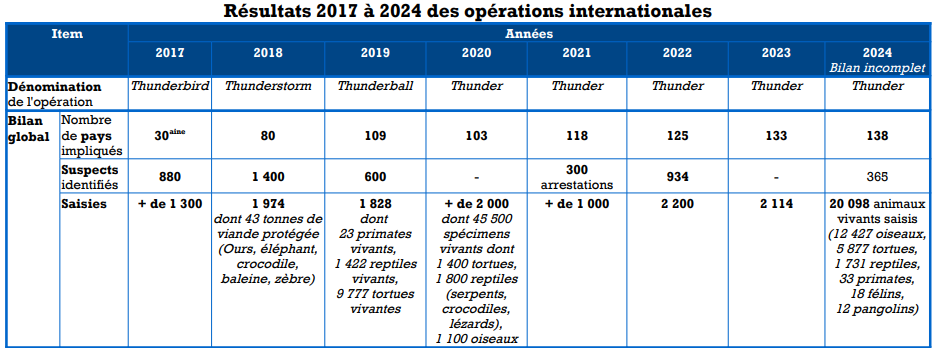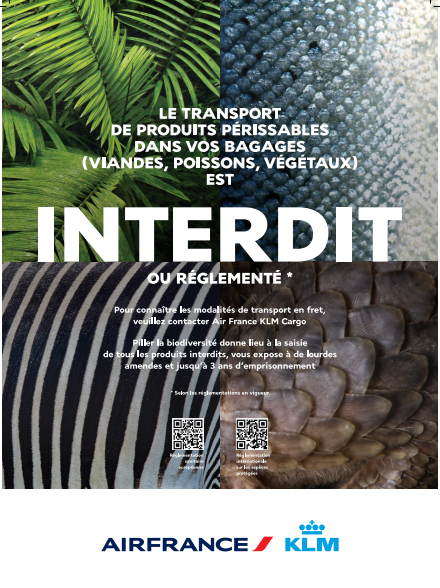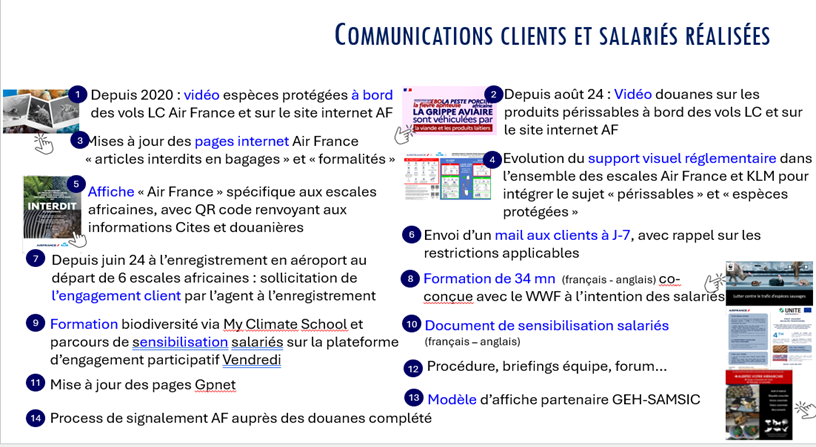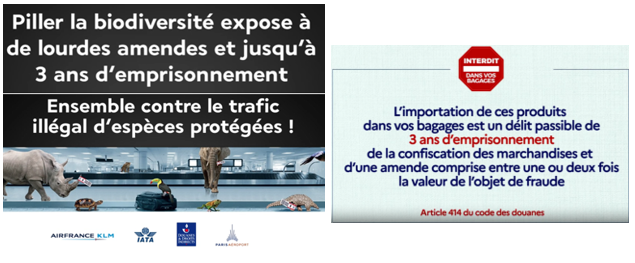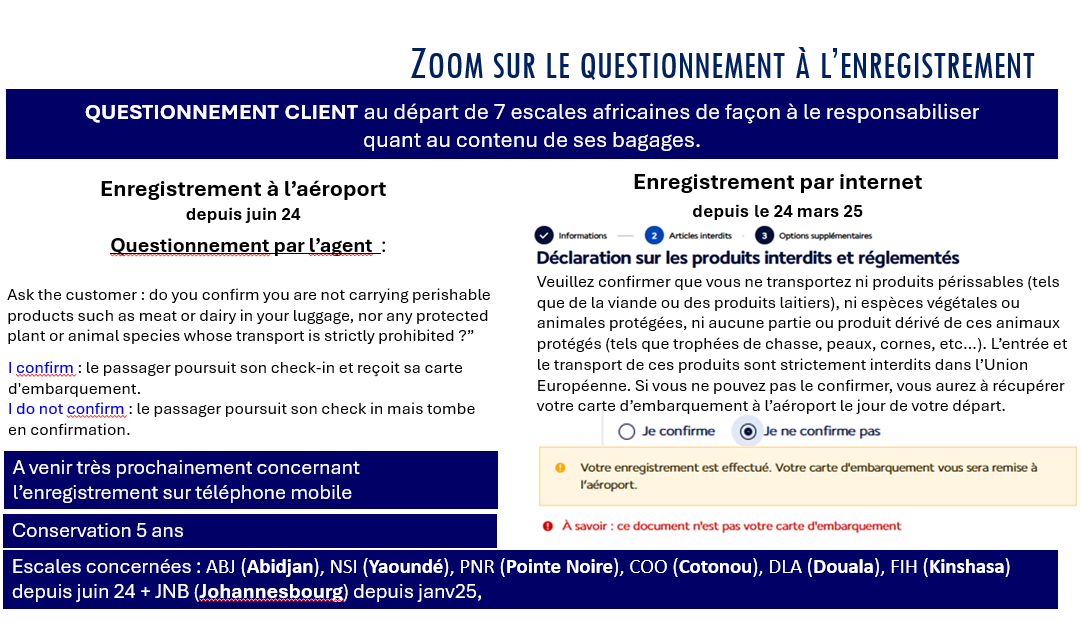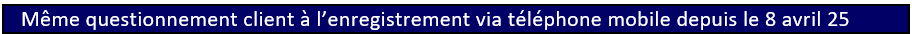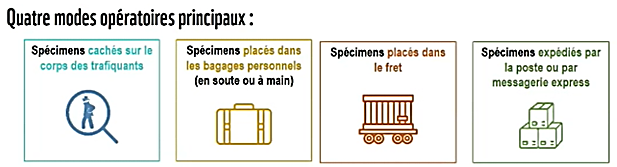- L'ESSENTIEL
- I. LE TRAFIC D'ESPÈCES SAUVAGES : DE
QUOI PARLE-T-ON
ET POURQUOI L'ACTION PUBLIQUE PEINE-T-ELLE À LE RÉPRIMER ?
- A. UN TRAFIC MONDIAL AUX RAMIFICATIONS MULTIPLES
DONT LES FLUX SIGNIFICATIFS AFFECTENT PARTICULIÈREMENT LA FRANCE
- 1. Un phénomène mondialisé et
lucratif qui affecte des milliers d'espèces et se combine à
d'autres trafics
- 2. La France, une plaque tournante du trafic
d'espèces sauvages en raison de son statut de pays de départ,
d'arrivée et de transit
- 3. Les importations illégales de viande de
brousse, des flux incessants qui congestionnent les capacités
douanières
- 1. Un phénomène mondialisé et
lucratif qui affecte des milliers d'espèces et se combine à
d'autres trafics
- B. UN TRAFIC AUX IMPACTS INSOUPÇONNÉS
ET AUX RISQUES SOUS-ESTIMÉS
- C. LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES
À LA LUTTE CONTRE CE TRAFIC
- 1. Des volumes en forte croissance alimentés
par le développement du trafic aérien et la diversification des
voies d'entrée
- 2. Des passagers mal informés qui
contribuent à la dispersion des moyens douaniers et empêchent le
ciblage efficace des trafics structurés
- 3. Une réponse judiciaire insuffisamment
réactive et agile qui explique la persistance des flux
- 4. Une criminalité transnationale complexe
à appréhender dont la lutte requiert une prise de conscience
internationale et un cadre renforcé de coopération
- 1. Des volumes en forte croissance alimentés
par le développement du trafic aérien et la diversification des
voies d'entrée
- A. UN TRAFIC MONDIAL AUX RAMIFICATIONS MULTIPLES
DONT LES FLUX SIGNIFICATIFS AFFECTENT PARTICULIÈREMENT LA FRANCE
- II. RÉDUIRE LE TRAFIC EN INVERSANT
L'APPROCHE : PASSER D'UNE LOGIQUE D'INTERCEPTION À DES ACTIONS
FONDÉES SUR LA PRÉVENTION, LA SENSIBILISATION ET LA
COOPÉRATION
- A. UN CADRE NORMATIF INSUFFISAMMENT DISSUASIF ET
AGILE
- 1. Les conventions et organisations
internationales, des outils à parfaire pour renforcer les moyens de la
lutte
- a) La Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(Cites), un outil performant pour encadrer le commerce légal mais
indigent pour lutter contre les trafics
- b) Le Règlement sanitaire international, une
approche fondée sur le risque inopérante face aux flux
illégaux d'espèces sauvages
- c) Le Consortium international de lutte contre la
criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC)
- d) L'Organisation mondiale de la santé
animale (OMSA)
- a) La Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(Cites), un outil performant pour encadrer le commerce légal mais
indigent pour lutter contre les trafics
- 2. Les textes européens et le plan d'action
de l'Union européenne contre le trafic des espèces sauvages, un
édifice non-contraignant dont les États membres doivent
s'emparer
- 1. Les conventions et organisations
internationales, des outils à parfaire pour renforcer les moyens de la
lutte
- B. UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE ET D'APPROCHE
POUR CONCENTRER LES MOYENS DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC HAUTEMENT LUCRATIF
D'ESPÈCES PROTÉGÉES
- 1. Favoriser la coordination internationale,
échelon pertinent en amont de la lutte contre la criminalité
environnementale et la détection précoce des crises
sanitaires
- 2. Renforcer la coopération inter-services
et les moyens de la lutte tout en forgeant une réponse douanière
plus agile et réactive
- 3. Investir dans des capacités de
détection renforcées
- 4. Mettre fin à la méconnaissance
réglementaire des voyageurs et renforcer l'effectivité des
sanctions qui répriment les trafics
- 5. Accompagner la prise de conscience du secteur
des transports pour réduire les franchissements de
frontière
- 6. La lutte numérique et postale, des pans
de l'action publique à ne pas négliger
- 1. Favoriser la coordination internationale,
échelon pertinent en amont de la lutte contre la criminalité
environnementale et la détection précoce des crises
sanitaires
- A. UN CADRE NORMATIF INSUFFISAMMENT DISSUASIF ET
AGILE
- I. LE TRAFIC D'ESPÈCES SAUVAGES : DE
QUOI PARLE-T-ON
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- TRAVAUX EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- DÉPLACEMENT À
L'AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
N° 903
SÉNAT
2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur les moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic des espèces protégées,
Par M. Guillaume CHEVROLLIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.
L'ESSENTIEL
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité, le 24 septembre 2025, le rapport d'information de Guillaume Chevrollier relatif aux moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et protégées.
À la veille de la COP20 Cites, forte du constat que ce sujet était aussi préoccupant qu'absent du débat public, la commission a voulu mettre en lumière les enjeux et les risques que fait peser la croissance continue du trafic d'espèces sauvages et protégées. En dépit des instruments de droit international et de la forte mobilisation douanière, cette criminalité conjuguant profits élevés et risques plus faibles que d'autres activités illicites prospère. Nous avons jusqu'à présent échoué à endiguer les flux que ce trafic charrie et à trouver les réponses adéquates pour réagir face à ce phénomène multifactoriel, tentaculaire, adaptatif et transnational. Réussir ce défi permettra de concentrer les moyens douaniers sur la lutte contre le narcotrafic.
Ce commerce illicite est porteur d'enjeux insoupçonnés : risques sanitaires majeurs pour la santé humaine et animale, contribution à l'érosion de la biodiversité, financement de réseaux criminels, perturbations écosystémiques menaçant les ressources vivrières des communautés locales... En raison de sa forte connectivité avec le reste du monde et des flux massifs de voyageurs arrivant sur son territoire, la France est particulièrement exposée aux risques que fait peser ce trafic. Les volumes d'animaux vivants et de produits carnés importés sont significatifs au point que la lutte contre le trafic d'espèces sauvages est devenue une course contre la montre pour éviter qu'un risque de zoonose ou d'épizootie survienne. Nous ne pouvons plus faire l'économie d'une stratégie plus efficace, plus ferme et mieux concertée pour y faire face.
La logique d'interception douanière qui a longtemps prévalu est désormais à bout de souffle : nous devons changer de dimension et activer sans tarder des solutions fondées sur la prévention, la sensibilisation et la coopération internationale pour tarir les flux, à tous les stades amont de l'arrivée sur le territoire. Ce changement de doctrine exigera une adaptabilité constante de notre réponse aux menaces identifiées, une coordination sans faille des forces de l'ordre et un investissement dans des solutions techniques d'aide à la détection des produits illicites.
La commission estime qu'il découle de notre devoir de vigilance face aux menaces sanitaires d'oeuvrer par tous les moyens dont dispose la puissance publique à la réduction drastique de l'ampleur du phénomène. Pour ce faire, elle a adopté 18 recommandations visant à orienter les acteurs de la lutte contre ce trafic et refondre en profondeur une action publique lacunaire, qui intervient trop tard, de manière trop peu dissuasive et insuffisamment coordonnée.
Contrôle douanier d'une valise à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
I. UN TRAFIC MONDIALISÉ EN EXPANSION, PORTEUR DE MENACES QUE LES AUTORITÉS NE PARVIENNENT PAS À ENDIGUER
A. UN PHÉNOMÈNE GLOBAL QUI AFFECTE DES MILLIERS D'ESPÈCES
Le caractère massif du trafic mondial s'illustre notamment par le fait qu'il concerne plus de 160 pays et affecte au moins 4 000 espèces animales et végétales, dont 3 250 listées en annexe de la Convention sur le commerce international des espèces menacées (Cites).
Pourcentage par groupes d'espèces saisies
entre 2015 et 2021
Source : Office des Nations unies contre la drogue et le crime
Entre 2015 et 2021, plus de 13 millions de saisies ont été recensées à l'échelle internationale, pour un volume estimé supérieur à 16 000 tonnes. Ces estimations ne représentent qu'une infime proportion des flux générés par ce trafic. Son illégalité contribue en grande partie à invisibiliser les volumes réels. L'action publique se fonde sur des estimations extrapolées à partir des saisies réalisées par les autorités nationales.
Le commerce illicite d'espèces sauvages génère au niveau mondial des flux financiers colossaux, à hauteur de 20 milliards de dollars américains par an, soit a minima le double en valeur du commerce légal.
En raison de sa position géographique favorisée, de la richesse de sa biodiversité ultramarine, de son attractivité commerciale et touristique, mais également de son insertion dans la mondialisation en tant que puissance commerciale et touristique, la France constitue un carrefour de premier plan pour le trafic d'espèces protégées, favorisé par les capacités de ses hubs maritimes et aéroportuaires.
En 2024, 560 constatations relatives à la Cites ont été réalisées par les services des douanes, en hausse de 4 % par rapport à 2023 : à cette occasion, plus de 98 000 spécimens ont été saisis, dont 3 508 spécimens d'origine animale. Outre les végétaux, les spécimens les plus saisis sont des coraux et coquillages : la faune marine représente la majorité des contentieux Cites, suivie des animaux vivants, principalement des oiseaux et des reptiles.
Un autre type de trafic affecte particulièrement la France par son ampleur et les flux qu'il génère, celui de la « viande de brousse », qui désigne la viande d'animaux sauvages en provenance d'Afrique et recouvre une grande variété d'espèces issues de la chasse non durable : singes, pangolins, porcs-épics, rongeurs, chauves-souris, antilopes, serpents...
Chaque année depuis 2018, les services douaniers constatent en moyenne 2 500 infractions et saisissent 22 tonnes de viandes domestiques ou sauvages, principalement dans les aéroports. Les résultats préliminaires d'une étude scientifique réalisée en partenariat avec la douane tendent à montrer que le volume de viande d'espèces sauvages transitant par Paris-CDG a augmenté de 74 % entre 2009 et 2024, avec un volume annuel estimé à 475,5 tonnes, soit plus de 9 tonnes par semaine. Ces résultats suggèrent que nous faisons face à un trafic non jugulé avec seulement 0,6 % de la viande de brousse transitant par Paris-CDG qui serait saisie...
B. UN TRAFIC AUX IMPACTS INSOUPÇONNÉS ET AUX RISQUES SOUS-ESTIMÉS
Le trafic illégal d'animaux vivants et de produits carnés, en raison de la circulation rapide de substances issues du vivant qu'il facilite en dehors de tout cadre sanitaire, engendre des risques majeurs et sous-estimés pour la santé, l'environnement et l'économie.
1. Une menace insuffisamment perçue pour la santé humaine et animale
Sur le plan sanitaire, les produits circulant dans le cadre de ce trafic échappent à toute chaîne de contrôle vétérinaire ou de quarantaine, augmentant ainsi le risque d'introduction d'espèces vectrices de maladies zoonotiques ou épizootiques sur le territoire national.
On estime que 60 % des maladies infectieuses affectant l'humain sont d'origine animale, et 70 % des maladies émergentes sont issues de la faune sauvage, dont certaines pouvant aboutir à une pandémie ou du moins des impacts sanitaires et économiques très graves pour les sociétés concernées. Les émergences du syndrome respiratoire aigu sévère de type 1 et 2 (SARS-CoV-1 et 2), du virus de l'immunodéficience humaine (HIV), d'Ebola ou de la variole du singe (Monkeypox) sont toutes liées à la consommation de viande de brousse...
Ce trafic est en mesure d'avoir un fort impact sur la santé publique, avec des agents pathogènes issus de la faune sauvage qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme et l'animal, avec des taux de morbidité et de mortalité élevés, tout en présentant un risque d'entrave au commerce et aux voyages internationaux.
« L'histoire nous enseigne que la question n'est pas de savoir si une prochaine pandémie surviendra, mais quand. » Tedros Adhanom Ghebreyesus, DG de l'OMS
2. Une source de pression majeure pour la biodiversité
Le commerce illégal d'espèces protégées et de viande de brousse est également porteur de menaces sur la biodiversité, à la fois dans les pays d'origine, mais également dans ceux de destination. L'IPBES1(*) a établi que le trafic d'espèces sauvages et de produits de la pêche illégale constitue l'une des principales menaces pour la biodiversité : les prélèvements non durables contribuent à accroître le risque d'extinction de 28 % des espèces menacées ou quasi menacées.
Ce trafic est susceptible de neutraliser les efforts de conservation de la nature, d'affecter les ressources vivrières des communautés locales, d'endommager les équilibres écosystémiques en cas de prélèvements trop abondants d'espèces et de limiter l'efficacité des politiques de préservation de l'environnement mises en oeuvre par les États. La disparition d'espèces clés bouleverse les chaînes alimentaires, la régénération des forêts et d'autres services écosystémiques vitaux. Il peut s'ensuivre une perte de résilience, pouvant entraîner des cascades d'extinctions, la perturbation des services écosystémiques, telles que la pollinisation ou la régulation des parasites et favoriser l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans les pays de destination.
3. Un trafic potentiellement à l'origine de troubles à l'ordre public
Ce trafic constitue par ailleurs une source de violences : chaque année, de nombreux décès de gardes forestiers sont à déplorer. Le caractère très lucratif de ce commerce illégal conduit les trafiquants à opérer en bande armée en prenant des risques importants. Au surplus, le trafic d'espèces sauvages peut constituer une menace pour la sécurité nationale, certains réseaux criminels se livrant également au blanchiment d'argent, au trafic d'armes et au financement du terrorisme.
C. UN ÉCHEC PERSISTANT À JUGULER LES FLUX DU TRAFIC
Le trafic trouve son premier moteur dans la croissance du transport aérien de voyageurs, qui alimente une augmentation arithmétique des flux illicites transportés. Le volume colossal de passagers et de fret transitant par les points d'entrée aéroportuaires, combiné à la nécessité de garantir un flux rapide pour éviter les retards, rend ainsi inenvisageable un contrôle systématique et approfondi. Ce facteur explique la porosité du passage en frontière, en dépit de la mobilisation à saluer des douaniers.
La mésinformation des voyageurs participe à notre échec de réduction des flux du trafic : la connaissance des interdictions n'est pas ancrée dans l'esprit des passagers. L'information relative à l'interdiction d'entrée de produits carnés et d'animaux protégés sur le territoire français est trop discrète, trop tardive et trop technique.
Elle n'enclenche pas de prise de conscience chez les voyageurs concernés. Un trop grand nombre de passagers font état de leur ignorance et de leur bonne foi quand les douaniers contrôlent leurs bagages avec d'importantes quantités de produits carnés, avec un régime de sanctions qui n'est pas compris ni légitime aux yeux des mis en cause.
Un autre facteur expliquant les difficultés persistantes de la France à enrayer ce trafic tient à la difficulté, pour les autorités douanières et la justice, de mettre en oeuvre une réponse pénale réactive, dissuasive et proportionnée à la gravité des menaces sanitaires. De plus, l'éparpillement des moyens de la lutte et l'implication d'un grand nombre de ministères contribuent à une coordination lacunaire et à la dispersion des responsabilités.
En outre, la forte croissance du nombre de voyageurs ne permet pas d'apporter une réponse répressive systématique à tous les faits, tous les passagers ne pouvant être contrôlés, ce qui amoindrit l'efficacité des réponses douanières et pénales puisque les auteurs peuvent compter sur cet aléa. Ce décalage entre la gravité des faits et la réponse judiciaire affaiblit considérablement l'effet dissuasif du droit et contribue à l'invisibilité du problème dans l'opinion publique.
La dernière difficulté sur laquelle achoppent les autorités françaises pour lutter efficacement contre le trafic d'espèces protégées tient à l'organisation et à la structuration des réseaux criminels transnationaux qui se livrent à cette activité criminelle : les modes opératoires agiles s'enchevêtrent avec d'autres trafics et mobilisent des moyens humains significatifs, des « mules » aux têtes de réseau.
Les volumes importants des marchandises issues de ce commerce et les ressources limitées, notamment le manque de main-d'oeuvre, de technologies avancées et de capacités médico-légales, entravent les efforts de répression. De plus, la corruption et la faiblesse des cadres juridiques des pays sources permettent aux trafiquants d'exploiter les failles, d'échapper aux poursuites et d'utiliser les capacités de transports publics de voyageurs. On assiste à un glissement progressif d'un marché de niche vers un phénomène criminel plus diffus et mondialisé, difficile à endiguer à moyens douaniers et judiciaires constants.
II. ENRAYER LE TRAFIC EN AGISSANT À TOUTES LES ÉTAPES DE LA CHAÎNE VOYAGEUR ET EN SORTANT DU « TOUT INTERCEPTION » QUI CONDUIT À UNE IMPASSE
Le trafic d'espèces protégées et de produits carnés illégaux est une bombe à retardement non seulement pour la biodiversité et l'économie légale, mais aussi et surtout pour la santé publique et la sécurité sanitaire mondiale : la réduction drastique de ces importations illégales n'est rien d'autre que l'accomplissement du devoir de protéger la santé publique et l'agriculture par d'autres moyens.
A. FAVORISER L'ACTION HORS DES FRONTIÈRES POUR TARIR LES FLUX À LA SOURCE
Se cantonner à des approches visant à intercepter les trafiquants à l'arrivée sur le territoire est une solution de court terme. Il serait préférable de rechercher les mesures transformatrices à la source du trafic, à travers la coopération internationale et diplomatique, pour éviter que ces produits ne soient dirigés vers la France. En outre, les trafiquants opèrent désormais à l'échelle mondiale, en exploitant les failles des législations nationales et les lacunes des contrôles aux frontières : il est donc vain de miser sur les réponses isolées, qui sont inefficaces.
Pour cette raison, un renfort de la coopération avec les pays d'origine du trafic constitue un indispensable préalable, tant sur le plan du contrôle avant embarquement que des moyens répressifs employés contre les réseaux criminels. La décrue des flux générés par le trafic suppose une collaboration efficace et des efforts collectifs à l'échelle de tous les États de l'aire de répartition, de transit et de destination des espèces, ainsi qu'à travers toute la chaîne de lutte contre la fraude.
En complément, il serait judicieux de soutenir, dans le cadre de l'aide publique au développement, les projets de renforcement des capacités douanières, techniques et financières des pays d'origine pour lutter à la source contre ces trafics.
B. RENFORCER LA COORDINATION DES ACTEURS DE LA LUTTE
La lutte contre le trafic d'espèces sauvages est une course contre la montre : elle exige une adaptabilité constante et une coordination sans faille des forces de l'ordre. Les difficultés ne tiennent pas à notre arsenal législatif et répressif, qui permet de sanctionner les trafiquants, mais découlent de la manière dont il est appliqué par des services douaniers embolisés par le flux des voyageurs et des marchandises, ainsi que par des juridictions engorgées, qui doivent par ailleurs répondre à des priorités pénales toujours plus nombreuses qui leur sont assignées.
La réponse, douanière comme judiciaire, demeure souvent symbolique, avec des amendes faibles, des peines rarement exécutées et une absence fréquente de confiscation : cette impunité de fait favorise la récidive et la banalisation du trafic.
Pour cette raison, les évolutions les plus transformatrices dans la lutte contre ce trafic ne seront pas de nature législative ni judiciaire, mais sont plutôt à chercher du côté du renforcement des moyens douaniers et de la coopération inter-services. Pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale, l'approche interministérielle et multidisciplinaire est indispensable, à travers la coordination des services de police et de gendarmerie, des juridictions spécialisées et de la société civile.
La transaction douanière constitue à cet égard un outil à systématiser, permettant le prononcé d'une sanction immédiate, facilitant une réponse rapide, proportionnée aux faits et dissuasive, présentant en outre l'avantage de préserver les ressources judiciaires.
C. INVESTIR DANS DES CAPACITÉS DE DÉTECTION DE POINTE
Au-delà du renforcement de la présence douanière pour répondre aux enjeux d'un trafic dont l'ampleur ne cesse de croître, il est fondamental de renforcer les investissements en matière de recherche, de détection et d'analyse des produits et substances illicites.
Il faut rendre le risque de se faire prendre si élevé que le trafic d'espèces sauvages deviendra moins attractif et moins profitable pour les criminels. Le facteur de dissuasion le plus efficace pour les trafiquants reste l'augmentation de la probabilité de la détection et de la saisie des marchandises. Le renforcement des moyens techniques à la disposition des douaniers répond à une logique d'efficacité et d'efficience.
Les investissements technologiques, aussi bien en matériel de détection qu'en outils informatiques d'analyse, notamment grâce à l'intelligence artificielle, permettront une détection plus rapide, plus précise et plus fiable que les résultats actuellement obtenus. Le recours aux brigades cynophiles permettra également des gains d'efficacité douanière, tout en rendant le contrôle perceptible par les voyageurs.
D. EN FINIR DÉFINITIVEMENT AVEC LA MÉCONNAISSANCE RÉGLEMENTAIRE
Il existe une profonde méconnaissance réglementaire de la plupart des passagers quant aux prohibitions de transport et d'importation de produits carnés et d'espèces protégées, qui suscite le désarroi des douaniers face au grand nombre de contrevenants d'ignorance. La commission fait le constat d'une défaillance informative majeure.
Il est nécessaire d'oeuvrer à une information renforcée et lisible, à tous les stades du parcours voyageur, dès l'achat du billet. Pour être identifiée, comprise et retenue par les voyageurs, il est nécessaire que cette information soit visuelle, multilingue, omniprésente et répétée, de l'achat du billet jusqu'au passage en douane. La commission préconise une véritable stratégie de martèlement de la réglementation en matière d'espèces protégées, afin de graver dans l'esprit des voyageurs la règle « pas de viandes, ni de produits animaux bruts », de la même manière que « pas d'armes et pas de drogues ».
L'intensification de la communication auprès des passagers est indispensable, mais ne permettra pas à elle seule de toucher l'ensemble des voyageurs. La commission propose de réfléchir à l'opportunité d'instaurer une auto-déclaration douanière obligatoire et simplifiée à remettre à l'arrivée, engageant juridiquement la responsabilité du signataire, qui permettrait à la fois d'informer, de responsabiliser et de sanctionner rapidement les contrevenants.
Les passagers devront aussi avoir la possibilité, au niveau de la zone de récupération des bagages, de jeter leur marchandise avant les contrôles douaniers, dans des poubelles pour déchets représentant un risque biologique, afin d'inciter au « dessaisissement volontaire » sans sanction.
De même, il est nécessaire de renforcer l'effectivité des sanctions, pour renforcer le caractère dissuasif de notre arsenal législatif. La commission estime que l'approche sanitaire constituerait la bonne qualification des infractions, dans le cadre d'une analyse fondée sur le risque, qui aurait le mérite de renforcer la cohérence de notre édifice normatif et d'unifier la réponse afin de tarir les flux de ce trafic, sans avoir à connaître précisément l'origine et la nature des marchandises interceptées.
E. IMPLIQUER LE SECTEUR DU TRANSPORT DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC
Les acteurs du transport, notamment aéroportuaires et maritimes, ont un rôle majeur à jouer vis-à-vis des passagers et des marchandises qu'ils acheminent, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés. Leur sensibilisation et leur mobilisation sont essentielles pour réduire les flux générés et les risques associés.
La commission préconise d'inciter les compagnies à faire preuve de vigilance par rapport aux espèces protégées, à travers une formation accrue de leur personnel, des mesures pour prévenir les trafics et des procédures spécifiques en cas de découverte de trafic par leurs services. L'idée serait de les engager à davantage informer les voyageurs et à mettre en place des mesures préventives.
Plutôt qu'instaurer des contraintes nouvelles dans le contexte fortement concurrentiel du transport aérien, qui pénaliseraient les acteurs nationaux sans parvenir à résoudre le problème à la bonne échelle, la commission plaide pour la création d'un label ou d'une certification pour les compagnies aériennes qui adoptent de bonnes pratiques pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, y compris des politiques de bagages spécifiques, leur offrant un avantage en termes d'image et d'attractivité pour les passagers soucieux de l'environnement.
F. ACTIVER DES MOYENS DE LUTTE NUMÉRIQUE ET POSTALE
Dans la mesure où le commerce illégal d'espèces sauvages et protégées prospère également par l'intermédiaire des colis postaux et de la vente en ligne, l'action publique doit investir ces champs d'action. Les réseaux criminels utilisent de plus en plus les plateformes numériques d'e-commerce et les réseaux sociaux, le fret postal pour les animaux de petite taille, les produits secs ou sous vide. C'est aujourd'hui un angle mort de notre action, faute de moyens humains et de technologies de détection adéquates.
Il faut sans plus tarder passer à une logique « tous flux » en investissant dans le développement de techniques automatisées d'analyse non invasive de colis postaux et de fret express, dont le volume colossal et exponentiel rend la détection de produits carnés ou de jeunes animaux particulièrement complexe. Ceci implique également de responsabiliser les acteurs de la chaîne postale et de la livraison express, par exemple à travers des obligations de vigilance et de déclaration renforcées.
Pour contrer la progression de vente et l'achat d'animaux ou de produits illégaux via des plateformes en ligne, des groupes privés sur les réseaux sociaux, des forums spécialisés et des applications de messagerie cryptées, il serait opportun de développer des outils automatisés pour identifier et bloquer les contenus liés au trafic, mais également de proposer des canaux de signalement faciles aux utilisateurs et d'accroître la responsabilisation des plateformes d'e-commerce, les places de marché en ligne et les réseaux sociaux afin qu'ils surveillent, signalent et suppriment les annonces de vente d'espèces ou de produits illégaux.
Source : Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Les principales recommandations : changer
d'échelle
face aux enjeux de la lutte contre le trafic
d'espèces sauvages et protégées
Passer d'une logique d'interception à des approches fondées sur la prévention, la sensibilisation et la coopération
Miser sur la coopération diplomatique avec les pays sources du trafic pour tarir les flux en provenance de destinations sensibles et favoriser l'échange de renseignements en matière d'activités criminelles transnationales
Renforcer les capacités d'enquête et de répression dans les pays sources du trafic à travers la formation, le soutien en équipement et le partage d'expertise
Faire en sorte que la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale élève la mise en oeuvre de procédures pour combattre le trafic d'espèces sauvages au niveau de « norme » et non de simple « recommandation » et promouvoir l'engagement et la redevabilité des acteurs du transport pour prévenir, détecter et bloquer les activités illégales
Instaurer l'obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de signaler toute suspicion de commerce en ligne d'espèces protégées et instaurer des modalités de suivi, de saisie et de sanction agiles pour s'adapter à la malléabilité de ces modes opératoires numériques
Forger des outils réactifs et dissuasifs pour tarir les importations de produits carnés
Renforcer les moyens douaniers et les outils de ciblage consacrés aux contrôles, afin d'améliorer la répression des trafics et réduire le risque pour la santé humaine et animale que fait peser l'entrée incessante de ces produits carnés hors de tout protocole sanitaire
Recourir plus systématiquement aux transactions douanières au montant dissuasif prononcées et perçues directement par les douaniers au moment des constatations, afin de rompre avec l'idée d'un trafic à forte profitabilité et à faible risque de condamnation
Interdire l'importation de toute espèce animale et de produit carné par des particuliers sur le territoire européen, combiné à un régime déclaratif sur l'honneur relatif au non-transport de produits prohibés, avant l'entrée sur le territoire
Envisager la possibilité de retirer le visa de court séjour en cas de constatations répétées de transport de produits carnés afin de mettre un coup d'arrêt au trafic dit « de subsistance », voire une interdiction du territoire français pour les ressortissants étrangers
I. LE TRAFIC D'ESPÈCES SAUVAGES : DE QUOI
PARLE-T-ON
ET POURQUOI L'ACTION PUBLIQUE PEINE-T-ELLE À LE
RÉPRIMER ?
Aborder un phénomène aussi multifactoriel, tentaculaire, adaptatif et transnational que le trafic d'espèces protégées et sauvages implique modestie et humilité, d'autant plus que les recommandations émanant d'une assemblée parlementaire sont nécessairement contraintes dans l'espace, alors que les leviers réellement transformateurs sont plutôt à chercher au niveau européen et multilatéral, grâce à des mécanismes de droit international, de coopération renforcée et de partage de renseignements.
Ce trafic englobe une extrême diversité de formes et d'enjeux : à la fois les produits d'origine animale, tels que les animaux vivants, leurs sous-produits avec l'ivoire ou la viande de brousse, et les produits végétaux, comme le bois précieux et des plantes dont la rareté, la floraison ou des (supposées) vertus médicinales alimentent une forte demande. Le phénomène concerne un grand nombre d'espèces prélevées dans leur milieu naturel par le braconnage, la pêche illégale ou la coupe illégale de végétaux, ainsi que des animaux élevés en captivité. Il présente également une double facette concernant les espèces animales, avec d'un côté le trafic organisé d'espèces protégées et de l'autre le trafic de produits carnés de viande sauvage destinée à la consommation, la « viande de brousse », qui répond à de toutes autres problématiques.
De nombreux moteurs alimentent l'offre et la demande de ces produits, dont le commerce illicite est extrêmement lucratif : ce que nous savons des déterminants et des flux réels de ce trafic ne constitue qu'une infime partie de ce qu'il faudrait connaître pour renforcer le caractère dissuasif de la réglementation et l'efficacité de l'action publique. À ce titre, l'iceberg constitue une métaphore opportune pour illustrer les difficultés à appréhender ce trafic, qu'il s'agisse de son ampleur, de ses effets ou des flux financiers qu'il génère.
En dépit du caractère lacunaire des connaissances, il existe néanmoins suffisamment de données, d'indices et d'études permettant de conclure à la saillance et à la nécessité de répondre aux enjeux sanitaires, économiques et environnementaux, au niveau mondial comme à l'échelle nationale. La lutte contre le trafic d'espèces sauvages est une course contre la montre, qui exige une adaptabilité constante, une coordination sans faille des forces de l'ordre et un investissement durable dans des solutions techniques innovantes et collaboratives. Pour réprimer ce trafic et les criminels qui l'animent, les travaux de la mission d'information ont fait apparaître la nécessité de multiplier les approches, les politiques et les programmes d'actions, tout en renforçant et coordonnant mieux les interventions publiques.
Les connaissances relatives à ce trafic, ou plus exactement à ces trafics car les marchés où s'écoulent les produits de cette activité criminelle sont multiples et segmentés, suggèrent que la France, en particulier Paris et sa région, est devenue un point d'entrée majeur. Ce constat oblige notre pays, notamment auprès de ses partenaires européens, à s'emparer des enjeux posés par ce trafic et à élaborer des solutions pour y remédier. Cette situation s'explique notamment par le nombre et la régularité de ses connexions aériennes directes avec les régions pourvoyeuses du trafic, l'Afrique centrale et de l'Ouest, et son interconnexion avec l'ensemble du marché européen.
D'autres voies d'entrée existent, telles que les liaisons maritimes et postales, mais dans la mesure où les saisies sont majoritairement réalisées au sein des zones aéroportuaires, où les contrôles sont plus systématiques, il s'agit du trafic le mieux connu et documenté. Ainsi, le rapport se concentrera prioritairement sur les trafics transitant par la voie aérienne, sans négliger pour autant les autres voies de communication, même si elles sont moins connues, avec de nombreuses inconnues sur le volume et les modes opératoires, notamment le trafic maritime, très mal analysé au regard des problématiques qui nous occupent ici, alors qu'il engendre des flux certainement très significatifs.
A. UN TRAFIC MONDIAL AUX RAMIFICATIONS MULTIPLES DONT LES FLUX SIGNIFICATIFS AFFECTENT PARTICULIÈREMENT LA FRANCE
1. Un phénomène mondialisé et lucratif qui affecte des milliers d'espèces et se combine à d'autres trafics
Depuis 2016, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) publie tous les quatre ans le World Wildlife Crime Report, le rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages2(*). Ce document, fruit de la collaboration de plus d'une cinquantaine de scientifiques et d'experts, constitue sans nul doute le meilleur point d'entrée pour cerner et approfondir le sujet qui nous occupe. Il vise à dégager les principales tendances en matière de commerce illicite d'espèces sauvages, à en analyser les impacts pour les communautés locales et les dommages pour les écosystèmes, à en comprendre les causes et les déterminants mais également à fournir des pistes de réflexion pour juguler un trafic qui affecte des milliers d'espèces animales et végétales dans plus de 160 pays.
La troisième édition du rapport, qui date de mai 2024 et repose sur des données issues des registres nationaux de saisies et d'arrestations de 2015 à 20213(*), fait état de progrès localisés, avec une réduction sensible des impacts pour certaines espèces iconiques, dont les éléphants et les rhinocéros, mais dépeint un trafic aux effets et aux impacts dévastateurs qui ne montre aucun signe de ralentissement à l'échelle mondiale.
Le caractère massif du trafic mondial s'illustre notamment par le fait qu'il affecte plus de 4 000 espèces animales et végétales, dont 3 250 listées en annexe de la Convention sur le commerce international des espèces menacées (Cites). Entre 2015 et 2021, plus de 13 millions de saisies ont été recensées, pour un volume estimé supérieur à 16 000 tonnes.
Les saisies ne font cependant qu'offrir un instantané de la présence de certains produits issus de la faune à un moment donné de la « chaîne commerciale » et ne représentent qu'une infime proportion de l'ensemble des flux générés par ce trafic. Il faut bien avoir à l'esprit que son illégalité contribue en grande partie à invisibiliser les volumes réels, qui font l'objet d'estimations à partir d'extrapolation des saisies réalisées par les autorités nationales.
Source : Office des Nations unies contre la drogue et le crime
Conséquence de l'invisibilisation des flux, l'estimation des transactions financières générées par ce trafic est particulièrement malaisée. Outre le fait qu'une partie très significative du commerce illégal échappe aux saisies4(*), la valeur de la contrebande dépend fortement de l'endroit où elle est interceptée, notamment de sa proximité au marché final, là où la valeur est la plus élevée. La « valeur ajoutée » créée par un trafiquant réside en effet dans sa capacité à faire passer le produit au-delà des barrières, légales et physiques, mises en place par les autorités et les forces de l'ordre, depuis le lieu de prélèvement jusqu'au marché de destination. Selon le pays où elle a lieu, la valeur de la saisie peut ainsi fortement varier, rendant inévitable la détermination d'une fourchette nécessairement imprécise.
En 2016, il était estimé que le commerce illicite d'espèces sauvages générait des flux financiers à hauteur de 7 à 23 milliards de dollars américains par an5(*), le consensus s'établissant actuellement à environ 20 milliards par an. À titre de comparaison, le commerce légal des espèces inscrites à la Cites produisait sur la même période une valeur annuelle moyenne d'environ 1,8 milliard de dollars pour l'ensemble des espèces animales, et environ cinq fois ce montant, soit 9,3 milliards de dollars, pour les espèces végétales.
Source : WWF et Air France
Outre cette imprécision quantificative, s'ajoute la problématique de la qualification légale : contrairement à de nombreux produits stupéfiants, la possession de la plupart des produits issus de la faune sauvage est légale dans de nombreux pays à travers le monde. Le caractère légal ou illégal du commerce de ces produits n'a bien souvent pas un caractère d'évidence pour les acheteurs, car il dépend généralement de la manière dont ils ont été obtenus, de la légalité du transport et du respect des prescriptions déclaratives aux passages de frontière.
Les trafiquants tirent parti de cette complexité en orientant les produits illégaux vers des marchés où les acheteurs se soucient peu de la légalité de la provenance ou ne sont pas en mesure de la vérifier. Ils blanchissent également des produits illégaux en les intégrant dans des chaînes commerciales légales, en exploitant les faiblesses des exigences de traçabilité des expéditions ou en passant par des élevages ou des stocks mal contrôlés. En conséquence, de nombreux produits issus de la faune sauvage, bien que prélevés ou échangés illégalement, peuvent être mis en vente sur des marchés finaux légaux, de façon illicite, dans des proportions quasiment impossibles à déterminer.
Selon le rapport mondial 2024 sur la criminalité liée aux espèces sauvages, la criminalité liée à la faune semble être avant tout opportuniste, perpétrée par des logisticiens ou hommes d'affaires faiblement connectés entre eux, qui assurent la consolidation et la logistique du transport pour le commerce légal comme illégal, tirant profit des produits les plus lucratifs. De manière générale, il semble que les trafiquants d'espèces sauvages planifient leurs activités comme des groupes criminels organisés, en fonction des risques et des gains, mais que les structures de ces groupes sont souples, les hiérarchies peu claires et la plupart ne sont pas animés par une logique criminelle au sens strict.
Néanmoins, le trafic d'espèces sauvages peut impliquer des groupes criminels hautement organisés, comme au Mexique ou en Afrique du Sud, où des études de cas ont montré que des organisations de trafic de drogue se diversifiaient vers de nouvelles activités illégales, incluant le trafic de bois et d'autres produits issus de la faune, qui reposent sur des structures criminelles existantes, impliquant des systèmes de protection, de racket, de blanchiment d'argent et de corruption. La lutte contre ces trafics étant rarement érigée au rang de priorité pénale, les autorités nationales échouent à démanteler ces organisations, « la plus grande part des arrestations et des incarcérations visent des criminels de bas étage ».
Si l'on s'intéresse aux moteurs du trafic et aux déterminants de la demande qui s'exprime pour ces biens et produits, force est de constater que ce commerce illégal alimente un large éventail de secteurs et de débouchés, au premier rang desquels figurent l'alimentation, la médecine traditionnelle, le prestige associé à la détention de nouveaux animaux de compagnie, la collection de plantes ornementales et autres naturalia6(*) exposées dans des cabinets de curiosités, ainsi que les produits de luxe. Faute de campagnes de sensibilisation à vaste échelle, les consommateurs ne sont toutefois que rarement en situation de faire un choix éclairé quant à l'origine des produits qu'ils achètent et aux dangers sanitaires, environnementaux et économiques associés.
2. La France, une plaque tournante du trafic d'espèces sauvages en raison de son statut de pays de départ, d'arrivée et de transit
En raison de sa position géographique favorisée, de la richesse de sa biodiversité ultramarine, de son attractivité commerciale et touristique, mais également de son insertion dans la mondialisation en tant que puissance globale, la France constitue un carrefour de premier plan pour le trafic d'espèces protégées, favorisé par la présence de ses hubs maritimes et aéroportuaires permettant d'assurer une excellente connectivité avec l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Au niveau européen, elle est au centre des échanges intracommunautaires avec toute l'Europe occidentale et une voie d'entrée maritime de premier ordre aux côtés de la Belgique et des Pays-Bas.
La France constitue une zone de confluence pour le trafic d'espèces sauvages, étant tout à la fois zone de réception, d'émission et de transit. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, avec 70,3 millions de passagers par an et 300 destinations desservies dans le monde entier, constitue un hub de prédilection pour ce trafic, en raison notamment du grand nombre de vols directs en provenance d'Afrique, qui facilite l'introduction de petites quantités dissimulées dans les bagages. Quand on évoque ce trafic, on pense principalement aux voies d'entrée aéroportuaires, mais il ne faut pas occulter l'importance des voies maritimes et routières, ainsi que le fret et les colis postaux. La diversité des points d'entrée expose particulièrement la France à ce trafic et contribue à faire de notre pays une zone plus sensible que les autres pays européens.
Selon les indications fournies au rapporteur par la Direction générale des douanes et des droits indirects, 560 constatations relatives à la Cites ont été réalisées en 2024 par les services des douanes, soit une hausse de 4 % par rapport à 2023. Plus de 98 000 spécimens ont été saisis, dont 3 508 spécimens d'origine animale. Outre les végétaux, les spécimens les plus saisis sont des coraux et coquillages (1 178 spécimens). La faune marine représente ainsi la majorité des contentieux Cites, suivie des animaux vivants, principalement des oiseaux et des reptiles. 1 157 spécimens d'animaux ou parties d'animaux morts ou empaillés ont aussi été saisis en 2024. Ces tendances, si elles sont plus marquées en France, n'épargnent pas les autres pays européens : le rapport Traffic7(*) sur les saisies au sein de l'UE des espèces Cites évoque 5 196 saisies en 2023, en constante augmentation depuis 2020 (4 301 saisies).
Si l'on s'en réfère au seul aéroport Paris-Charles de Gaulle, environ 500 kg de viandes d'espèces protégées par la Convention de Washington sont interceptés chaque année par la douane. Les difficultés d'identification ADN des espèces et la destruction régulière des saisies à des fins de prévention des risques sanitaires font qu'il n'est malheureusement pas possible d'obtenir des données plus précises : tout porte cependant à croire que ce chiffre est sous-estimé, même s'il reste impossible de déterminer dans quelle proportion.
Il convient de se garder de l'idée que la France serait uniquement une destination d'arrivée et de transit pour les trafiquants et la contrebande de ces produits : des trafics ont également cours sur notre territoire. Ainsi, la Guyane, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, considérées comme des points chauds de la biodiversité mondiale, attirent la convoitise des trafiquants afin d'alimenter les marchés illégaux en espèces exotiques, telles que les perroquets, les reptiles (tortues et serpents), les coraux ou certaines plantes protégées.
Le territoire hexagonal, qui abrite également de nombreuses espèces protégées au titre de la réglementation nationale et de la Cites, est concerné par de nombreux trafics comme les chardonnerets élégants, la tortue d'Hermann mais aussi l'anguille européenne qui est une espèce endémique de l'Europe de l'Ouest. Certaines tortues, oiseaux ou singes en captivité trouvent preneurs à plusieurs milliers d'euros. L'Asie joue un rôle moteur dans les dynamiques de ce trafic : selon une publication de 2020 sur le rôle de la France dans le commerce d'espèces sauvages8(*), 44 % des spécimens saisis au transit en France avaient pour destination la Chine, notamment l'ivoire, les reptiles, les coraux et d'autres espèces végétales, avec la France comme hub de transit identifié dans de nombreuses saisies signalées par d'autres États membres de l'Union européenne.
On peut citer à titre d'illustration les civelles, alevins des anguilles européennes, qui sont victimes d'un trafic transnational rapportant chaque année environ 3 milliards d'euros selon Europol. La montée des prix sur le marché noir, corrélée à la disparition des espèces endémiques et à leur statut de mets recherché en Asie où ils sont très appréciés des consommateurs fortunés, constitue un aiguillon du trafic qui conduit à des prix avoisinant les 6 000 € le kg pour les civelles. Il s'agit d'un enjeu majeur compte tenu de son impact sur l'état des populations d'anguilles européennes, ainsi que des profits générés par les groupes organisés qui y prennent part. Europol estime qu'environ 300 millions d'anguilles européennes sont illégalement transportées chaque année depuis l'Europe vers l'Asie, pour des profits annuels estimés à 2 à 3 milliards d'euros. Les réseaux orchestrant l'exportation illégale des civelles se complexifient, comme en témoigne un procès en avril 2025, au cours duquel 8 personnes ont été jugées par le tribunal correctionnel de Créteil pour leur implication dans un trafic international de civelles9(*).
La France constitue également un pays d'importation pour alimenter une demande croissante de collectionneurs de faune et de flore, le marché florissant des nouveaux animaux de compagnie, ainsi que les cabinets de curiosité qui se développent. En effet, l'engouement pour les espèces rares animales (pythons, scorpions, axolotls, lézards) ou végétales (orchidées, cactus) alimente une demande illégale dans les foires ou sur internet.
La France constitue aujourd'hui l'un des plus gros marchés européens pour les nouveaux animaux de compagnie, recherchés pour leur rareté, leur exotisme ou leur valeur statutaire. Une demande croissante pour des animaux de compagnie « originaux » ou « tendances » contribue au développement de ce marché10(*). Cela inclut aussi bien des reptiles (serpents, tortues, lézards), des oiseaux exotiques (perroquets, rapaces), que des petits mammifères (félins, primates, suricates) et même des insectes rares. L'attrait pour l'exotisme et le statut social que la possession de ces animaux peut conférer sont des moteurs importants.
Les réseaux sociaux nourrissent également certaines tendances, à la normalisation voire la glorification de la détention d'espèces sauvages, créant une augmentation de la désirabilité de certaines espèces. L'essor du commerce en ligne permet en outre de se procurer des espèces plus difficiles à obtenir sur le marché légal, tels que les singes ou les félins, comme le serval ou le caracal. L'on constate également des effets de mode, comme la médiatisation de l'acquisition d'espèces sauvages et exotiques comme symbole de réussite sociale et de richesse par des influenceurs.
La France est aussi marquée ces dernières années par l'essor des cabinets de curiosité qui génèrent une demande nouvelle pour des objets issus d'animaux sauvages (taxidermies, crânes, ossements, ivoire, carapaces, corne de rhinocéros, cuir...) pour les collectionneurs, mais aussi les particuliers occasionnels ou des touristes, notamment originaires des États-Unis où l'engouement pour les cabinets de curiosité est encore plus marqué. À titre d'exemple, les douaniers ont saisi en 2023 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle 392 crânes de primates provenant du Cameroun11(*).
Il résulte de ces éléments que la France a une responsabilité particulière à endosser dans la lutte contre ce trafic, en raison de la place prépondérante qu'elle occupe dans les itinéraires et les routes commerciales illégales arrivant, partant et transitant depuis notre pays.
3. Les importations illégales de viande de brousse, des flux incessants qui congestionnent les capacités douanières
Outre le commerce illégal d'espèces protégées qui vient d'être esquissé, il convient de faire la lumière sur un autre type de trafic qui affecte particulièrement la France par son ampleur et les flux qu'il génère, celui de la « viande de brousse ». Ce trafic tire son illégalité du fait que toute importation de produits d'origine animale non inspectée et validée par un service vétérinaire est interdite, afin de protéger la santé des consommateurs et la propagation de pathogènes susceptibles d'affecter les élevages. Même si les espèces ne sont pas protégées par la Cites, le transport de produits carnés dans les bagages des voyageurs est strictement prohibé par le droit européen12(*), ces produits représentant un risque avéré pour la santé publique, la santé animale et la biodiversité.
Le terme de « viande de brousse » désigne habituellement la viande d'animaux sauvages en provenance d'Afrique13(*), les espèces domestiques étant généralement visées sous le vocable de « viande de bétail ». Les espèces concernées sont diverses et incluent par exemple chauves-souris, primates, insectes, pangolin, agouti, varans, crocodile, antilope, porc-épic... Le transport de viande de brousse et le trafic d'espèces protégées relèvent cependant de thématiques à distinguer car relevant de cadres, de pratiques et de finalités qui, bien souvent, ne se recoupent pas.
Le trafic d'espèces protégées est essentiellement motivé par une recherche d'enrichissement personnel illégalement, en connaissance de cause ou la volonté de disposer, au regard de leur rareté ou de leur attrait, de spécimens rares aux fins de se doter d'une « collection ». L'importation de viande de brousse répond, quant à elle, plutôt à un besoin culturel exprimé par les résidents d'origine africaine installés sur le territoire national, avec pour finalité une consommation, à l'occasion notamment de fêtes. La consommation de viande de brousse est fortement liée à l'identité culturelle et aux traditions culinaires des pays d'origine.
Ces consommations sont vécues comme un moyen de maintenir un lien avec la terre de ses ancêtres et de retrouver les saveurs de l'enfance. Dans les pays d'origine, en zone rurale, la viande de brousse est une source majeure de protéines animales. Cette habitude perdure même dans les pays d'accueil, où les alternatives sont pourtant nombreuses. La consommation de viande d'espèces sauvages est principalement réservée aux grandes occasions, dans le cadre de fêtes ou de cérémonies : la viande d'espèces sauvages, relativement chère, est considérée comme un mets délicat. Consommer de la viande d'espèces sauvages permettrait ainsi à la diaspora de maintenir un lien avec sa culture d'origine et de perpétuer des traditions culinaires familiales.
Il semblerait que ces consommations répondent moins à un besoin alimentaire qu'à une fonction identitaire, culturelle ou statutaire. La question des déterminants culturels est centrale : les travaux du Cirad, conduits en Thaïlande par Michel de Garine, ont ainsi montré que la consommation de viande de rat, pourtant susceptible de transmettre des maladies selon son stockage, son transport ou sa méthode de cuisson, bénéficie d'une bonne image et est perçue comme une viande particulièrement saine, en dépit des réalités sanitaires14(*).
Dans certaines cultures, la consommation de certaines espèces de viande de brousse, notamment les primates, confère un statut social, voire du prestige. Elle serait également consommée régulièrement, par des personnes plus aisées issues de la diaspora, à des fins diététiques. La viande d'espèces sauvages serait considérée comme de meilleure qualité et plus bénéfique à l'organisme. Certains consommateurs affirment que la viande de brousse a un goût unique et inimitable que l'on ne retrouve pas dans les viandes d'élevage et sont imprégnés de la croyance que sa consommation est bénéfique pour la santé. Elle serait également associée à des croyances spirituelles ou médicinales, ou encore perçue comme un symbole d'authenticité pour certains consommateurs.
Les liens historiques que la France entretient avec certains pays d'Afrique et d'Asie ont favorisé les échanges commerciaux et migratoires de plusieurs diasporas sur notre territoire. Cela entraîne une augmentation de la consommation de produits traditionnels issus de la pharmacopée asiatique, pharmacopée africaine ou encore de la viande d'espèces sauvages, avec des consommateurs qui recherchent les propriétés organoleptiques de ces produits ou parce qu'ils estiment que ces produits sont de bien meilleure qualité que ceux disponibles en France. L'aéroport CDG constitue ainsi l'un des derniers maillons d'une chaine d'approvisionnement qui commence en forêt où ces espèces sont chassées. Grâce aux infrastructures routières qui se développent à l'échelle du continent africain, cette viande peut être aisément acheminée vers les grands centres urbains africains pour satisfaire une classe moyenne qui aspire à manger « comme au village ». Pour les mêmes raisons, une partie de cette viande continue son parcours depuis ces centres urbains vers ceux de France et d'Europe.
Les travaux de terrain menés par le WWF France ont mis l'accent sur l'existence de « filières » d'importation et de distribution illégales de la viande de brousse en Île-de-France, qui coexisteraient avec un commerce plus opportuniste ou basé sur des réseaux informels. Entendus par la mission d'information, les représentants de cette organisation ont indiqué au rapporteur que des grossistes disposent d'une capacité de stockage de viande de brousse préalablement importée, permettant d'approvisionner des détaillants, généralement des épiceries alimentaires, voire des restaurants communautaires.
À ceci s'ajoutent des intermédiaires, qui peuvent faciliter la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs, ainsi que des vendeurs occasionnels qui concentrent leur période de vente de viande de brousse sur des périodes de plus forte demande, par exemple lors de fêtes religieuses. Un rapport inter-inspections consacré à la lutte contre l'importation illégale de produits carnés15(*) évoque quant à lui une « ubérisation » croissante du commerce de viande de brousse, à travers des commandes via les réseaux sociaux ou l'existence de « mules ». Les enquêtes diligentées jusqu'à présent ont perdu la trace des produits, officiellement introuvables dans les restaurants africains.
Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, le marché de la viande de brousse en France est avant tout un marché de niche, communautaire, clandestin et informel, centré autour de la diaspora africaine, notamment d'Afrique de l'Ouest et Centrale. Une partie des flux aéroportuaires vise ainsi à alimenter un commerce à travers des mécanismes de « bouche à oreille ». À noter que le kilo de viande d'espèces sauvages oscille entre 30 et 60 euros, et que des valises entières ont été retrouvées avec des noms et numéros de téléphone de clients. Le contenu en viande de brousse d'un bagage de 23 kg se vend ainsi en moyenne entre 700 et 1 400 €. Quoi qu'il en soit, la difficulté à se procurer de la viande d'espèces sauvages en France, combinée à sa rareté, contribue à sa valeur et à son attrait au sein de certaines communautés d'origine africaine.
Ce contexte explique pourquoi les saisies douanières de denrées prohibées concernent tout particulièrement les vols en provenance d'Afrique subsaharienne. Chaque année, en moyenne, depuis 2018, les services douaniers, principalement dans les aéroports, constatent 2 500 infractions et saisissent 22 tonnes de viandes domestiques ou sauvages, dont environ 700 kg de viande d'espèces sauvages protégées formellement identifiées. La tendance est à l'augmentation assez sensible des saisies de produits carnés : pour l'année 2024, les douanes ont constaté 3 051 infractions et saisi près de 22,8 tonnes de produits carnés, dont 455 kg de viandes d'espèces sauvages protégées. Les tonnages d'espèces protégées communiqués sont souvent sous-estimés, car ils ne prennent en compte que les saisies formellement identifiées16(*).
Lors d'un déplacement effectué en juillet 2025 au terminal 2E par la mission d'information à Paris-Charles de Gaulle à la rencontre des acteurs en première ligne face à ce trafic, les douaniers ont fait part de leur impuissance face au caractère incessant et systématique des bagages voyageurs en provenance de certaines destinations contenant des produits carnés. Les produits saisis sont généralement emballés dans des sacs plastiques ou dans des glaciaires, rangés dans les bagages entre divers autres produits alimentaires et objets en tous genres. En général, il s'agit de bagages à part, le bagage principal contenant des effets personnels.
Produits périssables saisis au
terminal 2E de l'aéroport Charles de
Gaulle
(année 2024)
|
Nombre de constatations |
Quantités saisies (tonnes) |
Progression par rapport à 2023 |
|
|
Viande |
2 221 |
15,3 |
+ 18,6 % |
|
Poissons |
205 |
6,3 |
- 11,3 % |
|
Végétaux |
2 040 |
34 |
+ 6,6 % |
|
Produits laitiers |
69 |
0,3 |
- 4,3 % |
|
Total |
4 535 |
56,2 |
+ 7,3 % |
Source : Direction générale des douanes et droits indirects
Les résultats préliminaires d'une étude scientifique réalisée en partenariat avec la douane française17(*) tendent à montrer que le volume de viande d'espèces sauvages transitant par Paris-CDG a augmenté de 74 % entre 2009 et 2024, avec un volume annuel estimé à 475,5 tonnes transitant par le Terminal 2E, soit plus de 9 tonnes par semaine. Ces résultats suggèrent que nous faisons face à un trafic non jugulé avec seulement 0,6 % de la viande de brousse qui transite par le Terminal 2E de CDG qui serait saisie. Le vétérinaire de la faune sauvage Michel Halbwax a indiqué à la mission d'information que tous les taxons étaient représentés (chiroptères, ongulés, rongeurs, primates) notamment ceux qui représentent les plus gros risques pour la santé humaine.
Face à l'ampleur de ce trafic et en raison des enjeux sanitaires qu'il recouvre, la mission d'information plaide pour une connaissance renforcée des dynamiques du trafic, des itinéraires, de l'économie criminelle associée et des déterminants de la consommation de viande de brousse, à travers des études et enquêtes auprès des publics cibles. Disposer d'études sur les consommations de viande de brousse en France permettrait de mieux caractériser le trafic, tant dans son ampleur que dans sa géographie, tout en fournissant un cadre de référence afin de pouvoir évaluer les futures mesures de lutte qui seraient mises en place et accompagner les mesures de réduction de la demande bien ciblées et fondées sur les sciences sociales, axées sur la modification du comportement des consommateurs18(*).
Recommandation n° 1 : Soutenir la réalisation d'études multidisciplinaires pour renforcer la connaissance du modus operandi des trafiquants d'espèces protégées et affiner la compréhension des déterminants socio-culturels de la consommation de viande de brousse et son évolution, en vue de sensibiliser les consommateurs aux risques associés à la circulation incontrôlée de produits carnés hors de leur zone de chasse.
L'efficacité des interventions axées sur les comportements sociaux suppose une solide compréhension des publics visés, savoir qui ils sont, ce qui motive leur comportement et quels obstacles les empêchent d'en changer. Cet indispensable savoir, à travers sa mise à disposition au profit des acteurs de la lutte contre ce trafic et les institutions concernées par les méfaits de ce trafic, permettra d'adapter les stratégies de prévention et de répression de manière plus efficace. Il pourrait servir de socle à la sensibilisation des communautés consommatrices, notamment à travers une communication mettant l'accent sur la disponibilité de viandes d'élevage et de poissons susceptibles d'être préparées de manière à se rapprocher des saveurs traditionnelles, via des épices ou des modes de cuisson spécifiques.
B. UN TRAFIC AUX IMPACTS INSOUPÇONNÉS ET AUX RISQUES SOUS-ESTIMÉS
Le trafic illégal d'animaux vivants et de produits carnés, du fait notamment de son ampleur et de la circulation rapide de substances issues du vivant qu'il facilite en dehors de tout cadre ou protocole sanitaire, engendre des risques majeurs, multidimensionnels et sous-estimés pour la santé, l'environnement et l'économie. La crise de la Covid-19 a permis de mettre en lumière et d'affiner la compréhension de ces risques, tout en lui conférant une forte résonance médiatique, que la mission d'information estime opportun de mobiliser pour accentuer la nécessité d'une réponse publique plus déterminée.
1. Une menace insidieuse et permanente pour la santé humaine et animale
Sur le plan sanitaire, les produits circulant dans le cadre de ce trafic échappent à toute chaîne de contrôle vétérinaire ou de quarantaine, augmentant ainsi le risque d'introduction d'espèces vectrices de maladies zoonotiques ou épizootiques sur le territoire national. Selon l'OMS et la FAO, près de trois quarts des maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale, principalement de la faune sauvage. Sur le plan sanitaire, on estime que 60 % des maladies infectieuses affectant l'humain sont d'origine animale, et 70 % des maladies émergentes sont issues de la faune sauvage, dont certaines pouvant aboutir à une pandémie ou du moins des impacts sanitaires et économiques très graves pour les sociétés concernées.
Il existe une abondante littérature scientifique relative au risque sanitaire du trafic d'espèces19(*). Il n'est pas inutile de rappeler que les émergences du syndrome respiratoire aigu sévère de type 1 et 2 (SARS-CoV-1 et 2), du virus de l'immunodéficience humaine (HIV), d'Ebola, de la variole du singe (Monkeypox), de Simian T-Cell Lymphotropic Virus (STLV) sont par exemple toutes dues à la consommation de viande de brousse. La pandémie du Sida à laquelle le monde fait face depuis plus de 40 ans présente ainsi un fort lien de causalité avec la consommation de viande de brousse20(*). Si rien n'est fait pour contrer plus efficacement ce trafic, la liste pourrait encore s'allonger...
Comme le prophétise Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, « l'histoire nous enseigne que la question n'est pas de savoir si une prochaine pandémie surviendra, mais quand ». Il convient dès lors de se préparer à cette éventualité, mais également de mettre en oeuvre des mécanismes de surveillance et d'alerte avancée pour éviter la survenance de la prochaine pandémie de grande ampleur. La Covid-19 est le dernier exemple frappant de cette menace, en illustrant les coûts colossaux que peut engendrer une crise sanitaire d'origine zoonotique, tant en dépenses publiques qu'en perte de PIB, des milliers de milliards d'euros à l'échelle mondiale.
|
Ce que la pandémie de la Covid-19 nous a enseigné La crise de la Covid-19 a constitué un électrochoc majeur pour les sociétés, a considérablement affiné les connaissances scientifiques et renforcé la prise de conscience de la gravité potentielle des différentes menaces sanitaires. Confirmation du lien entre faune sauvage et zoonoses : La pandémie a rappelé de manière éclatante que près des trois quarts des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses et que la faune sauvage (et son commerce) en est un réservoir majeur. Le rôle présumé du marché de Wuhan et la proximité entre humains et animaux sauvages ont mis en lumière le risque. Accélération de la recherche : La pandémie a stimulé la recherche sur les mécanismes de transmission des virus, l'identification des réservoirs animaux, les phénomènes de franchissement de barrière d'espèce, et la modélisation de la propagation. Les laboratoires de l'Anses ont renforcé la surveillance qu'ils opèrent sur ces sujets. Renforcement des approches globales : La Covid-19 a popularisé et mis en évidence l'importance de l'approche « Une seule Santé », qui reconnaît l'interconnexion intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Cela implique une collaboration étroite entre les professionnels de la santé humaine, vétérinaire et environnementale. Prise de conscience politique et publique : Les gouvernements et le grand public sont désormais bien plus conscients des risques liés au trafic d'espèces sauvages et à la consommation de produits d'origine animale non contrôlés. Cela a conduit à des appels au renforcement des législations et des contrôles. Vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement : La pandémie a également mis en évidence la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et la nécessité de renforcer la biosécurité aux frontières. Source : échange avec Éric Cardinale, directeur scientifique santé animale de l'Anses |
Ainsi, dans la mesure où la grande majorité des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent des animaux aux humains, il est nécessaire de favoriser des systèmes de coopération, de contrôle et de réponse adaptés à cette menace. Le trafic d'animaux vivants, en particulier les espèces sauvages, et de produits carnés issus de la faune sauvage augmente considérablement les contacts entre espèces, créant des opportunités pour les virus et bactéries de franchir la barrière des espèces. Les crises sanitaires récentes présentant un risque avéré ou présomptif de franchissement de la barrière inter-espèce par des agents pathogènes circulant initialement chez les animaux comme la Covid-19, l'influenza porcin, l'influenza aviaire, les infections par le West Nile Virus, l'émergence à venir de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui illustrent parfaitement le danger que fait courir la circulation de ces espèces ainsi que la réalité et le sérieux de la menace.
De nombreux virus zoonotiques peuvent être présents dans la viande de brousse. Même après fumage ou séchage, certains virus peuvent persister, comme Ebola (associé aux grands singes et aux chauves-souris, transmissible par la consommation de viande d'animaux infectés), le virus Marburg (chauve-souris), la fièvre de Crimée-Congo (via des tiques vectrices présentes sur le pourtour méditerranéen, y compris en Corse et dans l'Hexagone, ou le sang d'animaux infectés), le MERS-CoV ou coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (dromadaires), l'infection à virus Nipah (chauves-souris et porcs), la fièvre de Lassa (rongeurs) ou encore des agents liés à la fièvre de la Vallée du Rift. Des études ont mis en évidence la présence d'anticorps ou de matériel génétique de virus Ebola dans des échantillons de viande de brousse illégale saisis en Europe21(*). Une campagne de dépistage sur la faune sauvage au Parc naturel de Makira à Madagascar en 2022-2023 a également révélé des traces de circulation de maladies zoonotiques telles que la peste, la leptospirose et la toxoplasmose.
La viande de brousse, souvent manipulée dans des conditions d'hygiène sommaires et transportée sur de longues distances sans chaîne du froid adéquate, constitue ainsi un vecteur de risque majeur. La consommation de viande de brousse peut être à l'origine de toxi-infections alimentaires individuelles ou collectives. Les agents pathogènes peuvent persister dans les tissus pendant plusieurs jours, qu'il s'agisse de bactéries (Salmonella, E. coli pathogènes, Campylobacter, Listeria et d'autres bactéries en raison de conditions d'abattage et de manipulation insalubres et de la contamination fécale ou environnementale) ou de parasites, tels que les nématodes (Trichinella spiralis chez les suidés sauvages), les cestodes (ténias) ou les protozoaires (toxoplasmose) peuvent infecter les animaux sauvages et être transmis à l'homme par l'ingestion de viande insuffisamment cuite. En résumé, la viande de brousse peut contaminer l'humain par ingestion, contact cutané, inhalation de particules biologiques ou blessure lors de la découpe ou des manipulations.
La faune sauvage peut en outre être porteuse d'agents pathogènes inconnus, résistants ou mal détectés (virus, parasites et bactéries), ce qui complique la surveillance épidémiologique des saisies. En raison de leur dangerosité, les produits issus du trafic d'animaux vivants et de viande de brousse qui échappent à tout contrôle sanitaire ou vétérinaire doivent faire l'objet d'une attention sanitaire plus marquée de la part des autorités publiques : en contrôlant mieux le commerce illégal, on réduit le risque de propagation de maladies de l'animal à l'homme.
Il n'est pas inenvisageable que ce trafic puisse être à l'origine d'une Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), déclaration formelle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en cas d'« événement extraordinaire qui est déterminé comme constituant un risque pour la santé publique pour d'autres États à cause de la propagation internationale de la maladie et pouvant potentiellement nécessiter une réponse internationale coordonnée ».
Le trafic illégal d'espèces sauvages et de produits carnés remplit plusieurs des critères pouvant conduire à la déclaration d'une USPPI, avec notamment un risque avéré de propagation internationale. En faisant voyager des animaux ou leurs produits à travers les continents, ce trafic crée des vecteurs parfaits pour la propagation rapide d'agents pathogènes bien au-delà des frontières d'un pays : un virus émergent dans un marché de faune sauvage en Afrique ou en Asie peut se retrouver à Paris en quelques dizaines d'heures via un voyageur ou un colis. Ce trafic est également en mesure d'avoir un fort impact sur la santé publique, avec des agents pathogènes issus de la faune sauvage qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme, avec des taux de morbidité et de mortalité élevés, tout en présentant un risque d'entrave au commerce et aux voyages internationaux.
Cette hypothèse a été prise au sérieux par le ministère de la Santé, qui a saisi, juste après la crise sanitaire, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (CoVARS) dans le but de définir une cartographie des risques sanitaires inspirée de l'approche « Une seule santé », tenant notamment compte de l'accélération probable de l'émergence de nouvelles zoonoses susceptibles de représenter une menace pour la santé des populations et de mécanismes multifactoriels et complexes, générateurs de crises sanitaires, comme le changement climatique et ses conséquences environnementales, l'augmentation des interactions humaines avec les réservoirs de pathogènes (élevage, déforestation), la mondialisation des transports, etc. L'objectif de la cartographie des risques sanitaires était d'orienter et prioriser les stratégies d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires de demain.
L'avis du HCSP du 27 octobre 2023 a permis de mettre en exergue 14 maladies infectieuses définies comme hautement prioritaires, selon une méthodologie multicritères développée par l'ECDC, le centre européen d'épidémiologie et de contrôle des maladies. L'avis du CoVARS du 3 avril 2024 a quant à lui permis d'évaluer les risques de situations sanitaires exceptionnelles (SSE) majeures pour la santé humaine en France au cours des années 2025-2030, sur la base d'une analyse des cartographies existantes des risques sanitaires liés aux infections et à l'environnement en France, à l'échelle européenne et internationale.
La combinaison de ces deux avis a permis de définir une liste de risques prioritaires pour le Centre de crises sanitaires22(*) selon leur typologie, leurs spécificités géographiques ainsi que le degré de risque associé. On peut citer parmi les risques élevés : les infections respiratoires aiguës (IRA), les arboviroses (notamment la dengue, Chikungunya, Zika, West Nile), l'influenza aviaire hautement pathogène, les coronavirus pandémiques, les fièvres hémorragiques virales, mais également la maladie X, maladie inconnue et de nature à provoquer une épidémie grave. La rage, le paludisme, les encéphalites à tique, la maladie de Lyme et Mpox et autres pathologies émergentes ou ré-émergentes (rougeole, infections invasives à méningocoques...) font l'objet également d'une attention particulière. La majorité de ces risques sont zoonotiques et peuvent résulter du contact avec un animal ou un vecteur potentiellement importé ou absent naturellement du territoire. Néanmoins, la majorité des cas signalés de maladie émergente sont aujourd'hui le fruit d'une contamination à l'extérieur du territoire.
Ce trafic est par ailleurs à la confluence de trois dimensions sanitaires qui s'imbriquent, avec la santé publique, la santé humaine et la santé environnementale. Cette interdépendance est généralement mise en évidence et étudiée dans le cadre des approches dites « Une seule santé ». Des interactions contaminantes (« spillover ») vers l'humain ou des animaux domestiques, pouvant à leur tour contaminer l'homme, peuvent résulter par exemple de la manipulation ou la consommation des animaux sauvages ou de leurs produits, sans précaution sanitaire, mais aussi de la contamination des élevages ou des lieux de culture par les animaux sauvages qui sont attirés par exemple par la ressource alimentaire.
Ces franchissements sont facilités par les modifications des écosystèmes qui génèrent des interactions plus grandes entre espèces sauvages et domestiques ou les humains. Les espaces de l'être humain et de la nature s'interpénètrent de plus en plus, avec une réduction des sanctuaires naturels et une extension des zones géographiques favorables au développement et à la survie de pathogènes et des vecteurs. En outre, l'état général de santé, et en particulier de stress, des animaux constitue également un facteur aggravant sur le risque de contamination et de contagiosité en cas de maladie infectieuse.
La nature des espèces faisant l'objet des trafics et leur provenance inquiète également sur le plan de la santé animale, avec un risque significatif d'importation et de développement d'épizooties, c'est-à-dire de maladies infectieuses transmises par la faune aux autres animaux. De nombreux agents pathogènes issus de la faune sauvage sont susceptibles d'émerger à l'occasion de franchissement de la barrière d'espèce, avec ou sans mutation. L'introduction de produits carnés ou d'animaux vivants non contrôlés peut introduire des maladies animales hautement contagieuses et dévastatrices pour l'élevage national et européen, à l'instar de la peste porcine africaine (PPA), la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) ou la fièvre aphteuse. Les viandes « de chasse » peuvent véhiculer des pathogènes divers, également dangereux pour les cheptels européens : charbon, fièvre aphteuse, coronavirus bovins. L'arrivée de ces maladies aurait des conséquences économiques catastrophiques pour les filières agricoles.
La peste porcine africaine est un exemple frappant d'une maladie épizootique qui menace de façon très sérieuse les filières d'élevage et le commerce international, et dont l'introduction via des produits carnés illégaux est une préoccupation constante en Europe. Bien que n'étant pas une zoonose, son impact économique peut être équivalent à celui d'une crise sanitaire majeure pour l'élevage. Si cette maladie devait se propager sur le territoire français, la France perdrait son statut indemne qui lui permet actuellement d'exporter sa viande et les conséquences économiques se chiffreraient alors à plusieurs centaines de millions d'euros, avec un risque de déstabilisation majeure de la filière porcine française.
Il convient de rappeler que les risques de propagation d'un virus dépendent du type de pathogène, de sa transmissibilité, de sa période d'incubation et de ses modes de transmission. Ces éléments conditionnent également la nature, l'intensité et le calendrier des mesures à déployer. Le risque sanitaire est obtenu en multipliant une probabilité d'apparition d'une épidémie par les conséquences. Plus la viande de brousse est importée sur le territoire national, plus la probabilité d'apparition d'une épidémie augmente et plus le risque est important. Certains agents pathogènes peuvent persister plusieurs jours sur une carcasse et certaines de ces carcasses arrivent fraiches, avec des animaux tués en forêt moins de 24 heures avant le vol.
Au vu des éléments qui viennent d'être exposés, la mission d'information estime que la lutte contre ce trafic doit faire l'objet d'une attention bien plus soutenue des autorités et du public, à travers des compagnes de sensibilisation et une meilleure connaissance des risques associés à ce trafic. Les effets de la crise sanitaire, encore frais dans les mémoires, doivent être mobilisés à des fins démonstratives et argumentatives. En outre, les moyens de la lutte doivent être renforcés aux points d'entrée du territoire, au nom du principe de précaution : le coût de l'inaction est toujours supérieur aux investissements d'anticipation et de préparation aux risques et aux menaces.
Recommandation n° 2 : Sensibiliser les pouvoirs publics, les magistrats et les acteurs de la chaîne aéroportuaire aux approches « Une seule santé » et aux risques de zoonose et d'épizootie associés à l'introduction massive d'espèces végétales et animales en dehors de tout cadre sanitaire, dans le but d'éviter une nouvelle pandémie due au franchissement de la barrière inter-espèces par des agents pathogènes.
2. Un trafic dont l'ampleur et les implications sont dommageables à la biodiversité
Outre les risques sanitaires significatifs et ininterrompus que fait peser le trafic d'espèces sauvages sur la santé humaine et la santé animale, le commerce illégal d'espèces protégées et de viande de brousse est également porteur de menaces sur la biodiversité, et ce à plusieurs niveaux : à la fois dans les pays de départ, mais également dans ceux de destination. Ces risques sont parmi les mieux documentés sur le plan scientifique, notamment grâce aux rapports de l'IPBES23(*) qui ont mis en évidence que les sociétés humaines dépendent de 50 000 espèces sauvages pour leur survie, dont elles retirent de nombreux avantages, qu'il s'agisse d'alimentation, d'énergie, de matériaux, de substances médicinales, de loisirs ou d'autres besoins humains.
À travers des rapports synthétisant et analysant un grand nombre d'études scientifiques, les experts de l'IPBES sont parvenus à démontrer que le trafic d'espèces sauvages et de produits de la pêche illégale constitue l'une des principales menaces pour la biodiversité. Le commerce des espèces sauvages génère une pression importante sur les espèces, qui nuit à leur durabilité, et conduit à l'effondrement des populations sauvages24(*). Il a ainsi été établi que le prélèvement non durable contribue à accroître le risque d'extinction de 28 % à 29 % des espèces menacées ou quasi menacées appartenant à dix groupes taxonomiques évalués dans le cadre de la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature25(*).
Le rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages précité souligne « qu'au-delà d'une menace existentielle pour les espèces ciblées, les destructions et prélèvements engendrés par le trafic illégal provoquent des impacts écosystémiques déstabilisant les interdépendances entre espèces sur lesquelles reposent les fonctions écosystémiques, y compris celles jouant un rôle face au réchauffement climatique ». De plus, cette criminalité « réduit les bénéfices socioéconomiques pour les populations locales, que cela soit leurs revenus du commerce légal ou l'accès à la nourriture » et « favorise la corruption et la fraude au niveau politique ».
À grande échelle, quand il est perpétré par des réseaux capables de mobiliser des moyens humains et logistiques significatifs, ce trafic est susceptible de neutraliser les efforts de conservation de la nature, d'affecter les ressources vivrières des communautés locales, d'endommager les équilibres écosystémiques en cas de prélèvements trop abondants d'espèces et de limiter l'efficacité des politiques de préservation de l'environnement mises en oeuvre par les États. Il prive également les pays qui en sont victimes d'une partie des ressources matérielles et immatérielles générées par leur patrimoine naturel et culturel.
Couplés à une forte pression démographique, à la déforestation et aux changements d'usage des terres qui réduisent les habitats naturels, ces trafics conduisent à de profonds déséquilibres environnementaux menaçant la stabilité des écosystèmes, voire à des effondrements de certaines espèces : la population d'éléphants des forêts a ainsi chuté de 86 % ces trois dernières décennies26(*), quand celle des rhinocéros s'est effondrée de 97,6 % depuis 1960. Ces deux espèces sont particulièrement emblématiques des dynamiques du commerce illégal, dont le braconnage constitue l'un des principaux facteurs de déclin, en raison des sous-produits extrêmement lucratifs que sont l'ivoire et la corne : un braconnier peut ainsi vendre une corne de rhinocéros pour un montant compris entre 50 000 et 75 000 dollars des États-Unis27(*).
L'érosion alarmante de la biodiversité dans certains pays africains est notamment due à ces prélèvements d'espèces sauvages qui échappent à tout contrôle. Ces prélèvements ont un impact d'autant plus fort pour la faune sauvage qu'ils touchent des espèces ayant des cycles de reproduction lents avec un nombre de progénitures restreint. Dans le bassin du Congo, plus de cinq millions de tonnes d'espèces sauvages seraient prélevées annuellement28(*), un rythme qui n'est pas soutenable pour la biodiversité.
Ce trafic repose sur le braconnage et la capture illégale d'espèces menacées dans leurs milieux naturels, conduisant à la surexploitation des populations, à leur déclin, voire, si rien n'est fait pour renverser la tendance, à l'extinction à terme des espèces concernées. Les pangolins, rhinocéros, éléphants, grands singes, perroquets et de nombreuses espèces de poissons et de reptiles sont particulièrement touchés par ce trafic : il s'agit d'une menace directe et irréversible, qui contribue également à mettre en péril des écosystèmes vitaux déjà fragilisés.
La chasse non durable dans les régions tropicales épuise également les ressources animales, qui sont souvent une source essentielle de protéines pour les communautés locales, aggravant ainsi l'insécurité alimentaire. C'est ainsi qu'environ 300 espèces de mammifères sont menacées d'extinction à cause de la chasse pour la viande sauvage. Outre l'impact sur les écosystèmes qu'entraîne la disparition de populations d'animaux sauvages, elle menace également la sécurité alimentaire des populations rurales. Pour de nombreuses communautés locales, la faune sauvage constitue en effet un moyen de subsistance et une source majeure de protéines. Le braconnage à grande échelle, souvent orchestré par des acteurs externes, les prive de cette ressource vitale, sans leur offrir d'alternatives viables, tout en constituant une concurrence déloyale pour les filières légales.
La disparition d'espèces clés bouleverse les chaînes alimentaires, la régénération des forêts via la dispersion des graines et d'autres services écosystémiques vitaux. Il peut s'ensuivre une dégradation des habitats et une perte de résilience des écosystèmes, pouvant entraîner des cascades d'extinctions et la perturbation des services écosystémiques, telles que la pollinisation ou la régulation des parasites.
L'introduction d'animaux vivants est également susceptible de conduire à l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans les pays de destination, qui concurrencent les espèces indigènes, altèrent les habitats et peuvent véhiculer des maladies. L'IPBES a ainsi établi que « le commerce international a également été reconnu comme une source importante et en croissance rapide d'introduction d'espèces exotiques envahissantes », qui affectent l'abondance et la répartition des espèces sauvages et peuvent accroître le stress et les difficultés pour les communautés humaines qui utilisent les ressources animales et végétales ainsi concurrencées.
On estime qu'en métropole, en moyenne, 12 nouvelles espèces s'installent tous les dix ans depuis 1984 dans chaque département29(*). Selon une étude publiée en 2023 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'Université Paris-Saclay, les préjudices économiques sont tels que les espèces exotiques envahissantes peuvent être comparées à une catastrophe naturelle au niveau mondial : de 1980 à 2019, les dégâts causés par les espèces invasives sont estimés au montant astronomique de 1 200 milliards de dollars.
L'IPBES estime que plus de 37 000 espèces exotiques ont été introduites par les activités humaines, dont 3 500 ayant des impacts négatifs documentés dans la littérature, avec une variabilité du caractère invasif selon les taxons. Les espèces exotiques envahissantes sont impliquées dans 60 % des extinctions globales d'espèces documentées, leur coût économique mondial a dépassé les 390 milliards d'euros par an en 2019, et a au moins quadruplé chaque décennie depuis 197030(*).
La prévention des espèces exotiques envahissantes représente également un véritable défi pour les autorités françaises, avec l'introduction d'espèces vectrices de pathogènes, tel le moustique tigre, allergisantes comme l'ambroisie ou avoir un comportement agressif. D'autre part, ces espèces peuvent avoir un impact négatif sur les activités économiques et de loisirs, notamment les cultures et les élevages, les activités forestières, touristiques, la navigation fluviale ou encore la pêche professionnelle et de loisir.
Afin d'être cohérent avec les mesures adoptées dans le cadre de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes visant à préserver les écosystèmes et les espèces indigènes contre les espèces exotiques envahissantes et les impacts qu'elles génèrent, la mission appelle à accroître les efforts de biosécurité en vue d'éviter que le commerce illégal des espèces sauvages ne favorise la propagation sur notre territoire d'espèces envahissantes, dont l'éradication est très coûteuse, voire impossible une fois que les espèces se sont acclimatées, et à l'origine de coûts de gestion significatifs.
3. Un commerce illégal lucratif à la confluence d'autres activités criminelles
Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la criminalité environnementale constitue la quatrième activité criminelle transnationale organisée la plus lucrative au monde, aux côtés du trafic d'armes, de drogues et de la traite d'êtres humains. À titre d'illustration, le trafic d'ivoire d'éléphant, de corne de rhinocéros et de parties de tigre d'Afrique et d'Asie du Sud-Est vers l'Asie génère à lui seul chaque année 75 millions de dollars de profits31(*). Selon le WWF, les trafiquants passeraient illégalement, chaque année, plus de 100 millions de tonnes de poissons, 1,5 million d'oiseaux vivants et 440 000 tonnes de plantes médicinales. Ce commerce illégal dégagerait chaque année un chiffre d'affaires global estimé à plus de 14 milliards de dollars américains.
La criminalité environnementale progresse dans l'ensemble des pays européens ; elle se professionnalise et s'internationalise. L'organisation internationale de police criminelle et l'ONUDC rapportent par ailleurs l'augmentation continue de l'ampleur et de la rentabilité de ce trafic, qui apparaît souvent associé à d'autres activités illicites comme le blanchiment d'argent ou la corruption, et dont les revenus peuvent alimenter des groupes armés et des réseaux terroristes.
En effet, les risques encourus et les peines sanctionnant les trafiquants sont moins élevés dans de nombreux pays tandis que les bénéfices sont de plus en plus élevés : 3 milliards d'euros chaque année pour le trafic de civelles, 60 000 euros le kilo de poudre de corne de rhinocéros, plusieurs centaines voire milliers d'euros pour des espèces de flore sauvage, etc. Les produits issus de ce trafic s'échangent fréquemment à un prix supérieur à celui de l'or : un kilogramme de poudre de corne de rhinocéros se vendait fin 2014 aux États-Unis 2,5 fois plus cher qu'un kilo de cocaïne32(*). Ce trafic génère ainsi une économie souterraine non fiscalisée, concurrente des filières légales, et favorise le blanchiment d'argent via les circuits de revente. Plusieurs études suggèrent que le commerce légal est intrinsèquement lié au commerce illégal : il permet de blanchir la vente d'espèces sauvages détenues illégalement ou capturées dans la nature, afin d'alimenter différents marchés légalement constitués.
D'ampleur transnationale, cette criminalité est généralement polymorphe (mêlant évasion fiscale, trafic de stupéfiants, etc.) et opérée par des réseaux criminels organisés qui s'engagent dans cette activité en raison des faibles risques encourus et des profits élevés. Ce trafic est de plus en plus souvent investi par des réseaux de criminalité organisée, structurés et transnationaux, qui tirent profit de la forte valeur marchande de ces espèces rares, ce qui complique la lutte contre ce trafic et nécessite une coopération internationale renforcée. Ces réseaux criminels transnationaux utilisent également des méthodes de blanchiment, des cryptomonnaies et des financements issus d'autres types de criminalité.
Le trafic d'espèces sauvages n'est que rarement isolé, il s'articule généralement autour de trafics connexes (drogues, armes, contrefaçons, voire traite d'êtres humains) exploités par les mêmes réseaux criminels. Interpol et l'ONUDC soulignent que les filières logistiques, les routes, les circuits de blanchiment et les modes opératoires sont fréquemment mutualisés. Cette porosité entre trafics complexifie les enquêtes, certains réseaux utilisent le trafic d'espèces comme vecteur de diversification à faible risque, d'autant plus attractif que les peines encourues sont souvent plus faibles que pour les stupéfiants. Le commerce illégal d'espèces protégées peut faire office de trafic précurseur, permettant de tester de nouvelles routes pour des trafics plus lourdement sanctionnés, voire de trafic de complément.
Ce trafic constitue par ailleurs une source majeure de violences : chaque année, de nombreux décès liés à des affrontements entre gardes forestiers et braconniers sont à déplorer33(*). Le caractère très lucratif de ce commerce illégal conduit en effet les trafiquants à prendre des risques importants et à opérer en bande armée, au mépris de la législation et des mesures de surveillance mises en oeuvre par les états. Au surplus, le trafic d'espèces sauvages peut constituer, dans les pays sources, une menace pour la sécurité nationale, car certains de ces réseaux criminels se livrent également au blanchiment d'argent, au trafic d'armes et au financement du terrorisme.
À leur paroxysme, ces trafics peuvent porter atteinte à l'État de droit en alimentant la corruption et en aggravant l'insécurité, ce qui peut compromettre toute perspective de développement économique et de stabilité politique. En ce cas, la coopération internationale est un préalable nécessaire au démantèlement des réseaux, en coordonnant les moyens de la lutte afin de tarir la demande dans les pays de destination et d'inverser le ratio entre risques et profits pour les trafiquants. Aucun pays n'est en mesure, à lui seul, de faire échec à ce trafic, qui mobilise des ressources et des moyens logistiques de réseaux transnationaux excédant largement les moyens de surveillance et de contrôle susceptibles d'être mis en oeuvre par un état en développement, faisant face par ailleurs à de nombreux défis socio-économiques.
Comme c'est le propre de tous les trafics transnationaux, chaque fois que les flux ne sont pas canalisés par les pays de départ, ils sont à l'origine d'une pression sur les pays de destination, ce qui est notamment le cas de la France.
C. LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À LA LUTTE CONTRE CE TRAFIC
Pour les raisons qui viennent d'être exposées, considérer le trafic à la seule échelle nationale conduit à une impasse : nous avons tendance à mesurer les réussites en matière de lutte contre le trafic d'espèces protégées à travers des indicateurs d'arrestations et de saisies, mais ces seules modalités d'intervention n'ont aucun impact à long terme sur la réduction des incitations criminelles transnationales qui nourrissent le trafic.
La réponse douanière est indispensable, mais elle est loin de suffire : face à la croissance continue des flux de voyageurs et de marchandises, les capacités d'interception sont impuissantes à juguler à elles seules le trafic, d'autant que ce phénomène se combine avec des passagers peu sensibilisés aux enjeux du trafic et méconnaissant la réglementation, un cadre judiciaire insuffisamment dissuasif - l'impossibilité d'appréhender tous les trafiquants et de les poursuivre adéquatement rend le risque acceptable pour les criminels - ainsi que des modalités de coopération internationale à peine ébauchées.
Rappelons que la France a une responsabilité majeure dans la lutte contre le commerce illicite d'espèces sauvages, dans la mesure où notre pays constitue à la fois une zone de départ, notamment pour les civelles ou les coraux polynésiens, d'entrée dans l'Union européenne, de transit entre les pays sources d'Afrique et les pays de destination d'Asie ou d'Amérique du Nord, mais également de destination, qu'il s'agisse d'oiseaux exotiques ou encore de reptiles.
1. Des volumes en forte croissance alimentés par le développement du trafic aérien et la diversification des voies d'entrée
En premier lieu, le trafic trouve son premier moteur dans la croissance du transport aérien de voyageurs, qui conduit à une augmentation arithmétique des flux illicites transportés par bagages, toutes choses égales par ailleurs. En moyenne, le trafic aérien mondial double de volume tous les 15 ans, une tendance qui se vérifie depuis l'après-Seconde Guerre mondiale34(*).
Croissance du transport aérien mondial par continent
Source : Banque mondiale
Ces dynamiques sont également valables pour notre pays, avec une progression du trafic aérien de l'ordre de 110 % en France ces vingt dernières années. En 2024, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a accueilli près de 70,3 millions de passagers, soit une hausse de 4,3 % de trafic par rapport à 2023, ce qui en fait le premier aéroport de France et le deuxième en Europe en termes de trafic. Avec un taux de correspondance de 20,3 % en 2024, la plateforme de correspondance de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est le troisième hub européen pour l'offre de connectivité globale et le premier pour le trafic intercontinental35(*).
D'après les projections des acteurs du secteur, notamment Iata, cette progression devrait se poursuivre, à un rythme légèrement inférieur, avec un trafic mondial qui pourrait atteindre 8,6 milliards de passagers à l'horizon 2043, contre 4,5 milliards en 2019, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,6 %36(*).
Les aéroports de Paris, qui desservent régulièrement plus de 300 destinations, dont plusieurs sensibles au regard de la problématique du commerce illégal d'espèces protégées, expliquent que la France constitue un point d'entrée majeur et de transit vers d'autres pays pour les flux générés par ce trafic. Selon la majorité des acteurs entendus par la mission d'information, l'augmentation du volume de viandes saisies est directement corrélée à l'augmentation globale du nombre de vols et à la massification du transport aérien, facteur qui a contribué à la modification même de la manière dont ce trafic est mis en oeuvre. Le syndicat national FO Douanes a indiqué au rapporteur que « le trafic d'espèces protégées et de produits carnés interdits ne faiblit pas -- il se transforme. Il se structure. Il s'adapte. Il se professionnalise. Ce n'est plus une succession de fraudes isolées. C'est un phénomène désormais structurant, inscrit dans une logique de réseaux internationaux, mêlant commerce illégal, logistique d'export et circuits de blanchiment. »
Le volume colossal de passagers et de fret transitant par les points d'entrée aéroportuaires, combiné à la nécessité de garantir un flux rapide pour éviter les retards, rend ainsi inenvisageable un contrôle systématique et approfondi. Les autorités douanières, dont le temps de contrôle est restreint pour mener à bien des inspections approfondies afin de faciliter les sorties d'aéroport et les transferts de passagers en correspondance, doivent faire des choix fondés sur l'analyse de risque.
Les agents des douanes entendus par la mission d'information ont fait état de l'injonction contradictoire d'intercepter ces flux alors que le maître mot de la circulation aéroportuaire est la fluidité. Les contrôles douaniers génèrent en effet un ralentissement du flux voyageur post-salle de livraison bagage et des désagréments pour les autres voyageurs. À cette difficulté s'ajoute en outre la délicate question du placement des animaux saisis, quand les trafiquants sont appréhendés en possession d'animaux vivants et qu'une solution de prise en charge doit être rapidement trouvée.
Le devenir des animaux vivants et des produits saisis
Les découvertes d'animaux vivants dans les aéroports sont assez rares et concernent principalement des espèces de petite taille : reptiles, amphibiens, insectes et passereaux. En 2024, la douane a indiqué à la mission d'information avoir intercepté 167 animaux, dont 35 tortues, 62 oiseaux (dont 18 perroquets), 21 araignées et scorpions, un serpent, 254 kg de civelles et plus de 180 kg de coraux.
L'arrêté du 24 mars 2017 fixe les conditions d'accueil de la prise en charge dans des points d'entrée du territoire des animaux en provenance des pays tiers dont le statut sanitaire est incertain. À ce jour, des locaux d'isolement temporaire sont opérationnels à Paris-CDG et à Orly et des conventions sont passées avec un prestataire dans les principaux points d'entrée dans l'Union européenne, Le Havre, Lyon, Bâle-Mulhouse, Saint-Malo et Nice.
Certaines infractions à la Convention de Washington peuvent aboutir à la saisie d'animaux vivants pour lesquels une solution de placement doit alors être trouvée. Le sort des animaux dépend en ce cas d'un faisceau de critères, tels que l'espèce, l'état sanitaire, l'origine, le statut Cites, les risques zoonotiques mais également des capacités locales d'accueil et de quarantaine disponibles au sein des structures d'accueil.
Pour les espèces exotiques ou pour lesquels un relâché n'est pas envisageable, les autorités recherchent des structures spécialisées pour l'accueil pérenne, généralement auprès des parcs zoologiques. Le placement et l'accueil des animaux vivants saisis dans le cadre de trafics ou de détention illégale relèvent d'une mission de service public. L'accueil de ces animaux ne se limite pas à un simple hébergement, il implique une véritable prise en charge sanitaire et comportementale, dans une logique de réhabilitation. Cela comprend systématiquement des examens vétérinaires complets, des protocoles de quarantaine, le déparasitage, les vaccinations, l'identification individuelle (puçage ou marquage) ainsi que le suivi médical régulier.
Un réseau national, le Service d'assistance aux animaux sauvages saisis (SAASS) a été créé pour assurer l'accueil des spécimens au sein de structures agréées, garantissant le bien-être animal et le respect des règles sanitaires. Ce dispositif, opérationnel depuis avril 2025, comprend un numéro d'appel unique pour connaître les capacités d'accueil. Géré par l'Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), il fait office de guichet unique destiné à coordonner et suivre les placements d'espèces animales non domestiques vivants saisis, confisqués par les autorités de contrôle ou dont le propriétaire souhaite se dessaisir.
Dans ce cadre, les missions de l'AFdPZ sont les suivantes :
- mise en place d'une base de données répertoriant les structures françaises et limitrophes autorisées susceptibles d'accueillir ces animaux,
- coordination du placement des animaux sauvages, afin d'optimiser la recherche de lieux d'accueil et le bien-être des animaux,
- suivi des animaux placés tout au long de la procédure, de leur réception dans les structures à leur prise en charge à long terme.
Unique en Europe, le SAASS constitue aujourd'hui le dispositif national structuré pour centraliser cette gestion. Le programme 113 de la mission Écologie finance ce service à hauteur d'environ 160 000 € par an, dans le cadre d'un marché conclu pour 3 ans.
En ce qui concerne les saisies des produits carnés et des sous-produits inertes, les spécimens Cites confisqués ou abandonnés peuvent faire l'objet d'une remise à titre définitif, notamment :
- aux musées et parcs zoologiques gérés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ou gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics. Certains spécimens, comme l'ivoire sculpté, les trophées ou les animaux naturalisés, peuvent être confiés au Muséum national d'Histoire naturelle, qui les conserve pour la recherche, l'éducation ou l'exposition, en les soustrayant définitivement au commerce illégal ;
- aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'État ou d'une collectivité territoriale ainsi qu'aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés situés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne.
Il n'en demeure pas moins que la quasi-totalité des produits carnés illégaux (viande de brousse, produits laitiers, etc.) saisie est systématiquement détruite. Il s'agit d'une mesure sanitaire impérative pour prévenir l'introduction de maladies. La destruction se fait par incinération ou équarrissage, selon des protocoles stricts pour éviter toute contamination. L'incinération d'une tonne de marchandise coûte environ 2 000 euros. Au sein des aérogares parisiennes, une procédure spécifique a été instituée qui s'appuie sur une convention conclue entre le Groupe ADP et la société Butin, prestataire spécialisé dans la gestion et le traitement de ces déchets sensibles.
Il convient par ailleurs de relever que la concentration des moyens douaniers au sein des aéroports ne saurait constituer la solution à même de résorber à elle seule les flux du trafic. Pour les animaux vivants et les produits carnés, les points d'entrée concernent l'ensemble de nos frontières et les types de transport (ferroviaire, maritime, fret postal et express, routier). Les vecteurs empruntés dépendent de la nature, de la taille des espèces et de leur provenance, mais également des risques identifiés par les trafiquants et la pression de contrôle qui diffèrent selon les points d'entrée.
Si les grands aéroports comme Roissy-Charles de Gaulle constituent des « points chauds » au regard du trafic d'espèces protégées, les trafiquants utilisent également d'autres aéroports, des ports maritimes ou des routes terrestres via d'autres pays européens pour faire transiter leur contrebande. Ainsi, les grands ports maritimes à l'instar du Havre, de Marseille ou de Dunkerque sont des points d'entrée potentiels pour des volumes plus importants de produits carnés illégaux, souvent dissimulés dans des conteneurs de marchandises légales. Le contrôle des conteneurs est un défi logistique majeur en raison de leur nombre colossal. La voie maritime est également cruciale pour d'autres types de trafic environnemental, comme le bois illégal ou les produits de la pêche non réglementée.
À titre d'exemple, le trafic de chardonnerets, une espèce protégée appréciée pour la beauté de son chant, passe principalement par la voie maritime et routière en provenance d'Afrique du Nord. Le trafic de civelles à l'exportation emprunte quant à elle aussi bien la voie aérienne que la voie terrestre, avec l'utilisation de mules et de transporteurs intermédiaires.
Les organisations criminelles se caractérisent par une forte adaptabilité et n'hésitent pas à changer de routes ou de vecteurs en fonction de leur analyse de risques pour éviter les contrôles douaniers et réduire les risques d'interception. La mission insiste en conséquence sur le fait que la lutte contre ces trafics ne peut se limiter à la seule approche aéroportuaire et doit englober l'ensemble des points de passage, à travers la mobilisation de tous les opérateurs (douanes et OFB, mais également gendarmerie et police) et une coopération accrue au niveau européen et international pour une réponse globale plus efficace.
2. Des passagers mal informés qui contribuent à la dispersion des moyens douaniers et empêchent le ciblage efficace des trafics structurés
Outre les flux générés par un trafic opéré en toute connaissance de cause par des réseaux criminels organisés, les douaniers font également face à un phénomène plus diffus, mais non moins massif, d'entrée illégale de produits carnés en provenance d'Afrique Centrale et Occidentale due à des voyageurs qui emportent ces produits dans leurs bagages pour des raisons essentiellement culturelles, sans avoir la claire conscience d'être dans l'illégalité.
Bien que le droit européen et national prohibe strictement l'importation de produits carnés pour des raisons sanitaires, la connaissance de cette interdiction n'est pas bien ancrée dans l'esprit des passagers. Cette situation s'explique notamment par le fait que la signalétique voyageurs et l'information mise à leur disposition depuis l'achat du billet et tout au long de leur parcours voyageur sont largement perfectibles. En outre, la complexité de la réglementation européenne, qui autorise l'emport de certaines quantités de poisson fumé et éviscéré (cf. infra), contribue sans aucun doute à la confusion et au manque de clarté des prohibitions.
De l'avis de la majorité des acteurs entendus par le rapporteur, l'information relative à l'interdiction d'entrée de produits carnés et d'animaux protégés sur le territoire français reste aujourd'hui trop discrète, trop tardive et trop technique. Elle ne permet pas d'enclencher une véritable prise de conscience chez les voyageurs concernés.
Ces insuffisances informationnelles conduisent à des effets pervers : un trop grand nombre de passagers excipent de leur ignorance et de leur bonne foi quand les douaniers contrôlent leurs bagages avec d'importantes quantités de produits carnés, avec un régime de sanctions qui n'est pas compris ni légitime aux yeux des mis en cause. Plusieurs acteurs entendus par la mission d'information estiment pour cette raison qu'il est indispensable de rendre l'interdiction omniprésente et explicite, sur le modèle de la lutte contre la contrefaçon, afin d'inscrire l'interdiction dans les habitudes des voyageurs et en finir avec l'invocation de la bonne foi des passagers dont la marchandise est saisie.
Le point de vue des douaniers sur la lisibilité de la réglementation
Lors d'une table ronde ayant réuni début juillet 2025 les principaux syndicats représentatifs du personnel des douanes, les douaniers ont confirmé à la mission d'information que la plupart des voyageurs invoquent l'ignorance de la réglementation, dans la mesure où « un passager peut transporter plusieurs kilos de viande interdite ou des spécimens d'espèces protégées sans avoir été informé une seule fois des interdictions en vigueur » (FO Douanes).
L'insuffisante connaissance de la réglementation par les passagers nuit à la qualité de la réponse douanière : « on constate un manque criant d'information ciblée à destination des voyageurs. L'ignorance de bonne foi est encore trop souvent invoquée, ce qui affaiblit l'efficacité des mesures de contrôle » (Unsa Douanes).
Les agents entendus par la mission ont évoqué des pistes afin de réduire ce déficit informationnel : « La sensibilisation devrait pouvoir commencer avant même le voyage, continuer pendant et jusqu'à l'arrivée des passagers à Roissy » (Solidaires Douanes). C'est toute la chaîne du parcours voyageur qui doit contribuer à résorber la méconnaissance, voire l'ignorance réglementaire, depuis l'achat du billet d'avion jusqu'au point de passage douanier dans le pays d'arrivée, en passant par l'aéroport de départ la compagnie qui opère le transport des passagers.
Les représentants de la CGT Douanes plaident pour un renforcement significatif des effectifs et des moyens consacrés à la lutte contre ce trafic en particulier, mais également pour contrer l'entrée d'autres produits illégaux et de stupéfiants, pour une raison qui s'explique par la nature même de l'activité douanière : « le métier de douanier reste un métier manuel : pour trouver des marchandises de fraude, il faut ouvrir un carton, un colis, une valise et vérifier de visu ».
L'information des passagers doit faire l'objet d'un soin tout particulier de la part de l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de transport, pour mettre fin une fois pour toutes à la méconnaissance des interdictions de transport. En favorisant la visibilité, la compréhension et les menaces que fait peser le trafic d'espèces sauvages et de produits carnés illégaux pour la santé, l'environnement, la sécurité, on peut espérer un changement des comportements et une adhésion plus forte des voyageurs aux mesures de lutte contre ce trafic.
La mission estime ainsi qu'il est indispensable de renforcer la communication et la sensibilisation des voyageurs, pour en finir avec des flux incessants qui congestionnent les capacités de contrôle douanier tout en dispersant les moyens consacrés à la lutte contre le trafic d'espèces protégées et au démantèlement de réseaux transnationaux qui réalisent des profits colossaux avec une prise de risque bien inférieure à celle qui caractérise d'autres types de trafics illégaux.
3. Une réponse judiciaire insuffisamment réactive et agile qui explique la persistance des flux
Une autre raison susceptible d'expliquer les difficultés persistantes de la France à enrayer ce trafic tient à la difficulté, pour les autorités douanières et la justice, de mettre en oeuvre une réponse pénale réactive, dissuasive et adaptée à la gravité des menaces sanitaires que fait peser l'importation d'espèces protégées et de produits carnés en dehors de tout contrôle sanitaire. La difficulté qui se pose aux autorités douanières et aux forces de l'ordre n'est pas liée au niveau des sanctions qu'ils doivent mettre en oeuvre, celles-ci ayant été renforcées ces dernières années, mais au fait qu'elles constituent des instruments juridiques peu agiles pour contrer la nature et à l'intensité de ces crimes et délits.
Le cadre normatif a en effet évolué à plusieurs reprises ces dernières années afin de renforcer la sévérité du dispositif pénal en la matière, pour répondre aux exigences de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, demandant aux États membres d'établir des sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour les espèces protégées, l'architecture normative repose sur la Convention de Washington (Cites), transposée dans le droit de l'Union par les règlements (CE) n° 338/97 et 865/2006, plus stricts que le texte international37(*).
Outre ces dispositions de droit international et européen qui s'appliquent à la France, plusieurs dispositions de droit national prohibent et sanctionnent l'importation illégale d'espèces protégées, déclinée par le code de l'environnement, notamment aux articles L. 411-1 à L. 415-6. Ils interdisent l'importation, l'exportation, la détention et la commercialisation d'espèces protégées sans les autorisations nécessaires. Pour les produits carnés et produits d'origine animale, le code rural et de la pêche maritime contient des articles relatifs à la santé et à la protection animales, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des aliments. Les articles L. 236-1 et L. 236-1 A prévoient des interdictions et des sanctions en cas d'introduction de produits d'origine animale non conformes aux normes sanitaires.
La loi dite « Biodiversité » du 8 août 201638(*) a renforcé le quantum des peines applicables pour les atteintes au patrimoine biologique (espèces animales non domestiques et espèces végétales non cultivées), dont font partie les espèces protégées. L'article 129 de cette loi a ainsi doublé les peines d'emprisonnement encourues, de 1 à 2 ans, et décuplé l'amende, de 15 K€ à 150 K€ d'amende, pour les infractions définies à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, comme le fait de porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ou à la conservation d'espèces végétales non cultivées. Une modification ultérieure de cet article, apportée par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, a relevé le quantum de la peine encourue de deux à trois ans, permettant d'effectuer certaines investigations dans le cadre de commissions rogatoires ou pour des techniques spéciales d'enquête, en le portant également à sept ans en cas de commission en bande organisée, sanction codifiée quant à elle à l'article L. 415-6 du code de l'environnement.
La France dispose ainsi d'un cadre de réponse pénal parmi les plus répressifs en Europe concernant le trafic d'espèces protégées. En effet, une évaluation a été faite, à la demande de la Commission européenne, de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 et a fait l'objet du dépôt d'un rapport le 28 octobre 2020. Selon ce rapport, les peines de prison encourues en France se situaient au-dessus de la médiane et les peines d'amende au niveau de la médiane des autres États membres.
Nous bénéficions ainsi d'un arsenal juridique particulièrement étoffé, qui vise à s'adapter à la diversité des biens appréhendables, reconnu au niveau international. Les sanctions pour l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées sont lourdes et visent à être dissuasives. Elles peuvent être de nature administrative, douanière ou pénale, le droit offrant un large éventail de sanctions, de la simple amende administrative à des peines de prison lourdes pour la criminalité organisée.
L'ensemble de ces dispositifs s'applique quelle que soit la nationalité des auteurs. Toutefois, s'agissant des faits du bas du spectre, le choix d'une transaction douanière semble être une réponse plus efficace à mettre en oeuvre pour les contrevenants d'habitude, dans la mesure où elle est appliquée dès le stade du contrôle et permet une application immédiate des amendes transactionnelles, plutôt que la voie judiciaire, longue à initier et à instruire, avec un magistrat qui statuera en pure perte, avec un contrevenant qui aura quitté depuis longtemps le territoire national.
Malgré cet édifice normatif robuste et progressivement renforcé, avec des importations illégales de viande de brousse ou d'espèces protégées susceptibles d'être punies jusqu'à 150 000 € d'amende et trois ans d'emprisonnement, la réponse judiciaire est cependant défaillante pour faire face aux importations illégales de viande de brousse. Les voyageurs le savent : certains trafiquants, qui font plusieurs aller-retours par semaine entre les pays d'approvisionnement de la viande de brousse et l'aéroport Charles de Gaulle, perpétuent leur trafic en toute impunité car ils se savent hors d'atteinte par le système de maintien de l'ordre. Certains trafiquants, redevables de plusieurs milliers d'euros d'amendes douanières, continuent leur trafic en toute impunité, sans jamais être inquiétés.
Le faible taux de poursuite des contrevenants par les autorités judiciaires n'encourage pas non plus les agents des douanes à entamer des procédures d'infractions, par ailleurs assez longues, si elles ont peu de chance d'être suivies d'effet. Les douaniers entendus par la mission d'information ont ainsi résumé leur sentiment vis-à-vis des mesures judiciaires susceptibles d'être activées : « la réponse judiciaire classique se révèle souvent trop lente, lourde et inadaptée face à des flux massifs et quotidiens d'infractions. Pour gagner en efficacité, il est essentiel de privilégier des procédures simplifiées, réactives et immédiatement applicables, incluant notamment des sanctions administratives automatiques dans les cas les plus courants » (Unsa Douanes).
La justice pénale spécialisée est en effet confrontée à plusieurs difficultés récurrentes et structurelles, telles que la carence des moyens d'enquête spécialisée ou la complexité des investigations à mettre en oeuvre pour ce type de faits, notamment au regard de leur dimension internationale. Ces freins sont de nature à entraver l'aboutissement des affaires dans des délais raisonnables, conditions d'une réponse pénale efficace.
En dépit des difficultés à qualifier un trafic qui n'est pas défini légalement en tant que tel, mais que l'on peut appréhender en retenant les faits de détention, de transport, d'importation, d'exportation, d'acquisition et de cession d'espèces animales protégées, la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a indiqué dans ses réponses au questionnaire du rapporteur que l'activité judiciaire pénale en matière de trafic d'espèces animales protégées a concerné entre 1 430 et 1 679 personnes chaque année entre 2021 et 202439(*).
Pour les espèces non protégées au titre de la Cites ou par le droit français, les poursuites judiciaires sont nettement plus rares, d'où le sentiment d'une certaine impunité pour les voyageurs concernés, la confiscation des produits faisant bien souvent office de sanction faute de moyens, de temps d'instruction ou de magistrats spécialisés, générant une forme de lassitude de la part des douaniers.
L'importance du nombre de voyageurs concernés, notamment selon les provenances de vols, ne permet pas d'apporter une réponse répressive systématique à tous les faits, tous les passagers ne pouvant être contrôlés, ce qui est de nature à amoindrir l'efficacité des réponses douanières et pénales puisque les auteurs peuvent compter sur cet aléa. Ce décalage entre la gravité des faits et la réponse judiciaire affaiblit considérablement l'effet dissuasif du droit. Il contribue également à l'invisibilité du problème dans l'opinion publique.
Le défi demeure d'assurer une réponse contentieuse pleinement cohérente et suffisamment dissuasive, en particulier face à un trafic international très lucratif et souvent lié à la criminalité organisée, mais également pour réduire significativement la masse des passagers qui transportent de petites quantités de produits carnés : ces flux incessants mobilisent en continu les moyens douaniers et les détournent des enjeux sanitaires et financiers les plus aigus, liés au trafic organisé par des réseaux criminels transnationaux.
La circulaire du 16 décembre 2013 relative au trafic d'espèces protégées40(*) insiste ainsi sur la nécessaire fermeté de la réponse pénale, dont elle détaille la mise en oeuvre, selon les typologies de faits. Cette circulaire, publiée à une époque où le phénomène était moins aigu, appelle à ce que ce contentieux fasse l'objet d'un traitement spécifique par le référent « environnement » du parquet, lequel doit s'attacher à être clairement identifié par l'ensemble des acteurs de la lutte contre ces trafics. Cette circulaire conseille notamment de proscrire la conclusion de transaction douanière dans le cas de comportements récidivistes, en énonçant que « les responsables des trafics organisés à grande échelle devront systématiquement faire l'objet de poursuites devant les tribunaux répressifs et de réquisitions empreintes de fermeté. Dans le montant des amendes requises, vous veillerez à prendre en compte, outre la situation économique de l'intéressé, la valeur des spécimens en cause dont l'estimation pourra apparaitre dans l'enquête initiale, ou en vous renseignant auprès des services spécialisés. »
La cohérence de la réponse pénale dépend également de la coordination de l'action de l'autorité judiciaire et des administrations compétentes. L'instauration récente, par un décret de septembre 202341(*), des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (Colden), constitue une avancée positive et encourageante. Cette instance a en effet pour vocation de favoriser l'échange d'informations et la prise de décisions coordonnées en matière de protection environnementale et de lutte contre ces trafics. Le pilotage opérationnel des Colden et la manière dont ces structures s'empareront de ces sujets seront déterminants pour le renforcement de l'efficacité de la lutte contre les trafics d'espèces sauvages.
Aujourd'hui, face aux flux en présence, la voie judiciaire n'est pas en mesure d'appréhender l'intégralité des faits et des infractions, ce qui n'est d'ailleurs pas souhaitable. En effet, au-delà des questions des capacités de contrôle permettant la découverte des faits, d'investigation par les services enquêteurs et de traitement judiciaire, de nombreux faits de faible intensité, tels que l'importation limitée de produits carnés dans le cadre d'une consommation personnelle, ne nécessitent pas la saisine d'une juridiction et trouvent une réponse bien plus efficace dès le stade de la constatation des faits, dans la mise en oeuvre d'une transaction douanière au moment du contrôle.
Le traitement douanier de ces constatations repose sur la mise en oeuvre de modalités appropriées de contrôle, permettant de différencier les faits en fonction de leur gravité, selon par exemple les quantités importées, la présence ou non d'espèces Cites ou les cas de récidive. Ces critères font régulièrement l'objet de protocoles entre les parquets généraux et l'administration des douanes, qui permettent d'articuler l'action des douanes et celle de l'autorité judiciaire et de proportionner la réponse douanière et judiciaire aux infractions constatées. Ces protocoles favorisent la mise en oeuvre d'une réponse administrative rapide et efficace pour les faits du bas du spectre, qui constituent la plus grande masse de ce contentieux, comme l'importation de petites quantités de viande d'espèces non protégées, ce qui permet de privilégier la mobilisation des services d'enquêtes voire des services spécialisés et la réponse judiciaire pour les affaires les plus graves et complexes.
S'agissant des faits du bas du spectre, la majorité des constatations font l'objet d'une réponse douanière consistant en un dessaisissement des marchandises et à l'application, le cas échéant, d'une amende douanière prononcée dans le cadre d'une transaction douanière, qui permet un recouvrement immédiat des sommes42(*). La transaction douanière impose à l'infracteur de s'acquitter d'une amende dite « transactionnelle » après abandon des spécimens saisis, faisant ainsi cesser les poursuites. Des seuils peuvent être fixés au préalable avec les parquets pour savoir jusqu'à quel nombre de spécimens une transaction peut être accordée. Au-delà de ces seuils ou en l'absence de ceux-ci, le parquet sera informé de la saisie afin de décider des suites à donner.
Tout efficace que soit cette procédure, elle est néanmoins longue et complexe à mettre en oeuvre dans l'espace confiné réservé aux contrôles douaniers situé dans l'enceinte aéroportuaire, au sortir de vols transportant plusieurs centaines de passagers dont une proportion significative des bagages contient des marchandises prohibées. Du fait des contraintes procédurales pesant sur l'édiction des amendes douanières, ces constatations incessantes ne peuvent se transformer en sanction s'appliquant à tous les passagers contrevenants.
Il est également malaisé pour les douaniers de déterminer un montant d'amende à la hauteur des bénéfices générés par ce commerce illicite et des risques sanitaires et environnementaux qu'il engendre. La mission estime en effet que le quantum des peines doit mieux refléter la réalité des différentes menaces que ce trafic fait peser, afin de réduire les flux et concentrer les moyens douaniers sur les trafics structurés mis en oeuvre par des réseaux transnationaux.
De nombreux acteurs entendus par le rapporteur estiment en définitive que les juridictions françaises disposent d'un arsenal juridique complet et adapté, permettant de répondre de manière cohérente et efficace aux enjeux de la criminalité environnementale transnationale dans sa globalité, même si l'édiction des sanctions et la perception des amendes prévues pour le trafic de viande de brousse pourraient être simplifiées.
Les difficultés ne tiennent pas à la norme en elle-même, mais découlent de la manière dont elle est mise en oeuvre par des juridictions engorgées, qui doivent par ailleurs répondre à de multiples priorités pénales. Pour cette raison, les évolutions les plus transformatrices dans la lutte contre ce trafic ne seront pas de nature législative ni judiciaire, mais sont plutôt à chercher du côté du renforcement des moyens douaniers et de la coopération inter-services et internationale.
4. Une criminalité transnationale complexe à appréhender dont la lutte requiert une prise de conscience internationale et un cadre renforcé de coopération
La dernière difficulté sur laquelle achoppent les autorités françaises pour lutter efficacement contre le trafic d'espèces protégées tient à l'organisation et à la structuration des réseaux criminels transnationaux qui se livrent à cette activité criminelle : ils mettent en oeuvre des modes opératoires agiles, qui s'enchevêtrent avec d'autres trafics et mobilisent des moyens humains significatifs, des « mules » aux têtes de réseau. Le recours à des chaînes logistiques complexes met bien souvent en échec les capacités de détection douanière : Interpol estime ainsi que seuls 10 à 15 % du trafic d'espèces sauvages serait intercepté, ce qui paraît une fourchette optimiste d'après les dires des acteurs de terrain et scientifiques entendus.
Ce trafic est malaisé à appréhender et à cartographier, dans la mesure où il peut revêtir des formes multiples, avec des organisations aussi bien individuelles que familiales, mais également mafieuses. La profitabilité et les risques encourus par les trafiquants expliquent que les réseaux aient investi ce segment criminel et perfectionné leurs modes opératoires. Le trafic d'espèces sauvages est de plus en plus souvent le fait de réseaux criminels organisés, sophistiqués et adaptables : ils utilisent des techniques de dissimulation élaborées, corrompent parfois des agents, et exploitent les failles des systèmes de contrôle. La direction générale des douanes et d'autres experts ont signalé à la mission d'information que plusieurs tendances indiquent un glissement progressif d'un marché de niche vers un phénomène criminel plus diffus, mondialisé et difficile à endiguer, ce qu'illustrent notamment les opérations coups de poing coordonnées au niveau international par l'Organisation mondiale des douanes (OMD).
Les opérations Thunder, des coups
de filet instructifs
sur les dynamiques et les modalités du trafic
d'espèces sauvages
Lancée en 2017, sous le nom Opération Thunderbird puis Thunderstorm et enfin Thunder, cette initiative vise à lutter contre le commerce illégal et la criminalité transnationale liée à la faune et à la flore sauvage, ainsi que la récolte illégale et le braconnage. Cette opération a aussi été conçue dans le but de permettre aux pays participants de tester et d'améliorer leurs capacités organisationnelles, leurs méthodes et le partage de renseignements entre les différents services au niveau national et international. Lors des dernières éditions, plus de 130 pays ont participé à l'opération Thunder.
Cette initiative est portée conjointement par Interpol et l'OMD, en réponse au constat des Nations Unies qui mettait en avant l'essor et la structuration internationale de la criminalité environnementale, notamment en raison du fait qu'elle se singularise par une balance coût-bénéfice plus avantageuse face aux sanctions pénales que d'autres formes de criminalité.
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects
Ces opérations sont devenues une initiative annuelle majeure en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et au bois, qui met en lumière les enjeux afférents à ces trafics et mobilise des milliers de fonctionnaires des douanes, de la police, de la faune et de l'environnement à travers le monde. Les premières opérations, baptisées Thunderbird, avaient un champ plus restreint, se focalisant sur le trafic d'oiseaux. À compter de 2019, le champ de recherche et d'intervention s'est progressivement élargi au contrôle et au transit de l'ensemble des espèces sauvages.
L'approche collaborative de cette opération permet de lutter plus efficacement contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts en favorisant le développement des enquêtes sur les affaires, de la saisie aux poursuites judiciaires. La coopération douanière et les échanges de renseignements lors de l'opération Thunder avec l'ensemble des acteurs internationaux comme l'OMD, Interpol, Europol et nationaux (OFB, Gendarmerie) permet d'affiner les méthodes et les modalités de coopération nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre ces trafics.
En dehors des bénéfices directs de cette opération spécifique, la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a indiqué à la mission d'information que l'opération Thunder a permis le développement d'autres coopérations interservices permettant de mener à bien des opérations synchronisées en métropole, en outre-mer et entre les différents pays afin d'identifier les filières (exemple des civelles), intercepter des flux et de démanteler les réseaux ou poursuivre les trafiquants.
L'ICCWC estimant que la majeure partie des affaires sont liées à des réseaux transnationaux de mieux en mieux structurés qui peuvent financer d'autres formes de criminalité notamment grâce au blanchiment, cela démontre la nécessité de la coopération transversale et internationale afin de dépasser le cadre des simples saisies pour pouvoir remonter les filières. Suivant les flux et les espèces, certains services vont pouvoir agir sur le trafic en coupant la demande, d'autres en agissant sur l'offre, certains pour interrompre les routes empruntées.
Source : Solidaires Douanes
Les opérations Thunder démontrent que, face à un trafic globalisé, la réponse doit être coordonnée. La coopération douanière et l'échange d'informations sont des leviers essentiels à renforcer : ciblage des flux suspects, actions synchronisées, partage en temps réel des données Cites et création d'unités mixtes pérennes, autant de moyens à l'efficacité prouvée pour entraver les trafics d'espèces sauvages et tarir les flux.
Les pays sont confrontés à des défis de taille dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages en raison de la complexité et de l'ampleur des réseaux de trafic impliqués. Les trafiquants utilisent des méthodes de dissimulation de plus en plus sophistiquées, telles que des compartiments secrets dans les cargaisons, des étiquettes trompeuses ou de faux permis Cites, ce qui complique la détection. Les volumes colossaux du commerce et les ressources limitées, notamment le manque de main-d'oeuvre, de technologies de scan avancées et de capacités médico-légales, entravent les efforts de répression. De plus, la corruption et la faiblesse des cadres juridiques des pays sources permettent aux trafiquants d'exploiter les failles, d'échapper aux poursuites et d'utiliser les capacités de transports publics de voyageurs.
Si les vecteurs aériens et maritimes sont connus et documentés, tous les vecteurs sont utilisés, le trafic par colis express ou postaux connaissant une progression constante, dont la détection constitue un véritable défi pour les autorités douanières. Ces évolutions s'expliquent par la nature même des produits trafiqués : plus une espèce est menacée et difficile à obtenir légalement, plus sa valeur est élevée sur le marché illégal et plus désirable est sa possession pour les collectionneurs. Certains spécimens sont considérés comme des investissements, générant une spéculation qui alimente une forte demande et incite les réseaux criminels à y répondre en mettant en oeuvre des filières logistiques intégrées, depuis les pays sources jusqu'aux pays de destination.
Face à un trafic dont la demande s'internationalise et qui repose de plus en plus fréquemment sur des réseaux criminels fortement dotés en moyens logistiques et humains, la mission d'information constate plusieurs carences de l'action publique, qui l'amèneront à formuler au cours des pages qui suivront plusieurs pistes d'amélioration pour y remédier :
- le défi de renforcer les capacités de détection douanière dans un contexte de progression marqué du transport aérien ;
- l'enjeu de faire progresser l'information et la sensibilisation des voyageurs aux risques sanitaires et aux interdictions d'emports d'espèces protégées et de produits carnés ;
- la nécessité de mettre en oeuvre des sanctions dissuasives et proportionnées qui permettront de tarir les flux carnés non criminels qui embolisent les contrôles douaniers ;
- et le développement d'une coopération internationale renforcée pour contrer les réseaux transnationaux qui font prospérer un trafic porteur de nombreux risques pour la santé humaine et animale, la biodiversité et le commerce légal.
II. RÉDUIRE LE TRAFIC EN INVERSANT L'APPROCHE : PASSER D'UNE LOGIQUE D'INTERCEPTION À DES ACTIONS FONDÉES SUR LA PRÉVENTION, LA SENSIBILISATION ET LA COOPÉRATION
A. UN CADRE NORMATIF INSUFFISAMMENT DISSUASIF ET AGILE
Comme cela vient d'être montré, le trafic d'espèces protégées et de produits carnés a pris des dimensions inédites suite à sa massification et sa professionnalisation, voire son industrialisation : le cadre international élaboré il y a plus de cinquante ans montre de plus en plus ses limites pour répondre aux nombreux défis sanitaires, environnementaux et judiciaires. Il est vain d'espérer lutter efficacement contre ce trafic à cadre multilatéral et normatif constant, sans prise de confiance renforcée des enjeux et en n'accentuant pas significativement l'information et la sensibilisation des passagers aériens.
S'il existe plusieurs instruments internationaux en matière de protection des espèces sauvages et de l'environnement au sens large, ceux-ci se concentrent essentiellement sur le commerce légal ou sur la prévention et la gestion des risques, plutôt que sur l'incrimination et la répression d'activités illégales. Ils n'ont pas été conçus dans le but de réprimer et de mettre fin aux trafics, pas plus qu'ils ne structurent la coopération, laissant le soin aux autorités nationales d'animer la lutte et d'apporter les réponses judiciaires adéquates, territoire par territoire.
Cette approche, novatrice au moment de sa conception mais aujourd'hui notoirement insuffisante, n'est plus adaptée aux formes nouvelles, au dynamisme et aux risques qui caractérisent ce trafic.
1. Les conventions et organisations internationales, des outils à parfaire pour renforcer les moyens de la lutte
Outre les instruments encadrant spécifiquement la circulation et le commerce des espèces protégées et des produits carnés, présentés ci-après, plusieurs outils de droit international ont été forgés afin d'élaborer des objectifs et un cadre d'action en matière de réduction des flux criminels illégaux.
Ainsi de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée, signée en décembre 2000 afin de renforcer la lutte et la coordination des efforts contre le crime organisé, qui vise selon les termes de son article 1er à « promouvoir la coopération afin de prévenir et combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée », en partant du principe que si la criminalité traverse les frontières, la répression doit aussi les traverser. On peut également mentionner d'autres textes internationaux, comme la Convention des Nations unies contre la corruption, dite Convention de Merida de 2003, instrument qui met en oeuvre un cadre d'action contre toutes les formes de criminalité, fournissant à ce titre une réponse non-spécifique au trafic d'espèces sauvages.
On peut également citer la Convention sur la diversité biologique de 1992, dont l'objectif repose sur la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité : si l'arrêt de l'extinction d'espèces causée par les activités humaines constitue l'un de ses objectifs - repris par le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal qui promeut un commerce des espèces sauvages durable, sûr et légal -, elle ne comporte cependant pas de dispositions dédiées à la pénalisation du trafic d'espèces protégées.
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), dite aussi Convention de Bonn de 1979, prend également en compte une dimension transnationale, mais son périmètre couvre insuffisamment les espèces sauvages concernées par le trafic. Ces instruments transversaux de droit international peuvent ponctuellement être mobilisés dans le cadre de la lutte contre le trafic d'espèces protégées, mais ils ne permettent pas de répondre de façon complète à l'ensemble des dimensions et des enjeux de trafic, n'ayant pas été élaborés à cette fin.
Ceci explique que les autorités nationales s'appuient principalement sur l'instrument spécifiquement dédié à la prise en compte de cette problématique, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites), dite Convention de Washington de 1973.
a) La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites), un outil performant pour encadrer le commerce légal mais indigent pour lutter contre les trafics
Signée le 3 mars 1973, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites), dite Convention de Washington, vise à encadrer strictement le commerce international des espèces menacées à travers des mécanismes de contrôle, fondés sur la limitation et l'interdiction de leur importation et exportation. Les dispositions de cet accord intergouvernemental, qui compte 184 États Parties, dont la France43(*) et l'Union européenne, s'appliquent aux 40 000 espèces animales et végétales inscrites dans ses Annexes, vivantes ou mortes, entières ou non, ainsi qu'aux objets et produits qui en sont obtenus. Cette régulation a été conçue pour prévenir la surexploitation tout en permettant un commerce légal et durable dans un cadre sécurisé, sans nuire à la biodiversité et aux écosystèmes.
Cet accord international vise à garantir que le commerce international de spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas leur survie, en fixant un cadre juridique et une série de procédures, la plus emblématique étant l'instauration d'un système de permis et de certificats qui doivent être vérifiés par les autorités douanières aux frontières, garantissant ainsi une traçabilité et un contrôle du commerce légal. Pour ce faire, la Cites est fondée sur un système d'Annexes, répertoriant environ 40 000 espèces animales et végétales et réglementant leur passage en frontières : le commerce des espèces en Annexe I est interdit, tandis que le commerce des espèces en Annexes II et III est encadré.
Ce classement des espèces protégées est susceptible d'évoluer dans le temps : la Conférence des Parties (COP), qui se tient tous les deux à trois ans44(*), permet de réviser les listes d'espèces protégées et d'en inscrire de nouvelles, adaptant ainsi la Convention aux évolutions du trafic et aux besoins de conservation. La complexité des mécanismes décisionnels propres au système de la Conférence des Parties et les lenteurs procédurales de modification des Annexes de la Cites sont cependant susceptibles d'entraîner des retards préoccupants dans la protection des espèces les plus vulnérables : compte tenu des menaces multifactorielles qui pèsent sur ces espèces ainsi que des capacités limitées de recherche à leur égard, un risque réel existe qu'elles disparaissent avant même de pouvoir bénéficier de la protection de la Cites.
Pour fonctionner correctement, la Cites suppose une étroite coopération entre le pays exportateur, qui contrôle à travers un système de permis les prélèvements sur son territoire et garantit leur caractère non préjudiciable à l'espèce considérée, et le pays importateur des spécimens, qui n'accepte sur son territoire que ce qui a été exporté légalement par le pays de provenance, avec les garanties environnementales qu'apporte la Cites. Ses articles II et VIII imposent aux États qui sont Parties à la Convention de ne pas faire le commerce d'espèces inscrites si ce n'est conformément à la Convention, à prendre des mesures appropriées pour appliquer la Convention et d'interdire le commerce de spécimens qui viole la Convention, y compris en sanctionnant ce commerce.
Le bon fonctionnement et la coordination des Parties à la Convention repose sur un secrétariat dédié, siégeant à Genève et administré par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Cette instance offre notamment l'avantage de compiler et d'agréger des données au sein de la base de données commerciale de la Cites45(*), alimentée par les rapports annuels des Parties depuis 1975, qui regroupe près de 23 millions d'enregistrements sur le commerce international des espèces protégées. Gérée par le Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature (Unep-WCMC) pour le compte du Secrétariat de la Cites, elle garantit la collecte continue de données fiables et actualisées sur le commerce d'espèces protégées : cette obligation de reporting permet d'identifier les tendances et flux commerciaux, de détecter les pratiques illicites et d'adapter les mesures de contrôle, renforçant ainsi la lutte contre le trafic d'espèces protégées.
Cette base de données constitue un outil puissant qui permet aux informations sur le commerce illégal de devenir une ressource accessible et précieuse pour les Parties à la Cites. Elle contient des données sur les saisies individuelles, notamment les quantités saisies, les itinéraires de trafic, les taxons, les modes de transport. Ces données peuvent éclairer la prise de décision et les réponses fondées sur des preuves pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, tout en soutenant la recherche et la compréhension de ce type de criminalité.
La France est attachée à son adhésion à la Cites : elle est, en valeur, la sixième contributrice financière à la Convention et a organisé la 74e session du Comité Permanent de la Cites à Lyon, en mars 2022. Elle fait régulièrement des propositions d'inscription d'espèces (concombres de mer, requins...). Cette implication s'inscrit aussi dans son engagement dans la lutte contre la criminalité environnementale, à travers notamment son soutien au Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, créé par la Cites46(*).
La douane et les contrôles en matière de contrôle Cites
En tout point du territoire national, les agents des douanes peuvent contrôler la régularité de la détention ou de la circulation de marchandises, en application de l'article 215 du code des douanes (CD). Les douaniers sont ainsi compétents pour mener à bien tout contrôle au titre de la Cites sur l'ensemble du territoire et disposent à cette fin de pouvoirs adaptés :
- aux points d'entrée ou de sortie du territoire national et à la circulation intérieure, la douane dispose d'un pouvoir général de contrôle des personnes, de leur bagage, des véhicules et des marchandises (article 60 CD, dans les conditions prévues à l'article 60 et aux articles 60-1 à 60-10) ;
- en zone internationale, lors de transbordements (article 60-4 CD) ;
- dans les locaux professionnels (article 63 ter CD) ;
- dans les locaux des prestataires de services postaux (article 66 CD) ;
- chez les particuliers (article 64 CD) ;
- en mer (articles 62 et 63 CD) - la douane dispose d'unités spécialisées, garde-côtes et brigades de surveillance nautique, pour réaliser ces contrôles en mer et dans les ports.
Les douaniers disposent de pouvoirs d'investigation, tels que les livraisons surveillées ou les coups d'achat (articles 67 bis-I et 67 bis-4), techniques particulièrement performantes pour la recherche des infractions à la Cites.
L'Office national antifraude (Onaf), service de police judiciaire, conduit des enquêtes judiciaires afin d'identifier et de démanteler les réseaux organisés, y compris à l'international, en ayant la faculté de saisir les avoirs criminels issus de ces trafics. L'Onaf est fortement impliqué dans la lutte contre le trafic international de civelles. En 2024, un observatoire de la criminalité environnementale a également été créé au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour mieux appréhender les multiples facettes de ces trafics.
Pour compléter le dispositif national de contrôle de circulation des espèces protégées, la DGDDI est dotée d'un réseau de douaniers référents en matière d'espèces protégées, afin de faciliter le partage d'informations et de bonnes pratiques au sein du maillage territorial de la douane. Ce réseau apporte une première expertise sur le spécimen contrôlé et un appui aux agents chargés des contrôles. Cette expertise peut être complétée par des rapports d'analyse ou d'identification des spécimens délivrés par le Service commun des laboratoires ou par le Museum national d'histoire naturelle.
Malgré tout son intérêt, la Cites se caractérise par plusieurs limites : si son objectif premier consiste à réguler le commerce légal international des espèces menacées d'extinction, elle n'a pas expressément pour objectif de pénaliser les trafics d'espèces ni de fédérer la lutte contre ce trafic au niveau international. Bien que son article 8, paragraphe 1, prévoie que les Parties à la Cites prennent des sanctions pénales frappant soit le commerce illégal, soit la détention illégale de spécimens, ou les deux, cette Convention n'instaure pas les modalités ni les formes que doivent prendre les mesures de pénalisation des trafics d'espèces. Elle ne fonde pas de cadre pour l'entraide pénale ou l'organisation d'enquêtes conjointes, pas plus qu'elle ne facilite la coopération douanière et judiciaire pour démanteler des réseaux criminels organisés.
Par ailleurs, la Cites prend insuffisamment en compte la dimension nationale et transnationale des trafics d'espèces sauvages et ne porte pas sur l'ensemble des espèces sauvages menacées par les trafics, les espèces répertoriées au sein de ses annexes couvrant moins d'un pourcent de l'ensemble des espèces sauvages connues. De plus, le système de permis Cites est susceptible d'être détourné par les trafiquants pour blanchir des animaux vivants et des parties de leur corps provenant de sources illégales dans le commerce.
En outre, la bonne application de la Convention de Washington dépend de la bonne volonté des États, d'autant que le cadre de la Cites ne permet pas de répondre à lui seul à la problématique d'importation illicite de produits carnés, puisque selon les indications fournies au rapporteur par les douanes, seuls 15 à 20 % de ces derniers seraient issus d'espèces inscrites à la Cites.
Ainsi, la portée de la Convention de Washington est limitée par la couverture lacunaire des espèces concernées - seules sont protégées celles qui sont listées au sein des Annexes -, l'appropriation et la mise en oeuvre des mécanismes de la Convention très inégales entre pays, l'absence de mécanismes contraignants en cas de non-application et un manque d'articulation avec les autres enjeux liés au trafic, notamment la criminalité organisée ou les risques sanitaires.
Il serait opportun, dans un premier temps, d'oeuvrer au renforcement des outils de suivi, de sanction et d'assistance technique par le Secrétariat de la Cites et dans le cadre de la coopération internationale, notamment aux États qui sont aux premières lignes du trafic et qui ne sont pas en mesure de mobiliser des moyens douaniers et judiciaires suffisants.
b) Le Règlement sanitaire international, une approche fondée sur le risque inopérante face aux flux illégaux d'espèces sauvages
Révisé en 2005 et adopté par 196 États, le Règlement sanitaire international (RSI) de l'Organisation mondiale de la santé est un instrument de droit international qui définit le cadre juridique international pour prévenir la propagation internationale des maladies. Il vise notamment à mettre en oeuvre un réseau d'alerte et de réponse en matière de crises sanitaires, en couvrant les maladies infectieuses, mais aussi tout événement susceptibles d'avoir des conséquences sanitaires internationales.
Seul instrument international juridiquement contraignant en matière de sécurité sanitaire, l'objectif du RSI est de prévenir la propagation mondiale des maladies infectieuses et des menaces sanitaires dans un contexte de développement continu des voyages et des échanges commerciaux internationaux, tout en limitant les entraves au trafic international. L'objet et la portée du RSI, définis à son article 2, consistent à « prévenir la propagation internationale des maladies, à s'en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. »
La ratification du Règlement sanitaire international emporte notamment l'obligation, pour les États Parties, de développer des capacités essentielles minimales en santé publique, de notifier à l'OMS les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale et d'apporter un soutien aux pays en développement et aux pays à économie en transition pour l'acquisition, le renforcement et le maintien des capacités de santé publique.
Le RSI permet théoriquement de couvrir les menaces issues du trafic d'animaux sauvages et d'espèces protégées : il oblige en effet les États Parties à détecter, évaluer, notifier et rendre compte des événements de santé publique qui peuvent constituer une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), y compris les épidémies de zoonoses, même s'il ne les mentionne pas explicitement et n'intègre pas les dimensions de criminalité environnementale ou de biodiversité.
Bien qu'il ne cible pas le trafic d'espèces sauvages et n'aborde pas la question de l'import de produits animaux par les individus, le RSI constitue néanmoins un instrument de droit international crucial pour la gestion des risques sanitaires que ce trafic peut générer. Il fournit en effet un cadre pour la surveillance, la notification et la réponse aux événements sanitaires internationaux, y compris les maladies zoonotiques qui peuvent être transmises par la viande de brousse. Le RSI promeut une approche intégrée qui reconnaît l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale, ce qui est un préalable indispensable pour lutter préventivement et efficacement contre les maladies zoonotiques.
Les dispositions du RSI prévoient la préparation des points d'entrée pour la prise en charge d'animaux au statut sanitaire incertain, mais il est muet sur le contrôle vétérinaire à mettre en oeuvre dans ce cadre. Sa mise en oeuvre en droit interne a donné lieu, par l'effet des dispositions de l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 201747(*), à deux types d'infractions délictuelles au sein du code de la santé publique, aux articles L. 3116-5 et L. 3116-6 : l'altération ou la dissimulation de fait dont la révélation est obligatoire en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies et la non déclaration par négligence de fait dont la révélation est obligatoire en matière de lutte contre la propagation de maladies. Ces deux types d'infraction ne sont cependant pas mobilisables pour réprimer des faits de trafic d'espèces animales protégées.
Pour répondre aux enjeux sanitaires du trafic d'espèces sauvages, la Convention de Washington et le RSI constituent deux cadres complémentaires mais cloisonnés, avec de nombreux angles morts sur les aspects criminels, logistiques et transversaux du trafic. Bien que le RSI couvre théoriquement les zoonoses, il ne met en oeuvre aucune disposition ou directive spécifique pour faire face aux risques sanitaires liés au commerce illégal d'espèces sauvages. Il fait par ailleurs reposer l'effort de prévention et de répression sur les États, sans élaborer de cadre commun ni favoriser la prise en compte des enjeux et des menaces spécifiques à ce commerce illégal.
c) Le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC)
Le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages ou ICCWC (International Consortium on Combating Wildlife Crime) vise à apporter un soutien coordonné aux agences nationales de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages et aux réseaux sous-régionaux et régionaux qui agissent au quotidien pour la défense des ressources naturelles.
Il consiste en un partenariat collaboratif entre cinq organisations intergouvernementales ayant des mandats complémentaires et spécialisés, afin de renforcer les systèmes de justice pénale et à développer les capacités à long terme des autorités pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Les agences composant l'ICCWC sont le Secrétariat de la Cites, l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD).
Créé en novembre 2010, le Consortium fournit une gamme complète d'outils et de services, en collaboration avec les autorités de la chaîne de justice pénale, afin de les aider à prévenir, détecter, enquêter, poursuivre, perturber et traiter de manière efficace les crimes contre la faune et la flore sauvages et les forêts. Le Consortium promeut et soutient les interventions fondées sur la science et l'expertise, fournit une assistance opérationnelle et technique ciblée et dispense des formations complètes. Ces actions sont menées en fonction des besoins et des priorités identifiés ou des demandes reçues.
Le Consortium regroupe également diverses plateformes pour la coordination d'activités et d'opérations visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. À cette fin, il a élaboré en 2018 un Guide sur la rédaction de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages48(*) ayant pour objectif d'aider les Parties à protéger les espèces sauvages en criminalisant les infractions graves liées à ces espèces, renforçant ainsi les capacités des Parties en matière de poursuites et de justice pénale. Ce guide est conçu comme un outil d'assistance technique destiné à aider les Parties à réviser et à modifier la législation existante et à adopter des outils réglementaires mieux calibrés pour faire face à la criminalité liée aux espèces sauvages.
Le Consortium met également à disposition des États une boîte à outils analytique sur la criminalité liée aux espèces sauvages, permettant une analyse complète de leur réponse à la criminalité liée aux espèces sauvages et l'identification de leurs besoins en matière d'assistance technique. Conçu comme un outil d'auto-évaluation, ce dispositif repose sur un ensemble de 50 indicateurs organisés autour de huit résultats souhaités en matière d'application efficace du cadre législatif de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages49(*).
En novembre 2022, lors de la COP19 Cites au Panama, la Vision 2030 de l'ICCWC a été adoptée, avec cinq objectifs principaux en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages :
a) réduire les possibilités de criminalité liée aux espèces sauvages ;
b) renforcer la dissuasion contre la criminalité liée aux espèces sauvages ;
c) améliorer la détection de la criminalité liée aux espèces sauvages ;
d) renforcer la perturbation et la détention des criminels ;
e) mener des actions fondées sur des preuves, échanger des connaissances et collaborer, afin d'atteindre les quatre premiers objectifs et de renforcer l'impact de l'ICCWC.
La mission d'information souligne l'intérêt de cette plateforme en matière de prise de conscience et de mise à disposition de connaissances, qui permet aux États de mieux identifier les enjeux et les réponses adéquates, d'évaluer l'efficacité des mesures mises en oeuvre au niveau national et d'initier une démarche de progrès continu en bénéficiant d'une expertise de pointe mise à la disposition de l'administration et des agences nationales. Il s'agit d'une première étape vers une réponse internationale mieux coordonnée et un cadre unifié de réponse et de répression face à une criminalité transnationale dont les enjeux sanitaires concernent un grand nombre d'États, au regard de la propagation potentielle des zoonoses.
d) L'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA)
L'Organisation mondiale de la santé animale (Omsa) constitue depuis plus d'un siècle l'organisation intergouvernementale de référence en matière de santé animale. Fondée en 1924 sous le nom d'Office international des épizooties (OIE) afin de faire face à une épidémie mondiale de peste bovine qui décimait le bétail, cette organisation fédérant aujourd'hui 183 membres et siégeant à Paris a pris en 2003 l'appellation d'Organisation mondiale de la santé animale. Elle s'attache notamment à la diffusion d'informations scientifiques vétérinaires relatives aux maladies animales infectieuses, à la coordination de la réponse mondiale face aux urgences en matière de santé animale afin de limiter leur impact négatif pour la société et à l'amélioration de la santé animale à l'échelle mondiale.
L'Omsa est un organisme de normalisation reconnu par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (dit « Accord SPS »), un traité de l'Organisation mondial du commerce (OMC) entré en vigueur en 1995 servant de cadre multilatéral de règles et disciplines pour orienter l'élaboration, l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de favoriser l'utilisation de référentiels harmonisés entre les Membres et de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce.
À ce titre, l'Omsa est compétente pour élaborer des normes internationales qui sont reconnues par l'OMC pour les litiges relatifs à l'Accord SPS et visant à la gestion du risque de propagation de maladies lié à la commercialisation des animaux ou de leurs produits, à l'exclusion des risques de sécurité sanitaire des aliments liés à la consommation des produits, qui sont couverts par le Codex Alimentarius.
Lors de son audition, l'Omsa a indiqué avoir publié en 2024 des lignes directrices spécifiques aux risques de maladies dans le cadre du commerce de faune sauvage50(*), ainsi qu'un guide sur la méthode d'évaluation du risque que des espèces deviennent invasives51(*).
Ces publications recommandent notamment de promouvoir l'approche « Une seule santé », « impliquant un travail en collaboration entre les secteurs de la santé humaine, animale et de l'environnement afin de s'assurer que tous les aspects sont pris en considération, notamment la conservation de la biodiversité, le bien-être animal, les réglementations nationales et internationales ayant trait aux espèces menacées et en voie de disparition, et la réduction du risque concernant la santé humaine et la santé animale » et de procéder à des analyses de risques approfondies visant à réduire le risque de transmission de maladies sur les marchés de faune sauvage et tout au long de la chaîne d'approvisionnement de ces espèces, « qui prennent en compte le bien-être animal, le risque en matière de santé, le risque en matière de conservation et le risque pour les valeurs socio-économiques, puis identifier des mesures proportionnées de gestion ou de réduction du risque ». La mission d'information souligne l'intérêt de ces publications, en ce qu'elles favorisent la prise de conscience et mettent l'accent sur les risques sanitaires et environnementaux liés au commerce de la faune sauvage, tout en proposant un répertoire de bonnes pratiques et en signalant les vigilances à mettre en oeuvre par les autorités sanitaires.
Le rapporteur relève que les structures intergouvernementales et les accords internationaux permettant de répondre aux enjeux posés par ce trafic d'espèces sauvages existent déjà : plutôt que dupliquer ou spécialiser des structures dont le champ d'intervention est plus large, il recommande de renforcer leur audience, de favoriser la diffusion des recommandations qu'elles édictent auprès des acteurs pertinents et d'inciter au développement de mécanismes de coopération douanière et judiciaire entre États.
2. Les textes européens et le plan d'action de l'Union européenne contre le trafic des espèces sauvages, un édifice non-contraignant dont les États membres doivent s'emparer
a) Les textes encadrant le transport et le commerce d'espèces protégées et de produits carnés
Les États membres de l'Union européenne appliquent un corpus de règlements déclinant la Convention de Washington encadrant la circulation et le commerce des espèces protégées sur le territoire européen, de même qu'ils veillent au respect de l'interdiction de l'entrée sur le territoire européen des produits carnés d'espèces non protégées, au sens de la Cites, par les voyageurs en provenance de pays tiers à l'Union européenne.
Ces textes normatifs et les orientations qui en découlent font office de socle règlementaire pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages au niveau européen, en se fondant sur une interdiction de principe visant à limiter les risques sanitaires que feraient peser ces entrées d'espèces animales non soumises à certification d'hygiène et vétérinaire sur la santé humaine et animale européenne. Cette approche est complétée par le cadre analytique et les outils mis en oeuvre par la Cites quand les espèces font l'objet d'une protection en vertu de cette convention internationale. Pour rappel, ce régime s'applique aussi bien aux spécimens d'espèces animales et végétales, morts ou vivants, qu'à des parties et à leurs produits dérivés, tel que l'ivoire.
En premier lieu, le règlement (UE) 2019/212252(*) pose le principe de l'interdiction d'entrée sur le territoire européen, dans les bagages des voyageurs, de toute viande, produit à base de viande et produits laitiers provenant de pays tiers à l'Union européenne, sauf exceptions mineures, notamment le poisson éviscéré, le miel et les aliments pour nourrissons. C'est en application de ce règlement que l'importation de produits carnés, provenant ou non d'espèces protégées, est illégale.
Cette interdiction, fondée sur le fait que les produits d'origine animale peuvent véhiculer des agents pathogènes causant des maladies infectieuses, vise à prévenir l'introduction de maladies animales graves (peste porcine africaine, fièvre aphteuse, grippe aviaire, etc.) aux conséquences dévastatrices sur l'élevage et la santé humaine. Il s'agit du texte de référence au niveau européen pour fonder la réponse en matière de lutte contre l'importation illégale de viande de brousse. Ce même règlement impose également que tous les produits animaux non conformes aux règles qu'il fixe sont remis à l'arrivée dans l'Union européenne en vue de leur élimination officielle.
En second lieu, ce qui concerne les espèces animales et végétales protégées au titre de la Cites, la Convention de Washington a progressivement été déclinée à l'échelle de l'Union par une succession de règlements européens. L'architecture normative européenne actuellement en vigueur est principalement constituée des textes suivants53(*) :
- les règlements qui harmonisent et renforcent l'application de la Cites sur le territoire de l'Union européenne : le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dit « règlement de base », et le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97, dit « règlement de mise en oeuvre » ;
- le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. Le règlement (CE) n° 853/2004 impose quant à lui des exigences d'hygiène strictes en matière de production, de transformation et de commercialisation pour garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires d'origine animale ;
- la directive européenne n° 2024/1203, adoptée le 20 mai 2024, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, qui a remplacé la directive 2008/99/CE, et inclut la lutte contre le trafic d'espèces sauvages. Elle créé de nouvelles infractions (trafic de bois, recyclage illégal de composants polluants de navires...), notamment pour les actes intentionnels de destruction environnementale irréversible ou à long terme, et renforce certaines sanctions. Elle prévoit notamment à l'article 3 que les États membres doivent veiller à ce que constitue une infraction pénale le commerce illicite d'un spécimen ou de plusieurs spécimens, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens d'une espèce de faune sauvage inscrite aux annexes du règlement (CE) n° 338/97 précité. Sa transposition en droit interne doit intervenir d'ici mai 2026 et les États ont jusqu'à mai 2027 pour établir une stratégie nationale de lutte contre les infractions pénales environnementales (article 21).
Toutes les espèces inscrites à la Cites sont reprises dans l'une des quatre annexes du règlement (CE) n° 338/97 susmentionné : les annexes A, B, C et D, selon le degré de protection applicable. À ce titre, leur commerce est soit interdit, pour les espèces inscrites en annexe A, soit soumis à des conditions de régulation pour les annexes B, C et D. Le commerce de ces dernières est soumis à la présentation à l'importation ou à l'exportation d'un permis ou d'un certificat délivré à la demande des opérateurs ou des particuliers sur l'application54(*) « i-Cites ». Ces demandes sont instruites en France par les Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). À titre d'illustration, 163 000 documents Cites ont été émis en France en 2023, dont 75 % pour des produits en cuir.
La réglementation européenne est plus contraignante que celle prévue par la convention internationale, laquelle classe les espèces en trois annexes distinctes : I, II et III, en fonction du niveau de protection applicable. Le règlement (CE) n° 338/97 en prévoit quant à lui quatre (A, B, C et D), avec des annexes spécifiques incluant des espèces non listées Cites mais menacées à l'échelle de l'UE55(*). En d'autres termes, cette réglementation permet l'interdiction unilatérale d'importation de certaines espèces depuis des pays tiers et rend possible l'interdiction du commerce intra-européen pour des espèces sensibles.
Plusieurs acteurs ont déploré l'inutile complexité de la réglementation européenne en ce qui concerne les espèces non protégées56(*), en soulignant le régime différentiel réservé aux produits carnés et à ceux de la pêche, source de confusion et d'une insuffisante appropriation de la règle par les voyageurs, qui ne comprennent pas toujours la différence de traitement appliqué aux produits de la pêche et la viande. Les agents des douane rencontrés par la mission d'information ont indiqué au rapporteur que cette différence de traitement n'était pas de nature à favoriser la clarté, la lisibilité et l'appropriation de la norme par les passagers, en appelant à mettre fin à cette complexité réglementaire qui génère des temps de contrôle accrus aux frontières.
En septembre 2023, les autorités françaises ont officiellement appelé l'attention de la Commission européenne sur le seuil de 20 kg réservé aux produits de la pêche frais et éviscérés ou aux produits de la pêche préparés ou transformés, alors que les produits de la pêche non éviscérés sont autorisés dans la limite de 2 kg par personne, indiquant que l'absence de viscères est particulièrement difficile à vérifier pour les services de contrôle, au regard de l'état des poissons importés.
En réponse, la Commission européenne a précisé aux autorités françaises que les produits de la pêche présentaient un risque moindre de transmission d'agents pathogènes au regard de la santé animale, par rapport aux viandes et produits à base de viande et produits laitiers. Si cette affirmation est scientifiquement exacte, elle introduit néanmoins de la confusion dans la compréhension de la norme, dommageable à la clarté de la réponse douanière qui est apportée en réponse à ce phénomène. Le rapporteur estime qu'il est nécessaire que les autorités françaises poursuivent les échanges avec la Commission européenne afin de simplifier la compréhension de la norme et faire cesser ces importations qui ont lieu dans des conditions d'hygiène toute relative.
Recommandation n° 3 : Favoriser la lisibilité de la norme en rationnalisant la législation européenne qui prohibe l'importation de produits carnés, mais autorise celle de poisson séché et éviscéré, source d'incompréhension et de confusion pour les voyageurs, en promouvant une approche « Zéro produit animal brut », et faire en sorte que les interdictions absolues d'emport de certaines espèces ou produits soient sanctionnées de façon immédiate et anticipable, avec un seuil de tolérance zéro.
b) Le plan d'action européen de lutte contre le trafic d'espèces sauvages
Adopté en 2016 par la Commission européenne, le plan d'action de l'UE contre le trafic d'espèces sauvages se veut une réponse stratégique pour orienter et coordonner les efforts des États membres afin de mettre un terme au commerce illégal d'espèces sauvages, dont le continent européen constitue une plaque tournante du trafic mondial. Cette vision stratégique partagée au niveau de l'UE ambitionne de rendre l'action collective plus puissante que la somme des actions individuelles et isolées. Après un premier plan d'action couvrant la période 2016-2020, la seconde version du plan d'action révisé, publiée en novembre 2022, vise à orienter l'action de l'UE et coordonner celle des États membres dans la lutte contre le trafic d'espèces sauvages jusqu'en 2027.
L'adoption de ces plans d'action a permis la promotion d'un cadre stratégique unifié, en offrant une approche cohérente et coordonnée pour les 27 États membres, ce qui est essentiel dans la mesure où le trafic touche l'ensemble du territoire européen et ne s'arrête pas aux frontières nationales. Ils ont favorisé une approche globale et holistique des enjeux du trafic d'espèces sauvages, les plans couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du trafic, de la source à la demande finale, en intégrant différentes facettes : législation, application, prévention et coopération. Ils visent à améliorer la détection, l'enquête, la poursuite et la condamnation des trafiquants, en s'appuyant pour ce faire sur un renforcement des capacités des douanes, des forces de l'ordre, et des systèmes judiciaires, ainsi qu'une meilleure coordination entre les États membres.
Ces plans ont favorisé la prise en compte des menaces que ce trafic fait peser, en reconnaissant explicitement que le trafic d'espèces sauvages est une forme grave de criminalité organisée, justifiant des mesures mieux coordonnées et plus sévères et ont contribué à la promotion de l'approche « Une seule santé », en mettant l'accent sur le lien entre le trafic d'espèces sauvages et les risques de zoonoses. Ils constituent également une vitrine des politiques publiques européennes, servant notamment au renforcement des partenariats mondiaux, de la collaboration avec les pays tiers, les organisations internationales (Cites, Interpol, OMD, ONUDC) ainsi que les acteurs du secteur privé.
Les plans d'action européens de lutte contre le trafic d'espèces sauvages se sont révélés des outils précieux, porteurs d'évolutions positives en Europe, tels qu'une impulsion politique nouvelle, une coopération accrue entre les forces de l'ordre et un rôle renforcé de l'UE au sein des négociations internationales de la Cites. Le plan d'action révisé vise désormais explicitement à « faire en sorte que les peines infligées pour le trafic des espèces sauvages soient proportionnelles au crime ».
Néanmoins, en dépit de leur indéniable intérêt et des avancées qu'ils ont favorisées, ces plans d'action comportent certaines lacunes structurelles, dont la difficulté d'évaluer les progrès faute d'indicateur et de base de référence. Les efforts pour impliquer le secteur privé et la société civile à travers l'Europe n'ont pas non plus produit les effets escomptés. L'efficacité du plan d'action dépend en outre de l'engagement des États membres, puisque la mise en oeuvre des mesures du plan d'action est sous leur responsabilité, à travers l'adoption des stratégies et des mesures nationales. La question des moyens financiers consacrés est elle aussi cruciale : comme le reconnaît le plan d'action révisé, « aucun progrès réel ne peut être accompli dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages sans un financement suffisant disponible pour soutenir les actions d'accompagnement, tant au niveau de l'UE que dans ses États membres ».
En résumé, l'impact de ces plans n'a pas encore trouvé son plein déploiement en raison de l'hétérogénéité des sanctions mises en oeuvre par les États membres, de l'absence d'obligation de mise en oeuvre, des moyens financiers et budgétaires déployés et d'un suivi perfectible, faute de données et d'indicateurs standardisés. Le plan d'action révisé comporte désormais un cadre pour l'établissement de rapports, le suivi et l'évaluation, qui n'existait pas dans le plan précédent, mais il est encore trop tôt pour juger de son efficacité et de sa capacité à piloter une action publique européenne plus efficace et mieux coordonnée.
De nombreux acteurs jugent le cadre européen pertinent et adapté pour mener à bien la lutte contre le trafic d'espèces protégées à l'échelle transfrontalière, même si sa lisibilité pourrait être renforcée à travers notamment l'interdiction de toute importation de poissons frais et séchés par les passagers provenant de pays tiers. Une plus grande implication des États membres serait nécessaire pour que ce cadre puisse mettre un terme au trafic des espèces protégées. Celle-ci ne sera pas aisée à atteindre, dans la mesure où les États ne sont pas confrontés avec la même acuité aux enjeux de ce trafic : les flux de produits carnés entrant de façon illégale sur le territoire national ne sont en rien comparables entre la France et les pays du Nord ou de l'Est de l'Europe, même si la sécurité sanitaire profite in fine à tous les États.
B. UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE ET D'APPROCHE POUR CONCENTRER LES MOYENS DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC HAUTEMENT LUCRATIF D'ESPÈCES PROTÉGÉES
Face aux défis croissants posés par l'intensification du trafic d'espèces sauvages sur le territoire national, la mission d'information estime qu'il existe plusieurs axes d'amélioration pour réduire les risques que génère ce trafic et que leur efficacité dépend notamment de la capacité des pouvoirs publics à les déployer simultanément. Une lutte efficace contre les méfaits de ce trafic n'est pas hors d'atteinte, à condition toutefois de mieux fédérer les efforts des différents acteurs, d'inscrire les stratégies nationales dans le cadre d'une coopération européenne et internationale, tout en promouvant une réponse douanière plus rapide et énergique.
Fort des convictions qu'il s'est forgées au cours de ses travaux, le rapporteur déplore le fait que notre doctrine de réponse à ce trafic se fonde essentiellement sur une logique d'interception douanière, alors que d'autres solutions pourraient opportunément être mises en oeuvre afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés, à travers des interventions permettant d'agir à la fois sur l'offre et la demande. Il est urgent de passer d'une logique de saisies opportunistes et aléatoires à une logique de démantèlement de réseaux.
Explorer de nouvelles voies d'actions préventives, telles que la coopération avec les États de provenance du trafic, l'association plus étroite des acteurs du transport, l'amélioration de l'information et de la sensibilisation des passagers, à travers des capacités de détection renforcées, permettraient de réduire significativement les risques complexes et évolutifs que ces trafics font peser.
1. Favoriser la coordination internationale, échelon pertinent en amont de la lutte contre la criminalité environnementale et la détection précoce des crises sanitaires
Avant même de chercher à activer des réponses nationales, la recherche de solutions visant à tarir les flux à la source, à travers la coopération internationale et diplomatique, peut s'avérer une voie fructueuse. De l'avis de plusieurs spécialistes entendus par la mission d'information, le cadre multilatéral serait un échelon pertinent pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale. Même s'il est plus complexe et lent à mobiliser, le multilatéralisme constitue un niveau complémentaire aux dispositions du droit français, aux accords bilatéraux ou encore au cadre européen. Il s'agit également du cadre idéal pour promouvoir l'approche « Une seule santé » qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, pour une meilleure prévention, détection des maladies et capacité conjointe de contrôle, notamment via la préparation aux urgences sanitaires.
Dans la mesure où les trafiquants d'espèces protégées opèrent désormais à l'échelle mondiale, en exploitant les failles des législations nationales et les lacunes des contrôles aux frontières, les réponses isolées sont inefficaces : elles génèrent des déplacements et des reports de trafic vers d'autres pays et routes commerciales, les réseaux criminels étant en mesure de s'adapter aux évolutions normatives non concertées au niveau régional, grâce à leur agilité logistique. Dès lors, aucun pays, organisme ou organisation ne peut escompter lutter efficacement, à lui seul, contre le commerce illégal d'espèces sauvages.
Pour contrer la relative inefficience des mesures isolées à l'échelle d'un trafic globalisé, la réponse politique gagnerait à être internationale, articulée et décloisonnée, en traitant le trafic d'espèces non plus comme une simple infraction environnementale, mais comme un enjeu de sécurité, de santé publique et de développement international. Pour y parvenir, un renfort de la coopération avec les pays d'origine du trafic constitue un indispensable préalable, tant sur le plan du contrôle avant embarquement que des moyens répressifs employés contre les réseaux criminels. La décrue des flux générés par le trafic suppose une collaboration efficace et des efforts collectifs à l'échelle de tous les États de l'aire de répartition, de transit et de destination des espèces, ainsi qu'à travers toute la chaîne de lutte contre la fraude.
Parmi les actions en amont qui pourraient utilement être mises en oeuvre au terme d'une coopération étroite avec les pays d'origine, citons celles qui visent à mieux identifier et comprendre les motivations des trafiquants, à accompagner les chasseurs et les gestionnaires locaux afin qu'ils deviennent des sentinelles d'émergence à travers la mise en place de systèmes d'alertes et de surveillance communautaires efficaces, ainsi que les efforts visant à soutenir la collaboration, la coordination, la planification et les réponses communes de ces différents acteurs. Naturellement, les mesures les plus efficaces pour agir à la source des trafics nécessitent le renforcement des contrôles douaniers au départ, à travers des mécanismes de coopération, de formation et d'aides à l'acquisition d'équipement de détection, ainsi que des évolutions normatives visant à pénaliser les prélèvements illégaux de faune sauvage au sein des États à l'origine des trafics, à travers notamment l'élaboration de cadres juridiques plus robustes relatifs à la santé animale, à la gestion de la faune sauvage et à la sécurité alimentaire.
Recommandation n° 4 : Renforcer les capacités d'enquête et de répression dans les pays sources du trafic à travers la formation, le soutien en équipement et le partage d'expertise, afin d'agir à la source en réduisant les flux qui embolisent les capacités douanières.
Pour les mêmes raisons, le cadre européen est également pertinent pour parvenir à réduire l'ampleur d'un trafic qui profite de la libre circulation des personnes et des biens, ce qui exige par conséquent une réponse coordonnée entre États. Le niveau européen est particulièrement adapté à la coordination, au renforcement et à l'harmonisation des réponses normatives à activer de façon à éviter les distorsions de concurrence.
De même, le renforcement de la coopération en matière de renseignement international sur les activités criminelles transnationales et le développement de partenariats plus étroits avec les services de renseignement étrangers pour démanteler les réseaux dès les pays d'origine ou de transit pourraient utilement accroître l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et le volume des saisies douanières. Par ailleurs, l'accroissement des investissements dans le renseignement douanier doit être envisagé, y compris l'infiltration de réseaux, la surveillance des marchés noirs en ligne, tout en organisant une surveillance des transactions financières liées au trafic.
Recommandation n° 5 : Miser sur la coopération diplomatique avec les pays sources du trafic, aux niveaux national et européen, pour tarir les flux en provenance de certains vols et favoriser l'échange de renseignements en matière d'activités criminelles transnationales.
Il existe d'ores et déjà plusieurs déclarations et prises de position, au niveau régional et mondial, pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, notamment des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies57(*), qui rappellent les préoccupations que pose « l'ampleur croissante du braconnage et du commerce illicite d'espèces sauvages et de produits dérivés et par ses conséquences économiques, sociales et environnementales néfastes » et encouragent les pays à prendre des mesures.
L'Organisation mondiale des douanes a également adopté la « United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration », le 15 mars 2016 à Londres, dans le but de mobiliser le secteur privé - transport, finance, logistique - dans la lutte contre le trafic d'espèces. Des groupes français comme Air France ou ADP sont signataires de cette déclaration.
Celle-ci se donne pour objectif d'inciter les parties signataires, constituées d'entreprises, d'agences et d'organisations, à prendre des mesures pour faire obstacle aux itinéraires suivis pour le trafic d'espèces sauvages, faisant directement référence à la convention Cites. Même si elle ne comporte aucune disposition contraignante de par sa nature même, la Déclaration repose sur 11 engagements, dont l'engagement de tolérance zéro à l'égard du commerce illégal d'espèces sauvages, l'amélioration des systèmes de données et de l'innovation, et l'amélioration du partage d'informations dans le secteur des transports.
Elle a entraîné des engagements volontaires utiles, à travers des protocoles, des formations et des partenariats, en mettant en lumière le rôle crucial du secteur des transports et a accru la sensibilisation des entreprises et de leurs employés aux risques de trafic. De même, des formations spécifiques ont été développées pour le personnel des transports, qu'il s'agisse des contrôleurs ou des agents de fret, afin de les aider à identifier les activités suspectes. La déclaration encourage en outre un meilleur échange d'informations entre les entreprises de transport et les autorités chargées de l'application de la loi. De nombreuses entreprises ont à cette occasion revu et renforcé leurs protocoles internes pour détecter et signaler les cas de trafic.
Malgré ces avancées, il est difficile de quantifier précisément l'impact de cette déclaration sur la réduction du trafic, car il s'agit d'un engagement volontaire non contraignant et inégalement appliqué, avec une mise en oeuvre variable selon les entreprises. Elle a indéniablement créé un élan et une prise de conscience, mais la persistance du trafic indique que des efforts continus et des mécanismes de redevabilité plus forts sont toujours nécessaires. La Déclaration de Buckingham Palace est un bon exemple d'accord de collaboration, reposant sur des engagements clairs, pour avancer de façon coordonnée avec les acteurs sensibilisés.
D'autres initiatives, n'émanant pas des États, ont également été mises en oeuvre dans le but d'accompagner les évolutions pertinentes pour réduire les points faibles tout au long de la chaîne de transport et d'approvisionnement, qui profitent aux trafiquants. Une coordination plus poussée des acteurs privés et publics est notamment proposée par l'organisation United for Wildlife, fondée en 2013 par le prince William et la Royal Foundation. Ses membres fondateurs sont également à l'origine des engagements dans le cadre de la Déclaration de Buckingham Palace précitée.
Pour tenter de remédier aux méfaits du trafic d'espèces sauvages, cette association réunit, au sein de son groupe de travail sur le transport créé en 2014, United for Wildlife Transport Taskforce, des entreprises du secteur des transports afin de sensibiliser le public aux activités criminelles, d'identifier l'exposition du secteur et de trouver des solutions pour mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages.
Ce groupe de travail rassemble notamment des experts mondiaux de l'industrie du transport et du fret, y compris des aéroports, des compagnies maritimes et des compagnies aériennes, ainsi que des organismes publics, afin d'identifier et de faciliter les actions menées par le secteur privé. Les partenaires réunis au sein de ce groupe de travail ont notamment noué une coopération avec le groupe Microsoft afin d'explorer une nouvelle technologie de balayage pionnière, qui a le potentiel d'augmenter considérablement les détections de produits de la faune sauvage dans le fret. Ils ont également oeuvré, avec les organisations non gouvernementales WWF et Traffic, à l'adoption de nouvelles directives, adoptées par l'Organisation maritime internationale et approuvées par l'ONU, pour la « prévention et la répression de la contrebande d'espèces sauvages à bord des navires engagés dans le trafic maritime international ».
Au titre des efforts mis en oeuvre pour réduire les risques causés par le commerce illégal d'espèces protégées et sauvages, il convient également de mentionner l'Accord sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies adopté le 20 mai 2025 à la 78e Assemblée mondiale de la Santé par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui marque un tournant décisif cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19. Il contient des éléments concrets pour prévenir de futures crises sanitaires et garantir que les États soient mieux préparés à y répondre, de façon solidaire et coordonnée. Bâti sur un principe d'équité, il prévoit des mécanismes permettant de faciliter l'accès rapide aux vaccins, médicaments et outils de diagnostic en cas d'urgence sanitaire.
Il acte l'inscription, pour la première fois dans un accord international, de l'approche « Une seule santé » comme principe fondamental. Cette avancée se fonde sur ce que les crises sanitaires récentes nous ont enseigné : santé humaine, santé animale et celle de l'environnement sont indissociables. En intégrant la surveillance des zoonoses, la protection des écosystèmes et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens, l'accord vise à agir sur la racine des pandémies. Les principes qu'il promeut, notamment à l'article 4, sont ceux nécessaires à encourager la prise en compte du risque en amont via une surveillance multisectorielle, la prévention et réduction des risques à l'interface humain-animal-environnement, qui devraient mener à identifier des actions vis-à-vis du trafic d'espèces sauvages susceptible de devenir une menace pandémique.
Bien que l'accord ne cible pas directement le trafic d'espèces sauvages, sa logique de prévention des pandémies et son ancrage dans l'approche « Une seule santé » offrent un cadre puissant pour justifier et renforcer les actions contre ce trafic, en le reconnaissant comme une menace majeure pour la santé publique mondiale. Il offre une nouvelle légitimité et un nouvel angle d'approche pour les efforts de lutte contre ce phénomène. Son impact dépendra cependant de la volonté à les traduire en actions concrètes.
En reconnaissant le lien entre faune sauvage et risques sanitaires, l'Accord mondial sur les pandémies appelle à renforcer les contrôles sur les filières à risque, dont la viande de brousse, sans pour autant créer d'obligation juridique directe sur le trafic d'espèces. En se focalisant sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, il y a tout lieu de penser qu'une fois ratifié par les États, l'accord les incitera à renforcer la surveillance des zoonoses, ce qui inclut la surveillance des marchés d'animaux vivants, des élevages et des flux d'espèces sauvages, qu'ils soient légaux ou illégaux. Cet Accord permettra également de renforcer la coopération internationale sur le sujet, en créant une ambition politique commune, en disposant de constats partagés et de définitions harmonisées, susceptibles de déboucher sur des incriminations et des moyens de répression mis en commun - qui n'existent pas encore de manière spécifique pour le trafic d'espèces protégées - face à une criminalité de plus en plus transnationale.
En complément de cet Accord novateur et des coopérations qui se nouent entre les acteurs à l'initiative d'organisations qui fédèrent l'action contre ce trafic, les dispositifs internationaux de surveillance et d'alerte d'émergence épidémiologique sont également stratégiques pour éviter la propagation d'épizooties et de zoonoses. C'est ainsi que la France, sous l'impulsion du Cirad, de l'Inrae et de l'IRD, a porté l'initiative Prezode (Preventing Zoonotic Diseases Emergence) en 202158(*). Ce dispositif, réunissant actuellement 257 membres de 80 pays différents, vise à mieux comprendre, prévenir, surveiller et détecter à temps les risques de pandémies zoonotiques. L'initiative s'appuie elle aussi sur l'approche intégrée « Une seule santé », qui implique tous les acteurs de la santé humaine, animale et environnementale par la prise en compte des facteurs environnementaux, sociétaux, économiques, éthiques et politiques qui caractérisent un socio-écosystème et participent à l'émergence des zoonoses.
Afin de favoriser la détection précoce, les réseaux de surveillance épidémiologique impliquent un effort de formation auprès des populations vivant et travaillant dans les zones sensibles : chasseurs, gardes-forestiers, pour leur permettre de repérer les signes d'une épidémie chez les animaux, morts notamment, de se munir des équipements de protection personnelle adéquats, d'alerter les autorités sanitaires par des procédures collectives efficaces. Parmi les initiatives intéressantes sur le plan de la surveillance avancée, se distingue l' International Alliance against Health Risks in Wildlife Trade59(*), mise en oeuvre par le gouvernement allemand pour améliorer les connaissances, les partager et soutenir le passage de la science aux politiques publiques réunissant plus de 500 acteurs, principalement issus d'organisations non gouvernementales et académiques.
À l'échelle nationale, on peut signaler la mise en oeuvre de la plateforme d'épidémiosurveillance santé animale (ESA) afin de faciliter l'échange d'informations entre différents acteurs ministériels, des professionnels de la santé animale, des chercheurs et des agences sanitaires. De son côté, la Direction générale de la santé (DGS) est au centre d'un réseau d'alerte passant par les professionnels de santé, médecins et laboratoires, et les agences régionales de santé (ARS), incluant les centres nationaux de référence et Santé publique France, permettant de détecter les menaces pour la santé publique. De cette façon, toute circulation inhabituelle d'un pathogène exotique sera signalée à la DGS qui partagera ce signal avec ses partenaires pour une recherche conjointe de la source et la mise en place de mesures de gestion.
La DGS s'appuie pour mener à bien ses missions sur un Centre de crises sanitaires (CCS), qui assure la centralisation des alertes et la coordination ou la participation à la réponse à ces alertes, ainsi que l'anticipation et la cartographie des risques sanitaires, l'élaboration des plans de préparation et de réponse aux menaces sanitaires, et le volet sanitaire des plans de défense et de sécurité. Entendus en juin 2025, les représentants de la DGS ont indiqué au rapporteur n'avoir connaissance d'aucune alerte dont la viande de brousse serait à l'origine.
Les coopérations transfrontalières en matière de lutte contre la criminalité environnementale sont également des outils efficaces, à condition que la collaboration des services d'enquête et de contrôle soit bien coordonnée. Citons à cet égard l'initiative du parquet de Bayonne, qui a créé le Groupe opérationnel transfrontalier de lutte contre les atteintes à l'environnement (Goltae), devenu par la suite « Colden transfrontalier » à la suite de la création de cette dernière instance en 2023. Ce groupe réunit les parquets de San Sebastián et de Bilbao ainsi que les services d'enquête spécialisés français et espagnols, avec pour objectif de permettre un échange d'informations avec les autorités espagnoles sur les problématiques environnementales communes, et de faciliter les demandes d'entraide européenne en matière de pêche illicite et le trafic de civelles et d'algue rouge.
En définitive, les cadres multilatéral, européen et transfrontalier apparaissent essentiels au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés, permettant d'accroître la coopération et la coordination internationale dans la répression des trafics d'espèces protégées. Il est par ailleurs nécessaire de promouvoir l'application stricte et entière de la Cites, le partage d'informations et de ressources entre pays, d'accompagner la bonne mise en oeuvre du récent Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, mais également de soutenir les acteurs privés, à l'instar de ceux qui ont signé la Déclaration de Buckingham Palace, tout en encourageant le soutien technique et financier de projets visant à renforcer les capacités des pays d'origine à lutter à la source contre le trafic d'espèces sauvages.
2. Renforcer la coopération inter-services et les moyens de la lutte tout en forgeant une réponse douanière plus agile et réactive
Outre la nécessité d'une coopération internationale accrue afin de réduire à la source les flux générés par le trafic d'espèces protégées, il importe également que l'ensemble des acteurs nationaux concourant à cette lutte unissent et coordonnent leurs efforts pour réduire les risques que pose ce trafic et réprimer de manière dissuasive les trafiquants qui cherchent à faire entrer ces produits sur le territoire national.
En matière de lutte contre la criminalité environnementale, l'approche interministérielle et multidisciplinaire est indispensable, à travers la coordination des services de police et de gendarmerie, des juridictions spécialisées et de la société civile. Au cours de son audition, le syndicat FO Douanes a déploré l'« absence d'un cadre coopératif lisible » et plaidé pour l'élaboration d'un protocole interservices national, applicable à chaque plateforme aéroportuaire ainsi qu'en faveur d'une formation initiale obligatoire sur les enjeux du trafic d'espèces au cours de la scolarité douanière.
Le Commandement pour l'environnement et la santé (Cesan) de la gendarmerie nationale a également indiqué à la mission d'information que de nombreux services oeuvrent en France sur la thématique de la lutte contre le trafic d'espèces protégées, à l'instar des douanes, de l'OFB ou de la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP), mais souvent de façon insuffisamment concertée. Bien qu'une coopération opérationnelle ait été mise en oeuvre entre les douanes et les autres acteurs de la lutte, elle n'est que peu effective avec les services d'investigation, ce qui constitue un frein au démantèlement effectif des filières. Il apparaît à la mission d'information indispensable de développer l'échange de renseignements entre les services des douanes et les services spécialisés de la Gendarmerie nationale, notamment l'Oclaesp60(*) et le Cesan, à la fois prévisionnel et a posteriori, afin d'obtenir des résultats plus significatifs.
Recommandation n° 6 : Mieux appréhender les flux et les routes empruntées par ce trafic à travers la compilation des données au sein d'un système d'information dédié consultable par les forces de l'ordre et la justice afin de détecter les récidives, pérenniser les espaces institutionnalisés d'échange entre les acteurs qui luttent contre ce phénomène afin de rompre avec la logique de « silos administratifs » et inciter à l'élaboration d'une base de données européenne des auteurs et des saisies avec échange d'informations entre les services de lutte des différents États membres.
Un service à compétence nationale, « Tracnat », est par ailleurs en cours de déploiement au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) à la suite de la stratégie nationale biodiversité 2030. Inspiré du modèle de Tracfin, il sera chargé de lutter contre le commerce illicite d'espèces menacées, l'importation de bois issu de la déforestation et de minéraux venant de zones de conflit. La mission d'information forme le voeu que la création de cette entité permettra de surmonter le déficit de coordination administrative entre les différents services chargés de la lutte contre ce trafic.
Les constats de la mission interministérielle sur la lutte contre l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées
Ce rapport conjoint du CGAAER61(*), de la DGDDI62(*) et de l'Igedd63(*), publié en décembre 2023, a cherché à comprendre pourquoi les pouvoirs publics français étaient impuissants à empêcher l'entrée de produits carnés ou d'animaux vivants importés illégalement dans les bagages de passagers arrivant dans les aéroports nationaux et en particulier parisiens64(*).
Tout en constatant que c'est au niveau européen, voire international, que cette question devrait être traitée pour une efficacité optimale, cette mission a notamment fait le constat que « cet échec est en partie dû à l'absence d'action coordonnée des nombreux ministères impliqués ». Elle souligne que la mobilisation des pouvoirs publics et des services répressifs n'a rien de comparable avec celle de la lutte contre les trafics de stupéfiants, de contrefaçons ou de cigarettes.
Elle estime que le groupe de travail interministériel sur les importations illégales de produits carnés et d'espèces sauvages dans les bagages des voyageurs, constitué en 2023, pourrait permettre de commencer à lever cet obstacle en élaborant une feuille de route pilotée par un délégué interministériel dûment mandaté.
De même, en dépit des évolutions législatives intervenues ces dernières années65(*) et des circulaires de politiques pénales spécialisées66(*), les tribunaux ne sont pas encore suffisamment outillés ni sensibilisés pour assurer une réponse cohérente et dissuasive aux enjeux de conservation et au trafic d'espèces protégées. En l'absence d'orientation nationale et de politique pénale dédiée, la plupart des dossiers instruits bénéficient de suites minimales, prenant la forme de sursis, d'amendes faibles, voire l'abandon des poursuites. La réponse, douanière comme judiciaire, demeure aujourd'hui souvent symbolique, avec des amendes faibles, des peines rarement exécutées et une absence fréquente de confiscation : cette impunité de fait perçue par les voyageurs favorise la récidive et la banalisation du trafic, notamment chez des auteurs souvent ressortissants étrangers, pour lesquels la réponse judiciaire classique est difficile à mettre en oeuvre.
La diversité du contentieux environnemental, son volume relativement réduit au regard de la masse des contentieux multiples que traitent les juridictions et sa technicité militent pour une spécialisation accrue de certains magistrats du parquet comme du siège, ainsi que des services d'enquête qui ont à connaitre des affaires de trafic d'espèces protégées. La mission ne sous-estime aucunement le foisonnement des priorités pénales et l'encombrement des tribunaux, mais il serait à tout le moins opportun de sensibiliser les magistrats aux enjeux et aux risques que ce trafic comporte.
Une lutte plus efficace contre le trafic d'espèces sauvages suppose à la fois un arsenal législatif puissant, avec des peines plus lourdes et la qualification de crime organisé, ainsi qu'une stratégie pénale dédiée pour la spécialisation et la coordination de l'action des forces de l'ordre, mais également un cadre de réponse hybride combinant des sanctions immédiates et des enquêtes judiciaires approfondies pour s'attaquer à l'ensemble de la chaîne criminelle.
Il est apparu au rapporteur, au terme de ses auditions, que la réponse immédiate et administrative était la plus adaptée aux cas flagrants et de moindre ampleur, tandis que la voie judiciaire apparaît comme plus appropriée afin de mener à bien les enquêtes complexes visant les têtes de réseaux et les criminels organisés. Afin de distinguer le trafic occasionnel de viande de brousse portant sur de petites quantités et un trafic organisé s'opérant à vaste échelle par des groupes criminels transnationaux, il importe de différencier les réponses en fonction de la nature et de la gravité des infractions.
Afin de ne pas ajouter à l'encombrement des tribunaux, la voie judiciaire doit être réservée aux trafics organisés ou aux multirécidivistes générant des revenus significatifs, pour lesquels le cadre législatif permet d'ores et déjà d'engager des poursuites, en menant en parallèle une réflexion sur la nécessité de renforcer les sanctions pénales. Couplé à la coopération internationale préconisée plus haut, ce traitement ciblé peut être de nature à affaiblir des réseaux structurés et assurer le caractère dissuasif des sanctions. Actuellement, les sanctions prévues pour réprimer le trafic d'espèces protégées en bande organisée sont beaucoup trop faibles et présentent un caractère insuffisamment dissuasif, sans compter qu'elles sont rarement recouvrées et, quand elles le sont, elles ne le sont que partiellement. La gradation du système de sanctions doit être revue, de manière à le rendre dissuasif et à inciter sans ambiguïté les passagers à respecter la règlementation française et européenne.
En ce qui concerne les infractions individuelles, notamment celles commises par des particuliers effectuant des importations occasionnelles, elles peuvent être traitées efficacement dans le cadre de procédures administratives ad hoc, dont il convient toutefois de simplifier le recours. Ainsi, la sanction immédiate telle que la transaction douanière constitue une réponse rapide, proportionnée et dissuasive, qui présente l'avantage de préserver les ressources judiciaires. La transaction douanière, prévue aux articles 350 et suivants du code des douanes, fournit aux agents des douanes un outil souple et rapide pour les infractions constatées à la frontière auprès des voyageurs, y compris étrangers. Cette réponse immédiate apparaît notamment adaptée à la grande variété des personnes visées et aux modalités de réalisation des contrôles effectués, en tenant compte de la rapidité des flux de contrôle notamment dans une enceinte aéroportuaire.
La systématisation du recours à la transaction douanière pourrait constituer une réponse pertinente au phénomène de masse que constitue l'importation de produits carnés dans les bagages de voyageurs aéroportuaires. Elle offre une réponse rapide, au stade du contrôle, et adaptée à différentes typologies de faits, en tenant compte des quantités importées, de la présence ou non d'espèces Cites et du contexte de réitération de la part des personnes mises en cause. Elle permet de moduler le montant de l'amende pour tenir compte de la valeur à la revente des espèces importées illégalement, à travers une sanction immédiate, visible et proportionnée sans accroître l'engorgement des tribunaux. La transaction douanière présenterait au surplus l'avantage de rendre moins profitable financièrement les multiples passages de marchandises prohibées.
Recommandation n° 7 : Recourir plus systématiquement aux transactions douanières au montant dissuasif prononcées et perçues directement par les douaniers au moment des constatations, afin de rompre avec l'idée d'un trafic à forte profitabilité et à faible risque de condamnation.
Lors de son audition, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a reconnu tout l'intérêt de cet outil transactionnel, en soulignant qu'il était préférable que son utilisation reste limitée aux faits de moindre intensité. L'articulation entre une répression pénale ciblée, fondée sur un cadre législatif dissuasif et une gestion administrative adaptée à la forte intensité du trafic, garantit ainsi une réponse équilibrée et opérationnelle face aux défis posés par le trafic d'espèces protégées.
Depuis fin 2024, la mise en service d'un outil dématérialisé de transaction par les douanes à l'aéroport Charles de Gaulle a permis de développer très sensiblement le recours aux transactions douanières pour le transport de denrées périssables, très majoritairement pour des espèces « hors Cites ». Alors que cette procédure était peu utilisée jusqu'alors, avec une majorité de dessaisissements simples en raison du très grand nombre d'infracteurs, 945 transactions douanières ont été établies entre le 1er janvier et le 24 juin 2025. Cet outil numérique permet en outre d'identifier les récidivistes, pour lesquels le montant de la pénalité est doublé. C'est pourquoi la mission d'information préconise la poursuite de cette tendance.
Si la transaction douanière est pleinement pertinente pour les petites infractions et les primo-délinquants, afin de mettre en oeuvre une réponse rapide et efficace, elle ne doit toutefois en aucun cas se substituer aux poursuites pénales lourdes pour les cas de trafic organisé ou de récidive, où seules des peines d'emprisonnement et des amendes conséquentes, assorties de confiscations, peuvent avoir un effet réellement dissuasif.
C'est notamment la raison pour laquelle une réflexion doit être engagée en vue d'évaluer s'il convient d'élever le trafic d'espèces protégées et sauvages au même rang répressif que d'autres formes de criminalité organisée grave, à l'instar du trafic de drogue, d'armes ou la traite des êtres humains. Ce renforcement du quantum des peines permettrait l'application de peines réellement dissuasives, mais surtout l'utilisation de techniques d'enquête plus intrusives et efficaces : écoutes, infiltrations, saisies d'avoirs criminels, etc. tout en facilitant l'identification des filières liées d'approvisionnement et de vente.
3. Investir dans des capacités de détection renforcées
Au-delà du renforcement de la présence douanière pour faire face à un trafic dont l'ampleur ne cesse de croître, il est apparu nécessaire à la mission d'information de renforcer les investissements en matière de recherche, de détection et d'analyse des produits faisant l'objet du trafic d'espèces protégées. Il est nécessaire d'endiguer les flux du trafic à la source, dans les pays de départ, à travers les mécanismes de coopération décrits plus haut. Pour ce faire, il est indispensable d'améliorer nos capacités douanières à l'entrée, afin de réduire les risques que ce trafic fait peser sur la sécurité sanitaire.
La mission d'information insiste sur la nécessité de rendre le risque de se faire prendre si élevé que le trafic d'espèces sauvages deviendrait moins attractif et moins profitable pour les criminels. Le renforcement des moyens techniques à la disposition des douaniers répond à une logique d'efficacité et d'efficience. Le facteur de dissuasion le plus efficace pour les trafiquants reste l'augmentation de la probabilité de la détection et de la saisie des marchandises : quand le risque pour un trafiquant de perdre sa marchandise s'accroît, l'espérance de rentabilité diminue à due proportion. De plus, outre la diminution du risque et le renforcement de la dissuasion, cette approche est susceptible d'améliorer les conditions de travail des agents des douanes tout en augmentant le produit des amendes douanières.
L' amélioration des techniques de contrôle, à travers par exemple l'identification rapide grâce aux kits d'analyse ADN avec PCR ou le recours à des outils numériques d'aide à la décision, permet d'espérer une meilleure connaissance de l'origine des flux et des espèces saisies, préalable à la mise en place de mesures d'anticipation et d'interception plus performantes. Il existe un fort besoin de pouvoir identifier spécifiquement et rapidement la nature des produits illégalement importés pour s'assurer du régime juridique dont ils relèvent et adapter les protocoles de biosécurité à mettre en oeuvre pour faire face aux risques posés par ces marchandises. En l'état actuel de la dotation matérielle de la douane, cette analyse est généralement difficile à accomplir, la viande de brousse provenant souvent sous forme « boucanée », c'est-à-dire fumée et séchée.
Recommandation n° 8 : Améliorer la robustesse des règles de biosécurité, investir dans la science forensique pour favoriser l'identification des saisies et rehausser le quantum des peines pour réprimer le trafic d'espèces protégées au même niveau que celui des trafics d'armes et de stupéfiants.
Hormis quelques rares cas offrant une possibilité d'identification évidente, la conduite d'analyses ou de vérifications implique actuellement des délais incompatibles avec la réalisation des contrôles aux frontières, particulièrement au sein des zones aéroportuaires présentant des contraintes fortes (flux massifs, complexité logistique et délais d'intervention réduits). Plusieurs pistes peuvent être explorées afin d'améliorer la célérité et la fiabilité des détections, à l'instar des techniques d'imagerie à rayons X, en particulier la tomographie 3D et les scanners CT, qui constituent des technologies prometteuses, mais également le soutien à la recherche de méthodes de détection innovantes, d'identification génétique des espèces et de techniques robustes de traçabilité.
Les scanners d'aéroport actuels sont capables de produire des images 3D de haute résolution des bagages et du fret. En créant des bibliothèques de référence d'images radiographiques d'espèces protégées, il est possible d'entraîner des systèmes informatiques à détecter ces animaux ou leurs produits. Cette approche présenterait l'avantage de mettre en oeuvre un dépistage automatique et non invasif. L'amélioration des technologies de balayage, du partage de l'information des systèmes de données sont des pistes qui semblent prometteuses. La mise en place de ces mécanismes de détection poussée ne doit pas seulement être envisagée à la fin d'un vol : les solutions potentielles peuvent également être mises en oeuvre au départ d'un vol, dès les pays d'origine, sans perturber les processus établis, dans le cadre de protocoles de coopération à définir.
Il pourrait également être envisagé le développement d'une application facilitant la reconnaissance des espèces, basée sur un référentiel numérique à jour et intégré au système d'aide au contrôle. Mais le gain le plus significatif est sans doute à attendre de l'Intelligence artificielle (IA) : combinée aux systèmes de vidéosurveillance et aux techniques d'imagerie précitées, elle est de nature à révolutionner la détection douanière. Des algorithmes d'apprentissage peuvent être entraînés à identifier des motifs suspects dans les images radiographiques ou les flux vidéo, signalant ainsi des cas potentiels de trafic. À titre d'exemple, le projet Seeker67(*) a démontré la capacité de l'IA à détecter automatiquement des articles illégaux liés à la faune lors du contrôle des bagages à l'aéroport de Londres Heathrow.
L'IA pourrait également analyser les schémas de voyage et les comportements des passagers pour identifier les trafiquants, à travers des systèmes capables d'analyser de grandes quantités de données telles que les flux de passagers, les schémas de fret, les réservations, les données financières ou les réseaux sociaux, dans le but d'identifier en amont les trafiquants potentiels, dès l'arrivée à l'aéroport ou lors de l'expédition des marchandises, grâce à des modèles prédictifs permettant d'anticiper les itinéraires, les espèces ciblées et les méthodes de dissimulation émergentes. Avant d'être mises en oeuvre et déployées à grande échelle, il est cependant fondamental que ces techniques disruptives soient précédées d'un large débat au regard des forts risques qu'ils comportent pour la protection des données personnelles.
Ces évolutions technologiques sont également de nature à réduire les risques pour les agents en contact direct avec des marchandises potentiellement infectées, avec l'amélioration des conditions d'exercice des contrôles douaniers. En effet, dans le cadre des contrôles qu'ils accomplissent, les douaniers peuvent entrer en contact avec des animaux vivants, ce qui conduit à des risques de morsure, de piqûre, coupure et de contacts avec des parasites, susceptibles d'entraîner une contamination. Ils sont exposés, par les manipulations qu'ils accomplissent lors des contrôles, à des risques majeurs en termes de santé68(*). Les agents des douanes sont en effet considérés comme un groupe professionnel « à haut risque » pour les infections et les risques pour la santé environnementale. Des outils de détection plus poussés, fondés sur des technologies thermiques, optiques ou rayons X, permettraient de réduire ces risques par l'identification plus fine et précise des menaces en amont.
Même si les agents sont sensibilisés aux risques rencontrés dans ce type de contrôle au regard de la dangerosité que peuvent présenter les espèces de la faune et de la flore et au regard des risques biologiques et sanitaires des produits carnés, ces évolutions technologiques constitueraient un précieux appui aux détections visuelles impliquant l'ouverture et la manipulation des bagages et des colis.
Recommandation n° 9 : Renforcer les moyens douaniers et les outils de ciblage consacrés aux contrôles, afin d'améliorer la répression des trafics dans un contexte d'intensification du transit de voyageurs et de marchandises, et de réduire le risque pour la santé humaine et animale que fait peser l'entrée incessante de produits carnés et d'animaux vivants hors de tout protocole sanitaire.
L'approche la plus efficace pour accroître les capacités de détection douanière réside dans la combinaison de plusieurs technologies innovantes. Par exemple, un système d'IA pourrait analyser les images radiographiques afin d'identifier les articles suspects, puis déclencher une alerte pour qu'un chien renifleur confirme la présence de produits carnés ou d'espèces protégées. La vidéosurveillance augmentée par l'IA pourrait surveiller les zones de transit pour détecter des comportements inhabituels. Cette synergie permettrait une détection plus rapide, plus précise et plus fiable que les résultats actuellement obtenus, en raison également de dispositifs de détection qui peinent à suivre le rythme des techniques de dissimulation de plus en plus sophistiquées employées par les trafiquants.
Les évolutions supposent cependant des investissements coûteux et la réunion de plusieurs facteurs : l'efficacité de l'IA dépend de la qualité et de la quantité des données d'entraînement (images radiographiques et vidéos). La création de bibliothèques complètes et correctement cataloguées d'images d'espèces protégées et de leurs sous-produits est un travail colossal, d'autant que tout système de détection produit un certain taux de faux positifs. La variété quasi infinie des espèces sauvages (mammifères, reptiles, oiseaux, insectes, plantes, bois) et de leurs produits dérivés (ivoire, cornes, peaux, viande, médicaments traditionnels) rend l'identification automatisée particulièrement complexe. Avant le déploiement de ces équipements de nouvelle génération, il est donc crucial de minimiser ces erreurs en fiabilisant le plus possible les instruments mis à la disposition des douaniers pour éviter de surcharger les équipes de contrôle et de ralentir les opérations aéroportuaires.
Il convient en outre de garder présent à l'esprit que le principal enjeu ne réside pas tant dans la détection du trafic que dans les capacités opérationnelles des agents, largement sollicitées en raison de l'afflux massif de produits carnés. Les investissements technologiques ne produiront leurs pleins effets que si les moyens humains de la douane sont en mesure d'exploiter les gains de productivité résultant de ces innovations. Le développement technologique devra en effet être concilié avec la capacité des services douaniers à traiter les flux de bagages et de voyageurs. La Commission européenne a relevé en 2022 le manque de personnel et de moyens dédiés à la lutte Cites à l'échelle du continent : dans 61 % des États membres, moins de 10 agents y consacrent ne serait-ce qu'une partie de leur temps.
Cette contrainte est accentuée par le fait qu'à l'aéroport Charles de Gaulle la majorité des arrivées en provenance des zones concernées par le trafic d'espèces protégées est concentrée sur un intervalle de temps très court, compris entre 6 et 11 heures, c'est-à-dire en même temps que de nombreux vols d'autres provenances et avec d'autres missions de lutte contre la fraude à réaliser en parallèle. Les horaires de présence douanière, vétérinaire ou de la PAF sont encore trop souvent organisés selon une logique de service public classique, et non en tenant compte de la pression réelle des flux. Cela crée des zones grises temporelles, parfaitement connues et exploitées par les trafiquants. La mission d'information appelle à corriger ces failles à l'origine d'effets d'aubaine préjudiciables à l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées.
L'adéquation des moyens humains aux volumes trafiqués est en effet fondamentale et indépassable pour détecter, traiter et juger les infractions. La recherche de solutions permettant d'améliorer l'efficience et la rapidité du traitement des procédures est également une voie à explorer. Pour cette raison, la mission d'information plaide pour un renforcement ciblé des effectifs douaniers chargés des contrôles aéroportuaires, en mettant également l'accent sur l'amélioration des conditions de travail et la logistique des contrôles, le renforcement de l'efficacité des équipements de protection individuelle et l'installation d'équipements spécialisés pour identifier les produits animaux, spécimens dissimulés ou cargaisons suspectes.
En complément des évolutions technologiques et du renforcement des moyens humains, le recours à des chiens de détection, connus pour leur efficacité et fréquemment employés par certains pays69(*), permet de compléter la panoplie des techniques de contrôle en accroissant de manière significative les taux de détection. La présence régulière des équipes de chiens de détection en zone passagers présente en outre l'avantage de marquer les voyageurs et de rendre le contrôle perceptible.
Leur sens de l'odorat développé leur permet de détecter des traces infimes d'espèces sauvages ou de produits dérivés, même cachées dans des bagages ou du fret. Des études ont montré que les chiens de détection sont souvent plus rapides et plus efficaces que les méthodes humaines pour couvrir de larges zones et trouver des échantillons dissimulés. Des programmes de formation spécialisés et la mobilisation d'agents affectés à la conduite des chiens sont cependant nécessaires pour maximiser l'efficacité de cette technique éprouvée.
Recommandation n° 10 : Systématiser l'emploi de brigades cynophiles, pour démontrer la réalité des contrôles et accentuer la perception du risque de détection, recourir aux technologies innovantes combinées à des outils fondés sur l'intelligence artificielle pour faciliter la détection des bagages frauduleux et réduire la porosité des points de passage en douane.
4. Mettre fin à la méconnaissance réglementaire des voyageurs et renforcer l'effectivité des sanctions qui répriment les trafics
La plupart des acteurs entendus ont souligné la profonde méconnaissance réglementaire de la plupart des passagers quant aux prohibitions de transport et d'importation de produits carnés et d'espèces protégées et le désarroi des douaniers face au grand nombre de contrevenants d'ignorance. Même si, en droit, l'objection d'ignorance normative n'est pas susceptible de rendre inopérantes les sanctions douanières ou pénales70(*), en vertu du principe selon lequel « nul n'est censé ignoré la loi », il convient malgré tout d'être attentif à cette question et d'oeuvrer à une information renforcée et lisible, à tous les stades du parcours voyageur.
Contrairement à certaines interdictions répétées depuis l'achat du billet jusqu'à l'arrivée à destination et qui bénéficient à ce titre d'une forte visibilité et d'une bonne connaissance des voyageurs, la prohibition concernant l'emport de produits carnés et d'espèces protégées est beaucoup plus discrète. La mission d'information estime qu'un effort de sensibilisation accru doit être mis en oeuvre, de la part de l'ensemble des acteurs.
Pour être identifiée, comprise et retenue par les voyageurs, il est nécessaire que cette information soit visuelle, multilingue, omniprésente et répétée, de l'achat du billet jusqu'au passage en douane. De même, elle doit être diffusée à travers des canaux multiples et renforcée par des campagnes de communication massives, notamment sur les réseaux sociaux et dans les zones de transit. Cette stratégie de martèlement de la réglementation en matière d'espèces protégées implique une mobilisation coordonnée des compagnies, des plateformes, des agences de voyage, des aéroports, des douanes et des pouvoirs publics.
a) Repenser la manière d'informer les passagers et renforcer la lisibilité de la norme
Les travaux du rapporteur ont mis l'accent sur une défaillance informative majeure en matière de réglementation encadrant l'importation d'espèces protégées et de produits carnés : on informe beaucoup trop tard les passagers. Pour que le message puisse modifier les comportements et les habitudes, il convient d'inverser la logique en rappelant chaque fois que possible les interdictions réglementaires tout au long du parcours voyageur, et ce dès l'achat du billet.
L'information sur l'interdiction de transporter des denrées animales et les risques encourus est en effet aujourd'hui insuffisante, trop tardive et trop discrète. Les passagers impliqués dans les saisies plaident souvent la bonne foi et le manque d'information. Pour qu'elle devienne réellement dissuasive, l'interdiction doit être répétée de manière systématique, multilingue et explicite à chaque étape du parcours voyageur : à l'achat du billet, à l'enregistrement, en vol et à l'arrivée. L'enjeu est de graver dans l'esprit des voyageurs la règle « pas de viande, ni de produits animaux bruts » de la même manière que « pas d'armes et pas de drogues ».
Au cours de son audition, le directeur santé animale de l'Anses, Éric Cardinale, a suggéré que le message pourrait s'articuler autour des éléments suivants : « Emporter de la viande illégale, ce n'est pas juste ramener un peu de chez soi, c'est risquer des amendes, introduire des maladies mortelles et financer des trafics illégaux. Déclarez-le, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de risque de maladie si c'est jeté. Ne le déclarez pas, et vous risquez gros. »
La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a indiqué à la mission d'information être pleinement consciente de l'enjeu de mieux informer les voyageurs durant l'ensemble de leur parcours, c'est-à-dire de l'enregistrement dans le pays de départ jusqu'à l'arrivée en France. En combinant différentes approches, il est en effet possible de créer un écosystème d'information et de dissuasion qui agit tout au long du parcours voyageur, de la planification à l'arrivée, rendant la tâche plus difficile pour les trafiquants et plus claire pour les passagers honnêtes.
La sensibilisation des voyageurs s'est notamment traduite par la production de nouveaux supports d'information :
- de nouvelles affiches ont été installées dans les principaux aéroports par la DGDDI et des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la douane ;
- Air France a intégré la vidéo créée par la DGDDI (version française et anglaise) dans les programmes de tous ses vols long-courriers ;
- des supports ont été adressés aux consulats des pays de provenance concernés pour sensibiliser les voyageurs ;
- la DGDDI a organisé une exposition à l'aéroport de Lyon pendant les vacances scolaires 2024 afin de toucher un maximum de voyageurs en partance vers l'Afrique, en partenariat avec Vinci ;
- une exposition spécifique est prévue prochainement dans les aéroports de Paris concernés par les importations massives de produits carnés dans les bagages voyageurs.
Le groupe Air France - KLM s'est quant à lui engagé de manière volontaire dans la voie du rappel de la réglementation concernant la prohibition du transport de produits périssables dans les bagages, par l'intermédiaire d'une campagne de communication répondant aux critères de lisibilité et d'accessibilité du message à faire passer. Cette initiative, intéressante, gagnerait à être mise en oeuvre par d'autres compagnies afin de toucher un plus grand nombre de passagers.
Afin d'accroître l'efficacité de la communication, un message immédiatement reconnaissable grâce à un pictogramme pourrait être déployé, dont le visuel signifierait qu'aucun produit carné ni animal brut - viande de brousse, charcuterie artisanale, fromage au lait cru non pasteurisé - n'est autorisé. Il est souhaitable que ce message soit uniforme et identique pour tous les canaux de communication. Les messages qui accompagnent ce pictogramme devront clairement indiquer qu'il n'y a pas de « petites quantités » ou de « consommation personnelle » tolérée pour les produits non transformés ou à risque, sauf dérogation stricte et traçable.
Outre le rappel réglementaire strict des interdictions, ces messages pourraient être assortis de rubriques « pour en savoir plus » établissant le lien entre le trafic d'espèces sauvages, la consommation de viande de brousse non contrôlée et l'émergence de zoonoses et de pandémies. Cela constituerait un argument puissant pour la santé des citoyens, audible et compréhensible des passagers, qui verraient ainsi l'intérêt à respecter une interdiction dont ils comprennent la raison et le fondement scientifique.
Recommandation n° 11 : Élaborer une signalétique informative multicanaux à destination des passagers, depuis l'achat du billet jusqu'à l'arrivée à destination, rappelant les interdictions de transport d'espèces sauvages tout au long du parcours voyageur, pour en finir avec l'invocation du principe de bonne foi qui nuit à l'efficacité de la réponse douanière.
Comme indiqué plus haut, la complexité de la réglementation européenne en matière de transport et d'importation de produits périssables71(*) constitue également un facteur de complexité qui entre en contradiction avec la clarté normative indispensable au respect de la législation. Le rapport de la mission interministérielle sur la lutte contre l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées de décembre 2023 avait relevé que la Commission européenne a rejeté la proposition de la France d'abolir les dérogations à l'interdiction d'importation par les particuliers en matière de poisson, d'oeufs et de miel, afin de rendre la réglementation plus lisible et pour mieux prendre en compte le risque sanitaire.
Un réexamen de cette position serait de nature à clarifier le message en direction des passagers, avec l'interdiction pure et simple de l'introduction sur le territoire de tout produit carné ou animal brut, mais permettrait également de faciliter le travail de contrôle des services douaniers et d'afficher la cohérence d'une législation fondée sur un principe de précaution sanitaire.
b) Envisager le principe d'une déclaration sur l'honneur
L'intensification de la communication auprès des passagers est un préalable indispensable, mais qui ne permettra toutefois pas de toucher l'ensemble des voyageurs susceptibles de transporter des espèces protégées et des produits carnés. D'autres vecteurs devront être mobilisés si l'on vise un objectif d'information systématique de tous les passagers, qui rendrait inopérante l'objection de méconnaissance de la règle de droit et permettrait d'écarter l'ignorance de bonne foi lors des contrôles douaniers.
Sur le modèle de dispositifs existant dans certains pays anglo-saxons, la mission d'information préconise une réflexion au niveau européen, avec les autres États de l'Union européenne et les acteurs privés, sur l'opportunité d'instaurer une obligation de remplir au moment de l'enregistrement, pour les voyageurs en provenance des pays tiers ou de zones concernées par le phénomène, une déclaration sur l'honneur attestant avoir pris connaissance des règles en matière d'importation de produits animaux ou végétaux et de ne pas transporter de marchandise illicite, denrées animales ou espèces protégées.
À cela pourrait également s'ajouter, sur le modèle australien ou canadien, une auto-déclaration douanière obligatoire et simplifiée à remettre à l'arrivée, engageant juridiquement la responsabilité du signataire, qui permettrait tout à la fois d'informer, de responsabiliser et de sanctionner rapidement les contrevenants. Les systèmes australien et néo-zélandais reposent sur une question simple et directe dans la carte d'arrivée : « Transportez-vous des produits d'origine animale, végétale, de la terre... ? » Le passager doit simplement cocher « oui » ou « non ». L'accent est mis sur les lourdes pénalités en cas de fausse déclaration, avec des amendes élevées, une interdiction d'entrée, voire des poursuites pénales.
Cette proposition de faire signer une déclaration sur l'honneur de non-transport de marchandises prohibées constituerait un levier intéressant : elle formalise de façon objective et opposable l'information et l'acceptation de la connaissance des règles par le passager, rendant l'argument d'ignorance caduc.
Recommandation n° 12 : Interdire l'importation de toute espèce animale et produit carné par des particuliers sur le territoire européen, combiné à un régime déclaratif sur l'honneur relatif au non-transport de produits prohibés, avant l'entrée sur le territoire.
Si elle devait être mise en oeuvre, l'introduction de cette mesure forte doit s'accompagner d'aménagements spécifiques : il serait opportun que les voyageurs aient également la possibilité, au niveau de la zone de récupération des bagages, de jeter leur marchandise avant les contrôles douaniers, dans des contenants spécifiquement désignés à cet effet, à l'exemple de poubelles pour déchets représentant un risque biologique. Ce dispositif est notamment connu sous le nom anglais d'« amnesty bin ».
En disposant des poubelles clairement identifiées avant les points de contrôle douanier, où les passagers de bonne foi peuvent se délester de produits non déclarés ou marchandises illicites sans encourir de pénalité, cela inciterait les voyageurs au « dessaisissement volontaire » sans sanction, sauf pour les espèces Cites qui doivent toujours être déclarées, en offrant une dernière chance de se conformer aux règles.
Le déploiement de bacs de collecte identifiés et visuellement percutants avant les contrôles de sécurité et douaniers, avec le message « Jetez ici vos produits interdits, sans risque », présenterait en outre d'autres avantages : les voyageurs ne pourraient plus feindre d'ignorer la loi en passant devant les douaniers, rendant inopérante l'objection de bonne foi par le voyageur contrôlé. Le déploiement de ces dispositifs permettrait de limiter l'affluence aux passages de frontières et réduire le nombre de constatations et de saisies à opérer pour les douaniers, grâce aux abandons volontaires de marchandises prohibées.
Recommandation n° 13 : Rendre possible l'abandon de produits carnés avant le passage en douane grâce à la mise en place de points de collecte dédiés surmontés du rappel de la règlementation (« amnesty bin »).
c) Renforcer l'effectivité des sanctions pour dissuader les trafiquants
Si le lancement de campagnes de sensibilisation, la généralisation de formulaires douaniers sur les interdictions d'importation aux voyageurs et l'affichage dans les aérogares constituent des approches pertinentes, elles n'auront cependant d'effet tangible que sur les passagers de bonne foi et ne suffiront aucunement à mettre un terme aux trafics structurés opérés par des réseaux criminels transnationaux. Pour lutter contre le fléau du crime organisé, seule l'activation effective de leviers judiciaires permettra de renforcer le caractère dissuasif de notre arsenal législatif.
En combinant une information massive et claire, des sanctions connues et systématiquement appliquées - qu'elles soient administratives pour les cas mineurs ou pénales et lourdes pour les trafics organisés - et une meilleure traçabilité des antécédents, il est possible d'entraîner une véritable prise de conscience et de faire évoluer l'analyse de risque encouru par les voyageurs et trafiquants pour le fait d'introduire ces marchandises illicites en France.
Au cours de ses travaux, le rapporteur s'est forgé la conviction qu'il fallait s'assurer que les peines encourues soient à la hauteur des bénéfices générés par ce trafic et des risques sanitaires et environnementaux qu'il engendre. Pour cette raison, il préconise de rehausser les sanctions pénales, en les alignant sur celles prévues pour le trafic de stupéfiants, afin de mieux refléter la gravité écologique, sanitaire et criminelle de ces actes. Certains pays ont instauré un quantum des peines très sévère afin de réprimer l'introduction d'espèces protégées et sauvages sur leur territoire national, qui suggère que nous n'avons pas pleinement pris la mesure des risques sanitaires et écologiques posés par ce trafic.
Quelques exemples de législations
étrangères
en matière d'importation d'espèces
sauvages
On se concentrera ici sur le Lacey Act aux États-Unis et l'Environment Protection and Biodiversity Conservation Act en Australie, qui présentent la particularité commune d'instaurer des poursuites systématiques en cas de violation du droit étranger, qui permet au juge national de sanctionner une importation illégale même si l'infraction a eu lieu à l'étranger. Ces systèmes législatifs reposent sur une responsabilité pénale des entreprises, des sanctions très dissuasives et sont renforcés par des capacités de saisie très fortes, des formations spécifiques pour la manipulation de la faune, des obligations de déclaration et un suivi rigoureux des importateurs.
Le Lacey Act, amendé en 2008, rend illégal le commerce (importation, exportation, transport et vente) de tout poisson, faune, flore ou produit végétal pris, possédé, transporté ou vendu en violation de toute loi, traité ou règlement des États-Unis, de toute loi tribale amérindienne ou de toute loi étrangère. C'est un instrument extrêmement puissant car il permet aux procureurs américains de poursuivre des trafiquants, même si l'acte de braconnage initial s'est produit dans un autre pays, dès lors que le produit transite ou est destiné aux États-Unis. Il impose également des exigences de déclaration pour les produits végétaux et forestiers, afin de lutter contre l'exploitation illégale du bois.
Le cas australien (« coffre-fort ») est spécifique, car il découle de spécificités propres au territoire : il s'agit d'un écosystème insulaire et fragile, susceptible de pâtir de catastrophes écologiques en raison de l'introduction d'espèces invasives. C'est pourquoi un cadre législatif très strict concernant l'importation de produits d'origine biologique a été élaboré, avec des contrôles rigoureux aux frontières et des sanctions très lourdes pour les fausses déclarations. Les peines pour l'exportation illégale d'espèces natives peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et des amendes considérables (110 000 AUD). La force de ce système réside dans la combinaison d'une information très claire aux voyageurs sur les risques et une application stricte des peines en cas de non-conformité.
Cette architecture normative est cependant difficilement transposable dans un pays comme la France : notre connectivité avec d'autres régions du monde est plus grande et nous formons un marché commun avec les autres États de l'Union européenne, ce qui contraint notre capacité à mettre en oeuvre des mesures inspirées par ces modèles de façon unilatérale.
L'application de la Cites, non couplée à une autre stratégie, ne permettra pas de répondre à la problématique d'importation illicite de produits carnés, puisque moins de 15 % de ces derniers seraient issus d'espèces inscrites à la Cites. Les importations de viande de brousse sont préoccupantes pour leur non-conformité avec les normes sanitaires et vétérinaires européennes. Cette infraction, bien que porteuse de risque pour la santé publique, n'est généralement pas liée à des réseaux de criminalité organisée d'envergure comparable. Elle relève principalement du droit sanitaire public, visant à prévenir la propagation de maladies animales et zoonotiques.
C'est un levier que la mission d'information préconise de mieux mobiliser : le volet sanitaire pourrait constituer le point d'entrée des infractions, dans le cadre d'une approche fondée sur le risque, qui aurait le mérite de renforcer la cohérence de notre édifice normatif et d'unifier la réponse afin de tarir les flux de ce trafic, sans avoir à connaître précisément l'origine et la nature des marchandises interceptées. Le simple fait qu'elles présentent un danger pour la santé humaine et animale suffirait dans cette hypothèse à qualifier l'infraction.
Recommandation n° 14 : Rationnaliser le contentieux en matière de trafic d'espèces protégées, reposant aujourd'hui sur 174 infractions dispersées dans plus de quinze codes, en privilégiant les poursuites sous l'angle sanitaire et de santé publique, gage d'une qualification plus immédiate des infractions.
Pour les « petits contrevenants », c'est-à-dire les passagers sans antécédent douanier qui transportent de faibles quantités de marchandises prohibées, l'amende forfaitaire douanière ou la transaction douanière peuvent constituer une réponse rapide et proportionnée, à condition que le montant soit suffisamment dissuasif - par exemple, 300 à 500 euros pour une première infraction de viande de brousse.
En parallèle, une meilleure sensibilisation du grand public en France pourrait limiter la demande et impacter des réseaux hors de portée de nos frontières, notamment grâce à une meilleure information sur les risques sanitaires de la consommation de viande d'espèces sauvages, au départ et à l'arrivée sur le territoire national.
Pour les volumes plus significatifs ou la récidive, le passage devant le tribunal correctionnel semble indispensable, en étudiant la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement, des amendes significatives, la confiscation des biens et des peines complémentaires telles que l'interdiction du territoire français pour les étrangers. La sévérité d'application des peines est l'une des conditions du caractère dissuasif de notre législation. L'impunité de fait qui prévaut, faute de réponse judiciaire à la hauteur des enjeux, neutralise en partie le travail de contrôle et l'engagement des douaniers sur ces questions.
Pour la criminalité organisée, l'application des peines aggravées - jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende - l'utilisation des techniques d'enquête spéciales et la coopération internationale sont essentielles afin de mettre un coup d'arrêt aux réseaux organisés opérant sur le territoire, remonter les filières et afficher la détermination des pouvoirs publics à réprimer fermement et sévèrement les criminels.
Recommandation n° 15 : Envisager la possibilité de retirer le visa de court séjour en cas de constatations répétées de transport de produits carnés afin de mettre un coup d'arrêt au trafic dit de subsistance, ou une interdiction du territoire français (ITF) pour les ressortissants étrangers.
5. Accompagner la prise de conscience du secteur des transports pour réduire les franchissements de frontière
Les acteurs du transport, notamment aéroportuaires et maritimes, ont également un rôle majeur à jouer vis-à-vis des passagers et des marchandises qu'ils acheminent, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés. Leur sensibilisation et leur mobilisation sont essentielles pour réduire les flux générés et les risques associés. C'est d'ailleurs la conviction qui a animé en 2016 les signataires de la déclaration de Buckingham Palace, déjà présentée plus haut dans ce rapport, qui vise à favoriser la collaboration des acteurs du transport, faciliter le partage d'informations avec les autorités compétentes, notamment les douanes, et à sensibiliser les différents acteurs aéroportuaires à la lutte contre le trafic d'espèces.
Outre ces engagements volontaires, il existe un cadre normatif qui stipule les obligations en la matière des acteurs du transport. Au titre du règlement sanitaire international (RSI) et du code de la santé publique72(*), dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moyens de s'informer sur les risques sanitaires connus de leur destination ainsi que, le cas échéant, sur les mesures de protection recommandées. Les compagnies de transport ont ainsi vocation à accompagner et renforcer l'effort de sensibilisation aux réglementations et aux interdictions qu'elles déclinent.
En cas de risque pour la santé publique, ces mêmes exploitants sont tenus de diffuser, par tout moyen, à chaque passager en provenance ou à destination de zones prédéfinies par l'autorité administrative, les informations relatives aux précautions d'hygiène à respecter ou à la conduite à tenir en présence de cas suspects afin d'éviter la propagation internationale d'une maladie.
Au cours des travaux de la mission d'information, plusieurs acteurs ont déploré le manque d'implication des compagnies aériennes dans le processus de contrôle des bagages voyageurs et ont proposé d'aligner le régime de responsabilité des transporteurs aériens sur celui des transporteurs routiers, qui sont responsables des marchandises qu'ils transportent. Le cadre juridique actuel engage en effet la responsabilité juridique du passager pour le transport de marchandises illégales telles que des spécimens ou produits d'espèces Cites, et non celle du transporteur aérien vis-à-vis de la cargaison des passagers contenant des spécimens d'une espèce animale ou végétale protégée.
Outre la différence fondamentale de nature entre le transport routier et aérien, la mission d'information estime cependant que cette évolution n'est pas opportune si elle ne concerne que le territoire national : toute évolution relative au régime de responsabilité des transporteurs aériens et maritimes doit être discutée au sein des instances européennes et internationales, afin d'éviter des distorsions de concurrence et reports de trafic qui ne résoudraient en rien la problématique des espèces protégées, tout en pénalisant les compagnies qui y seraient soumises.
En revanche, le rapporteur partage la nécessité d'inciter les compagnies à faire preuve de vigilance par rapport aux espèces protégées, à travers une formation accrue de leur personnel, des mesures pour prévenir les trafics et des procédures spécifiques en cas de découverte de trafic par leurs services. L'idée serait de les engager à davantage informer les voyageurs et à mettre en place des mesures préventives, voire à envisager une obligation de déclaration sur l'honneur de non-transport de denrées interdites ou d'animaux vivants.
Plutôt qu'instaurer des contraintes nouvelles dans le contexte fortement concurrentiel du transport aérien qui pénaliseraient les acteurs nationaux sans parvenir à résoudre le problème à la bonne échelle, il pourrait être envisagé la création d'un label ou d'une certification pour les compagnies aériennes qui adoptent de bonnes pratiques pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, y compris des politiques de bagages spécifiques, leur offrant un avantage en termes d'image et d'attractivité pour les passagers soucieux de l'environnement. La crédibilité et la confiance en cette labellisation doit s'appuyer sur des systèmes d'audit indépendants afin d'évaluer l'efficacité des mesures anti-trafic mises en oeuvre par les compagnies aériennes, maritimes et de fret.
Au cours des auditions, plusieurs acteurs ont par ailleurs suggéré de mobiliser le levier du régime d'emport des bagages, à travers des mesures telles que le renchérissement significatif du coût du second bagage, voire son interdiction. Si elle peut paraître séduisante à première vue, cette solution soulève plusieurs difficultés juridiques et économiques : elle est notamment contraire au principe européen et international de libre détermination de la politique tarifaire par les compagnies aériennes et présente un fort risque de distorsion de concurrence, au détriment des acteurs nationaux soumis à une contrainte tarifaire à laquelle les compagnies étrangères échapperaient.
En l'état des dynamiques du marché du transport aérien, une modification du régime d'emport des bagages instaurée pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages semble peu réaliste et difficilement applicable sans effets indésirables massifs sur les voyageurs et la concurrence. La mission d'information estime que l'approche la plus judicieuse consiste à se concentrer sur des mesures incitatives, une meilleure coordination internationale et des technologies de renseignement plus sophistiquées pour cibler les trafiquants, tout en laissant aux compagnies aériennes la flexibilité de leurs politiques tarifaires pour maintenir leur compétitivité. Plutôt qu'imposer des règles nouvelles à l'origine d'effets de bord difficiles à anticiper, il serait préférable que les organisations internationales de l'aviation civile (OACI) ou du transport aérien (Iata) émettent des recommandations ou des « bonnes pratiques » aux compagnies, présentant l'avantage de préserver leur autonomie tarifaire tout en favorisant une convergence.
Recommandation n° 16 : Convaincre les États parties à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale d'élever la mise en oeuvre de procédures pour combattre le trafic d'espèces sauvages au niveau de « norme » et non de simple « recommandation » et promouvoir l'engagement et la redevabilité des acteurs du transport pour prévenir, détecter et bloquer les activités illégales.
Au cours de son audition, l'International Air Transport Association (Iata) a indiqué avoir publié des directives sur les recommandations concernant le transport interdit d'animaux sauvages, allant des communications à la collaboration croisée avec les partenaires de l'industrie73(*). Iata a également mené des campagnes relatives à la peste porcine africaine pour sensibiliser les compagnies aériennes, les aéroports et les autorités aux menaces que le trafic d'espèces sauvages fait peser sur la biodiversité et la santé humaine et animale. Des vidéos diffusées à bord, développées par les autorités nationales, montrent les menaces, promeuvent les bonnes pratiques et informent sur les réglementations en vigueur concernant les espèces sauvages.
Au niveau de l'industrie, Iata fournit également aux compagnies aériennes qui le souhaitent une évaluation environnementale (IEnvA), qui peut faire l'objet d'une certification spécifique du module « Faune Sauvage », reçue à ce jour par 8 compagnies aériennes. Parmi les compagnies aériennes s'étant engagées dans cette démarche, on peut notamment citer les exemples d'Air France, qui a inclus des messages et vidéos sur certaines lignes et de British Airways, qui a nommé des référents pour promouvoir ce sujet.
Les efforts d'Air France pour répondre aux
enjeux
du trafic d'espèces protégées
Lors de son audition, Air France a indiqué avoir pleinement conscience qu'informer et communiquer auprès des clients et des salariés relevait du périmètre de responsabilité d'une compagnie aérienne. Ses objectifs en la matière visent à toucher le client à chaque étape de son parcours et à sensibiliser les salariés, particulièrement ceux en contact avec les clients et leurs bagages, pour répondre aux questions, identifier et signaler les signaux faibles d'un potentiel trafic.
Air France informe ainsi ses clients des interdictions concernant le transport d'espèces protégées et de produits carnés, notamment sur son site commercial dans la rubrique « Articles interdits dans les bagages », ainsi qu'à bord des vols long-courriers en s'appuyant sur une vidéo de sensibilisation sur le trafic illégal. Ces informations sont également incluses dans les messages électroniques adressés aux passagers en amont de leur voyage.
Source : Air France
Les sanctions relatives au transport illégal d'espèces sauvages sont rappelées à bord, dans les vidéos produites par Air France et les douanes, en mettant également l'accent sur les aspects sanitaires.
Source : Air France
Dans l'optique de sensibiliser les voyageurs durant l'ensemble de leur parcours, Air France a mis en oeuvre de façon volontaire des modifications de son système informatique d'enregistrement au départ de sept escales africaines pour recueillir un engagement de la part du client. Depuis avril 2025, la totalité des clients emportant au moins un bagage en soute en provenance de l'une des sept destinations identifiées sont interrogés au minimum une fois quant à leur éventuel transport de produits interdits par la Cites et la réglementation sanitaire européenne.
6. La lutte numérique et postale, des pans de l'action publique à ne pas négliger
Jusqu'à présent, les constats et recommandations ont surtout porté sur la façon de réduire le volume et les flux des produits prohibés transportés par des voyageurs au sein de leurs bagages, depuis le pays de départ où les marchandises illicites sont collectées jusqu'à l'arrivée et le franchissement du contrôle douanier. Il ne s'agit pas cependant du seul canal utilisé par les trafiquants, le commerce illégal d'espèces sauvages et protégées prospérant également par l'intermédiaire des colis postaux et de la vente en ligne.
Si le transport aérien est bien identifié comme un canal du trafic, tous les vecteurs sont utilisés : les douanes ont indiqué au rapporteur que le trafic par colis express ou postaux connaissait une progression constante. Pour répondre à la forte demande solvable qui leur est adressée, les trafiquants d'espèces sauvages et protégées ont développé un réseau logistique et de transport interconnecté, impliquant des points d'entrée aériens, terrestres et maritimes, des compagnies aériennes de passagers et de fret et des compagnies maritimes. Les importations de marchandises illicites par conteneurs arrivant aux ports maritimes de Marseille et du Havre sont également significatives, bien que complexes à quantifier faute de données : le WWF a estimé au cours de son audition que 72 à 90 % du volume d'espèces sauvages faisant l'objet d'un trafic illégal au niveau mondial sont passés en contrebande via l'industrie du transport maritime, ce qui plaide pour une stratégie dédiée à cette voie d'entrée, même s'il ne s'agit pas de l'angle qui a été privilégié par la mission d'information au cours de ses travaux.
Les trafiquants mobilisent également de façon croissante des courriers express, des sociétés postales et des transitaires pour la livraison des marchandises illégales. Le trafic s'hybride de plus en plus, facilité en cela par le progrès technologique : les réseaux criminels utilisent aussi les plateformes numériques d'e-commerce et les réseaux sociaux, le fret postal pour les animaux de petite taille, les produits secs ou sous vide, ainsi que les transports routiers transfrontaliers.
Source : WWF et Air France
Selon les données fournies par ADP au rapporteur, 40,5 % des flux illicites d'espèces protégées saisies dans les enceintes aéroportuaires ont transité par le fret postal express en 2023. La direction interrégionale des douanes de Paris-Aéroports a ainsi réalisé 155 saisies en fret express et général cargo dans les aéroports parisiens, soit près de 30 % des constatations nationales, dont 17 par la DRV (voyageurs de Roissy) et 133 par la DRF (Fret de Roissy). Le fret express devient progressivement une porte d'entrée majeure du trafic sur le territoire national : de petites quantités de produits carnés, comme de la viande séchée et des produits transformés, voire de jeunes animaux tels que des reptiles et des insectes, sont désormais envoyées par la poste ou via des services de fret express. Les colis sont souvent très bien dissimulés, d'autant que le volume colossal des colis internationaux rend la détection peu probable.
En fret express, ADP a indiqué à la mission d'information que l'on trouvait principalement des espèces végétales, comme des cactus de Thaïlande et des plantes endémiques de Madagascar, et des parties d'animaux, dents de requins, griffes d'ours, etc. Dans les vols cargo, les saisies incluent des pièces plus importantes, voire ponctuellement des animaux vivants en provenance d'Afrique ou d'Asie. Un python vivant a récemment été découvert au centre de dédouanement postal, ainsi que des scorpions Pandinus imperator, légèrement venimeux, cachés dans de petites boîtes scotchées.
Recommandation n° 17 : Passer à une logique « tous flux » en investissant dans le développement de techniques automatisées d'analyse non invasive de colis postaux et de fret express, dont le volume colossal et exponentiel rend la détection de produits carnés ou de jeunes animaux particulièrement complexe.
En ce qui concerne la croissance rapide du commerce illégal d'espèces sauvages via internet et les réseaux sociaux, elle n'a pas été anticipée ni traitée avec des outils suffisamment agiles par les pouvoirs publics. Accompagnée par l'essor d'internet, des réseaux sociaux et du fret postal, la mode des nouveaux animaux de compagnie (NAC) soutient le trafic d'espèces protégées. L'intérêt des collectionneurs pour des spécimens exotiques, vivants ou non, reste élevé, ce qui alimente un marché parallèle très actif, à travers les réseaux sociaux, les plateformes de vente et les foires. On observe également une diversification vers des espèces plus rares, plus complexes à élever ou plus dangereuses. La quête de l'exclusivité est un moteur.
Aujourd'hui, de nombreuses plateformes en ligne, légales ou semi-légales, permettent de se procurer en quelques jours, livrés par fret postal et express, des spécimens vivants ou morts d'espèces protégées. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux mettent en avant certaines tendances, notamment en rendant désirable le fait de posséder des animaux exotiques tels que des félins, des singes, des rapaces ou des insectes, soit autant de moteurs pour une demande nouvelle. Les contenus publiés sur les réseaux sociaux ou autre plateforme de partage exercent une influence certaine sur l'offre et la demande illégales d'animaux sauvages.
À titre d'exemple, une très forte augmentation du trafic de servals et de caracals est observée en France depuis la création de comptes dédiés à la vie de ces félins en maison et la diffusion de visuels faisant apparaître des personnes influentes avec ces animaux. Ces vidéos, non modérées, renforcent l'image que cette appropriation d'une espèce sauvage chez soi est acceptable et que cela ne pose pas de problématiques particulières. L'utilisation généralisée des réseaux sociaux a facilité certains effets de mode, comme la médiatisation de l'acquisition d'espèces sauvages et exotiques comme symbole de réussite sociale et de richesse. Si cette tendance a historiquement toujours existé, la multiplication des plateformes en ligne facilitant la diffusion et les échanges a entraîné une explosion du commerce illégal des espèces sauvages, y compris en France. C'est devenu un champ à part entière où prospère le trafic, avec un sentiment d'impunité pour ceux qui s'y adonnent grâce à l'anonymat des transactions.
Le rôle joué par le commerce en ligne devient en effet majeur pour l'achat d'animaux sauvages et de leurs produits dérivés. Les recherches pionnières menées par l'Ifaw74(*) depuis plus d'une décennie et demie ont permis de découvrir des dizaines de milliers d'annonces ou de publications proposant des espèces sauvages protégées et leurs parties à la vente sur Internet. À titre d'exemple, l'étude de 2023 sur le commerce de l'ivoire en ligne75(*) a montré que des quantités importantes d'ivoire sont encore commercialisées en ligne dans l'UE : en seulement 23 jours, 1 330 articles en ivoire ou suspectés d'en contenir ont été enregistrés à la vente à travers 831 annonces, réparties sur 49 places de marché en ligne et sites web de maisons de vente aux enchères opérant dans sept pays de l'UE.
La vente et l'achat d'animaux ou de produits illégaux se font ainsi de plus en plus via des plateformes en ligne, des groupes privés sur les réseaux sociaux, des forums spécialisés et des applications de messagerie cryptées, soit des canaux offrant un certain anonymat et permettant d'atteindre un large public rapidement. Ainsi que l'indique le directeur santé animale de l'Anses, « l'ampleur du trafic est le reflet d'une tension entre une offre criminelle organisée et très profitable, et une demande diversifiée, alimentée par des facteurs culturels, sociaux et un manque de sensibilisation, le tout facilité par la mondialisation et les outils numériques. La progression observée est donc le résultat de cette interaction, qui continue de représenter une menace majeure pour la biodiversité et la santé publique ».
Des évolutions législatives opportunes sont cependant à signaler ces dernières années s'agissant de la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages en ligne. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a notamment précisé que les réglementations qui encadrent le commerce des spécimens d'espèces menacées, tant sur le plan national qu'européen, s'appliquent également au commerce en ligne. La loi du 30 novembre 2021 relative au bien-être animal est venue apporter certaines réponses à cette problématique, son article 18 prohibant l'offre et la cession d'animaux de compagnie en ligne par des particuliers. Aux termes de cette loi, seuls les vendeurs professionnels d'animaux de compagnie peuvent réaliser ces transactions, sous réserve que les annonces soient présentées dans une rubrique spécifique et comportant « des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal ». L'article 4 de la loi du 9 juin 2023 relative à l'influence commerciale sur les réseaux sociaux précise qu'il est interdit aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale, sauf pour les établissements autorisés à détenir ces animaux, « toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement », c'est-à-dire les espèces non domestiques susceptibles d'être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément, dont la liste est limitativement fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Outre ces évolutions normatives, des initiatives privées ont également cherché à réduire ces modes opératoires en pleine progression. Sur ce registre, on peut notamment citer l'exemple de la Coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne, initiée en 2018 par les organisations non gouvernementales WWF, Traffic et Ifaw, qui regroupe aujourd'hui 47 sociétés partenaires. En fédérant des entreprises de e-commerce, de recherche et de réseaux sociaux, cette coalition vise à réduire le trafic d'espèces sauvages en ligne en invitant l'ensemble des acteurs du secteur à partager des constats et des bonnes pratiques.
À ce jour, les sociétés partenaires ont déclaré avoir bloqué ou supprimé plus de 24,1 millions d'annonces violant leurs politiques sur les espèces sauvages interdites à la vente. Parmi les espèces concernées figuraient notamment des grands félins, des reptiles, des primates et des oiseaux vivants destinés au commerce d'animaux de compagnie exotiques, ainsi que des produits issus d'espèces sauvages telles que les éléphants, les pangolins et les tortues marines. Avec l'appui de la Coalition, chaque entreprise partenaire s'engage à élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des dispositifs visant à contribuer à l'élimination du trafic d'espèces sauvages en ligne.
Ces efforts doivent néanmoins être accompagnés par ceux de la puissance publique, pour aller au-delà de la détection des ventes illégales en ligne et des campagnes de prévention ciblées sur les réseaux sociaux et forums spécialisés, qui restent néanmoins indispensables. Il convient de s'adapter à la massification croissante des flux postaux, largement alimentée par le développement du commerce en ligne, qui nécessite une évolution des dispositifs de détection automatisée et des contrôles douaniers pour espérer contrecarrer ces modes opératoires. La tâche sera ardue, car plusieurs difficultés sont à surmonter : un volume exponentiel de colis qui met en échec les contrôles douaniers systématiques ; une absence de filtrage déclaratif réel à l'envoi et une faible coopération des plateformes privées dans la détection en amont.
Pour tenter d'y remédier, il est indispensable d'impliquer et de responsabiliser les acteurs de la chaîne postale et de la livraison express. Il pourrait par exemple être envisagé une obligation de déclaration renforcée pour les colis à destination de particuliers contenant des produits d'origine animale ou végétale. Une responsabilisation des plateformes (Chronopost, DHL, FedEx, Amazon...) pourrait être renforcée via une charte de coopération Cites, couplée par exemple à un audit de conformité et une clause de signalement obligatoire.
Étant donné le volume des annonces, des forums et des messageries sécurisés à surveiller sur internet, il serait préférable de développer des outils automatisés pour identifier et bloquer les contenus liés au trafic, mais également de proposer des canaux de signalement faciles aux utilisateurs et d'accroître la responsabilisation des plateformes d'e-commerce, les places de marché en ligne et les réseaux sociaux afin qu'ils surveillent, signalent et suppriment les annonces de vente d'espèces ou de produits illégaux.
Recommandation n° 18 : Instaurer l'obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de signaler toute suspicion de commerce en ligne d'espèces protégées et instaurer des modalités de suivi, de saisie et de sanction agiles pour s'adapter à la malléabilité des modes opératoires du commerce illégal.
La mission d'information préconise également la mise en oeuvre d'évolutions juridiques et techniques permettant de faire face à la progression très soutenue du trafic en ligne d'espèces protégées, via des plateformes numériques, mais également par la voie postale pour assurer la livraison finale. C'est un volet qu'il est impérieux de ne pas négliger, en recourant notamment aux enquêtes sous pseudonyme76(*), en intensifiant la surveillance des échanges et transactions sur internet par les services chargés de mener à bien les contrôles Cites et en soutenant les investissements douaniers en matière de détection automatisée des colis et du fret cargo.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Soutenir la réalisation d'études multidisciplinaires pour renforcer la connaissance du modus operandi des trafiquants d'espèces protégées et affiner la compréhension des déterminants socio-culturels de la consommation de viande de brousse et son évolution, en vue de sensibiliser les consommateurs aux risques associés à la circulation incontrôlée de produits carnés hors de leur zone de chasse.
Recommandation n° 2 : Sensibiliser les pouvoirs publics, les magistrats et les acteurs de la chaîne aéroportuaire aux approches « Une seule santé » et aux risques de zoonose et d'épizootie associés à l'introduction massive d'espèces végétales et animales en dehors de tout cadre sanitaire, dans le but d'éviter une nouvelle pandémie due au franchissement de la barrière inter-espèces par des agents pathogènes.
Recommandation n° 3 : Favoriser la lisibilité de la norme en rationnalisant la législation européenne qui prohibe l'importation de produits carnés, mais autorise celle de poisson séché et éviscéré, source d'incompréhension et de confusion pour les voyageurs, en promouvant une approche « Zéro produit animal brut », et faire en sorte que les interdictions absolues d'emport de certaines espèces ou produits soient sanctionnées de façon immédiate et anticipable, avec un seuil de tolérance zéro.
Recommandation n° 4 : Renforcer les capacités d'enquête et de répression dans les pays sources du trafic à travers la formation, le soutien en équipement et le partage d'expertise, afin d'agir à la source en réduisant les flux qui embolisent les capacités douanières.
Recommandation n° 5 : Miser sur la coopération diplomatique avec les pays sources du trafic, aux niveaux national et européen, pour tarir les flux en provenance de certains vols et favoriser l'échange de renseignements en matière d'activités criminelles transnationales.
Recommandation n° 6 : Mieux appréhender les flux et les routes empruntées par ce trafic à travers la compilation des données au sein d'un système d'information dédié consultable par les forces de l'ordre et la justice afin de détecter les récidives, pérenniser les espaces institutionnalisés d'échange entre les acteurs qui luttent contre ce phénomène afin de rompre avec la logique de « silos administratifs » et inciter à l'élaboration d'une base de données européenne des auteurs et des saisies avec échange d'informations entre les services de lutte des différents États membres.
Recommandation n° 7 : Recourir plus systématiquement aux transactions douanières au montant dissuasif prononcées et perçues directement par les douaniers au moment des constatations, afin de rompre avec l'idée d'un trafic à forte profitabilité et à faible risque de condamnation.
Recommandation n° 8 : Améliorer la robustesse des règles de biosécurité, investir dans la science forensique pour favoriser l'identification des saisies et rehausser le quantum des peines pour réprimer le trafic d'espèces protégées au même niveau que celui des trafics d'armes et de stupéfiants.
Recommandation n° 9 : Renforcer les moyens douaniers et les outils de ciblage consacrés aux contrôles, afin d'améliorer la répression des trafics dans un contexte d'intensification du transit de voyageurs et de marchandises, et de réduire le risque pour la santé humaine et animale que fait peser l'entrée incessante de produits carnés et d'animaux vivants hors de tout protocole sanitaire.
Recommandation n° 10 : Systématiser l'emploi de brigades cynophiles, pour démontrer la réalité des contrôles et accentuer la perception du risque de détection, recourir aux technologies innovantes combinées à des outils fondés sur l'intelligence artificielle pour faciliter la détection des bagages frauduleux et réduire la porosité des points de passage en douane.
Recommandation n° 11 : Élaborer une signalétique informative multicanaux à destination des passagers, depuis l'achat du billet jusqu'à l'arrivée à destination, rappelant les interdictions de transport d'espèces sauvages tout au long du parcours voyageur, pour en finir avec l'invocation du principe de bonne foi qui nuit à l'efficacité de la réponse douanière.
Recommandation n° 12 : Interdire l'importation de toute espèce animale et de produit carné par des particuliers sur le territoire européen, combiné à un régime déclaratif sur l'honneur relatif au non-transport de produits prohibés, avant l'entrée sur le territoire.
Recommandation n° 13 : Rendre possible l'abandon de produits carnés avant le passage en douane grâce à la mise en place de points de collecte dédiés surmontés du rappel de la règlementation (« amnesty bin »).
Recommandation n° 14 : Rationnaliser le contentieux en matière de trafic d'espèces protégées, reposant aujourd'hui sur 174 infractions dispersées dans plus de quinze codes, en privilégiant les poursuites sous l'angle sanitaire et de santé publique, gage d'une qualification plus immédiate des infractions.
Recommandation n° 15 : Envisager la possibilité de retirer le visa de court séjour en cas de constatations répétées de transport de produits carnés afin de mettre un coup d'arrêt au trafic dit de subsistance, voire une interdiction du territoire français (ITF) pour les ressortissants étrangers.
Recommandation n° 16 : Convaincre les États parties à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale d'élever la mise en oeuvre de procédures pour combattre le trafic d'espèces sauvages au niveau de « norme » et non de simple « recommandation » et promouvoir l'engagement et la redevabilité des acteurs du transport pour prévenir, détecter et bloquer les activités illégales.
Recommandation n° 17 : Passer à un logique « tous flux » en investissant dans le développement de techniques automatisées d'analyse non invasive de colis postaux et de fret express, dont le volume colossal et exponentiel rend la détection de produits carnés ou de jeunes animaux particulièrement complexe.
Recommandation n° 18 : Instaurer l'obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de signaler toute suspicion de commerce en ligne d'espèces protégées et instaurer des modalités de suivi, de saisie et de sanction agiles pour s'adapter à la malléabilité des modes opératoires du commerce illégal.
TRAVAUX EN COMMISSION
Désignation d'un rapporteur
(Mercredi 30 avril 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Le 6 juin dernier, lors du déplacement de la commission à l'aéroport Charles de Gaulle, nous avions consacré nos échanges avec la direction interrégionale des douanes et le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature aux moyens juridiques, humains et budgétaires de la lutte contre le trafic d'espèces protégées.
À cette occasion, nous avons pu mesurer concrètement l'ampleur des flux de ce trafic, qui génère l'importation annuelle d'au moins 270 tonnes de viande d'espèces sauvages. Ceux qui étaient présents se souviendront sans peine du triste spectacle, éprouvant pour la vue et l'odorat. C'est tout l'intérêt des déplacements de ce type de pouvoir échanger avec ceux qui sont « en premières lignes » des sujets entrant dans le champ de compétence de notre commission.
Les douaniers ne parviennent pas à réguler ce trafic, les flux massifs et constants embolisant leur capacité de contrôle : l'insuffisante détermination des pouvoirs publics à le combattre est d'autant plus incompréhensible. Il s'agit en effet de l'une des quatre activités criminelles transnationales les plus lucratives au monde, qui se caractérise en outre par des taux de poursuite bien inférieurs aux trafics de drogue ou d'armes. En d'autres termes, ce trafic est envisagé par les organisations criminelles comme une activité illégale rémunératrice à risques inférieurs. En outre, une partie de ce trafic est constituée par des voyageurs insuffisamment informés, qui ne pensent pas à mal et participent aux méfaits induits par ces importations illicites. Des actions de sensibilisation des voyageurs pourraient ainsi être envisagées, avant d'avoir à mobiliser des réponses judiciaires.
Ce trafic affecte la biodiversité, s'agissant de produits animaux ou d'animaux vivants issus d'espèces protégées. Il est également porteur de graves risques sanitaires, difficilement quantifiables, mais réels pour la santé humaine et animale, susceptibles de provoquer des bouleversements tant sanitaires qu'économiques pour les éleveurs.
Les travaux de la mission d'information pourraient ainsi rechercher les évolutions juridiques et extra-juridiques pertinentes pour renforcer l'efficacité de la lutte contre ce trafic et envisager les évolutions législatives pour y parvenir. Même si ce phénomène reste largement ignoré, il y a urgence à lui apporter des réponses et à imaginer des solutions pérennes et réalistes.
Pour conduire ces travaux, j'ai reçu la candidature de notre collègue Guillaume Chevrollier.
Mme Nicole Bonnefoy. - Je regrette que nous ne procédions pas à la désignation d'un co-rapporteur issu de l'opposition, comme le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain en a déjà exprimé le souhait lors de la dernière réunion de bureau de la commission. Associer un sénateur d'un autre groupe politique aurait été un plus pour la qualité de nos travaux, comme c'est notamment le cas pour la mission d'information sur les nuisances sonores causées par les transports. J'ai bien conscience que les auditions seront ouvertes à tous les commissaires, mais cela n'empêche pas que l'absence de co-rapporteur soit regrettable, notamment sur un sujet ne prêtant pas à polémique.
M. Jean-François Longeot. - Comme vous l'indiquez, les auditions du rapporteur seront ouvertes à tous les sénateurs de la commission intéressés par le sujet. Je ne doute pas que Guillaume Chevrollier, notre rapporteur, sera à l'écoute de toutes les idées, d'où qu'elles viennent, pour accroître l'efficacité des moyens de lutter contre ce trafic.
Il en est ainsi décidé.
Examen du rapport
d'information
(Mercredi 24 septembre 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Bien que nous nous soyons déjà retrouvés la semaine dernière pour procéder à la désignation d'un rapporteur, c'est ce matin que nous reprenons réellement nos travaux parlementaires, avant de pouvoir nous atteler à nouveau à des travaux législatifs, quand le Gouvernement sera nommé.
Nous sommes réunis pour l'examen du rapport d'information de notre collègue Guillaume Chevrollier sur les moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et protégées, sujet aussi méconnu que préoccupant.
Tous ceux qui ont participé au déplacement de la commission en juin 2024 à l'aéroport Charles-de-Gaulle le savent, l'importation massive et quasi ininterrompue d'espèces protégées et de viande de brousse par la voie aérienne constitue un véritable fléau. Nous avions alors rencontré des douaniers désemparés, en première ligne face à cette submersion silencieuse qui embolise nos capacités d'interception et fait peser de sérieuses menaces sur notre sécurité sanitaire, environnementale et économique.
À l'arrivée de certains vols, pas moins d'un bagage sur deux contient des produits carnés, dont l'importation est pourtant strictement prohibée par le droit européen. La plupart des passagers en situation d'infraction affirment en outre ignorer l'interdiction ; cette méconnaissance réglementaire sur laquelle prospère le trafic ne peut et ne doit plus durer. Quant aux trafiquants qui importent des produits de façon illicite en toute connaissance de cause, nous devons mobiliser contre eux un arsenal répressif agile et dissuasif, car ces trafics constituent l'une des grandes causes de l'érosion de la biodiversité.
Lors du déplacement de la commission, j'ai pris toute la mesure de ce phénomène et de la nécessité de trouver des solutions pour y répondre : notre pays ne saurait rester plus longtemps une passoire ; les risques sont trop importants. Il s'agit non pas de juger les voyageurs qui consomment ces produits pour des raisons culturelles, mais de mettre fin à des flux porteurs de menaces pour la santé humaine et animale, qui peuvent être à l'origine de zoonoses ou d'épizooties. Que l'on se rappelle seulement que la covid-19 est probablement originaire d'un marché d'animaux sauvages à Wuhan ou que la pandémie du sida est due à la manipulation de viande de singe infectée par le virus souche du VIH. C'est dire si les enjeux sont massifs et l'urgence d'agir bien attestée.
Je tiens à remercier le rapporteur, Guillaume Chevrollier, de son implication et de la qualité de son rapport. Il a entendu tous les acteurs de la lutte contre ce trafic, des vétérinaires et des experts de sécurité sanitaire et environnementale, en se rendant à nouveau à l'aéroport de Roissy à la rencontre des douaniers. Lors de notre première visite, l'un d'entre eux m'avait dit : « Merci de votre visite ; mais de nombreux politiques sont venus sans qu'il n'y ait jamais de suite... » Cela m'a marqué. Je lui ai promis qu'il y aurait une suite. Au cours de leurs contrôles, les douaniers laissent passer des personnes dont ils sont sûrs qu'ils transportent des produits illicites, parce qu'ils sont déjà en train de contrôler des voyageurs et qu'ils ne peuvent pas vérifier tous les bagages. Il faut vraiment les accompagner.
Le rapporteur formule des recommandations pour en finir avec cette bombe à retardement qu'est le trafic incontrôlé d'espèces sauvages et protégées, hautement lucratif et pourtant peu risqué pour les trafiquants. Nous devons mettre fin à notre candeur coupable et changer d'échelle. C'est précisément ce que vous proposera le rapporteur, qui fait à mon avis oeuvre utile, alors que le sujet n'a pas la résonance médiatique qu'il mérite. Ce phénomène doit sortir des soutes des avions afin d'être mis en lumière dans le débat public. J'espère que ce rapport y contribuera...
M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. - Comme le président vient fort justement de le rappeler, la problématique abordée par les travaux de contrôle qui nous occupent ce matin, le trafic d'espèces sauvages et protégées, ne bénéficie pas de la lumière médiatique ni de l'attention politique qu'elle mériterait, même si, au cours d'une mission de suivi sur la pandémie de Covid, j'avais engagé des travaux sur ce sujet et alerté sur les dangers zoonotiques. Cette problématique est à la confluence de multiples enjeux et porteuse de sérieuses menaces pour la santé publique, tant humaine qu'animale.
Vous savez, comme moi, que l'action publique n'apporte de solutions efficaces que si les problèmes à résoudre sont décrits, analysés et identifiés comme tels par la société, qui doit avoir conscience des enjeux, des menaces et du coût de l'inaction ; on peut faire le parallèle avec la situation budgétaire. En dépit des risques multiples dont il est porteur, le trafic d'espèces sauvages prospère à bas bruit et progresse dans l'ombre, faute d'être considéré pour ce qu'il devrait être : un enjeu sanitaire, environnemental et économique à part entière. Mon rapport d'information vise, par ses constats et ses recommandations, à mettre fin à cette méconnaissance et à ériger la lutte contre ce trafic d'espèces sauvages et protégées au rang de devoir sanitaire.
Comment me suis-je forgé cette conviction ? Au terme d'une vingtaine d'auditions, auxquelles vous avez été conviés, après avoir entendu plus d'une cinquantaine d'experts, de scientifiques et de douaniers et à l'issue d'un déplacement à l'aéroport Charles-de-Gaulle en juillet dernier, après un précédent déplacement de la commission à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, quelques mois plus tôt, tout indique, depuis les données statistiques jusqu'au sentiment des acteurs de la lutte, que la France échoue à endiguer les flux d'animaux vivants, de produits carnés et de marchandises illicites que ce trafic charrie ; nous échouons à trouver les réponses adéquates pour réagir face à ce phénomène multifactoriel, tentaculaire, adaptatif et transnational.
De quoi parle-t-on ? D'un trafic mondial, qui affecte plus de 4 000 espèces animales et végétales dans plus de 160 pays ; d'un commerce illicite dont les autorités douanières, tous pays confondus, ont réalisé entre 2015 et 2021 plus de 13 millions de saisies, pour un volume intercepté supérieur à 16 000 tonnes ; d'une activité illicite extrêmement lucrative, générant des flux financiers supérieurs à 20 milliards de dollars par an, même si on peut trouver d'autres estimations variant au sein d'une fourchette entre 7 et 23 milliards.
On parle aussi d'un trafic avec de puissants moteurs, qui répond à une demande qui ne faiblit pas, alimentant un large éventail de secteurs et de débouchés : consommation alimentaire, médecine traditionnelle, mode des nouveaux animaux de compagnie relayée par de nombreux influenceurs, collection de plantes ornementales, vogue des cabinets de curiosités qui rappelle d'autres époques, le tout nourri par de puissantes incitations sur les réseaux sociaux ; d'un trafic bien implanté et en développement dans notre pays, qui constitue à la fois un pays de départ, un pays d'arrivée et un pays de transit, grâce à ses hubs maritimes et aéroportuaires qui assurent une excellente connectivité avec l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Notre territoire n'est pas indemne de ce trafic : je pense notamment à la très lucrative contrebande de civelles en Vendée et sur le pourtour du Golfe de Gascogne, mais également aux espèces exotiques des outre-mer, telles que les perroquets, les reptiles, les coraux ou certaines plantes protégées.
On parle en outre d'un trafic qui embolise nos capacités d'interception douanière - en 2024, plus de 98 000 espèces protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites) ont été saisies, dont 3 500 d'origine animale - ; d'un trafic à deux visages : les espèces protégées au titre de la Convention de Washington, car menacées d'extinction en cas d'exploitation non durable, et le trafic de « viande de brousse », soit la viande d'animaux sauvages en provenance d'Afrique qui recouvre une grande variété d'espèces - singes, pangolins, porcs-épics, rongeurs, chauves-souris, antilopes, serpents -, qui arrivent en quantité significative dans nos aéroports, transportés dans des glacières.
Chaque année depuis 2018, les services douaniers constatent en moyenne 2 500 infractions et saisissent 22 tonnes de viande domestique ou sauvage, principalement dans les aéroports. Une étude scientifique conduite en partenariat avec la douane, dont les résultats n'ont pas encore été publiés, fait état d'un volume annuel estimé à 475,5 tonnes, soit plus de 9 tonnes par semaine. Ces résultats suggèrent que nous faisons face à un trafic non jugulé : seulement 0,6 % de la viande de brousse transitant par Charles-de-Gaulle serait saisie...
Voilà pour le constat chiffré, dont vous conviendrez qu'il dessine un tableau assez sombre. Il s'obscurcit encore si l'on s'intéresse à présent aux risques et menaces que ce trafic fait peser, qui sont principalement de trois ordres.
Une menace pour la santé humaine et animale d'abord : sur le plan sanitaire, les produits circulant dans le cadre de ce trafic échappent à toute chaîne de contrôle vétérinaire ou de quarantaine, augmentant ainsi le risque d'introduction d'espèces vectrices de maladies zoonotiques ou épizootiques sur le territoire national. On estime que 60 % des maladies infectieuses affectant l'humain sont d'origine animale, et 70 % des maladies émergentes sont issues de la faune sauvage, dont certaines pouvant aboutir à une pandémie ou du moins à des impacts sanitaires et économiques très graves pour les sociétés concernées. Comme l'a rappelé le président, les émergences du syndrome respiratoire aigu sévère (Sars) de type 1 et 2, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), d'Ebola ou de la variole du singe (Monkeypox) sont toutes liées à la consommation de viande de brousse. On suspecte également la covid-19 d'être en lien avec le marché d'animaux sauvages de Wuhan. Il s'agit donc d'un risque non pas hypothétique, mais fort grave. Les risques sont également significatifs pour l'agriculture, si importante dans notre pays, en particulier l'élevage, à travers les épizooties : les agents pathogènes issus de la faune sauvage peuvent provoquer des maladies graves chez l'animal, avec des taux de morbidité et de mortalité élevés, susceptibles de conduire à l'abattage de tout un cheptel.
Ce trafic constitue ensuite une source de pression majeure pour la biodiversité : selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) - le « Giec » de la biodiversité -, le trafic d'espèces sauvages et de produits de la pêche illégale constitue l'une des principales menaces pour la biodiversité. Les prélèvements non durables contribuent à accroître le risque d'extinction de 28 % des espèces menacées ou quasi menacées. Ce trafic est susceptible de neutraliser les efforts de conservation de la nature, d'affecter les ressources vivrières des communautés locales, d'endommager les équilibres écosystémiques en cas de prélèvements trop abondants d'espèces et de limiter l'efficacité des politiques de préservation de l'environnement mises en oeuvre par les États. La disparition d'espèces clés bouleverse les chaînes alimentaires, la régénération des forêts et d'autres services écosystémiques vitaux. Il peut s'ensuivre une perte de résilience, pouvant entraîner des cascades d'extinctions, la perturbation des services écosystémiques, telles que la pollinisation ou la régulation des parasites et favoriser l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans les pays de destination. On a souvent évoqué ce sujet au sein de notre commission.
Ce trafic constitue enfin une source de violence, car il alimente des réseaux criminels, permet le blanchiment d'argent pour d'autres trafics - c'est le quatrième trafic le plus important après la drogue, les armes, les êtres humains - et peut entraîner le décès de gardes forestiers : le caractère très lucratif de ce commerce illégal conduit en effet les trafiquants à opérer en bande armée en prenant des risques importants.
On l'aura compris, la lutte contre le trafic d'espèces sauvages est une course contre la montre, pour éviter que les risques dont ce trafic est porteur se matérialisent. Du fait de son volume, de son intensité et de la congestion douanière qu'il provoque au sein des aéroports, ce trafic constitue l'exemple même d'une bombe à retardement sanitaire.
En ce cas, comment expliquer l'impuissance de notre pays à juguler ce trafic ? J'avancerai ici quelques explications.
Le trafic trouve son premier moteur dans la croissance du transport aérien de voyageurs, qui alimente une augmentation arithmétique des flux illicites transportés. Le volume colossal de passagers et de fret transitant par les points d'entrée aéroportuaires, combiné à la nécessité de garantir un flux rapide pour éviter les retards, rend ainsi inenvisageable un contrôle systématique et approfondi des bagages. Ce facteur explique la porosité du passage en frontière, en dépit de la mobilisation à saluer des douaniers, dont nous avons reçu l'ensemble des représentants syndicaux ou presque.
La mésinformation des voyageurs participe à notre échec de réduction des flux du trafic : la connaissance des interdictions n'est pas ancrée dans l'esprit des passagers. L'information relative à l'interdiction d'entrée de produits carnés et d'animaux protégés sur le territoire français est trop discrète, trop tardive et trop technique.
Un autre facteur explicatif tient à la difficulté, pour les autorités douanières et la justice, à mettre en oeuvre une réponse pénale réactive, dissuasive et proportionnée à la gravité des menaces sanitaires. De plus, l'éparpillement des moyens de la lutte et l'implication d'un grand nombre de ministères contribuent à une coordination lacunaire et à la dilution des responsabilités.
Enfin, l'organisation et la structuration des réseaux criminels transnationaux qui se livrent à cette activité criminelle expliquent aussi notre échec : les modes opératoires agiles des trafiquants s'enchevêtrent avec d'autres trafics, mobilisent des moyens humains significatifs, des « mules » aux têtes de réseau, s'hybrident avec d'autres modes de transport, notamment le fret et les colis postaux, qui dépendent d'une autre chaîne de contrôle. De plus, la corruption et la faiblesse des cadres juridiques des pays sources permettent aux trafiquants d'exploiter les failles, d'échapper aux poursuites et d'utiliser les capacités de transports publics de voyageurs. On assiste à un glissement progressif d'un marché de niche vers un phénomène criminel plus diffus et mondialisé, difficile à endiguer à moyens douaniers et judiciaires constants.
Une fois dressé ce panorama et dessinée cette cartographie des risques et des lacunes de l'action publique, il me reste à vous proposer les solutions et les évolutions possibles que j'ai identifiées au cours de mes travaux, afin de réduire drastiquement les flux qui congestionnent nos capacités douanières au sein des aéroports.
Comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce trafic constitue non seulement une grave menace pour la biodiversité et l'économie légale, mais aussi et surtout pour la santé publique et la sécurité sanitaire mondiale. Les efforts à mettre en oeuvre découlent à mes yeux de l'obligation qui incombe à l'État et aux pouvoirs publics de protéger la santé publique et l'agriculture.
Je préconise en premier lieu de changer d'approche pour faire face à ce trafic. Aujourd'hui, nous privilégions une logique d'interception, à l'arrivée, quand les marchandises illicites et les produits carnés sont détectés dans les bagages voyageurs : cela revient à écoper la mer à la petite cuillère, si j'ose dire. Il serait bien plus judicieux de rechercher les mesures transformatrices à la source du trafic, avec les pays de départ, via la coopération internationale et diplomatique, pour éviter que ces produits ne soient dirigés vers la France. En outre, les trafiquants opèrent désormais à l'échelle mondiale, en exploitant les failles des législations nationales et les lacunes des contrôles aux frontières : il est donc vain de miser sur les réponses isolées, qui sont inefficaces.
Pour cette raison, un renfort de la coopération avec les pays d'origine du trafic constitue un indispensable préalable, sur le plan tant du contrôle avant embarquement que des moyens répressifs employés contre les réseaux criminels. La décrue des flux générés par le trafic suppose une collaboration efficace et des efforts collectifs à l'échelle de tous les États de l'aire de répartition, de transit et de destination des espèces, ainsi qu'au travers de toute la chaîne de lutte contre la fraude.
Il me paraît également nécessaire de renforcer la coordination des acteurs nationaux chargés de la lutte, ainsi que l'échange de renseignements. La lutte contre le trafic d'espèces sauvages est une course contre la montre : elle exige une adaptabilité constante et une coordination sans faille des forces de l'ordre. Les difficultés ne tiennent pas à notre arsenal législatif et répressif, qui permet de sanctionner les trafiquants, mais découlent de la manière dont il est mis en oeuvre par des services douaniers embolisés par les flux des voyageurs et des marchandises, ainsi que par des juridictions engorgées, qui doivent par ailleurs répondre aux priorités pénales toujours plus nombreuses qui leur sont assignées. À cet égard, il semble opportun de systématiser les sanctions immédiates, sur la forme d'amendes perçues dès la constatation et la saisie, à travers l'outil de la transaction douanière, qui présente l'avantage d'être à la fois facile à mobiliser et dissuasive, sans recourir à des ressources judiciaires.
Les évolutions les plus transformatrices dans la lutte contre ce trafic ne seront pas de nature législative ni judiciaire, mais sont plutôt à chercher du côté du renforcement des moyens douaniers et de la coopération interservices. Pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale, l'approche interministérielle et multidisciplinaire est indispensable, à travers la coordination des services de police et de gendarmerie, des juridictions spécialisées et de la société civile, pour que l'émiettement des moyens de lutte ne nuise pas à son efficacité.
Il me paraît également utile d'investir dans des capacités de détection renforcée, via des équipements de pointe : il est fondamental de renforcer les investissements en matière de recherche, de détection et d'analyse des produits et substances illicites. Il faut rendre le risque de se faire prendre si élevé que le trafic d'espèces sauvages deviendra moins attractif et moins profitable pour les criminels. Le facteur de dissuasion le plus efficace pour les trafiquants reste l'augmentation de la probabilité de la détection et de la saisie des marchandises. Le renforcement des moyens techniques à la disposition des douaniers répond ainsi à une logique d'efficacité et d'efficience. Le recours aux brigades cynophiles permettrait également des gains en matière de détection, tout en rendant le contrôle perceptible par les voyageurs.
J'ai identifié un axe majeur de progression en prenant la mesure de la méconnaissance réglementaire par les voyageurs et de la défaillance informative majeure mises en évidence par l'ensemble des acteurs. Cette situation suscite le désarroi des douaniers face au grand nombre de contrevenants d'ignorance. Il est indispensable de mettre en oeuvre une stratégie de martèlement des prohibitions de transport. Il est nécessaire d'oeuvrer à une information renforcée et lisible, à tous les stades du parcours voyageur, dès l'achat du billet. Pour être identifiée, comprise et retenue par les voyageurs, il est nécessaire que cette information soit visuelle, multilingue, omniprésente et répétée, de l'achat du billet jusqu'au passage en douane. Il faut graver dans l'esprit des voyageurs la règle « pas de viandes ni de produits animaux bruts », de la même manière que « pas d'armes ni de drogues ».
Cette intensification de la communication auprès des passagers est indispensable, mais ne permettra pas de toucher l'ensemble des voyageurs. Il me paraîtrait utile de réfléchir à l'opportunité d'instaurer une autodéclaration douanière obligatoire et simplifiée à remettre à l'arrivée pour les voyageurs en provenance des zones sensibles, engageant juridiquement la responsabilité du signataire, qui permettrait à la fois d'informer, de responsabiliser et de sanctionner rapidement les contrevenants. Certains États le font. Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence, cette réflexion doit s'engager à l'échelle européenne. Les passagers devront aussi avoir la possibilité, dans la zone de récupération des bagages, de jeter leur marchandise avant les contrôles douaniers, dans des poubelles pour déchets représentant un risque biologique, afin d'inciter au dessaisissement volontaire sans sanction.
Il me semble également intéressant d'associer plus étroitement les acteurs du transport dans la lutte contre ce trafic. Leur sensibilisation et leur mobilisation sont essentielles pour réduire les flux générés et les risques associés. Je préconise d'inciter les compagnies à faire preuve de vigilance par rapport aux espèces protégées, au travers d'une formation accrue de leur personnel, de mesures pour prévenir les trafics et de procédures spécifiques en cas de découverte de trafic par leurs services. L'idée serait de les engager à informer davantage les voyageurs et à mettre en place des mesures préventives. Il ne me semble pas que la contrainte soit la solution : les compagnies aériennes évoluant dans un secteur extrêmement concurrentiel et ayant un océan de normes à respecter, il me paraîtrait peu judicieux d'abonder dans cet empilement normatif. Le rapport d'information que je vous présente a déjà permis de faire bouger les lignes, en provoquant un changement de comportement de certaines compagnies.
Nous pourrions plutôt oeuvrer à la création d'un label ou d'une certification pour les compagnies aériennes qui adoptent de bonnes pratiques pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, y compris des politiques de bagages spécifiques, leur offrant un avantage en termes d'image et d'attractivité pour les passagers soucieux de l'environnement.
Enfin, il me semble essentiel d'activer de nouveaux canaux de lutte contre ce trafic, pour accentuer les efforts de contrôle du continent peu exploré de la lutte numérique et postale. Le commerce illégal d'espèces sauvages et protégées prospère également par l'intermédiaire des colis postaux et de la vente en ligne : l'action publique doit donc investir ces champs. Les réseaux criminels utilisent de plus en plus les plateformes numériques d'e-commerce et les réseaux sociaux, le fret postal pour les animaux de petite taille, les produits secs ou sous vide. C'est aujourd'hui un angle mort de notre action, faute de moyens humains et de technologies de détection adéquates.
Il faut sans plus tarder passer à une logique « tous flux » en investissant dans le développement de techniques automatisées d'analyse non invasive de colis postaux et de fret express, dont le volume colossal et exponentiel rend la détection de produits carnés ou de jeunes animaux particulièrement complexe. Cela implique également de responsabiliser les acteurs de la chaîne postale et de la livraison express, par exemple au travers d'obligations de vigilance et de déclaration renforcées. Pour contrer la progression de la vente et de l'achat d'animaux ou de produits illégaux via des plateformes en ligne, des groupes privés sur les réseaux sociaux, des forums spécialisés et des applications de messagerie cryptées, il serait opportun de développer des outils automatisés pour identifier et bloquer les contenus liés au trafic. Il faut également proposer des canaux de signalement faciles aux utilisateurs et accroître la responsabilisation des plateformes d'e-commerce, les places de marché en ligne et les réseaux sociaux afin qu'ils surveillent, signalent et suppriment les annonces de vente d'espèces protégées ou de produits illégaux.
Telles sont les préconisations dont je vous propose l'adoption. Vous l'aurez compris, je propose non pas une révolution ni l'annonce d'une énième priorité de notre action publique, mais des leviers transformateurs en étant soucieux des finances publiques :
- une coopération internationale, via des échanges de renseignements, des enquêtes conjointes et le renforcement des capacités de contrôle des pays sources du trafic ;
- une meilleure coordination des acteurs de la lutte pour mettre en échec ces trafiquants et les risques qu'ils font peser sur la santé humaine et animale ;
- des moyens douaniers renforcés, pour mieux détecter et mettre fin à la trop grande porosité de nos frontières ;
- et une information tous canaux pour en finir avec les passagers qui disent méconnaître les interdictions et un renforcement de notre capacité à contrôler le fret, les colis postaux et les trafics qui se font en ligne en toute impunité.
Certaines mesures nécessiteront des dotations budgétaires complémentaires, pour l'acquisition de moyens douaniers et le renforcement des agents dédiés à la lutte ; je suis néanmoins intimement persuadé qu'il s'agit d'un bon usage des deniers publics et que des économies en résulteront ; que l'on se remémore le coût phénoménal de la pandémie de Covid-19.
Si l'action publique n'est pas plus volontariste, il est probable que nous aurons à faire face à une nouvelle crise sanitaire ; il est de notre devoir de la prévenir et de protéger la santé de nos concitoyens d'une zoonose et les exploitations agricoles d'une épizootie. Au travers du rapport d'information que je vous soumets, j'ai cherché à identifier les enjeux et les solutions pour y remédier. J'espère que le prochain gouvernement s'en emparera pour limiter le volume du trafic, ce qui permettra de redéployer des moyens douaniers sur la lutte contre le fléau du narcotrafic, ainsi que l'a préconisé le rapport de commission d'enquête de nos collègues Jérôme Durain et Étienne Blanc.
M. Jean-François Longeot, président. - Monsieur le rapporteur, je vous remercie de ce travail très utile, qui permet d'éclairer nos collègues et dont je formule le voeu qu'il ait des suites législatives et réglementaires.
M. Didier Mandelli. - Je souhaite que ce rapport d'information puisse être diffusé largement auprès des différents ministères concernés : transports, santé, agriculture, etc. Alors que nous demandons à toutes les filières des efforts importants en matière de sécurité sanitaire, ne laissons pas passer ces tonnes de produits non tracés. J'ai encore en mémoire l'odeur pestilentielle que nous avions respirée lors de notre visite à Roissy, à l'aéroport voilà quelques mois. Les douaniers sont désabusés ; ils savent que plus des trois quarts des marchandises en question leur échappent.
Puissent les recommandations du rapporteur ne pas rester lettre morte. Des mesures, textes législatifs ou actions concrètes de la part des différents ministères s'imposent pour faire cesser ces trafics préjudiciables tant à la biodiversité des territoires dans lesquels les espèces sont prélevées qu'à la situation sanitaire dans nos contrées. Certes, je conçois que les cultures puissent différer selon les pays, mais il faut que des règles s'appliquent.
M. Jean-François Longeot, président. - Il y a besoin d'une vraie prise de conscience. J'invite ceux qui n'ont pas pu nous accompagner lors de notre visite à Roissy à s'intéresser aux conditions dans lesquelles les douaniers travaillent. On nous a par exemple parlé de trafic de viande de singe boucanée - car, même si c'est difficile à imaginer, certains de nos concitoyens font le choix de manger du singe... -, vendue à 150 euros le kilo. Je pense qu'il faut diffuser très largement ce rapport et continuer le travail de sensibilisation.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 3 juin 2025
- Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : Mmes Maud LELIÈVRE, présidente du comité français et Inès ANDRIEU D'IRAY, chargée de mission « protection des espèces ».
- Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) : MM. Guillaume VANDERHEYDEN, sous-directeur au commerce international et Florent NOURIAN, chef de bureau lutte contre la fraude.
- Scientifiques : Mme Anne-Lise CHABER, spécialiste santé planétaire, docteur en médecine vétérinaire et docteur en épidémiologie, et M. Michel HALBWAX, vétérinaire de la faune sauvage et biologiste de la conservation.
Jeudi 5 juin 2025
- Table ronde avec le Commandement pour l'environnement et la santé (Cesan) et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) : MM. Fabrice BOUILLIE, général de division, commandant du Cesan, et Ludovic EHRHART, colonel, chef de l'Oclaesp.
Mardi 17 juin 2025
- Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) : M. Alexandre FEDIAEVSKY, responsable du département préparation et résilience.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) : M. Éric CARDINALE, directeur scientifique santé animale, et Mme Sarah AUBERTIE, chargée des relations institutionnelles.
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) : MM. Michel de GARINE-WICHATITSKY, écologue et vétérinaire, et Léonard LIVERT, chargé d'affaires publiques.
- Office français de la biodiversité (OFB) : MM. Olivier THIBAULT, directeur général, et Charles FOURMAUX, directeur police et permis de chasser.
Mercredi 18 juin 2025
- Ministère des affaires étrangères : M. Jean-Charles GONTIER, conseiller sécurité à la sous-direction de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
Mardi 24 juin 2025
- Direction générale de la santé (DGS) : MM. Alexis PERNIN, adjoint au sous-directeur du pôle de préparation aux crises, et Bruno VION, chef de projet risques infectieux émergents.
- Direction générale de l'aviation civile (DGAC) : MM. Emmanuel VIVET, sous-directeur des services aériens à la direction du transport aérien, et Morgan VERIN, chef de programme facilitation.
- Table ronde avec les associations de protection de l'environnement : Mmes Mia CRNOJEVIC-CHERRIER, chargée de campagnes auprès du Fonds international pour la protection des animaux (Ifaw), et Lorélie ESCOT, responsable du programme « vie sauvage - commerce illégal et coexistence » auprès du WWF France.
- Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) : M. Rodolphe DELORD, président, et Mme Cécile ERNY, directrice et vice-présidente du Comité Français de l'UICN.
Mercredi 25 juin 2025
- Groupe Air France-KLM : M. Aurélien GOMEZ, directeur des affaires parlementaires et territoriales, Mme Marie-Pierre PERNET, responsable développement durable et biodiversité, et M. Rémy HADDAD, chargé d'affaires publiques.
- Association du transport aérien international (Iata) : MM. Robert CHAD, responsable de secteur France, Belgique, Pays-Bas et Europe du Sud, et Quentin GEEVERS, gestionnaire de campagnes et de politiques France, Belgique et Pays-Bas.
Mardi 8 juillet 2025
- Ministère de la Justice - Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) : Mme Vanessa BRONSTEIN, sous-directrice de la justice pénale spécialisée, et M. Gilles CHABRIER, rédacteur au sein du bureau du droit économique, financier et social, de l'environnement et de la santé publique (BEFISP).
- Ministère de la transition écologique - Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) : M. Damien LAMOTTE, directeur adjoint, et Mme Camille DUBOS, adjointe au chef de bureau de l'encadrement des impacts sur la biodiversité (ET4), organe national de gestion de la Cites.
- Secrétariat de la Cites : M. Edward VAN ASH, coordonnateur du consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), unité de lutte contre la fraude.
- Table ronde avec les Syndicats nationaux des agents des douanes (CGT Douanes, Solidaires Douanes, FO Douanes, Unsa Douanes) : Mme Manuela DONÀ, secrétaire générale de CGT Douanes, MM. Nicolas OUDIN, permanent de CGT Douanes, Yannick DEVERGNAS, co-secrétaire général, agent en poste à la brigade de surveillance extérieure (BSE) du Bourget de Solidaires Douanes, Guillaume QUÉROMÈS, co-secrétaire de la section de Roissy, agent en poste au bureau de Roissy Cargo centre de Solidaires Douanes, Mme Laetitia TAPON - référente Cites, agente à la cellule de ciblage du fret (CCF) de Roissy de Solidaires Douanes, MM. François SCHALLEBAUM, membre du bureau national, agent en poste à la BSE du transmanche à Gare du Nord de Solidaires Douanes, Fabien MILIN, agent en poste à l'unité dédiée au dédouanement (UDD) de Roissy de Solidaires Douanes, Laurent JOLY, secrétaire général adjoint de FO Douanes, Grégory DUCORNETZ, secrétaire général adjoint de l'Unsa Douanes, Mme Amandine GENIN, secrétaire interrégionale de la section Unsa Douanes Paris Aéroports, et M. Nicolas HUIN, représentant de l'Unsa Douanes.
Mercredi 9 juillet 2025
- Préfecture de police de Paris : MM. Stéphane DAGUIN, préfet délégué pour la sécurité des plateformes aéroportuaires, Yacine BACHA, chef du service sécurité et loyauté des produits alimentaires à la direction départementale de la protection des populations (DDPP 75) et Mme Nathanaëlle CHELELEKIAN, inspecteur de la santé publique vétérinaire (DDPP 75).
DÉPLACEMENT
À
L'AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE
Jeudi 10 juillet 2025
- Présentation de contrôles de bagages voyageurs en provenance de vols sensibles au terminal 2E, en présence de MM. Gilbert BELTRAN, directeur interrégional des douanes de Paris Aéroports, Simon DECRESSAC, directeur régional de Roissy-Voyageurs, Philippe ZEINULABEDIN-RAFI, chef de la division 3 de la direction régionale de Roissy-Voyageurs, Emmanuel BIZERAY, chef des services douaniers de la surveillance du terminal 2E ainsi que les agents de la brigade de surveillance extérieure en poste.
- Séquence d'échanges avec MM. Gilbert BELTRAN, directeur interrégional des douanes de Paris Aéroports, Mathieu CUIP, directeur des affaires publiques du groupe ADP, Paul BEYOU, responsable des affaires publiques nationales d'ADP, Aurélien GOMEZ, directeur des affaires parlementaires et territoriales d'Air France, Mme Marie-Pierre PERNET, manager développement durable d'Air France, MM. Rémy HADDAD, chargé d'affaires publiques d'Air France et Michel HALBWAX, vétérinaire auprès du Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (Sivep).
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
3 |
Favoriser la lisibilité de la norme en rationalisant la législation européenne qui prohibe l'importation de produits carnés, mais autorise celle de poisson séché et éviscéré, source d'incompréhension et de confusion pour les voyageurs, en promouvant une approche « Zéro produit animal brut », et faire en sorte que les interdictions absolues d'emport de certaines espèces ou produits soient sanctionnées de façon immédiate et anticipable, avec un seuil de tolérance zéro |
Commission européenne, Parlement européen, Gouvernement et douane |
Modification de la réglementation européenne et évolution législative |
|
|
5 |
Miser sur la coopération diplomatique avec les pays sources du trafic, aux niveaux national et européen, pour tarir les flux en provenance de certains vols et favoriser l'échange de renseignements en matière d'activités criminelles transnationales. |
États tiers, Commission européenne, Gouvernement et services de renseignement |
Diplomatie, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux |
|
|
7 |
Recourir plus systématiquement aux transactions douanières au montant dissuasif prononcées et perçues directement par les douaniers au moment des constatations, afin de rompre avec l'idée d'un trafic à forte profitabilité et à faible risque de condamnation. |
Douane |
Instruction ministérielle |
|
|
8 |
Améliorer la robustesse des règles de biosécurité, investir dans la science forensique pour favoriser l'identification des saisies et rehausser le quantum des peines pour réprimer le trafic d'espèces protégées au même niveau que celui des trafics d'armes et de stupéfiants. |
Gouvernement et Parlement |
Loi et règlement |
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
9 |
Renforcer les moyens douaniers et les outils de ciblage consacrés aux contrôles, afin d'améliorer la répression des trafics dans un contexte d'intensification du transit de voyageurs et de marchandises, et de réduire le risque pour la santé humaine et animale que fait peser l'entrée incessante de produits carnés et d'animaux vivants hors de tout protocole sanitaire. |
Gouvernement et douane |
Projet de loi de finances et |
|
|
11 |
Élaborer une signalétique informative multicanaux à destination des passagers, depuis l'achat du billet jusqu'à l'arrivée à destination, rappelant les interdictions de transport d'espèces sauvages tout au long du parcours voyageur, pour en finir avec l'invocation du principe de bonne foi qui nuit à l'efficacité de la réponse douanière. |
Gestionnaires d'aéroports, compagnies aériennes et douane |
Loi, règlement et bonnes pratiques |
|
|
12 |
Interdire l'importation de toute espèce animale et produit carné par des particuliers sur le territoire européen, combiné à un régime déclaratif sur l'honneur relatif au non-transport de produits prohibés, avant l'entrée sur le territoire. |
Commission européenne et Parlement européen |
Règlement européen puis transposition en droit interne |
|
|
14 |
Rationaliser le contentieux en matière de trafic d'espèces protégées, reposant aujourd'hui sur 174 infractions dispersées dans plus de quinze codes, en privilégiant les poursuites sous l'angle sanitaire et de santé publique, gage d'une qualification plus immédiate des infractions. |
Gouvernement et Parlement |
Loi et règlement |
|
|
15 |
Envisager la possibilité de retirer le visa de court séjour en cas de constatations répétées de transport de produits carnés afin de mettre un coup d'arrêt au trafic dit de subsistance, ou une interdiction du territoire français (ITF) pour les ressortissants étrangers. |
Gouvernement et Parlement |
Loi et règlement |
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
16 |
Convaincre les États parties à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale d'élever la mise en oeuvre de procédures pour combattre le trafic d'espèces sauvages au niveau de « norme » et non de simple « recommandation » et promouvoir l'engagement et la redevabilité des acteurs du transport pour prévenir, détecter et bloquer les activités illégales. |
Gouvernement et IATA |
Diplomatie et négociations relatives à la réglementation aérienne |
|
|
17 |
Passer à une logique « tous flux » en investissant dans le développement de techniques automatisées d'analyse non invasive de colis postaux et de fret express, dont le volume colossal et exponentiel rend la détection de produits carnés ou de jeunes animaux particulièrement complexe. |
Gouvernement, douane et acteurs de la chaîne logistique postale et du fret |
Projet de loi de finances, |
|
|
18 |
Instaurer l'obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de signaler toute suspicion de commerce en ligne d'espèces protégées et instaurer des modalités de suivi, de saisie et de sanction agiles pour s'adapter à la malléabilité des modes opératoires du commerce illégal. |
Gouvernement et Parlement |
Loi et règlement |
* 1 IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.
* 2 Les rapports sont consultables (en anglais) à l'adresse suivante :
https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/25 216 155
* 3 Les auteurs du rapport insistent cependant sur le fait que le trafic ne peut s'analyser uniquement en termes de flux de saisies et doit être couplé avec d'autres sources - travaux de terrain, littérature académique, études d'impact : « Les niveaux réels de trafic d'animaux sauvages sont évidemment bien supérieurs aux saisies enregistrées et il est important de garder à l'esprit qu'il existe des lacunes importantes concernant le trafic de bois, les pêcheries et certains autres secteurs commerciaux majeurs. ».
* 4 Étant donné qu'il existe de nombreux marchés indépendants pour les produits illégaux issus de la faune sauvage, il est complexe de les agréger et de les comparer afin d'obtenir des vues d'ensemble à différentes échelles géographiques.
* 5 The rise of environmental crime : A growing threat to natural resources peace, development and security, Programme des Nations unies pour l'environnement et Interpol, 2016.
* 6 Par opposition aux artificialia, ce sont les objets d'histoire naturelle des trois règnes (minéral, animal et végétal) exposé dans les cabinets de curiosité.
* 7 https://www.traffic.org/publications/reports/Cites-listed-seizures-eu-2021/
* 8 Shiraishi H., Escot L., Kecse-Nagy K. and Ringuet S., Wildlife trade involving France : An analysis of Cites trade and seizure data, 2020. Synthèse disponible en français ici :
* 9 https://www.actu-environnement.com/ae/news/trafic-illegal-civelles-huit-membres-bande-organisee-condamnes-45 989.php4 : « En février 2023, 302 kilogrammes de civelles européennes, soit environ 900 000 spécimens, avaient été saisis à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). L'enquête avait révélé que les civelles étaient pêchées illégalement vers Nantes, puis entreposées à Villeneuve-Saint-Georges, avant de passer par Dakar au Sénégal où un nouveau regroupement était effectué avant une réexportation vers l'Asie via le fret aérien. ».
* 10 « Rien que d'observer mes serpents, ça me fait voyager » : la nouvelle vogue des animaux de compagnie exotiques, Le Monde, 30 avril 2022, Maroussia Dubreuil, consultable à l'adresse suivante : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/30/rien-que-d-observer-mes-serpents-ca-me-fait-voyager-la-nouvelle-vogue-des-animaux-de-compagnie-exotiques_6124 284_4500 055.html
* 11 https://www.mnhn.fr/fr/actualites/trafic-d-especes-protegees-392-cranes-de-primates-saisis-par-la-douane
* 12 Le règlement (UE) 2019/212 pose le principe de l'interdiction d'entrée sur le territoire européen, dans les bagages des voyageurs, de toute viande, produit à base de viande et produits laitiers provenant de pays tiers à l'Union européenne, sauf dérogation dûment encadrée. La réglementation sera présentée plus loin.
* 13 Il s'agit d'une grande variété d'animaux sauvages, souvent issus de la chasse non durable : singes (chimpanzés, gorilles, babouins, etc.), pangolins, porcs-épics, rongeurs géants (aulacodes), chauves-souris, antilopes (céphalophes), serpents, et même parfois de grands félins ou d'autres espèces menacées. La viande est souvent transportée sous diverses formes - fraîche, fumée, séchée ou salée - pour faciliter sa conservation.
* 14 Réponse du Cirad au questionnaire envoyé par le rapporteur de la mission d'information.
* 15 Mission interministérielle sur la lutte contre l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées, CGAAER, DGDDI et Igedd, décembre 2023.
* 16 Les produits carnés illégaux arrivent souvent sous forme découpée, séchée, ou congelée, rendant difficile l'identification précise des espèces. Seuls les tests ADN permettent une détermination fiable.
* 17 Cette étude n'est pas encore publiée, mais la mission d'information a entendu les auteurs de celle-ci qui ont accepté de dévoiler leurs premiers résultats.
* 18 À l'instar du projet pilote de la Commission « Reframing the Exotic Pet Trade in Europe - Developing Effective Science-Based Demand Reduction Interventions » https://www.veteffect.nl/reframing-the-exotic-pet-trade-in-europe--developing-effective-science-based-demand-reduction-interventions.html
* 19 Publication de février 2021, A rapid review of evidence on managing the risk of disease emergence in the wildlife trade, https://www.woah.org/app/uploads/2022/08/a-oie-review-wildlife-trade-march2021.pdf
* 20 Phylogénie des SIV et des VIH - Mieux comprendre l'origine des VIH, Martine Peeters, Marie-Laure Chaix, Éric Delaporte Med Sci (Paris), 24 6-7 (2008) 621-628 : « Bien que le mode exact de transmission des virus simiens à l'homme ne soit pas connu, l'exposition à du sang ou à des sécrétions d'animaux infectés à l'occasion de la chasse ou de la préparation de la viande de brousse semble la cause la plus probable de contamination. Les morsures de singes captifs peuvent également avoir été un autre mode de contamination. »
DOI : https://doi.org/10.1051/medsci/20 082 467 621
* 21 Le virus Ebola est un pathogène présent dans la viande de brousse, hautement transmissible et létal chez l'humain. Il semblerait qu'aucun cas n'ait été identifié en France malgré des poussées épidémiques importantes en Afrique.
* 22 La direction générale de la santé dispose d'un service dénommé « Centre de crises sanitaires » (CCS) qui assure la centralisation des alertes et la coordination ou la participation à la réponse à ces alertes, ainsi que l'anticipation et la cartographie des risques sanitaires, l'élaboration des plans de préparation et de réponse aux menaces sanitaires, et le volet sanitaire des plans de défense et de sécurité, en s'assurant de leur déclinaison par les agences sanitaires et les ARS.
Ainsi, en cas de crise, le CCS pilote l'ensemble de la réponse ministérielle, en lien le cas échéant avec la cellule interministérielle de crise, les autres ministères et les acteurs territoriaux.
* 23 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, souvent surnommée le « Giec de la biodiversité ».
* 24 https://www.ipbes.net/sustainable-use-assessment
* 25 Résumé à l'intention des décideurs de l'évaluation thématique de l'utilisation durable des espèces sauvages de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, page 11.
* 26 https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/25/les-elephants-d-afrique-menaces-d-extinction-en-raison-du-braconnage-et-de-la-disparition-de-leurs-habitats_6074 437_3244.html
* 27 https://www.mnhn.fr/fr/actualites/couper-les-cornes-des-rhinoceros-pour-les-sauver-du-braconnage
* 28 https://www.nationalgeographic.fr/photographie/reportage-de-la-foret-a-la-table-au-coeur-du-commerce-de-la-viande-de-brousse
* 29 https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/especes-exotiques-envahissantes-des-impacts-ecologiques-et-economiques
* 30 Summary for policymakers of the thematic assessment of invasive alien species and their control of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
* 31 https://www.unodc.org/toc/fr/crimes/organized-crime.html
* 32 Rapport d'information fait par la députée Michèle Tabarot, en application de l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la protection des espèces menacées, n° 5049, déposé le jeudi 17 février 2022.
* 33 Ainsi, de 2006 à 2021, l'International Ranger Federation a recensé 2 351 décès de gardes forestiers et rangers morts en service pour la protection de la nature et de la faune sauvage, dont 42 % sont liés à une origine criminelle.
* 34 https://theconversation.com/trafic-aerien-mondial-une-croissance-fulgurante-pas-prete-de-sarreter-116 107
* 35 https://essentiel.groupe-adp.com/fr/la-nouvelle-dynamique-du-marche-aerien-se-confirme
* 36 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-compagnies-aeriennes-anticipent-deux-fois-plus-de-passagers-dans-20-ans-20 240 718
* 37 Cette architecture normative sera présentée au sein de la seconde partie du présent rapport d'information.
* 38 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
* 39 « Nous avons identifié que, de 2021 à 2024, entre 471 et 508 personnes ont été condamnées chaque année pour ce type de faits de trafic d'espèces protégées ou qui indirectement en révèlent nécessairement l'existence, à travers les mesures législatives ou réglementaires de protection particulières dont les espèces font l'objet. Il convient toutefois de compléter ces chiffres en précisant que sur cette même période, entre 1430 et 1679 personnes ont fait l'objet d'une orientation pénale. Entre 96,9 et 98,2 % des affaires poursuivables ont fait l'objet d'une réponse pénale, cette réponse pouvant être la mise en oeuvre d'une procédure alternative ou de poursuites. »
* 40 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ ?id=37 794
* 41 Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l'eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales.
* 42 La transaction douanière est prévue à l'article 350 du code des douanes, qui prévoit que « l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger ».
* 43 La France a adhéré à cette convention le 11 mai 1978 par l'effet de la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977.
* 44 La prochaine Conférence des Parties, la COP20 Cites, se tiendra à Samarcande en Ouzbékistan du 24 novembre au 5 décembre 2025. Généralement, 50 à 70 propositions d'amendements sont soumises à la COP, pouvant mener à des discussions sur plusieurs centaines d'espèces animales et végétales, ainsi qu'environ 80 à 100 propositions de résolutions ou de décisions. La France portera cette année une proposition additionnelle de classement de la famille des Centrophoridae, requins d'eaux profondes menacés par le commerce international, une proposition faisant suite à l'organisation de la 3e Conférence des Nations unies sur l'Océan (Unoc) à Nice en juin 2025. D'autres points commencent à émerger des discussions préliminaires entre les États, notamment s'agissant de l'encadrement du commerce des grenouilles, de l'anguille ou bien encore par anticipation de la demande d'interdiction du commerce du bois de pernambouc qui sera portée par le Brésil.
* 45 https://Citesdata.un.org/ Cette base de données n'est cependant accessible qu'aux administrations gouvernementales des Parties à la Cites, aux autorités nationales de gestion de la Cites, ainsi qu'aux organismes partenaires du Consortium sur la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC).
* 46 Ce consortium regroupe la Cites, Interpol, l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), la Banque Mondiale et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).
* 47 Ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international de 2005 : par l'effet de ce texte, le préfet se voit reconnaître des pouvoirs de police spéciale pour la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour prévenir la propagation éventuelle d'une infection ou d'une contamination dans l'intérêt de la santé publique.
* 48 https://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/Wildlife-Crime_ebook_F.pdf
* 49 https://iccwc-wildlifecrime.org/tools-and-services
* 50 Organisation mondiale de la santé animale (2024), Lignes directrices pour aborder les risques de maladies dans le cadre du commerce de faune sauvage, Paris, 93 pages.
https://www.woah.org/app/uploads/2024/05/wildlife-trade-guidelines-fr.pdf
* 51 https://www.woah.org/en/document/oieguidelines_nonnativeanimals_2012/
* 52 Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission.
* 53 Ont été volontairement omis de cette énumération, à des fins de lisibilité, certaines dispositions encadrant spécifiquement le commerce de produits d'origine animale, tels que le règlement (CE) n° 737/2010 relatif aux produits dérivés du phoque ou le règlement (CE) n° 1523/2007 interdisant le commerce des fourrures de chiens et de chats.
* 54 Ce site permet aux opérateurs de déposer une demande dématérialisée de permis ou de certificats Cites : https://Cites.application.developpement-durable.gouv.fr/accueil.do ;jsessionid=A3AD56536C37D846B12265A1D404EAF2.tc_Cites_172_150
* 55 Les importations, exportations, transports et détentions illicites des espèces protégées listées dans les quatre annexes du règlement (CE) n° 338/97 sont prévues et réprimées en droit national par le code des douanes, aux articles 38, 215, 414, 419 et 428 et à l'arrêté du 11 décembre 2011 portant application de l'article 215 du code des douanes. S'agissant des prohibitions s'appliquant aux produits carnés, indépendamment de la nature des espèces animales, les articles 38, 428 et 414 du code des douanes sanctionnent les voyageurs qui importent des espèces non conformes au règlement délégué (UE) 2019/2122 modifié.
* 56 Règlement délégué (UE) n° 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019, évoqué plus haut.
* 57 Notamment les résolutions 69/314 du 30 juillet 2015, 70/301 du 9 septembre 2016, 71/326 du 11 septembre 2017, 73/343 du 16 septembre 2019, 75/311 du 23 juillet 2021 sur la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et 77/325 du 25 août 2023.
* 58 Le Cirad participe également au réseau CaribVet qui rassemble des organisations internationales, l'ensemble des États caribéens et les États-Unis afin de mettre en oeuvre des politiques régionales communes de santé animale, créer des systèmes d'alertes efficaces et précoces afin d'améliorer les connaissances relatives aux maladies animales.
* 59 https://alliance-health-wildlife.org/
* 60 Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.
* 61 Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
* 62 Inspection des services de la Direction générale des douanes et droits indirects.
* 63 Inspection générale de l'environnement et du développement durable.
* 64 https://agriculture.gouv.fr/telecharger/143 535
* 65 On pense ici aux lois du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui avaient notamment pour ambition d'améliorer le traitement du contentieux pénal environnemental.
* 66 À l'instar de la circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale du 9 octobre 2023, qui invite notamment les parquets, en sus des infractions au code de l'environnement et au code de douanes, et lorsque les procédures le justifient, « à relever de manière systématique les infractions de faux et d'usage de faux lorsqu'elles sont constituées, ce qui est fréquemment le cas notamment dans l'hypothèse de trafic de déchets ou de trafic d'espèces animales protégées ».
* 67 Seeker est un projet de recherche en IA de Microsoft qui a été expérimenté à l'aéroport de Heathrow, à Londres, et a démontré sa capacité à détecter les éléments d'espèces sauvages illégaux dissimulés dans les bagages et le fret. L'objectif est d'ensuite les tracer pour faire cesser le braconnage.
* 68 Voir par exemple : Mamma M, Spandidos DA. Customs officers in relation to viral infections, tuberculosis, psittacosis and environmental health risk. Exp Ther Med. 2019 Feb ;17(2) :1149-1153. doi : 10.3892/etm.2018.7077.
* 69 https://www.traffic.org/news/106-and-not-out-sniffer-dogs-tackling-wildlife-poaching-passes-100-as-newest-recruits-graduate/
* 70 C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les articles 392 et 419 du code des douanes instituent une présomption simple de responsabilité pénale pour les détenteurs de marchandises frauduleuses.
* 71 Cf pages 66 et suivantes.
* 72 Notamment à l'article R. 3115-66.
* 73 ENCOM Guidance on Prohibited Carriage of Wildlife and Related Products by Passengers
http://www.fakd.org/pdf/encom-pax-wildlife-guidance-final-2003-nov-2015.pdf
* 74 https://www.ifaw.org/campaigns/disrupt-wildlife-cybercrime
* 75 https://www.ifaw.org/international/resources/elephant-in-the-net
* 76 L'article L. 172-11-1 du code de l'environnement permet aux inspecteurs de l'environnement de procéder à des enquêtes sous pseudonyme internet sans être pénalement responsables de leurs actes.