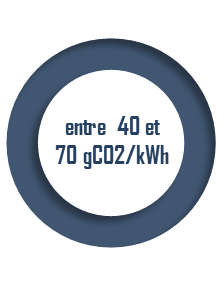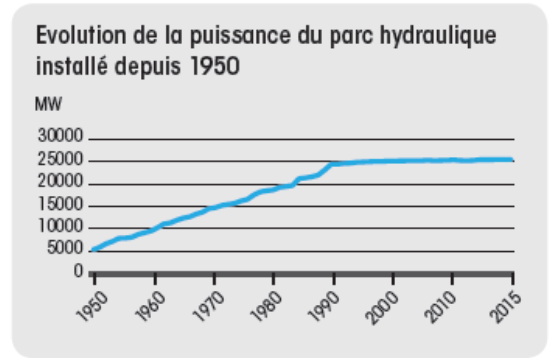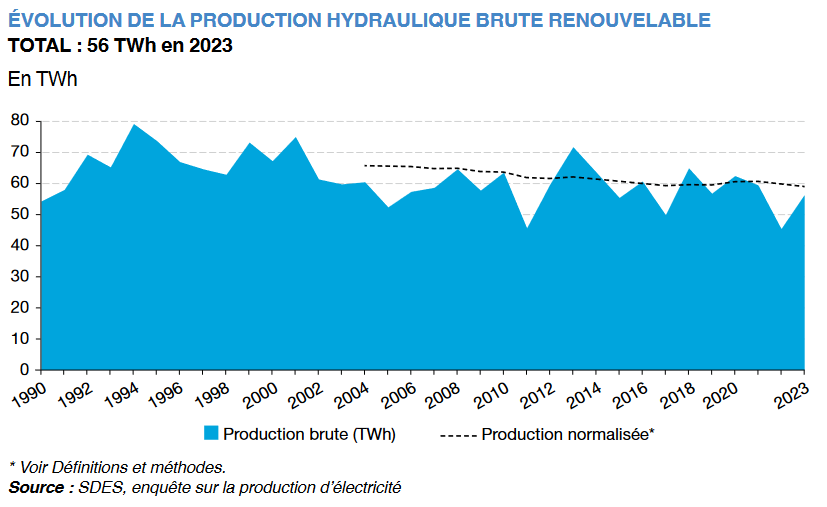- L'ESSENTIEL
- I. DEPUIS 20 ANS,
L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES OBÉRÉES
PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE
- II. UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS
VERS LES AUTORISATIONS EST ENVISAGÉ POUR RÉSOUDRE CE
DIFFÉREND
- III. POUR UN CHANGEMENT DE RÉGIME
CONSENSUEL, SÉCURISÉ ET RÉUSSI DES CONCESSIONS VERS LES
AUTORISATIONS :
15 PROPOSITIONS RÉUNIES EN 4 AXES
- A. LE PREMIER AXE VISE À ÉVALUER EN
AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE
RÉGIME
- B. LE DEUXIÈME AXE TEND À
SÉCURISER LES PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU
CHANGEMENT DE RÉGIME
- C. LE TROISIÈME AXE PROPOSE DE
TERRITORIALISER LA GOUVERNANCE ET LES PROCÉDURES APPLICABLES AU SECTEUR
DE L'HYDROÉLECTRICITÉ, À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE
RÉGIME
- D. LE DERNIER AXE PRÉVOIT DE
COMPLÉTER LE CHANGEMENT LÉGISLATIF DE RÉGIME PAR UNE
RÉVISION DES CADRES RÈGLEMENTAIRE ET EUROPÉEN
APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ
- A. LE PREMIER AXE VISE À ÉVALUER EN
AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE
RÉGIME
- I. DEPUIS 20 ANS,
L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES OBÉRÉES
PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE
- HYDROÉLECTRICITÉ : FAIRE
BARRAGE
À LA MISE EN CONCURRENCE
- I. ÉNERGIE ANCIENNE, PILOTABLE ET
DÉCARBONÉE, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OBÉRÉES PAR UN
DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE, VIEUX DE PLUS
DE 20 ANS
- A. REPRÉSENTANT 12 % DE NOTRE
PRODUCTION ÉLECTRIQUE, DONT 42 % DE CELLE RENOUVELABLE,
L'HYDROÉLECTRICITÉ CONSTITUE UN ATOUT POUR NOTRE TRANSITION
ET NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES
- 1. L'énergie hydraulique : une
énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été
adoptées au sortir des deux guerres mondiales
- 2. Les installations hydroélectriques :
une diversité d'installations, partagées entre le régime
des concessions et celui des autorisations, selon leur puissance
- 3. La production hydroélectrique : une
activité économique importante et des bénéfices
environnementaux intéressants
- 4. Les concessions hydroélectriques
échues du groupe EDF : des concessions placées sous un
régime transitoire dit « des délais
glissants »
- 5. Les objectifs en matière d'énergie
hydroélectrique : une bonne prise en compte dans le code de
l'énergie et le décret sur la programmation
pluriannuelle de l'énergie (PPE)
- 1. L'énergie hydraulique : une
énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été
adoptées au sortir des deux guerres mondiales
- B. DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, UN DIFFÉREND
ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT OBÈRE
LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
HYDROÉLECTRIQUE FRANÇAISE
- 1. Une première mise en demeure
adressée en 2015 à la France par la Commission
européenne, sur le fondement des articles 102 et 106 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE)
- 2. Une seconde mise en demeure adressée
à la France par la Commission européenne en 2019,
sur le fondement de la directive dite
« Concession », du 26 février 2014,
et des articles 49 et 56 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
- 3. De 2015 à 2023, des
échanges n'ayant pas permis de clore les procédures
engagées par la Commission européenne à l'encontre de
la France
- 4. En 2021 et 2023, des échanges
entre la Commission européenne et les autres pays européens ayant
permis de clore les procédures initiées à leur
encontre
- 1. Une première mise en demeure
adressée en 2015 à la France par la Commission
européenne, sur le fondement des articles 102 et 106 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE)
- A. REPRÉSENTANT 12 % DE NOTRE
PRODUCTION ÉLECTRIQUE, DONT 42 % DE CELLE RENOUVELABLE,
L'HYDROÉLECTRICITÉ CONSTITUE UN ATOUT POUR NOTRE TRANSITION
ET NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES
- II. SI LES SOLUTIONS LÉGISLATIVES
ENVISAGÉES PAR LE PASSÉ N'ONT PAS PERMIS DE RÉSOUDRE LE
DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT, UN
CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS
APPARAÎT AUJOURD'HUI COMME UN COMPROMIS À PORTÉE DE
MAINS
- A. LES SOLUTIONS ISSUES DE LA LOI DITE
« TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »,
DU 15 AOÛT 2015, SE SONT RÉVÉLÉES
INOPÉRANTES POUR RÉSOUDRE LE DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION
EUROPÉENNE ET L'ÉTAT
- 1. Un consensus de l'État, autorité
concédante, et du groupe EDF, concessionnaire, sur l'échec des
solutions législatives issues de la loi dite « Transition
énergétique »,
du 15 août 2015
- 2. Le regroupement de concessions : un
regroupement des concessions de Coindre-Marèges et de
Saint-Pierre-Marèges de la Société hydroélectrique
du Midi (SHEM) annulé par le Conseil d'État en 2022
- 3. La prolongation de concessions contre
travaux : une prolongation de la concession de la Truyère contre
travaux du groupe EDF refusée par la Commission européenne
en 2018
- 4. La constitution d'une quasi-régie :
un placement des concessions hydroélectriques du groupe EDF dans une
quasi-régie dans le cadre du projet « Hercule »
abandonné en 2021
- 5. La constitution de sociétés
d'économie mixte hydroélectriques (Semh) : une option
toujours ouverte impliquant cependant la mise en concurrence des concessions
hydroélectriques
- 1. Un consensus de l'État, autorité
concédante, et du groupe EDF, concessionnaire, sur l'échec des
solutions législatives issues de la loi dite « Transition
énergétique »,
du 15 août 2015
- B. LES ACTEURS ÉCONOMIQUES, INSTITUTIONNELS
ET POLITIQUES ONT DES POSITIONS TRÈS DIVERSES SUR LA RÉSOLUTION
DU DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT, QUI
FONT TOUTEFOIS APPARAÎTRE UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS
VERS LES AUTORISATIONS COMME UN COMPROMIS À PORTÉE DE
MAINS
- 1. Des acteurs économiques aux positions
plutôt divergentes sur l'organisation du marché français de
l'hydroélectricité
- a) Le point de vue du groupe EDF : une
préférence pour un changement de régime des concessions
vers les autorisations et une révision de la directive dite
« Concession »,
du 26 février 2014
- b) Le point de vue des concurrents du groupe
EDF : des positions hétérogènes allant de
l'accompagnement du changement de régime des concessions vers les
autorisations à son refus au profit d'un renouvellement des concessions
par appels d'offres
- a) Le point de vue du groupe EDF : une
préférence pour un changement de régime des concessions
vers les autorisations et une révision de la directive dite
« Concession »,
du 26 février 2014
- 2. Des acteurs syndicaux et locaux aux positions
plutôt convergentes sur l'organisation du marché français
de l'hydroélectricité
- a) Le point de vue des syndicats : un
très large soutien au changement de régime des concessions vers
les autorisations sous réserve de conditions liées à la
propriété des ouvrages, au statut des personnels ou à la
soutenabilité des contreparties
- b) Le point de vue des élus locaux :
un très large soutien au changement de régime des concessions
vers les autorisations sous réserve de conditions liées aux
redevances ou aux instances locales
- a) Le point de vue des syndicats : un
très large soutien au changement de régime des concessions vers
les autorisations sous réserve de conditions liées à la
propriété des ouvrages, au statut des personnels ou à la
soutenabilité des contreparties
- 3. Des acteurs institutionnels nationaux et
européens ayant convenu d'un accord de principe sur la
réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe
EDF
- a) Le point de vue des institutions
nationales : une préparation bien avancée du changement du
régime des concessions vers les autorisations, mais une perspective
toujours incertaine de révision de la directive dite
« Concession »,
du 26 février 2014
- b) Le point de vue des instances
européennes : une compatibilité sous conditions du
changement de régime des concessions vers les autorisations avec le
droit de l'Union européenne et une révision de la directive dite
« Concession », du 26 février 2014,
n'étant pas susceptible de produire des effets avant 2030
- c) Un accord de principe, annoncé par le
Premier ministre, entre la Commission européenne et la France sur la
réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF,
dont les modalités d'application doivent encore être
précisées
- a) Le point de vue des institutions
nationales : une préparation bien avancée du changement du
régime des concessions vers les autorisations, mais une perspective
toujours incertaine de révision de la directive dite
« Concession »,
du 26 février 2014
- 1. Des acteurs économiques aux positions
plutôt divergentes sur l'organisation du marché français de
l'hydroélectricité
- A. LES SOLUTIONS ISSUES DE LA LOI DITE
« TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »,
DU 15 AOÛT 2015, SE SONT RÉVÉLÉES
INOPÉRANTES POUR RÉSOUDRE LE DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION
EUROPÉENNE ET L'ÉTAT
- III. POUR UN PASSAGE CONSENSUEL,
SÉCURISÉ ET RÉUSSI DU RÉGIME DES CONCESSIONS VERS
CELUI DES AUTORISATIONS : 15 PROPOSITIONS RÉUNIES
EN 4 AXES
- A. ÉVALUER EN AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE
ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE RÉGIME
- B. SÉCURISER LES PARAMÈTRES
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU CHANGEMENT DE RÉGIME
- C. TERRITORIALISER LA GOUVERNANCE ET LES
PROCÉDURES APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ
À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE RÉGIME
- D. COMPLÉTER LE CHANGEMENT
LÉGISLATIF DE RÉGIME PAR UNE RÉVISION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE ET DU CADRE EUROPÉEN APPLICABLES AU SECTEUR DE
L'HYDROÉLECTRICITÉ
- A. ÉVALUER EN AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE
ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE RÉGIME
- I. ÉNERGIE ANCIENNE, PILOTABLE ET
DÉCARBONÉE, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OBÉRÉES PAR UN
DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE, VIEUX DE PLUS
DE 20 ANS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
N° 1
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires
économiques (1)
sur l'avenir des
concessions
hydroélectriques,
Par MM. Daniel GREMILLET, Patrick CHAUVET, Jean-Jacques
MICHAU
et Fabien GAY,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
L'ESSENTIEL
Mercredi 1er octobre 2025, la commission des affaires économiques a adopté les conclusions de sa mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques, confiée aux rapporteurs Daniel Gremillet, Patrick Chauvet, Jean-Jacques Michau et Fabien Gay. En effet, un différend, en passe d'être résolu, oppose la Commission européenne à l'État depuis 20 ans s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF, ce qui obère les perspectives de toute la filière hydroélectrique française.
Les rapporteurs ont organisé 25 auditions, entendant : le ministre chargé de l'énergie, les représentants de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), le président du groupe EDF, les syndicats de ce groupe, les concurrents de ce groupe, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ou encore les représentants de la Commission européenne. Ils ont aussi auditionné les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, en charge d'une mission d'information proche pour l'Assemblée nationale.
Les rapporteurs ont identifié le changement de régime des concessions vers les autorisations comme la solution la plus prometteuse pour éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises. C'est pourquoi ils ont formulé 15 recommandations, réunies en 4 axes, proposant : d'évaluer en amont sa robustesse technique et son impact financier, de sécuriser ses paramètres économiques et sociaux, de territorialiser la gouvernance et les procédures du secteur hydroélectrique et enfin de réviser les cadres règlementaire et européen applicables à ce secteur.
I. DEPUIS 20 ANS, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES OBÉRÉES PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE
A. L'HYDROÉLECTRICITÉ CONCOURT À NOTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L'hydroélectricité constitue une énergie ancienne, dont les lois fondatrices remontent au 16 octobre 1919 et au 8 avril 1946. Les barrages hydrauliques ont été construits à des fins, d'abord de navigation et d'irrigation, dès le XIXe siècle, puis de production d'électricité, au cours du XXe siècle. Puis spécifiquement, les premiers barrages hydroélectriques ont été édifiés dans les années 1920 et les derniers dans les années 1990.
La filière hydroélectrique regroupe une diversité d'installations hydrauliques, qui relèvent du régime des concessions ou des autorisations, selon que leur puissance excède ou non 4,5 mégawatts (MW). Selon la CRE, le parc a regroupé 2 500 installations en 2020, dont 400 pour les concessions et 2 100 pour les autorisations. Pour Réseau de transport d'électricité (RTE), sa capacité a atteint 25,7 gigawatts (GW) en 2023.
La filière hydroélectrique génère une production électrique importante, qui contribue à la sécurisation et à la décarbonation de notre système électrique. Selon RTE, sa production a représenté 58,8 térawattheures (TWh) en 2023, soit 12 % de la production totale et 42 % de celle renouvelable. C'est la 2e source d'électricité, après le nucléaire, et la 1ère source renouvelable, devant l'éolien. Pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), les émissions de cette production sont demeurées limitées, entre 40 et 70 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure (gCO2/kWh).
B. UN DIFFÉREND OPPOSE LA FRANCE À LA COMMISSION EUROPÉENNE
Les concessions hydroélectriques échues du groupe EDF n'ont pas pu être renouvelées en raison d'un différend entre la Commission européenne et la France. Selon la DGEC, 38 de ces concessions ont été placées sous le régime dit « des délais glissants », qui permet leur prorogation aux conditions antérieures en contrepartie d'une redevance. Si ce régime permet de garantir la continuité de l'exploitation des concessions, il exclut tout investissement non prévu par leurs cahiers des charges.
En effet, deux mises en demeure ont été adressées à la France. Le 13 octobre 2015, une première a été engagée par la Direction générale en charge de la concurrence (DG COMP), concernant les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prohibent les abus de position dominante et les aides d'État aux entreprises publiques. Le 7 mars 2019, une seconde a été initiée par la Direction générale en charge du marché intérieur (DG GROW), s'agissant des articles 49 et 56 du TFUE, qui interdisent les restrictions à la liberté d'établissement et à la liberté de service, ainsi que de la directive dite « Concession », du 26 février 2014.
Aujourd'hui, la France est le seul pays européen pour lequel une mise en demeure est pendante. En effet, 7 autres États membres avaient fait l'objet de procédures similaires. Or la Commission européenne a clos, en 2021, celles engagées à l'encontre de cinq régimes d'autorisation, pour des raisons d'opportunité, et, en 2023, celles initiées contre deux régimes de concession, après la révision de leur cadre législatif ou règlementaire.
|
Chiffres clés de la filière hydroélectrique française |
||||
|
installations hydrauliques dont 400 concédées et 2 100 autorisées en 2020, selon la CRE |
de capacité hydroélectrique en 2023, selon RTE |
de production hydroélectrique en 2023, selon RTE |
concessions du groupe EDF placées sous le régime dit « des délais glissants », selon la DGEC |
d'émission en fonction des installations hydrauliques, selon l'Ademe |
II. UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS EST ENVISAGÉ POUR RÉSOUDRE CE DIFFÉREND
A. APRÈS L'ÉCHEC DE PRÉCÉDENTES SOLUTIONS, UN CHANGEMENT DE RÉGIME EST AUJOURD'HUI ENVISAGÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Les solutions issues de la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015, n'ont pas permis de résoudre le différend entre la Commission européenne et l'État. D'une part, un regroupement de concessions, appliqué aux concessions de Coindre-Marèges et de Saint-Pierre de Marèges du groupe Engie, a été annulé par un arrêt du Conseil d'État du 12 avril 2019. D'autre part, une prolongation de concessions contre travaux a été refusée par la Commission européenne, pour le projet de la Truyère du groupe EDF, dans sa lettre du 12 juillet 2018, puis en tant que tel, dans sa mise en demeure du 7 mars 2019. S'agissant des sociétés d'économie mixte hydroélectriques, si elles permettent d'associer les collectivités territoriales à un opérateur économique, elles n'excluent pas la mise en concurrence.
Aussi, le Gouvernement a d'abord envisagé le regroupement des concessions du groupe EDF dans une quasi-régie, qui permet de déroger à la mise en concurrence sous trois conditions : le contrôle de l'État analogue à ses propres services ; la réalisation par la société de 80 % de son activité dans ce cadre ; l'absence de capitaux privés dans cette société. Ce régime est compatible avec l'article 17 de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. Pour autant, sa mise en oeuvre aurait induit la filialisation des activités hydroélectriques du groupe EDF, ce qui aurait soulevé un risque de désoptimisation voire de démembrement de ce groupe. De plus, elle aurait interrogé la pérennité des activités hydroélectriques des concurrents du groupe EDF.
Dans ce contexte, le Gouvernement envisage désormais un changement de régime des concessions vers les autorisations. Il concernerait l'ensemble des concessions, du groupe EDF et de ses concurrents, échues et non échues. Pour y parvenir, il requerrait : la résiliation des contrats de concession et le paiement d'une indemnité de résiliation ; le déclassement des biens hydroélectriques ; la cession de gré à gré de ces biens et le versement d'un prix de cession ; la conception d'un nouveau régime d'autorisation, d'une nouvelle redevance et d'une nouvelle gouvernance pour les installations hydrauliques de plus de 4,5 MW. En contrepartie du maintien des exploitants historiques, une part virtuelle des capacités de production hydroélectriques serait ouverte par enchère aux acteurs de marché.
B. ACCEPTÉ SUR LE PRINCIPE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE, LE CHANGEMENT DE RÉGIME ATTEND D'ÊTRE PRÉCISÉ DANS SES MODALITÉS
Le 28 août dernier, l'ancien Premier ministre François Bayrou a annoncé la conclusion d'un accord de principe entre la Commission européenne et l'État au sujet de l'organisation des concessions hydroélectriques françaises, de nature à éteindre les deux mises en demeure précitées. Le schéma retenu comporterait trois volets : le passage du régime de concession à un régime d'autorisation pour l'exploitation de l'énergie hydraulique, à l'exception des ouvrages de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ; la possibilité de maintien des exploitants en place, de manière à garantir la continuité de l'exploitation des ouvrages ; la mise à disposition par le groupe EDF de 6 GW de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs, via des enchères concurrentielles mises en vente par la CRE. Il pourrait faire l'objet d'une proposition de loi déposée par les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo.
Un grand nombre de personnes auditionnées ont fait part aux rapporteurs de leur intérêt, sur le principe, pour un changement de régime des concessions vers les autorisations, tout en plaidant pour préciser certaines modalités. Tout d'abord, le groupe EDF a rappelé la nécessité que la contrepartie laisse inchangée la gestion opérationnelle de la production hydroélectrique, soit appliquée à un volume limité et temporaire d'hydroélectricité, et ne soit pas semblable à un Arenh hydraulique. S'agissant de la CRE, elle a indiqué être disposée à réguler la contrepartie, en plaidant pour laisser telle quelle cette gestion opérationnelle de la production hydroélectrique mais aussi pour tenir compte des volumes d'hydroélectricité déjà commercialisés sur les marchés par le groupe EDF. De leur côté, les syndicats des personnels du groupe EDF ont mis l'accent sur l'incessibilité des ouvrages transférés, le maintien du statut des industries électriques et gazières (IEG), ou le refus de mesures compensatoires excessives, de type Arenh hydraulique. Pour ce qui les concerne, les associations d'élus locaux ont proposé la consolidation de la gouvernance et le maintien d'une redevance. Enfin, les concurrents du groupe EDF ont plaidé pour une mise en concurrence des concessions hydroélectriques de ce dernier par appel d'offres ou, à défaut, un accès à la contrepartie.
Le Gouvernement a répondu à certaines interrogations des rapporteurs sur le changement de régime des concessions vers les autorisations. D'une part, l'indemnité de résiliation et le prix de cession doivent être définis par une commission d'experts indépendants. D'autre part, les futures cessions des biens transférés doivent faire l'objet d'un droit d'opposition. Autre point, à l'échelon local, les compétences, gouvernance et redevance actuelles doivent être maintenues. Enfin, la contrepartie doit laisser inchangée l'exploitation opérationnelle de la production hydroélectrique, l'enjeu étant d'introduire une part de concurrence sur la commercialisation des produits, non sur la gestion des ouvrages.
La Commission européenne a également répondu à certains questionnements des rapporteurs sur le changement de régime des concessions vers les autorisations. Tout d'abord, elle a rappelé que les États membres sont libres de choisir l'organisation du secteur hydroélectrique sur leur territoire selon le modèle de leur choix. Plus encore, s'agissant du devenir de la CNR, dont la concession vient d'être renouvelée, elle a confirmé que les États membres peuvent choisir des modèles différents pour leurs différents aménagements. Enfin, elle a réaffirmé que les États membres doivent respecter les règles européennes relatives à la concurrence, au marché intérieur et à l'énergie.
III. POUR UN CHANGEMENT DE
RÉGIME CONSENSUEL, SÉCURISÉ ET RÉUSSI DES
CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS :
15 PROPOSITIONS
RÉUNIES EN 4 AXES
Les rapporteurs sont convaincus de l'intérêt de l'accord de principe annoncé sur la réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF. Aussi les rapporteurs se félicitent-ils de la résolution attendue du différend opposant la Commission européenne à l'État à ce sujet. En effet, ce différend obère les perspectives de développement de la toute la filière hydroélectricité française depuis 20 ans. À l'heure où le protectionnisme américain et le bellicisme russe éprouvent chaque jour la sécurité d'approvisionnement énergétique de la France et de l'Union européenne, les autorités nationales et européennes doivent définir les modalités d'application de cet accord de principe, sans rien sacrifier, ni de la garantie fondamentale de notre souveraineté énergétique nationale, ni de l'harmonisation légitime des règles du marché européen de l'énergie. Convenir de telles modalités d'application est également indispensable à la réussite de notre transition énergétique nationale, et donc à la réduction des émissions européennes de 55 % d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à nos engagements européens et internationaux.
Les rapporteurs sont aussi convaincus de la nécessité pour les parlementaires, députés comme sénateurs, de parler d'une même voix sur ce sujet transpartisan, d'intérêt national. C'est pourquoi les rapporteurs saluent le travail effectué par la mission d'information conduite par les députés, sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, dont les conclusions ont été rendues publiques le 13 mai dernier. Les rapporteurs partagent le constat formulé par les députés sur la préférence donnée au changement de régime des concessions vers les autorisations. Ils constatent que l'accord de principe annoncé évoque l'éventualité d'une traduction législative prochaine, le cas échéant dans le cadre d'une proposition de loi déposée par ces députés. Les rapporteurs rappellent que le Sénat avait proposé l'expérimentation d'un tel passage, à l'article 21 de la proposition de loi dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024 puis adoptée au Sénat, en première lecture, le 16 octobre 2024, et en deuxième lecture, le 8 juillet 2025. Dans la mesure où l'examen en deuxième lecture de cette proposition de loi n'est pas encore intervenu à l'Assemblée nationale, les rapporteurs appellent les députés à amender ce texte pour y introduire leurs propositions, afin de réaliser le passage du régime des concessions vers celui des autorisations. Il s'agit en effet du véhicule législatif le plus rapide et le plus aisé à faire prospérer.
En identifiant précisément les lignes directrices du Sénat, les rapporteurs souhaitent que leur rapport d'information serve de point d'appui à la définition des modalités d'application de cet accord de principe. C'est pourquoi ils proposent 15 propositions, réunies en 4 axes.
A. LE PREMIER AXE VISE À ÉVALUER EN AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE RÉGIME
Dans la mesure où les implications juridiques et financières d'un tel changement sont fortes, les rapporteurs plaident pour évaluer son impact financier, via la Cour des comptes, et sa robustesse technique, via le Conseil d'État.
De plus, ils préconisent de ne légiférer qu'en possession d'une lettre de confort de la Commission européenne, garantissant la compatibilité du changement de régime avec le droit de l'Union européenne.
Enfin, compte tenu de l'urgence de la situation, ils proposent de légiférer préférentiellement par le biais d'amendements à la proposition de loi dite « Gremillet », dès son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
B. LE DEUXIÈME AXE TEND À SÉCURISER LES PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU CHANGEMENT DE RÉGIME
En premier lieu, les rapporteurs proposent d'exclure de ce changement les concessions qui viennent d'être renouvelées (Rhône), celles pour qui l'activité fluviale est principale et l'activité hydroélectrique accessoire (Seine, Moselle) ou encore celles qui sont régies par des accords internationaux1(*) (Rhin, Doubs, L'Arve, Émosson).
S'agissant du transfert de propriété des ouvrages hydroélectriques, les rapporteurs proposent trois garde-fous. Le premier est financier : il s'agit de garantir la juste évaluation des indemnités de résiliation des contrats de concession et des prix de cession de ces ouvrages par une commission d'experts indépendants. Le second est juridique : il consiste à prévoir la faculté pour l'État de s'opposer à la cession de ces ouvrages, ainsi qu'un haut niveau de contrôle par ce dernier de l'organisation et de l'exploitation de ces ouvrages. Le dernier est social : il vise à préserver le statut national des personnels des IEG sur ces ouvrages.
Concernant la contrepartie au maintien des exploitants historiques, les rapporteurs appuient son encadrement par la CRE. De plus, ils estiment que cette contrepartie doit laisser inchangée la gestion opérationnelle des installations hydrauliques par leurs propriétaires. Enfin, ils considèrent que cette contrepartie doit être restreinte à une part temporaire et limitée de la commercialisation de l'électricité issue des installations hydrauliques.
C. LE TROISIÈME AXE PROPOSE DE TERRITORIALISER LA GOUVERNANCE ET LES PROCÉDURES APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ, À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE RÉGIME
Pour ce faire, les rapporteurs plaident pour faciliter la mise en oeuvre des projets hydrauliques. Tout d'abord, ils proposent de consolider les compétences du ministre chargé de l'énergie dans le cadre du nouveau régime d'autorisation. Au-delà, ils appellent à veiller à l'absence de surtransposition dans l'application des règles relatives à la continuité écologique des cours d'eau. Enfin, ils proposent d'appliquer à l'ensemble des installations hydrauliques deux novations sénatoriales en faveur de la « petite hydroélectricité », issues de la loi dite « Climat-Résilience », du 22 août 2021 : il s'agit du médiateur national de l'hydroélectricité et du portail national de l'hydroélectricité.
De plus, les rapporteurs appellent à mieux associer les collectivités territoriales à ces projets hydrauliques. D'une part, ils proposent de préserver la perception de leurs redevances, en privilégiant le dispositif calqué sur les concessions non échues, c'est-à-dire excluant tout revenu normatif et tout prix cible, qui leur est le plus favorable. D'autre part, ils suggèrent de consolider la gouvernance tripartite de l'eau entre l'État, les collectivités territoriales et les exploitants hydrauliques, notamment dans la révision des cahiers des charges. Enfin, ils préconisent de mieux intégrer la résilience au changement climatique, dont la gestion des sécheresses et des crues, très prégnante pour les territoires ruraux, à cette révision.
D. LE DERNIER AXE PRÉVOIT DE COMPLÉTER LE CHANGEMENT LÉGISLATIF DE RÉGIME PAR UNE RÉVISION DES CADRES RÈGLEMENTAIRE ET EUROPÉEN APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ
Tout d'abord, les rapporteurs plaident pour intégrer ce changement au décret en cours sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Ils proposent d'y fixer des objectifs au Gouvernement visant : d'une part, à atteindre une capacité pour l'hydroélectricité de 29 GW d'ici 2035 ; d'autre part, à opérer pour les concessions hydroélectriques leur passage du régime des concessions vers celui des autorisations, en appliquant une contrepartie sur celles du groupe EDF ; également, à laisser inchangée la concession de la CNR, a minima jusqu'à son expiration ; enfin, à négocier l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014.
En outre, les rapporteurs appellent les autorités nationales à négocier cette exclusion auprès des autorités européennes, quelles qu'en soient les difficultés. En effet, une révision suppose le soutien d'autres pays européens, présente un calendrier d'application éloigné et ne résout pas à elle seule le différend entre la Commission européenne et l'État.
HYDROÉLECTRICITÉ : FAIRE BARRAGE
À LA MISE EN
CONCURRENCE
I. ÉNERGIE ANCIENNE, PILOTABLE ET DÉCARBONÉE, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OBÉRÉES PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE, VIEUX DE PLUS DE 20 ANS
A. REPRÉSENTANT 12 % DE NOTRE PRODUCTION ÉLECTRIQUE, DONT 42 % DE CELLE RENOUVELABLE, L'HYDROÉLECTRICITÉ CONSTITUE UN ATOUT POUR NOTRE TRANSITION ET NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES
1. L'énergie hydraulique : une énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été adoptées au sortir des deux guerres mondiales
L'énergie hydraulique constitue une énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été adoptées au sortir des deux guerres mondiales.
En France, les barrages hydrauliques ont été construits, d'abord à des fins de navigation et d'irrigation, dès le XIXe siècle, puis de production d'électricité, au XXe siècle. Plus spécifiquement, les premiers barrages hydroélectriques ont été édifiés dans les années 1920 et les derniers dans les années 1990.
L'énergie hydraulique, elle-même, nourrit à un lien très spécifique avec notre pays. En effet, c'est l'ingénieur Aristide Bergès, issu d'une famille de papetiers de l'Ariège, qui a démontré la viabilité du recours à cette énergie, d'abord pour l'industrie, en 1867, puis pour l'électricité, en 1882. Il a forgé l'expression de « houille blanche », pour populariser l'hydroélectricité, en opposition à la « houille noire », qui désignait alors le charbon. L'exposition universelle de Paris en 1889 a offert une vitrine mondiale à cette innovation2(*).
Dans ce contexte, la loi du 16 octobre 2019 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a posé les fondements du cadre légal applicable aux activités hydroélectriques, en instituant pour ces activités un régime concessif soumis au contrôle de l'État.
Tout d'abord, cette loi a nationalisé l'énergie hydraulique, en posant le principe selon lequel « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. » (article 1er). Plus encore, elle a distingué le régime des concessions de celui des autorisations, en plaçant sous ce premier régime « les entreprises qui ont pour objet principal la fourniture de l'énergie à des services publics de l'État, des départements, des communes et des établissements publics ou à des associations syndicales [...] dont la puissance maximum [...] excède 150 kilowatts [...] et les entreprises dont la puissance maximum excède 500 kilowatts. » (article 2). Enfin, elle a prévu un renouvellement au moins décennal des concessions, en instituant un droit de préférence au profit du concessionnaire sortant, en ces termes : « Dix ans au moins avant l'expiration de la concession, l'administration doit notifier au concessionnaire si elle entend ou non lui renouveler sa concession [...] Le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. »
Par la suite, la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a consolidé le cadre légal afférent aux activités hydroélectriques, en renforçant le contrôle exercé par l'État.
En effet, cette loi a nationalisé la production d'électricité (article 1er) et a transformé Électricité de France (EDF) en établissement public national industriel et commercial (EPIC) (article 2).
Cependant, plusieurs lois ont bouleversé le cadre légal prévu pour les activités hydroélectriques, en distendant le contrôle opéré par l'État.
Tout d'abord, la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est venue relever de 0,15 ou 0,5 à 4,5 mégawatts (MW) le seuil distinguant le régime des concessions de celui des autorisations (article 25).
Plus encore, la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a transformé le groupe EDF en société anonyme, dont le capital doit être détenu par l'État, à hauteur d'au moins 70 % (article 24).
Or, depuis la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (article 38), sauf lorsqu'elles sont confiées à un établissement public (article 41).
Autre point, la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au profit du concessionnaire sortant en cas de renouvellement d'une concession (article 7).
Cependant, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite « Transition énergétique », a précisé que le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) s'applique aux personnels des concessions hydrauliques, sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle (article 171).
La montée de l'État au capital du groupe d'EDF, de 70 à 100 %, par la loi du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe EDF d'un démembrement (article 1er), n'a pas modifié cette situation, dans la mesure où ce groupe demeure une société anonyme.
Cependant, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)3(*) a indiqué en ces termes que cette configuration serait de nature à faciliter la constitution d'une quasi-régie : « Si la nationalisation du groupe EDF ne permet pas aujourd'hui à elle seule de s'affranchir d'un renouvellement par mise en concurrence des contrats de concession, elle constitue néanmoins une nouvelle opportunité notamment pour les conditions à remplir pour l'attribution de contrats de concessions hydroélectriques à une quasi-régie. En effet, la détention par des capitaux publics est une des conditions cumulatives requises pour qualifier une relation de quasi-régie. »
Hormis les concessions hydroélectriques du groupe EDF, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, a institué une concession unique pour l'ensemble de ces travaux d'aménagement, octroyée par décret (article 2). Cette concession a été confiée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) par un décret du 16 juin 1934.
La loi du 4 janvier 1980 relative à la CNR a précisé son statut de société anonyme, dont la majorité du capital est détenu par les collectivités territoriales et par d'autres personnes morales publiques, ainsi que ses missions, notamment la production et la commercialisation de l'électricité dans le cadre de la concession précitée (article 1er).
Plus récemment, la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône, dite « Aménagement du Rhône », a permis de prolonger la concession du Rhône attribuée à la CNR jusqu'au 31 décembre 2041 (article 1er). À l'initiative du Sénat, cette loi a placé les missions de cette concession sous le timbre des objectifs énergétiques nationaux, dont l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 (article 2).
Pour la DGEC4(*), cette concession, distincte de celles du groupe EDF, n'appelle pas à voir son mode de renouvellement évoluer sur les deux prochaines décennies : « S'agissant de la concession du Rhône octroyée à la CNR, celle-ci a fait l'objet d'une prolongation jusqu'en 2041 par la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône. Le mode de renouvellement de cette concession après 2041 doit être examiné, au même titre que le renouvellement des autres concessions. »
2. Les installations hydroélectriques : une diversité d'installations, partagées entre le régime des concessions et celui des autorisations, selon leur puissance
La filière hydroélectrique regroupe une diversité d'installations hydrauliques, qui relèvent du régime des concessions ou de celui des autorisations, selon leur puissance.
D'un point de vue technique, différents types d'installations hydrauliques existent5(*) :
- les installations dites « au fil de d'eau », qui turbinent tout ou partie du débit des cours d'eau sans capacité de stockage ;
- les installations dites « par éclusées », qui disposent d'une petite capacité de stockage ;
- les « centrales de lac », qui bénéficient d'une plus grande capacité de stockage ;
- les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), qui fonctionnent en circuit fermé.
D'un point de vue juridique, l'article L. 511-5 du code de l'énergie, dans la filiation de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980 susmentionnée, place les installations hydrauliques sous le régime des concessions, lorsque leur puissance excède 4,5 mégawatts (MW), et sous le régime des autorisations, dans le cas contraire. S'agissant des installations relevant du régime des autorisations, l'article L. 531-1 du même code les soumet en principe à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)6(*), prévue à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, et, plus largement, au régime de l'autorisation environnementale (AE), mentionné à l'article L. 181-1 du même code.
L'article R. 521-1 du code de l'énergie précise que l'octroi d'une installation relevant du régime des concessions relève du ministre chargé de l'énergie, pour les concessions supérieures à 100 MW, et du préfet du département, dans les autres cas. Concernant l'autorisation environnementale délivrée à une installation relevant du régime des autorisations, l'article R. 181-2 du code de l'environnement fait du préfet de département l'autorité compétente et l'article R. 181-3 du même code fait du service de l'État chargé de la police de l'eau le service coordinateur de l'instruction des demandes d'autorisation.
Fait notable, l'article L. 524-1 du code de l'énergie dispose que le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion de l'eau7(*), qui est consulté sur toute décision de modification des conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques et comprend des représentants de l'État, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains et des associations représentatives d'usagers de l'eau. En outre, l'article L. 212-4 du code de l'environnement prévoit que le même représentant de l'État peut créer une commission locale de l'eau (CLE), qui est consultée pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et comporte des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées.
Au total, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE)8(*), le parc hydroélectrique français a regroupé 2 500 installations hydrauliques en 2020, dont 400 pour le régime des concessions et 2 100 pour celui des autorisations. Pour Réseau de transport d'électricité (RTE), la capacité installée de ce parc a atteint 25,7 gigawatts (GW) en 2023, soit 17,3 % de la capacité totale du parc électrique en 20239(*). Si la capacité installée du parc hydraulique a fortement cru des années 1950 aux années 1990, en passant de moins de 5 à plus de 25 GW grâce à la mise en service de grands barrages, elle est restée relativement stable depuis lors, ainsi que l'illustre le graphique suivant, tiré des travaux de la CRE10(*).
Sur les 400 concessions hydroélectriques évoquées par la CRE, 296 ont relevé du groupe EDF11(*) et 31 du groupe Engie12(*),13(*) - 12 via la Société hydroélectrique du Midi (Shem) et 19 via la Compagnie nationale du Rhône (CNR)14(*) - en 2021, les autres étant détenues par de petits producteurs indépendants. Selon la DGEC, on dénombre à date 340 concessions hydroélectriques représentant 500 usines hydroélectriques, dont la puissance est détenue par le groupe EDF, à hauteur de 19,5 GW, et par le groupe Engie, à hauteur de 3,7 GW - dont 740 MW pour la Shem et 3 GW pour la CNR.
Parmi ces installations hydrauliques, France Hydroélectricité a insisté sur le cas particulier des concessions dites « autorisables ».
Il s'agit des installations hydrauliques, comprises entre 0,5 et 4,5 MW, qui étaient exploitées sous le régime des concessions avant la loi du 15 juillet 1980 et doivent depuis lors être exploitées sous le régime des autorisations, mais seulement à l'expiration de leurs contrats de concession, en application du principe de non-réactivité des lois et des réglements et des principes généraux du droit des contrats.
L'association s'est exprimée en ces termes à leur sujet : « France Hydroélectricité fédère de nombreux petits concessionnaires hydroélectriques, à gestion publique ou privée, avec des puissances généralement inférieures à 15 MW. Les grandes concessions historiques (EDF, CNR, Shem) ne relèvent pas de son périmètre. Au sein de ces concessions, certaines sont concessibles (si leur puissance est supérieure à 4,5 MW) à l'issue de leur titre en cours ou échu et d'autres sont autorisables (si leur puissance est inférieure à 4,5 MW et supérieure à 0,5 MW). On dénombre environ 64 centrales de ce second type, pour une puissance de 134 MW. Ces concessions sont exposées aux mêmes difficultés que les concessions d'EDF (manque de visibilité induisant un blocage des investissements et manque de gros entretiens) et doivent faire partie de toute réforme à venir sur les fins de concessions. »
3. La production hydroélectrique : une activité économique importante et des bénéfices environnementaux intéressants
La filière hydroélectrique génère une production d'électricité renouvelable importante, qui contribue à la sécurisation de notre système électrique et hydraulique, à la décarbonation de notre économie et encore au développement de nos territoires.
En 2023, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique a atteint 58,8 térawattheures (TWh), ce qui a représenté 11,9 % de la production d'électricité totale et 41,5 % de celle renouvelable, selon RTE15(*). C'est donc la 2e source d'électricité, après l'énergie nucléaire, et la 1ère source d'électricité renouvelable, devant l'énergie éolienne.
Pour la DGEC, la même année, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique a atteint 56 TWh, ce qui a représenté 14,5 % de notre consommation d'énergie primaire renouvelable et 15,3 % de notre production d'énergie primaire renouvelable16(*).
La production hydraulique est restée relativement stable sur les vingt dernières années. Pour autant, elle a fortement varié selon le volume des précipitations, le débit des fleuves et le niveau des stocks. Les faibles années de production, en 1990, 2005, 2011, 2017 et 2022, son niveau de production est resté autour de 50 TWh. À l'inverse, les années de forte production, en 1992, 1994, 1999, 2001 et 2013, ce niveau a atteint autour de 70 TWh. Le retour à de meilleures conditions métrologiques a fait augmenter de 24 % ce niveau entre 2022 et 2023. Le graphique ci-dessous, tiré des travaux de la DGEC, montre cette évolution17(*).
Au-delà de la production d'électricité en tant que telle, l'énergie hydraulique apporte de multiples bénéfices :
- énergie pilotable, elle contribue à la stabilité et la flexibilité du réseau électrique, à la sécurité des personnes et des biens, à l'alimentation en eau et à l'irrigation des cultures, et enfin à la navigation fluviale et aux activités de loisirs ;
- énergie renouvelable, elle participe à la décarbonation de notre économie, ses émissions de gaz à effet de serre (GES) étant limitées entre 40 et 70 grammes d'équivalents en dioxyde de carbone par kilowattheure (gCO2eq/kWh), selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)18(*) ;
- énergie mature, elle concourt à la maîtrise des coûts et des prix de l'électricité, ses coûts unitaires moyens étant de 30 à 50 € / MWh pour les grandes installations au fil de l'eau, de 70 à 90 € pour celles de forte puissante et exploitant des hautes chutes et de 70 à 160 € pour celles de plus faible puissance, selon la DGEC19(*) ;
- énergie territorialisée, elle génère des activités rémunératrices, notamment dans les régions montagneuses ou rurales, le marché de l'hydroélectricité ayant représenté 3,6 milliards d'euros (Mds) en 2016, dont 636 millions d'euros (M€) d'investissements et 91 M€ d'exportations, ainsi que 12 600 emplois, selon l'Ademe20(*).
4. Les concessions hydroélectriques échues du groupe EDF : des concessions placées sous un régime transitoire dit « des délais glissants »
Les concessions hydroélectriques du groupe EDF arrivées à échéance n'ont pas pu être renouvelées, en raison d'un différend entre la Commission européenne et l'État.
Aussi ont-elles été placées sous un régime transitoire dit « des délais glissants ».
Depuis la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015 (article 116), ce régime permet la prorogation de ces concessions aux conditions antérieures (article L. 521-16 du code de l'énergie).
En contrepartie, une redevance ad hoc proportionnelle aux recettes leur est appliquée (article L. 523-3 du même code), sur le même modèle que celle afférente aux concessions non échues (article L. 523-2 du même code), en application de la loi du 28 décembre 2018 de finances initiale pour 2019 (article 27). Le produit de cette redevance est alloué à l'État (pour moitié), aux départements (pour un tiers), aux communes (pour 1/12ème) et aux groupements de communes (pour 1/12ème). Un prix cible de l'électricité sert de plafond au versement des parts des collectivités territoriales et de leurs groupements, depuis la loi du 30 décembre 2022 de finances initiale pour 2023 (article 127). Dans ce contexte, le taux de la redevance a été fixé à 40 % du résultat normatif de la concession, diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat (article R. 523-5 du même code). De son côté, le prix cible a été fixé à 100€/MWh, par un arrêté du 10 mai 2023 relatif aux prix cibles mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'énergie (article 2).
À l'initiative du Sénat, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite « Aper », (article 73) a permis l'inscription des dépenses d'investissements réalisés durant la période dite « des délais glissants » sur un compte dédié, afin que leur part non amortie puisse être remboursée au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (article L. 521-16 du même code).
Selon la DGEC, 38 concessions hydroélectriques échues du groupe EDF ont été placées sous ce régime transitoire dit « des délais glissants », au 31 décembre 2024. Ces concessions représentent une capacité installée de 3,15 GW, soit 16 % de la puissance hydraulique du groupe EDF21(*).
Le tableau ci-après, transmis par la DGEC, présente ces concessions. On constate que 60,5 % des concessions concernées sont arrivés à échéance dans les années 2020, contre 36,8 % dans les années 2010 et 2,6 % dans les années 2000. C'est donc un phénomène qui s'est récemment amplifié.
|
Nom de la concession |
Commune |
Puissance électrique installée (kW) |
Type de production (principale) |
Date de fin |
|
BANCAIRON/ COURBAISSE |
CLANS ; MALAUSSENE |
76 220 |
Fil de l'eau |
31/12/2003 |
|
CHAMBON (RESERVOIR) |
AURIS |
0 |
Lac |
31/12/2010 |
|
SAUTET/ CORDEAC |
CORDEAC ; CORPS |
133 900 |
Lac |
31/12/2011 |
|
LAC MORT |
ST BARTHELEMY DE SECHILIE |
8900 |
Lac |
21/02/2012 |
|
BROMMAT |
BROMMAT |
406 000 |
Lac |
31/12/2012 |
|
HAUTE DORDOGNE |
CHAMPS SUR TARENTAINE MAR |
275 700 |
Lac |
31/12/2012 |
|
LAVAUD GELADE |
FAUX LA MONTAGNE ; PEYRAT LE CHATEAU |
0 |
Lac |
31/12/2012 |
|
SARRANS/ BOUSQUET |
STE GENEVIEVE SUR ARGENCE |
184 950 |
Lac |
31/12/2012 |
|
BISSORTE/ SUPER-BISSORTE |
ORELLE |
818 260 |
Pompage |
31/12/2014 |
|
BRILLANNE/ LARGUE |
VILLENEUVE |
39 200 |
Lac |
31/12/2015 |
|
GIROTTE/ BELLEVILLE/ HAUTELUCE/ BEAUFORT/ VILLARD |
BEAUFORT ; VILLARD SUR DORON ; HAUTELUCE |
94 570 |
Lac |
31/12/2015 |
|
TEICH |
AX LES THERMES |
6100 |
Éclusée |
31/12/2017 |
|
PORTILLON |
BAGNERES DE LUCHON |
56 230 |
Lac |
31/12/2018 |
|
BAIGTS |
BAIGTS DE BEARN |
8630 |
Fil de l'eau |
31/12/2019 |
|
MONCEAUX-LA-VIROLE |
ST HILAIRE LES COURBES |
16 150 |
Lac |
31/12/2019 |
|
AIGLE |
CHALVIGNAC |
360 000 |
Lac |
31/12/2020 |
|
CAJARC |
CAJARC |
8500 |
Fil de l'eau |
31/12/2020 |
|
DAMPJOUX |
NOIREFONTAINE |
4900 |
Fil de l'eau |
31/12/2020 |
|
POINTIS-DE-RIVIERE |
POINTIS DE RIVIERE |
7000 |
Fil de l'eau |
31/12/2020 |
|
BAOUS (LE) |
BOUT DU PONT DE LARN |
13 630 |
Éclusée |
31/12/2021 |
|
GESSE/ ST-GEORGES |
AXAT ; BESSEDE DE SAULT |
12 400 |
Fil de l'eau |
31/12/2021 |
|
GUCHEN |
GUCHEN |
5560 |
Fil de l'eau |
31/12/2021 |
|
LABARRE |
FOIX |
4900 |
Fil de l'eau |
31/12/2021 |
|
LARDIT |
CAMPOURIEZ |
43 300 |
Lac |
31/12/2021 |
|
ORGEIX |
ORGEIX |
5000 |
Éclusée |
31/12/2021 |
|
ROUZE/ USSON |
ROUZE |
16 300 |
Éclusée |
31/12/2021 |
|
ST-GENIEZ-O-MERLE |
ST GENIEZ O MERLE |
36 600 |
Éclusée |
31/12/2021 |
|
VINTROU |
LE VINTROU |
31 500 |
Lac |
31/12/2021 |
|
PONT-ESCOFFIER |
LE BOURG D OISANS |
51 300 |
Fil de l'eau |
31/12/2022 |
|
ST-ETIENNE-CANTALES/ NEPES |
LAROQUEBROU ; ST ETIENNE CANTALES |
106 000 |
Lac |
31/12/2022 |
|
ASTON |
ASTON |
104 000 |
Éclusée |
31/12/2023 |
|
CASTELNAU-LASSOUTS |
LASSOUTS |
41 900 |
Éclusée |
31/12/2023 |
|
VAUFREY |
VAUFREY |
6300 |
Éclusée |
31/12/2023 |
|
CASTILLON/ CHAUDANNE |
CASTELLANE ; DEMANDOLX |
75 780 |
Lac |
31/12/2024 |
|
CIERP |
CIERP GAUD |
11 000 |
Fil de l'eau |
31/12/2024 |
|
PEAGE-DE-VIZILLE |
VIZILLE |
46 300 |
Fil de l'eau |
31/12/2024 |
|
PONT-DE-LA-REINE |
SALIGOS |
14 100 |
Fil de l'eau |
31/12/2024 |
|
RIVIERES |
RIVIERES |
23 200 |
Éclusée |
31/12/2024 |
Régime transitoire, le régime dit « des délais glissants » présente des avantages mais aussi des inconvénients :
- sur le plan des avantages, ce régime garantit la continuité de l'exploitation de la concession échue jusqu'à son renouvellement, ce qui permet de poursuivre la production énergétique et la gestion de l'eau et de maintenir un haut niveau de sécurité, sans vide juridique donc ;
- sur le plan des inconvénients, ce régime exclut tout développement ou toute modification qui ne serait pas prévu par le cahier des charges de la concession échue, ce qui n'offre, ni la possibilité juridique, ni la visibilité économique, nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements.
Parmi les autres inconvénients :
- le groupe EDF a souligné que l'exploitation des concessions échues n'est pas nécessairement favorable, car le concessionnaire est tenu d'exploiter une concession même déficitaire et de s'acquitter d'une redevance spécifique et élevée dans tous les cas ;
- s'agissant des concurrents du groupe EDF, ils ont pointé le manque d'investissements induit par les concessions échues. France Hydroélectricité a rappelé que le régime dit « des délais glissants » a conduit à un effet pervers, dans la mesure où ce régime conçu comme provisoire a eu tendance à s'éterniser, les concessions échues en relevant depuis 10 ans voire 20 ans. De son côté, l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg) a critiqué l'immobilisme induit par ce régime, caractérisé avec un sous-investissement chronique, une gestion environnementale obsolète et des redevances nationales ou locales manquantes. Dans le même esprit, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode) a relevé la durée indéfinie, les incertitudes économiques et les recettes manquantes imputables à ce régime ;
- concernant les associations d'élus locaux, elles ont insisté sur les pertes de recettes fiscales induites par les concessions échues. Départements de France (DF) et l'Association nationale des élus de montage (ANEM) ont déploré le prix cible de 100€/MWh plafonnant la part de la redevance allouée aux collectivités territoriales. En outre, l'Association des élus de bassins (ANEB) s'est plus généralement inquiétée du report de charge vers les collectivités territoriales des impacts morphologiques des concessions hydroélectriques sur les cours d'eau.
5. Les objectifs en matière d'énergie hydroélectrique : une bonne prise en compte dans le code de l'énergie et le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
Si la filière hydroélectrique est bien prise en compte dans les objectifs législatifs et réglementaires nationaux existants en matière d'énergie, le différend entre la Commission européenne et l'État compromet l'atteinte effective de ces objectifs.
À l'initiative du Sénat, l'hydroélectricité a été intégrée au titre préliminaire du code de l'énergie, qui fixe nos objectifs législatifs nationaux en matière d'énergie et de climat. Depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-climat », (article 1er) et la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience », (article 89), le 4° bis du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie comporte ainsi pour objectif « d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ».
En application de cet objectif législatif, le décret du 10 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) (article 3), décline plusieurs objectifs réglementaires pour l'hydroélectricité. Il prévoit ainsi des objectifs de capacité installée22(*) de 25,7 GW d'ici fin 2023 et entre 26,4 et 26,7 GW d'ici fin 2028. La capacité installée du parc hydraulique représentant 25,7 GW en 2023 selon RTE23(*), le premier objectif a été atteint mais les deux autres ne semblent pas en passe de l'être.
Dans le cadre de l'actualisation du volet réglementaire de notre programmation énergétique nationale, le Gouvernement a proposé des objectifs de capacité installée24(*) de 26,3 GW en 2030 et de 28,5 GW en 2035, dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNIEC), transmis à la Commission européenne le 10 juillet 2024, ainsi que dans le projet de décret sur la PPE25(*), mis en consultation le 7 mars 2025. Plus précisément, le PNIEC et le projet de décret sur la PPE prévoient que la hausse de 2,8 GW des capacités installées d'ici 2035 se répartissent entre 1,7 GW pour les STEP, 610 MW pour les installations relevant du régime des concessions et 440 MW pour celles relevant du régime des autorisations. Pour atteindre ces objectifs, il est envisagé la poursuite du soutien public à la petite hydroélectricité et l'étude d'un tel soutien pour les STEP. En revanche, la production envisagée demeure d'environ 54 TWh, dans la mesure où « l'augmentation limitée des capacités hydroélectriques ne se traduira pas nécessairement par une augmentation du productible, notamment en raison des impacts attendus du changement climatique sur la ressource en eau. » Au total, la résolution du différend entre la Commission européenne et l'État est abordée de manière très allusive par le projet de décret sur la PPE : « À court et moyen termes, la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques est [...] nécessaire à l'atteinte des objectifs hydroélectriques ».
S'agissant de l'actualisation du volet législatif de notre programmation énergétique nationale, le Sénat avait proposé un objectif de capacité installée de 29 GW d'ici 2035, dans le cadre de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024. Au fil de la navette parlementaire, toujours en cours à la date de publication du présent rapport d'information, l'objectif de capacité sectoriel proposé par le Sénat a été remplacé par un objectif de production global suggéré par le Gouvernement, de 200 TWh d'électricité renouvelable d'ici 2030, incluant l'hydroélectricité.
À ce stade, la DGEC a fait part de sa disposition à faire évoluer, dans une certaine mesure, le contenu du décret sur la PPE en matière d'hydroélectricité. D'une part, le changement de régime des concessions vers les autorisations pourrait y être mentionné : « Dans le cas où l'option de passage vers un régime d'autorisation serait retenue avant l'adoption de la PPE, cette option pourrait y être mentionnée. » D'autre part, l'exclusion de la concession du Rhône attribuée à la CNR de ce changement de régime pourrait également y être précisée : « Il pourrait être indiqué dans la PPE qu'une attention particulière sera accordée à la concession du Rhône ». En revanche, ce n'est pas le cas de l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dite « Concession » : « Il n'est pas envisagé de préciser dans la PPE que la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques fera l'objet de négociations sur l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive 2014/23/UE dite Concession. » Enfin et surtout, l'introduction d'un objectif de 29 GW de capacité installée pour l'hydroélectricité d'ici 2035 n'est pas souhaitée par le Gouvernement : « Au regard 1) du délai de construction des grandes STEP et du calendrier de résolution des précontentieux européens et 2) du rythme de développement de la petite hydroélectricité, l'objectif de développement de + 2,8 GW à l'horizon 2035 est déjà ambitieux. Rehausser cet objectif à 29 GW, soit 3,1 GW, ne paraît ainsi pas pertinent. »
Quels que soient les objectifs législatifs et réglementaires nationaux in fine retenus en matière l'hydroélectricité, seule une résolution du différend entre la Commission européenne et l'État peut permettre leur réalisation concrète :
- tout d'abord, la DGEC a rappelé que le régime dit « des délais glissants » limite les possibilités d'investissement, en ces termes : « La situation de blocage liée aux précontentieux en cours limite fortement le développement de capacité hydroélectrique des ouvrages en concessions. En effet, les contrats échus ne peuvent pas être modifiés et la modification des contrats en cours pour réaliser de gros investissements nécessiterait leur mise en concurrence, en application des règles de la commande publique et de la directive concessions. » ;
- dans le même esprit, France Hydroélectricité a souligné que la filière hydroélectrique a davantage besoin de moyens concrets que d'objectifs programmatiques, ainsi : « Les objectifs sont conformes aux propositions de la filière. C'est sur la mise en oeuvre de ces objectifs que porteront les discussions à venir. » ;
- pour ce qui le concerne, le groupe EDF a rappelé que le développement de ses nouveaux projets nécessite la résolution du différend actuel, en ces termes : « Nous partageons pleinement ces objectifs de développement et EDF a d'ores et déjà identifié les projets pour y répondre [...] Ces projets sont très majoritairement situés sur des concessions existantes et nécessitent donc un réglement rapide des contentieux européens pour être développés dans les temps considérés ». Il a rappelé que l'extension d'une STEP à Montézic (Aveyron) est bloquée depuis 10 ans. Il a précisé avoir identifié, en cas de résolution du différend, 2 GW de projets d'ici 2035 et 2 GW supplémentaires d'ici 2050. Le développement des STEP envisagé par le groupe dans ce cadre permettrait d'augmenter significativement le stockage de l'électricité en 10 ans : les capacités installées pourraient augmenter d'1,5 GW pour le turbinage (en mode « production ») et d'1,8 GW pour le pompage (en mode « consommation »), tandis que l'énergie totale stockable pourrait croître de 30 gigawattheures (GWh) (sur l'ensemble du cycle) ;
- enfin, l'un des concurrents du groupe EDF, le groupe Engie a estimé que l'atteinte des objectifs économiques dépend de la résolution des difficultés juridiques, ainsi : « À ce jour, l'incertitude juridique persistante liée au contentieux sur les concessions hydroélectriques bloque les investissements de développement ou de modification substantielle des installations [...] L'atteinte de ces objectifs dépendra de la levée des incertitudes juridiques et de l'ouverture effective du marché à l'ensemble des opérateurs. » Il a rappelé que ses investissements ont été limités sur 20 ans, la Shem n'ayant pu développer que 7 MW, soit 1 % de sa puissance, et la CNR que 33 MW, soit 1 % de sa puissance. Il a précisé qu'en cas de résolution du différend, la Shem pourrait étudier le développement d'une STEP dans le Haut-Ossau (Pyrénées-Atlantiques) voire le rehaussement de certains barrages.
B. DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, UN DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT OBÈRE LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE HYDROÉLECTRIQUE FRANÇAISE
1. Une première mise en demeure adressée en 2015 à la France par la Commission européenne, sur le fondement des articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
La première procédure, toujours pendante, engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, date de 2015. Il s'agit de la procédure n° 2015/2187 portée par la Direction générale de la concurrence (DG COMP). Elle concerne la méconnaissance supposée du premier paragraphe de l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prohibe les aides d'État accordées aux entreprises publiques contraires aux règles des traités et de l'article 102, qui interdit le fait pour une entreprise d'exploiter de façon abusive une position dominante sur tout ou partie d'un marché intérieur. Dans ce contexte, une mise en demeure a été adressée à la France, le 23 octobre 2015, puis une lettre de faits, le 18 décembre 2019.
Interrogée par les rapporteurs, la Commission européenne a précisé que les mesures étatiques visées par cette première procédure sont :
- le maintien en vigueur, à compter du 19 février 199926(*), de l'ensemble des mesures (lois, décrets et arrêtés préfectoraux) par lesquelles les autorités françaises ont attribué au groupe EDF, sans mise en concurrence, 189 concessions hydroélectriques27(*) antérieurement à cette date ;
- le maintien en vigueur, à compter du 19 février 1999, de l'ensemble des mesures (lois, décrets et arrêtés préfectoraux) par lesquelles les autorités françaises ont attribué au groupe EDF, sans mise en concurrence, 98 concessions hydroélectriques28(*) postérieurement à cette date ;
- l'absence de procédure de mise en concurrence pour 9 concessions hydroélectriques29(*) arrivées à échéance le 26 septembre 200830(*) et continuant d'exploitées, pour 8 d'entre elles, dans le cadre du régime dit « des délais glissants », mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie, ou d'un mandat d'exploitation.
Sollicité par les rapporteurs, le groupe EDF a indiqué contester cette mise en demeure à un double titre :
- d'une part, les concessions hydroélectriques du groupe ne sont pas susceptibles de conférer un avantage concurrentiel majeur car la production hydraulique ne représente qu'une part limitée de la production totale d'électricité et aucun avantage possible tiré de cette production hydraulique ne peut être répercuté dans les offres de détail ;
- d'une part, la concurrence s'est développée sur le marché de la fourniture d'électricité, alors que la production hydraulique est restée stable, ce qui démontre selon le groupe l'absence de lien entre la non-remise en concurrence des concessions hydroélectriques et la situation de ce marché.
De manière générale, le groupe a relevé que, de 2015 à 2019, la position de la Commission européenne n'a pas évolué en dépit des mutations du marché français et qu'elle n'a pas apporté de nouvel élément de nature à démontrer l'existence d'un abus effectif dans le cadre concessif.
De son côté, la DGEC a rappelé la contestation par le Gouvernement de cette mise en demeure, en ces termes : « Les autorités françaises ont toujours contesté ces mises en demeure. »
2. Une seconde mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne en 2019, sur le fondement de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, et des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
La seconde procédure, elle aussi pendante, engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, date de 2019. Il s'agit de la procédure n° 2018/2378 lancée par la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises (DG GROW). Elle concerne la méconnaissance supposée de l'article 49 du TFUE, qui prohibe les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, et de l'article 56, qui interdit les restrictions à la libre prestation de services. Elle porte également sur le non-respect allégué des articles 3, 30, 31 et 43 de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 ; ces articles concernent, respectivement, les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, les principes généraux de l'attribution des concessions, les avis de concessions et les modifications de contrats en cours. Dans ce contexte, une mise en demeure a été adressée à la France, le 7 mars 2019, de même qu'à 7 autres États membres sur des fondements proches : Autriche, Allemagne, Pologne, Portugal, Suède, Italie et Royaume-Uni.
Sollicitée par les rapporteurs, la Commission européenne a précisé que les mesures étatiques visées concernent :
- l'absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement en temps utile des concessions hydroélectriques arrivées à échéance ;
- la prolongation des concessions contre travaux, introduite à l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie, par la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015 (article 116) ;
- les décisions de renouvellement et d'octroi de concessions hydroélectriques prises en faveur d'EDF depuis le 26 septembre 202831(*),32(*) ;
- le renouvellement des concessions hydroélectriques sans mise en concurrence, en les attribuant directement aux concessionnaires historiques, opéré par le décret du 26 septembre 200833(*) (article 36).
Interrogé par les rapporteurs, le groupe EDF a relevé que la Commission européenne a procédé au classement, le 23 septembre 2021, des procédures engagées à l'encontre de plusieurs pays européens, à raison de la méconnaissance avancée de leur régime d'autorisation avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « Service ». De plus, le groupe a rappelé que la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé, dans son arrêt Eco-Wind, du 28 mai 2020, que les activités de production d'électricité ne constituent pas en tant que telles un service.
Quant à la DGEC, elle a ici aussi rappelé la contestation par le Gouvernement de cette mise en demeure, ainsi : « Les autorités françaises ont toujours contesté ces mises en demeure. »
3. De 2015 à 2023, des échanges n'ayant pas permis de clore les procédures engagées par la Commission européenne à l'encontre de la France
De 2015 à 2023, des échanges ont été conduits, sans succès, entre la Commission européenne et la France afin d'éteindre les deux procédures en cours en matière de concessions hydroélectriques.
Selon la DGEC, à la suite des mises en demeure de 2015 et de 2019, le Gouvernement a échangé avec la Commission européenne d'abord sur l'option de la constitution d'une quasi-régie puis sur celle d'un passage vers le régime d'autorisation. Cependant, aucun échange n'a eu lieu en 2024, à raison de l'instabilité politique. Ces échanges ont toutefois repris en 2025 au sujet de ce passage vers le régime d'autorisation, ainsi que des contreparties qu'il suppose pour être en conformité avec le droit de l'Union européenne.
Aussi la DGEC a-t-elle indiqué aux rapporteurs : « Les autorités françaises ont échangé fin 2023 avec les services de la Commission européenne à propos de la nouvelle option d'un passage sous un régime d'autorisation [...]. Ces échanges n'ont pas été conclusifs. Compte tenu du contexte politique et des travaux complémentaires menés par les autorités françaises, notamment auprès du Conseil d'État, les autorités françaises n'ont pas repris contact avec la Commission européenne en 2024. Les échanges avec la Commission européenne ont repris début 2025. Plus particulièrement, il a été proposé à la Commission une transformation du régime concessif en régime d'autorisation, tout en conservant les exploitants en place, ainsi que l'adoption de contreparties via la mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydrauliques. »
À l'évidence, le maintien des concessions hydroélectriques échues sous le régime dit « des délais glissants » ne constitue pas une solution pérenne.
Du point de vue national, c'est un régime qui ne permet pas de modifier les cahiers des charges des concessions échues, afin d'y réaliser de nouveaux investissements. C'est pourquoi la DGEC a rappelé : « Cet article dispose bien que la prorogation s'effectue aux conditions antérieures de telle sorte que les exploitants ne peuvent pas réaliser de nouveaux investissements (comme la création de station de transfert d'énergie par pompage) qui ne seraient pas prévus par leur cahier des charges ».
Du point de vue européen, c'est un régime qui ne permet pas de solder les procédures précitées, à commencer par celle engagée par la DG COMP en 2015. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a indiqué : « Pour ce qui concerne la procédure de la DGCOMP [...] en prorogeant les concessions arrivées à échéance au profit du seul concessionnel sortant, soit EDF dans la grande majorité des cas, ce régime contribue au maintien de la position dominante d'EDF sur l'hydroélectricité et donc à l'infraction aux articles 106 et 102 du TFUE ».
Pour autant, le risque d'astreinte pesant sur l'État en l'absence de résolution des procédures paraît à ce stade limité.
Tout d'abord, les autorités françaises ont toujours répondu aux sollicitations de la Commission européenne. Aussi la DGEC a-t-elle indiqué : « À date, les échanges entre la Commission se poursuivent [...]. Les autorités françaises se sont attachées à répondre aux différentes sollicitations et questions de la Commission à la suite des deux mises en demeure et n'ont pas dépassé le stade de la phase précontentieuse. Les pistes de solutions actuellement étudiées par les autorités françaises [...] et présentées à la Commission visent à éteindre le précontentieux en cours en vue d'un classement des mises en demeure par la Commission au regard de la mise en conformité de la France avec le droit européen. »
Plus encore, les autorités européennes n'ont pour l'heure pas saisi la CJUE. Ainsi la Commission européenne a-t-elle précisé : « S'agissant des astreintes, selon les dispositions de l'article 260 du TFUE, celles-ci ne peuvent être infligées que par la Cour de justice soit dans le cas où la Cour reconnaît qu'un État membre ne s'est pas conformé à un arrêt de manquement, soit dans le cas où la Cour constate qu'un État membre a manqué à son obligation de communiquer à la Commission des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative. »
Enfin, la Commission européenne et la France ont su, par le passé, aboutir sur d'autres dossiers en matière d'hydroélectricité :
- en 2011, la Commission européenne s'est désistée dans une affaire pendante devant la CJUE34(*), dans le cadre de l'infraction n° 2003/2237, à l'encontre du droit de préférence qui avait été codifié par un décret du 22 mars 199935(*) puis supprimé par un décret du 26 septembre 200836(*) ;
- en 2022, la Commission européenne a estimé que la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2041, de la concession du Rhône attribuée à la CNR, dans le cadre de la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône, dite « Aménagement du Rhône », ne soulevait pas de préoccupation quant à l'existence d'aides d'État.
Ainsi que l'a rappelé la CNR, la résolution en cours des concessions du groupe EDF n'appelle pas à faire évoluer sa concession du Rhône : « Quelles que soient les modalités de la réforme du secteur hydroélectrique actuellement envisagée par le législatif, CNR a pour priorité la complète réalisation de ces missions, laquelle suppose le maintien de la concession jusqu'à sa nouvelle échéance, fixée au 31 décembre 2041. [...] CNR a informé la Commission européenne de la mise en oeuvre de la loi du 28 février 2022 précitée et a des échanges réguliers avec elles dans le cadre de la mise en oeuvre de certains projets. Lors de ces échanges, la Commission européenne a pu exprimer une position favorable à des régimes adaptés en fonction des différentes situations en France. »
4. En 2021 et 2023, des échanges entre la Commission européenne et les autres pays européens ayant permis de clore les procédures initiées à leur encontre
En 2021 et 2023, les échanges conduits entre la Commission européenne et les autres pays européens ont permis d'éteindre les procédures les concernant en matière de concessions ou d'installations hydroélectriques.
Dans le cadre de la procédure n° 2018/2378 lancée par la DG GROW, 7 États membres avaient été visés, aux côtés de la France : l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni. Selon la DGEC, parmi ces pays, cinq appliquent le régime des autorisations, tandis que l'Italie et le Portugal bénéficient du régime des concessions.
Interrogée par les rapporteurs, la Commission européenne a confirmé que le différend avec la France était le seul pendant : « il n'existe plus actuellement de différends similaires dans le domaine de la gestion hydroélectrique. »
Tout d'abord, en 2021, elle a clos six procédures d'infraction à l'encontre de l'Autriche, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de la Suède et du Royaume-Uni, pour des raisons d'opportunité, constatant en effet l'absence d'intérêt économique des opérateurs. C'est pourquoi elle a précisé que « cette décision, motivée par des raisons d'opportunité, ne constitue pas une validation de la conformité de ces régimes au droit de l'Union européenne. La Commission européenne s'était limitée à constater, à l'époque, une absence d'intérêt économique des opérateurs pour participer à une mise en concurrence des autorisations existantes. »
Plus encore, en 2023, elle a également clos la procédure d'infraction à l'encontre du Portugal, dans la mesure où le Portugal a modifié son décret-loi n° 22A/2007 qui autorisait le renouvellement de gré à gré des concessions hydroélectriques. C'est la raison pour laquelle elle a spécifié que « s'agissant du Portugal, la Commission européenne reprochait à cet État membre d'autoriser des concessions hydroélectriques sans mise en concurrence, en méconnaissance des directives 2014/23/UE et 2006/123/CE. L'article 35, paragraphe 2, du décret-loi n° 226-A/2007 permettait en effet une telle modification sur la seule base d'un accord entre les pouvoirs adjudicateurs et les concessionnaires. À la suite de la révision de ce texte en 2023, la procédure d'infraction a été clôturée. »
Sollicitée par les rapporteurs, la DGEC a également relevé que le différend entre la Commission européenne et la France était le seul encore ouvert : « Ainsi, la France est dorénavant le seul pays mis en demeure à propos de l'hydroélectricité, les autres mises en demeure ayant été classées, soit avec l'engagement des États membres de se mettre en conformité, soit parce que les régimes d'autorisation préexistants ne n'y prêtaient pas. »
Revenant sur le classement de la procédure à l'encontre de l'Italie et du Portugal, elle a rappelé que ces pays ont procédé à la révision du régime juridique applicable à leurs concessions hydroélectriques : « L'Italie et le Portugal, exploitant sous le régime de la concession, se sont engagés à procéder à la mise en concurrence de leurs concessions [...] Si ces deux pays ont adapté leur cadre législatif aux exigences du droit européen, aucune concession d'énergie hydraulique de taille significative ne semble avoir fait l'objet d'un renouvellement avec mise en concurrence. »
De plus, elle a observé que le classement de la procédure à l'encontre de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Pologne et de la Suède n'a pas nécessité la révision du régime juridique afférent à leurs installations hydroélectriques : « L'Allemagne, l'Autriche, la Pologne et la Suède exploitant sous le régime de l'autorisation ont quant à elles obtenu le classement de la mise en demeure de la Commission [...] sans avoir à modifier leur cadre juridique national en matière d'exploitation de l'énergie hydraulique. Il semblerait que la Commission ait considéré l'enjeu de mise en concurrence négligeable en raison de la barrière à l'entrée que représente le régime d'autorisation (rachat des infrastructures hydrauliques et essentiel du potentiel hydraulique européen déjà exploité) [...] Il est également possible que l'arrêt de la CJUE qui réaffirme que l'électricité est une marchandise et non un service (CJUE, 28 mai 2020, Eco-Wind, aff. C727/17 [...]) et qu'elle n'est donc pas soumise à la directive services, ait pu jouer dans les clôtures des mises en demeure. »
II. SI LES SOLUTIONS LÉGISLATIVES ENVISAGÉES PAR LE PASSÉ N'ONT PAS PERMIS DE RÉSOUDRE LE DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT, UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS APPARAÎT AUJOURD'HUI COMME UN COMPROMIS À PORTÉE DE MAINS
A. LES SOLUTIONS ISSUES DE LA LOI DITE « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE », DU 15 AOÛT 2015, SE SONT RÉVÉLÉES INOPÉRANTES POUR RÉSOUDRE LE DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT
1. Un consensus de l'État, autorité concédante, et du groupe EDF, concessionnaire, sur l'échec des solutions législatives issues de la loi dite « Transition énergétique », du 15 août 2015
Depuis la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015 (article 116), plusieurs solutions législatives ont été proposées sans succès pour remédier au différend entre Commission européenne et l'État s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF.
L'État, autorité concédante, et le groupe EDF, concessionnaire, partagent le même point de vue sur leur insuffisance.
D'une part, la DGEC a relevé que ces solutions ne répondent ni à la difficulté juridique avancée de la position dominante du groupe EDF ni à la nécessité économique avérée de relance des investissements de la filière hydroélectrique. C'est pourquoi elle a indiqué : « Les dispositions actuellement prévues par le droit français ne permettent pas de répondre aux précontentieux ni aux enjeux de développement de l'hydroélectricité. Tout d'abord, l'ensemble des mesures [...] ne répondent pas aux griefs de la Commission européenne s'agissant de la position dominante d'EDF sur le marché électricité. Outre ces considérations concurrentielles, les dispositions précitées ne permettent pas de relancer les investissements au sein des concessions, qui ne pourraient être entrepris quasi-exclusivement que lors du renouvellement des titres d'exploitation. »
D'autre part, le groupe EDF a rappelé que ces solutions ont même pu être sources de contentieux. C'est la raison pour laquelle il a affirmé : « Les solutions législatives existantes [...] ne suffisant pas à résoudre le contentieux avec la Commission européenne ; certaines ont même alimenté le différend. »
2. Le regroupement de concessions : un regroupement des concessions de Coindre-Marèges et de Saint-Pierre-Marèges de la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) annulé par le Conseil d'État en 2022
Les articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie ont proposé un regroupement des concessions hydroélectriques. En effet, ils permettent de fixer une date d'échéance commune aux concessions hydroélectriques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, selon la méthode dite « des barycentres », que ces concessions soient détenues par un concessionnaire commun ou par plusieurs concessionnaires distincts.
Le groupe Engie a demandé à bénéficier d'un regroupement des concessions de la Shem sur la Dordogne - de Coindre-Marèges et Saint-Pierre-Marèges. Cependant, un arrêt du Conseil d'État, du 12 avril 202237(*), a annulé le décret du 20 mars 2019 38(*)permettant ce regroupement.
Interrogé par les rapporteurs, le groupe Engie a rappelé l'intérêt du dispositif de regroupement de concessions pour certaines concessions détenues par la Shem : « À défaut d'être applicable à toutes les concessions, le regroupement de concessions selon la méthode dite des barycentres est un mécanisme acceptable pour la Commission européenne et qui dispose d'une base juridique solide en droit français. Il n'est cependant pas en mesure, à lui seul de régler la situation. Cette méthode peut trouver son application immédiate pour les concessions hydrauliquement liées de Marèges et Saint-Pierre-Marèges. »
Cependant, le groupe EDF a souligné l'insuffisance de ce dispositif de regroupement de concessions, qui ne permet que de reculer l'échéance de la remise en concurrence de la concession ainsi regroupée, sans véritablement permettre de nouveaux investissements : « Cette disposition ne constitue pas une solution pérenne puisqu'elle ne permet pas de reculer l'échéance de fin de concession et donc de mise en concurrence, recul qui peut, selon les situations, être assez bref. De surcroît, elle ne permettrait pas de relancer le développement, puisque des investissements importants à ce titre constitueraient des modifications substantielles des concessions qui ne sont pas autorisées par la directive Concession ».
La DGEC a dressé un constat similaire, en ces termes : « Cet article ne facilite toutefois que la fin des concessions actuelles et ne traite pas la question de l'octroi de la future concession, qui portera donc sur un périmètre étendu. Or c'est bien lors de l'octroi du nouveau contrat de concessions que les investissements nécessaires pourront être entrepris. »
Enfin, la CNR a fait observer que le dispositif de regroupement de concessions ne pourrait pas répondre à tous les cas de figure : « Ce dispositif ne trouverait pas à s'appliquer aux ouvrages hydroélectriques isolés. »
3. La prolongation de concessions contre travaux : une prolongation de la concession de la Truyère contre travaux du groupe EDF refusée par la Commission européenne en 2018
L'article L. 521-16-3 du code de l'énergie a prévu une prolongation contre travaux des concessions hydroélectriques. En effet, il permet de prolonger les concessions hydroélectriques, sans mise en concurrence, en contrepartie de la réalisation d'un programme de travaux par leurs concessionnaires, afin d'atteindre les objectifs énergétiques nationaux, prévus aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code.
Le groupe EDF a demandé à bénéficier d'une prolongation contre travaux pour la concession de la vallée de la Truyère, proposant d'ailleurs la construction d'une STEP de 500 MW. Cependant, la Commission européenne a refusé la prolongation de cette concession, dans une lettre du 12 juillet 2018, puis a constaté la non-conformité du dispositif de prolongation en tant que tel avec la directive dite « Concession », du 26 février 2014, dans sa mise en demeure du 7 mars 2019.
Sollicitée par les rapporteurs, le groupe EDF a rappelé le refus du projet et du dispositif par la Commission européenne : « La Commission européenne a pourtant considéré en 2018 que le projet n'était pas compatible avec l'article 43, paragraphe 1, b) (travaux devenus nécessaires) de la directive Concession. Elle a par ailleurs estimé, dans le cadre de la mise en demeure de 2019, que l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie n'était pas conforme à ces dispositions de la directive Concession. Bien que l'État et EDF contestent cette analyse, cette circonstance démontre que la prolongation des concessions en contrepartie d'investissements ne permet pas de répondre à toutes les difficultés soulevées par le contentieux opposant la Commission à l'État. »
De son côté, la DGEC a brossé un constat proche : « La prolongation contre travaux, définie à l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie, pourrait débloquer des investissements, mais la Commission européenne considère cette disposition française comme contraire au droit européen, car elle ouvrirait des modalités de modification de contrats de concession qui ne sont pas prévues par la directive européenne sur les concessions [...]. Par conséquent, l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie relatif à la prolongation contre travaux n'a jamais été mis en oeuvre. »
Dans sa réponse aux rapporteurs, la Commission européenne a rappelé l'incompatibilité du dispositif de prolongation contre travaux avec la directive dite « Concession », du 26 février 2014 : « L'article L. 521-16-3 du code de l'énergie (adopté par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte) [...] crée une possibilité de modification des contrats de concession qui n'est pas prévue par la directive 2014/23/UE (par exemple une prolongation significative de la durée de la concession, introduite après l'attribution initiale, sans nouvelle mise en concurrence). »
4. La constitution d'une quasi-régie : un placement des concessions hydroélectriques du groupe EDF dans une quasi-régie dans le cadre du projet « Hercule » abandonné en 2021
On distingue traditionnellement deux modes de gestion d'un service public :
- la régie, par laquelle l'État ou une collectivité territoriale exercent eux-mêmes ce service public ;
- la concession, par laquelle l'État ou une collectivité territoriale (le concédant) confient par contrat à un tiers (le concessionnaire) la réalisation de ce service public.
La quasi-régie est issue du doit de l'Union européenne :
- elle a d'abord été reconnue par la jurisprudence de la CJUE, dans l'arrêt Teckal, du 18 novembre 199939(*) ;
- par la suite, elle a été intégrée à la directive dite « Concession », du 26 février 2014 (paragraphe 3 de l'article 17).
L'article L. 3211-1 du code de la commande publique dispose ainsi que l'autorité concédante peut attribuer un contrat de concession à une quasi-régie sans mise en concurrence, lorsque trois conditions sont réunies :
- le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
- la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
- la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à son capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Interrogée par les rapporteurs, la DGEC a rappelé que l'intérêt du recours à la quasi-régie pour la gestion des activités hydroélectricité réside dans la possibilité d'octroyer des contrats de concession de gré à gré, mais aussi d'adapter facilement les cahiers des charges aux imprévus, notamment pour tenir compte de l'impact du changement climatique.
Plus précisément, la DGEC a rappelé que le schéma présenté à la Commission européenne, dans le cadre du projet de réorganisation du groupe EDF, dit « Hercule », était de placer les activités de groupe dans une filiale, dit « EDF Bleu », détenue à 100 % par ce groupe :
- d'une part, la filiale aurait été placée dans une relation de quasi-régie vis-à-vis de l'État, ce qui aurait permis de passer des contrats de concession sans procédure de publicité ni de mise en concurrence ;
- d'une part, la filiale aurait été placée dans une relation d'entreprise liée40(*) vis-à-vis du groupe, ce qui aurait permis ici aussi de réaliser des prestations au profit du groupe en dérogeant aux mêmes procédures.
Cependant, la DGEC a rappelé les difficultés juridiques posées par la constitution d'une quasi-régie, en ces termes : « Lors des échanges avec la Commission dans le cadre du dossier Hercule, les services de la DG-COMP ont pu considérer que ce schéma pouvait être mis en oeuvre, sous réserve que les autorités françaises (i) préservent l'indépendance stricte de la filiale Hydro vis-à-vis d'EDF (ce qui excluait donc en pratique la possibilité d'un contrôle analogue d'EDF sur ladite filiale) et (ii) que cette entité n'opère pas nécessairement toutes les concessions pour lesquelles EDF est concessionnaire. Toutefois, les services de la DG-GROW ont, quant à eux, considéré qu'au regard des règles de la commande publique, pour que la relation de quasi-régie puisse être effective, il était nécessaire qu'un contrôle analogue d'EDF sur sa filiale soit caractérisé. Ils ont par ailleurs soulevé le fait que l'exception d'entreprise liée ne pouvait a priori se combiner avec le bénéfice de l'exceptionquasi-régie ».
Dans le même ordre d'idées, le groupe EDF a indiqué les difficultés organisationnelles soulevées par la constitution d'une quasi-régie, ainsi : « Quant à la quasi-régie, le passage en quasi-régie des concessions d'EDF a fait l'objet de discussions avec la Commission. Si celle-ci ne pouvait s'opposer à la création d'une quasi-régie (qui permet d'échapper à l'obligation de mise en concurrence, au titre d'une exception prévue par la directive Concession elle-même), elle l'accompagnait d'exigences inacceptables quant à l'organisation d'EDF, exigences revenant à un démantèlement. Cette option n'aurait de surcroît pu régler que la question des concessions d'EDF et non la situation des autres concessions hydroélectriques puisque la quasi-régie impose la détention de 100 % par l'État. »
Les concurrents du groupe EDF ont relevé des difficultés du même ordre les concernant dans le cas de la constitution d'une quasi-régie. Tout d'abord, le groupe Engie a estimé que « la quasi-régie conduit à la disparition de la Shem, ce qui est totalement inacceptable et paradoxal. » Dans le même esprit, la CNR a précisé que « compte tenu des spécificités de la CNR, notamment s'agissant de la structure de son actionnariat, la mise en oeuvre de l'exception de la quasi-régie ne serait pas applicable. » Pour ce qui concerne l'Afieg, elle a indiqué que « les analyses convergent pour souligner que cette option ne serait pas adaptée à tous les concessionnaires actuels. » Enfin, France Hydroélectricité a précisé que « cette solution ne pouvant s'appliquer aux petites concessions que nous représentons, elle ne nous apparaît pas comme pertinente. »
L'ensemble des syndicats membres de l'Intersyndicale du groupe EDF ont souligné les difficultés induites par la constitution d'une quasi-régie. Ainsi, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a rappelé que « le contrat de quasi-régie impose la filialisation d'EDF Hydro, renvoyant au projet Hercule et à un rejet fort du corps social. Une filiale hydro serait exposée à des risques économiques liés aux changements climatiques et à des complications de mobilité inter-filiales et entre la maison mère et la filiale. La pérennité de la direction technique générale (DTG), qui travaille en grande partie pour le parc nucléaire, serait également en question. » De plus, la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) a indiqué que « la CFE Énergies a en effet réaffirmé [...] son opposition au schéma de quasi-régie. Outre que ce schéma, qui était une composante centrale du projet Hercule, conduit à la désintégration de fait du groupe EDF, la quasi-régie engendrerait une catastrophique désoptimisation des liens structurels entre parc nucléaire et parc hydroélectrique. Elle n'apporte enfin aucune réponse aux spécificités des opérateurs historiques que sont la CNR et la Shem. ». Un constat proche a été exprimé par la Fédération nationale énergie mines - Confédération générale des travailleurs (FNEM-CGT), en ces termes : « Nous sommes opposés à la quasi-régie, qui obligerait à la filialisation de la banche hydraulique pour EDF avec des destructions d'emplois dans les structures transverses aujourd'hui compétentes pour la sûreté des ouvrages. Ce modèle reviendrait aux propositions du projet Hercule qui visait à dissocier le parc de production hydraulique du reste de la production électrique, ceci en faisant fi des liens techniques, de sûreté et de sécurité du système. » Un autre constat similaire a été brossé par la Fédération nationale énergie mines - Force Ouvrière (FNEM-FO) ainsi : « Pour FO Energie, la quasi-régie entraîne quasi de facto la séparation de l'hydraulique de la maison mère EDF SA. Par ailleurs, sans écriture précise dans la loi, elle ne protège pas de l'éclatement même de l'hydro. »
Enfin, plusieurs associations d'élus locaux concernées ont également rappelé les difficultés posées par la constitution d'une quasi-régie. D'une part, DF a estimé que « cette solution, qui présente des garanties juridiques, a été envisagée par le gouvernement français, au cours de la période 2019-2021. Elle induisait cependant une déconsolidation de la composante hydroélectrique du groupe EDF. Cette déconsolidation au plan opérationnel posait plusieurs difficultés à EDF, attaché au maintien d'une consolidation [...] pour des raisons organisationnelles, commerciales et managériales. Par ailleurs, certains acteurs de la filière hydraulique sont opposés à cette solution de quasi-régie, estimant qu'elle ne devrait concerner que les concessions d'EDF. En effet, cette solution imposerait le rachat des concessions non échues. » D'autre part, l'ANEM a indiqué qu'elle « n'a pas étudié l'ensemble de ces solutions. Pour autant, il apparaît que la proposition de la quasi-régie est largement rejetée par les autres exploitants, comme par les représentants des personnels. »
5. La constitution de sociétés d'économie mixte hydroélectriques (Semh) : une option toujours ouverte impliquant cependant la mise en concurrence des concessions hydroélectriques
L'article L. 521-18 du code de l'énergie a autorisé la constitution de sociétés d'économie mixte hydroélectriques (Semh). En effet, il permet de constituer une société, pour une durée limitée, pour la conclusion et l'exécution d'une concession hydroélectrique ; cette société réunit, autour d'un opérateur économique, des actionnaires formés par les collectivités territoriales riveraines et leurs groupements, voire des personnes morales de droit public et leurs établissements ou leurs entreprises.
Si ce dispositif des Semh n'a soulevé aucune difficulté ni devant le Conseil d'État ni devant la Commission européenne, son intérêt reste cependant limité.
Interrogé par les rapporteurs, le groupe EDF a rappelé que le dispositif des Semh implique une mise en concurrence des concessions hydroélectriques : « Le dispositif des Semh, également introduit par la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, implique la mise en concurrence des concessions lors de leur renouvellement, ce qui n'est pas la volonté d'EDF ».
Sollicité par les rapporteurs, la CNR a également relevé l'application des règles de mise en concurrence dans le cadre de ce dispositif des Semh : « La sélection de l'actionnaire opérateur économique de la Semh est effectuée à travers une procédure de mise en concurrence respectant les mêmes règles et critères que la procédure prévue pour la sélection d'un concessionnaire hydroélectrique ».
Pour ce qui la concerne, la DGEC a fait part d'une position convergente, ainsi : « La création de Semh permet d'associer les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou personnes morales de droit public au capital des sociétés concessionnaires d'une chute hydraulique. Cette possibilité a été introduite par la loi pour accompagner la procédure de sélection par mise en concurrence de l'opérateur économique industriel, qui sera l'actionnaire majoritaire de la société concessionnaire. »
Autre point, l'Afieg a indiqué que l'application concrète du dispositif des Semh dépend en réalité de l'implication effective des collectivités territoriales : « La mise en place d'une Semh dépend bien entendu de l'appétence des collectivités concernées. Plusieurs d'entre elles ont manifesté leur intérêt comme par exemple : le Conseil départemental de la Savoie [ou] la communauté de communes de la vallée du Louron (Pyrénées). »
Enfin, France Hydroélectricité a fait observer que le dispositif des Semh ne s'appliquerait pas à toutes les situations : « Quant aux Semh, elles paraissent essentiellement s'adresser à des partenaires de droit public, ce qui laisserait de côté tous les concessionnaires de droit privé. »
B. LES ACTEURS ÉCONOMIQUES, INSTITUTIONNELS ET POLITIQUES ONT DES POSITIONS TRÈS DIVERSES SUR LA RÉSOLUTION DU DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT, QUI FONT TOUTEFOIS APPARAÎTRE UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS COMME UN COMPROMIS À PORTÉE DE MAINS
1. Des acteurs économiques aux positions plutôt divergentes sur l'organisation du marché français de l'hydroélectricité
Les acteurs économiques ont des positions plutôt divergentes sur l'organisation du marché français de l'hydroélectricité ; si la plupart d'entre eux soutiennent un changement de régime des concessions vers les autorisations (le groupe EDF, le groupe Engie, la CNR, la Shem, France Hydroélectricité), d'autres plaident pour un renouvellement de ces concessions par appels d'offres (Afieg, Anode).
a) Le point de vue du groupe EDF : une préférence pour un changement de régime des concessions vers les autorisations et une révision de la directive dite « Concession », du 26 février 2014
Le groupe EDF a fait part de son intérêt pour un changement de régime des concessions vers les autorisations, en ces termes : « Le changement de régime vers un système d'autorisation rencontre la préférence d'EDF pour mettre un terme de manière claire et définitive aux questions soulevées par la gestion des ouvrages hydroélectriques et le renouvellement des contrats de concession. »
À court terme, il plaide donc pour instituer un nouveau régime d'autorisation pour les ouvrages hydroélectriques. Le champ de ce nouveau régime pourrait concerner l'ensemble des concessionnaires relevant de la loi du 19 octobre 1929 relative à l'énergie hydraulique, que leurs concessions soient échues ou non.
Pour sa mise en oeuvre, ce régime requerrait plusieurs étapes :
- la résiliation des concessions en vigueur et le versement d'une indemnité par l'État selon les modalités définies par la loi et non les contrats ;
- le transfert encadré de la propriété des ouvrages, avec le déclassement du domaine public, le paiement d'un prix de cession par le concessionnaire déterminé par une commission indépendante, l'impossibilité de cession par lui des ouvrages transférés sauf accord de l'État et le maintien du statut national des personnels des IEG sur ces ouvrages transférés.
- l'institution d'un régime d'autorisation pour les ouvrages hydrauliques de plus de 4,5 MW, en maintenant les compétences actuelles du ministre de l'énergie et des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;
- l'introduction d'une redevance du même type que celle applicable au régime dit « des délais glissants », prévue à l'article L. 523-3 du code de l'énergie, c'est-à-dire assise sur le revenu net plutôt que sur le chiffre d'affaires.
Pour mettre fin aux mises en demeure européennes, le groupe EDF a indiqué être disposé à ce que ce changement de régime soit assorti d'une contrepartie, ainsi : « En passant en régime d'autorisation, la mise en demeure de 2019 deviendrait sans fondement, mais celle de 2015 ne serait pas résolue. C'est pour cette raison que, pour mettre fin à plus de dix ans de contentieux et ainsi permettre la relance de l'hydroélectricité indispensable pour l'équilibre du système électrique, des mesures pourraient être nécessaires. EDF serait évidemment prête à les envisager compte tenu de l'enjeu dès lors que ces contreparties sont acceptables, raisonnables et limitées dans le temps. »
Cette contrepartie pourrait consister à mettre à disposition une partie raisonnable et temporaire de la production d'hydroélectricité du groupe aux autres fournisseurs et/ou aux industriels.
Cependant, plusieurs lignes rouges seraient fixées :
- le maintien de l'outil industriel et de la gestion opérationnelle par le groupe ;
- la limitation de la contrepartie à la seule commercialisation de la production d'hydroélectricité, avec un volume raisonnable et une durée limitée ;
- le refus de l'application d'un dispositif semblable à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) aux activités hydroélectriques, dont le prix ne couvre pas les coûts de production du groupe et dont l'option s'exerce par les fournisseurs alternatifs en bénéficiant.
À plus long terme, le groupe EDF appelle à l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. Pour lui, l'obligation de remise en concurrence des concessions n'est pas souhaitable et les conditions de modification des contrats en cours sont trop restrictives. Cependant, le groupe est conscient du fait qu'une telle réforme ne pourrait intervenir que selon un calendrier éloigné et qu'elle supposerait, de surcroît, le soutien d'autres pays européens dont les procédures en matière de concessions ou d'installations hydroélectriques sont aujourd'hui closes.
b) Le point de vue des concurrents du groupe EDF : des positions hétérogènes allant de l'accompagnement du changement de régime des concessions vers les autorisations à son refus au profit d'un renouvellement des concessions par appels d'offres
Certains concurrents du groupe EDF se sont montrés favorables au changement de régime des concessions vers les autorisations, tout en rappelant plusieurs garde-fous :
- tout d'abord, la CNR a rappelé que la quasi-régie ne peut lui être appliquée, a plaidé pour une exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, et a demandé à ce qu'un changement de régime laisse inchangée la concession du Rhône, jusqu'à son expiration le 31 décembre 2041 :
- plus encore, la groupe Engie a réitéré son opposition à la quasi-régie41(*), fait part de réserves sur l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive précitée et a indiqué ne pas être opposé à un changement de régime sous conditions : l'exclusion de la concession de la CNR, qui vient d'être renouvelée, une vigilance sur la situation de la Shem, rare acteur alternatif dont la taille demeure modeste, l'absence de distinction entre les concessions échues et celles non échues et l'institution d'une contrepartie sur les seules concessions du groupe EDF ;
- enfin, France Hydroélectricité a réaffirmé son opposition à la quasi-régie, a plaidé pour une exclusion de l'hydroélectricité de la directive susmentionnée et a précisé être favorable à un changement de régime ici aussi sous conditions : l'absence de distinction entre les concessions échues et celles non échues, l'introduction d'une clause d'incessibilité des ouvrages transférés et la préservation de la compétence du ministre de l'énergie.
D'autres concurrents du groupe EDF ont plaidé pour un renouvellement des concessions du groupe par appels d'offres, faisant part de critiques ou de demandes s'agissant d'un éventuel changement de régime des concessions vers les autorisations :
- d'une part, l'Afieg a identifié le renouvellement des concessions par appels d'offres comme la solution la plus simple, la plus solide et la plus optimale. Elle a estimé que le changement de régime des concessions vers les autorisations soulève de nombreuses incertitudes juridiques, notamment au regard de la position dominante, des aides d'État, de la directive dite « Concession » du 26 février 2014, de la directive dite « Service » du 12 décembre 2006, ou encore du préambule de la Constitution de 1946. Enfin, elle a insisté sur l'importance d'une compensation en cas d'un tel changement de régime, via une régulation tarifaire ou un accès virtuel ;
- d'autre part, l'Anode a identifié le renouvellement des concessions par appels d'offres comme la solution la plus transparente, la plus efficace et la plus équilibrée. Elle a indiqué qu'un changement de régime des concessions vers les autorisations ne doit pas favoriser exclusivement les concessions du groupe EDF. Elle a également insisté sur l'importance d'une compensation en cas d'un tel changement de régime, via une régulation tarifaire ou un contrat pour différence.
2. Des acteurs syndicaux et locaux aux positions plutôt convergentes sur l'organisation du marché français de l'hydroélectricité
Les acteurs syndicaux et locaux ont des positions plutôt convergentes sur l'organisation du marché français de l'hydroélectricité ; sept de ces acteurs sont intéressés par un changement de régime des concessions vers les autorisations (CFDT, CFE-CGC, FNEM-CGT, FNEM-FO, DF, ANEB, ANEM) et cinq par une révision de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 (CFDT, FO-FNEM, DF, ANEB, ANEM).
a) Le point de vue des syndicats : un très large soutien au changement de régime des concessions vers les autorisations sous réserve de conditions liées à la propriété des ouvrages, au statut des personnels ou à la soutenabilité des contreparties
L'ensemble des syndicats de personnels membres de l'Intersyndicale du groupe EDF se sont dits favorables au changement de régime des concessions vers les autorisations, tout en proposant des conditions sur la propriété des ouvrages, le statut des personnels et à la soutenabilité des contreparties :
- la CFDT a identifié le changement de régime des concessions vers les autorisations comme seule solution mobilisable, en insistant sur la nécessité pour l'État de conserver des prérogatives sur les ouvrages transférés, via soit une quasi-domanialité publique, soit une action spécifique. Elle a également indiqué être favorable à la constitution d'un EPIC et à l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, tout en rappelant l'absence de soutien européen. Enfin, elle a indiqué être opposée à la mise en concurrence des concessions, à la constitution d'une quasi-régie et à la création d'un service d'intérêt économique général (SIEG)42(*) ;
- la CFE-CGC a également identifié le changement de régime des concessions vers les autorisations comme seule solution mobilisable, en précisant que ce régime est relativement répandu à l'échelon européen et qu'il ne saurait être conditionné pour la France à des mesures compensatoires excessives, de type Arenh hydraulique. Elle a également indiqué être favorable à l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. Enfin, elle a affirmé être opposée à la mise en concurrence des concessions et à la constitution d'une quasi-régie ;
- la FNME-CGT a fait part de son intérêt pour le changement de régime des concessions vers les autorisations, dès lors qu'il est assorti de conditions, telles que l'incessibilité des ouvrages transférés, la majorité publique des opérateurs exploitants, le maintien du statut national des IEG et le traitement identique du « Lac France ». Elle a également précisé être favorable à la création d'un SIEG. Enfin, elle a affirmé être opposée à la mise en concurrence des concessions et à l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive, dite « Concession », du 26 février 201443(*) ;
- enfin, la FNEM-FO a aussi fait part de son intérêt pour le changement de régime des concessions vers les autorisations, là encore sous réserves de conditions, comme l'incessibilité des ouvrages transférés, le maintien du statut national des IEG, et le refus de mesures compensatoires excessives, de type Arenh hydraulique. Elle a également indiqué être favorable à la constitution d'un EPIC et à l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. Enfin, elle a indiqué être opposée à la mise en concurrence des concessions et à la constitution d'une quasi-régie.
Quant à Solidaires Énergie (SUD Énergie), qui n'appartient pas à l'Intersyndicale du groupe EDF, le syndicat a affirmé être favorable à la création d'un EPIC et à la constitution d'une quasi-régie, mais non à la mise en concurrence des concessions, à leur changement de régime vers les autorisations ou encore à l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 201444(*).
b) Le point de vue des élus locaux : un très large soutien au changement de régime des concessions vers les autorisations sous réserve de conditions liées aux redevances ou aux instances locales
L'ensemble des associations d'élus locaux concernés ont indiqué soutenir le changement de régime des concessions vers les autorisations, tout en suggérant des conditions sur les redevances ou les instances locales :
- en premier lieu, DF a rappelé être opposée à la mise en concurrence des concessions hydrauliques ainsi qu'à la constitution d'une quasi-régie. En revanche, elle a précisé être favorable au changement de régime des concessions vers les autorisations sous conditions, comme l'application d'une quasi-domanialité publique, l'introduction d'une gouvernance tripartite de l'eau État-hydroélectricien-collectivités territoriales pour la rédaction et l'exécution des cahiers des charges ou encore la préservation des redevances de ces dernières sur le modèle de celles applicables aux concessions nouvelles ou renouvelées, mentionnées à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, c'est-à-dire allouées pour 1/3 aux départements, 1/12e aux communes et 1/12e à leurs groupements, sans prise en compte d'un prix cible de l'électricité. Au-delà, elle a aussi précisé soutenir l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 ;
- en second lieu, l'ANEM a réaffirmé être opposée à la mise en concurrence des concessions hydroélectriques de même qu'à la constitution d'une quasi-régie. À l'inverse, elle a indiqué soutenir le changement de régime des concessions vers les autorisations sous conditions, telles que l'exclusion de la concession de la CNR, l'institution d'une contrepartie sur les concessions du groupe EDF, le renforcement de la gouvernance locale de l'eau ou la préservation des redevances des collectivités territoriales, selon le même schéma que celui exposé par DF. De surcroît, elle a affirmé appuyer l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 ;
- enfin, l'ANEB a réitéré son opposition à la mise en concurrence des concessions hydroélectriques et son soutien au changement de régime des concessions vers les autorisations sous conditions, dont l'institution d'une gouvernance locale de l'eau de l'eau, selon des modalités similaires à celles proposées par DF, de même que l'inscription, dans les cahiers des charges des concessions, de la gestion équilibrée de la ressource en eau, de la répartition partagée des coûts et des impacts des aménagements, et de la prise en compte du rôle d'écrêtement des crues, indispensable à la prévention des inondations et à la protection des personnes, dans le contexte du changement climatique.
3. Des acteurs institutionnels nationaux et européens ayant convenu d'un accord de principe sur la réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF
a) Le point de vue des institutions nationales : une préparation bien avancée du changement du régime des concessions vers les autorisations, mais une perspective toujours incertaine de révision de la directive dite « Concession », du 26 février 2014
La DGEC a confirmé l'engagement de l'État en direction d'un changement du régime des concessions vers les autorisations, en ces termes : « Les autorités françaises envisagent la transformation du régime concessif en régime d'autorisation, tout en conservant les exploitants en place, mais en proposant d'autres modalités d'accès à la ressource de production-vente d'électricité. »
Elle a rappelé qu'un tel régime d'autorisation n'a rien d'inédit. D'une part, en France, outre la petite hydroélectricité, de nombreuses centrales de production d'électricité (nucléaire, thermique, éolien ou photovoltaïque) relèvent d'un régime d'autorisation. D'autre part, à l'échelon européen, plusieurs pays (Allemagne, Autriche, Pologne, Royaume-Uni, Roumanie, Suède) exploitent l'énergie hydraulique sous un régime d'autorisation.
Elle a identifié les étapes suivantes afin de réaliser ce passage du régime des concessions vers celui des autorisations :
- la résiliation de l'ensemble des contrats de concession, en cours ou échus, et le calcul par des experts indépendants de l'indemnité de résiliation à verser par l'État aux anciens concessionnaires, sauf pour les concessions qui viennent d'être renouvelées (CNR45(*)), dont la navigation fluviale est l'activité principale et la production hydroélectrique celle accessoire (Seine, Moselle), ou qui sont régies par des accords internationaux (Rhin, Doubs, l'Arve, Émosson) ;
- le déclassement législatif des biens hydroélectriques du domaine public de l'État ;
- la cession de gré à gré des ouvrages avec un droit de priorité des anciens concessionnaires46(*) et le calcul par des experts indépendants du prix de cession à verser par ces anciens concessionnaires à l'État47(*), l'État devant disposer de garanties, tel qu'un droit d'opposition sur les futures cessions par les nouveaux propriétaires ;
- la conception d'un nouveau régime d'autorisation spécifique48(*) pour les installations hydroélectriques supérieures à 4,5 MW et l'octroi d'une telle autorisation aux nouveaux propriétaires, la répartition actuelle des compétences entre le ministre chargé de l'énergie49(*), les directions départementales des territoires (DDT)50(*) et les DREAL étant inchangée et des moyens de contrôle de ces nouveaux propriétaires étant reconnus à l'État (transmission d'un rapport, déclarations d'utilité publique, sanctions en cas de manquement) ;
- la perception d'une soulte51(*) l'année du changement de régime des concessions vers les autorisations et d'une redevance annuelle à compter de cette année, une instance de dialogue avec les élus locaux et les parties prenantes étant prévue ;
- l'ouverture aux autres acteurs de marché d'une part virtuelle des capacités de production hydroélectrique à travers un dispositif de marché et un processus d'enchères, contrôlés par la CRE, l'exploitation opérationnelle des installations hydrauliques étant strictement indépendante de ces livraisons de produits de marché, c'est-à-dire que l'exploitant est le seul décisionnaire de la production électrique et de la gestion de l'eau.
La DGEC a rappelé que le changement de régime des concessions vers les autorisations permettrait de préserver les installations et de développer les investissements dans le secteur de l'hydroélectrité : « En permettant aux exploitants actuels, notamment au groupe EDF, de devenir propriétaires des ouvrages hydrauliques, cette option permet de conserver un haut niveau d'intégration d'EDF et ainsi de développer les capacités de financement des acteurs industriels en vue de réinvestissements ou d'investissements à l'étranger. »
Elle a confirmé que ce changement de régime laisse inchangée la concession du Rhône allouée à la CNR, a minima jusqu'à son échéance le 31 décembre 2041 : « Il n'est pas prévu que la concession de la CNR, prolongée jusqu'en 2041, selon des dispositions législatives spécifiques, soit concernée avant cette échéance par une bascule vers un régime d'autorisation. Il s'agit en effet d'une concession d'aménagement du Rhône dotée d'un statut spécial conféré par la loi de 1921 confiant à la CNR [...] la mission d'aménagement et d'exploitation du Rhône de la frontière suisse à la mer au triple point de vue de la production d'électricité, la navigation fluviale et l'irrigation agricole. [...] Dans la perspective de l'après 2041, il conviendra d'étudier le régime juridique le plus adapté aux enjeux de la gestion du fleuve Rhône et de l'exécution des missions de service public non énergétiques (navigation, gestion des ports et de la ressource en eau, soutien à l'irrigation). En outre, mettre fin au régime concessif sur le Rhône pourrait fragiliser la réalisation des plans quinquennaux d'investissements par le concessionnaire au profit du territoire. »
Elle a signifié que la contrepartie envisagée est de nature à garantir la concurrence, non sur l'exploitation des ouvrages, mais sur la cession des produits : « Pour sécuriser juridiquement la cession de gré à gré des biens aux anciens exploitants, il est proposé d'introduire un dispositif permettant d'ouvrir à d'autres acteurs du marché une part virtuelle des capacités de production hydraulique via un dispositif de marché qui prévoit la mise à disposition de tiers (acteurs de marchés, fournisseurs, agrégateurs, opérateurs hydrauliciens, industriels...), à travers un processus d'enchères, de volumes de productibles pilotables et activables, aux caractéristiques de celles des barrages hydrauliques, tout en maintenant les exploitants historiques en place. Ce dispositif de contreparties au maintien des exploitants historiques en place reviendrait donc à donner accès aux acteurs de marché une part virtuelle des centrales hydrauliques, et ainsi à avoir une part de concurrence non pas sur l'exploitation des ouvrages, mais à travers la cession de produits de marchés. L'exploitation des ouvrages hydrauliques serait strictement indépendante de la livraison des produits de marchés proposés, de telle sorte que l'exploitant reste le seul décisionnaire au niveau des ouvrages, en fonction des enjeux de production énergétique et de gestion de l'eau y compris en situation de stress hydrique ou de crue. »
Une consultation a été lancée par la DGEC, du 22 mai au 15 juin derniers, afin de sonder l'intérêt des acteurs de marché pour les différents produits envisagés dans le cadre de cette contrepartie.
À date, elle a indiqué que la contrepartie a été présentée à la Commission européenne, qui s'est montrée ouverte, sous conditions : « La présente solution a été partagée à la Commission et a fait l'objet de plusieurs échanges, notamment sur les contours des contreparties envisagées au maintien des exploitants en place sans mise en concurrence. À ce stade, la Commission s'est montrée ouverte à la solution proposée par les autorités françaises sous réserve (i) du volume de contrepartie retenu et de leur durée, (ii) de l'intérieur du marché pour les produits identifiés, et (iii) des modalités de commercialisation de ces produits afin que les enchères puissent être réalisées de manière ouverte, transparente et non-discriminatoire, sous le contrôle de la CRE. »
Au-delà du changement de régime des concessions vers les autorisations, la DGEC a indiqué être favorable à l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 : « L'opportunité de défendre certaines extensions des exclusions de la directive demeure [...] a minima du point de vue de l'échéance de la concession du Rhône le 31 décembre 2041. »
Cependant, elle a indiqué qu'une telle modification de la directive était peu susceptible d'aboutir en l'absence de soutien d'autres pays européens : « Cette position devrait être portée avec d'autres États membres, afin de réunir une majorité, ce qui paraît à ce stade difficile [...] Cela sera d'autant plus délicat que d'autres États membres (Italie, Portugal) ont clos leurs procédures avec la Commission en mettant en concurrence, ou en prévoyant de le faire dans leur législation interne, les concessions concernées. »
Enfin, elle a précisé qu'une telle modification de la directive précitée n'était pas forcément suffisante pour éteindre le différend entre la Commission européenne et l'État : « L'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive 2014/23/UE n'exonèrerait pas nécessairement les concessions d'énergie hydraulique de respecter les principaux fondamentaux du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment les principes de liberté d'établissement, de non-discrimination et de transparence [...] De plus, il n'est aucunement acquis qu'une exclusion de l'hydroélectricité [...] suffirait à écarter le risque d'un abus de position dominante automatique, titré de la méconnaissance de l'article 106, paragraphe 1er, du TFUE, lu en combinaison avec l'article 102 du TFUE. Enfin, [...] le cas des contrats de concessions actuellement visés par la Commission européenne ne serait pas réglé rétroactivement. »
Pour ce qui la concerne, la CRE a indiqué sa disponibilité pour réguler la contrepartie devant assortir le changement de régime des concessions vers les autorisations, étant précisé que cette contrepartie doit laisser le groupe EDF libre de l'exploitation et du pilotage de ses installations hydroélectriques et tenir compte des volumes d'électricité déjà vendus sur les marchés à terme.
C'est la raison pour laquelle la CRE a indiqué qu'elle « n'a pas d'analyses à apporter sur le régime juridique choisi. Elle constate que l'option d'une autorisation d'exploiter suscite le plus de débats. La CRE comprend que le passage à un régime d'autorisation d'exploiter pourrait s'accompagner d'une contrepartie sur la vente d'électricité produite à partir des barrages hydroélectriques. Du point de vue de la CRE, il est important que le futur dispositif laisse les producteurs libres de l'exploitation et du pilotage de leurs installations de production. Ils disposent d'une compétence spécifique et sont les mieux placés pour optimiser ces installations. Ainsi, la production hydroélectrique continue à s'adapter aux besoins du système à court terme. La CRE précise également qu'EDF met déjà en vente sur les marchés à terme des volumes liés à ses exploitations hydrauliques. Cet aspect devra être considéré dans l'élaboration d'une solution. Enfin, la CRE tient à souligner qu'elle assumera le rôle qui lui sera attribué par le futur accord entre l'État français et la Commission européenne, et qu'elle n'a pas vocation à défendre un modèle ou un autre auprès de la Commission. »
b) Le point de vue des instances européennes : une compatibilité sous conditions du changement de régime des concessions vers les autorisations avec le droit de l'Union européenne et une révision de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, n'étant pas susceptible de produire des effets avant 2030
Interrogée sur l'opportunité d'un changement de régime des concessions vers les autorisations, la Commission européenne a rappelé la liberté des États membres dans l'organisation du marché hydroélectrique, ce qui signifie qu'elle n'a pas de préférence pour tel ou tel modèle dès lors que les règles européennes sont respectées, en ces termes : « Les États membres sont libres d'organiser le secteur hydroélectrique sur leur territoire selon le modèle de leur choix dans le respect des règles européennes relatives notamment à la concurrence, au marché intérieur et à l'énergie. La Commission n'a pas de préférence pour un modèle plutôt qu'un autre dès lors que les règles européennes sont respectées. »
Sollicitée sur le cas des concessions des concurrents du groupe EDF, à commencer par la CNR, la Commission européenne a indiqué : « Il convient de préciser que la procédure de la DG COMP concerne uniquement EDF [...] Les États membres sont libres d'organiser le secteur hydroélectrique sur leur territoire selon le modèle de leur choix dans le respect des règles européennes relatives à la concurrence, au marché intérieur et à l'énergie. Dès lors les États membres peuvent choisir des modèles différents pour les différents aménagements hydroélectriques sur leur territoire dès lors que les règles européennes sont respectées. »
Au-delà de ces considérations générales, la Commission européenne a fait part de son point de vue sur les conditions d'un changement de régime des concessions vers les autorisations.
D'une part, elle a estimé qu'un éventuel transfert de la propriété des ouvrages hydroélectriques et/ou l'attribution d'autorisation d'exploiter de tels ouvrages doit se faire en principe via une procédure de mise en concurrence : « Un éventuel transfert de la propriété d'ouvrages hydroélectriques et/ou l'attribution d'autorisation d'exploiter ces ouvrages doit se faire en principe via des procédures de mise en concurrence ouvertes et transparentes. De telles procédures sont également susceptibles de conforter l'examen aux fins du contrôle des aides d'État. De plus, l'attribution d'une autorisation et son renouvellement doivent remplir les exigences établies par le cadre légal européen applicable aux régimes d'autorisations, à savoir la directive 2006/123/CE (« services ») et, le cas échéant, les principes du Traité. Une attribution de gré à gré constitue indéniablement une restriction au sens de l'article 49 TFUE. Une restriction à la liberté d'établissement pourrait être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. »
D'une part, elle a relevé qu'une éventuelle contrepartie sur la production hydroélectrique doit également se faire en principe via une procédure de mise en concurrence : « Une éventuelle règlementation tarifaire visant à fixer le prix de vente de production hydroélectrique serait contraire à la règlementation européenne du secteur de l'énergie, en particulier l'article 3, b) du règlement 2019/943 selon lequel les États membres veillent à ce queles règles du marché [de l'électricité] encouragent la formation libre des prix et évitent les actions qui empêchent la formation des prix sur la base de l'offre et de la demande. La formation libre des prix permet également de conserver les incitations à produire de manière optimale pour le système électrique français et européen en conservant un signal de prix de marché. Si l'intérêt de produits spécifiques devait être confirmé, ces produits devraient faire l'objet d'appels d'offres transparents et non-discriminatoires. »
Au-delà du changement de régime des concessions vers les autorisations, la Commission européenne a indiqué avoir engagé une révision des directives européennes 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2024/25/UE sur la commande publique.
Une consultation a été organisée par elle, de février à mars derniers, afin d'évaluer si ces directives atteignent leurs objectifs en matière de concurrence, de transparence et d'efficacité et, le cas échéant, de proposer leur ajustement.
Sans se prononcer sur l'opportunité d'exclure l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, la Commission a rappelé plus généralement les prérequis pour réviser ces directives.
Tout d'abord, elle a rappelé que l'engagement de la révision dépendra du résultat de la consultation : « L'éventuelle révision des directives européennes sur la commande publique dépendra des résultats de l'évaluation actuellement en cours. Si cette évaluation révèle que les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE n'atteignent pas pleinement leurs objectifs ou qu'elles ne sont plus adaptées aux évolutions du marché, la Commission européenne pourra alors proposer des modifications législatives. À l'inverse, si l'évaluation conclut à leur efficacité, aucune réforme ne sera engagée. »
Plus encore, elle a fait observer qu'une éventuelle révision ne peut produire d'effet immédiat : « En tout état de cause, dans l'hypothèse d'une révision, il est peu probable que les nouvelles dispositions produisent des effets avant 2030. »
c) Un accord de principe, annoncé par le Premier ministre, entre la Commission européenne et la France sur la réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF, dont les modalités d'application doivent encore être précisées
Dans ce contexte, le 28 août dernier, l'ancien Premier ministre François Bayrou a annoncé par voie de communiqué de presse52(*) la conclusion d'un accord de principe entre la Commission européenne et l'État au sujet de l'organisation des concessions hydroélectriques françaises.
Cet accord de principe doit permettre de résoudre les deux précontentieux européens, l'un lié à la non-remise en concurrence des concessions échues (celui ouvert par la DG GROW en 2019) et l'autre portant sur la position jugée dominante de la société EDF (celui initié par la DG COMP en 2015).
Le schéma retenu comporte trois volets :
- le passage du régime de concession à un régime d'autorisation pour l'exploitation de l'énergie hydraulique, à l'exception des ouvrages de la CNR ;
- la possibilité de maintien des exploitants en place, de manière à garantir la continuité de l'exploitation des ouvrages, cette continuité étant indispensable au regard des enjeux de sécurité, de gestion de l'eau, de maintien des compétences et des emplois et de retour de valeur pour les territoires ;
- la mise à disposition par le groupe EDF de 6 GW de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs, via des enchères concurrentielles mises en vente par la CRE.
Ce schéma doit se traduire dans un véhicule législatif, le communiqué de presse précité évoquant l'éventualité du dépôt d'une proposition de loi par les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo.
III. POUR UN PASSAGE CONSENSUEL, SÉCURISÉ ET RÉUSSI DU RÉGIME DES CONCESSIONS VERS CELUI DES AUTORISATIONS : 15 PROPOSITIONS RÉUNIES EN 4 AXES
A. ÉVALUER EN AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE RÉGIME
Les rapporteurs sont convaincus de l'intérêt de l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou sur la réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF. Aussi les rapporteurs se félicitent-ils de la résolution attendue du différend opposant la Commission européenne à l'État à ce sujet. En effet, ce différend obère les perspectives de développement de toute la filière de l'hydroélectricité depuis 20 ans. À l'heure où le protectionnisme américain et le bellicisme russe éprouvent chaque jour la sécurité d'approvisionnement énergétique de la France et de l'Union européenne, les autorités nationales et européennes doivent définir les modalités d'application de l'accord de principe, sans rien sacrifier, ni de la garantie fondamentale de notre souveraineté énergétique nationale, ni de l'harmonisation légitime des règles du marché européen de l'énergie. Convenir de telles modalités d'application est également indispensable à la réussite de notre transition énergétique nationale et donc à la réduction des émissions de GES européennes de 55 % d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à nos engagements européens et internationaux.
Les rapporteurs sont aussi convaincus de la nécessité pour les parlementaires, députés comme sénateurs, de parler d'une même voix sur ce sujet transpartisan, d'intérêt national. C'est pourquoi les rapporteurs saluent le travail effectué par la mission d'information conduite par la députée Marie-Noëlle Battistel et le député Philippe Bolo, sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, dont les conclusions ont été rendues publiques le 13 mai dernier. Les rapporteurs partagent le constat formulé par les députés sur la préférence donnée au changement de régime des concessions vers les autorisations. Ils constatent que l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou évoque une traduction législative prochaine, le cas échéant dans le cadre d'une proposition de loi déposée par ces députés. Les rapporteurs rappellent que le Sénat avait proposé l'expérimentation d'un tel passage, à l'article 21 de la proposition de loi dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024 puis adoptée au Sénat, en première lecture, le 16 octobre 2024, et en deuxième lecture, le 8 juillet 2025. Dans la mesure où l'examen en deuxième lecture de cette proposition de loi n'est pas encore intervenu à l'Assemblée nationale, les rapporteurs appellent les députés à amender ce texte pour y introduire leurs propositions, afin de réaliser le passage du régime des concessions vers celui des autorisations. Il s'agit en effet du véhicule législatif le plus rapide et le plus aisé à faire prospérer.
L'objet du présent rapport d'information est de servir de point d'appui à la définition des modalités d'application de cet accord de principe, en identifiant précisément les lignes directrices du Sénat. Dans ce contexte, les rapporteurs formulent 15 propositions, réunies en 4 axes.
Le premier axe des propositions des rapporteurs vise à évaluer en amont la robustesse technique et l'impact financier du changement de régime des concessions vers les autorisations.
Les rapporteurs observent que le risque contentieux pesant sur les concessions hydroélectriques du groupe EDF est massif. En effet, le groupe dispose de 296 concessions hydroélectriques, sur un total de 340 concessions. Or 38 de ces concessions, échues mais non renouvelées, ont d'ores et déjà été placées sous le régime dit « des délais glissants ». En termes de capacités installées, cela représente 19,5 GW, sur un total de 23,2 GW.
Un changement de régime des concessions vers les autorisations induit nécessairement des transferts financiers. En effet, pour réaliser un tel transfert, il faut déterminer une indemnité de résiliation, allouée par l'État aux anciens concessionnaires, un prix de cession, acquittée par les nouveaux propriétaires à l'État, et enfin une redevance, due annuellement par les nouveaux exploitants à l'État mais aussi aux départements, aux communes et aux groupements de communes. De plus, la contrepartie envisagée visant à ouvrir une part virtuelle des capacités de production hydroélectrique du groupe EDF aux autres acteurs de marché représente un manque à gagner susceptible de peser sur les recettes, le résultat et l'endettement du groupe.
Un changement de régime des concessions vers les autorisations suppose également des évolutions juridiques. Ici aussi, pour réaliser un tel transfert, il faut résilier les contrats de concession, déclasser les ouvrages hydroélectriques, céder ces ouvrages de gré à gré, créer un régime d'autorisation spécifique sur les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW, instituer la contrepartie envisagée sur la production d'hydroélectricité, introduire une redevance spécifique pour l'État, mais aussi pour les départements, les communes et les groupements de communes. La DGEC a indiqué avoir engagé des échanges avec le Conseil d'État au sujet de la robustesse juridique d'un tel montage. Certains concurrents du groupe EDF (Afieg, Anode) ont clairement interrogé cette robustesse. En tout état de cause, la Commission européenne a rappelé que ce montage devrait in fine respecter les règles européennes relatives à la concurrence, au marché intérieur et à l'énergie, qui prescrivent en principe des procédures de mise en concurrence pour l'attribution d'une autorisation ou l'accès à la contrepartie.
Dans ce contexte, les rapporteurs estiment crucial d'évaluer l'impact financier d'un changement de régime des concessions vers les autorisations, en saisissant la Cour des comptes, ainsi que sa robustesse technique, en sollicitant le Conseil d'État. Le cas échéant, le Parlement pourrait lui-même procéder à la saisine de la Cour des comptes, dans le cadre de la mission d'assistance du Parlement à l'évaluation des politiques publiques, mentionnée à l'article 47-2 de la Constitution et à l'article L. 132-6 du code des juridictions financières. Il pourrait également lui-même procéder à la saisine du Conseil d'État, dans le cadre de l'avis sur une proposition de loi, prévu à l'article 39 de la Constitution et à l'article L. 112-1 du code de justice administrative.
|
Recommandation n° 1 : Évaluer l'impact financier d'un changement de régime, via la Cour des comptes, et la robustesse technique d'un tel changement, via le Conseil d'État. |
Le différend opposant la Commission européenne à l'État s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF est emblématique d'un manque de dialogue entre les autorités françaises et celles européennes dans la production non seulement de la loi nationale mais aussi des directives européennes. Pour résoudre durablement ce différend, le changement de régime ne peut être mis en place qu'au terme d'un compromis entre ces autorités, sur le plan tant des principes généraux que des modalités particulières.
Légiférer sans un tel compromis a conduit à des errements par le passé. À titre d'exemple, l'article 116 de la loi dite « Transition énergétique », du 17 octobre 2015, est venu créer un dispositif de prolongation de concessions contre travaux, à l'article L. 521-6-3 du code de l'énergie. Or ce dispositif a été adopté sans consultation préalable de la Commission européenne. Dans une lettre du 12 juillet 2018, elle a refusé la notification du projet de la prolongation contre travaux de la concession de la vallée de la Truyère. Puis, dans sa mise en demeure du 7 mars 2019, elle a constaté la non-conformité du dispositif de prolongation contre travaux en tant que tel, au regard de la directive dite « Concession », du 24 février 2014. C'est un mauvais exemple de législation, à ne pas réitérer.
À l'inverse légiférer sur la base d'un tel compromis a permis des succès par le passé. À titre d'exemple, la loi dite « Aménagement du Rhône », du 28 février 2022, est venue prolonger la concession du Rhône attribuée à la CNR jusqu'au 31 décembre 2041. Or cette prolongation a été adoptée après consultation préalable de la Commission européenne. En effet, le Gouvernement était en possession d'une lettre de confort, confirmant l'absence de préoccupation soulevée par cette prolongation au titre des aides d'État. Depuis lors, la CNR a pu engager un plan d'investissement de 3 Mds€ : 500 millions d'euros (M€) pour les travaux d'investissements supplémentaires, 700 M€ au titre de plans quinquennaux successifs et 2,1 Mds€ pour la maintenance et le renouvellement des ouvrages existants. C'est un bon exemple de législation, sur lequel prendre appui.
Dans ce contexte, les rapporteurs estiment crucial de ne légiférer sur le changement de régime des concessions vers les autorisations qu'en possession d'une lettre de confort de la Commission européenne, garantissant la compatibilité de ce changement de régime avec le droit de l'Union européenne. Ils se félicitent que des échanges aient repris en 2025 entre le Gouvernement et la Commission européenne au sujet des principes et des contreparties d'un tel changement de régime. Ils se félicitent également que les parlements aient pu échanger directement avec la Commission européenne, dans le cadre des missions parlementaires respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, ils se félicitent de l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou s'agissant de la réorganisation des concessions hydroélectriques françaises. Si les modalités d'application de cet accord de principe doivent encore être précisées, le différend entre la Commission européenne et la France peut et doit donc être pleinement et rapidement résolu.
|
Recommandation n° 2 : Ne légiférer qu'en possession d'une lettre de confort de la Commission européenne garantissant la compatibilité du changement de régime avec le droit de l'Union européenne. |
Dès lors qu'il est accompagné d'une évaluation juridique et financière nationale et d'une lettre de confort européenne, le changement de régime peut et doit être transposé législativement. Les rapporteurs observent que l'accord de principe annoncé par le Premier ministre François Bayrou évoque l'éventualité d'un dépôt par les députés d'une proposition de loi en ce sens. Or un nouveau texte est nécessairement source de délais et d'aléas. Compte tenu de l'urgence de la situation, les rapporteurs appellent les députés à amender de leurs propositions la proposition de loi dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024, dès qu'elle sera examinée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. En effet, l'article 21 de ce texte avait proposé l'expérimentation d'un tel passage. Le périmètre initial adopté au Sénat pour ce texte comportait bien « l'expérimentation du passage, pour les concessions hydroélectriques, du régime des installations concédées vers celui des installations autorisées », ainsi que le rappelle le rapport législatif53(*) publié à cette occasion.
|
Recommandation n° 3 : Compte tenu de l'urgence de la situation, légiférer préférentiellement par le biais d'amendements à la proposition de loi dite « Gremillet », dès son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. |
B. SÉCURISER LES PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU CHANGEMENT DE RÉGIME
Le deuxième axe des propositions des rapporteurs tend à sécurité les paramètres économiques et sociaux du changement de régime des concessions vers les autorisations.
Tout d'abord, les rapporteurs estiment crucial de définir le bon périmètre du nouveau régime. Certes, la Commission européenne a rappelé que les procédures européennes en cours ne concernent que les concessions hydroélectriques du groupe EDF. Pour autant, tant le groupe EDF que ses concurrents (Engie, France Hydroélectricité) ont plaidé pour ne pas faire de distinction entre les concessions de ce groupe et celles de ses concurrents et entre les concessions échues et non échues. De plus, la CNR a appelé au maintien de sa concession, au moins jusqu'à son échéance le 31 décembre 2041. Enfin, le DGEC elle-même a indiqué réfléchir à l'exclusion des concessions qui viennent d'être renouvelées (CNR), dont l'activité fluviale est l'activité principale et la production hydroélectrique accessoire (Seine, Moselle) ou qui sont régies par des accords internationaux54(*) (Rhin, Doubs, L'Arve, Émosson). Les rapporteurs plaident pour de telles exclusions, à commencer par celle demandée par la CNR ; ils rappellent que la Commission européenne a considéré à ce sujet que les États membres peuvent choisir des modèles différents pour les aménagements hydroélectriques sur leur territoire dès lors que les règles européennes sont respectées. À ce stade, les rapporteurs constatent que l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou maintient l'exception de la CNR, qui relève d'un statut spécifique, sans faire mention des autres cas d'exception.
|
Recommandation n° 4 : Exclure du changement de régime la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ainsi que les concessions pour lesquelles la production d'électricité est accessoire (Seine, Moselle) ou qui sont régies par des accords internationaux (Rhin, Doubs, l'Arve, Émosson). |
Plus encore, les rapporteurs jugent indispensables de définir le bon niveau des indemnités de résiliation et des prix de cession. La DGEC et le groupe EDF ont rappelé que le changement de régime des concessions vers les autorisations nécessiterait plusieurs étapes dont notamment, d'une part, la résiliation des contrats en cours et le versement d'une indemnité de résiliation de l'État vers les anciens concessionnaires et, d'autre part, la cession de gré à gré des ouvrages hydroélectriques déclassés et le versement d'un prix de cession des anciens concessionnaires vers l'État. Le prix de cession des ouvrages dû par les anciens concessionnaires pourrait être diminué de l'indemnité de résiliation due par l'État. La correcte évaluation financière des ouvrages hydroélectriques déclassés est indispensable pour sécuriser leur transfert de propriété, en valorisant les biens des personnes publiques et en respectant les droits des contractants. En effet, il est interdit aux propriétaires publics de céder leurs biens à vil prix, c'est-à-dire sans contrepartie suffisante. Dans le contexte, la DGEC comme le groupe EDF envisagent le recours à une commission d'experts indépendants. Un concurrent du groupe EDF (Afieg) a insisté sur les risques juridiques induits par la définition du prix de cession des ouvrages déclassés. Les rapporteurs approuvent le recours à une commission d'experts indépendants ; ils rappellent que la Commission européenne a indiqué qu'un tel transfert doit respecter le cadre légal européen applicable aux régimes d'autorisation des ouvrages hydroélectriques, qui prévoit en principe des procédures ouvertes et transparentes.
|
Recommandation n° 5 : Garantir la juste évaluation des indemnités de résiliation des contrats de concession et des prix de cession des ouvrages hydroélectriques transférés par une commission d'experts indépendants. |
Autre point, les rapporteurs estiment indispensable de maintenir un contrôle de l'État sur les ouvrages hydroélectriques transférés. La DGEC a indiqué envisager plusieurs moyens de contrôles étatiques : la transmission d'un rapport annuel, le recours à des déclarations d'utilité publique, un droit d'opposition aux futures cessions d'ouvrages ou encore l'application de sanctions en cas de manquements. Le groupe EDF a lui aussi estimé utile le maintien d'un droit d'opposition de l'État aux futures cessions des ouvrages. Un concurrent du groupe EDF (France Hydroélectricité), de même que plusieurs syndicats de personnels membres de l'intersyndicale du groupe EDF (CFDT, FNEM-CGT, FNEM-FO) ont plaidé pour une incessibilité des ouvrages hydroélectriques transférés. Les rapporteurs soutiennent la mise en oeuvre des moyens de contrôle précités, à commencer par la faculté pour l'État de s'opposer à leur cession. C'est une nécessité pour prévenir le morcellement de notre patrimoine hydraulique et garantir l'application de la sûreté hydraulique.
|
Recommandation n° 6 : Prévoir la faculté pour l'État de s'opposer à la cession des ouvrages hydroélectriques transférés ainsi qu'un haut niveau de contrôle par ce dernier de l'organisation et de l'exploitation de ces ouvrages. |
Fait notable, les rapporteurs considèrent nécessaire de définir un cadre robuste pour la contrepartie envisagée au maintien des exploitants historiques. Pour prévenir tout risque de position dominante du groupe EDF, et en contrepartie du maintien des exploitants historiques dans le cadre du changement de régime des concessions vers les autorisations, la DGEC envisage l'ouverture d'une part virtuelle des capacités de production hydroélectriques du groupe EDF ; l'enjeu est donc de permettre une part de concurrence, non sur l'exploitation des ouvrages en tant que telle, mais sur la cession de produits de marchés liés. Le groupe EDF s'est montré ouvert à un tel dispositif, sous réserve de lignes rouges : le maintien de l'outil industriel et de la gestion opérationnelle par le groupe, la limitation de la contrepartie à la seule commercialisation de la production d'hydroélectricité, avec un volume raisonnable et une durée limitée et le refus d'un dispositif semblable à l'Arenh, dont les prix ne couvrent pas les coûts et dont l'option s'exerce par les fournisseurs alternatifs en bénéficiant. De leurs côtés, certains syndicats de personnels membres de l'intersyndicale du groupe EDF (CFE-CGC, FNEM-FO) ont appelé à refuser des compensations excessives de type Arenh hydraulique. S'agissant des concurrents du groupe EDF, le groupe Engie a insisté sur la limitation de cette compensation aux seules concessions hydroélectriques du groupe EDF. D'autres concurrents ont relevé l'importance de cette compensation en cas de changement de régime des concessions vers les autorisations (Anode, Afieg). De son côté, la CRE s'est dite disposée à gérer le dispositif, ce qui offrirait des gages d'indépendance vis-à-vis des acteurs de marché, de transparence dans les procédures d'accès et d'expertise sur le fonctionnement du marché ; plus substantiellement, elle a estimé que ce dispositif doit tenir compte, d'une part, de la liberté pour le groupe EDF de l'exploitation et du pilotage de ses installations hydrauliques et, d'autre part, du fait que ce groupe met déjà en vente sur les marchés à terme des volumes liés à ces mêmes installations. Les rapporteurs proposent la régulation par la CRE de la contrepartie envisagée au maintien des exploitants historiques ; ils observent que la Commission européenne a estimé qu'une telle contrepartie doit respecter le cadre légal européen applicable à la formation des prix sur le secteur de l'énergie, qui prévoit en principe des procédures ouvertes et transparentes. À ce jour, les rapporteurs observent que l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou prévoit bien le contrôle par la CRE de la mise en vente des capacités hydroélectriques via des enchères concurrentielles.
|
Recommandation n° 7 : Confier à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'encadrement de la contrepartie envisagée au maintien des exploitants historiques. |
S'agissant de la contrepartie précitée, les rapporteurs plaident pour un strict encadrement de ses conditions d'application, appelant à refuser toute condition qui pourrait s'apparenter à un Arenh hydraulique.
Tout d'abord, les rapporteurs appellent à ce qu'elle soit sans incidence sur la gestion opérationnelle des ouvrages hydroélectriques transférés. C'est une obligation forte qui est partagée par la DGEC, la CRE et le groupe EDF. En effet, la contrepartie envisagée repose sur une stricte séparation entre l'exploitation des ouvrages, totalement maintenue auprès des opérateurs historiques, et la commercialisation des produits, partiellement ouverte à leurs concurrents. Ce sont les exploitants actuels qui sont les mieux à même d'assurer la production d'hydroélectricité, nécessaire à notre sécurité d'approvisionnement, et de garantir la gestion hydraulique, nécessaire à notre sûreté hydraulique ; leur rôle est d'autant plus important que le contexte de changement climatique peut renforcer les épisodes de sécheresse ou de crues. Pour les rapporteurs, ces enjeux économiques et sécuritaires justifient pleinement l'exclusion de cette contrepartie de la gestion opérationnelle des installations hydrauliques. Sur ce sujet, les rapporteurs relèvent que l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou comporte bien la possibilité de maintenir les exploitants en place, afin de garantir la continuité de l'exploitation des ouvrages, compte tenu des enjeux liés à la sécurité des ouvrages, à la gestion de l'eau ainsi qu'au maintien des compétences et des emplois.
Plus encore, les rapporteurs plaident pour que la contrepartie ne concerne qu'une part raisonnable et limitée de la commercialisation d'électricité des ouvrages transférés. C'est une exigence forte qui est partagée par la CRE, le groupe EDF et certains syndicats des personnels de l'Intersyndicale de ce groupe. D'une part, la CRE a estimé nécessaire de tenir compte des ventes sur les marchés à terme liées à la production d'hydroélectricité déjà réalisées par ce groupe. D'autre part, le groupe EDF a plaidé pour limiter la contrepartie à la seule commercialisation de la production d'électricité, avec un volume raisonnable et une durée limitée. Enfin, le groupe et certains syndicats des personnels membres de son Intersyndicale (FNME-CGT, FNME-FO) ont appelé à refuser des compensations excessives de type Arenh hydraulique. Selon les rapporteurs, ce refus légitime d'un Arenh hydraulique suppose de restreindre la contrepartie à une part temporaire et limitée de la commercialisation d'électricité issue des installations hydrauliques. À ce stade, les rapporteurs soulignent que l'accord de principe annoncé par le Premier ministre François Bayrou propose la mise à disposition par EDF de 6 GW de capacités hydroélectriques à des tiers et au bénéfice des consommateurs.
|
Recommandation n° 8 : Garantir dans cette contrepartie le maintien de la gestion opérationnelle des installations hydrauliques par leurs propriétaires et la limiter à une part temporaire et limitée de la commercialisation de l'électricité issue des installations hydrauliques. |
Enfin, les rapporteurs estiment fondamental de préserver le statut national des personnels des IEG dans le cadre du changement de régime des concessions vers les autorisations. En l'état actuel du droit, l'article 171 de la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015, applique ce statut aux personnels des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle. Cela ne couvre pas explicitement le cas de figure d'un changement de régime des concessions vers les autorisations. Or les rapporteurs rappellent que la constitution d'une quasi-régie, envisagée dans le cadre du projet « Hercule », a achoppé en raison d'une forte opposition du corps social ; en effet, les opposants à cette réforme craignaient que la filialisation des activités hydroélectriques du groupe EDF ne conduise à un démembrement de ce groupe et à une désoptimisation de ses activités. Pour éviter que le changement de régime des concessions vers les autorisations ne trébuche pour les mêmes raisons organisationnelles, certains syndicats de personnels de l'intersyndicale du groupe EDF ont appelé à préserver dans ce cadre le statut des IEG (FNEM-CGT, FNEM, FO). La DGEC et le groupe EDF ont précisé qu'il s'agissait bien de l'intention du Gouvernement. Les rapporteurs les appellent à traduire cette intention en acte.
|
Recommandation n° 9 : Préserver le statut national des personnels des industries électriques et gazières (IEG). |
C. TERRITORIALISER LA GOUVERNANCE ET LES PROCÉDURES APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE RÉGIME
Le troisième axe des propositions des rapporteurs tend à territorialiser la gouvernance et les procédures applicables au secteur de l'hydroélectricité, à l'occasion du changement de régime des concessions vers les autorisations.
Tout d'abord, les rapporteurs estiment nécessaire de consolider les compétences du ministre chargé de l'énergie dans le cadre du nouveau régime d'autorisation. En l'état actuel du droit, l'article L. 511-5 du code de l'énergie applique le régime des concessions aux installations hydrauliques de plus de 4,5 MW et le régime des autorisations dans le cas contraire. S'agissant des installations relevant du régime des autorisations, l'article L. 531-1 du même code les soumet en principe à la nomenclature des IOTA, prévue à l'article L. 214-1 du code de l'environnement et, plus largement, au régime de l'AE, mentionné à l'article L. 181-1 du même code. De plus, l'article R. 521-1 du code de l'énergie confie les installations relevant du régime des concessions supérieures à 100 MW au ministre chargé de l'énergie et celles inférieures à ce seuil au préfet de département. Concernant les installations relevant du régime des autorisations, l'article R. 181-2 du code de l'environnement fait du préfet de département l'autorité compétente et l'article R. 181-3 du même code le service de l'État chargé de la police de l'eau le service coordinateur de l'instruction. Or la DGEC a indiqué qu'elle entend instituer un nouveau régime d'autorisation spécifique pour les installations hydrauliques supérieures à 4,5 MW, qui engloberait l'AE mais non l'IOTA ; elle a précisé qu'elle envisage de laisser inchangée la répartition des compétences entre le ministre chargé de l'énergie, les DDT et les DREAL.
Les rapporteurs constatent que plusieurs acteurs économiques plaident pour le maintien de la compétence actuelle du ministre chargé de l'énergie (EDF, France Hydroélectricité) dans le cadre de ce nouveau régime. Plus généralement, ils observent qu'une association d'élus locaux (Anem) appelle à simplifier les normes environnementales applicables aux projets d'hydroélectricité sur plusieurs points concrets (constitution de guichets uniques, conduite d'études locales, prise en compte des avis locaux, adaptation des schémas locaux). Les rapporteurs partagent la nécessité de faciliter la mise en oeuvre des projets hydroélectriques : d'une part, ils appellent à consolider les compétences du ministre chargé de l'énergie dans le cadre du nouveau régime d'autorisation ; d'autre part, ils plaident pour veiller à l'absence de surtransposition dans l'application des règles relatives à la continuité écologique des cours d'eau, depuis la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et sur les milieux aquatiques, prise en application de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; enfin, ils proposent d'appliquer à l'ensemble des installations hydrauliques deux novations sénatoriales en faveur de la « petite hydroélectricité », instituées par l'article 89 de la loi dite « Climat-Résilience », du 22 août 2021 : le médiateur national de l'hydroélectricité, instance chargée de la résolution amiable des litiges entre les porteurs de projets et l'État55(*), et le portail national de l'hydroélectricité, point d'accès unique et dématérialisé aux schémas locaux pour les porteurs de projets56(*).
|
Recommandation n° 10 : Consolider les compétences du ministre chargé de l'énergie sur les installations hydrauliques et simplifier les normes environnementales applicables aux projets hydroélectriques. |
De plus, les rapporteurs jugent indispensable de préserver la perception des redevances par les collectivités territoriales. En l'état actuel du droit, les concessions hydroélectriques sont assujetties à une redevance, qui diffère selon que la concession soit échue (article L. 523-3 du code de l'énergie) ou non échue (article L. 523-2 du même code). La première redevance repose sur le revenu normatif plutôt que le chiffre d'affaires. Dans les deux cas, le produit de cette redevance est alloué à l'État (pour moitié), aux départements (pour un tiers), aux communes (pour 1/12e) et aux groupements de communes (pour 1/12e). Dans le premier cas, un prix cible de l'électricité sert de plafond au versement des parts des collectivités territoriales et de leurs groupements, depuis la loi de finances initiale pour 2023 (article 127). Plusieurs associations d'élus locaux (DF, ANEB) ont insisté sur la nécessité de préserver une telle redevance, en privilégiant celle applicable aux concessions non échues, mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, qui ne tient compte ni du revenu net, ni du prix cible. Le groupe EDF a proposé d'instituer une redevance calquée sur celle afférente aux concessions échues, mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'énergie. De son côté, la DGEC a confirmé l'institution d'une redevance spécifique dans le cadre du nouveau régime d'autorisation d'exploiter. Pour les rapporteurs, c'est la redevance calée sur les concessions non échues, mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, qui doit être privilégiée, dans la mesure où elle exclut tout revenu normatif et tout prix cible, ce qui est plus favorable aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
|
Recommandation n° 11 : Préserver la perception des redevances par les collectivités territoriales et de leurs groupements, en privilégiant un dispositif calé sur les concessions non échues, c'est-à-dire excluant le revenu normatif et le prix cible. |
Autre point, les rapporteurs estiment crucial de consolider la gouvernance locale de l'eau associant les collectivités territoriales. Selon le droit en vigueur, les collectivités territoriales et leurs groupements sont associés à l'exploitation des concessions hydroélectriques par le biais, soit d'un comité de suivi de l'exécution de la consommation et de gestion de l'eau (article L. 524-1 du code de l'énergie), soit d'une CLE en tenant lieu (article 212-4 du code de l'environnement). L'ensemble des associations d'élus locaux (DF, ANEM, ANB) ont demandé le renforcement de la gouvernance locale de l'eau, selon une modalité tripartite associant l'État, le concessionnaire et les collectivités territoriales et leurs groupements. DF a demandé à ce que les associations d'élus locaux participent à la révision des cahiers des installations hydrauliques. De plus, l'ANEM a proposé de veiller, dans ces cahiers des charges, à intégrer les sujets de la gestion équilibrée de la ressource en eau, de la réparation partagée des coûts et des impacts des aménagements, ainsi que de la prise en compte du rôle d'écrêtement des crues, indispensable à la prévention des inondations et à la protection des personnes. Le groupe EDF et la DGEC a insisté sur la nécessité pour les exploitants des installations hydrauliques de conserver la maîtrise de la gestion de l'eau, dans le cadre de la contrepartie au maintien des exploitants historiques. En outre, cette dernière a confirmé l'institution d'une instance de dialogue avec les élus locaux et les parties prenantes. Pour les rapporteurs, davantage que la création d'une instance de dialogue, c'est une véritable gouvernance tripartite de l'eau, associant l'État, le concessionnaire et les collectivités territoriales et leurs groupements, qui doit être instituée afin de permettre une gestion partagée de la ressource en eau.
|
Recommandation n° 12 : Consolider une gouvernance tripartite de l'eau entre l'État, les collectivités territoriales et les exploitants des installations hydrauliques. |
Enfin, les rapporteurs considèrent fondamental d'intégrer la résilience au changement climatique dans les missions des installations hydrauliques. Plusieurs associations d'élus locaux ont insisté sur la nécessité de la prise en compte de l'aggravation du changement climatique et de la gestion des crues dans ce cadre dans les territoires ruraux et de montagne (ANEB, ANEM). Dans le même esprit, plusieurs syndicats de personnels de l'intersyndicale du groupe EDF (CFDT, CFE-CGC) ont aussi souligné l'impact du changement climatique sur les activités hydroélectriques. Enfin, le groupe EDF et la DGEC a rappelé le besoin pour les exploitants des installations hydrauliques de conserver la maîtrise de la gestion de l'eau, y compris en situation de sécheresse ou de crue, en dépit de la contrepartie du maintien des exploitants historiques. Les rapporteurs estiment indispensable que la révision des cahiers des charges des installations hydrauliques intègre la résilience de ces installations au changement climatique. Ils rappellent que c'est un combat de longue date de la commission, qui a prévu cette prise en compte pour les centrales nucléaires, à l'article 21 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire », et l'a proposée pour les réseaux de distribution et de transport d'électricité, dans le cadre de la proposition de loi dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024.
|
Recommandation n° 13 : Intégrer la résilience au changement climatique dans les missions des installations hydrauliques. |
D. COMPLÉTER LE CHANGEMENT LÉGISLATIF DE RÉGIME PAR UNE RÉVISION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DU CADRE EUROPÉEN APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ
Le dernier axe des propositions des rapporteurs préconise de compléter le changement législatif de régime par une révision du cadre réglementaire et du cadre européen applicables au secteur de l'hydroélectricité.
En premier lieu, les rapporteurs souhaitent que le chantier de changement de régime des concessions vers les autorisations soit intégré dans le décret sur la PPE.
Si l'hydroélectricité est déjà prise en compte dans le décret sur la PPE, c'est sans fixer d'objectif quant à la résolution du différend entre la Commission européenne et l'État s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF. En l'état actuel du droit, l'article 3 du décret du 10 avril 2020 sur la PPE prévoit des objectifs de capacité installée pour l'hydroélectricité57(*) de 25,7 GW d'ici fin 2023 et entre 26,4 et 26,7 GW d'ici fin 2028. Dans le cadre du projet de décret sur la PPE, mis en consultation le 7 mars 2025, le Gouvernement a proposé des objectifs de capacité installée pour l'hydroélectricité58(*) de 26,3 GW d'ici 2030 et 28,7 GW d'ici 2035. Le projet de décret sur la PPE prévoit que la hausse de 2,8 GW des capacités installées d'ici 2035 se répartisse entre 1,7 GW pour les STEP, 610 MW pour les installations relevant du régime des concessions et 440 MW pour celles relevant du régime des autorisations. Pour atteindre ces objectifs, il est envisagé la poursuite du soutien public à la petite hydroélectricité et l'étude d'un tel soutien pour les STEP. En revanche, la production envisagée demeure d'environ 54 TWh, dans la mesure où « l'augmentation limitée des capacités hydroélectriques ne se traduira pas nécessairement par une augmentation du productible, notamment en raison des impacts attendus du changement climatique sur la ressource en eau. » Au total, la résolution du différend entre la Commission européenne et l'État est abordée de manière très allusive dans le projet de décret sur la PPE : « à court et moyen termes, la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques est nécessaire pour l'atteinte des objectifs hydroélectriques ».
Dans ce contexte, les rapporteurs proposent de renforcer l'ambition du décret sur la PPE en matière d'hydroélectricité sur plusieurs points. Tout d'abord, ils souhaitent l'introduction d'un chiffrage global de capacité installée pour l'hydroélectricité de 29 GW au total d'ici 2035. C'est un chiffrage qui a été proposé par la filière hydroélectrique française, dans le cadre de la proposition de loi dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024. En effet le rapport législatif59(*) publié à cette occasion souligne l'intérêt pour ce chiffrage du groupe EDF de France Hydroélectricité (FH)60(*). D'une part, le premier a indiqué : « concernant l'hydraulique, les propositions de la PPL sont en ligne avec la vision d'EDF, en prévoyant une augmentation des capacités à 29 GW, dont 1,7 GW de STEP supplémentaire d'ici 2035 ». D'autre part, le second a précisé : « Nous sommes favorables aux objectifs proposés dans la PPL, plus ambitieux que ceux prévus dans le projet de PPE (à 28.5 GW). » Plus encore, les rapporteurs souhaitent que l'objectif de résolution du différend entre la Commission européenne et l'État s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF, figurant déjà dans le décret sur la PPE, soit complété pour préciser qu'il intervient en opérant le passage du régime des concessions vers celui des autorisations, en instituant une contrepartie au maintien des opérateurs historiques sur la production d'hydroélectricité du groupe EDF et en laissant inchangée la concession du Rhône attribuée à la CNR a minima jusqu'à son expiration le 31 décembre 2041. Enfin, les rapporteurs plaident pour que le décret sur la PPE comporte une mention sur la nécessité pour les autorités françaises de négocier auprès des autorités européennes l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014.
À ce stade, les rapporteurs constatent que la DGEC est disposée à intégrer certaines de ces préconisations au projet de décret sur la PPE. D'une part, le changement de régime des concessions vers les autorisations pourrait y être mentionné : « Dans le cas où l'option de passage vers un régime d'autorisation serait retenue avant l'adoption de la PPE, cette option pourrait y être mentionnée. » D'autre part, l'exclusion de la concession du Rhône attribuée à la CNR de ce changement de régime pourrait également y être précisée : « Il pourrait être indiqué dans la PPE qu'une attention particulière sera accordée à la concession du Rhône ». En revanche, l'introduction d'un objectif de capacité installée totale pour l'hydroélectricité de 29 GW d'ici 2035 n'est pas souhaitée par la DGEC : « Au regard 1) du délai de construction des grandes STEP et du calendrier de résolution des précontentieux européens et 2) du rythme de développement de la petite hydroélectricité, l'objectif de développement de + 2,8 GW à l'horizon 2035 est déjà ambitieux. Rehausser cet objectif à 29 GW, soit + 3,1 GW, ne paraît ainsi pas pertinent. » Quant à la mention de la négociation de l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, elle n'est pas envisagée par la DGEC : « Il n'est pas envisagé de préciser dans la PPE que la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques fera l'objet de négociations sur l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive 2014/23/UE dite "Concession". » Les rapporteurs appellent le Gouvernement à évoluer afin d'intégrer au décret sur la PPE une stratégie claire en direction de la préservation de notre patrimoine hydraulique et, par voie de conséquence, de notre souveraineté énergétique.
|
Recommandation n° 14 : Au-delà, intégrer le chantier du changement de régime des concessions vers les autorisations dans le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en fixant des objectifs précis au Gouvernement visant à : - atteindre une capacité installée totale pour l'hydroélectricité de 29 GW d'ici 2035 ; - opérer le passage pour les concessions hydroélectriques du régime des concessions vers celui des autorisations, en instituant une contrepartie au maintien des exploitants historiques sur la production d'hydroélectricité du groupe EDF ; - laisser inchangée la concession du Rhône attribuée à la CNR, a minima jusqu'à son expiration le 31 décembre 2041 ; - négocier l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. |
En second lieu, les rapporteurs souhaitent que le Gouvernement négocie le cadre européen le plus favorable à l'hydroélectricité, notamment dans le cadre de la révision de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. Selon le droit en vigueur, l'article 10 et l'annexe II de la directive précitée ne prévoient pas d'exclusion pour le secteur de l'hydroélectricité, au contraire de la mise à disposition, de l'exploitation ou de l'alimentation des réseaux d'eau ou d'électricité par exemple. Or la seconde mise en demeure de la Commission européenne, du 7 mars 2019, porte notamment sur le manquement supposé de la France aux articles 3, 30, 31 et 43 de la directive précitée, qui concernent, respectivement, les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, les principes généraux de l'attribution des concessions, les avis de concessions et les modifications de contrats en cours. De plus, la Commission européenne a envisagé une révision de différentes directives sur la commande publique (2014/23/UE susmentionnée mais aussi 2014/24/UE et 2024/25/UE).
Dans ce contexte, les rapporteurs proposent de négocier l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. Il s'agit d'une demande forte des acteurs économiques (le groupe EDF, France Hydroélectricité), syndicaux (CFDT, FNEM-FO) et locaux (DF, ANEM). La DGEC elle-même a indiqué souhaiter une telle révision, au moins pour sécuriser le cadre applicable à la concession du Rhône allouée à la CNR après son échéance le 31 décembre 2041 : « L'opportunité de défendre certaines extensions des exclusions de la directive demeure [...] a minima du point de vue de l'échéance de la concession du Rhône le 31 décembre 2041. »
Pour l'heure, les rapporteurs observent que la perspective de l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, reste éloignée. Le groupe EDF, la DGEC et la Commission européenne ont ainsi relevé, en des termes proches, que la révision de cette directive, d'une part, doit avoir pour prérequis le soutien d'une majorité d'États membres, d'autre part, ne peut avoir d'effet qu'à une échéance lointaine. Or le groupe EDF et la DGEC ont rappelé que l'ensemble des autres États membres ayant fait l'objet d'une procédure de mise en demeure par la Commission européenne s'agissant de leurs concessions ou de leurs installations hydrauliques ont vu cette procédure close en 2021 ou 2023. De plus, la Commission européenne a précisé que la révision des différentes directives afférente aux marchés publics ne sera engagée que si la consultation préalable, organisée par elle, de février à mars 2025, fait apparaître que ces textes n'atteignent pas leurs objectifs en matière de concurrence, de transparence et d'efficacité. Enfin, la DGEC a rappelé qu'une exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, est peu susceptible d'éteindre à elle-même le différend entre la Commission européenne et l'État s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF, en ces termes : « L'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive 2014/23/UE n'exonérerait pas nécessairement les concessions d'énergie hydraulique de respecter les principes fondamentaux du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment les principes de liberté d'établissement, de non-discrimination et de transparence [...] De plus, il n'est aucunement acquis qu'une exclusion de l'hydroélectricité [...] suffirait à écarter le risque d'un abus de position dominante automatique, tiré de la méconnaissance de l'article 106, paragraphe 1er, du TFUE, lu en combinaison avec l'article 102 du TFUE. Enfin, [...] le cas des contrats de concessions actuellement visés par la Commission européenne ne serait pas réglé rétroactivement. »
En dépit de ces difficultés, les rapporteurs estiment que la perspective de la révision directive dite « Concession », du 26 février 2014, constitue une fenêtre d'opportunité à saisir pour en exclure l'hydroélectricité de son champ.
|
Recommandation n° 15 : Au-delà, négocier l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. |
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je suis heureuse de reprendre avec vous les travaux de notre commission. Nous avions engagé plusieurs missions d'information sur des sujets d'importance et, en attendant que soit précisé l'ordre du jour à venir, nous poursuivons notre action avec la présentation de rapports particulièrement attendus.
Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui nos collègues Daniel Gremillet, Patrick Chauvet, Fabien Gay et Jean-Jacques Michau, qui vont nous présenter les conclusions de leur mission d'information transpartisane sur l'avenir des concessions hydroélectriques.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. - Comme vous le savez, notre commission nous a confié une mission d'information transpartisane sur l'avenir des concessions hydroélectriques. Nous avons été désignés rapporteurs le 19 mars dernier, avons défini notre programme le 9 avril et avons engagé nos auditions le 20 mai.
Le différend qui oppose la Commission européenne à l'État depuis vingt ans s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF est en passe d'être résolu. En effet, l'ancien Premier ministre François Bayrou a annoncé un accord de principe entre la Commission européenne et l'État à ce sujet, le 28 août dernier. Pour autant, beaucoup reste encore à faire pour définir les modalités d'application de cet accord de principe ; c'est indispensable pour que le compromis trouvé soit appliqué concrètement et effectivement.
Au cours de nos travaux, nous avons organisé 25 auditions, ce qui nous a permis de recueillir le point de vue de l'ensemble des parties prenantes : le ministre chargé de l'énergie, les représentants de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), le président du groupe EDF, les syndicats de ce groupe, ses concurrents, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ou encore les représentants de la Commission européenne. Nous avons aussi auditionné les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, chargés d'une mission d'information sur un sujet proche, pour l'Assemblée nationale.
Au terme de nos travaux, nous avons identifié le changement de régime des concessions vers les autorisations comme la solution la plus prometteuse pour éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises. C'est pourquoi nous avons formulé quinze recommandations, réunies en quatre axes, visant à évaluer en amont sa robustesse technique et son impact financier, sécuriser ses paramètres économiques et sociaux, territorialiser la gouvernance et les procédures du secteur hydroélectrique, et enfin réviser les cadres réglementaire et européen applicables à ce secteur.
Permettez-moi de revenir, tout d'abord, sur les bénéfices énergétiques, économiques et environnementaux de l'hydroélectricité.
Nous sommes tous ici attachés à l'hydroélectricité, qui constitue une énergie ancienne, pilotable et décarbonée. Or cette source d'énergie voit ses perspectives de développement obérées par un différend avec la Commission européenne, vieux de vingt ans.
L'hydroélectricité représente un atout pour notre transition et notre souveraineté énergétiques. C'est une énergie ancienne, dont les lois fondatrices trouvent leur origine dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et dans la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. On doit à l'ingénieur Aristide Bergès d'avoir démontré la viabilité du recours à cette énergie, qualifiée de « houille blanche », d'abord pour l'industrie, en 1867, puis pour l'électricité, en 1882. Les barrages hydrauliques ont été construits, d'abord à des fins de navigation et d'irrigation, dès le XIXe siècle, puis à des fins de production d'électricité, au cours du XXe siècle. Puis spécifiquement, les premiers barrages hydroélectriques ont été édifiés dans les années 1920 et les derniers dans les années 1990.
La filière hydroélectrique regroupe une diversité d'installations hydrauliques, qui relèvent du régime des concessions ou de celui des autorisations, selon que leur puissance excède ou non 4,5 mégawatts (MW), selon l'article L. 511-5 du code de l'énergie. Selon la CRE, le parc hydroélectrique a regroupé 2 500 installations hydrauliques en 2020, dont 400 relevant du régime des concessions et 2 100 du régime des autorisations. Pour Réseau de transport d'électricité (RTE), la capacité installée de ce parc a atteint 25,7 gigawatts (GW) en 2023.
La filière hydroélectrique assure une part importante de la production d'électricité, qui contribue à la sécurisation de notre système électrique et hydraulique, à la décarbonation de notre économie ainsi qu'au développement de nos territoires. Selon RTE, la production hydroélectrique s'est élevée à 58,8 térawattheures (TWh) en 2023, ce qui a représenté 12 % de notre production d'électricité totale et 42 % de la production renouvelable. C'est donc la deuxième source d'électricité après le nucléaire, et la première source renouvelable, devant l'éolien. Pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), les émissions de gaz à effet de serre (GES) de cette production sont demeurées limitées, entre 40 et 70 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. - En dépit de ses bénéfices énergétiques, économiques et environnementaux, rappelés par mon collègue Daniel Gremillet, l'hydroélectricité voit ses perspectives de développement obérées par le différend avec la Commission européenne.
Les concessions hydroélectriques du groupe EDF arrivées à échéance n'ont pas pu être renouvelées. Parmi elles, 38 ont été placées sous le régime dit « des délais glissants », mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie, qui permet la prorogation de ces concessions aux conditions antérieures, en contrepartie du paiement d'une redevance ad hoc, prévue à l'article L. 523-2 du même code. Le principal avantage de ce régime est de garantir la continuité de l'exploitation de la concession échue jusqu'à son renouvellement, ce qui permet de poursuivre la production de l'électricité et de la gestion de l'eau, en maintenant un haut niveau de sécurité sans vide juridique. Son principal inconvénient est d'exclure tout développement ou toute modification qui ne seraient pas prévus par le cahier des charges de la concession échue, ce qui n'offre ni la possibilité juridique ni la visibilité économique nécessaires à la réalisation des nouveaux investissements.
Deux mises en demeure ont été adressées à la France par la Commission européenne. La première, engagée par la direction générale de la concurrence (également appelée « DG COMP ») date du 13 octobre 2015. Elle concerne la méconnaissance supposée de l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prohibe les aides d'État accordées aux entreprises publiques, et de l'article 102, qui interdit le fait pour une entreprise d'exploiter de façon abusive une position dominante sur tout ou partie du marché intérieur. La seconde, initiée par la direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises (aussi dénommée « DG GROW ») date du 7 mars 2019. Elle porte sur le non-respect allégué de l'article 49 du TFUE, qui prohibe les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, de l'article 56, qui interdit les restrictions à la liberté de service, et enfin de la directive européenne du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dite « Concession ».
La France est actuellement le seul pays européen pour lequel une mise en demeure est pendante. En effet, sept autres États membres avaient fait l'objet de la seconde mise en demeure, cinq pays exploitant l'hydroélectricité via un régime d'autorisation - l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni - et deux autres pays via un régime de concession - l'Italie et le Portugal. Or la Commission européenne a clos, en 2021, les procédures à l'encontre de ces régimes d'autorisation, pour des raisons d'opportunité, constatant l'absence d'intérêt économique et, en 2023, celles à l'encontre de ces régimes de concession, après la révision par ces pays de leur cadre législatif ou réglementaire. S'agissant de la France, la Commission européenne n'a autorisé que la prolongation jusqu'au 31 décembre 2041 de la concession du Rhône allouée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), par la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône.
Je me réjouis que cette loi, adoptée à l'unanimité par les deux assemblées parlementaires et dont j'étais le rapporteur pour notre commission, ait permis de conférer une solution durable à cette concession. Je souhaite indiquer d'emblée que la réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF ne doit en aucun cas remettre sur le métier le cas spécifique de la concession du Rhône de la CNR.
En revanche, pour les concessions hydroélectriques du groupe EDF, après l'échec des solutions législatives issues de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite « Transition énergétique », un changement du régime des concessions vers celui des autorisations est aujourd'hui envisagé.
En effet, les solutions législatives issues de cette loi n'ont pas permis de résoudre le différend entre la Commission européenne et l'État. D'une part, un regroupement de concessions hydroélectriques, mentionné aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie, a été appliqué par un décret du 20 mars 2019 aux concessions de Coindre-Marèges et de Saint-Pierre-Marèges, du groupe Engie, mais annulé par un arrêt du Conseil d'État du 12 avril 2019. D'autre part, une prolongation de concessions contre travaux, prévue à l'article L. 521-16-3 du même code, a été refusée par la Commission européenne, pour le projet de la Truyère, dans sa lettre du 12 juillet 2018, puis en tant que telle, dans sa mise en demeure du 7 mars 2019. Enfin, la constitution de sociétés d'économie mixte hydroélectriques (Semh), permise par l'article L. 521-18 du même code, constitue une option toujours ouverte pour associer les collectivités territoriales autour d'un opérateur économique, mais elle n'exclut pas la mise en concurrence des concessions hydroélectriques.
M. Fabien Gay, rapporteur. - Dans le contexte de blocage juridique, dépeint par mon collègue Patrick Chauvet, le Gouvernement et le groupe EDF ont exploré plusieurs solutions pour réorganiser les concessions hydroélectriques de ce groupe.
Tout d'abord, le Gouvernement et le groupe EDF ont envisagé le regroupement des activités hydroélectriques du groupe dans une quasi-régie, qui permet de déroger à la mise en concurrence sous trois conditions, mentionnées à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique : le contrôle de l'État analogue à ses propres services ; la réalisation par la société de 80 % de son activité dans ce cadre ; l'absence de capitaux privés dans cette société. Il s'agit d'une option compatible avec l'article 17 de la directive dite « Concession » du 26 février 2014. Pour autant, les syndicats des personnels et les associations d'élus locaux ont relevé que la filialisation des activités hydroélectriques du groupe aurait conduit à une désoptimisation, voire à un démembrement de ce groupe. De plus, les concurrents du groupe EDF ont indiqué qu'elle aurait remis en cause la pérennité de leurs propres activités hydroélectriques.
Dans ce contexte, le Gouvernement et le groupe EDF envisagent désormais un changement de régime des concessions vers les autorisations. Il concernerait l'ensemble des concessions du groupe EDF et de ses concurrents, échues et non échues. Pour y parvenir, il requerrait plusieurs étapes : la résiliation des contrats de concession en vigueur et le paiement d'une indemnité de résiliation ; le déclassement des biens hydroélectriques ; la cession de gré à gré de ces biens et le versement d'un prix de cession ; la conception d'un nouveau régime d'autorisation, d'une nouvelle redevance et d'une nouvelle gouvernance pour les installations hydrauliques de plus de 4,5 MW. En contrepartie du maintien des exploitants historiques, une part virtuelle des capacités de production hydroélectriques serait ouverte par enchère aux acteurs de marché.
Un grand nombre de parties prenantes ont fait part de leur intérêt, sur le principe, pour le changement de régime des concessions vers les autorisations, tout en plaidant pour certaines modalités d'application. Tout d'abord, le groupe EDF a rappelé la nécessité que la contrepartie laisse inchangée la gestion opérationnelle de la production hydroélectrique, qu'elle soit appliquée à un volume limité et temporaire d'hydroélectricité et qu'elle ne soit pas semblable à un « Arenh hydraulique » - c'est-à-dire similaire au dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh). Pour sa part, la CRE a indiqué être disposée à réguler la contrepartie, en plaidant pour laisser telle quelle cette gestion opérationnelle de la production hydroélectrique, mais aussi pour tenir compte des volumes d'hydroélectricité déjà commercialisés sur les marchés par le groupe EDF. De leur côté, les syndicats des personnels ont mis l'accent sur l'incessibilité des ouvrages transférés, le maintien du statut des industries électriques et gazières (IEG), ou le refus de mesures compensatoires excessives, de type « Arenh hydraulique ». Pour ce qui les concerne, les associations d'élus locaux ont proposé la consolidation de la gouvernance locale et le maintien d'une redevance locale. Enfin, les concurrents du groupe EDF ont plaidé pour une mise en concurrence des concessions hydroélectriques de ce dernier par appel d'offres ou, à défaut, un accès à la contrepartie pesant sur sa production d'hydroélectricité.
Le Gouvernement a répondu à certaines de nos interrogations sur ce changement de régime des concessions vers les autorisations. D'une part, l'indemnité de résiliation et le prix de cession doivent être définis par une commission d'experts indépendants. D'autre part, les futures cessions des biens transférés doivent faire l'objet d'un droit d'opposition. Autre point, à l'échelon local, les compétences, gouvernance et redevance actuelles doivent être maintenues. Enfin, la contrepartie doit laisser inchangée l'exploitation opérationnelle de la production hydroélectrique, l'enjeu étant d'introduire une part de concurrence sur la commercialisation des produits et non sur la gestion des ouvrages.
La Commission européenne a aussi répondu à certains de nos questionnements sur ce changement de régime. Tout d'abord, elle a rappelé que les États membres sont libres de choisir l'organisation du secteur hydroélectrique sur leur territoire selon le modèle de leur choix. Plus encore, s'agissant du devenir de la CNR, dont la concession vient d'être renouvelée, elle a confirmé que les États membres peuvent choisir des modèles distincts pour leurs différents aménagements. Enfin, elle a réaffirmé que les États membres doivent respecter les règles européennes relatives à la concurrence, au marché intérieur et à l'énergie.
Dans ce contexte, le 28 août dernier, l'ancien Premier ministre François Bayrou a annoncé par voie de communiqué de presse la conclusion d'un accord de principe entre la Commission européenne et l'État au sujet de l'organisation des concessions hydroélectriques françaises. Cet accord de principe doit permettre de résoudre les deux précontentieux européens : l'un concerne la non-remise en concurrence des concessions échues (celui de 2019 de la « DG GROW ») et l'autre, la position jugée dominante du groupe EDF (celui de 2015 de la « DG COMP »).
Le schéma retenu comporte trois volets : le passage du régime de concession à un régime d'autorisation pour l'exploitation de l'énergie hydraulique, à l'exception des ouvrages de la CNR ; la possibilité du maintien des exploitants en place, de manière à garantir la continuité de l'exploitation des ouvrages, indispensable au regard des enjeux de sécurité, de gestion de l'eau, de maintien des compétences et des emplois et de retour de valeur pour les territoires ; enfin, la mise à disposition par le groupe EDF de 6 GW de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs, via des enchères concurrentielles mises en vente par la CRE.
Ce schéma doit se traduire dans un véhicule législatif, le communiqué de presse précité évoquant l'éventualité du dépôt d'une proposition de loi par les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo. Il ne s'agit, à ce stade, que d'une éventualité ; rappelons que la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative déposée par notre collègue Daniel Gremillet prévoyait, en son article 21, une expérimentation du passage du régime des concessions vers celui des autorisations.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. - Le passage du régime des concessions vers celui des autorisations apparaît donc comme le schéma retenu par le Gouvernement et accepté par la Commission européenne, comme l'a présenté mon collègue Fabien Gay. Nous sommes convaincus de l'intérêt de l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou sur la réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF. Aussi nous félicitons-nous de la résolution attendue du différend opposant la Commission européenne à la France à ce sujet. En effet, ce différend obère les perspectives de développement de toute la filière hydroélectrique française depuis vingt ans. À l'heure où le protectionnisme américain et le bellicisme russe éprouvent chaque jour la sécurité d'approvisionnement énergétique de la France et de l'Union européenne, les autorités nationales et européennes doivent définir les modalités d'application de cet accord de principe, sans rien sacrifier, ni de la garantie fondamentale de notre souveraineté énergétique nationale ni de l'harmonisation légitime des règles du marché européen de l'énergie. Convenir de telles modalités d'application est également indispensable à la réussite de notre transition énergétique nationale et donc à la réduction des émissions de GES européennes de 55 % d'ici à 2030 pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, conformément à nos engagements européens et internationaux.
Nous sommes aussi convaincus de la nécessité pour les parlementaires, députés comme sénateurs, de parler d'une même voix sur ce sujet transpartisan, d'intérêt national. C'est pourquoi nous saluons le travail effectué par la mission d'information conduite par les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, dont les conclusions ont été rendues publiques le 13 mai dernier. Nous partageons le constat formulé par les députés sur la préférence donnée au changement de régime des concessions vers les autorisations. Nous constatons que l'accord de principe annoncé par le Premier ministre François Bayrou évoque l'éventualité d'une traduction législative prochaine, le cas échéant dans le cadre d'une proposition de loi déposée par ces députés. Nous rappelons que le Sénat avait proposé l'expérimentation d'un tel passage, à l'article 21 de la proposition de loi dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024 puis adoptée au Sénat, en première lecture, le 16 octobre 2024, et en deuxième lecture, le 8 juillet 2025. Dans la mesure où l'examen en deuxième lecture de cette proposition de loi n'est pas encore intervenu à l'Assemblée nationale, nous appelons les députés à amender ce texte pour y introduire leurs propositions, afin de réaliser le passage du régime des concessions vers celui des autorisations. Il s'agit en effet du véhicule législatif le plus rapide et le plus aisé à faire prospérer.
L'objet de notre rapport d'information est de servir de point d'appui à la définition des modalités d'application de cet accord de principe, en identifiant précisément les lignes directrices du Sénat. Dans ce contexte, nous formulons quinze propositions, réunies en quatre axes.
Le premier axe vise à évaluer en amont la robustesse technique et l'impact financier du changement de régime des concessions vers les autorisations.
Dans la mesure où les implications juridiques et financières d'un changement de régime sont fortes, nous plaidons pour évaluer l'impact financier d'un tel changement, via la Cour des comptes, et sa robustesse technique, via le Conseil d'État.
De plus, nous préconisons de ne légiférer qu'en possession d'une lettre de confort de la Commission européenne, garantissant la compatibilité du changement de régime avec le droit de l'Union européenne.
Enfin, compte tenu de l'urgence de la situation, nous proposons de légiférer préférentiellement par le biais d'amendements à la proposition de loi dite « Gremillet », dès son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Le deuxième axe tend à sécuriser les paramètres économiques et sociaux du changement de régime des concessions vers les autorisations.
Nous proposons tout d'abord d'exclure du champ du changement de régime les concessions qui viennent d'être renouvelées - comme celle du Rhône, évoquée par mon collègue Patrick Chauvet -, celles pour qui l'activité fluviale est principale et l'activité hydroélectrique accessoire - comme celles de la Seine ou de la Moselle - ou encore celles qui sont régies par des accords internationaux notamment avec l'Allemagne et la Suisse - comme celles du Rhin, du Doubs, de l'Arve ou d'Émosson. À ce stade, nous constatons que l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou maintient l'exception de la CNR, qui relève d'un statut spécifique, sans faire mention des autres catégories d'exception.
S'agissant du transfert de propriété des ouvrages hydroélectriques en tant que tel, nous proposons trois garde-fous. Le premier est financier : il s'agit de garantir la juste évaluation des indemnités de résiliation des contrats de concession et des prix de cession de ces ouvrages par une commission d'experts indépendants. Le deuxième est juridique : il consiste à prévoir la faculté pour l'État de s'opposer à la cession de ces ouvrages, ainsi qu'un haut niveau de contrôle par ce dernier de l'organisation et de l'exploitation de ces ouvrages. Le dernier est social : il vise à préserver le statut national des personnels des IEG sur ces ouvrages.
S'agissant de la contrepartie au maintien des exploitants historiques, nous appelons à confirmer son encadrement par la CRE ; l'accord de principe annoncé par l'ancien Premier ministre François Bayrou prévoit bien le contrôle par cette commission de la mise en vente des capacités hydroélectriques via des enchères concurrentielles. De plus, nous estimons que cette contrepartie doit laisser inchangée la gestion opérationnelle des installations hydrauliques par leurs propriétaires ; l'accord de principe prévoit bien la possibilité de maintenir les exploitants en place afin de garantir la continuité de l'exploitation. Enfin, nous considérons que cette contrepartie doit être limitée à une part temporaire et restreinte de la commercialisation de l'électricité issue des installations hydrauliques ; l'accord de principe propose la mise à disposition par EDF de 6 GW de capacités à des tiers, au bénéfice des consommateurs.
Le troisième axe de nos propositions vise à territorialiser la gouvernance et les procédures applicables au secteur de l'hydroélectricité, à l'occasion du changement de régime des concessions vers les autorisations.
Plus précisément, nous plaidons pour faciliter la mise en oeuvre des projets hydrauliques. Nous proposons d'abord de consolider les compétences du ministre chargé de l'énergie dans le cadre du nouveau régime. Ensuite, nous appelons à veiller à l'absence de surtransposition en matière de continuité écologique des cours d'eau. Enfin, nous suggérons d'appliquer à l'ensemble des installations hydrauliques deux novations sénatoriales en faveur de la petite hydroélectricité, issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience » : le médiateur national de l'hydroélectricité, prévu à l'article 89 de cette loi, et le portail national de l'hydroélectricité, inscrit à l'article L. 511-4 du code de l'énergie.
En outre, nous appelons à mieux associer les collectivités territoriales à ces projets. Il convient, d'abord, de préserver la perception de leurs redevances en privilégiant le dispositif calqué sur les concessions non échues, c'est-à-dire excluant tout revenu normatif et tout prix cible, le plus favorable aux collectivités. Ensuite, nous suggérons de consolider la gouvernance tripartite de l'eau - État, collectivités territoriales et exploitants d'installations hydrauliques -, en particulier pour la révision des cahiers des charges. Enfin, nous préconisons de mieux intégrer à cette révision la résilience au changement climatique, notamment la gestion des sécheresses et des crues, capitale pour les territoires ruraux.
Le dernier axe de nos recommandations consiste à compléter le changement législatif par une révision des cadres réglementaire et européen applicables au secteur de l'hydroélectricité.
D'abord, nous plaidons pour intégrer le changement de régime dans le décret en cours d'élaboration sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Nous proposons aussi d'y fixer au Gouvernement des objectifs précis : atteindre une capacité installée totale de 29 GW d'ici à 2035 ; opérer pour les concessions hydroélectriques leur passage du régime des concessions vers celui des autorisations en instituant une contrepartie sur celles du groupe EDF ; laisser inchangée la concession du Rhône attribuée à la CNR au moins jusqu'à son expiration, le 31 décembre 2041 ; négocier l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. En outre, nous appelons les autorités nationales à négocier cette exclusion auprès des autorités européennes, quelles qu'en soient les difficultés - une révision suppose le soutien d'autres pays, présente un calendrier d'application éloigné et ne résout pas, à elle seule, le différend entre la Commission européenne et la France.
Vous trouverez le détail de nos propositions dans le tableau de mise en oeuvre et de suivi.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Merci à tous les quatre pour votre important travail et la présentation à la fois synthétique et détaillée de ce rapport.
M. Yannick Jadot. - Merci aux rapporteurs. Il était temps, en effet, de s'emparer de ce sujet... Face au contentieux, trop de gouvernements, depuis longtemps, se sont planqués !
Pour notre part, nous continuons de défendre la quasi-régie. La solution proposée dans ce rapport nous paraît à la fois floue et fragile sur le plan juridique.
Au-delà des principes, nous ne connaissons pas les détails de l'accord conclu avec la Commission européenne par le gouvernement Bayrou. Cette incertitude nous inquiète : nous craignons une privatisation déguisée et le retour d'un outil de type « Arenh hydraulique ».
Par ailleurs, je constate une incohérence avec nos travaux sur la proposition de loi dite « Gremillet » : vous proposez de fixer des objectifs quantifiés pour l'hydroélectricité, après avoir expliqué, dans les débats en séance sur ce texte, qu'il ne fallait pas définir d'objectifs chiffrés par catégorie d'énergie...
Enfin, nous justifions collectivement un régime particulier pour l'hydroélectricité par les différents usages de l'eau et la protection de l'environnement. Si nous nous opposons à la privatisation, ce n'est pas seulement parce que les investissements réalisés l'ont été par la collectivité et que les risques sont considérables - les plus importants après ceux liés au nucléaire. C'est aussi du fait des enjeux liés aux usages de l'eau. Or il semble que la réduction des normes environnementales, écartée lors des débats sur la proposition de loi dite « Gremillet », fasse son retour dans ce rapport. Ces éventuelles évolutions de la hiérarchie des usages de l'eau nous inquiètent, d'autant qu'elles pourraient être incompatibles avec la directive dite « Eau ».
Nous découvrons ce rapport, que nous étudierons avec attention. Mais le flou du régime proposé nous inquiète. Quid, à terme, de la propriété des grands barrages, de la propriété foncière ? EDF devra-t-elle racheter ses propres barrages ? À quel prix les 6 GW d'électricité seront-ils vendus et ne va-t-on pas permettre, une nouvelle fois, à certains acteurs de se faire beaucoup d'argent sur des infrastructures relevant de la collectivité ?
Certes, le rapport propose des garanties, mais qui nous paraissent fragiles, notamment en ce qui concerne l'évaluation du prix des ouvrages et la capacité de l'État à s'opposer à des cessions.
Nous ne soutenons donc pas ces propositions. La quasi-régie, qui n'avait pas été exclue par la Commission européenne, serait à nos yeux une meilleure solution. Le débat existe, y compris entre les organisations syndicales rattachées aux barrages.
Mme Martine Berthet. - Merci aux quatre rapporteurs pour leur travail et ces propositions. Sénatrice de la Savoie, département qui compte le plus grand nombre de concessions, je suis particulièrement sensible à ce sujet.
Un important travail juridique et financier sera nécessaire, mais il est temps d'avancer, et la proposition de loi dite « Gremillet » nous en donne l'occasion.
Les élus des territoires concernés sont très attachés au maintien des redevances, destinées à compenser des nuisances et difficultés diverses.
La situation actuelle aurait pu être évitée si nous avions été plus proactifs au moment de l'élaboration de la directive dite « Concession ». Il faut désormais travailler à sa modification - c'est l'objet de votre dernière proposition.
S'agissant de la transition vers le régime d'autorisations, je m'interroge : se fera-t-elle au fur et à mesure de l'échéance des concessions ou au même moment pour toutes ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. - Madame Berthet, la transition se fera au fur et à mesure que les concessions arriveront à échéance.
Une éventuelle révision de la directive européenne nous amènerait à je ne sais quand... Or nous avons déjà perdu assez de temps, notamment au regard de l'urgence climatique, que nul ne conteste.
Contrairement à vous, monsieur Jadot, nous considérons que notre proposition renforce la place de l'eau et la gestion de celle-ci. En particulier, elle vise à assurer une cohérence territoriale de cette gestion, utile, par exemple, pour la gestion des risques - qu'il s'agisse de la pénurie ou de l'excès d'eau.
M. Fabien Gay, rapporteur. - Tout le monde est conscient du retard pris. Si nous ne sortons pas du blocage, les investissements seront encore différés.
La meilleure solution aurait été de conserver l'existant, mais ce n'est pas possible. Parmi les options possibles, il y a, en effet, la quasi-régie, que le président Guillaume Gontard, notamment, avait défendue. Pour ma part, je défends la position que soutiennent toutes les organisations syndicales représentatives. Je dis bien : toutes. Seule l'organisation SUD, qui n'est pas représentative - nous l'avons pourtant auditionnée aussi - et que l'on sait très liée à La France insoumise (LFI), soutient plutôt la quasi-régie.
Pourquoi ai-je, avec mon groupe, voté contre la quasi-régie ? Parce que nous étions en pleine bagarre contre le projet dit « Hercule », de l'ancien président-directeur général Jean-Bernard Lévy, dont elle faisait partie. Il s'agissait de scinder l'entreprise en trois et d'en privatiser une partie. Tous les syndicats étaient donc fermement opposés à la quasi-régie et le restent.
Nul ne nie les incertitudes qui entourent le futur régime d'autorisations. En particulier, nous avons débattu entre nous de la compensation, qui doit être la plus limitée possible. S'il s'agit d'instaurer un « Arenh hydraulique », c'est non : nous sommes unanimes sur ce point.
La solution proposée est la moins mauvaise et permet de régler le problème. Tout le monde ou presque y souscrit : Gouvernement, quasi-totalité des groupes parlementaires, ensemble des syndicats, élus locaux. Quant aux risques, il faut les traiter, y compris dans le volet législatif de la réforme.
Soit nous adoptons cette solution, soit nous restons dans l'expectative et continuons de ne pas avancer. Quant au retour du projet dit « Hercule », je ne peux pas le soutenir.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. - Je souligne à mon tour que nous avons auditionné toutes les organisations syndicales et qu'une seule a émis un avis divergent.
Certes, c'est au moment de la préparation de la directive qu'il fallait faire le match. Mais, au point où nous en sommes, tout retard supplémentaire serait très défavorable à l'intérêt général.
Il n'y a sans doute pas de système parfait, mais celui que nous proposons permet au moins de redémarrer. Voyez la CNR : elle réinvestit. Il est vrai qu'une validation de la Commission européenne était prévue, alors que, dans les autres cas, il faudra aller la chercher.
Second petit regret : dans la proposition de loi de programmation énergétique, nous avions insisté pour expérimenter le régime d'autorisations ; si nous l'avions fait, nous pourrions déjà en mesurer les avantages et les inconvénients.
Si nous ne prenons pas ce petit chemin, nous resterons à l'arrêt.
Nous avons, tous les quatre, travaillé avec objectivité et en écoutant les uns et les autres. Quand un consensus se dégage des auditions, il est important d'en tenir compte.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. - La situation est ubuesque : alors que le système actuel fonctionne plutôt bien, nous sommes obligés d'inventer des solutions pour pouvoir continuer à produire.
La révision de la directive, nous continuerons d'y travailler ; mais elle prendra des années, notamment parce que, aujourd'hui, nous manquons d'alliés.
La solution que nous préconisons nous paraît la moins mauvaise. Mais ce n'est que le début d'un processus : nous devons travailler aux modalités d'application de l'accord de principe, afin d'éliminer les biais que les uns et les autres ont évoqués.
Au fil des auditions, nous nous sommes aperçus que nous perdions 10 % de production faute de pouvoir produire mieux avec les barrages existants, notamment via des stations de transfert d'énergie par pompage (Step).
Enfin, nous avons auditionné aussi nos collègues députés ; nous sommes tous parfaitement en phase.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. - J'ajoute, en réponse à M. Jadot, que nous proposons des objectifs quantifiés dans le décret, non dans la loi. De fait, la filière a besoin d'objectifs. Mais nous restons fidèles aux positions prises sur ma proposition de loi.
Tout le monde a été auditionné ; nous n'avons oublié personne. La France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir réglé ce problème. Les deux assemblées et le Gouvernement ont la même position : c'est l'occasion de sortir d'une impasse qui a trop duré et qui nous pénalise économiquement - sans compter que, en matière d'hydroélectricité, tout le matériel est français ! Les enjeux environnementaux aussi, que l'on n'évoquait pas au début du conflit avec Bruxelles, mais qui sont majeurs, plaident pour l'option que nous proposons.
Venus d'horizons politiques différents, nous avons trouvé un chemin dans l'intérêt de notre pays et de nos territoires. Aujourd'hui, les planètes sont assez bien alignées pour sortir de ce trop long contentieux.
Les recommandations sont adoptées.
La mission d'information adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Jeudi 15 mai 2025
- Électricité de France (EDF) : Mmes Emmanuelle VERGER, directrice d'EDF Hydro, Ludivine OLIVE, directrice des relations institutionnelles d'EDF Hydro, et M. Florent JOURDE, directeur adjoint des affaires publiques.
Mardi 20 mai 2025
- Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg) : M. Géry LECERF, président.
- Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode) : MM. Julien TCHERNIA, président, et Ali HAJJAR, vice-président.
- Compagnie nationale du Rhône (CNR) : Mme Laurence BORIE-BANCEL, présidente du directoire, MM. Thomas SAN MARCO, directeur exécutif des affaires publiques et de la communication, Philippe MAGHERINI, directeur exécutif des affaires régulatoires et juridiques, et Mme Bernadette LACLAIS, directrice des affaires publiques.
- Engie : MM. Jean-Baptiste SÉJOURNÉ, directeur Régulation, Christophe THOMAS, directeur des relations externes, et Mme Océane PEYLACHON, chargée des relations avec le Parlement.
- Société hydroélectrique du Midi (Shem) : M. Samuel RENARD, directeur général.
- France Hydroélectricité (FH) : Mme Anne PENALBA, vice-présidente, et M. Jean-Marc LÉVY, délégué général.
- Commission de régulation de l'énergie (CRE) : Mmes Emmanuelle WARGON, présidente, Anne-Sophie DESSILLONS, directrice du développement des marchés et de la transition énergétique, et M. Aodren MUNOZ, responsable des relations institutionnelles.
- Commission européenne - Direction générale de la concurrence (DG COMP) : Mmes Anna COLUCCI, directrice à la direction B - énergie et environnement, Marieke SCHOLZ, chef d'unité Antitrust, MM. Flavien CHRIST, senior expert Antitrust, Nicola PESARESI, chef d'unité Aides d'État, et Mme Violetta IFTINCHI, chargée de dossier Aides d'État.
- Commission européenne - Direction générale de l'énergie (DG ENER) : Mmes Annamaria MARCHI, chef d'unité adjoint - Marché intérieur de l'énergie, et Mathilde LALLEMAND DUPUY, chef d'équipe - Marché intérieur de l'énergie.
- Commission européenne - Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (DG GROW) : MM. Salvatore D'ACUNTO, chef d'unité - marché unique, contrôle de l'application et suppression des obstacles - mise en oeuvre, Javier PALMERO ZURDO, chef d'unité adjoint, Robert WEIN, administrateur, et Sébastien PECHBERTY, administrateur.
- Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne : MM. Axel DEMENET, conseiller Concurrence et aides d'État, et Jean-Luc VIETTE, conseiller Concurrence et aides d'État.
- Solidaires-Énergie (SUD-Énergie) : Mme Anne DEBREGEAS, porte-parole.
- Confédération française de l'encadrement-Énergies (CFE-Énergies) : MM. Alexandre GRILLAT, secrétaire général, et Emmanuel GOOSSENS, secrétaire fédéral.
- Fédération nationale des mines et de l'énergie - Confédération générale des travailleurs (FNME-CGT) : MM. Fabrice COUDOUR, secrétaire général, et Jean-Damien NAVARRO, collectif hydraulique fédéral.
- Force Ouvrière-Énergie (FO-Énergie) : M. Paul GUGLIELMI, délégué syndical central - délégué fédéral, et Mme Armelle RYCKELYNCK, secrétaire fédérale en charge du secteur Hydro.
- Confédération fédérale des travailleurs Hydro (CFDT Hydro) : Mme Catherine CUTIVET, délégué coordonnateur du groupe EDF, et M. Michel LOZANO, délégué coordonnateur du groupe EDF.
Mardi 27 mai 2025
- Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : MM. Laurent KUENY, directeur de l'énergie, et François LAILHEUGE, adjoint au chef du bureau des énergies renouvelables hydrauliques et marines, en charge de l'hydroélectricité.
- Assemblée nationale : Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, députée, et M. Philippe BOLO, député.
Mardi 10 juin 2025
- Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : M. Marc FERRACCI, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, Mme Violaine TARIZZO, conseillère énergies fossiles, marchés carbone et certificats d'économie d'énergie, et M. Boris MAZEAU, conseiller chargé du Parlement et des élus.
- Électricité de France (EDF) : M. Bertrand FONTANA, président-directeur général, Mme Emmanuelle VERGER, directrice d'EDF hydro, et M. Florent JOURDE, directeur adjoint des affaires publiques.
Mercredi 11 juin 2025
- Départements de France (DF) : MM. Martial SADDIER, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Édouard GUILLOT, conseiller en charge des dossiers de l'énergie et de l'environnement, et Mme Marylène JOUVIEN, chargée des relations avec le Parlement.
- Association nationale des élus de la montagne (Anem) : MM. Jean-Pierre VIGIER, président, Olivier RIFFARD, délégué général, et Charles MEILLER, conseiller.
- Association nationale des élus des bassins (Aneb) : M. Bruno FOREL, président, et Mme Catherine GREMILLET, directrice.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg)
- Association nationale des élus des bassins (Aneb)
- Association nationale des élus de la montagne (Anem)
- Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode)
- Confédération fédérale des travailleurs Hydro (CFDT Hydro)
- Commission de régulation de l'énergie (CRE)
- Commission européenne :
· Direction générale de la concurrence (DG COMP)
· Direction générale de l'énergie (DG ENER)
· Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (DG GROW)
- Compagnie nationale du Rhône (CNR)
- Départements de France (DF)
- Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)
- Électricité de France (EDF)
- Engie
- Fédération nationale des mines et de l'énergie - Confédération générale des travailleurs (FNME CGT)
- Force Ouvrière-Énergie (FO-Énergie)
- France Hydroélectricité (FH)
- Société hydroélectrique du Midi (Shem)
- Solidaires-Énergie (SUD-Énergie)
- Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Évaluer l'impact financier d'un changement de régime, via la Cour des comptes, et la robustesse technique d'un tel changement, via le Conseil d'État |
Gouvernement Cour des comptes Conseil d'État |
6 mois |
Rapport d'évaluation Avis juridique |
|
2 |
Ne légiférer qu'en possession d'une lettre de confort de la Commission européenne garantissant la compatibilité du changement de régime avec le droit de l'Union européenne |
Gouvernement Commission européenne |
6 mois |
Lettre de confort |
|
3 |
Compte tenu de l'urgence de la situation, légiférer préférentiellement par le biais d'amendements à la proposition de loi dite « Gremillet », dès son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale |
Gouvernement Assemblée nationale |
1 an |
Amendements à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
4 |
Exclure du changement de régime la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ainsi que les concessions pour lesquelles la production d'électricité est accessoire (Seine, Moselle) ou qui sont régies par des accords internationaux (Rhin, Doubs, l'Arve, Émosson) |
Gouvernement Parlement EDF CNR |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
5 |
Garantir la juste évaluation des indemnités de résiliation des contrats de concession et des prix de cession des ouvrages hydroélectriques transférés par une commission d'experts indépendants |
Gouvernement Parlement EDF |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
6 |
Prévoir la faculté pour l'État de s'opposer à la cession des ouvrages hydroélectriques transférés ainsi qu'un haut niveau de contrôle par ce dernier de l'organisation et de l'exploitation de ces ouvrages |
Gouvernement Parlement EDF |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
7 |
Confier à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'encadrement de la contrepartie envisagée au maintien des exploitants historiques |
Gouvernement Parlement CRE EDF |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » Évolution des décisions de la CRE |
|
8 |
Garantir dans cette contrepartie le maintien de la gestion opérationnelle des installations hydrauliques par leur propriétaires et la limiter à une part temporaire et limitée de la commercialisation de l'électricité issue des installations hydrauliques |
Gouvernement Parlement EDF |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
9 |
Préserver le statut national des personnels des industries électriques et gazières (IEG) |
Gouvernement Parlement EDF |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
10 |
Consolider les compétences du ministre chargé de l'énergie sur les installations hydrauliques et simplifier les normes environnementales applicables aux projets hydroélectriques |
Gouvernement Parlement |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
11 |
Préserver la perception des redevances par les collectivités territoriales et de leurs groupements, en privilégiant un dispositif calé sur les concessions non échues, c'est-à-dire excluant le revenu normatif et le prix cible |
Gouvernement Parlement |
1 an |
Modification législative, dans le cadre de la prochaine loi de finances |
|
12 |
Consolider une gouvernance tripartite de l'eau entre l'État, les collectivités territoriales et les exploitants des installations hydrauliques |
Gouvernement Parlement |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi dite « Gremillet » |
|
13 |
Intégrer la résilience au changement climatique dans les missions des installations hydrauliques |
Gouvernement Parlement EDF |
1 an |
Modification législative, préférentiellement par amendement à la proposition de loi « Gremillet » Évolution des cahiers des charges des concessions |
|
14 |
Au-delà, intégrer le chantier du changement de régime des concessions vers les autorisations dans le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en fixant des objectifs précis au Gouvernement visant à : - atteindre une capacité installée totale pour l'hydroélectricité de 29 gigawatts (GW) d'ici 2035 ; - opérer le passage pour les concessions hydroélectriques du régime des concessions vers celui des autorisations, en instituant une contrepartie au maintien des exploitants historiques sur la production d'hydroélectricité du groupe EDF ; - laisser inchangée la concession du Rhône attribuée à la CNR, a minima jusqu'à son expiration le 31 décembre 2041 ; - négocier l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. |
Gouvernement |
6 mois |
Modification du décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) |
|
15 |
Au-delà, négocier l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 |
Gouvernement Commission européenne |
5 ans |
Révision de la directive du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession |
* 1 Notamment avec l'Allemagne et la Suisse.
* 2 Site de la Société hydroélectrique du Midi (Shem), consultable ici.
* 3 Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), Réponse au questionnaire budgétaire du Rapporteur Daniel Gremillet, sur les crédits « Énergie » de la mission « Écologie », du projet de loi de finances initiale pour 2025.
* 4 Idem.
* 5 Site du ministère chargé de l'écologie, consultable ici.
* 6 L'article R. 214-1 du code de l'environnement soumet à la nomenclature IOTA les installations, ouvrages ou travaux « constituant un obstacle à la continuité écologique », c'est-à-dire, soit « entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation », soit « entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ».
* 7 Lorsqu'elle existe, la commission locale de l'eau (CLE), mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, tient lieu du comité de suivi de l'exécution de la concession et de gestion de l'eau, prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie.
* 8 Commission de régulation de l'énergie (CRE), Rapport Coût et rentabilités de la petite hydroélectricité en métropole continentale, janvier 2020, p. 8.
* 9 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan électrique 2023, p. 24.
* 10 Commission de régulation de l'énergie (CRE), Rapport Coût et rentabilités de la petite hydroélectricité en métropole continentale, janvier 2020, p. 7.
* 11 Électricité de France (EDF), réponse au questionnaire du rapporteur Patrick Chauvet sur la proposition de loi n° 813, déposée le 1er septembre 2021.
* 12 Engie, réponse au questionnaire du rapporteur Patrick Chauvet sur la proposition de loi n° 813, déposée le 1er septembre 2021.
* 13 Il s'agit des grandes unités du groupe.
* 14 Engie, réponse au questionnaire du rapporteur Patrick Chauvet sur la proposition de loi n° 813, déposée le 1er septembre 2021.
* 15 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan électrique 2023, p. 31.
* 16 Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTE), Chiffres clés des énergies renouvelables, Édition 2024, pp. 6 , 11 et 40.
* 17 Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTE), Chiffres clés des énergies renouvelables, Édition 2024, p. 40.
* 18 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Document des jeux de données monocritères issus de la Base Carbone, Catégorie 2 : Émissions directes - énergie, 2025.
* 19 Ministère de la transition écologique et solidaire (MTE), Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2029-2023 et 2024-2028, 2020, p. 115.
* 20 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Étude Marchés et emplois dans le domaine des énergies renouvelables, 2014-2016, mars 2019.
* 21 Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).
* 22 Dont l'énergie marémotrice.
* 23 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan électrique 2023, p. 24.
* 24 Dont les stations d'énergie par pompage (STEP).
* 25 Le chiffrage s'élève même à 28,7 GW d'ici 2035 dans le projet de décret sur la PPE.
* 26 Il s'agit de la date de transposition de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
* 27 Selon le chiffrage établi le 25 mars 2025.
* 28 Idem.
* 29 Idem.
* 30 Il s'agit de la date d'adoption du décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
* 31 Idem.
* 32 Notamment les décisions de renouvellement des concessions de Camon et de Valentine (18 décembre 2008), de Kembs (17 juin 2009), de Moyenne Romanche (29 décembre 2010) et de Romanche-Gavet (29 décembre 2010).
* 33 Décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
* 34 Affaire C-354/08.
* 35 Décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
* 36 Décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
* 37 Conseil d'État, 7e - 2e chambres réunies, 12/04/2022, 434 438.
* 38 Décret n° 2019-212 du 20 mars 2019 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne.
* 39 CJCE 18 nov. 1999, aff. C-107/98, « Teckal SRL c/Cne Viano ».
* 40 Depuis ll'article L. 2511-7 du code de la commande publique a prévu une telle dérogation aux règles de mise en concurrence, elle-même permise par l'article 13 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2024 sur l'attribution de contrats de concession.
* 41 Mais aussi aux hypothèses, non envisagées par l'État et le groupe EDF, d'une régie, d'un service d'intérêt économique général (SIEG) ou d'un établissement public industriel et commercial (EPIC).
* 42 Considérant que cette option n'exclut pas la mise en concurrence.
* 43 Estimant que cette option ne règle pas le différend européen.
* 44 Pour des raisons proches.
* 45 A minima jusqu'à son échéance le 31 décembre 2041.
* 46 À la maille de l'ensemble des concessions qu'ils exploitent, de manière à prohiber le rachat par l'exploitant des concessions les plus rentables ou les plus intéressantes.
* 47 Une procédure de mise en concurrence étant prévue en cas de refus des anciens concessionnaires d'exercer leur droit de priorité pour l'acquisition des ouvrages.
* 48 Englobant l'autorisation environnementale, mais non l'autorisation au titre de la loi sur l'eau.
* 49 Pour les installations hydrauliques supérieures à 100 MW.
* 50 Pour les installations hydrauliques inférieures à 100 MW.
* 51 Déterminé par des experts indépendants, cette soulte pourrait correspond au prix de vente des ouvrages aux exploitants historiques, diminué de leur éventuelle indemnisation au titre de la résiliation anticipée des concessions non échues.
* 52 Premier ministre, Communiqué de presse « Le Premier ministre salue le franchissement d'une étape importante pour la relance des investissements dans le secteur de l'hydroélectricité », 28 août 2025.
* 53 Sénat, rapport n° 642 (2023-2024), déposé le 29 mai 2024, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, p. 178.
* 54 Notamment avec l'Allemagne et la Suisse.
* 55 Mentionné au C de l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 21 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et à l'article 70 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
* 56 Mentionné à l'article L. 511-14 du code de l'énergie.
* 57 Dont l'énergie marémotrice.
* 58 Dont les stations d'énergie par pompage (STEP).
* 59 Sénat, rapport n° 642 (2023-2024), déposé le 29 mai 2024, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, pp. 72 et 73.