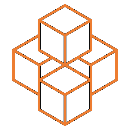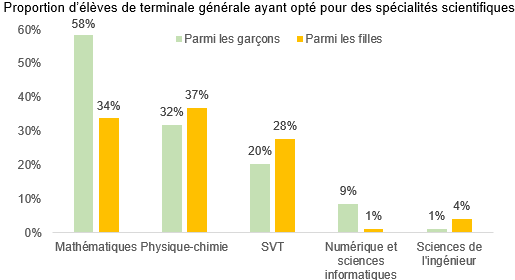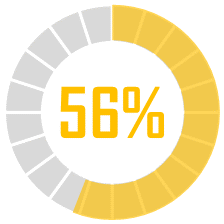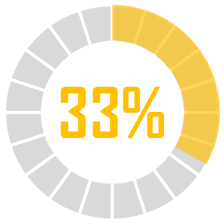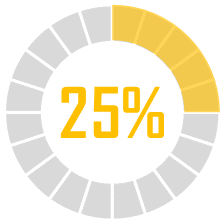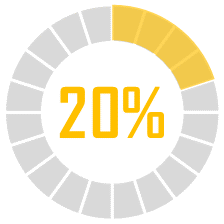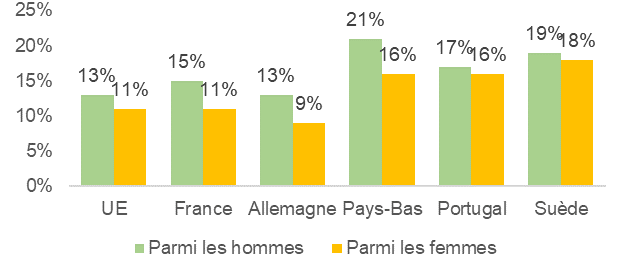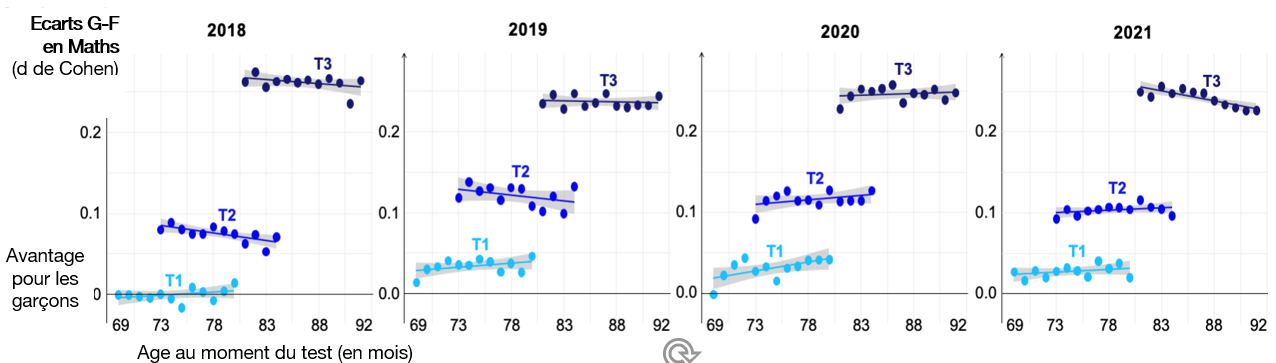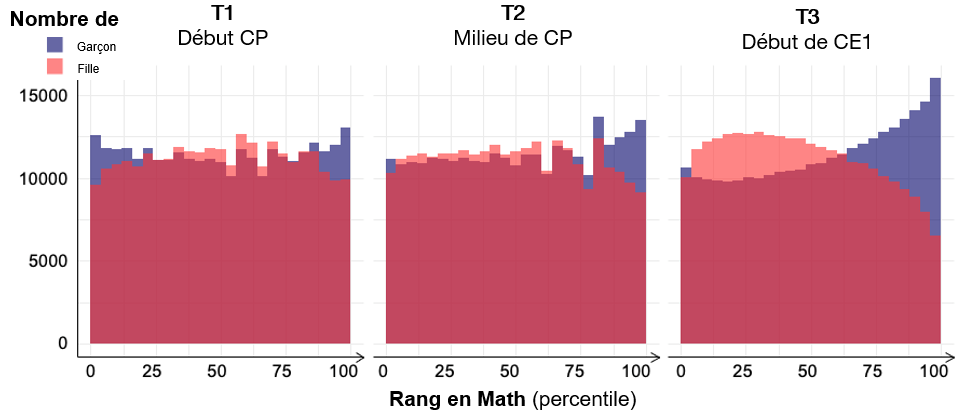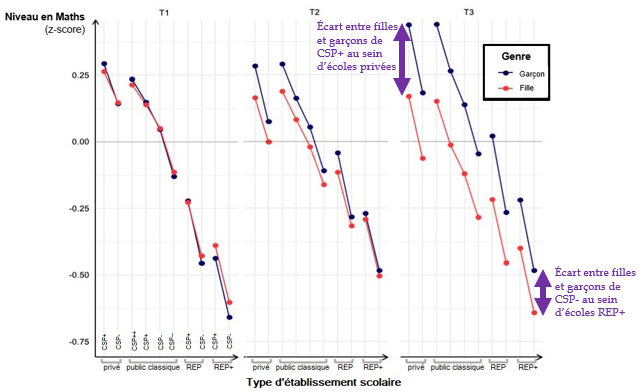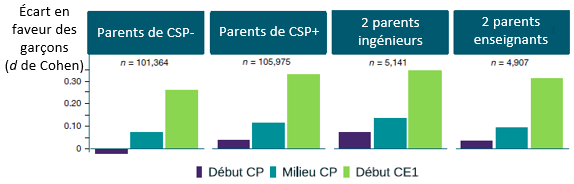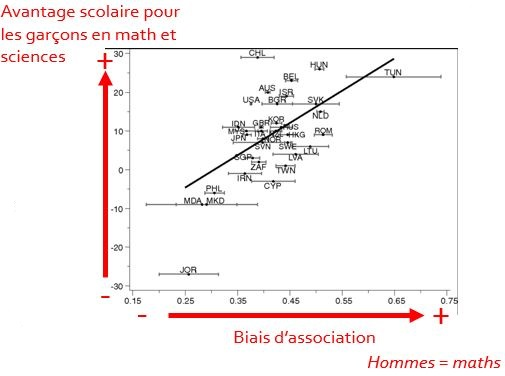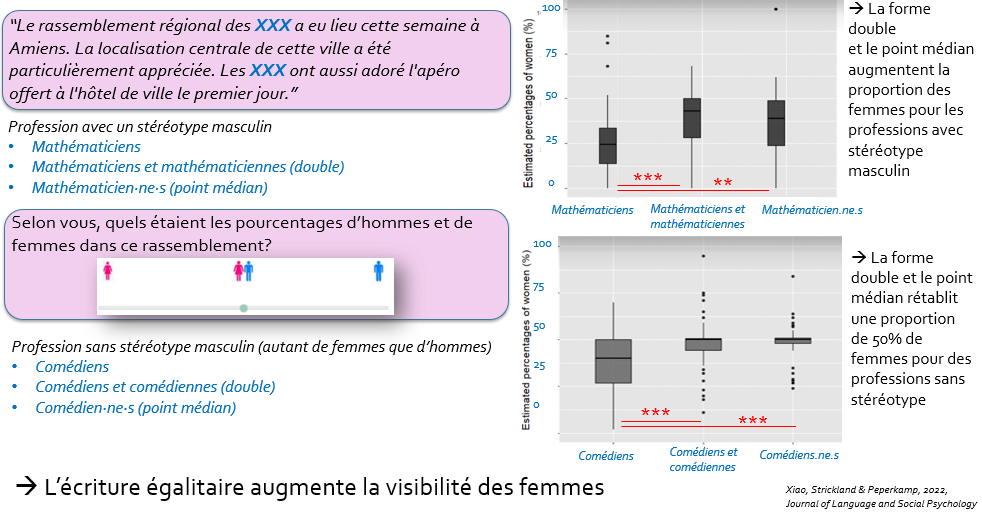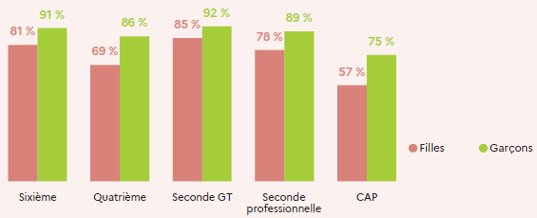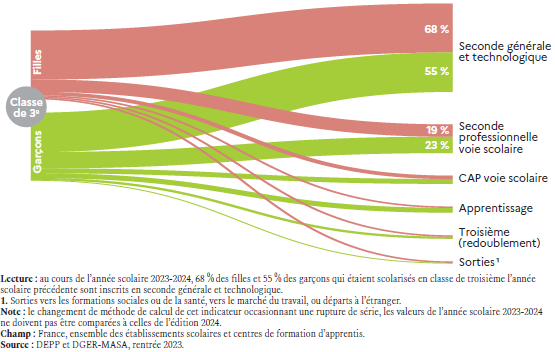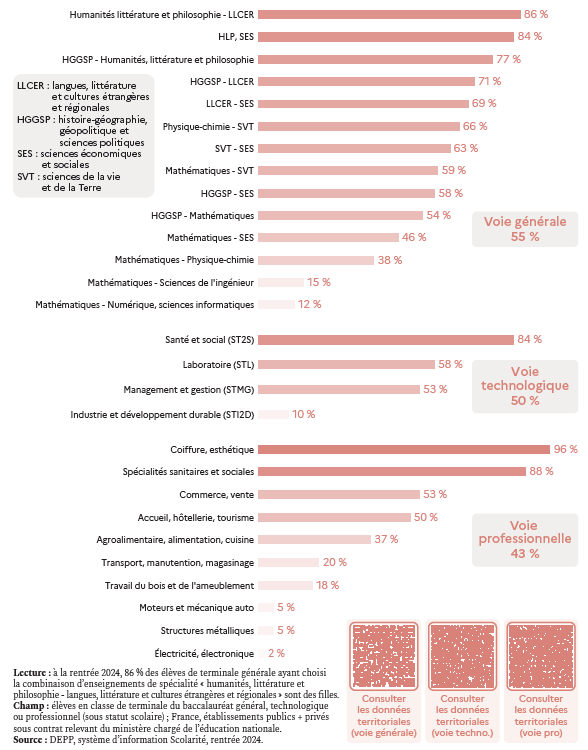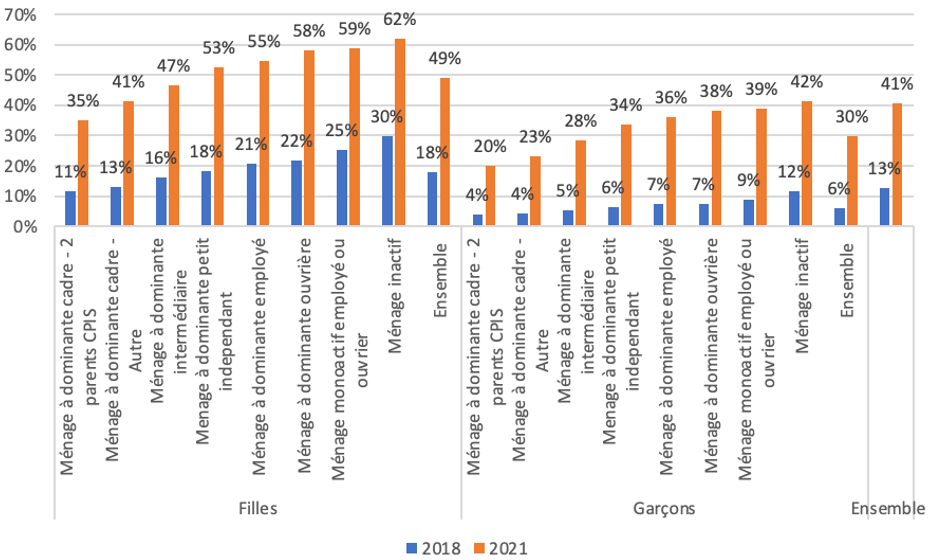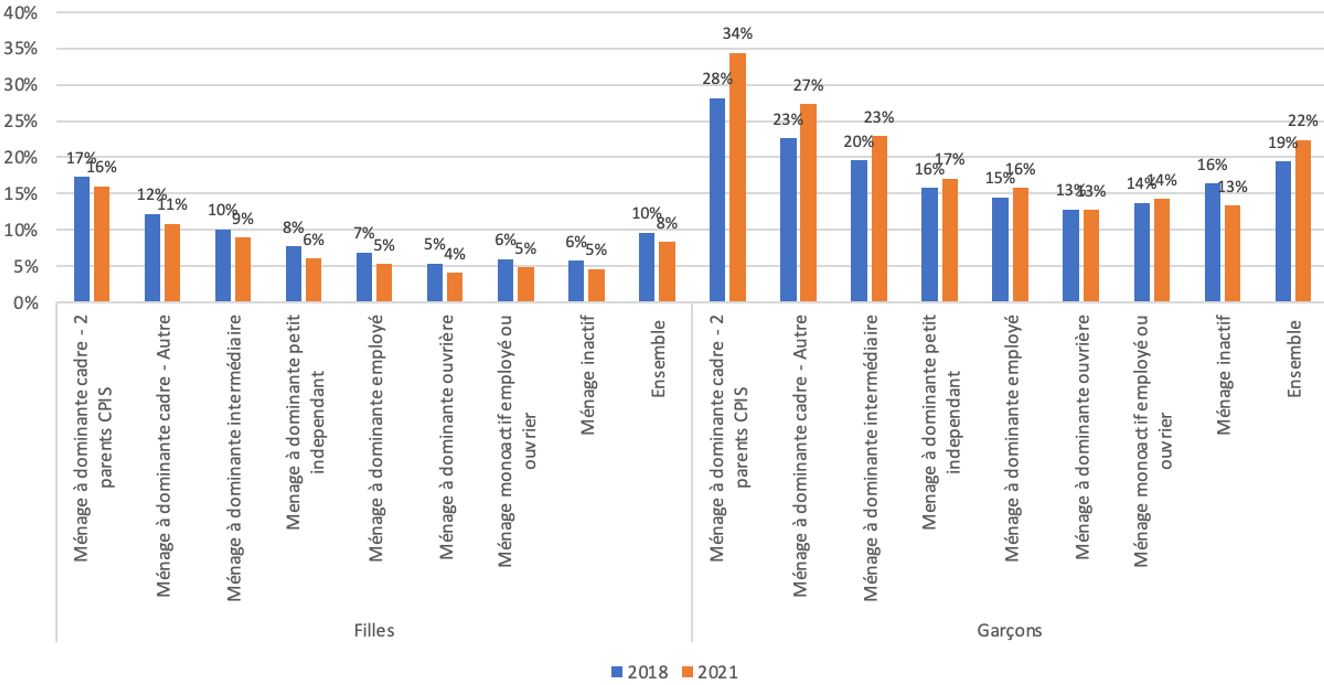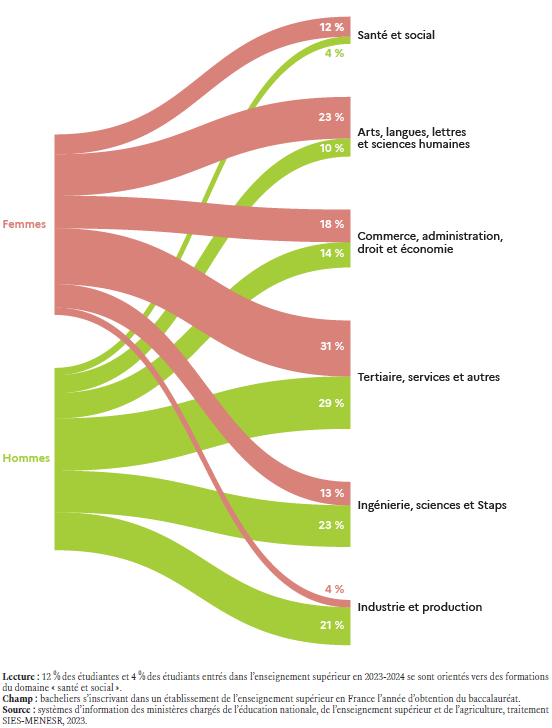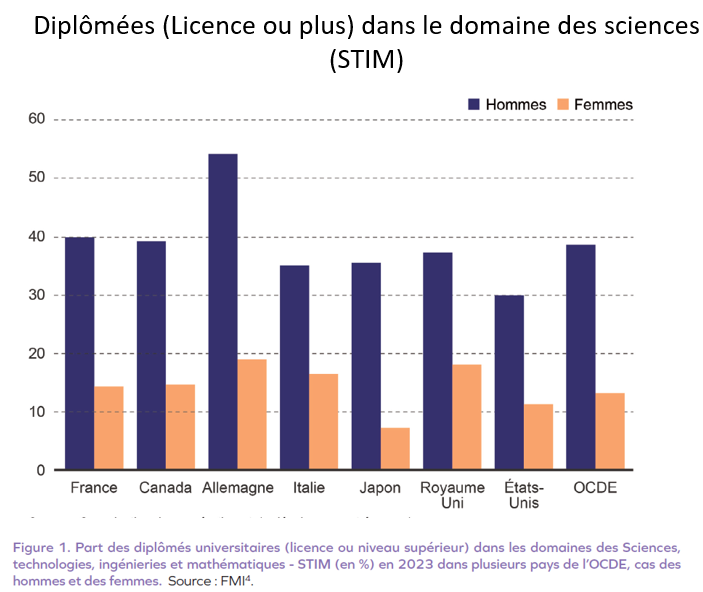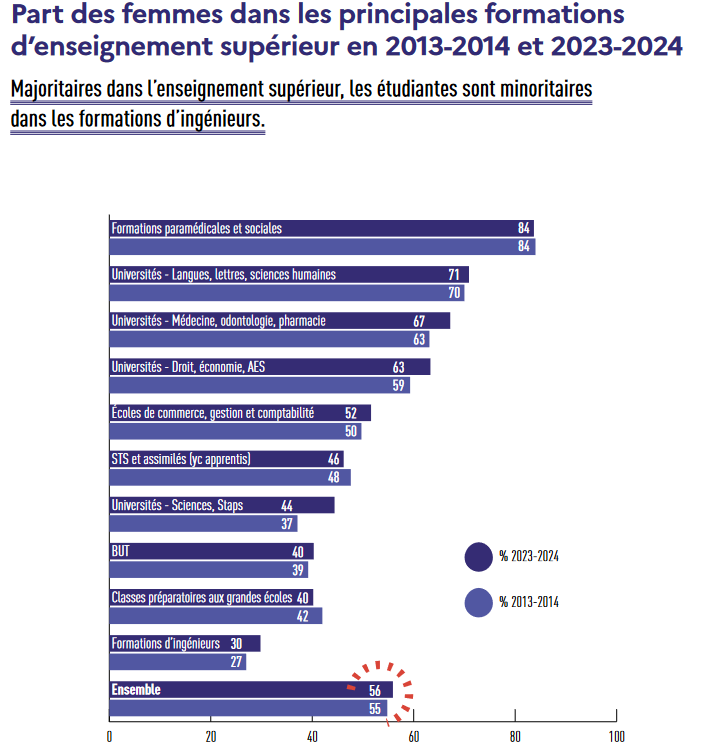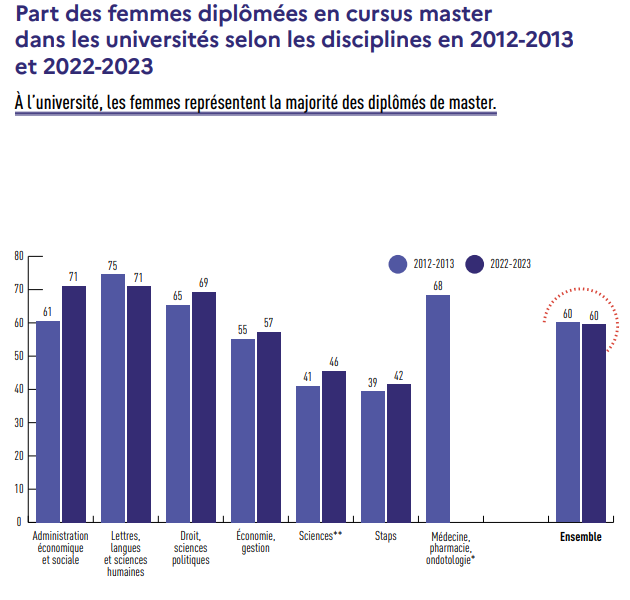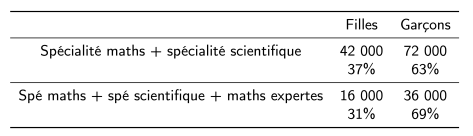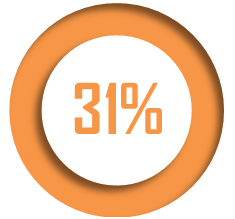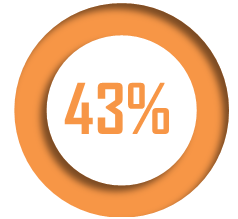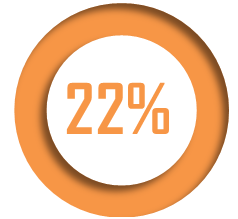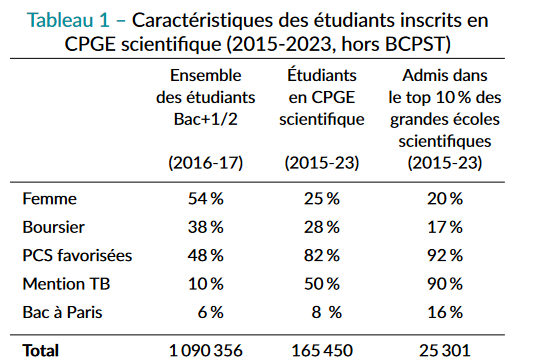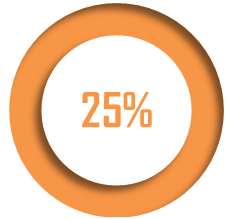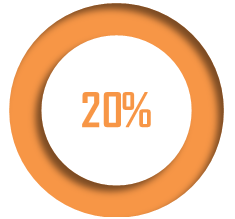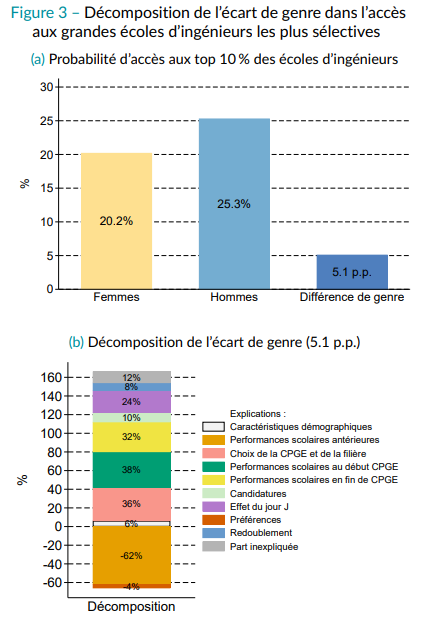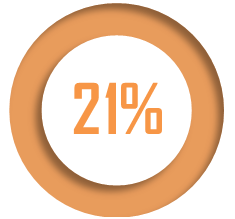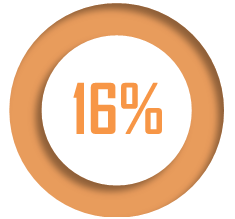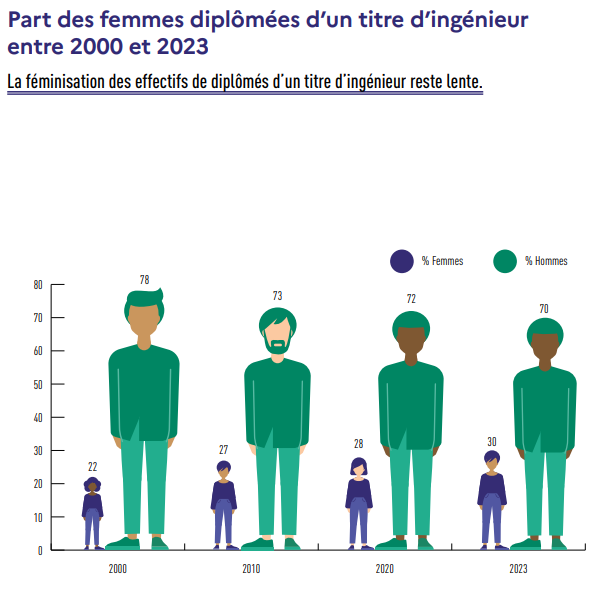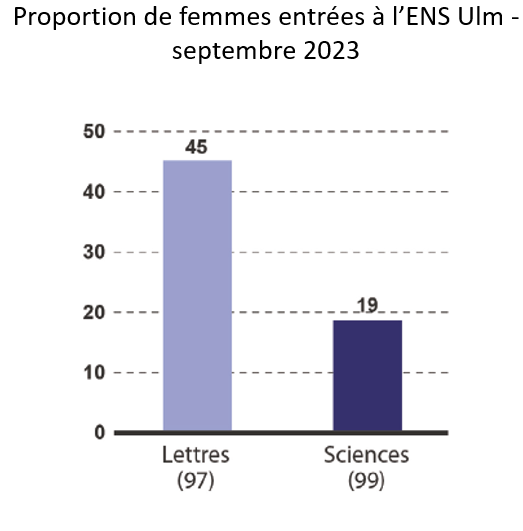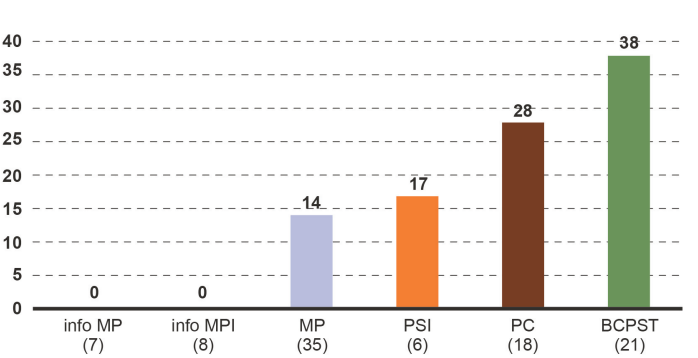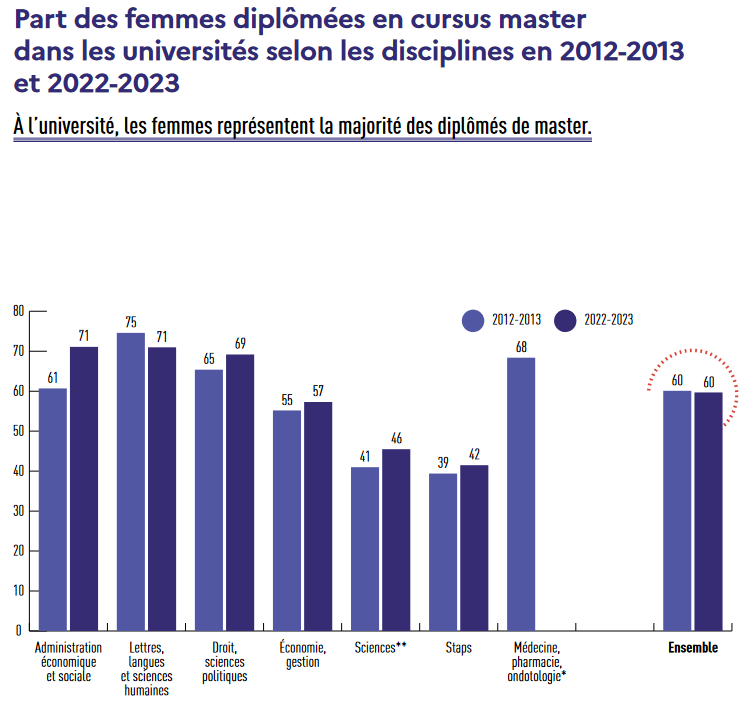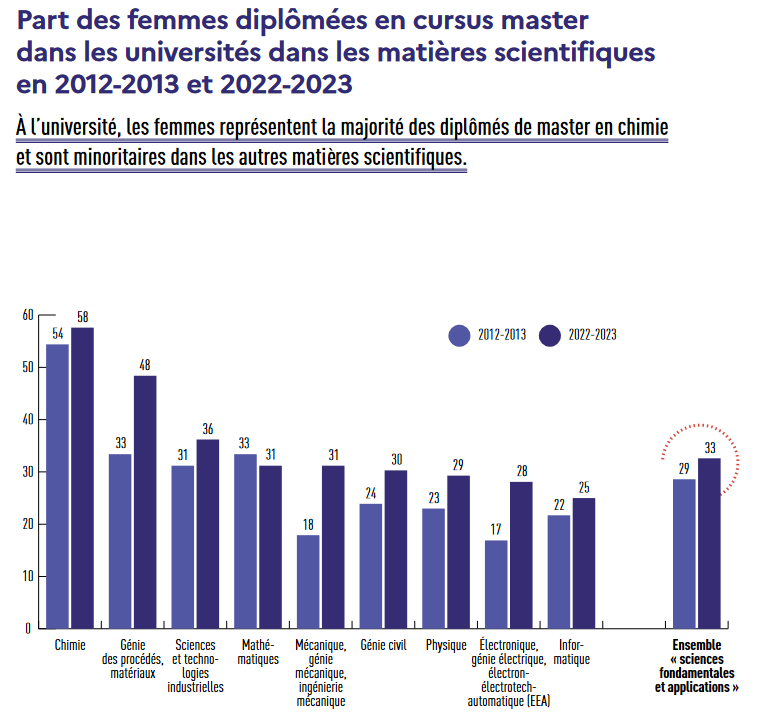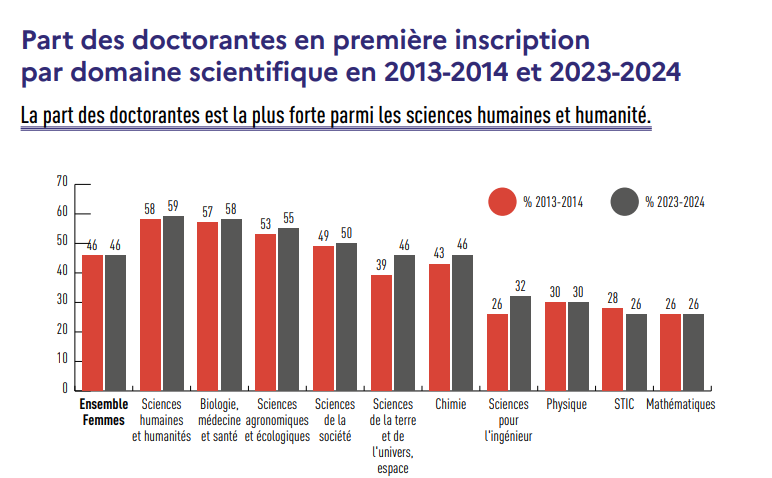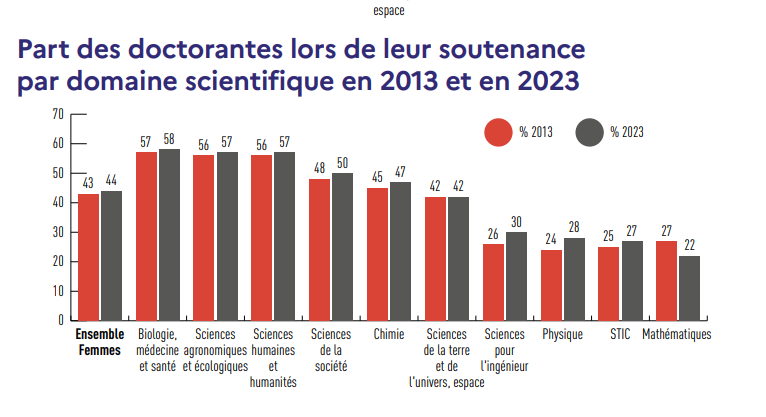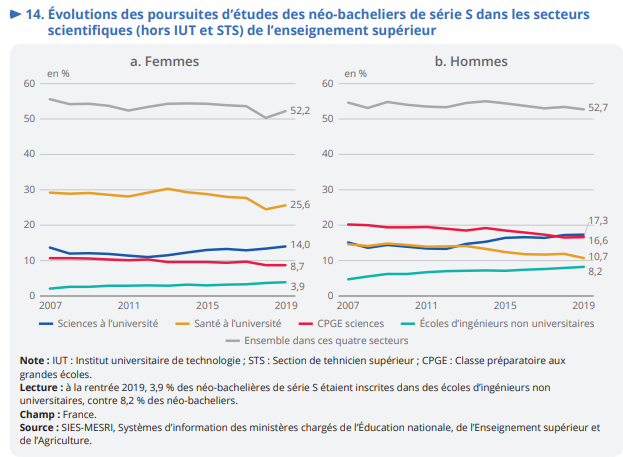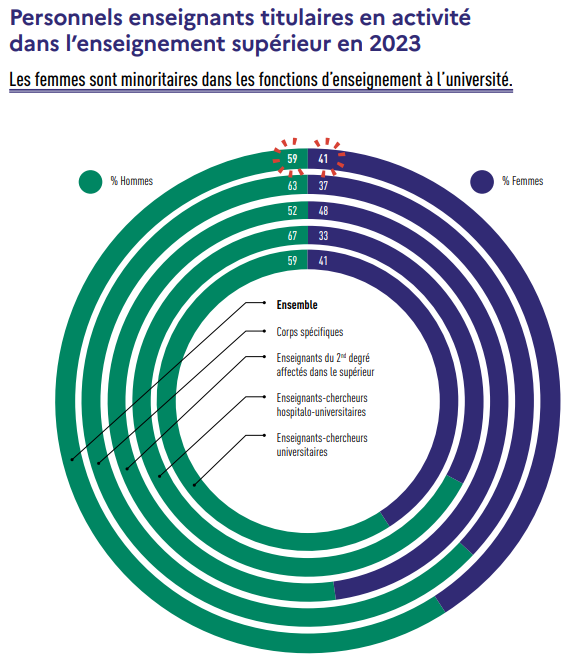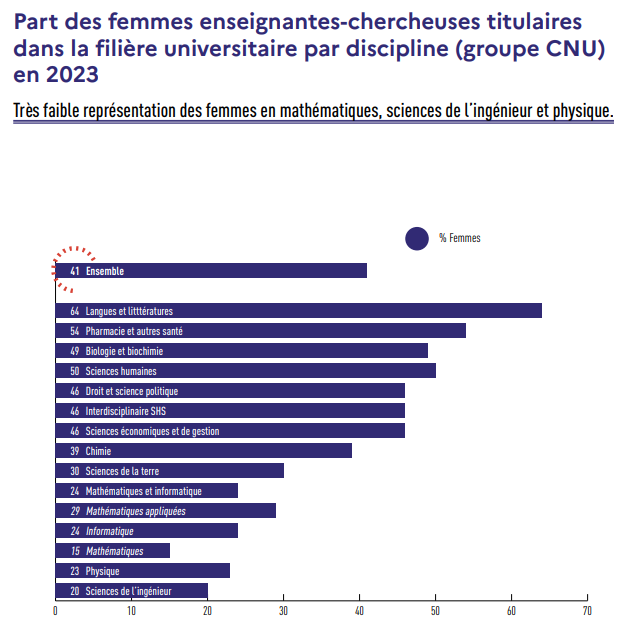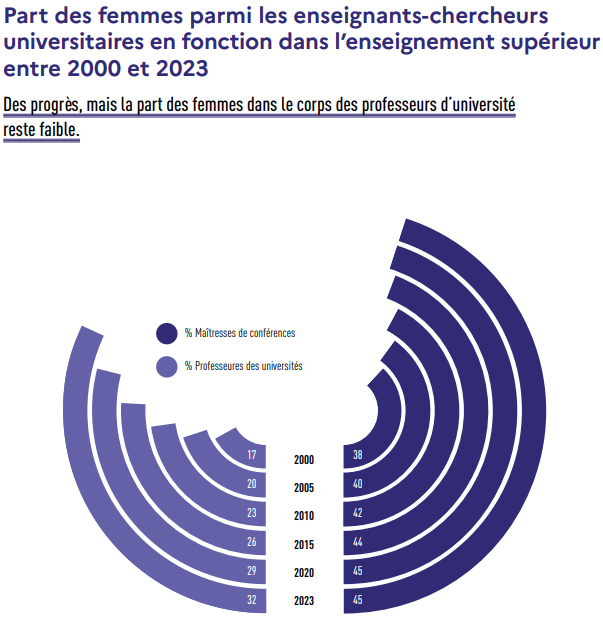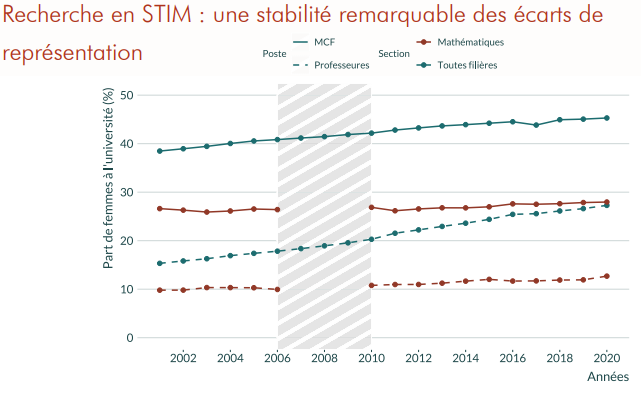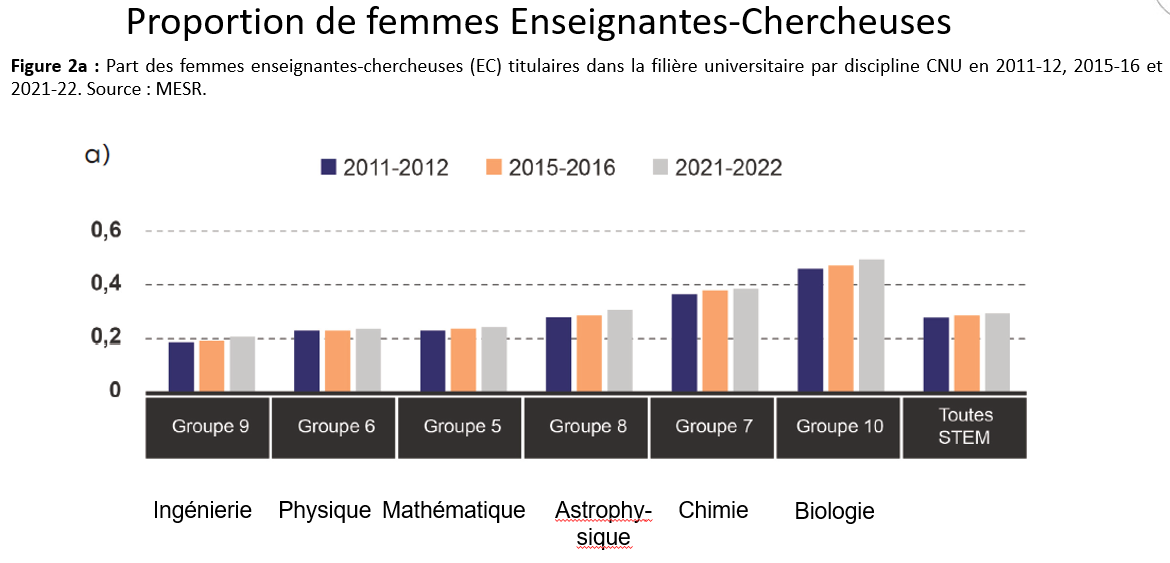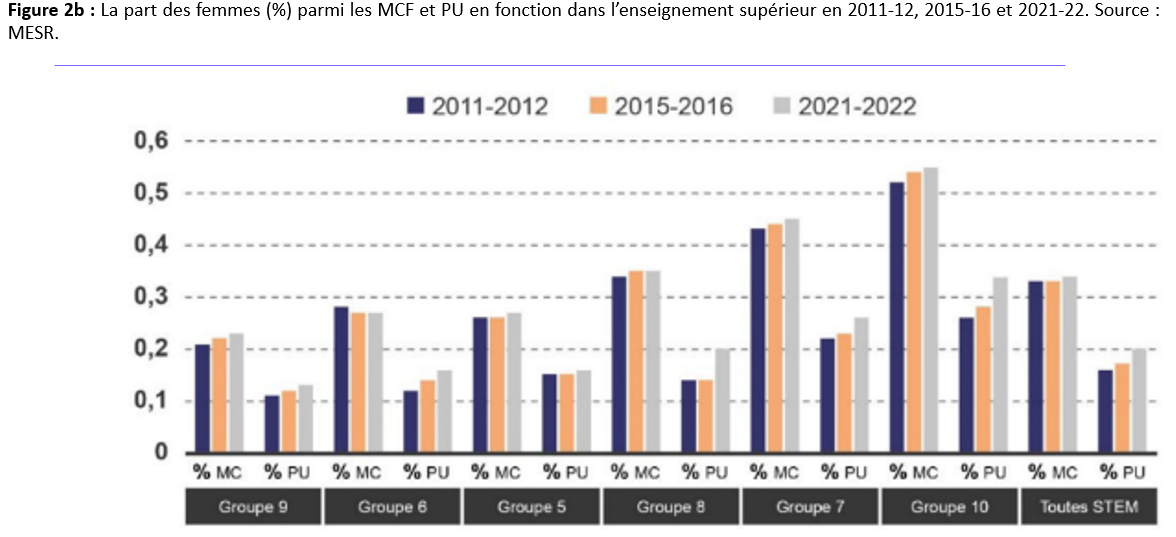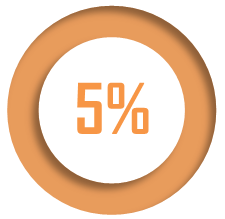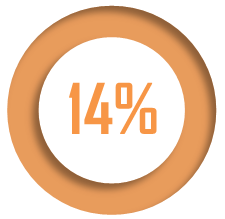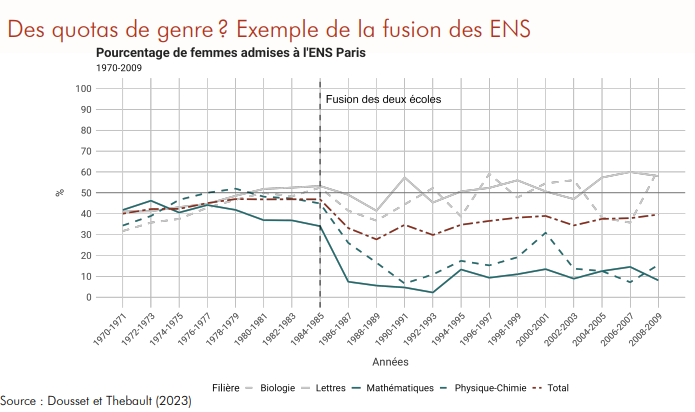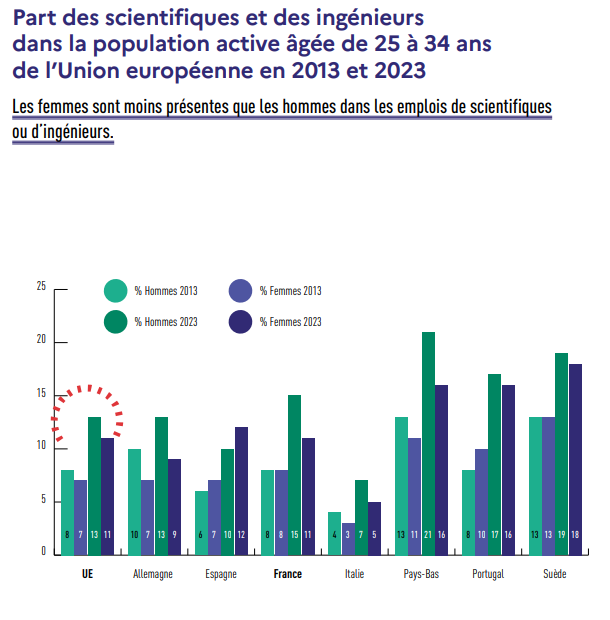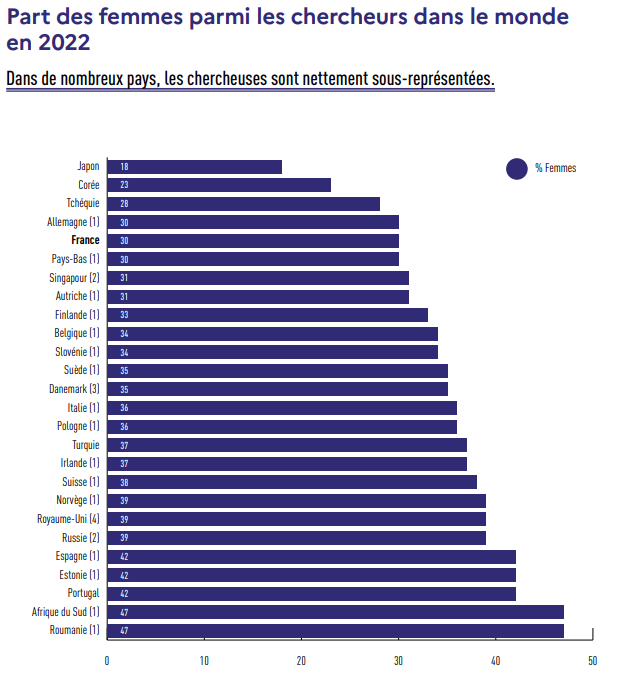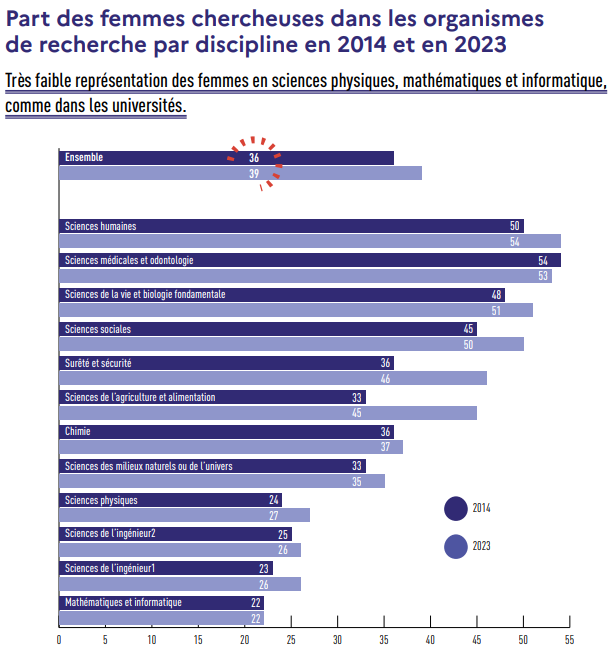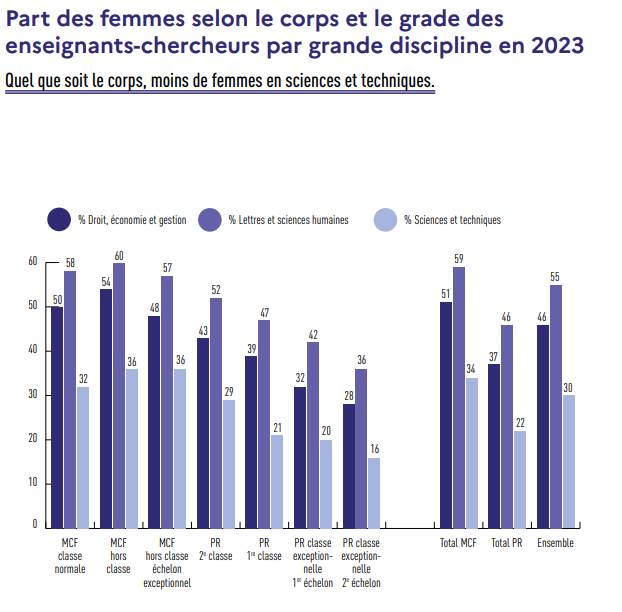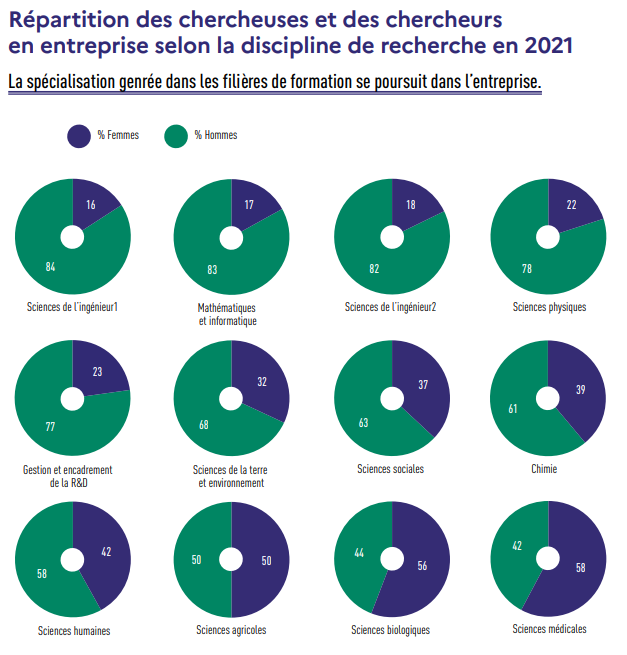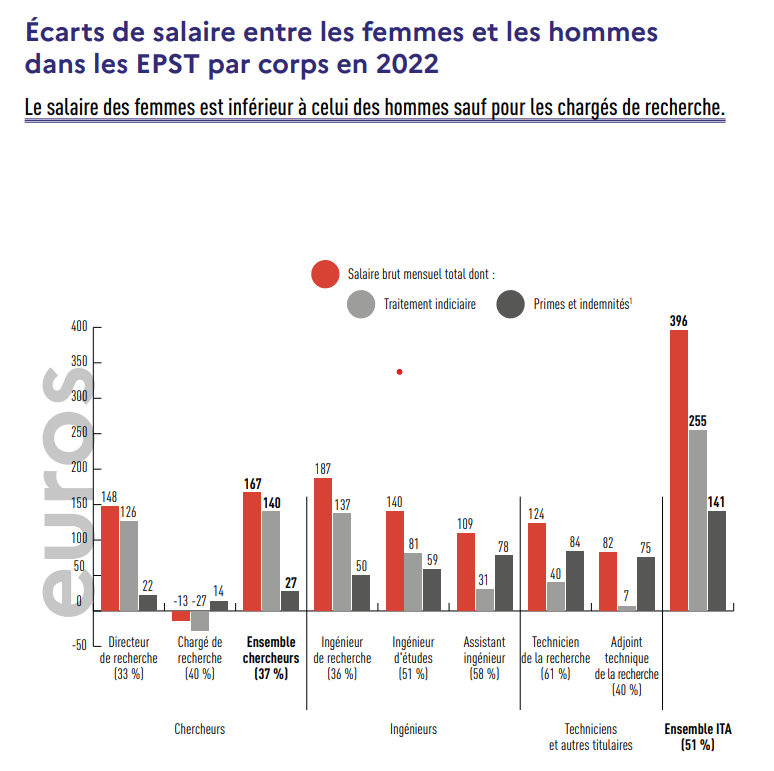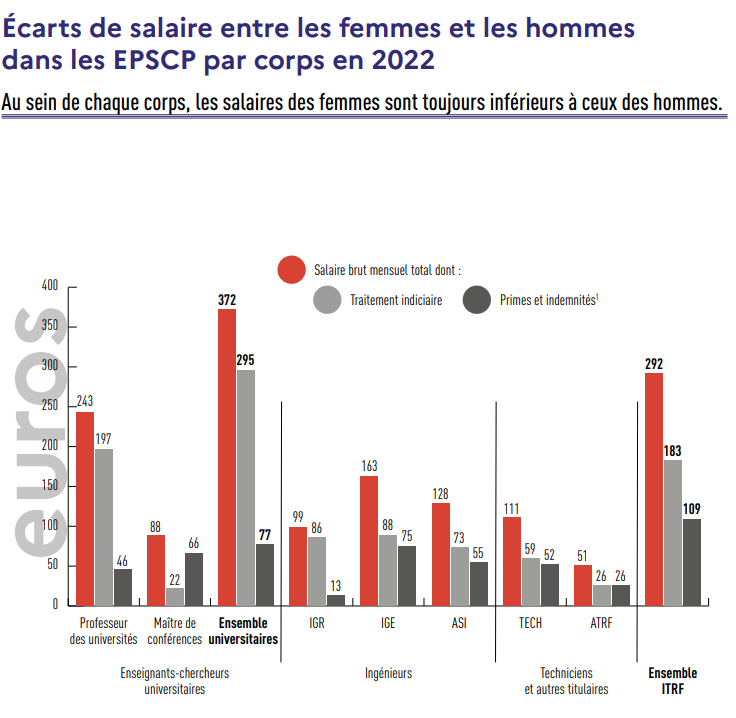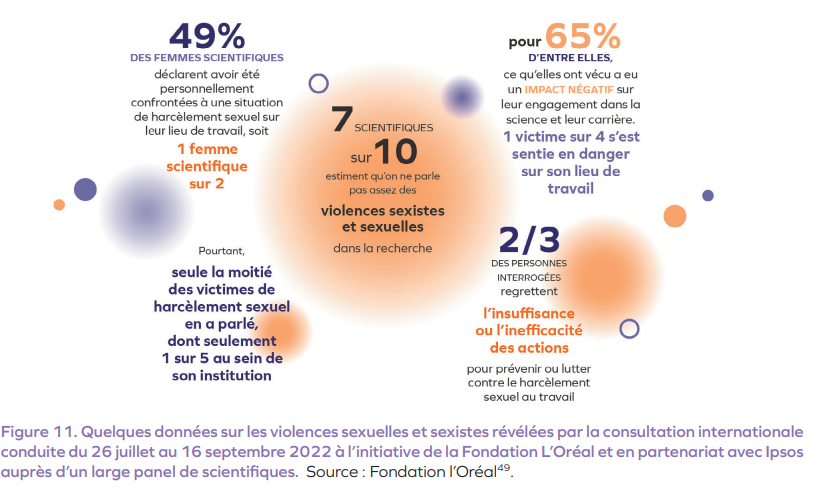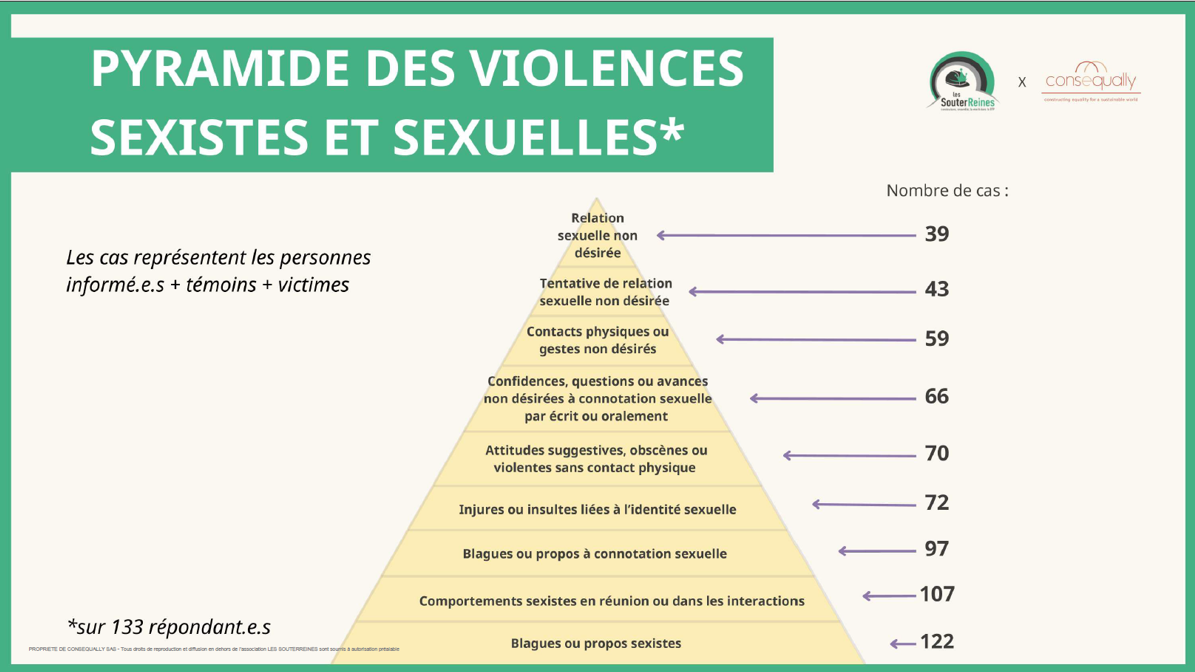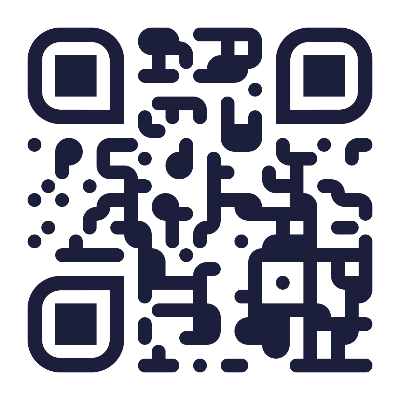- L'ESSENTIEL
- AVANT PROPOS
- I. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
- A. CONSTATS : DES ÉCARTS DE
RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES ENTRE FILLES ET GARÇONS
DÈS LE DÉBUT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE, CONSÉQUENCES DE
BIAIS DE GENRE TRANSVERSAUX
- 1. Premiers écarts de
résultats : une dérive continue à partir du CP
- 2. Variable d'origine : des
stéréotypes précoces qui faussent l'équation
- a) À la maison, des différences
d'interactions avec les petites filles et petits garçons dès le
plus jeune âge
- b) À l'école, des attentes et
interactions différentes vis-à-vis des filles et des
garçons
- c) Des activités et objets culturels qui
demeurent très genrés
- d) Des stéréotypes connus très
tôt des enfants, qui les intériorisent ensuite
- a) À la maison, des différences
d'interactions avec les petites filles et petits garçons dès le
plus jeune âge
- 1. Premiers écarts de
résultats : une dérive continue à partir du CP
- B. RECOMMANDATIONS : CONVAINCRE LES FILLES ET
LEURS ENSEIGNANTS QUE LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES SONT AUSSI
FAITES POUR ELLES
- A. CONSTATS : DES ÉCARTS DE
RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES ENTRE FILLES ET GARÇONS
DÈS LE DÉBUT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE, CONSÉQUENCES DE
BIAIS DE GENRE TRANSVERSAUX
- II. DANS LE SECONDAIRE, FAVORISER UNE ORIENTATION
ÉGALITAIRE DES FILLES ET DES GARÇONS
- A. CONSTATS : AU FIL DES ANNÉES, DES
INÉGALITÉS DE GENRE, SOCIALES ET TERRITORIALES QUI SE CUMULENT ET
PÈSENT DANS LES CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET
D'ORIENTATION
- B. RECOMMANDATIONS : RÉÉCRIRE
L'ÉQUATION POUR ENCOURAGER L'ENVIE DE MATHÉMATIQUES ET DE
SCIENCES
- 1. Plutôt que de changer les filles,
changeons l'enseignement et la perception des sciences
- 2. Valoriser des rôles modèles
féminins accessibles et les faire venir dans les établissements
scolaires
- 3. Se donner les moyens de promouvoir
l'égalité filles-garçons dans les établissements
scolaires et les choix d'orientation
- a) Former l'ensemble des personnels de
l'Éducation nationale aux enjeux d'égalité et les
impliquer dans cette démarche
- b) Transmettre une culture de
l'égalité aux jeunes, en agissant aussi sur les
garçons
- c) Assurer les filles de leur
légitimité et de leurs compétences
- d) Sensibiliser tous ceux qui accompagnent les
élèves dans leurs choix d'orientation, y compris les
parents
- a) Former l'ensemble des personnels de
l'Éducation nationale aux enjeux d'égalité et les
impliquer dans cette démarche
- 1. Plutôt que de changer les filles,
changeons l'enseignement et la perception des sciences
- A. CONSTATS : AU FIL DES ANNÉES, DES
INÉGALITÉS DE GENRE, SOCIALES ET TERRITORIALES QUI SE CUMULENT ET
PÈSENT DANS LES CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET
D'ORIENTATION
- III. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MIEUX
ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES PROTÉGER DU SEXISME ET DES
VIOLENCES
- A. CONSTATS : DES JEUNES FEMMES MINORITAIRES
ET SOUVENT VICTIMES DE SEXISME VOIRE DE VIOLENCES
- 1. Une sous-représentation féminine
dans les filières scientifiques du supérieur, parmi les
élèves comme parmi les enseignants
- a) Un déficit de filles en classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui se creuse encore
à l'entrée des écoles d'ingénieurs les plus
prestigieuses et des écoles normales supérieures (ENS)
- (1) Une « perte en ligne »
des filles dans les classes préparatoires les plus
compétitives
- (2) En conséquence, une
sous-représentation de plus en plus marquée des filles dans les
grandes écoles les plus sélectives et prestigieuses
- (3) Des filles souvent
« dissuadées » par leur entourage direct de
s'orienter vers les filières STIM les plus sélectives
- b) Un déficit de filles au sein des
filières universitaires dites STIM
- (1) Les filles étudient les sciences mais
restent minoritaires en sciences fondamentales
- (2) Un taux de féminisation des
filières scientifiques qui progresse très peu sur le temps
long
- c) Une sous-représentation féminine
parmi les enseignants-chercheurs dans les universités scientifiques et
parmi les enseignants de CPGE scientifiques
- a) Un déficit de filles en classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui se creuse encore
à l'entrée des écoles d'ingénieurs les plus
prestigieuses et des écoles normales supérieures (ENS)
- 2. Sexisme ordinaire et violences
omniprésents dans les études scientifiques en dépit d'une
prise de conscience ces dernières années
- a) Une désaffection des filles liée
à la persistance d'un climat sexiste et de violences subies au cours des
études supérieures scientifiques
- (1) Des chiffres encore insuffisamment
précis pour mesurer la prévalence des VSS dans l'enseignement
supérieur scientifique
- (2) Des témoignages recueillis par la
délégation au cours de ses travaux
- (3) Quelles conséquences des VSS subies
dans l'enfance sur les choix de trajectoires à l'âge
adulte ?
- b) Une montée en puissance des dispositifs
de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les
études supérieures, qui témoigne d'une prise de conscience
récente de ce phénomène
- (1) Un cadre législatif et
réglementaire défini à partir de 2019
- (2) Une application à
géométrie variable au sein des universités,
dépendante des initiatives de leurs responsables
académiques
- (3) Des dispositifs spécifiques aux grandes
écoles scientifiques
- a) Une désaffection des filles liée
à la persistance d'un climat sexiste et de violences subies au cours des
études supérieures scientifiques
- 1. Une sous-représentation féminine
dans les filières scientifiques du supérieur, parmi les
élèves comme parmi les enseignants
- B. RECOMMANDATIONS : CONSTRUIRE UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET PROTECTEUR POUR LES ÉTUDIANTES, EN
EXPÉRIMENTANT DE NOUVELLES SOLUTIONS
- 1. Instaurer des quotas et des mesures en faveur
des filles
- a) Mettre en place des quotas de filles dans
l'enseignement supérieur scientifique en veillant à expliciter
l'intérêt de cette mesure
- (1) Des quotas de filles dans les études
scientifiques : où, quand et comment ?
- (a) Des quotas en CPGE scientifiques
- (b) Des quotas aux concours d'entrée dans
les grandes écoles et au sein des filières universitaires les
plus sélectives et les moins féminisées
- (c) Une nécessaire communication autour de
la mise en place de quotas de genre
- (2) D'autres formes possibles de dispositifs
incitatifs
- b) Mettre en place des dispositifs d'accueil
favorables aux filles qui décident de s'engager dans ces cursus
académiques
- c) Repenser l'organisation des processus de
sélection et favoriser la pluridisciplinarité des parcours
- (1) Repenser l'organisation des processus de
sélection au sein des filières scientifiques
- (2) Favoriser la pluridisciplinarité et
l'hybridation des parcours de l'enseignement supérieur
- a) Mettre en place des quotas de filles dans
l'enseignement supérieur scientifique en veillant à expliciter
l'intérêt de cette mesure
- 2. Renforcer la lutte contre le sexisme et les VSS
dans l'enseignement supérieur
- 1. Instaurer des quotas et des mesures en faveur
des filles
- A. CONSTATS : DES JEUNES FEMMES MINORITAIRES
ET SOUVENT VICTIMES DE SEXISME VOIRE DE VIOLENCES
- IV. DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS
SCIENTIFIQUES, RECRUTER PLUS DE FEMMES ET NE PAS LES FAIRE FUIR
- A. CONSTATS : UNE SOUS-REPRÉSENTATION
ET UN MANQUE DE VISIBILITÉ DES FEMMES DANS LA MAJORITÉ DES
MÉTIERS SCIENTIFIQUES
- 1. Seulement un tiers de femmes dans les
métiers des sciences et de l'ingénierie
- 2. Des carrières féminines ralenties
voire anéanties par des discriminations, des inégalités et
des VSS
- a) Une discrimination de genre à l'oeuvre
dès les processus de recrutement
- (1) Des biais de genre à l'oeuvre au moment
de recruter des candidats pour des postes en sciences dans les
universités
- (2) Des difficultés en lien avec un
recrutement de plus en plus tardif, notamment dans les sciences
« dures »
- b) Un modèle traditionnel de
carrière scientifique qui peut être dissuasif pour les femmes et
entraîner des inégalités salariales persistantes
- (1) Un modèle traditionnel de
carrière scientifique parfois dissuasif
- (2) Le conflit entre « travail
productif et travail reproductif » ou l'enjeu de la
maternité
- (3) Des règles de
représentativité et une répartition genrée des
responsabilités académiques aboutissant à une surcharge de
travail pour les femmes
- (4) Des inégalités salariales
persistantes
- c) La persistance de violences sexistes et
sexuelles dans la recherche et les carrières scientifiques
- a) Une discrimination de genre à l'oeuvre
dès les processus de recrutement
- 3. De nombreuses femmes scientifiques au parcours
inspirant oubliées, méconnues ou invisibilisées
- 4. Le manque de femmes scientifiques : un
enjeu d'égalité et de justice mais aussi d'innovation et de
performance
- 1. Seulement un tiers de femmes dans les
métiers des sciences et de l'ingénierie
- B. RECOMMANDATIONS : FACILITER LE RECRUTEMENT
ET LA POURSUITE DE CARRIÈRE DES FEMMES
- 1. Ajuster les procédures de recrutement et
de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs
- 2. Valoriser des politiques de recrutement et de
promotion positives et proactives en faveur des femmes au sein des
entreprises
- 3. Faciliter le déroulé de
carrière des femmes scientifiques
- 4. Renforcer la lutte contre le sexisme ordinaire
et les VSS
- 1. Ajuster les procédures de recrutement et
de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs
- A. CONSTATS : UNE SOUS-REPRÉSENTATION
ET UN MANQUE DE VISIBILITÉ DES FEMMES DANS LA MAJORITÉ DES
MÉTIERS SCIENTIFIQUES
- I. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- EXAMEN EN DÉLÉGATION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
- CONSULTATION DU DOSSIER EN LIGNE
(RAPPORT ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS)
N° 9
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes (1) sur la place des
femmes
dans les
sciences,
Par Mmes Marie-Do AESCHLIMANN, Jocelyne ANTOINE, Laure DARCOS et Marie-Pierre MONIER,
Sénatrices
Tome I - Rapport
(1) Cette délégation est composée de : Mme Dominique Vérien, présidente ; Mmes Annick Billon, Evelyne Corbière Naminzo, Laure Darcos, Béatrice Gosselin, M. Marc Laménie, Mmes Marie Mercier, Marie-Pierre Monier, Guylène Pantel, Marie-Laure Phinera-Horth, Laurence Rossignol, Elsa Schalck, Anne Souyris, vice-présidents ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Agnès Evren, Jocelyne Antoine, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Hussein Bourgi, Mmes Colombe Brossel, Samantha Cazebonne, M. Gilbert Favreau, Mme Véronique Guillotin, M. Loïc Hervé, Mmes Micheline Jacques, Lauriane Josende, Else Joseph, Annie Le Houerou, Marie-Claude Lermytte, Brigitte Micouleau, Raymonde Poncet Monge, Olivia Richard, Marie-Pierre Richer, M. Laurent Somon, Mmes Sylvie Valente Le Hir, Marie-Claude Varaillas, M. Adel Ziane.
L'ESSENTIEL
Moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et à peine un quart des ingénieurs en France sont des femmes. Cette sous-représentation massive n'est pas une fatalité : elle résulte de biais, de stéréotypes, d'inégalités et de violences qui jalonnent le parcours scolaire et professionnel des filles et des femmes. À l'issue de huit mois de travaux, après avoir entendu près de 120 personnes, les rapporteures formulent 20 recommandations de nature à donner aux femmes et aux filles toute leur place dans les parcours et carrières scientifiques. Un enjeu d'égalité, de justice mais aussi d'innovation scientifique et de compétitivité économique.
1. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
A. Des écarts de résultats en mathématiques entre filles et garçons dès le début de l'école primaire
Alors que filles et garçons ont des résultats quasi-identiques en mathématiques en entrant en CP, les garçons ont une avance marquée dès quatre mois de CP. Ce phénomène est systémique, présent quel que soit le contexte social, familial et territorial et l'environnement scolaire. Ces écarts, qui se creusent tout au long de l'école primaire, en particulier parmi les élèves les plus performants, sont, en France, les plus élevés des pays européens et de l'OCDE.
Ils sont la conséquence de stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants sont confrontés dès le plus jeune âge et qu'eux et leur entourage proche intériorisent :
|
à la maison, les adultes encouragent davantage la stimulation motrice, l'autonomie, les jeux de construction et les jeux compétitifs chez les garçons, favorisant visualisation dans l'espace, estime de soi, esprit de compétition et rapidité, tandis que les compétences langagières et sociales sont davantage encouragées chez les filles ; |
|
|
à l'école, les garçons prennent davantage la parole, sont interrogés sur des questions de réflexion et encouragés à être en compétition, tandis que les filles sont invitées à être sages et interrogées sur des questions de mémorisation. En outre, les enseignantes - pour les trois quarts des femmes avec un profil littéraire - sont susceptibles de transmettre à leurs élèves filles leur faible appétence pour les mathématiques ; |
|
|
les activités et objets culturels demeurent très genrés : moins de 15 % de femmes scientifiques au cinéma, dans les séries et dans les dessins animés, moins de 30 % de prises de parole de femmes dans l'émission C'est pas sorcier et trois fois plus d'hommes que de femmes sur les couvertures de Science&Vie Junior ; |
|
|
dès l'âge de six ans, les enfants associent le génie, le talent intellectuel inné, la « bosse des mathématiques » à la figure masculine ; |
|
|
|
les performances des élèves sont affectées par la « menace du stéréotype », c'est-à-dire la crainte de confirmer et alimenter un stéréotype les concernant. Pour un exercice donné, les filles réussiront mieux s'il leur est présenté comme relevant du dessin plutôt que de la géométrie, et vice-versa pour les garçons. |
B. Recommandations : convaincre les filles et leurs enseignants que les mathématiques et les sciences sont aussi faites pour elles
· Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes ;
· Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et les former à la pédagogie égalitaire, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine et en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes ;
· Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires ;
· Renforcer les actions de l'Arcom afin d'augmenter la représentation des femmes scientifiques dans les médias audiovisuels ;
· Soutenir la médiation et les activités scientifiques, dans et hors des établissements scolaires, sur l'ensemble du territoire.
2. DANS LE SECONDAIRE, FAVORISER UNE ORIENTATION ÉGALITAIRE
A. Des inégalités de genre, sociales et territoriales qui se cumulent et pèsent dans les choix de spécialités et d'orientation
|
Si les écarts de niveaux se comblent en partie au collège, les filles déclarent néanmoins moins d'appétence et de confiance en elles dans la discipline mathématique. Elles font très nettement moins que les garçons le choix de la spécialité mathématiques en lycée général, en particulier depuis la réforme du lycée de 2019. À l'issue du bac, les choix d'orientation demeurent genrés : seules 17 % des bachelières poursuivant des études supérieures optent pour des filières STIM contre 44 % des garçons. |
B. Recommandations : réécrire l'équation pour encourager l'envie de mathématiques et de sciences
· Faire connaître les études et métiers scientifiques aux collégiennes et lycéennes et mettre en valeur leur utilité sociale (campagnes de communication, clubs, stages, programmes d'immersion, etc.) ;
· Faire intervenir dans les établissements scolaires des jeunes femmes scientifiques constituant des rôles modèles à la fois inspirants et accessibles ;
· Former l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale à la prévention et la lutte contre les stéréotypes et biais de genre ;
· Transmettre une culture d'égalité aux jeunes, en abandonnant l'idée de changer ou encourager les filles et en agissant davantage sur les représentations et attitudes des garçons ;
· Mettre en place un véritable service public de l'orientation, sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et associant les familles.
3. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MIEUX ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES PROTÉGER DU SEXISME ET DES VIOLENCES
A. Des jeunes femmes minoritaires et souvent victimes de sexisme voire de violences
Les femmes représentent
|
des étudiants de l'enseignement supérieur |
des étudiants |
des élèves |
des étudiants |
Les raisons pour lesquelles les jeunes femmes, pourtant intéressées par les sciences, se détournent des études supérieures scientifiques, notamment dans le domaine des STIM, sont multiples :
· préférence pour d'autres types d'études, pluridisciplinaires et hybrides ;
· sentiment de ne pas être à leur place dans les cursus scientifiques et stratégie d'évitement massif des filières à forte composante mathématique ;
· appréhension vis-à-vis de la très faible mixité de l'environnement et la potentielle toxicité d'un milieu majoritairement masculin et compétitif ;
· climat persistant de sexisme ordinaire et de violences sexistes et sexuelles (VSS).
B. Recommandations : construire un environnement favorable et protecteur pour les étudiantes, en expérimentant de nouvelles solutions
· Expérimenter des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique à différents degrés et niveaux de la scolarité, en communicant sur leur existence et légitimité ;
· Développer des dispositifs incitatifs et accueillants pour les filles : bourses dédiées, places en internat, espaces temporaires de non-mixité, regroupement dans les classes sélectives, facilitation des passerelles entre parcours académiques ;
· Rendre obligatoire, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre les VSS et la formation du personnel sur ces questions.
4. DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS SCIENTIFIQUES, RECRUTER PLUS DE FEMMES ET NE PAS LES FAIRE FUIR
A. Une sous-représentation et un manque de visibilité des femmes dans la majorité des métiers scientifiques
Les femmes représentent aujourd'hui moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Ce chiffre stagne ces dernières années.
Les carrières féminines sont ralenties voire anéanties par des discriminations, des inégalités et des VSS, alimentant le phénomène dit du « tuyau percé ». Les femmes sont confrontées à :
· des biais de genre dès leur recrutement et tout au long de leur carrière notamment au moment de potentielles promotions ;
· des exigences fondées sur le modèle traditionnel du « bon chercheur », implicitement masculin, entièrement consacré à son activité professionnelle ;
· des inégalités salariales persistantes, qui s'expliquent principalement par leur sous-représentation au sein des postes de professeurs d'université et des postes à responsabilités ;
· des VSS : une femme scientifique sur deux déclare avoir été personnellement confrontée à une situation de harcèlement sexuel au travail, mais seulement une sur cinq en a parlé au sein de son institution.
Or, il est aujourd'hui indispensable de former au moins 20 000 ingénieures et ingénieurs et 60 000 techniciennes et techniciens de plus chaque année pour permettre à la France de rester compétitive dans les domaines scientifiques.
B. Recommandations : faciliter le recrutement et la poursuite de carrière des femmes
· Ajuster les procédures de recrutement et de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs : quotas, formation des jurys aux biais de genre, révision des critères d'évaluation, mentorat ;
· Dynamiser le recrutement et la promotion de femmes au sein des entreprises du secteur scientifique : sensibilisation des employeurs aux enjeux de mixité, éga-conditionnalité de certaines aides publiques, prix dédiés aux femmes scientifiques et ingénieures, féminisation de tous les noms de métiers scientifiques ;
· Favoriser la conciliation vie professionnelle - vie familiale : réforme des congés parentaux et soutien aux jeunes parents chercheurs ;
· Renforcer les dispositifs de lutte contre les VSS afin de créer des espaces protecteurs pour les femmes scientifiques et tarir le phénomène du tuyau percé.
AVANT PROPOS
À l'occasion de la Fête de la science, dont l'édition 2025 se tient du 3 au 13 octobre, la délégation aux droits des femmes du Sénat publie un rapport d'information consacré à la place des femmes dans les sciences.
Au cours de huit mois de travaux, menés par quatre rapporteures - Marie-Do Aeschlimann, Jocelyne Antoine, Laure Darcos et Marie-Pierre Monier - la délégation a entendu environ 120 personnes et procédé à près de 80 heures d'auditions : chercheurs et chercheuses scientifiques, Académie des sciences, sociologues, économistes, ingénieures et élèves ingénieures, enseignants, représentants de l'éducation nationale, directeurs de grandes écoles, associations, collectivités territoriales, acteurs économiques...
Elle a pu constater combien les femmes demeurent sous-représentées dans les domaines et carrières scientifiques en France aujourd'hui, sans réel progrès au cours de la dernière décennie.
En réalité, la problématique ne réside pas dans l'accès des filles et femmes aux sciences en général mais aux mathématiques, aux sciences physiques, à l'informatique et aux sciences de l'ingénieur - des filières généralement regroupées sous les acronymes STIM ou STEM. En effet, les filles et femmes sont nombreuses dans les sciences médicales et les sciences du vivant et de la terre. En revanche, les femmes ne représentent qu'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs.
Cette sous-représentation est la conséquence d'une insuffisante orientation des filles vers les filières et spécialités scientifiques au lycée et dans les études supérieures mais aussi de différences de représentations et de résultats entre filles et garçons dès l'école primaire, en particulier en mathématiques.
Or, les sciences façonnent notre présent et dessinent notre avenir. Elles sont au coeur des grands défis contemporains : transition écologique, révolution numérique, intelligence artificielle, progrès médical.
Il n'est pas acceptable que les femmes soient privées de perspectives professionnelles dans ces domaines si importants, ni que la collectivité soit privée d'une partie si essentielle de ses talents. À ce titre, féminiser les sciences est un enjeu de justice et d'égalité mais aussi d'innovation, de compétitivité et d'excellence pour notre recherche et pour nos entreprises.
Le présent rapport dresse un état des lieux documenté des obstacles et inégalités auxquels les filles et les femmes sont confrontées et formule vingt recommandations à chaque étape de leur parcours : école primaire ; enseignement secondaire et choix d'orientation ; enseignement supérieur ; carrières professionnelles.
L'objectif est clair : donner aux filles et aux femmes toute leur place dans les sciences, et faire en sorte que la France se dote d'une communauté scientifique plus diverse et plus performante.
I. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
Comprendre pourquoi les femmes restent si peu nombreuses dans les sciences suppose de revenir aux racines mêmes des inégalités. Car les écarts ne naissent pas au moment des choix d'orientation : ils s'installent bien plus tôt, tout au long du parcours scolaire.
Les travaux de la délégation ont permis d'établir que l'analyse de ces écarts de résultats ne saurait se réduire à des grilles de lecture mettant en avant :
- soit de moindres performances des filles en mathématiques ou dans des contextes compétitifs,
- soit un manque de confiance et une auto-censure de celles-ci.
Certes, ces variables entrent dans une équation qui est par nature multifactorielle, mais il s'agit d'aller plus loin en interrogeant les causes de leur apparition, le rôle des stéréotypes et biais de genre et la socialisation genrée des filles et des garçons. La délégation ne peut se satisfaire d'explications qui tendraient à essentialiser, voire à considérer comme innées, les aptitudes et attitudes respectives des filles et des garçons, qui seraient présentées comme les causes des différences dans leurs résultats et orientations, quand elles sont bien davantage les conséquences d'inégalités sous-jacentes.
En effet, il n'existe pas de différences cognitives à la naissance entre filles et garçons et pourtant des performances et des perceptions différenciées vis-à-vis des mathématiques et des sciences se construisent dès le plus jeune âge : des différences notables entre filles et garçons apparaissent au cours de l'école primaire, et ce dès le CP. Ces différences ne relèvent pas d'un moindre potentiel mais sont les conséquences de stéréotypes précoces, auxquels les enfants sont confrontés à la maison, à l'école et dans leur environnement, et qu'ils intériorisent très tôt.
S'appuyant sur de nombreux travaux de recherche et témoignages documentant ces observations, la délégation est convaincue de la nécessité de viser, en priorité, cette étape clé du parcours scolaire et du développement personnel, comportemental et relationnel des enfants, que constitue l'école primaire.
A. CONSTATS : DES ÉCARTS DE RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES ENTRE FILLES ET GARÇONS DÈS LE DÉBUT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE, CONSÉQUENCES DE BIAIS DE GENRE TRANSVERSAUX
Alors que globalement les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les garçons, un décrochage au niveau des performances en mathématiques se manifeste dès les premiers mois de l'école primaire et le début d'un enseignement formel des mathématiques.
1. Premiers écarts de résultats : une dérive continue à partir du CP
a) Des écarts de performances, en faveur des garçons, dès le début de l'enseignement formel des mathématiques en CP
Les résultats des évaluations nationales menées depuis 2018 ont révélé l'apparition d'un écart de performances en mathématiques entre filles et garçons lors des premiers mois de scolarisation1(*). Ces résultats en population générale vont dans le même sens que l'analyse d'une cohorte d'enfants sur plusieurs années, publiée par l'Ined2(*), qui indique qu'à l'âge de 4-5 ans il n'existe aucun écart de niveau entre filles et garçons - voire une légère avance des filles - en mathématiques, tandis qu'une nette avance des garçons apparaît à l'âge de 6-7 ans.
Une étude récemment publiée dans la revue Nature3(*), et présentée à la délégation par la chercheuse en neurosciences Pauline Martinot4(*), détaille, avec des analyses croisées, l'ensemble des différences dans les résultats obtenus par 3 millions d'élèves de CP et CE1 lors des tests cognitifs en mathématiques menées en CP et CE1 entre 2018 et 2022. Alors que filles et garçons ont des résultats quasi-identiques en mathématiques en entrant en CP (T1 sur les graphiques ci-dessous), les garçons progressent davantage que les filles, avec une avance marquée dès quatre mois de CP (T2), renforcée en début de CE1 (T3).
Écarts filles-garçons aux tests de mathématiques en CP et CE1
Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025
Ces écarts de résultats sont particulièrement marqués chez les élèves les plus performants, au sein desquels la proportion de filles chute fortement entre le début de CP et le début de CE1. Au début du CP, les garçons sont majoritairement représentés dans les extrêmes de la distribution de niveaux en mathématiques (résultats les plus faibles et résultats les plus élevés), tandis que les filles sont plus nombreuses dans un niveau moyen. En début de CE1, les garçons sont sur-représentés parmi les élèves avec les meilleures performances et représentent les trois quarts des élèves parmi les 1 % d'élèves avec les meilleurs résultats.
Distribution des garçons et des filles
selon leurs résultats
aux tests de mathématiques
Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025
Ces écarts entre filles et garçons sont présents quel que soit le contexte social, familial et territorial et l'environnement scolaire.
Ils démarrent néanmoins plus tôt et sont plus marqués chez les enfants issus de familles très favorisées (CSP+). Selon Pauline Martinot, cela s'explique probablement par le fait que ces familles encouragent davantage la compétitivité académique précoce de leurs fils que ne le font les familles moins favorisées quel que soit le sexe de leur enfant.
Pour autant, il convient de garder à l'esprit le fait que les écarts entre milieux socio-économiques sont prédominants : il y a davantage d'écarts entre les élèves en fonction de leur milieu familial qu'entre garçons et filles d'un même milieu. En CP (T1 et T2), le score en mathématiques des filles issues de CSP+ est inférieur à celui des garçons issus de CSP+ mais est en revanche supérieur à celui des garçons - comme des filles - issus de CSP-. Ce constat est moins net en CE1 : les filles issues d'un milieu plutôt ou très favorisé ont alors des résultats équivalents à ceux des garçons issus d'un milieu plutôt ou très défavorisé.
Résultats des filles et des garçons lors de tests cognitifs en mathématiques en début de CP (T1), milieu de CP (T2) et début de CE1 (T3) en fonction du statut socio-économique de leur famille, par type d'établissement scolaire
NB : les résultats par type d'établissement scolaire sont déclinés en fonction du statut socio-économique des familles, avec un découpage à la médiane (CSP+/CSP-), ou par quartile pour les établissements publics classiques (CSP++/CSP+/CSP-/CSP--).
Champ : élèves entrés en CP en 2018.
Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025
Écarts de résultats en
mathématiques en faveur des garçons
en fonction de la
catégorie socioprofessionnelle des parents
Champ : élèves entrés en CP en 2018.
Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025
b) Un décrochage exponentiel tout au long de l'école primaire
Au-delà des premiers écarts qui apparaissent au cours du CP, les évaluations repères - menées à l'entrée de chaque classe à l'école primaire afin d'évaluer le niveau global des élèves et d'identifier les acquis et besoins spécifiques de chaque élève - mettent en lumière un décrochage continu des filles sur les compétences en mathématiques tout au long de l'école primaire. À partir du CE1, les garçons présentent systématiquement des performances supérieures à celles des filles dans quasiment toutes les compétences mathématiques évaluées et cet écart se creuse au fil des années5(*). Cet écart s'amplifie particulièrement parmi les élèves les plus performants6(*).
Résultats comparés des filles et des
garçons aux évaluations nationales
menées à la
rentrée 2024 à l'école primaire
En début de CP, les filles présentent de meilleures performances que les garçons dans cinq des sept compétences évaluées, des compétences similaires dans la sixième et des compétences légèrement inférieures dans la septième (« comparer des nombres »). Les écarts de taux de maîtrise satisfaisante sont néanmoins relativement faibles, de maximum 3,3 points de pourcentage ;
En début de CE1 : les écarts de performances sont à l'avantage des garçons dans six compétences sur huit, tandis que les filles réussissent mieux dans deux compétences (« reproduire un assemblage » et « calculer mentalement »). Les écarts de taux de maîtrise satisfaisante sont plus élevés dans les compétences où les garçons ont l'avantage, allant jusqu'à un écart de 14,5 points dans la compétence « additionner », tandis qu'ils sont inférieurs à 3 points dans les compétences où les filles ont l'avantage ;
En début de CE2 : les garçons présentent des performances supérieures à celles des filles dans toutes les compétences évaluées, à l'exception du calcul posé où l'avantage est légèrement en faveur des filles. L'écart de taux de maîtrise satisfaisante est supérieur à 10 points sur les compétences « mémoriser des procédures » (15,4 points d'écart) et « placer un nombre sur une ligne graduée » ;
En début de CM1 : les garçons présentent de nouveau des performances supérieures à celles des filles dans toutes les compétences évaluées, à l'exception du calcul posé où les performances des filles et des garçons sont désormais similaires et non plus à l'avantage des filles. Les écarts sont particulièrement marqués sur les compétences « mémoriser des procédures » (18,5 points d'écart de taux de maîtrise satisfaisante) et « placer un nombre sur une ligne graduée » ;
En début de CM2 : les garçons présentent des performances supérieures dans toutes les compétences, sauf la compétence « poser et calculer » où les résultats sont comparables entre filles et garçons. Les écarts sont de nouveau particulièrement marqués sur les compétences « mémoriser des procédures » (19,1 points d'écart de taux de maîtrise satisfaisante) et « placer un nombre sur une ligne graduée ».
L'évaluation nationale menée à l'entrée en sixième, qui évalue les acquis de l'école primaire, relève que le score moyen des garçons en mathématiques est supérieur à celui des filles et que cet écart s'est creusé entre 2017 et 2024 : alors que le score moyen des filles est resté stable, celui des garçons a progressé. Cet écart se traduit par une proportion de garçons dans les groupes les plus performants supérieure à celle des filles (36,2 % contre 27,6 %) et inversement pour les groupes les moins performants (29,3 % contre 35,4 %).
Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère chargé de l'éducation nationale
Les enquêtes internationales, en particulier l'évaluation Timss (Trends in International Mathematics and Science Study), réalisée tous les quatre ans en fin de quatrième année d'école primaire (CM1 en France), confirment ce décrochage des filles par rapport aux garçons.
Lors des derniers tests Timss en CM1, réalisés en 2023, les scores moyens des élèves français en mathématiques et en sciences sont restés stables par rapport à 2019, à un niveau bien inférieur à la moyenne européenne dans ces deux disciplines.
L'écart entre filles et garçons s'est quant à lui accru dans ces deux disciplines, en faveur des garçons7(*). Certes, les garçons ont un score supérieur aux filles en mathématiques dans quasiment tous les pays de l'UE et de l'OCDE participant à l'enquête, mais c'est en France que l'écart est le plus important (23 points). S'agissant des sciences, il n'existe pas d'écart significatif entre filles et garçons dans la moitié des pays et il n'en existait pas non plus en France lors des tests de 2015, contre un écart de 8 points en France en 2023.
Une fois encore, au-delà des différences filles-garçons, les résultats sont fortement corrélés au statut socio-économique des familles : les écarts de performances entre les élèves les plus favorisés et les élèves les moins favorisés sont de 81 points en mathématiques et 83 points en sciences, faisant de la France l'un des pays de l'UE et de l'OCDE les plus inégalitaire socialement. La déclinaison des résultats de l'enquête Timss ne permet cependant pas d'analyser finement la façon dont inégalités de genre et inégalités sociales se croisent.
En revanche, une étude du Conseil d'évaluation de l'école8(*) souligne la nécessité d'analyser les résultats des évaluations nationales à l'échelle de chaque école. En CE1, les écarts des taux de maîtrise en résolution de problèmes - domaine qui mobilise l'ensemble des compétences mathématiques - sont en faveur des garçons dans 53 % des écoles de France, en faveur des filles dans 30,5 % d'entre elles et sont nuls ou pratiquement nuls dans 16,5 %. Cependant, dans 80 % des écoles, les écarts fluctuent d'une année sur l'autre : ce sont tantôt les garçons qui réussissent le mieux, tantôt les filles, tantôt ni les uns ni les autres. Les 16 % d'écoles où les écarts sont systématiquement en faveur des garçons, qui sont plus fréquemment des écoles plus favorisées, expliquent la moitié des écarts de résultats.
Il importe néanmoins de garder un certain recul vis-à-vis de l'ensemble des résultats présentés. Tout d'abord, lors des tests, certains exercices n'évaluent pas tant des compétences mathématiques que la vitesse de réponse. Ensuite, ces tests ne sont qu'une photographie à instant t, dans un contexte de pression évaluative, souvent plus défavorable aux filles, et ne reflètent pas nécessairement le niveau des élèves tout au long de l'année, voire sont marqués par des contre-performances.
Pour autant, les écarts de résultats entre filles et garçons doivent nous alarmer, qu'ils résultent de différences de compétences mathématiques au sens strict ou également de différences de performances dans des contextes compétitifs et évaluatifs. Ces différences sont la résultante de stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants font face dès le plus jeune âge et qu'ils intériorisent eux-mêmes très tôt.
2. Variable d'origine : des stéréotypes précoces qui faussent l'équation
Il convient de rappeler à titre liminaire, pour peu qu'il soit nécessaire de le faire, qu'il n'existe pas de différence à la naissance entre le cerveau des petites filles et celui des petits garçons. S'agissant des compétences cognitives associées aux mathématiques, les nourrissons naissent avec un socle commun d'appréhension des objets, de l'espace et des nombres9(*), avec un sens du nombre identique chez les filles et les garçons10(*). Par la suite, il y a autant de différences anatomiques entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme qu'entre le cerveau de deux hommes ou celui de deux femmes.
Il ressort des auditions menées par la délégation que les écarts de résultats filles-garçons à l'école primaire sont la conséquence des stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants sont confrontés dans leur environnement dès le plus jeune âge et de l'intériorisation de ces stéréotypes. Au-delà des écarts de résultats à l'école primaire, plus globalement, la compréhension de tous les mécanismes à l'oeuvre dans la faible féminisation des métiers scientifiques et la prégnance du sexisme et des violences sexistes et sexuelles dans ce secteur ne saurait être détachée de l'ensemble des problématiques liées aux stéréotypes et biais de genre et aux différences dans la socialisation et l'éducation des filles et garçons.
a) À la maison, des différences d'interactions avec les petites filles et petits garçons dès le plus jeune âge
Charlotte Jacquemot, chercheuse en sciences cognitives, a détaillé auprès des rapporteures11(*) l'importance des interactions précoces dans la construction d'une culture genrée. Les parents et autres adultes de référence n'ont en effet pas la même façon d'interagir avec les bébés et les petits enfants selon leur sexe.
Les adultes encouragent davantage la stimulation motrice, l'autonomie, le sport, les jeux de construction et les jeux compétitifs chez les garçons et emploient avec eux un langage fonctionnel insistant sur les faits et leurs explications. Ces pratiques favorisent l'estime de soi, l'esprit de compétition et la rapidité.
Quant aux filles, elles sont davantage encouragées à exprimer leurs émotions, à être obéissantes, à prendre soin des autres ainsi que de leur apparence, à lire et se déguiser, et les parents emploient avec elles un langage affectif émotionnel. Selon une étude de l'Ined12(*), à dix ans, les filles assurent déjà davantage de tâches domestiques que les garçons. L'ensemble de ces pratiques favorise le développement des compétences langagières et sociales et de l'empathie des filles - des qualités qu'il serait utile de développer également chez les garçons. En revanche, ces pratiques ne favorisent pas particulièrement l'estime de soi, ni des compétences en logique et en rapidité.
b) À l'école, des attentes et interactions différentes vis-à-vis des filles et des garçons
De nombreux travaux de recherche montrent que l'école participe toujours d'une socialisation genrée et conduit à des écarts de performances entre filles et garçons, en dépit d'efforts récents en la matière.
La chercheuse Pauline Martinot a ainsi souligné devant les rapporteures13(*) le rôle que joue l'environnement scolaire dans l'accroissement des écarts filles-garçons en mathématiques entre le CP et le CE1, mettant en avant l'impact du temps de scolarisation, sans corrélation avec l'âge des enfants, dans cet écart, et relevant le fait que l'accroissement de l'écart de performances a été légèrement moins marqué lorsque les élèves ont suivi des enseignements à la maison pendant la période du covid-19.
Les stéréotypes des enseignants en matière de lien entre genre et sciences, bien qu'ils soient majoritairement inconscients, induisent des biais de genre dans leurs interactions avec les élèves, ont des conséquences sur l'estime de soi et la motivation des filles, et donc in fine sur leurs résultats en mathématiques14(*).
À l'école, les garçons sont davantage encouragés à prendre la parole, à poser des questions, à être en compétition et à se dépasser académiquement, tandis que les filles sont encouragées à être sages, à s'exprimer correctement et à faire attention aux autres. En classe et dans les bulletins scolaires, les enseignants n'utilisent pas les mêmes adjectifs pour qualifier des élèves aux résultats identiques : la fille est « studieuse » et « bonne élève », le garçon est « brillant » ou « doué ».
Nathalie Sayac, professeure des universités en didactique des mathématiques, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, a présenté aux rapporteures15(*) les conclusions d'observations menées dans des classes de CP : les discours de la moitié des enseignants sont porteurs de stéréotypes, portant notamment sur le meilleur niveau en mathématiques, la plus grande curiosité et l'appétence supérieure pour les défis des garçons par rapport aux filles. En outre, les filles sont deux fois moins sollicitées que les garçons lors des cours de mathématiques et sont surtout interrogées sur la mémorisation de la leçon, moins pour des questions de réflexion. Nathalie Sayac a précisé auprès des rapporteures que les enseignants n'avaient généralement pas conscience de ces biais de genre mais que ceux-ci affectaient substantiellement les résultats de leurs élèves.
Elle a également mis en avant l'importance du contexte de l'enseignement et de l'évaluation des mathématiques dans l'expression des stéréotypes de genre. Elle relevait ainsi que lorsqu'on laisse le choix du contexte d'un problème mathématiques aux élèves, tous améliorent leurs résultats. Elle estimait également que les enseignants peuvent créer une pression évaluative, notamment lors de la réalisation des tests précédemment évoqués, ce qui se révèle plus préjudiciable pour les filles et peut biaiser les perceptions des écarts de résultats.
Le profil des enseignants - à 85 % des enseignantes au niveau primaire - affecte également la façon dont ils enseignent les mathématiques à leurs élèves.
En primaire, l'enseignement des mathématiques et des sciences est assuré par des professeurs des écoles ayant suivi des formations où ces disciplines n'étaient pas prioritaires et qui ne se sentent pas en confiance pour assurer cet enseignement.
Trois quarts des étudiants de la mention 1er degré du master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) sont issus de licences en sciences humaines et sociales, lettres ou langues. La culture scientifique a donc été majoritairement absente du cursus des professeurs des écoles pendant au moins trois ans. Seuls 12 % sont issus de licences en sciences16(*).
Des études montrent que les professeures des écoles peuvent transmettre leur anxiété vis-à-vis des mathématiques à leurs élèves filles et réduire ainsi les performances de celles-ci, sans que les garçons soient quant à eux affectés17(*).
Au-delà des discours et attitudes des enseignants, des stéréotypes de genre sont également véhiculés par les manuels scolaires, qui invisibilisent les femmes scientifiques. Selon une étude du Centre Hubertine Auclert18(*), dans les manuels proposés en classe de CP, les femmes représentent 40 % des personnages, 70 % de ceux qui font la cuisine ou le ménage, mais seulement 3 % des professions scientifiques.
c) Des activités et objets culturels qui demeurent très genrés
Les écarts de résultats et d'appétence des filles et des garçons dans le champ des sciences et des mathématiques s'expliquent aussi par l'ensemble de l'environnement dans lequel ils sont immergés, les livres et revues qu'ils lisent, les films, séries et émissions qu'ils regardent, les activités qu'ils pratiquent ou encore les lieux de culture scientifique qu'ils fréquentent.
Les jeux, jouets et loisirs des garçons sont davantage axés sur la mobilité, la manipulation, la rapidité et la compétition. La familiarité avec ces compétences donne un avantage comparatif aux garçons dans les tests qui valorisent la rapidité et l'esprit de compétition, tels ceux menés lors des évaluations en mathématiques. La chercheuse Charlotte Jacquemot expliquait également lors de son audition19(*) que si les garçons sont meilleurs dans les activités de rotation mentale, mobilisées notamment en géométrie, c'est principalement parce qu'ils pratiquent davantage de sport et de jeux vidéo. Les bons résultats dans les activités de rotation mentale sont en effet corrélés avec l'utilisation de jeux vidéo et non avec le genre.
Même lorsque les filles sont en contact avec des activités et contenus scientifiques, elles ne sont pas spécialement incitées à continuer à s'intéresser à ces contenus. Ainsi, dans un musée scientifique, les parents passent trois fois plus de temps à expliquer les faits scientifiques et les relations de causalité à leur fils qu'à leur fille20(*).
Lors de son audition21(*), Clémence Perronet, sociologue des sciences, a souligné le fait qu'à l'âge de l'école primaire et même du collège, filles comme garçons expriment une envie partagée de connaître la science mais que les filles découvrent des contenus leur indiquant que la science n'est pas faite pour elles. Pour elle, « la culture scientifique est conçue à destination des garçons et des hommes ».
Ses travaux montrent ainsi que les femmes scientifiques sont invisibilisées au sein des objets culturels et que les rares femmes présentes sont stéréotypées. Elle recense moins de 15 % de femmes scientifiques au cinéma, dans les séries et dans les dessins animés, moins de 30 % de prises de parole de femmes dans l'émission C'est pas sorcier et trois fois plus d'hommes que de femmes sur les couvertures de Science&Vie Junior.
Plus globalement, comme le démontrent tous les rapports de la délégation, les stéréotypes de genre demeurent bien ancrés dans notre société et sont transmis très tôt aux enfants.
d) Des stéréotypes connus très tôt des enfants, qui les intériorisent ensuite
En effet, les enfants, filles comme garçons, intègrent très jeunes les stéréotypes de genre et les véhiculent entre eux.
Selon Isabelle Régner, professeure de psychologie sociale et vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d'Aix Marseille Université (amU)22(*), les enfants connaissent les stéréotypes dès l'âge de quatre ou cinq ans, associant notamment dès cet âge les mathématiques aux garçons et la lecture aux filles, et la composante automatique de ces stéréotypes se renforce vers l'âge de dix ans.
À partir de six ou sept ans, les enfants commencent à associer systématiquement le génie, le talent intellectuel inné, la « bosse des mathématiques » à la figure masculine.
Des chercheurs ont ainsi montré que la perception du « talent intellectuel » comme étant davantage masculin est établie dès l'âge de six ans23(*). Pour cela, ils ont présenté à des enfants une photo d'homme et une photo de femme en leur demandant d'abord qui était la personne « très, très intelligente » puis qui était la personne « très, très gentille ». À cinq ans, garçons comme filles choisissent dans la même proportion la personne de leur propre sexe à ces deux questions. En revanche, dès six ans, un écart se creuse : les garçons continuent à davantage désigner l'homme comme la personne « très, très intelligente » tandis que moins de la moitié des filles désigne la femme, et vice-versa pour la question portant sur la personne « très, très gentille ». À ce même âge, les filles commencent à éviter les activités censées être pour les enfants très intelligents, dont les mathématiques font partie.
Une expérience portant sur des élèves de 11 à 13 ans, dont la moitié de filles, a mis en évidence des résultats différents en fonction de la consigne donnée aux élèves pour un exercice identique, à savoir la reproduction de la figure complexe de Rey-Osterrieth24(*). Lorsque l'exercice est présenté comme de la géométrie, appartenant au champ des mathématiques, les garçons réussissent mieux que les filles (moyenne de score de 24 contre 21). En revanche, lorsque l'exercice est présenté comme du dessin, les filles réussissent mieux que les garçons (moyenne de score de 26 contre 22). Dans les deux cas, l'exercice est pourtant strictement identique, seule varie la perception qu'ont les enfants de leurs compétences supposées pour réaliser l'exercice, en fonction de la discipline dont il est censé relever.
Des scientifiques d'universités américaines reconnues ont développé depuis les années 1990 des tests d'association implicite, dont l'un porte sur les associations entre genre et sciences25(*). Ce test montre que des biais sont présents chez tous les individus, hommes comme femmes, qui, globalement, associent implicitement le domaine des arts aux femmes et le domaine des sciences aux hommes. Plus ces biais sont présents, plus les garçons et les hommes ont un avantage dans les matières et filières scientifiques. Ainsi, la pratique de ce test sur plus de 500 000 personnes dans 34 pays différents a montré une corrélation nette entre la présence de biais d'association entre hommes et sciences, d'une part, et les différences filles-garçons dans les résultats en mathématiques et en sciences en classe de quatrième d'autre part26(*).
Corrélation entre la présence de
biais d'association et les résultats
en mathématiques et en
sciences d'élèves de quatrième
Source : graphique présenté par Charlotte Jacquemot lors de son audition
Les performances des élèves, comme des individus en général, sont ainsi affectées par la « menace du stéréotype », c'est-à-dire la crainte de confirmer et alimenter un stéréotype les concernant. La crainte d'une moins bonne performance génère des interférences cognitives, exacerbe le stress et sature la mémoire du travail, c'est-à-dire la capacité à traiter l'information et mobiliser les connaissances pertinentes. Ce phénomène induit des contre-performances chez les filles lors des tests en mathématiques.
B. RECOMMANDATIONS : CONVAINCRE LES FILLES ET LEURS ENSEIGNANTS QUE LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES SONT AUSSI FAITES POUR ELLES
Face au rôle que jouent les stéréotypes véhiculés par l'entourage et l'environnement des jeunes enfants, la délégation appelle à agir dès le plus jeune âge. Il s'agit de développer une culture globale de l'égalité mais aussi une culture scientifique pour toutes et tous, afin d'encourager, chez les filles comme chez les garçons, une curiosité scientifique et un intérêt pour les mathématiques.
Le premier levier à activer est celui de la formation de leurs enseignantes et enseignants, afin de les mettre en confiance dans l'enseignement des mathématiques et des sciences et de leur donner les outils pour mettre en place une pédagogie vivante et égalitaire des mathématiques et des sciences, au bénéfice de l'ensemble de leurs élèves.
1. Renforcer la formation initiale et continue des professeurs des écoles
a) Renforcer le bagage scientifique et la formation à la didactique des mathématiques et des sciences
Il apparaît aujourd'hui primordial de renforcer la formation des enseignants du premier degré, dont les trois quarts sont aujourd'hui des femmes ayant suivi des études littéraires, afin qu'ils construisent un rapport plus positif et concret aux mathématiques et dépassent leur appréhension à enseigner cette discipline.
La réforme de la formation initiale des professeurs des écoles, qui entrera en vigueur en 2026, apporte des éléments de réponse à cet objectif en prévoyant de renforcer le bagage pluridisciplinaire et scientifique des futurs enseignants.
Le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sera accessible à bac+3 et sera suivi de deux années de master, au sein d'un institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé) pour l'enseignement public ou en institut supérieur de formation de l'enseignement catholique (Isfec) pour l'enseignement privé. Ces deux années seront consacrées à la formation initiale des enseignants, mêlant cours, stages et temps de mise en responsabilité. Dans ce cadre, le volume horaire consacré aux sciences sera renforcé, sans que le détail soit encore connu.
Par ailleurs, une licence professorat des écoles (LPE) sera mise en place afin de préparer le concours. Cette licence pluridisciplinaire comportera une formation aux disciplines scientifiques au cours des trois années de formation, à hauteur de 200 heures de mathématiques et 110 heures de sciences. En outre, pour passer d'une année à l'autre, aucune compensation entre les notes en français et en mathématiques ne sera possible, afin de s'assurer d'un niveau minimal suffisant.
La délégation salue ce renforcement du volume horaire consacré aux enseignements scientifiques, dont bénéficieront les futurs enseignants, en particulier ceux s'inscrivant dans le cadre d'une formation en cinq ans.
Elle regrette cependant que ce nouveau focus apporté aux enseignements scientifiques ne se retrouve pas dans la refonte des épreuves du concours. En effet, l'exposé disciplinaire en mathématiques ne sera plus obligatoire, puisque les candidats pourront choisir entre français et mathématiques, de même que la préparation à l'épreuve d'enseignement en sciences et technologies, puisque les candidats pourront choisir trois disciplines sur les quatre proposées, alors que ce choix relevait jusqu'à présent d'un tirage au sort à chaque session, incitant les candidats à ne négliger aucune des disciplines concernées.
Elle partage le constat d'Anne-Lise Rotureau, déléguée générale et conseillère du président du réseau des Inspé : « les étudiants pensent leur formation initiale sous le prisme du concours ; si l'enseignement scientifique figure obligatoirement au concours, ils travailleront cette discipline »27(*). Elle est donc favorable à une épreuve obligatoire en sciences, ou a minima à un retour au tirage au sort des épreuves retenues peu de temps avant le concours afin que les étudiants s'investissent dans cette discipline.
En outre, d'ici la mise en application de cette réforme, à partir de la rentrée 2026, il conviendra de veiller au contenu des programmes élaborés en matière de formation scientifique. Une attention toute particulière devra être accordée à la formation à la didactique des mathématiques. En effet, l'enseignement des mathématiques à l'école primaire n'est pas seulement une question de savoir disciplinaire mais tout autant une question d'approche et de méthode d'enseignement de la discipline.
Afin que les élèves développent un rapport positif aux mathématiques, fondé sur de bonnes bases pour la suite de leur parcours scolaire, l'apprentissage de cette discipline à l'école primaire doit mettre l'accent sur la compréhension des nombres, des opérations et de l'abstraction, privilégier la manipulation et l'expérimentation, s'inscrire dans la construction d'un raisonnement et d'une démarche scientifiques, et mettre les mathématiques en relation avec d'autres disciplines et avec l'environnement quotidien et global des élèves. Afin de toucher les élèves dans la diversité de leurs sensibilités, il convient d'intégrer à la fois la dimension abstraite et la dimension concrète des mathématiques.
Comme le relevait l'inspectrice générale Nathalie Sayac, lors de son audition, « tout le monde peut maîtriser le contenu du programme de mathématiques de primaire, ce qui compte c'est la façon dont on l'enseigne »28(*).
Cela implique de mieux armer les professeurs des écoles afin qu'ils se sentent en confiance sur leur capacité à enseigner les mathématiques et les sciences, qu'ils aient un recul suffisant sur ces disciplines pour vulgariser des concepts complexes et les inscrire dans la construction d'un raisonnement scientifique et qu'ils aient connaissance d'exercices de manipulation et d'expérimentation leur permettant de rendre les sciences enthousiasmantes et accessibles pour eux comme pour leurs élèves.
Cette formation à la didactique des mathématiques et des sciences doit se faire dans le cadre de la formation initiale mais aussi de la formation continue. Il est en effet nécessaire de former les enseignants déjà en poste, et notamment ceux qui, à la suite de la réforme du lycée, n'ont pas suivi d'enseignement de mathématiques en première et en terminale. En outre, la licence pluridisciplinaire ne concernera que la moitié des lauréats du concours de professeur des écoles et l'autre moitié des lauréats, issus de licences générales, n'aura potentiellement pas bénéficié de cours de mathématiques et de sciences pendant trois années.
Pour cela, les partenariats entre les Inspé et des initiatives comme La main à la pâte ou les Maisons pour la science sont particulièrement intéressants. Ainsi, la Maison pour la Science en Lorraine est directement installée au sein de l'Inspé Lorraine et a implanté des centres ressources La main à la pâte dans des territoires éloignés des universités, permettant de mettre à disposition des ressources, outils scientifiques et matériels pédagogiques à un plus grand nombre d'enseignants.
Une fois les enseignants formés, il convient en effet de leur mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour leur classe, comme le recommandait d'ailleurs le rapport Villani-Torossian29(*), dont les préconisations relatives à la formation des professeurs des écoles ont été intégrées à la réforme à venir.
Dans le même esprit, la délégation juge particulièrement intéressantes les initiatives, menées notamment par les maisons pour la science, visant à proposer aux enseignants des immersions d'une semaine dans un laboratoire scientifique afin de voir la façon dont les chercheurs travaillent et mettent en application des connaissances scientifiques.
De façon générale, au-delà de la formation des enseignantes et enseignants, il s'agit de leur redonner le goût des mathématiques, afin qu'ils puissent eux-mêmes transmettre ce goût aux élèves.
La délégation estime que les professeurs pourraient également être davantage accompagnés ponctuellement, sur certaines notions ou certains types d'expérimentation, par des intervenants extérieurs, tels que des membres de la Fondation La main à la pâte ou des doctorants en mission de médiation scientifique.
Pourrait également être envisagée, comme le propose le conseil d'analyse économique30(*), la création de brigades de professeurs des écoles spécialisés en mathématiques et formés pour améliorer son enseignement. Des professeurs qualifiés extérieurs interviennent fréquemment dans les écoles primaires en langues, en musique ou en sport. De telles interventions pourraient également être envisagées en mathématiques, afin de soutenir les professeurs des écoles et les aider à renouveler leur pédagogie, avec une approche à la fois scientifique et égalitaire.
Dans cette optique, les conseillers pédagogiques référents mathématiques devraient également être davantage mobilisés, ce qui suppose d'en recruter davantage.
|
Recommandation n° 1 : Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles, futurs comme actuels, et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes. |
b) Sensibiliser aux biais de genre et former à la pédagogie égalitaire
Le renforcement de la formation initiale et continue des professeurs des écoles doit également passer par une formation accrue et plus concrète à la pédagogie égalitaire.
La majorité des enseignants n'ont pas conscience des biais de genre qu'ils reproduisent. Il s'agit donc de les amener à une prise de conscience des biais inégalitaires à l'oeuvre dans leur classe et dans leurs propres attentes et interactions vis-à-vis des élèves et de les former à une pédagogie égalitaire dans une logique de responsabilisation et non de culpabilisation.
Lors de son audition, la chercheuse en sciences cognitives Charlotte Jacquemot a insisté sur le fait que « prendre conscience des stéréotypes et les reconnaître permet de se comporter de manière plus égalitaire »31(*). Des travaux de recherche montrent que les enseignants ayant pris connaissance de leurs propres biais de genre, associant davantage les sciences aux hommes et garçons, modifient ensuite leurs attitudes, améliorant ainsi la progression des élèves filles en mathématiques.
Cela suppose que les enseignants, et plus largement les équipes éducatives, disposent d'éléments objectifs leur permettant de prendre conscience des inégalités présentes dans leur établissement et leur classe, puissent observer les dynamiques à l'oeuvre dans différentes classes et soient informés des acquis de la recherche en matière de stéréotypes et biais de genre.
Le Conseil d'évaluation de l'École (CEE) relève32(*) que les rapports d'auto-évaluation et d'évaluation externe, rédigés à l'occasion des évaluations d'écoles tous les cinq ans et transmis au CEE, s'emparent très peu de la problématique des écarts filles-garçons ; ce qu'il explique notamment par le fait que les déclinaisons filles-garçons ainsi que les éléments de comparaison avec d'autres écoles, groupes d'écoles ou le niveau national ne figurent pas systématiquement parmi les données transmises aux équipes éducatives.
Lors d'une expérimentation menée dans l'académie de Versailles par un groupe de travail du CEE, la communication aux équipes éducatives de résultats des filles et des garçons en CP et en CE1 par école sur plusieurs cohortes ainsi que de la variabilité des écarts observée a suscité des interrogations et une réflexion auprès des différentes catégories de personnel.
Afin de soutenir la démarche évaluative des équipes éducatives, le groupe de travail a publié des grilles d'observation de l'activité des élèves et des enseignements en français et en mathématiques, qui peuvent être utilisées comme outils pour l'évaluation des écoles et pour les observations croisées dans le cadre des formations des professeurs des écoles en constellations des Plans mathématiques et français, qui incluent des temps d'observations croisées dans les classes.
Sur cette base, la délégation estime essentiel que les équipes pédagogiques puissent disposer des résultats déclinés par genre de leur école aux évaluations nationales, afin qu'ils prennent conscience de l'existence de biais au sein même de leur établissement, qu'ils puissent analyser la situation spécifique de leurs élèves mais aussi qu'ils soient en mesure d'évaluer l'impact des actions mises en place.
|
Recommandation n° 2 : Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et leur transmettre des indicateurs statistiques portant sur les écarts de résultats filles-garçons, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle de leur établissement, afin d'engager une prise de conscience, de leur permettre de suivre la situation spécifique de leurs élèves et d'évaluer l'impact des actions mises en place. |
Cependant, ce premier volet de sensibilisation n'est pas suffisant à lui seul et doit s'accompagner d'une présentation des outils et méthodes concrètes que peuvent utiliser les enseignants pour changer leurs pratiques dans le quotidien de leur classe.
Or, le récent rapport « Filles et mathématiques » de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) et de l'Inspection générale des finances (IGF)33(*) relève que les actions visant à favoriser l'égalité filles-garçons sont « restées longtemps à la porte de la classe et n'ont que peu activé le levier de la pédagogie et de la didactique des disciplines ».
Lors de son audition34(*), Nathalie Sevilla, directrice de l'Inspé de Lorraine, a mis en avant l'existence d'une formation des enseignants à l'égalité femmes-hommes, obligatoire depuis 2023, tout en déplorant le fait qu'il s'agisse essentiellement d'une sensibilisation d'ordre général alors même qu'il existe des obstacles didactiques propres à chaque discipline, mis en évidence par la recherche. Elle a également témoigné des difficultés des étudiants à faire des liens entre les apports de connaissances liés à cette formation et le quotidien concret de la classe.
Il est donc essentiel que la formation à l'égalité et la pédagogie égalitaire incluent des conseils concrets à destination des enseignants, adaptés en fonction de la discipline enseignée. Ces conseils doivent porter sur les attitudes vis-à-vis des élèves (pour ne pas véhiculer de stéréotypes), le vocabulaire à utiliser pour s'adresser à eux ou les féliciter (en mettant l'accent sur les efforts et le processus d'apprentissage), les tours de prise de parole (pour s'assurer d'un équilibre filles-garçons), la diversification des exemples et la mobilisation de contextes non masculins dans les exercices (par exemple en plaçant la résolution de problèmes mathématiques dans le champ de l'architecture, de l'environnement, du design), etc.
S'agissant de la formation initiale, le cahier des charges de la future licence pluridisciplinaire et du master de formation des enseignants comprend une mention renvoyant à la pédagogie égalitaire. Il conviendra de veiller à ce que les Inspé mettent en place des formations plus pertinentes à cette pédagogie, en s'appuyant sur les derniers résultats et outils proposés par la recherche.
En outre, alors que les étudiants de licence attendent essentiellement des Inspé qu'ils les préparent au concours de professeurs des écoles et qu'ils s'investissent moins dans les matières qui ne font pas l'objet d'une épreuve à ce concours, la délégation recommande l'organisation d'une épreuve au concours de professeurs des écoles intégrant les enjeux d'égalité et de pédagogie égalitaire, soit sous la forme d'une épreuve spécifique, soit en l'intégrant de façon plus explicite aux épreuves orales d'admission.
Par ailleurs, la formation des 370 000 professeurs des écoles déjà en poste est également essentielle.
Le plan Filles et mathématiques, annoncé par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Elisabeth Borne en mai 2025, prévoyait l'organisation, pour tous les professeurs de l'Éducation nationale, de séances de sensibilisation de deux heures aux biais de genre lors de la rentrée 2025. Ces séances devaient être réalisées avant le 15 septembre dans tous les établissements scolaires. La délégation se félicite de cette initiative, dont elle s'interroge cependant sur la mise en oeuvre : elle souhaite disposer d'un bilan établissant le nombre d'établissements ayant effectivement effectué ces séances, le nombre d'enseignants sensibilisés, les intervenants internes ou extérieurs mobilisés, les supports utilisés, les retours formulés par les enseignants, ainsi que les actions que les équipes éducatives ont décidé de mettre en place à l'issue de ces séances.
|
Recommandation n° 3 : Réaliser un bilan des séances de sensibilisation des professeurs de l'Éducation nationale aux biais de genre qui devaient être menées à la rentrée 2025, afin de reconduire cette initiative de façon plus efficace à chaque rentrée scolaire. |
Le plan Filles et mathématiques prévoit également qu'entre 2025 et 2029, tous les professeurs des écoles devront suivre une formation d'au moins une journée portant sur la prévention des biais de genre et des stéréotypes dans l'apprentissage des mathématiques. Il conviendra cependant de veiller aux modalités et au contenu de cette formation afin de s'assurer de son efficacité.
En effet, une récente étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale (CSEN)35(*) a montré qu'une formation en ligne aux stéréotypes de genre, sans mise en pratique directe ni accompagnement dans la classe, est insuffisante et ne permet pas de réduire les différences de résultats filles-garçons en mathématiques. Cette même étude ne montre pas de meilleurs résultats en mathématiques chez les élèves dont les enseignants ont bénéficié d'une formation en didactique des mathématiques ou des formations du Plan Mathématiques. Ces résultats témoignent, selon ses auteurs, « de la difficulté de former efficacement les enseignants, et aussi de la nécessité d'évaluer les effets des formations, surtout si elles ont vocation à être implémentées à grande échelle ».
Il importe donc que les formations soient assurées en présentiel, incluent des conseils concrets et soient associées à un accompagnement en classe, afin d'aider les enseignants à mettre en place une pédagogie égalitaire dans l'ensemble des disciplines qu'ils enseignent, et en premier lieu les mathématiques, mais aussi que ces formations soient évaluées afin de les rendre plus efficaces.
La délégation sera particulièrement vigilante à la mise en oeuvre effective des précédentes annonces gouvernementales, de la réforme des Inspé et des modules de formation initiale et continue des enseignants.
|
Recommandation n° 4 : Former l'ensemble des professeurs des écoles à la pédagogie égalitaire, et en particulier à une pédagogie égalitaire des mathématiques, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine, en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes et en évaluant l'efficacité de ces formations. |
2. Renforcer la culture de l'égalité dans l'enseignement primaire
a) Penser les contenus pédagogiques sous le prisme de l'égalité
Les questions d'égalité filles-garçons font d'ores et déjà partie de la politique éducative dès l'école primaire, notamment dans le cadre des cours d'enseignement moral et civique, en place dès le CP, qui comportent un volet dédié à l'égalité filles-garçons.
De même, les séances d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité dites EVARS, prévues par la loi depuis 200136(*), doivent permettre d'aborder cette problématique. Le nouveau programme d'éducation à la vie affective et relationnelle - seuls ces deux aspects étant abordés à l'école maternelle ainsi qu'à l'école primaire - est entré en vigueur à la rentrée 2025 et met l'accent, non seulement sur les connaissances du corps, mais aussi sur les compétences psychosociales, le respect de soi et des autres et l'égalité entre filles et garçons. La délégation rappelle ici son soutien constant aux séances d'EVARS, qui constituent un levier indispensable à la progression de l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre toutes les formes de violences.
Au-delà de ces contenus pédagogiques abordant directement les enjeux d'égalité, il importe que, sans entraver la liberté pédagogique du corps enseignant, ces enjeux soient pris en compte dans les programmes et les manuels de l'ensemble des disciplines.
Une charte sur les manuels scolaires, fondée sur les travaux du Centre Hubertine Auclert et réalisée avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, a été signée en septembre 2024 par les 32 éditeurs membres de l'Association des éditeurs des manuels scolaires. Le cahier des charges s'articule autour de cinq principes :
· une représentation plurielle et équilibrée des femmes et des hommes ;
· une plus grande visibilité des femmes dans le champ des savoirs ;
· une présentation non sexiste des femmes et des hommes à tous les âges de la vie ;
· des mises en situation ne renforçant pas les stéréotypes ;
· un langage égalitaire simple.
Il s'agit désormais de s'assurer de l'application de cette charte par les éditeurs, en en réalisant un bilan d'ici la fin d'année 2026. Si cette modalité souple ne s'avérait pas suffisante pour faire évoluer les contenus, la mise en place d'une labellisation égalité filles-garçons des manuels scolaires pourrait être envisagée.
Dans la lignée de l'objectif visant à donner une meilleure visibilité aux femmes, une réflexion sur l'emploi, de façon raisonnée, d'une écriture égalitaire pourrait être engagée. En effet, divers travaux scientifiques montrent que les modalités d'écriture influencent les perceptions et que l'usage d'une langue inclusive ou égalitaire permet de réduire certains stéréotypes induits par l'usage systématique du masculin neutre. Ainsi, lorsqu'un texte est rédigé en utilisant uniquement le masculin neutre, en particulier lorsqu'il s'agit d'une profession avec un stéréotype masculin (par exemple « les mathématiciens »), les personnes interrogées sous-estiment systématiquement la proportion de femmes, tandis qu'elles estiment cette proportion à un niveau bien plus élevé lorsqu'un texte est rédigé en employant la double flexion (mathématiciennes et mathématiciens)37(*).
Effet de l'usage d'une écriture
égalitaire pour désigner une profession
sur la perception de
la proportion de femmes au sein de cette profession
Source : graphiques présentés par Charlotte Jacquemot lors de son audition
Si l'usage de signes typographiques entre plusieurs terminaisons d'un mot (« point milieu ») et l'invention de mots nouveaux soulèvent de nombreuses questions, évoquées au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive38(*), en revanche une réflexion pourrait être engagée sur l'usage systématique de la double flexion pour évoquer des professions au sein des établissements scolaires et des contenus pédagogiques.
b) Mobiliser les établissements scolaires autour des enjeux d'égalité
Plus globalement, la délégation appelle à mobiliser l'ensemble des équipes éducatives, enseignants, chefs d'établissement et personnels de l'Éducation nationale, autour des enjeux d'égalité filles-garçons et de la prévention et de la lutte contre les stéréotypes et biais de genre et les comportements sexistes dès le plus jeune âge.
Elle soutient la proposition de la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)39(*) d'établir un cahier des charges pour une labellisation égalité filles-garçons des établissements du premier degré, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les établissements du second degré.
Face à un foisonnement d'informations sur les enjeux d'égalité filles-garçons, disponibles notamment sur le réseau Canopé, elle recommande également la rédaction d'un vademecum bien structuré et fournissant des ressources claires et facilement mobilisables, sur le modèle du vademecum sur la laïcité.
Elle encourage également les établissements scolaires à organiser des événements à l'occasion de la Fête de la science, début octobre, mais aussi de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le 11 février.
|
Recommandation n° 5 : Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et à la déconstruction des stéréotypes et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires. |
3. Développer la culture scientifique pour toutes et tous, dans tous les territoires
Au-delà des enjeux d'égalité filles-garçons, la délégation est convaincue de la nécessité d'acculturer l'ensemble des jeunes à la culture scientifique dès le primaire, tant sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire et hors scolaire.
Cette culture scientifique, notamment les émissions, revues, musées et actions de médiation scientifiques, doit veiller à soutenir les aspirations des filles qui montrent un intérêt pour les sciences, en mettant en lumière des femmes scientifiques et leur contribution à la recherche.
a) Augmenter la représentation des femmes scientifiques dans les médias audiovisuels
L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a un rôle à jouer s'agissant de la représentation des femmes scientifiques dans les médias, conformément à sa mission d'assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle.
La délégation souhaite que l'Arcom publie, dans le cadre de son rapport annuel sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio, des données sur la proportion de femmes scientifiques à l'antenne et leur temps de parole ainsi que sur leur représentation dans les programmes de fiction diffusés, y compris les dessins animés.
En outre, l'Arcom mène des actions d'incitation et de contrôle à l'égard des acteurs du secteur audiovisuel afin d'améliorer la représentation des femmes. La délégation invite l'Arcom à renforcer ces actions afin que les éditeurs atteignent des objectifs chiffrés de représentation des femmes scientifiques conformes avec la proportion de femmes parmi les métiers concernés, qu'ils veillent au temps de parole et non uniquement à la présence à l'antenne, qu'ils imposent la présence systématique de femmes dans les émissions scientifiques, qu'ils soient vigilants sur les programmes de fiction et de dessins animés diffusés et qu'ils forment leurs équipes aux enjeux d'égalité et de lutte contre les stéréotypes de genre.
|
Recommandation n° 6 : Inclure, dans le rapport annuel de l'Arcom sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio, des données sur la proportion de femmes scientifiques à l'antenne et leur temps de parole ainsi que sur leur représentation dans les programmes de fiction diffusés, et renforcer les actions d'incitation et de contrôle à disposition de l'Arcom à l'égard des acteurs du secteur audiovisuel afin d'augmenter cette représentation. |
b) Soutenir les structures, actions et lieux de médiation scientifique et d'enseignement ludique des mathématiques et des sciences
La délégation exprime son attachement à toutes les initiatives et structures visant à renforcer la culture scientifique de toutes et tous, en particulier les musées scientifiques et la Fête de la science. Elle soutient naturellement La Cité des sciences et de l'industrie et appelle de ses voeux la réouverture du Palais de la Découverte, institution phare de la médiation scientifique, fermée pour rénovation depuis quatre ans et dont beaucoup craignent qu'elle ne réouvre jamais ses portes.
Les rapporteures ont été très favorablement impressionnées par la dynamique en faveur de la culture scientifique engagée au Portugal. Lors d'un déplacement à Lisbonne40(*), elles ont pu découvrir la richesse du programme Ciência Viva, un programme d'activités scientifiques extra-scolaires, déployé par une agence nationale spécifiquement dédiée à la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du grand public et créée en 1996.
Le programme « Ciência Viva » au Portugal fêtera 30 ans en 2026
Le programme Ciência Viva, créé au Portugal en 1996, est mis en oeuvre par une agence nationale pour la culture et l'éducation scientifiques, avec pour but de dynamiser l'enseignement des sciences à l'école et de diffuser le plus largement possible, auprès de l'ensemble de la population, et surtout des plus jeunes, le goût pour la culture scientifique.
Ce programme est déployé localement par des antennes territoriales de l'agence nationale, en collaboration avec les écoles et des professeurs de tous les niveaux, dès la petite enfance. Sur l'ensemble du territoire portugais, un réseau de 21 centres de sciences est organisé pour diffuser la culture scientifique dans tout le pays et susciter, dès le plus jeune âge, un intérêt pour la science. Ce réseau comportera, d'ici 2026, un total de 23 centres de ressources scientifiques.
L'agence nationale est également attentive à assurer une égalité de traitement entre filles et garçons s'agissant de l'éducation scientifique. Certaines activités s'adressent plus spécifiquement aux filles, telles que la robotique ou le codage.
L'agence dispose d'un « pavillon » national situé à Lisbonne et que les rapporteures ont pu visiter : des classes viennent de tout le Portugal pour visiter ce pavillon et y pratiquer des activités scientifiques. Le pavillon propose également des expositions permanentes et temporaires qui accueillent de nombreuses familles en mettant l'accent sur la vulgarisation scientifique et l'apprentissage par le jeu.
Par ailleurs, les 21 centres de sciences répartis sur l'ensemble du territoire portugais accueillent toutes les semaines une classe différente appartenant à des écoles primaires. Chaque centre travaille ainsi en lien avec la municipalité et l'école concernées. Le déplacement fait l'objet d'un co-financement par la municipalité, l'école et le centre local de sciences. Les enfants accueillis ont entre 6 et 9 ans.
En outre, un programme d'implantation d'un réseau national de « clubs de sciences vives » dans les écoles portugaises a vu le jour en 2018, né d'une coopération entre le ministère de l'éducation nationale et l'agence nationale Ciência Viva.
En 2018, le réseau comptait environ 240 clubs contre près de 900 aujourd'hui. Près de 90 % des groupements scolaires disposent d'un club de sciences vives (718 au total), ce qui touche environ 1 million d'élèves. Ces clubs proposent des activités pratiques et expérimentales à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté éducative et font l'objet ensuite de sessions de partage d'expériences et de bonnes pratiques.
Source : Délégation aux droits des
femmes du Sénat - déplacement à Lisbonne
du 9 au
11 juillet 2025.
Ainsi, en 2022, au Portugal, 36 % des Portugaises et Portugais déclaraient souhaiter en savoir davantage sur les développements scientifiques, contre seulement 17 % des Françaises et Français, la moyenne des pays de l'OCDE se situant à 16 %. Par ailleurs, 64 % des Portugaises et Portugais fréquentaient régulièrement ou occasionnellement des lieux de diffusion de culture scientifique, tels que des musées, contre seulement 37 % des Françaises et des Français. Enfin, le Portugal comptait 42,6 % de femmes parmi ses chercheurs scientifiques, contre moins de 30 % en France.
La délégation soutient toutes les initiatives qui permettent d'augmenter la dimension ludique des apprentissages scientifiques pendant et hors du temps scolaire : expérimentations, ateliers type La main à la pâte, sorties scolaires scientifiques, événements à l'occasion de la Fête de la science, concours, rallyes, clubs de maths, d'échecs, de modélisation, d'informatique ou de jeux intelligents, etc.
L'enseignement du jeu d'échecs à l'école ou sur le temps périscolaire, notamment par le biais du programme « class'échecs », est un exemple d'initiative intéressante. Les échecs développent en effet des capacités de logique, d'abstraction, de stratégie, d'anticipation et de rigueur, qui sont utiles dans le développement d'un raisonnement scientifique et mathématique. Cela est aussi vrai pour d'autres types de jeux comme le bridge, le go ou les dames.
Les rapporteures ont découvert avec intérêt la Maison des mathématiques et de l'informatique portée par l'Université de Lyon, qui permet de découvrir les mathématiques et l'informatique de manière à la fois rigoureuse et ludique. Des expositions, ateliers, conférences et stages sont ouverts à tout type de public (enseignants, adultes curieux, scolaires, familles, jeune public...).
Comme proposé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse Jean-Michel Blanquer41(*), des vacances apprenantes à dominante « mathématiques et sciences » pourraient également permettre de mettre l'accent sur la dimension ludique de l'apprentissage de ces disciplines. Ce type d'initiative peut également s'intégrer au sein des programmes « École ouverte », « Cités éducatives » ou encore « Plan mercredi ».
Ainsi que le recommandait le rapport Villani-Taroussian, certaines activités ludiques peuvent être intégrées directement au sein des écoles, en s'appuyant sur les portails Animath ou Fondation Blaise Pascal, et des collaborations plus étroites et institutionnalisées pourraient être nouées entre le scolaire et le périscolaire.
En effet, l'enseignement scolaire et les activités périscolaires, par nature différents, se nourrissent mutuellement et les échanges entre enseignants et intervenants périscolaires profitent à chacun, dans le respect de leurs compétences respectives. Ainsi, la Maison pour la Science de Lorraine propose des ateliers périscolaires qui permettent aux enfants de manipuler des objets et outils en lien avec leurs apprentissages scolaires.
Un récent rapport de la Cour des comptes sur l'enseignement primaire42(*) préconise d'assurer un continuum pédagogique et éducatif dans et en dehors du temps scolaire, en développant une approche concertée de l'organisation des activités péri et extrascolaires, entre l'Éducation nationale et les collectivités territoriales, mais aussi en systématisant l'évaluation de ces activités en vue d'identifier et de sélectionner les activités les plus efficaces en termes d'apprentissages scolaires des élèves.
La délégation est également favorable au développement de la médiation scientifique assurée par des doctorants et des jeunes chercheurs, en particulier des jeunes femmes.
En effet, dans le cadre de contrats doctoraux, les universités permettent aux doctorants de consacrer un sixième de leur temps de travail, soit 32 jours dans l'année, à des missions de diffusion de l'information scientifique et technique, par le biais de structures de médiation scientifique, de laboratoires ou d'associations.
Ainsi, la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS) de l'Université Paris-Saclay propose à des élèves de 8 à 15 ans de participer à des ateliers animés par des doctorantes et doctorants dans le cadre de leur mission doctorale. De même, dans le cadre du programme « Les sciences, c'est leur chance » de l'Université Grenoble Alpes, des doctorantes et doctorants préparent et animent les séances de sciences en binôme avec les enseignants volontaires de classes d'école primaire situées dans des quartiers politique de la Ville.
Afin d'encourager la participation des doctorants à de telles actions, celle-ci doit être davantage rendue possible par les universités, dans le cadre de contrats doctoraux, et être reconnue et valorisée dans le parcours des doctorants, par exemple par l'obtention de crédits.
La délégation tient à souligner la nécessité de veiller à un accès équitable aux actions de médiation scientifique, qui doivent également atteindre les élèves situés dans les territoires ruraux et défavorisés, notamment les établissements des réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+).
|
Recommandation n° 7 : Soutenir la médiation scientifique, dans et hors des établissements scolaires, notamment en garantissant l'avenir du Palais de la Découverte, en facilitant les interventions de doctorantes et doctorants dans les écoles et en finançant des sorties et activités post et périscolaires scientifiques sur l'ensemble du territoire. |
4. Sensibiliser les parents à l'égalité filles-garçons
Aucune évolution du caractère genré de la socialisation des filles et des garçons ne sera possible sans associer les parents aux préoccupations en matière d'égalité filles-garçons, notamment dans le champ des mathématiques et des sciences.
Cela suppose d'informer les parents de l'égalité en compétences mathématiques des filles et des garçons et de casser l'idée du caractère inné de l'intelligence et du talent mathématique en particulier.
Il s'agit de les sensibiliser afin qu'ils soient vigilants à développer des interactions variées avec leurs filles comme avec leurs fils et à jouer aux mêmes jeux quel que soit le sexe de leur enfant. S'agissant de leurs filles, ils peuvent être encouragées à valoriser la curiosité, la résolution de problèmes, ainsi que des jeux de construction et de rapidité, afin de renforcer leur confiance en elles et d'éviter le développement d'une anxiété dans les contextes de compétition.
Pour cela, peuvent être mobilisées des campagnes de communication grand public mais aussi, de façon plus directe, les réunions de rentrée scolaire organisées avec les parents d'élèves. Dès la maternelle, les parents doivent être sensibilisés par les chefs d'établissements et les enseignants aux enjeux d'égalité filles-garçons.
Lors de son audition43(*), Jean-Michel Blanquer a évoqué l'initiative de la mallette des parents, mise en place lorsqu'il était recteur de l'académie de Créteil afin de renforcer le lien entre l'école et les familles, qui étaient accueillies en petit groupe afin de les associer aux objectifs poursuivis par l'école pour leurs enfants. Il pourrait être envisagé d'adjoindre à de telles rencontres une dimension autour de l'égalité filles-garçons en mathématiques et en sciences.
II. DANS LE SECONDAIRE, FAVORISER UNE ORIENTATION ÉGALITAIRE DES FILLES ET DES GARÇONS
Les premières différences filles-garçons dans le rapport aux mathématiques et aux sciences constatées dès l'école primaire se confirment au collège et au lycée. Si leurs résultats se rapprochent, c'est en revanche la perception que les jeunes et leur entourage ont de leurs performances qui se différencie de plus en plus.
Cela se traduit par des choix de spécialité et d'orientation qui demeurent extrêmement genrés en fin de troisième et au lycée.
Alors qu'aujourd'hui les discours en faveur de l'égalité et de la mixité des métiers font peser les responsabilités sur les filles, invitées à « oser » et à « ne plus s'auto-censurer », la délégation invite à changer de regard : plutôt que de sans cesse chercher à changer les filles, pourquoi ne pas plutôt, d'une part, changer l'enseignement et la perception des sciences, en les rendant plus enthousiasmantes pour toutes et tous, et, d'autre part, faire évoluer les représentations et les attitudes des garçons, en transmettant une réelle culture de l'égalité, en questionnant la hiérarchie des compétences, des qualités et des métiers et en luttant contre tous les propos et comportements sexistes et violents qui dissuadent les filles de s'orienter vers les sciences.
A. CONSTATS : AU FIL DES ANNÉES, DES INÉGALITÉS DE GENRE, SOCIALES ET TERRITORIALES QUI SE CUMULENT ET PÈSENT DANS LES CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET D'ORIENTATION
1. Un décrochage des collégiennes comme des collégiens vis-à-vis des mathématiques et des sciences
a) Un décrochage global, moins marqué chez les filles, qui réduisent donc leur écart au cours du collège
Au collège, une proportion significative d'élèves décroche progressivement en mathématiques, avec des notes qui chutent significativement en quatrième.
Les enquêtes internationales mettent en lumière ce net décrochage des élèves français en mathématiques et sciences, dont le niveau en classe de quatrième est ainsi inférieur à la moyenne internationale des pays de l'UE et de l'OCDE participant à l'enquête Timss.
En raison d'un décrochage plus fort des garçons, les écarts de résultats entre filles et garçons se réduisent entre la sixième et la troisième.
Ce phénomène, déjà documenté par Christian Baudelot et Roger Establet dans leur célèbre ouvrage Allez les filles !44(*), a été confirmé par plusieurs études postérieures. Ainsi, une étude de 201945(*) relevait qu'en sixième les filles avaient des performances plus faibles en mathématiques mais qu'entre la sixième et la troisième elles se maintenaient davantage que les garçons, comblant leur écart. Cette même étude constatait que, parallèlement, l'écart de résultats en faveur des filles en français se creusait progressivement. Une étude plus récente46(*) confirme qu'au cours du collège les filles progressent davantage que les garçons en français comme en mathématiques, réduisant ainsi leur écart avec les garçons s'agissant des mathématiques.
L'évaluation internationale Timss menée auprès d'élèves de quatrième continue à faire apparaître des résultats supérieurs en mathématiques pour les garçons, mais cet écart se situe dans la moyenne des pays de l'UE et de l'OCDE participant à l'enquête47(*), contrairement aux écarts relevés en classe de CM1. En outre, cet écart, de 12 points, est bien moins significatif que l'écart de résultats entre élèves favorisés et peu favorisés, qui atteint 103 points. S'agissant des sciences, les niveaux de performance sont similaires entre filles et garçons48(*).
En début de seconde générale et technologique, le taux de maîtrise satisfaisante des mathématiques est de 84 % pour les garçons contre 75 % pour les filles49(*).
Comme pour les résultats à l'école primaire50(*), inégalités sociales et inégalités de genre se croisent dans l'analyse des écarts de performances des élèves.
Des travaux de la Chaire Unesco « Femmes et science » de l'université Paris Dauphine-PSL, analysant les 10 % d'élèves les plus performants dans les enquêtes PISA - montrent que « les filles réussissent mieux en sciences - et plus précisément en mathématiques - dans les pays où les élèves issus de milieux défavorisés obtiennent de meilleurs résultats. Autrement dit, réussir en sciences en tant que fille relève du même mécanisme social que réussir en sciences lorsqu'on est issu des catégories socioprofessionnelles défavorisées », déclarait Elyes Jouini, professeur de mathématiques et d'économie et titulaire de la Chaire, devant la délégation51(*).
b) Des critiques sur la façon dont les mathématiques et les sciences sont enseignées
Devant ce décrochage, de nombreux interlocuteurs entendus ou rencontrés par la délégation ont posé un regard critique sur l'enseignement des sciences et des mathématiques dans le second degré, déplorant notamment le manque de liens entre les mathématiques et les autres disciplines - pas uniquement scientifiques, ainsi que les difficultés des professeurs à rendre leur enseignement concret et enthousiasmant pour les élèves.
Ces critiques se retrouvent chez les collégiens : en classe de quatrième, à peine la moitié des élèves (42 % des filles et 59 % des garçons) déclarent aimer les mathématiques et seulement un quart des élèves (24 % des filles et 29 % des garçons) considèrent que leur enseignement est d'une grande clarté52(*).
Au collège, les élèves abordent de façon séparée les différentes disciplines scientifiques : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie. Un enseignement intégré de science et technologie (EIST), articulant en sixième et cinquième physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie, peut être mis en place pour favoriser un décloisonnement disciplinaire. Cependant, il concerne aujourd'hui un nombre limité de collèges et n'a pas prouvé son efficacité dans la progression des performances et de la motivation des élèves en sciences au cours du collège53(*).
Lors de la réforme du lycée, mise en oeuvre à la rentrée 2019, la création de l'enseignement scientifique en classe de première générale visait à renforcer la culture et l'approche scientifiques des élèves en articulant sciences de la vie et de la terre, physique et mathématiques - cette dernière discipline faisant de nouveau l'objet d'un enseignement spécifique depuis 2023. Cependant, comme l'a déploré l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer lui-même devant la délégation, ces heures peuvent être réparties de manière éclatée, par discipline, sans faire l'objet d'une approche intégrée et transversale.
c) Des différences de rapport aux mathématiques entre filles et garçons
Au-delà de la question des performances, l'enquête Timss met en lumière des différences de perception des mathématiques entre filles et garçons : 59 % des garçons déclarent aimer les mathématiques, contre 42 % des filles, et surtout 54 % des garçons se déclarent confiants en leurs capacités en mathématiques, contre 40 % des filles.
Ce phénomène se retrouve également chez les élèves les plus performants en mathématiques : les filles sont moins confiantes que les garçons quant à leurs performances, et ce de façon très notable en classe de quatrième.
Proportion d'élèves filles et garçons pensant avoir réussi le test de mathématiques, parmi les élèves les plus performants aux évaluations de rentrée dans cette discipline
Source : DEPP, questionnaires élèves, septembre 2024.
Plus globalement, de nombreux travaux de recherche montrent qu'à compétences égales, les hommes ont tendance à surestimer leurs capacités et les femmes à les sous-estimer, et ce particulièrement en mathématiques et en sciences54(*).
Les garçons restent perçus dans leur ensemble, par eux-mêmes, leurs camarades, leurs familles et leurs enseignants, comme étant meilleurs en mathématiques et sciences. Un sondage, réalisé dans le cadre du rapport de France Stratégie sur les stéréotypes filles-garçons55(*), montre qu'un quart des jeunes de 11-17 ans pensent que les garçons ont davantage l'esprit scientifique que les filles.
Les interlocuteurs entendus par les rapporteures ont partagé de nombreux témoignages de propos sexistes tenus entre élèves mettant en doute les capacités des filles en mathématiques et en sciences.
Ces stéréotypes ne sont pas présents que chez les élèves, des biais de genre existent également chez leurs enseignants. Ils se manifestent dans leur façon d'interroger les élèves, les consignes données et la manière de penser les trajectoires scolaires. De nombreux travaux de recherche56(*) montrent que les enseignants en mathématiques accordent une attention supplémentaire aux garçons, qui prennent davantage la parole spontanément, qui sont davantage interrogés avec des consignes complexes et dont les réponses sont davantage attendues. Les termes employés pour évaluer et qualifier les élèves ne sont également pas identiques, que ce soit à l'oral ou sur leurs bulletins scolaires. Pour Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, « là où les garçons sont souvent félicités pour leurs talents, les jeunes filles, elles, sont plus fréquemment complimentées pour leurs efforts. Cette situation génère, chez bon nombre de jeunes femmes, un sentiment de doute [et] constitue un frein réel à leur orientation vers les filières scientifiques et techniques. »57(*)
Ces perceptions différenciées affectent les performances des jeunes filles : lorsqu'elles abordent un exercice en ayant à l'esprit le stéréotype selon lequel les filles sont moins douées dans cette discipline, les filles subissent une pression et de l'anxiété supplémentaires, qui conduisent à des contre-performances, selon le mécanisme de la « menace du stéréotype » précédemment évoqué58(*). Pour Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'université Paris-Dauphine59(*), ce mécanisme se manifeste particulièrement dans les contextes compétitifs, nombreux et structurants dans le système scolaire français, et dans les environnements mixtes, où la compétition implique simultanément filles et garçons.
Ces différences de perceptions peuvent aider à comprendre pourquoi, en dépit de performances qui ne sont globalement pas si éloignées entre filles et garçons en mathématiques et en sciences à la fin du collège et même à résultats scolaires équivalents, les filles font très nettement moins que les garçons le choix de spécialités et filières ouvrant la voie à des métiers scientifiques.
2. Des choix de spécialités et d'orientation professionnelle genrés en fin de troisième comme au lycée
a) En fin de troisième, des inégalités sociales et de genre dans l'orientation vers les voies technologiques et professionnelles
Lors de l'orientation en fin de troisième, les effets de l'origine sociale et du genre des élèves s'articulent entre eux.
Ainsi que le déclarait la sociologue Marianne Blanchard : « au total, ceux qui ont le moins de probabilité d'accéder à une terminale scientifique, ce sont les garçons des classes défavorisées car ils seront davantage orientés vers une voie professionnelle en fin de troisième. »60(*)
Les filles accèdent davantage à une seconde générale et technologique : c'est le cas de 68 % d'entre elles, contre seulement 55 % des garçons.
Orientation des filles et des garçons en fin de troisième
Pour autant, au sein des différentes voies et filières, les proportions de filles et garçons varient fortement. Les filles représentent ainsi 55 % des élèves de la voie générale, 50 % de ceux de la voie technologique et 45 % de ceux la voie professionnelle. Les différences sont surtout notables au sein des filières61(*) :
· au sein de la voie technologique, on compte 84% de filles en « santé et social », mais seulement 10 % de filles en « industrie et développement durable » ;
· au sein de la voie professionnelle, on recense 96 % de filles en « coiffure, esthétique », mais seulement 5 % en « moteurs et mécanique auto » et 2% en « électricité, électronique ».
Proportion de filles au sein des différentes filières et combinaisons de spécialités en terminale générale, technologique et professionnelle
Source : DEPP, Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, 2025.
b) Un moindre choix des spécialités scientifiques chez les filles en lycée général, accentué depuis la réforme du lycée
En seconde générale et technologique, tous les élèves ont des enseignements communs, comportant 4 heures hebdomadaires de mathématiques, 3 heures de physique-chimie, 1h30 de sciences de la vie et de la terre (SVT) et 1h30 de sciences numériques et technologie. Ils peuvent également choisir un enseignement général ainsi qu'un enseignement technologique.
Dans ce cadre, lors de la rentrée 2024, environ 10 % des élèves de seconde générale et technologique avaient choisi un enseignement optionnel scientifique. Cependant, la proportion de filles au sein de ces enseignements varie grandement en fonction de leur contenu, réel ou supposé : les filles ne représentent que 15 % des élèves ayant opté pour « sciences de l'ingénieur » ou « création et innovation technologiques » mais 60 % de ceux ayant choisi « biotechnologies » ou « sciences et laboratoires »62(*).
Dans la suite de leur parcours, depuis la réforme du baccalauréat menée par le ministre Jean-Michel Blanquer qui a mis fin au système des trois séries, les élèves de lycée général choisissent des enseignements de spécialité : trois disciplines en classe de première puis deux en terminale parmi les trois suivies en première.
Pour de nombreux interlocuteurs de la délégation, cette réforme a d'abord eu des effets très négatifs et suscité des délusions. Pour Romain Soubeyran, directeur de CentraleSupélec, « le message initial, selon lequel "toutes les spécialités ouvrent l'ensemble des parcours possibles", a semé une certaine confusion. Beaucoup d'élèves ont été abusés par cette promesse. » Il estime qu'aujourd'hui « il semble que l'information ait été mieux intégrée : celles et ceux qui envisagent une prépa scientifique savent désormais qu'ils doivent impérativement choisir des spécialités scientifiques, notamment les mathématiques, sans quoi ils se trouveraient, de fait, exclus de ces parcours. »63(*) Pour autant, cela suppose que les élèves sachent dès la seconde qu'ils souhaitent s'orienter vers une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) scientifiques et a minima qu'ils connaissent ce type de formation.
Il semble qu'un déficit global d'informations sur les liens entre choix de spécialités et orientation future perdure, en particulier chez les filles, ainsi que chez les élèves les moins favorisés.
Selon Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, la réforme du lycée « n'a pas encore été pleinement assimilée. Certains chefs d'établissement adoptent encore une approche quelque peu naïve en matière d'orientation, soutenant que les élèves doivent choisir les options qui les intéressent. Or, bien que les différentes combinaisons, comme la biologie et la musique, puissent paraître passionnantes, elles sont pénalisantes pour l'orientation. »64(*) Elle estime ainsi que nous sommes dans une phase transitoire.
Pour Elyes Jouini, titulaire de la chaire Unesco Femmes et sciences de Paris-Dauphine-PSL, « en laissant les filles libres de choisir, sans cadre ni alerte, on les prive d'une liberté véritable, celle-ci n'étant pas éclairée »65(*).
La réforme du lycée a ainsi été suivie d'une diminution de la proportion de filles optant pour la spécialité de mathématiques, ce qui a été d'autant plus problématique qu'au départ - et jusqu'à la rentrée 2023 - les mathématiques ne figuraient pas en tant que telles dans le tronc commun de première, qui ne comprenait qu'un enseignement scientifique global.
Ainsi, en 2021, 49 % des filles et 30 % des garçons ne suivaient plus d'enseignement spécifique de mathématiques en terminale, contre respectivement 18 et 6 % en 2018, avant la réforme.
Le taux de renonciation aux mathématiques est fortement corrélé à l'origine sociale des élèves, qu'il s'agisse des garçons comme des filles : 58 % des filles et 38 % des garçons de terminale issus de familles à dominante ouvrière ont abandonné les mathématiques, contre 35 % des filles et 20 % des garçons dont les deux parents sont cadres.
De façon plus générale, il importe de ne pas percevoir « les filles » comme un bloc homogène car les filles ne sont pas toutes dans la même situation vis-à-vis de l'accès aux sciences et en particulier aux mathématiques, qui demeurent une discipline de sélection, pour laquelle les inégalités sociales et de genre se croisent.
Proportion, en fonction du sexe et de l'origine
sociale, des élèves de terminale
ne suivant plus
d'enseignement spécifique de mathématiques
Source : Blanchard, Déage, Lemistre, Rossignol-Brunet
Proportion, en fonction du sexe et de l'origine sociale, des élèves de terminale suivant une spécialité mathématiques en 2018, ou l'enseignement de spécialité de mathématiques + l'option mathématiques expertes en 2021
Source : Blanchard, Déage, Lemistre, Rossignol-Brunet
Ce phénomène perdure six ans après la réforme, même si moins de filles renoncent aux mathématiques. Lors de la rentrée 2024, en première générale, parmi leurs trois enseignements de spécialité, 77 % des garçons ont choisi l'enseignement de spécialité « mathématiques » contre 58 % des filles. En outre, moins de 5 % des filles choisissent la spécialité « numérique et sciences informatiques » ou « sciences de l'ingénieur », contre respectivement 18 et 8 % des garçons pour chacune de ces spécialités.
Effectifs et proportion d'élèves de
première générale par enseignement
de
spécialité à la rentrée 2024
|
Enseignement de spécialité |
Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |
Proportion de filles |
Part d'élèves ayant fait ce choix |
Part de filles ayant fait ce choix |
Part de garçons ayant fait ce choix |
|
Mathématiques |
252 513 |
48,4 % |
66,0 % |
57,5 % |
76,7 % |
|
Physique-chimie |
173 243 |
46,3 % |
45,3 % |
37,8 % |
54,8 % |
|
Sciences économiques et sociales (SES) |
167 749 |
58,8 % |
43,9 % |
46,4 % |
40,7 % |
|
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
152 826 |
60,8 % |
40,0 % |
43,7 % |
35,3 % |
|
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) |
127 727 |
62,7 % |
33,4 % |
37,7 % |
28,0 % |
|
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) |
114 812 |
65,7 % |
30,0 % |
35,5 % |
23,2 % |
|
Humanités, littérature et philosophie (HLP) |
68 885 |
80,4 % |
18,0 % |
26,1 % |
8,0 % |
|
Numérique et sciences informatiques (NSI) |
36 905 |
19,1 % |
9,7 % |
3,3 % |
17,6 % |
|
Sciences de l'ingénieur (SI) |
16 908 |
16,1 % |
4,4 % |
1,3 % |
8,4 % |
|
Arts plastiques |
12 815 |
79,5 % |
3,4 % |
4,8 % |
1,5 % |
|
Éducation physique, pratiques et culture sportives |
7 998 |
32,3 % |
2,1 % |
1,2 % |
3,2 % |
|
Cinéma-audiovisuel |
4 874 |
61,8 % |
1,3 % |
1,4 % |
1,1 % |
|
Histoire des arts |
3 048 |
80,2 % |
0,8 % |
1,2 % |
0,4 % |
|
Théâtre |
2 959 |
75,1 % |
0,8 % |
1,0 % |
0,4 % |
|
Musique |
1 838 |
60,1 % |
0,5 % |
0,5 % |
0,4 % |
|
Danse |
531 |
87,8 % |
0,1 % |
0,2 % |
0,0 % |
|
Littérature et langue et culture de l'Antiquité (LLCA) latin |
527 |
75,5 % |
0,1 % |
0,2 % |
0,1 % |
|
LLCA grec |
217 |
70,5 % |
0,1 % |
0,1 % |
0,0 % |
|
Arts du cirque |
123 |
68,3 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
|
Biologie-écologie (lycées agricoles) |
4 |
75,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
Source : DEPP, Système d'information Scolarité, public + privé sous contrat, rentrée 2024.
Lors de la rentrée 2024, en terminale générale, la moitié des garçons a choisi une combinaison de deux spécialités scientifiques, contre un tiers des filles. A contrario, la moitié des filles n'a choisi aucune spécialité scientifique, contre 30 % des garçons.
S'agissant spécifiquement des mathématiques, trois niveaux d'enseignement sont possibles :
· l'option « mathématiques complémentaires » pour celles et ceux qui abandonnent la spécialité « mathématiques » mais souhaitent poursuivre un enseignement de mathématiques (3 heures par semaine) : elle est choisie par 16 % des filles et 12 % des garçons. L'accès à cette option est techniquement possible pour des élèves n'ayant pas suivi de spécialité « mathématiques » en première et uniquement l'enseignement du tronc commun, cependant cela exige une forte remise à niveau ;
· l'enseignement de spécialité « mathématiques » (6 heures par semaine) : 58 % des garçons contre 34 % des filles ont choisi cette spécialité ;
· l'enseignement de spécialité couplé à l'option « mathématiques expertes » (9 heures par semaine) : seule une fille sur dix a choisi « mathématiques expertes » contre un quart des garçons, qui représentent donc deux tiers des élèves au sein de cette option.
Au total, la moitié des filles de terminale n'a aucun enseignement de mathématiques, contre 30 % des garçons.
Par ailleurs, la refonte des programmes de mathématiques a entraîné un relèvement du niveau d'exigence, ce dont on peut se féliciter pour les futurs scientifiques, mais qui ouvre peu d'opportunités à des élèves souhaitant continuer à étudier les mathématiques sans pour autant poursuivre des études scientifiques. Selon plusieurs interlocuteurs de la délégation, depuis la réforme du lycée, on ne propose plus aux lycéens que les mathématiques pour faire des sciences, et non plus les mathématiques qui étaient proposées dans la filière ES (économique et sociale) et permettaient de faire de l'économie.
Or, les mathématiques ne sont pas utiles que pour les études scientifiques. Elles le sont également pour les futurs professeurs des écoles, comme précédemment évoqué, mais aussi pour les chercheurs en sciences sociales, pour ceux qui travailleront dans des entreprises ou des administrations, dans la comptabilité, la gestion ou le management.
Effectifs et proportion d'élèves de
terminale générale par enseignement
de
spécialité à la rentrée 2024
|
Enseignement de spécialité |
Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |
Proportion de filles (%) |
Part d'élèves ayant fait ce choix (%) |
Part de filles ayant fait ce choix (%) |
Part de garçons ayant fait ce choix (%) |
|
Mathématiques |
168 112 |
41,8 |
44,8 |
33,8 |
58,3 |
|
Physique-chimie |
130 069 |
58,9 |
34,6 |
36,9 |
31,9 |
|
Sciences économiques et sociales (SES) |
118 985 |
46,6 |
31,7 |
26,7 |
37,9 |
|
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |
91 725 |
62,6 |
24,4 |
27,7 |
20,4 |
|
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) |
88 424 |
63,3 |
23,6 |
27,0 |
19,3 |
|
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) |
66 485 |
71,1 |
17,7 |
22,8 |
11,4 |
|
Humanités, littérature et philosophie (HLP) |
37 356 |
82,2 |
10,0 |
14,8 |
4,0 |
|
Numérique et sciences informatiques (NSI) |
17 061 |
15,2 |
4,5 |
1,2 |
8,6 |
|
Sciences de l'ingénieur (SI) |
10 471 |
80,4 |
2,8 |
4,1 |
1,2 |
|
Arts plastiques |
5 447 |
14,7 |
1,5 |
0,4 |
2,8 |
|
Éducation physique, pratiques et culture sportives |
5 725 |
32,2 |
1,5 |
0,9 |
2,3 |
|
Cinéma-audiovisuel |
3 826 |
63,1 |
1,0 |
1,2 |
0,8 |
|
Histoire des arts |
2 381 |
82,2 |
0,6 |
0,9 |
0,3 |
|
Théâtre |
2 168 |
78,0 |
0,6 |
0,8 |
0,3 |
|
Musique |
1 351 |
58,3 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
Danse |
379 |
92,1 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
|
Littérature et langue et culture de l'Antiquité (LLCA) latin |
293 |
79,2 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
LLCA grec |
99 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Arts du cirque |
100 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Biologie-écologie (1) |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(1) proposé dans les lycées agricoles
Source : DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.
Effectifs et proportion d'élèves de terminale générale par combinaison d'enseignements de spécialité (« doublette ») à la rentrée 2024
|
Enseignement de spécialité |
Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |
Proportion de filles |
Part d'élèves ayant fait ce choix |
Part de filles ayant fait ce choix |
Part de garçons ayant fait ce choix |
|
Mathématiques, physique-chimie |
79 378 |
37,7 % |
21,1 % |
14,4 % |
29,5 % |
|
HGGSP, SES |
48 257 |
58,2 % |
12,9 % |
13,5 % |
12,0 % |
|
Physique-chimie, SVT |
36 417 |
66,4 % |
9,7 % |
11,6 % |
7,3 % |
|
Mathématiques, SES |
33 225 |
46,5 % |
8,9 % |
7,4 % |
10,6 % |
|
Mathématiques, SVT |
23 046 |
59,2 % |
6,1 % |
6,6 % |
5,6 % |
|
LLCER, SES |
22 241 |
69,3 % |
5,9 % |
7,4 % |
4,1 % |
|
HGGSP, LLCER |
16 004 |
71,5 % |
4,3 % |
5,5 % |
2,7 % |
|
SVT, SES |
12 099 |
62,9 % |
3,2 % |
3,7 % |
2,7 % |
|
HGGSP, HLP |
12 085 |
76,8 % |
3,2 % |
4,5 % |
1,7 % |
|
Mathématiques, NSI |
11 905 |
12,1 % |
3,2 % |
0,7 % |
6,2 % |
|
HLP, LLCER |
8 688 |
85,6 % |
2,3 % |
3,6 % |
0,7 % |
|
HLP, SES |
8 498 |
84,5 % |
2,3 % |
3,5 % |
0,8 % |
|
HGGSP, mathématiques |
6 780 |
54,9 % |
1,8 % |
1,8 % |
1,8 % |
|
Mathématiques, LLCER |
5 267 |
57,4 % |
1,4 % |
1,5 % |
1,3 % |
|
SVT, LLCER |
4 869 |
73,1 % |
1,3 % |
1,7 % |
0,8 % |
|
Mathématiques, SI |
4 615 |
14,5 % |
1,2 % |
0,3 % |
2,4 % |
|
HGGSP, SVT |
4 327 |
56,1 % |
1,2 % |
1,2 % |
1,1 % |
|
Autres |
37 704 |
61,5 % |
10,0 % |
11,2 % |
8,7 % |
Source : DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.
Effectifs et proportion d'élèves de terminale générale selon l'enseignement optionnel facultatif suivi à la rentrée 2024
|
Premier enseignement optionnel facultatif |
Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |
Proportion de filles |
Part d'élèves ayant fait ce choix |
Part de filles ayant fait ce choix |
Part de garçons ayant fait ce choix |
|
Mathématiques complémentaires |
52 606 |
62,7 % |
14,0 % |
15,9 % |
11,7 % |
|
Mathématiques expertes |
60 833 |
33,5 % |
16,3 % |
9,8 % |
24,1 % |
|
Droit et grands enjeux du monde contemporain |
28 123 |
73,7 % |
7,5 % |
10,0 % |
4,4 % |
Source : DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.
Certes, les effets directs de la réforme du lycée - et de la plus faible proportion de filles suivant des spécialités mathématiques et scientifiques - sur la proportion de filles susceptibles d'accéder à une carrière scientifique doivent être nuancés.
Lors de son audition, l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer a estimé qu'avoir moins d'élèves, filles comme garçons, choisissant des spécialités scientifiques n'était pas problématique en matière d'orientation puisque « là où environ 50 % des élèves issus de la série S poursuivaient dans des filières scientifiques, nous constatons désormais que près de 90 % des élèves ayant choisi les enseignements scientifiques s'y engagent effectivement dans l'enseignement supérieur »66(*).
Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur à l'Université Paris Saclay, a également relevé, lors de son audition67(*), que cette réforme n'a pas modifié la proportion de filles dans les études supérieures scientifiques, qui reste stable, mais a plutôt conduit à une anticipation du choix d'abandonner les mathématiques : dès la première et non plus seulement après le bac.
Pour autant, cette précocité des choix s'avère problématique.
Lors de son audition, la sociologue Marianne Blanchard a dénoncé « le piège des choix » qui impose aux élèves d'exprimer leur individualité par des choix, alors même que, selon elle, « plus on demande aux jeunes de faire des choix tôt, plus les modèles sont stéréotypés ».68(*)
En outre, comme l'a mis en avant Elyes Jouini, « plus les choix d'orientation interviennent précocement, plus ils pénalisent les publics déjà défavorisés, qu'il s'agisse des femmes en sciences ou des jeunes issus de milieux modestes. Ces décisions précoces manquent souvent d'une information complète et égalitaire : seuls les enfants bénéficiant d'un entourage familial ou environnemental informé accèdent à un véritable éclairage, ce qui renforce inexorablement les inégalités. »69(*)
Par ailleurs, les filles ont souvent des projets professionnels multiples et diversifiés et celles qui ont de bons résultats en mathématiques ont souvent également de bons résultats dans les matières littéraires, et sont attachées à la pluridisciplinarité, ce qui est moins le cas pour les garçons. Pour elles, faire des choix, c'est donc aussi renoncer.
De plus, toujours selon Marianne Blanchard, les filles font davantage des choix sécurisés et ne choisissent donc pas l'option « mathématiques expertes » par crainte de ne pas réussir alors même qu'elles pourraient réussir dans cette discipline.
Le caractère massif des écarts entre filles et garçons dans le choix de spécialités scientifiques et d'enseignements en mathématiques est donc problématique, tout particulièrement par ce qu'il implique en matière d'orientation genrée.
c) Des choix d'orientation genrés à l'issue du bac
En fin de terminale, les filles sont bien moins nombreuses que les garçons à s'orienter vers des filières scientifiques : en 2023, seules 17 % des bachelières faisant le choix de poursuivre des études supérieures ont opté pour des filières STIM, contre 44 % des garçons70(*).
Les interlocuteurs entendus par la délégation ont également mis en avant le fait que les lycéennes expriment davantage que les garçons un goût pour la pluridisciplinarité et le souhait de garder cette pluridisciplinarité avant de faire un choix d'orientation professionnelle définitif, formulant donc moins souvent des choix d'orientation post-bac centrés sur un parcours uniquement scientifique.
Orientation par filière des bachelières et bacheliers s'inscrivant dans un établissement de l'enseignement supérieur en France l'année d'obtention du bac
Une nouvelle fois, inégalités sociales et inégalités de genre se croisent dans les choix d'orientation post-bac, y compris dans les choix des types de formation scientifique.
Ainsi, les interlocuteurs rencontrés par les rapporteures lors d'un déplacement dans la Meuse71(*) ont témoigné de l'existence de stratégies d'orientation différentes en fonction de l'origine sociale et de l'origine géographique : les jeunes filles rurales de milieux populaires s'orientent davantage vers les sciences de la vie, les jeunes filles rurales de classe intermédiaire vont plus vers des prépas intégrées au sein d'écoles d'ingénieurs, tandis que les jeunes filles urbaines favorisées suivent davantage un parcours en CPGE.
Lors de son audition, Elyes Jouini a souligné le fait que l'écart d'orientation vers les filières scientifiques se manifeste en particulier parmi les meilleurs élèves, les filles se détournant davantage que les garçons de ces filières : « plus on est performant en sciences, plus on a de chances de poursuivre des études scientifiques. Pourtant, cet effet se révèle beaucoup plus fort pour les garçons que pour les filles. Autrement dit, les meilleures filles en sciences ne se dirigent pas nécessairement vers les filières scientifiques, ou pas avec la même intensité que leurs homologues masculins. » 72(*)
Selon des travaux menés par Thomas Breda73(*), les différences de résultats en mathématiques ne suffisent pas à expliquer les écarts d'orientation entre filières scientifiques et littéraires parmi les meilleurs élèves. Les filles ont en effet plus souvent un profil de double réussite en mathématiques et en français.
Il estime que la prise en compte de l'avantage comparatif entre ces deux disciplines est un meilleur facteur explicatif puisque 30 % des filles sont meilleures en mathématiques qu'en français, contre 60 % des garçons. Ainsi, nombre de garçons s'orientent vers les filières scientifiques par défaut, faute de perspectives littéraires comparables.
En outre, l'avantage comparatif des élèves façonne leur perception d'eux-mêmes et leur confiance en eux vis-à-vis des différentes disciplines : « exceller en mathématiques conduit à se percevoir comme "matheux", tandis qu'être meilleur en français renforce une identité littéraire. Or, les filles, même très performantes en mathématiques, s'avèrent souvent encore meilleures en lettres et tendent à se considérer comme littéraires. Les enseignants, en valorisant les meilleurs élèves dans chaque discipline, contribuent sans doute à renforcer ce phénomène. »
Il est souvent dit que les jeunes filles sont découragées par l'aspect compétitif des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Pourtant, elles représentant les deux tiers des étudiants en médecine, ainsi qu'en classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la terre), des études scientifiques qui sont pourtant sélectives et très compétitives. Elles sont également nombreuses dans d'autres filières sélectives, comme les CPGE littéraires ou économiques, ainsi que les instituts d'études politiques.
La chercheuse Georgia Thebaut expliquait ainsi devant la délégation : « plus une filière est sélective, plus elle recrute d'élèves issus de catégories favorisées. En revanche, lorsqu'on examine la part de femmes dans ces mêmes filières, aucune relation comparable n'apparaît. On observe ainsi une proportion importante de femmes dans des formations très sélectives, comme les CPGE littéraires, où environ 80 % des élèves admis ont obtenu une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat. »74(*)
Cette explication apparaît donc comme en partie fallacieuse et d'autres facteurs propres aux études scientifiques expliquent la faible proportion de jeunes filles choisissant ces cursus.
L'enquête GenderScan menée auprès des étudiantes et étudiants d'écoles d'ingénieur en France révèle que plus de 40 % des étudiantes ont été dissuadées, à un moment ou à un autre de leur parcours, de s'orienter vers les filières STIM et que 32 % des étudiantes en filières STIM et 45 % des étudiantes inscrites dans des formations numériques ont subi des formes de découragement liées à leur genre. Ce découragement est venu de la part de professeurs, qui sont des prescripteurs décisifs dans les choix d'orientation, de l'entourage familial ainsi que du cercle amical. Ce constat a interpellé Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs : « combien d'autres auraient pu nous rejoindre si elles n'avaient pas été découragées ? »75(*).
La délégation rejoint ce questionnement et s'est donc penchée sur les actions de nature à ne plus décourager les jeunes filles de s'intéresser aux savoirs et métiers scientifiques.
B. RECOMMANDATIONS : RÉÉCRIRE L'ÉQUATION POUR ENCOURAGER L'ENVIE DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES
La délégation souhaite délaisser la rhétorique autour du « manque de confiance en soi » et de « l'auto-censure » des filles, qui fait peser sur les filles la responsabilité de leur moindre choix d'une orientation scientifique et oriente les solutions sur un changement de comportement des filles, qu'il s'agirait d'encourager à oser.
Ainsi que le soulignait Clémence Perronnet, sociologue des sciences, lors de son audition « l'absence de confiance en elles des filles n'est pas la cause de l'absence d'orientation vers des filières scientifiques, mais plutôt la conséquence de ce qu'elles vivent lorsqu'elles s'intéressent aux sciences et des remarques sexistes qui leur font comprendre qu'elles n'ont pas leur place dans ce secteur »76(*).
Non seulement la rhétorique autour de l'auto-censure évite de creuser les causes profondes du manque de confiance en elles des jeunes filles, en lien avec les stéréotypes et biais de genre précédemment évoqués77(*), mais elle n'interroge pas les raisons légitimes qu'ont les jeunes filles de se détourner des mathématiques et des sciences. En effet, les filles n'ont pas nécessairement une vision positive de ces disciplines ni des métiers scientifiques, qu'elles associent à des métiers non seulement masculins, sexistes et donc potentiellement dangereux, mais aussi à des métiers abstraits et austères, dont elles ne perçoivent pas le sens.
La délégation souhaite donc changer d'angle de vue et, plutôt que de chercher à changer les filles, encourager l'envie de mathématiques et de sciences chez toutes et tous.
1. Plutôt que de changer les filles, changeons l'enseignement et la perception des sciences
a) Faire évoluer l'enseignement des mathématiques et des sciences
Alors que seules 42 % des filles, contre 59 % des garçons, déclarent aimer les mathématiques en classe de quatrième78(*), il importe de se pencher sur la façon dont cette discipline est enseignée, sur le contenu des programmes et sur les méthodes pédagogiques.
La délégation soutient tous les ateliers concrets de type Mains à la pâte, qui permettent aux élèves de manipuler, expérimenter et ainsi découvrir les mathématiques et les sciences autrement. Elle recommande également de renforcer les partenariats des collèges et lycées avec les maisons des sciences afin de développer cette approche expérimentale et participative.
Dans le cadre du plan Filles et mathématiques, la ministre Élisabeth Borne a annoncé la mise en place de classes à horaires aménagés Mathématiques et Sciences en quatrième et troisième. Ces classes devront comporter la moitié de filles. La délégation soutient cette proposition, dont il conviendra d'évaluer l'efficacité, en particulier en suivant la cohorte des élèves jusqu'à la terminale afin de vérifier si l'intégration dans ces classes augmente la probabilité de poursuivre un cursus scientifique poussé.
La ministre Élisabeth Borne a également communiqué autour de la rénovation du contenu et des méthodes de deux enseignements - l'enseignement des sciences numériques et technologiques (SNT), obligatoire en seconde générale et technologique, et la filière technologique « sciences et technologies industrielles et du développement durable (STIDD) » - dans le but de donner davantage envie aux élèves, et en particulier aux filles, de s'orienter vers les filières STIM.
Faire évoluer l'enseignement des mathématiques et des sciences suppose aussi de rapprocher les enseignants de professionnels travaillant dans la recherche ou dans l'industrie, afin de leur donner des exemples de mises en application concrètes et actuelles des disciplines qu'ils enseignent, qu'ils pourront ensuite mobiliser pour leurs élèves. Cela permettra également aux enseignants de mieux conseiller leurs élèves dans leur choix d'orientation grâce à une meilleure connaissance des métiers.
Au-delà de la salle de classe, la participation des filles à des concours et clubs mathématiques et scientifiques, sur le temps périscolaire, doit être encouragée. Ces activités peuvent être l'occasion pour les élèves de découvrir d'autres facettes de l'utilité des mathématiques et des sciences. Ainsi, lors d'un déplacement dans la Meuse79(*), une professeure du collège Pierre et Marie Curie de Bouligny, qui fait partie du réseau des collèges La Main à la pâte, a souligné auprès des rapporteurs les multiples bénéfices qu'avait eu le concours C'est génial pour ses élèves, qui avaient notamment pu visiter une école d'ingénieurs.
De multiples initiatives se développent aujourd'hui, proposant une autre approche des sciences et des technologies, y compris hors du temps scolaire. Ainsi, l'initiative Girls can code propose des stages gratuits d'initiation à l'informatique destinés aux collégiennes et lycéennes, en non-mixité.
Enfin, l'évolution du rapport des élèves filles aux mathématiques peut également passer par une augmentation de la proportion de femmes parmi leurs professeurs. Si les femmes représentent 51 % des professeurs de mathématiques au collège, elles ne représentent plus que 37 % des professeurs de mathématiques au lycée, 24 % en première année de CPGE scientifique, 21 % en deuxième année de CPGE scientifique et même 18 % en classe étoile. Elles ne représentent également que 21 % des lauréats de l'agrégation en mathématiques, contre 47 % dans les autres disciplines.
S'il est nécessaire d'améliorer le niveau des élèves en mathématiques et en sciences et de combler l'écart de résultats entre filles et garçons, cet effort de montée en niveau ne suffit pas. Comme l'a souligné Elyes Jouini, « le paradoxe norvégien montre qu'il ne suffit pas d'améliorer les résultats des filles en sciences pour influencer leur choix d'orientation. Même lorsqu'elles excellent en sciences, elles restent souvent très performantes en lettres, ce qui leur laisse davantage de choix. Or, en raison de l'environnement et des stéréotypes persistants, elles se dirigent préférentiellement vers les filières littéraires. »80(*) Il faut donc donner envie aux filles de s'orienter vers les filières scientifiques, et pour cela mettre en valeur leur intérêt et leur finalité.
b) Mettre en valeur l'utilité des mathématiques, des savoirs scientifiques et des métiers qui mobilisent ces compétences
Tous les interlocuteurs rencontrés par la délégation ont insisté sur l'intérêt, tant personnel que collectif, des études scientifiques, ainsi que sur la nécessité de davantage mettre en avant cet aspect qui n'est souvent pas évident pour les élèves et leurs familles. La valorisation de l'intérêt mais aussi des implications sociales des études scientifiques est d'autant plus primordiale que les filles, en raison de leur socialisation, expriment davantage que les garçons la recherche d'un métier qui ait du sens.
Ainsi que l'exposait Denis Choimet, président de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques, lors de son audition : « alors que l'utilité, l'intérêt et le sens des études médicales sont évidents pour tous, il faut présenter aux élèves les atouts multiples, bien que non évidents, des études à forte composante mathématiques »81(*).
En effet, les métiers scientifiques, y compris les métiers à forte composante mathématiques, qui peuvent paraître abstraits et lointains, sont en réalité très variés et sont bien souvent au coeur des enjeux de société et des défis de demain, tels que ceux de la transition écologique et de la transition numérique. Il importe de davantage mettre en avant cette utilité sociale des métiers scientifiques et de reformuler les définitions des métiers d'ingénieur et de chercheur, qui sont présentées aux élèves, lors d'interventions dans les établissements scolaires, lors des forums des métiers ainsi que sur les plateformes Onisep et Parcoursup.
Comme l'expliquait Fatima Bakhti lors de son audition : « un ingénieur c'est quelqu'un qui utilise des compétences scientifiques, mathématiques et techniques mais également des qualités humaines, telles que la capacité à travailler en équipe, pour apporter des réponses concrètes à des problématiques réelles » 82(*).
De même, Kumiko Kotera, astrophysicienne et chercheuse, affirmait lors de son audition : « Il me semble impératif de réexaminer la notion traditionnelle du chercheur, du physicien solitaire, enfermé dans son bureau et sortant des équations de son esprit. La science, telle que je la pratique, est avant tout une véritable joie collective. Nous formons un groupe de personnes qui se retrouvent aux quatre coins du monde, échangeant des idées et faisant résonner nos cerveaux ensemble. Concrètement, nous nous posons des questions scientifiques, des énigmes. Nous les posons sur la table, et nous nous réunissons pour partager nos idées. C'est un processus stimulant et enrichissant. Ce n'est pas tout, bien sûr, mais c'est ce qui nous motive chaque jour. »83(*)
Dans le même esprit, Elisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile chez ENGIE, membre du HCE et membre du comité de direction de Femmes@numérique, relevait devant la délégation84(*) que parler de métiers de la décarbonation, des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement est plus attractif que de parler de métiers industriels et que, devant ce constat, des entreprises industrielles comme Engie travaillent pour changer leur image et se rendre plus attractives auprès des nouvelles générations et en particulier des jeunes femmes.
Changer la présentation faite des études et métiers scientifiques se révèle très efficace. Ainsi, comme l'a mis en avant la sociologue Marianne Blanchard auprès des rapporteures85(*), le choix, fait par l'Université de Berkeley à la fin des années 2000, de nommer un parcours en informatique « Beauty and Joy of Computing » s'est avéré particulièrement opportun puisque ce parcours a attiré dès sa création une moitié de filles parmi ses élèves.
Il importe également d'expliquer aux jeunes l'intérêt personnel qu'ils peuvent tirer de carrières scientifiques. Ainsi que le relevait Sylvie Retailleau lors de son audition86(*), les études et carrières scientifiques sont porteuses d'ascension sociale, et ce beaucoup plus facilement que les études littéraires. En outre, comme le rappelait l'ancienne ministre et astronaute Claudie Haigneré devant les rapporteures87(*), les filles sont attendues dans les métiers scientifiques, il y a des débouchés pour elles.
Par ailleurs, il importe de ne pas isoler les mathématiques des autres matières et de montrer leur utilité dans un grand nombre de domaines, y compris relevant des sciences sociales. Lors de son audition, Marianne Blanchard a ainsi témoigné du nouvel intérêt que ses doctorantes en sociologie ont manifesté pour une formation accrue en mathématiques lorsqu'elles ont pris conscience de l'importance de la maîtrise des statistiques dans cette discipline.
Au vu de l'utilité des mathématiques dans de nombreuses disciplines, de nombreux interlocuteurs de la délégation ont plaidé pour le maintien d'un enseignement de mathématiques obligatoire au sein du tronc commun jusqu'à la terminale.
Un tel maintien permettrait de revenir sur l'anticipation, de plus en plus précoce, des choix d'orientation. L'astrophysicienne et chercheuse Kumiko Kotera déclarait elle-même : « Si, au lycée, j'avais eu à faire un choix concernant la poursuite ou non des sciences, je ne sais honnêtement pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'étais trop jeune pour prendre de telles décisions avant le lycée. Je ne savais pas ce qu'était véritablement la science. Le lycée, pour moi, a été une période extrêmement riche, qui m'a permis de mûrir et de comprendre le monde. C'est pourquoi je tiens à partager un message, qui est d'ailleurs largement soutenu par les professionnels de ma discipline : au lycée, la science ne doit pas être une option, elle doit faire partie du tronc commun. Cela permettrait aux filles de ne pas être confrontées à un choix biaisé dès le départ, imposé par la société. »88(*)
À ce stade, ce n'est pas le choix fait par la ministre de l'Éducation nationale qui a privilégié l'organisation d'une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques pour les élèves de première générale et technologique dès juin 2026. Les résultats de cette épreuve, qui portera soit sur le programme de l'enseignement commun de mathématiques, soit sur celui de l'enseignement de spécialité mathématiques, pour les élèves ayant choisi cette spécialité, seront intégrés au dossier Parcoursup des élèves. Une telle réforme semble de nature à valoriser l'importance accordée aux mathématiques jusqu'en classe de première.
Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay de l'Université Paris-Saclay et coordinatrice du collectif Mathématiques&Science, déplorait devant la délégation89(*) le fait que la réforme du lycée, en imposant aux élèves de terminale de choisir uniquement deux spécialités, amenait des élèves à abandonner les mathématiques sans nécessairement l'avoir souhaité. Elle recommandait donc d'ouvrir la possibilité de garder trois disciplines de spécialités scientifiques en terminale, sans perte de contenus.
c) Faire connaître les métiers et les études scientifiques dès le collège et poursuivre au lycée
S'il s'agit de souligner l'utilité sociale et l'importance des métiers d'ingénieurs et de scientifiques pour les défis de demain, il importe tout d'abord de les faire connaître aux élèves, et ce à un stade suffisamment précoce de leur scolarité pour qu'ils puissent faire les choix pertinents pour y accéder. En effet, il est impossible de se projeter dans un métier que l'on ne connaît pas.
Or, selon Jean Hubac, chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives de la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)90(*), les élèves de collège ne connaissent qu'une dizaine de métiers.
Il est donc nécessaire de davantage informer les élèves, de faire entrer dans les établissements scolaires des personnes représentant la diversité des métiers et de permettre aux élèves de se rendre dans des entreprises et structures pour y découvrir de façon concrète les métiers, par le biais de sorties scolaires, de stages ou de programmes d'immersion.
L'Académie des sciences mène diverses initiatives afin de présenter les métiers scientifiques aux filles. Elle travaille à la rédaction d'un ouvrage intitulé Les femmes (et les filles) dans les sciences, qui sera distribué dans tous les collèges afin de sensibiliser de façon large à la place des femmes dans les sciences et donner un éclairage sur la question des carrières des femmes scientifiques, tant du point de vue des blocages que des opportunités.
Le premier volet du Programme Tech pour toutes, lancé en 2023 et piloté par l'Inira, qui prévoit d'accompagner 10 000 jeunes femmes vers des études supérieures dans le numérique d'ici 2026, a quant à lui pour objectif de faire découvrir les métiers de la tech et du numérique aux lycéennes et étudiantes en prépa, à travers de la documentation, ainsi que des stages et immersions. Ce programme pourrait être élargi afin de cibler également les élèves de troisième, qui doivent elles aussi effectuer un stage.
Les ingénieures et scientifiques rencontrées par les rapporteures lors de leur déplacement au Centre de Meuse/Haute-Marne de l'Andra ont témoigné de l'utilité des stages : pour la première fois cette année, elles ont organisé un parcours d'accueil de plusieurs stagiaires de seconde, pendant quinze jours, et ont alors pris conscience du fait que les élèves ne connaissaient pas la diversité des métiers scientifiques, découvraient que les sciences pouvaient servir à des domaines variés et étaient intéressés par l'utilité concrète pour l'environnement de ce type de métiers.
La délégation souhaite donc que les instituts de recherche et les entreprises du secteur scientifique soient davantage incités à prendre des filles pour des stages de troisième et de seconde et à élaborer des programmes d'accueil leur permettant de prendre la pleine mesure de la diversité et de l'intérêt des métiers possibles dans ce secteur.
Il importe de présenter les métiers des sciences mais aussi les parcours permettant d'exercer ces métiers dès le collège, faute de quoi les élèves ne choisissent pas les bonnes options au lycée.
Denis Choimet, président de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques, a ainsi insisté lors de son audition91(*) sur l'utilité d'expliquer aux élèves moins bien informés la nécessité de faire le choix de la spécialité mathématiques au lycée en raison de sa complémentarité avec les autres disciplines scientifiques et de son importance pour les métiers scientifiques, qui en font notamment un pré-requis à l'entrée en CPGE scientifique.
Les établissements d'enseignement supérieur doivent être encouragés à nouer des liens avec les établissements scolaires du premier et du second degré et à proposer des programmes de mentorat ou d'accueil de jeunes filles afin de faire connaître leur formation de façon incarnée et attractive.
Certaines initiatives sont portées par des associations - telles que l'association Pégase qui intervient dans des écoles primaires et des collèges pour éveiller les plus jeunes aux filières scientifiques - et d'autres directement par les universités et écoles d'ingénieur - qui peuvent ainsi obtenir le label Cap Ingénieuses.
Ainsi, l'Université de Lorraine a mis en place deux dispositifs originaux :
· le dispositif des « étudiants ambassadeurs » qui se rendent dans les lycées ;
· le dispositif « un jour à l'université » qui permet à des lycéens de venir passer une journée à l'université durant les petites vacances scolaires.
L'initiative de l'école mathématiques Les Cigales propose à des lycéennes de seconde et de première une immersion gratuite, en pension complète, d'une semaine au Centre international de rencontres mathématiques sur le campus de Luminy d'Aix-Marseille Université. Cette initiative a essaimé et est désormais proposée, sous des formes diverses : les fourmis par l'APMEP à Lille, les mouettes savantes par l'Université de Rennes, les cigognes par l'Université de Strasbourg ou encore les lionnes par l'association Séphora Berrebi en Ile-de-France.
CentraleSupélec a quant à elle mis en place des « summer camps » à destination d'environ 150 lycéennes et lycéens - avec une parité des élèves, venus de toute la France - présentant de bons résultats scientifiques. Ces lycéens sont accueillis sur le campus, pendant une semaine début juillet, à l'issue de leur année de seconde. L'objectif de l'école est de leur fournir des informations sur les classes préparatoires et sur les différentes formations proposées par l'école, dont ces lycéens n'auraient pas eu connaissance par ailleurs.
L'École polytechnique organise également, sur son campus durant l'été, des camps scientifiques à destination de collégiens et lycéens, avec des critères sociaux et de parité. Des actions de tutorat et de mentorat sont également menées auprès de collégiens et lycéens par des étudiants et des enseignants chercheurs de l'école, avec une attention particulière portée aux jeunes filles. Enfin, les étudiants de première année se rendent dans des collèges et lycées au cours de leur stage, souvent accompagnés d'un ancien élève. La directrice générale Laura Chaubard a témoigné des effets positifs que ces initiatives, qui atteignent environ 25 000 élèves par an, ont à l'échelle individuelle : « Nous observons de belles histoires à l'échelle individuelle. Dans les deux dernières promotions, plusieurs jeunes femmes et jeunes hommes issus de milieux peu propices à la poursuite d'études scientifiques ont bénéficié de ces programmes de tutorat et de mentorat. Ils ont ensuite intégré l'X, Télécom Paris, l'ENS ou d'autres écoles de rang comparable. Ils nous font part de l'impact considérable que ces stages et ces rencontres ont eu dans leur décision de poursuivre des études scientifiques. »92(*)
Pour autant, ainsi qu'elle le reconnaît, il convient de réellement évaluer ce type d'initiatives, avec un suivi des cohortes accompagnées, alors qu'aujourd'hui « les progrès ne sont guère significatifs en ce qui concerne la féminisation des carrières scientifiques ».
Si ces initiatives, nécessairement d'ampleur limitée, sont positives, elles doivent cependant s'accompagner de campagnes d'information de plus grande envergure, à destination de l'ensemble des collégiens et collégiennes, et des lycéens et lycéennes.
Il importe de faire connaître les métiers et études scientifiques non seulement aux élèves mais aussi aux enseignants.
Ainsi Centrale Supélec a accueilli une cinquantaine de professeurs afin de leur présenter les classes préparatoires et les métiers d'ingénieurs. Lors d'un questionnaire de sortie, la direction de l'école a constaté que ces professeurs connaissaient peu ces programmes avant cette journée d'accueil et n'étaient donc pas en mesure de fournir des informations appropriées aux élèves. De telles initiatives pourraient être généralisées, en lien avec les rectorats.
|
Recommandation n° 8 : Faire connaître les études et métiers scientifiques aux collégiennes et lycéennes et mettre en valeur leur utilité sociale, en actualisant la présentation des métiers et formations sur les plateformes Onisep et Parcoursup, en menant des campagnes de communication, en finançant des clubs et stages scientifiques et en soutenant des programmes d'immersion dans l'enseignement supérieur ou en entreprise à destination des élèves mais aussi de leurs professeurs. |
2. Valoriser des rôles modèles féminins accessibles et les faire venir dans les établissements scolaires
a) Bien choisir les rôles modèles féminins présentés aux élèves
Diverses études soulignent l'efficacité de la mise en avant de rôles modèles féminins pour diminuer la prévalence des stéréotypes associés aux métiers scientifiques mais également augmenter le nombre de filles s'orientant vers des filières scientifiques.
Une étude93(*) a ainsi évalué le programme « For Girls in Science » de la Fondation L'Oréal, qui propose des interventions d'une heure de rôles modèles féminins en classe de seconde générale ou technologique et en classe de terminale scientifique : parmi les 25 % d'élèves avec les meilleurs résultats en mathématiques au bac, 37 % des filles des classes ayant bénéficié de l'intervention d'un rôle modèle féminin se sont orientées vers une CPGE scientifique, contre 24 % dans les classes témoins. À l'inverse, aucun effet significatif n'est relevé sur les garçons ; l'effet mimétisme est notable. Le programme réduit donc d'un tiers l'écart filles-garçons dans l'accès aux CPGE scientifiques parmi les élèves les plus performants. Et ce seulement après une intervention d'une heure.
Cette même étude relève que les effets du programme sur les choix d'étude dépendent du profil des rôles modèles qui sont intervenues en classe, au parcours desquelles les élèves doivent pouvoir s'identifier, ainsi que du contenu de leur intervention, plus efficace lorsqu'elle ne met pas l'accent sur la sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques.
Constatant qu'il manquait un échelon intermédiaire entre les lycéennes et les femmes scientifiques avec des carrières abouties, le programme Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, en partenariat avec l'Académie des sciences, sélectionne des jeunes chercheuses talentueuses, qui, au-delà de la dotation qu'elles reçoivent, ont vocation à un rôle d'ambassadrices de la science auprès des lycéens et des lycéennes, notamment dans le cadre du programme Pour les Filles et la Science.
Les interlocuteurs rencontrés par les rapporteures ont tous insisté sur l'importance de recourir à des rôles modèles intermédiaires, accessibles, auxquels les élèves peuvent s'identifier, à la fois parce que ce ne sont pas des femmes trop exceptionnelles ou des génies, et parce que ces femmes ont un parcours de vie dans lesquels les élèves peuvent se retrouver.
Ainsi que le relevait Patrick Flandrin physicien, directeur de recherche au CNRS, lors de son audition, « la représentation des femmes scientifiques dans les manuels peut être caricaturale, insuffisante ou restreinte à des figures emblématiques comme Marie Curie. Il est important de montrer que l'on peut avoir des femmes de science « exceptionnelles », mais il ne faut pas que ces exceptions, qui peuvent être trop impressionnantes, finissent par dissuader. »94(*)
Confirmant ce constat que « tous les modèles féminins de réussite en science ne sont pas des bons rôles modèles », la chercheuse Isabelle Régner a apporté, devant la délégation95(*), des précisions sur les caractéristiques d'un bon rôle modèle : « La littérature en psychologie sociale et cognitive a démontré, depuis plus de cinquante ans, les conditions nécessaires à l'efficacité des modèles de réussite. Un modèle, qu'il soit scientifique ou d'un autre domaine, ne sera pertinent que s'il permet aux personnes ciblées de s'identifier à lui. Il doit être adapté aux cibles auxquelles il s'adresse, qui doivent percevoir des éléments de similitude entre elles et le modèle. Le modèle doit être atteignable et doit aussi, dans sa façon de présenter sa réussite, infirmer le stéréotype qui essentialise la compétence ou l'incompétence du genre auquel il appartient : un bon modèle est donc un modèle qui a réussi par le travail et l'effort. »
Afin de favoriser l'identification des jeunes filles, les cinq grands critères suivants doivent guider la sélection du rôle modèle intervenant auprès de celles-ci :
· similitudes avec les jeunes filles concernées, du fait de l'origine sociale, territoriale ou culturelle ;
· relative proximité en âge : privilégier des étudiantes, doctorantes, jeunes chercheuses ou jeunes ingénieures, voire même des lycéennes ayant opté pour des spécialités scientifiques ;
· performances scolaires passées relativement proches du public cible afin que le parcours du modèle paraisse, et soit objectivement, accessible ;
· présentation de sa réussite comme le résultat de travail et d'efforts et non de compétences mathématiques ou scientifiques qui seraient innées ;
· capacité à rendre son parcours et son métier enthousiasmants.
b) Développer des partenariats avec des associations, des entreprises et des structures de l'enseignement supérieur au sein des établissements scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales
De nombreux établissements scolaires développent des politiques partenariales avec des associations et entreprises qui proposent de faire venir des élèves dans leurs structures, de mener des interventions au sein des classes ou encore de mettre en place des tutorats ou des mentorats.
Ces partenariats sont précieux et doivent être encouragés. Pour autant, il est ressorti des auditions une difficulté à cartographier l'ensemble des partenariats et une grande disparité entre établissements. Le rectorat ainsi que la région, acteur clé dans la formation, ont un rôle à jouer dans l'établissement et le renforcement de ce type de partenariats alors que l'Éducation nationale est encore peu ouverte aux entreprises.
Dans ce cadre, la région Grand Est a demandé à des associations de se regrouper afin de créer un parcours « Elles + sciences = grand Est », lancé en février 2025, afin de mener des sensibilisations et un accompagnement des élèves de la maternelle jusqu'à l'insertion professionnelle.
Le plan Filles et Mathématiques annoncé par la ministre Elisabeth Borne prévoit que, chaque année, de la troisième à la terminale, un réseau d'associations, d'étudiants ou de branches professionnelles, soit mobilisé par les chefs d'établissement, en lien avec les régions, pour que des femmes, rôles modèles, puissent présenter leur parcours à des jeunes filles. Ces rencontres sont expérimentées dans des académies volontaires depuis la rentrée 2025, et seront généralisées en 2026.
De nombreuses associations de promotion de la mixité dans les sciences existent, que la délégation tient à saluer ici, sans prétendre à l'exhaustivité : Elles Bougent, Femmes Ingénieures, Femmes et Science, Femmes et Mathématiques, Industri'Elles, Femmes@Numerique, Women and Girls in Tech, mais aussi des associations étudiantes et des associations d'alumni propres à chaque école ou université.
La délégation soutient les nombreuses initiatives déjà en place et préconise de mieux les cartographier et les coordonner sous l'égide du rectorat et de la région, afin d'atteindre l'ensemble des territoires, et en particulier les établissements scolaires ruraux.
Elle recommande également la mise en place de campagnes de communication sur les femmes scientifiques sur les plateformes scolaires type Parcoursup, sur la plateforme Onisep, dans les médias consacrés à l'orientation ainsi que dans les médias et sur les réseaux sociaux consultés par les jeunes.
|
Recommandation n° 9 : Organiser des campagnes de communication et des interventions dans les établissements scolaires autour de jeunes femmes scientifiques constituant des rôles modèles à la fois inspirants et accessibles. |
3. Se donner les moyens de promouvoir l'égalité filles-garçons dans les établissements scolaires et les choix d'orientation
a) Former l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale aux enjeux d'égalité et les impliquer dans cette démarche
Encourager l'envie de mathématiques et de sciences chez les filles exige également de créer un environnement propice, qui ne les dissuade pas de s'intéresser à ces disciplines et aux métiers qui mobilisent ces savoirs.
À cette fin, il est essentiel de former l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale - enseignants, chefs d'établissements, conseillers principaux d'éducation, inspecteurs, psychologues, etc. - à l'égalité filles-garçons, à la déconstruction et la lutte contre les stéréotypes, ainsi qu'aux façons de prévenir et agir face aux comportements sexistes, au harcèlement, aux violences sexuelles et à leurs conséquences.
Afin d'impliquer les personnels, la délégation souhaite que soient systématiquement assignés aux recteurs, directeurs académiques et chefs d'établissement des objectifs portant sur l'égalité filles-garçons et sur la mixité dans l'orientation scolaire, en particulier l'orientation des filles vers les filières scientifiques. Les statistiques sexuées pertinentes doivent être inscrites au sein des tableaux de bord Archipel et faire l'objet d'un suivi par les chefs d'établissement et les rectorats, dans le cadre du dialogue de gestion des lycées ainsi que du dialogue avec les enseignants et avec les parents.
En 2022, une lettre avait été adressée à l'ensemble des recteurs par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, afin d'atteindre la parité dans les spécialités mathématiques, physique-chimie et mathématiques expertes et de tendre vers la parité pour les autres enseignements (Sciences de l'ingénieurs - NSI - numérique et sciences informatiques). Nous en sommes toujours loin.
Comme précédemment évoqué, le plan Filles et mathématiques, annoncé par la ministre Elisabeth Borne en mai 2025 sur la base du rapport Filles et mathématiques précité96(*), comporte plusieurs mesures visant à former, sensibiliser et impliquer tous les personnels de l'Éducation nationale face aux stéréotypes et biais de genre et pour rapprocher les filles des mathématiques et des sciences :
· sensibilisation de deux heures aux biais de genre pour tous les personnels dès la rentrée 2025 ;
· plan de formation pluriannuel à la prévention des biais de genre et des stéréotypes dans l'apprentissage des mathématiques, avec, dès la rentrée 2025, une formation d'au moins une journée pour l'ensemble des professeurs de mathématiques de collège (24 000) et de lycée général et technologique (12 000) ;
· affichage d'une charte de lutte contre les stéréotypes dans les salles des professeurs ;
· objectifs cibles, intégrés dans les objectifs des chefs d'établissement, afin d'obtenir, d'ici 2030, 30 000 filles supplémentaires qui choisissent la spécialité « mathématiques » et la gardent en terminale, soit 5 000 filles de plus par an dès la rentrée 2025, ce qui représente en moyenne 2 filles supplémentaires par établissement chaque année.
La délégation se félicite de ces annonces, dont elle suivra avec attention la concrétisation.
La formation des professeurs aux enjeux d'égalité doit désormais franchir un palier supplémentaire et être accélérée, afin de toucher tous les professeurs en poste. Les académies doivent déployer des plans de formation permettant de toucher l'ensemble des enseignants, avec une priorité donnée dans un premier temps aux professeurs de mathématiques.
C'est ce qu'a mis en place l'Académie d'Amiens, qui dispose, depuis la rentrée 2023, d'un plan de formation de tous les professeurs de mathématiques à l'égalité filles-garçons, avec quatre piliers : objectiver la situation, pour susciter une prise de conscience ; déconstruire les mécanismes à l'oeuvre grâce aux apports de la recherche ; expliquer l'importance de cet enjeu pour l'Éducation nationale ; donner des pistes d'action concrètes pour agir.
La sociologue Marianne Blanchard a témoigné97(*) de son expérience lors des formations qu'elle assure à l'Inspé de Toulouse auprès des enseignants stagiaires du second degré : cette formation suscite des prises de conscience, mais également des réticences très fortes, appuyées sur l'idée que les garçons sont plus forts en mathématiques. Le chemin est donc encore long à parcourir.
Comme le préconise le rapport Filles et mathématiques précité, afin de renforcer sa légitimité auprès des professeurs et son appropriation par ceux-ci, la formation à la pédagogie égalitaire dans les disciplines scientifiques et technologiques doit s'appuyer sur les acquis de la recherche et privilégier des observations croisées de classe.
En outre, pour inciter les professeurs de mathématiques à se former à la pédagogie égalitaire dans le cadre de leur formation continue, le suivi d'une telle formation pourrait devenir un pré-requis pour le passage au grade « hors classe » ou pour une candidature à un poste en CPGE.
Ainsi que l'a exposé Jean Hubac, chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives de la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), lors de son audition98(*), l'ensemble des professeurs - et pas uniquement ceux de mathématiques - doivent être formés à l'égalité filles-garçons et être sensibilisés à la question spécifique des biais de genre en mathématiques dans la mesure où les propos tenus par les professeurs de matières littéraires ont des effets sur la façon dont les élèves se projettent sur un cursus en mathématiques.
Cette formation globale est d'autant plus importante pour les professeurs principaux, qui sont amenés à conseiller les élèves dans leur orientation. Or, Laure Etévez, responsable du groupe Femmes & Mathématiques de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP), a déploré, lors de son audition99(*), la plus faible proportion de professeurs de mathématiques professeurs principaux en terminale depuis la réforme du bac.
Développer une culture de l'égalité au sein des établissements scolaires suppose de s'en donner les moyens financiers et humains.
Or les politiques d'égalité filles-garçons dans l'Éducation nationale reposent aujourd'hui largement sur le volontariat et le volontarisme des acteurs, comme le relève le rapport IGÉSR -IGF « Filles et mathématiques » précédemment évoqué :
· la DGESCO ne compte qu'un seul équivalent temps plein sur cette thématique ;
· les référents académiques égalité filles-garçons n'ont pas de décharge nationale et l'animation académique de la politique d'égalité filles-garçons ne fait pas l'objet d'une déclinaison systématique au niveau des unités éducatives (dialogue de gestion, fiche d'objectifs, évaluation d'établissement...) ;
· les référents égalité filles-garçons en établissement sont censés bénéficier d'une formation et impulser une dynamique mais ils ne bénéficient pas d'une indemnité pour mission particulière.
Il apparaît donc primordial de doter les référents égalité filles-garçons de moyens dédiés. En particulier, les référents égalité au sein des établissements doivent pouvoir bénéficier de formations spécifiques, de décharges d'activité, ainsi que d'une rémunération sous forme de prime.
Plus globalement, il s'agit de favoriser la construction d'un environnement bienveillant alors qu'aujourd'hui encore l'école n'est pas neutre et continue à propager des stéréotypes. Il existe, depuis 2022, un label égalité filles-garçons des établissements scolaires qui a permis de labelliser 1 100 établissements, soit 10 % des établissements. Cette démarche, qui permet d'impliquer l'ensemble de la communauté éducative et des élèves d'un établissement, doit se poursuivre. Des moyens doivent être prévus au sein de la DGESCO afin d'appuyer cette labellisation.
|
Recommandation n° 10 : Former l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale à la prévention et la lutte contre les stéréotypes et biais de genre, avec une priorité donnée aux enseignants de mathématiques et en s'appuyant sur les acquis de la recherche et les observations croisées de classe. |
b) Transmettre une culture de l'égalité aux jeunes, en agissant aussi sur les garçons
Lors de son audition100(*), la sociologue Marianne Blanchard a mis en avant les risques que pouvaient comporter des discours expliquant la faible proportion de filles dans les sciences uniquement par les stéréotypes de genre dont sont victimes les filles, diluant les responsabilités, d'autant que ces discours insistent généralement sur le caractère inconscient des stéréotypes. Elle estime que de tels discours occultent les causes de l'existence de ces stéréotypes et font oublier les autres dynamiques, d'inégalités sociales mais aussi de violences sexistes et sexuelles, et la nécessité de travailler également avec les garçons.
Ce constat rejoint celui fait par Jérôme Courduriès, professeur des universités en anthropologie, chargé de mission « égalité de genre et lutte contre les violences sexuelles » à l'université Toulouse-Jean Jaurès : « Ce qui est en cause, c'est tout particulièrement l'éducation des garçons, la socialisation masculine et plus généralement une représentation des identités de genre. Au lieu du modèle de masculinité conquérante et séductrice, il nous faudrait privilégier le modèle d'une masculinité plurielle. Au lieu d'identités de genre stéréotypées et hiérarchisées, il nous faudrait privilégier le respect d'identifications d'identités de genre diverses. Dans ce domaine, les libertés et les droits acquis par certaines ou certains ne retranchent rien aux libertés et droits des autres, bien au contraire. »101(*)
La délégation en est convaincue : transmettre une culture de l'égalité impose de s'adresser tant aux filles qu'aux garçons.
Il s'agit en premier lieu de s'efforcer de développer chez les garçons des dispositions considérées comme féminines, telles que l'empathie, le soin des autres, le soin de son environnement ou la coopération, et d'éviter qu'ils ne développent des comportements sexistes et violents. En outre, comme le soulignait Marianne Blanchard, plutôt que d'inciter les filles à développer des dispositions considérées comme masculines, telles que le goût pour la compétition, la prise de risque ou le contrôle des émotions, peut-être pourrait-on remettre en cause le caractère intrinsèquement positif de celles-ci.
Cet objectif est en phase avec les principes de l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS), dont le nouveau programme est entré en vigueur à la rentrée 2025. La délégation sera vigilante à la mise en oeuvre effective des trois séances annuelles d'EVARS sur la base de ce nouveau programme.
Il est également essentiel que tous les établissements scolaires appliquent une politique de tolérance zéro vis-à-vis des propos sexistes, notamment ceux mettant en cause les compétences des filles, et a fortiori des comportements sexistes et violents.
Par ailleurs, s'il est essentiel d'ouvrir les horizons des filles, il convient également d'interroger l'orientation massive des garçons vers les sciences et la technique, et le délaissement par ceux-ci des métiers de la santé, du social, de l'aide à la personne ou de l'enseignement. La progression de l'égalité femmes-hommes impose de rétablir un équilibre dans les choix offerts aux garçons comme aux filles.
Cette question renvoie à la hiérarchie des savoirs, des métiers et des modèles de réussite, sur laquelle il convient aussi de s'interroger.
Ainsi qu'en témoignait Mélanie Guenais, en se fondant notamment sur des discours prononcés par des étudiantes lors de la cérémonie de remise de diplôme de l'ESPCI, de nombreuses jeunes filles appellent aujourd'hui à déconstruire des modèles de réussite « façonnés par des hommes dans des contextes historiques et sociaux où les femmes étaient exclues par défaut ». Elles s'interrogent aussi sur « des modèles de réussite qui mènent à un effondrement » et « considèrent que le changement passe également par leurs choix de secteurs d'engagement ».102(*)
Au-delà de la nécessité de valoriser des métiers scientifiques porteurs de sens, pour que les jeunes filles s'engagent dans ces parcours, il est également impératif de mieux valoriser les métiers dits du care, à la fois pour les femmes qui s'orientent massivement vers ces métiers essentiels et pour attirer davantage d'hommes dans ce secteur.
Plus globalement, la délégation rejoint les analyses du rapport de France Stratégie précité103(*), qui relève que « les stéréotypes ne sont pas que des représentations mentales mais se nourrissent des inégalités observées », que « ces préjugés se forgent non seulement dans l'imaginaire collectif mais aussi dans l'observation du quotidien, en particulier chez les enfants » et que « par conséquent, changer les représentations implique aussi de réduire les inégalités entre femmes et hommes ».
|
Recommandation n° 11 : Transmettre une culture d'égalité aux jeunes, en abandonnant l'idée de changer ou encourager les filles et en agissant davantage sur les représentations et attitudes des garçons. |
c) Assurer les filles de leur légitimité et de leurs compétences
Alors qu'aujourd'hui les filles continuent à subir des biais de genre négatifs tout au long de leur apprentissage des mathématiques et des sciences, il s'agit de les convaincre de leur légitimité et leurs compétences pour s'orienter vers des filières scientifiques.
Cela peut passer par une meilleure transparence quant à leurs résultats. En effet, les filles, même parmi les meilleures élèves, sous-estiment leur position dans la distribution des notes. Des expérimentations ont prouvé que le fait de leur fournir des informations objectives permet de réduire cet écart et d'augmenter leur probabilité de candidater à des formations sélectives comme les CPGE104(*).
En outre, il s'agit de les convaincre qu'ainsi que le déclarait Marianne Blanchard, « pas besoin d'être un génie en mathématiques pour suivre des études scientifiques »105(*).
Enfin, il s'agit d'expliquer aux filles que leur présence est recherchée dans les filières scientifiques mais aussi, plus globalement, de « dégenrer » l'orientation. Pour cela, pourrait être envisagée l'instauration de bonus sur Affelnet et sur Parcoursup pour les filles et garçons formulant des voeux d'orientation dans des formations où l'un des sexes représente moins de 30 % des étudiants. D'autres mesures visant l'enseignement supérieur sont développées dans la suite de ce rapport106(*).
d) Sensibiliser tous ceux qui accompagnent les élèves dans leurs choix d'orientation, y compris les parents
Au-delà des appétences et souhaits exprimés par les élèves eux-mêmes, de nombreux acteurs jouent un rôle dans les choix d'orientation : familles, enseignants, chefs d'établissement, psychologues de l'Éducation nationale, camarades de classe, etc.
Il est essentiel de convaincre l'ensemble de ces acteurs de ce qu'affirmait si clairement Sylvie Retailleau lors de son audition : « les compétences nécessaires dans les métiers des sciences et des technologies n'ont rien à voir avec le genre »107(*).
De nombreux interlocuteurs de la délégation ont insisté sur la nécessité de se donner les moyens de mettre en place un véritable service public de l'orientation et de former les psychologues de l'Éducation nationale - qui ont remplacé les conseillers d'orientation - et les directeurs de centres d'information et d'orientation (CIO) aux enjeux d'égalité femmes-hommes.
Il est également nécessaire de renforcer et actualiser les connaissances qu'ont les professeurs et chefs d'établissement des études et métiers scientifiques.
Lors de son audition108(*), Denis Choimet, président de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques, a ainsi souligné l'importance de mieux informer les professeurs et chefs d'établissements, qui peuvent avoir une vision datée ou erronée des CPGE scientifiques et par conséquent dissuadent les filles de les intégrer.
De même, Valérie Brusseau de l'association Elles bougent a mis en avant l'importance de mieux faire connaître les métiers de l'industrie aux professeurs du secondaire, qui connaissent souvent mal ces métiers.
Il est essentiel de toucher également les parents, qui sont prescripteurs dans les choix d'orientation. La synthèse de la concertation nationale sur l'orientation des élèves menée début 2025109(*) souligne la nécessité de mieux associer les familles aux actions et démarches d'orientation, en organisant des réunions d'information interactives régulières, en intégrant les parents à des actions collectives organisées par les établissements comme des forums et des séances d'information, ou encore en impliquant les associations de parents d'élève.
Il importe de leur faire connaître la diversité des métiers, les perspectives professionnelles et les niveaux de rémunération au sein des métiers scientifiques et d'ingénieurs. Il faut également les informer du caractère presque gratuit des classes préparatoires et des écoles d'ingénieur pour les familles issues de milieux populaires.
Les parents ont aussi souvent besoin d'être rassurés. En particulier, dans les territoires ruraux, les parents apparaissent particulièrement réticents à l'idée de laisser leurs filles partir dans des villes éloignées de leur lieu de vie. Ces préoccupations se retrouvent également dans les départements et collectivités d'outre-mer, où la distance géographique et logistique freine l'accès des jeunes ultramarins aux études supérieures. Il importe donc de proposer des places en internat ou des facilités de logement pour les filles et d'informer en amont les parents de ces facilités.
Plus globalement, Valérie Debord, première vice-présidente Emploi, formation, orientation, apprentissage et enseignement supérieur de la Région Grand Est et présidente déléguée de la commission formation-emploi au sein de Régions de France110(*), a mis en avant l'intérêt de renforcer la communication à destination des élèves et familles des territoires ruraux afin de leur faire connaître des métiers scientifiques mais aussi leur faire savoir que ces métiers pourront ensuite être exercés à proximité de leur bassin de vie.
Diverses associations ont saisi l'importance de mobiliser les familles pour faire évoluer les choix d'orientation des jeunes.
L'association Elles bougent mène ainsi une campagne nationale de déconstruction des stéréotypes auprès du grand public, afin de faire évoluer les perceptions des parents quant aux métiers scientifiques. Des antennes locales d'Elles bougent cherchent aussi à inviter les parents à venir, avec leurs filles, pour visiter des usines, mais y parviennent difficilement.
Dans le cadre du programme Power minottes de BPW, qui permet à des enfants de 7 à 13 ans de découvrir des métiers, les parents sont invités à rester pendant toute la durée de l'événement, sont sensibilisés aux biais cognitifs inconscients et peuvent eux aussi découvrir des métiers et leur caractère accessible pour leurs enfants.
De telles initiatives doivent être encouragées, tant les familles jouent un rôle essentiel dans la construction du parcours scolaire et l'orientation de leurs enfants.
|
Recommandation n° 12 : Mettre en place un véritable service public de l'orientation, sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et associant les familles. |
Une fois franchies les barrières de l'orientation au collège et au lycée, les jeunes femmes se trouvent confrontées à de nouveaux obstacles : minoritaires dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur, elles y affrontent un sexisme encore trop ordinaire et bien souvent des violences.
C'est pourquoi les classes préparatoires, les grandes écoles et les universités constituent un autre maillon décisif pour donner aux femmes toute leur place dans les sciences.
III. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MIEUX ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES PROTÉGER DU SEXISME ET DES VIOLENCES
L'enseignement supérieur concentre les inégalités héritées du secondaire et en introduit de nouvelles.
Garantir un environnement favorable et protecteur est essentiel pour que les talents féminins ne se perdent pas à ce moment décisif de la formation professionnelle. À cette fin, la délégation entend expérimenter de nouvelles solutions.
A. CONSTATS : DES JEUNES FEMMES MINORITAIRES ET SOUVENT VICTIMES DE SEXISME VOIRE DE VIOLENCES
1. Une sous-représentation féminine dans les filières scientifiques du supérieur, parmi les élèves comme parmi les enseignants
S'agissant de la poursuite des études supérieures, en France, le pourcentage global de femmes diplômées dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément désignés sous les acronymes STIM ou STEM, est très inférieur à celui des hommes diplômés.
Une étude du FMI portant sur l'ensemble des pays de l'OCDE indiquait ainsi qu'en 2023, la France ne comptait globalement que 13 % d'étudiantes universitaires diplômées dans les domaines des STIM, contre 40 % d'étudiants diplômés, soit un écart de près de 30 points entre filles et garçons diplômés de l'enseignement supérieur dans ce domaine spécifique des sciences. Cet écart est globalement équivalent à l'écart moyen observé dans l'ensemble des pays de l'OCDE.
Ainsi que le rappelait, lors de son audition111(*), Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation et représentante de la chaire « Femmes et sciences » à l'Université Paris Dauphine-PSL, « bien que les femmes soient, en moyenne, plus diplômées que les hommes, elles restent sous-représentées dans certaines filières, en particulier celles relevant des STIM. (...) En France, les étudiantes sont majoritaires dans l'enseignement supérieur et obtiennent plus de diplômes que leurs homologues masculins, mais elles ne représentent qu'environ 30 % des élèves en écoles d'ingénieurs selon les chiffres de la DEPP112(*) ».
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)113(*)
Les choix des femmes quant aux disciplines universitaires étudiées ont globalement peu évolué au cours de la dernière décennie. Les chiffres publiés en mars 2025 par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche montrent que, durant l'année universitaire 2022-2023, 60 % des diplômés du cursus master en université étaient des femmes et qu'elles représentaient 71 % des diplômés en masters de lettres, langues et sciences humaines, contre 46 % des diplômés en sciences.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)114(*)
En outre, Georgia Thebault a également indiqué qu'une analyse des plateformes de préinscription dans l'enseignement supérieur (Admission post-bac, Parcoursup) a permis de s'interroger sur la nature des disparités d'accès aux différentes filières selon le genre : « on observe une proportion importante de femmes dans des formations très sélectives, comme les CPGE littéraires, où environ 80 % des élèves admis ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat. Cependant, cette répartition change sensiblement dès lors que l'on considère les filières scientifiques : dans les CPGE scientifiques, les DUT de production ou les licences de sciences et technologies, la proportion féminine chute en deçà de 50 %, à l'exception notable des filières de médecine et de biologie, où les femmes restent largement représentées ».
Si les femmes sont donc sous-représentées dans le domaine des STIM, elles sont, en revanche, bien présentes dans d'autres cursus scientifiques, notamment la chimie, la biologie, les sciences du vivant, la médecine, etc. Certaines spécialités scientifiques sont ainsi beaucoup plus féminisées que d'autres. Il est donc inexact de penser que les femmes n'auraient pas, de façon générale, d'appétence pour les sciences.
Ce constat explique notamment pourquoi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, auditionné par la délégation115(*), a pu affirmer aux rapporteures que « jamais (...) il n'y a eu autant de jeunes femmes engagées dans des études supérieures scientifiques en France. Les chiffres sont sans équivoque : entre 2018 et 2023, nous sommes passés de 676 000 à 742 000 étudiantes dans les filières scientifiques [hors domaine de la santé] ». Il a également précisé que « la part des filles dans ces formations est ainsi passée de 31,5 % à 34 %, ce qui représente environ 40 000 étudiantes supplémentaires engagées dans des études scientifiques -- à l'exclusion des études médicales. Si l'on restreint le périmètre à un segment encore plus spécifique, les STEM (sciences, technologies ingénierie et mathématiques), la part des femmes descend à 25 %. Ce taux est resté globalement stable ».
La délégation entend préciser que les chiffres cités par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui émanent de la publication « Repères et références statistiques » (RERS) de 2024 des services statistiques ministériels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, renvoient à l'effectif global des étudiants et étudiantes dans les formations scientifiques, hors domaine de la santé et hors inscriptions simultanées université-CPGE. En outre, s'agissant des chiffres auxquels l'ancien ministre fait référence pour le seul périmètre des STEM, il convient de préciser que le taux de 25 % cité correspond à celui de la part des femmes inscrites en CPGE scientifiques hors BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la terre). En effet, d'après les ressources statistiques disponibles précitées (RERS 2024), si l'on intègre l'ensemble des filières scientifiques, hors SVT et santé, le taux de féminisation s'établit en réalité à 32 %.
S'agissant plus précisément des filières sélectives, et notamment des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a précisé : « à l'heure où je m'adresse à vous, jamais, dans l'histoire de notre pays, nous n'avons compté autant d'élèves inscrits en classes préparatoires scientifiques », sans toutefois donner d'indications sur la répartition genrée des effectifs dans ces classes préparatoires.
Or, précisément, le taux de féminisation des études scientifiques diffère en fonction du type de filière suivie : filières universitaires, classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) pour intégrer différentes catégories d'écoles d'ingénieurs ou les écoles normales supérieures (ENS), ces dernières catégories relevant plus spécifiquement en France de filières qualifiées d'excellence. Même au sein des filières d'excellence, la répartition genrée varie en fonction du type d'enseignement dispensé et du type de science étudiée.
a) Un déficit de filles en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui se creuse encore à l'entrée des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses et des écoles normales supérieures (ENS)
(1) Une « perte en ligne » des filles dans les classes préparatoires les plus compétitives
S'agissant des filières d'excellence, celles qui mènent notamment aux écoles scientifiques les plus prestigieuses (écoles d'ingénieurs ou écoles normales supérieures), il a été porté à l'attention de la délégation que les femmes demeurent particulièrement sous-représentées dans les filières scientifiques les plus sélectives, notamment au sein des meilleures écoles d'ingénieurs françaises, alors même qu'elles intègrent les CPGE scientifiques avec, en moyenne, de meilleurs résultats scolaires que leurs homologues masculins.
D'après des données publiées par l'Institut des politiques publiques (IPP) en mai 2025, les quelque 200 CPGE scientifiques116(*) destinées aux bacheliers généraux, dont plus du quart est localisé en région parisienne, regroupent environ 25 000 étudiants par an, dont seulement un quart de filles.
Lors de son audition117(*) par les rapporteures, Denis Choimet, président de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques et professeur de classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) au prestigieux lycée du Parc, à Lyon, indiquait que « si l'on analyse l'amont des CPGE scientifiques (hors-BCPST), la situation est très simple : le « coeur de cible » de ces classes est constitué des lycéennes et lycéens suivant la spécialité mathématiques et une autre spécialité scientifique. Elles recrutent donc dans un vivier aux deux tiers masculins, et même à 70 % masculin si l'on ajoute l'option mathématiques expertes ».
Source : Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques
En outre, pour Denis Choimet, « nous ne sommes pas seulement en présence d'un vivier très déséquilibré, mais également, de la part des jeunes filles, d'une stratégie d'évitement massif des filières des CPGE à forte composante mathématique. »
Avant même le début de la CPGE, on observe ainsi un important hiatus entre le nombre de filles inscrites en classes préparatoires scientifiques et le nombre de celles qui intègrent effectivement ces classes.
Pour illustrer cette stratégie d'évitement, Denis Choimet a cité l'exemple du recrutement dans la filière MPSI118(*) du lycée du Parc à Lyon où il enseigne, par ailleurs représentatif de ce que l'on peut observer dans les établissements les plus sélectifs : « parmi l'ensemble des candidatures, il y a 31 % de filles. Parmi les 100 premiers candidats classés (c'est-à-dire les meilleurs), on trouve 43 % de filles. Cela veut dire que des lycéennes brillantes ont bien candidaté en MPSI, et ont été retenues ! Mais le jour de la rentrée, il n'y a plus que 22 % de filles dans les classes. C'est donc au moment de l'admission, où l'établissement recruteur a naturellement perdu la main, que l'hémorragie se produit. »
Exemple du recrutement en MPSI au lycée du Parc de Lyon
de candidatures féminines de filles parmi les meilleures candidatures de filles inscrites en MPSI
De même, Mélanie Guesnais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences, auditionnée par la délégation dans le cadre d'une table ronde119(*) réunissant plusieurs associations oeuvrant pour la mixité dans les sciences, a fait le constat d'une réelle déperdition d'effectifs féminins entre le moment de l'admission en classes préparatoires et l'inscription effective dans ces classes : « le problème ne se situe pas uniquement à l'entrée. À l'heure actuelle, environ 3 000 jeunes filles sont admises en classes préparatoires STIM, mais beaucoup ne s'y inscrivent pas effectivement. (...) En d'autres termes, sans levier véritable ni engagement concret pour leur assurer un accueil bienveillant et un environnement favorable, la situation ne progressera pas. »
Lors de son audition120(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a reconnu que « si les filles qui demandent à entrer dans les formations scientifiques les plus prestigieuses ont autant de chances que les garçons, à niveau égal, d'être retenues, c'est au moment de faire un choix définitif qu'elles renoncent à ces formations. Il faut absolument que la proportion de filles en classes préparatoires scientifiques atteigne 30 %, seuil à partir duquel l'effet ressenti est celui de la mixité. »
Une distinction s'impose toutefois entre les différentes catégories de CPGE scientifiques : ainsi que le rappelait Mélanie Guesnais, « actuellement, la plupart des classes affichent un taux supérieur à 25 %. Les cas les plus problématiques se trouvent dans les nouvelles classes préparatoires mathématiques-informatique, où l'absence quasi totale de filles est flagrante. »
Jacqueline Bloch, physicienne, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences121(*), a également alerté la délégation sur les très faibles effectifs féminins en classes préparatoires maths-info à l'inverse des classes qui dispensent d'autres matières telles que la biologie ou la chimie : « on observe une énorme différence entre les prépas qui dispensent un peu de biologie ou de chimie, dans lesquelles le pourcentage de femmes augmente, même s'il reste tout de même inférieur à 40 %. À l'inverse, plus on choisit la physique et les maths, plus le nombre de filles diminue. Et les chiffres sont extrêmement faibles quand on parle de math info122(*) ».
Si les filles ne représentent, en moyenne, qu'un quart des élèves intégrant des CPGE scientifiques, la proportion de celles admises dans les grandes écoles scientifiques les plus prestigieuses est encore plus faible puisqu'elles ne représentent plus qu'un cinquième des étudiants admis aux concours les plus sélectifs.
Source : Institut des politiques publiques (IPP) - Mai 2025 - Cécilia Bonneau, Léa Dousset
La sous-représentation féminine au sein des écoles d'ingénieurs les plus sélectives résulte notamment d'une « inversion progressive de l'écart de performance entre les femmes et les hommes au cours des années de classe préparatoire, notamment dans les filières les plus sélectives et compétitives, les classes étoiles », ainsi que le souligne une note123(*) de l'Institut des politiques publiques (IPP) de mai 2025, intitulée Comment expliquer la sous-représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives ?
Plus précisément, ainsi que le soulignait Georgia Thebault de la chaire « Femmes et science » de l'Université Paris Dauphine-PSL lors son audition124(*) par la délégation, si l'on examine la part des femmes parmi les étudiants dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs - environ 26 % en moyenne -, on constate une forte hétérogénéité selon le degré de sélectivité scolaire des établissements.
Dans les écoles d'ingénieurs les moins sélectives scolairement, les filles sont peu nombreuses, étant plutôt de bonnes élèves. Cette part progresse avec les déciles de sélectivité, sauf pour ce qui concerne les 10 % d'écoles les plus sélectives pour lesquelles on constate une chute de la part des filles admises.
Dans sa note précitée de mai 2025, l'Institut des politique publiques note ainsi que, lors de l'entrée en CPGE scientifique, les femmes ont en moyenne de meilleurs résultats scolaires que leurs homologues masculins. Pourtant, à l'issue de ces deux à trois années de classe préparatoire, elles accèdent moins souvent aux grandes écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Elles y représentent seulement 20 % des effectifs, contre 25 % dans les CPGE scientifiques.
de filles dans les CPGE scientifiques de filles dans les meilleures écoles d'ingénieurs
Pour expliquer ce phénomène de « déperdition » et cette sous-représentation, plusieurs phénomènes sont mis en avant par les autrices de la note précitée de l'IPP :
- une moindre performance le jour du concours : c'est l'effet « Jour J » selon lequel les femmes ont tendance à sous-performer lors des épreuves décisives du concours au regard de leurs résultats habituels, en particulier en mathématiques ;
- un renversement de l'écart de performance entre les sexes au cours de la scolarité en CPGE : initialement en faveur des femmes, cet écart de performance devient favorable aux hommes au cours de la première année de CPGE et s'amplifie jusqu'au concours ;
- cet écart de performance s'accroît particulièrement dans les environnements les plus compétitifs, notamment dans les classes préparatoires dites « étoiles », ce qui renforce la dynamique de décrochage relatif des femmes.
Source : Institut des politiques publiques (IPP) - Mai 2025 - Cécilia Bonneau, Léa Dousset
Le graphique ci-dessus montre que les femmes ont en moyenne 20,2 % de chances d'être admises dans l'une des écoles d'ingénieurs du top 10 %, contre 25,3 % pour les hommes, soit une différence de 5,1 points de pourcentage.
En outre, à performances scolaires équivalentes, les femmes s'orientent vers des classes préparatoires qui, en moyenne, envoient moins d'élèves dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Cette différence d'orientation explique environ 36 % de la sous-représentation des femmes.
Enfin, s'agissant de l'évolution des performances pendant la CPGE, il faut noter que 70 % de l'écart d'admission global est imputable aux notes obtenues durant la CPGE : 38 % pour celles obtenues dès la fin du premier trimestre de la première année, et 32 % pour celles obtenues après cela. À cela s'ajoute l'effet du « jour J » : à notes égales en fin de CPGE et à comportement de candidature équivalent, les femmes obtiennent des résultats inférieurs à ceux des hommes le jour même du concours.
Dès lors, le phénomène d'inversion des écarts de performance entre le baccalauréat et le début de la CPGE de même que l'amplification de ces écarts au cours de la classe préparatoire sont déterminants.
La note de l'IPP constate également l'effet d'un environnement particulièrement compétitif sur les performances académiques selon le genre, notamment l'admission en classes dite « étoile », qui ouvre des perspectives d'intégration plus élevée dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Ainsi, la probabilité d'intégrer une école du top 10 % est de 6 % en classe non étoile et de 38 % en classe étoile. Les résultats de l'étude montrent que « le fait d'être en classe étoile confère aux hommes un avantage relatif de 20 % par rapport aux femmes. (...) Autrement dit, la classe étoile, qui intensifie la pression académique, tend à creuser les inégalités de genre en matière de réussite aux concours. (...) La réaction différenciée des hommes et des femmes à un environnement d'étude très compétitif joue un rôle central dans les écarts de genre constatés à l'entrée des grandes écoles d'ingénieurs les plus sélectives ».
Lors de son audition125(*) devant la délégation, Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, avait fait référence à cette étude réalisée par l'IPP en soulignant que les moindres chances de réussite, des jeunes femmes admises en classe préparatoire par rapport à leurs homologues masculines pouvaient également s'expliquer par « la dynamique d'un effectif réduit, où elles se retrouvent à quatre pour cinquante dans une classe préparatoire « étoile », entraînant des sentiments d'isolement, une émulation amoindrie, voire un mal-être susceptible de nuire à leur performance ». Elle avait toutefois insisté sur l'importance de l'admission en classes « étoiles » et précisé que « quelques points de différence dans l'évaluation continue en classes préparatoires entraînent des disparités notables dans les parcours des étudiants. Ceux et celles qui accèdent à la classe étoile, très peu nombreux, se voient dotés de l'opportunité de préparer les concours les plus prestigieux, bien que les autres intègrent d'excellentes écoles d'ingénieurs. Il est indéniable qu'une distinction se manifeste au moment du passage en deuxième année ».
Il est indéniable qu'une moindre proportion de filles admises en deuxième année dans ces classes élitistes entraîne mécaniquement une plus faible proportion de filles admises dans les écoles plus sélectives.
(2) En conséquence, une sous-représentation de plus en plus marquée des filles dans les grandes écoles les plus sélectives et prestigieuses
D'après les données transmises à la délégation lors de son audition126(*) par Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, « à l'échelle nationale, nous recensons environ 200 écoles d'ingénieurs, qu'elles soient publiques ou privées, rassemblant près de 250 000 étudiants dans l'ensemble des formations proposées. Parmi eux, environ 200 000 suivent un cursus d'ingénieur en trois ou cinq ans. Seulement 30 % de ces élèves sont des femmes. »
Le taux de féminisation des cursus d'ingénieurs n'a, en outre, progressé que très lentement sur le long terme ainsi que le rappelait Georgia Thebault devant la délégation127(*) : une analyse des écoles d'ingénieurs montre une très grande stabilité entre 2006 et 2021 puisque la part des femmes est passée de 27 % au début du 21? siècle à seulement 31 % aujourd'hui, malgré la multiplication des dispositifs d'incitation à la mixité.
De même, Sylvie Retailleau, professeure d'université, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors de son audition128(*), s'inquiétait devant la délégation du fait qu'« en France, on ne comptait que 27 % de filles parmi les diplômés des écoles d'ingénieurs françaises en 2018. En 2022, elles étaient 29 %. À ce rythme, on pourrait envisager une parité dans ces écoles vers l'an 2150. »
Ce taux est encore plus faible lorsque l'on s'intéresse aux écoles d'ingénieurs les plus sélectives, et notamment celles qui dispensent des enseignements en lien, par exemple, avec la mécanique, les transports, l'électricité ou l'informatique.
Au cours d'une table ronde129(*) organisée le 15 avril 2025 réunissant des représentants de plusieurs grandes écoles scientifiques, la délégation a pu constater les difficultés rencontrées par ces écoles pour recruter des étudiantes.
Comme le soulignait devant la délégation Denis Bertrand, directeur de l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA), parmi les jeunes filles qui choisissent, après le bac, de poursuivre dans l'enseignement supérieur scientifique, « nombre d'entre elles s'orientent vers des filières telles que la chimie, les sciences de la vie ou l'agroalimentaire, où elles constituent environ 60 % des effectifs. À l'autre extrémité du spectre, les filières en lien avec la mécanique, les transports, l'électricité ou encore l'informatique n'accueillent qu'entre 15 et 22 % de jeunes femmes ».
Il précisait, en outre, que « l'ESTACA appartient au concours commun Avenir, qui regroupe plusieurs écoles d'ingénieurs. Or, seuls 22 % des candidats à ce concours sont des candidates. Pire encore, une fois le concours réussi, la proportion de jeunes filles qui choisissent effectivement de s'inscrire dans nos écoles diminue : parmi les 22,3 % de lauréates, seules 19,8 % s'inscrivent dans un des établissements du concours Avenir. À l'ESTACA, en raison notamment d'une certaine inertie et d'une image encore très marquée par la mécanique, les jeunes femmes ne représentent qu'environ 15 % de nos diplômés. »
Même au sein des écoles d'ingénieurs ayant mis en place des politiques pro-actives de féminisation de leurs effectifs, la progression de la proportion d'étudiantes dans leurs rangs reste lente et insuffisante.
C'est ainsi que l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP) compte aujourd'hui 31 % d'étudiantes, proportion qui, bien qu'au-dessus de la moyenne, « reste modeste au regard de l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés », d'après son directeur général, Joël Cuny, qui participait à la table ronde précitée du 15 avril. Il ajoutait que « l'évolution des chiffres, bien que progressive, reste insuffisante. En 1991, nous n'avions que 11 % d'étudiantes à l'ESTP. Leur nombre a été multiplié par 3 en 35 ans. Si cela peut être considéré comme un succès, il est cependant évident qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Pour atteindre la parité, nous estimons qu'il nous faudra encore une vingtaine d'années, soit jusqu'en 2050. Je crains néanmoins que nous ayons atteint une forme d'asymptote, ou que la réforme du bac, loin de contribuer à une meilleure équité, ait généré des effets contre-productifs ». En outre, au sein de l'ESTP, la répartition des effectifs féminins entre les différents cursus proposés n'est pas équilibrée puisque, « dans les travaux publics, la proportion d'étudiantes se situe autour de 20 % voire en-dessous tandis que dans le bâtiment, elle atteint 40 % », disparité qui, d'après le directeur général de l'école, mériterait d'être analysée.
De même, le directeur général de Centrale-Supélec, Romain Soubeyran, indiquait à la délégation lors de la table ronde précitée du 15 avril 2025, que depuis son arrivée à la direction de l'école en septembre 2018, la proportion de femmes parmi les élèves du cycle ingénieur oscille entre 17 % et 21 % : « nous recrutons après la classe préparatoire, et nous accueillons des promotions de 1 000 élèves. Lors des années plus favorables, nous avons atteint 21 % de femmes, mais l'an passé, ce taux s'élevait à 20 %, et en 2023, à seulement 17 % ».
Même constat pour l'École polytechnique (X) qui n'est donc pas épargnée par cette « désaffection » des filles puisqu'à la rentrée 2024, la proportion de femmes admises au concours du cycle ingénieur par la voie des classes préparatoires était de 16 %, contre 21 % en 2023, soit une baisse de 5 points en un an.
Proportion de femmes admises au concours du cycle ingénieur de l'École polytechnique (X)
par la voie des CPGE
en 2023 en 2024
Interrogée sur ce point lors de son audition130(*) par la délégation, Laura Chaubard, directrice générale de l'X, a indiqué que « le taux d'admission des femmes avoisinait 20 à 21 % ces dernières années, chiffre qui correspondait au pourcentage pondéré de candidates à l'École polytechnique en fonction des diverses filières. Bien que nous soyons insatisfaits de ce chiffre, nous étions toutefois satisfaits du fait que les femmes réussissaient aussi bien le concours que les hommes : 20 % de candidates, 20 % d'admises. L'année dernière, cependant, nous avons observé une dégradation de cette symétrie. En effet, la moyenne pondérée des candidates s'établissait à 18 %. Après l'admission, le taux de filles est tombé à 16 %, témoignant d'un double décrochage à la fois du nombre de candidates et du nombre d'admises. »
Elle a considéré que les résultats de 2024 étaient « effectivement très préoccupants, à l'École polytechnique, mais également dans les autres écoles d'ingénieurs », mais a souligné qu'il était toutefois inexact de dire que la tendance générale de ces dernières décennies était à la baisse.
D'après les chiffres du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche publiés en mars 2025, la part des femmes diplômées d'un titre d'ingénieur en France en 2023 était ainsi de 30 %, contre 22 % en 2000. En outre, entre 2010 et 2023, leur effectif a progressé de 61 % (+ 43 % pour les hommes). Si la féminisation des effectifs des personnes diplômées d'une école d'ingénieur existe bien, elle demeure particulièrement lente.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)131(*)
Le décrochage de la part des filles admises au concours du cycle ingénieur de l'École polytechnique doit toutefois nous interpeler, surtout dans le contexte général, précédemment évoqué, de désaffection des filles pour ces filières scientifiques les plus sélectives.
Ainsi que le formulait Elisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile chez ENGIE, membre du HCE et membre du comité de direction de l'association Femmes@numérique, lors de son audition132(*) par la délégation : « la chute récente de la part des filles à l'École polytechnique - de 21 % à 16 % en une seule année - doit être interprétée comme un signal d'alarme. Une diminution de cinq points ne saurait s'expliquer par une variation conjoncturelle. Elle manifeste, au contraire, l'installation d'une dynamique régressive, malgré les efforts engagés. Le déploiement du mentorat, la multiplication des programmes d'accompagnement, les cercles d'intérêt, les actions de terrain, ou encore les dispositifs tels que Tech pour Toutes ou Capital Filles, témoignent d'un engagement constant. Et pourtant, le recul s'accentue. »
S'agissant des écoles normales supérieures (ENS), autres filières d'excellence en France qui assurent notamment la formation des chercheurs, chercheuses et enseignants, enseignantes dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, le taux de femmes admises dans les filières scientifiques est également globalement très faible.
Parmi les élèves normaliens nommés à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm (ENS Ulm), les filles sont presque aussi nombreuses que les garçons dans les filières de « Lettres » (elle représentent 45 % de l'effectif total), mais sont très minoritaires, voire absentes (filière Info MPI), dans les filières « Sciences », au sein desquelles 99 élèves sont entrés en 2023, dont seulement 19 filles.
Source : Académie des sciences
La répartition des filles dans les différents groupes133(*) de la section « Sciences » parmi les élèves nommés à l'ENS Ulm à la rentrée universitaire 2023 montre que les filles représentaient 14 % des 35 élèves issus de la filière « maths physique » (MP), mais 0 % des filières « maths info » et, à l'inverse, respectivement près de 30 % et près de 40 % des filières « physique chimie » et « Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre ».
Source : Académie des sciences
Le constat est le même à l'ENS Lyon dont le président, Emmanuel Trizac, auditionné134(*) par la délégation dans le cadre de la table ronde avec des représentants des grandes écoles, a rappelé que « dans les classes préparatoires les plus sélectives au sein desquelles nous recrutons, environ 20 % des étudiants en mathématiques et informatique sont des femmes. Parmi ces 20 %, 16 % se présentent à nos concours. Ce taux réduit conduit à une perte significative au fil des années. Au final, sur les deux voies en mathématiques et informatique, et sur les quatre années cumulées, nous comptons un peu moins de 10 % de femmes. L'année dernière, pour la rentrée 2024, nous sommes même tombés en dessous de 5 % dans le flux d'entrée. »
De même, à l'ENS Paris-Saclay, lors de l'année universitaire 2024-2025, les femmes représentaient 32 % des étudiants, mais seulement 12 % des étudiants en sciences pour l'ingénieur et 25 % de ceux en sciences fondamentales, contre de 52 % de ceux en sciences humaines et sociales135(*). En outre, au sein de la discipline « sciences fondamentales », les filles représentaient 18 % des étudiants inscrits en informatique et seulement 11,5 % des inscrits en mathématiques.
(3) Des filles souvent « dissuadées » par leur entourage direct de s'orienter vers les filières STIM les plus sélectives
Lors de son audition136(*) par la délégation, Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) et directrice de l'école 3iL Ingénieurs, a fait état des résultats de la récente enquête Gender Scan dont la CDFEI est partenaire.
Ainsi, en 2025 :
- plus de 40 % des étudiantes actuellement en école d'ingénieurs déclarent avoir été dissuadées, à un moment ou à un autre, de s'orienter vers les filières STIM ;
- 56 % des étudiants inscrits dans des formations numériques, et 32 % dans d'autres filières relevant des STIM (hors numérique), déclarent avoir subi des formes de découragement liées à leur genre ;
- malgré cela, 96 % des étudiantes actuellement en école d'ingénieurs se déclarent satisfaites de leurs études.
L'enquête identifie trois principales sources de découragement :
- les enseignants, qui demeurent des prescripteurs décisifs dans les choix d'orientation : la culture et les compétences scientifiques des jeunes filles sont encore insuffisamment reconnues et valorisées, et elles sont moins encouragées à se tourner vers les domaines techniques ;
- l'influence du cercle amical : les pairs jouent un rôle non négligeable, et on observe malheureusement une persistance, voire un renforcement, des biais genrés chez les plus jeunes ;
- l'entourage familial qui continue d'exercer une influence marquée.
Dès lors, ainsi que le soulignait Dominique Baillargeat, « ces réponses nous invitent à nous interroger : combien d'autres auraient pu nous rejoindre si elles n'avaient pas été découragées ? Ce constat est d'autant plus préoccupant dans un contexte de pénurie d'ingénieurs. »
b) Un déficit de filles au sein des filières universitaires dites STIM
(1) Les filles étudient les sciences mais restent minoritaires en sciences fondamentales
Dans les filières universitaires, toutes les « sciences » ne sont pas logées à la même enseigne s'agissant de la féminisation des filières considérées. Comme le soulignait très justement Laura Chaubard, directrice générale de l'X lors de son audition137(*) par la délégation, « quand les femmes choisissent des sciences, elles s'orientent massivement vers des cursus en sciences de la vie ainsi que vers les filières de santé et médicales. »
D'après les derniers chiffres clés publiés138(*), en mars 2025, par la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, au sein des disciplines scientifiques universitaires, à la rentrée 2023, les femmes sont ainsi majoritaires en sciences de la vie et en médecine (66 % des étudiants dans les deux cas) et minoritaires en sciences fondamentales (33 % des étudiants).
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)
Si les femmes ne sont bien sûr pas absentes de toutes les filières scientifiques universitaires et si leur proportion au sein de ces filières a progressé au cours des dix dernières années, elles y sont encore sous-représentées et minoritaires, notamment au sein des formations sélectives, et plus particulièrement dans les secteurs d'avenir comme l'informatique ou les mathématiques.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)
Au sein des formations scientifiques, à l'université, les femmes représentent la majorité des diplômés de master en chimie mais sont minoritaires dans les autres matières scientifiques notamment en mathématiques, physique, électronique ou informatique. À l'exception notable des mathématiques, leur part a augmenté dans toutes les disciplines au cours de la dernière décennie, entre 2012-2013 et 2022-2023.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)
S'agissant plus particulièrement de la situation des doctorantes, dont le statut est spécifique car il s'agit de chercheuse en formation, à cheval entre un statut d'étudiante en thèse et de chercheuse qui se forme par l'expérience professionnelle de la recherche au sein d'une unité ou d'une équipe de recherche reconnue après une évaluation nationale, la progression des chiffres entre sur une décennie (entre 2013 et 2023) montre que si la part des femmes en première inscription est globalement stable, celle des femmes réalisant une soutenance progresse d'un point. Toutefois, en mathématiques, cette part est stable en première inscription mais elle diminue en soutenance (-5 points).
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)
(2) Un taux de féminisation des filières scientifiques qui progresse très peu sur le temps long
Les statistiques publiées chaque année par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche montrent une faible progression sur le temps long du taux de féminisation des filières STIM voire une baisse en mathématiques.
Ainsi, pour l'ensemble des filières « sciences fondamentales et applications » dans les universités françaises, la part des femmes diplômées en master est passée de 29 % en 2012-2013 à 33 % en 2022-2023, soit une progression de seulement quatre points en dix ans.
Cette progression a atteint six points en physique passant d'un taux de femmes diplômées de 23 % à 29 % et de seulement trois points en informatique (22 % à 25 %). En revanche, le taux de femmes diplômées en cursus master universitaire de mathématiques a baissé de deux points, passant de 33 % en 2012-2013 à seulement 31 % en 2022-2023, soit moins d'un tiers des diplômés.
Ainsi que le formulait Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences, lors de son audition139(*) par la délégation, « la tendance globale n'est pas favorable, notamment en mathématiques. La proportion de femmes en licence de mathématiques diminue. Ce constat ne résulte pas uniquement des réformes récentes. Ce phénomène existait déjà, mais les données montrent une baisse progressive et généralisée de la part des femmes dans cette discipline depuis 2005. Nous atteignons aujourd'hui des proportions extrêmement préoccupantes ».
Si la réforme du baccalauréat mise en oeuvre en 2019, à l'initiative de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, auditionné140(*) par la délégation, est souvent pointée du doigt comme ayant freiné la féminisation des filières scientifiques dans l'enseignement supérieur, il faut reconnaître que la moindre appétence des filles pour les filières STIM remonte à une plus d'une décennie. Comme évoqué précédemment par les rapporteures, la réforme du bac a surtout contribué à l'anticipation des choix d'orientation effectués par les lycéens et lycéennes.
Dans un dossier141(*) publié par l'Insee en mars 2022, intitulé « De l'école élémentaire à l'entrée dans l'enseignement supérieur : filles et garçons construisent des parcours distincts » et qui s'appuie sur des données collectées entre 2007 et 2019 (avant la mise en oeuvre de la réforme du baccalauréat), il est notamment indiqué que « les filles qui suivent des parcours scientifiques se dirigent davantage vers des carrières dans les filières de santé, tandis que les garçons ont des carrières plus diversifiées et s'orientent majoritairement vers toutes les autres filières scientifiques. (...) À l'entrée dans l'enseignement supérieur, les filles issues de série S investissent massivement les SVT et s'orientent vers un nombre plus restreint de filières que les garçons. »
Cette étude indique également qu'après un baccalauréat scientifique, les lycéennes ne s'orientent pas moins que les lycéens dans les voies scientifiques les plus sélectives, qui scolarisent 52 % des nouvelles bachelières et 53 % des nouveaux bacheliers de série S à la rentrée 2019.
Toutefois, cette apparente égalité masque un déséquilibre marqué : plus du quart des bachelières sont en effet inscrites dans les filières de santé à l'université (contre seulement 11 % des bacheliers) et les jeunes femmes sont nettement moins nombreuses dans les autres filières.
Dans les CPGE scientifiques et les écoles d'ingénieurs post-bac, la part de bacheliers représente près du double de celles des bachelières. En effet, les lycéennes ne candidatent dans ces segments que lorsqu'elles sont excellentes, au contraire des lycéens qui le font aussi avec des résultats plus modestes. Les bachelières de série S suivent davantage les CPGE économiques et littéraires que les bacheliers, mais ces filières sélectives scolarisent peu d'étudiants.
Cette étude conclut sur le fait que « certaines filières de l'enseignement supérieur sont davantage valorisées car elles permettent d'accéder à des emplois prestigieux et bien rémunérés sur le marché du travail. (...) Ces inégalités de carrières scolaires construites tout au long de la scolarité participent à entretenir par la suite la division sexuée du travail et conditionnent en partie les inégalités d'emploi, de position sociale et de salaire. »
Plus récemment, l'Observatoire du Bien-être du Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP)142(*) s'est penché sur cette corrélation entre les choix d'orientation scolaire et les inégalités, notamment salariales, rencontrées plus tard sur le marché du travail, et a cherché à analyser les motivations qui poussent les jeunes filles à s'orienter vers des carrières moins rémunératrices, sous l'angle de plusieurs facteurs combinés (goûts pour les matières étudiées dans le secondaire, pression parentale exercée sur le parcours scolaire, motivations liées aux études, aspirations professionnelles et valeurs associées au travail).
Il apparaît notamment que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à préférer étudier un domaine qui les passionne, même s'il n'offre pas la garantie d'un emploi bien rémunéré, et qu'elles accordent une importance nettement plus grande aux valeurs personnelles quand les hommes manifestent un intérêt plus marqué pour un emploi « dans un domaine en croissance, porté par les technologies émergentes ».
Ainsi, les femmes qui accordent une forte importance à donner du sens à leur vie, valorisent un métier-passion et aspirent à un emploi à forte dimension relationnelle et altruiste s'orienteront majoritairement vers des études en santé et paramédical.
Fait remarquable : au sein-même des filières sciences et technologies, les femmes témoignent d'un faible attrait pour des domaines très rémunérateurs sur le marché du travail tels que l'informatique/numérique et la finance, dont les valeurs leur semblent sans doute peu correspondre aux aspirations citées plus haut. En effet, seules 30 % des étudiantes en sciences et technologies expriment un intérêt pour un emploi dans l'informatique ou le numérique (contre 59 % des étudiants) et 30 % indiquent même ne pas être du tout intéressées par un emploi dans ce secteur (contre 5 % des étudiants).
c) Une sous-représentation féminine parmi les enseignants-chercheurs dans les universités scientifiques et parmi les enseignants de CPGE scientifiques
Outre la féminisation des études supérieures dans les filières scientifiques, la question de la représentativité des femmes au sein du corps enseignant dans ces filières, qu'elles soient universitaires ou plus sélectives (CPGE, écoles d'ingénieurs), se pose également avec acuité.
De façon globale au sein de l'université, les femmes sont minoritaires parmi l'ensemble des personnels enseignants titulaires en activité.
Ainsi, en 2023, la part des femmes ne dépassait pas 41 % parmi les enseignants-chercheurs de la filière universitaire, 39 % dans les organismes de recherche et 33 % parmi les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)143(*)
En outre, au sein des 41 % de femmes enseignantes-chercheuses titulaires, une large majorité (64 %) exercent dans les disciplines des langues et littératures, et une minorité, seulement 15 %, dans celle des mathématiques, 20 % dans celle des sciences de l'ingénieur, et 24 % dans celle des mathématiques et informatiques.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)144(*)
Parmi les femmes enseignantes-chercheuses en fonction dans l'enseignement supérieur, on peut établir une distinction entre les professeures d'université (PU) et les maîtresses de conférences (MCF) : si des progrès ont été réalisés au cours des vingt dernières années, la part des femmes dans le corps des professeurs d'université reste faible, passant de 17 % en 2000 à 23 % en 2010 et 32 % en 2023 toutes filières confondues. S'agissant des MCF, la part des femmes est passée de 38 % en 2000 à 42 % en 2010 et 45 % en 2023.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)145(*)
En outre, comme on l'a vu, au sein du vivier des professeures d'université (PU) et des maîtresses de conférences (MCF), celles qui enseignent les mathématiques sont très minoritaires : moins de 30 % s'agissant des MCF et un peu plus de 10 % s'agissant des PU.
Comme le soulignait Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences : « pour donner un ordre de grandeur, en mathématiques fondamentales, il y a quelques années, nous comptions une trentaine de femmes, elles sont aujourd'hui 40 sur 500 professeurs. Pour atteindre la parité, nous devrions recruter environ 200 professeures d'université supplémentaires. »
On note également que les écarts de représentation entre les mathématiques et toutes les filières confondues sont restés stables au cours des vingt dernières années.
Source : Georgia Thebault (Paris Dauphine - PSL)146(*)
S'agissant des autres matières scientifiques enseignées à l'université, les statistiques présentées à la délégation par l'Académie des sciences lors de son audition147(*), sur la base des chiffres du MESR, font également état d'une grande stabilité de la proportion de femmes enseignantes-chercheuses (PU et MCF) au cours de la dernière décennie. C'est en chimie et biologie qu'elles sont le plus nombreuses ; à l'inverse, elles sont faiblement représentées parmi les enseignants-chercheurs en ingénierie, physique et mathématiques.
Source : Académie des sciences - audition par la délégation
Ainsi que le constatait Hélène Bouchiat, physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et sciences de l'Académie des sciences, lors de son audition148(*) par la délégation, « les statistiques nous montrent, de façon générale, le déficit de femmes dans les sciences dites dures (mathématiques, informatique, physique et chimie) ». Elle soulignait, par ailleurs, que les femmes étaient moins nombreuses dans la catégorie, plus prestigieuse, des professeurs d'université (PU) que dans celle des maîtres de conférences (MCF) mais que, dans certaines disciplines, le vivier, c'est-à-dire les maîtres de conférences, avait même tendance à diminuer avec le temps.
Source : Académie des sciences - audition par la délégation
Pour reprendre les mots d'Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d'Aix Marseille Université (amU), « il existe un point commun à toutes les disciplines scientifiques : la persistance d'un plafond de verre. Il ne serait pas juste de dire que l'absence de femmes parmi les effectifs est normale. En effet, dans de nombreuses disciplines, nous observons 60 % à 70 % de femmes parmi les maîtres de conférences, mais à peine 30 % à 40 % parmi les professeurs d'université. Cette situation contribue également aux disparités salariales au sein des universités. En tout, 80 % des écarts de rémunération entre les sexes peuvent être attribués à la ségrégation des corps, c'est-à-dire à la sous-représentation des femmes dans les postes de rang A, quelle que soit la discipline. »
Enfin, la délégation estime qu'une attention particulière doit également être portée à la féminisation des postes d'enseignants en classes préparatoires scientifiques. Pour reprendre les mots d'Élisabeth Borne, auditionnée149(*) par la délégation en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, « parce que nous devons réaliser la parité à tous les niveaux et que les jeunes filles ont besoin de s'identifier à des figures fortes, nous devons également travailler sur la représentation des femmes parmi les enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles et les postes de direction des lycées ». À cet égard, la ministre a annoncé avoir demandé à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de veiller à nommer au moins 30 % de femmes parmi les professeurs des disciplines STIM en classes préparatoires.
2. Sexisme ordinaire et violences omniprésents dans les études scientifiques en dépit d'une prise de conscience ces dernières années
Le constat précédemment dressé par les rapporteures, celui d'une sous-représentation manifeste des femmes dans les études dites STIM150(*), amène nécessairement à se poser la question des raisons de cette si faible présence de femmes au sein des études scientifiques les plus sélectives, celles qui mènent aux carrières scientifiques, dans le domaine de la recherche et dans ceux de l'ingénierie, de l'informatique ou du numérique notamment.
Les raisons pour lesquelles les jeunes filles se détournent de ces voies d'accès les plus élitistes aux carrières scientifiques, sont multiples mais, parmi celles-ci, on peut notamment citer :
- le fait qu'elles ne s'y sentent pas attendues ou pas les bienvenues, qu'elles renoncent à se lancer dans des études scientifiques sélectives car « elles ne s'y sentent pas à leur place », pour reprendre les mots de la ministre Elisabeth Borne lors de son audition151(*) par la délégation ;
- le fait qu'elles redoutent la très faible mixité de l'environnement et l'éventuelle « toxicité » d'un milieu très majoritairement masculin et compétitif ;
- la persistance d'un climat de violences sexistes et sexuelles dont la réalité n'est pas encore suffisamment prise en compte par tous les responsables académiques dans le domaine des sciences, malgré une - plutôt récente - prise de conscience institutionnelle et ministérielle du phénomène.
Au cours de leurs travaux et des nombreuses auditions qu'elles ont menées, les rapporteures ont pu constater l'existence de différents niveaux de violences sexistes et sexuelles à l'oeuvre dans les milieux scientifiques : du « sexisme ordinaire » - dans certaines écoles d'ingénieurs par exemple, où les filles ne peuvent s'épanouir pleinement ou se sentir à l'aise - aux violences sexuelles, souvent aggravées par la consommation d'alcool dans les milieux étudiants, en passant par le sexisme et les violences qui peuvent ralentir les carrières des femmes scientifiques, y compris dans le cadre d'activités qui dépassent le cadre strictement professionnel, en marge, par exemple, de colloques ou de missions de terrain, et qui parfois les poussent à quitter le domaine scientifique.
a) Une désaffection des filles liée à la persistance d'un climat sexiste et de violences subies au cours des études supérieures scientifiques
Ni les statistiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), ni celle de l'enquête Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et les hommes, dite Virage, datant de 2015, ne permettent malheureusement de distinguer au sein du volet consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche les chiffres relatifs à la prévalence exacte des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les études scientifiques.
L'absence de ventilation de ces statistiques par filière est dommageable puisqu'en l'absence de données chiffrées, il est toujours difficile de mettre en place une politique publique efficace et suffisamment légitime aux yeux des acteurs censés la mettre en oeuvre.
En revanche, les travaux menés par la délégation ont permis de recueillir de nombreux témoignages relatifs aux violences encore à l'oeuvre, à des degrés divers, au sein des CPGE, grandes écoles ou encore filières universitaires scientifiques.
(1) Des chiffres encore insuffisamment précis pour mesurer la prévalence des VSS dans l'enseignement supérieur scientifique
La délégation a consacré une table ronde152(*) spécifique à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les études et carrières scientifiques.
Au cours de cette table ronde, ont notamment été présentés les travaux de recensement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) sur le sujet ainsi que ceux de l'enquête Virage précitée, réalisée en 2015, qui s'inscrivait dans la continuité de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) de 2000, et comportait notamment un volet « Universités ».
Pour reprendre les mots de Véronique Lestang-Préchac, sous-directrice Territoires, Sociétés, Savoirs au service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGESIP/DGRI) du MESR, qui a reconnu le caractère systémique des VSS au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, « dans les filières où les femmes sont sous-représentées, comme les filières STIM, le sexisme et les violences sexuelles peuvent être amplifiés et constituent des freins à l'orientation et à la poursuite des études et des carrières des femmes ».
Elle a, en outre, donné quelques indications sur la prévalence des VSS dans les études supérieures, précisant que le MESR avait d'abord soutenu l'enquête Virage, en lien avec à l'Institut national d'études démographiques (Ined), puis demandé à l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE) d'intégrer un volet VSS dans son enquête annuelle.
D'après les chiffres publiés dans le cadre de l'enquête de l'OVE, en 2020, 5 % de femmes se déclaraient victimes de VSS dans le cadre de leurs études, chiffre qui est passé à 14 % en 2023, soit une augmentation de près de 10 points en trois ans.
Résultats du volet
« VSS » de l'enquête annuelle de l'Observatoire
national
de la vie étudiante (OVE)
2020 2023
de femmes se déclarant victimes de VSS dans le cadre de leurs études
D'après Véronique Lestang-Préchac, « cette augmentation peut aussi s'expliquer par une meilleure communication, une connaissance accrue et une plus grande libération de la parole - alors qu'auparavant, régnait une sorte d'omerta et une non-compréhension des mécanismes en cause ».
S'agissant des résultats de l'enquête Virage de 2015, Amandine Lebugle, démographe, responsable d'études et de recherche à l'Observatoire du Samusocial de Paris, ancienne membre de l'équipe de coordination de l'enquête Virage, a rappelé à la délégation que cette enquête « cible les violences non pas uniquement au sein de l'enseignement supérieur, mais dans l'ensemble des sphères de la vie : espaces publics, travail, couple, famille et études ».
En revanche, un volet spécifique « Virage-universités » de cette enquête existe et révèle un taux de prévalence des violences différent de celui observé dans le cadre de l'enquête « principale » effectuée auprès de la population générale.
Ainsi, dans l'enquête Virage principale, 16 % des femmes et 15 % des hommes qui ont répondu au module sur les violences dans les études, ont déclaré au moins un fait de violence au cours des douze derniers mois. Dans le volet Virage-universités, les taux sont bien plus élevés : ils vont de 26 % à 34 % pour les femmes et de 18 % à 28 % pour les hommes.
D'après Amandine Lebugle, les faits les plus souvent rapportés pour les femmes concernent des propos et attitudes à caractère sexuel, suivis des propositions sexuelles insistantes et l'appropriation abusive du travail. Pour les hommes, ce sont principalement des moqueries, des insultes et également l'appropriation abusive du travail.
En outre, l'enquête sur les universités fait état d'un « cumul de faits de violences », ainsi que le rapporte Amandine Lebugle, « car la moitié des étudiantes et la moitié des étudiants qui ont déclaré au moins un fait en déclarent en réalité plusieurs ».
Les faits de violences le plus souvent rapportés sont les suivants :
- les principales situations de violence déclarées dans les universités sont les violences psychologiques pas ou peu graves ;
- la deuxième situation de violence regroupe les personnes ayant subi des violences sexuelles sans contact, avec des déclarations moins fréquentes dans le volet universités qu'en population générale ;
- la situation de violence sexuelle avec contact sans pénétration est, en revanche, bien plus fréquente dans le volet « universités » de l'enquête qu'en population générale, en particulier pour les femmes. Elles sont deux fois plus nombreuses dans ce volet à déclarer ce type de violences. Ce décalage est lié au fait que les femmes du volet « universités » ont souvent répondu au questionnaire sur internet pour dénoncer les agressions sexuelles qu'elles ont subies.
Enfin, l'enquête montre que les violences ont des conséquences directes sur les parcours universitaires : redoublement, arrêt des études, changement de filière. Elle révèle également que les personnes mobilisent très peu les services de l'université pour dénoncer les violences qu'elles peuvent y subir.
La délégation note toutefois, à regret, que ces différentes enquêtes ne permettent pas d'opérer une distinction entre les différentes filières de l'enseignement supérieur et notamment pas d'obtenir un éclairage chiffré quant au fait de savoir si les étudiantes en sciences déclarent plus souvent des violences que dans les autres filières universitaires.
En outre, la délégation estime que la dernière enquête Virage, désormais datée d'une dizaine d'années, n'est pas suffisamment actuelle pour mesurer l'ampleur de ces violences dans le système académique aujourd'hui. Or, d'après les informations fournies à la délégation, il n'est pas prévu de suite à l'enquête Virage de 2015.
(2) Des témoignages recueillis par la délégation au cours de ses travaux
Si les statistiques officielles disponibles en matière de prévalence des VSS dans les études supérieures ne permettent malheureusement pas d'isoler les études scientifiques, la délégation, au cours de ses nombreuses auditions et de ses déplacements sur le terrain, a pu, au travers de nombreux témoignages, récits et informations délivrées par des responsables académiques eux-mêmes, prendre la mesure de ce que l'on pourrait qualifier de « l'éléphant au milieu de la pièce » : la persistance d'un climat « au mieux » sexiste, au pire violent, pour les étudiantes en filières scientifiques, que ce soit en école d'ingénieurs ou dans certaines filières universitaires.
Lors de son audition153(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur, a insisté sur le caractère dissuasif du risque de violences sexistes et sexuelles auprès des jeunes filles qui pourraient prétendre s'inscrire en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : « si l'on veut dépasser ce plafond de verre à 25 %, il faut aller chercher des filles qui pourraient être affectées par ces remarques sexistes et qui ne le seront pas parce qu'on aura changé les choses, il faut, maintenant, que toutes les filles qui ont des talents en maths puissent aller en classe préparatoire : ce n'est pas aux jeunes filles de s'adapter aux remarques sexistes, c'est l'état d'esprit global qui doit changer. »
Elle a également reconnu avoir « été très surprise de constater qu'effectivement, des jeunes filles renoncent à des filières scientifiques parce qu'elles les jugent trop masculines, avec l'idée que, de ce fait, elles n'y seraient pas à leur place. (...) aujourd'hui, des jeunes filles renoncent à aller dans telle classe préparatoire parce qu'elles pensent y subir des remarques sexistes. »
Les directions de certaines grandes écoles scientifiques (écoles d'ingénieurs ou écoles normales supérieures) ont indiqué à la délégation avoir mené leurs propres enquêtes internes au sein de leurs écoles afin d'identifier de potentielles situations et victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est le cas notamment de Centrale-Supélec et de l'École polytechnique par exemple.
Ainsi, Romain Soubeyran, directeur général de Centrale-Supélec, a indiqué, lors de son audition154(*) devant la délégation, avoir identifié la problématique des violences sexuelles et sexistes (VSS) dès 2019, en considérant l'importance d'offrir un espace où la parole puisse être librement exprimée. Malgré la nomination d'une référente égalité femmes/hommes et la mise en place d'une cellule psychologique composée de psychologues soumis au secret médical, aucun signalement de violences n'était, dans un premier temps, remonté à la direction de l'école.
En mars 2021, le conseil d'administration de l'école a approuvé un premier plan égalité femmes/hommes, en particulier pour aborder la question des VSS, malgré l'absence de signalements. Ce plan incluait l'organisation d'une enquête annuelle auprès de tous les étudiants afin d'identifier les cas de VSS.
Comme l'a rappelé Romain Soubeyran, les résultats de cette enquête ont eu un impact considérable : « non seulement en révélant des faits inattendus pour les étudiants, mais également en suscitant une prise de conscience au sein de l'école. (...) Les comportements qui choquent le plus sont généralement liés à deux facteurs : le sexisme ordinaire, qui banalise l'infériorisation des femmes, et l'alcool, qui exacerbe souvent ces comportements. Ces deux enjeux constituent désormais des axes de travail prioritaires ».
Également auditionnée155(*) par la délégation, Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, a indiqué à la délégation que Polytechnique était la seule école d'ingénieurs à mener une enquête annuelle systématique sur le sujet des violences sexistes et sexuelles depuis quatre ans, à partir de janvier 2022, et à en publier les résultats156(*) : il s'agit d'une enquête anonyme sur les atteintes sexistes et sexuelles auprès de l'ensemble de sa population étudiante.
Principaux résultats de l'enquête sur les VSS à l'École polytechnique Janvier 2025
Les résultats de l'enquête de 2025 confirment globalement ceux des enquêtes précédentes concernant les profils des auteurs désignés et les circonstances dans lesquelles sont survenus les faits déclarés :
- les auteurs désignés sont à 70 % des hommes ;
- 95 % des victimes déclarées de violences sexuelles ou sexistes connaissent les auteurs des faits ;
- la majorité des faits déclarés de violences sexuelles ou sexistes ont lieu au sein des élèves et étudiants ;
- la majorité des atteintes déclarées ont lieu durant la vie quotidienne (28 %), les activités associatives (22 %), les stages (21 %), ou les soirées privées dans une résidence sur le campus (8 %) ;
- il apparaît une forte corrélation entre consommation d'alcool ou de stupéfiants et atteintes sexistes et sexuelles, qui est présente dans 43 % des cas déclarés.
À la différence des années précédentes, les personnes déclarant avoir fait l'objet d'atteintes sont majoritairement des hommes (à 54 %), 45 % pour les femmes et 1 % pour les personnes non-binaires.
Les victimes déclarées de faits de viol et tentative de viol restent néanmoins très majoritairement des femmes à plus de 80 %.
|
Le nombre de faits déclarés d'atteintes sexistes ou sexuelles reste très élevé et doit mobiliser toute l'attention des services de l'École (pour les hommes, 562 faits déclarés ; pour les femmes, 464 faits déclarés ; et pour les non-binaires, 13 faits déclarés). La comparaison avec les résultats de l'année précédente fait ressortir une baisse des faits déclarés de viol (16 cas déclarés en 2024 contre 24 en 2023), mais une hausse des faits déclarés d'atteintes sexistes et sexuelles de tous types (1 039 faits déclarés en 2024 contre 788 en 2023). |
Source : École polytechnique
Les milieux de l'université et de la recherche ne sont pas épargnés par ces violences.
Au cours d'une table ronde157(*) consacrée à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les études et carrières scientifiques, Rhita-Maria Ouazzani, astronome-adjointe au Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA) de l'Observatoire de Paris, membre de la Cellule d'écoute et de veille de l'Université PSL, coordinatrice de la commission Femmes et Astronomie de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A), a apporté à la délégation un témoignage éclairant à la fois sur son parcours personnel en tant qu'étudiante dans une filière à dominante masculine mais aussi en tant que membre de la cellule d'écoute et de veille de l'Université PSL, qui a pour mission de faciliter le signalement de situations de violences sexistes et sexuelles : « très tôt, dans le cadre scolaire puis universitaire, j'ai ressenti ce que signifie être en minorité dans des espaces historiquement masculins. À la fin de mon cursus universitaire en master de physique fondamentale, nous n'étions plus que cinq femmes dans une promotion de cinquante. Ce sentiment d'isolement s'est renforcé au fil des années avant que je mette des mots sur ce que je vivais. Comme beaucoup de femmes, j'avais intégré des stratégies d'évitement, des réflexes d'adaptation. »
Son parcours et son engagement au sein de la cellule d'écoute et de veille l'ont convaincue que l'un des principaux freins à l'égalité au sein des études et carrières scientifique reste la prévalence des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans ce milieu.
Après avoir fait état devant la délégation de nombreux parcours, d'étudiantes ou de doctorantes, entravés voire brisés par leurs expériences de violences sexistes et sexuelles, souvent banalisées ou ignorées, elle conclut que « ces témoignages ne sont pas des anomalies, ce sont des symptômes d'un système trop souvent défaillant. Tant que les VSS resteront ignorées ou minimisées, l'égalité dans la recherche restera un mirage ».
Au cours de la même table ronde, Jérôme Courduriès, professeur des universités en anthropologie, chargé de mission « Égalité de genre et de lutte contre les VSS » à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, a indiqué que, d'après le rapport de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes de l'enseignement supérieur, publié en 2024, près de 52 % des doctorantes et doctorants estiment que le doctorat est une période particulièrement propice aux VSS.
En outre, près d'un quart des doctorantes et doctorants qui se rendent dans leur laboratoire plus d'une fois par an déclarent y avoir subi ou été témoin d'au moins une forme de violence, de harcèlement ou de discrimination passible de sanctions légales. Les faits relèvent surtout d'agissements sexistes ou d'outrages sexistes, mais aussi de faits discriminatoires et de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles ou de viols.
Jérôme Courduriès a, par ailleurs, souhaité porter plus particulièrement l'attention de la délégation sur les congrès et colloques qui sont également des lieux professionnels à risque, puisque « 7 % des doctorantes et 9 % des personnes non binaires déclarent y avoir subi des atteintes ou agressions de nature sexuelle. Dans 90 % des cas, les auteurs de ces violences sont des hommes, très souvent des titulaires ou des chercheurs ou enseignants-chercheurs émérites ».
Des travaux montrent que les violences subies sont des facteurs de renoncement ou de distanciation avec le milieu professionnel, comme l'abandon de thèse.
Tous les domaines scientifiques sont concernés, mais ces faits paraissent encore davantage prégnants dans les sciences du vivant et de l'environnement, les sciences de l'ingénieur et techniques. On ne peut que remarquer que, dans ces mêmes domaines, les femmes sont moins nombreuses à tous les échelons, surtout au grade de professeur et assimilé, et donc particulièrement dans l'encadrement de thèse.
Les VSS déclarées par les personnes qui en ont été victimes vont des « blagues sexistes, remarques ou questions obscènes, sexualisantes ou dégradantes, jusqu'aux agressions sexuelles et viols, en passant par les discriminations et les insultes sexistes ou liées à l'orientation sexuelle supposée et le harcèlement sexuel ».
Ainsi que le mentionnait Véronique Lestang-Préchac158(*), sous-directrice au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, « les VSS n'ont pas lieu qu'entre étudiants, mais ce sont ces situations qui nous remontent, lors d'événements festifs par exemple. (...) De manière générale, de nombreux étudiants ne se sentent pas en sécurité durant ces événements. Nous travaillons donc sur ce sujet, mais il n'est pas exclusif. Ont été évoqués aussi les études de terrain et l'encadrement du doctorat. (...) Un binôme est formé entre le directeur ou la directrice de recherche et l'étudiant et l'étudiante. Désormais, le dispositif est beaucoup plus encadré avec les contrats doctoraux. Dans les laboratoires, le suivi de la thèse n'est plus fait qu'en binôme. »
En effet, comme le rappelait Jérôme Courduriès, l'enseignement supérieur et la recherche présentent un certain nombre de situations à risque, parmi lesquelles, en premier lieu, la relation entre doctorante, doctorant et directrice de thèse ou directeur de thèse, qui tout en étant très hiérarchisée est également peu codifiée et prend souvent la forme d'une relation très interpersonnelle.
En outre, le statut de doctorante et doctorant est hybride : « quand ils bénéficient d'un financement, ils sont salariés, mais ont aussi un statut étudiant. L'avenir professionnel des doctorantes et doctorants est si incertain dans de nombreux domaines, et si dépendant de l'appréciation de leur encadrante ou encadrant et de leur responsable hiérarchique, qu'il peut leur être difficile de poser des limites si cela s'avère nécessaire ».
Enfin, les espaces de travail sont nombreux et divers, et peuvent favoriser un brouillage des sphères privée et professionnelle dans les relations de travail et d'encadrement, particulièrement dans les temps de colloques ou de congrès.
(3) Quelles conséquences des VSS subies dans l'enfance sur les choix de trajectoires à l'âge adulte ?
Au cours de ses travaux, et notamment lors de sa table ronde159(*) sur les inégalités dans le recrutement et le déroulement de la carrière des femmes scientifiques, la délégation a été amenée à réfléchir aux raisons profondes pour lesquelles les filles semblent se détourner massivement des milieux académiques et professionnels scientifiques, ceux en lien avec les sciences dites « dures ».
Une des explications, avancée notamment par Elisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile chez ENGIE, membre du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) et du comité de direction de l'association Femmes@numérique, a retenu l'attention des rapporteures : elle pointe les conséquences des violences sexistes et sexuelles dont auraient pu être victimes les jeunes filles au cours de leur enfance, notamment dans le cadre d'activités sportives extra-scolaires.
Citant des chiffres rendus publics par le ministère des sports, elle a rappelé qu'« en France, un enfant sur sept subit des violences dans le cadre d'activités sportives ordinaires. Parmi ces victimes, 85 % sont des filles. Sur les 7 millions d'enfants licenciés dans un club sportif, environ 900 000 relèvent de cette statistique tragique. (...) 79,2 % des athlètes interrogés déclarent avoir subi au moins une forme de violence psychologique, 40 % des violences physiques, et 28,2 % des violences sexuelles. »
Sur le fondement de ces chiffres de violences subies, notamment par les jeunes filles pendant l'enfance, dans le cadre d'une pratique sportive, elle a estimé que « les jeunes filles ayant subi de telles violences évitent ensuite, durablement, tout environnement à dominante masculine ». Dès lors, le lien avec les filières scientifiques, souvent perçues comme des espaces masculins, devient évident : les jeunes filles victimes de violences se détournent massivement des filières techniques, dès lors qu'elles y perçoivent une majorité masculine.
Ainsi que le soulignait Elisabeth Richard, « les violences subies durant l'enfance façonnent durablement les trajectoires des petites filles, et le refus d'intégrer des univers masculins en constitue une conséquence directe. »
C'est pourquoi, des dispositifs permettant aux jeunes filles d'accéder sans crainte aux filières scientifiques doivent être mis en place dans le but notamment de créer des espaces où elles se sentent en sécurité et où la présence féminine paraît suffisante pour garantir un environnement perçu comme protecteur.
Ces environnements sécurisés renvoient à la notion de safe space développée par May Morris, directrice de recherches CNRS à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron, coordinatrice du programme de mentorat « Femmes et sciences » pour doctorantes à l'Université de Montpellier, lors de son audition160(*) par la délégation.
b) Une montée en puissance des dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les études supérieures, qui témoigne d'une prise de conscience récente de ce phénomène
Une prise de conscience de ces difficultés et du caractère dissuasif des situations de violences sexistes et sexuelles sur l'orientation des filles vers les études scientifiques au sein des écoles d'ingénieurs ou au sein des filières universitaires a lieu depuis quelques années.
Toutefois, les initiatives prises par le Gouvernement et par les responsables académiques sont encore trop récentes pour porter pleinement leurs fruits et doivent encore être généralisées, approfondies voire « professionnalisées ».
(1) Un cadre législatif et réglementaire défini à partir de 2019
Comme l'ont rappelé les représentantes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) lors de leur audition161(*) par la délégation, plusieurs initiatives gouvernementales ont eu pour objectif de renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les établissements publics d'enseignement supérieur au cours des dernières années. C'est notamment le cas du plan national d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2025-2027 qui fait de la prévention et du traitement des VSS un axe prioritaire.
Véronique Lestang-Préchac, sous-directrice du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, a précisé que « le nouveau cadre législatif et réglementaire, adopté en 2019, a également structuré les actions, en renforçant les obligations des établissements. Il impose notamment à l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur d'adopter un plan d'action pour l'égalité professionnelle, incluant obligatoirement un volet dédié à la lutte contre les VSS. »
Comme le rappelait Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, devant la délégation162(*), depuis 2019, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a accompagné 181 établissements dans l'élaboration de leurs plans d'action pour l'égalité professionnelle. Chaque établissement est désormais tenu de se doter de ce plan d'action ou d'un schéma directeur.
À partir d'octobre 2021, le MESR a déployé un plan national de lutte contre les VSS dans l'enseignement supérieur et la recherche. Initialement prévu jusqu'en 2025, ce plan a été pérennisé. Doté d'un budget initial de 1,7 million d'euros, ce financement a été doublé à partir de 2023, atteignant désormais 3,5 millions d'euros par an. Des postes spécifiques ont été créés dans chaque rectorat afin d'accompagner les établissements dans leur professionnalisation sur cette thématique, et de suivre le développement des cellules dédiées au sein des établissements. En outre, chaque année, une campagne de communication est lancée au début de l'année universitaire, visant à sensibiliser à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Ce plan s'articule autour de quatre axes et 21 mesures, portant notamment sur la formation, le renforcement des dispositifs de signalement, la communication et la valorisation des engagements.
Principaux axes du plan national de lutte contre
les VSS
dans l'enseignement supérieur et la recherche
(2021)
Quatre axes principaux : formation, renforcement des dispositifs de signalement, communication et valorisation des engagements.
1- Formation
Deux objectifs principaux ont guidé cet axe.
- professionnaliser l'ensemble des membres des dispositifs de signalement, c'est-à-dire les personnels responsables de l'accueil et du suivi des VSS, en les formant à l'écoute et à la prise en charge de ces situations. Depuis 2021, une centaine de formations ont été dispensées à plus de 4 000 agents qui interviennent désormais sur le terrain.
- sensibiliser massivement les étudiants et les étudiantes, grâce à des modules en ligne qui ont été développés par l'école IMT Atlantique. À ce jour, 70 établissements ont conventionné avec l'IMT Atlantique pour déployer ce module de sensibilisation auprès de leur communauté étudiante.
Une attention particulière est portée aux événements festifs - soirées étudiantes, week-ends d'intégration -, identifiés comme les lieux les plus propices aux VSS.
|
Enfin, le MESR travaille avec l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF) à l'élaboration de modules de formation à destination des personnels de direction. 2- Renforcement des dispositifs de signalement La mise en oeuvre de dispositifs de signalement de cas de violences sexistes et sexuelles dans les établissements de l'enseignement supérieur relève d'une obligation légale issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Chaque établissement doit disposer d'une cellule d'écoute assurant un accueil confidentiel, une orientation vers un accompagnement adapté, et un suivi des procédures à engager. 3- Déploiement d'une communication articulée aux niveaux local et national Il s'agit de mieux faire connaître les dispositifs existants et de valoriser les bonnes pratiques. 4- Favoriser l'engagement des étudiants et des personnels dans la lutte contre les VSS En 2022 et 2023, deux campagnes de financement ont été lancées à cette fin. En 2022, 35 projets ont été soutenus pour 350 000 euros et, en 2023, 51 projets pour 520 000 euros. |
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Le ministère a toutefois constaté, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan, le besoin de renforcer la prise en charge des VSS au niveau des rectorats, et de décliner son action à l'échelle territoriale. C'est la raison pour laquelle a été annoncée, en 2023, la création de 37 postes, chargés de mission « VSS » dans 18 régions académiques, centrés à la fois sur la politique de vie étudiante et la lutte contre les VSS.
En outre, un guide du traitement des violences dans les établissements a récemment été mis en place pour accompagner les présidents d'université dans la mise en place de dispositifs efficaces de lutte contre les VSS dans leurs établissements : procédure de signalement, traitement des cas signalés, enquêtes administratives, mesures disciplinaires potentielles. Publié au mois de décembre 2024, il constitue une aide aux présidents d'université qui ont un rôle essentiel à jouer en la matière et auxquels les autorités ministérielles ne peuvent se substituer.
(2) Une application à géométrie variable au sein des universités, dépendante des initiatives de leurs responsables académiques
Comme le soulignait Chloé Mour, chargée de mission « égalité, droits LGBT+ et lutte contre les violences sexistes et sexuelles », au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors de son audition163(*) par la délégation, « les outils (...) mis en place, notamment les différents guides, permettent aux responsables des établissements de se saisir de ces sujets et de mettre en place des actions. Selon les établissements, il peut y avoir des résistances et, comme cela a été dit, la volonté politique est particulièrement déterminante. Le cadre national permet de professionnaliser et de renforcer les actions qui sont menées. »
Au cours de ses travaux, la délégation a pu constater à quel point la mise en oeuvre et la réussite des dispositifs de lutte contre les VSS étaient étroitement dépendantes de la politique impulsée en la matière par les responsables d'établissements et notamment par les présidents d'université.
Plusieurs interlocuteurs et interlocutrices de la délégation ont insisté sur l'insuffisance des moyens alloués au niveau des établissements d'enseignement supérieur et sur l'absence de volonté politique au niveau de la gouvernance de ces établissements.
Comme on l'a vu précédemment, des moyens sont alloués au niveau national, à hauteur de 3,5 millions d'euros par an dans le cadre du plan national de lutte contre les VSS dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais ces moyens font parfois défaut au niveau des établissements eux-mêmes. En outre, plus que de la taille de l'établissement, l'attribution de moyens à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dépend notamment de la volonté politique des présidents.
Ainsi que le formulait Sophie Pochic, directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS), lors de la table ronde164(*) réunissant des représentants de la chaire « Femmes et science » de l'Université Paris Dauphine-PSL, « la lutte contre les VSS au sein des écoles d'ingénieurs et des universités constitue un enjeu majeur pour garantir un environnement serein et sécurisé, indispensable à la réussite des étudiantes. Il est avéré que le risque de VSS augmente lorsqu'une femme se trouve isolée dans un milieu à prédominance masculine. À ce stade, les moyens alloués restent largement insuffisants. Il serait nécessaire de désigner un référent spécifique dans chaque établissement et de prévoir le recrutement de juristes compétents pour traiter ces dossiers avec rigueur. Certaines universités commencent à entreprendre des actions. Toutefois, jusqu'à très récemment, les ressources engagées sur ces sujets relevaient davantage du « bricolage » que d'une volonté tangible et structurée. »
Trois freins majeurs à une lutte efficace contre les VSS dans l'enseignement supérieur et la recherche peuvent être identifiés, comme le précisait devant la délégation Rhita-Maria Ouazzani165(*), membre de la Cellule d'écoute et de veille de l'Université PSL :
- le manque de moyens : « les cellules d'écoute sont souvent portées à bout de bras, sans financement pérenne, avec des équipes réduites, parfois même bénévoles » ;
- l'absence de volonté politique : « tant que les présidences d'universités ne s'engagent pas clairement, rien ne bouge. À l'inverse, là où des vice-présidences à l'égalité sont en place, les dispositifs fonctionnent, et les avancées sont réelles ».
Or, comme le rappelait à la délégation166(*) Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d'Aix-Marseille Université (amU), seulement un tiers des référents égalité/diversité au sein des universités françaises détient un poste de vice-présidence tandis que « les deux autres tiers se heurtent à d'énormes difficultés et souffrent de ne pouvoir mettre en oeuvre des actions en faveur de l'égalité, d'autant qu'en l'absence de connaissances scientifiques sur ce sujet, leur argumentaire et leur plaidoyer sont rendus bien plus complexes » ;
- un déficit profond de culture des sciences sociales, notamment dans les filières scientifiques : « des ressources existent. Le ministère diffuse des formations, des guides, des enquêtes types. Mais sur le terrain, les cellules d'écoute fonctionnent avec des moyens dérisoires ».
Certains établissements universitaires, notamment parmi ceux que la délégation a pu entendre, sont toutefois très en pointe sur le sujet et ont mis en place des dispositifs innovants qui pourraient inspirer l'ensemble des universités et gagneraient donc à être généralisés.
Ces bonnes pratiques des établissements universitaires sont variées et recouvrent, entre autres, les actions suivantes :
- une sensibilisation des membres des comités de sélection chargés de recruter les enseignants-chercheurs ;
- des modules de formation visant à approfondir la compréhension de l'origine cognitive des stéréotypes de genre, qui s'adressent à la fois aux personnels académiques et aux étudiants ;
- une formation obligatoire sur les VSS pour les personnes qui se présentent à l'habilitation à diriger des recherches (HDR) ;
- la mise en place d'un service autonome et indépendant de recueil des signalements de VSS ;
- la publication d'un livret consacré aux VSS sur le terrain167(*) ;
- un programme de mentorat « Femmes et sciences » destiné aux doctorantes.
Exemples de bonnes pratiques dans les
universités en matière
de lutte contre les violences sexistes
et sexuelles (VSS)
1 - Université d'Aix-Marseille (amU)
Aix-Marseille Université (amU) a désigné une vice-présidente168(*) spécifiquement en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, ce qui n'est le cas que pour un tiers des référents égalité/diversité au sein des universités en France.
L'action phare instaurée depuis 2020 à Aix-Marseille Université, à la demande de la Faculté des sciences, consiste en une sensibilisation des membres des comités de sélection chargés de recruter les enseignants-chercheurs dans les deux corps, à savoir le rang B et le rang A (maître de conférences et professeur des universités). Cette sensibilisation est précise, standardisée et requiert un travail d'encadrement considérable de la part de la vice-présidente en charge de l'égalité et de celle de son équipe. En revanche, elle n'est pas chronophage pour les membres des comités, puisqu'elle se déroule en seulement trois phases de dix minutes.
La première phase de la sensibilisation des membres du jury a pour but de les informer, en amont, de la sous-représentation éventuelle des femmes dans ce domaine précis. Il s'agit de leur faire prendre conscience de leur processus décisionnel en matière d'équité de genre par rapport au vivier des candidatures.
La seconde phase consiste à les inviter à réaliser le test des associations implicites, un test informatique de dix minutes qui mesure la force d'ancrage des stéréotypes associés à la science selon le genre, c'est-à-dire à quel point nous associons la science et la technologie au masculin, et les sciences humaines et sociales au féminin. Les deuxièmes phases doivent impérativement se dérouler au début de chacune des réunions en présentiel.
Grâce à cette initiative, menée depuis cinq ans au sein de la Faculté des sciences, le pourcentage de femmes recrutées en tant que professeurs des universités est passée de 14 % à 50 %. Au total, plus de 800 membres de jury ont été sensibilisés, qu'ils soient hommes ou femmes.
Cette sensibilisation ne s'apparente toutefois pas à une formation : il s'agit d'un éveil de conscience momentané au sujet de ces enjeux. C'est pourquoi il est impératif de procéder à nouveau chaque année à des sessions de sensibilisation, tout en veillant à actualiser les supports afin d'éviter le sentiment de déjà-vu.
L'ensemble de ces séances de sensibilisation est par ailleurs ancré dans des formations. Des modules de 6, 9 et 18 heures sont proposés et, grâce à ces programmes, plus de 9 000 personnels académiques ont été formés, non seulement à Aix-Marseille Université, mais aussi dans d'autres établissements, et plus de 6 000 étudiants.
Ces formations sont très interactives, organisées par groupes de 15 à 20 participants maximum. Elles visent à approfondir la compréhension de l'origine cognitive des stéréotypes.
Le problème réside toutefois dans le fait que de nombreuses personnes ne participent pas à ces sessions de formation.
En outre, Aix-Marseille Université a instauré, en 2022, un service pour le respect et l'égalité, permettant de recueillir tous les signalements liés au racisme, au sexisme, aux violences sexuelles et sexistes, au harcèlement à caractère sexuel, au harcèlement moral, ainsi qu'au cyberharcèlement.
L'université a choisi de créer un service autonome en recrutant des professionnels externes spécialisés dans ces domaines.
La collecte et le traitement des signalements nécessitent une expertise professionnelle, qui ne s'improvise pas. Ils exigent une disponibilité à plein temps, et ne relèvent pas du rôle d'enseignants-chercheurs. En établissant ce service, l'université a constaté une augmentation des signalements, passant de 13 par an dans une université regroupant plus de 80 000 étudiants et 8 200 personnels, à 250 saisines. Ce chiffre continue de croître. Avec un service universitaire professionnel et une équipe de cinq personnes à temps plein, amU a la capacité d'assurer un suivi efficace.
2 - Université Toulouse-Jean-Jaurès
L'université Toulouse-Jean-Jaurès a mis en place, début janvier 2025, un nouveau dispositif de signalement des VSS qui témoigne de la persistance toujours prégnante de ces violences. Ce dispositif permet néanmoins une prise en charge de ces situations plus satisfaisante que par le passé.
En outre, l'université a élaboré, à l'attention notamment des mastérantes et doctorantes, un livret169(*) consacré aux VSS sur le terrain en sciences sociales et en archéologie. Ce livret est le fruit de plusieurs constats qui s'appliquent aux sciences sociales et à l'archéologie mais pourraient être généralisés aux autres disciplines qui impliquent des recherches de terrain, dont certaines disciplines scientifiques.
Premier constat, de nombreuses mastérantes et doctorantes ont été victimes d'agissements sexistes, d'agressions sexuelles et de viols dans le cadre de leurs recherches de terrain en sciences sociales ou lors de chantiers de fouilles en archéologie. Deuxième constat, aucune formation aux méthodes d'enquête et à la recherche, ou si peu, n'intègre véritablement ce risque des violences de genre et sexuelles. Troisième constat, peu de textes scientifiques épistémologiques et méthodologiques abordent cette dimension problématique de la recherche. Enfin, quatrième constat, il n'existe, à notre connaissance, aucune obligation des directeurs et directrices de thèse et des encadrants et encadrantes de recherche de se former sur cette question.
3 - Université de Montpellier
L'Université de Montpellier, sous l'impulsion de May Morris170(*), directrice de recherches CNRS à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron, coordinatrice du programme de mentorat « Femmes et sciences » pour doctorantes à l'Université de Montpellier, membre du CA de EPWS (European platform for Women in Science), a mis en place un programme de mentorat spécifiquement destiné aux doctorantes de l'université.
Ce programme de mentorat transversal vise notamment à garantir aux doctorantes ce que May Morris a décrit comme un safe place, à savoir un espace sécurisé pérenne, au-delà d'un simple espace d'écoute ponctuel, où les jeunes femmes peuvent s'exprimer sans crainte de répercussions.
Le réseau de mentors permet de faire émerger des situations problématiques que les doctorantes, souvent isolées au sein de leurs institutions ou placées sous des tutelles multiples, ne savent pas toujours comment ou à qui signaler.
Pour faire face à ces multiples difficultés, le programme de mentorat vise à accompagner les jeunes femmes scientifiques à un moment décisif de leur parcours. Ce dispositif constitue à la fois un réseau d'entraide, de soutien et d'accompagnement, ainsi qu'un vecteur de diffusion progressive de bonnes pratiques au sein des institutions scientifiques.
|
Plus de 1 000 doctorantes ont été accompagnées et la participation croît d'année en année, tant en nombre de sites qu'en volume de bénéficiaires. À la demande du ministère, une évaluation qualitative et quantitative a été conduite en 2023-2024, portant sur 800 mentorées accompagnées entre 2015 et 2023. Ce rapport met en lumière une très forte satisfaction à l'égard des ateliers, cercles et témoignages. Plus de 98 % des participantes recommandent le programme, évoquant des mots-clés comme « soutien », « confiance », « partage », « réseau ». Le taux d'insertion professionnelle atteint près de 70 % dans les trois mois suivants la soutenance de thèse, témoignant de l'efficacité du programme pour enrayer le phénomène du tuyau percé et favoriser le maintien des femmes dans les carrières scientifiques. Ce programme répond donc à un besoin impérieux à l'étape du doctorat qui, généralement, amorce le phénomène du tuyau percé. Cet environnement bienveillant et structurant constitue un véritable safe space, indispensable dans un milieu scientifique encore marqué par des comportements toxiques, sexistes et discriminants. Ces safe spaces doivent être pensés non pas comme des dispositifs à la marge, mais comme des éléments structurants de toute politique d'égalité. 4 - Observatoire de Paris Comme indiqué précédemment, la phase du doctorat est particulièrement importante et sensible pour les étudiantes en filières scientifiques. C'est pourquoi l'Observatoire de Paris-PSL, observatoire astronomique implanté sur trois sites et rattaché à l'université PSL, a décidé d'imposer aux personnes qui se présentent à l'habilitation à diriger des recherches d'avoir été formées aux questions de violences sexistes et sexuelles pour bénéficier de cette HDR. |
Source : travaux de la délégation aux droits des femmes du Sénat (2025)
(3) Des dispositifs spécifiques aux grandes écoles scientifiques
Dans la plupart des grandes écoles d'ingénieurs et dans les écoles normales supérieures (ENS), des dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles s'intégrant dans les plans pour l'égalité femmes-hommes ont été mis en place.
Encore récents, puisqu'ils n'ont souvent que quelques années d'existence et remontent, pour la plupart, au début des années 2020, le taux de connaissance de ces dispositifs par les étudiants et étudiantes est toutefois en augmentation, ce qui constitue un signal encourageant.
Ainsi que le dévoilait Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI), lors de son audition171(*) devant la délégation, la récente étude Gender Scan 2025, dont la CDEFI est partenaire depuis 2021, indique que la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuels (HVSS) a largement progressé, entre autres par le biais du dispositif « Ingénieuses ».
Ainsi, 76 % des jeunes femmes engagées dans des parcours liés au numérique ont aujourd'hui connaissance des dispositifs de lutte contre les VSS, contre seulement 27 % en 2021. Dans les autres filières STIM, ce taux est passé de 20 % en 2021 à 78 % en 2025.
Au cours de ses travaux, la délégation a pu prendre connaissance des initiatives mises en place par les directions des différentes écoles qu'elle a rencontrées.
Ainsi, au sein de l'école Centrale-Supélec, après avoir d'abord nommé une référente égalité femmes/hommes et mis en place une cellule psychologique chargée de recueillir des témoignages et signalements de violences sexistes et sexuelles, le conseil d'administration de l'école a approuvé, en mars 2021, un premier plan égalité femmes/hommes, en particulier pour aborder la question des VSS, qui incluait l'organisation d'une enquête annuelle, confiée à une association étudiante, auprès de tous les étudiants afin d'identifier les cas de VSS. Cette enquête a rencontré un véritable succès médiatique en 2021.
Pour la première fois, à partir de 2021, des signalements de faits de violences sexistes et sexuelles ont commencé à remonter, ainsi que des dépôts de plainte.
D'après Romain Soubeyran, directeur général de Centrale Supélec, « les résultats ont eu un impact considérable, non seulement en révélant des faits inattendus pour les étudiants, mais également en suscitant une prise de conscience au sein de l'école. Ils ont permis d'ouvrir un dialogue sur la manière de lutter plus efficacement contre le sexisme au quotidien. Nous avons insisté sur le fait que les comportements qui choquent le plus sont généralement liés à deux facteurs : le sexisme ordinaire, qui banalise l'infériorisation des femmes, et l'alcool, qui exacerbe souvent ces comportements. Ces deux enjeux constituent désormais des axes de travail prioritaires. Jusqu'à ce point, il était difficile de lutter contre le sexisme quotidien, car il était souvent minimisé sous forme de « blagues » ou de comportements prétendument innocents. Cependant, la mise en évidence du lien entre ces comportements et l'alcool nous a permis de prendre le sujet davantage au sérieux et de faire des progrès notables. »
Cette enquête est renouvelée tous les ans et les chiffres les plus récents indiquent des progrès encourageants.
L'école a toutefois adopté une politique de prévention forte et de tolérance zéro en rappelant, pour chaque promotion et à chaque rentrée, que « tout signalement fait l'objet d'un article 40, et que l'école se constitue systématiquement partie civile dans les procédures judiciaires lorsque cela est possible ».
En raison de la lenteur de la procédure judiciaire, l'école est souvent amenée, en cas de signalement, à prendre des mesures conservatoires d'éloignement à l'encontre de la personne mise en cause et à mener sa propre enquête administrative. De ce fait, Romain Soubeyran a indiqué à la délégation que « certains témoignages reçus indiquent que les victimes hésitent à signaler les faits ou à porter plainte, car le processus est trop éprouvant. L'ajout d'une enquête administrative, suivie d'une enquête judiciaire et d'un rapport d'instruction pour la section disciplinaire, envoie un signal négatif, selon elles (...) Il apparaît que les procédures juridiques nécessitent des améliorations pour traiter ce genre de sujet de manière adéquate ».
S'agissant de l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP), son directeur général, Joël Cuny, a également fait valoir devant la délégation que « la tolérance zéro vis-à-vis des violences n'est pas une cause suffisante à elle seule, mais elle est une condition sine qua non pour garantir l'accueil et l'accompagnement de nos jeunes filles dans nos écoles en toute sécurité », et rappelé que l'engagement face aux violences et aux comportements sexistes et discriminatoires devait être un engagement collectif. Il a ajouté : « cet engagement ne saurait être négociable. C'est une responsabilité fondamentale que nous devons assumer pleinement. Bien sûr, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte, mais il est essentiel de l'intégrer à un ensemble de démarches. »
La question des violences sexistes et sexuelles fait également partie des priorités de la feuille de route de Laura Chaubard, nommée directrice générale de l'École polytechnique en 2022, qui a indiqué à la délégation lors de son audition172(*) : « nous sommes la seule école d'ingénieurs à mener une enquête systématique sur ce sujet depuis quatre ans et à en publier les résultats. »
Cette enquête a deux objectifs principaux :
- d'une part, elle permet de remobiliser chaque année l'ensemble des acteurs de l'école dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;
- d'autre part, elle incite les élèves à comprendre que ce phénomène ne concerne pas seulement les promotions précédentes, mais qu'il se manifeste au sein de la leur, sur le campus, et autour d'eux.
Enfin, elle permet de suivre les actions menées par l'école dans le temps, de les ajuster et d'enrichir le groupe de travail constitué avec les élèves sur ce sujet depuis quatre ans. Ce travail a pour but de faire évoluer les dispositifs de sensibilisation, de prévention, de signalement, ainsi que d'accompagnement des témoins et des victimes.
Cette enquête anonyme promet de garantir la confidentialité des participants, et, par conséquent, elle ne peut pas servir à instruire des cas individuels de violences sexistes et sexuelles.
En revanche, l'école dispose d'une plate-forme et d'une cellule de signalement recueillant les témoignages.
À cet égard, Laura Chaubard a indiqué à la délégation que « lorsque nous soupçonnons un crime ou un délit, nous déclenchons un article 40. Nous accompagnons également nos élèves à la gendarmerie pour porter plainte dans certains cas. Des enquêtes sont menées par la suite. Au sein de l'école, nous prenons rapidement des mesures conservatoires. Lorsque cela s'avère pertinent, nous déclenchons une enquête de commandement - une enquête administrative dans le cadre militaire -, afin d'envisager des mesures disciplinaires appropriées au sein de l'établissement. »
Elle a également souligné que, dans les faits, il est plus simple de sanctionner et de prendre des mesures rapides dans les cas moins graves, qui se déroulent souvent en public, comme les atteintes sexistes, qu'elles soient verbales ou physiques, et les agressions sexuelles survenant devant des témoins lors de soirées, par exemple. En revanche, lorsqu'il s'agit de faits plus graves, tels que des agressions sexuelles ou des viols qui se produisent généralement dans la sphère privée des élèves - même si cette sphère est sur le campus - il est souvent bien plus compliqué pour l'école d'agir, surtout sans préjudice de l'enquête judiciaire qui doit être effectuée.
Les écoles normales supérieures (ENS) ont également mis en place des politiques actives de lutte contre les violences sexuelles, sexistes et le harcèlement, à l'instar de l'ENS de Paris-Saclay, dont le comité de pilotage dédié aux VSS (Copil VSS) mène une grande enquête triennale et a instauré une cellule d'écoute et une cellule de traitement des VSS, ou de l'ENS de Lyon dont le président Emmanuel Trizac a indiqué à la délégation lors de son audition173(*) que le dispositif mis en place par l'école s'adressait tant aux victimes qu'aux témoins et impliquait des acteurs distincts et indépendants de l'école.
Il permet d'assurer une prise en charge confidentielle, dans un espace d'écoute bienveillant, sans aucune implication de la gouvernance, ni jugement préalable. La mission égalité ainsi que le chargé de mission et les référents égalité de l'école jouent un rôle clé dans ce processus.
Lors de cet entretien, la personne peut ensuite être orientée vers des professionnels, tels que des psychologues, des services médicaux, ou des directions de départements ou de laboratoires. Cette démarche permet de préserver une trace légale et d'engager les étapes suivantes.
Si elle le souhaite, son signalement peut être présenté à une cellule de gestion nommée cellule action qui étudie l'ensemble des mesures possibles, en fonction des attentes et des besoins exprimés lors du recueil de la parole, et formule des préconisations différenciées en fonction du statut de la personne concernée : étudiante, étudiant, personnel, enseignant-chercheur, etc.
Ensuite, les propositions de cette cellule sont soumises à la présidence de l'ENS, qui doit mettre en oeuvre les mesures de protection et de traitement des faits. Ces mesures sont variées : mesures conservatoires, telles que l'interdiction d'accès au campus, éloignement de la personne concernée, enquêtes administratives, sanctions disciplinaires et, le cas échéant, signalement aux procureurs de la République, constitution de partie civile, etc.
Ce dispositif s'inscrit dans une réflexion plus large sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein de l'école en lien avec son plan d'action pour l'égalité.
Concernant les effets de cette politique de prise en charge, Emmanuel Trizac a indiqué à la délégation : « nous obtenons de bons retours et considérons que des résultats positifs ont été obtenus, mais il est évident que cet effort doit être constant. Rien n'est jamais acquis sur ce front. »
Globalement, les responsables académiques des grandes écoles scientifiques ont donc bien pris la mesure des défis à relever en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de leurs établissements et de la nécessité de créer des espaces sûrs, bienveillants et accueillants pour les jeunes femmes qui se destinent à ce type d'études.
Des efforts sont toutefois encore nécessaires pour convaincre ces jeunes femmes qu'elles ont toute leur place dans leurs établissements et qu'elles pourront s'y épanouir en toute sécurité sans craindre ni les remarques et intimidations sexistes, ni les violences et agressions sexuelles.
B. RECOMMANDATIONS : CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET PROTECTEUR POUR LES ÉTUDIANTES, EN EXPÉRIMENTANT DE NOUVELLES SOLUTIONS
Une fois dressés ces différents constats à la fois sur la désaffection des filles pour les études en STIM, que ce soit dans les filières universitaires ou dans les filières plus sélectives (CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles normales supérieures), sur les raisons qui pourraient l'expliquer et sur la persistance d'un climat sexiste voire de violences sexistes et sexuelles dans ces filières, la délégation estime qu'il est aujourd'hui temps de mettre en place des politiques publiques responsables et innovantes pour atteindre un taux de féminisation de ces filières qui permettra d'assurer une véritable mixité des carrières scientifiques.
Pour que les filles décident de s'orienter vers ce type d'études, elles doivent s'y sentir à leur place, attendues et accueillies dans un environnement protecteur et ouvert.
Cette révolution de genre dans les sciences nécessite la mise en place de mesures expérimentales, innovantes voire radicales que la délégation appelle de ses voeux :
- l'instauration de quotas de genre en classes préparatoires et à l'entrée des filières scientifiques les plus sélectives et les moins féminisées ;
- la mise en oeuvre de dispositifs favorables aux filles qui s'engagent dans ce type d'études : bourses spécifiques, augmentation des places en internat, regroupement des filles dans les classes les plus sélectives et compétitives ;
- l'expérimentation de séquences non-mixtes dans les parcours académiques scientifiques ;
- une réflexion quant à l'organisation des processus de sélection à l'entrée des grandes écoles (préparation aux concours et épreuves des concours) et quant à la facilitation des passerelles et l'hybridation des parcours académiques.
Comme le soulignait Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, devant la délégation174(*), « à l'heure actuelle, nous sommes tous profondément préoccupés par la situation. Les initiatives que nous avons mises en place semblent dépourvues de l'effet de levier escompté ». Il est donc nécessaire de « trouver des moyens concrets d'expérimenter » de nouvelles solutions.
Les rapporteures sont toutefois convaincues que la mise en oeuvre de toutes ces mesures ne donnera aucun résultat tangible et durable si la politique de lutte contre le sexisme et contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur scientifique n'est pas appliquée de façon homogène et volontaire par l'ensemble des responsables académiques.
En la matière, une diffusion des bonnes pratiques déjà à l'oeuvre dans certains établissements s'impose, de même qu'une véritable professionnalisation des acteurs en charge de la mise en oeuvre de cette politique publique qui doit devenir une des pierres angulaires de la féminisation des filières scientifiques de l'enseignement supérieur.
1. Instaurer des quotas et des mesures en faveur des filles
Lors de la présentation de son plan « Filles et maths » le 6 mai 2025, puis lors de son audition175(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur, a annoncé le renforcement de la place des filles dans les enseignements ouvrant vers les filières d'ingénieur et du numérique, avec un objectif, à l'horizon 2030, de 30 % de filles dans chaque classe préparatoire scientifique.
Elle a ainsi indiqué à la délégation que « l'objectif d'au moins 30 % de filles dans chaque classe préparatoire est important. Tout l'enjeu, c'est que les filles se sentent à leur place dans ces formations scientifiques et mathématiques, cela suppose qu'elles ne soient pas isolées, on a besoin de passer un cap de présence féminine dans ces classes pour que les filles se sentent chez elles dans la classe préparatoire spécialité maths. »
La délégation soutient cette démarche et estime même nécessaire, au-delà d'un « objectif chiffré », de fixer, si nécessaire en passant par la loi, des quotas de femmes en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques de même qu'à l'entrée des grandes écoles d'ingénieur, des ENS et des filières scientifiques universitaires les plus sélectives.
La nuance sémantique entre un objectif chiffré et un quota est importante dans la mesure où la notion de quota renvoie à celle d'une obligation légale de résultats.
a) Mettre en place des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique en veillant à expliciter l'intérêt de cette mesure
Pour reprendre les mots de Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, devant la délégation176(*) : « il est aujourd'hui urgent de mener des expérimentations. (...) Nous devons adopter une posture plus audacieuse dans le système éducatif français, notamment en expérimentant des quotas. Bien que je ne sois pas certaine que cette mesure soit providentielle, je suis convaincue qu'elle pourrait avoir un impact positif. (...) Ce verrou législatif, voire idéologique, mériterait de sauter. »
(1) Des quotas de filles dans les études scientifiques : où, quand et comment ?
Au cours de ses travaux, la délégation a pu constater à quel point la question de l'instauration de quotas de genre au sein des cursus scientifiques, notamment les plus sélectifs, n'était pas consensuelle, y compris au sein de la communauté académique et scientifique.
Si de nombreux interlocuteurs et interlocutrices de la délégation s'y sont montré favorables, estimant notamment que les quotas étaient « des points de passage obligés pour aider à une prise de conscience », pour reprendre les mots de Patrick Flandrin177(*), physicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, d'autres, comme Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'y sont montrés réticents voire hostiles faute d'un vivier suffisant ou par peur d'un effet stigmatisant contre-productif et du renforcement du « syndrome de l'imposteur », déjà très présent chez les étudiantes au sein des filières les plus sélectives.
Ainsi, Romain Soubeyran, directeur général de Centrale-Supélec, a indiqué à la délégation178(*) que « l'idée des quotas ou des points de bonification au concours a été écartée par le conseil d'administration pour plusieurs raisons. Premièrement, nous craignons qu'elle ne génère un retour de sexisme au quotidien. (...) Deuxièmement, le fameux syndrome de l'imposteur, qui touche les garçons, est encore plus marqué chez les filles dans nos promotions. Des enquêtes et données statistiques le confirment. (...) Un autre élément qui nous a poussés à écarter l'idée de quotas ou de points supplémentaires réside dans le rejet violent exprimé par de nombreuses étudiantes ». Par ailleurs, il a estimé que la mise en place de quotas ne modifierait pas véritablement le flux des diplômés et n'entraînerait pas de changement systémique.
Au contraire, Fatima Bakhti, présidente de l'Association Femmes Ingénieures, a estimé que les quotas « devraient être considérés non comme des privilèges, mais comme des instruments de correction d'un déséquilibre historique. Les femmes qui en bénéficient méritent pleinement leur place - qu'il s'agisse d'intégrer une classe préparatoire ou une école d'ingénieurs. »
On l'a vu, les mesures incitatives ont aujourd'hui atteint leurs limites. Les rapporteures sont donc convaincues de l'intérêt de mettre en oeuvre des mesures plus coercitives en fixant des quotas obligatoires de présence de filles à plusieurs niveaux : classes préparatoires, entrée des grandes écoles d'ingénieur, des écoles normales supérieures (ENS) et des filières scientifiques universitaires sélectives dans les matières les plus désertées par les femmes aujourd'hui.
L'objectif de 30 % de filles dans les CPGE scientifiques d'ici 2030, annoncé dans le plan « Filles et Maths » du ministère de l'éducation nationale en mai 2025, semble raisonnable et propice à assurer une mixité minimale au sein des études scientifiques. Cet objectif pourra être revu à la hausse compte tenu de la féminisation progressive des filières scientifiques.
À la question de savoir si les quotas étaient suffisants, Laura Chaubard a répondu qu'« ils n'entraîneront pas d'effet miracle. Personne n'empêche les femmes de choisir des classes préparatoires. Pour autant, j'en attends qu'elles reçoivent un signal indiquant qu'elles sont attendues et bienvenues dans ces établissements. Par ailleurs, il est essentiel que ces derniers réfléchissent à la manière de les accueillir et de les accompagner dans leur réussite, une fois qu'elles ne seront plus une minorité. Il me semble qu'un effet de seuil avoisine 30 %. Cet objectif paraît donc judicieusement calibré. Par la suite, ces quotas devraient suivre l'évolution de la parité dans les filières scientifiques, du moins je l'espère. Il n'existe aucune raison justifiant la non-atteinte, à terme, d'un ratio d'au moins 40 % de femmes et 40 % d'hommes. »
La délégation est, pour sa part, favorable à une expérimentation des quotas à différentes étapes de la scolarité. De tels quotas pourraient être introduits soit par le biais d'un cadre législatif nouveau, soit à travers une contractualisation des établissements avec le ministère de l'enseignement supérieur sur la base d'objectifs de résultats chiffrés.
(a) Des quotas en CPGE scientifiques
L'instauration de quotas de filles au moment de l'entrée en première année de CPGE scientifiques voire entre la première et la deuxième année doit être envisagée car la déperdition de filles et le phénomène dit du « tuyau percé » se manifestent souvent à cette étape charnière de la sélection.
Comme le soulignait Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences, les quotas en classes préparatoires constituent une mesure pertinente, à condition toutefois de bien définir où, pourquoi et comment ils doivent être appliqués car « faute de répondre à ces interrogations, nous risquons de viser à côté de la cible. L'objectif prévoyant de parvenir à 30 % de filles en classes préparatoires à l'horizon 2030 mérite une analyse attentive des chiffres : en réalité, cette proportion est déjà atteinte. Dès lors, que signifie cette donnée ? Elle s'applique à chaque classe. Or, des variations importantes existent. De quelles années parle-t-on ? De la première ou de la deuxième année ? »
Poursuivant, Mélanie Guenais a insisté devant la délégation179(*) sur cette étape charnière entre la première et la deuxième année de CPGE : « je veux insister sur la deuxième année de prépa, où les quotas deviennent intéressants. En effet, les filles y arrivent en première année souvent avec de meilleurs dossiers. Pourtant elles sont sous-représentées dans les classes étoilées, les meilleures filières. Étrangement, elles passent des premières places au fond de la classe, ce qui révèle clairement des biais dans les critères de sélection, surtout de la part des enseignants en mathématiques, qui restent décisionnaires. »
Par ailleurs, comme on l'a vu précédemment, la plupart des classes préparatoires scientifiques affichent un taux de féminisation de l'ordre 25 %. Les cas les plus problématiques se trouvent dans les nouvelles classes préparatoires mathématiques-informatique, où l'absence quasi-totale de filles est flagrante.
La mise en oeuvre de quotas dans les classes préparatoires exigera donc, en amont, une analyse fine des besoins précis de féminisation dans les différentes catégories de CPGE.
(b) Des quotas aux concours d'entrée dans les grandes écoles et au sein des filières universitaires les plus sélectives et les moins féminisées
Les rapporteures sont également favorables à la mise en oeuvre, au moins à titre expérimental, de quotas :
- au moment des concours d'entrée dans les grandes écoles scientifiques (écoles d'ingénieurs ou écoles normales supérieures) en ayant recours à un éventuel système de points de bonification au concours ou de places exclusivement réservées aux filles ;
- au moment de la candidature au sein des filières scientifiques universitaires les plus sélectives et les moins féminisées.
Ainsi que le rappelait Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine et représentante de la chaire « Femmes et science »180(*), « plusieurs leviers peuvent être activés afin de remédier à la sous-représentation des femmes, y compris à des étapes avancées de leur parcours scolaire. (...) l'introduction de quotas peut reconfigurer les intentions et les stratégies de dépôt de candidatures. Bien que d'autres travaux mettent en lumière que la ségrégation constatée dans les filières scientifiques trouve en grande partie son origine dans les voeux et orientations exprimés dès les plateformes de préinscription, l'instauration de quotas pourrait, en retour, agir sur ces comportements initiaux, en rééquilibrant les dynamiques d'autosélection. »
Un exemple historique de « quotas de genre », cité à plusieurs reprises au cours des travaux de la délégation, permet d'éclairer le débat sur la pertinence de la mise en place de quotas à l'entrée des grandes écoles scientifiques.
En effet, pendant plus d'un siècle, deux écoles normales supérieures (ENS) distinctes accueillaient d'un côté les filles (rue de Sèvres et Fontenay-aux-Roses), de l'autre les garçons (rue d'Ulm et Fontenay-Saint-Cloud), chacune disposant d'un nombre de places défini, ce qui, pour reprendre les mots de Laura Chaubard, ressemblait « étrangement à un quota ».
En 1986, cette distinction a pris fin et la fusion des ENS a été opérée afin, à l'époque, comme le rappelait Emmanuel Trizac, président de l'ENS Lyon181(*), « d'éviter les risques de stigmate, de naturalisation et d'essentialisation ».
La fusion des ENS en 1986 :
la fin d'un système de quotas de
facto qui a abouti à un effondrement
du recrutement
féminin dans les filières scientifiques des ENS
Jusqu'en 1986, deux ENS coexistaient : l'une pour les garçons (Ulm), l'autre pour les jeunes femmes (Sèvres).
Le fonctionnement de ces écoles s'apparentait, de fait, à un système de quotas : les élèves suivaient des cours mixtes en classes préparatoires, passaient des épreuves identiques au concours, parfois évalués par les mêmes jurys, et intégraient ensuite l'école, où ils partageaient de nombreux cours universitaires, à l'exception de certaines filières.
De 1970 à 1985, les statistiques témoignent d'une répartition relativement équilibrée. En moyenne, les filles représentent près de 50 % des admis, avec de légères variations selon les filières (mathématiques, physique-chimie, biologie, lettres).
Cependant, l'introduction du concours mixte en 1986 a produit des effets à la fois immédiats et pérennes.
En mathématiques, la proportion de femmes admises a subi une chute brutale, passant d'environ un tiers à 9 %, jusqu'à atteindre un seuil nul (0 %) en 1993. Une dynamique analogue s'observe en physique. En revanche, la représentation des femmes dans les disciplines littéraires et biologiques demeure stable autour de 50 %.
Le taux global de féminisation de l'établissement s'est considérablement réduit.
Cette chute s'explique tout d'abord par un effet mécanique, lié aux résultats : en moyenne, sur l'ensemble de la période considérée, les candidates obtenaient des notes légèrement inférieures à celles des candidats à l'écrit, notamment en mathématiques. Toutefois, cet écart ne permet d'expliquer qu'environ 50 % de la baisse constatée.
Le deuxième facteur relève des dynamiques comportementales. En effet, l'analyse des données révèle que les jeunes femmes se sont progressivement détournées du concours de l'ENS, avec une baisse marquée des candidatures féminines. Cet effet, loin de concerner indistinctement l'ensemble des classes préparatoires, s'est concentré dans les établissements les plus prestigieux, tels que le lycée Louis-le-Grand.
Même parmi les meilleures élèves, la propension à postuler au concours de l'ENS a significativement reculé. Cette dynamique a accru les écarts de probabilités d'accès à une carrière scientifique, universitaire et professorale pour les candidates affectées.
Source : Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine182(*)
À la lumière de cet exemple historique, il apparaît donc que l'instauration de quotas de genre au concours des grandes écoles scientifiques pourrait permettre d'impulser une nouvelle dynamique de recrutement féminin dans les filières scientifiques.
Pour reprendre les propos de Laura Chaubard, « à chaque étape de cette chaîne, nous devons affirmer notre volonté d'encourager les femmes à s'engager dans des études scientifiques, y compris pour les concours. L'instauration de telles mesures ne constituera pas un cadeau fait aux jeunes femmes qui en bénéficieront. Cependant, je suis fermement convaincue que cette initiative représente un cadeau pour les générations futures, en favorisant progressivement l'instauration de la parité dans les études scientifiques. »
Certaines expérimentations récentes ont déjà eu lieu, c'est le cas par exemple de celle conduite par l'EPF, une école d'ingénieurs membre du concours Avenir, qui a lancé l'initiative intitulée ParityLab, dont Denis Bertrand s'était fait l'écho lors de sa participation aux travaux de la délégation183(*) : « grâce à ses statuts spécifiques, cette école a pu mettre un concours distinct, exclusivement réservé aux jeunes filles, en parallèle de la voie d'admission classique. Les candidates peuvent ainsi choisir entre la voie mixte, qui demeure largement majoritaire, ou cette nouvelle voie spécifique. Nous suivons cette initiative avec beaucoup d'attention, car elle pourrait constituer une piste de transformation significative. (...) je tiens à souligner l'intérêt suscité par l'expérience qu'il a présentée. Bien qu'elle reste modeste à ce jour - une cinquantaine de places ouvertes aux filles via un concours dédié - elle représente une initiative prometteuse. »
Concernant la mise en place de quotas et leur utilité, Heïdi Sevestre, glaciologue, membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, a d'ailleurs fait état, lors de sa participation aux travaux de la délégation184(*), des pratiques en la matière à l'université du Svalbard en Norvège : « ici, des quotas sont appliqués à tous les niveaux : pour les étudiants, les doctorants, les post-doctorants, et pour tous les postes universitaires. Grâce à ce système, nous avons atteint une véritable égalité. Certains cursus rencontrent plus de difficultés que d'autres, mais dans l'ensemble, la parité est respectée à tous les échelons de l'université. »
La délégation estime que la France gagnerait ainsi à s'inspirer des bonnes pratiques mises en oeuvre par la Norvège qui semblent avoir fait leurs preuves.
En tout état de cause, la mise en place de quotas nécessite, dans le domaine des études scientifiques supérieures comme dans tout autre domaine, d'être accompagnée d'une communication pédagogique permettant de rendre cette mesure légitime et lisible.
(c) Une nécessaire communication autour de la mise en place de quotas de genre
Pour garantir l'efficacité de mesures de quotas, il convient de se doter des moyens nécessaires à leur réussite, notamment d'une large communication sur leur existence et leur légitimité.
Ainsi que le rappelait Elyes Jouini, professeur des universités en économie et mathématiques, titulaire de la chaire Unesco « Femmes et science » à l'Université Paris-Dauphine, devant la délégation185(*), « cette démarche doit s'accompagner, en premier lieu, d'une information précise et complète délivrée en amont aux jeunes filles comme aux jeunes garçons, portant sur les perspectives professionnelles, les niveaux de rémunération et les éventuelles contraintes propres aux filières concernées. Il s'agirait également d'identifier activement les meilleures candidates, de les accompagner et de les inciter à rejoindre ces voies. »
De même, Sophie Pochic, directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS), au cours de la même table ronde, a insisté sur le fait que « la mise en oeuvre de quotas doit impérativement s'accompagner d'une communication rigoureuse et de campagnes d'information, notamment sur les atouts méconnus, comme le caractère quasi gratuit des classes préparatoires pour les familles issues de milieux populaires ».
L'application stricte de quotas sans accompagnement peut en effet exposer au risque de stigmatisation, les jeunes femmes pouvant être perçues comme des « femmes quotas » et considérées comme illégitimes.
Toutefois, ces dispositifs ne sauraient produire leurs effets sans un vivier suffisamment fourni. Il est donc indispensable d'agir en amont, de manière volontariste, pour le constituer.
(2) D'autres formes possibles de dispositifs incitatifs
D'autres mesures incitatives sont également envisageables pour aider à constituer ce vivier permettant de rendre pleinement opérante une politique de quotas.
Comme le rappelait devant la délégation186(*) Cécile Jolly, économiste, cheffe de projet au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, co-autrice du rapport Lutter contre les stéréotypes filles-garçons187(*) publié en mai 2025, « la question du vivier constitue un enjeu déterminant. Les employeurs peuvent faire valoir l'absence de candidatures féminines ; or, sans politiques proactives en faveur de la constitution de ces viviers, les déséquilibres constatés perdureront. Ce cercle est, par nature, autorenforçant et appelle donc une action volontariste. »
Dès lors, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan formule plusieurs recommandations dans son rapport que la délégation estime nécessaire d'explorer, parmi lesquelles des dispositifs incitatifs tels que des bonus sur les plateformes Affelnet et Parcoursup, au bénéfice des filles comme des garçons qui s'orienteraient dans des spécialités et des filières où leur sexe est minoritaire.
Dans les filières où les filles sont les plus minoritaires, comme dans celles du numérique, de l'informatique ou de l'ingénierie, une progression de la mixité de 2 % par an est envisagée par le Haut-Commissariat car « il serait irréaliste d'espérer atteindre 40 % de jeunes filles dans les filières du numérique d'ici 2030, alors qu'elles ne représentent actuellement que 7 % des effectifs. À l'appui, nous proposons un système de bonification pour les établissements les plus engagés, afin d'encourager les efforts et d'éviter de pénaliser ceux qui rencontrent déjà des difficultés à cet égard. »
|
Recommandation n° 13 : Expérimenter des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique à différents degrés et niveaux de la scolarité. |
b) Mettre en place des dispositifs d'accueil favorables aux filles qui décident de s'engager dans ces cursus académiques
Outre la mise en oeuvre d'une politique volontariste de quotas de genre en classes préparatoires et à l'entrée des grandes écoles, la délégation estime nécessaire de proposer un ensemble de mesures favorables à l'accueil des filles dans ces filières, en s'inspirant notamment de bonnes pratiques déjà en place dans certaines écoles et des recommandations formulées au cours des travaux de la délégation par ses nombreux interlocuteurs.
Parmi ces mesures, la délégation recommande notamment :
- la création de bourses spécifiquement dédiées à soutenir les jeunes filles dans leur parcours scientifique.
Ce type de bourse existe déjà au sein de certaines écoles.
C'est le cas de Centrale-Supélec qui a mis en place un système de bourses et d'allocations spécifiques, particulièrement destiné aux femmes issues de milieux défavorisés. Ces bourses, dites Sébastienne Guyot, équivalent à 8 000 euros par an pendant trois ans, et sont financées par des entreprises.
C'est le cas également de l'ENS Paris-Saclay, dont la bourse « Femmes en sciences » instaurée il y a plusieurs années a été présentée à la délégation par sa présidente, Nathalie Carrasco, lors d'une table ronde réunissant une dizaine d'universitaires, chercheuses et ingénieures188(*) mais aussi de l'ENS de Lyon qui a créé, à compter de la rentrée universitaire 2025-2026, des bourses Cécile DeWitt-Morette, du nom d'une des plus grandes mathématiciennes du XXe siècle. Ces bourses visent toutes les femmes en mathématiques et informatique admises à l'ENS de Lyon - sans aucune exception, mais sur des critères académiques rigoureux et la pertinence du projet individuel. Une bourse de 12 000 euros par an est attribuée, pendant les quatre années de formation, soit un total de 48 000 euros.
Ce soutien substantiel est comparable à celui mis en place par les autres ENS et vise à envoyer un signal fort à toute une génération de lycéennes et d'étudiantes.
En outre, s'agissant des bourses sur critères sociaux qui existent déjà dans l'enseignement supérieur, un bonus supplémentaire pourrait être accordé aux filles qui se dirigent vers les filières scientifiques en fonction également de leur origine géographique et notamment de leur éloignement des campus.
- l'augmentation substantielle du nombre de places en internat réservées aux jeunes filles en classes préparatoires notamment et sur les campus des grandes écoles et universités.
Le faible nombre des places en internat aujourd'hui réservées aux filles qui pourraient se destiner à des études en CPGE scientifiques contribue à les dissuader de s'inscrire en classes préparatoires scientifiques.
Ainsi que le formulait Fatima Bakhti189(*), présidente de l'association Femmes ingénieures, « les places en internat sont fondamentales et adressent un message fort aux jeunes filles et à leurs familles, notamment celles qui peuvent être réticentes à voir leurs filles partir loin du domicile. Leur garantir un hébergement adapté, en internat ou en résidence universitaire, contribue à instaurer un climat de confiance. »
Plus encore, Mélanie Guenais, coordinatrice du collectif Maths et sciences, a insisté sur « la nécessité de lutter contre la précarité étudiante, l'isolement et les difficultés liées à la ruralité, notamment en garantissant des places en internat. Il est inacceptable qu'il n'existe pas encore de parité dans leur attribution. Lorsque l'on met en place des quotas sans aborder cette question fondamentale, on passe complètement à côté de la problématique. (...) Les prépas de proximité ne me semblent pas forcément être la solution idéale. En revanche, il est essentiel de garantir leur accueil en toute sécurité, notamment via des internats offrant des conditions financières et d'hébergement fiables. »
En outre, ainsi que le formulait très justement Elyes Jouini, titulaire de la chaire Unesco « Femmes et science » à l'Université Paris-Dauphine, devant la délégation190(*), « l'extension des places d'internat constitue un levier essentiel. Il ne s'agit pas seulement de la question du coût de la vie ; mais également d'un enjeu d'égalité : les internes disposent, dès la sortie des cours, de la possibilité immédiate de travailler, réviser, s'entraîner, alors que celles et ceux qui doivent rentrer chez eux cumulent temps de transport et gestion logistique, ce qui représente une charge supplémentaire non négligeable. Or, aujourd'hui, de nombreux internats restent exclusivement réservés aux garçons, ou bien affichent un déséquilibre flagrant avec un nombre de places bien supérieur pour les garçons. »
La délégation appelle donc à une substantielle amélioration des conditions d'internat des filles en classes préparatoires et dans l'enseignement supérieur ainsi qu'à une nette augmentation des places réservées aux filles dans ces internats. Force est de constater que l'offre reste aujourd'hui très insuffisante. Or, disposer d'une place en internat permet aux étudiantes de bénéficier d'un logement accessible et de pouvoir se consacrer pleinement à leurs études.
- le développement de cursus dans les territoires, permettant aux jeunes de suivre une ou deux années d'études post-bac au plus près de leur lieu de vie. Plusieurs interlocuteurs rencontrés par les rapporteures ont en effet souligné le fait qu'il était plus facile pour les jeunes femmes de quitter leur environnement familial à vingt ans, plutôt que directement à l'issue du lycée.
- le regroupement de filles dans les classes et l'expérimentation d'espaces temporaires et ponctuels de non-mixité
Si la délégation n'est pas favorable au retour de la non-mixité totale, elle estime que des formes de non-mixité temporaires pourraient être expérimentées au cours des cursus académiques, notamment lors de moments charnières des études scientifiques, par exemple en CPGE ou pour des « stages » thématiques d'approfondissement au cours des études.
Devant la délégation, Emmanuel Trizac191(*), président de l'ENS de Lyon, a rappelé que « la non-mixité, en soi, ne garantit pas l'égalité. La mixité non plus. Il serait pertinent de réfléchir à des espaces hybrides, à des formes de non-mixité temporaires. J'ai évoqué plus tôt des stages ponctuels en non-mixité, proposés à des lycéennes. Ils peuvent constituer un outil pertinent et efficace. Ce type d'initiative permet de créer un climat propice à l'épanouissement des filles, leur offrant un environnement où elles se sentent à l'aise, soutenues et valorisées, sans être placées dans une position minoritaire. Il s'agit de créer des espaces protecteurs, qui offrent des conditions de sérénité. Cependant, je ne pense pas que la non-mixité totale soit souhaitable. »
Laura Chaubard, directrice générale de Polytechnique, est allée jusqu'à envisager des classes non-mixtes précisant qu'un « proviseur d'un prestigieux établissement de classes préparatoires envisage de rassembler les jeunes femmes en prépa étoile dans une même classe, afin qu'elles ne soient plus quatre, mais vingt ou vingt-cinq, formant ainsi un noyau de solidarité, de camaraderie et de dialogue. »
S'agissant des actions menées par l'École polytechnique, elle a évoqué la mise en place récemment des stages « coup de boost » pour les classes préparatoires pendant les vacances de la Toussaint, en précisant que « si les femmes sont sous-représentées dans les classes préparatoires scientifiques, il s'avère aussi qu'elles abandonnent plus fréquemment durant les premiers mois. Durant ces stages, nous les emmenons dans les calanques pour une semaine dédiée aux sciences, mais également à des activités visant à renforcer leur confiance en soi et leur capacité à travailler en équipe, les incitant à persévérer dans cette voie. »
Sans se prononcer sur ses contours exacts ni plaider pour un retour d'une stricte non-mixité, la délégation est favorable à l'expérimentation d'espaces de non-mixité ponctuels dans le cadre du cursus académique, exclusivement dédiés aux filles, à la fois dans les classes préparatoires mais aussi au sein de certaines filières universitaires scientifiques où la présence des filles demeure faible et qui, on l'a vu, sont souvent caractérisées par des environnements très masculins, très compétitifs, parfois marqués par un climat sexiste pesant, voire par des violences.
|
Recommandation n° 14 : Développer des dispositifs incitatifs et accueillants pour les filles souhaitant s'orienter vers des filières scientifiques sélectives : bourses dédiées, places en internat, espaces temporaires de non-mixité. |
c) Repenser l'organisation des processus de sélection et favoriser la pluridisciplinarité des parcours
Un troisième axe de réflexion développé par la délégation a consisté à s'intéresser aux processus de sélection mis en place dans les filières scientifiques, notamment au sein des voies d'accès les plus sélectives, mais aussi à réfléchir au nécessaire développement de la pluridisciplinarité et de l'hybridation des parcours académiques en créant davantage de passerelles entre filières scientifiques ou non.
(1) Repenser l'organisation des processus de sélection au sein des filières scientifiques
De nombreux interlocuteurs et interlocutrices rencontrés par la délégation ont pointé le caractère parfois inadapté des critères de sélection au sein des filières sélectives ainsi que le format des épreuves de concours souvent défavorable aux jeunes filles.
Ainsi Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine et représentante de la chaire « Femmes et science » de Paris Dauphine-PSL, a proposé à la délégation192(*) des pistes de réflexion sur les critères de sélection au sein des filières scientifiques, portant sur :
- le choix à opérer entre un modèle valorisant le contrôle continu et celui fondé sur des examens à fort enjeu : « à titre d'exemple, l'expérience espagnole montre que le recentrage des pondérations en faveur des épreuves terminales, au détriment du contrôle continu, a eu pour conséquence une diminution du taux d'admission des jeunes femmes » ;
- le format des épreuves des concours d'accès aux écoles d'ingénieurs notamment : des travaux montrent qu'au regard de leurs résultats scolaires, les filles devraient y être admises en proportion bien plus élevée.
La question des écarts de performance est complexe car, même si ces écarts existent, ils ne peuvent pas toujours expliquer les différents choix d'orientation. Parmi les facteurs déterminants de ces écarts de performance figure l'intériorisation des stéréotypes de genre, et, plus spécifiquement, de leurs conséquences sur les performances scolaires des élèves. À performances scolaires comparables, les filles tendent à sous-estimer leurs compétences, en particulier en mathématiques, et à exprimer davantage d'anxiété vis-à-vis de cette discipline.
Comme souligné par Elyes Jouini, les stéréotypes influencent également les résultats objectifs, par un mécanisme dit de prophétie autoréalisatrice ou de « menace du stéréotype ». Cet effet se manifeste particulièrement dans les contextes compétitifs, qui sont nombreux et structurants dans le système scolaire français.
La littérature expérimentale a mis en évidence que les filles tendent à obtenir de moins bons résultats et à se retirer davantage des situations compétitives lorsque ces dernières sont exacerbées, notamment lorsqu'elles portent sur des tâches typiquement perçues comme masculines. Plus encore, ces effets sont amplifiés dans les environnements mixtes, où la compétition implique simultanément filles et garçons.
Une attention particulière doit être plus spécifiquement portée aux enjeux liés à l'évaluation et à la sélection dans le système éducatif.
Comment évalue-t-on les compétences ? Utilise-t-on des QCM, des questions ouvertes, des épreuves longues, des formats courts ?
La manière même dont sont structurés les exercices et les épreuves peut produire un impact significatif sur les résultats des élèves.
À cet égard, les travaux de la chercheuse italienne Silvia Griselda ont montré qu'en Italie, les filles réussissent moins bien en mathématiques lorsque les évaluations prennent la forme de QCM plutôt que de questions ouvertes. Autrement dit, des choix apparemment techniques et anodins dans la conception des épreuves peuvent induire des effets différenciés et contribuer aux écarts de performance observés.
Dès lors, la question centrale demeure : selon quels critères sélectionne-t-on les élèves, et comment ces critères façonnent-ils l'accès aux filières scientifiques ?
À cet égard, la note précitée de l'Institut des politiques publiques (IPP), publiée en mai 2025, intitulée « Comment expliquer la sous-représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives ? », conclut que des modalités de préparation des concours fortement compétitives peuvent engendrer des coûts en matière d'équité de genre et que, dès lors, améliorer la représentation des femmes dans les écoles les plus sélectives suppose de repenser l'organisation de ces processus de sélection.
En outre, cette note suggère de mener des recherches complémentaires pour évaluer si ces processus de sélection reflètent réellement les compétences requises pour réussir dans les filières scientifiques les plus exigeantes. En effet, « si la capacité à performer sous pression n'est pas essentielle à la réussite académique et professionnelle, alors le fonctionnement actuel des CPGE scientifiques pourrait être sous-optimal, en écartant de manière injustifiée une partie des talents féminins les plus prometteurs. »
Certaines grandes écoles d'ingénieurs ont commencé à mener cette réflexion sur leurs processus de sélection.
À l'ESTACA, où les femmes ne représentent que 15 % des diplômés, une réflexion est menée sur le concours d'entrée et son caractère réellement égalitaire en fonction du genre. En effet, comme le précisait son directeur général, Denis Bertrand, devant la délégation193(*), « les données montrent que les jeunes filles ont, en moyenne, un dossier scolaire meilleur que celui de leurs homologues masculins : elles se classent autour de la 3 700e place sur près de 10 000 candidats, contre la 4 800e place pour les garçons. Pourtant, lors des épreuves écrites, leurs résultats sont moins bons que ceux des garçons, inversant partiellement cette tendance : elles atteignent en moyenne la 4 000e place, contre la 3 500e pour les garçons. Conscients de cet écart, nous avons lancé, au sein du concours Avenir, un groupe de travail en collaboration avec des experts externes, afin d'étudier les causes de cette disparité et de réfléchir à une évolution du concours vers une plus grande équité entre les sexes. »
Un second axe de réflexion concerne la nature même des épreuves du concours Avenir qui repose en grande partie sur des questionnaires à choix multiples, réalisés dans un temps très limité. Il apparaît que ce format tend à désavantager les filles, malgré un niveau scolaire moyen souvent supérieur à celui de leurs homologues masculins. Cette observation alimente des réflexions autour de la pondération entre les résultats scolaires et les épreuves écrites, ainsi que sur l'introduction éventuelle d'autres modalités d'évaluation.
À Centrale-Supélec, une réflexion est également en cours sur le concours d'entrée à l'école. Dès 2019, une analyse approfondie a été menée afin d'identifier les biais éventuels et les leviers sur lesquels agir pour améliorer la présence féminine, en augmentant par exemple le coefficient du français au concours. En tout état de cause, d'après Romain Soubeyran, directeur général de l'école, « il existe peu de leviers au niveau du concours, tel qu'il est actuellement organisé ».
Par ailleurs, en 2025, l'ENS-PSL a mis en place une formation aux biais et stéréotypes de genre pour sensibiliser les membres des jurys des concours d'entrée qui font passer les épreuves orales du concours, sous l'impulsion notamment de Charlotte Jacquemot194(*), chercheuse au CNRS, directrice du département d'études cognitives de l'ENS-PSL et responsable du programme « Femmes et filles de sciences ». Toutes les écoles normales supérieures sont concernées par ces formations : sur les 500 enseignants-chercheurs, environ 200 ont suivi la formation en 2025.
Compte tenu des résultats de la recherche existante sur le sujet, la délégation estime nécessaire d'encourager ces réflexions sur la nature des épreuves de sélection au sein des filières scientifiques afin de minimiser les risques de contre-performance féminine.
(2) Favoriser la pluridisciplinarité et l'hybridation des parcours de l'enseignement supérieur
La délégation est également persuadée de l'intérêt de favoriser la pluridisciplinarité et l'hybridation des parcours en permettant de multiples passerelles entre les différentes formations post-bac.
Les rapporteures ont été frappées de constater, au cours de leurs travaux, à quel point les jeunes filles, lors du choix de leurs études, favorisent les formations qui mènent à des professions qui, selon elles, ont du sens et présentent un intérêt pour la société. Dès lors qu'elles sont assurées de pouvoir mélanger un certain nombre de matières dans un souci de pluridisciplinarité, elles sont plus enclines à s'orienter vers les filières scientifiques, y compris celles qui dispensent des enseignements de « sciences dures » (maths, physique, informatique).
Ce constat est à l'origine de plusieurs expérimentations menées dans certaines écoles d'ingénieurs ou certaines filières universitaires qui visent à proposer aux étudiantes et étudiants des parcours hybrides, de même que des possibilités de passerelles entre cursus à un moment ou un autre de son parcours académique.
À cet égard, Fatima Bakhti, présidente de l'association Femmes ingénieures, a encouragé, lors de son audition par la délégation195(*), à « développer davantage de passerelles et encourager la pluridisciplinarité. Nous en avions autrefois en terminale. Aujourd'hui, il convient de les renforcer au niveau post-bac. Certaines voies commencent à émerger, comme les combinaisons entre biologie et informatique ou science des données. Ces croisements de compétences ouvrent de nouvelles perspectives et permettent à chacune de trouver le métier qui lui correspond. »
C'est ce qu'a également suggéré Sarah Cohen-Boulakia, professeure des universités au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN) de l'Université Paris-Saclay, lors de la table ronde organisée à l'ENS Paris-Saclay196(*), en invitant à « briser les codes des disciplines ».
Pour Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche197(*), « il ne s'agit pas d'éliminer toute différenciation entre les parcours, mais de concevoir des passerelles, d'offrir des opportunités plutôt que d'ériger des barrières. L'objectif n'est pas de fermer des portes aux élèves, mais de leur proposer des itinéraires alternatifs qui, même s'ils nécessitent parfois un peu plus de temps, leur permettront d'atteindre leurs objectifs. Cette flexibilité de l'enseignement fait encore défaut en France. D'autres pays, comme ceux d'Europe du Nord ou le Canada, ont su développer une plus grande souplesse dans leurs systèmes éducatifs, en diversifiant les méthodes d'apprentissage et en favorisant des approches pédagogiques plus adaptées aux besoins des élèves. »
Les rapporteures avaient été particulièrement marquées par le témoignage de Marina Kvaskoff, épidémiologiste et chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), directrice du groupe de recherche Epigyn sur l'épidémiologie de la santé gynécologique, lors de la table ronde organisée sur les femmes scientifiques aux parcours modèles et inspirants, le 6 mars 2025.
Elle retraçait en effet son parcours académique « en dents de scie » et finalement couronné de succès grâce aux différentes passerelles dont elle avait pu bénéficier.
Extraits du témoignage de Marina
Kvaskoff
Épidémiologiste et chercheuse à l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm),
directrice du groupe de recherche Epigyn sur l'épidémiologie de
la santé gynécologique, lors de la table ronde organisée
par la délégation sur le thème
« Des femmes
scientifiques aux parcours modèles et
inspirants »
Jeudi 6 mars 2025
« Construire ma confiance en moi dans le domaine scientifique a été un processus long. Dès mon plus jeune âge, j'étais fascinée par la santé et les maladies, mais je ne me sentais pas légitime pour entreprendre des études scientifiques. Mes parents, qui n'avaient pas fait d'études supérieures, ignoraient tout des formations existantes. Je n'avais aucun modèle scientifique autour de moi, mais mon père était convaincu que la science représentait l'avenir et qu'elle me garantirait un emploi.
Au collège, j'étais une élève brillante. Cependant, en classe de seconde, mes parents se sont séparés. J'ai cessé de travailler et ai redoublé cette année. J'ai néanmoins pu intégrer une Première S, puis j'ai obtenu mon baccalauréat au rattrapage. Par la suite, j'ai tenté à deux reprises le concours d'entrée en faculté de pharmacie. Durant ces deux années, je n'ai cessé de douter de mes capacités.
|
Finalement, je n'ai pas réussi à intégrer cette formation. À l'issue de ces tentatives, je me suis retrouvée sans équivalence. À 21 ans, j'ai décidé de reprendre mes études en intégrant une première année de biologie à l'université. Au premier semestre, j'avais 10 de moyenne. Confrontée à ce résultat, je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de cela, que si je voulais poursuivre mes études, je devais impérativement aller plus loin. Ce sentiment d'échec m'a poussée à cesser d'écouter cette voix intérieure qui me freinait et à me consacrer pleinement à mon travail, enfin. J'ai étudié avec assiduité, redoublant d'efforts, et au second semestre, ma moyenne est montée à 15. Finalement, j'ai obtenu une mention Assez bien au DEUG (l'équivalent de la licence 2), ce qui m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir et que j'avais trouvé une méthode de travail efficace. J'ai ensuite poursuivi mon cursus en obtenant une mention Bien à la Maîtrise, puis une mention Très bien au Master. Par la suite, j'ai entrepris un double doctorat entre la France et l'Australie, dans le cadre d'une cotutelle internationale, avant d'effectuer mon post-doctorat à Harvard, où j'ai travaillé pendant trois ans et demi. À mon retour en France, j'ai réussi le concours de l'INSERM dès ma première tentative et j'ai obtenu un poste de chercheuse en 2016. Aujourd'hui, à près de 45 ans, forte de 20 ans d'expérience en épidémiologie de l'endométriose, je suis en train de créer une équipe de recherche dédiée à l'épidémiologie de la santé gynécologique. Mon objectif est non seulement de poursuivre mes travaux sur l'endométriose, que je connais bien, mais également d'explorer d'autres problématiques majeures en santé gynécologique, notamment les fibromes utérins et le syndrome des ovaires polykystiques, des pathologies non malignes encore trop méconnues. Si, il y a vingt ans, alors que je préparais ma thèse et manquais cruellement de confiance en moi, on m'avait dit que j'atteindrais ce niveau de reconnaissance et que je possédais un tel potentiel, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, en être consciente à l'époque m'aurait sans doute permis d'affronter mon parcours avec davantage de sérénité et moins d'appréhension quant à l'avenir. |
Source : Travaux de la délégation - Table ronde du 6 mars 2025
En France, certaines écoles d'ingénieurs ont identifié cette problématique de l'hybridation des parcours et l'ont reliée à l'enjeu de féminisation de leur recrutement.
Ainsi, Joël Cuny, directeur général de l'ESTP, a présenté devant la délégation198(*) les formations hybrides proposées par l'école en se disant « fermement convaincu que l'hybridation des formations, plutôt que la spécialisation précoce, constitue une réponse pertinente. À 18 ans, il me semble prématuré de forcer un choix. Si la classe préparatoire impose une certaine orientation, celle-ci reste néanmoins très spécialisée (MP, PC, PSI, etc.). L'ouverture à des études scientifiques plus générales apparaît donc comme une voie d'égal accès aux diverses disciplines, offrant une véritable opportunité d'orientation future ».
Ainsi, depuis 2002, l'ESTP a mis en place des parcours alliant à la fois l'architecture et l'ingénierie, des parcours dits « architecte-ingénieur » et « ingénieur-architecte ». Ces parcours sont particulièrement intéressants, car ils favorisent une parité, voire une proportion de 60 % d'étudiantes pour 40 % d'étudiants.
Concernant cette politique favorisant la pluridisciplinarité des formations, Joël Cuny a souligné que « cette hybridation est une approche fondamentale pour atteindre une véritable mixité. (...) il est impératif de fusionner les domaines de l'ingénierie et de l'architecture, mais il subsiste des difficultés pour faire reconnaître ces diplômes. Il nous a fallu surmonter de nombreux obstacles pour faire reconnaître ces parcours, qui relèvent de deux ministères distincts. Nous sommes persuadés que c'est une manière efficace d'attirer davantage d'étudiantes. »
L'école envisage également, pour attirer davantage d'étudiantes, d'autres évolutions, telles que l'ouverture de la construction et du bâtiment aux domaines du génie civil et du génie écologique.
De même, à Centrale-Supélec, le directeur général, Romain Soubeyran, a insisté sur la nécessité de proposer des cursus plus attractifs pour attirer davantage de femmes. Il a souligné le fait que « certaines disciplines en ingénierie sont très genrées. Par exemple, dans le domaine de l'agronomie, les femmes représentent 65 à 70 % des effectifs. Le secteur du BTP semble également relativement attractif pour elles. En revanche, nous nous positionnons sur des sciences de l'ingénieur plus classiques et traditionnelles, telles que la mécanique, l'électronique, et l'informatique. Les domaines numériques, en particulier, sont plutôt perçus comme répulsifs pour les femmes. »
Dès lors, afin d'attirer davantage de femmes, Centrale-Supélec a développé une politique de double diplôme avec Chimie ParisTech, des écoles d'agronomie et Sciences Po.
Pour reprendre les mots de Geogia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine et représentante de la chaire « Femmes et science » de Paris Dauphine-PSL, les passerelles dans l'enseignement supérieur apparaissent comme une piste essentielle, non seulement pour réduire les inégalités de genre, mais aussi pour agir sur les inégalités socio-économiques.
|
Recommandation n° 15 : Repenser les processus de sélection au sein des filières scientifiques, en adaptant les épreuves des concours d'entrée aux grandes écoles, et favoriser l'hybridation des parcours et les passerelles entre formations. |
2. Renforcer la lutte contre le sexisme et les VSS dans l'enseignement supérieur
La délégation l'a déjà longuement évoqué supra, renforcer la lutte contre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, et plus particulièrement dans les cursus scientifiques, est un prérequis indispensable à une plus grande mixité voire une parité dans les études scientifiques, y compris au sein des filières les plus sélectives.
Si le cadre législatif et règlementaire existe déjà, il convient d'une part d'en assurer l'application uniforme et volontaire au sein de l'ensemble des filières et niveaux concernés, d'autre part de permettre une diffusion à large échelle de toutes les bonnes pratiques aujourd'hui recensées, que ce soit dans les lycées qui accueillent des CPGE scientifiques, dans les écoles d'ingénieurs ou dans les universités.
Au cours de ses travaux, la délégation a constaté que la mise en oeuvre des politiques de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et de celles pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et les moyens qui y sont dédiés, étaient encore étroitement dépendantes des initiatives prises par la gouvernance des écoles et universités.
Pour reprendre les mots de Jérôme Courduriès, professeur des universités en anthropologie, chargé de mission Égalité de genre et de lutte contre les VSS à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, « les moyens alloués à la prévention et à la lutte contre les VSS ou à l'égalité entre les femmes et les hommes sont étroitement dépendants de la bonne volonté des présidents. Tout dépend donc beaucoup de la gouvernance et cela peut changer dans le temps. Nonobstant l'autonomie des universités, il nous faut réfléchir à des règles pour obliger les établissements à consacrer un certain niveau de moyens à la prise en charge de ces questions. »
À cet égard, la délégation recommande notamment :
- l'obligation pour l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur, sous peine de sanctions, de se doter d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec la mise en oeuvre de mesures concrètes incluant la désignation de référents « VSS », formés et indépendants, de cellules d'écoute et de signalement, l'organisation d'enquêtes annuelles auprès des étudiants sur la prévalence de ces violences, l'identification des situations propices aux VSS ;
- un renforcement de la collecte de données fiables et représentatives sur les VSS au sein de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur ;
- une véritable « professionnalisation » des référents égalité dans les écoles et universités qui leur permettrait de bénéficier d'une réelle légitimité institutionnelle au sein de leurs établissements et de pouvoir faire reconnaître, sur le plan professionnel, le temps consacré à cet engagement alors que ces activités relèvent trop souvent du bénévolat ;
- une généralisation des démarches de « labellisation » égalité professionnelle dans les établissements (lycées proposant des CPGE, universités et écoles d'enseignement supérieur) en lien avec AFNOR Certification notamment ;
- une sensibilisation et formation obligatoires sur les biais et stéréotypes de genre pour tous les membres des jurys des concours d'entrée aux grandes écoles scientifiques et ceux des comités de sélection chargés de recruter les enseignants-chercheurs à l'université ;
- une formation obligatoire sur les VSS pour tous les chercheurs qui souhaitent être habilités à diriger des recherches ;
- l'obligation des directeurs et directrices de thèse et des encadrants et encadrantes de recherche de se former sur les risques inhérents aux enquêtes de terrain.
Comme le soulignait très justement, devant la délégation199(*), Rhita-Maria Ouazzani, astronome-adjointe au Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA) de l'Observatoire de Paris, membre de la Cellule d'écoute et de veille PSL, coordinatrice de la commission Femmes et Astronomie de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A), « nous devons cesser de séparer les politiques d'égalité et les politiques de lutte contre les VSS. Il ne suffit pas d'encourager les jeunes femmes à faire des sciences ; il faut qu'elles puissent y rester et y évoluer en sécurité. Nous ne pouvons pas, en conscience, les envoyer dans un système qui ne les protège pas. »
|
Recommandation n° 16 : Rendre obligatoire, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur scientifique, la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que les formations du personnel académique sur ces questions. |
IV. DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS SCIENTIFIQUES, RECRUTER PLUS DE FEMMES ET NE PAS LES FAIRE FUIR
A. CONSTATS : UNE SOUS-REPRÉSENTATION ET UN MANQUE DE VISIBILITÉ DES FEMMES DANS LA MAJORITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES
La conséquence logique de cette faible féminisation des filières académiques scientifiques est une sous-représentation féminine dans les carrières scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, de la recherche, de l'informatique ou du numérique.
En effet, les femmes représentent aujourd'hui moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Ce chiffre stagne ces dernières années. Elles sont encore moins nombreuses à occuper des postes à responsabilité au sein des laboratoires de recherche ou des départements R&D des entreprises.
Il a été indiqué à la délégation qu'environ une femme sur deux, après avoir opté pour une carrière scientifique, quitterait ce champ professionnel au cours des dix années suivant l'obtention de son diplôme. Cette proportion interpelle, d'autant plus dans un contexte de fortes tensions en compétences dans les secteurs liés à la transition numérique, à la transition écologique, à l'intelligence artificielle ou encore à la santé. Ces enjeux nécessitent un vivier scientifique élargi, où la mixité représente un levier d'innovation, de performance et de qualité.
Ainsi que le soulignait Véronique Lestang-Préchac200(*), sous-directrice au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, « si une progression avait été constatée jusqu'à la fin des années 2000, la proportion des femmes dans ces filières stagne aujourd'hui à un niveau insuffisant. Ce phénomène du tuyau percé (...) ne s'arrête pas aux portes de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il se prolonge tout au long du parcours professionnel et des carrières scientifiques des femmes. »
Comment expliquer ce phénomène, qualifié de « tuyau percé », qui conduit à la disparition progressive des femmes dans les filières scientifiques, technologiques et numériques ? Se manifeste-t-il de manière homogène selon les secteurs ou les types de structures - laboratoires de recherche, établissements universitaires, entreprises privées ?
Au-delà de l'identification des freins, il appartient à la délégation de formuler des préconisations opérationnelles. Quels dispositifs permettraient de fidéliser les talents féminins ? Quels leviers activer pour favoriser leur accès aux postes à responsabilité ? Comment structurer des parcours de mentorat efficaces ? De quelle manière faire évoluer les pratiques de recrutement, d'évaluation, de management et de promotion dans les milieux scientifiques ?
Il paraît, en effet, essentiel de sensibiliser les employeurs et les décideurs à l'apport déterminant de la diversité. La présence accrue des femmes dans les équipes constitue un facteur reconnu de créativité, d'innovation et d'efficacité, tant dans les laboratoires que dans les entreprises.
Les stéréotypes de genre et la faible représentation des femmes dans les métiers d'avenir, notamment ceux liés aux technologies et à l'intelligence artificielle, génèrent des coûts économiques qu'il convient de mettre davantage en lumière.
1. Seulement un tiers de femmes dans les métiers des sciences et de l'ingénierie
Ainsi que le rappelait Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors de son audition devant la délégation, « les femmes sont encore fortement sous-représentées dans les métiers scientifiques et technologiques. Selon une étude de l'UNESCO, datant de 2018, moins de 30 % des chercheurs sont des femmes dans de nombreux pays occidentaux. Depuis lors, la situation n'a évolué que très faiblement. »
En outre, une étude récente de France Stratégie201(*), présentée à la délégation202(*) par Cécile Jolly, économiste et cheffe du projet « Prospective des métiers et des qualifications » au Haut-Commissariat, pointe le fait que les femmes demeurent minoritaires dans de nombreux métiers mobilisant des compétences scientifiques, technologiques et mathématiques de haut niveau qui figurent parmi les plus rémunérateurs.
Elles représentent, en effet, aujourd'hui moins d'un quart des effectifs dans les professions d'ingénierie informatique, de recherche en entreprise privée, d'ingénierie industrielle ou du bâtiment, avec une progression très faible dans le temps.
Les prospectives du Haut-Commissariat ne montrent, par ailleurs, pas d'amélioration significative de cette tendance, et certaines filières, comme l'informatique et l'industrie, connaissent même un ralentissement de leur féminisation.
Enfin, Cécile Jolly constatait devant la délégation que « les jeunes femmes qui ont suivi des cursus scientifiques exercent moins souvent que les jeunes hommes les métiers pour lesquels elles se sont formées. Elles s'orientent majoritairement vers la finance ou le conseil, plutôt que vers les secteurs scientifiques correspondant à leur formation. Et quand elles accèdent à ces métiers, elles tendent à les quitter plus rapidement. Cette situation s'explique en partie par des biais genrés, souvent inconscients, dans les processus de recrutement et sur le lieu de travail. »
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)203(*)
D'après les statistiques publiées en mars 2025 par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en 2023, dans l'UE27, la proportion d'hommes scientifiques ou ingénieurs dans la population active est de 13 % et celle des femmes de 11 %. En 2013, elles étaient de 8 % et 7 %. En France, ces proportions sont passées respectivement de 8 % et 8 % en 2013 à 15 % et 11 % en 2023.
En outre, dans de nombreux pays, les chercheuses sont nettement sous-représentées : en France elles ne représentaient que 30 % des chercheurs en 2022.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)204(*)
Les femmes chercheuses dans les organismes de recherche en France sont très faiblement représentées en sciences physiques, mathématiques et informatique, comme c'est le cas, on l'a vu, dans les universités.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
En 2023, 39 % des chercheurs dans les organismes de recherche sont des femmes. Elles représentent 54 % des chercheurs dans les sciences humaines et 22 % dans les domaines des mathématiques et de l'informatique.
Par ailleurs, au sein du corps des enseignants-chercheurs, en 2023, la proportion de femmes en sciences et techniques était de 30 % contre 55 % en lettres et sciences humaines. Cette différence par grande discipline existe quels que soient le corps et le grade.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Si l'on s'intéresse au secteur de la recherche et développement (R&D), en 2021, dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, 17 % seulement des chercheurs sont des femmes. Tandis que dans le domaine des sciences médicales, elles représentent 58 % des chercheurs.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche205(*)
Cette sous-représentation féminine dans les métiers scientifiques et technologiques que l'on observe dans de nombreux pays développés résulte de ce que les chercheurs nomment le « paradoxe de l'égalité » - ou « paradoxe norvégien » - comme l'expliquait devant la délégation206(*) Elyes Jouini, titulaire de la chaire « Femmes et science » à l'université Paris Dauphine-PSL : « le paradoxe « norvégien » (...) illustre qu'il ne suffit pas d'améliorer les résultats des filles en sciences pour influencer leurs choix d'orientation. Même lorsqu'elles excellent en sciences, elles restent souvent très performantes en lettres, ce qui leur laisse davantage de choix. Or, en raison de l'environnement et des stéréotypes persistants, elles se dirigent préférentiellement vers les filières littéraires. (...) Les pays les plus progressistes -- ceux qui promeuvent le plus l'égalité femmes-hommes -- affichent paradoxalement les plus faibles proportions de femmes dans les filières STIM. »
Or, dans le contexte actuel de transition énergétique, de réindustrialisation et de révolution de l'IA, la France a plus que jamais besoin d'ingénieures et d'ingénieurs, de techniciennes et de techniciens. Lors de son audition207(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, estimait indispensable de former au moins 20 000 ingénieures et ingénieurs et 60 000 techniciennes et techniciens de plus chaque année pour permettre à la France de rester compétitive dans ces domaines.
De même, Fatima Bakhti, présidente de l'association Femmes ingénieures, a alerté la délégation lors de son audition208(*) sur le fait qu'« il manque entre dix et vingt mille ingénieurs en France. Pour élargir ce vivier, il faut s'adresser à la moitié des Français, c'est-à-dire aux Françaises. C'est une nécessité très concrète. »
Ainsi que le formulait très justement Romain Soubeyran, directeur général de Centrale-Supélec, devant la délégation209(*), « nous laissons passer une quantité importante de talents féminins, alors même que la France connaît une pénurie d'ingénieurs, un problème largement documenté. (...) Aujourd'hui, les entreprises sont fortement demandeuses de femmes ingénieures. Ce n'était pas le cas dix ans plus tôt. »
Or, il faut garder en tête que les carrières scientifiques et d'ingénierie sont extrêmement valorisantes, tant sur le plan social qu'intellectuel et financier, pour reprendre les mots de Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique. Elles constituent des voies d'émancipation individuelle et sont au coeur d'enjeux technologiques majeurs pour la France et pour l'Europe. Le fait que les femmes en soient majoritairement absentes est une réelle source d'inquiétude tant d'un point de vue sociétal qu'économique.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue, comme le remarquait devant la délégation210(*) Valérie Brusseau, présidente de l'association Elles bougent, que si cette question de la mixité concerne les métiers d'ingénieurs, il convient également de ne pas négliger la situation des techniciennes qui rencontrent, elles aussi, des difficultés d'accès à ces filières.
2. Des carrières féminines ralenties voire anéanties par des discriminations, des inégalités et des VSS
Pour comprendre le phénomène dit du « tuyau percé » qui pousse vers la sortie certaines femmes ayant pourtant choisi de s'orienter vers des carrières scientifiques ou qui les font stagner à des niveaux de responsabilité ne correspondant pas à leurs compétences, il faut s'intéresser à ce que Sophie Pochic, directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS), décrivait devant la délégation211(*) comme le concept de « régime d'inégalités », plus complexe que celui de « plafond de verre », pour désigner l'ensemble des facteurs limitant les possibilités d'avancement des femmes à tous les niveaux hiérarchiques.
Il convient, ainsi que le formulait Sophie Pochic, « d'étudier les modes d'évaluation, de recrutement, de promotion, de rémunération, de financement, et même les interactions quotidiennes pour comprendre les avantages structurels, cumulatifs, dont bénéficient certains profils d'hommes. Pourquoi les politiques d'égalité et de lutte contre les VSS, pourtant existantes, ont-elles des effets si limités ? »
D'une part, on perd des femmes scientifiques à différentes étapes de la carrière, d'autre part, ce « régime d'inégalités » creuse les inégalités salariales entre femmes et hommes, notamment dans le domaine de la recherche et au sein des organisations académiques.
Pour lutter contre ce « régime d'inégalités », un renforcement progressif du cadre législatif et réglementaire des politiques d'égalité professionnelle au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est opéré au cours des quinze dernières années.
Ainsi, plusieurs lois ont été adoptées, telles que :
- la loi212(*) dite Sauvadet du 12 mars 2012 s'agissant de l'accès des femmes à la haute fonction publique, récemment complétée par la loi213(*) du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, issue d'une proposition sénatoriale faisant suite à des travaux de la délégation214(*) sur le bilan de la loi Sauvadet dix après ;
- la loi215(*) dite Fioraso du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
- la loi216(*) du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- la loi217(*) de programmation de la recherche (LPR) pour les années 2021 à 2030 du 24 décembre 2020, qui a introduit une initiative de « repyramidage », visant à rendre effective l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine e de la recherche, notamment en matière de promotions, de progression de carrière et de rémunération.
Ces textes ont notamment permis la mise en oeuvre d'actions visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et à améliorer la progression des carrières féminines.
a) Une discrimination de genre à l'oeuvre dès les processus de recrutement
Dans le domaine de la recherche scientifique, la délégation a constaté, au cours de ses travaux, à quel point les biais de genre, même inconscients ou non intentionnels, pouvaient affecter de façon négative la carrière des femmes scientifiques, et ce dès la procédure de recrutement.
(1) Des biais de genre à l'oeuvre au moment de recruter des candidats pour des postes en sciences dans les universités
Comme le rappelait devant la délégation218(*) Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les Discriminations d'Aix Marseille Université (amU), « un corpus conséquent de travaux met en lumière la discrimination de genre à l'égard des femmes lors des processus de recrutement pour des postes en sciences. »
Ainsi, il a été établi, à partir d'études basées sur l'envoi de CV identiques, que les professeurs d'université en physique, biologie et chimie, habitués à recruter des enseignants-chercheurs, évaluent les candidatures selon un biais de genre.
Lorsqu'ils examinent un dossier qu'ils croient masculin, ils attribuent systématiquement des compétences perçues comme supérieures par rapport à un CV, identique, mais qu'ils croient féminin. Ils se montrent plus enclins à recruter l'homme, à lui offrir un mentorat ainsi qu'un salaire nettement plus élevé. Étant donné que les CV sont strictement identiques, aucun critère objectif ne peut justifier de tels écarts, qui se font systématiquement au détriment des candidates. C'est donc une forme indéniable de discrimination de genre.
En outre, Isabelle Régner indique que « cette discrimination est d'autant plus susceptible de se manifester lorsque les évaluateurs et évaluatrices - car le genre de l'évaluateur n'influe pas sur la présence de biais - sont convaincus qu'il n'existe plus de discriminations de genre. »
Des biais similaires ont été mis en évidence, par les recherches précitées d'Aix-Marseille Université (amU), au sein des comités du CNRS, en particulier lors de l'évaluation des candidatures pour les postes de directeurs et directrices de recherche, couvrant un large éventail de disciplines.
Des biais linguistiques liés au genre dans les lettres de recommandation ont également été constatés. Indépendamment du genre de la personne les rédigeant, leur contenu est généralement plus favorable aux hommes qu'aux femmes. Les études montrent que cette différence de contenu dans les lettres de recommandation agit défavorablement dans le recrutement des femmes.
Sophie Pochic a également cité, devant la délégation, des études menées aux Pays-Bas qui montrent que « les indicateurs, critères et normes d'excellence scientifique ne sont pas objectifs : ils intègrent des appréciations genrées sur l'ambition, le leadership, la réputation ou le rayonnement international. Même avec une politique d'égalité et une formation des jurys, l'évaluation repose sur un cercle fermé, majoritairement masculin et national. La barre reste toujours placée plus haut pour les femmes, et leur recrutement demeure considéré comme plus risqué. »
Enfin, Emmanuel Trizac, président de l'ENS Lyon, a insisté devant la délégation219(*) sur les effets des stéréotypes de genre dans des situations contraintes, qui affectent les membres des jurys, qui doivent prendre des décisions difficiles et irréversibles, en particulier dans le cadre des comités de sélection pour les postes d'enseignants-chercheurs. Dès lors, selon lui, « il existe une inégalité d'accès à compétences égales, qui affecte particulièrement les femmes ».
Pour remédier à ces biais de genre dès la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, Aix-Marseille Université (amU) a instauré depuis 2020, à la demande de la Faculté des sciences, une sensibilisation des membres des comités de sélection chargés de recruter les enseignants-chercheurs dans les deux corps, à savoir le rang B et le rang A (maître de conférences et professeur des universités). Cette sensibilisation est précise, standardisée et requiert un travail d'encadrement considérable.
Grâce à cette initiative, menée depuis cinq ans au sein de la Faculté des sciences, le pourcentage de femmes recrutées en tant que professeurs des universités est passé de 14 % à 50 %. Au total, plus de 800 membres de jury ont été sensibilisés, qu'ils soient hommes ou femmes.
Au cours d'une table ronde220(*) consacrée aux inégalités dans le recrutement et le déroulement de carrière des femmes scientifiques, Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS, membre du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), a également fait état des différentes actions menées, depuis plusieurs années, par le CNRS en faveur du recrutement et de la carrière des femmes scientifiques, rappelant qu'« en 2024, le CNRS a reçu le prix Champion européen de l'égalité décerné par la Commission européenne, récompensant les progrès réels réalisés ces dernières années » grâce notamment à une évolution significative de la proportion de femmes accédant au corps des directrices de recherche, passant de 25 % en 2010 à 32 % fin 2024, soit une proportion proche de celle observée parmi l'ensemble des chercheuses.
Mathieu Arbogast a cependant reconnu qu'il était difficile de maintenir ces progrès « notamment dans un contexte où les candidatures féminines aux concours de chercheurs, y compris à l'international, tendent à se raréfier dans plusieurs disciplines comme l'astronomie ou la physique. La diversité dans les recrutements reste pourtant indispensable, notamment pour améliorer la qualité de la science. »
(2) Des difficultés en lien avec un recrutement de plus en plus tardif, notamment dans les sciences « dures »
Plusieurs interlocuteurs et interlocutrices de la délégation ont également signalé que le recrutement de plus en plus tardif aux postes de chercheurs pouvait être pénalisant pour les femmes.
Ainsi, Hélène Bouchiat, physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et sciences de l'Académie des sciences, a indiqué221(*) que « le recrutement s'opère de plus en plus tardivement ces derniers temps, notamment dans les sciences dures. Or, à 30 ans, il est compliqué d'être maintenu dans un statut précaire. On a envie de fonder une famille, on ne peut pas déménager facilement tous les six mois et cumuler des contrats à durée déterminée, surtout que d'autres professions sont possibles, comme celles dans l'industrie, ou d'autres où l'on utilise ses capacités scientifiques, sans subir cette pression. Donc les femmes disparaissent. »
Corrélativement à ce recrutement tardif, on observe une diminution du nombre de postes proposés aux jeunes. Or, comme le rappelait Hélène Bouchiat, « quand le nombre de postes diminue, il semblerait que ce soient les femmes les premières concernées. Le système devient de plus en plus élitiste et ce sont les femmes qui en pâtissent en premier. »
Évoquant son expérience personnelle devant la délégation lors d'une table ronde222(*) consacré aux parcours de femmes scientifiques inspirantes, Kumiko Kotera, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, a également jugé nécessaire d'adapter nos pratiques de recrutement, soulignant : « lors de mon passage dans les commissions du CNRS, j'ai pu constater l'importance d'un recrutement précoce. Il convient d'éviter cette tendance à recruter des chercheurs ayant déjà accumulé six, sept, voire huit années post-thèse, car cette attente excessive ne se justifie pas et contribue à précariser inutilement les carrières. Cette instabilité touche aussi bien les hommes que les femmes, mais elle est particulièrement préjudiciable à ces dernières. (...) retarder l'accès à un poste stable entrave profondément la construction d'une carrière, surtout pour les jeunes chercheurs et chercheuses. »
b) Un modèle traditionnel de carrière scientifique qui peut être dissuasif pour les femmes et entraîner des inégalités salariales persistantes
(1) Un modèle traditionnel de carrière scientifique parfois dissuasif
Pour reprendre les mots de Jacqueline Bloch, physicienne, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, « le modèle traditionnel de carrière scientifique, très masculin et individualiste, selon lequel il faut être un leader, travailler seul et se consacrer entièrement à la science, peut être dissuasif. »
Au cours de ses travaux, la délégation a constaté les effets néfastes et dissuasifs pour les femmes du modèle professionnel du « bon chercheur scientifique » implicitement masculin, entièrement consacré à son activité professionnelle, sans considération pour sa vie privée et familiale.
Ce modèle traditionnel continue d'ailleurs d'influencer les méthodes d'évaluation à l'oeuvre dans les parcours académiques et de recherche, comme le rappelaient les membres de l'Académie des sciences entendus par la délégation223(*) : les questions liées à l'évaluation, comme les promotions et les recrutements, sont souvent basées sur des critères pouvant devenir discriminants (course à l'excellence individuelle, fréquence des changements de laboratoires, participation à des conférences scientifiques, notamment à l'étranger, volume bibliométrique, etc.).
Comme le soulignait Thomas Breda, économiste, chercheur au CNRS et membre de la chaire « Femmes et science » de l'Université Paris Dauphine-PS224(*), il existe aujourd'hui des biais implicites de genre bien documentés concernant le milieu universitaire : « par exemple, lorsqu'une femme coécrit un article scientifique avec un homme, cette production tend à être moins valorisée pour sa carrière que si un jeune homme coécrit avec un chercheur senior, car on attribue davantage le mérite au collègue masculin. Les chercheuses font également face à des exigences plus élevées dans les processus de publication, et les études montrent que lors des séminaires de recherche, elles subissent des interruptions et des remarques d'une nature différente de celles adressées à leurs homologues masculins. »
Concernant les critères d'évaluation différenciés entre femmes et hommes dans le milieu de la recherche scientifique, Laure Saint-Raymond, mathématicienne et professeure des universités à l'ENS de Lyon, membre de l'Académie des sciences, estime qu'« aujourd'hui, cette évaluation pose problème, notamment en ce qui concerne les questions de genre. (...) les femmes travaillent de manière plus collective que les hommes, notamment dans les mathématiques. C'est un aspect important à prendre en compte dans l'évaluation ».
C'est pourquoi, comme l'indiquait à la délégation225(*), Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS, le CNRS préconise désormais une évaluation qualitative plutôt que strictement bibliométrique, cette dernière tendant à défavoriser les femmes. Il en concluait que « le modèle implicite du « bon chercheur », associé à l'autorité, à l'assertivité et au dévouement, reste fortement genré au masculin et doit être réinterrogé ».
De même, Sophie Pochic226(*) faisait état, au cours de son analyse des inégalités de carrière au sein des organisations académiques, d'une vision très normative de l'excellence sur lesquels reposent la plupart des parcours des chercheurs scientifiques : « progressivement, l'internationalisation et le management de la recherche, avec des entrepreneurs académiques à la tête d'équipes temporaires sur des projets, sont devenus des critères prépondérants. Depuis les années 90, les carrières académiques subissent une transformation profonde. On parle de managérialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. La compétition pour les rares postes stables s'est considérablement accrue. Les budgets de recherche sont désormais majoritairement distribués sous forme d'appels à projets très compétitifs (moins de 20 % de succès à l'ANR). Les débuts de carrière sont devenus plus incertains, précaires et tardifs, avec une période postdoctorale qui se prolonge. Toutes ces transformations reproduisent des inégalités. On les comprend mieux en les observant de façon dynamique, éclairant ainsi le « tuyau percé ». La précarisation de la première partie de carrière, contractuelle jusqu'à 35-40 ans dans presque tous les pays européens, exacerbe la compétition au sein d'une génération pour se construire un dossier dit d'excellence. »
(2) Le conflit entre « travail productif et travail reproductif » ou l'enjeu de la maternité
Ce modèle normatif du « bon chercheur » et du « bon scientifique » est d'autant plus pénalisant pour les femmes que ses manifestations sont les plus prégnantes au moment de leur carrière où ces dernières pourraient vouloir devenir mères.
Il s'agit d'un moment charnière dans la carrière d'une femme scientifique que Sophie Pochic a très justement qualifié de « conflit entre travail productif et travail reproductif pour les jeunes mères ».
Comme le soulignait Marina Kvaskoff227(*), épidémiologiste et chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), directrice du groupe de recherche Epigyn sur l'épidémiologie de la santé gynécologique, « l'arrivée d'un enfant modifie profondément le rythme de travail et l'accès à des solutions de garde adaptées constitue souvent un obstacle majeur. Nombre de chercheuses sont découragées à cette étape cruciale de leur carrière, conduisant à un abandon prématuré de leur parcours scientifique ».
Car, ainsi que Clotilde Coron, vice-présidente égalité, diversité et inclusion de l'Université Paris-Saclay, le faisait observer228(*), derrière une apparente souplesse et liberté d'organisation, la réussite dans les carrières académiques est, de fait, conditionnée à une très grande disponibilité professionnelle.
La question du retour de congé maternité demeure donc centrale pour les femmes au cours de leur carrière scientifique. Nombreuses sont celles qui témoignent d'un ralentissement ou d'un blocage dans leur progression professionnelle ainsi que d'un renoncement aux mobilités professionnelles, en lien avec leur maternité.
Ce problème de compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale aggrave auprès des femmes le manque d'attractivité de la recherche scientifique : cette incompatibilité résulte notamment du manque de valorisation du travail collectif au sein de la recherche scientifique et de l'injonction à l'internationalisation, longtemps perçue comme la norme et qui devient un critère de distinction pour un recrutement stable.
Or, pour reprendre les mots de Sophie Pochic, « cette mobilité répétée à l'étranger pour les trentenaires, sans garantie, doit notamment se négocier avec le ou la conjointe. Or, les rapports de pouvoir, même dans les couples scientifiques, restent asymétriques : les femmes se mettent davantage au service de la carrière de leur mari que l'inverse. Ainsi, quelles que soient leurs compétences, les femmes scientifiques se trouvent à armes inégales dans le jeu de la mobilité internationale précarisée. »
Pour répondre aux défis que représente la maternité pour les femmes poursuivant des carrières scientifiques, certaines solutions se mettent en place.
C'est le cas notamment au CNRS qui a proposé plusieurs ajustements liés à la parentalité : prolongation de contrat après un congé maternité ; maintien à taux plein d'une prime annuelle pour les IT (personnels relevant des métiers d'ingénierie et de soutien technique) ; déduction de 18 mois par enfant pour l'évaluation des chercheurs ; « packs » de financement de retour de congé maternité dans plusieurs instituts ; financement de crèches éphémères lors d'événements scientifiques.
(3) Des règles de représentativité et une répartition genrée des responsabilités académiques aboutissant à une surcharge de travail pour les femmes
Au cours de leurs carrières dans la recherche scientifique, les femmes peuvent être également pénalisées par des règles de représentativité dans les jurys de concours ou comités de sélection s'avérant parfois contre-productives et par une répartition genrée des responsabilités aboutissant à une surcharge de travail qui n'est pas rémunérée à sa juste valeur.
Ainsi, Hélène Bouchiat, physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et sciences de l'Académie des sciences, expliquait à la délégation229(*) que « des règles contre-productives ont été mises en place pour favoriser la visibilité des femmes, par exemple en prévoyant qu'il y ait des femmes dans chaque jury de recrutement ou de thèse. C'est une bonne idée a priori, mais cela représente du travail supplémentaire par rapport au travail de recherche et d'enseignement. De ce fait, les jeunes femmes qui ont la chance d'être recrutées se retrouvent très vite submergées par un enseignement qu'elles doivent monter, un laboratoire de recherche qu'elles doivent aussi faire démarrer, éventuellement une vie de famille. »
De même, Laure Saint-Raymond, mathématicienne, professeure des universités à l'ENS de Lyon et membre de l'Académie des sciences, a appelé à manier avec beaucoup de précaution la notion de quotas visant à améliorer la représentativité des femmes au sein des comités de recrutement : « les quotas peuvent sembler de bonnes idées mais qui, en réalité, nous font du tort, en tant que femmes. En tant que mathématicienne, je fais partie d'une communauté où les femmes sont sous-représentées. Pour améliorer la représentation des femmes, on a mis en place des mesures pour qu'il y ait des femmes dans tous les comités de recrutement. Cela signifie que nous contribuons à ces comités proportionnellement dix fois plus que nos collègues hommes. Le temps qui nous reste pour faire de la recherche et produire des résultats est donc d'autant plus limité. Cela me semble être une très mauvaise idée qui perdure... On peut même aller chercher des femmes qui ne sont pas spécifiquement compétentes sur le sujet traité, ce qui renforce le syndrome de l'imposteur. C'est davantage de travail et finalement, on est là juste pour le quota. »
Dès lors, la parité au sein des jurys de recrutement et comités de sélection entraîne une surcharge de travail pour les femmes scientifiques déjà en nombre insuffisant. Pour reprendre les mots de Patrick Flandrin, physicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, « s'il n'y a qu'un tiers de femmes dans le vivier et qu'on en exige 50 % dans les jurys, il y en aura forcément qui travailleront plus que d'autres ».
Les rapporteures estiment que cette « sur-sollicitation » des femmes dans les jurys constitue un enjeu majeur : ce déséquilibre crée un cercle vicieux, dans lequel une minorité assume une charge disproportionnée, avec un impact réel sur leur charge mentale et leur disponibilité. Il serait donc utile de réfléchir à des mécanismes de rééquilibrage de cet investissement.
Interrogé sur ce point précis par la délégation230(*), Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), a précisé que « la sursollicitation des femmes, notamment dans le cadre des comités de sélection universitaire, constitue une difficulté bien identifiée. La question reste complexe, car il n'est pas aisé d'affirmer qu'il faudrait désormais réduire la part des femmes dans certains dispositifs, au motif qu'elles y sont aujourd'hui surreprésentées. Cette situation s'explique en partie par une répartition inégale des charges et par le fait que toutes les activités ne bénéficient pas de la même reconnaissance institutionnelle. Il conviendrait sans doute d'envisager des mécanismes de régulation -- comme des plafonnements du temps passé en comités de sélection ou en présidence de jury --, mais la réflexion reste à approfondir. »
Cette surcharge de travail pour les femmes est également liée à une répartition inégale des tâches dans le monde académique.
Les femmes, davantage impliquées dans le suivi des étudiants et dans les missions d'accompagnement, cumulent souvent recherche, enseignement, responsabilités administratives et pédagogiques. Or, ces engagements ont longtemps été sous-évalués, voire sous-valorisés, dans l'évaluation des carrières universitaires.
Comme le faisait remarquer devant la délégation231(*) Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, les femmes sont souvent largement majoritaires dans les commissions universitaires à vocation pédagogique et sociale tandis les instances décisionnelles, en matière de gouvernance universitaire, de finance ou de recherche sont majoritairement dominées par des hommes. Elle en concluait que « cette répartition genrée des responsabilités au sein du monde académique (...) illustre une division persistante des rôles, qui influence la trajectoire des carrières scientifiques et universitaires ».
(4) Des inégalités salariales persistantes
Ces freins à la progression de carrière des femmes dans le domaine de la recherche scientifique sont également à l'origine d'écarts salariaux persistants entre femmes et hommes dans le milieu académique scientifique.
Ainsi que le rappelait Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes d'Aix-Marseille Université (amU), « il existe un point commun à toutes les disciplines scientifiques : la persistance d'un plafond de verre. (...) dans de nombreuses disciplines, nous observons 60 % à 70 % de femmes parmi les maîtres de conférences, mais à peine 30 % à 40 % parmi les professeurs d'université. Cette situation contribue également aux disparités salariales au sein des universités. En tout, 80 % des écarts de rémunération entre les sexes peuvent être attribués à la ségrégation des corps, c'est-à-dire à la sous-représentation des femmes dans les postes de rang A, quelle que soit la discipline. »
En outre, les statistiques publiées en mars 2025 par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche font état d'écarts de salaire entre femmes et hommes dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), de même que dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche232(*)
En 2022, un directeur de recherche homme d'un EPST sous tutelle du MESR perçoit en moyenne un salaire brut mensuel de 5 766 euros contre 5 619 euros pour une femme, soit un écart de 148 euros.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche233(*)
En moyenne, en 2022, l'écart entre le salaire brut mensuel d'un professeur des universités et celui d'une professeure des universités est de 243 euros et se décompose en 197 euros de traitement indiciaire et 46 euros de primes et indemnités.
c) La persistance de violences sexistes et sexuelles dans la recherche et les carrières scientifiques
Si l'on veut véritablement comprendre les raisons du phénomène de « tuyau percé » qui affecte les carrières des femmes scientifiques, il faut, une fois encore, s'intéresser à la prévalence de toute la palette des violences sexistes et sexuelles dans ce domaine : que ce soit le « sexisme ordinaire » encore profondément ancré dans le monde scientifique ou toutes les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes.
Pour reprendre les mots de May Morris234(*), directrice de recherches CNRS à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron, coordinatrice du programme de mentorat « Femmes et sciences » pour doctorantes à l'Université de Montpellier, membre du CA de EPWS (European platform for Women in Science), « le sexisme ordinaire, qu'il s'agisse de mansplaining, d'attitudes condescendantes ou de dénigrement, constitue un véritable facteur de mal-être. Ces comportements, banalisés, s'accumulent et finissent par peser lourdement sur les femmes, jusqu'à provoquer des départs ou des réorientations vers des environnements féminins, perçus comme des safe spaces. »
Une enquête menée par la Fondation L'Oréal en 2022 auprès des femmes scientifiques sur la prévalence des violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la recherche a mis en évidence la persistance de ces violences, comme le révèlent les données publiées ci-dessous.
Comme le révélait Françoise Conan, présidente de l'association Femmes & Sciences, au cours des séances d'accompagnement organisées dans le cadre de son programme de mentorat à destination des doctorantes, mis en place en 2015, les violences sexistes et sexuelles réapparaissent régulièrement dans les échanges, ce qui témoigne de difficultés subsistantes encore aujourd'hui malgré la prise de conscience qui s'est opérée notamment avec l'avènement du mouvement #metoo en 2017.
Certaines situations sont d'ailleurs plus propices que d'autres à la manifestation des violences sexistes et sexuelles, c'est le cas par exemple des congrès scientifiques. Une étude qualitative menée au CNRS par Farah Deruelle montre ainsi que, pour les scientifiques masculins seniors, ces congrès sont vécus comme une « parenthèse enchantée » où la séduction de jeunes collègues, voire l'aventure extra-conjugale, est considérée comme un des plaisirs du métier. Pour les jeunes chercheuses, au contraire, ces congrès constituent des zones à risque pour leur intégrité et leur carrière.
Le milieu de la recherche n'est évidemment pas le seul des milieux scientifiques concerné par cette persistance des VSS qui affecte le déroulement de carrière des femmes scientifiques.
Ainsi, l'association Elles bougent a mené en 2024 une enquête auprès de 6 000 femmes engagées dans des carrières scientifiques, qu'elles soient en poste ou en formation. Cette enquête a non seulement mis en évidence la persistance des stéréotypes de genre puisque 82 % des participantes déclarent avoir été confrontées à ces stéréotypes, mais elle a également révélé que 40 % des femmes interrogées craignent d'être confrontées à des violences sexistes et sexuelles au cours de leur carrières. En outre, 45 % des femmes actives attendent des mesures plus ambitieuses de la part des entreprises dans ce domaine. Ces violences sont particulièrement présentes au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, il est donc essentiel d'agir en amont.
Une autre enquête significative aux yeux des rapporteures, notamment parce qu'elle met en évidence le concept très intéressant de « pyramide des violences sexistes et sexuelles », est celle effectuée par l'association Les SouterReines235(*), rencontrée à l'occasion d'un déplacement des rapporteures dans la Meuse le 27 juin 2025.
Cette enquête réalisée auprès d'un échantillon de 133 répondantes évoluant dans le domaine très majoritairement masculin du BTP montre un continuum des violences sexistes et sexuelles, et permet une prise de conscience du caractère répandu de ces violences, à tous les niveaux hiérarchiques, sur le terrain et dans les bureaux.
Source : Association Les SouterReines (juin 2025)
3. De nombreuses femmes scientifiques au parcours inspirant oubliées, méconnues ou invisibilisées
Le faible taux de féminisation des carrières scientifiques, notamment dans le domaine de la recherche, doit également être relié à la question des modèles de femmes en sciences proposés aux jeunes filles qui pourraient vouloir se destiner à ce type de carrière.
a) Des modèles de femmes scientifiques parfois trop écrasants pour inspirer les jeunes filles aujourd'hui
Les modèles proposés peuvent être écrasants car trop impressionnants : c'est le cas, souvent cité au cours des travaux de la délégation, de Marie Curie, double prix Nobel, qui peut, comme le confiait à la délégation236(*) Emmanuel Trizac, président de l'ENS de Lyon, exercer un « effet repoussoir lié à la rhétorique de l'exceptionnalité ».
Comme l'expliquait devant la délégation237(*) Jacqueline Bloch, physicienne, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, « il est probable que les modèles de femmes en sciences proposés, qui sont peu nombreux, soient extrêmement impressionnants. Marie Curie est l'exemple emblématique d'une scientifique ayant reçu deux prix Nobel. Cependant, ce modèle peut être écrasant, surtout pour des jeunes filles qui manquent de confiance en elles. Il est crucial de présenter des scientifiques plus accessibles, notamment dans les classes, pour montrer que l'on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour réussir dans les sciences. »
De façon peut-être plus provocatrice, Alexandra Walczak, biophysicienne, directrice de recherche au CNRS et au Laboratoire de physique de l'École normale supérieure, membre de l'Académie des sciences, confiait à la délégation, lors d'une table ronde consacrée aux parcours de femmes scientifiques inspirantes : « nous avons besoin de davantage de femmes dites « moyennes ». Nous comptons déjà de nombreux hommes dits « moyens » et de femmes exceptionnelles. Cette affirmation peut sembler provocatrice, mais je crois sincèrement qu'elle est juste. »
Les rapporteures sont en effet convaincues de la nécessité de diffuser, auprès des jeunes, filles comme garçons, des modèles de femmes scientifiques « accessibles », leur permettant de s'identifier et de se projeter dans une carrière scientifique.
Comme le rappelait devant la délégation238(*) Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes d'Aix-Marseille Université, « bien qu'indispensables, tous les modèles ne s'avèrent pas efficaces. La littérature en psychologie sociale et cognitive a mis en lumière depuis plus de cinquante ans les conditions nécessaires à l'efficacité des modèles de réussite. Un modèle, qu'il soit scientifique ou d'un autre domaine, ne sera pertinent que s'il permet aux personnes de s'identifier à lui. »
À cet égard, Patrick Flandrin, physicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, a plaidé, auprès de la délégation239(*) pour la montée en puissance, en matière de représentation de femmes scientifiques, d'un « échelon intermédiaire » qui, jusqu'à un passé récent, faisait défaut, entre les lycéennes et les femmes scientifiques qui ont déjà des carrières très abouties mais restent exceptionnelles. Cet échelon est celui des doctorantes et des postdoctorantes, des jeunes femmes qui sont en train d'entrer dans la science et qui commencent à y faire carrière, avec déjà des résultats. Elles méritent d'être mises en avant. C'est une action que mène l'Académie des sciences en partenariat avec la fondation L'Oréal UNESCO, destinée à mettre en lumière les jeunes talents. Chaque année, 35 jeunes femmes, 20 doctorantes et 15 postdoctorantes sont reconnues tant pour leur travail que pour les projets qu'elles développent. »
Par ailleurs, l'Académie des sciences, elle-même, participe à cette volonté de féminisation des modèles scientifiques actuels et a récemment mis en place une politique pro-active de féminisation de ses membres.
La délégation a également souhaité, au cours de ses travaux, valoriser des parcours de femmes scientifiques inspirantes et accessibles. Ce fut notamment le cas lors de sa table ronde du 6 mars 2025, organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, sur le thème « Des femmes scientifiques aux parcours modèles et inspirants »240(*), qui a regroupé cinq femmes scientifiques issues de filières scientifiques très diverses (chirurgie, épidémiologie, glaciologie, biophysique et astrophysique), dont les parcours ont semblé aux rapporteures particulièrement inspirants pour les jeunes générations.
Au cours de cette table ronde, Kumiko Kotera, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, a insisté sur l'importance d'avoir des rôles modèles, y compris à un niveau avancé de sa propre carrière de scientifique. Elle a également souhaité adresser un message « aux jeunes filles (...) qui hésitent à se lancer dans la science, ou qui en ont peur, ou encore qui souhaitent s'y engager. Venez faire de la science et de la recherche telle que vous êtes en tant que femmes, avec vos doutes, avec votre force et vos délicatesses, avec vos élans bulldozers et vos réserves, votre rigueur, votre organisation, vos défauts, votre bazar, vos colères et votre sérénité, votre humanité, votre capacité à lire le monde d'un regard différent, votre artisanat, votre ingénierie, votre créativité et votre originalité. Et c'est tout ça qui fera que votre science sera belle. »
Les rapporteures ne sauraient mieux dire.
b) La persistance de « l'effet Matilda »
Outre la difficulté de diffuser des modèles de femmes scientifiques accessibles auprès des jeunes générations, notamment des jeunes filles, un autre phénomène historique a pu contribuer à minimiser le rôle des femmes dans les sciences et ainsi à invisibiliser certaines femmes scientifiques qui auraient pu jouer un rôle de modèle pour les jeunes générations : il s'agit de l'effet Matilda.
En effet, de nombreuses femmes scientifiques241(*) ont, par le passé, été invisibilisées et leurs découvertes et contributions à la science passées sous silence, selon le désormais connu « effet Matilda », concept développé dans les années 1980 par l'historienne des sciences Margaret Rossiter, en hommage à la militante féministe Matilda Joslyn Gage qui, dès la fin du XIXème siècle, avait dénoncé l'invisibilisation des femmes dans les sciences.
L'effet Matilda correspond au déni, à la spoliation ou à la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins.
Comme le suggérait devant la délégation242(*) Emmanuel Trizac, président de l'ENS de Lyon, « il est essentiel de considérer la question de la visibilité des modèles féminins, qui souffre d'un véritable phénomène d'éclipse. Ce phénomène, que nous avons qualifié par le passé d'« effet Matilda », désigne la minimisation des contributions des grandes scientifiques dans l'histoire. Un exemple notable est celui de Lise Meitner, physicienne pionnière dans le domaine de la fission nucléaire. Le prix Nobel a été attribué à son collaborateur, Otto Hahn, alors qu'elle en était également co-découvreuse. Cet exemple flagrant illustre le manque de reconnaissance accordée aux femmes scientifiques. Ce phénomène d'éclipse conduit à des asymétries de représentation importantes. Il est lié à la fois à l'histoire même des disciplines scientifiques et à la rareté des modèles féminins. »
C'est pourquoi les rapporteures se félicitent du projet243(*), initié par l'association Femmes & Sciences et la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, auquel participe notamment le CNRS, d'inscription de 72 noms de femmes scientifiques françaises sur la Tour Eiffel, aux côtés des 72 noms d'hommes scientifiques français qui y figurent déjà, inscrits en lettres dorées le long du premier étage, selon le même procédé technique et graphique.
Aujourd'hui bien documenté par les historiennes et historiens des sciences, l'effet Matilda est malheureusement toujours d'actualité, comme le soulignait Sophie Pochic244(*), directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS) et membre de la chaire « Femmes et science » de l'université Paris Dauphine-PSL, pour qui, « l'effet Matilda -- l'invisibilisation des femmes dans la production scientifique et la captation de leurs résultats par des collègues masculins --, mis en lumière par Margaret Rossiter, demeure d'actualité. Dans les grandes universités issues de fusions, de nouvelles hiérarchies se sont créées : certains hommes ont capté cumulativement les nouvelles ressources, notamment en sciences dures (LABEX, instituts convergences, chaires). Ces structures, temporaires, confient les missions transversales (égalité, diversité, VSS, communication, partenariats) à des contractuelles, souvent docteures, qui restent à la périphérie du monde académique. »
Au cours de leurs travaux, les rapporteures ont pu constater que ce phénomène n'avait pas disparu.
Elles ont, en effet, reçu le témoignage anonyme d'une chercheuse qui leur a confié avoir été spoliée, pendant son congé maternité, par un collègue chercheur, de données statistiques inédites collectées en vue d'une publication majeure dans une revue scientifique de renom, et avoir ensuite fait l'objet de « chantage » par ce chercheur afin que son nom soit associé à la future publication, faute de quoi il menaçait de publier, en avant-première, les données statistiques concernées. La chercheuse, pour ne pas compromettre la publication de son travail dans cette revue, a dû accepter d'ajouter le nom de ce collègue chercheur à celui des autres co-signataires de la recherche.
En outre, Mathieu Arbogast, chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au Centre national de recherche scientifique (CNRS), faisait également état devant la délégation245(*) du fait que « les femmes sont découragées de soumettre aux revues les plus prestigieuses et pénalisées dans les arbitrages sur l'ordre de signature ; leurs publications sont évaluées plus lentement ».
4. Le manque de femmes scientifiques : un enjeu d'égalité et de justice mais aussi d'innovation et de performance
Les raisons d'agir en faveur d'une plus grande mixité dans les métiers et carrières scientifiques sont multiples. Elles renvoient à la fois à des enjeux individuels mais aussi à des enjeux plus collectifs, d'ordre socio-économique.
En outre, si aucune politique publique volontariste ne prend ce sujet à bras le corps, il sera difficile voire impossible de rompre cette tendance. Nous sommes en effet face à un cercle vicieux selon lequel moins un milieu professionnel est féminisé, moins les femmes s'orientent vers ces métiers majoritairement masculins. De même, dans un milieu professionnel déjà très masculin, les recruteurs hésiteront à embaucher une femme de peur du risque d'inadéquation.
Comme le formulait très justement devant la délégation246(*) Cécile Jolly, économiste, cheffe de projet « Prospective des métiers et des qualifications » au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, « des recruteurs peuvent, implicitement, préférer recruter un homme dans un milieu masculin. Parallèlement, les femmes peuvent éprouver un malaise dans ces milieux, le sexisme demeurant la première cause de discrimination sur le marché du travail. Si la mixité ne garantit pas à elle seule l'égalité, elle en constitue néanmoins une condition indispensable. »
On estime qu'une proportion minimale de 30 % de femmes dans un secteur professionnel permet de donner un sentiment de mixité.
Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, estimait devant la délégation247(*) que « les talents féminins dans les métiers d'ingénieur ou de chercheur sont particulièrement recherchés et ce, de manière accrue ». En effet, comme évoqué précédemment, la pénurie d'ingénieurs et de personnels techniques scientifiques constatée en France nécessite d'accroître le vivier disponible en ouvrant massivement ces voies professionnelles aux femmes.
a) Un enjeu d'équité et de justice sociale
Les femmes sont aujourd'hui sous-représentées dans les métiers d'avenir et dans les secteurs les plus rémunérateurs.
Or, dans le prolongement des carrières en mathématiques, en informatique, dans les sciences et l'ingénierie, se joue la question de la rémunération dès le début de la carrière, avec des écarts entre hommes et femmes qui deviennent massifs dès l'entrée dans le monde professionnel.
Ainsi que le rappelait248(*) Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine, « les études scientifiques conduisent, en général, à des emplois mieux rémunérés. Selon différentes études, ces différences expliqueraient entre 20 et 30 % des écarts salariaux constatés sur le marché du travail (...). En outre, les filières scientifiques concentrent souvent les plus fortes dépenses publiques et bénéficient d'un encadrement renforcé ».
b) Un enjeu d'efficacité scientifique
Pour reprendre les mots de Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, « si les secteurs scientifiques, comme la physique, les mathématiques, le numérique ou les sciences de l'ingénieur, étaient exclusivement dominés par les hommes, certaines recherches ne seraient pas menées et certaines découvertes ne verraient jamais le jour. Le monde serait alors construit par et pour les hommes. »
La mixité dans les sciences est, en effet, gage d'efficacité et de dynamisme, notamment dans le domaine de la recherche scientifique.
Comme le formulait très justement Emmanuel Trizac, président de l'ENS de Lyon, « il est absurde de se priver de la moitié des cerveaux disponibles. Le talent n'a pas de genre, et nous avons besoin de toutes les compétences pour faire face aux défis qui se posent à nous, qu'il s'agisse du changement climatique, des avancées en physique quantique ou des enjeux de l'intelligence artificielle. »
De plus, la présence des femmes dans les équipes de travail contribue à améliorer leur fonctionnement et permet d'éviter certains biais dans les organisations, les procédures ou les protocoles expérimentaux.
Plusieurs exemples illustrent comment la sous-représentation des femmes a limité la qualité des productions scientifiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la médecine ou encore de la sécurité routière.
Ainsi, pendant longtemps, les tests d'airbags ont été effectués avec des mannequins de 80 kg et mesurant 1,80 mètre. Ce protocole était non seulement inadapté à la moitié de la population, mais il pouvait également se révéler dangereux. Il en va de même pour les tests de médicaments antiviraux, qui, pendant longtemps, ont été réalisés sur des cohortes majoritairement masculines.
Dès lors, pour Elyes Jouini, titulaire de la chaire « Femmes et science » de l'Université Paris Dauphine-PSL, « se priver d'un tel vivier de talents revient à collectivement s'affaiblir de manière significative. (...) la science elle-même subit un appauvrissement considérable du fait de la sous-représentation des femmes, le progrès scientifique reposant indéniablement sur la richesse et la diversité des points de vue. »
c) Un enjeu de souveraineté et de puissance économique.
Le contexte économique actuel, marqué par l'essor des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, exige une plus grande diversité des recrutements dans des secteurs aujourd'hui en forte demande. En effet, les métiers de demain exigeront encore plus de compétences scientifiques.
Comme le rappelait Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, il s'agit d'un « enjeu de souveraineté et de puissance économique pour la France. Le marché du travail accuse un déficit de dizaines de milliers d'ingénieurs. Nous avons besoin d'ingénieurs pour garantir l'autonomie stratégique et le développement technologique de la France et de l'Europe. »
En outre, comme le soulignait Sylvie Retailleau devant la délégation, le dynamisme des secteurs professionnels scientifiques et leur mixité sont également fondamentaux pour la cohésion sociale et territoriale. En effet, les laboratoires, les entreprises et les collectivités jouent un rôle essentiel dans le dynamisme des territoires, contribuant ainsi à leur développement et à leur cohésion.
Pour la délégation, il apparaît donc essentiel de sensibiliser les employeurs et les décideurs à l'apport déterminant de la diversité dans les milieux scientifiques. La présence accrue des femmes dans les équipes constitue un facteur reconnu de créativité, d'innovation et d'efficacité, tant dans les laboratoires de recherche que dans les entreprises. Les stéréotypes de genre et la faible représentation des femmes dans les métiers d'avenir, notamment ceux liés aux technologies et à l'intelligence artificielle, génèrent des coûts économiques préjudiciables pour la cohésion globale de notre société.
B. RECOMMANDATIONS : FACILITER LE RECRUTEMENT ET LA POURSUITE DE CARRIÈRE DES FEMMES
La féminisation des secteurs professionnels scientifiques, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans celui de l'ingénierie notamment, peut s'appuyer sur diverses mesures, que ce soit dans le domaine des procédures de recrutement et de promotion des femmes scientifiques, celui de la facilitation des carrières des femmes du point de vue notamment de la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale, enfin celui de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
1. Ajuster les procédures de recrutement et de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs
S'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche, la délégation recommande plusieurs mesures qui permettraient de favoriser les candidatures féminines au stade des procédures de recrutement et de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs, parmi lesquelles :
- de possibles quotas de genre pour le recrutement et les promotions de femmes ;
- des formations aux biais de genre des jurys de recrutement et comités de sélection ;
- ainsi que la mise en oeuvre de programmes d'accompagnement et de mentorat des femmes vers des postes à responsabilité.
Pour remédier à la question du recrutement tardif, peu compatible avec une vie de famille et qui précarise les jeunes chercheurs et chercheuses, et plus particulièrement les femmes, une solution proposée est de créer davantage de postes de maîtres de conférences, à un niveau de responsabilité permettant aux jeunes de candidater afin d'élargir le vivier et d'éviter une hyper-sélection préjudiciable aux femmes.
Comme Marina Kvaskoff, épidémiologiste et chercheuse à l'INSERM, qui s'exprimait devant la délégation à l'occasion d'une table ronde249(*) consacrée aux parcours de femmes scientifiques inspirantes, les rapporteures considèrent « fondamental de renforcer les dispositifs de soutien favorisant la poursuite des carrières féminines dans la recherche, tels que les plans d'égalité professionnelle, déjà mis en place à l'INSERM ou au CNRS, la formation des membres de jurys et de commissions, l'instauration de quotas de femmes, ou encore la mise en place de réseaux d'entraide et de mentorat. L'ensemble de ces initiatives joue un rôle clé dans la promotion des femmes dans les sciences. »
La mise en oeuvre de quotas de genre doit être étudiée notamment pour :
- les primo-recrutements d'enseignants en CPGE dans chaque discipline, et de chercheurs dans chaque institut du CNRS et à l'INRIA ;
- l'accès aux postes à responsabilité, notamment les postes de professeurs des universités ou de directeurs/directrices de recherche.
Ainsi que le rappelait Marina Kvaskoff lors de son intervention devant la délégation, « la question des quotas est surtout pertinente pour l'accès aux postes à responsabilité, où l'on observe un véritable déséquilibre. Les données disponibles, qu'il s'agisse de celles de l'INSERM, du CNRS ou d'autres organismes, montrent clairement une tendance récurrente : les femmes sont bien représentées dans les niveaux les plus bas de la hiérarchie, mais leur présence diminue drastiquement à mesure que l'on progresse vers des postes plus seniors. C'est précisément à ce niveau que les quotas jouent un rôle essentiel, car ils permettent de rétablir des proportions plus justes et de corriger ces déséquilibres structurels. »
De même, Kumiko Kotera, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, soulignait que, dans les domaines de l'astrophysique et de la physique, le vivier de femmes en doctorat et post-doctorat était conséquent mais que, en astrophysique notamment, une rupture dans les effectifs féminins se manifeste environ quatre ans après la soutenance de thèse, moment où nombre de jeunes femmes - qui représentent encore 30 % des effectifs - choisissent de renoncer à la recherche, souvent pour des raisons familiales.
Au sein du CNRS, s'agissant des promotions et accès aux responsabilités, les comités sont invités à promouvoir les femmes à proportion de leur présence dans le vivier de promouvables, même en cas de sous-représentation dans les candidatures. Par ailleurs, le Comité parité-égalité a formulé des propositions pour accroître la part des directrices de laboratoire, encore trop faible.
Pour mieux identifier les femmes à promouvoir et ainsi élargir le vivier des candidates, la mise en place de « search committees », sur le modèle universitaire américain, pourrait également être envisagée. Ces structures, mandatées par les établissements de recherche, auraient pour mission de rechercher activement des chercheuses qualifiées susceptibles d'accéder à des postes à responsabilité, y compris parmi les femmes qui ne se portent pas spontanément candidates. Avant chaque campagne de recrutement ou de promotion, ils seraient chargés d'établir une liste de profils féminins qualifiés, proposée aux jurys et comités de sélection.
Sur le modèle des mesures mises en place par Aix-Marseille Université, la délégation recommande également une formation obligatoire à la déconstruction des biais implicites de genre et à l'égalité femmes-hommes de tous les membres des jurys de recrutement et comités de sélection des universités.
La délégation recommande également de diversifier et objectiver les critères d'évaluation et de promotion dans le domaine de la recherche afin de ne pas valoriser uniquement les parcours masculins et de mettre en avant les contributions collectives ou pédagogiques, les participations à des jurys de recrutement, à des actions en faveur de l'égalité professionnelle, souvent sous-estimées et effectuées à titre bénévole alors qu'elles constituent souvent une part importante du travail des chercheuses.
Pour faciliter le déroulement de carrière des femmes scientifiques dans le domaine de la recherche et les accompagner vers des postes à responsabilité, la délégation recommande la généralisation de programme de mentorat et d'accompagnement, sur le modèle du programme de mentorat à destination des doctorantes mis en place par May Morris à l'Université de Montpellier. Ce dispositif constitue à la fois un réseau d'entraide, de soutien et d'accompagnement, ainsi qu'un vecteur de diffusion progressive de bonnes pratiques au sein des institutions scientifiques.
Le taux d'insertion professionnelle à l'issue de ce programme atteint près de 70 % dans les trois mois suivant la soutenance de thèse, témoignant de l'efficacité du programme pour enrayer le phénomène du tuyau percé et favoriser le maintien des femmes dans les carrières scientifiques.
Un point d'attention particulier porte sur la reconnaissance de l'engagement des mentors. Alors que les femmes supportent souvent une charge bénévole importante, sans compensation, il conviendrait d'envisager une valorisation effective de cet investissement. Celle-ci pourrait ne pas être uniquement financière, mais également intégrée dans les parcours de carrière, à l'image de ce qui se pratique en Suisse ou en Allemagne, où le mentorat est reconnu comme un critère dans les promotions professionnelles.
Enfin, la délégation recommande de rendre obligatoire la publication annuelle de données sexuées (recrutement, promotions, rémunérations) dans l'ensemble des établissements scientifiques publics et privés.
|
Recommandation n° 17 : Favoriser la féminisation du corps des enseignants et enseignants-chercheurs dans le domaine scientifique en agissant sur les procédures de recrutement et de promotion (quotas, formation des jurys aux biais de genre, révision des critères d'évaluation, programmes de mentorat, etc.) |
2. Valoriser des politiques de recrutement et de promotion positives et proactives en faveur des femmes au sein des entreprises
Pour une plus grande mixité au sein des carrières scientifiques dans l'entreprise, notamment au sein des métiers de l'ingénierie, il est indispensable de sensibiliser les chefs d'entreprises et les directions des ressources humaines (DRH) aux enjeux de la diversité des recrutements comme facteur d'innovation et de performance économique.
En outre, dans un contexte de pénurie d'ingénieurs, il en va de la survie économique des entreprises d'ingénierie de diversifier leurs recrutements et d'embaucher plus de femmes. Une fois au sein de l'entreprise, les femmes doivent également être promues à des postes de direction, dans les comités de direction (Codir) et les comités exécutifs (Comex).
C'est d'ailleurs l'objet de la loi250(*) du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité professionnelle et économique, dite Loi Rixain, qui, en instaurant une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les postes de direction des grandes entreprises, doit contribuer à la féminisation des recrutements, notamment dans les entreprises où l'on constate un manque de femmes, afin de constituer un vivier destiné à pourvoir à la nomination de femmes aux postes de direction. Ainsi, l'article 14 de la loi précitée crée une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises, accompagnée d'une obligation de transparence en la matière.
Ces obligations concernent toutes les entreprises d'au moins 1 000 salariés :
- à compter du 1er mars 2026 : elles doivent atteindre un objectif d'au moins 30 % de femmes et d'hommes cadres dirigeants et d'au moins 30 % de femmes et d'hommes membres d'instances dirigeantes. Dans le cas où ces objectifs ne sont pas atteints, l'entreprise concernée doit définir des mesures adéquates et pertinentes de correction ;
- à compter du 1er mars 2029 : les objectifs chiffrés passent de 30 % à 40 %.
La transposition en France de la directive européenne relative à la transparence des rémunérations n° 2023/970, qui impose de nouvelles obligations aux employeurs, tant lors du recrutement des salariés que pendant la durée du contrat de travail, afin de renforcer la transparence salariale et mieux lutter contre les inégalités salariales entre femmes et hommes, pourrait également être l'occasion d'ajouter aux indicateurs de transparence sur les salaires des indicateurs de progression de la mixité dans les entreprises, notamment dans les secteurs les moins féminisés comme ceux de l'ingénierie.
La délégation est également favorable à une réflexion plus poussée concernant l'éga-conditionnalité des aides publiques à la recherche, type crédit d'impôt recherche (CIR) ou convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), qui constitue une aide au recrutement des doctorants en entreprise et permet aux entreprises de bénéficier d'une aide financière pour recruter de jeunes doctorants dont les projets de recherche, menés en liaison avec un laboratoire extérieur, conduiront à la soutenance d'une thèse.
Le versement de ces aides publiques aux entreprises pourrait ainsi être conditionné au respect de critères de mixité et d'égalité femmes-hommes.
Enfin, la délégation estime nécessaire de valoriser, au sein des entreprises, l'engagement de femmes et d'hommes en faveur d'une progression de la mixité dans les secteurs peu féminisés, grâce, par exemple, au développement du recours au mécénat de compétences, qui permet à une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d'un organisme d'intérêt général. Ceux-ci vont mobiliser pendant un temps leurs compétences ou leur force de travail. La mise à disposition du salarié se fait sur son temps de travail, avec des conditions fiscales avantageuses. Ce type de dispositif facilite, par exemple, l'implication de salariés, femmes et hommes, dans des associations oeuvrant dans le domaine de la mixité dans les sciences, telles que les associations Elles Bougent ou Femmes ingénieures, entendues par la délégation et qui font un travail très utile en faveur de la féminisation des métiers scientifiques.
Le développement de prix dédiés aux femmes scientifiques et ingénieures, tels que le Prix ingénieuses, remis par la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et dont est partenaire l'association Femmes ingénieures, les Trophées des femmes de l'industrie ou encore le prix L'Oréal UNESCO déjà évoqué précédemment, sont de nature à accroître la visibilité des femmes scientifiques. Si l'existence de prix spécifiquement dédiés aux femmes scientifiques peut sembler discutable, la délégation estime qu'ils sont néanmoins utiles et peuvent, ainsi que le soulignait Patrick Flandrin, membre de l'Académie des sciences251(*), « jouer un rôle utile de déclencheur, comme un quota » et « visibiliser les femmes scientifiques, en particulier pour les nombreuses qui ne sont pas primées mais dont on a étudié les dossiers et qui pourront recevoir d'autres distinctions, non genrées cette fois. »
Enfin, cela peut sembler anecdotique ou symbolique, mais la féminisation des noms de métiers scientifiques peut également participer à une évolution des mentalités. Comme le rappelait Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, devant la délégation252(*), « la question du genre dans les représentations professionnelles demeure prégnante. L'usage du masculin pour désigner certaines professions contribue à perpétuer ces stéréotypes, tandis que la féminisation des noms de métiers, que permet notre langue, peut constituer un levier pour en atténuer les effets. »
|
Recommandation n° 18 : Dynamiser le recrutement et la promotion de femmes au sein des entreprises du secteur scientifique (sensibilisation des employeurs aux enjeux de mixité, éga-conditionnalité de certaines aides publiques, prix dédiés aux femmes scientifiques et ingénieures, féminisation de tous les noms de métiers scientifiques). |
3. Faciliter le déroulé de carrière des femmes scientifiques
Pour éviter le phénomène du tuyau percé et maintenir les femmes dans les carrières scientifiques, une attention particulière doit être portée aux conditions de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale avec des mesures qui pourraient, de fait, également bénéficier aux hommes.
La délégation préconise notamment d'envisager :
- une réforme du congé paternité et du congé parental pour une plus grande égalité dans le déroulé de carrière des pères et des mères.
Ainsi que le rappelait fort justement Kumiko Kotera253(*), astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, « tant que nous ne reconnaîtrons pas de manière significative le rôle des pères, en introduisant des congés paternité obligatoires et de longue durée, et en renforçant cette mesure dans les entreprises, dans le secteur de la recherche et dans toutes les sphères de la société, je suis convaincue que les femmes continueront à travailler avec un handicap. »
Heïdi Sevestre, glaciologue à l'Université du Svalbard en Norvège et membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, rappelait que le congé parental constitue un élément clé qui favorise l'égalité femmes-hommes en Norvège dans le domaine de la recherche scientifique, notamment pour l'accès aux postes à responsabilité. En Scandinavie, ce congé est particulièrement avantageux : quarante-neuf semaines de congé rémunérées à 100 %, ou une année complète avec un salaire maintenu à 80 %. Surtout, quinze semaines de congé maternité et paternité sont obligatoires. Ce dispositif garantit que les deux parents bénéficient d'un temps de présence équitable avec leur enfant. En Norvège, les conditions de travail, les salaires et la qualité de vie sont donc pensés pour favoriser un véritable équilibre et une solidarité au sein des équipes.
- des mesures de nature à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale notamment pour les jeunes parents : allègement des charges administratives et pédagogiques des chercheuses au retour de congé maternité ; décharges d'enseignement et un soutien spécifique aux jeunes parents chercheurs ; valorisation du travail collectif et en équipe permettant d'assurer une continuité des travaux même en l'absence d'un membre de l'équipe, de continuer à encadrer les étudiants et de répartir les tâches de manière plus efficace ; développement de dispositifs de gardes d'enfants au sein des instituts de recherche et des universités.
|
Recommandation n° 19 : Favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des jeunes chercheuses et chercheurs, en envisageant une réforme des congés parentaux et des mesures destinées à soutenir les jeunes parents chercheurs, notamment les femmes à leur retour de congé maternité. |
4. Renforcer la lutte contre le sexisme ordinaire et les VSS
La délégation en est convaincue : le renforcement de la lutte contre le sexisme ordinaire et les violences sexistes et sexuelles dans les secteurs scientifiques contribuera non seulement au maintien des femmes dans ces secteurs, mais aussi au dynamisme de ces secteurs en participant à la féminisation de leur recrutement.
Avant tout, comme on l'a vu précédemment, il est nécessaire de créer un espace considéré comme protecteur pour que les femmes restent dans les métiers scientifiques. C'est la notion de safe space développé par May Morris, directrice de recherches CNRS à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron, coordinatrice du programme de mentorat « Femmes et sciences » pour doctorantes à l'Université de Montpellier, au cours de la table ronde consacrée aux inégalités dans le recrutement et le déroulement de la carrière des femmes scientifiques.
Il s'agit de garantir, au-delà d'un simple espace d'écoute ponctuel, un espace protecteur pérenne où les jeunes femmes peuvent s'exprimer sans crainte de répercussions, être écoutées avec bienveillance et accompagnées. Ces espaces doivent, en outre, être conçus non pas comme des dispositifs à la marge, mais comme des éléments structurants de toute politique d'égalité.
Ces espaces protecteurs, ou safe space, s'inscrivent dans un réseau de mentorat transversal permettant notamment de faire émerger des situations problématiques.
La délégation recommande également la mise en oeuvre de politiques en faveur de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les VSS dans l'ensemble des organisations académiques. C'est déjà le cas dans beaucoup d'organisations académiques, dont le CNRS, qui ont souvent mis en place ces politiques, sous la pression de l'État et de l'Union européenne.
La délégation recommande des mesures pour aller plus loin, telles que la désignation dans chaque laboratoire d'un référent VSS formé ; la présence obligatoire de référents VSS et une parité d'intervenants lors des grandes conférences scientifiques254(*) ; l'inclusion d'engagements contre les VSS dans les chartes de financement public.
Il convient aussi de mieux valoriser le travail des chargées de mission égalité et diversité, très majoritairement des femmes, rarement à temps plein et qui engagent un investissement individuel considérable. Malgré des moyens faibles et limités, elles doivent gérer des missions toujours plus extensives (égalité, VSS, racisme, LGBT).
La délégation recommande également de veiller à inclure dans ces politiques d'égalité et de lutte contre les VSS les carrières des techniciennes et administratives. Ces dernières représentent parfois la moitié du personnel des organisations académiques : ainsi, au CNRS par exemple, 65 % des IT (personnels ingénieurs et techniciens) sont des femmes, mais seulement 32 % détiennent le grade d'ingénieure de recherche. Le CNRS a désormais pleinement intégré les IT dans son plan d'action pour l'égalité professionnelle 2024-2026.
Comme le soulignait Sophie Pochic255(*), directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS), « les politiques d'égalité restent concentrées sur les carrières scientifiques et les plus hauts grades, laissant de côté le personnel technique et support. Or, sans gestionnaires, chargées de mission, secrétaires pédagogiques, laborantines ou techniciennes, aucune activité scientifique ou pédagogique n'est possible. Ces « petites mains » ont longtemps été les grandes oubliées des politiques d'égalité. »
S'agissant du secteur privé, la délégation recommande, comme le suggère l'association Elles bougent, que la formation à la lutte contre les violences sexistes et à la culture de l'égalité soit rendue obligatoire dans les entreprises, à tous les niveaux, et notamment auprès des managers et des décideurs, dans une perspective d'intégration complète à la politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
|
Recommandation n° 20 : Renforcer les dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les secteurs professionnels scientifiques, publics comme privés, afin de créer des espaces protecteurs pour les femmes et contribuer à leur maintien dans les carrières scientifiques. |
LISTE DES RECOMMANDATIONS
CONVAINCRE LES FILLES ET LEURS ENSEIGNANTS
QUE LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES SONT
AUSSI FAITES
POUR ELLES
Recommandation n° 1 : Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles, futurs comme actuels, et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes.
Recommandation n° 2 : Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et leur transmettre des indicateurs statistiques portant sur les écarts de résultats filles-garçons, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle de leur établissement, afin d'engager une prise de conscience, de leur permettre de suivre la situation spécifique de leurs élèves et d'évaluer l'impact des actions mises en place.
Recommandation n° 3 : Réaliser un bilan des séances de sensibilisation des professeurs de l'éducation nationale aux biais de genre qui devaient être menées à la rentrée 2025, afin de reconduire cette initiative de façon plus efficace à chaque rentrée scolaire.
Recommandation n° 4 : Former l'ensemble des professeurs des écoles à la pédagogie égalitaire, et en particulier à une pédagogie égalitaire des mathématiques, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine, en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes et en évaluant l'efficacité de ces formations.
Recommandation n° 5 : Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et à la déconstruction des stéréotypes et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires.
Recommandation n° 6 : Inclure, dans le rapport annuel de l'Arcom sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio, des données sur la proportion de femmes scientifiques à l'antenne et leur temps de parole ainsi que sur leur représentation dans les programmes de fiction diffusés, et renforcer les actions d'incitation et de contrôle à disposition de l'Arcom à l'égard des acteurs du secteur audiovisuel afin d'augmenter cette représentation.
Recommandation n° 7 : Soutenir la médiation scientifique, dans et hors des établissements scolaires, notamment en garantissant l'avenir du Palais de la Découverte, en facilitant les interventions de doctorantes et doctorants dans les écoles et en finançant des sorties et activités post et périscolaires scientifiques sur l'ensemble du territoire.
RÉÉCRIRE L'ÉQUATION POUR
ENCOURAGER L'ENVIE
DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES
Recommandation n° 8 : Faire connaître les études et métiers scientifiques aux collégiennes et lycéennes et mettre en valeur leur utilité sociale, en actualisant la présentation des métiers et formations sur les plateformes Onisep et Parcoursup, en menant des campagnes de communication, en finançant des clubs et stages scientifiques et en soutenant des programmes d'immersion dans l'enseignement supérieur ou en entreprise à destination des élèves mais aussi de leurs professeurs.
Recommandation n° 9 : Organiser des campagnes de communication et des interventions dans les établissements scolaires autour de jeunes femmes scientifiques constituant des rôles modèles à la fois inspirants et accessibles.
Recommandation n° 10 : Former l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à la prévention et la lutte contre les stéréotypes et biais de genre, avec une priorité donnée aux enseignants de mathématiques et en s'appuyant sur les acquis de la recherche et les observations croisées de classe.
Recommandation n° 11 : Transmettre une culture d'égalité aux jeunes, en abandonnant l'idée de changer ou encourager les filles et en agissant davantage sur les représentations et attitudes des garçons.
Recommandation n° 12 : Mettre en place un véritable service public de l'orientation, sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et associant les familles.
CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET
PROTECTEUR POUR LES ÉTUDIANTES, EN EXPÉRIMENTANT
DE NOUVELLES
SOLUTIONS
Recommandation n° 13 : Expérimenter des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique à différents degrés et niveaux de la scolarité.
Recommandation n° 14 : Développer des dispositifs incitatifs et accueillants pour les filles souhaitant s'orienter vers des filières scientifiques sélectives : bourses dédiées, places en internat, espaces temporaires de non-mixité.
Recommandation n° 15 : Repenser les processus de sélection au sein des filières scientifiques, en adaptant les épreuves des concours d'entrée aux grandes écoles, et favoriser l'hybridation des parcours et les passerelles entre formations.
Recommandation n° 16 : Rendre obligatoire, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur scientifique, la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que les formations du personnel académique sur ces questions.
FACILITER LE RECRUTEMENT ET LA POURSUITE DE
CARRIÈRE
DES FEMMES SCIENTIFIQUES
Recommandation n° 17 : Favoriser la féminisation du corps des enseignants et enseignants-chercheurs dans le domaine scientifique en agissant sur les procédures de recrutement et de promotion (quotas, formation des jurys aux biais de genre, révision des critères d'évaluation, programmes de mentorat, etc.)
Recommandation n° 18 : Dynamiser le recrutement et la promotion de femmes au sein des entreprises du secteur scientifique (sensibilisation des employeurs aux enjeux de mixité, éga-conditionnalité de certaines aides publiques, prix dédiés aux femmes scientifiques et ingénieures, féminisation de tous les noms de métiers scientifiques).
Recommandation n° 19 : Favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des jeunes chercheuses et chercheurs, en envisageant une réforme des congés parentaux et des mesures destinées à soutenir les jeunes parents chercheurs, notamment les femmes à leur retour de congé maternité.
Recommandation n° 20 : Renforcer les dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les secteurs professionnels scientifiques, publics comme privés, afin de créer des espaces protecteurs pour les femmes et contribuer à leur maintien dans les carrières scientifiques.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Réunie le mardi 7 octobre 2025, sous la présidence de Dominique Vérien, présidente, la délégation a examiné le présent rapport d'information.
Dominique Vérien, présidente. - Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui notre rapport consacré à la place des femmes dans les sciences auquel nous avons consacré la majeure partie de nos travaux au cours de la session dernière.
C'est un rapport très attendu non seulement par notre délégation mais aussi par l'ensemble des interlocuteurs de la communauté scientifique que nous avons rencontrés au cours de nos travaux, environ 120 au total au cours de 80 heures d'auditions et de six déplacements en France et à l'étranger !
Je souhaite, pour commencer, rappeler que l'enjeu ici n'est pas celui de l'accès des filles et des femmes aux sciences de façon générale, mais bien aux mathématiques, aux sciences physiques et chimiques, à l'informatique et aux sciences de l'ingénieur (les filières dites STIM).
En effet, si les femmes sont nombreuses dans les sciences médicales et les sciences du vivant et de la terre ou la biologie par exemple, elles ne représentent qu'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France.
Comme vous le savez, en tant qu'ingénieure en travaux publics, c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur. Féminiser les sciences, ce n'est pas seulement un enjeu de justice et d'égalité. C'est aussi un enjeu d'innovation et de compétitivité pour notre recherche et nos entreprises, en un mot de souveraineté nationale.
Nos quatre collègues rapporteures, Marie-Do Aeschlimann, Jocelyne Antoine, Laure Darcos et Marie-Pierre Monier, ont travaillé sur ce sujet pendant plus de six mois.
Nous avons entendu plus d'une centaine de personnes lors d'auditions et tables rondes au Sénat : des femmes chercheuses ou ingénieures inspirantes, des chercheurs en sociologie, économie, psychologie ou sciences cognitives, des directeurs de grandes écoles, des professeurs du primaire, du secondaire et du supérieur, des étudiantes et alumni, des acteurs associatifs ou encore des représentants de l'État et des collectivités territoriales.
Nous avons également effectué plusieurs visites de terrain, sur le campus de Paris-Saclay, à l'institut Curie, au lycée Louis-le-Grand ou encore dans la Meuse, à l'invitation de notre collègue Jocelyne Antoine. Nous nous sommes également rendues au Portugal, à Lisbonne, pour nous inspirer de leurs actions en matière de diffusion de la culture scientifique auprès du grand public, et notamment du jeune public.
Nos auditions ont d'ores et déjà eu le mérite de mettre en lumière des femmes scientifiques aux parcours inspirants.
Chers collègues, vous avez sous les yeux l'Essentiel du rapport, c'est-à-dire sa synthèse. Vous avez reçu ce document hier ainsi que la liste des 20 recommandations proposées par les rapporteures.
Comme vous le voyez, il se découpe en quatre grands temps :
· l'école primaire ;
· l'enseignement secondaire et les choix d'orientation ;
· l'enseignement supérieur ;
· et enfin les carrières professionnelles.
Je laisse sans plus tarder la parole aux rapporteures, à commencer par notre collègue Jocelyne Antoine pour aborder le premier grand temps de notre rapport, celui de l'école primaire.
Jocelyne Antoine, rapporteure. - La sous-représentation des femmes dans les études et carrières scientifiques est la conséquence d'une insuffisante orientation des filles vers les filières et spécialités scientifiques au lycée puis dans les études supérieures, mais aussi de différences de représentations et de résultats entre filles et garçons dès l'école primaire, en particulier en mathématiques. C'est sur l'intégralité du parcours scolaire qu'il faut donc se pencher, et singulièrement sur l'école primaire, que nous avons identifiée comme une étape clé dans la construction des écarts de performance entre filles et garçons.
En effet, alors que filles et garçons ont des résultats similaires à l'entrée en CP, dès quatre mois de CP et d'enseignement formel des mathématiques, une nette avance des garçons apparaît, qui ne fait que s'accroître tout au long des années de primaire.
Ce phénomène est global : il se retrouve quel que soit le contexte social, familial et territorial et l'environnement scolaire.
Cependant, les écarts sont encore plus précoces et marqués chez les enfants issus de familles très favorisées, sans doute parce qu'elles encouragent davantage la compétitivité académique de leurs fils.
Certes, les écarts filles-garçons en mathématiques se retrouvent dans tous les pays de l'Union européenne et de l'OCDE, mais nous sommes le pays où les écarts sont les plus marqués.
Alors comment expliquer ces écarts ?
Il convient de rappeler - s'il en était besoin - qu'il n'existe aucune différence à la naissance entre le cerveau des petites filles et celui des petits garçons, qui ont un sens du nombre identique. Les différences qui apparaissent vers l'âge de six ans sont uniquement la conséquence des stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants sont confrontés dans leur environnement dès le plus jeune âge et qu'ils intériorisent.
Ces stéréotypes sont présents :
· à la maison, dans les interactions avec leurs parents, qui encouragent davantage la motricité, l'autonomie et la compétition des garçons ;
· à l'école, où les garçons interviennent davantage, en particulier sur des questions de réflexion, là où les filles sont interrogées sur des questions de mémorisation. En outre, les enseignants/enseignantes - qui sont, il faut le rappeler, aux trois quarts des femmes ayant suivi un cursus littéraire - peuvent transmettre leur anxiété ou, en tous cas, leur moindre appétence des mathématiques à leurs élèves filles - un effet mimétique qu'on ne retrouve pas avec leurs élèves garçons ;
· ces stéréotypes sont aussi présents dans tout l'environnement socio-culturel des enfants, les dessins animés, les magazines...
À six ans, les enfants associent déjà le talent intellectuel et mathématique à la figure masculine.
Face à ces constats, nous sommes donc convaincues de la priorité d'agir dès le plus jeune âge.
Le premier levier à activer est celui de la formation de leurs enseignants et enseignantes, plus particulièrement sur deux volets :
· d'une part, la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles qui doivent être renforcées afin qu'ils et elles soient plus à l'aise pour enseigner cette discipline ;
· d'autre part, la sensibilisation aux biais de genre à la pédagogie égalitaire, qui doit être intégrée au concours, en privilégiant notamment la formation entre pairs.
Plus globalement, la culture de l'égalité doit davantage se diffuser au sein des établissements scolaires, et notamment des contenus pédagogiques.
Nous formulons également plusieurs recommandations afin de développer la culture scientifique pour toutes et tous, dans tous les territoires.
La médiation, les stages, les sorties scolaires et les médias à caractère scientifique sont des vecteurs qu'il faut davantage mobiliser. C'est en voyant des femmes et des filles pratiquer et aimer les sciences que l'on convaincra les petites filles que ces disciplines sont faites pour elles.
Je laisse désormais la parole à notre collègue rapporteure Marie-Do Aeschlimann pour le deuxième temps fort du rapport : le collège, le lycée et l'orientation vers les études supérieures.
Marie-Do Aeschlimann, rapporteure. - Après le temps de l'école primaire, vient le temps du collège et du lycée et des premiers choix d'orientation. Une étape charnière car si les bons choix d'options ne sont pas faits à 14-15 ans, il est ensuite compliqué de rejoindre un parcours professionnel à forte dimension scientifique et mathématique.
Or, ces choix sont encore extrêmement genrés aujourd'hui. Et l'on peut douter de leur caractère entièrement libre et éclairé au vu des inégalités, des pressions et des stéréotypes sexistes auxquels les jeunes filles font face.
Si l'écart de niveaux entre filles et garçons en mathématiques tend à se réduire au cours du collège, on note en revanche de réelles différences dans leur rapport à cette discipline : 59 % des garçons déclarent aimer cette discipline et 54 % sont confiants dans leurs capacités dans cette discipline, contre respectivement 42 et 40 % des filles.
Les garçons restent perçus dans leur ensemble, par eux-mêmes, leurs camarades, leurs familles et leurs enseignants, comme étant meilleurs en mathématiques et en sciences. Un sondage récent de France Stratégie montre qu'un quart des jeunes de 11-17 ans pense que les garçons ont davantage l'esprit scientifique que les filles.
Au lycée, les filles font très nettement moins que les garçons le choix de filières et spécialités scientifiques. Certes, elles sont plus nombreuses que les garçons à accéder à une seconde générale et technologique, mais en terminale générale :
· seul un tiers des filles choisissent une combinaison de deux spécialités scientifiques, contre la moitié des garçons ;
· et seules 10 % des filles choisissent l'option « maths expertes », contre un quart des garçons.
Par la suite, seules 17 % des bachelières poursuivant des études supérieures optent pour des filières STIM, contre 44 % des garçons.
Nous souhaitons aujourd'hui délaisser la rhétorique autour du « manque de confiance en soi » et de « l'auto-censure » des filles, qui fait peser sur elles la responsabilité de leur faible choix d'une orientation scientifique. Plutôt que de changer les filles, nous pensons qu'il faut :
· d'une part, changer les mathématiques et les sciences, la façon dont elles sont perçues et enseignées, mettre en valeur leur utilité sociale, afin d'encourager l'envie de sciences chez toutes et tous ;
· et d'autre part, changer les garçons et promouvoir une réelle culture de l'égalité, avec une tolérance zéro pour les comportements sexistes.
Nous avons constaté, par ailleurs, un déficit global d'informations, sur les études et carrières scientifiques ainsi que sur les liens entre choix de spécialités et orientation future.
Afin de lutter contre ce déficit d'informations, nous appelons à développer des campagnes de communication actualisées et modernisées sur le portail Onisep, mais aussi à soutenir les clubs, les stages, les programmes d'immersion, ainsi que les interventions de rôles modèles féminins inspirants.
En la matière, nous tenons à préciser que Marie Curie ne saurait être le seul rôle modèle féminin. On ne demande pas aux garçons d'être Einstein pour s'orienter vers une carrière scientifique ! De même, il faut que nous présentions aux jeunes filles des rôles modèles certes inspirants mais surtout accessibles, proches en âge, qui ont brillamment réussi par leurs efforts, sans être forcément des génies.
Nous appelons également à la mise en place d'un véritable service public de l'orientation, qui soit sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et qui associe les familles, qui sont parmi les principales prescriptrices des choix d'orientation de leurs enfants et qui doivent donc, à ce titre, être elles aussi sensibilisées aux enjeux d'égalité.
Enfin, il est impératif d'agir davantage sur les représentations et attitudes des garçons, qui véhiculent bien souvent dans les classes des propos sexistes qui alimentent la petite musique selon laquelle les filles ne seraient pas bonnes en maths et donc pas légitimes à poursuivre des carrières scientifiques. Cela implique de donner enfin de véritables moyens aux référents égalité filles-garçons tant au niveau académique qu'au sein des établissements.
Je laisse maintenant la parole à notre collègue rapporteure Marie-Pierre Monier pour évoquer le troisième temps de notre rapport : l'enseignement supérieur.
Marie-Pierre Monier, rapporteure. - Une fois franchies les barrières de l'orientation au collège et au lycée, les jeunes femmes se trouvent confrontées à de nouveaux obstacles : aujourd'hui minoritaires dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur, elles y affrontent souvent un sexisme ordinaire et parfois des violences sexistes et sexuelles.
C'est pourquoi les classes préparatoires, les grandes écoles et les universités constituent un maillon décisif pour donner aux femmes toute leur place dans les sciences.
L'enseignement supérieur concentre ainsi les inégalités héritées du secondaire et en introduit de nouvelles.
En France, le pourcentage global de femmes diplômées dans les domaines des STIM est très inférieur à celui des hommes diplômés, puisqu'il est de 13 % d'étudiantes universitaires diplômées, contre 40 % d'étudiants diplômés, soit un écart de près de 30 points.
Au sein des STIM, certaines disciplines connaissent une trajectoire particulièrement préoccupante. Une experte a même parlé d'une « dynamique régressive ». C'est le cas des mathématiques, ce qui m'attriste particulièrement.
La part d'étudiantes dans les diplômes universitaires en mathématiques n'a cessé de stagner, voire de régresser, au cours de la dernière décennie. Cette proportion diminue en licence de mathématiques. Ce plafond est aussi constaté au sein du vivier des professeurs d'université et des maîtresses de conférences, minoritaires en mathématiques fondamentales. On compte ainsi 40 femmes sur 500 professeurs.
Les femmes demeurent particulièrement sous-représentées dans les filières scientifiques les plus sélectives, notamment au sein des meilleures écoles d'ingénieurs françaises, alors même qu'elles intègrent les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques avec, en moyenne, de meilleurs résultats scolaires que les hommes.
D'une part, les CPGE scientifiques recrutent dans un vivier aux deux tiers masculin, et même à 70 % masculin si l'on ajoute l'option mathématiques expertes. D'autre part, on constate, de la part des filles, une véritable stratégie d'évitement massif des filières à forte composante mathématique. Ainsi, si la plupart des classes prépa scientifiques affichent un taux de féminisation supérieur à 25 %, dans les nouvelles classes préparatoires mathématiques-informatique, l'absence quasi-totale de filles est flagrante.
Enfin, la proportion de filles admises dans les écoles scientifiques les plus prestigieuses (grandes écoles d'ingénieurs ou ENS) est encore plus faible puisqu'elles ne représentent plus que 20 % des étudiants admis aux concours les plus sélectifs.
Au total, dans les quelque 200 écoles d'ingénieurs recensées en France, seuls 30 % des 200 000 élèves qui suivent un cursus d'ingénieur en trois ou cinq ans sont des femmes.
Ce taux de féminisation n'a, en outre, progressé que très lentement sur le long terme : entre 2006 et 2021, la part des femmes ingénieures diplômées est passée de 27 % à seulement 31 %.
Au cours de nos travaux, nous avons en effet pu constater les difficultés rencontrées par les écoles d'ingénieurs pour recruter des étudiantes. Même au sein de celles ayant mis en place des politiques pro-actives de féminisation de leurs effectifs, comme par exemple à l'ESTP, à Centrale-Supélec ou encore à l'X, la progression de la proportion d'étudiantes reste lente et insuffisante.
Dans les écoles normales supérieures (ENS), autres filières d'excellence en France, qui assurent notamment la formation des chercheurs, chercheuses et enseignants, enseignantes dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, le taux de femmes admises dans les filières scientifiques est également très faible.
C'est le cas notamment à l'ENS Ulm (moins de 20 % de filles dans la section « sciences » en 2023 et 0 % dans la filière « maths informatique »), à l'ENS de Lyon (moins de 10 % de femmes dans les voies mathématiques et informatique au cours des 4 dernières années cumulées), ou encore à l'ENS de Paris-Saclay que nous avons visitée (12 % de femmes en sciences pour l'ingénieur et 25 % en sciences fondamentales - au sein des sciences fondamentales, seulement 11,5 % de femmes parmi les inscrits en mathématiques).
Enfin, au sein des disciplines scientifiques universitaires, si les femmes sont majoritaires en sciences de la vie et en médecine en 2023 (66 % des étudiants dans les deux cas), elles sont minoritaires en sciences fondamentales (33 % des étudiants).
Ces différents constats amènent à se poser la question des raisons de cette si faible présence de femmes au sein des études scientifiques les plus sélectives.
Elles sont multiples :
· elles ne s'y sentent pas attendues ou pas les bienvenues, « pas à leur place », pour reprendre les mots d'Elisabeth Borne ;
· elles redoutent la très faible mixité de l'environnement et l'éventuelle « toxicité » d'un milieu très majoritairement masculin et compétitif ;
· elles souffrent de la persistance d'un climat de violences sexistes et sexuelles dont la réalité n'est pas encore suffisamment prise en compte par tous les responsables académiques malgré une - plutôt récente - prise de conscience institutionnelle et ministérielle du phénomène.
C'est pourquoi, nous pensons que garantir un environnement favorable et protecteur est essentiel pour que les talents féminins ne se perdent pas à ce moment décisif de la formation professionnelle alimentant ainsi le phénomène bien connu du « tuyau percé ».
Dans cette perspective, nous proposons aujourd'hui d'expérimenter de nouvelles solutions pour atteindre un taux de féminisation de ces filières qui permettra d'assurer une véritable mixité des carrières scientifiques.
Parmi ces solutions, innovantes voire radicales, nous proposons :
· l'instauration de quotas en classes préparatoires et à l'entrée des filières scientifiques les plus sélectives et les moins féminisées ;
· la mise en oeuvre de dispositifs favorables aux filles : bourses spécifiques, augmentation des places en internat, regroupement des filles dans les classes les plus sélectives et compétitives ;
· l'expérimentation de séquences non-mixtes ponctuelles dans les parcours académiques scientifiques ;
· une réforme de l'organisation des processus de sélection à l'entrée des grandes écoles (préparation aux concours et épreuves des concours) et la facilitation des passerelles et l'hybridation des parcours académiques.
La mise en oeuvre de toutes ces mesures ne donnera cependant aucun résultat si la politique de lutte contre le sexisme et contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur scientifique n'est pas appliquée de façon homogène et volontaire par l'ensemble des responsables académiques.
Je laisse la parole à notre collègue rapporteure Laure Darcos pour une présentation de notre quatrième séquence : le déroulé des carrières des femmes scientifiques.
Laure Darcos, rapporteure. - La conséquence logique de cette faible féminisation des filières académiques scientifiques est une sous-représentation féminine dans les carrières scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, de la recherche, de l'informatique ou du numérique.
Les femmes représentent aujourd'hui moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Ce chiffre stagne ces dernières années. Elles sont encore moins nombreuses à occuper des postes à responsabilité au sein des laboratoires de recherche ou des départements R&D des entreprises.
Dans un contexte de fortes tensions en compétences dans les secteurs liés à la transition numérique, à la transition écologique, à l'intelligence artificielle ou encore à la santé, un vivier scientifique élargi est vital, où la mixité est gage d'innovation, de performance et de qualité, tant dans les laboratoires que dans les entreprises.
Aujourd'hui, il est indispensable de former au moins 20 000 ingénieures et ingénieurs et 60 000 techniciennes et techniciens de plus chaque année pour permettre à la France de rester compétitive dans ces domaines.
En outre, environ une femme sur deux, après avoir opté pour une carrière scientifique, quitterait ce champ professionnel au cours des dix années suivant l'obtention de son diplôme : c'est le phénomène effectivement bien connu du tuyau percé, que ma collègue Marie-Pierre Monier évoquait précédemment.
Celui-ci creuse les inégalités salariales entre femmes et hommes, notamment dans le domaine de la recherche scientifique.
On constate ces inégalités dès la procédure de recrutement des chercheurs.
D'une part, ce recrutement est de plus en plus tardif, ce qui peut être pénalisant pour les femmes. D'autre part, on observe une diminution du nombre de postes proposés aux jeunes.
Le déroulé de la carrière, ensuite, est également pénalisant pour les femmes. Le modèle professionnel du « bon chercheur scientifique » implicitement masculin, entièrement consacré à son activité professionnelle, sans considération pour sa vie privée et familiale, peut être dissuasif pour les femmes pour qui la difficile conciliation entre vie professionnelle et vie familiale aggrave le manque d'attractivité de la recherche scientifique.
Ce manque d'attractivité est également accentué par la prévalence de toute la palette des violences sexistes et sexuelles dans ce domaine : que ce soit le « sexisme ordinaire » encore profondément ancré dans le monde scientifique ou toutes les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes. Ces violences sont d'ailleurs particulièrement présentes au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, il est donc essentiel d'agir en amont.
Dès lors, afin d'accélérer la féminisation des secteurs professionnels scientifiques, nous formulons plusieurs recommandations.
Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche :
· des quotas de genre pour le recrutement et les promotions de femmes ;
· des formations aux biais de genre des jurys de recrutement et comités de sélection ;
· la mise en oeuvre de programmes d'accompagnement et de mentorat des femmes vers des postes à responsabilité.
Pour une plus grande mixité au sein des carrières scientifiques dans l'entreprise, notamment au sein des métiers de l'ingénierie, nous recommandons de sensibiliser les chefs d'entreprises et les directions des ressources humaines (DRH) aux enjeux de la diversité des recrutements comme facteur d'innovation et de performance économique.
La délégation est également favorable à une réflexion plus poussée concernant l'éga-conditionnalité des aides publiques à la recherche, type crédit d'impôt recherche (CIR) ou convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
Pour maintenir les femmes dans les carrières scientifiques, nous recommandons des mesures de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale :
· une réforme du congé paternité et du congé parental pour une plus grande égalité dans le déroulé de carrière des pères et des mères ;
· pour les jeunes parents : un allègement des charges administratives et pédagogiques des chercheuses au retour de congé maternité ; des décharges d'enseignement et un soutien spécifique aux jeunes parents chercheurs ; une valorisation du travail collectif et en équipe ; le développement de dispositifs de gardes d'enfants au sein des instituts de recherche et des universités.
Enfin, le renforcement de la lutte contre le sexisme ordinaire et les violences sexistes et sexuelles dans les secteurs scientifiques doit contribuer au maintien des femmes dans ces secteurs et à la féminisation de leur recrutement.
Avant tout, il est nécessaire de créer un espace protecteur pour que les femmes restent dans les métiers scientifiques.
Nous recommandons donc la mise en oeuvre de politiques en faveur de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les VSS dans l'ensemble des organisations académiques.
S'agissant du secteur privé, la formation à la lutte contre les violences sexistes et à la culture de l'égalité doit être rendue obligatoire dans les entreprises, à tous les niveaux, et notamment auprès des managers et des décideurs, et intégrée à la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE).
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour développer davantage l'une ou l'autre de nos recommandations. Je terminerai en remerciant notre présidente Dominique Vérien pour sa confiance et le soutien apporté à la réalisation de ce rapport, attendu depuis plusieurs années et qui je l'espère, fera date.
Marie-Pierre Monier, rapporteure. - Je souhaite vraiment insister sur le fait qu'il est fondamental que les enseignants du premier degré soient particulièrement attentifs à la réussite du processus.
J'aimerais rappeler aussi que pendant longtemps et jusqu'en 1986, les ENS étaient au nombre de deux et non-mixtes : l'une, Sèvres, n'accueillait que des filles, l'autre, Ulm, que des garçons. Il y avait donc la moitié de filles ! C'est depuis que la mixité a été introduite que nous constatons une baisse très significative des effectifs de filles dans les filières scientifiques des ENS. Et cela a une relation directe avec le syndrome de l'imposteur que nous avons déjà évoqué.
J'ai été aussi beaucoup interpellée par les programmes mis en place par les écoles d'ingénieurs - Centrale Supélec notamment - afin d'attirer davantage de filles. Car, la réalité c'est que la France en a besoin. Désormais, la seule façon de faire progresser notre société, c'est de parvenir à attirer plus de filles dans les écoles d'ingénieurs.
Laure Darcos, rapporteure. - Je voulais revenir sur l'observation qui semble à première vue assez contre-intuitive, selon laquelle les parents issus de CSP + poussent davantage leurs garçons que leurs filles dans les filières compétitives alors que dans les milieux moins favorisés, les fils et les filles seront traités plus équitablement. Cela nous a été confirmé par des sociologues et plusieurs interlocutrices entendues au cours de nos travaux : c'est dans les milieux aisés que l'opinion selon laquelle l'homme doit mieux gagner sa vie est plus répandue. Plusieurs ingénieures que nous avons auditionnées l'ont d'ailleurs personnellement expérimenté.
Laurent Somon. - Je suis un peu surpris par les données sur les violences sexuelles et sexistes : y a-t-il des données statistiques qui attestent qu'elles sont plus répandues dans les filières scientifiques ?
Marie-Pierre Monier, rapporteure. - Ce n'est pas la même proportion de filles !
Laurent Somon. - Certes, mais il y a tout de même des filières scientifiques fortement féminisées comme les écoles vétérinaires par exemple. Et d'ailleurs les filles y réussissent sans quota, ce qui m'amène à ma deuxième interrogation.
Pensez-vous que les quotas vont régler le problème ? Pour répondre aux besoins, ne vaudrait-il pas mieux ouvrir plus de postes ? Puisque les épreuves écrites sont anonymes, du brevet jusqu'aux concours les plus élevés, les quotas joueraient donc au moment des épreuves orales, en sélectionnant plutôt une candidate femme qu'un candidat homme ?
Dominique Vérien, présidente. - À l'École nationale de la magistrature, on manque d'hommes. Par conséquent, sans qu'il s'agisse à proprement parler de quotas, ces derniers bénéficient sans doute de meilleures chances d'être admis. Il faut savoir qu'en réalité, il y a des endroits où l'on rééquilibre ainsi les choses.
Laurent Somon. - Et à l'inverse, je citerai sans la nommer le cas d'une grande école de commerce, dont les jurys de concours, il y a plusieurs années, rééquilibraient la part des admis en faveur des hommes, pour des questions liées au temps de travail et à la crainte des entreprises de devoir faire face à un afflux de congés maternité.
À côté de ces discriminations qui peuvent exister, la question clé reste celle des besoins et de la nécessité de créer des postes.
Laure Darcos, rapporteure. - Concernant l'augmentation du nombre de postes, l'argument est valable, mais un peu biaisé car beaucoup de jeunes filles passent leur temps à nourrir le complexe de ne pas aller jusqu'au bout.
Le mot « quota » peut faire peur. Avec la présidente Dominique Vérien, nous sommes allées à la rencontre de jeunes filles en classes préparatoires scientifiques au lycée Louis-le-Grand. Quand nous avons abordé le sujet, elles se sont montrées agacées ne souhaitant pas que l'on réduise leur mérite au fait d'avoir été recrutée en raison de la mise en place de quotas. Sauf que nous raisonnons bien sûr ici à compétences égales. À partir du moment où, sur Parcoursup, elles sont aussi nombreuses que les garçons, mais que l'on constate une baisse de leur nombre en première année de classe préparatoire, et surtout entre la première et la deuxième année, cela signifie que certaines abandonnent pour des raisons autres que leurs compétences intellectuelles et scientifiques, par exemple, parce qu'elles ne trouvent pas forcément de places en internat adaptées, ou parce que, dans les groupes de travail, les garçons prennent toute la place pour répondre aux questions, et qu'elles n'ont donc pas l'impression de pouvoir s'imposer. En somme, elles abandonnent pour de mauvaises raisons.
Nous leur avons simplement parlé de notre propre expérience avec les quotas en politique, en leur disant : « Vous aurez peut-être l'impression d'être sacrifiées la première année, mais en réalité, vous travaillez aussi pour les générations suivantes. »
Dans les milieux de l'intelligence artificielle, nous avons besoin de femmes, notamment pour alimenter les algorithmes avec des données de santé féminines. L'objectif n'est pas forcément d'augmenter le nombre de postes pour qu'il y ait plus de femmes, mais simplement de rétablir un équilibre de mixité.
Ce constat est en effet valable dans la magistrature ou dans l'enseignement, où il serait important d'avoir plus d'hommes. Je vous invite à vous souvenir de l'expérience de cette étudiante normalienne que nous avons rencontrée à Louis-le-Grand.
Dominique Vérien, présidente. - En effet, comme vous le savez, le lycée Louis-le-Grand abrite les meilleures classes préparatoires scientifiques de France. Une jeune étudiante normalienne issue de ses rangs nous a fait part de son expérience à l'ENS Ulm où elle a été reçue aux deux concours, le concours élève et le concours étudiant, l'un en physique et l'autre en mathématiques.
Elle décide de se lancer dans une double licence mais s'en trouve alors fortement dissuadée par un responsable du laboratoire de mathématiques, qui lui fait part de ses doutes quant à sa capacité à réussir ce double cursus. L'étudiante persiste et obtient ses deux licences avec mention. Elle était la seule femme de sa promotion.
Ayant l'intention de poursuivre plus loin dans ce double cursus elle sollicite un bilan avec le même professeur, à qui elle venait pourtant de prouver ses compétences, et s'entend alors répondre qu'elle n'en serait pas capable et que suivre une double licence avait été une erreur. Par conséquent, l'étudiante a fini par choisir la physique et abandonner les mathématiques.
C'est absurde qu'une jeune femme aussi brillante se trouve dissuadée et doive renoncer à ses ambitions parce qu'un professeur ne veut pas de femme parmi ses étudiants.
Marie-Pierre Monier, rapporteure. - S'agissant des quotas, la glaciologue Heidi Sevestre qui réside et travaille au Svalbard norvégien et que nous avions auditionnée lors de notre événement sur les femmes scientifiques aux parcours inspirants en mars 2025, nous a expliqué que la Norvège en a mis en place à tous les stades : pour les étudiants, les doctorants, les post-doctorants, les professeurs d'université...
En France, l'école d'ingénieurs EPF a changé ses statuts pour créer le parcours ParityLab, qui comprend un concours et un programme de formation distincts, réservés aux jeunes filles, qui représentent 50 % des effectifs.
On peut tenter toutes ces initiatives, mais il faut surtout changer d'état d'esprit, car si cela fonctionne ailleurs, il n'y a aucune raison que cela ne marche pas en France.
On a vu que dans certaines CPGE scientifiques actuellement, il y a 40 % de filles admises sur Parcoursup et seulement 20 % qui se présentent le jour de la rentrée. Il faut absolument réussir à changer cela. Et également encourager la pluridisciplinarité car c'est cela qui attire les filles.
Annick Billon. - Je remercie nos quatre rapporteures et salue la persévérance de Laure Darcos, car nous évoquons ensemble ce sujet depuis de nombreuses années
Ce que j'apprécie dans votre rapport et votre présentation, c'est que tout le spectre des sujets y est traité. Je trouve son titre extrêmement intéressant, car il est très positif : il s'agit de féminiser pour dynamiser la société, c'est donc une plus-value. Par les sujets que nous traitons habituellement, que ce soit les violences, l'inégalité salariale ou la santé des femmes au travail, il ne nous est pas souvent donné l'occasion de rédiger un rapport avec autant d'aspects positifs et je pense qu'il faut s'en féliciter.
Nous avons rencontré grâce à vous de nombreuses femmes inspirantes que l'on ne voit pas suffisamment et qui ont la lourde responsabilité de s'engager pour rendre les femmes plus visibles dans les sciences. Comme elles l'ont relevé lors des auditions, on leur en demande donc toujours plus : non seulement il faut qu'elles soient brillantes, mais en plus il faut qu'elles jouent les « VRP » des sciences, sachant qu'elles sont moins nombreuses que les hommes et que cela représente une charge importante pour elles.
Je vois votre rapport comme une boîte à outils qui vivra très longtemps, à l'instar d'autres rapports comme « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité » ou « Femmes et agriculture : pour l'égalité dans les territoires ».
Vous évoquez les questions de formation, d'information, mais aussi de droit du travail, avec les congés parentaux, les modes de garde et la politique familiale. Vous parlez de bourses, d'internats et vous donnez des outils pour favoriser la place des femmes dans les cursus scientifiques.
J'ai une question à vous poser sur les quotas, qui sont l'un de ces outils.
Avez-vous évoqué entre vous l'option d'avoir des écoles non mixtes, puisque la question des violences sexuelles et sexistes se pose ? Comme à l'époque de l'ENS Sèvres, qui permettait d'apprendre dans un environnement non mixte et d'éviter les quotas.
Concernant l'ARCOM, ses représentants, que nous auditionnons régulièrement, mettent souvent en avant la nécessité d'une représentation égalitaire des hommes et des femmes. Faut-il durcir votre recommandation à son sujet ou lui donner plus de moyens pour la mettre en oeuvre ? Faut-il, spécifiquement pour les sciences, avoir des dispositifs de mesure différents ? En effet, lorsqu'on parle d'experts, il peut s'agir de spécialistes en politique, en sciences ou en littérature. On trouvera peut-être un vivier plus important de femmes expertes en enseignement ou en littérature que dans les sciences.
Pour éviter que tout le poids ne repose sur les femmes, qui doivent déjà travailler dans les sciences et, en plus, se valoriser, n'y a-t-il pas quelque chose à inventer pour mettre en lumière leur travail ? Ne pourrait-on pas créer des prix, des bourses ou d'autres outils pour distinguer chaque année des femmes qui, avec des parcours ordinaires, sont devenues ingénieures ?
Enfin, l'un des arguments pour attirer les femmes vers les sciences est la perspective, dans certaines carrières comme les ingénieures, de très bien gagner sa vie. Car cela signifie être autonome financièrement. D'autant que les entreprises recherchent des ingénieures femmes, notamment en raison d'obligations législatives de représentation des femmes dans les postes à responsabilité, avec les lois Copé-Zimmermann et Rixain.
Il faudrait sans doute mieux communiquer sur ces arguments et faire savoir qu'en devenant ingénieures, les femmes auront une carrière très évolutive, qu'elles ne s'enfermeront pas dans un domaine technique.
Jocelyne Antoine, rapporteure. - L'an dernier, je participais à l'assemblée générale de la fédération du BTP de mon département. Sur les dix interlocuteurs, dix messieurs, aucun ne m'a citée lors des propos introductifs, alors qu'ils s'adressaient volontiers à « Monsieur le député » ou « Monsieur le sénateur ».
J'ai gardé le sourire pendant les discours mais j'ai tout de même décidé de ne pas laisser passer, car dix oublis, ce n'est pas rien. Je suis donc allée voir le président de la fédération du BTP pour le remercier de son invitation et lui signifier que, dans la mesure où je n'étais apparemment pas présente, puisque jamais citée, je ne participerais pas au verre qui suivrait. J'ai donc quitté l'assemblée après les discours, très poliment.
Cette année, le président de la fédération du BTP a appelé ma collaboratrice car il organise en novembre un événement sur la place des femmes dans le BTP, en faisant intervenir plusieurs associations qui travaillent sur l'orientation des femmes, et m'a proposé de venir y présenter notre rapport.
Marie-Do Aeschlimann, rapporteure. - Pendant nos auditions, nous avons souvent évoqué le fait que les pays les plus égalitaristes ne sont pas ceux où la représentation des filles dans les carrières scientifiques est la plus élevée, c'est ce que l'on appelle le paradoxe de l'égalité. Cela s'explique par le fait que, dans les pays qui ne le sont pas - notamment en Afrique du Nord ou dans certains pays d'Amérique du Sud -, s'investir dans les sciences est vécu comme un moyen d'émancipation économique pour les filles, dans des contextes où les moyens des familles sont moindres.
Nous l'avons dit, les femmes recherchent en général des carrières où elles peuvent exprimer leur utilité sociale. C'est pourquoi on les retrouve beaucoup dans les métiers du soin, la magistrature ou l'éducation, où elles ont l'impression d'être utiles et de s'occuper des gens.
Aller vers des métiers avec la rémunération en ligne de mire n'est pas de prime abord un réflexe féminin. Cela va peut-être évoluer, je le constate aujourd'hui dans mon entourage. Les jeunes femmes souhaitent de plus en plus être autonomes, faire d'aussi belles carrières que les hommes et avoir des métiers rémunérateurs.
Les carrières scientifiques peuvent donner l'impression aux femmes qu'elles n'auront pas de véritable impact sur la vie réelle. Or, quand on construit, bâtit ou travaille dans l'industrie ou les travaux publics, on a un vrai impact sur le quotidien. De même, en travaillant dans les mathématiques ou les sciences fondamentales, l'impact existe, même s'il est plus lointain.
Il faut apprendre et sensibiliser les jeunes filles au fait qu'elles ont le droit d'aspirer à un métier où elles vont non seulement s'épanouir et avoir une réelle utilité, mais aussi bien gagner leur vie. Ce n'est pas un gros mot pour une jeune fille ! C'est aussi notre rôle, en tant que parents, élus et éducateurs, de laisser aux filles le droit de rêver à autre chose. C'est un long chemin, car cela nécessite de sensibiliser, d'encourager et de laisser entendre que c'est possible. Pour cela, on en revient aux rôles modèles inspirants qui doivent dire aux filles : « J'ai fait tel choix de carrière ou d'études, j'occupe maintenant telle fonction, je m'épanouis, je gagne bien ma vie, et toi aussi tu le peux, demain. » C'est tout un chemin, et j'espère que ce rapport aidera à ouvrir cette voie.
Jocelyne Antoine, rapporteure. - Je vais répondre Concernant la recommandation sur l'ARCOM. Elle se trouve dans la première partie de notre rapport, consacrée au premier âge. C'est cette partie de l'audiovisuel que nous avons ciblée.
Dans les rapports de l'ARCOM, cet aspect est vu de manière générale, mais des exemples nous ont montré que sur certains supports visuels s'adressant aux plus petits, et en particulier aux enfants de 5 ou 6 ans, dans les dessins animés ou les émissions de télévision, il y a une mauvaise représentation de l'image de la fille. C'est dans ce sens que nous souhaitions que l'ARCOM soit sensibilisée.
Laure Darcos, rapporteure. - Ce point sur l'ARCOM va de pair avec les manuels scolaires. En effet, comme l'a dit Élisabeth Borne, et comme nous l'ont montré les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, le respect une charte d'égalité femmes-hommes doit être obligatoire dans l'élaboration des manuels scolaires. D'après cette charte, lorsqu'on illustre une personne en blouse, par exemple, il faut cesser de représenter systématiquement un homme en chercheur et une femme en infirmière.
Autant nous pouvons corriger beaucoup de choses sur la représentativité à la télévision, autant, pour les sciences, il s'agit davantage d'un problème qui se pose dès l'enfance - dans les dessins animés, les émissions et les manuels scolaires - que d'un problème à grande échelle à l'âge adulte, dans les médias et l'audiovisuel.
Marie-Pierre Monier, rapporteure. - Pour les jeunes aujourd'hui, soit leur famille considère les filles comme les égales des garçons, capables de tout faire, soit c'est l'école qui joue ce rôle. On retrouve alors, la nécessité de travailler sur la place des filles et des garçons. Les sessions « EVARS » - l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle - recouvrent tout cela, à condition qu'elles soient effectivement dispensées.
Je voudrais vous rappeler les résultats d'une étude que nous citons dans notre rapport et qui montre à quel point ces stéréotypes sont ancrés. Face à un exercice de reproduction d'une figure géométrique, si vous dites aux filles qu'il s'agit d'un exercice de dessin, elles le reproduisent parfaitement et performent même mieux que les garçons ; si vous leur dites que c'est un exercice de géométrie elles y parviennent moins bien. Cela montre bien à quel point ces biais sont ancrés.
Je voudrais aussi revenir sur les rôles modèles qui ne doivent ni oppressants ni inaccessibles. Nous ne serons pas toutes Marie Curie.
Enfin, il y a tout un ensemble de choses à déconstruire. Une équipe de chercheurs de l'université d'Aix-Marseille a expliqué que, pour éviter les biais de genre au recrutement, elle organisait une séance de formation avec les membres du jury et que ces séances avaient significativement augmenté le taux de féminisation du recrutement.
Hussein Bourgi. - Je voudrais remercier nos quatre collègues rapporteures pour leur excellent travail. Étant juriste et non scientifique, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la synthèse de leurs recommandations. Je souhaite formuler deux suggestions.
La première est tirée d'une expérience personnelle. Il y a quelques années, avec le club de la presse de Montpellier, nous nous étions rendu compte que, systématiquement, les experts invités dans les médias nationaux, mais surtout locaux, étaient des hommes. La présidente du club de la presse de l'époque avait donc créé un comité pour travailler sur cette question. Nous avions recensé toutes les femmes expertes de notre département et de notre région dans ce que nous avions appelé « l'annuaire des expertes ». Une fois cet annuaire réalisé, il a fallu convaincre les directeurs de publication et les rédacteurs en chef. Nous avons donc mené un travail de très longue haleine, hommes et femmes ensemble, en les invitant à des petits déjeuners pour les sensibiliser au fait qu'ils faisaient systématiquement intervenir les mêmes intervenants. Nous avions choisi un exemple assez caricatural : un scientifique, parti à la retraite depuis dix ans, continuait d'être sollicité comme expert par tous les médias - France 3, Midi Libre, La Gazette de Montpellier, France Bleu Hérault.
Cette observation concerne la recommandation numéro 6, adressée à l'Arcom. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire un état des lieux et je suggère donc que notre délégation mène un travail de sensibilisation auprès des rédacteurs en chef de certains médias, à l'occasion de petits déjeuners par exemple. Je crois beaucoup en la vertu de ce mécanisme : voir une femme à la télévision, entendre une femme à la radio ou dans une interview dans la presse permet de se projeter, d'incarner une fonction.
Ma seconde suggestion est la suivante. Chaque année, nous avons en France une grande manifestation qui s'appelle la Fête de la science. Vendredi dernier, j'ai été invité par le lycée Joffre de Montpellier qui organisait une « Nuit de la science ». M'y rendant en tant que conseiller régional siégeant au conseil d'administration, j'ai discuté avec le proviseur. C'était formidable, il y avait beaucoup de visiteurs. Je leur ai cependant lancé un défi pour l'année prochaine : organiser la Nuit de la science en ne parlant que de femmes scientifiques, afin de les sortir de l'ombre pour les mettre en lumière. Je leur ai donc proposé de célébrer la Fête de la science pendant la journée en présentant des hommes et des femmes, mais de ne mettre en avant que des femmes scientifiques le soir. A priori, ils vont relever le défi. C'est pourquoi je suggère que nous utilisions peut-être un peu plus la Fête de la science en militant pour que beaucoup plus de femmes soient mises à l'honneur à cette occasion. C'est un moment où les Français, parfois très éloignés du monde scientifique, s'y intéressent, parce que c'est dans l'actualité ou parce que leurs enfants les y incitent.
Laure Darcos, rapporteure. - La Fête de la science existe déjà dans de nombreux territoires, mais nous avons dit à plusieurs reprises, lors de nombreuses auditions, qu'il fallait que les académies et l'Éducation nationale se saisissent de ce coup de projecteur annuel. En effet, cet événement est un peu trop devenu un entre-soi de scientifiques, finalement peu vulgarisé.
Nous avons commencé nos travaux en nous rendant auprès de la fondation La Main à la pâte, qui est une association véritablement exceptionnelle, raison pour laquelle nous l'avons mise à l'honneur dans le cadre du prix annuel de notre délégation.
Dominique Vérien, présidente. - Concernant le titre du rapport, les rapporteures et moi-même vous proposons : XX=XY, Féminiser les sciences, dynamiser la société.
Olivia Richard. - J'ai appris beaucoup de choses lors des auditions, qui étaient nombreuses. Bravo, mesdames les rapporteures, pour le travail que vous avez accompli ! Votre présentation est passionnante. Quel véritable enjeu ! On peut retrouver ces problématiques dans de nombreux domaines de la société.
Lorsque je suis allée en Chine, j'ai rencontré des habitants de Canton, le hub de toutes les nouvelles technologies. Des Français qui y sont installés m'ont dit qu'il y avait davantage d'ingénieures chinoises. Le nombre d'ingénieurs chinois était supérieur à la population française. Nous avons donc besoin d'ingénieurs et d'ingénieures. Bravo pour votre rapport, il est magnifique.
Laure Darcos, rapporteure. - Avec Marie-Pierre Richer et Béatrice Gosselin, nous avons été en mission en Égypte début septembre. Toutes les députées qui nous accompagnaient étaient ingénieures.
Annick Billon. - Il y a eu des propositions de résolution sur ces sujets. Peut-être devriez-vous en porter une ? Il y a peut-être matière à porter le sujet au plus haut niveau du Sénat.
Laurent Somon. - Je ne vous ai pas remercié tout à l'heure pour ce travail qui bouscule un peu nos connaissances sur le sujet.
La recommandation n° 1 me paraît très importante : il faut agir dès l'école primaire pour que les filles aient plus envie de faire des mathématiques. Cette recommandation, qui vise à renforcer la façon dont les enseignants du primaire peuvent faire aimer, et pas seulement apprendre, les mathématiques, est extrêmement importante.
Il manque une relation, qui peut exister dans certains secteurs, entre le primaire et le collège. En effet, les collèges bénéficient de professeurs spécialistes, alors que l'enseignant du primaire est « tout-terrain ». En plus, on lui demande souvent de faire des choses qui ne relèvent pas de son domaine.
Je vous remercie encore une fois pour ce travail remarquable.
Laure Darcos, rapporteure. - Pour ajouter un élément, nous sommes d'autant plus conscients que la réforme du baccalauréat de M. Blanquer en 2019 était problématique. Elle l'est pour la présence des femmes dans les classes préparatoires, mais également pour toutes celles qui feront ensuite des études pour devenir professeurs des écoles et qui, par conséquent, auront encore moins d'appétence pour les mathématiques et pour leur enseignement aux élèves du primaire.
À ce sujet, Élisabeth Borne a annoncé à la rentrée scolaire une véritable réforme de la formation des professeurs des écoles pour leur enseigner davantage les mathématiques et, comme vous le disiez, les faire aimer à leurs élèves.
Jocelyne Antoine, rapporteure. - Je souhaitais compléter ce point, qui est effectivement très important. Nous avons eu un espoir en voyant les directives d'Élisabeth Borne concernant la formation, qui font contrepoids à la réforme Blanquer, dont la conséquence est qu'une génération de jeunes filles arrive dans la préparation au métier d'enseignant sans avoir fait de mathématiques. La Première ministre les a réintroduit dans la formation des professeurs des écoles ; elle avait donc bien ciblé le problème. Quand une bonne mesure est prise, il faut savoir le souligner.
Dominique Vérien, présidente. - Nous en venons à l'adoption du rapport et de ses 20 recommandations. Vous avez sous les yeux l'Essentiel et la liste des recommandations, et en avez également été destinataires hier.
Le rapport et ses conclusions sont adoptés sans modification.
Le titre choisi pour le rapport est le suivant : « XX=XY, féminiser les sciences, dynamiser la société ».
Je clos désormais la séance, merci à toutes et à tous.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
|
13 février 2025 Réunion plénière |
|
|
Table ronde avec des membres de l'Académie des sciences |
|
|
- Jacqueline BLOCH |
Physicienne, directrice de recherche au CNRS |
|
- Hélène BOUCHIAT |
Physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et sciences de l'Académie des sciences |
|
- Patrick FLANDRIN |
Physicien, directeur de recherche au CNRS |
|
- Juliette ROCHET |
Biologiste, directrice du service des Comités, avis et rapports de l'Académie des Sciences |
|
- Laure SAINT-RAYMOND |
Mathématicienne et professeure des universités à l'ENS de Lyon |
|
6 mars 2025 Réunion plénière |
|
|
Table ronde avec des femmes scientifiques aux parcours modèles et inspirants |
|
|
- Carole MATHELIN |
PU-PH de gynécologie-obstétrique, présidente de l'Académie nationale de chirurgie |
|
- Marina KVASKOFF |
Épidémiologiste et chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) |
|
- Heïdi SEVESTRE |
Glaciologue, membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique |
|
- Aleksandra WALCZAK |
Biophysicienne, directrice de recherche au CNRS et au Laboratoire de physique de l'École normale supérieure, membre de l'Académie des sciences |
|
- Kumiko KOTERA |
Astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris |
|
27 mars 2025 |
|
|
Réunion plénière |
|
|
- Sylvie RETAILLEAU |
Ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur à l'Université Paris-Saclay |
|
2 avril 2025 Audition rapporteures |
|
|
- Charlotte JACQUEMOT |
Chercheuse au CNRS et directrice du département d'études cognitives de l'ENS-PSL, auteure de l'étude « Ressenti et discriminations de genre : ce qui freine la féminisation des filières scientifiques » |
|
8 avril 2025 Réunion plénière |
|
|
- Jean-Michel BLANQUER |
Ancien ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse |
|
10 avril 2025 Table ronde avec des représentants de grandes écoles |
|
|
- Dominique BAILLARGEAT |
Vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) et directrice de l'école 3iL Ingénieurs |
|
- Denis BERTRAND |
Directeur de l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA) |
|
- Joël CUNY |
Directeur général de l'École spéciale des travaux publics, des bâtiments et de l'industrie (ESTP) |
|
- Romain SOUBEYRAN |
Directeur de Centrale Supélec |
|
- Emmanuel TRIZAC |
Président de l'École normale supérieure (ENS) de Lyon |
|
29 avril 2025 Réunion plénière Table ronde avec des représentants de la
Chaire « Femmes et science » |
|
|
- Elyès JOUINI |
Professeur des universités en économie et mathématiques, titulaire de la chaire Unesco « Femmes et science » à l'Université Paris-Dauphine |
|
- Thomas BREDA |
Économiste, chercheur au CNRS, coauteur de l'étude sur Le décrochage des filles en mathématiques dès le CP de la Chaire Femmes et Sciences et de l'Institut des Politiques publiques |
|
- Georgia THEBAULT |
Chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine |
|
- Sophie POCHIC |
Directrice de recherche au CNRS et membre du Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS) |
|
6 mai 2025 Audition rapporteures Table ronde avec des professeurs et des représentants de l'éducation nationale |
|
|
- Jean HUBAC |
Chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives de la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
- Laure ETEVEZ |
Responsable du groupe Femmes et mathématiques au sein de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public |
|
- Nathalie SAYAC |
Professeure des universités en didactique des mathématiques, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche |
|
- Denis CHOIMET |
Président de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques |
|
14 mai 2025 Audition rapporteures Séquence avec des représentants des collectivités territoriales |
|
|
- Valérie DEBORD |
Première vice-présidente Emploi, formation, orientation, apprentissage et enseignement supérieur de la Région Grand Est |
|
- Sylvie D'ALGUERRE |
Conseillère régionale déléguée à l'Égalité Femme/Homme de la Région Grand Est |
|
- Sophie BORDERIE |
Présidente du Département du Lot et Garonne, présidente de la commission Droits des femmes de Départements de France |
|
15 mai 2025 Réunion plénière Table ronde avec des représentants
d'associations oeuvrant |
|
|
- Mélanie GUENAIS |
Maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, coordinatrice du collectif Maths et sciences |
|
- Fatima BAKHTI |
Présidente de l'Association Femmes Ingénieures |
|
- Françoise CONAN |
Professeure des universités à la faculté de sciences de Brest (Finistère), présidente de l'association Femmes et sciences |
|
- Véronique SLOVACEK-CHAUVEAU |
Présidente d'honneur de l'association Femmes et mathématiques |
|
- Valérie BRUSSEAU - Sophie HUET |
Présidente de l'association Elles bougent Directrice générale de l'association Elles bougent |
|
21 mai 2025 Audition rapporteures |
|
|
- Cédric VILLANI |
Mathématicien, membre de l'Académie des sciences |
|
27 mai 2025 Réunion plénière Table ronde sur la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles (VSS) |
|
|
- Véronique LESTANG-PRÉCHAC |
Sous-directrice Territoires, Sociétés Savoirs au service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGESIP/DGRI) du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
- Chloé MOUR |
Chargée de mission égalité, droits LGBT+ et lutte contre les violences sexistes et sexuelles, au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
- Amandine LEBUGLE |
Démographe, responsable d'études et de recherche à l'Observatoire du Samusocial de Paris, ancienne membre de l'équipe de coordination de l'enquête Virage |
|
- Rhita-Maria OUAZZANI |
Astronome-adjointe au Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA) de l'Observatoire de Paris, membre de la Cellule d'écoute et de veille PSL, coordinatrice de la commission Femmes et Astronomie de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A) |
|
- Jérôme COURDURIÈS |
Professeur des universités en anthropologie, chargé de mission Égalité de genre et de lutte contre les VSS à l'Université Toulouse-Jean Jaurès |
|
3 juin 2025 Audition rapporteures Audition de représentants des Instituts
nationaux supérieurs du professorat |
|
|
- Nathalie SEVILLA |
Directrice de l'INSPÉ de Lorraine |
|
- Jean-Paul ROSSIGNON |
Directeur de la Maison pour la Science en Lorraine, et directeur-adjoint de l'INSPÉ de Lorraine |
|
- Anne-Lise ROTUREAU |
Déléguée générale du Réseau des INSPÉ |
|
4 juin 2025 Réunion plénière Audition de représentants d'Aix-Marseille Université (amU) |
|
|
- Denis BERTIN |
Vice-président d'Aix-Marseille Université en charge du programme Safe place for Science |
|
- Isabelle RÉGNER |
Vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations d'Aix-Marseille Université |
|
5 juin 2025 Réunion plénière Audition d'Elisabeth Borne |
|
|
- Elisabeth BORNE |
Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
11 juin 2025 Audition rapporteures Table ronde de représentantes de syndicats de professeurs des écoles |
|
|
- Guislaine DAVID |
Co-secrétaire générale, porte-parole de la FSU-SNUipp |
|
- Caroline BRISEDOUX |
Secrétaire nationale CFDT Éducation Formation Recherche Publiques |
|
12 juin 2025 Réunion plénière Audition de Laura Chaubard |
|
|
- Laura CHAUBARD |
Directrice générale de l'École polytechnique |
|
17 juin 2025 Audition rapporteures Table ronde avec des associations
d'élèves et anciens élèves |
|
|
- Gabriela BELAID |
Présidente de Centrale Supélec au Féminin |
|
- Patricia DELON |
Présidente de Grandes écoles au féminin (GEF) |
|
- Dorothée CITERNE |
Diplômée X Ponts, Directrice Régionale Centre Est de SETEC (Lyon), membre du bureau de GEF et vice-présidente du bureau de Ponts Alumni |
|
- Sylvain GILAT |
Président d'ESPCI Paris Almumni |
|
- Dipty CHANDER |
Présidente de l'association E-mma EPITECH |
|
18 juin 2025 Réunion plénière Auditions de Clémence Perronnet et de Pauline Martinot |
|
|
- Clémence PERRONNET |
Sociologue des sciences rattachée au Centre Max Weber |
|
- Pauline MARTINOT |
Médecin et docteure en neurosciences, co-auteure de la note du Conseil scientifique de l'éducation nationale de septembre 2021 : « Qu'apprend-on des évaluations de CP-CE1 ? », première auteure de l'article paru dans la revue Nature, en juin 2025, “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade“. |
|
24 juin 2025 Auditions rapporteures Auditions de Marianne Blanchard et de Claudie Haigneré |
|
|
- Marianne BLANCHARD |
Sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Toulouse-Jean Jaurès |
|
- Claudie HAIGNERÉ |
Docteure en médecine, ancienne ministre, première femme française à être allée dans l'espace |
|
26 juin 2025 Réunion plénière Table ronde sur les inégalités dans
le recrutement et |
|
|
- Mathieu ARBOGAST |
Chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au Centre national de recherche scientifique (CNRS), ancien membre du Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes (HCEFH) |
|
- May MORRIS |
Directrice de recherche CNRS à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron, coordinatrice du programme de mentorat « Femmes et sciences » pour doctorantes à l'Université de Montpellier, membre du CA de EPWS (European platform for Women in Science) |
|
- Cécile JOLLY |
Économiste, cheffe de projet au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, co-autrice du rapport « Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d'ici à 2030 ? », mai 2025. |
|
- Elisabeth RICHARD |
Directrice des relations avec la société civile chez ENGIE, membre du HCEFH et membre du comité de direction de Femmes@numérique |
|
1er juillet 2025 Auditions rapporteures Auditions de Monika Boustany et d'Emmanuelle Larroque |
|
|
- Monika BOUSTANY |
Présidente fondatrice de Sciences for Girls (SciGi) |
|
- Emmanuelle LARROQUE |
Auteure de l'ouvrage « Tu seras scientifique, ma fille ! » (Septembre 2024), directrice de la start-up sociale Social Builder |
|
15 juillet 2025 Audition rapporteures Audition de Laure Danilo |
|
|
- Laure DANILO |
Présidente de l'Association nationale des professionnel.les de la culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI) |
LISTE DES DÉPLACEMENTS
MARDI 20 MAI 2025
VISITE DE L'INSTITUT DES CANCERS DES FEMMES (IHU) DE L'INSTITUT CURIE
· Parmi les interlocuteurs et interlocutrices rencontrés
|
Alain PUISIEUX Pre Anne VINCENT-SALOMON |
Président du Directoire de l'IHU Curie Directrice |
|
Jessica LEYGUES |
Secrétaire générale |
|
Dr Fatima MECHTA GRIGORIOU |
DRCE Inserm, responsable de l'Unité U1339 Inserm - Stress & Cancer Lab - Coordinatrice scientifique COMEX IHU |
|
Dr Géraldine GENTRIC |
Chargée de recherche Inserm Stress & Cancer Lab |
|
Dr Claire ROUGEULLE |
Directrice du Centre de recherche de l'Institut Curie |
|
Isabelle FROMANTIN et son équipe |
Infirmière experte plaies & cicatrisations |
|
Camille RICHARDOT |
Technicienne spécialisée au sein |
JEUDI 22 MAI 2025
PLATEAU DE SACLAY
|
· Rencontre dans les locaux d'Incub Alliance |
|
|
Arielle SANTÉ |
Directrice générale d'IncubAlliance |
|
Marie ROS-GUEZET |
Présidente de Paris Saclay au Féminin |
|
Assya VAN GYSEL |
Fondatrice du TEDx Saclay |
|
Manale KARAM |
Fondatrice et CEO d'IterOnco |
|
Muriel THOMAS |
Co-fondatrice de Carembouche et directrice de recherche à l'INRAE |
|
Colette KANELLOPOULOS-LANGEVIN |
Co-fondatrice et CEO de BCV Care |
|
Nadia TADJINE |
Co-fondatrice de D.Terre |
|
· Table ronde organisée à l'ENS Paris-Saclay |
|
|
Nathalie CARRASCO |
Présidente de l'ENS Paris-Saclay |
|
Clotilde CORON |
Vice-présidente « Égalité, diversité et inclusion » de l'Université Paris-Saclay |
|
Salma BAIRAT |
Normalienne étudiante en sciences pour l'ingénieur (génie électrique) |
|
Sarah COHEN-BOULAKIA |
Professeure des universités, chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique (LISN), directrice-adjointe de l'Institut DATAIA de l'Université Paris-Saclay |
|
Caroline FONTAINE |
Directrice de recherche au CNR |
|
Valérie MASSON-DELMOTTE |
Directrice de recherche CEA au Laboratoire de sciences du climat de l'environnement |
|
Sophie HENROT-VERSILLÉ |
Déléguée scientifique en charge des missions spatiales, responsable du pôle astroparticules, astrophysique et cosmologie d'IJCLab |
|
Marie GAYREL |
Vice-présidente Intelligence Surveillance et Reconnaissance chez Thales |
VENDREDI 27 JUIN 2025
DÉPLACEMENT DANS LA MEUSE
|
Fabienne GODEY |
Représentante du collège de Ligny-en-Barrois, premier collège « La main à la pâte » de la Meuse |
|
Delphine CHAMPMARTIN |
Représentante de l'association « La main à la pâte » |
|
Laurence MANSUY-HUAULT |
Enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine |
|
Aude HUMMEL |
Professeure agrégée de l'Université de Lorraine |
|
Jean-Paul ROSSIGNON |
Directeur-adjoint de l'INSPÉ de Lorraine et Directeur de la Maison pour la science |
|
Éric SAND |
Chef de projet opérationnel Ancrage Territorial à l'Université de Lorraine |
|
Sylvie D'ALGUERRE |
Conseillère régionale |
|
Élodie COSSERAT |
Représentante d'ENEDIS Lorraine |
|
Sophie HUGUENIN |
Représentante d'ENEDIS Lorraine |
|
Fanny DERVAUX |
Représentante d'ENEDIS Lorraine |
|
Cécile GRAFIADIS |
Représentante d'ENDiS Lorraine |
|
Jérôme DUMONT |
Président du Conseil départemental de la Meuse |
|
Laetitia PAVEL |
Représentante de l'association Les SouterReines |
|
Céline LEFEVRE |
Représentante de l'association Les SouterReines |
|
Cécile ROUSSEL |
Déléguée régionale association Elles bougent |
|
Camille ORTH |
Déléguée régionale association Elles bougent |
|
Emilia HURET |
Cheffe du centre Andra de Meuse/Haute-Marne |
|
Aliouka CHABIRON |
Ingénieure intégration des données/ Andra |
|
Mélanie LUNDY |
Ingénieure expérimentation géochimie / Andra |
|
Jessica LE PUTH |
Ingénieure en charge du creusement des ouvrages souterrains / Andra |
|
Céline RIGHINI-WAz |
Ingénieure géologue / Andra |
DU MERCREDI 9 AU VENDREDI 11 JUILLET 2025
DÉPLACEMENT À LISBONNE (PORTUGAL)
|
· Représentants de l'ambassade de France au Portugal |
|
|
Ariane LATHUILLE |
Conseillère diplomatique |
|
Mathilde VANACKERE |
Conseillère de coopération et d'action culturelle |
|
Nicolas SÉJOUR |
Conseiller économique |
|
Victor MARZO |
Chargé de coopération scientifique et universitaire |
|
Flavien MARCON |
Stagiaire INSP |
|
Victor MARZO |
Chargé d'affaires Europe et de partenariats publics à l'Institut français du Portugal (IFP) |
|
· Pre Clàudia SARRICO |
Secrétaire d'État à l'enseignement supérieur |
|
· Entretien avec des chercheuses |
|
|
Joana GONÇALVES-SÁ |
Physicienne et biologiste, Universidade de Lisboa |
|
Cristina BRITO |
Biologiste, Universidade de Lisboa |
|
Paola SANJUAN ALBERTE |
Chercheuse, lauréate L'Oréal |
|
Ana Rita LOPES |
PhD Junior Researcher, Marine and Environnemental Sciences Centre (MARE), laureate L'Oréal |
|
Céline S. Gonçalves |
PjD Assistant Researcher, Cancer Biomarkers and Therapeutics Research Team Life and Health Sciences Research Institute (ICVS) |
|
Maria de Lurdes RODRIGUES |
Vice-rectrice de l'Institut universitaire de Lisbonne |
|
· Échanges avec l'équipe de direction de la Commission pour la citoyenneté et l'égalité de genre (CIG) : |
|
|
Sandra RIBEIRO |
Présidente |
|
Andreia MARQUES |
Responsable des relations internationales |
|
Natividade COELHO |
Responsable de l'égalité, de la documentation et de la communication |
|
· Agence nationale « Ciência Viva » : |
|
|
Rosalia VARGAS |
Présidente |
|
Ivone FACHADA |
Membre de l'équipe de direction
|
|
· David SOUSA |
Directeur général de l'éducation |
|
· Femmes fondatrices de start-up : |
|
|
Luisa CRUZ |
Microharvest |
|
Karly RIBEIRO |
Sheerme |
|
Dulce GUARDA |
Splink |
|
· Femmes du monde économique : |
|
|
Nathalie BALLAN |
Entrepreneure dans le développement durable (B Lab Portugal) et secrétaire générale des CCEF Portgal |
|
Céline ABECASSIS-MOEDAS |
Rectrice pour l'innovation et l'entrepreneuriat à l'Université Católica (et CCEF) |
|
Manuela DOUTEL-HAGHIGHI |
Global Customer Experience Director à Microsoft Portugal, dirige Women@Microsoft |
|
Giorgia TEDESCHI |
Vice-président de la French Tech Lisbonne |
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
VISITE DU LYCÉE LOUIS-LE-GRAND - PARIS
· Interlocuteurs rencontrés
|
Joël BIANCO |
Proviseur |
|
Mireille SALAüN |
Proviseure-adjointe, responsable des CPGE |
|
Delphine GEYER |
Professeur de physique en CPGE |
|
Gil GUIBERT |
Professeur de mathématiques en PSI* |
|
une ancienne élève et des élèves de classes préparatoires scientifiques |
|
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS
|
N° |
Objet |
Acteurs concernés |
Support |
Mise en application |
|
Convaincre les filles et leurs enseignants que les
mathématiques |
||||
|
1 |
Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles, futurs comme actuels, et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes |
État (Ministère de l'Éducation nationale) Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé) |
Maquettes du concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE), du master « Enseignement et éducation » et des modules de formation continue Budget de l'État |
2026 |
|
2 |
Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et leur transmettre des indicateurs statistiques portant sur les écarts de résultats filles-garçons, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle de leur établissement, afin d'engager une prise de conscience, de leur permettre de suivre la situation spécifique de leurs élèves et d'évaluer l'impact des actions mises en place |
État (Ministère de l'Éducation nationale) Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé) |
Actions de formation |
Dès que possible |
|
3 |
Réaliser un bilan des séances de sensibilisation des professeurs de l'éducation nationale aux biais de genre qui devaient être menées à la rentrée 2025, afin de reconduire cette initiative de façon plus efficace à chaque rentrée scolaire |
État (Ministère de l'Éducation nationale), Rectorats |
Organisation interne |
2026 |
|
N° |
Objet |
Acteurs concernés |
Support |
Mise en application |
|
4 |
Former l'ensemble des professeurs des écoles à la pédagogie égalitaire, et en particulier à une pédagogie égalitaire des mathématiques, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine, en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes et en évaluant l'efficacité de ces formations |
État (Ministère de l'Éducation nationale) Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé) |
Modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré Arrêté ministériel définissant les modalités, les épreuves, les programmes et les savoirs exigibles pour le CRPE Maquettes pédagogiques et modules de formation des Inspé |
Dès que possible |
|
5 |
Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et à la déconstruction des stéréotypes et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires |
État (Ministère de l'Éducation nationale), Rectorats |
Circulaires ministérielles, projets d'établissement |
Dès que possible |
|
6 |
Inclure, dans le rapport annuel de l'Arcom sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio, des données sur la proportion de femmes scientifiques à l'antenne et leur temps de parole ainsi que sur leur représentation dans les programmes de fiction diffusés, et renforcer les actions d'incitation et de contrôle à disposition de l'Arcom à l'égard des acteurs du secteur audiovisuel afin d'augmenter cette représentation |
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) |
Article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Organisation interne |
2026 |
|
N° |
Objet |
Acteurs concernés |
Support |
Mise en application |
|
7 |
Soutenir la médiation scientifique, dans et hors des établissements scolaires, notamment en garantissant l'avenir du Palais de la Découverte, en facilitant les interventions de doctorantes et doctorants dans les écoles et en finançant des sorties et activités post et périscolaires scientifiques sur l'ensemble du territoire |
État Collectivités territoriales Établissements scolaires |
Budgets des différents échelons compétents |
2026 |
|
Réécrire l'équation pour encourager l'envie de mathématiques et de sciences |
||||
|
8 |
Faire connaître les études et métiers scientifiques aux collégiennes et lycéennes et mettre en valeur leur utilité sociale, en actualisant la présentation des métiers et formations sur les plateformes Onisep et Parcoursup, en menant des campagnes de communication, en finançant des clubs et stages scientifiques et en soutenant des programmes d'immersion dans l'enseignement supérieur ou en entreprise à destination des élèves mais aussi de leurs professeurs |
Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions), Parcoursup, établissements scolaires, rectorats et établissements d'enseignement supérieur |
Organisation interne |
Dès que possible |
|
9 |
Organiser des campagnes de communication et des interventions dans les établissements scolaires autour de jeunes femmes scientifiques constituant des rôles modèles à la fois inspirants et accessibles |
Rectorats, collectivités territoriales et établissements scolaires |
Actions à mener à chaque niveau territorial |
Dès que possible |
|
10 |
Former l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à la prévention et la lutte contre les stéréotypes et biais de genre, avec une priorité donnée aux enseignants de mathématiques et en s'appuyant sur les acquis de la recherche et les observations croisées de classe |
État (Ministère de l'Éducation nationale) Rectorats |
Actions de formation |
2026 |
|
11 |
Transmettre une culture d'égalité aux jeunes, en abandonnant l'idée de changer ou encourager les filles et en agissant davantage sur les représentations et attitudes des garçons |
État (Ministère de l'Éducation nationale) Établissements scolaires Parents |
Cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) |
Dès que possible |
|
12 |
Mettre en place un véritable service public de l'orientation, sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et associant les familles |
Rectorats |
Actions de formation en direction des directeurs de centres d'information et d'orientation (CIO), des professeurs et des chefs d'établissements |
2026 |
|
Construire un environnement favorable et
protecteur pour les étudiantes, |
||||
|
13 |
Expérimenter des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique à différents degrés et niveaux de la scolarité |
Gouvernement et Parlement Établissements d'enseignement supérieur |
Loi |
2026-2027 |
|
14 |
Développer des dispositifs incitatifs et accueillants pour les filles souhaitant s'orienter vers des filières scientifiques sélectives : bourses dédiées, places en internat, espaces temporaires de non-mixité |
Établissements d'enseignement supérieur Écoles d'ingénieurs CROUS |
Budget de l'État Décisions internes des établissements d'enseignement supérieur |
2026-2027 |
|
15 |
Repenser les processus de sélection au sein des filières scientifiques, en adaptant les épreuves des concours d'entrée aux grandes écoles, et favoriser l'hybridation des parcours et les passerelles entre formations |
Universités et Grandes écoles (dont Banques d'épreuves type Banque PT) |
Organisation interne |
Dès que possible |
|
16 |
Rendre obligatoire, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur scientifique, la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que les formations du personnel académique sur ces questions |
État (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) Établissements d'enseignement supérieurs |
Règlement intérieur ou charte interne |
Dès que possible |
|
Faciliter le recrutement et la poursuite de carrière des femmes scientifique |
||||
|
17 |
Favoriser la féminisation du corps des enseignants et enseignants-chercheurs dans le domaine scientifique en agissant sur les procédures de recrutement et de promotion (quotas, formation des jurys aux biais de genre, révision des critères d'évaluation, programmes de mentorat, etc.) |
Jury de recrutement des enseignants et enseignants-chercheurs dans le domaine scientifique |
Actions de formation Règlement intérieur des universités |
Dès que possible |
|
18 |
Dynamiser le recrutement et la promotion de femmes au sein des entreprises du secteur scientifique (sensibilisation des employeurs aux enjeux de mixité, éga-conditionnalité de certaines aides publiques, prix dédiés aux femmes scientifiques et ingénieures, féminisation de tous les noms de métiers scientifiques) |
État, associations (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs...) |
Actions de sensibilisation Clauses dans les appels à projets ou financements publics |
Dès que possible |
|
19 |
Favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des jeunes chercheuses et chercheurs, en envisageant une réforme des congés parentaux et des mesures destinées à soutenir les jeunes parents chercheurs, notamment les femmes à leur retour de congé maternité |
Gouvernement et Parlement |
Loi |
2026-2027 |
|
20 |
Renforcer les dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les secteurs professionnels scientifiques, publics comme privés, afin de créer des espaces protecteurs pour les femmes et contribuer à leur maintien dans les carrières scientifiques |
Entreprises, universités et grandes écoles, État |
Actions de formation et de sensibilisation Programmes de mentorat |
Dès que possible |
CONSULTATION DU DOSSIER EN LIGNE
(RAPPORT ET COMPTES
RENDUS DES AUDITIONS)
Pour consulter le dossier
* 1 Voir notamment : Stanislas Dehaene et Pauline Martinot, “Qu'apprend-on des évaluations de CP-CE1 ?“ note du CSEN n° 3, 2021 ; T. Breda, J. Sultan Parraud, L. Touitou, “Le décrochage des filles en mathématiques dès le CP : une dynamique diffuse dans la société”, Note IPP, janvier 2024.
* 2 Jean-Paul Fischer et Xavier Thierry, 2022, “Boy's math performance, compared to girls, jumps at age 6“ (in the ELFE's data at least), British Journal of Developmental Psychology. https://doi.org/10.1111/bjdp.12423
* 3 Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade“, Nature, juin 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09126-4
* 4 Audition du 18 juin 2025.
* 5 Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère chargé de l'éducation nationale
* 6 Fleury D., Le Cam M. et Vourc'h R., « Panel des élèves entrés en CP en 2011 - Performances à l'école élémentaire selon le niveau scolaire initial et l'origine sociale », Note d'information, n° 22.14, DEPP, 2022.
* 7 Cioldi I., Raffy G., 2024, "Timss 2023 en CM1 : les résultats en mathématiques et en sciences restent stables en France, sous la moyenne européenne, avec une hausse des inégalités entre filles et garçons", Note d'Information, n° 24.47, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-47
* 8 Le regard du CEE, Les écarts filles-garçons en mathématiques à l'école élémentaire, un enjeu pour les équipes pédagogiques. Étude menée à partir des résultats aux évaluations nationales à l'échelle de chaque école, janvier 2025.
* 9 Voir notamment : M. Amalric, S. Dehaene, PNAS, 2016 ; Hyde, J. S., Science, 2008.
* 10 Miller, Halpern, Trends Cog Sci, 2014.
* 11 Audition du 2 avril 2025.
* 12 Ined
* 13 Audition du 18 juin 2025.
* 14 Carlana M., Implicit Stereotypes: Evidence from Teachers' Gender Bias, The Quarterly Journal of Economics, Volume 134, Issue 3, August 2019, Pages 1163-1224, https://doi.org/10.1093/qje/qjz008
* 15 Audition du 6 mai 2025.
* 16 MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)
* 17 Beilock, Female teachers' math anxiety affects girls' math achievement, 2010.
* 18 Centre Hubertine Auclert, Manuels de lecture du CP : et si on apprenait l'égalité ?
* 19 Audition du 2 avril 2025.
* 20 Crowley, K. et al., 2001
* 21 Audition du 18 juin 2025
* 22 Audition du 4 juin 2025.
* 23 Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian, Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests, Science, 2017.
* 24 Pascal Huguet et Isabelle Régner, Stereotype Threat Among School Girls in Quasi-Ordinary Classroom Circumstances, Journal of Educational Psychology, 2007.
* 25 Pour effectuer ce test :
https://implicit.harvard.edu/implicit/user/demo.france/demo.france.updated/static/takeatest.html
* 26 Nosek, B. A., et al. (2009). National differences in gender- science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement. PNAS, 106(26), 10593-10597.
* 27 Audition du 3 juin 2025.
* 28 Audition du 6 mai 2025.
* 29 Rapport de Cédric Villani et Charles Torossian, 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, 2018.
* 30 Conseil d'analyse économique, Emmanuelle Auriol, Camille Landais et Nina Roussille, Égalité hommes-femmes : une question d'équité, un impératif économique, novembre 2024.
* 31 Audition du 2 avril 2025.
* 32 Le regard du CEE, Les écarts filles-garçons en mathématiques à l'école élémentaire, un enjeu pour les équipes pédagogiques, janvier 2025.
* 33 Rapport conjoint IGÉSR-IGF, « Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles », février 2025.
* 34 Audition du 3 juin 2025.
* 35 Note du CSEN n°13, Lilas Gurgand, Franck Ramus et Monica Neagoy, « Réduction des inégalités entre garçons et filles en mathématiques au CP : évaluation d'une formation expérimentale », juillet 2025.
* 36 Article L. 312-16 du code de l'éducation.
* 37 Xiao, H., Strickland, B. & Peperkamp, S. (2023). “How Fair is Gender-Fair Language? Insights from Gender Ratio Estimations in French”, Journal of Language and Social Psychology, 42(1), 82-106. https://doi.org/10.1177/0261927X221084643
* 38 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-404.html
* 39 Audition du 6 mai 2025.
* 40 Déplacement du 9 au 11 juillet 2025.
* 41 Audition du 8 avril 2025.
* 42 Rapport de la Cour des comptes, « L'enseignement primaire. Une organisation en décalage avec les besoins de l'élève », mai 2025.
* 43 Audition du 8 avril 2025.
* 44 Christian Baudelot, Roger Establer, Allez les filles !, Éditions du Seuil, 1992.
* 45 Joanie Cayouette-Remblière, Léonard Moulin, Comment évoluent les inégalités de performances scolaires au collège ? Un suivi longitudinal des élèves entre la 6e et la 3e, Population (édition française), 2019, 74 (4), pp.551-586.
* 46 M.-C. Delarue, L.Heidmann et G. Raffy, Apprentissages hétérogènes : comment les élèves progressent au collège ? Une étude psychométrique de l'évolution des compétences des élèves. Éducation & formations, 107(2), 7-34, 2024.
* 47 Lacroix A., Philippe C., Salles F., 2024, "Timss 2023 en quatrième pour les mathématiques : des résultats stables en France et un accroissement des écarts de performance entre les élèves", Note d'Information, n° 24.48, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-48
* 48 Blanche V., Bret A., Lacroix A., Salles F., 2024, "Timss 2023 en quatrième pour les sciences : un score moyen stable depuis 2019 mais toujours en retrait par rapport à l'international", Note d'Information, n° 24.49, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-49
* 49 DEPP, test de positionnement de début de seconde, septembre 2022.
* 50 Voir IA1
* 51 Audition du 29 avril 2025.
* 52 DEPP, Timss 2023 en quatrième pour les mathématiques : des résultats stables en France et un accroissement des écarts de performance entre les élèves, 2024
* 53 DEPP, Évaluation des effets du dispositif expérimental d'enseignement intégré de science et technologie, 2015.
* 54 Voir notamment : Baird CL, Keene JR, Closing the gender gap in math confidence: gender and race/ethnic similarities and differences, International Journal of Gender, Science and Technology, 2019 ; Anna Adamecz, Radina Ilieva, Nikki Shure, Revisiting the Dunning-Kruger effect: Composite measures and heterogeneity by gender, Journal of Behavioral and Experimental Economics Volume 116, Juin 2025, 102362.
* 55 Haut-Commissariat au plan - France Stratégie, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d'ici à 2030 ?, mai 2025.
* 56 Voir notamment les travaux de la sociologue Marie Duru-Bellat.
* 57 Audition du 10 avril 2025.
* 58 Voir IA2d.
* 59 Audition du 29 avril 2025.
* 60 Audition du 24 juin 2025.
* 61 DEPP, Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, 2025.
* 62 DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.
* 63 Audition du 10 avril 2025.
* 64 Audition du 12 juin 2025.
* 65 Audition du 29 avril 2025.
* 66 Audition du 8 avril 2025.
* 67 Audition du 27 mars 2025.
* 68 Audition du 24 juin 2025.
* 69 Audition du 29 avril 2025.
* 70 DEPP, 2025.
* 71 Déplacement du 27 juin 2025.
* 72 Audition du 29 avril 2025.
* 73 Audition du 29 avril 2025.
* 74 Audition du 29 avril 2025.
* 75 Audition du 10 avril 2025.
* 76 Audition du 18 juin 2025.
* 77 Voir IA2.
* 78 Lacroix A., Philippe C., Salles F., 2024, "Timss 2023 en quatrième pour les mathématiques : des résultats stables en France et un accroissement des écarts de performance entre les élèves", Note d'Information, n° 24.48, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-48
* 79 Déplacement du 27 juin 2025.
* 80 Audition du 29 avril 2025.
* 81 Audition du 6 mai 2025.
* 82 Audition du 15 mai 2025.
* 83 Audition du 6 mars 2025.
* 84 Audition du 26 juin 2025.
* 85 Audition du 24 juin 2025.
* 86 Audition du 27 mars 2025.
* 87 Audition du 24 juin 2025.
* 88 Audition du 6 mars 2025.
* 89 Audition du 15 mai 2025.
* 90 Audition du 6 mai 2025.
* 91 Audition du 6 mai 2025.
* 92 Audition du 12 juin 2025.
* 93 Thomas Breda, Julien Grenet, Marion Monnet, Clémentine Van Effenterre, "How Effective are French Role Models in Steering Girls Towards Stem? Evidence from French High Schools", The Economic Journal, 133, n° 653, 2023, p.1773-1809.
* 94 Audition du 13 février 2025.
* 95 Audition du 4 juin 2025.
* 96 Rapport conjoint IGÉSR-IGF, Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles, février 2025.
* 97 Audition du 24 juin 2025.
* 98 Audition du 6 mai 2025.
* 99 Audition du 6 mai 2025.
* 100 Audition du 24 juin 2025.
* 101 Audition du 27 mai 2025.
* 102 Audition du 15 mai 2025.
* 103 Haut-Commissariat au plan - France Stratégie, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d'ici à 2030 ?, mai 2025.
* 104 Camille Terrier, Rustamdjan Hakimov, Renke Schmaker, Confidence and College Applications: Evidence from a Randomized Intervention, 2023.
* 105 Audition du 24 juin 2025.
* 106 Voir IIIB.
* 107 Audition du 27 mars 2025.
* 108 Audition du 6 mai 2025.
* 109 Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), Synthèse de la concertation nationale sur l'orientation des élèves, avril 2025.
* 110 Audition du 14 mai 2025.
* 111 Table ronde du 29 avril 2025.
* 112 « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur », direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), ministère de l'éducation nationale, 2025.
* 113 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
* 114 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
Dans ce graphique, les « sciences » comprennent les « sciences fondamentales et applications », les « sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers » et les « plurisciences ».
* 115 Audition du 8 avril 2025.
* 116 Hors BCPST (Biologie, chimie, physique et sciences de la terre).
* 117 Audition du 10 mai 2025.
* 118 Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (1ère année de classe préparatoire scientifique - équivalent de Maths sup)
* 119 Audition du 15 mai 2025.
* 120 Audition du 5 juin 2025.
* 121 Audition du 13 février 2025.
* 122 Mathématiques, Informatique.
* 123 « Comment expliquer la sous-représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives ? », note de l'Institut des politiques publiques, mai 2025, autrices : Cécile Bonneau et Léa Dousset.
* 124 Table ronde du 29 avril 2025.
* 125 Audition du 12 juin 2025.
* 126 Table ronde du 10 avril 2025.
* 127 Audition du 29 avril 2025.
* 128 Audition du 27 mars 2025.
* 129 Table ronde du 15 avril 2025.
* 130 Audition du 12 juin 2025.
* 131 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
* 132 Table ronde du 26 juin 2025.
* 133 « Informatique Mathématiques-Physique » (info MP), « Informatique Mathématiques-Physique-Informatique » (info MPI), « Mathématiques Physique » (MP), « Physique-Sciences de l'ingénieur » (PSI), « Physique-Chimie » (PC), « Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre » (BCPST).
* 134 Audition du 10 avril 2025.
* 135 Chiffres communiqués aux rapporteures par l'ENA Paris-Saclay
* 136 Audition du 10 avril 2025.
* 137 Audition du 12 juin 2025.
* 138 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
* 139 Table ronde du 15 mai 2025.
* 140 Audition du 8 avril 2025.
* 141 https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047791?sommaire=6047805 - Mars 2022 - Auteurs : Léa Chabanon et Maxime Jouvenceau (DEPP)
* 142 Note de l'OBE n°2025-18 du 15 septembre 2025 « Entre passion et rémunération : comprendre les différences femmes-hommes dans les choix d'orientation post-bac » qui analyse les données recueillies par IPSOS dans le cadre d'une enquête mandatée par la Chaire Women in Business de Sciences Po menée en février 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 étudiantes et étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur français.
* 143 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
* 144 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
* 145 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
* 146 Audition du 29 avril 2025.
* 147 Audition du 13 février 2025.
* 148 Audition du 13 février 2025.
* 149 Audition du 5 juin 2025.
* 150 Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.
* 151 Audition du 5 juin 2025.
* 152 Audition du 27 mai 2025.
* 153 Audition du 5 juin 2025.
* 154 Table ronde du 15 avril 2025.
* 155 Audition du 12 juin 2025.
* 156 https://www.polytechnique.edu/sites/default/files/content/communiques/fichiers/2025-05/Synth%C3%A8se%20enqu%C3%AAte%20VSS%202025%20sur%20l%27ann%C3%A9e%202024%20Polytechnique.pdf
* 157 Table ronde du 27 mai 2025.
* 158 Table ronde du 27 mai 2025.
* 159 Table ronde du 26 juin 2025.
* 160 Table ronde du 26 juin 2025.
* 161 Table ronde du 27 mai 2025.
* 162 Audition du 27 mars 2025.
* 163 Table ronde du 27 mai 2025.
* 164 Table ronde du 29 avril 2025.
* 165 Table ronde du 27 mai 2025.
* 166 Audition du 4 juin 2025.
* 167 https://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/en-bref/brochure-violences-sexuelles-sur-le-terrain
* 168 Isabelle Régner, audition du 4 juin 2025.
* 169 https://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/en-bref/brochure-violences-sexuelles-sur-le-terrain
* 170 Table ronde du 26 juin 2025.
* 171 Table ronde du 10 avril 2025.
* 172 Audition du 12 juin 2025.
* 173 Table ronde du 10 avril 2025.
* 174 Audition du 12 juin 2025.
* 175 Audition du 5 juin 2025.
* 176 Audition du 12 juin 2025.
* 177 Table ronde du 13 février 2025.
* 178 Table ronde du 10 avril 2025.
* 179 Table ronde du 15 mai 2025.
* 180 Audition du 29 avril 2025.
* 181 Audition du 10 avril 2025.
* 182 Audition du 29 avril 2025.
* 183 Table ronde du 10 avril 2025.
* 184 Table ronde du 6 mars
* 185 Audition du 29 avril 2025.
* 186 Table ronde du 26 juin 2025.
* 187 Ref rapport
* 188 Déplacement de la délégation sur le plateau de Saclay le 22 mai 2025.
* 189 Table ronde du 15 mai 2025.
* 190 Table ronde du 29 avril 2025.
* 191 Table ronde du 10 avril 2025.
* 192 Table ronde du 29 avril 2025.
* 193 Table ronde du 10 avril 2025.
* 194 Audition du 13 avril 2025.
* 195 Table ronde du 15 mai 2025.
* 196 Déplacement de la délégation à Saclay le 22 mai 2025.
* 197 Audition du 27 mars 2025.
* 198 Table ronde du 10 avril 2025.
* 199 Table ronde du 27 mai 2025.
* 200 Table ronde du 27 mai 2025.
* 201 France Stratégie, « Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d'ici à 2030 ? », juin 2025.
* 202 Table ronde du 26 juin 2025.
* 203 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
Dans ce graphique, les « sciences » comprennent les « sciences fondamentales et applications », les « sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers » et les « plurisciences ».
* 204 Enseignement supérieur et recherche, Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, mars 2025.
Dans ce graphique, les « sciences » comprennent les « sciences fondamentales et applications », les « sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers » et les « plurisciences ».
* 205 Sciences de l'ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique. Sciences de l'ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique.
* 206 Table ronde du 29 avril 2025.
* 207 Audition du 5 juin 2025.
* 208 Table ronde du 15 mai 2025.
* 209 Table ronde du 10 avril 2025.
* 210 Table ronde du 15 mai 2025.
* 211 Table ronde du 29 avril 2025.
* 212 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
* 213 Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.
* 214 https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-723-notice.html
* 215 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
* 216 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
* 217 Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
* 218 Audition du 4 juin 2025.
* 219 Table ronde du 10 avril 2025.
* 220 Table ronde du 26 juin 2025.
* 221 Audition du 13 février 2025.
* 222 Table ronde du 6 mars 2025.
* 223 Audition du 13 février 2025.
* 224 Table ronde du 29 avril 2025.
* 225 Table ronde du 26 juin 2025.
* 226 Table ronde du 29 avril 2025.
* 227 Table ronde du 6 mars 2025.
* 228 Table ronde organisée à l'ENS Paris-Saclay à l'occasion du déplacement de la délégation à Paris-Saclay le 22 mai 2025.
* 229 Audition du 13 février 2025.
* 230 Table ronde du 26 juin 2025.
* 231 Audition du 27 mars 2025.
* 232 Sciences de l'ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique. Sciences de l'ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique.
* 233 Sciences de l'ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique. Sciences de l'ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique.
* 234 Table ronde du 26 juin 2025.
* 235 Association créée en 2020 pour la promotion de la mixité et l'inclusion dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
* 236 Table ronde du 10 avril 2025.
* 237 Audition du 13 février 2025.
* 238 Audition du 4 juin 2025.
* 239 Audition du 13 février 2025.
* 240 Voir
le compte rendu de la table ronde :
https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20250303/ddf_tr_06_03_2025.html
* 241 C'est le cas par exemple de Mileva Einstein, épouse d'Albert, qui a contribué à la mise en place de la théorie de la relativité, de Rosalind Franklin, qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN, de Jocelyn Bell, qui a découvert le premier pulsar, de Marthe Gautier, co-découvreuse du chromosome de la Trisomie 21, ou encore de Lise Meitner, découvreuse de la fission nucléaire : https://www.occitanie-ouest.cnrs.fr/sites/delegation_dr14/files/page/2024-03/Matilda2024_0.pdf
* 242 Table ronde du 10 avril 2025.
* 243 Une commission ad hoc, créée spécialement pour la mise en oeuvre de ce projet, a remis un rapport détaillant le projet début septembre 2025 à la maire de Paris. La liste finale des femmes scientifiques retenues par la commission sera rendue par l'association Femmes & Sciences à la maire de Paris mi-décembre 2025, après avis de l'Académie des Sciences et de l'Académie des Technologies.
* 244 Table ronde du 29 avril 2025.
* 245 Table ronde du 26 juin 2025.
* 246 Table ronde du 26 juin 2025.
* 247 Audition du 27 mars 2025.
* 248 Table ronde du 29 avril 2025.
* 249 Table ronde du 6 mars 2025.
* 250 Loi n° 2021-1774.
* 251 Audition du 13 février 2025.
* 252 Audition du 27 mars 2025.
* 253 Table ronde du 6 mars 2025.
* 254 Par exemple, la Société française de physique (SFP) a élaboré une charte selon laquelle les conférences scientifiques ne sont pas soutenues financièrement par la SFP si un certain seuil de femmes invitées n'est pas atteint.
* 255 Table ronde du 29 avril 2025.