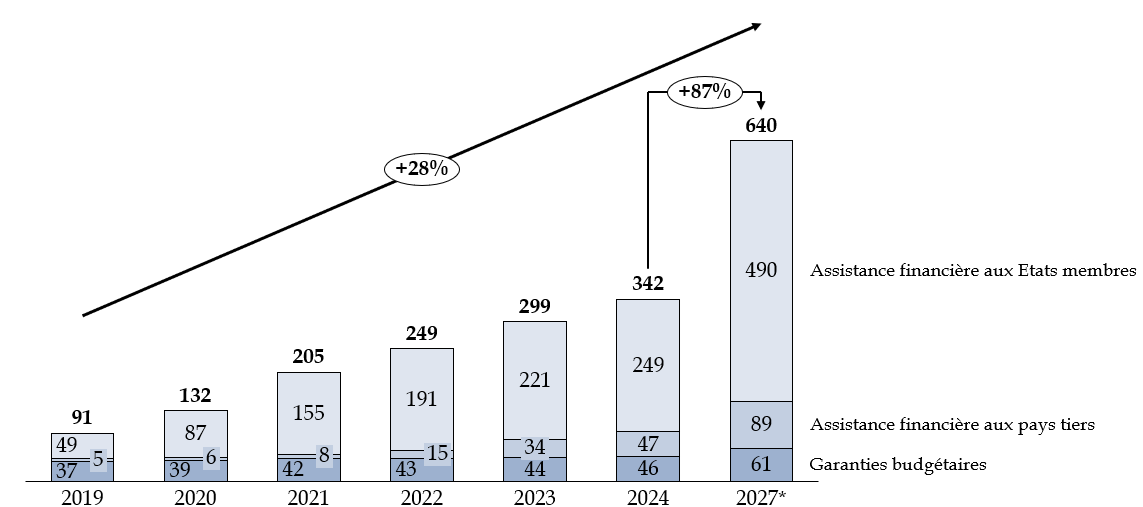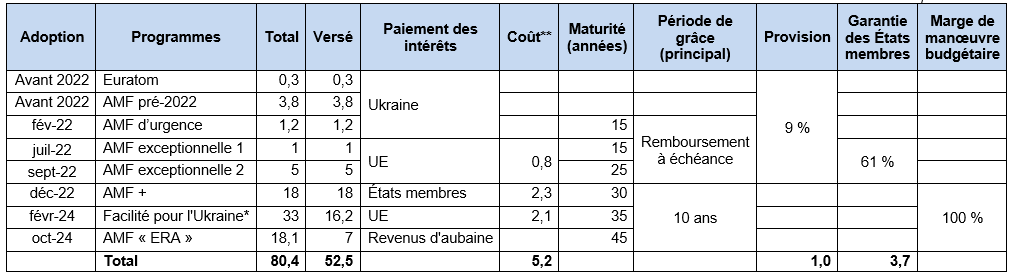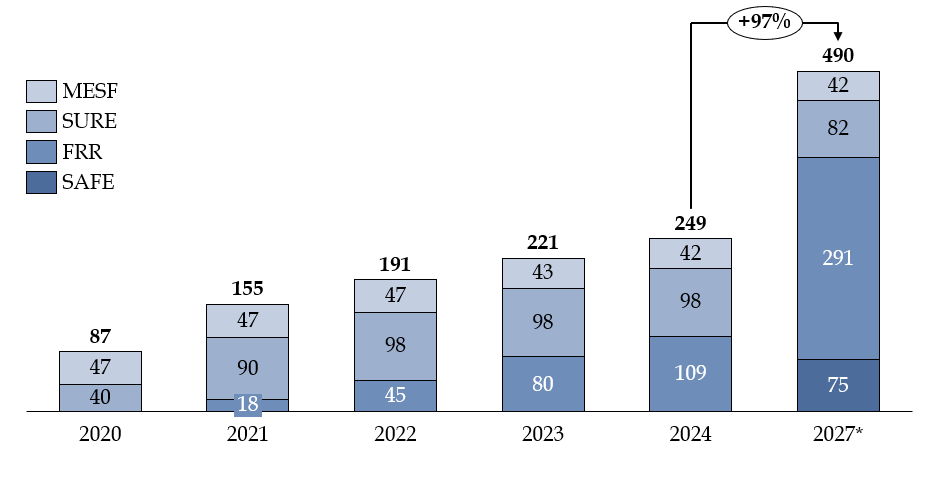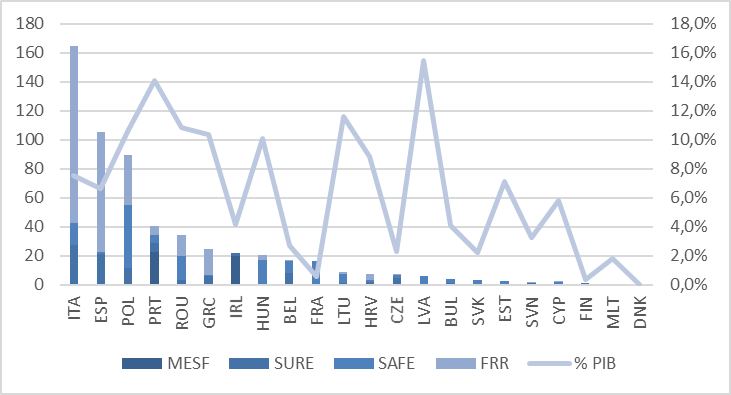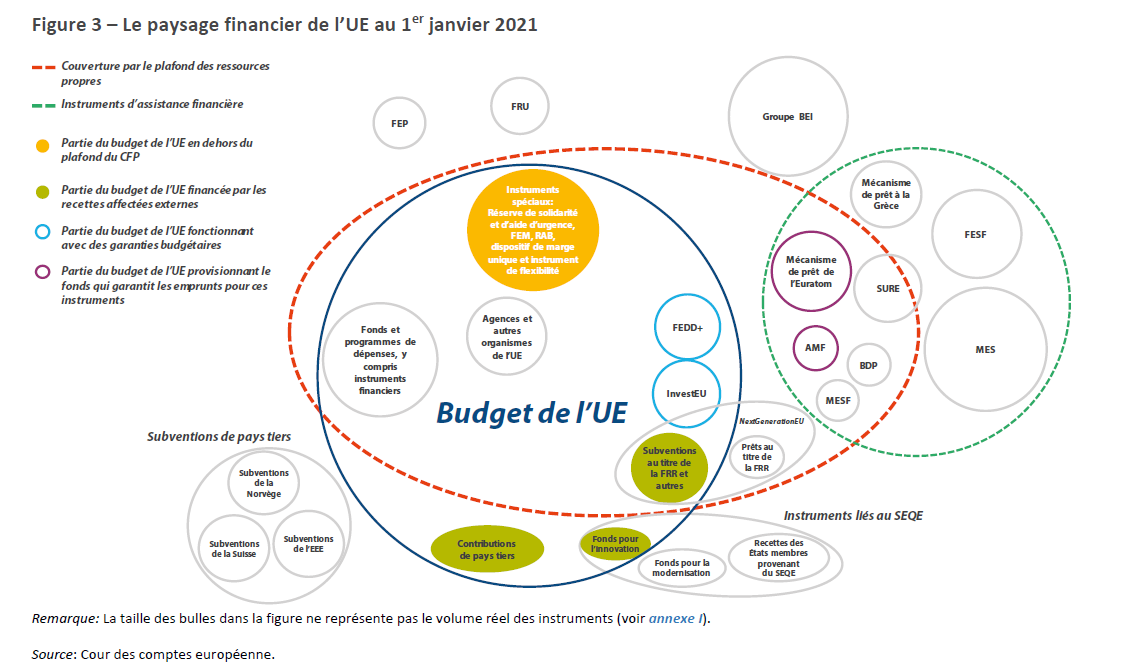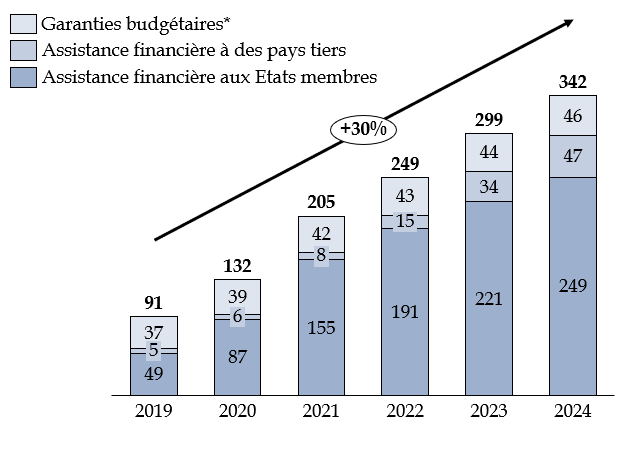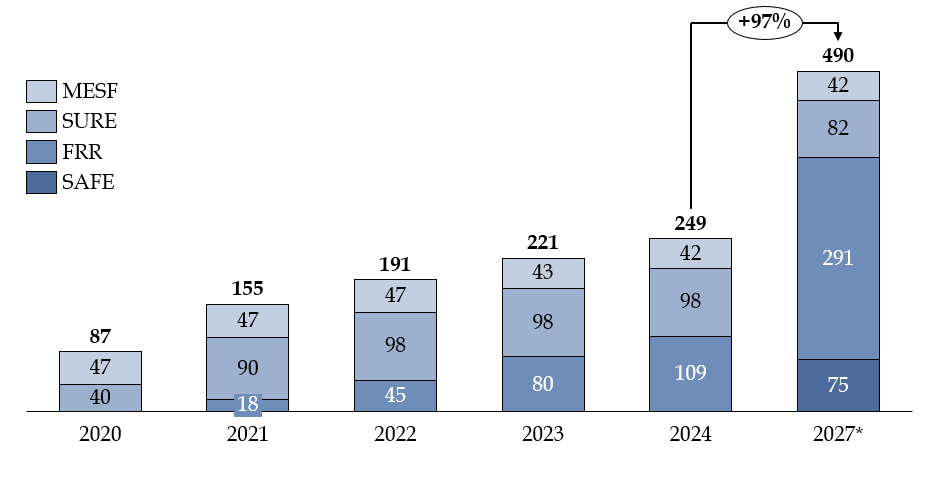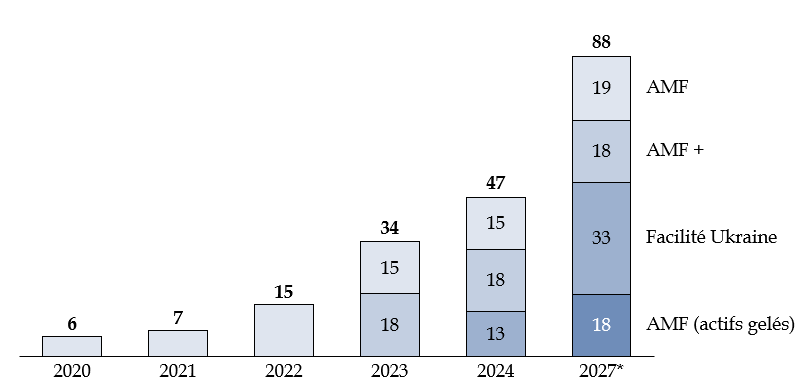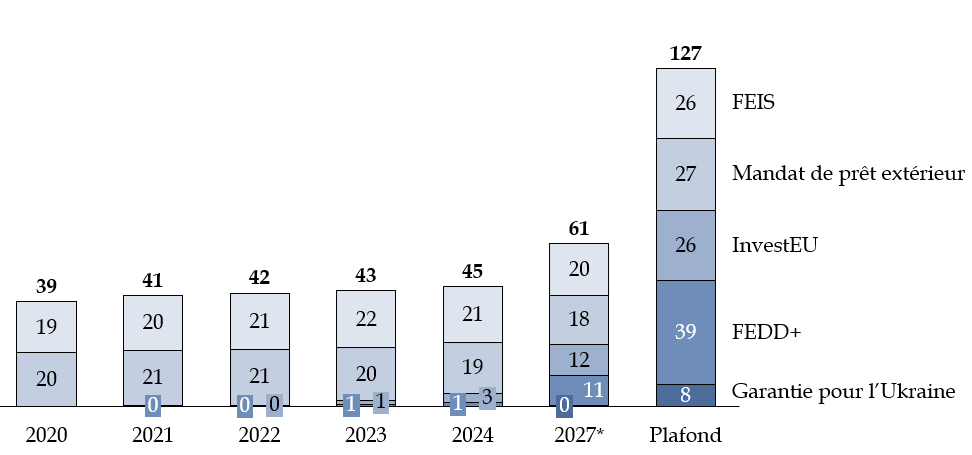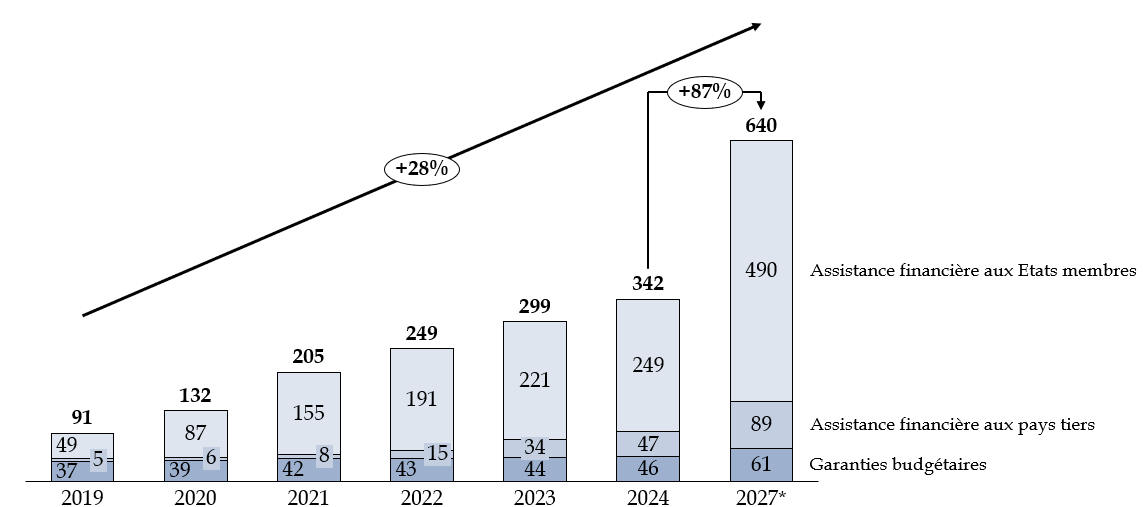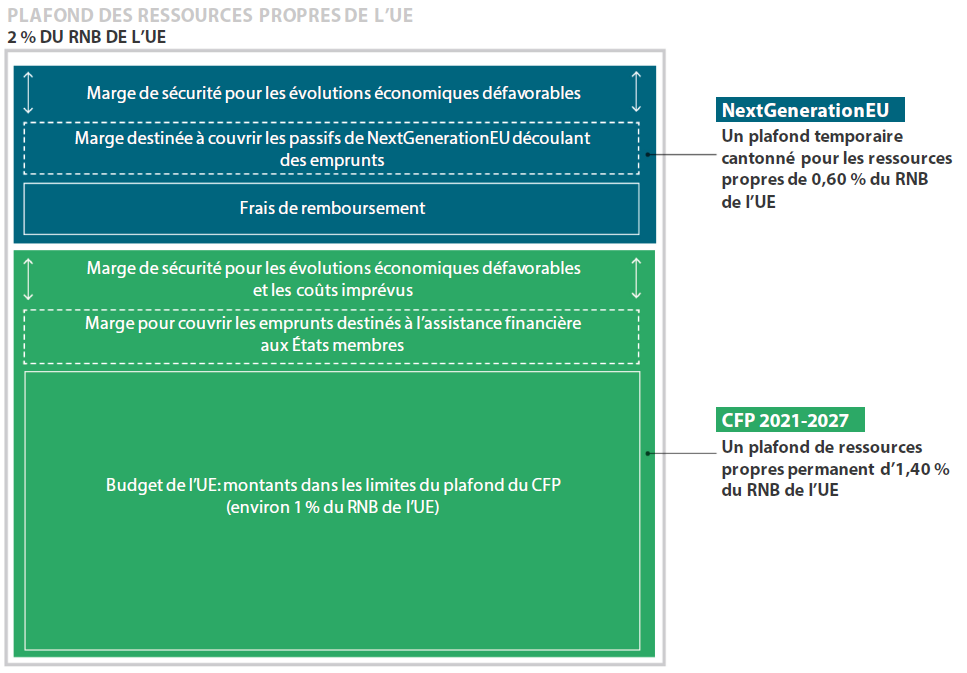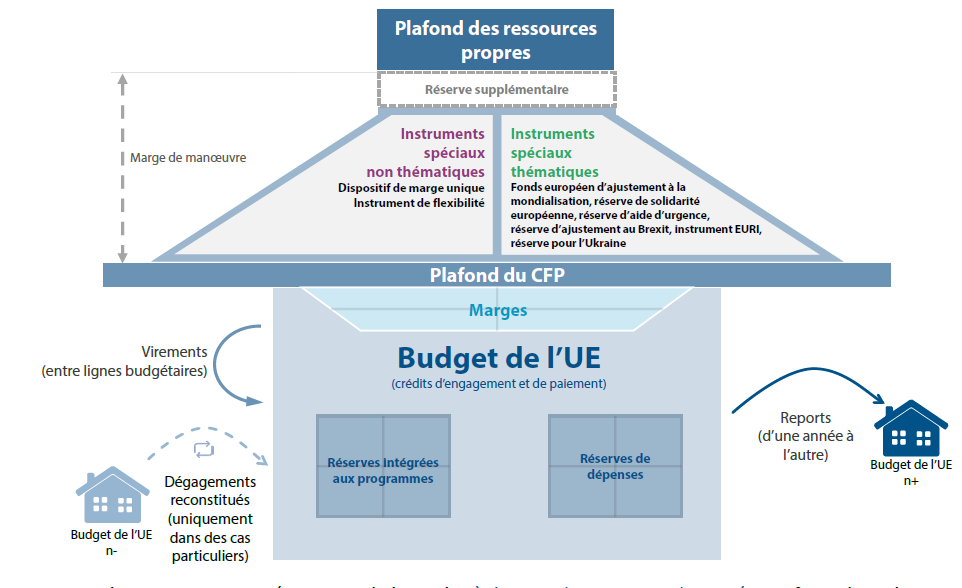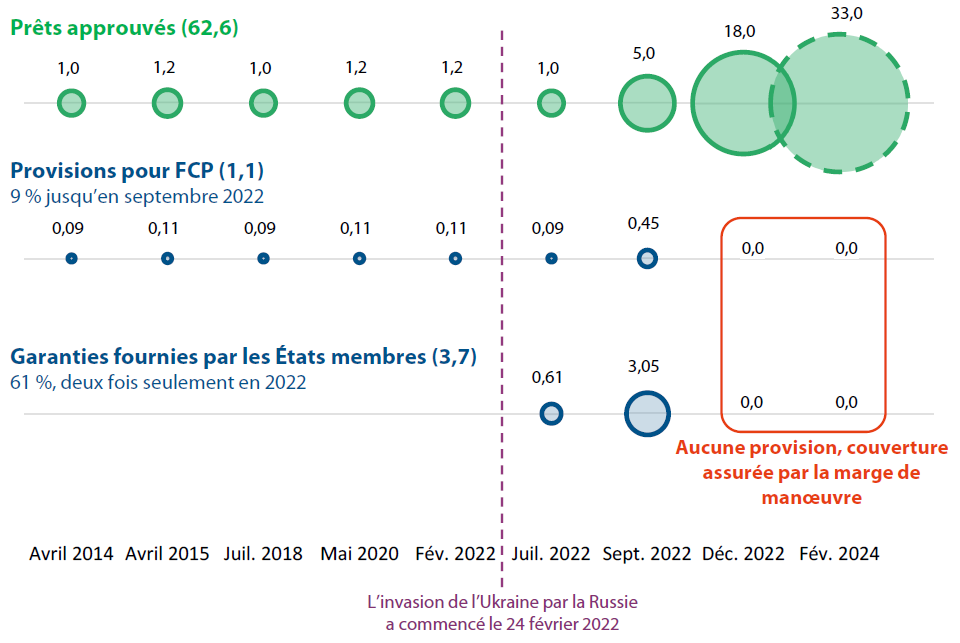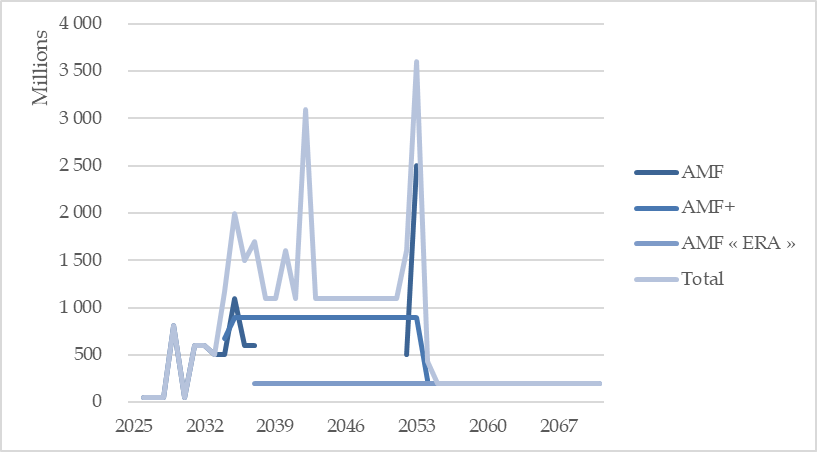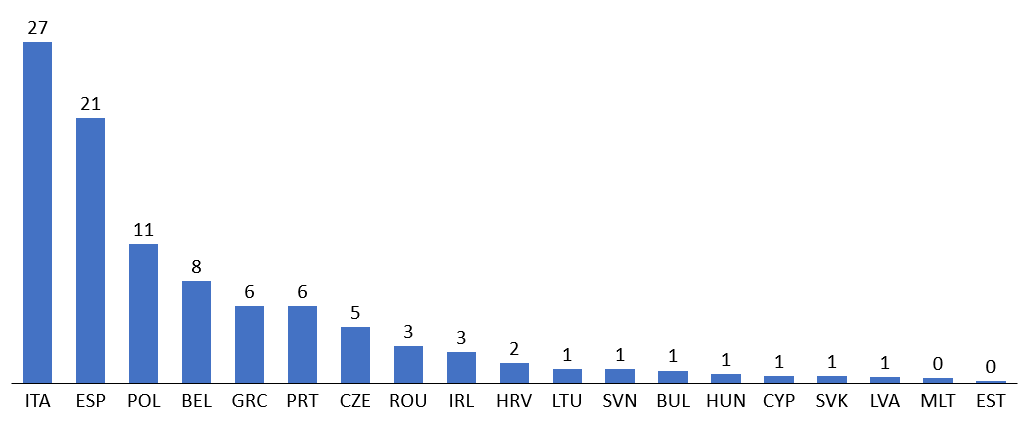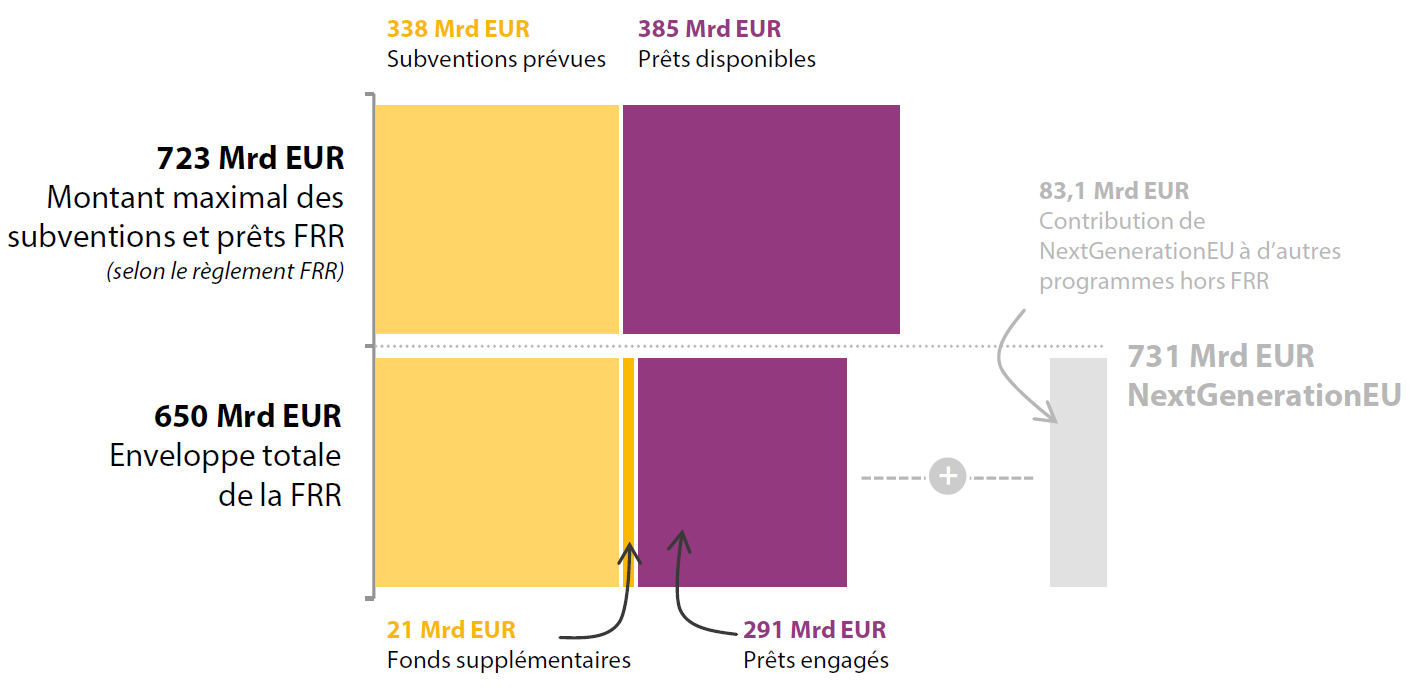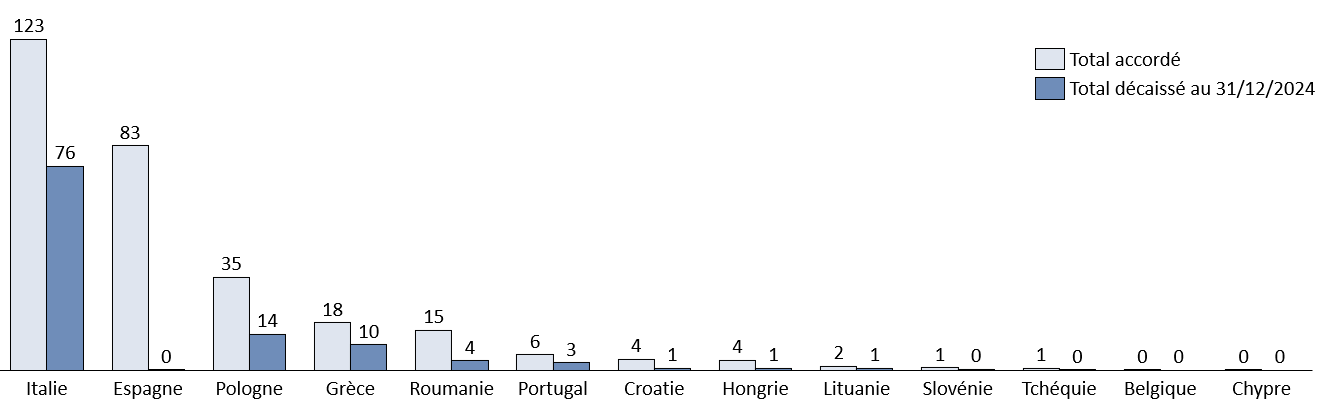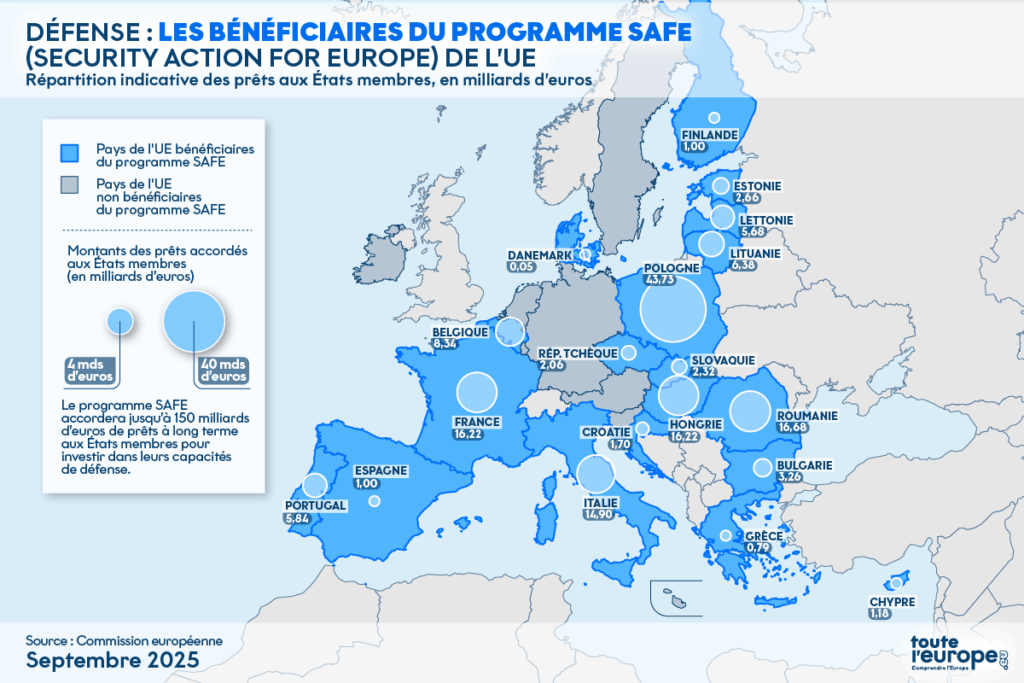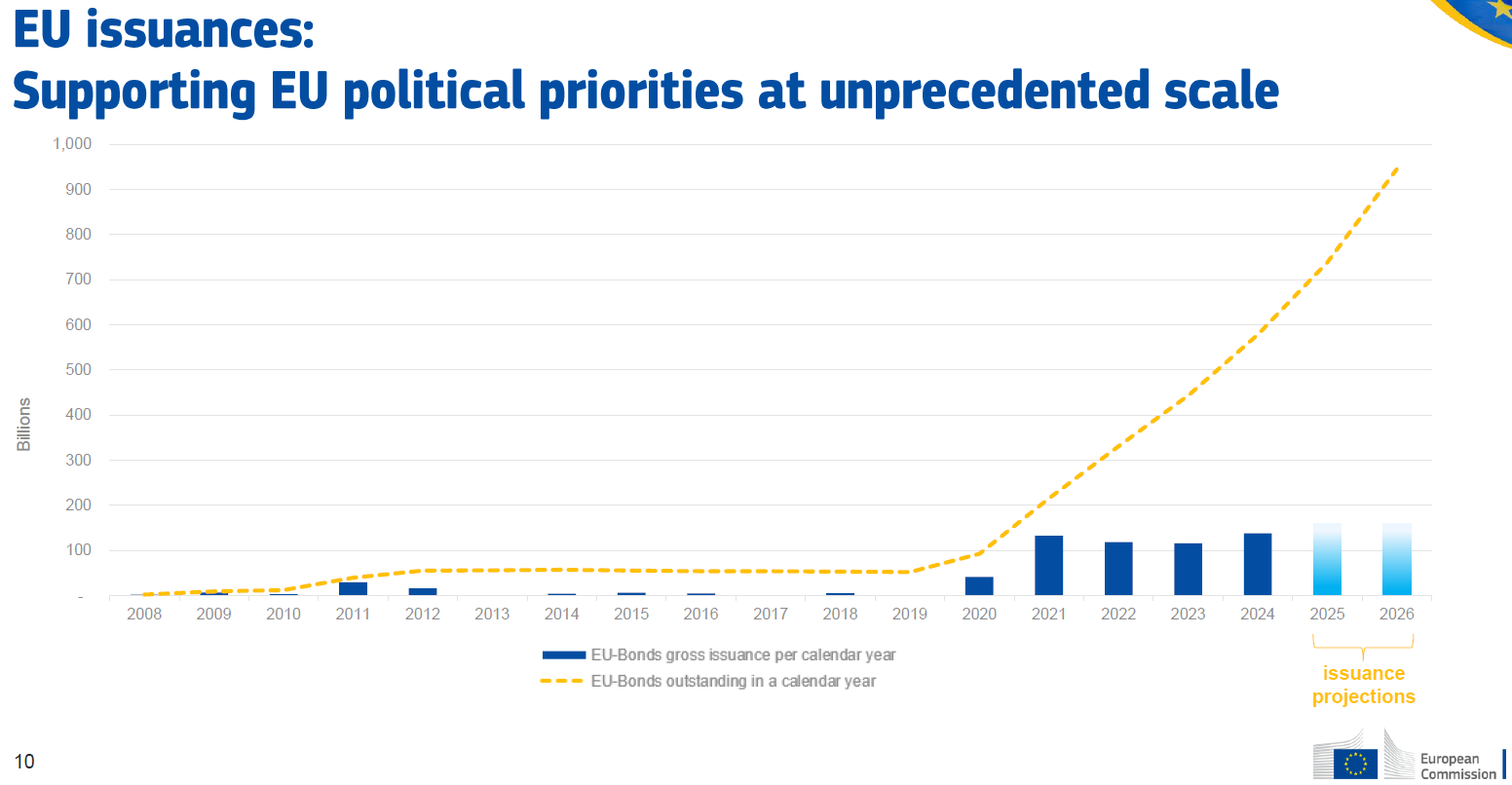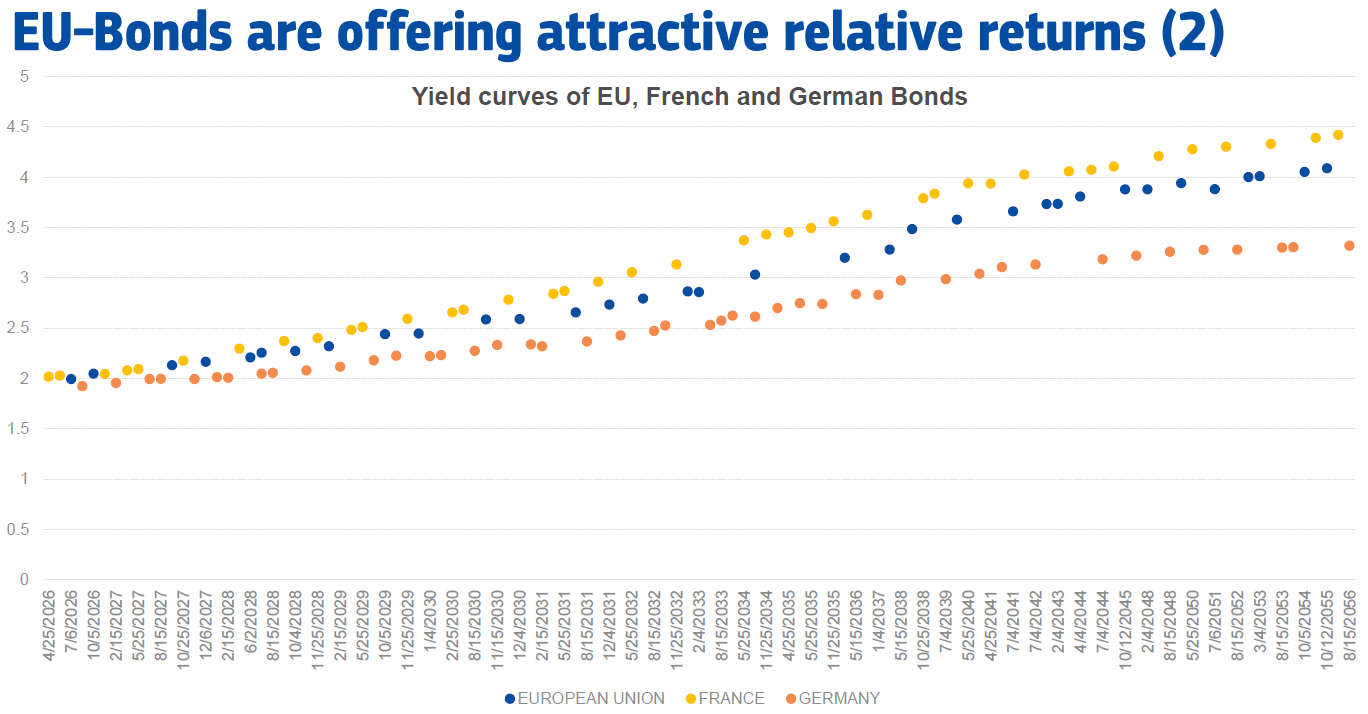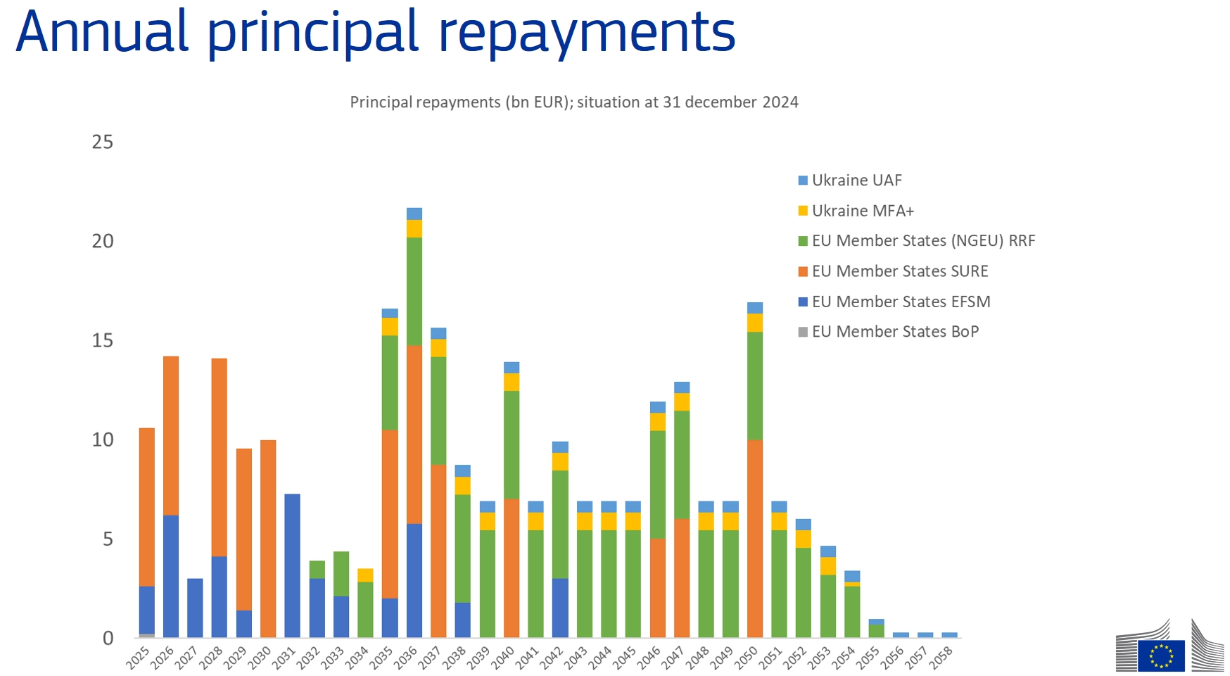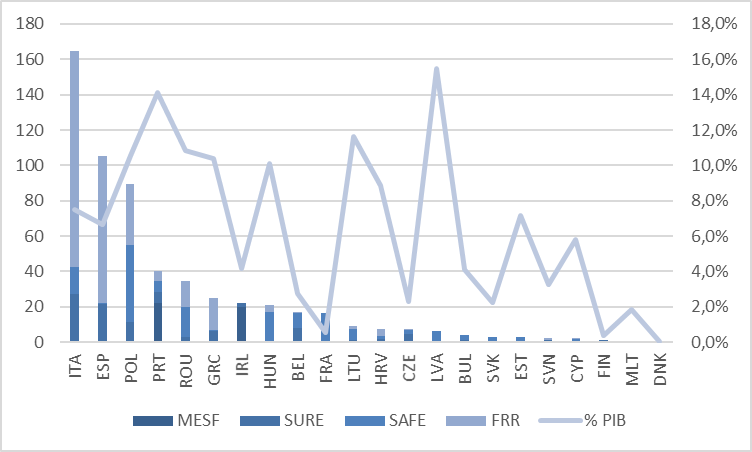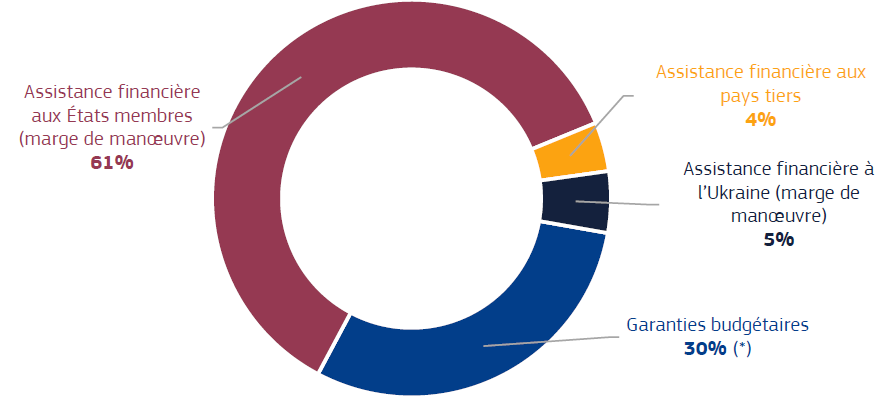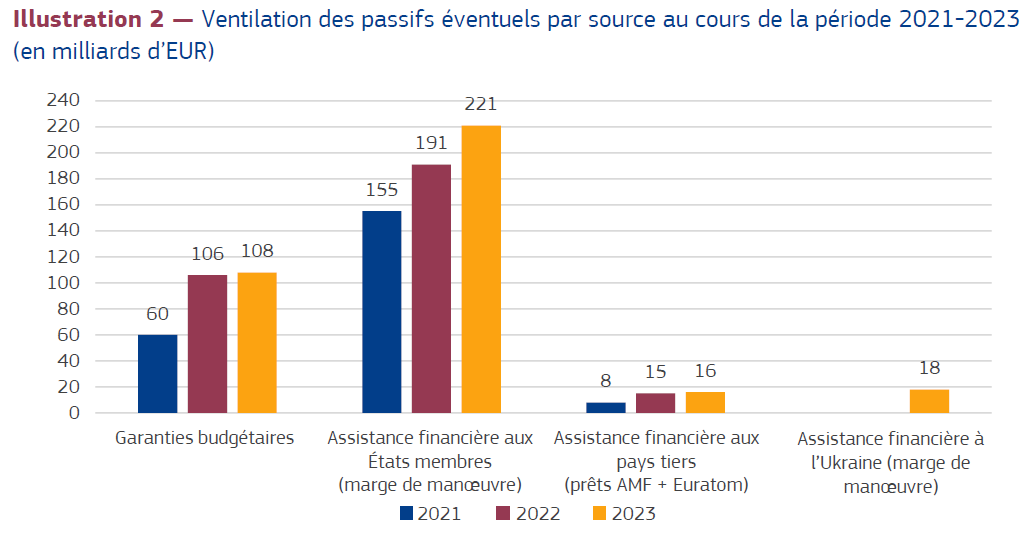- L'ESSENTIEL
- LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
- I. UN BUDGET EUROPÉEN EXPOSÉ PAR DES
ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE TOUJOURS PLUS NOMBREUX ET TOUJOURS
PLUS IMPORTANTS
- A. DÉFINITIONS ET PRÉSENTATIONS DES
PRINCIPAUX ENGAGEMENTS EXTRABUDGÉTAIRES DE L'UNION
EUROPÉENNE
- B. LES PASSIFS ÉVENTUELS ONT CONNU UNE
TRÈS FORTE HAUSSE, QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE DANS LES PROCHAINES
ANNÉES
- 1. Des passifs éventuels en forte
croissance, portés par des dispositifs d'assistance aux États
membres et, dans une moindre mesure, à l'Ukraine
- 2. Une tendance très haussière qui
devrait se poursuivre ces prochaines années
- a) Une assistance aux États membres en
très forte progression, sous l'effet du plan de relance et de nouveaux
engagements
- b) Une assistance aux pays tiers de moindre ampleur
mais au dynamisme marqué
- c) Des garanties qui devraient encore se
développer sur les dernières années du cadre financier
pluriannuel
- d) Une hausse toujours plus substantielle de
l'exposition du budget de l'Union européenne, qui pourrait être
accentuée par la situation budgétaire de l'Ukraine
- (1) La progression de l'exposition du budget de
l'Union européenne maintient son rythme très soutenu
- (2) Alors que le conflit ukrainien s'enlise, le
coût du soutien financier européen devrait encore progresser dans
les prochaines années
- a) Une assistance aux États membres en
très forte progression, sous l'effet du plan de relance et de nouveaux
engagements
- 1. Des passifs éventuels en forte
croissance, portés par des dispositifs d'assistance aux États
membres et, dans une moindre mesure, à l'Ukraine
- C. UNE EXPOSITION DU BUDGET EUROPÉEN
SUPPORTÉE MAJORITAIREMENT PAR LES ÉTATS-MEMBRES
- A. DÉFINITIONS ET PRÉSENTATIONS DES
PRINCIPAUX ENGAGEMENTS EXTRABUDGÉTAIRES DE L'UNION
EUROPÉENNE
- II. L'ASSISTANCE AUX PAYS TIERS CONNAÎT UNE
HAUSSE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE, SOUS L'EFFET DES DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS D'ASSISTANCE À L'UKRAINE
- A. L'ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE A LONGTEMPS
CONSTITUÉ LE PRINCIPAL MÉCANISME DE SOUTIEN FINANCIER À
DES PAYS TIERS
- B. LE SOUTIEN FINANCIER APPORTÉ À
L'UKRAINE S'EST ACCRU AVEC LES ANNÉES, À LA HAUTEUR DE
L'AGRESSION RUSSE, EXPOSANT DE PLUS EN PLUS FORTEMENT LE BUDGET
EUROPÉEN
- 1. Un soutien affirmé dès 2014, pour
faire face à l'agression russe, prenant la forme d'une assistance
macrofinancière (AMF) faiblement provisionnée
- 2. Un soutien maintenu à l'été
2022, mais avec un taux de couverture en forte hausse
- 3. À partir de 2023, l'ampleur du soutien
financier amène paradoxalement à faire fi des règles de
provisionnement
- 4. Depuis 2024, l'Union européenne s'efforce
de contenir son exposition financière en mobilisant les avoirs russes
immobilisés
- 5. Dans l'ensemble, un soutien d'ampleur qui
comporte plusieurs points d'attention
- 1. Un soutien affirmé dès 2014, pour
faire face à l'agression russe, prenant la forme d'une assistance
macrofinancière (AMF) faiblement provisionnée
- A. L'ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE A LONGTEMPS
CONSTITUÉ LE PRINCIPAL MÉCANISME DE SOUTIEN FINANCIER À
DES PAYS TIERS
- III. L'ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX
ÉTATS MEMBRES ET LES GARANTIES BUDGÉTAIRES ONT PERMIS DE
DÉMULTIPLIER LA PUISSANCE FINANCIÈRE DE L'UE
- A. UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX
ÉTATS MEMBRES DONT LA FORTE HAUSSE DOIT ÊTRE SUIVIE AVEC
VIGILANCE
- 1. Les instruments de dette en faveur des
États membres se sont accumulés avec les crises
successives
- a) Le MESF a constitué un premier
instrument financier de gestion de crise
- b) L'instrument SURE a permis d'apporter une
réponse rapide à un marché de l'emploi européen
gravement menacé par la crise sanitaire
- c) La facilité pour la reprise et la
résilience concentre des moyens très importants sur quelques
États membres, pour une efficacité discutable
- d) SAFE, un nouvel instrument de crise pour
financer l'effort de défense
- a) Le MESF a constitué un premier
instrument financier de gestion de crise
- 2. Les programmes d'assistance financière
aux États membres font courir des risques de moyen terme à la
France, en tant qu'emprunteur potentiel et en tant qu'État membre
contributeur
- 1. Les instruments de dette en faveur des
États membres se sont accumulés avec les crises
successives
- B. LES GARANTIES SUR LE BUDGET APPARAISSENT
AUJOURD'HUI COMME DES INSTRUMENTS SÉCURISÉS ET EFFICIENTS
- A. UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX
ÉTATS MEMBRES DONT LA FORTE HAUSSE DOIT ÊTRE SUIVIE AVEC
VIGILANCE
- IV. LE SUIVI DU RISQUE CAUSÉ PAR
L'EXPOSITION DU BUDGET EUROPÉEN N'EST AUJOURD'HUI RÉALISÉ
QU'À BRUXELLES ET SE CONCENTRE SUR LE COURT TERME
- A. UN SUIVI RÉGULIER ET DOCUMENTÉ AU
NIVEAU EUROPÉEN MAIS QUI POURRAIT ÊTRE ENRICHI, NOTAMMENT SUR
L'EXPOSITION À MOYEN TERME
- 1. La Commission européenne a adopté
et mis en oeuvre de bonnes pratiques en matière de documentation et
gestion des risques
- 2. Les passifs éventuels
provisionnés apparaissent maîtrisés, même si on ne
peut exclure un risque de sous-provisionnement à moyen terme
- 3. Une marge de manoeuvre suffisante pour
protéger le budget européen à court terme, mais qui
nécessite une analyse prospective à moyen-terme
- 1. La Commission européenne a adopté
et mis en oeuvre de bonnes pratiques en matière de documentation et
gestion des risques
- B. UN DÉFICIT DE SUIVI AU NIVEAU
FRANÇAIS EN L'ABSENCE DE RISQUE À COURT TERME
- A. UN SUIVI RÉGULIER ET DOCUMENTÉ AU
NIVEAU EUROPÉEN MAIS QUI POURRAIT ÊTRE ENRICHI, NOTAMMENT SUR
L'EXPOSITION À MOYEN TERME
- I. UN BUDGET EUROPÉEN EXPOSÉ PAR DES
ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE TOUJOURS PLUS NOMBREUX ET TOUJOURS
PLUS IMPORTANTS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 12
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur les engagements financiers extrabudgétaires de l'Union européenne,
Par M. Jean-Marie MIZZON,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
La commission des finances a examiné, le mercredi°8°octobre°2025, le rapport de M. Jean-Marie Mizzon, rapporteur spécial de la mission « Participation de la France au budget de l'Union européenne », à la suite de son contrôle budgétaire sur les engagements financiers extrabudgétaires de l'Union européenne.
I. UN BUDGET EUROPÉEN EXPOSÉ PAR DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE TOUJOURS PLUS NOMBREUX ET TOUJOURS PLUS IMPORTANTS
A. UNE EXPOSITION EN FORTE HAUSSE DU BUDGET DE L'UE
Les engagements extrabudgétaires recouvrent l'ensemble des obligations financières potentielles qui pourraient être contractées en fonction d'un événement futur, en d'autres termes, des situations où le défaut d'un tiers engage la responsabilité financière de l'UE. Le cas le plus fréquent est celui d'opérations où l'Union européenne (UE) prête en s'endettant. La notion recouvre le concept comptable de « passif éventuel » et comprend aussi les garanties budgétaires octroyées par l'UE.
Engagements extrabudgétaires de l'UE
|
Type de passif |
Description |
Principaux dispositifs |
|
Assistance financière aux États membres |
Prêts financés par des emprunts de l'Union pour lesquels celle-ci reste responsable vis-à-vis des investisseurs finaux |
Instrument de soutien temporaire à
l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE)
Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) Agir pour la sécurité de l'Europe (SAFE) |
|
Assistance financière aux pays tiers |
Assistances macrofinancières Dispositifs ad hoc en faveur de l'Ukraine |
|
|
Garanties budgétaires |
Garanties pour lesquelles l'Union couvre les pertes des partenaires chargés de la mise en oeuvre |
Fonds InvestEU |
Source : commission des finances du Sénat, d'après la Commission européenne
Au gré des crises, le niveau de risque porté par le budget européen a presque quadruplé entre 2019 et 2024 (soit une hausse moyenne de 30 % par an), avec une forte poussée au moment de la crise sanitaire (+ 51 % par an de 2019 à 2021) suivie d'une progression soutenue (+ 19 % par an depuis 2021) à mesure que les dispositifs d'assistance décidés durant la crise sanitaire ont été mis en oeuvre et que de nouveaux instruments ont été instaurés pour soutenir l'Ukraine. Or on peut s'attendre à ce que l'exposition du budget de l'Union européenne continue de s'accroître à un rythme plus que significatif, doublant presque d'ici la fin du CFP 2021-2027, pour atteindre 640 milliards d'euros. Le rythme de croissance se maintiendrait presqu'au rythme observé depuis 2019, atteignant 28 % par an.
Projection de l'exposition du budget de l'Union
européenne
à la fin du cadre financier pluriannuel
2021-2027
(en milliards d'euros)
Notes : *Estimations de la commission des finances, sur la base des données publiques et d'échanges avec les services de la Commission européenne.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne
B. UNE EXPOSITION SUPPORTÉE MAJORITAIREMENT PAR LES ÉTATS MEMBRES
Les risques que font courir les engagements extrabudgétaires aux finances de l'Union varient s'ils sont provisionnés ou non. Les garanties budgétaires et, jusque récemment, l'ensemble des passifs éventuels issus de l'assistance financière à des pays tiers, étaient partiellement provisionnés.
À l'inverse, les engagements extrabudgétaires ayant connu la plus forte progression ne sont pas provisionnés, soit ceux découlant de l'assistance financière aux États membres de l'UE, ainsi, désormais, que certains dispositifs de soutien à l'Ukraine. Ils sont couverts par la « marge de manoeuvre », soit l'écart entre le plafond des ressources propres pouvant être perçus auprès des États membres, fixé par la décision relative aux ressources propres, et les plafonds de dépenses, fixés par le cadre financier pluriannuel (CFP).
Si des enveloppes budgétaires existent pour faire face aux situations imprévues, et si les services de la Commission sont assurément experts pour réaliser des virements et des reports entre lignes budgétaires, il n'y a pas d'argent magique et tout défaut sur un instrument couvert par la marge de manoeuvre, se traduira, in fine, par une baisse de certaines dépenses de l'Union européenne, ou une hausse des contributions des États membres.
II. LE SOUTIEN FINANCIER APPORTÉ À L'UKRAINE S'EST ACCRU AVEC LES ANNÉES, À LA HAUTEUR DE L'AGRESSION RUSSE, EXPOSANT DE PLUS EN PLUS LE BUDGET EUROPÉEN
Le soutien à l'Ukraine représentait, fin 2024, près de 90 % des prêts accordés par l'Union à des pays tiers, expliquant la très grande majorité de la hausse observée sur ces prêts. Les montants prêtés à l'Ukraine ont en effet connu une progression exponentielle : de 4,1 milliards d'euros avant 2022 à 7,2 milliards d'euros en 2022 (+ 76 %) puis 18 milliards d'euros en 2023 (+ 150 %) et 33 milliards d'euros en 2024 (+ 83 %) : les prêts octroyés dans le cadre de la facilité pour l'Ukraine en 2024 représentent ainsi 8 fois le volume de prêt octroyé avant 2022. Au total, 80,4 milliards d'euros ont été engagés en faveur de l'Ukraine, dont 52,5 milliards déjà décaissés au 16 juin 2025, le reste devant l'être d'ici 2027.
Si les montants prêtés constituent l'exposition du budget de l'Union européenne, le coût direct de ces instruments s'élève à 5,2 milliards d'euros pour la bonification des intérêts, auquel on peut ajouter et 4,7 milliards d'euros de provisions et garanties pour la couverture du risque (coût porté, selon le dispositif, soit par le budget de l'Union européenne, soit par les États membres directement).
Alors que dans un premier temps, la guerre d'invasion russe en Ukraine a conduit à une augmentation du taux de couverture du risque sur les prêts accordés, passant de 9 % à 70 %, la forte progression des volumes prêtés à partir de 2023 a poussé à un revirement de position, avec l'abandon de toute forme de provisionnement. En pratique, les prêts, les plus volumineux ont été accordés aux conditions les plus favorables, avec des maturités de plus en plus longues et des garanties de moins en moins formalisées. Le rapporteur observe que ce revirement, qui constitue essentiellement un transfert de risque du budget de l'Union vers celui des États membres contributeurs, n'a été aucunement justifié par les autorités européennes et simplement présenté comme un ajustement technique.
Les administrations européennes et françaises interrogées minimisent, ce risque, en notant que les prêts en question bénéficient d'une période de grâce de 10 ans et de maturités longues pour lisser le choc. Le rapporteur spécial estime toutefois que, sans remettre en cause la nécessité de soutenir l'Ukraine contre une agression qui menace l'ensemble du continent, il est de bonne gestion de ne pas exclure la situation où ce pays sort durablement affaibli du conflit, très endetté et avec des capacités productives réduites, nécessitant une annulation ou une restructuration d'une partie plus ou moins significative de sa dette. Il appartient donc aux administrations européenne et française de communiquer clairement et régulièrement sur les sommes déboursées et remboursées sur cette dette particulièrement risquée, mais aussi sur le risque de défaut du partenaire ukrainien.
Synthèse des prêts accordés à l'Ukraine et de leurs modalités de garantie
(en milliards d'euros, sauf précision contraire)
Notes : * volet prêt ; **coût des bonifications d'intérêt apportées ; au 16 juin 2025.
Source : commission des finances d'après la Commission européenne (DG ECFIN)
Depuis fin 2024, les institutions européennes ont abandonné cette politique de prêts particulièrement risquée. Afin de maîtriser le coût de ces prêts et de limiter le risque associé à un défaut ukrainien, les États membres ont décidé, dès 2024, d'exploiter les avoirs russes immobilisés en Europe. Un premier prêt de 18,1 milliards d'euros a ainsi été accordé, fondé sur les revenus d'aubaine de ces actifs.
Aujourd'hui, alors que le conflit ukrainien s'enlise, le FMI estime qu'un soutien budgétaire substantiel sera encore nécessaire, dépassant les 10 milliards d'euros par an. Tandis que le soutien américain est très incertain, les prêts de l'UE à l'Ukraine pourraient franchir un nouveau cap dans les prochaines années. Les ressources de l'UE étant contraintes, de nouvelles pistes sont étudiées pour ne pas se limiter aux revenus d'aubaine des actifs russes immobilisés mais exploiter aussi leur capital. Selon ces modalités, un prêt de réparation de 140 milliards d'euros est envisagé pour combler les besoins budgétaires futurs de l'Ukraine, non sans susciter des interrogations sur le respect du droit de propriété de ces actifs et l'attractivité des places financières européennes. Le rapporteur spécial note par ailleurs que les dispositifs étudiés ne sont pas dépourvus de risque : les États européens devraient notamment restituer les sommes prélevées en cas de levée des sanctions sur la Russie ; ce remboursement serait, en théorie, atténué par le versement de réparations de guerre par le pays agresseur. Toutefois le montant de ces réparations est encore très incertain.
III. LES ENGAGEMENTS EXTRABUDGÉTAIRES REPRÉSENTENT UN RISQUE NON NÉGLIGEABLE À MOYEN-TERME, QUI DOIT ÊTRE MIEUX CONNU ET MIEUX MAÎTRISÉ
A. L'ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ÉTATS MEMBRES, EN FORTE HAUSSE, REPRÉSENTE LE PRINCIPAL ENGAGEMENT EXTRABUDGÉTAIRE DE L'UE ET POURRAIT PESER SUR LE BUDGET FRANÇAIS À MOYEN-TERME
L'assistance financière aux États membres constitue la principale source d'exposition du budget européen. Sa montée en volume s'est produite par étapes, suivant les grandes crises traversées par l'Union européenne, que ce soit la crise de la dette souveraine (création du mécanisme européen de stabilité financière - MESF) puis surtout la crise sanitaire (mise en place de la facilité pour la reprise et la résilience - FRR- et de l'instrument européen SURE pour financer les dispositifs de chômage partiel). Aujourd'hui, un nouvel instrument est mis en place pour répondre à la guerre d'agression russe en Ukraine et financer les dépenses de défense (le programme SAFE). La dynamique haussière des prêts aux États membres est appelée à se poursuivre et devrait porter le montant de l'assistance aux États membres à 490 milliards d'euros d'ici 2027.
Évolution attendue des dispositifs d'assistance aux États membres
(en milliards d'euros)
Notes : Seuls sont représentés les dispositifs de plus d'un milliard d'euros. *Estimations.
Source : commission des finances, d'après la Commission européenne et la Cour des comptes européenne
L'Union européenne est rapidement devenue l'un des principaux émetteurs de dette : en 2024 elle était le 5e émetteur souverain d'obligations en euros, après la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Le coût de cette dette est aujourd'hui compétitif et sur le plan financier, une majorité d'États européens, dont la France, a aujourd'hui intérêt à recourir aux instruments conçus par l'UE pour s'endetter. La généralisation massive de prêts de l'Union européenne à ses États membres appelle toutefois à une vigilance accrue de la France en tant qu'emprunteur et en tant que prêteur.
En tant qu'emprunteur, le simple fait de disposer de taux d'intérêts légèrement favorables ne saurait motiver à lui seul une décision d'investissement. Cette nouvelle dette ne doit pas s'ajouter mais se substituer à la dette existante. Surtout, il importe de contrôler la pertinence des dépenses engagées dans le cadre de ces instruments. En effet, ces grands programmes de prêts sont généralement adoptés dans des situations de crise et donc, dans des délais restreints, pouvant affecter leur qualité. À titre d'exemple, les premières évaluations menées font ressortir une efficacité et une efficience discutable des fonds déboursés dans le cadre de la FRR. Il apparaît donc primordial de modérer le recours à ces instruments et de permettre au Parlement de contrôler effectivement les sommes engagées,
L'essor des instruments de dette émis par l'Union européenne interroge aussi sur le risque que ceux-ci font encourir en dernier ressort à la France, second contributeur net au budget de l'Union européenne.
Répartition des principaux prêts de l'UE à ses États membres
(en milliards d'euros, au 31 décembre 2024)
Note : répartition indicative pour les prêts SAFE ; proportions affichées en % du PIB 2024.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne
Le rapporteur spécial observe que les prêts octroyés par l'Union européenne sont aujourd'hui concentrés sur un nombre limité d'États membres. Sur le plan quantitatif, trois pays affichent un recours aux instruments de prêt européens supérieur à 80 milliards d'euros (Italie, Espagne et Pologne) et 7 pays affichent des recours supérieurs à 10 % de leur PIB, principalement des pays d'Europe de l'Est, du fait de leur recours au dispositif SAFE (Lettonie, Lituanie, Roumanie, Pologne, Hongrie).
Si le risque de défaut est négligeable sur ces instruments à court terme, le rapporteur note à l'inverse que les perspectives sont bien plus contrastées à moyen terme, les risques sur la soutenabilité des finances publiques des trois États les plus exposés sont jugés élevés par les services de la Commission européenne d'ici 2035.
Au vu de l'importance des sommes prêtées par l'Union européenne, le rapporteur spécial estime que l'administration financière française doit réaliser un suivi des perspectives de défaut à moyen terme, total ou partiel, des principaux États membres ayant souscrit aux instruments de dette de l'Union et en tenir informé le Parlement
B. UN SUIVI DU RISQUE PRINCIPALEMENT RÉALISÉ À BRUXELLES ET QUI NE SE CONCENTRE QUE SUR LE COURT TERME
La Commission assure un suivi régulier et documenté des passifs éventuels et de leur viabilité, en analysant l'adéquation des provisions détenues dans le fonds commun de provisionnement (FCP) et en évaluant la viabilité des passifs éventuels bénéficiant d'une marge de manoeuvre, y compris en appliquant des tests de résistance.
D'après l'administration économique et financière française, les taux de provisionnement appliqués sont adéquats et les stress tests réalisés sont crédibles. Elle estime toutefois qu'il serait utile d'étendre l'horizon des stress tests réalisés, qui ne couvre pas aujourd'hui la période où la marge de manoeuvre européenne est la plus exposée.
Le rapporteur spécial note par ailleurs que la Commission européenne vise avant tout à défendre les intérêts de l'UE, en s'assurant que la marge de manoeuvre budgétaire suffit à assurer le paiement des passifs éventuels de l'Union européenne : l'analyse ne porte en rien sur les contributions supplémentaires pouvant être appelées auprès des États membres. Ce travail d'analyse n'est pas réalisé par l'administration française, qui, considérant qu'il n'existe pas de risque de court terme, se repose aujourd'hui sur les analyses de la Commission européenne.
Compte tenu du risque non-négligeable identifié à moyen terme sur les divers instruments de dette européenne et des limites des analyses aujourd'hui menées par la Commission européenne, le rapporteur spécial estime que le Parlement doit être mieux informé de l'évolution de l'exposition du budget européen et du risque d'un ressaut de la contribution nationale. Il recommande donc la communication d'une information enrichie et régulière à ce sujet, notamment dans le cadre de la documentation budgétaire. A minima, cette information pourrait être constituée d'une estimation maximaliste du risque encouru chaque année par le budget français, pondérée par une appréciation plus qualitative de l'administration financière sur la réalité de ce risque.
LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
Recommandation n° 1 : S'assurer que la Commission européenne communique régulièrement sur les sommes prêtées à l'Ukraine, l'avancée des décaissements et des remboursements et la prise en charge des intérêts (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).
Recommandation n° 2 : Analyser et présenter au Parlement l'ensemble des prêts accordés pour soutenir l'Ukraine financièrement, en identifiant notamment les coûts et les risques associés à ces dispositifs (direction du budget).
Recommandation n° 3 : Limiter le recours de la France aux prêts octroyés par l'Union européenne aux seules situations de crise où l'apport européen est manifeste (Gouvernement).
Recommandation n° 4 : Isoler dans la documentation budgétaire les opérations financées par des prêts européens, la motivation des dépenses associées et le coût du financement européen (direction du budget).
Recommandation n° 5 : Obtenir de la Commission européenne qu'elle étende l'horizon des « stress tests » réalisés pour évaluer la viabilité des passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).
Recommandation n° 6 : S'assurer que la Commission européenne enrichisse l'information communiquée sur les passifs éventuels de l'UE, par la mise à disposition de bases de données actualisées et la communication de projections sur la marge de manoeuvre (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).
Recommandation n° 7 : Rendre compte au Parlement, notamment à travers la documentation budgétaire, des informations enrichies communiquées par la Commission européenne sur les passifs éventuels (direction du budget).
Recommandation n° 8 : Communiquer régulièrement au Parlement l'exposition du budget de l'UE, les passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre et le risque d'une hausse future de la contribution française au budget l'Union européenne (direction du budget).
I. UN BUDGET EUROPÉEN EXPOSÉ PAR DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE TOUJOURS PLUS NOMBREUX ET TOUJOURS PLUS IMPORTANTS
L'importance économique de l'Union européenne n'a fait que croître depuis sa création et a connu une franche accélération ces dernières années, au gré d'une crise sanitaire sans précédent, puis de la guerre d'agression russe en Ukraine, qui ont nécessité une réponse concertée pour définir des instruments économiques et financiers à la hauteur des enjeux.
Sur le plan budgétaire, l'Union européenne se place depuis 1988 dans une perspective de moyen terme appelée cadre financier pluriannuel (CFP). L'actuel CFP couvre les exercices 2021-2027 et prévoyait initialement sur cette période un plafond de 1 074 milliards d'euros en crédits d'engagement et 1 061 milliards d'euros en crédits de paiement (en euros constants, au prix de 2018). Ces moyens sont relativement stables par rapport au CFP précédant, couvrant la période 2014-2020, à savoir 960 milliards d'euros en engagements et 909 milliards en paiements, aux prix de 2011.
La survenue de la crise liée au covid 19 début 2020 et ses graves conséquences économiques et financières ont cependant conduit à lui adjoindre un plan massif de relance budgétaire sous la forme d'un nouvel instrument financier appelé Next Generation EU, conçu pour donner une impulsion aux économies européennes en sortie de crise tout en investissant dans la transition écologique et la digitalisation des économies. Aux dépenses du CFP s'ajoutent donc désormais celles du plan Next Generation EU pour 750 milliards d'euros (en euros constants, aux prix de 2018). Cette enveloppe se répartit entre 360 milliards d'euros de prêts et 390 milliards d'euros de subventions.
Dernièrement, une série de crises, au premier rang desquelles la guerre d'agression russe en Ukraine, ont rendu nécessaire une révision à la hausse du cadre financier pluriannuel, sous la forme de trois règlements, formellement adoptés au Conseil le 29 février 2024. Cette révision a entrainé le financement de nouvelles priorités à hauteur de 64,6 milliards d'euros, dont 50 milliards d'euros dans une « facilité pour l'Ukraine ». Ces sommes comprennent 33 milliards d'euros de prêts et 31,6 milliards d'euros de subventions, impliquant, après redéploiement, 21 milliards d'euros de nouveaux fonds.
La facilité pour l'Ukraine n'épuise pas le soutien apporté par l'Union européenne à ce pays, qui comprend en outre différends dispositifs d'assistance macrofinancière (AMF), adoptés aux grés des fluctuations des conflits et des besoins financiers qu'il emporte : AMF d'urgence, AMF, exceptionnelle, AMF +, AMF avoirs gelés, etc. pour des montants cumulés se chiffrant en dizaines de milliards d'euros.
Au-delà de la simple inflation quantitative des moyens de l'Union européenne, on constate donc aussi une complexification de ses modes d'intervention. Dans un contexte budgétaire contraint, les crédits sont rares et le recours aux prêts ou autres « assistances macrofinancières » s'est généralisé pour financer les réponses aux crises successives rencontrées par l'Union européenne.
Or, si le cadre financier pluriannuel se décline chaque année dans un budget européen, financé par les États membres et analysé par la commission des finances du Sénat, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, dans un rapport dédié à la contribution de la France au budget de l'Union européenne, ce suivi ne s'étend pas, ou peu, aux nombreux engagements de l'Union européenne sans impact budgétaire direct, s'agissant notamment du remboursement des nombreux prêts octroyés par l'Union européenne. Au vu de la part croissante de ces engagements et de la situation politique et financière précaire de l'Ukraine, le rapporteur spécial a souhaité mettre en lumière l'importance de ces engagements, évaluer les risques qu'ils emportent à moyen ou long terme et s'intéresser à la gestion de ces risques par les autorités françaises et européennes.
A. DÉFINITIONS ET PRÉSENTATIONS DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS EXTRABUDGÉTAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Le concept de référence pour le suivi des engagements extrabudgétaires de l'Union européenne est celui de « passif éventuel », défini dans le règlement financier de l'Union européenne1(*) comme « une obligation financière potentielle qui pourrait être contractée en fonction de l'issue d'un événement futur ». L'article 213 de ce même règlement précise que « les garanties budgétaires et l'assistance financière peuvent entraîner un passif éventuel pour l'Union » : en effet, en cas de défaut des parties soutenues financièrement (« évènement futur »), l'Union peut se retrouver financièrement engagée (« obligation financière potentielle »).
Parmi ses considérants, le règlement financier pose que « pour garantir la notation de crédit de l'Union et, partant, sa capacité à fournir des financements efficaces, il est essentiel que les passifs éventuels soient autorisés, provisionnés et contrôlés selon un ensemble solide de règles qui devraient être appliquées à l'ensemble des garanties budgétaires. » À cet effet, aux termes de l'article 256, « la Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires et de l'assistance financière ».
Sur la base de ce rapport, on peut regrouper les engagements extrabudgétaires de l'Union européenne par nature en trois grandes catégories :
Typologie des passifs éventuels de l'Union européenne
|
Type de passif |
Description |
Principaux dispositifs |
|
Assistance financière aux États membres |
Prêts financés par des emprunts de l'Union pour lesquels celle-ci reste responsable vis-à-vis des investisseurs finaux, y compris en cas de défaut. |
Instrument de soutien temporaire à
l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE)
Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) Agir pour la sécurité de l'Europe (SAFE) |
|
Assistance macrofinancière (AMF) aux pays tiers |
Assistances macrofinancières Dispositifs ad hoc en faveur de l'Ukraine |
|
|
Garanties budgétaires |
Garanties pour lesquelles l'Union couvre (totalement ou en partie) les pertes des partenaires chargés de la mise en oeuvre (souvent la Banque européenne d'investissement - BEI) qui résultent de défauts de paiement (opérations de prêt ou de fonds propres). |
Fonds InvestEU |
Note : ces dispositifs sont présentés dans les parties dédiées à chaque type de passif.
Source : commission des finances du Sénat, d'après la Commission européenne
On peut constater la multiplicité des dispositifs concernés. Dans son rapport sur le paysage financier de l'Union européenne2(*), la Cour des comptes européenne observe une évolution de ce dernier au cours des décennies, avec une « [multiplication] au cours des 15 dernières années, une évolution qui répond essentiellement à différentes crises », la Cour de comptes européenne évoquant même une « prolifération ».
Cette prolifération et cette complexification ne sont que plus apparentes dans le schéma synthétique produit dans ce rapport pour livrer un aperçu de ces différents instruments (cf. schéma ci-contre), qui isole notamment les instruments d'assistance financière ainsi que les différentes composantes du plan Next Generation EU, rappelant les périmètres du budget européen et du plafond des ressources propres.
B. LES PASSIFS ÉVENTUELS ONT CONNU UNE TRÈS FORTE HAUSSE, QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE DANS LES PROCHAINES ANNÉES
Passifs éventuels et « exposition du budget de l'Union européenne »
Les institutions européennes ont recours à différents périmètres comptables pour quantifier l'importance des passifs éventuels de l'Union. Ainsi, conformément à l'article 256 du règlement financier, la Commission européenne produit chaque année à l'attention du Parlement européen et du Conseil un rapport sur les « passifs éventuels »3(*) là où, la Cour des comptes européenne, dans son rapport annuel sur l'exécution du budget de l'UE, préfère mesurer « l'exposition du budget de l'Union européenne ».
La différence est la suivante. Les passifs éventuels de l'Union européenne recouvrent :
- les passifs éventuels au titre des prêts accordés aux États membres et aux pays tiers (206 milliards d'euros fin 2022, 255 milliards d'euros fin 2023) ;
- les garanties budgétaires fournies (106 milliards d'euros fin 2022, 108 milliards d'euros fin 2023).
Dans leur décompte, Commission européenne et Cour des comptes européenne comptabilisent chacune le montant total des prêts accordés, la différence portant sur le traitement des garanties budgétaires :
- la Commission européenne tient compte de la garantie totale disponible « signée avec les contreparties », soit l'exposition maximale du budget de l'UE. Interrogée sur ce choix, la Commission indique que ce périmètre « fournit une mesure plus prudente du risque (...) En effet, les garanties budgétaires signées avec les contreparties sont irrévocables par nature, de sorte que les partenaires chargés de la mise en oeuvre ont le droit d'inclure de manière relativement autonome de nouvelles opérations ». Selon cette mesure, le niveau des passifs éventuels de l'Union européenne est la somme des deux agrégats cités, soit 312 milliards d'euros fin 2022 et 363 milliards d'euros fin 2023.
- la Cour des comptes européenne communique quant à elle chaque année sur une exposition du budget de l'Union européenne, qui ne prend en considération, pour les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires, que les garanties relatives aux « opérations signées par les contreparties et décaissées ». Elle mesure ainsi une exposition plus directe, concentrant l'analyse sur des garanties appelables plus immédiatement. Selon cette définition, l'exposition du budget de l'Union européenne se situe à 248 milliards d'euros fin 2022 et 298 milliards d'euros fin 2023.
Cette dernière méthodologie est privilégiée dans ce rapport, afin de mieux approcher le risque encouru à court ou moyen terme par le budget européen. Une mesure plus exhaustive, suivant la définition de la commission, est aussi présentée en complément dans le cadre de l'analyse de l'exposition future du budget européen.
1. Des passifs éventuels en forte croissance, portés par des dispositifs d'assistance aux États membres et, dans une moindre mesure, à l'Ukraine
Au gré des crises, le niveau de risque porté par le budget européen a presque quadruplé depuis 2019 (soit une hausse moyenne de 30 % par an), avec une forte poussée au moment de la crise sanitaire (+ 51 % par an de 2019 à 2021) suivie d'une progression soutenue (+ 19 % depuis 2021) à mesure que les dispositifs d'assistance décidés durant la crise sanitaire ont été mis en oeuvre et que de nouveaux instruments ont été instaurés pour soutenir l'Ukraine.
Évolution de l'exposition du budget de l'Union européenne
(en milliards d'euros)
Note : * Garanties budgétaires sur des opérations signées par les contreparties et décaissées.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne
a) Une part désormais prédominante des dispositifs de soutien aux États membres
L'essentiel de la hausse observée peut être attribuée aux dispositifs d'assistance financière aux États membres (de 49 milliards d'euros en 2019 à 249 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 200 milliards d'euros qui équivaut à 80 % de la hausse totale observée).
Jusqu'à la pandémie de COVID-19, les garanties budgétaires et l'assistance financière aux États membres étaient d'une ampleur similaire. Les garanties représentaient 40 % des passifs éventuels, réparties à parts à peu près égales entre celles portant, d'une part, sur des prêts de la banque européenne d'investissements (BEI) à des pays tiers et, d'autre part, sur des opérations financées par le Fonds européen des investissements stratégiques (EFSI, aussi géré par la BEI).
La majorité des passifs éventuels était constituée de prêts octroyés au titre du mécanisme européen de stabilité financière (MESF, 52,4 % de l'exposition totale en 2019). Établi en 20104(*), le MESF constitue une assistance financière de l'Union européenne à un État membre qui connaît de graves perturbations économiques ou financières, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle. Il est financé par le budget de l'UE, la Commission étant habilitée à emprunter jusqu'à 60 milliards d'euros sur les marchés financiers. Les prêts sont garantis par le budget de l'UE. Le MESF a principalement été activé pour l'Irlande et le Portugal, pour un montant total de 46,8 milliards d'euros (22,5 milliards pour l'Irlande et 24,3 milliards pour le Portugal).
Le gros de la progression constatée est expliqué par deux instruments : le programme SURE et la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), dans des proportions similaires sur la période observée. Le programme SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - Soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d'urgence) est un programme de réassurance chômage créé en 20205(*) afin d'apporter une aide financière aux États membres touchés par la crise sanitaire. Il prend la forme d'un prêt accordé par l'UE à l'État membre qui en a fait la demande et a permis de financer des mécanismes de chômage partiel. 98,5 milliards d'euros ont été prêtés à ce titre entre 2020 et 2022, date de fin de disponibilité de cet instrument.
Quant à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), elle est la pièce maîtresse du plan de relance Next Generation EU. Elle permet à la Commission de lever des fonds pour contribuer à réparer les dommages économiques et sociaux immédiats causés par la pandémie de COVID-19, tout en favorisant les transitions écologiques et numériques. Initialement créé en 20216(*), cet instrument a été revu en 20237(*) à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour rendre l'UE indépendante des combustibles fossiles russes et accélérer la transition énergétique propre de l'UE. Le budget de la facilité pour la reprise et la résilience s'élève à 650 milliards d'euros : 359 milliards d'euros de subventions et 291 milliards d'euros de prêts. Ces prêts accordés à des États-membres constituent un passif éventuel. Sur les 291 milliards d'euros de prêts convenus, 108,7 milliards d'euros ont été décaissés entre 2021 et 2024.
Dans l'ensemble, l'assistance financière aux États membres représente donc la majorité des engagements extra-budgétaires de l'Union, part qui devrait encore augmenter dans les années à venir.
b) Une progression remarquable de l'assistance financière aux pays tiers qui reflète l'important soutien apporté à l'économie ukrainienne
Le soutien apporté par l'Union européenne à des pays tiers prend principalement la forme d'une « assistance macrofinancière ». Créée en 1990, l'assistance macrofinancière (AMF) de l'Union européenne a pour but d'accorder une aide financière de nature macro-économique à des pays tiers dont la balance des paiements connaît des difficultés à court terme. Elle prend la forme de dons ou de prêts, adossés à une contribution financière du Fonds monétaire international (FMI) dans le contexte d'un programme d'ajustement et de réforme dans le pays concerné. Des prêts à moyen-long terme sont ainsi principalement accordés à des États dans le voisinage de l'Union européenne (Égypte, Tunisie, Jordanie, Balkans occidentaux, etc.).
La forte croissance observée est imputable au soutien apporté à l'Ukraine : alors que les AMF s'élevaient à moins de 5 milliards d'euros fin 2019, elles ont progressivement été portées à 7,5 milliards d'euros fin 2021, puis 15 milliards d'euros fin 2022, du fait notamment de l'AMF d'urgence décidée en faveur de l'Ukraine. En incluant des dispositifs comme l'AMF+ en faveur de l'Ukraine et la facilité Ukraine, l'assistance portée à des pays tiers s'élevait à 47 milliards d'euros fin 2024, soit près de dix fois le niveau observé fin 2019.
Cette dynamique mérite qu'une attention particulière lui soit consacrée. Dès 20228(*), la Cour des comptes européenne écrivait que « la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine augmente les risques pour le budget de l'UE », identifiant notamment « un risque accru que des passifs éventuels au titre du budget de l'UE déclenchent des obligations de payer. » La guerre emporte un risque de défaut dont le coût serait supporté par l'Union européenne et ses États-membres. Ce risque, encore embryonnaire à l'été 2022, s'est fortement accru avec le temps, avec la multiplication des dispositifs de soutien.
2. Une tendance très haussière qui devrait se poursuivre ces prochaines années
Il est possible d'offrir une projection future du volume des passifs éventuels de l'Union européenne en s'intéressant à l'ensemble des engagements signés mais non déboursés, suivant les trois grandes catégories identifiées : les prêts en faveur des États membres et des pays tiers et les garanties budgétaires. Cette méthodologie, employée par la Cour des comptes européenne dans son rapport annuel sur l'exécution du budget de l'Union européenne, est a priori un minorant. D'une part, elle ne tient nécessairement pas compte des derniers dispositifs annoncés, dont l'impact n'est souvent pas négligeable. D'autre part, l'estimation de la Cour des comptes européenne s'appuie sur la seule « exposition du budget de l'Union européenne », mesure relativement prudente : ce rapport s'attache à présenter plusieurs estimations, selon des scénarios plus ou moins favorables.
a) Une assistance aux États membres en très forte progression, sous l'effet du plan de relance et de nouveaux engagements
Évolution attendue des dispositifs d'assistance aux États membres
(en milliards d'euros)
Notes : Seuls sont représentés les dispositifs de plus d'un milliard d'euros.
*Estimations de la commission des finances, sur la base des données publiques et d'échanges avec les services de la Commission européenne.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne
Le dynamisme observé des dispositifs d'assistance aux États membres devrait se poursuivre et s'accentuer dans les prochaines années, les prêts aux États membres devant presque doubler d'ici 2027, suivant la mise en oeuvre de la FRR et le déploiement du nouveau dispositif SAFE.
Pour mémoire, le versement de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) est conditionné par la réalisation par les États membres de plans nationaux de reprise et de résilience : le montant total des prêts approuvés s'élève à 290,9 milliards d'euros. Or fin 2024, seuls 108,7 milliards d'euros avaient été décaissés : l'ensemble des prêts approuvés sera décaissé d'ici 2026, augmentant de près de 200 milliards d'euros le volume de prêts accordés à des États membres par rapport à fin 2024.
Un second dispositif qui devrait fortement gonfler le volume des prêts octroyés à des États membres est le nouvel instrument intitulé « Agir pour la sécurité de l'Europe - SAFE » (SAFE). Annoncé par la Commission européenne en mars 2025 dans le cadre de son plan « ReArm Europe », le règlement SAFE prévoit un montant maximal de 150 milliards d'euros de prêts qui peuvent fournir aux États membres un financement avantageux pour leurs besoins en matière de défense. Le 9 septembre 2025, l'exécutif communautaire a annoncé l'allocation provisoire de l'ensemble de ces moyens aux 19 États membres qui souhaitaient en bénéficier (dont 16,2 milliards d'euros pour la France). Il revient désormais aux pays concernés de présenter d'ici fin novembre un plan d'investissement détaillant les projets qu'ils souhaitent financer, l'objectif étant de signer des accords de financement au premier trimestre 2026. Au vu de la rapide mise en oeuvre de cet instrument, le règlement SAFE prévoyant des versements jusqu'à 20309(*), l'hypothèse est faite de décaissements linéaires, soit le versement de la moitié de l'enveloppe de 150 milliards d'euros d'ici fin 2027.
Quant aux autres instruments concernés (SURE, MESF), leur volume est amené à se réduire progressivement à mesure que les États emprunteurs remboursent les sommes empruntées. La trajectoire inscrite reprend les échanges avec la Commission.
b) Une assistance aux pays tiers de moindre ampleur mais au dynamisme marqué
Évolution attendue des dispositifs d'assistance aux pays tiers
(en milliards d'euros)
Notes : AMF : assistance macrofinancière.
Seuls sont représentés les dispositifs de plus d'un milliard d'euros. Un prêt « Euratom » de 300 millions d'euros est notamment exclu, affectant certains arrondis.
*Estimations de la commission des finances, sur la base des données publiques et d'échanges avec les services de la Commission européenne.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne
Tout comme pour les prêts aux pays membres, l'exposition aux pays tiers devrait presque doubler à court terme, du fait notamment de la mise en oeuvre de programmes d'importance en faveur de l'Ukraine. Ces dispositifs feront l'objet d'une analyse approfondie dans la suite de ce rapport mais on peut notamment citer l'importance de la facilité Ukraine (+ 20 milliards d'euros dans les prochaines années) et de l'assistance macrofinancière avoirs gelés (+ 18,1 milliards d'euros).
Les projections réalisées n'intègrent pas le potentiel prêt de réparation de 140 milliards euros accordé à l'Ukraine et mobilisant le capital des actifs russes gelés qui fait encore l'objet de discussions entre États membres (cf. analyse détaillée ci-dessous).
Enfin, les programmes d'assistance macrofinancière se poursuivent et contribuent à la hausse observée avec, dernièrement, des enveloppes de 4 milliards d'euros et 1,5 milliards d'euros au titre, respectivement, de facilités pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux et de la Moldavie.
c) Des garanties qui devraient encore se développer sur les dernières années du cadre financier pluriannuel
Évolution attendue des garanties budgétaires
(en milliards d'euros)
Notes : FEIS : fonds européen pour les investissements stratégiques ; FEDD (+) : fonds européen pour le développement durable (+).
Seuls sont représentés les dispositifs de plus d'un milliard d'euros (les garanties du FEDD ne sont notamment pas représentées).
*Estimations de la commission des finances, sur la base des données publiques et d'échanges avec les services de la Commission européenne.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne
Les garanties budgétaires comprennent deux types de dispositifs : les garanties destinées à soutenir l'investissement au sein de l'UE (fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), InvestEU) et hors de l'UE, notamment dans le cadre de la politique de voisinage (fonds européen pour le développement durable (FEDD), FEDD+, mandat de prêt extérieur de la BEI, garantie pour l'Ukraine).
S'agissant des garanties à vocation plus économique, le fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) outil principal du plan Juncker, a été lancé pour remédier au problème de la faiblesse prolongée de l'investissement privé dans l'UE à la suite de la crise financière. Il prend la forme d'une garantie budgétaire de 26 milliards d'euros accordée par le budget de l'UE au groupe BEI. Au titre du CFP 2021-2027, le programme InvestEU rassemble les activités précédemment menées au titre de l'EFSI et plusieurs autres instruments financiers et réalise des investissements dans des domaines similaires à ceux du FEIS10(*).
Hors de l'Union européenne, la garantie budgétaire la plus ancienne est celle fournie au titre du mandat de prêt extérieur de la BEI (MPE), qui vise à permettre à cette dernière d'entreprendre des opérations de financement dans des environnements plus risqués, à l'extérieur de l'UE, afin de développer les infrastructures socio-économiques et le secteur privé local. En 2017, la garantie au titre du fonds européen pour le développement durable (FEDD) a été mise en place pour soutenir les investissements et améliorer l'accès au financement, principalement en Afrique et dans les pays relevant de la politique de voisinage. Le FEDD+ a été établi pour le CFP 2021-2027 et porte sur un périmètre géographique plus large11(*).
Enfin, le règlement établissant une facilité pour l'Ukraine12(*) prévoit l'octroi d'une garantie de 7,8 milliards d'euros jusqu'à fin 2027. Il vise à mobiliser 40 milliards d'euros d'investissement public et privé pour soutenir l'investissement dans ce pays, notamment dans des secteurs critiques comme l'énergie.
La Commission européenne se refuse à faire des projections précises sur l'évolution des passifs éventuels correspondant à ces garanties budgétaires, du fait de « la grande variété des produits et des mécanismes de partage des risques utilisés, y compris les produits d'actions pour lesquels il est très difficile de prévoir le calendrier exact de déploiement des produits ». Elle indique toutefois à prendre en compte le stade de mise en oeuvre des différents instruments et prévoit « une légère baisse dans les années à venir » pour les instruments entièrement constitués (FEIS, FEDD, et MPE), « tandis qu'InvestEU et le FEDD+ devraient atteindre leur montant maximal vers la fin du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 ».
Afin d'évaluer l'exposition future du budget de l'Union européenne, la Cour des comptes européenne agrège l'ensemble des garanties liées à des opérations signées mais non encore décaissées. Compte tenu des difficultés méthodologiques rappelées par la Commission, cette méthode a le mérite de donner un ordre de grandeur et est ici reprise pour évaluer la progression du fonds InvestEU, du FEDD+ et de la nouvelle garantie pour l'Ukraine, en gardant à l'esprit qu'elle ne tient pas compte de tout effet d'accélération en fin de CFP. S'agissant des garanties entièrement constituées (FEIS, FEDD et MPE), une légère décrue est ici estimée sur la base des tendances qui ressortent des derniers chiffres publiés.
Le résultat de ces projections fait apparaître un certain dynamisme des garanties budgétaires à moyen terme (+ 33 %), qui viennent accroître l'exposition du budget de l'Union européenne à mesure que les nouveaux programmes de garanties se déploient, tandis que les anciens dispositifs se résorbent à un rythme plus mesuré.
Compte tenu du lent rythme de décaissement des opérations financières auxquelles l'Union européenne apporte une garantie, la méthodologie d'évaluation de la Cour des comptes européenne apparaît comme la plus appropriée. Toutefois, comme rappelé par la Commission européenne, « les garanties budgétaires signées avec les contreparties sont irrévocables par nature » et « les partenaires chargés de la mise en oeuvre ont le droit d'inclure de manière relativement autonome de nouvelles opérations ». À titre informatif, le graphique présenté ci-dessus inclut donc également le plafond des différents dispositifs budgétaires, qui se situe à près de deux fois le montant estimé.
d) Une hausse toujours plus substantielle de l'exposition du budget de l'Union européenne, qui pourrait être accentuée par la situation budgétaire de l'Ukraine
(1) La progression de l'exposition du budget de l'Union européenne maintient son rythme très soutenu
Projection de l'exposition du budget de l'Union
européenne
à la fin du CFP 2021-2027
(en milliards d'euros)
Notes : *Estimations de la commission des finances, sur la base des données publiques et d'échanges avec les services de la Commission européenne.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne
Pour conclure, on peut s'attendre à ce que l'exposition du budget de l'Union européenne continue de s'accroître à un rythme plus que significatif, doublant presque d'ici la fin du CFP 2021-2027, pour atteindre 640 milliards d'euros. Le rythme de croissance se maintiendrait presqu'au rythme observé depuis 2019, atteignant 28 % par an. Sur le plan quantitatif, la hausse observée est avant tout expliquée par l'assistance financière aux États membres, même si une hausse significative est en réalité attendue pour chaque catégorie de passifs éventuels (de plus d'un tiers). La suite de ce rapport s'intéresse aux conséquences de ces évolutions, qui peuvent atteindre des centaines de milliards d'euros, lesquelles conséquences varient selon le profil du dispositif et la gestion du risque associé.
(2) Alors que le conflit ukrainien s'enlise, le coût du soutien financier européen devrait encore progresser dans les prochaines années
Les besoins de l'économie ukrainienne sont tels que l'Union européenne sera nécessairement appelée à contribuer dans les prochaines années. Alors que les ressources du pays sont très majoritairement affectées à l'effort de guerre, l'Ukraine s'appuie largement sur un soutien financier extérieur pour supporter le coût social de la guerre et les investissements nécessaires. Ce soutien étranger est toutefois menacé depuis l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis, jusque là le premier donateur à la cause ukrainienne. L'Union européenne est donc devenue par la force des choses le principal bailleur de fonds de l'Ukraine, même si l'Ukraine s'efforce de mobiliser par ailleurs des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Le ministre des finances ukrainien a ainsi annoncé qu'il estime devoir lever 16 milliards d'euros auprès de ses partenaires pour boucler son budget 202613(*).
Dans le cadre de la revue périodique qu'il a réalisé en juin 202514(*) pour assurer le suivi du mécanisme élargi de crédit15(*) engagé en faveur de l'Ukraine, le FMI décrit l'ampleur du défi auquel ce pays est confronté et le soutien que ses partenaires devront apporter pour maintenir le pays à flot. Le FMI indique ainsi que les risques à court terme sont « exceptionnellement élevés », portant aussi bien sur la durée et l'intensité du conflit que sur la durabilité du soutien financier et militaire international, évoquant comme risque secondaire les conséquences d'attaque répétées sur la population ukrainienne et ses infrastructures énergétiques.
Le FMI craint par ailleurs une lassitude de la population ukrainienne face à la quantité de réformes déjà engagées, qui risque de mettre en péril celles encore nécessaires pour assainir la situation financière du pays et attirer les capitaux privés indispensables à sa reconstruction. Illustration de ces avertissements, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé une loi adoptée le 22 juillet 2025 par le Parlement ukrainien privant les principaux organes anti-corruption de leur indépendance16(*).
S'agissant plus spécifiquement de la dette ukrainienne, le FMI estime, dans ce contexte particulièrement difficile, que la soutenabilité de la dette ukrainienne n'est pas assurée et que cette dernière doit être restaurée à moyen terme par une combinaison de trois facteurs :
(i) par un « ajustement fiscal » substantiel (en augmentant les impôts) ;
(ii) par d'importants prêts concessionnels17(*) (« exceptional financing from creditors and donors ») ;
(iii) par une restructuration de sa dette, y compris d'importants warrants18(*) émis en 2015 pour des centaines de millions d'euros.
La revue de juin indique que les engagements suffisent à financer les douze prochains mois et que, dans le scénario de base, les perspectives de financement sont bonnes pour la suite.
Le scénario de base apparaît toutefois excessivement optimiste (fin du conflit au dernier trimestre 2025) et il appartient donc de se référer aux modélisations du scénario dit pessimiste (atténuation du conflit mi-2026). Ce scénario implique un surcoût de 12 milliards de dollars d'ici 2027, impliquant notamment des « prêts très concessionnels (proches de la subvention) » et des restructurations additionnelles de la dette existante. Les projections affichées font apparaître un déficit de financement (« financing gap ») d'un peu plus de 10 milliards de dollars par an à partir de 2028, nécessitant un roulement de la dette (« flow relief ») et d'importants financements exceptionnels.
Déficit de financement ukrainien en cas de réalisation du scénario pessimiste
(en milliards de dollars)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
Q1 |
Q2-Q4 |
|||||||||||
|
A. Déficit de financement (B+C+D+E) |
42,5 |
46,2 |
45,1 |
37,6 |
3,1 |
7,8 |
15,2 |
12,8 |
12,3 |
10 |
9,7 |
9,3 |
|
B. Financement officiel (hors FMI) |
38 |
36,4 |
51,9 |
20 |
1,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. FMI (estimation) |
4,5 |
5,3 |
2,4 |
2,2 |
1,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Allègement de la dette |
0 |
4,4 |
3 |
3,2 |
0,2 |
2,5 |
8 |
5,7 |
5,1 |
2,9 |
2,6 |
2,1 |
|
E. Financement exceptionnel |
- |
- |
- |
- |
- |
5,3 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
|
F. Préfinancement du budget |
- |
- |
- 12,2 |
12,2 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Source : Commission des finances, d'après le Fonds monétaire international (8e revue, juin 2025)
La tonalité de la revue du FMI n'est toutefois pas alarmiste. Il y est noté que, depuis le début de la guerre, les autorités ukrainiennes ont su prendre les mesures nécessaires pour répondre rapidement aux nombreux chocs auxquels elles ont été confrontées, faisant montre d'une gestion économique efficiente (« track record of effective economic management »). L'opinion positive du FMI repose aussi toutefois pour une large part sur le soutien affiché par les partenaires internationaux de l'Ukraine19(*) (« financing assurances from international partners and expected debt relief »). Partant de ce constat, le scénario le plus probable est que d'une part, l'Ukraine ne pourra pas rembourser ses emprunts en temps et en heure, et d'autre part, un soutien additionnel substantiel sera nécessaire à moyen terme.
C. UNE EXPOSITION DU BUDGET EUROPÉEN SUPPORTÉE MAJORITAIREMENT PAR LES ÉTATS-MEMBRES
Les risques que font courir les passifs éventuels aux finances de l'Union varient s'ils sont provisionnés ou non. Les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires et, jusque récemment, l'ensemble des passifs éventuels issus de l'assistance financière à des pays tiers, étaient partiellement provisionnés. En effet, aux termes de l'article 214 du règlement financier, le taux de provisionnement doit couvrir les pertes nettes attendues et offrir en outre un coussin de sécurité approprié pour couvrir les pertes imprévues (en pratique, le taux de provisionnement varie de 9 % à 50 %, selon l'instrument). Cette provision protège le budget de l'UE contre les défauts.
Les sommes provisionnées sont placées dans le fonds commun de provisionnement (FCP), créé en 2018 et opérationnel depuis 2021. Il classe ses ressources dans des compartiments distincts, correspondant chacun à un instrument contributeur provisionné. Il est principalement investi en obligations d'État. Fin 2024, la valeur de marché du FCP s'élevait à 23,2 milliards d'euros.
Les passifs éventuels découlant de l'assistance financière aux États membres de l'UE ne sont pas provisionnés, ainsi, désormais, que certains dispositifs de soutien à l'Ukraine. Ils sont couverts par la « marge de manoeuvre » (aussi appelée « marge sous plafond » ou « headroom » dans le jargon bruxellois), soit l'écart entre le plafond des ressources propres pouvant être perçus auprès des États membres, fixé par la décision relative aux ressources propres, et les plafonds de dépenses, fixés par le cadre financier pluriannuel (CFP). Cette différence sert de garantie à l'Union pour couvrir l'ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels en toutes circonstances, même en cas d'évolution économique défavorable.
La décision relative aux ressources propres pour le cadre financier pluriannuel 2021 - 202720(*) a initialement placé le plafond des ressources propres destiné à couvrir les crédits annuels de paiement à 1,40 % du revenu national brut (RNB) de l'UE (contre 1,23 % pour le CFP 2014-2020).
Afin de permettre à l'Union d'emprunter sur les marchés les fonds nécessaires pour NextGenerationEU, un plafond supplémentaire cantonné de 0,6 % du RNB de l'UE a été temporairement introduit dans la décision relative aux ressources propres.
Le plafond des ressources propres de l'Union européenne
Source : Cour des comptes européenne
Comme exposé précédemment, les dispositifs non-provisionnés, à savoir les dispositifs d'assistance aux états membres et certains dispositifs d'assistance à l'Ukraine, connaissent une forte croissance, qui devrait se poursuivre dans les prochaines années. Or, par définition, les dispositifs non-provisionnés représentent un risque plus direct pour les finances de l'Union. En effet, en cas de défaut, ils peuvent justifier une hausse des contributions des États membres, qui affecterait particulièrement la France, 2e contributeur net de l'Union européenne depuis le départ du Royaume-Uni.
Interrogées dans le cadre de ce contrôle, les services de la Commission confirment que « l'appui budgétaire des États membres peut être requis en cas de non-paiement des intérêts ou du principal par un bénéficiaire d'un prêt, situation qui ne s'est pas encore produite et qui reste conjecturale. »
Ils nuancent toutefois fortement ce risque en indiquant que « dans une telle éventualité extrême (...), la Commission, conformément à la législation applicable en matière de ressources propres, s'appuierait, dans la mesure du possible, sur une gestion active des liquidités et des redéploiements budgétaires. En dernier recours, la Commission peut demander à tous les États membres de fournir à titre provisoire la différence entre les actifs disponibles et les besoins de trésorerie. La mise à disposition de ces liquidités sera compensée, sans délai, dans le cadre du budget de l'UE. »
De fait, le budget européen n'a rien à envier au budget français en matière de complexité et dispose de toute une gamme d'instruments pour accommoder un carcan budgétaire parfois trop rigide. La Cour des comptes européenne a analysé dans le détail ces instruments dans son audit publié en septembre 202521(*), en distinguant notamment les virements et reports possibles sous le plafond du CFP des enveloppes spécifiques prévues au-dessus de ce plafond pour divers motifs, que ce soit des dépenses imprévues (instrument de flexibilité), des catastrophes majeures (réserve d'aide d'urgence), etc. :
Outils de flexibilité budgétaire dans le CFP 2021-2027
Source : Cour des comptes européenne
Si des marges de flexibilité existent bien, il appartient néanmoins de relativiser leur importance. La Cour des comptes européenne a ainsi déjà constaté une « utilisation intensive des outils de flexibilité », qui « témoigne des besoins accrus liés à la finalité de ces outils : la fréquence et l'ampleur des catastrophes naturelles (...), et les situations d'urgence ainsi que la crise humanitaire dans le voisinage de l'UE dues à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ». Cette consommation importante a rapidement réduit leur disponibilité pour le reste du CFP et a notamment rendu nécessaire en 2024 un réabondement de l'instrument de flexibilité à l'occasion de la révision du CFP (dont le plafond passe de 7,2 milliards d'euros à 9,2 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %).
Le caractère limité des instruments de flexibilité ne doit pas être condamné, bien au contraire. Comme le note la Cour des comptes européenne : « afin de répondre aux crises importantes et exceptionnelles telles que la guerre, les pratiques de gestion des finances publiques préconisent d'avoir recours à une budgétisation de crise, et non aux réserves ordinaires. Nous avons observé que le CFP ne disposait pas d'un mécanisme permettant de déclencher une budgétisation de crise pour répondre à de tels besoins. (...) Toute révision du CFP doit être approuvée à l'unanimité par le Conseil. »
En conclusion, si des enveloppes existent pour faire face aux situations imprévues, et si les services de la Commission sont assurément experts pour réaliser des virements et des reports entre lignes budgétaires, il n'y a pas d'argent magique et tout défaut sur un instrument couvert par la marge budgétaire, se traduira, in fine, par une baisse de certaines dépenses de l'Union européenne, ou une hausse des contributions des États membres.
II. L'ASSISTANCE AUX PAYS TIERS CONNAÎT UNE HAUSSE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE, SOUS L'EFFET DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D'ASSISTANCE À L'UKRAINE
A. L'ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE A LONGTEMPS CONSTITUÉ LE PRINCIPAL MÉCANISME DE SOUTIEN FINANCIER À DES PAYS TIERS
Jusqu'à 202422(*), l'assistance aux pays tiers a pris la forme de dispositifs d'assistance macrofinancière ou, à la marge, de prêts dits « Euratom ». Ces derniers prêts visent à fournir des financements à des pays tiers pour des investissements dans le secteur nucléaire, pour un montant total s'élevant à 200 millions d'euros fin 2020, 300 millions d'euros depuis 2021.
L'assistance macrofinancière (AMF) est une aide mobilisée à la demande des pays partenaires éligibles qui vise à répondre à des besoins de financement extérieur exceptionnels et temporaires au moyen d'un soutien à la balance des paiements, sous la forme de prêts et/ou de subventions (ou d'une combinaison de ceux-ci). Ce rapport s'intéresse aux prêts octroyés, qui seuls créent des passifs éventuels pour l'Union européenne.
Conformément aux dispositions des articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les décisions d'AMF sont généralement adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la Commission dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Lorsque la situation dans un pays tiers nécessite une assistance financière urgente de la part de l'Union, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter les décisions nécessaires, conformément à l'article 213 de ce même traité (procédure urgente, sans participation du Parlement européen).
En termes de financement, la Commission européenne s'endette pour prêter. Jusqu'à 2022, elle a eu recours à des emprunts adossés (« back-to-back loans »), autrement dit, chaque prêt était financé par une obligation de l'UE correspondante, dont l'échéance, le taux d'intérêt et le calendrier de remboursement concordent exactement avec ceux du prêt de l'UE. Depuis 2022, face à la hausse des sommes empruntées et dans une logique de rationalisation de sa politique d'émission de dette, la Commission n'émet plus d'emprunts adossés et a désormais recours à ce qu'elle nomme une approche unifiée pour les emprunts de l'UE. Selon cette approche, la Commission émet des obligations sous l'appellation unique d'« obligations de l'UE », pour financer ses différents instruments de dette. Cette approche est mise en oeuvre depuis l'AMF + pour l'Ukraine (cf. infra).
L'octroi de financements à des conditions favorables est conditionné à la mise en oeuvre de mesures d'ajustement et de réformes structurelles visant à s'attaquer aux causes profondes des problèmes économiques rencontrés. Les domaines typiques des mesures qui sous-tendent les AMF sont les finances publiques, la gouvernance et la lutte contre la corruption, le secteur financier, l'environnement des entreprises, la croissance durable, ainsi que les politiques sociales et du marché du travail. Les conditions de l'AMF sont définies dans un protocole d'accord (« memorandum of understanding »). Le Parlement européen et le Conseil sont régulièrement informés de l'évolution de l'AMF tout au long de sa mise en oeuvre.
La détermination du montant de l'assistance macrofinancière de l'Union repose sur une évaluation quantitative des besoins résiduels de financement extérieur du pays partenaire, et tient compte de sa capacité à se financer par ses propres ressources, en particulier par les réserves internationales dont il dispose. L'assistance macrofinancière de l'Union doit compléter les programmes et les ressources mis à disposition par le FMI et la Banque mondiale. Elle tient également compte des contributions financières attendues des donateurs bilatéraux et multilatéraux, du déploiement préexistant des autres instruments de financement de l'Union dans le pays et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.
Jusqu'à 202323(*), chaque prêt à un pays tiers était accompagné d'une provision à hauteur de 9 %24(*) (cf. infra). C'est cette mécanique qui limitait le montant des AMF accordées, puisque le montant total des provisions est plafonné par le cadre financier pluriannuel. Le CFP 2021-2027 affectait un montant de 1,046 milliard d'euros au provisionnement des prêts AMF en faveur des pays partenaires, plafond revu à la hausse dans le cadre de la révision à mi-parcours de 2024 (+ 529,9 millions d'euros).
En dehors du cas ukrainien, les autres programmes d'assistance macrofinancière accordés à des pays tiers s'élevaient à 4,7 milliards d'euros fin 2024 et étaient attribués à des pays dans le voisinage de l'Union européenne25(*). Ces prêts ne présentent pas d'enjeu financier particulier : ils sont provisionnés à un taux de 9 % dans le cadre du CFP actuel jusque 2023, ils étaient structurés en prêts adossés, transférant l'intégralité des coûts de financement aux bénéficiaires de prêts26(*) (cf. supra).
Ils font l'objet d'un suivi approfondi de la Commission, portant notamment sur la soutenabilité de la dette et la situation budgétaire des pays bénéficiant d'une opération d'AMF, en s'appuyant principalement sur l'évaluation régulièrement mise à jour dans le cadre du programme du FMI. La Commission dialogue par ailleurs avec les pays bénéficiaires, notamment dans le cadre des réunions annuelles de l'accord d'association. Enfin, pour les pays candidats, la Commission suit les progrès accomplis dans le respect des critères économiques dans le cadre du processus d'adhésion et formule des recommandations ciblées en vue de l'intégration par le pays de l'acquis de l'UE, y compris sur les questions relatives à la soutenabilité de la dette.
En termes de volume, la hausse des AMF ne se limite pas au seul cas de l'Ukraine. Une AMF de 4 milliards d'euros a ainsi été accordée à l'Égypte27(*) et une autre de 500 millions d'euros en faveur de la Jordanie28(*). La DG ECFIN indique par ailleurs que plusieurs AMF étaient en cours d'examen à l'été 2025, dont une nouvelle de 500 millions d'euros pour la Jordanie et une éventuelle AMF pour le Liban, qui serait toutefois subordonnée à l'adoption préalable d'un programme du FMI.
Le soutien à l'Ukraine représentait fin 2024 près de 90 % des prêts accordés par l'Union à des pays tiers, expliquant la très grande majorité de la hausse des prêts accordés à des pays tiers. Il fait l'objet, dans ce rapport, d'une analyse détaillée pour mieux appréhender les dispositifs qui le constituent, les coûts associés et les risques qu'ils font peser sur le budget de l'Union européenne et de ses États membres.
B. LE SOUTIEN FINANCIER APPORTÉ À L'UKRAINE S'EST ACCRU AVEC LES ANNÉES, À LA HAUTEUR DE L'AGRESSION RUSSE, EXPOSANT DE PLUS EN PLUS FORTEMENT LE BUDGET EUROPÉEN
1. Un soutien affirmé dès 2014, pour faire face à l'agression russe, prenant la forme d'une assistance macrofinancière (AMF) faiblement provisionnée
L'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 menace l'existence même de ce pays et, comme en attestent les nombreuses violations de l'espace aérien européen observées depuis septembre 2025, cette menace ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne.
Le conflit russo-ukrainien est toutefois plus ancien et une continuité peut être trouvée avec les affrontements qui se sont tenus dans le Donbass et en Crimée en 2014. Sur le plan financier, l'Union européenne a accordé 4,4 milliards de prêts à l'Ukraine sous la forme de 4 opérations d'AMF entre avril 2014 et mai 2020, afin d`attirer les investissements, stimuler la productivité et relever le niveau de vie à moyen terme. Ce soutien s'inscrivait dans une politique de voisinage de l'Union européenne de plus en plus active, le partenariat oriental de l'Union européenne lancé en 200929(*) ayant été renforcé pour les trois pays engagés dans le processus d'adhésion à l'UE : l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie (trois pays qui présentent une autre caractéristique commune : des conflits territoriaux irrésolus avec la Russie).
La DG ECFIN de la Commission européenne, en charge de ces dispositifs d'AMF, a publié en 2025 les résultats d'une évaluation30(*) d'une AMF d'1 milliard d'euros accordés à l'Ukraine par décision du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2018 (décision (EU) 2018/947). Selon des termes assez proches de ceux utilisés en 2025 par le FMI (cf. supra), l'objet de cet accord d'AMF était de combler le déficit de financement du budget ukrainien (« financing gap »). L'instrument a été conçu pour compléter le soutien financier assuré par le FMI et équilibrer le budget ukrainien, le tout afin d'assurer la stabilité économique du pays et de soutenir le programme de réformes en cours, grâce aux conditions associées à ces prêts, portant notamment sur la lutte contre la corruption. Ces deux effets ont envoyé un signal positif, encourageant l'investissement privé dans le pays.
Une dernière assistance a été accordée juste avant l'invasion russe : une assistance macrofinancière dite « d'urgence », formalisée par la décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022, soit le jour de l'entrée des troupes russes en Ukraine. 1,2 milliards d'euros de prêts ont été versés à l'Ukraine en deux tranches de 600 millions d'euros chacune, en mars et en mai 2022. La deuxième tranche était conditionnée à la réalisation de certaines réformes : les États membres ont jugé que la conditionnalité était entravée par force majeure et ont validé son déboursement.
Les prêts AMF accordés à l'Ukraine avant l'invasion russe de 2022 sont tous provisionnés et respectent les termes de l'article 31 du règlement IVCDCI31(*), qui prévoit que « le taux de provisionnement concernant la garantie pour l'action extérieure est de 9 % pour l'assistance macrofinancière de l'Union et pour les garanties budgétaires couvrant les risques souverains liés aux opérations de prêt. »
Il est noté que, toutes les opérations d'AMF sont normalement subordonnées à l'existence d'un programme non préventif du FMI et à un bilan satisfaisant de la mise en oeuvre des réformes du programme du FMI. Cela donne en effet une forte garantie que la dette du pays bénéficiaire est soutenable, car il s'agit d'une condition stricte pour que le FMI fournisse son assistance financière. Dans le cas de l'AMF d'urgence versée fin février 2022, le soutien de l'UE a devancé de quelques semaines le soutien du FMI accordé en mars 2022, un enchainement pouvant aisément être expliqué par les circonstances exceptionnelles et l'urgence à agir.
2. Un soutien maintenu à l'été 2022, mais avec un taux de couverture en forte hausse
Après l'AMF « urgente » de février 2022 vint l'assistance macrofinancière exceptionnelle, composée de deux prêts de 1 milliard d'euros32(*) (juillet 202233(*)) puis 5 milliards d'euros (septembre 202234(*)), décaissés tout au long de l'année 2022. Cette AMF visait à répondre aux besoins de financement immédiats et les plus urgents de l'Ukraine et à garantir que l'État ukrainien puisse continuer à exercer ses fonctions les plus critiques. Elle s'inscrivait dans le cadre des efforts internationaux exceptionnels déployés par les donateurs bilatéraux et les établissements financiers internationaux pour soutenir l'Ukraine.
Les termes de cette AMF sont particulièrement favorables, avec des échéances plus longues (passant de 15 ans à 25 ans). Par ailleurs, le budget de l'UE couvre exceptionnellement les coûts de taux d'intérêt et les frais administratifs découlant de l'AMF.
Comme pour les AMF précédentes, les 6 milliards d'euros de l'AMF exceptionnelle sont assortis d'une provision de 9 %, soit un montant total de 540 millions d'euros. Pour la première fois toutefois, la décision (UE) 2022/1628 explicite le risque que ces prêts font courir au budget de l'Union :
« Afin de permettre à l'Union d'apporter un soutien important à l'Ukraine au moyen d'une assistance macrofinancière exceptionnelle de l'Union d'un montant sans précédent (...), il est essentiel de protéger adéquatement le budget de l'Union contre la concrétisation de ces passifs éventuels et de veiller à ce qu'ils soient financièrement supportables au sens de l'article 210, paragraphe 3, du règlement financier35(*) .
Conformément au principe de bonne gestion financière, le fonds commun de provisionnement devrait être renforcé par des moyens proportionnels aux risques découlant des passifs éventuels liés à cette assistance macrofinancière exceptionnelle de l'Union d'un montant sans précédent pour un bénéficiaire unique. Sans un tel renforcement, le budget de l'Union ne serait pas en mesure, pour des raisons de sécurité financière, de fournir l'assistance sans précédent qui est requise pour répondre aux besoins de l'Ukraine face à la guerre. »
Partant de la reconnaissance de ce risque exceptionnel, les États membres sont appelés à apporter une garantie supplémentaire pour protéger les intérêts de l'Union : « afin de protéger le budget de l'Union, les prêts de l'assistance macrofinancière exceptionnelle de l'Union en faveur de l'Ukraine, d'un montant maximal de 6 milliards d'EUR, devraient bénéficier d'une couverture de 70 % au moyen de provisions versées (à hauteur de 9 %), lesquelles peuvent être complétées par des garanties des États membres qui assureraient la couverture budgétaire des pertes jusqu'à encore 61 % supplémentaires de la valeur des prêts. »
Et de fait, les États membres ont apporté une garantie supplémentaire. Ces garanties sont « irrévocables, inconditionnelles et à la demande », appelées « dans le cas où l'Union n'a pas reçu l'un des paiements dus par l'Ukraine (...) à temps pour s'acquitter des obligations financières de l'Union liées à des obligations émises ». Dans le cas de la France, l'article 149 de la loi de finances pour 202336(*) prévoit un montant maximal de 1 006 millions d'euros au titre de la garantie qu'elle apporte. Le risque effectif supporté est toutefois moindre puisque, l'accord de garantie signé avec l'Union européenne le 23 janvier 2023 et remis au rapporteur spécial dans le cadre de ce contrôle ne prévoit qu'une quote-part française de 638,7 millions d'euros à la garantie totale apportée par les États membres.
La décision de septembre 2022, au-delà des conditions favorables du prêt accordé (maturité, intérêts couverts par les États membres, etc.), représente ainsi une première évolution digne d'intérêt puisqu'elle fait directement reposer la majorité du risque sur les États membres.
Le rapporteur spécial note par ailleurs qu'elle interroge en creux le caractère suffisant du provisionnement adopté pour les AMF précédentes. En effet, si la décision de septembre 2022 reconnaît le risque associé aux AMF et adapte en conséquence le niveau de garantie, rien n'est fait pour ajuster la protection sur les prêts précédents, tout aussi risqués, certains étant même accordés le jour même de l'invasion russe.
La DG ECFIN estime que le taux de provisionnement de 9 % reste applicable37(*), se reposant sur les indicateurs économiques du pays et le lien avec des programmes du FMI. Dans le cadre de ce contrôle, la DG ECGIN a aussi indiqué au rapporteur spécial que les AMF accordées jusqu'à février 2022 ont « des échéances plus courtes en moyenne par rapport aux outils de soutien plus récents en faveur de l'Ukraine. »
L'appréciation de la DG ECFIN semble par trop optimiste. D'une part, la guerre d'agression menée par la Russie se poursuit et peut encore fortement dégrader la situation ukrainienne. D'autre part, les derniers rapports du FMI prévoient d'importants besoins de financement pour l'Ukraine dans les années à venir et leur appréciation positive repose en grande partie sur les engagements des donateurs bilatéraux et multilatéraux : or l'Europe devrait de plus en plus être mise à contribution, à mesure que les États-Unis se désengagent financièrement du conflit. Quant à la question de la maturité des prêts accordés, si elle est indéniablement plus courte pour les prêts accordés jusqu'à février 2022 (maturité de 15 ans contre 25 ans ou plus pour les autres instruments), une maturité de 15 ans laisse malheureusement suffisamment de temps pour que l'économie ukrainienne se dégrade suffisamment pour présenter un risque de défaut.
Interrogée sur les conséquences d'un éventuel défaut, la direction générale du Trésor note toutefois que, « si la provision de 9 % s'avérait insuffisante pour couvrir les engagements financiers de l'UE, des mesures pourraient être activées, notamment, des transferts temporaires entre différents compartiments du fonds commun de provisionnement afin de répondre au besoin de trésorerie ou l'utilisation de marges disponibles sur le budget de l'UE. »
3. À partir de 2023, l'ampleur du soutien financier amène paradoxalement à faire fi des règles de provisionnement
a) Un soutien financier en très forte hausse en 2023 et 2024, alors que le principe de provisionnement est abandonné
Le soutien financier apporté à l'Ukraine change de dimension à partir de 2023, faisant plus que doubler par rapport à l'année précédente (7,2 milliards d'euros en cumulé pour l'AMF d'urgence et l'AMF exceptionnelle). Une nouvelle assistance macrofinancière + (« AMF+ ») est créée, d'un montant maximal de 18 milliards d'euros sous forme de prêt38(*), versés tout le long de l'année 2023. Comme pour chaque AMF, le soutien apporté est conditionné à la mise en oeuvre de réformes et prévoit une communication transparente par l'Ukraine des fonds.
Toutefois, comparé aux opérations d'AMF précédemment décrites, l'AMF + offre une plus grande flexibilité et des conditions d'emprunt plus favorables. L'Ukraine devra rembourser les prêts hautement concessionnels sur une période maximale de 35 ans, à partir de 2033 (période de grâce de 10 ans). L'UE couvre par ailleurs les charges d'intérêts incombant à l'Ukraine39(*).
Surtout, pour la première fois, le prêt n'est pas provisionné mais couvert par la marge de manoeuvre du budget de l'UE. Comme indiqué dans le règlement, « compte tenu des risques financiers et de la couverture budgétaire, aucun provisionnement ne devrait être constitué ». De façon tout à fait contrintuitive, c'est le niveau excessif de risque qui a justifié l'absence de provision sur ce prêt.
Afin de couvrir la responsabilité financière découlant de ce prêt, le règlement fixant le CFP 2021-202740(*) a été modifié le lendemain41(*) afin de permettre que des ressources budgétaires de l'Union puissent être mobilisées à titre de garantie42(*), au-delà des plafonds du CFP et dans la limite du plafond des ressources propres, pour l'assistance financière octroyée à l'Ukraine pour les années 2023 et 2024. Étonnamment, ce revirement de position n'est pas plus expliqué dans le règlement modificatif du 15 décembre 2022, qui se contente de rappeler que le soutien à l'Ukraine « nécessite un provisionnement considérable issu du budget de l'Union et des garanties des États membres », que « l'Union devrait contribuer, conjointement à d'autres partenaires internationaux, à couvrir les besoins urgents de financement de l'Ukraine » et qu'une « part importante de l'assistance financière envisagée doit être fournie sous la forme de prêts. » Avant d'enchaîner : « il est dès lors approprié d'autoriser l'Union à fournir, d'une manière viable et rationnelle, les ressources budgétaires nécessaires (...) il devrait être possible de mobiliser les crédits nécessaires dans le budget de l'Union au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel pour les États membres ainsi que pour l'assistance financière à l'Ukraine disponible pour les années 2023 et 2024. Il convient que cette possibilité soit sans préjudice de l'obligation de respecter le plafond des ressources propres ».
Dans le cadre de ses échanges avec le rapporteur spécial, la Cour des comptes européenne confirme que « les raisons qui auraient conduit à ce que ce provisionnement soit écarté ou toute autre garantie complémentaire mise en place, ne sont pas précisées dans les documents rendus publics relatifs à la procédure législative qui relatent notamment les débats au Parlement et présentent les avis des différentes commissions. »
La seule explication apportée à cette prise de risques est donc qu'il est « approprié » pour l'Union d'apporter les ressources budgétaires nécessaires. Si cette affirmation, n'est pas remise en cause, la motivation du règlement passe sous silence le fait que cette décision constitue essentiellement un transfert de risque du budget de l'Union vers celui des États membres. Au contraire, la Commission européenne s'abrite derrière la complexité des instruments employés pour présenter cette modification sur son site internet43(*) comme une simple « modification technique ».
Une fois ce précédent établi, ce nouveau mode de couverture du risque est de nouveau utilisé en 202444(*), pour des sommes encore bien supérieures. En effet, dans le cadre de la révision du règlement CFP, une « facilité Ukraine » est créée45(*) à hauteur de 50 milliards d'euros, dont 33 milliards d'euros de prêts sur la période 2024-2027. Sur le plan financier, le règlement précise que « la facilité devrait contribuer à combler le déficit de financement de l'Ukraine jusqu'en 2027, notamment en octroyant, en temps utile et d'une manière prévisible, continue et ordonnée, un soutien non remboursable et des prêts assortis de conditions très favorables. Le soutien apporté au titre de la facilité devrait contribuer à maintenir la stabilité macrofinancière de l'Ukraine et à alléger ses contraintes de financement externe », précisant par ailleurs qu'il est « dans l'intérêt commun de l'Union et de l'Ukraine de faire progresser les efforts déployés par l'Ukraine pour réformer ses systèmes politique, juridique et économique en vue de son adhésion à l'Union. »
Alors que la guerre d'agression russe a justifié une très forte hausse du soutien financier de l'Union européenne en 2023 et en 2024, on assiste donc à un revirement de position : après avoir fortement augmenté le taux de provisionnement en 2022, les autorités européennes ont choisi d'abandonner complètement cette forme de garantie à partir de 2023.
Historique des prêts approuvés et
accordés à l'Ukraine de 2014
jusqu'au printemps 2024, avec les
provisions prévues et les garanties apportées
(en milliards d'euros)
Source : Cour des comptes européenne, rapport annuel sur l'exécution du budget 2023
b) Une prise de risque forte, inévitable, mais qui doit être suivie
À défaut d'explication officielle, il ressort des auditions menées par le rapporteur spécial dans le cadre de ce contrôle que c'est justement l'ampleur du soutien requis qui a prévenu le recours à un provisionnement des sommes prêtées. Sur le plan théorique, le recours au prêt permet de démultiplier la surface financière de l'Union européenne en recourant aux ressources futures pour combler des besoins urgents. Comme vu pour la vague précédente de prêts, le taux de provision en mesure de protéger le budget de l'Union est de l'ordre de 70 %. Ce qui pouvait d'entendre jusqu'à 5 milliards d'euros devient difficilement envisageable à mesure que s'étend le soutien de l'Union européenne : pour des prêts de 51 milliards d'euros (18 milliards + 33 milliards, il faudrait en effet provisionner près de 36 milliards d'euros, une somme inenvisageable sur le plan financier et une contrainte qui entraverait trop largement la capacité de l'Union européenne à répondre aux urgences à ses frontières.
La comptabilisation de provisions répond aux principes comptables de prudence et de l'image fidèle. Le provisionnement de fonds réalisé sur les prêts AMF permet de prévenir des pertes prévisibles sur des engagements extra-budgétaires de l'Union européenne, et limiter le choc sur les états financiers futurs de décisions passées. L'urgence de la situation a nécessité l'abandon de ce mode de gestion du risque. Toutefois, comme le note la Cour des comptes européenne dans son avis rendu sur la facilité pour l'Ukraine46(*), « aucun provisionnement n'est requis, que ce soit pour les 18 milliards d'euros de prêts au titre de l'assistance macrofinancière plus (AMF+) décaissés pendant l'exercice 2023 ou pour les 33 milliards d'euros de prêts proposés dans le cadre de la facilité pour l'Ukraine. »
Or, comme le note la Cour des comptes européenne dans ce même avis, « garantir des prêts directement au moyen de la marge de manoeuvre du budget de l'UE comporte des risques », rappelant que le risque de défaut pour les prêts garantis par la marge de manoeuvre est « directement supporté par les futurs budgets de l'UE ». Relevant « l'augmentation considérable de l'exposition du budget de l'UE à la situation en Ukraine », elle note que « les 33 milliards d'euros de prêts proposés contribueront inévitablement à accroître la pression sur la marge de manoeuvre budgétaire. »
Quelle est la réalité et l'ampleur de ce risque ? Interrogées à ce sujet dans le cadre de contrôle, la direction générale du Trésor et la direction du Budget rappellent en premier lieu qu'il appartient à l'Ukraine, en tant qu'État souverain, de rembourser ces prêts. La Commission européenne relève d'ailleurs dans la documentation accompagnant le budget 2026 de l'Union européenne que l'Ukraine n'a jamais fait défaut et n'a jamais manqué un remboursement à l'Union européenne. Cette rigueur, à mettre à l'actif du gouvernement ukrainien, ne préjuge malheureusement en rien de sa capacité future à payer les prêts européens, au vu de l'exposition croissante de l'Union, de l'instabilité du soutien américain et de la destruction des capacités productives ukrainiennes.
L'administration française interrogée par le rapporteur spécial note par ailleurs que dans l'hypothèse d'un défaut, « il pourrait être envisagé d'utiliser des marges disponibles sur le budget de l'UE (instruments de flexibilité), de redéployer des crédits sur le budget de l'UE, voire d'introduire de nouvelles ressources propres pour le budget de l'UE ». S'agissant des marges disponibles sur le budget de l'UE, comme vu précédemment, elles permettraient indéniablement de limiter l'impact d'un défaut éventuel mais ne pourraient constituer seules une réponse à un choc significatif. Quant à la piste de nouvelles ressources propres, elle ne peut être considérée comme une réponse crédible à court ou moyen terme, d'une part car ces nouvelles ressources doivent rembourser en priorité l'important emprunt ayant financé le plan de relance européen, d'autre part car les discussions entre États membres à ce sujet durent depuis 2021 et semblent aujourd'hui bloquées.
Les services de la Commission interrogés par le rapporteur spécial insistent pour leur part sur le cadre de gestion des risques mis en place par l'institution, centré sur le suivi du risque, la communication des informations, et l'application du modèle des « trois lignes de défense » : les services gestionnaires, le directeur des risques (dont le rôle a été élargie en 2025) et les services d'audit interne (cf. analyse détaillée dans la suite de ce rapport).
Surtout, la Commission pointe que les prêts garantis par la marge de manoeuvre budgétaire (facilité pour l'Ukraine et AMF+) ne sont pas des prêts adossés mais sont intégrés à l'approche unifiée en matière de financement, soit un instrument unique qui centralise toute la dette émise par la Commission. Par conséquent, pour ce qui est du risque de défaut, le calendrier le plus important n'est pas le calendrier des obligations de remboursement par le bénéficiaire mais le calendrier des obligations de paiement des coupons que l'UE a envers ses investisseurs. Par conséquent, d'après les services de la Commission, « tout déficit budgétaire peut être temporairement compensé sans compromettre les obligations de l'UE envers les acteurs du marché. »
Cette réponse n'est pas tout à fait satisfaisante aux yeux du rapporteur spécial : si une telle structure de financement permet effectivement de traiter le risque d'illiquidité, en lissant les pics de remboursement des différents prêts octroyés par l'Union européenne, elle ne fait néanmoins qu'octroyer du temps pour lever les fonds nécessaires et in fine, ne traite en rien le risque en matière de soutenabilité.
Quel est alors le risque sur ces deux prêts ? La valeur maximale, supposant un défaut intégral, serait de 51 milliards d'euros pour le budget de l'Union (33 milliards d'euros + 18 milliards d'euros), soit, une exposition maximale de 8,7 milliards d'euros pour la France (en retenant le maintien d'une clé de contribution de 17 %). Il s'agit ici du scénario catastrophe où l'Ukraine est incapable de rembourser le moindre euro emprunté. Or il s'agit de prêts longs (35 ans) avec une période de grâce de 10 ans. D'une part, ceci laisse du temps pour que le conflit se termine et que l'Ukraine commence à rebâtir son économie. D'autre part, ceci permet de lisser l'impact, en moyenne 2 milliards d'euros par an pendant 25 ans au niveau de l'Union européenne (soit 340 millions d'euros par an pour la France). Ainsi étiré dans le temps, il devient alors beaucoup plus envisageable pour l'Union européenne de faire jouer ses différents instruments de flexibilité pour atténuer le choc, et pour l'Ukraine de restructurer sa dette pour la rembourser sur une durée plus longue.
Il ne s'agit pas à l'inverse de minimiser le risque de défaut. Ainsi, sur le plan comptable, la Commission a déjà retenu une dépréciation de plus de 40 % sur les prêts de la facilité pour l'Ukraine octroyés fin 2024 (soit 5,7 milliards d'euros sur les 13,1 milliards d'euros déjà versés), ce taux reflétant les pertes attendues par la Commission.
Il est de bonne gestion de ne pas exclure la situation où l'Ukraine sort fortement affaiblie du conflit, fortement endettée et avec des capacités productives réduites, nécessitant une annulation d'une partie plus ou moins significative de sa dette. Il appartient donc à l'Union européenne de communiquer clairement et régulièrement sur les sommes déboursées et remboursées sur cette dette particulièrement risquée, mais aussi sur le risque de défaut du partenaire ukrainien. Dans un second temps, cette information doit être suivie par l'administration financière française et présentée à intervalle régulier au Parlement, qui jugera du niveau du risque financier et des ressources à prévoir pour le maîtriser.
4. Depuis 2024, l'Union européenne s'efforce de contenir son exposition financière en mobilisant les avoirs russes immobilisés
a) L'Union européenne mobilise désormais les intérêts générés par les avoirs russes immobilisés...
Malgré le soutien apporté, les besoins budgétaires de l'Ukraine ont continué d'augmenter considérablement, face à l'intensification et à la prolongation de la guerre d'agression menée par la Russie. Toutefois, depuis fin 2024, les institutions européennes ont abandonné cette politique de prêts simplement garantie par la marge de manoeuvre budgétaire. Si de nouveaux prêts ont été accordés pour soutenir l'Ukraine, pour des sommes toujours aussi conséquentes, ces nouveaux dispositifs d'assistance macrofinancière, s'appuient désormais également sur les avoirs russes immobilisés dans l'Union européenne.
En effet, après le début de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, la communauté internationale a interdit toute transaction liée aux actifs et aux réserves de la Banque centrale de Russie. Par conséquent, 260 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie dans le monde sont « immobilisés », dont plus des deux tiers dans l'UE (environ 210 milliards d'euros). D'après les services de la Commission européen, en fonction des taux d'intérêt, les revenus générés par ces actifs immobilisés (dits « revenus d'aubaine ») devraient rapporter entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an au profit de l'Ukraine. Ces revenus ne sont pas la propriété de la Russie et ils ne proviennent que de la décision d'immobiliser ces actifs.
L'Union européenne et les États du G7 ont donc décidé d'affecter ces revenus au financement de l'effort de guerre ukrainien. L'initiative « Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine » (ERA) initiée par les chefs d'État du G7 en 2024 consiste en des prêts de 45 milliards d'euros octroyés par les membres du G7 et l'Union Européenne à l'Ukraine pour financer ses besoins budgétaires, d'après les analyses effectuées par le FMI, pour les années 2025 et 2026. Le prêt de l'UE prend la forme d'un AMF d'un montant total de 18,1 milliards d'euros (AMF « ERA »)47(*), décaissé par tranches tout au long de l'année 2025.
Depuis, le 12 février 2024, le Conseil a en effet décidé que les dépositaires centraux de titres (DCT) qui détiennent plus d'un million d'euros d'avoirs et de réserves de la Banque centrale de Russie immobilisés du fait des mesures restrictives de l'UE doivent mettre en réserve les soldes de trésorerie exceptionnels qui s'accumulent du fait des mesures restrictives de l'UE et ne peuvent pas céder les bénéfices nets qui en découlent.
Le remboursement des intérêts et du principal sur les prêts ERA est couvert par les contributions de ces dépositaires centraux de titres (DCT)48(*). Les prêts accordés par les membres du G7 et l'UE dans ce cadre sont remboursés annuellement au prorata des prêts des contributeurs (la quote-part de l'UE étant de 40,22 %).
Si le mécanisme est indéniablement ingénieux, il ressort des auditions menées dans le cadre de ce contrôle que la structuration de cet instrument financier revêt aussi une part d'opportunisme. En effet, les revenus d'aubaine devaient initialement plutôt financer un autre dispositif, la facilité européenne pour la paix (FEP)49(*). Le 26 juillet 2024, l'UE a ainsi mis à disposition la première tranche du produit des avoirs russes immobilisés, soit 1,5 milliard d'euros, afin de soutenir l'Ukraine. Ces fonds ont été acheminés par l'intermédiaire de la facilité européenne pour la paix (90 % des fonds) et de la facilité pour l'Ukraine (10 %)50(*).
Toutefois, d'après la Direction du budget, interrogée sur ce sujet, « les négociations sur l'opérationnalisation [du FEP] achoppent toujours au Conseil notamment en raison d'un veto hongrois sur l'adoption des mesures d'assistance associées », analyse confirmée lors de l'audition du représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. La structuration de l'AMF ERA permettait donc de tirer effectivement parti de ces revenus d'aubaine.
Le rapporteur spécial note que le mécanisme retenu permet de débloquer une somme conséquente en faveur de l'Ukraine (18,1 milliards d'euros) tout en limitant l'exposition des États-membres, en exploitant les revenus d'aubaine sur les avoirs immobilisés russes.
Il note toutefois, d'une part, que ces revenus d'aubaine présentent une part d'incertitude sur le montant et la durée de ces revenus d'aubaine, qui seront fonction de la durée d'immobilisation des actifs russes et donc de la durée des sanctions associées, remarque que la Cour des comptes européenne a pu faire par le passé sur d'autres dispositifs souhaitant mobiliser ces revenus d'aubaine51(*).
D'autre part, ce choix d'affectation des revenus d'aubaine pourrait représenter un coût indirect pour la France, en cas de réabondement de la FEP, les États membres contributeurs devant alors supporter directement le coût de ce soutien. Pour mémoire, la FEP a permis d'allouer plus de 11,1 milliards d'euros pour financer l'effort militaire ukrainien depuis février 2022. L'hypothèse d'un réabondement ne semblait toutefois pas d'actualité d'après les administrations françaises interrogées.
b) ... une première étape avant la mobilisation des avoirs russes dans leur ensemble ?
À mesure que la guerre d'agression russe en Ukraine se poursuit, les besoins budgétaires de l'Ukraine se poursuivent et les autorités européennes envisagent désormais une mobilisation des avoirs russes immobilisés qui dépasserait les seuls intérêts qu'ils génèrent.
Ainsi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ainsi évoqué, dans son discours sur l'état de l'Union, la mise en place d'un prêt de réparation pour l'Ukraine qui exploiterait les actifs russes gelés. « C'est la guerre de la Russie. C'est donc à la Russie de payer. C'est pourquoi il nous faut travailler d'urgence à une nouvelle solution pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine à partir des avoirs russes gelés, grâce aux soldes de trésorerie associés à ces actifs russes (...) L'Ukraine ne remboursera le prêt qu'une fois que la Russie aura payé les dommages de guerre ».
Au moment de la rédaction de ce rapport, les modalités précises du dispositif envisagé par la Commission européenne n'étaient pas arrêtées. Ses grandes lignes étaient présentées dans une courte note52(*) distribuée aux États membres pour discussion dans le cadre de la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement du 1er octobre 2025.
Dans le détail, la proposition s'appuie sur le fait que, comme les autres grandes banques centrales, la Banque de Russie s'est constitué des réserves en devises étrangères, conservées principalement au sein d'une institution financière belge, Euroclear, l'un des principaux dépositaires centraux de titre (DCT), le plus grand système de règlement/livraison de titres au monde. En effet, sur les 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés en Europe, 185 milliards seraient placés auprès de cette institution financière. Sur ces 185 milliards d'euros, 176 milliards d'euros constituent aujourd'hui un solde de trésorerie, accumulé à mesure que les obligations d'État arrivaient à échéance. Dans les prochaines années, à mesure que les dernières obligations arrivent à échéance, le solde de trésorerie sera porté à 185 milliards d'euros.
La proposition vise à transférer ces soldes de trésorerie vers l'Union européenne, qui nouerait en retour un contrat de dette sur mesure avec Euroclear à un taux d'intérêt de 0 %. L'UE utiliserait ces fonds pour financer un prêt à l'Ukraine, le prêt de réparation pour l'Ukraine, qui ne serait remboursé par l'Ukraine que si elle reçoit des réparations de guerre de la Russie53(*).
L'enjeu crucial de la proposition est de proposer un instrument temporaire qui ne confisque pas les avoirs russes : l'ensemble serait débouclé au moment où les sanctions européennes seraient levées, à savoir au moment où la Russie cesse sa guerre d'agression et dédommage financièrement l'Ukraine. En effet, dans cette situation, la Russie indemniserait l'Ukraine, qui pourrait rembourser le nouveau prêt, et l'Union européenne pourrait alors restituer à Euroclear les soldes de trésorerie immobilisés.
L'opération serait complètement garantie par les États membres, la garantie étant déclenchée si Euroclear se voit dans l'obligation de transférer les soldes de trésorerie. En pratique, une telle situation se produirait en cas de levée des sanctions, ce qui entrainerait un dégel des avoirs russes.
Ce point est crucial dans la proposition formulée : les sanctions ne doivent pas être levées avant que la Russie paie des réparations de guerre. La proposition formulée appelle donc à ce que les sanctions envers la Russie puissent être prolongées à la majorité qualifiée des États membres, en vertu du 2. de l'article 31 du traité sur l'Union européenne.
Enfin, comme indiqué, la proposition repose sur le fait qu'Euroclear investisse dans l'instrument de dette sur mesure émis par l'Union européenne, qui doit être structuré de telle façon à ne pas dégrader le bilan d'Euroclear : des dispositions spécifiques guidant l'action d'Euroclear seraient adoptées à la majorité qualifiée sur la base de l'article 215 du TFUE.
Quel serait le montant prêté ? Sur les 185 milliards d'euros disponibles à terme en solde de trésorerie, 45 milliards d'euros devraient être consacrés à repayer les prêts ERA : en effet, si les soldes de trésorerie sont saisis et mobilisés, ils ne pourront plus générer les revenus d'aubaine qui financent ces prêts. Le prêt octroyé serait donc de l'ordre de 140 milliards d'euros.
En termes de cashflow, le prêt de réparation serait décaissé à l'Ukraine de manière échelonnée, selon les besoins constatés, par conséquent les soldes de trésorerie ne seraient virés que progressivement depuis Euroclear.
Cette proposition a reçu un soutien de poids en la personne du chancelier allemand Friedrich Merz, qui a publié une tribune54(*) pour appeler à une plus grande utilisation des avoirs russes gelés. Selon lui, « il convient d'élaborer dès maintenant une solution viable permettant, sans intervenir dans le droit de propriété, d'accorder à l'Ukraine un prêt sans intérêt d'un montant total de près de 140 milliards d'euros » qui permettraient de sécuriser les capacités de défense du pays pendant plusieurs années et seraient exclusivement réservés au financement de l'équipement militaire.
La proposition de la Commission doit encore être étoffée, détaillée sur le plan technique et discutée entre États membres. Au moment de la rédaction de ce rapport, en l'absence de diffusion d'une proposition détaillée, il est notamment difficile de se prononcer sur la question centrale de la confiscation des avoirs russes. En effet, pour des pays comme la France et la Belgique, qui hébergent les grands dépositaires centraux que sont Clearstream ou Euroclear, il est essentiel que la solution retenue offre les garanties suffisantes pour que les investisseurs mondiaux ne craignent pas que leurs fonds soient soumis à l'arbitraire politique des institutions européennes. Cette question dépasse au demeurant la seule présence de dépositaires centraux dans un État et intéresse chaque État membre, au nom de l'attractivité et du financement de l'économie européenne.
A supposer que la proposition détaillée offre effectivement une base juridique solide pour disposer des soldes de trésorerie sur les actifs gelés sans provoquer de fuite des capitaux, le rapporteur spécial note toutefois que la garantie accordée par les États membres à Euroclear les exposerait sur des montants significatifs et pour un risque qui semble tout sauf théorique. En effet, cette garantie risque principalement d'être engagée si les sanctions ne sont pas renouvelées. Ce renouvellement s'opère aujourd'hui à l'unanimité et pose à chaque fois le risque d'un veto d'un État membre.
En conclusion, le rapporteur spécial constate que, depuis 2022, les prêts accordés à l'Ukraine ont connu une progression exponentielle, qui risque de se poursuivre dans les prochaines années. Il ne souhaite aucunement critiquer le bienfondé de ces prêts, qui permettent de soutenir l'Ukraine face à une guerre d'agression russe qui menace la sécurité de l'ensemble du continent européen. Il note toutefois que dans un contexte où les crédits se font rares et où les besoins sont légion, les dispositifs financiers, d'une complexité croissante, se multiplient pour dégager rapidement les fonds nécessaires, conduisant à une hausse de l'endettement ukrainien et à une exposition toujours plus forte du budget européen, supportée en dernière analyse par les États membres contributeurs. Il appartient donc, d'une part, aux institutions européennes de communiquer plus clairement sur les risques que ces prêts font supporter aux membres (montants, échéance, etc.), d'autre part que le gouvernement français reflète chaque année ces analyses dans l'information qu'il communique au Parlement, afin que ce dernier puisse juger du niveau de risque qui pèse tant sur le budget de l'Union que sur le budget de la France, et puisse en tenir compte notamment dans son analyse des contributions présentes et futures de la France au budget de l'Union européenne.
Recommandation n° 1 : S'assurer que la Commission européenne communique régulièrement sur les sommes prêtées à l'Ukraine, l'avancée des décaissements et des remboursements et la prise en charge des intérêts (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).
Recommandation n° 2 : Analyser et présenter au Parlement l'ensemble des prêts accordés pour soutenir l'Ukraine financièrement, en identifiant notamment les coûts et les risques associés à ces dispositifs (direction du budget).
5. Dans l'ensemble, un soutien d'ampleur qui comporte plusieurs points d'attention
Compte tenu du nombre et de la diversité des dispositifs d'assistance financière accordés à l'Ukraine, il apparaît souhaitable à ce stade de faire le point leur modalités les coûts associés et les risques qu'ils font porter à l'Union européenne et aux États membres (cf. tableau ci-dessous).
Synthèse des prêts accordés à l'Ukraine et de leurs modalités de garantie (au 16 juin 2025)
(en milliards d'euros, sauf précision contraire)
|
Adoption |
Programmes |
Total |
Versé |
Paiement des intérêts |
Coût** |
Maturité |
Période de |
Provision |
Garantie |
Marge
de |
|
Avant 2022 |
Euratom |
0,3 |
0,3 |
Ukraine |
9 % |
|||||
|
Avant 2022 |
AMF pré-2022 |
3,8 |
3,8 |
|||||||
|
fév-22 |
AMF d'urgence |
1,2 |
1,2 |
15 |
Remboursement |
|||||
|
juil-22 |
AMF exceptionnelle 1 |
1 |
1 |
UE |
0,8 |
15 |
61 % |
|||
|
sept-22 |
AMF exceptionnelle 2 |
5 |
5 |
25 |
||||||
|
déc-22 |
AMF + |
18 |
18 |
États membres |
2,3 |
30 |
10 ans |
100 % |
||
|
févr-24 |
Facilité pour l'Ukraine* |
33 |
16,2 |
UE |
2,1 |
35 |
||||
|
oct-24 |
AMF « ERA » |
18,1 |
7 |
Revenus d'aubaine |
45 |
|||||
|
Total |
80,4 |
52,5 |
5,2 |
1,0 |
3,7 |
Notes : * volet prêt ; **coût des bonifications d'intérêt apportées.
Les AMF exceptionnelles bénéficient d'une bonification d'intérêts, avec un impact budgétaire de l'UE de 819 millions d'euros sur la période 2023-2027.
L'AMF+ bénéficie d'une bonification d'intérêts sur la période 2024-2027, pour un montant estimé par la DG ECFIN à 2,3 milliards d'euros, couverts par des contributions extérieures des États membres, qui ont tous signé des accords de garantie bilatéraux à cet effet.
Les prêts de la facilité pour l'Ukraine bénéficient d'une bonification d'intérêts sur la période 2025-2027, à verser sur le budget de l'UE. Dans la programmation financière du budget de l'UE, un montant de 2,1 milliards d'euros a été affecté à la couverture de cette bonification d'intérêts.
Source : commission des finances d'après la Commission européenne (DG ECFIN)
En premier lieu, les montants prêtés ont connu une progression exponentielle : de 4,1 milliards d'euros avant 2022 à 7,2 milliards d'euros en 2022 (+ 76 %) puis 18 milliards d'euros en 2023 (+ 150 %) et 33 milliards d'euros en 2024 (+ 83 %) : les prêts octroyés dans le cadre de la facilité pour l'Ukraine en 2024 représentent ainsi 8 fois le volume de prêt octroyé avant 2022. Au total, 80,4 milliards d'euros ont été engagés en faveur de l'Ukraine, dont 52,5 milliards déjà décaissés au 16 juin 2025, le reste devant être décaissé d'ici 2027. Pour mémoire, comme exposé précédemment, ce montant pourrait encore franchir un nouveau cap avec un prêt de réparation de 140 milliards d'euros envisagé pour combler les besoins budgétaires futurs de l'Ukraine, multipliant encore par 2,7 les sommes prêtées.
Si les montants prêtés constituent l'exposition du budget de l'Union européenne, le coût direct de ces instruments s'élève aujourd'hui à 5,2 milliards d'euros pour la bonification des intérêts, auxquels on peut ajouter 4,7 milliards d'euros pour le provisionnement et la garantie des risques55(*) (coût porté, selon le dispositif, soit par le budget de l'Union européenne, soit par les États membres.
On peut observer que les AMF accordées avant juillet 2022 sont sous-provisionnées. Il est en effet incohérent d'adopter des taux de provisionnement radicalement différents pour une même situation de conflit. En prenant comme référence le taux de garantie de 70 % adopté pour l'AMF exceptionnelle, le taux de 9% précédemment usité est insuffisant et le provisionnement supplémentaire nécessaire pour les 5,3 milliards d'euros prêtés avant le début du conflit serait de 3,2 milliards d'euros.
Enfin comme développé précédemment, on constate que, de 2014 à février 2024, des prêts de plus en volumineux ont été accordés à des conditions de plus en plus favorables, avec des maturités de plus en plus longues et des garanties de moins en moins formalisées.
L'utilisation des avoirs russes gelés à partir d'octobre 2024 a permis de répondre à ces observations en utilisant les revenus d'aubaine pour financer les coûts directs des prêt accordés. Le dispositif envisagé permettrait quant à lui d'utiliser le capital de ces avoirs et les réparations de guerre future pour contenir le risque de défaut ukrainien.
Calendrier de remboursement des AMF versées à l'Ukraine
(en millions d'euros)
Note : la catégorie « AMF » comprend les AMF antérieures à 2022, l'AMF d'urgence et les deux AMF exceptionnelles.
Source : commission des finances d'après la Commission européenne (DG ECFIN)
Le graphique ci-dessus s'appuie sur les calendriers de remboursement communiqués par la DG ECFIN et ne comprend pas le principal dispositif, la facilité pour l'Ukraine56(*). On peut néanmoins constater que, du fait du remboursement à l'échéance de certaines AMF, le calendrier des remboursements présente deux pics à plus de 3 milliards d'euros (en 2042 et 2053) et un pic à 2 milliards d'euros (dès 2035). Ces remboursements concentrés sur quelques années risquent de mettre en difficulté le partenaire ukrainien et de susciter des chocs budgétaires que devront gérer l'Union européenne et ses États membres. Il appartient d'ores et déjà de les identifier, pour pouvoir les anticiper57(*).
Enfin, il est rappelé que ce contrôle ne porte pas sur le soutien apporté à l'Ukraine mais sur les seuls engagements extrabudgétaires de l'Union européenne : il ne s'intéresse donc dans le détail qu'aux prêts accordés à l'Ukraine. Même s'ils constituent la majeure partie des aides financières apportées, le soutien accordé à l'Ukraine est néanmoins plus vaste et comprend aussi notamment 17 milliards d'euros d'aides non remboursables accordées dans le cadre de la facilité pour l'Ukraine (soit 2,9 milliards d'euros pour la France sur la période 2024-2027, suivant sa côte part). On peut aussi ajouter les 11,1 milliards d'euros de soutien militaire accordés directement par les États membres dans le cadre de la facilité européenne pour la paix, les 926 millions d'euros d'aide humanitaire pour aider les civils touchés par la guerre, ainsi que les différentes garanties budgétaires fournies par l'UE aux institutions financières multilatérales pour prêter à l'Ukraine (cf. infra).
Au vu de ces différents chiffres, le rapporteur spécial ne peut que constater que l'emprunt a constitué un recours privilégié pour débloquer en urgence des sommes substantielles. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut s'attendre à ce que des pays européens disposant de faibles marges budgétaires continuent de s'endetter pour soutenir l'effort de guerre ukrainien : il apparaît donc nécessaire d'assurer un suivi détaillé de ces engagements, de manière à s'assurer que les remboursements restent suffisamment espacés pour être assurés par l'Ukraine et que l'éventuel effort n'est pas transféré de manière démesurée sur les générations futures.
III. L'ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ÉTATS MEMBRES ET LES GARANTIES BUDGÉTAIRES ONT PERMIS DE DÉMULTIPLIER LA PUISSANCE FINANCIÈRE DE L'UE
A. UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA FORTE HAUSSE DOIT ÊTRE SUIVIE AVEC VIGILANCE
1. Les instruments de dette en faveur des États membres se sont accumulés avec les crises successives
Comme exposé précédemment, l'assistance financière aux États membres constitue la principale source d'exposition du budget européen. La dynamique haussière de ces mécanismes explique par ailleurs l'essentiel de la hausse observée, progressant de 49 milliards d'euros à 249 milliards d'euros entre 2019 et 2024, soit une hausse de 200 milliards d'euros qui équivaut à 80 % de la hausse totale observée.
La montée en volume de l'assistance financière aux États membres s'est produite par étapes, suivant les grandes crises traversées par l'Union européenne, que ce soit la crise de la dette souveraine (création du mécanisme européen de stabilité financière - MESF) puis surtout la crise sanitaire (mise en place de la facilité pour la reprise et la résilience - FRR- et de l'instrument européen SURE58(*)). Aujourd'hui, un nouvel instrument est mis en place pour répondre à la guerre d'agression russe en Ukraine (le programme SAFE59(*)). La dynamique haussière des prêts aux États membres est appelée à se poursuivre et devrait porter le montant de l'assistance aux États membres à 490 milliards d'euros d'ici 2027.
Comment comprendre cette hausse ? Ce rapport analyse les principaux dispositifs qui la sous-tendent avant d'étudier les apports de ces dispositifs et les risques qu'ils font peser sur les États membres.
a) Le MESF a constitué un premier instrument financier de gestion de crise
Jusqu' à la crise sanitaire, les principaux prêts accordés par l'Union européenne à ses États membres avaient été décidés dans le cadre du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), établi en mai 201060(*), en réponse à la crise de la dette de la zone euro. Il s'agit d'un programme de financement d'urgence visant à fournir une assistance financière aux États membres connaissant de graves perturbations financières ou économiques ou faisant face à une menace sérieuse à cet égard, notamment en raison d'événements exceptionnels qui échappent à leur contrôle.
La Commission européenne était habilitée à emprunter au nom de l'UE sur les marchés financiers jusqu'à 60 milliards d'euros, les prêts étant garantis par la marge de manoeuvre budgétaire. L'aide financière attribuée aux États membres pouvait prendre deux formes : un prêt ou une ligne de crédit, en autorisant l'État membre à tirer des fonds jusqu'à un plafond déterminé et pendant une période donnée. Pour bénéficier du MESF, un État membre devait formuler une demande comprenant une évaluation de ses besoins financiers et un programme de redressement économique et financier décrivant les différentes mesures visant à rétablir la stabilité financière.
Le MESF a été activé à plusieurs reprises. Il l'a notamment été pour l'Irlande et le Portugal pour un montant total de 46,8 milliards d'euros (22,5 milliards pour l'Irlande et 24,3 milliards pour le Portugal), déboursés sur trois ans, de 2011 à 2014. En juillet 2015, le MESF a aussi été de nouveau activé, pour apporter une assistance financière à court terme de 7,16 milliards d'euros à la Grèce. Ce mécanisme n'a jamais été activé pour la France.
Fin 2012, le MESF, créé dans l'urgence, a été intégré au sein du Mécanisme européen de stabilité (MES). Aucun nouveau prêt ne peut être accordé au titre du MESF ; les prêts en cours peuvent toutefois être allongés (ex : en 2024, le Portugal a demandé le report du remboursement des 1,8 milliard qu'il devait rembourser en 2024). Au 31 décembre 2024, 42 milliards d'euros étaient encore prêtés au titre du MESF (19,7 milliards d'euros pour l'Irlande, 22,3 milliards d'euros pour le Portugal).
Le MESF est un excellent exemple d'instrument financier d'assistance aux États membres qui a permis de faire face en urgence à une crise rencontrée au niveau de l'Union européenne.
b) L'instrument SURE a permis d'apporter une réponse rapide à un marché de l'emploi européen gravement menacé par la crise sanitaire
Premier dispositif d'assistance financière à des États membres créé en 202061(*) pour surmonter la pandémie de COVID 19, les prêts au titre de l'instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE -- « Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency »), avaient pour ambition d'aider les États membres à faire face à l'augmentation soudaine des dépenses publiques visant à protéger l'emploi. Ce dispositif d'urgence était doté d'une enveloppe globale de 100 milliards d'euros pour couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs nationaux de chômage partiel, ainsi que d'autres mesures similaires mises en place en réponse à la pandémie, en particulier pour les travailleurs indépendants.
Avec le dernier versement en date du 25 mai 2021, l'UE a fourni près de 98,4 milliards d'euros sous forme de prêts adossés. Les 19 États membres de l'UE qui ont demandé à bénéficier de l'aide ont reçu tout ou partie du montant demandé. On observe une concentration de la répartition de ces prêts, l'Italie et l'Espagne représentent la moitié des prêts octroyés, et les 5 premiers pays en représentent un peu plus des trois quarts. La France n'a pas sollicité de prêt SURE.
Répartition des prêts SURE
(prêts décaissés, en milliards d'euros)
Note : Italie (ITA), Espagne (ESP), Pologne (POL), Belgique (BEL), Grèce (GRC), Portugal (PRT), République Tchèque (CZE), Roumanie (ROU), Irlande (IRL), Croatie (HRV), Lituanie (LTU), Slovénie (SVN), Bulgarie (BUL), Hongrie (HUN), Chypre (CYP), Slovaquie (SVK), Lettonie (LVA), Malte (MLT), Estonie (EST).
Source : commission des finances d'après les comptes annuels de l'UE
À noter que le règlement créant l'instrument SURE prévoit en outre qu'un quart des prêts accordés sont garantis par les États-membres : « ces garanties sont nécessaires pour permettre à l'Union d'accorder des prêts d'un ordre de grandeur suffisant aux États membres, afin de soutenir les politiques du marché de l'emploi qui sont soumises à de très fortes tensions. Afin de garantir que le passif éventuel découlant de ces prêts est compatible avec le cadre financier pluriannuel (CFP) et les plafonds de ressources propres applicables, les garanties fournies par les États membres devraient être irrévocables, inconditionnelles et à la demande ».
La France, qui n'a pas souscrit de prêt SURE, est donc directement exposée du fait de cet instrument. L'ensemble des États membres garantit un peu moins de 25 milliards d'euros sur les 98,4 milliards d'euros prêtés. Chaque État contribuant selon sa part dans le revenu national brut (RNB) de l'Union, la garantie française a été fixée à environ 4,4 milliards d'euros, conformément à la convention signée avec la Commission européenne en juillet 202062(*). La garantie accordée par la France couvre les prêts jusqu'à leur date d'échéance maximale, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de remboursement des emprunts contractés par la Commission européenne dans le cadre de SURE (soit le 31 décembre 2053). La garantie n'est appelée par la Commission européenne que dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire si un État bénéficiaire de SURE ne peut pas honorer le remboursement d'un prêt ou des intérêts.
L'instrument SURE semble avoir atteint son objectif. Dans le rapport qu'elle consacre à cet instrument63(*), la Cour des comptes européenne émet un avis globalement favorable sur cet instrument, et notamment sur la réactivité affichée en temps de crise : « dans l'ensemble, nous estimons que la Commission a réagi rapidement et efficacement au défi consistant à aider les États membres à préserver l'emploi. Elle a pu verser l'aide de l'UE aux États membres plus rapidement que lorsqu'elle suit les procédures de financement ordinaires. Le cadre SURE a tenu compte du contexte d'urgence et limité le risque financier pour le budget de l'UE. » L'évaluation ne s'engage pas sur l'efficacité même du dispositif, indiquant qu'il semble avoir bénéficié à des centaines de millions de travailleurs européens mais que la Cour ne dispose pas des données nécessaires pour se prononcer définitivement.
c) La facilité pour la reprise et la résilience concentre des moyens très importants sur quelques États membres, pour une efficacité discutable
Une étape supplémentaire est franchie avec la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), qui constitue le principal engagement extrabudgétaire de l'Union européenne. Instrument au coeur du plan de relance européen « NextGenerationEU », plan acté lors du Conseil européen des 17-21 juillet 2020. Sa dotation initiale maximale était de 723 milliards d'euros, dont 385 milliards d'euros de prêts. Fin 2024, 650 milliards d'euros avaient été engagés par les États membres, dont 291 milliards d'euros sous forme de prêts : ce sont ces prêts qui constituent des passifs éventuels pour l'Union européenne.
Part des FRR dans le budget de Next Generation EU (situation fin 2024)
(en millions d'euros)
Source : Cour des comptes européenne
Le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la FRR a été révisé le 1er mars 2023 pour tenir compte des objectifs de financement du plan REPowerEU pour la sécurité énergétique de l'UE. Ce nouveau plan n'a pas entrainé de hausse de l'endettement commun au niveau européen, reposant sur une nouvelle utilisation de moyens existants64(*).
Par l'intermédiaire de la FRR, la Commission lève des fonds en empruntant sur les marchés des capitaux. Ces fonds sont ensuite mis à la disposition de ses États membres pour mettre en oeuvre des réformes et des investissements qui (i) rendent leurs économies et leurs sociétés plus durables et mieux préparées aux transitions écologique et numérique et (ii) s'attaquent aux défis recensés dans les recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen pour la coordination des politiques économiques et sociales.
Pour bénéficier d'un soutien au titre de la facilité, les gouvernements de l'UE ont soumis à la Commission des plans nationaux pour la reprise et la résilience, décrivant les réformes et les investissements qu'ils mettront en oeuvre d'ici la fin de 2026 (fin 2024, seuls 108,7 milliards d'euros avaient été décaissés sur les 291 milliards d'euros engagés). Dans les faits, on constate une forte concentration des prêts FRR auprès d'un nombre limité de pays, deux pays concentrant 70 % des prêts attribués et des prêts décaissés, cinq pays concentrant 95 % des prêts attribués et des prêts décaissés65(*). La France n'a pas sollicité de prêt FRR.
Répartition des prêts FRR
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances d'après les comptes annuels de l'UE
Ces plans doivent consacrer au moins 37 % de leur budget à des mesures écologiques et 20 % à des mesures numériques et sont assortis de jalons et de cibles clairement définis. Lorsque les jalons et cibles convenus sont atteints, les gouvernements peuvent demander le paiement (jusqu'à deux fois par an). Dans l'évaluation qu'elle a récemment consacrée à ce dispositif66(*), la Cour des comptes européenne note que « c'est la première fois que le modèle de « financement non lié aux coûts » a été mis en oeuvre sur une grande échelle et que les paiements dépendent de la réalisation satisfaisante de jalons et de cibles convenus au préalable ».
Le rapporteur spécial note en premier lieu que, contrairement au dispositif SURE, aucune garantie des États membres n'a été sollicitée, et ce malgré la hausse du risque encouru pour le budget de l'Union (le montant final des prêts décaissés est plus de trois fois supérieur au montant décaissé pour les prêts SURE). Le choix a été fait au contraire de modifier la décision ressources propres pour accroître la marge de manoeuvre budgétaire sous plafond (cf. supra).
Le rapporteur spécial relève par ailleurs que ce dispositif n'est pas exempt de critiques. L'évaluation menée par la Cour les identifie et en tire des « leçons » pour des instruments futurs fondés sur la performance. Dans une première série d'observations, elle note que « ce n'est pas parce que le financement n'est pas lié aux coûts que l'instrument est en soi fondé sur la performance », que la Cour définit en fonction de la réalisation des objectifs de l'action et du rapport coût / efficacité. Elle recommande d'employer des jalons harmonisés entre États membres, plus directement en lien avec les objectifs des FRR, de comparer les progrès réalisés aux coûts engagés et d'éviter les chevauchements entre les différents programmes.
En matière d'obligation de rendre compte, le constat est de nouveau sévère. « À la lumière de nos travaux, nous estimons qu'en dépit des améliorations apportées à ses travaux d'audit, la Commission n'a pas réussi à obtenir une assurance suffisante quant à la question de savoir si les États membres disposent de systèmes de contrôle interne efficaces permettant de garantir que les dépenses consenties au titre de la FRR respectent bien les règles en matière de marchés publics et d'aides d'État. »
De telles critiques interrogent sur l'opportunité de multiplier les dispositifs de ce genre au-delà des situations de stricte nécessité.
d) SAFE, un nouvel instrument de crise pour financer l'effort de défense
La guerre d'agression russe en Ukraine constitue aujourd'hui un défi sécuritaire aux frontières de l'Union européenne. Alors que les États européens ne peuvent plus récolter les dividendes de la paix, et que le soutien du partenaire américain apparaît de plus en plus friable, un consensus émerge au sein des États membres de l'UE sur la nécessité d'investir substantiellement dans la défense européenne. Dans un contexte où les ressources financières sont limitées et face au besoin de débloquer rapidement des sommes substantielles, les autorités européennes ont de nouveau conçu un mécanisme de prêt de l'UE à ses États membres pour lever les fonds nécessaires. Ainsi, dans le cadre de son plan « ReArm Europe », la commission européenne a dévoilé le 19 mars 2025 un nouvel instrument spécifique intitulé « agir pour la sécurité de l'Europe - SAFE », transposé dès le 27 mai 2025 dans un règlement du Conseil67(*).
Le règlement SAFE prévoit un montant maximal de 150 milliards d'euros de prêts qui peuvent fournir aux États membres un financement avantageux pour leurs besoins en matière de défense (prêts remboursables sur 45 ans, période de grâce de 10 ans). L'allocation de cette enveloppe est « axée sur la demande » sans clé de répartition.
Les États membres qui souhaitent recevoir des prêts doivent présenter à la Commission d'ici le 30 novembre 2025 un plan d'investissement européen pour l'industrie de la défense ciblé sur les sept domaines capacitaires arrêtés début mars par le Conseil (défense aérienne et antimissile, systèmes d'artillerie...). Ce plan doit inclure une description des activités, des dépenses et des mesures pour lesquelles l'État membre demande un prêt, des produits de défense qu'il a l'intention de se procurer et, le cas échéant, de la participation prévue de l'Ukraine aux activités prévues. SAFE finance des acquisitions conjointes entre plusieurs États membres ou États associés (Liechtenstein, Islande, Norvège et Ukraine, bien que ces États ne puissent pas recevoir de prêts). Le dispositif prévoit l'application de règles de commande publique simplifiées ainsi qu'une exonération de TVA pour les achats noués dans ce cadre. Les équipements concernés devront, pour les plus "simples" d'entre eux, contenir des composants d'origine l'UE représentant au moins 65 % du coût total du produit ; la maîtrise intégrale de la conception du produit devra également être assurée pour les équipements plus « complexes », afin de ne pas créer de nouvelles dépendances.
La Commission européenne a annoncé le 9 septembre 2025 l'allocation provisoire de ces moyens aux 19 États membres qui souhaitaient en bénéficier : la France aurait cette fois-ci recours à ce dispositif et serait même le 3e pays bénéficiaire, à égalité avec la Hongrie, loin derrière la Pologne toutefois, principal bénéficiaire de ce dispositif.
Allocation provisoire des prêts SAFE
(en milliards d'euros)
Source : www.touteleurope.eu d'après les annonces de la Commission européenne
Pour un État, le principal avantage du dispositif SAFE est de pouvoir s'endetter au taux de l'UE. La demande de la France reflète donc la dégradation de ses finances publiques, qui fait que le coût de sa dette est désormais supérieur à celui de l'Union.
Le rapporteur spécial note par ailleurs que ce dispositif, d'ampleur certes moindre que le FRR, reste néanmoins conséquent, mobilisant 150 milliards d'euros, soit 50 milliards de plus que l'instrument SURE, pourtant déjà un instrument de crise répondant à une situation exceptionnelle.
2. Les programmes d'assistance financière aux États membres font courir des risques de moyen terme à la France, en tant qu'emprunteur potentiel et en tant qu'État membre contributeur
L'augmentation de l'exposition financière du budget de l'Union européenne reflète l'évolution du rôle du budget de l'UE en tant qu'instrument de stabilisation et de soutien face à des crises d'ampleur exceptionnelle. Ce rôle s'est manifesté dès la crise des dettes souveraines et s'est progressivement affirmé avec la crise sanitaire et, aujourd'hui, la guerre d'agression russe en Ukraine.
À mesure que les sommes empruntées progressaient, l'Union européenne a progressivement rationalisé la manière dont elle lève de la dette, si bien qu'une majorité d'États européens, dont la France, a aujourd'hui intérêt à recourir aux instruments conçus par l'UE pour s'endetter. Ceci n'est toutefois pas sans poser de questions tant sur la structuration et sur le contenu de ces différents instruments que sur le contrôle que le Parlement peut effectivement exercer.
Par ailleurs, comme exposé précédemment, les sommes prêtées aux États membres ont progressé à un rythme effréné (+ 39 % par an entre 2019 et 2024). Si le risque de défaut d'un État membre apparaît aujourd'hui mesuré, il est supérieur à moyen terme. Or ces instruments, garantis par la seule marge de manoeuvre de l'UE, exposent particulièrement la France en tant que pays contributeur. Aussi il convient de suivre leur progression avec attention, ces prêts étant notamment concentrés sur quelques États.
a) Malgré l'intérêt d'une dette européenne bon marché, la prudence doit rester de mise pour l'État emprunteur
L'article 220 du règlement financier permet à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés financiers afin d'octroyer « conformément à des conditions prédéfinies et sous la forme d'un prêt, d'une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace ».
Avant la crise de la Covid-19, la Commission utilisait principalement cette possibilité dans le cadre de l'aide aux pays tiers via une forme de prêts adossés (« back to back »). En règle générale, les prêts accordés aux États membres de l'UE ont été accordés selon cette technique et ce mode de financement a notamment été utilisé pour les prêts SURE. Il n'y a donc pas eu de charge effective à ce titre.
En décembre 2022, la Commission a modifié sa stratégie de financement sur les marchés afin d'adopter une stratégie de financement unifiée (modification du règlement financier 2022/2434). Elle permet à la Commission d'émettre sur les marchés des obligations uniques (« obligations de l'EU ») afin de garantir de meilleures conditions de financement. Selon cette approche, la Commission émet des obligations sous l'appellation unique d'« obligations de l'UE », plutôt que sous des appellations différentes selon les programmes, tels que Next Generation EU, SURE ou AMF. Elle rassemble l'intégralité du produit des émissions dans une réserve de financement centrale et l'affecte en interne aux différents programmes d'action financés par l'émission d'obligations. Cela permet d'éviter la fragmentation des émissions de l'UE et de contribuer à une plus grande homogénéité du marché secondaire pour les obligations de l'UE.
Chaque année, la Commission adopte une décision d'exécution d'emprunt qui fixe un plafond maximal pour les opérations d'emprunt permettant de planifier sur une période d'un an. La Commission adopte également un plan de financement semestriel qui prévoit les emprunts pour les six mois à venir, dans les limites de la décision annuelle d'emprunt. Grâce à ses plans de financement, la Commission gère les attentes du marché et s'assure qu'elle peut lever les fonds nécessaires pour couvrir les besoins de paiement correspondants.
Émissions annuelles de dette européenne
(en milliards d'euros)
Note : « Émissions de dette de l'UE : un soutien aux priorités politiques de l'UE à une échelle sans précédent ».
Source : Commission européenne, « EU investor presentation »
En termes de montants, la quantité de dette émise par l'Union européenne a connu une progression exponentielle depuis la crise sanitaire. En 2024, le montant total des financements à long terme s'est élevé à 138,1 milliards d'euros, soit le montant le plus élevé d'obligations émises par l'UE en une seule année. À la fin de 2024, l'encours des obligations de l'UE s'élevait à 578,2 milliards d'euros, avec une échéance résiduelle moyenne d'environ 12 ans.
L'Union européenne est rapidement devenue l'un des principaux émetteurs de dette : en 2024 elle était le 5e émetteur souverain d'obligations en euros, après la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, mais devant la Belgique, les Pays-Bas ou l'Autriche. Afin d'émettre efficacement un volume de dette aussi important, la Commission européenne a rapidement mis en place une stratégie d'emprunt globale68(*), fondée sur les meilleures pratiques des principaux émetteurs de l'UE, combinant des opérations syndiquées et des adjudications, et s'appuyant sur un vaste réseau de négociants principaux69(*)
Les coûts des obligations européennes sont désormais compétitifs. la Commission européenne communique auprès de ses investisseurs sur le rendement supérieur de ses obligations par rapport aux obligations allemandes : ceci fait toutefois ressortir en creux le coût inférieur de ses obligations par rapport aux obligations françaises.
Courbes de rendement comparées des dettes
française,
européenne et allemande
(en %)
Note : « les obligations de l'UE offrent des retours relatifs attractifs ».
Source : Commission européenne, « EU investor presentation », d'après les données Bloomberg au 23 septembre 2025
Il peut alors devenir intéressant pour la France d'utiliser les instruments financiers de l'Union européenne plutôt que de lever sa propre dette. Ceci contribue à expliquer le recours à l'instrument SAFE, comme le note la direction du Budget dans le cadre de ce contrôle : « en cas de recours à l'instrument SAFE, ce dispositif pourrait être financièrement favorable à la France en cas de taux d'émissions relativement plus favorables de l'UE par rapport aux OAT françaises, et donc budgétairement favorable à trajectoire de dépenses militaires inchangée. » La généralisation massive de prêts de l'Union européenne à ses États membres appellent toutefois à une vigilance accrue de la France en tant qu'emprunteur et en tant que prêteur.
En tant qu'emprunteur, tout d'abord, le simple fait de disposer de taux d'intérêts légèrement favorables ne saurait motiver à lui seul une décision d'investissement. Les créances constituées auprès de l'Union européenne viennent s'ajouter à la dette publique au sens de Maastricht, qui pour mémoire s'établissait à 115,6 % du PIB à la fin du deuxième trimestre 2025, dépassant les projections inscrites pour 2025 dans son plan budgétaire et structurel de moyen terme (114,7 %). Cette dette nouvelle émise par l'UE ne donc s'ajouter à la dette française existante, mais, comme le note la direction du budget, en substitution de la dette existante.
Il importe par ailleurs de contrôler la pertinence des dépenses engagées dans le cadre de ces instruments. Le rapporteur spécial note que ces grands programmes de prêts sont généralement adoptés dans des situations de crise et donc, dans des délais restreints. La présidente de la Commission européenne qualifiait en 2025 le programme SAFE dans son discours sur l'État de l'Union « d'aide financière d'urgence face à un besoin urgent ». Si l'on peut se féliciter que les institutions européennes, puissent apporter une réponse suffisamment puissante et suffisamment rapide en temps de crise, ceci ne dispense pas pour autant l'exécutif d'un contrôle parlementaire.
En outre, s'agissant spécifiquement du programme SAFE, on peut relever que le Parlement européen a décidé de saisir en août 2025 la Cour de justice de l'UE après avoir été écarté des discussions sur l'élaboration de ce programme. En effet, la Commission a invoqué l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), qui permet à la Commission et au Conseil de renoncer à la procédure législative ordinaire et de contourner le contrôle démocratique du Parlement européen. Il est donc primordial que les parlements nationaux puissent effectivement contrôler les décisions engagées, et ce d'autant plus que, comme exposé précédemment, si d'après la Cour des comptes européenne, certains programmes comme le programme SURE semblent avoir répondu à leur objectif et apporté une valeur ajoutée européenne, l'efficacité et l'efficience des fonds déboursés dans le cadre de la FRR apparaît plus discutable. Le rapporteur spécial recommande donc, d'une part, de limiter le recours à ce type d'instrument à des situations de crise et, d'autre part, d'isoler dans la documentation budgétaire les programmes financés par ce type d'instruments, leur motivation et les coûts qui y sont associés.
Recommandation n° 3 : Limiter le recours de la France aux prêts octroyés par l'Union européenne aux seules situations de crise où l'apport européen est manifeste (Gouvernement).
Recommandation n° 4 : Isoler dans la documentation budgétaire les opérations financées par des prêts européens, la motivation des dépenses associées et le coût du financement européen (direction du budget).
Au-delà des considérations de bonne gestion qui s'imposent à la France en tant qu'emprunteur, l'essor de ces instruments de dette émis par l'Union européenne interroge aussi sur le risque que ceux-ci font encourir en dernier ressort à la France, second contributeur net au budget de l'Union européenne et pouvant être appelé à contribuer financièrement en cas de défaut.
b) Une France exposée en tant que pays contributeur à des prêts concentrés sur quelques États et qui présentent des risques de défaut non-négligeables à moyen-terme
Les dispositifs d'assistance financière aux États membres sont couverts par la marge de manoeuvre et, comme exposé précédemment, à ce titre, tout défaut sur ces instruments peut se traduire par une hausse de contribution des États membres au budget de l'Union européenne.
Le risque de défaut s'accroît avec le volume de prêts accordés par l'Union européenne. Il est aussi accentué par la concentration des prêts sur auprès de certains pays et l'existence de pics de remboursement sur certaines années.
Calendrier de remboursement des obligations de l'UE
(en milliards d'euros, au 31 décembre 2024)
Note de traduction : Ukraine UAF - facilité pour l'Ukraine ; MFA+ - AMF + ; RRF : FRR ; EFSM : MESF ; BoP : balance de paiement (négligeable).
Source : Commission européenne, présentation du 19 février 2025 de la Directrice générale du budget au Parlement européen
À court terme, les remboursements des sommes empruntées par l'UE sont inférieurs à 15 milliards d'euros par an et portent sur des prêts à des États membres (prêts SURE et MESF). Toutefois, à partir de 2035, plusieurs pics de remboursement sont observés à mesure que le nombre d'instruments devant être remboursés s'accroît (avec des remboursements supérieurs à 15 milliards d'euros en 2035, 2036, 2037 et 2050). Les prêts accordés à l'Ukraine sur la marge de manoeuvre doivent aussi être remboursés à partir de cette date-là.
À cette concentration temporelle s'ajoute une concentration spatiale, puisque les prêts octroyés par l'Union européenne sont aujourd'hui concentrés sur un nombre limité d'États membres.
Répartition des principaux prêts de l'UE à ses États membres
(en milliards d'euros, au 31 décembre 2024)
Note : répartition indicative pour les prêts SAFE ; proportions affichées en % du PIB 2024.
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne
Sur le plan quantitatif, trois pays affichent un recours aux instruments de prêt européens supérieur à 80 milliards d'euros (Italie, Espagne et Pologne), pour une dette cumulée de près de 360 milliards d'euros, soit plus de 62 % de la dette aux États membres.
Sur le plan plus qualitatif, 7 pays affichent des recours supérieurs à 10 % de leur PIB, principalement des pays d'Europe de l'Est, du fait de leur recours au dispositif SAFE (Lettonie, Lituanie, Roumanie, Pologne, Hongrie), mais aussi le Portugal, du fait de l'importance relative du prêt MESF, et aussi la Grèce, qui a profité des prêts du FRR. Un pays est à la jonction de ces deux critères, la Pologne, qui avec l'instrument SAFE (44,7 milliards d'euros) s'apprête à emprunter en cumulé 89 milliards d'euros, soit 10,6 % de son PIB 2024. Une telle concentration peut-elle menacer la solvabilité de ces États ?
Le rapporteur spécial a interrogé l'administration financière sur l'étendue du risque de défaut (total ou partiel) sur ces emprunts et l'impact financier qu'il aurait sur les contributeurs au budget de l'Union européenne. La direction générale du Trésor a reconnu que si « elle suit attentivement la situation macroéconomique des États membres », en revanche elle « n'effectue pas d'analyse spécifique dédiée sur le risque de défaut d'un État-membre de l'UE », rappelant toutefois que la situation financière de chacun des États membres fait l'objet d'une surveillance multilatérale étroite dans le cadre du Semestre européen et que la soutenabilité de la dette des États membres est analysée chaque année par la Commission européenne dans son « Debt sustainability Monitor »70(*).
La DG Trésor invite à analyser chaque situation au cas par cas et note que « par exemple, la capacité de l'Italie à dégager des excédents budgétaires continue de rassurer les marchés financiers, malgré son niveau d'endettement élevé. » Le rapporteur spécial confirme que, de fait, le risque de défaut semble négligeable à court terme. Si l'on s'intéresse aux pays ayant eu le plus recours aux instruments de dette émis par l'Union européenne71(*), soit l'Italie, l'Espagne et la Pologne, les services de la Commission européenne ont à chaque fois estimé que les risques sur la soutenabilité fiscale72(*) à court terme (« short term risks to fiscal sustainability ») de la dette étaient faibles, la soutenabilité fiscale ou soutenabilité des finances publiques désignant ici la capacité d'un gouvernement à maintenir ses politiques actuelles en matière de dépenses, de fiscalité et autres à long terme sans menacer sa solvabilité ni manquer à certaines de ses obligations.
Le rapporteur note à l'inverse que les perspectives sont bien plus contrastées à moyen terme, les risques sur la soutenabilité des finances publiques de chacun de ces trois États étant jugés élevés d'ici 2035. À titre d'exemple, la dette italienne doit atteindre 157 % de son PIB à cette date-là, la dette polonaise 95 % de son PIB, avant toute comptabilisation du prêt SAFE qui n'a pas encore été octroyé ou toute hausse des dépenses de défense.
Au vu de l'importance des sommes prêtées par l'Union européenne, le rapporteur spécial estime que l'administration financière française doit réaliser un suivi des perspectives de défaut à moyen terme des principaux États membres ayant souscrit aux instruments de dette de l'Union et en tenir informé le Parlement (cf. recommandation dans la suite de ce rapport).
B. LES GARANTIES SUR LE BUDGET APPARAISSENT AUJOURD'HUI COMME DES INSTRUMENTS SÉCURISÉS ET EFFICIENTS
1. Des programmes établis de longue date pour mobiliser l'investissement public et privé
Les garanties budgétaires sont accordées aux différents partenaires chargés de la mise en oeuvre de programmes destinés à soutenir l'investissement au sein de l'UE et en dehors. Dans le cadre de ces instruments, l'UE fournit des garanties afin de couvrir une partie des pertes et coûts potentiels découlant de leurs opérations de financement et d'investissement (c'est-à-dire les opérations de prêt ou de fonds propres).
Les garanties sur le budget de l'Union européenne impliquent une exposition potentielle du budget de l'UE, dans la mesure où elles peuvent être appelées en cas de défaillance d'un bénéficiaire. Cette exposition représente un risque budgétaire latent, qui peut se concrétiser en fonction de l'évolution économique ou géopolitique. La Commission européenne assure donc un suivi régulier de ces garanties afin de maintenir une transparence adéquate sur les engagements pris et de veiller à ce que des mécanismes appropriés de gestion des risques soient en place, y compris en matière de provisionnement.
a) Les garanties budgétaires destinées à soutenir l'investissement public et privé au sein de l'UE
Historiquement, le fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), créé en 201573(*), était l'outil principal du plan Juncker qui visait à relancer l'investissement et l'industrie en Europe après la crise des dettes souveraines, avec pour objectif initial de mobiliser 315 milliards d'euros d'investissements de 2015 à 2018, objectif porté en 2018 à 500 milliards d'euros à l'horizon 2020. La banque européenne d'investissement (BEI) est le seul partenaire chargé de la mise en oeuvre du FEIS. Le budget de l'UE fournit une garantie pouvant atteindre 26 milliards d'euros dans le cadre d'un accord entre l'UE et la BEI afin de protéger cette dernière contre les pertes potentielles qu'elle pourrait subir dans le cadre de ses opérations de financement et d'investissement (répartie en deux volets, l'un de 19,2 milliards d'euros pour les infrastructures et l'investissement, l'autre de 6,8 milliards d'euros pour les PME). La BEI adopte ses décisions d'investissement indépendamment de l'Union européenne, qui ne fait qu'apporter une garantie. L'évaluation menée de ce dispositif74(*) est positive, relevant notamment que le FEIS a permis de mobiliser 524,3 milliards d'euros de fonds publics et privés (soit plus que l'objectif de 500 milliards d'euros), dont 72 % de financements privés.
Le fonds InvestEU a été créé par la suite en 202175(*) en regroupant le FEIS et 13 autres instruments financiers de l'UE - précédemment gérés de manière indépendante. Il devait permettre de mobiliser plus de 372 milliards d'euros d'investissements publics et privés. Une garantie budgétaire de l'UE de 26,2 milliards d'euros couvre les investissements de la BEI et d'autres partenaires financiers. Fin septembre 2025, les institutions européennes ont convenu d'un accord pour porter ce plafond à 29,1 milliards d'euros d'ici 2027. Le fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d'investissement relevant de quatre priorités stratégiques de l'UE. Les investissements effectués portent sur des domaines similaires à ceux du FEIS76(*). Après une mise en place difficile dans un contexte macroéconomique affecté par le conflit ukrainien, l'évaluation à mi-parcours menée77(*) observe de nouveau un effet de levier favorable, avec 65 % de fonds privés levés.
b) Les garanties budgétaires destinées à soutenir l'investissement public et privé hors de l'UE
La garantie budgétaire la plus ancienne est celle fournie au titre du mandat de prêt extérieur (MPE) de la Banque européenne d'investissement (BEI). Son objectif était de renforcer la capacité de la BEI à entreprendre des opérations de financement dans des environnements plus risqués à l'extérieur de l'UE dans des domaines tels que le développement du secteur privé local et le développement des infrastructures socio-économiques. Ce mandat a expiré en 2021. Au 31 décembre 2024, le budget européen garantissait des prêts à hauteur de 19,2 milliards d'euros. De nouveau, un effet de levier favorable est observé, de l'ordre de x 20, le taux de provisionnement de 9 % s'étant avéré suffisant et la BEI finançant en règle générale 50 % du coût total des projets78(*).
En 2017, le fonds européen pour le développement durable (FEDD) a été conçu pour fournir des garanties et des financements mixtes afin de faciliter les investissements dans le voisinage européen et dans les pays subsahariens. Le FEDD faisait partie de la politique de développement de l'UE et a été mis en oeuvre par l'intermédiaire de plusieurs banques de développement, dont la BEI. Le FEDD est également entièrement constitué, la période d'éligibilité des signatures s'étant écoulée à la fin de 2024. Il disposait d'un budget de 5,1 milliards d'euros pour la période 2017-2021 (1,55 milliard d'euros de garanties et 3,5 milliards d'euros de financement mixte), visant à mobiliser 50 milliards d'euros. L'instrument visait à répondre à des objectifs tels que les causes socio-économiques profondes spécifiques de la migration et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et des priorités sectorielles établies.
Le nouveau FEDD+ élargit le FEDD et, avec le mandat de prêt extérieur de la BEI, forme un cadre d'investissement au titre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale - L'Europe dans le monde (IVCDCI - L'Europe dans le monde). Le plafond de garanti du FEDD+ était porté, au 31 décembre 2024, à 30,2 milliards d'euros, dont 26,0 milliards d'euros dans le cadre d'un accord signé avec la BEI, qui n'est plus le seul partenaire à mettre en oeuvre cet instrument.
Enfin, dans un contexte plus particulier, le règlement établissant une facilité pour l'Ukraine79(*) prévoit une capacité de garantie totale de 7,8 milliards d'euros jusqu'à fin 2027 afin de mobiliser 40 milliards d'euros d'investissement public et privé pour soutenir l'investissement dans ce pays, notamment dans des secteurs critiques comme l'énergie. Au 31 décembre 2024, les accords de garantie effectivement signés avec les partenaires n'autorisaient une garantie totale que de 0,8 milliard d'euros.
2. Des instruments sécurisés disposant d'un effet de levier intéressant
Garanties budgétaires accordées par l'UE
(en milliards d'euros, au 31 décembre 2024)
|
Plafond |
Opérations signées |
Opérations signées et décaissées |
Provision |
Taux de provisionnement |
|
|
FEIS |
25,373 |
22,998 |
21,033 |
8,941 |
35,2 % |
|
FEDD |
0,759 |
0,667 |
0,521 |
0,785 |
103,4 % |
|
MPE |
25,772 |
25,772 |
19,184 |
3,400 |
13,2 % |
|
InvestEU |
27,042 |
11,769 |
3,468 |
6,802 |
25,2 % |
|
FEDD+ |
30,173 |
11,228 |
1,341 |
2,943 |
9,8 % |
|
Garantie pour l'Ukraine |
0,790 |
0,172 |
0,132 |
0,202 |
25,6 % |
|
Ensemble des garanties budgétaires |
109,909 |
72,606 |
45,679 |
23,073 |
21,0 % |
Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne
Le taux de provisionnement appliqué aux différentes garanties budgétaires de l'UE varient pour refléter le fait que ces garanties diffèrent considérablement par les objectifs stratégiques poursuivis, par les structures de répartition des risques, ainsi que par le profil de risque des opérations sous-jacentes. Ils sont déterminés selon la méthode quantitative de la valeur à risque (VaR)80(*).
Le rapport de la Commission sur les passifs éventuels de l'UE, ainsi que les documents budgétaires annexés au projet de budget pour 2026 montrent que, globalement, les instruments de garantie budgétaire présentent un niveau de provisionnement adéquat au regard du niveau des valeurs à risque de ces instruments. Les programmes de garantie de l'UE sont anciens et année après année, on observe des taux de provisionnement élevés et suffisant pour couvrir le risque encouru.
Cette appréciation positive peut être nuancée pour la garantie pour l'Ukraine, où un taux de provisionnement de 25 %, alors que des taux de garantie de 70 % ont été observés sur d'autres produits financiers concernant ce pays. Ce risque est néanmoins nuancé par l'ampleur réduite de ce programme à ce stade et la fongibilité des sommes provisionnées, mais cette observation reste néanmoins un point d'attention pour la suite.
A l'inverse, le rapporteur spécial relève aussi qu'un consensus semble se faire sur le fait que l'effet de levier observé sur ces instruments en fait des outils efficaces et attractifs. L'évaluation de mi-parcours du programme InvestEU notait ainsi que « les instruments de garantie budgétaire tels qu'InvestEU sont intrinsèquement efficaces pour le budget de l'UE, offrant des avantages par rapport aux subventions grâce à un effet multiplicateur plus élevé ».
Le gouvernement français partageait ce diagnostic. Ainsi, lors du débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2025, le ministre délégué chargé de l'Europe a fixé comme objectif, dans le cadre des négociations qui s'ouvrent sur le prochain cadre financier pluriannuel, « de renforcer les instruments qui permettent de faire levier. Je pense à InvestEU, par exemple, qui a un très bon taux de retour, ou aux autres instruments de garantie à la Banque européenne d'investissement (BEI), afin de mieux mobiliser les fonds publics à côté des fonds privés pour financer nos priorités. »
Le rapporteur spécial partage cette appréciation et invite donc à une plus large mobilisation de ce type d'instruments, à condition de maintenir des taux de provisionnement aussi prudents que ceux adoptés par le passé.
IV. LE SUIVI DU RISQUE CAUSÉ PAR L'EXPOSITION DU BUDGET EUROPÉEN N'EST AUJOURD'HUI RÉALISÉ QU'À BRUXELLES ET SE CONCENTRE SUR LE COURT TERME
A. UN SUIVI RÉGULIER ET DOCUMENTÉ AU NIVEAU EUROPÉEN MAIS QUI POURRAIT ÊTRE ENRICHI, NOTAMMENT SUR L'EXPOSITION À MOYEN TERME
1. La Commission européenne a adopté et mis en oeuvre de bonnes pratiques en matière de documentation et gestion des risques
Suivi des passifs éventuels assuré par la commission européenne
Note : « Rapports sur les passifs éventuels ».
Source : Commission européenne
La Commission assure un suivi régulier et documenté des passifs éventuels et de leur viabilité, en analysant l'adéquation des provisions des passifs éventuels provisionnés détenus dans le fonds commun de provisionnement (FCP) et en évaluant la viabilité des passifs éventuels bénéficiant d'une marge de manoeuvre, y compris en appliquant des tests de résistance.
Formellement, elle produit deux rapports consacrés au sujet :
- le premier est publié en même temps que le projet de budget annuel sous la forme d'un document de travail des services de la Commission, conformément à l'article 41, paragraphe 5, du règlement financier. Il comporte notamment une analyse de l'adéquation du provisionnement des passifs éventuels provisionnés ;
- en complément, un second rapport dédié aux passifs éventuels est publié à l'automne, conformément à l'article 256 du règlement financier. Ce rapport donne également un aperçu des marges de manoeuvre et comprend des simulations de crise.
La gestion des risques associés aux passifs éventuels ne se limite toutefois pas à ces obligations documentaires et ont récemment été renforcées pour tenir compte d'observations de la Cour des comptes européenne81(*). Dans le cadre de ce contrôle, la Commission a insisté sur le fait que « compte tenu de l'importance croissante des garanties budgétaires et des programmes d'assistance financière pour la mise en oeuvre des politiques de l'UE, elle a renforcé, ces dernières années, ses outils de gestion des risques pour faire face aux passifs éventuels ».
Cette observation s'appuie notamment sur la décision 2025/369 de la Commission, qui élargit le rôle du directeur des risques et lui permet de suivre de manière indépendante l'ensemble des opérations financières de l'Union (soit la gestion de l'emprunt, de la dette et de la liquidité, les opérations de prêt et les garanties budgétaires et la gestion d'actifs). Le directeur des risques joue en effet un rôle central dans le modèle des trois lignes de défense, modèle de référence en matière de gestion des risques82(*) :
- la première ligne de défense se compose des services de la Commission chargés des opérations d'emprunt, de prêt et de gestion d'actifs de l'UE ainsi que des garanties budgétaires ;
- en tant que deuxième ligne de défense, le directeur des risques formule des politiques de gestion des risques et assure une surveillance indépendante des risques, garantissant des contrôles et des responsabilités supplémentaires ;
- la troisième ligne de défense est le service d'audit interne, qui fournit une assurance indépendante sur la gouvernance des risques.
Ainsi, si les crises successives traversées par l'Union européenne ont nécessité une prise de risques accrue de l'Union européenne sur le plan financier, ce risque est en partie contenu par sa gestion administrative, avec une supervision indépendante des risques et une communication régulière d'informations aux autorités politiques.
2. Les passifs éventuels provisionnés apparaissent maîtrisés, même si on ne peut exclure un risque de sous-provisionnement à moyen terme
Pour mémoire, les passifs éventuels de l'Union européenne peuvent être distingués entre ceux qui font l'objet d'une provision et les autres, couverts par la marge de manoeuvre budgétaire. Cette distinction est centrale en matière de gestion des risques et au coeur du suivi assuré par la Commission européenne. Les passifs éventuels provisionnés sont aujourd'hui minoritaires :
Ventilation des passifs éventuels par source au 31 décembre 2023
Note : (*) sur la base du montant total de garanties disponibles signées avec des contreparties.
Source : Commission européenne
Les sommes provisionnées sont centralisées au sein d'un fonds commun de provisionnement (FCP). Établi en vertu de l'article 212 du règlement financier, le FCP détient toutes les provisions réservées par le budget de l'Union ou versées par les États membres participants et les pays de l'AELE pour couvrir le risque de pertes sur les opérations protégées par les garanties internes83(*) et externes84(*) mises en oeuvre par l'Union européenne. Outre les garanties budgétaires, des provisions sont détenues dans le FCP pour la plupart des prêts au titre de l'assistance macrofinancière (AMF) accordés à des pays tiers85(*). Les provisions détenues dans le FCP constituent la réserve de capital sur laquelle sont prélevés les fonds pour faire face aux appels à garantie relatifs aux opérations soutenues et aux autres sorties de trésorerie.
Le FCP est devenu opérationnel en janvier 2021. À la fin de 2024, sa valeur de marché s'élevait à 23,2 milliards d'euros. Il s'agit du plus important des portefeuilles d'investissement gérés directement par la Commission. Les actifs du FCP sont gérés conformément à une politique commune d'investissement mais sont détenus dans différents compartiments liés principalement aux garanties budgétaires et aux programmes d'assistance financière individuels. Conformément à ses lignes directrices pour la gestion des actifs, le FCP conserve un portefeuille liquide et diversifié, principalement grâce à l'investissement dans des instruments de dette très bien notés (obligations émises par des gouvernements, des organisations supranationales, des agences d'État et des entreprises), dans le but de préserver le capital sur l'horizon d'investissement du fonds.
Il est ici noté que le principe de provisionnement ne va pas nécessairement de soi. À titre de comparaison, le Trésor britannique critique une telle pratique (HM Treasury, 2023), objectant que l'utilisation de fonds provisionnés expose le budget au risque de marché et immobilise ses ressources publiques. Cette position s'entend du point de vue d'une entité souveraine, dotée d'un pouvoir fiscal, car elle peut toujours faire appel au marché obligataire ou augmenter les impôts pour trouver les fonds nécessaires en cas de réalisation du risque et la pratique du provisionnement perd ainsi de son sens. À l'inverse, dans des circonstances normales, l'UE est financièrement liée par son cadre financier pluriannuel. Par conséquent, dans le cadre d'une règle d'équilibre budgétaire, la cristallisation des risques de fait peser une menace sur les dépenses budgétaires générales prévues dans le CFP lorsqu'il n'existe pas de réserve sous forme de provisions. La pratique du provisionnement semble donc parfaitement adaptée à la gestion de l'exposition extrabudgétaire de l'Union européenne ; à l'inverse, le fait de se reposer de plus en plus sur la marge de manoeuvre indique en creux que la réalisation du risque impliquera une contribution supplémentaire des États membres.
Lex taux de provisionnement appliqués semblent adéquats. Pour chaque instrument (garanties budgétaires ou assistance financière aux pays tiers), ils sont prévus dans chaque acte de base sous-jacent86(*). Interrogée sur le niveau de provisionnement pratiquée dans le cadre de ce contrôle, la direction générale du Trésor considère que la dotation du FCP est « appropriée », constatant qu'en 2023, le FCP a enregistré un montant du total des sorties à 350,9 millions d'euros, soit seulement 2 % de la valeur de marché du fonds (estimée à 18 milliards d'euros fin 2023).
La DG Trésor observe par ailleurs que fin 2023, environ 15,2 % du portefeuille du FCP se composait d'actifs liquides à court terme, constituant une source de liquidités prêtes à l'emploi en cas de sorties importantes dépassant la taille du coussin de liquidités87(*).
Enfin, la DG Trésor note une révision prudente de la méthodologie du taux de provisionnement effectif (TPE) sur 2023. Le TPE est le rapport entre le montant requis de trésorerie (et équivalents) dans la structure de gestion conjointe du FCP et la somme des montants requis de trésorerie (et équivalents) dans le cas où chaque compartiment serait géré séparément. Aux termes de l'article 213 du règlement financier, le TPE doit tenir compte de la diversification potentielle que pourrait entraîner la gestion groupée du FCP : le TPE devrait être fixé entre 95 % et 100 %, un taux inférieur à 100 % indiquant un effet de diversification. Au cas présent, la DG Trésor relève que, par précaution, la Commission a proposé que le TPE reste à 100 % pour 2023 en raison de l'absence de diversification observée entre les appels aux provisions des différents compartiments.
Le rapporteur spécial souhaite toutefois nuancer cette appréciation globalement positive de la gestion des actifs provisionnés. Il note que l'appréciation de la DG Trésor et de la Commission se concentrent principalement sur les flux financiers observés en 2023. Or les provisions doivent prévenir des pertes dans un futur où le risque peut être supérieur. Ainsi, il rappelle que seul un taux de provisionnement de 9 % a été retenu pour l'AMF d'urgence d'1,2 milliard d'euros accordée à l'Ukraine en février 2022, proportion qui ne reflète pas le niveau de risque associé à la guerre d'agression russe et, à tout le moins, n'est pas cohérent avec le taux de provision de 70 % retenu pour l'AMF exceptionnelle accordée à ce pays quelques mois plus tard : en adoptant ce même taux de 70 %, le sous-provisionnement serait de 61 % des sommes prêtées, soit 732 millions d'euros.
Il note par ailleurs que le niveau du FCP est sujet à des fluctuations de marché, pouvant potentiellement entraver son rôle de garantie. À titre d'exemple, le fonds a connu d'importantes pertes en 2022 (-8,9 %) qui n'ont pas été compensées par le rendement positif enregistré en 2023 (+ 5,2 %), menant à la recommandation suivante de la Cour des comptes européenne dans son rapport annuel sur l'exercice 2023 : « dans sa gestion du FCP, la Commission entend au moins veiller à la préservation du capital (...) après une année 2022 particulièrement médiocre (...) la performance financière non réalisée cumulée du portefeuille depuis sa création en 2021 était toujours négative à la fin de 2023 (...) Dans notre rapport annuel relatif à 2022, nous avons recommandé à la Commission de prendre toute mesure appropriée pour s'assurer que ses outils d'atténuation des risques - comme le fonds commun de provisionnement - aient une capacité suffisante. Cette recommandation reste valable. »
En réponse à ces observations, les services de la Commission ont indiqué dans le cadre de ce contrôle qu'en premier lieu, le FCP avait enregistré des performances positives en 2024 (+ 3,6 %) qui lui ont permis de récupérer intégralement ces pertes. Au demeurant, ces pertes étaient le fruit de marchés obligataires ayant enregistré en 2022 leur pire performance depuis 50 ans, en réponse à la forte hausse de l'inflation et, en particulier, aux coûts de l'énergie. Enfin, « la Commission a déployé des efforts pour diversifier l'univers d'investissement du FCP en autorisant des investissements en fonds propres par l'intermédiaire de fonds cotés (ETF) pouvant atteindre 7,5 % du portefeuille. Cela contribuera également à optimiser les paramètres de risque et le rendement attendu du portefeuille à long terme. »
Le rapporteur spécial note que l'observation de la Cour des comptes européenne portait sur un niveau insuffisant du FCP à la suite de fluctuations de marché ; que dans un contexte géopolitique particulièrement incertain et dans une tendance plus générale de réchauffement climatique, on ne peut pas exclure de nouvelles fluctuations de marché sans précédent à moyen terme ; que la principale réponse apportée par la Commission est le fait que le FCP investit dans des fonds côtés (ETF) pour accroître le rendement du FCP. Or, si le simple fait de diversifier le portefeuille du FCP contribue à diminuer son risque, les ETF, désormais ciblés dans une proportion significative (jusqu'à 7,5 % du portefeuille) présentent eux-mêmes un profil plus risqué, justifiant leur rendement supérieur au prix d'une plus grande volatilité pouvant être pénalisante dans un contexte défavorable. Par conséquent, le portefeuille du FCP reste exposé en cas de fluctuation importante du marché et pourra nécessiter d'être complété.
3. Une marge de manoeuvre suffisante pour protéger le budget européen à court terme, mais qui nécessite une analyse prospective à moyen-terme
Ventilation des passifs éventuels par
source
au cours de la période 2021-2023
(en milliards d'euros)
Source : Commission européenne
Alors que la logique du provisionnement est particulièrement adaptée à la gestion du risque pour une entité non-souveraine, ne disposant pas d'un pouvoir fiscal (cf. supra), les passifs éventuels non-provisionnés ont progressé plus vite que les autres à la faveur de la crise et représentaient deux tiers des passifs éventuels de l'Union européenne fin 2023. Comme vu précédemment, cette tendance est amenée à se poursuivre dans les prochaines années, portée tant par une hausse de l'assistance financière aux États membres que par le décaissement de prêts non provisionnés à l'Ukraine.
Dans son rapport annuel sur l'exercice 2023, la Cour des comptes européenne pointait « que cette approche comporte des risques non négligeables pour le budget de l'UE » (cf. supra). En réponse à cette observation, la Commission conteste la pertinence du provisionnement au-delà d'un certain volume de passifs, notant au sujet de la facilité pour l'Ukraine que « sur la base d'une évaluation des risques, un provisionnement égal à 70 % du montant du prêt aurait été nécessaire si le prêt était soutenu par le fonds commun de provisionnement (FCP). Il faudrait donc que le budget de l'UE mette à disposition et bloque 23 milliards d'euros à l'avance pour les engagements à échéance à long terme. La Commission estime qu'un provisionnement initial si important ne constituerait pas le meilleur moyen d'utiliser les ressources publiques ».
De fait, il apparaît peu concevable d'immobiliser de tels sommes dans un contexte d'urgence où chaque euro est précieux et peut contribuer à favoriser l'Ukraine sur le terrain militaire. Pour autant, il ne faut pas non plus passer sous silence le risque significativement accru qui découle de cette absence de provision.
Or la Commission, interrogée dans le cadre de ce contrôle sur le risque que fait courir au budget européen la part croissante des dispositifs d'assistance financière aux États membres couverts par la marge de manoeuvre, s'est contentée, de manière générale, de mettre en avant son cadre renforcé en matière de gestion des risques : « en outre, en ce qui concerne l'importance croissante des garanties budgétaires et des programmes d'assistance financière pour la mise en oeuvre des politiques de l'UE, la Commission a amélioré ses outils de gestion des risques pour faire face aux passifs éventuels » (cf. développements à ce sujet ci-dessus). Si le rapporteur spécial se félicite de la place renforcée occupée par le directeur des risques au sein de l'administration européenne, cette mesure ne suffit pas à elle seule à traiter un risque de défaut de plusieurs centaines de milliards d'euros.
Sur le plan technique, la Commission évalue chaque année la viabilité des passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre, ou en d'autres termes, la capacité du budget de l'UE à faire face à une situation dans laquelle l'exposition liée aux passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre se matérialiserait88(*). La Commission européenne effectue quatre « stress tests » :
- un stress test de baisse des taux de croissance de 1 pt par rapport aux prévisions économiques de la Commission, ce qui réduit le niveau du plafond de ressources propre et donc de la marge de manoeuvre sous ce plafond ;
- un stress test « recettes » dans lequel la Commission vérifie que la marge de manoeuvre sous le plafond de ressource propre serait suffisante dans le cas où l'ensemble des passifs éventuels se matérialisaient, i.e. si tous les États bénéficiant d'un dispositif d'assistance financière couvert par cette marge de manoeuvre faisaient défaut en même temps ;
- un stress test « dépenses », en fixant les dépenses au plafond du CFP, ce qui réduit également la marge de manoeuvre disponible sous le plafond de ressources propres du budget de l'UE ;
- un scénario « extrême » combinant les trois scénarios précédents.
Le dernier rapport en date publié par la Commission européenne, portant sur la situation au 31 décembre 2023 conclut que « la marge de manoeuvre est dotée de ressources suffisantes pour garantir la solidité du système financier de l'UE et sa solvabilité, même dans un scénario extrêmement négatif (...) [où] la marge de manoeuvre restante sous le plafond des ressources propres de 1,4 % du RNB de l'UE s'élèverait à 66,7 milliards d'euros en moyenne par année sur la période 2025-2029 et à 86,1 milliards d'euros en moyenne par année pour le plafond temporaire de 0,6 % du RNB de l'UE. »
Interrogée dans le cadre de ce contrôle, la direction du Budget, estime que ces stress tests sont à la hauteur des risques, en particulier au regard de l'hypothèse d'un défaut systémique sur l'ensemble des passifs couverts au titre d'une même année. Comme le souligne la Commission : « Concrètement, cela signifie que tous les pays bénéficiant de programmes d'assistance financière manqueraient simultanément à leur obligation d'honorer leurs remboursements à échéance [...] Il s'agit d'un scénario très improbable, qui ne tient pas de compte de toutes les mesures que peut prendre la Commission pour éviter une telle situation (par exemple un rééchelonnement de dette et une gestion active de la trésorerie ».
Elle estime néanmoins qu'il serait intéressant d'étendre l'horizon de ces stress tests, qui à ce stade, n'intègrent pas tous les remboursements prévus au titre des prêts accordés à l'Ukraine (du fait des périodes de grâce), ainsi que le remboursement du montant du principal des prêts accordés dans le cadre de la FRR. En effet la Commission indique que le remboursement du principal de ces prêts ne débutera qu'en 2032. La France porte régulièrement en filière budgétaire au Conseil de l'UE cette demande de réalisation de tests sur un horizon plus long.
Le rapporteur spécial partage cette analyse. Si les éléments présentés par la Commission sont plutôt rassurants à moyen-terme, une grande partie du risque encouru doit survenir à plus long terme (cf. supra), aussi il recommande l'horizon des stress tests réalisés.
Recommandation n° 5 : Obtenir de la Commission européenne qu'elle étende l'horizon des « stress tests » réalisés pour évaluer la viabilité des passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).
Il ressort par ailleurs des échanges avec l'administration financière française que l'information financière publiée par la Commission peut être complétée pour faciliter le suivi de l'exposition du budget européen. De manière régulière, notamment en comité budgétaire, la délégation française souligne la nécessité de disposer d'une information consolidée, actualisée et plus complète sur les passifs de l'Union.
En effet, le suivi des sujets de passifs de l'Union européenne est rendu complexe par la publication espacée de rapports traitant de données passées (cf. supra). À titre d'exemple, l'administration française, comme le rapporteur spécial, ont dû fonder leurs analyses pour l'essentiel sur les données communiquées dans le cadre du rapport « sur les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires et de l'assistance financière et sur la viabilité de ces passifs éventuels » (dit rapport « article 256 »), rapport dont les données mises à disposition à ce stade datent du 31 décembre 2023.
La direction générale du Trésor et la direction du Budget appellent donc de leurs voeux « tout enrichissement de l'information, ce que ce soit par la mise à disposition d'une base de données actualisée régulièrement, ou l'enrichissement de l'information fournie dans le cadre des rapports existants (...) Plus particulièrement, nous considérons qu'une extension des projections relatives à la marge de manoeuvre (qui à ce stade ne vont que jusqu'à 2029) serait nécessaire et utile pour contrôler la viabilité des garanties sur la marge de manoeuvre à long-terme ».
Par ailleurs, sur la question du soutien financier apporté à l'Ukraine, ces directions notent que « si la Commission européenne a déjà commencé à inclure des « focus » spécifiques sur l'Ukraine dans le cadre de son rapport sur les passifs éventuels, ce focus pourrait utilement être développé et enrichi. »
Le rapporteur spécial partage le constat général reproduit ci-dessus et, plus particulièrement, estime qu'il serait particulièrement judicieux que la Commission européenne étende ses projections relatives à la marge de manoeuvre, au vu du nombre toujours plus importants de passifs éventuels qu'elle couvre et de leur importance. Il appartiendra dans un second temps à l'administration française d'analyser et de présenter ces informations à la représentation nationale, notamment dans le cadre de l'annexe budgétaire « Relations financières avec l'Union européenne ».
Recommandation n° 6 : S'assurer que la Commission européenne enrichisse l'information communiquée sur les passifs éventuels de l'UE, par la mise à disposition de bases de données actualisées et la communication de projections sur la marge de manoeuvre (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).
Recommandation n° 7 : Rendre compte au Parlement, notamment à travers la documentation budgétaire, des informations enrichies communiquées par la Commission européenne sur les passifs éventuels (direction du budget).
B. UN DÉFICIT DE SUIVI AU NIVEAU FRANÇAIS EN L'ABSENCE DE RISQUE À COURT TERME
La Commission européenne réalise donc un suivi de l'exposition du budget européen, qui pourrait être encore davantage documenté et surtout comporter des analyses plus prospectives, mais qui apparaît néanmoins satisfaisant à court terme. Il s'agit toutefois d'une institution européenne soucieuse des intérêts de l'Union. En particulier, quand elle analyse les passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre, la Commission européenne vise avant tout à s'assurer que la marge de manoeuvre budgétaire suffit à assurer le paiement des passifs éventuels de l'Union européenne : l'analyse ne porte en rien sur les contributions supplémentaires pouvant être appelées auprès des États membres.
En effet, le rapport de la Commission sur les passifs éventuels définit un cadre d'évaluation fondé l'article 210, paragraphe 3, du règlement financier, sur la « Responsabilité financière de l'Union » qui dispose que « les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l'assistance financière qui sont supportés par le budget sont jugés supportables si leurs prévisions d'évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement fixant le cadre financier pluriannuel prévu à l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le plafond des crédits annuels pour paiements énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 » (soit le plafonds de dépense défini pour le cadre financier pluriannuel et le plafonds de recettes fixé par la décision ressources propres).
En d'autres termes, les analyses réalisées par la Commission ont pour objectif de s'assurer que les ressources maximales que l'UE est en mesure de prélever en une seule année au titre de la décision ressources propres (plafond des ressources propres) suffisent à financer les dépenses découlant du CFP ainsi que tout passif éventuel.
Le rapporteur spécial a donc interrogé l'administration financière française sur l'existence d'un suivi des potentiels appels à contribution futurs de la France causés par l'exposition du budget européen, pour la réponse suivante : « Le chiffrage d'un risque lié à la headroom (NB : la marge de manoeuvre) pour les États membres nécessiterait de réaliser des scénarios de défaut d'un ou plusieurs États membres (ou de l'Ukraine) au titre d'un (ou plusieurs) dispositif d'assistance financière couvert par la headroom. La direction du Budget ne procède pas à de tels travaux.
Dès lors, toute hypothèse de chiffrage serait purement conventionnelle, voire maximaliste, en se basant sur l'ensemble des passifs couverts par la headroom.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un défaut sur un dispositif d'assistance financière couvert par la headroom n'impliquerait pas nécessairement un ressaut de contribution nationale pour les États membres. D'autres leviers pourraient être activés en amont, comme des redéploiements sur le budget de l'UE, ou la mobilisation de marges disponibles (instrument de flexibilité). »
Comme vu précédemment, les passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre sont en très forte hausse, laquelle devrait se poursuivre dans les prochaines années. Si les risques semblent aujourd'hui maîtrisés, il n'est malheureusement pas possible d'être aussi affirmatif à moyen terme :
- premièrement, l'exposition repose en grande partie sur des prêts aux États membres qui apparaissent aujourd'hui solvables. Dans un contexte de hausse de l'endettement et de montée du souverainisme, on ne peut exclure que certains États remettent en question leurs engagements sur tout ou partie de la dette souscrite au niveau européen ;
- deuxièmement, l'exposition au conflit ukrainien est de plus en marquée et cette situation pourrait s'accentuer dans les prochaines années. Si les sommes en jeu sont moindres, la probabilité de défaut est supérieure et devra être étudiée avec attention, passée les périodes de grâce de 10 ans accordées sur ces prêts ;
- troisièmement, les administrations financières françaises ont-elles-même reconnu le besoin de disposer de plus d'informations sur l'exposition du budget européen à moyen terme ;
- quatrièmement, l'administration financière européenne dispose assurément d'outils pour limiter tout ressaut de la contribution française, mais d'une part, ces outils ne suffiraient pas seuls à combler un choc important et, d'autre part, ils ne créent pas de richesse, ils contribuent simplement à atténuer les chocs.
S'agissant de sujets complexes, impliquant une multitude de décisions successives sur des instruments souvent conçus pour repousser et diffuser le risque, la tentation est grande d'éviter le sujet et de remettre à plus tard la gestion du risque occasionné par l'exposition du budget européen, en attendant que celui se matérialise effectivement.
Le rapporteur spécial est convaincu que les sommes en jeu sont trop importantes pour être ignorées et que le risque induit par certains instruments financiers est significatif. Il estime donc que le Parlement doit être mieux informé de l'évolution de l'exposition du budget européen et du risque d'un ressaut de la contribution nationale. Il recommande donc la communication d'une information enrichie et régulière à ce sujet, notamment dans le cadre de la documentation budgétaire. A minima, cette information pourrait être constituée d'une estimation maximaliste du risque encouru chaque année par le budget français, pondérée par une appréciation plus qualitative de l'administration financière sur la réalité de ce risque.
Recommandation n° 8 : Communiquer régulièrement au Parlement l'exposition du budget de l'UE, les passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre et le risque d'une hausse future de la contribution française au budget l'Union européenne (direction du budget).
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 8 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de M. Jean-Marie Mizzon, rapporteur spécial, sur les engagements financiers extrabudgétaires de l'Union européenne.
M. Claude Raynal, président. - Nous allons maintenant entendre une communication de M. Jean-Marie Mizzon, rapporteur spécial sur les engagements financiers extrabudgétaires de l'Union européenne.
M. Jean-Marie Mizzon, rapporteur spécial. - Les engagements extrabudgétaires recouvrent le concept comptable de « passif éventuel », c'est-à-dire des obligations financières potentielles qui pourraient être contractées en fonction d'un événement futur. En pratique, il s'agit de situations où le défaut d'un tiers engage la responsabilité financière de l'Union européenne (UE) : le cas le plus fréquent est celui d'opérations où l'UE prête en s'endettant. Ces prêts peuvent être accordés à des États membres, l'exemple type étant, dans le cas du plan de relance européen, celui de la Facilité pour la reprise et la résilience, dite FRR, ou à des pays tiers, à travers des « assistances macrofinancières », plus connues sous le sigle d'AMF.
Les engagements extrabudgétaires couvrent aussi les garanties budgétaires octroyées par l'UE à des tiers comme la Banque européenne d'investissement (BEI), chargés de la mise en oeuvre de programmes destinés à soutenir l'investissement au sein de l'UE et en dehors.
Je souhaite en premier lieu évoquer avec vous le rythme effréné de la progression des engagements extrabudgétaires de l'UE et des risques qu'ils font peser sur son budget, mais aussi sur celui des États membres contributeurs.
Que ce soit la réponse à la crise sanitaire ou à l'agression russe en Ukraine, les dispositifs européens d'assistance financière ont été mis en place à la faveur de crises afin de pouvoir débloquer rapidement des sommes importantes. Les sommes en question sont en effet tout sauf négligeables : le niveau de risque porté par le budget européen a ainsi presque quadruplé entre 2019 et 2024, soit une hausse moyenne de 30 % par an, avec une forte poussée au moment de la crise sanitaire, avec une augmentation de 51 % par an de 2019 à 2021.
L'essentiel de la hausse observée peut être attribué aux dispositifs d'assistance financière aux États membres, qui ont progressé de 49 milliards d'euros en 2019 à 249 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 200 milliards d'euros, qui équivaut à 80 % de la hausse totale observée.
Quant à l'assistance aux pays tiers, si elle est d'ampleur moindre dans son ensemble, elle a néanmoins connu une progression encore plus dynamique, passant de 5 milliards d'euros en 2019 à 47 milliards d'euros en 2024, sous l'effet principalement du soutien apporté à l'Ukraine.
Cette expansion des engagements extrabudgétaires n'est pas près de s'arrêter. Sur la base des seuls instruments existants ou dont le règlement européen a été voté, on peut s'attendre à ce que l'exposition du budget de l'Union européenne continue de s'accroître à un rythme plus que significatif, doublant presque d'ici la fin du cadre financier pluriannuel 2021-2027, pour atteindre 640 milliards d'euros, principalement sous l'effet de la mise en oeuvre de la FRR, mais aussi avec les décaissements progressifs du programme SAFE (Security Action For Europe), nouveau programme de l'UE visant à financer les achats communs en matière de défense.
Or ces divers engagements ne sont pas sans risque pour les budgets de l'Union européenne et de ses pays contributeurs : il s'agit principalement d'un défaut des bénéficiaires, qui peut être géré de deux façons, avec le recours ou non à des provisions.
Sur le plan conceptuel, le principe de provisionnement ne va pas nécessairement de soi : à titre de comparaison, le Trésor britannique critique une telle pratique, objectant que l'utilisation de fonds provisionnés expose le budget au risque de marché et immobilise des ressources publiques. La position britannique s'entend du point de vue d'une entité souveraine, dotée d'un pouvoir fiscal, car elle peut toujours augmenter ses ressources pour trouver les fonds nécessaires en cas de réalisation du risque. À l'inverse, l'UE est liée par la décision relative aux ressources propres et la pratique du provisionnement, longtemps majoritaire, se justifiait.
Aujourd'hui, les garanties budgétaires de l'UE sont provisionnées, et pendant longtemps, c'était aussi le cas des prêts aux pays tiers.
Si un prêt n'est pas provisionné, il est alors couvert par ce que l'on appelle la « marge de manoeuvre », ou parfois la « marge sous plafond ». Cette marge de manoeuvre représente l'écart entre le plafond des ressources propres pouvant être perçues auprès des États membres, fixé par la décision relative aux ressources propres, et les plafonds de dépenses, fixés par le cadre financier pluriannuel (CFP).
Concrètement, en cas de réalisation du risque, lorsqu'un prêt est couvert par la marge de manoeuvre, ceci se traduit in fine par une baisse de certaines dépenses ou une hausse des contributions des États membres, même si, comme l'ont rappelé les services de Bercy et de la Commission, différents instruments de flexibilité existent, avec des enveloppes de crise et des possibilités de virement et de reports pour atténuer et diffuser le choc.
Or je constate que ce sont les engagements extrabudgétaires couverts par la marge de manoeuvre qui sont en forte hausse, qu'il s'agisse des dispositifs d'assistance aux États membres ou, désormais, de certains dispositifs de soutien à l'Ukraine.
Je souhaite justement commencer par étudier ces derniers dispositifs, qui ne sont pas les plus importants sur le plan quantitatif, mais où l'aléa est le plus prononcé.
Les prêts accordés à l'Ukraine représentent fin 2024 près de 90 % des prêts accordés à des pays tiers. On peut distinguer plusieurs vagues dans ce support.
Comme vous le savez, l'agression russe en Ukraine remonte à 2014 et, très vite, des prêts ont été accordés à l'Ukraine, les fameuses AMF. Ces prêts suivent le règlement européen en vigueur et sont provisionnés à 9 %. De 2014 à février 2022, cela représente un montant de 5,3 milliards d'euros.
Avec l'invasion russe de 2022, une AMF exceptionnelle de 6 milliards d'euros est décidée. Toutefois, compte tenu du risque, nouveau, son taux de couverture est porté à 70 %, la différence de 61 % étant constituée d'une garantie apportée par les États membres. De fait, une garantie d'un milliard d'euros a été votée en France dans la loi de finances pour 2023.
Dans un troisième temps, toutefois, à partir de 2023, une rupture s'opère et le principe d'une couverture en amont est abandonné. Deux dispositifs sont successivement décidés, une AMF+ de 18 milliards d'euros et une Facilité pour l'Ukraine de 33 milliards d'euros, qui ne sont désormais plus couverts que par la marge de manoeuvre. Ce choix est fait en catimini, sans justification officielle, noyé dans une discussion technique. Sur le fond, il est expliqué par le coût prohibitif que représenterait le provisionnement de ces instruments - environ 33 milliards d'euros.
En pratique, toutefois, les prêts les plus volumineux ont été accordés aux conditions les plus favorables, avec des maturités de plus en plus longues et des garanties de moins en moins formalisées, ce qui constitue essentiellement un transfert de risque du budget de l'UE vers celui des États membres contributeurs.
Bien sûr, les administrations européennes et françaises interrogées se sont voulues très rassurantes, notant que les prêts en question bénéficient d'une période de grâce de 10 ans et de maturités longues qui permettraient de lisser un choc éventuel.
Le rapport s'intéresse enfin à la nouvelle pratique de la Commission européenne, qui consiste à utiliser les actifs russes immobilisés à la suite des sanctions de l'UE. En octobre 2024, un premier prêt de 18 milliards d'euros a été accordé, financé par les revenus d'aubaine associés à ces actifs.
Alors que les projections du FMI affichent des besoins de financement pour l'Ukraine de l'ordre de 10 milliards de dollars par an pour les prochaines années, la Commission et les États membres étudient désormais la possibilité d'un nouveau soutien selon le mécanisme suivant : la société où sont déposés les actifs russes immobilisés, Euroclear prête 140 milliards d'euros à l'UE à un taux de 0 % ; celle-ci les prête en retour à l'Ukraine ; ce dernier prêt n'est remboursé que si l'Ukraine reçoit des réparations de guerre de la Russie.
Ce montage est encore en cours de discussion et suscite des débats sur le droit de propriété de ces actifs et l'attractivité des places européennes.
J'en viens maintenant aux dispositifs qui constituent la plus grosse part de l'exposition du budget de l'Union européenne : les dispositifs d'assistance aux États membres.
Le volume des prêts a fortement progressé au moment de la crise sanitaire avec deux dispositifs. Le premier, intitulé SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), était doté d'une enveloppe globale de 100 milliards d'euros pour couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs nationaux de chômage partiel. Le second, la FRR, était l'instrument pour distribuer le plan de relance européen NextGenerationEU. Fin 2024, l'enveloppe totale de la FRR était de 650 milliards d'euros, dont 291 milliards d'euros de prêts : c'est cette dernière enveloppe qui nous intéresse et qui explique une grande partie de la progression attendue des engagements extrabudgétaires d'ici à la fin du CFP.
Le reste de la hausse est expliqué par un nouveau programme, le programme SAFE, créé en 2025 pour financer des achats de défense en commun au sein de l'Union européenne. Le montant de ce programme s'élève à 150 milliards d'euros et sera décaissé jusqu'en 2030.
Jusqu'à maintenant, la France n'a jamais eu recours à ce type d'instrument, la dette française étant meilleur marché : ce n'est hélas plus le cas, et la France devrait recourir aux prêts permis par le programme SAFE à hauteur de 16 milliards d'euros.
La forte croissance de ces prêts n'est pas sans risque pour la France, en tant qu'emprunteur et en tant que prêteur.
En tant qu'emprunteur, il s'agit de ne pas céder aux sirènes de taux légèrement plus intéressants. Les dépenses engagées doivent avant tout être nécessaires. Or ces grands programmes de prêts sont conçus en temps de crise, dans des délais contraints ; à titre d'exemple, la Cour des comptes européenne a questionné l'efficacité des dépenses financées grâce à la FRR lors d'une évaluation menée à ce sujet.
Mais les conséquences principales affecteraient l'État prêteur. Comme nous l'avons vu, ces prêts sont garantis par la marge de manoeuvre et, à ce titre, sont principalement garantis par les États membres. La France est donc particulièrement exposée en tant que deuxième contributeur net au budget de l'Union.
Or je constate que cette exposition est concentrée, trois pays - l'Italie, l'Espagne et la Pologne - affichant une dette envers l'Union européenne de plus de 80 milliards d'euros. Ces instruments peuvent représenter des proportions importantes, supérieures à 10% du PIB pour sept États membres, principalement des pays d'Europe de l'Est souhaitant recourir au dispositif SAFE - la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Pologne, et la Hongrie.
L'administration de Bercy s'est de nouveau montrée rassurante dans nos échanges, mettant en avant le risque limité de défaut à court terme pour les États membres. Si les analyses de la Commission européenne qu'elle nous a communiquées confirment cette appréciation, ces mêmes analyses pointent un risque élevé sur les finances publiques de ces États à moyen terme.
Qu'en est-il de la gestion de ces risques ? J'ai pu constater dans le cadre de ce contrôle que la Commission produisait une documentation régulière et relativement bien fournie, ponctuée chaque année d'une analyse sur la viabilité de la couverture assurée par les provisions et par la marge de manoeuvre. Bercy juge ces tests globalement crédibles, à une exception près, celle de l'horizon de ces tests, qu'il conviendrait d'étendre.
Enfin, j'ai pu constater que les services de Bercy ne produisaient aucune analyse propre sur ce risque et se reposaient sur les travaux de la Commission européenne. Or cette dernière a pour mission de protéger avant tout les intérêts de l'Union et se soucie moins du niveau de la contribution française. Pour remédier à cette insuffisance, comme à d'autres, ce rapport présente huit recommandations.
M. Claude Raynal, président. - Merci, monsieur le rapporteur spécial, pour ce rapport complet et, il faut bien le reconnaître, extrêmement technique.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il est vrai que ce sont des sujets très techniques ; le Sénat doit veiller à rendre compréhensibles les caractéristiques de ces dispositifs.
La semaine dernière, Florence Blatrix Contat et moi-même participions à la conférence interparlementaire qui se tenait au Danemark. Nous avons constaté une demande quasi unanime d'un effort de consolidation européenne en faveur de la défense. Les Danois nous ont également expliqué qu'ils aidaient directement l'Ukraine en participant à son effort de défense. Ils considèrent que leur aide est ainsi plus ciblée et plus efficace ; nous devons être attentifs à cet arbitrage.
Le fonctionnement de l'Union européenne - je pense notamment aux présidences semestrielles - est naturellement complexe. Les parlements nationaux courent toujours le risque d'être en porte-à-faux ou de ne pas disposer du bon niveau d'information. Toute amélioration dans la connaissance et le contrôle de ces mécanismes permettra de mieux comprendre les enjeux.
Mme Florence Blatrix Contat. - Je partage le constat de notre rapporteur spécial : les engagements extrabudgétaires de l'Union européenne ont augmenté ; il faut donc renforcer le contrôle et améliorer la transparence.
La question de la compétitivité de l'Union européenne et de l'achèvement du marché unique nous est rappelée lors de chaque conférence interparlementaire. Dans ce cadre, les pays auront besoin d'investir massivement, notamment dans la transition écologique. Vous faites le constat que le coût de la dette européenne, des emprunts européens pour le compte des États membres, est aujourd'hui compétitif, ce qui est vrai pour la France, vu notre situation actuelle.
Je m'interroge sur la recommandation no 3, qui vise à limiter le recours aux prêts octroyés par l'Union européenne aux seules situations de crise où l'apport européen est manifeste. Il serait dommage pour la France de se priver du recours à de tels prêts pour financer des actions en faveur de la compétitivité, de la transition écologique et des grands objectifs que nous nous fixons. Dans le futur cadre financier pluriannuel, Ursula von der Leyen a proposé un nouvel emprunt de 400 milliards d'euros ; il serait donc dommage que la France, a priori, se prive de ces possibilités.
Mme Sylvie Vermeillet. - Je souscris à la remarque qui vient d'être formulée sur la réalité des fonds propres de l'Union européenne.
Comment seront remboursés tous ces prêts ? Existe-t-il des échéanciers ? Comment fonctionnent les différés de remboursement ? J'avoue ne rien comprendre à ces différents plans, alors que la France doit rembourser les emprunts liés au plan de relance dès 2028. Je n'ai jamais eu accès à un échéancier pays par pays.
M. Jean-François Rapin. - Je ne m'opposerai pas aux propos de Florence Blatrix Contat ; je souhaite simplement les modérer. Concernant l'architecture du prochain cadre financier pluriannuel, toutes les analyses montrent que le remboursement des prêts consentis par le programme NextGenerationEU plombera progressivement le budget de l'Union. On annonce un budget à 2 000 milliards d'euros, ce qui donne l'impression d'une augmentation considérable, mais il s'agit d'euros courants, et non d'euros constants. Autrement dit, on ne prend pas en compte les éléments inflationnistes importants qui ont bouleversé l'architecture budgétaire.
Je suis donc très attentif au nouveau CFP - je sais que les deux rapporteurs de la commission des affaires européennes du Sénat sur ces questions sont aussi vigilants. Je ne souhaite pas que l'on replonge dans de nouveaux emprunts sans disposer de davantage de visibilité - même si ceux-ci serviraient à financer des objectifs que nous partageons tous, comme l'amélioration de la compétitivité de l'Union. Je le répète : le remboursement des 750 milliards d'euros, sans ressources propres, est une catastrophe pour les budgets à venir. Toutes les politiques nouvelles visant à gérer l'urgence, notamment géopolitique, avec le réarmement, ne peuvent pas être financées, car nous sommes à l'os ! Voilà la légère différence que j'introduis par rapport aux propos de Florence Blatrix Contat, dont je connais la vigilance sur le sujet.
M. Marc Laménie. - Les montants des dispositifs d'assistance aux États membres augmentent fortement. La crise sanitaire est souvent l'explication avancée, mais on prévoit aussi une forte progression entre 2024 et l'échéance de 2027. Peut-on mettre un terme à cette progression ?
Mme Christine Lavarde. - Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec Florence Blatrix Contat. Il est très difficile d'assurer la viabilité du cadre financier 2021-2027. Les charges d'intérêt de l'emprunt NextGenerationEU ont considérablement augmenté par rapport à ce qui avait été envisagé au moment où les 750 milliards d'euros ont été levés. Nous devons donc commencer à rembourser les premiers intérêts, et cela n'est pas prévu dans le budget de l'Union. Par conséquent, on rabote, on essaie de trouver des solutions, mais comme aucun État membre ne veut contribuer davantage, il faut revenir sur des politiques qui avaient été définies au début du cadre.
Je souhaite également tirer la sonnette d'alarme pour la suite. Aujourd'hui, les journaux mettent en avant le dynamisme de l'économie italienne, mais celui-ci s'explique par l'argent qui provient de l'emprunt européen. Qu'adviendra-t-il de l'Italie quand elle devra commencer à rembourser ces emprunts ? La situation sera peut-être un peu différente.
Finalement, emprunter revient à reporter les difficultés à plus tard. Nous sommes confrontés au même problème avec notre dette. Ce rapport complète utilement les travaux que nous menons à la commission des affaires européennes.
M. Jean-Marie Mizzon, rapporteur spécial. - Madame Vermeillet, il n'y a jamais eu de défauts de paiement à ce jour sur les prêts accordés par l'UE couvert par la marge de manoeuvre et le système mis en place n'a jamais été pris en défaut. Cela dit, le passé ne permet pas de prédire l'avenir.
Madame Blatrix Contat, la qualité des projets éligibles est la première source de vigilance. L'expérience montre que les systèmes montés dans la précipitation ne sont pas toujours très performants. Il est donc préférable que le gouvernement fasse preuve de vigilance avant de se tourner vers des prêts proposés par l'Union européenne pour financer des actions dont l'efficacité et l'efficience peuvent être contestées. Sans compter que l'échelon européen ajoute un niveau supplémentaire de complexité au contrôle parlementaire.
Président Rapin, vous évoquiez le plan NextGenerationEU dans son ensemble et la nécessité de nouvelles ressources propres. Afin d'être parfaitement clair pour nos collègues non-spécialistes, le plan de relance européen dispose d'un volet prêts et d'un volet subventions. Le contrôle s'intéressait au volet prêts et au remboursement attendu des États. Mais le plan de relance comporte également un volet subventions, dont le remboursement est plus incertain, reposant sur l'adoption de nouvelles ressources propres. Les premiers remboursements doivent intervenir en 2028. Nous verrons comment la Commission, le Conseil et le Parlement tomberont d'accord.
Monsieur Laménie, ce sont des choix politiques qui mettront un terme à ce système. Nous savons d'ores et déjà que les montants des dispositifs d'assistance aux États membres augmenteront jusqu'en 2027. Pour la suite, la réponse est entre les mains des institutions européennes.
Madame Lavarde, vous avez raison : le succès économique actuel de l'Italie repose sur des raisons conjoncturelles. J'espère toutefois qu'à l'avenir, celles-ci deviendront structurelles.
Mme Florence Blatrix Contat. - Je reviens sur la recommandation no 3. J'ai bien entendu votre réponse sur la qualité des projets éligibles ; toutefois, celle-ci ne me convainc pas : en période de crise, certains projets peuvent être moins qualitatifs que ceux portant sur de grands objectifs.
Si cette recommandation était adoptée, la France se priverait d'une possibilité intéressante. Je m'abstiendrai donc sur ce point.
M. Claude Raynal, président. - Je m'abstiendrai également.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial et autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique - 7ème sous-direction du budget
- M. Louis PASQUIER DE FRANCLIEU, sous-directeur ;
- M. Alexandre DESCHAMP, chef du bureau des finances et des politiques de l'Union européenne ;
- M. Arthur CORBEL, adjoint au chef de bureau.
Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique - Direction générale du Trésor
- M. Emmanuel CHAY sous-directeur adjoint de la sous-direction Europe.
Direction générale du Budget - Direction F / bureau F2 - Garanties budgétaires, passifs éventuels, analyses et rapports financiers - Middle Office
- M. Nial BOHAN, directeur de la direction F ;
- M. Koen DIERCKX, chef de l'unité F2 ;
- M. Fabio FIORELLO, spécialiste des engagements extrabudgétaires ;
- M. Roko PEDISIC, spécialiste des engagements extrabudgétaires ;
- Mme Lourdes ACEDO MONTOYA, chef d'unité - CFP et cheffe économiste ;
- M. Christian ENGELEN, chef d'unité opération d'emprunt et de prêt - front office.
Direction générale des affaires économiques et financières - direction D / bureau D2 - Pays voisins et assistance macro-financière
- Mme Annika ERIKSGAARD, directrice des relations internationales économiques et financières, et gouvernance globale à la DG ECFIN ;
- Mme Stéphanie PAMIES, chef d'unité - Pays voisins et Assistance Macro-Financière ;
- Mme Lucile COLLIN, team leader - Pays voisins et Assistance Macro-Financière ;
- Mme Suzanne CASAUX, membre de l'équipe Pays voisins et Assistance Macro-Financière.
Représentation permanente de la France dans l'Union européenne
- Monsieur l'Ambassadeur Philippe LÉGLISE-COSTA, représentant permanent ;
- Monsieur Yves-Emmanuel BARA, expert national détaché.
Parlement européen
- Mme Alix DELASNERIE, administratrice.
Représentants de la Cour des comptes européenne sur « l'exposition financière du budget de l'Union européenne »
- M. Dirk PAUWELS, chef de cabinet ;
- M. Jindrich DOLEZAL, manager principal ;
- Mme Héloïse VADON, auditeur.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
S'assurer que la Commission européenne communique régulièrement sur les sommes prêtées à l'Ukraine, l'avancée des décaissements et des remboursements et la prise en charge des intérêts. |
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne |
2026 |
Comptes annuels consolidés |
|
2 |
Analyser et présenter au Parlement l'ensemble des prêts accordés pour soutenir l'Ukraine financièrement, en identifiant notamment les coûts et les risques associés à ces dispositifs. |
Direction du budget |
2026 |
Documentation budgétaire |
|
3 |
Limiter le recours de la France aux prêts octroyés par l'Union européenne aux seules situations de crise où l'apport européen est manifeste. |
Gouvernement |
2026 |
Décision gouvernementale |
|
4 |
Isoler dans la documentation budgétaire les opérations financées par des prêts européens, la motivation des dépenses associées et le coût du financement. |
Direction du budget |
2027 |
Documentation budgétaire |
|
5 |
Obtenir de la Commission européenne qu'elle étende l'horizon des « stress tests » réalisés pour évaluer la viabilité des passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre. |
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne |
2026 |
Rapport sur les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires et de l'assistance financière et sur la viabilité de ces passifs éventuels |
|
6 |
S'assurer que la Commission européenne enrichisse l'information communiquée sur les passifs éventuels de l'UE, par la mise à disposition de bases de données actualisées et la communication de projections sur la marge de manoeuvre. |
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne |
2026 |
Bases de données actualisées, information dans la documentation publique (comptes annuels, rapport sur les passifs éventuels) |
|
7 |
Rendre compte au Parlement, notamment à travers la documentation budgétaire, des informations enrichies communiquées par la Commission européenne sur les passifs éventuels. |
Direction du budget |
2027 |
Documentation budgétaire |
|
8 |
Communiquer régulièrement au Parlement l'exposition du budget de l'UE, les passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre et le risque d'une hausse future de la contribution française au budget l'Union européenne. |
Direction du budget |
2026 |
Documentation budgétaire |
* 1 Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.
* 2 Le paysage financier de l'Union européenne, un assemblage disparate nécessitant plus de simplification et un meilleur respect de l'obligation de rendre compte, Cour des comptes européenne, mars 2023.
* 3 C'est ce périmètre qui est retenu dans l'étude suivante, produite à l'attention de la commission des budgets du Parlement européen : les passifs financiers éventuels de l'Union européenne, Département thématique des affaires budgétaires, Direction générale des politiques internes, PE 764.906 - novembre 2024.
* 4 Règlement (UE) n°407/2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière.
* 5 Règlement (UE) 2020/672 -- Création d'un instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19.
* 6 Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience.
* 7 Règlement modificatif (UE) 2023/435.
* 8 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2021 sur l'exécution du budget de l'Union européenne.
* 9 Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l'instrument « Agir pour la sécurité de l'Europe par le renforcement de l'industrie européenne de la défense » (« instrument SAFE »).
* 10 Infrastructures durables, recherche, innovation et transformation numérique, petites et moyennes entreprises et investissements sociaux et compétences.
* 11 Afrique subsaharienne, Asie, Pacifique, Amérique latine et Caraïbes en plus des pays du voisinage.
* 12 Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l'Ukraine.
* 13 Reuters, 15 septembre 2025, Ukraine plans 2026 budget with 18.4 % deficit, PM says.
* 14 FMI, Ukraine: Eighth Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, juin 2025.
* 15 Le mécanisme élargi de crédit (MEDC) fournit une aide financière aux pays qui se heurtent à de graves problèmes de financement de la balance des paiements à moyen terme. Pour aider les pays à mettre en oeuvre des réformes structurelles à moyen terme, le MEDC prévoit un accompagnement prolongé du FMI à l'appui d'un programme et une période de remboursement plus longue.
* 16 Human rights watch, 24 juillet 2025, Ukraine : Une nouvelle loi sape l'indépendance des organismes anti-corruption.
* 17 Prêts accordés à des conditions bien plus avantageuses que celles du marché.
* 18 Les warrants sont des produits dérivés spéculatifs, donnant le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et jusqu'à une date d'échéance déterminés à l'avance.
Cf. aussi OMFIF, Ukraine must find a solution to restructure GDP warrants, 21 mai 2025.
* 19 « Financing assurances from international partners and expected debt relief ».
* 20 Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 decembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
* 21 Cour des comptes européenne, rapport spécial 18/2025: Flexibilité budgétaire de l'UE - Un réel atout en cas d'imprévus, mais un cadre trop complexe.
* 22 La révision de mi-parcours du cadre financier pluriannuel crée une facilité pour l'Ukraine, analysée dans la suite de ce rapport.
* 23 Depuis 2023, certains dispositifs d'assistance, couverts par la marge de manoeuvre de l'Union européenne, ne sont pas concernés par la limite des crédits de provisionnement.
* 24 Règlement (UE) 2021/947 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- Europe dans le monde, dit « règlement IVCDCI ».
* 25 Albanie, Arménie, Bosnie Herzégovine, Égypte, Géorgie, Jordanie, Kosovo, Kirghizstan, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, Tunisie.
* 26 Ce n'est toutefois plus le cas depuis janvier 2023, l'approche de financement de l'AMF étant passée d'une approche adossée à une structure unifiée, dans laquelle les émissions d'obligations sont découplées de décaissements spécifiques.
* 27Décision (UE) 2025/1267 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2025. Les trois versements envisagés pourraient avoir lieu à la fin de l'année 2025, à la mi-2026 et à la fin de 2026.
* 28Décision (UE) 2025/793 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025. Un premier versement de 250 millions d'euros a été effectué en septembre 2025.
* 29 Volet de la politique européenne de voisinage (PEV) spécialement consacré au voisinage oriental. Dans le cadre de la PEV, l'UE coopère avec ses voisins méridionaux et orientaux pour parvenir à l'association politique la plus étroite possible et au degré d'intégration économique le plus élevé qui soit. Le partenariat oriental vise l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Biélorussie (jusqu'à juin 2021), la Géorgie et la Moldavie.
* 30 Commission européenne, Joint ex-post evaluation of Macro-Financial Assistance (MFA) operations to Georgia, Moldova and Ukraine (2017-2020), janvier 2025.
* 31 Règlement (UE) 2021/947 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- Europe dans le monde, dit « règlement IVCDCI ».
* 32 Mise à disposition en application de la décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil. Cette assistance constituait le premier volet de l'AMF exceptionnelle d'un montant maximal de 9 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine annoncée par la Commission dans sa communication du 18 mai 2022 intitulée « Aide immédiate et aide à la reconstruction de l'Ukraine » et approuvée par le Conseil européen des 23 et 24 juin 2022.
* 33 Décision (UE) 2022/1201.
* 34 Décision (UE) 2022/1628.
* 35 Aux termes de cet article : « less passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l'assistance financière qui sont supportés par le budget sont jugés supportables si leurs prévisions d'évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement fixant le cadre financier pluriannuel ».
* 36 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 37 Cf. l'annexe 11 au budget 2026 de l'Union européenne « Budgetary Guarantees and Contingent Liabilities », p121.
* 38 Cf. règlement (UE) 2022/2463 du 14 décembre 2022 du Parlement européen et du Conseil, et le protocole d'accord conclu entre l'Ukraine et la Commission, entré en vigueur le 16 janvier 2023.
* 39 Au moyen de paiements ciblés supplémentaires versés par les États membres au budget de l'UE.
* 40 Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
* 41 Règlement (UE, Euratom) 2022/2496 du Conseil du 15 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
* 42 Au-delà des plafonds du CFP et dans la limite du plafond des ressources propres.
* 43 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/how-it-works/budget-law/legislation_fr
* 44 Aux termes de l'article 22 du règlement (UE) 2024/792 : « aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n'est constitué ».
* 45 Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l'Ukraine.
* 46 Avis 03/2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour l'Ukraine, Cour des comptes européenne.
* 47 Dans le détail, l'initiative du G7 « Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine » est fondée sur le mécanisme de coopération pour les prêts à l'Ukraine (ULCM) établi par le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024. L'ULCM accorde à l'Ukraine un soutien financier non remboursable pour l'aider à rembourser les prêts « ERA » bilatéraux accordés par les membres du G7 (Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Japon) à l'Ukraine, ainsi que le prêt « AMF ERA » accordé par l'Union.
* 48 Conformément au règlement (UE) 2024/1469, qui a modifié le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil. D'après la Commission, ces DCT doivent apporter à l'Union une contribution financière équivalente à 99,7 % des bénéfices exceptionnels nets découlant de l'immobilisation d'actifs souverains russes et qui s'accumulent depuis le 15 février 2024.
* 49 Cet instrument n'est pas financé via le budget européen mais directement par des contributions des États membres. Pour la France, la contribution est ainsi versée par les ministères contributeurs, à savoir le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, et le ministère des armées.
* 50 Conformément à la décision (PESC) 2024/1470 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
* 51 Cf. son avis 02/2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement du programme pour l'industrie européenne de la défense et d'un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense?, §30.
* 52 Non paper Reparations Loan Initiative, “Financial Support to Ukraine : the Front-Loading Russian Reparations to Ukraine Initiative”.
* 53 Cette construction permettrait que le prêt de réparation soit considéré par le FMI comme un passif éventuel et non comme une nouvelle dette de l'Ukraine.
* 54 A new financial impetus for peace in Ukraine, Financial Times, 25 septembre 2025.
* 55 Étant rappelé qu'en l'absence de défaut, les sommes provisionnées ne représentent pas un coût et seront restituées.
* 56 En outre, s'agissant de l'AMF « ERA », seuls les 7 milliards déjà versés sont représentés sur le total de 18,1 milliards d'euros pouvant être accordés.
* 57 Étant entendu que le risque de défaut de l'Union européenne dépend plus du calendrier de remboursement de la dette qu'elle a souscrite, qui n'est pas nécessairement aligné. Comme indiqué précédemment, cette analyse a peu de sens, les prêts risqués à l'Ukraine étant noyés au milieu d'autres prêts très peu risqués.
* 58 Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency.
* 59Security for Action for Europe.
* 60 Règlement (UE) n°407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière.
* 61 Règlement (UE) 2020/672 -- Création d'un instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19.
* 62 La garantie couvre non seulement le capital mais aussi les intérêts courus non échus sur ces prêts.
* 63 Cour des comptes européenne, rapport spécial 28/2022, Instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE), 2022.
* 64 Le financement sous forme de subventions du nouveau plan, d'une valeur maximale de 20 milliards d'euros, est assuré par le fonds pour l'innovation et la vente de quotas du système d'échange de quotas d'émission (SEQE).
S'agissant de la FRR, les chapitres REPowerEU peuvent être financés par le volet « prêt » de la facilité. Les États membres peuvent également transférer jusqu'à 5,4 milliards d'euros de fonds provenant de la réserve d'ajustement au Brexit vers la FRR pour financer les mesures REPowerEU.
* 65 L'Espagne rattrape progressivement son retard dans la mise en oeuvre de ce programme et début octobre 2025, 16,3 milliards d'euros de prêts avaient été décaissés.
* 66 Cour des comptes européenne, « Orientation sur la performance, obligation de rendre compte et transparence : quelles leçons tirer des points faibles de la FRR ? », document d'analyse 02/2025, 2025.
* 67 Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l'instrument « Agir pour la sécurité de l'Europe par le renforcement de l'industrie européenne de la défense » (« instrument SAFE »).
* 68 The rising cost of European Union borrowing and what to do about it, Institut Bruegel, 31 mai 2023.
* 69 Sur le même modèle que les spécialistes en valeur du trésor, qui sont les contreparties privilégiées de l'Agence France trésor pour l'ensemble de ses activités sur les marchés.
* 70 Dernière parution en date : Debt sustainability Monitor 2024, Institutional paper 306, Commission européenne, mars 2025.
* 71 Ou en cours d'émission s'agissant du programme SAFE.
* 72 La soutenabilité fiscale ou soutenabilité des finances publiques, désigne pour la Commission européenne la capacité d'un gouvernement à maintenir ses politiques actuelles en matière de dépenses, de fiscalité et autres sans menacer sa solvabilité ni manquer à certaines de ses obligations.
* 73 Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement.
* 74 Ex-post evaluation of the European Fund for Strategic Investments (EFSI), the European Investment Advisory Hub (EIAH) and the European Investment Project Portal (EIPP), Commission européenne, décembre 2022.
* 75 Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017.
* 76 Infrastructures durables, recherche, innovation et transformation numérique, petites et moyennes entreprises et investissements sociaux et compétences.
* 77 Interim evaluation of the InvestEU Programme, Commission européenne, décembre 2024.
* 78 Commission staff evaluation of the European Investment Bank's External Lending Mandate (2014-18), Commission européenne, septembre 2019.
* 79 Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024.
établissant la facilité pour l'Ukraine.
* 80 La VaR peut être définie comme le niveau des pertes du portefeuille qui, statistiquement et avec un certain niveau de confiance, ne sera pas dépassé sur une période donnée. Les niveaux de confiance pour les programmes internes (FEIS, InvestEU) et pour les programmes externes (FEDD, FEDD+) s'élèvent respectivement à 95 % et à 90 %, et tiennent compte de facteurs tels que les différences d'objectifs stratégiques et les cadres respectifs de ces programmes.
* 81 Cf. notamment le rapport spécial 16/2023 de la Cour des comptes européenne sur la gestion de la dette de l'UE.
* 82 Ex : « Trois lignes de Maîtrise pour une meilleure performance », Institut français de l'audit et du contrôle internes (IFACI), 2013.
* 83 Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et programme InvestEU.
* 84 Mandat de prêt extérieur (MPE), Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+).
* 85 À l'exception des prêts au titre de l'AMF+ accordés à l'Ukraine en 2023.
* 86 Règlement (UE) 2021/947 relatif au FEDD+, règlement InvestEU et règlement IVCDCI, complété par chaque décision individuelle pour les prêts AMF.
* 87 Réserves limitées de trésorerie, détenues auprès de la trésorerie centrale de la Commission et destinées à couvrir les sorties de trésorerie qui devraient se matérialiser sur une période de trois mois, sur la base des notifications des partenaires chargés de la mise en oeuvre. À la fin de 2023, le solde du coussin de liquidité s'élevait à 106 millions d'euros.
* 88 Cf. le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires et de l'assistance financière et sur la viabilité de ces passifs éventuels, rapport réalisé au titre de l'article 256 du règlement financier.