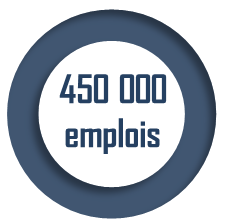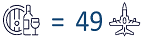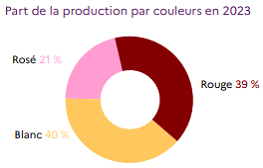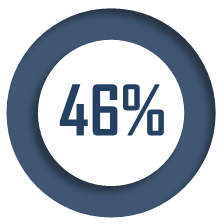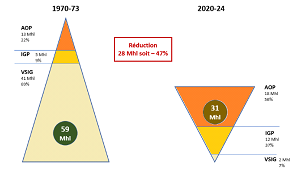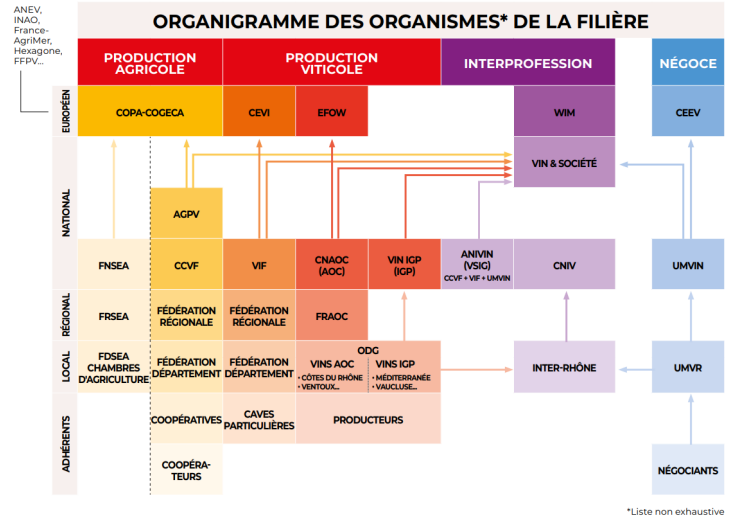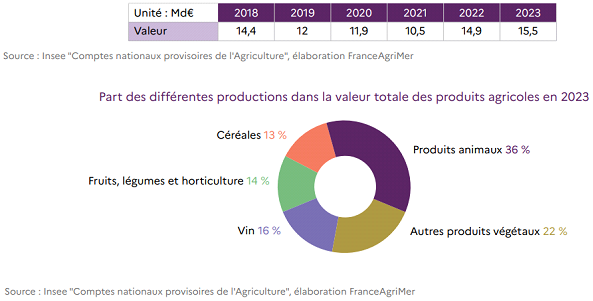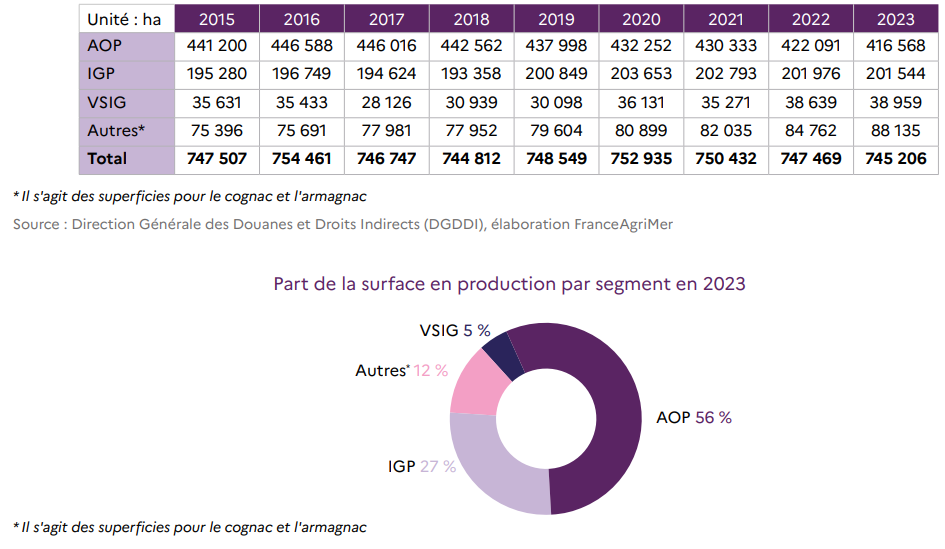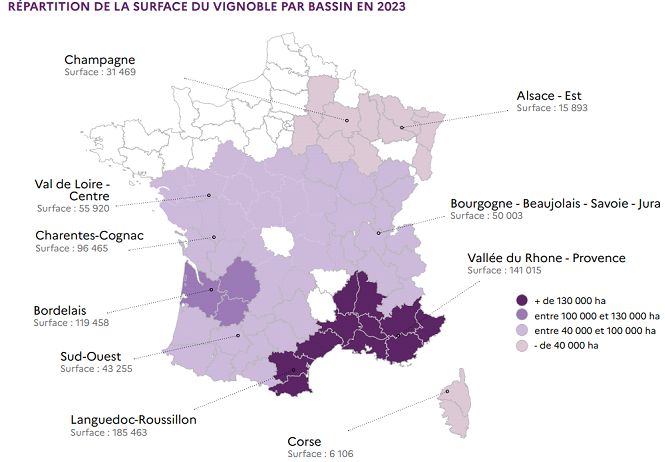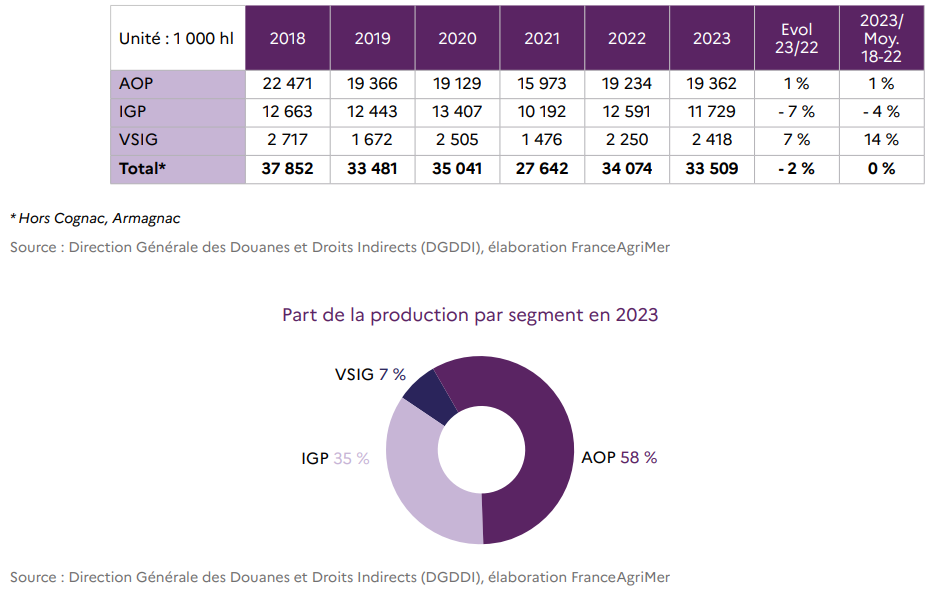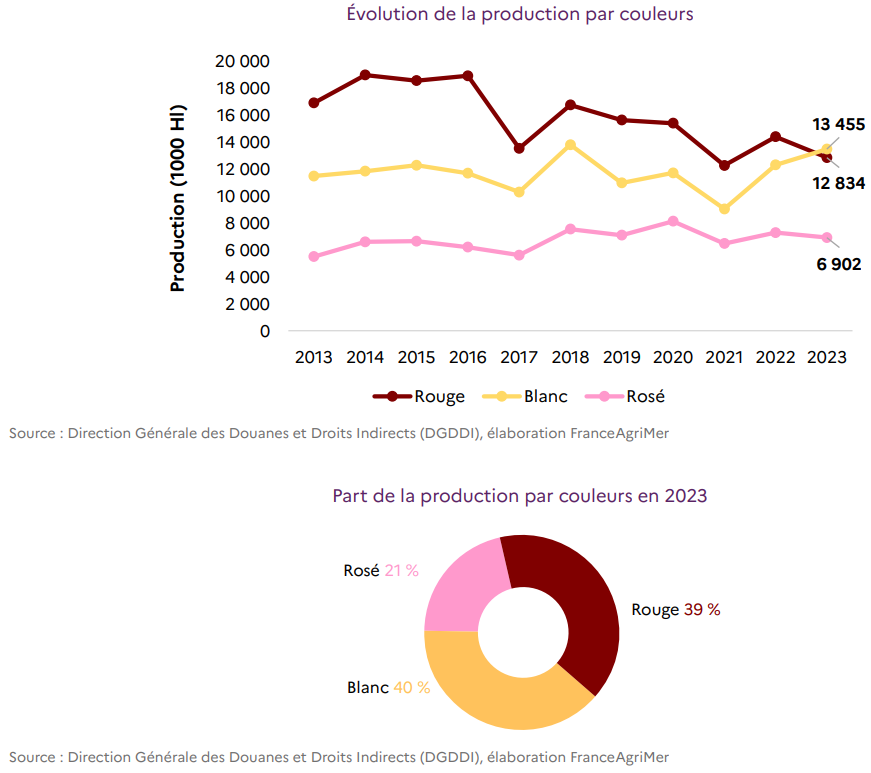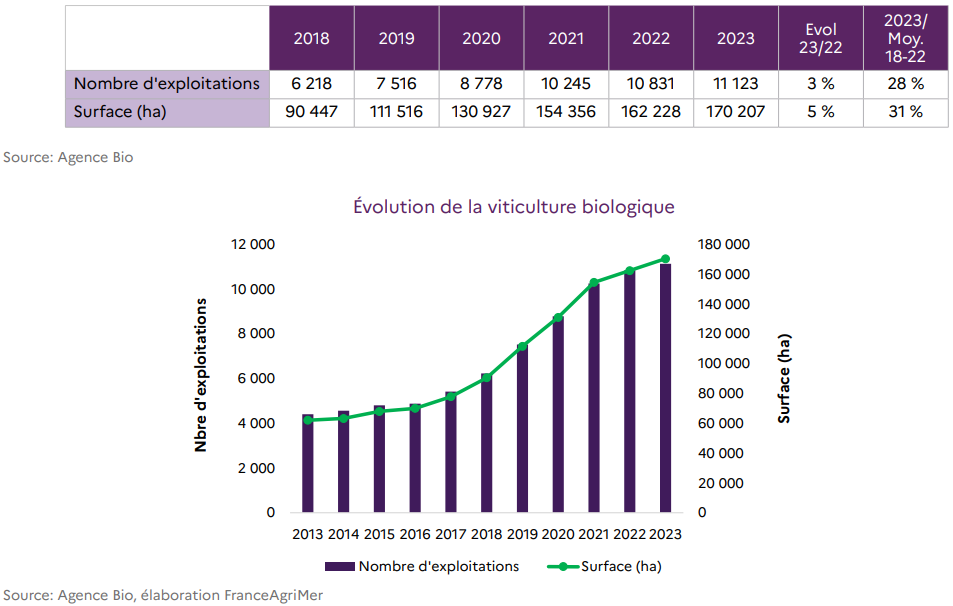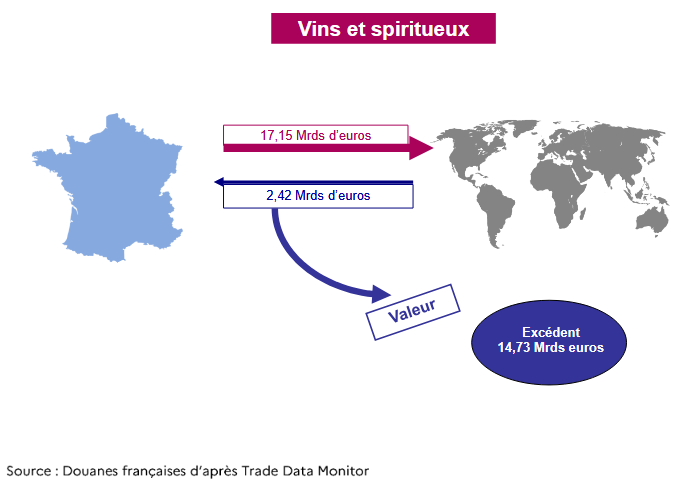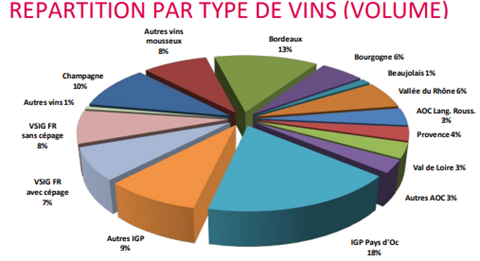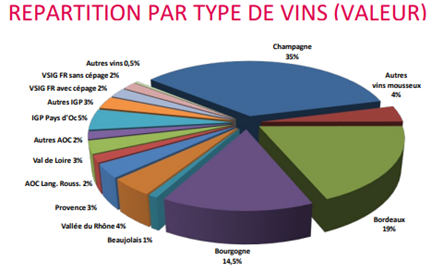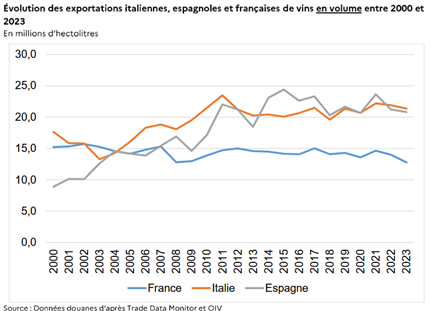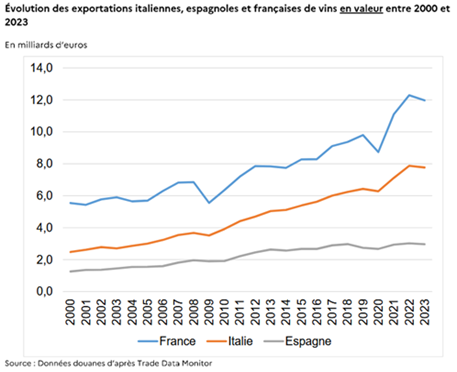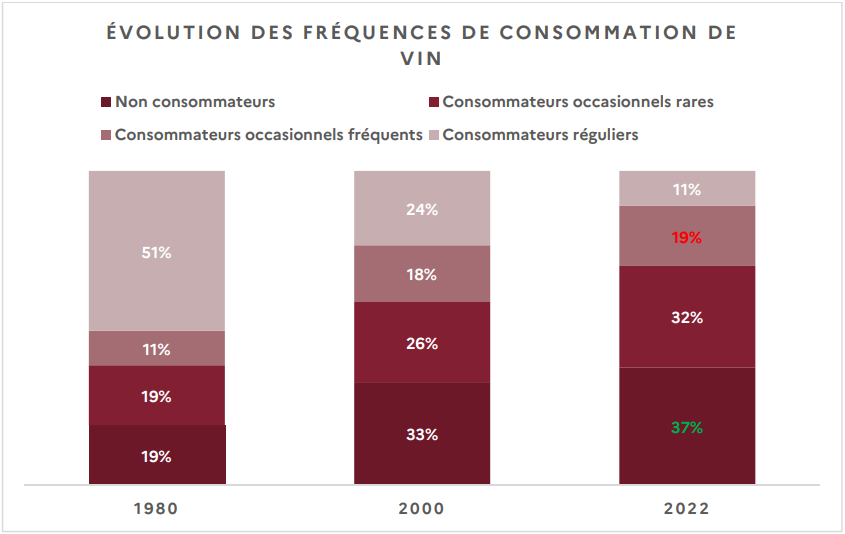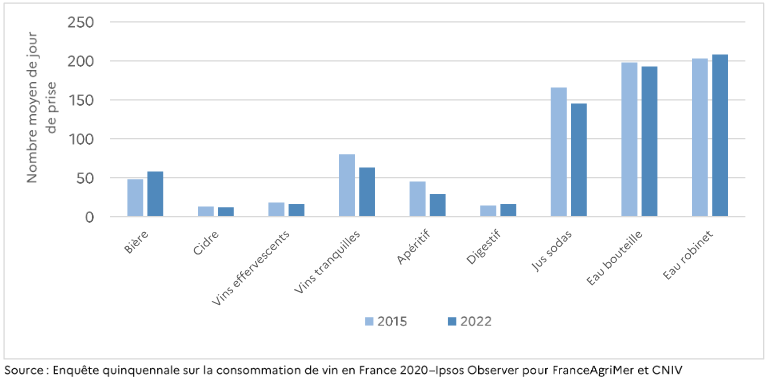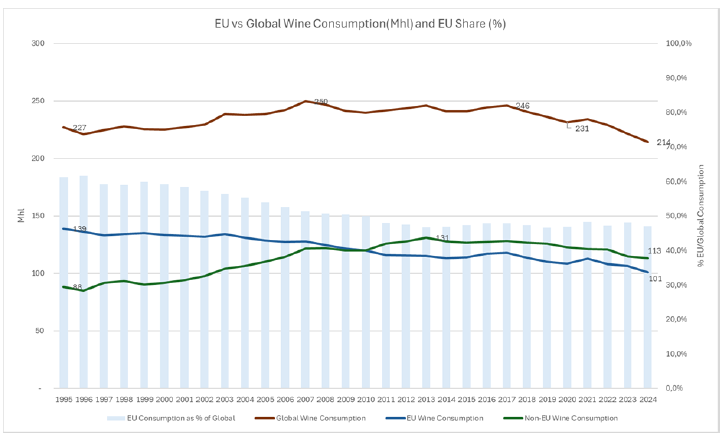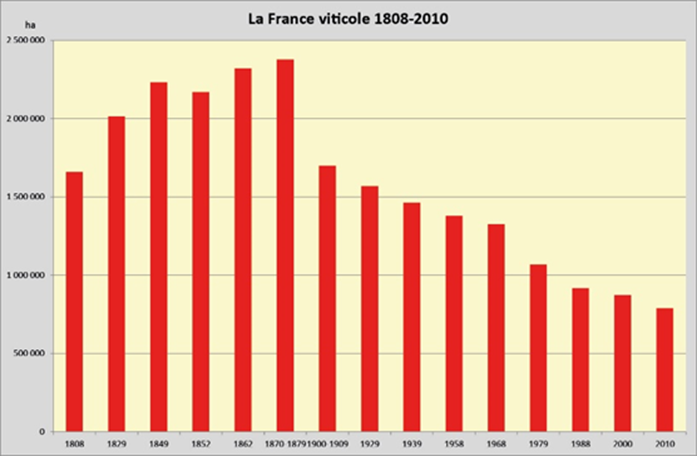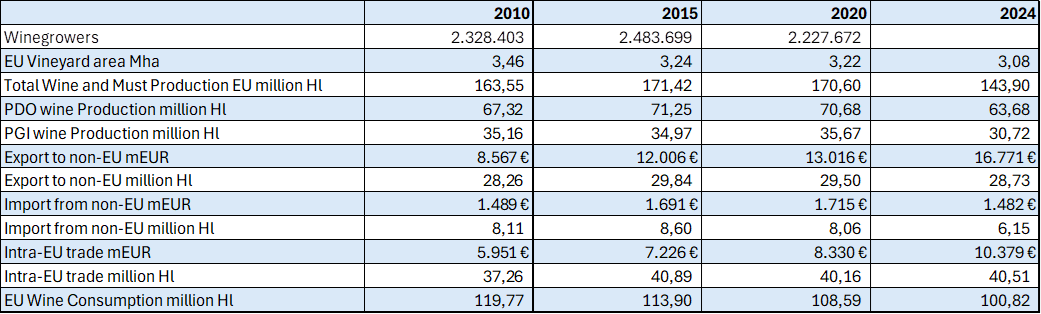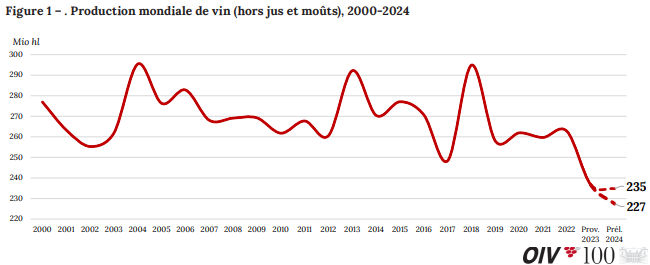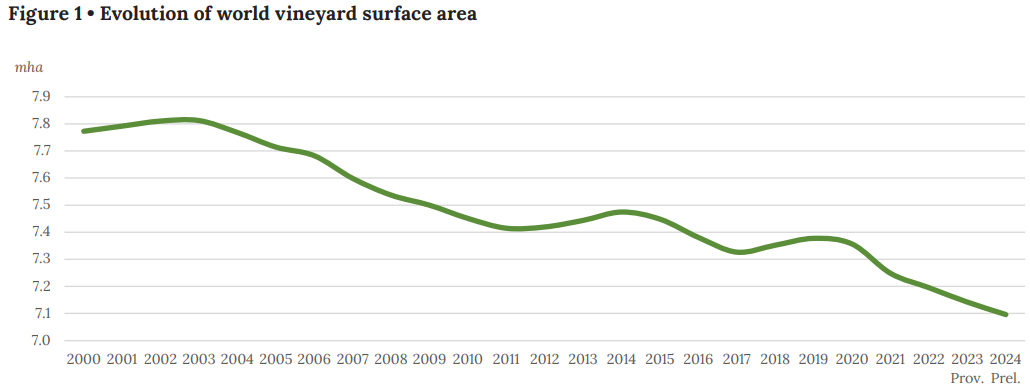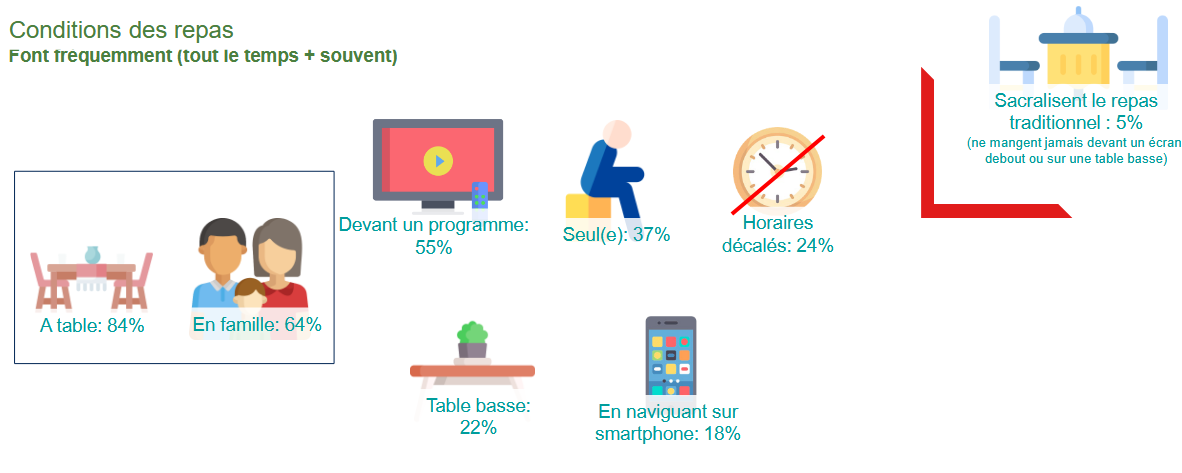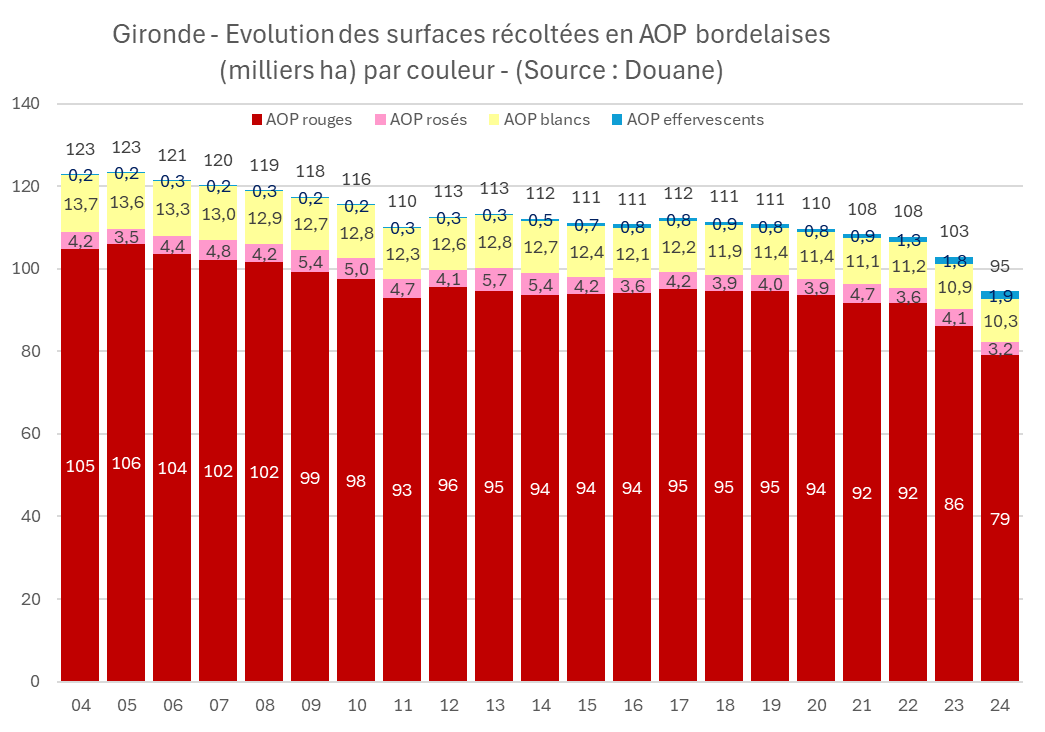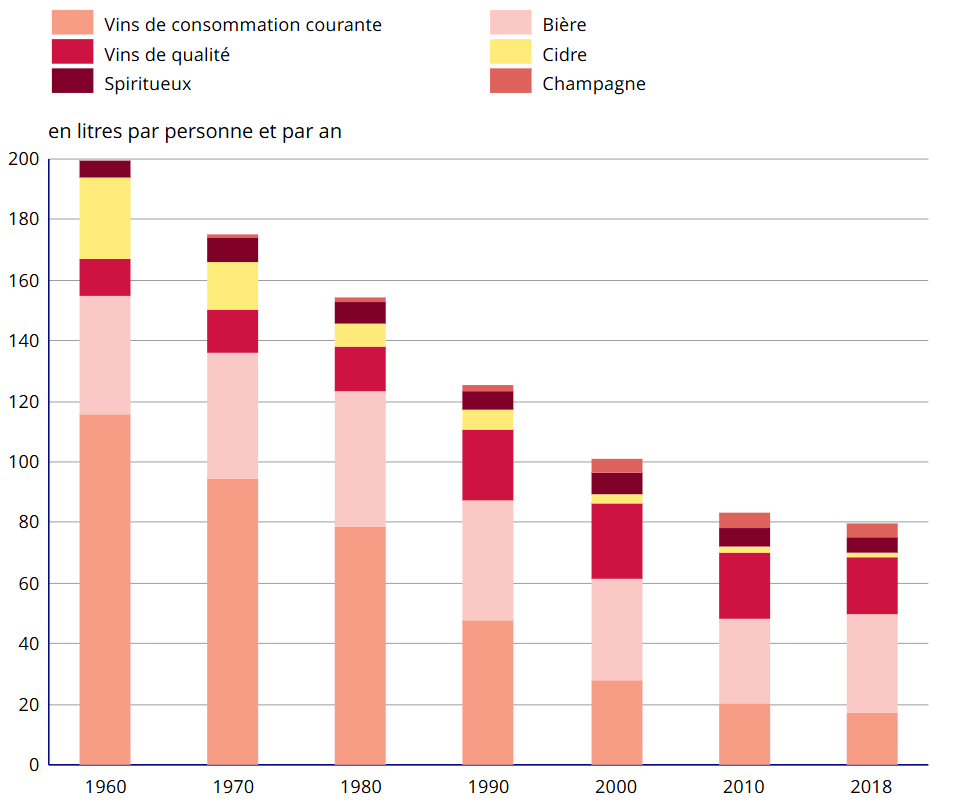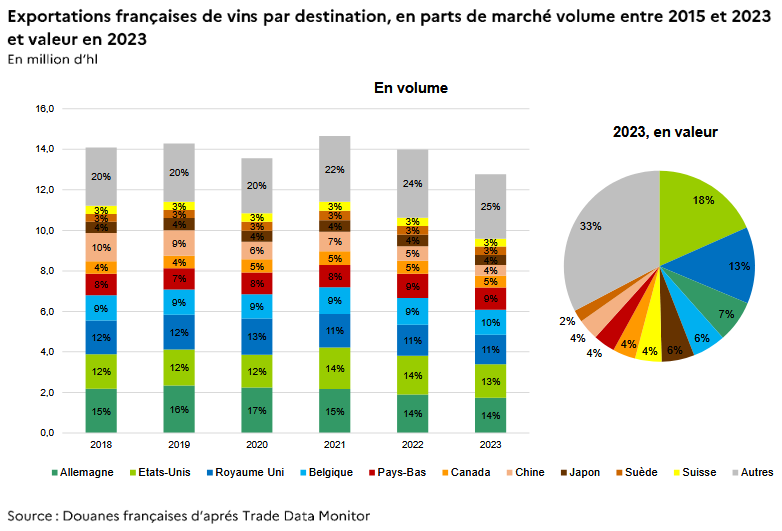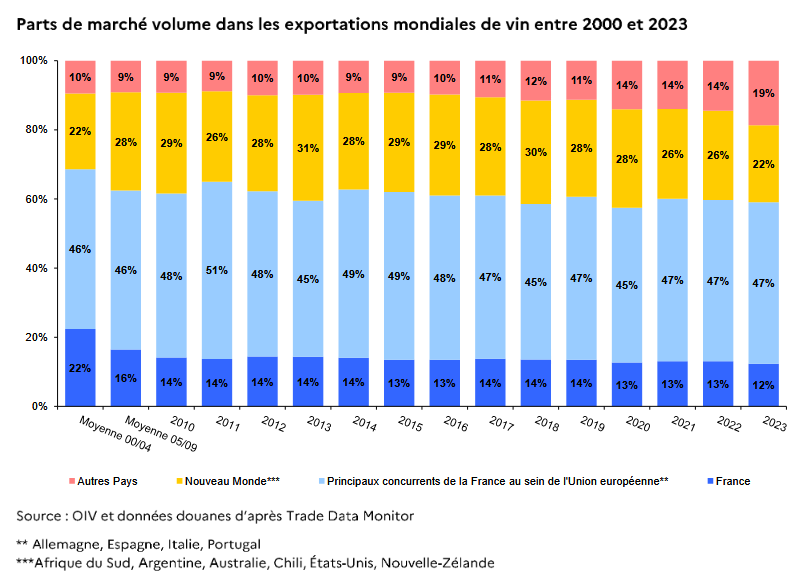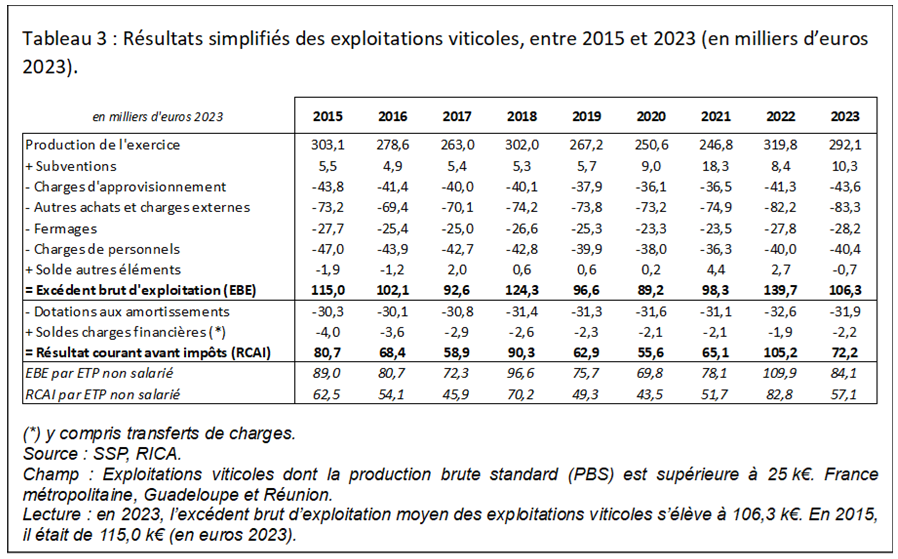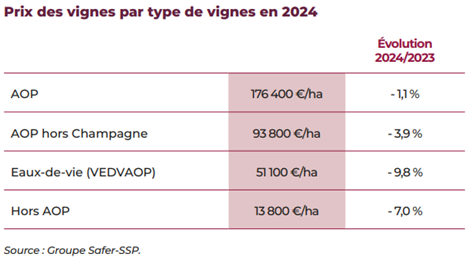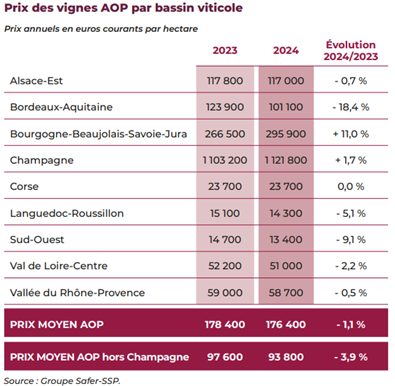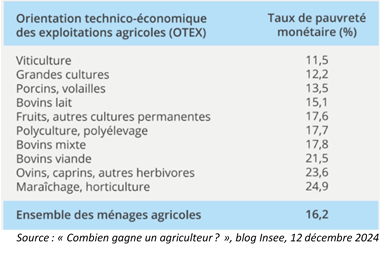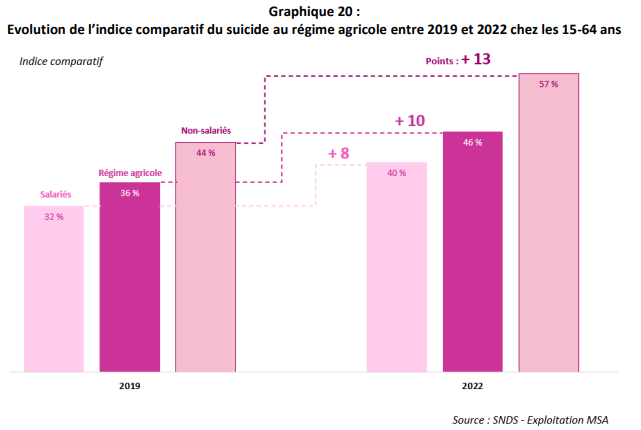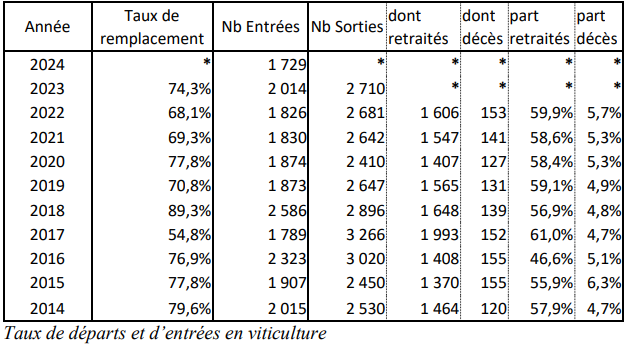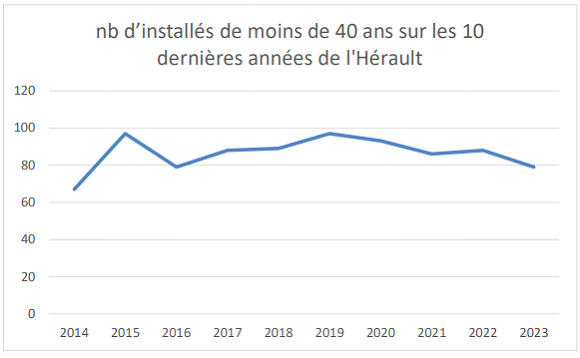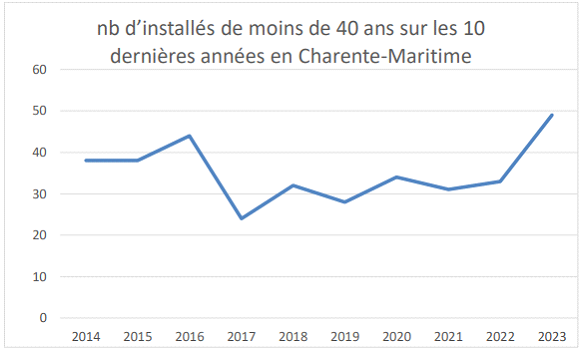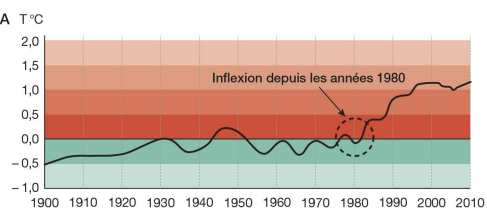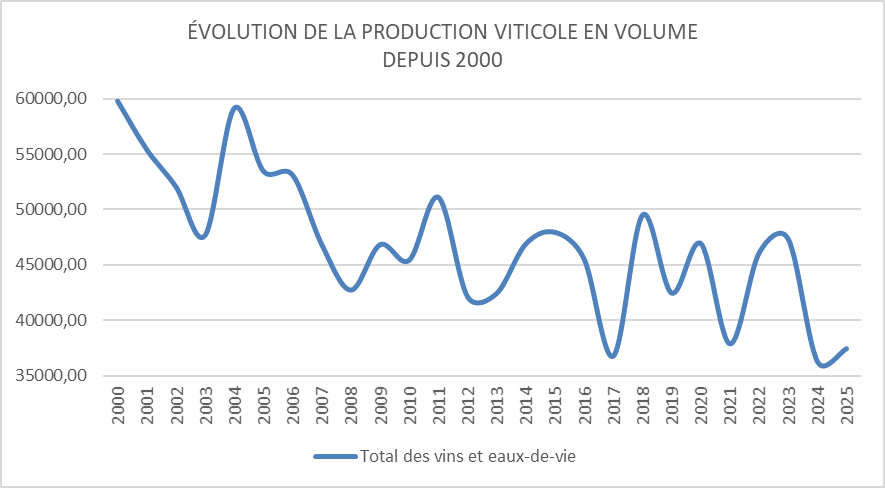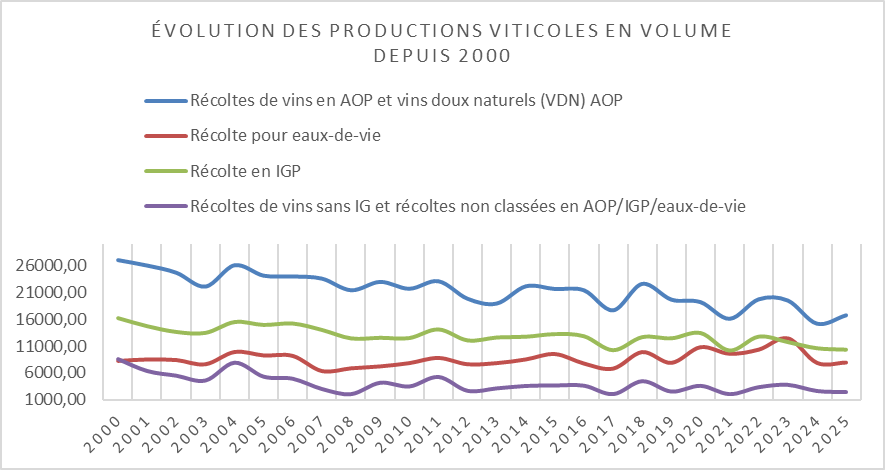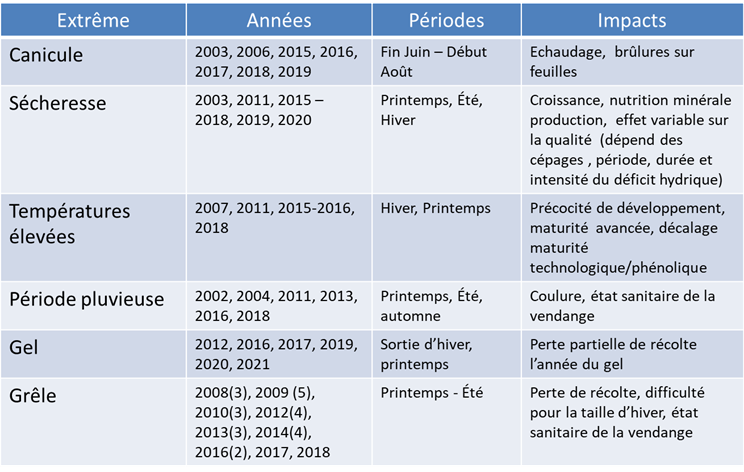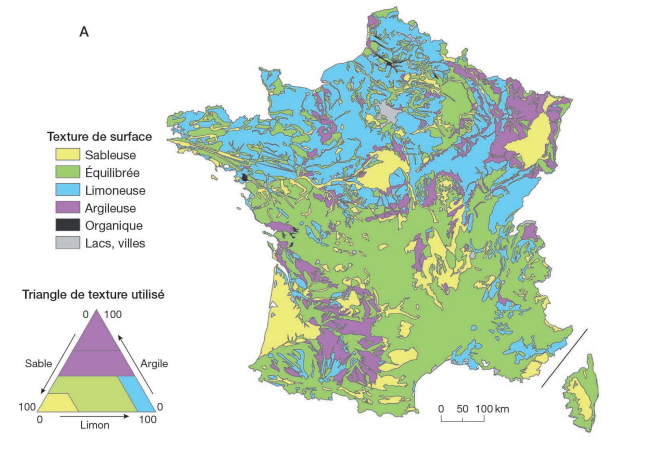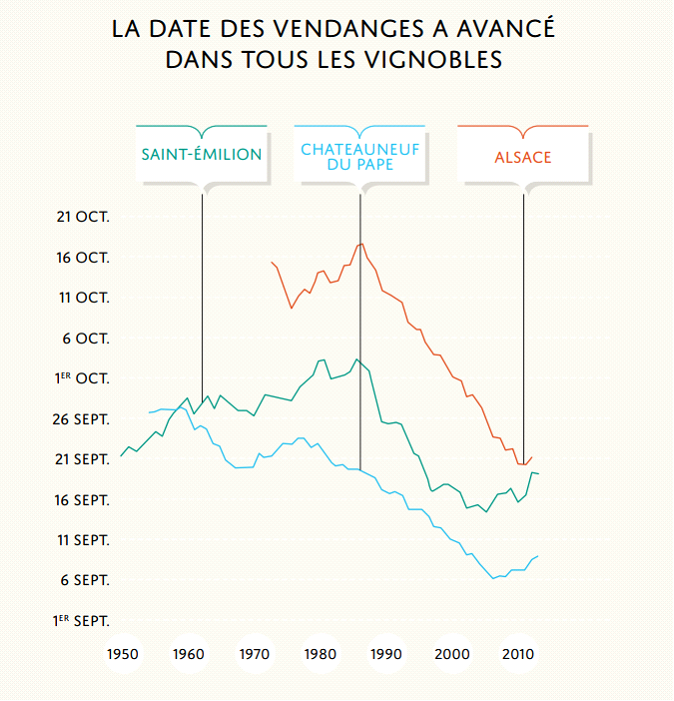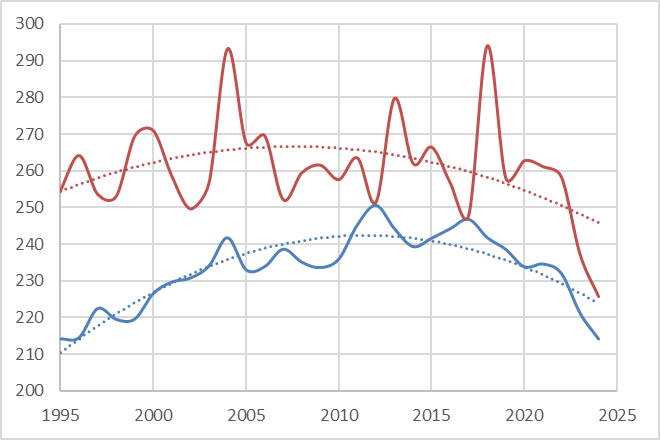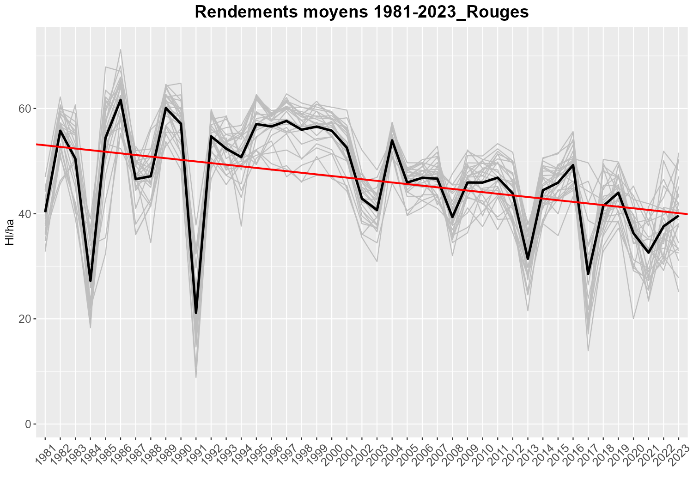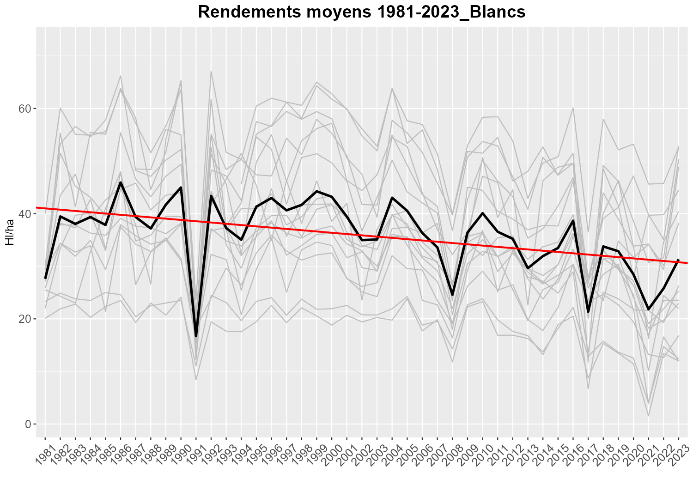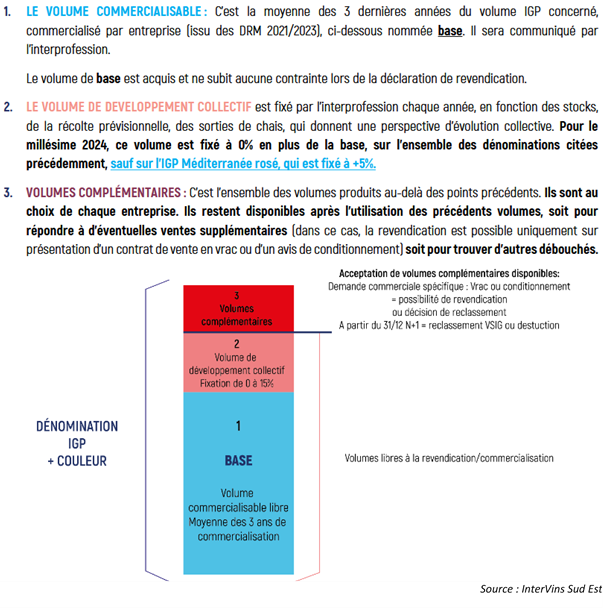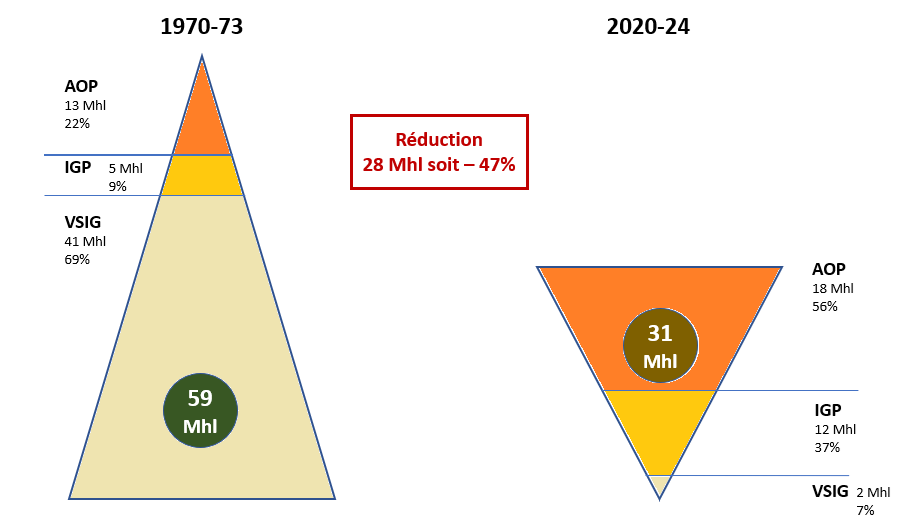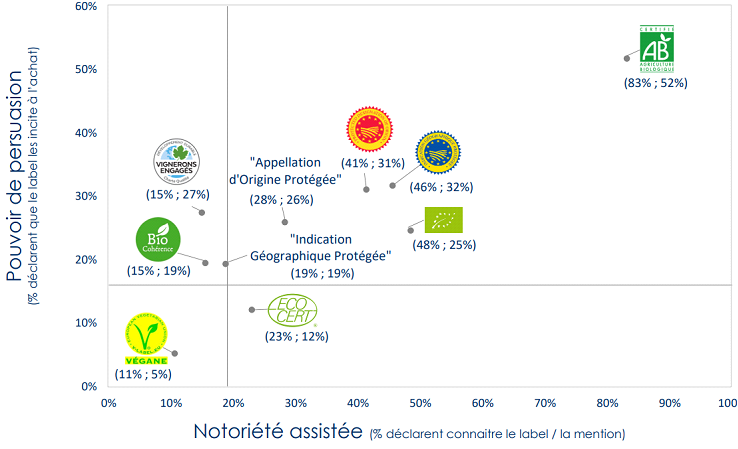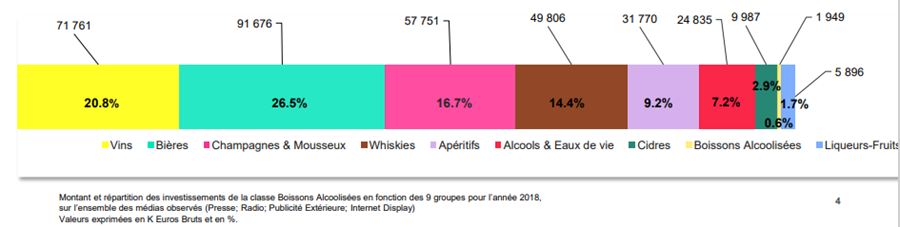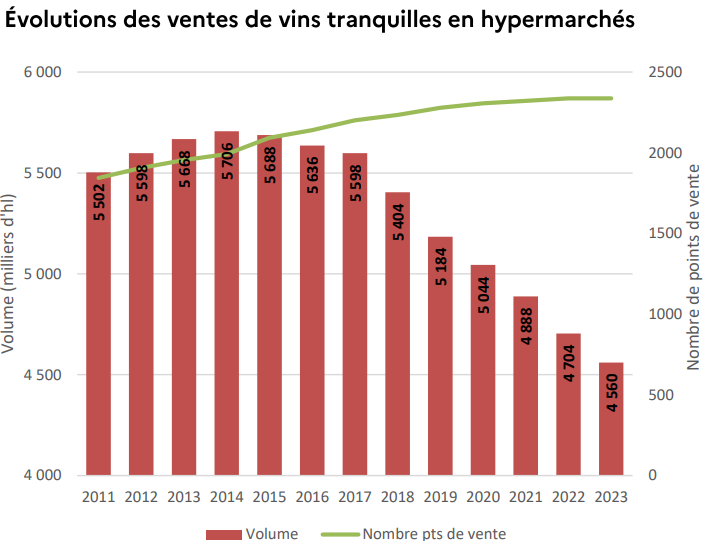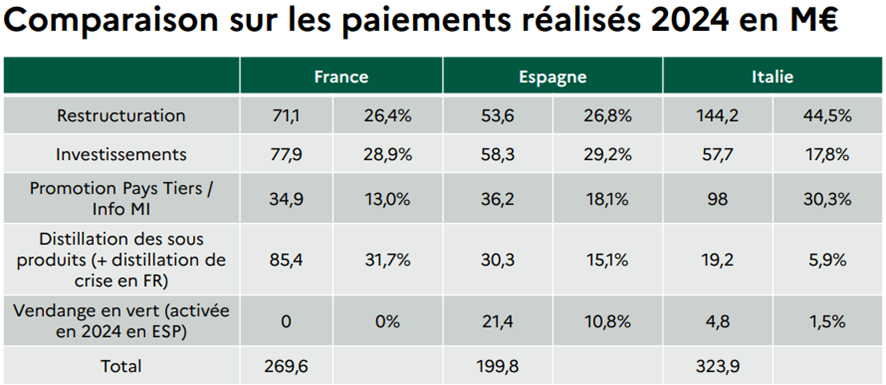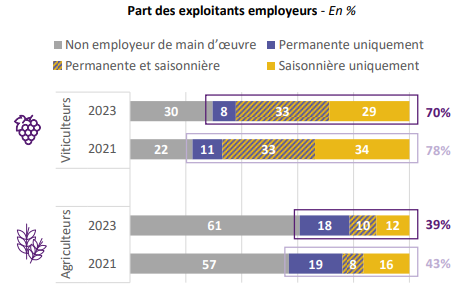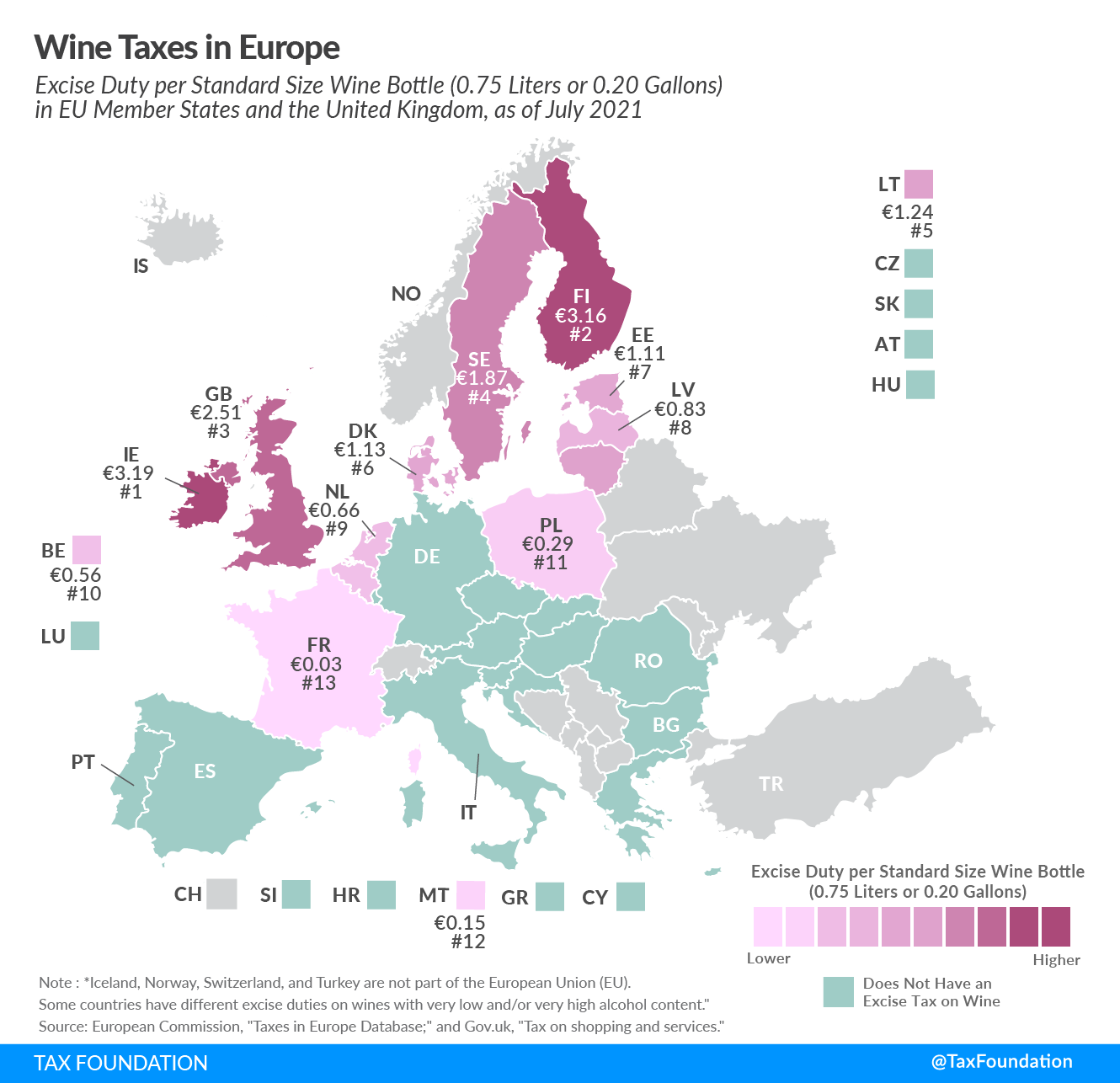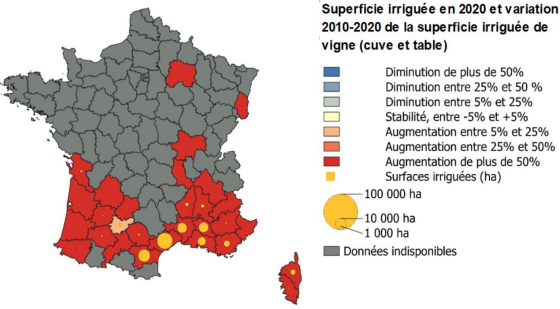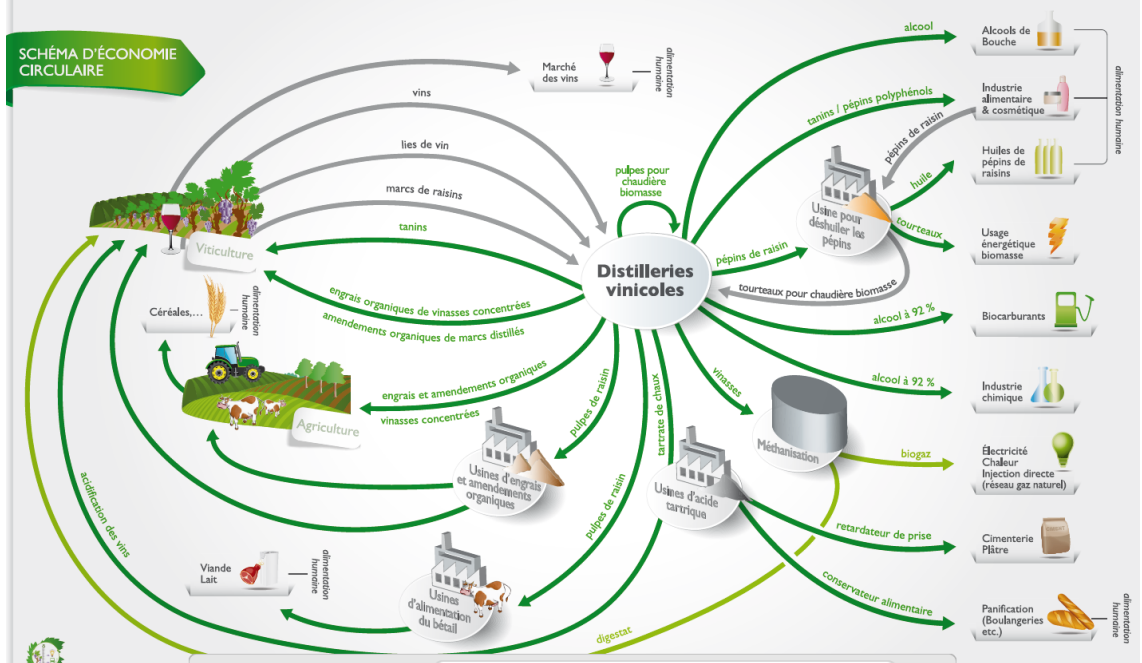- AVANT-PROPOS
- L'ESSENTIEL
- PARTIE I
LA VITICULTURE : UN SECTEUR HISTORIQUE
ET ÉCONOMIQUE MAJEUR AU CoeUR D'UNE POLYCRISE
POUR PARTIE PRÉVISIBLE
- I. LA VITICULTURE EN FRANCE : UNE
FILIÈRE HISTORIQUE D'EXCELLENCE QUI VOIT ROUGE
- A. UNE FILIÈRE COMPLEXE AU POIDS
ÉCONOMIQUE ET CULTUREL CONSIDÉRABLE
- B. UNE FILIÈRE DONT LES PRODUCTIONS DOMINENT
LE MARCHÉ MONDIAL
- A. UNE FILIÈRE COMPLEXE AU POIDS
ÉCONOMIQUE ET CULTUREL CONSIDÉRABLE
- II. ENTRE MUTATION DES CONSOMMATIONS ET CHOCS
EXOGÈNES RÉPÉTÉS, UNE FILIÈRE EN CRISE QUI
N'A PAS SU ANTICIPER LE MARCHÉ
- A. UNE BAISSE MONDIALE DE LA CONSOMMATION
TRADUISANT UN CHANGEMENT DE STATUT DU VIN TROP PEU ANTICIPÉ PAR LA
FILIÈRE
- B. DE NOMBREUX CHOCS EXOGÈNES DANS UN
CONTEXTE DE FORTE CONCURRENCE
- C. EN CONSÉQUENCE, UNE FILIÈRE QUI
VOIT ROUGE
- A. UNE BAISSE MONDIALE DE LA CONSOMMATION
TRADUISANT UN CHANGEMENT DE STATUT DU VIN TROP PEU ANTICIPÉ PAR LA
FILIÈRE
- III. UNE MULTIPLICATION DES ALÉAS
CLIMATIQUES ET SANITAIRES QUI DÉSTABILISE DES VIGNOBLES ENTIERS
- A. LES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES
IMPACTENT DE PLUS EN PLUS SÉVÈREMENT LA PRODUCTION
VITICOLE
- B. DES ALÉAS CLIMATIQUES QUI TENDENT
À RENFORCER LES ALÉAS SANITAIRES DANS UN CONTEXTE DE
RÉDUCTION DE LA DISPONIBILITÉ DES TRAITEMENTS
PHYTOSANITAIRES
- C. UNE PROBLÉMATIQUE DE L'EAU QUI DEVIENT
URGENTE
- A. LES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES
IMPACTENT DE PLUS EN PLUS SÉVÈREMENT LA PRODUCTION
VITICOLE
- I. LA VITICULTURE EN FRANCE : UNE
FILIÈRE HISTORIQUE D'EXCELLENCE QUI VOIT ROUGE
- PARTIE II - DES RÉPONSES QUI DOIVENT
AVANT TOUT
VENIR D'UNE FILIÈRE UNIE ENTRE L'AMONT ET L'AVAL,
CONQUÉRANTE ET RÉSILIENTE, AVEC L'APPUI INDISPENSABLE DES POUVOIRS PUBLICS
- I. LA FILIÈRE DOIT DAVANTAGE ORIENTER ET
MAÎTRISER SA PRODUCTION POUR MIEUX (RE)CONQUÉRIR DES PARTS
DE MARCHÉ
- A. LA RÉPONSE À LA CRISE NE SAURAIT
PASSER UNIQUEMENT PAR L'ARRACHAGE, MAIS PAR UNE PALETTE DE SOLUTIONS
ALLANT DE LA PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION
- 1. Si l'arrachage, véritable amputation du
potentiel productif français est parfois inévitable, la
filière doit davantage se saisir des outils de régulation de
l'offre à sa disposition
- a) L'arrachage, objectivement nécessaire
dans certaines circonstances, doit rester une solution de dernier
recours
- b) Aller vers une restructuration plus collective
du vignoble grâce au soutien financier de l'organisation commune des
marchés
- c) Des outils structurants découlant du
droit européen et mis en oeuvre avec l'aide de l'Inao et de
FranceAgriMer au service des filières
- d) L'indispensable régulation
interprofessionnelle
- e) Des évolutions positives attendues de
l'adoption prochaine du « Paquet vin »
- a) L'arrachage, objectivement nécessaire
dans certaines circonstances, doit rester une solution de dernier
recours
- 2. Un accompagnement indispensable de
l'État, mais plus sans condition
- 1. Si l'arrachage, véritable amputation du
potentiel productif français est parfois inévitable, la
filière doit davantage se saisir des outils de régulation de
l'offre à sa disposition
- B. UNE FILIÈRE QUI DOIT DAVANTAGE SE
TOURNER VERS LA DEMANDE TELLE QU'ELLE EST ET REPARTIR À L'OFFENSIVE EN
MISANT SUR SES ATOUTS
- 1. La filière gagnerait à ne pas se
reposer uniquement sur ses appellations, à réaffirmer
l'étanchéité des segments et à ne pas abandonner
l'entrée de gamme à la concurrence
- 2. Elle doit en outre mener à bien un choc
de communication et d'adaptation à la demande
- 3. Financer des bâtiments neufs ou la
conquête des marchés ? Un réajustement des
priorités est nécessaire
- 1. La filière gagnerait à ne pas se
reposer uniquement sur ses appellations, à réaffirmer
l'étanchéité des segments et à ne pas abandonner
l'entrée de gamme à la concurrence
- A. LA RÉPONSE À LA CRISE NE SAURAIT
PASSER UNIQUEMENT PAR L'ARRACHAGE, MAIS PAR UNE PALETTE DE SOLUTIONS
ALLANT DE LA PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION
- II. POUR QU'UN PACTE DE CONFIANCE PUISSE SE NOUER
AVEC L'AVAL, LE MAILLON DE LA PRODUCTION DOIT IMPÉRATIVEMENT
ÊTRE SÉCURISÉ DANS SON ACTIVITÉ
ET SES REVENUS
- A. LE COROLLAIRE D'UNE ATTENTION PLUS FORTE
À LA DEMANDE NE PEUT ÊTRE QUE LA SÉCURISATION DES
REVENUS DE L'AMONT PAR LA MOBILISATION DES OUTILS DU DROIT NATIONAL
ET EUROPÉEN
- 1. Les coûts de production sont difficiles
à connaître, mal connus et insuffisamment pris en compte
- 2. Les lois Égalim visent à
favoriser la construction du prix en avant des produits agricoles, mais
celles-ci ne sont que partiellement applicables à la filière
viticole
- 3. Le droit de l'Union européenne et la loi
prévoient des instruments nombreux et variés pour orienter les
prix, mais ceux-ci sont insuffisamment mobilisés
- a) La possibilité de publier des
indicateurs de coûts de production n'est pas utilisée par la
filière
- b) Le droit de l'Union européenne autorise
certaines orientations de prix, faculté que le Pays d'Oc a
utilisé pour la première fois en 2025
- c) Le droit de l'Union européenne et la loi
permettent la constitution d'organisation de producteurs...mais celle-ci est
rendue impossible par l'absence d'intervention du pouvoir
règlementaire
- d) Une fausse bonne idée : le
durcissement de l'interdiction de faire pratiquer des prix de cession
abusivement bas
- e) Soutenir les coopératives dans une
période très difficile
- a) La possibilité de publier des
indicateurs de coûts de production n'est pas utilisée par la
filière
- 1. Les coûts de production sont difficiles
à connaître, mal connus et insuffisamment pris en compte
- B. LE BESOIN D'UNE SIMPLIFICATION ET D'UNE
STABILISATION DES NORMES, NOTAMMENT FISCALES, FRAPPANT L'ACTIVITÉ DE
VITICULTEUR
- C. L'oeNOTOURISME EST UNE VOIE MAJEURE DE
DIVERSIFICATION QUI DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE
- 1. Une filière qui s'est largement
renforcée ces 20 dernières années
- 2. Un potentiel en partie inexploité, qui
appelle des efforts structurels
- 3. L'oenotourisme fait cependant face à des
contraintes règlementaires et législatives diverses qui
mériteraient d'être levées ou assouplies
- a) Mieux prendre en compte l'oenotourisme dans le
cadre de l'élaboration de la règlementation de l'urbanisme
- b) Une règlementation du travail dominical
peu lisible
- c) Le besoin d'adapter la complexe
règlementation de la consommation et de la vente d'alcool à la
réalité de l'oenotourisme
- d) Le besoin d'une clarification de la
fiscalité complexe applicable, en s'appuyant sur l'exemple
italien
- a) Mieux prendre en compte l'oenotourisme dans le
cadre de l'élaboration de la règlementation de l'urbanisme
- 4. Au-delà du fort potentiel de
l'oenotourisme, d'autres leviers de diversification à imaginer
- 1. Une filière qui s'est largement
renforcée ces 20 dernières années
- A. LE COROLLAIRE D'UNE ATTENTION PLUS FORTE
À LA DEMANDE NE PEUT ÊTRE QUE LA SÉCURISATION DES
REVENUS DE L'AMONT PAR LA MOBILISATION DES OUTILS DU DROIT NATIONAL
ET EUROPÉEN
- III. ASSURER UNE RÉSILIENCE
ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE
- A. LE BESOIN DE TRAVAILLER SUR LES
VARIÉTÉS, L'IRRIGATION ET LES SOLS
- 1. Les cépages et variétés
résistants sont un levier de résilience face au changement
climatique
- a) Malgré leur intérêt
certain, les cépages et variétés résistants
demeurent sous-employés dans le vignoble français
- b) Le déploiement des cépages et
variétés résistants, s'il est peut-être ralenti par
les indispensables phases d'expérimentation, peut s'intensifier par
l'accompagnement de la restructuration des vignobles ainsi qu'une meilleure
diffusion des connaissances
- a) Malgré leur intérêt
certain, les cépages et variétés résistants
demeurent sous-employés dans le vignoble français
- 2. Maintenir la viticulture dans les territoires
les plus difficiles par l'irrigation raisonnée, la restructuration des
sols et l'accompagnement économique
- 1. Les cépages et variétés
résistants sont un levier de résilience face au changement
climatique
- B. LE BESOIN DE MOBILISER ET DE SOUTENIR LES
PARTENAIRES DU MONDE VITICOLE
- 1. Renforcer les soutiens bancaires et
assurantiels
- 2. Afin d'assurer la résilience climatique
du vignoble français, il est nécessaire d'assurer, en amont, la
pérennité des pépiniéristes viticoles
- 3. Soutenir, en aval, les distilleries viticoles
en crise afin de maintenir une diversification des débouchés des
viticulteurs
- 1. Renforcer les soutiens bancaires et
assurantiels
- A. LE BESOIN DE TRAVAILLER SUR LES
VARIÉTÉS, L'IRRIGATION ET LES SOLS
- I. LA FILIÈRE DOIT DAVANTAGE ORIENTER ET
MAÎTRISER SA PRODUCTION POUR MIEUX (RE)CONQUÉRIR DES PARTS
DE MARCHÉ
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
N° 96
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la filière viticole,
Par MM. Daniel LAURENT, Henri CABANEL et Sebastien PLA,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
AVANT-PROPOS
Pendant longtemps, la viticulture a ronronné.
Une production abondante, globalement de qualité.
Une demande importante, au pays du vin.
Des vignobles fleurons, très organisés, véritables étendards à travers le monde de la culture, de l'histoire et du savoir-faire français.
Un prestige inégalé.
Une contribution à la balance commerciale de la France décisive.
Des crises récurrentes, certes, mais toujours surmontées, souvent à grand renfort d'argent public.
Dans de telles conditions, pourquoi se remettre en question : le producteur fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire produire, et la demande suivra. Le négociant regarde les cours du vin pour acheter au bon moment, ou bien franchit la frontière pour faire ses affaires.
Cette époque est révolue. Désormais, une bouteille d'huile d'olive se vend plus cher que certains vins sous appellation. Dans certains vignobles, des viticulteurs sont à bout, jusqu'à, pour certains, commettre l'irréparable.
Comment en est-on arrivé là ?
Les causes sont multiples, analysées dans ce rapport, mais finalement connues de tous.
La filière pouvait-elle prévoir la succession de chocs mondiaux qu'ont constituée la crise du Covid, l'agression russe, la saga des droits de douane chinois et américains ? De toute évidence non, elle a, comme de nombreux secteurs économiques, dû composer avec un environnement international dégradé et s'est retrouvée injustement prise pour cible dans des conflits qui ne la concernait pas.
En revanche, la filière pouvait prévoir l'évolution lente, mais constante de la demande, des mentalités, des habitudes de consommations, ce qu'elle n'a qu'imparfaitement fait.
Des décennies de montée en gamme, à tel point que pratiquement l'entièreté de la viticulture française est désormais sous signe de qualité, et pourtant, un consommateur lambda, lorsque celui-ci achète encore du vin, connaît-il la différence entre une AOP et une IGP ? A-t-il la moindre idée de la hiérarchie fine existant au sein même des AOP ? Lorsque toute une filière est sous signe de qualité, alors, en un sens, l'est-elle encore aux yeux du consommateur ?
23 ans après la publication du rapport sur l'avenir de la viticulture du sénateur Gérard César, qui, déjà alors, soulignait des tendances qui se confirment aujourd'hui, et formulait des propositions dont certaines sont reprises dans ce rapport, les rapporteurs de cette nouvelle mission d'information sur l'avenir de la viticulture ont une conviction : la filière a toutes les armes pour repartir de l'avant, et sortir d'une crise profonde, qui ne fera que s'aggraver si rien n'est fait.
Aussi, la principale recommandation du présent rapport consiste en l'organisation, au premier trimestre 2026, d'assises de la viticulture, pilotées au plus haut niveau par la ministre de l'agriculture, et incluant l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème viticole. Ces assises pourront prendre appui sur les travaux du plan de filière, actuellement au point mort.
Pour que ces assises de la viticulture constituent un véritable tournant pour la filière, les rapporteurs proposent qu'elles s'organisent autour d'un pacte entre l'amont et l'aval de la filière.
Dans trop de vignobles en effet, les deux familles ne se parlent pas, ne se comprennent pas, ne s'accordent pas sur une stratégie commune.
Pourquoi continuer à produire en masse des vins dont le maillon distribution explique depuis des années qu'ils ne correspondent plus à l'état de la demande ? Pourquoi, côté aval, acheter parfois des productions à vil prix, alimentant des offres commerciales indignes en supermarché, ou importer du vin de l'étranger alors que la production a plus que jamais besoin de soutien ?
Quel avenir pour les coopératives viticoles nées de l'intuition ancienne de viticulteurs pionniers qu'à plusieurs on est plus forts que seul ?
Ce pacte devra reposer sur deux évolutions majeures. Les rapporteurs proposent ainsi d'ouvrir, par expérimentation, les organismes de défense et de gestion à l'aval de la filière, pour que celui-ci puisse avoir voix au chapitre quant aux orientations de production choisies.
L'effort demandé à la production est considérable, tant l'histoire des ODG est ancienne. Cet effort ne saurait être unilatéral.
C'est pourquoi les rapporteurs proposent que cette évolution majeure soit conditionnée à un engagement formel, contrôlable et contrôlé par l'État, aux moyens d'indicateurs clairs, publics et transparents, d'un développement massif de la contractualisation dans les bassins de production qui en expriment le besoin.
En outre, les rapporteurs proposent que toute nouvelle aide à la distillation ou à l'arrachage soit conditionnée à la réussite de ces assises, et donc à l'entente entre l'amont et l'aval.
Ces assises de la viticulture devront être le lieu où chacun est mis devant ses responsabilités.
Les banques sont-elles prêtes à soutenir davantage la viticulture et accepter un surcroît de risque ?
Les grandes enseignes sont-elles prêtes à entamer une réflexion sur la redynamisation des ventes et sur certaines politiques tarifaires qui, parfois, interrogent ?
L'hôtellerie-restauration est-elle prête à modifier une politique tarifaire éloignant trop souvent le consommateur du vin à table ?
L'État est-il prêt, une fois encore, à apporter un indispensable soutien financier pour permettre à la filière de restructurer sa production ?
L'administration poursuivra-t-elle et amplifiera-t-elle l'urgent chantier de la simplification administrative ?
Ces assises de la viticulture doivent être un point de départ d'un nouvel acte de la viticulture française, qui n'oublie pas son héritage, mais au contraire le valorise davantage, qui prend conscience que produire n'est pas une finalité en soi, et qui, enfin, fait le pari de la confiance plutôt que la défiance entre chacun de ses maillons.
Les parlementaires intéressés aux questions viticoles peuvent, et veulent s'engager aux côtés de la filière. L'État et les administrations peuvent, et doivent soutenir ses acteurs. Les institutions européennes peuvent et doivent adapter la législation communautaire. Mais finalement, chacun le sait, les réponses ne pourront venir de la filière et de sa capacité à dépasser ses désaccords souvent légitimes, au service d'une ambition commune.
Tel est le voeu que formulent les rapporteurs de la mission d'information sur l'avenir de la viticulture, tous trois viticulteurs de métier, viscéralement attachés à la culture de la vigne.
L'ESSENTIEL
Comment expliquer que le prix de nombre de bouteilles de vin sous appellation soit inférieur au prix de l'huile d'olive ? Comment en est-on arrivé à un tel stade de mal-être en viticulture ?
Pendant plusieurs mois, la mission d'information transpartisane sur l'avenir de la filière viticole a mené 47 auditions et s'est déplacée dans l'Aude, l'Hérault, le Bordelais et en Bourgogne, à la rencontre des acteurs de la filière.
Les rapporteurs de la mission, Daniel Laurent, Henri Cabanel et Sébastien Pla ont acquis la conviction que si la filière n'a pas suffisamment su se remettre en question face aux évolutions sociétales et au changement climatique, elle dispose indiscutablement de tous les atouts pour sortir par le haut d'une conjonction historique de crises de natures différentes.
La commission des affaires économiques a ainsi adopté les 23 recommandations du rapport, avec la certitude que l'issue de cette polycrise tient en la capacité de l'amont et de l'aval de la filière à signer un pacte de confiance.
C'est pourquoi la commission appelle, principale recommandation du rapport, à la tenue rapide d'assises de la viticulture organisées par le ministère de l'agriculture afin d'aboutir à des compromis mutuels : faire intervenir davantage les acteurs de l'aval dans la production en échange de leur engagement formel et contrôlé de développer sans attendre les leviers existants de sécurisation du revenu de l'amont.
I. TRIPLE CRISE CONJONCTURELLE, STRUCTURELLE ET CLIMATIQUE : UNE FILIÈRE D'EXCELLENCE QUI VOIT ROUGE
A. UN LEADER MONDIAL
Filière profondément ancrée dans l'histoire, la culture et les paysages de France, la viticulture contribue de façon essentielle à l'économie nationale et à sa projection internationale.
|
La filière soutient directement ou indirectement près de |
produisant une valeur ajoutée de |
et générant des recettes fiscales de |
« Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. » art. L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)
L'Inao : un acteur aussi historique qu'incontournable à conforter absolument.
Fêtant ses 90 années d'existence, l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), temple des appellations, joue un rôle crucial auprès de la filière pour gérer et adapter leurs cahiers des charges. Ses moyens d'action, modestes au regard de son utilité, doivent impérativement être rehaussés.
Avec, pour la seule filière vin, pas moins de 236 organismes de défense et de gestion (ODG) gérant 442 appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP), 23 interprofessions aux contours complexes, et une myriade d'organismes représentatifs, la filière déploie des trésors de complexité nuisant nécessairement à l'émergence d'une vision partagée.
Pour autant, cette filière est historiquement performante à l'international. Les 3 % de surface agricole utilisée (SAU) qu'elle occupe génèrent, en 2023, 15,3 Mds€ de valeur, et 16 % de la valeur totale générée par l'agriculture française. En 2023, la filière a produit 33,5 Mhl de vin, un chiffre qui se monte à 47,3 Mhl avec les spiritueux.
Contrôlant 17 % des parts de marché mondial, la filière vins et spiritueux dégage en 2023 un excédent de 14,73 Mds€, soit l'équivalent de 49 Airbus A380, faisant d'elle la 3e contributrice à la balance commerciale française.
Avec 23 % de ses surfaces cultivées en bio (et 62 % des surfaces certifiées haute valeur environnementale [HVE]), la France est en outre le premier vignoble bio du monde.
B. MUTATION DES CONSOMMATIONS : UNE FILIÈRE EN CRISE QUI N'A PAS SU ANTICIPER LE MARCHÉ
La consommation de vin par habitant est passée de 135 litres en 1960 à 41 litres en 2023 et la proportion de non-consommateurs ou de consommateurs occasionnels rares est passée de 19 % en 1980 à 37 % actuellement, avec une baisse encore plus marquée chez les 18-24 ans, symptôme d'une coupure générationnelle dans la culture du vin, ce qui a de quoi inquiéter la filière.
En conséquence, la France arrache ses vignes si bien que la taille du vignoble devrait passer sous la barre des 750 000 ha en 2025, et vraisemblablement des 700 000 en 2026 ou 2027.
En réalité, si la France n'a pas arraché avant, c'est en raison sa capacité exceptionnelle à créer de la valeur. Mais aujourd'hui, on assiste autant à une crise de surproduction que de sous-commercialisation.
L'année 2023 symbolise cette nouvelle donne du vin, avec une production de vin blanc dépassant pour la première fois celle du vin rouge, perçu par le consommateur comme trop fort, tanique et alcooleux.
L'enjeu pour la filière n'est pas de convaincre les buveurs de boire davantage à l'encontre des recommandations des autorités de santé publique, mais de ramener dans le champ de la culture du vin ceux qui s'en sont éloignés par rupture de transmission et par évolution des goûts : montée en puissance de la bière et des cocktails et émergence des alternatives peu ou pas alcoolisées. La complexité du monde du vin est en outre un facteur repoussoir pour le consommateur peu averti.
C. DES CHOCS EXOGÈNES MAJEURS ET IMPRÉVISIBLES
Filière aux débouchés internationaux multiples, la viticulture a néanmoins dû essuyer des chocs majeurs sur deux marchés essentiels, alors même que la concurrence n'a jamais été aussi forte.
Premièrement, la fermeture brutale du marché chinois du fait des problèmes socio-économiques du pays pesant sur la consommation, et, s'agissant des spiritueux, de l'imposition de droits de douane provisoires suivie d'un régime de prix minimum de vente, entraîne des pertes colossales pour la filière cognaçaise. En un an seulement, la valeur des exportations vers la Chine a ainsi plongé de 20 %.
Deuxièmement, 16 mois de tensions commerciales avec les États-Unis à l'occasion du premier mandat de l'actuel président ont fait perdre à la filière 560 M€. Avec le début du second mandat, ce sont désormais 15 % de droits de douane qui seront appliqués sur les importations américaines de vins et spiritueux français, et qui s'ajoutent à un taux de change particulièrement pénalisant pour la filière.
Ces chocs, cumulés à une concurrence internationale rude et à l'évolution des goûts des consommateurs, aboutissent à l'affaiblissement de la toute-puissance française sur un marché mondial qu'elle contrôlait à hauteur de 22 % en volume il y a 20 ans, contre 12 % en 2023. Une fois encore, le choc est amorti par une perte de parts de marché moins grande en valeur.
|
Dans le Languedoc, sur 460 agriculteurs évalués |
|
dépistés en risque de burn-out |
|
Source : Baromètre e-santé « Amarok » de la MSA du Languedoc |
En conséquence, les indicateurs économiques de la filière virent au rouge : stagnation voire baisse de l'indice des prix à la production, la déflation touchant jusqu'aux appellations les plus prestigieuses à l'instar de Saint-Émilion, excédents bruts d'exploitation en baisse, chais pleins et revenus trop souvent en berne.
Dès lors, comment s'étonner du mal-être viticole palpable dans les campagnes, alors même que l'on assiste à un réel développement des politiques de détection et de prise en charge, animées par un coordinateur national interministériel ?
Les rapporteurs s'alarment de ce que cette crise de la viticulture mette encore plus la filière à risque pour renouveler les générations et installer des jeunes. Aussi, ils proposent de mettre rapidement en oeuvre l'aide au passage de relais, dont le principe a été adopté à l'occasion du vote de la loi d'orientation agricole, à l'initiative du Sénat.
D. DES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES QUI METTENT EN PÉRIL DES VIGNOBLES ENTIERS
La hausse des températures est désormais une réalité bien palpable dans les vignobles français, avec des millésimes 2022 et 2023 qui ont été deux des trois plus chauds de ces 30 dernières années et des dates de vendanges avancées de plusieurs semaines en l'espace de quelques décennies. Cela pose la question de l'adéquation des vins produits avec la demande, qui s'oriente vers la fraîcheur et la légèreté.
En outre, les aléas climatiques ne se comptent plus à l'échelle d'une vie, mais à l'échelle d'une année, et certains départements comme les Pyrénées-Orientales ou l'Aude en font la douloureuse expérience, rendant, par la même, difficile toute assurance des récoltes. En outre, le déficit hydrique de certaines zones, associé à d'autres facteurs, conduit à des effondrements de rendements. L'interprofession des vins du Sud-Ouest note une baisse de rendement de 33 à près de 38 %pour les vins IGP en 4 ans, dans un contexte où toute la filière, conventionnelle comme bio, est fragilisée par des retraits brutaux et non concertés de produits phytopharmaceutiques.
II. LA DESTRUCTION DU POTENTIEL PRODUCTIF DE LA VITICULTURE N'EST PAS UNE POLITIQUE DE LONG TERME
A. LA RÉGULATION DE LA PRODUCTION NE SAURAIT SE RÉSUMER À L'ARRACHAGE
Face à ce constat de polycrises, la conviction des rapporteurs est que l'arrachage, s'il est parfois tristement nécessaire, ne saurait constituer une politique d'avenir pour la filière. Véritable amputation du potentiel productif, les rapporteurs ne souscrivent pas à l'idée, répandue, que l'arrachage de 100 000 ha de vignes soit une solution, particulièrement à l'heure où l'on observe le début d'un mouvement international d'ajustement du potentiel productif. Aussi, ils recommandent de mobiliser au maximum les outils de gestion du potentiel de production et de commercialisation existants : droits de plantation, volumes complémentaires individuels, volumes commercialisables à échelle interprofessionnelle, etc.
Plus précisément, la mission invite à se saisir pleinement, sur le modèle de certaines interprofessions avancées sur ce sujet comme le Pays d'Oc ou la Champagne, du puissant outil que constitue la régulation interprofessionnelle, et qui a le mérite de mettre l'amont et l'aval autour d'une même table.
En outre, l'aide à la restructuration du vignoble ouverte par le plan stratégique national (PSN) pour un budget annuel d'environ 100 M€ doit être réorientée vers la restructuration collective et doit « sur-primer » les stratégies intégrant la plantation de variétés résistantes aux aléas.
Enfin, dans le cas des futures aides à la distillation, probablement inévitables, quoique très coûteuses, les rapporteurs proposent d'en conditionner l'usage à une analyse du positionnement et des débouchés de l'opérateur et, le cas échéant, à l'obligation d'arrachage temporaire ou définitif.
B. L'URGENCE À SE TOURNER VERS LA DEMANDE TELLE QU'ELLE EST
Les rapporteurs font le constat que le passage sous signes de qualité (AOP-IGP) de 95 % du vignoble ne s'est aucunement traduit par un surcroît de demande puisque le consommateur ne connaît globalement que peu le système des appellations et des mentions valorisantes, à l'exception notable du label bio.
En l'absence d'un effort massif de communication, le signe de qualité ne sauvera pas une filière qui ne parvient d'ailleurs pas à éviter les phénomènes de transferts de volumes produits entre AOP, IGP et VSIG.
En outre, certains segments d'entrée de gamme ont été abandonnés à la concurrence alors qu'une demande existe. Les rapporteurs proposent donc de partir à la reconquête de certains marchés d'entrée de gamme par le développement, dans les territoires propices, d'une filière « industrielle » du vin fondée sur des contrats pluriannuels de long terme entre l'amont et l'aval.
Ils proposent en outre de réaliser l'indispensable choc de communication en mutualisant une fraction des budgets interprofessionnels afin de promouvoir la « bannière France » plutôt que le particularisme local. Cette mutualisation a été possible dans le cadre du financement du plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble, il doit l'être pour renforcer l'image du vin français.
Dans cette logique les rapporteurs recommandent d'accroître l'enveloppe de la PAC relative à la promotion à l'exportation hors Union européenne et d'en compenser le surcoût par une baisse de certains financements non essentiels de l'enveloppe dédiée à la large catégorie des « investissements matériels et immatériels ».
III. REVENUS, SIMPLIFICATION ET DIVERSIFICATION : LES INDISPENSABLES LEVIERS DE SÉCURISATION DE L'AMONT
A. LE COROLLAIRE D'UNE ATTENTION PLUS FORTE À LA DEMANDE NE PEUT ÊTRE QUE LA SÉCURISATION DES REVENUS DE L'AMONT
Si les rapporteurs plaident pour reconnecter l'offre et la demande, les efforts demandés à l'amont ne sauraient être sans contrepartie de la part de l'aval. Certains vignobles demandent de longue date à avancer sur la problématique de la construction d'un prix juste doté d'un minimum de prévisibilité.
Les rapporteurs l'affirment : les outils juridiques existent. Ils exhortent donc la filière, et notamment le négoce, à enfin publier les indicateurs de coûts de production prévus par les lois dites « Égalim ».
Ils recommandent en outre de mettre en place les accords de durabilité prévus par le droit européen et qui permettent aux interprofessions ou, à défaut, aux producteurs, de publier des prix d'orientation, outil décisif dans la construction des prix « en marche avant », c'est-à-dire à partir des coûts de production.
Enfin, les rapporteurs appellent le Gouvernement à publier sans délai le décret permettant la reconnaissance des associations de producteurs viticoles qui, conformément au droit européen, peuvent négocier des contrats au nom de leurs membres.
Les coopératives -
Des acteurs
historiques des territoires à ne pas laisser tomber
Les rapporteurs ne peuvent évoquer la question du revenu sans s'alarmer de la situation des coopératives viticoles. Celles-ci assurent 40 % de la production nationale, 67 % des volumes de vin IGP et 58 % de la production de rosé. Leur modèle traditionnel, fondé sur la production en commun de vin en vrac au sein de petites unités, est mis à mal par les évolutions de la demande. Le Gouvernement s'était engagé à dégager 10 M€ pour les accompagner dans leur nécessaire et douloureuse restructuration. Or, les vignerons coopérateurs n'ont rien vu venir. Le Gouvernement doit tenir parole.
B. SIMPLIFICATION DES NORMES ET DIVERSIFICATION DES REVENUS
Outre la question du revenu de l'amont viticole, les rapporteurs soulignent que celles de la simplification administrative, de la stabilité fiscale, ou encore de la diversification sont fondamentales, pour assurer la résilience, mais aussi l'attractivité du métier.
La lettre d'engagement du 26 février 2024 envers la filière a constitué une base utile pour mener à bien des premiers travaux de simplification administrative. Mais à l'heure où un vigneron passe en moyenne 9 heures par semaine à des tâches administratives, il semble impératif d'approfondir la démarche et faire aboutir, au niveau national, le « dites-le-nous une fois » tant demandé par les professionnels.
De même, les rapporteurs appellent le Gouvernement, au niveau européen, à intensifier ses efforts pour parvenir à la création d'un guichet unique européen dédié au paiement de l'accise, qui permettra aux petites structures d'avoir enfin matériellement accès au marché européen, conformément au principe de libre circulation des marchandises.
Enfin, constatant que la filière fait déjà l'objet de taxes élevées et variées (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 20 %, accise, cotisation sociale sur les boissons alcooliques, impôt spécial sur les « prémix »), elle souligne l'urgence d'assurer une stabilité fiscale pour ne pas pénaliser une filière déjà en crise.
Les rapporteurs sont en outre convaincus que la filière viticole a besoin de se diversifier pour sécuriser son revenu. Avec 12 millions d'oenotouristes en 2023, la filière dispose ici d'un levier majeur de création de valeur et de promotion de ses productions. Ils formulent donc une série de recommandations visant à assurer le développement de cette activité en renforçant la coordination et la professionnalisation de ses acteurs, tout en sécurisant son financement via le PSN et en levant certaines contraintes règlementaires.
IV. ASSURER UNE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE DE LA FILIÈRE ET DE SES PARTENAIRES
Face au changement climatique, les réponses doivent être l'adaptation et la résilience. Parmi les leviers existants, le déploiement de variétés de vignes et de cépages résistants est un atout majeur pour le futur d'une viticulture qui est confrontée à la réduction des moyens phytosanitaires traditionnels de protection des cultures, y compris le cuivre en agriculture biologique. D'autant plus que la filière voit la palette de ses solutions phytopharmaceutiques diminuer continuellement, parfois brutalement, comme en témoigne le dossier du cuivre.
Leur déploiement permet en outre une réduction considérable des coûts d'intervention.
|
Expérimentation chambre d'agriculture de l'Aude |
Souvignier Gris |
Chardonnay |
|
Indice de fréquence des traitements |
2 |
13,2 |
|
Coût par hectare |
97 € |
609 € |
Les rapporteurs recommandent donc d'accélérer leur déploiement notamment en augmentant les seuils d'expérimentation du dispositif des variétés d'intérêt à fin d'adaptation (Vifa) de l'Inao et en invitant les ODG à en faire la promotion via les démonstrateurs territoriaux existants.
Enfin, soutenir la viticulture c'est aussi prévenir les difficultés des partenaires essentiels à la pérennité de la filière en amont et en aval de la production. À ce titre, les rapporteurs appellent à soutenir, en amont, les pépiniéristes viticoles pour qu'ils maintiennent un potentiel de production suffisant en particulier s'agissant des cépages et variétés de vignes résistants. Ils formulent en outre une recommandation pour sécuriser, à l'aval, à savoir les distilleries viticoles, en assurant une diversification des débouchés des produits viticoles en particulier en matière de distillation d'alcool vinique à destination des biocarburants.
V. POUR DES ASSISES DE LA VITICULTURE
Au terme de cette mission d'information, les rapporteurs sont convaincus de l'absolue nécessité d'organiser dès que possible des assises de la viticulture, qui permettront, par exemple sur la base du plan de filière actuellement au point mort, de nouer un pacte de confiance entre l'amont et l'aval. Puisque finalement, si de nombreux acteurs institutionnels et politiques peuvent aider la filière, celle-ci seule détient la clef qui permettra de sortir par le haut d'une crise historique. Aussi, dans le cadre de ces assises, les rapporteurs formulent deux recommandations :
1 - formaliser un engagement de l'aval de la filière, sous forme d'une déclaration d'engagements écrite par exemple, contrôlable et mesurable par les services de l'État, en faveur d'une véritable construction du prix « en marche avant » et d'une sécurisation dans la durée des débouchés des producteurs.
2 - débattre de la question de l'ouverture des ODG à l'aval de la filière, qui en est juridiquement exclu alors que ce n'est pas le cas dans le reste de l'agriculture. Ils proposent de mettre en place une expérimentation de trois ans d'une telle mesure, pour favoriser le dialogue, au stade de la production, entre les deux familles de la filière.
En outre, les rapporteurs proposent que toute nouvelle aide de crise soit conditionnée à la réussite de ces assises, et donc à l'entente entre l'amont et l'aval.
Ces assises de la viticulture devront inclure la diversité des partenaires de la viticulture, pour que tous soient mis devant leurs responsabilités : banques et assurances, grande distribution, hôtellerie-restauration, et bien entendu l'État et son administration.
Tel est le voeu que formulent les rapporteurs de la mission d'information sur l'avenir de la viticulture, tous trois viticulteurs, viscéralement attachés à la culture de la vigne.
PARTIE I
LA
VITICULTURE : UN SECTEUR HISTORIQUE
ET ÉCONOMIQUE MAJEUR AU
CoeUR D'UNE POLYCRISE
POUR PARTIE PRÉVISIBLE
I. LA VITICULTURE EN FRANCE : UNE FILIÈRE HISTORIQUE D'EXCELLENCE QUI VOIT ROUGE
A. UNE FILIÈRE COMPLEXE AU POIDS ÉCONOMIQUE ET CULTUREL CONSIDÉRABLE
1. Une filière historique implantée au coeur des territoires et contribuant activement à la vie socio-économique de la Nation
Si l'histoire de la viticulture n'a pas débuté sur le sol national, c'est bien dans la terre de France que les racines de cette culture et de ce savoir-faire vont plonger le plus profondément1(*). L'article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que « Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »
Aujourd'hui encore, malgré la crise profonde dans laquelle le secteur viticole est plongé, il convient de souligner le poids économique majeur de la filière, son importance culturelle et sa contribution décisive à la physionomie des territoires, à leur histoire et à leur dynamisme.
Cette contribution de la viticulture à la vie économique, culturelle et sociale de notre pays ne saurait être prise à la légère. Selon une étude du cabinet Deloitte pour les organisations Vin & Société et le comité national des interprofessions des vins (Cniv), rendue publique en janvier 2024, la filière spécialisée de la vigne et du vin2(*) réalise un chiffre d'affaires (CA) de près de 59 milliards d'euros (Mds€), dégage une valeur ajoutée (VA) de près de 17 Mds€, et génère 881 millions d'euros (M€) de rentrées fiscales pour l'État. La filière génèrerait enfin plus de 254 000 équivalents temps plein (ETP).
Au sein de cette filière, le maillon amont, à savoir la viticulture stricto sensu, génère, selon l'étude, 10 Mds€ de CA et 125 000 ETP, répartis sur 59 000 exploitations3(*).
A contrario, dans sa plus large acception, en prenant en compte les effets d'entraînement4(*), soit près 33 Mds€ de CA et quelque 186 000 ETP, la filière viticole génèrerait au total 92 Mds€ de CA, 32 Mds€ de VA, soit 1,4 % du PIB national, soutenant 440 000 ETP et générant 6,4 Mds€ de recettes pour les comptes publics.
Synthèse de la contribution de la
filière viticole française
à l'économie
nationale (selon les données de Deloitte)
|
Équivalents temps plein (ETP) générés |
CA généré (Mds€) |
VA générée (Mds€) |
Recettes fiscales générées (Mds€) |
|
|
Filière spécialisée de la vigne |
254 000 |
59 |
17 |
0,9 |
|
Dont viticulture |
124 000 |
10 |
5 |
0,25 |
|
Effets d'entraînement |
186 000 |
33 |
15 |
5,5 |
|
TOTAL |
444 0005(*) |
92 |
32 |
6,4 |
À titre de comparaison, un fleuron français et européen comme Airbus, basé à Toulouse, dégage un CA de 69 Mds€ en 2024, excellente année pour le groupe. Ce même fleuron génère en France 50 000 ETP, soit plus de deux fois moins que la viticulture au sens strict, et près de neuf fois moins que l'économie viticole dans son acceptation la plus large.
Les 3 % de surface agricole utilisée (SAU) occupés par la viticulture française produisent, en 2020, 24 % de la valeur totale de la production végétale et près de 16 % de la valeur de la production agricole totale6(*). La viticulture emploie en outre 128 370 ETP, soit 19 % du total de l'emploi agricole.
Cette viticulture créatrice de valeur demeure avant tout une activité familiale, comme en témoigne la taille moyenne des exploitations, qui s'établit en 2020 à 19 ha, soit largement en deçà de la taille moyenne d'une exploitation agricole, qui s'établit à 69 ha.
Sur certains territoires, la viticulture a contribué de façon décisive à façonner les paysages, les traditions, les cultures, et l'économie locale. Ainsi, le Languedoc-Roussillon, longtemps considéré comme le plus vaste vignoble du monde, a développé très tôt, grâce à la culture romaine et à un climat propice, la culture de la vigne. Malgré une succession de crises, ce vignoble n'a jamais perdu sa vocation viticole. C'est aussi cette région qui a vu l'émergence et le développement des coopératives viticoles avec la fondation, en 1901, de la Société coopérative à Maraussan7(*). C'est ce territoire encore qui vit la révolte des vignerons de 1907, contribuant pour partie à mettre à l'agenda politique la problématique de la protection des appellations qui aboutira, en 1935, à la création du système des appellations d'origine contrôlées (AOC).
Aussi, la filière viticole n'est-elle pas une filière comme les autres en France et dans les territoires. Elle est le fruit d'une longue histoire, souvent chahutée, en évolution permanente. Cette histoire, chaque vigneron peut la raconter derrière chaque bouteille qu'il vend en circuit court ou qu'il expédie à l'autre bout du monde. Cette histoire se raconte à travers des paysages façonnés par des générations de vignerons et un savoir-faire unique alliant maintien des traditions et science du vin et de l'oenologie, dont Bordeaux s'est fait, dans les années 1970-1980, capitale mondiale autour d'Émile Peynaud8(*), Pascal Ribéreau-Gayon9(*) ou encore Denis Dubourdieu10(*).
C'est au titre de cette immense richesse viticole que les 1 247 climats de Bourgogne, patrie d'Henri Jayer11(*), ont été inscrits, en 2015, au patrimoine mondial de l'Unesco, notamment sous l'impulsion d'Aubert de Villaine, alors président de l'association des climats de Bourgogne. Ces parcelles de tailles extrêmement réduites, souvent inférieures à un hectare, qui s'étendent de la côte de Beaune à la côte de nuits sur une cinquantaine de kilomètres (km), forgées depuis le haut Moyen-Âge par la main humaine et les ordres bénédictins et cisterciens, représentent l'une des expressions les plus abouties du lien entre les hommes et leurs terroirs, et de la minutie de leur travail de chaque mètre carré de terre.
Les touristes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ne s'y trompent pas, comme en témoigne la croissance continuelle du tourisme lié au vin en France, atteignant le chiffre de 12 millions d'oenotouristes en 2023, pour près de la moitié venant de l'étranger.
C'est finalement lorsque la vigne n'est plus présente, ou bien lorsqu'elle est laissée en friche, que l'on réalise son importance historique et son rôle d'aménageur d'espaces.
Car, en plus de sculpter les paysages, la vigne contribue à les sauvegarder, notamment face au risque incendie, qui augmente à mesure que s'accroissent les effets du changement climatique. À ce titre, le rapport d'information relatif à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie des sénateurs Jean Bacci, Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Rietmann, précise que « les autres types de culture, et en particulier la viticulture, ne sont pas reconnus pour leur utilité DFCI12(*) dans le cadre des MAEC13(*), alors que leur intérêt comme pare-feu, lorsque les inter-rangs ne sont pas enherbés, a été confirmé par plusieurs études ». Au demeurant, ce constat souligne d'emblée les contradictions qui peuvent exister entre des finalités différentes : l'enherbement est désormais encouragé pour accroître la qualité des sols et conserver l'humidité, mais a pour corollaire un affaiblissement du rôle de pare-feu.
L'incendie d'août 2025 ayant largement endommagé le massif des Corbières a souligné, une fois encore, la contribution que pouvaient apporter les vignes à la sauvegarde du paysage. Cet incendie, qui a parcouru près de 16 000 ha, dont 2 000 ha de terres agricoles, a également mis en lumière les conséquences de la réduction continuelle des surfaces viticoles dans l'Aude sur la propagation d'incendies ne trouvant alors sur leur parcours plus aucun rempart.
2. Une organisation complexe fruit de l'histoire, mais aussi des jeux d'acteurs
Si le monde agricole comporte de nombreux acteurs, celui de la viticulture atteint pour les non-initiés, voire même pour les plus avertis, des sommets de complexité.
Les acteurs de la filière sont professionnels et institutionnels.
a) Les acteurs professionnels
La complexité de la filière est particulièrement visible lorsque l'on tente de comprendre son organisation professionnelle.
À la base de cette organisation figure le triptyque des appellations d'origine protégée (AOP), indications géographiques protégées (IGP) et des vins sans appellation géographique (VSIG), en lien avec le système des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), dépassant le simple cadre de la viticulture, mais dont on doit les prémisses, au début du XXe siècle, à la mobilisation des vignerons. C'est ce système, désormais mis en place à l'échelle de l'Union européenne, qui fonde le premier niveau d'organisation de la filière viticole, autour de l'organisme de défense et de gestion (ODG), ancien syndicat d'appellation. Ainsi, 198 ODG gèrent les 366 AOP et 38 ODG gèrent les 76 IGP, un ODG pouvant regrouper plusieurs appellations et/ou indications. Concernant les spiritueux, 28 ODG gèrent les 51 indications géographiques (IG14(*)), dont 17 AOC. Ces ODG ont un rôle fondamental, sachant que neuf viticulteurs sur 10 produisent sous SIQO.
Ces unités de base peuvent ensuite se regrouper pour défendre leurs intérêts. Ainsi, en Bourgogne, les 52 ODG sont regroupés au sein de trois unions à savoir : l'union des grands crus de Bourgogne, l'union des crus de Bourgogne et l'union des appellations régionales.
Par suite, un regroupement plus large de producteurs est possible. Toujours en Bourgogne, les trois unions de producteurs sont regroupées au sein de la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB). Les ODG, moyennant cotisation, ont la possibilité de transférer à cette structure certaines de leurs missions pour assurer une cohérence d'action à l'échelle d'un territoire viticole.
L'ensemble de la production viticole est regroupé au sein de l'association générale de la production viticole (AGPV), dont la vocation est de porter, à un niveau plus unifié, la voix de l'amont viticole.
Les interprofessions rassemblent les collèges de la production et de la commercialisation des vins. Le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) rassemble ainsi, à parité, 45 membres appartenant à la famille de la viticulture, désignés par la CAVB, et qui inclut des représentants des coopératives, et 45 membres issus de la famille du négoce, désignés par la fédération des négociants éleveurs de grande Bourgogne (Fneb), regroupement des maisons de négoce.
Les interprofessions - Maillon essentiel de l'organisation agricole
Constituent des interprofessions tous les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente15(*). Cette reconnaissance peut être accordée par produit, au niveau national comme au niveau d'une zone de production.
Cette reconnaissance est conditionnée au fait que les groupements en cause représentent une part significative de ces secteurs d'activité.
En outre, ces groupements doivent suivre un ou plusieurs des objectifs énumérés au c) du § 1 ou au c) du § 3 de l'article 157 du règlement OCM16(*), pour les produits couverts par ce règlement ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des huit objectifs prévus par l'article L. 632-1 du CRPM.
Selon le comité national des interprofessions de vins à appellation d'origine et indication géographique (Cniv), les interprofessions vinicoles travaillent sur quatre grands thèmes17(*), sans que cette liste ne soit exhaustive :
· la promotion, par la valorisation de l'image et mise en avant des vins en France, en Europe et dans le monde ;
· la recherche et le développement, grâce à des programmes spécifiques adaptés aux vins et aux marchés ou mutualisation de travaux d'intérêt général (recherche sur le génome ou dépérissement du vignoble) ;
· l'économie, par la transparence, la connaissance, l'accès et la régulation des marchés ;
· la protection des IG et appellations.
Le principal instrument aux mains des interprofessions est sans doute l'accord interprofessionnel qui permet de fixer des règles qui seront applicables aux parties qui le signeront. En outre, dès lors que l'organisation interprofessionnelle est reconnue par les pouvoirs publics, celle-ci peut, conformément à l'article L. 632-3 du CRPM, demander à l'administration de rendre obligatoires, en tout ou partie, pour une durée déterminée, les dispositions contenues dans ses accords à l'ensemble des professions couvertes par le champ de l'interprofession : on parle alors d'accords étendus. Cette possibilité de mettre en oeuvre une régulation interprofessionnelle et fondamentale, et fera l'objet de développements en seconde partie de ce rapport.
Pour être étendus, de tels accords nécessitent une décision unanime des familles professionnelles représentées au sein de l'interprofession, sans qu'il soit en revanche nécessaire que la décision de chaque famille professionnelle ait elle-même été prise à l'unanimité des membres qui la composent. Une telle condition d'unanimité n'empêche donc pas l'extension de l'accord à certains membres des interprofessions opposés à l'accord : c'est tout l'intérêt de l'accord étendu.
Illustration de la complexité et du morcellement de la filière, celle-ci ne compte pas moins de 23 interprofessions, voire même 26 en intégrant l'interprofession des appellations cidricoles, l'union nationale interprofessionnelle cidricole et le comité national interprofessionnel du pineau des Charentes. Par comparaison, le vaste secteur des fruits, légumes et productions végétales spécialisées compte 10 interprofessions, de même que celui des grandes cultures et semences. En audition, presque toutes les interprofessions entendues par les rapporteurs ont considéré ce morcellement comme justifié, héritage des traditions viticoles locales. Les rapporteurs, conscients de la profondeur de l'histoire viticole française et de sa grande diversité, considèrent cependant qu'il conviendrait de s'interroger sur ce nombre, particulièrement concernant les vignobles méridionaux qui concentrent l'essentiel des interprofessions. Ce morcellement peut notamment résulter d'un découpage territorial étroit du champ de l'interprofession ou bien encore de la représentation d'un seul segment de marché, IGP ou AOP au sein de l'organisation. En tout état de cause, le chiffre de 23 interprofessions viticoles interroge, au moment où les rapporteurs considèrent que l'heure est au regroupement et à la solidarité.
À titre d'illustration, l'Occitanie compte quatre interprofessions :
· l'interprofession des vins du sud-ouest (IVSO),
· le comité interprofessionnel des vins du Roussillon (CIVR),
· le comité interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL),
· l'interprofession des vins de Pays d'Oc IGP (Inter'Oc)
De même, pour représenter les vins du Sud-Est, pas moins de trois interprofessions sont nécessaires :
· l'interprofession des vins d'appellations d'origine contrôlées côtes du Rhône et vallée du Rhône (Inter Rhône) ;
· l'association des vins du pays du sud-est de la France (InterVins Sud-Est) ;
· le comité interprofessionnel des vins de Provence (CIVP).
Enfin, d'autres interprofessions sont des regroupements de taille particulièrement modeste, à l'instar de l'interprofession des vins de Bergerac et Duras (IVBD) ou bien encore l'union interprofessionnelle du vin de Cahors (UICV).
Ces interprofessions sont elles-mêmes rassemblées au sein d'une association, le comité national des interprofessions de vins à appellation d'origine et indication géographique (Cniv), qui compte également parmi ses membres l'association nationale interprofessionnelle de vin de France (Anivin de France), qui est l'interprofession des VSIG. Le Cniv a pour mission de contribuer à l'organisation de la filière en participant aux débats institutionnels français et européens, suivant les négociations commerciales internationales et les évolutions règlementaires de la politique agricole commune (PAC). Il assure, en outre, un suivi et une analyse des données statistiques du marché viticole et accompagne les dossiers transversaux de recherche.
Ce morcellement des interprofessions est aussi, par voie de conséquence, un morcellement des moyens humains et financiers, de même qu'un morcellement des stratégies. Si les rapporteurs sont réservés quant à la recommandation de l'Assemblée nationale de faire évoluer le rôle du Cniv pour lui donner le statut d'interprofession nationale, les logiques de vignobles étant trop diverses, la filière gagnerait à engager une réflexion sur la rationalisation et la mutualisation, voire la fusion, de certaines interprofessions.
À ces acteurs il convient d'ajouter les coopératives viticoles, au nombre de 560, présentes partout sur le territoire, mais historiquement surtout dans le sud de la France, et plus particulièrement dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Elles sont aussi très présentes en Alsace. Celles-ci peuvent également se regrouper au sein d'unions, et sont représentées à l'échelle nationale par La coopération agricole, au sein d'une section dédiée, Vignerons Coopérateurs de France. Leur poids dans la production viticole est considérable puisqu'elles représentent environ 40 % de la production18(*).
En outre, Vignerons indépendants de France est un syndicat qui regroupe, sur la base de l'adhésion volontaire, la viticulture indépendante. L'organisation compte 33 fédérations départementales ou interdépartementales, huit fédérations régionales et une confédération nationale. Le syndicat revendique 7 000 adhérents.
La filière viticole compte encore d'autres acteurs de premier plan qu'il convient de mentionner, et qui recoupent le triptyque AOC/IGP/VSIG précédemment présenté.
Premièrement, la confédération nationale des appellations d'origine protégées (Cnaoc), acteur central de la filière et interlocuteur important des pouvoirs publics, regroupe les syndicats de producteurs en AOC. L'organisation dispose de 17 fédérations assurant un maillage du territoire pour représenter les près de 58 000 vignerons produisant en AOC (70 % de la viticulture française).
Deuxièmement, son homologue pour les vins IGP, la confédération des vins IGP de France (VinIGP), qui regroupe 28 des 38 ODG produisant en IGP, soit, selon l'organisation, la moitié des volumes produits sous ce SIQO. À noter l'absence de la plus importante IGP, aux volumes considérables, à savoir l'IGP Pays d'Oc.
Troisièmement, l'Anivin de France, précédemment mentionnée, qui vise à représenter les intérêts des producteurs de vin de France. À noter qu'à la différence de la Cnaoc et de VinIGP, Anivin de France est une interprofession.
Là encore, les rapporteurs s'interrogent sur la pertinence de l'existence de deux structures, la Cnaoc ainsi que VinIGP, pour représenter deux pans de la viticulture produisant sous SIQO, à savoir l'AOP et l'IGP. Ces deux organisations gagneraient à fusionner et ainsi mutualiser leurs moyens d'action auprès de leurs adhérents comme des pouvoirs publics.
Enfin, à ces très nombreuses organisations, s'ajoutent les maisons de négoce et les entreprises du secteur viticole, elles aussi regroupées dans des structures communes : la fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS), la fédération française des spiritueux (FFS), la fédération française des vins d'apéritif (FFVA) et l'union des maisons et marques de vin (UMVIN). Ces structures sont elles-mêmes regroupées, depuis 2024, au sein de la maison des vins et spiritueux (MVS).
Illustration simplifiée des acteurs de la filière viticole
Source : Magazine du vigneron des côtes du Rhône et de la vallée du Rhône, mai 2024
b) Les acteurs institutionnels
En partenariat avec ces nombreux acteurs de la profession viticole, les pouvoirs publics interviennent à plusieurs niveaux, chacun dans leur domaine de compétences.
À l'échelon de l'administration centrale, plusieurs acteurs clés doivent être mentionnés.
Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire (Masa) dispose, au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE), d'un bureau sectoriel dédié au suivi des vins et autres boissons, composé de neuf ETP, auquel s'ajoutent des bureaux chargés des politiques publiques transversales, dont certaines ont un impact sur la filière viticole.
Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique compte en son sein deux directions en lien étroit avec la filière :
· la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), chargée notamment de la protection du consommateur, de participer à l'élaboration des dispositions règlementaires entourant les pratiques oenologiques ou encore de veiller au respect de la loyauté des relations interentreprises19(*) ;
· la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), chargée de deux missions, l'une relative au régime économique des alcools, à travers la tenue du casier viticole informatisé (CVI) et l'autre à la fiscalité sectorielle.
À l'échelon déconcentré, ce sont principalement les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) qui exercent les missions les plus importantes en matière viticole, puisque pilotant les missions relevant du Masa. Elles sont notamment chargées d'organiser et d'animer les conseils de bassins viticoles, instances de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placées auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production viticole.
Enfin, deux établissements publics exercent des missions incontournables en matière viticole, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao).
FranceAgriMer est l'organisme payeur des aides sectorielles du secteur viticole financées par les crédits européens Fonds européen agricole de garantie20(*) (Feaga) dans le cadre du plan stratégique national (PSN). Dans le cadre d'une organisation originale offrant aux professionnels une large place, il organise le dialogue avec et au sein de la filière viticole au sein du conseil spécialisé vin et cidre, qui est le seul lieu où se retrouvent au niveau national l'ensemble des organisations professionnelles de la filière et les pouvoirs publics (DGPE, DGDDI et DGCCRF). Il collecte, analyse et diffuse les données économiques en assurant un suivi des marchés et en proposant des expertises économiques permettant aux pouvoirs publics d'adapter leurs actions. C'est également FranceAgriMer qui délivre les autorisations de plantation nouvelle et les autorisations de replantation sur le fondement des règles définies par la DGPE et la DGDDI. Les rapporteurs notent à ce titre que les missions d'analyse du marché de FranceAgriMer recoupent celles du Cniv, comme l'avaient déjà noté les auteurs du rapport de l'Assemblée nationale.
L'Inao, qui fête en 2025 ses 90 années d'existence, est chargé de la mise en oeuvre de la politique relative aux produits sous SIQO.
c) L'Inao : un acteur aussi historique qu'incontournable à conforter absolument
Institué en parallèle de la création des AOC21(*), sous l'impulsion décisive du sénateur de Gironde Joseph Capus, l'Inao, qui fête en 2025 ses 90 années d'existence, est chargé de la mise en oeuvre de la politique relative aux produits sous SIQO. L'institut s'appuie sur une gouvernance originale et qui a fait ses preuves, reposant sur les professionnels. Son rôle est d'expertiser techniquement et juridiquement les demandes relatives aux signes de qualité : reconnaissance d'une nouvelle appellation, modification d'un cahier des charges, protection juridique des signes et dénominations ou supervision des contrôles, ainsi que toute question transversale aux SIQO.
L'Inao : un établissement public aux dépenses maîtrisées
Dans une note à laquelle la mission d'information a pu avoir accès, l'Inao compare, par l'analyse des rapports annuels de performance de 2021 à 2023, le coût de fonctionnement de l'établissement par agent, à celui de nombreux établissements publics : Agence de services de paiement (ASP), Centre national de la propriété forestière (CNPF), FranceAgriMer, Agence bio, Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), VNF (Voies navigables de France), Agences de l'eau, Ademe, etc. Il ressort de cette analyse que l'Inao est, après le CNPF, l'établissement ayant le coût de fonctionnement par agent le plus réduit, avec des écarts avec les autres établissements pouvant aller du simple au double, voire davantage. L'Inao note en outre que l'évolution de ce coût sur la période 2021/2023 est l'une des plus modérées : + 3,9 %, contre des taux pouvant dépasser les 30 % pour d'autres agences.
Cependant, l'Inao se retrouve aujourd'hui au pied du mur. D'une part, sa charge de travail ne cesse d'augmenter :
· + 40 % de dossiers à traiter par rapport aux années 2010, un chiffre en augmentation constante notamment du fait de l'adaptation des SIQO aux aléas climatiques ;
· Nouvelle mission depuis 2022 relative à la gestion des dérogations demandées par les opérateurs bio en incapacité d'appliquer certaines règles du cahier des charges (7 000 dérogations individuelles en 2023).
En parallèle, ses moyens s'érodent :
· Avec un budget de 26 M€ par an financé à 70 % par une subvention pour charge de service public (SCSP), l'établissement est en déficit structurel depuis trois ans, compensant avec une trésorerie atteignant un niveau critiquement bas ;
· Sa SCSP a déjà été revue à la baisse en 2025 (- 700 000 €) et le Gouvernement propose de poursuivre cette baisse en 2026, pour aboutir à 1 018 000 € de baisse en deux ans ;
· Passage de 267 ETP en 2011 à 239 en 2016, puis 233 en 2022 ;
Pourtant, il serait faux d'affirmer que l'établissement ne prend pas sa juste part à l'effort légitime demandé à l'ensemble de la sphère publique :
· Augmentation du budget de fonctionnement de seulement 4 % en euros courant depuis 2017, malgré une inflation cumulée de 18 %, soit une baisse de ce même budget de 14 % en valeur réelle ;
· Diminution, rien que pour 2024, de 2 % du budget, en parallèle d'une inflation de 2 %.
Source : Inao
Au fil de leurs auditions, les rapporteurs ont constaté que les professionnels saluent la qualité du travail de l'Inao et la qualité du dialogue mis en place. Tous plaident pour une sanctuarisation de cet établissement public historique, dont le rôle et la montée en puissance ont accompagné celle des SIQO depuis près d'un siècle. Les rapporteurs affirment donc que l'établissement public doit impérativement poursuivre la mission qui lui a été confiée, et ses moyens, qui s'élèvent à environ 26 M€ - dont 30 % sont issus de droits professionnels -, et 233 ETP, renforcés. Ils rappellent, en outre, comme l'ont souligné plusieurs auditionnés, que ce coût annuel de 26 M€ est à mettre en regard des 42 Mds€ de chiffre d'affaires générés, en moyenne, par les SIQO tous les ans.
À ce titre, les rapporteurs s'étonnent du projet de budget proposé par le Gouvernement qui prévoit, à rebours complet des engagements pris, une nouvelle baisse du budget de l'établissement public, de l'ordre de 3,2 %, soit 561 631 €.
En responsabilité, et en pleine crise de la viticulture, les professionnels siégeant à l'Inao avaient voté, en conseil permanent, une augmentation significative des droits acquittés, de l'ordre de 24 % sur trois ans, pour prendre leur juste part à l'effort financier nécessaire à la bonne conduite des missions de l'Inao. Cette augmentation s'était accompagnée d'un engagement de l'État à augmenter à concurrence la dotation pour charge de service public de l'Inao, de façon à maintenir ce modèle de financement original et responsabilisant pour tous les acteurs.
Or non seulement le projet de loi de finances (PLF) prévoit une baisse du budget de l'institut, mais le plafond des droits perçus par l'établissement, dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012 et jamais révisés depuis, n'a pas été augmenté, empêchant donc les professionnels d'accroître leur contribution.
Les rapporteurs appellent donc l'État à honorer ses engagements et à soutenir une filière qui, en pleine crise, a fait le choix courageux d'augmenter de près d'un quart ses droits acquittés. Pour cela il est impératif :
· que la baisse du budget de l'Inao se convertisse en une hausse, pour un montant modeste, de l'ordre de 1,6 M€. Par comparaison, l'étude PestiRiv publiée en 2025 a coûté 11 M€22(*) ;
· d'augmenter les plafonds des droits acquittés par les professionnels, fixés à l'article L. 642-13 du CRPM, et augmenter le plafond du produit total de ces ressources, de sorte à permettre la hausse de 24 % consentie par les professionnels.
La gouvernance de l'Inao
L'Inao repose sur une gouvernance particulière et originale dans le paysage administratif, constituée des professionnels et des représentants des administrations, au sein d'instances dédiées que sont les comités nationaux. En matière de viticulture, il s'agit du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des boissons spiritueuses. Un conseil permanent est en charge des orientations stratégiques. Les professionnels décident donc eux-mêmes des orientations relatives à cette politique publique. Le commissaire du gouvernement peut valider ou s'opposer à ces orientations, mais ne peut pas les modifier. L'objectif de cette construction atypique de dialogue pour une structure administrative est de parvenir à un consensus au service de la protection et de la valorisation des SIQO. Cette particularité est l'une des raisons de la stabilité, de la constance et de la solidité de l'Inao et de la politique des SIQO.
Source : contribution écrite de l'Inao et site internet de l'institut
Ainsi, la filière viticole est-elle une filière complexe, très organisée, mais multipliant les instances. Un équilibre semble être à trouver entre respect de l'identité des terroirs et des traditions locales viticoles et efficacité dans la définition, le financement et la mise en oeuvre des stratégies de la filière, qui devraient être, pour certaines, communs23(*).
Recommandation : Demander à la filière de rationaliser son nombre d'interprofessions et aller vers la fusion de la Cnaoc et de Vin IGP.
Recommandation : Sanctuariser, dans le cadre du débat sur les agences, l'existence de l'Inao et respecter les engagements de l'État en matière d'augmentation conjointe de la contribution des professionnelles et de l'État à la hausse du budget de l'établissement.
B. UNE FILIÈRE DONT LES PRODUCTIONS DOMINENT LE MARCHÉ MONDIAL
1. Des productions diversifiées et d'excellence24(*)
La filière viticole française est une filière d'excellence qui s'explique notamment par la diversité et la qualité de ses productions, 95 % sous appellation, et la profondeur de son offre : vins blancs, rouges, rosés, champagnes, spiritueux, etc. Ses productions sont unanimement reconnues pour leur excellence.
Au sein de l'économie agricole, la viticulture occupe une place prépondérante. En 2021, sur les 387 290 exploitations agricoles françaises, 58 310 sont viticoles, soit 15 % de l'ensemble, occupant une SAU, en 2023, de 782 214 ha, dont 745 000 ha en production, soit seulement 3 % de la SAU totale. 73 % des exploitations ont des surfaces inférieures à 20 ha. Et pourtant, la valeur créée par ces surfaces modestes est considérable25(*). À titre de comparaison avec le premier et troisième producteur mondial de vin, les vignobles italien et espagnol occupent respectivement une superficie de 782 000 ha et de 930 000 ha soit environ 5,82 % et 3,8 % de leur surface agricole utilisée26(*).
a) Les surfaces par segments
En 2023, 56 % du vignoble français est destiné à la production de vin AOP, 27 % en IGP et 5 % en VSIG. On constate une stabilité, entre 2015 et 2023, des surfaces avec, dans le détail, une forte augmentation des surfaces en cognac et une baisse des surfaces en AOP. Les évolutions récentes des surfaces, très importantes, seront traitées dans une partie distincte du rapport.
Source : FranceAgriMer
Le plus grand vignoble demeure, de loin, celui du Languedoc-Roussillon avec une surface de plus de 185 000 ha, soit près d'un quart de la surface totale du vignoble français. Le deuxième vignoble est celui du Bordelais, avec un plus de 119 000 ha. Par comparaison, l'addition des vignobles de Bourgogne, du Beaujolais, de la Savoie et du Jura aboutit à une surface de 50 000 ha.
Source : FranceAgriMer
b) Les productions par segments
Si les surfaces en AOP représentent le double de celles en IGP, il n'en va pas de même pour les productions, en raison du plafonnement des rendements plus strict au sein des cahiers des charges AOP. En 2023, plus de 19 M d'hectolitres (hl) ont été produits en AOP, près de 12 M en IGP et 2,5 M en VSIG, pour une production totale de 33,5 Mhl. Cette production connaît des fluctuations grandissantes en raison du changement climatique, qui fera l'objet de développements particuliers. Ainsi, la production de 2018 s'était établie à 37,8 Mhl, celle-ci s'est effondrée en 2021 à moins de 28 Mhl, pour repasser à 33,5 Mhl en 2023. À noter qu'il s'agit de la production de vin, en incluant la production de vin aux fins de production de spiritueux, la production française s'établit à 47,3 Mhl en 2023, selon les données Agreste.
c) Une bascule historique du vin rouge vers le vin blanc
La France, pays du vin rouge, a connu en 2023 un basculement historique vers le vin blanc, qui représente désormais la production dominante, en lien avec les évolutions des attentes du consommateur. Ainsi, en 2023, sur les 33 Mhl produits, 12,8 M le sont en rouge, 13,4 en blanc et 6,9 en rosé. En réalité, si la proportion de vins blancs a augmenté, c'est aussi et surtout que la production de vin rouge a fortement diminué par rapport à 2018.
d) La France, premier vignoble bio du monde
La mission d'information tient à souligner l'avance de la viticulture en matière de développement des productions sous mention Agriculture biologique. Alors même que l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) fixe l'objectif de 21 % de la SAU cultivée en agriculture biologique au 1er janvier 2030, 23 % des surfaces viticoles le sont déjà en 2023, soit près d'un quart du vignoble, représentant plus de 170 000 ha. Ces chiffres flatteurs font de la France, selon FranceAgriMer, le premier vignoble biologique du monde.
Cette attention à l'environnement s'observe aussi dans le nombre très élevé de certifications environnementales de niveau 3, ou haute valeur environnementale (HVE), souvent première étape dans une démarche d'évolution des pratiques. Selon les données du Masa, alors qu'au 1er juin 2025, 9,6 % des exploitations agricoles sont certifiées HVE, représentant 8 % de la SAU française, 62 % des exploitations viticoles sont certifiées, ce qui est considérable. Dans le Bordelais par exemple, en 2024, 60 % des surfaces sont certifiées.
Si la viticulture est, il est vrai, historiquement grande consommatrice de produits phytopharmaceutiques, il est indéniable qu'elle est également la filière la plus résolument engagée dans des démarches vertueuses.
En outre, de récentes études tendent à montrer que les exploitations en agriculture biologique sont performantes, voire même, concernant notamment la viticulture à l'échelle de l'unité de production, plus performantes que des exploitations conventionnelles. Une publication de 2024 de l'Insee note qu'« En dépit d'un endettement plus élevé en moyenne (les dirigeants étant notamment plus jeunes), les exploitations bio affichent généralement un niveau de rentabilité économique équivalent aux structures en mode conventionnel.
Quatre filières agricoles concentrent 42 % des exploitations AB : maraîchage de plein air, viticulture, élevages de bovins lait et élevages de poules pondeuses. Parmi celles-ci, les résultats économiques rapportés à l'unité de production (hectare, vache, poule) sont bien souvent supérieurs en agriculture biologique, mais les résultats par exploitant non-salarié ne le sont pas toujours, car les exploitations biologiques sont souvent de taille plus petite. »
Il s'agit bien entendu d'un constat global, basé sur des données de 2020. Cinq ans plus tard, chacun peut constater la crise touchant le secteur bio, et notamment le secteur viticole bio.
2. Un leader mondial
a) Une puissance commerciale réelle
La valeur de la production viticole s'élève, en 2023, à 15,5 Mds€, alors même que la viticulture ne représente que 3 % des surfaces agricoles exploitées.
Avec, en 2023, une balance positive des exportations de vins de 11 Mds€27(*) en valeur pour le vin, de 3,76 Mds€ pour les spiritueux, et de 14,73 Mds€ au total, la viticulture est la principale source de l'excédent commercial français en matière agroalimentaire, contrôlant 17 % des parts de marché mondial.
Comme l'a illustré le rapport de septembre 2022 sur la compétitivité de la ferme France des sénateurs Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, le solde positif de la balance agroalimentaire française n'est désormais dû qu'à la performance de son secteur vins et spiritueux. Ce rapport souligne qu'en retranchant ce secteur stratégique, la balance française est déficitaire depuis 2006. Ce constat s'applique aux récentes statistiques pour 2024, qui montrent une nouvelle dégradation de la balance agroalimentaire française, en chute de 27 % par rapport à 2023, à 3 895 M€, et maintenue à flot par un solde vins et spiritueux dégradé, mais toujours significatif de 12 991 M€. À l'échelle de l'ensemble de la balance commerciale française, la filière vins et spiritueux représente le troisième excédent sectoriel, soulignant une fois encore le rôle crucial de cette filière.
Parmi les fleurons français en matière d'exportation figurent les vins de Bourgogne, le champagne ainsi que le cognac.
Source : FEVS
Ainsi, en 2024, sur un total de 10,9 Mds€ d'exportations de vins, le champagne pesait pour 3,8 Mds€, soit plus du tiers de la valeur totale. La Bourgogne, vignoble de 32 400 ha, soit 4 % du vignoble national, exportait pour 1,6 Mds€, soit 14,6 % de la valeur totale des exportations de vin. Autrement dit, les ventes de champagne et de vin de Bourgogne représentent à elles seules, en 2024, 49,6 % de la valeur totale des exportations de vin en 2024, alors même qu'elles ne représentent que 15,6 % des volumes exportés28(*).
Enfin, les exportations de cognac, malgré un net recul, s'élèvent en valeur en 2024 à 3 Mds€, contribuant donc pour plus de 20 % à l'excédent global vins et spiritueux de la France. Au sein même de la catégorie des spiritueux, le cognac représente près de 67 % de la valeur totale, loin devant les liqueurs puis la vodka, et alors même qu'en volume ce taux tombe à 29,7 %. Il convient toutefois de souligner les performances grandissantes de l'industrie française du whisky, dans un contexte baissier pour l'ensemble des autres spiritueux, qui enregistre, en 2024 (+ 21 %) une quatrième année consécutive de croissance de ses exportations29(*).
Les cinq premiers clients de la France sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l'Allemagne et Singapour. On notera l'importance des États-Unis puisque le pays représente, en 2024, 24,5 % du total des ventes à l'étranger, loin devant le Royaume-Uni, à 10,7 %. La Chine poursuit sa fermeture avec un repli de plus de 20 % sur un an, pour tomber à 6,1 % des ventes françaises.
b) Une production en valeur qui surpasse largement celle de la concurrence
À l'échelle de l'Union européenne, qui dispose d'un vignoble 3,08 Mha pour la campagne 2024/202530(*), la France, l'Italie et l'Espagne représentent près des trois quarts des surfaces.
Le plus vaste vignoble est le vignoble espagnol, d'une superficie de 930 000 ha31(*), représentant par là même le plus vaste vignoble au monde (13 % des surfaces), avec une production pour 2023 estimée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) à 31 Mhl.
La France et l'Italie disposent de surfaces inférieures, mais de rendements supérieurs. Les surfaces des deux pays sont proches, 782 000 ha en 2023 pour la France, et 728 000 ha32(*) en 2024 pour l'Italie.
L'Italie est depuis 2007, et à l'exception de 2011, 2013, 2014 et 2023, premier producteur mondial. En 2024, sa production est de 44 Mhl. Pour 2025, sa production attendue serait de 47 Mhl.
Si la France n'est plus, sauf quelques exceptions, le premier producteur européen en volume, son excellence se constate en étudiant la valorisation de ses productions. Avec une production en 2024 d'une valeur de 15,5 Md€ et un solde commercial positif de 14,3 Md€, la France devance très largement l'Italie dont les volumes d'exportation dépassent pourtant les 20 Mhl, contre 11 à 12 Mhl pour la France.
Dans sa réponse au questionnaire de la mission, FranceAgriMer indique que la France exporte à un prix moyen de 9,08 €/l, lorsque l'Espagne et l'Italie plafonnent respectivement à 1,52 € et 3,74 €. La valorisation est ainsi la véritable force de la filière française, même si l'établissement note que le revers de cette stratégie est une plus grande volatilité « en volume, mais surtout en valeur par rapport à ses concurrents, notamment pendant/après Covid ou lors de la période de forte inflation récente. »
La France s'est en outre imposée dans des marchés émergents en véritable leader, à l'image de l'Afrique du Sud où ses exportations de vins représentent 75 % des importations en valeur (39,7 Mds€ en 2024) du pays, devant l'Italie (11 %), l'Australie (4 %) et le Portugal (3 %). Cette dynamique sud-africaine est parallèle à l'essor des ventes de spiritueux, au total, la part en valeur des importations de vins et spiritueux français est passée de 4 % en 2004 à 12 % en 2014 et à 30 % en 202433(*). Également en Australie, la France est passée du deuxième fournisseur de vins du pays en 2014 avec des importations en valeur (167 Mds€), à premier fournisseur en 2024 (255 Mds€)34(*).
Ainsi, la France est-elle véritablement, encore à ce jour, leader sur un marché particulièrement compétitif à l'international. Ce constat est d'autant plus frappant que l'index d'intensité à l'export publié par l'OIV (% exports/prod.) souligne qu'environ 30 % seulement de la production française de vin est exportée, contre environ 45 % pour l'Italie voire même plus de 60 % pour l'Espagne. Se pose, du reste, la question de la dépendance de la filière à la santé du marché national et à l'état de la consommation.
Cette place de leader ne saurait néanmoins masquer la polycrise dans laquelle la filière est entrée, qui se traduit notamment par une dégradation croissante de ses indicateurs de santé économique.
II. ENTRE MUTATION DES CONSOMMATIONS ET CHOCS EXOGÈNES RÉPÉTÉS, UNE FILIÈRE EN CRISE QUI N'A PAS SU ANTICIPER LE MARCHÉ
A. UNE BAISSE MONDIALE DE LA CONSOMMATION TRADUISANT UN CHANGEMENT DE STATUT DU VIN TROP PEU ANTICIPÉ PAR LA FILIÈRE
1. Un déclin continu de la consommation en France et à l'étranger ayant un effet inévitable sur les surfaces cultivées
a) Au pays du vin, une consommation qui s'est effondrée en 60 ans
Le constat d'un déclin de la consommation de vin en France n'est pas nouveau et date de plusieurs dizaines d'années. Le rapport de 2002 de Gérard César en faisait déjà le constat en des termes toujours valables aujourd'hui : « les modes de consommation évoluent, la consommation régulière (27 % des consommateurs) cédant la place à une consommation occasionnelle (63 % des consommateurs), dans laquelle le vin revêt une dimension moins alimentaire, plus festive ». Pourtant, la filière a-t-elle pris la mesure de ce déclin ? Les rapporteurs affirment que non, de même que de nombreux représentants de filières entendus dans le cadre des auditions menées.
Selon les chiffres fournis par FranceAgriMer à la mission, la consommation intérieure taxée, qui regroupe l'ensemble des volumes de vins vendus en France acquittés du droit d'accise, est passée de 39 Mdhl pour la campagne 1985/1986 à moins de 23 Mdhl pour la campagne 2023/2024. La consommation de vin par habitant est passée de 135 litres (l) en 1960 à 41 l en 2023, une division supérieure à trois, ce qui est majeur.
Vin & Société, mobilisant des données Insee, indique dans une étude de 2023 que les Français consommaient en moyenne 200 l tous alcools confondus en 1960, contre 80 l actuellement. Et c'est bien la baisse du vin qui est très majoritairement responsable de cette chute. Sa consommation, très majoritaire en 1960 comme maintenant, a connu une baisse de 70 % depuis 1960, quand les spiritueux et les bières ont connu respectivement une baisse de 9 et 18 %.
La véritable interrogation demeure : jusqu'à quand cette baisse ininterrompue va-t-elle se poursuivre ? En effet, le mouvement ne semble pas terminé et, sachant qu'en 2023, selon les chiffres de l'OIV, la France se place à la troisième place mondiale en matière de consommation de vin par habitant, avec en moyenne 35 litres par an (derrière l'Italie, 36 l, et le Portugal, 52 l), le potentiel de baisse est encore significatif. À titre d'exemple, un Espagnol consomme en moyenne 20 l de vin par an, un Américain, moins de 10 l. Vin & Société, dans la même publication, s'appuyant sur des données de l'observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), montre en outre que depuis 2000, la consommation d'alcool poursuit sa baisse engagée en 1960, avec une diminution de 25 % de la quantité d'alcool mise en vente par habitant en litres équivalents d'alcool pur en 20 ans. Une fois encore, la plus forte baisse se constate pour le vin, avec une baisse de 34 %, soit un tiers, en seulement deux décennies.
Si la consommation moyenne baisse, la proportion de consommateurs baisse également, passant, selon l'enquête FranceAgriMer sur la consommation de vin en France en 2022, réalisée tous les cinq ans depuis 1980, de 51 % de consommateurs réguliers de vin35(*) en 1980 à 11 % en 2022. En additionnant les consommateurs réguliers et les consommateurs occasionnels fréquents, la proportion se monte à 30 %, contre 62 % en 1980. En parallèle, les non-consommateurs ou occasionnels rares sont passés de 19 % à 37 %, soit plus du tiers de la population. Gérard César, dans son rapport de 2002, alertait déjà : « Si tous les consommateurs devenaient occasionnels, il ne se boirait plus que 12 millions d'hectolitres de vin, contre 30 millions d'hectolitres actuellement. »
Source : FranceAgriMer
En termes de nombre moyen de jours de prise par boisson, le vin est en recul de 17 jours en 2022 par rapport à 2015, quand la bière connaît une augmentation de 10 jours.
Nombre moyen de jours de prise par boisson
La même enquête bidécennale nous enseigne que la baisse de la consommation d'alcool, et notamment de vin, est plus marquée chez les jeunes de 18 - 24 ans, ce qui a de quoi inquiéter la filière.
b) Une consommation européenne et mondiale qui décline également
Comme en France, la consommation européenne est en déclin. Selon les chiffres transmis par la Commission européenne, celle-ci était de 101 Mhl en 2024, contre 109 Mhl en 2020, 114 Mhl en 2015 et 120 Mhl en 2010. Cette baisse de la consommation était, jusqu'en 2018, contrebalancée par la hausse de la consommation des pays hors UE. Depuis cette date, cette consommation est aussi déclinante, si bien qu'à l'échelle de la planète, depuis le pic de consommation de 250 Mhl en 2007, on observe un mouvement de fond de baisse de la consommation qui s'établit, pour 2024, à 214 Mhl, soit le niveau le plus bas observé depuis 1961, bien avant l'ouverture de certains marchés d'importance.
Source : Organisation internationale de la vigne et du vin
c) Une baisse de la consommation qui conduit logiquement à une baisse des surfaces
La baisse des surfaces est en France, comme du reste en Italie, un phénomène récent, rendu inévitable au regard des évolutions de la consommation précédemment décrites. La question de l'ampleur que l'ajustement des surfaces doit prendre est en revanche discutée, et fera l'objet de développements en seconde partie du rapport.
En France, les surfaces ont connu une baisse très légère entre 2013 et 2023, de l'ordre de 1 %, passant de 787 325 ha à 782 214 ha. Cependant, cette baisse s'est brutalement accélérée à la faveur des plans d'arrachage mis récemment en place, mais aussi, plus globalement, en raison d'une accélération de la déprise agricole difficilement quantifiable, mais visible notamment via l'augmentation des vignes laissées en friche. L'aide nationale à la réduction définitive du potentiel viticole suite aux conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, aussi appelée « arrachage Ukraine », a permis de financer l'arrachage de 27 450 ha. Le dispositif spécifique mis en place pour le Bordelais aurait, quant à lui, entraîné l'arrachage de 9 200 ha. Au total, ce sont donc environ 36 650 ha qui ont été arrachés uniquement par le biais de ces deux dispositifs, ce qui signifie qu'en 2025, la taille du vignoble national sera assez nettement en dessous de 750 000 ha, sans compter les arrachages non subventionnés. En tenant compte des besoins d'ores et déjà exprimés par la filière, et qui seront abordés en seconde partie du rapport, il est très probable qu'en 2026 ou 2027, le vignoble français passe sous la barre des 700 000 ha, soit un véritable décrochage par rapport à ses principaux concurrents.
À titre d'exemple, en deux ans, en additionnant les arrachages non subventionnés, les arrachages « Ukraine » et les arrachages « sanitaires », Bordeaux a perdu 19 152 ha de vignes pour un vignoble qui, en 2022, en comptait 108 356.
La taille du vignoble français au fil du temps
La taille du vignoble national a considérablement évolué au fil des siècles. En 1808, 1,659 Mha de vignes couvraient la France. Le pic est atteint dans la décennie 1870 avec 2,377 Mha. À partir de cette décennie, les surfaces en vignes n'ont cessé de décroître avec, néanmoins, de très fortes variations départementales, puisque certains vignobles, les plus septentrionaux, vont pratiquement intégralement disparaître (Ille-et-Vilaine, Mayenne, Eure, Oise...), quand d'autres vont connaître un âge d'or, à l'instar du vignoble Bordelais.
Pour François Legouy36(*), géographe, professeur des universités émérite, l'évolution du vignoble français est marquée par deux grandes phases : la première étant un cycle de croissance jusque dans les années 1870, suivi d'un second initié par la crise du phylloxéra, qui atteint tout d'abord le Gard et les Bouches-du-Rhône au milieu des années 1860, pour, en moins de trois décennies, toucher et ravager l'ensemble des vignobles du territoire. À cette « guerre de trente ans » (Garrier, 1989) succède une seconde crise, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, celle de la fraude et de la surproduction, dont l'un des points culminants fut la révolte des vignerons du Languedoc de 1907.
Le XXe siècle sera celui de la mutation du vignoble, quantitative comme qualitative, au gré des évolutions de la demande, des crises (guerres mondiales, crise de 1929...), et des innovations (mécanisation, création des AOC...).
Source : Marcel Lachiver, Cervin, Onivins, RGA
Durant les années 2000, à l'échelle de l'UE, la taille du vignoble est, comme le souligne la Commission européenne dans sa contribution écrite, relativement stable, entre 3,1 et 3,3 Mha, et cela malgré des élargissements successifs, premier signe d'une discrète diminution des surfaces à géographie constante. Comme pour la France, l'accélération du déclin des surfaces est récente, et devrait se poursuivre pour les années à venir. Si entre 2015 et 2020, les surfaces n'ont diminué que de 20 000 ha, passant de 3,24 à 3,22 Mha, entre 2020 et 2024, ce sont 140 000 ha qui ont disparu, avec une surface globale s'établissant à 3,08 Mha.
Selon les données préliminaires de l'OIV, l'Europe représente toujours, en 2024, 45 % du vignoble mondial.
En tout état de cause, on observe que la diminution de la taille du vignoble européen n'a pas tout à fait suivi la baisse de la consommation de ses habitants. En effet, si entre 2010 et 2024, la consommation européenne a baissé de 15,8 %, les surfaces n'ont diminué que de 11 %, essentiellement ces toutes dernières années. De même, à l'exception des années 2023 et 2024, on constate une quasi-stabilité des volumes de production depuis 2010. L'équation européenne, et notamment française, a donc été, jusqu'à récemment, la suivante : baisse de la consommation, mais maintien global des surfaces et des volumes produits37(*). Si l'on peut croire que le surplus a opportunément trouvé à s'exporter, la réalité est là aussi plus contrastée, puisqu'on observe une grande stabilité dans les volumes exportés entre 2010 et 2024, entre 28 et 29 Mhl. Finalement, la filière doit en grande partie son salut à l'augmentation très significative de la valeur générée à l'export, qui a presque doublé entre 2010 et 2024, passant de 8,5 Md€ à 16,7 Md€, à volumes quasi constants. Il en va de même pour le commerce intra-européen, dont la valeur est passée de 5,9 Md€ à 10,4 Md€, alors même que les volumes échangés n'ont que faiblement augmenté. La puissance et la valorisation des grands vignobles français n'est à ce titre pas étrangère à cette dynamique européenne, comme en témoigne le fossé séparant la France des autres pays, notamment l'Espagne, en termes de valorisation de ses vins.
Cependant, lorsque la valorisation atteint un plateau, que la consommation poursuit sa chute, que la concurrence se renforce, que le pouvoir d'achat stagne ou se contracte, et que les aléas géopolitiques et climatiques s'accroissent, la réalité rattrape durement la filière à savoir, selon les points de vue, une surproduction au regard de la demande effective, ou une sous-performance en matière de commercialisation.
Source : Commission européenne
Enfin, à l'échelle mondiale, la tendance à la réduction des surfaces est également observée, de même qu'une forte réduction des volumes, en partie attribuable, notamment pour 2023 et 2024, à des conditions météorologiques très dégradées dans de nombreux vignobles. Les perspectives de la production mondiale de vin pour 2024, publiées par l'OIV font état d'une production entre 227 et 235 Mhl, soit la production la plus faible depuis 1961. La même organisation, dans son rapport State of the world vine ans wine sector in 2024, prévoit une baisse de 0,7 % de la taille du vignoble mondial, à 7,1 Mha. En comparant les courbes de la production et de la consommation de vin de l'OIV, on constate l'excès structurel de l'offre, qui s'est historiquement souvent maintenu à un niveau supérieur à 260 Mhl par rapport à l'état de la consommation, dont le pic historique à 250 Mhl en 2007.
2. Un changement de statut du vin, et une évolution des goûts
La baisse de consommation d'alcool et singulièrement de vin, aussi appelée déconsommation, est donc un processus de fond fortement lié au renouvellement des générations, à l'évolution des moeurs, mais aussi des politiques de prévention.
a) Un effet réel et bienvenu des politiques de prévention
Il est vrai que, pendant longtemps, les effets de la consommation excessive d'alcool n'étaient pas tout à fait documentés. Concernant le vin, en particulier, la théorie du « French Paradox », a notamment permis aux vins français d'augmenter très significativement leurs ventes aux États-Unis.
Le changement de statut du vin est en partie lié à l'évolution des connaissances scientifiques et au développement des messages de prévention relatifs à l'alcool. À cet égard, les rapporteurs souscrivent tout à fait aux invitations à la modération des autorités de santé, souvent résumées ainsi : « pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours »38(*).
L'enjeu de la filière n'est en effet pas de faire consommer davantage les 11 % de consommateurs réguliers, mais bien plutôt de s'adresser aux 32 % de consommateurs occasionnels rares et 37 % de non-consommateurs, et de faire découvrir à un public non averti, de plus en plus large, un produit, véhiculant une histoire et un savoir-faire, source de moments de convivialité.
Dans sa contribution écrite, Santé publique France indique que la proportion de consommateurs dont la consommation d'alcool se situe au-delà des normes de moindre risque est en baisse, et s'établit, pour 2021, à 22 % (contre 23,7 % en 2020)39(*). Les rapporteurs considèrent que les politiques de santé doivent avant tout cibler ce public, de même que les publics à risque comme les enfants, adolescents et femmes enceintes, et que les efforts de la filière doivent s'orienter vers la part de la population, désormais majoritaire, ne consommant pas ou très peu d'alcool, souvent par manque de transmission d'un héritage culturel.
b) Des évolutions sociétales considérables : changement des goûts, des comportements et des moments de consommation
Ce manque de transmission, en lien avec la profonde évolution de la société, est le second facteur déterminant de cet effondrement de la consommation de vin. La rupture observée dans la transmission des habitudes de consommation et de compréhension du vin est directement liée aux évolutions sociétales.
Pendant longtemps, comme l'a souligné le consultant et maître de conférences à Sciences Po Martin Cubertafond en audition, le vin a été considéré comme un véritable aliment, si bien qu'il a pu être servi dans les cantines aux enfants jusque dans les années 1950. Ce statut d'aliment a également été souligné par Vin & Société, dans sa contribution écrite. Ce positionnement du vin a totalement changé au cours du temps, devenant un produit festif de consommation souvent occasionnelle. Le vin est en outre encore très associé à un certain élitisme, d'autant plus lorsque la transmission des codes de cet univers ne se fait plus ou plus suffisamment.
Or, non seulement le statut du vin a changé, mais les occasions privilégiées pour le consommer déclinent. M. Cubertafond rappelle que le nombre de repas pris à table a diminué au cours du temps, notamment pour les plus jeunes générations, et sa sacralisation a connu un déclin, comme le souligne par exemple l'étude Ipsos « Fractures alimentaires en France », de 2021. De même, la consommation de viande a tendance à légèrement décliner au cours du temps et, à l'image du destin croisé du vin rouge et du vin blanc, la consommation de viande bovine, traditionnellement, et dans l'imaginaire collectif, associée à celle de vin rouge, a connu ces 20 dernières années un net déclin au profit des viandes blanches40(*). L'illustration ci-dessous souligne en outre l'évolution des conditions dans lesquelles les repas sont pris, dans un tiers des cas seul, dans la moitié des cas devant un écran. Le repas n'est plus sacralisé comme il pouvait l'être par le passé.
Source : Sondage Ipsos sur les habitudes de prise de repas
Ces évolutions ont un fort impact sur la consommation du vin, boisson de repas de famille autour d'une viande en sauce par excellence. En parallèle, cette boisson, et particulièrement le vin rouge, est encore peu perçue comme la boisson accompagnant des événements festifs en extérieur ou encore des apéritifs et des moments de convivialité après le travail (les « after-work »), à l'instar de la bière ou du cocktail. Le vin est également, du fait de son lourd et encombrant contenant, peu propice à un mode de vie toujours plus nomade.
Les rapporteurs considèrent que la filière n'a pas su adapter son offre à une tendance de fond qui n'est, à la différence d'autres chocs, pas survenue brutalement, mais progressivement et continuellement. En témoigne, par exemple, l'évolution des surfaces AOP plantées en blanc et en rouge dans le Bordelais : le blanc demeure tout à fait minoritaire, il a même décliné sur 20 ans, malgré la crise du rouge que chacun a pu voir venir.
Source : CIVB
L'évolution de la structure du budget des ménages est aussi à prendre en compte, avec une tension croissante sur le volet alimentaire, trop souvent variable d'ajustement d'un pouvoir d'achat limité.
L'impact de la crise sanitaire, puis de l'inflation qui s'ensuivit, se fait toujours ressentir sur certains postes de dépenses et, notamment, comme le soulignent les statistiques de l'Insee sur la consommation des ménages en 2024, le poste « boissons alcoolisées et tabac », en baisse de 5,3 % par rapport à sa tendance (2015-2019) d'avant crise41(*). Dans son analyse de la consommation des ménages par fonction en 2024, on observe en outre que si, en valeur, la consommation de boissons alcoolisées augmente, elle diminue de 5,4 % en volume en 2023, puis encore de 3,6 % en 2024, avec un écart négatif à la tendance 2015-2019 de 8,5 %.
En parallèle de cette tension, depuis 1960, la structure de la consommation des Français a évolué, délaissant massivement les vins de consommation courante, pour se tourner, en adéquation avec le changement de statut du vin, vers des vins de qualité supérieure. La consommation de bière a, en outre, augmenté significativement dans la répartition de cette consommation.
Consommation en boissons alcoolisées
Source : Insee, Les dépenses des ménages en boissons depuis 1960, 2020
Enfin, le vin souffre encore trop d'une réputation de boisson d'élite, nécessitant la maîtrise de certains codes, et donc détournant une partie des consommateurs potentiels. Ce constat s'applique particulièrement aux hommes et moins aux femmes, ayant une relation moins normée au vin. Comme le note Vin & Société, dans sa contribution écrite : « Chez les hommes, le vin est souvent perçu comme un territoire de connaissance, associé à une pression sociale pour manipuler les codes du vin (vocabulaire, gestes rituels). Cette perception cérébrale du vin peut rendre son accès intimidant, expliquant en partie pourquoi certains hommes se tournent vers d'autres boissons comme la bière, perçue comme plus conviviale et simple. Le vin rouge est largement perçu comme le "vrai vin", occupant une place dominante dans les imaginaires collectifs en raison de son association à la tradition, la gastronomie et la maturité. Cette prédominance limite l'émergence d'autres récits autour des vins blancs et rosés, qui peinent à s'imposer malgré leur accessibilité et leur modernité. En revanche, les femmes entretiennent une relation plus spontanée au vin, moins centrée sur les normes sociales, ce qui favorise une expérience davantage axée sur le plaisir du produit. Longtemps perçu comme un univers masculin, le vin s'associe désormais à l'émancipation et au renouveau, porté notamment par des femmes viticultrices, oenologues et sommelières. Leur façon de parler différemment du vin est valorisée par les consommateurs. ».
Il n'en reste pas moins que le vin reste difficile d'accès, comme en témoigne la multiplication des labels et autres mentions valorisantes, venant bien souvent se mêler et se confondre aux SIQO. Face à cette prolifération, les consommateurs ignorent, pour l'essentiel, quelle réalité recouvre telle ou telle inscription sur l'étiquette : bio, HVE (Haute valeur environnementale), Demeter, Terra vitis, Vignerons engagés, biodynamie, nature, sans sulfite, etc.
La même observation pourrait être faite concernant le système de médailles. Dans sa réponse au questionnaire de la mission, la DGCCRF identifie quelque 129 concours en capacité de délivrer des médailles, inscrits au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF).
Cette complexité, l'ensemble des acteurs entendus par la mission la reconnaît et la déplore. Elle se traduit par des rayons de vins en supermarché invitant bien souvent le consommateur à fuir plutôt qu'à faire acte d'achat. L'organisation traditionnelle de ces rayons, par région, tranche avec l'organisation d'autres rayons permettant, par un simple code couleur, de localiser son soda favori par exemple. La richesse et la profondeur de l'offre de vin se transforment, dans ce cas, en un frein à la consommation.
B. DE NOMBREUX CHOCS EXOGÈNES DANS UN CONTEXTE DE FORTE CONCURRENCE
1. La fermeture du marché chinois42(*)
a) Une fermeture brutale
Le marché chinois représentait depuis quelques années un débouché d'importance pour la filière viticole française, quatrième débouché pour l'exportation de vin en volumes, avec 10 % de parts de marché en 2018. Cinq ans plus tard, en 2023, la Chine est le septième débouché français, avec une part de marché tombée à 4 %. En y adjoignant les spiritueux, la Chine demeure, en 2024, le troisième débouché français, désormais à quasi-égalité avec l'Allemagne, mais affichant une chute de la valeur des exportations de 20,2 % en seulement un an.
En l'espace de quelques années, ce marché a subi un double choc à travers une réduction très forte des importations chinoises, et un différend commercial avec l'UE qui s'est traduit, à l'été 2025, par un accord de mise en place de prix minimum pour l'essentiel des exportateurs de spiritueux, pesant sur la filière.
Un temps considérée comme un eldorado pour la filière viticole française, la Chine, et ses 1,4 Md de consommateurs potentiels, a connu ces dernières années une baisse drastique de sa propre production domestique comme de ses importations.
La SAU chinoise a connu une vaste période d'expansion entre 2000 et 2015, suivi d'une phase de léger déclin, pour s'établir à 753 000 ha en 202443(*), soit un niveau quasi-équivalent à la SAU française. La différence majeure, comme le précise le conseiller agricole de l'ambassade de France en Chine, tient en ce que seulement 10 à 15 % de ces surfaces sont effectivement destinées aux grappes de cuve.
Les données de production chinoises diffèrent selon que l'on se réfère aux statistiques OIV ou aux statistiques du bureau national des statistiques de Chine (NBS), même si la tendance est similaire. Selon les données de ce dernier, là où la production chinoise atteignait un pic de production à 1 281 Mhl en 2013, celle-ci s'établit à seulement 214 Mhl en 2022, témoignant de l'effondrement de la production.
En matière d'importations, les chiffres sont, là aussi, à la baisse puisque la Chine importait, en 2024, pour 3,5 Md€ de vins et spiritueux (2 Md€ en spiritueux et 1,5 Md€ en vins), soit son niveau le plus faible (hors 2020) depuis 2016. Cette situation impacte directement les exportateurs français puisque, avec 415 M€ de vins en 2024, soit un tiers des importations de vins chinoises en valeur, et 1 Md€ de spiritueux, soit la moitié des importations en valeur, la France était jusqu'à peu, le premier exportateur en Chine. Ces données 2024 sont en baisse constante :
· de 10 % pour le vin sur une année, avec un niveau comparable à celui de 2010 ;
· de 30 % pour les spiritueux sur une année également.
La contribution écrite du conseiller agricole conclut que « sur le marché des vins et spiritueux, la part de marché de la France est revenue à son niveau avant Covid et 2024 met fin à une période d'exportation faste de 2021 à 2023 ».
Cette situation doit se comprendre au regard de plusieurs facteurs impactant négativement la consommation et, par suite, les importations :
· les mesures mises en place par le président chinois visant à lutter contre la corruption au sein des entreprises publiques. Le règlement chinois de 2013 visant à lutter contre la corruption a abouti à plus de 2,5 M de sanctions prononcées, et ce règlement a fait l'objet d'un durcissement en 2025 avec, par exemple, le passage d'une interdiction de consommation des alcools de luxe dans le cadre des relations de travail à une interdiction de consommation de tout alcool, sauf certaines exceptions ;
· le renforcement des lois sur la conduite en état d'ivresse ;
· les effets du Covid, qui a entraîné un accroissement de la consommation à domicile, défavorable au vin, car il se consomme majoritairement à l'extérieur du foyer ;
· la crise immobilière du pays, impactant le pouvoir d'achat des ménages ;
· un regain d'attrait pour des vins moins chers, favorable aux producteurs australiens ;
· la concurrence des boissons alternatives.
En conséquence, la consommation de vin par habitant poursuit sa diminution depuis le pic de 2017 à 0,14 l par an, pour s'établir, en 2022, à 0,05 l par an. On observe donc une baisse de la consommation de vin de 70 % entre 2017 et ses 19,3 Mhl écoulés et 2022, à 5,5 Mhl. À noter que cet effondrement ne s'observe en revanche ni pour la bière ni pour les spiritueux, qui connaissent une baisse modérée de leur consommation.
L'ensemble de cette dynamique impactant les exportations françaises est gravement accentuée, dans le cas des spiritueux, par l'épisode des droits de douane entre janvier 2024 et août 2025.
b) Droits de douane : un accord a minima pénalisant toujours fortement la filière des spiritueux
Le 5 janvier 2024, dans le cadre de l'enquête lancée quelques mois plus tôt par l'UE sur les subventions chinoises accordées aux véhicules électriques, la Chine a annoncé le lancement d'une enquête antidumping sur les spiritueux européens, dont 99 % sont français. La filière française s'est donc retrouvée, malgré elle, au coeur d'un conflit dont elle est pourtant tout à fait étrangère.
L'enquête a duré un an et demi et, le 11 octobre, la Chine a mis en place un régime de cautionnement pour la mise en oeuvre de droits provisoires. La menace pesant sur la filière était celle de l'établissement de droits définitifs allant, selon les entreprises, de 27,7 % à 34,9 %.
Finalement, après la mobilisation intense de la filière, de l'ambassade de France en Chine, du Gouvernement, du Président du Sénat, des parlementaires et de la Commission européenne, une mesure de « moindre mal » a finalement été trouvée, à savoir l'application d'un tarif minimal sur les bouteilles de spiritueux vendues en Chine. La disparition, en dehors de tout cadre légal, du cognac des duty free chinois a également trouvé une issue favorable.
Les rapporteurs rappellent néanmoins que cette solution n'est pas satisfaisante à plusieurs titres.
Premièrement, si elle évite des droits de douane d'une trentaine de pour cent, elle renchérit tout de même le prix à payer pour le consommateur chinois, au pire moment. Le BNIC estime que ces prix minimums, qui varient selon les opérateurs et les catégories de vieillissement, renchériront de 15 à 20 % le prix de la bouteille, ce qui est loin d'être négligeable.
Deuxièmement, elle ne concerne pas toutes les entreprises, mais 90 à 95 % d'entre elles. Autrement dit, pour de petites unités, la question de la survie économique se pose puisque, comme l'indique la MVS dans sa réponse au questionnaire de la mission, le régime mis en place conduit en pratique à leur exclusion du marché chinois. Le BNIC précise que cette situation concerne 42 opérateurs représentant, en 2023, 3,2 % des volumes. L'interprofession accompagne toujours actuellement ceux d'entre eux qui le souhaitent sur ce dossier.
Enfin, si la situation peut être considérée comme momentanément stabilisée, elle n'en reste pas moins tributaire de la volonté de la partie chinoise, qui peut décider à tout moment que le régime très strict de reporting imposé aux entreprises françaises n'est plus respecté et, par suite, appliquer les droits de douane initialement prévus pour réduire fortement, voire couper, l'accès à son marché.
Selon la MVS, entre août 2024 et juillet 2025, les importations d'eaux-de-vie de vin ou de marc français ont été divisées par plus de deux, passant de 770 M€ sur la période précédente, à 707 M€. À ces pertes économiques colossales, il convient d'ajouter, pour la filière et les grandes entreprises concernées, des frais d'avocats de plusieurs millions d'euros, mais aussi, et surtout le lien fortement détérioré entre le consommateur chinois et la filière, en raison de la désorganisation des réseaux de distribution ainsi que de l'enquête elle-même. Comme l'indique le BNIC dans sa réponse au questionnaire de la mission, « des décennies de travail marketing qu'il nous faut maintenant reprendre quasiment à zéro ».
Or il convient de rappeler que, concernant le cognac, cette filière génère, selon les chiffres du BNIC, 14 500 emplois directs, dont 4 429 viticulteurs et bouilleurs de cru. Elle ferait vivre 72 500 personnes grâce à sa puissance exportatrice, dont le fer de lance est de puissants groupes et un réseau de 243 maisons de négoce. 97,5 % du cognac étant consommé à l'étranger, une fermeture, même partielle, du marché chinois est susceptible d'avoir un impact important, et d'autant plus important que la filière a vu, en parallèle, son principal débouché se tendre également, à savoir les États-Unis.
2. Les tensions commerciales avec les États-Unis
Les États-Unis sont, de très loin, le premier client en valeur de la filière viticole française, et le deuxième en volume, derrière l'Allemagne. Ce débouché est donc absolument stratégique.
Les tensions commerciales avec les États-Unis débutent en octobre 2019, lorsque le pays est autorisé par l'OMC à appliquer des sanctions à concurrence de 7,5 Md$ par an, dans l'affaire des subventions accordées à Airbus par l'Union européenne. Quelques mois plus tard, l'UE sera autorisée à faire de même, à hauteur de 3,5 Md$, dans le cadre des subventions accordées à Boeing par les États-Unis. Les droits de douane mis en place par les États-Unis variaient de 10 à 25 % selon les produits et ont été appliqués d'octobre 2019 à mars 2021, date de leur suspension par l'administration Biden. En 16 mois de tensions commerciales, les pertes pour la filière se sont élevées, selon les chiffres communiqués par la FEVS, à 560 M€.
Avec le début du second mandat de Donald Trump, les tensions ont repris de plus belle et, après plusieurs mois d'incertitude défavorables au commerce, un accord a été trouvé en juillet 2025, prévoyant l'application de 15 % de droits de douane sur les vins et spiritueux européens. Malgré les efforts du commissaire européen chargé du commerce et de la sécurité économique, Marcos Sefcovic, l'UE n'a pas réussi à obtenir l'exception un temps espérée pour la filière vins et spiritueux. À cette situation s'ajoute un taux de change très défavorable pour les exportations nationales, renchérissant le prix de l'ordre d'une dizaine de pour cent selon la filière.
Comme le souligne la FEVS, depuis 1997, les droits de douane étaient nuls sur la plupart du commerce de spiritueux et de 2,5 % pour les vins européens exportés aux États-Unis. Le changement de politique est donc brusque, et nul doute que ses effets se feront sentir sur le long terme dans l'ensemble de la filière. La FEVS rappelle également qu'une hausse de 1 % du prix implique « une baisse mécanique de 0,8 % des volumes vendus. Or, nos prix progressent de près de 30 %, entre les droits de douane et le taux de change... ».
Il ressort des épisodes chinois et américain que la filière viticole française se trouve trop souvent prise pour cible à l'occasion d'épisodes de tensions internationales, ce qui contribue à déstabiliser une filière d'ores et déjà en situation de fragilité, et des pans de cette filière dépendant quasi-intégralement des exportations pour prospérer. Cette situation n'est, du reste, pas nouvelle, puisqu'en 2013, en réplique à une taxe européenne sur les panneaux solaires chinois, le pays avait annoncé lancer une enquête antidumping sur les vins européens. Un accord avait alors été trouvé, évitant à la filière des pertes dans un conflit ne la concernant, une fois encore, en rien.
3. Une concurrence féroce parmi les producteurs de vin et avec les autres boissons
En parallèle de chocs de nature géopolitique, à l'instar des tensions évoquées avec les États-Unis et la Chine, mais aussi les conséquences de la guerre en Ukraine (hausse du prix des matières premières, arrêt net des exportations, notamment de champagne en Russie, etc), la filière viticole fait face à une concurrence exacerbée, d'une part des autres pays producteurs, et, d'autre part, des autres types de boissons ayant les faveurs de plus en plus de consommateurs.
a) La concurrence des pays producteurs
Le vin est désormais un produit global, et si la France demeure leader en matière de valeur des exportations, de nombreux pays, historiquement producteurs44(*), mais aussi dits du « Nouveau Monde »45(*), sont désormais solidement installés dans le paysage viticole mondial. Leur force est bien souvent leur capacité à projeter à l'international de puissantes marques, à l'instar de l'entreprise australienne Penfolds, et des messages clairs pour le consommateur, souvent articulé autour du cépage plus que du terroir.
Ainsi, au fil des années, la France a vu ses marchés, notamment en volume, progressivement grignotés par ses concurrents.
Sur un temps relativement long, le recul de la France en volume, est tout à fait notable puisqu'elle représentait 22 % des exportations mondiales sur la période 2000-2004, contre seulement 12 % en 2023. En valeur, la part de marché française s'établit cependant à 17 % en 2023, en recul de 0,7 point par rapport à 2022. La France contrôle en outre 55 % des parts de marché en UE.
On constate donc que la France valorise ses productions au détriment, toutefois, des produits d'entrée de gamme générant des volumes. FranceAgriMer indique ainsi, dans sa réponse au questionnaire, qu'en 10 ans, les exportations françaises ont diminué de 11 % en volume, mais augmenté de 51 % en valeur.
L'établissement public indique que si les raisons des pertes de marchés de la filière sont très variables selon les pays, les pays du « Nouveau Monde » ont particulièrement performé en Asie, au détriment des producteurs historiques. Ainsi, par exemple, si la France, l'Espagne et l'Italie représentaient, en 2000, 90 % des importations chinoises de vin, seule la France demeure dans le top 3 en 2024, les principaux fournisseurs de la Chine étant le Chili (33 %) et l'Australie (28 %), particulièrement depuis la récente levée des droits chinois sur ce dernier pays.
b) La concurrence des autres boissons
La filière viticole fait aussi face, comme précédemment exposé, à l'évolution des consommations, à la baisse globale de la consommation d'alcool et, en son sein, à l'effondrement de la consommation de vin, notamment de vin rouge, en lien avec les évolutions sociétales de ces dernières décennies.
La filière est désormais concurrencée par une offre tout à fait diversifiée de boissons alcoolisées, avec notamment le succès de la bière et des cocktails, mais aussi de boissons non alcoolisées, plus en phase avec la demande d'un segment grandissant de la population.
Au fil des années, le poids de la bière dans les habitudes de consommation des Français s'est accru. Si en 1960, la bière représentait environ 19,5 % de la consommation globale d'alcool, ce poids est, en 2021, d'environ 40 %. Le poids du vin a, en revanche, connu une évolution inverse : d'environ 63,5 % de consommation globale en 1960, il représente aujourd'hui environ 20 % seulement.
La consommation de bière n'échappe certes pas à la tendance de fond de la baisse de la consommation d'alcool (de 39 à 32 litres), mais, par des stratégies de diversification, d'offres ultra locales et de marketing, elle est parvenue à se maintenir à un niveau élevé de consommation à travers le temps, là où le vin s'est effondré. Ainsi, selon les baromètres SoWine, dans le pays du vin, ce dernier est concurrencé, voire dépassé selon les années, dans le classement des alcools préférés des Français. Signal positif, en 2024 et 2025, le vin est redevenu, de peu (58 %), la boisson préférée des Français, devant la bière (56 %), le champagne (35 %) et les cocktails (27 %). À noter que selon le baromètre 2021, l'écart entre le vin et la bière était de 11 points en faveur du vin, témoignant de l'évolution récente des goûts, en défaveur du vin.
Comme le note FranceAgriMer dans son enquête sur la consommation de vin en France en 2022, « la consommation de bière s'ancre dans le quotidien, avec une augmentation de la consommation régulière, en semaine comme le week-end ».
Dans sa publication de 2020 « Les dépenses des ménages en boissons depuis 1960 », l'Insee souligne qu'« en 2018, les ménages consacrent 2,9 % de leur budget aux boissons consommées à domicile. Cette part a fortement baissé en 60 ans ; elle s'élevait à 6,4 % en 1960. Les préférences des consommateurs ont évolué : dans le budget boissons, la part des dépenses en boissons alcoolisées s'est réduite au profit des boissons non alcoolisées. En moyenne, par an, un ménage français dépense 476 euros en boissons non alcoolisées et 707 euros en boissons alcoolisées. (...) Les plus jeunes se tournent davantage vers la bière et les plus modestes consomment plus de sodas. »
Cette dynamique du marché des boissons non alcoolisées est portée par de récentes initiatives associatives ayant un écho grandissant, à l'image du « janvier sans alcool », ou « dry january »46(*).
Moins extrême que l'invitation à stopper toute consommation d'alcool, et selon une enquête du cabinet de consultants Nutrimarketing de février 2025, la tendance « NoLo », pour « No alcohol - low alcohol » s'accroît, surtout auprès des consommateurs les plus jeunes. On y apprend que ce marché atteint déjà 11 Md€ et qu'il devrait croître en moyenne de 7 % par an jusqu'en 2029. Sur ce marché du « NoLo », là aussi la bière a su tirer son avantage, par la création d'un segment sans alcool depuis de nombreuses années maintenant.
C. EN CONSÉQUENCE, UNE FILIÈRE QUI VOIT ROUGE
1. Des indicateurs économiques qui virent au rouge
Malgré l'excellence de la filière viticole, internationalement reconnue, et des chiffres toujours flatteurs, force est de constater que la crise s'installe, comme en atteste le discours de l'ensemble des interlocuteurs entendus par la mission. Cette crise, qui concerne inégalement les vignobles, se traduit dans de plus en plus d'indicateurs économiques qui tendent, pour l'essentiel, vers le bas. Comme démontré précédemment, cette crise est multifactorielle, mêlant éléments conjoncturels peu prévisibles et problématiques structurelles clairement anticipables.
D'ores et déjà, on observe une diminution de l'indice des prix à la production (Ippap), soulignant la difficulté de la filière à créer de la valeur. L'Ippap 2024, qui reflète les prix pratiqués par les producteurs pour leurs productions en vrac, est en effet pratiquement égal à son niveau de 2020, voire inférieur, notamment pour les AOP.
Évolution des Ippap viticoles (base 200 année 2000)
|
Année |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
vins |
100 |
106,3 |
118,5 |
108,2 |
101,4 |
|
AOP |
100 |
110,4 |
124,9 |
107,1 |
95,5 |
|
IGP |
100 |
103,1 |
113,5 |
104,2 |
101,2 |
|
VSIG |
100 |
106,7 |
110,2 |
100,2 |
96,5 |
Source : Insee
Les données transmises par FranceAgriMer, illustre bien la globale stagnation, à l'échelle nationale, du prix de l'hectolitre de vin IGP. Pour les blancs, le prix moyen s'élevait à 102,85 €/hl en 2014, il s'établit en 2024 à 110,25 €/hl, une augmentation sans commune mesure avec l'inflation. Pour les rosés, le prix moyen s'élevait à 90,02 €/hl en 2014, contre 86,05 €/hl en 2024. Pour les rouges, l'hectolitre se vendait en moyenne 87,86 €/ hl en 2004, et 90,05 €/hl en 2024. La dynamique sur 10 ans est similaire pour le segment des VSIG.
Dans le Bordelais, les données des trois dernières campagnes fournies à la mission attestent, là encore, d'une stagnation sur trois campagnes, voire, pour certains segments, d'une diminution du prix. Ainsi, le prix moyen d'un contrat en achat vrac d'un AOC Bordeaux rouge était de 955 € le tonneau de 900 l pour la campagne 2022/2023, quand ce même tonneau s'échangeait à 943 € en 2024-2025. Les appellations les plus prestigieuses ne sont pas épargnées, puisque le même volume d'AOC Saint-Émilion s'échangeait pour 3 993 € en 2022-2023, contre 3 320 € pour 2024-2025. La presse spécialisée s'est en outre fait l'écho de la catastrophique campagne des primeurs 2025, avec des baisses de prix sur les plus grands domaines.
Ces baisses de prix enregistrées dans le Bordelais sont à inscrire dans un contexte de réduction des surfaces et du potentiel de production, qui aurait pu laisser espérer un rééquilibrage de l'offre et de la demande. Or, on constate au contraire que malgré des productions 2023 et 2024 faibles, les prix baissent et les stocks augmentent.
|
2015 |
2024 |
Taux d'évolution |
|
|
Production toutes AOC Gironde (hl) |
5 325 154 |
3 338 214 |
- 40 % |
|
Stocks toutes AOC Gironde |
7 012 657 |
9 189 900 |
+ 31 % |
|
Surfaces toutes AOC Gironde |
111 703 |
95 211 |
- 15 % |
Source : FGVB
Aussi, il n'est pas étonnant de constater que l'excédent brut d'exploitation (EBE) des exploitations viticoles connaisse une baisse. En 2023, ce dernier est d'environ 106 000 €, un niveau inférieur à 2015. Le résultat courant avant impôts s'établit à 72 000 €, contre près de 81 000 € en 2015.
Cette dégradation s'observe, comme précédemment indiqué, dans la dégradation des parts de marché de la filière. FranceAgriMer a réalisé, dans sa publication sur les performances à l'export des filières agricoles et agroalimentaires françaises précédemment mentionnées, d'une part, une analyse à double entrée de l'évolution, à la hausse ou à la baisse, des parts de marché de la France et, d'autre part, de l'évolution, de l'amélioration à la détérioration, de la part de marché de la France par rapport à son principal concurrent, à savoir l'Italie. Le constat de l'agence est que la filière vins et spiritueux connaît non seulement une baisse de ses parts de marché, mais aussi une détérioration de sa position par rapport à l'Italie.
À ce constat général, il faut ajouter des constats particuliers, témoignant de la violence de la crise frappant certains vignobles.
Fort logiquement, le prix des terres agricoles suit cette dynamique de crise. Dans sa publication « Le prix des terres 2024 », la FNSafer note : « La crise viticole se poursuit et la baisse du prix moyen du bassin Bordeaux-Aquitaine s'accélère en 2024 (- 18,4 %). Les Bordeaux et les côtes de Bordeaux s'échangent désormais sur les mêmes bases de prix, à 8 000 euros/ha en moyenne. Les baisses des appellations intermédiaires se poursuivent également, telles que Saint-Emilion (- 7 %). Les appellations communales les plus prestigieuses Pauillac et Margaux n'échappent plus à la tendance. »
· · La FNSafer note ainsi, dans sa contribution écrite, qu'entre 2019 et 2024, le prix des terres en appellations Bordeaux a été divisé par deux, de même que pour certaines appellations en côtes de Bordeaux.
2. Des opportunités qui tardent à se dessiner
L'une des forces de la filière viticole française tient en la diversité de ces clients internationaux, lui permettant de faire face, dans une certaine mesure, aux aléas pouvant affaiblir une relation commerciale. En effet, selon FranceAgriMer, la France exporte dans 196 pays, un chiffre plus important que ses concurrents, et son indice de concentration volumique des trois premiers marchés demeure assez faible.
Ainsi, en 2023, passé les 10 premiers clients de la filière, la catégorie « autres clients » représentait 25 % des volumes exportés et 33 % de la valeur. En 2020, ces valeurs étaient respectivement de 20 % et 30 %, ce qui souligne l'effort des acteurs pour conquérir de nouveaux marchés et sécuriser leurs débouchés. Cependant, avec les incertitudes quant au marché américain, la fermeture du marché chinois et l'atonie du marché britannique, qui pénalise durement les exportations de champagne, la France voit ses trois premiers débouchés, qui ne sont certes pas les seuls, devenir à risque.
Dans ce contexte, la filière se tourne vers des marchés porteurs, à l'image de l'Afrique du Sud, du Nigéria ou encore des Émirats arabes unis. Cependant, d'autres opportunités tardent à se concrétiser.
C'est notamment le cas de l'accord avec le Mercosur, attendu par la filière, avec ses pays en croissance et l'émergence d'une classe moyenne se familiarisant avec les vins régionaux, comme le Brésil, l'Argentine ou le Chili, trois pays producteurs. La levée des barrières douanières prévue par l'accord avec le Mercosur devrait permettre aux vins français de devenir compétitifs sur ces marchés.
De même, au cours des auditions, il a été mentionné l'accord en cours de discussion avec l'Inde, pays de 1,4 Md d'habitants, peu ouvert à la filière française du fait de droits de douane prohibitifs. Le chiffre de 150 % de droits avait été notamment avancé en audition, chiffre également mentionné dans la presse spécialisée par Vianney Meynier, chef de pôle Business France pour l'Asie du Sud : « Les droits de douane à l'entrée atteignent 150 % auxquels il faut ajouter un coefficient supplémentaire de 7 à 10 selon l'État ».
En 2024, la Commission européenne a publié une analyse de l'impact cumulé des 10 accords de libre-échange actuellement en négociation, incluant ceux avec le Mercosur et l'Inde, sur l'agriculture européenne. Pour le secteur « Beverages and tobacco », catégorie composée, dans les exportations européennes pour 60 % de vins et spiritueux, l'impact anticipé est positif, tant dans le scénario conservateur que dans le scénario optimiste. La publication, disponible uniquement en anglais47(*), précise (traduction proposée) : « La balance commerciale globale de l'Union européenne dans le secteur des boissons et du tabac s'améliore de 111 millions d'euros (0,4 %) dans le scénario conservateur et de 461 millions d'euros (1,5 %) dans le scénario ambitieux. Sa balance commerciale avec les dix partenaires commerciaux avec lesquels elle a des accords de libre-échange s'améliore encore davantage de 114 millions d'euros dans le scénario conservateur et de 470 millions d'euros dans le scénario ambitieux, transformant une balance commerciale négative en balance positive dans les deux scénarios. Les pays qui enregistrent les plus fortes hausses des exportations de l'UE sont l'Inde, la Malaisie et le Mercosur, notamment dans le scénario ambitieux ».
Il est dès lors aisé de comprendre que la filière est en demande de ce type d'accords, dont les pas de temps en matière de négociation et de mise en oeuvre se comptent en années voire en décennies. Ces accords contribuent, en outre, à assurer une meilleure protection et reconnaissance des appellations.
Les rapporteurs ont toutefois conscience que la question des accords de libre-échange est sensible puisque, par définition, certains secteurs seraient plutôt gagnants, quand d'autres seraient plutôt perdants. En la matière, ils partagent la position du Gouvernement français consistant à demander la plus haute exigence en matière de garanties apportées à l'ensemble des filières agricoles, notamment en matière de respect des normes.
3. En conséquence, un mal-être réel et croissant
La filière viticole n'échappe pas au constat général et inquiétant d'un mal-être croissant, qui peut être source de profond découragement dans l'exercice du métier, voire conduire, dans les cas les plus extrêmes, à des suicides. Et cela, alors même que la viticulture est statistiquement plus épargnée par la précarité économique que les autres filières agricoles.
Lorsqu'un viticulteur est injustement pointé du doigt, c'est toute une filière qui est insultée, dans son histoire et dans son engagement au quotidien pour faire vivre un secteur économique majeur, étendard de la France à l'international.
En matière de prévention et de lutte contre le mal-être agricole, les rapporteurs de la mission d'information tiennent à souligner le chemin parcouru depuis l'alerte qu'ont constitué le rapport du 17 mars 2021 d'Henri Cabanel et de Françoise Férat sur les moyens mis en oeuvre par l'État en matière de prévention, d'identification et d'accompagnement des agriculteurs en situation de détresse, ainsi que celui du 2 décembre 2020 d'Olivier Damaisin sur la politique de prévention des suicides dans le monde agricole. Ces rapports, ainsi que l'impact considérable du film de 2019 d'Édouard Bergeon, Au nom de la terre, ont contribué à mettre en lumière la problématique du mal-être en agriculture et le manque de coordination des acteurs pour prévenir, détecter, sensibiliser et lutter contre ce fléau qui touche trop silencieusement nos campagnes.
Ainsi, le 23 novembre 2021, s'appuyant sur les recommandations des rapporteurs précités, une feuille de route Prévention du mal-être et accompagnement des agriculteurs en difficulté49(*) a été dévoilée par les ministres chargés de la santé, des solidarités, du travail et de l'agriculture, soulignant bien la transversalité de la problématique et, par suite, l'impérative action interministérielle. Les trois piliers de cette feuille de route sont : humaniser, aller vers et prévenir et accompagner. Une circulaire interministérielle du 31 janvier 2022 est venue préciser la mise en oeuvre de la stratégie et notamment la mise en place de comités départementaux dédiés à la prévention du mal-être agricole, dans le but de mettre en oeuvre localement les mesures de la feuille de route et, notamment, de renforcer et professionnaliser le réseau des sentinelles en agriculture, dans une logique de repérage précoce des personnes en difficulté.
Pour assurer le déploiement de la feuille de route, un coordinateur national interministériel a été nommé, Daniel Lenoir, auquel a succédé Olivier Damaison, entendu dans le cadre des auditions menées par les rapporteurs. À la suite d'un rapport de Daniel Lenoir de 2023 faisant le bilan des premières actions menées, et formulant 43 recommandations, les objectifs du coordinateur national ont été concentrés sur l'appropriation des mesures de prévention du mal-être et du suicide par les acteurs territoriaux. Sept chantiers ont été identifiés :
· renforcement de la prévention du suicide ;
· accès aux droits ;
· résilience face aux chocs économiques, climatiques ou sanitaires ;
· reconnaissance des maladies et accidents professionnels ;
· prévention des risques psychosociaux et amélioration des conditions de travail ;
· conciliation des vies professionnelles et personnelles ;
· accompagnement des transitions agricoles.
Les rapporteurs tiennent notamment à saluer la consolidation d'un réseau formé d'environ 5 000 sentinelles sur le territoire, ainsi que, de manière générale, la meilleure coordination des acteurs locaux en matière de mal-être agricole. De même, l'aide au répit en cas d'épuisement professionnel, mise en place par la MSA, véritable cheville ouvrière du plan interministériel contre le mal-être, est une initiative tout à fait fondamentale pour les agriculteurs en situation de burn-out. Cette aide doit être pérennisée et son financement sécurisé.
Illustration de l'accentuation du mal-être agricole, mais aussi de l'efficacité du réseau des sentinelles, la MSA a traité 5 800 signalements en 2024, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2023. Elle a, en outre, enregistré plus de 3 400 appels sur Agri'écoute, service d'écoute dédié au monde agricole et rural fonctionnant 24h/24 et 7J/7.
Le baromètre e-santé « Amarok »
En Bourgogne, la CAVB a mis en place un baromètre e-santé « Amarok », en partenariat avec l'association éponyme, permettant d'en apprendre davantage sur ce que ressentent les viticulteurs.
Le viticulteur est invité à répondre à un questionnaire qui permet de le situer soit en « balance positive », soit en « balance négative », selon une méthodologie innovante développée par Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier reposant sur des « satisfacteurs » et des « stresseurs ». Lorsqu'une personne se situe en « balance négative », un questionnaire supplémentaire est envoyé, avec son accord, dans le but d'opérer un dépistage de situation de burn-out et, le cas échéant, déclencher l'accompagnement approprié.
Selon les chiffres communiqués à la mission, à date du 13 octobre 2025, 70 % des 575 répondants sont en « balance négative », c'est-à-dire que « la personne est considérée comme rencontrant des difficultés quotidiennes dans la gestion de son exploitation et cela est en mesure d'affecter, plus ou moins fortement, sa charge mentale et sa santé. »
Pire, parmi les répondants en situation de balance négative, 88 % font l'objet d'un dépistage positif au burn-out, soit 62 % de l'ensemble de l'échantillon. Parmi eux, 61 ont demandé une prise en charge immédiate par un psychologue d'Amarok, avant une orientation vers les dispositifs existants.
À noter que des évaluations ont également été menées en lien avec la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et avec la MSA du Languedoc. Sur chaque échantillon, le pourcentage de balance positive ne s'élevait respectivement qu'à 34,2 % et 31,1 %. Des résultats soulignant une fois encore l'ampleur du mal-être agricole.
La massification du recours à cet outil fait d'ailleurs l'objet de la recommandation 27 du rapport de Daniel Lenoir, et faisait déjà l'objet de la recommandation 21 du rapport de Françoise Férat et Henri Cabanel.
Les rapporteurs notent enfin que, malgré la mobilisation réelle de nombreux acteurs en faveur d'une meilleure détection et prise en charge du mal-être agricole, la connaissance du phénomène du suicide en agriculture demeure perfectible. En effet, si la MSA, conformément à une recommandation du rapport de François Férat et Henri Cabanel susmentionné, publie annuellement dans son rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits au titre de 2026, des statistiques sur le risque de suicide50(*), elle n'effectue en revanche pas de suivi statistique exhaustif du phénomène, faute d'accès aux données. Cet état de fait a notamment été souligné par le coordinateur national en audition.
Pour 2022, la triste conclusion des analyses menées par la MSA est la suivante : « En 2022, le risque de suicide dans la population agricole est supérieur à celui de la population générale, quel que soit le type d'affiliation (salariés agricoles ou non-salarié agricole) ». Au sein de la tranche d'âge des 15-64 ans, le surrisque est considérable, s'établissant à 45,7 %, en nette augmentation par rapport à 2018, que ce soit chez les salariés ou les non-salariés agricoles.
Source : Rapport au ministre chargé de la
sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des
charges
et des produits au titre de 2026
Recommandation : Poursuivre la politique de prévention et de lutte contre le mal-être agricole en :
· pérennisant, généralisant et sécurisant le financement de l'aide au répit administratif mis en place par la MSA.
· disposant de données annuelles et fiables sur le nombre de suicides en agriculture, ainsi que leurs causes.
· généralisant l'usage du baromètre e-santé « Amarok ».
4. Dans ce contexte, comment encourager les jeunes à s'installer ?
Dans ce contexte a minima morose, voire, dans certaines zones, tout bonnement intenable, la question de l'installation se pose forcément.
Le rapport législatif de janvier 2025 des rapporteurs du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture des rapporteurs Laurent Duplomb et Franck Mennonville soulignait le risque réel d'une « désagricolisation » de la France, sachant que, selon les prévisions de la Cour des comptes, le nombre d'exploitations devrait passer de 389 779 en 2020 à 292 592 en 2035.
En effet, 60 % des exploitants agricoles actifs en 2020 auront atteint l'âge légal de la retraite à horizon 2030. Ce constat s'applique à l'agriculture de manière générale comme à la viticulture, puisque le taux de remplacement y fluctue selon les années, entre 68 % et 75 %.
Source : contribution écrite de JA
Dans sa contribution écrite, le syndicat Jeunes agriculteurs (JA) souligne le manque d'accompagnement des cédants vers la retraire, et la problématique de la mise en relation de ceux-ci avec les repreneurs. C'est cette problématique de la mise en relation que l'article 24 de la loi d'orientation agricole a tenté d'améliorer, avec la mise en place d'un point d'accueil département unique chargé de proposer, cinq ans avant qu'un exploitant agricole atteigne l'âge légal de départ à la retraite, une transmission des caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession. Sans réponse de l'exploitant, la proposition du point d'accueil à l'exploitant est renouvelée annuellement, dans le but de l'inciter à établir ce lien. En outre, le point accueil est accessible à toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole, et vise à favoriser la mise en relation entre les cédants et les repreneurs. Les rapporteurs ne peuvent qu'être favorables à ce dispositif.
Le syndicat JA souligne par ailleurs la problématique de l'évaluation des exploitations agricoles, qui peut être, au choix du cédant, économique ou patrimoniale. Il souligne que « beaucoup de cédants optent pour une évaluation patrimoniale, notamment lorsque leur exploitation comporte des bâtiments qui font rapidement monter la valeur patrimoniale. Cette option est davantage privilégiée dans le secteur viticole, qui connaît une succession de crises et où la rentabilité est de moins en moins certaine, impactant de fait la viabilité de l'installation d'un jeune. ».
La question du portage du foncier se pose ici, fort différemment selon les bassins. En effet, les vignobles épargnés par la crise de la viticulture ont connu une hausse significative du prix des terres, à l'instar de la Bourgogne, ce qui a d'ailleurs poussé le Gouvernement à modifier la législation fiscale pour permettre les transmissions familiales (rehaussement des seuils d'exonération des plus-values). Dans d'autres vignobles, la baisse voire l'effondrement du prix des terres pose la question du capital de départ en retraite de l'exploitant, puisqu'il est implicitement convenu en agriculture que la valorisation des terres et des actifs vient en quelque sorte compenser une rémunération souvent faible.
Dans sa contribution écrite, JA note : « On constate une baisse des installations dans les bassins historiques de plus en plus soumis aux aléas climatiques (Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales) alors que d'autres bassins qui se portaient bien voient leur nombre d'installés augmenter, seulement ces bassins se trouvent aujourd'hui en grande difficulté (Charente-Maritime). »
Pour ne prendre que l'exemple de la Charente-Maritime, pays du cognac, la problématique est particulièrement prégnante : des jeunes ayant acheté des terres au prix fort par un endettement souvent très élevé, se retrouvant contraints, du fait de l'indispensable régulation interprofessionnelle, de produire bien moins qu'envisagé pour atteindre le seuil de la rentabilité, et voyant, en parallèle, le prix des terres connaître une importante déflation51(*). Pour 2025, le rendement annuel a été fixé à 7,65 hl d'alcool pur par hectare, alors qu'en 2022 celui-ci était fixé à 14,73, ce qui témoigne de l'ampleur de la crise et permet d'imaginer aisément la situation complexe dans laquelle nombre de nouveaux installés se trouvent52(*).
JA, dans sa contribution écrite, note en outre que le nombre de jeunes formés aux métiers de la vigne est du vin est en régression. Il s'agit là d'un enjeu majeur que de maintenir l'attractivité de ces métiers, et d'attirer les jeunes de tous horizons, à l'heure où, chacun le sait, les « non-issus du milieu agricole » sont en augmentation constante.
Pour ces profils, l'installation est d'autant plus complexe. La formation aux métiers de la vigne et du vin est d'autant plus ardue qu'il est demandé au viticulteur d'aujourd'hui, non seulement de maîtriser le travail de la vigne et de la vinification, mais aussi d'avoir des notions avancées en matière de commercialisation ou encore de comptabilité et de droit, les normes appliquées à ce secteur d'activité étant nombreuses et complexes (voir infra).
À ce titre, la loi d'orientation agricole prévoit, en son article 7, une augmentation du nombre de jeunes formés aux métiers de l'agriculture de 30 % d'ici 2030. Cet objectif ambitieux semble nécessaire pour tenter de maintenir un tissu viticole dense par-delà les crises. Pour atteindre cet objectif, le même article 7 prévoit la mise en place par l'État et les régions d'un programme national d'orientation et de découverte des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire53(*). Les rapporteurs soulignent que ce programme ne saurait, naturellement, faire l'impasse sur la découverte des métiers de la vigne et du vin.
Cette même loi d'orientation agricole modifie le IV de l'article L. 1 du CRPM, pour y mentionner la mise en place d'une aide au passage de relais, décrite plus en détail à l'article 21.
Article 21 de la loi d'orientation agricole
« L'État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2026, une aide au passage de relais pouvant être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé une activité agricole à titre principal pendant une durée suffisante, s'ils cessent définitivement cette activité et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée. Cette aide au passage de relais est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite (...). »
Les rapporteurs considèrent que la mise en oeuvre de cette aide au passage de relais est tout à fait indispensable pour encourager les chefs d'exploitation proches de l'âge légal de la retraite, et dont la fin de carrière est difficile, à céder leur exploitation dans le cadre d'une transmission organisée et sécurisée financièrement pour l'exploitant. Si cette aide ne peut naturellement régler à elle seule la question de l'installation, et notamment la problématique des vocations au stade de l'enseignement agricole, il n'en demeure pas moins impératif qu'elle soit mise en place.
Recommandation : Dans la lignée de l'ambition portée par la loi d'orientation agricole, mettre en oeuvre rapidement l'aide au passage de relais pour faciliter la reprise des exploitations.
III. UNE MULTIPLICATION DES ALÉAS CLIMATIQUES ET SANITAIRES QUI DÉSTABILISE DES VIGNOBLES ENTIERS
A. LES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES IMPACTENT DE PLUS EN PLUS SÉVÈREMENT LA PRODUCTION VITICOLE
1. Le changement climatique affecte durablement la production viticole et ses rendements
a) Une récurrence des aléas climatiques qui affecte la production
En 2025, le changement climatique n'est plus un avenir inquiétant, mais une réalité à laquelle tous les vignobles sont confrontés. Dans son sixième rapport d'évaluation publié le 20 mars 2023, le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) estime que pour chacun de ces scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète atteindra 1,5 °C dès le début des années 2030 en raison des activités humaines. Au niveau national, le réchauffement de l'air s'établit à près de + 1,8°C en moyenne annuelle et il s'est accéléré depuis les années 1980, toutes les années depuis 1990 étant plus chaudes que la moyenne depuis 1900, avec des records de chaleur atteints en 2014, 2018, 2020, 2022, 2023 (Météo-France, 2024). À titre d'illustration, le millésime 2023 est le 3e millésime le plus chaud des 30 dernières années, derrière 2022 et 200354(*). Cette tendance accroît considérablement les risques climatiques et la fréquence de leurs manifestations, induisant des vagues de chaleur, des précipitations extrêmes, des gels tardifs55(*), jusqu'aux sécheresses et au changement de comportement des espèces. L'ouvrage Vigne, vin et changement climatique publié par Natalie Ollat et Jean-Marc Touzard offre un recueil précieux des connaissances scientifiques actuelles sur les conséquences du changement climatique sur la culture de la vigne.
Température moyenne de l'air en France depuis 1900
Source : Nathalie Ollat et Jean-Marc Touzard (coord.), Vigne, vin et changement climatique, Quae, 2024
La récurrence des aléas climatiques et l'accroissement de leur intensité ne sont pas étrangers aux fluctuations de plus en plus importantes de la production viticole annuelle, ce qui pose aux exploitations agricoles de nouveaux défis en matière de lissage des revenus, de mise en réserve des productions ou bien encore de problématiques assurantielles. L'année 2024 est à ce titre illustrative, puisqu'elle a vu la chute brutale des rendements56(*) (en baisse de 22 % avec 37,5 millions d'hectolitres) en lien direct avec la survenance d'aléas climatiques : une période de floraison humide, des pertes dues au gel et à la grêle et un avancement des vendanges pour éviter des pertes supplémentaires face au niveau de précipitations de septembre. Les prévisions de récolte pour 2025, marquées par une canicule dans le Sud-Ouest, l'incendie dans l'Aube, la sécheresse en Alsace, sont de l'ordre de 36 millions d'hectolitres57(*).
Source : Agreste - Conjoncture viticole
Source : Agreste - Conjoncture viticole
Le climat est en effet le facteur le plus décisif de la production viticole tant pour sa qualité que pour son rendement. La filière viticole française est unique par la diversité des conditions climatiques régionales qui ont influencé des terroirs, des cépages, des méthodes de culture. Face à cette diversité des bassins de production, les dérèglements induits par le changement climatique ont des conséquences différentes selon les territoires. Ces modifications des conditions de culture pourront redessiner la carte des vignobles français. On espère ainsi une augmentation du rendement dans de nouveaux vignobles dans le nord de la France, comme nous pouvons déjà le constater en Bretagne58(*), tandis qu'on observe une diminution tendancielle dans les vignobles du sud de la France (dans le Bordelais, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Languedoc-Roussillon)59(*).
La raison principale en est une modification des conditions climatiques de la période de véraison (maturation) et de récolte60(*). À ce titre, les aléas climatiques dans le Sud-Ouest (gel printanier, sécheresse, grêle, pluviométrie importante en septembre) ont conduit à une baisse continue de la production de son bassin viticole sur les quatre dernières années qui n'a jamais été observée auparavant. Lors des années de forte production dans cette région (2014, 2015, 2016), les rendements des vins AOP atteignaient en moyenne 49 hl/ha, et des vins IGP jusqu'à 93 hl/ha. Depuis quatre ans, les rendements évoluent entre 29 et 39 hl/ha en AOP et entre 57 et 62 hl/ha en IGP.
Cette évolution correspond à une baisse estimée entre 30 et 40 % de rendement pour les AOP, et entre 57 et 62 % pour les IGP61(*). De façon similaire, l'interprofession de la région Rhône Sud-Est estime à 50 % la baisse de rendement imputable au changement climatique. Cette évolution de la production est aussi constatée dans des vignobles du nord de la France, notamment en Champagne, qui connaît un déclin de son rendement de près de 26 % sur les 15 dernières années après un triplement de sa production de 1954 aux années 2000. Cette chute s'explique par une diminution du poids des grappes et de leur densité. Le comité champagne constate une perte de 25 % du potentiel de sa production liée aux aléas climatiques et phytosanitaires62(*). Le syndicat des vignerons indépendants observe, quant à lui, la répétition depuis 7 ans des pertes de rendements annuels de 10 % à 40 %.
Source : contribution écrite de l'Inrae
b) Un affaiblissement de l'état des sols et une hausse des températures
Aussi, loin des clichés souvent véhiculés sur la profession, tout agriculteur a désormais bien conscience que la gestion durable de ses terres cultivables est une condition indispensable à leur pérennité. En effet, malgré leur apparente abondance, les surfaces cultivables sont une ressource rare, voire non renouvelable à l'échelle humaine en raison de la lenteur du processus de génération naturelle des sols (pédogénèse), de l'ordre de quelques millimètres par millénaire63(*). À l'échelle mondiale, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 33 % des terres arables seraient modérément, gravement dégradées ou devenues improductives. À l'échelle européenne, 62 % des terres sont dégradées64(*), en raison de l'érosion, du tassement, de l'artificialisation ou de déséquilibres dans sa composition en carbone et nutriments, accélérés par le changement climatique. Le large spectre des types de sols viticoles en France métropolitaine (sableux, limoneux, argileux...) est dépendant du climat pour assurer sa régulation. Cette relation implique une compréhension du contexte pédoclimatique (climat du sol) d'un vignoble afin d'assurer le pilotage de la production viticole.
Source : Nathalie Ollat et Jean-Marc Touzard (coord.), Vigne, vin et changement climatique, Quae, 2024
La hausse des températures va continuer à dégrader le processus de croissance de la vigne. La vigne, à l'instar de la majorité des espèces végétales, dépend de la lumière du soleil afin d'assurer son processus de photosynthèse. Or la quantité de rayonnement captée par le feuillage de la vigne est très sensible à la température. Ainsi, si l'augmentation de l'ensoleillement permet une intensification de la photosynthèse, celle-ci cesse d'être optimale au-delà des 30°C degrés, et peut même endommager irréversiblement la plante au-delà des 45°C degrés65(*). En l'absence d'ombrage pour atténuer les rayonnements et d'irrigation pour contrer un stress hydrique sévère, les dégâts sur la capacité du pied de vigne persistent dans le temps. Ainsi, dans notre contexte de dépassement régulier des normales de saison et de répétition des épisodes caniculaires, une diminution de la photosynthèse est attendue. De façon complémentaire, le changement climatique induira en France une baisse de l'hygrométrie atmosphérique (humidité de l'air) inhibant la croissance végétative de la plante.
2. Le changement climatique bouscule de façon durable tant l'organisation que la qualité de la production viticole
a) L'organisation de la production doit s'adapter aux nouvelles conditions climatiques
Le rythme des saisons ne marque plus les étapes de la culture avec l'harmonie d'autrefois, les aléas deviennent la norme d'une viticulture sous pression constante du ciel. Le calendrier des vignerons se décale d'année en année sous l'effet des conséquences du changement climatique. Il est observé, par exemple en Alsace, que l'augmentation des températures a conduit à une accélération des étapes de culture et de récolte sur 70 ans : le débourrement a été avancé de 10 jours, la floraison de 23 jours, la véraison de 39 jours et la récolte de 25 jours66(*). Ce nouveau calendrier expose la vigne à une plus longue période de risque de gel printanier pouvant réduire le rendement, et également à une plus longue période d'exposition à des températures plus élevées influant sur le nombre d'inflorescences par pied, de fleurs par inflorescence, la fertilité des fleurs, la performance du pollen, jusqu'au poids et la composition de la baie de raisin.
Source : Stratégie de la filière
viticole face au changement climatique.
Inao, FranceAgriMer, Inrae,
IFV
L'organisation humaine de la récolte se complexifie également en raison de la hausse des températures lors des périodes de travaux de la vigne et de vendange67(*). En effet, l'augmentation des températures sur les périodes de vendange accentue la pénibilité des conditions de travail. Des vignerons témoignent de la hausse des malaises liés à la déshydratation et des accidents dus à des baisses de vigilance, alors même que la viticulture est l'un des quatre secteurs agricoles les plus accidentogènes68(*). De plus, la réorganisation des horaires de vendanges liée à l'ensoleillement pourrait avoir contribué à une certaine baisse de productivité observée lors des dernières vendanges. Cette pénibilité renforcée pour les travailleurs accentue la pression sur un recrutement déjà malaisé pour les employeurs.
b) Des aléas climatiques paradoxalement susceptibles de faire baisser le taux de couverture assurantielle en viticulture
L'un des outils majeurs à la disposition des viticulteurs pour faire face aux aléas climatiques est l'assurance contre ses effets sur les récoltes. La viticulture l'a très tôt compris, et, comme l'indique dans sa réponse au questionnaire le Masa, la filière a connu un développement continu de l'assurance récolte depuis les années 2010. Cette hausse s'est poursuivie à la suite de l'adoption de la loi du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
En 2023, le taux d'assurance a atteint un pic à 37,6 % des surfaces avant d'entamer un reflux en 2024 puis en 2025, année pour laquelle l'estimation fournie est de 34,9 %. L'Occitanie est, de loin, la région administrative la plus couverte avec un taux s'élevant à 48,5 % des surfaces.
Une analyse de l'évolution des primes d'assurances 2022-2024 a été menée. Ses résultats ont été présentés à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes (Codar) en 2025. Ces résultats indiquent notamment que, selon le Masa, « pour un même niveau de couverture du risque (même niveau de franchise), l'augmentation du taux d'aide, conjuguée à la prise en charge par la solidarité nationale de 90 % de la sinistralité du « troisième étage », a eu un effet bénéfique sur le coût de l'assurance récolte restant à la charge des agriculteurs ».
Pourtant, on observe depuis deux ans une baisse du taux de couverture, et les rapporteurs ont pu constater, sur le terrain, que les viticulteurs hésitaient de plus en plus à souscrire une assurance, certes largement subventionnée, mais coûteuse, au regard des bénéfices qu'ils peuvent espérer en tirer en cas d'aléas.
En effet, toute la problématique se posant à la viticulture comme, du reste, à l'agriculture de manière générale, est l'augmentation de la récurrence des aléas climatiques. Les indemnisations auxquelles peuvent prétendre les viticulteurs en cas d'aléas étant directement liées à leur référence de production historique, sur base d'une moyenne olympique quinquennale ou d'une moyenne triennale, la survenue de deux, trois voire quatre aléas climatiques de suite aboutit à l'effondrement de cette moyenne et, par suite, des indemnisations perçues.
Les rapporteurs alertent ainsi sur le risque de voir s'installer un cercle vicieux et paradoxal : alors même que la récurrence des aléas plaide pour une diffusion massive de l'assurance - permettant par ailleurs de garder à l'équilibre par le volume de contrats un marché peu rentable - l'effondrement de la moyenne olympique conduira à évincer de plus en plus de viticulteurs du système.
c) Le risque de déclin de la qualité des vins sous l'influence du changement climatique
La hausse globale de la température causée par le changement climatique fait craindre un déclin de la qualité de la production viticole affectant l'avenir de nombreuses exploitations. La viticulture se singularise des autres cultures par la décorrélation des prix de vente et du rendement. En effet, le prix de vente d'une bouteille de vin varie selon la renommée et la qualité du vin. Dès lors, la hausse de la température et une intensification de la contrainte hydrique causées par le changement climatique impacteront le développement des arômes, de la teneur en sucre, de l'acidité, du raisin et du vin. La composition des raisins français a évolué profondément ; les viticulteurs sont confrontés aujourd'hui à des raisins dont la teneur en sucre est excessive et à des acidités trop faibles. Dans le Languedoc par exemple, une étude du laboratoire Dubernet à Montredon-des-Corbières fait ressortir que le degré alcoolique des vins dans cette région est passé de 11 à 14 %, que l'acidité a perdu 1,5 g/l d'acide tartrique et que le pH est passé de 3,5 à 3,75 en 35 ans69(*).
L'Inao a déjà identifié ce phénomène naturel d'évolution des composantes des vins protégés. En effet, l'organisme de défense (ODG) de l'AOC « Côte Roannaise » a déposé une demande de révision de sa délimitation géographique en raison, d'une part, de l'urbanisation de son terroir et, d'autre part, de la difficulté des vignerons à élaborer des vins fruités et vifs (caractéristiques de leur appellation) suite aux sécheresses et à la précocité des débourrements. Le changement climatique a pour effet une montée en degré naturelle des vins en raison de l'augmentation des teneurs en sucre et de la chute de leur acidité. L'ODG espère obtenir une redélimitation de son aire parcellaire dans des terrains plus en altitude ou bénéficiant d'une exposition solaire moins forte.
Dans le Sud-Ouest, des cépages traditionnels montrent leur fragilité aux conséquences du changement climatique ; c'est notamment le cas d'un des cépages emblématiques, le merlot, qui représente 14 % des surfaces viticoles françaises. Le merlot est un cépage sensible à la surmaturation de ses baies et la hausse des températures dans ses terroirs traditionnels de Gironde et du Languedoc favorise son alcoolisation, notamment par un chargement en sucre altérant son équilibre organoleptique. On constate également une baisse de son rendement en raison de sa fragilité aux fortes chaleurs d'août à septembre70(*).
B. DES ALÉAS CLIMATIQUES QUI TENDENT À RENFORCER LES ALÉAS SANITAIRES DANS UN CONTEXTE DE RÉDUCTION DE LA DISPONIBILITÉ DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
1. Des aléas sanitaires aggravés par le changement climatique et la déprise agricole
Le risque sanitaire est attisé par le dérèglement climatique. S'il est difficile de prédire l'évolution de l'impact des maladies de la vigne sur les futurs rendements, il est établi que les taux de précipitations et les variations de température influent directement sur le développement des organismes à leur origine71(*). Il est déjà observé l'extension de maladies autrefois contenues à des zones identifiées comme le black rot (guignardia bidwellii) sur la façade atlantique, une maladie fongique prospérant dans un environnement humide et avec une hausse des températures, qui dessèche les grappes de raisin.
De façon plus préoccupante, le développement de certaines bactéries fait craindre la multiplication des menaces sanitaires pour lesquelles un traitement n'est pas encore disponible, à l'instar de l'infection causée par la bactérie xylella fastidiosa72(*), conduisant à l'arrachage et la destruction des plants contaminés conformément à la règlementation européenne visant à contrer sa propagation73(*).
Le réchauffement climatique fait également craindre une accélération de la propagation d'espèces d'insectes exotiques ravageuses ou vectrices de maladies pour la vigne comme, entre autres, la cicadelle africaine74(*), le scarabée japonais75(*) et la drosophila suzuki76(*). À titre d'exemple, en 2024, des cicadelles, du genre jacobiasca lybica, ont été identifiées en Corse et sur le pourtour méditerranéen, comme le souligne dans sa contribution écrite l'Institut français de la vigne et du vin (IFV). Le développement de cette cicadelle, pouvant ravager le feuillage de la vigne, est consécutif au réchauffement climatique dans ces bassins de production.
Ces dernières années, les vignobles français et européen sont particulièrement menacés par une maladie grave et incurable qui profite de la hausse des températures et des périodes de sécheresse pour s'étendre : la flavescence dorée, causant, lorsqu'elle se répand dans une exploitation, des pertes de rendements sévères par le dépérissement des plantes. Détectée en France depuis les années 1950, la maladie est provoquée par un phytoplasme, transmis aux ceps par un insecte vecteur, la cicadelle Scaphoideus titanus, originaire d'Amérique du Nord, présent d'abord sur le pourtour méditerranéen et désormais de l'Auvergne-Rhône-Alpes77(*) jusqu'au Val de Loire78(*).
À la différence du mildiou et du black rot, la flavescence dorée est classée comme organisme de quarantaine au niveau européen devant faire l'objet de mesures de lutte imposées. L'arrêté du 21 avril 202179(*) prescrit toute une série de mesures. En premier lieu, des mesures préventives, sous l'autorité de FranceAgriMer, prévoyant un contrôle sanitaire du matériel végétal (greffons et porte-greffes). En deuxième lieu, des mesures d'intervention établies par les préfets de région, de surveillance et de lutte contre la maladie incluant une série de trois traitements insecticides, voire l'arrachage des ceps infectés. Enfin, pour s'assurer de la pérennité de la génération suivante, la replantation ne peut advenir sans un traitement à l'eau chaude du matériel végétal.
En raison des difficultés économiques que connaît actuellement la filière viticole, certaines surfaces sont progressivement laissées à l'abandon formant des foyers de contamination et de recontamination pour les parcelles adjacentes cultivées. Selon les estimations du ministère chargé de l'agriculture, ces surfaces représenteraient, selon les régions, de quelques ares (Nord-Est) à plusieurs milliers (Nouvelle-Aquitaine)80(*). L'expansion de ces friches viticoles a déjà fait l'objet d'une loi promulguée le 13 juin 202581(*) qui vise leur limitation notamment via un nouveau régime de sanctions contraventionnelles pour s'assurer du respect des prescriptions en matière de lutte contre les organismes nuisibles règlementés.
La difficulté à enrayer la propagation de cette maladie est d'autant plus complexe que la densité du vignoble est forte. C'est notamment en partie à ce titre que le vignoble Bordelais, très dense, bénéficie d'un dispositif d'arrachage sanitaire en 2023. En effet, malgré les intenses efforts de prospection menés dans le cadre des groupements de défense contre les organismes nuisibles de Gironde, l'abandon d'une partie des vignes face à la baisse de la demande en vin rouge a constitué des réservoirs pour la propagation de la flavescence. Le plan était cofinancé par l'État et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), proposant chacun une aide forfaire de 6 000 euros par hectare (étant à préciser que l'aide d'État était conditionnée à une renaturation des terres82(*)). Grâce à ces deux dispositifs, le ministère en charge de l'agriculture estime que d'ici à la fin d'année 2025, près de 9 200 ha devraient avoir été arrachés.
2. Une viticulture engagée dans une démarche environnementale, mais mise à risque face à la faible disponibilité de solutions efficaces et abordables
a) Une dynamique de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques
Si le dérèglement climatique attise le développement de différentes menaces sanitaires de la vigne, la réduction continuelle des solutions phytopharmaceutiques fait craindre un désarmement des exploitants. Ce constat est d'ailleurs établi de longue date par la commission des affaires économiques du Sénat pour certaines filières agricoles, à l'instar de la culture de la betterave, de la noisette ou encore de la cerise.
L'appréciation du niveau d'usage des produits phytosanitaires se fait après le calcul de l'indicateur du nombre de traitements83(*). L'indice de fréquence des traitements (IFT) est fonction du nombre de produits appliqués et du nombre de passages pour chacun des produits phytopharmaceutiques84(*).
Les rapporteurs tiennent à rappeler une évidence : les produits phytosanitaires sont destinés à protéger les végétaux contre des organismes nuisibles, assurer leur conservation ou encore détruire les végétaux indésirables. Ils sont soumis à un régime d'approbation européen et national, encadré par le règlement 1107/200985(*) et le contrôle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)86(*). L'usage de ces produits est une charge (achats, stockage, épandages) pour l'exploitant qui, dès lors, n'en use que par nécessité selon la pression sanitaire affectant sur son exploitation.
À l'instar des autres filières agricoles, la viticulture prend part à l'objectif du plan Ecophyto87(*) de réduction de 50 % de l'usage des phytopharmaceutiques, en 2030, sur l'ensemble de la filière agricole française. La filière viticole s'inscrit dans une démarche tout à fait encourageante pour participer à cet effort collectif en faveur de l'environnement. En témoigne la forte dynamique des surfaces cultivées en agriculture ou certifiées HVE. À ce titre, en moins d'une décennie, l'IFT moyen perd 3,5 points.
|
IFT moyen |
Nombre de traitements |
|
|
Année 2013 |
16 |
19 |
|
Année 2016 |
15.3 |
20 |
|
Année 2019 |
12.5 |
18 |
Source : éléments obtenus par les
enquêtes pratiques culturales réalisées tous les
3 à 5 ans
par le service statistique du
ministère de l'agriculture et de la souveraineté
alimentaire
Il est à préciser que pour l'avenir, le « NOmbre de Doses Unités » (Nodu), l'indicateur jusqu'ici utilisé pour estimer la consommation de produits phytopharmaceutiques, ne sera plus l'outil de mesure principale, mais sera remplacé par « l'indicateur de risque harmonisé 1 » (HRI1)88(*) qui permet, d'une part, une comparaison plus aisée avec les pays européens et, d'autre part, une meilleure pondération selon la dangerosité des substances utilisées. Cette évolution est une demande globale du monde agricole pour permettre une meilleure prise en compte de l'utilisation de produits moins nocifs, mais nécessitant plusieurs passages sur la vigne.
En effet, toutes les substances n'ont pas une dangerosité équivalente, et il convient d'ailleurs de noter une nette tendance au retrait : selon le ministère de l'agriculture, en 2022, l'usage en agriculture des substances classées substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR1) a diminué de près de 87 % entre 2016 et 202089(*). Cette année, le comité d'orientation stratégique et de suivi de la stratégie Ecophyto 2030 a publié la valeur de l'indice HRI1 pour l'année 2022 : elle est en baisse de 36 % par rapport à la période 2011-201390(*).
b) L'inquiétude sur la pérennité des solutions disponibles, notamment en agriculture biologique
Si la filière viticole participe à un effort national de réduction de l'intensité de ses traitements, elle témoigne d'une inquiétude progressive face aux restrictions régulières apportées, à la disponibilité et l'utilisation de certaines substances actives encore indispensables. En effet, comme l'affirme la FNSEA dans sa contribution91(*), au niveau européen au titre du règlement 1107/200992(*), de 2018 à 2023, si les nouvelles approbations de substances actives ont quasiment doublé (de 45 à 79), les réapprobations ont plus que doublé (de 46 à 109), et les refus de renouvellement d'approbation ont quasiment quintuplé (de 27 à 121). Parallèlement, le nombre de substances autorisées annuellement a diminué de 12 % depuis 2017 (de 335 à 294) ; ce sont les insecticides qui ont connu la plus forte restriction avec une diminution de 21 %.
Il existe une asymétrie d'information entre les viticulteurs et les autorités de régulations phytopharmaceutiques. En effet, si les experts de l'Anses estiment que des études répétées et perfectionnées permettent d'anticiper, en partie, la démonstration de la nocivité de certaines molécules, dans sa contribution écrite, la Cnaoc estime que les viticulteurs perçoivent la non-réapprobation de leurs traitements de façon brutale du « jour au lendemain ». Les retraits d'autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques sont ainsi rarement anticipés et vécus de façon « punitive » par la filière. Ils peuvent provoquer une distorsion de concurrence face aux autres pays européens au détriment de la France, comme à la suite des retraits d'autorisation par l'Anses des herbicides « Pledge » et « Rami » contenant la molécule flumioxazine le 7 décembre 2024, renouvelée pourtant au niveau européen93(*).
De plus, les perspectives en la matière s'orientent vers une nouvelle réduction nationale de la disponibilité des traitements actuels. En 2025, le ministère en charge de l'agriculture estime que parmi 290 substances phytopharmaceutiques, 75 d'entre elles pourraient perdre leur autorisation d'usage au cours des 5 prochaines années94(*).
Pour davantage anticiper ces retraits, le Masa a mis en place, au sein de la stratégie Ecophyto, le dispositif « Parsada » : il s'agit du plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures. Le Parsada ambitionne de réunir et mobiliser les filières agricoles pour réduire leurs dépendances à des substances chimiques et accompagner scientifiquement les exploitants dans la transition écologique, notamment à travers des appels à projets gérés par FranceAgriMer qui permettent, entre autres, d'approfondir la recherche sur les insectes nuisibles (punaises Halyomorpha halys, taupins,...) et sur les méthodes alternatives aux traitements phytosanitaires (habitudes de cultures, techniques d'intervention, gestion du désherbage)95(*).
Le cuivre, produit phytosanitaire vital pour la viticulture biologique
La France, avec ses 23 % de surfaces viticoles, est le premier vignoble biologique du monde. La viticulture biologique s'astreint à utiliser des traitements naturels, exempts de molécules organiques de synthèse. Ils favorisent l'écosystème naturel en employant des traitements préventifs d'origine naturelle (cuivre et soufre notamment).
Cette culture de la vigne est encadrée par les règlements européens n°s 2092/91196(*)et 2033/201297(*). Les substances actives autorisées pour les traitements, homologuées « AB », les types d'amendement et de fertilisation sont définis dans des listes de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (utilisant des mécanismes naturels dans la lutte contre les ennemis des cultures), toute alternative n'y figurant pas est de fait interdite98(*).
Le cuivre en particulier est un élément majeur de la viticulture depuis le XIXe siècle et la mise au point de la bouillie bordelaise, il est devenu crucial pour la viticulture biologique, car c'est la seule substance active homologuée en AB à avoir un effet biologique fort. Néanmoins, les risques écotoxicologiques pour les sols et les cours d'eau font l'objet d'études régulières pour apprécier leurs effets potentiels. La démonstration de ces impacts environnementaux a déjà impulsé des restrictions à son usage, jusqu'à des interdictions dans certains pays européens (Pays-Bas, Danemark)99(*). Les traitements approuvés à base de cuivre restent néanmoins l'unique substance fiable et efficace contre la maladie du mildiou.
Les vignerons bio craignent pour l'avenir de filière biologique après les décisions de juillet 2025 de l'Anses. Celle-ci a renouvelé son autorisation de mise sur le marché pour seulement deux produits cupriques sur les vingt-deux qui lui étaient alors soumis. Les refus sont motivés par la protection de la santé humaine et du respect de l'environnement100(*). Les produits maintenus font, quant à eux, l'objet de restrictions limitant fortement leur utilisation concrète avec une dose maximale de 4kg/ha/an, une interdiction d'épandage pendant certaines périodes et en permanence sur les vignes proches des habitations et des cours d'eau101(*). S'il reste encore 17 produits approuvés, il est tout à fait possible qu'au moment du renouvellement de leur approbation, l'Anses restreigne à nouveau la disponibilité des seules substances autorisées en agriculture biologique, laissant les vignerons affronter les conséquences du changement climatique ou les contraignant à se reconvertir en viticulture conventionnelle pour traiter leurs vignobles.
Ce futur difficile est crédibilisé par le rapport de l'Anses sur les impacts socio-économiques de la limitation ou du retrait des produits cupriques102(*) qui estime qu'avec une dose de cuivre réduite de 50 % (2kg/ha/an), le rendement à l'hectare chuterait de 25 % en zone méditerranéenne et de 34 % en zone atlantique. Si la dose est ramenée à zéro, les rendements nationaux seraient divisés par deux en moyenne, et jusqu'à 90 % dans le sud de la France en cas de forte pression sanitaire.
C. UNE PROBLÉMATIQUE DE L'EAU QUI DEVIENT URGENTE
1. La vigne, plante méditerranéenne, est traditionnellement peu irriguée
La vigne, plante originaire du Moyen-Orient, connaît une tolérance naturelle à ces épisodes de chaleur, ce qui explique l'absence d'irrigation traditionnelle de cette culture. On observe, par exemple, des vignobles historiques (Côtes-de-Provence, Graves bordelais103(*)) reposant sur des sols caillouteux ou peu profonds. Si un déficit hydrique raisonnable permet certains effets bénéfiques sur la qualité organoleptique du vin (teneur en sucre, taille des baies, maturité du raisin)104(*), les déficits prolongés bouleversent la phénoménologie de la vigne et la composition de ses baies de raisins. En effet, le changement climatique produit une hausse des températures accélérant le phénomène naturel d'évapotranspiration105(*) des vignobles. Lorsque cette croissance dépasse les capacités de recherche en eau des sols par les pluies, en particulier l'été, elle crée des épisodes de déficit hydrique prolongés aux conséquences diverses pour les vignes (capacité à la photosynthèse, formation des arômes...)106(*).
L'intensification d'épisodes de déficit hydrique cause la répétition d'un phénomène menaçant les vignobles : la sécheresse. La sécheresse est un déficit anormal, sur une période prolongée, d'une (au moins) des composantes du cycle hydrologique terrestre107(*). Les effets de la sécheresse agricole sont négatifs à de multiples égards pour la viticulture : elle diminue la qualité des sols (érosion, vies organiques), impacte le développement de la plante (santé, pérennité et rendement de la vigne), vulnérabilise la filière (anticipations économiques perturbées, complexification du recrutement) et attise les risques pour l'environnement (biodiversité, incendies).
L'irrigation de la vigne n'est donc pas une pratique historique en Europe, mais une adaptation récente des pratiques culturales aux effets du changement climatique, qui pourrait toutefois, paradoxalement, augmenter la vulnérabilité des vignes à la sécheresse en l'habituant à des hydratations régulières108(*). Dans le sud de la France, l'irrigation de la vigne s'est ainsi développée au début des années 2000. Aujourd'hui, le principal bassin de production irrigué est celui du Languedoc-Roussillon avec 26 000 ha, soit 11 % de la superficie viticole, suivi par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 10 000 ha de vigne irriguée109(*). La France n'est pas un cas isolé, puisque sous l'effet de la hausse des températures, l'Espagne a largement développé son irrigation viticole depuis les années 2000 jusqu'à irriguer 31 % de son vignoble national en 2022110(*).
2. Des zones où le choix entre l'irrigation et l'arrêt pur et simple de la viticulture sont à venir
La mission d'information sur l'usage durable de l'eau constatait, dans son rapport d'information pour une politique de l'eau ambitieuse, responsable et durable111(*), la diminution de 14 % des ressources nationales en eau renouvelable depuis les années 1990, et identifiait à l'horizon 2050 une évolution de la variabilité saisonnière des précipitations (une hausse de l'ordre de 15 % en hiver et une baisse de l'ordre de 10 % en été), une diminution de la vitesse de recharge des nappes phréatiques de 10 à 25 % et la hausse constante de l'évapotranspiration réduisant le volume d'eau disponible pour les végétaux. Également identifiée dans la stratégie de la filière viticole face au changement climatique112(*) de l'Inao, l'Inrae, FranceAgriMer et l'IFV, la problématique de l'eau est une des conditions de production risquant d'être la plus impactée par le changement climatique.
Cette tendance climatique peut amener à voir les cartes des principaux bassins de production viticole évoluer dans les années à venir. En effet, le stress hydrique et l'excès de chaleur pourront contraindre certains vignobles du sud de la France, sans apport d'eau ou de restructuration des sols, à la réduction, voire l'abandon, de la culture de la vigne sur le pourtour méditerranéen tandis qu'au contraire ils offriront de nouvelles opportunités dans les territoires encore peu viticoles bénéficiant de conditions de culture renouvelées en Europe du Nord113(*). Il est à préciser que le fort potentiel d'adaptativité de la vigne à des conditions difficiles de culture pourrait permettre de s'adapter, dans certaines limites, à certaines nouvelles conditions de culture. Dans le passé, la culture de la vigne a pu être adaptée à des terrains arides et caillouteux (vallée du Rhône), en versant de zones montagneuses (Alpes) ou dans des sols peu profonds (Bourgogne)114(*).
Dans les Pyrénées-Orientales, territoire viticole composé à 80 % d'appellations d'origine protégées, la chambre d'agriculture rapportait, en 2023, qu'en raison des sécheresses successives et de la non-compensation des départs de viticulteurs, les rendements ont été divisés par deux en vingt ans : de <40hl/ha en 2004 à 20hl/ha en 2023.
À propos de cette situation locale, Jean-Marc Touzard, directeur de recherche à l'Inrae, estimait que « la région est en quelque sorte un laboratoire. Ce qui se passe aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales pourrait se produire dans dix ans dans la vallée du Rhône »115(*). En 2025, la chambre d'agriculture Occitanie confirme, dans son dernier bilan de santé du végétal sur le Languedoc-Roussillon116(*), une pluviométrie régionale déficitaire consécutive à un manque de pluie durant l'hiver à peine compensé par un printemps pluvieux avec une moyenne de - 143 mm, en rebond après 2023 (- 197 mm). Dans les pays européens exposés davantage aux conséquences de la hausse des températures, comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce, les régions viticoles seraient à 90 % menacées d'extinction d'ici la fin du XXIe siècle ; au niveau mondial, 49 à 70 % des régions productrices actuelles perdraient l'aptitude à la viticulture117(*).
PARTIE II -
DES RÉPONSES QUI DOIVENT AVANT TOUT
VENIR D'UNE FILIÈRE UNIE
ENTRE L'AMONT ET L'AVAL,
CONQUÉRANTE ET RÉSILIENTE, AVEC
L'APPUI INDISPENSABLE DES POUVOIRS PUBLICS
I. LA FILIÈRE DOIT DAVANTAGE ORIENTER ET MAÎTRISER SA PRODUCTION POUR MIEUX (RE)CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ
A. LA RÉPONSE À LA CRISE NE SAURAIT PASSER UNIQUEMENT PAR L'ARRACHAGE, MAIS PAR UNE PALETTE DE SOLUTIONS ALLANT DE LA PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION
1. Si l'arrachage, véritable amputation du potentiel productif français est parfois inévitable, la filière doit davantage se saisir des outils de régulation de l'offre à sa disposition
a) L'arrachage, objectivement nécessaire dans certaines circonstances, doit rester une solution de dernier recours
Face à la polycrise que traverse la viticulture, et particulièrement ses bassins bordelais et languedociens, l'arrachage est parfois une nécessité douloureuse à laquelle il faut se résoudre.
Cependant, les rapporteurs tiennent à souligner que la réponse à cette crise ne saurait être simple et univoque. Ainsi, ils rejettent l'idée qu'une simple campagne massive d'arrachage de dizaines de milliers d'hectares de vignes - les chiffres totaux de 100 000 ha sont évoqués au sein des filières et de l'administration - serait la solution logique et unique à une crise profonde et multifactorielle.
Arracher des vignes, véritable amputation d'un patrimoine pluriséculaire national et de son potentiel de production, ne saurait régler la problématique de l'inadéquation grandissante de l'offre et de la demande, pas plus qu'améliorer la relation parfois dégradée que peut entretenir la production et la distribution. Arracher les vignes ne contribuera pas non plus à dépoussiérer l'image que les générations les plus jeunes ont du vin.
Aussi, si l'arrachage peut être ponctuellement une solution inévitable, permettant à des exploitants de se retirer dans la dignité, ou à des exploitations de rééquilibrer leur modèle, celle-ci doit être réfléchie, ses conséquences sur les hommes, les marchés ou encore les paysages analysés, et s'accompagner d'une véritable stratégie de marché pour l'avenir.
Les rapporteurs font le même constat concernant les dispositifs de distillation de crise. Ces dispositifs, particulièrement coûteux pour l'État, dans une période de dégradation importante des finances publiques, ne sauraient être des puits sans fond pour une filière sans cap ni stratégie claire et partagée.
Les rapporteurs notent en outre que les analyses de la crise que traverse actuellement la viticulture, à l'échelle mondiale, ne sont pas nécessairement convergentes. Si un consensus est indéniable sur la nécessité d'ajuster le potentiel de production de certains bassins, il n'est pas à ignorer un risque de tension à moyen terme sur la disponibilité du vin à l'échelle mondiale.
C'est l'analyse que développe notamment le spécialiste Jean-Marie Cardebat, professeur d'économie à l'université de Bordeaux, reçu en audition, qui note que le constat de surproduction chronique à l'échelle mondiale mérite d'être nuancé.
En effet, s'appuyant sur les données de l'OIV, il souligne que, d'une part, les besoins de l'industrie en alcools sont de l'ordre de 25 à 30 Mhl par an, ce qui absorbe une bonne partie de l'excédent apparent de production, et que, d'autre part, l'écart entre la production et la consommation a tendance à se réduire dans le temps. Celui-ci était de 38 Mhl entre 1998 et 2008, de 29 Mhl entre 2009 et 2022 et de 13,8 Mhl entre 2023 et 2024. Pour deux années depuis 1995, les deux courbes ont même frôlé l'inversion, alimentant dans la presse internationale des discours sur des risques de pénurie.
Source : contribution écrite de
M. Cardebat à partir des données OIV (courbe
rouge :
production mondiale annuelle / Courbe bleue : consommation
mondiale annuelle)
Aussi, si la tendance à la « prémiumisation » des vins est sans conteste une tendance générale - « boire moins, mais mieux » -, on ne peut nier l'existence de fortes fluctuations de l'offre comme de la demande à l'échelle mondiale, constat qui devrait intéresser la filière française, grande exportatrice en valeur, mais moins en volume.
En effet, comme analysé en première partie, les volumes des exportations de l'Espagne et de l'Italie sont structurellement supérieurs aux volumes français. Cette tendance ne saurait être interprétée comme une donnée figée : si la France performe en matière de valorisation de ses vins, pourquoi ne pourrait-elle pas accroître ses performances en matière de volumes exportés ?
Enfin, M. Cardebat rappelait, en audition, que la tendance de nombreux vignobles était structurellement à la baisse des rendements, entraînant de fait, sur le temps long et à surfaces constantes, une baisse de la production. Cette tendance à la baisse des rendements, dont les facteurs sont multiples (changement climatique, modification de cahiers des charges, passage au bio, etc.), est toutefois une donnée de temps long, qui ne saurait répondre à l'urgence du moment à savoir l'impossibilité d'écouler son vin à un prix décent pour de nombreux vignobles, voire, pour certains, l'impossibilité de l'écouler tout court.
Rendements des AOP
bordelaises118(*)
(moyenne en gras, 1981-2023, source
CIVB)
Source : contribution écrite de M. Cardebat
L'arrachage doit ainsi être considéré avec raison, comme un mal parfois objectivement nécessaire à utiliser en dernier recours, dans le cadre d'une stratégie déterminée et, le cas échéant, de recours à la distillation (voir infra).
Au demeurant, ces réflexions ne sont pas propres à la France. De nombreux pays producteurs envisagent de réduire leur potentiel de production. Des chiffres de l'ordre de 20 % du vignoble américain sont parfois évoqués. En Australie, les surfaces diminuent depuis la campagne 2022-23119(*). Il en va de même pour la SAU espagnole, qui est passée de 966 000 ha en 2019 à 930 000 ha en 2024120(*).
A contrario, l'Italie continue de voir son vignoble croître, de 689 839 ha en 2014 à 721 572 en 2024121(*) et, malgré une problématique de surproduction qui se pose à ce pays comme aux autres, les solutions envisagées et dont la presse spécialisée se fait écho, tendent, sans exclure l'arrachage, à réguler le rendement par une panoplie d'outils permis par le droit européen et à la main des États membres122(*). En juillet 2024, dans un entretien au magazine spécialisé Vitisphère, Lamberto Frescobaldi, président de l'Unione Italiana Vini123(*), expliquait : « Nous devrons peut-être arracher des vignes, mais cela demande des réflexions approfondies. Tout d'abord, les vignobles en zones montagneuses ou dans des régions vallonnées de l'Italie sont absolument essentiels. La pérennité de certaines régions dépend des vignobles - on ne peut y implanter aucune autre culture. Nous sommes également contre les arrachages dans des régions qui ont implanté des vignobles au cours des vingt dernières années grâce aux subventions européennes dans le cadre de l'organisation commune des marchés (OCM). Allez dire à nos contribuables que nous arrachons des vignes dont la plantation a été financée avec leurs deniers. Personnellement, je serais furieux. Cela ne peut se justifier. »
Au total, les rapporteurs plaident pour ne pas s'engouffrer dans une solution de facilité que constitueraient des arrachages massifs, alors même que des arrachages dans les autres vignobles du monde pourraient contribuer à rééquilibrer l'offre globale et que de nombreux outils existent pour contribuer à la régulation des volumes (voir infra).
Cet argument était, du reste, celui de la direction générale de l'agriculture et du développement rural (DG Agri) de la Commission européenne, entendue par les rapporteurs en audition, qui n'est pas favorable à ce que des crédits européens contribuent à financer une destruction du potentiel productif du vieux continent. Si l'on ne peut nier le besoin de réajustement du potentiel productif de certains territoires, il convient de ne pas trop endommager un potentiel de production indispensable à la conquête des marchés.
Enfin, la question de l'arrachage doit se penser en lien avec les hommes et les territoires. Si l'arrachage peut permettre à un viticulteur de partir dignement à la retraite, l'accompagnement des autres professionnels contraints d'arracher est une question centrale.
De même, comme le soulignait la FNSafer lors de son audition, les opérations d'arrachage dans le Bordelais ont abouti à un mitage du paysage, avec parfois des parcelles de grande qualité se retrouvant neutralisées pour 20 ans. La question de la gestion de ces espaces est ici cruciale. La même organisation suggérait de pouvoir transférer l'obligation de renaturation des parcelles arrachées dans le cadre du dispositif d'arrachage « sanitaire » à d'autres parcelles, de façon à pouvoir définir des ensembles cohérents, en matière de reboisement par exemple, à l'échelle d'un territoire. Cette piste mériterait d'être analysée par les services de l'État.
b) Aller vers une restructuration plus collective du vignoble grâce au soutien financier de l'organisation commune des marchés
Par-delà l'outil de l'arrachage, dont le financement public est rendu extrêmement complexe par les faibles possibilités offertes par le droit européen - en témoignent l'arrachage « sanitaire », fondé sur une interprétation très constructive des textes et accompagné d'une obligation lourde, pour la partie financée par l'État, de renaturation des terres (jachère ou boisement), ainsi que l'arrachage « Ukraine », fondé sur une règlementation temporaire désormais échue - d'autres leviers peuvent être activés par la filière pour contrôler voire diminuer la production.
Les outils sont divers, dont bon nombre découlent du droit européen et de l'organisation commune des marchés (OCM) décrite au règlement 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles124(*) ainsi qu'au règlement 2021/2115 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques125(*). Ce dernier prévoit, pour le secteur viticole, 13 mesures d'aide ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre et les niveaux d'intervention. Les États membres définissent, au sein de leur PSN les aides qu'ils souhaitent activer. La Commission européenne approuve les PSN. Leur mise en oeuvre est essentiellement gérée par FranceAgriMer au moyen de décisions, pour chaque aide, du directeur général, qui s'inscrivent dans le cadre des mesures règlementaires de transpositions du droit européen figurant aux articles D665-39 à D665-45 du CRPM. Les États membres ont donc une marge de manoeuvre significative dans le choix des aides et la répartition des budgets, supérieure à celle de la précédente programmation PAC.
Le budget annuel alloué à la France pour la mise en oeuvre de ces aides est de 269,628 M€ (annexe VII du règlement 2115/2021). Il convient de souligner la qualité du suivi de FranceAgriMer, qui indique, dans sa réponse au questionnaire, parvenir à consommer l'intégralité de l'enveloppe, malgré l'inhérence des aléas quant au niveau de demande annuel des différentes aides.
Dans ce cadre, la France, en lien direct avec la profession, a choisi d'activer cinq dispositifs d'aides :
· Restructuration et reconversion du vignoble (point 58.01 du PSN) : 98,9 M€ consommés pour 2022-2023126(*)
· Investissements matériels et immatériels (point 58.02 du PSN) : 93 M€ consommés pour 2022-2023
· Distillation des sous-produits de la vinification (point 58.03 du PSN) : 25,8 M€ de consommés pour 2022-2023
· Information dans les États membres de l'Union européenne (point 58.04 du PSN) : petite enveloppe, dont le montant est inclus l'aide suivante dans les décomptes de FranceAgriMer auxquels les rapporteurs ont eu accès ;
· Promotion dans les pays tiers (point 58.05 du PSN) : 41,9 M€ de consommés pour 2022-2023 en incluant l'information dans les États membres.
On notera le choix historique de la filière de ne pas bénéficier d'aides à l'hectare comme l'agriculture, mais plutôt d'aller vers des aides visant à accroître la compétitivité des exploitations et leur adaptation.
Sera présentée dans cette partie uniquement l'aide à la restructuration du vignoble, d'autres aides faisant l'objet de développements ultérieurs.
Concernant cette aide, pour laquelle environ 71 M € de paiements ont été réalisés en 2024127(*), les rapporteurs souhaitent interroger les critères d'éligibilité à cette aide qui ne semblent pas être tout à fait de nature à restructurer le vignoble dans le sens d'une stratégie collective, qu'elle soit d'adaptation au changement climatique ou de marché.
Sur son site internet, FranceAgriMer précise que « Cette aide vise à permettre aux viticulteurs de développer la compétitivité de leurs exploitations viticoles et d'adapter leur production aux évolutions du marché. L'aide à la restructuration finance une partie des coûts de plantation et de palissage en vue d'une restructuration du vignoble, sous réserve du respect des critères d'éligibilité. ».
Les dépenses éligibles dans le cadre de cette aide sont relatives à :
· la reconversion variétale par plantation (action la plus courante) ;
· la relocalisation de vignobles ;
· la modification des modes de conduite ou de gestion du vignoble (incluant l'irrigation) ;
· la modification de la densité de plantations après arrachage et replantation.
L'aide, qui concerne en moyenne 9 000 exploitations et 13 000 à 15 000 ha par an, vise à compenser financièrement les pertes de recettes issues de ces opérations et à participer aux coûts de la restructuration. Elle peut aller jusqu'à 100 % des pertes et ne peut excéder 50 % des coûts de restructuration. Une majoration de l'aide est prévue pour les jeunes agriculteurs, les détenteurs d'un contrat d'assurance contre les phénomènes défavorables ou contre les intempéries et les actions réalisées dans le cadre d'un plan collectif de restructuration.
Le Languedoc-Roussillon, avec un peu plus du tiers des dossiers (notamment avec une forte proportion d'actions de reconversion variétale), est le vignoble mobilisant le plus cette aide, suivi de la vallée du Rhône - Provence, avec près d'un quart des dossiers, et de l'Aquitaine.
Un plan de restructuration peut être collectif (exploitants membres d'une structure collective qui dépose un plan collectif de restructuration pour tout ou partie d'un bassin viticole), ou individuel. Ainsi, environ 60 % des surfaces restructurées le sont dans un cadre individuel. Les rapporteurs considèrent que si la viticulture est plus forte en « jouant collectif », les dispositifs d'accompagnement financier doivent davantage orienter vers cet objectif. C'est pourquoi ils recommandent de supprimer la possibilité de bénéficier de l'aide dans le cadre d'un plan individuel, pour ne maintenir que les plans collectifs. Ce réajustement de l'aide permettrait en outre de dégager des marges de manoeuvre financière pour accroître d'autres aides, à l'instar de l'aide relative à la promotion pays tiers, et d'en ouvrir d'autres, notamment pour l'oenotourisme128(*).
Si l'arrachage est parfois rendu indispensable par les circonstances, la restructuration du vignoble par l'implantation de nouveaux cépages, plus résistants, moins alcooleux, permettant de produire des vins plus en phase avec les attentes du consommateur, est un levier majeur d'adaptation du vignoble, qui doit être mobilisé dans le cadre de stratégies collectives, et faire, à ce titre, l'objet d'un accompagnement financier.
En outre, les rapporteurs proposent de bonifier l'aide octroyée au titre de la restructuration du vignoble aux plans collectifs intégrant des cépages ou variétés résistants (voir infra).
Enfin, les rapporteurs s'étonnent que la possibilité de financer des actions de vendange en vert, définie par le règlement européen comme « la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée », n'ait pas été activée dans le cadre du PSN français. Pourtant, cette action permet de réduire les volumes en cas de récolte s'annonçant comme importante, de même que gérer les problématiques de stocks pouvant se poser localement. En la matière, l'aide de l'UE peut atteindre 50 % de la somme des coûts directs de la destruction et des pertes qui lui sont consécutives.
Ils constatent que l'Italie comme l'Espagne disposent de cet outil. En Espagne, l'outil est massivement utilisé, avec une réalisation en 2024 de plus de 21 M€, pour près de 11 % de l'enveloppe du pays. En Italie, cette possibilité a été activée en 2024, avec une réalisation modeste, de l'ordre de 5 M€. En tout état de cause, il s'agit d'un outil que les exploitations seraient libres d'utiliser ou non en fonction de leur stratégie. Néanmoins, les crédits disponibles étant limités, le choix de privilégier d'autres lignes d'aides, plus structurantes, paraît tout aussi entendable.
Recommandation : Permettre l'éligibilité de l'aide à la restructuration uniquement aux plans collectifs.
c) Des outils structurants découlant du droit européen et mis en oeuvre avec l'aide de l'Inao et de FranceAgriMer au service des filières
Outre les aides à la restructuration du vignoble, et, si la filière en faisait le choix, les aides à la vendange en vert, la filière dispose d'outils, à différents niveaux, pour réguler et lisser la production.
Premièrement, les ODG peuvent faire le choix de proposer une baisse de leurs rendements. Cet outil permet effectivement de réguler l'offre, mais uniquement dans une certaine limite, puisque la baisse du rendement entraîne une hausse des charges pour les exploitants. Un arbitrage est donc à effectuer entre restriction sur les rendements et équilibre économique.
Conformément aux articles D 645-7 et suivants du CRPM, les ODG peuvent mettre en place des volumes substituables individuels (VSI) et des volumes complémentaires individuels (VCI).
Le VSI n'est pas un outil de régulation des rendements à proprement parler, mais il permet, les années qualitatives, de produire au-dessus du rendement de l'appellation, dans la limite du rendement butoir, et de substituer le surplus à des stocks plus anciens. L'objectif est le rajeunissement et l'amélioration de la qualité des stocks.
Le VCI, quant à lui, lisse la variabilité interannuelle des volumes produits, dispositif incontournable à l'heure où les aléas climatiques sont plus récurrents, voire quasi-annuels dans certains vignobles.
Le VCI permet de mettre en réserve, dans des conditions déterminées par le cahier des charges de l'ODG, un pourcentage de la récolte d'une année, supérieur au rendement de base figurant au cahier des charges, mais sans toutefois pouvoir dépasser le rendement butoir fixé dans le cahier des charges. Par exemple, le cahier des charges de l'appellation Saint-Joseph129(*) prévoit un rendement de 40 hl/ha et un rendement butoir de 46 hl/ha, permettant des mises en réserve. Le VCI se constitue en année N et se revendique en année N+ 1 et permet donc de combler un déficit quantitatif de la récolte N-1. Son intérêt se manifeste bien entendu lorsqu'une appellation ne fait pas face à une succession d'aléas climatiques entraînant systématiquement de faibles récoltes.
Selon les données communiquées par l'Inao, en 2024, 121 appellations sont éligibles en vins blancs, 128 appellations en vins rouges, 8 en vins rosés, 4 vins mousseux et 4 vins liquoreux (soit près de 60 % des IG), et l'établissement indique que ce dispositif, expérimenté initialement par les appellations chablisiennes en 2005 et généralisé en 2022, s'est bien diffusé parmi les ODG.
En outre, la filière dispose d'un autre outil permettant de réguler les volumes sur un temps plus long, l'outil des droits de plantation.
Droits de plantations - Rappels historiques
La régulation des plantations de vignes n'est pas un phénomène nouveau. Ainsi, dès l'an 92, l'empereur Domitien adopta un décret prohibant la plantation de vignes, qui fût ensuite abrogé en l'an 280 par Protus130(*).
En France, le régime d'autorisation de plantations des vignes dans sa forme « moderne » a été créé par un décret du 30 septembre 1953131(*). L'idée était alors de promouvoir la production de vins de qualité, dans la droite lignée de l'institution des premières appellations d'origine contrôlée, en 1935132(*).
S'inspirant pour partie du dispositif français133(*), les Communautés européennes décident, en 1970, de réguler la plantation de vignes. Ainsi, sans interdire toute nouvelle plantation, sera interdite toute aide à la plantation, les États membres étaient toujours libres d'adopter des règles plus restrictives en matière de plantation nouvelle et de replantation de vigne, ainsi de la France.
En 1979, le Conseil décide de durcir les règles. Celui-ci relève que :
« l'analyse de la situation du marché du vin de table et de l'évolution spontanée du potentiel viticole fait apparaître une menace de déséquilibre entre l'offre et la demande de vin de table ; que cette situation impose de nouvelles orientations pour le développement du potentiel viticole permettant d'assurer l'équilibre du marché des vins de table »134(*).
Ainsi, la plantation de vin a d'abord été interdite, par un règlement du 5 février 1979, jusqu'à novembre 1979135(*). L'interdiction sera prolongée de nombreuses années, avec certains aménagements.
En 1999, le Conseil adopte une réforme d'ampleur de l'OCM vin. Celui-ci relève que, si l'équilibre du marché viticole s'est amélioré, certes lentement et difficilement136(*), il semble encore trop tôt pour lever les interdictions de plantation137(*), de telle sorte que finalement, de 1987 à 2015138(*), c'est un régime d'interdiction de plantation qui a prévalu à l'échelle de l'UE139(*).
Les règles actuelles en la matière sont prévues, au niveau européen, par les articles 61 et suivants du règlement 1308/2013 susmentionné, dit « OCM unique ». Au niveau national, ces règles sont reprises par le chapitre V du titre VI du livre VI du CRPM (art. L. 665-1 et s. ; D. 665-1 et s.).
Le règlement OCM unique est venu mettre un terme au régime d'interdiction des plantations qui prévalait jusque-là, remplacé par un régime d'autorisation140(*). Ce régime a été être prolongé jusque 2045141(*).
Le régime ainsi présenté ne s'applique qu'aux raisins de cuve, non pas aux raisins de table. L'autorisation est valable trois ans en principe, et les États membres peuvent accorder de nouvelles autorisations, dans une proportion inférieure ou égale à 1 % des surfaces plantées au niveau national au 31 juillet de l'année précédente. S'il n'est pas possible de dépasser ce seuil, il est possible de réduire ce pourcentage, soit au niveau national, soit au niveau régional, pour une AOP, une IGP ou pour les VSIG, afin d'éviter un excédent d'offres ou éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une IGP ou une AOP142(*).
FranceAgriMer est l'autorité de délivrance des autorisations de plantation, et l'Inao joue un rôle central d'expertise, de coordination et d'avis dans le dispositif français, notamment via ses instances, comité national AOV et comité IGP qui, règlementairement, proposent ou rendent un avis annuel sur la gouvernance du dispositif.
La France n'a toutefois jamais fait usage de la faculté de restreindre en dessous de 1 % la surface disponible au niveau national, pour la simple raison que, comme l'indique FranceAgriMer dans sa contribution écrite, les demandes ne s'établissent pas au-delà de 0,6 %. Elle le fait en revanche au niveau régional, en lien avec les ODG.
S'agissant de la décision de restreindre la surface disponible au niveau national, elle est prise par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du comité national compétent de l'Inao et du conseil spécialisé de la filière viticole de France AgriMer.
Au niveau local, concernant les demandes des ODG, la décision est toujours prise par les mêmes autorités et après avis du conseil de bassin et du conseil spécialisé de la filière viticole de France AgriMer, mais, cette fois, la décision est prise sur proposition du comité national compétent de l'Inao et non pas après avis de celui-ci. Si les ODG peuvent formuler des demandes pour accroître leur vignoble, ils peuvent aussi demander à installer des limitations à la croissance de celui-ci.
Les rapporteurs soulignent donc la responsabilité des acteurs de la filière dans l'approbation de vastes plans d'agrandissement de vignobles, à l'instar du vignoble du cognaçais, qui a crû de 14 500 ha entre 2018 et 2023, sur fond de dynamisme des exportations. Pour modérer ce propos, le BNIC souligne, dans sa contribution écrite, que les demandes de plantation étaient globalement 2,5 fois plus élevées que ce qui a effectivement été porté par la filière, témoignant de l'existence d'une vraie régulation de la part de l'interprofession.
d) L'indispensable régulation interprofessionnelle
L'article 167 du règlement OCM dispose qu'« afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment par la mise en oeuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158. »
Les rapporteurs considèrent que cet article est fondamental, puisqu'il permet, en plus des mécanismes de régulation du potentiel de production à la main des ODG, des mécanismes puissants et partenariaux de régulation de l'offre.
Cet outil permet d'empêcher la mise en marché de volumes de vins considérés en excédent par rapport à l'équilibre de marché du produit considéré, mesure qui s'impose à l'ensemble des producteurs à partir du moment où l'autorité administrative étend l'accord par arrêté. Ces volumes sont libérables selon les modalités définies dans l'accord, notamment lorsqu'une demande de marché est constatée.
Ces accords sont lourds à mettre en oeuvre, non seulement car ils nécessitent une convergence des vues de l'amont et de l'aval, mais aussi parce que le droit de l'Union européenne les encadre strictement. C'est à ce titre que le Masa indique, dans sa contribution écrite, que « les interprofessions peuvent prendre l'attache des ministères compétents pour soumettre leurs projets d'accords, afin d'identifier les éventuels points posant problème en amont.
Parmi les éléments vérifiés par les administrations à l'occasion de l'instruction de telles demandes, outre les dispositions de l'OCM, les points suivants sont en particulier examinés :
- Tout dispositif doit être justifié économiquement, objectif, et non discriminatoire ; à ce titre, la gestion du dispositif est collective et les règles doivent s'appliquer à l'ensemble des opérateurs (y compris la libération de la réserve).
- La description du dispositif de régulation doit fournir les éléments quantitatifs permettant de mesurer l'ampleur de la régulation au regard des quantités disponibles à la commercialisation de la récolte et les stocks et, dans le cas de mises en réserve, les modalités de libération des volumes.
- Le dispositif est décliné au niveau de chaque opérateur de manière objective et non discriminatoire ; aucune fixation de quota individuel de production ou de commercialisation. »
De plus en plus d'interprofessions commencent à s'intéresser à ce mécanisme, qui a la vertu de mettre autour de la table l'amont et l'aval de la filière, dans le but, peu aisé, de réaliser un diagnostic commun et s'accorder sur la régulation à mettre en oeuvre.
En la matière, il convient de citer la régulation mise en oeuvre de longue date en Champagne. Dans ce vignoble, un volume commercialisable est fixé annuellement, et les quantités produites entre le volume commercialisable et le rendement annuel du cahier des charges peuvent être mises en réserve dans la limite d'un plafond de 10 000 kg/ha, le surplus étant distillé. Des possibilités de déblocage de la mise en réserve existent à un niveau collectif comme individuel, notamment pour répondre aux besoins du marché. En outre, les quantités mises en réserve peuvent opportunément compenser les années de faible récolte, il s'agit de « l'assurance récolte champenoise », comme l'indique le comité interprofessionnel du vin de champagne dans sa contribution écrite.
S'il est vrai que la situation particulière de ce vignoble a pu rendre plus aisée la mise en place d'un tel système (une seule appellation AOC, productions essentiellement non millésimées, etc.), d'autres bassins se sont récemment saisis de l'outil pour le mettre en oeuvre selon des modalités propres aux caractéristiques de leurs vignobles.
Il faut ici citer l'exemple récent de l'IGP Pays d'Oc, principale IGP française en volume, qui est à l'origine de la mise en place de cet outil de régulation au sein d'Inter Oc. Le mécanisme s'articule autour d'un besoin individuel de commercialisation (BIC), établit en prenant en compte, sur cinq années, la moyenne des trois meilleures années en termes de sorties de chais. Il est établi par couleur et peut être ajusté à la hausse pour s'ajuster à la demande. Est également mise en place une réserve volumique pour les volumes excédant le BIC, qui devra être remplacée annuellement si elle n'est pas consommée.
Enfin, citons la mise en place du volume individuel de production commercialisable certifié (VIP2C) d'Intervins Sud Est pour l'IGP Méditerranée. Il s'agit d'un dispositif à trois étages : volumes commercialisables, volumes de développement collectif et volumes complémentaires.
Recommandation : Généraliser les dispositifs de régulation des volumes commercialisables à l'échelle des interprofessions.
e) Des évolutions positives attendues de l'adoption prochaine du « Paquet vin »
À la suite de la conjonction de crises ayant impacté la viticulture européenne, le commissaire européen Janusz Wojciechowski a mis en place un groupe de haut niveau (GHN) chargé de réfléchir à l'avenir de la viticulture et d'identifier les leviers nécessaires à son maintien et son développement. Ce groupe s'est réuni quatre fois entre le 11 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, date d'approbation des conclusions, qui ont donné lieu, le 28 mars 2025, à une proposition143(*) de la Commission européenne, le « paquet vin », de modification des règlements européens relatifs à la PAC, pour mettre en oeuvre, en avance de phase du calendrier normal de discussion de la prochaine programmation PAC, les évolutions proposées par le GHN.
Dans sa contribution écrite, la Cnaoc se montre tout à fait satisfaite des propositions : « Il faut souligner la très grande satisfaction de la filière et d'EFOW (homologue Cnaoc en Europe) sur le texte qui est à la hauteur des attentes des producteurs AOC et IGP. Ce texte répond à un objectif central : créer une boîte à outil pour mieux réguler nos marchés. »
Dans sa contribution écrite, le Masa confirme la satisfaction française en la matière.
Les avancées qui devraient être actées sont notamment relatives à une meilleure gestion du potentiel de production, ce dont les vignobles français et européens ont particulièrement besoin. Le règlement prévoit notamment une prolongation de la durée de vie des autorisations de replantations, qui passerait de trois à huit ans144(*), permettant de réaliser des arrachages temporaires, de même que la suppression des sanctions existantes en cas de non-utilisation de ces autorisations. Figure également la possibilité de fixer à 0 % la délivrance d'autorisations de plantations nouvelles dans certaines régions nécessitant une adaptation du potentiel de production. Enfin, est prévue la modification de l'article 216 de l'OCM145(*) pour ouvrir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures d'arrachage définitif volontaire en cas de crise justifiée.
En outre, le paquet vin va étendre aux ODG la possibilité (limitée aux interprofessions actuellement) de réaliser des actions de promotion de l'oenotourisme, stratégie de diversification abordée dans la suite de ce rapport.
Il entend également donner mandat à la Commission européenne pour simplifier les obligations d'étiquetage et notamment le développement du QR code, demande forte de la profession, notamment portée par la Cnaoc, qui y voit le moyen, outre l'intégration simple des informations obligatoires, de communiquer autour de l'identité du produit dans toutes les langues.
La publication du règlement est prévue pour début 2026, et devrait permettre aux pouvoirs publics et aux filières de disposer d'outils supplémentaires précieux, qui ne se résument pas à de l'arrachage.
Si l'ensemble de ces outils sera absolument nécessaire à la sortie de crise du vignoble français, le soutien de l'État, notamment financier, demeure indispensable. Dans un contexte de finances publiques particulièrement dégradées, ce soutien ne doit pas, ne doit plus, s'opérer sans condition.
2. Un accompagnement indispensable de l'État, mais plus sans condition
a) Un soutien indéniable de l'État à la filière
Les rapporteurs tiennent à rappeler que l'État a toujours été présent pour venir en soutien de sa filière viticole.
Dans sa réponse au questionnaire de la mission, le Masa chiffre à « plus d'un milliard d'euros » les aides publiques exceptionnelles accordées à la filière, entre 2020 (crise Covid) et le début de l'année 2025.
En 2020, la Commission européenne a autorisé un soutien à hauteur de 269 M€ visant à :
· mettre en place un dispositif « distillation de crise » pour 211 M€, financé à hauteur de 84 M€ par des crédits nationaux, le reste par le fonds européen agricole de garantie (Feaga) ;
· instaurer une aide au stockage privé de 58 M€, financée à 45 M€ nationalement.
En 2021 et 2022, l'éligibilité au régime des calamités agricoles a été exceptionnellement ouverte aux viticulteurs non assurés, face à l'ampleur des pertes de production, pour un coût d'environ 100 M€. Une aide pour les entreprises de l'aval a également été accordée pour un montant de plus de 118 M€, de même qu'un dispositif de prise en charge de cotisations sociales, à hauteur, pour la viticulture, de près de 90 M€. C'est notamment cet épisode de gel qui est à l'origine de la réforme des outils d'assurance récolte.
En 2023 et 2024, un nouveau dispositif de distillation de crise a été mis en place, pour un coût de 200 M€, dont 80 M€ financés sur fonds nationaux, et dont le Masa souligne que la négociation avec la Commission européenne aura été très difficile. Cette mesure a permis de distiller 2,7 Mhl, alors que le besoin exprimé était de 4,4 Mhl, ce qui est considérable, et alors même que les récoltes de 2022 et 2023 pouvaient être qualifiées de « normales », au regard de l'historique de production du vignoble, témoignant d'une véritable crise de la commercialisation.
En 2023, un fonds d'urgence pour les viticulteurs les plus touchés par les aléas climatiques a été mis en place, pour un coût de 80 M€.
En 2023-2025, un dispositif d'arrachage sanitaire de vignes en Gironde a été mis en place, dans le double cadre de la lutte contre la flavescence dorée et de la déprise agricole, aggravant la dissémination de la maladie. Ce dispositif est double, avec un volet financé par l'État et accompagné d'une obligation de renaturation sur 20 ans, et un volet financé par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), sans obligation de renaturation. Le coût pour les finances publiques est de plus de 30 M€.
Pour les années 2024-2025, une aide à la réduction définitive du potentiel viticole a été mise en place, dans le cadre d'un régime européen désormais échu mis en place pour soutenir l'économie européenne face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le coût pour l'État s'élève à plus de 104 M€.
Ces deux dispositifs d'arrachage ont ainsi permis d'arracher environ 9 200 ha pour le premier, et 26 279 pour le second. Environ 80 % des surfaces arrachées se concentrent sur trois régions à savoir l'Occitanie, le Bordelais et la vallée du Rhône.
Enfin, en 2025, deux fonds d'urgences ont été mis en oeuvre. Le premier, doté de 9 M€, vise à apporter un soutien de trésorerie aux jeunes viticulteurs installés depuis moins de cinq ans et en difficultés économiques en raison de l'accumulation des aléas climatiques, le second, d'un million d'euros, vise à apporter un soutien spécifique à l'arrachage de vignes mères de porte-greffes pour les pépiniéristes viticoles.
Cette longue liste d'aides, à laquelle il faut ajouter des dispositifs de droits communs pour lesquels les viticulteurs sont éligibles (aménagements fiscaux et sociaux transversaux pour faire face aux conséquences de la crise du Covid notamment), permet de constater que, d'une part, la filière viticole française se trouve bel et bien placée dans une crise forte, nécessitant un soutien annuel selon diverses modalités, et, d'autre part, que l'État, donc le contribuable, a été au rendez-vous de la solidarité nationale à l'égard de cette filière majeure que personne ne souhaite voir s'effondrer.
b) L'indispensable poursuite du soutien public, mais non sans condition
Au regard de la situation dans laquelle la filière viticole se trouve, il est évident, et absolument nécessaire que la solidarité nationale trouve de nouveau à s'exprimer. Dans certains territoires, il s'agit d'éviter l'effondrement de pans entiers d'une filière sinistrée par les aléas climatiques et déstabilisée par les mutations économiques. Il ne s'agit pas que de soutenir une filière, il s'agit de soutenir des territoires entiers dont une bonne partie de l'histoire et du dynamisme repose sur la viticulture et ses nombreux opérateurs, allant de l'amont de la production à l'aval de la distribution.
Toutefois, les rapporteurs considèrent que les efforts qui seront demandés au contribuable doivent s'accompagner d'un effort réciproque de la filière.
Aussi, ils proposent que les futurs dispositifs de distillation et d'arrachage soient systématiquement pensés ensemble : il n'est plus envisageable, pour une exploitation, de recourir massivement à la distillation de crise sans remise en cause de la stratégie et, éventuellement sans dispositif concomitant d'arrachage. Il ne s'agit pas de procéder systématiquement à de l'arrachage en cas de distillation, les rapporteurs considèrent cette option comme l'option du « dernier recours », mais à tout le moins de définir des contours d'une stratégie globale, et imposer, lorsque cela est pertinent, des mesures d'arrachage en l'échange de financement de mesures, coûteuses, de distillation.
Comme indiqué précédemment, le bilan de la dernière distillation de crise menée en 2023-2024 s'élève à près de 2,7 Mhl distillés, ce qui est considérable, mais par rapport à un besoin exprimé de 4,4 Mhl. En conséquence, comme l'ont affirmé de nombreux acteurs auditionnés, « les chais sont toujours pleins », et il y a fort à parier qu'une nouvelle campagne s'avère nécessaire. Elle devra être menée en contrepartie de mesures d'arrachage pour les exploitations en situation de surproduction chronique.
De plus, une réflexion semble à mener sur la nature des plants de vigne arrachés. En toute logique, des arrachages de plusieurs milliers d'hectares devraient avoir un impact immédiat sur le niveau de la récolte suivante. La réalité est plus nuancée puisqu'arracher des vignes productives n'a pas le même effet qu'arracher des vignes anciennes et peu productives. Si l'État devait financer de nouvelles mesures d'arrachage, il serait légitime qu'il ait son mot à dire sur la nature de ces arrachages.
Recommandation : Conditionner les futures aides à la distillation à la réalisation d'une analyse du positionnement et des débouchés et, le cas échéant, à l'obligation d'arrachage, temporaire ou permanent, d'une partie des surfaces ; et mener une réflexion locale sur le type de vigne qu'il convient d'arracher.
L'accompagnement de l'État ne saurait en outre se résumer à l'engagement de crédits budgétaires. Il doit accompagner la filière dans ses efforts vis-à-vis d'une meilleure compréhension de la demande.
B. UNE FILIÈRE QUI DOIT DAVANTAGE SE TOURNER VERS LA DEMANDE TELLE QU'ELLE EST ET REPARTIR À L'OFFENSIVE EN MISANT SUR SES ATOUTS
1. La filière gagnerait à ne pas se reposer uniquement sur ses appellations, à réaffirmer l'étanchéité des segments et à ne pas abandonner l'entrée de gamme à la concurrence
a) 95 % d'une production sous signe de qualité : était-ce bien raisonnable ?
Historiquement, les AOP représentaient l'élite de la production française, l'essentiel du vin produit étant du vin de table. La pyramide des appellations s'est, en l'espace d'un demi-siècle, brutalement inversée. Cet inversement est certes concomitant de l'évolution de la demande, en faveur de vins de qualité et porteurs d'une identité de terroir. Et puisque désormais, pratiquement l'entièreté de la viticulture est sous SIQO, on assiste à une dynamique de sursegmentation, avec la croissance des dénominations géographiques complémentaires146(*). Il semble possible d'affirmer sans trop de risque que pratiquement aucun consommateur ne serait capable d'en comprendre le fonctionnement.
L'exclusion de l'aval des ODG
L'article L. 642-18 du CRPM dispose que « La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produits pour lesquels un signe est revendiqué, la représentativité des opérateurs et une représentation équilibrée des différentes catégories d'opérateurs, ou des familles professionnelles regroupant les opérateurs s'agissant des organisations interprofessionnelles reconnues qui exercent les missions des organismes de défense et de gestion. »
Cette exigence de représentativité équilibrée connaît une exception pour la viticulture puisque l'article L. 644-5 du même code dispose que « Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts. ». L'article L. 644-5-1 prévoit une règle voisine concernant les vins sous IGP147(*).
Aussi, ces dérogations à l'équilibre prévu à l'article L 642-18 permettent que le pilotage d'une appellation viticole soit exclusivement effectué par le maillon production. Cette situation permet certes de s'assurer que le producteur reste maître chez lui, mais il emporte le risque d'une insuffisante prise en compte du volet commercialisation.
Ainsi, la simple création d'une IG n'emporte pas l'augmentation mécanique des ventes et des prix, encore faut-il que le terroir soit connu et reconnu. Si produire un produit de qualité est bel et bien la vocation de chaque viticulteur, l'on ne saurait oublier l'étape d'après à savoir la commercialisation.
C'est ici toute la difficulté du métier de viticulteur : comment demander à chaque génération d'être vigneron, viticulteur et commercial ? C'est bien pour cela que les rapporteurs n'ont cessé, au cours de leurs auditions, de prôner une meilleure entente entre l'amont et l'aval, qui ne sont rien d'autre que les deux faces d'une même pièce.
Source : contribution écrite de la MVS
En outre, il convient de garder à l'esprit que de nombreux consommateurs - en réalité, la plupart - n'ont qu'une connaissance très imparfaite des SIQO et, de manière générale, de l'univers du vin et de nombreuses certifications et mentions. Ce constat est encore plus vrai à l'échelle du consommateur européen. Ainsi, un rapport de 2015 de l'Assemblée nationale sur les signes d'identification de la qualité et de l'origine, soulignait qu'« un sondage eurobaromètre effectué auprès de 26 500 citoyens européens en mars 2011, révélait que 15 % des interrogés reconnaissaient le logo STG et 14 % les logos AOP et IGP » et qu' « une étude de l'UFC-Que choisir sur les AOC viticoles de 2007 a montré le peu de connaissance des consommateurs en la matière. Seuls 15 % des consommateurs peuvent citer le nom d'un cépage ». Le même rapport évoque aussi « une totale ignorance sur le contenu de l'IGP ».
La problématique de la connaissance des labels était, du reste, déjà soulignée par Gérard César dans son rapport de 2002, écrivant, concernant une enquête de l'Onivins et de l'Inra de 1995 : « Il en ressort que 35 % des consommateurs interrogés ignorent ce que signifient les trois lettres « AOC ». En outre, parmi les 65 % restant, 17 % n'ont pas été en mesure de citer un exemple de vin d'appellation.
Si une partie des consommateurs connaît les labels, encore faut-il qu'il en fasse un critère d'achat. Une étude de février 2021 de Wine Intelligence, portant sur la perception des labels de qualité et environnementaux par les consommateurs de vin en France, montre que le logo AOP est connu de 41 % des consommateurs et représente un pouvoir de persuasion pour seulement 31 % d'entre eux. La simple mention du même label, sans logo, fait baisser ces pourcentages respectivement à 28 % et 26 %148(*). En outre, parmi les 19 labels testés, le HVE arrive en 18e place ; avec un taux de notoriété de 3 %, à comparer à celui du bio, qui arrive en 1re place, avec un taux de 83 %.
Source : Wine intelligence, février 2021
France : perception des labels de
qualité et environnementaux
par les consommateurs de vin
Ces résultats confirment bien que l'IG ne génère pas, en elle-même, la valeur, et qu'une démarche commerciale est bien indispensable pour convaincre le consommateur.
Toutefois, l'étude précise que l'on observe une influence de l'âge, et que les jeunes générations sont plus attentives aux labels écoresponsables que leurs aînés.
Ainsi, le SIQO n'est malheureusement pas gage de réussite commerciale, et le manque d'étanchéité des segments contribue aussi à la destruction de la valeur.
b) Réaffirmer l'étanchéité des segments
Le système français et européen est fondé sur la hiérarchisation des productions, de l'AOP au VSIG, en passant par l'IGP. Cependant, la règlementation relative aux déclarations de récolte et de revendications des appellations permet dans les faits de brouiller les cartes, ce qui contribue finalement à affaiblir la valeur de chaque segment.
Dans le secret des auditions, la grande majorité des acteurs concernés par le phénomène concédaient une problématique réelle.
En effet, environ la moitié du vignoble français est constitué de surfaces en zones mixtes, avec une superposition des AOP et des IGP. La déclaration de récolte doit être effectuée auprès de la DGDDI chaque année le 10 décembre au plus tard. Elle porte sur les volumes produits. Ce n'est que par la suite d'intervient la revendication, avant le 31 décembre de l'année suivante pour les IGP, conformément à l'article D. 646-6 du CRPM. Concernant les AOP, le délai est fixé par le cahier des charges, conformément à l'article D. 644-4 du même code.
Ainsi, l'opérateur dispose d'une latitude forte pour choisir, tardivement, les volumes revendiqués, ce qui a un impact sur le marché. Cette situation est bien connue du comité national IGP puisqu'il a acté quelques évolutions à la suite de sa réunion du 18 mars 2025. Ainsi, l'Inao indique, sur son site internet qu' « afin de renforcer les équilibres commerciaux et de raisonner les volumes de production en fonction des marchés, plusieurs cahiers des charges ont revu leurs modalités de déclaration de récoltes et de revendication. Ainsi, un système de définition de volume maximum revendicable a été adopté pour plusieurs IGP, notamment Drôme, Méditerranée et Var. Cette régulation permettra d'éviter des fluctuations excessives de l'offre en IGP et de mieux structurer le marché des vins IGP. »
Par exemple, la proposition de modification du cahier des charges de l'IGP Drôme blanc, dispose que « Chaque opérateur fournit à l'ODG sa déclaration de récolte et/ou de production, avant le 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte. Les volumes déclarés à cette date en IGP constituent le volume maximum revendicable pour l'IGP Drôme. »
Cette initiative est saluée par les rapporteurs, qui estiment qu'il faut aller plus loin et modifier directement l'article D. 646-6 du CRPM pour rendre obligatoire cette démarche, et ainsi offrir plus de prévisibilité au marché.
Ils ont conscience, en outre, qu'il ne s'agit là que d'un des aspects de la problématique de l'étanchéité des segments, qui se manifeste assez clairement à l'occasion d'aléas climatiques, puisqu'on observe, comme l'ont souligné plusieurs auditionnés, que les productions AOP sont systématiquement moins touchées, sur une même parcelle, que les productions IGP, elles-mêmes moins impactées que les productions sans IG. Si les rapporteurs n'ont pas de solution « clef en main » à proposer à cette problématique - une déclaration à la parcelle, en plus d'alourdir les formalités administratives, ne règlerait vraisemblablement pas la problématique, comme l'a affirmé la DGDDI - ils invitent les acteurs de la filière dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de la valorisation de leurs productions, à engager une réflexion sur cette problématique connue de tous.
Enfin, une autre piste, mentionnée par la Cnaoc dans sa réponse au questionnaire, au titre du besoin de simplification (« dites-le-nous une fois »), consiste en la « fusion de la déclaration de récolte et de la déclaration de revendication pour les régions qui le souhaitent ». Les rapporteurs souscrivent à cette proposition à ceci près qu'ils recommandent de ne pas la mettre en oeuvre sur une base volontaire, mais bien obligatoire.
Recommandation : Assurer l'étanchéité des segments en :
· modifiant, pour les IGP, le CRPM pour raccourcir les délais de revendication et poser le principe que le volume revendiqué en IGP ne peut être supérieur à celui déclaré en récolte.
· mener en parallèle une réflexion sur une amélioration de l'étanchéité des segments notamment par la fusion obligatoire de la déclaration de récolte et de la déclaration de revendication.
c) Ne pas abandonner l'entrée de gamme à la concurrence
Si la force du vignoble français réside bien dans la valorisation qu'elle a la capacité d'apporter à ses vins, notamment par rapport à l'Espagne et à l'Italie (voir supra), elle ne saurait, néanmoins, abandonner l'entrée de gamme aux autres.
Certes, la France n'est pas avantagée par rapport à ses concurrents par son coût du travail ou encore son niveau de prélèvements, comme l'avait déjà montré le rapport sur la compétitivité de la ferme France du Sénat. Elle dispose néanmoins d'un savoir-faire exceptionnel, de vignerons capables de remplir des cahiers des charges stricts, et de structures de négoces à l'implantation mondiale en capacité financière d'investir.
La concurrence n'attend en effet pas la France, et si la Champagne a vu ses ventes diminuer récemment en Angleterre, ce n'est pas au profit d'autres pétillants français, mais bien du Prosecco italien, comme le confirme FranceAgriMer dans sa contribution écrite. Dans son dernier bilan du commerce extérieur, FranceAgriMer notait que la demande de Prosecco avait encore crû de quelque 32 % en 2023 par rapport à 2022...
Cet état de fait conduit d'ailleurs les rapporteurs à observer avec étonnement la véritable « guerre du Crémant » qui se joue actuellement alors que, de leur point de vue, une fois encore, il s'agirait plutôt de jouer collectif et d'aller porter des messages, plutôt que de contester des cahiers des charges d'IGP volontaires pour produire ce vin.
L'offensive italienne trouve une parfaite illustration dans la campagne de publicité exposée ci-dessous, effectuée au marché de Rungis à l'égard des professionnels. Le message est clair : achetez italien et vos marges seront assurées.
Un réinvestissement dans certains segments d'entrée de gamme apparaît ici indispensable pour assurer la pérennité de la filière, et ne pas se faire grappiller inlassablement des parts de marché. Si produire ce type de vin implique de s'affranchir de tout ou partie des cahiers de charges, notamment grâce à la liberté qu'offre le segment des VSIG, rien ne sera possible sans l'engagement des grands groupes de négoce, propriétaires de marques puissantes.
Chacun le sait, tous s'approvisionnent, dans des proportions variables, et pour leur entrée de gamme, en Espagne. L'effet de bord de cet approvisionnement est qu'il tend à ne pas se restreindre à l'entrée de gamme. FranceAgriMer note, dans son dernier bilan du commerce extérieur susmentionné, que « Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vins en vrac (75 %), soit 4,5 millions d'hectolitres, en baisse par rapport à 2022 (- 1 point de part de marché). Le manque de disponibilités en vins d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a en effet des difficultés à satisfaire la demande en vins à bas prix, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportations (volumes importants de vins étrangers réexportés par la France). Ainsi, la majeure partie des volumes importés correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Sur l'ensemble des importations françaises, ces derniers représentent 55 % des volumes et 16 % des valeurs. ». Avec de tels volumes, il est difficile de considérer ce phénomène comme anecdotique. Ainsi, la France est le quatrième plus grand importateur mondial de vins en volume et le troisième importateur de vins en vrac.
En la matière, la liberté du commerce est reine, et rien ne peut contraindre un acteur à choisir un partenaire plutôt qu'un autre. De même que le producteur est maître en son royaume, le négociant est maître en le sien. Toute la problématique est qu'il s'agit en réalité d'un seul et même royaume qui, pour croître et prospérer, doit entretenir et surtout élargir ses voies de communication.
En février 2023, les groupes d'études « Vigne et vin », présidé par Daniel Laurent, et « Agriculture, élevage et alimentation » du Sénat, présidé par Laurent Duplomb, recevaient en audition la Fédération française des vins d'apéritif. Celle-ci était venue devant les sénateurs avec un message clair « Nous avons les marchés, mais nous n'avons pas les vins ! ». Ainsi, pour les vins mousseux sans IG produits en France, la fédération indiquait que 60 % des vins de base étaient importés, ce qui correspondrait à un besoin d'environ 9 000 ha pour relocaliser la production de ces vins. À l'heure où la question de l'arrachage se pose, cela ne peut pas laisser indifférent.
La fédération esquissait alors l'idée d'une production de haute technicité, respectueuse de l'environnement, majoritairement sans IG et fondée sur une contractualisation de long terme, élément essentiel aux yeux des rapporteurs.
Ces réflexions prônent également pour sécuriser davantage les productions de VSIG, segment trop souvent considéré comme déversoir les années de production importante. Or, avec des fluctuations de production annuelles très importantes, précisément en raison de ce rôle de déversoir, il semble délicat de bâtir une stratégie fondée sur une sécurisation sur le long terme des volumes produits - cela n'est pas un gros mot - de façon plus industrielle pour servir les besoins d'entreprises s'adressant à des segments de marché trop longtemps délaissés par l'élitisme d'une production fondée uniquement sur le terroir.
Les rapporteurs en font donc appel, une fois encore, à cette capacité de dialogue que l'amont et l'aval doivent davantage développer pour construire des contrats pluriannuels entre les deux familles, permettant de réaliser des investissements importants dans des zones propices à la culture intensive de la vigne, à l'irrigation et à la mécanisation.
Recommandation : Partir à la reconquête de certains segments d'entrée de gamme par le développement, dans les territoires propices, d'une filière « industrielle » du vin fondée sur des contrats pluriannuels de long terme entre l'amont et l'aval.
2. Elle doit en outre mener à bien un choc de communication et d'adaptation à la demande
a) Un réel effort de communication nationale et internationale est à mener
Les rapporteurs ont pu faire le constat que le cadre législatif strict entourant la communication n'a pas empêché l'industrie de la bière de sur-performer en matière de communication, en s'appuyant sur des événements festifs, le dynamisme des productions ultralocales, le segment, modeste, mais constant, du sans-alcool, etc. Il en va de même pour certaines entreprises, qui consacrent des budgets importants à ce poste de dépense149(*). Les rapporteurs notent aussi des discours résolument positifs, à l'opposé de certains discours adoptant une position essentiellement défensive qu'ils ont pu entendre au cours de leurs auditions.
La loi Évin
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi « Évin »150(*), est venue encadrer strictement la publicité en faveur des boissons alcooliques.
D'abord, la loi fixe de façon limitative les supports sur lesquels la publicité en faveur des boissons alcooliques151(*) est autorisée. Cette liste est relativement étendue, puisqu'elle comprend la publicité dans la presse, mais aussi sur internet. Elle ne permet pas en revanche la publicité à la télévision.
La loi encadre surtout le contenu de ces publicités152(*). En effet, la publicité autorisée se limite principalement à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
En outre, cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine ou aux indications géographiques et comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Il a pu être précisé par la jurisprudence que la publicité, si elle est autorisée dans ces conditions, ne peut présenter qu'un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit153(*).
Afin de faciliter la promotion de l'oenotourisme, le législateur a enfin expressément prévu en 2016 que les « contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique » ne constituent pas une publicité tombant sous le coup de la loi Évin 154(*).
Ainsi, et quand bien même la loi Évin constitue l'un des cadres les plus restrictifs existant en Europe, celle-ci est loin d'empêcher toute forme de publicité en faveur des boissons alcooliques.
En matière de promotion internationale, la filière n'est en revanche pas limitée par la loi Évin, et les actions de communication et de promotion peuvent donc s'exercer plus librement. Encore faut-il avoir des budgets et une stratégie.
Ces budgets peuvent provenir des ODG, des interprofessions, des entreprises privées, des crédits européens (concernant la promotion pays tiers). Un article, certes ancien, de presse spécialisée, indiquait qu'en 2014, le CIVB orientait 85 % de son budget dans la communication. Si les rapporteurs comprennent bien le rôle de chacun, du niveau le plus local, à savoir l'ODG et leurs regroupements, communiquant sur son terroir, jusqu'au niveau interprofessionnel, chargé d'une communication plus large, en passant par l'entreprise, spécialisée sur sa marque ou son segment, ils considèrent que des marges de manoeuvre existent pour mutualiser une partie, même modeste, des budgets interprofessionnels aux fins de communication nationale et internationale unifiée.
En audition, le comité interprofessionnel des vins d'Alsace, témoignait du choix d'une cotisation volontaire obligatoire (CVO) assez haute pour dégager des budgets dédiés à la promotion et à la communication. Cette attention à la communication existe donc bel et bien, et ce n'est pas pour rien que le vignoble français demeure présent sur une très vaste variété de marchés.
En tout état de cause, les rapporteurs considèrent que l'exigence de « jouer collectif » commande de mettre en oeuvre des actions de communication en commun, qu'elles soient à l'échelle nationale, dans le cadre contraint de la loi Évin, ou à l'international.
À cette fin, plusieurs options peuvent être envisagées, comme confier le chef de filât au Cniv ou bien créer une association ad hoc pilotée par les parties prenantes intéressées, dotée d'un programme d'action pluriannuel de promotion du vin tricolore, et, surtout, de financements dédiés. Ces financements pourraient provenir d'une fraction des CVO en fonction du poids de chaque interprofession.
En somme, différentes options sont possibles, autour de cette exigence de plus grande mutualisation.
La filière en est d'ailleurs tout à fait capable, puisque les rapporteurs soulignent que les interprofessions co-financent, avec l'État, le programme national de lutte contre le dépérissement du vignoble (PNDV), qui en est actuellement à sa troisième mouture et qui est financé à hauteur de 1,5 M€ par les interprofessions et de 1,5 M€ par le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (Casdar).
Au demeurant, l'idée de création d'une structure ayant cette finalité n'est pas révolutionnaire, puisqu'un rapport de 2010 de Jérôme Despey, président du conseil spécialisé « Vin et cidre » de FranceAgriMer explorait déjà à l'époque la piste d'un fonds qui aurait notamment pour objet le financement de construire « une image forte "Vins de France" ». Y avaient déjà été envisagés la durée de ce fonds, les modalités de sa gouvernance, de même que son financement, imaginé public/privé.
En tout état de cause, une réflexion approfondie est à mener d'urgence, et des actions à prendre. Une étude de 2022 de Santé publique France, certes quelque peu datée, soulignait qu'en 2018, au pays du vin, 26,5 % des investissements publicitaires pour des boissons alcooliques étaient relatif aux bières, contre seulement 20,8 % pour les vins. Les investissements dans la communication autour des whiskey (14,4 %), dont la France demeure un producteur très modeste étaient finalement assez proches de ceux pour les champagnes et mousseux (16,7 %). Gageons que ces ordres de grandeur, qui interpellent, n'ont que peu évolué en 2025 et soulignons que, dès 2002, Gérard César écrivait, dans son rapport, que les 32 M€ investis, à son époque, par la filière viticole « représente seulement 7,5 % de la totalité des investissements publicitaires réalisés par le secteur des boissons (400 millions d'euros). C'est presque moitié moins que ce que dépense le secteur de la bière (62 millions d'euros) ou près de quatre fois moins que ce qu'y consacre le secteur des eaux minérales (117 millions d'euros). ». Là encore, la question de l'investissement publicitaire n'est pas nouvelle.
Source : Santé publique France
Enfin, la France doit s'inspirer de ce qui fonctionne, et à ce titre, une étude approfondie des stratégies de certains concurrents pourrait être opportune. Pourquoi l'Italie, par exemple, aurait-elle le quasi-monopole du « régime méditerranéen », outil de communication très efficace ?
Si la question de la mutualisation des moyens et du « jouer collectif » est centrale, une réflexion sur les supports de communication sera aussi à mener. En effet, le canal du e-commerce est en développement constant et semble représenter un véritable potentiel de croissance pour les opérateurs sachant s'en saisir. Selon le baromètre SoWine 2024 précédemment évoqué, la part des acheteurs en ligne augmente, à 39 % pour les spiritueux et 34 % pour le vin. Comme le note le syndicat des cavistes professionnels dans sa contribution écrite, pour lequel ce phénomène constitue autant une opportunité qu'une menace, « le e-commerce permet de toucher de nouveaux consommateurs au-delà de la zone d'influence physique des points de vente. » Le syndicat note en outre une accélération du phénomène depuis la crise sanitaire. Le conseiller agricole de l'ambassade de France en Chine notait, dans sa contribution écrite, l'accroissement de ce segment.
Dans une publication de février 2025, l'International Wines and Spirits Record (IWSR) notait que (traduction proposée) : « le marché mondial de l'alcool en ligne entre dans une nouvelle ère de croissance durable. Après des années de pics dus à la pandémie et de corrections ultérieures, les ventes en ligne de boissons alcoolisées devraient dépasser les 36 milliards de dollars d'ici 2028, soit une augmentation de 20 % en valeur au cours des cinq prochaines années ». Il soulignait en outre que « le e-commerce est devenu un outil essentiel pour la recherche : 63 % des acheteurs d'alcool en ligne effectuent des recherches approfondies avant d'effectuer un achat, une tendance de plus en plus répandue chez les acheteurs hors ligne. »
À ce titre, Market Business France, la plateforme digitale de mise en relation entre des vendeurs français et des acheteurs professionnels basés à l'étranger, sert de vitrine gratuite pour les opérateurs français, comme le soulignait l'établissement public dans sa contribution écrite. Elle notait qu'en 2024, 350 entreprises ont ainsi été approchées, pour 1 010 référencées.
Business France -
Un opérateur au service du rayonnement
des productions
françaises
Avec plus de 1 400 collaborateurs basés en France et dans 53 pays (71 bureaux), Business France aide les entreprises à s'internationaliser. L'opérateur indique, dans sa contribution écrite, que son action a permis, en 2024, de générer 1,8 Mds€ de chiffre d'affaires additionnel pour les PME/ETI françaises.
Cet accompagnement se fait au moyen de prestations payantes proposées aux entreprises.
En viticulture, l'opérateur propose différentes actions et notamment des opérations nommées « Tastin'France » dans différents pays, permettent de connecter des producteurs français et des clients internationaux. À l'occasion de l'événement Wine Paris, Business France invite également des délégations étrangères à venir découvrir les productions nationales.
Une Marketplace est en outre accessible gratuitement, permettant aux entreprises françaises de mettre leurs vins en « vitrine ». En 2024, 350 entreprises de la filière auraient été contactées par des acheteurs via ce canal.
Dans sa contribution écrite, Business France indique que 1 133 PME et ETI de la filière vitivinicole ont été accompagnées selon diverses modalités : pavillons France sur des salons, opérations « Tastin'France », « Business Meetings », présence sur la Market place, etc.
En 2019, Business France a lancé la « Team France Export », avec les chambres de commerce et d'industrie. Elle dispose de quatre conseillers référents sectoriels spécialisés sur la filière vitivinicole, ce qui peut paraitre assez modeste au regard de l'importance du secteur pour la balance commerciale française.
Dans sa contribution écrite, Business France indiquait aux rapporteurs « Nous notons cependant une forte présence de ces pays155(*) sur les salons du secteur avec d'importantes délégations d'entreprises, parfois plus nombreuses que les entreprises françaises. Leurs stands sont très visibles et une communication remarquable laissent penser à un soutien financier important aux entreprises de ces pays pour permettre leur participation ». Ce constat souligne qu'il reste encore une marge de progression importante dans cette ambition de « jouer collectif » que souhaitent porter les rapporteurs.
Les réseaux sociaux sont aussi à mentionner, tant il est prouvé que les influenceurs... influencent fortement les comportements de consommation de leur « communauté ». La problématique des réseaux sociaux demeure cependant la difficulté à s'assurer que le public touché est en âge de consommer des boissons alcoolisées. Le dernier baromètre SoWine, soulignait que 27 % des utilisateurs d'Instagram suivent des marques, producteurs ou domaines viticoles, et que 39 % des consommateurs accordent de l'importance aux conseils donnés par les influenceurs. 18 % d'entre eux ont même acheté du vin à la suite d'une recommandation sur les réseaux sociaux.
Un canal historique à redynamiser : la grande distribution
La grande distribution reste à ce jour un lieu privilégié pour l'achat de vin. En 2023, selon une étude de FranceAgriMer, 4,6 Mhl ont été commercialisés en hypermarchés et 2,9 Mhl en supermarchés. Or, le modèle est en crise et voit ses ventes chuter d'année en année en raison des tendances de consommation précédemment exposées.
Source : FranceAgriMer à partir des données Circana
Le vin rouge est particulièrement touché, avec un effondrement des volumes vendus en 2023 par rapport à la moyenne 2020/2022 de près de 14 %. FranceAgriMer explique « Les vins rouges perçus comme plus alcoolisés, plus forts, plus tanniques non plus la côte auprès des jeunes générations. En effet, si les vins rosés et les vins blancs s'en sortent mieux, ils sont également en recul en volume, mais augmentent en valeur ».
Face à ce constat, il n'y a pas de recette miracle, mais les rapporteurs soulignent les initiatives mentionnées en auditions, à savoir expérimenter des réorganisations de rayonnage par « moments de vie » plutôt que par région. De même, ils s'interrogent sur l'opportunité, comme pour la restauration, de mettre en oeuvre des campagnes de formation des conseillers de vente, pour davantage orienter un client généralement perdu devant un mur de références dont il ne maîtrise bien souvent pas les codes.
Enfin, par-delà ces leviers, les rapporteurs tiennent à mentionner la réflexion tout à fait pertinente du conseiller agricole de l'ambassade de France en Chine, qui notait, dans sa contribution, qu'« une approche plus pédagogique de la promotion pourrait être testée afin d'éveiller les consommateurs de la classe moyenne supérieure, laquelle est désireuse de comprendre et de se familiariser avec le produit. Une telle démarche permettrait de mieux singulariser les vins français par rapport aux vins proposés par l'hémisphère sud. Cela pourrait passer par l'organisation de cours d'oenologie pour débutants, aussi bien dans les universités afin de toucher le public des futurs diplômés que dans des lieux de consommation / vente ». De telles approches innovantes sont à encourager.
Recommandation : Réaliser enfin le choc de communication nécessaire à la (re)conquête de consommateurs nationaux et internationaux, en mutualisant une fraction des budgets des interprofessions aux fins de communication sous la « bannière France ». Investir plus massivement dans le développement des canaux de communication en croissance.
b) Sortir des conservatismes pour faire preuve d'innovation
La communication et l'innovation vont bien souvent de pair.
Les rapporteurs invitent ici la profession à s'émanciper de certains dogmatismes liés à l'héritage historique de la culture de la vigne. Qui aurait pensé, il y a quelques décennies, que le cognac se boirait en « long drink » ?156(*) Pourtant, les acteurs de la filière ont rapidement compris qu'à côté des amateurs traditionnels d'un spiritueux chargé d'histoire et de savoir-faire, des consommateurs moins avertis étaient à la recherche d'expériences plus simples et désaltérantes.
De même, il suffit de se rendre dans n'importe quel restaurant ou bar pour observer par soi-même la quasi-absence systématique de cocktails à base de vin. Or, le cocktail demeure, selon les études SoWine, la quatrième boisson préférée des consommateurs français d'alcools.
Il en va de même pour la consommation de vin rouge, tendanciellement à la baisse. Si l'époque des vins « parkerisés157(*) » semble révolue, une demande existe pour des vins légers et frais. Certains vins rouges se stockent désormais au réfrigérateur. Il est ainsi urgent de développer des gammes de produits en attente avec la demande telle qu'elle est, et non pas telle que l'on souhaiterait qu'elle soit. Les rapporteurs notent à ce titre la réussite de quelques domaines pionniers en la matière qui ont su, avant les autres, élargir leurs gammes et innover, tout en conservant des productions traditionnelles, destinées à un public d'avertis, plus conservateur et connaisseur, mais en déclin à l'échelle de l'ensemble des consommateurs.
Cette démarche doit se fonder sur des études de marché plus approfondies et sur l'analyse des attentes des consommateurs permettant d'ajuster le positionnement des vignobles. À ce titre, l'étude de février 2023 d'Interloire, est riche d'enseignement sur le positionnement des vins de l'interprofession et le potentiel de croissance de chaque segment au regard du profil des consommateurs. L'interprofession a ainsi identifié huit millions de consommateurs potentiels des vins rouges du Val de Loire.
Si une part croissante des consommateurs attendent des vins plus légers et frais, certains, de plus en plus nombreux, recherchent des vins partiellement voire totalement désalcoolisés. Peu importe l'appréciation philosophique que l'on peut en avoir - un vin sans alcool est-il un vin ? -, il s'agit d'un marché à investir, ou bien d'autres acteurs l'investiront. Ainsi, il existe désormais un segment bien installé des bières sans alcool, de même que du café sans caféine. Et si 32 % des Français, une donnée en hausse, ont déjà consommé des boissons « no-low », il s'agit très majoritairement de bières (61 %) ou de cocktails (42 %), le vin étant encore très peu cité (17 %)158(*). À titre de comparaison, parmi les consommateurs britanniques de ce type de boissons, 39 % consomment du vin. Sans porter d'appréciation sur le palais des Britanniques, cette proportion est plus de deux fois supérieure à celle de la France.
Enfin, les rapporteurs souscrivent entièrement aux constats et préconisations du rapport de leurs collègues de l'Assemblée nationale sur le rôle du contenant. Ils considèrent que cette question est loin d'être anecdotique, et que le vin est condamné à être marginalisé auprès d'une certaine clientèle, jeune et nomade ou ne buvant qu'un verre par repas, si la filière n'a à lui offrir que des bouteilles de 75 cl pesant 1 kg comme contenant.
Repenser l'expérience client et la
tarification dans le secteur
de l'hôtellerie-restauration
Une vaste majorité des auditionnés a souligné la problématique de la tarification du vin dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, à la bouteille, mais encore davantage au verre, avec l'application de coefficients multiplicateurs parfois jugés comme déraisonnables. Dans sa contribution écrite, le Groupement des hôtelleries & restaurations de France (GHR) indique que ce coefficient est généralement de trois à six, même s'il apparaît qu'aucune statistique ne soit véritablement élaborée sur ce point159(*).
L'application de coefficients multiplicateurs est nécessaire à l'équilibre économique du restaurateur, qui doit faire face à de très nombreuses charges. Cependant, une réflexion est à mener avec la profession viticole sur les voies et moyens d'une redynamisation des ventes, mutuellement bénéfique pour les parties.
En effet, la consommation de vin au restaurant, en raison de son prix et d'un manque chronique de formation des personnels, est en baisse, ce qui encourage d'ailleurs à augmenter le prix du verre au vin, pour compenser le manque à gagner d'une éventuelle non-consommation d'une partie du flacon.
En audition, les représentants de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et du GHR ont indiqué être prêts à travailler avec la filière viticole pour actionner les leviers permettant d'accroître la consommation de vin, des expérimentations sont d'ailleurs déjà en cours à Bordeaux. Les rapporteurs ne peuvent qu'encourager ce type de démarche.
3. Financer des bâtiments neufs ou la conquête des marchés ? Un réajustement des priorités est nécessaire
Comme précédemment évoqué, le PSN français prévoit la possibilité de faire financer sur les crédits européens des aides aux investissements matériels et immatériels, dont FranceAgriMer indique la finalité de la façon suivante : « Le dispositif de soutien aux investissements du secteur viticole a pour objectif de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence sur les marchés mondiaux en optimisant leur outil de production et les conditions d'élaboration et de mise en marché des vins en vue d'une meilleure adaptation de l'offre aux attentes du marché. », les rapporteurs considèrent qu'à l'heure de la crise, l'heure n'est plus à financer des bâtiments neufs et des chais flamboyants, mais bel et bien à accroître la compétitivité des exploitations.
Les rapporteurs notent à ce titre que les dépenses en la matière sont singulièrement plus élevées en France qu'en Italie (voir le tableau ci-dessous), qui consacre des moyens très élevés à l'aide à la promotion pays tiers.
Cette aide concerne environ 2 000 projets par an, avec un taux d'aide allant de 10 % à 40 % selon la taille de l'entreprise. Un peu plus de 30 % des aides notifiées sur cette ligne concernent les bâtiments : une marge de manoeuvre budgétaire, là encore pour financer d'autres priorités, semble envisageable ; ou bien pour bonifier davantage les trois types d'investissements déjà éligibles à une bonification, à savoir les aides pour les nouveaux installés, les investissements à caractère environnemental et les projets structurants (ex : création d'une union de caves coopératives).
Source : FranceAgriMer160(*)
Cette recommandation de sobriété dans certaines aides à l'investissement est le corollaire d'une autre proposition, relative à la promotion pays tiers. Cette aide, dans les circonstances actuelles de pertes de marché de la filière, paraît essentielle.
Elle concourt en effet à améliorer la compétitivité des vins français, au développement de leur image de marque et de leur notoriété. Sont éligibles, par appel à projets, six types d'actions :
· des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement. Cette action concentre l'essentiel des demandes d'aide ;
· la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ;
· des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ;
· des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ;
· des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion ;
· l'élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques oenologiques, les règles phytosanitaires et d'hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d'éviter les limitations d'accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès161(*).
L'aide financière est au maximum de 50 % des dépenses éligibles. Des paiements nationaux pourront atteindre 30 % maximum des dépenses éligibles sans que le total des aides de l'Union européenne et ces mêmes nationaux ne dépassent au total 80 % des dépenses éligibles. Sont éligibles à cette aide les caves coopératives et particulières, le négoce et les interprofessions.
Cette aide était historiquement sous-consommée (41 % pour 2019-2020 pour 187 dossiers), en raison de sa complexité. Un effort de simplification a permis d'inverser totalement la tendance, puisque la consommation de l'enveloppe pour 2022-2023 s'élève à 107 % pour un nombre de dossiers supérieur à 200. En 2024, le nombre de dossiers s'approcherait même des 300, témoignant de l'intérêt renouvelé des acteurs pour la mesure. Le négoce représente de loin la plus grosse part du budget, supérieur à 60 %, devant les interprofessions (26 à 27 %).
Les données transmises à la mission d'information témoignent du dynamisme des acteurs à destination des marchés émergents, ce qui confirme l'utilité de la mesure. Les rapporteurs proposent donc d'en accroître le budget dédié. Ils ont conscience qu'il s'agit là d'un sujet sensible au regard des relations entre l'amont et l'aval. Ils estiment que si l'amont doit consentir à ce type d'effort, cela ne peut pas être sans contrepartie, notamment en matière de contractualisation. Ce point fera l'objet de développements.
Les rapporteurs sont d'autant plus convaincus du caractère stratégique de cette aide qu'une analyse de l'impact de la mesure menée par FranceAgriMer auprès des bénéficiaires montre que l'essentiel de ces derniers le considère comme très significatif ou assez significatif.
Cette même enquête souligne toutefois un taux de satisfaction des demandeurs très mitigé, notamment en raison du manque de compréhension des actions éligibles de la difficulté à monter les dossiers. Cette complexité a été également mentionnée en audition, ce qui plaide pour la poursuite du travail de simplification, même si les rapporteurs tiennent à souligner que cette complexité est également la résultante des demandes des professionnels eux-mêmes et de leur attachement à financer de très nombreuses actions et à prévoir des cas particuliers, complexifiant d'autant le dispositif. Il est à ce titre tout à fait notable que la décision du DG de FranceAgriMer relatif aux modalités de l'aide soit longue de quelque 61 pages, même si, en réalité, cette remarque vaut bien davantage pour l'aide aux investissements. Avec une décision du DG de 71 pages, un travail reste à mener, avec les professionnels, pour aboutir à un meilleur ciblage des aides à financer, ce qui devrait aussi permettre une certaine simplification.
L'utilisation de ces aides fait en effet l'objet de nombreux contrôles approfondis de la part d'organismes mandatés par la Commission européenne. En date de l'audition de FranceAgriMer par les rapporteurs, l'établissement public indiquait faire l'objet de 17 audits en cours. Les conséquences des éventuelles irrégularités sont lourdes pour les entreprises bénéficiaires, il est dès lors de la responsabilité de FranceAgriMer de s'assurer de la qualité des dossiers.
Recommandation : Accroître le budget alloué à la promotion pays tiers, notamment par la baisse de celui consacré aux investissements, pour la partie relevant des bâtiments.
II. POUR QU'UN PACTE DE CONFIANCE PUISSE SE NOUER AVEC L'AVAL, LE MAILLON DE LA PRODUCTION DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SÉCURISÉ DANS SON ACTIVITÉ ET SES REVENUS
A. LE COROLLAIRE D'UNE ATTENTION PLUS FORTE À LA DEMANDE NE PEUT ÊTRE QUE LA SÉCURISATION DES REVENUS DE L'AMONT PAR LA MOBILISATION DES OUTILS DU DROIT NATIONAL ET EUROPÉEN
À l'instar d'autres filières agricoles, la filière viticole est confrontée à une difficulté de taille : réussir à assurer un revenu a minima décent à tous les viticulteurs. Si l'objectif est défendu par tous, force est néanmoins de constater que la filière viticole peine à assurer une construction en avant du prix du vin, en dépit de l'existence de nombreux dispositifs visant à poursuivre cet objectif, et notamment du fait de la quasi-inexistence de publications relatives aux coûts de production en viticulture.
1. Les coûts de production sont difficiles à connaître, mal connus et insuffisamment pris en compte
Le premier obstacle à la prise en compte des coûts de production dans le cadre de la construction du prix du vin est d'abord leur méconnaissance par les différents acteurs de la filière.
Comme le révèle une étude menée par le cabinet de conseil Ceresco, les freins à la connaissance des coûts de production agricole sont nombreux. Cette connaissance suppose d'abord la récolte de nombreuses données, ce qui peut s'avérer extrêmement chronophage. Le recours à un tiers pour la collecte des données, s'il peut s'avérer utile, reste coûteux.
Une fois les données collectées, encore faut-il arriver à déterminer le coût de production. Or, l'établissement des coûts de production suppose de recueillir des données issues d'un nombre suffisant d'exploitations comparables, faute de quoi l'échantillon ne sera pas représentatif. Cette mission peut s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît en raison de la segmentation de la production viticole. En effet, les paramètres pouvant influer sur le coût de production du vin sont très nombreux, entre la couleur, l'appellation, le degré d'exigence du cahier des charges, les cépages utilisés, les standards environnementaux observés, la taille de l'exploitation ou encore le type de vendange. En raison de cette hyper-segmentation, les études portant sur les coûts de production sont souvent réalisées à des échelles réduites et par des organismes dont les moyens financiers dédiés à l'observation économique ne sont pas forcément très développés. Il faut enfin relever que le particularisme de la filière viticole, dont la production est intimement liée au terroir, justifie qu'aucune initiative n'ait été prise afin de déterminer le coût moyen de production du vin au niveau national. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il n'existe aucun indice des prix d'achat des moyens de production agricoles (Ipampa)162(*) viticole, à la différence des filières d'élevage.
En dépit de ces difficultés, certaines initiatives ont pu être prises. Tel est notamment le cas des chambres d'agriculture. Ainsi, Chambres d'agriculture France publie chaque année, un guide relatif aux coûts des fournitures en viticulture et oenologie. Certaines chambres d'agriculture régionales ou départementales publient elles « le référentiel économique du vigneron », un document lisible, d'une dizaine de pages, listant les coûts de production selon des hypothèses déterminées163(*). Certaines interprofessions publient également des études relatives aux coûts de production, avec un niveau de détail parfois très important164(*).
Néanmoins, ces coûts peuvent varier significativement en fonction de nombreux facteurs. Et, de l'aveu de certains acteurs auditionnés, les coûts de production viticoles sont difficiles à connaître dans le détail et, par suite, trop souvent mal connus, rendant plus difficile la construction du prix en avant.
Quand bien même ces coûts de production seraient connus, les producteurs dénoncent régulièrement, et notamment à Bordeaux, des prix pratiqués par certains distributeurs qui ne prendraient pas en compte les coûts165(*). Le sujet est à l'origine de conflits fréquents entre producteurs et acheteurs.
Pourtant, le législateur national, tout comme le législateur européen, a pu prendre de nombreuses mesures visant à assurer la construction du prix en avant.
2. Les lois Égalim visent à favoriser la construction du prix en avant des produits agricoles, mais celles-ci ne sont que partiellement applicables à la filière viticole
Pour encourager la construction du prix en avant des produits agricoles, le législateur a prévu, dans le cadre des différentes lois dites « Égalim » certaines règles spéciales applicables à la vente de produits agricoles. Sont ainsi rendues obligatoires par l'article L. 631-24 du CRPM la forme écrite, la formulation de la première proposition par le producteur, la présence de clauses relatives au prix et aux modalités de révision automatique de ce prix, à la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés, aux modalités de collecte ou de livraison et aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement. Enfin, le contrat doit prévoir une durée obligatoire de trois ans a minima.
Néanmoins, la filière viticole, en raison de ses particularités, n'est pas soumise à l'intégralité de ces règles.
D'abord, les dispositions relatives à la durée minimale du contrat ne sont pas applicables aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. De manière générale, la règle de durée minimale n'est pas applicable aux contrats de vente de boissons alcooliques166(*).
Ensuite, par dérogation, en vertu d'un accord interprofessionnel étendu ou, en l'absence d'un tel accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés, il peut être dérogé à l'obligation de recourir à un contrat écrit167(*). Cette dérogation concerne une large majorité des AOP et IGP viticoles. En particulier, les vins de Bourgogne et du Bordelais ne sont pas soumis à la contractualisation écrite obligatoire. Les vins de France ainsi que les vins de la région languedocienne, de la vallée du Rhône, de la Provence de la Loire, d'Alsace et de Champagne sont quant à eux soumis à la contractualisation écrite obligatoire168(*).
Dans le cas où le contrat serait toutefois écrit, il doit respecter les règles précitées quand bien même l'écrit n'était pas obligatoire.
Cette large non-application des dispositifs issus des lois Égalim est bien la résultante de la volonté des professionnels. En effet, beaucoup d'entre eux estiment que ces dispositifs sont inadaptés à la filière, aux motifs que le vin est un produit agricole spécifique.
Néanmoins, les rapporteurs sont d'avis qu'une réflexion sur une généralisation de la contractualisation écrite obligatoire et l'application des règles Égalim à la filière viticole demeure nécessaire. Cette réflexion est par ailleurs en cours, et nombre d'interprofessions semblent elles aussi convaincues de l'intérêt de la contractualisation écrite. En effet, de nombreuses interprofessions, y compris là où la contractualisation écrite n'est pas obligatoire, proposent des contrats types169(*) comprenant les mentions précitées, offrant ainsi plus de sécurité juridique aux parties prenantes, et encourageant la formulation de la première proposition par le producteur.
Si la contractualisation écrite favorise dans une certaine mesure la construction du prix en avant, la clé résidera toutefois dans la publication des indicateurs de coûts de production. Néanmoins, cette faculté reste insuffisamment utilisée à ce stade.
3. Le droit de l'Union européenne et la loi prévoient des instruments nombreux et variés pour orienter les prix, mais ceux-ci sont insuffisamment mobilisés
a) La possibilité de publier des indicateurs de coûts de production n'est pas utilisée par la filière
S'agissant du prix, la loi rend obligatoire la « [prise en compte] d'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts » au moment de la proposition du contrat. À cette fin, les organisations interprofessionnelles sont habilitées à élaborer et publier des indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence171(*).
Le règlement OCM autorise aussi la publication de tels indicateurs. Précisément, l'article 210 du règlement OCM prévoit que la prohibition des ententes172(*) ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles qui sont nécessaires pour « améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production »173(*). Ces accords, décisions et pratiques concertés ne peuvent toutefois comprendre des « fixations de prix »174(*).
La publication de ces indicateurs présente un intérêt certain, alors que, ainsi qu'il a été vu, la connaissance des coûts de production par les producteurs est souvent limitée ou incomplète. En outre, la publication de ces indicateurs, et leur connaissance par tous « oblige » d'une certaine manière leur prise en compte, en particulier lorsqu'ils sont déterminés par un tiers à la négociation, à savoir l'interprofession. En effet, il peut être raisonnablement considéré que l'acheteur, supposé vouloir le prix le plus bas possible, n'ira pas en dessous de ces coûts de production, sauf à assumer la pratique d'un comportement de nature à asphyxier le producteur. En outre, la loi impose la « prise en compte » de tels indicateurs et la violation de cette obligation peut conduire à la caractérisation d'un prix abusivement bas, prohibé par le code de commerce175(*).
Toutefois, alors que certaines interprofessions agricoles176(*) publient des indicateurs de coûts de production, aucune interprofession viticole n'a publié de tels indicateurs à ce jour177(*).
D'abord, ainsi qu'il a été vu, la définition des coûts de production en viticulture s'avère certes peu aisée, en raison de difficultés techniques et méthodologiques. Mais, outre des difficultés techniques et méthodologiques, les acteurs auditionnés ont surtout invoqué des difficultés juridiques pour justifier l'absence de publication d'indicateurs de coûts de production dans le secteur viticole.
Il est vrai que certaines interprofessions et organisations viticoles ont pu, par le passé, être condamnées sur le fondement de la prohibition des ententes anticoncurrentielles178(*) pour avoir, de concert, élaboré et publié des recommandations de prix dans la presse spécialisée179(*). En effet, l'Autorité de la concurrence, tout comme la Cour d'appel de Paris, ont jugé que la publication de ces recommandations de prix était illicite dès lors qu'elles avaient pour objet d'uniformiser les prix, en violant la liberté de fixation des prix180(*). Il importe de préciser et d'insister sur le fait que l'Autorité de la concurrence, comme la Cour d'appel de Paris, n'ont sanctionné aucune pratique liée à la seule élaboration ou la publication d'indicateurs de coûts de production, mais bien la diffusion de recommandations de prix.
En outre, les interprofessions peuvent aussi, avant la publication d'indicateurs de coûts de production, saisir la Commission européenne a priori, qui se prononcera sur la conformité de la publication envisagée dans un délai de quatre mois181(*). Pour ne prendre qu'un exemple, le comité national interprofessionnel de la pomme de terre a déjà pu saisir la Commission européenne à ce titre, sans que cette dernière soulève d'objections182(*).
Ainsi, et eu égard à ce contexte et à l'intérêt que présente la publication des coûts de production pour la filière, les rapporteurs considèrent que la crainte de la violation du droit de la concurrence peut être relativisée et surmontée.
b) Le droit de l'Union européenne autorise certaines orientations de prix, faculté que le Pays d'Oc a utilisé pour la première fois en 2025
En outre, le règlement OCM a été modifié en 2021183(*) afin de prévoir deux nouvelles dérogations à la prohibition des ententes.
Le nouvel article 210 bis du règlement OCM prévoit ainsi en son premier paragraphe que la prohibition des ententes anticoncurrentielles ne s'applique pas « aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité184(*) supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national ».
Pour consolider juridiquement le recours à ce dispositif, la Commission européenne a publié des lignes directrices précisant les modalités de cet article185(*). Il est également possible de solliciter l'avis de la Commission européenne sur la compatibilité de l'accord envisagé, celle-ci devant répondre dans un délai de quatre mois186(*).
Ces dispositions offrent une marge de manoeuvre encore plus grande aux interprofessions, puisqu'elles permettent la publication de prix d'orientation. En effet, sur demande des Vignerons coopérateurs de France, la Commission européenne a donné, le 15 juillet 2025, un avis favorable187(*) à la demande d'adoption d'un projet d'accord visant à l'élaboration et la publication des prix d'orientation, et non simplement de coûts de production, sur les vins en vrac188(*) issus de six cépages189(*) produits dans la région Occitanie. Cet accord de durabilité ne concerne que les vins issus de l'agriculture biologique et les vins certifiés HVE.
Dans le détail, il est prévu, pour les deux prochaines années, que les producteurs de vin issus de l'agriculture biologique et HVE, représentés par l'ODG des vins de Pays d'Oc, conviennent avec les négociants et autres acheteurs de vin en vrac de la fixation de prix recommandés, appelés prix d'orientation (accord vertical). Ces prix n'auront aucun caractère obligatoire, mais auront vocation à constituer une base de négociation. Si aucun accord vertical ne peut être trouvé avec les acheteurs, les producteurs concluraient uniquement un accord entre eux (accord horizontal) et utiliseraient les prix d'orientation convenus dans leurs négociations individuelles avec les acheteurs190(*). L'interprofession des vins de Pays d'Oc jouera elle un rôle de facilitateur. En particulier, celle-ci aura pour mission de fournir aux parties les données économiques nécessaires à la définition des prix d'orientation, et devra évaluer l'efficacité de l'accord mis en oeuvre191(*).
Cet accord, qui ne résoudra pas à lui seul l'intégralité des difficultés par les filières bios et HVE dans le Pays d'Oc, présente de nombreux avantages. En effet, les coûts de production sont définis conjointement, par l'amont et l'aval, avec l'accompagnement des interprofessions. Cette définition conjointe permet ainsi une fixation des coûts de production qui se veut la plus objective et précise possible. Enfin, cet accord ne porte pas seulement sur la publication d'indicateurs de coûts de production, mais de prix d'orientation, permettant ainsi d'assurer une marge au producteur. Le prix déterminé n'a évidemment pas de caractère obligatoire, auquel cas l'accord violerait la liberté de fixation de prix. Néanmoins, il peut être espéré que celui-ci sera suivi dans une large mesure, dès lors que celui-ci a été fixé conjointement par l'amont et l'aval.
Ainsi, si l'expérience menée dans le Pays d'Oc s'avère concluante, la publication de prix d'orientation devra être envisagée dans d'autres bassins. Les rapporteurs suggèrent même de ne pas attendre pour engager les discussions au sein des bassins.
Dans le même esprit, l'article 172 ter du règlement OCM prévoit que, par dérogation à la prohibition des ententes, les interprofessions du secteur viticole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.
Toutefois, ce dispositif n'a jamais été utilisé, et n'a été que très rarement évoqué par les acteurs auditionnés. En effet, le champ d'application de cet article est très restreint, dès lors qu'il ne concerne que la vente de raisins. Néanmoins, si l'expérience tirée du premier accord de durabilité s'avère concluante, il pourrait être envisagé de porter l'ambition d'étendre le champ d'application de l'article 172 ter à la vente de vins AOP et IGP. Dans un premier temps, cette extension pourrait être limitée aux vins vendus en vrac, sur le modèle de l'expérience menée dans le Pays d'Oc, afin de limiter le potentiel effet anticoncurrentiel de telles orientations de prix.
c) Le droit de l'Union européenne et la loi permettent la constitution d'organisation de producteurs...mais celle-ci est rendue impossible par l'absence d'intervention du pouvoir règlementaire
Le règlement OCM permet en outre, à certaines conditions, la reconnaissance par les États membres d'organisation de producteurs (OP) opérant dans un secteur agricole précis192(*), dont le secteur viticole. Les conditions de reconnaissance sont prévues par le règlement.
D'abord, l'OP opérant dans un secteur précis doit être constituée à l'initiative des producteurs et exercer au moins l'une des activités listées par le règlement OCM193(*), dont la transformation conjointe, la distribution conjointe, ou encore l'emballage, l'étiquetage ou la promotion conjointe de produits agricoles.
Puis, l'OP doit, pour être reconnue, poursuivre l'un ou plusieurs des onze objectifs prévus par le règlement194(*). Ces objectifs sont :
- des objectifs d'ordre économique tels que le fait d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, la concentration de l'offre et la mise sur le marché de la production des membres de l'OP, l'optimisation des coûts de production ;
- des objectifs d'ordre environnemental ou relatifs à l'amélioration de la qualité de la production, tels que la promotion et l'assistance technique nécessaires à la mise en oeuvre de pratiques de production respectueuses de l'environnement et du bien-être animal, ou le développement de produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national.
Il y a lieu de préciser que le rôle des OP est sensiblement différent des interprofessions. Alors que le rôle principal des organisations interprofessionnelles est de faciliter les négociations contractuelles des producteurs avec les échelons présents à l'aval, les OP ont pour objet le renforcement de l'échelon amont de la production195(*). De même, le rôle des OP doit être distingué de celui des ODG, dont l'objet principal est de contribuer à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus196(*).
Ce renforcement de l'amont que permet la constitution d'OP est d'autant plus nécessaire dans un contexte où l'offre des producteurs est assez atomisée, tandis que la demande de l'aval est plus concentrée. Ainsi, l'Autorité de la concurrence elle-même considère le regroupement des producteurs « comme une des voies pertinentes permettant l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole et le rééquilibrage des négociations commerciales entre les producteurs et leurs acheteurs »197(*). Si les propos de l'Autorité ici repris concernaient l'ensemble de l'amont agricole, la filière viticole ne fait pas ici figure d'exception, bien au contraire.
Afin d'en étendre encore le pouvoir, le législateur européen a prévu en 2017198(*) une dérogation à la prohibition des ententes au bénéfice des OP, sous certaines conditions. Désormais, une OP reconnue « peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale », tout en échappant à la prohibition des ententes. Le bénéfice de cette dérogation est notamment conditionné au fait que « l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs »199(*).
En outre, le règlement OCM comprend un certain nombre de dispositions relatives aux statuts des OP200(*) et à l'octroi de la reconnaissance de ces organisations201(*). Le règlement OCM rend nécessaire l'intervention du pouvoir législatif ou règlementaire des États membres, puisqu'il appartient aux États membres de définir le nombre minimal de membres et/ou un volume minimal ou une valeur minimale de production commercialisable nécessaire à l'octroi de la qualité d'OP.
La partie législative du code rural et de la pêche maritime prévoit ainsi les principales règles relatives à la reconnaissance des OP202(*). Le Gouvernement a également prévu, dans de nombreux secteurs, les règles nécessaires à la reconnaissance d'OP203(*). Ainsi, au 1er janvier 2025, tous secteurs confondus, l'on comptait 609 OP et 35 associations reconnus par le ministère de l'agriculture204(*), signe de l'intérêt que portent les producteurs à cet instrument.
Toutefois, le Gouvernement n'a jamais adopté les dispositions règlementaires nécessaires à la reconnaissance des OP viticoles. Ainsi, la constitution de telles organisations est aujourd'hui impossible, et ce, en dépit de l'intérêt majeur que représentent les OP pour rééquilibrer les relations entre l'amont et l'aval. Le Gouvernement prive ainsi la filière d'un outil utile, aux mains des producteurs, et dont le coût est négligeable.
Les rapporteurs insistent donc : l'adoption des dispositions règlementaires nécessaires à la reconnaissance des OP viticoles, souvent réclamée par la filière, paraît ainsi indispensable et doit intervenir à bref délai.
d) Une fausse bonne idée : le durcissement de l'interdiction de faire pratiquer des prix de cession abusivement bas
Un autre instrument visant à assurer la construction du prix en avant des produits agricoles est l'article L. 442-7 du code de commerce, qui prohibe « le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas ». L'auteur de la pratique s'expose alors à la seule réparation du préjudice causé. L'action en réparation peut être exercée par toute personne justifiant d'un intérêt (et notamment la victime), par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou encore, sous certaines conditions, par le président de l'Autorité de la concurrence.
Les conditions prévues sont donc strictes : d'abord, doit être démontrée une certaine contrainte ou une action intentionnelle de l'acheteur (« faire pratiquer »), ainsi qu'un prix « abusivement bas », un prix « très bas » ne pouvant ainsi être sanctionné.
Or, la démonstration de la contrainte de l'acheteur s'avère, en pratique, difficile. Si certaines directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) ont pu réaliser des enquêtes, notamment dans le secteur laitier et de la viande, et ont pu, dans certains cas, considérer que les prix de cession étaient abusivement bas, la DGCCRF indique toutefois que les éléments de preuve de la contrainte n'étaient, en pratique, pas réunis205(*). Ainsi, la DGCCRF n'a jamais intenté d'action visant à faire sanctionner l'imposition de prix de cession abusivement bas206(*).
En outre, l'article L. 442-7 du code de commerce précise que, pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.
Or, ainsi qu'il a été vu, la filière viticole ne publie pas d'indicateurs de coûts de production, rendant d'autant plus difficile la caractérisation de la pratique prohibée par l'article L. 442-7.
Néanmoins, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par un jugement très remarqué du 22 février 2024, condamné pour la première fois deux acheteurs à indemniser le préjudice d'un viticulteur sur le fondement de l'article L. 442-7 du code de commerce207(*). D'abord, pour caractériser la première condition (« faire pratiquer »), le tribunal de commerce a principalement relevé que la proposition de prix n'avait pas été formée par le producteur, mais par l'acheteur. Puis, pour caractériser un prix abusivement bas, en l'absence de publication d'indicateurs de coûts de production, le tribunal de commerce a comparé le prix de vente avec le prix de vente moyen sur les marchés, sur la base d'estimations établies par un courtier assermenté208(*).
Ce jugement, qui a été frappé d'appel, illustre les difficultés que génère l'absence de publication des coûts de production. Alors que le coeur de la définition du « prix abusivement bas » repose sur la comparaison avec les coûts de production, le producteur n'a pas réussi à les établir, conduisant ainsi que le tribunal de commerce à choisir le prix de marché comme prix de référence, par défaut.
Après ce jugement, certaines voix se sont fait entendre pour une activation plus fréquente de l'article L. 442-7 du code de commerce209(*). D'autres, à l'instar des députés, souhaitent une modification de la définition du « prix abusivement bas », afin de la clarifier et de l'assouplir210(*).
Néanmoins, les rapporteurs ne préconisent pas de telles solutions. D'abord, il apparaît assez vain de multiplier les actions sur ce fondement, alors qu'il est très difficile d'en réunir les conditions. En outre, modifier la seule définition du prix abusivement bas ne règlera pas à elle seule la problématique liée à la contrainte exercée par l'acheteur (« faire pratiquer »). Enfin, et surtout, la filière viticole, qui traverse une crise sans précédent, a besoin d'unité et de rassembler l'amont, l'aval et les pouvoirs publics. La facilitation des actions sur le fondement de l'article L. 442-7 risquerait ainsi de conduire à un accroissement évitable des tensions entre les différents acteurs, sur un sujet très clivant.
Plutôt que ce chemin, les rapporteurs ne peuvent qu'encourager la filière à publier des indicateurs de coûts de production et, si besoin, des orientations de prix.
Recommandation : Faire un bond décisif sur la connaissance des coûts en viticulture et la contractualisation en :
• publiant les indicateurs de coûts de production prévus par l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ;
• envisageant, sur le modèle de l'IGP Pays d'Oc, la conclusion d'accords de durabilité comprenant la publication de prix d'orientation sur le fondement de l'article 210 bis du règlement OCM.
Recommandation : publier sans délai le décret nécessaire à la reconnaissance d'organisations et associations d'organisations de producteurs viticoles.
e) Soutenir les coopératives dans une période très difficile
La viticulture est indissociable de l'histoire des coopératives. Aujourd'hui encore, elles représentent 560 coopératives et unions (dont environ 130 en Champagne), auxquelles sont attachées 35 000 exploitations. Les coopératives représentent près de 40 % de la production viticole et 60 % des exploitants, avec un impact social de 60 000 emplois directs et indirects211(*). Les coopératives produisent en outre, sur la période 2016-2019, près de 67 % du total des volumes de vins IGP (36 % des AOP), et sont à l'origine de 58 % de la production totale de rosé. En Occitanie, les coopératives sont à l'origine de la production d'environ 70 % des volumes. Comme l'indique VCF dans sa contribution écrite : « Globalement les caves coopératives sont d'assez petite taille (quasiment toutes sont des PME et aucune n'atteint 500 M€ de CA.) et très nombreuses. La restructuration pour limiter les coûts de production et faire des économies d'échelle reste peu importante ».
Là où le taux d'évolution annuel, sur la période 2010-2019 des volumes produits en France était de - 0,96 %, ce taux atteignait - 1,79 % pour les coopératives, témoignant d'une dynamique baissière plus importante.
À l'automne 2024, il y aurait plus d'une centaine de caves en grande difficulté, soit plus de 20 % des entreprises coopératives de la filière vin. Cette part des caves dans l'impasse financière atteint 37 % en Occitanie, 40 % à Bordeaux et 50 % dans la vallée du Rhône. La dynamique de fusions-absorptions est déjà bien engagée puisque les coopératives étaient plus de 700 en 2010 et 960 en 2 000.
Les caves souffrent en effet de l'évolution structurelle de la consommation, produisant historique des volumes en vrac et peu en bouteilles. Elles ont en outre souffert de la concurrence qu'elles ont pu exercer les unes envers les autres lorsque dans un périmètre très réduit cohabite plusieurs coopératives.
À l'occasion de chacun de leur déplacement, les rapporteurs ont tenu à rencontrer les représentants de la coopération. S'ils ont pu y voir parfois de grandes difficultés voire de la détresse, ils ont aussi pu observer le dynamique de certaines structures pour mieux adresser la demande.
Le PLF pour 2025 avait acté la création d'un fond de 10 M€ en soutien à la restructuration des caves coopératives. Ce fond n'a jamais vu le jour, remplacé par une mission d'inspection du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) pour réaliser un diagnostic de ces structures. Selon le Masa, cette mission a pour objet :
- « d'identifier et quantifier les difficultés actuelles, ainsi que celles à venir, notamment en lien avec la mesure d'arrachage définitif en déploiement ou les problèmes rencontrés à l'export.
- d'identifier les différents leviers dont disposent les caves coopératives viticoles pour prévenir et amortir les crises conjoncturelles, mais aussi structurelles rencontrées par la filière.
- déterminer si les mesures du plan de soutien envisagé par les caves coopératives ainsi que leur calibrage financier sont pertinentes pour répondre aux problèmes rencontrés, et dans quelle mesure d'autres vecteurs, y compris non budgétaires, pourraient utilement s'y substituer le cas échéant ».
Les conclusions de la mission devraient être rendues fin 2025. Les rapporteurs appellent alors l'État, au regard des conclusions et des recommandations du rapport, à prendre ses responsabilités et à tenir les engagements pris devant les coopérateurs et la représentation nationale.
Recommandation : Dans le cadre des recommandations à venir du rapport du CGAAER sur les coopératives viticoles, assurer le soutien financier de l'État à leur restructuration, conformément aux engagement pris en PLF pour 2025.
B. LE BESOIN D'UNE SIMPLIFICATION ET D'UNE STABILISATION DES NORMES, NOTAMMENT FISCALES, FRAPPANT L'ACTIVITÉ DE VITICULTEUR
1. En plus des difficultés économiques, le poids des normes administratives
a) Un « choc de simplification » qui se fait attendre
La problématique de la complexité administrative dépasse largement les seules frontières de la viticulture, et des constats sont faits, de longue date, en matière d'agriculture au sens large. Ce sont notamment ces constats qui ont alimenté nombre de récentes manifestations agricoles, de même que des initiatives parlementaires, notamment au Sénat.
À l'occasion du salon international de l'agriculture (SIA) de février 2024, Thomas Cazenave, alors ministre délégué chargé des comptes publics et par ailleurs député de Gironde avait signé une lettre d'engagement avec les représentants de la filière, pour mener à bien un important chantier de sept axes de simplifications. Le ministre avait indiqué avoir recensé pas moins de « 86 déclarations potentielles et 54 portails, répartis entre les administrations et les organismes professionnels »212(*).
La lettre d'engagement du lundi 26 février 2024213(*)
Axe n° 1 : réexaminer le corpus déclaratif à l'aune du principe « dites-le-nous une fois »
Axe n° 2 : harmoniser les modalités de calcul du parcellaire en matière de viticulture
Axe n° 3 : simplifier les obligations requises par l'application « Mouvements viticoles »
Axe n° 4 : arrêter les contours d'un compte viticole unique
Axe n° 5 : assouplir le dispositif de circulation des vins en droits acquittés
Axe n° 6 : évaluer le système d'épalement des cuves en vue d'alléger la règlementation
Axe n° 7 : actualiser le régime de gestion des alambics
S'il faut souligner que de nombreux chantiers sont engagés, voire clôturés, à l'instar de l'harmonisation des modalités de calcul du parcellaire pour lesquelles les rapporteurs formuleront une recommandation (axe 2)214(*), l'ampleur des chantiers associée à l'instabilité gouvernementale n'est pas de nature à accélérer cet indispensable mouvement de simplification et d'actualisation du droit. En août 2024, Raphaël Fattier, le directeur de la Cnaoc soulignait toutefois à la presse spécialisée la continuité des travaux entrepris, par-delà les aléas politiques, dans la mesure où il s'agit d'un travail essentiellement technique, en lien avec les administrations concernées. Le directeur soulignait en outre « un tournant méthodologique dans le travail réalisé avec l'administration », ce dont les rapporteurs ne peuvent que se réjouir.
Dans sa contribution écrite, la DGDDI a fourni le tableau suivant d'avancement des différents chantiers engagés.
|
Action |
Statut |
Commentaires |
|
Mesures à réaliser à horizon 2025 |
||
|
Simplifier les obligations requises par l'application MVV (Mouvements viticoles) |
Réalisé |
- Travaux informatiques : basculement depuis les applications MVV et GAMMA legacy vers GAMMA2 réalisé le 25 juin 2025 - Travaux règlementaires : circulaire sur la circulation des produits viticoles non soumis à accise |
|
Assouplir le dispositif de circulation des vins en droit acquitté |
Réalisé |
- Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés publié au JO du 30 juin 2025 - Arrêté du 27 juin 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 publié au JO du 30 juin 2025 |
|
Évaluer le système d'épalement des cuves en vue d'alléger la règlementation |
Réalisé |
Décret n° 2025-591 du 27 juin 2025 portant simplifications des obligations relatives à la distillation : suppression de l'obligation d'épaler les cuves d'alcools tous les 20 ans (basculement dans les codes sectoriels) |
|
Actualiser le régime de gestion des alambics |
Réalisé |
Au 1er juillet, mise en place du régime déclaratif en lieu et place du régime d'autorisation préalable pour la réparation d'alambics. |
|
Clarifier la règlementation afin d'éviter des divergences d'interprétation et des inégalités de traitement entre viticulteurs d'un bassin viticole à l'autre |
En cours |
- Mise en oeuvre de la circulaire agroforesterie : publication d'une FAQ sur le site de la douane en mai 2025 - Circulaire relative à la prise en compte de certains éléments utiles à la bonne exploitation de la parcelle pour le calcul de la superficie plantée au CVI, éligible à la production signée. Présentation au CN VINIGP le 1er juillet 2025 et signature à suivre |
|
Clarifier les modalités de prise en compte des pertes et manquants dans le secteur des alcools (mesure ajoutée après la signature de la lettre d'engagement) |
Réalisé |
Circulaire du 30 juin 2025 - BOD n° 7583 |
|
Clarifier la doctrine relative à la taxe dite « premix » (mesure ajoutée après la signature de la lettre d'engagement) |
Réalisé |
Circulaire du 31 juillet 2025 |
|
Modernisation du régime des bouilleurs de cru et des bouilleurs ambulants (mesure ajoutée après la signature de la lettre d'engagement) |
En cours |
Organisation d'un groupe de travail avec les représentants des opérateurs au dernier quadrimestre 2025 |
|
Mesures à réaliser à horizon 2026-2027 |
||
|
Réexaminer le corpus déclaratif à l'aune du principe « dites-le-nous une fois » |
En cours |
- Poursuite des travaux internes à la douane pour simplifier et rationaliser nos outils informatiques à destination des opérateurs - Poursuite des travaux de rapprochement des outils entre FranceAgriMer et la douane |
|
Harmoniser les modalités de calcul du parcellaire en matière de viticulture |
En cours |
Saisine de la Commission européenne en vue d'un alignement des modalités de calcul des surfaces aidées et des modalités de calcul de la superficie plantée au CVI |
|
Arrêter les contours d'un compte viticole unique |
En cours |
Échanges avec d'autres administrations |
Si un réel et incontestable effort est donc à saluer, les nombreuses auditions menées, tout comme les déplacements effectués, ont convaincu les rapporteurs que le choc de simplification n'est pas encore advenu. Est à ce titre souvent mentionné le paradoxe de la dématérialisation des procédures, qui, si elle facilite la tâche des administrations, en vient parfois à compliquer la vie des professionnels, confrontés à des évolutions en cascade et non coordonnées entre les administrations, parfois juste avant ou pendant la période critique et épuisante des vendanges. Ainsi, la plateforme « GAMMA 2 » des douanes, sur laquelle les viticulteurs doivent renseigner de nombreuses informations, est-elle entrée en service en juillet 2025, juste avant les vendanges.
Marion Saüquere, directrice de la CAVB, indiquait en octobre 2025 à la presse spécialisée qu'« en moyenne, un vigneron passe 9h par semaine sur l'administratif ».
Les rapporteurs constatent que la mise en place du « dites-le-nous une fois » se fait malheureusement encore attendre sur les territoires et que la lourdeur des tâches administratives, combinée au risque de se voir infliger une sanction en cas d'erreur, pèse fortement sur le moral de la profession. Les vignerons qui le peuvent doivent souvent se résoudre à embaucher des spécialistes pour s'occuper des obligations administratives, ce qui grève la rentabilité des exploitations. Les viticulteurs ne pouvant se permettre de déléguer à des prestataires ou d'embaucher, se reposent bien souvent sur des conjoints eux aussi parfois à bout de souffle.
Dans sa contribution écrite, la Cnaoc souligne notamment les enjeux suivants :
· « Intégration du droit à l'erreur et d'une marge d'erreur ;
· Fusion de la déclaration de récolte et de la déclaration de revendication pour les régions qui le souhaitent ;
· Fusion des déclarations de surface et de la déclaration annuelle d'inventaire de juillet lorsque les dates coïncident ;
· Fusion du document administratif électronique et la déclaration d'échanges de biens ».
Les rapporteurs, eux-mêmes viticulteurs de profession, ne peuvent que souscrire à ces propositions.
Le baromètre e-santé 2024 de la CAVB souligne que pour un tiers des vignerons sondés, la relation avec l'administration est un facteur majeur de stress. En Bourgogne, où les parcelles sont réduites et où de nombreux vignerons vinifient de nombreuses appellations et vendent une large partie de leur production à l'international, les obligations administratives n'en sont que plus lourdes.
En outre, de très nombreuses auditions menées tendent à montrer, que, du ressenti de la profession, les administrations jouent le jeu de la simplification de façon parfois inégale. À ce titre, il apparaît que la DGDDI a véritablement mis à l'agenda la simplification en matière viticole, ce qui se doit d'être souligné.
Enfin, en matière de simplification, les rapporteurs notent qu'il existe différentes façons de mesurer la surface d'une parcelle viticole selon l'usage qui en est fait :
· Une surface cadastrale, correspondant à celle indiquée sur les actes de propriété et accessible en ligne sur le site geoportail.gouv.fr ;
· Une surface déclarée à la DGDDI, la surface « CVI ». Elle correspond à la surface plantée augmentée des éléments non productifs et paysagers de la parcelle à l'instar des haies, des talus ou des tournières ;
· Une surface mesurée par FranceAgriMer, la surface « primable », au ras des souches, qui sert à calculer les aides pouvant être perçues au titre de la restructuration du vignoble.
Source : Syndicat des vins Côtes de Provence
Une circulaire du 4 juillet 2025 est venue, à la demande de la filière, acter le fait que le calcul de la surface plantée inscrite au sein du CVI, en plus de prendre en compte les arbres et les haies, prend en compte les éléments utiles à la bonne exploitation de la parcelle, à savoir les tournières, bandes latérales, fossés et talus. Cette acceptation de la parcelle diffère donc nécessairement de la surface réellement plantée et permet indirectement d'accroître le potentiel de production, à l'heure où la filière évoque des problématiques de surproduction.
Aussi, les rapporteurs suggèrent de procéder à une simplification en ne prenant en compte que la surface réellement plantée comme référence au CVI, à l'instar de ce que prend en compte FranceAgriMer dans le calcul des aides aux viticulteurs. En cohérence, ils proposent que la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) soit assise sur cette même surface réellement plantée.
b) Une autre problématique structurelle : le recrutement
Comme d'autres secteurs économiques, la viticulture peine souvent à pourvoir à l'ensemble de ses besoins de main-d'oeuvre. C'est à ce titre que le secteur, ainsi que le secteur agricole de manière générale, a intégré la liste des métiers dits « en tension »215(*), permettant la délivrance d'autorisations de travail aux étrangers non européens, sans que la situation de l'emploi puisse être opposée. Cette simplification vise à faciliter et accélérer les recrutements.
Et pour cause, même si ce chiffre semble diminuer, selon une étude de la BPCE216(*) menée en interrogeant 1 251 chefs d'exploitations issus de tous les bassins viticoles, en 2023, 70 % des viticulteurs sont des employeurs (et même 81 % des vignerons), un chiffre bien supérieur aux agriculteurs, en raison des importants besoins en main-d'oeuvre au moment des vendanges. Selon cette même enquête, 75 % des viticulteurs déclarent avoir au moins une difficulté en tant qu'employeur, le recrutement de saisonniers revenant dans 48 % des cas.
Source : BPCE
Outre le recrutement, les viticulteurs employeurs doivent faire face à deux problématiques complémentaires, celle du logement et celle du temps de travail.
Durant les vendanges, les viticulteurs ont des besoins importants de main-d'oeuvre, mais aussi de vastes amplitudes horaires, condition indispensable à la récolte rapide des raisins à la maturité souhaitée. En conséquence, des dérogations à la durée maximale de temps de travail sont demandées par la filière. Ces dérogations sont prévues par les articles L. 3121-21, R. 3121-8 à R.3121-10 du code du travail, ainsi que par les articles L. 731-1, L. 713-13 et R. 713-11 à R. 713-13 du CRPM.
En cette matière, il a été indiqué aux rapporteurs le caractère usant, pour les professionnels, de devoir annuellement demander et justifier la même dérogation, pour les mêmes activités. En effet, la demande est nécessairement annuelle comme semble l'impliquer la lecture de l'article R. 3121-8 du code du travail susmentionné. Or, si les dates des vendanges sont certes amenées à évoluer en raison du dérèglement climatique, celles-ci sont effectuées de façon immuable chaque année, et nécessitent, chaque année, une utilisation intensive de main-d'oeuvre sur une courte période.
En déplacement en Bourgogne au contact des représentants de la filière, l'attention des rapporteurs a également été attirée sur la problématique des logements, condition essentielle pour attirer et fidéliser la main-d'oeuvre saisonnière. Cette problématique se rencontre dans de nombreux vignobles, comme l'ont d'ailleurs souligné de récentes enquêtes sur les conditions d'hébergement difficiles, voire tout bonnement illégales de certains saisonniers, notamment étrangers, dans de grands vignobles.
Les professionnels ont toutefois attiré l'attention des rapporteurs sur l'empilement des normes en matière d'hébergement, qui complique le développement de l'offre. C'est également le constat fait par la Cour des comptes dans un rapport de juillet 2025 sur le logement des travailleurs saisonniers. Notant que « Le mieux peut être l'ennemi du bien », la Cour écrit : « Les normes peuvent constituer un effet dissuasif auprès de certains employeurs. Ainsi, dans le secteur agricole, l'exigence normative, représente un investissement considéré comme trop lourd par les agriculteurs. Des effets collatéraux de précarisation des saisonniers agricoles ont pu être observés. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) considère que la règlementation trop stricte empêche les exploitants de proposer des solutions jugées non règlementaires, ce qui oblige les saisonniers à recourir à des solutions de fortune et à se retrouver parfois dans des situations bien pires. »
La Cour, comme, du reste, les interlocuteurs de terrain des rapporteurs, note par exemple que les règles de l'hébergement sous tente peuvent être questionnées. En effet, celui-ci est possible du 1er juin au 15 septembre uniquement dans certains cantons de 15 départements situés dans la moitié sud de la France, une règle datant de 1996217(*). Depuis, l'évolution des conditions climatiques semble interroger ce zonage.
Enfin, la Cour note l'existence de dérogations pour l'installation d'hébergements légers transitoires, qui pourraient contribuer à détendre la situation, à l'image du travail mené par la filière du kiwi dans la vallée de l'Adour, en lien avec des services de l'État facilitateurs, filière forte pourvoyeuse de main-d'oeuvre en novembre pour la récolte.
En tout état de cause, les difficultés de recrutement rencontrées par la filière, désormais classée parmi les secteurs en tension, sont accrues par ces problématiques relatives à l'établissement des dérogations en matière de temps maximal de travail et à celle de l'hébergement et des normes entourant ce dernier.
Recommandation : Amplifier le chantier de la simplification entamé :
· en faisant aboutir, au niveau national, le « dites-le-nous une fois » et en facilitant les modalités de recrutement et d'hébergement des travailleurs saisonniers ;
· réalisant les déclarations de récolte sur la surface réellement plantée et en asseyant l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) sur cette même surface.
c) Une simplification européenne qui se fait attendre : le guichet unique européen dédié au paiement de l'accise
La vente à distance directe vers un particulier résidant dans un autre État de l'Union européenne relève aujourd'hui du parcours du combattant, et ce, en particulier pour les petits producteurs.
En effet, la directive relative au régime général d'accise218(*) prévoit que, dans le cas d'une vente à distance, les produits sont soumis aux droits d'accise dans l'État membre de destination. En outre, la personne redevable des droits d'accise dans l'État membre de destination est l'expéditeur, et ces droits doivent être payés conformément à la procédure arrêtée par l'État membre de destination.
Aux fins de paiement des droits d'accise, l'expéditeur ou le représentant fiscal désigné par l'expéditeur doit, préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès d'un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l'État membre de destination. L'expéditeur s'acquittera enfin des droits auprès du bureau désigné par l'État membre de destination.
Ces règles compliquent largement l'exportation vers des particuliers. En effet, dès lors que l'accise doit être acquittée par l'expéditeur, dans le pays de destination et selon la procédure établie par celui-ci, une telle exportation suppose la maîtrise du droit du pays de destination. La maîtrise de l'anglais ou de la langue de l'État de destination sera, elle aussi, indispensable. Le coût administratif d'une telle opération se révèle ainsi important, conduisant de très nombreux producteurs à renoncer à l'exportation directe vers des particuliers.
À l'occasion de leur déplacement dans l'Aude et dans l'Hérault à la rencontre des acteurs de la filière dans le cadre de la mission d'information, un viticulteur visité par les rapporteurs a d'ailleurs soulevé cette problématique qui constitue un frein tangible à l'élargissement de ses débouchés.
Cette situation est particulièrement dommageable dans un contexte où la vente directe tend à se développer. Elle freine en particulier les producteurs qui accueillent des oenotouristes, dès lors que ces oenotouristes, s'ils sont venus en France en train ou en avion, ne peuvent emporter que des quantités très limitées de vin.
Face à cette situation, la filière réclame de longue date l'institution d'un guichet unique européen de paiement des droits d'accise, sur le modèle du guichet unique déjà existant en matière de TVA (guichet dit OSS-IOSS219(*)). Concrètement, l'expéditeur effectuerait les formalités nécessaires dans son État membre, et non plus dans l'État membre de destination, dans une langue qu'il maîtrise. En outre, ce guichet unique permettra à l'expéditeur d'accéder beaucoup plus facilement aux informations nécessaires à l'exportation, telles que le taux applicable.
Toutefois, en dépit de la mobilisation des autorités françaises à ce sujet, aucun accord n'a permis d'aboutir à la réalisation d'un guichet unique dédié au paiement de l'accise.
Il est vrai, comme a pu le souligner la DGDDI, que la création d'un tel guichet unique suppose l'unanimité au Conseil220(*). Néanmoins, une telle unanimité était également requise pour l'institution du guichet unique en matière de TVA221(*).
Ainsi, les rapporteurs souhaitent insister sur la nécessité de parvenir, dans les plus brefs délais, à créer un guichet unique en matière d'accise. Cette simplification est absolument nécessaire pour rendre pleinement effective la liberté de circulation des marchandises viticoles produites par les petits producteurs.
Recommandation : Intensifier au niveau européen, les efforts français pour parvenir à la création d'un guichet unique européen dédié au paiement de l'accise.
2. Veiller à concilier normes environnementales et pérennité des exploitations viticoles
Comme illustré précédemment, la filière viticole française, disposant du premier vignoble certifié bio du monde (23 % des surfaces) prend très au sérieux la question environnementale. Cette question ne saurait être instrumentalisée dans une optique de pointer du doigt un monde agricole et viticole déjà en situation de mal-être.
À ce titre, les rapporteurs souhaitent souligner que l'étude PestiRiv, menée pendant plusieurs années conjointement par l'Anses et Santé publique France, pour un coût d'environ 11 M€ - soit davantage que ce qui a été promis, et pour le moment non octroyé, aux coopératives pour accompagner leur restructuration - a eu pour résultats, rassurants, et comme l'ont confirmé les deux agences en audition en octobre 2025 devant les membres du groupe d'étude « Agriculture, élevage et alimentation » du Sénat, l'absence d'alerte. Et pour cause, si l'étude conclut, fort logiquement, que l'exposition aux produits phytopharmaceutiques (PPP) des riverains habitant à proximité des vignes est supérieure à celle des riverains qui en sont éloignés, elle ne recommande aucun retrait ou modification d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de produits.
Ces résultats sont donc la preuve, d'une part, que la protection garantie par les AMM fonctionne et, d'autre part, que les viticulteurs ne font pas n'importe quoi dans leurs vignes. Si la conclusion commune des deux agences recommande d'« inscrire les utilisations des PPP dans une logique de minimisation et de strict nécessaire », alors les rapporteurs ne peuvent que la partager dans le mesure où cela correspond d'ores et déjà à la démarche de la filière.
En outre, les rapporteurs souhaitent rappeler que la protection de l'environnement, indispensable, doit aussi s'inscrire dans le cadre d'une activité économique tout aussi indispensable aux territoires, aux hommes, au rayonnement et au dynamisme économique d'une filière. À ce titre, la filière, comme toute filière, doit être consultée dans le cadre de l'élaboration des normes la concernant.
L'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la suite d'une décision du 26 avril 2024 du Conseil d'État, a trouvé à s'appliquer à la filière. Jusqu'à une récente souplesse accordée par la direction générale de l'alimentation (DGAL), les viticulteurs ne pouvaient plus que très difficilement, en raison de contraintes horaires disproportionnées, traiter des vignes en fleurs, peu attractives pour les insectes, pour lutter contre la pression du mildiou, de l'oïdium ou encore du black-rot.
En outre, le dossier des zones de non-traitement (ZNT) constitue encore une norme affectant tout particulièrement la viticulture, dont les habitations (des riverains comme des viticulteurs) sont souvent proches des vignes. L'article 43 de la loi d'orientation agricole visait à ce titre à insérer, au sein du code de l'urbanisme, un nouvel article L. 151-6-3 afin de prévoir que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme définissent les conditions dans lesquelles est mise à la charge de l'aménageur l'institution d'un espace de transition entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Cette initiative sénatoriale, issue des amendements de Daniel Laurent, Loïc Hervé, Sebastien Pla et Florence Lassarade, a malheureusement été censurée comme « cavalier législatif ». Les rapporteurs ne peuvent que le déplorer car, lorsque l'urbanisation vient à la viticulture, ce n'est pas à la viticulture de s'adapter.
3. Ne pas alourdir le poids des taxes, déjà lourdes, frappant les boissons alcoolisées
a) La fiscalité des boissons alcooliques est déjà lourde et variée
En raison de leur importante consommation, les boissons alcooliques constituent une assiette d'imposition particulièrement rentable pour les pouvoirs publics. Ainsi, en 1324, le royaume de France ne comptait pas moins de 28 droits ou taxes sur la production, la circulation et la vente des boissons alcooliques222(*).
La finalité incitative, ou la visée « comportementale » de cette taxation des boissons alcooliques est plus récente, quoique discutée. Ainsi, selon une formule célèbre prononcée en 1864 par Karl David Heinrich Rau, économiste allemand, « l'eau-de-vie est (...) une excellente matière imposable, parce que son usage devient aisément excessif, se change promptement en habitude, et devient si dangereux pour l'esprit et le corps que le législateur doit désirer de restreindre sa consommation par l'élévation de son prix ». Néanmoins, le conseil des prélèvements obligatoires (CPO) relève que le principal objet de cette fiscalité n'était pas sa finalité désincitative. En effet, selon le CPO, jusqu'à la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée en 1954, la fiscalité indirecte était avant tout assise sur des objets dont la production, la consommation ou la circulation étaient facilement identifiables, plutôt que pour d'autres raisons d'intérêt général223(*).
Comme la très grande majorité des produits de consommation, les boissons alcooliques sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Alors que les produits alimentaires destinés à une consommation différée, y compris les boissons non alcooliques, sont soumis au taux réduit de 5,5 %224(*) et que les produits alimentaires destinés à une consommation immédiate, y compris les boissons non alcooliques, sont soumis au taux réduit de 10 %225(*), les boissons alcooliques font office d'exception et sont soumises au taux normal de 20 %226(*).
Outre la TVA, les boissons alcooliques sont soumises à plusieurs impositions spéciales. La plus importante d'entre elles est l'accise, impôt indirect frappant les boissons alcooliques et l'alcool, les produits énergétiques ainsi que les produits du tabac susceptibles d'être fumés227(*). Les règles relatives à l'accise sur les boissons alcooliques sont partiellement harmonisées au niveau européen depuis 1992 et l'adoption de trois directives228(*).
La France s'est également dotée, avec la loi Bérégovoy, d'une cotisation sociale sur les boissons alcooliques « en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé »229(*) et dont les règles générales sont analogues à celles de l'accise230(*). Initialement applicable aux seules boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 %, son assiette a été étendue en 2011 pour y inclure toutes les boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 %231(*).
Les taux de l'accise et de la cotisation sociale sur les principales boissons alcooliques se répartissent ainsi en 2025232(*) :
|
Catégorie fiscale |
Taux de l'accise |
Taux de la cotisation sociale |
Total |
|
Vins tranquilles |
4,12 €/hl233(*) |
0 |
4,12 €/hl |
|
Vins mousseux234(*) |
10,20 €/hl |
0 |
10,20 €/hl |
|
Vins pétillants faiblement alcoolisés (vol. < 8,5 %), cidres, poirés et hydromels |
1,43 €/hl |
0 |
1,43 €/hl |
|
Vins doux naturels et vins de liqueurs AOP dont le TAV < 18 % |
51,49 €/hl |
0 |
51,49 €/hl |
|
Vins doux naturels et vins de liqueurs AOP dont le TAV > 18 % |
51,49 €/hl |
20,61 €/hl |
72,10 €/hl |
|
Autres produits intermédiaires235(*) |
205,93 €/hl |
51,49 €/hl |
257,42 €/hl |
|
Bières dont le TAV < 2,8 %) |
4,05 €/hl/vol236(*) |
0 |
4,05 €/hl/vol |
|
Bières dont le TAV est compris entre 2,8 et 18 % |
8,10 €/hl/vol |
0 |
8,10 €/hl/vol |
|
Bières produites par de petites brasseries (prod. = 200 000 hl/an) |
4,05 €/hl/vol |
0 |
4,05 €/hl/vol |
|
Boissons fermentées autres que le vin et la bière |
4,12 €/hl |
0 |
4,12 €/hl |
|
Rhum des DOM |
950,12 €/hlap |
609,80 €/hlap |
1559,92 €/hlap |
|
Autres alcools237(*) |
1899,18 €/hlap238(*) |
609,80 €/hlap |
2508,98 €/hlap |
Ainsi, sur une bouteille d'eau-de-vie de vin de 70 cl titrant à 40 % d'alcool, le montant cumulé de l'accise et de la cotisation sociale atteint plus de 7 € par bouteille239(*).
Enfin, il y a lieu de préciser que les tarifs de l'accise et de la cotisation sociale sur les boissons alcooliques sont indexés sur l'inflation, sans que l'évolution annuelle ne puisse être négative ou excéder 1,75 %240(*).
En outre, en 1996, le législateur a souhaité limiter la consommation des boissons issue du mélange préalable d'une boisson non alcoolisée et d'une boisson alcoolisée, mélange plus connu sous le vocable de « prémix » ou « alcopop », quoique ce dernier soit désuet, au motif que ce type de boissons encouragerait la consommation d'alcool chez les plus jeunes. Pour atteindre cet objectif, le législateur a eu recours à l'instrument fiscal en créant un impôt spécial sur ces « prémix »241(*).
L'assiette de cet impôt a été étendue en 2004242(*) pour y inclure certaines boissons constituées par un ou plusieurs produits alcooliques et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti. Le but est ici de frapper les boissons pouvant être issues de mélanges d'alcool, comme un mélange de cidre et de liqueur ou un mélange de bière et de rhum243(*), et non pas des produits alcooliques classiques qui contiendraient plus de 35 grammes de sucre par litre.
Les vins aromatisés et les boissons aromatisées à base de vin comme le rosé pamplemousse244(*) étaient initialement exclus de l'assiette de cet impôt sur les prémix. Néanmoins, estimant que cela était nécessaire pour des motifs de santé publique, le législateur les a inclus à partir de 2020245(*).
Le taux se veut prohibitif : 3 000 euros par hectolitre d'alcool pur (€/hlap) pour les vins aromatisés et boissons aromatisées à base de vin, et 11 000 €/hlap pour les autres boissons assujetties.
L'assiette de cette taxe, combinée à son taux prohibitif, conduit à des résultats contraires à l'esprit de cette taxe. Ainsi, alors que le titre alcoométrique volumique de l'Aperol est de 11 % dans la très grande majorité des marchés, celui-ci titre à 12,5 % en France avec pour principal objectif d'échapper à la taxe prémix...
b) Assurer impérativement une stabilité fiscale à la filière
Ces dernières années, de nombreuses propositions visant à renforcer la fiscalité sur les boissons alcooliques ont pu émerger et de nombreux amendements aux derniers projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale visent à renforcer la fiscalité des boissons alcooliques. Ces amendements ont été pour l'essentiel rejetés et aucun d'entre eux n'a été adopté par les deux chambres parlementaires.
Quoiqu'elles puissent éventuellement être justifiées par des objectifs de rentabilité fiscale, ces propositions ne prennent que trop peu, voire aucunement, en compte les difficultés que connaît la filière viticole française ni son environnement concurrentiel.
Il convient d'abord de noter que l'assujettissement du vin à l'accise, aussi faible puisse-t-elle être, n'est pas loin de relever de l'anomalie. Alors que la France est historiquement le plus grand producteur de vin en Europe et dans le monde, celle-ci fait le choix de pénaliser sa propre filière en l'assujettissant à l'accise246(*). Ce choix, principalement justifié par un objectif de rendement fiscal, ne s'imposait aucunement : la directive européenne relative au taux de l'accise n'oblige pas à imposer l'accise sur les vins. C'est par ailleurs le choix réalisé par la moitié des États membres de l'Union européenne, et notamment par l'Italie et l'Espagne.
Taux de l'accise sur une bouteille de vin standard
de 75 cl
dans l'Union européenne et au Royaume-Uni en
juillet 2021
Source : Tax Foundation, d'après les données de la Commission européenne (Taxes in Europe Database)
La Commission européenne a déjà envisagé, en 2006, d'imposer aux États membres d'assujettir les vins à l'accise, en relevant le taux minimal, qui est nul aujourd'hui. Ce ne sont pas un, ni deux, mais douze États membres qui se sont opposés « avec fermeté à toute proposition visant à instaurer un taux minimal positif sur le vin »247(*).
Le rehaussement des taux de l'accise ou l'assujettissement des vins à la cotisation sur les boissons alcooliques, fût-ce au taux réduit, aurait plusieurs conséquences.
D'abord, de telles propositions omettent souvent de le rappeler : augmenter les droits de consommation sur les boissons alcooliques revient à augmenter le montant de la TVA. En effet, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA elle-même sont à inclure dans la base de l'imposition de la TVA248(*). Relever les taux des différents droits de consommation augmentant l'assiette de la TVA, le montant de la TVA croît lui aussi.
Ensuite, une telle hausse des droits de consommation viendrait fortement pénaliser une filière déjà fragilisée. En effet, le prix constitue un critère déterminant lors de l'achat de boissons, et constitue même le premier critère du consommateur qui souhaite acheter une bouteille de vin249(*). En somme, une augmentation brutale du prix du vin pourrait conduire les consommateurs de boissons à se tourner vers des boissons moins onéreuses, telles que la bière.
Par ailleurs, et quoique le phénomène serait sans doute d'une ampleur limitée, un fort accroissement du prix du vin vendu en France pourrait ainsi conduire les consommateurs frontaliers à se détourner du vin français au profit de vins étrangers, et notamment italiens et espagnols. En effet, il est possible, pour un particulier, d'importer librement jusqu'à 90 litres de vin, dont 60 litres de vin mousseux.
Ainsi, les propositions tendant à augmenter la fiscalité sur la consommation de vin en France pourraient affaiblir davantage la filière viticole française déjà en crise, tout en renforçant ses concurrents directs.
Recommandation : Garantir à la filière viticole une stabilité fiscale.
C. L'oeNOTOURISME EST UNE VOIE MAJEURE DE DIVERSIFICATION QUI DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE
L'oenotourisme est une activité en plein essor et un levier essentiel pour la filière viticole, permettant à de nombreux viticulteurs de diversifier leurs activités et sources de revenus. Si la filière viticole et ses partenaires ont tout à gagner à poursuivre le développement de l'oenotourisme, force est de constater que le potentiel de la France est sans doute sous-exploité. Des mesures de nature et degré divers devraient toutefois permettre à la filière de mieux exploiter son potentiel.
1. Une filière qui s'est largement renforcée ces 20 dernières années
La France, première destination touristique mondiale, n'a pas à rougir de ses performances en matière d'oenotourisme. La filière a vite compris le potentiel que représente cette activité, et commence à s'organiser pour la faire croître.
a) Une forte progression en volume et en valeur
L'oenotourisme a connu, sur les deux dernières décennies, une progression remarquable. Le rapport de Gérard César de 2002 identifiait déjà l'importance de cette activité. Selon Atout France, douze millions d'oenotouristes qui ont visité la France en 2023 (+ 20 % depuis 2016)250(*). Dans le détail, l'on compte 6,6 millions d'oenotouristes français et 5,4 millions d'oenotouristes étrangers. L'essor des clientèles étrangères est particulièrement marqué, avec une progression de + 29 %, contre + 14 % pour la clientèle française. Le chiffre d'affaires de la filière atteindrait 7 milliards d'euros, selon une étude réalisée par le cabinet Deloitte pour Vin & Société en 2025.
La France partait pourtant de loin. En effet, en 2006, le nombre d'oenotouristes, français comme étrangers, en France, était estimé à environ 7 millions seulement251(*), un chiffre assez faible au regard de la puissance d'attraction de la France. Autre chiffre révélateur : alors que l'on comptait, selon l'Agence française d'ingénierie touristique, environ 5 000 caves ouvertes à la visite en 2001252(*), plus de 10 000 sont aujourd'hui ouvertes à la visite253(*).
b) Une filière qui s'est structurée et professionnalisée
De nombreuses actions, mises en oeuvre par la filière, les viticulteurs et les pouvoirs publics expliquent ce développement.
D'abord, les pouvoirs publics ont déployé des efforts importants pour encourager la structuration de la filière. Michel Barnier, ministre chargé de l'agriculture et Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du tourisme ont demandé en 2006 à Paul Dubrule, ancien sénateur et cofondateur du groupe Accor, de leur remettre à un rapport sur l'état de l'oenotourisme. À la suite de ce rapport, faisant notamment le constat d'une insuffisante structuration de la filière, Michel Barnier et Hervé Novelli ont créé, en 2009, le Conseil supérieur de l'oenotourisme (CSO), association composée d'acteurs professionnels, d'institutionnels et d'experts issus du monde du tourisme et de la viticulture. C'est notamment sous son impulsion que sera créé le label Vignobles et Découvertes.
|
Le label Vignobles & Découvertes Dans la foulée de la création du conseil supérieur de l'oenotourisme, la marque « Vignobles & Découvertes » a été créée en 2009. Le label est attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, après recommandation du CSO, à une destination254(*) à vocation touristique et viticole et à ses partenaires proposant une offre de produits touristiques, tels que les caves ouvertes au public, établissements d'hébergement et des établissements de restauration, ainsi que les offices de tourisme. Afin d'améliorer la coopération entre les différents acteurs, la labellisation est aussi ouverte aux sites patrimoniaux naturels et culturels et aux événements associés à l'univers du vin. Ce label peut être considéré comme une réussite. En effet, aujourd'hui, ce sont 75 destinations et un réseau de plus de 8 600 acteurs oenotouristiques, dont 2 892 caves et domaines255(*), qui sont labellisés. |
Le label aura notablement contribué à l'amélioration et à la professionnalisation de l'offre oenotouristique. Alors que les initiatives en matière d'oenotourisme peuvent être nombreuses, le label Vignobles & Découvertes permet de renforcer la lisibilité de l'offre. En outre, le cahier des charges du label se veut exigeant, contribuant à la professionnalisation de l'offre. À titre d'exemple, l'on peut relever que la maîtrise d'une langue étrangère est exigée pour les partenaires souhaitant être labellisés.
Un autre levier ayant permis la professionnalisation de la filière est la formation. Des établissements spécialisés proposent aujourd'hui des formations dédiées à l'oenotourisme, à destination de professionnels principalement256(*). Les universités ne sont pas en reste et proposent de leur côté des diplômes d'université257(*). L'école de management de Strasbourg a même créé une chaire vin et tourisme, qui associe à ses travaux de nombreuses entreprises de la filière ainsi que le conseil interprofessionnel des vins d'Alsace258(*). Enfin, certaines régions ont également pris des initiatives en la matière, en assurant elles-mêmes des formations, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La filière oenotouristique se caractérise enfin par une offre diversifiée. Si la visite et la dégustation demeurent incontournables, l'offre s'est enrichie ces dernières années, combinant hébergement, restauration, promenades et activités ludiques liées au vin, telles que des escape games dans les vignes ou les chais. Certaines expériences vont plus loin encore, comme la « spéléoenologie », qui propose de déguster des vins dans le noir absolu de la grotte Saint-Marcel, en Ardèche.
c) Une amélioration de l'offre répondant à une demande croissante et aux besoins des viticulteurs
Cette professionnalisation et diversification de l'offre oenotouristique répondent à une demande croissante des touristes. Comme le relève le conseil supérieur de l'oenotourisme, « l'oenotourisme s'inscrit parfaitement dans la tendance du "slow travel" - un tourisme lent, qualitatif, à faible impact environnemental et à forte contribution économique locale ». En outre, selon un sondage réalisé par Dynata pour Vin & Société auprès de touristes allemands, chinois, espagnols, états-uniens, japonais, néerlandais et britanniques, 17 % des touristes internationaux citent le vin parmi les trois premières raisons les ayant conduits à visiter la France259(*). Selon Atout France, c'est un touriste international sur trois qui cite le vin et la gastronomie comme motivations de choix d'un séjour en France260(*).
Si l'oenotourisme répond à la demande, il répond aussi de nombreux besoins de viticulteurs et acteurs de la filière viticole, expliquant également son développement.
L'oenotourisme constitue d'abord un excellent moyen de promotion des vignobles et des caves, alors que la publicité du vin est strictement encadrée par la loi Évin261(*).
En effet, l'expérience oenotouristique crée un lien direct avec les clients, favorisant la fidélisation et le bouche-à-oreille. Ces mêmes visiteurs deviennent souvent des ambassadeurs de la marque, réduisant ainsi les coûts marketing traditionnels262(*).
L'activité oenotouristique permet ensuite aux exploitations et aux caves de diversifier leurs revenus. Confrontés à des aléas climatiques et géopolitiques qui ont tendance à se multiplier, les viticulteurs sont poussés à diversifier leurs activités. L'oenotourisme, qui peut être pratiqué tout au long de l'année, permet ainsi aux exploitations de lisser leurs revenus.
En outre, l'oenotourisme permet aux producteurs de diversifier leurs ventes, en renforçant le nombre de ventes directes à la propriété. Ce canal de distribution directe est particulièrement avantageux pour le producteur, la vente au détail au consommateur étant plus rémunératrice que la vente en gros à un négociant.
En dépit des efforts importants menés par la filière pour diversifier, professionnaliser et massifier l'offre, il apparaît que le potentiel oenotouristique de la France reste sous-exploité, la faute à une réflexion stratégique parfois insuffisamment aboutie, à tous les étages de la filière, et à de trop nombreuses contraintes.
2. Un potentiel en partie inexploité, qui appelle des efforts structurels
En matière d'oenotourisme, les chiffres attestent d'un vaste potentiel, qui doit être développé par le levier du financement, de l'organisation des acteurs et de l'amélioration constante de la qualité de l'offre.
a) La filière dispose d'une stratégie qu'elle doit poursuivre
Alors que la France demeure, avec 100 millions de touristes internationaux en 2024, la première destination touristique dans le monde263(*), et que son image est largement associée au vin, le potentiel reste, de l'aveu de la grande majorité des acteurs auditionnés, sous-exploité.
En dépit de son importance, la filière oenotouristique a longtemps manqué d'une réelle stratégie nationale. Plusieurs feuilles de route ont visé à combler ce manque. Tel est notamment le cas de la feuille de route d'octobre 2015 proposant 18 mesures en faveur du développement de l'oenotourisme et de sa promotion à l'international264(*). Toutefois, un certain nombre de ces recommandations n'a pas été adopté et la situation de la filière oenotouristique a largement évolué, en France, mais aussi à l'étranger.
Récemment, Nathalie Delattre, ministre chargée du tourisme, a chargé Hervé Novelli, président du CSO, d'élaborer une feuille de route pour développer l'oenotourisme en France. La ministre chargée du tourisme a également affirmé à plusieurs occasions sa volonté de faire de la France la première destination oenotouristique à l'horizon 2030265(*). La feuille de route de l'oenotourisme du conseil supérieur de l'oenotourisme a été présentée en juin 2025 et formule 37 recommandations, organisées selon 8 grands axes266(*) afin de renforcer la filière. Ces recommandations peuvent être distinguées en deux grandes catégories : celles relatives aux mesures structurelles qui doivent être prises par les pouvoirs publics et les acteurs de la filière et celles relatives aux contraintes règlementaires qu'il conviendrait d'assouplir ou lever, selon les cas.
b) Dans un contexte de baisse probable des financements, se saisir des possibilités permises par l'OCM
La filière risque d'abord d'être confrontée à une diminution de ses financements. En effet, Atout France, principal opérateur de l'État en matière de tourisme, a vu ses financements réduits au cours des dernières années. Alors que sa subvention pour charge de service public s'élevait à 31,5 M€ en 2016, celle-ci atteignait 23 M€ en 2025267(*). En outre, certains crédits d'intervention n'ont pas été renouvelés. Tel est par exemple le cas des crédits d'intervention du plan « Destination France », qui s'élevaient à 35 M€ sur les 3 dernières années.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire, comme le recommande le CSO, d'intégrer l'oenotourisme parmi les mesures financées par le plan stratégique national. Comme précédemment exposé, l'OCM permet de financer 13 mesures en soutien à la filière. La France a fait le choix d'en activer cinq, il est donc recommandé d'activer l'aide pour « les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l'Union en promouvant l'oenotourisme dans les régions de production », d'autant plus que dans le cadre du paquet vin, le champ de l'aide devrait être ouvert aux ODG268(*).
Un tel choix permettrait en effet de limiter les effets de la potentielle réduction des financements nationaux dédiés à l'oenotourisme.
Un tel choix paraît d'autant plus nécessaire que l'oenotourisme est un excellent moyen de promouvoir les vins français, la promotion devant, selon les rapporteurs et de nombreux acteurs auditionnés, figurer parmi les priorités du prochain plan stratégique national.
c) Le besoin d'un effort de coordination entre des acteurs très nombreux
La filière oenotouristique est aussi marquée par la présence de très nombreux acteurs publics et privés. En effet, la définition de la politique touristique et son animation est éclatée entre de nombreux acteurs, à savoir l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et les offices de tourisme. En outre, en raison de la nature même de l'oenotourisme, certaines chambres d'agriculture, interprofessions viticoles, syndicats nationaux et locaux ont pu prendre des initiatives.
Les acteurs proposant des prestations oenotouristiques sont là aussi nombreux : viticulteurs et vignerons, caves coopératives et particulières, cafés, bars à vins, restaurants, hôtels, agences de voyages, structures organisant des événements festifs...
Si cette pluralité d'acteurs peut constituer une force pour la filière, cela n'est pas le cas aujourd'hui, la faute à une insuffisante coordination à tous les niveaux. Certains acteurs auditionnés ont pu relever en particulier, comme les députés rapporteurs de la mission d'information sur les stratégies de marché de la filière viticole, qu'il était difficile d'identifier un chef de file au niveau national.
Si le Conseil supérieur de l'oenotourisme est une structure utile, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une association, dont les membres sont bénévoles, et qui ne peut donc pas jouer ce rôle. Activité à la fois agricole et touristique, il semblerait toutefois qu'Atout France, gestionnaire historique du label Vignobles & Découvertes, a vocation à jouer ce rôle de chef de file au niveau national. Le Gouvernement pourrait notamment confier à Atout France, le chef de filât de la mise en oeuvre de la feuille de route du CSO.
Enfin, l'effort de coordination doit aussi être réalisé par les différents acteurs économiques. Quoique cela soit difficile à mesurer, certains acteurs auditionnés ont pu noter que la coordination territoriale fait souvent défaut. Pour citer l'un d'eux : « les initiatives restent trop fragmentées, avec peu de synergie entre vignerons, offices de tourisme, restaurateurs et hébergeurs. Les territoires qui réussissent le mieux sont ceux qui ont développé une approche collective cohérente ». Comme pour la promotion des vins français à l'étranger, il apparaît là aussi essentiel de jouer collectif.
d) Une qualité de l'offre à renfoncer
Quand bien même l'activité oenotouristique s'est-elle largement structurée et professionnalisée, de nombreux progrès demeurent à faire. En effet, aujourd'hui, seulement 30 % des caveaux ouverts au public sont labellisés Vignobles & Découvertes269(*).
L'un des principaux leviers de progression est sans aucun doute la promotion des activités oenotouristiques proposées par les viticulteurs. Ces dernières années, le recours à des plateformes digitales pour la gestion des réservations a considérablement augmenté270(*). La marge de progression en la matière reste toutefois importante. D'après une étude d'Atout France réalisée en 2022 sur les modèles économiques de l'oenotourisme, seules 67 % des entreprises interrogées déclaraient réaliser un travail de référencement de leur offre oenotouristique sur Internet.
De même, aujourd'hui, comme le relève le CSO, il n'existe aucune page internet ou application recensant l'ensemble des offres oenotouristiques portant le label Vignobles & Découvertes à l'échelle nationale. À supposer qu'une telle solution soit trop difficile ou coûteuse à mettre en oeuvre techniquement au niveau national, les régions et les offices de tourisme ont tout à gagner à répertorier les prestations oenotouristiques différentes proposées sur leurs vignobles271(*).
3. L'oenotourisme fait cependant face à des contraintes règlementaires et législatives diverses qui mériteraient d'être levées ou assouplies
L'oenotourisme est en outre ralenti par un certain nombre de contraintes et complexités. Sans prétendre à l'exhaustivité, ces freins sont notamment issus de la règlementation de l'urbanisme, du travail, de la vente et de la fiscalité. Ces difficultés ont notamment pour cause le statut juridique de l'oenotourisme. Activité mi-agricole, mi-commerciale, la règlementation de l'oenotourisme est ainsi assez complexe.
a) Mieux prendre en compte l'oenotourisme dans le cadre de l'élaboration de la règlementation de l'urbanisme
Selon un certain nombre d'acteurs auditionnés, la règlementation de l'urbanisme constitue l'un des plus gros freins au développement de l'activité oenotouristique, les règles d'urbanisme pouvant ne pas permettre, dans les zones agricoles ou naturelles, la construction de bâtiments destinés à l'oenotourisme ou le changement d'usage d'un bâtiment agricole.
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs272(*) peuvent certes être autorisées dans les zones naturelles agricoles et forestières273(*). De même, le règlement peut désigner des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site274(*). Les règles applicables aux communes dépourvues de documents d'urbanisme ainsi qu'à celles dotées d'une carte communale sont très proches de celles qui viennent d'être citées pour les communes dotées d'un PLU275(*).
Enfin, à titre exceptionnel, le règlement peut délimiter dans les zones agricoles des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées.276(*)
Ainsi, si les règles d'urbanisme peuvent permettre le développement d'activités oenotouristiques dans les zones naturelles, agricoles et forestières, elles ne sont pas tenues de le faire, pouvant empêcher la réalisation de projets. Or, selon de nombreux acteurs auditionnés, les PLU prévoient rarement les dérogations permises par les textes. En la matière, il conviendrait peut-être de mieux sensibiliser les collectivités territoriales au développement de ce type de tourisme, qui s'inscrit en complémentarité de l'activité viticole.
b) Une règlementation du travail dominical peu lisible
La règlementation du travail le dimanche a souvent été critiquée par les acteurs auditionnés, en raison des inégalités de traitement qu'elle comprendrait.
Les règles diffèrent en effet selon la forme juridique de l'employeur. En ce qui concerne les exploitations agricoles, il y a lieu de rappeler que l'exploitant agricole est libre d'ouvrir son exploitation le dimanche, sauf à ce qu'un arrêté n'en impose la fermeture le dimanche.
Les règles relatives au repos le dimanche des salariés sont, elles, prévues par les articles L. 714-1 et suivants du CRPM (et les conventions collectives applicables). Ces dispositions prévoient que lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, il est possible de déroger au repos dominical selon les conditions prévues par l'article L. 714-1. Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon ces modalités dérogatoires, aux salariés employés à des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes277(*). Enfin, le travail le dimanche donne dans ces cas le droit à une majoration du salaire de 50 %278(*).
En ce qui concerne les caves, celles-ci sont le plus souvent des sociétés commerciales et ne prennent pas la forme d'exploitations agricoles. De nombreuses dérogations au repos dominical existent, qu'il s'agisse des dérogations au bénéfice des établissements de commerce de détail279(*), des dérogations accordées par le préfet280(*), pour les zones touristiques internationales281(*) ou encore des « dimanches du maire » pour les établissements de commerce de détail282(*). Ainsi, si de nombreuses dérogations existent pour les lieux de vente, les dérogations sont en réalité assez peu nombreuses pour la visite des caves en particulier, sauf si elles correspondent à la notion d'établissements de commerce en détail. Par suite, une réflexion sur l'harmonisation des règles de repos dominical applicable au secteur oenotouristique paraît nécessaire.
c) Le besoin d'adapter la complexe règlementation de la consommation et de la vente d'alcool à la réalité de l'oenotourisme
La règlementation de la consommation et de la vente d'alcool peut également constituer un obstacle pour le producteur, en particulier de spiritueux, qui souhaiterait développer une activité oenotouristique.
Plusieurs cas doivent être distingués.
D'abord, aucune licence n'est exigée lorsqu'une personne offre une dégustation gratuite de boissons alcoolisées.
Les choses se compliquent en revanche lorsque la dégustation est proposée à titre onéreux, cas dans lequel l'opération s'analyse en réalité comme une vente. Aucune licence n'est exigée lorsqu'une personne se livre à la vente au détail de boissons provenant de sa propre récolte283(*). En revanche, l'opérateur économique souhaitant vendre des produits qui ne sont pas issus de sa récolte devra, lui, disposer d'une licence adaptée284(*). Ainsi, pour les ventes à consommer sur place, l'opérateur peut soit disposer d'une licence III, ou « licence restreinte » qui comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois, soit disposer d'une licence IV dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », qui comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe285(*).
Or, l'achat de telles licences peut se révéler onéreux.
Pour faciliter la mise en place d'une offre de dégustation à titre onéreux, plusieurs amendements au projet de loi de la simplification de la vie économique, déposés par Sandra Marsaud et plusieurs de ses collègues286(*), ont été adoptés, contre l'avis du Gouvernement, en séance à l'Assemblée nationale. Les articles 26 quater et 26 quinquies, issus de ces amendements, doivent désormais passer le filtre de la CMP. Les rapporteurs appellent leurs collègues à soutenir ces mesures bienvenues de simplification.
D'autres difficultés concernent, elles, la vente de boissons alcooliques à l'occasion d'événements temporaires.
Par dérogation à l'interdiction d'ouverture d'établissements de 4e catégorie, il est possible d'ouvrir des débits de boissons de toute nature à consommer sur place dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations287(*), sur autorisation préalable du maire288(*). Cette autorisation est limitée aux boissons de 1re et 3e catégorie289(*). Par suite, il est impossible de proposer à la vente des boissons spiritueuses à l'occasion de fêtes locales. Là aussi, un autre amendement de Sandra Marsaud et plusieurs de ses collègues vise à lever cette contrainte290(*) (article 26 sexies du PJL).
Ces propositions favorisent la promotion de produits locaux et faciliteront la diversification des revenus des viticulteurs. Permettant de réelles simplifications, les rapporteurs ne peuvent que souscrire à l'esprit de ces amendements et recommandent leur maintien dans le texte issu de la CMP.
d) Le besoin d'une clarification de la fiscalité complexe applicable, en s'appuyant sur l'exemple italien
La fiscalité constitue un autre terrain où la nature particulière de l'oenotourisme, ni pleinement agricole ni pleinement touristique, peut générer certaines difficultés.
En effet, les revenus générés par les exploitants agricoles sont en principe des revenus agricoles291(*). Néanmoins, les activités agritouristiques, telles que des fournitures de repas ou des prestations d'hébergement, sont par principe des activités commerciales générant des bénéfices industriels et commerciaux292(*).
Or la réalisation de bénéfices industriels et commerciaux par une société civile imposée à l'impôt sur le revenu293(*) entraîne normalement l'assujettissement de la société civile à l'impôt sur les sociétés, peu importe la forme civile de la société294(*). Pour éviter cette solution et favoriser la diversification des revenus des exploitations agricoles, il est possible de rattacher des recettes accessoires au bénéfice de l'exploitation agricole295(*), dans les conditions prévues à l'article 75 du CGI. Par suite, les bénéfices industriels et commerciaux et les non commerciaux de l'exploitant agricole seront rattachés aux bénéfices agricoles.
Plusieurs conditions sont imposées pour bénéficier de ce rattachement :
· L'exploitant agricole doit être soumis à un régime réel d'imposition ;
· La moyenne annuelle des recettes accessoires des trois dernières années ne doit excéder ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années ni 100 000 €.
Néanmoins, l'article 75 du CGI prévoit également que si ces bénéfices accessoires sont rattachés aux bénéfices agricoles, ils ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution ni bénéficier des abattements pour les jeunes agriculteurs ou de l'étalement des revenus exceptionnels de l'exploitant agricole.
Par suite, l'enjeu de qualification du bénéfice issu d'une activité oenotouristique, qui n'est pas nécessairement évidente, conserve toute son importance.
En matière de TVA, la facturation de « packages oenotouristiques » peut elle aussi s'avérer complexe, toutes les opérations n'étant pas soumises au même taux. Notamment, la vente de boissons alcooliques est soumise au taux normal de 20 %, alors que la restauration est soumise au taux réduit de 10 %, tout comme les prestations d'hébergement296(*).
Ainsi, selon les rapporteurs, une réflexion sur la fiscalité de l'oenotourisme s'impose. Sur ce point, la France pourrait s'inspirer de l'Italie. En effet, le législateur italien a expressément défini l'oenotourisme comme « l'ensemble des activités de découverte et de connaissance du vin réalisées sur le lieu de production, incluant les visites des sites de culture, de production ou d'exposition des instruments nécessaires à la viticulture, la dégustation et la commercialisation des produits vinicoles de l'exploitation, y compris en association avec des denrées alimentaires, ainsi que les initiatives à caractère didactique et récréatif organisées au sein des caves »297(*).
L'oenotourisme étant ainsi clairement défini, le législateur italien a pu lui associer un régime fiscal partiellement unifié comprenant une définition du revenu imposable issu d'une activité oenotouristique pour l'impôt sur le revenu, ainsi qu'une déduction forfaitaire pour la TVA. Sans aller jusqu'à recommander de reprendre à l'identique le régime italien, il apparaît néanmoins que bénéficier d'une définition claire de l'oenotourisme permet d'offrir un régime juridique visant à favoriser cette activité.
Recommandation : Accompagner et accélérer le développement de l'oenotourisme en sécurisant son financement, en levant certaines contraintes législatives et règlementaires entravant son développement et en lui donnant une définition législative :
· modifier le PSN pour intégrer l'aide en faveur du développement de l'oenotourisme permise par le droit de l'OCM ;
· confier à Atout France le chef de filât de la mise en oeuvre de la feuille de route du conseil supérieur de l'oenotourisme ;
· mieux prendre en compte l'oenotourisme dans le cadre de l'élaboration de la règlementation de l'urbanisme ;
· faire aboutir les simplifications votées à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi « simplification » pour faciliter la mise en place d'une offre de dégustation à titre onéreux.
4. Au-delà du fort potentiel de l'oenotourisme, d'autres leviers de diversification à imaginer
Si l'oenotourisme constitue un levier majeur de diversification du revenu des exploitants, mais aussi de promotion de leur travail, les rapporteurs souhaitent attirer l'attention sur une dimension trop peu mise en débats, à savoir la diversification culturale.
a) Ne pas « mettre tous ses oeufs dans le même panier »
Le IV de l'article L. 1 du CRPM, issu de l'article 20 de la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations, dispose, en son 7°, que la politique d'installation et de transmission en agriculture se traduit par des actions ayant pour finalité « d'orienter en priorité l'installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ».
De même que de n'avoir que des clones identiques au sein d'une parcelle rend l'ensemble plus vulnérable aux maladies de la vigne, ne pratiquer que la viticulture rend l'exploitant plus vulnérable aux aléas de toute nature pouvant impacter la filière. L'idée pourrait ainsi se résumer par cette formule empreinte du bon sens paysan : « ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier ». Cet adage vaut d'autant plus que, malgré des statistiques flatteuses par rapport aux filières agricoles, le développement de l'assurance récolte en viticulture demeure très imparfait.
b) Des initiatives existent et méritent d'être encouragées
Dans sa contribution écrite, la Coordination rurale souligne à juste titre que « la spécialisation extrême de certains bassins - comme les régions viticoles historiques - a permis des gains de compétitivité, de qualité et de notoriété. Cependant, elle expose aujourd'hui les exploitations à une vulnérabilité accrue : un épisode de gel tardif ou de mildiou peut compromettre l'essentiel, voire la totalité du revenu annuel d'une exploitation en monoculture. La diversification, qu'elle soit menée au sein même de l'exploitation ou à l'échelle du territoire, permet de répartir les risques, d'étaler les revenus et d'explorer de nouveaux débouchés, notamment en circuits courts. »
Certes, comme le souligne la Cnaoc dans sa contribution écrite, « le concept d'AOC est non délocalisable », et il est évident que certains territoires se prêtent moins que d'autres à la diversification. Mais même au coeur d'un territoire comme la Bourgogne viticole, les rapporteurs, à l'occasion d'un déplacement, ont pu constater que la polyculture était possible. Un couple de viticulteurs, rencontré par la mission, y associait production viticole et grandes cultures. À Nuits-Saint-Georges, village mondialement connu pour la qualité de ses vins, des agriculteurs perpétuent la culture du cassis et, de manière générale, des fruits rouges, pour en faire des crèmes et des confitures.
Dans les vignobles méridionaux, notamment, des initiatives voient le jour, parfois rémunératrices à l'instar de la production d'huile d'olive. Ainsi, on observe des productions complémentaires de grenades, d'asperges, de fruits à coque, de lin, ou encore le développement de petites unités d'élevage.
Dans sa contribution écrite, Vignerons indépendants de France soutient également cette démarche de diversification, et estime que « près de 30 % des vignerons la pratique, en augmentation régulière ces dernières années ».
Cette diversification se heurte néanmoins à des problématiques importantes.
Tout d'abord, la faible disponibilité en eau de nombreux territoires contraint à réaliser des arbitrages. Comme le soulignait une personne rencontrée par la mission, « là où même la vigne ne peut plus pousser, peu de végétaux le peuvent ». Se posent ici des problématiques d'accès à l'irrigation et de restructuration des sols, évoquées dans la suite du rapport.
Ensuite, la faible structuration des marchés de certaines denrées rend difficile la conduite d'une culture annexe. Le producteur doit en effet pouvoir compter sur un réseau de distribution pas toujours fortement développé, même si le développement des circuits courts peut constituer un débouché intéressant.
Enfin, se pose une problématique de compétence : comme si le métier de viticulteur n'était pas, en soi, un métier à plein temps, il parait difficile de demander à un exploitant de diversifier seul ses débouchés. C'est pourquoi la diversification est plus aisée dans le cadre d'exploitations familiales et d'installations collectives.
Les rapporteurs rappellent, en outre, que l'article 26 de la loi d'orientation agricole précitée dispose qu'au plus tard en 2026, l'État se donne pour objectif de mettre en place des diagnostics modulaires des exploitations agricoles, notamment à l'occasion des cessions d'exploitation et des installations. Ces diagnostics, facultatifs, devront être composés de modules fournissant des informations notamment relatives « aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu'au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ». Ces diagnostiques doivent rapidement voir le jour et être ouverts à la viticulture en ce qu'ils constitueront un outil supplémentaire utile aux viticulteurs pour les aider à orienter leurs choix stratégiques et notamment en matière de possibilités de diversification.
Recommandation : Développer, au sein des structures collectives, et notamment au moment de l'installation, une réflexion sur les possibilités de diversifications culturales pour les viticulteurs.
III. ASSURER UNE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE
A. LE BESOIN DE TRAVAILLER SUR LES VARIÉTÉS, L'IRRIGATION ET LES SOLS
1. Les cépages et variétés résistants sont un levier de résilience face au changement climatique
a) Malgré leur intérêt certain, les cépages et variétés résistants demeurent sous-employés dans le vignoble français
La sélection variétale est un levier prometteur de résilience pour la filière viticole à l'heure où le changement climatique entraîne une modification des conditions de production dans les vignobles français et où l'accélération de ses manifestations conduira irrémédiablement les viticulteurs à recomposer l'encépagement (composition variétale) de leur exploitation. En fonction des terroirs, de leurs conditions pédoclimatiques et des impacts observables du changement climatique, les vignerons rechercheront différentes caractéristiques : un débourrement plus tardif (éclosion des bourgeons) ; un développement suffisant d'inflorescences et de fleurs ; une meilleure résistance au stress hydrique ; une véraison plus tardive (maturation des baies).
Dans cette recomposition à venir de l'encépagement, les cépages résistants298(*) doivent être mobilisés. Un cépage résistant regroupe l'ensemble des variétés de vigne destinées à la production vinicole présentant des résistances aux principales maladies, ravageurs, événements climatiques extrêmes. Elles s'obtiennent par croisement entre variétés de vignes traditionnelles ou par hybridation avec des espèces de vignes différentes.
La diffusion des cépages et variétés résistants demeure à ce jour malheureusement confidentielle. En effet, d'après l'Inrae, en 2025, 23 variétés résistantes sont plantées en France sur les 35 inscrites au Catalogue officiel des variétés de vigne. Elles représentent une superficie de seulement 2 700 hectares, soit environ 0,35 % de la surface viticole française.
Par comparaison, l'Italie a planté 3 600 hectares soit environ 0,5 % de sa surface viticole, la Suisse et l'Allemagne ont, quant à elles, planté respectivement sur 570 ha et 4 000 ha, soit environ 4 % de leur surface viticole. La France est donc en retard sur ses voisins européens et ses concurrents.
Les variétés les plus représentées en France sont le Floréal (841 ha) et le Souvignier gris (841 ha) qui, à elles seules, couvrent 60 % de la surface plantée en variétés résistantes. Viennent ensuite l'Artaban (243 ha), le Soreli (214 ha), le Vidoc (205 ha), le Muscaris (82 ha), la Cabernet cortis (70 ha), le Voltis (61 ha) et le Sauvignac (46 ha). Quinze autres variétés sont plantées sur les 165 ha restants299(*).
Depuis 2018, l'Inao, dans le cadre du dispositif « Vifa » (variétés d'intérêt à fins d'adaptation), permet aux ODG l'expérimentation de ces cépages et variétés pendant 10 ans sur une surface maximale de 5 % de l'exploitation expérimentatrice et une incorporation jusqu'à 10 % dans les assemblages de vins commercialisés sous AOP. En 2025, selon l'Inao, une trentaine d'AOC bénéficient de cette procédure, représentant la moitié de la production française. D'après l'IFV, 91 % des ODG prévoient d'accompagner la restructuration de leurs vignobles avec du matériel végétal plus résilient au changement climatique. Pourtant, les chiffres ne témoignent pas encore d'une réelle dynamique autour de ces variétés.
Les 4 et 5 septembre 2025, à l'occasion de leur déplacement dans l'Aude et l'Hérault, les rapporteurs ont rencontré des viticulteurs très attachés à leur offre en AOP et IGP, mais aussi produisant de la variété Floréal. Le domaine visité indiquait avoir vendu l'intégralité de ses stocks. Cela illustre qu'une demande est possible pour ces nouvelles variétés.
En outre, visitant le centre expérimental de la chambre d'agriculture de l'Aude du domaine de Cazes à Alaigne, ils ont pu constater que les coûts d'intervention annuels en produits phytopharmaceutiques entre une variété résistante (Souvignier Gris) et une variété traditionnelle (Chardonnay) ont un delta très important. En effet, l'indice de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT) de la variété Chardonnay est de 13,3 tandis qu'il est de 2 pour le Souvignier Gris, ce qui explique qu'en 2020, le coût d'intervention à l'hectare (coût des produits d'entretien, des tracteurs et des pulvérisateurs automatiques ainsi que de la main-d'oeuvre tractoriste) pour le Chardonnay était de 609 euros, alors qu'il était de 97 euros pour le Souvignier Gris. Les suivis réalisés en 2024 dans le cadre de l'observatoire national du déploiement des cépages résistants (OsCaR) attestent du potentiel des variétés résistantes pour la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques avec une réduction moyenne de 80 % de l'IFT fongicide par rapport à la référence nationale 2019300(*).
Les cépages et variétés résistants permettent ainsi aux vignerons non seulement de réduire leur empreinte environnementale, en accord avec le plan Écophyto301(*), mais aussi de réaliser des économies substantielles.
L'intérêt majeur que constituent les cépages et variétés résistants a justifié l'intervention de la recherche publique, là où historiquement, l'innovation variétale traditionnelle était plutôt à l'initiative des pépiniéristes producteurs qui, de sélections en croisements, aboutissaient à des variétés possédant un gène (monogénétique) ou plusieurs (polygéniques) résistant à certaines pathologies (oïdium et mildiou).
Mais face à l'accélération des besoins en diversification variétale, l'État, via notamment l'Inrae302(*), a impulsé une démarche de sélection à grande échelle afin de parvenir au pyramidage (cumul) des gènes résistants. Par exemple, trois projets scientifiques soutenus par l'Inrae ont permis d'accroître les connaissances sur les variétés les plus à même d'être sélectionnées pour développer des variétés de cépages résistants : VitAdapt303(*), GreffAdapt304(*) et celui du centre de ressources biologiques de la vigne de Vassal-Montpellier305(*).
La mobilisation de ces ressources scientifiques dote ainsi la France d'un atout unique pour proposer une diversification de son encépagement, illustrée par les résultats de l'important programme ResDur306(*). Les rapporteurs constatent que cet atout demeure sous-exploité.
En complément, un suivi sanitaire a été mis en place par l'Inrae et l'IFV en 2017, grâce à la création de l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants (« OsCaR »). Il assure un suivi auprès des vignerons cultivant ces nouvelles variétés afin d'étudier l'efficacité des résistances génétiques face aux évolutions des agents pathogènes. En effet, l'oïdium et le mildiou présentent un fort potentiel évolutif leur permettant de contourner la résistance. Pour assurer un suivi sanitaire, l'Observatoire bénéficie d'un réseau de parcelles d'observation et d'un dispositif d'alerte pour identifier rapidement d'éventuels comportements anormaux.
Les cépages et variétés résistants sont par ailleurs confrontés à des procédures d'autorisation de commerce du matériel végétal et de plantation de vignes laborieuses ralentissant leur déploiement.
b) Le déploiement des cépages et variétés résistants, s'il est peut-être ralenti par les indispensables phases d'expérimentation, peut s'intensifier par l'accompagnement de la restructuration des vignobles ainsi qu'une meilleure diffusion des connaissances
On recense actuellement près de 330 variétés de vigne inscrites au catalogue national. En moyenne, six demandes d'inscription sont déposées par an. L'inscription au catalogue permet d'attribuer une autorisation de mise sur le marché au niveau de l'UE des bois et plants de vignes307(*) des variétés évaluées officiellement dans le respect des obligations européennes en la matière308(*).
En France, les inscriptions sont faites à la suite d'une procédure particulièrement longue, nécessaire, mais de moins en moins compatible avec l'urgence du changement climatique. En effet, l'obtenteur ou le représentant du cépage doit déposer une demande de classement définitif309(*) devant FranceAgriMer310(*). Le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (Geves)311(*), est chargé de s'assurer que la variété, d'une part, se conforme au protocole d'examen « DHS »312(*) (distincte, homogène et stable) et, d'autre part, réussisse les épreuves « Vate » (Valeur agronomique, technologique et environnementale). Les évaluations sont conduites dans des centres d'expérimentation spécialisés ou des exploitations viticoles de production sur une durée maximale de 10 ans. En cas de refus du classement définitif, il est obligatoire de procéder à la destruction des ceps à l'échéance de la durée maximale d'expérimentation313(*).
Si les tests sont satisfaisants, l'inscription au Catalogue est effectuée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à la suite de l'avis d'experts de la section vigne du comité technique permanent de la sélection314(*) (CTPS). Par la suite, la création de clones et de semences est soumise à l'approbation315(*) de FranceAgriMer, autorité nationale en charge du contrôle de la production et de la certification du matériel végétal des pépiniéristes et des obtenteurs316(*). Ainsi, la commercialisation de ce matériel (bois et plants) est possible au sein de l'Union européenne uniquement après, premièrement, inscription au catalogue d'un État membre de la variété, deuxièmement, certification du matériel commercialisé par FranceAgriMer, puis enfin, délivrance d'un passeport sanitaire européen317(*) délivré également par FranceAgriMer318(*).
Afin d'accélérer le rythme de plantation des cépages résistants, il existe un régime dérogatoire319(*) : le classement temporaire qui autorise la plantation « en conditions réelles » et non en centre spécialisé, sur le territoire d'un pays de l'UE d'une variété non inscrite au catalogue national ou étant inscrite sur celui d'un autre État membre de l'UE. Néanmoins, cette plantation est subordonnée à l'organisation de son étude pendant 5 à 10 ans afin d'acquérir les données nécessaires à la démonstration de l'adaptation de la variété ou du cépage aux objectifs de production du bassin viticole.
L'inscription de nouveaux cépages n'est donc pas aisée et prend du temps. Si le temps de la recherche est important, et pour partie incompressible, les rapporteurs soulignent qu'une fois le cépage inscrit, il convient d'encourager son adoption.
Dans cette perspective, le levier des aides à la restructuration du vignoble, présentées supra, pourrait être mobilisé. Les ODG et les interprofessions pourraient quant à elles en assurer une promotion plus active.
Premièrement, en matière d'aide à la restructuration, les conseils de bassin pourraient avoir un rôle plus actif de diffusion des variétés et cépages résistants. En effet, ils sont chargés de fixer les priorités de leur bassin dans le cadre des orientations de FranceAgriMer pour l'élaboration et la mise en oeuvre, notamment, de la restructuration du vignoble320(*). Les rapporteurs recommandant que seuls les plans collectifs de restructuration puissent faire l'objet d'une aide (voir supra), les comités de bassins pourraient davantage inciter à orienter ces plans dans le sens d'un déploiement plus ambitieux des cépages résistants.
En outre, une bonification des aides accordées dans le cadre des plans collectifs intégrant ces cépages pourrait être envisagée, de manière à soutenir et encourager l'innovation.
Les conseils de bassin viticole
Il s'agit de l'instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production. Recouvrant l'organisation des filières au niveau régional, les bassins viticoles représentent les aires traditionnelles de production et des zones d'appellation (AOC, IGP, VSIG). Les missions et la composition des conseils de bassin sont depuis le décret du 27 décembre 2017321(*) fixées aux articles D. 665-16 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ces instances visent à assurer une cohérence régionale en matière de politique publique, de gestion des aides et de dialogue avec l'administration.
Les conseils de bassin, parmi leurs différentes missions, se prononcent en particulier sur les éléments suivants :
- l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;
- la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;
- la question du potentiel de production ;
- la réflexion sur la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
Il existe 10 conseils de bassin viticole : Alsace-Est, Aquitaine, Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, Champagne, Charentes-Cognac, Corse, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, Val-de-Loire-Centre et Vallée-du-Rhône-Provence.
Deuxièmement, les cépages résistants en France doivent bénéficier d'une meilleure diffusion auprès des exploitants, qui ne les connaissent encore que trop peu. Les ODG ont ici un rôle à jouer. Pour dissiper les doutes des viticulteurs, en 2025, l'Inao participe au projet Vitilence, piloté par l'Institut français de la vigne et du vin et coordonné par FranceAgriMer, qui vise à mettre en contact les ODG avec des « démonstrateurs territoriaux » qui peuvent être, entre autres, des organismes de recherche, des instituts et centres techniques liés aux filières concernées ou des entreprises, afin de présenter diverses solutions d'adaptation au changement climatique aux producteurs. L'Inao encourage ainsi la mise en place d'animateurs territoriaux dédiés à des expérimentations viticoles (microvinification) afin d'accompagner les viticulteurs dans la recherche des nouvelles variétés et cépages qui correspondraient aux qualités organoleptiques recherchées.
Enfin, les rapporteurs notent que les stratégies de commercialisation des vins issus de ces nouvelles variétés ne peuvent reprendre celles des vins traditionnels. En effet, elles requièrent un changement de posture auprès des négociants et des consommateurs afin de valoriser une nouvelle orientation de l'encépagement français. Le projet européen Horizon Europe « GrapeBreed4IPM » coordonné par l'Inrae a déjà pu identifier ce frein qui limite la valorisation du potentiel qualitatif des nouvelles variétés. En la matière, les interprofessions, incluant l'aval de la filière, ont un rôle à jouer.
Recommandation : Donner une impulsion forte au développement des variétés résistantes aux aléas climatiques et sanitaires en :
- proposant à l'Inao d'augmenter la surface maximale d'expérimentation et d'incorporation, respectivement à 10 % et 15 %, dans le cadre de son dispositif variété d'intérêt à fin d'adaptation ;
- bonifiant l'aide octroyée au titre de la restructuration du vignoble aux plans collectifs intégrant des cépages ou variétés résistants ;
- invitant les ODG à faire connaître auprès de leurs membres les cépages résistants notamment par l'intermédiaire des démonstrateurs existants ;
- menant une réflexion commerciale, au sein des interprofessions, pour donner de l'élan aux vins issus de nouvelles variétés.
2. Maintenir la viticulture dans les territoires les plus difficiles par l'irrigation raisonnée, la restructuration des sols et l'accompagnement économique
a) Une irrigation de la vigne en augmentation, non par confort, mais par nécessité
Les pouvoirs publics sont conscients du défi que représente la gestion durable de l'eau à des fins agricoles. Ainsi qu'évoqué précédemment, les épisodes de sécheresse sont des événements climatiques conjoncturels qui entraînent une raréfaction de l'eau éprouvant les sols et la flore. L'étude prospective du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan réalisée en 2025 projette que d'ici 2050, l'ensemble du territoire national connaîtra progressivement une situation de stress hydrique chronique, lorsque la disponibilité en eau sera inférieure à la demande. La même étude prévoit, sur la même période, qu'en résultera une augmentation des besoins en eau en agriculture chaque été, attisée par le phénomène d'évapotranspiration des végétaux et des sols. Le Masa anticipe que cette hausse des besoins en eau d'irrigation entraînera des tensions sur les différents usages de la ressource322(*).
S'agissant de la viticulture, la vigne étant pourtant traditionnellement non irriguée, l'irrigation a connu un certain essor, devenant un outil de pilotage323(*), surtout sur le pourtour méditerranéen324(*). L'IFV a identifié les deux principales sources de prélèvements d'eau directs de la filière correspondant d'une part, à l'irrigation des vignes et, d'autre part, aux opérations en cave325(*).
L'analyse par l'Inrae326(*) des données du recensement agricole de 2020 transmis par le Masa aux rapporteurs permet d'observer l'essor de l'irrigation viticole : d'une part, le nombre d'exploitations viticoles pratiquant l'irrigation a quasiment doublé, avec une hausse de 86 % par rapport à 2010, ce qui représente 11 % des viticulteurs en 2020 contre 5 % en 2010 et, complémentairement, les surfaces de vignes destinées à la vinification irriguées ont été multipliées par 2,6 entre 2010 et 2020. Selon le recensement agricole, 91 % des exploitations recourant à l'irrigation et 96 % des surfaces irriguées se situent dans le bassin hydrographique du Rhône-Méditerranée et en Corse en 2020.
Source : L'irrigation en France, États des lieux 2020 et évolutions, S. Loubier, A. Scotti et G.Pignard
La prise en considération des tensions en matière d'usage de l'eau par les pouvoirs publics a permis l'impulsion d'un service d'information et de recensement des déficits hydriques. En 2023, après les conséquences de la sécheresse de l'été 2022, la plateforme Vigieau a été mise en place pour permettre d'assurer l'accessibilité et la transparence de l'information sur l'état des restrictions d'eau en France. Son site internet permet ainsi de connaître l'ensemble des restrictions d'usage de l'eau décidées par le préfet sur un département donné. Par ailleurs, certains territoires sont identifiés au sein des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)327(*) en raison de leur « déséquilibre quantitatif structurel en eau » correspondant à des situations dans lesquelles les prélèvements sont tels qu'ils menacent le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Source : étude prospective sur l'eau du
Haut-Commissariat au Plan 2025 :
L'étude
prospective du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan
réalisée en 2025
L'irrigation est devenue une question clef pour la viticulture de demain et il existe plusieurs leviers de financement.
L'ensemble des aides apportées par les pouvoirs publics en matière d'irrigation doivent respecter les conditions d'éligibilité européenne visant, entre autres, à soutenir uniquement les investissements qui ne portent pas préjudice à l'environnement329(*) et à atteindre les objectifs de conservation des eaux330(*). Dans ce cadre, la mise en place d'un système d'irrigation est éligible aux interventions autorisées en faveur de l'économie de la gestion de l'eau dans le secteur du vin331(*).
Au niveau national également, le Masa porte un fonds hydraulique agricole332(*) visant à financer des solutions de modernisation et de développement des infrastructures hydrauliques permettant d'améliorer la résilience hydrique d'exploitations agricoles. Ce fond est prévu par la mesure n° 21 du plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau (dit « plan eau ») annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023. Abondé de 20 M en 2024, renouvelé en 2025, et, selon les documents budgétaires disponibles, en 2026333(*), il a déjà permis de financer 51 projets dont 3 en partie destiné à l'irrigation viticole334(*).
Au niveau local, les collectivités régionales peuvent financer des projets hydrauliques dans le cadre du volet régional du PSN dont elles ont la responsabilité (le plan stratégique régional) en mobilisant leur budget propre et le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Les agences de l'eau financent quant à elles, uniquement des projets visant soit à économiser l'eau335(*) pour réduire les prélèvements dans les milieux naturels, soit à mobiliser des ressources de substitution aux prélèvements dans les territoires en déséquilibre structurel.
La région méditerranéenne est à l'avant-garde de l'adaptation de la viticulture à la hausse des températures par une irrigation raisonnée, une sécurisation des ressources hydriques et la recherche de solutions écologiques.
Les bassins viticoles du pourtour méditerranéen connaissent en effet une situation très préoccupante. La vulnérabilité climatique de leurs exploitations les a amenés à intégrer de nouvelles solutions d'adaptation dans un contexte d'accès à l'irrigation raisonnée, à la suite de l'ouverture des cahiers des charges AOP à l'irrigation336(*).
La Cnaoc observe, dans sa contribution écrite, que le modèle en AOP Côtes-de-provence est peu consommateur d'eau : 22 % du vignoble sont irrigués, soit 2,7 % des surfaces agricoles irriguées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En outre, les exploitations concernées sont équipées à 95 % en goutte-à-goutte.
En 2024, face aux terribles incendies dans le sud de la France, le Masa a lancé le plan « Agriculture climat Méditerranée » (PAM)337(*) visant à accompagner la diversification des productions et l'adaptation des territoires aux enjeux climatiques sur les 5 régions les plus concernées par les impacts du dérèglement climatique du climat méditerranéen. La filière viticole y est mobilisée au sein « d'aires agricoles de résilience climatique ». Par exemple, en Occitanie, en février 2025, cinq projets viticoles ont été retenus concernant des plans collectifs de stratégie d'adaptation au changement climatique338(*).
L'initiative régionale peut être à l'origine de projets très ambitieux, à l'image du réseau de canaux Aqua Domitia. Les rapporteurs tiennent à souligner l'intérêt de cet ouvrage pour la pérennité de la viticulture locale. Celui-ci, décidé par le conseil régional d'Occitanie, est conçu pour interconnecter l'eau du Rhône avec les ressources existantes sur les territoires côtiers du Gard à l'Aude. Son objectif est d'assurer le développement agricole et économique de ces territoires en diminuant la pression sur les ressources hydriques locales. La réalisation des cinq premiers maillons, sur les 6 initialement prévues, s'est achevée en 2022. En 2024, la région Occitanie a lancé une étude d'opportunité et de faisabilité pour un projet d'extension du projet Aqua Domitia jusqu'au département des Pyrénées-Orientales339(*).
Le projet Aqua Domitia est un projet ancien, et les rapporteurs ne peuvent que déplorer qu'à l'époque des premières études de dimensionnement des besoins et, par suite, du réseau à bâtir, trop peu d'exploitations viticoles ne se soient manifestées, témoignant d'un manque de vison à long terme sur les conséquences du dérèglement climatique.
Enfin, de nécessaires adaptations techniques et règlementaires ont déjà été mises en oeuvre, à l'instar du décalage du 15 août au 15 septembre de la date à partir de laquelle l'irrigation des vignes à raisin de cuve est interdite340(*). Cette évolution tient compte des remontées des viticulteurs soumis à une diversité de situations climatiques selon leur géographie et leur encépagement341(*).
Dans sa contribution écrite, l'Inrae mentionne en outre l'unité expérimentale de Pech Rouge (UEPR), chargée de développer la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation de la vigne342(*) afin de remédier aux conflits d'usage résultants des déficits hydriques en limitant les prélèvements dans les ressources naturelles. Cette solution, quasiment inexistante en France, a contrario d'autres pays343(*), offrirait un outil supplémentaire de sécurisation hydrique de la viticulture. Les rapporteurs ne peuvent qu'encourager son développement.
b) Apporter l'eau à chaque exploitation est illusoire, c'est pourquoi la résilience des vignobles doit être soutenue par une recherche dynamique en faveur des alternatives à l'irrigation
Il est indispensable d'encourager le développement des alternatives à l'irrigation pour favoriser la résilience globale de la viticulture.
L'eau est une ressource à maintenir dans les vignobles pour assurer la viabilité des sols. Des adaptations visant à sauvegarder la santé des sols sont déjà référencées à l'exemple des stratégies de couverture du sol par enherbement qui produisent de nombreuses externalités positives344(*), préviennent l'impact des intempéries et limitent la pression des ravageurs, mais limitent le rôle de pare-feu de la vigne.
Par ailleurs, une démarche de restructuration des sols se déroulant sur plusieurs années, jusqu'à la reconstruction de la vie organique, un accompagnement par un financement européen paraît pertinent par souci d'équité entre les viticulteurs qui auront accès à l'irrigation, le cas échéant partiellement financée via le PSN, et ceux qui n'y auront pas accès.
À ce titre, parmi les 13 types d'interventions possibles dans le secteur du vin prévues par la règlementation européenne345(*), les rapporteurs constatent le choix des pouvoirs publics et de la filière de ne pas ouvrir au sein du PSN346(*) une intervention relative « à la conservation des sols ». Une réflexion sur l'ouverture d'un financement européen pour les viticulteurs semble ici à mener dans le cadre du prochain PSN.
Dans sa contribution écrite, la Cnaoc a, en outre, souligné la nécessité de soutenir, sans hiérarchisation, les méthodes d'hydrologie régénérative (retenues naturelles, valorisation des eaux de ruissèlement...), le développement des solutions inspirées de l'agroforesterie347(*), le déploiement des cépages résistants et, enfin, des programmes de formation agroécologique. C'est effectivement la diversité des possibilités d'adaptation qui permettra de répondre, pour partie, à la diversité des situations des vignobles français.
Au surplus les rapporteurs tiennent à rappeler que la question du financement de la prévention des aléas climatiques paraît centrale. La commission des affaires économiques a déjà eu à souligner, en matière d'élevage, que la prévention est trop souvent le parent pauvre des politiques publiques. Or, il est souvent plus économe de « prévenir » plutôt de que de « guérir ».
Des expérimentations ont déjà été menées, et les rapporteurs souhaitent prendre les exemples de la grêle et du gel.
La grêle est en effet un des aléas climatiques dont les dommages peuvent être désormais grandement réduits par l'installation de filets paragrêles. En 2022, une étude de l'IFV348(*) constate que pour un coût d'installation de 15 000 euros à l'hectare, les filets diminuent les dégâts de grêles sur les grappes de 89 % en fréquence et de 98 % en intensité. L'étude observe également des effets positifs pour assurer la résilience du vignoble face au changement climatique dont une augmentation de l'ombrage et une protection contre les maladies cryptogamiques.
Cette voie est d'autant plus à explorer que l'usage de filets paragrêles est désormais possible sous régime d'appellation. En effet, après une expérimentation bourguignonne de 3 ans, l'Inao a permis en 2018 l'usage de filet paragrêle monorang dans des cahiers des charges AOP349(*).
Le gel printanier constitue aussi un aléa climatique majeur pour la viticulture, qui connaît une fréquence et une intensité renforcées sous l'effet du changement climatique350(*). Si l'élévation des températures en hiver contribue à diminuer le nombre de jours avec une température négative durant cette saison, ce réchauffement progressif conduit en retour à une avancée de la date de débourrement (éclosion des bourgeons) des vignes351(*). Cette évolution sera géographiquement diverse sur le territoire352(*) : ainsi, le risque de gel printanier destructeur augmentera dans les vignobles continentaux de Bourgogne et de Champagne, se stabilisera dans l'Ouest, tandis qu'il diminuera sur le pourtour méditerranéen353(*).
Les épisodes de gel tardif, pouvant anéantir le rendement annuel d'une exploitation, sont par définition très coûteux, notamment pour les finances publiques lorsque des dispositifs de soutien, comme en 2021 et 2022, sont mis en place (voir supra)354(*).
Or, là encore, des méthodes de prévention se développent. Dans sa brochure n° 27355(*), l'IFV relève l'existence de méthodes indirectes et directes de protection de la vigne contre le gel : d'une part, le cadre de conduite de l'exploitation (emplacement de la parcelle, taille des branches tardive356(*), choix du cépage) et, d'autre part, l'acquisition de matériels ou la réalisation de prestations de brassage d'air et de chauffage. En 2019357(*), L'IFV a réalisé un décompte du coût d'acquisition et des prestations de certaines opérations dont, entre autres, l'installation d'une tour antigel fixe358(*) (? 10 000 €/ha), le passage d'un hélicoptère (? 200 €/h/ha), l'installation d'un aspirateur à air froid (de 13 000 à 26 000 €), l'aspersion d'eau (? 0,27 €/l de vin359(*)) ou encore l'allumage de bougies nocturnes360(*) (? 0,49 €/l de vin).
Si ces investissements représentent un coût non négligeable, les rapporteurs soulignent, comme pour la grêle, que soutenir ces investissements, dans les zones les plus à risque, par exemple via des dépenses de guichet, constituerait peut-être une source d'économies à moyen terme au regard des dispositifs d'indemnisation a posteriori toujours mis en place par l'État.
La règlementation européenne permet, en outre, l'octroi d'une aide publique nationale à l'investissement en faveur de l'acquisition de matériels de protection contre les aléas climatiques361(*). Celle-ci est également mentionnée au sein du PSN362(*). Des dépenses de guichet sont donc possibles pour soutenir ces investissements.
En outre, une meilleure association des viticulteurs à la prévention des conséquences du changement climatique - notamment par la mise en place de paiements pour services environnementaux (PSE), reconnaissance légitime à l'égard de ceux qui s'inscrivent dans une démarche, souvent difficile, d'évolution des pratiques - semble nécessaire.
À ce titre, le plan biodiversité du 4 juillet 2018 a permis la mise en place d'une expérimentation de PSE destinée aux agriculteurs à partir de 2020. Ce dispositif du ministère de la transition écologique (MTE) et des agences de l'eau, prévu jusqu'en 2027, vise à valoriser et inciter les actions en faveur de l'environnement au moyen d'une enveloppe de 170 M€ sur la période 2020-2024363(*). Deux catégories de services environnementaux sont distinguées : d'une part, la gestion des structures paysagères (haies et mares) et, d'autre part, la gestion des systèmes de production agricole (couverts végétaux et ressources agroécosystèmes). En 2024, le MTE a identifié environ 3 500 agriculteurs engagés dans un PSE sur l'année en cours. La rémunération de l'agriculteur intervient après l'atteinte des objectifs observée annuellement sur les parcelles concernées sur une période de 5 à 7 ans. Cette expérimentation gagnerait sans doute, après son évaluation, à être étendue.
Reconnaître le rôle actif du viticulteur dans la lutte contre la diminution de la biodiversité implique également de reconnaître les situations inégales selon les régions cultivées face au changement climatique.
Les rapporteurs soulignent à ce titre l'existence d'un mécanisme de soutien déjà mis en place au niveau national pour d'autres filières agricoles, à savoir l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN)364(*), intervention prévue dans le PSN365(*) en tant que mesure de soutien à l'agriculture dans les zones où les conditions d'exploitation sont difficiles (altitude, pente et climat).
Cette aide vise à compenser une part du différentiel de revenu engendré par des contraintes naturelles ou spécifiques (surcoût qui en découle) pour lutter contre le risque de déprise agricole dans ces territoires. Le PSN mentionne, en sa faveur, une évaluation démontrant l'efficacité de l'ICHN pour stabiliser les revenus des exploitations bénéficiaires366(*).
Cependant, l'ICHN n'a pas été pensée, à l'origine, pour la viticulture, qui est donc exclue du dispositif367(*). C'est pour cette raison que les conseils interprofessionnels des vins du Pays d'Oc, dans leur contribution écrite, sollicitent la reconnaissance des zones méditerranéennes dans la future PAC comme soumises à un handicap climatique à la suite de la multiplication des incendies et des sécheresses. Si « les zones méditerranéennes » constituent sans doute des zones trop larges, avec, en leur sein, une variété de problématiques, les rapporteurs soulignent qu'une réflexion semble à mener à l'avenir sur les contours de ce que pourrait être une indemnité compensatoire de handicap climatique. En effet, maintenir la viticulture dans certaines zones spécifiques sera, à l'avenir, si difficile qu'elle relèvera davantage d'un engagement du viticulteur pour son territoire que d'un calcul économique rationnel. Cet engagement doit être reconnu et rémunéré.
Des réflexions prospectives sont donc à mener, pour imaginer les soutiens de demain aux viticulteurs désireux de poursuivre les traditions viticoles de leurs territoires.
Recommandation : Porter au niveau européen l'ambition de rendre les activités de restructuration des sols éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.
B. LE BESOIN DE MOBILISER ET DE SOUTENIR LES PARTENAIRES DU MONDE VITICOLE
1. Renforcer les soutiens bancaires et assurantiels
Les rapporteurs souhaitent mentionner l'importance de premier ordre du soutien bancaire, au moment même où de nombreuses exploitations ou coopératives sont en situation financière fragile, voire dégradée.
Aussi, ils ont tenu à interroger le Crédit agricole (CA). Sa contribution écrite, souligne « la détérioration de la rentabilité des exploitations viticoles, les prix de vente en dessous des coûts de production, l'augmentation des stocks, la dégradation des notations bancaires, l'augmentation des besoins de trésorerie, la diminution des demandes de financements d'investissement et une augmentation des défaillances d'entreprise. »
Face à cette situation, les rapporteurs ont eu des retours parfois mitigés du terrain s'agissant du soutien bancaire. Le CA a quant à lui mis en avant les dispositifs mis en oeuvre pour la filière, notamment des crédits de soutien à la trésorerie ou encore l'action de la caisse régionale du Languedoc en faveur plus spécifiquement du secteur coopératif.
Les rapporteurs n'ont pas suffisamment d'éléments pour porter une appréciation complète et étayée de l'état du soutien bancaire, mais souhaitent néanmoins rappeler que celui-ci est central et complémentaire du soutien de l'État. Dans le cadre d'une relation de confiance, parfois ancienne, avec son établissement, le viticulteur est en droit d'attendre du soutien dans les moments délicats de la vie économique de son exploitation. Les banques, quant à elles, demeurent des établissements privés et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'action des pouvoirs publics, mais plutôt venir en appui avec volontarisme.
Finalement, comme les rapporteurs aiment à le rappeler, la solution vient toujours de la coopération et de la relation de confiance qui devraient s'établir entre les acteurs.
Enfin, les rapporteurs souhaitent souligner l'enjeu, pour les exploitations agricoles, de pouvoir bénéficier de la flexibilité permise par les offres quasi-fonds propres, qui peuvent utilement se combiner à des prêts à taux zéro dans le cadre d'une installation par exemple. En effet, chacun sait que s'installer en pleine crise nécessite courage et soutien, notamment financier.
La question de la séparation de l'endettement pour l'acquisition du foncier et de l'endettement visant à réaliser les indispensables investissements dans l'exploitation, se pose, tant le prix des terres, dans certains vignobles, est devenu un frein majeur à l'installation.
Concernant l'assurance, les rapporteurs sont convaincus que la diffusion de l'assurance récolte demeure tributaire de la double question de la moyenne olympique368(*) et du taux de franchise. Lorsqu'une exploitation, comme dans l'Aude ou les Pyrénées-Orientales, connaît quatre aléas climatiques en cinq ans, on comprend aisément que les modalités de calcul de l'indemnisation posent problème.
Dans sa contribution écrite, le Masa confirme avoir avancé, au niveau européen, sur la problématique de la moyenne olympique puisque « la proposition de la Commission européenne vise à étendre la période de référence pour le calcul de la moyenne olympique de cinq à huit ans, en particulier pour les cultures pérennes, mais aussi pour les autres situations où une période de cinq ans est inadéquate. Un allongement de la période de référence utilisée permet un meilleur lissage du rendement historique retenu pour l'exploitation, notamment en cas de succession de mauvaises années ».
Si la perspective de passer d'une référence de cinq à huit ans va dans le bon sens, les rapporteurs considèrent qu'une réflexion plus globale sur le dispositif devrait être menée, d'autant que la viticulture n'est pas la seule filière à entretenir des griefs contre l'assurance récolte. Aussi, au regard de la complexité et de l'importance du sujet, ils suggèrent le lancement d'une mission, qui pourrait par exemple être confiée au CGAAER, dans le but d'objectiver la situation et de proposer des pistes d'amélioration de la réforme. En l'état, l'objectif de 60 % de terres assurées en viticulture d'ici 2030, inscrit au tableau annexé à la loi, paraît bien éloigné.
Recommandation : Saisir le CGAAER dans le but de mener une mission d'évaluation sur la mise en oeuvre de l'assurance récolte en viticulture et les mesures permettant d'en accroître l'efficacité et la diffusion.
2. Afin d'assurer la résilience climatique du vignoble français, il est nécessaire d'assurer, en amont, la pérennité des pépiniéristes viticoles
a) Les pépiniéristes viticoles sont le premier maillon de la chaîne de production des vins et souffrent également de difficultés climatiques et économiques
La profession occupe le premier maillon de l'activité viticole en permettant la création et le renouvellement des vignobles. L'activité de pépiniériste viticole consiste à produire puis commercialiser de jeunes plants de vigne, des boutures greffables et des greffons369(*). La filière, qui s'est développée au XIXe pour produire des variétés résistantes à l'invasion du phylloxéra370(*), est un acteur historique contribuant à la pérennité de l'activité viticole européenne371(*). À l'échelle nationale, la surface agricole utilisée (SAU) dédiée à la pépinière viticole couvre 4 000 hectares de vignes mères372(*) en pépinières, ce qui correspond à 0,017 % de la SAU nationale.
La filière française bénéficie d'une renommée internationale en raison de la qualité de son savoir-faire et de la diversité des cépages produits. En 2023, les exportations de bois et de plants représentaient 24,3 M€373(*).
Malgré ce dynamisme apparent, la filière connaît une crise étroitement liée à celle de la viticulture en France, subissant les mêmes aléas climatiques extrêmes et les conséquences de la politique de réduction du potentiel de production viticole. Cette dynamique fragilise l'exercice de la profession. En huit ans, selon les chiffres de la fédération française de la pépinière viticole (FFPV), le nombre de pépiniéristes viticoles a connu une baisse de 25 %, de 546 producteurs en 2016 à 407 en 2024.
La production et le coût des plants de vigne
Le processus de production commence au sein des centres de prémultiplication gérés par l'IFV et ses partenaires locaux374(*), cultivant uniquement les variétés renseignées au catalogue officiel des variétés de vigne375(*), pour fournir aux pépiniéristes le matériel végétal viticole (greffons et porte-greffes). La section vigne du CTPS certifie les caractères génétiques et l'état sanitaire du matériel végétal produit.
Le pépiniériste peut mettre en vente ses plants de vigne dès que le greffon soudé à un bois de vigne (porte-greffe) a développé un réseau racinaire suffisant pour la plantation en vignoble. Son prix de vente est déterminé en premier lieu, par la rémunération de la main-d'oeuvre (chargée de la production, de la traçabilité, du stockage et de la commercialisation), en deuxième lieu, par les coûts des ressources mobilisées (paillage, cirage, conditionnement, produits phytosanitaires) et, en dernier lieu, par le coût du matériel végétal (greffons, porte-greffes).
Le coût d'achat pour le viticulteur dépend du volume commandé (dicté par la densité de sa culture, variant régionalement) et des variétés commandées. En 2025, le coût moyen pour un hectare était, selon la FFPV, de 20 000 euros.
L'accélération des événements climatiques extrêmes éprouve les pépinières. Tout d'abord, le dérèglement climatique accentue les principaux risques pesant sur le végétal que sont le déficit hydrique et la contamination sanitaire. En effet, les variations de température et de précipitation par rapport aux moyennes de saison modifient le cycle de croissance des plants de vigne. La multiplication des événements climatiques extrêmes (grêles, gelées tardives, canicules) endommage également la production de la filière. En outre, ces variations climatiques favorisent la propagation de maladies et de parasites affectant la durée de vie et la qualité des plants produits.
S'agissant des déficits hydriques, l'accès à l'irrigation s'est affirmé comme la priorité des pépiniéristes. En effet, les très hautes chaleurs sont particulièrement nocives pour les jeunes plants qui nécessitent un arrosage régulier après greffage au printemps et jusqu'à la fin de l'été. La soudure du greffon et le développement racinaire du porte-greffe sont très sensibles à cette régularité. En outre, certaines opérations spécifiques de multiplication (prégermination376(*), forçage377(*)) se déroulent en chambre chaude ou en serre et nécessitent un contrôle augmenté de l'humidité.
Or, au 1er août 2025, la plateforme Vigieau recensait 31 départements au niveau de gravité maximum de sécheresse « crise » et 17 départements en alerte renforcée. Si des arrêtés préfectoraux relatifs à des restrictions d'irrigation limitent l'irrigation agricole générale et mentionnent bel et bien une prise en compte de l'irrigation des cultures des jeunes plants via un mode d'irrigation localisé (micro-aspersion et gouttes à gouttes)378(*), les pépiniéristes sont dès lors confrontés à la nécessité d'investir dans des systèmes économes d'irrigation. L'achat et la mise en place de systèmes de goutte-à-goutte, de stockage d'eau pluviale, de sondes tensiométriques379(*) représentent parfois, selon la FFPV, un coût d'investissement trop élevé pour les petites et moyennes structures. L'attention à ces structures mérite d'être renforcée.
b) De la bonne santé des pépiniéristes viticoles dépend la bonne santé de la viticulture
La filière a déjà beaucoup investi dans des techniques de prévention des aléas climatiques, notamment dans la mise en place de filets de protection contre le gel, des abris contre les tempêtes, le paillage des sols pour prévenir les déficits hydriques. Néanmoins, elle alerte aussi, dans sa contribution écrite, sur les risques que représente la réduction constante de l'usage des traitements phytosanitaires pour la santé des futurs plants et la pérennité de certaines techniques de culture. La production biologique est en outre mise en difficulté en raison de la réduction des traitements disponibles à base de cuivre380(*).
Or les pépiniéristes viticoles sont nécessaires au déploiement à grande échelle des cépages résistants, leur savoir-faire étant indispensable à la multiplication des variétés encore peu présentes en France. Les nouvelles variétés développées en particulier par les programmes scientifiques, comme ResDur (Inrae), présentent une quantité limitée de matériel végétal381(*). En 2024, selon FranceAgriMer, le parc de vignes mères était composé, en effet, à 90 % de 10 variétés seulement382(*). Il est donc nécessaire de développer un potentiel de diversification des cépages disponibles pour les viticulteurs.
Cependant, la tendance actuelle est à la réduction du potentiel productif du parc de vignes mères de porte-greffes des pépiniéristes pour s'adapter à la demande déclinante de la filière viticole383(*). À ce titre, en 2025, face aux difficultés économiques des pépiniéristes viticoles, le Masa a ouvert un dispositif d'aide exceptionnelle pour l'arrachage des vignes mères dont le montant forfaire est fixé à 3 000 euros par hectare arraché pour une enveloppe maximale d'un million d'euros.
Si une aide à l'arrachage pouvait effectivement correspondre à un besoin, une aide de guichet à l'entretien des vignes mères de cépages résistants est tout aussi nécessaire pour inciter et soutenir les pépiniéristes à s'engager dans cette voie, forcément plus coûteuse que la multiplication des plants traditionnels. Sans matériel végétal suffisant, il est en effet inutile d'appeler les viticulteurs à s'engager davantage dans la voie d'avenir que constituent les cépages et variétés résistants.
Recommandation : Apporter un soutien aux pépiniéristes viticoles en :
- développant un « réflexe pépiniériste » au sein des préfectures lors de l'édiction des arrêtés sécheresse ;
- mettant en place une aide financière à l'entretien des vignes mères de cépages et variétés résistants lors des deux premières années de plantation afin de dimensionner le potentiel de production des pépiniéristes.
3. Soutenir, en aval, les distilleries viticoles en crise afin de maintenir une diversification des débouchés des viticulteurs
a) Les distilleries viticoles ont un rôle fondamental de valorisation des sous-produits de la viticulture et de régulateur des excédents de production
Les distilleries viticoles françaises collectent, transforment et valorisent les résidus et les sous-produits de la vinification grâce à un processus de distillation reposant sur une séparation des éléments contenus dans le vin et dans les résidus pour en extraire l'alcool au degré de pureté souhaité. Cette distillation permet d'aboutir à la production en plus de 10 produits, dont entre autres : de l'alcool de bouche, de l'huile de pépins de raisin, de l'alcool destiné à la carburation384(*), du tartrate de chaux et des colorants naturels.
Ces produits obtenus permettent d'approvisionner le secteur agricole en engrais, en alimentation de bétails ainsi que l'industrie alimentaire et énergétique en matière première. Ainsi, la distillerie des marcs de raisin385(*), des lies de vin386(*) et du vin permet la fourniture d'alcool à usage industriel (+ de 92 degrés) pour l'industrie, de pépins blancs pour le secteur pharmaceutique, d'acide tartrique pour le secteur de la construction et de la vinasse pour les centres de méthanisation.
Selon la fédération nationale des distilleries coopératives viticoles (FNDCV), entre 650 000 et 980 000 tonnes de marcs frais et entre 760 000 et 1,7 million d'hectolitres de lies de vin sont collectés et distillés par an, ce qui est considérable, à la mesure de l'importance de la filière viticole française. La FNDCV indique que le chiffre d'affaires de cette filière s'élève à près de 200 M€ et emploie directement ou indirectement près de 3 000 personnes. On comptait 40 distilleries viticoles sur la campagne 2022-2023.
Le rôle de ces distilleries est donc au coeur d'une économie circulaire de la filière viticole. Elles permettent aux viticulteurs, premièrement, de traiter les marcs de raisin et les lies de vin en vue de respecter l'interdiction de sur-pressurage des raisins387(*), deuxièmement, d'éliminer la part de pollution dans les matériaux récoltés388(*) et, enfin, de valoriser des sous-produits ou des résidus de vinification.
Source : Contribution écrite de la FNDCV et l'UNDV
Plus encore, les distilleries viticoles sont un rouage essentiel de la régulation du marché vinicole. En effet, le procédé de distillation du vin permet d'éliminer les excédents de production pour les volumes de vins produits au-delà des rendements autorisés. Le volume moyen de vin distillé depuis 2017 est de 18 353 hectolitres, avec un maximum à 183 243 hl (2018/2019) et un minimum à 16 087 hl (2021/2022)389(*).
Cette filière a bénéficié, de 2019 à 2023, d'un dispositif d'aide à la distillation des sous-produits de la vinification destinée aux acteurs qui supportent les coûts de traitement (collecte et distillation). L'aide financée par le Feaga390(*) représentait 0,04 €/kg de marcs et 0,42 €/hl de lies de vin, ramené à l'hectolitre de vin produit ceci correspond à 0,73 % d'aide/hl. FranceAgriMer estime que cette aide est relativement minime comparée aux services rendus en faveur de l'environnement391(*).
Depuis 2023392(*), la distillation peut être intégrée aux programmes de soutien au secteur viticole à titre temporaire pour permettre l'élimination des excédents de production dans le cadre d'une distillation de crise393(*). Cette dérogation a pu être mise en oeuvre, en réaction au déséquilibre, né du contexte international et inflationniste, entre l'offre et la demande sur le marché du vin rouge et rosé394(*) dès la campagne 2023/2024. Les forfaits fixés au versement des producteurs viticoles pour les vins rouges et rosés sont élevés, pour la fourniture des vins en vrac, à 45 €/hl pour les vins sans indication géographique, 65 €/hl pour les indications géographiques protégées et 75 €/hl pour les appellations d'origine protégées, auxquels s'ajoutent 5 €/hl pour les opérations de collecte et de distillation. Ce dispositif a permis l'élimination de 2,7 millions d'hectolitres de vin en 2023 et 2024395(*).
b) Le modèle économique fragile des distilleries viticoles justifie une attention particulière au maintien de leur marché
L'équilibre économique et financier des distilleries est intimement lié aux fluctuations des marchés des alcools et des coproduits. Elles subissent ainsi une perte de rentabilité en raison de l'ouverture à une concurrence agressive de leur débouché principal : l'alcool destiné à la biocarburation. En effet, les biocarburants sont produits à partir de biomasse, et sont utilisés comme complément (en « incorporation ») aux carburants fossiles. En l'absence d'obstacles règlementaires à l'alimentation du marché du bioéthanol à partir d'alcools issus des marcs de raisin et de lies de vins, les distilleries viticoles se sont orientées vers ce débouché prometteur.
En 2024, les biocarburants représentaient 11 % de la consommation primaire d'énergies renouvelables en France396(*). Les trois quarts de cette consommation correspondaient au biodiesel d'origine végétale ou animale, incorporé au gazole fossile ou directement sous forme de B100 pour des moteurs adaptés. Le dernier quart de consommation correspondait à la part des bioessences issues, entre autres, de bioéthanol (produit à partir de la fermentation de sucre naturel), que les distilleries viticoles produisent à partir de résidus viniques.
Selon la FNDCV, les ventes d'alcool représentent le tiers et pour certaines les deux tiers du chiffre d'affaires des distilleries viticoles. Le débouché majeur de l'alcool distillé est la biocarburation qui représente environ 70 à 75 % du chiffre d'affaires des distilleries viticoles au niveau national. En 2023, sur les 13 851 180 hl d'éthanol mis à la consommation en France, 713 000 hl soit environ 5,15 %, sont issus de marcs de raisin397(*).
Or, depuis 2023, les prix de vente sur ce marché ont diminué de 40 % du fait de l'ouverture du marché aux productions d'usines brésiliennes, ukrainiennes, pakistanaises ou chinoises. Les acheteurs se tournent vers ces nouveaux fournisseurs proposant des prix bien inférieurs (? 100 €/hl) aux alcools issus des sous-produits de la vinification (? 145 €/hl). En parallèle, le marché des alcools de bouche, correspondant à la production d'eaux-de-vie de vin, a diminué de 35 à 40 % en volume et de près de 20 % en valeur depuis 2020.
La liste de l'ensemble des matières premières mobilisables de la production des biocarburants est délimitée par l'annexe IX de la directive européenne RED III. Elle dispose que seuls les vins n'ayant pas de débouchés pour la consommation humaine sont autorisés comme matière première à la production de biocarburant398(*). Ainsi, les vins consommables envoyés à la distillation de crise ne relèvent pas de cette catégorisation et, par conséquent, cette production ne peut être vendue une fois distillée sur le marché du bioéthanol, destiné à l'incorporation en biocarburants, pénalisant la filière.
Dans le cadre de cette même directive RED III, l'Union européenne prévoit une augmentation de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, à 42,5 % d'ici 2030 contre 22 % aujourd'hui. En 2019, dans l'objectif d'inciter à l'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports, la France, en accord avec le droit européen399(*), s'est dotée d'une taxe à finalité spéciale : la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (Tirib), renommée à partir de 2023 taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans le transport400(*) (Tiruert). Cette taxe est dégressive en fonction de l'atteinte, par les opérateurs, des objectifs cibles de consommation de biocarburants ; lorsque ceux-ci sont atteints, la taxe est nulle.
Le 12 mai 2025, la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a débuté une phase de consultation401(*) d'un projet de remplacement de la Tiruert par un mécanisme règlementaire d'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Irric) qui imposerait à chaque acteur concerné des objectifs spécifiques et mesurables de réduction de l'intensité carbone par filière. Ce changement d'outil de politique publique offre aux acteurs davantage de flexibilité dans le choix de l'investissement technologique le mieux adapté à leur activité.
La conséquence directe pour la filière des distillateurs viticoles est ainsi sa mise en concurrence avec les autres offres, bénéficiant de centres de production et de gisement, bien supérieures aux leurs : biocarburants avancés diesel, biogaz carburant (BioGNV), biogaz avancés essence (processus de fermentation de matières organiques) produits à partir d'autres productions agricoles plus compétitives (céréales, betteraves).
Cette mise en concurrence constitue une menace immédiate pour la survie même de ces petites unités indispensables aux viticulteurs pour la valorisation, obligatoire, de leurs sous-produits. Les distilleries viticoles, rouages indispensables de la transition écologique et énergétique n'ont en effet pas la taille critique pour pouvoir rivaliser avec des structures brésiliennes, ukrainiennes ou encore chinoises. C'est pourquoi les rapporteurs proposent que, dans le cadre du projet Irric, un sous-objectif d'incorporation de biocarburants d'origine vinique soit instauré.
Recommandation : Soutenir les distilleries en insérant dans le projet Irric un sous-objectif d'incorporation de « biocarburants avancés essence d'origine vinique » afin de dimensionner le dispositif pour éviter une concurrence déloyale avec des unités de production massive.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Organiser dès que possible des assises de la viticulture fondées sur un pacte de confiance entre l'amont et l'aval de la filière et actant d'une part la possibilité pour le négoce d'intégrer les organismes de défense et de gestion (ODG) et, d'autre part, un engagement formel et contrôlé de développement des outils de contractualisation. Conditionner toute nouvelle aide de crise à l'aboutissement de ces assises.
Recommandation n° 2 : Demander à la filière de rationaliser son nombre d'interprofessions et aller vers la fusion de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine contrôlées (Cnaoc) et de Vin Indication géographique protégée (IGP).
Recommandation n° 3 : Sanctuariser, dans le cadre du débat sur les agences, l'existence de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) et respecter les engagements de l'État en matière d'augmentation conjointe de la contribution des professionnelles et de l'État à la hausse du budget de l'établissement.
Recommandation n° 4 : Poursuivre la politique de prévention et de lutte contre le mal-être agricole en :
· pérennisant, généralisant et sécurisant le financement de l'aide au répit administratif mis en place par la MSA.
· disposant de données annuelles et fiables sur le nombre de suicides en agriculture, ainsi que leurs causes.
· généralisant l'usage du baromètre e-santé « Amarok ».
Recommandation n° 5 : Dans la lignée de l'ambition portée par la loi d'orientation agricole, mettre en oeuvre rapidement l'aide au passage de relai pour faciliter la reprise des exploitations.
Recommandation n° 6 : Réorienter les aides européennes à la viticulture ouvertes par le plan stratégique national (PSN) en :
· ne permettant l'éligibilité de l'aide à la restructuration uniquement aux plans collectifs ;
· accroissant le budget alloué à la promotion pays-tiers, notamment par la baisse de celui consacré aux investissements, pour la partie relevant des bâtiments ;
· portant au niveau européen l'ambition de rendre les activités de restructuration des sols éligibles à l'aide et la restructuration et à la reconversion des vignobles.
Recommandation n° 7 : Généraliser les dispositifs de régulation des volumes commercialisables à l'échelle des interprofessions.
Recommandation n° 8 : Conditionner les futures aides à la distillation à la réalisation d'une analyse du positionnement et des débouchés et, le cas échéant, à l'obligation d'arrachage, temporaire ou permanent, d'une partie des surfaces ; et mener une réflexion locale sur le type de vigne qu'il convient d'arracher.
Recommandation n° 9 : Assurer l'étanchéité des segments en :
· modifiant, pour les indications géographiques protégées (IGP), le code rural et de la pêche maritime (CRPM) pour raccourcir les délais de revendication et poser le principe que le volume revendiqué en IGP ne peut être supérieur à celui déclaré en récolte ;
· mener en parallèle une réflexion sur une amélioration de l'étanchéité des segments notamment par la fusion obligatoire de la déclaration de récolte et de la déclaration de revendication.
Recommandation n° 10 : Partir à la reconquête de certains segments d'entrée de gamme par le développement, dans les territoires propices, d'une filière « industrielle » du vin fondée sur des contrats pluriannuels de long terme entre l'amont et l'aval.
Recommandation n° 11 : Réaliser enfin le choc de communication nécessaire à la (re)conquête de consommateurs nationaux et internationaux, en mutualisant une fraction des budgets des interprofessions aux fins de communication sous la « bannière France ». Investir plus massivement dans le développement des canaux de communication en croissance.
Recommandation n° 12 : Faire un bond décisif sur la connaissance des coûts en viticulture et la contractualisation en :
· publiant les indicateurs de coûts de production prévus par l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ;
· encourageant, sur le modèle de l'IGP Pays d'Oc, la conclusion d'accords de durabilité comprenant la publication de prix d'orientation sur le fondement de l'article 210 bis du règlement Organisation commune des marchés agricoles (OCM).
Recommandation n° 13 : Publier sans délai le décret nécessaire à la reconnaissance d'organisations et associations d'organisations de producteurs viticoles.
Recommandation n° 14 : Amplifier le chantier de la simplification entamé en :
· faisant aboutir, au niveau national, le « dites-le-nous une fois » et en facilitant les modalités de recrutement, d'hébergement et de contrôle des travailleurs saisonniers ;
· réalisant les déclarations de récolte sur la surface réellement plantée et en asseyant l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) sur cette même surface ;
· intensifiant, au niveau européen, les efforts français pour parvenir à la création d'un guichet unique européen dédié au paiement de l'accise.
Recommandation n° 15 : Accompagner et accélérer le développement de l'oenotourisme en sécurisant son financement, en levant certaines contraintes législatives et règlementaires entravant son développement et en lui donnant une définition législative :
· modifier le PSN pour intégrer l'aide en faveur du développement de l'oenotourisme permise par le droit de l'OCM ;
· confier à Atout France le chef de filât de la mise en oeuvre de la feuille de route du conseil supérieur de l'oenotourisme ;
· mieux prendre en compte l'oenotourisme dans le cadre de l'élaboration de la règlementation de l'urbanisme ;
· faire aboutir les simplifications votées à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi « simplification » pour faciliter la mise en place d'une offre de dégustation à titre onéreux.
Recommandation n° 16 : Développer, au sein des structures collectives, et notamment au moment de l'installation, une réflexion sur les possibilités de diversifications culturales pour les viticulteurs.
Recommandation n° 17 : Donner une impulsion forte au développement des variétés résistantes aux aléas climatiques et sanitaires en :
· proposant à l'Inao d'augmenter la surface maximale d'expérimentation et d'incorporation, respectivement à 10 % et 15 %, dans le cadre de son dispositif variété d'intérêt à fin d'adaptation ;
· bonifiant l'aide octroyée au titre de la restructuration du vignoble aux plans collectifs intégrant des cépages ou variétés résistants ;
· invitant les ODG à faire connaître auprès de leurs membres les cépages résistants notamment par l'intermédiaire des démonstrateurs existants ;
· menant une réflexion commerciale, au sein des interprofessions, pour donner de l'élan aux vins issus de nouvelles variétés.
Recommandation n° 18 : Apporter un soutien aux pépiniéristes viticoles en :
· développant un « réflexe pépiniériste » au sein des préfectures lors de l'édiction des arrêtés sécheresse ;
· mettant en place une aide financière à l'entretien des vignes mères de cépages et variétés résistants lors des deux premières années de plantation afin de dimensionner le potentiel de production des pépiniéristes.
Recommandation n° 19 : Soutenir les distilleries en insérant dans le projet de mécanisme Incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Irric) un sous-objectif d'incorporation de biocarburants avancés essence d'origine vinique afin de dimensionner le dispositif pour éviter une concurrence déloyale avec des unités de production massives.
Recommandation n° 20 : Approfondir les liens entre la filière et l'hôtellerie-restauration ainsi qu'entre la filière et la grande distribution, pour tenter de redynamiser la consommation et les achats de vin.
Recommandation n° 21 : Dans le cadre des recommandations à venir du rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) sur les coopératives viticoles, assurer le soutien financier de l'État à leur restructuration, conformément aux engagements pris en projet de loi de finances pour 2025.
Recommandation n° 22 : Garantir à la filière viticole une stabilité fiscale.
Recommandation n° 23 : Saisir le CGAAER dans le but de mener une mission d'évaluation sur la mise en oeuvre de l'assurance récolte et les mesures permettant d'en accroître l'efficacité et la diffusion.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nous examinons maintenant un rapport très intéressant sur l'avenir de la filière viticole, et qui contient des propositions décoiffantes.
M. Daniel Laurent, rapporteur. - Merci, madame la présidente, d'avoir confié ce rapport à trois viticulteurs de métier. Nous avons procédé à une cinquantaine d'auditions et rencontré environ 130 personnes, en présentiel et en visioconférence. Nous sommes allés, par ce dernier moyen, en Chine, aux États-Unis, en Italie, en Espagne et en Belgique - pour rencontrer la Commission européenne. Nous avons effectué des déplacements dans nos territoires, en Bourgogne, à Bordeaux, dans l'Hérault, dans l'Aude - où nous avons constaté les effets dramatiques de l'incendie de cet été. Nous sommes allés jusqu'à Cucugnan où nous avons prié le curé pour qu'il aide la viticulture ! Nous avons vécu de bons moments : le vin, c'est la convivialité !
Notre but n'était pas de publier un rapport supplémentaire. Le dernier rapport de l'Assemblée nationale était axé sur les stratégies de marché des filières viticoles. Nous, nous avons voulu écrire un rapport qui traite du sujet de façon plus globale, qui aille au fond des problèmes, qui dise véritablement les choses, en mettant les viticulteurs et la filière viticole devant leurs responsabilités. C'est pourquoi nous avons émis 23 recommandations dont certaines peuvent être qualifiées de « décoiffantes ».
« Souvent considérée comme le fleuron de l'agriculture française, notre viticulture est aujourd'hui confrontée à des évolutions qui semblent mettre en cause ses fondements. Depuis deux ans, un certain nombre de clignotants sont au rouge. Les exportations diminuent, les parts de marché des vins français sur les marchés extérieurs s'érodent, alors que, parallèlement, la consommation domestique continue de baisser. La situation du secteur s'en ressent, la mévente entraînant un gonflement des stocks, une baisse des cours et rendant nécessaire le recours à trois distillations de crise successives. »
Ces mots sont ceux de notre ancien collègue Gérard César, dans l'introduction de son rapport, il y a 23 ans, sur l'avenir de la viticulture. Notre rapport souligne des éléments similaires.
Comment se fait-il qu'au supermarché, l'huile d'olive coûte plus cher qu'une bonne partie des bouteilles de vin ? Pourtant, notre filière vitivinicole est une filière d'excellence : pris dans une acception large, elle soutient directement ou indirectement 450 000 emplois ; elle produit une valeur ajoutée de 32 milliards d'euros et génère 6,4 milliards d'euros de recettes fiscales.
Cette filière est complexe du fait de sa longue histoire : pour la seule filière vin, on dénombre 236 organismes de défense et de gestion (ODG), qui gèrent 442 appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP). On y dénombre pas moins de 23 interprofessions, quand la vaste filière des fruits, légumes et production végétales spécialisées n'en compte que 10.
Néanmoins, soulignons les chiffres flatteurs de cette belle et complexe filière : 3 % d'occupation de la surface agricole utilisée (SAU) génèrent plus de 15 milliards d'euros de valeur et 16 % de la valeur totale de la production agricole du pays. Contrôlant 17 % des parts de marché mondial, notre filière vins et spiritueux dégage en 2023 un excédent à l'export de 14,7 milliards d'euros, en faisant la troisième contributrice de la balance commerciale. C'est l'équivalent de 49 Airbus A380 !
Toutefois, la filière fait face, depuis plusieurs années, à de nombreuses crises : une crise de la consommation, une crise conjoncturelle liée aux aléas internationaux, une crise structurelle et une crise climatique.
La consommation est passée de 135 litres par habitant et par an en 1960 à 41 litres en 2023 et elle continue de décroître annuellement. Cette consommation plus raisonnée n'est naturellement pas une mauvaise chose pour la santé publique, mais cette évolution va bien au-delà : nous sommes au bord d'une rupture culturelle. Les non-consommateurs et consommateurs très occasionnels représentent plus du tiers de la population. Ce constat vaut particulièrement chez les plus jeunes.
Cette crise du vin touche surtout le vin rouge. Il est tout à fait notable qu'en 2023, pour la première fois, la production de vin blanc soit devenue majoritaire. L'évolution des goûts est bien là : préférence pour les vins légers, frais, pour les boissons peu voire non alcoolisées, succès de la bière qui a su miser sur des unités de fabrication ultra-locales.
On constate en outre une véritable rupture générationnelle, due, bien souvent, à l'absence de transmission des codes du vin, ce qui contribue à dissuader tout un public de se tourner vers une boisson trop souvent considérée comme élitiste.
En conséquence, la viticulture française arrache, notamment dans le Bordelais et en Occitanie, tant et si bien que notre surface de 780 000 hectares en 2023 passera probablement sous la barre des 700 000 hectares ces prochaines années.
À cette première crise, de temps long, s'ajoute une crise que la viticulture n'aurait su prévoir : l'attrition de deux de ses principaux marchés, la Chine et les États-Unis.
En Chine, le marché s'est violemment refermé en raison de problématiques socio-économiques internes affectant lourdement les importations de vin. En parallèle, un différend commercial avec l'Union européenne a conduit le pays à imposer des droits de douane provisoires à la filière spiritueuse, puis, récemment, dans le cadre d'un accord imparfait, à instaurer un régime de prix minimum.
Aux États-Unis, la filière chiffrait déjà à 560 M€ les pertes liées au premier mandat du président américain et le second est marqué par l'imposition de 15 % de droits de douane aux importations européennes, sans parler d'un taux de change particulièrement défavorable, renchérissant d'environ 10 % le prix des vins vendus.
Enfin, à ces chocs commerciaux majeurs, il convient d'ajouter la crise climatique, qui frappe durement une filière déjà éprouvée. Tout le monde a en mémoire le terrible incendie des Corbières, dans une zone où les viticulteurs enchaînent les aléas climatiques d'année en année.
Les aléas entraînent des fluctuations majeures de la production, mettant à risque la viticulture et contribuant à affaiblir le taux de couverture assurantielle en raison de la problématique de la moyenne olympique. En conséquence, la filière voit ses indicateurs économiques plonger. État des stocks, rémunération, résultats d'entreprises : les signaux sont au rouge.
Face à ce constat, nous proposons 23 recommandations dont je vous livre la principale : l'organisation par la ministre de l'agriculture, Annie Genevard, d'assises de la viticulture française au premier semestre 2026. En effet, nous montrons dans le rapport que si la filière souhaite sortir la tête de l'eau, elle doit absolument nouer un pacte de confiance entre ses composantes amont et aval, c'est-à-dire entre les producteurs et les négociants. C'est toute la filière, dans son ensemble, qui a son destin entre ses mains.
Ces assises de la vitiviniculture devront être le lieu des compromis mutuels. Il faut faire intervenir davantage le négoce dans la production, en levant, sous forme d'expérimentation, le verrou législatif l'empêchant d'intégrer des ODG en échange d'un engagement formel du négoce, contrôlable et contrôlé par l'État, à développer sans délai les leviers de sécurisation du revenu de l'amont. Ces leviers existent. Mes collègues vont vous en parler.
M. Henri Cabanel, rapporteur. - Avec mes deux corapporteurs, nous avons réalisé un travail important, à la fois au Sénat et sur le terrain. Nous avons souhaité que cette mission soit la plus large possible, et après près de 58 heures passées à entendre les acteurs de la filière, après nos déplacements dans l'Aude, l'Hérault, le Bordelais et en Bourgogne, nous nous sommes forgé la conviction que pour sortir de l'ornière, il nous faut une stratégie. Vous m'entendez depuis toujours répéter dans l'hémicycle que sans stratégie nationale, la filière va dans le mur, car les enjeux sont multiples. Sur le terrain, nous avons noté l'hétérogénéité des exploitations, qu'elles soient individuelles ou coopératives. Celles qui ont compris les enjeux et élaboré des stratégies s'en sortent mieux que les autres.
Nous nous sommes montrés prudents sur la question brûlante de l'arrachage. Pourquoi arracher ? Pour réduire encore et toujours notre potentiel productif et laisser nos parts de marché se faire irrémédiablement grignoter par des acteurs ayant une stratégie de conquête bien en place ? Cette réflexion est aussi valable pour les dispositifs, très coûteux, de financement de distillation de crise. Allons-nous demander 100 M€ tous les deux ans pour distiller des surplus invendables car déconnectés des attentes du marché ? Je rappelle que les soutiens financiers de crise à la viticulture s'élèvent, depuis 2015, à plus d'un milliard d'euros. Nous proposons de conditionner les futures aides à la distillation à une analyse du positionnement de l'opérateur et de ses débouchés. Le cas échéant, si cela s'avère effectivement indispensable, l'aide à la distillation doit s'accompagner d'une obligation d'arrachage temporaire ou permanent.
Cependant, nous montrons, dans le rapport, que bien d'autres outils existent, à la main des ODG, mais aussi des interprofessions, en lien avec les pouvoirs publics. Le premier instrument, et non des moindres, est constitué par les aides de l'Union européenne ouvertes dans le plan stratégique national (PSN). La viticulture dispose d'un budget annuel d'environ 270 M€, qu'elle ventile en cinq mesures d'aide à finalités différentes. L'une d'elles est l'aide à la restructuration et à la conversion du vignoble, plus couramment appelée « aide à la plantation ». Nous proposons de donner une véritable direction à ces aides en ne rendant éligibles que les plans collectifs, qui témoignent donc d'une stratégie collective pour répondre à une demande. Nous proposons en outre d'instaurer une bonification pour les stratégies collectives incluant la plantation de variétés résistantes aux maladies et au changement climatique, car il s'agit là d'un levier fondamental dans un contexte de retraits brutaux d'autorisation de produits phytopharmaceutiques pour les viticulteurs, en conventionnel comme en bio.
Les ODG ont d'autres outils à leur disposition, dont la mise en place de volumes complémentaires individuels (VCI) pour lisser la variabilité interannuelle des volumes produits, par la mise en réserve d'un pourcentage de la récolte d'une année. Mentionnons aussi les autorisations de plantation, qui peuvent être limitées au niveau régional, en lien avec les ODG. La durée de vie des droits à la plantation devrait être portée à huit ans dans le cadre du paquet « vin » actuellement en cours d'adoption à Bruxelles, ce qui permettra par exemple de réaliser de l'arrachage temporaire.
Enfin, nous recommandons dans ce rapport de mettre en oeuvre, en sus d'une régulation de la production, une régulation de la commercialisation. Cette régulation est rendue possible par le droit de l'Union européenne et est déjà appliquée depuis fort longtemps en Champagne ou en Charente, mais aussi depuis peu en IGP Pays d'Oc. Elle a, premièrement, le mérite de mettre les deux familles, production et négoce, autour de la table. Elle permet ensuite, en cas d'accord sur le diagnostic et la stratégie, de déterminer pour chaque exploitation un besoin individuel de commercialisation, accompagné d'un système de réserve, parfois surnommé « réserve climatique ». Si l'exploitant souhaite commercialiser davantage de volumes, il devra justifier de l'existence d'un débouché. Ainsi, nous évitons d'inonder un marché de volumes invendables et, par conséquent, de tirer les prix vers le bas. Nous recommandons à chaque interprofession de se saisir de cet outil très puissant de régulation, mais aussi de coopération.
Le paquet Vin contient lui aussi tout une boîte à outils pour mieux réguler la filière, et notamment la possibilité de fixer la délivrance d'autorisations de plantations nouvelles à 0 % dans certaines zones en tension.
Enfin, dans ce rapport, nous constatons que le fait que 95 % de notre viticulture soit sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (Siqo) ne nous a pas empêchés de perdre nos clients et de ne pas convaincre les jeunes consommateurs de boire du vin, pour la simple raison que la connaissance des appellations est très limitée en dehors des spécialistes.
Nous recommandons un choc de communication par la mise en commun d'une fraction du budget des interprofessions dans le but de communiquer sur la marque France. Certains de nos voisins communiquent sur la marque nationale, comme l'Italie, et en bénéficient pleinement.
Nous plaidons en outre pour revenir sur l'abandon de l'entrée de gamme et développer, dans les territoires qui s'y prêtent, une viticulture mécanisée capable d'alimenter certains marchés comme celui des vins d'apéritif ou des vins mousseux issus de fermentation en cuve close, actuellement pourvus par l'étranger. Cela nécessite, encore une fois, l'engagement des deux parties et donc des contrats pluriannuels.
Enfin, cet effort sur la demande doit se traduire par l'augmentation des aides à la promotion dans les pays tiers, financées par la baisse de certaines aides non essentielles en matière d'investissement.
Il s'agit là d'un effort global : communication, investissement et logique partenariale afin de réussir à pérenniser la filière.
M. Sebastien Pla, rapporteur. - J'invite chacun à lire ce rapport qui contient nombre de données actualisées sur une filière peu documentée jusqu'à présent.
Nous avons besoin d'orienter nos efforts vers la demande pour produire ce que l'on est capable de commercialiser. Cela implique des efforts de l'amont viticole qui ne sauraient se faire sans contrepartie. En effet, le corollaire d'une attention plus marquée à la demande est la sécurisation du revenu du producteur.
Les outils existent, mais il convient d'accepter de se mettre autour de la table, de s'écouter et de partager les mêmes stratégies.
Nous recommandons tout d'abord que les interprofessions publient enfin les indicateurs de coûts de production prévus par les lois Égalim. Il est certes difficile de définir les coûts en viticulture tant celle-ci est hétérogène selon les terroirs et les modes de culture, mais ce n'est pas impossible. Des exemples existent.
Nous recommandons ensuite de mettre en oeuvre des accords de durabilité prévus par le droit de l'Union européenne qui permettent aux interprofessions ou, en cas de désaccord, aux producteurs, de publier des prix d'orientation, outils décisifs de cette construction des prix en marche avant dont nous avons tant besoin pour mieux définir le partage de la valeur.
En outre, nous nous interrogeons : pourquoi la viticulture n'a-t-elle pas d'organisations de producteurs, alors que le droit européen permet qu'elles négocient des contrats pour le compte de leurs membres ? Nous demandons donc au Gouvernement la publication du décret permettant la reconnaissance de ces organisations de producteurs dans le champ viticole.
Enfin, nous ne pouvions parler de revenu sans mentionner la situation difficile de nos coopératives viticoles, qui assurent tout de même 40 % de la production nationale, et même 68 % des volumes produits en IGP. Les caves coopératives sont des amortisseurs sociaux indispensables dans nos territoires. Elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière que les grosses caves nationales. Leur modèle traditionnel, fondé sur de la vente en vrac et des petites unités, parfois en concurrence dans un périmètre très réduit, est totalement mis à mal par les évolutions de la demande évoquées par Daniel Laurent. Les coopératives doivent urgemment, là encore, adopter une vision stratégique, se regrouper, se restructurer. Elles le font déjà, mais ont besoin d'un accompagnement conjoncturel fort. Aussi, nous demandons au Gouvernement, à l'issue de la publication du rapport sur la situation des coopératives qu'il a commandé, d'honorer son engagement pris devant nous en loi de finances pour 2025 : dédier 10 M€ au soutien aux coopératives viticoles.
Cette crise risque, une fois encore, dans de nombreux territoires, d'entraîner de la déprise. S'il n'est pas facile de s'installer en agriculture, cela l'est d'autant moins lorsque votre secteur d'activité est en crise. Nous recommandons ainsi de rapidement donner vie à l'aide au passage de relais figurant dans la loi d'orientation agricole.
Si sécuriser le revenu de l'amont viticole est une impérieuse nécessité, notre rapport souligne aussi le besoin de simplification et de stabilité des normes frappant la viticulture. Aussi, nous invitons l'administration à enfin mettre en oeuvre ce principe du « dites-le nous une fois » demandé par la viticulture. En 2024, avaient été recensés pas moins de 86 déclarations possibles et 54 portails répartis entre les administrations et les organismes professionnels. C'est une véritable jungle. Cela ne peut plus durer.
À l'échelon européen, nous invitons le Gouvernement à oeuvrer en faveur de la mise en oeuvre du guichet unique dédié au paiement de l'accise, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la TVA, et qui devrait lever une barrière majeure à la capacité d'exportation de nos producteurs. Il est actuellement plus facile d'exporter aux États-Unis qu'au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas normal.
Nous sommes, en outre, dans une filière confrontée à une diversité de taxes dont il convient d'assurer la stabilité. Je rappelle que parmi les trois plus grands producteurs de vin européens, seule la France a fait le choix de pénaliser sa propre filière en l'assujettissant à l'accise. Je sais que quelques parlementaires qui ignorent l'écosystème viticole souhaitent introduire une fiscalité comportementale...
Nous voulons de la simplification et de la stabilité.
Dans notre rapport, nous soulignons aussi la nécessité de réfléchir à la diversification comme outil de sécurisation des revenus de la filière. En la matière, avec 12 millions d'oenotouristes par an, chiffre en croissance constante, nous avons un levier puissant tant de diversification que de valorisation de la production, alors même que nous avons bien conscience que faire de la publicité pour notre terroir est, en viticulture, un exercice contraint par la loi Évin.
Nous abordons par ailleurs la résilience économique et climatique, qui doit passer par le développement de variétés résistantes. Dans l'Aude, la chambre d'agriculture nous expliquait qu'à parcelle équivalente, l'indice de fréquence de traitement (IFT) du cépage souvignier gris était de 2 alors que celui du chardonnay était de 13. En conséquence, le coût d'intervention à l'hectare était de 97 euros pour le premier et de 609 euros pour le second. Outre l'intérêt en matière de résilience, il y a un véritable intérêt économique à développer ces variétés, et nous formulons des propositions en ce sens.
La résilience d'une filière dépend, enfin, de la résilience de toutes ses composantes. Ainsi, nous alertons sur la situation délicate des pépiniéristes viticoles, partenaires indispensables de l'amont, de même que des distilleries viticoles, tout aussi indispensables, à l'aval. Nous formulons des propositions pour les soutenir.
En conclusion, nous sommes confiants dans le fait que la viticulture française détient la capacité de sortir par le haut de cette crise, tout simplement parce qu'elle en a toutes les ressources. C'est un secteur économique d'excellence. Nous plaidons pour l'organisation sans délai d'assises de la viticulture, où chacun devra être amené à prendre ses responsabilités.
C'est en jouant en équipe que la filière viticole fera face aux défis dressés sur son chemin. Il y a bien un avenir pour elle.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Merci aux trois rapporteurs pour ce travail, mené avec passion.
M. Franck Montaugé. - Merci à tous les trois pour ce travail aussi remarquable que nécessaire et urgent. Je m'interroge sur le vote de ce rapport, qui formule des recommandations nombreuses aux conséquences importantes. Dans mon territoire, la viticulture occupe une grande place, et je voudrais pouvoir discuter avec mes interlocuteurs locaux avant de voter. Je suis convaincu de la qualité du rapport après en avoir parcouru les recommandations. J'y suis plutôt favorable à titre personnel. Néanmoins, je voudrais voter en connaissance de cause, en fonction d'une lecture approfondie et des discussions avec mes interlocuteurs. Est-il possible de décaler le vote ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - J'entends ces réflexions légitimes. Nous sommes attendus. Ne pas voter ce rapport, sa publication ou ses 23 recommandations serait dommageable.
Je suis plutôt favorable à ce que nous votions aujourd'hui, comme sur tous les rapports d'information depuis la reprise de nos travaux parlementaires. Cela n'empêche pas chacun de sonder son territoire.
M. Daniel Laurent, rapporteur. - Nous sommes attendus. Il y a urgence. Vous connaissez les difficultés des territoires viticoles. Tout a été organisé pour que le rapport soit publié le plus rapidement possible après les vendanges.
Je voudrais tranquilliser Franck Montaugé. Nous avons rencontré 130 personnes, dont de très nombreux représentants des filières viticoles, et nous sommes allés largement, grâce à la visioconférence, en Europe et à l'étranger. Jusqu'à présent, la viticulture ronronnait, en courbant l'échine pendant les crises. Elle n'a pas pris de décisions systématiques pour avancer dans le bon sens. Ce rapport formule des recommandations décoiffantes, mais qui vont dans le bon sens.
M. Henri Cabanel, rapporteur. - Je comprends l'interrogation de Franck Montaugé, car ce rapport est riche de recommandations.
M. Franck Montaugé. - Je ne dis pas qu'elles sont trop nombreuses !
M. Henri Cabanel, rapporteur. - Ce rapport est issu d'un travail transpartisan et les auditions étaient ouvertes à tous. Je comprends toutefois que chacun souhaite en rendre compte dans les territoires.
La viticulture est une filière excessivement complexe et hétérogène. Il est évident que nous essayons d'être cohérents avec la vision des parlementaires que nous sommes. Certaines recommandations, notamment en Pays d'Oc, vont décoiffer. Nous allons être critiqués, c'est sûr, mais nous avons essayé de prendre un maximum de hauteur dans l'intérêt de la filière nationale.
Lors de toutes nos auditions, nous avons commencé par dire : « Vous n'avez pas fait le job ! ». En effet, la filière a ronronné sans prendre la mesure des enjeux de baisse de la consommation et de changement climatique. Forcément, nous n'avons pas fait plaisir à nos interlocuteurs.
Par nos propositions, nous essayons de répondre à tout cela, en écoutant tout le monde, en allant tant dans des régions où la viticulture se porte bien, comme la Bourgogne, que dans d'autres où c'est moins le cas. Nous avons essayé d'être les plus cohérents possible, malgré l'hétérogénéité de la filière. Je connais une IGP très importante dans ma région dont les représentants ne souriront pas, mais nous avons agi dans l'intérêt de la filière. Nous avons essayé de travailler en cohérence pour dégager une vision claire de l'avenir, en sachant que tout le monde devra fournir des efforts. Nous prônons l'union. Sans union, ce sera un échec.
La France a encore, dans le monde, l'image d'un pays de vin. Cette vision doit être partagée par tous les bassins viticoles.
M. Sebastien Pla, rapporteur. - Je ne voulais pas cosigner un rapport pour qu'il prenne la poussière. Ce ne sera pas le cas de celui-là. Depuis vingt ans, chacun, dans la filière, a sa propre vision des choses et les pouvoirs publics répondent au coup par coup. Cela coûte très cher pour un résultat assez défavorable. Ayons le courage de dire les choses, même si cela ne fera pas plaisir à tous puisque chacun défend son pré carré sans tendre la main aux autres ni dégager une vision générale et partagée. Celui qui est en amont dit que celui qui est en aval profite de lui, alors que peut-être que le premier ne produit pas ce que le second est capable de vendre. Personne ne se parle. Alors, oui, nous allons être vivement critiqués !
M. Franck Montaugé. - J'ai bien entendu vos explications. Quelle est la position de la coopération viticole française sur vos propositions ? Henri Cabanel a fait allusion aux problèmes sur son territoire. Est-ce lié à la fusion suggérée entre Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine contrôlées (Cnaoc) et de la confédération des vins IGP de France (Vins IGP) ?
Qu'en est-il de la dimension budgétaire ? Le caractère d'urgence appelle un engagement du ministère de l'agriculture. On l'interpelle, mais il ne répond pas.
M. Henri Cabanel, rapporteur. - Nous sommes en accord sur ce dernier point. Nous devons continuer à faire pression sur le Gouvernement pour que les engagements envers la restructuration des caves coopératives soient tenus, notamment le déblocage des 10 millions d'euros promis. Nous rencontrerons la ministre de l'agriculture bientôt.
Daniel Laurent l'a largement évoqué : il existe une multitude d'organisations. Dans le Languedoc, il y a quatre interprofessions ; il en faut une, voire deux, mais pas quatre ! Il faut concentrer les budgets. Nous demandons à la filière de réduire le nombre d'acteurs.
M. Franck Montaugé. - Vous vous attaquez à une dimension culturelle importante.
M. Henri Cabanel, rapporteur. - Nous avons auditionné de nombreux acteurs. Nous avons pris en compte leurs remarques, mais il est impossible de tous les contenter. Nous mettons en avant l'impérative nécessité d'être unis. Il faudra que chacun mette de l'eau dans son vin, si je puis dire.
Il y a une vraie hétérogénéité, même au sein d'un même bassin viticole. Certaines coopératives ont très bien compris les enjeux, mais ce n'est pas le cas de toutes.
M. Daniel Laurent, rapporteur. - La Champagne et la région de Cognac ont su équilibrer leur production et leur vente. Beaucoup de choses pourraient être faites sur d'autres territoires.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. - Avec Yannick Jadot, je suis rapporteur de la mission d'information sur la nouvelle donne du commerce international. Lors des nombreuses auditions que nous avons menées, nos interlocuteurs, qu'ils soient économistes, chercheurs, avocats, représentants des douanes ou des fédérations professionnelles, nous ont déclaré qu'il n'y avait pas de hausse significative des droits de douane, de façon générale à l'échelle nationale. Je crains que ce diagnostic macroéconomique rassurant ne fasse oublier des filières en première ligne, comme la viticulture, dans les négociations. La filière vin est-elle bien défendue à l'occasion des négociations des accords de libre-échange et comment s'assurer qu'elle ne soit pas sacrifiée dans un compromis global ? La France met deux, trois ou quatre ans pour prendre une décision, alors que Donald Trump décide en une heure. À tout moment, les montants des droits de douane peuvent augmenter considérablement.
M. Daniel Laurent, rapporteur. - Nos ministres de l'agriculture et de l'économie interviennent auprès de la Commission européenne. Malheureusement, nous subissons, l'Union européenne n'arrivant pas à entrer dans un rapport de force constructif avec la Chine et les États-Unis.
M. Lucien Stanzione. - Ce rapport formule nombre de propositions décoiffantes. Daniel Laurent est venu dans le Vaucluse. On aurait aussi pu organiser des auditions dans la vallée du Rhône.
M. Henri Cabanel, rapporteur. - Nous avons auditionné Inter Rhône.
M. Lucien Stanzione. - On ne peut pas nier le travail considérable de nos collègues. Mais je sais que des professionnels sauteront au plafond quand ils liront certaines recommandations.
Il faudrait des points d'étape au cours de la rédaction des rapports pour être tenus informés.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Compte tenu de l'agenda et de la charge de travail, c'est impossible. Ne nous leurrons pas.
Mme Marie-Lise Housseau. - Je veux vous confirmer l'urgence. Les élus de mon territoire ont été sollicités cet été par Vinovalie dont la situation est désastreuse, alors que cette coopérative, jugée exemplaire, a réalisé beaucoup d'efforts de restructuration. Leurs banques historiques ne veulent plus les aider à surmonter leurs difficultés de trésorerie. Je retrouve dans ce rapport un certain nombre de points évoqués par les responsables, qui m'ont bien rapporté les intérêts divergents des viticulteurs. Le cognac, qui produit du vin blanc, a asséché le marché des viticulteurs du Tarn.
Je pense qu'il faut faire confiance aux rapporteurs et voter ce rapport.
M. Daniel Salmon. - Merci aux rapporteurs pour leur important travail. Je rejoins les propos de Franck Montaugé sur la méthode d'adoption des rapports. Nous découvrons des préconisations sur table, or, nous ne sommes pas tous experts de la matière. Les recommandations de ce rapport me semblent très positives, mais j'aurais besoin d'approfondir certains points.
La filière viticole appartient à notre culture, elle façonne nos paysages, mais elle est mal en point de façon structurelle et durable. Il faut, en effet, prendre de la hauteur.
On peut regretter la baisse de la consommation de vin, mais l'alcool fait encore 49 000 morts par an en France et selon le directeur de la police d'Ille-et-Vilaine, 80 % des violences intrafamiliales sont liées à des problèmes d'alcool.
Le sujet des assurances n'est abordé que dans la dernière recommandation. Il est fondamental. Les aléas climatiques entraînent une production erratique.
L'installation-transmission pose aussi problème. Toute une génération s'apprête à partir à la retraite, or, une grande partie des jeunes n'ont pas la même vision que leurs aînés. Alors que la SAU de la vigne n'est que de 3 %, la viticulture consommerait 20 % des pesticides utilisés dans notre pays. Le modèle doit sans doute évoluer pour attirer davantage les jeunes.
La construction du prix doit être davantage étudiée. Où est la marge ?
La diversification est essentielle. C'est là que se trouve la résilience. La monoculture est néfaste. Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier !
Il me paraît essentiel de travailler sur les débouchés du vin.
M. Bernard Buis. - Merci pour ce rapport important qui met les pieds dans le plat. La baisse de la consommation est phénoménale. Or, la tendance ne changera pas. Il faut en être conscient. Des sommes ont été massivement versées à la filière viticole depuis des années, à fonds perdu. Cela doit cesser. Désormais, il ne faut produire que ce que l'on est capable de commercialiser.
Ce rapport fera prendre conscience à tous les territoires des éléments sur lesquels il faut avancer ensemble.
Il faut cesser la monoculture et privilégier la culture différenciée. Les vignobles du Tricastin, dans la Drôme, ont été restructurés et les agriculteurs s'en sortent bien.
Je voterai ce rapport sans état d'âme.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Je salue les rapporteurs, qui se sont rendus en Côte d'Or, tout petit vignoble qui a toujours jugulé les crises, par une collaboration fructueuse entre producteurs et négociants.
Le sujet de la transmission reste majeur.
Une stratégie en faveur des vins de France à l'étranger doit être adoptée. C'est ainsi qu'on luttera contre nos concurrents italiens, bien plus organisés.
Les viticulteurs de Côte d'Or m'ont sollicitée pour que la filière entre davantage dans le dispositif Égalim. Qu'en pensez-vous ?
M. Serge Mérillou. - Je voterai ce rapport, ne serait-ce que par confiance envers les rapporteurs. La situation du monde viticole est pire que ce que j'imaginais il y a encore quelques mois : suicides, découragement. Le Bordelais est au bord du précipice. L'arrachage de vignes modifie le paysage. Si le rapport décoiffe, tant mieux ! Il faut redonner confiance à cette filière.
M. Denis Bouad. - Je voterai ce rapport.
La recommandation n° 3 vise à « sanctuariser, dans le cadre du débat sur les agences, l'existence de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) ». Alors que l'État s'en désengage budgétairement, il faut demander cette sanctuarisation avec force.
Dans le Gard, on dénombre 46 caves coopératives. Je dis depuis trois ans qu'il faut en supprimer la moitié, mais je prêche dans le désert. Ces caves n'ont plus de liquidités. Le Crédit agricole a des encours qui font peur.
Chez moi, le changement climatique et le manque d'eau posent la question de l'avenir de la viticulture.
Ce rapport décoiffe : tant mieux.
M. Yannick Jadot. - Je confirme les propos d'Évelyne Renaud-Garabedian. Il est aberrant de voir, dans les grandes foires internationales, les stands de l'Italie, de l'Espagne, puis ceux de chaque région française.
Avez-vous traité la question de la financiarisation de certaines appellations et de son impact sur la gestion de ces filières ?
Qu'en est-il de la demande et de l'offre de nouvelles méthodes de production ? Une bouteille sur quatre, ou sur cinq, est issue de la viticulture biologique. Il y a de nouveaux modes de production, de nouveaux usages, de nouveaux clients.
M. Henri Cabanel, rapporteur. - La consommation d'alcool doit être modérée : pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. Les exemples cités par monsieur Salmon sont liés à l'addiction à l'alcool.
Notre rapport aborde largement les cépages résistants, qui divisent par trois à cinq l'usage d'intrants. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) a été précurseur en la matière, mais la filière ne s'en est pas saisie. Nous voulons une surprime à la plantation pour ces cépages. L'avenir de la viticulture bio passera par là.
Le vignoble français bio est le premier au monde, avec 24 % des surfaces viticoles plantées en bio.
En ce qui concerne les subventions et l'impression que l'argent versé à la filière est dépensé à fonds perdu, permettez-moi de vous faire part d'une anecdote : chaque année la chambre d'agriculture de l'Hérault organise une réunion à l'occasion des vendanges, avec le préfet, les élus, tous les acteurs, etc. Je n'en ai raté aucune : à chaque fois, la filière a demandé des subventions. Certes, la chambre d'agriculture joue son rôle de syndicat, mais cela signifie qu'il y a un manque de stratégie, en amont, concernant l'utilisation de cet argent, et que nous devons aussi, en tant qu'élus, être vigilants quant à l'emploi de l'argent public.
Il est vrai que les vignerons de Côte d'Or n'ont pas de problème pour vendre leurs productions, mais ils rencontrent des difficultés pour transmettre leur exploitation. Les terres du vignoble bourguignon ont été surévaluées : les viticulteurs sont riches, certes, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus transmettre leurs terres. Il faut trouver des solutions.
Sur la loi Égalim, il convient de généraliser la publication des indicateurs de coûts de production. En outre, l'IGP Pays d'Oc s'est saisi d'outils complémentaires prévus par le droit européen. Nous devons encourager cela car il est vrai qu'il est problématique de trouver des bouteilles de Bordeaux à un euro dans certains supermarchés.
En ce qui concerne l'Institut national de l'origine et de la qualité, nous recommandons de le sanctuariser et que l'État respecte son engagement d'augmenter sa contribution à son financement. Nous devons faire confiance à cet organisme qui nous semble indispensable.
Nous demandons à l'État de tenir son engagement de verser les 10 millions d'euros promis pour accompagner la restructuration des caves coopératives. Le département de l'Hérault a pris de l'avance et a déjà entamé cette politique de restructuration depuis une dizaine d'années. Toutefois cette politique ne sera efficace que si elle s'accompagne d'un changement de stratégie : si l'on fusionne deux coopératives qui vont mal, celle qui sera issue de la fusion ira mal.
En ce qui concerne l'eau, je suis très clair : les parlementaires qui disent qu'il y aura assez d'eau pour tous les usages agricoles mentent ! Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde ! L'agriculture a besoin d'eau, mais il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. Pour être équitables à l'égard de ceux qui manquent d'eau, nous préconisons d'instaurer un financement public pour la restructuration des sols, de même que la PAC fournit des financements publics pour l'irrigation. Il s'agit que le peu d'eau de pluie qui tombe soit utilisé de manière optimale.
Je déplore, comme Yannick Jadot, que la France ne fasse pas bloc à l'occasion des salons. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. C'est un handicap pour nos exportations : si nous sommes bons en valeur, nous sommes très mauvais en volume. Nous exportons entre 12 et 13 millions d'hectolitres de vins, quand nos concurrents italiens en exportent 21 ou 22, de même que nos concurrents espagnols, car ils sont groupés et déploient une stratégie commerciale qui nous fait défaut.
La financiarisation du foncier pose des problèmes. On le constate en Bourgogne. Une loi foncière est nécessaire.
M. Yannick Jadot. - Les vignerons sont propriétaires en Bourgogne. Ce n'est pas le cas dans le Bordelais.
M. Henri Cabanel, rapporteur. - Pas tous, mais il y a une volonté de mainmise de la part d'un grand groupe français, qui fait de la spéculation foncière et fait exploser les prix. Une loi est nécessaire.
M. Daniel Laurent, rapporteur. - Dans ce rapport transpartisan - j'insiste sur ce point -, nous formulons des recommandations décoiffantes, mais indispensables, sur la base des données que nous avons recueillies dans l'essentiel des régions, afin de garantir l'avenir de la viticulture. La viticulture va mal. Pour se redresser, elle doit prendre son destin en main.
M. Sebastien Pla, rapporteur. - Nous émettons des préconisations. Celles-ci ne sont pas obligatoires. Toutes ne pourront pas être mises en oeuvre par le législateur ou par Bruxelles : nombre d'entre elles relèveront de l'action des professionnels du secteur, s'ils le souhaitent. C'est un travail collectif. Il était de notre responsabilité de faire des préconisations susceptibles parfois de heurter les uns ou les autres, mais un sursaut est nécessaire, car la filière continue de perdre des parts de marché.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Lundi 26 mai 2025
- Confédération paysanne : MM. Thomas GIBERT, porte-parole, et Olivier HORIOT, membre de la commission viticulture.
- Jeunes Agriculteurs (JA) : M. Jean-Baptiste SABLAIROLES, administrateur en charge du dossier viticulture, et Mme Élise DUPONT, conseillère productions végétales et innovation.
- Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV) : MM. Bernard FARGES, président, et Didier DELZESCAUX, directeur.
- Confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à appellations d'origine contrôlées (CNAOC) : MM. Jérôme BAUER, président, Raphaël FATTIER, directeur, et Damien GILLES, président de la fédération des AOC du Sud-Est (FRAOC).
Mercredi 11 juin 2025
- Chambres d'agriculture de France : M. Denis CARRETIER, secrétaire-adjoint et président de la chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, Mmes Blanche SEGURA, chargée de mission agro-économiste viticulture, et Alix DAVID, chargée de mission affaires publiques.
- Audition commune de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et de l'Institut français de la vigne et du vin (IFV) :
· Inrae : MM. Christian LANNOU, directeur scientifique adjoint agriculture, Éric DUCHENE, directeur de l'unité Santé de la vigne et qualité du vin (SVQV), Marc GAUCHÉE, conseiller du PDG pour les relations parlementaires et institutionnelles ;
· IFV : MM. Bernard ANGELRAS, président, et Christophe RIOU, directeur général.
- Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) : M. Christian PALY, président, et Mme Carole LY, directrice.
Jeudi 12 juin 2025
- Audition commune de l'ambassade de France en Espagne et de l'ambassade de France en Italie : MM. Jean-Baptiste FAURÉ, conseiller pour les affaires agricoles à Madrid, et Philippe MERILLON, conseiller pour les affaires agricoles à Rome.
- Association nationale interprofessionnelle des vins de France (Anivin de France) : Mmes Marine DESCOMBE, présidente, et Valérie PAJOTIN, directrice.
- Business France : Mmes Laurence DE TOUCHET, directrice de la programmation Export, et Laure ELSAESSER, cheffe du service agrotech.
- Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) : M. David CHATILLON, coprésident.
- Ambassade de France en Chine : M. Cédric PRÉVOST, conseiller pour les affaires agricoles à Pékin.
- Audition commune du Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) et de l'Union générale des viticulteurs pour l'AOC Cognac (UGVC) : MM. Florent MORILLON, président (BNIC), Raphaël DELPECH, directeur général (BNIC), et Anthony BRUN, président (UGVC).
Lundi 23 juin 2025
- Audition commune de Vin & Société et de l'Institut français d'opinion publique (Ifop) : MM. Joël FORGEAU, vice-président délégué (V&S), Mme Stéphanie PIOT, déléguée générale adjointe (V&S), et M. Gaspard JABOULAY, directeur des études qualitatives au département Opinion et Stratégies d'entreprise (Ifop).
- Ambassade de France aux États-Unis : M. Christian LIGEARD, conseiller pour les affaires agricoles à Washington.
- Audition de la Fédération française de la pépinière viticole (FFPV) : MM. Guillaume MERCIER, responsable de production des pépinières Mercier, Vincent DELBOS, directeur général des pépinières Guillaume, Giovanni VARELLI, président de Vitipep's, et David AMBLEVERT, ancien président de la FFPV, gérant des pépinières viticoles Amblevert et vice-président de l'Institut français de la vigne et du vin.
- Grands Chais de France : M. Joseph HELFRICH, président-directeur général, Mme Anne-Laure HELFRICH, directrice marketing, et M. Serge FLEISCHER, directeur général de la Maison Arthur Metz.
- FranceAgriMer : Mmes Julie BRAYER MANKOR, directrice générale adjointe, Marie TOUVAIS, cheffe du service Gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles, et M. Ygor GIBELIND, délégué filière vin.
Mardi 24 juin 2025
- Sociétés d'aménagement foncier (Safer) : MM. Fabien JOFFRE, président de la Safer de Nouvelle-Aquitaine, Philippe de SEGONZAC, directeur de la Safer de Bourgogne-Franche-Comté et directeur référent du réseau des Safer viticoles, Michel LACHAT, directeur départemental Gironde, référent viticole pour la Safer de Nouvelle-Aquitaine, Nicolas POULHALEC, directeur départemental Tarn et référent viticole pour la Safer d'Occitanie, et Loïc JÉGOUZO, adjoint au directeur des études de la Fédération nationale des Safer et coordinateur national du réseau des Safer viticoles.
- Vignerons indépendants de France : MM. Jean-Marie FABRE, président, Ludovic WALBAUM, secrétaire général, et Marc DURET, directeur général.
- Audition commune de la Fédération des cavistes indépendants (FCI) et du Syndicat des cavistes professionnels (SCP) : MM. Cyril CONIGLIO, président (FCI), Johannès MARCON, président (SCP) et directeur général des vins Marcon, et Patrick JOURDAIN, président d'honneur (SCP).
- Confédération des grossistes de France (CGF) : Mme Kristelle HOURQUES, directrice des affaires publiques, MM. David ZYLBERBOGEN, président-directeur général des établissements Millet, Stéphane MAUTIN, président-directeur général de Distriboissons, et Adrien ROUQUETTE, président-directeur général du Groupe Rouquette.
- Fédération du commerce et de la distribution (FCD) : MM. Hugues BEYLER, directeur agriculture et filières, et Vincent MARTIN, directeur du collège alimentaire de la Fédération du commerce coopératif et associé (FCA).
Mercredi 25 juin 2025
- Agence SoWine : Mme Marie MASCRÉ, fondatrice et présidente-directrice générale, et M. Sylvain DADÉ, fondateur.
- Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : M. Jérôme DESPEY, vice-président, Mmes Pauline HEURTEBIZE, chargée de mission viticulture et productions végétales, et Romane SAGNIER, chargée de mission affaires publiques.
Jeudi 26 juin 2025
- Association nationale des élus de la vigne et du vin (ANEV) : MM. Christian Klinger, président, sénateur du Haut-Rhin, et Amaury LESAINT, directeur.
- Atout France : Mme Rose-Marie ABEL, directrice générale par intérim/secrétaire générale, MM. Ludovic WALBAUM, président du pôle oenotourisme, et Martin LHUILLIER, responsable du pôle oenotourisme.
Mardi 1 juillet 2025
- Conseil supérieur de l'oenotourisme (CSO) : M. Hervé NOVELLI, président.
- Confédération des Vins IGP de France : M. Gérard BANCILLON, président, et Mme Christelle JACQUEMOT, directrice.
- Confédération des coopératives vinicoles de France (CCVF) : M. Joël BOUEILH, président des vignerons coopérateurs de France.
Lundi 7 juillet 2025
- Audition commune de la Fédération nationale des distilleries coopératives viticoles (FNDCV) et de l'Union nationale des distilleries vinicoles (UNDV) : MM. Bruno GUIN, président de la FNDCV et de l'Union des distilleries de la Méditerranée, Frédéric PELENC, directeur (FNDCV), Mmes Claire DOUENCE, présidente de l'UNDV, et Pauline BLANCKAERT, directrice (UNDV).
- Interprofession des vins du Val de Loire (Interloire) : M. Camille MASSON, président.
- Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) : MM. Serge FLEISCHER, président, et Gilles NEUSCH, directeur.
- Université de Bordeaux : M. Jean-Marie CARDEBAT, professeur d'économie, notamment spécialiste de l'économie du vin, participant à l'animation de la chaire Vins et spiritueux.
- Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO) : MM. Joël BOUEILH, co-président, et Christophe BOU, co-président.
Mardi 8 juillet 2025
- Table ronde d'organismes représentant le Sud-Ouest :
· Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL) : MM. Pierre BORIES, président, et Olivier LEGRAND, délégué général ;
· Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon (CIVR) : M. Jean-Christophe BOURQUIN, président ;
· Syndicat des producteurs des vins de Pays d'Oc : M. Jacques GRAVEGEAL, président ;
· Syndicat des producteurs des Terres du Midi : M. Ludovic ROUX, président.
- Inter Beaujolais : MM. Jean-Marc LAFONT, président, et Sébastien KARGUL, vice-président.
Mardi 2 septembre 2025
- Table ronde sur l'oenotourisme :
· Domaine & Demeure : MM. Karl O'HANLON, fondateur et président-directeur général ;
· Agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : M. Laurent CORMIER, directeur général par intérim ;
· Vinotrip : M. Julien PLAUD, cofondateur et directeur général ;
· Visit Alsace / Alsace destination tourisme : Mme Nathalie KALTENBACH, présidente, mare de Barr, et M. Marc LÉVY, directeur général.
- Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) : MM. Thibaut FIÉVET, sous-directeur de la fiscalité douanière, et Julien COUDRAY, chef du bureau des contributions indirectes.
- Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) : MM. Jean-François FRUTTERO, président, et Christophe SIMON, chargé des relations parlementaires.
- Audition commune d'Intervins Sud-Est, Inter Rhône et du Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) : MM. Philippe PELLATON, président (Inter Rhône), Roger RAVOIRE, président (Intervins Sud-Est), Mme Marine GAYRARD, directrice (Intervins Sud-Est), et M. Brice EYMARD, directeur (CIVP).
- Maison des vins et des spiritueux : MM. Jean-Pierre COINTREAU, président, Michel CHAPOUTIER, président de l'Union des maisons et marques de vin (UMVIN), Nicolas OZANAM, délégué général de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS), et Géraud DE LA NOUE, vice-président de la Fédération française des spiritueux (FFS).
Mercredi 3 septembre 2025
- Audition commune de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et de Santé publique France (SPF) :
· Anses : Mme Charlotte GRASTILLEUR, directrice générale en charge du pôle « produits règlementés », MM. Jérôme LAVILLE, adjoint au chef d'unité décisions du pôle « produits règlementés », Matthieu SCHULER, directeur général délégué en charge du pôle Sciences pour l'expertise, et Mme Sarah AUBERTIE, chargée des relations institutionnelles ;
· SPF : M. Sébastien DENYS, directeur Santé environnement travail, Mmes Clémence FILLOL, responsable de l'unité Surveillance des expositions au sein de la direction Santé environnement travail, Viet NGUYEN THANH, responsable de l'unité Addictions à la direction de la prévention et de la promotion de la santé, et Alima MARIE-MALIKITE, directrice de cabinet.
- Crédit Agricole : MM. Jean-Pierre TOUZET, directeur du pôle Agri-agro, garantie et capital développement, Jean-Christophe ROUBIN, directeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et Mme Lilia GUETAT, chargée de mission affaires publiques.
- Audition commune du Bureau interprofessionnel des vins du Centre-Loire (BIVC) et de la Fédération des unions viticoles du Centre (FUVC) : MM. Arnaud BOURGEOIS, coprésident (BIVC), François BOUTEILLE, directeur (BIVC), Marc THIBAULT, coprésident (FUVC), et Mme Nathalie PRIEUR, directrice (FUVC).
- Audition commune de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et du Groupement des hôtelleries et des restaurations (GHR) : MM. Franck TROUET, délégué général (GHR), Franck CHAUMÈS, président national de la branche restauration (Umih), et Mme Julie BESSE, directrice juridique, des affaires règlementaires, européennes et des affaires sociales (Umih).
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : Mmes Odile CLUZEL, sous-directrice produits et marchés agroalimentaires, Claire DAMIEN, cheffe du bureau des produits d'origine végétale et boissons alcoolisées, et M. Benjamin NARDEUX, adjoint à la cheffe du bureau des produits d'origine végétale et boissons alcoolisées.
- Audition commune d'organismes viticoles du Sud-Est :
· Syndicat des vignerons du Var : M. Éric PAUL, président ;
· Syndicat des producteurs de vins IGP des Bouches-du-Rhône : MM. Patrick MICHEL, coprésident, et Thierry ICARD, président ;
· IGP Méditerranée : M. Thierry ICARD, président.
- Personnalité qualifiée : M. Martin CUBERTAFOND, consultant en stratégie et maître de conférences à Sciences-Po Paris.
Mardi 16 septembre 2025
- Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) : M. Olivier DAMAISIN, coordinateur national interministériel du Plan de prévention du mal-être en agriculture, Mme Anne-Marie SOUBIELLE, adjointe au coordinateur national interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture, et M. Emmanuel GÉRAT, chargé de mission auprès du coordinateur national.
- Région Grand Est : M. Franck LEROY, président du conseil régional.
- Direction générale de l'agriculture et du développement durable de la Commission européenne : MM. Pierre BASCOU, directeur général adjoint chargé des directions International et Marchés, et Mauro POINELLI, directeur général adjoint chargé des directions Vins, spiritueux et produits horticoles.
- Association Addictions France : M. Bernard BASSET, président d'honneur, et Mme Louise LEFEBVRE-LEPETIT, chargée de mission plaidoyer.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Bordeaux négoce
- Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB)
- Conseiller agricole de l'ambassade de France en Afrique du Sud
- Conseiller agricole de l'ambassade de France en Argentine
- Conseiller agricole de l'ambassade de France en Australie
- Conseiller agricole de l'ambassade de France au Brésil
- Conseiller agricole de l'ambassade de France au Chili
- Fédération des grands vins de Bordeaux (FGVB)
- Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB)
- Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FNSafer)
- Fédération nationale entrepreneurs des territoires (FNEDT)
- Institut national de la consommation - 60 millions de consommateurs (INC)
- Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Région Bretagne
- Région Corse
- Région Grand Est
- Région Pays de la Loire
LISTE DES DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENT EN BOURGOGNE, CONJOINT AVEC LE GROUPE D'ÉTUDES VIGNE ET VIN
Mercredi 18 juin 2025
- Dîner de travail avec :
· M. Thiébault HUBER, président de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) et vigneron à Meursault ;
· M. Jérôme CHEVALIER, président adjoint de la CAVB et vigneron à Charnay-lès-Mâcon ;
· M. Manuel OLIVIER, secrétaire général de la CAVB et vigneron à Concoeur ;
· Mme Marion SAÜQUERE, directrice de la CAVB ;
· M. Raphaël FATTIER, directeur de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à appellations d'origine contrôlées (CNAOC).
Jeudi 19 juin 2025
- Réunion de travail dans les locaux de la CAVB à Beaune avec :
· M. Thiébault HUBER, président de la CAVB et vigneron à Meursault ;
· M. Jérôme CHEVALIER, président adjoint de la CAVB et vigneron à Charnay-lès-Mâcon ;
· M. Manuel OLIVIER, secrétaire général de la CAVB et vigneron à Concoeur ;
· Mme Marion SAÜQUERE, directrice de la CAVB ;
· M. Raphaël FATTIER, directeur de la CNAOC ;
· M. Bruno VERRET, vice-président de la CAVB et vigneron à Saint-Bris-le-Vineux (Yonne) ;
· M. Matthieu WOILLEZ, vice-président de la CAVB et vigneron à Vézelay (Yonne).
- Visite de l'exploitation de M. Thiébault HUBER à Meursault.
- Visite de la Cité des climats et des vins de Bourgogne et déjeuner de travail en présence de :
· M. Thiébault HUBER, président de la CAVB et vigneron à Meursault ;
· Mme Marion SAÜQUERE, directrice de la CAVB ;
· M. Albéric BICHOT, président de la Fédération des négociants-éleveurs de grande Bourgogne (FNEB) ;
· M. Pierre GERNELLE, directeur de la FNEB ;
· M. Raphaël FATTIER, directeur de la CNAOC ;
· M. Vincent LAVIER, président de la chambre régionale d'agriculture ;
· Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLE, directrice de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté (DRAAF BFC) ;
· M. Denis THOMAS, vice-président du conseil départemental de la Côte-d'Or ;
· M. Manuel OLIVIER, vice-président de la chambre départementale d'agriculture de Côte-d'Or.
- Visite des Hospices civils de Beaune avec :
· M. Guillaume KOCH, directeur des Hospices civils de Beaune ;
· Mme Sandrine ALLARD-SAINT-ALBIN, responsable de l'Hôtel-Dieu ;
· M. Pierre GERNELLE, directeur de la FNEB.
- Visite de la cuverie Boisset à Nuits Saint Georges et réunion de travail avec la FNEB :
· M. Jean Claude BOISSET, président-directeur général du groupe Boisset ;
· M. Georges LEGRAND, conseiller du président de la maison Boisset ;
· MM. Gilles SEGUIN et Jean-François CURIE, directeurs généraux du groupe Boisset ;
· M. Gregory PATRIAT, viniculteur du groupe Boisset ;
· M. Thomas SEITER, président de la maison Louis Jadot ;
· M. Jean Philippe ARCHAMBAUD, directeur du château Philippe Le Hardi ;
· M. Pierre GERNELLE, directeur de la FNEB.
Vendredi 20 juin 2025
- Visite du domaine Lucien ROCAULT à Saint Romain
- Visite de la cave coopérative de Bissey-sous-Cruchaud et échange avec la Fédération des caves coopératives de Bourgogne Jura (FCCBJ) en présence de :
· Mme Bénédicte BONNET, vigneronne coopératrice à la cave de Buxy et coprésidente de la FCCBJ ;
· Mme Élodie SEGAUD, directrice de la FCCBJ ;
· M. Jean Philippe PRETET, vigneron et président de la cave de Bissey ;
· M. Julien GUILLAUME, directeur de la cave de Bissey ;
· M. Jean-Christophe DUPRÉ, vigneron et président de la cave de Mancey ;
· M. Cédric PERRAUD, vigneron et président de la cave de Buxy.
DÉPLACEMENT EN GIRONDE
Jeudi 3 juillet 2025
- Visite de l'exploitation de M. Jérôme ZAROS et table ronde à La Saulve autour des enjeux de la viticulture bordelaise avec :
· M. Stéphane GABARD, président de l'ODG Bordeaux et Bordeaux supérieur ;
· M. David LABAT, président de l'ODG de l'Entre-deux-Mers ;
· M. Magali VÉRITÉ, vice-présidente de la chambre d'agriculture de Gironde ;
· M. Jean-Michel GARDE, président de la Fédération des grands vins de Bordeaux (FGVB) ;
· M. Yann LE GOASTER, directeur de la FGVB ;
· M. Renaud JEAN, négociant, viticulteur et membre du Collectif Viti 33.
- Visite des caves de Rauzan et table ronde sur les enjeux des coopératives du Bordelais avec :
· M. Thomas SOLANS, président des caves de Rauzan ;
· M. Mikaël COUSINET, président de la cave Univitis ;
· M. Julien B?ÉROT, président de la cave de Sainte-Radegonde ;
· M. Christian PASCAUD, vice-président de la cave de Saint-Émilion ;
· M. Pierre PLAGNOL, jeune agriculteur.
- Déjeuner de travail en présence de :
· M. Jacques LURTON, président des vignobles André Lurton et propriétaire du château, ;
· M. David LABAT, président de l'ODG de l'Entre-deux-Mers ;
· M. Bernard FARGES, président du Comité national des interprofessions des vins (CNIV) ;
· M. Jean-Samuel EYNARD, président de la chambre d'agriculture de Gironde ;
· Mme Magali VÉRIT?É, vice-présidente de la chambre d'agriculture de Gironde ;
· M. Denis BARO, président de Coop de France Nouvelle-Aquitaine et de la fédération des coopératives vinicoles d'Aquitaine ;
· M. Allan SICHEL, président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux ;
· M. Jean-Marie GARDE, président de la FGVB ;
· M. Yann LE GOASTER, directeur de la FGVB ;
· M. Stéphane HÉRAUD, président de l'union des caves de Tutiac ;
· M. David LABAT, président de l'ODG de l'Entre-deux-Mers ;
· M. Stéphane GABARD, président de l'ODG Bordeaux et Bordeaux supérieur ;
· M. Franck TEXIER, vice-président de la Fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne
· Mme Catherine DUPÉRAT, directrice de Bordeaux Négoce.
- Visite de la maison Jean-Baptiste Audy à Libourne avec :
· M. Michel MOULÈNE, directeur général adjoint et responsable commercial de la maison Jean-Baptiste Audy ;
· M. Franck TEXIER, vice-président de la fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne ;
· Mme Catherine DUPÉRAT, directrice de Bordeaux Négoce.
DÉPLACEMENT DANS LE LANGUEDOC
Jeudi 4 septembre 2025
- Visite du domaine de Manse à Lattes, siège du Syndicat des producteurs de vins de Pays d'Oc, et réunion de travail en présence de :
· M. Jacques GRAVEGEAL, président du Syndicat des producteurs de vins de Pays d'Oc ;
· Mme Florence BARTHES, directrice d'Inter'Oc ;
· Mme Véronique GIZARD, directrice des services du Syndicat des producteurs de vins de Pays d'Oc ;
· M. Rémi DUMAS, président des Jeunes agriculteurs de l'Hérault ;
· Mme Sophie NOGUES, présidente de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Hérault ;
· M. François-Régis BOUSSAGOL, président des Vignerons indépendants de l'Hérault ;
· M. Fabien CASTELBOU, président des Vignerons coopérateurs d'Occitanie ;
· Mme Delphine ANTOLIN, animatrice territoriale des Vignerons coopérateurs de l'Hérault ;
· Mme Valérie BASTOUL, directrice de la Chambre d'agriculture de l'Hérault ;
· M. Jean-Marc TOUZARD, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).
- Audition de la Confédération paysanne de l'Hérault au domaine de Manse en présence de MM. Olivier PILLET, porte-parole départemental, et Dominique SOULLIER, secrétaire départemental.
- Déjeuner de travail en compagnie de M. Olivier SIMONOU, président d'Inter'Oc.
- Rencontre à la cave coopérative Les Caves Molière, à Abeilhan, avec M. Jean-Philippe GUIRAUDOU, président de la cave, accompagné de plusieurs membres du conseil d'administration, et Mme Catherine FIS, première adjointe au maire d'Abeilhan.
- Rencontre au domaine Saint-Georges d'Ibry, à Abeilhan, avec :
· M. Michel CROS-PELOT, vigneron ;
· Mme Marianne CROS-PELOT, vigneronne ;
· M. Jean-Philippe CROS, vigneron ;
· Mme Catherine FIS, première adjointe au maire d'Abeilhan.
- Dîner de travail en présence de de MM. Ludovic ROUX, président de la Chambre d'agriculture de l'Aude, et Jean-Marie FABRE, président des Vignerons indépendants de France.
Vendredi 5 septembre 2025
- Rencontre au Syndicat des vins AOC de Limoux avec :
· M. Thomas ROGER, président du syndicat ;
· M. Pierre-Louis FARGES, vice-président du syndicat et président de la cave Sieur d'Arques ;
· M. Nicolas THEREZ, vice-président du syndicat et représentant des caves particulières ;
· M. Bastien LALAUZE, membre du bureau et représentant de la maison de négoce Paul Mas ;
· M. Jérôme BOYÉ, membre du bureau et président de la cave Anne de Joyeuse ;
· M. Pierre DURAND, maire de Limoux.
- Visite du centre expérimental de la Chambre d'agriculture du domaine de Cazes, à Alaigne, en présence de :
· M. Ludovic ROUX, président de la Chambre d'agriculture de l'Aude ;
· Mme Marie-Hélène FOREST, directrice de la Chambre d'agriculture de l'Aude ;
· M. Gilles FOUSSAT, président de l'ODG de l'AOP Malepère.
- Déjeuner de travail avec :
· M. Ludovic ROUX, président de la Chambre d'agriculture ;
· Mme Marie-Hélène FOREST, directrice de la Chambre d'agriculture ;
· M. Damien ONORRE, président du Syndicat des vignerons de l'Aude ;
· M. Philippe MONZIOLS, directeur du Syndicat des vignerons de l'Aude ;
· M. Marc VÉRA, président de la cave La Vigneronne, président de la Coop' de l'Aude ;
· M. Christophe GUALCO, président des Vignerons indépendants de l'Aude ;
· M. Jean-Luc Fabry, directeur des Vignerons indépendants de l'Aude ;
· M. Loïc ESCOURROU, coprésident du Syndicat des jeunes agriculteurs de l'Aude ;
· M. Jean-Philippe MARI, vigneron, président de la Fédération Sud des AOC ;
· M. Olivier VERDALE, président de l'ODG de l'AOC Corbières ;
· M. Pierre BORIES, président du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL) ;
· Mme Lucie ROESCH, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude ;
· M. Xavier PIOLIN, directeur adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Aude ;
· Mme Hélène SANDRAGNÉ, présidente du Conseil départemental de l'Aude.
* 1 La domestication de la vigne et, par la suite, les débuts de la viticulture se situeraient, selon les dernières études disponibles (Dual domestications and origin of traits in grapevine evolution, Yang Dong, Shengchang Duan, Qiuju Xia, et al, Science 3 Mars 2023), à la fois dans le croissant fertile et dans le Caucase quelque 11 000 ans avant notre ère.
* 2 Pour cette étude, la « filière spécialisée de la vigne et du vin » comprend la viticulture stricto sensu, les courtiers, les négociants et commerce de gros, la grande distribution, la restauration, les cavistes et le e-commerce.
* 3 À noter que les chiffres publiés le 12/12/2024 par FAM font état, précisément, en 2021, de 58 310 exploitations viticoles, rassemblant 128 370 ETP, soit 19 % des ETP agricoles.
* 4 Par exemple, en prenant en compte l'activité de tonnellerie générée par l'activité viticole (effet direct), de même que la demande sylvicole consécutive de l'activité de tonnellerie (effet indirect).
* 5 Le rapport de 2002 de Gérard César sur la filière viticole indiquait alors que « au total, la filière vitivinicole au sens le plus large occuperait 800 000 personnes en équivalent temps-plein ».
* 6 Production totale (hors subventions) = produits végétaux + produits animaux + services.
* 7 Stéphane Le Bras. Le mouvement coopératif au XXe siècle. Un levier pour préserver l'économie viticole du sud de la France. J. Pérard et C. Wolikov. Quelles durabilités en vigne et en cave ?, Rencontres du Clos-Vougeot 2017, Chaire Unesco/Centre G. Chevrier, p. 173-186, 2018.
* 8 Universitaire, oenologue de renom, ayant initié plusieurs changements majeurs dans le travail de la vigne. Co-auteur notamment de l'ouvrage Le goût du vin, paru en 1980.
* 9 Professeur émérite, oenologue de renom et notamment co-auteur de l'ouvrage de référence Traité d'oenologie, paru initialement à la fin des années 1940 et régulièrement réédité
* 10 OEnologue, ingénieur agronome et viticulteur, célèbre notamment pour ses travaux sur le vin blanc, fondateur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin
* 11 Grand viticulteur bourguignon, diplômé d'oenologie, reconnu notamment pour ses qualités de vinificateur et pour son usage de la macération à froid à l'aide de glace carbonique
* 12 Défense de la forêt française contre les incendies.
* 13 Mesures agroenvironnementales et climatiques.
* 14 Il existe, depuis 2008, une classification européenne spécifique pour les boissons spiritueuses visant, comme pour les IGP, à protéger l'indication géographique de celles-ci. Si des spiritueux peuvent donc relever d'une AOC, ils ne peuvent relever d'une IGP, mais d'une IG (Whisky breton, rhum de Guadeloupe, etc.).
* 15 Article L. 632-1 du CRPM.
* 16 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
* 17 Fonctionnement de l'Interprofession / Cniv.
* 18 Source : contribution écrite de Vignerons Coopérateurs de France.
* 19 Comme le souligne le Masa dans sa contribution écrite : « ce rôle est ancien. En 1907, à la suite de la révolte des vignerons languedociens, un corps spécial de la répression des fraudes est créé. Le contrôle du vin constitue l'une de ses principales missions. Aujourd'hui, le contrôle des vins et spiritueux par la DGCCRF fait toujours l'objet d'une attention particulière. Neuf “Brigades d'Enquêtes Vins et Spiritueux” (BEVS) - comptant une cinquantaine d'agents répartis dans toute la France - effectuent des contrôles au stade de la production : vignerons, négociants vinificateurs, fabricants de produits oenologiques, distilleries, etc. »
* 20 Financé sur le budget de l'Union européenne, le Feaga est avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), cofinancé par ses États membres, l'un des deux piliers de la politique agricole commune.
* 21 Décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l'alcool.
* 22 Le rapport abordera cette étude dans sa seconde partie.
* 23 Voir infra.
* 24 Les données et illustrations de cette partie proviennent de FranceAgriMer et de sa publication « Les chiffres clés de la filière Viti-Vinicole 2023 ». Certaines données sont de 2021, car non actualisées annuellement, quand d'autres le sont annuellement, permettant de mentionner les données 2023.
* 25 Voir supra.
* 26 Contributions écrites des conseillers agricoles auprès des ambassades de France en Italie et Espagne.
* 27 Vins et spiritueux Commerce extérieur Bilan 2023, FranceAgriMer, juin 2024.
* 28 Source : calculs Sénat à partir des données FEVS.
* 29 En 2024, selon les chiffres de la FEVS, les exportations de whisky français s'élèvent à 133 M€ en valeur, derrière le brandy et le rhum (133 M€ chacun).
* 30 Source : Commission européenne.
* 31 Source : contribution écrite du conseiller agricole de l'ambassade de France en Espagne.
* 32 Source : contribution écrite du conseiller agricole de l'ambassade de France en Italie.
* 33 Contribution écrite de la direction du Trésor.
* 34 Contribution écrite du conseiller agricole à l'ambassade de France à Canberra.
* 35 Tous les jours ou presque.
* 36 François Legouy. Géohistoire de l'espace viticole français de 1808 à nos jours. Atlas de la vigne et du vin : un nouveau défi de la mondialisation, Armand Colin, 2015.
* 37 À noter toutefois que sur un temps plus long, on observe une baisse tendancielle de la production française en volume puisqu'à partir de 2007, et à l'exception de 2012, celle-ci ne dépassera plus les 50 Mhl. Cette baisse peut s'expliquer par une baisse des surfaces de l'ordre de 100 000 ha entre 2000 et 2010, pour ensuite se stabiliser légèrement en dessous de 800 000 ha, mais aussi du fait de la tendance à la baisse des rendements dans certains vignobles, en partie attribuable aux dérèglements climatiques.
* 38 Plus précisément, la recommandation de Santé publique France (SPF) et de l'Institut national du cancer, issue de leur publication de 2017 « Avis d'experts relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France » est la suivante : « Si vous consommez de l'alcool, il est recommandé pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie : de ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres standard par jour ; d'avoir des jours dans la semaine sans consommation ».
Du reste, la dernière préconisation en date de l'OMS relative à la politique de lutte contre les maladies non transmissibles, de septembre 2025, reprend la notion de « consommation abusive » (« reduce the harmful use of alcohol ».
* 39 SPF indique par ailleurs que « À noter qu'il y a une forte sous-déclaration de la consommation d'alcool dans les enquêtes populationnelles qui peut expliquer les différences entre les travaux de C. Hill (fondées sur le produit des taxes) et les données déclaratives des enquêtes déclaratives telles que le Baromètre de Santé publique France (consommation déclarée). »
* 40 Voir notamment la publication n° 443 de juillet 2025 de FranceAgriMer.
* 41 L'Insee indique : « En particulier, les dépenses en transports, très affectées en 2020 par la crise sanitaire, restent en 2024 très en deçà de leur tendance d'avant-crise (- 12,8 % par rapport à la tendance 2015-2019), mais aussi de leur niveau de 2019 (- 2,7 %). De même, les dépenses en meubles et articles de ménage et entretien courant du foyer sont en deçà de leur tendance d'avant crise (- 10,7 %), tout comme les dépenses en articles d'habillement et en chaussures (- 5,6 %), en boissons alcoolisées et tabac (- 5,3 %) et en produits alimentaires et boissons non alcoolisées (- 3,8 %). En revanche, les dépenses en loisirs, sport et culture, fortement affectées par la crise sanitaire, retrouvent cette année leur tendance d'avant-crise, tout comme celles de logement, eau, gaz et électricité, affichant une progression nette par rapport à leur niveau de 2019 (respectivement + 9,5 % et + 5,6 %). »
* 42 Les données présentées dans cette partie sont, pour l'essentiel, issues de la contribution du conseiller agricole de l'ambassade de France en Chine.
* 43 Soit environ 0,14 % de la SAU totale du pays.
* 44 Allemagne, Espagne, Italie, Portugal.
* 45 Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande.
* 46 Initialement imaginé en 2013 par l'organisation anglais Alcohol Change UK.
* 47 « The EU's overall trade balance in beverages and tobacco improves by EUR 111 million (0.4 %) in the conservative scenario and by EUR 461 million (1.5 %) in the ambitious scenario. Its trade balance with the 10 FTA48 partners improves even more, by EUR 114 million in the conservative scenario and by EUR 470 million in the ambitious scenario turning a negative trade balance into a positive one in both scenarios. The countries accounting for the greatest increases in EU exports are India, Malaysia and Mercosur, particularly in the ambitious scenario. »
* 49 Dès 2011, un plan de prévention du suicide dans le monde agricole avait été annoncé.
* 50 Le rapport précise : « Les données mobilisées ont été extraites et traitées dans le Système national des données de santé (SNDS). Ce dernier contient les informations sur les circonstances et la cause initiale du décès, via une base mise à disposition par le Centre d'Épidémiologie sur les Causes médicales de Décès (CépiDc, Inserm). »
* 51 De l'ordre, pour 2024, de 20 à 25 % en Charente, et de 10 à 15 % en Charente-Maritime selon la FNSafer.
* 52 À noter que l'interprofession a mis récemment en place un système sophistiqué de volume complémentaire cognac individuel (VCCI) sur six campagnes, permettant à un exploitant de procéder à des arrachages et, en contrepartie, d'augmenter son rendement proportionnellement, dans la limite de 12hl d'alcool pur par hectare. Les surfaces sont donc, pour ceux qui s'engagent dans cette voie, réduites, mais le potentiel de production augmente.
* 53 L'article 14 de cette même loi prévoit en outre l'établissement de contrats territoriaux entre les établissements, la région et les représentants des branches professionnelles, dans l'objectif, le cas échéant, de consolider ou d'ouvrir des sections de formation professionnelle.
* 54 « Millésime 2023 : Chaud, précoce et sec, caractérisé par une adaptation constante des pratiques » rédigé par Étienne Neethling (ESA) et Hervé Quénol (CNRS), dans la revue des OEnologues n° 190 de janvier 2024).
* 55 Sgubin G., Swingedouw D., Dayon G., García de Cortázar-Atauri I., Ollat N., Pagé C., Van Leeuwen C., 2018. The risk of tardive frost damage in French vineyards in a changing climate. Agricultural and Forest Meteorology, 250-251, 226-242.
* 56 Viticulture. Production viticole 2024 : une baisse marquée à 37 millions d'hectolitres|Agreste, la statistique agricole.
* 57 Viticulture. Une production viticole 2025 estimée à 36 millions d'hectolitres|Agreste, la statistique agricole.
* 58 « Bretagne : Vive le réchauffement », J. Reux, La Vigne, n° 389, octobre 2025, p.19.
* 59 Selon l'Agreste, en 2025, la production bordelaise est en baisse de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale, celle du Sud-Ouest en retrait de 17 %, celle du Sud-Est de 10 %et celle du Languedoc-Roussillon de 19 %.
* 60 Inaki Garcia de Cortazar, Adaptation du modèle STICS à la vigne (Vitis vinifera L. ) : utilisation dans le cadre d'une étude d'impact du changement climatique à l'échelle de la France, thèse, 2006.
* 61 Source : Contribution écrite de l'Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO).
* 62 Contribution écrite du Comité Champagne.
* 63 Nathalie Ollat, Jean-Marc Touzard, Vigne, vin et changement climatique.
* 64 EUSO Dashboard - consulté le 14/10/2025.
* 65 Nathalie Ollat, Jean-Marc Touzard, Vigne, vin et changement climatique.
* 66 Ibid.
* 67 Risques pour les vendanges et les vendangeurs : les résultats préoccupants de l'étude Cliseve - Revue française d'oenologie.
* 68 Les risques professionnels des salariés agricoles 2018-2022, MSA, juillet 2024.
* 69 Van Leeuwen C., Destrac-Irvine A., Dubernet M., Duchêne E., Gowdy M., Marguerit E., Pieri P., Parker A., de Rességuier L., Ollat N., 2019. An update on the impact of climate change in viticulture and potential adaptations. Agronomy, 9 (9), 514.
* 70 Vins de Bordeaux : changement climatique, mildiou, désaffection des consommateurs... le merlot est-il en danger ?
* 71 Source : contribution écrite de l'Inrae.
* 72 Xylella fastidiosa, c'est quoi ? | Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.
* 73 Règlement d'exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l'introduction et la dissémination dans l'Union de Xylella fastidiosa.
* 74 Vignes carbonisées : la cicadelle africaine est déjà en France.
* 75 Première détection du scarabée japonais en France : une menace pour l'agriculture et les espaces verts.
* 76 Source : contribution écrite de l'Inrae.
* 77 La flavescence dorée, un fléau qui s'étend | FREDON Auvergne Rhône Alpes.
* 78 Foyers de flavescence dorée en région Centre-Val de Loire | DRAAF Centre-Val de Loire.
* 79 Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur NOR : AGRG2108908A.
* 80 Rapport de la CAE sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées du 21 mai 2025.
* 81 Loi n° 2025-533 du 13 juin 2025 instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées.
* 82 Cette condition se fonde sur les Lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier relatives au financement de la « suppression de capacités pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires [...] ». La « renaturation » consiste à créer dans un délai de deux ans après l'arrachage, des boisements ou des jachères afin d'éviter l'érosion des sols ou d'autres effets négatifs sur l'environnement. Le plan impose ainsi l'absence de toute activité agricole ou de valorisation agricole pour une durée de 20 ans minimum sur ces terres.
* 83 Le traitement phytopharmaceutique est l'application d'un produit de protection de la vigne lors d'un passage. Le traitement correspond à l'application d'un produit spécifique à un moment précis et le passage est l'opération d'épandage d'un ou plusieurs produits.
* 84 Un produit phytopharmaceutique est un produit composé d'une ou plusieurs substances actives et de coformulants.
* 85 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
* 86 Créée par l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, l'Anses est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et du travail. L'organisation de l'Anses est précisée par le décret n° 2010-719 du 28 juin 2010 modifié.
* 87 La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides prévoit que les États membres doivent adopter des plans d'action nationaux, concrétisés en France par le plan Écophyto II+.
* 88 Les indicateurs de suivi de la stratégie Écophyto 2030 | Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
* 89 Indicateurs des ventes de produits phytopharmaceutiques | Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
* 90 Stratégie Ecophyto 2030 : le Gouvernement partage un premier bilan en Comité d'orientation stratégique et de suivi afin de réduire l'utilisation et les risques des produits phytosanitaires et soutenir les filières agricoles | Ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique.
* 91 Contribution écrite de la FNSEA à partir de chiffres du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
* 92 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
* 93 Règlement d'exécution (UE) 2022/43 de la Commission du 13 janvier 2022.
* 94 Contribution écrite du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
* 95 L'actualité du Plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) | Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
* 96 Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
* 97 Règlement d'exécution (UE) n ° 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique.
* 98 Décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022 fixant les conditions d'inscription sur les listes de produits de biocontrôle NOR : AGRG2201458D.
* 99 Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures biologiques ?
* 100 -50 % de cuivres autorisés dans le vignoble par l'Anses.
* 101 « Cuivre : La grande lessive de l'Anses », C. Stef, Bertrand Collard, La Vigne, n° 389, octobre 2025, p.12.
* 102 Analyse des impacts socio-économiques de la limitation ou du retrait des produits phytosanitaires à base de cuivre en agriculture.
* 103 Source : cahiers des charges de l'Inao.
* 104 Les conséquences d'un stress hydrique prolongé sur le vin.
* 105 D'après l'Office national des forêts, l'évapotranspiration désigne le processus par lequel l'eau liquide terrestre est renvoyée dans l'atmosphère environnante sous forme gazeuse.
* 106 Nathalie Ollat, Jean-Marc Touzard, Vigne, vin et changement climatique.
* 107 Selon l'Inrae, on distingue la sécheresse météorologique, qui correspond à un déficit prolongé de précipitations, de la sécheresse agricole, résultant d'un manque d'eau disponible dans le sol pour les plantes, ainsi que de la sécheresse hydrologique qui correspond à un déficit de début des cours d'eau, des niveaux des nappes et de retenues à des niveaux inférieurs aux moyennes correspondant à la période donnée.
* 108 Le changement climatique va chambouler la géographie du vin, souligne une étude - ladepeche.fr.
* 109 Ojeda H., Saurin N., L'irrigation de précision de la vigne : méthodes, outils et stratégies pour maximiser la qualité et les rendements de la vendange en économisant de l'eau.
* 110 Contribution écrite du conseiller agricole à l'ambassade de France à Madrid.
* 111 Mission d'information sur la "Gestion durable de l'eau : l'urgence d'agir pour nos usages, nos territoires et notre environnement" | Sénat.
* 112 DP Inao - Stratégie de la filière viticole face au changement climatique.pdf.
* 113 van Leeuwen, C., Sgubin, G., Bois, B. et al. Climate change impacts and adaptations of wine production. Nat Rev Earth Environ 5, 258-275 (2024).
* 114 Ollat N., Touzard J-M, Vigne, vin et changement climatique.
* 115 Faute de pluie, les Pyrénées-Orientales craignent de maigres vendanges - La Revue du vin de France
* 116 Bulletin de santé du végétal Viticulture (territoire Languedoc-Roussillon) - Bilan de la campagne 2024 - Chambre d'agriculture - Occitanie.
* 117 Van Leeuwen, Ibid.
* 118 Rendement des AOP en vin rouge pour le premier graphique, et rendement des AOP en vin blanc pour le second.
* 119 Contribution écrite du conseiller agricole de l'ambassade de France en Australie.
* 120 Contribution écrite du conseiller agricole de l'ambassade de France en Espagne.
* 121 Source OIV.
* 122 Voir notamment : https://www.vitisphere.com/actualite-105 056-crise-viticole-en-italie-syndicats-et-gouvernement-a-la-recherche-de-solutions-.html et https://www.vitisphere.com/actualite-104 812-face-au-declin-de-la-demande-litalie-doit-repenser-sa-politique-viticole-selon-luiv.html
* 123 Union réunissant environ 800 entreprises italiennes générant 85 % des exportations nationales.
* 124 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
* 125 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.
* 126 Les montants peuvent varier selon les années, même si les ordres de grandeur restent similaires
* 127 Sur les précédents exercices, le niveau de consommation de cette aide est aux alentours de 100 M€
* 128 Ces deux propositions feront l'objet de développements infra.
* 129 Cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « SAINT-JOSEPH » homologué par arrêté du 4 juillet 2024, publié au JORF du 7 juillet 2024.
* 130 F. BARTHE, « Autorisations et contrôle des plantations viticoles », Revue de Droit rural, n° 458, Décembre 2017, dossier 17.
* 131 Décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, en particulier art. 35 et suivants.
* 132 Proposition de résolution européenne n° 298 du 10 février 2011 sur le régime des droits de plantation de vigne déposée par MM. Gérard César et Simon Sutour.
* 133 Ibidem.
* 134 Exposé des motifs du Règlement (CEE) n° 454/80 du Conseil, du 18 février 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché vitivinicole et le règlement (CEE) n° 338/79 établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées.
* 135 Article 2 du règlement (CEE) n° 348/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant des mesures visant à adapter le potentiel viticole aux besoins du marché.
* 136 Exposé des motifs du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole.
* 137 Il y a lieu ici de relever, comme le fait par ailleurs le Conseil, que si les interdictions de plantation sont devenues le principe pendant quelque temps, il n'en reste pas moins que cette interdiction constitue une atteinte importante au droit de propriété qui doit ainsi être dûment justifiée par un impératif d'intérêt général.
* 138 La tonalité change toutefois avec la réforme de l'OCM vin de 2008. Cette fois, si le législateur européen estime que les conditions de levée de l'interdiction des plantations ne sont pas réunies, de telle sorte que l'interdiction doit être maintenue jusqu'au 31 décembre 2015. Celui-ci insiste sur la nécessité que cette interdiction soit, après cette date, « définitivement levée afin de permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché. ».
* 139 Avant l'abandon du principe d'interdiction, en 2016, (voir infra), il ressort de la dernière règlementation alors en vigueur que les plantations étaient autorisées s'ils elles étaient couvertes par :
• un droit de plantation nouvelle ;
• un droit de replantation ;
• un droit de plantation prélevé sur une réserve.
Enfin, le règlement OCM de 1999 avait prévu un système de réserve nationale ou locale. Cette réserve, existant en parallèle des droits de plantation et de replantation, pouvait se voir attribuer ces droits ainsi des droits de plantation nouvellement créés. En France, cette réserve sera instituée en 2002, et gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).
* 140 L'exposé des motifs du règlement précise en effet que « La décision de mettre fin à l'interdiction transitoire de plantation de vigne au niveau de l'Union est justifiée par le fait que les principaux objectifs visés par la réforme de l'organisation du marché viticole de l'Union de 2008 ont été atteints, notamment la fin des excédents structurels de la production vinicole, qui existaient de longue date, l'amélioration progressive de la compétitivité du secteur viticole dans l'Union et le fait qu'il est de plus en plus orienté vers le marché (...) ».
* 141 Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
* 142 Article 63 du règlement OCM unique.
* 143 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) nº 251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur viticole et pour les produits vinicoles aromatisés.
* 144 En l'état du droit, et suite à un décret du 31 juillet 2025, un viticulteur dispose de cinq ans pour demander une autorisation de replantation et trois ans pour ensuite replanter. Avec l'extension de trois à huit ans de la durée prévue pour replanter, le paquet vin permettrait de passer d'un total de huit à 13 ans entre la demande initiale et la replantation effective. La durée d'une autorisation simple de plantation demeurerait de trois ans.
* 145 Cet article 216 dispose que « Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés ».
* 146 Dans sa contribution écrite, l'Inao indique que « la Dénomination Géographique Complémentaire (DGC) est une unité géographique plus petite particulière, située au sein de la zone géographique de l'appellation. Elle est reconnue, elle a une délimitation particulière et elle est inscrite dans les cahiers des charges, mais elle ne fait pas l'objet d'une protection à la différence d'une dénomination protégée en AOP ou IGP. »
* 147 « Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production. »
* 148 À noter la performance singulière du logo AB puisque 83 % des consommateurs de vin déclarent connaître le logo et 52 % qu'il les incite à l'achat d'un vin.
* 149 Un auditionné a évoqué 10 % du chiffre d'affaires dédiés aux dépenses de communication chez Heineken, 17 % chez Diageo, et 16 % chez Pernod Ricard.
* 150 Les dispositions relatives à la publicité des boissons sont codifiées aux articles L 3323-2 et suivants du code de la santé publique.
* 151 Article L. 3323-2 du code de la santé publique.
* 152 Article L. 3323-4 du code de la santé publique.
* 153 Cass. civ. 1e, 20 mai 2020, n° 19-12.278, publié au Bulletin. On notera que cette jurisprudence a été sévèrement critiquée. En effet, le texte ne fait référence à l'objectivité que pour la couleur et les caractéristiques olfactives et gustatives...la jurisprudence antérieure était plus souple.
* 154 Article L. 3323-3-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Relativement récentes, la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion d'interpréter ces dispositions.
* 155 Les concurrents de la France
* 156 En réalité, le cognac se buvait déjà comme cela jusqu'au phylloxéra et dans la génération née avant 1900. Ainsi, Charles de Gaulle buvait une « fine à l'eau » en apéritif.
* 157 Le dico-du-vin.com en donne cette définition : « des vins très aromatiques, excessivement concentrés et boisé ; caractères dus à une extraction et à un élevage sous bois exagérés ».
* 158 Source : Baromètre SoWine.
* 159 À ce titre, il a été indiqué aux rapporteurs, en audition, que le Cniv travaillait à l'intégration de données extraites de la comptabilité de la restauration, pour mieux connaître les contours de ce canal de distribution. Cette initiative va dans le bon sens et permettra de poser des constats partagés.
* 160 À noter que les paiements peuvent être différents d'une année à l'autre. Ainsi, selon les données transmises par FAM, le montant de l'aide à l'investissement se situerait plutôt, ces dernières années entre 90 et 95 M€.
* 161 Source : site internet de FAM.
* 162 L'Ipampa est un outil global pour mesurer les coûts d'achat des moyens de production des agriculteurs.
* 163 V. p. ex., dans le Bordelais, dans le vignoble de Sancerre ou encore en Saône-et-Loire.
* 164 V. pour un exemple d'étude détaillée, l'étude réalisée en 2022 par le bureau national interprofessionnel du Cognac.
* 165 V. p. ex, à l'été 2025, la polémique provoquée par la vente de bouteilles de vins de Bordeaux pour 1,39€...
* 166 14ème alinéa du III de l'article L. 631-24 du CRPM.
* 167 Article L. 631-24-2 du CRPM.
* 168 Article R. 631-6-1 du CRPM.
* 169 En particulier, la DGCCRF relève dans sa contribution « [qu'au] niveau interprofessionnel, on note une tendance favorable à la contractualisation avec la mise à disposition par 17 interprofessions viticoles170 sur 24 de contrats types écrits, alors même que dans le ressort de 11 d'entre elles, la contractualisation écrite est facultative ».
* 171 Ibidem.
* 172 Article 101 § 1 du TFUE.
* 173 Article 210 § 1, qui vise l'article 157 § 1 c) du règlement OCM.
* 174 Article 210 § 4 d) du règlement OCM.
* 175 Sur la question du prix « abusivement bas » et sa sanction, voir infra.
* 176 Pour la liste des interprofessions publiant des indicateurs de coûts de production, v. ce tableau récapitulatif de l'observation de la formation des prix et des marges, à jour du 18 octobre 2023.
* 177 Contribution écrite de la DGCCRF.
* 178 Les ententes anticoncurrentielles sont prohibées par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que par l'article L. 420-1 du code de commerce.
* 179 La différence entre le prix référence et le coût de production réside dans le fait que le prix référence est un prix recommandé de vente. La publication d'indicateurs de coûts de production ne constitue pas en soi un prix référence.
* 180 Autorité de la concurrence, 23 mai 2018, n° 18-D-06 du 23 mai 2018 ; cour d'appel de Paris, 12 mai 2022, n° RG20/156 067.
* 181 Article 210 § 2 du règlement OCM.
* 182 Comm. eur., 30 juin 2017, C (2017) 4417 final ; ADLC, 3 mai 2018, avis 18-A-04, § 197.
* 183 Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
* 184 On entend par « norme de durabilité » une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivant des objectifs environnementaux ou la production de produits agricoles selon des méthodes moins consommatrices de pesticides ou encore la santé et le bien-être des animaux (Art. 210 bis § 3 du règlement OCM).
* 185 Commission européenne, 8 décembre 2023, Lignes directrices sur l'exclusion de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour les accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l'article 210 bis du règlement (UE) n° 1308/2013.
* 186 Article 210 bis, § 6, du règlement n° 1308/2013.
* 187 Commission européenne, 15 juillet 2025, Avis sur la demande d'avis formée conformément à l'article 210 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 présentée par Vignerons Coopérateurs de France, C (2025) 4863 final (seule la version en langue français fait foi, quoique seule la version en langue anglaise ait fait l'objet d'une publication).
* 188 L'accord porte uniquement sur les vins en vrac, dès lors que les prix de ces vins sont beaucoup plus homogènes. En outre, le prix des vins en bouteilles dépend plus largement des facteurs qui ne sont pas liés aux coûts de production (renommée, marketing). Ainsi, pour limiter les effets sur la concurrence, les Vignerons Coopérateurs de France, qui ont saisi la Commission européenne, ont limité leur demande aux vins en vrac (avis préc., § 9).
* 189 Merlot, Cabernet-Sauvignon, Grenache, Cinsault, Chardonnay and Sauvignon (avis préc., § 13). Ces six cépages représentent environ 80 % de la production de l'IGP Pays d'Oc (contribution écrite du syndicat des producteurs des vins de Pays d'Oc).
* 190 Comm. eur., avis préc., §§ 10-13.
* 191 S'agissant enfin de la détermination du prix d'orientation, il est prévu une méthodologie en deux temps. D'abord, les parties à l'accord devront déterminer les coûts de production, qui comprennent tant les coûts de production de la vigne en elle-même, que les coûts de vinification. Les coûts de production par hectare seront déterminés à partir des comptes audités d'exploitation. Puis, le rendement moyen par hectare sera déterminé sur la base des déclarations des exploitants, permettant d'obtenir un coût moyen de production à l'hectolitre. Les coûts de vinification seront, eux, enfin établis à partir d'hypothèses standardisées. Une fois les coûts de production déterminées, il conviendra de déterminer la marge revenant au producteur, dans la limite de 20 % des coûts de production. Cette marge a un double objet, à savoir protéger le producteur contre des variations imprévues de coûts et lui assurer une marge suffisante l'incitant à poursuivre une production HVE ou en agriculture biologique.
* 192 Article 152, § 1, du règlement OCM. Précisément, les États membres peuvent reconnaître les organisations de producteurs à condition qu'elles se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, § 2, et, conformément à l'article 153, § 2, c, sont contrôlées par ceux-ci.
* 193 La liste exhaustive des activités pouvant être poursuivie est définie à l'article 152, § 1, b) du règlement OCM.
* 194 Article 152, § 1, c) du règlement OCM.
* 195 Autorité de la concurrence (ADLC), avis n° 18-1-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole, § 34 ; v. égal. les articles 152 et suiv. et l'article 157 du règlement OCM.
* 196 Article L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime.
* 197 ADLC, avis préc., § 36.
* 198 Article 4, § 10, b) du règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017.
* 199 Article 152, § 1 bis, b) du règlement OCM.
* 200 Article 153 du règlement OCM.
* 201 Article 154 du règlement OCM.
* 202 Articles L. 551-1 à L. 554-1 du CRPM.
* 203 Pour les produits relevant du champ de l'OCM des produits agricoles, ces règles sont prévues aux articles D551-1 à D551-88 du CRPM.
* 204 Ministère de l'agriculture, 2 septembre 2025, « Organisation économique : les organisations de producteurs ».
* 205 Contribution écrite de la DGCCRF.
* 206 L'article L. 442-4 du code de commerce permet en effet au ministre chargé de l'économie ou le ministère public de demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques prohibées par l'article L. 442-7. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile.
* 207 T. com. Bordeaux, 6e ch., 22 févr. 2024, n° RG2022F01 972.
* 208 Dans le détail, les tonneaux de vin en AOC Médoc vendus par le producteur étaient vendus à 1 157 € et 1 184 €. Les estimations du courtier assermenté sur les ventes de tonneaux AOC Medoc à la même période se situaient entre 1 300 et 1 800€. Le tribunal de commerce a alors retenu une valeur médiane pour établir un prix de marché de référence à 1 550 €, puis a jugé que les prix de 1 157 € et 1 184 € étaient abusivement bas.
* 209 Lucas Bettoni, « Insuffisance du revenu agricole : plaidoyer pour une activation de l'article L. 442-7 du code de commerce », Recueil Dalloz, 2024, p. 553.
* 210 Recommandation n° 15 du rapport d'information n° 1269 déposé par M. Sylvain Carrière et Mme Sandra Marsaud, députés, sur les stratégies de marché de la filière viticole.
* 211 Les données de cet encadré sont issues de la contribution écrite des Vignerons coopérateurs de France (VCF) et de l'édition spéciale filière vinicole de 2023 de l'Observatoire économique et financier du Haut conseil de la coopération agricole.
* 212 Article de Vitisphère du 18 mai 2024, « 7 simplifications administratives face aux 86 déclarations et 54 portails pour la filière vin, disponible ici.
* 213 Le développement de chacun des axes est disponible ici.
* 214 Circulaire du 4 juillet 2024 relative à la prise en compte de certains éléments utiles à la bonne exploitation de la parcelle pour le calcul de la superficie plantée au casier viticole informative, éligible à la production.
* 215 Arrêté du 1er mars 2024 modifiant l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
* 216 BPCE, L'observatoire Agriculture-viticulture 2023, Focus viticulture.
* 217 Arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles.
* 218 Les règles relatives aux ventes à distance sont prévues par l'article 44 de la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise.
* 219 One-Stop-Shop - Import One-Stop-Shop.
* 220 Article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
* 221 Ibidem.
* 222 Charles de Villedeuil, Histoire de l'impôt sur les boissons, Paris, 1854, cité par le rapport d'information n° 399 (2013-2014) de M. Yves Daudigny et Mme Catherine Deroche, fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 26 février 2014.
* 223 Conseil des prélèvements obligatoires, « La fiscalité nutritionnelle », juillet 2023, note n° 5, p. 3.
* 224 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI.
* 225 m. et n. de l'article 279 du CGI.
* 226 e) du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI.
* 227 Le fait générateur de l'accise est la production, ou l'importation dans l'Union européenne du produit soumis à accise (art. L. 311-4 du CIBS). Par principe, l'exigibilité, c'est-à-dire le moment où naît l'obligation de payer, est concomitante du fait générateur (art. L. 141-2 du CIBS). Néanmoins, l'article L. 311-12 du CIBS prévoit certaines exceptions. En ce qui concerne, le redevable, il s'agira le plus souvent du producteur ou de celui qui procède à la sortie du régime suspensif d'accise (art. L. 311-26 du CIBS).
* 228 La première directive est relative au régime général d'accise : elle pose les principales définitions et les fondamentaux du régime d'accise. La deuxième directive est, elle, relative aux structures des droits d'accise, et vient notamment harmoniser les définitions des différents produits soumis à accise. Enfin, la dernière directive est relative aux taux.
* 229 Article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, repris à l'article à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale (CSS).
* 230 Article L. 245-8 du CSS.
* 231 Article 22 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
* 232 Article L. 313-19 et suivants du CIBS ; article L. 245-9 du CSS.
* 233 Conformément à l'article 9 de la directive 92/83/CEE, le volume de produit fini constitue la base de calcul de l'accise sur le vin.
* 234 Il convient de ne pas confondre vins pétillants et vins mousseux. La différence principale réside dans la surpression due à l'anhydride carbonique en solution : celle des vins pétillants est comprise entre 1 et 2,5 bars, celle des vins mousseux est supérieure à 3 bars (cf partie II de l'annexe VII du règlement n° 1308/2013 dit règlement OCM).
* 235 Les produits intermédiaires sont les produits qui ont un titre alcoométrique compris entre 1,2 et 22 % qui relèvent des codes tarifaires NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont ni des bières ni des vins tranquilles ou mousseux (art. 16 de la directive 92/83/CEE ; art. L. 313-15 du CIBS). Cette catégorie comprend notamment les vins doux naturels et vins de liqueurs d'appellation d'origine contrôlée, les vermouths ou encore les vins pétillants comme le prosecco.
* 236 Conformément à l'article 3 de la directive 92/83/CEE, l'accise sur la bière est déterminée par référence au nombre d'hectolitres par titre alcoométrique volumique (comme en France) ou par référence au nombre d'hectolitres par degré Plato (°P), unité permettant d'exprimer le pourcentage en masse d'extrait sec du moût avant fermentation.
* 237 La catégorie « autres alcools » ou « alcool éthylique » selon la directive 92/83/CEE comprend les produits alcooliques titrant à plus de 22 % ainsi que les eaux-de-vie.
* 238 Conformément à l'article 20 de la directive 92/83/CEE, l'accise est définie par référence au nombre d'hectolitres par alcool pur (hlap) pour les produits relevant de la catégorie fiscale de l'alcool éthylique
* 239 2508,98 / 100 = 25,09 €/l et 0,7 * 0,4 = 0,28 lap/bouteille ; 25,09*0,28 = 7,02 €.
* 240 Article L. 313-19 du CIBS et L. 245-9 du CSS.
* 241 Article 1613 bis du CGI.
* 242 Article 44 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
* 243 Circulaire du ministre chargé des comptes publics du 31 juillet 2025, n° BOD 7593, pp. 10-11.
* 244 Boissons répondant aux définitions prévues par le règlement n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991.
* 245 Article 15 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 246 Outre le taux, l'accise entraîne une charge administrative importante pour les viticulteurs.
* 247 Exposé des motifs de la proposition n° COM/2006/0486 final de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
* 248 1° du I de l'article 267 du CGI.
* 249 Baromètre Sowyne/Dynata, 2023, Les Français et leur budget d'achat vin, p. 4.
* 250 Atout France, 10 février 2025, L'oenotourisme en France en pleine croissance : 12 millions de visiteurs en 2023.
* 251 Vitisphère, 5 janvier 2007, OEnotourisme : une façon efficace de promouvoir le vin... à condition de ne pas le faire en dilettante. Article cité et reproduit par le rapport de Paul DUBRULE, « l'oenotourisme : une valorisation des produits et du patrimoine vitivinicoles », remis au ministre de l'agriculture le 18 avril 2007, pp. 56 et 73.
* 252 Paul Dubrule, rapport précité, p. 6.
* 253 Contribution écrite d'Atout France.
* 254 Au sens du règlement d'usage, une destination s'entend comme d'un territoire à vocation touristique et viticole d'un rayon de 30 kilomètres environ (2. 1 de l'annexe II du règlement).
* 255 Contribution écrite d'Atout France.
* 256 L'université du vin de Suze-la-Rousse (Drôme) propose ainsi une formation « Chargé de projets oenotouristiques », dispensée sur 75 jours. L'école du vin de Bordeaux propose elle de nombreuses formations à destination des acteurs du tourisme.
* 257 Les diplômes d'université (DU) sont des diplômes délivrés par les universités en leur nom propre, et qui ne relèvent pas du ministère de l'enseignement supérieur (article L. 613-2 du code de l'éducation). Ces formations sont souvent spécialisées, et leur volume horaire est inférieur à celui d'une licence ou d'un master. L'université de Reims propose un DU « Management de l'oenotourisme » tandis que l'université de Toulon propose un DU « OEnotourisme et produits du terroir durable ».
* 258 Vin & Société, juillet 2025, L'impact de l'oenotourisme en France.
* 259 Vin & Société, juillet 2025, L'impact de l'oenotourisme en France
* 260 Atout France, L'oenotourisme.
* 261 Voir supra pour une présentation de cette loi.
* 262 Contribution écrite du Conseil supérieur de l'oenotourisme.
* 263 Communiqué de presse commun du ministère chargé du tourisme, Atout France et ADN Tourisme, 21 janvier 2025, Une année 2024 record pour le tourisme français grâce à la croissance des recettes internationales et à la solidité du marché domestique qui dessine un horizon prometteur pour 2025.
* 264 Pôles d'excellence touristique, octobre 2015, 18 mesures en faveur du développement de l'oenotourisme et de sa promotion à l'international.
* 265 Le Figaro Vin, 17 février 2025, « Il nous faut être vigilants » : sur fond de craintes de guerre commerciale, le salon du vin Wine Paris a ouvert.
* 266 Respectivement intitulés : Libérer les énergies ; clarifier ; faciliter ; former ; innover ; célébrer ; financer et élargir.
* 267 Contribution écrite d'Atout France.
* 268 Article 3 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) nº 251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur viticole et pour les produits vinicoles aromatisés.
* 269 Contribution écrite du Conseil supérieur de l'oenotourisme.
* 270 Ibidem.
* 271 En ce sens, l'exemple de la route des vins de Provence peut être cité. Le site internet renvoie vers les sites internet des différents offices de tourisme situés sur la route, offices qui répertorient et valorisent tous les destinations Vignobles & Découvertes existantes.
* 272 La notion d'équipements collectifs est comprise au sens large. Elle comprend des structures d'hébergement (Rép. min. agri, n° 22 170 : JO Sénat, 7 oct. 2021, p. 5745).
* 273 Ces constructions peuvent être autorisées dès lors dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (1° du I de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme).
* 274 2° du I de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
* 275 V. pour les communes dépourvues de document d'urbanisme, art. L. 111-4, 1 à 2°bis, et, pour les communes dotées d'une carte communale, art. L. 161-4, I, 2° du code de l'urbanisme.
* 276 Article L. 151-13 du code de l'urbanisme.
* 277 Ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations. Article R. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 278 Article 5 de l'accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention collective du 2 avril 1974, attaché à la convention collective nationale de la production agricole et Cuma du 15 septembre 2020 étendu par arrêté du 2 décembre 2020 (NOR : AGRS2100383A).
* 279 Article L. 3132-13 du code du travail.
* 280 Article L. 3132-20 du code du travail.
* 281 Article L. 3132-24 du code du travail.
* 282 Article L. 3132-26 du code du travail.
* 283 En revanche, le viticulteur vendant du vin produit par un autre producteur devra disposer d'une licence adaptée. Il en va de même pour les négociants et vinificateurs qui vendent du vin issu de récoltes dont ils ne sont pas propriétaires.
* 284 Article L. 3336-5 du code de la santé publique (ex-article 502 du CGI).
* 285 Article L. 3331-1 du code de la santé publique. Selon l'article L. 3321-1, les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels ne titrant pas plus de 18 sont des boissons du troisième groupe, tandis que les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits relèvent du quatrième groupe
* 286 Amendements n° 1648, n° 1634, n° 1639, n° 1643 au projet de loi de simplification de la vie économique, déposés par Mme Marsaud et plusieurs de ses collègues.
* 287 Article L. 3334-1 du code de la santé publique.
* 288 Premier alinéa de l'article L. 33 342 du code de la santé publique.
* 289 Troisième alinéa du même article.
* 291 Selon le premier alinéa de l'article 63 du CGI : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires-exploitants eux-mêmes. »
* 292 Les bénéfices industriels et commerciaux sont définis par l'article 34 du code général des impôts.
* 293 Rappelons ici que les exploitations agricoles sont pour beaucoup constituées par des sociétés civiles imposées à l'impôt sur le revenu.
* 294 2 de l'article 206 du code général des impôts.
* 295 BOI-BA-CHAMP-10-40, § 150.
* 296 b du 4° de l'article 261 D du CGI et a de l'article 279 du CGI.
* 297 Article 1er, § 502, de la loi n° 205 du 27 décembre 2017. Libre traduction.
* 298 Selon la contribution écrite de l'Inrae, on use traditionnellement du terme de « cépage » pour désigner l'ensemble des variétés du genre Vitis vinifera, destinées à la production du vin (raisin à cuve). Le terme de « variété » peut être utilisé pour désigner les hybrides résistants issus des croisements de Vitis vinifera avec d'autres espèces, nord-américaines et asiatiques, du genre Vitis.
* 299 D'après la note technique nationale de 2025 rédigée par le comité de pilotage de l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants (OsCaR).
* 300 D'après la note technique nationale de 2025 rédigée par le comité de pilotage de l'OsCaR.
* 301 La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides prévoit que les États membres doivent adopter des plans d'action nationaux, concrétisés en France par le plan Écophyto II+.
* 302 Article R.831-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 303 Le projet VitAdapt a été mis en place, en 2009, dans l'objectif d'identifier les réactions de 52 cépages à différentes conditions de culture reproduisant les conséquences du changement climatique sur les sols, la résistance à certains pathogènes, l'irrigation et la température.
* 304 Le projet GreffAdapt a débuté en 2015 pour étudier, de façon similaire à VitAdapt, la réaction des variétés de porte-greffes afin d'identifier les variétés les plus intéressantes pour les proposer aux viticulteurs.
* 305 Le centre de ressources biologiques de la vigne de Vassal-Montpellier est un conservatoire des ressources génétiques de la vigne ouvert en 1949. Il dispose d'une collection scientifique de matériel viticole unique qui permet à ses chercheurs de documenter chaque variété recensée pour répondre aux demandes des scientifiques et des sélectionneurs.
* 306 Le programme ResDur (RESistance DURable) de l'Inrae a accompagné le développement de douze nouvelles variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium correspondant à des qualités organoleptiques recherchées : Artaban, Vidoc, Floreal et Voltis, inscrites au catalogue officiel en 2018 ; cinq nouvelles variétés résistantes : Coliris N, Lilaro N, Sirano N, Selenor B, Opalor B en 2022 ; et enfin trois nouvelles en 2024 : Calys N, Exelys B et Artys B. L'Inrae estimait le coût du programme à 411 000 euros par an en 2020.
* 307 La commercialisation est régie par les articles R. 661-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du 17 juin 2020 NOR AGRG2014549A, qui font transposition de la directive du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériaux de multiplication végétative de la vigne (68/193/CEE). Les conditions sanitaires de production sont quant à elles prévues par le règlement 2016/2037 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.
* 308 Dans le respect des objectifs fixés par la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968.
* 309 Article 2 de l' Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve.
* 310 Article 5, Ibid.
* 311 Article 1er de l'arrêté du 28 février 1990 NOR : AGRP9000416A.
* 312 Les normes « DHS » sont fixées par la directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne. Selon la contribution écrite de l'Inrae, les demandes d'examen sont à déposer devant le Geves, les examens sont réalisés par l'Inrae et nécessitent une période d'observation minimale de 3 ans.
* 313 Article R.661-33 du code rural et de la pêche maritime.
* 314 Article D.665-14 du code rural et de la pêche maritime.
* 315 Article R.661-25 du code rural et de la pêche maritime.
* 316 En conformité avec les articles 1er et 2d du règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
* 317 Document officiel utilisé pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union (y compris pour une circulation à l'intérieur de chaque État membre), et attestant que ceux-ci respectent les dispositions règlementaires européennes relatives à la santé des végétaux issus du règlement n° 2016/2031/UE et du règlement d'exécution N° 2017/2313/UE.
* 318 Article R. 251-16 du code rural et de la pêche maritime : « En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25 ».
* 319 Article 3 de l' Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve.
* 320 Article D.665-16-2 du code rural et de la pêche maritime.
* 321 NOR : AGRS1719528D.
* 322 Contribution écrite du Masa.
* 323 Hernan Ojeda et Nicolas Saurin, L'irrigation de précision de la vigne : méthodes, outils et stratégies pour maximiser la qualité et les rendements de la vendange en économisant de l'eau, Innovations Agronomiques, Inrae, 2014.
* 324 Léonie Cambrea, Christophe Lafon et Laurent Mayoux, En direct des territoires - L'irrigation de la vigne en ex-Languedoc-Roussillon : un potentiel de production maintenu par les économies d'eau, Sciences Eaux & Territoires, Inrae, 2020.
* 325 Selon la contribution écrite de l'IFV, le prélèvement d'eau en cave est principalement dû au nettoyage du matériel et est sujet à forte variabilité (entre 1L et 10L d'eau par litre de vin). S'agissant de l'irrigation, le prélèvement d'eau à la vigne varie autour de 600 m3/ha/an (ou 60 mm/ha/an).
* 326 Contribution écrite du Masa et le rapport de l'Inrae accessible sur le lien suivant : L'évolution de l'irrigation en France.
* 327 Le régime des Sdage est codifié aux articles L.212-1 à L.212-2-3 du code de l'environnement. Les Sdage sont des documents de planification de l'eau dans les 6 bassins hydrographiques français. Ils permettent d'identifier les territoires nécessitant des actions de gestion structurelle de l'eau pour prévenir ou réduire les épisodes de sécheresse. Pour exemple, au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a la particularité d'être située sur trois bassins hydrographiques (Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne, Seine-Normandie), sont identifiés 20 territoires328 comme étant en déséquilibres quantitatifs.
* 329 Article 5,6, 73,74 et 105 du Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
* 330 Fixés dans la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
* 331 Les interventions en faveur de l'irrigation dans le secteur du vin sont prévues au Chapitre 3, section 4, article 58, §1, m), i) du règlement (UE) 2021/2115.
* 332 Contribution écrite du Masa.
* 333 Projet annuel de performance 2026 - 149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
* 334 Contribution écrite du Masa.
* 335 Article L.213-9-2 du code l'environnement.
* 336 Contribution écrite de la Cnaoc.
* 337 Contribution écrite du Masa.
* 338 Les Aires Agricoles de Résilience Climatique (AARC) en Occitanie | DRAAF Occitanie.
* 339 Contribution écrite du Masa.
* 340 Décret n° 2023-735 NOR : AGRT2318049D du 8 août 2023 relatif à l'irrigation des vignes, consécutif des travaux du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique.
* 341 Contribution écrite du Masa.
* 342 Réutiliser les eaux usées pour irriguer la vigne | Inrae.
* 343 Selon la contribution écrite de l'Inrae, cette pratique est très développée en Israël (90 % des eaux traitées sont réutilisées et 70 % de ces volumes servent à l'irrigation des cultures), aux États-Unis (surtout en Californie et Floride), en Australie (40 % d'eaux usées traitées réinjectées dans le réseau d'eau potable), et dans plusieurs pays européens, tels que l'Italie et l'Espagne (où respectivement 8 % et 14 % des eaux usées traitées sont réutilisées).
* 344 Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al.. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des oenologues et des techniques viticoles et oenologiques, 2021, 178, pp.24-26. ?hal-03 130 035?.
* 345 Article 58, m), v) du règlement 2021/2115.
* 346 58.01 du PSN - 2023-2027.
* 347 Selon le Masa : « L'agroforesterie est l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle. (...) En principe, l'arbre, par son système racinaire, crée des conditions dans les couches profondes du sol qui favorisent l'alimentation en eau et en minéraux des cultures de surface. Les techniques agroforestières permettent de disposer les arbres afin que ceux-ci favorisent au maximum les cultures et rentrent le moins possible en compétition avec elles. »
* 348 Lien vers l'étude de l'IFV.
* 349 « Les viticulteurs peuvent maintenant utiliser des filets anti-grêle - La Revue du vin de France ».
* 350 Sgubin G., Swingedouw D., Dayon G., García de Cortázar-Atauri I., Ollat N., Pagé C., Van Leeuwen C., 2018. The risk of tardive frost damage in French vineyards in a changing climate.
* 351 Selon l'IFV, la vigne est sensible au gel dès l'apparition des jeunes feuilles en raison de leur composition en eau. Lors d'un épisode de gel, ces feuilles brunissent et se dessèchent.
* 352 Vigne, vin et changement climatique.
* 353 Ibid ; Sgubin G., et al. (2018).
* 354 Indemnisations pour un total de 100 M€ pour les finances publiques, auxquelles il convient d'ajouter les prises en charge de cotisations sociales, pour un montant de 90 M€.
* 355« La grêle et le gel de printemps : comment s'en protéger ? n°27 - Institut Français de la Vigne et du Vin ».
* 356 D'après N. Ollet et J-M. Touzard « Vigne, vin et changement climatique » dans les zones les plus gélives, une taille tardive permet de retarder le débourrement et donc la fenêtre de risque, elle a, en revanche, des conséquences importantes sur le rendement.
* 357 IFV, Ibid. Les chiffres sont à mettre en considération avec la hausse des prix consécutives à l'accélération de l'inflation depuis 2019.
* 358 Il est à noter que les tours antigel fixes génèrent une nuisance sonore de 70 à 100 dB à 300 m.
* 359 Calculs réalisés une base de rendement de 50 hl/ha.
* 360 Pour trois nuits avec une base de 4 heures d'allumage par nuit.
* 361 Article 73 du règlement 2021/2115.
* 362 73.01 du PSN - 2023-2027.
* 363 Paiements pour services environnementaux publics | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique.
* 364 Article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime.
* 365 Prévues dans le règlement (UE) n° 1305/2013 aux articles 31 et 32.
* 366 Épices, ADE, 2017, Évaluation ex post du programme de développement rural hexagonal (PDRH). Programmation Feader 2007/2013, rapport pour le MAA, cofinancé par le Feader, Paris.
* 367 Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées. NOR : AGRT2305083A.
* 368 Moyenne du rendement sur les 5 dernières années en excluant le meilleur et le moins bon rendement de cette moyenne. L'exploitant peut en outre recouvrir alternativement à la moyenne triennale si celle-ci lui est plus favorable.
* 369 Un greffon est une partie vivante d'un végétal insérée dans un autre végétal, appelé porte-greffe, visant à associer les caractéristiques des deux plantes améliorant la résistance aux maladies et la productivité des plants.
* 370 Gilbert Garrier, « Le Phylloxéra. Une guerre de trente ans (1870-1900) », Éd. Albin Michel, Paris, 1989.
* 371 Roger Pouget, « Histoire de la lutte contre le phylloxéra de la vigne en France : 1868-1895 », Paris, Institut National de la Recherche Agronomque, 1990.
* 372 Les vignes mères sont cultivées pour produire les futures boutures de porte-greffes et des greffons.
* 373 La pépinière viticole française consolide ses positions à l'export.
* 374 « En quoi consiste la prémultiplication ? - Institut Français de la Vigne et du Vin ».
* 375 La liste des espèces de plantes cultivées est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 661-4 du code rural et de la pêche maritime.
* 376 La prégermination est un traitement appliqué aux graines avant de les mettre en terre pour accélérer leur germination et favoriser la croissance du futur plant.
* 377 Le forçage est une technique utilisée pour faire pousser des raisins en dehors de leur saison normale de croissance. Elle permet de décaler la période de floraison et ainsi de réduire l'impact du changement climatique sur la production.
* 378 Par exemple l'arrêté préfectoral des Pyrénées-Orientales n° DDTM/SER/2025 du 6 août 2025.
* 379 Les sondes tensiométriques sont des capteurs conçus pour mesurer la disponibilité en eau du sol. Elles permettent de piloter l'irrigation de façon à économiser l'eau.
* 380 Rapport : Partie I, III, B., Des aléas sanitaires aggravés par le changement climatique et la déprise agricole.
* 381 Dans sa contribution écrite, l'Inrae identifie cette limitation des clones et des pieds de vigne comme un frein au déploiement des nouvelles variétés de cépages et de vignes résistants.
* 382 En outre, 43 % des vignes avaient moins de 10 ans, 38 % entre 10 et 24 ans, et 19 % plus de 24 ans. Source : Chiffres clés filière bois et plants de vigne | FranceAgriMer.
* 383 Décision INTV-GECRI-2025-34 et INTV-GECRI-2025-46 du directeur de FAM, Aide à l'arrachage des vignes mères de porte-greffes.
* 384 Les biocarburants et biocombustibles couvrent l'ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Biocarburants | Ministères de l'aménagement du territoire et de la transition écologique.
* 385 Selon l'IFV, les marcs de raisin correspondent aux résidus de pressurage des raisins frais.
* 386 Selon l'IFV, les lies de vin correspondent soit aux résidus déposés dans les récipients de stockage du vin, soit à ceux issus de la filtration du vin.
* 387 Annexe VIII, D, § 1 du règlement OCM.
* 388 Selon l'IFV, la distillation des sous-produits du vin contribue à protéger l'environnement en empêchant la libération dans la nature des éléments polluants issus des traitements phytosanitaires et surtout de leur très forte teneur en alcool.
* 389 Contribution écrite de la FNDCV.
* 390 Son budget annuel se composait de 40 M€ de l'enveloppe du PNA 2019-2023 et de 35 M€ par an issue du PSN.
* 391 Contribution écrite de FranceAgriMer.
* 392 Règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur viticole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission lien.
* 393 Distillation de crise 2023 | FranceAgriMer.
* 394 Décision FranceAgriMer INTV-GPASV 2023-75 du 29 novembre : info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-53d11dad-0cf3-4196-8403-1e7cb8c1f4a5
* 395 Source : FranceAgriMer.
* 396 Biocarburants | Chiffres clés des énergies renouvelables 2024.
* 397 Contribution écrite de la FNDCV et UNDV.
* 398 d) & k) ; Partie A ; Annexe IX ; D ; Directive (RED III) n° 2018/2001 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 399 Article premier de la directive 2020/262/CE du Conseil établissant le régime général d'accise.
* 400 Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.
* 401 Consultation sur le projet de mécanisme incitant à la réduction de l'intensité carbone des carburants (IRICC) | Consultations publiques.