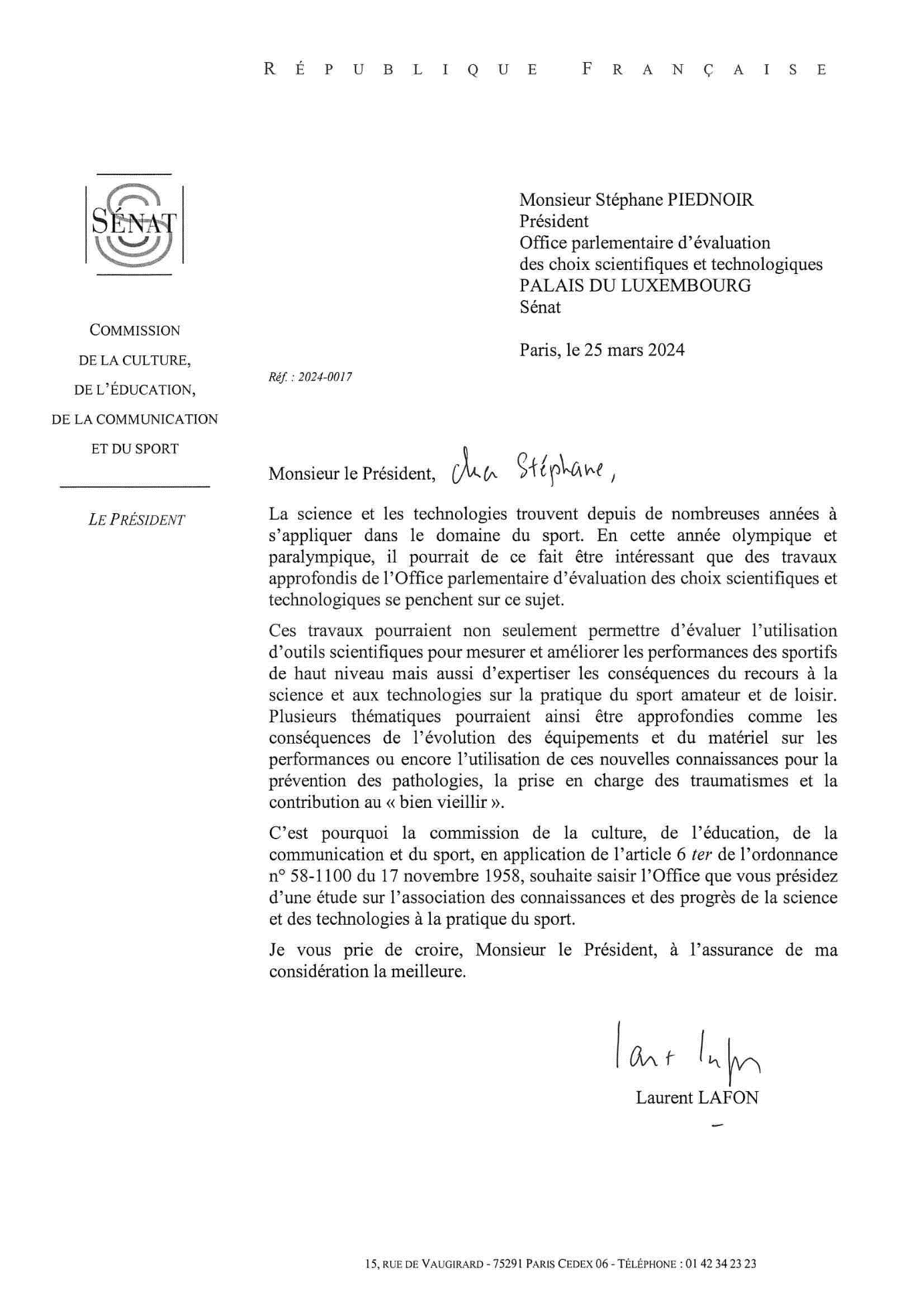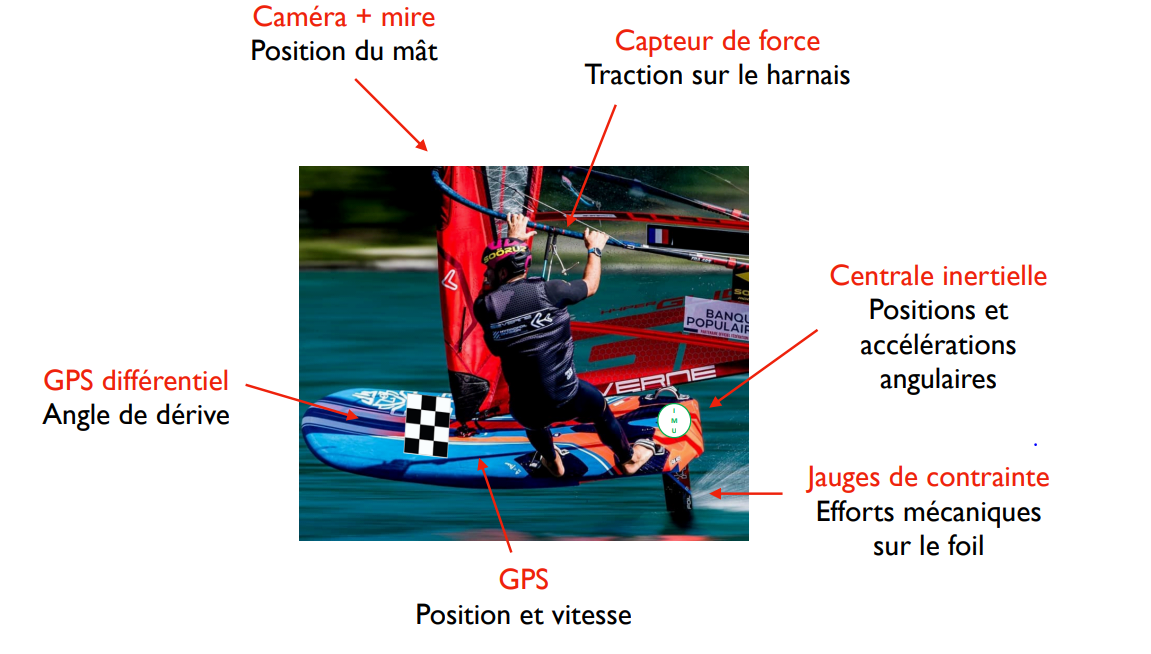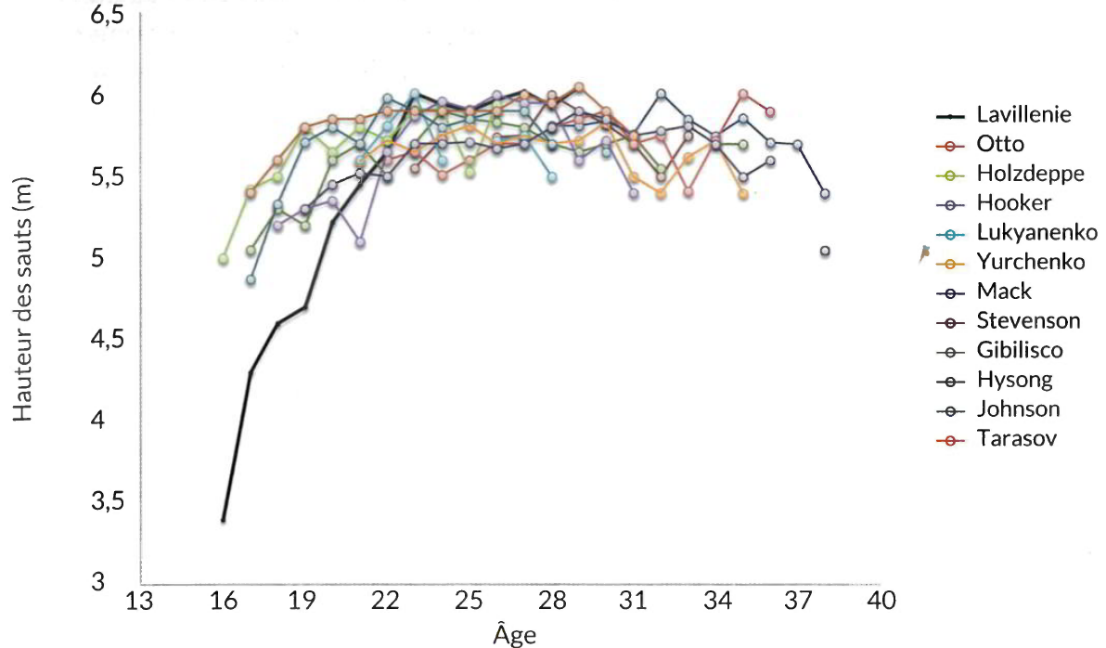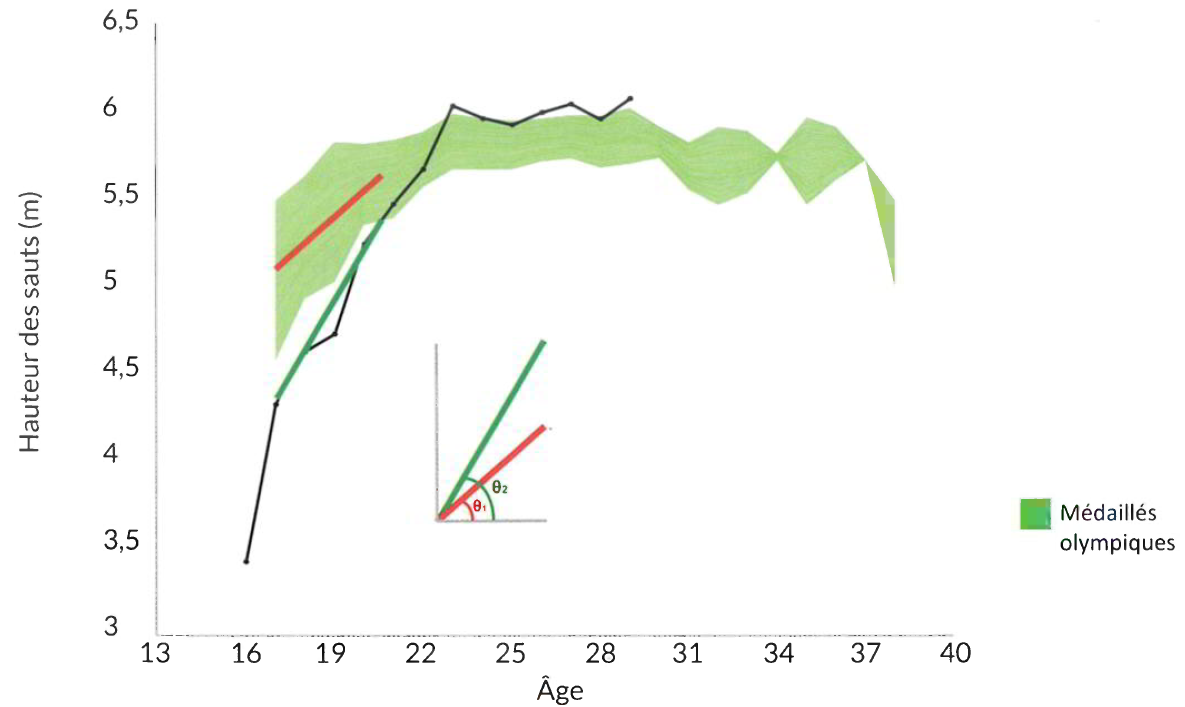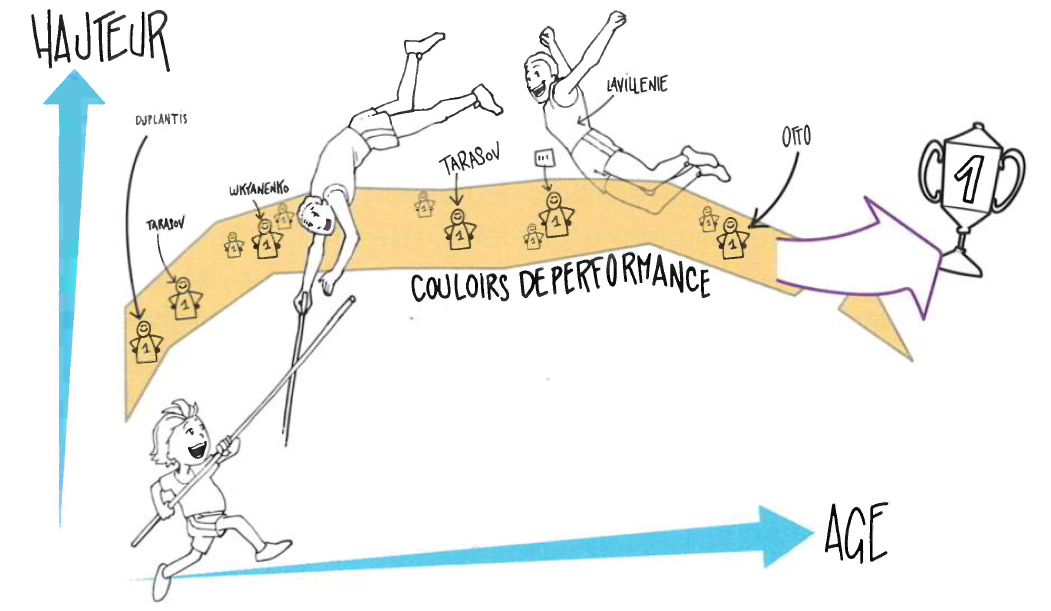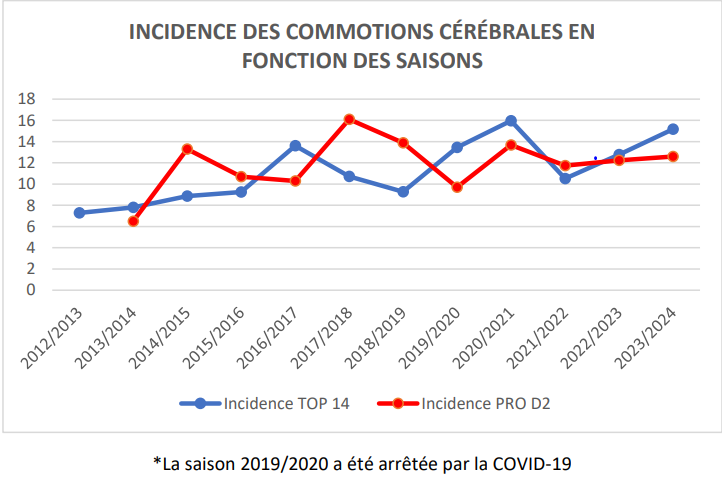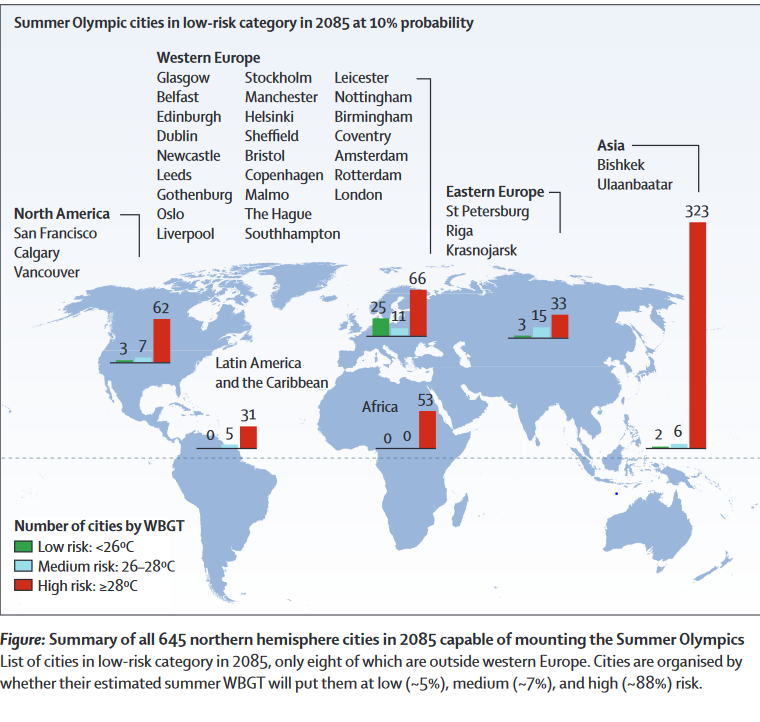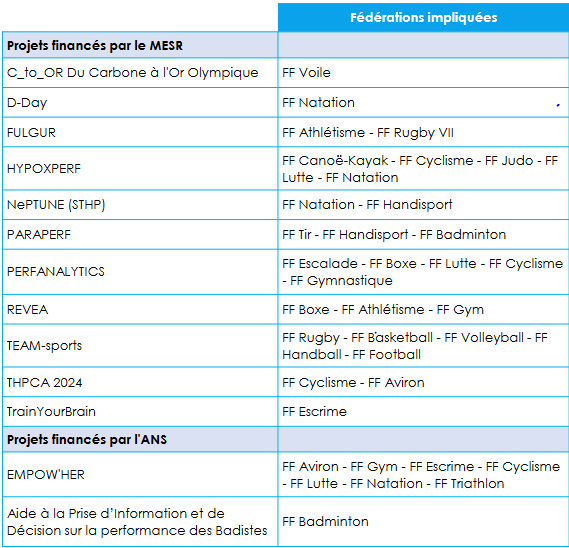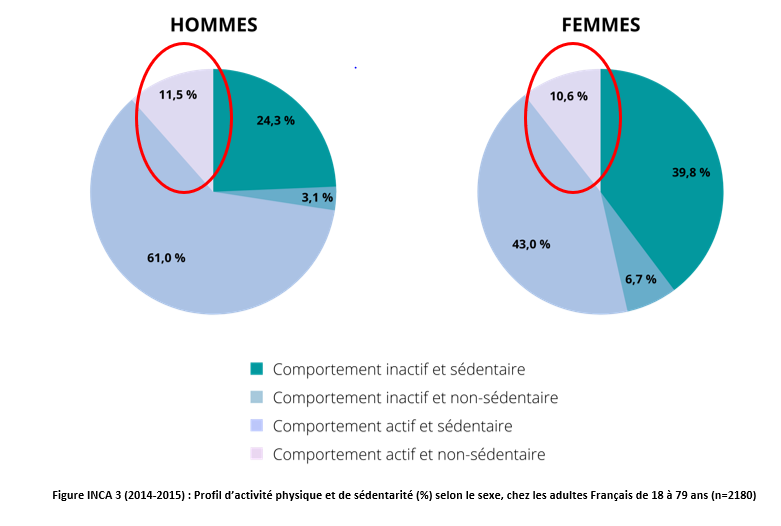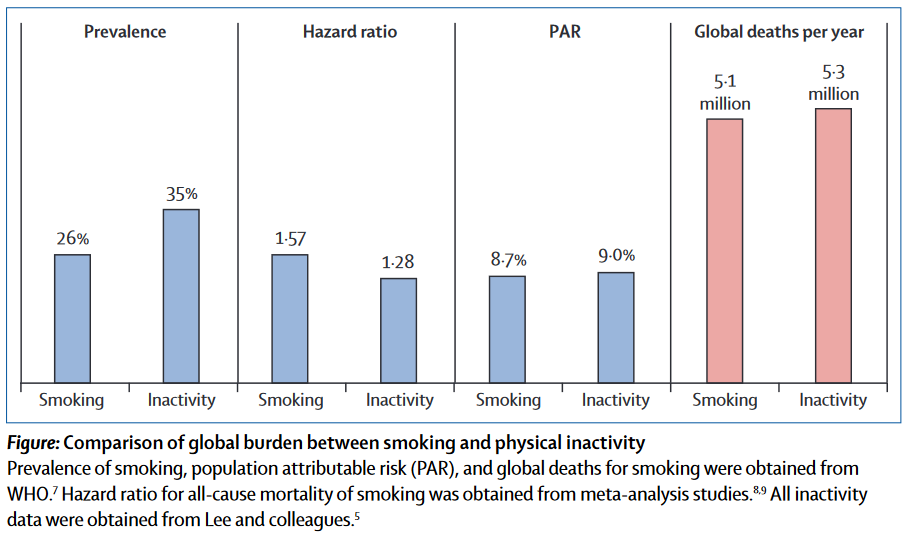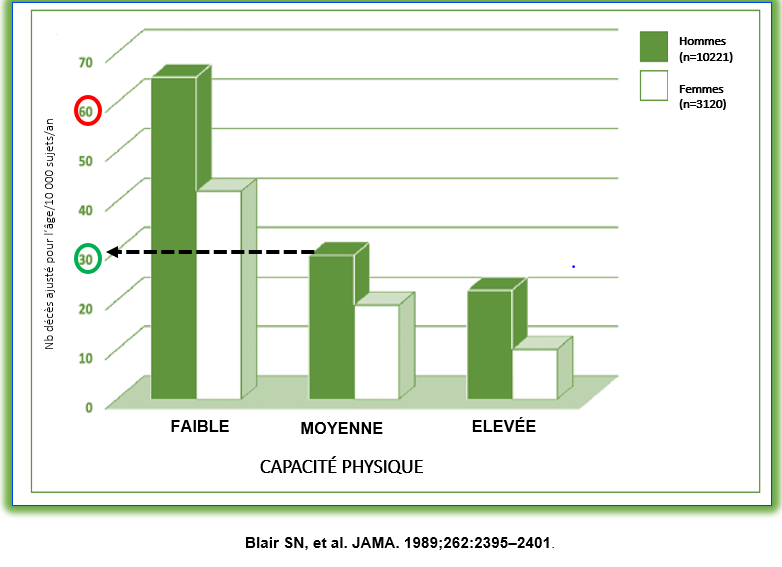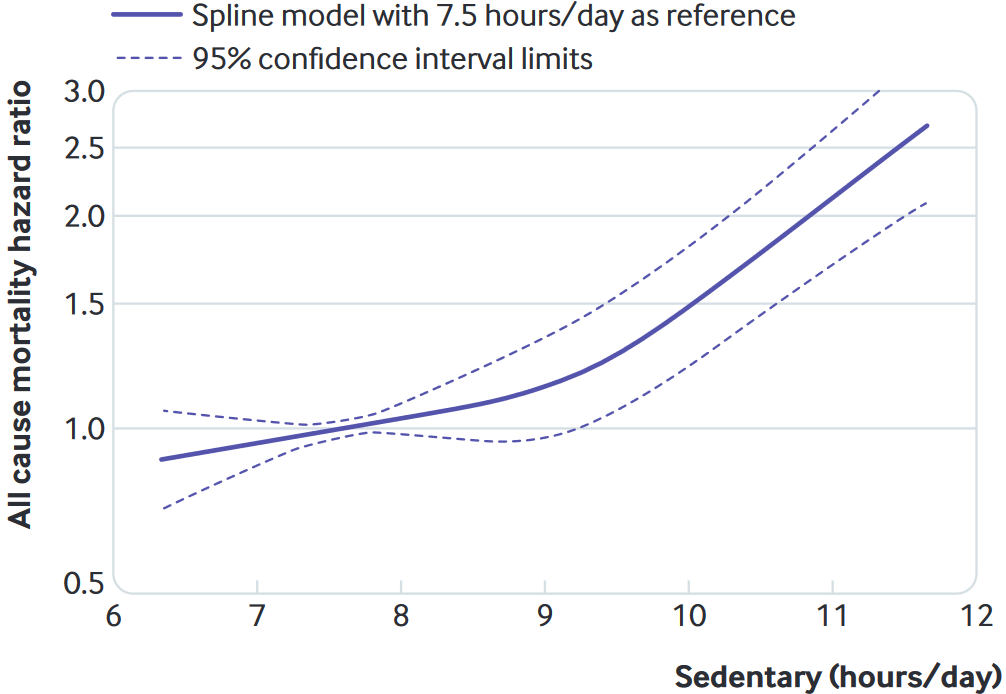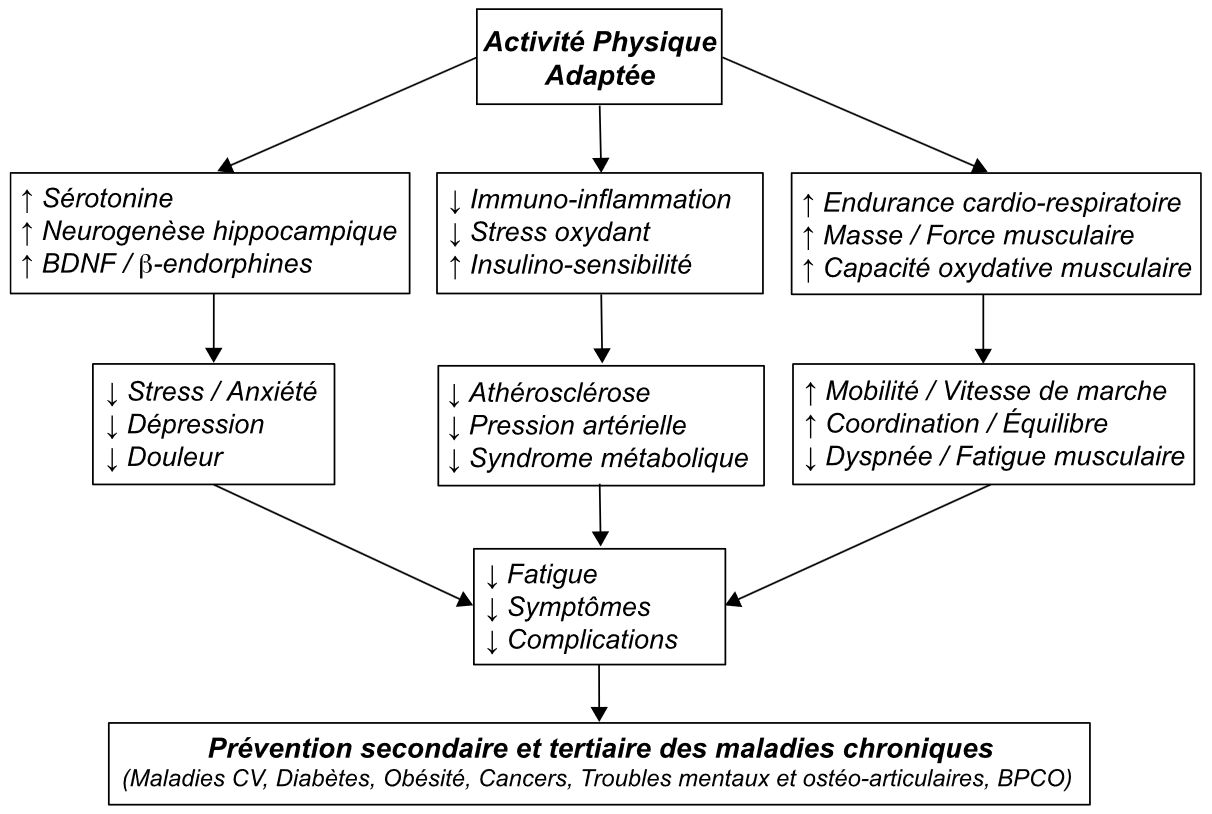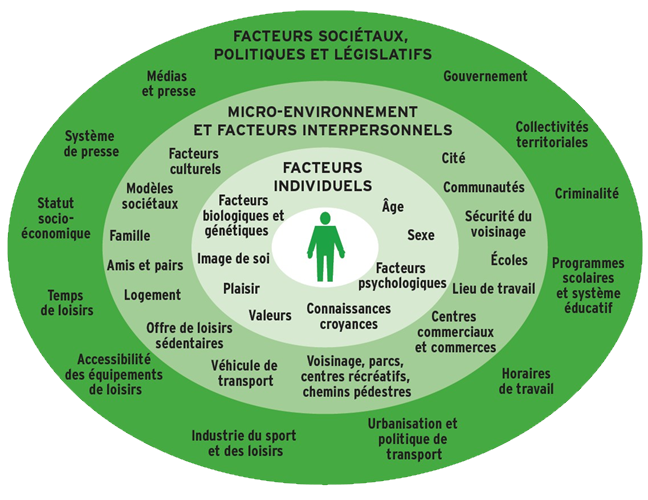- LETTRE DE SAISINE DE L'OFFICE PAR LA COMMISSION DE
LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT DU
SÉNAT
- LISTE DES RECOMMANDATIONS DE L'OFFICE
- AVANT-PROPOS
- REMERCIEMENTS
- I. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES ONT UN IMPACT
CONSIDÉRABLE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU, MÊME SI LEUR UTILISATION N'EST PAS EXEMPTE D'EFFETS
NÉFASTES
- A. LE RÔLE MAJEUR DE LA SCIENCE ET DES
TECHNOLOGIES DANS L'AMÉLIORATION DES MATÉRIAUX ET DES
ÉQUIPEMENTS
- B. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA
DÉTECTION DES HAUTS POTENTIELS
- C. LE POIDS DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DANS
LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES
- 1. L'apport de la science à la
préparation des athlètes
- 2. Une préparation physique qui ne laisse
rien au hasard
- 3. La gestion de la fatigue
- 4. La prévention des blessures
- 5. Le rôle croissant de la
préparation mentale
- 6. La préparation technique et
tactique
- 7. L'attention accrue portée par la
recherche à la santé mentale des sportifs de haut niveau
- 1. L'apport de la science à la
préparation des athlètes
- D. LES EFFETS NÉFASTES DE LA
« TECHNOLOGISATION » DES PERFORMANCES DANS LE
SPORT
- 1. Le renforcement des
inégalités
- 2. Une surveillance des athlètes et une
pression psychologique accrue
- 3. La technologisation de la performance au
détriment de la santé des athlètes ?
- 4. Les dérives vers le dopage et l'homme
augmenté
- 5. Le développement de pratiques
pseudo-scientifiques
- 6. Une trop grande importance accordée aux
données
- 1. Le renforcement des
inégalités
- A. LE RÔLE MAJEUR DE LA SCIENCE ET DES
TECHNOLOGIES DANS L'AMÉLIORATION DES MATÉRIAUX ET DES
ÉQUIPEMENTS
- II. POUR PRÉPARER LES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024, LA FRANCE A ENGAGÉ UNE STRATÉGIE
D'OPTIMISATION SCIENTIFIQUE DE LA PERFORMANCE, MAIS ELLE DOIT ENCORE LEVER
CERTAINS OBSTACLES POUR QUE CETTE STRATÉGIE S'INSCRIVE DANS LA
DURÉE
- A. L'ORGANISATION DU SPORT DE HAUT NIVEAU EN
FRANCE : UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES MAIS ATTEINT SES
LIMITES
- B. LES EFFORTS DE STRUCTURATION ET DE FINANCEMENT
DE LA RECHERCHE POUR LE SPORT DE TRÈS HAUTE PERFORMANCE
- C. LA RÉORGANISATION DU SPORT DE HAUT
NIVEAU : LA CRÉATION DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT
- D. DES AVANCÉES TRÈS
SIGNIFICATIVES
- E. DES OBSTACLES PERSISTANTS
- A. L'ORGANISATION DU SPORT DE HAUT NIVEAU EN
FRANCE : UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES MAIS ATTEINT SES
LIMITES
- III. LES RECHERCHES ET LES INNOVATIONS AU SERVICE
DES PERFORMANCES DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ONT DES APPLICATIONS
DANS LES DOMAINES DE LA MÉDECINE, DE L'APPAREILLAGE ET DES
LOISIRS
- A. UN CONTINUUM ENTRE LA PERFORMANCE ET LA
MÉDECINE
- B. LES INTERACTIONS DANS LE DOMAINE DE
L'APPAREILLAGE
- C. LE TRANSFERT DES TECHNOLOGIES DU SPORT DE HAUT
NIVEAU VERS LE SPORT DE LOISIR
- A. UN CONTINUUM ENTRE LA PERFORMANCE ET LA
MÉDECINE
- IV. EN DÉPIT DES BÉNÉFICES
RECONNUS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ HUMAINE, LA
CONDITION PHYSIQUE DE LA POPULATION CONTINUE DE SE DÉGRADER.
AU-DELÀ DES RECHERCHES DÉJÀ ENGAGÉES, UN EFFORT
PARTICULIER DOIT ÊTRE MENÉ POUR IDENTIFIER LES OBSTACLES À
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET METTRE EN PLACE DES INTERVENTIONS EFFICACES ET
DURABLES
- A. LES IMPACTS DE L'INACTIVITÉ PHYSIQUE ET
DE LA SÉDENTARITÉ
- B. UN CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR LES BIENFAITS DE
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
- 1. Le rôle de l'activité physique
dans la santé physique
- 2. L'activité physique, facteur
d'amélioration de la santé cognitive et mentale
- 3. L'activité physique comme promoteur d'un
vieillissement en bonne santé
- 4. Le rôle à la fois préventif
et curatif de l'activité physique pour de nombreuses maladies non
transmissibles
- 1. Le rôle de l'activité physique
dans la santé physique
- C. LA DÉGRADATION DE LA CONDITION PHYSIQUE
DE LA POPULATION
- D. LE RELATIF ÉCHEC DES POLITIQUES
PUBLIQUES EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LA
SÉDENTARITÉ
- E. LES PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR INCITER
À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
- 1. L'analyse scientifique des freins et des
leviers à l'activité physique
- 2. Le concept de littératie physique pour
expliquer, promouvoir et éduquer à l'activité
physique
- 3. Des recherches visant une personnalisation et
une optimisation des préconisations en matière d'activité
physique
- 4. Le rôle des sciences de
l'implémentation pour assurer le succès des interventions en
matière d'activité physique
- 5. Les innovations technologiques au
bénéfice de l'activité sportive et physique de
demain
- 1. L'analyse scientifique des freins et des
leviers à l'activité physique
- A. LES IMPACTS DE L'INACTIVITÉ PHYSIQUE ET
DE LA SÉDENTARITÉ
- V. LES DIX RECOMMANDATIONS DE L'OFFICE
- A. METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
ET DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE
- 1. Sanctuariser et élargir les programmes
de recherche en lien avec le sport de très haut niveau (notamment sur
les spécificités féminines), tout en associant davantage
les fédérations
- 2. Renforcer l'expertise des
fédérations et les moyens de l'Insep et de l'Agence nationale du
sport
- 3. Charger l'Agence nationale du sport de
représenter l'ensemble des fédérations et des clubs
sportifs dans les relations avec les fournisseurs de données afin de
peser dans les négociations sur les aspects techniques et de
souveraineté des données relatives aux sportifs
français
- 4. Veiller à ce que l'esprit de la loi
Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine soit
respecté
- 5. Faire de la prévention des commotions
cérébrales et du coup de chaleur d'exercice des priorités
de santé publique, notamment dans les compétitions extrêmes
et pour les jeunes publics
- 6. Réglementer la préparation
mentale dans le sport et rationaliser les diplômes des
préparateurs physiques
- 1. Sanctuariser et élargir les programmes
de recherche en lien avec le sport de très haut niveau (notamment sur
les spécificités féminines), tout en associant davantage
les fédérations
- B. FAIRE DE LA FRANCE UNE NATION ACTIVE ET
SPORTIVE
- 7. Actualiser régulièrement les
données sur la sédentarité, l'activité physique,
les temps passés devant les écrans et la condition physique des
Français
- 8. Faire de la prescription de l'activité
physique adaptée un axe majeur du traitement non médicamenteux
des maladies chroniques et des troubles de santé mentale
- 9. Promouvoir les recherches sur la
réduction de la sédentarité et l'encouragement à
l'activité physique ainsi que sur la motivation et l'observance à
long terme des pratiques physiques
- 10. Redonner sens à l'activité
physique au quotidien à tout âge : de l'école
maternelle jusqu'aux structures médicalisées
- 7. Actualiser régulièrement les
données sur la sédentarité, l'activité physique,
les temps passés devant les écrans et la condition physique des
Français
- A. METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
ET DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE
- I. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES ONT UN IMPACT
CONSIDÉRABLE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU, MÊME SI LEUR UTILISATION N'EST PAS EXEMPTE D'EFFETS
NÉFASTES
- EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
|
N° 2074 |
N° 121 |
||||
|
ASSEMBLÉE NATIONALE |
SÉNAT |
||||
|
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
SESSION ORDINAIRE 2025 - 2026 |
||||
|
Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale |
Enregistré à la présidence du Sénat |
||||
|
le 13 novembre 2025 |
le 13 novembre 2025 |
||||
|
RAPPORT au nom de L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION sur La science dans la mêlée pour une nation sportive par M. David ROS, sénateur |
|||||
|
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale par M. Pierre HENRIET, Premier vice-président de l'Office |
Déposé sur le Bureau du Sénat par M. Stéphane PIEDNOIR, Président de l'Office |
||||
|
Composition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Président M. Stéphane PIEDNOIR, sénateur Premier vice-président M. Pierre HENRIET, député Vice-présidents |
|||||
|
M. Jean-Luc FUGIT, député M. Gérard LESEUL, député M. Alexandre SABATOU, député |
Mme Florence LASSARADE, sénatrice Mme Anne-Catherine LOISIER, sénatrice M. David ROS, sénateur |
||||
|
DÉPUTÉS |
SÉNATEURS |
||||
|
M. Alexandre ALLEGRET-PILOT M. Maxime AMBLARD M. Philippe BOLO M. Éric BOTHOREL M. Joël BRUNEAU M. François-Xavier CECCOLI Mme Olga GIVERNET M. Maxime LAISNEY Mme Mereana REID ARBELOT M. Arnaud SAINT-MARTIN M. Emeric SALMON M. Jean-Philippe TANGUY Mme Mélanie THOMIN Mme Dominique VOYNET |
M. Arnaud BAZIN Mme Martine BERTHET Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP M. Patrick CHAIZE M. André GUIOL M. Ludovic HAYE M. Olivier HENNO Mme Sonia de LA PROVÔTÉ M. Pierre MÉDEVIELLE Mme Corinne NARASSIGUIN M. Pierre OUZOULIAS M. Daniel SALMON M. Bruno SIDO M. Michaël WEBER |
||||
LETTRE DE SAISINE DE L'OFFICE PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT DU SÉNAT
LISTE DES RECOMMANDATIONS DE L'OFFICE
AXE 1 : METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE
|
Recommandation n° 1 : |
Sanctuariser et élargir les programmes de recherche en lien avec le sport de très haut niveau (notamment sur les spécificités féminines), tout en associant davantage les fédérations |
|
Recommandation n° 2 : |
Renforcer l'expertise des fédérations et les moyens de l'Insep et de l'Agence nationale du sport |
|
Recommandation n° 3 : |
Charger l'Agence nationale du sport de représenter l'ensemble des fédérations et des clubs sportifs dans les relations avec les fournisseurs de données afin de peser dans les négociations sur les aspects techniques et de souveraineté des données relatives aux sportifs français |
|
Recommandation n° 4 : |
Veiller à ce que l'esprit de la loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine soit respecté |
|
Recommandation n° 5 : |
Faire de la prévention des commotions cérébrales et du coup de chaleur d'exercice des priorités de santé publique, notamment dans les compétitions extrêmes et pour les jeunes publics |
|
Recommandation n° 6 : |
Réglementer la préparation mentale dans le sport et rationaliser les diplômes des préparateurs physiques |
AXE 2 : FAIRE DE LA FRANCE UNE NATION ACTIVE ET SPORTIVE
|
Recommandation n° 7 : |
Actualiser régulièrement les données sur la sédentarité, l'activité physique, les temps passés devant les écrans et la condition physique des Français |
|
Recommandation n° 8 : |
Faire de la prescription de l'activité physique adaptée un axe majeur du traitement non médicamenteux des maladies chroniques et des troubles de santé mentale |
|
Recommandation n° 9 : |
Promouvoir les recherches sur la réduction de la sédentarité et l'encouragement à l'activité physique ainsi que sur la motivation et l'observance à long terme des pratiques physiques |
|
Recommandation n° 10 : |
Redonner sens à l'activité physique au quotidien à tout âge : de l'école maternelle jusqu'aux structures médicalisées |
AVANT-PROPOS
Le sport est au coeur de nombreux enjeux : des enjeux économiques, financiers, politiques, de puissance, mais aussi des enjeux humains et de santé publique.
Le sport est devenu un phénomène économique mondial. Des milliards de dollars sont investis chaque année dans les événements sportifs, les droits de diffusion, les parrainages et la commercialisation des produits dérivés. La mondialisation du sport a été un moteur majeur de sa transformation en élargissant son audience, en internationalisant ses compétitions et en stimulant sa croissance économique.
Sur le plan politique, le sport est utilisé comme un outil de diplomatie et d'influence par les gouvernements et les organisations internationales, comme en témoigne la concurrence féroce que se livrent la Chine et les États-Unis dans le décompte des médailles pour les Jeux ou encore l'exclusion par le Comité international olympique de la Russie et de la Biélorussie des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Dans ce contexte, la science et les technologies sont de plus en plus sollicitées pour accompagner et optimiser les performances des athlètes et avoir un impact sur les résultats des compétitions souvent très serrés1(*).
Les États-Unis ont été parmi les premiers à adopter dès les années 1960 des méthodes scientifiques pour l'entraînement sportif. En France, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) a été créé en 1975 pour former et préparer les athlètes de haut niveau en utilisant des méthodes scientifiques.
Certaines institutions sont considérées comme des modèles dans le recours à la science dans le domaine du sport. C'est le cas de l'Institut australien du sport fondé en 1981 ou encore de l'Institut du sport du Royaume-Uni (UK Sport) créé en 1997.
Alors que la France organisait les jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a saisi le 25 mars 2024 l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques afin « d'évaluer l'utilisation d'outils scientifiques pour mesurer et améliorer la performance des sportifs de haut niveau mais aussi d'expertiser les conséquences du recours à la science et aux technologies sur la pratique du sport amateur et de loisir ».
L'Office a nommé le 9 avril 2024 Jean-Luc Fugit, député du Rhône, et David Ros, sénateur de l'Essonne, rapporteurs de cette étude. La dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 a suspendu les travaux de l'Office. Lors de sa reconstitution en octobre 2024, il a nommé Stéphane Vojetta, député des Français établis hors de France, en remplacement de Jean-Luc Fugit.
Les deux rapporteurs ont organisé 50 auditions afin d'entendre des chercheurs, des responsables de l'Agence nationale du sport, de l'Insep, de fédérations sportives, des athlètes et des entreprises. Ils ont effectué huit déplacements qui ont permis de rencontrer 104 personnes dans des laboratoires de recherche, un Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps), des gymnases et des hôpitaux.
En raison de la déclaration d'inéligibilité de Stéphane Vojetta le 11 juillet 2025 par le Conseil constitutionnel, le sénateur David Ros est devenu l'unique rapporteur de cette étude qui reste néanmoins le fruit d'un travail collectif entre les deux parlementaires.
Quatre grandes séries d'observations résultent de l'ensemble de ces travaux :
- la science et les technologies ont un impact considérable sur les facteurs de performance des sportifs de haut niveau, même si leur utilisation n'est pas exempte d'effets néfastes (I) ;
- la stratégie engagée par la France dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris a eu pour objet d'encourager l'optimisation scientifique de la performance, mais certains obstacles doivent encore être levés pour que cette stratégie s'inscrive dans la durée (II) ;
- les recherches et les innovations au service des performances des sportifs de haut niveau ont des applications dans de nombreux domaines comme la médecine, l'appareillage et les loisirs (III) ;
- si les bénéfices de l'activité physique sur la santé humaine font l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique, la condition physique de la population continue de se dégrader. Un effort particulier doit donc être mené pour identifier les obstacles à l'activité physique et mettre en place des interventions efficaces et durables (IV).
À l'issue de cette étude, l'Office présente dix recommandations pour renforcer durablement l'accompagnement scientifique à la performance et à l'activité sportive et faire de la France une nation active et sportive.
REMERCIEMENTS
Cette étude est le fruit d'une immersion dans le monde du sport à la recherche de méthodes et de résultats scientifiques mais également dans le monde de la recherche au service du sport. Parmi les chercheurs rencontrés, nombreux sont ceux qui sont ou ont été des sportifs de haut niveau. Ils sont donc très sensibles aux enjeux et aux pressions auxquels sont confrontés les athlètes et s'engagent au quotidien auprès d'eux avec un objectif commun : améliorer les performances sportives des athlètes pour faire rayonner la France dans les compétitions.
Ce souci de faire gagner la France se retrouve dans les recherches menées en matière d'activité physique et de sédentarité. Certes, il ne s'agit plus de faire monter des sportifs sur les podiums, mais de permettre à la population française de gagner la bataille contre des modes de vie aux conséquences délétères pour sa santé.
Afin de réaliser cette étude, et au-delà de plus de cinquante heures d'auditions, de nombreux échanges ont été nécessaires avec les personnes entendues pour obtenir des précisions sur certains chiffres, expliciter certaines affirmations, approfondir certaines hypothèses.
Votre rapporteur tient à remercier toutes les personnes impliquées dans ce dialogue pour leur transparence, leur disponibilité et leur réactivité.
Il est particulièrement reconnaissant à l'égard de tous les chercheurs, responsables sportifs, médecins, agents de l'Insep et de l'Agence nationale du sport qui non seulement ont pris le temps de répondre à ses multiples sollicitations mais ont contribué à la structuration de cette étude sur un sujet particulièrement vaste et protéiforme.
Enfin, il remercie chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont pris le temps de relire ce rapport afin d'en garantir la pertinence scientifique.
I. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES ONT UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, MÊME SI LEUR UTILISATION N'EST PAS EXEMPTE D'EFFETS NÉFASTES
A. LE RÔLE MAJEUR DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DANS L'AMÉLIORATION DES MATÉRIAUX ET DES ÉQUIPEMENTS
1. Les matériaux et les équipements au coeur de la performance
Les matériaux et les équipements jouent un rôle crucial dans la performance des sportifs de haut niveau.
a) Des matériaux légers et résistants
La recherche de vitesse conduit à privilégier des matériaux légers et résistants pour permettre aux sportifs de se déplacer plus facilement et avec plus d'efficacité, tout en réduisant la fatigue.
C'est ainsi, par exemple, que les vélos du Tour de France sont passés en un siècle de modèles en acier pesant près de 15 kilogrammes à des modèles de 6,8 kilogrammes2(*) fabriqués avec du carbone, des alliages d'aluminium ou de nouveaux matériaux comme le titane. Le carbone, utilisé pour fabriquer les cadres, les fourches, les jantes et même certains composants comme les tiges de selle, offre des performances incomparables. Sa structure fibreuse permet une répartition précise de la matière, optimisant ainsi chaque gramme tout en garantissant une excellente résistance aux forces exercées sur le vélo. Pour fabriquer les composants critiques des vélos tels que les plateaux, les guidons ou les pédaliers, les constructeurs intègrent de plus en plus des alliages métalliques innovants. L'aluminium est l'un des plus répandus grâce à son excellent rapport poids/résistance, mais l'utilisation du titane s'accroît pour sa durabilité et sa légèreté exceptionnelle, notamment pour les axes de pédaliers3(*).
Un autre exemple est lié à l'apparition de nouvelles chaussures : intégrant une plaque de carbone dans la semelle intermédiaire et une mousse réactive, elles ont révolutionné les performances en course à pied. En effet, la plaque en carbone agit comme un ressort, aidant à propulser le coureur vers l'avant et réduisant l'énergie nécessaire pour maintenir une vitesse élevée. La semelle intermédiaire utilise une mousse très légère offrant un excellent retour d'énergie, aidant également le coureur à économiser de l'énergie. Certaines études ont montré que la Vaporfly de Nike pouvait améliorer l'efficacité de la course jusqu'à 4 % en moyenne à une vitesse de 18 km/h.
De même, le développement des lames de course en fibre de carbone utilisées par les athlètes amputés des membres inférieurs a eu un impact considérable sur l'amélioration de leurs performances en leur permettant de bouger avec plus de fluidité et de puissance.
b) Des équipements aéro- et hydrodynamiques
Une attention particulière est apportée à l'aérodynamisme et à l'hydrodynamisme des équipements afin de réduire la résistance de l'air ou de l'eau et augmenter la vitesse de déplacement.
C'est ainsi que l'utilisation des foils4(*) a bouleversé les courses nautiques, que ce soit dans les disciplines olympiques de voile5(*) comme dans les courses au large. En effet, les bateaux sont soutenus par la poussée d'Archimède, opposée au poids du volume d'eau déplacé par la coque. Ce phénomène a un inconvénient majeur : lorsque le bateau se déplace, il crée un système de vagues qui se propagent à la surface de l'eau. L'énergie cinétique contenue dans le sillage est perdue pour la propulsion, ralentissant ainsi le bateau. En ajoutant des surfaces portantes sous l'embarcation (les foils), la coque sort de l'eau à partir d'une certaine vitesse. La traînée de vagues et la traînée de friction en sont considérablement diminuées, autorisant des vitesses bien plus élevées6(*). Le Vendée Globe 2024 a, de nouveau, confirmé la supériorité des voiliers à foils. Ainsi, le premier bateau à dérives droites n'est arrivé qu'en 16e position, derrière 15 IMOCA7(*) à foils.
L'optimisation des combinaisons, notamment en cyclisme, permet de réduire les frictions aérodynamiques.
À une vitesse de 60 km/h, 90 à 95 % de la puissance fournie par le cycliste sert à lutter contre la friction aérodynamique. Le pourcentage restant se répartit entre les frictions des pneus et les frictions dans la transmission (chaîne/pignon/plateau).
Dans le cadre du projet Très haute performance en cyclisme et aviron (THPCA), l'institut aérotechnique rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, en collaboration avec le laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon, s'est interrogé sur la manière d'aider les cyclistes à minimiser les frictions à travers l'optimisation des combinaisons. Vingt-cinq types différents de textiles ont été fournis par l'équipementier Le Coq sportif pour être caractérisés en soufflerie, d'abord sur un cylindre, ensuite sur des mannequins aux mensurations des cyclistes. Des textiles spécifiques ont été choisis pour les bras, les jambes et le tronc. En effet, des bandes rugueuses sur les bras permettent de raccrocher le flux d'air à l'arrière des bras afin de minimiser les écarts de pression avant-arrière, responsables de la force de résistance de l'air. La réglementation de l'UCI (Union cycliste internationale) impose un millimètre d'épaisseur au maximum pour ces structures. Celles-ci ne sont pas nécessaires sur les jambes et le tronc en raison de leur plus grand diamètre, conduisant au choix d'un tissu lisse pour ces derniers. Ensuite, des prototypes sont réalisés et testés par les athlètes.
Le travail d'optimisation des combinaisons permet d'économiser entre une dizaine et une cinquantaine de watts, soit entre 1 et 5 % de la puissance produite par un cycliste au cours d'un sprint (environ 1 000 watts).
Les fauteuils roulants de course sont également conçus pour réduire la résistance au roulement. Ils sont allongés, près du sol et ne comportent que trois roues, deux à l'arrière et une à l'avant. Les roues sont grandes et fines, souvent en matériaux composites pour réduire le poids. Le siège est incliné en avant pour favoriser une position aérodynamique.
Les longueurs de châssis allant jusqu'à deux mètres sont utilisées pour maintenir la stabilité dans les virages. Le carrossage, quant à lui, augmente la distance entre les points de contact des deux grandes roues, ce qui contribue à améliorer la stabilité latérale du fauteuil de sport8(*).
Cette optimisation des fauteuils de course a permis d'augmenter de manière fulgurante les performances des athlètes. Entre 1984 et 2024, le record du 800 m fauteuil aux jeux Paralympiques est passé de 2 min 17 s 27 à 1 min 31 s 50, soit une diminution de plus de 30 %.
c) Des équipements plus sûrs
Une autre priorité des recherches sur les matériaux et les équipements porte sur leur rôle en matière de protection et de sécurité.
En gymnastique, les praticables de sol de compétition sont constitués d'un plancher dynamique avec des ressorts sur lesquels sont ajoutées une mousse de quatre centimètres et une moquette, ce qui donne une surface très dynamique mais également très confortable, limitant les risques de traumatisme.
La décision de la Fédération internationale de gymnastique de remplacer en 2001 le cheval de saut par la table de saut visait également à mieux protéger les athlètes. À cette date, 35 % de toutes les blessures enregistrées en gymnastique artistique se produisaient sur cet engin. En outre, l'introduction par certains athlètes des sauts arrière à partir de la rondade a entraîné des accidents malheureusement mortels. L'agrès a donc été complètement transformé. Il se présente en un corps de table légèrement courbé, monté sur un support long de 120 cm (contre 165 cm pour l'ancien cheval) et large de 95 cm (contre 55 cm précédemment). Sa surface large et plate réduit les risques de glissades et de chutes. En outre, les tables de saut sont conçues avec des matériaux qui absorbent mieux les chocs, réduisant ainsi l'impact sur les articulations des gymnastes. La surface stable et large des tables de saut permet aux gymnastes d'exécuter des sauts plus complexes et plus spectaculaires, améliorant ainsi leur performance globale tout autant que l'intérêt du public.
Le remplacement des pistes cendrées d'athlétisme par des pistes synthétiques à la fois souples et antidérapantes a eu un impact important sur les performances, mais également sur la prévention des blessures des athlètes.
Les terrains de football ou de rugby ont fait l'objet d'importantes innovations pour renforcer leur résistance et apporter plus de confort aux joueurs. Ainsi, la marque française Natural Grass a développé une technologie (AirFibr) qui consiste à faire pousser une pelouse 100 % naturelle sur un substrat composé de sable, de liège et de fibres synthétiques. La surface de jeu est homogène et reste plane et stable quelles que soient les conditions climatiques. Le terrain est, par ailleurs, résistant au cisaillement. Enfin, il optimise l'amortissement et la restitution d'énergie, permettant de générer de plus faibles charges articulaires au niveau des membres inférieurs que sur des surfaces comparables.
d) Des équipements conçus pour assurer un certain confort aux sportifs
La recherche et l'innovation sur les matériaux portent sur leur adaptation aux conditions climatiques et l'amélioration du confort des sportifs.
C'est le cas des vêtements thermorégulateurs qui aident à maintenir une température corporelle optimale ou encore des membranes imper-respirantes qui protègent de la pluie et favorisent l'évacuation de l'humidité : ces équipements ne vont pas mener un athlète à la victoire mais leur absence peut lui être préjudiciable.
Les chaussures jouent également un rôle majeur dans le confort des athlètes, notamment au rugby et ont un impact direct sur la performance. Elles offrent un soutien à la cheville pour éviter les entorses, ce qui est crucial dans un sport avec autant de contacts et de changements de direction rapides. L'amorti de la semelle permet de réduire l'impact sur les articulations lors des courses et des sauts. Des chaussures bien ajustées réduisent le risque d'ampoules et d'inconfort pendant le jeu, tandis que des matériaux légers et respirants permettent de garder les pieds au sec et à l'aise, ce qui est important dans le cadre de matchs longs et intenses. Elles doivent également être fabriquées avec des matériaux résistants pour supporter les rigueurs du jeu.
Les actions engagées par le club de rugby Racing 92 ont particulièrement attiré l'attention du rapporteur. Une première sélection est réalisée en testant l'ensemble des chaussures proposées aux joueurs sur un robot de l'Ensam9(*). Leur résistance à des comportements extrêmes est analysée et les modèles inadaptés sont éliminés.
Le Racing 92 a également développé un partenariat avec l'équipementier de semelles Sidas World Podiatech qui finance et met à disposition du club des matériaux qui ne sont pas encore sur le marché pour proposer de nouveaux choix de semelles. Les semelles sont d'abord testées sur le robot, pour en vérifier les paramètres mécaniques, puis elles sont proposées aux joueurs. Une étude clinique de six mois vérifie que les résultats sont concluants à partir de critères objectifs.
Par ailleurs, un podologue est employé par le Racing 92 pour optimiser le chaussage des joueurs. Selon le morphotype du joueur, la forme de son pied, sa posture, sa signature biomécanique, mais également en fonction de ses gestes, le podologue lui recommande un modèle de chaussure. Puis, en fonction de l'historique de pathologie du joueur, la chaussure sera légèrement déformée pour l'adapter au pied de ce dernier ; le contrefort peut même être refait et plusieurs jeux de semelles seront réalisés en fonction de la nature du terrain sur lequel évolue le joueur. Les joueurs amènent régulièrement leurs nouveaux modèles pour les faire adapter. Les chaussures peuvent être thermosoudées, chauffées, les pressions peuvent être adaptées.
Pour réaliser ses interventions auprès des joueurs, le podologue dispose d'un scan 3D avec une précision au dixième de millimètre de l'analyse morphologique du pied.
Il y a donc une approche très personnalisée du chaussage.
2. L'importance de la caractérisation des matériaux et du réglage des matériels
La compréhension des propriétés des matériaux (comme la résistance, le poids, la flexibilité, la durabilité) joue un rôle crucial dans l'amélioration de la performance des sportifs de haut niveau en permettant de développer des équipements plus efficaces, plus sûrs et mieux adaptés aux besoins spécifiques des athlètes, comme en témoignent les exemples suivants.
a) La caractérisation des revêtements des raquettes de tennis de table
Une raquette de tennis de table est constituée par un assemblage de bois, de mousse et d'élastomère. Actuellement, 1 647 raquettes différentes sont homologuées par la Fédération internationale de tennis de table qui impose deux contraintes : des revêtements uniformes et une épaisseur maximale de 4 mm de chaque côté de la raquette.
Les pongistes français, qui fabriquent souvent eux-mêmes leurs raquettes, ont exprimé le besoin d'un appui scientifique afin d'orienter leur choix parmi la multitude de revêtements disponibles pour leurs raquettes, un choix aujourd'hui empirique.
Dans ce but, une thèse10(*) a été financée par le groupement de recherche Sports et activités physiques afin d'identifier les caractéristiques pertinentes d'un revêtement et de comprendre comment elles influencent l'aptitude de la raquette à donner de la vitesse et de l'effet à la balle. Elle a abouti aux résultats suivants :
- plus la mousse est épaisse, plus la vitesse de rotation de la balle peut être élevée ;
- pour améliorer la performance de la raquette en termes de vitesse, il faut privilégier un matériau rigide ;
- pour améliorer la rotation, il faut un matériau plutôt souple, gardant une cohésion spatiale, avec un faible écrasement de la balle, donc une balle plutôt rigide.
b) La caractérisation et le réglage du matériel pour les épreuves d'IQfoil et de Kitefoil
Les épreuves d'IQfoil11(*) et de Kitefoil12(*) ont fait leur entrée dans la discipline voile pour la première fois aux jeux Olympiques de Paris. Dans le cas du IQfoil, le matériel est imposé et fourni par un seul constructeur. Dans le cas du Kitefoil, le matériel est également imposé, mais les athlètes ont le choix du constructeur. A priori, le matériel est très homogène. Pourtant, il existe de petites variations dans la fabrication et les sportifs sont capables d'analyser finement le comportement de leur embarcation et de distinguer le matériel le plus performant. Le projet de recherche « Du carbone à l'or »13(*) a analysé ces ressentis, donné aux sportifs plus d'éléments objectifs pour renforcer la finesse de leur analyse et les a aidés à atteindre une vitesse optimale à travers leurs réglages et leurs décisions sur l'eau.
La compréhension du fonctionnement du matériel et la recherche des optimums pour guider les sportifs dans le choix de leurs réglages se sont déroulées en plusieurs étapes.
La première phase a consisté à observer ce qui se passe pendant la navigation et à s'intéresser aux sensations et perceptions des athlètes dont les commentaires étaient enregistrés au fil de la navigation. Parallèlement, des mesures physiques étaient recueillies (vitesse, angle de gîte, etc.). Des séances « d'autoconfrontation augmentée » ont ensuite été réalisées pendant lesquelles les commentaires des athlètes sur les moments clés enregistrés au fil de la navigation étaient synchronisés avec des mesures physiques. L'objectif était de déterminer si les moments cruciaux perçus par les athlètes étaient associés à des paramètres physiques particuliers afin d'aider chaque athlète à choisir les matériels les plus appropriés et à retrouver plus rapidement en compétition des réglages et des techniques qui optimisent ses performances.
Le recueil en grande quantité de données pendant la navigation avec les athlètes a exigé le développement et l'intégration sur les planches d'IQfoil et de Kitefoil d'instrumentations spécifiques : des GPS différentiels extrêmement précis pour calculer les angles de la planche par rapport à sa position sur la Terre, des capteurs de force pour mesurer les forces exercées par l'athlète, des capteurs de force sur le foil, des centrales inertielles, des caméras, etc.
Mesures physiques : planches IQFOIL
Source : Du carbone à l'or
Les mesures effectuées en navigation ont dû être complétées par des mesures en soufflerie afin de quantifier certains paramètres impossibles à mesurer dans l'eau tels que la traînée aérodynamique de l'athlète et ses variations en fonction des positions des jambes et des bras et des modifications des tenues vestimentaires.
Enfin, une modélisation physique a été réalisée en retenant les forces essentielles : le poids, la traction exercée par la voile et les forces de portance générées par le foil immergé. L'objectif était, en utilisant les équations de la mécanique, de rechercher les valeurs des paramètres (angles de gîte, position du centre de gravité, poids de l'athlète...) qui maximisent la vitesse pour des conditions extérieures données (vitesse et direction du vent).
c) L'optimisation du fauteuil tennis en fonction des surfaces de jeu
À l'occasion des jeux Paralympiques de 2024, une thèse Cifre a été consacrée à l'optimisation du choix et des réglages des fauteuils utilisés sur la terre battue14(*).
Pour améliorer la mobilité des joueurs et réduire l'effort nécessaire pour se déplacer, l'interaction entre les pneumatiques et les roulettes avec la surface de jeu a été analysée. En effet, ce contact crée une résistance au roulement qui entraîne une perte d'énergie et peut diminuer la capacité de l'athlète à se déplacer. Selon une étude antérieure, la résistance au roulement sur la terre battue est 1,5 fois supérieure à celle des terrains durs.
Afin de trouver la meilleure combinaison de roues et de roulettes, plusieurs combinaisons ont été testées en utilisant des « chariots de décélération », conçus spécialement pour l'expérience. Ils ont permis d'analyser plusieurs paramètres des grandes roues (le carrossage, la pression et le type de pneumatique) et des roulettes (diamètre, dureté, matériau et profil). Grâce à des centrales inertielles fixées sur les chariots, leur vitesse linéaire ainsi que le taux de décélération ont été calculés. La multiplication de ce taux par la masse du système a permis de déterminer la force de résistance au mouvement. Une force plus faible indiquait une configuration plus performante, avec moins de résistance.
Les résultats ont montré que le type de pneumatique et sa pression sont des éléments essentiels pour choisir la meilleure configuration. Toutes choses égales par ailleurs (masse, carrossage, pneumatiques identiques), une pression optimale permet de réduire la résistance de 1,42 fois par rapport à une pression moins adaptée. Les caractéristiques des roulettes se sont également révélées importantes. Ainsi, l'utilisation de la roulette la plus performante permet de réduire les frottements de 1,8 fois par rapport à la roulette la moins performante.
3. Des équipements sur mesure pour les parasportifs
Plus le niveau d'exigence sportive est élevé, plus les athlètes ont tendance à privilégier un matériel personnalisé, qui répond à leurs spécificités et permet d'améliorer leur performance, qu'ils aient ou non un handicap.
Néanmoins, la conception d'équipements sur mesure pour les parasportifs dépasse la recherche de la seule performance. Elle vise l'adaptation desdits équipements aux besoins spécifiques des athlètes et permet de compenser leurs limitations physiques en fonction des disciplines. En outre, un équipement bien adapté est essentiel pour le confort et la sécurité des para-athlètes.
a) La nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des para-athlètes
Les équipements des parasportifs doivent souvent être réalisés sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque athlète, en tenant compte de leurs particularités physiques, de leur morphologie, de l'antécédent des blessures ainsi que des exigences de leur sport. Par exemple, il est nécessaire d'adapter l'ergonomie des poignées d'escrime à chaque athlète pour faciliter la prise de poignée, la stabilité et les appuis. De même, les palettes permettant aux escrimeurs de poser leurs pieds sont souvent réalisées sur mesure car les palettes standards ne sont pas adaptées.
Lorsque la discipline sportive implique l'utilisation d'un fauteuil, une multitude de paramètres vont être ajustés en fonction de la morphologie de l'athlète et de son positionnement dans le fauteuil : la largeur et la profondeur de l'assise, la hauteur du dossier, le carrossage (angle des roues par rapport à la verticale), la taille des roues, l'avancée de l'assise, etc.
La configuration optimale repose sur un compromis entre les capacités de l'athlète, les exigences de sa discipline et les contraintes relatives au matériel. Ainsi, les athlètes paraplégiques sans capacité abdominale vont privilégier une assise inclinée qui relèvera leurs genoux et leur offrira une meilleure stabilité. Toutefois, cette position entraîne une pression plus forte sur les ischio-fessiers et peut provoquer des escarres. Le réglage retenu devra donc trouver un équilibre entre l'amélioration des performances du sportif et la prévention des blessures.
Les évolutions proposées aux athlètes varient selon leur discipline. Pour les sports dynamiques, les fauteuils sont équipés de centrales inertielles permettant de quantifier le déplacement et la cinétique de propulsion sur des tests standardisés évaluant la capacité à sprinter ou la maniabilité.
Ces capteurs permettent d'enrichir l'analyse des performances et des capacités de l'athlète en mesurant la cadence de la propulsion, la vitesse et l'accélération. Ces tests en situation de pratique, avec les fauteuils utilisés en compétition, offrent la possibilité de mesurer les effets de nouveaux réglages ou d'un nouveau fauteuil afin de valider ou non les choix15(*).
La fabrication des prothèses en lame de carbone est également réalisée sur mesure. La conception de la lame est cruciale. Elle doit être adaptée au poids du sportif, à ses capacités physiques et aux spécificités de la discipline. Ainsi, les lames de carbone utilisées pour le sprint vont privilégier la rigidité et la restitution d'énergie pour optimiser la vitesse et la propulsion, alors que les lames de carbone de demi-fond sont conçues pour l'endurance et le confort et vont donc favoriser la souplesse et l'amorti. L'emboîture qui reçoit le moignon doit être parfaitement alignée et ajustée pour éviter les frottements et les blessures. Des essais et des réglages sont effectués avec les sportifs pour s'assurer que la lame est confortable et performante.
b) La spécialisation des fauteuils pour répondre aux contraintes des disciplines sportives
Aux jeux Paralympiques de Paris, 12 disciplines sur 22 exigeaient l'utilisation de fauteuils roulants manuels. Pour autant, les spécificités des disciplines conduisent à développer des fauteuils particuliers qui privilégient des qualités différentes.
Ainsi, les fauteuils pour les épreuves d'athlétisme vont rechercher une faible résistance au roulement (cf. supra) pour augmenter la vitesse de déplacement.
Pour les sports de précision (tir à l'arc, tir au fusil) comme pour les épreuves de lancer (poids ou disque) et d'escrime, la stabilité du fauteuil va être privilégiée. Dans ces disciplines, la stabilité est d'une telle importance qu'elle requiert une fixation au sol du fauteuil roulant.
En revanche, une bonne maniabilité sera recherchée pour le rugby fauteuil, le basket fauteuil et le tennis fauteuil. Les études biomécaniques et la perception des sportifs démontrent une corrélation entre l'angle de carrossage et la capacité à pivoter rapidement. L'évolution du matériel tend à favoriser des angles de carrossage de plus en plus importants. Il y a une trentaine d'années, l'angle de carrossage utilisé par les basketteurs ne dépassait pas 12°. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sportifs choisit des angles de carrossage compris entre 15° et 24°. La conséquence directe de ce réglage est une augmentation de la largeur du fauteuil.
B. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA DÉTECTION DES HAUTS POTENTIELS
1. Les effets indésirables d'une sélection reposant exclusivement sur l'âge chronologique
Une revue de littérature16(*) portant sur 189 études ayant concerné 61 344 athlètes de 35 disciplines différentes a montré que sur 38 383 sportifs juniors de haut niveau, 89,2% d'entre eux ne l'étaient plus dans la catégorie adultes de haut niveau.
Lors de son audition17(*), Julien Piscione, responsable du département Accompagnement à la performance à la Fédération française de rugby, a fait remarquer que seuls 29 % des joueurs actuels en équipe de France avaient suivi le parcours classique dans les académies de rugby à partir de 15 ans.
· L'âge relatif
L'âge relatif fait référence au mois de naissance pour des individus d'un même groupe d'âge. Un enfant né en janvier a presque un an de plus qu'un enfant né en décembre de la même année. L'un des biais de sélection consiste à se focaliser sur l'âge relatif des joueurs au moment de leur sélection, ce qui conduit à privilégier les jeunes nés en début d'année. Au rugby, il a été constaté que parmi les jeunes âgés de 15-16 ans qui intègrent l'U16, 40 % sont nés au premier trimestre et 10 % au dernier trimestre. Au lieu de procéder à la détection de potentiels, les entraîneurs favorisent les individus relativement plus âgés et donc physiquement plus matures par rapport aux sportifs plus jeunes. Ce constat est largement étayé et démontré par la littérature scientifique dans tous les sports et ce indépendamment du sexe18(*).
Afin de pallier le biais lié à l'âge relatif, l'équipe de l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport de l'Insep calcule des coefficients de calibrage à partir d'une régression linéaire entre la distribution des performances et les mois de naissance permettant de rééquilibrer les performances en fonction des sports, du sexe et de l'effet de l'âge relatif. Cette méthode permet un premier rééquilibrage qui doit cependant être complété par la prise en compte de l'âge biologique.
· L'âge biologique
Contrairement à l'âge chronologique représenté par le nombre d'années depuis la naissance, l'âge biologique est lié au processus d'évolution qualitative des cellules, des organes et des systèmes biologiques vers un fonctionnement adulte. Cette maturation fait apparaître de grandes différences entre les jeunes relevant d'une même catégorie d'âge mais présentant des âges biologiques différents19(*). Il existe en effet une relation graduelle entre les performances et les niveaux estimés des sportifs d'une part et leur état de maturité d'autre part. Il convient donc de pondérer les performances avec des coefficients correctifs en lien avec l'âge biologique.
En 2024, la Fédération française de ski a pris en compte l'âge biologique dans un classement de performance. Elle a constaté qu'après pondération, un jeune skieur classé 31e au classement général se retrouvait premier dans sa catégorie. Ce genre d'information peut avoir un impact majeur pour la stimulation et la poursuite de la pratique sportive notamment à 14 ans, âge charnière auquel certains jeunes décrochent du sport.
· L'âge d'entraînement
L'âge d'entraînement correspond au temps cumulé d'entraînement dans une discipline donnée. La méconnaissance de l'historique de pratique et d'entraînement du sportif conduit régulièrement à sélectionner dans les catégories jeunes ceux qui comptent le plus grand nombre d'heures de pratique. L'entraînement est une condition nécessaire pour atteindre un haut niveau dans un sport donné mais elle n'est pas suffisante. De même, une pratique précoce et spécifique améliore les performances à court terme mais ne permet pas de garantir le succès sportif à l'âge adulte.
Dans certains cas, la spécialisation précoce peut devenir un obstacle à une carrière de haut niveau20(*), pouvant engendrer blessures de surutilisation, burnout et abandon de la pratique sportive.
Pour favoriser l'apprentissage des habiletés complexes et spécifiques d'un sport, il est important de s'appuyer sur une base motrice large. Celle-ci favorisera la capacité d'apprentissage moteur sur le long terme. Lorsqu'un enfant est spécialisé très tôt dans un seul sport, le conduisant à acquérir une motricité très spécifique au détriment de son développement global, il risque d'être confronté à une barrière de compétences qui rendra l'accession aux stades supérieurs plus difficile.
Idéalement, les habiletés motrices de base doivent être développées le plus largement possible entre 3 et 8 ans21(*).
Le risque de spécialisation précoce est de perturber cette période critique avec des apprentissages moteurs trop spécifiques. Les études qui se sont intéressées aux parcours d'athlètes d'élite montrent qu'un grand nombre d'athlètes de haut niveau ont expérimenté plusieurs activités sportives durant l'enfance avant de se spécialiser.
Une spécialisation précoce est par ailleurs souvent associée à une augmentation des risques de blessures. La plupart des blessures observées chez les jeunes athlètes concernent la structure des tissus (os, muscles, tendons) et sont liées à la répétition intensive de mouvements spécifiques.
Une étude récente22(*) a montré une plus grande chance d'être médaillé dès lors qu'environ 1 400 à 2 100 heures d'entraînement dans le sport principal sont atteintes entre 19 et 21 ans, combinées approximativement à 730 à 1 020 heures d'entraînement dans d'autres sports avant 14 ans. Cela remet donc en question l'idée, aberrante selon les spécialistes, mais encore trop répandue, de la nécessité de cumuler 10 000 heures de pratique pour atteindre un « soi-disant haut niveau ».
2. L'élaboration de couloirs de performance
Les performances brutes dans les catégories jeunes ne semblent donc pas forcément pertinentes et les études scientifiques insistent sur la nécessité de s'intéresser aux cinétiques de progrès. C'est la raison pour laquelle la détection des potentiels passe désormais par l'élaboration pour chaque sportif d'une trajectoire de performances qui représente graphiquement ses performances en fonction de son âge et permet d'observer les cinétiques de progression.
Par ailleurs, un « couloir de performance » est associé à la trajectoire personnelle de l'athlète, qui représente les chemins de progression par lesquels sont passés les meilleurs athlètes de la discipline. La présence de la courbe de progression individuelle dans le couloir de performance globale permet de visualiser le niveau de performance du sportif et de le situer par rapport aux meilleures performances mondiales.
Cinétiques de progression d'athlètes au regard des tendances évolutives des meilleurs athlètes déjà médaillés
|
Performance maximale par âge au saut à la perche de 12 médaillés olympiques (2000-2012) |
|
Performance maximale de Renaud Lavillenie (ligne noire) et des parcours olympiques (aire verte) |
Source : Adrien Sedeaud, Florian Rousseau, Gagner avec les données : comment les mettre au service du sport de haut niveau, Insep, 2024
Illustration des couloirs de performance
Source : Adrien Sedeaud, Florian Rousseau, Gagner avec les données : comment les mettre au service du sport de haut niveau, Insep, 2024 ; dessin réalisé par Yann Chapus
À l'instar d'autres fédérations, la Fédération française de badminton s'est approprié cet outil de détection des potentiels. Depuis 2009, elle analyse toutes les données de classement de tous les joueurs mondiaux, en particulier tous les joueurs faisant partie du top 70 sont intégrés dans ce couloir de performance. Cet outil permet d'accompagner les athlètes faisant l'objet d'un fort potentiel pour leur proposer un suivi personnalisé sans attendre qu'ils fassent partie du top 10.
3. La plus-value des experts de terrain
En dépit des outils présentés, l'identification de potentiels reste complexe. La réalisation de tests de performance chez les jeunes n'est pas forcément efficace dans la mesure où ils ne permettent pas de tenir compte de la nature complexe, dynamique et parfois récursive du processus de développement.
Des études ont montré l'intérêt d'approches plus holistiques, s'intéressant aux facteurs physiques et techniques, mais également aux caractéristiques psychologiques, cognitives et sociologiques des jeunes sportifs. Ainsi, le lieu de naissance, le soutien de l'écosystème familial ou des entraîneurs, l'historique des blessures sont autant d'informations qui permettent d'évaluer le futur sportif de haut niveau. L'évaluation des potentiels passe donc par le recueil et le traitement d'une quantité toujours plus grande de données.
Pour autant, le rôle de l'entraîneur reste indispensable, comme l'a montré une étude récente23(*) qui a analysé l'impact de l'association de tests moteurs et psychologiques à « l'oeil du maquignon » que représente l'entraîneur.
En s'appuyant sur des batteries de tests moteurs et psychologiques, pondérés par la maturation mais également par la pratique et l'historique de l'entraînement, le soutien familial et l'estimation des entraîneurs (possibilité de devenir professionnel estimée sur une échelle de 0 à 100), une équipe de chercheurs suisses a tenté de prédire quels joueurs allaient devenir professionnels ou pas au regard de l'ensemble de ces éléments. Les performances motrices seules ainsi que le croisement des batteries multidimensionnelles prédisaient moins bien la réussite future que la mesure des coachs.
L'intérêt de ces analyses est de montrer que le meilleur modèle pour estimer les chances futures d'un jeune sportif est celui croisant l'estimation des entraîneurs avec toutes les autres données. Il est donc essentiel non seulement d'appliquer les bons modèles aux batteries de tests envisageant la maturité sportive mais également d'incorporer des données subjectives de praticiens afin d'enrichir l'approche.
L'étude des performances sous le prisme recalibré des âges relatifs, biologiques et d'entraînement devrait conduire les entraîneurs comme les responsables des filières de détection à modéliser des trajectoires individuelles de progression. L'aspect individuel des parcours de vie, enrichis de multiples indicateurs physiologiques, biomécaniques, sociologiques, psychologiques, familiaux ou encore environnementaux, permet d'estimer les hauts potentiels sportifs. Pour autant, aucun outil national n'existe, qui pourrait être mis à la disposition des fédérations françaises. Leur intérêt dépasse largement la sphère du haut niveau et ils mériteraient d'être développés en direction de tous les enfants pour mesurer leur capital santé, leur capital sportif et leur capital de progression.
À la rentrée 2025, le Gouvernement a mis en place une évaluation des aptitudes physiques des élèves de 6e à l'aide de trois tests standardisés : un test d'endurance, un test de force musculaire et un test de vitesse. Les élèves sont évalués entre trois niveaux d'aptitude pour chaque épreuve : « à besoins », « fragile » ou « satisfaisant »24(*). Cette évaluation devrait permettre d'adapter les enseignements aux besoins identifiés. Cette initiative doit être saluée et mériterait d'être généralisée aux enfants entrant à la maternelle, au CP et au lycée. Mesurer l'aptitude physique à différents stades du développement de l'enfant permettrait de dresser un portrait global et de tracer une trajectoire continue de l'enfance à l'âge adulte, plutôt que de se limiter à une vision ponctuelle au moment de l'entrée au collège. Sans cette approche élargie, il paraît difficile d'intégrer les notions de trajectoire et de parcours défendues précédemment. À l'instar du carnet de santé, un carnet d'activité physique devrait être institué pour tous les enfants afin de suivre leur appropriation de la littératie physique25(*).
C. LE POIDS DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DANS LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES
1. L'apport de la science à la préparation des athlètes
La préparation des athlètes est indispensable pour améliorer leurs performances, réduire les risques de blessure et maintenir leur niveau dans la durée. Elle s'appuie sur des connaissances en biomécanique et en physiologie de la motricité.
La biomécanique fournit les principes scientifiques pour comprendre comment les mouvements sont générés et optimisés. Elle s'intéresse à l'étude des mouvements (cinématique), aux forces internes et externes qui agissent sur le corps, au travail mécanique effectué par les muscles et la puissance générée, etc.
La physiologie de l'exercice étudie les adaptations de l'organisme humain à l'effort physique et s'intéresse particulièrement au système cardiovasculaire, au système respiratoire, au système musculaire ou encore au métabolisme énergétique.
La motricité et les neurosciences sont étroitement liées, car le mouvement est contrôlé par le système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière. À travers des recherches sur le contrôle moteur, la plasticité cérébrale, la proprioception ou encore l'apprentissage moteur, les neurosciences contribuent à appréhender la complexité de la motricité. Elles jouent un rôle croissant dans l'optimisation de la performance à travers l'entraînement cognitif ou encore la gestion du stress.
D'autres sciences jouent un rôle important dans la préparation des sportifs comme la psychologie qui constitue le fondement scientifique de la préparation mentale, mais également la sociologie, qui permet de mieux comprendre les facteurs sociaux et culturels de la performance.
Les sciences jouent donc un rôle clé dans tous les aspects de la préparation des athlètes : physique, psychologique, technique et tactique.
2. Une préparation physique qui ne laisse rien au hasard
a) La construction scientifique des entraînements
· La caractérisation de la discipline
La préparation physique des athlètes dépend de la discipline sportive, chaque sport ayant des exigences physiques spécifiques. Par exemple, un marathonien aura besoin d'une grande endurance cardiovasculaire et musculaire, tandis qu'un haltérophile devra développer une force maximale. La préparation physique doit donc s'appuyer au préalable sur une caractérisation fine de la discipline et une évaluation des qualités requises pour exceller dans le sport concerné.
Une même discipline peut exiger des compétences différentes selon les positions. Au rugby, des études GPS et d'analyse de mouvement ont mesuré le temps moyen passé dans les différentes allures26(*) selon les positions. Il a été constaté que les ailiers et arrières passaient presque 2,5 fois plus de temps dans la catégorie « course d'intensité élevée » que les piliers et 2e ligne, alors que les piliers, 2e et 3e lignes passaient 7 fois plus de temps que les arrières dans la catégorie « efforts statiques ». Ces chiffres mettent en exergue des exigences très différentes, qui doivent être prises en compte lors de l'élaboration d'un entraînement.
· L'analyse des capacités physiques de l'athlète
Afin de proposer un entraînement adapté aux besoins de l'athlète, il est indispensable d'évaluer au préalable ses capacités physiques telles que l'endurance, la vitesse, la force et la puissance.
Plusieurs biomarqueurs permettent d'obtenir des informations sur les caractéristiques physiques et physiologiques de l'athlète :
- l'activité musculaire qui permet notamment d'identifier les muscles les plus actifs pendant un mouvement spécifique ;
- la consommation d'oxygène maximale (VO2max) qui reflète la capacité maximale de transport et d'utilisation d'oxygène et permet de déduire leur capacité d'endurance ;
- les paramètres cinématiques qui décrivent les positions du corps osseux et permettent de mesurer la vitesse, les accélérations et les décélérations ainsi que la distance parcourue ;
- les paramètres cinétiques qui portent sur les forces impliquées dans le mouvement.
Plusieurs technologies ont été développées pour mesurer les biomarqueurs du mouvement humain.
Les ergomètres mesurent avec précision les différentes grandeurs physiques liées à l'exercice d'une activité physique, par exemple la puissance développée (mesurée en watts) et le travail fourni (mesuré en joules ou en calories). Il existe différents types d'ergomètres, adaptés à diverses activités : l'ergocycle (vélo-ergomètre) pour le cyclisme, l'ergomètre rameur pour mesurer l'effort fourni lors de la pratique de l'aviron, le tapis-ergomètre pour la marche et la course ; l'ergomètre à bras pour les exercices des membres supérieurs. Selon la nature de l'effort réalisé (durée, intensité, protocole), ces appareils permettent d'évaluer des capacités telles que l'endurance ou la force maximale. L'énergie dépensée est généralement estimée à partir de ces mesures ou mesurée séparément, à l'aide d'un calorimètre.
Les ergomètres sont souvent équipés d'instruments complémentaires pour mesurer d'autres grandeurs comme la fréquence cardiaque (à l'aide d'un cardiofréquencemètre), la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone (à l'aide d'un pneumotachomètre couplé à un capillaire de prélèvement des gaz expirés).
Les plateformes de force mesurent la force et la puissance générées par les athlètes lors de sauts, de sprints et d'autres mouvements explosifs. Elles permettent également d'évaluer l'équilibre et la stabilité des athlètes, ce qui est crucial dans de nombreux sports.
Les dispositifs GPS donnent de nombreuses indications sur les déplacements des joueurs (distance parcourue, vitesse, accélérations, changements de direction). Selon le dispositif utilisé, il est également possible d'enregistrer la fréquence cardiaque des athlètes grâce au cardiofréquencemètre qui peut y être inclus. Ils permettent de quantifier la charge de travail des joueurs (c'est-à-dire l'effort physique total ainsi que sa durée et son intensité). Ils ont l'avantage de pouvoir être utilisés en dehors des laboratoires dans des conditions qui reflètent la réalité de la pratique sportive.
· L'individualisation et le suivi de la préparation physique
La préparation physique se concentre essentiellement sur deux composantes : le travail musculaire et le travail cardiovasculaire. Elle vise à générer des adaptations physiologiques pour améliorer les performances des sportifs. Concomitamment, d'autres facteurs doivent être surveillés tels que la fatigue et le besoin de récupération pour éviter que l'entraînement soit contreproductif et limiter le risque de blessure.
Les programmes d'entraînement sont donc individualisés afin de tenir compte des caractéristiques, des besoins spécifiques et des objectifs de chaque sportif. Cela passe par une planification personnalisée qui prend en considération les forces et les faiblesses des individus mais également leur ressenti quotidien.
Ainsi, chaque matin, la plupart des sportifs de haut niveau remplissent un questionnaire sur leur quantité de sommeil et sa qualité, leur humeur, leur niveau de fatigue, la présence de courbatures, de blessures ou de douleurs chroniques. À partir de ces informations, le programme d'entraînement peut être ajusté pour s'assurer qu'il reste efficace et adapté aux besoins du sportif.
b) L'adaptation aux facteurs environnementaux
L'environnement externe peut avoir un impact non négligeable non seulement sur la performance, mais également sur la santé des sportifs. Ainsi, la chaleur peut provoquer une déshydratation, une augmentation de la température corporelle, un stress cardiovasculaire et une altération des fonctions cognitives. L'altitude va réduire l'oxygène disponible, altérer la performance aérobie et augmenter les fréquences respiratoire et cardiaque.
Afin de s'adapter à ces facteurs environnementaux, les sportifs vont s'entraîner dans des conditions de chaleur ou d'altitude simulées.
Les chambres à hypoxie offrent un environnement contrôlé dans lequel le niveau d'oxygène est réduit pour simuler des conditions d'altitude élevée. Les chambres climatiques permettent de contrôler la température et l'humidité pour stimuler des conditions de chaleur. Avec certaines chambres spécifiques, il est possible de moduler la température, l'humidité et le niveau d'oxygène.
La plateforme scientifique HIPE (Health Improvement Through Physical Exercise) de Marseille dispose d'une chambre environnementale dans laquelle la température, l'humidité, l'altitude, le rayonnement solaire, mais également les polluants et les allergènes peuvent être contrôlés pour placer les sportifs dans les conditions les plus représentatives de leur compétition.
L'acclimatation à la chaleur
Comme tous les mammifères, l'homme est un animal à sang chaud. Il doit maintenir une température centrale constante autour de 37 degrés pour que son organisme fonctionne de manière optimale. Au-delà de la production de chaleur métabolique, la principale source de chaleur produite par l'homme est liée à son activité musculaire. Lors d'un exercice physique, les muscles se contractent et 75 % de l'énergie est transformée en chaleur tandis que 25 % sert à se déplacer. Cette chaleur doit être évacuée pour éviter une augmentation de la température corporelle. Pour réguler sa température, l'homme utilise la transpiration. Des milliers de glandes sudoripares sont présentes au niveau de la surface cutanée. Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux au niveau de la peau « arrache » de l'énergie et permet de stabiliser la température centrale de manière très efficace. Néanmoins, lorsque la température externe augmente, le corps doit augmenter la production de sueur pour favoriser la perte de chaleur par évaporation. En outre, l'efficacité de la transpiration varie selon le taux d'humidité ambiante dans la mesure où celle-ci limite considérablement la quantité de vapeur d'eau susceptible d'être évaporée par la peau : dans une ambiance chaude et sèche, l'évaporation sera beaucoup plus facile que dans une ambiance chaude et humide.
La température a des impacts contrastés sur la performance sportive27(*). Dans les épreuves de sprint (de 100 mètres à 400 mètres), courir à plus de 25 degrés a un impact positif sur la performance. Sur les épreuves de demi-fond (de 800 mètres à 10 000 mètres), on commence à observer un effet délétère, qui n'est pas important, mais qui peut aller jusqu'à une chute des performances de 1,5 % pour le 10 000 mètres. Sur le marathon et la marche, la chaleur entraîne des pertes de performance qui peuvent aller jusqu'à 3 %.
La recherche s'intéresse depuis longtemps à la manière la plus efficace de préparer les athlètes à la chaleur. Elle préconise d'augmenter l'entraînement en endurance car ce type d'entraînement permet, par l'élévation de la température corporelle qu'il produit à chaque séance, ainsi que par la sudation qu'il déclenche, de simuler une exposition à la chaleur. Chaque séance d'entraînement en endurance permet ainsi une acclimatation partielle à la chaleur.
Néanmoins, la meilleure préparation pour la pratique du sport en environnement chaud est l'acclimatation à la chaleur au moins une semaine avant (et idéalement entre deux et trois semaines avant) la compétition. L'objectif est de provoquer les adaptations physiologiques nécessaires en confrontant l'organisme aux températures et à l'humidité qu'il subira pendant l'épreuve. Le débit sudoral va gagner en efficacité en étant plus précoce et plus intense, le volume plasmatique va augmenter, permettant de maintenir la pression artérielle et d'améliorer la circulation sanguine, la perte de sodium et d'électrolytes va être plus limitée, la température cutanée et la température centrale vont diminuer, ce qui réduira le risque de coup de chaleur. Avec le temps, le coeur devient plus efficace pour pomper le sang, ce qui va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque et favoriser la performance. In fine, l'adaptation permet que le débit cardiaque soit moins mobilisé pour évacuer la chaleur et plus utilisé pour l'endurance et la performance.
À défaut de pouvoir s'effectuer dans les contraintes environnementales du terrain, l'entraînement peut être réalisé dans une chambre climatique pour faciliter l'acclimatation.
3. La gestion de la fatigue
a) Les impacts de la fatigue
La fatigue physique est une réponse naturelle et inévitable à l'activité physique. Elle provoque au niveau physiologique une diminution de la capacité des muscles à produire une force, une augmentation de la dépense énergétique, une accumulation de lactate, une déshydratation, un épuisement des réserves de glycogène et des microdéchirures dans les fibres musculaires.
La fatigue mentale altère également les performances physiques. Cette fatigue résulte de l'engagement prolongé dans des tâches mentales exigeantes, telles que des tâches réalisées pendant une longue période sur un ordinateur. Une étude de 200928(*) a montré que la fatigue mentale diminue de 15 % la performance d'endurance en raison d'une augmentation de la perception de l'effort qui conduit à un désengagement prématuré de la tâche. De même, la performance psychomotrice est affectée : les gestes techniques et les décisions sont moins performants.
Lors de son audition29(*), Mathias Pessiglione, directeur de recherche, co-responsable de l'équipe « Motivation, cerveau et comportement » de l'Institut du cerveau, a expliqué que les décisions devenaient plus impulsives en présence de fatigue mentale. Une étude réalisée par l'Institut du cerveau en collaboration avec l'Insep et l'Agence française de lutte contre le dopage a montré qu'un entraînement sportif trop intensif pouvait être assimilé à un travail intellectuel excessif, entraînant les mêmes effets impulsifs lors des prises de décision. Cela pourrait expliquer le recours à des produits dopants par certains athlètes qui n'arrivent plus à « performer » et cherchent à récupérer leur performance à court terme.
Compte tenu des impacts délétères de la fatigue sur la performance et l'état de santé de l'athlète, des stratégies sont mises en place pour la mesurer et la gérer.
b) La mesure de la fatigue
La fatigue peut faire l'objet d'évaluations subjectives, au moyen d'échelles visuelles analogiques30(*) et de questionnaires.
Elle peut également être mesurée de manière objective par électroencéphalographie, oculométrie, imagerie par résonance magnétique (IRM) ou électromyographie. Toutefois, ces techniques nécessitent un appareillage sophistiqué. Elle peut aussi être estimée31(*) objectivement et directement par le sportif grâce à un cardiofréquencemètre qui évalue la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). La VFC est la fluctuation de l'intervalle de temps qui sépare deux battements cardiaques consécutifs. Cette variabilité a une relation étroite avec l'activité du système nerveux autonome, qui reflète l'interaction complexe entre les influences parasympathiques et sympathiques. Grâce à des mesures faites dans des conditions standardisées (le matin et à jeun), on peut déterminer la branche la plus influente du système nerveux autonome. La VFC doit être mesurée quatre à sept fois par semaine pour obtenir des résultats significatifs.
Un niveau de VFC élevé témoigne d'un bon niveau de santé physique et psychologique. En revanche, une baisse de VFC observée chez un sportif peut être associée à des niveaux de fatigue ou de stress trop élevés et alerter sur le risque de basculement de l'athlète vers de la fatigue chronique.
Est-ce que la fatigue varie selon le sexe des athlètes ?
À un niveau d'intensité relatif (entre 30 % de la VO2 max et 50 % de la VO2 max), il y a une moindre fatigabilité chez les femmes. Les résultats sont différents en cas de niveau d'intensité absolu.
Les femmes, pour chaque niveau d'intensité, ont une fatigue musculaire périphérique atténuée due aux spécificités musculaires des femmes chez lesquelles la surface occupée par les fibres lentes est plus importante en pourcentage que chez les hommes.
D'autres facteurs interviennent, comme le métabolisme musculaire : les femmes consommant plus de lipides à l'effort, la glycolyse est atténuée. L'activation du système nerveux sympathique varie selon le sexe et conduit à une vasodilatation plus importante chez les femmes, qui facilite la clairance des métabolites et l'apport en oxygène.
En termes de force relative, les femmes ont un niveau de force plus faible, ce qui entraîne une compression mécanique plus réduite. Cette moindre résistance au flux sanguin améliore la perfusion et limite l'accumulation de métabolites.
Une analyse statistique s'appuyant sur 38 000 courses et 5 millions de résultats a été utilisée pour vérifier si les femmes ont une meilleure endurance lorsque la distance augmente. 7 251 paires d'hommes et de femmes ont été constituées, qui ont couru la même année une course courte et une course longue. Il a été constaté en moyenne que, pour chaque paire, l'écart entre les hommes et les femmes diminuait lorsque la distance augmentait, ce qui confirme leur meilleure endurance par rapport aux hommes.
c) La gestion de la fatigue
L'entraînement guidé par VFC est une nouvelle approche de l'entraînement dans le sport de haut niveau : les entraîneurs établissent des protocoles d'entraînement qui peuvent être adaptés en fonction de l'évolution de la VFC.
D'autres stratégies sont mises en place pour lutter contre la fatigue32(*).
Certaines sont plutôt conjoncturelles, comme celle de l'affûtage, qui vise à diminuer la fatigue résiduelle engendrée par l'entraînement tout en maximisant les adaptations physiologiques et, en conséquence, la performance. L'affûtage repose sur le fait que chaque entraînement a deux effets : un effet « fatigue », mais également un effet « amélioration de la condition physique » à travers les adaptations physiologiques, neurophysiologiques et neuromusculaires33(*) qu'il va provoquer et qui vont contribuer à augmenter la performance du sportif.
Concrètement, lorsqu'un sportif s'entraîne très intensément, il va ressentir un niveau de fatigue très élevé, mais son niveau de condition physique sera également très haut34(*).
À l'approche d'une compétition, l'enjeu pour le sportif est donc d'identifier les modalités qui permettent de diminuer au maximum ce niveau de fatigue cumulée sans modifier le niveau de condition physique. L'affûtage va influencer les paramètres d'entraînement dans les deux à trois semaines qui précèdent les grands événements sportifs. Une méta-analyse35(*) de 2007 montrait que la stratégie optimale chez les athlètes de haut niveau consistait à réduire de moitié (41 à 60 %) le volume d'entraînement pendant les deux semaines précédant la compétition, tout en maintenant l'intensité et la fréquence. Ce type de stratégie permet d'avoir un gain de performance de l'ordre de 2 %.
L'affûtage, selon les stratégies d'entraînement, peut prendre deux formes : un entraînement normal suivi d'un affûtage, ou un entraînement avec surcharge suivi d'un affûtage.
Lorsque l'affûtage est précédé d'une surcharge d'entraînement, le gain de performance est supérieur à 2 %. Cependant, le sportif peut être exposé à un risque de fatigue excessive et de blessure si le temps de récupération est insuffisant.
En pratique, l'efficacité de l'affûtage se heurte à une grande variabilité interindividuelle, certains athlètes progressant beaucoup, tandis que d'autres ne progressent pas du tout. L'enjeu est donc d'adapter l'affûtage en fonction du niveau de fatigue cumulée. Si celui-ci est élevé, il faut diminuer davantage le volume d'entraînement. S'il est faible, il n'est pas nécessaire de le diminuer dans les proportions fixées par les recommandations.
La récupération joue structurellement un rôle fondamental pour lutter contre la fatigue36(*), qu'il s'agisse de la récupération à court terme à la suite de l'entraînement ou de la récupération à long terme dans le cadre de la périodisation de l'entraînement. La charge de travail imposée par une séance d'entraînement peut être appréhendée sous l'angle du stress physiologique qu'elle génère. L'homéostasie des cellules musculaires est déstabilisée. Des ajustements homéostatiques se produisent alors pour rétablir l'équilibre interne du corps pendant l'exercice, notamment par le biais d'augmentations de la fréquence cardiaque, du rythme de la ventilation et de la température corporelle, ou au moyen d'un changement du flux métabolique. Lorsque le corps est soumis de manière répétitive à un stress physiologique, il réagit par des adaptations d'ordre morphologique, métabolique ou neuromusculaire. Les adaptations à l'entraînement à long terme sont le résultat des effets cumulés de chaque entraînement à court terme.
Le déséquilibre de l'homéostasie tend à diminuer dès l'arrêt de l'entraînement. Pour autant, cette période apparemment passive est importante pour les adaptations ultérieures. Par exemple, l'expression de l'ARN messager de plusieurs enzymes oxydatives apparaît toujours élevée jusqu'à 24 heures après l'entraînement, témoignant d'une action importante associée aux adaptations à l'entraînement longtemps après la disparition de ses effets aigus.
Une récupération inadéquate entre les séances d'entraînement provoque donc de mauvaises adaptations accompagnées de symptômes de fatigue et d'une altération des fonctions musculaires. Elle ne permet pas à l'athlète de s'entraîner avec l'intensité requise ou avec la bonne charge lors de la séance suivante.
Pour favoriser le processus de récupération, les athlètes ont donc recours à des stratégies de récupération proactive comme le massage, la cryothérapie, l'immersion (notamment contrastée, en alternant des bains chauds et des bains froids pour stimuler la circulation sanguine) ou encore les étirements. Ces techniques ont pour but de faire pencher la balance stress/récupération du côté de la récupération, afin de permettre à l'athlète de tolérer des volumes d'entraînement supérieurs ou de favoriser les effets positifs de la charge d'entraînement.
Par ailleurs, la périodisation de l'entraînement consiste à planifier un programme d'entraînement à court et à long terme avec des charges variables et des périodes de repos et de récupération adéquates. La périodisation offre donc un cadre permettant de contrôler la fatigue de l'athlète par une gestion fine du stress et de la récupération.
D'autres facteurs influencent la récupération comme la nutrition et le sommeil.
La pratique sportive de haut niveau se traduit par une importante augmentation des besoins en énergie et l'équilibre de la balance énergétique nécessite alors une augmentation des apports alimentaires. L'adéquation de l'apport alimentaire aux dépenses énergétiques est un facteur clé de la récupération nutritionnelle. Différentes modifications métaboliques sont en effet constatées durant l'exercice : des pertes hydroélectrolytiques, des pertes protéiques ainsi qu'une baisse des réserves en glycogène et une mobilisation des réserves lipidiques. La phase de récupération devra donc permettre de compenser les pertes consécutives à l'effort physique fourni pendant l'entraînement ou la compétition, en adaptant l'alimentation à ces périodes avant, pendant et après l'effort.
Le sommeil joue un rôle crucial dans la récupération des sportifs. Pendant le sommeil, le corps répare les tissus musculaires endommagés, notamment à travers la libération de l'hormone de croissance qui atteint son pic pendant le sommeil profond. Le sommeil permet également au système nerveux central de récupérer, ce qui est indispensable pour les performances cognitives et la coordination motrice. Le sommeil joue un rôle important dans la consolidation de la mémoire et l'apprentissage des compétences motrices. Il aide à réguler les hormones liées au stress. Enfin, un manque de sommeil peut augmenter le risque de blessure en affectant le temps de réaction, la prise de décision et la précision des mouvements.
Selon une étude récente37(*), entre 49 % et 64 % des sportifs de haut niveau souffrent de troubles du sommeil. Les causes sont multiples : stress lié à la pression pour maintenir ou augmenter leurs performances, entraînements intensifs dont les horaires peuvent affecter les cycles de sommeil, voyages fréquents pour les compétitions accompagnés souvent de décalages horaires, horaires de compétition qui retardent l'heure du coucher et réduisent la durée du sommeil.
Le projet de recherche D-Day financé dans le cadre du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance s'est intéressé aux méthodes de récupération ayant un impact sur la qualité et la quantité de sommeil.
Plusieurs stratégies ont été retenues telles que la cryostimulation38(*), les bains froids, les bains chauds ou encore les matelas thermorégulateurs, mais également l'éducation au sommeil39(*). Les chercheurs se sont attachés à intégrer ces stratégies dans la routine des athlètes. Cela a impliqué d'interroger les athlètes sur leurs habitudes et leurs croyances en matière de récupération, d'identifier les déterminants psychologiques leur permettant d'adopter de nouveaux comportements et d'évaluer leurs préférences parmi les différentes méthodes proposées.
d) Vers un traitement contre la fatigue mentale ?
Au cours de son audition, Mathias Pessiglione40(*) a expliqué que des recherches étaient en cours pour essayer d'expliquer le phénomène de la fatigue mentale par la biologie du cerveau. La mobilisation du cortex latéral préfrontal pour un travail cognitif exigeant de longue durée entraînerait l'accumulation dans cette zone du cerveau de métabolites potentiellement toxiques. La fatigue pourrait ainsi correspondre à l'envoi par le cerveau d'un signal préconisant de s'arrêter pour éviter l'accumulation de substances toxiques. La spectroscopie par IRM permet de voir un dérivé métabolique spécifique du cortex latéral préfrontal en cas de travail exigeant. D'autres travaux montrent un effondrement de l'activité du cortex latéral préfrontal en cas de surentraînement.
Actuellement, les préconisations pour se remettre d'un surentraînement sont le repos, la consultation d'un psychologue, le changement d'environnement. Néanmoins, les recherches en cours laissent espérer qu'il sera un jour possible d'identifier des cibles métaboliques dans le cerveau à l'origine de la fatigue cérébrale, et ainsi de prévoir des interventions médicamenteuses pour ce genre de syndrome.
L'usage du smartphone favorise-t-il la fatigue mentale ?
Plusieurs études ont mesuré l'impact du smartphone sur la fatigue mentale.
Un utilisateur passe aujourd'hui en moyenne 3,3 heures par jour sur son téléphone, dont 1 h 30 sur les réseaux sociaux, 1 h 20 à jouer et 40 minutes à téléphoner. Il vérifie son smartphone environ 250 fois par jour.
Ces chiffres traduisent une dépendance quotidienne, dont les effets commencent seulement à être compris. L'utilisation répétée et prolongée du smartphone peut influer sur la capacité de mémoire de travail (faire des calculs) et l'intelligence fluide (reconnaissance de figures) : dès que le téléphone est près de nous, il affecte notre capacité de concentration et notre rendement au travail, parfois même quand on ne le regarde pas.
Une utilisation aiguë du smartphone, dès 30 à 45 minutes, peut avoir des effets sur la performance cognitive. Cela peut altérer l'attention, la vigilance, l'inhibition, ou encore la prise de décision. Par exemple, à partir de tests de vigilance (PVT), une étude41(*) a mis en évidence une augmentation des temps de réaction après 45 minutes d'utilisation du smartphone, ainsi qu'une baisse de l'efficacité dans les tâches nécessitant une inhibition motrice. Ces altérations surviennent le plus souvent sans que l'utilisateur en ait forcément conscience.
Selon cette même étude, les régions cérébrales sollicitées lors d'une utilisation prolongée du smartphone (le cortex dorsolatéral préfrontal et le cortex cingulaire antérieur) sont également mobilisées lors d'états de fatigue mentale. Cet argument est mis en avant pour affirmer que l'utilisation prolongée du téléphone portable induit une fatigue mentale.
Toutefois, aucune altération des performances physiques (la force ou l'endurance) n'a été observée jusqu'à présent. Les marqueurs physiologiques classiques de la fatigue mentale (comme l'activité cérébrale, la fréquence cardiaque ou les pupilles) ne varient pas significativement après l'usage du smartphone.
Si les tests de détente verticale et d'endurance ont montré qu'il n'y avait pas d'effet sur la performance physique, la prise de décision est néanmoins altérée dans la mesure où l'entraînement ne permet pas de l'améliorer. Cela pose donc la question de l'utilisation du téléphone juste avant l'entraînement.
D'autres études montrent que l'effet du téléphone portable, de manière aiguë, entre 30 et 45 minutes, altère les performances, par exemple en football, en natation, en boxe, ou même dans les exercices de musculation. Une étude de 201742(*) a montré que dans le football, les performances diminuent lorsqu'on demande à des joueurs de tirer sur une cible et de faire un parcours sous forme de rectangle.
Ont également été montrées une altération des capacités visuomotrices chez les joueurs de volley-ball43(*), une altération de la prise de décision chez les boxeurs44(*) ainsi qu'une augmentation du temps nécessaire pour parcourir 50 mètres chez les nageurs45(*).
Ces travaux montrent que l'utilisation des smartphones devrait être déconseillée 45 minutes avant le début d'une compétition afin de ne pas altérer les performances des sportifs. La dose d'utilisation du smartphone reste toujours à définir, mais son implication dans les performances et dans la fatigue mentale n'est pas à négliger.
Plus généralement, de nombreuses études46(*) ont montré l'effet délétère sur le sommeil de l'utilisation du smartphone au moment du coucher et ses répercussions sur l'état de fatigue, en particulier chez les adolescents47(*).
4. La prévention des blessures
L'analyse des capacités physiques des athlètes avec les ergomètres ou les centrales inertielles en début de saison permet d'identifier les facteurs de risque de blessure.
En athlétisme, les lésions musculaires des ischio-jambiers sont très fréquentes chez les sprinters. L'évaluation isocinétique permet de mesurer plusieurs paramètres tels que la force maximale, la puissance musculaire, l'endurance musculaire et le ratio entre les muscles agonistes et antagonistes (par exemple le ratio quadriceps/ischio-jambiers). Ces données permettent d'analyser les performances musculaires des membres inférieurs, et également d'identifier des déséquilibres musculaires ou des faiblesses spécifiques susceptibles d'entraîner des risques de blessure. Ainsi, la faiblesse musculaire des ischio-jambiers relative à la force du quadriceps48(*) (mise en évidence par le ratio ischio-jambiers/quadriceps) est un facteur prédictif de lésion des ischio-jambiers.
La prévention des blessures passe également par une analyse de la symétrie entre les côtés gauche et droit du corps qui peut révéler des déséquilibres ou des compensations dus à des blessures.
L'intelligence artificielle a vocation à participer à l'anticipation des risques de blessures chez les sportifs. Utilisée dans l'analyse des mouvements et la biomécanique des athlètes, elle peut anticiper les risques liés à la fatigue musculaire, aux déséquilibres posturaux ou à des charges d'entraînement excessives. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent également détecter les signes de fatigue ou de surmenage chez les athlètes, ce qui permet de prévenir les blessures en ajustant les programmes d'entraînement.
Les outils numériques permettent d'améliorer le suivi et la prise en charge des risques de blessure. Ainsi, le badminton est un sport à spécialisation précoce, ce qui peut entraîner le développement de certaines pathologies très spécifiques du fait de l'intensité et du volume d'entraînement à des âges où le corps humain change. L'une des pathologies les plus courantes au badminton est le conflit fémoro-acétabulaire qui peut à terme nécessiter une intervention chirurgicale à l'âge de 20 ans. La collecte des données dès le début de carrière de l'athlète sur l'articulation de la hanche pourrait permettre de détecter plus tôt les premiers signes de douleurs chroniques et de proposer une prise en charge adaptée et individuelle pour prévenir ces blessures.
5. Le rôle croissant de la préparation mentale
Il existe trois déterminants biologiques de la performance :
- les facteurs constitutionnels inhérents à l'organisme tels que l'âge, la taille, la composition corporelle et l'héritage génétique ;
- les facteurs liés à la condition physique développée par l'entraînement physique ;
- les facteurs cognitifs qui peuvent être améliorés par la préparation mentale, tels que l'intelligence de jeu ou l'intelligence de course, ainsi que les facteurs liés à l'estime de soi et à la confiance en soi, la motivation et la concentration.
Longtemps sous-estimée, la préparation mentale joue un rôle croissant dans la préparation des athlètes car elle peut influer de manière significative sur leurs performances.
Au cours de son audition, Yann Cucherat49(*), manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport, a expliqué que le taux de conversion des médaillés mondiaux en médaillés olympiques était de 50 % pour la France contre 100 % pour d'autres nations. Tout en rappelant qu'en matière de très haute performance, les résultats sont très aléatoires et que le plus dur était de « rééditer l'exploit », il a néanmoins expliqué que la sous-optimisation de la préparation mentale des athlètes français par rapport à certains athlètes étrangers pouvait expliquer en partie cet écart.
L'implication des sciences humaines et sociales dans la quête de performance sportive de haut niveau a permis de donner des bases scientifiques solides à la préparation mentale des athlètes, qu'elle soit individuelle ou collective.
a) La préparation mentale individuelle
· La gestion des pensées et des émotions
La préparation mentale individuelle vise à développer des habiletés mentales chez l'athlète pour réguler ses pensées, ses émotions et ses comportements. Elles sont regroupées en cinq grandes catégories :
- la connaissance de soi, préliminaire indispensable à tout programme d'entraînement mental. Il s'agit pour le sportif d'être lucide sur ses pensées, ses sensations et ses émotions ;
- la motivation et la fixation d'objectifs. Les deux formes principales de motivation chez le sportif de haut niveau sont le plaisir de la pratique et l'envie de gagner. Elles sont complémentaires : le plaisir va permettre de ressentir des sensations et d'apprendre des techniques mais il est insuffisant pour être performant en compétition. L'envie de gagner est un moteur puissant pour développer le niveau d'exigence et de compétence du sportif et renforcer sa confiance en lui lorsqu'il atteint cet objectif. Néanmoins, si l'athlète ne s'entraîne que pour gagner, cela va générer une anxiété importante. La fixation d'objectifs50(*) (un niveau de performance ou de compétence spécifique pour atteindre un résultat particulier) permet d'augmenter la motivation du sportif à réussir ainsi que sa satisfaction et sa confiance dans ses performances, de tirer le meilleur parti de ses entraînements, d'améliorer ses compétences et ses performances, d'éviter l'ennui en rendant l'entraînement plus stimulant et de développer une « philosophie de la performance » en l'incitant à faire de son mieux et à réaliser son potentiel ;
- la gestion des émotions, comme le stress, mais également la frustration ou la colère qui peuvent conduire à un soulagement de très court terme mais s'accompagnent de conséquences néfastes durables51(*) ;
- la concentration : tous les athlètes reconnaissent avoir des difficultés à se concentrer pendant la durée d'une performance ou à des moments précis. Les difficultés de concentration sont généralement dues à des distractions à la fois internes (pensées, inquiétudes, préoccupations) et externes (distracteurs visuels tels que le public, les concurrents, les caméras, et distracteurs auditifs tels que des rires, des cris, des moqueries ou des sifflets). Comme la force et la vitesse, la concentration doit être entraînée et un certain nombre de stratégies et d'exercices permettent de l'améliorer52(*).
S'il existe un consensus scientifique sur l'importance des habiletés mentales décrites précédemment, deux modèles coexistent pour la gestion des émotions.
Les approches « traditionnelles » visent à modifier le contenu des pensées et des émotions grâce à différentes techniques :
- le discours interne positif implique l'utilisation de phrases ou de mots positifs pour renforcer la confiance en soi et maintenir une attitude optimiste. L'idée est de remplacer les idées négatives ou limitantes par des affirmations positives qui encouragent et motivent ;
- la relaxation est utilisée pour réduire le stress et l'anxiété ;
- la visualisation positive consiste à imaginer des scénarios de réussite et à se voir accomplir ses objectifs avec succès. Elle aide à préparer mentalement le sportif à faire face à des situations réelles en renforçant sa confiance et en réduisant son anxiété.
Grâce à ces techniques, les sportifs sont censés atteindre un état optimal (le flow) leur permettant de réaliser la meilleure performance.
Néanmoins, ces approches demandent aux athlètes de produire un effort supplémentaire et peuvent augmenter la charge cognitive ressentie. Dans certains cas, ces efforts peuvent même s'avérer vains dans la mesure où plus les athlètes vont essayer d'éviter de penser à quelque chose, plus ils vont y penser.
En outre, les sportifs peuvent être dans un état mental sous-optimal tout en restant performants.
De nouvelles approches de la préparation mentale53(*) ont donc été développées qui reposent également sur les habiletés mentales de base mais envisagent une nouvelle relation avec les sensations, les pensées et les émotions. Plutôt que de les voir comme des dysfonctionnements ou des problèmes à résoudre, les approches fondées sur la pleine conscience reposent sur l'acceptation de ces états. L'objectif est de prendre de la distance vis-à-vis des ressentis, en les considérant comme des événements passagers. En fournissant moins d'efforts pour « lutter contre », les athlètes vont diriger davantage leur attention sur les éléments pertinents pour leur performance.
Trois mécanismes principaux sont à l'oeuvre dans les approches fondées sur la pleine conscience :
- la lucidité : le sportif doit être conscient des émotions et des pensées qui surgissent ;
- l'acceptation : le sportif doit « faire avec » ses pensées, ses émotions et ses sensations sans les juger, ni chercher à les modifier ou les supprimer ;
- la re-concentration : le sportif doit être capable de ramener son attention sur les éléments essentiels de sa performance après une perturbation ou une distraction.
· Les apprentissages par l'imagerie mentale
Si l'entraînement physique reste indispensable dans l'apprentissage du geste technique, le développement des neurosciences a mis en avant l'importance de l'imagerie mentale. Elle s'appuie sur la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à se restructurer et à s'adapter en réponse à de nouvelles expériences et à l'apprentissage. L'imagerie mentale aide les athlètes à perfectionner leurs compétences motrices et à améliorer leurs performances grâce à un entraînement répétitif et ciblé, notamment dans les sports demandant une gestuelle millimétrée avec un temps de réaction rapide et une répétition rigoureuse des mouvements (sport automobile, golf, danse). Elle favorise l'automatisation et les performances des gestuelles aussi bien en force qu'en précision. Lorsque les sportifs s'entraînent à imaginer une situation ou un geste, ils sont encouragés à impliquer tous leurs sens afin de créer une expérience plus immersive et renforcer l'efficacité de l'imagerie mentale.
· L'entraînement des capacités cognitives grâce à NeuroTracker
Le NeuroTracker est un système d'entraînement cognitif qui s'appuie sur une technologie de suivi oculaire et des exercices de réalité virtuelle.
Concrètement, un jeu de huit balles colorées et numérotées se déplace en trois dimensions sur un écran. Lorsque le numéro des balles disparaît, il faut suivre des yeux le plus de balles possible et donner leur numéro lorsqu'elles s'arrêtent. Le niveau de difficulté dépend de la vitesse de déplacement des balles et de leurs mouvements (rebonds et collisions).
Cet outil est largement utilisé notamment par les rugbymen pour évaluer et entraîner leurs capacités cognitives liées à la perception visuelle (capacité à traiter rapidement et avec précision des informations visuelles, ce qui est crucial pour anticiper les mouvements des adversaires et des coéquipiers), à l'attention et la concentration (capacité à se concentrer sur des éléments pertinents dans un environnement complexe et dynamique comme un match de rugby), à la prise de décision rapide et sous pression, à la mémoire de travail (capacité à retenir et manipuler des informations à court terme, ce qui aide à planifier et exécuter des stratégies de jeu).
· L'entraînement à l'endurance mentale
Si la fatigue physique a un impact direct sur les performances de l'athlète, la fatigue mentale ne doit pas être négligée. L'entraînement à l'endurance mentale se caractérise par l'ajout de tâches cognitives induisant de la fatigue mentale à un entraînement standard physique ou technique. Cela peut inclure des tâches de mémoire, des calculs mathématiques ou des jeux de réflexion. L'objectif est d'augmenter la capacité du cerveau à gérer la fatigue et le stress pendant des efforts prolongés, ce qui peut être utile pour des athlètes d'endurance54(*) comme les coureurs de marathon, les cyclistes et les triathlètes.
Une étude récente a été consacrée aux manifestations objectives (fatigabilité de la performance neuromusculaire) et subjectives (fatigue perçue, effort et charge de travail) de la fatigue chez des escrimeurs d'élite à la suite d'une compétition simulée en cinq reprises55(*). Il est apparu que la fatigue mentale et les efforts perçus étaient plus importants que la fatigue musculaire, incitant les auteurs de l'étude à conclure que les escrimeurs d'élite devaient augmenter l'allocation de ressources mentales à la tâche plutôt que de ressources physiques pour contrebalancer l'effet délétère de la fatigue sur la performance.
Une autre étude conduite dans le cadre du projet de recherche TrainYourBrain s'est également intéressée au phénomène de fatigue (physique et mentale) en escrime56(*). Ses résultats ont montré que même à la fin de la compétition, les altérations physiques constatées n'étaient que modérées. En revanche, les perceptions de fatigue mentale ont augmenté au cours des cinq matchs et étaient très élevées à la fin de la compétition.
Une méthode d'entraînement visant à améliorer la résistance à la fatigue mentale a alors été testée auprès de 24 épéistes des équipes de France Jeunes en s'inspirant des principes de l'entraînement à l'endurance mentale57(*). Le protocole d'entraînement d'endurance mentale comprenait quatre séances hebdomadaires, trois séances de « double tâche » et une séance intégrée à l'entraînement, pendant cinq semaines. Les séances dites de « double tâche » de 30 minutes consistaient en une tâche de pédalage couplée à un exercice cognitif réalisé sur tablette numérique. Les exercices cognitifs visaient à solliciter l'attention et le contrôle inhibiteur des athlètes pour générer une charge mentale importante.
Les séances intégrées à l'entraînement visaient quant à elles à augmenter la charge de travail cognitive lors d'une séance d'assaut en escrime. Des tâches cognitives brèves étaient réalisées à la place des temps de récupération, qui variaient de 1 à 5 minutes.
Les résultats de ce travail ont montré que les athlètes qui ont suivi cet entraînement ont une perception plus faible de leur fatigue pour une même tâche et maintiennent mieux leur niveau de performance en condition de fatigue. Leurs résultats aux tests cognitifs réalisés après la période d'entraînement ont mis en évidence une meilleure capacité à maintenir leur attention. Ils ont également montré une perception de performance plus élevée associée à un moindre niveau de frustration.
Toutefois, la charge cognitive provoquée par cet entraînement est importante. Certaines précautions doivent donc être prises au regard des risques causés par une surcharge cognitive excessive (épuisement, irritabilité, baisse de motivation...). Les auteurs du projet de recherche insistent sur la nécessité de planifier ce type d'entraînement sur une durée limitée, en évitant les périodes de compétitions intensives, ainsi que les périodes où les sollicitations scolaires, professionnelles ou personnelles peuvent être importantes pour les athlètes.
b) La préparation mentale collective
La psychologie sociale a largement investi le champ de la préparation mentale collective dans le sport.
· L'identification à l'équipe
L'identification à l'équipe constitue un pilier essentiel de la performance en sport collectif. Elle favorise la cohésion d'équipe, une meilleure communication, une compréhension mutuelle et une bonne coordination sur le terrain. Elle peut également renforcer la motivation des joueurs, développer la confiance ainsi que le soutien mutuel et aider les joueurs à surmonter les défis et les échecs.
Pour autant, l'identification à l'équipe n'est pas un phénomène statique et ne peut être encouragée que par une compréhension approfondie des mécanismes psychologiques et sociaux sous-jacents58(*).
Le projet de recherche Team Sports59(*) s'est intéressé aux facteurs qui participent à l'identification d'un joueur ou d'une joueuse à son équipe.
Il a identifié les facteurs situationnels qui, dans le cadre de vie comme dans le cadre de jeu, influencent l'identification à l'équipe. Les résultats confortent le ressenti que les éléments qui ont trait à l'équipe ou à l'engagement pour le groupe sont ceux qui favorisent le plus le fait de se sentir membre du groupe. En particulier, le sens du « Nous » s'intensifierait au gré des vécus partagés d'expériences intenses. Par conséquent, si les matchs concourent naturellement à de telles expériences, il est important d'en provoquer d'autres lors des entraînements et même au sein du cadre de vie.
En revanche, des défaites successives, des relations socio-affectives hétérogènes entre les joueurs et l'entraîneur, des contre-performances individuelles favorisent le repli sur soi. Ces constats mettent en lumière l'importance du soutien social au sein du collectif.
Les relations entraîneur/sportif et le climat motivationnel d'entraînement jouent également un rôle crucial dans la construction de l'identité à l'équipe.
· Les adaptations collectives
La recherche en psychologie du sport s'intéresse à la manière dont les joueurs s'orientent vers une stratégie collective pour faire face à des événements. Une adaptation collective particulièrement étudiée porte sur la gestion du stress60(*) pour faire face aux émotions et aux facteurs de stress communs rencontrés pendant les compétitions (rythme de jeu, niveau de l'opposition, erreurs d'arbitrage, conflits dans l'équipe, etc.).
Il apparaît que plus les individus ont des relations harmonieuses au sein du collectif, plus ils sont capables de s'adapter et de s'organiser facilement en développant une intelligence collective. La fonction des leaders est étudiée de manière approfondie car ils peuvent jouer un rôle clé dans l'initiation et la mise en oeuvre de la gestion collective du stress, mais également s'avérer de « mauvais » leaders lorsqu'ils sont soumis à un stress intense. Les études montrent que les leaders influent considérablement sur l'émotion du groupe. S'ils s'effondrent, tout le reste du groupe est affecté sur le plan psychoaffectif. L'autorégulation émotionnelle est donc une compétence clé d'un leader pour éviter la « contamination émotionnelle » de tout le groupe.
Plus généralement, la représentation traditionnelle du capitaine seul leader de son équipe sur le terrain est largement battue en brèche. Des chercheurs ont découvert que 66 % des joueurs ayant été désignés en tant que leaders n'ont pas d'influence réelle sur leur équipe61(*). Les équipes sportives les plus performantes se caractérisent par un leadership partagé entre l'entraîneur, le capitaine et les joueurs. Certains membres de l'équipe joueront avant tout un rôle motivationnel, d'autres fourniront une expertise technique ; certains s'assureront de maintenir la cohésion et l'esprit d'équipe, tandis que d'autres veilleront à établir des relations harmonieuses parmi les coéquipiers entre les matchs. Cette forme de leadership met l'accent sur le rôle des pairs comme complément important au leadership formel62(*).
La préparation au stress vise à apprendre à anticiper la réaction face au stress et à former les joueurs à certaines compétences qui vont favoriser une réponse collective efficace, notamment pour les compétences émotionnelles et relationnelles. En effet, pendant les matchs, les possibilités et la nature des interventions des entraîneurs sont très limitées. Des programmes d'entraînement mental sont ainsi développés pour amener les équipes à réfléchir aux stratégies collectives qu'elles utilisent et à celles qu'elles pourraient mobiliser pour gérer collectivement leur stress telles que l'analyse et la planification de l'action, le partage d'informations, la régulation émotionnelle interpersonnelle ou encore la re-concentration.
· Le développement de technologies au service de la psychologie sociale
Dans le cadre du projet de recherche Team Sports, plusieurs technologies ont été développées afin d'induire des états psychoaffectifs dans l'entraînement des joueurs et de mesurer en direct et de manière objective les ressentis individuels et collectifs.
Un outil utilisant la réalité virtuelle a été conçu permettant de renforcer ou de diminuer le sentiment de connexion avec l'équipe, provoquant ainsi différents états affectifs chez l'utilisateur. L'objectif est d'induire des états émotionnels pour optimiser les effets de l'entraînement mental, mais également se familiariser avec des contextes de jeu particuliers (championnats du monde, jeux Olympiques).
Une technologie de tracking vidéo mobilisant de l'intelligence artificielle a été développée pour capturer les états émotionnels des équipes. Elle permet de suivre automatiquement les indicateurs comportementaux liés à la dynamique de groupe spécifique à chaque sport, comme le langage corporel individuel et collectif des joueurs de rugby pendant un match ou la vitesse de repli défensif en handball.
Un autre instrument a été mis au point pour enregistrer le niveau de stress collectif au travers de situations de jeu comme le poids de l'essai d'un adversaire ou d'une perte de balle. À partir de modèles statistiques, l'algorithme permet de mesurer la dynamique du rapport de force psychologique sur le terrain ainsi que de comprendre et de mieux anticiper les phénomènes de contagion émotionnelle.
· Le rôle précurseur de la Fédération française de rugby en matière de préparation mentale collective
La Fédération française de rugby fait figure de précurseur pour la prise en compte de la préparation mentale collective comme facteur de performance à part entière. Depuis 2016, elle a élaboré un modèle « systémique » de la performance qui englobe la dimension mentale et dans lequel les émotions, la confiance, le leadership, la cohésion, l'identité, etc. viennent mobiliser et optimiser les facteurs de base de la performance du sportif.
Parmi les quatre pôles du département d'accompagnement à la performance mis en place par cette fédération figure le pôle Préparation mentale et accompagnement des staffs composé d'une quinzaine de personnes avec cinq missions :
- structurer la préparation mentale au sein du rugby français ;
- former et accompagner les différents staffs des équipes de France ;
- mettre à disposition des compétences et des ressources humaines liées aux différentes expertises associées à l'accompagnement mental et à la performance (recherche, accompagnement scientifique, accompagnement des collectifs, préparation mentale, formation) ;
- développer, tester et mettre en place des méthodologies et des outils de travail ;
- améliorer les connaissances dans le domaine des sciences humaines et sociales appliquées au rugby.
Dans ce cadre, une étude scientifique a été menée sur les émotions du groupe qui a fait apparaître que les émotions collectives (manière dont chaque joueur perçoit l'émotion de l'équipe en tant qu'entité) ont plus d'effets sur les performances individuelles et collectives que les émotions individuelles des joueurs.
Des normes d'expression émotionnelle ont été établies avec la collaboration des entraîneurs nationaux afin d'optimiser chez les joueurs la façon d'exprimer leurs émotions sur le terrain. Des formations visant à renforcer l'intelligence émotionnelle ont été intégrées aux programmes des rassemblements internationaux, favorisant le développement de compétences adaptatives et de stratégies collectives de régulation émotionnelle. Il s'agit de travaux en groupes pour développer les principales compétences émotionnelles (expression, reconnaissance, régulation, etc.) sur le plan individuel ainsi que surtout collectif. L'objet est de maîtriser les phénomènes de contagion émotionnelle à l'origine des « craquages sous pression ».
Une étude approfondie des temps non joués (temps de match pendant lesquels les joueurs qui sont sur le terrain ne sont pas impliqués directement dans l'action)63(*) a été réalisée. Ces temps non joués représentent 54 % du temps d'un match international. Ils revêtent une importance cruciale dans l'optimisation de la performance collective, en permettant notamment au groupe de discuter et d'ajuster la stratégie et la tactique, de partager l'information, de réguler les émotions, de rester concentré sur les objectifs immédiats et d'affirmer la maîtrise par chacun de la situation (comme lors du rassemblement des joueurs après la marque d'un essai).
6. La préparation technique et tactique
L'intégration de la technologie, depuis les dispositifs portables jusqu'aux analyses avancées grâce à l'intelligence artificielle, a révolutionné la préparation tactique et technique des athlètes.
a) Les technologies au service de l'optimisation du mouvement
· Les techniques d'analyse du mouvement
La biomécanique permet d'améliorer la performance des athlètes en identifiant les schémas de mouvement les plus efficaces. Une meilleure conscience corporelle et un ajustement précis des gestes permettent de réduire la fatigue musculaire et d'améliorer l'efficacité du mouvement64(*). L'optimisation du mouvement repose sur plusieurs principes : l'économie d'énergie, la réduction des forces inutiles et l'amélioration de l'alignement postural.
Plusieurs systèmes de capture de mouvement ont été développés pour permettre aux athlètes d'analyser leurs mouvements et d'ajuster leurs postures pour une meilleure efficacité motrice.
Les systèmes de capture optique de mouvement65(*) offrent une grande précision même pour des mouvements complexes et fournissent des données détaillées sur la position, la vitesse et l'accélération des différentes parties du corps. Ils présentent néanmoins certains inconvénients. Ils ne peuvent pas être utilisés en situation réelle : non seulement l'environnement doit être contrôlé avec des caméras calibrées66(*), mais les sportifs sont bardés de capteurs qui les empêchent d'accomplir des mouvements qui créeraient des obstructions entre les marqueurs et les caméras67(*). Par ailleurs, ces systèmes sont souvent coûteux.
D'autres systèmes de capture de mouvement sont fondés sur les technologies inertielles. Généralement portables et faciles à installer, ils occasionnent une gêne limitée pour les athlètes au cours de l'entraînement et peuvent être utilisés dans divers environnements pour des applications en direct. Ils sont également moins chers que les systèmes optiques.
L'analyse des services au volleyball à partir de capteurs inertiels
L'objectif des travaux réalisés conjointement par la plateforme CARTIGEN (CHU de Montpellier) et le Centre national de volleyball était de comprendre le geste sportif pour l'optimiser.
Ces travaux ont porté sur l'analyse de la performance au service d'une vingtaine de sportifs âgés de 17 à 21 ans. Pour chacun des joueurs, il a été demandé de réaliser 20 services avec au minimum 30 secondes de récupération entre chaque service. Pour chacun des gestes, la capture du mouvement a été réalisée à l'aide de capteurs inertiels, la vitesse des services a été mesurée avec un radar, la qualité du service a été donnée par l'entraîneur (très bien, bien, moyen, mauvais) et la position du ballon dans le terrain a été enregistrée dans un fichier Excel.
Les résultats préliminaires ont montré que les vitesses articulaires de l'épaule et du coude n'avaient que très peu d'impact sur la vitesse du ballon mais que l'essentiel de l'énergie transmise au ballon provenait du mouvement de flexion du bassin et du tronc. Ces premiers résultats ont permis aux entraîneurs d'identifier avec précision l'apport de chacune des articulations dans la production de vitesse du ballon.
Source : Gilles Dufour et al., Les capteurs inertiels dans le sport de haut niveau : application au volleyball, ACAPS 2023. Les environnements de l'activité physique et sportive, octobre 2023
Néanmoins, les centrales inertielles peuvent connaître des dérives68(*) et les erreurs peuvent s'accumuler au fil du temps. Elles nécessitent une calibration régulière pour conserver leur précision.
D'autres systèmes utilisant l'intelligence artificielle sont en train d'être développés pour générer des données sur les sportifs sans avoir besoin de les équiper de capteurs.
La start-up Chiron IT69(*) a ainsi mis au point un système d'analyse du mouvement par caméra à base d'IA et de vision par ordinateur. Au démarrage, l'utilisateur se place face à la caméra et reste statique pendant deux secondes. Lorsque l'utilisateur effectue des mouvements, le suivi précis des points articulaires du corps est réalisé par une image qui est ensuite traitée afin de recomposer le squelette humain de l'utilisateur en deux ou trois dimensions.
Dans un entretien récent70(*), Gaël Guilhem, directeur du laboratoire Sport expertise performance de l'Insep, a évoqué des outils d'intelligence artificielle permettant, à partir de vidéos et de données d'imagerie médicale d'une personne donnée, de fournir des informations sur sa vitesse de déplacement ainsi que sur les vitesses de rotation de ses bras et de ses jambes.
La vision assistée par ordinateur offre également des perspectives très prometteuses en supprimant le port de capteurs par les sportifs et en permettant d'obtenir des données individuelles et collectives pour les membres d'une équipe et leurs adversaires (cf. infra).
· La réalité virtuelle
La réalité virtuelle joue un rôle de plus en plus important dans l'optimisation des mouvements. Elle permet de capturer et d'analyser les mouvements en temps réel, offrant aux sportifs des retours immédiats pour améliorer la technique et l'efficacité des mouvements.
Elle offre un environnement sûr pour simuler des situations réelles, ce qui permet aux utilisateurs de pratiquer et de perfectionner leurs mouvements sans risque. Elle est ainsi largement utilisée par les pilotes de course pour simuler des circuits et améliorer leur temps de réaction et leurs trajectoires sans risque d'accident mais également par les skieurs pour simuler une compétition de saut à ski dans une soufflerie.
Plus récemment, le projet de recherche REVEA71(*) a développé, en coopération avec les fédérations françaises de boxe, d'athlétisme et de gymnastique, des outils d'entraînement virtuel dans ces trois disciplines.
· L'intelligence artificielle
L'IA a transformé profondément la préparation technique des sportifs car elle offre des capacités inédites pour analyser des données hétérogènes et complexes afin de personnaliser les entraînements et d'anticiper les risques de blessure.
Par exemple, dans le domaine de la course à pied, des capteurs intégrés aux chaussures peuvent enregistrer des données sur la foulée, la cadence, la force de poussée ou l'équilibre. Ces données sont ensuite analysées par un algorithme d'IA qui identifie les points d'amélioration, comme une répartition de poids inégale pouvant causer des blessures. Sur cette base, des recommandations précises sont fournies à l'athlète pour corriger sa posture et améliorer sa performance.
b) Les technologies au service de la préparation des rencontres sportives
· Les dispositifs GPS et LPS pour le suivi de la performance des joueurs et l'analyse tactique
Les dispositifs GPS (Global Positioning System) et LPS (Local Positioning System) offrent des informations relatives aux déplacements des joueurs, telles que la distance parcourue, la vitesse, l'accélération et les changements de direction. Ces données aident les entraîneurs à évaluer la performance individuelle et collective de leurs joueurs, mais également à les comparer à celle des adversaires lorsqu'ils disposent de ces données. Les données GPS et LPS peuvent également être utilisées pour analyser les schémas de mouvement des joueurs et des équipes. Cela permet aux entraîneurs de développer des tactiques plus efficaces et d'identifier des domaines à améliorer.
· L'analyse vidéo
L'analyse vidéo, surtout lorsqu'elle est associée à l'intelligence artificielle, est devenue un outil indispensable dans la préparation des matchs et des compétitions. Comme l'a fait remarquer le médecin du Racing 92, Sylvain Blanchard, lors de son audition72(*) : « Un joueur de rugby passe plus de temps en travail vidéo tactique qu'en temps d'entraînement sur le terrain ou en salle de musculation. »
En amont des matchs, l'analyse vidéo permet de comprendre les tactiques utilisées par les équipes adverses. Elle offre aux entraîneurs la possibilité de décrypter leurs schémas de jeu, d'identifier leurs forces et leurs faiblesses et d'anticiper leur stratégie. La bonne appréhension du jeu de l'adversaire est cruciale pour développer des tactiques de contre-jeu efficaces.
Au niveau individuel, l'analyse vidéo permet de déduire les métriques des joueurs adverses et aide à comprendre leurs habitudes, leurs compétences et leurs points faibles. Cette connaissance permet d'adapter l'entraînement pour préparer spécifiquement les athlètes à affronter leurs opposants directs, en mettant l'accent sur les techniques et les stratégies qui maximiseront leurs chances de succès.
La vidéo joue également un rôle clé dans la préparation mentale et tactique du collectif. En visualisant et en comprenant en détail le jeu adverse, les joueurs peuvent se préparer mentalement à ce qu'ils affronteront sur le terrain, ce qui peut augmenter la confiance et la cohésion de l'équipe.
Pendant les matchs, les analyses vidéo associées à des systèmes d'IA peuvent fournir des recommandations en matière de stratégie. Grâce à l'analyse des séquences de jeu et des mesures de performance, l'IA peut identifier des schémas et des tendances qui ne sont pas forcément visibles à l'oeil nu et aider les entraîneurs et les joueurs à prendre des décisions stratégiques et à ajuster le jeu.
Une fois le match terminé, l'analyse vidéo permet de revoir les performances des joueurs pour identifier les forces et les faiblesses. Cela inclut l'analyse des mouvements, des techniques et des décisions prises pendant le match. Les entraîneurs peuvent ainsi fournir un retour individuel aux joueurs en utilisant des séquences vidéo pour illustrer des points spécifiques. Cela aide les joueurs à visualiser ce qu'ils ont bien fait et ce qu'ils doivent améliorer. Les erreurs tactiques commises pendant le match peuvent être analysées en détail pour comprendre ce qui a mal tourné et comment les éviter à l'avenir.
L'analyse vidéo ne concerne pas uniquement les sports collectifs. Dans le cadre du projet « Très haute performance en cyclisme et aviron », le laboratoire de physique de l'ENS de Lyon a développé un outil de tracking vidéo portable permettant d'accéder à la vitesse instantanée de tous les cyclistes et de calculer la puissance fournie par tous les coureurs, notamment celle des adversaires de l'équipe de France. Il a ainsi été constaté que la puissance fournie par les athlètes français était 100 à 110 watts inférieure à celle fournie par leurs concurrents hollandais.
En partenariat avec la Fédération française de tennis de table, l'école Centrale Lyon a développé à partir de vidéos filmées pendant les compétitions et grâce à l'intelligence artificielle un dispositif d'analyse automatisée des matchs permettant de détecter les événements de jeu (type de coup effectué, effet donné à la balle, zone de rebond sur la table, position du joueur, etc.) et d'identifier les schémas de jeu (enchaînements de coups). L'objectif était de fournir des données sur les adversaires des sportifs français pour comprendre leurs points forts et leurs points faibles (fautes en coup droit, en revers, types de service) et d'essayer d'identifier des schémas de jeu gagnants et perdants extraits de l'analyse de précédentes rencontres des futurs adversaires des pongistes français.
7. L'attention accrue portée par la recherche à la santé mentale des sportifs de haut niveau
La santé mentale des athlètes a longtemps été un tabou et reste un sujet sensible en dépit des prises de parole médiatiques de certains sportifs de haut niveau et des efforts entrepris par les organisations sportives internationales pour déstigmatiser les troubles psychiques.
Entre 2013 et 2020, treize positions de consensus scientifique sur la santé mentale dans le sport ont été publiées73(*), et de nombreuses recherches scientifiques s'intéressent aux facteurs socio-environnementaux les plus déterminants pour la santé mentale des athlètes. La situation socioprofessionnelle joue en particulier un rôle primordial74(*). La santé mentale des athlètes est particulièrement vulnérable à certaines périodes charnières comme le départ de la maison pour entrer dans une structure d'entraînement ou la fin de la carrière sportive75(*). D'autres facteurs peuvent impacter la santé mentale comme les blessures physiques, le surentraînement, la pression constante liée à la performance, le harcèlement, les attentes des entraîneurs et des médias, les sponsors, la famille. Les athlètes pratiquant des sports artistiques, des sports ayant des catégories de poids ou des sports d'endurance sont particulièrement ciblés par ces recherches.
Une attention particulière doit être portée aux éventuels troubles du comportement alimentaire chez les mineurs, en particulier chez les mineures, 45 % d'entre elles étant touchées selon certaines études.
Les troubles mentaux chez les sportifs de haut niveau ne doivent pas non plus être sous-estimés, même si, selon les études, les résultats sont très contrastés.
Quant aux troubles du sommeil, ils toucheraient entre 49 et 64 % des sportifs de haut niveau selon les études.
Une étude76(*) réalisée en 2011 par l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes) auprès de plus de 2 000 athlètes français aboutissait aux résultats suivants : 12,1% déclaraient avoir déjà eu des troubles anxieux ; 11,3% des troubles dépressifs ; 7,5% des troubles du comportement ; 26,6% des troubles du sommeil ; 4,1% des consommations abusives de substances (alcool, compléments alimentaires, tabac, etc.). Des différences notables entre sportifs et sportives étaient constatées selon les symptômes. Ainsi, 11,2% des sportives étaient concernées par au moins un trouble alimentaire, contre 5,5% des sportifs. 16,3% des sportives avaient connu au moins un épisode de dépression contre 8,7% des sportifs.
Un autre résultat marquant porte sur les relations entraîneurs/sportifs qui jouent un rôle déterminant dans la santé mentale des athlètes. Cette relation peut parfois s'accompagner d'un phénomène d'emprise constaté en particulier dans les sports dans lesquels les athlètes sont très jeunes et les sports qui mettent en avant la force (boxe, lutte, judo).
Plusieurs projets de recherche sur cette thématique sont financés par des fonds européens. Le projet de recherche MENTIS sur le rôle de l'entourage sur la santé mentale du sportif de haut niveau s'est achevé en 2024. Le projet EURPHORIA (2025-2027) vise à mettre en place un cadre européen pour la promotion de la santé mentale dans les organisations sportives à partir d'une enquête quantitative et qualitative réalisée auprès de dirigeants d'organisations sportives. Un guide de bonnes pratiques sera réalisé à destination des organisations sportives et sera testé en conditions réelles dans une ou deux organisations. Quant au projet PORTAL, il a vocation à soutenir la santé mentale des athlètes de haut niveau en transition de fin de carrière. Une étude de la littérature scientifique et des besoins des sportifs sera réalisée, des contenus pour faciliter cette période de transition seront créés, et une plateforme numérique leur sera consacrée.
D. LES EFFETS NÉFASTES DE LA « TECHNOLOGISATION » DES PERFORMANCES DANS LE SPORT
1. Le renforcement des inégalités
La science et les technologies sont devenues incontournables dans le domaine du sport de haut niveau, offrant des outils et des innovations sans précédent pour améliorer la performance des athlètes.
Néanmoins, le poids croissant de la science et des technologies dans l'amélioration des performances des sportifs de haut niveau risque de renforcer les inégalités au sein du monde sportif.
· Les inégalités entre les nations et les clubs
Une étude de 201677(*) a mis en lumière une corrélation entre le nombre de publications scientifiques ayant trait aux jeux Olympiques et le nombre de médailles obtenues. Ainsi, les trois nations ayant publié le plus d'articles scientifiques sur des sujets relatifs aux jeux Olympiques (les États-Unis avec 709 articles, la Chine avec 516 articles et le Royaume-Uni avec 435 articles) sont également les États ayant obtenu le plus de médailles aux jeux Olympiques de Rio (respectivement 121, 70 et 67).
Actuellement, seuls les grands clubs, les nations les plus développées et les structures bien financées peuvent bénéficier des innovations les plus avancées. Cela risque de creuser le fossé entre les compétiteurs, en offrant un avantage à ceux qui disposent des outils les plus performants.
Lors de son audition78(*), Olivier Maurelli, responsable de la cellule Recherche et performance à la Fédération française de handball, s'est inquiété du retard pris par le handball français dans l'utilisation des données.
Comme tous les sports collectifs se déroulant à l'intérieur d'une salle, le handball doit faire appel à la technologie du Local Positioning System (LPS) conçue pour fonctionner dans des environnements dans lesquels les signaux GPS ne peuvent pas pénétrer. Concrètement, des balises sont placées à des emplacements fixes tout autour du terrain et émettent des signaux identifiés par les capteurs portés par les joueurs. Les données sont ensuite envoyées à un système central qui calcule en temps réel la position des joueurs et permet de déduire des informations particulièrement utiles aussi bien pour l'entraînement que pendant les matchs grâce à l'analyse des mouvements des joueurs et l'évaluation de leurs performances individuelles. Les données recueillies servent notamment à améliorer l'entraînement et optimiser les stratégies. Néanmoins, le handball français se heurte aux coûts financiers liés à l'acquisition de cette technologie. Son coût d'installation s'élève à 40 000 euros, auxquels il faut ajouter 15 000 euros pour une vingtaine de balises. Par ailleurs, le recrutement d'un data scientist pour collecter les données, les traiter et les vulgariser à destination des entraîneurs représente un coût supplémentaire compris entre 25 000 et 30 000 euros net.
Selon Olivier Maurelli, l'Allemagne et le Danemark, qui se sont lancés dans l'équipement systématique en LPS de leurs clubs professionnels de handball, observent des résultats concrets dans l'amélioration des performances de leurs joueurs.
Compte tenu du coût de la technologie LPS, la Fédération française de handball étudierait la piste de la vision assistée par ordinateur. Concrètement, le dispositif envisagé s'appuierait sur deux caméras pour filmer l'intégralité du terrain à partir de plusieurs focales et permettrait aux algorithmes de détecter l'ensemble des joueurs et de fournir des données physiques (distances parcourues, vitesses) et des données sur le jeu (possession de balle, nombre de passes, temps forts et temps faibles, schémas tactiques préférentiels, etc.).
· Les inégalités entre hommes et femmes
Les inégalités entre les femmes et les hommes sont fortement ancrées dans le sport. S'il a fallu attendre 1934 pour que les femmes puissent participer aux jeux Olympiques et 1984 pour qu'elles puissent participer au marathon dans le cadre des jeux Olympiques, les inégalités salariales restent très fortes tandis que le sport féminin est beaucoup moins médiatisé que le sport masculin, ce qui a un impact direct sur leur visibilité et, par conséquent, sur les opportunités de financement et de soutien.
Les sciences du sport s'intéressent également moins aux femmes qu'aux hommes. Sur les cinq dernières années, 9 % des études portaient exclusivement sur les femmes contre 71 % exclusivement sur les hommes79(*).
La plupart des protocoles médicaux, nutritionnels et d'entraînement que les sportives suivent sont en fait conçus pour les hommes. L'étude de la performance sportive chez les femmes a longtemps été inexistante et seuls des hommes étaient sélectionnés pour faire les tests afin d'enlever tous les biais méthodologiques liés aux réponses hormonales.
Des lacunes dans les connaissances sur les femmes sportives
« Bien que les athlètes féminines représentent environ 50 % de la population, il existe un manque de connaissances dans des domaines tels que la performance sportive, la santé cardiovasculaire, la santé musculo-squelettique, la physiologie post-partum et la recherche sur l'allaitement. Il est essentiel de favoriser la diversité tant au sein des cohortes de participants que des équipes de recherche. Cela implique notamment de concevoir des études expérimentales tenant compte des spécificités physiologiques féminines et d'élaborer des recommandations fondées sur des données probantes et adaptées aux sportives. Il est également nécessaire de mener des analyses distinctes afin de prendre en compte les différents mécanismes explicatifs des blessures ou des problèmes de santé chez les hommes et les femmes. Des recommandations d'entraînement physique spécifiques au sexe peuvent contribuer à améliorer l'adhésion et les réponses physiologiques dans les populations cliniques. Cependant, les femmes restent sous-représentées dans la recherche sur les sports récréatifs et de compétition, ce qui reflète leur sous-représentation dans les domaines de la santé et des maladies. Il est essentiel de remédier à ce problème pour soutenir la performance et la sécurité des femmes dans le sport. »
Source : Extrait de l'article d'Anderson et al., « Under-representation of women is alive and well in sport and exercise medicine: what it looks like and what we can do », BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 9, 2023. Traduit avec DeepL.com (version gratuite).
Les recherches en sciences du sport se focalisent souvent sur les facteurs influençant la performance dans le but d'individualiser l'entraînement des athlètes pour optimiser leur performance.
Or, les spécificités féminines, comme les fluctuations hormonales liées au cycle menstruel, n'ont pas encore été intégrées dans ces recherches. Cela engendre un important défaut dans l'individualisation de l'entraînement des femmes.
La question des cycles menstruels était taboue jusqu'à très récemment sous la conjonction de deux phénomènes. D'une part, le personnel encadrant les sportives reste masculin dans sa grande majorité et peu sensibilisé à ces questions. D'autre part, le milieu du sport de haut niveau tend à véhiculer des valeurs liées à la force, à la résilience, au courage, à la résistance à la douleur et à la fatigue, qui n'incitent pas les sportives à faire part de leurs gênes et de leur souffrance. Pourtant, divers facteurs de la performance, comme la force, l'endurance, la raideur ligamentaire, le sommeil ou la nutrition, sont sous influence des variations hormonales et on a pu mesurer une différence de 8 % de réaction à l'effort lors d'un entraînement à un moment optimal et à un moment moins optimal du cycle.
Les différences intersexes en termes de composition corporelle et de métabolisme énergétique sont importantes. Les spécificités hormonales vont influencer la croissance et la maturation, la masse adipeuse et la masse musculaire, les réserves énergétiques et les activités métaboliques et vont fortement conditionner la performance80(*).
L'influence de la composition corporelle sur la performance dans le cadre d'exercices de type explosif et d'endurance
Dans les exercices brefs et intenses tels que les sauts, les sprints ou les lancers, les performances des hommes sont supérieures à celles des femmes.
Ces différences de performance ne semblent pas être liées à des différences métaboliques. En effet, les réserves en substrats utilisés lors de ce type d'effort (l'adénosine triphosphate, la phosphocréatine et le glycogène) ne sont pas différentes entre les hommes et les femmes pour un même âge et un même niveau d'entraînement.
En revanche, la comparaison de la composition corporelle des hommes et des femmes fait apparaître de vraies différences : un homme de 70 kg a une masse adipeuse en moyenne de 8,4 kg, soit 12 % de son poids corporel, et une masse musculaire de 28 kg, soit 40 % de son poids. En comparaison, une femme de 55 kg n'aura que 19 kg de muscles (soit 35 % de son poids corporel) et 11,6 kg de masse adipeuse, soit 21 % de son poids de corps. Ce surplus de masse adipeuse chez la femme génère un réel inconvénient pour des activités de type explosif.
La composition corporelle est fortement influencée par les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles féminines (oestrogènes et progestérone) favorisent le stockage d'IGF-1, ce qui confère à la femme un taux supérieur de masse grasse. Cela se manifeste dès l'âge de 11-12 ans. À l'inverse, le taux de masse maigre est supérieur chez les garçons, et c'est la testostérone qui favorise cette prise de masse musculaire qu'on peut voir à partir de 12-13 ans.
L'influence des hormones sexuelles va donc conditionner le morphotype de l'athlète. Il est évident que l'homme a une composition corporelle avantageuse, avec un rapport poids/puissance qui est optimal pour les efforts d'explosion.
En ce qui concerne les épreuves d'endurance, voire d'ultra-endurance, il faut rappeler que les femmes ont commencé à participer à des épreuves de longue durée très tard, sous prétexte que ces épreuves étaient trop dangereuses pour elles.
Actuellement, le record féminin pour le marathon est attribué à la Kenyane Ruth Chepngetich en 2 heures 9 minutes et 56 secondes. Chez les hommes, le record est détenu par le Kenyan Kelvin Kiptum en 2 heures 0 minute et 35 secondes. Sur de longues distances, on observe que l'écart entre hommes et femmes se réduit au fur et à mesure que la distance s'allonge. Lors d'une course de 90 km, les femmes auraient la capacité de maintenir plus longtemps un pourcentage élevé de VO2max et conserveraient plus facilement leur allure optimale de fin de course.
Est-ce que les femmes pourraient un jour franchir la ligne d'arrivée avant les hommes ? En 2006, la Chambérienne Corinne Favre est arrivée en tête lors de la première course Courmayeur-Champex-Chamonix, une course de 100 km avec 6 000 mètres de dénivelé. En 2022, sur la Diagonale des Fous (165 km avec plus de 10 000 mètres de dénivelé), Courtney de Walter s'est classée quatrième. La course à vélo transcontinentale (de Sofia en Bulgarie à Brest) a été remportée en 2019 par une femme.
Pour expliquer les performances féminines sur de très longues distances, il convient de s'intéresser au métabolisme énergétique. La femme possède une surface de fibres de type 1 supérieure, une meilleure capillarisation et une meilleure flexibilité métabolique pour une capacité importante à utiliser les lipides en tant que substrat énergétique pour fournir de l'ATP. Si l'on mesure le quotient respiratoire à l'exercice et le rapport entre le volume rejeté en CO2 et la consommation d'oxygène, celui-ci est toujours inférieur chez la femme, ce qui témoigne d'une oxydation lipidique plus importante. Cette adaptation permet à la femme d'épargner les stocks en glycogène et donc une moindre fatigue sur des longues distances, favorisant ainsi un maintien d'un haut potentiel sur le long terme.
L'utilisation majorée des graisses à l'effort chez la femme est liée à des réserves en triglycérides au niveau adipeux supérieures chez elles à celles des hommes. Elles sont également plus utilisées à l'exercice, de même que les acides gras libres qui se trouvent au niveau sanguin. Ces adaptations sont liées au rôle de la 17-bétaestradiol qui fait partie des oestrogènes.
Des études récentes prennent en compte les spécificités féminines. Le projet de recherche EMPOW'HER81(*) est mené par le pôle Performance de l'Insep en collaboration avec plusieurs fédérations françaises82(*). Il vise à maximiser les performances des athlètes féminines élites en optimisant leurs réponses à l'entraînement par des charges de travail adaptées, en synergie avec leur physiologie et leur cycle menstruel. Ce projet s'articule autour de trois axes :
- un suivi longitudinal multiparamétrique des variations des réponses aux charges d'entraînement et de compétition ;
- le suivi des sportives de haut niveau en parallèle de leur charge d'entraînement et de leurs compétitions ;
- la création et la validation de préconisations d'individualisation de l'entraînement à partir des profils et des réponses aux charges identifiées.
Les efforts de sensibilisation du milieu sportif aux spécificités physiologiques féminines et à leur impact sur leur bien-être et leur performance devront être poursuivis et accentués.
À l'issue des jeux Olympiques de Paris, un sondage réalisé auprès des sportives y ayant participé a constaté que 93 % d'entre elles estimaient important d'être accompagnées sur le sujet, mais qu'une sur deux reconnaissait n'avoir eu aucun accompagnement spécifique dans le cadre de leur préparation.
2. Une surveillance des athlètes et une pression psychologique accrue
Fréquence cardiaque, température corporelle, saturation en oxygène, durée et intensité des séances, niveau de fatigue : les données collectées tout au long de la journée auprès des athlètes donnent d'importants renseignements sur leurs conditions physiques, leurs performances athlétiques, voire leur état de santé.
Les athlètes peuvent se sentir constamment surveillés, sachant que chaque performance et chaque mouvement sont enregistrés et analysés. Cela peut mener à un sentiment d'intrusion dans leur vie privée et à une perte d'autonomie.
Comme l'a résumé une des personnes auditionnées : « Pour certains athlètes, la donnée fait aussi peur qu'elle rassure : dans une compétition exacerbée pour les places en sélection des jeux Olympiques, ils craignent de révéler une douleur ou une blessure. »
En outre, le fait que chaque aspect de leur performance soit mesuré peut augmenter le stress et l'anxiété des sportifs. Ils peuvent ressentir une pression accrue pour performer constamment à leur meilleur niveau, ce qui peut être psychologiquement épuisant. La crainte de ne pas atteindre les objectifs fixés par les données peut créer de l'anxiété. Les athlètes peuvent redouter que des performances inférieures aux attentes ne mènent à des conséquences négatives, comme une réduction du temps de jeu. Enfin, une dépendance excessive aux données peut mener à une perte de confiance en leurs propres sensations et instincts et faire douter les athlètes de leurs capacités naturelles.
La collecte massive des données personnelles des sportifs pose également la question de la protection des données personnelles.
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit six fondements juridiques qui permettent de mettre en oeuvre un traitement licite83(*). Le premier porte sur le consentement de la personne concernée, qui doit être libre, éclairé, spécifique et univoque, et encore plus strict lorsqu'il s'agit de données dites sensibles, comme les données de santé. Ainsi, la Cnil rappelle que le port d'un capteur lors des entraînements et compétitions officielles repose sur l'assentiment du sportif. Dans la réalité, le consentement libre et éclairé peut être biaisé compte tenu de la très forte concurrence entre les athlètes et de leur dépendance vis-à-vis des fédérations, des clubs ou des sponsors. Le sportif peut alors renoncer, consciemment ou non, à ses droits, dans l'espoir de préserver ses chances de performances et sa carrière. La pression structurelle du système sportif brouille ainsi les frontières entre les choix personnels et les obligations implicites.
Par ailleurs, les fédérations, mais également l'Insep, peuvent fonder la collecte des données sur leur mission d'intérêt public84(*). Généralement, les joueurs signent un contrat pour que l'on puisse utiliser leurs données (contrat de cession).
Néanmoins, le traitement de certaines données par l'intelligence artificielle peut fournir des indications sur la santé des athlètes, et notamment identifier des risques de blessures. C'est la raison pour laquelle de nombreux juristes ont été impliqués dans la mise en place de l'Athlete management system de l'Insep afin de garantir la protection du secret médical et de se plier aux exigences du RGPD.
La collecte des données soulève également la question de leur conservation et de la souveraineté des solutions. Ainsi, les données des outils utilisés couramment (Team HRV, OURA, Kinnexon, etc.) sont analysées et transformées en utilisant des algorithmes et des logiciels qui restent la propriété exclusive de ces entreprises et ne sont pas publics. Or, l'absence d'accès aux signaux bruts et aux algorithmes appliqués empêche les fédérations sportives de vérifier la fiabilité des informations restituées et crée de fait une dépendance stratégique.
Dans les faits, les données des athlètes français enrichissent les bases de données des entreprises étrangères qui s'en servent pour améliorer leurs produits ensuite commercialisés à l'échelle mondiale. Par ailleurs, l'absence de contrôle sur ces données particulièrement sensibles fait courir un risque réel de diffusion d'informations stratégiques aux équipes concurrentes de la France ayant la même nationalité que ces entreprises (essentiellement australiennes et américaines). Face à ce danger, certains pays, comme les Pays-Bas, ont imposé auxdites entreprises des cadres juridiques plus protecteurs et des exigences contractuelles plus strictes. En France, l'absence d'un modèle souverain cohérent et un rapport de force défavorable pour le monde sportif vis-à-vis de ces entreprises en raison de l'émiettement des demandes85(*) aboutissent à un modèle économique dans lequel il faut payer pour accéder à ses propres données, sans garantie de transparence et avec le risque de fuite vers les concurrents.
3. La technologisation de la performance au détriment de la santé des athlètes ?
Que ce soit les clubs ou les fédérations, tous mettent en avant le rôle de la science pour améliorer les performances des sportifs tout en réduisant le risque de blessures par un suivi individualisé aussi bien pendant les entraînements que pendant les matchs.
a) La science au service du « sport spectacle »
Toutefois, en contribuant à repousser les frontières physiques et psychiques humaines, la science ne contribue-t-elle pas au développement du « sport spectacle » au détriment de la santé des sportifs ?
L'accompagnement scientifique des sportifs a permis de surcharger les calendriers des compétitions, comme en témoignent les trois exemples suivants.
Pour la saison 2024-2025, les footballeurs du Paris Saint-Germain ont participé à 31 matchs de Ligue 1, 6 matchs pour la Coupe de France, un match pour le Trophée des champions, 10 matchs pour la UEFA Champions League et 8 matchs pour la FIFA Club World Cup, soit plus de 50 matchs.
Les rugbymen du Stade toulousain ont participé à 33 matchs dans le cadre du Top 14 et de la Coupe d'Europe de rugby à XV, sans compter les 5 matchs du Tournoi des six nations auxquels ont participé les 13 joueurs du Stade toulousain sélectionnés dans le XV de France.
Les joueurs du Montpellier Handball ont participé à 58 matchs entre août 2024 et juin 2025, sans compter les matchs des jeux Olympiques de l'été 2024 et ceux de la Coupe du monde entre janvier et février 2025 pour les six joueurs du Montpellier Handball sélectionnés dans l'équipe de France masculine.
Dans un podcast récent86(*), Olivier Maurelli, responsable de la cellule R&D à la Fédération française de handball a expliqué qu'entre janvier 2024 et juin 2025, les joueurs de l'équipe masculine de France ont participé aux championnats d'Europe (janvier 2024), aux jeux Olympiques (été 2024) et aux championnats du monde (janvier 2025), en plus des matchs des championnats de France et de la Ligue européenne de handball, ce qui ne leur a pas permis de prendre plus d'une semaine de repos en près d'un an et demi de compétition.
Dans un autre domaine, les changements rendus possibles par la science dans la préparation physique et la nutrition ont conduit à une transformation physique significative des athlètes. Les rugbymen sont devenus plus grands et plus lourds. Par exemple, les trois-quarts centres, qui pesaient en moyenne environ 84 kg dans les années 1980, ont vu leur poids augmenter de manière significative, avec des joueurs atteignant plus de 100 kg, auxquels on demande de combiner rapidité et puissance. Les changements de morphologie augmentent l'intensité des chocs et conduisent à une incidence élevée de blessures. Des études rapportent des taux de blessures au rugby allant de 83,9 à 90,1 blessures pour 1 000 heures de jeu, avec une augmentation notable des blessures pendant les derniers quarts de matchs pendant lesquels la fatigue est plus prononcée.
On peut donc se demander si les espoirs mis dans la science pour prévenir et mieux traiter les blessures n'ont pas pour effet de conduire le monde du sport à s'exonérer d'une réflexion sur l'évolution des pratiques et, dans le cas du rugby notamment, sur le fait que le corps humain n'est pas fait pour encaisser de tels impacts.
b) Une prévention et une gestion des commotions cérébrales encore insuffisantes
En France, les commotions cérébrales restent encore mal connues dans le sport de haut niveau. Selon l'Insep, on estime à 200 000 par an le nombre de commotions cérébrales toutes disciplines confondues, mais il n'existe pas de recensement officiel généralisé. Au rugby, il y aurait une commotion cérébrale tous les deux matchs pour une équipe professionnelle. Au football, 19 à 25 % des buts sont marqués de la tête dans les compétitions internationales. Une commotion cérébrale intervient tous les 50 à 70 matchs87(*).
· Une reconnaissance tardive des conséquences à long terme des commotions cérébrales
Les commotions cérébrales sont des lésions traumatiques du cerveau dues à un choc direct au niveau de la tête, du cou ou de n'importe quelle autre partie du corps, induisant une force impulsive sur le cerveau. Cet impact entraîne des altérations biologiques qui sont à l'origine d'altérations fonctionnelles neuronales dont les manifestations cliniques peuvent survenir dès l'impact initial ou après quelques minutes ou quelques heures et se résolvent souvent spontanément dans les jours qui suivent.
La commotion est protéiforme : mal de tête, vertige, troubles de la vision, difficulté de concentration et de mémoire, amnésie, troubles de l'équilibre, démarche titubante, difficultés à se remettre debout, manque de coordination, confusion, somnolence. La perte de connaissance n'intervient que dans 15 % des cas. Les commotions cérébrales ont longtemps été sous-évaluées car il s'agit de blessures invisibles. Comme le faisait remarquer l'une des personnes auditionnées : « Il n'y a rien de cassé, il n'y a pas de sang. » Les études de neuro-imageries n'identifient pas systématiquement des lésions structurelles ou des anomalies.
Le risque majeur encouru par le sportif s'il n'interrompt pas son activité physique en cas de commotion est le syndrome du second impact. Lorsqu'un nouvel impact survient alors que les symptômes de la première commotion n'ont pas disparu, un oedème cérébral diffus peut se créer entraînant de graves séquelles, voire la mort.
Par ailleurs, à la suite d'une ou de plusieurs commotions cérébrales, des syndromes post-commotionnels peuvent persister au-delà de la période de récupération habituelle. Ces symptômes peuvent inclure des maux de tête, des étourdissements, des troubles de la concentration, des problèmes de mémoire, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil et une sensibilité à la lumière et au bruit. Longtemps, ces symptômes (en particulier le mal de tête, la sensibilité au bruit et à la lumière) ont été ignorés par les athlètes les plus à risque88(*) car ils n'étaient guère compatibles avec la culture viriliste à laquelle ils sont confrontés, centrée sur le muscle et la puissance, dans laquelle la douleur fait partie intégrante de la performance et le mal de tête et la dépression sont plutôt associés au genre féminin.
Les recherches sur le syndrome post-commotionnel prolongé ont fait apparaître que le fait d'être du sexe féminin, le nombre d'antécédents de commotion, la survenue d'une autre commotion le jour même, l'absence de sortie immédiate du terrain, le nombre important de symptômes dans les premières 72 heures, la présence d'une amnésie rétrograde et/ou antégrade sont autant de facteurs de risque qui majorent le risque de signes commotionnels persistants.
Enfin, les commotions cérébrales peuvent avoir des effets sur le vieillissement avec l'apparition de maladies neurodégénératives comme l'encéphalopathie chronique traumatique (ECT). Les symptômes de cette maladie peuvent inclure des changements de comportement, des troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire et de cognition, ainsi que des symptômes moteurs similaires à ceux de la maladie de Parkinson. Les symptômes peuvent apparaître des mois ou des années après les traumatismes crâniens répétés. Toutefois, le diagnostic définitif de l'encéphalopathie chronique traumatique ne peut être posé qu'après un examen post mortem d'un échantillon du tissu cérébral, au microscope, car l'ECT ne cause pas d'anomalie macroscopique visible.
Si la boxe89(*) a été reconnue relativement tôt comme traumatogène pour le cerveau, il a fallu attendre les années 1990 pour que le caractère potentiellement dommageable pour le cerveau d'autres sports comme le football américain, le hockey sur glace ou la lutte, fasse l'objet d'un nombre croissant de publications aux États-Unis.
En 2002, le docteur Bennet Omalu, médecin légiste et co-fondateur du Barin Injury Research Institute, identifie l'encéphalopathie chronique traumatique dans le cerveau de l'ancien centre des Pittsburgh Steelers, Mike Webster, 50 ans, qui s'est suicidé90(*). En 2012, 4 500 anciens joueurs lancent une plainte collective contre la Ligue professionnelle de football américain (NFL), qu'ils accusent d'avoir dissimulé les risques des commotions cérébrales sur leur santé. Pour éviter un procès, la Ligue a accepté un accord prévoyant le versement aux victimes d'un milliard d'euros sur une durée de 65 ans.
À la fin de l'année 2023, plus de 200 anciens joueurs de rugby internationaux, affirmant souffrir de lésions cérébrales, ont assigné en justice World Rugby et les fédérations anglaise et galloise pour mettre en cause leur responsabilité dans leur état de santé.
Une étude rétrospective des causes des décès des joueurs de football américain portant sur plus de 3 000 cas montre que leur espérance de vie est plus longue que celle de la population générale. En revanche, le taux de décès de cause neurologique est trois fois plus important que celui observé dans la population générale et l'incidence des maladies d'Alzheimer et de Charcot est quatre fois plus élevée que dans la population générale.
En 2019, une étude91(*) a démontré le lien entre football professionnel et maladies neurodégénératives en étudiant les causes de décès chez les joueurs de football professionnels. En 2022, une étude92(*) comparable a été publiée concernant 9 693 joueurs de football professionnels français décédés entre 1950 et 2012, puis une étude suédoise93(*) portant sur 6 007 footballeurs suédois (dont 510 gardiens de but).
Ces trois publications présentent les mêmes éléments conclusifs : le joueur de football professionnel a une sous-mortalité globale par rapport à la population générale (notamment concernant les pathologies cardiovasculaires et les cancers pulmonaires) et une espérance de vie allongée. Mais le risque de mortalité par maladie neurodégénérative est multiplié par 1,46 chez les Suédois, 2,33 chez les Français et 3,45 chez les Écossais pour les anciens footballeurs professionnels. Le risque de démence d'Alzheimer est multiplié par 1,62 chez les Suédois, 4,08 chez les Français et 5,07 chez les Écossais.
Dans l'étude suédoise, les chercheurs ont pu distinguer entre les gardiens de but et les autres joueurs : les gardiens, qui ne se servent pratiquement jamais du jeu de tête, semblent épargnés par les maladies neurodégénératives, laissant entendre que les impacts répétés à la tête lors du jeu de tête pourraient avoir une grande part de responsabilité dans la genèse des maladies neurodégénératives, même si cette hypothèse n'a pas encore été démontrée.
Ces études soulèvent également la question des subcommotions94(*), dont les implications potentielles à long terme sur la santé cérébrale sont de plus en plus reconnues. Les subcommotions répétées, même si elles sont légères, peuvent avoir un effet cumulatif sur la santé du cerveau. Les subcommotions peuvent provoquer une inflammation du cerveau et des dommages aux cellules nerveuses, ce qui peut contribuer au développement de maladies dégénératives. Les traumatismes crâniens répétés sont associés à une accumulation de la protéine tau dans le cerveau, un marqueur caractéristique de l'encéphalopathie chronique traumatique. Or, il a été calculé que dans le football américain, un joueur moyen en National Football League reçoit en moyenne 1 000 coups de tête par an tandis qu'un joueur de football peut faire jusqu'à 1 500 têtes par an selon la position qu'il occupe.
Une étude95(*) menée par des chercheurs hollandais a évalué les performances cognitives de 84 footballeurs professionnels. Elle a constaté que les joueurs qui occupaient les positions d'arrière, plus soumis aux têtes répétées, obtenaient de moins bons résultats aux tests mesurant la vitesse d'exécution. Les mêmes chercheurs ont également évalué 53 joueurs professionnels en activité à qui ils ont fait passer des tests neuropsychologiques ainsi qu'une population d'athlètes pratiquant des sports sans contact96(*). Les tests mesurent la vitesse d'exécution. La mémoire visuelle était d'autant plus altérée que les joueurs avaient subi des commotions, et il existait comme dans l'étude précédente une corrélation en fonction du poste et du nombre de têtes. Il convient de remarquer que les joueurs en activité ne se plaignaient d'aucun trouble cognitif.
· Une gestion des commotions cérébrales variable selon les clubs, les disciplines et les niveaux de performance
Dans le rugby, plusieurs protocoles ont été successivement mis en place pour prendre en charge les commotions cérébrales des joueurs professionnels. Ces protocoles sont réévalués et complétés régulièrement.
Depuis 2012, un protocole commotion a été instauré pour permettre au corps médical d'examiner chaque joueur susceptible d'avoir subi une commotion cérébrale pendant une rencontre.
Trois questionnaires baptisés HIA (Head Injury Assessment) et comprenant notamment des tests de mémoire et d'équilibre sont prévus. Le HIA 1 est réalisé immédiatement au bord du terrain pour autoriser ou interdire le retour du joueur dans le match. Dans les trois heures qui suivent, le HIA 2 permet au médecin de réévaluer l'examen neurologique. Enfin, un nouvel examen par un neurologue (HIA 3) est prévu entre 48 heures et 72 heures après la blessure. Si la commotion est confirmée, le joueur a l'obligation de prendre une période de 12 jours minimum de repos. La date et les modalités de reprise de l'activité sont décidées par un consultant indépendant commotion cérébrale (ICC).
Le Protocole HIA est soutenu électroniquement par l'application Specialised Concussion Rugby Management (SCRM). L'application SCRM est utilisée par World Rugby pour le processus HIA dans le cadre des compétitions et permet l'enregistrement standardisé des évaluations HIA (de référence et après l'impact à la tête), des étapes et des évaluations individualisées de la rééducation, et de la consultation d'un consultant indépendant en commotion cérébrale si nécessaire.
Un observatoire des commotions cérébrales a également été créé afin de repérer les commotions cérébrales qui seraient passées inaperçues lors des rencontres du XV de France, du TOP 14 et de PRO D2 : chaque match est analysé dès la fin du week-end par un observateur indépendant qui remplit une fiche d'observation recensant les différents événements qui pourraient avoir provoqué une commotion cérébrale. Les informations sont ensuite centralisées. S'il y a doute sur une potentielle commotion cérébrale non vue durant la rencontre, un courrier est adressé au médecin de l'équipe du joueur concerné pour réaliser un diagnostic. Cet observatoire permet également de vérifier que les examens imposés (HIA 1, HIA 2 et HIA 3) sont bien enregistrés dans la base de données SCRM.
Un système de surveillance vidéo des joueurs a été mis en place dans lequel un médecin indépendant des deux équipes peut, en cas de suspicion de commotion cérébrale, avertir directement l'arbitre afin qu'il fasse sortir le joueur concerné pour être examiné. D'abord limité aux matchs du XV de France et du TOP 14, ce système a ensuite été étendu aux matchs de PRO D2.
En 2023, World Rugby a décidé d'imposer dans les compétitions élites et les championnats professionnels des protège-dents instrumentés97(*) qui détectent les impacts à la tête. En cas de suspicion de commotion cérébrale, le joueur est sorti du terrain pour examen.
Un important effort de sensibilisation est également réalisé auprès des joueurs, des entraîneurs, des médecins et des arbitres. À l'heure actuelle en France, le rugby est la discipline sportive dans laquelle la gestion des commotions cérébrales est la plus aboutie. Il a fallu néanmoins plus de 20 ans pour que cet ensemble de règles soit élaboré et respecté par les joueurs professionnels, même si certains progrès restent à faire98(*).
Le taux d'incidence des commotions cérébrales semble néanmoins en augmentation chez les professionnels, en particulier en TOP 14.
Source : Observatoire des commotions cérébrales
La Fédération française de rugby a également mis en place un protocole « commotion cérébrale » pour le rugby amateur.
Le « carton bleu » a fait son apparition lors de la saison 2017-2018 dans les compétitions de Fédérale 1 et Top 8 féminin ; à partir de la saison 2019-2020, il a été appliqué à toutes les compétitions fédérales et régionales.
Le carton bleu est donné à un joueur ou une joueuse lorsqu'un arbitre détecte un ou plusieurs signes évidents de commotion cérébrale ou suspecte une commotion cérébrale.
L'attribution d'un carton bleu entraîne la sortie définitive de l'aire de jeu.
Les signes de commotion cérébrale peuvent également être portés à la connaissance de l'arbitre par tout officiel de match. De même, l'encadrement technique peut décider de sortir définitivement de l'aire de jeu tout joueur montrant des symptômes de commotion.
Le signalement d'un carton bleu entraîne de facto, à compter du lendemain de la rencontre, un blocage de la licence sur le logiciel fédéral, un repos physique et cognitif complet de 24 heures minimum, ainsi qu'un arrêt des sports de contact d'au minimum 10 jours complets pour tout(e) joueur(se) âgé(e) de 19 ans et plus et d'au minimum 23 jours complets pour tout(e) joueur(se) âgé(e) de moins de 19 ans. Ce délai peut être porté à 21 jours ou 90 jours de repos, s'il s'agit de la deuxième ou troisième commotion cérébrale subie lors des 12 derniers mois.
Régulièrement, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour faire connaître la règle du carton bleu et inciter les arbitres à l'utiliser. Néanmoins, en l'absence d'un médecin ou de surveillance vidéo, la détection des commotions cérébrales repose sur les arbitres, les entraîneurs et les coéquipiers, ce qui amoindrit l'efficacité du dispositif de prévention. Or, les joueurs amateurs représentent l'écrasante majorité des licenciés.
Un biais similaire entre joueurs professionnels et joueurs amateurs est observé pour d'autres disciplines.
Ainsi, la Fédération française de football a imposé un recensement strict des commotions cérébrales et de leur prise en charge pour les joueurs professionnels et les footballeurs des équipes de France : les informations doivent être transmises à la direction médicale de la fédération sous peine de sanctions financières.
Les clubs amateurs sont également soumis à une obligation de déclaration. Néanmoins, selon les informations fournies par la Fédération française de football99(*), « il existe un vrai biais déclaratif sur les feuilles de matches informatisées. Il n'existe pas de personnel médical ou de secouriste dans les clubs français tout niveau. Sachant que de nombreuses commotions peuvent devenir symptomatiques dans les 48 heures, elles ne sont pas comptabilisées comme blessure à la tête. Enfin, les commotions arrivant à l'entraînement ne sont pas comptabilisées. »
En ce qui concerne le basket-ball, il a fallu attendre 2019 pour qu'un protocole de gestion des commotions cérébrales soit mis en place pour les compétitions dépendant de la Ligue nationale de basket-ball. La présence d'un médecin référent est obligatoire pour chaque match. En cas de suspicion de commotion cérébrale observée par l'arbitre, il autorise le médecin à entrer sur le terrain pour effectuer le bilan et la prise en charge du joueur. Un protocole « commotion cérébrale » a été mis en place exigeant de la part du joueur commotionné un certificat de reprise du basket-ball en compétition avant tout nouveau match.
Lors des compétitions organisées par la Fédération française de basket-ball, la présence d'un médecin n'est pas obligatoire et donc pas systématique. En revanche, au début de la saison 2024-2025, tous les arbitres ont dû valider une formation en ligne sur la commotion cérébrale.
Le recensement des signalements de commotions cérébrales est effectué par les commissions médicales de la Ligue nationale de basket-ball et de la Fédération française de basket-ball pour les compétitions les concernant.
En ce qui concerne la Fédération française d'équitation (648 000 licenciés en 2024), il n'existe aucun recensement des commotions cérébrales, aussi bien pour les sportifs de haut niveau que pour les sportifs amateurs.
La Fédération française de handball a introduit à partir de la saison 2019-2020 pour tous les niveaux de jeu nationaux et territoriaux (hors professionnels) le carton blanc délivré par le juge arbitre en cas de suspicion de commotion cérébrale. Il fait alors entrer deux personnes autorisées pour examiner le joueur concerné. L'officiel responsable de l'équipe décide, au vu des symptômes constatés, s'il autorise son joueur a` reprendre le jeu. S'il ne l'autorise pas, le joueur concerné quitte aussitôt le banc de remplacement. Quelle que soit la décision prise par l'officiel responsable sur la reprise de jeu, celle-ci est consignée sur la feuille de match électronique. Dans les 24 à 48 heures suivant la remontée de la feuille de match signalant le carton blanc, un courriel type est adressé au joueur concerné (et a` ses représentants légaux s'il est mineur) pour l'informer qu'il fait l'objet d'une suspicion de commotion cérébrale lors d'un match et qu'il lui est préconisé de consulter dans les plus brefs délais son médecin traitant ou un médecin du sport compétent en commotion cérébrale.
Néanmoins, cette consultation n'est pas obligatoire et aucun certificat médical n'est exigé pour la reprise de l'activité sportive. Contrairement au rugby, la licence n'est pas bloquée. Une étude récente100(*) a montré qu'une faible proportion de joueurs ayant reçu un carton blanc allait consulter. Durant la saison 2023-2024, sur les 709 joueurs ayant reçu un carton blanc et ayant été identifiés comme à haut risque de commotion, seuls 153 ont déclaré une consultation. Sur ces 153, 59 avaient été arrêtés par leur médecin.
La Fédération française de judo a mis en place un protocole en cas de commotion cérébrale distinguant les licenciés de moins de vingt ans et les licenciés de plus de vingt ans, ainsi que les licenciés qui font partie d'une structure de projet de performance fédéral et les autres licenciés.
Depuis la saison 2024, un dispositif de déclaration informatique de suspicion de commotion cérébrale pendant la compétition ou l'entraînement a été mis en place. En cas de suspicion, un repos strict de 48 heures est imposé. À l'issue de ce repos, soit le médecin lève la suspicion de commotion cérébrale, soit il la confirme, ce qui implique un arrêt complet de l'activité de 7 à 21 jours selon les cas. Le déverrouillage de l'arrêt temporaire de la pratique lié à la commotion cérébrale ne peut intervenir qu'après un nouvel examen médical et la délivrance d'un certificat d'absence de contre-indication (CACI) à la pratique des activités physiques et sportives en général, y compris en compétition. Il est encore prématuré de tirer un bilan du dispositif mis en place compte tenu de son entrée en vigueur très récente.
En ce qui concerne les sports de glace, le recensement des commotions cérébrales a été initié seulement lors de la saison 2024-2025 et ne concerne pour l'instant que les sportifs de haut niveau. En juin 2025, un protocole de prévention des conséquences des blessures lors des compétitions, en particulier des commotions cérébrales, a été validé. Il prévoit la détection d'une éventuelle commotion cérébrale par l'officiel d'arbitrage et un secouriste formé, l'arrêt automatique de la compétition pour l'athlète concerné, sa prise en charge par la commission médicale, et le suivi des consultations médicales initiales et dans les mois suivant la blessure. La licence n'est pas suspendue automatiquement.
Pour les sportifs qui ne sont pas considérés comme des sportifs de haut niveau, la prévention des commotions cérébrales passe pour l'instant par l'information et la sensibilisation des présidents de clubs et la mise en place d'affiches par la commission médicale depuis la rentrée sportive 2025.
· Des changements de pratiques qui ne sont pas à la hauteur des avancées scientifiques
Les fédérations font souvent remarquer que les commotions interviennent majoritairement à la suite d'un fait de jeu, sans qu'une faute ne soit commise.
Selon la Fédération française de football, au cours des cinq dernières années, 70 % des commotions sont survenues après un fait de jeu sans faute sifflée par l'arbitre. Dans les matchs internationaux, selon l'UEFA, 65 % des blessures à la tête survenues en match de Ligue des champions ou en Europa League ne sont pas associées à une faute. D'autres statistiques précisent que les commotions interviennent dans 83 % des cas lors d'un duel aérien pour prendre le ballon de la tête avant son adversaire et dans 62 % des cas lors d'un contact tête contre tête.
Dans la réponse au questionnaire sur les commotions cérébrales envoyé à plusieurs fédérations, la Fédération française de basket-ball fait remarquer qu'« au basket, contrairement à d'autres sports collectifs, les circonstances de survenue des commotions cérébrales sont essentiellement la résultante de faits aléatoires et involontaires : contact accidentel entre deux joueurs ou joueuses (par exemple lors de la pose d'écrans), la chute sur le sol dur (après rebond ou « dunk »), un coup de coude involontaire, un contact violent avec le ballon... »
Néanmoins, le changement des règles peut avoir un impact sur les commotions cérébrales dans certaines disciplines sportives.
Dans le football, la décision prise en 2006 de sanctionner d'un carton rouge le jeu dangereux (coups de coude à la tête directs et délibérés) lors des contacts aériens a fait baisser le nombre de blessures à la tête de 29 %.
Dans le rugby, la réglementation a également été modifiée sur les plaquages hauts, sur la protection des joueurs dans les airs et sur la mêlée pour améliorer la sécurité des joueurs. D'autres mesures seraient nécessaires.
Comme il a été indiqué précédemment, les matchs de rugby professionnels faisant tous l'objet d'un enregistrement vidéo, il pourrait être envisagé d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les situations dangereuses et les éventuels comportements déviants. L'objectif serait d'apporter une aide à la décision aux arbitres pour sanctionner ces comportements, même en l'absence de commotion cérébrale.
Certains intervenants ont regretté des sanctions trop légères envers les sportifs ayant provoqué des situations dangereuses. Lors de son audition, Philippe Chauvin101(*) a fait remarquer qu'un joueur de rugby ayant fait l'objet d'une suspension pour jeu dangereux peut voir sa période de suspension réduite de moitié s'il présente des excuses. Par ailleurs, s'il fait un stage pour apprendre à plaquer, la durée de suspension est réduite d'une semaine. Selon lui, la réticence à sanctionner des joueurs compte tenu de l'impact financier éventuel pour leurs clubs conduit à une mauvaise application de l'article 9 alinéa 11 du règlement du World Rugby selon lequel « on ne doit rien tenter qui soit dangereux ou imprudent pour autrui ».
Ces propos doivent être nuancés. Certes, la commission de discipline a la possibilité de réduire la durée de suspension d'un joueur, mais chaque décision est prise en tenant compte de la gravité de la faute et des antécédents du joueur. S'il a déjà été sanctionné, la participation à un stage de sensibilisation n'aura pas d'impact sur la durée de sa suspension. Il en est de même si la faute est à la fois lourde et volontaire, même si le joueur exprime des remords.
En avril 2025, à la suite d'un nouveau choc à la tête causé par un ballon, alors même qu'elle avait interrompu sa carrière pendant près d'un an en raison d'une commotion cérébrale, la gardienne du Metz Handball Cléopâtre Darleux s'est indignée qu'une telle action ne soit sanctionnée que par deux minutes d'exclusion et a dénoncé un « protocole commotion bidon ».
Dans le rugby, certains préconisent une limitation du poids des joueurs afin de renforcer l'efficacité de la prévention des commotions cérébrales. En effet, les écarts de poids selon les positions et les équipes peuvent être considérables. Or, la masse et la vitesse d'un joueur influent directement sur la force de l'impact. À l'instar de la boxe ou du judo pour lesquels des catégories de poids ont été instaurées, une homogénéisation des gabarits en fonction des postes pourrait être instaurée dans le rugby, notamment pour les lignes arrière, afin de réduire l'intensité des collisions et les risques de blessure. Concrètement, le poids des ailiers pourrait être limité à 100 kg, pour éviter des impacts « inégaux » entre des joueurs de 130 kg et d'autres de 80 kg.
c) Les « coups de chaleur » d'exercice : un phénomène longtemps ignoré
Le coup de chaleur d'exercice est défini par une température corporelle centrale supérieure à 40 °C et des troubles neurologiques en lien avec un effort physique. Il reflète une production de chaleur dépassant les mécanismes de thermorégulation de l'organisme et s'observe le plus souvent lors d'exercices physiques intenses en milieu chaud et humide.
Une première phase, faite de symptômes non spécifiques (asthénie, crampes, céphalées, douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées) précède une phase où chaque système biologique peut présenter une défaillance plus ou moins sévère. Au niveau neurologique, l'atteinte est variable : elle peut débuter par des céphalées, une irritabilité et un état confusionnel pouvant aller jusqu'au coma. Une chute brutale du débit cardiaque peut être constatée. Une atteinte hépatique et une insuffisance rénale aiguë sont fréquentes. Les manifestations cliniques sont liées à l'induction d'une réponse inflammatoire systémique et à une coagulation intravasculaire disséminée déclenchées par le stress thermique intense, pouvant conduire à la dysfonction multi-organique, voire au décès.
La prise en charge immédiate du coup de chaleur d'exercice par l'induction d'un refroidissement rapide est impérative pour en éviter les conséquences catastrophiques.
Selon Nicolas Bouscaren102(*), praticien hospitalier en santé publique, le coup de chaleur d'exercice serait la deuxième cause de mortalité chez les sportifs. Certains chercheurs estiment qu'elle pourrait même être la première cause de mortalité mais son incidence serait sous-estimée car il s'agit d'une pathologie encore peu étudiée et susceptible de présenter les mêmes symptômes qu'un malaise cardiaque.
Certaines technologies sont développées pour lutter contre le coup de chaleur d'exercice, comme des casquettes ou des gilets réfrigérants pour freiner l'élévation de la température centrale.
Dans une optique de prévention, des capsules miniaturisées à avaler sont également mises sur le marché. Elles transmettent la température centrale en continu et permettent un suivi de l'athlète.
Néanmoins, cette pathologie reste encore largement méconnue du milieu médical comme du milieu sportif alors qu'elle devrait faire l'objet de campagnes de sensibilisation et provoquer une réflexion au niveau international sur l'adaptation des compétitions au réchauffement climatique.
Pendant les jeux Olympiques de Tokyo de 2021, la température ambiante a dépassé 34 degrés et le taux d'humidité a parfois atteint près de 70 %. Si une étude103(*) a montré que seul 1 % des athlètes avait été affecté par la chaleur, 50 des 174 participants (masculins et féminins) au marathon en ont subi les conséquences, avec vomissements ou évanouissement.
Les conditions extrêmes rencontrées régulièrement par les joueurs de tennis pendant l'US Open ou l'Open d'Australie (températures supérieures à 35 degrés avec plus de 70 % d'humidité) soulèvent également des interrogations sur les risques qu'ils encourent en dépit d'une préparation physique adaptée et une hydratation régulière.
Dans une étude de 2016104(*), des chercheurs se sont intéressés aux villes de l'hémisphère nord susceptibles d'organiser des jeux Olympiques d'été d'ici la fin du siècle sans mettre en danger la santé des athlètes. Ils ont choisi l'épreuve du marathon, qui demande le plus d'endurance, comme critère principal et ont retenu uniquement les villes pour lesquelles la probabilité d'une température à l'ombre égale ou supérieure à 26 degrés est inférieure à 10 %.
D'ici 2085, seules 33 villes, dont 25 en Europe occidentale, répondraient à ce critère comme le montre le schéma ci-après.
D'autres solutions peuvent être retenues. Ainsi, lors des championnats du monde d'athlétisme à Doha au Qatar en 2019105(*), le départ du marathon a eu lieu à minuit pour éviter la chaleur, ce qui n'a pas empêché les marathoniennes d'être confrontées à une température ambiante de 32 degrés et une humidité de 74 %. 41 % d'entre elles ont abandonné (28 sur 68 participantes), contre seulement 11 % aux championnats du monde à Londres en 2017.
4. Les dérives vers le dopage et l'homme augmenté
a) Innovation technologique ou dopage ?
Certaines innovations technologiques permettent d'aller au-delà des limites des capacités physiques humaines et d'améliorer les performances.
La limite entre innovations technologiques et dopage est souvent mince et les innovations s'accompagnent souvent de polémiques. Les instances internationales s'interrogent alors sur la nécessité d'adapter la réglementation sur le matériel pour distinguer ce qui relève de l'aide au sportif de ce qui relève de l'avantage déloyal.
L'apparition en 2008 des combinaisons de natation en polyuréthane a contribué fortement à l'amélioration des performances des athlètes. Pendant deux ans, de nombreux records ont été battus grâce au polyuréthane qui offre au nageur une meilleure flottabilité et une meilleure glisse106(*). Toutefois, selon certains spécialistes, ces combinaisons apportent un bénéfice technique trop important au regard de la composante physiologique. Elles ont donc été interdites en 2010 et les records invalidés.
Par la suite, la Fédération internationale de natation a arrêté la liste des combinaisons et des maillots de bain homologués. Les combinaisons intégrales sont interdites en compétition quelle que soit leur composition. Les hommes peuvent nager avec un short cycliste et les femmes avec un vêtement à bretelles qui court des épaules jusqu'au-dessus du genou.
L'apparition à partir de 2016 de chaussures avec des lames de carbone et les modifications successives de la réglementation en athlétisme ont montré la difficulté de maintenir un équilibre entre innovation technologique et équité sportive.
Ces chaussures ont permis l'amélioration de l'ensemble des records mondiaux masculins et féminins sur toutes les distances, du 5 000 mètres au marathon. L'analyse fine des performances sur 10 kilomètres, en semi-marathon et lors des marathons entre 2012 et 2019 chez les vingt meilleur(e)s et les cent meilleur(e)s athlètes mondiaux montre que 2016 et surtout 2017 ont été deux années charnières. Les performances ont été systématiquement améliorées chez les hommes comme chez les femmes qui ont utilisé les chaussures à lame de carbone, et ceci de manière très claire chez les cent meilleurs mondiaux. Pour le marathon, les performances ont été améliorées et les temps de course abaissés de 2 % chez les femmes et de 1,2 % chez les hommes. Chez les femmes, les vingt meilleures mondiales ont amélioré leurs records de 2 minutes et 10 secondes en moyenne. En octobre 2019, Eliud Kipchoge équipé d'un nouveau prototype de chaussure avec trois lames de carbone, courait le marathon en moins de deux heures.
Face à la montée de la polémique sur l'avantage que procureraient les chaussures à lame de carbone, la Fédération internationale d'athlétisme a arrêté de nouvelles règles avant les jeux Olympiques de Tokyo.
En ce qui concerne les pointes utilisées sur piste, elle a réduit l'épaisseur maximale du drop (différence entre la hauteur de la semelle sous le talon et à l'avant-pied) à 20 millimètres quelle que soit la distance de la course. Cette limite est également valable pour les épreuves de saut.
Sur route (épreuves de course et de marche), l'épaisseur maximale est restée fixée à 40 millimètres. En revanche, une seule lame de carbone est autorisée et toute chaussure doit être disponible à l'achat sur le marché (en ligne ou en magasin) pendant une période de quatre mois, avant de pouvoir être utilisée en compétition.
Le dopage « technologique » change la nature du sport et biaise la compétition s'il n'est pas universellement partagé, il est donc essentiellement une question de règle et de convention.
b) Les nouvelles formes de dopage
Au-delà des réglementations fixées par les fédérations internationales pour limiter le dopage technologique, l'Agence mondiale antidopage élabore, harmonise et coordonne au niveau international les règles et les politiques antidopage dans tous les sports et tous les pays. Chaque année, elle définit une liste des méthodes et substances interdites qui est transcrite dans le droit français par décret. Au niveau national, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) met en oeuvre les actions contre le dopage.
Sont ainsi interdits les anabolisants (utilisés pour augmenter la taille des muscles), l'érythropoïétine (qui stimule la fabrication de globules rouges et augmente notamment la masse musculaire et l'endurance), l'hormone de croissance (qui augmente la croissance des muscles et limite la masse grasse), les modulateurs hormonaux et métaboliques comme l'insuline (qui peuvent soit limiter l'action des oestrogènes, soit favoriser la prise de masse musculaire), les bêta-2-antagonistes (qui augmentent les capacités respiratoires et présentent un effet anabolique sur les muscles), les diurétiques et les agents « masquants »107(*), les stimulants et glucocorticoïdes (qui optimisent les facultés intellectuelles, réduisent la sensation de fatigue et offrent une meilleure tolérance à la douleur), les narcotiques (qui permettent de masquer la douleur), les cannabinoïdes (qui améliorent le sommeil et le relâchement musculaire) ou encore les bêtabloquants (qui ont un effet relaxant et peuvent limiter les tremblements musculaires).
Les nouvelles techniques de lutte contre le dopage
La lutte contre le dopage a fait l'objet d'avancées significatives, notamment avec la méthode « Dried Blood Spot » et l'instauration du passeport biologique de l'athlète.
La technique du Dried Blood Spot (DBS) est une méthode de prélèvement sanguin utilisée dans la lutte contre le dopage. Elle consiste à recueillir quelques gouttes de sang, généralement collectées au bout du doigt ou dans le haut du bras, sur un papier filtre spécial où le sang est laissé sécher. Cette technique est moins invasive que les prélèvements veineux traditionnels et permet une conservation et un transport plus faciles des échantillons. En outre, les échantillons DBS sont plus stables, ce qui permet une analyse plus précise des substances dopantes, même après une période prolongée.
Le passeport biologique de l'athlète est un outil de suivi longitudinal qui compile les résultats de divers tests antidopage au fil du temps. Il permet de surveiller les variations des marqueurs biologiques individuels, ce qui peut révéler l'usage de substances ou de méthodes interdites. Il comprend généralement plusieurs modules :
- un module hématologique qui permet de surveiller les paramètres sanguins pour détecter l'utilisation de substances ou de méthodes qui améliorent le transport de l'oxygène, comme l'érythropoïétine (EPO). Ainsi, une augmentation inexpliquée d'un paramètre lié au module hématologique peut suffire à condamner un athlète même sans identification d'un quelconque produit ;
- un module endocrinien qui se concentre sur la détection de diverses hormones, comme l'hormone de croissance ;
- un modèle stéroïdien pour surveiller les concentrations de stéroïdes endogènes et détecter les anomalies qui pourraient indiquer l'utilisation de stéroïdes exogènes. Néanmoins, une anomalie ne sera pas toujours concluante et l'utilisation de la spectrométrie de masse isotopique peut être nécessaire pour prouver le dopage. Par exemple, pour distinguer entre la testostérone « endogène » et une version exogène, il faut connaître la composition en isotopes du carbone de la molécule. La molécule naturelle est plus riche en carbone 13 que son homologue végétale. Néanmoins, il existe déjà des testostérones de synthèse enrichies en carbone 13.
L'intelligence artificielle (IA) pourrait renforcer la panoplie des outils à la disposition des autorités publiques pour lutter contre le dopage108(*).
Dans le cas des nouveaux produits de synthèse, qui consistent souvent en des substances interdites légèrement modifiées, un appareil d'analyse aidé par l'IA pourrait repérer des composés très proches de produits bannis sans être inscrits eux-mêmes sur la liste officielle. Les laboratoires antidopage pourraient repérer plus facilement des anomalies. En s'appuyant sur des bases de données très larges comme il en existe maintenant, l'IA pourrait mettre en évidence des molécules comparables à des stéroïdes, à tel stimulant, etc. et alerter sur la possible présence d'un nouveau produit de synthèse. Par ailleurs, l'IA pourrait être utile pour traiter un grand volume de données rassemblant les performances des athlètes, leur géolocalisation - les pays et les sites d'entraînement dans lesquels le dopage est prépondérant sont connus - et aider à un meilleur ciblage des contrôles.
Néanmoins, en dépit des progrès réalisés par les agences de lutte contre le dopage pour déceler les substances illicites, de nouvelles formes de dopage apparaissent.
Au cours de leur audition109(*), les responsables de l'AFLD ont mentionné le dopage génétique qui implique la manipulation du matériel génétique d'un individu pour améliorer ses performances sportives. Contrairement aux méthodes traditionnelles de dopage qui utilisent des substances externes comme les stéroïdes ou les hormones, le dopage génétique vise à modifier l'expression des gènes pour augmenter la force, l'endurance ou la récupération musculaire.
Les techniques de dopage génétique peuvent inclure l'utilisation de thérapies géniques pour introduire ou modifier des gènes spécifiques. Par exemple, un gène souvent ciblé est celui qui code pour l'érythropoïétine (EPO), une hormone qui stimule la production de globules rouges, améliorant ainsi l'apport en oxygène aux muscles.
Le dopage génétique est difficile à détecter et à réguler, car il peut ne laisser aucun marqueur ou signature traçable dans les fluides corporels ou les tissus d'un athlète. Le dopage génétique peut également être impossible à distinguer des variations ou mutations naturelles des gènes ou de l'expression des gènes d'un athlète.
Le protocole d'une thérapie génique n'a cependant rien d'anodin. Ainsi, pour éviter le rejet par l'organisme du virus utilisé comme vecteur, des traitements immunosuppresseurs sont prescrits. Or, ils sont difficilement conciliables avec un entraînement intensif et de bonnes performances. En outre, pour un effet notable, la quantité de transgènes à injecter est importante.
Le dopage « cérébral » pourrait être une nouvelle forme de dopage visant à réduire la fatigue des athlètes. Comme l'activité du cortex latéral préfrontal tend à diminuer en cas de fatigue, des recherches sont entreprises pour stimuler artificiellement cette zone spécifique du cerveau afin de lutter contre la fatigue. Ainsi, la stimulation électrique transcrânienne directe (TDCS110(*)) est une technique non invasive qui utilise un courant électrique de faible intensité pour stimuler des zones spécifiques du cerveau. Ces techniques ont été développées à l'origine pour traiter la dépression, l'anxiété, les douleurs chroniques, mais elles pourraient être utilisés pour améliorer la performance. Elles reposent sur l'hypothèse qu'en stimulant électriquement les aires corticales, on pourrait favoriser la plasticité des réseaux neuronaux et faciliter certains apprentissages, ou bien inhiber des mécanismes de régulation de la douleur et de la fatigue. Bien qu'il n'y ait pas de preuve scientifique de son efficacité pour lutter contre la fatigue, cette technologie intéresse la communauté médicale et les industriels pour ses potentialités.
Ainsi, la TDCS pourrait être utilisée pour stimuler des zones du cerveau associées à la vigilance et aux fonctions cognitives, ce qui pourrait aider à réduire la sensation de fatigue mentale. En modulant l'activité neuronale dans des régions spécifiques, la TDCS pourrait aider à améliorer l'efficacité des réseaux neuronaux impliqués dans la gestion de la fatigue. Certaines études suggèrent que la TDCS a des effets positifs sur l'humeur, ce qui pourrait aider indirectement à réduire la fatigue, surtout si celle-ci est liée à des états dépressifs ou anxieux. Enfin, la TDCS pourrait avoir un impact sur la perception de l'effort, rendant les tâches physiques ou mentales moins fatigantes. Il convient de noter qu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a été menée pour analyser les effets à long terme sur le cerveau de l'utilisation répétée et prolongée de la TDCS.
Le dopage « intellectuel » pourrait être encouragé par l'apparition de nouvelles molécules très proches, voire identiques aux peptides endogènes de notre cerveau et connues pour augmenter l'attention, ou bien favoriser la sécrétion d'endorphines et ainsi accélérer la récupération. Selon Michel Audran111(*), les traitements proposés pour la maladie de Parkinson pourraient également avoir un intérêt pour le dopage.
c) Vers une normalisation de l'homme augmenté ?
L'homme a toujours souhaité et tenté d'améliorer ses performances.
Cette possibilité qu'a l'être humain en bonne santé de s'améliorer a été démultipliée par les progrès de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie qui permettent non seulement de soulager et guérir des maladies, mais également de doper certaines capacités physiques et mentales.
Ainsi, de nombreux sportifs ont recours à la chirurgie réfractive pour améliorer leurs performances visuelles. Au golf, cette pratique a été lancée par Tiger Woods en 1999 et s'est généralisée non seulement chez un grand nombre de golfeurs, mais également dans des disciplines aussi variées que le biathlon, la course de fond, le beach-volley, le tennis, le football, le canoë, le cyclisme, la voile ou encore le bobsleigh.
Actuellement, des thérapies géniques sont envisagées pour traiter des dystrophies musculaires. L'IGF-1 est une protéine qui joue un rôle crucial dans la croissance et le développement musculaire. En introduisant l'ADN codant l'IGF-1 dans les cellules musculaires, les chercheurs espèrent stimuler la régénération musculaire et ralentir la progression de la dystrophie musculaire. Si cette thérapie s'avérait efficace, elle pourrait être utilisée non seulement pour éviter le déclin musculaire chez des patients sains mais également pour stimuler la régénération musculaire chez les sportifs de haut niveau.
L'effacement des frontières entre la médecine thérapeutique et la médecine d'amélioration soulève plusieurs questions éthiques : est-ce que des technologies peuvent être détournées de leur indication thérapeutique pour améliorer les performances de sportifs en bonne santé ? Est-ce que l'amélioration obtenue ne crée pas un avantage injuste vis-à-vis des autres athlètes et ne pourrait donc pas être considérée comme du dopage ?
Actuellement, la chirurgie réfractive n'est pas interdite, ce qui n'est pas sans soulever des interrogations sur le caractère subjectif des limites imposées entre innovation technologique et dopage.
Il convient de remarquer que certaines voix s'opposent à la politique de lutte contre le dopage en avançant les arguments suivants. D'abord, elle ne permet pas d'endiguer le dopage et créerait ainsi une distorsion de concurrence entre les athlètes qui respecteraient les règles et ceux qui utiliseraient des produits dopants. Ensuite, elle serait hypocrite dans un monde où le public exige sans arrêt de nouveaux exploits et de nouveaux records alors même que les capacités physiques des athlètes sont limitées.
C'est la raison pour laquelle certains défendent le concept de l'homme « augmenté » et prônent même l'organisation de compétitions « augmentées » qui autoriseraient le dopage afin de permettre aux athlètes de dépasser leurs propres limites. Le dopage serait alors considéré comme une technique parmi d'autres pour accroître ou mettre en valeur les différences qui sont décisives au cours d'une compétition donnée.
Les premiers jeux « augmentés » devraient se tenir à Las Vegas en 2026 avec une centaine de participants réunis autour de quelques disciplines valorisant soit la vitesse soit la force : l'athlétisme (100 mètres, 100 mètres haies et 60 mètres), la natation (50 mètres et 100 mètres en nage libre ainsi que le 100 mètres en papillon) et l'haltérophilie (épaulé-jeté et arraché).
Pour l'instant, cette initiative est largement critiquée aussi bien par les États que par la communauté sportive internationale. Il conviendra de voir si l'organisation de ces jeux aboutit et, le cas échéant, s'ils arrivent à « séduire » le public.
5. Le développement de pratiques pseudo-scientifiques
La préparation physique comme la préparation mentale constituent des facteurs déterminants dans l'amélioration des performances des athlètes. Toutefois, faute d'une régulation des métiers de l'encadrement sportif, ce secteur a vu fleurir de nombreuses pratiques pseudo-scientifiques qui relèvent souvent du charlatanisme.
Lors de son audition112(*), Mickaël Campo, maître de conférences en psychologie du sport à l'université de Bourgogne et responsable de la préparation mentale à la Fédération française de rugby, a regretté le vide juridique qui entoure le métier de préparateur mental, qui permet à n'importe qui d'exercer ce métier et de vendre des formations dont la qualité ne fait l'objet d'aucun contrôle. Il existe une multitude d'appellations - préparateurs mentaux, psychologues du sport, coach mental, entraîneur cérébral, accompagnateur de talent, etc. - qui correspondent plus à des positionnements marketing qu'à une distinction fondée sur des compétences validées scientifiquement. Les réseaux sociaux renforcent ce biais à travers des affirmations erronées et une communication confuse.
Les jeux Olympiques ont mis en lumière l'importance de la préparation mentale pour la performance et la santé mentale des athlètes, tout en révélant le retard de la France dans ce domaine. Cette situation a favorisé l'émergence de pseudo-experts s'autoproclamant préparateurs mentaux sans formation en psychologie du sport ou sur l'éthique de la pratique.
Les fédérations ont une autonomie décisionnelle dans l'élaboration de leurs orientations structurelles en matière de préparation mentale. Faute de réglementation au niveau national, certaines, comme la Fédération française de ski, ont créé leur propre système interne d'accréditation ou se sont rapprochées de la Société française de psychologie du sport afin de renforcer leur système d'accréditation, à l'instar de la Fédération française de rugby. Néanmoins, les orientations fédérales dépendent de décideurs souvent éloignés des spécificités de la psychologie du sport qui peuvent être séduits par des discours persuasifs plus que par des compétences certifiées. La préparation mentale peut ainsi être déléguée à des intervenants extérieurs dont le niveau d'expertise est au mieux inadapté, au pire inexistant.
Cette absence de réglementation du métier de préparateur mental peut entraîner des risques pour les athlètes et les entraîneurs à court et long terme d'autant que certains préparateurs mentaux peu scrupuleux tendent à confondre préparation et santé mentale. Le préparateur mental est chargé d'optimiser la performance, notamment en mobilisant tout ce qui est lié aux habiletés mentales de l'athlète. En revanche, il n'est pas compétent pour soigner d'éventuels troubles mentaux et émotionnels et doit alors orienter le sportif vers un psychologue qui s'occupera de l'accompagnement psychologique et sera responsable des interventions thérapeutiques.
La France dispose de solides formations universitaires en psychologie du sport113(*). Pourtant, en l'absence de carte professionnelle spécifique aux fonctions support dans lesquelles s'inscrit la préparation mentale, les étudiants diplômés de ces formations n'ont pas accès à un titre reconnu nationalement. Non seulement ils ne bénéficient d'aucune protection de leur statut, mais ils se retrouvent souvent évincés par des profils « formés » sur internet et mieux référencés sur les réseaux sociaux.
Le métier de préparateur physique souffre également de l'absence de carte professionnelle spécifique et de statut propre à cette activité. Il fait d'ailleurs l'objet d'un flot d'appellations allant du coach sportif au préparateur physique sans que les savoir-faire requis n'aient été arrêtés formellement, qu'il s'agisse de la maîtrise des données fondamentales de la physiologie de l'exercice, de la connaissance des techniques de renforcement musculaire (musculation traditionnelle, haltérophilie ; etc.), de la capacité à gérer les fondements méthodologiques de l'entraînement (périodisation, évolution dynamique des charges, etc.), de la maîtrise des techniques de récupération du sportif ou encore de la capacité d'assurer les conditions de réathlétisation du sportif en liaison avec l'équipe médicale afin de reconstruire progressivement la condition physique. Les formations universitaires Staps offrent ce socle de connaissances.
Lors de l'audition d'Olivier Maurelli, celui-ci a expliqué que 90 cartes professionnelles peuvent être actuellement utilisées pour être considéré comme préparateur physique, avec des disparités énormes en matière de formation et de compétences : certains peuvent avoir suivi une formation privée pendant trois week-ends tandis que d'autres ont fait cinq ans d'études et sont titulaires d'un doctorat.
Certaines structures professionnelles ont pris les devants : les préparateurs physiques employés et salariés à plein temps obtiennent le statut d'entraîneur et rejoignent le syndicat professionnel des entraîneurs associé à la fédération (Tech 15 pour le rugby par exemple). Certaines fédérations ont mis en place un « certificat de compétences spécifiques en préparation physique » qui oblige les professionnels souhaitant intervenir en clubs ou dans la fédération à passer un diplôme interne après une formation d'une année. D'autres fédérations, comme celles du basket-ball, du football et du handball, délivrent un diplôme de « préparateur physique spécialiste ».
Néanmoins, une harmonisation des formations et la reconnaissance officielle de la profession de préparateur physique par les pouvoirs publics à travers la délivrance d'une carte professionnelle seraient particulièrement souhaitables. Une formation commune universitaire faciliterait cette harmonisation des compétences, qui pourrait être complétée par des certificats de spécialisation accordés par les fédérations afin de tenir compte des besoins spécifiques des différentes disciplines sportives.
6. Une trop grande importance accordée aux données
Les données sont devenues omniprésentes dans le sport de haut niveau, que ce soit dans la détection des talents, dans la planification des entraînements ou dans la préparation des compétitions.
Néanmoins, elles doivent être utilisées avec discernement et rester une aide à la décision dans des contextes particulièrement complexes pour lesquels d'autres facteurs sont à prendre en compte. Ainsi, il arrive régulièrement qu'un entraîneur maintienne sur le terrain un joueur en dépit de biomarqueurs dégradés et que celui-ci s'avère particulièrement performant car les données ne tiennent pas compte des « habiletés mentales » du sportif qui sont en revanche connues de l'entraîneur.
L'utilisation des données ne doit donc pas réduire la capacité des sportifs et des entraîneurs, ceux-ci étant à même de prendre des décisions à partir de leurs connaissances et expériences.
L'omniprésence des données peut également entraîner une surcharge d'informations. Les sportifs et entraîneurs peuvent être submergés de données et de statistiques. Cela peut les empêcher de se concentrer sur les éléments clés de la pratique sportive. Dans ce cadre, le rôle du sport scientist est indispensable pour sélectionner les données qui ont un réel intérêt et les compiler de manière simple et intelligible.
Pour certains, la surutilisation des données peut conduire à une homogénéisation des jeux et à une « robotisation » des joueurs, dénaturant ainsi la beauté du sport qui réside dans l'inattendu et l'imprévisible.
II. POUR PRÉPARER LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024, LA FRANCE A ENGAGÉ UNE STRATÉGIE D'OPTIMISATION SCIENTIFIQUE DE LA PERFORMANCE, MAIS ELLE DOIT ENCORE LEVER CERTAINS OBSTACLES POUR QUE CETTE STRATÉGIE S'INSCRIVE DANS LA DURÉE
A. L'ORGANISATION DU SPORT DE HAUT NIVEAU EN FRANCE : UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES MAIS ATTEINT SES LIMITES
1. Un modèle né dans les années 1960 qui a permis une amélioration des résultats sportifs pendant plusieurs décennies
Les jeux Olympiques de Rome en 1960 s'étaient soldés par un cuisant échec pour la France, les athlètes français n'ayant obtenu que cinq médailles dont aucune en or.
En réaction, l'État, sous l'impulsion du général de Gaulle, a doté les fédérations de plus de moyens financiers mais aussi de conseillers techniques pour développer et encadrer le sport. Parallèlement, des investissements ont été engagés dans des programmes d'équipements sportifs.
Le sport de haut niveau s'est longtemps appuyé sur quatre piliers : le ministère des sports, les fédérations sportives, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps).
Le ministère des sports est l'instance centrale de pilotage. Il définit la politique nationale du sport de haut niveau, alloue les subventions aux fédérations sportives, coordonne les établissements publics comme l'Insep et les Creps et établit les listes ministérielles des sportifs de haut niveau.
Les fédérations sportives organisent la pratique et la compétition dans leur discipline. Elles sélectionnent les athlètes pour les grandes compétitions internationales (Mondiaux, jeux Olympiques), gèrent les parcours d'excellence sportive en lien avec le ministère. Les financements qu'elles obtiennent de l'État sont associés à des conventions d'objectifs qui portent à la fois sur le développement des pratiques, le sport de haut niveau, le sport-santé et les actions d'emploi et de formation.
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) placé sous la tutelle du ministère des sports, l'Insep est le centre d'entraînement olympique et paralympique de référence du sport français. Il accueille les athlètes pour leur préparation et apporte une expertise scientifique, médicale et technique.
Les Creps interviennent dans trois domaines : la préparation et l'accompagnement des sportifs de haut niveau, la formation aux métiers du sport et l'animation ainsi que l'accueil de stages et de manifestations.
2. Un modèle devenu moins performant
La stagnation des résultats des athlètes français aux jeux Olympiques depuis 20 ans et la baisse des résultats aux jeux Paralympiques ont soulevé des interrogations sur la pertinence de la politique française du sport de haut niveau.
À la suite de l'attribution en septembre 2017 de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, la ministre des sports de l'époque a chargé Claude Onesta d'une mission sur la haute performance sportive afin d'augmenter les chances de médailles de la France. Cette étude a abouti à plusieurs conclusions.
D'abord, la vision française du sport de haut niveau est trop large et met sur le même pied l'adolescent qui intègre un pôle Espoir et le champion olympique.
Ensuite, l'investissement des fédérations en matière de haute performance varie fortement d'une fédération à l'autre sans répercussion sur le montant des subventions qui leur sont attribuées.
L'État ne joue pas son rôle de stratège faute de compétences humaines suffisantes et d'outils d'évaluation performants. Il établit les listes de sportifs de haut niveau sans avoir de réelle expertise sur les propositions des fédérations sportives tandis que les projets de performance sportive de celles-ci sont reconduits sans évaluation ni analyse de leur pertinence en termes de résultats atteints.
L'accompagnement professionnel et la formation des jeunes sportifs Espoir ne sont pas adaptés aux sportifs relevant de la haute performance, souvent obligés d'investir 100 % de leur temps dans leur projet de conquête de podiums.
Le statut social et financier des entraîneurs n'est pas à la hauteur des exigences de la haute performance et les offres de formation en leur direction sont inadaptées.
L'Insep accueille de nombreux athlètes de haut niveau sur son site, mais les meilleurs sportifs tendent à s'en éloigner, posant la question du positionnement de l'Insep dans la politique de haute performance.
De même, les Creps répondent avec qualité aux problématiques de formation sportive et scolaire des pôles sportifs114(*) qui y sont implantés, mais ils jouent un rôle secondaire dans l'accueil et la réussite des champions de niveau international.
Le sport paralympique n'est pas une priorité des fédérations. Il souffre d'un encadrement réduit et pas suffisamment expert ainsi que de moyens très limités par rapport au sport olympique.
Enfin, la France accuse un retard par rapport à ses principaux concurrents dans l'utilisation des sciences du sport pour optimiser les performances.
B. LES EFFORTS DE STRUCTURATION ET DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE POUR LE SPORT DE TRÈS HAUTE PERFORMANCE
1. La mise en place du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance
La France a longtemps accusé un retard vis-à-vis de ses principaux concurrents sur les questions de recherche, d'innovation et d'utilisation de la data à des fins d'amélioration de la performance sportive.
Dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Gouvernement a lancé en 2020 le programme prioritaire de recherche (PPR) Sport de très haute performance. Financé à hauteur de 20 millions d'euros sur cinq ans par le plan France 2030, ce programme est piloté scientifiquement par le CNRS et géré par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il associe des équipes de recherche et des fédérations sportives dans un triple objectif : apporter des solutions scientifiques et technologiques aux sportifs de haut niveau pour atteindre la performance optimale ; transposer les avancées de la recherche à la préparation des athlètes en s'appuyant sur des projets appliqués et innovants ; réduire le retard de la France vis-à-vis de ses concurrents en matière de recherche et d'innovation dans le domaine sportif.
Ce PPR s'articule autour de neuf défis thématiques :
- l'équilibre de vie et l'environnement de l'athlète ;
- la prévention et le traitement des facteurs de risque ;
- la cognition et la préparation mentale ;
- les interactions homme-matériel et l'optimisation du matériel ;
- l'apprentissage et l'optimisation du geste sportif ;
- la quantification des charges d'entraînement ;
- les big data et l'IA au service de la performance ;
- la performance dans son environnement ;
- les spécificités du domaine paralympique.
Deux appels à projets ont permis de financer 11 projets de recherche impliquant 21 fédérations olympiques et paralympiques. Par ailleurs, l'Agence nationale du sport a apporté un soutien financier à deux projets complémentaires : un projet transversal sur l'effet des cycles menstruels sur les performances (EMPOW'HER) et un projet en neurosciences en lien avec la Fédération française de badminton sur les effets d'un entraînement d'aide à la prise d'information et de décision sur la performance des badistes en vue des jeux Olympiques de Paris.
Le financement de 11115(*) projets de recherche
Le PPR a permis le financement de 11 projets de recherche appliquée, menés en partenariat avec des universités, des grandes écoles, des instituts de recherche, des fédérations sportives et des structures d'entraînement.
Le projet NEPTUNE s'est penché sur l'optimisation du geste en natation en utilisant les données et l'IA, incluant la dimension handisport. Trois principaux axes de recherche ont structuré ce projet. Le premier a été le suivi automatique et les stratégies de course, pour lesquels les nageurs ont été suivis en compétition grâce à des caméras aériennes et sous-marines, tandis que leur squelette était modélisé grâce à l'intelligence artificielle. Le deuxième axe portait sur la coordination motrice et la propulsion, pour lesquelles l'objectif était d'utiliser des capteurs miniatures et portables pour améliorer la technique de nage et optimiser les trajectoires. Le troisième axe s'est intéressé à la résistance de l'eau, l'objectif étant de minimiser la traînée de l'eau pour optimiser l'efficacité et l'économie de nage.
Le projet FULGUR a cherché à identifier les facteurs de risque de blessures et à optimiser les charges d'entraînement. Pour ce faire, les chercheurs se sont intéressés au sprint, en étudiant les impacts de la course à haute vitesse sur les muscles, en décrivant avec précision la mécanique du sprint. Les chercheurs ont également étudié le profil musculo-squelettique de chaque athlète afin de développer des programmes d'entraînement individualisé, principale mesure de prévention pour réduire les blessures.
Le projet D-DAY a visé à optimiser les trois dernières semaines de préparation des nageurs de l'équipe de France précédant les jeux Olympiques puis Paralympiques de Paris 2024. Le programme a comporté trois étapes pour diminuer la fatigue des nageurs. Les chercheurs ont d'abord évalué la qualité de sommeil des nageurs grâce à des questionnaires, mais aussi grâce aux outils de la médecine du sommeil, comme des accéléromètres portés au poignet durant la nuit ou des capteurs frontaux pour enregistrer l'activité cérébrale. Une fois le niveau de fatigue cumulée estimé, des méthodes de diminution du niveau de fatigue ont été validées, telles que le recours à la cryostimulation, qui soumet les nageurs à des projections d'air à - 110 degrés pendant trois minutes après chaque entraînement. À partir de ces résultats, le but du programme a été d'accompagner les athlètes vers une routine de récupération adaptée et individualisée, selon leurs profils biomécanique, physiologique et psychologique. Les améliorations de performances sont estimées à 2 %, ce qui est considérable dans un sport de haut niveau.
Le projet TEAM-SPORTS s'est intéressé à la cognition et à la préparation mentale dans le sport de haut niveau, plus particulièrement pour les sports collectifs comme le rugby, le football, le volley-ball et le handball. Le but a été d'optimiser le management et d'améliorer les performances individuelles dans un contexte de groupe. Pour ce faire, le projet a cherché à mieux comprendre les phénomènes d'identité collective par une approche de l'identité sociale et de la théorie des émotions intergroupes. Ce projet de psychologie sociale et sportive s'est donc intéressé aux interactions, aux émotions, aux processus cognitifs et au contrôle moteur.
Le projet PARAPERF avait pour objectif de maximiser les chances d'obtenir un titre aux jeux Paralympiques de Paris autour de trois axes.
Le premier a consisté à analyser les performances des athlètes français, à modéliser leur trajectoire de progression et à les situer dans le contexte concurrentiel de leur discipline. L'objectif était de développer et d'adapter ces méthodes d'analyse aux spécificités des disciplines paralympiques, afin de mettre à disposition des staffs des outils d'aide à la décision. Cet axe de recherche devait permettre de caractériser les trajectoires de chaque athlète afin d'améliorer sa performance en fonction de son potentiel.
Le deuxième axe a visé à optimiser les performances des athlètes en fauteuil, 12 sports sur les 22 représentés aux jeux Paralympiques exigeant l'utilisation de fauteuils roulants manuels. L'objectif était d'optimiser chaque couple athlète-équipement par une évaluation individualisée et d'anticiper les risques de blessures en fonction de l'ergonomie et des conditions de pratique.
Le troisième axe a consisté à appréhender les facteurs socio-environnementaux favorables à la très haute performance en caractérisant les environnements psychosociaux les plus favorables. Cet axe a débouché notamment sur l'élaboration de guides destinés aux intervenants et aux athlètes.
Le projet Du carbone à l'or olympique a visé l'optimisation du matériel pour les épreuves de voile, sport très technologique dans lequel le matériel a un fort impact sur les performances. L'idée a été d'améliorer les propriétés mécaniques des matériaux, de permettre une meilleure interaction entre l'homme et son matériel et d'améliorer la confiance de l'athlète en lui-même et en son équipement.
Le projet HYPOXPERF 2024 a étudié les effets de l'entraînement en hypoxie sur la performance des sportifs. L'état d'hypoxie est utilisé par les sportifs pour augmenter leur ventilation, leur fréquence cardiaque et leur débit sanguin. Les performances sportives sont alors optimisées par l'augmentation de la production d'hémoglobine, et donc par une optimisation de la capacité de transport de l'oxygène par le sang. Ce programme a permis d'identifier les réponses hypoxiques individuelles en utilisant un entraînement en altitude/hypoxie. Il a également permis de valider certaines méthodes d'exposition ou d'entraînement hypoxiques pour les athlètes afin de maximiser leurs performances.
Le projet PerfAnalytics a exploité l'analyse vidéo et la biomécanique pour objectiver la performance gestuelle dans plusieurs disciplines, telles que l'escalade, le BMX, la gymnastique, la boxe ou la lutte. Par la numérisation des séquences sportives, la traduction de ces données en identificateurs de performances et la modélisation en biomécanique, ce projet a travaillé sur l'analyse du mouvement, le traitement vidéo, la biomécanique des mouvements et les statistiques du sport.
Le projet REVEA a utilisé la réalité virtuelle pour renforcer les capacités motrices et réduire les blessures, afin de réaliser des entraînements plus intenses sans augmenter les charges physiques associées. Elle permet aussi une évaluation objective des performances et des progrès des athlètes. Ce projet s'est intéressé principalement à la gymnastique, à la boxe et à l'athlétisme, disciplines dans lesquelles la réalité virtuelle peut améliorer la performance motrice des athlètes.
Le projet TrainYourBrain a exploré les interactions entre régulation mentale, fatigue et performance en escrime. Il a cherché à optimiser la préparation mentale des escrimeurs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'escrime est un sport exigeant en termes de préparation mentale et un match peut basculer à un seul point près. Ce projet a caractérisé les exigences physiques et mentales spécifiques ainsi que la gestion de la fatigue tout au long de la compétition d'escrime au plus haut niveau de performance. Il s'est également intéressé aux stratégies de régulation nécessaires pour affronter une décision de l'arbitre et les émotions. Des méthodes innovantes d'entraînement psychophysiologiques pour développer des stratégies adaptées de régulation perceptives, attentionnelles et émotionnelles ont été mises au point et évaluées auprès des athlètes. Un entraînement en endurance mentale a ainsi été mis en place auprès des escrimeurs pour leur permettre de mieux résister à la fatigue.
Le projet THPCA a cherché à modéliser et optimiser la production et la dissipation d'énergie dans les sports cyclistes et d'aviron. Dans ces deux sports, l'objectif est de maximiser la vitesse, ce qui implique de maximiser la puissance développée par l'athlète, de minimiser la dissipation d'énergie et d'optimiser le couplage entre l'athlète et son équipement. Le programme a étudié chacun de ces trois axes.
Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au cours des six dernières années, les projets PPR « Sport de très haute performance » ont donc accéléré le rapprochement des communautés scientifiques, des fédérations sportives et du réseau Grand Insep (RGI)116(*) afin de mieux comprendre les éléments constitutifs de la performance dans les différentes disciplines sportives et d'identifier les besoins des entraîneurs des sportifs médaillables. Cent trente sportives et sportifs du cercle haute performance identifiés par l'Agence nationale du sport (ANS) ont pu bénéficier de cet accompagnement scientifique.
2. La structuration des sciences du sport
a) Une recherche longtemps cantonnée dans les laboratoires des Staps
La recherche sportive « à la française » a longtemps été principalement menée dans les laboratoires des unités de formation et de recherche des Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) qui s'intéressent à toutes les thématiques en relation avec le sport, les activités physiques sportives et artistiques ainsi qu'avec les sciences du comportement et du mouvement humains. La filière Staps regroupe une cinquantaine de structures universitaires réparties sur l'ensemble du territoire.
Parallèlement, d'autres structures de recherche, notamment dans les écoles d'ingénieur, ont travaillé avec des fédérations sportives. Ces projets de recherche et de coopération ont été financés par des appels à projets régionaux ou européens.
Enfin, jusqu'à la création de l'Agence nationale du sport, l'Insep disposait d'une enveloppe de 500 000 euros par an pour financer entre 20 et 30 projets de recherche. Entre 2009 et 2020, ce sont près de 200 projets qui ont été financés, favorisant le dialogue entre le monde scientifique et le monde sportif et contribuant au développement de collaborations souvent durables.
La désignation en 2017 de Paris comme ville organisatrice des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a permis d'accélérer la structuration de la recherche autour du sport de haut niveau.
b) Le lancement du programme Sciences2024
Le programme Sciences2024 est un programme de recherche collectif consacré à l'accompagnement des athlètes français dans leur quête de titres aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Lancé officiellement en septembre 2018, il regroupe 14 membres fondateurs : l'École polytechnique, le CNRS, l'école Centrale Lyon, l'École des Ponts ParisTech, les Arts et Métiers, l'Ensta, l'École navale, l'ENS de Lyon, l'ENS de Paris, l'ENS de Rennes, l'ESCPI, l'Insa de Lyon, l'Insep et le Centre national des sports de la Défense (CNSD).
Les membres de Sciences2024 ont été impliqués dans quatre projets de recherche financés par l'ANR dans le cadre du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance : le projet NePTUNE co-porté par l'École des Ponts ParisTech, le projet Du carbone à l'Or porté par l'ESPCI et l'École navale, le projet REVEA porté par l'Inria et le projet THPCA (Très haute performance en cyclisme et aviron) porté par l'École polytechnique. Au total, Sciences2024 a été impliqué dans plus de 50 projets de recherche concernant des disciplines aussi variées que le tir à l'arc, l'aviron, le rugby à XV, le cyclisme, l'athlétisme, la voile, le tennis de table, la boxe ou encore la natation. Les disciplines académiques mobilisées ont été principalement la physique, la mécanique et les mathématiques.
c) La création du groupement de recherche Sports et activités physiques
Le groupement de recherche (GDR) Sports et activités physiques a été créé en 2019 dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il avait pour objectif de fédérer, dans une perspective de recherches pluri et interdisciplinaires, l'ensemble des acteurs du sport et de l'activité physique, en mettant en synergie les laboratoires de recherche, les industriels du sport et les usagers que sont les fédérations sportives, leurs athlètes et les citoyens.
Parmi les quatre axes scientifiques du GDR, deux correspondent directement aux problématiques soulevées dans la présente étude :
- les facteurs humains et sociaux de la haute performance : le GDR vise à lever les verrous de la performance identifiés sur le terrain par les entraîneurs et les équipes de France à travers le développement de recherches interdisciplinaires ;
- sports, santé et bien-être : cet axe entend explorer les freins et leviers à la pratique physique à toutes les étapes de la vie et examine les effets distincts et combinés de l'inactivité physique et de la sédentarité sur la santé physique et mentale ainsi que l'optimisation de l'activité physique adaptée.
Piloté par le CNRS, le GDR regroupe 150 laboratoires et plus de 1 100 chercheurs. Près de la moitié d'entre eux sont issus des sciences de la vie (physiologie, neurosciences et biomécanique), mais les sciences humaines et sociales sont également bien représentées (37 % des chercheurs). À l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, six sociétés savantes se sont coordonnées autour de la problématique « les enjeux des Jeux » et ont organisé plusieurs congrès et manifestations. Par ailleurs, un réseau thématique pluridisciplinaire (RTP) dénommé Sports et sociétés a été fondé et a dressé l'état de l'art selon quatre axes : éducation et inclusion ; santé et bien-être ; emploi et tourisme sportif ; relations et circulations internationales.
Afin de promouvoir la recherche dans les domaines du sport et de l'activité physique, le GDR a lancé un programme de contrats doctoraux, dont plusieurs ont permis de soutenir des projets de recherche du programme Sciences2024.
À l'occasion d'une conférence117(*) dédiée à la recherche au service du sport et du parasport, Jean-François Robin, alors responsable adjoint du département de la recherche de l'Insep, a montré l'impact des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur la structuration de la recherche autour du sport de haut niveau : « Il y a six ans, 76 chercheurs étaient identifiés comme travaillant sur le sport de haut niveau, aujourd'hui, ils sont près de 2 000. »
C. LA RÉORGANISATION DU SPORT DE HAUT NIVEAU : LA CRÉATION DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT
1. Les objectifs : réformer le modèle sportif de haut niveau français et améliorer le rang de la France à l'échelle internationale
Le rapport Onesta précité préconisait la création d'une organisation autonome porteuse d'une stratégie nationale assurant l'évaluation, la prospective, la stratégie et le management du projet « Performance 2024 ».
Dans cette perspective, l'Agence nationale du sport (ANS) a été créée par arrêté ministériel du 24 avril 2019 sous la forme d'un groupement d'intérêt public associant des représentants de l'État, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des acteurs économiques.
L'un des objectifs assignés à l'ANS était de renforcer la performance sportive, notamment dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'ANS s'est donc dotée d'un pôle Haute performance et a présenté en juillet 2020 une stratégie et un plan d'action Ambition bleue reposant sur plusieurs principes :
- des moyens ciblés à travers la mise en place d'un contrat annuel spécifique pour soutenir le projet de performance des fédérations et la création d'une cellule Performance 2024118(*) bénéficiant en priorité de l'accompagnement et des dispositifs mis en place par l'Agence pour optimiser les performances ;
- la recherche d'expertises nouvelles et complémentaires à celles existantes ;
- une attention portée à l'accompagnement global et individualisé des athlètes avec deux engagements : garantir qu'aucun athlète de la délégation olympique et paralympique (soit environ 800 sportifs) ne soit sous le seuil de pauvreté à l'échéance des Jeux de Paris 2024 et s'assurer que tous les athlètes de la cellule Performance disposent d'au moins 2 500 euros nets de ressources par mois ;
- la montée en compétences des entraîneurs : initié en 2022, le plan Coachs a pour but d'améliorer l'accompagnement des athlètes et de renforcer l'expertise des entraîneurs à travers des actions concrètes telles que l'organisation de séminaires et de webinaires, le partage d'expérience entre pairs, des interventions d'experts dans des champs annexes tels que le media training, la santé mentale, la gestion de crise, etc. Ce plan prévoit également la revalorisation financière des entraîneurs ;
- une logique de proximité avec la création de 17 maisons régionales de la performance afin d'accompagner l'athlète et son entraîneur où qu'ils se trouvent sur le territoire. Concrètement, ces maisons de la performance doivent constituer des guichets uniques regroupant au sein d'un Creps ou d'un opérateur public équivalent l'ensemble des acteurs de la performance. Elles proposent des solutions adaptées et individualisées autour de cinq axes : l'optimisation de la performance (physique et mentale), l'accompagnement paralympique, l'analyse de la performance, la montée en compétences de l'encadrement et le suivi socioprofessionnel ;
- le développement de la performance paralympique à travers deux stratégies : faire émerger les champions de demain par la participation au développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap ; structurer et professionnaliser le mouvement paralympique en renforçant l'expertise (mettre en place des staffs intégrés pluridisciplinaires dans les domaines de la physiologie, de la nutrition, de la préparation physique et mentale, des équipements et du matériel) et développer le lien avec la recherche et l'innovation ;
- le financement d'équipements de haut niveau et de haute performance afin d'améliorer les conditions d'accueil et d'entraînement des athlètes se préparant aux JOP 2024. Entre 2019 et 2023, 53 millions d'euros ont été consacrés aux équipements et matériels pour le haut niveau et la haute performance.
2. Un projet phare dans l'accompagnement scientifique à la performance : le Sport Data Hub
Le Sport Data Hub (SDH) est une initiative développée conjointement par le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport et l'Insep en 2020. Ce projet vise à moderniser et optimiser la haute performance sportive en France en utilisant les données et les outils numériques.
Le Sport Data Hub a vocation à faciliter la collecte, le traitement et l'analyse des données de l'écosystème sportif français, souvent nombreuses, mais trop éparpillées et parfois mal exploitées. Il est conçu pour être un outil collaboratif destiné à répondre aux besoins des différents acteurs du sport de haut niveau :
- pour les athlètes, en leur offrant des outils numériques facilitant leur quotidien et leur pratique sportive ;
- pour les acteurs de la performance (coachs, directeurs de performance, encadrement sportif...) en leur fournissant une aide à la décision ;
- pour les décideurs (Agence nationale du sport, direction des sports, directeurs techniques nationaux, établissements, maisons régionales de la performance), en apportant des outils permettant la gestion de l'organisation du sport de haut niveau et la communication entre les acteurs ;
- pour les chercheurs, en facilitant l'innovation et la recherche scientifique dans le sport de haut niveau.
Le Sport Data Hub doit permettre d'améliorer les performances des sportifs de haut niveau grâce à un suivi individualisé reposant sur des données précises issues de l'entraînement et des compétitions, mais également d'analyser la concurrence internationale à travers des outils comme l'analyse vidéo et des indicateurs de performance avancés.
Le Sport Data Hub a mis progressivement à disposition du monde sportif différents outils.
Les AMS (athlete management systems) sont devenus des outils indispensables permettant de centraliser les informations liées à la gestion des athlètes. Cela peut inclure la gestion des performances, la planification de l'entraînement, le suivi médical, l'analyse de la concurrence, etc. De nombreuses fédérations travaillent déjà au quotidien avec des AMS qu'elles ont achetés « sur étagère » ou qu'elles ont développés elles-mêmes. Pour les fédérations qui n'y ont pas encore accès, l'Insep propose l'AMS Athlète 360, une solution de suivi des données d'entraînement et de l'état physique et psychologique des athlètes permettant une meilleure information et prise de décision par l'encadrement pour individualiser l'entraînement des athlètes, réduire ou augmenter la charge de travail du groupe, renforcer le suivi médical. D'autres données119(*) peuvent être croisées avec celles d'Athlète 360 en fonction des besoins des entraîneurs et des fédérations. Les analyses peuvent être restituées sous la forme de visualisations pertinentes et faciles d'accès pour les acteurs de terrain du sport de haut niveau.
Le programme Médaillabilité est un programme d'analyse de performances individuelles des athlètes en lien avec la concurrence internationale pour estimer leurs chances de médailles.
Le portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) recense la situation professionnelle des sportifs, afin de permettre un suivi adapté.
La plateforme nationale Vis'OR regroupe toutes les données relatives aux athlètes, à leurs performances et aux dispositifs de soutien (financements, contrats de performance, actions territoriales) à l'attention des instances de pilotage du sport français.
L'ensemble de ces informations sont centralisées dans un portail numérique France.sport qui propose un espace public et une partie réservée aux acteurs du sport de haut niveau.
En complément du Sport Data Hub, le plan de transformation numérique des fédérations a permis à celles-ci d'accélérer leurs projets data avec l'achat de capteurs et d'équipements numériques et l'embauche de data scientists ou de sport scientists.
D. DES AVANCÉES TRÈS SIGNIFICATIVES
1. Des coopérations fortes entre le monde scientifique et le monde sportif
Le programme prioritaire de recherche Sport haute performance a mobilisé de nombreuses fédérations autour de projets innovants visant à soutenir les athlètes et leurs entraîneurs dans leur quête d'excellence. Parmi les 36 fédérations olympiques et paralympiques, 21 ont participé individuellement ou collectivement à au moins un projet de recherche (59 % des fédérations). Cette implication illustre la volonté des fédérations d'exploiter un levier jusque-là sous-utilisé.
Certaines fédérations comme celles du cyclisme et de la natation se sont particulièrement démarquées par leur engagement, participant chacune à quatre projets distincts. Ce niveau d'implication traduit la capacité de leurs instances dirigeantes à identifier et exploiter les opportunités offertes par le PPR pour renforcer les performances dans la discipline concernée.
Selon une enquête réalisée en 2024120(*), une majorité de fédérations, qu'elles soient olympiques ou paralympiques, a reconnu la plus-value des projets de recherche dans l'amélioration de la performance sportive : 63 % des fédérations olympiques et 75 % des fédérations paralympiques estiment que ces programmes ont eu un impact positif sur la performance de leurs athlètes. Elles se montrent satisfaites de l'accompagnement offert par l'ANS dans le cadre de ces programmes : 29 % des fédérations olympiques se disent « très satisfaites » de cet accompagnement, et 71 % l'évaluent comme « satisfaisant » (100 % pour les fédérations paralympiques).
Du côté des coachs, 55 % des répondants estiment que le programme a pu contribuer à améliorer la performance, et 35 % soulignent une réelle plus-value. 90 % des entraîneurs ayant répondu estiment que le programme de recherche a eu un apport positif sur la performance des athlètes.
Liste des programmes de recherche et des fédérations concernées par chaque programme
Source : Données ANS et MESR, 2024
Au-delà de l'enjeu important que représentaient les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le PPR a également permis de structurer un écosystème durable de recherche au service du sport. En faisant dialoguer universités, organismes de recherche, grandes écoles et fédérations, il a permis de créer un environnement au service des besoins concrets du haut niveau, de la performance et de l'innovation.
Les auditions menées dans le cadre de la présente étude ont mis en évidence la création de liens forts entre la communauté scientifique et la communauté sportive. La convention signée, dans le cadre du programme Sciences2024 entre Centrale Lyon et la Fédération française de tennis de table pour développer des outils de collecte de données et d'analyse tactique des matchs en est un bon exemple.
Cette coopération s'est avérée particulièrement fructueuse et a abouti à la participation d'Aymeric Erades, doctorant de Centrale Lyon et du laboratoire Liris121(*) du CNRS, aux jeux Olympiques de 2024 aux côtés de l'équipe de France de tennis de table. Cette aventure s'est inscrite dans une coopération de longue date entre cette grande école et la direction technique nationale du tennis de table.
Quelques critiques ont néanmoins été adressées au PPR qui devront être prises en compte dans la perspective d'un nouveau programme de financement de la recherche dans le sport de haut niveau.
D'abord, seuls des projets de grande ampleur se développant sur une durée pouvant aller jusqu'à 40 mois et associant plusieurs laboratoires de recherche et une ou plusieurs fédérations sportives ont été financés. Le montant d'aide minimum était de 750 000 euros et le coût complet des projets devait être au minimum trois fois le montant de l'aide demandée. Or, l'accompagnement scientifique à la performance peut requérir des délais plus rapides pour répondre à un besoin particulier.
Par ailleurs, le PPR n'a pas bénéficié aux disciplines des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Compte tenu de la suppression concomitante des appels à projets opérés par l'Insep, certaines fédérations comme celle du ski ont vu leurs crédits d'accompagnement scientifique fortement diminuer.
Enfin, les crédits consacrés au PPR ont été affectés exclusivement aux laboratoires de recherche alors que plusieurs fédérations se sont elles-mêmes impliquées dans les projets de recherche.
2. La montée en compétence des fédérations
· La mise en place d'un accompagnement scientifique à la performance
Le développement de la coopération entre la science et le monde sportif résulte en grande partie du fait que les fédérations sportives ont pris conscience que la science pouvait contribuer à l'amélioration des performances sportives. Les fédérations se sont donc organisées pour faire émerger une structure dédiée à l'accompagnement scientifique de la performance, comme en témoigne le processus suivi par la Fédération française de ski pour optimiser la recherche au service du ski de haut niveau et créer un pôle Développement, formation et suivi scientifique.
Le pôle Développement, formation et suivi scientifique de la Fédération française de ski : étapes de sa création et missions
1989 - JO d'hiver d'Albertville : création d'une cellule recherche
2001 - Création du conseil sportif et scientifique : émergence de projets de recherche à partir des problématiques formulées par les entraîneurs nationaux, multiplication de la production de documents scientifiques et techniques
2007 - Création du département sportif et scientifique ; ajout du secteur formation
2023 - Création du pôle Développement, formation et suivi scientifique auquel sont confiées cinq missions :
- la recherche scientifique : traiter les demandes d'information provenant des équipes de France, voire des centres interrégionaux d'entraînement et des formateurs ; orienter et suivre les travaux de recherche réalisés en collaboration avec des laboratoires extérieurs ;
- l'accompagnement scientifique : synthétiser l'information existante par le biais des revues de littérature scientifique puis traduire ces données en contenus exploitables par l'entraîneur et le formateur ; conseiller, en fonction de la demande, les entraîneurs sur le suivi d'entraînement ; suivre l'élaboration des directives techniques nationales dans l'ensemble des disciplines ;
- la formation : élaborer des méthodes et des outils pédagogiques permettant des progressions orientées soit vers le développement de la pratique, soit vers la performance, assurer l'encadrement des formations initiales et continues, bénévoles et professionnelles ; coordonner et harmoniser les contenus des formations initiales et continues et participer à l'élaboration de leur contenu ;
- la veille technologique : valider l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du suivi d'entraînement ; conseiller les entraîneurs sur les modes d'utilisation ;
- le développement : mise en place des politiques publiques ; accompagnement des structures associatives.
Certaines fédérations attachent depuis plusieurs décennies une importance particulière à l'accompagnement scientifique à la performance. Ainsi, la Fédération française de rugby suit de manière attentive les avancées scientifiques et technologiques en matière sportive et a peu à peu étoffé son département d'accompagnement à la performance. Aujourd'hui, celui-ci comporte quatre pôles (Analyse performance, Préparation physique, Préparation mentale et accompagnement des staffs, Sciences du sport R&D), trois cellules (cellule Vidéo, cellule Nutrition & récupération, cellule Data) et emploie plus d'une trentaine de personnes sans compter les prestataires qui interviennent régulièrement.
D'autres fédérations, avec des budgets beaucoup plus modestes, ont récemment largement investi dans l'accompagnement scientifique de la performance. Ainsi, la Fédération française de badminton, sous l'impulsion de son directeur de la performance, s'est fortement impliquée pour développer l'usage des données dans la gestion des entraînements des athlètes et l'évaluation des potentiels.
Globalement, sous l'impulsion de l'Insep, les fédérations ainsi que les établissements nationaux, notamment les Creps, ont recruté des référents scientifiques facilitant le transfert des résultats de la recherche vers le « terrain » tout en collaborant, voire pilotant des projets de recherche appliquée.
Cette montée en compétence de l'écosystème du sport de performance s'est également appuyée sur de nouvelles formations mises en place par l'Insep et les établissements du réseau Grand Insep à destination des cadres actuels et futurs des fédérations sportives. D'une part, le master Entraînement et optimisation de la performance sportive (EOPS) créé en 2012 à l'Insep a pour objectif (exclusif depuis 2018) la formation des accompagnateurs scientifiques de la performance. D'autre part, de nombreux certificats spécifiques de compétences (CSS) sont mis en place annuellement pour former les cadres des fédérations et des établissements. À titre d'exemple, les CSS Entraînement sous stress environnementaux, Variabilité de la fréquence cardiaque, ou encore Analyse de la performance apportent de nombreuses connaissances scientifiques pouvant être intégrées dans les pratiques quotidiennes des athlètes.
Par ailleurs, le ministère des sports a lancé à l'Insep en 2018 le Réseau national d'accompagnement scientifique de la performance et de l'innovation (RNASPI), dont la mission consiste à aider les fédérations à former leurs référents scientifiques, à mutualiser les ressources et les savoir-faire, à rassembler et catalyser les échanges entre les acteurs sportifs et scientifiques et à diffuser les avancées scientifiques auprès des entraîneurs afin de les aider dans leurs pratiques.
Le RNASPI a joué un rôle important avec ses partenaires académiques (Inria, GDR-CNRS, CEA, Sciences 2024, C3D122(*), etc.) et sportifs (ANS, Insep, fédérations et établissements) pour catalyser les dynamiques en matière de recherche, d'accompagnement scientifique et d'innovation dans la perspective de Paris 2024, en servant d'intermédiaire entre les communautés du sport et de la recherche.
Le RNASPI a contribué à structurer et animer le réseau des accompagnateurs et intervenants scientifiques et technologiques en fédérations et établissements, notamment avec la mise en place systématique d'au moins un référent scientifique dans chaque structure. L'Agence nationale du sport a incité les fédérations à investir dans la dimension scientifique et technologique à travers le renforcement des ressources humaines allouées à la recherche et l'innovation (conventions d'objectifs et de performance annuelles, plans de transformation numérique, etc.).
En janvier 2018, cinq fédérations et deux établissements du réseau Grand Insep avaient au moins un référent scientifique. Désormais, les 38 fédérations et 28 établissements du réseau Grand Insep en disposent.
De plus, la moitié des référents scientifiques ont réalisé une thèse, ce qui facilite le développement de nombreuses collaborations avec des équipes de recherche académique en cohérence avec les besoins et les verrous scientifiques et technologiques rencontrés par les acteurs de la performance sportive.
Depuis les états généraux du sport en 2016 et la volonté de Thierry Braillard, alors secrétaire d'État chargé des sports, « d'être au rendez-vous de cette révolution technologique du sport de haut niveau », les politiques mises en place ont permis en quelques années de structurer la recherche dans le domaine de la haute performance et de l'accompagnement scientifique des fédérations, en favorisant la synergie entre les acteurs de la performance sportive, de la recherche et parfois aussi les acteurs privés. La communauté certes encore protéiforme des accompagnateurs et intervenants scientifiques et technologiques de la performance sportive constitue la réponse apportée par la France à la nécessaire collaboration entre les acteurs de la performance (entraîneurs, athlètes, staffs, DTN, etc.) et les acteurs de la recherche et de l'innovation (universités, organismes de recherche académique, entreprises allant des start-up aux grandes entreprises, etc.).
· La multiplication des conventions industrielles de formation pour la recherche (Cifre)
Le dispositif des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) permet d'allouer une subvention de 42 000 euros, sur trois ans, à tout acteur socio-économique, entreprise, association, collectivité territoriale, mais également aux fédérations nationales et aux clubs sportifs qui recrutent un doctorant pour lui confier une mission de recherche organisée en partenariat avec un laboratoire académique.
Ce dispositif est utilisé depuis longtemps par le milieu sportif puisqu'entre 2009 et 2015, 19 Cifre ont été attribuées et 22 entre 2016 et 2019.
Il a connu un fort développement à partir des années 2020 puisque sur la période 2021-2024, le nombre de Cifre attribuées a été porté à 40.
Ce dispositif a largement contribué à la montée en compétences scientifiques des fédérations et des clubs sportifs.
Il permet aux fédérations et aux clubs d'améliorer les performances des athlètes dans un domaine précis dans le cadre d'une thèse. Ainsi, le Racing 92 a financé deux Cifre pour travailler, d'une part, sur « la physique de la mêlée » avec comme objectif de déterminer les paramètres déterminants de la performance en mêlée, d'autre part, sur l'optimisation du lancer en touche.
Les doctorants impliqués dans les Cifre sont souvent engagés par les fédérations nationales et les clubs sportifs à l'issue de leur thèse et contribuent ainsi à renforcer l'implantation de la science dans le monde sportif. Ce fut par exemple le cas d'Antoine Kneblewski qui, à l'issue de sa thèse sur le lancer en touche, est devenu préparateur physique au Racing Club 92.
E. DES OBSTACLES PERSISTANTS
En dépit des indéniables progrès réalisés, des obstacles subsistent dans l'accompagnement scientifique des performances sportives.
1. Les contraintes administratives
· Une mise en oeuvre parfois difficile de la loi Jardé
La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (loi « Jardé ») encadre « les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales » et vise à leur donner un cadre unique. Elle a pour objet de protéger les personnes concernées et de garantir l'éthique des recherches.
Trois types de recherches sont distingués selon le niveau de risque pour les personnes :
- les recherches interventionnelles avec risque (expérimentation de nouvelles molécules sur des personnes malades par exemple) ;
- les recherches interventionnelles « visant à évaluer les soins courants » ne comportant que des risques négligeables123(*) ;
- les recherches non interventionnelles ou observationnelles dans lesquelles les actes pratiqués et les produits utilisés le sont de manière habituelle (suivi statistique de cohortes de malades par exemple)124(*).
L'ensemble de ces recherches sont soumises à l'autorisation d'un comité de protection des personnes (CPP)125(*).
Certains scientifiques rencontrés dans le cadre de cette étude ont regretté l'hétérogénéité des pratiques et des décisions des comités de protection des personnes. Pour certains d'entre eux, ces comités dépasseraient leurs compétences en évaluant les projets de recherche avec d'autres critères que ceux prévus expressément par la loi, par exemple en expertisant la méthodologie utilisée dans le cadre du projet de recherche.
De la même façon, ils critiquent la composition des CPP qui, malgré le souci de diversité du législateur, rassemblent parfois uniquement des représentants de la recherche clinique parmi les professionnels de la recherche. Selon eux, cela nuit aux demandes d'autorisation de leurs projets de recherche du fait d'une méconnaissance des caractéristiques de la recherche en sciences du sport et de la recherche fondamentale non pathologique sur l'être humain.
La loi Jardé prévoit la désignation d'un promoteur du projet, condition préalable à l'examen du projet par un CPP. Or, plusieurs chercheurs ont regretté que certaines tutelles (notamment les universités) soient réticentes à assumer ce rôle, ce qui contribue à allonger la procédure.
À titre d'exemple, dans le cadre d'une thèse, le centre de recherche Bordeaux Population Health (Unité de recherche 1219) souhaitait lancer un projet de recherche destiné à évaluer objectivement l'intensité de la sollicitation physique en kinésithérapie libérale des personnes post-AVC en phase chronique. Ce projet de recherche nécessitait l'autorisation d'un CPP et, par conséquent, la nomination d'un promoteur. Or, le centre de recherche à l'origine du projet n'a pu compter ni sur l'université de Bordeaux (qui estimait ne pas disposer des moyens humains nécessaires pour accompagner le projet auprès du CPP) ni sur un CHU (qui exigeait une contrepartie financière) pour remplir le rôle de promoteur. C'est finalement l'association Handisport qui a assumé ce rôle afin que le projet puisse être lancé, mais la recherche d'un promoteur a retardé les travaux de recherche de plusieurs mois.
· Les difficultés rencontrées par les entreprises pour bénéficier de la prise en charge transitoire pour dispositif innovant
Le décret du 23 février 2021 introduit la possibilité d'une prise en charge transitoire de certains produits et prestations préalablement à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).
La prise en charge transitoire est un dispositif de prise en charge des produits de santé susceptibles d'être innovants ayant une finalité thérapeutique ou de compensation du handicap et relevant du champ de la LPPR. Il permet leur remboursement pendant un an en attendant la prise en charge classique via la LPPR.
Trois prérequis ont été définis pour qu'un dispositif soit éligible à cette prise en charge transitoire :
- le dispositif médical doit disposer du marquage CE ;
- il ne doit pas être déjà pris en charge dans le cadre des prestations d'hospitalisation ;
- l'industriel a déposé ou s'engage à déposer une demande d'inscription de ce dispositif médical sur la LPPR dans un délai de 12 mois à compter de sa demande de prise en charge transitoire.
Lorsque ces conditions sont remplies, le processus d'évaluation des dossiers devant la CNEDiMTS126(*) (Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé) est accéléré. La CNEDiMTS doit évaluer les dossiers dans un délai de 60 jours après l'accusé de réception du dossier complet et rendre un avis sur les sept critères d'éligibilité définis par le décret du 23 février 2021127(*) permettant d'apprécier, pour chaque indication médicale couverte par le dispositif médical, le potentiel de la technologie :
- entrer dans la prise en charge d'une maladie grave ou rare ou compenser un handicap ;
- ne pas avoir de comparateur pertinent, autrement dit intervenir sur un besoin médical non ou mal couvert ;
- être susceptible d'apporter une amélioration significative de l'état de santé ou de la compensation du handicap du patient ;
- être susceptible d'être innovant, notamment parce qu'il présente un caractère de nouveauté autre qu'une simple évolution technique au regard des technologies de santé utilisées dans l'indication revendiquée ;
- être susceptible, au vu des résultats des études cliniques, de présenter une efficacité cliniquement pertinente et un effet important au regard desquels ses effets indésirables potentiels sont acceptables ;
- faire l'objet d'études en cours de nature à apporter, dans un délai de 12 mois à compter de la demande, des données suffisantes pour que la CNEDiMTS soit en mesure de rendre un avis relatif à la demande d'inscription à la LPPR ;
- ne pas être un dispositif médical numérique présentant une visée thérapeutique ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale.
La société Proteor, leader français de la conception et la fabrication d'orthèses et de prothèses, a développé la première prothèse au monde128(*) composée d'une pièce unique pour remplacer le genou, la cheville et le pied amputés et permettre de retrouver une marche fluide.
Dix ans de recherche et développement ont été nécessaires pour la mise au point de ce procédé permettant la coordination simultanée du mouvement de la cheville et du genou en prolongement de la hanche. Le lancement industriel de la prothèse a débuté en 2022 aux États-Unis.
En revanche, il a fallu attendre 2025 pour que l'assurance maladie française prenne en charge son remboursement129(*) alors même que la société Proteor avait déposé un dossier pour une prise en charge transitoire compte tenu du caractère innovant de cette prothèse.
Selon Nicolas Piponniau, responsable du développement de nouveaux produits chez Proteor : « À la suite du dépôt de notre dossier, nous avons été sollicités par les services de la direction de la Sécurité sociale pour fournir des informations complémentaires, ce que nous avons fait. Malheureusement, nous n'avons plus eu de nouvelles de l'avancement de notre dossier malgré plusieurs tentatives de prise de contact via les services de la Sécurité sociale ou via l'Agence de l'innovation en santé. En tant que fabricant, nous avons regretté ne pas pouvoir bénéficier de ce dispositif de prise en charge transitoire pour dispositif innovant. En effet, développer de telles solutions engendre des coûts de développement de plusieurs millions d'euros et une prise de risque en attendant le succès commercial. C'est dans ce cadre que le temps compte, notamment pour les PME et les ETI comme Proteor. La prise en charge transitoire nous aurait permis d'avancer le lancement en France entre neuf mois et un an. Ce temps d'attente a un impact direct sur notre pilotage R&D, nous incitant à temporiser les développements autour du produit et faisant donc peser un risque de retard technologique par rapport à nos concurrents. »
2. Les contraintes culturelles
Un nombre croissant de fédérations reconnaît le rôle de la science et des technologies dans l'amélioration des performances. Toutefois la sensibilisation des sportifs, des entraîneurs et des dirigeants à l'apport de la science et des technologies à l'amélioration des performances est très variable.
Les entraîneurs et les staffs techniques sont souvent issus de leur filière de pratique sportive et n'ont pas forcément de formation scientifique universitaire ou académique. Selon une enquête récente130(*), 55 % d'entre eux ont passé une licence, majoritairement Staps, mais seuls 0,7 % d'entre eux possèdent un doctorat. Par ailleurs, certains entraîneurs peuvent percevoir l'accompagnement scientifique à la performance comme une remise en cause de leur compétence et de leur autorité.
Du côté des scientifiques, une attitude « prescriptive » peut créer des tensions avec les entraîneurs et les sportifs qui ont une connaissance approfondie et pratique de leur sport au moins aussi valable que les connaissances théoriques des scientifiques. À cet égard, plusieurs d'entre eux ont souligné que leurs recherches conduisent souvent à valider a posteriori des méthodes d'entraînement ou des dispositifs utilisés de manière empirique par les entraîneurs et les sportifs et à leur donner une base scientifique.
Les scientifiques peuvent proposer des projets de recherche, mais ils doivent prendre en compte les besoins et les problématiques sportives formulés par l'encadrement sportif. Cela implique une phase d'observation et d'échanges pour comprendre les caractéristiques de la discipline sportive, les interactions entre le sportif, le matériel, l'environnement physique mais également les avancées scientifiques déjà réalisées au sein des fédérations qui n'ont pas forcément fait l'objet de publications. Bien que la performance sportive soit multifactorielle, les recherches scientifiques restent majoritairement monodisciplinaires, sans vision holistique. L'interdisciplinarité et la multidisciplinarité doivent être encouragées afin de démultiplier l'impact concret de la recherche sur les performances sportives et proposer des publications inédites dans les grands journaux scientifiques.
Par ailleurs, les scientifiques et les sportifs ont des temporalités différentes, guidées par des objectifs distincts que sont les attendus académiques pour les premiers et les résultats sportifs pour les seconds. Le temps de la recherche est souvent relativement long au regard des besoins des sportifs et aboutit généralement dans le cadre d'une thèse de trois ans à une publication sur une problématique scientifique revue par les pairs. Au contraire, les sportifs ont des échéances plus courtes, rythmées par la planification des phases d'entraînement et de compétition. La collaboration avec les scientifiques doit apporter une plus-value adaptée aux différentes échéances temporelles du sportif et permettre la transformation des pratiques et l'optimisation des performances sans délai par rapport aux concurrents. Les staffs sont également peu enclins à diffuser les résultats qui contribuent à donner un avantage concurrentiel aux athlètes qu'ils suivent.
Pour les fédérations dont les disciplines sont représentées aux jeux Olympiques et Paralympiques, les projets de performance sont rythmés par les olympiades. L'intégration du projet de recherche dans le programme de performance de la fédération doit être privilégiée afin de faire correspondre la stratégie sportive fédérale avec des objectifs scientifiques formalisés.
Enfin, les sportifs ont un emploi du temps particulièrement chargé entre les entraînements, les stages et les compétitions, dont certains nécessitent de longs déplacements sur plusieurs continents. Ce nomadisme et cette disponibilité épisodique doivent être pris en considération par les scientifiques.
3. Les limites liées à la formation
· Des emplois du temps chargés qui compliquent la formation continue
Les emplois du temps des entraîneurs des sportifs de haut niveau sont très chargés, notamment en raison des multiples déplacements (120 jours par an pour au moins 56 % d'entre eux131(*)). Le temps à consacrer à l'actualisation des savoirs et à la formation, notamment dans leurs dimensions scientifiques et technologiques, doit donc être adapté à ces contraintes.
De nombreux acteurs impliqués dans des actions de formation et d'information des entraîneurs de haut niveau (Insep, réseau Grand Insep, École des cadres du sport) s'efforcent de prendre en compte ces contraintes. Ainsi, le pôle Formation de l'Insep propose différents modules de formation professionnelle continue pour la montée en compétence des entraîneurs comme chef de projet ou analyste de la performance. Un master Staps EOPS Accompagnement scientifique de la performance a été développé en partenariat avec l'université Paris Cité dans ce but. Enfin, dans une approche plus générale, diverses universités proposent des formations licence-master-doctorat et des diplômes universitaires dans le champ du sport adaptés aux spécificités des staffs sportifs.
· Des limites inhérentes à la fragilité du statut des référents scientifiques
L'établissement de liens durables entre les chercheurs et les staffs des équipes de France peut être compromis par le renouvellement des personnels encadrants au sein des fédérations à la fin de chaque olympiade. L'arrivée d'un nouveau directeur technique national (DTN) et de nouveaux entraîneurs exige souvent de reconstruire le lien de confiance qui avait été tissé avec l'équipe sortante.
Toutefois, la mise en place depuis 2017 de référents scientifiques dans chaque fédération et chaque établissement du réseau Grand Insep a vocation à structurer l'accompagnement et la recherche scientifiques, faciliter le dialogue entre les scientifiques et les sportifs et diffuser les résultats scientifiques auprès des personnels chargés de la performance et des entraîneurs.
Néanmoins, le rôle et la légitimité des référents scientifiques restent encore fragiles selon les fédérations. L'hétérogénéité des profils des référents scientifiques au sein des fédérations et des établissements du réseau Grand Insep ainsi que la multiplicité des fonctions qu'ils ont souvent à remplir en sus de leur métier de référent scientifique ne leur permettent pas d'exercer un suivi scientifique quotidien de manière satisfaisante.
Confrontés à des emplois du temps chargés, leur implication en tant que référent scientifique dépend largement de la manière dont ils peuvent imposer leur rôle et faire valoir l'utilité de la recherche dans l'amélioration des performances. Comme les autres, ils n'échappent pas au renouvellement des postes à la suite de chaque élection des instances fédérales et leur positionnement peut être fragilisé en cas de changement de stratégie des instances dirigeantes alors qu'ils devraient incarner une certaine stabilité en matière d'accompagnement scientifique de la performance.
La reconnaissance des métiers de responsables scientifiques, d'accompagnateurs et d'intervenants scientifiques et technologiques dans les fédérations et les établissements nationaux devrait donc être une priorité. Elle devrait s'accompagner d'une harmonisation des terminologies, d'un positionnement clair dans l'organigramme et de fiches métiers appropriées, par exemple à travers un rattachement à la direction technique nationale. En outre, le travail des référents scientifiques doit s'inscrire dans la durée pour être efficace. À l'instar du médecin fédéral qui accompagne les sportifs sur le long terme, le référent scientifique devrait bénéficier d'un statut faisant de lui un élément structurel dans l'accompagnement scientifique des athlètes à la performance.
Parallèlement, le métier de référent scientifique mériterait d'être mieux connu et valorisé dans les formations universitaires, notamment dans les masters EOPS. Il serait également pertinent de développer des dispositifs pour accueillir dans les fédérations et les établissements nationaux des chercheurs et enseignants-chercheurs à travers des mises à disposition par exemple sur la période d'une olympiade132(*).
Cette expérience doit être valorisée dans la carrière et l'évaluation de l'enseignant-chercheur auprès des différentes parties prenantes (DTN, chefs d'établissement, présidents d'université, responsables des organismes nationaux de recherche, directeurs de laboratoire, etc.).
4. Les limites financières et organisationnelles
L'accompagnement scientifique de la performance se heurte à des obstacles financiers et varie fortement en fonction de l'aisance financière des fédérations et des orientations prioritaires de la direction technique nationale.
Ainsi, la Fédération française de rugby attache depuis plusieurs décennies une importance particulière à l'accompagnement scientifique à la performance. Au fur et à mesure des avancées scientifiques et technologiques, elle a peu à peu étoffé son département d'accompagnement à la performance. Actuellement, onze personnes salariées ou prestataires intervenant auprès des équipes de France sont titulaires d'un doctorat de sciences et quatre sont actuellement doctorants. Par ailleurs, un chef de projet R&D est titulaire d'un diplôme d'ingénieur Ensta.
La Fédération française de football dispose depuis 2022 d'un centre de recherche à Clairefontaine au sein de la DTN. Cette cellule est dédiée à l'accompagnement et à la recherche avec un lien fort avec la formation. Elle a notamment permis d'intégrer dans les programmes de formation des savoirs issus des dernières avancées scientifiques et technologiques en matière d'entraînement et de gestion des athlètes et des entraîneurs.
La Fédération française de natation est très avancée en matière d'analyse vidéo et d'élaboration de données au service des entraîneurs.
En revanche, certaines « petites » fédérations comme celles du surf ou du hockey sur gazon ne disposent pas de structure d'accompagnement scientifique à la performance.
Disposer d'un budget consacré à l'accompagnement scientifique de la performance est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il importe que le président et le directeur technique national de la fédération soient convaincus de l'utilité du référent scientifique. Il arrive à l'inverse que certaines fédérations aux moyens limités attachent une importance particulière à l'accompagnement scientifique.
Avec 315 000 licenciés, la Fédération française d'athlétisme a créé en 2022 une cellule d'optimisation de la performance avec notamment un nutritionniste, une préparatrice mentale, un sport scientist et une data analyst.
La Fédération française de badminton compte 225 000 licenciés et a lancé une stratégie ambitieuse d'utilisation des données pour améliorer la performance de ses sportifs de haut niveau et repérer les nouveaux potentiels.
La satisfaction des besoins à court terme des athlètes et des entraîneurs peut se faire au détriment des référents scientifiques : entre le recrutement d'un préparateur physique ou d'un référent scientifique, le choix se fera la plupart du temps en faveur du premier.
Au-delà des moyens propres des fédérations, des incertitudes ont pesé pendant un an sur la poursuite du financement de la recherche pour le sport de haut niveau. Le PPR Sport de très haute performance a fortement accéléré la mise en place d'un écosystème autour de l'accompagnement scientifique de la haute performance.
Jusqu'à l'annonce faite le 4 juillet 2025133(*) par la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, aucun nouveau financement n'avait été décidé pour l'accompagnement scientifique des athlètes aux jeux Olympiques de Brisbane de 2032.
Les fédérations concernées par les Jeux de 2028 sont en train de définir leur plan de performance afin de pouvoir intégrer un volet recherche et développement dans l'attente de plus de visibilité sur les financements134(*).
Faute de visibilité suffisante sur les futurs financements, les coopérations développées entre organismes de recherche et fédérations sont parfois remises en cause, les chercheurs étant contraints d'investir d'autres domaines de recherche pour obtenir des financements, ce qui pourrait entraîner des pertes de compétences dans les laboratoires. Pourtant, des solutions existent avant le lancement des nouveaux appels à projets du PPR pour la haute performance sportive et l'innovation. Ainsi, la prise en compte et l'inscription du sport dans les thématiques transversales des appels à projets génériques annuels de l'ANR permettraient de financer des projets de recherche en lien avec la performance sportive. Par ailleurs, les fédérations et établissements appartenant au réseau Grand Insep135(*) pourraient être déclarés éligibles aux financements ANR au même titre que les entreprises et associations.
Il convient de noter que les fédérations concernées par les jeux Olympiques d'hiver de 2026 n'ont pas bénéficié du PPR Sport de très haute performance, voire ont été pénalisées à l'instar de la Fédération française de ski qui, faute de financement, a dû réduire sa cellule de recherche à une seule personne. Pourtant, l'organisation par la France des jeux Olympiques d'hiver de 2030 nécessiterait la définition dès à présent d'un plan ambitieux sur la dimension scientifique et technologique de l'accompagnement des disciplines sportives concernées.
Le réseau national des référents scientifiques sous l'égide de l'Insep a également vu ses effectifs et son budget réduits : alors qu'il était composé de trois équivalents temps plein en 2024, une seule personne est désormais chargée de son animation avec un budget réduit.
De nombreuses personnes auditionnées se sont interrogées sur l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Toutes ont reconnu que les Jeux avaient resserré les liens entre la recherche et le sport de haut niveau. Toutefois, des relations structurelles exigent un financement à long terme de cette coopération, à l'instar de ce qu'ont entrepris les Britanniques ou les Japonais qui ont profité de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques dans leur pays pour mettre en place une politique à long terme d'accompagnement scientifique du sport de haut niveau.
Les fédérations doivent être encouragées à mettre en place de façon durable des cellules Recherche, en lien direct avec les acteurs de la performance, avec des personnels formés sur le plan scientifique capables de discuter avec les chercheurs. C'est à cette seule condition que pourra être assurée une politique d'accompagnement à la performance sur le long terme.
De même, la diffusion des résultats scientifiques auprès des staffs et des entraîneurs et leur prise en compte nécessitent une transformation des mentalités et des compétences spécifiques dans les fédérations, ce qui prend du temps et nécessite des moyens financiers. Les projets de performance des fédérations ont vocation à asseoir cette dynamique, mais non seulement les ressources de l'Agence nationale du sport ont été réduites136(*) depuis la fin des jeux Olympiques de Paris alors que de nouvelles olympiades s'annoncent, mais la légitimité de l'agence elle-même est contestée137(*). En cinq ans d'existence, elle a pourtant mis en place à travers son pôle Haute performance des bases solides pour l'accompagnement scientifique du sport de très haute performance français.
III. LES RECHERCHES ET LES INNOVATIONS AU SERVICE DES PERFORMANCES DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ONT DES APPLICATIONS DANS LES DOMAINES DE LA MÉDECINE, DE L'APPAREILLAGE ET DES LOISIRS
A. UN CONTINUUM ENTRE LA PERFORMANCE ET LA MÉDECINE
1. Des coopérations fortes entre la recherche fondamentale et la recherche clinique
La motricité est le résultat de processus complexes qui impliquent notamment le système nerveux central, le système nerveux périphérique et les muscles.
Composé du cerveau et de la moelle épinière, le système nerveux central est responsable de l'intégration des informations sensorielles et de la coordination des mouvements volontaires et involontaires. Dans le cerveau, le cortex moteur envoie des signaux aux motoneurones de la moelle épinière qui à leur tour activent les muscles. Les nerfs périphériques transmettent les signaux du système nerveux central aux muscles. Les muscles reçoivent les signaux nerveux envoyés par le cerveau et produisent les mouvements par leur contraction. Ils sont essentiels dans le maintien de la posture et la stabilité du corps.
Les lésions du système nerveux central peuvent entraîner des troubles de la motricité centrale, comme dans le cas des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson ou de certaines formes de paralysie cérébrale. Les troubles de la motricité périphérique peuvent être causés par différentes sortes de neuropathies, mais également par la maladie de Charcot-Marie-Tooth138(*) ou le syndrome du canal carpien. Plusieurs maladies peuvent affecter les muscles comme les myopathies qui entraînent leur dégénérescence progressive ou encore les maladies neuromusculaires.
Les sciences du mouvement ont pour objet, en mobilisant la biomécanique, la physiologie de l'exercice, les neurosciences et la psychologie du sport, l'analyse et la compréhension du mouvement humain sous toutes ses formes, de la performance à la déficience. Les coopérations entre les laboratoires des Staps et les centres hospitalo-universitaires se sont multipliées au cours du temps.
· Les coopérations entre laboratoires des sciences du mouvement et centres hospitalo-universitaires
Plusieurs laboratoires peuvent être mentionnés. Le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité (LIBM) rassemble 150 enseignants-chercheurs, médecins, doctorants et post-doctorants sur trois sites : l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne, l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry et l'université Claude-Bernard à Lyon.
Il se caractérise par une recherche multidisciplinaire ayant tissé des liens forts et efficients entre Staps et médecine. À Saint-Étienne, le laboratoire est implanté au sein d'une plateforme de recherche, l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport (Irmis), intégrant à la fois le LIBM et le service de physiologie clinique et de l'exercice (unités de myologie et de médecine du sport) du CHU de Saint-Étienne.
De même, le laboratoire Caps (Cognition, action et plasticité sensorimotrice), unité mixte de recherche entre l'Inserm et l'université de Bourgogne, a développé des liens étroits avec le CHU de Dijon-Bourgogne. Cinq de ses services sont intégrés dans des projets de recherche. La Plateforme d'investigation technologique (PIT) du CHU est adossée au Caps pour des projets de recherche translationnels.
Le Human Lab HIPE (Health Improvement Through Physical Exercise) est également un laboratoire de recherche autour de la physiologie humaine. Implanté dans le centre hospitalo-universitaire de la Timone à Marseille, il constitue une unité scientifique de référence pour l'évaluation physique des athlètes de haut niveau afin d'améliorer leur performance, mais également pour l'étude du rôle de l'activité physique dans le bien-être, la prévention et le traitement des pathologies.
· La création de chaires dont les sujets de recherche sont communs aux sportifs de haut niveau et aux patients
La Chaire ActiFS (Activité physique Fatigue et Santé) à Saint-Étienne a pour objectif de comprendre les mécanismes de la fatigue chronique et aiguë afin de prescrire une activité physique personnalisée et adaptée139(*). Par exemple, 10 à 25 % des personnes qui consultent un médecin généraliste sont touchées par l'asthénie140(*), ce qui compromet leur engagement dans une activité physique alors que l'activité physique est considérée comme indispensable pour prévenir un certain nombre de maladies. Dans ce cadre, 19 projets et axes de recherche sont en cours sur des sujets très larges, allant de l'électrostimulation neuromusculaire à l'effet de l'entraînement sur les réponses cardiovasculaires et neuromusculaires à l'exercice.
La chaire Sport santé de l'université de Poitiers est constituée d'un réseau de 19 laboratoires de la région Nouvelle-Aquitaine travaillant ensemble sur le thème du sport et de la santé. L'objectif est de construire des projets de recherche interdisciplinaires en lien avec l'activité physique et la santé des populations. La chaire donne accès à de nombreux équipements scientifiques grâce à un plateau technique mutualisé. Certains laboratoires associés à la chaire ont travaillé sur le projet de recherche D-Day en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Actuellement, le projet IKT in motion (Integrated knowledge translation) cherche à identifier les conditions à réunir pour développer des territoires physiquement actifs en prenant en compte l'avis de l'ensemble des parties prenantes (usagers, collectivités territoriales, professionnels de santé, professionnels du sport, acteurs de la formation et de la recherche, etc.). Le projet Women in motion, également en cours, cherche à comprendre la réponse du système cardiovasculaire de la femme à l'activité physique à chaque période de la vie (puberté, grossesse, ménopause), et tente d'identifier les conséquences psychologiques et les déterminants psychosociaux de l'adhésion à l'activité physique chez les femmes.
La chaire Active Aging 2.0, créée au sein de l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, a pour objet de prévenir les effets du vieillissement par l'activité physique et les nouvelles technologies. Ce projet s'articule autour de trois axes : la recherche, les tests et l'innovation technologique. Parmi les travaux de recherche menés, on peut mentionner la préservation des ressources cognitivo-motrices ou encore la prévention du risque de chute. L'objectif est d'étudier les trajectoires de vieillissement afin d'identifier le vieillissement optimal.
· La multiplication des formations universitaires associant sport et santé
L'université de Bordeaux a créé en 2018 l'Institut universitaire des sciences de la réadaptation (IUSR). Cet institut regroupe les filières traitant des sciences de la réadaptation et d'autres filières paramédicales faisant l'objet d'un diplôme universitaire. Plusieurs formations sont proposées, comme l'orthophonie, la psychomotricité, l'orthoptie, l'audioprothèse, la masso-kinésithérapie, l'ergothérapie, ou encore la pédicurie-podologie. Fort d'un partenariat avec le CHU de Bordeaux, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent et l'antenne Croix-Rouge de Bordeaux, l'IUSR met les étudiants en relation avec le monde de la recherche. L'objectif est de rapprocher ces formations paramédicales, historiquement éloignées de l'université, du monde académique. Un parcours d'initiation à la recherche est proposé, sous la forme d'un double cursus avec trois unités d'enseignement en lien avec la recherche et un stage en laboratoire (140 heures). Depuis 2019, 85 étudiants ont suivi ce parcours, dont 50 l'ont terminé ; 30 % ont poursuivi en master 2.
D'autres voies universitaires permettent d'investir le champ de la santé, en croisant sciences du sport, réadaptation, prévention et activité physique. C'est le cas de la spécialité Activité physique adaptée et santé (Apas) dans le cursus Staps. À Bordeaux, cet enseignement vise à former des professionnels capables d'agir auprès de publics à besoins spécifiques, avec des enjeux de santé, d'inclusion et de participation sociale. La première année fait partie du tronc commun, puis les étudiants se spécialisent en L2 et L3, avec plus de 500 heures spécifiques consacrées à l'activité physique adaptée (APA). L'approche est universitaire, fondée sur les sciences et la pratique. La licence s'articule autour de cours théoriques (biomécanique, physiologie, physiopathologie, sciences humaines et sociales, psychologie, sociologie) mais également autour de nombreux travaux dirigés appliqués et de mises en situation concrètes (locomotion en fauteuil, cécité, parasport, etc.). À Bordeaux, des partenariats avec des structures spécialisées permettent d'intervenir directement auprès de publics spécifiques, comme des traumatisés crâniens, des personnes obèses, des patients suivis en psychiatrie (via l'hôpital Charles-Perrens), ou encore des personnes en situation de précarité à Mérignac, en lien avec le service de cohésion sociale.
Pour celles et ceux qui poursuivent en master, 25 places sont ouvertes chaque année à Bordeaux en master Réhabilitation et promotion de la santé par l'activité physique adaptée.
2. Des domaines de recherche communs à la haute performance et à la médecine
De nombreux domaines de recherche concernent à la fois des sportifs de haut niveau et des patients. Les exemples suivants illustrent les liens forts entre la performance et la médecine.
a) La neuroplasticité
La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se restructurer en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cette capacité permet au cerveau de s'adapter à de nouvelles situations, mais également de compenser les pertes de certaines fonctions et de maximiser les fonctions restantes.
L'activité physique, c'est-à-dire le fait de bouger et de réaliser des actions de manière concrète, est l'un des moyens les plus efficaces pour stimuler la plasticité cérébrale. Dans les situations où le mouvement est temporairement impossible (par exemple en cas d'immobilisation), d'autres techniques peuvent favoriser la neuroplasticité : imaginer l'action à réaliser (imagerie mentale), observer quelqu'un en train d'effectuer l'action ou encore utiliser des verbes d'action qui activent le système sensorimoteur.
Ces techniques sont utilisées aussi bien chez les sportifs de haut niveau que chez des patients ou des personnes âgées.
Les techniques favorisant la neuroplasticité aident les athlètes à perfectionner leurs compétences motrices et à améliorer leurs performances grâce à un entraînement répétitif et ciblé. S'entraîner à la représentation mentale d'un mouvement est devenu de plus en plus commun dans le quotidien des athlètes, notamment dans les sports demandant une gestuelle millimétrée avec un temps de réaction rapide et une répétition rigoureuse des mouvements (sport automobile, golf, danse). La représentation mentale favorise l'automatisation des gestuelles et les performances de ces dernières aussi bien en force qu'en précision.
Ces techniques sont également utilisées pour faciliter la récupération après un accident vasculaire cérébral.
L'accident vasculaire cérébral se caractérise par une lésion d'une partie du cerveau à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin. Les cellules nerveuses sont détruites par asphyxie dans la région concernée. Lorsque les cellules du cortex moteur sont touchées, la motricité du patient va être entravée. Les techniques de neuroplasticité peuvent aider à restaurer les fonctions perdues en favorisant la réorganisation des zones saines du cerveau sans être en activité.
De la même manière, chez les personnes âgées, la commande nerveuse peut être affectée à la suite d'une chute. L'imagerie motrice, une forme spécifique d'imagerie mentale qui incite l'individu à s'imaginer réaliser un mouvement, peut aider à leur réhabilitation physique.
Les exercices d'imagerie motrice sont également utilisés par des publics qui se fatiguent rapidement et sont limités dans la pratique réelle d'activité physique. Des protocoles simples peuvent être développés pour compléter les exercices physiques avec des exercices de représentation mentale qui favorisent la neuroplasticité et aident à maintenir et même à améliorer les fonctions motrices.
b) La fatigue
Comme il a été indiqué précédemment141(*), les sportifs de haut niveau sont tous confrontés au phénomène de fatigue et une bonne gestion de cette dernière est fondamentale pour maintenir une performance optimale, prévenir les blessures, protéger leur santé et allonger leur carrière sportive.
Les sportifs ne sont pas les seuls à souffrir de fatigue. Le syndrome de fatigue chronique toucherait 250 000 personnes en France, dont 80 % de femmes142(*). Il se traduit par une asthénie permanente dès le réveil, l'apparition depuis au moins six mois d'une fatigabilité profonde qui s'accompagne souvent d'une incapacité à effectuer les tâches quotidiennes et d'une intolérance à la position debout et à l'effort ainsi que de douleurs musculaires et articulaires.
Aucun de ces symptômes n'est soulagé par le sommeil et le repos, qui ne sont pas réparateurs.
La fatigue peut également apparaître à la suite d'un séjour en réanimation ou d'une maladie infectieuse (covid long par exemple). De même, les personnes atteintes de cancer, de pathologies neurologiques (sclérose en plaques, maladies neuromusculaires), néphrologiques (insuffisants rénaux aux stades 3 et 4) ou dysimmunitaires (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, rhumatismes inflammatoires, etc.) ainsi que de nombreuses personnes âgées ressentent de la fatigue : les tâches demandent plus d'effort, elles sont perçues comme difficiles, ce qui conduit ces personnes à être moins actives. S'instaure alors un cercle vicieux dans lequel la fatigue pousse à l'inactivité, qui à son tour favorise la sédentarité. La sédentarité accélère le déconditionnement physique qui lui-même accentue l'atrophie musculaire et contribue à la fatigue. Il est donc primordial de rester ou redevenir actif.
De nombreuses équipes de recherche cherchent à comprendre la physiopathologie de la fatigue chronique ainsi que les mécanismes spécifiques de désadaptation responsables de la faiblesse et de la fatigabilité musculaires afin d'optimiser les stratégies d'intervention en rééducation et reconditionnement par l'activité physique adaptée.
L'équipe de recherche « Physical Ability and Fatigue in Health and Disease » du LIBM143(*) a mené une trentaine de projets de recherche clinique sur la fatigue neuromusculaire et l'activité physique adaptée entre 2006 et 2023. À la suite de ces travaux, un hôpital de jour a été créé qui propose une expertise sur la fatigue musculaire, le diagnostic de la fatigue (liée ou non à une maladie) ainsi que sa caractérisation et la prescription d'un entraînement personnalisé. Concrètement, les patients remplissent des questionnaires sur leur état de santé, la fatigue ressentie, la dépression, l'anxiété. L'état nutritionnel est également évalué. Ils font l'objet d'un bilan sanguin complet et d'une évaluation métabolique à l'exercice (VO2max, seuil lactique, etc.). Ils sont également soumis à des tests de fatigue neuromusculaire et des tests fonctionnels et leur force musculaire comme leur équilibre et leur souplesse sont évalués.
À l'issue de cette phase, les patients reçoivent une prescription qui fixe les modalités et les posologies de l'entraînement. Une application permet de communiquer avec eux, notamment avec ceux qui sont insuffisants cardiaques, la rééducation n'étant pas réalisée à l'hôpital de jour. Certains patients sont inclus dans des protocoles de recherche sur douze semaines afin de vérifier l'impact de la prescription d'activité physique adaptée sur leur état de santé et sur la fatigue qu'ils ressentent.
Les patients sont impliqués dans la prise en charge de leur pathologie dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique qui leur apprend notamment à connaître leur maladie et les traitements existants.
Selon le professeur Guillaume Millet, qui est à l'origine de ces travaux sur la fatigue, la principale difficulté dans la mise en oeuvre de l'activité physique adaptée réside dans le nombre insuffisant de structures d'accueil des patients. Afin de combler cette lacune, il souhaiterait pouvoir créer une salle réservée aux patients à proximité (voire au sein) du CHU de Saint-Étienne. La salle pourrait être gérée par une association et employer des enseignants en activité physique adaptée qui accompagneraient les patients pendant quelques mois pour favoriser l'acquisition de leur autonomie dans la pratique d'activité physique adaptée. Des liens avec la filière APA (licence et master Apas) du département Staps seraient à développer.
3. Des applications communes : l'exemple de l'électrostimulation
L'électrostimulation peut être utilisée pour étudier la fatigue ou la défaillance neuromusculaire et déterminer si celle-ci est due à une altération de la commande nerveuse ou à une diminution de la capacité musculaire elle-même. Des personnes peuvent perdre 20 % de leur capacité à produire de la force pour des raisons très différentes. Dans certains cas, le muscle peut être fatigué ou défaillant et moins capable de produire de la force. Pour remédier à cette situation, il faudra entraîner le muscle pour le rendre plus résistant à la fatigue. Dans d'autres cas, la capacité du muscle à produire de la force est intacte, mais la commande du cerveau vers le muscle est altérée. L'accent devra alors être mis sur des stratégies ciblant la commande nerveuse pour éviter une défaillance au fur et à mesure de la répétition de l'action.
L'électrostimulation peut être utilisée pour contourner le système nerveux central et stimuler directement les nerfs qui commandent les muscles. En appliquant des impulsions électriques au muscle au repos, on peut mesurer la force générée en réponse à ces impulsions. Si la force est faible avec l'électrostimulation, la fatigue ou la défaillance est musculaire.
L'électrostimulation permet également de vérifier si la fatigue ou la défaillance est liée à la commande nerveuse. Elle est alors réalisée durant une contraction maximale volontaire. Si la force produite par la stimulation électrique est significativement plus élevée que celle produite par la contraction volontaire, cela peut indiquer une fatigue ou une défaillance de la commande centrale. Pour localiser les altérations nerveuses (cerveau ou moelle épinière), on peut également utiliser la stimulation magnétique transcrânienne. Elle consiste à poser une bobine électromagnétique contre le cuir chevelu qui envoie des impulsions magnétiques à travers le crâne pour modifier l'activité des neurones du cerveau. Parallèlement, des électrodes sont placées sur le muscle d'intérêt pour mesurer son activité. Lorsque la zone du cortex moteur est activée, le muscle se contracte grâce à la commande du cerveau vers le muscle.
L'électrostimulation est souvent utilisée pour mesurer l'impact de l'entraînement sur les capacités neuromusculaires des sportifs de haut niveau ou des patients. Elle est alors réalisée sur le muscle au repos ou pendant une contraction maximale volontaire avant puis après l'entraînement.
L'électrostimulation est également employée pour faciliter la récupération des sportifs de haut niveau en l'appliquant directement sur les muscles. Les courants utilisés sont des courants à basse fréquence et faible intensité, qui provoquent des microcontractions du muscle, proches d'un massage. La circulation sanguine est stimulée, ce qui aide à éliminer plus rapidement les toxines accumulées pendant l'effort.
L'électrostimulation permet de prévenir l'atrophie musculaire malgré une mobilité réduite. Utilisée par les sportifs de haut niveau en cas de blessure, cette technologie offre la possibilité d'effectuer une activité physique à des personnes qui peuvent difficilement en faire. Dans ce cas, les courants sont appliqués à haute fréquence et à haute intensité afin de provoquer une contraction importante du muscle.
Au laboratoire Cognition, action et plasticité sensorimotrice de Dijon, un rameur a été conçu et aménagé pour être utilisé par des paraplégiques. Des électrodes sont collées sur les muscles quadriceps et reliées au stimulateur. Le patient tient dans sa main une commande qui, lorsqu'on appuie sur un bouton, envoie le courant dans les muscles du quadriceps qui vont se contracter et faire reculer le siège. Le courant est coupé lorsque le bouton est relâché. L'électrostimulation se substitue au travail volontaire des muscles mais a le même impact sur la santé que l'activité physique, à condition toutefois d'atteindre une intensité permettant de simuler un nombre de fibres musculaires suffisant pour mettre en mouvement le corps du patient. L'équipe de recherche sur l'électrostimulation fonctionnelle de Dijon a cité l'exemple d'un athlète spécialisé dans le handibike, qui en s'entraînant sur ce rameur, a augmenté ses capacités respiratoires de 70 %. Avec de l'entraînement, les paraplégiques arrivent à faire du rameur de manière fluide et naturelle.
L'utilisation de cette technique a été étendue à d'autres catégories de population, notamment les personnes en réadaptation respiratoire, les personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale ou encore les personnes atteintes d'une sclérose en plaques.
Devant l'intérêt de cette technologie, l'université de Bourgogne a décidé d'élargir l'utilisation du rameur au-delà des protocoles de recherche afin de permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à des programmes encadrés et adaptés d'activité physique.
Dans le même objectif, l'association Stimule ton handicap a été créée pour les personnes porteuses de handicap lié à la locomotion (lésion médullaire, neuropathie périphérique, hémiplégie, etc.) désireuses de participer à un programme d'activité physique adapté à leurs contraintes.
L'objectif est d'améliorer l'état de forme des participants grâce à l'évolution de deux facteurs :
- la VO2max (capacité maximale du corps à s'adapter à un exercice) : des études ont montré qu'après six mois d'entraînement, cette valeur est en moyenne multipliée par deux ;
- la masse musculaire : ce paramètre peut être augmenté de 150 % en six mois, ce qui a des répercussions directes sur la vie quotidienne des personnes (aisance pendant les transferts et les déplacements), sans parler du bénéfice esthétique et de l'amélioration de l'estime de soi.
Après une évaluation complète de la personne, un programme individualisé de séances de rameur une à deux fois par semaine est mis en place, adapté aux besoins et aux capacités des pratiquants et faisant l'objet d'une évaluation régulière toutes les dix séances afin de quantifier les progrès.
Si cette initiative est particulièrement appréciée par les membres de l'association, son développement se heurte à un manque de moyens financiers et humains. Actuellement, ce sont les étudiants en Staps qui animent bénévolement les séances et l'association ne dispose pas de locaux dédiés à cette activité. En outre, le rameur utilisé est un prototype développé par l'université qui jusqu'à présent n'a recueilli l'intérêt d'aucun industriel, ce qui aurait permis de lancer sa commercialisation et de poursuivre son développement. Au contraire, plusieurs entreprises européennes qui avaient participé à sa conception ne produisent plus les pièces nécessaires à son entretien, qui doivent être commandées aux États-Unis. Aussi, le rameur ne répondant plus aux normes CE, il n'est plus possible d'obtenir des financements pour des projets de recherche utilisant ce matériel.
L'équipe de recherche de l'université de Bourgogne s'intéresse également à l'électrostimulation fonctionnelle sur vélo qui permet de s'affranchir des difficultés liées aux séances de réadaptation traditionnelles basées sur la modulation de la résistance sur le vélo. Pour les personnes souffrant d'un déficit de mobilité ou très déconditionnées, un tel protocole est difficile à mettre en pratique. L'équipe est en train de travailler sur un programme d'entraînement avec une échelle reposant sur la perception de l'effort. En effet, il a été constaté que les patients estiment l'exercice de pédalage plus facile lorsqu'il est réalisé avec l'assistance de l'électrostimulation. Une étude est donc menée pour vérifier si le fait de faire reposer les séances en réadaptation sur la perception de l'effort plutôt que sur la modulation de la résistance du vélo ne conduirait pas les patients à développer plus de puissance grâce à l'électrostimulation tout en ayant l'impression d'une plus grande facilité, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l'adhésion à l'activité physique.
Le laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, sous l'égide de Vance Bergeron, chercheur devenu tétraplégique en 2013 à la suite d'un accident de vélo, s'est également spécialisé dans l'électrostimulation fonctionnelle. Ce chercheur a créé en 2015 l'association ANTS144(*) afin de rendre accessibles le sport et les nouvelles technologies aux personnes en situation de handicap moteur. Puis, en 2019, la salle S.P.O.R.T145(*) a été inaugurée dans les locaux de l'ENS de Lyon. Le local et les équipements de musculation sont accessibles en fauteuil roulant. Cet espace propose deux vélos équipés d'électrostimulation, des appareils de musculation adaptés, un accompagnement par des enseignants en activité physique adaptée. L'arrière d'un rameur a été repensé par l'ENS avec un siège, un dossier, des poignées et un harnais de sécurité qui peut être ajouté. Il est également possible de régler la hauteur des pieds ainsi que l'amplitude des jambes avec des ressorts décalables. En 2019, Vance Bergeron et son ancien doctorant Amine Metani ont fondé la start-up Circles qui développe des vélos et rameurs à électrostimulation destinés à des centres de rééducation fonctionnelle et à des salles de sport dédiées aux personnes en situation de handicap moteur, ce qui a valu à Vance Bergeron la médaille de l'innovation du CNRS.
Actuellement, 120 personnes ayant un handicap moteur (maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, personnes paraplégiques, tétraplégiques ou encore victimes d'accidents vasculaires cérébraux) viennent régulièrement faire de l'activité physique dans la salle S.P.O.R.T, qui allie rééducation, activité physique, plaisir et socialisation.
En dépit de son succès146(*), l'association ANTS est confrontée à plusieurs défis. D'abord, il lui faut trouver une nouvelle salle d'ici la fin de l'année 2025. Par ailleurs, le coût des équipements reste très élevé. Ainsi, le modèle américain TR300147(*) coûte 50 000 euros.
La salle S.P.O.R.T est actuellement unique en France alors que notre pays compte 120 000 personnes souffrant de sclérose en plaques, 50 000 paraplégiques et tétraplégiques, 7 % de la population française souffrent de douleurs neuropathiques et 3 à 3,5 millions de personnes sont considérées comme à mobilité réduite.
4. Une préoccupation commune : la personnalisation des entraînements
Qu'elles visent les sportifs de haut niveau ou les patients, les recherches en sciences du mouvement partagent la même préoccupation : développer des programmes d'entraînement individualisés au plus près des besoins des personnes auxquelles ils sont destinés pour améliorer leurs performances. Si la personnalisation des entraînements est pratiquée depuis longtemps en matière de sport de haut niveau, l'activité physique adaptée n'a été reconnue officiellement comme une modalité de soin non médicamenteux qu'en 2016148(*).
L'activité physique adaptée est une thérapeutique individualisée qui prend en compte les pathologies du patient, ses capacités fonctionnelles ainsi que son degré d'autonomie mais également l'efficacité des exercices proposés. En effet, les patients ne réagissent pas tous de la même manière : certains vont réagir mieux dans le cas d'exercices à basse intensité, d'autres vont être plus sensibles à du renforcement musculaire seul ou combiné à des exercices cardiovasculaires. Il faut donc développer des outils pour définir les exercices qui conviennent le mieux à chaque patient.
La prise en compte de la fatigue du moment doit permettre d'adapter la séance afin notamment de maintenir la motivation et l'engagement des patients.
Le projet EvaLife vise à proposer un programme d'entraînement personnalisé. Développé par le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité (LIBM) et le laboratoire Hubert-Curien, il repose sur trois piliers :
- une station mobile d'autoévaluation des capacités physiques (force du bas du corps, force du haut du corps, endurance, souplesse, équilibre, puissance, etc.) pendant une heure à partir de sept tests ;
- le développement d'un plan d'entraînement par un algorithme qui tient compte non seulement des capacités physiques, mais également du temps et du matériel disponibles ;
- une application sur smartphone qui va proposer des séances d'entraînement.
À la fin de chaque séance, la personne est invitée à préciser si elle a trouvé l'exercice difficile et si elle a ressenti des douleurs. Ces informations sont prises en compte par l'algorithme pour la conception des futures séances d'entraînement.
Cette initiative avait pour but initial de favoriser l'activité physique chez des personnes sédentaires sans pathologie avérée. La conception d'une station mobile d'autoévaluation des capacités physiques devait permettre à des entreprises de louer ce matériel pour que leur personnel puisse réaliser les tests sur leur lieu de travail et bénéficier d'un programme d'activité physique adapté à réaliser en autonomie (à domicile).
Au regard des difficultés rencontrées pour créer la start-up pouvant prendre en charge cette activité, le projet EvaLife a été réorienté vers des personnes souffrant d'une pathologie afin de leur proposer, grâce à une application sur leur smartphone, un programme d'activité physique répondant à leurs besoins individuels. Un premier essai a été lancé avec un patient atteint de myopathie. À la différence de l'application prévue pour les personnes sans pathologie avérée, le programme d'entraînement développé par l'algorithme doit faire l'objet d'une validation par un enseignant en activité physique adaptée (ou un autre professionnel de santé) avant d'être envoyé au patient.
Ce suivi personnalisé présente plusieurs avantages. Proposé en complément de séances avec un enseignant en APA, il permet de motiver les patients à faire les exercices et à ne pas se désengager. En outre, il permet de pallier le nombre insuffisant d'enseignants en APA et limite le coût de la prise en charge de l'APA. Toutefois, ce projet doit faire l'objet d'essais cliniques pour tester son efficacité et prétendre à une prise en charge par l'assurance maladie. Ces essais cliniques n'ont, au moment de la rédaction du présent rapport, pas encore trouvé de financement (plusieurs demandes de financement sont en cours).
B. LES INTERACTIONS DANS LE DOMAINE DE L'APPAREILLAGE
1. La biomécanique et l'analyse du mouvement au service de l'appareillage
La biomécanique et l'analyse du mouvement sont essentiels dans le domaine de l'appareillage des personnes dont la mobilité est altérée, notamment pour la fabrication de prothèses.
L'analyse biomécanique permet de décomposer le mouvement en différentes phases - par exemple lors de la marche entre phase d'appui et phase de balancement - pour comprendre précisément comment la prothèse doit fonctionner à chaque étape. L'analyse du mouvement est réalisée grâce à des systèmes de capture de mouvement qui enregistrent et analysent le mouvement tridimensionnel des segments corporels. Les plateformes de force mesurent les actions mécaniques de contact entre les pieds et le sol et permettent de quantifier les forces de réaction au sol, le centre de pression, l'équilibre et la stabilité. D'autres mesures renseignent sur l'activité musculaire et permettent d'évaluer la dépense et l'efficacité du mouvement.
Grâce à des modèles informatiques reposant sur la biomécanique, il est possible de simuler le comportement d'une prothèse avant sa fabrication, ce qui permet d'optimiser sa conception. Une attention particulière est portée à l'emboîture149(*) pour éviter les points de pression et les frottements susceptibles de provoquer des plaies ou des infections. Ainsi, dans le cadre de sa collaboration avec Proteor150(*), l'Institut de biomécanique Georges-Charpak, spécialisé notamment dans la modélisation et la simulation numérique, modélise les chargements151(*) et les déformations des moignons pour anticiper les réactions des tissus mous au niveau de l'emboîture.
Les matériaux utilisés dans les prothèses doivent être biocompatibles et capables de résister aux forces et aux contraintes biomécaniques. La biomécanique aide à sélectionner les matériaux appropriés et à concevoir des structures qui peuvent supporter ces contraintes sans causer de dommages aux tissus environnants.
L'analyse biomécanique guide également la conception pour réduire la dépense énergétique de l'utilisateur, en optimisant la transmission des forces et en favorisant des mouvements plus naturels et moins fatigants. Les prothèses peuvent ainsi être conçues pour stocker et restituer de l'énergie pendant la marche. La consommation d'énergie pendant la marche d'une personne ayant subi une amputation transfémorale est en effet de 50 à 100 % plus élevée que chez une personne valide. Concrètement, lorsqu'une personne amputée marche à une vitesse de confort pour une personne valide, l'effort qu'elle fournit correspond à un footing. Or, de nombreuses personnes âgées diabétiques sont concernées par des amputations et leurs capacités physiologiques ne leur permettent pas forcément de remarcher avec une prothèse. La biomécanique aide à développer des protocoles de rééducation adaptés, en analysant les mouvements de l'utilisateur avec la prothèse pour améliorer sa maîtrise et son confort.
La biomécanique est au coeur d'un processus multidisciplinaire qui associe ingénierie, médecine, ergonomie et technologie pour créer des prothèses toujours plus performantes et adaptées aux besoins des utilisateurs. À l'Institut biomécanique humaine Georges-Charpak, biomécaniciens et cliniciens travaillent en étroite coopération, la biomécanique étant couplée à la physiologie. Au-delà des outils traditionnels utilisés pour la biomécanique et l'analyse du mouvement (système optoélectronique de capture de mouvement, centrales inertielles, électromyogramme pour quantifier l'activation musculaire), l'institut dispose de plusieurs systèmes d'imagerie médicale, dont des systèmes d'élastographie ultrasonore pour mesurer les propriétés mécaniques des tissus.
La biomécanique au service de l'innovation : la prothèse Synsys
Pour une personne amputée fémorale, la prothèse doit fournir à la fois un genou, une cheville et un pied. Jusqu'à présent, le marché des prothèses offrait des genoux prothétiques auxquels on associait un pied prothétique avec des éléments de connectique entre le genou et le pied. La prothèse Synsys permet d'intégrer une articulation de genou avec une articulation de cheville travaillant en synergie ainsi qu'un pied prothétique, offrant un contrôle électronique de la phase d'appui. Cette prothèse permet de retrouver une marche fluide en collant au plus près de la biomécanique de la marche d'une personne valide. Lorsqu'une personne valide marche, elle relève la pointe du pied quand il n'est pas en contact avec le sol. Or, les prothèses traditionnelles ne permettent pas ce mouvement, ce qui implique une certaine rigidité du pied et un risque de trébuchement. Dotée de capteurs, la prothèse Synsys reconnaît en temps réel les phases du cycle de la marche152(*) et reproduit le mouvement coordonné entre le genou et la cheville153(*), ce qui permet une mise à plat du pied dans différentes situations, en marche à plat mais également en descente de pente ou d'escalier, offrant une plus grande sécurité pour son utilisateur.
En outre, une application pour smartphone a été développée pour permettre au patient de régler la hauteur du talon de la prothèse afin de l'adapter à la chaussure qu'il porte.
2. La démocratisation des équipements et l'adaptation des normes à l'évolution technologique
a) Un marché de niche coûteux
Le matériel adapté à l'activité physique des personnes en situation de handicap est un marché de niche et son prix reste un obstacle de taille pour la diffusion de la pratique sportive.
Ainsi, un fauteuil roulant de compétition peut coûter jusqu'à 8 000 euros. En outre, plus le handicap est important, plus la personne en situation de handicap a besoin de matériel sur mesure pour compenser le handicap et plus le matériel est cher. Or, 50 % des personnes en situation de handicap vivent dans des quartiers labellisés « politique de la ville ». Selon le professeur Patrick Genêt154(*), il faudrait permettre aux personnes en situation de handicap de tester plusieurs sports en développant des bourses au matériel et des échanges.
Au cours de son audition, la chercheuse Mai-Ahn Ngo155(*) a présenté une initiative intéressante de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDHP) de Belfort : un référent sport accompagne les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans la sélection du sport qu'ils souhaitent pratiquer ainsi que dans le choix du matériel et du club d'accueil. Une fois ces choix réalisés, la personne peut demander un matériel spécifique dans le cadre de sa PCH, sachant que la MDPH dispose d'un certain nombre de matériels qu'elle peut prêter.
Il pourrait être opportun de généraliser ce dispositif, par exemple par le détachement d'un fonctionnaire du ministère des sports ayant des connaissances en activités physiques adaptées pour jouer le rôle de référent sport dans les MDPH, à l'instar des référents en matière d'éducation ou d'emploi détachés dans les MDPH.
L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris a sensibilisé les pouvoirs publics, ainsi que l'opinion publique, aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap pour pratiquer une activité sportive. Depuis novembre 2024, la PCH permet de financer jusqu'à 75 % d'une aide technique, dont les lames de sport, pour un montant allant jusqu'à 13 300 euros sur 10 ans. Tous les composants de la prothèse peuvent être pris en charge : lame, manchon, emboîture, genou, etc.
À partir du 1er décembre 2025, l'assurance maladie devrait prendre en charge l'intégralité des fauteuils roulants, dont les fauteuils roulants sportifs156(*). Concrètement, les fauteuils roulants standards permettant le sport de loisir verront leur remboursement multiplié par quatre, pour atteindre 2 400 euros. Les fauteuils roulants plus complexes, conçus sur mesure pour répondre aux exigences de la compétition ou aux besoins spécifiques des sportifs, feront l'objet d'un dispositif simplifié. Leur remboursement sera possible sur demande d'accord préalable (DAP) auprès de l'Assurance maladie.
Certains industriels se sont également engagés à faciliter l'accès au sport en nature pour les personnes amputées.
L'entreprise Salomon a ainsi lancé le projet Adaptive, un projet visant à créer des prothèses innovantes pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer des sports comme la course à pied, le ski et le snowboard en relevant un double défi : technologique et financier.
Le projet Adaptive a débuté grâce à Jérôme Bernard, un athlète triple amputé qui a imaginé une prothèse robuste et abordable en collaboration avec Airbus. Cette prothèse utilise les chutes de carbone provenant de la fabrication des avions Airbus A350.
Alors qu'une lame coûte autour de 10 000 euros, la start-up Hopper a réussi à diminuer drastiquement les coûts de production en réduisant au maximum la partie non standardisée de la lame (à l'exception du manchon, car personne n'est amputé au même niveau) pour proposer une prothèse dont le prix est compris entre 1 500 et 2 000 euros. Salomon a développé une semelle spécialement adaptée à la course en montagne qui se fixe sur ladite lame.
Plus récemment, Salomon a conçu des prothèses pour le ski et le snowboard en tenant compte des besoins spécifiques des athlètes en situation de handicap. La prothèse de snowboard intègre une lame de course à pied, tandis que celle pour le ski recrée le mouvement naturel de la cheville pour faciliter la pratique du ski de piste et du ski de randonnée. Afin de diminuer les coûts de production, ces prothèses ont été conçues pour pouvoir être fabriquées sur les chaînes de production des skis et des snowboards.
La technologie de l'impression 3D permet de réduire fortement les coûts. Dans de nombreux pays à faible revenu, seules 5 à 15 % des personnes nécessitant un appareillage orthopédique, notamment des prothèses, en bénéficient réellement. Dans les zones éloignées et dangereuses, les médecins sont rares et le matériel est coûteux. Des prothèses mal conçues ou mal ajustées peuvent causer des lésions cutanées, des escarres et une fatigue musculaire. C'est pourquoi l'association Handicap International a entrepris de tester la technologie de l'impression 3D pour résoudre ces problèmes. Un petit scanner 3D est utilisé pour créer un moule numérique du membre amputé. Ce moule peut être adapté aux besoins du patient à l'aide d'un logiciel de modélisation numérique avant d'être transmis à une imprimante 3D dédiée afin de créer une emboîture sur mesure. Les prothèses 3D font encore l'objet d'essais mais elles pourraient constituer une alternative aux prothèses traditionnelles dans des zones isolées et sans infrastructures médicales adaptées.
L'utilisation du numérique et de l'impression 3D devrait également faciliter la démocratisation des protections intra-buccales sur mesure.
Plusieurs études ont montré l'intérêt des protections intra-buccales pour réduire les risques de lésion des tissus mous (lèvres) et des dents antérieures maxillaires, les risques de choc inter-arcades et à la base du crâne ainsi que les risques de commotion cérébrale et d'atteinte cervicale.
Le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et la norme NF S72-427 spécifient les exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité applicables aux protections intra-buccales (PIB), notamment en matière de rétention de la PIB, de recouvrement des dents, d'espace de ventilation, d'épaisseur de la PIB et de performance à l'impact. Les protections intra-buccales sur mesure faites par injection ou par pression positive sont beaucoup plus précises car elles sont adaptées à la morphologie de la bouche.
Par ailleurs, elles sont confortables, durables et offrent une protection optimale quand elles sont confectionnées dans le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité. Pourtant, elles ne représentent que 13 % des protections intra-buccales portées157(*), notamment en raison de leur coût (plus de 300 euros), mais également parce que les modalités de fabrication sont plus contraignantes. Jusqu'à trois visites chez le dentiste sont nécessaires : une première fois pour prendre des empreintes, une deuxième fois pour définir la position mandibulaire et une troisième fois pour faire des réglages et récupérer la protection intra-buccale. En outre, le délai de fabrication peut être long.
Afin de réduire la durée et les coûts de fabrication des protections intra-buccales sur mesure, une équipe de chercheurs et de praticiens158(*) a développé une technique de fabrication qui permet, à l'issue de l'enregistrement numérique intra-buccal, de concevoir la protection intra-buccale par ordinateur puis de l'imprimer en 3D. Il est désormais possible de fabriquer une protection intra-buccale sur mesure en moins de trois quarts d'heure et pour moins de 100 euros.
b) L'adaptation des normes aux évolutions technologiques
La prise en compte des évolutions technologiques dans les dispositifs médicaux et les aides techniques est freinée par l'évolution très lente des normes.
Les normes sur les dispositifs médicaux sont indispensables pour garantir la sécurité des patients et des utilisateurs. Elles fixent des critères de qualité que les fabricants doivent respecter, assurant ainsi la fiabilité et la durabilité des dispositifs.
Néanmoins, elles peuvent ralentir l'arrivée sur le marché de dispositifs médicaux innovants.
Les normes garantissent que les dispositifs médicaux, comme les prothèses, sont conçus et fabriqués de manière à minimiser les risques pour les utilisateurs. Leur élaboration est le fruit d'un long processus s'appuyant sur des recherches, des études et des consultations avec des experts et des parties prenantes. Un fois qu'une norme est adoptée, elle a vocation à durer. Les normes mettent donc du temps à s'adapter aux évolutions technologiques.
Par ailleurs, les normes fixent des coefficients de sécurité pour décrire la capacité d'un système à supporter des charges ou des contraintes au-delà de celles auxquelles il est normalement soumis. Si les coefficients de sécurité augmentent la fiabilité des prothèses en réduisant le risque de défaillance, ils peuvent néanmoins les rendre tellement contraignantes pour l'usager qu'elles deviennent inutilisables.
C'est la situation que rencontrent de nombreux sportifs et associations qui souhaitent développer des prothèses pour la pratique sportive de personnes en situation de handicap. Le matériel qu'ils conçoivent doit être abordable et ergonomique, ce qui apparaît bien souvent comme un obstacle au strict respect des normes de sécurité imposées aux dispositifs médicaux. En outre, les risques financiers liés à la certification du matériel comme dispositif médical sont trop importants au regard des bénéfices escomptés sur ce marché de niche. Par conséquent, très peu d'entreprises sont prêtes à investir dans ce secteur.
Comme le faisait remarquer un chercheur de l'Institut de biomécanique humaine Georges-Charpak : « Les snowboarders sont confrontés au dilemme suivant : soit ils utilisent la prothèse allemande qui respecte les normes, mais n'a pas évolué depuis 15 ans et ressemble à un char d'assaut ; soit ils achètent du matériel beaucoup plus performant aux États-Unis qui ne bénéficie pas du certificat CE mais qu'ils vont casser à un moment donné ; soit ils fabriquent leur propre prothèse en sollicitant le soutien technologique de laboratoires de recherche français. Toutefois, cette solution met en porte-à-faux les instituts de recherche dans la mesure où ils ne peuvent pas garantir la fiabilité à 100 % du matériel, en dépit de l'attention portée à sa solidité. Quelle serait la responsabilité du laboratoire si un utilisateur se blesse ?»
En outre, dans la mesure où la prothèse utilisée ne dispose pas du certificat CE, elle ne peut pas être utilisée dans le cadre d'un appel à projets.
Des entreprises se sont néanmoins créées avec le but de rendre la pratique de sport outdoor accessible à tous, quel que soit le handicap. Ainsi, depuis 30 ans, la société Tessier fabrique du matériel pour les sports de glisse comme les sitwakes ou les sitskis. Toutefois, les produits proposés entrent dans la catégorie d'aides techniques et non de dispositifs médicaux159(*). Ils restent néanmoins très onéreux. Les stations de ski commencent à s'équiper et à louer ces matériels aux sportifs en situation de handicap.
Il est donc important que les appareillages pour la pratique sportive entrent dans la catégorie d'aides techniques pour bénéficier des innovations technologiques auxquelles ils auraient plus de mal à accéder en tant que dispositifs médicaux.
C. LE TRANSFERT DES TECHNOLOGIES DU SPORT DE HAUT NIVEAU VERS LE SPORT DE LOISIR
1. L'essor des applications mobiles
Un sondage réalisé par Odoxa en 2019 fait apparaître que quatre Français sur dix utilisent des objets connectés dans le cadre de leurs activités sportives. Grâce aux avancées technologiques, les amateurs de sport ont désormais accès à une multitude d'applications mobiles qui leur permettent de mesurer toutes sortes de paramètres160(*).
L'un des principaux intérêts des applications mobiles pour les sportifs amateurs réside dans la possibilité de suivre leurs performances en temps réel. Grâce à la géolocalisation, des applications comme Strava ou Runkeeper permettent aux utilisateurs de suivre leurs entraînements, que ce soit pour la course à pied ou le cyclisme. Ces plateformes collectent une grande quantité de données telles que la distance parcourue, la vitesse, le temps de course, la fréquence cardiaque, voire la cadence de course ou l'altitude.
Ces informations permettent aux sportifs de mesurer leur progression au fil du temps.
D'autres avancées des nouvelles applications sportives ont été permises par l'intégration de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces technologies permettent de créer des programmes d'entraînement personnalisés en fonction du niveau, des objectifs et des préférences de l'utilisateur. L'intelligence artificielle de l'application Freelectics est capable d'évaluer les progrès réalisés et d'adapter continuellement le programme d'entraînement afin d'optimiser les résultats. Cela peut s'avérer très utile pour les pratiquants qui n'ont pas de coach personnel ou qui ne sont pas en mesure de suivre des cours en salle. En intégrant des éléments comme la récupération, la fréquence des séances ou le type d'exercices, l'IA permet de rendre l'entraînement plus efficace.
Les marques d'équipements sportifs investissent également dans la réalisation d'entraînements individualisés. Par exemple, Salomon développe actuellement un algorithme d'entraînement adaptatif intégrant l'analyse de l'historique sportif, des tests de terrain et les réponses à un questionnaire afin de générer un plan d'entraînement individualisé. Ce type de dispositif est directement inspiré de l'approche scientifique du sport de haut niveau et illustre le phénomène actuel de transfert technologique vers le grand public.
L'aspect sanitaire est également un axe fondamental des applications mobiles pour sportifs. En plus du suivi des performances, plusieurs applications s'intéressent à la santé générale, avec des informations sur le stress, la respiration, le « body battery »161(*), la nutrition. Des applications comme MyfitnessPal ou Yazio permettent aux utilisateurs de suivre leur alimentation et de gérer leur apport calorique en scannant les produits alimentaires et en calculant la valeur nutritionnelle de leurs repas. Ces outils visent les personnes souhaitant atteindre des objectifs spécifiques, comme la prise de masse musculaire ou la perte de poids.
Certaines applications vont encore plus loin en intégrant des conseils sur la gestion du sommeil. Par exemple, l'application Sleep Cycle aide à analyser les cycles de sommeil, élément clé pour faciliter la récupération et améliorer les performances sportives.
L'un des principaux défis pour beaucoup de sportifs amateurs reste la motivation. Les applications ont donc développé des fonctionnalités sociales qui permettent aux utilisateurs de rester connectés et de se stimuler mutuellement. Des plateformes comme Strava ou Zwift, une application pour les cyclistes et les coureurs en intérieur, offrent la possibilité de rejoindre des groupes virtuels, de participer à des défis communautaires ou encore de suivre les performances d'autres utilisateurs.
Les réseaux sociaux de sport créent des environnements dans lesquels les utilisateurs se motivent et s'encouragent les uns les autres. Cela renforce la dimension sociale du sport tout en rendant la pratique plus agréable. Les challenges virtuels organisés par les applications, comme des courses ou des parcours de groupe, ont pour objectif d'inciter les utilisateurs à se dépasser, en offrant un aspect ludique et compétitif.
De plus en plus d'applications exploitent le côté ludique pour rendre le sport plus engageant. Zwift entend transformer l'expérience du cyclisme et de la course en intérieur en un véritable jeu vidéo. Les utilisateurs pédalent ou courent sur les parcours virtuels et peuvent interagir avec d'autres sportifs du monde entier. La pratique devient plus attractive et offre une sensation d'immersion souvent plus motivante que la séance d'entraînement traditionnelle.
D'autres applications, comme Nike Run Club, offrent également des niveaux, des défis à relever ou des classements en ligne, apportant une dimension de jeu et de compétition. Cela donne aux utilisateurs un objectif complémentaire de la simple performance physique, ce qui peut rendre la pratique sportive plus attrayante, en particulier pour ceux qui sont réticents à l'exercice.
La course à pied et le cyclisme ne sont pas les seules disciplines à bénéficier d'applications mobiles. Des protège-tibias connectés apparaissent désormais de plus en plus dans le football amateur, ou encore des capteurs insérés dans les chaussettes, pouvant afficher la distance parcourue, le nombre de touches de balle, la force de frappe ou encore les déplacements. Au tennis, des capteurs de mouvement installés à l'extrémité du manche de la raquette permettent de mesurer la vitesse et la rotation des balles, l'endroit de leur impact sur la raquette, le nombre d'échanges. Il est également possible d'analyser son jeu avec différents schémas et graphes, notamment la force de frappe, le type de frappe et les zones de frappe.
Les montres cardio GPS intègrent des algorithmes de mesure de natation en piscine. En plus de mesurer les longueurs, et donc l'allure et la distance, la plupart d'entre elles détectent le style de nage, comptent le nombre de mouvements par longueur et donc la cadence. Elles déterminent également le score SWOLF : cet indicateur d'efficacité prend en compte le temps pour effectuer une longueur et le met en rapport avec le nombre de mouvements.
2. Des équipements de pointe au service du sport de loisir
Compte tenu de la taille du marché que représente le sport de loisir par rapport au sport de haut niveau ainsi que de l'intérêt grandissant des sportifs amateurs à bénéficier d'un matériel performant, de nombreuses entreprises investissent dans des programmes de recherche afin de faire profiter tous les usagers, amateurs comme professionnels, de ces avancées technologiques.
Decathlon a ainsi développé son SportsLab, un immense laboratoire de près de 80 000 mètres carrés, entièrement dédié au sport. Des chercheurs en biomécanique, en physiologie, en psychologie, en orthopédie ainsi qu'en ergonomie y étudient le corps humain et ses interactions avec les équipements. Des collaborations sont nouées avec des sportifs professionnels afin de perfectionner et optimiser les équipements proposés par l'entreprise. Le SportsLab dispose d'ateliers de prototypage, d'une usine d'assemblage et d'un laboratoire pour réaliser les tests mécaniques. Ces travaux ont permis de mettre à disposition du grand public des équipements comme des brassières de sport plus adaptées pour les sportives, des vélos pour enfants dont les freins sont conçus pour faciliter l'apprentissage du freinage, des vélos de course intégrant les mêmes technologies que les modèles professionnels développés pour l'équipe AG2R ou encore des modèles de chaussures particulièrement performants (utilisés notamment par Jimmy Gressier pour battre le record d'Europe sur 5 km en 2025).
Au-delà du sport amateur, les avancées technologiques dans le sport de haut niveau peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne du grand public.
Ainsi, les voitures bénéficient des innovations technologiques issues du sport automobile, qu'il s'agisse des systèmes de freinage, des systèmes de sécurité, des suspensions, des boîtes de vitesses ou encore du choix des matériaux. En effet, la performance des écuries automobiles repose en grande partie sur le développement de prototypes toujours plus performants. Afin de rentabiliser ces investissements, les constructeurs automobiles ont donc intérêt à diffuser les innovations technologiques développées pour les voitures de course ou de rallye sur les véhicules du quotidien, qui représentent un marché bien plus large.
3. L'impact des objets connectés : vers une nouvelle forme de pratique de l'activité physique ?
Cet accès facilité du grand public aux objets connectés et aux données transforme profondément la manière de faire du sport et devient une source de motivation en elle-même pour les utilisateurs. Il y a un effet d'émulation dans le fait de pouvoir mesurer sa progression d'une semaine à l'autre, de se fixer des objectifs ou encore de comparer ses performances à celles des autres. Le sport, pour certains, ne repose plus uniquement sur le plaisir et la satisfaction personnelle que l'on retire de l'activité elle-même, mais sur des éléments extérieurs comme les récompenses et la reconnaissance sociale.
Certains auteurs parlent en ce sens de « gamification », entendu comme un processus appliquant des mécaniques du jeu (points, badges, défis, classements, etc.) dans des contextes non ludiques pour motiver les personnes, voire modifier leur comportement162(*). Ainsi, dans les applications pour smartphone, la gamification prend la forme d'octroi de titres, de trophées ou de récompenses aux utilisateurs les plus performants et assidus. Le sport ou d'autres activités demandant des efforts deviennent plus attractifs, et peuvent être perçus comme une compétition, un défi à relever pour gagner.
Les pratiques de « mesure de soi » (ou « quantified self »163(*)) s'appliquent aussi au sport. Certains auteurs parlent de « self tracking »164(*). À travers les objets connectés, les utilisateurs sont de plus en plus tournés vers une mise en données quantitatives de leur personne, avec notamment la trace de leurs résultats sportifs.
Plusieurs études ont étudié l'impact des objets connectés sur un engagement durable dans l'activité physique. Les résultats sont assez contrastés. Certaines études165(*) mettent en évidence une motivation accrue à pratiquer une activité physique via l'utilisation d'applications, d'autres ne constatent pas de différence entre les groupes utilisant des applications et ceux qui suivent une routine sportive sans elles.
Une étude166(*) sur l'utilité des applications de fitness afin de motiver les personnes à maintenir leur activité physique a conclu aux résultats suivants : l'utilisation des applications de fitness répond aux besoins psychologiques des participants en favorisant des émotions de compétence, d'autonomie et d'appartenance. Ces applications facilitent le suivi des progrès, permettent de se lancer des défis et de se mesurer à d'autres sportifs, ce qui motive les participants à maintenir leurs comportements d'exercice.
L'usage de nouvelles technologies par le grand public est en expansion mais seul un nombre limité d'outils est utilisé. Ainsi, parmi les coureurs connectés167(*), 73 % se servent de smartphones, 73 % de montres connectées, mais seulement 7 % de cardiofréquencemètres, 3,7 % de bracelets et 1,4 % de vêtements, chaussures et lunettes connectés.
Leur diffusion est socialement différenciée168(*) : les hommes, les urbains, les diplômés de l'enseignement supérieur et les cadres ayant des revenus supérieurs à la moyenne, les actifs en bonne santé pratiquant une activité physique régulière et dont l'âge est compris entre 30 et 49 ans sont surreprésentés.
On constate également des usages genrés des applications numériques. Une étude169(*) consacrée aux relations entre les femmes pratiquant la course à pied et les objets connectés montre que les femmes se contentent de mesures assez simples (temps et distance) et font peu appel aux fonctionnalités avancées des objets connectés telles que le dénivelé ou la trace GPS.
Elles privilégient la consultation des données en temps réel et s'investissent peu dans l'étude a posteriori des données recueillies. Par ailleurs, elles peuvent se passer des objets connectés dans leur entraînement beaucoup plus facilement que les hommes. Parmi les raisons qu'elles évoquent pour l'utilisation du smartphone, figurent l'appui motivationnel, mais également le sentiment de sécurité qu'il procure et la possibilité d'être jointes à tout moment pour des questions domestiques et éducatives.
Elles envisagent l'usage d'objets connectés pour l'amélioration de leur forme plus que pour l'affichage de performances. Aussi, elles utilisent peu les fonctions visant à partager et comparer les performances. Enfin, elles utilisent moins que les hommes les fonctions destinées à quantifier le nombre de calories brûlées et à définir des programmes d'entraînement pour perdre du poids. Ce constat pourrait s'expliquer par le fait que les coureuses sont en moyenne plus minces que les coureurs.
L'usage des applications peut parfois conduire à des dérives. Certains sportifs les ont tellement intériorisées qu'ils évoquent frustration et déception dès que leur activité n'est pas enregistrée et peuvent même renoncer à une séance d'activité physique en l'absence de possibilité de produire des données. Des utilisateurs déclarent aussi s'ennuyer en l'absence de récompenses ou être anxieux à l'idée de pratiquer sans connexion. En effet, la satisfaction procurée par les indicateurs de performance tend parfois à prendre le pas sur la dimension subjective de l'activité (sensations éprouvées, ressenti corporel). L'utilisation des applications peut accentuer l'obsession de la performance et susciter de l'anxiété.
Par ailleurs, le devenir des données personnelles récoltées par les applications soulève de nombreuses interrogations. Les sportifs utilisent en très grande majorité les versions gratuites des applications. Les entreprises qui les développent se rémunèrent donc en cédant les données qu'elles récoltent, notamment pour générer des publicités ciblées.
Le site internet Pixel de Tracking a publié le 31 mai 2020 une étude qui dresse la liste des données personnelles collectées par les applications Runkeeper d'Asics et Runstatic d'Adidas, mais également la liste et le profil des tiers qui reçoivent ces données.
Elle a montré que Runkeeper utilise plusieurs outils : Firebase qui permet l'hébergement et le développement d'applications mobiles, l'envoi de notifications et de publicités, la remontée des erreurs et des clics effectués dans l'application ; Iterable, une société de marketing mobile permettant à Runkeeper de « segmenter » ses utilisateurs pour ensuite mieux les cibler via des notifications, des messages in-App, des SMS ou des mails personnalisés ; Appsflyer qui permet à Runkeeper de savoir quelles campagnes publicitaires ont déclenché l'installation de l'application ; Ampliture, un outil permettant d'analyser en détail le comportement de l'utilisateur sur l'application. Grâce à celui-ci sont tracés chaque écran vu, le nombre de pas, la durée de l'activité, mais également le nombre d'amis sur l'application, le modèle de smartphone, l'opérateur mobile, les marques de chaussures utilisées, etc. Runkeeper utilise également Google Ad Manager pour diffuser de la publicité en lui transmettant les informations suivantes : sexe, tranche d'âge, information sur la course la plus longue, sur la moyenne des courses, sur le nombre de courses, si l'utilisateur a déjà fait du vélo, de la randonnée, etc.
Dans l'application Runstatic, les données collectées concernent l'identité, la localisation, les tailles et les pointures, les achats, le profil de l'utilisateur et des informations sur son comportement, sa communauté d'amis, ses activités, ses préférences, son inscription par le biais de Google ou Facebook, sa liste d'amis Facebook, et des informations concernant les activités d'entraînement importées à partir des comptes connectés. Ces informations sont transmises à Google et Facebook, à Adjust, une société de marketing mobile spécialisée dans l'attribution de campagnes publicitaires, à Amarsys, société de data marketing permettant à Runstatic de profiler ses utilisateurs de manière extensive pour leur envoyer des publicités ciblées.
IV. EN DÉPIT DES BÉNÉFICES RECONNUS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ HUMAINE, LA CONDITION PHYSIQUE DE LA POPULATION CONTINUE DE SE DÉGRADER. AU-DELÀ DES RECHERCHES DÉJÀ ENGAGÉES, UN EFFORT PARTICULIER DOIT ÊTRE MENÉ POUR IDENTIFIER LES OBSTACLES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET METTRE EN PLACE DES INTERVENTIONS EFFICACES ET DURABLES
A. LES IMPACTS DE L'INACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA SÉDENTARITÉ
1. L'inactivité physique et la sédentarité : deux notions distinctes
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l'activité physique comme « tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie ». L'activité physique désigne tous les mouvements que l'on effectue au quotidien, dans le cadre des loisirs par exemple, sur le lieu de travail, lors des tâches ménagères ainsi que pour se déplacer. L'activité physique englobe le sport mais c'est une notion plus large : monter un escalier, tailler ses rosiers, passer l'aspirateur, promener son chien sont des formes variées d'activité physique.
L'OMS a fixé des niveaux recommandés d'activité physique pour la santé en fonction des classes d'âge.
Les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans doivent réaliser au moins 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue.
Les adultes doivent pratiquer au moins 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue par semaine. Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les adultes devraient augmenter la durée de leur activité d'endurance d'intensité modérée de façon à atteindre 300 minutes par semaine, ou pratiquer 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité soutenue.
Être physiquement inactif correspond à être en deçà des recommandations faites par l'OMS.
Cette notion est à distinguer de la sédentarité, qui correspond au temps cumulé assis ou allongé, pendant la période d'éveil, au cours duquel la dépense énergétique est égale ou proche de la dépense énergétique de repos.
Activité physique et sédentarité ne sont pas incompatibles. Il est possible d'être actif physiquement tout en ayant un mode de vie sédentaire.
Ainsi, une personne peut aller courir trois fois par semaine pendant trente minutes et respecter ainsi les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique tout en ayant un comportement sédentaire en restant assise à son bureau toute la journée. Selon l'étude INCA 3170(*), 61 % des hommes et 43 % des femmes auraient un comportement actif et sédentaire.
Néanmoins, près d'un quart des hommes et 40 % des femmes cumulent un comportement inactif et sédentaire.
En France, seuls 11,5 % des hommes et 10,6 % des femmes ont un comportement actif et non sédentaire. Or, l'inactivité physique et la sédentarité ont des conséquences délétères sur la santé.
2. Les risques liés à l'inactivité physique et à la sédentarité
a) Les risques liés à l'inactivité physique
On estime que 5,3 millions de décès sont dus à l'inactivité physique, ce qui en fait le quatrième facteur de risque de mortalité à l'échelle mondiale, avant le tabac171(*). Une étude plus récente estime que 15,7 % de la mortalité prématurée172(*) pourrait être évitée si les personnes insuffisamment actives respectaient les recommandations de l'OMS (au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine).
Comparaison au niveau mondial de l'impact respectif du tabagisme et du manque d'activité physique
b) La capacité physique, un puissant paramètre du risque de mortalité
La capacité physique fait référence à notre capacité à réaliser des tâches physiques.
Il a été démontré173(*) que les taux de mortalité toutes causes confondues ajustés à l'âge diminuaient en fonction des quintiles d'aptitude physique, passant de 64 décès par an pour 10 000 personnes chez les hommes les moins aptes à 18,6 décès pour 10 000 personnes chez les hommes les plus aptes.
Les valeurs correspondantes pour les femmes étaient de 39,5 décès pour 10 000 personnes pour les femmes dont les capacités physiques sont les plus faibles à 8,5 pour 10 000 personnes pour les femmes dont les capacités physiques sont les plus élevées.
Taux de mortalité en fonction de la capacité physique
Notre capacité physique est largement déterminée par nos capacités aérobies, mesurées par la consommation maximale d'oxygène (VO2max). Celle-ci dépend de la capacité de notre système respiratoire à capter l'oxygène, puis de notre système cardio-circulatoire à le transporter jusqu'au muscle où le métabolisme énergétique va permettre au muscle de se contracter. La VO2max est donc le reflet de notre santé cardiovasculaire et métabolique. C'est la raison pour laquelle elle est considérée comme un puissant paramètre du risque de mortalité, indépendamment du genre, de l'âge, des facteurs de risque cardiovasculaire ou de l'existence de pathologies174(*). Un niveau de 15 à 18 mL/kg/min est considéré comme minimum pour préserver l'indépendance fonctionnelle des sujets175(*).
Notre capacité physique est également déterminée par notre force musculaire, mesurée à travers la force de préhension de la main. À l'instar de la capacité cardio-respiratoire, la force de préhension de la main est un indicateur important du risque de mortalité. Ainsi, une étude de 2019176(*) a montré qu'entre les sujets qui ont la force la plus élevée et ceux qui ont la force la moins élevée, la survie est augmentée de 40 %, et même de 80 % lorsque l'on compare la force de malades chroniques.
c) Les risques liés à la sédentarité
La sédentarité est un facteur de risque de mortalité précoce indépendamment du niveau d'activité physique. Le risque de mortalité augmente dès que l'on passe plus de 9 heures par jour assis comme le montre le schéma suivant et il existe une relation linéaire entre la sédentarité (mesurée par accéléromètre) et la mortalité globale, avec un risque de mortalité globale augmenté de 48 % lorsque la sédentarité s'élève à 10 heures par jour et un risque de mortalité multiplié par presque 3 lorsque la sédentarité atteint 12 heures par jour.
Source : Ekelund et al., « Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality: systematic review and harmonized meta-analysis », British Medical Journal, 366, 2019
Une étude de 2023177(*) a évalué le risque relatif de différentes pathologies associées à la sédentarité, révélant des augmentations de risques allant de 13 % pour le diabète de type 2 à 30 % pour le cancer colorectal et la démence chez les adultes ayant un comportement sédentaire excessif par rapport à ceux dont le niveau de sédentarité est plus faible.
Une étude prospective suédoise178(*) publiée en 2018 a suivi 851 adultes dont 55 % étaient des femmes pendant 15 ans. Parmi ces adultes, 57 % suivaient les recommandations de 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Le temps moyen passé assis mesuré par accéléromètre s'élevait à 8 heures 09 par jour. En classant les sujets en tertiles en fonction de leur sédentarité, il est apparu que par rapport aux sujets les moins sédentaires (6,5 heures par jour), les plus sédentaires (9,8 heures par jour) ont un risque de mortalité globale multiplié par 2,7, un risque de mortalité cardiovasculaire multiplié par 5,5 et un risque de mortalité par cancer multiplié par 4,3, et ce après ajustement pour tenir compte de l'activité physique.
La sédentarité est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Des études montrent que les personnes sédentaires ont un risque accru de développer des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Selon une méta-analyse de 2020, les personnes qui passent plus de 8 heures par jour assis ont un risque de mortalité cardiovasculaire augmenté de 17 % par rapport à celles qui sont moins sédentaires.
La sédentarité est associée à un risque accru de plusieurs types de cancers. Diverses méta-analyses ont montré que la sédentarité augmente le risque de cancer du sein de 15,5 %179(*) et le risque de cancer colorectal de 24 %180(*).
d) Les enfants et les adolescents fortement concernés par les risques sanitaires liés à l'inactivité physique et la sédentarité
Depuis plusieurs années, l'Anses181(*) alerte les pouvoirs publics sur les risques sanitaires associés à la sédentarité et à l'inactivité physique des enfants et adolescents.
L'adolescence est une période charnière au cours de laquelle les habitudes acquises ont tendance à se pérenniser, voire à s'accentuer à l'âge adulte avec des effets associés sur la santé.
Selon l'expertise menée par l'Agence en 2020, parmi les jeunes de 11 à 17 ans :
- 66 % présentent un risque sanitaire préoccupant, caractérisé par le dépassement simultané des deux seuils sanitaires : plus de 2 heures de temps d'écran et moins de 60 minutes d'activité physique par jour182(*) ;
- 49 % présentent un risque sanitaire très élevé, caractérisé par des seuils plus sévères, soit plus de 4 h 30 de temps d'écran journalier ou moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Parmi ceux-là, 17 % sont même particulièrement exposés, cumulant des niveaux très élevés de sédentarité (plus de 4 h 30 d'écran par jour) et d'inactivité physique (moins de 20 minutes par jour).
La sédentarité est associée à un risque accru de surpoids et d'obésité chez l'enfant183(*). Or, d'après la Haute Autorité de santé, la probabilité qu'un enfant obèse le reste à l'âge adulte varie selon les études de 20 à 50 % avant la puberté, et de 50 à 70 % après la puberté. Plus le rebond d'adiposité - c'est-à-dire le moment physiologique où, après une diminution de l'indice de masse corporelle (IMC) chez l'enfant, celui-ci recommence à augmenter - est précoce, plus le risque d'obésité à l'âge adulte est élevé.
Chez les adolescents, on note une altération de certains marqueurs de santé, dont l'adiposité, dès 3-4 heures par jour passées devant un écran pour des activités de loisir.
B. UN CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR LES BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
1. Le rôle de l'activité physique dans la santé physique
a) L'amélioration de la capacité cardio-respiratoire
La pratique régulière d'activité physique ou un entraînement en endurance permettent de maintenir et d'améliorer la capacité cardio-respiratoire. Une augmentation de la VO2max de 10 à 15 % (soit 3 à 5 mL/kg/min) est mesurée habituellement après un entraînement d'endurance de 6 à 8 semaines chez un sujet d'aptitude physique moyenne.
Ce gain a un impact sur la survie puisqu'il a été montré, sur une période de 20 ans, qu'une augmentation d'1 MET184(*) de la capacité maximale aérobie (3,5 mL O2/kg/min) est associée à une réduction de 12 % de la mortalité. L'amélioration de la capacité cardio-respiratoire par l'activité physique a un effet particulièrement bénéfique sur les personnes peu entraînées puisque celles qui améliorent leur capacité maximale aérobie pendant le suivi voient leur risque de mortalité diminuer de 35 %185(*).
b) Le développement musculaire et la sécrétion de myokines
Le muscle est l'élément central de tous les exercices physiques (marcher, sauter, lancer, porter, etc.). L'activité physique joue un rôle capital dans la construction et la définition des différentes masses musculaires. Elle agit directement sur la typologie, la taille et le nombre de fibres musculaires. Les exercices dits endurants améliorent la capillarisation des fibres, la sensibilité à l'insuline, le volume des mitochondries et leur fonction. Les exercices dits résistants augmentent la masse et la force des groupes musculaires stimulés, traduisant une amélioration de l'activation motrice.
Lorsqu'il est mobilisé, le muscle produit des myokines qui non seulement agissent sur le muscle lui-même, mais sont également relarguées dans la circulation sanguine et exercent des effets bénéfiques sur des organes plus éloignés comme le foie, les reins, le cerveau, les os, etc. Concrètement, certaines myokines freinent le vieillissement cérébral en favorisant la connexion des synapses et en améliorant la vascularisation et l'oxygénation cérébrale. D'autres promeuvent la prolifération et la différenciation des ostéoblastes, les cellules responsables de la formation du tissu osseux. Certaines myokines participent à la régulation du métabolisme énergétique, avec des effets bénéfiques sur les troubles qui y sont liés comme l'obésité ou le diabète de type 2.
Grâce à l'activité physique, le muscle devient un organe sécrétoire, « dialoguant » avec les autres tissus.
c) L'effet protecteur de l'activité physique sur le coeur
L'activité physique186(*) entraîne un remodelage cardiaque chez les sujets entraînés par rapport aux inactifs, qui se traduit par une hypertrophie myocardique, une augmentation du volume télédiastolique et de la vitesse de relaxation, conduisant à augmenter le débit cardiaque maximal et en conséquence la capacité maximale aérobie.
Une activité physique régulière et fréquente tout au long de la vie (4 à 5 séances hebdomadaires) permet de contrecarrer le vieillissement physiologique cardiovasculaire. En outre, l'entraînement physique permet de diminuer la fréquence cardiaque au repos et d'augmenter la vitesse de récupération après un exercice.
d) Les effets positifs de l'activité physique sur le poids
L'activité physique a un effet bénéfique sur le poids quel que soit l'âge du sujet187(*). Elle est associée à une diminution de l'adiposité, de l'obésité ou du surpoids tant chez l'enfant que chez l'adolescent.
e) L'impact de l'activité physique sur la santé osseuse
L'os est constamment renouvelé. Il joue un rôle important dans les fonctions mécaniques de soutien, de locomotion et de protection des organes vitaux. L'adaptation des os à l'activité physique s'effectue toujours sur le long terme, lors du processus de renouvellement. En l'absence de pathologie, lorsqu'ils sont soumis à l'activité physique, et en particulier aux impacts, les os se renforcent : les diaphyses s'épaississent, les épiphyses deviennent plus denses. L'organisation des travées se modifie pour que les impacts habituellement subis pendant l'activité physique (par exemple, à chaque foulée d'un coureur) soient mieux supportés. Les points d'insertion des muscles se renforcent et s'adaptent aux tractions plus importantes des muscles.
L'activité physique est cruciale avant et pendant la puberté, période où se constitue une très grande partie du capital osseux, facteur déterminant de la santé osseuse présente et future. Elle permet de développer une architecture interne des os qui leur confère une plus grande solidité.
À l'âge adulte, l'activité physique retarde la diminution de la densité minérale osseuse et la dénaturation de l'architecture interne des os188(*).
2. L'activité physique, facteur d'amélioration de la santé cognitive et mentale
a) Les effets sur les capacités cognitives
Chez les enfants, les effets de l'activité physique sur les capacités cognitives sont positifs à de nombreux égards : ils se traduisent par une amélioration des capacités attentionnelles, de la mémoire, des fonctions exécutives, de l'inhibition et de la flexibilité cognitive.
Dans un rapport récent189(*), l'Académie nationale de médecine fait les remarques suivantes : « Encourager l'activité physique chez les jeunes a des conséquences positives sur la réussite scolaire et le développement cognitif. L'amélioration des résultats scolaires s'exprime en particulier sur la lecture, l'expression orale et les mathématiques, et elle est principalement médiée par l'amélioration de la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. Les sports d'équipe (basket-ball, handball, football, etc.) et les arts martiaux sont reconnus pour améliorer les fonctions cognitives. La durée de l'activité physique, plus que son intensité, semble être déterminante pour observer l'amélioration des fonctions cognitives. »
Une note du Conseil scientifique de l'éducation nationale190(*) souligne un effet bénéfique de l'activité physique sur la performance en mathématiques. Les activités physiques les plus exigeantes sur le plan cognitif semblent avoir un effet bénéfique renforcé.
Plusieurs études191(*) montrent que la promotion de l'activité physique a davantage d'effets sur le fonctionnement cognitif chez des enfants en surpoids que sur des enfants de poids « normal ».
La pratique d'une activité régulière pendant l'enfance est donc particulièrement importante car il s'agit d'une période critique pour développer la réserve cognitive.
Pour les fonctions exécutives192(*) qui permettent de traiter et d'intégrer de manière appropriée les informations issues de l'environnement, l'activité physique a un impact tout au long de la vie. Elle mobilise les muscles et le système cardio-respiratoire, dont la capacité accrue est positivement corrélée aux performances exécutives. En outre, l'exercice physique contribue au maintien du volume cérébral et favorise l'augmentation du volume de l'hippocampe, une structure essentielle à la mémoire.
b) Les effets de l'activité physique sur le sommeil
L'activité physique permet d'améliorer la qualité et la quantité de sommeil en agissant comme un synchronisateur du rythme circadien. La latence d'endormissement est plus courte, le sommeil est plus long et plus profond et l'éveil diurne est de meilleure qualité193(*).
c) L'impact positif de l'activité physique sur le psychisme
L'activité physique est l'occasion de rencontres, surtout dans le cadre de l'activité physique de loisir, elle contribue au renforcement du lien social et joue un rôle important dans la socialisation des individus.
L'activité physique joue également un rôle fondamental dans le bien-être global des individus. Elle augmente la production de dopamine et de sérotonine, contribuant à une meilleure régulation émotionnelle194(*).
Par ailleurs, l'activité physique favorise la régulation du cortisol, une hormone liée au stress, et procure une sensation de plaisir immédiat, notamment grâce à la libération de â-endorphines lors d'efforts d'intensité modérée à élevée195(*). Cette réponse neurochimique contribue à l'amélioration de l'humeur et à la réduction du stress.
L'activité physique participe également à la construction d'une image positive de soi. L'amélioration progressive de ses capacités physiques donne un sentiment de compétence et de maîtrise de son corps et contribue à la construction et à la structuration de l'estime globale de soi, en particulier chez les adolescents196(*).
Une étude197(*) illustre l'impact positif de l'activité physique sur l'estime de soi corporelle. Sur un échantillon de 1 000 participants âgés de 12 à 60 ans, un groupe témoin a été comparé à un groupe engagé dans un programme d'activités physiques adaptées. À l'issue de l'expérimentation, seuls les participants du groupe expérimental ont présenté une amélioration significative de leur soi physique perçu, notamment en termes de condition physique et d'apparence corporelle.
3. L'activité physique comme promoteur d'un vieillissement en bonne santé
Il existe un consensus sur le fait que l'activité physique agit comme une médecine et réduit les effets du vieillissement. Au-delà de la prévention des maladies chroniques, l'exercice permet de prolonger l'espérance de vie en bonne santé.
Les personnes qui sont actives toute leur vie ont une espérance de vie en bonne santé qui peut être prolongée de 7 à 10 ans. La France est très performante en termes d'espérance de vie (85,3 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes), mais elle se classe seulement entre le 10e et le 12e rang au niveau européen en termes d'espérance de vie sans incapacité (respectivement 64,5 et 63,4 ans). C'est en Suède que l'espérance de vie sans incapacité est la plus élevée : 71 ans pour les femmes et 70,2 pour les hommes.
Selon les projections démographiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la population de la France métropolitaine pourrait être composée d'un tiers de personnes âgées de plus de 60 ans en 2050. Le maintien en bonne santé des personnes âgées afin de retarder la phase de dépendance est un impératif à la fois moral et financier, pour les pouvoirs publics comme pour la société française tout entière.
Le vieillissement entraîne un profond remodelage du système neuromusculaire au niveau central et au niveau périphérique. L'un des effets de ce remodelage est la diminution de la force maximale volontaire qui résulte du phénomène de sarcopénie198(*)/dynapénie199(*). Les personnes qui font de l'exercice tout au long de leur vie préservent leur masse musculaire plus longtemps que les personnes sédentaires. Les recommandations d'activité physique préconisent de combiner des exercices d'endurance avec un renforcement musculaire afin d'atténuer la diminution de la force maximale, de prévenir la sarcopénie et de réduire la fatigabilité musculaire.
De même, l'activité physique réduit les risques de fracture en atténuant la déminéralisation osseuse liée au vieillissement et en diminuant les risques de chute.
L'avancée en âge est accompagnée par des altérations structurales et fonctionnelles qui se traduisent par une dégradation des performances cognitives. Bien que les liens entre structures (cérébrales) et fonctions (cognitives) restent à établir précisément, il est admis que l'amélioration des fonctions cognitives repose en grande partie sur la plasticité du système nerveux, c'est-à-dire son potentiel de réorganisation en réponse à ses habitudes de vie (activité physique, nutrition, engagement social). La plasticité peut être négative (lorsqu'elle provoque des effets délétères sur les performances) ou positive (atténuation des différences entre les jeunes et les plus âgés).
Des études suggèrent qu'un potentiel de plasticité cérébrale demeure au cours du vieillissement normal et que cette plasticité peut être exploitée pour constituer une « réserve »200(*) qui permet non seulement de restaurer les altérations structurales, mais également d'atténuer ou de retarder le déclin des performances cognitives. La constitution de la « réserve cérébrale » est favorisée par l'adoption d'habitudes de vie neuroprotectrices dont fait partie la pratique régulière d'activités physiques, c'est-à-dire d'exercices qui utilisent les mouvements pour stimuler le système neuro-musculo-squelettique. Les études épidémiologiques, transversales et interventionnelles révèlent que l'exercice physique chronique stimule la plasticité cérébrale et permet de compenser, au moins partiellement, les changements intrinsèques qui caractérisent le vieillissement cérébral au niveau structural (volume cérébral, connectivité, vascularisation) et fonctionnel (intensité et localisation des activations des différentes aires cérébrales) ainsi qu'au niveau cognitif (performances cognitives).
4. Le rôle à la fois préventif et curatif de l'activité physique pour de nombreuses maladies non transmissibles
a) Un rôle préventif avéré
L'activité physique régulière permet de prévenir la plupart des maladies chroniques non transmissibles201(*).
L'activité physique permet de réduire les risques de cancer. Treize cancers ont une incidence réduite par une activité physique régulière : les cancers de l'oesophage, du foie, de la vessie, du rein, du cardia, du côlon, du rectum, du cerveau, du sein, de l'endomètre, du poumon ainsi que les cancers hématologiques (leucémie, myélome). Pour les cancers de la vessie, du sein, du côlon, de l'endomètre, de l'oesophage et du cardia, le risque d'incidence est réduit de 15 à 30 % pour les personnes ayant le niveau d'activité physique le plus élevé par rapport à celles ayant le niveau d'activité physique le moins élevé.
Selon le National Cancer Institute202(*), le rôle préventif de l'activité physique sur l'apparition de certains cancers s'explique par ses effets biologiques sur l'organisme :
- la réduction des taux d'hormones sexuelles, telles que l'oestrogène, et des facteurs de croissance qui sont associés au développement et à la progression du cancer du sein et du côlon203(*) ;
- la prévention d'un taux élevé d'insuline dans le sang, qui est associé au développement et à la progression du cancer du sein et du côlon204(*) ;
- la réduction de l'inflammation ;
- l'amélioration du fonctionnement du système immunitaire ;
- la modification du métabolisme des acides biliaires, réduisant l'exposition du tractus gastro-intestinal à ces substances potentiellement cancérigènes205(*) ;
- la réduction du temps de transit des aliments dans le système digestif, diminuant l'exposition du tractus gastro-intestinal à d'éventuelles substances cancérigènes susceptibles de favoriser les cancers du côlon.
L'activité physique permet également de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Celles-ci sont la première cause de mortalité pour les femmes : l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux tuent huit fois plus que le cancer du sein. L'activité physique réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 40 à 50 % lorsqu'on la mesure objectivement avec un capteur de mouvement.
En effet, l'activité physique améliore le profil lipidique en diminuant le LDL cholestérol et les triglycérides et en augmentant le HDL cholestérol, ce qui réduit l'effet du LDL cholestérol sur la formation de la plaque d'athérome et donc la survenue de pathologies cardiovasculaires. La pratique régulière d'activité physique permet également de diminuer la pression artérielle, avec en moyenne une réduction respectivement de 3,4 et 2,4 mmHG des pressions systolique et diastolique avec trois à cinq séances d'activité physique par semaine. Or, un effet sur l'incidence des pathologies cardiovasculaires est observé dès une réduction de la pression artérielle d'1 mmHG.
L'activité physique a également un impact sur les facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète. Selon la Société francophone du diabète, l'activité physique permet de réduire de 50 % l'incidence du diabète de type 2 chez les sujets à haut risque.
L'effet bénéfique d'une activité physique régulière en prévention primaire des AVC et des accidents ischémiques transitoires est prouvé.
Une méta-analyse206(*) s'appuyant sur 196 articles couvrant 94 cohortes, représentant plus de 30 millions de personnes et 810 000 décès, a examiné la relation dose-effet entre l'activité physique et la mortalité.
Cette étude montre que, toutes choses égales par ailleurs, le fait de passer de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine à 300 minutes diminue la mortalité toutes causes confondues de 31 %, la mortalité cardiovasculaire de 29 % et la mortalité par cancer de 29 %. Cette étude montre également que 15 minutes d'activité physique par jour permettent de réduire la mortalité par cancer de 15 %.
L'activité physique permet également de diminuer de 30 % le risque de démence et le risque de maladie de Parkinson.
b) Un rôle curatif indéniable pour de nombreuses pathologies
En 2021, en France, 12 millions de patients souffraient d'une maladie chronique reconnue dans le cadre du dispositif d'affection de longue durée (ALD). La prévalence de ces maladies est passée de 14,6 % en 2008 à 17,8 % en 2021, notamment à cause du vieillissement de la population.
Les maladies chroniques s'accompagnent à long terme d'un déconditionnement musculaire et d'une augmentation de la masse grasse, en partie dus à la mobilité réduite et à une baisse de l'activité physique quotidienne. Les effets bénéfiques de l'activité physique sont très largement multifactoriels et impliquent plusieurs mécanismes d'action notamment sur les muscles squelettiques locomoteurs (figure ci-après). Le type d'exercice physique est également déterminant dans les adaptations physiologiques observées. Les exercices d'endurance améliorent la fonction cardiaque et la résistance à la fatigue des muscles locomoteurs, tandis que les exercices de renforcement musculaire augmentent la masse et la force musculaires.
L'étude collective de l'Inserm sur la prévention et le traitement des maladies chroniques par l'activité physique présente les résultats suivants.
Chez les personnes obèses, avoir une pratique d'activité physique importante réduit la mortalité toutes causes confondues indépendamment de l'indice de masse corporelle. Ainsi, les patients obèses actifs présentent un risque relatif de mortalité identique aux individus normo-pondérés. Pour autant, même en bonne condition physique, les personnes obèses conservent un risque de développer des pathologies cardiovasculaires ou un diabète de type 2 supérieur à celui constaté chez les sujets normo-pondérés.
Chez les patients obèses, l'effet de l'activité physique peut avoir un impact majeur dans la perte de masse grasse, notamment viscérale, facteur majeur de risque cardiovasculaire. Par ailleurs, il a été constaté que les exercices d'endurance étaient particulièrement efficaces pour diminuer la pression artérielle chez les personnes obèses montrant des niveaux de pression artérielle élevés en début de programme.
Schéma des effets bénéfiques de l'activité physique dans les maladies chroniques
Source : Étude collective de l'Inserm (2019) précitée
BDNF : Brain-Derived Neurotrophic Factor ; BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive ; CV : cardiovasculaire
La pratique d'une activité physique est un élément fondamental pour lutter contre le diabète de type 2 et ses complications. Ces dernières sont principalement cardiovasculaires et dégénératives (rétinopathie, neuropathie, néphropathie) et définissent la sévérité de la maladie et son influence sur la vie quotidienne du patient. La pratique d'une activité physique par le patient diabétique de type 2 réduit le risque de mortalité toutes causes (entre - 30 % et - 40 %), mais aussi celui de mortalité cardiovasculaire (- 25 % à - 40 %), première cause de décès chez ces patients.
Le syndrome coronaire aigu, avec ou sans infarctus du myocarde, signe l'entrée du patient dans la pathologie coronaire. Le syndrome coronaire aigu touche sept millions de personnes supplémentaires dans le monde chaque année. Le taux de mortalité à un an est aujourd'hui de l'ordre de 10 %. Chez les patients qui survivent, 20 % souffrent d'un deuxième événement cardiovasculaire au cours de la première année. Dans ce cadre, la prévention par l'exercice physique est cruciale pour réduire les risques de récidive et améliorer la qualité de vie. Les méta-analyses montrent qu'un programme de réadaptation cardiaque fondé sur l'activité physique induit une baisse de 30 % de la mortalité d'origine cardiovasculaire, de 26 % de la mortalité totale et une diminution de 31 % du risque de réhospitalisation.
L'insuffisance cardiaque chronique (ICC) est une pathologie fréquente et grave. Son incidence annuelle augmente régulièrement du fait du vieillissement de la population et de l'amélioration des traitements des pathologies cardiovasculaires, en particulier de la maladie coronaire. La mortalité à cinq ans de l'ICC reste très élevée (30 % à 50 %), et dans les pays industrialisés son coût est estimé en moyenne à 2 % des dépenses totales de santé.
Pendant très longtemps, la pratique d'activité physique a été contre-indiquée pour les patients atteints d'ICC afin de laisser le coeur fatigué « se reposer » et par crainte d'aggravation ou de complication de la pathologie sous-jacente. Ce n'est qu'au cours des vingt dernières années que l'association d'une activité physique adaptée au traitement optimal de l'ICC a été proposée et progressivement recommandée par les différentes sociétés savantes. Les progrès dans la connaissance de la physiopathologie de l'ICC ont permis de comprendre que le déconditionnement physique pouvait rendre compte pour une large part d'une évolution progressive de l'ICC d'une maladie du coeur vers une maladie systémique avec une atteinte associée des systèmes ventilatoire et musculaire squelettique. Ces altérations secondaires contribuent aux deux symptômes cliniques dominants de l'ICC, la dyspnée207(*) et la fatigue, qui permettent de chiffrer les degrés de gravité de l'ICC. Il a aussi été montré que l'inactivité physique aggrave le pronostic des patients atteints d'ICC et contribue à une augmentation de la mortalité précoce.
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent la première cause mondiale de handicap fonctionnel et la troisième cause de handicap en général. L'AVC, longtemps décrit comme une pathologie spécifique aux personnes âgées, concerne de plus en plus les personnes de moins de 55 ans. Le mode de vie actuel et les facteurs de risque cardiovasculaire, en premier lieu le tabagisme, jouent un rôle important dans cette évolution. Les séquelles post-AVC sont neuromusculaires et cognitives. Après la survenue d'un AVC, les patients sont très peu actifs dans la vie quotidienne, leur niveau d'inactivité physique et de sédentarité est trop élevé. Ils présentent ainsi une faible capacité cardio-respiratoire.
Il est cependant prouvé que le réentraînement après un AVC est bénéfique pour améliorer la capacité cardio-respiratoire, la force musculaire, la déambulation et les activités quotidiennes.
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui se caractérise par une obstruction bronchique permanente et peu sensible aux bronchodilatateurs, connaît une prévalence dont la progression ne cesse d'inquiéter les spécialistes de santé publique. Elle est actuellement considérée comme la troisième cause de mortalité au niveau mondial. La mortalité associée à la BPCO diminue depuis quelques années chez les hommes et augmente chez les femmes.
En France, la prévalence se situe entre 5 et 10 %, mais elle est très certainement sous-évaluée en raison d'un dépistage complexe et coûteux. Les coûts directs de cette pathologie sont estimés entre 3 700 et 7 500 euros par an et par patient, auxquels il convient d'ajouter des coûts indirects (absentéisme, perte de productivité, etc.) et des coûts personnels liés à une qualité de vie dégradée.
L'activité physique, véritable pierre angulaire de la réhabilitation respiratoire, est reconnue depuis de nombreuses années comme l'unique méthode ayant un niveau de preuve de grade A pour l'amélioration de la qualité de vie, de la tolérance à l'effort et la réduction de la dyspnée et des exacerbations208(*) des patients atteints de BPCO. Plus récemment, de nombreux travaux ont complété ces données. Il a ainsi pu être mis en évidence que l'activité physique pouvait réduire la vitesse du déclin du VEMS209(*), marqueur essentiel de la gravité de l'obstruction bronchique, et ainsi limiter l'apparition de cette pathologie ou ralentir sa progression. Le niveau d'activité physique est également relié à la diminution des hospitalisations en lien avec la BPCO ainsi qu'à la probabilité de survie des patients atteints de BPCO. Des travaux réalisés sur des suivis parfois longs (plus de 7 ans) rapportent des résultats extrêmement homogènes mettant en évidence que la probabilité de survie des patients atteints de BPCO chute de façon spectaculaire avec la réduction du niveau d'activité physique habituelle.
L'asthme est une maladie caractérisée par des épisodes réversibles d'altération plus ou moins sévère de la fonction respiratoire et une hyperréactivité bronchique considérable. Sa prévalence est d'environ 11 % chez les enfants et 7 % chez les adultes. Si la prévalence de l'asthme chez ces derniers est stable, elle a toutefois tendance à augmenter chez les enfants. L'activité physique chez le patient asthmatique est un paradoxe car elle a un impact positif sur son état clinique mais elle peut également provoquer un bronchospasme post-exercice. C'est souvent l'une des principales raisons qui fait renoncer les asthmatiques à l'activité physique. Pourtant, les effets rapportés sont réels : amélioration de l'aptitude physique aérobie qui s'accompagne d'une meilleure protection contre le bronchospasme post-exercice par une majoration considérable de la bronchodilatation d'exercice, amélioration de la qualité de vie et de l'état clinique des patients avec un accroissement significatif du nombre de jours passés sans symptôme respiratoire.
L'activité physique occupe également une place fondamentale dans le traitement des pathologies ostéo-articulaires. Des exercices spécifiques permettent de réduire ou prévenir les déficiences et les limitations d'activité spécifiques à la pathologie ostéo-articulaire sous-jacente (raideur, instabilité, déformation articulaire, faiblesse musculaire, troubles de la marche, etc.). Ils s'appuient sur le renforcement musculaire, la mobilité, l'étirement ou la proprioception des articulations ou des groupes musculaires atteints. Le programme d'activité physique non spécifique quant à lui cherche à réduire ou prévenir les déficiences et les limitations d'activité liées à l'évolution chronique de la maladie ou à l'iatrogénie médicamenteuse, telles que la fatigue, les symptômes d'anxiété et de dépression, la baisse des performances musculaires globales qui contribuent au syndrome de déconditionnement à l'effort.
En France, environ trois millions de personnes vivent après avoir été atteintes d'un cancer, et la moitié est âgée de 70 ans ou plus. Les cancers les plus fréquents chez les personnes âgées sont les cancers du sein, de la prostate et du côlon-rectum, suivis des hémopathies malignes et du cancer de l'endomètre. Après le diagnostic d'un cancer, on observe une diminution du niveau d'activité physique total et d'activité physique d'intensité élevée ainsi qu'une augmentation de la sédentarité. Par ailleurs, le surpoids, l'obésité et la prise de poids observés pendant et après un cancer sont associés à une augmentation du risque de récidive de certains cancers, à une hausse de la morbidité et de la mortalité toutes causes confondues ainsi qu'à une augmentation de risque de second cancer.
L'Institut national du cancer estime que la pratique d'une activité physique post-diagnostique est associée à une diminution de la mortalité globale de 40 % pour les cancers du sein et du côlon et de 30 % pour les cancers de la prostate. Des effets positifs plus marqués apparaissent pour les quantités d'activité physique par semaine les plus élevées mais restent néanmoins significatifs avec une activité moindre (5 MET/h par semaine)210(*).
L'ensemble des essais randomisés et méta-analyses confirment le bénéfice de l'activité physique en termes d'amélioration des capacités cardio-respiratoires et physiques, que le programme d'activité physique soit initié au début de la chimiothérapie, dès la fin des traitements ou à distance de ceux-ci.
De nombreuses méta-analyses ont montré que l'activité physique pendant ou après le traitement est associée à une réduction du poids, de l'IMC et de la masse grasse. Lorsque les études se limitent aux femmes ménopausées, elles montrent un bénéfice de l'activité physique sur la diminution du pourcentage de masse grasse et un gain ou maintien de la masse musculaire.
L'ensemble des méta-analyses ayant étudié l'impact de l'activité physique sur la fatigue rapporte de façon convergente que l'activité physique, pendant et après les traitements, diminue la fatigue, notamment chez les patients porteurs de cancers du sein et de la prostate.
L'activité physique semble en outre jouer un rôle bénéfique pour plusieurs effets secondaires des traitements (douleurs, perte de la densité minérale osseuse associée à l'hormonothérapie et la ménopause précoce).
La prévalence des troubles dépressifs concerne trois millions de personnes en France avec deux fois plus de femmes que d'hommes. Un trouble dépressif augmente le risque d'adopter un mode de vie sédentaire et de diminuer le niveau d'activité physique hebdomadaire. Pourtant, des essais randomisés contrôlés ont testé l'efficacité de programmes d'activité physique adaptée en tant qu'alternative aux médicaments et ont constaté une équivalence de bénéfices entre programme d'activité physique et médicament antidépresseur chez les patients ayant un trouble dépressif. Après le traitement d'un épisode dépressif, une pratique régulière d'activité physique contribuerait à prévenir les récidives d'épisode dépressif.
C. LA DÉGRADATION DE LA CONDITION PHYSIQUE DE LA POPULATION
Nos sociétés modernes sont confrontées à un paradoxe majeur.
Le niveau de preuve de l'impact de nos habitudes de vie sur notre santé est de plus en plus élevé : le nombre de citations pour « physical activity and health » dans Pubmed est passé de 1 230 entre 1970 et 1979 à 3 612 entre 1980 et 1989, 14 066 entre 1990 et 1999, 44 503 entre 2000 et 2009 et 132 765 entre 2010 et 2019.
Pourtant, nos habitudes de vie ne font que dégrader la condition physique de la population générale.
1. Le non-respect des recommandations en matière d'activité physique
En France, quelles que soient les tranches d'âge, l'activité physique est considérée comme insuffisante au regard des recommandations de l'OMS et l'inactivité physique semble devenue une norme de vie. L'étude INCA 3211(*) a montré que 37,5 % des hommes et 46,4 % des femmes se déclaraient inactifs. Les femmes sont les plus concernées : en 10 ans, la proportion de femmes physiquement actives a diminué de 16 %.
En ce qui concerne les plus de 65 ans, 87 % d'entre eux connaissent les préconisations de l'OMS, mais seulement 30 % les respectent.
Le niveau de pratique de l'activité physique des adolescents est également inquiétant. Une étude réalisée sur près de 1,6 million de personnes en 2020 montre que, parmi les populations jeunes (11-17 ans) des 25 pays les plus favorisés, la France occupe le 22e rang.
Les données épidémiologiques les plus récentes en France proviennent d'enquêtes réalisées entre 2014 et 2016 (étude INCA 3 menée en 2014-2015 et étude ESTEBAN mise en place de 2014 à 2016). Les résultats de ces enquêtes montrent que 49,3 % des garçons et 76,7 % des filles âgés de 6 à 17 ans ne respectent pas les recommandations de 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par jour.
La puberté est un des marqueurs du déclin de l'activité physique quel que soit le sexe. Si 70 % des garçons et 56 % des filles âgés de 6 à 10 ans respectent les recommandations de l'OMS, ils ne sont plus que 40 % des garçons et 16 % à l'âge de 15 à 17 ans.
Le niveau d'activité physique est marqué par d'importantes inégalités de genre. À partir de 11 ans, les filles sont moins actives que les garçons et cette tendance s'accentue avec l'âge.
Les inégalités observées dans la pratique d'activités physiques et sportives sont également sociales. La proportion d'adolescents ayant de faibles niveaux d'activité physique est plus importante dans les établissements scolaires situés en zones défavorisées que dans ceux en zones mixtes, ou en zones favorisées (respectivement 41 %, 21 % et 19,5 %). Au sein de chaque catégorie d'établissement, un gradient social est observé, les élèves issus de milieux socio-économiques modestes ayant les plus faibles niveaux d'activité physique, en particulier à cause d'un manque de soutien et d'engagement de la part de leurs parents. De même, la pratique sportive en club ou au sein d'une association est plus importante chez les jeunes dont le ou les parents ont un niveau scolaire élevé.
L'enseignement d'éducation physique et sportive constitue une part importante de l'activité physique des élèves. Interrogés dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques, approximativement 80 % des enfants et adolescents déclarent avoir eu un cours d'EPS la semaine qui précède. Dans le cadre du projet SCOPE (Suivi de la condition physique des élèves) mené à Rennes, il a été constaté que les jours d'EPS permettent une augmentation conséquente de l'activité physique des lycéens (85 % atteignent les recommandations d'activité physique ce jour-là contre 23 % les jours sans EPS). Les pratiquants en clubs sportifs sont les plus susceptibles de respecter les recommandations de l'OMS. Pour les jeunes, le sport est un moyen privilégié de réaliser de l'activité physique.
Certains publics sont particulièrement sujets à l'inactivité, comme les enfants en situation de handicap, trop souvent privés d'accès à une activité physique et sportive faute d'aménagements spécifiques.
Plus largement, les enfants en situation de surpoids ou d'obésité sont pris dans des cercles vicieux, leur pathologie les tenant éloignés de l'activité physique et sportive, notamment des cours d'EPS, alors qu'ils devraient au contraire bénéficier de possibilités de pratique renforcées212(*).
L'environnement physique a une forte incidence sur le niveau d'activité physique des enfants et des adolescents. Le temps passé en dehors de la maison, l'accès à des espaces de jeu, la disponibilité des équipements, les aménagements des logements, le potentiel piétonnier du quartier, sa densité ou encore la sécurité du trafic peuvent être des déterminants. Ainsi, 40 % seulement des enfants âgés de 6 à 10 ans utilisent un mode de transport actif pour se déplacer du domicile familial à l'établissement scolaire, essentiellement à pied. 60 % des déplacements sont effectués avec un moyen de transport motorisé, dont 31,7 % en voiture. Le choix du mode de transport est principalement guidé par des critères de sécurité : 46 % des parents ne sont pas favorables à ce que leurs enfants se rendent au collège à vélo pour des raisons de sécurité.
La pandémie de covid-19 a, malheureusement, eu un impact particulièrement négatif sur l'activité physique. Entre 30 et 60 % des enfants et adolescents ont diminué leur niveau d'activité physique pendant le premier confinement.
2. La montée inquiétante du niveau de sédentarité
En France, une étude de 2015213(*) sur les comportements sédentaires de 35 000 travailleurs adultes a révélé qu'ils passaient 12 heures assis les jours de travail et 9 heures les jours non travaillés.
On observe néanmoins des différences selon les classes d'âge. Les 15-25 ans passent en moyenne plus de 6 heures par jour assis, principalement devant des écrans. Ce temps reste élevé au cours de la vie d'adulte, mais n'est plus que de 3 h 45 chez les 55-64 ans. En revanche, plus de 80 % des personnes âgées ont des comportements sédentaires élevés.
Le temps sédentaire passé devant la télévision est inversement associé au niveau d'instruction. Par contre, le temps passé devant un ordinateur pendant le temps de loisir est associé au niveau d'instruction.
Chez les enfants et les adolescents, le temps total passé assis occupe 45 % de la journée à 7 ans et 75 % de la journée à 15 ans. L'école participe à la sédentarité en maintenant les élèves en position assise. On estime que 65 à 70 % du temps passé à l'école l'est dans un comportement de sédentarité.
Le temps passé devant un écran est considéré comme un marqueur du comportement sédentaire. L'évolution rapide des technologies et l'omniprésence des médias numériques affectent la façon dont les enfants et les adolescents se divertissent. Les activités physiques sont reléguées au second plan au profit d'activités sédentaires sur écran. Les enquêtes sur le temps passé devant les écrans sont anciennes. Ainsi, selon l'étude ESTEBAN menée en 2014-2016, chez les garçons, 50,7 % des 6-10 ans, 72,5 % des 11-14 ans et 87,1 % des 15-17 ans passent au moins trois heures par jour devant un écran. Chez les filles, ces pourcentages sont respectivement 41,2 % des 6-10 ans, 67,8 % des 11-14 ans et 71 % des 15-17 ans. Des données plus récentes214(*) recueillies de 2020 à 2021 auprès de 283 collégiens ont montré qu'en moyenne, ceux-ci déclaraient passer 4 h 27 devant un écran chaque jour. Mais ces données sont déjà un peu anciennes et elles reposent sur une base déclarative qui tend à sous-estimer ou minimiser le temps passé réellement devant les écrans.
Cet indicateur est un marqueur social. Ainsi, la proportion d'enfants passant plus de trois heures par jour devant un écran est inversement associée au niveau d'étude du ou des parents de l'enfant, chez les garçons comme chez les filles.
La pandémie de covid-19 a là aussi favorisé les comportements sédentaires des enfants et des adolescents. 60 à 80 % d'entre eux ont augmenté leur temps d'exposition à un écran. L'augmentation de la sédentarité pendant cette période a été plus marquée chez les enfants (+ 2 h 40 min par jour) que chez les adultes (+ 2 h 06 min). Une étude portant sur 30 000 enfants de différentes nationalités215(*) a montré que le temps moyen passé devant les écrans par les 3-18 ans est passé de 162 minutes par jour à 246 minutes pendant la pandémie. Or, un an après la pandémie, seuls 15 % des enfants de 8-11 ans avaient baissé leur temps de sédentarité, ce qui laisse penser que les habitudes prises pendant la pandémie ont perduré.
Le temps passé devant les écrans par les enfants est un élément important à prendre en compte, 71 % des élèves de 11 ans et 83 % des élèves de 12 ans étant équipés d'un smartphone.
La condition physique représente un déterminant majeur de santé chez l'enfant et l'adolescent. D'une manière générale, la condition physique des garçons de 6 à 12 ans est légèrement meilleure que celle des filles, à l'exception de l'agilité et de la souplesse. De faibles capacités physiques à l'adolescence sont associées à une augmentation de la morbidité et de la mortalité à l'âge adulte.
Dans de très nombreux pays, on note une baisse régulière des capacités cardio-respiratoires des enfants et adolescents depuis les années 1980, souvent plus importante chez les garçons que chez les filles, mais qui s'atténue depuis les années 2000. En France aussi, la baisse des capacités cardio-respiratoires est importante et régulière depuis le début des années 1980. Les capacités musculaires (force, puissance et endurance musculaire) des jeunes diminuent régulièrement depuis le début des années 2000, avec pour conséquence une baisse de 11 centimètres en 30 ans des performances lors de sauts en longueur sans élan, indépendamment de l'âge, du sexe et du poids corporel.
Selon la Fédération française de cardiologie, en quarante ans, les enfants ont perdu environ 25 % de leur capacité cardiovasculaire. En 1970, un collégien pouvait courir 600 mètres en trois minutes. Aujourd'hui, pour parcourir la même distance, il lui faut en moyenne une minute de plus. Trois enfants sur cinq ne savent pas enchaîner quatre sauts à cloche-pied en entrant en sixième.
La pandémie de covid-19 a accentué la dégradation de la condition physique des enfants. L'Onaps216(*) a réalisé une étude longitudinale de manière à évaluer les effets des différents confinements liés à la covid-19 sur la condition physique et les performances cognitives des enfants du primaire. Pour cela, 106 élèves de CE2 et CM1 ont participé à une évaluation en février 2020 (juste avant le premier confinement) et 100 élèves de CE2 et CM1 à une évaluation en janvier 2021. Ces enfants ont réalisé la même batterie de tests évaluant leurs caractéristiques anthropométriques, leur composition corporelle, leurs préférences d'activités, leurs performances cognitives et leur condition physique. Les résultats n'ont fait apparaître aucune différence concernant le poids, l'IMC, le pourcentage de masse grasse et la force de préhension. En revanche, la puissance musculaire, la motricité, les capacités cardio-respiratoires et les performances cognitives sont apparues significativement réduites en 2021 (post-confinements) comparativement à ce qui était observé avant les confinements (mars 2020), soulignant ici un effet délétère de ces derniers.
3. Des coûts sanitaires induits très élevés
Différentes études économiques réalisées à l'échelle internationale et à l'échelle nationale ont cherché à évaluer les coûts associés à l'inactivité physique et à la sédentarité dans nos sociétés. Les variations dans les estimations s'expliquent par l'hétérogénéité méthodologique considérable entre les différentes études. En effet, certaines ne prennent pas en compte l'ensemble des pathologies associées à l'accumulation de comportements délétères, d'autres ne prennent en compte que les coûts à l'échelle du secteur public ou du secteur privé.
Le point commun de toutes ces études est la probable sous-estimation des coûts en raison des choix méthodologiques qui ont été faits.
France Stratégie217(*) a évalué en 2022 le coût de l'inactivité physique. Un outil a été élaboré pour estimer les coûts évités en termes de mortalité et de morbidité, pour des scénarios caractérisés par la proportion de personnes adultes (20-39 ans ou 40-74 ans), sans maladie chronique préexistante, dont l'activité physique deviendrait, jusqu'à leur décès, conforme aux recommandations de l'OMS.
Son utilisation permet de mettre en évidence qu'un coût annuel de 140 milliards d'euros serait évité si toutes les personnes inactives sans maladie chronique préexistante âgées de 20 à 74 ans devenaient actives et le restaient jusqu'à leur décès. Le coût évité par personne devenant définitivement active s'élève à 840 euros pour une personne âgée de 20 à 39 ans et à 23 275 euros pour une personne âgée de 40 à 74 ans : plus de 90 % de ces valeurs sont liés au coût social de la mortalité, environ 5 % au coût des pertes de bien-être liées à la maladie et le reste aux dépenses de soins.
En France, entre 40 000 et 50 000 décès sont annuellement attribuables à la sédentarité et à l'inactivité physique.
En 2021, en France, 12 millions de patients souffraient d'une maladie chronique reconnue dans le cadre du dispositif d'affection de longue durée (ALD). Les projections du ministère de la santé annoncent une augmentation des malades chroniques de 750 000 à 1 million entre 2020 et 2025 et une déclaration des maladies chroniques de plus en plus précoce (dès 30 à 40 ans).
Selon l'Assurance maladie, en 2020, les pathologies et les traitements chroniques ont représenté 63 % des dépenses de santé du régime général (environ 86 milliards d'euros) et concerné 36 % de la population (soit près de 21 millions de personnes pour le régime général de la sécurité sociale). La prévention des maladies chroniques est donc cruciale pour contenir les dépenses de santé.
Par ailleurs, l'augmentation de l'espérance de vie s'accompagne d'une augmentation des années de vie en incapacité, même s'il y a une baisse importante de la mortalité pour les maladies cardiovasculaires et la plupart des cancers. Or, selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, si la part des 65-74 ans devrait rester stable entre 2020 et 2070, la part des 75-84 ans devrait passer de 6,1 % à 10 % et celle des 85 ans et plus passer de 3,4 % à 7,8 %.
Actuellement 7,2 % de la population de 60 ans et plus bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie et le montant total de la contribution des finances publiques à la compensation de la perte d'autonomie s'élève à 27,7 milliards d'euros. L'allongement de l'espérance de vie sans incapacité constitue donc un enjeu financier majeur.
D. LE RELATIF ÉCHEC DES POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LA SÉDENTARITÉ
1. 25 ans d'efforts pour rendre la population française plus active et moins sédentaire
Les bénéfices associés à l'activité physique sur la santé sont aujourd'hui largement démontrés tant en prévention primaire que dans le champ du soin, à tous les âges de la vie. Cependant, une trop faible proportion de la population française respecte les recommandations en matière d'activité physique et la sédentarité se généralise à toutes les classes d'âge. Au début des années 2000, une dynamique autour de la promotion de l'activité physique bénéfique pour la santé a émergé en France et de nombreuses politiques publiques se sont succédé depuis 25 ans pour essayer d'encourager l'adoption d'un mode de vie physiquement actif.
Dans le champ de la nutrition, le programme national nutrition santé (PNNS) est le principal plan offrant un cadre général à la promotion de l'activité physique. Le PNNS 2001-2005 définissait neuf objectifs prioritaires en termes de santé publique. Le dernier d'entre eux visait à « augmenter l'activité physique quotidienne par une amélioration de 25 % du pourcentage des sujets faisant l'équivalent d'au moins 1/2 h de marche rapide par jour ». Il était également précisé que « la sédentarité étant un facteur de risque de maladies chroniques, [elle] doit être combattue chez l'enfant » sans que des mesures concrètes ou des objectifs chiffrés soient fixés.
Le PNNS 2006-2010 fixait comme objectif « une amélioration de 25 % du pourcentage des personnes, tous âges confondus, faisant l'équivalent d'au moins une demi-heure d'activité physique d'intensité modérée, au moins cinq fois par semaine (soit 75 % des hommes et 50 % des femmes) ».
Le PNNS 2011-2016 élargissait aux enfants ses recommandations en matière d'activité physique, tout en reconnaissant la difficulté de faire changer les mentalités : « Un grand nombre d'initiatives ont déjà été développées [...] Cependant, il est nécessaire de renforcer la politique de promotion et d'éducation à la santé. » Il fixait comme objectif d'augmenter la proportion d'adultes situés dans la classe d'activité physique élevée respectivement de 20 % et 25 % chez les hommes et les femmes, et d'augmenter la proportion d'adultes situés dans la classe d'activité physique moyenne de 20 % au moins. En ce qui concerne les enfants, l'objectif du PNNS 3 était d'inciter au moins 50 % des jeunes de 3 à 17 ans à avoir une activité physique d'intensité élevée trois fois par semaine pendant au moins une heure. Le temps passé devant les écrans constituait déjà une préoccupation dans le troisième PNNS, qui fixait comme objectif de le réduire de 10 % pour la tranche d'âge des 3 à 17 ans.
Parallèlement, le conseil des ministres du 10 octobre 2012 a décidé le lancement du premier plan national de santé publique dédié à l'activité physique, à la nutrition et à l'alimentation. Décliné au niveau régional, il reposait sur quatre priorités : promouvoir et développer la pratique de l'activité physique et sportive ; généraliser et professionnaliser l'activité physique et sportive en Ehpad ; renforcer la prise en compte de la promotion de l'activité physique et sportive comme facteur de santé ; initier de nouveaux partenariats publics-privés.
Le quatrième PNNS (2019-2023), prolongé jusqu'en 2024, affichait la volonté que 80 % de la population adulte atteigne un niveau d'activité physique au moins modéré. Il souhaitait également réduire de 20 % le nombre d'adultes passant plus de trois heures par jour devant un écran en dehors de leur activité professionnelle.
Il a été complété par la stratégie nationale sport santé (2019-2024) visant à améliorer l'état de santé de la population en favorisant l'activité physique et sportive de chacun, au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie. Cette stratégie, copilotée par le ministère chargé des sports et le ministère chargé de la santé, s'articulait autour de quatre axes : la promotion de la santé et du bien-être par l'activité physique et sportive ; le développement et le recours à l'activité physique adaptée à visée thérapeutique ; la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants ; le renforcement et la diffusion des connaissances. C'est dans le cadre de cette stratégie que les maisons sport-santé ont été créées en 2019. Elles ont pour objectif d'accompagner les personnes souhaitant pratiquer une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être ou thérapeutiques.
Le cinquième programme national nutrition santé devrait être présenté à l'automne 2025. La deuxième stratégie nationale sport santé 2025-2030 (SNSS 2) a été rendue publique le 5 septembre 2025. Elle fixe une feuille de route articulée autour de douze mesures pour lever les freins à la pratique sportive et accompagner chaque Français quels que soient son âge, son état de santé ou ses conditions de vie.
Les douze mesures de la stratégie nationale sport santé 2025-2030 organisées en 5 objectifs
Objectif 1 : mettre en place les conditions d'une pratique physique accessible à tous
Action 1 : instaurer le mois de l'activité physique et sportive
Action 2 : faciliter l'accès à une offre de sport-santé
Action 3 : faciliter l'accès aux équipements sportifs pour la pratique du sport-santé
Action 4 : renforcer les maisons sport-santé et les positionner comme pivot du sport-santé sur le territoire
Objectif 2 : augmenter le niveau d'activité physique des jeunes à l'école et à l'université
Action 5 : poursuivre la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école élémentaire et en établissements sociaux et médico-sociaux
Action 6 : développer l'activité physique des collégiens et lycéens éloignés d'une pratique régulière
Action 7 : généraliser le déploiement d'initiatives sport-santé et de maisons sport-santé dans les établissements d'enseignement supérieur
Objectif 3 : sensibiliser les acteurs et développer l'activité physique dans le monde professionnel
Action 8 : inciter les entreprises à proposer des dispositifs de promotion de l'activité physique et de lutte contre la sédentarité à leurs employés
Action 9 : renforcer la place de l'activité physique et sportive dans les trois versants de la fonction publique
Objectif 4 : prévenir la perte d'autonomie des personnes avançant en âge par le sport-santé
Action 10 : faire de la pratique de l'activité physique une priorité du premier mandat de la conférence nationale de l'autonomie afin de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées
Objectif 5 : développer le recours à l'activité physique adaptée à des fins thérapeutiques
Action 11 : prendre en charge l'activité physique adaptée pour le traitement des principales maladies chroniques
Action 12 : former les professionnels du sport-santé, effecteurs et prescripteurs, à l'activité physique à visée de santé pour faciliter l'orientation des patients
Dans le champ des maladies chroniques, plusieurs plans ont intégré la dimension activité physique, tels que le plan d'actions national Accidents vasculaires cérébraux 2010-2014, le plan Obésité 2010-2013, les différents plans Cancer lancés depuis 2003 ainsi que le plan d'action pour les maladies chroniques lancé en 2023.
L'activité physique joue également un rôle important dans tous les plans lancés dans le champ du vieillissement, qu'il s'agisse des plans nationaux successifs « Bien vieillir » lancés depuis 2003, du plan national d'action de prévention de la perte d'autonomie de 2015 ou encore du plan « Vieillir en bonne santé » de 2020.
La place de l'activité physique dans les politiques de santé a été confirmée dans plusieurs lois.
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a mis en avant l'importance de l'activité physique comme moyen de prévention des maladies et d'amélioration de la santé. Elle a fixé des objectifs en matière de réduction de la sédentarité et d'augmentation de la pratique régulière d'activité physique.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de la santé a intégré l'activité physique adaptée dans le parcours de soins des patients atteints d'affection de longue durée. Désormais, les médecins traitants peuvent prescrire une activité physique adaptée aux patients atteints d'affections de longue durée. Les professionnels de santé tels que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens ainsi que les enseignants en activité physique adaptée sont autorisés à dispenser ces activités.
La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a entendu favoriser l'accès à la pratique sportive pour tous les Français, quels que soient leur âge, leur condition physique ou leur lieu de vie. Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été prévues, comme le développement des équipements sportifs de proximité, « une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires », en plus des programmes d'EPS et l'instauration d'un « pass'sport » de 50 euros par enfant pour financer une adhésion dans un club.
Cette loi a également introduit plusieurs évolutions pour renforcer le sport-santé. Elle a étendu les possibilités de prescription médicale d'activité physique adaptée aux patients atteints de maladie chronique et aux personnes présentant des facteurs de risques ou en perte d'autonomie. Elle a également donné une légitimité aux maisons sport-santé en créant un chapitre les concernant dans le code de santé publique.
En 2024, il a été décidé que la promotion de l'activité physique et sportive (APS) serait une grande cause nationale. L'objectif était de mettre en avant le sport et de replacer l'activité physique au coeur de la vie des Français avec un mot d'ordre : « Bouger 30 minutes par jour ». Cette initiative a permis de favoriser l'activité physique chez les jeunes par la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire et d'ajouter deux heures d'EPS par semaine au collège. En outre, le pass'sport peut désormais être utilisé pour l'inscription dans une structure de loisir sportif marchand (une salle de sport par exemple).
Par ailleurs, dans le cadre du deuxième plan Génération 2024, 300 millions d'euros ont été débloqués sur trois ans pour déployer les infrastructures sportives à proximité des établissements scolaires, des tests d'aptitudes physiques ont été mis en place dès la 6e pour évaluer l'évolution de la condition physique chez les jeunes, en particulier les capacités cardiovasculaires, et le nombre de places en classes sport-études a été augmenté, pour passer de 10 000 à 25 000 d'ici 2026.
Enfin, à la rentrée 2025, une évaluation systématique des qualités physiques des élèves de 6e a été mise en place afin de positionner les performances des élèves par rapport à la moyenne de leur groupe d'âge et d'adapter les enseignements aux besoins identifiés.
2. De nombreux obstacles à la mise en place des politiques publiques de lutte contre la sédentarité
En dépit des mesures prises par les pouvoirs publics, la sédentarité a fortement progressé en France, notamment chez les enfants, et le niveau d'activité physique reste faible.
Les causes du relatif échec des politiques françaises en matière d'incitation à l'activité physique sont plurielles. Leur analyse dépasse largement l'objet du présent rapport qui se limite à présenter l'apport de la science dans la lutte contre l'inactivité physique et la sédentarité.
Le développement de l'inactivité physique et de la sédentarité est un phénomène mondial auquel un nombre croissant de pays est confronté et tous peinent à inverser cette tendance.
La France a lancé un certain nombre de dispositifs intéressants mais leur mise en place se heurte à des obstacles qui réduisent leur efficacité218(*).
L'activité physique est désormais considérée comme une thérapeutique non médicamenteuse et peut être prescrite par ordonnance depuis 2016. Néanmoins, ce dispositif serait peu utilisé car les séances d'activité physique adaptée ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Par ailleurs, la médecine en France reste essentiellement curative plutôt que préventive. Les thérapies non médicamenteuses pourtant validées scientifiquement ont du mal à s'imposer. La formation initiale et continue des professionnels médicaux et paramédicaux sur l'impact de l'activité physique sur la santé reste insuffisante. Or, seul un médecin convaincu et convaincant peut entraîner une meilleure adhésion et observance thérapeutique chez son patient.
La Haute Autorité de santé a élaboré des référentiels d'aide à la prescription de l'activité physique adaptée par pathologie ou état de santé, mais ils sont trop mal connus des médecins. L'activité physique adaptée pâtit d'un manque d'information sur les filières et sur les dispositifs de sport-santé sur ordonnance. Par ailleurs, les formations et le métier des enseignants en activité physique adaptée et des éducateurs sportifs formés susceptibles de prendre en charge les patients manquent de lisibilité et de crédibilité auprès des médecins.
Le choix du sport comme grande cause nationale pour 2024 a permis d'organiser 3 159 événements et projets toute l'année avec 98 partenaires. Selon un sondage réalisé par OpinionWay en novembre 2024, 90 % des Français disent que l'opération « Bouger 30 minutes chaque jour » est bonne pour la santé et la forme, et 73 % des Français ont entendu parler de cette opération, même s'ils ne sont que 43 % à savoir que le sport a été déclaré grande cause nationale pour 2024 et qu'aucune des personnes interrogées n'est capable de rattacher le programme « 30 minutes par jour » aux actions menées dans le cadre de la grande cause nationale de 2024.
Un rapport du Sénat219(*) de 2024 réalisé par Béatrice Gosselin et Laure Darcos s'est intéressé au dispositif de 30 minutes d'activité physique par jour mis en place à l'école primaire et a souligné « une mise en oeuvre parcellaire ». En effet, selon l'enquête DGESCO auprès des directeurs d'école parue en janvier 2024, « le taux de 91,5 % de ceux indiquant observer une mise en oeuvre des 30 minutes d'activité physique quotidienne ne représente que 55 % de l'ensemble des écoles. Par ailleurs, sur les écoles indiquant mettre en oeuvre cette mesure, 22 % indiquent qu'elle concerne moins de la moitié des classes de l'école. » Le rapport sénatorial s'interroge donc sur l'impact réel du dispositif en matière de lutte contre la sédentarité. Il souligne également un manque de temps, d'espace adapté et de formation pour l'application efficace de cette mesure. Ainsi, seule une école sur quatre indique avoir été accompagnée à l'occasion de la mise en oeuvre des 30 minutes d'activité physique quotidienne.
Comme le rappelle la mission flash de l'Assemblée nationale menée par Frédérique Meunier et Christophe Proença220(*), l'éducation physique et sportive est un apprentissage à part entière dont les objectifs excèdent largement la seule acquisition de compétences physiques ou motrices puisque les enfants apprennent également à coopérer, à s'exprimer en utilisant leur corps, à s'approprier des méthodes et des outils (chronométrage, tableaux de suivi, etc.), à partager des règles, des rôles et des responsabilités. Enfin, l'EPS doit apprendre aux élèves « à entretenir leur santé par une activité physique régulière », un objectif que l'on retrouve dans les programmes de l'ensemble des cycles.
Ces compétences, à la fois motrices, cognitives et psychosociales, sont absolument décisives pour pouvoir s'intégrer et évoluer en société de façon autonome et responsable, tout en préservant sa santé physique et mentale. Elles devraient donc être appréhendées comme des savoirs fondamentaux et l'EPS, comme une matière centrale.
Pourtant, la mission flash a estimé que c'était loin d'être le cas, en particulier dans le premier degré, alors que c'est précisément entre 6 et 11 ans que se joue en grande partie la capacité d'une personne à s'engager dans l'activité physique221(*) pour le reste de sa vie : ce que les spécialistes nomment « la littératie physique ». La mission flash a estimé que l'EPS reste trop négligée dans le premier degré, où elle constitue souvent une variable d'ajustement. Elle a calculé que si les programmes officiels prévoient trois heures hebdomadaires d'EPS obligatoire pendant toute l'école primaire, le temps moyen effectif consacré à cette matière n'est en réalité que d'une heure 45 minutes par semaine et que dans certaines écoles, les cours d'EPS ne sont pas du tout dispensés.
La mission flash a avancé plusieurs facteurs pour expliquer la relative marginalisation de l'EPS dans le premier degré : le niveau très variable d'appétence et de compétence des enseignants, qui restent mal formés à l'enseignement de l'EPS222(*), et le fait que les postes de conseillers pédagogiques en EPS ne sont pas tous pourvus, alors qu'ils constituent des ressources importantes pour les enseignants du premier degré.
La mission flash a également regretté que le volume hebdomadaire d'EPS fixé à quatre heures en 6e soit ensuite réduit à trois heures dans les classes de 5e, 4e et 3e, alors que c'est dans ces tranches d'âge que beaucoup d'adolescents délaissent la pratique sportive et augmentent leur sédentarité à travers l'usage du téléphone portable.
La difficile mise en oeuvre d'une culture de l'activité physique dépasse largement le cadre scolaire et touche l'ensemble de la société française, notamment le milieu professionnel.
Dans une interview donnée à France Assos santé223(*), Pierre Rondeau224(*), économiste et codirecteur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès, a fait remarquer que les bénéfices d'une activité sportive ou d'une activité physique régulière en termes de santé sont connus mais se heurtent à la représentation que se fait notre société du sport. Que ce soit à l'école, à l'université ou au travail, il n'est nulle part valorisé.
Ainsi, moins d'une entreprise sur cinq proposerait du sport à ses collaborateurs. Selon lui, le coût de la sédentarité s'élève à 17 milliards d'euros en prenant en compte l'absentéisme, les soins liés aux maladies, la perte d'autonomie, les risques sociaux. Neuf milliards d'euros225(*) seraient nécessaires pour permettre à l'ensemble de la population française d'accéder à une activité physique ou sportive et prévenir les risques sanitaires évoqués précédemment. Pourtant, les décideurs politiques ne seraient pas prêts à réaliser cet investissement de neuf milliards alors même qu'il conduirait à une économie nette de huit milliards d'euros.
Le manque de reconnaissance dont souffrent le sport et l'activité physique en France a été souligné par plusieurs intervenants au cours des auditions menées dans le cadre de cette étude.
Audrey Bergouignan226(*) a ainsi fait remarquer que la France a une culture du sport moins développée que beaucoup d'autres pays, et ne peut pas être considérée comme une nation sportive. Elle a illustré ses propos en expliquant qu'en France, l'athlète est souvent perçu comme une personne qui a échoué dans ses études, alors que toutes les universités américaines considèrent le sport comme un élément clé de notoriété et de réputation et s'efforcent d'attirer les étudiants ayant les meilleures performances sportives.
Vincent Nougier227(*) a également constaté que si la France est attachée à ses sportifs de haut niveau (SHN) en termes de communication, de résultats sportifs et de grands champions, elle n'a pas pour autant une culture de l'activité physique pratiquée quotidiennement par la population.
3. Un héritage des Jeux de 2024 trop limité
À l'occasion de l'accueil des grands événements sportifs, il est souvent fait état de l'« effet de démonstration » qu'ils peuvent susciter pour les populations hôtes qui se sentiraient inspirées par les réussites et exploits sportifs au point de s'engager elles-mêmes dans des pratiques physiques.
Les organisateurs des jeux Olympiques de Paris 2024 ont souligné l'occasion unique que ces Jeux devaient représenter pour construire une « Nation sportive »228(*). De nombreux équipements sportifs construits pour les Jeux ont été légués aux habitants des territoires d'accueil comme le rappelle le député Benjamin Dirx dans son rapport d'information229(*).
Extrait du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'impact budgétaire et l'héritage des Jeux
La plupart des infrastructures sportives construites ou rénovées pour les JOP sont destinées à être léguées aux habitants des territoires d'accueil. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, date à laquelle le Cojop a remis les clés des ouvrages olympiques, la Solideo a entamé sa phase d'héritage, centrée sur la reconversion des équipements sportifs utilisés lors des Jeux. Plusieurs de ces équipements ont déjà été livrés, parmi lesquels :
- la marina du Roucas Blanc à Marseille, inaugurée en janvier 2025 ;
- le pôle d'activité multisport (Prisme) à Bobigny, inauguré le 1er février 2025 ;
- le complexe sportif Pablo Neruda, ouvert depuis le 9 avril 2025 à Saint-Ouen ;
- les pistes de vélo tout terrain (VTT) de la colline d'Élancourt, ouvertes le 17 mai 2025 ;
- le Centre aquatique olympique à Saint-Denis, accessible au grand public depuis le 2 juin 2025 ;
- la piscine de la ville de Colombes, qui a ouvert le 28 juin 2025.
D'autres équipements sportifs sont en cours de reconversion avant leur ouverture au public, tels que :
- le parc des sports du Bourget ;
- la réimplantation des 18 bassins de natation temporaires du Centre aquatique olympique et de Paris La Défense Aréna dans le département de la Seine-Saint-Denis, avec des travaux prévus tout au long de l'année 2025 ;
- la réutilisation des installations de sports urbains, notamment le skatepark street à La Courneuve et la zone de warm-up à Noisy-le-Sec, dont les travaux se poursuivent jusqu'à mi-2026.
Les équipements sportifs représentent un héritage direct des JOP pour les territoires d'accueil, contribuant à favoriser la pratique sportive de leurs habitants. Les opérations de reconversion menées par la Solideo visent à transformer ces infrastructures, initialement conçues pour des pratiques sportives de haut niveau, en équipements adaptés à tous les profils de licenciés et de pratiquants. Par exemple, sur la colline d'Élancourt, des pistes VTT moins techniques ont été aménagées afin de développer la pratique de loisir.
En Seine-Saint-Denis, département où la pratique de la natation reste encore peu répandue, le volet aquatique revêt une importance particulière, avec la construction de quatre nouvelles piscines et la rénovation de quatre autres. Associés au programme « 1, 2, 3 Nagez ! », ces équipements ont notamment permis aux enfants de Saint-Denis de rejoindre la moyenne nationale en ce qui concerne leur compétence en matière de natation. Une étude évaluant l'impact des Jeux sur les capacités en natation des enfants du département, sous l'égide du Dijop, est prévue pour publication fin 2025.
Le « ruissellement » des événements sportifs sur la participation sportive de masse est très débattu, les effets identifiés par la littérature se révélant très inégaux au gré des circonstances et des contextes comme en témoigne un article scientifique récent230(*) qui a recensé les études sur cette question.
Les effets limités des grands
événements sportifs sur la pratique sportive
amateur
(extrait de l'article d'Hugo Bourbillères et
Mathieu Djaballah sur les impacts des grands événements sportifs
internationaux)
Les études qui se sont penchées sur la question identifient généralement des augmentations temporaires et assez localisées. Par exemple, Perks (2015) montre que les jeux Olympiques de 2010 à Vancouver n'ont eu presque aucun impact sur les niveaux de participation sportive au plan national, mais la région de Vancouver a connu une hausse modeste et assez ponctuelle immédiatement après l'événement. La Coupe du monde de rugby 2007 a engendré une augmentation des effectifs dans les clubs, notamment dans les régions où il est traditionnellement peu pratiqué (Barget et Gouguet, 2010). Lors du départ du Tour de France 2015 aux Pays-Bas, 24 % des spectateurs déclaraient que le fait d'assister à l'événement les incitait à devenir plus actifs (Van Bottenburg et al., 2016), mais il ne s'agissait que de données déclaratives. Une autre étude montre que les Jeux du Commonwealth à Glasgow en 2014 ont eu une certaine influence sur la participation sportive, mais principalement sur les populations préalablement engagées dans des activités physiques (Cleland et al., 2019).
Au-delà de ces quelques cas plutôt positifs, il existe bien plus d'exemples de l'absence d'effet d'encouragement. Feng et Hong (2013) n'ont par exemple trouvé aucune relation entre la participation sportive dans les villes en Chine et les Jeux de 2008 à Pékin. Il est par ailleurs intéressant d'analyser les jeux Olympiques de 2012 à Londres. En effet, aucune édition antérieure n'avait fait de l'héritage en termes d'augmentation des pratiques sportives un objectif aussi proactivement poursuivi (Weed, 2014 ; Manzenreiter, 2014). L'expression « inspirer une génération » résumait cette ambition, qui visait à faire en sorte qu'un million de personnes supplémentaires pratiquent un sport d'ici la fin des Jeux. L'un des enjeux majeurs était de répondre à la problématique de l'obésité au Royaume-Uni. Les résultats, cependant, ne sont pas très positifs. Selon l'enquête Active People de Sport England, la participation sportive nationale (au moins une fois par semaine) a légèrement augmenté (de 34,6 % à 36,9 %) pendant la période précédant les Jeux (2005-2012), mais elle a diminué dès l'année suivant l'événement.
Il est donc difficile de valider l'existence d'un effet incitatif des grands événements sportifs sur les pratiques physiques de masse. Cet effet est, au mieux, modeste et vaut essentiellement pour les personnes déjà actives (Frawley, 2013). Déclencher une hausse de la participation sportive des personnes sédentaires (séniors, personnes en difficultés sociales) reste une véritable gageure. Pour ce faire, il semble falloir ne pas se contenter d'effets spontanés, mais mettre en oeuvre des politiques volontaristes au sein du territoire d'accueil, permettant notamment de réduire l'inégalité d'accès aux pratiques. Il faut donc non seulement agir sur les comportements individuels, mais également sur l'offre de pratiques physiques à tous les niveaux (Girginov et Hills, 2009).
Un rapport de l'Injep231(*), publié en janvier 2025 révèle que le nombre de licences annuelles délivrées par quarante-cinq des principales fédérations sportives a augmenté d'environ 5 % à la rentrée 2024-2025. Il s'agit d'une hausse modérée, qui touche peu les fédérations sportives ayant le plus de licenciés (football, tennis, équitation, basket-ball et rugby), généralement peu sensibles à l'impact des jeux Olympiques. Toutefois, les jeux Olympiques de Paris ont permis de mettre en lumière de nombreux sports moins reconnus. En ce sens, certaines fédérations enregistrent une hausse notable de leurs licenciés, comme le tennis de table (+ 23 %), le badminton (+ 19 %), l'escrime (+ 19 %), le tir à l'arc (+ 15 %) ou encore le taekwondo (+ 13 %).
Comme le souligne le rapport, l'enjeu pour ces fédérations est de parvenir à faire perdurer cet engouement et à conserver leurs licenciés. La Fédération française handisport se révèle également être grande gagnante des Jeux, avec une hausse de 21 % de ses licenciés. Cette hausse soudaine est probablement due au rayonnement de ces sports grâce aux médaillés français et à la mise en lumière de nouvelles célébrités inspirantes dans ces disciplines.
E. LES PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR INCITER À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
La question n'est plus de savoir si l'activité physique est bénéfique, mais comment inciter l'ensemble de la population à pratiquer et à intégrer l'activité physique dans son quotidien.
La conception spontanéiste de l'autonomie en activité physique considère qu'il suffit que le patient soit informé des bénéfices de l'activité physique pour qu'il décide de changer ses habitudes. Toutefois, face aux limites rencontrées par ce modèle, une conception plus interventionniste s'est peu à peu imposée, qui part du principe que l'autonomie en activité physique ne va pas de soi et qu'elle peut être construite dans le cadre d'une intervention éducative.
C'est cette conception qui a conduit à introduire la prescription par ordonnance de l'activité physique. Il a été constaté qu'une ordonnance écrite a en moyenne deux fois plus de chances d'être convertie en actes qu'un simple conseil oral. Néanmoins, les médecins restent insuffisamment formés à l'intérêt et à la mise en oeuvre de l'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse232(*). En outre, leur confiance dans les professionnels de terrain compétents en matière d'activité physique adaptée reste limitée.
Il est important de discuter avec le patient de l'objectif et des modalités de l'activité physique en tenant compte de ses envies, de ses motivations et de son parcours de soin. L'enjeu majeur de la pratique d'activité physique chez les personnes atteintes de maladies chroniques est la motivation et l'adhésion à une activité physique régulière.
Les sciences humaines et sociales peuvent contribuer utilement à guider les pouvoirs publics pour analyser les freins et les leviers à l'activité physique, parvenir à optimiser et à personnaliser les préconisations et assurer la durabilité des interventions.
Une partie de la communauté scientifique mise également sur le développement d'innovations technologiques pour favoriser et personnaliser l'activité physique.
1. L'analyse scientifique des freins et des leviers à l'activité physique
Lors de son audition, Olivier Rey233(*) s'est inspiré de la théorie de l'autodétermination234(*) pour présenter les trois facteurs qui suscitent l'engagement dans l'activité physique et sportive :
- le sentiment d'auto-efficacité : la croyance en sa capacité à accomplir une tâche physique joue un rôle crucial dans la décision de s'engager dans une activité physique. Les expériences de succès précédentes et le soutien social ont un impact positif sur ce sentiment ;
- le plaisir et la motivation intrinsèque : de nombreuses études montrent que le plaisir et le bien-être ressentis pendant une activité sont un prédicteur fort de l'engagement initial ;
- les influences sociales et culturelles : les normes sociales et les modèles positifs, tels que la famille et les pairs, sont des déclencheurs clés pour démarrer une activité physique.
Trois facteurs favorisent également le maintien de l'engagement :
- les objectifs liés à la maîtrise et à la progression personnelle235(*) ;
- le soutien des pairs, de la famille et des coachs ;
- l'établissement d'une routine ancrée dans le quotidien.
Enfin, trois facteurs sont souvent à l'origine de la rupture de l'engagement dans l'activité physique :
- les barrières psychologiques et physiques (les blessures, le stress et le manque de temps) ;
- la motivation extrinsèque236(*) excessive ;
- le plaisir diminué : la perception d'une activité comme étant une corvée ou trop exigeante contribue à la rupture.
La prise en compte de ces résultats scientifiques est indispensable pour mettre en place une politique publique efficace visant à inciter durablement la population à faire de l'activité physique et appelle les remarques suivantes.
a) Des cours d'EPS qui ne suscitent pas l'engouement pour l'activité physique
Le sentiment d'auto-efficacité joue un rôle primordial dans l'engagement dans l'activité physique. La première expérience est fondamentale car elle va conditionner la poursuite ou non par l'individu de l'activité physique. En outre, plus une personne a réussi une tâche par le passé, plus elle croit en sa capacité à la réussir à nouveau. De même, observer des individus proches réussir augmente la croyance en ses propres capacités. Enfin, les encouragements et le soutien social renforcent la confiance en soi.
Alors que l'environnement scolaire est perçu comme le lieu idéal de la promotion de l'activité physique, les expériences vécues et marquantes en éducation physique ne semblent pas systématiquement favorables à l'atteinte de son objectif de promouvoir durablement l'activité physique. Par conséquent, les modalités d'enseignement devraient être adaptées afin de tenir compte des différences de niveau physique entre les élèves et d'éviter à la fois de dégoûter les enfants peu disposés à l'exercice physique et d'ennuyer les plus actifs.
Par ailleurs, si les objectifs liés à la maîtrise et à la progression personnelle figurent parmi les facteurs clés du maintien de l'engagement dans l'activité physique, on peut s'interroger sur l'impact du système de notation normatif imposé à l'école, avec une prise en compte insuffisante, voire inexistante des progrès réalisés individuellement.
b) Le rôle du plaisir dans l'engagement et le maintien dans l'activité physique
Une étude de 2018237(*) s'est intéressée aux raisons qui incitent les personnes âgées à être actives en distinguant entre les 60-70 ans et les plus de 70 ans. Quelle que soit leur classe d'âge, le plaisir est le déterminant qui contribue à un haut niveau d'autodétermination à pratiquer une activité physique régulière. C'est même le seul facteur pour les plus de 70 ans. Pour les 60-70 ans, le besoin de rester en bonne santé ainsi que l'affiliation sont également des facteurs de motivation pour pratiquer de l'activité physique. En revanche, l'évitement de la maladie et la reconnaissance sociale n'ont pas d'influence positive sur la pratique de l'activité physique.
Une étude de 2021238(*) a examiné les liens entre les motivations à l'activité physique et l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse sur une période de cinq ans, couvrant la transition de la fin de l'enfance (9-11 ans) à l'adolescence moyenne (15-16 ans) chez les garçons et les filles. Les données proviennent de l'étude longitudinale Monitoring Activities of Teenagers to Comprehend their Habits (MATCH), qui a suivi des élèves de 5e et 6e années dans 17 écoles du Nouveau-Brunswick, au Canada.
Chez les garçons, les motivations liées à la forme physique étaient négativement associées à la pratique d'activité physique, alors que les motivations liées au plaisir et à la compétence étaient positivement associées à la pratique d'activité physique.
Chez les filles, les motivations liées au plaisir étaient positivement associées à la pratique d'activité physique pendant la fin de l'enfance. Les motivations liées à la compétence étaient positivement associées à la pratique de l'activité physique de la fin de l'enfance à l'adolescence moyenne.
Les résultats suggèrent que les motivations liées à la forme physique ne sont pas efficaces pour augmenter l'activité physique chez les adolescents, surtout chez les garçons. En revanche, le plaisir est un prédicteur fort de la pratique d'activité physique, surtout chez les garçons. Chez les filles, cette association positive diminue avec l'âge. Les motivations liées à la compétence sont positivement associées à la pratique d'activité physique pour les deux sexes, avec un effet plus prononcé chez les filles.
En conclusion, cette étude met en lumière l'importance des motivations intrinsèques, comme le plaisir et la compétence, pour promouvoir l'activité physique chez les jeunes, tandis que les motivations extrinsèques, comme la forme physique et l'apparence, semblent moins efficaces.
Pourtant, en dépit de l'importance du plaisir dans l'engagement et le maintien de l'activité physique montrée par les recherches scientifiques, les pouvoirs publics ciblent majoritairement les bénéfices de l'activité physique sur la santé pour inciter la population à être plus active.
Une étude de 2024239(*) s'est intéressée aux raisons permettant de comprendre la relative inefficacité d'une politique qui met en avant les effets de l'activité physique sur la santé et arrive au constat suivant : l'obtention des bénéfices sur la santé implique des efforts considérables. Or, ces bénéfices sont différés dans le temps, ce qui limite l'intérêt à s'engager dans une activité physique. En outre, des mécanismes de distorsion des croyances peuvent amener les individus à traiter certaines informations avec un « scepticisme motivé », en particulier lorsqu'elles ne correspondent pas à leurs préférences. Les personnes peuvent être tentées de minimiser les bienfaits de l'activité physique, surtout si ce comportement est peu plaisant pour elles.
Au contraire, le plaisir, et plus globalement des expériences affectives positives, réduisent la perception de l'effort physique et entraînent des conséquences immédiates, obtenues en lien direct avec l'activité réalisée. Enfin, plus les personnes vont éprouver du plaisir, plus elles vont être enclines à donner du crédit aux bienfaits apportés par l'activité physique. L'enjeu est alors d'apprendre aux personnes à se faire plaisir en faisant de l'activité physique, en choisissant les activités qui leur plaisent, en les pratiquant à des intensités agréables, en sélectionnant le lieu et le moment de la journée qui leur conviennent le mieux.
c) Les moyens de se prémunir contre l'abandon du sport chez les jeunes
L'analyse scientifique des freins à l'activité physique chez les adolescents remet également en cause les stratégies de santé publique principalement orientées vers la promotion du sport au profit des politiques se concentrant sur la prévention de l'abandon du sport.
Une étude de 2024240(*) s'est intéressée à l'évolution de la pratique d'activité sportive entre l'enfance et l'adolescence. 1 149 adolescents des Bouches-du-Rhône ont été amenés à déclarer en 2019 s'ils étaient pratiquants sportifs, s'ils avaient abandonné une pratique sportive régulière ou s'ils n'avaient jamais été pratiquants sportifs réguliers.
Sur les 1 080 adolescents (garçons et filles) retenus241(*), 66,4 % étaient des pratiquants sportifs, 28,9 % avaient abandonné la pratique sportive et 4,7 % n'avaient jamais pratiqué.
La répartition entre pratiquants, anciens pratiquants et ceux qui n'avaient jamais pratiqué varie en fonction du sexe. Il y a 19,3 % de moins de filles pratiquant une activité sportive que de garçons (56,9 % contre 76,2 %). Le pourcentage de filles ayant abandonné la pratique sportive est plus élevé que chez les garçons (35,1 % contre 22,5 %), de même que le pourcentage de filles n'ayant jamais pratiqué (8 % contre 1,3 %).
Les résultats de cette étude montrent que si les adolescents qui avaient entrepris une activité sportive n'y avaient pas renoncé242(*), plus de 95 % des adolescents seraient encore engagés dans une pratique sportive. De plus, les inégalités de pratique des adolescents en fonction du sexe et du statut socio-économique sont principalement le résultat du processus d'abandon qui s'exerce à divers degrés. Ainsi, la situation économique et sociale des parents a peu d'impact sur le taux d'enfants n'ayant jamais pratiqué (l'écart est seulement de 4 % entre les enfants « défavorisés » et les enfants « favorisés »). En revanche, ce facteur influence fortement le maintien de la pratique à l'adolescence puisque l'écart de pratique sportive entre les enfants « favorisés » et les enfants « défavorisés » atteint 19 % à la date de l'étude.
Le processus d'abandon de la pratique sportive, socialement déterminé, entre l'enfance et l'adolescence, est significatif, d'où la pertinence d'une politique menée par le système éducatif et les fédérations sportives visant à limiter lesdits abandons.
Si les taux d'abandon étaient fortement abaissés, les taux de participation seraient les mêmes entre filles et garçons et entre adolescents issus de différents milieux sociaux. Les interventions doivent donc être ciblées pour réduire le taux d'abandon sportif des filles et des adolescents issus des milieux les plus modestes.
Les auteurs de l'étude mettent en avant plusieurs facteurs à prendre en compte :
- la densité des installations sportives au sein des lieux de vie est liée à la participation sportive. Les installations pourraient être construites selon les préférences des jeunes pour soutenir leur engagement ;
- à l'échelle interpersonnelle, la perception négative du climat de compétition a été mise en avant comme responsable d'une proportion abondante d'abandons des filles. Il faut donc développer une offre sportive proposant une diversité d'expériences à côté de celle de la compétition pour maintenir l'engagement des jeunes filles dans le temps ;
- le manque de plaisir est souvent mentionné comme cause d'abandon : selon la théorie de l'autodétermination, ce manque de plaisir peut être lié à de faibles sentiments de compétence, d'autonomie ou d'appartenance au groupe ; il faudrait donc développer un parcours d'orientation sportif, qui prendrait la forme de passerelles entre différentes fédérations sportives pour faciliter la transition des jeunes d'un sport à l'autre.
L'éducation physique étant obligatoire jusqu'à 16 ans, elle devrait constituer un levier important pour contrer le phénomène d'abandon sportif qui se déroule hors l'école, en développant par exemple des contenus éducatifs fondés sur la connaissance des activités sportives et ayant pour finalité de soutenir la motivation des jeunes à s'engager dans une pratique sportive en dehors de l'école. Elle pourrait également initier les adolescents à des pratiques sportives en lien avec celles qu'ils pratiquent en dehors de l'école, pour leur fournir les compétences nécessaires au passage d'une activité physique à l'autre.
Une étude de 2019243(*) s'est intéressée aux raisons qui poussent les adolescents à abandonner le sport.
Entre 11 et 14 ans, la principale raison avancée est la perte de plaisir dans la pratique du sport en club244(*). Le cadre sportif peut apparaître trop sérieux, les exercices trop répétitifs. Selon les adolescents, la compétition occupe une place soit trop importante, soit trop réduite. Le manque de compétence, un niveau insuffisant ou l'absence de victoires pendant la saison incitent également les adolescents à abandonner le sport qu'ils pratiquent.
Enfin, les adolescents justifient l'abandon de la pratique sportive par une mauvaise atmosphère au sein du club ou de l'équipe, ou encore la mésentente avec l'entraîneur.
À partir de 15 ans (ce qui correspond à l'entrée au lycée), l'école est responsable du décrochage sportif : la pression exercée sur les lycéens pour l'obtention de résultats académiques élevés les pousse à augmenter le temps consacré aux études au détriment des loisirs, notamment du sport. Par ailleurs, aux emplois du temps souvent très chargés s'ajoute la phase des devoirs, ce qui laisse peu de temps pour la pratique d'un sport.
Même si les résultats de cette étude méritent d'être confirmés245(*), ils offrent des pistes de réflexion intéressantes pour « réconcilier » les jeunes et le sport. Ainsi, les fédérations sportives ont un rôle important à jouer pour comprendre les raisons qui poussent les jeunes à se détourner du sport et pour s'engager à la fois dans la fidélisation des pratiquants, mais également dans des stratégies d'accueil de nouveaux pratiquants. En effet, la moitié des adolescents ayant décroché en matière de pratique dans un club sportif manifestent le souhait de reprendre une activité sportive. Néanmoins, plus le temps pendant lequel ils ne pratiquent plus de sport s'allonge, plus leur motivation diminue. Un dispositif pourrait donc être développé permettant aux enfants et adolescents déjà licenciés dans un club, de pouvoir tester gratuitement d'autres sports. En cas d'essai concluant, la licence pourrait être transmise au nouveau club.
Un tel dispositif a été testé dans trois départements. Il s'agit de la carte « passerelle » qui permet aux écoliers du CM1, du CM2 et de sixième licenciés à l'Usep246(*) ou à l'UGSEL247(*) de tester différents sports gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club. Selon le bilan de l'expérimentation, 50 % des jeunes ayant testé un sport ont ensuite pris leur licence dans un club sportif, permettant ainsi une pratique plus assidue de la discipline choisie.
Une réflexion doit également être menée sur les temps scolaires et sur la place du sport dans l'enseignement, trop souvent relégué au second plan alors même que la recherche scientifique montre le lien entre la pratique d'une activité physique et les performances scolaires.
À cet égard, il convient de remarquer qu'avec 1 000 heures de cours par an au lycée, la France se situe largement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, laissant peu de temps pour les activités sportives extra-scolaires.
Par ailleurs, et en dépit des critiques exprimées précédemment, l'école joue un rôle fondamental pour l'activité physique des enfants et des adolescents via les heures d'EPS obligatoires hebdomadaires de la primaire au lycée. Néanmoins, la France fait partie des pays où les élèves ont le plus de vacances, avec 16 semaines par an. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 14 semaines observée dans les pays d'Europe et de l'OCDE. Plusieurs intervenants ont fait remarquer que le temps d'activité physique diminuait fortement pendant les vacances scolaires, en particulier pour les enfants les plus défavorisés.
Toute réflexion sur le temps scolaire en France devrait avoir pour objectif de dégager du temps pour favoriser l'activité physique des collégiens et des lycéens.
2. Le concept de littératie physique pour expliquer, promouvoir et éduquer à l'activité physique
Selon Margaret Whitehaed248(*), le concept de littératie physique (LP) se définit comme « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension nécessaires qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique durant toute sa vie ». Dans cette définition, la « motivation » se manifeste par une attitude positive et le désir de pratiquer l'activité physique. La « confiance » et la « compétence physique » sont liées à la croyance en sa propre capacité à utiliser, appliquer et apprendre efficacement une pluralité de mouvements dans des contextes variés. La « connaissance et la compréhension » font référence à la prise de conscience de son propre corps, de sorte que l'on puisse évaluer avec précision ses capacités de mouvement, formuler des suggestions d'amélioration et être en mesure de comprendre comment l'activité physique influence sa santé globale249(*).
La notion de littératie physique est caractérisée par quatre dimensions inséparables250(*) :
- la dimension physique qui correspond aux capacités et habiletés motrices, au contrôle du corps et à la condition physique acquise par et pour le mouvement ;
- la dimension psychologique constituée des attitudes et des émotions associées au mouvement ainsi qu'à leur impact sur la confiance et la motivation pour bouger ;
- la dimension sociale qui renvoie aux habiletés communicationnelles, facilitatrices d'interactions avec autrui (entraîneurs, adversaires, coéquipiers, amis, etc.) ;
- la dimension cognitive qui repose sur la compréhension et le développement des connaissances nécessaires à l'activité physique et à la prise de conscience de l'intérêt d'une vie active.
Concrètement, un individu « physiquement lettré » serait davantage enclin à s'engager dans des activités physiques et sportives non seulement parce qu'il dispose des compétences mais également parce qu'il est capable de se saisir, voire de provoquer des opportunités d'activité physique et sportive.
Comme le font remarquer les auteurs de l'article précité : « Aujourd'hui, la reconnaissance des apprentissages scolaires reste attachée à l'évaluation et à la note qui en résulte, mais peine à garantir les effets de ces apprentissages sur l'adoption de modes de vie durable. Ainsi, l'appréciation de la littératie physique des élèves ne doit pas prendre la forme d'une évaluation sommaire destinée à juger et à comparer leur niveau à des normes, mais plutôt à les conseiller et les guider vers des pratiques, des ateliers ou des ressources qui seraient favorables à leur vie physique. [...] Le développement de la littératie physique à l'école ne peut reposer uniquement sur les leçons d'EPS et nécessite d'envisager un parcours de formation scolaire favorable au développement de ses quatre domaines. Une des clés de la réussite est de repenser l'environnement scolaire afin de multiplier les opportunités d'activités physiques quotidiennes. »
L'Éducation nationale a ciblé deux apprentissages prioritaires dès le plus jeune âge : apprendre à nager et savoir faire du vélo. Depuis 2008, le programme « j'apprends à nager » vise à rendre les enfants à l'aise dans l'eau dès le plus jeune âge, à favoriser l'apprentissage de la natation et à prévenir les noyades. Cet apprentissage est destiné aux enfants de 4 à 6 ans251(*) dans le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Le plan « Savoir rouler à vélo » est mis en oeuvre avec les ministères de l'intérieur, des transports et les acteurs du monde sportif. Il a pour but le déploiement d'un apprentissage massif du vélo pour les élèves de 6 à 11 ans dans le cadre scolaire ou périscolaire. L'objectif est de leur permettre de circuler à vélo en réelle autonomie à l'entrée au collège, tout en les incitant à des mobilités actives, en toute sécurité.
Ces initiatives doivent être saluées et mériteraient d'être systématisées à tous les enfants.
Par ailleurs, compte tenu de la détérioration générale de la condition physique constatée chez les enfants, il est urgent non seulement de développer leur littératie physique dès le plus jeune âge afin de leur donner le goût de l'activité physique, mais également de rendre leur environnement et le rythme de leurs journées propices à l'activité physique.
3. Des recherches visant une personnalisation et une optimisation des préconisations en matière d'activité physique
a) Des recommandations en matière d'activité physique à adapter au profil et au mode de vie des personnes
Les recommandations en matière d'activité physique pour obtenir des bénéfices sur la santé, notamment pour diminuer le risque d'apparition des maladies chroniques, sont relativement uniformes en matière de durée (30 à 50 minutes d'exercice aérobie par jour), d'intensité (modérée à vigoureuse) et de fréquence (3 à 5 fois par semaine). Cependant, cet effet dose-réponse dépend du niveau de condition physique du pratiquant. Chez des pratiquants peu entraînés, des effets significatifs peuvent être obtenus même avec des doses plus faibles, alors que chez les pratiquants entraînés, la dose nécessaire pour observer un effet doit être plus importante. Selon le professeur Jean-Jacques Temprado, pour les personnes très actives, il faut ajouter au moins la moitié de la dose préconisée en moyenne dans les messages de prévention.
La prescription de l'activité physique doit donc prendre en compte les caractéristiques biologiques et comportementales de l'individu ainsi que son contexte de vie socio-économique. Plusieurs interlocuteurs ont insisté sur la nécessité de sortir du slogan simpliste de « 30 minutes d'activité physique par jour » pour déterminer comment, chez quel public, dans quelles conditions et en lien avec quels autres comportements de santé il est concrètement possible d'encourager l'activité physique.
Lors de son audition252(*), la professeure Martine Duclos a présenté plusieurs études visant à affiner les préconisations en matière d'activité physique afin de tenir compte des capacités physiques, de la disponibilité et des modes de vie des personnes.
Une équipe de recherche253(*) s'est interrogée sur l'efficacité d'une activité de faible intensité en réalisant une méta-analyse à partir de six études de cohortes comportant au total 13 960 personnes âgées de 55 à 78 ans et suivies pendant sept ans.
L'étude fait apparaître qu'une activité de faible intensité254(*) peut diminuer la mortalité cardiovasculaire à condition d'être pratiquée trois heures par jour. Ces résultats permettent ainsi de faire des recommandations aux personnes rencontrant des difficultés de mobilité.
Faute de temps, de nombreuses personnes exercent une activité physique uniquement le week-end, voire un seul jour par semaine255(*). Les femmes sont particulièrement concernées en raison de la multiplicité des tâches qu'elles ont à gérer dans la vie quotidienne256(*). Une étude menée en 2023257(*) pour mesurer l'impact sur la santé de la concentration de l'activité physique sur un seul jour s'est appuyée sur une cohorte de la UK Biobank comportant 89 000 personnes, âgées de 57 à 69 ans, dont 56 % de femmes.
Les résultats obtenus montrent un impact identique de l'activité physique sur la mortalité cardiovasculaire qu'elle soit répartie sur la semaine ou concentrée sur un ou deux jours. Les risques de démence et d'accident cardiovasculaire sont diminués de 23 %, le risque de maladie de Parkinson de 49 %, le risque de dépression de 26 %, le risque d'anxiété de 28 %.
En matière d'activité physique intense, 75 à 150 minutes par semaine sont préconisées avec des séquences de 10 à 15 minutes à chaque fois. Plusieurs études ont analysé l'impact d'une activité physique intense de courte durée (moins de 5 minutes par jour) sur la santé.
Une première étude258(*) s'est appuyée sur une cohorte de la UK Biobank de 71 893 personnes équipées d'un accéléromètre, âgées en moyenne de 62,5 ans, dont 55,9 % de femmes. Le suivi a été réalisé pendant près de 6 ans. Quatre groupes ont été distingués :
- celui faisant moins de 10 minutes d'activité physique intense par semaine ;
- celui réalisant entre 10 à 20 minutes d'activité physique intense par semaine ;
- celui réalisant entre 30 à 60 minutes d'activité physique intense par semaine ;
- celui réalisant plus de 60 minutes par semaine.
L'impact sur la mortalité toutes causes confondues a été étudié. Il a été constaté qu'une activité physique intense comprise entre 10 et 30 minutes par semaine permet de diminuer les risques de mortalité de 30 %. 15 minutes d'activité physique intense par semaine constituent la dose minimale pour diminuer le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires de 50 %. Au-delà de 56 minutes par semaine, l'activité physique intense n'aurait plus d'impact sur la diminution du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Concrètement, des sessions quotidiennes de trois minutes par jour d'activité physique intense seraient suffisantes pour réduire de moitié les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires.
Une autre étude259(*) s'est intéressée à l'impact de l'activité physique pendant des durées très courtes (une à deux minutes) réalisées dans le cadre de la vie quotidienne. L'étude s'est intéressée à des personnes inactives avec un âge moyen de 61,8 ans et suivies pendant près de sept ans à partir de la UK Biobank. Elle a montré que trois sessions d'une minute par jour diminuent la mortalité cardiovasculaire de 39 % et la mortalité par cancer de 40 %.
Il convient d'éviter tout malentendu dans l'interprétation de ces études qui n'ont pas vocation à inciter la population générale à moins d'activité physique dont l'intérêt dépasse largement la prévention des risques de santé. En revanche, elles montrent que les recommandations générales peuvent être personnalisées, voire optimisées et que des objectifs d'activité physique relativement modestes peuvent être inclus sans difficulté dans la vie quotidienne tout en ayant des impacts non négligeables sur la prévention de certaines maladies.
Ces résultats s'intègrent dans une réflexion plus globale sur l'optimisation du temps - souvent restreint - que peuvent consacrer des personnes peu actives à l'activité physique. Dans le cadre de l'obésité et du diabète par exemple, des exercices d'endurance combinés à du renforcement musculaire sont préconisés pour la perte de masse grasse viscérale et le contrôle glycémique. Lorsque leur condition physique le permet, des exercices intenses réalisés de manière fractionnée sur un temps court sont proposés aux patients obèses ou diabétiques, car ils procurent des bénéfices et des résultats équivalents à ceux d'exercices d'intensité plus faible mais plus longs.
b) L'analyse de la pertinence scientifique de l'injonction des 10 000 pas par jour
Certains chercheurs se sont intéressés à la pertinence des « 10 000 pas par jour »260(*), injonction apparue il y a près de cinquante ans dans le cadre d'une campagne publicitaire pour le lancement d'un podomètre261(*) japonais. Cet objectif de 10 000 pas s'est ensuite diffusé, notamment dans les applications mobiles alors qu'aucune étude scientifique n'avait validé le fait qu'il faille atteindre cet objectif pour bénéficier des bienfaits de la marche sur la santé.
Depuis, plusieurs études ont montré que le nombre de pas nécessaires pour un effet positif sur la santé variait selon les publics étudiés et était généralement inférieur à 10 000 pas par jour.
Dans une étude américaine menée en 2019 sur des femmes âgées en moyenne de 72 ans262(*), les chercheurs ont observé une réduction de la mortalité toutes causes confondues chez les femmes qui effectuaient au moins 4 400 pas par jour (comparé à celles qui en faisaient en moyenne 2 700). Au-delà de 7 500 pas par jour, aucun bénéfice additionnel n'était observé. En outre, dans cette étude, l'intensité de la marche n'était pas associée à une baisse de la mortalité significative lorsqu'on tenait compte du nombre de pas fait chaque jour. Ces résultats pourraient servir à encourager les personnes sédentaires pour qui 10 000 pas par jour représentent un but inatteignable.
En 2021, une autre étude263(*) a été menée chez des hommes et des femmes dont l'âge moyen était de 45 ans. Cette étude suggère que 7 000 pas par jour est le seuil au-delà duquel le risque de décès est diminué dans cette population. Au-delà de 10 000 pas par jour, aucun bénéfice additionnel en matière de risque de décès n'a été observé.
En 2022, une analyse croisée264(*) des études disponibles a montré que le plus grand bénéfice en termes de réduction de la mortalité et des maladies cardiovasculaires est observé autour de 6 000 à 8 000 pas par jour pour les personnes âgées de 60 ans et plus, et autour de 8 000 à 10 000 pas par jour pour les personnes âgées de moins de 60 ans.
À l'été 2025, une nouvelle analyse265(*) des études scientifiques disponibles a été publiée sur l'intérêt des 10 000 pas par jour. Par rapport à 2 000 pas, 7 000 pas par jour sont associés à une réduction de 47 % du risque de mortalité toutes causes confondues. Le risque d'incidence des maladies cardiovasculaires est réduit de 25 % et celui de mortalité due aux maladies cardiovasculaires de 47 %. La réduction d'incidence du cancer n'est pas significative, mais le risque de mortalité par cancer est réduit de 37 %. Les résultats de cette analyse font également état d'un risque réduit de 14 % de diabète de type 2, d'un risque réduit de 38 % de démence et d'un risque réduit de 22 % de symptômes dépressifs.
Bien que 10 000 pas par jour représentent un objectif souhaitable pour les personnes actives en matière de bénéfice pour la santé, 7 000 pas par jour sont associés à des améliorations cliniquement significatives et pourraient constituer un objectif plus réaliste et plus facile à atteindre pour les personnes faiblement ou modérément actives.
L'un des défis est d'inciter les personnes sédentaires à l'activité physique. Des préconisations trop ambitieuses peuvent les décourager. C'est la raison pour laquelle les experts sont enclins à suggérer aux personnes peu actives de commencer par ajouter 1 000 pas par jour à leur activité physique quotidienne, soit une marche de 10-15 minutes, et d'augmenter chaque semaine la durée de cette marche quotidienne jusqu'à atteindre environ 7 500 pas par jour.
4. Le rôle des sciences de l'implémentation pour assurer le succès des interventions en matière d'activité physique
Les études scientifiques insistent toutes sur l'impact de l'activité physique et de la réduction de la sédentarité sur la santé. Pourtant, ces études ont peu d'impact en santé publique en raison de leur faible répercussion sur le comportement de la population.
Le style de vie actif est un comportement de santé complexe, déterminé par des facteurs relevant de niveaux micro, méso et macro-environnementaux. Les incitations politiques sont insuffisantes pour encourager la population à adopter et à maintenir un comportement favorable à sa santé. Outre le système de santé (facteur macro-environnemental), des facteurs impliqués dans l'adhésion à un style de vie actif ont été identifiés, qu'il s'agisse de facteurs personnels ou micro-environnementaux (auto-efficacité, historique d'activité physique, motivation), et des facteurs méso-environnementaux (accessibilité aux équipements, modalités de mise en oeuvre de l'activité physique : intervenants, supervision, lieux de pratique).
Facteurs qui influencent la pratique de l'activité physique
D'après Booth issu de l'ouvrage : Rostan F., Simon C., Ulmer Z. dir. Promouvoir l'activité physique des jeunes. Élaborer et développer un projet de type Icaps. Saint-Denis : Inpes, coll. Santé en action, 2011
Les sciences de l'implémentation ont vocation à développer des stratégies spécifiques pour promouvoir l'intégration des résultats de la recherche dans la politique et la pratique des soins de santé266(*). Elles se définissent comme l'étude scientifique de méthodes visant à promouvoir l'adoption systématique des résultats de recherche et autres pratiques fondées sur des preuves scientifiques dans les pratiques de routine et, ainsi, à améliorer la qualité et l'efficacité des soins.
Elles interviennent à différentes échelles : au niveau du patient, mais également au niveau des acteurs de terrain, des organisations et de la politique de santé. Elles nécessitent une évaluation initiale du contexte, des obstacles et des facteurs facilitant la réalisation d'une intervention complexe, afin de déterminer les stratégies initiales à adopter pour favoriser cette réalisation.
Dans son rapport d'habilitation à diriger des recherches, Aude-Marie Foucaut267(*) fait la remarque suivante à propos de la prescription d'activité physique en oncologie : « En tant qu'intervention non médicamenteuse efficace, l'exercice physique en oncologie ne consiste pas seulement à conseiller ou à promouvoir un style de vie actif et de parler de son bénéfice, mais consiste à proposer un volume d'exercices (fréquence, intensité, temps et type d'exercices) et des modalités particulières d'exercices (supervision, environnement de pratique, usage du numérique, en contexte urbain ou rural, modalités d'accompagnement motivationnel et éducatif, coûts, etc.). Ainsi, et au regard des sciences de l'implémentation, il conviendra d'identifier et de mettre en évidence dans les recommandations de bonnes pratiques les “composants centraux” (ou invariants) - éléments essentiels et indispensables à la mise en oeuvre de l'exercice physique dans les parcours -, et les “périphériques adaptables” (ou composants modulables) - les éléments, structures et systèmes adaptables liés à l'intervention d'exercice physique et à l'organisation dans laquelle elle est mise en oeuvre. Le maintien des composants centraux et l'adaptation des périphériques adaptables permettra de supporter la validité interne, la fiabilité, et la fidélité de l'intervention. Ce focus est à notre connaissance très peu effectué dans les recommandations internationales alors que nous sommes à l'heure où les études d'implémentations en contexte de vie réelle doivent être développées pour une science des solutions qui accuse un retard conséquent vis-à-vis de la science des problèmes. »
De nombreuses personnes entendues ont insisté sur la nécessité d'investir dans les sciences de l'implémentation pour que l'efficacité de l'intervention ne soit pas seulement potentielle mais devienne réelle.
5. Les innovations technologiques au bénéfice de l'activité sportive et physique de demain
Les accéléromètres permettent d'analyser les mouvements. Au cours d'une journée de 24 heures, six comportements de mouvement peuvent être identifiés : le sommeil, le temps passé assis, le temps passé debout sans bouger, la marche lente, la marche rapide et des exercices physiques. Une étude de 2024268(*) a mesuré le temps consacré à chacun de ces comportements269(*) et a étudié l'impact d'une modification du temps dédié à certains comportements sur la pression artérielle.
Il a été constaté qu'une augmentation du temps passé à faire de l'exercice physique ou à dormir270(*) conduisait à une réduction de la pression artérielle. Concrètement, une augmentation du temps consacré à l'exercice physique de cinq minutes par jour aux dépens des cinq autres comportements permet de réduire la pression artérielle systolique de 0,68 mmHg et la pression artérielle diastolique de 0,54 mmHg. Une baisse de la pression artérielle systolique de 2 mmHg a également été constatée lorsque l'exercice physique remplace 20 minutes de marche rapide, 21 minutes de sédentarité, 22 minutes debout, 26 minutes de marche lente et 27 minutes de sommeil.
Cette étude montre qu'une réallocation limitée des comportements au bénéfice de l'exercice physique a un réel effet sur la pression artérielle. Les montres connectées (qui sont équipées d'un accéléromètre) peuvent jouer un rôle important pour analyser les comportements au cours de la journée et faciliter des modifications peu exigeantes qui auront néanmoins un réel effet sur la santé.
L'intelligence artificielle devrait également contribuer à améliorer la santé des personnes en tenant compte de tous les comportements de mouvement et aboutir à une médecine prescriptive d'activités physiques personnalisées. Elle permettra aussi de tenir compte du rythme circadien des personnes dans la pratique des activités physiques en privilégiant, le cas échéant, certaines périodes de la journée.
D'autres innovations technologiques ont pour objet de faciliter l'accès à l'activité physique pour des catégories de population rencontrant certaines difficultés à pratiquer une activité physique régulière, comme les personnes en situation de handicap. L'exergaming, à savoir le fait d'effectuer une activité physique de manière ludique et motivante en passant par le jeu vidéo, peut constituer une piste intéressante pour permettre à ces personnes d'exercer une activité physique. La chercheuse Mai-Anh Ngo a évoqué les possibilités offertes par le Ring Fit Adventure, un jeu vidéo pratiqué sur Nintendo Switch, dans lequel le joueur se déplace le long d'un parcours déterminé en courant sur place et en sautant au-dessus d'obstacles en pressant et relâchant un anneau en plastique (le Ring-Con) fourni avec le jeu. L'exergaming présente le double intérêt de permettre la pratique du sport et de l'activité physique à domicile et de lui donner une connotation ludique, ce qui peut motiver des personnes a priori peu sensibles à l'activité physique. Le jeu peut même être paramétré de manière à le rendre accessible à des personnes lourdement handicapées.
De plus en plus de jeux vidéo sont développés à l'intention des personnes âgées. L'objectif est de solliciter les capacités cognitives tout en proposant une activité physique grâce à divers outils numériques. Des systèmes de touches avec des jeux de lumière permettent de stimuler le joueur et de le faire bouger tout en jouant. Des recherches sont entreprises pour développer des programmes de réalité virtuelle personnalisés afin de tenir compte des spécificités et des besoins de chaque utilisateur. Dans le cadre de la chaire Active Aging, le projet de recherche Silver Explorer vise à concevoir un jeu vidéo pour et avec les séniors, en réalité virtuelle, utilisable à domicile avec un concept d'entraînement, des modules d'exercice, ainsi qu'une histoire attractive qui inciterait le joueur à pratiquer régulièrement et à maintenir ses capacités physiques.
À Rennes, le laboratoire M2S (Mouvement, sport, santé) a développé un jeu vidéo proposant une activité physique à des enfants atteints de cancer qui sont dans des chambres stériles. Les séances d'activité physique sont adaptées aux informations métaboliques et aux traitements que l'enfant reçoit. Grâce à un algorithme de machine learning, le comportement du compagnon virtuel de l'enfant est individualisé afin de proposer des séances adaptées. La fréquence cardiaque de l'enfant est prise en compte pendant toute la durée du jeu et ce dernier est modulé pour ne pas dépasser un nombre de battements cardiaques défini à l'avance. Par exemple, l'un des jeux développés propose à l'enfant de couper des briques dans différents environnements, comme sur une plage ou dans l'espace. La vitesse des cubes est adaptée en fonction de la fréquence cardiaque de l'enfant.
L'université Paris-Saclay, dans le cadre du projet CESAM (Centre d'étude du sport et d'analyse du mouvement), utilise les exergames dans ses recherches. Si ces jeux, développés par la société Neoexpérience, ont d'abord été conçus pour divertir, les acteurs du monde de la recherche et du sport ont décelé en eux un potentiel intéressant pour améliorer la motricité et les habiletés cognitives, en particulier chez les personnes âgées. Des jeux à but thérapeutique ont donc été mis au point, qui ciblent la mémoire de travail ou encore la flexibilité attentionnelle.
D'une manière générale, l'exergame est utilisé pour inciter à bouger les gens peu enclins à l'activité physique. Des programmes de stimulation physique et cognitive par le jeu sont mis en place auprès de publics qui ont des déficits cognitifs, physiques ou moteurs. D'autres projets existent avec des enfants exposés à des déficits importants dans leurs habiletés motrices générales. Le jeu va permettre d'améliorer leur capacité à lancer une balle, à tirer dans un ballon ou même à sauter.
Selon certaines études271(*), les exergames seraient une piste intéressante pour développer l'activité physique adaptée en direction d'enfants en manque de pratique physique afin d'atteindre l'objectif fixé des 30 minutes d'activité par jour dans les écoles primaires, ou encore pour des gens réfractaires au sport en raison de capacités physiques insuffisantes. Leur caractère ludique a vocation à faciliter puis maintenir la motivation des publics ciblés pour cette pratique.
Néanmoins, les exergames tendent à encourager l'utilisation des écrans, ce qui peut s'avérer paradoxal au moment où de nombreuses études scientifiques insistent sur la nécessité de réduire le temps passé devant les écrans, notamment des enfants et adolescents.
Par ailleurs, ces technologies sont très coûteuses : l'équipement d'une salle dédiée aux exergames s'élève à 25 000 euros. Tout achat d'exergame doit donc faire l'objet d'une réflexion préalable sur son utilité au regard d'autres investissements. À supposer par exemple qu'une école dispose du budget pour l'acquisition d'un exergame, on peut se demander s'il ne serait pas plus pertinent d'employer un éducateur sportif pour accompagner les enseignants dans la mise en place des 30 minutes d'activité physique par jour, pour animer les récréations et les pauses-déjeuner et pour développer une stratégie en faveur de l'activité physique au sein de l'école.
V. LES DIX RECOMMANDATIONS DE L'OFFICE
En conclusion de cette étude, l'Office formule deux grandes séries de recommandations : les premières visent à maintenir et accroître l'apport de la science au développement de la performance et de l'activité sportive, les secondes à encourager plus fortement la pratique sportive en France.
A. METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE
1. Sanctuariser et élargir les programmes de recherche en lien avec le sport de très haut niveau (notamment sur les spécificités féminines), tout en associant davantage les fédérations
L'accompagnement scientifique à la performance est devenu indispensable pour remporter les compétitions au plus haut niveau mondial. La France a pris du retard par rapport à certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Australie qui, depuis des décennies, intègrent la science dans leur stratégie sportive. Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont été l'occasion de renforcer la coopération entre la science et le sport de haut niveau. Il faut maintenant asseoir cette stratégie dans le temps.
Cet objectif implique de :
- garantir le financement du nouveau programme prioritaire de recherche de 20 millions d'euros annoncé en juillet 2025 pour préparer les jeux Olympiques d'été de 2028 à Los Angeles et les jeux Olympiques d'hiver de 2030 en France ;
- accorder le cas échéant la responsabilité scientifique des projets de recherche sélectionnés aux référents scientifiques des fédérations parties prenantes ; s'assurer que les fédérations impliquées pourront bénéficier de financements afin de couvrir les moyens humains et d'accompagnement qu'elles engagent ;
- financer des études scientifiques sur la physiologie des sportives et son impact sur la pratique et les performances sportives ;
- ouvrir les projets de recherche liés au sport aux appels à projet de l'Agence nationale de la recherche (ANR) en inscrivant le sport dans les thématiques transversales des appels à projets génériques annuels et en déclarant éligibles au financement de l'ANR les fédérations et les établissements appartenant au réseau du Grand Insep.
2. Renforcer l'expertise des fédérations et les moyens de l'Insep et de l'Agence nationale du sport
Les fédérations, le réseau Grand Insep et l'Agence nationale du sport sont les piliers du sport de haut niveau en France. Les fédérations sont responsables de la stratégie sportive dans leurs disciplines et de l'accompagnement de leurs athlètes. Elles sont toutes conscientes du rôle de la science sur l'amélioration des performances sportives même si la mise en pratique de cette stratégie varie selon les fédérations.
Pour accroître leur expertise, l'Office propose de :
- renforcer la formation scientifique des entraîneurs et des sportifs en encourageant l'acquisition de diplômes universitaires et la formation à la culture scientifique dans des parcours professionnalisants ;
- renforcer la légitimité des référents scientifiques au sein des fédérations en précisant leurs tâches et les compétences requises dans des fiches de poste ; mentionner explicitement le rôle et l'implication attendus du référent scientifique dans le cadre des projets de performance fédéraux ;
- faciliter le recrutement de doctorants dans les fédérations en augmentant le nombre de bourses Cifre ;
- augmenter le plafond d'emplois de l'Insep et de l'ANS pour tenir compte de l'apparition de nouveaux métiers (sport data scientists) et pour renforcer leurs fonctions d'accompagnement scientifique à la performance272(*).
3. Charger l'Agence nationale du sport de représenter l'ensemble des fédérations et des clubs sportifs dans les relations avec les fournisseurs de données afin de peser dans les négociations sur les aspects techniques et de souveraineté des données relatives aux sportifs français
De plus en plus de données sont produites et traitées dans le domaine du sport, soulevant à la fois des enjeux de souveraineté et des enjeux techniques liés au traitement de ces données. L'Insep et les fédérations sportives sont des clients relativement modestes des grandes entreprises, le plus souvent étrangères, qui fournissent et hébergent les données. La récupération des données brutes auprès des fournisseurs constitue un véritable enjeu mais ceux-ci y sont réticents car cela permettrait de mettre à jour les algorithmes utilisés pour leur traitement. Néanmoins, le recueil des données brutes est indispensable pour vérifier que les données traitées ne sont pas même involontairement biaisées, voire faussées. Il existe en outre un risque de confidentialité pour des données exploitées par des entreprises américaines, australiennes ou britanniques.
Pour remédier à ces difficultés, il serait judicieux de mettre fin à la fragmentation des marchés de données, chaque fédération négociant actuellement de son côté avec les fournisseurs de données, et de confier à une entité nationale comme l'Agence nationale du sport la représentation de l'ensemble des fédérations et clubs sportifs dans les relations avec les fournisseurs de données, à l'instar de ce que font UK Sport ou Team USA.
4. Veiller à ce que l'esprit de la loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine soit respecté
La loi Jardé clarifie les règles applicables aux recherches pratiquées sur l'être humain en fonction de leur niveau de risque et du degré d'intervention sur les personnes. Les comités de protection des personnes (CPP) sont chargés de vérifier que les projets de recherche respectent un certain nombre de critères médicaux, techniques et juridiques afin d'assurer la protection des personnes.
Dans le domaine des sciences du sport, les projets de recherche ne présentent généralement pas le même degré d'intervention sur les personnes que les projets en recherche clinique. Il conviendrait donc que les CPP adaptent leurs contrôles à la nature de ces projets et veillent à l'homogénéisation de leurs décisions dans le respect de l'esprit de la loi Jardé.
5. Faire de la prévention des commotions cérébrales et du coup de chaleur d'exercice des priorités de santé publique, notamment dans les compétitions extrêmes et pour les jeunes publics
Les commotions cérébrales restent encore mal connues dans le sport de haut niveau et dans le sport amateur en France, en dépit des efforts croissants de sensibilisation de la part des fédérations. Aussi, plusieurs mesures doivent être mises en oeuvre pour les prévenir ainsi que leurs conséquences à long terme :
- financer des études longitudinales sur le suivi des sportifs professionnels afin de disposer d'indicateurs chiffrés sur leur incidence et leurs effets à long terme en matière de santé ;
- enrichir le système de surveillance vidéo des joueurs du rugby avec l'intelligence artificielle afin de repérer les situations à risque et les attitudes déviantes de certains joueurs même en l'absence de commotions cérébrales que l'arbitre pourrait sanctionner. Cette surveillance vidéo des joueurs pourrait être étendue à d'autres disciplines sportives (handball, basket-ball, judo) ;
- prévoir des sanctions plus sévères dans tous les sports de contact pour lesquels certains comportements de jeu sont susceptibles d'entraîner des commotions cérébrales. L'exclusion par exemple de deux minutes du joueur de handball qui tire dans la tête du gardien introduite en 2022 n'est pas suffisamment dissuasive ;
- s'assurer que les protège-dents connectés imposés par World Rugby depuis 2023 pour détecter les impacts à la tête remplissent correctement leur fonction première de protection contre les chocs ;
- engager au niveau international une réflexion sur l'homogénéisation des gabarits en fonction des postes au rugby pour renforcer l'efficacité de la prévention des commotions cérébrales ;
- renforcer la sensibilisation des joueurs amateurs ;
- au rugby, interdire les plaquages et les chocs répétés lors des rucks pour les joueurs de moins de 15 ans ;
- s'aligner sur les pratiques en vigueur aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande interdisant au football les jeux de tête pour les enfants avant l'âge de 11 ans. L'apprentissage de la technique du jeu de tête doit faire l'objet de consignes au niveau national afin notamment de l'accompagner d'exercices visant à renforcer les muscles de la nuque. La taille et la pression des ballons utilisés doivent être modifiées. L'utilisation de balles en mousse pour l'apprentissage des têtes au football doit être privilégiée ;
- encourager les recherches sur le coup de chaleur d'exercice, pathologie largement sous-estimée aussi bien par le milieu médical que par le milieu sportif. Les recherches doivent être amplifiées pour connaître les mécanismes physiologiques en cause et améliorer l'efficacité de sa prise en charge. Parallèlement, le coup de chaleur d'exercice doit faire l'objet de campagnes de sensibilisation auprès des sportifs et des équipes médicales.
6. Réglementer la préparation mentale dans le sport et rationaliser les diplômes des préparateurs physiques
Les préparateurs physiques et mentaux jouent un rôle déterminant dans l'amélioration des performances des sportifs de haut niveau. Pourtant, ces professions ne sont pas clairement identifiées et restent confrontées à la multiplication de pratiques pseudo-scientifiques qui non seulement nuisent à la crédibilité de ces métiers, mais peuvent mettre en danger les athlètes. Il faut donc structurer ces professions. Il est proposé d'instaurer un cadre commun de connaissances qui s'appuierait sur la formation Staps Entraînement et optimisation de la performance sportive pour les futurs préparateurs physiques et préparateurs mentaux.
Dans l'attente d'une réglementation des compétences et des diplômes requis pour les métiers de préparateur physique et de préparateur mental, le développement de labels par les fédérations et l'Insep devrait être encouragé afin de garantir la qualité des prestations des préparateurs physiques et des préparateurs mentaux en activité.
En ce qui concerne le métier de préparateur physique, il est proposé la mise en place d'une carte professionnelle dédiée aux fonctions support de l'encadrement sportif avec mention spécifique Préparation physique, distincte des 80 diplômes et brevets existants dont les intitulés utilisent pourtant des termes en rapport avec la préparation physique (conduite de séances de préparation physique sportive, développement et maintien des capacités physiques, musculation éducative, sportive et d'entretien, etc.). Cette carte professionnelle doit sanctionner des connaissances et des compétences spécifiques273(*). Par ailleurs, le préparateur physique doit également être un entraîneur, ce qui suppose l'obtention du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS)274(*).
Le métier de préparateur mental doit également être réglementé. Un groupe de travail créé en 2022 et piloté conjointement par la Société française de psychologie du sport, l'Association nationale représentative des jeunes du champ du sport et de l'association ainsi que la Conférence des directeurs et directrices en Staps a publié 15 préconisations275(*) dont l'Office considère qu'elles méritent d'être reprises par les pouvoirs publics.
Elles répondent à une double exigence : reconnaître la richesse et la diversité des pratiques existantes, tout en construisant un cadre commun, lisible, rigoureux et protecteur pour les entraîneurs et les sportifs.
Parmi les propositions avancées figure la création d'un titre professionnel inscrit au répertoire national des certifications professionnelles conditionnant l'exercice de la profession. L'accès au métier de préparateur mental serait réservé aux personnes justifiant d'une formation master276(*) intégrant un socle disciplinaire en psychologie du sport et d'un stage long débouchant sur un mémoire professionnel. Avant de pouvoir exercer, un minimum de 300 heures de pratique et de 20 heures de supervision par un professionnel serait exigé.
Des dispositions transitoires pour les professionnels déjà en activité seraient envisagées visant soit à leur permettre de se mettre en conformité à travers un titre provisoire, soit à poursuivre leur activité sans formation complémentaire à partir d'une certaine ancienneté.
Enfin, à l'instar de ce qui est proposé pour les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux feraient désormais l'objet d'un statut professionnel à travers la création d'une carte professionnelle dédiée aux fonctions support de l'encadrement sportif avec mention spécifique Préparation mentale.
B. FAIRE DE LA FRANCE UNE NATION ACTIVE ET SPORTIVE
7. Actualiser régulièrement les données sur la sédentarité, l'activité physique, les temps passés devant les écrans et la condition physique des Français
Les enquêtes sur l'activité physique des Français, leur propension à la sédentarité et le temps passé devant les écrans sont anciennes. Ainsi, l'étude ESTEBAN sur le temps passé devant les écrans par les enfants et adolescents a été menée entre 2014 et 2016. De même, les avis de l'Anses relatifs à l'évaluation des risques liés aux niveaux d'activité physique et de sédentarité des enfants et des adolescents datent de 2016 et de 2020.
Il est donc urgent de disposer de données plus récentes à la fois sur le taux de sédentarité, sur l'activité physique et sur les temps passés devant les écrans. Leur actualisation régulière est nécessaire car elle permettra d'évaluer les politiques publiques engagées pour lutter contre la sédentarité et encourager l'activité physique. Il est donc indispensable d'investir financièrement, matériellement et humainement dans des enquêtes populationnelles sur ces thématiques pour obtenir des données actualisées.
Les données sur la condition physique des Français, en particulier des enfants, ne font pas non plus l'objet d'un suivi régulier. À la rentrée 2025, le Gouvernement a mis en place une évaluation des aptitudes physiques des élèves de 6e. Il serait pertinent de généraliser cette initiative aux enfants entrant en maternelle, au CP et au lycée. À l'instar du carnet de santé, un carnet d'activité physique devrait être institué pour tous les enfants afin de suivre leur appropriation de la littératie physique, mais également de pouvoir faire des comparaisons dans le temps et d'évaluer les politiques publiques en matière d'incitation à l'activité physique et leurs répercussions sur l'habileté motrice.
8. Faire de la prescription de l'activité physique adaptée un axe majeur du traitement non médicamenteux des maladies chroniques et des troubles de santé mentale
La prévention secondaire vise à agir au tout début de la maladie afin d'en limiter l'évolution ou d'en faire disparaître les facteurs de risque. La prévention tertiaire consiste, lorsque la maladie est installée, à réduire l'aggravation, les complications, les invalidités et les rechutes.
Il existe un consensus scientifique sur le rôle de l'activité physique aussi bien en matière de prévention secondaire qu'en matière de prévention tertiaire. C'est la raison pour laquelle l'activité physique adaptée est considérée depuis 2016 comme une thérapie non médicamenteuse pour les patients atteints d'une affection de longue durée ou de pathologies chroniques.
Néanmoins, en pratique, l'activité physique adaptée peine à trouver sa place dans notre système de soins. Les obstacles sont nombreux et ont été répertoriés dans une étude mentionnée précédemment277(*) : méconnaissance persistante de l'impact de l'activité physique sur la santé par l'ensemble des professionnels de santé ; statut peu adapté des enseignants en activité physique adaptée qui ne sont pas reconnus comme auxiliaires médicaux ; situation financière fragile des maisons sport-santé en l'absence de financement de fonctionnement pérenne. Le non-remboursement des programmes d'activité physique adaptée à visée thérapeutique par l'assurance maladie est également considéré comme un frein au développement de cette thérapie non médicamenteuse.
Il convient donc de mettre l'activité physique adaptée au coeur de la stratégie de santé publique en levant systématiquement les obstacles cités précédemment. Cela passe par la formation et la sensibilisation des professionnels de santé, en particulier des médecins que la loi a autorisés depuis 2016 à prescrire de l'activité physique adaptée à visée thérapeutique ; la reconnaissance des enseignants en activité physique adaptée en tant qu'auxiliaires de santé ; la stabilité financière des maisons sport-santé. Le remboursement des programmes d'activité physique adaptée à visée thérapeutique par l'assurance maladie coûterait plusieurs milliards à court terme, mais il permettrait de faire des économies en réduisant les facteurs de risque liés à certaines maladies et en ralentissant, voire en empêchant leur aggravation. La stratégie nationale sport santé 2025-2030 rappelle qu'une vingtaine d'expérimentations relevant de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 intègrent de l'APA dans le parcours de soins de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, respiratoires, obésité, cancers). Certaines sont terminées et ont démontré leur efficacité. Plusieurs autres arrivent à échéance en 2025 et 2026. Une analyse économique des coûts-bénéfices de ces expérimentations doit être entreprise pour éclairer le législateur et lui permettre de prendre une décision fondée sur des données scientifiques, sans connotation morale278(*).
9. Promouvoir les recherches sur la réduction de la sédentarité et l'encouragement à l'activité physique ainsi que sur la motivation et l'observance à long terme des pratiques physiques
Les sciences de l'implémentation devraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre la sédentarité et l'encouragement de l'exercice physique. Elles visent à identifier les obstacles et les facilitateurs à la réalisation d'une intervention complexe, à développer des stratégies d'implémentation, à adapter les interventions aux contextes locaux ainsi qu'à sensibiliser non seulement les professionnels de santé, mais également toutes les parties prenantes (politiques, administrations, etc.). Ces approches permettent de traduire les connaissances scientifiques en actions concrètes et efficaces pour promouvoir un mode de vie actif. Elles s'intéressent aux facteurs qui motivent les individus à pratiquer de l'activité physique et aux conditions qui favorisent l'observance à long terme des stratégies mises en place. Ainsi, les études scientifiques mettent toutes en avant l'importance des motivations intrinsèques comme le plaisir ou la compétence pour promouvoir l'activité physique. Pourtant, le discours des pouvoirs publics continue de mettre d'abord l'accent sur les bénéfices de l'activité physique sur la santé.
Les recherches dans le domaine des sciences de l'implémentation sont peu développées en France. Il convient donc de les promouvoir et d'assurer leur financement dans le cadre de la stratégie nationale sport santé 2025-2030 en cours d'élaboration.
10. Redonner sens à l'activité physique au quotidien à tout âge : de l'école maternelle jusqu'aux structures médicalisées
Le slogan « 30 minutes d'activité par jour » a l'avantage d'être simple et de donner une marge d'action relativement large aux Français pour qu'ils puissent se l'approprier facilement. Néanmoins, notre environnement comme nos styles de vie laissent peu de place à l'activité physique et nous poussent à toujours plus de sédentarité. Une politique efficace de promotion de l'activité physique et de lutte contre la sédentarité ne peut donc pas reposer sur la seule sensibilisation des individus et leur responsabilisation pour adopter de nouveaux comportements.
Une réflexion holistique s'impose afin de redonner du sens à l'activité physique au quotidien à chaque étape de la vie, dans divers contextes (écoles, lieux de travail, Ehpad, etc.) et pour divers profils de personnes, en lien avec l'enjeu de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Des actions ciblées doivent être envisagées selon les publics279(*) (enfants, adultes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc.) qui ne pourront être efficaces que si les environnements sont également adaptés pour faire de l'activité physique une évidence.
De même, la lutte contre la sédentarité doit être pensée et intégrée dans l'organisation de la scolarité et du travail pour avoir un impact durable sur les comportements.
L'élaboration de telles stratégies dépasse largement l'objet du présent rapport. Elles concernent des secteurs aussi variés que l'aménagement du territoire, les transports, la santé, l'école, le monde du travail, les loisirs.
La stratégie nationale sport santé mise en place en 2019 par les ministères chargés du sport et de la santé a comme objectif d'améliorer l'état de santé de la population en favorisant l'activité physique et sportive de chacun. Elle est toutefois conçue de façon trop sectorielle et faute de financements adéquats, aucune réforme structurelle ne peut être mise en oeuvre pour développer par exemple des infrastructures sportives, favoriser la mobilité douce ou encore aménager les villes afin de rendre l'activité physique agréable et pouvoir la pratiquer en sécurité.
Pourtant, la dégradation de la condition physique de nos concitoyens en raison de la sédentarité et du manque d'activité physique constitue une bombe à retardement pour nos finances publiques et notre système de santé qu'il convient de désamorcer au plus vite.
La stratégie nationale sport santé 2025-2030 présentée le 5 septembre 2025 fixe une feuille de route articulée autour 12 mesures concrètes, pour lever les freins à la pratique sportive et accompagner chaque Français quels que soient son âge, son état de santé ou ses conditions de vie.
Elle devra être considérée comme l'une des politiques publiques prioritaires des prochaines années et portée au plus haut niveau de l'État. Pour être efficace, elle devra impliquer l'ensemble des ministères afin de mettre en oeuvre une politique coordonnée avec des objectifs chiffrés, un budget dédié et une évaluation régulière des actions entreprises. C'est à ces conditions qu'elle parviendra à faire de la France une nation compétitive, active et saine.
EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'est réuni le jeudi 13 novembre 2025 afin d'examiner le projet de rapport sur « Science et sport », présenté par M. David Ros, sénateur, rapporteur.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - Nous nous retrouvons pour la présentation d'un rapport attendu, celui de notre collègue David Ros, sur la thématique « Science et sport », et plus précisément sur l'impact de la science et des technologies sur la performance sportive.
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir confié cette mission sur la science et le sport.
Les aléas politiques ont fait de la rédaction de ce rapport une expérience particulière. En effet, nous avons commencé nos travaux en mars 2024, avec Jean-Luc Fugit. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, en juin 2024, c'est Stéphane Vojetta qui l'a remplacé, avant que l'élection de ce dernier soit invalidée en juillet 2025. J'ai donc terminé la rédaction seul. Nos deux collègues députés ont néanmoins fortement contribué à ces travaux, auxquels je tiens à les associer, même si leur nom n'apparaîtra pas. Ainsi, nous avons mené plus de cinquante auditions, rencontré plus de cent personnes et effectué huit déplacements pour aboutir à ce rapport dépassant les 200 pages.
Nos travaux se sont orientés selon quatre axes principaux et se terminent par dix recommandations. Le premier axe concerne l'apport de la science au sport de compétition et ses éventuels effets pervers. Le deuxième traite des conséquences de l'organisation à Paris des jeux Olympiques et Paralympiques qui a créé une dynamique de structuration autour de la relation science-sport. Le troisième, sur lequel nous avons beaucoup insisté, Jean-Luc Fugit, Stéphane Vojetta et moi-même, porte sur la manière dont les travaux de recherche sur le sport de haut niveau irriguent la pratique du sport en général, la médecine, le bien-être et le bien-vieillir. Enfin, la dernière partie souligne le paradoxe entre l'abondance des travaux scientifiques sur l'activité physique et la faible pratique du sport ou de l'activité physique en France.
La première partie du rapport, sur l'effet de la science et des technologies sur la performance des sportifs de haut niveau, concerne principalement trois domaines : les matériaux et les équipements, la détection des talents et la préparation des athlètes.
Pour les matériaux, par exemple, tout le monde rêve de s'acheter un vélo que l'on peut soulever d'un doigt. Le poids des vélos de compétition est ainsi passé en quelques dizaines d'années de plus de quinze kilogrammes à moins de sept kilogrammes.
Je mentionne également les semelles à plaques de carbone, qui augmentent de 4 % l'efficacité de la course, ainsi que, dans le domaine de la voile, les nombreux travaux menés sur l'optimisation aéro- et hydrodynamique.
Des progrès sont également constatés dans le domaine de la sécurité des athlètes, par exemple pour lutter contre les chocs sur les pistes d'athlétisme ou les praticables de gymnastique. C'est également le cas du confort, grâce aux innovations technologiques portant sur les textiles et les chaussures. Ainsi, au Plessis-Robinson, le centre de recherche du Racing 92 effectue un travail considérable de personnalisation des chaussures pour les joueurs.
De plus en plus de travaux sont menés sur la caractérisation des équipements, particulièrement pour les athlètes paralympiques, comme sur l'adaptation des fauteuils de tennis aux surfaces de jeu. Ces travaux scientifiques ont des retombées évidentes pour les autres sportifs. Ainsi, le parasportif est une locomotive qu'il convient de mettre en avant pour les sportifs de haut niveau, mais également pour les sportifs de tous les jours.
Un autre domaine de recherche porte sur la détection des hauts potentiels, encore imparfaite sur certains aspects, car la plupart des modèles se focalisent excessivement sur l'âge de naissance, et non sur l'âge biologique. Il faut également tenir compte de l'historique de la pratique d'une personne, par exemple le nombre de semaines d'entraînement. À titre de comparaison, un élève qui obtient 18 en mathématiques après y avoir consacré six heures d'entraînement n'a pas forcément le même potentiel que celui qui, pour la même note, s'est préparé pendant six minutes... Il faut donc faire de même pour les sportifs.
J'en viens à la préparation des athlètes, qui existait bien sûr avant les Jeux, mais le phénomène s'est amplifié. De très nombreux domaines scientifiques sont concernés : la biomécanique, la physiologie, les neurosciences, la psychologie, avec la préparation mentale, et la sociologie. Les données permettent d'individualiser les programmes d'entraînement de manière très sophistiquée en fonction des capacités initiales et des objectifs recherchés. En parallèle, on développe de plus en plus la préparation mentale, même pour de très grands sportifs comme Teddy Riner. Loin d'être un aveu de faiblesse, il s'agit d'un élément essentiel dans la préparation des athlètes aux compétitions.
S'ajoutent encore les sciences et préparations techniques et tactiques avant l'épreuve, notamment via la réalité virtuelle. Par exemple, Loïs Boisson, au cours de la rééducation postérieure à son opération de la hanche, a utilisé des lunettes de réalité virtuelle pour simuler certains gestes et réapprendre à se déplacer correctement. Le même principe est applicable pour se préparer à la technique de l'adversaire. Au tennis de table par exemple, les frères Lebrun ont analysé les services de leurs adversaires, afin de mieux anticiper les effets donnés à la balle. Ces technologies joueront un rôle croissant dans la préparation aux épreuves.
Se pose cependant la question des possibles effets néfastes de la technologie.
Tout d'abord, on observe des inégalités grandissantes entre les fédérations, dont certaines n'ont pas les moyens de mettre ce genre d'outils à la disposition de leurs sportifs. En outre, au cours des cinq dernières années, 9 % des études ont concerné des athlètes femmes, contre 71 % exclusivement des hommes. Un rééquilibrage est donc nécessaire, d'autant que les spécificités physiologiques du cycle féminin ont un effet sensible sur leur performance le jour de l'épreuve.
Par ailleurs, la surveillance permanente des athlètes qui résulte de la collecte des données peut être un facteur de stress pour l'athlète, qu'il faut apprendre à gérer. De manière plus générale, cela pose la question de l'impact des données sur la santé des athlètes, les outils technologiques devant servir à comprendre leur état de forme plutôt qu'à outrepasser leurs limites physiques.
J'aborde, enfin, la dérive du dopage numérique et de l'homme « augmenté ». Ainsi, en 2026, la compétition des « jeux augmentés », organisée par des milliardaires américains, tolérera toute forme de dopage. Ses créateurs envisagent même qu'y soit battu le record du monde du 100 mètres... Anabolisants, numérique, matériel, tout sera permis, suivant l'idée selon laquelle l'homme peut être encore meilleur à chaque épreuve. Les limites sanitaires de cet exercice sont claires.
Nous en arrivons au deuxième axe du rapport : en 2024, les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris ont été l'occasion de réorganiser l'accompagnement scientifique de la performance sportive en France.
Notre modèle du haut niveau, qui date des années 1960, avait été organisé autour de quatre piliers : le ministère chargé des sports, les fédérations, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (Creps). Si les résultats passés ont été significatifs, le constat plus récent était celui d'un retard par rapport à d'autres pays en matière de très haute performance et d'accompagnement scientifique ; je songe notamment à nos amis britanniques, ce qu'ont illustré les derniers Jeux de Londres.
Telle est la raison de la réorganisation, qui a commencé en 2018 avec le lancement du programme Sciences2024 et un programme prioritaire de recherche (PPR) doté de 20 millions d'euros sur cinq ans. C'est à la fois beaucoup et peu lorsque l'on considère les projets menés dans le cadre de la préparation aux jeux Olympiques. Un groupement de recherche (GDR) Sports et activités physiques a été créé, qui mêle sciences et sports, afin de franchir les barrières psychologiques et culturelles qui existent entre ces deux mondes.
Cela a permis de restructurer les institutions du sport de haut niveau avec, notamment, la création de l'Agence nationale du sport (ANS), qui comprend un pôle Haute performance. Parmi les projets réalisés par l'ANS, le plus important est le Sport Data Hub, qui permet de centraliser des données physiologiques et biomécaniques des sportifs de haut niveau, irriguant les programmes personnalisés que j'ai mentionnés. Cet outil n'existait pas avant le lancement des Jeux.
Le bilan est globalement positif. Les coopérations ont été renforcées entre les mondes scientifique et sportif, favorisant une montée en compétence des fédérations. On a vu ainsi naître un écosystème de l'accompagnement scientifique de la performance. Reste, cependant, la question des moyens.
Des obstacles administratifs subsistent également, notamment liés à la mise en oeuvre de la loi Jardé du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, dont l'esprit n'est pas toujours compris ou respecté, et à la concurrence de pays européens qui n'ont pas le même regard. Un projet de loi de bioéthique devrait être prochainement examiné : ce sera l'occasion de reconsidérer cette problématique, y compris sous un angle européen.
Enfin, il demeure des obstacles culturels, qui tiennent à la place de la science de manière générale dans le monde sportif.
Comme je l'ai dit, il existe des inégalités entre des fédérations riches et pauvres. L'ANS devrait jouer un rôle de modération ou, à tout le moins, de soutien à l'égard de certaines fédérations.
N'oublions pas non plus l'incertitude sur le financement de la recherche pour le sport de haut niveau. Certes, pour la période post-2024, nous bénéficierons encore du phare des Jeux de 2030. Cependant, pour que ce dispositif soit efficace dans la durée, son financement ne doit pas dépendre des seules séquences olympiques.
Le troisième axe du rapport concerne les retombées des recherches initialement destinées au sport de haut niveau. Dans quels domaines ont-elles irrigué la médecine, le bien-être en général ou le soin de personnes présentant des séquelles ou des blessures, l'appareillage et les loisirs ?
Nous avons tout d'abord observé, notamment en province, un continuum très fort entre la recherche sur la performance sportive et la médecine : outre le sportif et le scientifique, le médecin n'est souvent pas très loin. Par exemple, à Saint-Étienne ou à Dijon, l'université, un centre sportif et un hôpital sont tout proches et s'articulent autour de l'objectif commun d'un traitement personnalisé, grâce à la fois au numérique et à l'approche humaine.
Les retombées dans le domaine de l'appareillage sont considérables, avec d'énormes progrès sur l'analyse du mouvement et sur la biomécanique dont les victimes de traumatismes liés notamment aux accidents de la route pourront par exemple bénéficier.
Un enjeu important réside dans la démocratisation des équipements, l'effet de masse faisant baisser les prix, ce qui permet d'accroître leur diffusion. Il reste néanmoins une difficulté d'adaptation des normes d'innovation technologique avant la mise sur le marché. Sans doute le législateur devra-t-il veiller à faciliter cette démarche dans le cadre d'expérimentations.
Dans le domaine du sport de loisir et grand public, l'approche personnalisée dont bénéficie le champion s'est étendue aux sportifs amateurs avec, par exemple, des matériels qui permettent, soit de disposer d'un coach numérique, soit d'apprendre avec un coach humain comment utiliser le numérique. Chacun peut s'identifier à un sportif de haut niveau et se fixer ses propres objectifs.
Les équipements de pointe se diffusent également et ont tendance à se personnaliser, avec une pratique physique à la demande. Là encore, il convient d'être prudent face à une possible dérive technologique. Ainsi, une pratique sportive guidée par les seules recommandations numériques pourrait faire perdre le bénéfice des sensations personnelles.
La dernière partie du rapport concerne les effets du sport sur la santé physique, qui font l'objet d'un consensus généralisé. Pourtant, ce consensus peine à se matérialiser.
En préambule, il convient de distinguer les notions de sédentarité et d'inactivité physique. En effet, si les deux phénomènes peuvent se cumuler, il est aussi possible, tout en ayant une activité physique, d'être sédentaire du fait de sa profession. La sédentarité et l'inactivité physique ont des impacts distincts et forts sur la santé. Ainsi, faire du sport ne suffit pas, il faut aussi lutter contre la sédentarité au quotidien. Actuellement, seuls 11,5 % des hommes et 10,6 % des femmes sont à la fois actifs et non sédentaires. On note que les femmes, avec toutes les tâches qu'elles accomplissent, sont finalement plus actives que les hommes.
L'impact de la sédentarité est considérable sur la santé. L'inactivité physique est, elle, liée à 5,3 millions de décès par an dans le monde ; il s'agit du quatrième facteur de mortalité, juste avant le tabac. Elle entraîne de nombreux problèmes de santé, dont l'augmentation des risques d'obésité, de diabète et, bien sûr, de maladies cardiovasculaires. De plus en plus d'études scientifiques montrent aussi une corrélation avec le développement de cancers.
Pourtant, les bienfaits de l'activité physique sont connus et documentés scientifiquement. Ainsi, des études menées dans tous les pays, sous différentes approches, aboutissent aux mêmes résultats. Bien évidemment, l'on songe avant tout à la santé physique, avec le renforcement du coeur, des muscles et des os, comme nous l'avons tous appris à l'école. Mais sont désormais aussi connus les rôles préventifs et curatifs de l'activité pour un certain nombre de maladies, y compris le cancer.
En outre, de plus en plus d'études font état d'effets sur la santé mentale et cognitive, avec une amélioration de la mémoire et de la concentration. Dans l'idéal, en cours d'apprentissage, à chaque heure et demie de travail intellectuel intense devrait être associé un quart d'heure de marche rapide.
S'ajoute à cela la diminution de l'anxiété et de la dépression, maux qui touchent de plus en plus nos sociétés. Par ailleurs, même si le résultat est moins clair, de premières études ont été publiées sur la relation entre l'activité physique et la lutte contre le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer, par la combinaison de certains exercices de concentration et de pratiques sportives. Le sujet est d'autant plus important que ce type de maladies s'accroît fortement et que nous vivons plus longtemps.
Ainsi, le gain moyen lié à l'activité physique se situerait entre sept et dix ans d'espérance de vie en bonne santé. Soit dit en passant, lorsque l'on parle du départ à la retraite, ce qui compte n'est pas tant l'âge limite que le nombre d'années qu'il reste à vivre en bonne santé. Nous devrions le prendre en compte dans le cadre de nos réflexions politiques.
Néanmoins, on constate une dégradation extrêmement alarmante de la condition physique des Français. Ainsi, pas moins de 37,5 % des hommes et 46,4 % des femmes, ainsi que 70 % des plus de 65 ans, sont inactifs. Par ailleurs, 66 % des jeunes de 11 à 17 ans cumulent plus de deux heures devant les écrans et moins d'une heure d'activité physique par jour. Les inégalités sociales sont marquées dans ce domaine, et le phénomène a été amplifié depuis la covid-19, en particulier chez les enfants et les adolescents.
Les conséquences sont claires : la condition physique est moins bonne et les coûts sanitaires sont extrêmement élevés, ce qui doit être relevé en période d'examen du budget. Ainsi, le « sport sur ordonnance » est souvent considéré par Bercy comme une dépense supplémentaire, alors que les études montrent très clairement qu'il aboutirait à une baisse des dépenses futures.
On peut donc parler d'un échec des politiques publiques menées, toutes tendances politiques confondues, malgré vingt-cinq ans d'initiatives, du programme national nutrition santé (PNNS) et des stratégies nationales sport santé (SNSS), dont la dernière concerne la période 2025-2030. Or ces plans et ces actions de communication ne se traduisent pas dans les faits.
On peut pointer un certain nombre d'obstacles, à commencer par un urbanisme inadapté. De plus, du fait des inégalités sociales, ces plans ne profitent qu'à une partie de la population. Enfin, il existe un manque global de reconnaissance de l'importance du sport et de l'activité physique tout au long du parcours scolaire de l'enfant, au lycée, à l'université, voire dans le monde de l'entreprise. Il faut donc changer de paradigme culturel quant à la manière dont nous considérons le sport et l'activité physique dans notre société.
Comme l'a évoqué hier la commission de la culture du Sénat, l'héritage des JOP est limité et ne fait pas l'objet d'une stratégie d'accompagnement au-delà de l'événement lui-même, qu'il s'agisse de la compétition de 2024 ou de celle de 2030. Dans ces conditions, comment passer d'une nation de sportifs à une nation sportive ?
Des travaux scientifiques existent pour aider à promouvoir l'activité physique. Un aspect important consiste à mettre en avant la motivation principale qui doit être le plaisir. En parallèle, la communication sur les bénéfices pour la santé doit se poursuivre et être reliée au plaisir de faire du sport, plutôt qu'à la contrainte.
L'éducation physique et sportive (EPS) est essentielle pour développer l'activité physique. La ministre des sports Marie Barsacq, très intéressée par la question, m'avait indiqué qu'elle s'était heurtée à une position quelque peu dogmatique des syndicats de professeurs d'EPS, qui estimaient que la création et le suivi d'un parcours sportif et sanitaire du jeune, de la sixième à la troisième, n'était pas leur métier. Il y a donc un travail culturel à mener, d'autant plus que les données chiffrées existent, avec le bilan de compétences effectué à l'entrée en sixième. Confier ce travail aux professeurs d'EPS, dans le cadre d'un contrat avec les enfants qu'ils suivent pendant les quatre années du collège, valoriserait leur métier. Tout le monde gagnerait à placer le sport au coeur des enseignements. Pourquoi ne pas multiplier le nombre de professeurs principaux enseignant l'EPS, au lieu de réserver ce rôle aux professeurs de mathématiques ou de physique ?
Un autre sujet est l'abandon du sport entre l'enfance et l'adolescence, pour différentes raisons : les premières amours, l'abandon des sports collectifs, la passion pour les écrans ou la musique... Ce décrochage, en augmentation, est aussi de plus en plus précoce, puisqu'auparavant, il intervenait à 15 ou 16 ans, contre 12 ou 13 ans désormais. Là encore, le rôle du professeur d'EPS est important pour donner confiance aux jeunes et les aider à poursuivre l'activité sportive tout au long de leur parcours scolaire.
Plus globalement, il existe une responsabilité importante de l'école, du lycée, de l'université, des grandes écoles, des entreprises et des administrations dans le rapport au sport, qui est souvent réduit à ce que l'on fait après... Par exemple, à Polytechnique, le sport ne représente qu'un tout petit coefficient. Or, puisque l'activité physique améliore la concentration, donc l'apprentissage et la productivité une fois adulte, il faut la remettre au coeur de la société. En particulier, les administrations doivent être exemplaires dans les possibilités offertes à leurs employés de pratiquer du sport.
Un travail d'explication est également nécessaire pour que chaque individu adapte son activité physique en fonction de son âge, de ses pathologies et de son contexte social.
J'en viens aux dix recommandations du rapport qui s'orientent selon deux axes principaux. Les six premières consistent à mettre la science au service de la performance et de l'activité sportive, les suivantes visent à faire de la France une nation sportive.
En premier lieu, il faut sanctuariser et élargir les programmes de recherche. Nous avons vu les effets positifs des 20 millions d'euros dépensés sur cinq ans. Les pérenniser est une bonne chose, mais peut-être faudrait-il augmenter le montant. La recherche de crédits publics étant difficile aujourd'hui, j'avais évoqué avec la ministre la possibilité d'avoir recours plus largement au mécénat, comme c'est déjà parfois le cas.
Deuxièmement, il faut mener un travail avec les fédérations, l'Insep et l'ANS, notamment s'agissant du soutien de cette dernière aux fédérations qui n'ont pas les moyens de lancer des programmes de recherche. Cela permettrait non seulement d'augmenter le nombre de médailles, comme l'a mentionné hier la ministre Marina Ferrari, mais aussi de renforcer le lien entre les domaines scientifique et sportif.
La troisième recommandation consiste à faire de l'ANS le seul interlocuteur des fournisseurs de données, notamment pour les scientifiques. Cela soulève la question de la souveraineté sur lesdites données, qui pèse sur les discussions techniques. Pour l'heure, elles sont quelque peu dispersées, alors que leur volume va augmenter très fortement.
Quatrièmement, il faut s'assurer du respect de l'esprit de la loi Jardé, ou peut-être en repréciser le cadre.
La cinquième recommandation, extrêmement importante, concerne la prévention des commotions cérébrales et des coups de chaleur. Un important travail sur les commotions a été réalisé dans le monde du rugby, par exemple au Racing 92. Mais le phénomène touche beaucoup d'autres sports, comme le handball et le football. Ainsi, certains pays nordiques interdisent aux joueurs de football de moins de 11 ans de pratiquer le jeu de tête, parce que le cerveau n'est pas encore complètement protégé à cet âge. Pourquoi pas en France ? Il en va de même pour le judo : la multiplication des chutes, de 4 à 6 ans, et même jusqu'à 11 ans, pourrait provoquer des débuts de cisaillement autour du cerveau. La fédération devrait peut-être modifier la pratique du baby-judo.
Partie du rugby de haut niveau, cette réflexion s'est bien diffusée dans d'autres sports. Mais il n'y a pas, à notre connaissance, de démarche générale du ministère sur la prévention des commotions, alors que celles-ci ont des conséquences extrêmement importantes, y compris celle du coût lié aux maladies et problèmes de santé de longue durée qu'elles occasionnent.
Les coups de chaleur sont un phénomène qui a d'abord été identifié et analysé par les militaires. Souvent associés à l'exposition directe à la chaleur, ils peuvent advenir lors de la pratique de sports extrêmes. Ainsi, la température des participants à des épreuves de trails peut dépasser 39 degrés, du fait d'une réaction du corps aux inflammations liées à l'épreuve subie par l'organisme.
Or la température de certains corps ne peut pas redescendre, ce qui peut provoquer l'arrêt du coeur voire une mort subite. Des matériaux sont en cours de développement pour refroidir les organes externes et améliorer le fonctionnement du corps et du cerveau et faire face à ces coups de chaleur.
Ce phénomène est toutefois méconnu car lorsqu'une personne meurt de mort subite ou d'un arrêt cardiaque, le coup de chaleur est rarement mis en avant. Des études permettent désormais de mieux l'identifier.
Ainsi, un travail global de prévention, à la fois sur les commotions et les coups de chaleur, devrait être mené par le ministère.
La sixième recommandation vise à réglementer la préparation mentale, domaine dans lequel la formation des praticiens est marquée par une grande hétérogénéité : détention d'un diplôme ou non, niveau réel de compétence... La formation des préparateurs physiques doit également être revue, en lien notamment avec les ministères des sports et de l'enseignement supérieur.
Le second axe, plus général, de nos recommandations tend à faire de la France une nation, sinon sportive, du moins active. La septième recommandation consiste à actualiser les données sur la sédentarité et l'activité physique, dans des bases de données comprenant l'activité physique, le temps passé devant les écrans, ou encore la condition physique générale des Français. Ces éléments doivent être accessibles en permanence de manière dynamique dans le cadre d'un observatoire, jusqu'à ce que les consulter devienne un réflexe, comme l'on s'informe chaque matin de la météo sur son téléphone, et une source de motivation.
Huitièmement, il s'agit de faire de l'activité physique adaptée un axe majeur des traitements non médicamenteux et d'ancrer culturellement la conviction selon laquelle cette activité adaptée permet de lutter contre des maladies chroniques et des troubles de la santé mentale. L'idéal serait de disposer de critères d'évaluation pour mesurer le retour sur investissement, c'est-à-dire les dépenses que cette activité physique permettrait d'éviter, afin de convaincre Bercy de généraliser la démarche dans les budgets des années à venir.
La neuvième recommandation vise à promouvoir les sciences de l'implémentation pour réduire la sédentarité et mettre en oeuvre des stratégies de long terme pour encourager l'activité physique.
Cela va de pair avec la dernière recommandation, qui relève de la communication, puisqu'elle consiste à mettre en pratique, de l'école maternelle aux structures médicalisées, du premier au dernier âge, l'activité physique ou le sport, sous l'angle à la fois de la santé publique et de la performance, qu'il s'agisse de l'apprentissage des enfants, de la pratique dans le monde professionnel, ou de l'activité intellectuelle lorsque l'on vieillit. Ce travail implique au premier chef les ministères de l'éducation nationale, des sports, de la recherche et de l'économie et des finances.
Pour conclure, si la SNSS 2025-2030 a déjà fait l'objet d'actions de communication, elle doit désormais être portée au plus haut niveau de l'État, lequel peut agir par l'exemple, ne serait-ce qu'au travers de la pratique du sport dans les administrations.
Je suis certain que lors de la présentation prochaine de cette stratégie, la ministre des sports sera présente, mais pas son homologue de l'éducation nationale. Avec mon collègue Bernard Fialaire, nous avions réuni les acteurs du sport et de la recherche, ainsi que le délégué interministériel chargé du sport-santé, Vincent Roger. Lorsque nous nous sommes étonnés de l'absence de représentants de l'éducation nationale, celui-ci nous avait dit que trois personnes avaient pourtant été invitées. Cela illustre bien le fait qu'il ne s'agit pas de l'une des priorités de ce ministère, ce qui pose problème.
De manière plus générale, pour être efficace, il faut une implication coordonnée de tous les ministères, avec des budgets dédiés et, surtout, des critères d'évaluation clairs pour mesurer si les actions menées vont dans le bon sens. Or ces critères sont simples : il s'agit de l'état physique des Français, dont la cartographie est essentielle. C'est ainsi que nous pourrons voir si nous allons dans la bonne direction.
Mme Olga Givernet, députée. - Après l'expérience des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et en vue de ceux de 2030, des éléments sont-ils amendables dans le cadre du projet de loi en cours de discussion ? Les JOP de 2030 marqueront, à n'en pas douter, des avancées technologiques concernant l'usage des matériaux et la mise en place de conditions nécessaires à la pratique sportive.
Dans la lettre de saisine de l'Office, l'e-sport n'est pas évoqué. Un large public, avec une forte émulation, est pourtant concerné. Envisagez-vous de mettre l'accent sur le sujet ultérieurement ?
Enfin, concernant l'accès aux données, on observe le développement de nombreuses applications santé qui permettent, par exemple, de calculer le nombre de pas. Comment peut-on favoriser l'appropriation par le grand public de ces technologies ?
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - La Cour des comptes a indiqué que la disponibilité des acteurs, aussi bien pour la communication et la logistique que de la part des entreprises et du bénévolat, a constitué un atout pour les JOP de Paris. Il s'agira de vérifier que l'écosystème de compétences réunies fonctionne aussi bien lors des JOP de 2030.
Un montant de 20 millions d'euros sera consacré au lancement du programme prioritaire de recherche (PPR). Les thématiques seront différentes de celles mises en avant lors des JOP de Paris. Les acteurs de la recherche française sont en pointe, notamment dans les domaines du matériel, mais aussi sur des thématiques en lien avec les conditions météorologiques ; l'enjeu sera de bien les mobiliser.
Quand on dispose de peu de moyens, il faut identifier les sportifs qui ont un potentiel pour favoriser leur progression. En 2012, lors des JOP de Londres, le Royaume-Uni avait largement battu son record de médailles en ciblant un certain nombre de disciplines, notamment le cyclisme sur piste. En vue des JOP de Los Angeles, sa stratégie a évolué : en multipliant par dix le budget, il ambitionne désormais de se situer derrière les États-Unis et la Chine pour le nombre de médailles.
Par ailleurs, les JOP, en particulier ceux d'hiver, constituent une vitrine pour le tourisme et le matériel.
Nous n'avons pas étudié la question de l'e-sport. En revanche, l'apport de la réalité virtuelle est désormais intégré dans la préparation des sportifs de haut niveau ; je pense notamment à la possibilité de s'entraîner en dépit de blessures. Le matériel est encore coûteux, mais cet aspect pourrait se développer auprès du grand public.
Aujourd'hui, alors que nous sommes saturés de données, se pose la question de leur juste utilisation, au regard des objectifs que nous nous sommes fixés. Comme pour l'intelligence artificielle, une phase d'apprentissage est nécessaire. Au-delà des données, la sensation aussi doit guider dans l'effort.
Au lycée, un semestre est consacré à la pratique de la musculation. À cet âge, les garçons font de la musculation dans leur coin, guidés par les seuls influenceurs, et ils pensent tout savoir sur le sujet. Les professeurs d'EPS pourraient jouer un rôle pédagogique, en établissant un programme, en échangeant avec les jeunes sur le discours des influenceurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, les professeurs étant, le plus souvent, déconnectés de ces vagues de données qui nous submergent.
Par ailleurs, des questions liées à la souveraineté se posent concernant l'utilisation et le partage de ces données.
M. Daniel Salmon, sénateur. - Certaines définitions, notamment celle de la sédentarité, me semblent encore assez floues.
J'établis une différence entre le sport du quotidien et celui qui vise la performance. Par quotidien, j'entends la marche quand on se rend à son travail. Ce type d'activité physique n'est pas considéré comme du sport, mais s'avère fondamental en matière de santé.
Aujourd'hui, notre société valorise la performance, et cela entraîne certains excès : je pense à l'exemple, cité par le rapporteur, de la hausse de température corporelle après un effort prolongé. Par ailleurs, comme de nombreuses études le montrent, ce culte de la performance conduit les personnes à des déplacements néfastes d'un point de vue écologique, sans parler de la question des déchets qui se pose notamment en Himalaya. Autant le sport au quotidien doit être valorisé, autant la performance ultime soulève de nombreuses questions. On peut également s'interroger sur la place de la technologie. Le sport génère une activité économique non dénuée de conséquences écologiques.
Concernant le sport de haut niveau, on observe des phénomènes d'usure après un certain âge. Il s'agit de placer les curseurs au bon endroit, afin d'encourager l'activité physique sans tomber dans l'excès.
Nous devons également prendre en compte la question de l'alimentation. Notre société est encore trop favorable aux aliments gras et sucrés : cette année encore, je défendrai des amendements visant à lutter contre cette tendance par la suppression de la publicité sur ces produits.
Enfin, il y a le sujet des écrans, et leur usage délétère pour nos jeunes.
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - Sur les douleurs articulaires, les données ne préviennent malheureusement pas de l'usure d'un ménisque. À ce titre, les sensations éprouvées restent essentielles.
L'ultra-trail concerne très peu de personnes. Avec le réchauffement climatique, se pose plus globalement la question de savoir comment nous allons continuer à faire du sport. En 2085, les températures moyennes devraient se situer au-delà des 28 degrés Celsius sur une grande partie du globe. L'idée est de développer de nouveaux matériaux qui permettront une activité physique dans des conditions favorables...
M. Daniel Salmon, sénateur. - Tout en luttant contre le réchauffement climatique !
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - Nous projeter dans l'avenir n'exclut pas de gérer aussi le présent.
Sur les questions alimentaires, nous disposons des connaissances ; l'enjeu est de savoir les utiliser.
Les effets néfastes des écrans sont bien connus. Par exemple, le fait d'être en contact de façon prolongée avec un écran moins de quarante-cinq minutes avant de s'endormir, altère la qualité du sommeil et la récupération physique.
Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour échapper à l'inactivité physique, il faut que les enfants de 5 à 17 ans aient chaque jour une activité d'intensité modérée à soutenue d'une durée de soixante minutes et que les adultes aient chaque semaine une activité d'intensité modérée d'une durée de cent cinquante minutes. Les critères sont donc assez vagues. Par ailleurs, l'important n'est pas le nombre de pas effectués chaque jour, mais le rythme de la marche. Plus la marche est rapide, plus on augmente la capacité cardio-respiratoire et plus on améliore l'état général de santé.
La sédentarité correspond au temps passé assis ou allongé. Pour autant, on peut être assis et effectuer des exercices de gainage passif.
Mme Florence Lassarade, sénatrice, vice-présidente de l'Office. - J'ai été surprise par le faible taux - 11 % - de personnes pratiquant une activité physique, même modérée, après 65 ans. Je connais, en effet, de nombreuses associations proposant de la marche aux seniors. Les plus de 65 ans ne constituent pas une catégorie homogène, il faudrait introduire des tranches d'âge.
Il y a quelques années, l'université Clermont Auvergne avait mené une enquête sur l'installation de vélo-bureaux dans les classes, qui avaient permis d'augmenter le niveau sportif tout en améliorant les performances scolaires. Hélas, l'expérience ne s'est pas généralisée. Pourtant, elle s'appuyait sur le constat que la performance des meilleurs élèves en sport actuellement correspond à la performance des moins bons élèves en sport il y a 20 ans.
Les enseignants ont, en général, peu d'appétence pour le sport. Cela ne favorise pas une activité physique régulière des élèves. On tolère de moins en moins les enfants agités, alors que l'agitation est naturelle à cet âge. On constate également une augmentation de 20 % de l'obésité en vingt ans.
Dès l'enfance, il s'agit de s'attaquer aux habitudes les plus ancrées. À ce titre, l'influence des grands sportifs, qui font rêver les enfants, est décisive. Après chaque période de jeux Olympiques ou de Coupe du monde de football, il est frappant de voir les enfants se mettre au sport.
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - Les statistiques montrent qu'il existe de nombreuses différences entre le troisième et le quatrième âge. Je m'interroge sur le fait que les clubs de marche ne soient pas recensés dans le périmètre des activités sportives. L'activité physique ne requiert pas toujours une licence en club. Se pose alors la question de sa prise en compte dans les statistiques.
Une large part du temps scolaire - 65 à 70 % - est sédentaire. Dans le cadre d'une expérience visant à lutter contre l'obésité menée en milieu scolaire aux États-Unis, une moitié de la classe devait se tenir debout, en situation de musculation passive, pendant les cours. Les effets ont été nuls sur le poids ; en revanche, on a constaté de meilleurs résultats scolaires chez les élèves restés debout ; et les résultats ont été meilleurs encore en incluant cinq minutes de marche active toutes les heures et demie.
La corrélation entre une activité physique régulière et de meilleurs résultats scolaires est avérée, notamment en période d'apprentissage. En privilégiant une alternance des rythmes, l'activité physique favorise la mémorisation et la concentration.
Concernant les enseignants, au-delà des appétences individuelles, l'enjeu est culturel. Dans le parcours d'apprentissage de l'enfant, ils ne considèrent pas le sport comme une pratique essentielle. Dans les pays anglo-saxons, les classes sont plus actives et interactives. Il faut remettre l'activité physique et le sport au centre de la société.
La compétition induit l'idée d'un dépassement de soi, et les sportifs de haut niveau sont des modèles auxquels les jeunes peuvent s'identifier.
M. Pierre Henriet, député, premier vice-président de l'Office. - On peut tout faire dire à des statistiques. Le rapport indique que 11 % des hommes et 10,6 % des femmes pratiquent une activité physique. Sans doute faut-il travailler à une nomenclature plus précise de l'activité physique afin de mieux comprendre les enjeux.
L'absence de lien entre le sport et l'éducation est préoccupant. Les sportifs de haut niveau, qui connaissent bien les modèles éducatifs étrangers, ont été nombreux à le dire lors des JOP de 2024. Il existe une volonté politique pour faire de la France une nation sportive, mais nous sommes loin de pouvoir atteindre cet objectif, car le sport n'est pas une priorité dans notre pays. Il n'est pas valorisé dans les études comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. L'Éducation nationale ne semble pas avoir la volonté de faire entrer le sport à l'école. L'Office doit se saisir de cette problématique et faire des propositions sur le sujet.
La situation est paradoxale : alors que les enseignants d'EPS disposent de nombreuses compétences et qu'ils sont soumis à un processus de sélection particulièrement rude, on constate une incompréhension, voire un dégoût des élèves pour le cours d'EPS qui va les éloigner de la pratique sportive.
Vous n'avez pas évoqué le sujet du sport cérébral ; je pense notamment aux échecs. Un certain nombre d'études ont montré les bienfaits de l'activité sur les performances cognitives, ce qui représente un argument supplémentaire pour renforcer le lien entre le sport et l'éducation.
Enfin, qu'adviendra-t-il de ce rapport ? Je suppose qu'il sera présenté à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat. Il serait intéressant d'en faire autant à l'Assemblée nationale.
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - Les taux de 11 % et de 10,6 % que vous avez mentionnés correspondent à des comportements à la fois actifs et non sédentaires. Pour ce qui est des comportements inactifs et sédentaires, les taux s'élèvent à 24 % pour les hommes et 39 % pour les femmes. 61% des hommes sont actifs et sédentaires.
Concernant le sport cérébral, j'étais persuadé qu'une activité physique concomitante améliorait les capacités de concentration ; des spécialistes m'ont répondu que le cerveau n'était pas conditionné pour effectuer deux activités à la fois et qu'il fallait privilégier les séquences alternées.
Un certain nombre des recommandations du rapport sont adressées au ministère, notamment celles qui concernent l'ANS et les JOP de 2030. Des éléments de notre rapport pourront également être repris dans le cadre du budget ou de propositions de loi (PPL) spécifiques.
Je souscris à ce que vous avez dit sur les professeurs d'EPS. Le concours est très difficile, en particulier celui de l'agrégation, et les professeurs disposent de nombreuses connaissances en matière de physiologie, de physique et de mécanique ; je déplore que celles-ci ne soient pas mieux utilisées dans le cadre de l'apprentissage.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - Le rapport traite, d'une part, de la technologie qui permet d'augmenter les performances, d'autre part, de la recherche sur le corps humain.
Concernant la technologie, vous avez évoqué l'évolution du poids des vélos. Or nous avons su parfois interrompre certaines avancées qui dénaturaient une pratique : je pense, par exemple, à l'usage des combinaisons en natation. Actuellement, on peut s'interroger sur le développement de l'utilisation des chaussures à plaque carbone dans la course à pied.
Quant à l'accompagnement à la performance, notamment avec l'utilisation de capteurs de données qui permettent d'analyser les mouvements et les chocs, c'est une évolution qui me semble profitable, même si elle concerne surtout les sportifs de haut niveau. La réalité virtuelle permet également de mieux appréhender la pratique ainsi que les aspects tactiques.
On observe une forme d'addiction dans l'utilisation des applications. Liée à l'impératif d'atteindre des objectifs, elle peut favoriser l'isolement du sportif. Des dérives existent, en particulier dans la course à pied. Nous ne disposons pas de moyens législatifs pour lutter contre ce phénomène, d'où l'importance des messages de pédagogie pour sensibiliser les sportifs au risque d'enfermement dans un univers numérique alors que l'on apprend beaucoup au contact des autres.
En ce qui concerne les « Enhanced Games » qui doivent se dérouler l'année prochaine aux États-Unis, il est effrayant que certains sportifs soient prêts à tous les dopages pour optimiser leurs performances.
La recherche sur les capacités du corps humain présente certains aspects positifs. La promotion des pratiques sportives contribue à la lutte contre les maladies : je pense notamment à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à certains cancers dont la progression est ralentie par l'exercice physique. Sans aller jusqu'à dire que nos sept à dix années d'espérance de vie supplémentaire en bonne santé mériteraient que l'on décale d'autant l'âge de départ à la retraite, la connaissance scientifique permet aujourd'hui de faire progresser la santé publique.
Toutefois, des dérives existent et nous serons vigilants, notamment au moment de la révision de la loi de bioéthique. Qu'est-il possible de modifier dans la biologie du corps humain pour augmenter les capacités de celui-ci ? Nous avons en tête ce qui se pratiquait à l'époque en Allemagne de l'Est : les femmes athlètes étaient mises enceintes quelques mois avant les compétitions internationales afin de développer des hormones augmentant leurs capacités physiques. Chacun se rappelle également les médecins attachés aux équipes de cyclisme pour pratiquer des transfusions sanguines désormais interdites.
Les médecins oeuvrant pour des équipes sportives de haut niveau ont toujours un temps d'avance sur le législateur. À chaque fois, c'est au moment où éclatent les scandales que nous découvrons les capacités de la médecine. Peut-être pourrions-nous envisager une action sur les règlements des compétitions sportives ?
Je considère que la France n'est pas une nation sportive. Nous obtenons des résultats surtout lorsque nous accueillons de grandes compétitions. Mais nous n'avons pas ce sentiment d'acculturation, qui est perceptible dès l'école dans les pays anglo-saxons. Par exemple, nos étudiants délaissent le sport pendant leurs études et nous n'avons pas de compétitions entre les universités comme il en existe aux États-Unis.
La première action à mener concerne l'école et l'EPS. Par exemple, il serait opportun que les professeurs disposent des données permettant un suivi des qualités de l'élève ; cela aiderait à individualiser la pratique sportive. Rien n'est fait non plus, pendant la scolarité, pour encourager le développement du sport de haut niveau. Ainsi, Amélie Oudéa-Castera a suivi un cursus scolaire dans le privé qui lui garantissait une plus grande flexibilité dans ses apprentissages et dans le passage de ses examens afin de faire du tennis de haut niveau.
Sur les traumatismes, la prévention progresse, notamment dans le rugby. Mais certains sports qui connaissent un fort développement sont effrayants : ainsi, dans les arts martiaux mixtes (MMA), tous les coups sont permis.
Le dépassement de soi reste une valeur importante, mais l'on peut s'engager dans une activité sportive sans se mettre en danger.
Notre corps sécrète de la dopamine durant l'effort et il serait pertinent d'axer la communication sur la recherche de ce plaisir gratuit que procure le sport.
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - La frontière entre l'innovation technologique et le dopage, ainsi que les effets néfastes des applications pour les sportifs amateurs, sont traités dans le rapport.
Concernant la loi de bioéthique, il faudra tenir compte des échanges entre les coachs sportifs et les chercheurs qui ne disposent pas des mêmes outils. Certains sportifs s'intéressent aux enjeux scientifiques, mais dans la plupart des cas, c'est le coach qui a le rôle d'informer et de mettre en confiance.
Pour ce qui est du suivi des enfants, je suis d'accord avec vous : les enseignants d'EPS verraient leur fonction revalorisée si on leur confiait la responsabilité du suivi des enfants à travers un passeport sportif numérique auquel les médecins auraient également accès. On mettrait ainsi en avant non seulement le sport, mais aussi celui qui l'enseigne. Il importe d'impliquer le ministère chargé des sports et celui de l'éducation nationale dans cette réflexion.
Le problème des coups de chaleur se pose aussi pour les ouvriers qui travaillent dans le bâtiment. Les matériaux développés pour les sportifs pourraient être intégrés à leur équipement.
Les commotions sont un sujet central dans le rugby. Désormais, des capteurs renseignent l'entraîneur en temps réel sur les données physiques du joueur.
Quant au lien entre le sport et les études, je peux témoigner d'un exemple flagrant de défaillance du système français. En effet, j'ai rencontré un jeune Français originaire de Toulon qui jouait dans l'équipe junior de rugby et voulait poursuivre ses études. Finalement, il est parti en Angleterre, car l'université de Leicester était prête à lui payer ses études tout en lui permettant de jouer pour l'équipe locale.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - En matière écologique, on observe des progrès, malgré le problème persistant de l'empreinte carbone liée aux déplacements. Les compétitions ouvertes aux amateurs, notamment celles de course à pied, suscitent un vif engouement et sont devenues un vrai business. D'autres signes sont encourageants, comme la prochaine édition du marathon de Paris qui se fera sans gobelets ni bouteilles en plastique. Certains organisateurs renoncent à la distribution de t-shirts.
Par ailleurs, la pratique sportive induit des comportements alimentaires différents. Avant une compétition par exemple, les sportifs font attention à tout ce qu'ils ingèrent.
Nous serons attentifs au suivi de ce rapport dans nos commissions respectives, voire dans le cadre d'un débat dans l'hémicycle. Dans la période actuelle, un moment de concorde nationale ne serait pas superflu.
M. David Ros, sénateur, vice-président de l'Office, rapporteur. - Nous pourrions également transmettre ce rapport aux commissions des affaires sociales des deux chambres.
L'Office adopte à l'unanimité le rapport « La science dans la mêlée pour une nation sportive » et autorise sa publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
· Marie Barsacq, ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de France
· Nicolas Bouscaren, praticien hospitalier Santé publique, méthodologiste
· Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
Béatrice Bourgeois, présidente
Jérémy Roubin, secrétaire général
· Laboratoire AntiDopage Français (LADF)
Magali D'Elia, secrétaire générale
· Groupement de recherche Sports et activités physiques (CNRS)
Audrey Bergouignan, directrice de recherche CNRS, responsable du groupement de recherche
Philippe Terral, professeur de sociologie, membre du bureau du groupement de recherche
Thomas Borel, responsable des affaires publiques et des relations parlementaires du CNRS
· Sciences2024
Christophe Clanet, directeur du programme Sciences2024
· Ludovic Seifert, professeur des universités à l'UFR Staps, enseignant-chercheur du laboratoire Cetaps (Centre d'études des transformations des activités physiques et sportives) de l'université de Rouen Normandie
· Sylvain Blanchard, directeur médical et scientifique du Racing 92
· Vincent Nougier, professeur à l'université Grenoble Alpes
· Samuel Vergès, directeur de recherche Inserm, responsable de l'équipe Hypoxie-Exercice du laboratoire Hypoxie physiopathologie (HP2) - Université Grenoble Alpes/Inserm/CHU Grenoble Alpes
· Laurent Bosquet, directeur du laboratoire Move (UR 20296), coordinateur de la chaire Sport santé à la faculté des sciences du sport de l'université de Poitiers
· Sylvain Ferez, maître de conférences (HDR), directeur du laboratoire Santé, éducation, situations de handicap (SantTESiH) à l'université de Montpellier
· Marc Fermigier, professeur émérite, porteur du projet Du carbone à l'or olympique au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes à l'ESPCI Paris/PSL
· Amandine Aftalion, directrice de recherche CNRS au Centre d'analyses et de mathématiques sociales (Cams) - École des hautes études en sciences sociales (EHESS)/CNRS
· Cédric Moro, directeur de recherche Inserm, responsable de l'équipe MetaDiab à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires (I2MC) - Inserm/Université Toulouse III Paul-Sabatier
· Claire Thomas-Junius, directrice du laboratoire de biologie de l'exercice pour la performance et la santé (LBEPS)
· Alexandra Malgoyre, médecin en chef, chercheur, chef du département Environnements opérationnels à l'Institut de recherche biomédicale des armées (Irba)
· Agence nationale du sport
Yann Cucherat, manager général Haute performance
Philippe Graille, responsable Sport Data Hub/Recherche/Innovation
Benoît Schuller, responsable du Sport Data Hub
· Pascale Duché, directrice du laboratoire Impact de l'activité physique sur la santé (IAPS) - Faculté des sciences du sport/UFR Staps de l'université de Toulon
· Anne Vuillemin, enseignant-chercheur en Staps à l'université Côte d'Azur, présidente de la Société française de santé publique (SFSP)
· Mai-Anh Ngo, ingénieure de recherche CNRS au groupe de recherche en droit, économie, gestion (Gredeg) - CNRS/Université Côte d'Azur
· Julien Piscione, responsable du département Accompagnement à la performance de la Fédération française de rugby
· Sébastien Dalgalarrondo, chargé de recherche CNRS à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, sciences sociales, politique, santé (Iris)
· Paul Charton, directeur général de Chiron IT
· Olivier Rey, maître de conférences à l'Institut des sciences du mouvement (ISM) - Université Aix-Marseille/CNRS, porteur du projet Mouv'en santé
· Corentin Clément-Guillotin, maître de conférences, laboratoire Motricité humaine, expertise, sport, santé (Lamhess) - Université Côte d'Azur
· Augustin Vicard, directeur de l'Institut de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep), président de l'Observatoire national du sport
· Benjamin Pageaux, professeur adjoint à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique (Eksap) de l'université de Montréal
· Général Paul Sanzey, responsable du Centre national des sports de la Défense (CNSD) - Ministère des armées
· Jean-François Chermann, neurologue, spécialiste des commotions cérébrales
· Mathias Pessiglione, directeur de recherche, co-responsable de l'équipe Motivation, cerveau et comportement de l'Institut du cerveau
· Nicolas Coulmy, directeur du pôle Développement, formation, suivi scientifique de la Fédération française de ski (FFS)
· Bastien Soulé, professeur des universités, membre du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport (L-ViS) de l'université Claude-Bernard Lyon 1
· Yannick Nyanga, ancien joueur professionnel de rugby, international français, co-auteur du livre Data et sport : la révolution
· Jérémy Pierre, maître de conférences (HDR), porteur du projet Propa à l'UFR Staps de l'université Gustave Eiffel
· Martine Duclos, présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité (Onaps)
· Salomon
Nicolas Horvais, chef de projet Innovation & Sustainability
Thibaut Poupard, responsable Footwear, Innovation & Sustainability
· Fédération française Handisport (FFH)
Sandra Mauduit, coordinatrice du service Recherche expertise formation
Marjolaine Astier, référente expertise et formation
· Mickaël Campo, maître de conférences en psychologie du sport à l'université Bourgogne Europe
· Fédération française de handball (FFHandball)
Olivier Maurelli, conseiller technique national en charge du dossier recherche et développement
Emmanuel Bidet, médecin de l'équipe de France masculine
Mourad Bounouara, responsable fédéral du projet Hand fauteuil
Pierrick Bernard, responsable scientifique du projet handisport à la fédération
· Gymnova
Rémi Karakotchian, directeur général
Patrice Ferraina, directeur commercial France et marketing
· Philippe Chauvin, père de Nicolas Chauvin, ancien troisième ligne des Espoirs du Stade Français décédé en 2018
· Fédération française de voile
Paul Iachkine, référent scientifique
Philippe Mourniac, ancien directeur des équipes de France de voile olympique
· Julie Doron, maîtresse de conférences (HDR) en psychologie appliquée au sport et à la performance à l'UFR Staps - laboratoire Motricité, interactions, performance de l'université de Nantes
· Bernard Mossant, entraîneur de Gabriel Tual à la Fédération française d'athlétisme (FFA)
· Thierry Soler, directeur technique national par intérim de la Fédération française de badminton (FFBaD)
· ISPC Synergies (Institut de Santé Parasport Connecté)
François Genêt, président
Philippe Fourny, directeur général
· Laboratoire Mouvement, sport, santé (M2S) - Université Rennes 2
Benoît Bideau, directeur
Franck Multon, professeur des universités
Guillaume Claude, chercheur
· Michaël Attali, professeur des universités à l'université Rennes 2
LISTE DES DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENT À PALAISEAU LE JEUDI 6 JUIN 2024
· X-Novation Center, École polytechnique
Christophe Clanet, directeur du programme Sciences2024
Romain Labbé, directeur général de Phyling
· Inria Saclay
Cédric Adjih, chercheur
Nicolas Anciaux, délégué scientifique adjoint
François Cottin, chercheur
Petra Isenberg, chercheuse
Olivier Le Maître, chercheur
Emilie Peinchaud, responsable communication - Centre de Saclay
Frédérique Vidal, chargée de mission Relations institutionnelles et appui aux territoires
DÉPLACEMENT AU PLESSIS-ROBINSON LE MERCREDI
15 JUIN 2024
RACING 92
· Laurent Travers, président du directoire
· Julien Albinet, directeur général adjoint
· Philippe Rouch, directeur des relations Entreprises, École nationale supérieure d'arts et métiers
· Sylvain Blanchard, médecin
· Maxence Duffuler, ingénieur Data
· Jean-Philippe Viseu, podologue du sport
DÉPLACEMENT À LYON ET SAINT-ÉTIENNE LE MERCREDI 8 JANVIER 2025
· Laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon
Emmanuel Trizac, président de l'École normale supérieure de Lyon
Stéphane Parola, vice-président Recherche de l'École normale supérieure de Lyon
Jean-Christophe Géminard, directeur du laboratoire de physique
Philippe Odier, maître de conférences, laboratoire de physique
Romain Vuillemot, maître de conférences, École centrale de Lyon
Vincent Dolique, ingénieur de recherche CNRS
Mathilde Ranc, coordinatrice et enseignante en APA, responsable de la salle S.P.O.R.T (Stimulating People and Organizing Recreational Therapies)
· Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport (Irmis), Saint-Étienne
Thomas Lapole, directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité (LIBM)
Jérémy Rossi, responsable de la plateforme technologique de l'Irmis
Léonard Féasson, responsable du l'unité de myologie du CHU
DÉPLACEMENT À DIJON LE JEUDI 9 JANVIER 2025
· Charalambos Papaxanthis, directeur du laboratoire Cognition, action et plasticité sensorimotrice (Caps) - Inserm/Université Bourgogne Europe
· Hervé Assadi, directeur de l'UFR Staps Dijon-Le Creusot de l'université Bourgogne Europe
· Romuald Lepers, professeur des universités, directeur adjoint de l'UFR Staps Dijon-Le Creusot de l'université de Bourgogne Europe
· Centre d'expertise de la performance (CEP) - Gilles Cometti
Carole Cometti, directrice
Guillaume Berthe, préparateur physique
Baptiste Chanel, préparateur physique
Valentin Gal, adjoint aux préparateurs physiques
Quentin Richard, adjoint aux préparateurs physiques
Baptiste Rusch, adjoint aux préparateurs physiques
Mehdi Ighirri, entraîneur au club Dijon Métropole Handball
Élise Prudhomme, entraîneur au club Jeanne d'Arc Dijon Basket
· Laboratoire Cognition, action et plasticité sensorimotrice (Caps)
Gaëlle Deley, maître de conférences
Jérémie Gaveau, enseignant chercheur
Pauline Hilt, chercheuse Inserm
Florent Lebon, enseignant-chercheur
Carol Madden-Lombardi, chercheuse CNRS
Vianney Rozand, maître de conférences
Ahmad Kaddour, ingénieur d'études Inserm
Cyril Chatain, post-doctorant
Quentin Marre, post-doctorant
Gabriel Poirier, post-doctorant
Julia Sordet, doctorante
Samuel Gerbe, doctorant
Pierre Navarro, doctorant
Rudy Toussaint, doctorant
· Centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne
Davy Laroche, enseignant-chercheur
Sophie Julliand, kinésithérapeuthe
Lauranne Claquesin, coordinatrice des études cliniques
DÉPLACEMENT À PARIS LE JEUDI 20 MARS
2025 MATIN
INSTITUT DE BIOMÉCANIQUE HUMAINE
GEORGES-CHARPAK
· Sébastien Laporte, professeur des universités, directeur de l'institut
· Hélène Pillet, professeure des universités
· Xavier Bonnet, maître de conférences
DÉPLACEMENT À LILLE LE JEUDI 20 MARS
2025 APRÈS-MIDI
B'TWIN VILLAGE DE DECATHLON
· Damien Fournet, directeur du Decathlon SportsLab
· Nils Gueguen, leader Advanced Science
· Cédric Morio, directeur du programme de recherche Haute Performance
· Franck Pilet, responsable Affaires publiques France
DÉPLACEMENT À ORSAY LE VENDREDI 28
MARS 2025 APRÈS-MIDI
FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT
DE L'UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
· Christopher Hautbois, doyen de la Faculté des sciences du sport, vice-président Partenariats et management du sport de la conférence des directeurs et des doyens Staps
· Michel-Ange Amorim, professeur des universités, IUF honoraire
· Bastien Berret, professeur des universités, responsable de l'équipe Mouvement humain, adaptation, performance sportive (MHAPS)
· Jules Bernard-Espina, maître de conférences
· Florys Castan-Vicente, maîtresse de conférences
· Anne-Marie Heugas, maître de conférences
· Alexandra Perrot, maître de conférences (HDR)
· Ioannis Bargiotas, ingénieur de recherche
DÉPLACEMENT À PARIS LE MARDI 8 AVRIL
2025
INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L'EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE
(INSEP)
· Direction
Fabien Canu, directeur général
Djamel Achache, conseiller du directeur général
· Pôle médical - spécificités féminines
Juliana Antero, chercheure Spécificité féminine
Caroline Maitre, gynécologue-médecin du sport
· Pôle médical - santé mentale
Hélène Joncheray, chercheur en sociologie de la performance sportive
Laure Calviac, responsable de l'unité de psychologie du sport
Alexis Ruffault, chercheur en psychologie
· Plateau technique
Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes)
Gaël Guilhem, directeur du laboratoire Sport, expertise et performance (SEP)
Benoit Schuller, responsable du Sport Data Hub à l'Agence nationale du sport
Adrien Sedeaud, chercheur et adjoint du directeur de l'Irmes
Nathan Miguens, ingénieur de recherche
Patrick Roux, formateur au pôle Formation
DÉPLACEMENT À BORDEAUX LE MARDI 22 AVRIL 2025
· Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine (Incia) - Université de Bordeaux/CNRS
Sandrine Bertrand, directrice
Philippe Poisson, responsable d'unité au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux
Aymar de Rugy, directeur de recherche CNRS en neurosciences au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux
Hélène Cassoudesalle, maître de conférence - praticien hospitalier au CHU de Bordeaux
Étienne Guillaud, responsable de la plateforme d'analyse du mouvement (PAM)
Camille Jeunet, chargée de recherche
· Gymnase SMART (Sport mouvement ambition recherche et technologie)
Julien Morlier, directeur
Kevin Blin, manager
Effie Segas, ingénieure
· Thierry Weissland, maître de conférences à l'université de Bordeaux
· Noémie Duclos, kinésithérapeute, maître de conférences à l'université de Bordeaux
· Matthieu Pachoud, responsable du développement technique et scientifique du projet Neurathletics
· Antoine Gomez, designer en neurosciences
· Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps) de Bordeaux
Patrice Béhague, directeur
Jean-François Di Martino, responsable de la performance paralympique
DÉPLACEMENT À MARSEILLE ET
TOULON
LES MERCREDI 23 ET JEUDI 24 AVRIL 2025
· Institut des sciences du mouvement Étienne-Jules Marey (ISM) - Faculté des sciences d'Aix-Marseille Université
Maxime Travert, professeur des universités
Jean-Jacques Temprado, professeur des universités
· Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection
Maxime Luiggi, maître de conférences
· Faculté des sciences du sport d'Aix Marseille Université
Denis Bertin, directeur de l'unité d'appui à la recherche (UAR) HIPE Human Lab
· Université de Toulon
Arnaud Faupin, vice-président Formation
Pascale Duché, directrice du laboratoire Impact de l'activité physique sur la santé
Éric Watelain, professeur des universités
Arnaud Richard, professeur des universités
Ilona Alberca, enseignante chercheuse
Opale Vigié, post-doctorante
Loriant Honnorat, doctorant
Mathieu Deves, doctorant Cifre
· Josée Massi, maire de Toulon
* 1 Lors des championnats du monde d'athlétisme de Tokyo en 2025, Jimmy Gressier a gagné la course des 10 000 mètres en 28'55''77. Les deuxième et troisième ont franchi la ligne d'arrivée respectivement en 28'55''83 et 28'56''02. Au saut en hauteur, le Néozélandais Hamish Kerr s'est imposé en franchissant 2,36 m contre 2,34 m pour le deuxième et 2,31 m pour le troisième.
* 2 Limite inférieure instaurée par l'Union cycliste internationale en 2000 pour garantir un équilibre entre la recherche d'une légèreté optimale et la durabilité nécessaire pour résister à l'intensité des courses professionnelles.
* 3 Jean-Baptiste Delame, « Le poids des vélos du Tour de France », Lokkirent, 3 décembre 2024, https://www.lokki.rent/media/poids-velo-tdf
* 4 Appendices en forme d'ailes.
* 5 Le catamaran Nacra 17 a été sélectionné comme support officiel olympique en 2016 à Rio. Toutefois, ce n'est qu'aux jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qu'il est passé de dérives courbes à des foils en C et des safrans avec des plans porteurs, devenant ainsi un bateau entièrement volant.
* 6 Marc Fermigier, « Voler sur l'eau : la révolution des foils », Pour la science, n° 560, 16 mai 2024.
* 7 IMOCA signifie International Monohull Open Class Association. Cette association a donné son nom à la catégorie de bateau qu'elle gère, à savoir le bateau monocoque de 60 pieds.
* 8 Arnaud Faupin, « Jeux Paralympiques : pourquoi les fauteuils sont-ils si différents selon les compétitions ? », The Conversation, 27 août 2024.
* 9 École nationale supérieure d'arts et métiers.
* 10 Théophile Rémond, Physique du rebond : application à la balle de tennis de table. Mécanique des matériaux, École normale supérieure de Lyon-ENS Lyon, 2023.
* 11 Planche à voile sur foil.
* 12 Sport de glisse nautique où la planche de surf équipée d'un foil et le surfeur sont entraînés par l'action du vent sur un cerf-volant.
* 13 Projet de recherche financé dans le cadre du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance (voir infra II. C. 1.).
* 14 Mathieu Deves, Tennis fauteuil : comment la science améliore les performances, The Conversation, 20 août 2024. La thèse, encadrée par Arnaud Faupin, Christophe Sauret et Arnaud Hays, a débuté en 2023 et devrait s'achever en 2026.
* 15 Nicolas Forstmann, Julien Schipman, Bryan Le Toquin et Jean-François Toussaint, « Paraperf - optimisation de la performance paralympique : de l'identification à l'obtention de la médaille », Réflexions Sport # 32, novembre 2024.
* 16 Güllich et al., « Quantifying the extent to which successful juniors and successful seniors are two disparate populations: A systematic review and synthesis of findings », Sports Medecine, 53(6), 2023.
* 17 Audition du 16 janvier 2024.
* 18 S. Cobley, J. Baker, N. Wattie, et J. McKenna, « Annual age-grouping and athlete development: a meta-analytical review of relative age effects in sport », Sports Medicine, vol. 39, n° 3, 2009, ou encore K. L. Smith, P. L. Weir, K. Till, M. Romann, et S. Cobley, « Relative Age Effects Across and Within Female Sport Contexts: A Systematic Review and Meta-Analysis », Sports Medicine, vol. 48, n° 6, June 2018.
* 19 Sedeaud et al., « Talent identification: Time to move forward on estimation on potentials? Proposed explanations and promising methods », Sports Medicine, January 15, 2025.
* 20 Boris Jidovtseff, « Spécialisation sportive précoce : quels risques sur le développement et sur la santé ? », Ortho-rhumato, Volume 14, n° 2, 2016.
* 21 Certains sports exigent néanmoins une spécialisation précoce, principalement les disciplines artistiques et acrobatiques comme la gymnastique, la danse ou encore le patinage artistique. En gymnastique, pour atteindre un haut niveau, les premiers contacts avec la discipline se font entre 4 et 8 ans. L'entraînement s'intensifie d'année en année et à partir de 11-12 ans, les gymnastes de haut niveau y consacrent la totalité de leur temps de loisir.
* 22 Bart et al., « The path to international medals: A supervised machine learning approach to explore the impact of coach-led sport-specific and non-specific practice », PLOS One, September 2020.
* 23 Sieghartsleitner et al., « Science or Coaches' eyes? Both! Beneficial Collaboration of Multidimensional Measurements and Coach Assessments for Efficient Talent Selection in Elite Youth Football », Journal of Sports Science and Medicine, 18, 2019.
* 24 Tout en se félicitant de cette initiative, votre rapporteur s'étonne qu'un quatrième critère plus positif n'ait pas été introduit, qui aurait valorisé les enfants les plus aptes physiquement.
* 25 Cf. IV. D. 2. La littératie physique est définie comme « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permet de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique durant toute sa vie ».
* 26 Les allures mesurées sont regroupées en activités de faible intensité (immobile, marcher, trottiner, course d'intensité moyenne) et activités de haute intensité (course d'intensité élevée, sprint, effort statique comme la mêlée ordonnée).
* 27 Guy et al., « Adaptation to hot environmental conditions: an exploration of the performance basis, procedure and future directions to optimize opportunities for elite athletes », Sports Medicine, Vol. 45, November 2014.
* 28 Marcora et al., « Mental fatigue impairs physical performance in humans », Journal of applied physiology, 106 (3), 2009. Le protocole retenu consistait à faire réaliser aux participants 90 minutes de tâches d'AX-CPT (test reconnu au niveau international pour mesurer la fatigue mentale dans lequel on demande au sujet d'appuyer sur la touche espace quand la lettre X est présentée à la suite de la lettre A et de ne pas répondre pour tous les autres stimuli tels que la couleur des lettres), puis un test d'endurance à 80 % de la puissance maximale aérobie.
* 29 Audition du 13 février 2025.
* 30 Pour mesurer la fatigue, une échelle visuelle analogique se présente sous forme d'une ligne horizontale longue d'une dizaine de centimètres avec des descriptions aux extrémités telles que « pas de fatigue » à l'extrémité gauche de la ligne (0) et « extrêmement fatigué » à l'extrémité droite de la ligne (10). L'individu est invité à indiquer un trait sur la ligne qui correspond à son niveau de fatigue actuel.
* 31 D'autres paramètres altèrent la VFC indépendamment de la fatigue, comme la douleur ou les émotions, ce qui conduit votre rapporteur à préférer le terme d'évaluation plutôt que de mesure.
* 32 La préparation mentale permet de lutter contre la fatigue mentale (cf. supra).
* 33 Adaptations se produisant à la suite de la fatigue due à l'entraînement physique et améliorant la condition physique de l'athlète :
1. Adaptations physiologiques : augmentation de la capacité cardiovasculaire, amélioration de la capacité pulmonaire, renforcement du système immunitaire, amélioration de la régulation hormonale, augmentation de la densité osseuse.
2. Adaptations neurophysiologiques : amélioration de la coordination motrice, renforcement des connexions neuronales, augmentation de la myélinisation des fibres nerveuses, amélioration de la synchronisation neuromusculaire.
3. Adaptations neuromusculaires : augmentation de la force musculaire, amélioration de l'endurance musculaire, renforcement des tendons et des ligaments, amélioration de la récupération musculaire, augmentation de la masse musculaire maigre.
Ces adaptations contribuent à une meilleure performance athlétique et à une plus grande résistance à la fatigue.
* 34 À condition de ne pas avoir atteint un niveau de fatigue qui ne lui permette plus d'améliorer sa condition physique quel que soit le volume de l'entraînement, voire qui conduise à une baisse des performances. Il y a alors un risque de burnout qui impose une réduction de l'activité physique.
* 35 L. Bosquet, J. Montpetit, D. Arvisais, I. Mujika, « Effects of tapering on performance: a meta-analysis », Medicine and Science in Sports and Exercise, 39 (8), August 2007.
* 36 Insep, Améliorer sa récupération en sport, 2013.
* 37 Sébastien Le Garrec, « La santé mentale des athlètes », Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Volume 209, Issue 4, Avril 2025.
* 38 Il a été montré que pour avoir un effet positif sur la qualité et la quantité de sommeil, la cryostimulation devait être utilisée au plus près de l'heure du coucher et ce pendant au moins cinq jours consécutifs.
* 39 Constituée de deux ateliers collectifs et d'un atelier individuel.
* 40 Audition de Mathias Pessiglione, co-responsable de l'équipe « Motivation, cerveau et comportement » de l'Institut du cerveau, le 13 février 2025.
* 41 Jacquet, Thomas et al., « Acute Smartphone Use Impairs Vigilance and Inhibition Capacities », Scientific Reports, vol. 13, n° 1, December 2023.
* 42 G. Greco, R. Tambolini et F. Fischetti, « Negative effects of smartphone use on physical and technical performance of young footballers », Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2017.
* 43 L. S. Fortes, G. P. Berriel, H. Faro, C. G. Freitas-Júnior et L. A. Peyré-Tartaruga, « Can prolongate use of social media immediately before training worsen high level male volleyball players' visuomotor skills? », Perceptual and Motor Skills, 129, 2022.
* 44 L. S. Fortes et al., « Playing videogames or using social media applications on smartphones causes mental fatigue and impairs decision-making performance in amateur boxers », Applied Neuropsychology: Adult, 2021.
* 45 L. S. Fortes, D. de Lima-Júnior, P. Gantois, J. R. A. Nasicmento-Júnior, et F. S. Fonseca, « Smartphone use among high level swimmers is associated with mental fatigue and slower 100- and 200- but not 50-meter freestyle racing », Perceptual and Motor Skills, 128, 2021.
* 46 Note scientifique n° 37 La pollution lumineuse de Mme Annick Jacquemet, sénatrice, faite au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ( https://www.senat.fr/rap/r22-292/r22-2921.pdf).
* 47 Hartstein et al., « The impact of screen use on sleep health across the lifespan: A National Sleep Foundation consensus statement », Sleep Health, Volume 10, Issue 4, August 2024.
* 48 Yeug et al., « A prospective cohort study of hamstring injuries in competitive sprinters: preseason muscle imbalance as possible risk factor », British Journal of Sports Medicine, 43, 2009.
* 49 Audition du 19 décembre 2024.
* 50 Société française de psychologie du sport, Fiche 2, « L'essentiel de la préparation mentale - Fixation des objectifs », 2020.
* 51 Les exemples sont hélas nombreux. On peut citer Alexis Lebrun qui, lors de sa confrontation avec son frère au cours du championnat de France en mars 2025, a frappé la table plusieurs fois dans un geste d'énervement et s'est cassé un doigt.
* 52 Société française de psychologie du sport, Fiche 5, « L'essentiel de la préparation mentale - Concentration », 2020. Les athlètes peuvent identifier les types de distractions présentes pendant la compétition et les intégrer à l'entraînement. Ils sont également incités à sélectionner des mots clés qui les aident à se concentrer sur des éléments utiles pendant la compétition. La répétition d'affirmations positives dans sa tête, surtout si elles sont basées sur la réalité telles que « je me sens en forme et fort », « je suis prêt à partir » est une autre technique pour éviter les distractions.
* 53 Marjorie Bernier, « TrainYourBrain, un programme de préparation mentale pour optimiser la lucidité et l'engagement en match », Réflexions Sport, Numéro 32, Insep, novembre 2024.
* 54 Cf. projet de recherche TrainYourBrain financé dans le cadre du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance.
* 55 Varesco et al., « Fatigue in elite fencing: Effects of a simulated competition », Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, August 13, 2023.
* 56 Une compétition à l'entraînement reproduisant un format de compétition pour les jeux Olympiques a été organisée avec les athlètes de l'équipe de France, comprenant cinq matchs en 15 touches séparés de temps de récupération similaires à ceux d'une compétition officielle.
* 57 Varesco et al., « Effects of 5-week brain endurance training on fatigue and performance in elite youth épée fencers », International Journal of Sports Physiology and Performance, 20 (7), May 27, 2025.
* 58 Mickaël Campo, « TEAM Sports : la dimension mentale en sports collectifs », Réflexions Sport, Numéro 32, Insep, novembre 2024.
* 59 Programme financé dans le cadre du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance, voir infra II. B. 2.
* 60 Appelées stratégies de communal coping.
* 61 S. Cotteril et K. Fransen, « Athlete leadership in sport teams. Current understanding and future directions », International Review of Sport and Exercice Psychology, Vol 9, N° 1, April 2016.
* 62 Éric Brunelle et Dominic Lauzon-Marques, « Inspirer pour performer. Le leadership partagé dans les équipes sportives », Gestion, Volume 44 n° 4, hiver 2020.
* 63 Pendant un essai, pendant un arbitrage vidéo, etc.
* 64 A. Lees, « Techniques and applications of biomechanics in sport », Journal of Sports Sciences, 20 (10), 2002.
* 65 Des capteurs cinématiques sont placés sur le sportif en des points de référence du corps, plus particulièrement sur les articulations. Les caméras de capture de mouvement envoient des rayons infrarouges sont réfléchis par les capteurs cinétiques, ce qui permet d'enregistrer leur position, donc les mouvements du corps. Toutes les retranscriptions du déplacement spatial du sportif sont visibles sur l'ordinateur.
* 66 L'ordinateur doit connaître la position et l'orientation relatives des caméras pour reconstruire les mouvements en trois dimensions.
* 67 Le fait que les rayons infrarouges des caméras ne peuvent pas traverser les obstacles entre la caméra et le marqueur a pour incidence la perte du capteur et donc du mouvement du sportif.
* 68 Ces dérives proviennent des erreurs intrinsèques des capteurs et de l'intégration numérique, provoquant des erreurs sur la position, l'orientation et la vitesse.
* 69 Audition de Paul Charton, CEO de Chiron IT, le 16 janvier 2025.
* 70 Gaël Guilhem, « Comment l'IA aide-t-elle à rendre les athlètes plus performants ? », Techniques de l'ingénieur, 21 février 2025.
* 71 Financé dans le cadre du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance.
* 72 Audition du 23 octobre 2024.
* 73 Vella, Schweickle, Sutcliffe, Swann, « A systematic review and meta-analysis of mental health position statements in sport: scope, quality and future directions », Psychology of Sport and Exercise, Volume 55, July 2021.
* 74 Thèse en cours de Simon Valverde sous la direction d'Hélène Joncheray sur l'identification et la prévention des risques psychosociaux chez les sportifs de haut niveau et/ou professionnels en France.
* 75 Sébastien Le Garrec, « La santé mentale des athlètes », Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Volume 209, Issue 4, avril 2025.
* 76 Schaal et al., « Psychological balance in high level athletes: gender-based differences and sport-specific patterns », PloS ONE, Volume 6, Issue 5, May 2011.
* 77 Cressey et al., « Scholarly Olympics : how the games have shaped research », Nature, 536, 2016.
* 78 Audition du 27 février 2025.
* 79 Ryan et al., « Inequalities in the evaluation of male versus female athletes in sports medicine research: a systematic review », The American Journal of Sports Medicine, Volume 51, Issue 12, 2022.
* 80 Nathalie Boisseau, Martine Duclos, Michel Guinot, La femme sportive : spécificités physiologiques et physiopathologiques, 2009.
* 81 Exploring Menstrual Periods Of Women athletes to Escalate Ranking.
* 82 L'escrime, l'aviron, le football, le ski et le cyclisme.
* 83 RGPD, Article 6 : Licéité du traitement.
* 84 L'Insep justifie l'utilisation d'un « Athlete Management System » pour l'analyse posturale des sportifs à des fins de prévention des blessures et d'optimisation de la performance, par la mission d'intérêt public en application des dispositions de l'article R. 211-2 du code du sport. En effet, l'Insep participe à la politique nationale du développement des activités physiques et sportives particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique. À ce titre, il assure, en lien avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs de haut niveau. Les fédérations délégataires justifient elles aussi la collecte de données d'entraînement par la mission d'intérêt public en application du contrat de performance et du contrat de délégation (articles L. 131-15 et R. 131-28 et R. 131-28-1 du code du sport qui encadrent le contrat de performance et le contrat de délégation).
* 85 Les demandes d'équipement en GPS ou LPS ou encore les demandes d'Athlete management systems ne sont pas centralisées au niveau du ministère chargé des sports ou de l'Agence nationale du sport, ce qui permettrait d'imposer un seul interlocuteur face aux entreprises et de profiter de la taille du marché national pour négocier des conditions contractuelles plus favorables, à l'instar de ce qui est fait dans certains pays étrangers (à travers UK Sport au Royaume-Uni par exemple). À l'heure actuelle, chaque fédération et chaque club négocie directement avec lesdites entreprises.
* 86 Podcast Team Sports numéro 8 - Science en jeu, « Affiner l'art de l'entraînement », 17 juin 2024.
* 87 Dans la réponse de la Fédération française de football au questionnaire envoyé dans le cadre de la présente étude sur la détection et la prise en charge des commotions cérébrales, les statistiques avancées pour les trois dernières saisons sont les suivantes : le nombre de matches professionnels (L1, L2, Coupe de France, Coupe d'Europe) s'est élevé à 661 pour la saison 2024/2025, 840 pour la saison 2023/2024 et 867 pour la saison 2022/2023. Le nombre de commotions cérébrales identifiées a été respectivement de 10, 13 et 20.
* 88 Dans les disciplines telles que le rugby, le football américain, la boxe, la lutte, le judo.
* 89 Dès 1928, le Punch Drunk était décrit par Harrisson Martland, médecin légiste et passionné de boxe, chez des boxeurs atteints de démence, de dysarthrie et de syndrome cérébelleux. En 1937 était inventé le concept de dementia pugilistica, identifiant l'association entre des troubles cognitifs, une ataxie et un syndrome parkisonien. En 1973, Corsellis fait une description très précise de la démence pugilistique (J.A. Corsellis et al., « The aftermatch of boxing », Psychological Medicine, 1973).
* 90 J. F. Chermann, E. Orhant, D. Brauge, « Comment, en France, le rugby et le football ont permis de mieux prendre en charge la commotion cérébrale ? », La lettre du neurologue, Volume XXVIII, N° 6, juin 2024.
* 91 Mackay et al., « Neurodegenerative Disease Mortality among Professional Soccer Players », The New-England Medical Review and Journal, 381 (19), November 7, 2019.
* 92 Orhant et al., « A retrospective analysis of all-cause and cause-specific mortality rates in French male professional footballers », Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 32 (9), September 2022.
* 93 Ueda et al., « Neurodegenerative disease among male elite football (soccer) players in Sweden: a cohort study », Lancet Public Health, 8 (3), April 2023.
* 94 Selon Jean- François Chermann, neurologue spécialiste des commotions cérébrales chez les sportifs, une subcommotion correspond à un impact transmis au cerveau lors d'un coup avec altération neurologique très transitoire d'une durée de l'ordre de la minute. Cette altération neurologique regroupe des signes comme la sensation d'être sonné, la vision d'étoiles sans qu'aucun syndrome post-commotionnel ne survienne. Cf. « Complications retardées des commotions : encéphalopathie chronique post-traumatique », La médecine du sport.com.
* 95 Matser et al., « A dose-response relation of headers and concussions with cognitive impairment in professional soccer players », Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 23, 2001.
* 96 Matser et al., « Chronic traumatic brain injury in professional soccer players », Neurology, 51, 1998.
* 97 Si cette initiative doit être saluée, sa mise en oeuvre soulève de nombreuses critiques. En effet, les protège-dents choisis pour être instrumentés présenteraient des lacunes en matière de protection contre les chocs. La Fédération française de rugby a officiellement saisi World Rugby sur ce sujet.
* 98 Dans son rapport sur le suivi des commotions cérébrales en TOP 14 et PRO D2 pendant la saison 2023-2024, l'observatoire des commotions cérébrales constate qu'un nombre important de HIA 3 n'est pas enregistré dans le SCRM alors que cette consultation est non seulement obligatoire, mais également primordiale pour la détermination de la durée d'arrêt d'un joueur avant son retour au jeu.
* 99 Réponse au questionnaire sur la gestion des commotions cérébrales envoyé par les rapporteurs à la Fédération française de football.
* 100 Quentin Lhuaire, « La commotion cérébrale dans le handball amateur en France : étude nationale prospective autour du protocole carton blanc », Médecine humaine et pathologique, 2024.
* 101 Audition du 19 mars 2025.
* 102 Audition du 10 octobre 2024.
* 103 Inoue et al., « Incidence and factor analysis for the heat-related illness on the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games », BMJ Open Sport & Exercice Medicine, 9, 2023.
* 104 Smith et al., « The last Summer Olympics? Climate change, health and work outdoors », The Lancet, Volume 388, Issue 10045, 2016.
* 105 Décalés d'août à fin septembre pour s'adapter au climat.
* 106 Les vitesses de nage avaient été augmentées de plus de 2 %.
* 107 Ils permettent de cacher la prise d'autres substances dopantes interdites.
* 108 Michel Audran, « L'Olympisme mis à l'épreuve », Pour la science, hors-série n° 124, août-septembre 2024.
* 109 Audition du 10 octobre 2024.
* 110 Transcranial direct current stimulation.
* 111 Cf. entretien de Michel Audran, ancien directeur du Laboratoire national de lutte antidopage de Châtenay-Malabry, Pour la science, hors-série n° 124, août/septembre 2024.
* 112 Audition du 27 février 2025.
* 113 Telles que le master mention Staps : entraînement et optimisation de la performance sportive (EOPS), spécialisé en psychologie du sport ; le master EOPS non spécialisé en psychologie du sport mais complété par un diplôme universitaire en psychologie du sport ; le master mention psychologie complété par un diplôme universitaire en psychologie du sport.
* 114 Les pôles sportifs implantés dans les Creps sont des structures d'entraînement et de formation pour les sportifs de haut niveau, incluant les pôles Espoir, les pôles France et parfois des pôles ressources nationaux. Ils offrent aux jeunes athlètes un encadrement professionnel, des installations sportives optimales et un accompagnement personnalisé pour concilier réussite sportive et parcours scolaire ou universitaire. Les disciplines varient selon les Creps, mais peuvent inclure l'athlétisme, le basket-ball, l'escrime, le handball, le tennis de table, etc.
* 115 12 projets ont été retenus à la suite de l'appel à projets. Toutefois, le projet BEST-Tennis n'a pas été reconduit à l'issue de la première évaluation.
* 116 Il s'agit d'une organisation en réseau des centres d'entraînement et de formation de haut niveau maillant le territoire français (Creps, Écoles nationales, Centre national des sports de la Défense).
* 117 Conférence organisée le 29 juillet 2024 par le ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur au Club France.
* 118 Cette cellule est composée des athlètes appartenant au cercle de haute performance (athlètes ayant gagné une médaille il y a moins de deux ans aux JOP ou lors de championnats du monde), des athlètes réalisant régulièrement des performances de niveau mondial, des athlètes réalisant des performances de niveau mondial occasionnellement et les athlètes en devenir à potentiel exceptionnel.
* 119 Il peut s'agir de données d'applications mobiles, d'accéléromètres, de capteurs optiques, de chambres environnementales, de caméras vidéo à haute fréquence, etc.
* 120 Enquête adressée aux encadrants techniques en charge de la haute performance des fédérations, Mouvens, 2024.
* 121 Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information.
* 122 Conférence de directeurs et directrices.
* 123 Il s'agit par exemple de prélèvements de sang ou d'échantillons biologiques (biopsies cutanées, écouvillonnages, etc.), de la collecte de données physiologiques au moyen de capteurs ou d'imagerie, ou encore de stimulations externes mécaniques, électriques ou magnétiques.
* 124 Il s'agit par exemple du recueil de salive, d'urines, de sueur, du recueil de données par capteurs extracorporels non invasifs (EEG, ECG, pression artérielle), d'enregistrements vidéo, de photos, de questionnaires.
* 125 Organismes mis en place pour encadrer les recherches biomédicales par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
* 126 Le passage devant cette commission est indispensable puisque c'est elle qui formule un avis pour le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux.
* 127 Décret modifié par le d écret n° 2023-232 du 30 mars 2023 relatif à la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale.
* 128 Cf. infra III. B. 1.
* 129 La prothèse Synsys coûte 86 000 euros.
* 130 F. Burlot, M. Delalandre, H. Joncheray, J. Demeslay, M. Julla-Marcy, A. Heiligenstein et F. Bignet, Les conditions de travail des entraîneurs des jeux Olympiques de Tokyo : des carrières au travail quotidien, Doctoral dissertation, Insep, 2002.
* 131 F. Burlot, M. Delalandre, H. Joncheray, J. Demeslay, M. Julla-Marcy et A. Heiligenstein, 2023. Article précité.
* 132 À cet égard, certaines fédérations et établissements nationaux ont un rôle précurseur. Ainsi, le nouveau référent scientifique de la Fédération française de voile est un chercheur de l'Ifremer détaché à 50 % de son temps. De même, le référent scientifique de la Fédération française de gymnastique est un enseignant-chercheur de l'université de Besançon détaché à 100 %. Le Creps de Toulouse bénéficie d'une mise à disposition à 50 % d'une enseignante-chercheuse qui est déchargée de ses enseignements pour mener des actions d'accompagnement avec les sportifs en complément de son activité de recherche.
* 133 Le vendredi 4 juillet 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Marie Barsacq a annoncé le lancement d'un nouveau programme de recherche dédié à la haute performance sportive. Ce programme fera l'objet d'un investissement de 20 millions d'euros dans le cadre de France 2030, et des appels à projets sont prévus à l'horizon janvier 2026.
Ce programme sera structuré autour de huit axes prioritaires :
1. Biomécanique et sciences de l'entraînement : perfectionner les gestes techniques et s'adapter à des environnements extrêmes ;
2. Technologie sportive et équipements : optimiser le matériel et rechercher des gains marginaux (textiles, parasport) ;
3. Intelligence artificielle : traitement et exploitation des données massives ;
4. Préparation mentale et physiologie : prévention des blessures, gestion du stress ;
5. Santé globale de l'athlète : lutte contre le burnout et accompagnement à la reconversion ;
6. Facteurs environnementaux et sociétaux : impacts du sommeil et des sollicitations médiatiques ;
7. Facteurs humains : prise en compte du genre, des sciences de l'apprentissage dans la performance ;
8. Approche intégrative : recours à l'IA prédictive pour la récupération et la prévention des blessures.
* 134 L'appel à projets qui résultera de ce nouveau programme prioritaire de recherche pour la haute performance sportive et l'innovation ne sera lancé qu'en janvier 2026, soit deux ans seulement avant les jeux Olympiques de Brisbane. L'accompagnement scientifique à la performance en France présentera donc un retard de 3 à 4 ans par rapport aux pays anglo-saxons. Quant aux Australiens, les soutiens supplémentaires aux programmes scientifiques au service des jeux Olympiques à Brisbane ont commencé en 2022, traduisant une vision à long terme ambitieuse et structurante sur 10 ans.
* 135 Les établissements du réseau Grand Insep concentrent sur les territoires de nombreuses interactions entre les différentes communautés scientifiques et sportives pour la haute performance. Certains Creps (Montpellier et son antenne à Font-Romeu, Toulouse, Poitiers, Bordeaux, Nantes, Vichy, etc.) emploient plusieurs responsable et accompagnateurs scientifiques titulaire d'un doctorat et menant avec les universités locales de nombreux projets de recherche. Il existe également des laboratoires communs comme à Poitiers ou à Vichy avec deux laboratoires de l'université de Clermont.
* 136 Le budget de l'Agence nationale du sport est passé de 461 millions d'euros en 2024 à 415,2 millions d'euros en 2025, même si, selon le manager général de la haute performance de l'Agence nationale du sport, cette réduction des crédits n'a pas eu d'impact pour le sport de haut niveau dont les crédits sont restés stables à 114 millions d'euros.
* 137 La commission d'enquête sénatoriale sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État a rendu son rapport le 3 juillet 2025 dans lequel elle préconise la suppression de l'ANS.
* 138 Qui entraîne une faiblesse musculaire et une atrophie.
* 139 Cf. supra III. A. 2.
* 140 Il s'agit d'une fatigue anormale qui subsiste après le repos.
* 141 Cf. I. C. 3.
* 142 Les personnes souffrant de fatigue chronique à la suite d'une maladie ou même sans cause identifiée (fatigue idiopathique) seraient au nombre de plusieurs millions.
* 143 Laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité.
* 144 Advance Neurorehabilitation Therapies and Sport, acronyme anglais pour Sports et Thérapies Neuro-éducatives Avancées.
* 145 Stimulating People and Organizing Recreational Therapies.
* 146 50 personnes sont actuellement sur liste d'attente.
* 147 Vélo ergomètre robotisé avec stimulation électrique fonctionnelle.
* 148 Loi n° 20168-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. L'activité physique adaptée vise des personnes incapables de pratiquer des activités physiques ou sportives ordinaires en autonomie et en sécurité et considérées comme inactives.
* 149 Partie de la prothèse dans laquelle s'insère le moignon.
* 150 Entreprise française qui fabrique des dispositifs médicaux orthopédiques.
* 151 Le chargement d'une prothèse est l'action de mise en contact entre le moignon et la prothèse via l'emboîture.
* 152 Phase d'appui, phase oscillante et position neutre.
* 153 En phase d'appui, la flexion du genou autorise la dorsiflexion de la cheville, ce qui permet les mouvements de triple flexion du membre inférieur (flexions simultanées de la cheville, du genou et de la hanche) utilisés par les sujets non amputés pour descendre les escaliers ou les pans inclinés et s'asseoir. En phase oscillante, la flexion du genou provoque une dorsiflexion automatique de la cheville permettant d'augmenter la distance entre le pied et le sol afin de limiter les risques de trébuchement.
* 154 Praticien hospitalier en médecine physique de réadaptation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches.
* 155 Audition du 19 décembre 2024.
* 156 Actuellement, l'assurance maladie assure une prise en charge forfaitaire de 598 euros pour les fauteuils destinés au sport de loisir.
* 157 World Rugby a imposé le port de protège-dents connectés afin de pouvoir détecter tout fait de jeu à forte accélération que subiraient les joueurs. Néanmoins, une polémique entoure le choix des protège-dents effectué par World Rugby, qui connaîtraient des insuffisances dans leur mission première, qui est de protéger les tissus mous et les dents et de réduire les risques de commotion cérébrale. La Fédération française de rugby a saisi World Rugby sur cette question.
* 158 Sont impliqués dans ce projet l'UMR 1219 BPH Inserm/Université de Bordeaux, le service de médecine physique et de réadaptation ainsi que le service de médecine bucco-dentaire du CHU de Bordeaux, le laboratoire I2M UMR CNRS 5295 Ensam, la plateforme d'analyse du mouvement, Incia, UMR CNRS 5287.
* 159 Les normes relatives aux aides techniques sont moins contraignantes que celles liées aux dispositifs médicaux.
* 160 Benhdia Yanis, « Les Nouvelles applications mobiles pour les amateurs de sport », Stratégiedigitalesport.com.
* 161 La jauge d'énergie « Body battery » dans l'application Garmin Connect est une fonction qui utilise la variabilité de fréquence cardiaque, le niveau de stress et l'activité pour estimer les réserves d'énergie de l'utilisateur durant la journée.
* 162 Sebastian Deterding et al., « From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification” », Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, ACM, 2011.
* 163 Minna Ruckenstein et Mika Pantzar, « Beyond the Quantified Self: Thematic Exploration of a Dataistic Paradigm », New Media & Society, vol. 19, no 3, mars 2017. La mesure de soi ou « quantified self » est un ensemble de pratiques qui consistent à analyser sa capacité physique ou son mode de vie : poids, tension, calories consommées, nombre de pas dans la journée, rythme cardiaque, etc. L'objectif est d'améliorer sa santé et son bien-être.
* 164 Éric Dagiral, Christian Licoppe, Anne-Sylvie Pharabod, « Quantified Self », Réseaux. Communication - technologie - société, n° 216, 2019.
* 165 Evé Southcott and Julius Jooste, « Unveiling the Impact of Mobile Fitness Applications on Motivational Orientation in Sustaining Exercise Behaviors: A Qualitative Investigation », Physical Culture and Sport. Studies and Research, 103, 2024.
* 166 Evé Southcott and Julius Jooste, 2024, étude précitée.
* 167 Bénédicte Vignal, Guillaume Routier, Brice Lefèvre, Bastien Soulé, « Courir et mesurer autrement : le recours aux objets connectés par les pratiquantes de la course à pied », Loisir et Société/Society and Leisure, 2022, pp.1-24.
* 168 Cf. enquêtes menées par BVA (2023), le Credoc (2022) et Emmanuel Dagiral et ses collaborateurs (2019).
* 169 B. Vignal, G. Routier, B. Lefèvre et B. Soulé, « Courir et mesurer autrement : le recours aux objets connectés par les pratiquantes de la course à pied », Loisir et Société, 45(3), 482-505, 2022.
* 170 Étude publiée par l'Anses sur les consommations et les habitudes alimentaires de la population française.
* 171 Chi Pang Weng, Xifeng Wu, « Stressing harms of physical activity to promote exercise », The Lancet, vol. 380, July 21, 2012.
* 172 Garcia et al., « Non-occupational physical activity and risk of cardiovascular disease, cancer and mortality outcomes: a dose-response meta-analysis of large prospective studies », British Journal of Sports Medicine, 57, 979-989, 2023.
* 173 Blair et al., « Physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy men and women », JAMA, November 3, 1989.
* 174 Ross et al., « Importance of Assessing cardiorespiratory fitness in clinical practice: a case for fitness as a clinical vital sign: a scientific statement from the American Heart Association », Circulation, Volume 134, Number 24, 2016.
* 175 Frédéric Costes, « Effets physiologiques de l'activité physique », Revue du rhumatisme monographies, 88, 2021.
* 176 Jochem et al., « Association between muscular strength and mortality in clinical populations: a systematic review and meta-analysis », JAMDA, 20, 2019.
* 177 Chaput et al., « Economic Burden of excessive sedentary behaviour in Canada », Canadian journal of public health, 114 (2), April 2023.
* 178 Dohrn et al., « Accelerometer-measured sedentary time and physical activitvy. A 15 year follow-up of mortality in a Swedish population-based cohort », Journal of science and medicine in sport, 21 (7), 2018.
* 179 Lee et al., « Sedentary work and breast cancer risk: A systematic review and meta-analysis », Journal of Occupational Health, 63 (1), June 23, 2021.
* 180 D. Schmid, M. F. Leitzmann, « Television viewing and time spent sedentary in relation to cancer risk: a meta-analysis », Journal of the National Cancer Institute, 106 (7), 2014.
* 181 Avis de 2016 et de 2020 relatifs à l'évaluation des risques liés aux niveaux d'activité physique et de sédentarité des enfants et des adolescents.
* 182 Il convient d'insister sur le fait que les chiffres sont anciens et que les temps d'écran ont certainement augmenté.
* 183 Cabanas-Sanchez et al., « Associations of total sedentary time, screen time and non-screen sedentary time with adiposity and physical fitness in youth: the mediating effect of physical activity », Journal of Sports Sciences, 37 (8), 2018.
* 184 Metabolic Equivalent of Task : cette unité a été créée spécialement pour mesure l'activité physique. Le MET s'appuie sur le rapport entre la dépense énergétique d'activité pratiquée et celle du métabolisme au repos. 8,75 MET équivaut aux recommandations de 150 minutes d'activité à intensité physique modérée à intense par semaine.
* 185 Kokkinos et al., « Exercice capacity and mortality in older men: a 20-year follow-up study », Circulation, Volume 122, 2010.
* 186 Frédéric Costes (2021). Étude précitée.
* 187 Damon L Swift et al., « The Effects of Exercise and Physical Activity on Weight Loss and Maintenance », Progress in Cardiovascular Diseases, 61(2), July-August 2018.
* 188 Eddy Zakhem et al., « Étude observationnelle sur l'impact du type d'activité physique sur la densité minérale osseuse, la géométrie osseuse de la hanche et le TBS chez des hommes adultes », Kinésithérapie, la Revue, Volume 15, Issue 163, juillet 2015.
* 189 Claude-Pierre Giudicelli, Xavier Bigard, Améliorer la pratique des activités physiques, du sport et réduire la sédentarité à l'école, un enjeu de santé publique, Rapport de l'Académie nationale de médecine adopté le 17 septembre 2024.
* 190 Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, « Activité physique, fonctionnement cognitif et performances scolaires : niveau de preuve et grade de recommandation », Note du Conseil scientifique de l'éducation nationale, n° 6, février 2022.
* 191 Subramanian et al., « Effect of Structured and Unstructured Physical Activity Training on Cognitive Functions in Adolescents. A randomized Control Trial », Journal of Clinical and Diagnostic Research for doctors, 9, 2015 ; Hunter et al., « Active kids active minds: a physical activity intervention to promote learning? », Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, 5, 2014.
* 192 En neurosciences, on appelle fonctions exécutives du cerveau un ensemble de processus cognitifs qui permettent à un individu de réguler volontairement ses pensées et ses comportements pour atteindre un objectif ou s'adapter à une situation nouvelle ou complexe.
* 193 Kredlow et al. (2015). « The effects of physical activity on sleep: a meta-analytic review », Journal of Behavorial Medicine, 38, 2015.
* 194 Romain Meeusen et Kenny De Meirleir, « Exercise and Brain Neurotransmission », Sports Medicine, vol. 20, n° 3, September 1995.
* 195 Lynette L. Craft et Frank M. Perna, « The Benefits of Exercise for the Clinically Depressed », The Primary Care Companion For CNS Disorders, vol. 6, n° 3, June 2004.
* 196 M. L. Bruchon-Schweitzer, Une psychologie du corps, Paris, P.U.F, 1990.
* 197 G. Ninot, D. Delignières et M. Fortes, « L'évaluation de l'estime de soi dans le domaine corporel », Revue Staps, 53, 2000.
* 198 Perte progressive de la masse musculaire liée au vieillissement.
* 199 Perte de la force musculaire.
* 200 Jean-Jacques Temprado, « Effets de l'exercice physique sur les fonctions cognitives au cours du vieillissement », Gérontologie et société, N° 156, vol. 40, 2018.
* 201 Expertise collective de l'Inserm, Activité physique : prévention et traitement des maladies chroniques, 2019.
* 202 Page internet du National Cancer Institute: physical activity and cancer.
* 203 Winzer et al., « Physical activity and cancer prevention: a systematic review of clinical trials », Cancer Causes and Control, 22 (6), 2011.
* 204 Cf. Winzer et al. (2011). Étude précitée.
* 205 Bernstein et al., « Bile acids as carcinogens in human gastrointestinal cancers », Mutation Research, 589 (1), 2005.
* 206 Garcia et al., « Non-occupational physical activity and risk of cardiovascular disease, cancer and mortality outcomes: a dose-response meta-analysis of large prospective studies », British Journal of Sports Medicine, 57, 2023.
* 207 Difficulté à respirer.
* 208 Épisodes d'aggravation des symptômes tels que la toux, l'essoufflement (dyspnée) et la production d'expectorations.
* 209 Volume d'air expiratoire maximal en une seconde.
* 210 Institut national du cancer, Bénéfices de l'activité physique pendant et après cancer, mars 2017.
* 211 Études individuelles nationales de consommations alimentaires menées par l'Anses entre 2014 et 2015.
* 212 Cf. Frédérique Meunier et Christophe Proença, mission flash sur l'activité physique et sportive et la prévention de l'obésité en milieu scolaire, commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Communication du 19 mars 2025.
* 213 Saidj et al., « Descriptive study of sedentary behaviours in 35,444 French working adults: cross-sectional findings from the ACTI-Cités study », BMC Public Health, 15, 379, 2015.
* 214 Données du Centre national d'appui au déploiement en activité physique et lutte contre la sédentarité (CNDAPS).
* 215 Madigan et al., « Assessment of Changes in Child and Adolescent Screen Time During the covid-19 Pandemic », JAMA Pediatrics, Vol. 176, N° 12, 2022.
* 216 Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité.
* 217 France Stratégie, L'évaluation socioéconomique des effets de santé des projets d'investissement public, rapport du groupe de travail présidé par Benoît Dervaux et Lise Rochaix, mars 2022.
* 218 Dominique Delandre, rapport de la mission interministérielle sport-santé. Travaux conduits de novembre 2022 à 2023. Remis le 7 avril 2025.
* 219 Sénat, Redonner du souffle aux « 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école » pour améliorer la santé des élèves, rapport d'information n° 774 (2023-2024), déposé le 25 septembre 2024 ; https://www.senat.fr/rap/r23-774/r23-774.html
* 220 Assemblée nationale, mission flash sur l'activité physique et sportive et la prévention de l'obésité en milieu scolaire, 19 mars 2025 ;
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/documents/sportsco/l17n27177607_document.pdf
* 221 Cette capacité correspond à la littératie physique, définie par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie.
* 222 L'EPS est l'une des matières de la formation initiale des futurs professeurs des écoles, mais sa place a reculé depuis les années 2000. Dans les maquettes de master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation), les horaires dédiés à l'EPS sont réduits, passant en quelques années de 100 heures à 50 heures, parfois même à 24 heures dans certains instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPE) (Créteil, Clermont, Lille).
* 223 https://www.france-assos-sante.org/2025/03/24/en-termes-de-sante-publique-il-faut-mener-une-politique-de-valorisation-du-sport/
* 224 Coauteur avec Louise Le Borgne du livre Les Français et le sport. Bâtir une nation sportive, le défi français (Le Cherche-Midi, 2024).
* 225 Les investissements viseraient notamment la prise en charge de la prescription d'activité physique adaptée, la rénovation des infrastructures et le recrutement d'enseignants d'EPS.
* 226 Directrice de recherche CNRS, responsable du groupement de recherche Sports et activités physiques, audition du 24 octobre 2024.
* 227 Professeur à l'UFR Staps de l'université Grenoble Alpes, audition du 7 novembre 2024.
* 228 Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Des jeux responsables et utiles. Pour un héritage durable, août 2024.
* 229 Rapport d'information déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'impact budgétaire et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (M. Benjamin Dirx), n° 1667.
* 230 Hugo Bourbillères, Mathieu Djaballah, « Impacts des grands événements sportifs internationaux : points de repères et controverses », Management & organisations du sport, 6, 2024.
* 231 Injep, Les licences sportives annuelles au sortir des Jeux de Paris 2024, janvier 2025.
* 232 Anne-Marie Foucaut (coordinatrice), Ordonnances en activité physique adaptée : 100 prescriptions, 2e édition, 2024.
* 233 Maître de conférences à l'université Aix-Marseille, audition du 30 janvier 2025.
* 234 E. L. Deci et R. M. Ryan, « Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health », Canadian Psychology, 49 (3), 2008.
Cette théorie s'intéresse aux motifs qui poussent un individu à l'action. Elle présente un continuum motivationnel qui va de la motivation la moins autodéterminée (il s'agit de l'amotivation) à la motivation la plus autodéterminée (la motivation intrinsèque) en passant par la motivation extrinsèque elle-même divisée en régulation intégrée (caractérisée par l'acceptation consciente des valeurs induites par l'action et l'atteinte des objectifs), régulation identifiée (caractérisée par l'acceptation consciente des objectifs et de la nécessité des actions pour les atteindre), régulation introjectée (engagement intériorisé mais soumis à une régulation externe) et régulation externe (engagement lié à des demandes externes ou un contexte social).
* 235 La théorie des buts d'accomplissement développée notamment par John G. Nicolls en 1984 est un cadre théorique en psychologie qui explique comment les individus s'engagent dans une tâche en distinguant deux types d'approche : les individus qui adoptent des buts de maîtrise cherchent à développer leurs compétences et à apprendre la tâche à accomplir. Ils sont motivés par l'apprentissage et l'amélioration personnelle. La compétence est évaluée de manière autoréférencée, c'est-à-dire en fonction de ses propres progrès et efforts. Les individus qui adoptent des buts de performance cherchent à démontrer une compétence supérieure par rapport aux autres. La compétence est évaluée de manière normative, en comparaison avec les autres.
* 236 L'activité physique est pratiquée non en raison du plaisir qu'elle procure, mais pour des raisons externes comme la recherche de récompenses tangibles (médailles, prix, argent), la reconnaissance sociale, le désir d'améliorer son apparence physique ou de perdre du poids pour répondre à des normes sociales ou médicales.
* 237 Pauline Maillot, Clémentine Becquard, Alexandra Perrot, « Motivation des personnes âgées à pratiquer une activité physique », Gérontologie et société, n° 156, vol. 40, 2018.
* 238 Abi Nader et al., « Associations between physical activity motives and trends in moderate-to-vigorous physical activity among adolescents over five years », Journal of sports sciences, 2021.
* 239 Maltagliati et al., « Why people should run after positive affective experiences instead of health benefits? », Journal of Sport and Health Science, Volume 3, Issue 4, July 2024.
* 240 Maxime Luiggi, Maxime Travert, Jean Griffet, « Adhésion et abandon de la pratique sportive chez l'adolescent : vers une politique de rétention ? », Santé publique, Volume 36, N° 5, septembre-octobre 2024.
* 241 Les questionnaires remplis à moins de 50 % ou comportant des réponses aberrantes n'ont pas été retenus.
* 242 Lorsqu'on additionne le taux de pratiquants sportifs et le taux de celles et ceux qui ont abandonné la pratique sportive.
* 243 Colin Gatouillat, Jean Griffet et Maxime Travert, « Navigating the circles of social life: Understanding pathways to sport drop-out among French teenagers », Sport, Education and Society, 15 juillet 2019.
* 244 Dans cette étude, la quasi-totalité des 100 adolescents ayant abandonné la pratique sportive exerçait celle-ci dans un club.
* 245 Cette étude a porté sur 395 adolescents de sept établissements différents tous situés dans les Bouches-du-Rhône.
* 246 Union sportive du premier degré.
* 247 Union générale sportive de l'enseignement libre.
* 248 Margaret Whitehead, « The Concept of Physical Literacy », European Journal of Physical Education, Volume 6, Issue 2, 2001.
* 249 Thèse de Joseph Gandrieau soutenue publiquement le 20 décembre 2023, Comprendre et mesurer le concept de littératie physique : un défi majeur pour promouvoir l'activité physique durable ?
* 250 Joseph Gandrieau, Thibaut Derigny, Christophe Schnitzler, François Potdevin, « Envisager la littératie physique pour éduquer à une vie active », Métiers santé, avril-août 2020.
* 251 Ce plan concerne également des enfants plus âgés et des adultes. Les enfants âgés de moins de 11 ans représentent 85 % du nombre total des participants. Depuis 2008, 239 325 pratiquants ont bénéficié de ce dispositif et 62 558 enfants ont validé le test qui atteste des compétences minimales permettant d'assurer sa propre sécurité dans l'eau. 318 sites sont concernés. Cf. Fédération française de natation, Bilan des plans ministériels « j'apprends à nager/aisance aquatique », 2024.
* 252 Cheffe de service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, audition du 27 février 2025.
* 253 Qiu et al., « Does objectively measured light-intensity physical activity reduce the risk of cardiovascular mortality? A meta-analysis », European Heart Journal. Quality of Care and Clinical Outcomes, 7, 2021.
* 254 Faire la cuisine, faire du repassage, se déplacer dans sa maison, arroser ses plantes, faire le marché...
* 255 Dans les pays anglo-saxons, cette tendance à concentrer un maximum d'activités physiques sur un seul jour est dénommée : « weekend warrior physical activity ».
* 256 Selon l'Insee, depuis 25 ans, les hommes s'occupent un peu plus de l'éducation des enfants, mais leur contribution aux tâches domestiques est restée relativement stable. Les femmes gèrent 71 % des tâches ménagères et 65 % des tâches parentales.
* 257 Khurshid et al., « Accelerometer-Derived “Weekend Warrior” Physical Activity and Incident Cardiovascular Disease », JAMA, 2023.
* 258 Ahmadi et al., « Vigorous physical activity, incident heart disease and cancer: how little is enough? », European Heart Journal, 2002.
* 259 Stamatakis et al., « Association of wearable device-mesured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality », Nature medicine, 2022.
* 260 Ce qui correspond à une distance comprise entre 6 et 8 kilomètres en fonction de la longueur des pas, soit entre 1 h 15 et plus de 2 heures de marche selon la vitesse de marche.
* 261 Le podomètre s'appelait manpo-kei, ce qui peut être traduit par « l'outil pour mesurer les 10 000 pas ».
* 262 Lee et al., « Association of step volume and intensity with all-cause mortality in older women », JAMA Internal Medicine, 179 (8), May 29, 2019.
* 263 Paluch et al., « Steps per day and all-cause mortality in middle-aged adults in the coronary artery risk development in young adults study », JAMA Network Open, September 3, 2021.
* 264 Paluch et al., « Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts », The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 3, March 2022.
* 265 Ding et al., « Daily steps and health outcomes in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis », Lancet Public Health, July 3, 2025.
* 266 L'activité physique dans un but de santé est considérée comme une intervention non médicamenteuse et peut être associée à un soin.
* 267 Aude-Marie Foucaut, Les sciences de l'implémentation au service du style de vie actif dans les parcours de soins ; date de soutenance : 5 septembre 2023.
* 268 Blodgett et al., « Device-mesured 24-H movement behaviors and blood pressure: a 6-part compositional individual participant data analysis in the ProPass consortium », Circulation, Volume 151, Number 2, November 6, 2024.
* 269 14 761 personnes ont été considérées dans l'étude. Le temps moyen de sommeil s'élève à 7,3 heures, le temps de sédentarité à 10,7 heures, le temps passé debout à 3,17 heures, le temps consacré à la marche lente à 1,57 heure, le temps passé à marcher rapidement à 1,13 heure et le temps consacré à des exercices physiques (course et cyclisme) à 16 minutes.
* 270 Une baisse de 2 mmHg de la pression artérielle systolique a été constaté lorsque 2 heures 50 minutes de sédentarité ont été remplacées par du sommeil.
* 271 Vaillant-Coindard et al., « Utilité perçue de l'exergaming pour favoriser l'activité physique à l'école : étude pilote auprès des enseignants », Santé Publique, HS2, vol. 36, 2024 ; https://doi.org/10.3917/spub.hs2.2024.0117.
* 272 Actuellement, une seule personne à l'Insep est chargée de l'animation du réseau national des référents scientifiques, ce qui est largement insuffisant. La mise en place du Sport Data Hub par l'Agence nationale du sport va également nécessiter l'embauche de personnels supplémentaires.
* 273 Telles que : maîtriser les données fondamentales de la physiologie de l'exercice, connaître les particularités de l'évolution des capacités physiques dans le temps en fonction de l'âge et du genre, être capable de gérer les fondements méthodologiques de l'entraînement, maîtriser les outils technologiques, connaître les techniques de renforcement musculaire, maîtriser les techniques de récupération du sportif, être capable d'assurer les conditions de réathlétisation en lien avec l'équipe médicale, être capable d'expliquer et de démontrer des réalisations techniques, etc.
* 274 Ou encore la licence Staps spécialité Entraînement sportif.
* 275 Cf. Réglementation de la préparation mentale dans le sport. Préconisations du Comité national des préparateurs mentaux (CNPM).
* 276 Soit un master Staps EOPS spécialisé en psychologie du sport, soit un master EOPS associé à un diplôme universitaire en psychologie du sport, soit un master en psychologie combiné à un diplôme universitaire en psychologie du sport.
* 277 Rapport de la mission interministérielle sport-santé « Delandre » remis le 7 avril 2025.
* 278 Certains opposants au remboursement de l'activité physique adaptée par l'assurance maladie renvoient à la responsabilité individuelle des patients de prendre des dispositions favorables à leur santé. Dans ce cas, le même raisonnement devrait être appliqué au remboursement des médicaments dont l'effet est amoindri par des comportements à risques de la part des patients. Or, personne ne remet en cause le remboursement des prescriptions de médicaments.
* 279 Les recommandations du rapport Delandre peuvent servir de base à cette réflexion.