II. ANALYSE DES CRÉDITS PAR OPÉRATEUR
A. FRANCE TÉLÉVISIONS : UNE RÉFORME À LA FOIS COÛTEUSE ET PERNICIEUSE
1. Le budget théorique pour 2012
Le présent projet de loi de finances prévoit que France Télévisions reçoit les dotations suivantes :
- 2 126,3 millions d'euros (soit 2 082,6 millions d'euros HT), contre 2 146,5 millions d'euros TTC en LFI 2011, au titre du programme 841 « France Télévisions » de la mission « Avances à l'audiovisuel public », ce qui correspond à une baisse de 0,9 % des crédits ;
- et 443,9 millions d'euros (contre 389,9 millions en LFI 2011) au titre du programme 313 « Contribution au financement de l'audiovisuel » de la mission Médias, ce qui correspond à une hausse de plus de 13,8 % des crédits.
La dotation publique globale de France Télévisions pour l'année 2010 s'élève donc à 2 570,2 millions d'euros TTC (2 526,5 millions d'euros HT) , soit une augmentation de 1,3 % des crédits .
Le PAP précise cependant que les recettes publicitaires ayant été plus élevées que prévues en 2011, l'État a choisi de diminuer les crédits de France Télévisions de 28 millions d'euros en exécution et de les reporter sur 2012, en majorant la dotation de l'État, ce qui porterait en fait la progression à 2 598,2 millions d'euros, soit selon le PAP, une augmentation de 3,6 % par rapport à la dotation publique en 2011 (sic).
Au-delà de ces arguties budgétaires, soulignons que cette évolution, si elle n'était pas remise en cause par le futur projet de loi de finances rectificative, rendrait la trajectoire financière pour 2012 conforme au contrat d'objectifs et de moyens.
Par ailleurs le budget de France Télévisions devrait être complété par des ressources publicitaires estimées à 425 millions d'euros en 2012, ce qui constitue une hypothèse à peu près réaliste.
Au final, en cumulant les ressources et après les prélèvements et commissions divers, les recettes nettes disponibles de France Télévisions devraient s'élever en 2012 à 2 626,6 millions d'euros, soit 77,7 millions d'euros de plus qu'en exécution 2011, dont près de 80 % devraient être dépensés en coûts de grille.
Si le fonctionnement de France Télévisions paraît a priori garanti en 2012, une lecture plus attentive des crédits montre que son financement n'est pas assuré, ne serait-ce qu'à moyen terme, et que l'entreprise a été profondément fragilisée par la réforme menée en 2009.
2. Un groupe fragilisé par la réforme de l'audiovisuel
a) L'entreprise commune : une réalisation confuse et contradictoire
La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a refondu les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 afin de substituer aux différentes sociétés existantes une société nationale de programme unique, dénommée France Télévisions. En lui conférant la qualité de société nationale de programme, le législateur a donné à la société France Télévisions pour objet principal non plus simplement de coordonner l'activité des chaînes mais de concevoir et de programmer directement des émissions audiovisuelles .
La constitution de l'entreprise unique s'est effectuée par une fusion-absorption juridiquement ordonnée par l'article 86 de la loi du 5 mars 2009 et réputée intervenir à la date du 1 er janvier 2009. Les statuts de la nouvelle société nationale de programme unifiée ont ensuite été approuvés par le décret n° 2009-1263 du 19 octobre 2009.
Outre les aspects sociaux, la mise en place de l'entreprise unique représentait un défi important d'adaptation en interne.
Votre rapporteur salue tout d'abord la capacité de la direction de France Télévisions et des syndicats à négocier un accord sur l'avenant à la convention collective des journalistes, qui a été signé le 15 septembre 2011. Il s'agissait d'un défi important imposé par la réforme.
Votre rapporteur espère qu'un texte de substitution à la convention collective des personnels techniques et administratifs, qui doit être signé avant le 8 octobre 2012, le sera dans le même esprit.
Par ailleurs, la mise en place du guichet unique , tant craint par les producteurs, ne s'est pas réalisée, notamment grâce au choix de M. Rémy Pflimlin, de redonner leur place aux différentes chaînes, à la fois dans le projet éditorial mais également en termes de choix et de négociation.
En revanche, le malaise lié à la mise en place de la réforme ne semble pas dissipé , ce qui a conduit France Télévisions à demander l'introduction dans le COM d'un objectif d'amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail et à créer une direction de la prévention des risques liés au travail, y compris les risques psychosociaux.
Votre rapporteur constate que cette fragilisation du groupe France Télévisions par la création de l'entreprise unique a été gérée en évitant le pire. Il considère en revanche que la question de son financement posera des problèmes très rapidement.
b) Une fragilisation économique de l'État et de France Télévisions
Je crois qu'il est important tout d'abord de souligner, comme l'a fait Mme Martine Martinel, rapporteur des crédits relatifs aux médias à la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, que le financement de la réforme de 2009 est une « bombe à retardement pour les finances publiques ».
En effet, la taxe sur les recettes de publicité des éditeurs de télévision instaurée par la loi du 5 mars 2009 précitée a vu son taux passer de 3 % du montant des recettes annuelles, à 0,5 % jusqu'à la suppression totale de la publicité sur France Télévisions. Le montant des sommes encaissées, qui devait avoisiner les 50 millions d'euros, s'est donc élevé à 17,8 millions d'euros en 2010 et devrait rester à ce niveau en 2011 et 2012 3 ( * ) .
En outre, la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts (CGI) sur les prestations fournies par les opérateurs de communications électroniques a fait l'objet d'un avis motivé de la part de la Commission européenne, qui estime qu'elle est incompatible avec l'article 12 de la directive « autorisation » , laquelle prévoit que les taxes imposées aux opérateurs de télécommunications doivent être spécifiquement et directement liées à la couverture des coûts administratifs et réglementaires du secteur des télécommunications. La France ayant décidé de ne pas se conformer à cet avis, la question sera tranchée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).
Le produit de cette taxe, qui s'est élevé à 255 millions d'euros en 2010, devrait avoisiner les 250 millions d'euros en 2011 et 2012.
Le montant cumulé de ces deux taxes se fixe à environ 270 millions d'euros, ce qui est éloigné des 450 millions d'euros prévus initialement et encore bien loin des 300/350 millions d'euros nécessaires afin de neutraliser la réforme de l'audiovisuel public sur les comptes de l'État. A cela s'ajoute le risque précité et très réel de voir la Commission européenne demander à la France de rembourser plusieurs centaines de millions d'euros aux opérateurs télécoms.
Par ailleurs, aussi incroyable que cela puisse paraître, et plus inquiétant encore, aucun financement spécifique n'a été prévu pour la compensation de la suppression totale de la publicité sur France Télévisions .
S'agissant de la compensation versée à France Télévisions, elle est passée de 450 millions d'euros en 2009 à un chiffre inférieur aujourd'hui, qu'il est un peu difficile d'estimer au vu du double financement budgétaire et affecté de la société nationale de programmes. Ce que l'on peut commenter en revanche, c'est la trajectoire fixée par la tutelle à France Télévisions pour ses recettes publicitaires : celles-ci sont supposées passer de 425 millions d'euros en 2011 à 450 millions d'euros en 2012, ce qui est optimiste du point de vue du marché publicitaire, surtout lorsque le cap qui est fixé à France Télévisions pour 2016 est en fait la suppression totale de la publicité, et donc de ses recettes commerciales. France Télévisions est donc supposée augmenter ses ressources propres avant de les voir s'effondrer !
Votre rapporteur constate que l'ambiguïté de la majorité présidentielle est particulièrement frappante sur la question du parrainage. Sans que l'on sache bien pourquoi, celui-ci est resté autorisé après 20 heures sur les antennes de France Télévisions. Le groupe a donc utilisé cette marge de manoeuvre afin d'augmenter ses recettes, mais cette pratique a déplu et on lui a imposé une « charte de parrainage », l'autorisant à en faire, mais de manière modérée ( sic ). Il s'agit au mieux d'une valse-hésitation et au pire d'un double langage, mais dans tous les cas ce type de comportement nuit très fortement à un groupe qui a besoin de stabilité dans une période où le modèle télévisuel est en mutation.
c) Les défis de France Télévisions
(1) Le développement numérique : un projet nécessaire et coûteux
Comme la presse écrite avant lui, le monde audiovisuel fait sa révolution numérique : les innovations technologiques, la multiplication des écrans, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché ont déjà modifié le paysage et le modifieront profondément ces prochaînes années.
L'audiovisuel public se doit de suivre les usages et les technologies au service des téléspectateurs et de l'ambition culturelle qu'on peut avoir pour lui. Dans ce cadre, France Télévisions axe son développement sur une stratégie de « média global ». L'objectif de France Télévisions est ainsi d'optimiser l'exposition des contenus du service public sur l'ensemble des supports de communication (Internet, mobile, TV sur ADSL ...) et l'ensemble des terminaux (TV, PC, mobiles, terminaux nomades...).
Cette stratégie passe, selon France Télévisions, « par l'intégration d'une logique multi-supports dès l'amont de la conception des programmes, par le développement de nouveaux services et par l'acquisition des droits nouveaux médias des programmes diffusés par France Télévisions ».
La stratégie multimédia de France Télévisions se décline en trois dimensions : le développement d'offres transversales, le développement de la télévision hors de l'écran traditionnel et la préparation de l'Internet télévisuel.
Votre rapporteur se réjouit déjà du succès des sites Internet de France Télévisions qui ont enregistré une fréquentation moyenne de 36,2 millions de visites par mois en moyenne en 2010, soit une croissance de 12,1 % par rapport à 2009. Le nombre de pages vues sur les sites a quant à lui atteint en moyenne 308 millions par mois contre 342 millions en 2009, soit une baisse de 10 %, qui s'explique notamment par une modification de la méthode pour compter les pages sur certains sites.
En 2011, le nombre moyen de visites par mois sur les sites Internet du groupe France Télévisions a atteint 39,3 millions, soit une progression de 9 % par rapport à 2010.
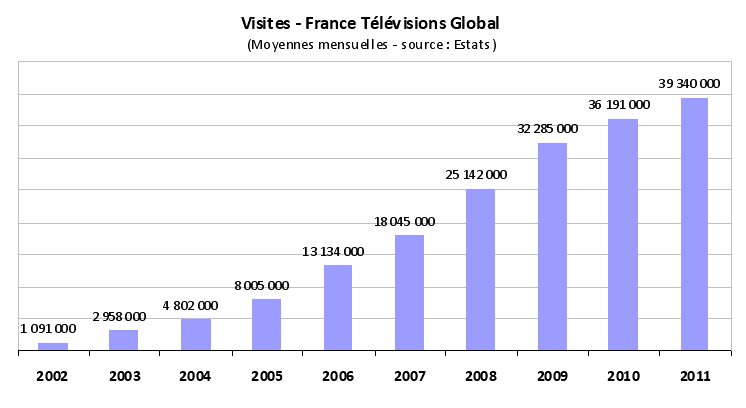
Source : Réponses au questionnaire budgétaire
Mais cette réussite des sites doit s'accompagner d'une mise en valeur intéressante des contenus. A cet égard, le développement d'une offre transversale (aux chaînes de France Télévisions) autour de cinq thématiques est pertinent. Il s'agit de :
« - la création d'une plateforme d'information en continu traitant l'actualité en temps réel. Cette offre sera multiplateforme, accessible aussi bien sur un écran d'ordinateur que sur les mobiles et les téléviseurs connectés ;
- du développement d'une offre d'information internationale. Rénové, renforcé, le site « Géopolis » deviendra la tête de pont d'une offre transversale dans ce domaine ;
- du développement d'une offre d'information culturelle. En étendant ses contenus au-delà des vidéos, le site « Culture Box » élargira son offre originelle : plus de formats, plus de contenus, plus de proximité ;
- du renforcement du dispositif événementiel sur le modèle de ce que France Télévisions a réalisé lors du « web10 » ou du « Salon de l'agriculture ». Avec des créations numériques ad hoc , des relais dans les programmes et des actions in situ, c'est à chaque fois un dispositif lourd qui trouve son relais et son écho dans des actions en ligne ;
- et du renforcement de l'offre d'information de proximité, par le biais des 24 sites régionaux de France 3 et des 9 sites « pays » de RFO ».
À l'image de la plateforme d'information, une plateforme sport devrait voir le jour en 2012.
Sur le développement de la télévision « hors la boîte », divers canaux sont utilisés.
La stratégie de France Télévisions sur les réseaux sociaux a été renforcée avec l'animation de diverses communautés. Votre rapporteur considère que cette voie est particulièrement importante :
- dans la perspective de rajeunissement de l'audience du groupe , qui constitue un réel enjeu ;
- et surtout, afin de faire partager au plus grand nombre les valeurs du service public , comme celles de l'indépendance d'esprit, du pluralisme et de la citoyenneté. Dans son rapport sur les jeunes et les nouveaux médias, votre rapporteur avait ainsi souligné le fait que les valeurs de service public irriguaient également la programmation jeunesse, avec la volonté de fédérer les parents et les enfants, les petits et grands et les filles et les garçons face à un marché qui a de plus en plus tendance à segmenter les publics, de favoriser l'originalité de la narration et l'exemplarité des programmes 4 ( * ) . Il avait également insisté sur l'importance de la stratégie de développement de ces programmes sur tous les supports dans la perspective de constitution d'un « service public numérique ».
Le souhait de dynamiser le club des téléspectateurs est à cet égard une excellente idée car il constitue une source potentielle de rayonnement de l'offre de France Télévisions.
En mobilité, France Télévisions a longtemps été en retard.
Le lancement du « player » France Télévisions (application disponible sur iPad et iPhone) en avril 2011 a permis de le combler en partie. A la fin juillet 2011, cette application a été téléchargée plus de 730 000 fois. En août 2011, la nouvelle version a intégré localement la diffusion des chaînes ultramarines et a proposé le rattrapage des journaux télévisés régionaux. L'application est désormais disponible sur Androïd.
Selon France Télévisions, le « player » ouvre la voie à un service regroupant direct, rattrapage et partage . Il doit inspirer la refonte du service de TV de rattrapage, présent actuellement sur pluzz.fr mais également sur les box des opérateurs. En effet, l'offre est aujourd'hui accessible sur les box de Free et d'Orange. Des accords similaires sont en passe d'être signés avec SFR (mise à disposition du service fin 2011) et Bouygues (mise à disposition du service au 1 er semestre 2012).
Votre rapporteur estime que cette politique constitue un enjeu majeur pour le service public qui a pour mission d'offrir le plus largement au citoyen la possibilité de visionner gratuitement des programmes qu'il a financés par la contribution à l'audiovisuel public et qui font partie du patrimoine culturel français.
Il note à cet égard que l'iPlayer de la BBC représente 12 % de l'ensemble des visites de sites de vidéo au Royaume-Uni, ce qui est particulièrement exceptionnel. Le fait que le groupe audiovisuel soit propriétaire des programmes qu'ils diffusent change la donne, néanmoins, il doit clairement s'agir d'une source d'inspiration pour France Télévisions.
S'agissant de la télévision connectée, votre rapporteur se réjouit que la réflexion de France Télévisions ait été menée largement en amont.
L'analyse suivante lui semble être pertinente, avec une anticipation de ce que pourrait être cette télévision connectée :
« - s'il s'agit d'un mode applicatif, France Télévisions devra être fortement présente sur les magasins d'applications et nouer des partenariats avec les fabricants de matériels ;
- s'il s'agit d'une barre de recherche, France Télévisions devra être performante sur les métadonnées et sur la promotion de ses marques ;
- s'il s'agit des chaînes comme actuellement, France Télévisions devra concentrer ses efforts sur l'enrichissement de ses programmes ;
- s'il s'agit d'un second écran, France Télévisions devra prioritairement être active sur les réseaux sociaux et reconnue dans les outils de recommandation .
Parce que la réalité des usages résultera probablement d'un mélange de ces hypothèses, France Télévisions se préparera à saisir toutes les opportunités et a pour cela formé une « force opérationnelle » dédiée à cette réflexion ».
Le secteur du développement numérique a bénéficié en 2010 d'un budget de 35,6 millions d'euros en 2010 et de 56,5 millions d'euros pour 2011. Votre rapporteur regrette que le contrat d'objectifs et de moyens ne détaille pas l'investissement prévu en la matière de 2012 à 2015 car il s'agit indéniablement de l'un des grands chantiers de France Télévisions, qui demandera des investissements importants.
(2) La mise en place d'une chaîne jeunesse
Le groupe France Télévisions a pour ambition de mettre en place avec France 4 une chaîne pour jeunes adultes (15-34 ans) populaire de service public.
Votre rapporteur ne conteste pas cette ambition mais insiste sur l'importance de créer une offre jeunesse spécifique , qui soit largement dédiée à l'animation. A cet égard, il estime qu'une cohabitation des deux cibles sur un même canal est possible et l'appelle de ses voeux.
d) La définition d'un modèle de financement crédible
Votre rapporteur considère que la contribution à l'audiovisuel public est le socle du financement du secteur parce qu'à travers son affectation, elle garantit l'indépendance de ce média majeur qu'est l'audiovisuel.
Au vu à la fois des difficultés budgétaires de France Télévisions et de la part très importante de dotation budgétaire dans son financement, votre rapporteur a considéré qu'il était nécessaire de faire des propositions permettant d'augmenter le rendement de la CAP. A cet égard, il se réjouit que la commission ait adopté la mesure simple et juste qu'est la réintégration des résidences secondaires dans son assiette, même s'il entend celles et ceux qui considèrent qu'ajoutée à une politique d'austérité injuste, cette réintégration pourrait être incomprise.
Votre rapporteur souligne qu'il s'agit d'une idée défendue avec constance par notre commission. Lors de la réforme du recouvrement de la redevance audiovisuelle par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, M. Louis de Broissia, alors rapporteur du budget des médias au nom de votre commission, s'était ainsi opposé à l'exonération des résidences secondaires dans les termes suivants : « votre rapporteur conteste l'opportunité d'une telle décision, dont le coût est estimé à 58 millions d'euros. La fraude sur les résidences secondaires n'était pas une fatalité et pouvait être efficacement endiguée. En effet, le taux de 65 % de fraude avancé par l'Inspection générale des finances s'expliquait notamment par l'exigence de la preuve d'une détention permanente du dispositif de réception pour que la redevance soit perçue. Il fallait dans ces conditions avoir à faire à des contribuables extrêmement vertueux pour que ces derniers ne profitent pas des largesses offertes par une telle disposition : ils n'avaient en effet qu'à déclarer transporter leur poste chaque fois qu'ils se rendaient dans leur résidence secondaire pour se voir dispensés du paiement de la redevance. (...) Il est regrettable qu'en ne décidant de ne prélever qu'une seule redevance par foyer, le Gouvernement donne l'impression de valider a posteriori le choix des fraudeurs. Ce faisant, il limite du même coup le dynamisme de l'assiette de la redevance au risque de pénaliser les entreprises de l'audiovisuel public ».
Point n'est besoin d'en dire davantage. L'adoption tôt ou tard de cette mesure, dont le rendement est évalué entre 200 et 250 millions d'euros, paraît nécessaire afin d'assurer la pérennité de notre audiovisuel public, alors que l'on a fait disparaître 400 millions d'euros de recettes publicitaires .
* 3 Selon les réponses aux questionnaires budgétaires, ce montant serait de 17 millions d'euros en 2011 et 18 millions d'euros en 2012.
* 4 Les nouveaux médias : des jeunes libérés ou abandonnés ? Rapport d'information n° 46 (2008-2009) de M. David ASSOULINE, fait au nom de la commission des affaires culturelles.







