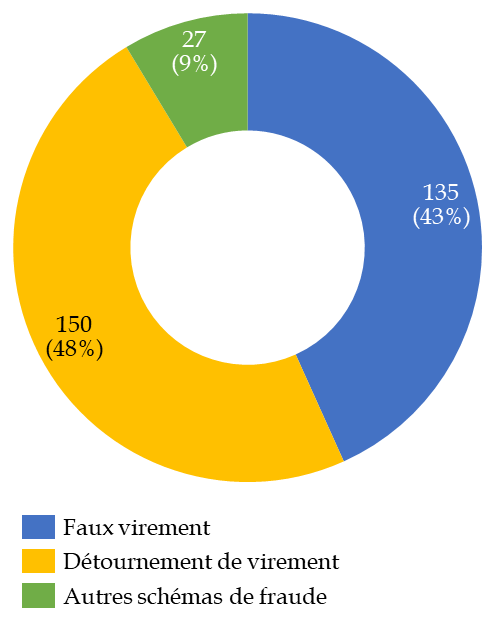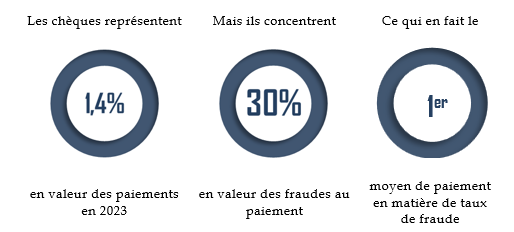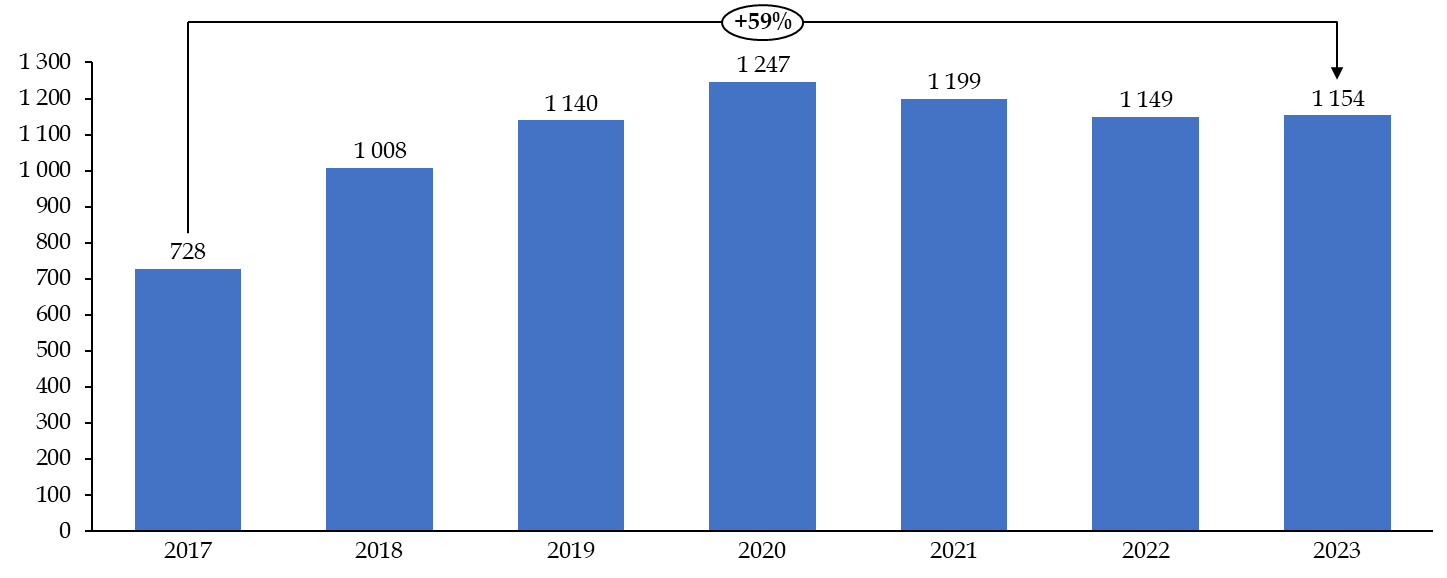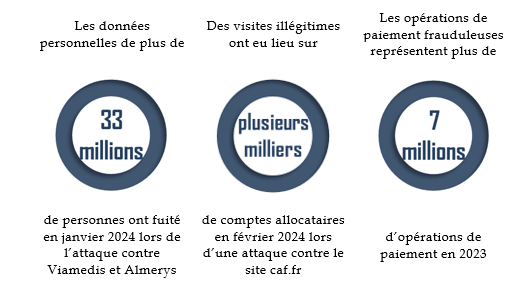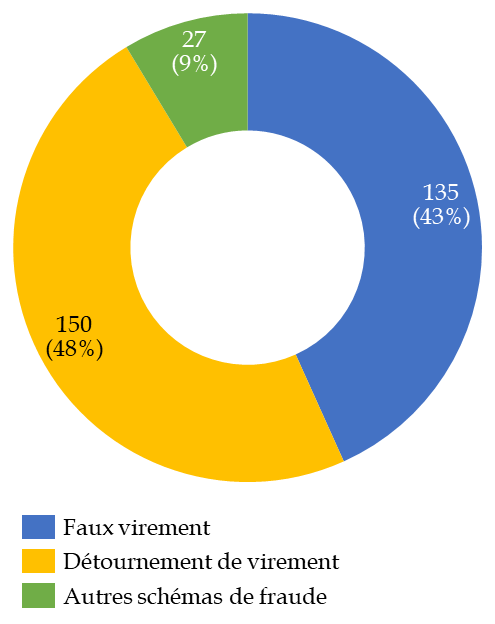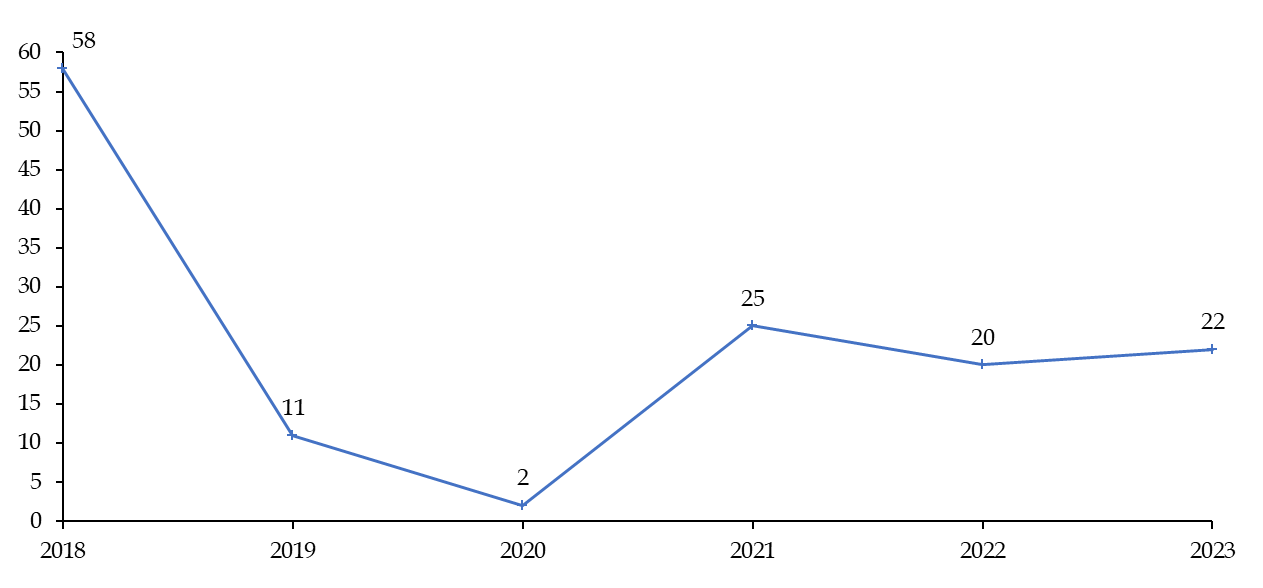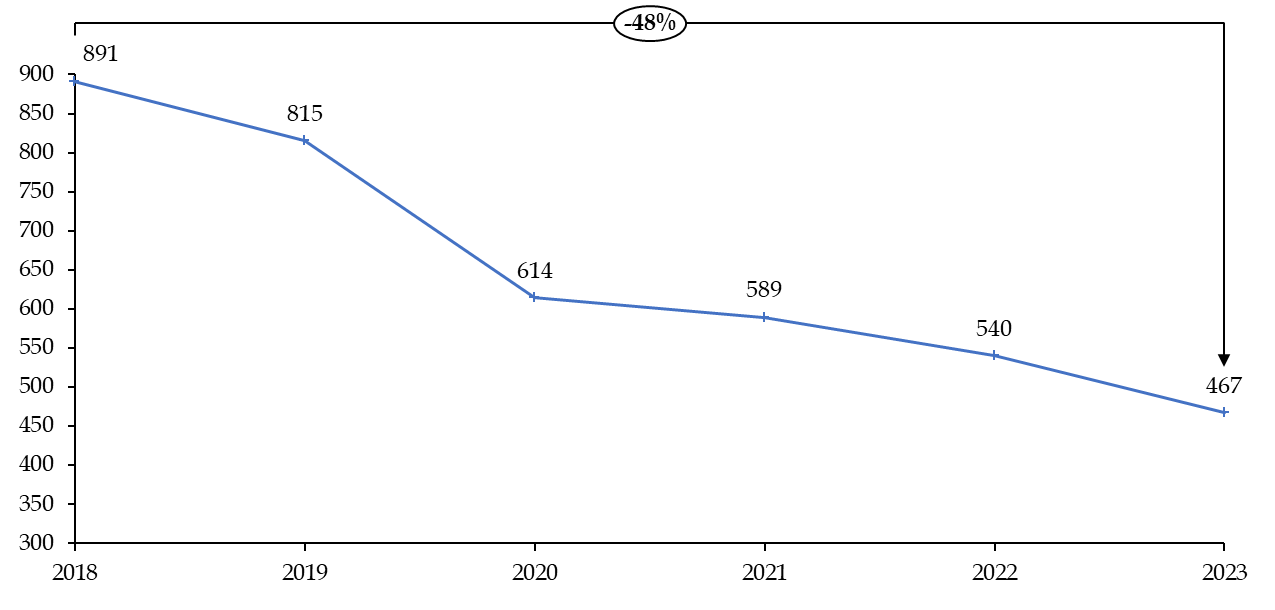- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- ARTICLE 1er
Création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude
- ARTICLE 1er bis
Intégration d'indicateurs de performance du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF) au rapport annuel
de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP)
- ARTICLE 2
Élargissement des obligations de signalement à la Banque de France
pesant sur les tirés ayant rejeté un chèque aux fins de mise à jour
du fichier national des chèques irréguliers (FNCI)
- ARTICLE 3
Création d'un service de consultation du fichier national
des chèques irréguliers (FNCI) par le banquier au moment
de la présentation du chèque au paiement
- ARTICLE 4
Coordination pour assurer l'applicabilité de la proposition de loi
dans les collectivités d'outre-mer
- ARTICLE 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 54
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur la
proposition de loi, adoptée
par l'Assemblée nationale, visant
à renforcer la lutte
contre la fraude
bancaire,
Par Mme Nathalie GOULET,
Sénateur
Procédure de législation en commission,
en application de l'article 47 ter du Règlement
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
Voir les numéros :
|
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
884, 1153 et T.A. 82 |
|
|
Sénat : |
496 (2024-2025) et 55 (2025-2026) |
|
L'ESSENTIEL
Déposée le 4 février 2025 par le député Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi n° 496 (2024-2025) visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a pour objet d'apporter des compléments et des ajustements techniques à l'arsenal normatif existant en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement.
La proposition de loi, composée de cinq articles dans sa version transmise au Sénat, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 31 mars 2025 en intégrant 13 amendements par rapport au texte initial.
Réunie le 22 octobre 2025, sous la présidence du sénateur Claude Raynal, président, la commission des finances a examiné le rapport du sénateur Nathalie Goulet sur ce texte et procédé à l'examen de cette proposition de loi selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du Règlement du Sénat.
Le rapporteur, qui soutient l'adoption de ces mesures de renforcement du dispositif de lutte contre la fraude au paiement SEPA et contre la fraude au chèque, estime que ces mesures, si elles sont bienvenues, sont insuffisantes et devront être complétées par des initiatives complémentaires au regard de l'importance de renforcer la lutte contre la fraude aux moyens de paiement - et en particulier aux fraudes associées au piratage des données personnelles.
Au regard de l'importance de permettre une entrée en vigueur rapide des dispositions de la proposition de loi, la commission a adopté la proposition de loi sans modification.
I. LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT DES
MESURES DE RENFORCEMENT DE L'ARSENAL NORMATIF DE LUTTE CONTRE
LA FRAUDE AU
PAIEMENT SEPA ET CONTRE LA FRAUDE AU CHÈQUE
A. LA CRÉATION D'UN FICHIER CENTRALISÉ DES COMPTES BANCAIRES SIGNALÉS POUR RISQUE DE FRAUDE EST UN LEVIER POUR AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU PAIEMENT SEPA
L'article 1er de la proposition de loi prévoit la création d'un mécanisme de partage d'information entre les prestataires de service de paiement sous la forme d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF).
Ce fichier, qui recense les coordonnées bancaires des comptes identifiés comme étant suspects par les dispositifs de contrôle interne, serait géré par la Banque de France et intégralement financé par des contributions des prestataires de services de paiement.
La conformité de ce traitement de données au règlement général sur la protection des données (RGPD) est assurée par la limitation du nombre de personnes ayant accès au compte et par la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) pour rendre un avis sur les mesures d'application de la loi fixant les modalités de collecte, de conservation et de consultation des données du fichier.
L'article 1er bis prévoit d'intégrer des indicateurs de performance relatif à ce fichier dans le rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.
Répartition de la fraude au virement selon le schéma de fraude
(en millions d'euros et en 2023)
Source : commission des finances, d'après les données de l'OSMP
La création de ce mécanisme de partage d'information, qui est de nature à renforcer la lutte contre la fraude au virement et la fraude au prélèvement qui représentent un préjudice de 334 millions d'euros en 2023, est cohérente avec le mouvement de sécurisation des paiements SEPA1(*) prévu à l'échelle de l'Union européenne.
Cette sécurisation sera notamment permise par l'entrée en vigueur de l'obligation de proposer un service gratuit de vérification de la cohérence des coordonnées bancaires (Verification of Payee - VoP) à partir du 9 octobre 2025 dans les pays de la zone euro en application du règlement (UE) du 13 mars 2024 relatif aux virements instantanés.
Elle sera complétée à moyen terme par les mesures prévues par la proposition de règlement (UE) sur les services de paiement (RSP) publiée par la Commission européenne en juin 2023 et qui prévoit expressément la mise en place d'un mécanisme de partage d'information entre les prestataires de services de paiement sur les comptes suspects.
La création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF) est cohérente avec le processus en cours de sécurisation des paiements SEPA prévu par le droit de l'Union européenne
B. DES MESURES D'AJUSTEMENT DU FONCTIONNEMENT DU FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS (FNCI) DE NATURE À RENFORCER SON EFFICACITÉ
L'article 2 complète le code monétaire et financier pour prévoir une obligation de signalement à la charge du tiré2(*) en cas de rejet d'un chèque falsifié ou contrefait. Cette obligation, qui codifie une pratique de place, sécurise la procédure de mise à jour du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) géré par la Banque de France.
De manière complémentaire, l'article 3 prévoit d'ouvrir le service de consultation des données du FNCI aux banquiers lors de la présentation d'un chèque au paiement. Cette extension ciblée des personnes ayant accès au FNCI permettra de renforcer la portée de ce dispositif de lutte contre la fraude au chèque.
L'article 4 assure l'applicabilité outre-mer des dispositions de la présente loi.
II. LES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI DEVRONT ÊTRE COMPLÉTÉES POUR TENIR COMPTE DE L'AGGRAVATION DU RISQUE DE FRAUDE AUX MOYENS DE PAIEMENT
A. LES FRAUDES AUX MOYENS DE PAIEMENT CONNAISSENT UNE CROISSANCE DYNAMIQUE DANS UN CONTEXTE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE DES SCHÉMAS DE FRAUDE
La fraude aux moyens de paiement constitue un phénomène massif et croissant qui a représenté en 2023 un préjudice total de 1,2 milliards d'euros dont 364 millions d'euros correspondent à des fraudes au chèque et 334 millions d'euros à des fraudes au paiement SEPA, ces deux catégories étant couvertes par la présente proposition de loi.
Il est également à relever que la lutte contre la fraude est une « guerre de mouvement » dans laquelle la puissance publique est tenue de s'adapter en permanence à l'apparition de nouveaux schémas de fraude. Les épisodes de fuites massives de données personnelles observées depuis 2024 créent à ce titre un risque aggravé de renforcement de la fraude aux moyens de paiement par usurpation d'identité.
Évolution dans le temps de la fraude aux moyens de paiement
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données de l'OSMP
B. IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR RAPIDEMENT DES INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURISATION DES MOYENS DE PAIEMENT
En premier lieu, le rapporteur remarque que depuis janvier 2025, le traitement des demandes de consultation des données personnelles contenues dans le fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) a été transféré de la Cnil à l'administration fiscale. Ce transfert constitue une première étape vers la simplification de l'accès par les particuliers à leurs données personnelles inscrites dans le Ficoba - qui contient l'ensemble des comptes et coffres forts ouverts dans un établissement bancaire en France.
Au regard du risque d'usurpation d'identité, l'accessibilité du Ficoba doit être encore renforcée en permettant d'une part un accès en temps réel à ses données personnelles depuis l'espace sécurisé du site impots.gouv.fr et d'autre part l'envoi systématique d'une notification à chaque particulier lors de l'ouverture d'un compte à son nom.
L'accès direct et sécurisé aux données Ficoba est un levier déterminant de lutte contre l'usurpation d'identité aux fins d'ouverture frauduleuse d'un compte bancaire
En second lieu, le rapporteur relève que les formules de chèque en circulation des entreprises en difficulté sont susceptibles de constituer un instrument de fraude et que des mesures doivent être prises pour garantir une information rapide des établissements bancaires concernés de l'ouverture d'une procédure collective et de son déroulement.
La commission a adopté la proposition de loi sans modification. Cette dernière sera examinée en séance publique le mardi 29 octobre 2025.
EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 1er
Création d'un fichier national des
comptes signalés pour risque de fraude
Le présent article a pour objet de permettre le partage d'informations sur les comptes suspects entre les prestataires de services de paiement en créant un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF).
La gestion de ce fichier national centralisé est confiée à la Banque de France. La fourniture des données figurant dans ce fichier relève de la responsabilité des prestataires de services de paiement, y compris les institutions financières publiques, lorsque leurs dispositifs de lutte interne contre la fraude fait apparaître une suspicion.
L'inscription d'un compte sur le fichier national de signalement n'entraîne pas un blocage des opérations sur ce compte et ne peut justifier à elle seule la clôture de ce compte. À la suite du signalement, le teneur du compte signalé est tenu de réaliser les diligences nécessaires pour évaluer son caractère frauduleux.
Le nouvel article L. 521-6-1 du code monétaire et financier renvoie à deux arrêtés d'application pour fixer d'une part la nature des données collectées et leurs modalités de collecte et d'autre part les modalités de financement par les prestataires de services de paiement des frais de fonctionnement du fichier.
L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement élargissant aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) la possibilité de transmettre un signalement à la Banque de France - la Banque de France procédant à l'inscription du compte dans le fichier sous réserve de ses propres contrôles.
La création de cet instrument de partage d'information sur les comptes suspects entre les prestataires de services de paiement constitue un levier de lutte contre la fraude au virement et au prélèvement, qui représente 334 millions d'euros en 2023. Il s'agit d'un mécanisme dont la création est soutenue à la fois par les acteurs bancaires et par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements. Cette proposition de création d'un fichier national intervient par surcroît à l'issue d'une expérimentation concluante.
La commission a adopté cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : L'OBLIGATION DE RECOURIR À UN MÉCANISME D'AUTHENTIFICATION FORTE NE SUFFIT PAS À FAIRE OBSTACLE AUX PRATIQUES DE FRAUDES AUX VIREMENTS ET AUX PRÉLÈVEMENTS QUI REPRÉSENTE 334 MILLIONS D'EUROS PAR AN
A. L'OBLIGATION DE RECOURIR À UN MÉCANISME D'AUTHENTIFICATION FORTE A ÉTÉ COMPLÉTÉE DEPUIS LE MOIS D'OCTOBRE 2025 PAR UNE OBLIGATION DE MISE À DISPOSITION D'UN INSTRUMENT DE VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE DES COORDONNÉES BANCAIRES
Un « virement SEPA3(*) », ou virement, constitue une opération de paiement par laquelle un prestataire de service de paiement exécute une instruction donnée par un payeur en créditant, à partir du compte du payeur, le compte d'un bénéficiaire désigné par le payeur dans son instruction.
Le virement constitue un moyen de paiement courant, premier moyen de paiement en valeur sur le territoire national, qui représente en 2023 en France 5,7 milliards d'opérations pour un montant total de 30 589 milliards d'euros soit 89 % des transactions en valeur en 20234(*).
Pour renforcer la sécurité des transactions réalisées par virement, le droit de l'Union européenne prévoit, depuis l'entrée en vigueur des dispositions afférentes de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 20155(*), dite « directive sur les services de paiement 2 » (DSP 2), une obligation d'authentification forte du client du prestataire de services de paiement lorsque ce client engage une opération de paiement électronique, ce qui recouvre notamment le cas des virements électroniques.
En application de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, qui transpose les obligations prévues à l'article 97 de la directive (UE) « DPS 2 », les prestataires de services de paiement sont tenus d'appliquer une authentification forte du client lorsqu'il initie une opération de paiement électronique ou qu'il exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude. Cette obligation est assortie de lourdes conséquences dès lors que, en application du V de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le payeur ne supporte aucune conséquence financière en cas de paiement frauduleux réalisé par son prestataire de services de paiement sans authentification forte6(*).
La notion « d'authentification forte » est définie par le droit de l'Union comme une authentification reposant sur deux éléments ou plus, indépendants entre eux, et appartenant aux trois catégories suivantes : « connaissance » (quelque chose que seul le client connaît), « possession » (quelque chose que seul le client possède) et « inhérence » (quelque chose lié à ce que le client est)7(*). En pratique, les prestataires de service de paiement - et en particulier les banques - effectuent l'authentification forte du client en utilisant d'une part les identifiants et codes d'accès au compte (rattachés à la catégorie « connaissance ») et d'autre part le téléphone mobile du client (rattaché à la catégorie « possession »). Les appareils permettant une reconnaissance biométrique offrent la possibilité par surcroît d'utiliser un élément d'authentification rattaché à la catégorie « inhérence ».
L'encadrement normatif des virements effectués au sein de la zone SEPA se trouve actuellement dans une phase de renforcement progressif de leur niveau de sécurisation, parallèlement à l'entrée en vigueur d'un cadre réglementaire ayant pour objet de favoriser la diffusion des paiements instantanés.
En effet, le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 relatif aux virements instantanés en euros8(*) prévoit l'application progressive de nouvelles obligations à la charge des prestataires de services de paiement dont notamment d'une part l'obligation d'offrir la possibilité d'envoyer et de recevoir des virements instantané en appliquant le même tarif que pour un virement standard et d'autre part l'obligation de proposer aux clients des prestataires de services de paiement un service gratuit de contrôle de cohérence des coordonnées bancaires.
L'obligation de proposer à l'ensemble des clients un service gratuit de cohérence des coordonnées bancaires (VoP - Verification of Payee), inscrite à l'article 5 quater du règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 dit « règlement SEPA »9(*), constitue un levier déterminant de sécurisation des virements dans la zone SEPA. Elle est entrée en vigueur le 9 octobre 2025 dans les pays de la zone euro. En pratique, elle impose aux différents prestataires de services de paiement de proposer aux clients de vérifier la concordance entre les coordonnées bancaires indiquées dans l'ordre de virement et le nom du bénéficiaire figurant dans le même ordre.
Ce nouveau service de VoP constituera un instrument légitime et opportun de protection des particuliers dès lors que la législation actuelle décharge entièrement les prestataires de services de paiement de leur responsabilité lorsqu'elle exécute un virement en se fondant sur des coordonnées bancaires fourni par leur client, y compris lorsque le client du prestataire de services de paiement a été victime d'une fraude. Le juge judiciaire a récemment réaffirmé la portée de ce principe en dégageant la banque de toute responsabilité dans le cas d'une fraude dans laquelle un couple ayant acheté une voiture en ligne a effectué un virement vers un compte frauduleux, n'appartenant pas au vendeur de la voiture, dont les coordonnées (IBAN10(*)) leurs avaient été communiqués par courriel à la suite d'un piratage informatique11(*).
Périmètre des prestataires de services de paiement
Les prestataires de services de paiement (PSP) constituent une catégorie de prestataires de service régulés par le code monétaire et financier (CMF). En application de l'article L. 521-1 du CMF, les PSP incluent :
- les établissements de crédit ;
- les établissements de paiement ;
- les établissements de monnaie électronique ;
- les prestataires de services d'information sur les comptes ;
- lorsqu'ils fournissent des services de paiement : la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations.
Un « prélèvement SEPA », ou prélèvement, constitue une opération de paiement par laquelle un bénéficiaire, ou créancier, ordonne le transfert d'une somme vers son compte depuis le compte d'un payeur, ou débiteur, qui lui a préalablement donné son consentement sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Les prélèvements représentent un moyen de paiement courant, par exemple pour payer des abonnements téléphoniques ou de fourniture d'énergie. Les prélèvements représentent en 2023 en France 4,6 milliards d'opérations pour un montant total de 2 139 milliards d'euros, soit 6 % des transactions en valeur en 202312(*).
La réalisation des prélèvements est encadrée à l'échelle française et européenne pour faire obstacle aux fraudes consistant à réaliser des prélèvements de manière indue. En premier lieu, pour réaliser un prélèvement, les bénéficiaires ou créanciers doivent demander un identifiant, appelé ICS (identifiant créancier SEPA), utilisable dans l'ensemble de la zone SEPA. En France, le registre des ICS est tenu par la Banque de France.
En deuxième lieu, le règlement SEPA prévoit expressément d'une part que le payeur donne son consentement au bénéficiaire et d'autre part la possibilité pour les clients de PSP de limiter les prélèvements autorisés à une « liste blanche » de bénéficiaires spécifiés13(*). Pour autant, le rapporteur relève que cette possibilité est peu utilisée14(*) en pratique dès lors que l'oubli de l'ajout d'un bénéficiaire sur la « liste blanche » fait courir au client un risque de facture impayée et, partant, de rupture de service pouvant présenter des risques.
Enfin en troisième lieu, le payeur dispose dans le cas d'un prélèvement d'un délai de contestation particulièrement long qui est de huit semaines en tout état de cause et de treize mois pour un prélèvement pour lequel il n'a pas donné son consentement.
B. PLUSIEURS SCHÉMAS DE FRAUDE PERMETTENT DE CONTOURNER LES MÉCANISMES DE PROTECTION EXISTANTS ET EXPLIQUENT UN VOLUME DE FRAUDE ANNUELLE ATTEIGNANT 334 MILLIONS D'EUROS EN FRANCE POUR LES VIREMENTS ET LES PRÉLÈVEMENTS
En dépit des instruments de lutte contre la fraude aux paiements SEPA15(*), les virements et les prélèvements continuent de constituer des moyens de paiement sujets à la fraude. Selon les données de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) rattaché à la Banque de France, la fraude totale aux moyens de paiement scripturaux atteint 1,2 milliards d'euros en 2023 dont 334 millions d'euros, soit 28 %, pour les paiements SEPA.
La fraude aux virements représente en 2023 un montant total de 312 millions d'euros pour 90 000 opérations frauduleuses, soit une moyenne de 3 400 euros pour les virements concernés16(*).
En vue de contourner la protection constituée par l'obligation d'authentification forte, les fraudes au virement reposent sur deux schémas principaux qui représentent 91 % des fraudes en valeur.
Répartition de la fraude au virement selon le schéma de fraude
(en millions d'euros et en 2023)
Source : commission des finances, d'après les données de l'OSMP
En premier lieu, le schéma de fraude « faux virement » consiste pour un fraudeur à appliquer la procédure suivante :
- obtention des identifiants et codes secrets de la victime, notamment en ayant recours à l'hameçonnage (phishing) ;
- contournement de l'identification forte pour réaliser un virement soit par des techniques de manipulation, par exemple en se faisant passer pour un conseiller bancaire (spoofing), soit par des techniques de détournement de la ligne téléphonique de la victime (SIM swapping) ;
- réception du virement sur un compte dans la zone SEPA puis transfert des sommes concernées en dehors de la zone SEPA pour faire obstacle à leur récupération.
En second lieu, le schéma de fraude « détournement de virement » consiste pour le fraudeur à se faire passer pour le bénéficiaire légitime d'un virement et à transmettre des coordonnées bancaires frauduleuses à la victime. La manipulation consiste souvent pour le fraudeur à se faire passer pour un artisan ou un fournisseur, ou bien pour un supérieur hiérarchique (« fraude au président »). Une fois le virement exécuté, les fonds sont transférés en dehors de la zone SEPA pour faire obstacle à leur récupération.
La fraude au prélèvement représente en 2023 un montant total de 22 millions d'euros pour 78 000 opérations frauduleuses, soit une moyenne de 300 euros pour les prélèvements concernés17(*). Le montant de la fraude au prélèvement connaît de fortes variations annuelles et il a été réduit à hauteur de 62 % entre 2018 et 2023 selon les données de l'OSMP.
Évolution de la fraude au prélèvement depuis 2018
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données de l'OSMP.
La fraude au prélèvement repose principalement sur un schéma de fraude, qualifié de « faux prélèvement », qui concentre 99 % des fraudes en valeur en 2023.
Dans ce schéma, le fraudeur se procure une liste d'IBAN ayant par exemple fait l'objet d'une fuite de données puis le fraudeur engage une demande de prélèvement sur le compte de la victime sans joindre une copie du mandat à l'ordre de prélèvement. Une fois la somme transférée vers le compte bénéficiaire, les fonds sont transférés en dehors de la zone SEPA pour faire obstacle à leur récupération.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UN FICHIER NATIONAL DES COMPTES SIGNALÉS POUR RISQUE DE FRAUDE PERMETTANT UN ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT AUX FINS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
A. LA CRÉATION D'UN REGISTRE CENTRALISANT LES COMPTES SUSPECTS EST UN INSTRUMENT EFFICACE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE EXPÉRIMENTATION PRÉALABLE
Un des instruments envisagés par les acteurs de place - et en particulier par les acteurs bancaires - pour renforcer la lutte contre la fraude aux paiements SEPA est la création d'un système de partage de données entre les prestataires de service de paiement (PSP) dans le but de leur permettre d'identifier rapidement, grâce à leurs coordonnées bancaires (IBAN), les comptes ayant été utilisés par les fraudeurs dans le cadre d'opérations illicites.
Toutefois, comme l'a relevé l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) en septembre 2024 dans son rapport annuel pour 2023, le droit actuel en matière de secret bancaire fait obstacle à une communication directe de ces données entre les banques. L'OSMP a recommandé par conséquent une évolution du cadre normatif pour permettre ce partage d'information (recommandation n°1 du rapport annuel pour 2023 de l'OSMP).
La conformité de ce traitement de données avec le droit national et le droit de l'Union en matière de protection des données personnelles repose sur l'objectif de lutte contre la fraude du dispositif, dès lors que cette finalité constitue un intérêt légitime au regard du droit de l'Union18(*).
Le rapporteur relève que des instruments de partage d'information sur les comptes suspects aux fins de lutte contre la fraude existent déjà dans d'autres pays de l'Union européenne dont notamment aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie ou encore en Autriche19(*).
La communauté bancaire a par suite mené une expérimentation, en coopération avec les services de la Banque de France, pour tester l'efficacité d'un mécanisme de centralisation des informations relatives aux comptes suspectés d'être utilisés par des fraudeurs dans des schémas de fraude aux paiements SEPA. Cette expérimentation, menée pendant une période de référence de cinq mois (de juillet à novembre 2023), a associé les six principaux groupes bancaires français en lien avec la Fédération bancaire française (FBF), la direction générale du Trésor et la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les mesures statistiques menées à l'occasion de cette expérimentation, sans conséquence opérationnelle sur les paiements concernés, ont permis d'établir le fait que le montant des fraudes susceptibles d'être évitées par la mise en place d'un mécanisme de partage d'information excède les coûts associés à la création et à la gestion d'un tel mécanisme20(*).
Il est enfin à relever que l'institution d'un mécanisme de partage d'information entre les prestataires de services de paiement (PSP) fait partie des évolutions proposées à l'échelle européenne par la Commission européenne dans le cadre de sa proposition de règlement sur les services de paiement publiée le 28 juin 202321(*).
Alors que cet acte législatif fait encore l'objet d'une négociation entre les institutions de l'Union européenne, le rapporteur relève que le Conseil de l'Union soutient, dans sa position adoptée en juin 2025, le fait de rendre obligatoire la participation des prestataires de services de paiement à un mécanisme de partage des données relatives à la fraude prévu à l'article 83 de la proposition de règlement.
Si cette obligation venait à être intégrée au futur règlement sur les services de paiement (RSP), la création d'un fichier à l'échelle nationale permettrait d'anticiper la conformité du droit français au droit de l'Union.
B. LE FICHIER NATIONAL DES COMPTES SIGNALÉS POUR RISQUE DE FRAUDE, TENU PAR LA BANQUE DE FRANCE, SERAIT FINANCÉ ET ALIMENTÉ PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT (PSP)
L'objet de l'article 1er de la proposition de loi est de donner une base légale à la création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude, qui serait géré par la Banque de France. Il prévoit la création à cet effet d'un nouvel article L. 521-6-1 dans le code monétaire et financier.
Le I de ce nouvel article prévoit la création d'un fichier national des comptes que les prestataires de services de paiement établis ou exerçant en France estiment susceptibles d'être frauduleux. Le périmètre des acteurs tenus d'effectuer des signalements exclut expressément les prestataires de services d'information sur les comptes et les établissements de paiement fournissant exclusivement un service d'initiation de paiement. Ces exclusions ciblées sont justifiées par le fait que ces prestataires ne réalisent pas de prélèvement ni de virement sur des comptes de paiement.
Ce fichier, qui est géré par la Banque de France, recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiements et les comptes de dépôt. Il comprend également des éléments caractérisant la suspicion de fraude.
Le II de ce nouvel article consacre la responsabilité des prestataires de services de paiement (PSP) dans la fourniture des données contenues dans le fichier. Les PSP, qui sont tenus de réaliser les signalements en cas de suspicion de fraude établie notamment dans le cadre de leur mécanisme de contrôle interne, sont également tenus d'actualiser le fichier lorsque les motifs de soupçons disparaissent ou qu'un faisceau d'indice suggère qu'un compte signalé a été ouvert à la suite d'une usurpation d'identité.
Le II précise également expressément que les frais afférents à la tenue du fichier ne sont pas refacturés aux clients soupçonnés et que les PSP sont responsables des données figurant dans le fichier qui leurs sont transmises.
Le II bis A prévoit la possibilité pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de signaler à la Banque de France les comptes qu'elles estiment suspects. Il précise que l'inscription des comptes dans le fichier est effectuée par la Banque de France sous réserve de ses propres contrôles.
Le II bis précise expressément d'une part que l'inscription d'un compte dans le fichier national des comptes signalés pour risque de fraude n'a pas pour effet d'interdire les opérations de paiement impliquant ce compte et d'autre part que cette inscription ne saurait être seul un motif de résiliation d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt. Le II bis précise également que le PSP teneur d'un compte déclaré procède sans délai aux diligences ayant pour objet d'évaluer son caractère frauduleux lorsqu'un compte est inscrit dans le fichier.
Le III fixe un principe de confidentialité des données inscrites dans le fichier en interdisant à la Banque de France et aux PSP de diffuser ces informations. Il précise également que la Banque de France est déliée du secret professionnel dans le cadre de l'utilisation de ce fichier conformément au nouvel article L. 521-6-1 du code.
Le IV renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), pour la fixation de la nature des données du fichier ainsi que leurs modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation.
Le V renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Banque de France, pour la fixation des tarifs acquittés par les prestataires de services de paiement pour couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.
Parallèlement à la création de ce nouvel article L. 521-6-1, et à une coordination d'ordre légistique, l'article 1er fixe également en son III une date d'entrée en vigueur différée fixée à six mois après la promulgation de la loi.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ASSEMBLÉE NATIONALE A PRÉCISÉ LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU FICHIER ET LE PÉRIMÈTRE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'EFFECTUER UN SIGNALEMENT
Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'article 1er a été modifié par l'adoption de cinq amendements dont un lors de l'examen en commission.
Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur Labaronne, qui a été lui-même modifié par deux sous-amendements.
Cette nouvelle rédaction globale avait notamment pour objet, sans modifier l'économie générale du mécanisme de partage d'information à travers un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude, d'inclure les institutions financières publiques dans le champ de l'obligation de signalement lorsqu'elles fournissent des services de paiement et de prévoir une entrée en vigueur différée du dispositif, six mois après la promulgation de la loi.
Au stade de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements dont trois de précisions rédactionnelles.
L'Assemblée nationale a également adopté l'amendement n° 21 de la députée Françoise Buffet, ayant reçu deux avis défavorables du Gouvernement et de la commission, qui ouvre la possibilité aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de réaliser un signalement auprès de la Banque de France en cas de suspicion de compte frauduleux - la Banque de France étant chargée le cas échéant de procéder à l'inscription du compte dans le fichier après avoir réalisée son propre contrôle.
LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LA CRÉATION D'UN FICHIER NATIONAL DES COMPTES SIGNALÉS POUR RISQUE DE FRAUDE EST UNE RÉFORME UTILE POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX VIREMENTS ET AUX PRÉLÈVEMENTS QUI DEVRA ÊTRE COMPLÉTÉE PAR DES RÉFORMES ULTÉRIEURES
A. LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES SUSPECTS EST UN LEVIER OPPORTUN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET COHÉRENT AVEC LES ÉVOLUTIONS À VENIR DU CADRE NORMATIF EUROPÉEN
Au regard de l'importance d'adapter le cadre normatif à l'évolution des techniques de fraude, le rapporteur soutient pleinement le dispositif centralisé de partage d'information prévu par cet article à travers la création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude.
Le montant des fraudes aux paiements SEPA, qui atteint 334 millions d'euros en 2023, justifie pleinement la mobilisation de nouveaux instruments de lutte comme l'avait recommandé du reste l'Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement dans son rapport annuel pour 2023 publié en septembre 2024.
La création de ce fichier est d'autant plus opportune qu'elle répond à une demande des acteurs bancaires qui partagent avec leurs clients un intérêt dans le fait de lutter efficacement contre la fraude aux paiements SEPA. Le rapporteur relève enfin que cette création fait suite à une expérimentation dont les résultats en matière de lutte contre la fraude se sont révélés concluants.
Parallèlement, le rapporteur remarque également que ce renforcement de notre arsenal législatif contre la fraude au virement et au prélèvement s'inscrit dans un contexte normatif plus large de renforcement de la protection des clients des prestataires de services de paiement. En effet, la création du fichier national interviendra peu de temps après l'entrée en vigueur dans la zone euro en octobre 2025 de l'obligation pour les PSP de proposer un service de contrôle de cohérence des coordonnées bancaires (VoP) gratuit à leurs clients. Enfin, ce fichier national s'inscrit dans le droit fil de la proposition de règlement sur les services de paiement (RSP) de la Commission européenne et il pourrait constituer, selon le texte définitivement adopté à l'échelle de l'Union, une mise en conformité anticipé avec le droit de l'Union européenne.
B. LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX VIREMENTS ET AUX PRÉLÈVEMENTS DEVRAIT ÊTRE COMPLÉTÉ EN TENANT COMPTE DES ÉVOLUTIONS ACTUELLES OU À VENIR DES SCHÉMAS DE FRAUDE
Le rapporteur relève également que, sans remettre en cause l'opportunité de créé un fichier national de signalement, ce dispositif ne sera pas suffisant pour mettre fin à la fraude aux virements et aux prélèvements et qu'il devra être complété par des mesures complémentaires dans des textes législatifs ou réglementaires à venir.
En premier lieu, le rapporteur souligne que le fichier national des comptes signalés pour risque de fraude doit avoir un caractère évolutif pour être à même de s'adapter à l'apparition de nouveaux schémas de fraude. L'arrêté d'application prévu au IV du nouvel article L. 521-6-1 du code monétaire et financier doit à ce titre permettre une évolution rapide de ce mécanisme en cas d'apparition de nouveaux schémas de fraude.
Le rapporteur relève à ce titre que le dispositif actuel risque d'être perméable à l'utilisation systématique par les fraudeurs de « coordonnées virtuelles » (IBAN virtuel) et que la pratique devra permettre aux autorités publiques de faire évolue le dispositif à l'usage pour faire également échec à ce type de stratégie.
En second lieu, le rapporteur note qu'une attention particulière doit être apportée au risque croissant d'usurpation d'identité dans le cadre de création de comptes de paiement ou de comptes de dépôts. L'exemple récent d'une fuite massive de données personnelles à l'occasion de l'attaques intervenue en janvier 2024 de deux entreprises exerçant une activité dans le secteur des mutuelles et des complémentaires santé illustre ce risque accru de fraude par usurpation d'identité.
Le rapporteur relève à ce titre que les demandes d'accès au fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) peuvent être réalisées depuis janvier 2025 directement depuis l'espace particulier du site « impots.gouv.fr »22(*). Ce fichier, géré par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), recense l'ensemble des comptes et coffres forts ouverts auprès d'établissements bancaires en France23(*) et sa consultation par un usager permet de vérifier qu'aucun compte frauduleux n'a été ouvert en son nom.
Les particuliers disposant désormais d'une procédure simplifiée de demande de consultation des informations du Ficoba les concernant, le rapporteur estime que ce dispositif devrait être renforcé dans les années à venir. En effet, la procédure simplifiée actuellement mise en oeuvre présente plusieurs limites liées d'une part au fait qu'il continue d'exister un temps de traitement de la demande par l'administration fiscale en conséquence de quoi la consultation par l'usager des informations du Ficoba le concernant ne peut être faite que de manière différée et d'autre part au fait que la communication réalisée par l'administration fiscale sur cette possibilité a été modeste en conséquence de quoi la possibilité de consulter certaines informations contenues dans le Ficoba reste largement méconnue des usagers.
Le rapporteur propose par conséquent de permettre non seulement une information en temps réel des particuliers relative aux données les concernant contenues dans le Ficoba, ainsi qu'un mécanisme de notification systématique des usagers lorsqu'un compte bancaire et assimilé est ouvert à leur nom.
Ce mécanisme, de type « push »24(*), constituera un complément utile, en matière de lutte contre la fraude au virement et au prélèvement, au fichier national de signalement dont la création est prévue par le présent article.
Si la mesure prévue par le présent article est utile et attendue, elle est loin d'être à la hauteur des enjeux soulevés par l'ensemble des fraudes aux moyens de paiement et en particulier aux cas de fraude associés à des usurpations d'identité pour lesquels nos concitoyens sont aujourd'hui insuffisamment protégés. L'examen à venir de plusieurs initiatives législatives dans ce domaine25(*) pourront être l'occasion de compléter notre dispositif de lutte contre ces fraudes aux moyens de paiement.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 1er bis
Intégration d'indicateurs de
performance du fichier national des comptes signalés pour risque de
fraude (FNC-RF) au rapport annuel
de l'Observatoire de la
sécurité des moyens de paiement (OSMP)
Le présent article a pour objet d'intégrer expressément au rapport annuel d'activité de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements (OSMP), prévu par la loi, des indicateurs de performance relatifs au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude dont la création est prévue par l'article 1er.
Le rapporteur relève que les missions de l'OSMP, organe de concertation associant l'administration centrale, le Parlement et les principales parties prenantes en matière de sécurité des moyens de paiement, sont cohérentes avec le suivi de la performance du FNC-RF.
L'intégration au rapport annuel de l'OSMP d'indicateurs de performance du FNC-RF constitue dès lors un levier opportun pour suivre l'efficacité de ce dispositif et orienter d'éventuelles évolutions à venir.
La commission a adopté cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : L'OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS DE PAIEMENT (OSMP) EST UN ORGANE D'EXPERTISE ET DE CONCERTATION CHARGÉ D'UNE MISSION DE SUIVI DES MESURES PRISES ET DE PROPOSITION DE NOUVELLES MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURISATION DES MOYENS DE PAIEMENT
L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement est un organe de concertation et d'expertise en matière de sécurité des moyens de paiement. Il a été institué par la loi « Vaillant » du 15 octobre 2001 relative à la sécurité quotidienne26(*), sous la dénomination « Observatoire de la sécurité des cartes de paiement ». La loi « Sapin 2 » du 9 décembre 201627(*) a renommé cet organe, qui est devenu l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, et élargi ses compétences à l'ensemble des moyens de paiement.
Si le secrétariat de l'OSMP est assuré par la Banque de France depuis sa création en 2001, l'OSMP s'appuie sur l'expertise croisée de ses membres qui représentent à la fois le Parlement, les administrations concernées, les émetteurs de moyens de paiement, les opérateurs de systèmes de paiement, les associations de commerçants, les associations d'entreprises et les associations de consommateurs. La composition précise de l'OSMP est fixée par le pouvoir réglementaire28(*).
Le I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, qui consacre dans la loi les fonctions de l'OSMP, prévoit trois missions expresses pour cet organe :
- assurer le suivi des mesures de sécurisation des moyens de paiement ;
- établir les statistiques de la fraude aux moyens de paiement ;
- réaliser une veille en matière de moyens de paiement dans le but de proposer des moyens de lutte contre la fraude aux moyens de paiement.
Enfin, le I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier prévoit que l'OSMP établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre des finances et transmis au Parlement.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ASSEMBLÉE NATIONALE A PROPOSÉ D'INTÉGRER AU RAPPORT ANNUEL DE L'OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS DE PAIEMENT DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU FICHIER NATIONAL DES COMPTES SIGNALÉS POUR RISQUE DE FRAUDE
La proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale ne comprenait aucune modification des dispositions de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier relatives à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP).
L'article 1er bis de la proposition de loi a été créé par l'amendement n° 22 de la députée Françoise Buffet, adoptée par l'Assemblée nationale en séance publique avec deux avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Cet article prévoit de modifier le I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier pour intégrer explicitement au contenu du rapport annuel d'activité de l'OSMP des indicateurs de performance du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LE SUIVI DE LA PERFORMANCE DU FICHIER NATIONAL DES COMPTES SIGNALÉS POUR RISQUE DE FRAUDE EST UN LEVIER OPPORTUN POUR GARANTIR SON EFFICACITÉ
Le rapporteur relève que les travaux de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiements constituent des documents de référence à la disposition des autorités gouvernementales et du Parlement en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiements.
Une partie des mesures proposées par la présente proposition de loi sont à ce titre inspirées des travaux de l'OSMP et plus particulièrement des recommandations de son rapport annuel pour 2023 publié en septembre 2024.
La qualité des travaux de l'OSMP repose notamment sur sa composition qui associe non seulement des experts techniques représentants l'administration centrale et la Banque de France mais également des membres du Parlement ainsi que les différentes parties prenantes de « l'écosystème des moyens de paiements » dont notamment les acteurs bancaires, les associations de commerçants et les associations de consommateurs.
Il est dès lors souhaitable de confier à l'OSMP une mission explicite de suivi de la performance du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude avec des indicateurs qui pourront mesurer notamment le nombre de signalements annuels, le nombre de fraudes détectées et empêchées grâce à ces signalements, ainsi que le montant de ces fraudes en valeur qui pourra être comparé aux coûts totaux du dispositif pour en mesurer l'efficience.
Le rapporteur relève par suite que l'intégration au rapport annuel de l'OSMP d'indicateurs de performance du FNC-RF constitue une mesure opportune qui permettra par surcroît d'orienter le législateur ou le pouvoir réglementaire en matière d'évolution du dispositif si nécessaire.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 2
Élargissement des obligations de
signalement à la Banque de France
pesant sur les tirés ayant
rejeté un chèque aux fins de mise à jour
du fichier
national des chèques irréguliers (FNCI)
Le présent article a pour objet d'élargir les obligations de signalement à la Banque de France pesant sur les tirés ayant refusé de payer un chèque.
La rédaction actuelle de l'article L. 131-84 prévoit une obligation de signalement à la charge du tiré en cas de défaut de provision suffisante, de compte clôturé ou d'opposition pour perte ou vol d'un chèque présenté pour paiement.
Conformément au périmètre du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) tenu par la Banque de France, cet article prévoit d'intégrer aux obligations de signalement à la Banque de France des tirés le cas dans lequel un banquier rejette un faux chèque, qu'il soit falsifié ou contrefait.
Cette mesure ayant pour objet de compléter les cas couverts par l'article L. 131-84 constitue une codification bienvenue d'une pratique de place dans un contexte dans lequel la fraude au chèque représente un préjudice annuel de 364 millions d'euros.
La commission a adopté cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LE FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS EST UN FICHIER DE CENTRALISATION DES INFORMATIONS SUR LES CHÈQUES ILLICITES GÉRÉ PAR LA BANQUE DE FRANCE POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX CHÈQUES
A. LE FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS, GÉRÉ PAR LA BANQUE DE FRANCE, EST UN DISPOSITIF CENTRALISÉ DE PARTAGE D'INFORMATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU CHÈQUE
Pour renforcer la lutte contre la fraude au chèque et faciliter les contrôles de régularité effectués par les commerçants, le pouvoir réglementaire a institué en 1992, après avis de la Cnil, un fichier national des chèques irréguliers (FNCI)29(*).
Le FNCI est un dispositif de partage d'information aux fins de lutte contre la fraude dont la gestion centralisée est assurée par la Banque de France30(*). Le fichier de base du FNCI recense les informations suivantes :
- les coordonnées bancaires des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ;
- les éléments d'identification des faux chèques ;
- les coordonnées bancaires des comptes clôturés sur lesquels des chèques ont été émis ;
- les coordonnées bancaires et, lorsqu'ils sont connus, les numéros de formules des comptes pour lesquels une déclaration de perte ou de vol a été enregistrée.
Le FNCI se distingue du fichier central des chèques (FCC) qui recense, dans l'objectif d'informer les établissements de crédit, les personnes frappées d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ou d'un retrait de carte par leur banque.
La mise à jour du FNCI repose notamment sur la fourniture de données à la Banque de France par les banquiers qui sont tenus, en qualité de tirés31(*), de transmettre à la Banque de France des déclarations d'incidents de paiement et des déclarations relatives au refus de paiement d'un chèque pour cause de clôture du compte sur lequel les formules ont été délivrées ou pour cause d'opposition pour perte ou vol.
Cette obligation de signalement à la Banque de France à la charge des banquiers est inscrite à l'article L. 131-84 du code monétaire et financier. Dans le cas des déclarations des incidents de paiement, l'obligation de déclaration est assortie d'une amende de 12 000 euros en cas d'omission de déclaration d'un incident de paiement à la Banque de France par le tiré32(*).
B. LA FRAUDE AU CHÈQUE REPRÉSENTE UN PRÉJUDICE DE 364 MILLIONS D'EUROS EN 2023 MALGRÉ LA MISE EN PLACE D'INSTRUMENT DE LUTTE CONTRE CETTE FRAUDE DONT LE FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS
Le chèque est un moyen de paiement qui connaît un net recul dans son utilisation sur le territoire national. D'après les données de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), le montant des chèques échangés est passé de 891 milliards d'euros en 2018 à 467 milliards d'euros en 2023 soit un recul de 48 %.
Évolution dans le temps du montant des chèques échangées
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données de l'OSMP
Pour autant, le chèque constitue un moyen de paiement particulièrement sujet à la fraude et il représente, en taux de fraude, le premier vecteur de fraude aux moyens de paiement avec un taux de 0,078 % en 2023.
Le premier schéma de fraude en valeur en matière de fraude au chèque est la perte ou le vol de formules de chèques qui représente 66 % de la fraude en valeur en 2023 soit 240 millions d'euros.
En incluant l'ensemble des schémas de fraude, la fraude au chèque représentait un montant total de 364 millions d'euros répartis entre 204 000 opérations, soit une fraude moyenne de 1 800 euros33(*).
II. LE DROIT PROPOSÉ : UN ÉLARGISSEMENT DES OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT À LA BANQUE DE FRANCE POUR LES TIRÉS AYANT REJETÉ UN CHÈQUE POUR FALSIFICATION OU CONTREFAÇON
L'article 2 de la proposition de loi prévoit de modifier l'article L. 131-84 du code monétaire et financier pour compléter les cas dans lesquels le tiré est tenu d'opérer un signalement à la Banque de France aux fins de renseigner le FNCI.
En effet, dans l'état actuel du droit, l'obligation de signalement prévue à l'article L. 131-84 couvre les cas de refus de paiement lié à un défaut de provision, à la clôture du compte et à l'opposition pour perte ou vol. En revanche, elle ne prévoit pas expressément le signalement en cas de rejet par le tiré d'un faux chèque, c'est-à-dire d'un chèque contrefait34(*) ou falsifié35(*).
Alors que les banquiers réalisent en pratique un signalement à la Banque de France lorsqu'ils rejettent un faux chèque, et que des dispositions réglementaires36(*) prévoient déjà que le FNCI contient les éléments d'identification des faux chèques, cet article a pour objet de codifier cette pratique de signalement en prévoyant expressément une obligation de signalement à la charge du tiré en cas de rejet d'un faux chèque.
Le dernier alinéa de l'article prévoit également d'intégrer à l'article L. 131-84 un renvoi express à des dispositions réglementaires d'application précisant les modalités des signalements prévus par cet article, ces modalités étant aujourd'hui fixées par les articles R. 131-26 et R. 131-32 du code monétaire et financier.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ DES PRÉCISIONS RÉDACTIONNELLES SANS MODIFIER LA PORTÉE DE CET ARTICLE
Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'article 2 a été modifié par l'adoption de deux amendements.
Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur Labaronne.
Au stade de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur Labaronne, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, apportant des précisions rédactionnelles et introduisant un renvoi à des mesures réglementaires d'application.
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : L'ÉLARGISSEMENT DES OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT À LA BANQUE DE FRANCE À CHARGE DES TIRÉS EN CAS DE REJET D'UN CHÈQUE EST UN LEVIER BIENVENU DE CONSOLIDATION DU FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS
En dépit du recul progressif de l'usage du chèque comme moyen de paiement, les formules de chèque continuent malheureusement de constituer un vecteur déterminant de fraude, avec un montant estimé à 364 millions d'euros de fraudes au chèque en 2023 comme il a été rappelé.
Au regard du taux de fraude particulièrement important sur les chèques, qui représentent 1,4 % des paiements en valeur mais 30 % des fraudes en 202337(*), le rapporteur souligne qu'il est impératif que les instruments de lutte contre la fraude au chèque soient préservés, voire renforcés lorsque cela est possible.
Par suite, l'ajustement technique relatif au fichier national des chèques irréguliers (FNCI) proposé par cet article, consistant à codifier dans la loi la pratique de signalement systématique à la Banque de France par le tiré lorsqu'il rejette un chèque falsifié ou contrefait, constitue une consolidation bienvenue de l'arsenal normatif de lutte contre la fraude.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 3
Création d'un service de consultation
du fichier national
des chèques irréguliers (FNCI) par le
banquier au moment
de la présentation du chèque au paiement
Le présent article a pour objet de créer un service de consultation du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) ouvert au banquier de l'établissement du remettant lors de la présentation d'un chèque au paiement.
Ce nouveau service se distingue du service « Vérifiance » proposé par la Banque de France en application de l'article L. 131-86 du code monétaire et financier qui permet de vérifier la régularité d'un chèque et qui est ouvert exclusivement aux personnes ayant accepté un chèque comme paiement d'un bien ou d'un service - situation dans laquelle le banquier de l'établissement du remettant ne se trouve pas.
La création de ce nouveau service constitue un vecteur d'accélération de la détection des fraudes au chèque et, partant, un instrument de renforcement de l'efficacité de cette lutte.
La commission a adopté cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LE SERVICE « VÉRIFIANCE » DE LA BANQUE DE FRANCE PERMET AUX PROFESSIONNELS D'INTERROGER LE FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS POUR CONTRÔLER LA RÉGULARITÉ D'UN PAIEMENT PAR CHÈQUE
Le fichier national des chèques irréguliers (FNCI) est un fichier centralisé de lutte contre la fraude au chèque38(*), géré par la Banque de France, qui recense les comptes des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, les faux chèques, les comptes clôturés sur lesquels des chèques ont été émis ainsi que les comptes ayant fait l'objet d'une opposition pour cause de perte ou de vol39(*).
En application de l'article L. 131-86 du code monétaire et financier et pour donner aux personnes acceptant des paiements, dont en particulier les commerçants, des moyens de lutte contre la fraude, la Banque de France propose le service « Vérifiance », accessible sur abonnement, qui permet à une personne recevant un chèque comme moyen de paiement d'un bien ou service de vérifier la régularité de ce chèque. Pour garantir la protection des données personnelles, l'article L. 131-86 du CMF prévoit également que l'origine des demandes d'information est enregistrée.
En pratique, ce service repose sur un code couleurs en indiquant à l'usager, à partir de la lecture de ligne codée en bas du chèque, un voyant qui peut être vert (si le chèque n'est pas enregistré dans le FNCI), orange (si le compte est enregistré au titre de la perte ou du vol des formules de chèques) ou rouge (si le chèque ou le compte sont inscrits au FNCI).
II. LE DROIT PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UN SERVICE D'INTERROGATION DU FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS OUVERTS AUX BANQUIERS
L'article 3 de la proposition de loi prévoit de modifier l'article L. 131-86 du code monétaire et financier, qui constitue la base légale du service « Vérifiance », pour y ajouter un alinéa relatif à un service de consultation à destination des banquiers souhaitant vérifier la régularité des chèques lors de leur présentation au paiement.
Cette rédaction, qui maintient un enregistrement de l'origine des demandes d'information, permet de couvrir un nouveau cas d'usage dès lors que la législation actuelle impose à la Banque de France de réserver le service « Vérifiance » aux personnes qui acceptent un chèque comme paiement d'un bien ou d'un service, ce qui ne correspond pas à la situation dans laquelle se trouver le banquier de l'établissement du remettant, c'est-à-dire l'établissement de crédit du bénéficiaire du chèque, lorsque le bénéficiaire remet le chèque à l'encaissement.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ DES PRÉCISIONS RÉDACTIONNELLES SANS MODIFIER LA PORTÉE DE CET ARTICLE
Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'article 3 a été modifié par l'adoption d'un unique amendement rédactionnel, déposé au stade de l'examen en commission par le rapporteur Labaronne.
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : L'OUVERTURE AUX BANQUIERS DE LA POSSIBILITÉ D'INTERROGER LE FICHIER NATIONAL DES CHÈQUES IRRÉGULIERS CONSTITUE UNE MESURE UTILE POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
En dépit du recul progressif de l'usage du chèque comme moyen de paiement, les formules de chèque continuent malheureusement de constituer un vecteur déterminant de fraude, avec un montant estimé à 364 millions d'euros de fraudes au chèque en 2023.
Le rapporteur souligne que le FNCI, ainsi que sa consultation à travers le service « Vérifiance », constitue un instrument insuffisamment mobilisé. En effet, le taux d'utilisation du service « Vérifiance » pour consulter le FNCI et contrôler la régularité des chèques émis est de seulement 3,2 % en 2023. Par suite, si le FNCI a permis de déjouer 7,7 % des tentatives d'utilisation de chèques frauduleux en 2022, la performance de cet instrument peut être amélioré en renforçant les outils de mobilisation du FNCI.
Par suite, l'ouverture d'un nouveau service d'interrogation du FNCI ouvert aux banquiers lors de la présentation du chèque au paiement constitue une voie de renforcement de l'efficacité du FNCI en élargissant sa diffusion tout en maintenant un périmètre compatible avec le respect du droit à la protection des données.
Le rapporteur relève à ce titre que l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) avait recommandé dans son rapport annuel pour 2020, publié en juillet 2021, de « permettre aux banques en tant que présentateurs de chèques de consulter le fichier national des chèques irréguliers (FNCI) » (recommandation n° 2)40(*). L'ouverture de cette possibilité a pour effet d'étoffer les procédures de contrôle lors de la remise à l'encaissement des chèques.
Par suite, le rapporteur remarque que la modification de la loi proposée par cet article, qui permet la mise en place par la Banque de France d'un nouveau service de vérification de la régularité des chèques accessible aux banquiers lors de la présentation d'un chèque au paiement, constitue un élément de consolidation souhaitable du dispositif normatif de lutte contre la fraude au chèque.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 4
Coordination pour assurer
l'applicabilité de la proposition de loi
dans les
collectivités d'outre-mer
Le présent article a pour objet d'assurer l'applicabilité des mesures prévues par la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer.
Il prévoit une adaptation des modalités d'application de ces mesures dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il est souhaitable que les mesures de lutte contre la fraude aux moyens de paiement s'appliquent de manière adaptée sur l'ensemble du territoire, y compris dans les collectivités d'outre-mer.
La commission a adopté cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LA NOUVELLE-CALÉDONIE, LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA SONT RÉGIES PAR LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ LÉGISLATIVE
La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont des collectivités régies par le principe de spécialité législative, consacré par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna et par la loi organique du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie41(*), en application duquel les dispositions législatives n'y sont applicables que sous réserve d'une mention expresse de cette applicabilité dans la loi et peuvent faire l'objet d'adaptation à l'organisation particulière de ces collectivités.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'INTRODUCTION DE DISPOSITIONS DE COORDINATION POUR GARANTIR L'APPLICABILITÉ DES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
La proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale ne comprenait aucune disposition de coordination pour assurer l'applicabilité des mesures de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer.
L'article 4 de la proposition de loi a été créé par l'amendement n° CF30 du rapporteur Daniel Labaronne, adopté par l'Assemblée nationale en commission des finances.
Cet article prévoit de modifier le livre VII de la partie législative du code monétaire et financier d'une part pour prévoir expressément l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des modifications des articles L. 131-84 et L. 131-86 du code monétaire et financier et du nouvel article L. 521-6-1 du même code et d'autre part pour adapter la rédaction du nouvel article L. 521-6-1 du code monétaire et financier pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour y intégrer l'Institut d'émission d'outre-mer qui est compétent pour mettre en oeuvre la politique monétaire de l'État dans la zone du franc CFP42(*).
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LES MESURES CONTRE LA FRAUDE PRÉVUES PAR LA PROPOSITION DE LOI ONT VOCATION À S'APPLIQUER EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Les mesures de lutte contre la fraude aux moyens de paiement prévues par le présent projet de loi ont vocation à s'appliquer dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Par suite, il est opportun que des mesures spécifiques prévoient l'adaptation et l'applicabilité des mesures de la proposition de loi dans ces collectivités d'outre-mer.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 22 octobre sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a examiné le rapport de Mme Nathalie Goulet, rapporteur, et élaboré le texte de commission sur la proposition de loi n° 496 (2024-2025), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
M. Claude Raynal, président. - Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
Cet examen intervient selon la procédure de législation en commission, prévue par les articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, conformément à la décision prise en ce sens par la Conférence des présidents.
Selon cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote du texte. La proposition de loi fera l'objet d'un seul vote en séance publique le 29 octobre prochain et ne pourra pas faire l'objet d'amendements en séance, sauf si le retour à la procédure normale est demandé d'ici à vendredi prochain, avant 17 heures. Si tel n'est pas le cas, seuls seront recevables en séance les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec des textes en vigueur, ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle.
La réunion est ouverte à l'ensemble des sénateurs. Si chacun peut s'exprimer à l'occasion de l'examen des articles et des amendements, seuls les membres de notre commission peuvent voter.
Notre réunion est ouverte au public et fait l'objet d'une captation vidéo, retransmise en direct sur le site internet du Sénat.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Nous examinons la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, qui a été déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 4 février dernier par Daniel Labaronne.
Dans la mesure où l'objectif de lutte contre la fraude aux moyens de paiement est consensuel, la proposition de loi a été accueillie favorablement sur tous les bancs de l'Assemblée et elle a finalement été adoptée, à l'unanimité, le 31 mars dernier.
Notre réunion de ce matin s'inscrit donc dans un processus législatif consensuel et relativement rapide. Ce texte est attendu.
Pour permettre ce renforcement rapide de notre arsenal de lutte contre la fraude aux moyens de paiement, j'ai procédé aux auditions relatives à ce texte dès le mois de juillet dernier. Nous étions ainsi prêts pour l'examen de ce texte dès le début du mois de septembre, conformément au calendrier initialement fixé, mais celui-ci a été perturbé par les péripéties gouvernementales que je n'ai pas besoin de rappeler.
La fraude aux moyens de paiement est un phénomène de masse qui concerne chacun d'entre nous, comme usager et comme victime potentielle. Le préjudice total était estimé, en 2023, à 1,2 milliard d'euros par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP).
Le montant de la fraude au paiement Sepa - espace unique de paiement en euros -, dans l'espace unique de paiement en euros, qui concerne la fraude au virement et au prélèvement bancaire, d'une part, et la fraude au chèque, d'autre part, est estimé à 698 millions d'euros chaque année. La proposition de loi couvre par conséquent 58 % des montants annuels des fraudes au paiement.
Nous avons pris du retard en matière de sensibilisation et de prévention. La question est non pas de savoir si nous allons nous faire pirater un jour, mais quand ! Il faut donc sensibiliser les gens à cette fraude. C'est un sujet d'une importance capitale lorsque l'on sait que les organismes de sécurité sociale peuvent eux-mêmes être piratés et que les données ainsi collectées sont susceptibles d'être utilisées pour d'autres usages, comme la fraude aux moyens de paiement.
La Cour de cassation a rappelé expressément, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2025, que si un client indiquait de mauvaises coordonnées bancaires pour un virement après avoir été manipulé par un fraudeur, la banque était entièrement dégagée de sa responsabilité. Dans le cas d'espèce, un couple, qui avait viré une somme d'argent vers un compte frauduleux en pensant régler un concessionnaire automobile, a dû subir seul le préjudice de la fraude dont il a été victime.
Un nombre croissant de nos concitoyens sont victimes de ce type de fraude par détournement d'un virement légitime. Selon un mode opératoire fréquemment rencontré, la boîte mail d'un commerçant ou d'un artisan est piratée et l'ensemble de leurs correspondants reçoivent alors un courriel indiquant que leur paiement doit être fait sur un nouveau compte bancaire, dont le numéro Iban n'est pas celui du commerçant ou de l'artisan. Évidemment, les fonds sont à ce moment-là détournés. Il s'agit d'une fraude d'une facilité déconcertante qui, malheureusement, a un impact très important. Il est donc impératif que nous agissions.
Sur le plan de la technologie, les schémas de fraude sont en constante évolution. Les outils de piratage informatique ne cessent de se perfectionner et il y a fort à craindre que le perfectionnement de l'intelligence artificielle (IA) générative, en particulier des technologies d'imitation de la voix ou d'une vidéo (deepfake), ne se traduise par une aggravation inquiétante des cas de fraude par manipulation.
Pour lutter contre la fraude au paiement Sepa, la proposition de loi crée un nouveau dispositif : le fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF).
Ce fichier national, qui recensera les coordonnées bancaires - c'est-à-dire les Iban - jugées douteuses ou suspectes par les prestataires de services de paiement et notamment les banques, constituera un outil essentiel de partage d'information pour lutter contre la fraude.
En effet, dans l'état actuel du droit, le secret bancaire empêche les banques qui le souhaiteraient d'échanger entre elles des informations sur les comptes qu'elles identifient comme suspects.
L'introduction d'un fichier centralisé géré par un tiers de confiance, qui sera en l'espèce la Banque de France, permet de concilier le double objectif de protection proportionnée des données personnelles, d'une part, et de partage rapide et efficace des soupçons de fraude portant sur un ou plusieurs Iban, d'autre part.
J'ajoute que la création de ce fichier s'inscrit pleinement en cohérence avec l'évolution actuelle ou à venir du cadre européen de sécurisation des virements Sepa.
Comme de nombreux usagers ont pu le constater, l'entrée en vigueur du règlement européen du 13 mars 2024 sur les virements instantanés a eu pour effet d'imposer aux prestataires de paiement de la zone euro, depuis le 9 octobre dernier, de mettre en place un service gratuit de vérification de la cohérence des coordonnées bancaires. Grâce à ce service, nous sommes désormais tous mis en mesure de vérifier la cohérence entre l'Iban que nous indiquons et le nom du bénéficiaire avant de valider un virement.
À moyen terme, le renforcement du partage d'information entre les prestataires de services de paiement est l'un des leviers de lutte contre la fraude identifiée par la Commission européenne dans sa proposition de règlement sur les services de paiement publiée en juin 2023. La création du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude constituera donc une mise en conformité anticipée du droit français avec le droit européen - ce qui placera la France aux avant-postes sur ce sujet.
En matière de fraude au chèque, les mesures prévues par le texte concernent essentiellement l'amélioration du fonctionnement du fichier national des chèques irréguliers (FNCI).
Créé en 1992 et géré directement par la Banque de France, le FNCI est un outil majeur de la lutte contre la fraude au chèque. Il permet de recenser l'ensemble des personnes frappées par une interdiction bancaire ou pénale d'émettre un chèque, ainsi que l'ensemble des comptes clôturés, des faux chèques et des chèques sur lesquels une opposition a été activée pour cause de perte ou de vol.
La proposition de loi prévoit deux mesures techniques qui seront précieuses pour renforcer l'utilisation du FNCI, car celui-ci est sous-utilisé : son taux de consultation était seulement de 3,2 % en 2023.
La première mesure consiste à inscrire dans la loi une obligation de signalement à la Banque de France lorsqu'une banque rejette un chèque contrefait ou falsifié.
La seconde mesure vise à élargir le nombre des personnes susceptibles de pouvoir interroger le FNCI avant d'accepter un chèque en intégrant les banquiers lors de la présentation du chèque au paiement.
Après avoir présenté ces mesures essentiellement techniques, je voudrais aborder maintenant les perspectives. En effet, madame la ministre, nous allons examiner un certain nombre de textes relatifs à la lutte contre la fraude dans les prochaines semaines. Il sera utile de muscler encore les dispositifs existants. Ce n'est pas possible à l'occasion de l'examen de ce texte, car son adoption est urgente et qu'il me paraît plus sage que le Sénat l'adopte dans des termes conformes au texte transmis pour assurer son entrée en vigueur rapide. Toutefois, l'examen des textes à venir nous permettra de débattre et d'adopter d'autres dispositifs.
En ce qui concerne la fraude bancaire liée à une usurpation d'identité, je pense que des mesures doivent être prises pour renforcer l'accessibilité du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) pour les particuliers. En effet, ce fichier, qui recense l'ensemble des comptes et coffres-forts ouverts dans un établissement bancaire en France, est un instrument efficace pour lutter contre les usurpations d'identité. Or il n'existe pas de Ficoba européen. Il me semble urgent d'en créer un. Malheureusement, ce n'est pas possible. Nous en avions discuté au sein de la commission des affaires européennes du Sénat. Rappelons que plusieurs pays européens n'ont pas de fichier centralisé des comptes bancaires. Voilà qui retarde à la fois les recherches, les poursuites et, évidemment, les sanctions. Cela complique singulièrement la lutte contre la fraude. Le projet de Ficoba européen reste donc un doux rêve ; c'est dommage, mais il faut manifestement s'y résigner, car il n'y a pas d'autre solution.
Compte tenu de l'ampleur des fuites de données récentes, il est très probable que chacun d'entre nous puisse être victime, un jour ou l'autre, d'une ouverture de compte par usurpation d'identité.
Pour mieux lutter contre ce risque, j'avance deux solutions simples : d'abord permettre à tous les particuliers de consulter en temps réel leurs données personnelles inscrites au Ficoba depuis leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr ; ensuite, prévoir un mécanisme de notification systématique envoyée à l'usager lorsqu'un compte bancaire est ouvert à son nom, sur le modèle des notifications qui peuvent être envoyées lorsque l'on effectue un paiement par carte bancaire. Cette proposition semble emporter l'adhésion de la Fédération bancaire française (FBF) ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Je pense qu'une mise en place rapide de ce dispositif permettra d'éviter de nombreuses fraudes et arnaques.
Le fichier national des comptes signalés, dont la création est prévue par le texte, englobera fort heureusement les paiements effectués par l'Agence de services et de paiement (ASP), qui verse chaque année 27 milliards d'euros d'aides publiques par le biais de 12 millions de virements. J'ajoute également que pour renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques, il conviendrait dans un autre texte d'envisager d'étendre le principe d'un fichier centralisé aux numéros Siret suspects.
En conclusion, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter sans modification cette proposition de loi, qui prévoit principalement la création d'un nouveau fichier, dispositif associant l'ensemble des acteurs, et qui ne coûte rien aux contribuables puisque l'intégralité des coûts du dispositifs seront supportés par les prestataires de services de paiement.
Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. - La lutte contre la fraude aux moyens de paiement est un sujet majeur, et je me réjouis de participer avec vous ce matin à l'amélioration du cadre législatif existant. Je me tiens par ailleurs à votre disposition, madame le rapporteur, pour travailler sur ce sujet à l'avenir.
Le Gouvernement attache une importance toute particulière à la lutte contre la fraude bancaire, car celle-ci s'accompagne de réalités humaines et économiques lourdes de conséquences : des particuliers sont abusés par de faux conseillers bancaires, des entreprises sont fragilisées par des détournements de virements, des collectivités sont confrontées à des pratiques frauduleuses de plus en plus sophistiquées. Il ne faut pas négliger les traumatismes humains suscités par ces pratiques.
Selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, la fraude aux paiements a représenté en 2024 un préjudice de près de 1,2 milliard d'euros. Même si le montant global diminue légèrement en tendance, les techniques employées se renouvellent sans cesse et les fraudeurs savent exploiter les moindres failles du système.
Il est crucial pour l'action publique de maintenir la confiance dans les paiements : protéger cette confiance, c'est aussi protéger notre économie et nos concitoyens.
C'est dans ce contexte que le député Daniel Labaronne, que je tiens ici à saluer, s'est personnellement engagé sur ce sujet. Son initiative s'enracine dans une conviction simple : notre droit doit évoluer pour renforcer la protection de nos concitoyens face à des fraudes de plus en plus sophistiquées.
Lorsque des chèques volés ou des moyens de paiement usurpés servent à régler des amendes, des cotisations ou des prestations, ce sont les finances de l'État, de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales qui en pâtissent directement.
En ce sens, la lutte contre la fraude n'est pas seulement un enjeu de sécurité : il s'agit également d'un impératif de justice fiscale et de crédibilité de l'action publique. Il y va, au fond, du lien de confiance entre les citoyens et les institutions.
Lutter contre la fraude implique avant tout - c'est ma conviction - de renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs concernés : les établissements bancaires, les autorités publiques et l'État.
C'est en partageant l'information, en coordonnant les analyses et en harmonisant les pratiques que nous pourrons construire une réponse réellement efficace. Le numérique offre à cet égard un potentiel majeur. Il permet de mettre en réseau nos capacités de détection et d'alerte.
En recourant à des bases de données plus agiles, interopérables et sécurisées, nous pouvons renforcer la prévention, améliorer la réactivité face aux menaces émergentes et élever notre niveau d'alerte collectif.
Cette approche, fondée sur la coopération et la confiance, doit guider l'action publique dans les années à venir.
L'article 1er de la proposition de loi crée un fichier national auprès de la Banque de France, afin de recenser les comptes signalés comme étant potentiellement frauduleux : il sera ainsi possible de bloquer, avec davantage de célérité, des virements vers ces comptes, sous le contrôle de la Banque de France.
Ce mécanisme renforcera l'efficacité globale du dispositif de lutte contre la fraude au virement. Les montants concernés s'élevaient à un total de 351 millions d'euros en 2024.
Afin de maintenir un dispositif cohérent et centré sur la fraude aux paiements, le Gouvernement n'est pas favorable à une extension de l'accès à ce fichier à d'autres entités privées que celles qui ont été énumérées dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement est également très attentif aux problématiques relatives au traitement des données à caractère personnel et au respect du cadre fixé par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Il y va du maintien de garanties fondamentales pour les citoyens et pour les entreprises. Je tiens également à saluer l'extension des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), qui pourra contrôler et accompagner les acteurs lors de leur utilisation du fichier, au regard des exigences définies par la RGPD.
La mobilisation de la Cnil dans ce dispositif s'inscrit dans la continuité de ses missions existantes. Elle est déjà compétente pour superviser l'utilisation, par les établissements bancaires, des données issues de deux fichiers nationaux tenus par la Banque de France : le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui permet de prévenir et de traiter les situations de surendettement, et le fichier national des chèques irréguliers, qui permet d'informer les commerçants sur la régularité des chèques remis en paiement. Dans les deux cas, la Cnil exerce pleinement ses pouvoirs de contrôle et, le cas échéant, de sanction, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le dispositif prévu par la proposition de loi s'inscrit donc dans une architecture juridique déjà éprouvée, qui garantit la proportionnalité du traitement des données et la protection des droits des usagers, tout en renforçant notre capacité d'action collective contre la fraude.
C'est pourquoi nous soutenons les protections pour les utilisateurs qui ont été inscrites dans le texte lors des débats à l'Assemblée nationale.
Ces garde-fous visent notamment à interdire la clôture d'un compte au seul motif qu'il a été signalé, à inscrire une obligation d'effectuer des déclarations correctives en cas de disparition du soupçon de fraude, ou encore à obliger l'établissement teneur du compte signalé à effectuer sans délai des vérifications sur le caractère frauduleux du compte.
Le Gouvernement souhaite également que l'efficacité de ce fichier national puisse être mesurée et évaluée dans le rapport annuel de l'OSMP, comme le prévoit l'article 1er bis de la proposition de loi.
Enfin, je tiens à mentionner ici les travaux en cours au niveau européen sur ces sujets.
La procédure de révision de la deuxième directive sur les services de paiement est parvenue au stade du trilogue, et elle devrait aboutir à la création d'un mécanisme européen de partage de données à des fins de lutte contre la fraude aux paiements.
Dans ces négociations, le Gouvernement est très attentif à veiller à la compatibilité entre les propositions européennes et le fichier dont nous débattons aujourd'hui.
La lutte contre la fraude doit également concerner les chèques. Ces derniers constituent de loin le moyen de paiement le plus fraudé, même si leur utilisation diminue depuis plusieurs années. Si le montant des opérations frauduleuses par chèque a fléchi de 25 % en 2024, il s'établissait tout de même à 270 millions d'euros en 2024. Les personnes qui utilisent le plus les chèques sont les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables aux fraudes ; je songe notamment aux personnes âgées. Il est donc important de renforcer la panoplie à disposition des banques pour lutter contre ces fraudes. C'est l'enjeu des articles 2 et 3 du texte.
Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 31 mars dernier. Elle vise à renforcer les moyens d'action des prestataires de services de paiement, tout en respectant scrupuleusement les droits des utilisateurs.
Le Gouvernement soutient pleinement ce texte et souhaite que celui-ci puisse entrer en vigueur sans délai.
J'appelle donc le Sénat à l'adopter de manière conforme, afin que ses dispositions puissent être mises en oeuvre rapidement.
La lutte contre les fraudes exige une mobilisation totale. Vous pouvez compter sur mon engagement sur ce sujet, comme je sais pouvoir compter sur la mobilisation de tous les parlementaires. Il s'agit d'une priorité qui doit nous rassembler, au-delà des clivages partisans, afin de répondre à une attente majeure de nos concitoyens.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je pense, madame la ministre, que votre appel sera entendu et que nous devrions parvenir à un vote conforme.
Nous passons beaucoup de temps, au travers des différents textes que nous examinons, à légiférer sur des aspects parcellaires de la lutte contre la fraude. Nous avons sans cesse le sentiment de « bricoler » des bouts de texte, sans avoir de vue d'ensemble. Considérant l'ampleur des enjeux et des problèmes, ce n'est pas une manière de procéder. Pardonnez-moi, mais nous avons quelque peu l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère !
Mme Christine Lavarde. - C'est vrai !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il est nécessaire de pouvoir répondre rapidement au problème de la fraude bancaire. Un simple clic peut parfois suffire à placer quelqu'un dans une situation très difficile. Tout le monde est concerné. Lorsque l'on doit aller vite et que l'on n'a pas forcément le temps, on est tous vulnérable. Certes, les personnes âgées sont particulièrement exposées à ce type de fraude, mais de nombreuses entreprises ont aussi été victimes de telles malversations. Même les professionnels du secteur sont parfois la cible d'escroqueries.
Je souscris évidemment aux orientations et aux propositions de notre rapporteur.
Je voudrais vous interroger sur la fraude au chèque bancaire. Les chèques sont de moins en moins utilisés. Disposez-vous d'éléments précis sur le recul de son usage et sur les perspectives d'évolution de recours à ce moyen de paiement ? En tout état de cause, si l'on constate que la fraude à ce moyen de paiement reste élevée, il conviendra de prendre des mesures pour y remédier et les aménagements prévus par la proposition de loi vont de ce point de vue dans le bon sens.
M. Marc Laménie. - Je remercie notre rapporteur pour sa présentation très pédagogique et passionnée.
Le nombre de chèques émis chaque année diminue. Un certain nombre de commerçants ou d'artisans n'acceptent d'ailleurs plus ce moyen de paiement. Le paiement par carte bancaire se développe de plus en plus, y compris pour de petites sommes, au détriment des espèces. Or les fraudes concernant les cartes bancaires sont très importantes. Elles frappent souvent les personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées. Les cartes peuvent être volées et les codes piratés. La proposition de loi prend-elle en compte cet aspect ?
M. Michel Canévet. - Je tiens à remercier notre rapporteur pour son engagement sur la question de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes.
Il est très important de lutter contre la fraude bancaire. À cet égard, je voudrais attirer l'attention sur deux sujets, qui pourraient d'ailleurs être traités par voie réglementaire.
J'évoquerai tout d'abord la question des paiements par prélèvement Sepa. La durée de validité des mandats Sepa est très longue. En théorie, un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement Sepa n'a été présenté pendant 36 mois ne peut plus être utilisé, mais, en fait, il reste actif. Le scandale de l'affaire SFAM est ainsi lié à une utilisation, après une longue période d'inactivité, de mandats de prélèvement qui avaient été autorisés dans le passé et qui étaient encore actifs, car les clients n'avaient pas expressément demandé leur résiliation auprès de l'établissement bancaire. Les victimes ne s'étaient pas rendu compte immédiatement des prélèvements. Ce texte, s'il est adopté, permettra au pouvoir réglementaire de traiter ce problème.
Ensuite, il me semble important que les sociétés de financement puissent aussi avoir accès aux fichiers créés par le texte. Il est utile que ces opérateurs, qui dépendent des établissements bancaires et qui réalisent des opérations d'ampleur - de leasing par exemple -, puissent disposer d'informations sur ceux qui sont susceptibles de frauder.
M. Albéric de Montgolfier. - Je connais le cas d'une personne qui a été victime d'une usurpation d'identité. Grâce à son RIB, qui était valable, les escrocs ont pu mettre en place des prélèvements sur son compte bancaire, ouvrir de multiples lignes téléphoniques et appeler des numéros surtaxés. Ces opérations ont abouti à des prélèvements de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Pensez-vous que l'article 1er du texte permettrait de répondre à ce cas de figure ? J'en doute, car le RIB n'était pas suspect. Comment dès lors lutter contre ce type de fraude ? Est-il prévu d'instaurer un mécanisme d'alerte en cas de prélèvement ? Les victimes de ces arnaques découvrent toujours après coup que leur compte a été prélevé.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Monsieur le rapporteur général, selon les données de l'OSMP, on observe que l'utilisation des chèques a effectivement baissée de 48 % entre 2018 et 2023, ce qui vaut aussi bien pour le montant des transactions concernées que pour le nombre d'opérations réalisées, lequel est passé de 891 millions à 467 millions. La fraude au paiement par chèque reste néanmoins un sujet. On a ainsi constaté, dans certaines affaires, que des entreprises en difficulté ou en voie de liquidation avaient conservé, à des fins d'escroquerie, des formules de chèques pouvant encore être utilisées. Nous ne plaidons nullement pour l'interdiction des chèques, mais force est de constater que leur utilisation est manifestement en chute libre, sous l'effet du développement de nouveaux modes de paiement.
Monsieur Laménie, le texte ne concerne pas les cartes bancaires. Il porte uniquement sur les prélèvements et sur les virements pour ce qui concerne le fichier national des comptes signalés pour risque de fraude.
Monsieur de Montgolfier, les dispositions du texte que nous examinons permettent de répondre à la situation que vous avez évoquée, puisque l'Iban sera signalé dès qu'un virement ou un prélèvement aura été effectué sur le compte.
M. Albéric de Montgolfier. - Certes, mais il sera alors trop tard, car le mal sera fait !
L'idéal serait d'être alerté en cas de prélèvement. Le cas très concret que j'ai exposé a abouti à un préjudice de 60 000 euros, en raison de l'ouverture frauduleuse de lignes téléphoniques auprès de la société SFR, que je souhaite dénoncer publiquement, car son service de lutte contre la fraude ne fonctionne pas le dimanche, et les escrocs le savent ! Ils sont allés dans de petites boutiques, qui ont accepté d'ouvrir de multiples lignes téléphoniques, qui ont permis ensuite d'appeler des numéros surtaxés. Dans ce cas, l'Iban n'est pas suspect, mais lorsque la personne découvre les prélèvements quinze jours plus tard, le mal est fait.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Dans le cas que vous évoquez, les prélèvements sont répétitifs. L'article 1er, s'il était déjà en vigueur, ne permettrait pas, malheureusement, d'empêcher l'ouverture de la ligne téléphonique ni le premier prélèvement, mais il permettrait de signaler la fraude pour éviter les prélèvements ultérieurs.
M. Albéric de Montgolfier. - Il faudrait que l'on soit informé par une alerte lorsque notre compte est prélevé.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Monsieur Canévet, les sociétés de financement ne sont pas des établissements de crédit. Elles ne sont pas prestataires de services de paiement. C'est pourquoi elles ne sont pas concernées par ce texte. J'ai bien noté les pistes d'amélioration réglementaire que vous avez évoquées.
Enfin, notre rapporteur général a déploré, à juste titre, que nos travaux en matière de lutte contre la fraude soient saucissonnés. Le Sénat examinera ainsi, en séance publique, le 5 novembre prochain, la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment, qui découle des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur la criminalité organisée. Puis, le 12 novembre, nous examinerons le projet de loi sur la fraude, qui portera sur la fraude fiscale et la fraude sociale, qui est un peu un texte « ramasse-miettes ». Madame la ministre, ce n'est vraiment pas une méthode de travail !
La commission des finances appelle depuis longtemps de ses voeux un « grand soir » de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Il est grand temps, tant pour des questions de sécurité que pour des questions budgétaires, de prendre ce sujet à bras-le-corps.
Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée. - Mme le rapporteur et M. le rapporteur général ont entièrement raison : nous devons avoir une vision globale du problème de la fraude. Pour l'instant, nous adaptons progressivement notre système. Nous devons faire preuve d'agilité, car les fraudeurs ont toujours un temps d'avance pour repérer les failles des dispositifs existants. Nous devons accepter l'idée que les fraudes vont se multiplier à l'avenir et être de plus en plus diverses et variées. Nous traitons aujourd'hui de la fraude bancaire, mais il existe bien d'autres formes de fraudes.
C'est en marchant que l'on apprend. Nous améliorons notre dispositif antifraude au fur et à mesure. La France est particulièrement en avance sur ce sujet par rapport à d'autres pays européens - il est parfois bon de comparer -, même si notre législation n'est pas suffisante. Toutefois, progressivement, nous réussirons à avoir une approche globale du problème. Nous avons donc, madame le rapporteur, les mêmes objectifs.
En ce qui concerne les chèques, la fraude recule plus vite que leur usage ne diminue. L'utilisation des chèques a diminué de 16 %, tandis que la fraude a baissé de 25 %. En fait, les fraudeurs ont bien compris que la fraude au chèque n'est pas ce qui rapporte le plus. Ils se tournent plutôt vers les paiements dématérialisés.
L'instauration de la double authentification a constitué récemment une grande avancée pour sécuriser les paiements par carte bancaire. Voilà une mesure qui protège les utilisateurs, tout en leur faisant prendre conscience qu'ils peuvent être une cible, car, comme vous le dites fort justement, la question est non pas de savoir si nous serons un jour victime d'une fraude, mais quand.
Monsieur Canévet, peut-être à l'avenir pourra-t-on ouvrir l'accès au nouveau fichier aux sociétés de financement, mais dans l'immédiat ce n'est pas possible en raison de l'application du RGPD. Les sociétés de financement sont des sociétés privées, et non des établissements bancaires. En raison de la législation sur les données à caractère personnel, il n'est pas possible de leur ouvrir l'accès à ce fichier à ce stade. Mais nous pouvons continuer à travailler sur le sujet pour lever ce frein.
M. Claude Raynal, président. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Nous vous proposons de considérer que ce périmètre inclut des dispositions relatives à la création d'un fichier aux fins de prévention, de recherche et de détection de la fraude en matière de paiement ; les dispositions relatives aux cas dans lesquels les prestataires de service de paiement ont l'obligation d'informer la Banque de France aux fins de mise à jour du fichier national des chèques irréguliers ; et les dispositions relatives à la mission d'information assurée par la Banque de France en matière de vérification de la régularité d'un chèque.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES SELON LA PROCÉDURE DE LÉGISLATION EN COMMISSION
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - L'article 1er contient la principale mesure de la proposition de loi. Il vise à créer un nouveau fichier centralisée géré par la Banque de France : le fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Ce fichier sera alimenté par les prestataires de services de paiement, c'est-à-dire principalement les banques, lorsque leur système de contrôle interne aura identifié un compte suspect. Les coordonnées du compte en question, c'est-à-dire son Iban, seront alors inscrites dans le fichier, ce qui imposera au teneur de compte de procéder aux diligences nécessaires pour déterminer si ce compte est frauduleux et pour le fermer le cas échéant.
J'ajoute que ce fichier n'aura pas de coût pour les finances publiques puisque les frais associés seront entièrement pris en charge par les prestataires de services de paiement.
Ce dispositif constituera un instrument utile pour lutter contre la fraude. Sa création est attendue par les acteurs de place.
C'est pourquoi je vous propose d'adopter cet article sans modification.
L'amendement COM-1 rectifié bis, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 1er est adopté sans modification.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Cet article vise à inscrire dans la loi le fait que le rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement devra inclure des indicateurs de performance relatifs au fonctionnement du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il est pertinent de mesurer la performance de nos instruments de lutte contre la fraude. Aussi je vous propose d'adopter cet article sans modification.
L'article 1er bis est adopté sans modification.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Cet article apporte une modification technique au fonctionnement du FNCI en inscrivant dans le code monétaire et financier une obligation pour les banques de réaliser un signalement à la Banque de France lorsqu'elles rejettent un chèque contrefait ou falsifié.
Cet article codifie utilement une pratique de place. Je vous propose par conséquent de l'adopter sans modification.
L'amendement COM-2 rectifié bis, repoussé par le rapporteur et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté sans modification.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Cet article apporte également une modification technique au fonctionnement du FNCI. Il prévoit la création d'un service d'interrogation du FNCI par les banques lorsqu'elles reçoivent un chèque à l'encaissement.
Dans l'état actuel du droit, les seules personnes autorisées à interroger le FNCI sont celles qui reçoivent un chèque comme paiement d'un bien ou service, ce qui n'est pas le cas du banquier qui reçoit un chèque à l'encaissement. Cet article vise à élargir à ces banquiers la possibilité d'interroger le FNCI. Cela permettra d'accélérer la détection de la fraude au chèque.
Je vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
L'article 3 est adopté sans modification.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur. - Cet article, ajouté par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, procède aux coordinations juridiques nécessaires pour assurer la bonne application des dispositions du texte dans les territoires d'outre-mer.
Je vous propose d'adopter cet article sans modification.
L'article 4 est adopté sans modification.
Après l'article 4 (nouveau)
L'amendement COM-3 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
La proposition de loi est adoptée sans modification.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
TABLEAU DES SORTS
|
Article 1er |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. BILHAC |
1 rect. bis |
Anticipation de la date d'entrée en vigueur de l'article 1er |
Rejeté |
|
Article 1er bis (nouveau) |
|||
|
Article 2 |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. BILHAC |
2 rect. bis |
Fixation d'un délai maximal de trois jours pour le signalement à la Banque de France par le tiré d'un cas de rejet d'un faux chèque |
Rejeté |
|
Article 3 |
|||
|
Article(s) additionnel(s) après Article 4 (nouveau) |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. BILHAC |
3 rect. |
Modification de la définition de la notion d'authentification dans le code monétaire et financier |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »43(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la
mention du texte « transmis » dans la Constitution, le
Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport
au contenu précis des dispositions du texte initial,
déposé sur le bureau de la première assemblée
saisie44(*).
Pour
les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien
matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de
l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la
présence de « cavaliers » dans le
texte45(*). Pour les
lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un
« cavalier » toute disposition organique prise sur un
fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a
été pris le texte initial46(*).
En application de l'article 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des finances a arrêté, lors de sa réunion du 22 octobre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 496 (2024-2025) visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
Ce périmètre comprend :
- les dispositions relatives à la création d'un fichier aux fins de prévention, de recherche et de détection de la fraude en matière de paiement ;
- les dispositions relatives aux cas dans lesquels les prestataires de service de paiement ont l'obligation d'informer la Banque de France aux fins de mise à jour du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) ;
- les dispositions relatives à la mission d'information assurée par la Banque de France en matière de vérification de la régularité d'un chèque.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Direction générale du Trésor
- M. Anselme MIALON, chef du bureau « Services bancaires et moyens de paiement » (BANCFIN 4) ;
- M. David SABBAN, adjoint au chef du bureau BANCFIN 4 ;
- M. Sofien ABDALLAH, conseiller parlementaire et relations institutionnelles.
Banque de France
- Mme Hélène TANGUY, directrice des services aux particuliers ;
- M. Alexandre STERVINOU, directeur des études et de la surveillance des paiements ;
- Mme Véronique BENSAID-COHEN, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur de la Banque de France ;
- M. Gabriel PREGUIÇA, chargé de mission auprès de Mme Véronique Bensaid-Cohen ;
- M. Clément BOURGEOIS, adjoint au chef de service des moyens de paiement scripturaux.
Fédération bancaire française (FBF)
- M. François LEFEBVRE, directeur général adjoint ;
- M. Jérôme RAGUENÈS, directeur du département numérique et moyens de paiement ;
- M. Jérôme PARDIGON, directeur relations institutionnelles France.
Service de renseignement financier Tracfin
- M. Alban GENAIS, directeur adjoint ;
- Mme Eve MATHIEN, agent du service ;
- Mme Caroline WEILL, adjointe au chef du département des affaires institutionnelles.
Agence de services et de paiement (ASP)
- M. Sylvain MAESTRACCI, président-directeur général.
Personnalité qualifiée
- M. Charles PRATS, ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude.
Assemblée nationale
- M. Daniel LABARONNE, député, auteur de la proposition de loi contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux ;
- Mme Anne-Audrey CLAUSS, cheffe de cabinet du député LABARONNE ;
- M. François MARCELOT, administrateur à la commission des finances de l'Assemblée nationale.
*
* *
- Contribution écrite -
Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-496.html
* 1 Single Euro Payments Area (SEPA).
* 2 L'établissement bancaire qui émet le chèque.
* 3 Single Euro Payments Area. La zone SEPA inclut les vingt-sept États-membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Vatican, le Monténégro et l'Albanie.
* 4 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), septembre 2024, Rapport annuel 2023, p. 121.
* 5 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
* 6 Cass. Com., 30 août 2023, n° 22-11.707 B, D. 2023.2124, note Lasserre Capdeville.
* 7 30) de l'article 4 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
* 8 Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) no 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.
* 9 Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
* 10 International Bank Account Number (IBAN). Il s'agit de l'identifiant international d'un compte bancaire, composé d'au plus 34 caractères. Les IBAN des comptes tenus en France comprennent 27 caractères et commencent par « FR ».
* 11 Cass. Com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.537 B, D. 2025.196, note Storrer.
* 12 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), septembre 2024, Rapport annuel 2023, p. 121.
* 13 3 de l'article 5 du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009.
* 14 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), septembre 2024, Rapport annuel 2023, p. 45.
* 15 Les « paiements SEPA » recouvrent à la fois les virements et les prélèvements.
* 16 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), septembre 2024, Rapport annuel 2023, p. 123.
* 17 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), septembre 2024, Rapport annuel 2023, p. 123.
* 18 Article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
* 19 Réponse de la Banque de France au questionnaire du rapporteur.
* 20 Réponse de la Banque de France au questionnaire du rapporteur.
* 21 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010, COM(2023)367 final.
* 22 Avant le 6 janvier 2025, les demandes étaient traitées par la Cnil.
* 23 Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.
* 24 À titre d'exemple, certains paiements par carte bancaire font l'objet d'une information en temps réel envoyée par l'établissements bancaires concerné à leurs clients.
* 25 Dont notamment la proposition de loi n° 877 (2024-2025) pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment déposée sur le bureau du Sénat le 19 août 2025 par le rapporteur et le sénateur Raphaël Daubet.
* 26 Article 39 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
* 27 Article 65 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
* 28 Article R. 142-22 du code monétaire et financier.
* 29 Article 1 de l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en oeuvre par la Banque de France.
* 30 Article 4 de l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en oeuvre par la Banque de France.
* 31 En matière de paiement par chèque, le « tiré » désigne l'établissement qui tient le compte du « tireur », c'est-à-dire de la personne ayant émis le chèque. Le paiement du chèque au bénéficiaire est réalisé par le tiré, sauf dans le cas d'un refus de paiement.
* 32 3 de l'article L. 163-10 du code monétaire et financier.
* 33 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), septembre 2024, Rapport annuel 2023, p. 123.
* 34 Un chèque contrefait est un chèque créé de toutes pièces par un fraudeur qui peut être tiré sur une banque réelle ou une banque fictive.
* 35 Un chèque falsifié est un chèque régulier altéré un fraudeur par grattage, gommage ou effacement.
* 36 Article 1 de l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en oeuvre par la Banque de France.
* 37 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), septembre 2024, Rapport annuel 2023, p. 123.
* 38 Des éléments circonstanciés sur l'état de la fraude au chèque et une description plus détaillée du fonctionnement du FNCI figurent au I du commentaire de l'article 2 de la proposition de loi au sein du présent rapport.
* 39 Article 1 de l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en oeuvre par la Banque de France.
* 40 Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), juillet 2021, Rapport annuel 2020, p. 55.
* 41 Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
* 42 Article L. 721-18 du code monétaire et financier.
* 43 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 44 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 45 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 46 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.