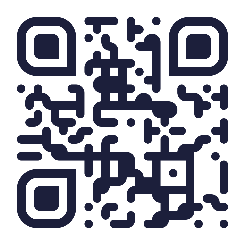- L'ESSENTIEL
- I. LA CONSTITUTION DE LA CINQUIÈME
RÉPUBLIQUE : UN TEXTE À FORTE CAPACITÉ
D'ADAPTATION
- II. UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE QUI
ENTEND « PRIMO-MINISTÉRIALISER » LA
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE POUR RÉPONDRE À
LA SITUATION DE BLOCAGE POLITIQUE ACTUELLE
- III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE
PROPOSITION DE LOI QUI MANQUE SA CIBLE
- I. LA CONSTITUTION DE LA CINQUIÈME
RÉPUBLIQUE : UN TEXTE À FORTE CAPACITÉ
D'ADAPTATION
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Abrogation des articles 9, 12 et 13 de la Constitution
- Article 2
Suppression de la prise de parole du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès
- Article 3
Attribution au Premier ministre du pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale
- Article 4
Extension des pouvoirs du Premier ministre en matière réglementaire, de nomination et de présidence du conseil des ministres
- Article 5
Attribution au Premier ministre du pouvoir de signer les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres et de nommer aux emplois civils et militaires de l'État
- Article 6
Engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale après chaque nouvelle nomination d'un Premier ministre
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 414
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation,
du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1)
sur la proposition de loi
constitutionnelle visant à restreindre
certaines prérogatives du
Président de la
République et à
renforcer
celles du
Premier ministre,
responsable devant le
Parlement,
Par M. Stéphane LE RUDULIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
269 rect. et 415 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
25 révisions constitutionnelles en un peu moins de 70 ans, soit en moyenne une révision presque tous les deux ans et demi : si la Constitution de la Cinquième République affiche la longévité la plus importante de notre histoire institutionnelle, le nombre de ses révisions est assurément la marque d'un texte vivant que les Français, en particulier par la voix de leurs représentants, ne rechignent pas à réinterroger.
Dans un contexte d'instabilité gouvernementale et de fragmentation de l'Assemblée nationale depuis 2024, la proposition de loi constitutionnelle déposée par la présidente Cécile Cukierman et les membres du groupe CRCE-K, visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement, pose la question de l'articulation des prérogatives au sommet de l'exécutif, entre le chef de l'État et le chef du Gouvernement. Ce texte entend en particulier opérer un mouvement de « primo-ministérialisation » de la Cinquième République, en confiant une partie des attributions du Président de la République au Premier ministre.
D'une part, l'expérience montre que les prérogatives que la proposition de loi entend retirer au Président de la République n'ont jusqu'ici jamais empêché le Premier ministre de mettre en oeuvre sa politique pour autant qu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. D'autre part, si elle est mue par la volonté de remédier à l'instabilité gouvernementale observée depuis 2024, force est de constater que la proposition de loi manque sa cible. Cette instabilité est la conséquence non du rapport de forces au sommet de l'exécutif mais de la difficulté à dégager une majorité durable à l'Assemblée nationale.
Pour ces raisons et pour permettre au débat en séance publique d'avoir lieu sur le texte déposé, la commission des lois, suivant l'avis de son rapporteur Stéphane Le Rudulier, n'a pas adopté cette proposition de loi.
I. LA CONSTITUTION DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE : UN TEXTE À FORTE CAPACITÉ D'ADAPTATION
A. UN ÉQUILIBRE AU SOMMET DE L'EXÉCUTIF CONDITIONNÉ TANT PAR LA LÉGITIMITÉ ÉLECTORALE ET POLITIQUE QUE PAR L'EXERCICE DU POUVOIR
La Cinquième République est un régime parlementaire. L'article 20 de sa Constitution pose en effet le principe de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. Sur le plan politique, la capacité du Gouvernement à déterminer et conduire la politique de la nation dépend, au moins pour la mise en oeuvre de son programme législatif, de l'existence au sein de l'Assemblée nationale d'une majorité le soutenant, ou, à tout le moins, d'une majorité disposée à ne pas le mettre en échec, cette majorité pouvant, le cas échéant, varier selon le texte examiné.
Telle qu'elle découle de la Constitution et de l'esprit de ses concepteurs, la répartition des rôles entre le chef de l'État et le chef du Gouvernement peut être résumée de la façon suivante :
- en sa qualité, sur le fondement de l'article 5 de la Constitution, de garant de la continuité de l'État et de la souveraineté nationale, ainsi que d'arbitre du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République détient un pouvoir de « faire faire » et dispose, à ce titre, notamment, de pouvoirs importants de nomination, dont celle du Premier ministre et des membres du Gouvernement, mais aussi du pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale ;
- parce que le Gouvernement dispose de l'administration et de l'initiative des lois et intervient directement dans la procédure législative, le Premier ministre, qui dirige son action en application de l'article 21 de la Constitution, détient un pouvoir de « faire ».
Cet équilibre entre un Président de la République « arbitre » et un Premier ministre « capitaine » peut, en termes de capacité à fixer une ligne politique pour gouverner le pays, tourner en faveur de l'un ou de l'autre selon qu'il existe ou pas une concordance des majorités issues des élections présidentielle et législatives mais aussi selon la pratique que l'un et l'autre ont de leurs prérogatives respectives.
Le pouvoir de « faire faire » du chef de l'État n'est ainsi pleinement effectif que pour autant qu'il dispose d'une légitimité, pas seulement électorale mais plus largement politique. Depuis qu'elle a lieu au suffrage universel direct1(*), l'élection présidentielle française est bien de nature politique, aucun candidat n'ayant le sentiment de concourir à une fonction purement représentative. La légitimité du suffrage universel direct ne suffit toutefois pas, dans notre régime parlementaire, à garantir au Président de la République la capacité d'imprimer une direction à la politique nationale, en particulier intérieure : il lui faut, pour cela, pouvoir nommer un Gouvernement aligné sur sa ligne politique assuré d'être soutenu durablement par l'Assemblée nationale.
En cas de concordance des majorités issues des élections présidentielle et législatives, la Cinquième République a ainsi pu être qualifiée de régime parlementaire à tendance présidentialiste, le Président de la République disposant de facto, selon certains commentateurs, d'un pouvoir de révocation du Premier ministre et du Gouvernement - même si le Général de Gaulle avait pris soin de rappeler, devant le comité consultatif constitutionnel le 8 août 1958, qu'un tel pouvoir de révocation était contraire au rôle d'arbitre du Président de la République, le Premier ministre n'étant responsable que devant le Parlement. En l'absence d'une telle concordance, comme en période de cohabitation, le régime a, à l'inverse, pris une dimension primo-ministérielle marquée.
B. DES POUVOIRS PRÉSIDENTIELS QUI NE FONT PAS, EN EUX-MÊMES, OBSTACLE À LA CONDUITE DE LA POLITIQUE DE LA NATION PAR LE GOUVERNEMENT
Comme c'était déjà le cas sous les Troisième et Quatrième Républiques, le Président de la République préside le conseil des ministres, en vertu de l'article 9 de la Constitution. Cette présidence l'habilite à décider, en dernier ressort, de l'ordre du jour du conseil des ministres et implique qu'il signe les ordonnances et décrets qui y sont délibérés, comme le prévoit l'article 13 de notre loi fondamentale. En pratique, cet ordre du jour, préparé par le secrétariat général du Gouvernement, est généralement arrêté en concertation entre le Président de la République et le Premier ministre. S'il est arrivé, une seule fois en période de cohabitation2(*), que le chef de l'État s'oppose à l'inscription de l'ordre du jour d'un texte, ce fut seulement pour reporter sa délibération au conseil des ministres suivant afin que le Gouvernement, à sa demande, réexamine les difficultés constitutionnelles qui avaient été soulevées par le Conseil d'État.
À noter que l'existence d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État ne fait pas obstacle à ce que le Premier ministre organise, de sa propre initiative, des conseils de gouvernement ou de cabinet3(*), comme ce fut le cas sous Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ou encore des séminaires gouvernementaux.
Il résulte, par ailleurs, de l'article 19 de la Constitution que les actes pris par le Président de la République sur le fondement de son article 13 sont nécessairement contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables, y compris les décrets de nomination aux emplois civils et militaires. Celui qui contresigne, en ce qu'il engage sa responsabilité, peut refuser d'apposer sa signature, de sorte que le chef de l'État doit s'assurer, à tout le moins, de l'absence d'opposition de la part des contresignataires.
Quant au refus du Président de la République de signer des ordonnances préparées par le Gouvernement et délibérées en conseil des ministres, l'expérience4(*) a montré qu'il n'a fait que contraindre le Gouvernement à emprunter la voie parlementaire pour adopter les dispositions en cause.
II. UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE QUI ENTEND « PRIMO-MINISTÉRIALISER » LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE POUR RÉPONDRE À LA SITUATION DE BLOCAGE POLITIQUE ACTUELLE
A. LA VOLONTÉ DE RÉSOUDRE L'INSTABILITÉ GOUVERNEMENTALE ACTUELLE ET DE MIEUX ASSOCIER LES CITOYENS AU PROCESSUS DÉCISIONNEL
Dans leur exposé des motifs, les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle partent du postulat que la France traverse « une crise multiforme violente, tant sur le plan économique, que social ou institutionnel ».
Ils estiment que la Cinquième République a connu une dérive présidentialiste avec la réduction, en 2000, à cinq ans de la durée du mandat présidentiel et l'inversion du calendrier électoral plaçant, à compter de 2002, le scrutin législatif dans le sillage du scrutin présidentiel. Ils voient en outre, dans la dissolution de l'Assemblée nationale décidée le 9 juin 2024 par le Président de la République, le symbole d'une hyper-présidentialisation en décalage avec l'aspiration de nos concitoyens à être mieux associés « aux mécanismes de décision dans une forme de démocratie continue », concept développé par le professeur Dominique Rousseau5(*) pour inventer de nouvelles voies permettant de mieux associer les citoyens à la fabrication de la volonté générale.
Selon les auteurs de la proposition de loi, la Cinquième République serait marquée par une « ambiguïté originelle », à savoir « l'hésitation entre régime parlementaire et présidentiel », qui jouerait « un rôle premier dans le blocage actuel ». Ce blocage semble se référer à la difficulté pour les gouvernements qui se sont succédé depuis l'été 2024 à former des alliances au sein d'une Assemblée nationale désormais fragmentée en au moins trois blocs dont chacun refuse de gouverner avec les deux autres.
B. UNE RÉFORME CONSTITUTIONNELLE CANTONNÉE AU RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU PREMIER MINISTRE ET DE SA RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. Le transfert de prérogatives du Président de la République au Premier ministre
En abrogeant les articles 9, 12 et 13 de la Constitution, l'article 1er de la proposition de loi retire au Président de la République respectivement la présidence du conseil des ministres, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et la responsabilité de signer les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres et de nommer aux emplois civils et militaires de l'État.
L'article 3 de la proposition de loi attribue le pouvoir de dissolution au Premier ministre. Son article 4 lui confie la présidence du conseil des ministres, lequel ne pourrait dorénavant se tenir que sur le lieu d'exercice de ses prérogatives. Son article 5 lui transfère le pouvoir de signer les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres et de nommer aux emplois civils et militaires de l'État, dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues à l'article 13 de la Constitution.
L'article 2 de la proposition de loi supprime, pour sa part, la possibilité pour le Président de la République de prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès, qui avait été instituée par la révision constitutionnelle de 20086(*).
2. Une quasi-procédure obligatoire d'investiture du Gouvernement à chaque nouvelle nomination d'un Premier ministre
L'article 6 de la proposition de loi modifie l'article 49 de la Constitution afin de systématiser, après chaque nomination d'un Premier ministre par le Président de la République, l'engagement de la responsabilité de son Gouvernement devant l'Assemblée nationale. Cette procédure d'investiture obligatoire n'est pas sans rappeler l'article 94 de la Constitution italienne contraignant chaque nouveau gouvernement à obtenir, dans les dix jours suivant sa formation, la confiance des deux chambres du parlement.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE PROPOSITION DE LOI QUI MANQUE SA CIBLE
A. UNE CRISE D'ORDRE POLITIQUE ET NON D'ORDRE INSTITUTIONNEL
L'instabilité gouvernementale constatée depuis 2024 est la conséquence d'un fait politique et non pas d'un paramètre constitutionnel. Les élections législatives de l'été 2024 ont en effet produit une Assemblée nationale divisée en trois grands blocs, le bloc central devant, pour gouverner, disposer du soutien ou de l'absence d'opposition de l'un des deux autres groupes politiques pivots, à sa gauche et à sa droite. Ce fait politique est le résultat d'une sociologie électorale marquée par une plus forte polarisation du vote vers les extrêmes de l'échiquier politique.
Or la Constitution du 4 octobre 1958 a précisément été conçue pour faire face aux situations dans lesquelles le Gouvernement peinerait à s'appuyer sur une coalition parlementaire stable. Elle est ainsi armée d'outils de parlementarisme rationalisé : comme l'avait exposé Michel Debré dans son discours du 27 août 1958 devant le Conseil d'État, « la question de confiance est l'arme du Gouvernement, et de lui seul ». La motion de censure, seul moyen pour les députés de renverser un Gouvernement, obéit à des conditions exigeantes, dont une adoption à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Le mécanisme de l'adoption de textes sans vote, avec engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le fondement du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, de même que la procédure de mise en vigueur par ordonnances d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale après l'expiration de leurs délais d'examen par le Parlement ont achevé de garantir au Gouvernement la capacité de gouverner en l'absence d'une majorité, même relative.
Dans un pays qui a connu 15 constitutions depuis 1791, le rapporteur ne peut que prévenir contre la tentation d'une remise en cause de l'équilibre au sommet de l'exécutif qui équivaudrait, en réalité, à un énième changement de régime pour répondre à une situation dont les tenants sont d'abord politiques et sociologiques, plutôt qu'institutionnels.
B. UNE PROPOSITION DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE EN MANQUE DE COHÉRENCE
Le rapporteur relève tout d'abord que la révision constitutionnelle envisagée n'a nullement pour effet de mieux associer les citoyens au processus décisionnel et, en se limitant à renforcer les pouvoirs du Premier ministre, elle n'est pas davantage de nature à corriger la « verticalité prodigieuse du pouvoir » que les auteurs de la proposition de loi dénoncent dans leur exposé des motifs.
Dès lors qu'elle n'entend pas revenir sur l'élection au suffrage universel direct du Président de la République, elle tend même, de façon paradoxale, à remettre en cause la légitimité démocratique de ce dernier en le privant du pouvoir de dissolution, élément pourtant essentiel dans l'exercice de son rôle d'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. De même, le fait de lui retirer la présidence du conseil des ministres fragiliserait le chef de l'État dans ce rôle d'arbitre, en abolissant un contact pourtant essentiel avec les rouages de l'État.
Enfin, si elle entend ressourcer au Parlement la légitimité du pouvoir du Gouvernement, en imposant à ce dernier une investiture à chaque nouvelle nomination d'un Premier ministre, la proposition de loi placerait ce dernier sans recours s'il n'obtient pas la confiance ou en cas de motion de censure adoptée contre son Gouvernement : un Premier ministre non investi ou censuré, contraint de démissionner, ne pourrait en retour prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans ce face-à-face asymétrique, le conflit entre le Premier ministre et le Parlement se trouverait privé d'arbitre.
Estimant qu'elle ne constitue pas une réponse adaptée à la crise politique qu'elle entend résoudre et qu'elle comporte plusieurs fragilités qui minent sa cohérence, la commission, suivant l'avis de son rapporteur, n'a pas adopté la proposition de loi. Conformément au gentlemen's agreement en vigueur au Sénat s'agissant des espaces réservés aux groupes politiques d'opposition, ce sera donc le texte initial de la proposition de loi qui sera discuté en séance.
*
* *
La commission n'a pas adopté la proposition de loi constitutionnelle.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Abrogation des articles 9, 12 et 13 de la
Constitution
En abrogeant trois articles de la Constitution, l'article 1er vise à retirer au Président de la République les prérogatives suivantes :
- la présidence du conseil des ministres, prévue par l'article 9 ;
- le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, prévu par l'article 12 ;
- le pouvoir de signer les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres et le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'État, prévus par l'article 13.
La commission n'a pas adopté l'article 1er.
1. Le droit en vigueur
a) La présidence du conseil des ministres (article 9 de la Constitution)
La Constitution introduite et commentée par Guy Carcassonne et Marc Guillaume qualifie l'article 9, aux termes duquel : « Le Président de la République préside le conseil des ministres », de « laconique » mais « essentiel »7(*).
Rédigées dans les mêmes termes que l'article 32 de la Constitution de la Quatrième République8(*), ces dispositions sont le fruit de la tradition constitutionnelle française, qui a toujours confié au Président de la République la présidence du conseil des ministres, même lorsque le chef du gouvernement portait le titre de président du Conseil.
L'évolution de la nature du régime, et notamment du rôle du Président de la République, procède davantage de l'esprit et de la pratique des institutions9(*). Comme le relevait Jean-Marc Sauvé, « il ne suffit pas qu'une Constitution instaure une réunion organique de ministres, lui confère des pouvoirs importants et en confie la présidence au chef de l'État pour que cette institution fonctionne selon un modèle univoque »11(*) : son fonctionnement a ainsi pu être sensiblement différent lors des périodes de cohabitation, pendant lesquelles un rééquilibrage s'opère entre les prérogatives du Président de la République et celles du Premier ministre.
La Constitution du 4 octobre 1958 se distingue toutefois des constitutions précédentes en conférant au conseil des ministres des prérogatives étendues, notamment la délibération sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur certains décrets.
Des attributions très étendues
La Constitution impose l'intervention du conseil des ministres dans de nombreux domaines : pour les projets de loi (article 39), les ordonnances (articles 13, 38 et 74-1), les décrets en conseil des ministres (article 13), pour certaines nominations (article 13), pour décréter l'état de siège (article 36) et pour l'engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49).
L'intervention du conseil des ministres peut également être imposée par le législateur. Par exemple, la loi renvoie à un décret en conseil des ministres pour la déclaration de l'état d'urgence (article 2 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence) ou de l'état d'urgence sanitaire (article L. 3131-13 du code de la santé publique), pour la dissolution d'associations (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) ou d'un conseil municipal, départemental ou régional (articles L. 2121-6, L. 3121-5 et L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales), pour la révocation d'un maire ou d'un adjoint (article L. 2122-6 du même code), pour autoriser la comparution comme témoin du Premier ministre ou d'un autre membre du Gouvernement (article 652 du code de procédure pénale), ou encore pour écarter l'application de la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration sur une demande vaut acceptation (article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration)12(*).
Il en va de même lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une nomination est prononcée par décret en conseil des ministres. En outre, comme l'expose le Guide de légistique édité par le secrétariat général du Gouvernement, « il est d'usage, bien qu'aucun texte ne le prévoie explicitement, de pourvoir en conseil des ministres aux emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement »13(*).
Il résulte de l'article 9 de la Constitution que c'est en présence et sous l'autorité du Président de la République que les membres du conseil des ministres - le Premier ministre, les ministres de plein exercice et, lorsque le décret fixant leurs attributions le prévoit ou que l'ordre du jour justifie leur présence, les ministres délégués et les secrétaires d'État - délibèrent, sauf cas exceptionnels. Le dernier alinéa de l'article 21 dispose que le Premier ministre « peut, à titre exceptionnel, suppléer [le Président de la République] pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé »14(*).
Si le Gouvernement peut, sans que la Constitution le prévoie expressément, se réunir sous la présidence du Premier ministre, sous la forme d'un conseil de gouvernement ou de cabinet, cette faculté n'a été que rarement utilisée.
Le Président de la République tient de sa présidence du conseil des ministres le pouvoir de fixer le calendrier de ses réunions et son ordre du jour. Dans la pratique, cet ordre du jour est déterminé conjointement avec le Premier ministre, selon des modalités qui varient en fonction de la situation politique15(*).
La doctrine est partagée sur la portée des prérogatives associées à la présidence du conseil des ministres, notamment la capacité ou non du Président de la République de refuser l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi : en période de cohabitation, un seul précédent est connu à ce jour, lorsqu'en 2001 le président Chirac a différé l'examen du projet de loi relatif à la Corse16(*).
En dehors de ces dispositions, le fonctionnement du conseil des ministres n'est régi par aucun texte. S'il se réunit habituellement au palais de l'Élysée, il peut se réunir en tout lieu17(*). Le conseil des ministres s'est même réuni en visioconférence lors de la crise sanitaire de 2020-2021. Interrogé à ce sujet par le président Philippe Bas, le Premier ministre a rappelé que « pour considérer que le conseil des ministres a été valablement réuni, il convient [...] d'examiner non pas s'il a donné lieu à une réunion physique de ses membres, mais si des modalités d'organisation lui ont effectivement permis de délibérer »18(*), soutenant que tel était le cas en l'espèce. Depuis, la visioconférence a été utilisée à plusieurs reprises, notamment - dans un format « mixte » - afin de permettre au Président de la République de présider la réunion à l'occasion d'un déplacement.
b) Le pouvoir de dissolution (article 12 de la Constitution)
L'article 12 de la Constitution confère au Président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale.
En vertu de l'article 19 de la Constitution, il s'agit d'un pouvoir propre et discrétionnaire du Président de la République19(*), qui n'est pas soumis au contreseing du Premier ministre20(*). L'exercice de ce pouvoir n'est soumis qu'à la consultation préalable du Premier ministre et des présidents des deux assemblées : cette consultation, qui peut être orale, est une pure formalité et les avis rendus ne contraignent aucunement le Président de la République.
La Constitution interdit toutefois la dissolution de l'Assemblée nationale dans certaines circonstances : en cas d'intérim présidentiel (article 7), dans les douze mois qui suivent une précédente dissolution (article 12) ou en cas de mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. En outre, elle impose l'organisation d'élections et, à la suite de celles-ci, la réunion de l'Assemblée nationale à bref délai.
En faisant de la dissolution un pouvoir discrétionnaire du Président de la République, la Constitution du 4 octobre 1958 s'est écartée de la tradition républicaine, selon laquelle l'exercice de cette prérogative était strictement encadré. L'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 soumettait ainsi la dissolution de la Chambre des députés par le Président de la République à un avis conforme du Sénat, quand l'article 51 de la Constitution du 27 octobre 1946 l'enserrait dans des conditions très strictes : la survenue, dans une période de dix-huit mois, de deux crises ministérielles résultant de l'adoption, à la majorité absolue des députés, d'une motion de censure ou du refus de la confiance dans les mêmes conditions. Soumise au contreseing du président du Conseil, la dissolution devait être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée nationale21(*).
Du fait de la crise institutionnelle provoquée par la dissolution du 16 mai 1877 comme des contraintes qui enserraient sa mise en oeuvre, le pouvoir de dissolution n'a été, par la suite, mis en oeuvre qu'à une seule reprise sous la Troisième République et la Quatrième République, le 2 décembre 1955. Depuis 1958, il a été fait usage à six reprises de l'article 12 de la Constitution.
L'exercice du pouvoir de dissolution sous la Cinquième République
• le 9 octobre 1962, par le général de Gaulle, en réponse à l'adoption d'une motion de censure ;
• le 30 mai 1968, par le général de Gaulle, en réponse aux événements de mai 1968 ;
• le 22 mai 1981 et le 14 mai 1988, par François Mitterrand, afin d'obtenir une majorité parlementaire en sa faveur à la suite de son élection puis de sa réélection ;
• le 21 avril 1997, par Jacques Chirac, en anticipation des élections législatives prévues l'année suivante ;
• le 9 juin 2024, par Emmanuel Macron, à la suite des résultats des élections européennes de 2024.
c) Les pouvoirs découlant de l'article 13 de la Constitution
(1) Le pouvoir réglementaire du président de la République
Le premier alinéa de l'article 13 de la Constitution prévoit que le Président de la République « signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres ».
Le pouvoir réglementaire ainsi reconnu au Président de la République constitue une exception à la règle selon laquelle, en vertu de l'article 21, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. Les décrets du Président de la République demeurent cependant soumis au contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres compétents.
En dehors des décrets relatifs à l'état de siège (article 36), la Constitution ne détermine pas les décrets qui doivent faire l'objet d'une délibération en conseil des ministres. La délibération en conseil des ministres résulte, le plus souvent, d'une norme supérieure (cf. 1.a).
Le Conseil d'État, dans sa décision d'Assemblée Meyet du 10 septembre 199222(*), a toutefois déduit des dispositions de l'article 13 de la Constitution que tout décret évoqué en conseil des ministres devait être regardé comme un décret délibéré en conseil des ministres et, partant, comme relevant du pouvoir réglementaire du Président de la République, même si aucun texte n'imposait cette délibération. Les dispositions créées ou modifiées par un tel décret ne peuvent plus alors être modifiées que par un décret délibéré en conseil des ministres, sauf à ce que le décret l'ait autorisé23(*).
Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine comme ouvrant la porte à une extension très large, voire incontrôlée, du pouvoir réglementaire du Président de la République dès lors que ce dernier est maître de l'ordre du jour du conseil des ministres et qu'il lui est ainsi loisible d'évoquer des projets de décret pour lesquels aucune norme supérieure n'impose qu'ils soient délibérés en conseil des ministres24(*). En dépit de ces critiques, la jurisprudence Meyet ne s'est pas traduite, à ce jour, par une extension illimitée du pouvoir réglementaire du Président de la République, le nombre de décrets en conseil des ministres demeurant réduit.
(2) Le pouvoir de nomination
Le premier alinéa de l'article 13 de la Constitution consacre la compétence de principe du Président de la République pour les nominations « aux emplois civils et militaires de l'État ».
Cette compétence de principe constitue un retour à ce qui avait cours sous la Troisième République : l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 prévoyait ainsi que le Président de la République « nomme à tous les emplois civils et militaires ». Sous la Quatrième République, si le pouvoir de nomination appartenait en principe au président du Conseil (article 47 de la Constitution de 1946), la Constitution réservait au Président de la République la nomination, en conseil des ministres, à certains emplois supérieurs25(*) (article 30) ainsi que la nomination des magistrats du siège (article 84).
Le régime des nominations qui résulte de l'article 13 de la Constitution se caractérise par une certaine complexité. Comme le relevait le comité présidé par le doyen Vedel, « la compétence générale ainsi reconnue au Président a le double défaut d'être largement nominale et de s'exercer en outre dans une certaine confusion », relevant notamment que « l'intervention respective du Président de la République ou du Premier ministre en la matière se fait sur la base de dispositions qui manquent de clarté »26(*). Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Édouard Balladur27(*), a repris à son compte ce constat et proposé la modification des dispositions régissant les pouvoirs de nomination du Président de la République et du Premier ministre28(*).
Si l'article 21 de la Constitution prévoit que le Premier ministre « nomme aux emplois civils et militaires », sa compétence s'exerce à titre subsidiaire, « sous réserve des dispositions de l'article 13 »29(*). Elle ne s'exerce que dans les limites de la délégation consentie par le Président de la République, en application du quatrième alinéa de l'article 1330(*) et des articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État31(*).
Dans la pratique, les nominations relevant du Président de la République demeurent limitées en nombre et réservées aux emplois supérieurs. Pour les autres corps et cadres d'emplois, pour lesquels la marge de manoeuvre est toutefois réduite, la nomination relève, par l'effet des dispositions précitées, des ministres ou des autorités déconcentrées.
Les prérogatives du Premier ministre en la matière ne sont toutefois pas négligeables : outre les emplois relevant de ses services, il nomme, conjointement avec les ministres ou les autres autorités compétentes, aux emplois de direction de l'État régis par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 201932(*).
Les modalités de nomination par le Président de la République en application de l'article 13
Certaines nominations relèvent d'un décret en conseil des ministres.
Il s'agit, en premier lieu, des emplois expressément mentionnés au troisième alinéa de l'article 13 : les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales.
En relèvent, en second lieu, les emplois déterminés par une loi organique (quatrième alinéa de l'article 13) : l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1958 précitée mentionne l'emploi de procureur général près la Cour des comptes, les « emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres » et les emplois pour lesquels cette procédure était, à la date de publication de l'ordonnance, prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière.
En dernier lieu, il est pourvu en conseil des ministres à certains emplois lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières le prévoient, bien que la légalité de telles prescriptions soit douteuse compte tenu des dispositions précitées de l'ordonnance du 28 novembre 1958. Selon le Secrétariat général du Gouvernement, « il est également d'usage, bien qu'aucun texte ne le prévoie explicitement, de pourvoir en conseil des ministres aux emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement »33(*).
Les autres nominations relèvent d'un décret du Président de la République.
Sont notamment concernés les emplois mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes ; les magistrats de l'ordre judiciaire ; les professeurs de l'enseignement supérieur ; les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ; à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'institut national du service public et les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.
Le pouvoir de nomination du Président de la République ne relève pas de ses prérogatives discrétionnaires. Qu'elles aient lieu ou non en conseil des ministres, les nominations sont soumises au contreseing du Premier ministre et des ministres responsables.
De plus, à l'exception des emplois à la décision du Gouvernement, les nominations des fonctionnaires sont encadrées par les règles statutaires qui régissent leurs corps respectifs et celles des magistrats de l'ordre judiciaire par les dispositions qui leur sont propres (article 65 de la Constitution et ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).
Enfin, depuis la révision constitutionnelle de 2008, les nominations à certains emplois ou fonctions importants « pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » doivent être précédées d'un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. La nomination ne peut être prononcée lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cette procédure concerne une cinquantaine d'emplois énumérés par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
2. La position de la commission
Conformément au gentlemen's agreement et afin que la discussion en séance publique puisse avoir lieu sur la base du texte déposé par son auteure, le rapporteur a proposé à la commission, qui l'a suivi, de ne pas adopter l'article 1er.
La commission n'a pas adopté l'article 1er.
Article 2
Suppression de la prise de parole du Président de la
République devant le Parlement réuni en Congrès
L'article 2 de la proposition de loi tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 18 donnant au Président de la République la possibilité de prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès et prévoyant que sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
La commission n'a pas adopté l'article 2.
1. Le droit en vigueur
Le deuxième alinéa de l'article 18 de la Constitution prévoit que le Président de la République « peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. »
L'introduction de cette faculté à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2008 visait, selon les mots du professeur Anne Levade « à rompre avec une anomalie résultant de notre histoire constitutionnelle »34(*).
La Constitution du 4 octobre 1958 a initialement perpétué le principe de l'interdiction de la présence du Président de la République devant les assemblées parlementaires, qui trouve son origine aux débuts de la Troisième République35(*).
Afin de réduire l'influence sur les chambres du Président de la République, Adolphe Thiers, la loi du 13 mars 1873, dite loi « de Broglie », encadra strictement son expression devant celles-ci, dans des conditions que Thiers qualifia de « cérémonial chinois ». À cet encadrement se substitua bientôt une interdiction pure et simple. L'article 6 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 fixa comme forme exclusive de communication entre le Président de la République et le Parlement des messages « qui sont lus à la tribune par un ministre ».
Ces dispositions ont été reprises par la Constitution de 1946 puis par celle de 1958, le premier alinéa de son article 18 prévoyant à l'origine que « Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat »36(*).
Comme le relevait le président Jean-Jacques Hyest : « l'impossibilité pour le Président de la République de s'adresser directement au Parlement a été entendue très strictement au point d'interdire l'accès de l'enceinte des assemblées au chef d'État. Il n'a été dérogé à ce principe qu'avec d'infinies précautions. Ainsi, lorsque M. Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République, s'était rendu au Sénat lors du centième anniversaire de l'institution en 1975, la tribune avait été démontée afin de “déparlementariser” symboliquement l'hémicycle du Palais du Luxembourg »37(*).
Relevant qu'une telle interdiction de paraître devant le Parlement procédait d'une « conception étroite de la séparation des pouvoirs »38(*), le comité Balladur a proposé de permettre au Président de la République de « rendre compte de son action devant la représentation nationale ».
Il est notable que cette mesure ait été conçue par le comité Balladur comme allant dans le sens d'un renforcement du rôle du Parlement39(*). Dans le même sens, le président Hyest soulignait que les dispositions originelles de l'article 18 « participent davantage à la limitation de pouvoir d'information du Parlement [qu'elles ne concourent] à préserver ses prérogatives »40(*). Pour les opposants à la révision de 2008, une telle mesure participait au contraire d'une dérive présidentialiste de la Cinquième République et d'une marginalisation du Premier ministre41(*).
La possibilité pour le Président de la République de s'exprimer devant le Parlement, qui s'est ajoutée au droit de message prévu au premier alinéa de l'article 18, est néanmoins fortement contrainte42(*).
Son allocution ne peut être prononcée que devant les deux assemblées réunies en Congrès, convoquées à cet effet par un décret du Président de la République non soumis au contreseing. Il se déduit de la rédaction du deuxième alinéa de l'article 18 que la réunion du Congrès ne peut avoir que ce seul objet, le Président de la République ne pouvant intervenir à l'occasion d'une réunion ayant pour objet une révision de la Constitution.
En prévoyant l'absence du Président de la République au cours des débats qui suivent son allocution comme l'absence de vote à l'issue de ces derniers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 conservent au Premier ministre le monopole de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et interdisent toute remise en cause de celle du Président de la République à cette occasion.
La lourdeur de cette procédure explique qu'elle n'a été mise en oeuvre qu'à quatre reprises depuis 2008 :
- le 22 juin 2009, par Nicolas Sarkozy ;
- le 16 novembre 2015, par François Hollande ;
- les 3 juillet 2017 et 10 juillet 2018, par Emmanuel Macron43(*).
2. La position de la commission
La commission a considéré que la suppression du deuxième alinéa de l'article 18 de la Constitution n'était ni opportune ni susceptible de rééquilibrer les rapports entre le Président de la République et le Premier ministre - à supposer même qu'un tel rééquilibrage doive être poursuivi.
Comme le relève le professeur Anne Levade, « la proposition d'abroger le deuxième alinéa de l'article 18 de la Constitution a des allures de symbole et fait fi de l'intention autant que de la réalité du dispositif qui a été introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 »44(*). Pour Arnaud Teyssier, « supprimer cette faculté ne sert à rien, dès lors qu'elle n'a pas donné au Président de la République une puissance institutionnelle nouvelle »45(*).
Conformément au gentlemen's agreement et afin que la discussion en séance publique puisse porter sur le texte déposé par son auteure, le rapporteur a proposé à la commission, qui l'a suivi, de ne pas adopter l'article 2.
La commission n'a pas adopté l'article 2.
Article 3
Attribution au Premier ministre du pouvoir de dissoudre
l'Assemblée nationale
En coordination avec son article 1er qui abroge l'article 12 de la Constitution, l'article 3 de la proposition de loi transfère au Premier ministre le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale.
Le rapporteur estime qu'un tel transfert n'est nullement nécessaire à la consécration de la nature parlementaire de la Cinquième République et qu'il aurait pour effet de priver le Président de la République d'un outil essentiel dans l'exercice de son rôle d'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
La commission n'a pas adopté cet article.
1. Le droit en vigueur
Il est renvoyé au commentaire de l'article 1er de la proposition de loi pour l'analyse des dispositions en vigueur de l'article 12 de la Constitution qui confient au Président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale.
2. Le dispositif proposé : le transfert au Premier ministre du pouvoir de dissolution
L'article 3 de la proposition de loi complète l'article 20, qui pose le principe de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, par quatre alinéas visant à transférer au Premier ministre le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ces quatre alinéas sont la reprise, moyennant le changement du titulaire de la prérogative en cause, des dispositions de l'article 12 de la Constitution. Les délais d'organisation des élections législatives et de mise en place de la nouvelle Assemblée sont donc maintenus, de même que l'interdiction de prononcer une dissolution dans l'année qui suit l'organisation des élections législatives.
3. La position de la commission : un transfert qui ne peut qu'ajouter au risque de blocage politique
Le pouvoir de dissolution est un outil déterminant dans l'exercice par le Président de la République de son rôle d'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. En appelant le peuple à trancher un conflit entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou entre lui et cette dernière46(*), il est un instrument démocratique de résolution d'une crise politique. Retirer ce pouvoir discrétionnaire au Président de la République est donc, selon le rapporteur, incompatible avec l'esprit de l'article 5 de la Constitution. Pour reprendre les termes de Michel Debré dans son discours du 27 août 1958 devant le Conseil d'État, la dissolution « est l'instrument de la stabilité gouvernementale. Elle peut être la récompense d'un Gouvernement qui paraît avoir réussi, la sanction d'un Gouvernement qui paraît avoir échoué. Elle permet entre le chef de l'État et la nation un bref dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une heure décisive ».
Le rapporteur rappelle, par ailleurs, que le pouvoir de dissolution est censé exercer, sans pour autant être mis en oeuvre, un effet dissuasif à l'endroit des députés, a fortiori dans le cadre d'un scrutin législatif majoritaire qui les conduit nécessairement à tenir compte de leurs chances de réélection en cas d'organisation, dans un temps contraint, de nouvelles élections législatives. Comme le relèvent Guy Carcassonne et Marc Guillaume dans leur édition commentée de La Constitution, « [...] l'importance du droit de dissolution ne tient pas seulement à ses utilisations. Elle tient avant tout à la menace qu'en permanence il fait peser sur les députés. Avec le scrutin majoritaire, tout député déteste la dissolution qui, au mieux, lui coûte le temps et l'argent de la campagne et, au pis, peut lui faire perdre son siège [...]. Cette crainte révérencielle est gage de sagesse [...] »47(*).
Or cet effet dissuasif n'aurait assurément pas la même portée dans l'hypothèse où le pouvoir de dissolution serait détenu par le Premier ministre qui, lui-même, se trouve fragilisé par la possibilité que les députés le renversent par l'adoption d'une motion de censure. La prime serait en réalité à celui qui « tire » le premier, dès lors que le Premier ministre ne peut, son Gouvernement une fois renversé, faire usage de la dissolution pour répliquer à une censure. La question se pose de savoir si un Premier ministre nouvellement nommé par le Président de la République après une précédente censure peut, avant d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale comme l'exige la proposition de loi, prononcer la dissolution de la chambre basse. Une autre solution aurait pu consister à s'inspirer de l'exemple espagnol où la dissolution revêt un caractère automatique lorsqu'au terme de deux mois, aucune majorité ne s'est dégagée pour former un nouveau gouvernement.
Enfin, historiquement, si le chef de l'État était déjà titulaire du pouvoir de dissolution sous les Troisième et Quatrième Républiques, c'est la Cinquième République qui en a fait un pouvoir discrétionnaire, en se bornant à le soumettre à des consultations préalables des hautes autorités de l'État sans que celles-ci puissent lier la décision du Président de la République.
De l'avis de plusieurs universitaires et personnalités entendus par le rapporteur, le transfert du pouvoir de dissolution au Premier ministre n'est non seulement pas nécessaire à la consécration de la nature parlementaire de notre régime mais n'est pas davantage indispensable à un rééquilibrage du pouvoir exécutif en faveur du Premier ministre. Nombreux sont les exemples de pays européens dans lesquels le chef de l'État détient le pouvoir de dissolution, celui-ci étant toutefois subordonné au contreseing du Premier ministre ou à un accord du Gouvernement - sauf en Autriche, où ce pouvoir reste discrétionnaire.
Si l'intention des auteurs de la proposition de loi était donc de limiter les pouvoirs discrétionnaires du Président de la République, d'autres voies auraient pu être envisagées, comme l'encadrement de son droit de dissolution par des conditions de droit, telles qu'une proposition préalable du Premier ministre, le cas échéant, après vote du Gouvernement, ou des circonstances factuelles, telles que la succession de plusieurs crises gouvernementales dans un délai déterminé.
Aux yeux du rapporteur, ni l'objectif des auteurs de la proposition de loi, ni les moyens qu'ils envisagent pour y parvenir ne paraissent opportuns. Toutefois, conformément au gentlemen's agreement, il a proposé à la commission, qui l'a suivi, de se borner à ne pas adopter l'article 3 afin de permettre à la discussion en séance publique de porter sur le texte d'origine des auteurs de la proposition de loi.
La commission n'a pas adopté l'article 3.
Article 4
Extension des pouvoirs du Premier ministre en matière
réglementaire, de nomination et de présidence du conseil des
ministres
L'article 4 tend à confier au Premier ministre la présidence du conseil des ministres et précise que celui-ci se tient sur le lieu d'exercice de ses fonctions.
Il attribue également au Premier ministre, en conséquence de l'abrogation de l'article 13 de la Constitution proposée par l'article 1er de la proposition de loi constitutionnelle, l'intégralité de l'exercice du pouvoir réglementaire et du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires.
La commission n'a pas adopté l'article 4.
1. Le droit en vigueur
Il est renvoyé au commentaire de l'article 1er de la proposition de loi pour l'analyse des dispositions en vigueur des articles 9 et 13 de la Constitution.
2. La proposition de loi constitutionnelle
L'article 4 propose plusieurs modifications de l'article 21 de la Constitution, qui a trait aux prérogatives du Premier ministre.
Le 1° ajoute, au début de l'article 21, un nouvel alinéa conférant au Premier ministre la présidence du conseil des ministres. Cet alinéa précise également que le conseil des ministres « se tient sur le lieu d'exercice de ses prérogatives ».
Il laisse toutefois subsister le dernier alinéa de cet article qui permet au Premier ministre, à titre exceptionnel, de suppléer le Président de la République pour la présidence d'un conseil des ministres.
Le 2° modifie également le premier alinéa de l'article 21 pour confier au Premier ministre le monopole de l'exercice du pouvoir réglementaire et des nominations aux emplois civils et militaires.
Rédaction envisagée pour l'article 21 de la Constitution
« Le Premier ministre préside le Conseil des ministres qui se tient sur le lieu d'exercice de ses prérogatives.
« Le Premier ministre Il dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13,Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
« Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
« Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
« Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. »
En l'état de la proposition de loi constitutionnelle, les nominations prononcées par le Président de la République, outre celles du Premier ministre et des membres du gouvernement (article 8), se réduiraient à celles directement prévues par la Constitution : membres et président du Conseil constitutionnel (article 56), membres du Conseil supérieur de la magistrature (article 65), Défenseur des droits (article 71-1) et, possiblement, à celles prévues par le statut de la magistrature, dès lors que le Président de la République demeurerait, en vertu de l'article 64, le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
3. La position de la commission
Le rapporteur relève que les modifications proposées aboutiraient à un bouleversement des équilibres au sein du pouvoir exécutif.
Ôter au Président de la République la présidence du conseil des ministres comme son pouvoir de nomination constituerait une rupture avec la tradition constitutionnelle française. Les attributions du Président de la République seraient alors moindres que sous les Troisième et Quatrième Républiques, où il présidait le conseil des ministres et disposait d'un pouvoir de nomination (cf. commentaire sous l'article 1er).
Plus largement, comme le relevait le professeur Anne Levade, retirer au Président de la République son pouvoir de nomination constituerait, plus largement, « une rupture avec la tradition des régimes parlementaires dans lesquels les chefs de l'État - y compris ceux dotés des compétences les moins importantes - disposent toujours d'une compétence résiduelle de nomination »48(*).
Le rapporteur souligne qu'une telle amputation des prérogatives du Président de la République empêcherait ce dernier d'exercer les missions essentielles qui lui sont conférées par la Constitution, et que la proposition de loi constitutionnelle ne remet pas en cause.
Sauf à considérer ces attributions comme
purement honorifiques, il est ainsi permis de s'interroger sur la
manière dont le Président de la République pourrait
alors veiller au respect de la Constitution,
assurer « par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que
la continuité de
l'État », garantir l'indépendance nationale,
l'intégrité du territoire et le respect des traités
(article 5), être le chef des armées (article 15) et
garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire (article
64)49(*).
Au surplus, le rapporteur relève que la précision qu'il est proposé d'ajouter au sujet du lieu de réunion du conseil des ministres paraît superfétatoire. Le professeur Jean-Philippe Derosier a rappelé que « l'exercice d'une telle compétence se fait rarement ratione loci »50(*). Or, s'il se réunit habituellement au palais de l'Élysée, le conseil des ministres peut être réuni en tout lieu, voire à distance (cf. commentaire sous l'article 1er).
Aux yeux du rapporteur, ni l'objectif des auteurs de la
proposition de loi, ni les moyens qu'ils envisagent pour y parvenir ne
paraissent opportuns. Conformément au gentlemen's agreement, il
a proposé à la commission,
qui l'a suivi, de se borner
à ne pas adopter l'article 4 afin de permettre à
la discussion en séance publique de porter sur le texte d'origine
des auteurs de la proposition de loi.
La commission n'a pas adopté l'article 4.
Article 5
Attribution au Premier ministre du pouvoir de signer les
ordonnances et décrets délibérés en conseil des
ministres et de nommer aux emplois civils et militaires de l'État
En coordination avec son article 1er qui abroge l'article 13 de la Constitution, l'article 5 de la proposition de loi transfère au Premier ministre le soin de signer les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres et de nommer aux plus hauts emplois civils et militaires de l'État.
Le rapporteur estime que les pouvoirs que le Président de la République tire de l'article 13 de la Constitution consubstantiels à son rôle de chef des armées et d'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
La commission n'a pas adopté cet article.
1. Le droit en vigueur
Il est renvoyé au commentaire de l'article 1er de la proposition de loi pour l'analyse des dispositions en vigueur de l'article 13 de la Constitution qui confient au Président de la République le pouvoir de signer les ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres et de nommer aux plus hautes fonctions civiles et militaires de l'État.
2. Le dispositif proposé : le transfert au Premier ministre des prérogatives du Président de la République prévues actuellement à l'article 13 de la Constitution
En coordination avec l'article 1er de la proposition de loi abrogeant l'article 13 de la Constitution, l'article 5 du texte introduit dans la Constitution un nouvel article 20-1 prévoyant que les ordonnances et décrets en conseil des ministres - il n'est pas précisé qu'il s'agit de ceux « délibérés » en conseil des ministres - sont signés par le Premier ministre et que celui nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Répliquant les dispositions de l'article 13 de la Constitution, moyennant l'attribution au Premier ministre des prérogatives en cause, le nouvel article 20-1 envisagé maintient la procédure d'audition des personnalités nommées par le Président de la République par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat avec la possibilité que ces nominations ne puissent aboutir si l'addition des votes négatifs représente, au sein des deux commissions compétentes, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.
3. La position de la commission : des compétences présidentielles qui n'ont jamais fait obstacle à ce que le Gouvernement puisse mettre en oeuvre la politique qu'il détermine
La faculté pour le Président de la République de refuser de signer des ordonnances délibérées en conseil des ministres n'a pas été remise en cause depuis l'opposition manifestée par François Mitterrand en 1986 à ce qu'il soit procédé par cette voie à des privatisations d'entreprises nationalisées avant 1981 ainsi qu'au redécoupage des circonscriptions législatives. S'il tend à remettre en cause une autorisation accordée souverainement au Gouvernement par le Parlement pour légiférer dans des délais encadrés et un domaine circonscrit, l'exercice de cette faculté n'a eu, dans les faits, que pour effet de retarder l'adoption des mesures envisagées en contraignant le Gouvernement à privilégier la voie législative.
Le rapporteur souligne que le pouvoir d'appréciation du Président de la République sur l'opportunité de signer une ordonnance n'est, du reste, pas sans vertu : on se souviendra de l'épisode italien au cours duquel le président Giorgio Napolitano avait refusé de signer l'ordonnance présentée par le président du Conseil Silvio Berlusconi, destinée à permettre à ce dernier d'échapper aux poursuites judiciaires engagées contre lui.
Quant à un refus présidentiel de signer un décret délibéré en conseil des ministres, il apparaît d'autant plus improbable que, s'il s'agit d'un décret d'application de la loi - et c'est très majoritairement le cas -, un tel refus, en faisant obstacle à la mise en oeuvre de la volonté générale exprimée par le Parlement ou directement par le peuple, poserait en définitive la question de savoir s'il y a lieu d'y voir un manquement du chef de l'État à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat au sens de l'article 68 de la Constitution.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose certes de l'administration et de la force armée en application de l'article 20 de la Constitution, ce qui pourrait justifier de confier au Premier ministre le soin de désigner les titulaires des plus hautes fonctions de l'appareil administratif et militaire.
Toutefois, la proposition de loi constitutionnelle laisse intact l'article 15 de la Constitution qui charge le Président de la République, en sa qualité de chef des armées, de présider les conseils et comités supérieurs de la défense nationale, de même que l'article 5 qui en fait le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire : alors qu'il a le pouvoir de décider du « feu nucléaire », il peut paraître incongru qu'il soit privé de la possibilité de désigner les titulaires des plus hautes fonctions de l'armée.
Quant au plan diplomatique, l'article 14 de la Constitution confie au Président de la République le pouvoir d'accréditer tant les ambassadeurs de la France auprès des puissances étrangères que les ambassadeurs étrangers en France : il semble dès lors cohérent qu'il puisse décider de la nomination des ambassadeurs de la France à l'étranger.
Enfin, le rapporteur rappelle, d'une part, que le pouvoir de nomination du Président de la République ne concerne que le périmètre circonscrit de l'article 13 et des lois organiques prises pour son application : l'article 21 attribue ainsi au Premier ministre l'ensemble des nominations aux emplois civils et militaires ne relevant pas de ce périmètre. D'autre part, tous les décrets de nomination du Président de la République, que ceux-ci soient délibérés en conseil des ministres ou pas, doivent être contresignés, en application de l'article 19 de la Constitution, par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables, seuls ces contresignataires étant responsables.
Mettre fin au pouvoir du Président de la République constituerait, en outre, une rupture avec la tradition constitutionnelle française, l'article 30 de la Constitution de la Quatrième République ayant chargé, par exemple, le chef de l'État de nommer les plus hauts fonctionnaires de l'État. Ajouté à la perte de la présidence du conseil des ministres, le retrait d'un tel pouvoir achèverait de mettre le Président de la République à l'écart des rouages essentiels de l'État, en contradiction avec sa mission d'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
En tout état de cause, confier le pouvoir de nomination aux plus hautes fonctions de l'État au Premier ministre ne saurait constituer un moyen crédible de garantir la neutralité des plus hauts responsables du service public, le chef du Gouvernement ne pouvant sérieusement être regardé comme mieux placé que le Président de la République pour échapper à l'influence des partis politiques et au risque du « spoils system ».
Aux yeux du rapporteur, ni l'objectif des auteurs de la proposition de loi, ni les moyens qu'ils envisagent pour y parvenir ne paraissent opportuns. Toutefois, conformément au gentlemen's agreement, il a proposé à la commission, qui l'a suivi, de se borner à ne pas adopter l'article 5 afin de permettre à la discussion en séance publique de porter sur le texte d'origine des auteurs de la proposition de loi.
La commission n'a pas adopté l'article 5.
Article 6
Engagement de la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée nationale après chaque nouvelle nomination d'un
Premier ministre
L'article 6 de la proposition de loi systématise l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale après chaque nomination d'un nouveau Premier ministre.
En remettant en cause le principe de la confiance présumée de l'Assemblée nationale à l'égard d'un Gouvernement nouvellement nommé, le rapporteur estime que la proposition de loi est de nature à accroître le risque d'instabilité gouvernementale qu'elle entend pourtant juguler. Il rappelle qu'en tout état de cause, l'article 49 de la Constitution, par le mécanisme de la motion de censure, offre déjà la possibilité aux députés de dénier leur confiance au Gouvernement.
La commission n'a pas adopté cet article.
1. Le droit en vigueur
L'article 49 de la Constitution est le pendant de son article 20 qui pose le principe de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. Il organise les conditions de l'engagement de cette responsabilité, l'article 50 prévoyant qu'en cas de refus de la confiance demandée à l'Assemblée ou d'adoption par celle-ci d'une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Instrument essentiel du parlementarisme rationalisé, l'article 49 comporte quatre alinéas :
- le 1er alinéa prévoit le mécanisme dit de la question de confiance : ce mécanisme est laissé à la main du Premier ministre qui peut décider, après délibération en conseil des ministres, d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale. En faisant de la question de confiance une simple faculté à la discrétion du Premier ministre, la Constitution de la Cinquième République instaure un principe de confiance présumée du Parlement ;
- le 2e alinéa permet, en contrepartie, à au moins un dixième des députés de déposer une motion de censure contre le Gouvernement, cette motion devant, pour être adoptée, recueillir un nombre de votes favorables - les abstentions ne sont pas comptabilisées - supérieur au nombre de membres composant l'Assemblée nationale ;
- le 3e alinéa, plus communément appelé le « 49.3 », institue le mécanisme de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, ainsi que sur le vote d'un autre projet ou proposition de loi par session. L'engagement de cette procédure est décidé en conseil des ministres et permet de considérer le texte comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 49 ;
- le 4e alinéa prévoit que le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
2. Le dispositif proposé : la systématisation de la question de confiance
L'article 6 de la proposition de loi tend :
- d'une part, à contraindre le Premier ministre, après sa nomination, à engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, mettant ainsi fin à l'idée d'une confiance présumée de cette dernière ;
- d'autre part, à permettre au Premier ministre d'engager à nouveau cette responsabilité à tout moment au cours de ses fonctions. Il est à noter que la proposition de la loi ne conditionne pas l'exercice de cette faculté à une délibération préalable du conseil des ministres, comme c'est pourtant le cas aujourd'hui.
3. La position de la commission : une quasi-procédure d'investiture inopportune
Dans son discours du 27 août 1958 devant le Conseil d'État, Michel Debré avait rappelé que « la question de confiance est l'arme du Gouvernement, et de lui seul ». Le système rationalisé prévu par l'actuel article 49 de la Constitution fait peser sur les députés la charge d'apporter la preuve qu'une majorité d'entre eux est opposée au Gouvernement. Il a été précisément conçu pour permettre au pays d'être gouverné même en l'absence d'une majorité absolue en soutien du Gouvernement au sein de l'Assemblée nationale.
Si, en instituant une quasi-procédure d'investiture du Gouvernement - qui était à l'oeuvre sous la Quatrième République -, la proposition de loi entend ressourcer sa légitimité au Parlement, elle tend à soumettre le pouvoir de nomination que le Président de la République tient de l'article 8 à une procédure d'approbation de nature politique. Elle aurait pour effet de rapprocher la désignation du Gouvernement de la procédure d'investiture organisée par l'article 63 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, selon laquelle le chancelier fédéral est élu par le Bundestag sur proposition du Président fédéral.
Cette procédure d'investiture apparaît, au
demeurant, redondante avec la possibilité,
déjà prévue par le deuxième alinéa de
l'article 49 de la Constitution, pour une majorité de
députés de renverser tout Gouvernement nouvellement
nommé : on notera, à cet égard, que,
depuis
l'été 2024, chaque déclaration de
politique générale des gouvernements qui se sont
succédé s'est accompagnée du dépôt d'une ou
plusieurs motions de censure et qu'aucune n'a été
adoptée.
Le rapporteur observe que, bien qu'animée par la volonté de résoudre la situation de blocage politique actuelle, la proposition de loi ne s'aventure pas à introduire à l'article 49 de la Constitution la motion dite de défiance constructive, qui impliquerait que, pour renverser le Gouvernement, une majorité de députés devrait être contrainte de s'accorder sur la désignation d'un nouveau Premier ministre. Eu égard à la fragmentation de l'Assemblée nationale en trois blocs qui se refusent a priori à gouverner ensemble, certains commentateurs pensent qu'un tel mécanisme aurait fait obstacle au renversement du gouvernement de Michel Barnier à la fin de l'année 2024.
Toutefois, ce mécanisme de défiance constructive, outre qu'il est peu adapté à une culture politique française peu encline aux grands accords de coalition sur le modèle allemand, conduirait à instituer une forme de pouvoir de nomination du Premier ministre concurrent de celui que le Président de la République tient de l'article 8 de la Constitution.
En définitive, la proposition de loi pourrait conduire à une situation potentiellement inextricable dans laquelle le pays ne pourrait disposer d'un Gouvernement, en l'absence de majorité claire émergeant de l'Assemblée nationale prête à l'investir et en l'absence de mécanisme de défiance constructive garantissant la désignation d'un Premier ministre alternatif assuré du soutien d'une majorité parlementaire.
Aux yeux du rapporteur, ni l'objectif des auteurs de la proposition de loi, ni les moyens qu'ils envisagent pour y parvenir ne paraissent opportuns. Toutefois, conformément au gentlemen's agreement, il a proposé à la commission, qui l'a suivi, de se borner à ne pas adopter l'article 6 afin de permettre à la discussion en séance publique de porter sur le texte d'origine des auteurs de la proposition de loi.
La commission n'a pas adopté l'article 6.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous passons à l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement, présentée par Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues.
Mme Cécile Cukierman, auteure de la proposition de loi constitutionnelle. - Ce texte n'a pas vocation à régler la crise politique et institutionnelle que traverse notre pays depuis des années. Cependant, il nous importe de contribuer à apporter des ajustements à une Constitution qui, depuis 1958, a évolué.
Dès 1958, s'est posée la question de la dyarchie au sommet de l'exécutif formée par le Président de la République et le Premier ministre, aux contours difficilement appréhendables par nos concitoyens. L'élection du Président de la République au suffrage universel direct en 1962 a été de nature à enclencher un virage vers un régime présidentiel, qui s'est accentué au fil des années. Jusqu'à dernièrement, le Premier ministre pouvait s'appuyer, y compris en période de cohabitation, sur une majorité à l'Assemblée nationale, recourant parfois à certains articles de la Constitution, dont le fameux « 49.3 », pour contrer certaines aspirations fortes.
Depuis 2027, les choses ont évolué. Le Président de la République a renforcé l'hyper-présidentialisation du régime, affaiblissant ainsi le pouvoir parlementaire.
Le Président de la République doit « nommer » le Premier ministre, selon les termes très clairs retenus par le constituant. Or, depuis la dernière dissolution, il « choisit » le Premier ministre, faisant fi du résultat des élections législatives, au nom d'une stabilité dont chacun peut observer depuis dix-huit mois les limites au vu de la durée des gouvernements. Ceux-là mêmes qui raillaient la Quatrième République au lendemain des élections législatives de 2024 ne sauraient s'inscrire en faux contre la succession de Premiers ministres au cours des dernières années, y compris au sein d'une même année civile.
Face à ce constat, nous avons fait le choix de nous concentrer sur le rapport des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier ministre, non pas pour nous attaquer à l'institution présidentielle, ni au pouvoir parlementaire, mais pour réorganiser, à l'instar de ce qui peut se passer dans d'autres démocraties voisines, les pouvoirs du Premier ministre. Telle est la philosophie de cette proposition de loi constitutionnelle.
Nous ne faisons pas partie de ceux qui appellent à la destitution du Président de la République. Je ne fais pas non plus partie de ceux qui se gargarisent, dans nos territoires, du « Macron, dégage ! », slogan que pourraient s'approprier 80 % de nos concitoyens. Quand nos institutions sont à ce point décriées, c'est la démocratie qui est fragilisée, et cela favorise le populisme. C'est pourquoi nous voulons rééquilibrer les pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre, pour les renforcer en faveur de ce dernier.
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. - Nous sommes saisis d'une proposition de loi constitutionnelle qui vise, pour reprendre les termes de son intitulé, « à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement ».
Concrètement, ce texte retire au chef de l'État la présidence du conseil des ministres, le pouvoir de signer les ordonnances et décrets qui y sont délibérés et de nommer aux plus hautes fonctions civiles et militaires de l'État, ainsi que le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ces trois prérogatives sont transférées au Premier ministre qui devra, en outre, engager systématiquement, après sa nomination par le Président de la République, la responsabilité de son Gouvernement.
Cette volonté de rééquilibrage au sommet de l'exécutif se fonde sur un diagnostic : une crise protéiforme sociale, politique et institutionnelle. Force est de constater que, à chaque situation de crise, il y a toujours eu cette volonté de faire table rase du passé pour aboutir à ce qui serait la perfection constitutionnelle. Néanmoins, excepté les situations à caractère exceptionnel, comme les lendemains d'une guerre ou d'un coup d'État, il semble toujours aventureux de se lancer dans un processus d'écriture ou de révision de la Constitution en plein milieu d'une crise, le risque étant de confondre des éléments conjoncturels et structurels et, au lieu de corriger, à juste titre, certains écueils, de faire naître en réalité d'autres difficultés.
Alors, sommes-nous dans une situation de crise ? Et dans l'affirmative, quelle en serait la nature ?
Il est vrai que la dissolution de 2024 a incontestablement aggravé la fragmentation, l'émiettement de l'offre politique et donc la stabilité gouvernementale. Mais de mon point de vue, la fragmentation n'a pas pour cause première cette dissolution. Certes, c'est un facteur aggravant, mais nullement le facteur originel.
Cette crise tient d'abord, me semble-t-il, à l'effondrement relatif des deux grandes formations politiques qui ont structuré la vie politique et les coalitions organisées autour d'elles : je veux bien évidemment parler des Républicains et des Socialistes. Le paysage politique s'est en quelque sorte fracturé entre plusieurs camps. Pour faire simple, même si les termes peuvent-être contestables : centre, gauche, droite, extrême droite, extrême gauche. Aucun de ces éléments fragmentés n'est en mesure d'organiser une coalition durable.
Plus profondément, et cela dépasse le cadre de l'examen de cette proposition de loi constitutionnelle, cette situation tient, me semble-t-il, à une société profondément divisée. La représentation politique actuelle est à l'image de la société. Il est aujourd'hui difficile de structurer la société autour d'un véritable projet ou encore d'une idéologie fédératrice. Il en résulte que cette situation s'apparente plus à une crise de la démocratie qu'à une crise institutionnelle ou de régime. Et un des éléments structurants de cette crise démocratique tient au fait que le vote n'embraye plus sur la décision politique parce que les dirigeants politiques ont peut-être perdu une large partie de leur capacité à agir sur le réel. Certains peuvent avoir le sentiment que le pouvoir s'est en quelque sorte déplacé dans les mains des institutions européennes, des juges, des autorités administratives indépendantes, des puissances financières ou encore des réseaux sociaux.
Ainsi, politiquement, nous ne pouvons pas dire que cette période est facile à décrypter. Cela étant, j'ai le sentiment que nos institutions tiennent le coup. Je pense que la nature du blocage est avant tout d'ordre politique et non institutionnel. Le coeur du blocage réside en réalité dans le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue ou relative. Rappelons que la Cinquième République a été conçue précisément pour gérer cette situation, et que la Constitution apporte tous les instruments permettant de sortir d'une telle situation. Par exemple, nous avons évoqué cette année, pour la première fois depuis la naissance de la Cinquième République, les ordonnances budgétaires. C'est vraiment l'esprit même du régime.
Face à ce constat, la question est de savoir si le transfert de nombreuses compétences du Président de la République, directement élu par le peuple, à un Premier ministre dépendant du Parlement peut aider à surmonter cette crise politique que nous traversons. C'est en fait la question fondamentale à laquelle nous invite à répondre cette proposition de loi constitutionnelle.
L'idée sous-jacente du texte, même si elle n'est pas clairement exprimée, est la suivante : il faudrait ressourcer la légitimité du pouvoir au Parlement, avec cette faculté de former des coalitions éventuellement thématiques. C'est un pari relativement incertain.
D'abord, le consensus politique n'est pas dans la tradition constitutionnelle française. Certes, on peut inciter à y pourvoir, mais les récents travaux budgétaires laissent entendre que la situation au Parlement ne favorise pas ce consensus. Aujourd'hui, on se retrouve dans un système très proche de celui des Troisième et Quatrième Républiques. C'est l'habileté politique qui permet la survie du Gouvernement. Le Premier ministre, en dépit de son habileté, n'est pas arrivé, même sur des éléments thématiques précis, à créer une forme de consensus. Nous sommes dans une situation de paralysie parce que toute décision un peu brutale, un peu courageuse menacerait la survie du Gouvernement. Et, en toute hypothèse, la situation présente n'est pas imputable, de mon point de vue, à l'équilibre interne du pouvoir exécutif, contrairement à ce que soutient l'exposé des motifs de cette proposition de loi constitutionnelle.
Ce qui peut être à l'origine analysé comme une situation de blocage relève, à mon sens, de la pratique de nos institutions.
J'ai le sentiment que l'équilibre recherché par cette proposition de loi constitutionnelle ne serait pas de nature à résoudre le problème. Toutefois, ce texte répond, à mon sens, à une autre question. Il peut paraître légitime de se saisir du contexte singulier dans lequel nous sommes pour essayer de pousser à nouveau cette idée qu'il faudrait diminuer les pouvoirs du Président de la République et augmenter ceux du Premier ministre pour aller vers la primo-ministérialisation plutôt que la présidentialisation du régime.
Néanmoins, ce qui peut paraître gênant à la lecture de l'exposé des motifs, c'est cette idée sous-jacente que notre régime ne serait pas un régime parlementaire. Or, si nous avons un Gouvernement responsable politiquement devant le Parlement, et dans le même temps, un pouvoir de dissolution dans les mains de l'exécutif, alors nous sommes véritablement face à un régime parlementaire.
Pour autant, je voudrais souligner l'importance de la pratique. Il est vrai que notre régime a été très majoritairement présidentialisé, avec, d'ailleurs, des interprétations totalement différentes en fonction de la personnalité du Président de la République en exercice : la présidentialisation vue par le général de Gaulle n'est pas identique à celle vue par Georges Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing, par François Mitterrand, par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, par François Hollande et aujourd'hui par Emmanuel Macron. Mais au cours de la Cinquième République, nous avons eu aussi des périodes de primo-ministérialisation au travers notamment des trois cohabitations. Ce n'est donc pas la lettre du texte qui dicte la dynamique de l'exécutif, mais bel et bien la pratique.
On pourrait m'opposer qu'il suffirait de verrouiller le texte de telle manière que l'on empêche les pratiques « déviantes ». Mais je mise plutôt sur le pari de l'intelligence et de la confiance dans les acteurs politiques, partant du principe que nous ne sommes jamais à l'abri de circonstances qui exigeraient que l'on puisse tirer du côté soit de la primo-ministérialisation, soit de la présidentialisation. J'aime cette souplesse de nos institutions.
En d'autres termes, la période est certes dysfonctionnelle en pratique, mais nous pourrions trouver regrettable que l'on en tire des conclusions et des conséquences qui conduiraient inexorablement à déséquilibrer le régime en le verrouillant à l'excès d'autant que, comme on a pu le constater, chaque fois que le constituant a voulu édicter des règles beaucoup trop précises, la pratique s'est adaptée au travers d'un processus de contournement.
J'en veux pour preuve un exemple frappant : l'un des objectifs de la révision constitutionnelle de 2008 était d'accorder plus de temps au Parlement, notamment grâce au partage de l'ordre du jour. Cela supposait une baisse du nombre de textes gouvernementaux et un moindre recours à la procédure accélérée, ce qui ne s'est pas produit.
J'en viens à l'analyse du texte.
L'article 1er a pour objet l'abrogation de plusieurs articles de la Constitution, dont l'article 9, sur la présidence du conseil des ministres. Cela nous renvoie à l'article 4 de la proposition de loi constitutionnelle, aux termes duquel le Premier ministre présiderait un conseil des ministres, qui « se tient sur le lieu d'exercice de ses prérogatives ».
En préambule, je rappelle, d'une part, que la présidence du conseil des ministres était déjà attribuée au chef de l'État sous les Troisième et Quatrième Républiques ; d'autre part, que le fait qu'un chef d'État préside le conseil des ministres n'est pas incompatible avec la primo-ministérialisation du régime. En outre, le fait de présider ne signifie pas pour autant que l'on dispose d'un pouvoir de décision, ce qu'illustrent les périodes de cohabitation. Toutefois, ce transfert de la présidence fait perdre la possibilité, pour le Président de la République, d'influer de manière hebdomadaire sur le travail gouvernemental.
Le fait que la détermination de l'ordre du jour du conseil des ministres relève de la compétence du Président de la République conduit, en période de concordance des majorités, à ce qu'il incite le Gouvernement à privilégier les axes sur lesquels lui-même s'est engagé. En revanche, dans le cadre d'une cohabitation, cette prérogative avait permis à Jacques Chirac de refuser, en février 2001, l'inscription à l'ordre du jour d'un conseil des ministres d'un projet de loi relatif à la Corse ; il s'agissait, alors, de demander au gouvernement de tenir compte des difficultés juridiques soulevées par le Conseil d'État sur ce texte. Cela n'a eu pour effet, en définitive, que de reporter l'examen de ce projet de loi au conseil des ministres suivant. Toutefois, si ce phénomène de blocage et de paralysie des institutions devait se prolonger dans le temps, la question d'un manquement du Président de la République à ses devoirs susceptible de justifier une procédure de destitution se pose.
La notion de « lieu d'exercice de ses prérogatives » est floue. Il conviendrait de la supprimer, si le texte devait prospérer, afin d'éviter toute interprétation excessive.
Le transfert au Premier ministre du droit de dissoudre l'Assemblée nationale change la logique générale du régime. En réalité, le fait que le Président de la République prononce la dissolution n'est pas, en soi, un facteur de présidentialisation du régime. Ainsi, au Royaume-Uni, c'est le monarque qui dissout, sur la requête du Premier ministre, et non ce dernier. En revanche, c'est en en conditionnant l'usage que nous pouvons amoindrir le droit de dissolution, par exemple sur la forme, après un vote en conseil des ministres, ou selon des critères factuels, telle la succession de deux crises dans un délai de dix-huit mois, comme sous la Quatrième République. Au surplus, même un régime primo-ministériel pourrait conduire à des dissolutions à répétition, ce qui, à mon avis, ne satisferait pas davantage les auteurs de ce texte.
Je souligne que l'article 5 de la Constitution, qui fait du Président de la République le garant de la continuité de l'État et de l'indépendance nationale, ainsi que l'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, n'est pas modifié par cette proposition de révision constitutionnelle. Or imagine-t-on un seul instant qu'un Président de la République, chef des armées, ayant la possibilité de mettre en oeuvre les pleins pouvoirs, en application de l'article 16 de la Constitution, et pouvant décider du référendum, n'ait aucun contact avec le conseil des ministres et, surtout, n'ait plus la possibilité de dissoudre l'Assemblée ? La dissolution est une arme majeure pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le Président, élu au suffrage universel direct et qui conserverait des compétences considérables, n'aurait alors plus les moyens d'interagir avec les rouages de l'État.
En outre, comment un Premier ministre renversé dissoudrait-il, en retour, l'Assemblée nationale ? Faudrait-il considérer qu'en qualité de titulaire du droit de dissolution, il ne serait pas immédiatement démis et qu'il aurait cette possibilité dans le cadre de la gestion des affaires courantes ? Cela s'annonce complexe.
L'article 1er de la proposition de loi tend également à supprimer l'article 13 de la Constitution, qui porte sur le pouvoir de nomination du Président de la République. Or parmi les démocraties occidentales, de nombreux Présidents de la République, même lorsque leur poids institutionnel est faible, possèdent un pouvoir de nomination. Ce n'est donc pas un élément constitutif de la présidentialisation du régime.
Il convient également de rappeler que tout décret de nomination du Président de la République est, conformément à l'article 19 de la Constitution, contresigné par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Par ailleurs, la distinction entre les nominations du Président de la République et du Premier ministre contribue à la hiérarchisation des emplois de la haute fonction publique. Ainsi, il n'est pas anormal que le Président de la République nomme les ambassadeurs, puisqu'ils représentent l'État. Ainsi, comment le Président de la République, chef des armées, pourrait-il assurer l'indépendance et l'intégrité de notre pays et présider les conseils et comités supérieurs de défense nationale, s'il ne pouvait nommer les titulaires des plus hautes fonctions militaires ?
Autre incongruité : la proposition de loi maintient les dispositions de la Constitution chargeant le chef de l'État d'accréditer nos ambassadeurs auprès des puissances étrangères, tout en le privant du pouvoir de nommer nos diplomates.
Par ailleurs, la procédure de l'article 13 prévoit un contrôle parlementaire de toute nomination au travers d'auditions dans les deux chambres. Notons que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont fait le choix du veto à une majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés par les commissions permanentes compétentes, dans une forme de cadeau fait au Président de la République dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008. Cela peut conduire à des situations problématiques en fragilisant, en fonction du vote des parlementaires, la légitimité de celui qui exerce la fonction.
L'article 2 de la proposition de loi constitutionnelle vise à supprimer l'adresse du Président de la République au Parlement réuni en Congrès. C'est une fausse bonne idée, la vertu du symbole. En effet, cette disposition, issue de la révision constitutionnelle de 2008, a toujours fait l'objet d'une incompréhension, étant considérée comme un facteur de présidentialisation. Selon le rapport du comité Balladur, elle a été introduite en raison de l'impossibilité, pour le Président de la République, de s'adresser directement aux parlementaires, alors même qu'il a la faculté de parler au peuple via les médias de masse. De surcroît, n'importe quel chef d'État étranger peut venir s'adresser aux parlementaires français.
Par ailleurs, la pratique a démontré qu'il n'y a pas eu d'abus de cette disposition constitutionnelle, avec seulement une utilisation par Nicolas Sarkozy et deux par Emmanuel Macron, alors que ce dernier avait laissé entendre qu'il pourrait prononcer un discours annuel, sur le modèle du discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. Quant à François Hollande, qui revendiquait une « présidence normale » et qui aurait pu, à ce titre, ne pas y avoir recours, il s'est adressé de la sorte au Parlement au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Il ne me semble pas que ces expériences aient placé les parlementaires dans un état d'abaissement ou de soumission au regard de la fonction présidentielle. Je considère donc qu'il faudrait maintenir cette possibilité.
J'ai déjà évoqué mon point de vue sur l'article 3, qui transfère au Premier ministre le droit de dissolution.
J'en arrive à la question des ordonnances et des décrets. Pourquoi le Président de la République les signe-t-il ? Tout simplement parce qu'il préside le conseil des ministres, organe où sont délibérés ces textes. Ainsi, le fait que le Président de la République signe les ordonnances et les décrets n'est pas en soi la manifestation d'une présidentialisation à l'excès, d'autant que la non-signature du décret d'application d'une loi pourrait s'apparenter à un refus de promulguer celle-ci, c'est-à-dire à un manquement grave à sa fonction.
Concernant le refus de signer une ordonnance, l'expérience de François Mitterrand nous montre qu'une telle pratique n'a pas fait l'objet d'une sanction. Le recours aux ordonnances n'étant qu'une procédure dérogatoire, cette opposition n'a fait que contraindre le Gouvernement à emprunter la voie parlementaire pour la mise en oeuvre de ses réformes.
Enfin, l'article 6 de la proposition de loi constitutionnelle introduit, à l'article 49 de la Constitution, une question de confiance obligatoire lors de la prise de fonctions du Premier ministre, ce qui ressemble étrangement à une investiture déguisée. Curieusement, les auteurs n'ont pas fait le choix de l'introduire à l'article 8 de la Constitution. Ainsi, le Président de la République nomme toujours qui il veut comme Premier ministre, sans aucune condition.
Je remarque, en premier lieu, que très nombreux sont les Premiers ministres qui se sont soumis à une question de confiance, ce qui n'est pas une procédure d'investiture, dans la mesure où ils en ont la maîtrise, sans automaticité. En second lieu, dans la pratique, aucun Premier ministre n'a été démis par l'Assemblée nationale de cette manière.
En revanche, une motion de défiance constructive, mécanisme que la proposition de loi constitutionnelle n'envisage pas, conduirait, en cas de censure, à l'introduction d'une nouvelle procédure par laquelle les parlementaires imposeraient le choix du Premier ministre au Président de la République.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle qui nous est soumise ne me paraît pas constituer une réponse adaptée à la crise politique que ses auteurs entendent résoudre. En se bornant à renforcer les prérogatives du Premier ministre, elle n'est pas davantage de nature à corriger la verticalité du pouvoir dénoncée dans l'exposé des motifs.
Pour l'ensemble de ces raisons et en application du gentlemen's agreement, je vous propose de ne pas adopter de texte. En ce cas, c'est la proposition de loi constitutionnelle dans sa version initiale qui serait examinée en séance publique.
Pour terminer, je remercie la présidente Cécile Cukierman, l'auteure du texte, pour nos échanges sur ces questions éminemment passionnantes.
M. François Bonhomme. - Nous nous plaçons dans la tradition de contestation des dérives de la Cinquième République par le parti communiste, qui est parfaitement dans son droit. Cependant, nous avons tout de même soixante-huit ans de recul. Ainsi, la Cinquième République sera bientôt le régime qui aura duré le plus longtemps depuis la Révolution, donnant au pays une bienheureuse stabilité.
Aujourd'hui, on invoque une crise politique, économique, sociale et psychologique. Dans ce contexte, la seule chose qui fonctionne à peu près en France, ce sont les institutions. Modifier cet équilibre est donc discutable, alors que la stabilité politique a été un fait majeur, notamment sur le plan économique, tout comme l'est, aujourd'hui, la fragilité institutionnelle. Or cette dernière procède d'une élection consécutive à une dissolution hasardeuse ; elle est donc entièrement liée aux pratiques.
Même en 1958, si l'on reprend le discours de l'époque sur une supposée dérive autoritaire du général de Gaulle, l'époque était celle d'un combat politique où la Cinquième République était prise en otage. De la même manière, d'autres groupes politiques proposent régulièrement l'élection des députés au scrutin proportionnel, ce qui serait une manière d'étouffer un régime qui repose sur le fait majoritaire.
La Cinquième République est un bien très précieux. D'aucuns disent qu'elle serait un corset parfois trop serré, qui empêcherait de respirer. Oui, elle a des baleines, des laçages, mais le suffrage universel est là pour assurer son rééquilibrage.
Nous devons avancer avec précaution, plutôt que de nous saisir de l'actualité immédiate pour tout remettre en cause.
M. Éric Kerrouche. - Il n'est pas certain qu'un système dans lequel 80 % des Français éprouvent de la défiance à l'égard du monde politique et 66 % estiment que notre démocratie fonctionne mal est forcément le bon.
Cela étant dit, nous avons une vision positive du texte proposé par le groupe communiste, même si nous réserverons notre vote pour la séance. Il reprend l'un des éléments du triptyque qui nous est cher pour un meilleur fonctionnement de la Cinquième République : déprésidentialisation, parlementarisation et démocratisation.
Je ne puis approuver certains éléments développés par le rapporteur. Ainsi, un éventuel retour en arrière institutionnel n'a rien d'automatique. On peut regretter que certaines forces politiques structurantes n'aient plus le même rôle qu'avant, mais la thèse du désalignement et du réalignement des partis politiques montre bien que la crise dépasse largement deux partis politiques. L'idée d'un culbuto, dans lequel le système d'avant reviendrait, reste une vue de l'esprit.
Ensuite, notre système n'est ni parlementaire ni présidentiel ; il appartient à la catégorie des régimes semi-présidentiels, dont il existe une soixantaine d'exemples dans le monde. La caractéristique de ces régimes est celle de la double responsabilité, avec un Président élu et un gouvernement responsable à la fois devant la chambre basse du Parlement et devant le Président. Telle est la nature de notre régime, sauf au moment de la cohabitation, où il s'aligne sur un système parlementaire, ce qui est bien documenté dans la littérature internationale.
Enfin, il est important de rappeler qu'en France, le fait majoritaire est un hasard. Lors de l'élaboration de la Constitution de la Cinquième République, ses auteurs se demandaient si le nombre des procédures visant à mettre en place un parlementarisme rationalisé serait suffisant. Le fait majoritaire fut, dans ce contexte, une divine surprise.
Contrairement à ce qu'a dit notre collègue François Bonhomme, aucun système électoral n'est consubstantiel à la Cinquième République. En effet, le mode de scrutin ne figure pas dans la Constitution, puisqu'il dépend d'une loi simple. C'est pourquoi il a pu être modifié à l'occasion des élections législatives de 1986. Notre Constitution est donc complètement agnostique en la matière, même si le mode de scrutin a des conséquences fortes sur le fonctionnement de nos institutions.
J'en arrive au coeur des débats : le pouvoir présidentiel. À vrai dire, avant même l'élection au suffrage universel de 1962, ce pouvoir existait déjà au sein de nos institutions, comme le montrent l'article 5, qui fait du Président à la fois l'arbitre et le garant des institutions, et l'article 19, sur ses pouvoirs propres.
Cependant, depuis lors, tout se passe comme si le Président de la République, de manière systémique, s'octroyait des attributions qu'il n'a pas. Nous sommes dans une logique de président thaumaturge, capable de miracles parce qu'il est élu au suffrage universel. Par exemple, en novembre 2025, lorsqu'Emmanuel Macron nous dit qu'il va rétablir le service national, et alors même qu'il n'en a aucunement la faculté, cela n'a même pas suscité d'étonnement. C'est la raison pour laquelle nous saluons le travail de nos collègues communistes, même si nous aurions sans doute choisi une autre rédaction.
La déprésidentialisation est la condition d'un meilleur fonctionnement de notre régime politique : plus le temps passe, plus la période de grâce accordée au Président de la République diminue. Ainsi, à chaque fois, l'élastique se tend avant une élection présidentielle qui annonce le grand « reset », laissant croire que le prochain président aura, seul, la capacité à transformer les choses. Quand cela n'arrive pas, la désillusion survient toujours plus vite, ce qui remet en cause le fonctionnement de notre système. Sans action de notre part, ce dernier s'effondrera de lui-même, d'où l'importance de trouver des équilibres et de déplacer la responsabilité politique.
C'est ce que prévoit en grande partie le texte qui nous est soumis. Comme l'indique l'exposé des motifs, l'objectif de nos collègues du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky est de contribuer à cette prise de conscience, sans prétendre qu'une seule proposition de loi, examinée lors d'un espace réservé de l'ordre du jour, puisse transformer l'économie du système. Cependant, ne pas tenir compte de la situation, espérer que nous reviendrons à des jours meilleurs est, selon moi, une hérésie.
La première condition, pour débloquer le régime, est d'abord de tenir compte de la fragmentation politique, donc d'adopter un mode de scrutin proportionnel, comme l'ont fait les autres pays européens. Cela passe par une loi ordinaire.
Toutefois, il est évident qu'il faudra transformer le système de l'intérieur, si l'on veut que notre démocratie fonctionne à nouveau.
Mme Cécile Cukierman. - Avec cette proposition de loi constitutionnelle, nous n'essayons pas de surfer sur l'actualité. Ainsi, croire que les résultats de l'élection de 2024 sont un accident de l'histoire serait une véritable erreur. La France est fracturée, l'Assemblée nationale est fracturée : d'une certaine manière, heureusement que cette dernière est à l'image de notre pays ! On ne peut pas à la fois considérer que la France s'archipélise depuis dix ans et s'attendre à ce que les représentants des Français soient unanimes.
Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Dès les élections de 2022, la délicate recherche d'une majorité absolue de 289 députés avait commencé. La tripartition, alors quelque peu balayée, s'est aggravée en 2024, et je ne saurais dire ce qui adviendra en 2027, si une dissolution a lieu cette année-là. Je ne suis pas certaine, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, que celui-ci emportera une majorité absolue à l'Assemblée.
Par conséquent, il ne s'agit pas de régler les comptes d'hier, mais de nous projeter sur la manière dont nos institutions fonctionneront dans le cadre d'une multipartition. Pour un temps incertain, mais durable, le fait majoritaire n'est pas garanti : tel est le noeud du problème.
Dès lors, nous devons repenser la répartition des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier ministre. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons pas aujourd'hui dans une situation de cohabitation comparable à celles que nous avons connues sous François Mitterrand ou Jacques Chirac, avec un bloc ayant recueilli une majorité aux élections législatives et d'une couleur politique différente de celle du Président de la République.
La vraie difficulté est que tous les candidats à l'élection présidentielle feront des promesses, alors qu'aucun n'a la certitude de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale pour les mettre en oeuvre. Je suis d'ailleurs assez surprise d'entendre des dirigeants politiques de tous bords, y compris le mien, nous parler du grand temps politique que sera 2027 et des grandes décisions qu'il faudrait reporter après l'élection présidentielle. Collectivement, nous sommes en train de mentir aux Français. En effet, si demain un Président de la République, quel qu'il soit, ne pouvait appliquer ce qu'il a promis, nous continuerions d'alimenter le « tous pourris ».
C'est en cela que la période actuelle n'est pas le simple soubresaut d'une crise institutionnelle. Par conséquent, sans vouloir ni renverser la table ni tout réécrire, je ne m'aventurerai pas à parier que la Cinquième République continuera de tenir comme elle l'a fait jusqu'ici, tant la vie politique française est devenue plus qu'incertaine.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Nous ne pouvons que souscrire à l'excellente analyse du rapporteur, qui a apporté point par point des réponses ciblées et pertinentes.
Bientôt, les Français choisiront à nouveau un Président de la République, comme ils ont choisi de confier un second mandat à l'actuel et comme ils ont choisi les députés à l'Assemblée nationale. C'est donc faire peu de cas de leur vote que de chercher à reporter toute la faute sur une seule personne. Chacun doit assumer ses responsabilités.
Ce qui se passe à l'Assemblée nationale a des répercussions concrètes dans la vie des Français. Il est fort de café de chercher, par des moyens détournés, à opposer ce fait au Président de la République.
Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants suivra la recommandation du rapporteur.
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. - Pour répondre sur la notion de tripolarisation et d'émiettement de la vie politique, la question est de savoir si nous sommes dans une situation durable. L'élection présidentielle de 2027 va-t-elle éclaircir l'horizon et permettre l'émergence d'une nouvelle offre politique obtenant une majorité ? Nous n'avons pas de boule de cristal.
Le fait majoritaire n'est pas inhérent à la Cinquième République. Michel Debré disait précisément que nous disposions, dans notre Constitution, de tous les outils pour éviter les blocages institutionnels dus à une absence de majorité.
En Allemagne, il existe six groupes politiques au Bundestag, contre onze à l'Assemblée nationale en France. L'émiettement actuel est-il durable ? Nous aurons une réponse concrète en 2027. Modifier nos institutions avant serait donc prématuré.
Concernant le mode de scrutin, le recours au scrutin proportionnel à l'élection législative de 2024 aurait abouti sensiblement à la même répartition qu'aujourd'hui. Changer le mode de scrutin ne mettrait donc pas fin à l'émiettement de l'offre politique.
Enfin, sur le régime présidentiel ou semi-présidentiel, tous les constitutionnalistes que nous avons auditionnés nous disent que nous sommes dans un régime parlementaire.
M. Éric Kerrouche. - Ah non !
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. - Dès lors qu'il existe un gouvernement responsable devant le Parlement et un pouvoir de dissolution, nous parlons d'un régime parlementaire. Il peut être rationalisé, comme la Cinquième République, mais il n'y a pas, dans la typologie des régimes constitutionnels, de régime à proprement parler semi-présidentiel.
M. Éric Kerrouche. - Il faut sortir du cas de la France.
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. - C'est ce que j'ai fait, puisque j'évoque le Portugal et le Royaume-Uni dans mon rapport.
Clairement, nous sommes dans une crise politique, avec une défiance envers la classe politique. Toutefois, cette même défiance ne concerne pas la Cinquième République ou ses institutions.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Mes chers collègues, ainsi que l'a rappelé notre rapporteur, et comme le prévoit le gentlemen's agreement sur les propositions de loi de niche parlementaire, le rapporteur nous propose de ne pas adopter le texte, afin que le débat en séance porte sur la proposition de loi dans sa version d'origine.
EXAMEN DES ARTICLES
Articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6
Les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 ne sont successivement pas adoptés.
La proposition de loi constitutionnelle n'est pas adoptée.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi constitutionnelle déposée sur le Bureau du Sénat.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Mme Cécile Cukierman, présidente du groupe CRCE-K, auteure de la proposition de loi constitutionnelle
Universitaires et personnalités qualifiées
Mme Marie-Anne Cohendet, professeure de droit public à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
M. Jean-Philippe Derosier, professeur de droit constitutionnel à l'université de Lille
Mme Anne Levade, professeur de droit public à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
M. Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit public à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, président de l'Association française de droit constitutionnel
M. Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'université Paris II Panthéon-Assas
M. Olivier Rouquan, politiste, constitutionnaliste, chercheur associé au Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques
M. Dominique Rousseau, professeur émérite de droit public à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
M. Arnaud Teyssier, inspecteur général de l'administration et historien
CONTRIBUTION ÉCRITE
M. Jean-Éric Schoettl, conseiller d'État, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-269.html
* 1 Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
* 2 Projet de loi relatif à la Corse, en février 2001.
* 3 Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution (introduite et commentée), 2025, Éditions du Seuil, p. 94.
* 4 Refus de François Mitterrand de signer des ordonnances en mars 1986 (privatisations) et octobre 1986 (redécoupage des circonscriptions législatives).
* 5 Dominique Rousseau, « La démocratie continue : fondements constitutionnels et institutions d'une action continuelle des citoyens », Confluence des droits_La revue, 11 février 2020.
* 6 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
* 7 Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution (introduite et commentée), Éditions du Seuil, collection Points, 2025, p. 94.
* 8 Cet article 32 comportait une seconde phrase aux termes de laquelle : « Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances ».
* 9 Selon la professeure Marie-Anne Cohendet : « La présidence du Conseil des ministres n'a pas été la cause première du système présidentialiste. La pratique de l'article 9 fut d'abord une conséquence du déséquilibre institutionnel dont le coeur est le droit de dissolution. Mais en étant un des instruments majeurs de la confiscation du pouvoir gouvernemental par le président, elle participa au renforcement de la puissance présidentielle et des habitus présidentialistes qui favorisent à leur tour la suprématie présidentielle »10, « Commentaire de l'article 9 de la Constitution », in F. Luchaire, G. Conac et X. Prétot (dir.), La Constitution de la Ve République, Economica, 2009, p. 386.
* 11 Jean-Marc Sauvé, « Le conseil des ministres », in Constitution et pouvoirs, mélanges en l'honneur de Jean Gicquel, Montchrestien, 2008, p. 500.
* 12 Plus rarement, l'intervention du conseil des ministres peut également procéder d'un texte réglementaire : en vertu de l'article 1er du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, celles-ci sont fixées par décrets délibérés en conseil des ministres.
* 13 Fiche 4.2.1, p. 3, version du 28 novembre 2025.
* 14 Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution (introduite et commentée), Éditions du Seuil, collection Points, 2025, p. 143-144 : « Les présidents n'en ont fait usage, à ce jour, que pour des raisons de santé (cinq fois en 1964, 1973, 1992, 1994 et 2005) ou, une fois seulement, en raison d'un long déplacement à l'étranger (en 1964 lors du voyage du général de Gaulle en Amérique latine) ».
* 15 Jean-Marc Sauvé (op. cit., p. 530) précise qu'en situation de cohabitation, la fixation de l'ordre du jour « repose sur un accord entre le Président de la République, qui décide, et le Premier ministre, qui propose. Elle ne peut donc être unilatérale, ni d'un côté, ni de l'autre, puisqu'elle constitue une compétence partagée. »
* 16 Les professeurs Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux répondent positivement à cette question (« Corse : le Président de la République avait le droit de ne pas inscrire le projet à l'ordre du jour du Conseil des ministres », Recueil Dalloz, 2001, p. 1107), à l'inverse de la professeure Marie-Anne Cohendet (« Corse : Jacques Chirac n'avait pas le droit », Le Monde, 20 février 2001). Dans sa réponse au questionnaire, le professeur Anne Levade était d'avis que « s'il décide de l'ordre du jour du conseil des ministres qu'il préside, le Président de la République ne peut, à cette occasion, exercer un droit de veto qui serait assurément une violation de la Constitution et, en particulier, de l'article 5 [...] ». Jean-Marc Sauvé juge que si le Président de la République « est fondé à vérifier que les textes et délibérations proposées pour le Conseil des ministres ne contreviennent pas à ses pouvoirs ni aux principes qu'il a pour mission de faire respecter », toutefois « la capacité du chef de l'État de brider l'initiative des lois que l'article 39 reconnaît au Premier ministre est extrêmement limitée [...]. Un veto présidentiel est d'autant moins envisageable que le droit d'initiative législative du Premier ministre s'exerce, après délibération du Conseil des ministres, par la voie d'un décret de dépôt signé par le Premier ministre [...] » (op. cit. p. 531).
* 17 Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le conseil des ministres s'est réuni en province à plusieurs reprises, notamment à Lyon (1974), Évry (1975) et Lille (1986). Il en a été de même sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec des réunions à Strasbourg et Ajaccio (2007).
* 18 Le Premier ministre soulignait également qu'« il est fait recours à un dispositif de visioconférence, porté par un système sécurisé de niveau confidentiel défense, conçu et opéré par l'État, qui permet une parfaite qualité et confidentialité des échanges » (réponse à la question d'actualité au gouvernement n° 1793G, JO Sénat du 15 avril 2021, p. 3193).
* 19 Le décret du Président de la République prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale est un acte de Gouvernement, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître (CE, 20 février 1989, Allain, n° 98538, Rec.). Si le Conseil constitutionnel juge qu'aucune disposition de la Constitution ne lui donne compétence pour statuer sur une demande d'annulation d'un tel décret (décisions n° 88-4 ELEC du 5 juin 1988 et n° 88-1040/1054 AN du 13 juillet 1988), il examine les recours formés contre le décret convoquant les électeurs après la dissolution de l'Assemblée nationale (décisions n° 88-1 ELEC du 11 juin 1981 et n° 2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC du 20 juin 2024).
* 20 L'absence de contreseing a pu susciter de nombreux débats devant le Comité consultatif constitutionnel : voir à ce sujet le commentaire de l'article 12 de Pierre Avril dans La Constitution de la Ve République, préc., p. 476 et suivantes.
* 21 L'article 51 de la Constitution du 4 novembre 1848 interdisait expressément la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République, son article 68 qualifiant une telle mesure de « crime de haute trahison » par lequel le président « est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale ». Ces dispositions n'ont pas suffi à empêcher la dissolution de l'Assemblée nationale, le 2 décembre 1851.
* 22 CE, Assemblée, 10 septembre 1992, Meyet, n° 130376, au Recueil.
* 23 Cette « démeyétisation » peut être expresse (CE, 9 septembre 1996, Collas, au Recueil) ou résulter de choix de codification (CE, 5 février 2024, Association des centres de lavage indépendants, n° 470962, aux Tables).
* 24 Olivier Gohin, L'évolution de la jurisprudence Meyet de 1992 sur le pouvoir réglementaire du Président de la République, Recueil Dalloz, 1997, n° 11 du 13 mars 1997, p. 129 ; Guy Carcassonne et Marc Guillaume, op. cit, p. 116 et 117.
* 25 Il s'agit des conseillers d'État, du grand chancelier de la Légion d'honneur, des ambassadeurs et des envoyés extraordinaires, des membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, des recteurs des universités, des préfets, des directeurs des administrations centrales, des officiers généraux et des représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer.
* 26 Rapport remis au Président de la République le 15 février 1993 par le comité consultatif pour la révision de la Constitution, Paris, La Documentation française, 1993, page 13.
* 27 « Une Ve République plus démocratique », rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, octobre 2007.
* 28 Les propositions du comité étaient les suivantes : « laisser au président de la République le soin de nommer aux emplois militaires, sous réserve d'une délégation de ce pouvoir au Premier ministre dans des conditions plus claires prévues par une loi ; distinguer, s'agissant des nominations aux emplois civils, entre celles délibérées en Conseil des ministres et les autres, les premières étant fixées par la Constitution ou par la loi, afin que le Président de la République ne puisse en modifier la liste par le simple jeu de la fixation de l'ordre du jour du Conseil des ministres comme cela a été le cas dans le passé ; conférer au Premier ministre le soin de procéder aux nominations autres que celles délibérées en Conseil des ministres, sauf si la loi en dispose autrement » (ibid., p. 16).
* 29 Au regard des termes de cet article, le Conseil d'État a jugé que les dispositions du statut d'un établissement public renvoyant, pour la nomination de son directeur, à un décret devaient s'interpréter comme réservant cette compétence au Président de la République (CE, 20 décembre 2006, n° 278159, T.)
* 30 Aux termes de cet alinéa : « Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. »
* 31 Aux termes de cet article 3 : « L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'État autres que ceux prévus à l'article 13 (par. 3) de la Constitution et aux articles 1er et 2 ci-dessus peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 (par. 4) et 21 (par. 1er) de la Constitution. » Dans la pratique, les délégations opérées sur ce fondement sont rares. En revanche, l'article 4 de cette ordonnance autorise, de manière très large, la déconcentration du pouvoir de nomination, par la voie législative ou réglementaire, aux ministres ou aux « autorités subordonnées ».
* 32 Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'État.
* 33 Guide de légistique, fiche 4.2.1., p. 3.
* 34 Réponse au questionnaire adressé par le rapporteur.
* 35 Sur le modèle du discours sur l'état de l'Union du président des États-Unis, l'article 52 de la Constitution de la Deuxième République faisait obligation au Président de la République, de présenter chaque année devant l'Assemblée nationale, par un message, « l'exposé de l'état général des affaires de la République ».
* 36 Sous la Cinquième République, le droit de message est un pouvoir propre du Président de la République, qui n'est pas soumis au contreseing.
* 37 Rapport n° 387 (2007-2008) sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois du Sénat, juin 2008, p. 85.
* 38 Guy Carcassonne (op. cit., p. 122) la qualifie de « surannée », le président Hyest, dans son rapport précité, d'« anachronique ». Dans sa réponse au questionnaire adressé par le rapporteur, le professeur Anne Levade relève en outre que cette pratique conduit « à une bizarrerie : alors qu'aucun État ayant opté pour le régime parlementaire n'interdit à son chef de l'État - qu'il soit un monarque ou un président - de s'exprimer devant les assemblées, le Président de la République française était le seul chef d'État qui ne pouvait pas s'exprimer devant le Parlement français puisque cette possibilité était offerte à un chef de l'État étranger. »
* 39 Rapport du comité « Balladur », op. cit., p. 14.
* 40 Rapport n° 387 de M. Jean-Jacques Hyest, préc. p. 86.
* 41 Pour Bernard Frimat, sénateur : « Le droit de s'adresser au Congrès participe de l'"omniprésidence". Il réduit à un simple exercice formel la déclaration de politique générale du Premier ministre. J'ai l'intime conviction que cette prise de parole devant un Congrès muet est la raison essentielle pour laquelle cette révision a été engagée. Dans le lieu le plus illustre de la monarchie, nous verrons peut-être, selon les termes de Robert Badinter, "la monocratie triomphante en majesté à Versailles" », compte rendu intégral de la séance du Congrès du Parlement du 21 juillet 2008, p. 7.
* 42 Le président Hyest soulignait que « les exigences matérielles liées à la réunion du Congrès, la solennité du cadre devraient inciter le chef de l'État à ne recourir à cette procédure que de manière exceptionnelle », Rapport n° 387, préc.
* 43 Ce dernier s'était engagé, alors qu'il était candidat, à venir rendre compte de son action chaque année devant le Parlement réuni en Congrès.
* 44 Réponse au questionnaire adressé par le rapporteur.
* 45 Audition du 3 février 2026.
* 46 Comme à la suite du renversement en 1962 du Gouvernement de Georges Pompidou par l'Assemblée nationale, en réaction à la mise en place, souhaitée par le Président de la République, de l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État.
* 47 Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution (introduite et commentée), 2025, Éditions du Seuil, p. 113.
* 48 Réponse au questionnaire adressé par le rapporteur.
* 49 Olivier Rouquan soulignait ainsi, dans sa réponse au questionnaire adressé par le rapporteur, que ces modifications revenaient à priver « en partie le Président de la République de la possibilité d'exercer son rôle d'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, voire son rôle de garant de l'autonomie nationale ». Dans le même sens, le professeur Anne Levade était d'avis qu'« il ne semble pas possible d'imaginer que le Président de la République ne nomme pas les ambassadeurs alors que, symétriquement, c'est à lui que les ambassadeurs étrangers présentent leurs lettres de créance ».
* 50 Audition du 3 février 2026. Dans sa réponse au questionnaire adressé par le rapporteur, le professeur Anne Levade qualifiait cette formule d'« assurément peu claire en même temps que très inhabituelle puisque jamais une constitution ne fixe le lieu où se déroule le Conseil des ministres afin de ne pas empêcher qu'il se tienne si les circonstances interdisaient qu'il se déroule à sa localisation habituelle ».