III. OBSERVATIONS
A. LA PÉRENNITÉ DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR EST GARANTIE PAR LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
1. Les dispositions de la loi organique
Votre
rapporteur spécial formule depuis plusieurs années trois
remarques :
-Les comptes spéciaux du trésor constituent un outil
budgétaire utile qu'il convient de préserver.
- Les comptes spéciaux du trésor sont les supports de la gestion
patrimoniale de l'Etat.
-La répartition entre crédits du budget général et
comptes spéciaux du trésor doit être faite avec rigueur.
Votre rapporteur spécial se félicite que les dispositions de la
loi organique du 1
er
août 2001, relative aux lois de finances
qui concernent les comptes spéciaux du trésor, aient tenu compte
de ces remarques.
En effet, les dispositions de la loi garantissent la pérennité
des comptes spéciaux du trésor (qui s'appelleront
désormais comptes spéciaux). Elles font des comptes
spéciaux du trésor un instrument privilégié pour la
gestion des participations financières de l'Etat, de la dette et des
pensions.
La loi organique du 1er août 2001 institue quatre catégories de
comptes spéciaux :
- les comptes d'affectation spéciale,
- les comptes de commerce,
- les comptes d'opérations monétaires,
- les comptes de concours financiers, catégorie qui regroupe les actuels
comptes de prêts et comptes d'avance.
Chaque compte constitue une mission au sens de la loi organique et ne peut donc
être créé que par une disposition de loi de finances
d'initiative gouvernementale.
La loi du 1er août 2001 crée de droit trois comptes
spécifiques :
- un compte d'affectation spéciale retraçant les
opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des
participations financières de l'Etat. Ce compte sera l'héritier
de l'actuel compte n° 902-24 qui retrace le produit des
opérations de privatisation et les dotations en capital aux entreprises
publiques.
- un compte de pensions et avantages accessoires, sous la forme d'un compte
d'affectation spéciale, à partir duquel seront payées les
pensions des agents publics et les charges de compensation aux régimes
de retraite.
- un compte de la dette et de la trésorerie de l'Etat, sous la forme
d'un compte de commerce, retraçant l'ensemble des opérations
budgétaires - à l'exclusion des charges et des produits de
trésorerie constituées par l'amortissement et l'émission
d'emprunts - relatives à la dette de l'Etat. La loi organique
élargit ainsi l'objet du compte de commerce créé par la
loi de finances rectificative pour 2000, qui ne retrace que les seules
opérations de gestion active.
S'agissant des comptes d'affectation spéciale, la loi organique
répond à certaines observations de votre rapporteur
spécial :
a) Une logique d'affectation interprétée avec rigueur
L'article 21 de la loi organique impose que les dépenses prises en charge par un compte d'affectation spéciale soient, à partir de la loi de finances pour 2006, financées par des recettes « qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».
b) Une étanchéité entre les comptes d'affectation spéciale et le budget général renforcée
Le même article renforce l'étanchéité entre les comptes d'affectation spéciale et le budget général, en réduisant de 20 % à 10 % des crédits initiaux de chaque compte le versement qu'il est possible d'effectuer à partir du budget général, et en interdisant, sauf pour les deux comptes d'affectation spéciale spécifiques cités plus haut et sauf disposition de loi de finances pour les autres comptes, les versements au budget général réalisés à partir d'un compte.
c) Une meilleure information des commissions des finances
La loi organique institue une procédure d'information préalable des commissions des finances en cas de majoration réglementaire des crédits du compte en cours d'année permise par un excédent de recettes. Le ministre des finances doit informer au préalable les commissions des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année.
2. Exercice de prospective
Votre
rapporteur spécial a réfléchi à l'impact de ces
dispositions sur le nombre de comptes spéciaux du trésor et sur
l'évolution de chacune des catégories de comptes spéciaux
du trésor.
Il ne sait pas si la tendance à la diminution de comptes
spéciaux du trésor, et tout particulièrement des comptes
d'affectation spéciale, va se poursuivre ou au contraire s'inverser.
Deux interprétations opposées peuvent être tirées de
la nouvelle loi organique.
D'une part, la règle selon laquelle les dépenses des comptes
d'affectation spéciale doivent être financées par des
recettes « qui sont, par nature, en relation directe avec les
dépenses concernées » va conduire à un travail de
remise en ordre afin de clôturer ou de modifier les comptes ne
répondant pas à cette exigence. De même, la limitation des
mouvements de crédits entre comptes spéciaux et budget
général peut être de nature à limiter le recours
à l'instrument des comptes d'affectation spéciale.
D'autre part, la création d'un certain nombre de comptes est toujours
possible pour faire face à la demande de certains secteurs
socio-économiques très attachés à une logique
d'affectation.
Votre rapporteur spécial doute que le gouvernement se prive dans un
grand nombre de cas de la souplesse des comptes d'affectation spéciale
pour résoudre les problèmes éventuels liés à
la disparition des taxes parafiscales.
B. LA PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR RESTE INSATISFAISANTE
Votre
rapporteur spécial se trouve dans l'obligation de réitérer
un certain nombre de remarques formulée l'an passé. Il note que
les documents budgétaires relatifs aux comptes spéciaux du
trésor ne donnent qu'un aperçu vague des conditions
réelles de leur exécution.
Ceci est dû pour l'essentiel aux montants considérables des
reports dont bénéficient les comptes d'affectation
spéciale. Votre rapporteur spécial signalait dans sa
présentation des crédits pour 2001 que
les comptes
d'affectation spéciale constituent une série
« d'icebergs budgétaires » dont la partie
immergée, les reports de crédits, n'apparaît pas.
La pratique des reports de crédits a des fondements multiples. Elle
trouve sa cause tout d'abord dans le régime particulier de gestion des
autorisations de programme et des crédits de paiements lié aux
conditions d'exécution des dépenses des comptes d'affectations
spéciales. L'obligation de faire figurer en prévision des
crédits de paiement à hauteur des autorisations de programme
conduit à « provisionner » chaque année une
fraction des crédits et à les reporter l'année suivante
afin de mettre en réserve l'ensemble des crédits de paiement
nécessités par une opération d'investissement. Les reports
de crédits peuvent ensuite être expliqués par un profil de
recettes dans l'année tel qu'une proportion, variable mais significative
des crédits ne peut être engagée avant la date limite
fixée pour l'engagement des crédits.
Votre rapporteur spécial rappelle que les soldes reportés en fin
de gestion 2000 se sont élevés à 2,73 milliards d'euros,
soit une progression de 37,9 % par rapport à l'exercice
précédent.
On aboutit ainsi à la situation pour le moins paradoxale où
les crédits ouverts en loi de finances ne sont pas appelés
à être consommés tandis que les crédits
consommés ne sont pas débattus.
Votre rapporteur spécial souhaite que figurent dans les documents
budgétaires les reports pour chacun des comptes d'affectation
spéciale et de manière plus générale que soit
précisé pour chaque compte spécial du trésor le
solde tel qu'il est évalué pour le début de l'exercice.
S'agissant de comptes d'avances notamment, la prévision, comme la
constatation, d'excédents ou de déficits ne prend sa
signification qu'en fonction du solde initial que le résultat de
l'année améliore ou détériore.
C. LES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE SONT D'ORES ET DÉJÀ SOUMIS À DE TRÈS IMPORTANTS RÉAJUSTEMENTS.
Le bleu
dont dispose votre rapporteur spécial est d'ores et déjà
caduc en ce qui concerne les deux principaux comptes d'affectation
spéciale : le compte 902-24, compte d'affectation des produits de
cessions de titres, parts et droits de société et le compte
902-33, fonds de provisionnement des charges de retraite et de
désendettement de l'Etat.
Le gouvernement a pour ces deux comptes, quelques semaines après la
distribution des documents budgétaires, fait adopter par
l'Assemblée Nationale des amendements modifiant profondément les
crédits inscrits pour 2002.
Dans les deux cas, ces amendements réagissent de manière
importante à un changement de conjoncture.
Le compte 902-33 voit fondre ses recettes pour 2002, comme cela avait
déjà été le cas en cours d'exécution 2001,
pour répondre à la demande d'une des deux sociétés
détentrices d'une licence UMTS consistant à voir diminuer le
montant de la redevance à verser. Le compte n'est plus
crédité, en prévision pour 2002, que de
1.238 millions d'euros, contre 2.476 quelques semaines plus tôt, au
titre des deux licences (619 millions d'euros de « ticket
d'entrée » chacune) qu'il reste à octroyer.
Le compte 902-24 devrait bénéficier de recettes
supplémentaires issues de la privatisation soudaine d'Autoroutes du Sud
de la France : cette privatisation doit permettre de financer tout ou
partie du plan de relance annoncé par le gouvernement le 19 octobre
2001. Dans cette perspective, les recettes prévues du compte 902-24 ont
été majorées, à l'issue de la discussion à
l'Assemblée Nationale de la première partie du projet de loi de
finances pour 2002, de 1.540 millions d'euros.
1. L'avenir limité du fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat.
L'avenir du fonds de provisionnement des charges de
retraite et
de désendettement institué par la loi de finances pour 2001
paraît bien sombre à votre rapporteur spécial.
Le compte a subi deux revers. L'objet du compte d'affectation spéciale a
tout d'abord été réduit. Aucun crédit n'a
été inscrit, contrairement aux prévisions, pour
l'amortissement de la dette. Les crédits destinés à doter
le compte ont ensuite été revus à la baisse :
« le ticket d'entrée » de l'UMTS a été
revu, deux licences n'ont pas été attribuées faute de
candidats. Les crédits du compte ont ainsi été
divisés de moitié.
Evolution des crédits affectés au compte 902-33 (en millions d'euros)
|
|
2001 |
2002 |
2003 à 2016 |
||||
|
Prévision LFI 2001 |
Réalisation 2001 |
Prévision 2001 |
Prévision PLF 2002
|
Prévision PLF 2002
|
Prévision 2001 |
Estimation |
|
|
Fonds de réserve des retraites |
2.820 |
1.238 |
2.820 |
2.476 |
1.238 |
708 |
n.c. |
|
Amortissement de la dette |
2.134 |
0 |
2.134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Les
perspectives de ce compte d'affectation spéciale sont également
limitées par l'affectation prévue d'une partie du produit de la
privatisation d'Autoroutes du Sud de la France au fonds de réserve des
retraites. Deux comptes d'affectation spéciale, le compte 902-24 et le
compte 902-33 sont donc destinés au même objet : abonder le
fonds de réserve des retraites.
Votre rapporteur spécial estime que ce compte risque à terme de
disparaître faute de recettes suffisantes, peut-être au profit d'un
compte d'affectation spéciale à l'objet plus large, le compte
d'affectation spéciale créé par la loi organique du
1
er
août 2001 destiné à payer les pensions des
agents publics et à financer les charges de compensation aux
régimes de retraite.
2. Les perspectives incertaines du compte d'affectation des produits de privatisation 902-24.
Le
compte 902-24 connaît un effet de ciseaux entre recettes de privatisation
et besoins de financement du secteur public.
La diminution des recettes de privatisation s'explique d'une part par la
réduction du périmètre des entreprises publiques. Les
privatisations ne constituent pas une ressource pérenne pour
l'Etat : les bénéfices qu'elles lui procurent ont vocation
à se réduire à mesure que s'accroissent les
aliénations d'actifs.
Elle trouve sa cause d'autre part dans la conjoncture défavorable des
marchés financiers qui peut conduire, soit à une cession à
moindre prix des entreprises publiques, soit à un report de leur mise
sur le marché. La dernière hypothèse est sans doute
préférable pour optimiser la gestion patrimoniale de l'Etat. Elle
ne résout pas le problème de financement du secteur public.
Ainsi, une conjoncture défavorable conduit à un double paradoxe.
Les entreprises figurant sur la liste de privatisation ne
bénéficient pas des financements qu'elles pourraient trouver sur
les marchés d'actions. Les autres ne peuvent bénéficier de
dotations en capital à la hauteur de leurs besoins en raison de la
raréfaction des recettes de privatisations.
a) La diminution du volume des opérations du compte 902-24
Après avoir connu des recettes particulièrement
élevées en 1997 et 1998 du fait notamment de la vente des titres
de France Telecom, le compte enregistre des dépenses en baisse depuis
1999.
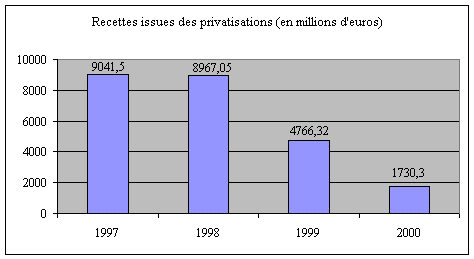
(1) 2000
Contrairement aux années précédentes
où elles étaient largement sous-estimées, les recettes du
compte n° 902-24 relatif aux produits de cessions, titres, parts et
droits de sociétés ont été
surévaluées en loi de finances initiale pour 2000.
Estimées à 2.583 millions d'euros en loi de finances initiale,
elles n'ont atteint en exécution que 1.730,5 millions d'euros.
Les recettes pour 2000 se sont décomposées entre :
-les souscriptions ordinaires : 1.364,91 millions d'euros,
-les souscriptions bénéficiant d'un règlement
différé : 139,06 millions d'euros,
-les reversements d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital :
223,08 millions d'euros,
-le reversement résultant des investissements réalisés par
l'Etat dans des fonds de capital-investissement : 3,22 millions d'euros.
Les principales cessions de titres ont concerné
Aérospatiale-Matra-EADS pour 1.110 millions d'euros et Altadis
(anciennement SEITA) pour 135,3 millions d'euros. Elles représentent 95
% des recettes du compte en 2000.
Les autres cessions de titres ont
touché CNP-Assurances, pour 25,29 millions d'euros et la SOFREMI (0,3
millions d'euros).
Enfin, deux opérations ont été réalisées en
2000 au titre des reversements d'actionnaires ou de dotations en capital. Le
compte 902-24 a enregistré en recettes 152,45 millions d'euros en
provenance de la SGCP
1(
*
)
.
L'Etablissement public de réalisation de défaisance
(EPRD)
2(
*
)
a lui reversé un
excédent de trésorerie de 68,6 millions d'euros qui avait
été constaté par la Cour des comptes en 1999 mais n'a
été versé sur le compte 902-24 qu'en 2000.
(2) 2001
La seule
opération notable achevée en 2001 s'élève à
724 millions d'euros et concerne le versement du dividende de Thomson SA en
application de l'article 5 de la loi de finances rectificative 2000-1353 du 31
décembre 2000.
4.039 millions d'euros avaient été prévus en loi de
finances initiale pour 2001 au titre des recettes de privatisation. Votre
rapporteur spécial doute de la réalisation de cet objectif de
recettes en raison des retards ou reports dans certaines opérations de
cession d'actifs.
Pour 2002, la première partie du projet de loi de finances pour 2002
adoptée le 19 octobre 2001 à l'Assemblée Nationale
évalue les recettes des privatisations à 5.432 millions d'euros
dont 1.540 millions au titre de la privatisation d'Autoroutes du Sud de la
France.
b) Le report des opérations de privatisation
Le
rapport 2001 sur l'Etat actionnaire établi en application de l'article
142 de la loi sur les nouvelles régulations économiques fait
état de cinq entreprises figurant sur la liste annexée à
la loi de privatisation du 19 juillet 1993 et qui n'ont pas fait l'objet
à ce jour d'un transfert au secteur privé.
Il s'agit de :
-Air France
-Caisse centrale de réassurance
-CNP Assurances
-Société nationale d'étude et de construction de moteurs
d'aviation (SNECMA)
-Société française de production et de création
audiovisuelle (SFP)
Air France et la CNP ont fait l'objet d'une ouverture partielle de capital,
respectivement en 1998 et 1999.
La SFP a fait l'objet d'une annonce officielle le 8 octobre 2001. Le processus
de cession de gré à gré réalisée sous le
contrôle d'une personnalité indépendante, M. Bruno
Lasserre, est arrivé à son terme. L'offre présentée
par Euromédia Télévision en association avec
Bolloré Investissement a été retenue. Le prix payé
par l'acquéreur sera de 4,57 millions d'euros.
Enfin, malgré l'annonce faite par le gouvernement le 23 juin dernier
d'une ouverture au marché d'un quart du capital de la
société, l'introduction en bourse de la SNECMA a
été ajournée le 17 septembre dernier. Elle
« interviendra lorsque les conditions du marché le
permettront ».
c) L'ajout des besoins de financement du secteur public aux besoins du fonds de réserve des retraites
L'Assemblée Nationale a accepté le 19 octobre
2001 un
amendement gouvernemental qui modifie en profondeur l'objet du compte 902-24
d'affectation des recettes de privatisations. Alors que celles-ci
étaient affectées principalement aux dotations en capital du
secteur public et plus marginalement à des investissements
réalisés dans des fonds de capital-investissement, l'amendement
prévoit que des versements pourront être effectués au fonds
de réserve des retraites.
Le ministre de l'économie et des finances a annoncé que
"les moins-values de recettes pour le Fonds de Réserve pour les
Retraites
3(
*
)
pourront être
compensées par le versement de recettes de privatisation".
L'amendement du gouvernement précise que le versement à
partir du compte 902-24 pourra ainsi atteindre jusqu'à 1.240 millions
d'euros.
Dès lors, sur la cession d'Autoroutes du Sud de la France, pour un
montant prévu de 1.540 millions d'euros, 1.240 millions d'euros
devraient aller au fonds de réserve des retraites, 150 millions à
la BDPME et 150 millions à un fonds de soutien et de sûreté
du secteur aérien.
Les besoins du secteur public ne devraient pas se tarir pour autant. Le rapport
2001 sur l'Etat actionnaire établi en application de l'article 142 de la
loi sur les nouvelles régulations économiques fait ainsi
état de 1.600 millions d'euros de dotations en capital, avances
d'actionnaires ou apports à des entreprises publiques entre le 16
août 2000 et le 15 août 2001. Les versements les plus importants
concernent :
-Réseau Ferré de France (RFF) : 1.067 millions d'euros
-Charbonnages de France : 310 millions d'euros
-Etablissement Public de Financement et de Restructuration (EPFR) : 228
millions d'euros
-Entreprise Minière et Chimique (EMC) : 42 millions d'euros
-Compagnie Générale Maritime et Financière (CGMF) : 3
millions d'euros.
d) La nécessité de mieux prendre en compte les frais liés aux opérations de cession
La Cour
des comptes dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour
2000 constate que se reproduit chaque année un problème
d'affectation des dépenses liées aux opérations de
privatisations :.
«
Les dépenses afférentes aux ventes de titres se
sont élevées à 182,398 MF dont 142,762 au titre de EADS
soit 78 % du total. Par ailleurs dans le cadre des opérations de
privatisation de la Banque Hervet, un montant de 2,392 MF a été
imputé sur l'article 81 du chapitre 37-75 du budget des finances.
En 2000, aucune convention de répartition de frais n'a été
conclue entre l'État et une entreprise faisant l'objet d'une cession. En
effet, dans le cadre de la constitution d'EADS, l'ensemble des frais a
été pris en charge par l'entreprise. S'agissant de TMM,
l'État n'étant pas directement actionnaire de cette entreprise,
aucun frais n'a été supporté par l'État.
La Cour
constate que cette partie des dépenses du compte n° 902-24 continue
de poser des problèmes de transparence. Les différentes
catégories de dépenses n'ont jamais été
formalisées ; ainsi la pratique fait que les dépenses sont
imputées soit sur ce compte soit sur le budget général, et
peuvent concerner à la fois
des commissions, des frais de
publicité et aussi des montages
financiers. Il y a là un
manque de lisibilité regrettable . »
Le gouvernement répond partiellement à cette critique en
indiquant dans son rapport sur l'Etat actionnaire 2001 que «
Les
dépenses engagées dans le cadre d'opérations de cession
peuvent être imputées soit au chapitre 37-75 article 81 du budget
du Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, soit au
compte d'affectation spéciale 902-24. Sont imputées au chapitre
37-75 article 81 les dépenses d'études préalables à
toute décision de cession. Viennent en débit du compte
d'affectation spéciale, à la rubrique "dépenses
afférentes aux ventes de titres", les dépenses
postérieures à la prise de décision de cession. Cette
catégorie regroupe :
- les frais de mission de conseil du Gouvernement ;
- la quote-part de l'Etat afférente aux frais de campagne de
communication (définies par des conventions de partage de frais entre
l'Etat et l'entreprise) ;
- les commissions de garantie, de placement et de direction ;
- les honoraires d'incitation (incintive fees).
Du 16 août 2000 au 15 août 2001, les dépenses
afférentes aux ventes de titres inscrites sur le compte 902-24 se sont
élevées à 30,1 millions d'euros. Au cours de la même
période, le montant des dépenses ordonnancées à
partir du chapitre 37-75 art 81 au titre des études relatives au
financement des entreprises publiques, s'est élevé à 3
millions d'euros. »
Votre rapporteur spécial comprend les fondements de la
répartition opérée entre budget général de
l'Etat et compte d'affectation spéciale. Il lui semble néanmoins
que l'application de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances
qui fait de chaque compte spécial une mission poussera à bien
identifier l'ensemble des opérations liées aux privatisations, en
amont ou en aval de la décision, dans un compte bien défini.
D. LE COMPTE D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES ET LE COMPTE D'AVANCES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES RÉVÉLENT DES CAGNOTTES AU PROFIT DE L'ETAT.
Les comptes spéciaux du trésor détiennent parfois des ressources cachées. Votre rapporteur spécial a le sentiment que l'Etat bénéficie de petites « cagnottes » au sein du compte d'émission des monnaies métalliques 906-04 à l'occasion du passage à l'euro et au sein du compte 903-54 d'avances sur le montant des impositions revenant aux départements et communes, qui lui permettent de réduire le déficit annoncé pour 2002 dans des proportions non négligeables.
1. Un bénéfice net sur l'euro : le compte d'émission des monnaies métalliques 906-04
Le compte d'opérations métalliques créé par la loi de finances rectificative pour 1960 retrace les opérations auxquelles donnent lieu l'émission et le retrait des monnaies métalliques. Ce compte, géré par la direction du Trésor, prend une importance toute particulière à l'occasion du passage à l'euro. Il permet en effet de mettre en parallèle émission de l'euro et retrait du franc. Dans cette perspective, le compte d'opérations métalliques fait état d'un bénéfice sur l'euro .
Evolution du compte spécial
(en millions d'euros)
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001 |
2002
|
|
|
prévu |
réalisé* |
|||||
|
+ 18,03 |
- 25,12 |
- 36,42 |
- 72,51 |
- 59,61 |
- 91,39 |
+ 533 |
* au 1 er août 2001
Ce
bénéfice exceptionnel de
533 millions d'euros (3,5 milliards
de francs) pour 2002
s'explique par l'étude, poste par poste, du
compte spécial.
Au crédit du compte spécial figure :
- la valeur nominale des pièces émises
- le produit de la vente des pièces démonétisées
Au débit du compte sont inscrits :
- la valeur nominale des pièces retirées de la circulation
- le montant des sommes versées à l'administration des monnaies
et médailles en règlement des dépenses de fabrication.
a) Une émission massive d'euros en 2002
Les euros frappés à l'occasion du programme de frappe qui a débuté en 1998 ne seront émis qu'à partir du premier janvier 2002. Le compte spécial pourrait être crédité des 8,1 milliards de pièces inscrites au plan de frappe de la direction des Monnaies et Médailles entre 1998 et 2001.
Plan de frappe des euros 1998-2001
|
|
2 |
1 |
0,5 |
0,1 |
0,05 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
Total |
|
En millions de pièces |
470 |
820 |
650 |
791 |
1080 |
1130 |
1500 |
1700 |
8141 |
Au
crédit du compte pourraient également s'ajouter les 1,8 milliards
de pièces prévues par la direction des monnaies et
médailles pour 2002, soit fin 2002 près de 10 milliards de
pièces.
Pour établir ce programme d'émission, la Banque de France a
été contrainte de formuler deux hypothèses. La
première a été d'établir la demande de
pièces en euros qui se manifestera dans le courant 2002 et donc le
besoin de renouvellement global de la monnaie métallique. La seconde a
été de réaliser le calendrier prévisionnel des
sorties de pièces en euros, surtout dans les premières semaines
pour éviter une pénurie.
La masse d'euros à mettre en circulation a été d'abord
calculée en fonction du nombre de francs en circulation. 20,7 milliards
de pièces ont été frappées depuis le dernier
changement de cours légal du franc. La Banque de France estime que sur
cette masse une évaporation de 50 % a eu lieu. Elle explique en grande
partie cette évaporation par le nombre de visiteurs étrangers (70
millions chaque année), mettant en avant que 300 millions de
pièces disparaissent chaque année. Après sondage sur un
stock de 15.000 pièces,
la masse de pièces en francs en
circulation lui paraît être de 10,5 milliards.
La Banque de France a ensuite mené une enquête auprès des
établissements de crédits et des grands opérateurs pour
connaître leurs besoins en euros. Le schéma logistique retenu
limite le nombre d'approvisionnements en euros et impose donc aux
opérateurs de couvrir leurs besoins jusqu'à fin janvier. C'est
pour cette raison que le plan initial de frappe d'euros a dû être
majoré de 541 millions d'unités en 2001 et porté à
8,1 milliards de pièces fin 2001.
La préalimentation sera pour la même raison extrêmement
massive puisqu'elle atteindrait au total 6,5 milliards de pièces en tout
début d'année
. Etant donné l'importance de la
préalimentation, les émissions du mois de janvier seront
vraisemblablement limitées. Après la suppression du cours
légal, au 17 février 2002, la Banque de France estime que les
ménages reconstitueront leurs encaisses dormantes et le rythme de sortie
hebdomadaire d'euros devrait être de 75 millions d'euros.
Calendrier prévisionnel des sorties de pièces
en
euros
(en millions de pièces)
|
Préalimentation |
Semaines |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
... |
|
6.436 |
Flux |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
... |
|
6.436 |
Total |
6.436 |
6.436 |
6.486 |
6.536 |
6.586 |
6.636 |
6.711 |
6.786 |
6.861 |
6.936 |
7.011 |
7.086 |
... |
Au
total, le nombre de pièce émises en 2002 devrait ainsi avoisiner
les 10 milliards. Ce chiffre ne repose sur aucun précédent
historique. Il est sans doute élevé : il vise en effet
à éviter toute pénurie.
Les émissions d'euros prévus pour 2002 comportent sans doute une
part de précaution. Cette précaution permet incidemment
d'enregistrer un excédent non négligeable sur le compte 906-04.
En absence d'autre expertise, votre rapporteur spécial n'est
néanmoins pas fondé à remettre en cause l'hypothèse
de la Banque de France.
b) Une évaporation des francs
Le
compte 906-04 enregistrera en crédit la valeur nominale des francs
retirés de la circulation. La Banque de France estime que sur les 10,5
milliards de pièces en circulation, un certain nombre ne reviendra pas
dans ses caisses, ce que votre rapporteur spécial ne conteste pas. Il
existe un taux d'opportunité à l'échange qui dépend
de la valeur faciale de la monnaie.
La Banque de France estime que seule 7,6 milliards de pièces seront
retournées. Elle a estimé ce chiffre de la manière
suivante :
Application d'une décôte à la circulation réelle estimée
|
2001 |
Circulation réelle
|
Décote % |
Retour
des francs
|
|
20 francs |
40 |
0 % |
40 |
|
10 francs |
824 |
0 % |
824 |
|
5 francs |
388 |
5 % |
369 |
|
2 francs |
564 |
5 % |
635 |
|
1 franc |
1.561 |
15 % |
1.326 |
|
0,5 franc |
1.018 |
15 % |
865 |
|
0,2 franc |
1.696 |
40 % |
1.018 |
|
0,1 franc |
2.474 |
40 % |
1.484 |
|
0,05 franc |
1.967 |
40 % |
1.180 |
|
|
10.532 |
|
7.643 |
Le retour des francs devrait intervenir selon le scénario suivant :
Calendrier prévisionnel de retour des francs
|
S-1 |
Semaines |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S13 |
S14 |
|
238 |
Flux |
659 |
989 |
989 |
989 |
989 |
716 |
571 |
426 |
281 |
181 |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
238 |
Total |
897 |
1886 |
2875 |
3863 |
4852 |
5568 |
6139 |
6565 |
6846 |
7027 |
7152 |
7277 |
7402 |
7527 |
|
Semaines |
S15 |
S16 |
S17 |
S18 |
S19 |
S20 |
S21 |
S22 |
S23 |
S24 |
S25 |
S26 |
Total |
||
|
Flux |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
7.644 |
||
|
Total |
7557 |
7582 |
7602 |
7617 |
7627 |
7632 |
7636 |
7639 |
7.641 |
7.642 |
7.643 |
7.644 |
|||
Le bénéfice exceptionnel qui serait constaté sur le compte 906-04 lors du passage à l'euro s'explique ainsi par l'écart entre le nombre de pièces en euros qui seront émises et le nombre de pièces en francs qui seraient retournées. Cet écart, en prévision, est dû à la décote appliquée par la Banque de France sur la circulation réelle des francs, décote qui n'est pas contestable dans son principe. Dans son application, votre rapporteur spécial s'étonne de constater que la Banque de France ne pratique aucune décote sur les pièces de 20 et 10 francs, ce qui signifie que toutes les pièces de cette valeur seraient retournées.
c) Des autres charges plus négligeables
Il convient également de déduire du compte 906-04 le coût de fabrication des pièces qui sera facturé par le direction des monnaies et médailles au titre de son programme de frappe pour 2002. Ce coût est estimé à 122 millions d'euros en 2002.
Ecart entre valeur d'émission et coût de fabrication (tarifs 2001)
|
Valeur
d'émission des coupures
|
Coût de fabrication des coupures
|
|
2 |
0,1506 |
|
1 |
0,1274 |
|
0,5 |
0,0669 |
|
0,20 |
0,0520 |
|
0,10 |
0,0401 |
|
0,05 |
0,0293 |
|
0,02 |
0,0252 |
|
0,01 |
0,0213 |
d) De petits profits sur l'euro...
L'Etat réaliserait donc en 2002, avec les seules
pièces, un bénéfice exceptionnel de 533 millions d'euros
(3,5 milliards de francs) grâce au passage à l'euro. Votre
rapporteur spécial constate qu'un bénéfice analogue sera
réalisé sur les billets puisque la Banque de France devrait
reverser en 2002 à l'Etat, sur la ligne 805 « recettes
accidentelles à différents titres », 240 millions
d'euros (1,5 milliards de francs) de recettes exceptionnelles liées
au retrait des billets en francs.
Le bénéfice sur les billets
est sans doute moins important du fait de coût d'opportunité
à l'échange plus faibles.
Il y a quelque paradoxe à constater qu'au moment où l'Etat
abandonne son droit régalien le plus ancien, celui de battre monnaie, et
sa souveraineté monétaire, il réalise un
bénéfice exceptionnel de 773 millions d'euros (5 milliards de
francs).
Si l'Etat pratiquait une comptabilité en coûts complets, il
faudrait sans doute déduire de ce bénéfice de 2002 les
coûts de fabrication des pièces payées sur 1998, 1999, 2000
et 2001, soit un total de 396 millions d'euros. Il serait également
possible de rapprocher ce bénéfice des coûts
supportés par l'Etat par ailleurs, comme les coûts de
communication du ministère de l'économie et des finances (7,6
millions d'euros en 2002).
Quoiqu'il en soit, l'Etat est le seul agent économique qui, à
côté des inévitables coûts d'adaptation au changement
de monnaie, bénéficie de tels profits sur l'euro.
2. Les excédents du comptes d'avances 903-54 sur le montant des impositions revenant aux départements et communes.
Le
compte d'avances retrace les avances qui sont versées aux
collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article
34 de la loi n°77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier et remboursées par précompte sur
le montant des impositions revenant aux dites collectivités.
En dépenses, figure le montant des émissions d'impôts
locaux et en recettes les encaissements effectifs complétés par
des recettes d'ordre représentatives de frais de
dégrèvements et non-valeur pris en charge par l'État sur
le chapitre 15-01 des charges communes ; les admissions en non-valeur et les
dégrèvements sont enregistrés dans les comptes du
comptable en classe 4 puis ensuite inscrits au compte n° 903-54.
Le compte d'avances aux collectivités locales représente à
lui seul 54.400 millions d'euros soit plus de 60 % des dépenses de
l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor. Il devrait
connaître un excédent record en 2002, à 900 millions
d'euros.
a) L'inflexion du solde du compte d'avances
Le compte d'avances a connu une nette inflexion à partir de 1996. Les déficits ont laissé la place à des excédents de plus en plus importants. De plus, le solde effectivement constaté en fin d'année est supérieur à celui prévu en loi de finances initiale.
Evolution du compte d'avances 903-58 (en millions d'euros)
|
|
Avances |
Variation |
Recettes |
Variation |
Solde |
Solde/avances |
|
1990 |
31.817 |
|
30.956 |
|
- 860 |
- 2,7 % |
|
1991 |
34.879 |
9,6 % |
33.749 |
9,0 % |
- 1.130 |
- 3,24 % |
|
1992 |
37.071 |
6,3 % |
35.554 |
5,3 % |
- 1.517 |
- 4,09 % |
|
1993 |
40.607 |
9,5 % |
39.119 |
10 % |
- 1.489 |
- 3,67 % |
|
1994 |
43.949 |
8,2 % |
42.390 |
8,4 % |
- 1.559 |
- 3,55 % |
|
1995 |
46.268 |
5,3 % |
43.934 |
3,6 % |
- 2.334 |
- 5,04 % |
|
1996 |
49.538 |
7,1 % |
49.834 |
13,4 % |
295 |
+ 0,6 % |
|
1997 |
51.919 |
4,8 % |
51.942 |
4,2 % |
23 |
+ 0,04 % |
|
1998 |
54.076 |
9,2 % |
54.161 |
4,3 % |
85 |
+ 0,16 % |
|
1999 |
54.776 |
5,5 % |
55.421 |
2,3 % |
645 |
+ 1,18 % |
|
2000 |
55.649 |
2,9 % |
56.734 |
2,4 % |
1.085 |
+ 1,95 % |
|
2001 (LFI) |
55.293 |
- 0,6 % |
55.888 |
- 1,5 |
594 |
+ 1,1 % |
|
2002 (PLF) |
54.400 |
- 1,6 % |
55.300 |
- 1,1 % |
900 |
+ 1,7 % |
b) La remise en cause du fonctionnement habituel du compte
Les
spécialistes de finances publiques locales expliquaient encore
récemment que le compte subissait un effet de profil et un effet de
solde qui conduisait à constater des déficits non seulement en
cours d'année, mais aussi en fin d'exercice.
L'effet de profil a été considéré comme
« inhérent » au fonctionnement du compte. L'Etat
verse les acomptes sur les impôts directs locaux, chaque mois, par
douzième. Jusqu'il y a peu, l'Etat recouvrait effectivement les
impôts locaux en fin d'année, mis à part un acompte de 50 %
de la taxe professionnelle versé en milieu d'année par certaines
entreprises. Il s'en suivait une charge de trésorerie pendant onze mois
sur douze.
Ce effet de profil a été partiellement
atténué. La Direction Générale de la
Comptabilité Publique indique en effet que la taux d'adhésion
à la mensualisation s'est élevé en 2000 à
respectivement 25,5 %, 18,2 % et 2,4 % pour la taxe d'habitation, la taxe
foncière et la taxe professionnelle.
L'effet de solde a lui visiblement totalement disparu.
Il était
dû au non-recouvrement d'une fraction des montants émis au cours
de l'exercice. Ce non-recouvrement, qui aurait dû être neutre
puisque se reportant d'année en année, se traduisait par un
déficit pour deux raisons : l'augmentation du produit voté
et l'absence d'amélioration des taux de recouvrement.
c) Des excédents dont les explications ne sont pas totalement satisfaisantes
Aucune raison n'explique à elle seule la formation des excédents depuis 1996. Aucune ne permet de déterminer l'évolution du compte pour l'avenir.
(1) L'impact indéniable, mais non chiffré, de l'amélioration du taux de recouvrement
L'amélioration du taux de recouvrement recouvre trois réalités distinctes : l'efficacité plus grande du service de l'impôt, le changement du mode de calcul du taux de recouvrement 4( * ) et l'augmentation des dégrèvements. Aucune de ces composantes n'est directement quantifiable.
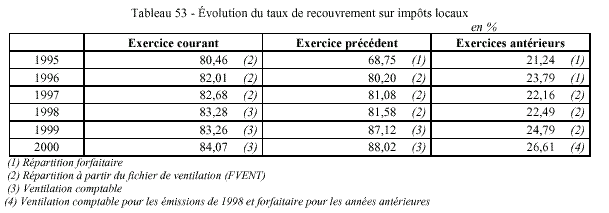
Source : Rapport de la Cour des Compte sur
l'exécution des lois de finances en 2000
(2) La baisse des impôts directs locaux
Le compte connaît en 2001 et en 2002, au moins en prévision, une diminution des avances versées qui correspond à une baisse des émissions d'impôts par les collectivités locales. De manière transitoire, les recettes du compte, qui enregistrent le reliquat des impositions des années précédentes, se trouvent donc supérieures aux charges des impôts de l'année.
d) Une prise en compte du solde cumulé à relativiser
Les déficits du compte d'avances constatés en fin d'année ont un statut particulier par rapport à ceux d'autres comptes spéciaux du trésor. Ils ne sont pas reportés sur l'exercice suivant mais ne constituent pas pour autant une charge définitive. Ils constituent le « culot » du compte qui représente en quelque sorte une créance de l'Etat sur les contribuables locaux.
Evolution du solde cumulé (en millions d'euros)
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Solde cumulé |
- 16.975 |
- 16.952 |
- 16.867 |
- 16.222 |
- 15.137 |
L'importance de ce culot est néanmoins à
relativiser.
Celui-ci se réduit de plus en plus au fur et à mesure de la
constatation, non plus de déficits mais d'excédents. Surtout, il
est aussi à mettre en parallèle avec le niveau des
dépôts obligatoires de trésorerie opérés par
les collectivités locales.
Le solde des comptes des collectivités locales auprès du
Trésor s'établit comme suit :
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Solde du compte au 31/12 |
+ 12.578 |
+ 14.599 |
+ 16.234 |
+ 18.500 |
+ 21.006 |
e) Un nouvel équilibre des relations financières Etat/Collectivités locales ?
Votre rapporteur spécial n'est pas évidemment en mesure de définir un bilan d'ensemble des relations financières Etat/Collectivités locales. Trop de paramètres manquent encore. Votre rapporteur spécial constate néanmoins que les données ont changé depuis la parution de son rapport d'information, en 1989, sur la gestion de trésorerie des collectivités locales. Il se propose de poursuivre ses travaux plus avant pour mieux appréhender les évolutions du compte d'avances aux collectivités locales et ses conséquences sur les relations financières entre Etat et collectivités locales.







