3ÈME PARTIE -
LA CONSTRUCTION D'UN INDICE SYNTHÉTIQUE DE
RESSOURCES ET DE CHARGES
I. MÉTHODOLOGIE
L'objectif central dans la construction d'un indice
synthétique de ressources et de charges a consisté à
prendre en compte des moyennes et à les appliquer aux données
physiques des départements.
Ainsi, on ne favorise pas les départements qui ont une politique dite
« dynamique », et, à l'inverse, on ne pénalise pas les
départements dont la gestion est rigoureuse.
Les données obtenues sont donc des données normatives que ce soit
pour les ressources ou pour les charges. Elles doivent permettre de mesurer
l'écart de richesse entre les départements après
prélèvements de leurs charges obligatoires.
-
-
- A. RESSOURCES PRISES EN COMPTE
-
Les dotations versées par l'Etat ont également été incluses dans l'indice dans la mesure où elles font suite à des modifications de la fiscalité locale. La suppression d'une recette d'ordre fiscal a été substituée par une compensation de l'Etat et les inégalités entre les départements ont ainsi été figées. Ont donc été prises en compte :
- La dotation relative à la suppression de la vignette (hors Corse du Sud et Haute Corse).
- La dotation relative à la réduction des droits de mutation.
- Le contingent d'aide sociale versée dans la dotation globale de fonctionnement.
La compensation relative à la suppression de la part salaires dans l'assiette de taxe professionnelle n'a pas été intégrée à ce niveau dans la mesure où elle est déjà prise en compte dans le potentiel fiscal.
Les ressources ainsi obtenues n'ont pas été corrigées de l'effort fiscal ou du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal pour respecter le principe d'un calcul à partir de moyennes nationales et non de données propres à chacun des départements. La prise en compte de ces indicateurs aurait pu entraîner un biais dans le calcul de l'indice.
-
-
- B. CHARGES PRISES EN COMPTE
-
• Les dépenses relatives aux collèges et aux transports scolaires,
• Les dépenses de voirie,
• Les dépenses relatives aux personnes âgées,
• Les dépenses relatives à l'enfance,
• Les dépenses relatives à la gestion du RMI.
Ont été prises en compte au réel :
• Les dépenses relatives à la participation au SDIS,
• Les dépenses relatives aux handicapés.
Enfin, des dépenses moyennes de personnel ont été affectées aux départements au prorata du poids des charges calculées ci-dessus.
Le total de ces charges rapportées au nombre d'habitant permet d'avoir une mesure des inégalités de charges qui pèsent sur les départements.
Au final, ce sont 19,8 milliards d'euros de charges qui ont été prises en compte au titre des dépenses obligatoires. Les dépenses totales de fonctionnement (dépenses obligatoires, plus dépenses facultatives) des départements représentent en 2001 plus de 22,4 milliards d'euros. La méthode utilisée conduit donc à construire un indice comprenant 88,6 % des dépenses des départements.
Validation de la méthode suivie :
Le graphique suivant permet de vérifier la cohérence des dépenses obligatoires calculées par rapport aux dépenses totales observées dans chaque département :
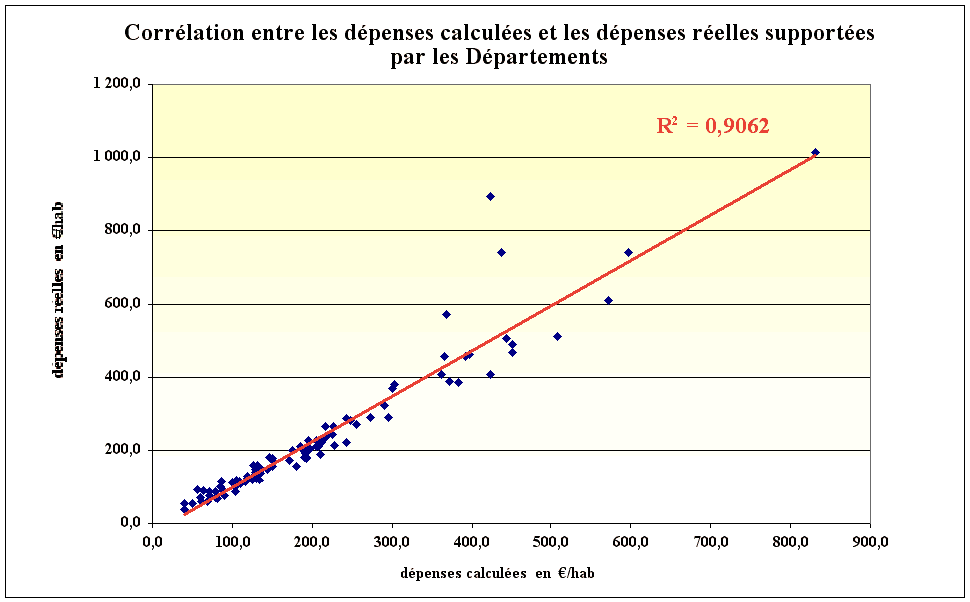 *
les données chiffrées sont fournies en annexe II
*
les données chiffrées sont fournies en annexe II
La
corrélation, proche de 1, est donc très forte entre les
dépenses calculées à partir de moyennes nationales et les
dépenses réelles supportées dans chaque
département. Deux départements ont des dépenses
réelles largement supérieures aux dépenses
calculées : il s'agit des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.
Autrement dit, les écarts de charges sont donc respectés avec un
raisonnement sur des moyennes nationales.
Cette bonne corrélation permet non seulement de valider la
méthodologie suivie mais aussi de démontrer que les
départements ont le même comportement de dépense compte
tenu de leurs caractéristiques socio-économiques.
-
-
- C. VALEUR DE L'INDICE SYNTHÉTIQUE
Le solde ainsi obtenu permet de connaître le besoin ou l'excédent de financement des départements après paiement de leurs dépenses obligatoires.
C'est à partir de ce solde que les inégalités sont mesurées.
Dans un deuxième temps, a été ajoutée la DGF/habitant (hors contingent d'aide sociale) perçue par les départements, afin de vérifier si cette dotation permet ou non de corriger les inégalités.







