L'information des citoyens
M. Laurent CHICOINEAU
Directeur du CCSTI, Grenoble
Bonsoir. Je vais vous parler d'un projet qui est en cours de démarrage et en cours de réalisation en me présentant très rapidement et en vous situant très rapidement ce qu'est un CCSTI (Centre de culture scientifique, technique et industrielle) et quelle est sa place dans les dispositifs d'information des citoyens.
Un CCSTI est une association de loi 1901 qui est conventionnée avec le ministère délégué à la Recherche. Il y a une cinquantaine de ces centres en France, vous en avez au moins un dans chaque région, excepté Champagne-Ardennes.
La mission, la finalité de ces associations, c'est la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au plus grand nombre, c'est-à-dire la sensibilisation de tous ceux qui ne sont pas de formation scientifique ou qui n'ont pas d'attaches professionnelles scientifiques.
De plus en plus, nous nous retrouvons au coeur de la problématique sciences-société. Je veux dire par là que la mission traditionnelle de vulgarisation telle qu'elle avait été initiée par le Palais de la Découverte dans les années 30 et ensuite reprise dans les années 60-70 n'est plus suffisante.
On se rend compte qu'on a un travail complémentaire à faire au niveau de la simple vulgarisation, c'est-à-dire à la simple simplification ou transmission des connaissances dans le public. Donc, on adopte des méthodes aujourd'hui de pluralité de points de vue, d'approches non disciplinaires, c'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas à une information sur la chimie mais plutôt à des sujets - on a parlé des cosmétiques, on a parlé de la santé à différents angles -, les gens s'intéressent à des angles, à des sujets et pas à des disciplines scientifiques a priori.
Puis, ce qu'on a également remarqué, c'est que, par une mise en culture des sciences, c'est-à-dire quand on fait le lien avec l'histoire, l'histoire des sciences mais aussi l'histoire, la grande histoire, quand on fait le lien avec l'économie, avec l'art parce que les artistes parlent des sciences et parlent du monde d'aujourd'hui et de demain, et aussi avec la philosophie, on touchait un plus large public et on pouvait peut-être mieux faire passer un certain nombre d'informations qui comprennent des éléments scientifiques.
Nos modes d'action consistent dans des expositions interactives, des ateliers de pratique scientifique, des rencontres-débats avec les chercheurs eux-mêmes et avec d'autres professionnels, la fête de la science en France (vous en avez sûrement entendu parler), mais aussi des formations, de l'édition et des collaborations avec les médias locaux, radio et presse quotidienne, pour parler de nos modes d'information.
Si on parle des nanotechnologies et des nanosciences, la question de base est : qu'est-ce qu'on attend comme information ?
Si on veut aller à la rencontre du public et lui parler des nanotechnologies, en partant du principe que, a priori, il n'est pas forcément intéressé, essayons de réfléchir à l'angle sous lequel on va pouvoir lui en parler, quelles sont les attentes principales. Donc d'abord, évidemment, qu'est-ce que c'est les nanotechnologies, de quoi parle-t-on et surtout, comment puis-je le comprendre, c'est-à-dire à quelles connaissances que j'ai déjà je vais pouvoir raccrocher ces nouvelles connaissances.
C'est aussi à quoi cela va servir. Est-ce que ça pourra résoudre mes problèmes de santé, mes problèmes de travail, trouver un emploi par exemple ? Est-ce que ça va pouvoir résoudre mes problèmes du quotidien ou tout basiquement de confort, comme on disait tout à l'heure ? Et puis, tout de suite après, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il y a des risques pour l'environnement ? Est-ce qu'il y a des risques pour moi, pour mes enfants, pour les générations futures ?
Egalement : ou est-ce que ça se fabrique ? Qui le fabrique ? Combien ça coûte ? - parce qu'on est dans une question sur les technologies, on parle de produits, de production ; ce sont des attentes d'information de la part du public qu'on retrouve assez fortement - et puis, la question a été soulevée tout à l'heure, c'est un public déjà plus spécialisé mais ça intéresse aussi beaucoup les gens de savoir comment la France et l'Europe se situent par rapport aux Etats-Unis, au Japon, aux autres pays émergents dans les matières scientifiques.
Toutes ces questions, je ne les tire pas de mon chapeau mais de différentes enquêtes que nous menons régulièrement auprès du public. Cela a été fait pour la microélectronique, pour les biotechnologies, et aujourd'hui autour des nanotechnologies : comment, face à ce déferlement de prouesses technologiques, le simple citoyen réagit-il et comment peut-il avoir un accès ? Qu'est-ce qui va le motiver pour avoir un accès à l'information et participer au débat, comme les précédents orateurs le souhaitaient ?
Quelles sont les difficultés ? Elles ont été largement évoquées aujourd'hui. Les nanotechnologies sont des technologies émergentes, il n'y a pas encore beaucoup d'applications, je parle du point de vue du grand public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'application qui tue, il n'y a pas l'équivalent du téléphone portable pour les nanotechnologies, on n'arrive pas bien à les distinguer des microtechnologies, ce n'est pas tout à fait clair en termes d'échelle.
Et puis, il n'y a pas non plus d'entreprises porte-drapeaux, ces entreprises qui apportent de la lisibilité, comme il y a eu Microsoft pour l'informatique, Yahoo pour Internet, etc...
La convergence biotechnologies-numérique-robotique induit pas mal de confusion aussi dans l'esprit des gens, cela a été soulevé tout à l'heure.
Quand on parle de thérapie cellulaire, on parle de nanotechnologies, de nanobiotechnologies. Il y a beaucoup de controverses scientifiques, il y a aussi des chercheurs qui font part de leurs doutes, cela a été soulevé dans des exposés précédents.
Puis, il y a un environnement concurrentiel international très fort qui est aussi soutenu fortement par les politiques, ce qui a été aussi dit par le représentant de la Commission européenne et par d'autres orateurs, ce qui fait que, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être contre ou de douter de l'intérêt des nanotechnologies. C'est un impératif technologique, un impératif de développement qui est à la fois mentionné par les entreprises en concurrence internationale et par les pouvoirs publics qui disent qu'il faut que l'Europe soit avant les Etats-Unis et qui en font un fer de lance.
Ces discours ne contribuent pas à rendre très claires les nanotechnologies. On observe aussi une méfiance croissante envers les nouvelles technologies de la part du public, de la part de l'opinion publique.
Evidemment, l'éclatement de la bulle Internet y est pour quelque chose et puis je vous rappelle tous les discours quasi mystiques qu'on avait autour d'Internet qui allait révolutionner la société... Certes, aujourd'hui nous communiquons par mails et nous avons développé un certain nombre de services mais, que je sache, la révolution n'a pas encore eu lieu.
Puis, dernier point sur lequel on a commencé à travailler, c'est que les nanotechnologies, comme beaucoup de disciplines scientifiques modernes, sont très difficiles à communiquer parce qu'il n'y a pas d'images ou peu d'images. Il n'y a pas de représentations. C'est très flou, on parle de l'invisible, on parle de l'infiniment petit et c'est la porte ouverte à tous les fantasmes.
Quelles sont ces vues du nanomonde ? C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Evidemment, il y a des images scientifiques, tout de même, la fameuse image IBM. Là, on se projette déjà dans une approche Bottom-Up. Il y a des images d'artistes aussi, c'est-à-dire que, à côté de la communauté scientifique - c'est ça qui est peut-être aussi dommage, il faudrait plus d'interactions entre les deux communautés -, il y a des artistes qui se sont emparés du sujet nano, de l'infiniment petit, pour travailler leur création.
Puis, il y a les images populaires. J'ai mentionné le film Le Voyage fantastique qui date de 1966 et L'Aventure intérieure qui date des années 80 avec ce fantasme d'aller se promener à l'intérieur du corps humain et de voir l'intérieur du corps humain comme on l'a vu tout à l'heure avec la caméra dans la capsule, le voyage fantastique que fait cette microcaméra dans la capsule.
Tout ça, toutes ces images populaires vont façonner l'imaginaire et surtout les représentations du public. Cela va orienter à la fois les attentes, à la fois les préjugés, à la fois les idées fausses et les idées vraies que le public peut se faire de ces technologies.
L'étape 2004, celle dans laquelle nous sommes entrés cette année, sera celle d'un travail sur les images et les représentations qui passe d'abord par - inventaire, c'est un grand mot - une recherche, une classification des images scientifiques.
On se rend compte que, lorsqu'on demande à un chercheur ce qu'on pourrait mettre comme image si on devait résumer les nanobiotechnologies en une image... C'est une question très compliquée et pourtant le public en a besoin parce que le public a besoin d'images, nous avons tous besoin d'images et si nous (nous, communauté scientifique) ne sommes pas capables de produire ces images, d'autres vont le faire à notre place, et pourront « manipuler », en tout cas induire des idées dans l'opinion publique, et nous aurons une perte de contrôle, de maîtrise des images « réelles », en tout cas de comment on peut représenter en tant que scientifiques le nanomonde, les nanotechnologies.
De même, il y a un certain nombre d'artistes qui ont déjà travaillé là-dessus, effet de mode peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas historien de l'art. En tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tellement l'apport de ces artistes dans l'histoire de l'art mais plutôt tout ce qu'ils vont mettre en oeuvre dans ces représentations, ce qu'ils vont essayer de dénoncer, de quoi vont-ils faire l'apologie, comment vont-ils projeter leur problématique personnelle autour de ce nanomonde, dans ce nanomonde. Tout ça, c'est autant d'indices qui peuvent être des portes d'entrée vers de la compréhension.
Puis, en dehors de ce travail sur l'image, en parallèle, nous faisons aussi un travail d'enquête, donc de type sociologique, auprès de la population en essayant de travailler sur les attentes des gens.
L'idée est de valider les questions que je vous présentais précédemment, et puis de voir si d'autres sont aussi présentes. Donc, les attentes du public vis-à-vis des nanosciences, les niveaux de compréhension.
C'est très important parce que, quand on a fait une enquête sur les biotechnologies, il y a trois ou quatre ans, on s'est rendu compte que les gens, quand on leur demandait s'ils avaient entendu parler d'ADN, ils disaient oui ; mais quand on leur demandait s'ils savaient ce que c'était, ils disaient non.
Donc il ne faut pas s'arrêter simplement au niveau du vocabulaire mais il faut voir quels sont tous les niveaux de compréhension qui sont à l'oeuvre dans la population, qui ne sont pas forcément induits par les médias, et c'est pour ça d'ailleurs que, tout à l'heure, je posais une question sur l'éducation.
Et puis les références aussi. C'est-à-dire que, en matière de nouvelles connaissances, on va s'accrocher forcément à quelque chose, à une référence, donc quelle est la référence ? Quand on parle des nanotechnologies, à quoi fait-on référence immédiatement ?
Ce qui est intéressant, il me semble, c'est de doubler cette enquête par une enquête auprès des scientifiques, auprès de la communauté scientifique, c'est-à-dire que la question de l'image et de la représentation n'est pas uniquement dans la tête de la population. Tout à l'heure, quelqu'un a dit justement qu'un chercheur c'était aussi un citoyen, ça peut être un père de famille, une mère de famille, donc c'est aussi quelqu'un qui vit des passions et qui vit dans sa société.
C'est intéressant aussi de savoir comment tout ça, vis-à-vis de son travail, et en l'occurrence des chercheurs dans les nanotechnologies, comment tout ça est utilisé en termes de visions, en termes de stratégies, en termes de doutes.
Tous les scientifiques ne pensent pas la même chose, heureusement, même s'ils ne travaillent pas dans le même domaine. Et c'est intéressant de voir par exemple, ça a été cité tout à l'heure, de voir comment et si les étudiants en thèse connaissent les personnes visionnaires qui ont été citées tout à l'heure, Bill Joy ou Drexler.
Comment ils se positionnent par rapport à ça ? Est-ce qu'ils sont conscients que les controverses qui sont largement médiatisées, ils en sont en fait un des acteurs ? Au lieu de subir ces controverses, peut-être que ce serait intéressant d'avoir une sorte de formation de ces jeunes scientifiques pour répondre à toutes ces questions de médiation et de diffusion vers le public.
Enfin, le travail que nous faisons cette année comporte également un recensement de manipulations et d'expositions sur le même thème mais aussi sur des scénographies de salons professionnels ou des documents de communication industriels comme le film Nanotechnologies qui a été produit par la Commission européenne.
C'est très intéressant de voir comment les acteurs eux-mêmes communiquent, quelles sont les images qu'ils produisent, dans lesquelles ils se retrouvent et donc par lesquelles ils vont se présenter au public.
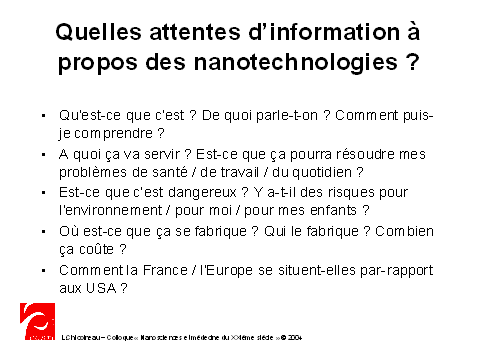
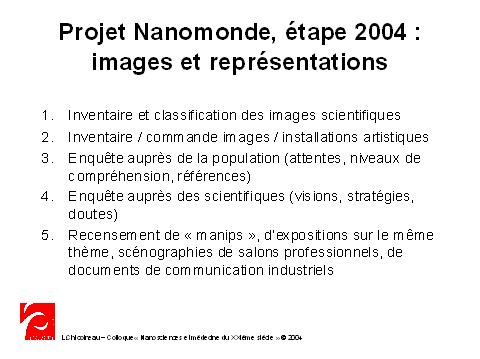
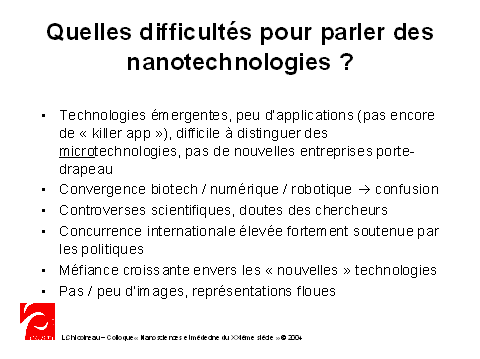
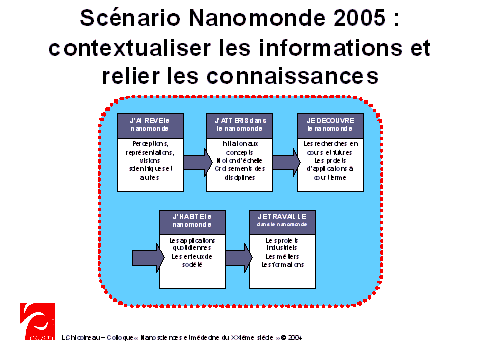
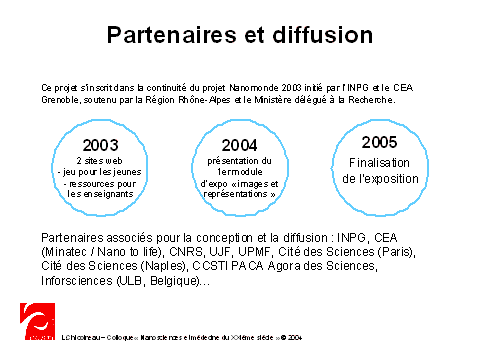 Je termine là-dessus.
L'objectif de ce projet, « Nanomonde 2005 », vous l'avez
compris était un projet d'exposition avec toute une série
d'environnements, d'informations et de débats et d'éducation avec
un objectif qui est de contextualiser les informations et relier les
connaissances.
Je termine là-dessus.
L'objectif de ce projet, « Nanomonde 2005 », vous l'avez
compris était un projet d'exposition avec toute une série
d'environnements, d'informations et de débats et d'éducation avec
un objectif qui est de contextualiser les informations et relier les
connaissances.
Encore une fois, il ne suffit pas de vulgariser ou de faire des enquêtes sociologiques, il ne suffit pas de mettre un artiste avec des scientifiques. Par contre, l'ensemble est intéressant et c'est par l'ensemble de ces différents éléments que nous allons peut-être créer du sens, motiver le public à aller un peu plus loin dans ces technologies.
Je termine sur les partenaires et diffusions pour dire que ce projet a une base scientifique importante. Il a été initié par l'Institut polytechnique de Grenoble et le CEA à Grenoble, soutenu par la région Rhône-Alpes et le ministère délégué à la Recherche. Il a démarré en 2003 par la création de sites Internet pour parler des nanotechnologies à travers deux sites : l'idée de faire un jeu pour les jeunes et puis un site de ressources pour les enseignants.
En 2004, je vous en ai parlé, nous organisons le module « Expo images et représentations » dont nous prévoyons la finalisation de l'exposition et sa présentation au public fin 2005.
Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas rester à Grenoble, non pas parce qu'on aime les voyages mais parce que d'autres acteurs font du développement dans les nanotechnologies en dehors de Grenoble.
Ce travail est fait en relation forte, de plus en plus forte, notamment avec la Cité des Sciences, à Paris, mais aussi en Italie avec la Cité des Sciences de Naples, avec un autre centre de culture scientifique implanté à Marseille, l'Agora des Sciences, avec l'Université libre de Bruxelles en Belgique, qui a une unité de médiation scientifique qui s'appelle Inforsciences, et d'autres partenaires qui sont en cours de validation.
L'idée, encore une fois, c'est d'essayer d'avoir un regard - là, je parle en tant que Grenoblois - un peu plus universel que simplement lié à des préoccupations qui, pour le coup, sont très locales.
A Grenoble, vous l'avez compris, il y a beaucoup de développement autour des nanotechnologies et il y a aussi quelques manifestants et quelques opposants qui font entendre leur voix. Donc, de cette problématique locale, nous souhaitons aller vers quelque chose d'un petit peu plus universel. Merci.
M. Alain CIROU
Merci, Laurent CHICOINEAU. Je vous propose de rejoindre l'estrade en compagnie des autres intervenants pour répondre jusqu'à 19 heures, à quelques questions, quelques observations en guise de conclusion.







