2. Peut-on échapper à de nouvelles hausses de prélèvements ?
Votre commission des finances n'est, par principe, pas favorable à une augmentation des prélèvements obligatoires. Cependant, elle est encore moins favorable à ce qu'un déficit public élevé conduise à une augmentation de la dette obligeant à consacrer une part croissante des dépenses publiques au financement de ladite dette. Compte tenu de la très grande difficulté de réduire rapidement et significativement le déficit structurel par la seule maîtrise des dépenses, on ne peut exclure qu'il faille, au moins temporairement, accroître à moyen terme le taux de prélèvements obligatoires.
Le fond du problème, c'est que les augmentations de dépenses publiques réalisées au début des années 1980 et au début des années 1990 n'ont pas été financées, comme l'indique le graphique ci-après.
Les dépenses publiques, les recettes publiques et le solde structurel depuis 1980
(en points de PIB)
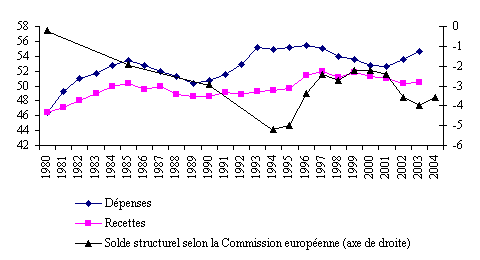
Sources : Commission européenne (« L'ajustement structurel des soldes publics », printemps 2004 ; prévisions économiques du printemps 2005), Insee
Selon les estimations de la Commission européenne, le déficit structurel est passé de presque 0 point de PIB en 1980 à 2 points de PIB en 1985, avant d'atteindre 5 points de PIB en 1993, et, grâce aux efforts menés en 1995 et en 1996, de se stabiliser autour de 3 points de PIB.
Les augmentations de dépenses non gagées effectuées au début des années 1980 et au début des années 1990 ont donc accru le déficit structurel de respectivement 2 points de PIB et 3 points de PIB. Sans ces augmentations de dépenses non gagées, la France aurait un excédent structurel de 2 points de PIB.
Ce graphique montre également que la croissance des dépenses publiques observée depuis 1993 a été soutenable, puisqu'elle a été égale à celle du PIB.
Selon les estimations de la Commission européenne et de l'OCDE, le déficit structurel de la France est de l'ordre de 3 % du PIB. Pour le ramener à 1 % du PIB, il serait donc nécessaire d'accroître à moyen terme les prélèvements obligatoires d'environ 2 points de PIB , ce qui correspond à un effort analogue à celui réalisé en 1995 et en 1996.
L'élasticité des recettes publiques au PIB étant, sur longue période, de l'ordre de l'unité, une telle augmentation des prélèvements obligatoires n'aurait à être réalisée qu'une fois , si les dépenses publiques continuaient de croître au même rythme que le PIB.
Le « multiplicateur keynésien » étant en France proche de l'unité, une telle mesure est susceptible de réduire d'autant, à court terme, la croissance du PIB. Ce serait cependant le « prix à payer » pour les augmentations passées des dépenses publiques.
Une telle question doit être assumée avec lucidité. Elle peut apparaître déplaisante ou déplacée. Mais votre rapporteur général considère qu'il est de son devoir de l'évoquer ici, dans un tel rapport d'orientation budgétaire. La France est-elle capable de restreindre plus drastiquement sa dépense publique ? Peut-elle assumer les conséquences socio-économiques d'une rigueur dont personne n'ose vraiment parler ? Inventerons-nous un nouveau « modèle » où la justice et l'efficacité trouveraient leur compte ? Le pire est de subir des choix non explicités et non préparés par un vrai débat public. Le concept d'un plan de redressement mérite ainsi d'être évoqué en cette fin de législature, marquée de faux-pas mais aussi de quelques avancées réelles. Deux années ne seront pas de trop pour élaborer de nouvelles perspectives, qui feront naturellement appel à des efforts partagés.







