TROISIÈME PARTIE - VALORISER DURABLEMENT LA BIODIVERSITE
Il est parfois utile de reconsidérer les vérités d'évidence.
Si l'on s'attache au développement de l'humanité depuis 10 000 ans - ce qu'on a appelé la civilisation -, on doit constater que ce développement s'est fait au détriment des espaces naturels et de la biodiversité du vivant.
Faut-il alors préserver la biodiversité ?
Ne pourrait-on pas se contenter de limiter les excès de la pression anthropique à venir et de continuer à arbitrer, le plus souvent possible, en faveur des activités humaines chaque fois qu'elles conduisent à modifier ou à faire disparaître les écosystèmes ?
Cette façon de faire n'est plus pertinente parce qu'au-delà de l'attachement de chacun pour le patrimoine émotionnel de la biodiversité, celle-ci est d'abord un atout pour l'humanité .
La proximité d'une crise énergétique majeure liée à la raréfaction des ressources énergétiques fossiles et la nécessité d'atténuer les effets du changement climatique impose une forte inflexion de notre modèle de développement économique .
Dans cette perspective, l' utilité de la biodiversité des écosystèmes doit être considérée dans une double approche .
L'une, traditionnelle, qui consiste à garder à l'esprit qu'il est nécessaire de faire un usage durable des biens et services qu'elle nous propose ,
L'autre, plus novatrice, qui consiste à faire de la biodiversité un des supports du nouveau modèle de développement auquel - les crises climatiques et énergétiques aidant - on ne pourra pas se soustraire.
Sur ce dernier point, deux axes de recherche se profilent : l'identification et la rémunération des services rendus par les écosystèmes et l'exploration d'un réservoir de biens qui pourrait être une des boîtes à outils de la quatrième révolution industrielle .
I. LA VALORISATION DES SERVICES ECOLOGIQUES
Les services écologiques sont comme une « main invisible » qui a permis le développement de l'humanité 52 ( * ) .
Dans un article devenu depuis célèbre 53 ( * ) , l'économiste R. Costanza a répertorié 17 grandes fonctionnalités produites par les écosystèmes de la planète, de la régulation du climat et de l'atmosphère à la production de nourriture et de matières premières.
Dans le même ordre d'idées, « l'évaluation du millénaire » qui s'efforçait, par ailleurs, de mesurer les risques d'appauvrissement de ces fonctionnalités les a regroupées en quatre grandes catégories de services (la logistique du système, les flux d'approvisionnement du système, la régulation du système et les services culturels).
Les écosystèmes de la planète dispensent à l'humanité des services qui sont autant d'économies externes indispensables.
Mais si ces apports sont très diversifiés, ils sont très insuffisamment reconnus.
A. DES SERVICES DIVERSIFIES
Par définition, les services écologiques qui s'expriment dans un environnement naturel ne se distinguent pas des manifestations de cet environnement, leurs fonctions essentielles ne sont donc pas toujours perceptibles .
Par exemple, les services de régulation de l'atmosphère de transformation du méthane et du Co2 assurés par les plantes et les micro-organismes sont invisibles mais essentiels. Un article récemment paru dans Nature (19 octobre 2006) a établi qu'au Svalbard, des micro-organismes recyclent le méthane émis par des volcans à 1250 mètres de fond.
Cela donne une idée de l'offre très diversifiée des services écologiques.
On mentionnera trois types d'exemples de ces services écologiques : les services sanitaires, agronomiques et hydrologiques.
1. Les services sanitaires
Des expériences convergentes effectuées au Brésil par l'Institut Oswaldo Cruz et aux Etats-Unis par le National Institut of Health Service ont prouvé expérimentalement que la biodiversité des milieux joue un rôle d'inhibiteur de pathologies graves pour l'homme (leishmaniose, maladie de Chagos, maladie de Lyme)
On a constaté à l'opposé que la destruction des milieux 54 ( * ) était un facteur favorisant la propagation de ces maladies :
- d'une part, les vecteurs porteurs de ces affections peuvent se transporter dans les milieux fréquentés par les hommes sans que leur ravageurs le fassent (c'est le cas de la punaise en Indonésie dans les palmeraies à huile plantées à la suite d'une déforestation),
- et, d'autre part, la destruction des milieux naturels peut entraîner celle de mammifères porteurs du pathogène mais ayant peu de contact avec l'homme, ce qui encourage les vecteurs à se fixer sur des mammifères qui ont plus de contact avec l'homme (chien, chat, rat).
Cette contention des pathogènes est très importante. Mais on en découvre la valeur lorsque les écosystèmes correspondants sont détruits.
Cette fonction d'inhibition assurée par les écosystèmes pourrait jouer un rôle capital dans la perspective du changement climatique .
On doit rappeler que les agents pathogènes pour l'homme sont 300 fois plus nombreux dans les zones tropicales que dans les régions tempérées.
Or, le changement climatique aidant, une partie d'entre eux pourrait connaître une translation vers des zones plus tempérées. On a déjà constaté que les épisodes de poussée d'El Niño, qui correspondent à un réchauffement, créent dans l'hémisphère sud une montée des épidémies.
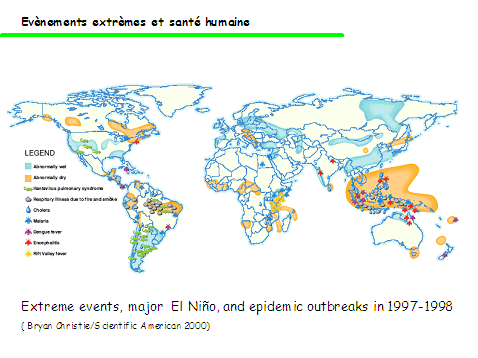
Il va donc de soi que la limitation de l'extension de ces pathogènes sera d'autant plus forte qu'elle pourra s'adosser à des écosystèmes variés .
* 52 On peut même affirmer, comme le fait J.C. Lefeubvre, que l'économie industrielle au XIX ème siècle a pris son essor grâce à la constitution de gisements de charbon dans les zones humides du carbonifère. En quelque sorte, un service écologique à retardement.
* 53 R. Costanza et al. « The Value of the worlds' ecosystem services ». Nature 1997 - vol.387.
* 54 Notamment dans les zones intermédiaires entre les campagnes et les villes où les biotopes sont déséquilibrés et favorables aux insectes vecteurs de transmission (mouches, moustiques, tiques)







