D. SUR QUEL CHAMP APPLIQUER LES INDICATEURS DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ?
Le champ sur lequel on applique les indicateurs de partage de la valeur ajoutée influence la valeur de l'indicateur de partage de la valeur ajoutée ainsi que la perception de ses évolutions.
Il existe, en effet, une très forte hétérogénéité des conditions de partage de la valeur ajoutée , entre les secteurs institutionnels identifiés par la comptabilité nationale, mais aussi au sein de ces secteurs .
De fait, on constate la grande diversité de niveau des salaires dans la valeur ajoutée de chaque catégorie d'agents économiques : la part des salaires dans la valeur ajoutée atteint environ 67 % pour les sociétés non financières, 10 % pour les ménages, 83 % pour les administrations publiques et 64 % dans les sociétés financières.
Cette variété correspond aux types de production de chaque secteur, ainsi qu'à des particularités techniques de comptabilisation de leur production.
PART DE LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DANS
LA VALEUR AJOUTÉE
AU COÛT DES FACTEURS - DE 1949 À
2008
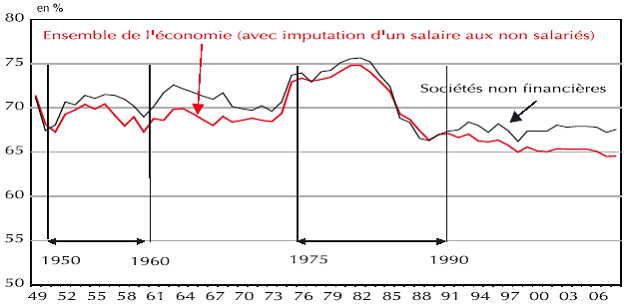
Source : Insee, comptes nationaux annuels - base 2000, calculs des auteurs
Le graphique ci-dessus rend compte de l'évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie et des seules sociétés non financières (SNF) respectivement.
Il montre que le diagnostic sur la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et profits peut différer selon qu'on s'intéresse à l'ensemble de l'économie ou aux seules entreprises non financières.
On observe, en effet, que la part des salaires dans la valeur ajoutée des SNF apparaît structurellement supérieure à celle estimée pour l'ensemble de l'économie .
En outre, même si les évolutions sont souvent parallèles, des divergences peuvent apparaître comme ce fut, en particulier, le cas à partir de 1990. Alors que le taux des rémunérations du travail reste à peu près stable dans le champ des SNF, considéré pour l'ensemble de l'économie, il baisse de l'ordre de 3 points.
Cette dernière évolution résulte d'un effet de composition venant de ce que les secteurs autres que les SNF dans lesquels la valeur ajoutée revenant aux salaires est plus faible comparativement ont accru leur place dans l'ensemble de la valeur ajoutée. Cet effet de composition paraît avoir plus que compensé le phénomène d'accroissement apparent de la part des salaires dans la valeur ajoutée des secteurs hors SNF pour la période considérée.
PART DE LA RÉMUNÉRATION DES
SALARIÉS DANS LA VALEUR AJOUTÉE
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
ET DES MÉNAGES HORS EI (1949-2007)
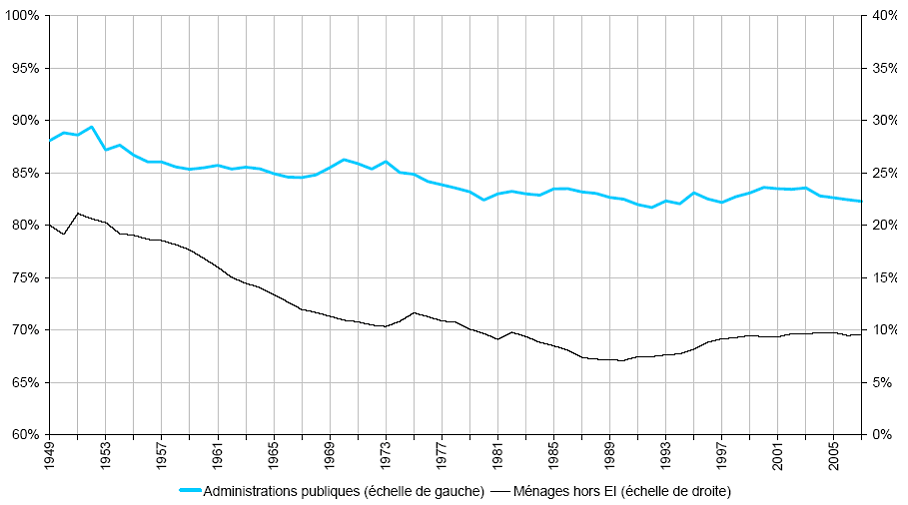
Source : Insee, Comptabilité nationale en base 2000 ; valeur ajoutée au prix de base
En effet, même si sur longue période la part des salaires dans la valeur ajoutée des administrations publiques (échelle de gauche du graphique ci-dessus) et des ménages (échelle de droite) a nettement reculé (- 5 points pour les premières, - 10 points pour les secondes depuis 1949), à partir de 1990, cette part s'est un peu redressée pour les ménages (+ 3 points) et s'est stabilisée pour les administrations publiques.
Pour les sociétés financières, la part des salaires dans leur valeur ajoutée a également augmenté, plus considérablement d'ailleurs.
PART DE LA RÉMUNÉRATION DES
SALARIÉS DANS LA VALEUR AJOUTÉE
DES SOCIÉTÉS
FINANCIÈRES (1949-2007)

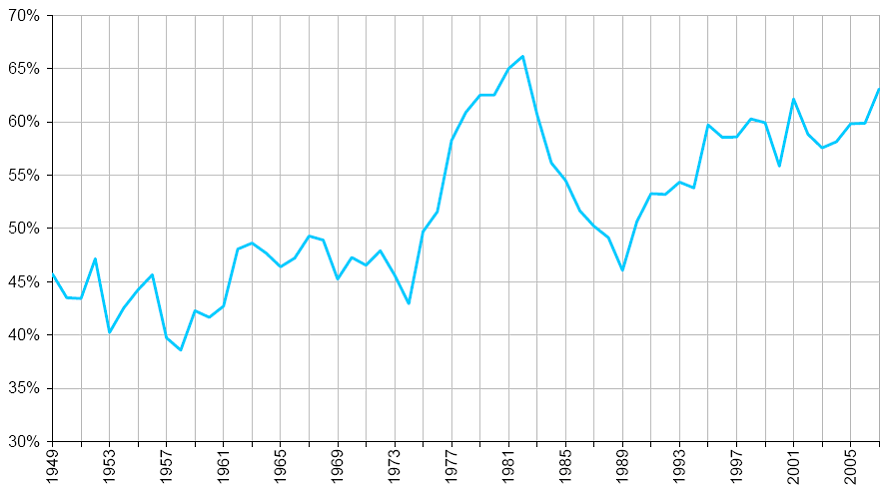
Source : Insee, Comptabilité nationale en base 2000 ; valeur ajoutée au prix de base
Si la structure de la production était restée identique, on aurait dû constater une augmentation de la part de salaires dans la valeur ajoutée. Mais les modifications intervenues ont renforcé la place des secteurs pour lesquels la part des salaires dans la valeur ajoutée, malgré une évolution positive ces dernières années, est plus faible que celle des SNF, si bien qu'au total, la recomposition sectorielle de l'économie française a exercé un effet de réduction de la part des salaires dans la valeur ajoutée .
Dans nombre de travaux récents, seule la répartition de la valeur ajoutée des entreprises non financières est prise comme référence. Tel est le cas en particulier du rapport de la mission présidée par M. Jean-Philippe Cotis, au nom des spécificités de la notion, et du partage, de la valeur ajoutée des autres agents économiques.
Ces spécificités sont, en effet, fortes. Et l'agrégation sans précaution des secteurs de l'économie peut aboutir à des images faussées.
Mais, inversement, il résulte quelques inconvénients d'une option réduisant l'analyse aux seules sociétés non financières.
1. La valeur ajoutée des ménages et son partage
L'activité de production des ménages (hors entreprises individuelles) comporte principalement, en l'état des normes comptables, qui limitent les activités des ménages prises en compte pour évaluer leur production, la production de services à la personne et de services de logement. Ces derniers engendrent la perception de loyers, soit réellement versés par les locataires, soit dits « loyers imputés » c'est-à-dire correspondant au service rendu à eux-mêmes par les ménages propriétaires-occupants 366 ( * ) .
Quant aux salaires versés par les ménages, ils sont composés uniquement des salaires versés aux « employés à domicile ». Dans ces conditions, la production des ménages ressort comme nécessitant surtout du capital (en l'espèce les logements) ce que traduit la très faible part des salaires dans leur valeur ajoutée.
* 366 Le choix de compter en production le service que se rendent à eux-mêmes les ménages propriétaires-occupants déconcerte parfois, notamment parce que les loyers qui permettent d'évaluer cette production ne donnent évidemment pas lieu à des débours effectifs. Pourtant, comme on considère sans hésitation que les entreprises de location de logement ont une activité de production, il faut admettre que la mise à disposition d'un logement, quelle que soit l'identité du propriétaire et du bailleur, représente bien un service.







