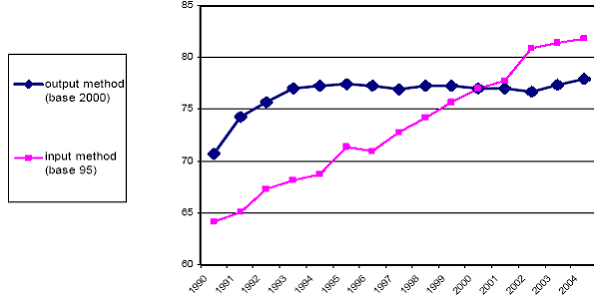2. La valeur ajoutée des administrations publiques et son partage
Pour les administrations publiques , la proportion des salaires dans leur valeur ajoutée (83 %) est nettement plus élevée que pour les autres secteurs.
Ceci est lié aux caractéristiques de leur activité qui consiste principalement à rendre des services nécessitant pour l'essentiel de la main-d'oeuvre. Mais cette situation résulte aussi des conventions qui s'appliquent pour valoriser la production des services non marchands.
La production à prix courants des branches non-marchandes dans les comptes nationaux est évaluée par la somme des coûts . Les produits correspondants ne faisant, par définition, pas l'objet de transactions sur le marché (à la différence des branches marchandes), la production de ces branches ne peut pas être évaluée à partir des ventes.
Cette méthode (dite de « l'input ») pose un problème d'évaluation de la production des administrations publiques. Comme les services rendus sont estimés à partir de leurs coûts et non de leur utilité, et comme coûts et utilité peuvent différer, il peut exister un écart entre la production telle qu'elle est recensée et la valeur des services qu'elle rend aux autres agents économiques.
Par ailleurs, l'affectation des évolutions de la productivité des effectifs concourant aux productions non marchandes ne peut être réellement restituée puisque, pour l'essentiel, la production est évaluée en fonction des salaires versés.
C'est pour dépasser ces limites que d'autres méthodes d'estimation des productions non marchandes sont en cours de développement. Tel est le cas avec les méthodes sont « basées sur l' output ». Il s'agit là d' utiliser des indicateurs directs visant à estimer l'évolution réelle de la production au niveau le plus fin . Dans ce cas, on peut notamment estimer un indice de volume de la production non-marchande.
Historiquement, les méthodes employées pour estimer la production en volume de services non marchands dans les comptes français ont varié. Dans un premier temps le caractère productif de ces activités n'était pas reconnu. Lorsqu'on a commencé à évaluer une production non-marchande, en base 1971 , le PIB « marchand » restait l'agrégat privilégié pour la mesure de la croissance et c'était la méthode « input » qui était utilisée pour évaluer le non-marchand. A l'époque, cette convention présentait moins d'inconvénients puisque les branches non-marchandes étaient moins étendues, les hôpitaux étant considérés comme des services marchands (jusqu'à ce que leur mode de financement soit modifié par l'introduction des « dotations globales »). La base 1980 a innové en introduisant des indices de production directs pour la santé et l'éducation. Pour l'enseignement on utilisait comme indicateurs les effectifs ventilés en 12 types élémentaires d'enseignement. Avec la base 1995 on est cependant revenu à une méthode de type « input », les services individualisables n'étant plus traités différemment des autres services non-marchands.
Cependant dans le cadre de la préparation de la base 2000, et en raison des nouvelles recommandations internationales, on a commencé à se préoccuper de rechercher des méthodes donnant des indicateurs directs plus satisfaisants du point de vue de la prise en compte de la qualité et de l'évolution des pondérations.
La méthode « output » a été retenue pour les comptes nationaux français en base 2000. Elle a été introduite pour l'éducation non marchande dans les comptes publiés en mai 2005 et pour la santé non marchande dans ceux publiés en mai 2006 .
|
SENSIBILITÉ DU VOLUME DE LA PRODUCTION NON
MARCHANDE
Les nouvelles évaluations ont conduit à réviser à la baisse l'évolution du volume de la production d'éducation non marchande (cf. graphique) au cours de la période récente. En effet, l'évolution positive du volume en base 1995, quand la production était mesurée en fonction des coûts, traduisait l'augmentation des moyens mis en oeuvre, notamment l'amélioration de la qualification des enseignants et leur nombre. En base 2000, avec une évaluation de la production par les « output », la stagnation du volume constatée depuis 1996 est liée à l'évolution démographique (baisse des effectifs scolarisés dans certaines filières), non compensée par une augmentation de la fréquence de réussite aux examens ou un accès plus fréquent dans une classe de niveau supérieur.
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION EN PRIX
CHAÎNÉS
(en milliards d'euros, année 2000 comme année de référence)
|
Source : INSEE. Le partage volume-prix, base 2000. Michel Braibant.
Les résultats du passage à la méthode de l'output gardent un caractère conventionnel, lié à la manière encore fruste dont est appréhendé le volume d'éducation, en particulier l'effet qualité. Un travail d'harmonisation sur ce sujet est sans aucun doute nécessaire, sans lequel les comparaisons internationales, au sein de l'Union européenne elle-même, risquent d'être biaisées.
Quoi qu'il en soit, le passage à une valorisation de la production non-marchande fondée sur une mesure des services réellement rendus est de nature à mieux restituer le contenu en salaires desdites productions dont il restera à régler le traitement comptable du côté des utilisateurs.