III. LE PROBLÈME DU TRAITEMENT DU REVENU DU TRAVAIL NON-SALARIÉ
Le suivi de la part des salaires dans la valeur ajoutée - sur longue période ou en comparaison internationale - peut être biaisé par des évolutions structurelles parmi lesquelles figure la « salarisation » croissante.
Celle-ci désigne le processus d'augmentation du fait salarial dans l'économie en lien, en particulier, avec la décroissance du nombre d'entrepreneurs individuels. Le secteur agricole témoigne particulièrement bien de cette évolution qui touche également d'autres secteurs à mesure que la concentration économique se produit.
La salarisation conduit à une augmentation mécanique de la part des salaires dans la valeur ajoutée .
Mais, ce processus peut être moins net, ou même inversé, si l'on considère qu'une part des revenus des entrepreneurs individuels, auxquels se substituent des salariés, est représentative de salaires.
C'est, de fait, ainsi que procède la comptabilité nationale, puisque le revenu des entrepreneurs individuels y est appelé « revenu mixte » et considéré comme servant à la fois à rémunérer le travail de ces entrepreneurs (composante salariale) et la détention de l'entreprise (composante profit).
Le processus de salarisation a provoqué une augmentation du rapport des salaires au revenu mixte des entrepreneurs individuels. A ce fait, essentiellement structurel, a correspondu une dynamique haussière mécanique de la masse salariale et, ainsi, par contrecoup, de la part des salaires dans le PIB.
C'est cette déformation structurelle qu'il convient de corriger pour apprécier à champs constant l'évolution de la répartition de la valeur ajoutée 373 ( * ) , ce qui suppose d'imputer une part du revenu mixte des entrepreneurs individuels aux salaires.
Les conditions de cette correction posent des problèmes qui ne sont pas tous surmontés car la question de l'évaluation de la composante salariale du revenu mixte des entrepreneurs individuels (EI) est complexe.
Traditionnellement, on attribuait à l'ensemble des travailleurs indépendants un salaire égal ou proportionnel au salaire moyen des salariés . Cette méthode de correction uniforme est peu satisfaisante, notamment pour les comparaisons en longue période car la composition de la population des non-salariés a évolué avec le temps. On est passé d'une population d'entrepreneurs individuels (largement composée d'agriculteurs) disposant sans doute d'un salaire inférieur au salaire moyen vers un non salariat (où les professions libérales à hauts revenus sont fortement représentées) où la rémunération du travail est supérieure à ce salaire. Dans un tel contexte, supposer que le salaire implicite des non-salariés a évolué comme celui des salariés conduit à des biais . Quand la rémunération du travail des EI est inférieure au salaire moyen, on la surestime ; quand elle lui est supérieure, on la sous-estime. Autrement dit, dans le premier cas, on aboutit à une part des salaires dans la valeur ajoutée probablement supérieure à ce qu'elle est en fait quand, dans le second, on la sous-évalue. Dans les faits, l'application de la méthode uniforme conduit en début de période à une part des salaires dans la valeur ajoutée sans doute excessive par rapport à la réalité et, en fin de période, inférieure à ce qu'elle est dans les faits.
Une méthode alternative consiste à attribuer à chaque travailleur indépendant le salaire moyen de sa branche d'activité , et non pas le salaire moyen global (Askenazy, 2003). Cette correction peut se révéler délicate pour les activités où la proportion des EI est élevée, par manque de données de référence concernant le salariat. Par ailleurs, elle suppose que, dans le champ des EI, on retrouve les mêmes variations du partage de la valeur ajoutée que celles constatées dans les entreprises. Par exemple, on fait comme si, lors des chocs pétroliers, les indépendants s'étaient attribués à eux-mêmes des salaires plus dynamiques que leur revenu mixte d'exploitation. Dans ces conditions, il est assez probable que la part effective des salaires dans la valeur ajoutée a connu, au niveau des années 70, un pic un peu moins accusé que celui décrit habituellement.
Pour pallier ces difficultés, Krueger (2000) propose d'utiliser une troisième méthode avec une clé de répartition fixe qui, appliquée au revenu mixte des EI, donne la part salariale et celles du « taux de marge ».
Mais cette méthode présente un autre risque de biais si des changements structurels au sein du non-salariat modifient l'intensité capitalistique de ce secteur. Dans ce cas, il n'y a pas de raison de supposer que le revenu mixte se répartit entre capital et travail d'une manière parfaitement fixe au cours du temps.
Quelque soit la méthode choisie, la prise en compte de la salarisation réelle de l'économie (migration des EI vers le salariat et part des salaires dans le revenu mixte des indépendants) est nécessaire quand on entend mesurer la répartition de la valeur ajoutée totale entre salaires et profits, si l'on souhaite disposer de données homogènes dans le temps et d'un point de vue international.
Mais, ainsi que le conclut le rapport de M. Jean-Philippe Cotis : « au total, on peut dire qu'il n'y a pas de méthode indiscutable pour appréhender le partage des revenus des indépendants [...]. »
Cette conclusion est évidemment décevante car, même si les résultats obtenus selon la méthode sélectionnée sont de second ordre par rapport à l'impact de la correction réalisée pour tenir compte de la salarisation croissante de l'économie, le choix de la méthode influence les résultats , si bien qu'en fonction des choix statistiques il existe une incertitude de l'ordre de quelques points de valeur ajoutée sur le niveau et l'évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée.
La méthode « désagrégée » atténue la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée que la méthode usuelle - la méthode uniforme - fait ressortir.
MÉTHODE USUELLE ET DÉSAGRÉGÉE
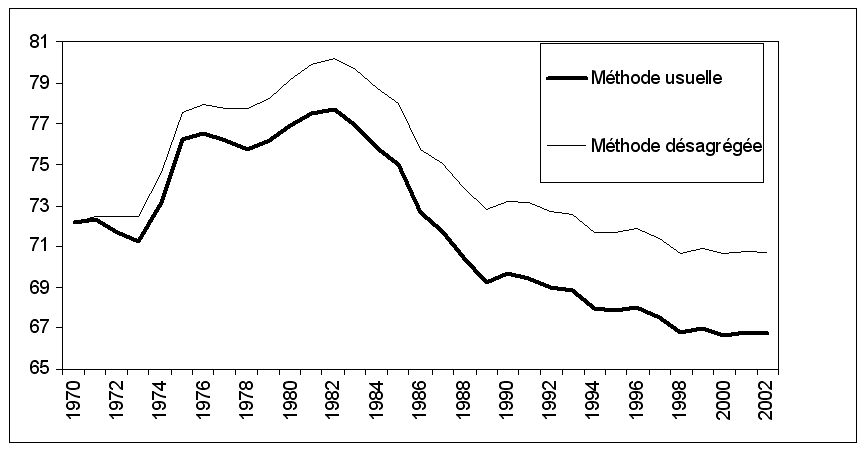
Source : 11 ème colloque de l'Association de comptabilité nationale. Janvier 2006. Nicolas Canry.
ÉVALUATIONS DU PARTAGE DE LA VALEUR
AJOUTÉE
POUR L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE
SANS ET AVEC
CORRECTIONS DU TAUX DE SALARISATION
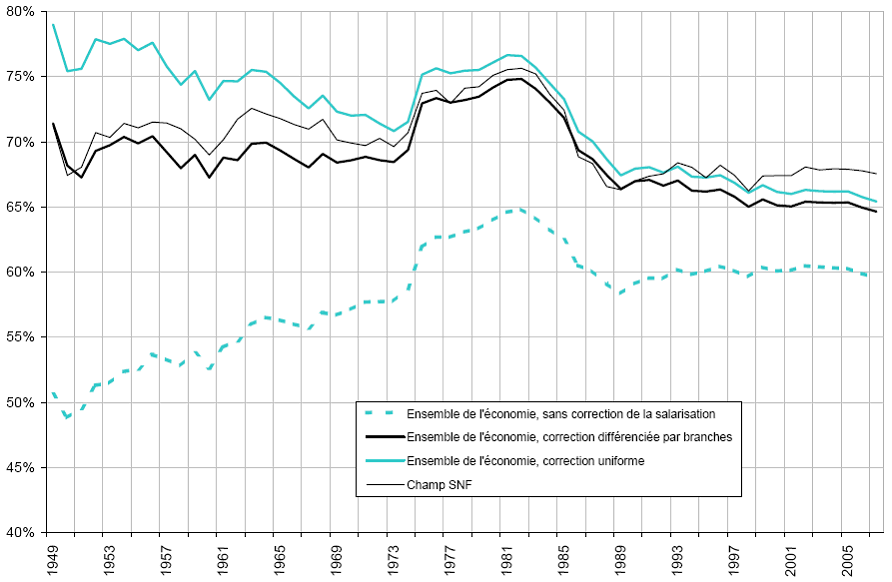
Note : valeur ajoutée au coût des facteurs
Source : Rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », par M. Jean-Philippe COTIS. INSEE.
La perception de la part des salaires dans la valeur ajoutée dépend donc largement d'opérations statistiques nécessaires mais qui reposent sur des fondements fragiles.
La convention selon laquelle l'ensemble des revenus créés par les indépendants est exclu des salaires conduit à observer une part des salaires dans la valeur ajoutée nationale sensiblement inférieure au niveau qu'elle atteint lorsqu'on assimile certains de ces revenus à des salaires, assimilation qui rapproche de la réalité. C'est en début de période que l'écart est le plus important puisqu'il est compris entre 20 et 30 points de valeur ajoutée selon la convention appliquée pour valoriser les salaires des indépendants. Par la suite, il ne cesse de se réduire. En fin de période, il n'est plus que de 10 points de valeur ajoutée.
Cette évolution résulte de la salarisation de la main d'oeuvre utilisée pour créer de la valeur ajoutée, autrement dit de l'enrichissement de la valeur ajoutée en salaires dont la courbe en pointillés témoigne. Celle-ci est, en effet, tributaire de la salarisation croissante de l'économie. Mais, elle correspond aussi à la déformation du partage de la valeur ajoutée en dehors de cet effet, déformation dont les courbes en plein traduisent les évolutions.
Entre 1949 et le début des années 70 l'impact de la salarisation est très fort. Hors cet effet, le partage de la valeur ajoutée n'évolue que peu quand on neutralise la salarisation sauf quand on pose l'hypothèse que les entrepreneurs individuels disposaient de revenus salariaux du même ordre de grandeur que les salariés, ce qui ne paraît pas vraisemblable.
Au-delà, la salarisation exerce apparemment moins d'effets sur le partage de la valeur ajoutée qui semble obéir presque totalement à d'autres variables. Cependant, à partir du milieu des années 80, la salarisation soutient un peu la part des salaires dans la valeur ajoutée que les autres facteurs tendent à infléchir.
Au-delà de ces incertitudes statistiques, la correction pour salarisation présente, à côté de fortes justifications, quelques inconvénients de méthode .
L'inclusion de la composante salariale du revenu mixte des entrepreneurs individuels dans les salaires pour apprécier la part des salaires dans la valeur ajoutée permet de mieux apprécier la contribution du « capital humain » sous forme de travail à la création de richesses dans l'économie . Elle permet de dépasser l'effet de frontière juridique que représente le lien salarial, le statut.
Toutefois, elle conduit à amalgamer deux rémunérations qui sont institutionnellement différentes , n'étant pas soumises aux mêmes régimes juridiques, fiscaux et sociaux notamment et qui, en outre, ont des propriétés économiques différenciées, en lien avec leurs particularités institutionnelles mais aussi avec des caractéristiques économiques plus structurelles.
En premier lieu, il apparaît que, sur longue période, la « part salariale » dans le revenu mixte des EI connaît de très fortes fluctuations.
PART SALARIALE DANS LE REVENU MIXTE DES EI
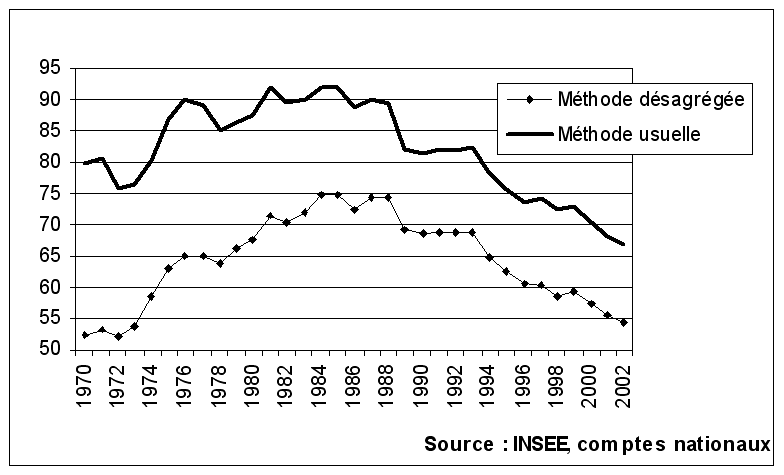
Source : 11 ème colloque de l'Association de comptabilité nationale. Janvier 2006. Nicolas Canry.
En outre, on observe que les salaires et les revenus salariaux des EI connaissent des dynamiques distinctes.
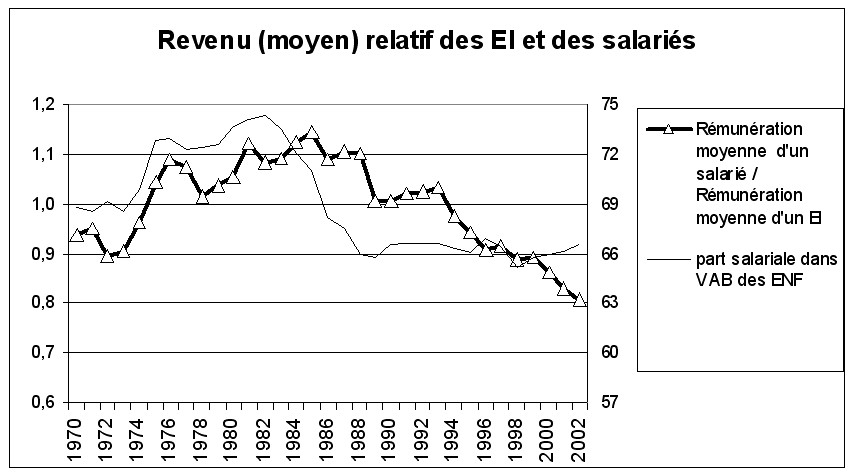
Source : 11 ème colloque de l'Association de comptabilité nationale. Janvier 2006. Nicolas Canry.
Enfin, et surtout, le départ entre rémunérations du travail et rétribution des capitaux intangibles qui prennent une place importante dans l'activité des indépendants pose un problème si aigu que toute certitude est presque exclue quant au niveau relatif des salaires des indépendants.
Ainsi outre que l'agrégation des deux formes de rémunération salariale - que représentent le salaire des vrais salariés et la « part salariale » du revenu des indépendants - conduit à perdre de l'information sur les évolutions concernant la part des richesses créées par chacune des catégories envisagées revenant aux salaires, elle repose sur des incertitudes telles que le suivi du partage de la valeur ajoutée apparaît nécessairement entaché d'une marge d'incertitude de quelques points de valeur ajoutée.
* 373 Dans certains pays - le Royaume-Uni notamment - un processus inverse de désalarisation s'est produit avec le passage au statut d'entrepreneurs individuels d'un grand nombre de salariés. Si on devait ignorer la part du revenu mixte de ces entrepreneurs individuels correspondant à des salaires, on serait conduit à en déduire qu'une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée s'est produite. Cette conclusion qui conduirait à faire ressortir une hausse correspondante du taux de marge serait également un peu excessive.







