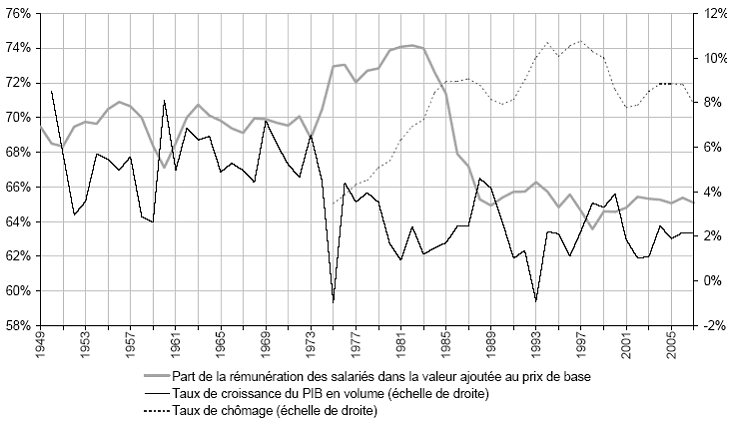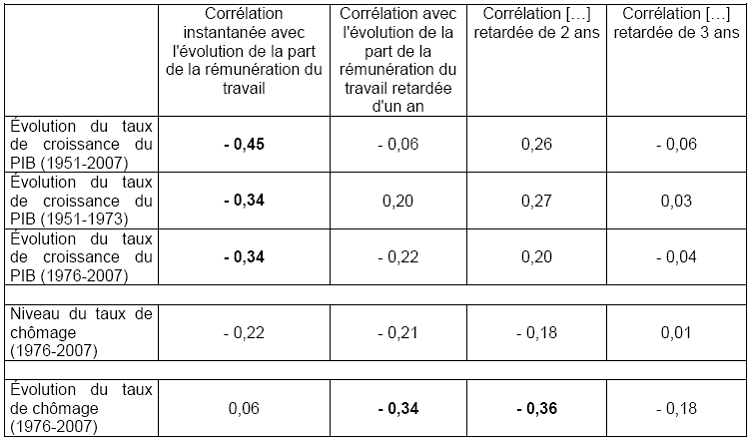ANNEXE N° 2 : POURQUOI LA BAISSE DE LA PART SALARIALE DANS LA VALEUR AJOUTÉE ?
La baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée conduit à examiner les facteurs qui ont pu jouer en ce sens.
Pour cela, il faut élargir l'examen souvent mené sur la base des seules théories du marché du travail à l'aide d'analyses plus structurelles portant sur les conditions de la croissance.
Souvent conduites sous le seul angle technique de la combinaison des facteurs de production, les analyses doivent être diversifiées pour tenir compte des effets de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie avec une particulière attention aux conditions du conflit de répartition.
Alors que les approches classiques conduisent à prévoir une stabilité de la part des salaires dans la valeur ajoutée à partir de déterminants reposant sur le fonctionnement des marchés des facteurs de production, les constats empiriques, qui ne confirment pas cette prévision, ont conduit à diversifier les explications données à la trajectoire de la répartition de la valeur ajoutée.
Il s'est agi de sauver l'hypothèse de rationalité des comportements des agents en réconciliant les déséquilibres observés avec ceux auxquels auraient abouti des comportements totalement rationnels.
Cette entreprise a consisté à justifier le partage de la valeur ajoutée en considérant qu'il résultait bien toujours d'un programme de minimisation des coûts quitte à faire intervenir des ruptures exogènes (le progrès technique biaisé) ou des conceptions renouvelées des coûts (les coûts de transaction, les coûts anticipés...).
Pourtant, cette dernière entreprise qui témoigne d'une complexification d'un modèle dont la simplicité initiale est tenue en échec par les observations empiriques ne suffit pas.
Il paraît nécessaire de compléter ces approches par des considérations plus structurelles.
1. La théorie classique prévoit une stabilité du partage de la valeur ajoutée
On est amené à penser, malgré son élégance formelle, que l'analyse théorique classique du partage de la valeur ajoutée, qui passe par la théorie des marchés des facteurs de production, et de leur rémunération, dans un cadre de concurrence pure et parfaite, ne décrit pas les faits observés, même quand les conditions de la théorie sont réunies .
Dans le modèle classique pur, les prix relatifs des facteurs n'influencent pas durablement le partage de la valeur ajoutée et se trouve ainsi prédite une stabilité de la répartition de la valeur ajoutée. Or, c'est le contraire qu'on a pu observer et il est peu probable que cela ne soit dû qu'à un état imparfait accidentel des marchés.
|
LES DÉTERMINANTS THÉORIQUES DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE La théorie classique admet qu'il puisse y avoir une instabilité du partage de la valeur ajoutée transitoire due au cycle de productivité. Mais, ce déséquilibre doit se résorber. Pour qu'il persiste, il faut que le taux de chômage structurel augmente du fait des déséquilibres de court terme. Alors les effets d'hystérèse peuvent provoquer une baisse durable de la part des salaires dans la valeur ajoutée . A. Le cycle de productivité A court terme , la conjoncture peut exercer des effets sur le partage de la valeur ajoutée . Les effets ici décrits sont cependant considérés comme transitoires. En cas de récession ou de reprise conjoncturelle de l'activité, l'emploi s'adapte avec retard au cycle de la production. Dans un premier temps, le taux de croissance du PIB et la part des rémunérations dans la valeur ajoutée évoluent en sens contraire, processus qu'on appelle « cycle de productivité » ( cf . graphique et tableau suivants). Toutefois, au cours des quelques trimestres qui suivent, en théorie, l'emploi s'adapte à la conjoncture et l'effet initialement observé sur le partage de la valeur ajoutée disparaît. Par exemple, en phase d'accélération de la croissance, après avoir diminué, la part des salaires dans la valeur ajoutée rejoint progressivement son niveau initial car les salaires se calent sur la productivité. B. Les effets d'hystérèse Cependant, les fluctuations de l'emploi à court terme peuvent influencer plus durablement le partage de la valeur ajoutée. Une conjoncture durablement déprimée , qui provoque transitoirement une hausse la part des salaires dans la valeur ajoutée jusqu'à ajustement de l'emploi, peut entraîner une hausse durable du taux de chômage et peser structurellement, par ce biais, sur la formation des salaires , ce qui vient abaisser structurellement la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée. Cet argument est souvent invoqué pour expliquer que le partage de la valeur ajoutée dans les années 1990 ait été plus défavorable aux salariés que celui qui prévalait avant le premier choc pétrolier ( cf. Malinvaud 1998 qui retient cette explication comme « la plus convaincante ») . C. Comment appréhender ces effets ? Le cycle de productivité et l'incidence des effets d'hystérèse produisent sur la part des salaires dans la valeur ajoutée des effets plus ou moins durables et puissants. |
|
INFLUENCE DE LA CONJONCTURE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Mais, le niveau de cette corrélation est très influencé par le premier choc pétrolier puisque, hors de cette phase, le coefficient de corrélation baisse. Les résultats présentés dans le tableau suivant font apparaître que la corrélation entre la part des salaires dans la valeur ajoutée et l'évolution du taux de croissance du PIB est forte. A très court terme, instantanément, la baisse de la croissance entraîne une hausse de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée. Cette corrélation s'élève à - 0,45 sur l'ensemble de la période (1951-2007) ; à - 0,34 sur les sous-périodes antérieures (1951-1973) et postérieures (1976-2007) au premier choc pétrolier. Toutefois, au bout de trois ans, un ajustement intervient. S'agissant du chômage , la corrélation avec l'évolution de la part salariale apparaît plus significative quand on appréhende le chômage en variation plutôt qu'en niveau (ce qui implique que l'augmentation ou la diminution du taux de chômage comptent plus que son niveau). Elle est relativement persistante même si elle ressort comme maximale après une ou deux années.
CORRÉLATION EMPIRIQUE ENTRE L'ÉVOLUTION
DU PARTAGE
Ces estimations montrent d'abord que le partage de la valeur ajoutée peut ne pas être stable quand interviennent des changements dans le rythme de croissance et dans le niveau du chômage. Mais, elles indiquent aussi que la répartition de la valeur ajoutée s'ajuste assez rapidement aux évolutions conjoncturelles. Toutefois, cet ajustement est contrarié par les évolutions du taux de chômage ce qui laisse supposer que des effets permanents sont attribuables à cette dernière variable. Ces effets d'hystérèse seraient toutefois modérés et moins liés au niveau atteint par le chômage qu'à ses variations 374 ( * ) . Autrement dit, les estimations ici commentées tendent à accréditer l'idée que le partage de la valeur ajoutée retrouve, après quelques délais, un point d'équilibre qui peut toutefois être (modérément) perturbé par la variation du taux de chômage. A supposer que ces estimations soient exactes, elles invitent à considérer que la variation du taux de chômage peut être une variable susceptible de déplacer le curseur du partage de la valeur ajoutée. En revanche, elles ne disent rien sur les voies et moyens de résorber le chômage. |
L'analyse classique pure passe par les effets attribués à la rémunération des facteurs.
Sans doute, en théorie, la variation de la rémunération relative des facteurs de production pourrait influencer le partage de la valeur ajoutée .
Mais, les présupposés de la théorie économique classique ont conduit les économistes, qui utilisent généralement une fonction de production particulière, dite de type Cobb-Douglas, pour modéliser la croissance économique à long terme, à écarter cet effet.
Cette fonction de production, qui correspond à l'idée que les facteurs de production sont combinés optimalement à raison de leur prix et de leur productivité marginale, est caractérisée par une élasticité de substitution unitaire entre le capital et le travail. Cette hypothèse implique que le partage de la valeur ajoutée reste inchangé lorsque le prix d'un facteur de production augmente, du fait de mécanismes économiques qui jouent en sens contraire.
Soit, en effet, une hausse du coût du travail, il se produit :
- dans un sens, un effet direct et immédiat (l'augmentation des salaires) qui tend à accroître la masse salariale ;
- en sens contraire, un effet de substitution du capital au travail (à niveau de production donné) défavorable à l'emploi et donc à la masse salariale.
En somme, interviendraient dans le fonctionnement de l'économie des mécanismes typiquement « classiques » de variation du volume des facteurs de production en fonction de leurs prix. Quand le prix d'un facteur augmente, sa quantité diminue, laissant inchangée la répartition des revenus entre les facteurs de production mais pas nécessairement la dynamique de la croissance puisqu'alors les facteurs de production ne sont pas employés à leur niveau maximum ni à leur coût minimum.
* 374 Tout se passe comme si le niveau du chômage, qu'il atteigne 5 % ou 15 % de la population active, n'avait pas d'incidence sur le partage de la valeur ajoutée, résultat quelque peu étonnant qui vient contredire le lien souvent établi entre le niveau de l'inflation et le niveau du taux de chômage (courbe de Philips).