b) Des salaires et un niveau de protection sociale relativement élevés en France
• La France se caractérise par un niveau élevé des salaires et de la protection sociale, celle-ci étant financée pour l'essentiel par des contributions des entreprises et des salariés (voir graphique ci-après). Le Conseil économique et social observait en 2007 que « le financement de la protection sociale est constitué de ressources encore très largement assises sur les salaires, ce qui ne paraît plus totalement justifié, du fait de l'universalité accrue des prestations maladie et famille notamment, et du « coin social » que ces cotisations constituent par rapport aux plus proches voisins européens » 195 ( * ) .
Évolution de la part des principaux financeurs du régime général
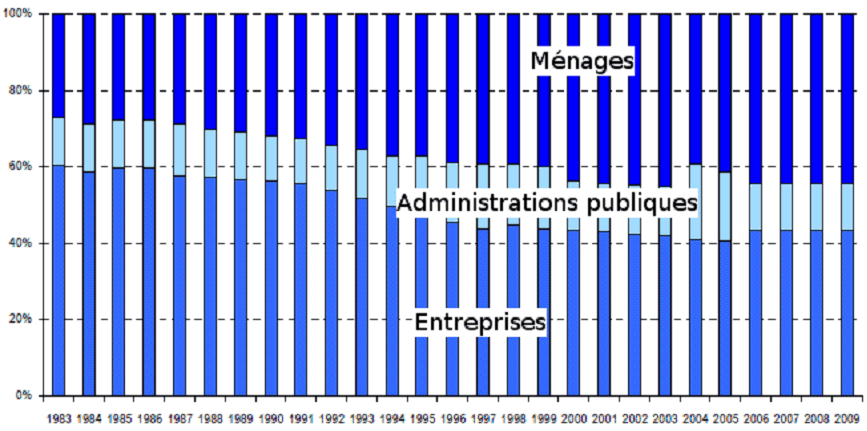
Source : ACOSS, annexe 1 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011
Plus que dans d'autres pays européens, le coût de la protection sociale en France pèse sur les entreprises : les cotisations sociales à charge des employeurs représentaient 43,8 % des recettes de protection sociale en 2008 contre seulement 34,9 % en Allemagne et 32,5 % au Royaume-Uni 196 ( * ) .
|
Nombre d'entrepreneurs ou d'économistes auditionnés ou rencontrés par la mission ont évoqué la question des charges sociales. À titre d'exemple, M. Hervé Pichon (PSA) a estimé que l'écart de charges entre la France et l'Allemagne équivaut à un surcoût de fabrication de l'ordre de 400 euros par véhicule, cet écart ayant tendance à s'accroître. M. Daniel Segond (RAGT, industrie agroalimentaire), rencontré à Toulouse, a considéré pour sa part que la différence de charges sociales entre la France et les pays voisins coûtait deux points de rentabilité. Certains industriels, comme M. Franck Riboud (Danone) ou M. Reinold Geiger (L'Occitane en Provence), ont en revanche relativisé le poids des charges dans leur activité. |
En 2010, le coût du travail moyen en France était de trois à cinq fois plus élevé qu'en Chine ou en Inde. Il existe également des différences importantes au sein de l'Union européenne : à la fin de 2009, le coût de la main d'oeuvre roumaine ou bulgare était dix fois moins élevé qu'en France, celui de la Pologne et de la Slovaquie cinq fois moins élevé et celui du Portugal ou de la Grèce respectivement trois et deux fois moins élevé que celui de la France.
Le coût horaire moyen de la main d'oeuvre dans l'industrie manufacturière de la zone euro est moindre que celui de la France et de l'Allemagne sur l'ensemble de la période.
• Toutefois, l'évolution du coût horaire moyen de la main-d'oeuvre en France est semblable à celui des autres pays de la zone euro. Seul le Royaume-Uni connaît une augmentation plus rapide que les autres pays et, dans une moindre mesure, les Pays-Bas et le Danemark. L'Italie bénéficie d'une légère inflexion à partir de 2006 et se démarque de l'évolution française.
S'agissant de l'Allemagne, on a vu précédemment (voir supra , « Un contre-exemple allemand qui se fonde sur des structures économiques différentes ») que, au-delà des chiffres en valeur absolue, ce pays a suivi une politique de modération salariale qui a réduit considérablement l'écart du coût horaire du travail avec la France. Le graphique ci-dessous montre que l'Allemagne se démarque très nettement, non seulement de la France, mais de l'ensemble de la zone euro, avec une pente d'évolution très inférieure à celle des autres pays.
Évolution du coût horaire moyen de la
main-d'oeuvre en Europe 2000-2008
197
(
*
)
(base 100 en 2000)
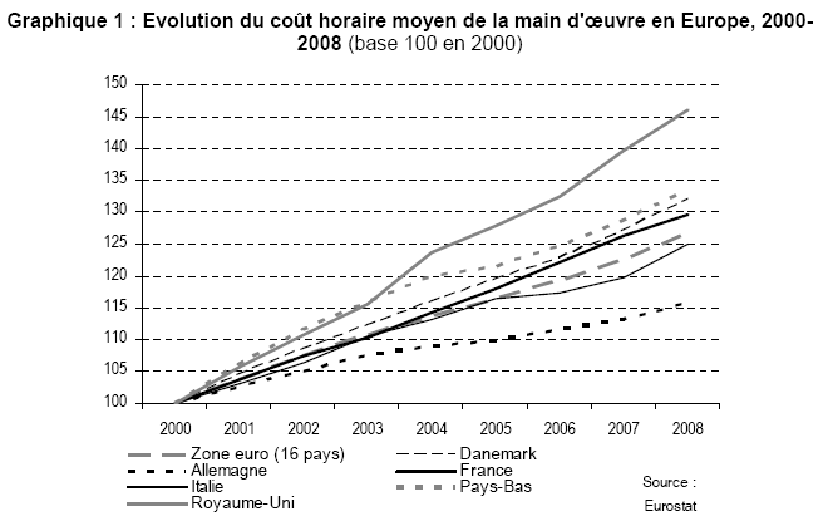
* 195 Conseil économique et social, Le financement de la protection sociale , avis présenté par Mme Anne Duthilleul, 2007.
* 196 Source ; Eurostat, Recettes de protection sociale par type, Cotisations sociales à charge des employeurs, 2008.
* 197 Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, La Documentation française, juin 2010, p. 93.







