2. Préserver l'atout français sur le coût de l'électricité
a) Le coût de l'électricité : un enjeu décisif pour l'ensemble de l'industrie
Pour certaines entreprises fortes consommatrices d'énergie, l'évolution du coût de l'électricité constitue une donnée fondamentale pour leur développement, voire pour leur survie. C'est le cas :
- pour les industries électro-intensives qui se caractérisent par une structure de coûts de production, marquée par l'importance du coût de l'électricité ;
- mais aussi pour d'autres industries, notamment chimiques et automobiles, qui ont fait valoir auprès de la mission l'atout que représente le coût de l'électricité relativement modéré dont bénéficie la France.
Part moyenne du coût électrique dans
le prix de vente
selon le type de produits (moyenne
2000-2007)
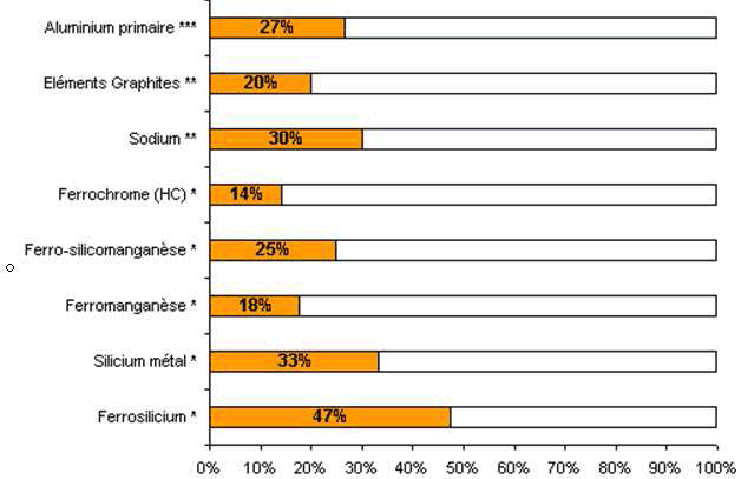
Source : Fédération nationale des industries électro-métallurgiques, électrochimiques et connexes
C'est la raison pour laquelle ces industries ont organisé leur système de production de telle sorte que le coût de l'électricité soit à la fois minime et prévisible sur le moyen et long terme . Tel était le cas jusqu'à présent, ces entreprises bénéficiant de conditions tarifaires très avantageuses accordées par l'opérateur national, Électricité de France (EDF), en contrepartie de certaines contraintes et engagements.
|
Les industries électro-intensives Les industries électro-intensives regroupent plusieurs branches de la métallurgie et de la chimie utilisant l'électricité comme apport énergétique dans les procédés d'élaboration ou de transformation des minerais, métaux et alliages, tels que l'aluminium (Rio Tinto Alcan), le silicium (Ferropem), le sodium, les ferroalliages ou encore certains éléments carbone et graphites tels que les électrodes. Les produits issus de ces activités sont utilisés par les secteurs traditionnels de l'industrie tels que la sidérurgie, la fonderie ou la chimie, mais aussi dans les filières industrielles d'avenir telles que le photovoltaïque. Cette industrie contribue directement à l'indépendance économique et stratégique sur le plan national et européen. Son maintien et son développement concourent à l'aménagement du territoire et au développement équilibré des régions. Elle représente 5 000 emplois directs, 25 000 emplois indirects et 4 milliards d'euros de chiffres d'affaires et contribue positivement à la balance commerciale française pour 3 milliards d'euros par an. Ces entreprises évoluent dans un contexte international très concurrentiel avec une capacité limitée de répercussion des surcoûts en aval sans perte de parts de marché. |
Au début du siècle dernier, ces usines ont fait le choix de s'implanter dans les vallées montagneuses, à proximité des centrales hydro-électriques naissantes, bien qu'elles soient éloignées de leurs fournisseurs de matières premières et de leurs débouchés commerciaux. Le coût des acheminements, qui constituait alors un handicap logistique majeur, était en réalité largement compensé par l'avantage retiré de l'accès direct à l'énergie hydro-électrique locale.
Ce compromis est toujours valable aujourd'hui, puisque des entreprises comme Ferropem ou Rio Tinto Alcan bénéficient encore de conditions très compétitives d'approvisionnement auprès d'EDF, qui résultent des dispositions de la loi du 8 avril 1946 de nationalisation et, historiquement, de leur implication financière dans le développement de l'énergie hydraulique. En effet, en 1946, la nationalisation des moyens de production électrique a été compensée pour ces industries par le maintien de l'usufruit de la production des centrales hydrauliques. Plus tard, la filière ayant également soutenu l'essor du secteur nucléaire, ces conditions spécifiques ont fait l'objet d'accords successifs avec EDF en fonction des évolutions de la législation. À titre d'exemple, grâce à la conclusion d'un contrat d'achat signé avec l'opérateur national au début des années 80, l'un des grands groupes électro-intensifs implantés en France a obtenu, en contrepartie d'investissements dans le développement du parc nucléaire, la garantie d'un coût moyen équivalent à environ 30 euros par mégawatt-heure (MWh), valable jusqu'au 31 décembre 2013.
b) Les conséquences de l'ouverture du marché de l'électricité pour la compétitivité des industries
Avec le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité engagé en 1996 par l'Union européenne 207 ( * ) et la transposition progressive des dispositions correspondantes en droit interne 208 ( * ) , les industries électro-intensives ont été contraintes de s'organiser pour sécuriser leurs approvisionnements et leurs tarifs.
• En effet, contrairement à ce que l'on aurait pu en attendre, la libéralisation du marché de l'électricité s'est traduite en France par une augmentation des tarifs. C'est pourquoi, après la hausse des prix consécutive à l'ouverture du marché aux clients professionnels au 1 er juillet 2004, il a été prévu que ces derniers puissent bénéficier jusqu'au 31 décembre 2010 d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement au marché (TaRTAM) 209 ( * ) .
Pour une consommation constante « en ruban », le TaRTAM s'élevait, en 2010, à 42 euros par Mwh, soit un niveau nettement inférieur au prix moyen du marché (56 euros), mais supérieur d'environ 20 % à celui de l'électricité française d'origine nucléaire (31 euros par Mwh).
En réalité, du fait de l'importance de la part d'électricité d'origine hydraulique et nucléaire, les coûts de production en France se trouvent être particulièrement compétitifs par rapport à ceux des autres États membres, encore fortement dépendants de centrales au charbon ou au gaz, beaucoup moins efficientes : ainsi, le prix de l'électricité en France est inférieur de 27 % à la moyenne européenne pour les ménages et de 33 % pour les autres consommateurs.
En 2006 et 2007, le TaRTAM a fait l'objet de deux procédures contentieuses de la part de la Commission européenne, au motif qu'il aurait pu constituer une forme de subvention déguisée aux entreprises éligibles et un obstacle à l'ouverture du marché électrique.
• Afin d'échapper à toute condamnation mais aussi de permettre aux consommateurs français de continuer à bénéficier de la modicité du coût de l'électricité nucléaire, le Gouvernement s'est engagé à régulariser la situation de la France au regard des directives européennes en faisant adopter par le Parlement la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite loi NOME 210 ( * ) .
Ce texte prévoit la mise en place jusqu'en 2025 d'un système temporaire d'accès régulé à l'électricité de base rebaptisé « accès régulé à l'électricité nucléaire historique » (ARENH), qui consiste à permettre à tout fournisseur alimentant des consommateur sur le territoire national d'obtenir, dans la limite d'un plafond global de 130 TWh (soit un quart de la production d'électricité d'origine nucléaire d'EDF), une certaine quantité d'électricité à un prix régulé reflétant la totalité des coûts de production du parc nucléaire (exploitation, maintenance, prolongement de la durée de vie, démantèlement des centrales, gestion des déchets radioactifs, etc.).
Quel que soit le prix fixé pour l'ARENH, les prix de l'électricité seront inéluctablement amenés à augmenter dès 2016. Dans cette perspective, les industries électro-intensives ne pourront pas trouver de solutions adaptées à leurs contraintes en termes de compétitivité et de visibilité tarifaire dans le cadre de la tarification ARENH, les quantités allouées aux fournisseurs et les tarifs correspondants étant fixés annuellement.
Les solutions alternatives résident donc dans la conclusion de contrats de fourniture de moyen ou long terme avec les producteurs d'électricité permettant aux industriels d'obtenir des droits de tirage sur la production d'électricité en contrepartie d'investissements en faveur du développement du parc nucléaire ou hydraulique, ce que permet la nouvelle loi NOME.
c) Les pistes envisageables pour limiter la hausse des prix de l'électricité pour les industries électro-intensives
(1) La tarification contractuelle obtenue par le consortium Exeltium ne suffit pas à lever toutes les hypothèques qui pèsent sur le secteur
Dès 2006, plusieurs grands groupes industriels se sont organisés en consortium pour obtenir une tarification préférentielle de l'électricité sur longue période en contrepartie d'investissements lourds en faveur du développement de la capacité du parc de production nucléaire.
Depuis le 1 er mai 2010, les vingt-six groupes membres d'Exeltium bénéficient d'un approvisionnement d'électricité au tarif négocié de 42 euros par kWh, valable pour les vingt-quatre prochaines années (voir encadré ci-après) .
Bien que relativement élevé par rapport au prix actuel dont bénéficient certaines industries électro-intensives au titre de l'accord qu'elles ont conclu avec EDF et qui court jusqu'à la fin de 2013, ce prix est inférieur à celui du marché et présente l'avantage d'être garanti sur une longue période. Au vu de l'ampleur des investissements nécessaires pour assurer le développement de ces filières, cette visibilité et cette garantie constituent un atout concurrentiel et stratégique déterminant.
|
Le projet Exeltium Fondé par six grands industriels très gros consommateurs d'électricité (Air Liquide, Arcelor Mittal, Arkema, Rio Tinto Alcan, Rhodia et Solvay), le consortium Exeltium a été constitué en mai 2006 pour négocier des prix d'électricité plus bas avec les producteurs d'énergie. Le contrat initial prévoyait la fourniture de 13 térawattheures (Twh) par an pendant vingt-quatre ans, en contrepartie du financement direct de tranches nucléaires, grâce à un prêt bancaire de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros. L'apport financier versé à EDF doit permettre au consortium d'acquérir des droits sur une partie de la production électronucléaire de l'opérateur historique avec l'engagement d'acheter une quantité déterminée d'électricité dans les 24 prochaines années. Au final, le contrat de partenariat signé avec EDF a permis aux vingt-six groupes électro-intensifs membres du consortium d'obtenir un volume total de 312 Twh pour un tarif de 42 euros le MWh, sur 24 ans, dont la livraison a débuté au 1 er mai 2010. Ce tarif est supérieur d'environ 5 euros au tarif vert qui leur est accordé actuellement par EDF et qui prévaut jusqu'au 31 décembre 2015. |
Malheureusement, la solution offerte par Exeltium ne résout pas toutes les difficultés du secteur :
- d'abord, les volumes concernés sont loin de couvrir l'intégralité des besoins des adhérents du consortium ;
- ensuite, le tarif négocié avec EDF n'est pas suffisamment compétitif au regard de ceux qui prévalent dans d'autres pays ou régions du monde ;
- enfin, le niveau des participations financières exigées est très élevé, ce qui entraîne une sélection à l'entrée du dispositif relativement discriminante, en particulier pour les plus petits groupes.
(2) La nécessité d'autoriser les industriels à négocier des tarifs contractuels aménagés compatibles avec les exigences européennes
Au vu des enjeux que représente l'évolution du coût de l'électricité pour ces filières, plusieurs pistes sont à l'étude afin d'atténuer les effets de la mise en oeuvre de la loi NOME. L'objectif est d'identifier des leviers permettant de prévoir un aménagement des tarifs de l'électricité qui soit compatible avec les exigences européennes liées à l'ouverture du marché .
Il s'agit en réalité de valoriser le rôle spécifique que pourraient jouer les consommateurs électro-intensifs ou les grands groupes industriels pour réguler la distribution d'électricité sur un réseau dont la capacité est limitée et tend à arriver à saturation.
Les industries électro-intensives se caractérisent, en effet, par un profil de consommation atypique, qui allie :
- une consommation de base en ruban avec un facteur de charge très élevé de l'ordre de 1 100 Mw (soit l'équivalent de trois à cinq centrales thermiques, proche d'une tranche nucléaire) ;
- une capacité à « saisonnaliser » la consommation sur de longues périodes programmables ;
- une capacité d'effacement total en période de pointe sous préavis très court ;
- la possibilité d'interrompre totalement sans délai leur consommation en cas de crise, ce que l'on appelle l'interruptibilité ;
- une localisation proche des bases de production électrique, ce qui réduit potentiellement les coûts de transport et les pertes en ligne sur des gros débits (avantages de la « ligne directe ») ;
- enfin, de faibles exigences sur la qualité de la fourniture énergétique.
Si elles étaient valorisées et se traduisaient par des avantages tarifaires, ces caractéristiques pourraient permettre d'optimiser la distribution d'électricité grâce à une charge stable sur le réseau.
La loi NOME prévoit la prise en compte de l'effacement et de l'interruptibilité . Mais à l'heure actuelle, la contrepartie tarifaire qui pourrait en résulter n'est pas chiffrée. Cette souplesse de fonctionnement doit bénéficier d'une valorisation maximale pour atténuer les effets de l'augmentation des tarifs sur la facture énergétique des industriels.
À l'inverse, aucune disposition n'a prévu la prise en compte de la situation des sites industriels, le plus souvent implantés à proximité des centrales de production, ce qui réduit les coûts d'utilisation des réseaux et les pertes en ligne (évaluées en moyenne entre 6 % et 8 %). L'application d'une tarification de « ligne directe » , comme l'a prévu l'Allemagne 211 ( * ) , permettrait de résoudre cette anomalie tarifaire et de placer notre industrie sur un pied d'égalité avec ses concurrentes allemande, italienne, chinoise, canadienne, norvégienne ou américaine.
|
La mission suggère de favoriser la prise en compte de l'effacement, de l'interruptibilité et de la proximité de l'approvisionnement en électricité qu'offrent les industries électro-intensives et de prévoir en conséquence des aménagements tarifaires compatibles avec les exigences européennes , qui minorent le prix de l'électricité qui leur est distribué et contribuent ainsi à préserver l'avantage compétitif acquis par la France dans ce domaine grâce au développement de son parc nucléaire. |
* 207 Directive 1996/92/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 ; directives 2009/72/CE et 2009/73/CE.
* 208 Loi du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité ; loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et aux industries électriques et gazières ; loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
* 209 Loi du 7 décembre 2006 précitée.
* 210 Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
* 211 Loi du 7 juillet 2005 et ordonnance fédérale BGB1.I.S.2225 du 25 juillet 2005 relative aux tarifs d'acheminement sur les réseaux.







