2. Une charge budgétaire dont le caractère excessif n'est plus évident, compte tenu d'une prospérité relative améliorée
a) Une prospérité relative considérablement améliorée
Pour plaider le caractère excessif de la charge budgétaire supportée par leur pays, les gouvernements britanniques successifs allaient invoquer non seulement la nature structurelle du déséquilibre existant entre les contributions du Royaume-Uni et les retours qu'il pouvait en attendre, mais aussi la situation défavorable de son économie (cf. I et II.A.)
M. Wilson faisait valoir, tout d'abord, qu'une contribution nette disproportionnée par rapport au poids du Royaume-Uni dans le PIB communautaire risquait d'accentuer les difficultés de l'économie et de la monnaie britannique.
Mme Thatcher, elle aussi, allait arguer, ensuite, de ce que son pays était, à l'époque, l'un des moins riches de la CEE avec le septième PIB par habitant (sur dix États membres).
Mais comme cela avait alors déjà été observé 61 ( * ) , il n'était pas certain que cette infériorité du niveau et des performances de l'économie britannique soit durable.
De fait, cette dernière est devenue, avant la crise, l'une des plus fortes de l'Union européenne, au terme d'un redressement particulièrement brillant marqué par :
- une « tertiarisation » accentuée, avec l'essor des services financiers de la City,
- une reconversion de l'industrie, dont l'importance a globalement diminué, vers des activités technologiquement avancées (notamment les biotechnologies).
Cette amélioration a été facilitée par l'avantage 62 ( * ) de la rente pétrolière et gazière de la mer du Nord.
Tous les indicateurs témoignent du rattrapage et de l'accession de la Grande-Bretagne au rang des premières puissances économiques européennes.
Durant les décennies 1980 et 1990, la croissance du Royaume-Uni a été supérieure à celle de la France et de l'Allemagne, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Taux de croissance annuel moyen (TCAM) en
%
|
1965/1973 |
1973/1980 |
1980/1990 |
1990/2000 |
1997/2007 |
|
|
France |
5,2 |
2,6 |
2,4 |
1,9 |
2,4 |
|
Allemagne |
4,1 |
2,1 |
2,4 |
1,9 |
1,6 |
|
Royaume-Uni |
3,2 |
0,9 |
2,7 |
2,1 |
2,9 |
Le graphique ci-après montre que les années qui sont suivi l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun (1973) et l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher (1979) ont été effectivement difficiles, de même que le début de la décennie 1990, lorsque John Major est devenu Premier ministre. Mais ensuite, de 1993 à 2007, pendant presque quinze ans, la croissance du PIB britannique par habitant a été continuellement très soutenue.
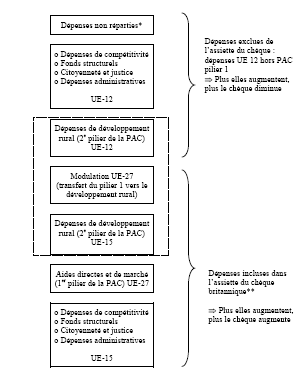
Ayant dépassé celui de la France, au début des années 2000, le PIB aux prix courants du Royaume-Uni lui est redevenu inférieur en 2008, selon Eurostat, en raison d'une dépréciation de la livre par rapport à l'euro et d'une moindre vulnérabilité à la crise de l'économie française. Cependant, par habitant et exprimé en standard de pouvoir d'achat, le PIB britannique reste supérieur au PIB français et au PIB allemand.
|
PIB aux prix courants
|
PIB par habitant
|
|||||
|
Royaume-Uni |
Allemagne |
France |
Royaume-Uni |
Allemagne |
France |
|
|
1998 |
1299,6 |
1952,1 |
1315,3 |
117,6 |
122,4 |
115,0 |
|
2003 |
1647,1 |
2136,8 |
1594,8 |
121,8 |
116,5 |
111,8 |
|
2008 |
1816,1 |
2495,8 |
1950,1 |
116,9 |
116,0 |
107,3 |
Source : Eurostat
Dans son classement des pays les plus riches du monde, la CIA 63 ( * ) fait figurer, pour sa part, le Royaume-Uni devant la France, en 2010, selon une mesure du PIB effectuée en dollars et en parité de pouvoir d'achat.
Ces comparaisons ne sont pas sans importance, s'agissant d'apprécier l'équité d'un mécanisme, dont la justification initiale fait appel à une moindre prospérité relative supposée du Royaume-Uni et qui s'apparente un peu à un troc - rabais contre PAC - entre la France et le Royaume-Uni, destiné à faire accepter celle-ci par ce dernier.
* 61 Cf. article précité du Monde de juillet 1974
* 62 Le Royaume-Uni est devenu autosuffisant en 1980, la production et les exportations atteignant un sommet en 1985. Comme l'a rappelé la revue Alternatives économiques (n° 291 - mai 2010), la disponibilité du pétrole et du gaz de la mer du Nord a représenté pour l'économie britannique un avantage annuel par rapport à l'économie française de l'ordre de 3 % du PIB durant la période 1980-2000.
* 63 Central Intelligence Agency (USA) - The World Fact Book - 2010
9e - Royaume-Uni : 2 189 000 M $ (PPA)
10 e - France : 2 160 000 M $







