c) La réduction des recettes perçues par l'Etat en lien avec l'impôt économique local
(1) La suppression de la CMTP et de la CNP
La cotisation minimale de taxe professionnelle et la cotisation nationale de péréquation étaient deux cotisations perçues par l'Etat en lien avec la taxe professionnelle. Elles affectaient la lisibilité de la relation entre les collectivités et les entreprises, puisqu'une partie de l'impôt économique local revenait à l'État.
La cotisation nationale de péréquation était particulièrement accusée de perturber le lien fiscal entre les collectivités et les contribuables. En effet, appliquée aux entreprises disposant d'établissements situés dans les communes où le taux global de TP était inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national, elle pénalisait les communes qui appliquaient des taux bas.
Comme le résumait notre collègue Gilles Carrez, alors rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, dans son rapport sur la loi de finances pour 2010, « [...] mérite d'être posée l'opportunité du maintien, en l'état, d'une cotisation nationale de péréquation qui ne finance plus, depuis 2003, la péréquation et qui fausse la réalité du lien fiscal, en maintenant, en outre, l'État au coeur de la fiscalité locale 41 ( * ) . »
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a proposé sa suppression à l'occasion de la première lecture du projet de loi de finances pour 2010 et l'intégration de l'équivalent de son produit dans les taux communaux et intercommunaux.
La suppression de la CMTP et de la CNP a ainsi considérablement renforcé la lisibilité de l'impôt économique local et le lien entre les collectivités et les entreprises puisque, désormais, la totalité de la CET revient aux collectivités locales, mis à part les frais de gestion perçus par l'État. Ces derniers ont, pour leur part, fait l'objet d'une révision.
(2) La réduction des frais de gestion perçus par l'État
La réforme a en effet été l'occasion de réduire les frais de gestion perçus par l'État au titre du recouvrement des impôts locaux. Ils ont diminué de 8 % à 3 % pour un certain nombre d'entre eux 42 ( * ) .
Les frais de gestion comprennent les frais de dégrèvement et de non-valeur, contrepartie des frais assumés par l'État liés aux dégrèvements et aux admissions en non-valeur, et les frais d'assiette et de recouvrement. S'ils sont fixés de manière forfaitaire et n'ont pas vocation à refléter avec exactitude les coûts engendrés par le recouvrement des impôts par l'État, il n'en reste pas moins qu'ils étaient auparavant fixés à un niveau très élevé, comme l'avaient relevé un certain nombre de parlementaires. L'État a profité de cette réforme pour corriger cette situation et rendre aux collectivités une partie de l'impôt qui leur revient .
Comme l'a évoqué Julien Dubertret devant la mission, en réponse à une observation de notre collègue Dominique de Legge, « ces frais d'assiette et de recouvrement ne constituent pas en eux-mêmes une mesure analytique du coût de l'impôt. C'est un préciput que l'État prend sur le recouvrement de ressources sur lesquelles, par ailleurs, il assure les collectivités contre des aléas de recouvrement. ...
Il est sûr que ces frais d'assiette et de recouvrement sont maintenant passés du côté des collectivités locales. Pour ce qui est de la taxe professionnelle ou de ce qui en tient lieu aujourd'hui, les choses sont rééquilibrées très fortement et positivement en faveur des collectivités territoriales, qui bénéficient désormais des frais d'assiette et de recouvrement et de l'avance régulière, à un niveau particulièrement important au cours de l'année, celle-ci étant faite sur un produit globalement estimé. Les collectivités territoriales sont enfin assurées de recevoir 100 % du produit voté.
Que dire d'autre ? Ces frais d'assiette et de recouvrement n'en étaient peut-être pas formellement. Ce n'est un secret pour personne et le sujet a été évoqué dans le cours des débats, ici comme à l'Assemblée nationale, à de nombreuses reprises pendant des années. Il existe un consensus pour dire qu'il s'agissait d'un état de fait, un impôt sur l'impôt. Les collectivités locales en bénéficient maintenant en matière de taxe professionnelle. Cela fait partie du grand équilibre entre l'État et les collectivités locales, en prenant en compte les contraintes globales de redressement des finances publiques que nous devons à nous-mêmes et à nos partenaires européens. »
Ce rééquilibrage n'a néanmoins pas concerné la totalité des impositions directes locales. Les frais de gestion perçus au titre des contributions et taxes suivantes sont ainsi demeurés inchangés :
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- la taxe de balayage ;
- les contributions et taxes recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales et EPCI ;
- les taxes pour frais des chambres consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambres de métiers et de l'artisanat).
Le tableau suivant synthétise les effets de la réforme sur les frais de gestion perçus par l'État.
Les frais de gestion avant et après la réforme de la taxe professionnelle
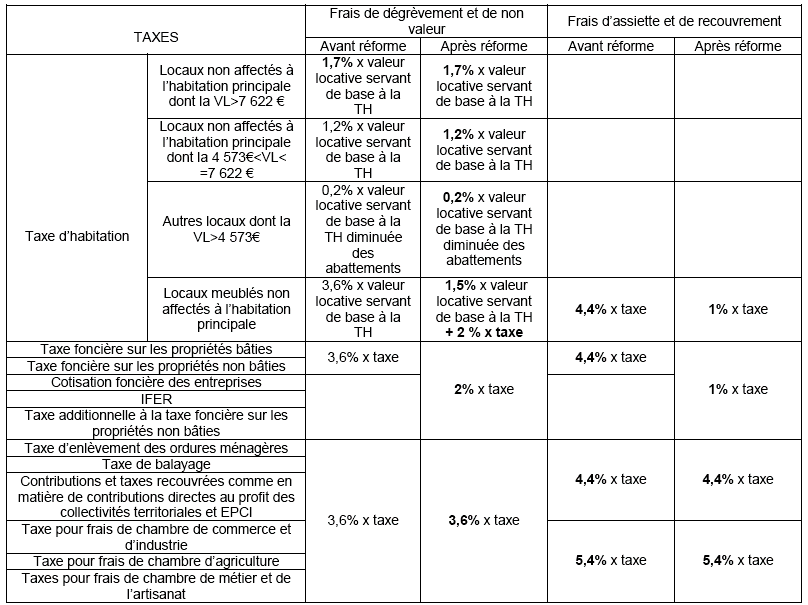
Source : Circulaire du ministère de l'intérieur n ° COT/B/11/07973/C « Informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2011 », p. 71
La réévaluation des frais de gestion n'a donc été que partielle. Aussi la mission préconise-t-elle la poursuite de l'effort de rapprochement des frais de gestion perçus par l'État des coûts effectivement supportés au titre du recouvrement des impôts locaux, tout en reconnaissant l'impossibilité d'une stricte correspondance entre les deux.
A cette fin, une réévaluation régulière de l'ensemble des frais de gestion perçus par l'État devrait avoir lieu, en concertation avec les collectivités.
|
Proposition n° 13 : Prévoir une réévaluation régulière et complète des frais de gestion perçus par l'État au titre du recouvrement des impositions directes locales |
De façon générale, c'est la question de l'équilibre des relations financières existant entre les collectivités et l'État au travers des impôts locaux et du compte d'avances qui doit être posée.
Le jaune budgétaire consacré aux transferts financiers de l'État aux collectivités affirme que « l'ensemble des relations financières entre l'État et collectivités territoriales paraît globalement équilibré sur le compte d'avances aux collectivités territoriales 43 ( * ) », en présentant un tableau synthétisant ces derniers.
Cet équilibre n'apparaît toutefois pas de manière évidente. Julien Dubertret a pour sa part relevé devant la mission les difficultés d'un tel exercice et de l'interprétation de ses résultats : « Je me suis essayé, dans des fonctions antérieures mais proches, à un exercice que beaucoup de fonctionnaires ont tenté à la direction du Budget, afin d'étudier comment les plus et les moins se répartissaient entre l'État et les collectivités territoriales, en prenant les frais d'assiette et de recouvrement, la garantie de recouvrement à 100 % assurée par l'État aux collectivités -sachant que l'on ne recouvre jamais à 100 % - et en tenant compte de l'obligation de dépôt des fonds au trésor et de différentes autres choses, comme le coût financier de l'avance faite au long de l'année du produit d'un impôt qui n'est recouvré qu'en fin d'année...
Je n'ai jamais trouvé de réponse claire à la question de savoir qui était gagnant ou perdant. En moyenne, cela s'équilibre à peu près. Les thuriféraires ont de la chose une vision plus jacobine et des approches plus tranchées, ayant tendance à considérer qu'en l'état actuel, le dispositif est à peu près équilibré. »
S'il ne lui a pas été possible d'apprécier l'ensemble de cet équilibre dans le cadre de son analyse, la mission considère qu'une attention particulière devra être portée à cette question à l'avenir.
* 41 Rapport sur le projet de loi de finances pour 2010, (n° 1946),tome II, Examen de la première partie du PLF, Conditions générales de l'équilibre financier, volume 2, articles 2 et 3. P. 47.
* 42 La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la CFE, les IFER, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Une partie de la taxe d'habitation a également vu les modes de calcul de ses frais de gestion revus. Cf. tableau inséré au texte.
* 43 Jaune « Transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales » annexé au projet de loi de finances pour 2012 , pp. 152-154.







