2. Les conséquences de la modification du panier fiscal local
a) La réforme restreint la concurrence entre territoires et entre collectivités
Du point de vue des collectivités territoriales, le remplacement de la taxe professionnelle par la CET permet de remédier aux effets dommageables de la concurrence fiscale que se livraient les territoires les uns par rapport aux autres .
À la faveur des débats parlementaires, la réforme a mis en place un nouvel impôt, la CVAE , dont le taux, fixé au plan national (1,5 %), est facteur de réduction de la concurrence fiscale .
La réforme modifie totalement l'impact du critère fiscal sur l'implantation géographique des entreprises en neutralisant l'effet taux de la CVAE.
Elle permet ainsi d'éviter que les collectivités reproduisent le schéma antérieur qui les conduisait, lorsqu'elles disposaient de bases très importantes, à conserver des taux bas, tandis que les collectivités « pauvres » en base augmentaient les leurs afin de produire de la ressource fiscale.
La fin de la concurrence fiscale entre collectivités territoriales doit être doublement nuancée.
En premier lieu, malgré la neutralisation du taux de la CVAE, la réforme n'a pas distendu le lien entre entreprises et territoires . L'intérêt d'accueillir des entreprises pour les collectivités reste substantiel, les ressources fiscales résultant des nouvelles implantations demeurant importantes.
En second lieu, la réforme de la taxe professionnelle préserve, à la marge, la possibilité d'une concurrence fiscale entre communes en leur laissant la possibilité de moduler la CFE , part foncière de la CET.
b) La réforme a pour conséquence une répartition plus lisible des ressources fiscales locales
La réforme procède à un partage plus lisible des impôts pour les contribuables - particuliers ou entreprises- entre catégories de collectivités.
Ainsi, le bloc communal décide seul des taux de la CFE, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation. Il est également seul à percevoir et à pouvoir moduler le taux de la taxe sur les surfaces commerciales.
La seule taxe dont le taux est modulable qui reste perçue par plusieurs catégories de collectivités territoriales est la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui bénéficie à la fois au bloc communal et aux départements.
Enfin, les régions ne disposent plus du produit d'aucune des quatre taxes directes locales ni du pouvoir de modulation des taux qui leur est attaché.
c) Les ressources fiscales locales risquent désormais d'être davantage sensibles à la conjoncture
Le remplacement de la taxe professionnelle par la CET modifie la nature de l'imposition des entreprises, et par extension celle des ressources fiscales dévolues aux collectivités territoriales.
Avant réforme, la fiscalité locale reposait sur une fiscalité professionnelle dont les bases étaient représentatives d'un stock (immobilisations et valeurs foncières). Les collectivités territoriales disposaient ainsi d'une fiscalité dont l'évaluation était relativement prévisible et dont le dynamisme était régulier, ainsi que le montre l'évolution des bases économiques de la taxe professionnelle sur la période 1999-2009 58 ( * ) (évolution en moyenne de 3,4 % dans une fourchette annuelle située entre 2 % et 6 %).
À l'inverse, la CVAE est assise sur un flux , la valeur ajoutée, qui réintroduit de fait le facteur « salaires » dans le paquet fiscal local. L'assiette de la nouvelle imposition économique repose ainsi sur un produit directement corrélé à la croissance du produit intérieur brut national .
Les hypothèses retenues par la mission « Durieux-Subremon » en 2010, en adéquation avec les hypothèses de croissance du programme de stabilité 2011-2015, apportent un éclairage qui se veut rassurant sur l' évolution possible des nouvelles bases fiscales de la CVAE. Le rapport conclut en effet que la dynamique de la nouvelle fiscalité (la part CVAE) devrait s'établir à un niveau moyen plus élevé que celui de la taxe professionnelle (4,2% contre 3,4 %), prévision confirmée par l'évolution plus favorable de la valeur ajoutée depuis 1999.
Cette dynamique s'inverse toutefois dans les périodes de récession et, bien que moins sensiblement, en cas de ralentissement économique.
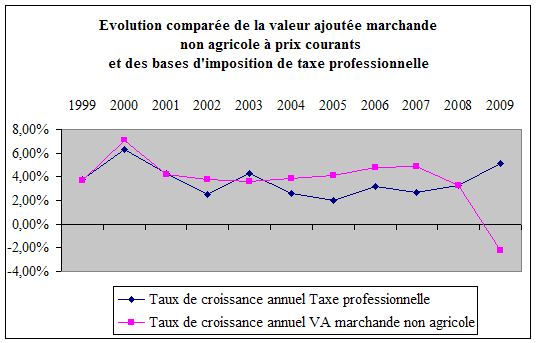
Sources : Données INSEE, Comptes nationaux (valeur ajoutée à prix courants hors agriculture et services principalement non marchands) et Rapport de l'observatoire des finances locales 2009 (évolutions annuelles à législation constante et en euros courants en %).
Compte tenu des perspectives limitées de croissance à court et moyen terme, le risque est réel que le niveau des ressources des collectivités, soumises aux fluctuations de la croissance, évolue de manière moins dynamique qu'envisagé lors de la réforme. Les mécanismes de compensation et de garantie de ressources préserveront un seuil minimal de ressources pour les collectivités mais n'assureront pas un minimum de croissance de celles-ci.
Le produit de la CVAE, plus volatile par nature que celui de la taxe professionnelle, induit en tout état de cause une plus grande variabilité des ressources fiscales locales des collectivités , ce qui grève leur capacité structurelle de pilotage des recettes et de planification des dépenses. Selon les données de l'INSEE, la valeur ajoutée marchande non agricole varie dans le même sens que le PIB national mais dans des proportions plus importantes. Les bases fiscales de la CVAE ont une élasticité supérieure à 1 59 ( * ) .
Évolution du PIB et de la valeur ajoutée de l'industrie et des services marchands non agricole depuis 1979 (en volume)

Source : Insee, comptes annuels base 2000. Calculs : ADF.
La réforme accentue, en particulier, la sensibilité à la croissance nationale des budgets des départements et des régions . En effet, 23 % des recettes de fonctionnement des départements sont directement liées à l'activité économique (Droits de mutation à titre onéreux DMTO, 48,5 % du produit national de la CVAE), et la CVAE représente les trois quarts du panier fiscal des régions.
Cette situation n'est toutefois pas spécifique aux collectivités territoriales puisque l'Etat est soumis à des aléas comparables en matière de ressources fiscales 60 ( * ) . La réforme de la taxe professionnelle présente l'intérêt de mettre en cohérence les budgets des collectivités avec les évolutions économiques nationales, d'une part, et de favoriser leur participation aux efforts de l'Etat lorsque la conjoncture économique se dégrade, d'autre part.
C'est précisément sur cette logique que repose le dispositif de compensation des produits de la CVAE (DCRTP et FNGIR) : il assure des ressources « plancher » mais n'a pas vocation à compenser les aléas de dynamisme de la CVAE d'une année sur l'autre.
* 58 Rapport Durieux-Subremon, p.13 (mai 2010).
* 59 Source : Réponse de l'ADF au questionnaire de la mission commune d'information.
* 60 Le produit de l'impôt sur les sociétés a ainsi reculé entre 2008 et 2009 de 49,5 milliards d'euros à 20,9 milliards d'euros (source : INSEE)







