F. FAUT-IL EXTERNALISER DAVANTAGE LE SOUTIEN ?
Cette question, relativement indépendante de celle des bases de défense stricto sensu, a souvent été soulevée lors des visites de terrain effectuées, dans la mesure où les externalisations potentielles concernent largement le domaine du soutien. L'externalisation des fonctions de soutien pourrait affecter le périmètre des missions que doivent assurer en propre les bases de défense .
Dans la lignée des travaux de la RGPP, la loi de programmation militaire avait prévu que le recentrage sur l'opérationnel s'accompagne de vagues d'externalisation dans le soutien :
|
Loi de programmation militaire, rapport annexé : « L'ambition de la réforme de la fonction « achats » est de permettre de bénéficier d'un service au moins équivalent à moindre coût (...). Les services tels que l'habillement, la restauration ou les infrastructures feront l'objet d'externalisations qui permettront de réaliser des économies en bénéficiant de la performance économique des prestataires externes. La qualité des services sera ainsi améliorée tandis que les armées et les personnels civils se consacreront à leur coeur de métier. » |
Dans un premier temps, c'est donc très résolument que le ministère de la défense s'est engagé sur la voie des externalisations.
A cette approche volontariste s'est désormais substituée une démarche plus nuancée et pragmatique, ce dont vos rapporteurs se félicitent. Car ce sujet, qui est devenu une pomme de discorde entre syndicats et administration, est le lieu d'un véritable paradoxe : il n'y a jamais eu aussi peu d'externalisations que depuis qu'elles sont devenues un âpre enjeu de débat !
Vos rapporteurs ont le sentiment que cette pratique, ancienne, désormais très encadrée, restera marginale. Son principal apport sera peut-être d'avoir introduit une analyse systématique et très fouillée sur les coûts et l'organisation des fonctions considérées, qui est certainement un levier de modernisation très fort pour des missions qui resteront probablement, pour l'essentiel, exercées en régie.
1. Une portée réelle limitée qui contraste avec son enjeu émotionnel
a) Un mouvement engagé bien avant la RGPP
Suivant la définition donnée par la Cour des Comptes 38 ( * ) , et qui résume bien le but de ces opérations, l'externalisation vise, dans le secteur public, à confier à des sociétés spécialisées des tâches exécutées jusque là en interne, afin de permettre le recentrage des activités sur les missions dites de « coeur de métier » et d'obtenir un service de qualité identique à un coût inférieur.
La nécessité de déléguer à des opérateurs privés les tâches ne relevant pas du « coeur de métier » militaire, qui existait depuis des temps immémoriaux, s'est imposée avec le passage à une armée professionnelle, décidée en 1996. Cette nécessité a été réaffirmée avec la décision de réduire les effectifs du ministère de la défense de 54 000 postes d'ici à 2014.
Lors de leurs visites de terrain, vos rapporteurs ont été frappés par la disproportion entre le faible nombre d'externalisations et leur fort impact psychologique pour les personnels , preuve, sans doute, que la question a pu être posée en termes un peut trop dogmatiques.
|
Une pratique ancienne Mode de gestion très ancien dans les armées, l'externalisation n'est pas née avec la réforme de 2008, même si les montants en jeu ont augmenté, d'ailleurs plutôt depuis le milieu des années 2000 que depuis 2008. Tradition séculaire, l'achat externe de prestations autrefois assurées en régie a augmenté sous l'effet de la suspension de la conscription, pour assurer les tâches dites « ancillaires » qui étaient auparavant assurées par les appelés, mais aussi sous l'effet des différents plans de modernisation du ministère de la défense. A partir de 1997, des contrats sont conclus, le plus souvent localement, avec des prestataires extérieurs. Le mouvement s'accélère dans les années 2000 avec les premières réflexions sur la modernisation du ministère. C'est d'ailleurs en 2006, avant la mise en place de la réforme de 2008, qu'est décidée l'externalisation qui a concerné le plus grand nombre de personnels, celle des 20 000 véhicules de la gamme civile. Les principales externalisations sont antérieures ou extérieures à la RGPP : véhicules de la gamme commerciale ; renouvellement de la flotte et simulateurs pour la formation des pilotes d'hélicoptères à Dax ; affrètements aériens avec ou sans pilotes, déploiement des réseaux de desserte de l'armée de l'air ; cession d'usufruit des satellites de communication militaires, transport stratégique maritime par navires rouliers..... Une partie des externalisations concerne d'ailleurs le maintien en condition opérationnelle (MCO) du matériel et les opérations extérieures. D'ailleurs, dans son rapport de février 2011, la Cour des Comptes observe que si on neutralise les externalisations liées aux MCO et aux opérations extérieures, les dépenses d'externalisation peuvent être évaluées à 951 millions d'euros en 2008, soit une croissance de 15% en 15 ans. |
b) Un « chiffon rouge » social
La mission RGPP avait identifié, dans le cadre de 15 projets fonctionnels, un « volant » de 16 000 postes externalisables . Ce chiffre, dont les différents représentants du ministère de la défense ont affirmé qu'il ne constituait pas -et n'avait à leur sens jamais constitué- un objectif pour les ministres successifs , a largement servi de « chiffon rouge » sur le plan social . Il est encore fréquemment cité, en particulier par les organisations syndicales du personnel civil.
Le potentiel d'externalisation recensé par la RGPP
|
Projet |
Effectifs potentiels (audit RGPP) |
|
RHL suite |
8000 |
|
Infrastructures |
2200 |
|
Bureautique/SIC DIRISI |
Non estimé |
|
Armement |
1250 |
|
MCO terrestre |
1200 |
|
MCO aéronautique |
750 |
|
Formation |
838 |
|
Habillement |
400 |
|
Transport surface |
396 |
|
Protection |
250 |
|
Expérimentation FM Creil |
na |
|
Entraînement |
39 |
|
SEA |
20 |
|
SSA |
10 |
Source : Cour des Comptes (2011)
Ce chiffre a cristallisé les oppositions, du fait de l'ambigüité initiale de son articulation avec les 54.000 suppressions de postes : s'agissait-il d'une « couche » supplémentaire de restrictions ?
L'externalisation a dès lors été perçue par les syndicats comme une machine à détruire de l'emploi public.
En outre, parallèlement, des craintes se faisaient jour, en partie sous l'effet des travaux d'analyse du ministère et de la Cour des Comptes, que les économies attendues ne soient pas au rendez-vous et que, mal maîtrisé, le processus ne vienne fragiliser le « coeur de métier » de la défense, par ailleurs difficile à définir.
En définitive, l'approche est aujourd'hui beaucoup plus nuancée. En témoigne la réponse transmise par le ministère à vos rapporteurs sur ce sujet, qui est très claire : « Il n'existe pas d'objectif global de réduction d'effectifs lié à des externalisations dans la conduite de la réforme du ministère. Il s'agit d'un moyen au service de cette réforme. ».
c) Des réalisations jusqu'alors assez limitées
De fait, les réalisations sont finalement, aujourd'hui, assez limitées. D'après le dernier recensement annuel 39 ( * ) effectué par le Secrétariat général pour l'administration, la part des externalisations dans le budget de la défense (hors pensions) ne dépasse pas 3% :
Part des externalisations dans le budget de la défense (hors pensions)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
2% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
5% |
6% |
3% |
3% |
(Hors SIMMAD pour les années 2009 et 2010)
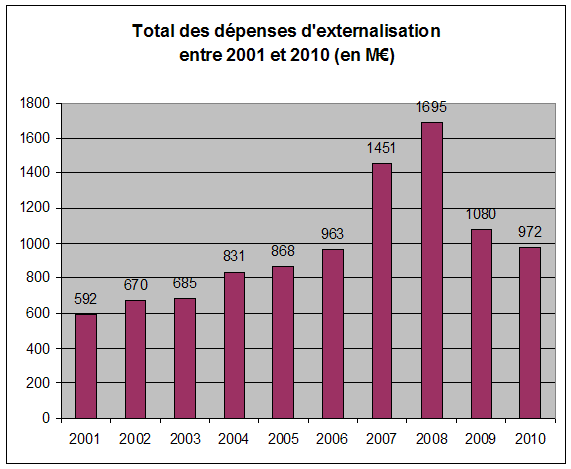
Source : SGA. Chiffres hors SIMMAD pour 2009 et 2010
d) Une méthodologie peu à peu consolidée
(1) Des critères de choix désormais bien établis
Depuis quelques années, le ministre de la défense a fixé quatre conditions strictes aux externalisations, pour lesquelles il est désormais seul décisionnaire :
- ne pas affecter la capacité des armées à réaliser leurs missions opérationnelles,
- permettre, de manière pérenne, des gains économiques significatifs pour l'État et le ministère, évalués avec une méthode rigoureuse, prenant en compte les coûts complets des scénarios étudiés : régie, régie rationalisée et externalisation,
- préserver les intérêts des personnels, notamment au travers des conditions de reclassement,
- éviter la création de positions dominantes chez les fournisseurs et préserver les possibilités d'accès des PME à la commande publique.
Du point de vue de la capacité opérationnelle , les risques sont ceux de la perte de compétence pour les missions externalisées, très difficiles à réinternaliser. La notion de coeur de métier, par essence non externalisable, est difficile à définir avec précision. Si la restauration en général ne relève pas forcément du coeur de métier de la défense, c'est le cas de la restauration sur les théâtres d'opération, ce qui nécessite de conserver un volant suffisant de cuisiniers militaires projetables. C'est le sens de la notion de « socle » de compétences qui doivent être conservés en interne.
À noter que sur le plan des gains économiques attendus , deux facteurs viennent mécaniquement diminuer les avantages qu'on peut attendre de l'externalisation : tout d'abord l'acquittement de la TVA , qui ne frappe pas, par construction, les activités menées en régie, et ensuite le fait que la mise à disposition de longue durée relevant de la loi du 3 août 2009 et du décret du 21 septembre 2010, dite « MALD », a un coût pour le ministère de la Défense . L'agent mis à disposition, sur la base du volontariat, et qui dispose d'un droit au retour, voit sa rémunération maintenue, une convention entre le ministère de la Défense et l'employeur fixant le montant du différentiel remboursé, qui reste à charge du ministère. En outre, les gains doivent être mesurés dans la durée : au-delà du prix d'appel lors d'un premier marché, il existe un risque de renchérissement lors du renouvellement, lorsque la compétence est perdue, a fortiori quand le marché est peu concurrentiel
Du point de vue de l'objectif de préservation de l'intérêt des personnels civils et militaires, des dispositions protectrices du statut des personnels ont été mises en place. Deux dispositifs statutaires sont prévus : la mise à la disposition , dispositif d'ores et déjà opérationnel , et le détachement, dispositif en cours de mise en place. Tous les deux s'appuient sur trois principes : le volontariat , le maintien du statut d'agent public , le droit au retour . Quant aux agents qui ne sont pas mis à la disposition ou détachés chez le prestataire, ils font l'objet d'un reclassement au sein du ministère et bénéficient de l'ensemble des mesures d'accompagnement social des restructurations du ministère de la défense prévus par le PAR. Les militaires sont affectés sur un autre emploi de leur grade.
|
Dans le cadre de la mise à la disposition (MALD40 ( * ) |
), les personnels civils et militaires qui le souhaitent sont mis à la disposition du prestataire, sous réserve du volume et des caractéristiques de postes créés par celui-ci. Les agents continuent à exercer les mêmes fonctions, sur les mêmes postes et dans les mêmes lieux que ceux qu'ils occupaient dans le cadre de l'activité en régie. Dans cette position, les agents conservent leur statut et restent rémunérés par l'État en application des règles qui les régissent. Le prestataire rembourse au ministère de la défense un montant qui est fixé dans le contrat, calculé sur la base de ce qu'il aurait versé en termes de salaires et charges à ses propres employés.
En pratique, 55 volontaires ont, pour la première fois, bénéficié de ce dispositif au titre du projet RHL1 (Restauration, Hôtellerie, Loisirs), dont 38 militaires, dont 3 de carrière et 17 personnels civils. Depuis, plusieurs personnels (11) ont été recrutés par les prestataires, deux ont demandé un détachement, deux ont quitté l'in
|
stitution et le droit à retour a été utilisé à 5 reprises. Au 1er mai 2012, le dispositif bénéficie à 35 personnels, dont 19 militaires et 16 civils. S'agissant du projet "multiservices" de la base de Creil, au démarrage du contrat 23 militaires, dont 3 de carrière, se sont portés volontaires pour une mise à la disposition. Depuis, trois d'entre eux ont été recrutés par le prestataire, trois ont demandé à utiliser leur droit à retour et trois ont quitté l'institution. Dans le cadre du détachement, les agents auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de bénéficier d'une intégration au sein de l'entreprise prestataire. Ils signeront alors un contrat de travail avec le prestataire, sans pour autant perdre leur statut d'agent public, et seront rémunérés par l'entreprise. Le statut du détachement peut intéresser les personnels dès lors que la rémunération chez le prestataire, proposée via un contrat de travail de droit privé est plus élevée, ou pour poursuivre au sein de celui-ci, et après une première phase de mise à la disposition, un nouveau parcours professionnel. Au terme du contrat liant l'administration au prestataire, les agents transférés sont réintégrés au sein du ministère de la défense. Si le contrat est renouvelé, ils ont à nouveau la possibilité de faire acte de volontariat pour exercer leur activité chez le prestataire. Les agents ont, en tout état de cause la possibilité de demander à tout moment, dès lors que le terme du contrat liant l'administration au prestataire n'est pas atteint, de revenir au ministère de la défense pour y occuper un nouvel emploi. |
Enfin, l'accès des PME à la commande publique est une préoccupation que partagent vos deux rapporteurs, déjà développée ci-dessus. Même si, par définition, les externalisations concernent des activités autrefois exercées en régie et sont donc des marchés nouveaux pour les prestataires, il ne faudrait pas que la trop grande concentration de ces marchés ne conduise à un effet d'éviction pour les PME.
(2) Une décision maîtrisée de bout en bout par le ministre, qui associe les personnels
Le projet d'instruction décrivant le processus ministériel de préparation et de conduite des projets d'externalisation, dont vos rapporteurs ont eu communication, prévoit un processus sérieusement étayé, en 5 phases successives (réflexions amont, analyse préliminaire, évaluation préalable, consultation du marché et évaluation finale, mise en oeuvre).
Dans ce schéma, le ministre de la défense a souhaité prendre à son niveau toute décision de franchissement d'une étape critique (fin de l'étude préalable, avant la consultation des entreprises ; décision définitive d'engager ou pas l'externalisation, au regard de l'évaluation finale, avec les offres des entreprises).
Techniquement, le ministère de la défense est désormais outillé pour mener une évaluation économique et sociale approfondie, qu'elle soit préalable ou finale, grâce à la mise en place d'une mission spécifique qui a développé une méthodologie sérieuse. La mission achats intervient afin d'assurer une bonne connaissance des marchés, des prestations des entreprises et des prix, et mener des études de benchmarking ou parangonnage.
Un dispositif d'information de l'ensemble des personnels, civils comme militaires concernés par le projet analysé, est prévu tout au long du processus. Une concertation avec les fédérations syndicales a été mise en place. Les représentants du ministère de la défense auditionnés par vos rapporteurs ont insisté sur l'association des syndicats à la démarche , par le biais d'une information préalable, tant lors du lancement des études qu'au moment de la présentation des résultats. Les représentants des organisations professionnelles entendues par votre commission, ne partagent pas ce sentiment ; certaines estiment que, si elles sont informées, elles ne sont pas réellement écoutées.
(3) L'introduction d'une alternative : la « régie rationalisée »
En parallèle de la définition des quatre critères pour examiner toute décision d'externalisation, et du renforcement de la capacité d'expertise du ministère, le ministre de la défense a demandé que l'évaluation économique et sociale comporte l'analyse comparée systématique et objective de deux scénarios : le recours à des prestations externalisées, d'une part, et d'autre part, un maintien de la régie, mais rationalisée en profondeur. C'est ce qu'on appelle la « régie rationalisée ».
De la sorte, la décision finale porte sur un scénario d'optimisation, qui sera soit le recours à des prestations externes, soit une transformation en profondeur du fonctionnement en régie. L'externalisation n'est qu'une des deux options dans le choix ministériel.
Ainsi par exemple, l'expérimentation du projet d'amélioration des fonctions de restauration (restauration hôtellerie loisirs, ou RHL) comporte clairement deux volets : l'externalisation et la régie rationalisée.
|
L'expérimentation de la régie
rationalisée en parallèle de l'externalisation :
Le projet RHL comprend une phase d'expérimentation, dénommée RHL-1, qui porte sur huit sites 41 ( * ) |
,
|
qui représentent une activité de près de deux millions de repas par an, et qui concerne 356 personnels dont 152 civils de la défense. Son périmètre fonctionnel recouvre principalement la fonction restauration (11 restaurants et 300 personnels de soutien) et à titre secondaire les fonctions hôtellerie et loisirs (55 personnels concernés).L'opération RHL-1 a donné lieu à la notification d'un marché alloti le 21 décembre 2010 pour une entrée en vigueur à compter du 10 janvier 2011. Les gains annuels attendus sont de 18% par rapport au mode de fonctionnement en régie. Par ailleurs, une expérimentation portant sur la rationalisation de la régie de la fonction RHL, dénommée RHL-RR, a été engagée sur 5 autres sites (439 postes). Les résultats de l'évaluation préalable, et leur comparaison à ceux obtenus au titre de l'opération RHL-1 ont été présentés aux organisations syndicales. La mise en oeuvre du projet RHL-RR est programmée à partir du mois d'octobre 2011. |
(4) Un levier pour la rationalisation : l'exemple de l'harmonisation des effets vestimentaires
Même si c'est pour y renoncer in fine , le fait d'envisager l'externalisation conduit ainsi à une optimisation des fonctions considérées. Assez logiquement, l'externalisation amène à organiser les fonctions en faisant davantage abstraction de l'historique pour être davantage axé sur la maitrise des coûts et à importer les meilleures pratiques professionnelles.
Les travaux préalables au projet d'externalisation de l'habillement (projet en cours) ont ainsi été l'occasion d'un important travail d'harmonisation des tenues entre armées, qui touche l'ensemble des effets :
- effets « identitaires », dans la mesure où cela ne remet pas en cause l'identité des armées ;
- effets « spécialisés » et de combat, lorsque les conditions d'emploi sont similaires.
Un catalogue unique des effets d'habillement a été réalisé. Constitué sur la base de 20 dotations types regroupant l'ensemble des articles utilisés, ce catalogue est le référentiel unique interarmées pour les travaux de programmation et d'acquisition des effets et articles d'habillement. Un millier d'articles sont référencés. Plus de 50% sont communs au moins à 2 armées. L'harmonisation peut également se traduire par l'emploi de variantes, sur une même base de documents techniques, variantes qui amènent à satisfaire un besoin utilisateur par un produit approchant un article existant.
|
EXEMPLE DE FAMILLES DE PRODUITS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION : - les effets de combat dont certains effets de FELIN ; - certains effets de la tenue de sortie (pantalons, jupe, veste, manteau, casquette, tricorne), chaque armée gardant son coloris ; - certains effets de service courant (blouson demi-saison, parka d'uniforme, chemises, chaussures) ; - effets de vol (blouson de vol tissu, tenue de vol équipages forces spéciales) ; - sous-vêtements « concept multicouches » ; - certains effets des forces spéciales (démarche en cours). |
De même, les marchés groupés se sont développés. La planification 2012 pour l'approvisionnement des effets prévoit la passation d'un total d'environ 67 marchés dont 46% sont des marchés interarmées et 54% des marchés spécifiques à une seule armée.
Enfin, les études réalisées sur l'externalisation amènent à s'attaquer au problème de la réduction des stocks bien trop volumineux et coûteux, habitudes héritées du temps de la conscription.
En matière de marchés, d'harmonisation des tenues, et de gestion des stocks, des actions de modernisation et de simplification sont en cours ; elles ont été et seront sources d'économies.
Il est certain que la perspective d'une éventuelle externalisation est un levier de rationalisation : favorisant la comparaison et la diffusion des meilleures pratiques, la remise en cause des méthodes existantes pour rechercher la meilleure efficacité et le meilleur coût est en soi un gain.
* 38 Rapport public annuel 2011 : « Un premier bilan des externalisations au ministère de la Défense »
* 39 Note en date du 22 décembre 2011, « Synthèse des externalisations du MINDAC en 2010 », .externalisations portant sur l'année 2010
* 40 Article 43 de la loi mobilité et parcours professionnels (LMPP) du 3 août 2009 - décret d'application du 21 septembre 2010
* 41 Ecole des troupes aéroportées à Pau, Ecole Nationale des sous-officiers d'active à St Maixent, Cercles de garnison de Bordeaux et Lyon , GAM-STAT de Valence, Centre de commandant Mille à Houilles, Ecole des pupilles de l'air à Grenoble et EETAA 722 à Saintes.







