IV. INTERVENTION DE M. LUC DOYEN, DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS, MEMBRE DU GROUPEMENT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE THÉORIQUE ET APPLIQUÉE (GRETHA), UNIVERSITÉ DE BORDEAUX : « SCÉNARIOS ET MODÉLISATION ÉCOLOGICO-ÉCONOMIQUES. »
Je mettrai l'accent sur trois dimensions de la gestion durable des pêches : l'aspect prospectif, à partir de la notion de scénario, l'aspect méthodologique, sous l'angle de la modélisation, et l'aspect économique, à travers la bioéconomie et l'écologie économique.
Comme cela a été précédemment évoqué, les écosystèmes marins sont sous pression, avec des vulnérabilités écologiques, sur le plan de la biodiversité, et économiques, se traduisant par une stagnation des biens et services écosystémiques.
La création de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) s'inscrit dans cette perspective bioéconomique, d'écologie économique, à l'interface entre la science et l'aide à la décision. Inspiré de ce qui a été fait avec un certain succès avec le GIEC ou IPCC 17 ( * ) , pour le climat, l'IPBES s'attache à créer des scénarios, et, en particulier, des scénarios bioéconomiques.
La construction de scénarios bioéconomiques pertinents doit s'appuyer sur les trois piliers des politiques publiques :
- Le premier pilier est constitué par la connaissance scientifique, à travers des données, des systèmes d'information, en particulier halieutique, et des modèles bioéconomiques et écosystémiques.
- Le deuxième pilier est constitué par les objectifs inter-temporels : il s'agit notamment de l'objectif, fixé lors du Sommet de Johannesburg et repris par la politique commune de la pêche (PCP) 18 ( * ) , d'atteindre le rendement maximal durable en 2015.
- Le troisième pilier est formé des instruments au service des politiques publiques, qui sont de trois types : réglementaire (quotas, aires marines protégées), monétaire (taxes, subventions) et informationnel (écolabels tels que le Marine Stewardship Council ou le Pavillon France).
Concernant les objectifs inter-temporels, nous avons déjà évoqué le RMD, qui est issu d'un raisonnement à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on essaie de capturer le surplus de croissance de la ressource à travers son renouvellement. Cette notion est associée à une courbe en forme de cloche ( ci-après ), l'idée intuitive étant de prélever le maximum sur cette courbe.
ÉQUILIBRES (GORDON-SCHAEFER, 1954)
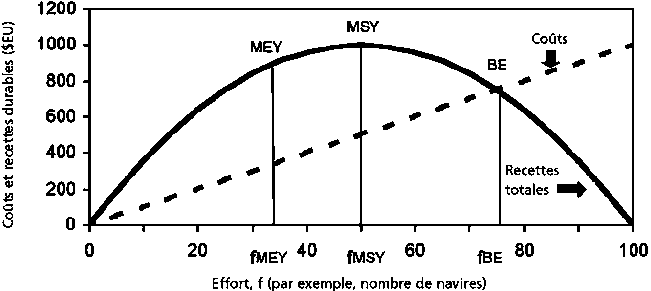
Source : Luc Doyen
Les économistes intègrent à cette courbe les coûts et les prix. Ils s'intéressent à la maximisation, à l'équilibre, des profits et obtiennent un rendement économique maximum ou Maximum economic yield (MEY) qui a des vertus non seulement économiques mais aussi en termes de conservation des stocks, ce qui est assez contre-intuitif. Cela peut être démontré : les niveaux de stocks sont meilleurs au rendement économique maximum (MEY) qu'au MSY (RMD), avec des niveaux d'effort de pêche plus faibles.
L'utilisation des notions de MSY et MEY fait l'objet de nombreux débats. Les Australiens militent activement pour l'utilisation du rendement économique maximum comme point de référence en termes d'objectifs inter-temporels.
Le bilan mondial de la gestion des stocks n'est pas très bon. Beaucoup de stocks sont surexploités. Il faut donc changer d'approche , en passant par exemple à l'approche écosystémique. Les travaux de Bernard Chevassus-au-Louis 19 ( * ) préconisent une extension des approches à l'équilibre, pour opérationnaliser la durabilité. Il s'agit de « passer d'une vision d'exploitation équilibrée d'une ressource à celle d'une gestion dynamique d'un écosystème et de l'ensemble des biens et services qu'il produit avec la préoccupation de leur fourniture à long terme » 20 ( * ) .
Les éléments essentiels de cette opérationnalisation de la durabilité sont :
- Une approche multicritères, prenant en compte les dimensions tant écologique qu'économique et sociale, ce qui signifie une multiplicité de points de référence et de seuils critiques à satisfaire ;
- L'équité intergénérationnelle est un élément extrêmement important. Il s'agit de réconcilier le présent et le futur.
- L'équité intra-générationnelle est un objectif important du développement durable, qui dépend des échelles sur lesquelles on travaille.
Une approche intéressante, développée en particulier en France, est l'approche dite de viabilité ou de co-viabilité, ou encore d'éco-viabilité . Elle consiste à travailler sur la sécurité bioéconomique des écosystèmes. Elle est proche de l'approche de précaution et vise à satisfaire, au cours du temps, un certain nombre de contraintes et de points de référence, issus de cette vision multicritères et d'équité intergénérationnelle que j'évoquais précédemment.
Le Golfe de Gascogne a donné lieu à une application intéressante de cette approche, avec des pêcheries démersales 21 ( * ) , multi-espèces (sole, langoustine, merlu) et multi-flottilles (chalutiers, fileyeurs) 22 ( * ) , avec donc des complexités dans le sens où il existe des interactions techniques, des prises accessoires et beaucoup d'incertitudes sur le renouvellement des différents stocks. Des travaux 23 ( * ) ont permis d'identifier des stratégies d'effort permettant de satisfaire un ensemble de contraintes, de rester au-dessus de seuils critiques de précaution aussi bien du point de vue de la biomasse des différentes espèces que du point de vue des profits des différentes flottilles.
Concernant les instruments et la gouvernance de ces politiques bioéconomiques, le point de départ est la tragédie de l'accès libre avec des acteurs possiblement peu vertueux, myopes et peu coopératifs, au sens économique. Cela génère de la surexploitation.
Il est donc nécessaire de passer à des approches coopératives et de régulation . Différents instruments sont utilisables : des instruments réglementaires, monétaires ou mixtes du type des marchés de droits transférables. Comme cela avait été évoqué dans le rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, la question de l'utilisation de ces marchés de droits se pose. Un certain nombre de pays militent pour leur utilisation : la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Islande par exemple. Beaucoup de débats et de tensions entourent cette idée.
À dessein, je n'utilise pas les termes de marchés individuels de quotas transférables.
Ces marchés de quotas transférables génèrent une efficience économique dans le sens d'une maximisation des rentes et d'un effort plus réduit (au niveau du MEY), avec donc des pressions plus faibles. Mais ces marchés génèrent, par ailleurs, de la concentration dans le secteur, ce qui constitue une difficulté importante. La question de l'acceptabilité sociale de ces marchés de droits se pose donc légitimement. Différents travaux 24 ( * ) montrent que l'on peut identifier des conditions permettant de réconcilier objectifs sociaux, économiques et écologiques en utilisant ces systèmes de quotas transférables. Ces conditions portent sur les stocks et sur une stratégie de quotas extrêmement spécifique.
Le message sous-jacent à mon propos est que ces marchés doivent être régulés : il faut choisir judicieusement les niveaux de quotas et de taux admissible de capture (TAC) qui en sont à la base.
Il me semble donc, à travers les problématiques, enjeux, défis et résultats évoqués, que le travail sur la bioéconomie, l'écologie économique et la modélisation bioéconomique peut être pertinent et éclairant pour une gestion durable des pêches.
* 17 Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Intergovernmental panel on climate change).
* 18 Voir glossaire.
* 19 Voir notamment : L'approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, rapport du Centre d'analyse stratégique (CAS), par M. Bernard Chevassus-au-Louis, Inspecteur général de l'agriculture (2009) et La biodiversité c'est maintenant, du même auteur (Aube, 2013).
* 20 Chevassus, 2010
* 21 Sur les différents types d'espèces marines (pélagiques, démersales, benthiques), voir glossaire.
* 22 Sur les différents types de navires de pêche, voir glossaire.
* 23 Gourguet et al., Fisheries Research, 2013 ; Doyen et al., Ecological Economics, 2012.
* 24 The triple bottom line : meeting ecological, economic and social goals with individual transferable quotas, J.C Péreau, L. Doyen, L.R Little, O. Thébaud, Journal of Environmental economics and management (2012)







