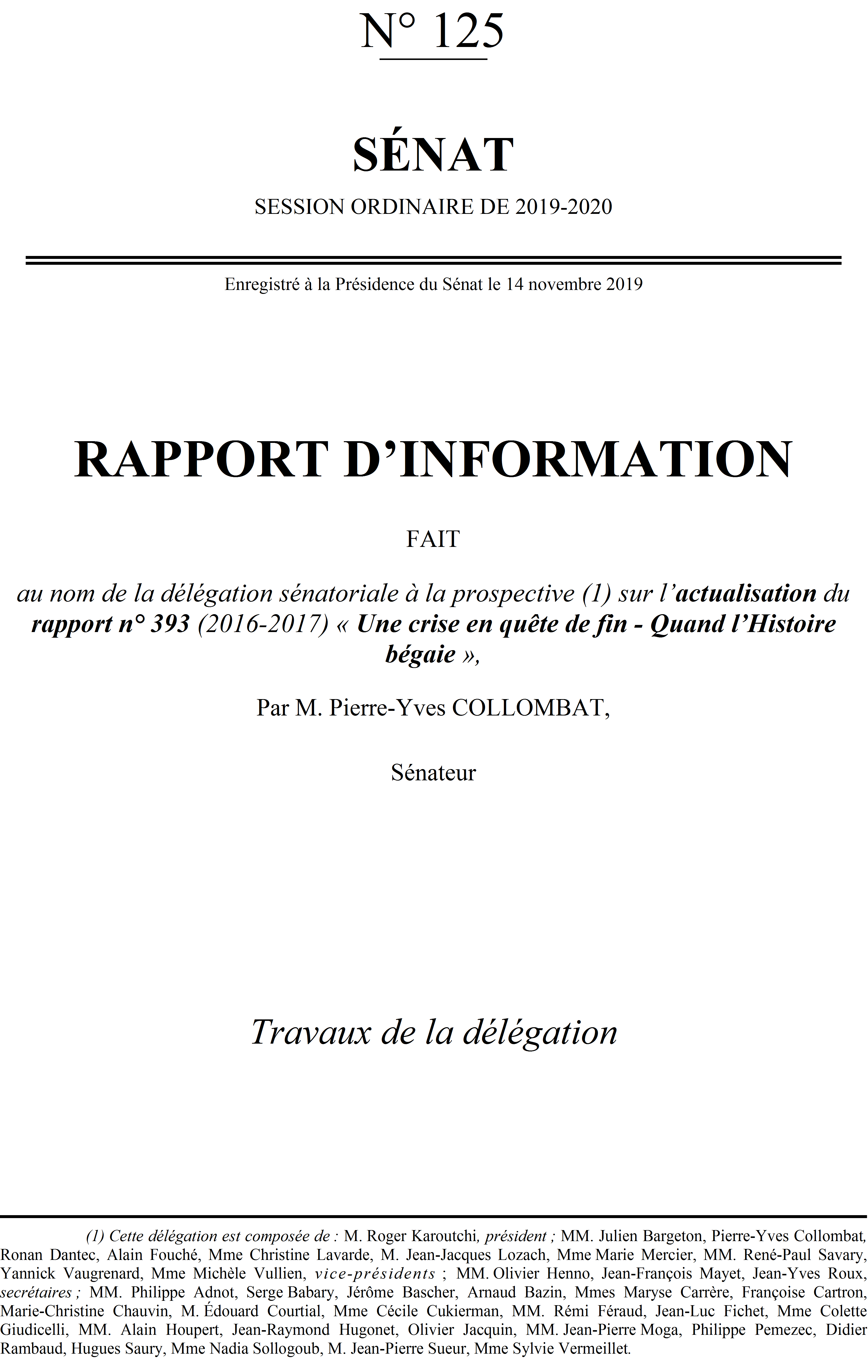Rapport d'information n° 125 (2019-2020) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT , fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 14 novembre 2019
Disponible au format PDF (491 Koctets)
-
Travaux en délégation
-
I. AUDITION DE M. SÉBASTIEN JEAN,
DIRECTEUR DU CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES ET D'INFORMATIONS
INTERNATIONALES (CEPII)
-
II. AUDITION DE M. JEAN MICHEL NAULOT, ANCIEN MEMBRE
DU COLLÈGE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(AMF)
-
III. AUDITION DE M. BERTRAND BADIE, PROFESSEUR DES
UNIVERSITÉS À L'INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE
PARIS
-
IV. EXAMEN DU RAPPORT
-
I. AUDITION DE M. SÉBASTIEN JEAN,
DIRECTEUR DU CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES ET D'INFORMATIONS
INTERNATIONALES (CEPII)
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
La délégation à la prospective a confié fin 2018 à Pierre-Yves Collombat un travail d'actualisation de son rapport de février 2017 consacré à la crise financière (rapport n°393 (2016-2017) « Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie »).
Au cours de sa réunion du 14 novembre 2019, la délégation à la prospective a examiné ce travail d'actualisation. Elle a autorisé la publication, d'une part, des travaux de la délégation (tome I du présent rapport), d'autre part, de la position personnelle du rapporteur (tome II).
Travaux en délégation
I. AUDITION DE M. SÉBASTIEN JEAN, DIRECTEUR DU CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES ET D'INFORMATIONS INTERNATIONALES (CEPII)
Jeudi 13 décembre 2018
M. Roger Karoutchi, président . - Monsieur Sébastien Jean, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin, est directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), titulaire d'une thèse de doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris I et ingénieur de l'École Centrale de Paris. Il a rédigé en juillet dernier une note, publiée par le conseil d'analyse économique, intitulée : « Avis de tempête sur le commerce international : quelle stratégie pour l'Europe ? » et c'est à ce sujet que nous l'entendons aujourd'hui.
M. Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) . - La note à laquelle vous faites référence s'appuie sur une hypothèse de départ, selon laquelle les bouleversements récents du commerce international obligent à une remise à plat de la façon dont on considère la question et les réponses à y apporter, en particulier, en ce qui concerne la bonne stratégie pour l'Europe.
Pour résumer à grands traits la note, je dirai que nous - Philippe Martin, André Sapir et moi-même - avons tout d'abord tenté d'analyser l'impact de la mondialisation commerciale en termes de bouleversements sociaux et économiques internes.
À cet égard, nous considérons que l'ouverture commerciale depuis une trentaine d'années n'est pas la cause, du moins pas la cause principale, des bouleversements sociaux majeurs et en particulier de la montée des populismes partout en Europe, que nous attribuons plutôt à une incapacité à apporter des bonnes réponses.
Pour autant, nous considérons que les impacts sociaux de l'ouverture commerciale - notamment en termes d'accélération du changement structurel - appellent des réponses de l'État.
Deuxièmement, nous faisons le constat qu'il résulte de l'accélération récente de vives tensions commerciales une forte incertitude, qui agit principalement sur les décisions des entreprises. Ces tensions sont un puissant facteur de déstabilisation, empêchant les entreprises de prendre des mesures de long terme, qui freinent ou différent les investissements.
Pour l'instant, les effets ne s'en sont pas encore fait sentir, mais ceci s'explique en grande partie par les mesures de relance fiscale, puisque les gouvernements américain et chinois ont décidé de contrebalancer l'impact frontal du choc commercial par des politiques internes de relance macroéconomique conjoncturelles.
En Europe, depuis le printemps dernier, les enquêtes de conjoncture montrent que le climat des affaires souffre passablement de ces incertitudes commerciales et ceci surtout en Allemagne, dont l'économie est fortement dépendante des exportations, mais aussi en France.
Face à ce constat, nous prévenons qu'une guerre commerciale généralisée pourrait coûter très cher à l'Europe. Si les petits pays, plus dépendants du commerce extérieur, étaient plus impactés, nos simulations montrent que cet affrontement commercial pourrait coûter aux autres pays entre 3 à 4 points de PIB, c'est-à-dire avoir un impact proche de celui de la crise financière de 2008-2009.
La sortie d'un cadre coopératif pourrait se traduire par une augmentation sensible des droits de douane, qui pourrait aller au-delà de 25 %, niveau estimé comme un seuil, ce que les précédentes crises ont prouvé - notamment celle des années 30, mais aussi plus récemment la crise commerciale entre les États-Unis et la Chine.
La situation de l'Europe est certes spécifique dans l'échiquier mondial, puisque, union commerciale d'États, l'Europe est plus forte commercialement que politiquement et n'a donc aucun intérêt à sortir du principe multilatéral.
À notre sens, la priorité de l'Europe doit être la sauvegarde du système commercial multilatéral, basé sur des règles établies en commun, et formalisé par des traités, actuellement celui de l'OMC, que les États s'attachent à appliquer, même imparfaitement.
Pour autant, tel qu'il existe actuellement, ce système doit faire face à une nouvelle donne liée à la place de la Chine, devenue première puissance industrielle et commerciale mondiale, ce qui n'était pas le cas au moment de son entrée dans l'OMC.
À cette époque-là, l'intégration de la Chine s'était faite avec l'espoir d'une convergence sociale et normative future. Or, aujourd'hui, l'économie chinoise, fortement subventionnée par l'État, ne semble pas en voie d'évolution et représente donc une menace majeure de concurrence déloyale.
Aussi, il ne faudrait pas que ce qui s'est passé dans les années 2000 pour les panneaux voltaïques se reproduisent dans d'autres secteurs : l'automobile, l'aéronautique, la robotique, etc., autant de secteurs encore fortement subventionnés par l'État chinois. C'est le défi majeur pour l'Europe.
Face à cette menace, les États-Unis adoptent une position agressive, qui consiste à vouloir casser le développement de l'économie chinoise, ce qui nous semble ni possible ni surtout souhaitable.
Pour notre part, nous considérons qu'il vaudrait mieux envisager une réforme de l'OMC, visant à faire en sorte que le développement de l'industrie chinoise ne se fasse pas au détriment de la nôtre : l'industrie européenne ne doit pas être la variable d'ajustement des choix de politique industrielle chinois.
Afin de pouvoir envisager le rétablissement de la possibilité d'une concurrence libre et non faussée, nous appelons donc à la renégociation, au sein de l'OMC : des règles entourant le régime des subventions industrielles ; de la réponse au transfert forcé de technologie industrielle.
À ce sujet, nous considérons que l'enjeu réside moins dans la bataille autour des droits de propriété intellectuelle - la Chine ayant bien compris l'intérêt d'évoluer vers une économie de l'innovation - que de faire cesser, d'une part, le cyber espionnage industriel, d'autre part et surtout, la conditionnalité de l'accès au marché chinois.
Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la Chine continue de conditionner l'accès des produits étrangers à son marché, en imposant par exemple des plafonds de participation dans ses propres entreprise nationales, ou encore en conditionnant la vente directe à la cession des droits de propriété intellectuelle.
Les freins sont donc moins réglementaires que pratiques, dans la mise en oeuvre des ventes, ce qui est plus difficile à faire évoluer.
Je termine sur l'utilité des accords de libre-échange dans ce contexte.
Si le but premier d'un accord de libre-échange est l'efficacité de l'allocation des ressources, et donc la croissance et l'innovation, on ne peut plus attendre aujourd'hui de ces traités le type de gain qu'on pouvait attendre dans les années 1960, années au cours desquelles l'Europe avait besoin de concurrence extérieure.
Aujourd'hui, la réflexion européenne sur l'opportunité de nouer des accords de libre-échange doit envisager toutes les externalités - sociales et environnementales notamment - induites.
D'autre part, elle doit nécessairement s'inscrire dans le contexte d'incertitude que j'ai décrit précédemment. C'est typiquement le cas de l'accord que nous sommes en train de nouer avec le Japon, qui est aussi une garantie d'alliance stratégique notamment face aux États-Unis.
Comment, enfin, rendre contraignantes les clauses non commerciales, sociales ou environnementales, au sein des accords commerciaux ?
Tant que la sanction du non-respect des clauses reste basée sur la preuve de l'existence d'un préjudice, il sera très difficile de faire respecter un engagement social : à titre d'exemple, comment prouver qu'une entrave au droit syndical au Guatemala aura des conséquences concrètes sur l'industrie américaine ?
Si le non-respect d'un engagement social ou environnemental ne se traduit pas par une sanction commerciale, il restera au stade de voeu. C'est cette logique qui a été retenue dans le cadre du partenariat Transpacifique, en liant les droits préférentiels de l'industrie textile vietnamienne pour entrer sur le marché nord-américain à l'évolution de la liberté syndicale dans ce pays.
C'est également l'esprit qui a présidé aux négociations commerciales franco-japonaises sur l'industrie automobile.
Un accord commercial peut donc tout à fait être un instrument de politique étrangère, utilisé à d'autres fins que le développement de la croissance, je pense notamment au cadre des négociations de l'Accord de Paris sur le climat.
M. Roger Karoutchi, président . - Tout cela a l'air très policé, mais, dans la réalité, on a l'impression que ce sont les pays les moins policés qui ont le dernier mot. Regardez le Président américain Donald Trump. Il est unanimement condamné, et malgré cela, il obtient toutes les concessions commerciales qu'il souhaite. Tout se passe comme si seuls les petits pays, parce que cela les protège, avaient un intérêt à respecter les accords commerciaux ; pendant que les « grands » les foulent au pied !
Le rapport de force n'est-il pas devenu un élément-clé dans les négociations commerciales ?
M. Pierre-Yves Collombat . - Vous nous alertez sur l'impact social des tensions commerciales et je partage totalement avec vous cette idée ! Elles vont venir s'ajouter aux tensions que traverse déjà notre société.
Mais cela ne date pas d'hier. Déjà l'émissaire américain du Président Wilson expliquait aux Européens, au moment du renoncement aux accords de Bretton Woods que « le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème ».
Alors pourquoi les Américains ont-ils mis fin au système alors qu'ils en étaient les principaux bénéficiaires ?
Cela ne signifie-t-il pas que ce système libéral induit des effets pervers, même chez ceux qui en sont les principaux bénéficiaires ?
Aujourd'hui, les Américains continuent à fabriquer la monnaie qui leur permet d'acheter tout, y compris les entreprises des autres pays, ce qui nécessite de réfléchir au rôle du dollar à l'intérieur de ce système.
Je voudrais également attirer votre attention sur le rôle des multinationales, qui sont devenues les principaux acteurs du commerce international.
Tout se passe aujourd'hui comme si ces multinationales, à travers leurs filiales, étaient devenues maîtres du trafic, jouant des paradis fiscaux et intentant des procès aux États quand ils leur imposent des règles de bonne conduite.
Vous parlez d'effets collatéraux et d'externalités négatives, notamment sociales et environnementales, mais ce système n'est-il pas structurellement pervers ?
Je ne me ferai pas le chantre du protectionnisme, mais je constate qu'à chaque fois que les Européens ont essayé d'imposer la clause de préférence européenne, les Américains ont répondu par un accord de libre-échange, comme si le libre-échange était devenu un sacro-saint intouchable.
Qu'est-ce que cela signifie ? Et pourquoi, selon vous, Donald Trump a-t-il gagné les élections sur cette thématique ?
M. Serge Babary . - Ne trouvez-vous pas qu'il y a un paradoxe à parler d'harmonisation et de rapprochement au niveau mondial, quand, au sein même de la zone européenne, il n'existe pas entre les pays de l'Union d'harmonisation des règles fiscales, sociales, environnementales et même normatives ?
Quand on sait les conséquences dommageables de cette situation pour les producteurs qui échangent sur le marché intra-européen, cette première étape n'est-elle pas un préalable, avant même de parler d'influencer la liberté syndicale dans des pays d'autres zones ou d'apaiser les relations internationales ?
Mme Marie Mercier . - Vous parliez d'incertitude et cela m'a fait penser à cette phrase : « le problème de notre temps, c'est que l'avenir n'est plus ce qu'il a été ». Ce que je veux dire, c'est que l'avenir est par essence incertain et que le passé seul est fixe. Pour revenir à notre sujet, je vois mal les Européens aller voir les Chinois et leur demander poliment de cesser de nous espionner.
M. Yannick Vaugrenard . - Il y a vingt ans, on se demandait « quand la Chine s'éveillera ? », aujourd'hui on se demande « quand la Chine s'arrêtera ? ».
Le compte-rendu qu'a fait la commission des affaires étrangères de son déplacement en Chine est, à cet égard, saisissant. L'influence de la Chine, en particulier en Afrique, devient extraordinairement importante. La multiplication des échanges commerciaux mondiaux en yuan chinois et la convertibilité récente du yuan en or est en train de bouleverser la donne financière du commerce international.
Face à ce nouveau rapport de force, l'Europe doit se poser les bonnes questions et l'idée d'une Europe évolutive, qui avancerait par cercles concentriques, devient assez incontournable. Nous l'avons fait pour la monnaie. Ne serait-ce pas le moment de le faire aussi pour nos règles fiscales et commerciales ?
Car les Chinois sont en train d'acquérir les ports africains, sous couvert de garantie de prêt. Ce sont les nouvelles routes de la soie !
Il me paraît donc urgent de faire évoluer notre stratégie d'alliances, en faisant entrer la Chine, mais aussi l'Inde parmi nos partenaires, à défaut de quoi nous serons bientôt dépassés !
M. Roger Karoutchi, président . - Pour aller dans votre sens, j'ajoute qu'il y a quelques jours, le Gouvernement chinois a protesté sur le fait que la France possède encore des marchés privilégiés en Afrique, au titre de ses anciens liens coloniaux !
M. Yannick Vaugrenard . - Vous évoquiez, par ailleurs, la nécessité de réformer l'OMC. Comment se fait-il que cette organisation puisse accepter des États qui ne respectent pas les normes sociales minimales ? Vous paraît-il possible de rendre le respect de ces clauses conditionnelles à l'entrée et au bénéfice des garanties de l'OMC ?
Mme Michèle Vullien . - Il me semble que l'avancée de la Chine est d'autant plus inquiétante que les Chinois avancent masqués.
On assiste néanmoins à un réinvestissement sur les produits de qualité. La réindustrialisation de l'Europe ne passe-t-elle pas par la bataille de la qualité ?
M. Sébastien Jean . - Je suis entièrement d'accord avec vos réflexions sur le manque d'harmonisation en Europe. La règle de l'unanimité empêche les avancées sur ce point, et on pourrait en dire tout autant du secteur des services par exemple, ce qui fait qu'on n'a pas d'Amazon européen. C'est un handicap majeur.
Que le commerce soit devenu un élément central du débat politique aux États-Unis, c'est indéniable et cela tient au fait que les Américains cherchent à avoir toujours plus de protection, sans augmenter pour autant la place de l'État dans l'économie.
Or, les États-Unis ont échoué à s'ajuster au système dont ils ont été les architectes, puisqu'ils ont en même temps organisé le choc concurrentiel, en mettant fin au système de Bretton Woods, et démantelé leur système de protection sociale. Le résultat, largement commenté depuis, est la baisse structurelle des salaires depuis presque 35 ans.
Ceci s'ajoute au déficit structurel de la balance commerciale, puisque les États-Unis vivent avec un déficit dont ils n'assument pas les conséquences : le monde entier continue de se procurer du dollar par d'autres moyens. Si ce déficit n'a donc pas de conséquence monétaire, en revanche il pèse sur l'outil de production et entraîne une désindustrialisation dont les conséquences sociales et territoriales sont fortes.
Que les relations commerciales ne soient pas un jeu d'enfants, c'est certain et encore on ne voit que la partie immergée de l'iceberg ! Mais l'OMC a le mérite d'exister et quelle autre règle serait viable sinon ? Il faut être réaliste. En l'absence d'un système de règlement des différends entre États, au niveau international, c'est la canonnière !
Il faut bien être conscient qu'une sortie de ce système pourrait être dommageable pour tous : nous en avons la préfiguration avec la politique de Donald Trump.
Le rapport de force a prévalu lors de l'établissement de l'OMC. Dès le départ, les États-Unis ont imposé ce qui les arrangeait. La véritable question est : à quelle fin les États-Unis utilisent-ils cette puissance ? Ce qui pose problème, c'est que l'administration de Donald Trump reste floue et incohérente. Car empiler des droits de douane n'a jamais permis de réduire un déficit commercial, qui reste un curseur macroéconomique du différentiel entre la consommation et la production intérieure. Aujourd'hui, le déficit commercial américain atteint des sommets, non pas à cause de la politique commerciale, mais à cause des mesures fiscales.
La logique sous-jacente de ces mesures américaines tient dans la concurrence stratégique avec la Chine.
L'appareil politique et industriel américain est arc-bouté contre la Chine, désignée comme le concurrent majeur : on retrouve cette rhétorique de la peur dans les discours des conseillers politiques du président Trump.
Les États-Unis vont-ils arriver à faire réformer la Chine ? C'est l'étalon de la réussite du mandat de Donald Trump.
L'Europe, le Japon et les États-Unis, s'ils s'allient pragmatiquement, ont les moyens d'obtenir des réformes. L'alliance me parait être une méthode beaucoup plus puissante que la menace.
Dans cette bataille, les outils existent : l'examen minutieux des investissements étrangers directs en Europe, et à cet égard, la mise en place d'un comité européen est en cours ; plus de réciprocité dans l'accès aux marchés publics ; les accords de libre-échange, même si leur mise en oeuvre est compliquée ; les instruments de défense commerciale, notamment contre le dumping et les subventions, qui doivent être utilisés de manière plus réactive et plus ciblée.
Il n'existe donc pas de solution miracle, mais nous avons à notre portée des instruments, qu'il faut utiliser.
Vous évoquiez l'influence du yuan, pour l'instant, ce n'est pas flagrant. À mon avis, tant que l'économie chinoise restera surinvestie par la régulation étatique, le yuan ne sera pas un concurrent possible au dollar, qui reste la monnaie reine dans les échanges. Commercer dans une autre monnaie que le dollar, coûte plus cher. Il n'y a donc pas d'autre alternative pour l'instant.
Il n'en reste pas moins que nous sommes à l'orée d'une période nouvelle, dont personne ne pourra prédire ce qu'elle sera, mais dont je pense qu'elle sera pire encore après Trump.
La position de l'appareil de défense et de renseignement américain est encore plus agressive que celle du président Trump, dont les tweets restent acceptables au regard du discours du 4 octobre du vice-président Mike Pence, qui a montré toute la combativité de l'appareil américain.
Raison de plus pour nous, Européens, de trouver une voie négociée.
M. Roger Karoutchi, président . - Je vous remercie.
II. AUDITION DE M. JEAN MICHEL NAULOT, ANCIEN MEMBRE DU COLLÈGE DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
Jeudi 14 février 2019
M. Roger Karoutchi, président . - Monsieur Jean-Michel Naulot, vous avez été banquier, puis membre du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien ? », publié au Seuil en 2013, et plus récemment, en janvier 2017, « Éviter l'effondrement ».
Comment analyser la situation financière actuelle et les risques apparus depuis la crise financière de 2008 sera notre première question. Puis, nous ouvrirons la discussion.
M. Jean Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre de l'Autorité des marchés financiers (AMF) . - Commençons, si vous le voulez bien, par un peu de perspective historique.
Mardi dernier, France 2 diffusait quatre documentaires sur l'Allemagne des années 20 et 30, qui montraient bien la responsabilité de la crise financière américaine dans le basculement des années 30 en France et en Allemagne, basculement qui aura mis fin aux années folles pour plonger nos pays dans la misère que l'on connaît et la montée des fascismes.
J'évoque cette période car je crois que, comme dans les années 30, nous avons basculé depuis 2008 dans une période de crise que je vous propose maintenant d'analyser.
La photo de la finance internationale d'aujourd'hui est inquiétante : même d'anciens grands responsables de banques centrales comme Jean-Claude Trichet ou Jacques de la Rosière sont inquiets sur l'évolution des choses. C'est, peut-être, la première fois depuis 40 ans que ce constat fait l'unanimité.
Le fait marquant de la situation actuelle se trouve, à mon sens, dans la déconnexion des marchés de l'économie.
Depuis l'élection de Donald Trump, les marchés d'action ont progressé de 30 %. Il faut y voir, bien sûr, l'effet de la réforme fiscale des entreprises, qui a consisté à détaxer les profits. Or, cet argent a servi presque entièrement au rachat d'actions, qui a connu, aux États-Unis, l'année dernière, un record d'environ 1 000 Md$, c'est-à-dire un doublement par rapport à l'année précédente. Il faut y ajouter l'accroissement des dividendes, d'environ 20 %. La détaxation n'a donc pas servi à l'investissement, mais bien à enrichir les actionnaires.
Mais attention, la déconnexion de la sphère réelle et de la sphère financière ne date pas d'hier : on constate une césure au tournant des années 1980.
Avant cette date, la progression du PIB et de l'indice Dow Jones allaient de pair.
Depuis, l'indice du cours des actions a décollé : il a été multiplié par 30 entre les années 90 et 2017, pendant que le PIB américain doublait seulement.
Les délocalisations et les paradis fiscaux ne suffisent pas à tout expliquer.
Le paysage du marché obligataire est au moins aussi inquiétant : lorsque, dans le passé, le taux de croissance de l'économie américaine était de l'ordre de 2,5 %, les taux obligataires étaient d'environ 5 %, comme les taux de la banque centrale. Aujourd'hui, avec la politique inédite des banques centrales menée depuis 10 ans, ils ont chuté à environ 2,5 %, ce qui est quasiment nul si on tient compte de l'inflation.
Ce phénomène est inédit. Est-on dans une situation systémique, c'est-à-dire dans un système où le risque serait structurel ?
Pour évaluer le risque, il faut analyser trois facteurs, car en 1930, comme en 2000, ou en 2008, on retrouve ces trois mêmes symptômes : une très grande abondance de liquidités ; une dette, notamment privée, très élevée ; une insuffisance de la régulation.
Concernant le premier point, j'ai retrouvé dans les archives de la banque fédérale américaine un texte écrit par le conseil de politique monétaire américain en février 1929. Permettez-moi de vous le lire, car il est parlant. Il y est écrit que « de nombreuses années d'expérience ont montré que les augmentations de crédit au-delà des besoins de l'économie conduisent normalement à des résultats malheureux, à des excès spéculatifs, à des hausses de prix, à des bulles, qui se terminent par la dépression ». On était quelques mois avant la crise de 1929...
C'est la conséquence d'années de taux d'intérêt bas. C'est le même processus de cause à effet qui se reproduit quand, en 1996, Alan Greenspan constate que « nous sommes face à une exubérance des marchés financiers ». Il attendra pourtant quatre ans avant d'augmenter les taux, ce qui marquera le début des turbulences. Puis, de nouveau en 2007, la Réserve fédérale a tardé à relever les taux. À chaque fois, on a augmenté trop tardivement les taux d'intérêt.
J'en viens à la question de la dette : que ce soit en 2000, par la dette des entreprises - en France, 4 ou 5 grands groupes ont frisé la faillite -, ou par la dette des ménages américains en 2007, le niveau d'endettement privé est un facteur de crise.
Enfin, la question de l'absence de régulation. En 1929, l'emprise des banquiers sur les régulateurs a été flagrante, ce qui n'est pas sans rappeler la situation d'aujourd'hui. En 2000, c'est l'administration Clinton qui tente de réguler les hedge funds . En 2007 - j'étais alors en fonction de régulateur - subitement la Commission européenne nous demandait d'arrêter le mouvement de libéralisation du système financier, à l'oeuvre depuis 10 ans. C'était alors trop tard...
Considérant ces trois facteurs, le scénario est toujours le même : c'est la hausse des taux qui est le prélude à l'éclatement des bulles. Or, cette façon de faire - une hausse tardive et précipitée des taux - apparaît presque comme une politique assumée.
Le futur président de la banque centrale américaine, Ben Bernanke, n'écrivait-il pas en 2002, certes avant la crise de 2008 : « il y a moins de risque à tarder d'augmenter les taux d'intérêt et à briser la croissance qu'à laisser éclater une crise financière » ?
Où en est-on aujourd'hui en 2019 ? Je vais reprendre chacun de ces éléments, si vous le voulez bien.
Premièrement, la création monétaire. Rappelons que la création monétaire est, traditionnellement, le fruit des prêts des banques commerciales, pilotés par la banque centrale, via la politique des taux d'intérêt.
À ceci s'ajoute, depuis 10 ans, le fait que les banques centrales manient la planche à billets. Est-ce que les banques centrales, si elles étaient restées sous le joug des gouvernements, auraient créé autant de monnaie ? J'en doute... Au début des années 1990, on nous expliquait que le risque, c'était précisément la planche à billets...
Aux États-Unis, le tournant date des années 2015-2017. Les marchés sont devenus hypersensibles aux évolutions des taux : on est dans une période où une hausse, même légère des taux, provoque des turbulences. Par exemple, au mois de décembre, le marché américain de la dette à haut rendement (« high yield ») - celle des entreprises notées BB + ou en dessous - a connu sa plus longue traversée du désert depuis au moins 1995 : 41 jours sans opérations. Or, ce marché représente des montants très importants : 5 000 Md$ aux États-Unis, si on comptabilise les marchés obligataires avec.
Pendant 50 ans, le bilan de la banque centrale américaine était très stable : entre 4 et 6 % du PIB américain. Depuis la crise, on est monté à 22-23 %. La réduction du bilan devient un problème de crédibilité pour la banque centrale. De plus, en cas de crise, sur quoi agir ? Car on ne peut baisser les taux en dessous de 0 ! Ce serait la révolte des épargnants.
À l'heure actuelle, ceci suscite un grand débat aux États-Unis : alors que le déficit budgétaire américain s'alourdit, peut-on poursuivre la baisse des taux ?
En Europe, le bilan de la Banque centrale européenne représente 42 % du PIB. C'est 100 % au Japon et en Suisse, on est proche du hedge fund !
La Suisse est un cas d'école, dont on peine à trouver la logique : d'un côté, la politique budgétaire est systématiquement excédentaire, ce qui fait monter le cours du franc suisse, et de l'autre, la banque centrale indépendante lutte contre la hausse du cours de la monnaie, en achetant toutes sortes d'actifs américains.
Cette situation n'est pas éloignée de celle de l'euro et de l'Allemagne.
En résumé, les politiques des banques centrales aboutissent comme jamais dans le passé à créer de la liquidité. Or, où va cette liquidité excédentaire par rapport aux besoins du marché ? Sur des marchés spéculatifs. C'est bien connu « la finance travaille pour la finance ».
Venons-en à la question de la dette. Un économiste américain, Hyman Minski, rappelait dans les années 1980 que « dans les périodes d'euphorie, on oublie la dette. C'est dans les périodes de crise que les investisseurs prennent conscience du problème ».
Sur ce sujet, les rapports du FMI depuis quelques années sont extrêmement bien faits, même s'ils sont inquiétants : la dette publique est passée de 70 % du PIB en 2000 à 107 % il y a 2 ans. C'est un bond spectaculaire.
Je constate depuis trente ans qu'il existe un cercle diabolique entre les crises financières et la dette. Dans les périodes de crise, on relance l'endettement public, les banques centrales baissent leurs taux pour y faire face et ainsi de suite. En France, on était encore aux alentours des critères de Maastricht en 2007.
Je pense que le niveau de la dette publique actuel est dangereux pour la stabilité financière, le volume de la sphère financière n'est plus tenable !
Les chiffres de la dette privée sont également alarmants : aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Chine et en Corée.
En France, la dette immobilière a atteint 1 000 milliards d'euros : soit un doublement depuis 2008, un quadruplement depuis 2000 ! Quand on sait que ces crédits sont accordés au taux de 1,5 % avec une durée moyenne de 20 ans, cela laisse rêveur... Et au Canada, c'est le double !
Aux États-Unis, même si on retire les GAFA, qui faussent un peu les chiffres, la dette des entreprises reste très élevée : elle est plus importante qu'en 2016. Je vous renvoie pour les chiffres aux tableaux du FMI.
J'en viens enfin à la régulation. Incontestablement, depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et même en mettant à part les huit grandes banques américaines davantage surveillées que les autres, on a reculé sur le domaine de la supervision. Tout est interprété de manière très souple : la règle qui interdisait aux banques de faire de la spéculation, le respect des ratios, les stress-tests, etc.
En Europe, séparons la question des banques de celle des marchés financiers.
En ce qui concerne les banques, pour moi, le tournant date de l'automne 2017 : on a alors renoncé définitivement à la réforme dite « Barnier » du nom de l'ancien ministre Michel Barnier qui proposait une séparation des activités des banques et une filialisation des activités les plus risquées. Ce qu'y ont vu les banquiers, c'est seulement que la filialisation des activités allait engendrer une hausse des coûts de financement, ce qui allait entraîner la réduction des volumes traités.
Le 26 juin 2004, à Bâle, la réunion des gouverneurs de banque centrale, sous la gouvernance de Jean Claude Trichet, donnait aux banques deux « permissions » pour ouvrir les possibilités de crédit : en pondérant le risque en fonction de la qualité du crédit, et en les autorisant à utiliser leurs modèles internes pour calculer leur risque. Cette réforme donnait en réalité tout pouvoir aux agences de notation.
En 2017, on a voulu revenir sur cette réglementation, mais le lobby des banques a été si fort que la réforme s'est faite à minima : d'ici 2027, les banques ne pourront pas s'éloigner de 27,5 % du chiffre calculé par le régulateur. Ce qui laisse encore tout pouvoir aux banquiers.
Je termine ce propos liminaire en évoquant la question du marché des quotas de carbone. Je vous rappelle que la taxe carbone ne s'applique pas à la grande industrie polluante, mais seulement aux particuliers. Depuis 3 ans, une réserve des quotas de carbone a été créée pour faire remonter les cours autour de 20 euros, ce qui est plutôt positif, mais il me semble invraisemblable qu'aujourd'hui, on taxe les ménages et pas la grande industrie polluante !
Ne serait-il pas temps d'arrêter cette distribution gratuite de quotas de carbone à la grande industrie polluante ? Cela me semble une évidence. Ils ont pourtant été reconduits jusqu'en 2030 ! Ne serait-il donc pas temps de repenser le marché au niveau européen ?
En conclusion, je dirai que la seule question valable ne consiste pas à se demander : que ferait-on en cas de nouvelle crise ? Mais bien comment l'anticiper pour la prévenir ? Les solutions, on les connait, et elles sont relativement faciles à mettre en oeuvre, mais encore faut-il le vouloir ! La zone euro reste extrêmement fragile, l'Italie notamment aurait beaucoup de mal à se remettre d'une nouvelle crise.
M. Pierre-Yves Collombat . - Le sous-titre de votre dernier ouvrage « La prochaine crise financière sera pire qu'en 2008 » est très clair. Il semble que certains banquiers centraux n'aient pas compris cela. On entend en effet dire que « tout est sous contrôle » depuis la mise en oeuvre de la réglementation de 2008 : obligation de fonds propres, ratio de levier, etc. Mais quand on y regarde de près, ces « filets » de sécurité ont des trous bien larges et les marges de manoeuvres restent dans les mains des banques, sans compter les établissements cachés qui fleurissent hors de la réglementation (plateformes d'échanges, produits dérivés), si bien que le risque systémique semble plutôt se déplacer que se réduire.
Deuxièmement, en matière financière, on peut se demander s'il y a un pilote dans l'avion. Dans votre livre, vous dites justement que, lors de la prochaine crise, ce ne sont pas les banquiers, mais les hommes politiques qui seront montrés du doigt. Tout se passe comme si les régulateurs pilotaient à vue : le marché s'autorégule gentiment. Vous dites d'ailleurs également qu'on pense « qu'en régulant les banques, on régulera la finance », sauf que ce n'est pas comme cela que cela marche.
Troisièmement, on a l'impression que deux sphères coexistent désormais ; la sphère financière d'un côté, l'économie de l'autre. Cela me fait penser à cette image de la charrette tirée par des boeufs, qui transporte des missiles transcontinentaux - c'était à l'époque de l'ex-URSS - mais elle convient aussi aujourd'hui pour symboliser ce qui se passe dans la sphère financière : la grande lessiveuse de la finance plombe l'économie réelle.
La part des crédits aux entreprises dans le bilan des banques est réduite à la peau de chagrin, et c'est sans parler de la spéculation immobilière !
Prenez BNP-Paribas en 2007 : 107 milliards de fonds propres et 40 milliards de valorisation boursière, ce qui veut dire qu'elle vaut moins que ses fonds propres ! Que peut-on en déduire ?
Mme Christine Lavarde . - À l'occasion de l'examen de la loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), le Sénat a voté un amendement que j'ai déposé qui permet la transférabilité des assurances-vie après une période de huit ans, de manière à venir contrecarrer le monopole actuel des banques.
L'idée est aussi de pouvoir mobiliser ces fonds au service de l'économie réelle, et non, comme c'est le cas aujourd'hui, au profit de la sphère financière. Autant vous dire que les pressions ont été fortes pour que je retire cet amendement...
Mme Michèle Vullien . - Mais comment faire pour que l'économie réelle reprenne le pas sur l'économie spéculative ? Vous avez été un grand banquier, vous devez avoir des idées ? La délégation a eu l'occasion de réfléchir sur le rôle de l'État stratège en matière de développement industriel. Comment orienter la richesse vers l'industrie ?
M. Jean Michel Naulot . - Concernant le transfert de l'assurance-vie, je pense que c'est un amendement excellent, non pas en tant qu'ancien banquier, mais en tant que citoyen, il me semble que si j'avais un contrat d'assurance-vie auprès d'une grande banque en difficulté, cela me rassurerait de savoir qu'il peut être repris par un autre opérateur sain.
Et d'ailleurs, pourquoi huit ans ? Aujourd'hui, avec la flat tax , cela n'a plus lieu d'être.
Mme Christine Lavarde . - C'est pour les anciens contrats.
M. Jean Michel Naulot . - Que la pression soit très forte ne m'étonne pas, ce qui m'étonne par contre, c'est la solidarité des banquiers centraux avec ces lobbies.
Concernant la spéculation boursière, rarement l'écart a été aussi important.
Vous citez BNP-Paribas, mais regardez la Deutsche Bank : 60 milliards de fonds propres et autour de 15 milliards de valorisation boursière. C'est un indice très important du fait qu'il y a un malaise.
Tout le système bancaire repose sur la confiance. À Jacques de la Rosière à qui je posais récemment la question de savoir s'il y avait une limite à l'action des banques centrales, il me citait Keynes, selon qui la seule limite est la question du retournement de la confiance.
C'est la même chose pour les banques : quand la capitalisation boursière s'éloigne trop de la valeur, c'est que les gens ont perdu confiance, c'est inquiétant en soi.
Concernant la question de l'équilibre à retrouver entre l'économie réelle et la finance, on voit bien à quel point, par contraste, on est entré dans ce que Philippe Séguin a été le premier à appeler le capitalisme financier dans les années 1990.
Dans le monde de l'entreprise, on a vu les actionnaires sortir de leur rôle dans le courant des années 1980 : ils sont passés de contrôleur du management à gouverneur de leur entreprise. Ils en ont pris la direction !
Dans un capitalisme industriel qui fonctionne bien, le management poursuit l'enrichissement collectif au sein de la société. Aujourd'hui, le management et les actionnaires font corps commun, au profit de leur propre enrichissement. C'est un pervertissement.
Alors, quelles solutions ? Il me semble qu'il en existe, de relativement simple. Il faut agir sur les marchés financiers !
En France, tout se passe comme si on n'écoutait que les gens qui s'intéressent aux banques, comme Jean Tirole, économiste français, président de la fondation Jean-Jacques-Laffont - Toulouse School of Economics, directeur scientifique de l'Institut d'économie industrielle à Toulouse et membre fondateur de l'Institute for Advanced Study in Toulouse par exemple.
D'autres, comme Michel Aglietta, un économiste qui propose des solutions pour réguler les marchés financiers, sont très peu entendus. Il avait notamment produit un remarquable rapport en 2007 sur les hedge funds .
Et pourtant, des dizaines de mesures pourraient, rapidement, réduire le volume de la finance : car c'est la seule solution - réduire le volume !
Prenons les hedge funds : ils sont tous, sans exception, domiciliés dans les paradis fiscaux et on a renoncé depuis 2008 à plafonner leurs effets de leviers. Voici deux mesures efficaces : limiter l'effet de levier à 5 ou 6, et domicilier le hedge fund là où le gérant exerce son activité, c'est-à-dire à Londres et à New York.
Idem pour le trading à haute fréquence : si vous vous mettez à facturer les ordres annulés, vous en ferez drastiquement chuter le volume, car c'est devenu une méthode.
Pour les produits dérivés, on peut forcer tous les produits dérivés à passer par des chambres de compensation : vous réduisez aussitôt tous les produits non liquides.
Ainsi, vous écrivez une page de dix mesures simples.
Cela rejoint la question du pilote : comment dialoguer quand vous avez autour de la table un Donald Trump ?
En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on ne mesure pas à quel point les banques centrales sont entrées dans le jeu des marchés financiers.
Accroissement des liquidités en circulation et creusement des inégalités depuis 30 ans : voici le paysage actuel, John K. Galbraith l'avait déjà décrit dans les années 30. Avant la crise, une petite minorité profite de la situation et ensuite, ce sont les classes moyennes qui paient. L'emprise des riches sur le système aboutit à un dérèglement du système.
Joseph E. Stiglitz l'a bien montré : l'absence d'augmentation du pouvoir d'achat des classes moyennes est un symptôme.
Il y a évidemment un lien entre les taux bas et l'envolée de la dette : on pousse les gens à s'endetter. On a tendance à sous-estimer l'effet des politiques des banques centrales sur le pouvoir d'achat et sur la financiarisation du système.
M. Roger Karoutchi . - Je vous remercie.
III. AUDITION DE M. BERTRAND BADIE, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS À L'INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Jeudi 7 mars 2019
M. Roger Karoutchi, président . - Nous avons le plaisir de recevoir ce matin, dans le cadre de l'actualisation du rapport de M. Pierre-Yves Collombat sur la crise financière - qui, en 2017, avait fait exploser les compteurs dans l'hémicycle et les milieux financiers... - M. Bertrand Badie, agrégé de sciences politiques, professeur à Sciences Po et enseignant -chercheur au centre d'étude des relations internationales. M. Badie est l'auteur de très nombreux ouvrages et le directeur de la collection « L'état du monde » aux éditions La Découverte, dont le dernier numéro, pour 2019, s'intitule « Le retour des populismes ».
Il se trouve que le populisme est un élément central de la réflexion en cours de Pierre-Yves Collombat sur la crise financière : les populismes sont-ils une conséquence ou une cause de la déstabilisation financière ? Votre analyse, monsieur le professeur, nous intéresse donc particulièrement. Je laisserai notre rapporteur réagir en premier à votre exposé introductif, puis je donnerai la parole à nos collègues présents.
M. Bertrand Badie, professeur des Universités à l'Institut d'études politiques de Paris . - Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour évoquer ce sujet éminemment complexe. J'entrerai directement dans le vif du sujet. Chez les politologues, le terme de populisme a toujours fait peur à tout le monde. C'est typiquement le problème à soumettre à un étudiant que l'on a envie de coller à un examen ! C'est un mot indéfinissable, pour la raison classique qu'il mêle vocabulaire scientifique et vocabulaire polémique, et croiser les deux est toujours risqué. Il renvoie en outre à des séquences historiques diverses dont il est difficile de dégager des racines communes.
Écartons pour commencer certaines idées reçues : le populisme n'est ni une idéologie politique, ni une doctrine, ni un programme, ni une politique publique. Il ne désigne pas, contrairement à ce qu'on lit fréquemment dans la presse, un régime politique, non plus qu'un système politique. Que reste-t-il, dès lors ? Je suis un vieux durkheimien, et invoquerai volontiers mon maître pour parler de pathologie populiste. Mais attention : le mot pathologie n'est pas dans la bouche de notre grand sociologue une injure, et les populistes ne sont pas des malades ! Durkheim désigne par ce terme une dysfonction profonde de la société ou du système politique, suffisamment grave pour avoir des répercussions communes et durables sur l'ensemble de la société et du système politique. Derrière l'hypothèse populiste se cache donc une crise de confiance à l'égard des institutions. C'est une pathologie politique grave, ce moment où s'opère une coupure profonde entre les gouvernés et les gouvernants, ce dernier terme désignant aussi bien les personnes que les institutions.
Pour le politologue, cela implique d'orienter les recherches sur des situations. Il y a en effet des situations populistes, desquelles dérivent des techniques de mobilisation populistes. Ces techniques, au passage, peuvent être de gauche comme de droite : le FPÖ autrichien est un parti populiste ultralibéral sur le plan économique, alors que certains partis populistes scandinaves sont nettement interventionnistes.
Qu'est-ce qui peut provoquer cette crise de défiance des gouvernés à l'égard de leurs institutions, qui se transmettra ensuite au personnel politique ? Distinguons une crise de légitimité d'une crise de l'efficacité - l'une renvoyant souvent à l'autre. La crise de légitimité est une crise de décalage. Elle survient par exemple lorsque les institutions ne sont plus en prise avec les éléments culturels de la population. Les pays récemment décolonisés ont ainsi connu, juste après les indépendances, des mouvements populistes extrêmement forts incarnés par Gamal Abdel Nasser, Kwame NKrumah, Patrice Lumumba, Soekarno, ou encore Jawaharlal Nehru. La crise venait alors de l'incompréhension de la population face à des institutions importées. Le décalage entre la population et les institutions peut aussi être historique, lorsque ces dernières semblent dépassées. La crise d'efficacité renvoie à l'hypothèse d'une crise économique et sociale - songez aux années 1930 - ou d'une crise de l'environnement international. Celui-ci, en réalité, joue souvent le rôle le plus important : l'accusation de l'étranger est alors, en quelque sorte, le nerf de la crise.
Nous avons connu quatre vagues de populisme. La première, fondatrice, date de la fin du XIX e siècle et submerge simultanément les États-Unis, la Russie et la France. Lorsque le capitalisme bancaire restructure l'économie américaine, qui était jusqu'alors rurale, les paysans, du Middle-West en particulier, se sont sentis menacés. Cela s'est traduit par une très forte défiance à l'égard des institutions politiques et la création d'un parti populiste, le people's party , dont le candidat a failli remporter l'élection présidentielle - tout cela évoque la situation de M. Trump - ainsi que par le sentiment d'un environnement international hostile. La même chose se produit au même moment en Russie : la vieille paysannerie, base sociale de l'empire tsariste, s'est senti menacée par le développement d'un capitalisme préindustriel et le mouvement d'occidentalophilie défiant alors les slavophiles - là aussi, les facteurs internes et externes se mêlent. En France, le boulangisme procédait de facteurs analogues, internationaux surtout, car ce n'est pas tant la légitimité des institutions politiques qui était en cause - la III e République était encore jeune - que la difficulté à digérer l'humiliation de la défaite de 1870. Le boulangisme est d'abord affirmation patriotique et désir de revanche.
Une deuxième vague nous a touchés dans l'entre-deux-guerres. Les historiens débattent encore de l'impact de la crise économique des années 1930 sur la naissance du fascisme et du nazisme. Or cette crise est postérieure à l'apparition du fascisme italien, qui naît plutôt de la frustration de la victoire, souvent pire que la défaite - et que l'on observe aussi au Japon. Le nazisme, lui, ne résulte pas moins de l'effondrement économique que - je vais vous choquer - du refus de Clemenceau d'asseoir l'Allemagne à la table des négociations de paix, fait sans précédent dans la culture diplomatique européenne. Ce refus a alimenté en Allemagne la défiance à l'égard des institutions, jugées incapables de protection contre l'étranger.
La troisième vague de populisme, après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas affecté l'Europe, sauf si l'on range dans cette catégorie le bref mouvement poujadiste - qui ressemble assez à l'antifiscalisme que nous voyons dans la rue actuellement en France. Pour l'essentiel, cette troisième vague se joue dans ce que l'on appelait alors de façon méprisante le tiers-monde, dans quasiment tous les pays qui ont alors accédé à l'indépendance. Elle prend de l'ampleur à partir de la dénonciation d'institutions inefficaces, illégitimes et incompréhensibles, et prend la forme de l'apologie d'un leader. L'Amérique latine est à cheval entre la deuxième et la troisième vague : le populisme qui y émerge dès les années 1930 se prolonge après la Seconde Guerre mondiale. Songez par exemple au gétulisme au Brésil ou au péronisme en Argentine, qui sont essentiellement des réactions à l'omniprésence américaine et au sentiment d'être dépossédé de sa souveraineté par les États-Unis. Le péronisme est d'abord un antiaméricanisme, le gétulisme est une résistance forte contre la tutelle américaine - sous ce rapport, la présidence de M. Bolsonaro est intéressante...
La quatrième vague, que nous observons actuellement, a plusieurs particularités. D'abord, elle est universelle. C'est la première fois que l'on peut identifier un dénominateur commun à toutes les expériences politiques dans le monde. Et non seulement le populisme parvient au pouvoir, ce qu'il n'était pas parvenu à faire à la fin du XIX e siècle, mais il inverse l'hégémon pour contester l'ordre du monde et la mondialisation. Voilà en effet le bouleversement du monde que nous ne savons pas regarder en face : depuis un an et demi, les États-Unis sont devenus la première puissance contestataire mondiale, et c'est une révolution absolument considérable, et le sera davantage encore si M. Trump est réélu en 2020 ! Outre les États-Unis, signalons le cas de la Russie, de la Turquie, ou encore des Philippines, dont le président Duterte a traité le Saint-Père de « fils de pute » - je me permets de le citer pour illustrer l'incroyable exceptionnalisme populiste, qui se permet tout : jamais Staline ni Hugo Chavez n'auraient parlé ainsi !
Deuxième caractéristique : ce phénomène accomplit profondément la geste populiste en cela qu'il se cristallise autour d'une même accusation, celle de la mondialisation. Et cela se comprend, car comment imaginer qu'un système politique puisse passer de l'ère interétatique à la mondialisation sans changer profondément ses institutions ? La question de la démocratie se pose dès lors avec acuité en Europe. Qu'il évoque les enjeux économiques, sociaux, politiques ou diplomatiques, le populisme, agent pathogène certes inconscient de ce qu'il fait, nous place face au grand enjeu de notre millénaire : l'inadéquation des institutions politiques existantes à la mondialisation. Luc Rouban a mené une enquête pour Sciences Po qui montre que 82 % des personnes déclarant soutenir les gilets jaunes - car sur les gilets jaunes eux-mêmes, on ne peut guère enquêter - ont une vision négative de la mondialisation. Or nos institutions ne nous défendent pas contre la mondialisation, en laquelle nous ne voyons donc que délocalisations, commerce international et vulnérabilité de notre appareil industriel.
On peut encore définir le populisme par un mode de mobilisation. Un homme politique populiste tentera de tirer avantage de la peur populiste. Les relais institutionnels étant cassés, il misera sur une mobilisation autoritaire et anti-institutionnelle, c'est-à-dire dirigée contre les parlementaires ou les partis politiques. Cela se traduit par une prime au chef - je ne les énumérerai pas pour ne pas mettre dans le même panier Adolf Hitler, Donald Trump ou Marine Le Pen. Quoi qu'il en soit, le charisme du chef est opposé aux logiques institutionnelles. Le populisme se traduit encore par un renouvellement des modes de communication, faisant plus de place à la mobilisation de masse.
À partir du moment où les fils institutionnels sont mis à nu, où tout se cristallise sur la dénonciation des médiations, c'est l'identité qui sert de point de ralliement, et sur un mode radical puisqu'elle est elle-même désinstitutionnalisée. Comptant douze nationalités dans ma famille, je suis fier d'appartenir à une nation dont l'identité est institutionnelle - droit du sol, principe de nationalité... - et pourvu que ça dure, mesdames et messieurs les législateurs ! En situation populiste, cette conception politique, noble, contractuelle, du politique, se trouve défiée par les anticorps ethnico-religieux. Cela prend des formes extrêmement diverses, celle de la revendication de particularismes régionaux par exemple. Je suis ainsi frappé de voir des drapeaux régionalistes dans les cortèges de gilets jaunes. Tout ceci aboutit à reconstruire, en guise de substitut à des institutions méprisées et délaissées, une nation identitaire fondée sur le repli, qui est la négation de la nation d'origine, émancipée de l'absolutisme, des empires ou des puissances coloniales par la conquête de droits pour le peuple. C'est ainsi que le migrant devient le bouc-émissaire commode, alors que migration et mondialisation sont l'avenir du monde - et c'est ainsi fort bien ! Bref, le populisme reconstitue le mythe identitaire fondateur en base positive, productrice d'une nouvelle utopie - régressive en l'espèce : Europe chrétienne ou quête des racines françaises.
Ainsi, la mobilisation populiste, issue d'une pathologie originaire, bouleverse complètement les paramètres de notre système international.
M. Roger Karoutchi, président . - Merci pour cette présentation. La vague actuelle de populisme n'est-elle pas davantage que les précédentes liée à la mondialisation, en raison de l'accélération des déplacements, de la financiarisation et de la mondialisation de l'économie ? Autrement dit, le refus de la mondialisation n'est-il pas lié à la vitesse excessive de cette mondialisation ? Ne se nourrit-il pas de notre incapacité à freiner ou réguler la mondialisation des échanges et de l'information ? En période de crise, les gens veulent des coupables mais n'en trouvent pas ; par conséquent, c'est la Terre entière qui prend ! Voyez-vous, les gens ne refusent pas la mondialisation de Coca-Cola ou de Walt Disney, mais celle de l'entreprise qui ferme leur usine. Dans les années 1970, on se réjouissait de la mondialisation, prometteuse pour les débouchés de notre agriculture et l'ouverture de notre jeunesse étudiante. Aujourd'hui, la mondialisation est largement perçue comme négative. On peut certes réguler les marchés financiers, mais on ne peut décemment fermer les réseaux ou interdire les échanges. Je résume ma question : que peut réellement faire le législateur ? Baisser la tête et laisser passer la vague ?
M. Bertrand Badie . - Toutes les vagues de populisme ont une cause internationale : la première mondialisation, la Première Guerre mondiale, la décolonisation, la mondialisation actuelle. Or le citoyen est rarement en prise directe sur l'international ; c'est donc aux institutions de servir de filtre, et il est des périodes dans lesquelles ce filtre ne fonctionne pas. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de crise en Europe entre 1945 et la période actuelle ? Parce que pendant la guerre froide, ce filtre fonctionnait. Ce n'est plus le cas.
En quoi consiste ce filtre ? Conduire le changement, mais l'adaptation à la mondialisation n'a pas été conduite. Deux autres éléments jouent à très court terme. En premier lieu, l'éducation politique et la socialisation à la mondialisation. La mondialisation a été considérée comme un épouvantail ! Je dis toujours à mes étudiants que la mondialisation, c'est aussi l'éradication de la variole en Afrique par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La mondialisation, c'est comme le cholestérol : il y en a une bonne et une mauvaise, et on ne parle que de la seconde. En second lieu, le déni du réel. Nous faisons comme si nous en étions encore à l'époque de la bataille de la Marne, ce qui aboutit à des échecs, forcément mal digérés par nos compatriotes. Je reconnais à cet égard au président de la République un certain courage : voilà l'unique candidat à la présidentielle de l'histoire politique française à s'être présenté sous une banderole favorable à la mondialisation, et à l'avoir défendue à la tribune de l'assemblée générale des Nations unies en septembre 2017 et en septembre 2018. Le problème, c'est qu'un océan de discours allait alors en sens contraire...
En matière de gouvernance globale, il y a beaucoup de choses à faire, et d'ailleurs plein de choses ont été faites. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, mais dans la mondialisation, de nombreux trains arrivent à l'heure : l'OMS a fait un travail formidable, de même que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation (FAO). Songez que le nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim est resté stable ces cinquante dernières années, à 850 millions, quand la population mondiale doublait. Et je ne dis rien des communications et des transports. Le bilan de la mondialisation est ultra-favorable ! Mais la grande erreur - déni du réel - a été de confondre mondialisation et ultralibéralisme, comme s'il fallait passer par la punition ultralibérale pour s'insérer dans la mondialisation. Or non, une autre mondialisation est possible, qui passe par la régulation, la solidarité - je retrouve mon maître Durkheim -, l'approfondissement du multilatéralisme, la réduction mondiale des inégalités ou encore la sécurité humaine, ce concept créé par le PNUD en 1994 pour regrouper les sécurités alimentaire, sanitaire, environnementale, économique, individuelle, culturelle et politique. Hélas, personne ne connaît cette notion, pourtant beaucoup plus importante que la dénonciation du traité Intermediate nuclear forces (INF), qui n'a plus aucune importance sur le plan géopolitique.
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Vous connaissez la première phrase du Manifeste du parti communiste de Marx : « Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme ». Aujourd'hui, c'est du populisme qu'il s'agit. Et pour éloigner les fantômes, les injures ont remplacé les fumigations d'encens : xénophobes, antisémites, leur lance-t-on ! Hitler viendra chercher ceux qui ne votent pas bien, ajoute-t-on parfois ! J'ai apprécié que vous dépassiez ces procédés, dans votre livre, pour tenter de trouver des éléments communs aux phénomènes populistes.
Mais vous semblez hésiter entre deux explications fondamentales : d'une part, la convergence fortuite de causes occasionnelles et locales, d'autre part, l'absence d'institutions adaptées à la mondialisation, nouveauté inéluctable, irrésistible et orientée dans le sens de l'Histoire... Or ce n'est pas la première mondialisation, Karl Polanyi l'a montré en long, en large et en travers. Et il faudrait, dites-vous, trouver les institutions correspondant à la mondialisation, mais comment ? Avec quelle souveraineté ? Peut-on seulement agir sur les institutions sans restaurer les souverainetés nationales, les seules que nous connaissions ? Au fond, si nous ne sommes pas adaptés à la mondialisation, c'est que nous serions arriérés, ou opposés à l'avenir... Les choses, je crois, sont plus compliquées que cela, et ce qui se passe est peut-être l'inverse de ce que vous décrivez.
M. Yannick Vaugrenard . - Je commencerai pour ma part en citant Jaurès : « Le courage est de chercher la vérité et de la dire ». C'est, d'une certaine manière, ce que vous avez commencé à faire. La mondialisation n'est pas un point de vue mais un constat. La seule question qui se pose est celle de savoir que faire avec. Or voilà des années que nos responsables politiques ont refusé de dire la vérité à nos concitoyens : nous n'avons plus les mêmes pouvoirs politiques et économiques qu'il y a quarante ou cinquante ans. La mondialisation a bien sûr parfois des aspects positifs, et vous les avez évoqués, mais ne devons-nous pas dire à nos concitoyens que nous devons intervenir aux niveaux européen et mondial - à l'ONU, à l'OMC ou à l'OIT - pour être plus fort ? Nous serions inspirés de rabattre un peu notre fierté, celle du coq qui nous sert d'emblème, qui chante haut mais a les pieds où vous savez...
Il est cependant faux de dire que nous ne pouvons plus rien faire au niveau national. Dans un même pays, les inégalités et injustices sociales et territoriales subsisteront toujours, indépendamment de la mondialisation. Or ces inégalités-là, le politique peut les réguler - limiter les écarts de revenus par exemple. Il ne cesse donc pas d'être efficace.
M. Bertrand Badie . - Mon métier consiste précisément à chercher à identifier les causes des phénomènes, globales ou individuelles. C'est donc un compliment que vous m'adressez, monsieur le rapporteur, car la rigueur scientifique exige d'hésiter entre cause locale et cause globale !
Je vous rejoins sur le fait que la première vague populiste était liée à la première mondialisation : je l'ai précisé. Discutons à présent du remède, mais soyons modestes car, même en médecine, toutes les pathologies ne se guérissent pas. Or je crains que la pharmacie politique ne contienne pas encore le remède contre le populisme. Je prendrai toutefois votre balle au bond à propos de la souveraineté nationale : je crois que la notion de souveraineté a changé de sens depuis le XIX e siècle, et j'ai très peur des discours souverainistes qui considèrent la souveraineté actuelle comme au temps de Louis-Philippe.
S'il est vrai que la souveraineté nationale reste une matrice, tout l'art politique consiste à lui faire tirer les conséquences des transformations du contexte international, et ce n'est pas nouveau. Et cela n'a hélas pas été fait au moment opportun, dans les années 1960 ou 1970. Je pense qu'en France, l'homme qui a le mieux compris ce nouveau contexte est le général de Gaulle, qui avait en effet vu dès son arrivée au pouvoir que l'avenir du système international ne se jouait pas sur la pérennisation du clivage est-ouest, mais dans le rapport nord-sud. D'où sa politique arabe, son voyage en Amérique latine ou la reconnaissance de la Chine. Or ce travail n'a pas été poursuivi ! Il est tout de même extraordinaire que, pour résoudre les crises mondiales, nous ne soyons pas capables de construire un partenariat avec la Chine, qui est tout de même la puissance déterminante de l'avenir. J'ai souvenir d'une réception à l'ambassade de Chine en octobre 2017 au cours de laquelle l'ambassadeur de Chine avait salué le caractère exemplaire des relations franco-chinoises, car le président Macron, depuis son élection, s'était entretenu cinq minutes au téléphone avec le président Xi Jinping... Manière très diplomatique de dire que quelque chose ne va pas ! Bref, il aurait fallu mettre la souveraineté nationale davantage en marche - sans jeu de mots, bien sûr.
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Mais la souveraineté n'a aucun sens dans un système libéral !
M. Bertrand Badie . - Ne confondons pas la souveraineté comme positionnement d'un système politique donné dans le système mondial, et la souveraineté nationale comme expression et moteur de la volonté politique d'une nation.
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Si le régulateur de la société est le marché, ce ne peut être une nation !
M. Bertrand Badie . - Nous ne sommes pas dans un monde ultralibéral à ce point. Ce n'est pas le marché qui a aboli la peine de mort...
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Mais c'est l'objectif !
M. Bertrand Badie . - Le poison est ce concept de démondialisation, qui ne veut rien dire. Cela me fait penser à la débrouettisation, qu'aurait revendiquée les gens craignant l'arrivée de la brouette... La mondialisation est un processus qui échappe à tout le monde, et qui est d'ailleurs plus technologique qu'économique. Il faut savoir non seulement s'y adapter, mais la façonner, car elle est façonnable. Certes pas par un seul État, ni même par l'Europe seule, mais l'Europe peut bien davantage que la France. L'intégration régionale observable partout dans le monde, en Europe comme en Asie et en Amérique latine, résulte de la conscience que le cran intermédiaire permettant d'avoir un début de prise sur la mondialisation est l'échelon régional. Le problème, c'est qu'il est gravement mis en péril par la fièvre populiste. Je défends également le multilatéralisme, capable, fort et qui a fait beaucoup de choses : pourquoi le laisse-t-on de côté ? Je vous invite à relire la formidable déclaration du millénaire de Kofi Annan, qui contient absolument tout sur le bon usage du multilatéralisme dans la mondialisation.
Je vous rejoins sur les inégalités. L'indice de Gini des inégalités mondiales est de 0,65, ce qui est extraordinairement dangereux. Pour mémoire, au pic de l'inégalité dans les nations européennes à la fin du XIX e siècle, l'indice de Gini s'élevait à 0,45 ou 0,5... Autrement dit, entre un Burundais, qui gagne 330 dollars par an, et un Luxembourgeois qui en gagne 110 000, il y a un fossé explosif, d'autant que ces inégalités sont connues de tous. Le traitement des inégalités nationales est certes à notre portée, à condition de les insérer dans une politique cohérente, car il ne peut y avoir une politique nationale et une politique sociale globale. Or pour l'instant, on ne sait pas tricoter les deux. C'est comme un cancer, qu'on ne peut traiter indépendamment des autres parties du corps. Dans son formidable livre sur les inégalités mondiales, Branco Milanovic, ancien chef économiste de la Banque mondiale, explique magistralement que la mondialisation a profité au centile de la population mondiale la plus riche et aux classes moyennes asiatiques, et conduit à l'appauvrissement des classes moyennes occidentales. Pire encore est la perception qu'en ont ces dernières, qui se voient totalement ruinées.
M. Jean-Luc Fichet . - Merci pour la qualité de votre intervention. Vous avez dit que les plus favorables aux gilets jaunes étaient à 82 % réticents à la mondialisation. J'ai eu le sentiment, pour en avoir rencontré, qu'une minorité sachante manipulait une majorité utilisatrice des réseaux sociaux mais relativement ignorante et que la précarité économique conduisait à tenir un discours antiparlementariste et, pour ainsi dire, anti-tout. Leur expliquer notre fonctionnement politique permet cependant parfois de dissoudre quelque peu les oppositions. J'en ai conclu que les réseaux sociaux trompaient les gens, et que nous avions de la pédagogie à faire.
Je crois aussi que le populisme s'alimente de petites choses, notamment des petites phrases de dirigeants. Dire que certaines personnes ne sont rien ou que les gens n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un emploi crée une humiliation terrible. Un ministre de l'économie a même dit aux gens habitant à dix kilomètres de chez moi qu'ils étaient des illettrés ! Voilà ce qui alimente le populisme.
M. Jean-Raymond Hugonet . - Je mesure la chance que nous avons de participer à une heure si matinale à des échanges aussi intéressants. Vous avez mis le doigt, Monsieur Badie, sur un point important : le rôle de la pédagogie. Notre peuple en a plus que jamais besoin, et vous avez tordu le cou à des idées reçues avec un grand talent.
Vous avez employé l'expression délicieuse d'utopie régressive. Dans l'Essonne, nous en avons un éminent pourvoyeur : Nicolas Dupont-Aignan, qui est un homme fin et intelligent, capable de dire ce qu'il faut pour capter sa clientèle. Comment analysez-vous l'évolution de ces utopies régressives ? Madame Le Pen, par exemple, ne parle plus de la sortie de l'euro, car qui peut désormais contester que l'euro ait été un bien pour nous, Français ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Moi !
M. Bertrand Badie . - Vous posez le problème de la communication politique, qui est, dans notre pays, profondément malade. Lassé de me faire traiter de « cosmopolite circoncis » sur les réseaux sociaux, je pense d'ailleurs qu'il y a lieu de légiférer sur la question. L'anonymat, qui permet de dire tout et n'importe quoi, est très dangereux. Nous sommes hélas entrés dans un monde de fake news , ce qui est absolument destructeur. L'ennui est que celui qui l'a le plus dénoncé en est le plus grand producteur, mais c'est un autre problème... Autre chose sont les petites phrases, qui font partie de la communication moderne. La une de presse qui montre Poincaré visitant un cimetière de poilus et qui pose la question de savoir s'il rit ou est aveuglé par le soleil n'a pas créé de mouvement d'opinion. Aujourd'hui, la moindre petite phrase est répétée, disséquée et amplifiée. Il y aurait un livre à écrire - en deux volumes, donc, pour ne pas les confondre - sur les effets désastreux des fake news, et des petites phrases... Les comportements politiques et sociaux se forment désormais davantage sur la superficialité que sur la délibération. Or la démocratie, c'est la délibération, qui suppose d'entrer dans la profondeur des sujets, soit le contraire des petites phrases !
Un autre élément me frappe : le rôle des imaginaires sociaux, qui ont été absolument bouleversés en quelques années. Quand j'étais jeune, l'imaginaire était national, local aussi, mais à peine européen. L'imaginaire est désormais mondial, ce qui permet d'expliquer le djihadisme, par exemple. C'est ainsi que le monde se structure. Mireille Delmas-Marty, cherchant à concevoir un système normatif adapté à la mondialisation, a identifié des imaginaires contemporains : l'utopie du marché, le tout-numérique, l'utopie de la terre mère, de l'empire-monde, ou ce qu'elle appelle encore l'imaginaire des poètes. Le grand problème, c'est que nous n'en délibérons pas, et n'essayons pas de fixer notre imaginaire pour les décennies à venir. Les utopies régressives gagnent lorsque nous ne réussissons pas à construire des utopies projectives. Le grand succès de l'Europe au XIX e siècle est dû au fourmillement d'utopies : communiste, socialiste, anarchiste, libérale... Le XX e siècle, lui, a été utopicide. Le panarabisme, le panafricanisme ont été tués dans l'oeuf, ce qui a conduit à la faillite du tiers-monde. Au monde islamique comme ailleurs, le monde occidental arrogant a expliqué que le choix n'était pas permis. Résultat : n'a subsisté que l'utopie du retour à l'islam de l'âge d'or, du VII e siècle, portée par les Dupont-Aignan du monde musulman.
La responsabilité du personnel politique est de passer un tiers de son temps à proposer des utopies projectives, c'est-à-dire susceptibles d'accompagner les mutations. L'asphyxie par la pensée unique a désormais atteint un niveau inquiétant. Ce n'est pas Éric Zemmour qui fournira les utopies du XXI e ou du XXII e siècle ! Nous sommes figés dans le déni du réel, c'est notre maladie principale. L'idée que l'Europe n'est plus l'étoile du berger et que le sud est désormais plus riche et plus peuplé que le nord nous est insupportable ; alors, nous allons chercher de nouvelles batailles de la Marne au Tchad ou en Mésopotamie. Ainsi que me le disait un ami au club des vingt hier soir, nous avons une très belle diplomatie mais nous n'avons plus de politique étrangère. Comme disait le général de Gaulle : « Eh bien, monsieur le président, nous mourrons ensemble ».
M. Roger Karoutchi, président . - Sur cet élan d'optimisme, nous vous remercions.
IV. EXAMEN DU RAPPORT
Jeudi 14 novembre 2019
M. Roger Karoutchi, président . - Nous examinons ce matin le rapport de notre collègue Pierre-Yves Collombat qui actualise son précédent rapport de 2017, intitulé : « Une crise en quête de fin. Quand l'Histoire bégaie », qui avait eu un bel écho à l'époque et donné lieu à un débat dans l'hémicycle.
J'ai pris connaissance du rapport dans son intégralité et, comme j'ai pu en discuter avec certains d'entre vous, je ne suis pas d'accord avec toutes les propositions, notamment celles qui ont des implications politiques. Nous connaissons tous les idées de notre collègue Pierre-Yves Collombat.
Cependant, je suis d'avis que ce travail, conséquent, comme nous avons pu le constater, forme un tout : nous n'allons donc pas le détricoter ou l'amender par morceaux.
Aussi, nous trouverons la formule juste, mais, en substance, je vous propose que la délégation autorise la publication de ce rapport dans son intégralité, avec la mention qu'il n'engage que le rapporteur, et qu'il le présente à la délégation à la prospective, mais pas avec son aval. Ainsi, il n'engagera pas l'ensemble de la délégation.
De manière générale, je n'aime pas beaucoup le système qui consiste à donner à un groupe politique un espace, puis à modifier les termes du texte que celui-ci présente dans ce cadre, jusqu'à ce que le groupe en question ne puisse plus voter pour le texte dont il a lui-même demandé l'inscription. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé lors de la réforme constitutionnelle que les textes présentés par un groupe politique soient adoptés ou rejetés d'un bloc, tels quels.
Sous cette réserve, je laisse à présent le rapporteur vous exposer les grandes lignes de son rapport. Je le redis, la publication est une chose, l'essentiel est le débat.
M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - Chers collègues, Monsieur le président, j'adhère tout à fait à votre point de vue : ce rapport ne traduit que mon opinion. C'est d'ailleurs à cela que sert le débat : confronter des opinions différentes, sinon c'est inutile.
Cette introduction à notre réunion ne saurait qu'être brève. Chacun d'entre vous ayant reçu en temps et en heure le rapport, a pu prendre connaissance de son contenu et de ses conclusions. Il est dès lors inutile de vous les résumer.
D'autant plus que, comme je vous en ai averti, la lecture de l'introduction et de la conclusion, avec éventuellement des incursions dans les six parties du texte, suffit à donner une bonne idée de mon analyse.
Dans mon esprit, les préconisations ne sont pas essentielles, mais j'avais cru comprendre lors de la réunion du 6 juin dernier, au cours de laquelle je vous avais présenté un point d'étape, que vous étiez demandeurs de ces propositions.
La réunion d'aujourd'hui permettra d'éclaircir les points demeurés obscurs et éventuellement de rectifier les erreurs que j'aurais pu commettre en juin.
Si je ne vous présente pas l'ensemble du rapport, ce que je souhaite faire, en revanche, c'est vous préciser quelles ont été mes intentions en rédigeant ce long - trop long - rapport, cette « fusée soviétique » pour reprendre l'expression de notre président... assortie cependant de quelques « scuds ».
Mon intention n'est pas de convaincre - même si j'apprécierais qu'il en aille ainsi pour au moins quelques-uns d'entre vous -, encore moins d'inquiéter, mais d'éclairer sur la mécanique et les résultats réels, parfois aux antipodes de ce qui était souhaité, de la grande transformation néolibérale de l'empire américain, au cours de ce dernier demi-siècle.
Je sais trop la part de subjectivité entrant dans la conviction, que l'on convainc seulement ceux qui le sont déjà presque, pour avoir d'autre prétention que d'apporter des faits, des chiffres trop négligés, que de mettre en évidence des convergences entre des évolutions, des politiques, des choix apparemment sans rapport.
Que je ne connaisse pas d'autres tentatives de ce genre, ne signifie pas que d'autres explications que les miennes, d'autres mises en cohérence des pièces du puzzle et donc d'autres conclusions ne soient possibles.
Elles le sont évidemment, simplement je ne les connais pas.
À la discussion, là aussi, d'apporter quelques pistes.
Ce qui me laisse cependant espérer n'être pas - pour l'essentiel en tous cas - dans l'erreur, c'est que des personnalités parmi les mieux informées et avec lesquelles je suis généralement en désaccord, sont arrivées, par d'autres chemins, aux mêmes conclusions que moi.
L'essentiel, c'est le lien entre les faces financière, économique, sociale et politique de la crise mondiale globale que nous traversons ; c'est qu'il y a urgence à en prendre conscience et à agir même si mon sentiment reste qu'en l'état actuel des rapports de force et des intérêts, un pays comme la France ne peut qu'espérer limiter la casse pour ce qui la concerne.
Si on le faisait, ce serait déjà beaucoup.
Ces personnalités aussi bien informées qu'on puisse l'être, de tous horizons, j'en donne la liste dans le rapport, je n'y reviendrai donc pas, sauf - et ce sera mon ouverture dans le débat - pour évoquer le discours d'Emmanuel Macron le 11 juin de cette année devant l'Organisation internationale du travail (OIT), une analyse à laquelle je ne changerai pas une ligne.
Je le cite : « Je l'ai dit avec force : je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient, sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Ce sont les mêmes qui se sont réveillés avec des gens qu'ils pensaient inéligibles, ce sont les mêmes qui sont sortis de l'Europe alors même qu'ils pensaient que ça n'adviendrait jamais. C'était souvent les plus amoureux d'ailleurs de cette forme de capitalisme et de l'ouverture à tout crin.
Moi, je ne veux pas commettre avec vous la même erreur et donc nous devons réussir à ce que notre modèle productif change en profondeur pour retrouver ce que fut l'économie sociale de marché, une manière de produire, de créer de la richesse indispensable, mais en même temps de porter des éléments de justice et d'inclusion et une manière d'organiser l'innovation partout dans le monde et l'ouverture mais de faire que chacun y trouve sa part. »
Comme le souligne Emmanuel Macron, le risque d'implosion du système financier n'est pas le seul danger majeur qui menace l'empire américain et ses provinces, il y a aussi celui de l'implosion politique dont les conséquences sont tout aussi difficiles à prévoir.
Regardez les derniers résultats des élections en Europe, en Allemagne il y a deux semaines, puis en Espagne dernièrement : toutes les semaines, l'avancée des extrêmes se réalise.
Ce que j'ai essayé de montrer, c'est donc qu'il n'y a pas une cause - la financiarisation du système capitaliste qu'on pourrait réguler - et ses conséquences sociales et politiques qu'il s'agirait de soigner, mais un système mondial où tout se tient, un système mondialisé pris au piège de ses contradictions, contradictions qui le rendent de moins en moins réformable par le jeu démocratique normal.
Il y a donc une logique mortifère à l'oeuvre. Sauf un changement radical de l'attitude des États-Unis, je ne vois pas comment nous allons l'enrayer.
Si je devais classer à grands traits mes préconisations, je mettrai en exergue deux grands points. Le premier serait d'appliquer les réformes financières du G20 décidées après la grande crise de 2008. Le second serait de se préparer à l'éventuelle catastrophe, en gardant à l'esprit la priorité : continuer à financer le système économique.
Et, in fine , il faudrait que nous arrivions à faire jouer au Parlement un autre rôle que celui de figuration qu'il joue aujourd'hui.
Ce rapport se veut une prise de conscience.
M. Roger Karoutchi , président . - Sous les réserves que j'ai exprimées en introduction, je partage votre inquiétude.
Nous n'avons tout de même pas appris grand-chose de l'histoire : bien sûr l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, mais aussi l'installation d'un certain nombre de régimes autoritaires, notamment en Europe de l'Est, pendant l'entre-deux guerres sont intimement liés à la crise politique, financière et économique que traversait l'Europe durant cette période.
Il faut être aveugle pour ne pas voir le lien entre crise économique et crise politique. Les populismes - qu'ils soient de gauche ou de droite - jouent sur la déstabilisation de l'équilibre social, en actionnant les peurs, les égoïsmes et le nationalisme, et le système est en danger.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a cru qu'un maillage d'accords internationaux, notamment avec les accords de Bretton Woods, puis ceux qui ont conduit à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou l'OIT, suffirait à garantir une nouvelle stabilité en Europe.
Aujourd'hui, plus de 50 ans après, à peu près toutes les institutions internationales sont en crise, nonobstant la qualité des hommes qui les dirigent : l'OTAN, l'ONU, l'OMC et même l'OCDE. Les directives de l'OCDE, notamment, ne sont plus appliquées par les États.
Bien sûr nous ne sommes plus dans les années 30 : nous sommes dans un système où la masse de capitaux en circulation constitue en elle-même un risque financier et donc économique et social.
Sommes-nous en mesure de nous protéger contre ces facteurs de crise ?
Nous l'avons fait, notamment par le biais des nouvelles réglementations interbancaires. Mais sincèrement, je n'ai pas le sentiment que ces systèmes suffisent.
Si, donc, nous différons sur la nature des préconisations, nous nous rejoignons sur la conviction de la potentialité du risque et je peux vous dire que, pour en avoir discuté avec lui, Gérald Darmanin, le ministre de l'action et des comptes publics, n'hésite pas à dire lui-même que s'il y a une crise, tout ce que nous décidons aujourd'hui sera emporté.
Et le Parlement dans tout cela ? La première question pour moi reste le rétablissement de la souveraineté sur l'impôt. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission des finances. Cependant, nous avons aussi indéniablement la responsabilité d'interpeller les pouvoirs publics.
Quand j'entends le ministre de l'économie et des finances se réjouir d'une croissance à 1,1 ou 1,2 %, je reste dubitatif. Faut-il lui rappeler le montant de la dette internationale ?
Heureusement des hommes de son propre bord politique, comme Jean-Michel Naulot, que nous avons eu l'occasion d'entendre devant la délégation pour l'élaboration de ce rapport, rappellent des évidences et nous mettent en garde : les facteurs de risque et d'explosion sont là.
Mme Christine Lavarde . - J'avais compris que le rapport que nous examinons ce matin était une actualisation du précédent de 2017, avec trois années de recul. Je m'attendais donc à apprendre ce qui avait été fait, était en cours de réalisation - ou pas - notamment au regard des mises en garde et des prédictions précédentes du rapporteur. Je n'ai pas eu l'impression de trouver une réponse à ces questions dans le rapport qui nous a été transmis, mais peut-être est-ce dû à ma lecture trop rapide de ce travail imposant ?
Le rapporteur peut-il nous aider à faire un lien avec le passé et nous dire s'il avait eu raison trop tôt, sur certains points au moins ?
M. Yannick Vaugrenard . - Je pense que ce rapport, comme le précédent de 2017, inscrit notre délégation pleinement dans son rôle de lanceur d'alerte.
Même si, comme le président, je n'adhère pas entièrement aux préconisations de ce rapport, son rôle d'interpellation me parait extrêmement juste.
Il me parait évident qu'un certain nombre de dérives aux niveaux international comme national nous place aujourd'hui sur un volcan dont l'éruption peut advenir d'un jour à l'autre.
Ce qui me marque dans la manière dont a été gérée la crise financière de 2008, c'est que nous avons bien senti les effets économiques et sociaux, qui ont été redoutables, mais pas les conséquences juridiques.
Je m'explique : on a vu nombre de personnes perdre leur maison, leurs économies, leur situation, et pendant ce temps, qu'est-il arrivé aux responsables de toutes ces faillites ? Rien. Les grands banquiers internationaux ont-ils senti les effets de la crise ? Je ne crois pas. Rien n'a changé pour eux, ni juridiquement ni financièrement.
Donc, ceux qui ont payé les pots cassés ne sont pas ceux qui ont suscité et adopté les comportements qui ont pourtant été à l'origine de la faillite globale.
L'opinion publique se rend bien compte de cette injustice. Les conséquences, nous les voyons sur les résultats électoraux et sur les comportements citoyens, en France, en Espagne, aux États-Unis et ailleurs.
Les espoirs suscités par la chute du mur de Berlin ne sont pas là. L'ouverture économique devait amener avec elle un renforcement de la démocratie. Or, à postériori, cette période apparait comme celle d'un monde de bisounours car l'évolution n'a pas été celle que l'on espérait.
Je reviens donc sur l'importance de disposer de structures de lanceurs d'alertes, en particulier pour attirer l'attention sur nos comportements politiques.
L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, en dehors de toute considération politique, nous interpelle les uns et les autres. En effet, l'attitude de contestation systématique des partis politiques, de droite comme de gauche, dès lors qu'ils arrivent dans l'opposition, n'est plus tenable. Ce blocage perpétuel a conduit l'opinion publique à perdre confiance dans l'objectivité des partis politiques traditionnels et à se tourner vers les extrêmes.
Cette perte de confiance dans les responsables, politiques comme économiques, nous oblige, nous, partis politiques, à une introspection pour arrêter ce systématisme de comportement - c'est-à-dire la contestation automatique dès lors que nous ne sommes plus majoritaires.
Enfin, pour moi, l'erreur fondamentale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a été de vouloir intégrer des pays très différents sans imposer de norme d'organisation du travail, car une économie de marché sans norme sociale constitue une fuite en avant dont nous gérons aujourd'hui les conséquences.
M. Jérôme Bascher . - Je voudrais tout d'abord saluer l'oeuvre de Pierre-Yves Collombat - qui, par son ampleur mais aussi son analyse, m'a fait penser par certains aspects aux Choses vues d'un Victor Hugo -, pour aussitôt, cela va sans le dire, marquer mon désaccord avec certaines de ses conclusions.
Je reviens tout de suite sur ce que vient de dire Yannick Vaugrenard : on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé pour les banques après 2008. Dès 2008, en effet, sont nées certaines règles prudentielles financières internationales, parmi lesquelles le renforcement des fonds propres, qui a constitué une « petite secousse ».
Mais le vrai sujet, ce sont les « grandes secousses ». La plus grande, je crois, c'est le choc de la mondialisation, qui s'amplifie avec les sommes en circulation.
La croissance de la Chine, notamment, crée de nouveaux risques, dans des endroits mal ou moins maitrisés qui s'exonèrent, justement, des règles internationales. Pour le dire autrement, les banques chinoises ne se sentent pas toujours concernées par la règlementation de Bâle III. Or, la somme des capitaux gérés, même dans une monnaie peu liquide, crée des risques internationaux forts.
Tout se passe donc comme si se développait un système prudentiel à deux vitesses, avec l'Ouest, comme on disait avant la chute du mur de Berlin, qui répète qu'on ne peut plus se permettre de voir une banque mettre le monde en faillite, et le reste du monde, qui grossit à toute vitesse, mais qui obéit à d'autres préoccupations.
En effet, en ce sens, l'histoire bégaie. Je suis d'accord avec vous.
Aujourd'hui, tout le monde attend la crise en Chine ou en Inde, mais rappelez-vous, l'avant-dernière crise, celle de 1998 était déjà née en Asie du Sud-Est, et tout le monde fait comme si on l'avait oublié.
C'est là où votre analyse, Monsieur le rapporteur, me parait juste : cette mondialisation a totalement déconnecté les peuples de l'évolution du monde.
Vous disiez, Monsieur le président, qu'il serait déjà bon que le Parlement se remette à maîtriser l'impôt. Je suis d'accord avec vous.
Ce sentiment que la marche du monde se déconnecte de la marche des peuples est, je l'avoue, un gros sujet d'inquiétude.
M. Roger Karoutchi, président . - Je trouve cette distinction entre « petite crise » et « grosse crise » judicieuse. En effet, depuis 2008, nous avons eu à faire face à des petites crises, mais que se passera-t-il quand nous ferons face à une « grosse crise », à une explosion de la bulle de liquidités mondiale ?
À ce moment-là, à quoi serviront les petites règles prudentielles de mon agence bancaire ?
Cela fait plus d'un an que l'on entend les principaux anciens responsables des organismes financiers, monétaires et bancaires, mondiaux dire « ça va exploser ». On danse sur un volcan en se disant « tant qu'il n'explose pas, ça va ».
Concernant les conséquences politiques, je voudrais partager avec vous les résultats d'un sondage récent qui m'a surpris, selon lequel, au second tour d'une élection présidentielle française, si elle avait lieu aujourd'hui, 67 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteraient pour Marine Le Pen.
Plus que les chiffres - étonnants -, l'analyse qui en est faite est intéressante. Interrogés sur leurs motivations, ces 67 % disent, à 81 %, que ce choix s'explique par le fait que M. Mélenchon et Mme Le Pen sont tous les deux hostiles à la mondialisation et au système bancaire.
Ce que je veux dire, c'est que les partis classiques regardent monter la peur face à l'instabilité financière, et que la peur continuera de monter si l'on n'arrive pas à la maîtriser.
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Concernant la continuité et la rupture avec les constats du premier rapport de 2017, je voudrais vous renvoyer tout d'abord à l'ouvrage Crashed , publié en octobre 2018, dans lequel l'historien britannique Adam Tooze analyse les répercussions mondiales de la débâcle des banques américaines en 2008. Cet ouvrage a été décisif pour moi dans l'évolution de ma pensée.
L'idée majeure développée dans cet ouvrage est que les remèdes utilisés depuis 2008 contre la crise sont devenus eux-mêmes une cause d'autodestruction du système.
Ces remèdes reposent sur la croyance que l'économie ne peut fonctionner que si l'on y injecte en permanence de la liquidité. Or, cette idée est un piège. Plus on injecte des liquidités, plus on rend, au contraire, tout le système vulnérable. Dans ce système, il y a ceux à qui la liquidité profite : les États-Unis, qui veulent continuer à « faire des affaires » et les autres, qui demandent des hausses de taux d'intérêt.
En Europe, on cumule tous les inconvénients : on continue à s'endetter, mais en même temps, on se serre la ceinture. L'endettement ne sert pas à répondre, même de façon démagogique, aux préoccupations matérielles des gens.
Pour répondre sur le point des régulations prudentielles, certes, il y a eu de nouvelles réglementations imposées aux banques, mais, d'une part, Jean-Michel Naulot nous disait que seul un tiers des mesures ont été appliquées effectivement, d'autre part, en parallèle, s'est développé tout un système souterrain, - j'y consacre une large partie du rapport : le shadow banking -, qui vit en symbiose avec le système bancaire, en représente près de la moitié en terme de bilan selon les chiffres mêmes de la Banque de France, et qu'on ne maîtrise absolument pas.
Au final, comme le disait le Président Karoutchi, ce sont des mesures pour temps calme.
Le plus étonnant est ce mécanisme de résolution, un fonds censé répondre aux cas de faillite, abondé à hauteur de 50 milliards d'euros pour l'Europe, quand la somme des bilans bancaires est de...15 000 milliards.
J'en arrive aux conclusions politiques du rapport : pour moi, il est aujourd'hui indéniable que la situation dans laquelle nous sommes résulte de choix politiques clairs et que nous ne sortirons de cette situation que par une évolution de ces choix.
Ce second rapport a été pour moi le moment d'éclairer et d'expliquer cette conviction. En réalité, tout est lié. Il n'y a pas, d'un côté, un système financier à la dérive et, en parallèle, un système décisionnel. L'un est justifié par l'autre et inversement. Notamment je montre comment nous subissons aujourd'hui les conséquences du détricotage de l'État-providence, en termes de chômage de masse.
C'est l'accumulation de travail et d'auditions qui m'a permis d'arriver à cette conclusion.
Vous trouverez également dans ce rapport beaucoup de références au passé et aux analyses, notamment, de Karl Polanyi. Ce n'est pas de la nostalgie de ma part, c'est juste que ces analyses sont parfois beaucoup plus opérantes pour aujourd'hui que nombre d'analyses contemporaines.
J'aurais aimé aller plus loin sur l'analyse de la situation préfasciste. Polanyi s'interroge : comment le fascisme est apparu comme une solution dans un système en panne ? Comment les fondamentaux de nos systèmes de pensée ont été dissous ? Cela mériterait une étude en profondeur.
Enfin, concernant les préconisations, je ne les ai rédigées que parce que vous les réclamiez et aussi parce que c'est le rôle du Parlement de proposer des voies de sortie. Mais elles ont peu de chance d'être appliquées.
Cela va dans le sens de votre idée de lanceur d'alerte.
M. Roger Karoutchi, président . - Je voudrais ajouter quelque chose, concernant ce fameux fonds de crise et les 50 milliards prévus pour faire face aux faillites en Europe. Cela peut paraître beaucoup mais il faut comparer ce qui est comparable et, justement, je rappelle qu'en 2008, il a fallu injecter en France 400 milliards pour sortir de la crise de 2008. C'est là que la différence entre « petite » et « grosse » crise est opérante.
Notre attentisme va nous jouer des tours, tout comme l'aveuglement des médias. Rappelez-vous : lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie, c'était la crise financière, le système bancaire italien s'était effondré, la presse italienne saluait l'arrivée au pouvoir d'un leader autoritaire qui devait être provisoire. Finalement, l'Italie l'a gardé 20 ans....
Ce que vous disiez, Monsieur le rapporteur, tout à l'heure est édifiant : non seulement la dette augmente, mais en plus, les gens n'ont aucune contrepartie en termes de confort et de niveau de vie.
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur . - Absolument. J'aurais dû d'ailleurs insister tout à l'heure : le point central c'est que toute cette liquidité injectée ne va pas dans l'économie. Elle ne sert qu'à faire monter les prix de biens existants, sans permettre de faire produire de nouvelles richesses. D'où certaines préconisations du rapport qui visent à remettre le système financier au service du financement de l'économie.
Mme Marie Mercier . - Merci pour ce rapport intéressant. J'ai une préoccupation : le premier parti politique en France aujourd'hui c'est l'abstention. Nos concitoyens ne vont pas voter.
Qui donne de l'espoir aux jeunes aujourd'hui ? C'est la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Je trouve cela inquiétant. Comme le dit le président, nous sommes assis sur un volcan.
Alors à moins de vous demander de vous faire greffer deux tresses, cher rapporteur, je me demande comment nous allons faire pour « fracasser les consciences ». Ce qui est inquiétant, c'est ce paradoxe entre la vision crépusculaire que vous nous décrivez et les espoirs suscités par ce genre de personnes. Même si l'écologie est bien, à juste titre, l'une des premières priorités des Français.
M. Jean-Raymond Hugonet . - Pour moi, cette jeune Greta fait partie des épisodes qui passent comme les séries à la télévision et dont on attend simplement le prochain épisode. La première préoccupation des Français aujourd'hui, ce n'est plus la sécurité, l'emploi ou le logement, c'est la santé.
Allez écouter les manifestants qui vont défiler aujourd'hui devant le Sénat !
Pour moi, il y a une seule façon d'arrêter ces singeries, c'est l'autorité. Sinon, comme l'évoquait le président, c'est une autre ombre qui se profile : c'est la guerre.
Rappelez-vous de la grande époque de Dexia. Alors maire en 2001, j'ai eu affaire à ces gens qui venaient dans nos collectivités condescendre à prêter de l'argent aux élus que nous sommes. Qui aurait, alors, prédit l'effondrement de Dexia, qui nous a, par ailleurs, coûté cher ?
Nous sommes dans un système qui a perdu la boule, qui amène à la tête de l'État un personnage qui est exactement ce que les Français exècrent : un énarque et un banquier.
C'est donc un système dit démocratique qui amène à la Présidence de la République un homme qui ne représente pas le choix de la majorité des Français. Les trois derniers présidents ont d'ailleurs été élus par un concours de circonstances. Quel sera le prochain ?
M. Yannick Vaugrenard . - Je voudrais juste revenir sur le fond du rapport et la raison d'être de la délégation à la prospective.
Cela fait deux fois que le prix Nobel d'économie a été remis à un Français : Jean Tirole puis, il y a quelques jours, Esther Duflo. La France compte d'éminents économistes, parmi lesquels Thomas Piketty, qui vient de publier un ouvrage extrêmement documenté.
Pourquoi ne pas les auditionner et ainsi poursuivre le travail de notre collègue ?
M. Roger Karoutchi, président . - Nous pourrions en effet entendre Esther Duflo. Merci à nouveau, Monsieur le rapporteur. Votre rapport nous interpelle. Il sera publié en votre nom personnel mais il engage la délégation à poursuivre ses travaux.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
I. AUDITIONS DEVANT LA DÉLÉGATION À LA PROSPECTIVE
• Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII)
• Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du collège de l'Autorité des marchés financiers
• Bertrand Badie, professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d'études et de recherches internationales
II. AUDITIONS DEVANT LE RAPPORTEUR
• Romaric Godin, journaliste à Mediapart
• Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne
• Martine Orange, journaliste à Mediapart
• Thierry Philipponnat, directeur de l'Institut Friedland
• Jacques Sapir, directeur d'études, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation de l'École des Hautes études en sciences sociales (CEMI-EHESS)
• Henri Sterdyniak, conseiller scientifique à l'Observatoire français des conjonctures économiques
• Patrick Artus, chef économiste et membre du comité exécutif, Natixis
• Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès
• Pierre-Charles Pradier, co-directeur académique du Laboratoire d'excellence au service de la régulation financière (LabEx ReFi), Université Paris I Panthéon-Sorbonne
• Laurent Clerc, directeur d'étude et d'analyse des risques, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Banque de France
• Véronique Bensaid-Cohen, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur de la Banque de France
• Bertrand Badie, professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d'études et de recherches internationales
• Jean-Yves Potel, écrivain et universitaire
• James Kenneth Galbraith, économiste