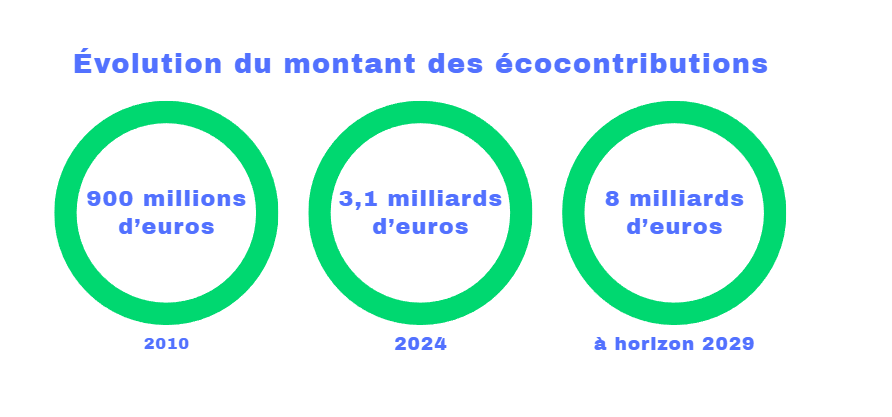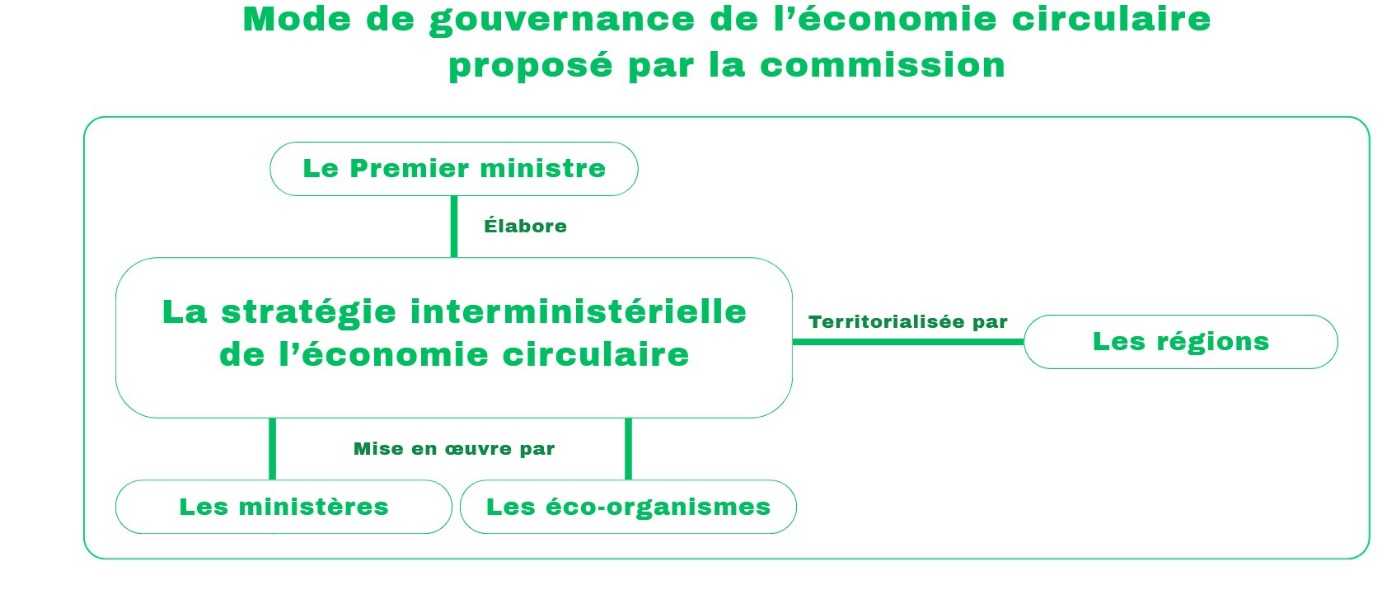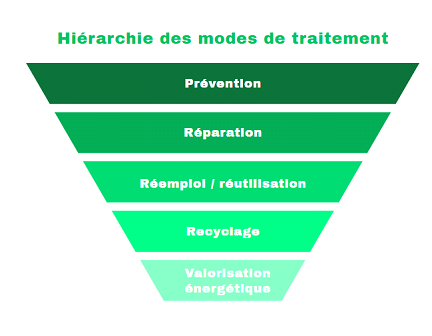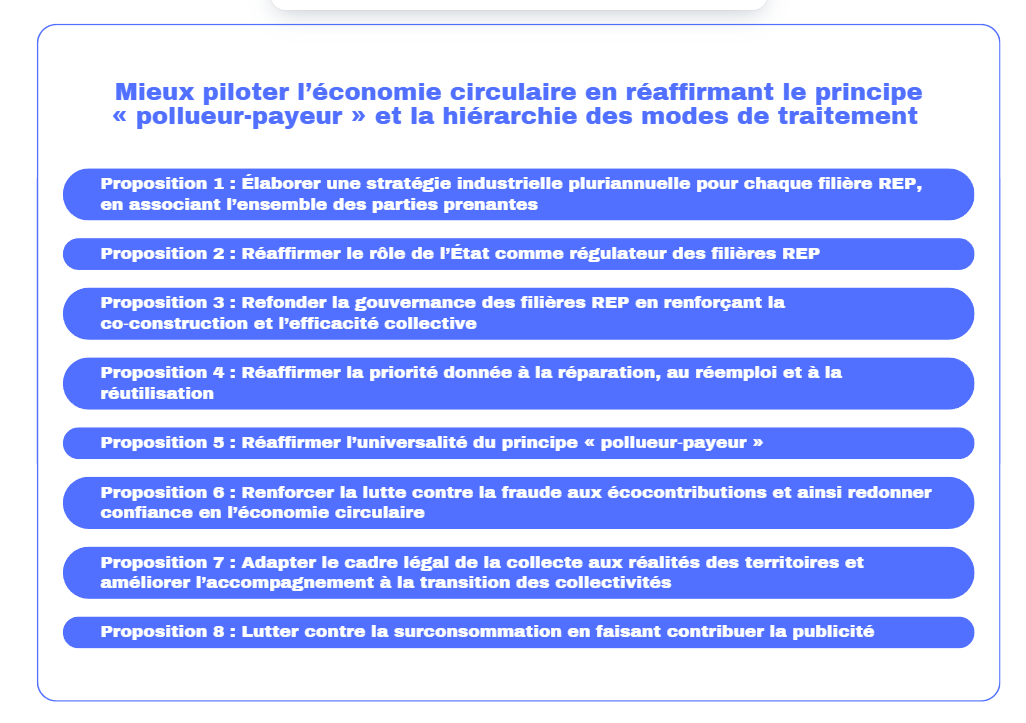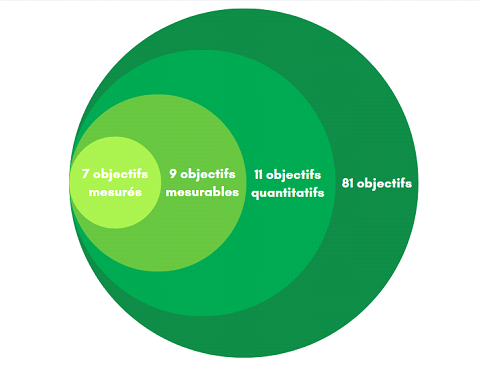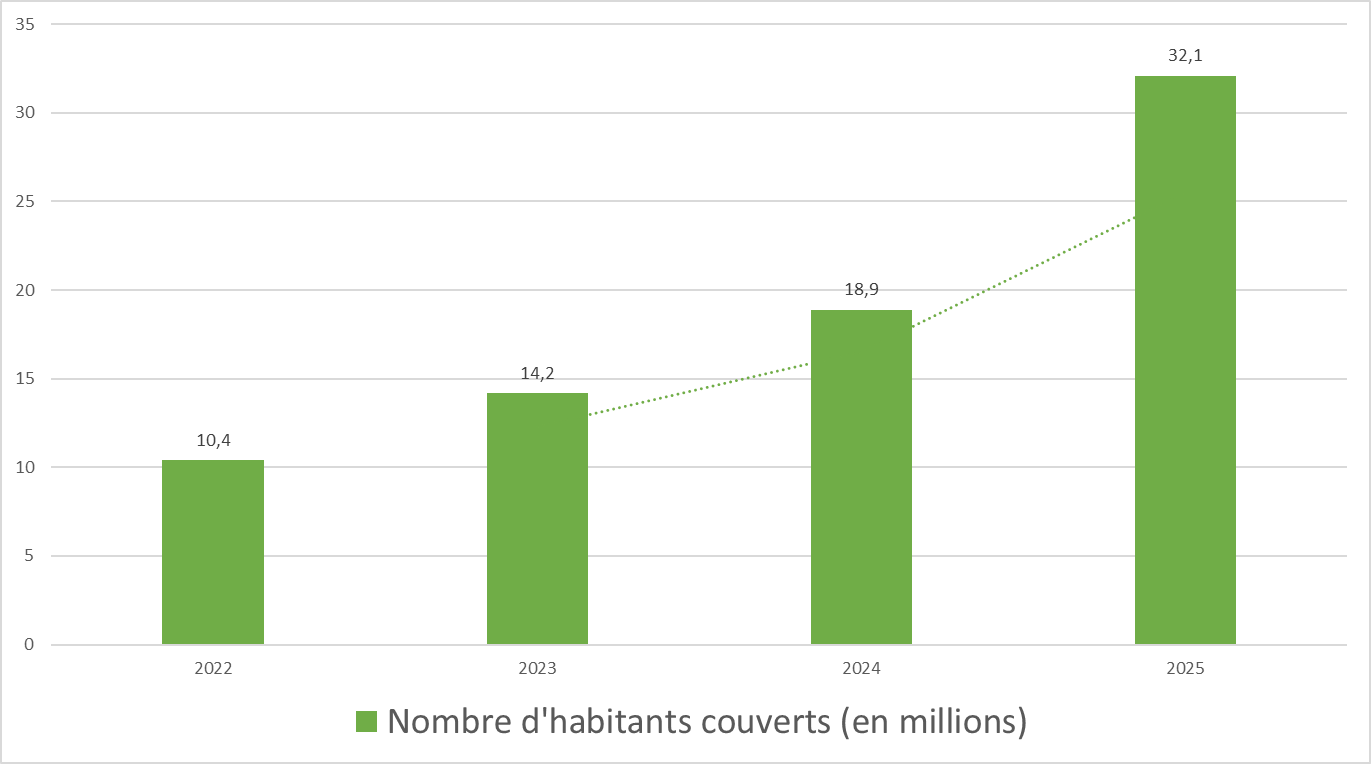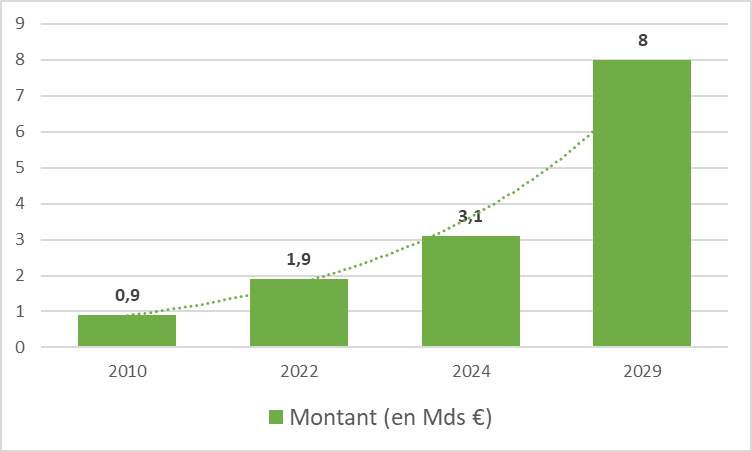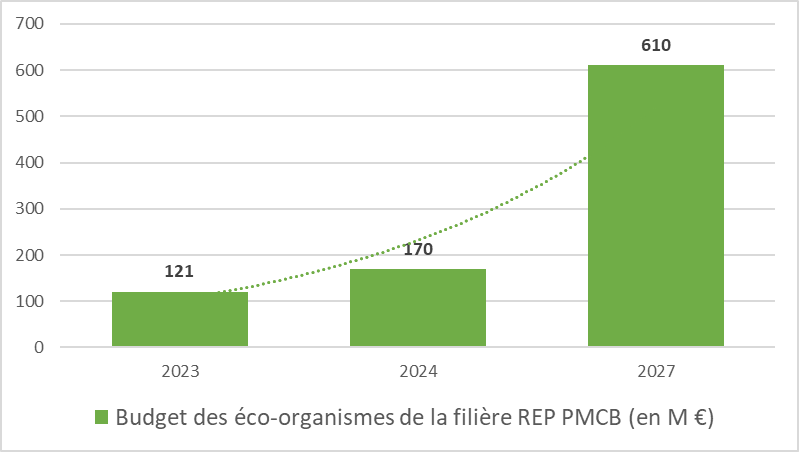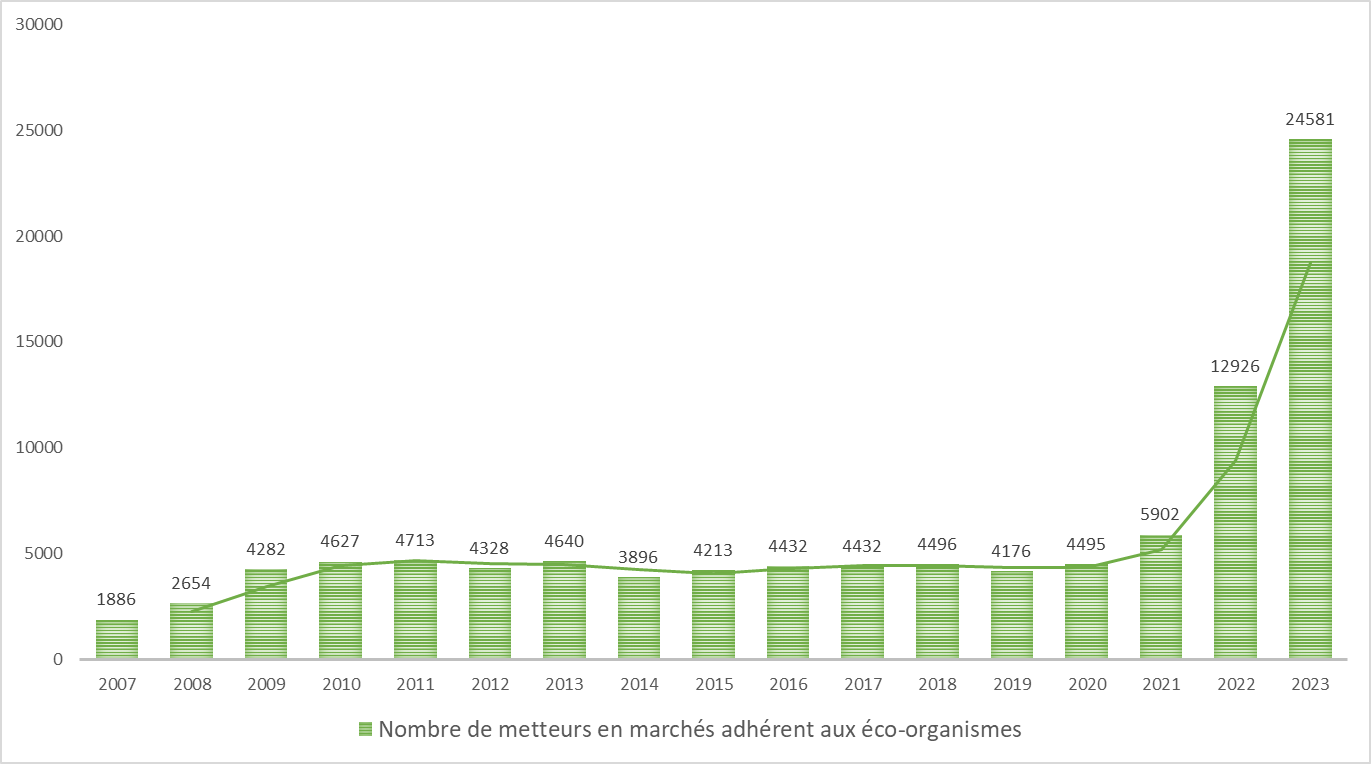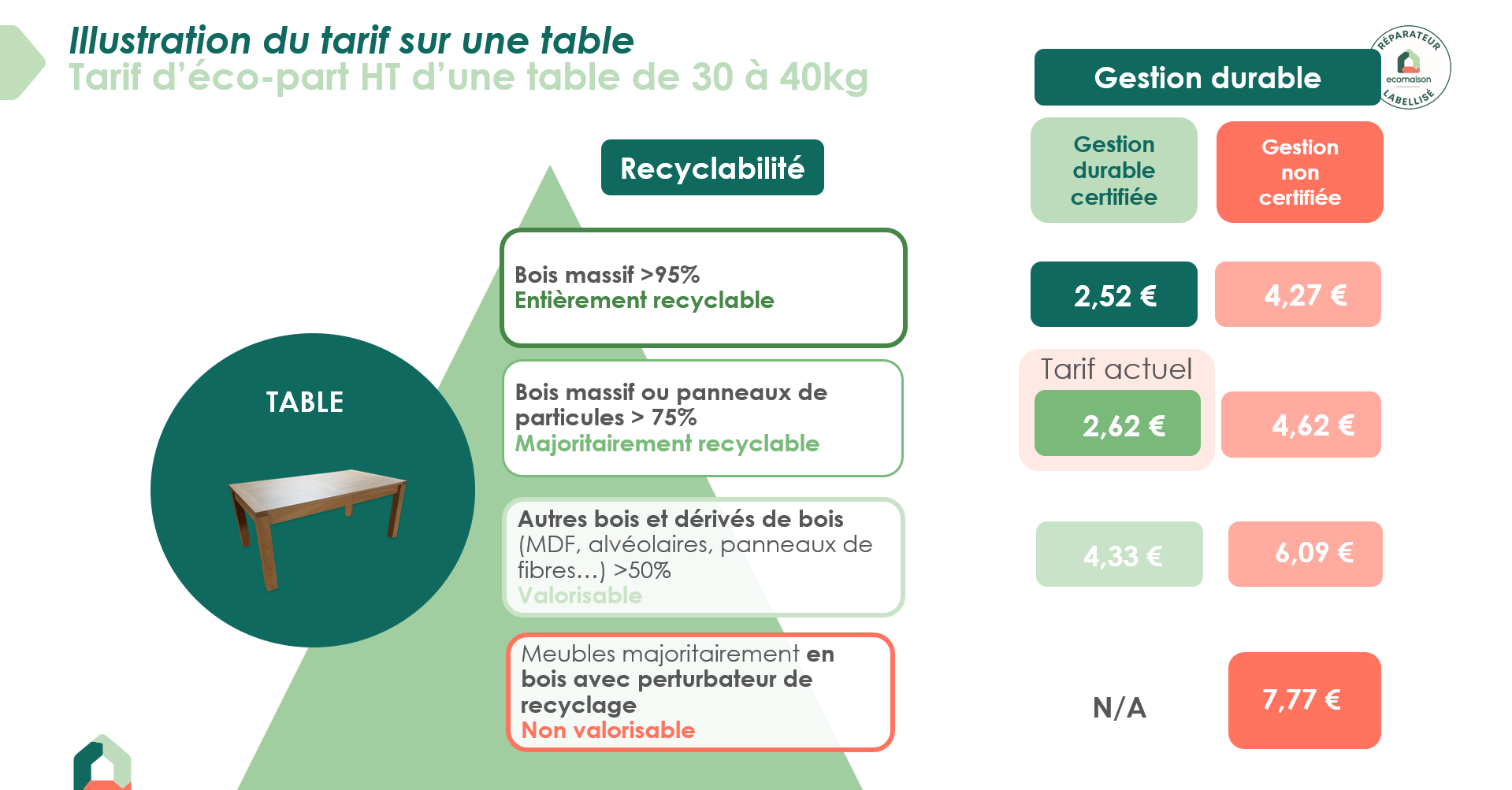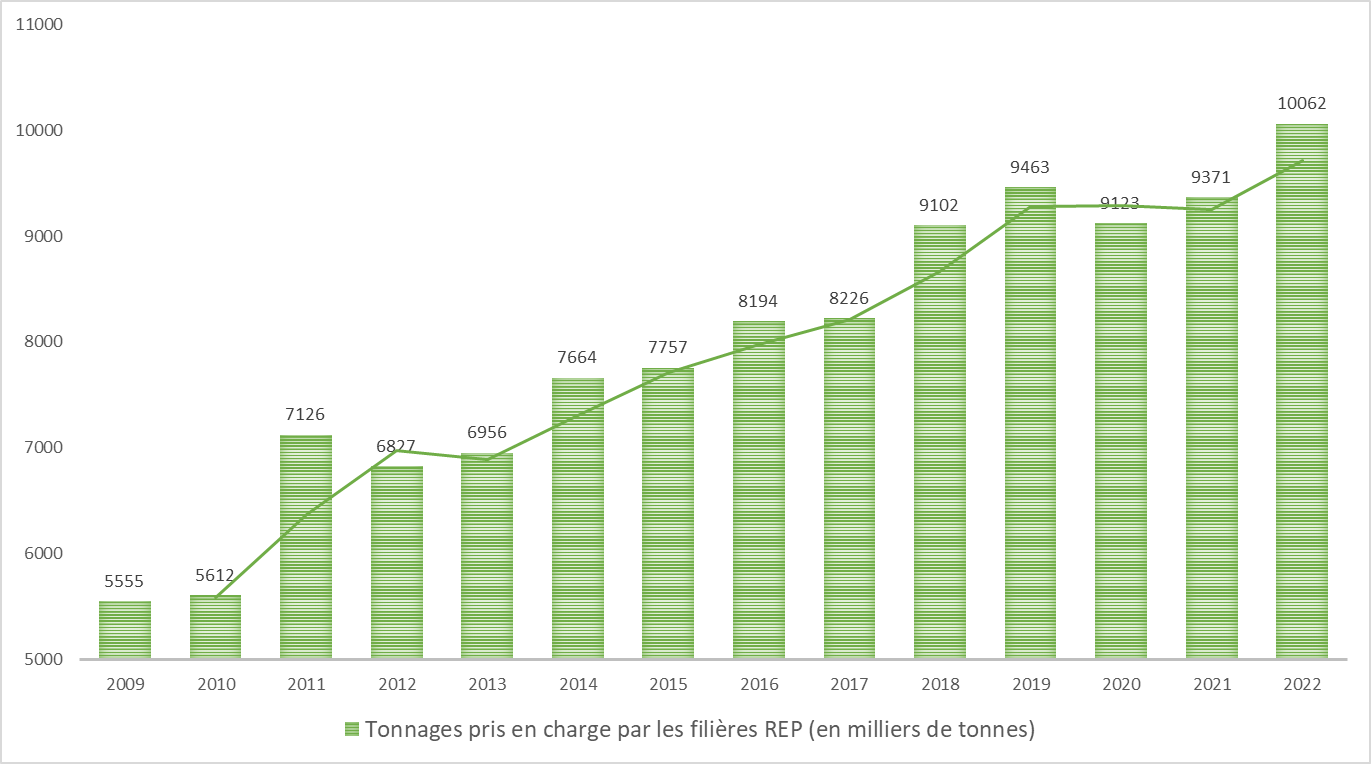- L'ESSENTIEL
- I. UNE POLITIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU
CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE
STRATÉGIQUE
- A. UNE LOI À L'ORIGINE D'OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, DONT LA PLUPART RESTENT, À CE STADE, NON
ATTEINTS
- B. L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE, NOUVEL ENJEU
PRIMORDIAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
- C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE
CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
- A. UNE LOI À L'ORIGINE D'OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, DONT LA PLUPART RESTENT, À CE STADE, NON
ATTEINTS
- II. PILOTER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE
INDISPENSABLE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE
- A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE
INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST
AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE
- B. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA
GOUVERNANCE DES ÉCO-ORGANISMES, POUR AFFIRMER LE RÔLE DE
RÉGULATEUR DE L'ÉTAT ET RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION
- 1. Mieux associer les parties prenantes au pilotage
des filières REP par une réforme de la gouvernance
- a) Une gouvernance entre les mains exclusives des
metteurs en marché, au détriment des collectivités
territoriales et des opérateurs de déchets
- b) Les instances créées par la loi
Agec de 2020 -- la CiFREP et la CPP -- n'ont pas atteint leur objectif
d'association des parties prenantes
- c) Une simplification de la gouvernance des
filières REP est ainsi nécessaire pour renforcer la
co-construction et l'efficacité collective
- a) Une gouvernance entre les mains exclusives des
metteurs en marché, au détriment des collectivités
territoriales et des opérateurs de déchets
- 2. Une régulation par l'État cruciale
pour garantir le respect de l'intérêt général par
les éco-organismes
- 1. Mieux associer les parties prenantes au pilotage
des filières REP par une réforme de la gouvernance
- A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE
INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST
AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE
- III. UNE STRATÉGIE À DÉPLOYER
TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT, DE LA CONCEPTION DU PRODUIT AU TRAITEMENT DU
DÉCHET
- A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA
CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT
- B. LA COLLECTE : SOUTENIR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PAR UNE PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION
TERRITORIALE ET UN FINANCEMENT ADAPTÉ
- 1. Les objectifs nationaux et européens
obligent les collectivités territoriales à faire évoluer
la collecte des déchets ménagers
- 2. Une transition à accompagner, en
adaptant le cadre légal et le soutien de l'État à la
diversité des territoires
- 3. Tri à la source des
biodéchets : une dynamique territoriale à soutenir par un
cadre réglementaire stabilisé et un accompagnement
préservé
- 1. Les objectifs nationaux et européens
obligent les collectivités territoriales à faire évoluer
la collecte des déchets ménagers
- C. UNE HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS À RÉAFFIRMER
- A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA
CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT
- I. UNE POLITIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU
CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE
STRATÉGIQUE
- LISTE DES PROPOSITIONS
ADOPTÉES PAR LA COMMISSION
- TRAVAUX EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
- ANNEXE
N° 786
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec),
Par Mme Marta de CIDRAC et M. Jacques FERNIQUE,
Sénatrice et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.
L'ESSENTIEL
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité, le 25 juin 2025, le rapport d'information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique relatif à l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Sous l'impulsion de la présidente du groupe d'études « Économie circulaire », Marta de Cidrac, la commission a en effet considéré qu'il était temps - cinq ans après son entrée en vigueur - d'en dresser le bilan.
Il était légitime que le législateur s'interroge compte tenu des changements intervenus. Les objectifs environnementaux novateurs et exigeants portés par cette loi ont permis une prise de conscience bien réelle, même si tous n'ont pas encore été atteints. La crise énergétique liée à la guerre en Ukraine a mis en lumière la nécessité pour l'économie circulaire, véritable levier d'autonomie stratégique, de prendre une nouvelle envergure au service d'une ambition renouvelée pour notre économie et notre souveraineté industrielle. La politique d'économie circulaire de demain devra également prendre en compte la défense de notre compétitivité économique et la lutte contre les passagers clandestins, conditions essentielles de l'acceptabilité des politiques mises en oeuvre.
Pour atteindre ces objectifs, une réforme de la gouvernance nationale et territoriale est nécessaire. Une stratégie interministérielle de l'économie circulaire, déclinée territorialement à l'échelle régionale doit être mise en place. Elle permettrait aux acteurs économiques d'avoir la visibilité indispensable à l'investissement. S'agissant des filières REP, la gouvernance des éco-organismes mérite d'être revue, en associant de manière plus efficace les parties prenantes.
Ce pilotage renouvelé serait déployé à chaque étape du cycle de vie des produits :
- lors de la conception et de la commercialisation, le rôle de la publicité dans la surconsommation doit être interrogé ;
- au stade de la collecte, l'accompagnement de l'État envers les collectivités territoriales doit être renforcé ;
- enfin, le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets s'impose, avec une priorité pour le réemploi et la réparation, puis le recyclage.
La commission, à travers huit recommandations qu'elle a adoptées, entend ainsi redonner à la politique d'économie circulaire une véritable colonne vertébrale industrielle, en réaffirmant deux principes structurants : le principe « pollueur-payeur » et la hiérarchie des modes de traitement.
I. L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, UNE POLITIQUE AU CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE STRATÉGIQUE
A. DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, À L'ORIGINE D'UNE PRISE DE CONSCIENCE
La loi Agec de 2020, première loi française consacrée à l'économie circulaire, portait avant tout une ambition environnementale forte. Même s'il est encore trop tôt pour mesurer pleinement l'atteinte des objectifs -- dont beaucoup sont fixés au-delà de l'horizon 2025 --, tous les acteurs entendus ont salué la prise de conscience provoquée par cette loi.
Mais ils ont aussi souligné les difficultés rencontrées sur le terrain, qui menacent l'atteinte à terme d'une grande partie des 81 objectifs fixés par la loi. Pour la commission, la conclusion est claire : la politique d'économie circulaire a besoin d'un nouveau souffle.
B. L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE, NOUVEL ENJEU PRIMORDIAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Pour les acteurs européens rencontrés par les rapporteurs1(*), l'économie circulaire est devenue un levier essentiel pour réduire notre dépendance aux importations de matières premières et prévenir une potentielle crise des ressources. L'Union européenne a bien saisi cet enjeu, en particulier depuis la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine : l'économie circulaire est aujourd'hui l'un des rares volets du Pacte vert pour l'Europe à continuer de progresser, malgré les vents contraires.
L'enjeu de notre autonomie stratégique est pourtant insuffisamment pris en compte dans les politiques françaises d'économie circulaire : alors qu'une gestion stratégique apparaît indispensable pour limiter notre vulnérabilité en termes d'approvisionnement en matières premières, certains axes de la politique française d'économie circulaire tendent à l'inverse à augmenter la dépendance aux importations de ressources critiques. Les actions menées en vue de préserver notre indépendance peuvent également profiter à la politique de l'emploi, en réduisant le risque de délocalisation.
« L'économie circulaire doit davantage être prise en compte en France comme un levier pour garantir notre autonomie stratégique, en réduisant notre dépendance aux importations. »
Marta de Cidrac, rapporteure
C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
D'ici 2029, le montant total des écocontributions2(*) devrait être multiplié par près de 9 par rapport à 2010 : une progression spectaculaire, due à l'élargissement du nombre de filières et à la hausse des barèmes d'écocontributions. Mais cette hausse, perçue comme brutale par certaines entreprises, alimente des interrogations croissantes sur la soutenabilité du système.
Source : données de la DGPR
L'acceptabilité de l'économie circulaire est également limitée par le phénomène des « passagers clandestins ». Certains producteurs ne s'acquittent pas de leurs écocontributions pourtant obligatoires. En échappant à leurs responsabilités, ils faussent la concurrence au détriment des entreprises vertueuses. Ces fraudes nourrissent ainsi un sentiment d'injustice économique qui mine l'adhésion au système. Des efforts pour lutter contre ces pratiques sont tangibles, mais ils demeurent insuffisants face à l'ampleur du phénomène.
Pour la commission, il est indispensable d'améliorer la lutte contre la fraude pour restaurer un climat de confiance et garantir des règles du jeu équitables, conditions essentielles pour assurer la viabilité économique et l'efficacité environnementale du modèle circulaire (Proposition n° 6).
II. PILOTER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE INDISPENSABLE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE...
A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST AUJOURD'HUI INDISPENSABLE
Pour beaucoup d'acteurs, la politique d'économie circulaire manque aujourd'hui de vision d'ensemble, de boussole. Pour investir et pour innover, les acteurs économiques ont pourtant besoin de visibilité. Une vraie coordination interministérielle est également demandée, car l'économie circulaire ne répond pas uniquement à un enjeu environnemental. Elle est aussi intimement liée à notre industrie, à notre économie, à notre politique de formation et à nos problématiques d'aménagement du territoire.
C'est pourquoi la commission propose qu'une stratégie industrielle soit élaborée au plus haut niveau, par un service à compétence interministérielle directement rattaché au Premier ministre. Cette stratégie permettra de fixer des objectifs chiffrés à moyen terme, de préciser les leviers à mobiliser - qu'il s'agisse des écocontributions, de la formation, des aides publiques ou des investissements - tout en clarifiant ce qui relève ou non du champ d'action des éco-organismes. Et surtout, elle s'imposerait à l'ensemble des ministères, pour garantir la cohérence de l'action publique (Proposition n° 1).
Pour éviter que cette stratégie nationale ne reste qu'une stratégie de papier, un ancrage territorial est indispensable. La région, qui dispose depuis la loi NOTRe de 20153(*) d'une compétence de planification en matière de déchets est l'échelon le plus pertinent pour territorialiser cette stratégie.
Encore faut-il doter les régions de moyens à la hauteur de cette nouvelle ambition. L'adaptation des financements est ainsi une condition sine qua non de la réussite. À cet égard, le fonds économie circulaire, qui soutient déjà des projets de réduction des déchets, de réemploi et de recyclage, pourrait utilement évoluer vers une gestion partagée entre l'Ademe et les régions. Il deviendrait alors le « bras armé » de la stratégie nationale, déployée au plus près des territoires.
B. UNE REFONTE DE LA GOUVERNANCE DES ÉCO-ORGANISMES, POUR RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION ET AFFIRMER LE RÔLE DE RÉGULATEUR DE L'ÉTAT
Les rapporteurs plaident également pour la refonte de la gouvernance des éco-organismes4(*). De nombreux acteurs ont alerté les rapporteurs sur un déséquilibre : les producteurs, qui financent le système, en conservent aussi le contrôle, créant un conflit d'intérêts structurel. L'objectif légitime de contenir les coûts peut se traduire, dans les faits, par une pression sur les collectivités et les opérateurs de déchets, au détriment de l'intérêt général, et par des difficultés dans l'atteinte des cibles fixées par l'État.
La loi Agec avait posé les premiers jalons d'une gouvernance plus ouverte, en créant :
· la commission interfilières REP (CiFREP), qui a vocation à être l'instance de dialogue transversale aux différentes filières REP ;
· des comités des parties prenantes (CPP), placés auprès de chaque éco-organisme, qui rendent un avis public non contraignant sur certaines décisions.
Cette gouvernance actuelle montre aujourd'hui ses limites : instances peu efficaces, consultation purement formelle, composition insuffisamment représentative.
Pour la commission, ces structures doivent être remplacées par de nouveaux comités des parties prenantes, institués au niveau de chaque filière REP. Dotés de véritables pouvoirs de pilotage (orientation stratégique, suivi des résultats, validation des plans d'action), ces comités auront une composition adaptée au fonctionnement de chaque filière, garantissant une représentation équilibrée des parties prenantes et une co-construction renforcée des décisions (Proposition n° 3).
Les rapporteurs ont également constaté des limites dans la régulation par l'État des éco-organismes, en particulier s'agissant de l'encadrement de la concurrence entre éco-organismes, à l'origine d'effets pervers : dumping réglementaire ou financier, complexité excessive pour les collectivités, ou encore inefficacité environnementale.
Pour la commission, l'État doit jouer pleinement son rôle de régulateur. L'État, garant de l'intérêt général, doit pouvoir imposer des objectifs clairs, proportionnés, économiquement soutenables et veiller à leur respect ainsi qu'encadrer la concurrence entre éco-organismes (Proposition n° 2).
III. ... À DÉPLOYER TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT, DE LA CONCEPTION DU PRODUIT AU TRAITEMENT DU DÉCHET
A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT
Dès la conception, l'économie circulaire doit être pensée. L'écoconception -- qui consiste à créer des produits plus durables, réparables, recyclables -- doit être mieux encouragée, notamment par un système de bonus-malus renforcé et harmonisé à l'échelle européenne, pour valoriser les produits les plus vertueux.
Au moment de la commercialisation, il faut aussi agir. Nous devons freiner la surconsommation, en encadrant les pratiques publicitaires les plus agressives. À ce titre, la commission propose que la publicité contribue elle aussi à la prévention et au traitement des déchets. Puisqu'elle incite à consommer, elle doit assumer sa part de responsabilité dans le cadre de la REP.
Pour garantir l'universalité de la mise en oeuvre de ce principe, la commission propose également la création d'une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « amont ». Le principe de cette taxe « balai » est simple : lorsqu'un produit n'est pas couvert par une filière REP, le producteur devra s'acquitter d'une taxe, reversée aux collectivités territoriales, pour couvrir le coût de la gestion du déchet qu'elles supporteraient à défaut seules.
B. LA COLLECTE : SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PAR UNE PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE ET UN FINANCEMENT ADAPTÉ
Les travaux des rapporteurs confirment la position constante de la commission : la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques n'est pas la bonne solution. Elle concentre le débat sur une part très minoritaire des déchets plastiques, avec des effets négatifs bien identifiés tant économiques qu'environnementaux.
Pourtant, la mise en oeuvre de la consigne constituera une obligation européenne, si l'objectif intermédiaire de collecte des bouteilles plastiques n'est pas atteint en 2026. La suppression de cet objectif intermédiaire européen est donc souhaitable, pour laisser aux mesures locales les plus adaptées au terrain et déjà engagées, le temps de porter leurs fruits.
L'État doit accompagner les collectivités dans cette transition, en tenant compte de leurs réalités. Cela passe par un soutien plus fort au tri à la source des biodéchets, un assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la tarification incitative, et un effort renouvelé de communication auprès des citoyens.
C. UNE HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS À RÉAFFIRMER
Il est enfin urgent de réaffirmer un principe fondamental : celui de la hiérarchie des modes de traitement. Inscrite dans notre droit depuis 19755(*), cette hiérarchie nous invite à privilégier la réparation, le réemploi et la réutilisation avant le recyclage. C'est une logique de sobriété, à la fois plus respectueuse des ressources, plus sobre en énergie et favorable à l'emploi local, qui a été privilégiée par le législateur.
La loi Agec a amorcé ce virage, avec la création de deux fonds : l'un dédié à la réparation -- qui finance le « bonus réparation » -- et l'autre dédié au réemploi -- qui soutient les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS). Mais leur mise en oeuvre reste encore trop laborieuse.
Les difficultés tiennent pour beaucoup à leur gouvernance : ces fonds sont aujourd'hui pilotés par les éco-organismes, eux-mêmes contrôlés par les producteurs, ce qui crée un conflit d'intérêts évident.
La commission propose, pour y remédier, de confier aux régions la gestion de ces fonds. Cela permettrait de renforcer leur efficacité, de mieux les ancrer dans les territoires, et de prévenir les blocages liés aux intérêts financiers des filières. Elle plaide également pour une meilleure reconnaissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en leur garantissant un accès prioritaire aux gisements de déchets réutilisables.
« Dans le contexte de la montée en puissance des distributeurs et des plateformes de seconde main, il est essentiel de protéger la plus-value sociale et environnementale qu'apportent les structures de l'ESS. »
Jacques Fernique, rapporteur
Bien entendu, même si la réparation et le réemploi doivent être encouragés en priorité, le développement de capacités nationales de recyclage reste indispensable, ce qui limite le taux de recyclage sur le plan environnemental. Sur le plan économique, elle contraint les éco-organismes à exporter les déchets, et oblige les producteurs à importer de la matière recyclée pour tenir leurs objectifs d'incorporation.
Pour la commission, l'État doit donc soutenir le développement d'une véritable industrie nationale du recyclage, capable de traiter plus de matière recyclable sur notre sol et de garantir des débouchés économiques stables à ses filières.
I. UNE POLITIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE STRATÉGIQUE
A. UNE LOI À L'ORIGINE D'OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, DONT LA PLUPART RESTENT, À CE STADE, NON ATTEINTS
1. La loi Agec de 2020, première loi française dédiée à l'économie circulaire
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - dite loi Agec de 2020 -, première loi française dédiée à l'économie circulaire, avait avant tout une visée environnementale. S'inscrivant dans un objectif plus large d'« accélération écologique », le projet de loi avait pour vocation, selon le discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, « d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes »6(*).
Le projet de loi initial, déposé le 10 juillet 2019, initialement constitué de 13 articles, a été considérablement enrichi par le Sénat, qui l'a porté à 103 articles, puis par l'Assemblée nationale : le texte promulgué comportait au total 130 articles.
Le texte définitif regroupe ainsi des dispositions hétérogènes de portée et d'ampleur variable, mais qui poursuivent toutes des objectifs partagés, s'inscrivant dans le cadre du passage à l'économie circulaire :
- mieux informer le consommateur sur ses choix de consommation ;
- lutter contre le gaspillage en favorisant le réemploi, la réutilisation ainsi que l'économie de la fonctionnalité et servicielle ;
- assurer l'application du principe « pollueur-payeur », en étendant et en approfondissant le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) ;
- mieux lutter contre les dépôts sauvages.
L'économie circulaire
La transition vers une économie circulaire vise, conformément à l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ».
L'économie circulaire a ainsi pour objectif la réduction de l'empreinte environnementale par trois moyens distincts :
- la prévention des déchets par la sobriété dans la consommation, la lutte contre le gaspillage et la mise en oeuvre de l'écoconception ;
- l'allongement de la durée de vie des produits (réparation, réemploi, réutilisation) ;
- le respect de la hiérarchie des modes de traitement, qui permet de limiter leur impact environnemental (recyclage, ou à défaut valorisation énergétique des déchets et en dernier recours, enfouissement).
En France, ce concept de hiérarchie des modes de traitement est introduit par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, qui anticipe la transposition d'une directive européenne sur le même sujet7(*). Cette loi fondatrice acte la préférence pour la prévention de la production de déchets sur le recyclage, lui-même à privilégier par rapport à la valorisation énergétique et à l'enfouissement. La loi a ensuite progressivement appliqué les préceptes de l'économie circulaire, et intégré explicitement au code de l'environnement ce concept par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi « TECV ».
Au-delà de ces mesures, la loi Agec de 2020 a fixé des objectifs environnementaux à atteindre qui semblent, de l'aveu de l'ensemble des personnes entendues par la mission d'information, particulièrement ambitieux.
Dans le détail, la loi a fixé 81 objectifs environnementaux, de différentes natures, analysés par le rapport du groupe de travail « Évaluation » du Conseil national de l'économie circulaire (Cnec)8(*) : 70 de ces objectifs sont qualitatifs, tandis que 11 sont quantitatifs.
Parmi les objectifs quantitatifs, le Cnec différencie les objectifs mesurables, c'est-à-dire ceux pour lesquels des données et une méthodologie existent, des objectifs non mesurables. Parmi les objectifs non mesurables, une deuxième typologie d'objectifs est effectuée, entre les objectifs effectivement mesurés par un organisme et les objectifs non mesurés. Concernant la loi Agec de 2020, 9 objectifs sont mesurables, tandis que 2 ne sont pas mesurables faute d'indicateur et de données disponibles et 7 de ces objectifs mesurables sont effectivement mesurés.
Les objectifs définis par le Cnec comme « qualitatifs » regroupent les objectifs non chiffrés : parmi les 70 objectifs, on retrouve 40 « obligations », 18 « interdictions », 7 « créations » et 4 « possibilités ». Les contrôles sur ces objectifs apparaissent également limités : selon le rapport du Cnec précité, seuls 17 de ces 70 objectifs font l'objet de contrôles par l'administration.
Seule une minorité des objectifs de la loi Agec de 2020 peuvent ainsi être mesurés, limitant ainsi les possibilités d'évaluation de la loi.
Objectifs quantitatifs de la loi Agec de 2020
|
Article de la loi Agec de 2020 |
Objectif |
Statut |
|
3 |
Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2030 par rapport à 2010 |
Mesurable et mesuré |
|
3 |
Réduire de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2030 par rapport à 2010 |
Mesurable et mesuré |
|
4 |
Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, afin d'atteindre l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 |
Mesurable, mais non mesuré |
|
5 |
Tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025 |
Mesurable et mesuré |
|
9 |
Mettre en place une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027 |
Non mesurable |
|
10 |
Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse |
Mesurable et mesuré |
|
11 |
Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale |
Non mesurable |
|
66 |
Atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 |
Mesurable et mesuré |
|
66 |
Réduire de 50 % d'ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché |
Mesurable et mesuré |
|
72 |
Consacrer 5 % des contributions reçues par les éco-organismes aux fonds de réemploi et de réutilisation |
Mesurable et mesuré |
|
110 |
Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière9(*) d'ici 2025 |
Mesurable, mais non mesuré |
Source : Cnec, 2023
2. Les premiers éléments de trajectoire témoignent de difficultés dans l'atteinte des objectifs
Les échéances des objectifs ne permettent pas, à ce stade, d'en dresser un bilan global, puisque le législateur n'a prévu une échéance antérieure à 2025 que pour un seul objectif. Toutefois, l'écart à la trajectoire d'atteinte -- fixée au niveau réglementaire ou dans les cahiers des charges des éco-organismes -- permet d'ores et déjà d'évaluer le réalisme de l'atteinte des objectifs environnementaux.
Certains de ces objectifs dépassent déjà la trajectoire prévue par la loi Agec, ce dont on peut se réjouir. Ainsi, concernant la réduction des déchets en installation de stockage, une forte baisse des déchets mis en décharge est constatée : entre 2010 et 2023, le tonnage s'est réduit de 29 %, alors même que la loi Agec ne prévoyait qu'une réduction de 10 % d'ici 203510(*).
Pour la plupart de ces objectifs, la trajectoire apparaît toutefois à ce stade difficile à tenir.
Les objectifs de prévention des déchets constituent l'axe le plus en retard sur l'échéance. S'agissant de la quantité de déchets, la tendance est à l'augmentation, alors même que la loi Agec de 2020 prévoit une diminution de 15 % de la quantité de déchets ménagers par habitant par rapport à 2010. En 2021, 611 kg de déchets sont collectés par habitant, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année de référence 201011(*). Selon les projections de l'association de collectivités territoriales Amorce transmises à la mission, ce chiffre devrait rester stable d'ici 2030, atteignant à cette date 606 kg par habitant.
Les objectifs relatifs au recyclage n'apparaissent également pas en situation d'être atteints. S'agissant du plastique, alors que la loi Agec de 2020 prévoyait de tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025, seuls 28 % des emballages plastiques ménagers sont recyclés en France.
Alors même que l'un des objectifs de la loi Agec était de porter les politiques publiques de l'économie circulaire vers l'amont (sobriété, prévention des déchets, réemploi, réparation) et non plus seulement vers l'aval (recyclage, valorisation, réduction de l'enfouissement), il apparaît paradoxalement que seul l'objectif le plus en aval de la réduction de l'enfouissement est en passe d'être atteint.
L'évaluation de l'atteinte des objectifs qualitatifs tend également à renforcer le constat de difficultés dans l'atteinte des objectifs de la loi Agec de 2020.
L'article 88 de la loi Agec a ainsi fixé un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets à la date du 31 décembre 2023. Pourtant, au 1er janvier 2025, l'Ademe estime que seul environ un français sur deux -- soit 32 millions d'habitants -- est desservi par une solution pour ses biodéchets.
Couverture de la population en tri à la source des biodéchets
Source : CATDD, à partir des données de la direction générale de la prévention des risques (DGPR)
3. En dépit de ces difficultés, la définition de ces objectifs a permis une prise de conscience
Les auditions des rapporteurs ont permis de constater une certaine unanimité de la part des acteurs entendus quant à la prise de conscience permise par les objectifs environnementaux ambitieux de la loi Agec de 2020.
D'une part, l'accent mis sur la prévention des déchets a conduit, dans toutes les filières, à une réflexion sur les possibilités de réemploi et de réparation, qui n'était pas systématique dans toutes les filières REP. Même si les objectifs ne sont à ce stade pas atteints, une réflexion globale sur les opportunités de développement de ces pratiques est ainsi de plus en plus développée.
D'autre part, les objectifs transversaux de la loi Agec de 2020 ont permis un rattrapage des filières économiques moins avancées sur ce sujet. Par exemple, pour le secteur du bâtiment, l'article 72 de la loi Agec de 2020 a conduit à la création en 2023 d'une filière REP, dite « Produits et matériaux de construction du bâtiment » (PMCB). Deux ans plus tard, la plupart des objectifs fixés pour cette filière REP sont loin d'être atteints. Toutefois, la loi a permis des avancées : la création de points de collectes disponibles pour tous les détenteurs de déchets sur tous les canaux de reprise (points de proximité, entrepôts, chantiers) et la sensible amélioration des quantités collectées et recyclées pour certaines matières comme le plâtre ou le verre12(*).
Les filières à responsabilité élargie des producteurs
Le principe de REP, introduit en France par la loi du 15 juillet 1975 précitée et dans l'Union européenne (UE) par la directive-cadre déchet de 200813(*), constitue une application du principe « pollueur-payeur », en transférant la responsabilité de la prévention et de la gestion des déchets aux producteurs : ce principe est aujourd'hui fixé au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
L'essentiel des producteurs s'acquitte collectivement de cette obligation en mettant en place des éco-organismes dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. Ils versent à cet éco-organisme une contribution financière appelée écocontribution14(*).
Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics15(*) pour une durée maximale de six ans renouvelables, doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.
Avant la loi Agec, il existait douze filières REP, aujourd'hui mentionnées à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement16(*). La loi Agec a complété cette liste par dix nouvelles filières, créées ou devant être créées entre 2021 et 202517(*).
En plus du quasi-doublement des filières intégrées, la loi Agec a largement modifié le régime des filières REP pour le rendre plus robuste. Elle a notamment aggravé les sanctions associées (art. L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l'environnement), en instituant une instance de gouvernance - la commission interfilières REP - et une instance de supervision des filières - la direction de supervision des filières REP au sein de l'Ademe, ou encore en renforçant la modulation des écocontributions.
Plus généralement, comme l'a relevé France Industrie dans son audition, la loi Agec de 2020 a permis de faire de l'économie circulaire un sujet pour tous les acteurs économiques, et plus seulement pour les gestionnaires de déchets. Selon l'expression utilisée par le Cnec, la loi Agec de 2020 aurait ainsi constitué un « coup de pied dans la fourmilière »18(*).
In fine, comme l'a souligné un éco-organisme de la filière REP PMCB, « les objectifs sont faits pour être challengeant et ambitieux »19(*), et les difficultés actuellement rencontrées dans leur atteinte quatre ans plus tard paraissent être révélatrices de l'ambition du législateur plutôt que d'un échec de la loi.
B. L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE, NOUVEL ENJEU PRIMORDIAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Au cours d'un déplacement auprès des institutions de l'UE, les rapporteurs, après avoir échangé avec la Commission européenne, la Représentation permanente de la France auprès de l'UE et des ONG européennes, ont pu constater l'importance de l'économie circulaire pour assurer une autonomie stratégique, enjeu particulièrement pris en compte à l'échelle européenne.
Les différents interlocuteurs rencontrés ont ainsi souligné la spécificité de l'économie circulaire par rapport aux autres volets de la politique environnementale : alors que le Pacte vert pour l'Europe semble, en 2025, à l'arrêt, l'économie circulaire est le seul objectif pour lequel une dynamique persiste, avec l'adoption de nombreuses réglementations sectorielles durant ces dernières années (règlement « Emballages » de 202520(*), règlement « Écoconception » de 202421(*), règlement « Batteries » de 202322(*), projet de révision de la directive-cadre déchets...). Un projet plus global de réglementation, l'acte européen sur l'économie circulaire, devrait d'ailleurs être présenté en 2026.
L'acte européen sur l'économie circulaire
La Commission européenne a annoncé qu'elle présenterait d'ici 2026 un « acte » européen sur l'économie circulaire qui vise à renforcer l'économie circulaire en Europe grâce à une série de mesures structurantes, avec un accent sur l'optimisation de la gestion des déchets, l'amélioration du recyclage des équipements électroniques et la création d'un cadre incitatif pour soutenir les entreprises et les acteurs publics dans cette transformation.
L'objectif principal de la Commission européenne est de réduire la dépendance aux ressources vierges, d'améliorer la gestion des déchets et d'optimiser l'utilisation des matières premières dans un cadre plus durable, en multipliant par deux d'ici 2030 le taux de circularité23(*).
Cette spécificité s'explique, selon la Commission européenne et selon la Représentation permanente de la France auprès de l'UE (RPFUE), par une prise de conscience de l'importance de la rétention de matière sur le continent européen. Le cabinet de la commissaire européenne Jessika Roswell, chargée de l'environnement, de la résilience en matière d'eau et d'une économie circulaire compétitive, évoque ainsi une menace, depuis la crise de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine, d'une « crise de la matière », qui serait également liée à une dépendance européenne aux importations.
En France, l'économie circulaire est un levier pour assurer l'autonomie stratégique nationale en réduisant la dépendance aux importations de ressources critiques. Elle apparaît, à ce stade, insuffisamment prise en considération.
Au contraire, certaines politiques mises en oeuvre dans le cadre de l'économie circulaire en France ont paradoxalement augmenté la dépendance aux importations plutôt qu'à la réduire dans certains secteurs. Au cours de son audition, l'Alliance du commerce a ainsi déploré une insuffisante prise en compte de la dépendance aux importations dans les obligations d'incorporation de plastique recyclé propres à la filière REP Textiles qui a conduit, dans un premier temps, à importer de la matière recyclée plutôt qu'à la recycler en France. De même, durant son audition, la Fédération nationale du bois (FNB) a déploré l'export de déchets de bois-construction engendré par la création en 2023 de la filière REP PMCB, en raison de l'insuffisance en France des capacités de recyclage.
Les politiques d'économie circulaire permettent pourtant de mobiliser un gisement de ressources matières considérables. Les déchets générés annuellement en France représentent potentiellement plus de 40 % des besoins annuels de matière pour la consommation24(*), et constituent donc une opportunité de réduction de la dépendance aux importations. Selon le Medef, il convient ainsi « de s'interroger sur la manière dont l'État prend en compte les enjeux relatifs aux ressources qui sont des enjeux de souveraineté majeurs. Or, ce sujet pourtant central est quasiment absent du fonctionnement du système REP. »
Ces mêmes politiques, en plus de réduire la dépendance aux importations, constituent aussi un potentiel frein aux délocalisations. Comme le souligne par exemple le Réseau Vrac et Réemploi au cours de son audition, la mise en oeuvre du réemploi d'emballages consignés rend difficile la délocalisation de la production : pour que ce mode d'emballage soit économiquement soutenable, les lieux de production et de distribution ne doivent pas être éloignés de plus de 200 kilomètres.
Les rapporteurs appellent à une prise de conscience collective au niveau national de notre vulnérabilité en termes d'approvisionnement en matières premières, et à assurer la prise en compte de l'impératif d'autonomie stratégique dans l'ensemble des politiques d'économie circulaire, en favorisant une vision interministérielle de ces politiques.
C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les auditions des rapporteurs ont permis de constater que l'acceptabilité de l'économie circulaire est conditionnée à l'impact des obligations sur la compétitivité économique. Comme l'a souligné par exemple la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD), de nombreux acteurs économiques considèrent qu'à ce stade, la performance environnementale a été privilégiée dans la régulation des filières REP sans suffisamment prendre en compte l'impact de l'économie circulaire sur la performance économique.
1. Une augmentation exponentielle des écocontributions, source d'inquiétudes et de distorsions économiques
Les acteurs économiques entendus, dont notamment France Industrie et le Medef, ont fait part de leurs inquiétudes face au coût économique croissant des filières REP, qui apparaît insuffisamment évalué lors du vote de la loi Agec de 2020.
Pour les filières existantes, la loi Agec s'est ainsi traduite par un quasi-doublement des écocontributions du fait de l'extension des obligations (fonds réparation et réemploi, prise en charge du nettoiement, lutte contre les dépôts sauvages...). À l'horizon 2029, les écocontributions devraient ainsi atteindre 8 milliards d'euros, contre 900 millions d'euros en 2010, soit une multiplication plus de 8 en moins de 20 ans due à un élargissement du nombre de producteurs concerné et à une augmentation des écocontributions.
Évolution du montant total des
écocontributions
(constatée pour 2010 et 2022,
projetée pour 2024 et 2029)
Source : CATDD, à partir des données de la DGPR
À titre d'exemple, pour la filière REP des déchets, équipements électriques et électroniques (DEEE), l'intégration au cahier des charges des évolutions de la loi Agec de 2020 fait passer le montant des écocontributions de 382 millions d'euros en 2023 à 550 millions d'euros en 2025, en raison du renforcement des objectifs de collecte et de recyclage, de la création de fonds réemploi et réparation, et de l'obligation de financement de projets de recherche et développement. Comme le souligne l'éco-organisme de la filière REP DEEE Ecologic, l'acceptation de cette augmentation est « d'autant plus difficile que les justifications environnementales de ces augmentations ne sont pas démontrées et que les producteurs soupçonnent du gaspillage »25(*).
Cette hausse exponentielle engendre, comme le relèvent le Medef et France Industrie devant les rapporteurs, un manque d'acceptabilité de la part des producteurs, qui ne perçoivent pas une amélioration équivalente des performances environnementales des filières.
Pour les acteurs de la nouvelle filière REP PMCB, le manque d'acceptabilité économique est particulièrement fort en raison d'une trajectoire économique difficilement soutenable pour les acteurs économiques du secteur, comme le dénoncent les éco-organismes agréés26(*) et certaines organisations professionnelles, comme Coedis27(*), qui représente les entreprises de la distribution professionnelle spécialisées dans l'approvisionnement au second oeuvre du bâtiment.
Budget des éco-organismes de la
filière REP PMCB
(constaté pour 2023 et 2024,
projeté 2027)
Source : CATDD à partir des données de la DGPR
Le coût de l'économie circulaire est par ailleurs plus substantiel que celui des écocontributions, en raison d'une charge administrative liée à la mise en conformité aux exigences de la loi Agec de 2020. À titre d'exemple, pour le groupe Fnac-Darty, le coût administratif lié à la mise en conformité avec la loi Agec de 2020 est ainsi estimé à 1,5 million d'euros par la Fevad28(*).
Au-delà de l'impact économique direct, ces écocontributions sont source de distorsions de concurrence, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale.
Les écocontributions peuvent tout d'abord favoriser certains produits par rapport à d'autres. Ainsi, comme le relève la Fédération nationale du bois (FNB), le barème des écocontributions de la filière REP PMCB tend structurellement à défavoriser le bois-construction, pourtant matériau plus vertueux environnementalement, par rapport aux autres matériaux de même catégorie : en 2023, le barème moyen d'écocontributions s'élève à 7,6 euros par tonne pour le bois-construction, contre 5 euros par tonne en moyenne pour les matériaux non inertes de la filière. La proposition de loi de Mme Anne-Catherine Loisier visant à rééquilibrer la filière REP PMCB au profit des produits du bois29(*), adoptée le 15 mai 2025 par le Sénat, vise précisément à répondre à cette problématique. Ce texte propose d'instaurer un mécanisme de juste répartition de l'effort financier attendu des différents matériaux, au profit des matériaux les plus performants en matière d'économie circulaire, en visant particulièrement le bois-construction.
Les rapporteurs appellent la poursuite de la navette parlementaire de ce texte, très attendu par la filière bois, et à son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, afin d'assurer une répartition plus équitable des efforts entre les matériaux.
2. La fraude de certains producteurs réduit l'acceptabilité de l'économie circulaire
a) Une fraude qui reste conséquente, en dépit des améliorations permises par l'article 62 de la loi Agec de 2020
La principale distorsion de concurrence relative à l'économie circulaire concerne la fraude aux écocontributions : il arrive en effet que des producteurs ne s'acquittent pas de leurs obligations relatives à l'économie circulaire, soit en ne s'enregistrant pas auprès d'un éco-organisme soit en établissant auprès de l'éco-organisme de fausses déclarations --. Ces « passagers clandestins », ou « free riders », bénéficient alors d'un avantage comparatif par rapport aux producteurs respectueux du cadre légal.
Alors que la part des écocontributions tend à devenir de plus en plus importante dans le prix du produit, la distorsion de concurrence avec les récalcitrants risques de nuire fortement à l'acceptabilité globale du dispositif.
Le contrôle et la sanction des fraudeurs : une procédure qui repose sur une coopération entre éco-organismes et administration
L'article R. 541-120-1 du code de l'environnement assigne aux éco-organismes une mission de sensibilisation des producteurs à leurs obligations de responsabilité élargie, et les charge d'établir des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées.
En application de cette disposition, les éco-organismes transmettent à la DGPR des dossiers permettant de lancer la procédure de sanction prévue à l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement :
- le ministre chargé de l'environnement met en demeure la personne intéressée, qui dispose d'un mois pour présenter ses observations ;
- par une décision motivée, le ministre chargé de l'environnement peut ensuite prononcer une amende administrative qui ne peut excéder, par unité ou par tonne de produits concernés, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 pour une personne morale. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 euros ;
- dans le cas où le producteur ne dispose pas d'un identifiant unique, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner en plus le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 euros.
L'article 62 de la loi Agec de 2020 a renforcé la lutte contre la fraude aux écocontributions en prévoyant :
- à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement qu'une interface électronique est soumise aux obligations de responsabilité élargie des producteurs, sauf lorsque l'interface justifie que le tiers producteur a déjà rempli ces obligations ;
- à l'article L. 541-10-10 du même code un identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de REP et qui peut être demandé par l'acheteur.
Le développement conjoint de ces deux outils a contribué fortement à réduire la fraude, tout particulièrement dans le cadre des interfaces électroniques. Dans la filière REP DEEE, la possibilité pour la place de marché de se substituer au producteur a ainsi entraîné une explosion du nombre de metteurs sur le marché contributeurs auprès d'un éco-organisme, témoignant d'une régularisation de la situation des producteurs fraudeurs. Entre 2021 et 2023, le nombre de metteurs en marché adhérents à un éco-organisme de la filière REP DEEE a ainsi été multiplié par cinq en seulement deux ans.
Évolution du nombre de metteurs en
marché adhérents
à la filière REP
DEEE
Source : à partir des données de l'éco-organisme Ecosystem
La fraude aux écocontributions reste toutefois un enjeu majeur pour les filières REP, tout en étant d'ampleur variable selon les filières et les produits.
Les sanctions prononcées par la DGPR contre les fraudeurs aux écocontributions sont, à ce stade, limitées : du 1er janvier 2024 au 15 mars 2025, 176 dossiers « complets » ont été transmis par les éco-organismes à la DGPR qui, en retour, a adressé 138 mises en demeure. Dans ce cadre, 46 metteurs sur le marché se sont d'ores et déjà mis en conformité et seules 7 sanctions ont été prononcées.
La fraude aux écocontributions est toutefois bien plus répandue que ne le laissent à penser les signalements effectués. Par exemple, s'agissant du bois-construction, la DGPR a reçu 20 signalements par les éco-organismes, pour un montant d'écocontributions évalué à 130 000 euros, qui ont conduit à 10 mises en demeure. La comparaison entre les déclarations aux éco-organismes et le gisement évalué par l'étude de préfiguration de la filière REP PMCB permet d'estimer qu'environ 35 % des mises sur le marché de bois ne font pas l'objet d'écocontributions, soit un chiffre bien plus conséquent que les quelques signalements remontés30(*).
La filière REP « Textile, linges et chaussures » (TLC) connaît également une fraude significative, en raison du développement du phénomène des « facilitateurs ». Depuis l'entrée en vigueur de l'identifiant unique, un marché de mandataires qui facilitent la déclaration des metteurs en marché asiatiques s'est développé, sans pour autant que ces facilitateurs s'assurent du respect des obligations REP par les metteurs en marché, et sans que ces obligations soient vérifiables. En 2025, environ 50 % des déclarations de la filière REP « Textiles » sont effectuées par ces facilitateurs, dont 90 % concernent des entreprises chinoises représentant environ 30 millions de pièces mises sur le marché, soit 1 % des volumes déclarés31(*).
À l'inverse, la fraude est plus limitée dans certaines filières REP. C'est par exemple le cas de la filière REP « Huiles lubrifiantes ou industrielles ». Bien que nouvelle (création par la loi Agec), cette filière REP parvient à faire contribuer l'équivalent de 93 % de son gisement. La fraude aux écocontributions reste ainsi marginale32(*), en raison de la structuration particulière du marché. De même, dans la filière REP PMCB, le nombre de free riders apparaît extrêmement faible pour les déchets inertes (minéraux) selon l'éco-organisme Écominero33(*).
Certains éco-organismes pointent également des suites insuffisantes portées aux signalements effectués : un éco-organisme, Valdelia, déclare ainsi avoir transmis une trentaine de dossiers étayés de contrevenants pour établir la non-adhésion et la non-contribution de metteurs sur le marché, sans pour autant avoir eu connaissance de la moindre sanction prononcée, dont la cause serait « un manque de moyens humains de la DGPR pour analyser ces dossiers et les instruire »34(*). De la même manière, l'éco-organisme Citeo dans la filière REP Emballages ménagers et papiers graphiques (EMPG) remarquait « jusqu'à présent un manque de visibilité sur le suivi et les actions menées par les pouvoirs publics pour investiguer sur les dossiers transmis », tout en se félicitant de « la récente publication de sanctions à l'égard de sept free riders » et en appelant la DGPR à poursuivre cette méthode35(*).
Le manque de moyens des services instructeurs oblige bien souvent la DGPR à se concentrer sur les dossiers les plus emblématiques : selon le Medef, « l'État n'a pas les moyens de sanctionner les petits montants. Or il s'agit le plus souvent d'une multitude de petits montants qui, ajoutés, constituent à la fin des montants importants. »36(*)
Enfin, l'effet dissuasif des sanctions prononcées (amendes administratives éventuellement assorties d'astreintes) est limité, comme le déplore l'Organisme coordinateur agréé pour la filière du bâtiment (Ocab), en raison d'un manque de communication de l'État sur les sanctions prononcées37(*).
Il convient de noter qu'une part irréductible de la fraude aux écocontributions s'inscrit dans un contexte plus large de contrebande et d'existence de marchés parallèles, les mesures ciblées sur la fraude aux écocontributions ne permettront en tout état de cause pas de réduire ces phénomènes. La filière REP « Produits du tabac » est particulièrement concernée, comme le dénonce l'éco-organisme Alcome38(*) : « le marché parallèle représente environ 38 % de la consommation, dont 15 % d'achats légaux à l'étranger, et 23 % de contrebande et de contrefaçon. Ces volumes échappent au dispositif d'écocontribution alors que la charge de leur nettoiement pèse sur Alcome. »
b) Des aménagements législatifs sont nécessaires, pour rendre la lutte contre la fraude plus dissuasive et efficace
Les rapporteurs appellent aujourd'hui à des évolutions législatives, dans la continuité de la loi Agec de 2020, pour assurer une lutte efficace contre la fraude et garantir ainsi l'acceptabilité de l'écocontribution chez l'ensemble des producteurs.
Plusieurs éco-organismes, des fédérations de producteurs, comme l'Association des industries françaises des matériaux (AIMCC), la Fédération des industries des peintures, encres, colles, couleurs et résines (Fipec) et L'Ameublement français ainsi que la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC) et l'Union nationale des entreprises de valorisation (Unev) ont évoqué la généralisation de la visibilité des écocontributions en tant que piste d'amélioration de la lutte contre la fraude. Selon eux, rendre visible pour le consommateur final l'écocontribution assumée sur un produit dans les différentes filières REP -- comme c'est aujourd'hui le cas pour les filières REP DEA et DEEE -- serait de nature à lutter contre les passagers clandestins et à mieux informer le consommateur39(*).
Au cours, de leurs auditions, la DGPR et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont toutefois émis des réserves quant à l'efficacité d'une telle mesure. Selon la DGCCRF, « l'affichage d'une écocontribution visible n'est pas gage d'une meilleure efficacité du dispositif de REP, et ne constitue pas un outil adéquat de lutte contre les fraudes, car la mention sur les factures n'est pas une garantie de paiement : un producteur fraudeur peut ne pas la payer et l'afficher quand même »40(*).
Une telle mesure n'apparaît également pas adaptée à l'objectif d'information du consommateur, également cité par les éco-organismes à l'origine de la proposition. En effet, comme le souligne également la DGCCRF, « son montant peut être dérisoire (ex : quelques centimes sur les téléphones mobiles), et n'a pas de signification autre que le montant payé par le producteur à l'éco-organisme pour la prise en charge de la fin de vie du produit. Il ne reflète pas le coût de gestion des déchets, encore moins le coût écologique du produit, et son affichage peut donc conduire à brouiller le message avec les autres informations environnementales (affichage énergétique, indice de réparabilité...), à minimiser les impacts environnementaux ». L'association de collectivités territoriales Amorce41(*) partage cette vision, considérant qu'en termes « d'affichage pour le public, des indices prévus par la loi Agec (réparabilité) semblent plus pertinents pour orienter le geste d'achat au regard de la qualité du produit et de son écoconception. »
Plus généralement, il n'est pas certain que la visibilité de l'écocontribution s'inscrive pleinement dans la logique de la REP : en vertu du principe « pollueur-payeur », l'écocontribution vise à internaliser le coût de gestion du produit, qui constitue le coût réel du produit, à l'image de la masse salariale ou des coûts de recherche et développement par exemple. Pour le président de la CiFREP « la transmission pure et simple de l'écocontribution aux consommateurs finaux déresponsabilise les producteurs » voire même risque de transformer la REP en une « responsabilité élargie du consommateur »42(*).
Les rapporteurs considèrent ainsi que, s'agissant de la lutte contre la fraude aux écocontributions, la généralisation de la visibilité de l'écocontribution n'est pas une mesure adaptée, ce d'autant plus que, comme le souligne la DGPR et la Fédération des magasins de bricolage (FMB)43(*), une telle mesure serait une charge administrative supplémentaire pour l'entreprise et pourrait réduire l'incitation à l'écoconception, en retirant l'écocontribution des négociations commerciales.
La poursuite des metteurs en marché non établis en France, et spécifiquement de ceux non établis dans l'Union européenne, apparaît particulièrement difficile. L'éco-organisme Aliapur de la filière REP Pneumatiques considère ainsi « qu'un à deux millions de pneus entrent en France sans payer d'écocontribution ». L'éco-organisme souligne que, pour le plus gros acteur identifié, domicilié hors de l'Union européenne, l'administration leur a indiqué que « des poursuites ont peu de chances d'aboutir »44(*).
En effet, comme le souligne le Medef, l'État est aujourd'hui « dans l'incapacité d'émettre des amendes administratives contre des entreprises basées à l'étranger » tandis que, pour les éco-organismes « la procédure actuelle les oblige à notifier à l'étranger les décisions des tribunaux français, ce qui est globalement faisable en Europe, mais très coûteux et compliqué hors UE, notamment en Asie »45(*).
L'obligation pour les producteurs non établis en France de désigner un mandataire financier permettrait de faciliter la poursuite de ces metteurs en marché étrangers.
Concrètement, ces producteurs étrangers seraient dans l'obligation de désigner par écrit un mandataire, une personne physique ou morale établie en France chargée d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de REP dont elle accepte le mandat. En cas de non-respect des obligations, l'éco-organisme puis la DGPR pourront ainsi poursuivre le mandataire.
Le principal obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure était sa compatibilité avec le droit européen. Il est toutefois sur le point d'être levé : la révision en cours de la directive-cadre déchets de 2008, qui a fait l'objet d'un accord en trilogue le 15 février 2025, permet aux États membres de rendre la désignation de mandataires financiers obligatoire46(*).
Les rapporteurs appellent ainsi à rendre cette désignation obligatoire comme le prévoient, dans la version adoptée par le Sénat, deux propositions de loi en cours de navette : la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile47(*) et la proposition de loi précitée visant à rééquilibrer la filière à REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois.
Si cette obligation est créée, une vigilance particulière devra être apportée à l'articulation avec la possibilité offerte par l'article 62 de la loi Agec de 2020 aux plateformes en ligne de se substituer aux producteurs dans les obligations de REP, comme l'ont demandé au cours de leur audition commune la Fevad et l'Alliance française des places de marché (AFPDM) : une telle disposition ne doit en effet pas créer de nouvelle obligation pour les producteurs pour lesquels la plateforme fait déjà office de mandataire.
Si l'obligation de désignation d'un mandataire financier permet de faciliter l'application de certaines sanctions, les rapporteurs en mesurent toutefois les limites. Comme le relève la DGPR, « l'efficacité de la mesure dépendra du respect de la désignation d'un mandataire, ce qui n'est pas garanti »48(*). En l'absence de désignation, il restera difficile d'émettre une quelconque sanction. La désignation d'un mandataire permettrait de cibler les déclarations incomplètes ou fausses de producteurs étrangers, plutôt que les producteurs n'ayant effectué aucune déclaration, qui ne désigneront probablement pas de mandataire. Des mesures complémentaires sont donc nécessaires.
De nombreux acteurs entendus ont également souligné la nécessité d'une coopération renforcée entre administrations. L'éco-organisme Aliapur a ainsi pointé le manque de coordination entre les services douaniers et la DGPR, tandis que le Medef considère que le croisement des données serait utile au contrôle des free riders.
En particulier, l'échange de données entre la DGPR et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) apparaît opportun afin de fiabiliser l'évaluation des tonnages mis sur le marché par les non-contributeurs49(*), et de disposer ainsi d'une meilleure évaluation des fraudes liées aux importations, qui nuisent à la compétitivité des producteurs français.
L'échange avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est également souhaitable, dans un contexte d'émergence de plateformes qui contreviennent à la fois au droit de la consommation et aux règles relatives à l'économie circulaire.
Pour les rapporteurs, il convient ainsi d'autoriser les agents de la DGPR, de l'Ademe, des douanes et de la DGCCRF à se communiquer des informations sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire, pour renforcer le cadre des contrôles menés par ces administrations, comme le prévoient les deux propositions de lois précitées relatives à l'impact environnemental du textile et visant à rééquilibrer la filière à REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois.
Il est enfin indispensable, pour mieux lutter contre la fraude aux écocontributions, de rendre les sanctions plus dissuasives, en systématisant la publicité des sanctions prononcées et -- comme le propose la DGPR -- de relever le montant des sanctions prévues : il pourrait ainsi être envisagé d'imposer le paiement rétroactif des contributions non payées à un éco-organisme pour que la fraude coûte in fine plus cher que l'adhésion à un éco-organisme.
Proposition n° 650(*) : Pour renforcer la lutte contre la fraude aux écocontributions et ainsi redonner confiance en l'économie circulaire, il convient de :
- rendre obligatoire la désignation d'un mandataire financier pour les metteurs en marché non établis en France ;
- autoriser le partage d'informations entre administrations ;
- rendre les sanctions plus dissuasives par la publication systématique des sanctions prononcées et le relèvement des niveaux de sanction.
II. PILOTER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE INDISPENSABLE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE
A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE
1. À l'échelle nationale, une stratégie industrielle doit fixer, à moyen terme, les orientations de l'économie circulaire
De nombreuses organisations entendues par les rapporteurs ont déploré le manque de vision industrielle du déploiement des filières REP. Comme le souligne l'éco-organisme Valobat, le « déploiement d'une REP a des incidences sur la politique industrielle du tri, du recyclage et de la valorisation »51(*), il est ainsi nécessaire de « discuter des grandes orientations organisationnelles et industrielles structurantes ». De même, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) insiste sur la nécessité d'une stratégie industrielle coconstruite, « tenant compte des impacts industriels, sociaux, économiques et environnementaux sur toute la chaîne de valeur »52(*).
De nombreux acteurs déplorent également le manque de visibilité à moyen terme sur les orientations politiques de l'État en matière d'économie circulaire, qui entrave la capacité des opérateurs à investir, selon le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets (SNEFiD).
La planification actuelle apparaît ainsi trop « en silos ». Une multiplication de réflexions sectorielles, sur des filières REP particulières, a créé aujourd'hui un « archipel de réglementations », sans réflexion d'ensemble sur les orientations de l'économie circulaire. De nombreux acteurs ont, à ce titre, déploré l'absence de document planificateur intégrateur, depuis la feuille de route économie circulaire (Frec) de 2018.
Enfin, l'absence de dimension interministérielle empêche également le déploiement d'une économie circulaire équilibrée, qui prend en compte non seulement les enjeux environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. Les enjeux de l'économie circulaire dépassent en effet largement le périmètre du ministère de la transition écologique. Le Medef appelle à réfléchir à l'économie circulaire « dans un cadre plus global qui est celui de la politique industrielle de la France et d'une stratégie sur les ressources »53(*).
L'économie circulaire implique en effet un développement industriel, un aménagement du territoire réfléchi ainsi qu'une politique active de formation. À titre d'exemple, lors de son audition, le Réseau Vrac et Réemploi a évoqué les besoins conséquents en formation identifiés pour les prochaines années : le réseau a identifié durant les 15 prochaines années un potentiel de plus de 30 000 emplois dans le secteur du vrac et du réemploi pour atteindre les objectifs de la loi Agec de 2020.
Une stratégie industrielle transversale et interministérielle de l'économie circulaire est ainsi aujourd'hui nécessaire.
Celle-ci doit fixer des objectifs de moyen-terme -- sur 10 ans par exemple --, déclinés par filière REP, qui concerneraient bien sûr les éco-organismes et les metteurs en marché, mais aussi l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire qui contribuent à l'atteinte de ces objectifs : collectivités territoriales, opérateurs de déchet, acteurs de l'ESS, associations environnementales... Cette stratégie identifierait les besoins en capacité ainsi que les leviers à mettre en oeuvre, tout au long de la durée de vie du produit (prévention, réparation, réemploi, recyclage, etc.), pour appuyer la stratégie nationale. Elle dresserait également un schéma directeur pour la réparation, la réutilisation et le réemploi, en cartographiant les gisements sur le territoire.
L'élaboration de la stratégie pourrait être utilement confiée au Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) dont c'est le rôle. Placé auprès du Premier ministre, le SGPE a en effet notamment pour mission de coordonner « l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire »54(*). Le positionnement politique de cet organe est adapté à cette mission. Portée par le Premier ministre, la stratégie définie pourrait ainsi s'imposer à l'ensemble des ministères, à charge pour eux de prendre en compte ces orientations dans leurs politiques.
Comme l'appelle de ses voeux la Fnade, « une véritable co-construction industrielle avec l'ensemble des acteurs concernés »55(*) est indispensable pour dimensionner au mieux cette stratégie. Le SGPE devrait ainsi mener une large concertation initiale en amont de la définition de la filière, qui intégrerait l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire.
2. Une stratégie territorialisée par les régions, chefs de file de l'économie circulaire
La déclinaison territoriale de cette stratégie nationale pourrait naturellement être confiée aux régions, qui sont l'échelon de planification en matière de prévention et de traitement des déchets.
En effet, l'article 8 de la loi NOTRe de 201556(*) a confié aux régions un rôle de planification en matière de gestion des déchets, inscrit à l'article L. 541-13 du code de l'environnement. Les régions sont ainsi chargées d'élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), qui concourt à l'atteinte des objectifs nationaux, en planifiant l'implantation territoriale des installations et en incluant un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.
L'article 109 de la loi Agec de 2020 a renforcé son rôle, en lui confiant « la coordination et l'animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d'économie circulaire, notamment en matière d'écologie industrielle et territoriale »57(*).
La région dispose depuis une décennie d'une compétence de planification en matière de déchets. Il s'agit donc de l'échelon naturel de déclinaison territoriale de la stratégie industrielle nationale d'économie circulaire, qui pourrait être incluse au PRPGD.
L'association d'élus Régions de France a toutefois déploré une appropriation hétérogène par les régions de cette nouvelle compétence, en raison d'un portage politique parfois insuffisant.
Les rapporteurs considèrent que pour assurer une véritable appropriation politique de l'économie circulaire des régions, des moyens financiers calibrés pour l'exercice de cette compétence doivent être mis à leur disposition : le fonds économie circulaire pourrait être cogéré entièrement par l'Ademe et les régions, constituant ainsi le « bras armé » de l'application, par les régions, de la stratégie nationale. L'Ademe pourrait ainsi jouer pleinement son rôle de préconisation de lignes directrices et d'appui technique, tandis que la gestion opérationnelle de ce fonds serait assurée par les régions.
L'article 57 de la loi dite « 3DS » de 202258(*) prévoit une telle délégation, codifiée à l'article L. 131-6 du code de l'environnement, mais qui reste partielle (seule une partie des fonds sont cogérés) et sur une base volontaire qui peine à produire des effets.
Le fonds économie circulaire
Créé en 2009 sous le nom initial de fonds déchets et géré par l'Ademe, le fonds économie circulaire vise à soutenir financièrement les projets contribuant à la réduction des déchets, au réemploi, au recyclage et à la transition vers une économie plus sobre en ressources.
Ce fonds s'élève, en 2025, à 170 millions d'euros. En 2024, il a ciblé des actions visant à faire évoluer les pratiques de consommation et les pratiques des collectivités en charge du service public des déchets, à développer l'écoconception, à soutenir le recyclage et à développer des actions d'accompagnement et de structuration des entreprises comme des collectivités territoriales59(*).
Il convient enfin d'éviter de décliner mécaniquement les objectifs nationaux par régions. Comme l'a fait remarquer l'association Régions de France, le « nomadisme » régional des déchets, expliqué par les caractéristiques propres à chaque région qui rendent plus ou moins facile l'implantation d'installations de traitement, rend difficile la fixation d'objectifs régionaux uniformes. Les régions devraient donc être chargées de simplement contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale, sans se voir assigner d'objectifs chiffrés.
Proposition n° 1 : Élaborer une stratégie industrielle pluriannuelle de l'économie circulaire, en associant l'ensemble des parties prenantes.
Cette stratégie fixerait des objectifs chiffrés de moyen terme et préciserait les leviers à mobiliser (écocontributions, dispositifs de formation, soutiens publics, investissements...), tout en clarifiant ce qui relève ou non du champ d'intervention des éco-organismes.
Elle doit être :
- élaborée au niveau national par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), service à compétence interministérielle rattaché au Premier ministre ;
- territorialisée par les régions, désignées chefs de file de l'économie circulaire, qui exerceraient cette mission en s'appuyant sur le fonds économie circulaire, cogéré avec l'Ademe.
B. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA GOUVERNANCE DES ÉCO-ORGANISMES, POUR AFFIRMER LE RÔLE DE RÉGULATEUR DE L'ÉTAT ET RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION
1. Mieux associer les parties prenantes au pilotage des filières REP par une réforme de la gouvernance
a) Une gouvernance entre les mains exclusives des metteurs en marché, au détriment des collectivités territoriales et des opérateurs de déchets
La gouvernance des filières REP suscite une réelle insatisfaction de la part de nombreux acteurs, comme ont pu le constater les rapporteurs à l'issue de leurs travaux préparatoires.
Les décisions structurantes sont en effet prises, dans le respect du cahier des charges défini par arrêté, par les éco-organismes, des sociétés de droit privé détenues par les metteurs en marché.
De nombreux acteurs ont pointé le « conflit d'intérêts majeur », selon l'expression de l'AMF60(*), d'une telle centralité des metteurs en marché : étant eux-mêmes les financeurs, au titre de l'écocontribution, l'intérêt financier objectif de l'éco-organisme consiste à réduire le poids des obligations financières assumées, au détriment des autres acteurs de l'économie circulaire, et en particulier des collectivités territoriales et des opérateurs de déchets.
Comme l'a ainsi souligné l'association de collectivités territoriales Amorce, « les associations de collectivités constatent la difficulté à obtenir la prise en compte de leur demande lorsque l'État n'a pas fixé de garde-fou dans les arrêtés portant cahier des charges, lorsqu'il ne demande pas de contrat type dans les dossiers d'agrément ou lorsqu'il laisse aux parties prenantes décider du montant des soutiens à verser aux collectivités locales. Ces négociations aboutissent généralement à des blocages avec des refus de compenser à la juste mesure les coûts supportés par les collectivités. »61(*)
La centralité des metteurs en marché fait l'objet d'une dénonciation particulièrement forte et partagée par les opérateurs de déchets. Selon la Fnade, « la loi Agec a ainsi déséquilibré les relations entre les éco-organismes et le reste des acteurs », en conduisant à « tirer la filière vers le bas », avec des « industriels de la gestion et de la valorisation des déchets sous-payés par rapport à la prestation réalisée »62(*). Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFiD) partage le même constat, dénonçant la « volonté de faire toujours moins cher des éco-organismes », tandis que la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire (Federrec) évoque « le déséquilibre dans les relations commerciales avec les gestionnaires de déchets », avec des éco-organismes qui auraient « un droit de vie ou de mort sur les acteurs privés intervenant sur leur marché »63(*). Enfin, pour l'Association des recycleurs indépendants (ARI), le déséquilibre des relations commerciales avec les éco-organismes constitue « le coeur des problématiques des recycleurs indépendants »64(*).
Certains éco-organismes reconnaissent eux-mêmes une « contestation par les représentants des gestionnaires de déchets des barèmes de soutien financier établis par l'éco-organisme »65(*).
Ce déséquilibre dans les relations entre éco-organismes et opérateurs de déchets entraîne des conséquences identifiées par les quatre organisations représentatives des opérateurs de déchets entendus : conditions tarifaires drastiques, clauses abusives, durées de contrat trop courtes ou encore absence de rémunération de certaines prestations.
Il est bien entendu inévitable que l'éco-organisme -- une société privée -- essaie de contracter avec les opérateurs de déchets au plus faible prix possible. Toutefois, comme le relèvent les organisations précitées et comme l'a notamment souligné le rapport interinspections relatif à la performance et à la gouvernance des filières REP66(*), la plupart des éco-organismes sont en position de monopole ou d'oligopole sur leur filière REP. Leur position largement dominante sur les acteurs privés intervenant sur leur marché et leur pouvoir de structuration de marché exorbitant entraîne structurellement un déséquilibre dans leurs relations avec les opérateurs de déchets.
Au-delà des opérateurs de déchets, d'autres acteurs insistent sur la nécessité d'une plus grande co-construction des filières REP. Le Medef considère ainsi qu'afin « d'assurer le bon fonctionnement des filières REP, il est nécessaire de coconstruire ces filières en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs concernés puis d'assurer une juste concurrence entre les acteurs ainsi qu'un suivi et des sanctions proportionnées en fonction des enjeux et des responsabilités imputables à chacun. »67(*) De même, pour l'AMF « la très faible (ou inexistante) représentation de l'ensemble des parties prenantes dans la gouvernance des REP compromet son efficacité, puisque l'ensemble des acteurs du secteur sont concernés par le dispositif : collectivités, petites entreprises du secteur, ESS. »68(*)
b) Les instances créées par la loi Agec de 2020 -- la CiFREP et la CPP -- n'ont pas atteint leur objectif d'association des parties prenantes
L'article 62 de la loi Agec de 2020 a réformé la gouvernance des filières REP dans le sens d'une plus grande association des parties prenantes en prévoyant la création :
- de la commission interfilières REP (CiFREP), qui a vocation à être l'instance de dialogue transversale aux différentes filières REP ;
- des comités des parties prenantes (CPP), placés auprès de chaque éco-organisme, qui rendent un avis public non contraignant sur certaines décisions.
La CiFREP et les CPP
Placée auprès du ministre chargé de l'environnement, la CiFREP est composée de 5 collèges69(*), représentant les producteurs, les associations de protection de l'environnement, les opérateurs de déchets et l'État. Elle émet des avis non contraignants sur les projets d'arrêtés portant cahiers des charges, sur les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels, sur les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des écocontributions et sur les orientations des actions de communication interfilières.
Également créés en 2020, les CPP sont composés de producteurs, de représentants des collectivités territoriales, d'associations de protection de l'environnement, d'associations de protection des consommateurs et d'opérateurs de déchets70(*). Ils rendent un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur le barème d'écocontributions, sur l'attribution du fonds réemploi et réutilisation ou encore sur les modulations de l'écocontribution.
L'efficacité de ces deux organismes est critiquée par une grande majorité des organisations entendues.
S'agissant de la CiFREP, la grande diversité des sujets traités, qui concernent l'ensemble des filières REP, entraîne, selon France Industrie, une « embolie » de la commission : ses membres ne disposeraient pas du temps et de la compétence requise pour traiter de sujets hétérogènes et techniques, ce d'autant plus que les délais d'examen sont souvent trop restreints, comme le dénonce notamment la fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)71(*). L'éco-organisme Valdelia considère ainsi qu'en raison de l'engorgement de la CiFREP72(*), « ses membres n'ont pas la possibilité d'étudier les dossiers de façon approfondie ». Pour l'AMF, « la CiFREP ne peut pas atteindre ses objectifs tant qu'elle sera consultée sur tous les textes réglementaires », les textes soumis, trop techniques, n'étant pas adaptés pour être instruits par une commission à vocation généraliste73(*). Enfin, pour la Fnade, « les débats sont survolés et manquent de vision industrielle » et « il n'y a pas de possibilité de présenter de manière approfondie des contre-propositions »74(*).
Pour beaucoup, l'examen en CiFREP des décisions intervient également trop en aval, à un stade où la négociation entre les différentes parties prenantes sous l'égide de l'État est déjà terminée, comme l'a notamment souligné France Industrie au cours de son audition.
Enfin, les avis de la CiFREP consultatifs ne sont pas toujours suivis par l'État, même lorsqu'ils témoignent d'une unanimité, comme le regrettent notamment Valdelia et la Fnade.
Certaines organisations entendues demandent ainsi une réforme de la CiFREP, dans le sens d'une plus grande opposabilité des décisions prises et d'une refonte des modalités de discussion tandis que d'autres, comme l'éco-organisme Valdelia, remettent en cause le fondement même de cette entité.
Les Comités des parties prenantes font également l'objet de critiques de la part de nombreux acteurs.
Pour leurs membres, les CPP sont généralement perçus comme des « chambres d'enregistrement »75(*), qui permettent à l'éco-organisme d'informer les parties prenantes des décisions prises, plutôt que comme un véritable lieu de concertation qui permettrait aux acteurs de la filière de peser sur les décisions. Pour l'éco-organisme Léko76(*), le CPP, « du fait de son rôle consultatif, n'exerce qu'une influence limitée sur les décisions ». Certains acteurs, comme la Fnade, appellent ainsi à la suppression des CPP, vus comme de fausses instances de concertation.
Par ailleurs, l'association Les Amis de la Terre a fait remonter au cours de son audition ses difficultés à assurer une présence dans les nombreux CPP existants, puisque chaque éco-organisme en dispose d'un. L'association Zero Waste France, qui partage ces mêmes difficultés, considère également qu'il est ardu pour une association généraliste de l'économie circulaire de se prononcer sur les décisions des éco-organismes, qui relèvent parfois d'un haut niveau de technicité, alors que l'association ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour recruter des spécialistes de chaque secteur. France Industrie s'est fait, au cours de son audition, le relais des associations environnementales sur ce point, évoquant des difficultés récurrentes dans l'atteinte du quorum du CPP.
c) Une simplification de la gouvernance des filières REP est ainsi nécessaire pour renforcer la co-construction et l'efficacité collective
Les rapporteurs constatent que cinq ans après la promulgation de la loi Agec de 2020, il est souhaitable de dresser le bilan de la gouvernance créée par cette loi et d'en tirer les conséquences, en renforçant la co-construction tout en simplifiant les instances de gouvernance.
La CiFREP et les CPP, qui ont tous les deux échoué à associer les parties prenantes aux filières REP, pourraient être remplacés par des Comités de parties prenantes refondés, situés au niveau des filières REP, comme le préconise notamment l'Ademe77(*), et non plus au niveau des éco-organismes.
En effet, l'échelle filière REP apparaît plus pertinente que l'échelle éco-organisme pour assurer que cette instance soit bien un comité de pilotage de la filière, et pas seulement une chambre d'enregistrement qui acte les décisions de l'éco-organisme, et pour qu'il permette d'échanger sur des sujets stratégiques, et non plus seulement sur des questions techniques. Cette évolution, appelée de ses voeux par la Confédération des grossistes de France, qui propose « la création d'instances de concertation au sein de chaque filière REP, rassemblant tous les acteurs : producteurs, éco-organisme(s), opérateurs de gestion des déchets et collectivités »78(*), permettrait également de réduire le nombre de CPP, et d'éviter ainsi la dispersion des compétences dénoncée par les associations environnementales. Les CPP devraient toutefois rester au niveau de la filière et ne pas devenir interfilières, pour éviter les problèmes d'engorgement propres à la CiFREP.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces nouveaux CPP. Tout d'abord, il est nécessaire que les projets de décisions soient soumis suffisamment en amont, afin d'assurer qu'une marge de manoeuvre pour d'éventuelles modifications soit encore possible. Il convient ensuite de confier des pouvoirs décisionnels au CPP, sans bien sûr priver l'éco-organisme de son autonomie ni priver l'État de son rôle légitime de régulateur. Un avis conforme du CPP sur le projet d'arrêté d'agrément des éco-organismes ou des systèmes individuels pourrait par exemple être envisagé.
Enfin, il convient de conserver une certaine souplesse dans la composition de ces CPP, afin de les adapter à la diversité des filières REP. L'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit que la composition de ces CPP peut être adaptée « pour tenir compte des spécificités de chaque filière ». En dépit de cette précision utile du législateur, l'article D. 541-90 du même code, qui fixe la composition des CPP, n'a pas prévu une telle souplesse. Pourtant, les parties prenantes sont particulièrement spécifiques dans certaines filières. L'éco-organisme Dastri a par exemple souligné lors de son audition que dans la filière REP des Dispositifs médicaux perforants des patients en autotraitement, les parties prenantes sont les pharmaciens ainsi que les associations de patients, il conviendrait donc d'adapter la composition du CPP en conséquence.
Proposition n° 3 : Refonder la gouvernance des filières REP en renforçant la co-construction et l'efficacité collective.
La gouvernance actuelle, fondée sur la CiFREP et les comités des parties CPP placés auprès des éco-organismes, montre aujourd'hui ses limites : instances peu efficaces, consultation purement formelle, composition insuffisamment représentative.
Ces structures pourront être remplacées par de nouveaux Comités des parties prenantes, institués au niveau de chaque filière REP. Dotés de véritables pouvoirs de pilotage (orientation stratégique, suivi des résultats, validation des plans d'action), ces comités auront une composition adaptée au fonctionnement de chaque filière, garantissant une représentation équilibrée des parties prenantes et une co-construction renforcée des décisions.
2. Une régulation par l'État cruciale pour garantir le respect de l'intérêt général par les éco-organismes
L'encadrement des filières REP par l'État repose à titre principal sur deux organisations : l'Ademe et la direction générale de la prévention des risques (DGPR).
L'Ademe, agence de l'État chargée de la transition écologique, dispose d'une direction de la supervision des filières REP comportant 36 équivalents temps plein (ETP)79(*), financée par une redevance de 13 millions d'euros payée par les éco-organismes. L'agence est chargée de financer des études dont la programmation est définie avec les éco-organismes et de suivre les performances des différentes filières, à partir des données transmises par les éco-organismes.
La DGPR, administration centrale du ministère de la transition écologique, dispose d'un bureau de la responsabilité élargie des producteurs. Au total, 8 agents suivent les 19 filières REP, chargés à la fois du cadre réglementaire, du contrôle et du dialogue avec les acteurs des filières, mais également de la participation à l'ensemble des travaux européens et internationaux sur les filières REP80(*). La direction occupe un rôle central dans la régulation des filières REP, étant à la fois chargée de l'élaboration des cahiers des charges, de l'agrément des éco-organismes, des sanctions de fraudeurs et des éventuelles sanctions des éco-organismes.
Les règles de sanction des éco-organismes
Le système des filières REP repose notamment sur la possibilité d'imposer des sanctions aux éco-organismes, prévues à l'article L. 541-9-6 du code de l'environnement, en cas de non-respect d'une prescription ou non-respect d'un objectif fixé par le cahier des charges.
Dans le cas du non-respect d'une prescription, le ministre chargé de l'environnement doit aviser l'éco-organisme des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et lui laisser un mois pour présenter ses observations, écrites ou orales. Une fois ces observations transmises et après instruction de la DGPR, le ministre peut mettre en demeure l'éco-organisme. Il peut ensuite le sanctionner, sous la forme d'une amende administrative, d'une consignation, de la réalisation d'office, du paiement d'une astreinte journalière ou d'une suspension ou du retrait de l'agrément à l'éco-organisme.
Dans le cas du non-respect d'un objectif, le ministre chargé de l'environnement doit aviser l'éco-organisme des faits qui lui sont reprochés et lui proposer de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés dans un délai de dix-huit mois. Le ministre doit ensuite engager une procédure contradictoire avec l'éco-organisme afin que celui-ci soit en mesure de faire part de ses observations. C'est seulement à l'issue de cette procédure que des sanctions peuvent être proposées, celles-ci pouvant prendre la forme d'une amende administrative, du paiement d'une astreinte journalière ou d'une suspension ou du retrait de l'agrément à l'éco-organisme.
L'ensemble des sanctions sont publiées sur le site du ministère : deux éco-organismes ont fait l'objet d'une telle procédure à ce jour, Alcome et Dastri.
Les rapporteurs insistent sur le rôle de régulateur de l'État et sur sa légitimité, en tant que garant de l'intérêt général, pour imposer des obligations aux éco-organismes : des sommes considérables leur sont confiées, auxquelles doivent être adossés des objectifs de résultats.
Les travaux préparatoires de la mission d'information ont permis de faire émerger des axes de progrès de cette régulation : l'expertise économique de l'Ademe peut paraître insuffisante, comme l'ont relevé certains éco-organismes ainsi que le Medef, conduisant à des études de préfiguration imparfaites ou bien, comme le dénonce l'AIMCC, à des objectifs économiquement peu réalistes.
Une attention particulière doit être portée au financement de la collecte et du traitement des déchets par les éco-organismes qui doit, selon le droit européen81(*), couvrir a minima 80 % des coûts.
L'adaptation des demandes d'informations de l'Ademe aux moyens des éco-organismes apparaît également souhaitable : il n'est pas envisageable d'avoir le même niveau d'exigences pour des éco-organismes comme Citeo, qui emploie près de 500 salariés82(*), que pour de très petits éco-organismes comme Dastri, qui ne dispose que d'une dizaine de collaborateurs et a souligné, lors de son audition, ne pas être en capacité de répondre à toutes les demandes de l'Ademe.
Enfin, la régulation de la concurrence entre éco-organismes constitue également un axe majeur de la mission de supervision de l'État. Plusieurs acteurs ont souligné les effets négatifs de la concurrence entre éco-organismes : pour l'AMF, « les relations sont plus difficiles quand il y a plusieurs éco-organismes, car il y en a toujours au moins un pour pratiquer une politique de réduction des coûts en réduisant les soutiens aux collectivités. »83(*). De même, selon la Fevad, la concurrence entre éco-organismes complique les procédures, dilue les investissements et est source de complexité administrative. Pour un syndicat de traitement des déchets ménagers rencontré au cours d'un déplacement, cette concurrence est également source d'ambiguïté, les consignes étant différentes entre éco-organismes.
Les organismes coordinateurs sont censés faciliter la gestion de cette concurrence. Selon le Medef, les missions de régulation de ces organismes devraient toutefois être revues, ces derniers ne jouant pas encore pleinement leur rôle de médiation.
À l'inverse, la situation de monopole d'éco-organismes dans certaines filières REP est aussi dénoncée par certains acteurs comme la Fnade84(*), qui considère que dans cette situation, « une sanction trop importante qui déstabiliserait l'éco-organisme risquerait d'entraîner de fortes perturbations de service pour les usagers » : le monopole dissuade donc la DGPR de mettre en oeuvre des sanctions. La concurrence pourrait en effet avoir des effets bénéfiques : dans la filière REP EPMG, elle aurait permis, selon un éco-organisme entendu, de stimuler l'innovation et la capacité des éco-organismes à se remettre en cause.
La DGPR, en tant qu'autorité régulatrice, a donc pour mission de réguler cette concurrence pour éviter qu'elle ne soit source de complexité, mais également d'évaluer, pour chaque filière REP en fonction du contexte, la pertinence d'agréer plusieurs éco-organismes. Dans le cadre de cette concurrence, il convient également de limiter les possibilités de dumping par un éco-organisme, en fixant par exemple des modulations obligatoires à l'échelle de la filière REP.
Le rôle de l'État dans la régulation des règles de modulation de l'écocontribution est essentiel comme ont pu le constater les rapporteurs dans le cadre de leurs travaux. Les éco-organismes ont principalement utilisé la possibilité de modulation de l'écocontribution pour fixer des primes, sans prévoir pour autant des pénalités, qui constituent l'autre revers de la politique d'incitation par la modulation. Il convient, pour le régulateur, d'imposer dans le cahier des charges des pénalités lorsqu'elles sont pertinentes et d'empêcher l'éco-organisme d'en atténuer la portée en interdisant le cumul de bonus et de pénalités par un même producteur.
Proposition n° 2 : Réaffirmer le rôle de l'État comme régulateur des filières REP.
L'État doit pleinement assumer sa fonction de régulation, en fixant le cadre d'action des éco-organismes, à travers :
- la définition d'objectifs clairs, proportionnés et économiquement soutenables, en lien avec les ambitions de performance environnementale ;
- et l'encadrement de la concurrence entre éco-organismes, pour éviter les effets de dumping réglementaire ou financier, ou une complexité excessive pour les collectivités territoriales et les opérateurs de déchets.
III. UNE STRATÉGIE À DÉPLOYER TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT, DE LA CONCEPTION DU PRODUIT AU TRAITEMENT DU DÉCHET
A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT
Les rapporteurs ont pu constater au cours de leurs auditions la nécessité de placer le plus en amont possible la réflexion relative à l'économie circulaire. Dès le stade de la conception puis de la mise en marché du produit, il apparaît ainsi nécessaire d'interroger nos modes de consommation et d'assurer que chaque producteur soit pleinement responsable de ses produits.
1. Harmoniser dans le marché intérieur les modulations fondées sur des critères d'écoconception
L'économie circulaire doit être intégrée dès la conception du produit, qui doit respecter les règles d'écoconception, afin d'être facilement réparable et recyclable.
La modulation des écocontributions avec un système de bonus-malus, rendue plus incitative par l'article 62 de la loi Agec de 2020, apparaît être l'instrument le plus approprié pour inciter à l'écoconception des produits.
La filière REP DEA constitue à ce titre un bon exemple : comme le relève L'Ameublement français, l'écomodulation dans la filière en fonction de la présence de perturbateurs de recyclage dans le produit permet de faire varier l'écocontribution du simple au double, voire même au triple85(*).
Exemple de modulation des écocontributions dans la filière REP DEA
Source : Ecomaison
Plusieurs acteurs, dont la FIEEC, ont insisté sur la nécessité d'assurer une harmonisation européenne des modulations d'écocontributions : les entreprises ne conçoivent pas en effet leurs produits pour le seul marché français. L'acte européen pour l'économie circulaire, prévu pour 2026, pourrait permettre de poursuivre cette harmonisation des modulations dans l'ensemble du marché intérieur.
Dans la filière REP DEEE, la création d'un indice de durabilité apparaît particulièrement bienvenue, comme l'appelle de ses voeux l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP). Il est souhaitable également de prévoir une définition européenne de cet indice de durabilité, auquel pourrait opportunément être adossée une modulation des écocontributions.
2. Lutter contre la surconsommation, en régulant les pratiques les plus agressives
Les rapporteurs insistent sur un aspect de l'économie circulaire insuffisamment pris en compte de l'économie circulaire : pour lutter contre la production de déchets et réduire la consommation de matières, le premier axe doit être de lutter contre la surconsommation, en consommant moins, mais mieux. Une action ciblée mériterait d'être engagée sur deux leviers : le rôle de la publicité dans la consommation et la responsabilité du consommateur dans son geste d'achat.
a) Responsabiliser le consommateur, en lui permettant d'effectuer ses choix de manière éclairée
L'article 2 de la loi « Climat et résilience » de 202186(*) a commencé à tracer une voie dans ce sens en prévoyant un affichage environnemental afin d'informer le consommateur sur les impacts environnementaux de certains biens et services et certaines catégories de biens et services ainsi que sur le respect de critères sociaux. À cette fin, elle a mis en place des expérimentations d'une durée maximale de cinq ans pour « évaluer les différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage » et construire ainsi des dispositifs fonctionnels et pertinents. Le même article 2 prévoit, à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, que cet affichage est rendu obligatoire pour des catégories de biens et de services fixées par décret. L'application de cette obligation reste encore, près de quatre ans après son entrée en vigueur, balbutiante.
Les rapporteurs appellent à généraliser cet affichage environnemental et à le rendre obligatoire au plus vite, pour permettre au consommateur d'effectuer ses choix de manière éclairée.
b) Faire pleinement contribuer la publicité, en application du principe « pollueur-payeur »
Le rôle de la publicité dans la surconsommation doit également aujourd'hui être interrogé.
La loi Agec de 2020 avait prévu des mesures de restriction de la publicité. En particulier, l'article 12 visait à lutter contre la surconsommation en interdisant, dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes. La loi Climat et résilience de 2021 a ensuite renforcé cette réglementation, en prévoyant notamment à son article 7 l'interdiction de la publicité pour certains produits87(*).
Une régulation spécifique des pratiques commerciales les plus agressives est aujourd'hui incontournable. La proposition de loi relative à l'impact environnemental de l'industrie textile précitée a été précurseur, en créant une pénalité sur les écocontributions pour les produits qui cible certaines pratiques commerciales : la modulation dépend du coefficient de durabilité, qui mesure l'incitation à surconsommer en prenant en compte la largeur de gamme, l'incitation à réparer et la transparence sur l'origine du produit.
La généralisation de la prise en compte de l'agressivité des pratiques commerciales qui incitent à surconsommer dans la modulation des écocontributions est souhaitable, pour renforcer la sobriété des modes de consommation.
Les rapporteurs insistent également sur le rôle de l'État dans le lancement de campagnes de communication incitant à plus de sobriété, ce d'autant plus que, comme l'a souligné auprès des rapporteurs l'association Les Amis de la Terre, les producteurs, qui contrôlent les éco-organismes, ont un intérêt économique objectif à augmenter les quantités produites. Ils ont par ailleurs pu constater, au cours d'un déplacement dans un syndicat de traitement de déchets ménagers dans le Bas-Rhin, que les collectivités territoriales jouent elles aussi un rôle majeur dans cette incitation à la sobriété, en dehors de toute obligation légale.
Les rapporteurs considèrent qu'une contribution de la publicité à la prévention et au traitement des déchets est souhaitable, au-delà des interdictions sectorielles et des obligations d'information prévues par les lois Agec puis Climat et résilience. Une modulation des écocontributions en fonction de l'intensité publicitaire, c'est-à-dire de la part du budget de l'entreprise dédiée à la publicité, est ainsi souhaitable. À terme, les rapporteurs souhaitent que soit envisagée une écocontribution financée directement par les publicitaires, pour internaliser l'impact de la publicité sur la surconsommation.
Proposition n° 8 : Lutter contre la surconsommation en régulant les pratiques commerciales agressives et en envisageant une modulation de l'écocontribution selon l'intensité publicitaire des produits voire, à terme, une écocontribution financée directement par les publicitaires.
3. Réaffirmer l'universalité du principe « pollueur-payeur »
Le tonnage de déchets effectivement pris en charge par les filières REP a progressivement augmenté depuis le début des années 2000, passant de 5 555 tonnes en 2009 à 10 0062 tonnes en 202288(*).
Évolution des tonnages pris en charge par les filières REP
Source : à partir des données de la DGPR
La loi Agec de 2020, en créant dix nouvelles filières REP, a fortement augmenté le gisement de déchets couverts89(*), qui passera de 16,4 millions en 2022 à 68,2 millions de tonnes lorsque les deux dernières filières REP prévues par la loi Agec seront pleinement opérationnelles90(*), selon le rapport interinspections précité. Au total, 22 % du gisement total de déchets en France (310 millions de tonnes) sera ainsi soumis à la REP, contre 5 % en 2022.
Une grande majorité des déchets produits restent toutefois exclus du principe de REP. Pour garantir l'universalité du principe « pollueur-payeur » chaque producteur doit contribuer. Ce d'autant plus qu'en l'absence de filière REP, le traitement des déchets ménagers est pris en charge par le service public de gestion des déchets (SPGD) des collectivités territoriales et de leurs groupements c'est-à-dire, in fine, par le contribuable.
L'application du régime des filières REP ne semble toutefois pas la solution universelle pour faire contribuer le producteur. Les difficultés propres au démarrage de la filière REP PMCB tendent à confirmer l'idée que le système, s'il fonctionne très bien dans certains secteurs, n'est pas transposable à toutes les filières.
L'association de collectivités territoriales Amorce entendue a proposé la création d'une taxe « balai », qui pourrait concerner l'ensemble des produits non soumis à la REP : il s'agirait d'une composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui serait due par tout metteur en marché d'un produit ne bénéficiant d'aucune filière de recyclage et n'entrant dans aucune filière de REP. Cette TGAP « amont », pourrait être affectée ou bien directement au service public de gestion des déchets ou bien à l'Ademe qui l'utiliserait via le fonds économie circulaire pour soutenir la transition vers l'économie circulaire.
Les rapporteurs appellent à envisager la création d'une telle taxe, qui permettrait d'assurer la pleine application du principe « pollueur-payeur ».
Plusieurs éco-organismes ont souligné la possibilité théorique de verser des primes supérieures au montant total de l'écocontribution depuis la loi Agec de 2020, ce qui conduirait l'éco-organisme à financer les producteurs. Les rapporteurs considèrent qu'il convient, pour garantir la pleine application du principe « pollueur-payeur », de rendre impossible cette inversion de l'écocontribution étant donné que le traitement des déchets, même pour les produits conçus dans les meilleures conditions, présente un coût que le producteur doit assumer.
Proposition n° 5 : Réaffirmer l'universalité du principe « pollueur-payeur ».
Pour garantir une contribution équitable de l'ensemble des metteurs en marché :
- instaurer une TGAP « amont » applicable aux produits en dehors du périmètre des filières REP, afin d'assurer une couverture complète des flux mis sur le marché ;
- encadrer les mécanismes de modulation des écocontributions, en prévoyant explicitement que le montant des primes perçues par les producteurs ne peut excéder celui des contributions versées, afin de préserver l'équilibre financier du système et d'éviter tout effet d'aubaine.
B. LA COLLECTE : SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PAR UNE PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE ET UN FINANCEMENT ADAPTÉ
1. Les objectifs nationaux et européens obligent les collectivités territoriales à faire évoluer la collecte des déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers assurée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels a été transféré le service public de gestion des déchets (SPGD) constitue un levier d'action majeur de la transition vers une économie circulaire.
La loi TECV de 201591(*), qui prévoit l'extension des consignes de tri d'ici 2022, et la loi Agec de 2020, qui fixe des objectifs de collecte et prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets, ont ainsi eu un impact majeur sur le SPGD. La mise en oeuvre de ces mesures a conduit les collectivités territoriales à engager des investissements importants, comme ont pu notamment le constater les rapporteurs à l'occasion d'un déplacement auprès d'un syndicat de traitement des déchets ménagers dans les Yvelines.
L'atteinte des objectifs nationaux est d'autant plus indispensable qu'au niveau européen, une contribution sur le plastique non recyclé a été créée en 2021, dans le cadre du Plan de relance européen92(*) : chaque pays doit s'acquitter d'une contribution fixée à 0,8 euro par kilogramme de déchets d'emballages en plastique non recyclés. La France est, en 2023, le premier contributeur pour cette ressource propre de l'Union européenne, qui s'élève à 1,564 milliard d'euros, contre 1,423 milliard d'euros pour l'Allemagne. Elle assume donc à elle seule 21,7 % du produit total de la contribution.
Les auditions des associations d'élus locaux concernées par le SPGD (AMF, Intercommunalités de France, Amorce) tout comme les déplacements, dans le Bas-Rhin et dans les Yvelines, auprès de syndicats de traitement des déchets ménagers ont permis de constater à la fois les efforts menés par des collectivités volontaires pour atteindre ces objectifs, mais aussi le besoin d'adaptation du cadre réglementaire et de mise en place d'un accompagnement adapté par l'État.
Ces travaux ont également permis de conforter la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable dans sa conviction exprimée avec constance que la consigne pour recyclage plastique est une fausse solution, qui aurait en effet pour inconvénient de focaliser le débat sur une partie très minoritaire du gisement.
La consigne pour recyclage plastique :
une fausse solution aux nombreux effets pervers
La consigne pour recyclage des bouteilles plastiques est un dispositif par lequel les consommateurs paient un montant supplémentaire lors de l'achat d'une bouteille en plastique, qu'ils peuvent récupérer en la rapportant après usage dans un point de collecte spécifique. Des dispositifs de consigne pour recyclage des bouteilles en PET sont utilisés dans plusieurs pays européens, en particulier en Allemagne depuis 2003.
Ce système est toutefois moins pertinent qu'il n'y paraît : la consigne concerne uniquement les bouteilles en PET, alors que l'objectif fixé en droit européen et national de collecte de 90 % des bouteilles en 2026 concerne l'ensemble des résines. Si la consigne était mise en place, deux systèmes parallèles coexisteraient (captation via le SPGD des autres résines).
De plus, la consigne pour recyclage est porteuse d'effets environnementaux pervers : loin de lutter contre le plastique, elle pérennise la production et la consommation et ne fait en réalité que prolonger la durée de vie d'une matière qui restera in fine un déchet à éliminer. Elle complexifie de plus le geste de tri, alors même que la loi Agec de 2020 visait à le simplifier.
La consigne centre le débat sur une partie très minoritaire du gisement : les bouteilles en plastique pour boisson représentent 1 % des déchets ménagers, 2,8 % des déchets d'emballages et 15,4 % des déchets d'emballages en plastique. C'est déjà une part des emballages particulièrement bien recyclée : ces bouteilles sont collectées pour recyclage à hauteur de 60,3 % en 2022, contre 21,4 % pour l'ensemble des emballages plastiques.
Enfin, la consigne est un dispositif économiquement irrationnel, socialement et territorialement injuste. Le surcoût des scénarios avec consigne pour les citoyens-contribuables est évalué par l'Ademe à un montant compris entre 181 et 229 millions d'euros par an à partir de 2029, sans compter les pertes liées aux investissements élevés des collectivités territoriales pour augmenter leurs capacités de collecte et leurs centres de tri, qui s'avéreraient inutiles faute de gisement. Le consommateur sera également pénalisé puisqu'il supportera le montant des consignes non rapportées, estimé entre 161 et 252 millions d'euros en 2029 par l'Ademe.
Source : Rapport d'information n° 850 (2022-2023) du 5 juillet 2023 de Mme Marta de Cidrac fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable relatif à la consigne pour réemploi et recyclage sur les emballages
Le règlement « Emballages » de 2025 impose pourtant une consigne obligatoire pour le recyclage des bouteilles plastiques et canettes d'ici le 1er janvier 2029, sauf si un taux de collecte de 80 % est atteint dès 2026, afin d'atteindre l'objectif d'un taux de collecte séparée de 90 % en 2029, comme le souligne l'étude de législation comparée annexée au présent rapport.
Les rapporteurs insistent sur l'inopportunité d'un tel dispositif et appellent à la suppression de l'objectif intermédiaire de taux de collecte pour 2026 tout en maintenant l'objectif final de 2029, pour laisser le temps aux efforts des collectivités territoriales de porter leurs fruits.
2. Une transition à accompagner, en adaptant le cadre légal et le soutien de l'État à la diversité des territoires
Les auditions des rapporteurs tout comme les déplacements effectués ont démontré le bienfait de la tarification incitative pour améliorer la performance de collecte sur un territoire, en faisant payer les usagers en fonction de la quantité de déchets qu'ils produisent, afin de les encourager à trier davantage et à réduire leurs déchets résiduels.
Un rapport de la Cour des comptes de 202293(*) étaye l'efficacité de ce type de tarification : en moyenne, sa mise en place permet de réduire de 41 % la quantité d'ordures ménagères résiduelles (OMR). 97 % des intercommunalités qui produisent moins de 150 kg d'OMR et 100 % de celles qui produisent moins de 100 kg d'OMR par habitant ont recours à une tarification incitative.
Comme l'avait déjà souligné la commission en 202394(*), le cadre réglementaire trop rigide est aujourd'hui un frein au développement de cette tarification. En particulier, pour les rapporteurs, la tarification incitative doit pouvoir être appliquée sur une partie seulement de la commune, conformément au souhait des associations d'élus locaux Amorce et Intercommunalités de France. Il faut en effet tenir compte des communes comportant à la fois des quartiers d'habitat vertical, dans lesquels la mise en place d'une telle tarification est moins aisée, ainsi que des quartiers pavillonnaires.
Enfin, l'association Amorce entendue a appelé à une campagne de communication massive de l'État autour de l'extension du geste de tri simplifié à tous les emballages, pour accroître globalement les performances de collecte sélective des emballages en accompagnant l'évolution du geste de tri.
3. Tri à la source des biodéchets : une dynamique territoriale à soutenir par un cadre réglementaire stabilisé et un accompagnement préservé
Le développement de solutions de tri à la source de biodéchets se poursuit en 2025, en dépit du retard pris par rapport à l'objectif initial de la loi Agec de 2020 de généralisation en 2024.
Il convient de prendre en compte dans cette appréciation la répartition des solutions mises en place par les collectivités95(*) :
- des solutions de gestion de proximité (bornes d'apports volontaires) sont mises en place dans trois quarts des collectivités identifiées actives, en majorité mixtes et rurales, couvrant près de 30 % de la population française, qui sont toutefois, selon France Biodéchets, bien souvent trop éloignées pour encourager au geste de tri96(*) ;
- La collecte séparée en porte à porte est mise en place dans seulement un quart des collectivités identifiées actives, en majorité de grandes agglomérations, couvrant ainsi près de 20 % de la population française.
Les données manquent à ce stade pour estimer les résultats des différents modes de collecte : selon la DGPR97(*), une étude de l'Ademe sur ce sujet serait souhaitable.
Comme l'ont souligné l'association Compostplus ainsi que la DGPR, le « moteur » de la mise en place de ces solutions est avant tout la volonté politique d'élus locaux, qui souhaitent améliorer la gestion des déchets sur le territoire de leur collectivité. Le soutien par l'État, s'il n'est pas suffisant pour déclencher une action chez ceux qui ne souhaitent pas s'engager, reste toutefois souhaitable pour aider une collectivité volontaire à sauter le pas.
Les crédits du fonds vert ont contribué au déploiement des solutions du tri à la source des biodéchets. L'association Régions de France déplore toutefois un arrêt de l'éligibilité au fonds des projets de tri à la source des biodéchets après l'échéance légale de déploiement. L'association Intercommunalités de France98(*) plaide également pour « un plan de rattrapage soutenu, territorialisé, et adapté à la diversité des contextes locaux, afin d'atteindre les objectifs fixés tout en tenant compte des réalités de terrain. »
Pour les rapporteurs, conserver le soutien de l'État au déploiement du tri à la source des biodéchets, comme le demande aussi l'association France Biodéchets, pour ne pas enrayer une dynamique bien engagée sur les territoires est essentiel.
Un deuxième frein majeur est l'absence de stabilisation du cadre réglementaire sur les matières fertilisantes et supports de culture, qui devait être fixé par un décret et un arrêté dit « socle commun ». Identifiée par une enquête de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP)99(*) comme un des freins au déploiement du tri à la source, cette absence de cadre réglementaire sécuriserait l'exutoire des biodéchets utilisés à des fins de méthanisation. Cette lacune est également dénoncée par les associations Compostplus, France Biodéchets et la fédération nationale de l'agriculture biologique (Fnab).
Proposition n° 7 : Adapter le cadre légal de la collecte aux réalités des territoires et améliorer l'accompagnement à la transition des collectivités.
Pour mieux tenir compte de la diversité des situations locales et mieux accompagner les collectivités territoriales, l'État doit :
- assouplir les conditions de mise en oeuvre de la tarification incitative, afin de permettre un déploiement progressif, y compris sur une partie seulement du territoire communal ;
- proposer, au niveau européen, la suppression de l'objectif intermédiaire de collecte des bouteilles plastiques, pour laisser le temps aux mesures engagées par les collectivités territoriales de produire leurs effets ;
- déployer des campagnes régulières nationales de communication co-validées avec les représentants des collectivités territoriales ;
- encourager le déploiement du tri à la source des biodéchets, en rendant les collectivités territoriales éligibles aux soutiens financiers, y compris après l'entrée en vigueur de l'obligation légale, et en clarifiant le cadre légal de valorisation des biodéchets.
C. UNE HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS À RÉAFFIRMER
La hiérarchie des modes de traitement, consacrée au niveau national par la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et au niveau européen par la directive-cadre de déchets de 2008, implique de préférer la réparation, puis le réemploi et la réutilisation au recyclage, pour préserver davantage les ressources matières (le recyclage entraînant une dégradation inéluctable), l'énergie, l'environnement (le recyclage génère des émissions de gaz à effet de serre) et l'emploi (le réemploi, la réutilisation et la réparation génèrent des emplois locaux difficilement délocalisables).
Pour les rapporteurs, il est crucial de réaffirmer au niveau européen l'attachement de la France à cette hiérarchie mise en cause par certains États membres, comme la mission a pu le constater lors d'un déplacement auprès des institutions européennes.
1. La réutilisation, le réemploi et la réparation restent les laissés pour compte de l'économie circulaire
a) La loi Agec de 2020 a entamé un virage à confirmer en faveur de la réparation, du réemploi et de la réutilisation
L'article 62 de la loi Agec de 2020 a placé la hiérarchie des modes de traitement au coeur des filières REP en prévoyant la création par chaque éco-organisme de deux nouveaux fonds :
- le fonds réparation, prévu à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement ;
- le fonds réemploi et réutilisation, prévu à l'article L. 541-10-5 du même code, qui finance des structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) et qui doit être doté d'au moins 5 % du montant des écocontributions perçues.
Le bilan de ces deux dispositifs apparaît, à ce stade, mitigé.
S'agissant du fonds réparation, leur mise en place de ces fonds dans les différentes filières REP a permis la labellisation au 31 décembre 2024 de 9 864 réparateurs éligibles au dispositif, ce qui est supérieur à l'objectif fixé par le Gouvernement de 7 500 réparateurs labellisés100(*). Les premiers résultats sont également visibles : fin 2024, 1,5 million d'opérations de réparation ont été soutenues via un « bonus réparation », pour un montant de 63 millions d'euros.
Nombre de réparateurs labellisés par filière REP
|
Filière REP |
Nombre de réparateurs |
|
Équipements électriques et électroniques (DEEE) |
7 261 |
|
Textiles, linge de maison et chaussures (TLC) |
1 546 |
|
Articles de sport et loisirs (ASL) |
756 |
|
Articles de bricolage et de jardinage (ABJ) |
243 |
|
Éléments d'ameublement (DEA) |
58 |
|
Jouets |
0 |
|
TOTAL |
9 864 |
Source : à partir des données de la DGPR
Le lancement de ces fonds réparation, qui doivent être mis en place dans 6 filières REP101(*), s'est fait de manière échelonnée selon les filières :
- pour la filière REP DEEE, les fonds réparation sont opérationnels depuis décembre 2022 ;
- pour la filière REP TLC et DEA, le fonds réparation n'est opérationnel que depuis novembre 2023 ;
- pour la filière REP ABJ depuis janvier 2024 avec seulement 39 réparations soutenues entre janvier et avril 2025 ;
- pour la filière REP ASL depuis juillet 2024 avec 25 000 réparations soutenues fin avril 2025102(*) ;
- pour la filière REP Jouets, le fonds réparation a débuté en 2023 avec un montant symbolique de 100 000 euros, mais aucun réparateur n'a souhaité obtenir le label. De ce fait, aucun bonus n'a pu être distribué103(*).
La mise en oeuvre de ces fonds est ainsi apparue laborieuse : à l'exception des filières REP DEEE et TLC, aucune filière REP n'a respecté le calendrier de mise en place fixé par le cahier des charges104(*).
Les premiers retours d'expérience mettent en avant une sous-utilisation généralisée des fonds : de 2022 à 2024, seuls 30 % de l'enveloppe des fonds de réparation a ainsi été dépensée, entraînant un report massif d'enveloppes : sur 2025, plus de 140 millions d'euros sont budgétés pour l'ensemble des filières, mais, avec le report des années précédentes, le total atteint 350 millions d'euros105(*).
L'insuffisante mobilisation des fonds réparation s'explique tout d'abord par le nombre insuffisant de réparateurs labellisés : selon l'association HOP, près de 75 % des réparateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE) restent à labelliser, tout comme environ 90 % des artisans de la filière REP TLC ou 85 % des réparateurs de cycle REP ASL. Les causes invoquées par les réparateurs pour ne pas se labelliser sont, selon une étude de la même association106(*), le coût trop élevé de la labellisation, la complexité du processus et le remboursement tardif des bonus avancés.
Au-delà de cet enjeu de la labellisation, le nombre de réparateurs apparaît trop faible selon l'Institut national de l'économie circulaire (Inec) et selon les éco-organismes Ecomaison pour la filière REP DEA et Refashion pour la filière REP TLC. Dans la filière REP DEEE, 2 900 techniciens dans la réparation sont à recruter d'ici 2027 selon l'association Orée, en raison de 400 postes non pourvus, de 1 750 départs à la retraite et de 750 créations de postes nécessaires.
Le coût trop lourd des réparations, parfois supérieur au prix d'un produit neuf, est également identifié par les éco-organismes Ecomaison et Refashion comme un facteur limitant la mobilisation du dispositif, alors que le bonus réparation apparaît bien souvent trop faible pour être incitatif, comme l'ont évoqué notamment les associations HOP et Zero Waste France.
Les fonds réemploi et réutilisation ont également été mis en oeuvre dans les 6 filières REP concernées, définies à l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement107(*).
Répartition des montants versés dans
le cadre du fonds réemploi
et réutilisation et des tonnages
concernés en 2023
|
Filière REP |
Montant versé |
Tonnage réemployé/réutilisé |
|
DEEE |
16,2 M€ |
39 941 tonnes |
|
TLC |
4,5 M€ |
4 134 tonnes |
|
DEA |
3,2 M€ |
42 124 tonnes |
|
ASL |
1,3 M€ |
3 067 tonnes |
|
Jouets |
0,5 M€ |
680 tonnes |
|
ABJ |
0,1 M€ |
440 tonnes |
|
TOTAL |
25,8 M€ |
90 385 tonnes |
Source : données Ademe
La filière REP « Emballages ménagers papiers graphiques » (EMPG), dans laquelle les éco-organismes financent la gestion des déchets via des contributions versées aux collectivités locales, mais ne gèrent pas directement la collecte, n'est pas concernée par l'obligation de création d'un fonds de réemploi et de réutilisation. Des objectifs de réemploi sont toutefois fixés dans le cahier des charges et les éco-organismes doivent apporter un soutien financier au développement de solutions de réemploi et de réutilisation et au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation, selon une logique d'appel à projets.
Pour 2023, le taux de réemploi devait atteindre 5 %. Les éco-organismes de la filière ont mobilisé 36 millions d'euros de soutien, ce qui a permis d'atteindre un taux de réemploi de 1,1 %108(*). Comme le relève l'éco-organisme Citeo109(*), « le secteur des emballages ménagers n'a pas pu bénéficier, comme c'est le cas dans d'autres filières, d'un tissu économique national pratiquant déjà le réemploi des emballages et sur lequel les éco-organismes auraient pu construire ou s'appuyer, comme cela peut être le cas avec certaines structures ESS dans d'autres secteurs. » Dans cette filière REP, le syndicat Elipso souligne que le réemploi nécessite « une transformation profonde des chaînes logistiques et industrielles »110(*) selon une logique de boucle fermée, avec le développement de solutions de collecte, de lavage, de contrôle qualité et de redistribution.
Le développement du réemploi, initialement axé sur les structures de l'ESS, est toutefois aujourd'hui en crise, en raison de la montée en puissance d'une offre concurrente de reprise par les plateformes de seconde main et par les distributeurs. À première vue, l'essor de nouveaux acteurs sur le marché du réemploi paraît positif. En pratique toutefois, comme le relève le Medef, « l'intérêt que les consommateurs portent au réemploi fragilise paradoxalement les acteurs historiques de l'ESS »111(*). En effet, comme le dénonce également la Fnade, les distributeurs comme les plateformes de vente d'occasion ne se concentrent que sur des produits de marque à forte valeur ajoutée. « Le gisement naturel de qualité échappe donc à l'ESS », comme le note L'Ameublement français. Le reste du gisement perd de fait de son attractivité, ce qui remet en cause l'équilibre économique des structures de l'ESS, qui prennent en charge, comme l'a rappelé au cours de son audition l'Union pour un Réemploi Solidaire, l'ensemble des flux et non pas uniquement les flux à forte valeur ajoutée.
Les soutiens financiers apportés par les éco-organismes aux structures de l'ESS sont également limités, en dépit de la création des fonds réemploi et réutilisation, comme l'a dénoncé la Fondation Envie au cours de son audition. Selon l'Union pour un Réemploi Solidaire, ils représentent « entre 1 et 6 % maximum des recettes globales d'une structure de réemploi, alors que ces financements devraient permettre de soutenir massivement le développement du réemploi »112(*), en raison notamment de propositions de financement des éco-organismes à la fois insignifiantes et contraignantes. Aucune des filières REP n'a atteint la cible de 5 % des contributions reçues, pourtant fixée par la loi Agec de 2020113(*). Il convient par ailleurs de noter, comme l'ont souligné les acteurs de l'ESS au cours de leur audition commune, que cette cible de 5 % n'est pas un montant maximal, mais une cible minimale qui peut être dépassée par les éco-organismes.
b) Une évolution nécessaire de la gouvernance de ces fonds, pour dépasser le conflit d'intérêts inhérent à une gestion par les éco-organismes
Pour les rapporteurs, les difficultés dans le déploiement des fonds réemploi et réparation sont inhérentes à leur gouvernance : la gestion des fonds réemploi et réparation par les éco-organismes, contrôlés par les producteurs, crée un conflit d'intérêts évident.
Comme le relève la DGCCRF114(*), « un risque de conflits d'intérêts voire de pratiques anticoncurrentielles semble exister du fait même du rôle dévolu aux éco-organismes en matière d'économie circulaire alors que ceux-ci ont par construction dans leur conseil d'administration des fabricants et vendeurs de produits neufs. » En effet, le gisement de produits réemployables et de déchets réutilisables concurrence directement les produits neufs.
Le syndicat de traitement des déchets ménagers rencontré au cours d'un déplacement dans les Yvelines a partagé ce sentiment d'un soutien parfois ambivalent des éco-organismes au réemploi et à la réparation, constat également partagé par la Fnade et par Zero Waste France.
Une évolution de la gouvernance des fonds réemploi et réparation est donc nécessaire. Pour les rapporteurs, il est souhaitable de fusionner les fonds des différents éco-organismes d'une même filière REP puis d'en confier la gestion aux régions, comme l'appelle de ses voeux l'association Régions de France entendue.
En effet, la région serait chargée de décliner territorialement la stratégie industrielle d'économie circulaire. Cette collectivité est l'échelon le plus adapté pour répartir ces fonds sans risque de conflits d'intérêts.
Afin de renforcer la demande en faveur du réemploi et de la réutilisation, l'article 58 de la loi Agec imposait aux services de l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales et leurs groupements d'acquérir annuellement des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées, dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. La commande publique représente 10 % du PIB. Sa mobilisation est donc cruciale pour soutenir l'économie circulaire. La mise en oeuvre de l'obligation reste embryonnaire : selon ESS France, trop peu de collectivités avaient déclaré la part de leurs achats concernés en 2025, ce qui rend impossible l'obtention de chiffres consolidés et représentatifs.
Les rapporteurs proposent d'envisager un soutien financier incitatif pour les collectivités territoriales qui remplissent leurs obligations relatives à l'article 58 de la loi Agec, instaurant par exemple une réduction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour ces collectivités territoriales.
Proposition n° 4 : Réaffirmer la priorité donnée à la réparation, au réemploi et à la réutilisation.
Pour faire de ces pratiques le coeur opérationnel de l'économie circulaire :
- confier aux régions la gestion des fonds réemploi et réparation, afin de renforcer leur efficacité, d'assurer un meilleur ancrage territorial des soutiens, et de prévenir les conflits d'intérêts inhérents à la gestion actuelle par les metteurs en marché via les éco-organismes ;
- introduire un levier fiscal incitatif, en prévoyant une réduction de TGAP pour les collectivités respectant leurs obligations en matière d'achats circulaires (biens issus du réemploi, produits intégrant des matières recyclées), afin de récompenser les démarches exemplaires et d'amplifier leur diffusion.
- prioriser l'accès au gisement pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), dont la plus-value sociale et environnementale est essentielle dans les territoires, pour éviter la monopolisation de la « crème » du réemploi par d'autres acteurs.
2. Le recyclage : des investissements nécessaires, pour assurer le développement en France de capacités industrielles adéquates
En dépit du développement de la réparation, du réemploi et de la réparation, qui doivent être priorisés, l'augmentation des capacités nationales de recyclage est impérative pour atteindre les objectifs nationaux.
L'absence de capacités nationales suffisantes a en effet un impact environnemental -- en ralentissant l'augmentation de la part des biens exportés -- mais également un impact économique : les éco-organismes sont contraints d'exporter leurs déchets pour atteindre leurs objectifs de recyclage -- comme c'est par exemple le cas dans la filière REP PMCB ou la filière REP TLC -- tandis que les producteurs, pour atteindre leurs objectifs d'incorporation de matière recyclée, doivent importer de la matière.
La politique de soutien au recyclage doit être conçue comme une véritable politique industrielle, ce d'autant plus que, comme le note la Banque des territoires dans sa contribution écrite, « les capacités de recyclage ne diffèrent pas des sites industriels et sont soumises aux mêmes impératifs de compétitivité drastiques pour affronter une concurrence mondiale. »115(*)
Dans ce contexte, les rapporteurs saluent les annonces récentes du Gouvernement de soutien au développement d'une industrie nationale du recyclage : dans le cadre du salon Choose France de 2025, l'implantation d'une usine de recyclage chimique des fibres mélangées et d'une usine de recyclage textile a été annoncée. Le Plan plastique 2025-2030116(*), présenté par le Gouvernement en juin 2025, témoigne également d'une prise de conscience salutaire du soutien industriel nécessaire au développement d'implantations industrielles de recyclage en prévoyant la « massification du soutien des éco-organismes à l'investissement industriel » tout comme « le déploiement de l'appel à projet Objectif Recyclage MATières (ORMAT) ».
En complément de ces implantations souhaitables, la stratégie industrielle doit permettre à ces nouvelles usines de disposer à la fois de la matière et des débouchés nécessaires. Comme le relève la Fnade, cet équilibre entre intrants et incorporation apparaît à ce stade loin d'être atteint pour les déchets plastiques : 4 millions de tonnes de déchets plastiques devraient être recyclées en France pour atteindre l'objectif fixé par la loi Agec de 100 % de plastique recyclé, mais la demande de plastique recyclé pour incorporation ne représente, à ce stade, qu'un million de tonnes117(*).
Il convient donc de soutenir une augmentation rapide et durable de la demande de matière recyclée. La généralisation dans les différentes filières REP des primes en fonction de l'incorporation de matières recyclées apparaît ainsi souhaitable pour les rapporteurs, qui insistent également sur l'opportunité d'y adjoindre, comme c'est par exemple le cas dans la filière REP TLC, une clause de proximité : seule l'incorporation de matière recyclée à proximité, par exemple à moins de 1 500 kilomètres, permettrait de bénéficier de la prime.
Enfin, au niveau européen, la mise en oeuvre de « clauses miroirs » dans les accords internationaux relatifs au traitement des déchets devra être systématique pour éviter que les capacités nationales de recyclage ne subissent la concurrence déloyale d'autres États aux règles environnementales moins-disantes alors que, selon l'association Orée, l'importation de matières reste peu contrôlée, posant des risques sanitaires118(*). L'acte européen pour l'économie circulaire, présenté en 2026, pourrait opportunément permettre à l'Union européenne d'inscrire cette généralisation.
LISTE DES PROPOSITIONS
ADOPTÉES PAR LA
COMMISSION
Proposition 1 : Élaborer une stratégie industrielle pluriannuelle pour chaque filière REP, en associant l'ensemble des parties prenantes
Cette stratégie fixerait des objectifs chiffrés de moyen terme et préciserait les leviers à mobiliser (écocontributions, dispositifs de formation, soutiens publics, investissements...), tout en clarifiant ce qui relève ou non du champ d'intervention des éco-organismes.
Elle doit être :
- élaborée au niveau national par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), service à compétence interministérielle rattaché au Premier ministre ;
- territorialisée par les régions, désignées chefs de file de l'économie circulaire, qui exerceraient cette mission en s'appuyant sur le fonds économie circulaire, cogéré avec l'Ademe.
Proposition 2 : Réaffirmer le rôle de l'État comme régulateur des filières REP
L'État doit pleinement assumer sa fonction de régulation, en fixant le cadre d'action des éco-organismes, à travers :
- la définition d'objectifs clairs, proportionnés et économiquement soutenables, en lien avec les ambitions de performance environnementale ;
- et l'encadrement de la concurrence entre éco-organismes, pour éviter les effets de dumping réglementaire ou financier, ou une complexité excessive pour les collectivités territoriales et les opérateurs de déchets.
Proposition 3 : Refonder la gouvernance des filières REP en renforçant la co-construction et l'efficacité collective
La gouvernance actuelle, fondée sur le CiFREP et les comités des parties CPP placés auprès des éco-organismes, montre aujourd'hui ses limites : instances peu efficaces, consultation purement formelle, composition insuffisamment représentative.
Ces structures pourront être remplacées par de nouveaux Comités des parties prenantes, institués au niveau de chaque filière REP. Dotés de véritables pouvoirs de pilotage (orientation stratégique, suivi des résultats, validation des plans d'action), ces comités auront une composition adaptée au fonctionnement de chaque filière, garantissant une représentation équilibrée des parties prenantes et une co-construction renforcée des décisions.
Proposition 4 : Réaffirmer la priorité donnée à la réparation, au réemploi et à la réutilisation
Pour faire de ces pratiques le coeur opérationnel de l'économie circulaire :
- confier aux régions la gestion des fonds réemploi et réparation, afin de renforcer leur efficacité, d'assurer un meilleur ancrage territorial des soutiens, et de prévenir les conflits d'intérêts inhérents à la gestion actuelle par les metteurs en marché via les éco-organismes ;
- introduire un levier fiscal incitatif, en prévoyant une réduction de TGAP pour les collectivités respectant leurs obligations en matière d'achats circulaires (biens issus du réemploi, produits intégrant des matières recyclées), afin de récompenser les démarches exemplaires et d'amplifier leur diffusion.
- prioriser l'accès au gisement pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), dont la plus-value sociale et environnementale est essentielle dans les territoires, pour éviter la monopolisation de la « crème » du réemploi par d'autres acteurs.
Proposition 5 : Réaffirmer l'universalité du principe « pollueur-payeur »
Pour garantir une contribution équitable de l'ensemble des metteurs en marché :
- instaurer une TGAP « amont » applicable aux produits en dehors du périmètre des filières REP, afin d'assurer une couverture complète des flux mis sur le marché ;
- encadrer les mécanismes de modulation des écocontributions, en prévoyant explicitement que le montant des primes perçues par les producteurs ne peut excéder celui des contributions versées, afin de préserver l'équilibre financier du système et d'éviter tout effet d'aubaine.
Proposition 6 : Pour renforcer la lutte contre la fraude aux écocontributions et ainsi redonner confiance en l'économie circulaire, il convient de :
- rendre obligatoire la désignation d'un mandataire financier pour les metteurs en marché non établis en France ;
- autoriser le partage d'informations entre administrations ;
- rendre les sanctions plus dissuasives par la publication systématique des sanctions prononcées et le relèvement des niveaux de sanction.
Proposition 7 : Adapter le cadre légal de la collecte aux réalités des territoires et améliorer l'accompagnement à la transition des collectivités
Pour mieux tenir compte de la diversité des situations locales et mieux accompagner les collectivités territoriales, l'État doit :
- assouplir les conditions de mise en oeuvre de la tarification incitative, afin de permettre un déploiement progressif, y compris sur une partie seulement du territoire communal ;
- proposer, au niveau européen, la suppression de l'objectif intermédiaire de collecte des bouteilles plastiques, pour laisser le temps aux mesures engagées par les collectivités territoriales de produire leurs effets ;
- déployer des campagnes régulières nationales de communication co-validées avec les représentants des collectivités territoriales ;
- encourager le déploiement du tri à la source des biodéchets, en rendant les collectivités territoriales éligibles aux soutiens financiers, y compris après l'entrée en vigueur de l'obligation légale, et en clarifiant le cadre légal de valorisation des biodéchets.
Proposition 8 : Lutter contre la surconsommation en régulant les pratiques commerciales agressives et en envisageant une modulation de l'écocontribution selon l'intensité publicitaire des produits voire, à terme, une écocontribution financée directement par les publicitaires
TRAVAUX EN COMMISSION
Désignation d'un
rapporteur
(Mercredi 13 novembre 2024)
M. Jean-François Longeot, président. - Mercredi 16 octobre dernier, le Bureau de la commission a acté le principe de la création d'une mission d'information sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec).
Quatre ans après l'entrée en vigueur de cette loi, nous commençons à observer l'impact des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) sur la compétitivité de nombreux acteurs économiques, alors que les écocontributions payées par les producteurs en application du principe pollueur-payeur montent progressivement en charge.
En parallèle, les résultats environnementaux attendus ne sont pas toujours au rendez-vous : les objectifs de recyclage des emballages plastiques ne sont pas atteints, ce qui conduit la France à payer, chaque année, une contribution de 1,5 milliard d'euros à l'Union européenne, comme nous l'avons évoqué pas plus tard que la semaine dernière au cours de l'audition de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Les objectifs de collecte ne sont pas davantage atteints, tandis que le réemploi et la réutilisation, qui, dans l'esprit de l'économie circulaire, doivent être privilégiés, restent encore balbutiants.
Enfin, la mise en place de certaines des nouvelles filières REP créées par la loi Agec est particulièrement laborieuse.
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable doit prendre toute sa place dans le débat public pour éclairer au mieux le législateur, en menant ses propres travaux d'évaluation. Nous avons été alertés, Marta de Cidrac, présidente du groupe d'études Économie circulaire, et moi-même, sur ces signaux et sur la nécessité d'un travail du Sénat. Le Bureau de la commission a pleinement approuvé cette démarche. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une mission interne d'information sur le bilan de la loi Agec de 2020.
Afin d'associer le plus largement possible les commissaires à ces travaux, il a été décidé qu'un corapporteur issu d'un groupe minoritaire serait désigné et que l'ensemble des commissaires qui le souhaitent pourraient assister aux auditions des rapporteurs.
J'ai reçu les candidatures de Marta de Cidrac et de Jacques Fernique. Je vous propose de les désigner rapporteurs.
La commission désigne Mme Marta de Cidrac et M. Jacques Fernique rapporteurs de la mission d'information sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec).
M. Jean-François Longeot, président. - Mes chers collègues, je vous félicite et vous souhaite bon courage pour engager le travail qui vous attend. Nous y porterons une très grande attention.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - Bien évidemment, mes chers collègues, les auditions seront ouvertes à tous. Nous mènerons notre travail de manière transpartisane et ouverte.
Le sujet est éminemment important pour nos collectivités. Je ne doute pas que vous en ayez parfaitement conscience !
M. Jacques Fernique, rapporteur. - J'insiste sur la nécessité d'une collaboration transpartisane.
Nous avons à comprendre pourquoi, cinq ans après la loi Agec, 40 % des déchets qui sont théoriquement soumis à REP échappent encore à la collecte. Nos objectifs de recyclage ne sont pas atteints, et ceux du réemploi le sont encore moins. Il nous faudra étudier comment nous pouvons rectifier cette tendance, surtout que ce sont les collectivités qui paient les pots cassés de ces trajectoires non réalisées.
Examen du rapport d'information
(Mercredi 25 juin 2025)
Le compte rendu relatif à ce point de l'ordre du jour sera publié ultérieurement.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 21 janvier 2025
- Ecomaison : Mme Dominique MIGNON, présidente, et M. Xavier REBARDY, directeur des affaires règlementaires et juridiques.
- Valobat : M. Jérôme D'ASSIGNY, directeur des affaires publiques, de la relation collectivités et maîtrise d'ouvrage, Mme Florence COLLOT, directrice des relations adhérents et M. Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, administrateur.
- Valdelia : M. Arnaud HUMBERT-DROZ, directeur exécutif et Mme Élodie RIVIÈRE, directrice des relations institutionnelles.
- Collectif des éco-organismes : Mmes Dominique MIGNON, présidente d'Ecomaison et Laurence BOURET, déléguée générale de DASTRI, MM. Nicolas DEFRENNE, directeur général de SOREN, et Emmanuel TOUSSAINT D'AUVERGNE, directeur général de Screlec.
Mercredi 22 janvier 2025
- Table ronde sur les entreprises du bâtiment (Fédération française du bâtiment - FFB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment - Capeb) : MM. David AMADON, directeur des affaires techniques et professionnelles de la Capeb, Thibaut BOUSQUET, directeur des affaires publiques de la Capeb, Jean-Michel MARTIN, administrateur confédéral en charge de l'économie circulaire et président des métiers du bois de la Capeb, Franck PERRAUD, vice-président de la FFB, Éric DURAND, directeur des affaires techniques de la FFB, et Benoît VANSTAVEL, directeur des relations institutionnelles de la FFB.
Mardi 28 janvier 2025
- Mouvement des entreprises de France (Medef) : Mme Anne-Charlotte WEDRYCHOWSKA, co-présidente du comité économie circulaire, M. Sébastien SUREAU, directeur de mission au pôle Transition écologique, Mmes Cathy DUFOUR, membre du bureau de la commission consommation, et Charlotte DRONNEAU, chargée de mission senior au pôle affaires publiques.
- Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) : Mmes Muriel OLIVIER, déléguée générale, Lucie MUNIESA, directrice affaires publiques Paprec, et Françoise WEBER, directrice des schémas de responsabilité élargie des producteurs (REP) Veolia.
- Association des recycleurs indépendants : MM. Samuel LOSTIS, président, et Patrick ARMABESSAIRE, membre du bureau.
Mercredi 29 janvier 2025
- France Biodéchets : M Stephan MARTINEZ, président, Mme Julie ORLIAC, déléguée régionale, MM. Édouard VAN HEESWYCK, conseiller spécial, Damien GRASSET, administrateur, et Etienne ANQUETIN, administrateur.
- Confédération des grossistes de France : Mmes Kristelle HOURQUES, directrice des affaires publiques, et Nathalie FUSSLER, directrice environnement.
Mercredi 5 février 2025
- Association Amorce : M. Nicolas GARNIER, délégué général.
- Association des Maires de France : M. Sylvain GUINAUDIE, co-président du GT déchets, et Mme Sylviane OBERLÉ, chargée de mission prévention des pollutions.
Mardi 11 février 2025
- Intercommunalités de France : Mmes Odile BEGORRE-MAIRE, administratrice, Montaine BLONSARD, responsable des relations avec le Parlement et Anaëlle CONTREPOIS, conseillère déchets, économie circulaire, agriculture, commande publique.
- Ecominéro : MM. Mathieu HIBLOT, directeur délégué, et Benoît PLANCHARD, responsable des Relations institutionnelles.
Mercredi 12 février 2025
- Citeo : MM. Jean HORNAIN, directeur général, Laurent GRAVE-RAULIN, secrétaire général, et Mme Anne-Sophie LOUVEL, directrice opérations et territoires.
- L'Ameublement français : M. Arnaud VISSE, président, et Mme Cathy DUFOUR, déléguée générale.
Mercredi 12 mars 2025
- Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federrec) : M. Jean-François CARENCO, président délégué, Mme Sophie SICARD, présidente de la commission prospective & innovation, M. Manuel BURNAND, directeur général, et Mme Adèle MOTTE, responsable des relations publiques.
Mardi 18 mars 2025
- Fédération nationale du bois (FNB) : MM. Stéphane VIVES, président du directoire du groupe Monnet sève, et Nicolas DOUZAIN-DIDIER, délégué général.
Mercredi 19 mars 2025
- Direction générale de la prévention des risques (DGPR): M. Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l'économie circulaire pour la DGPR.
Jeudi 20 mars 2025
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : M. Ambroise PASCAL, délégué à la transition écologique.
Mardi 1er avril 2025
- Table ronde sur la EC2027, Association Orée, Institut national pour l'économie circulaire - Inec : M. Alexandre TANAY, vice-président d'EC2027, Mme Marie-Anne FALCONET, représentante au sein de l'association EC2027 de l'entreprise Jouga, M. Pierre-Yves BURLOT, président de l'Association Orée, Mme Nathalie BOYER, déléguée générale de l'Association Orée, M. Hugo CONZELMANN, responsable affaires publiques et juridiques de l'Inec, et Mme Caroline SAISSI, chargée de mission affaires publiques et juridiques de l'Inec.
- Aliapur : MM. Hervé DOMAS, directeur général, et Pierre OBRECHT, directeur relations extérieures.
- Table ronde sur la « Filière DEEE » (Ecologic, Ecosystem, Soren, Fédération des industries électriques, électroniques et de communication - Fieec) : MM. René-Louis PERRIER, président d'Ecologic, Bertrand REYGNER, directeur des relations institutionnelles et techniques d'Ecologic, Quentin BELLET, responsable des affaires publiques d'Ecologic, Mmes Nathalie YSERD, directrice générale d'Ecosystem et Chloé BRUMEL-JOUAN, directrice relations institutionnelles, juridique et contrôle interne d'Ecosystem, M. Nicolas DEFRENNE, directeur général de Soren, Mmes Anne-Charlotte WEDRYCHOWSKA, directrice économie circulaire et RSE de la Fieec, et Aridge KHAYATI, chargée d'affaires publiques de la Fieec.
Mardi 8 avril 2025
- Conseil national de l'économie circulaire (Cnec) : M. Jean-Michel BUF, président.
- Alliance du commerce : Mme Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE, directrice des affaires économiques et juridiques.
- Léko : M. Patrick BARIOL, directeur général, Mmes Marion HALBY, directrice des opérations, et Claire VALLE, responsable des affaires institutionnelles et réglementaires.
- Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (CiFREP) : M. Jacques VERNIER, président.
Mardi 13 mai 2025
- Table ronde sur les « Nouvelles filières REP » (Cyclevia - huiles usagées, Alcome - tabac, Ecologic - sport et loisirs, bricolage et jardin) : M. André ZAFFIRO, directeur général de Cyclevia, Mmes GUERNALEC ANNE, responsable juridique de Cyclevia, Marie-Noëlle DUVAL, directrice générale d'Alcome, MM. Pierre-Étienne DELFLY, responsable de la sensibilisation d'Alcome, Bertrand REYGNER, directeur général adjoint d'Ecologic, Mme Amélie MONTORIOL, directrice nouvelles filières d'Ecologic, et M. Quentin BELLET, responsable affaires publiques d'Ecologic.
- Table ronde sur les « Acteurs économiques des matériaux de construction » (Fédération des distributeurs de matériaux de construction - FDMC, Association française des industries de matériaux et composants de construction - AIMCC, Coedis, Fédération des industries des peintures, encres, colles, couleurs et résines - Fipec, Fédération des magasins du bâtiment - FMB) : Mmes Marie ARNOUT, présidente de la FDMC, Cynthia CAROFF, présidente de la commission RSE et développement durable de la FDMC, MM. Patrick BOURDON, président de la commission économique de la FDMC, Laurent MARTIN SAINT LÉON, délégué général de la FDMC, Mmes Adrienne OUVRIEU, directrice juridique de la FDMC, Caroline LESTOURNELLE, présidente de la commission environnement de l'AIMCC, MM. Jean-Christophe BARBANT, directeur des affaires juridiques de l'AIMCC, Thierry VOLAND, animateur du GT économie circulaire de l'AIMCC, Roland MONGIN, délégué général de Coedis, Cyril GALY-DEJEAN, responsable affaires publiques de Coedis, Mme Kim SIHASSEN, responsable environnement de Coedis, MM. Guillaume FRÉMAUX, président d'Haghebaert & Frémaux, fabricant de peintures et président du Sipev de la Fipec, Pierre-Henri de LONGCAMP, directeur pôle influence de Fipec, Laurent PRIGENT, responsable environnement de Fipec, et Mme Caroline HUPIN, déléguée générale de la FMB.
Mercredi 14 mai 2025
- Table ronde « ESS » (Emmaüs France, ESS France, Réseau national des ressourceries et recycleries, Fondation Envie) : M. Thomas LADREYT, délégué général adjoint d'Emmaüs France, Mme Aurore MÉDIEU, responsable transition écologique pour ESS France et le Réseau national des ressourceries et recycleries, et M. Guillaume BALAS de la Fondation Envie.
Mardi 20 mai 2025
- Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD) : M. François de TARRAGON, vice-président et Mme Guénola GASCOIN, secrétaire générale.
- Syndicat Elipso : MM. Sébastien RICARD, responsable des relations institutionnelles du groupe Guillin, et Quentin BLOT, chargé de mission recyclage.
- Réseau Compost Plus : Mme Isabelle PETIOT, vice-présidente, MM. Antoine GUILLOU, adjoint à la mairie de Paris en charge de la propreté de l'espace public, de la réduction des déchets, du réemploi, du recyclage et de l'assainissement, et Thomas COLIN, conseiller organique.
- Dastri : Mme Laurence BOURET, déléguée générale.
Mercredi 21 mai 2025
- Agence de la transition écologique : MM. Baptiste PERRISSIN-FABERT, directeur général délégué, et Jean-Charles CAUDRON, direction de la supervision des filières REP.
Lundi 26 mai 2025
- Fédération nationale d'agriculture biologique (Fnab) : MM. Olivier CHALOCHE, co-président, et Félix LEPERS, chargé des politiques publiques et de la règlementation.
- Union nationale des entreprises de valorisation (Unev) : M. Réda SEMLALI, président.
- France Industrie : M. Emmanuel GUICHARD, directeur général de la Fédération des entreprises de la beauté (Febea), représentant de France industrie au sein du Cnec.
Mardi 27 mai 2025
- Table ronde sur le « Commerce en ligne » (Fédération du e-commerce et de la vente à distance - Fevad, Alliance française des places de marché - APDM) : MM. Marc LOLIVIER, délégué général de la Fevad, Hugo JUBLAN, responsable RSE, paiement et logistique de la Fevad, Moncef LAMECHE, responsable des affaires publiques de la Fevad, Mme Nathalie BILTZ VUAILLAT, membre de l'APDM et M. Paul SMAIL, expert de l'APDM.
- Table ronde « Associations environnementales » (Zero Waste France, Les amis de la Terre) : Mmes Pauline DEBRABANDERE, responsable plaidoyer et campagnes de Zero Waste France, Bénédicte KJAER KAHLAT, responsable des affaires juridiques de l'association de Zero Waste France, et M. Pierre CONDAMINE, chargé de campagne surproduction au sein de l'association Les amis de la Terre.
- Association Halte à l'obsolescence programmée (HOP) : Mme Laëtitia VASSEUR, déléguée générale.
Mardi 10 juin 2025
- Réseau Vrac & Réemploi : Mmes Célia RENNESSON, directrice générale, et Lucia PEREIRA, directrice des affaires juridiques et réglementaires.
Mercredi 11 juin 2025
- Régions de France : M. Jean-Michel BUF, conseiller régional.
- Refashion : Mme Maud HARDY, directrice générale.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Alliance Carton nature (ACN)
- Alliance française des industries du numérique (AFIN)
- Altkin
- Association française des compostables biosourcés (AFCB)
- Banque des territoires
- Comité français de l'emballage papier carton (Cofepac)
- Comité stratégique de filière mode et luxe
- Fédération des industries mécaniques (FIM)
- France filière pêche
- HP Inc.
- Huntsman Building Solutions
- Reloop Platform
- Réseau compost citoyen
- Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles (Sesemn)
- Syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique (Syprea)
- Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide (SNARR)
- United.b
LISTE DES DÉPLACEMENTS
BRUXELLES
Jeudi 3 avril 2025
- Entretien avec MM. Jan CEYSSENS, chef de cabinet adjoint, et Luis PLANAS HERRERA, conseiller, au cabinet de Mme Jessika ROSWALL, commissaire européen chargée de l'environnement, de la résilience de l'eau et de l'économie circulaire compétitive ;
- Entretien avec MM. Cyril PIQUEMAL, représentant permanent adjoint de la France auprès de l'Union européenne, et Hugo SANCHEZ, conseiller chargé de l'économie circulaire à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;
- Entretien avec Mmes Esra TAT, directrice exécutive, et Lauriane VEILLARD, représentantes de l'organisation non gouvernementale « Zero Waste Europe » ;
- Entretien avec M. Marco Musso, représentant de l'organisation non gouvernementale « Bureau européen pour l'environnement ».
BAS-RHIN
(Scherwiller)
Lundi 19 mai 2025
- Entretien avec MM. Jean-Pierre PIELA, président du SMICTOM d'Alsace Centrale, Nicolas PIERAUT, directeur et Mme Sylvie PEPIN, responsable du service Prévention Animation Communication ;
- Entretien avec M. Martin KLIPFEL, conseiller communautaire de la CC Ried de Marckolsheim ;
- Entretien avec M. Philippe MEINRAD, codirigeant d'Agrivalor, président de l'association Agriculteurs Composteurs de France, membre du bureau de l'association Agriculteurs Méthaniseurs de France.
YVELINES
(Carrières-sous-Poissy et
Chanteloup-les-Vignes)
Jeudi 22 mai 2025
- Entretien avec MM. François DAZELLE, premier adjoint au maire d'Achères, conseiller communautaire de la communauté urbaine GPS&O et président du comité syndical de Valoseine, Mark VENUS, adjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye, conseiller communautaire de la communauté d'agglomération SGBS et vice-président du comité syndical de Valoseine, Michel LEPERT, adjoint au maire de Chambourcy, délégué de la communauté d'agglomération SGBS au comité syndical de Valoseine, Philippe BARON, adjoint au maire de Carrières-sous-Poissy, délégué de la communauté urbaine GPS&O au comité syndical de Valoseine, Philippe LE BEULZE, DGS d'Unilys - syndicats intercommunaux Boucle des Yvelines, Nicolas REQUIER, directeur général délégué pour Suez RV Energie Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne Franche-Comté et Mme Chloé BOITARD, responsable d'exploitation chez Suez.
- Entretien avec Mmes Émilie MORAND, présidente-directrice générale du site Le Relais Val de Seine Emmaüs et Catherine ARENOU, maire de Chanteloup-les-Vignes.
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Élaborer une stratégie industrielle pluriannuelle pour chaque filière REP, en associant l'ensemble des parties prenantes |
État, SGPE et régions |
Loi (modification des compétences des régions), règlement et circulaire |
|
|
2 |
Réaffirmer le rôle de l'État comme régulateur des filières REP |
État (administration centrale) |
Règlement (arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes, sanctions) |
|
|
3 |
Refonder la gouvernance des filières REP en renforçant la co-construction et l'efficacité collective |
État (administration centrale) |
Loi (modification de l'article L. 541-10
|
|
|
4 |
Réaffirmer la priorité donnée à la réparation, au réemploi et à la réutilisation |
État, régions, collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets, éco-organismes |
Loi et règlement |
|
|
5 |
Réaffirmer l'universalité du principe « pollueur-payeur » |
État |
Loi et règlement |
|
|
6 |
Renforcer la lutte contre la fraude aux écocontributions et ainsi redonner confiance en l'économie circulaire. |
État |
Loi et règlement (sanctions) |
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
7 |
Adapter le cadre légal de la collecte aux réalités des territoires et améliorer l'accompagnement à la transition des collectivités |
État, Union européenne, collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets |
Loi et règlement |
|
|
8 |
Lutter contre la surconsommation en régulant les pratiques commerciales agressives et en envisageant une modulation de l'écocontribution selon l'intensité publicitaire des produits voire, à terme, une écocontribution financée directement par les publicitaires |
État |
Loi et règlement |
ANNEXE
ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE
À la demande de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la division de la Législation comparée a réalisé une étude sur les régimes de responsabilité élargie du producteur (REP) dans quatre pays de l'Union européenne : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Selon le principe de la REP, les producteurs, c'est-à-dire les personnes qui mettent sur le marché certains produits, peuvent être rendus responsables du financement ou de l'organisation de la prévention et de la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie119(*).
La législation européenne relative aux déchets - principalement la directive-cadre 2008/98/CE120(*) - fournit un cadre global pour la mise en oeuvre de la REP dans l'Union européenne (UE). Les États membres, via leurs législations respectives, sont responsables de la mise en oeuvre de la REP. L'étude comparée de ces mises en oeuvre à l'échelle nationale montre que les filières REP ont des modalités de fonctionnement et de gouvernance relativement hétérogènes au sein de l'UE.
A. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE : STATISTIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
À titre liminaire, le tableau ci-dessous présente les résultats de certains indicateurs utilisés dans le cadre de suivi de l'UE sur l'économie circulaire. Parmi les quatre pays étudiés, l'Allemagne est la plus performante pour le recyclage de l'ensemble des déchets municipaux ainsi que la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE). Les Pays-Bas enregistrent un très bon taux de recyclage pour l'ensemble des déchets d'emballage et l'Italie plus spécifiquement pour les déchets d'emballage plastique. Dans l'ensemble, les taux de recyclage constatés en France sont inférieurs à ceux observés dans les quatre pays étudiés.
Statistiques en matière de gestion des déchets
|
UE |
France |
Allemagne |
Espagne |
Italie |
Pays-Bas |
|
|
Production totale de déchets par habitant (kg par hab.) |
4 991 (2022) |
5 076 (2022) |
4 604 (2022) |
2 480 (2022) |
3 212 (2022) |
6 921 (2022) |
|
Taux de recyclage des déchets municipaux ( %) |
48,2 (2023) |
42,2 (2023 |
68,2 (2023) |
41,4 (2023) |
53,3 (2023) |
58,4 (2023) |
|
Taux de recyclage de tous les déchets d'emballage |
65,4 (2022) |
67,2 (2022) |
68,5 (2022) |
69,4 (2022) |
71,9 (2022) |
75,2 (2022) |
|
Taux de recyclage des emballages plastiques ( %) |
40,7 (2022) |
25,2 (2022) |
51,1 (2022) |
51,5 (2022) |
54,6 (2022) |
45,7 (2022) |
|
Taux de réutilisation et de recyclage des DEEE ( %) |
80,7 (2022) |
77,2 (2022) |
85,5 (2022) |
69,5 (2022) |
83,7 (2022) |
72,76 (2022) |
Source : Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/monitoring-framework (consulté le 31 mars 2025).
B. LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN
La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets) harmonise le cadre juridique relatif au traitement des déchets dans l'Union européenne qui était jusqu'alors fragmenté dans plusieurs textes modifiés à maintes reprises.
Cette directive prévoit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Au titre de ces mesures, la directive a notamment établi une hiérarchie en matière de traitement des déchets (article 4) et rappelé le principe du pollueur-payeur. Elle a aussi et surtout introduit le régime de « responsabilité élargie du producteur » (article 8). La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une approche de politique environnementale qui confère aux producteurs la responsabilité de leurs produits tout au long du cycle de vie de ces derniers, y compris en aval de la consommation. Il s'agit concrètement, pour le producteur concerné, de réduire les incidences de ses produits tout au long du cycle de vie de ceux-ci, notamment en améliorant leur conception et la gestion des déchets qui en sont issus. Pour soumettre les producteurs au régime REP, l'article 8 précité autorise les États membres à prendre des mesures prévoyant « le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités ».
La directive 2018/851/UE modifiant la directive-cadre déchets, dans le cadre du paquet sur l'économie circulaire, a introduit des exigences minimales pour les systèmes REP dans toute l'UE, notamment sur la transparence des coûts et la couverture totale des frais de gestion des déchets.
Au 1er mars 2025, il existe cinq filières REP obligatoires à l'échelle de l'Union et une sixième devrait prochainement voir le jour. Elles concernent les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les véhicules hors d'usage (VHU), les emballages, les batteries, le plastique à usage unique et, bientôt, le textile.
Les VHU font l'objet d'un régime de REP consacrée dans la directive 2000/53/CE121(*) du 18 septembre 2000 - modifiée pour la dernière fois en 2023. La directive prévoit notamment la mise en place de systèmes de collecte des VHU et de leurs pièces détachées, répartis efficacement sur les territoires des États membres.
Les batteries et leurs déchets font également l'objet d'une filière REP dans le règlement (UE) 2023/1542122(*) du 12 juillet 2023 - abrogeant une directive antérieure de 2006 qui prévoyait déjà une telle filière.
Un régime de REP a également été créé pour les DEEE par la directive 2012/19/UE123(*) du 4 juillet 2012 - modifiée pour la dernière fois en 2024. La directive instaure des mesures relatives à la conception du produit - les composants et matériaux des équipements électriques et électroniques doivent faciliter leur réemploi - et à la collecte de ces équipements lorsqu'ils ont été consommés. Ces derniers doivent être jetés séparément des déchets municipaux non triés.
La directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 a imposé la mise en place d'un régime de REP à l'ensemble des emballages124(*) au plus tard le 31 décembre 2024. Cette directive a été récemment abrogée par le règlement (UE) 2025/40125(*) du 19 décembre 2024 qui définit des objectifs de valorisation et de recyclage pour les États membres se matérialisant par des obligations incombant aux producteurs, notamment au stade de la fabrication des emballages : leurs composants doivent faciliter leur réemploi ou, à titre subsidiaire, leur recyclage.
Une filière REP a en outre été créée pour les produits contenant du plastique à usage unique126(*) via la directive (UE) 2019/904127(*) du 5 juin 2019. En vertu de cette directive, les États membres doivent notamment prévoir une obligation pour les producteurs de couvrir les coûts du nettoyage des déchets sauvages sous la forme d'écocontributions dont les montants sont fixés de façon pluriannuelle.
Enfin, le Parlement européen et le Conseil ont conclu en février 2025 un accord sur une révision ciblée128(*) de la directive-cadre sur les déchets, prévoyant la création d'une filière REP obligatoire pour le textile. Les producteurs de textiles siégeant dans un État membre de l'Union devront couvrir les frais liés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets textiles et ce de façon obligatoire après une période transitoire de 30 mois à partir de l'entrée en vigueur de la future directive. Ces dispositions s'appliqueront à tous les producteurs distribuant des produits textiles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. Les micro-entreprises sont également concernées par cette nouvelle filière REP mais disposeront d'une période transitoire plus longue pour mettre en place les mesures.
C. ALLEMAGNE
La loi allemande de 2012 relative à la promotion de l'économie circulaire définit la « responsabilité liée au produit » (Produktverantwortung) comme un ensemble d'obligations comprenant la reprise, le recyclage et l'élimination des produits mis sur le marché, la prise en charge de la responsabilité financière pour la gestion des déchets issus de ces produits ainsi que la participation aux coûts supportés par les organismes publics d'élimination des déchets. Depuis 2020, la responsabilité liée au produit comprend également une obligation de vigilance (Obhutspflicht) visant à empêcher la destruction des invendus.
Il existe six régimes de REP en Allemagne, correspondant aux cinq régimes obligatoires en vertu du droit de l'UE (DEEE, piles et accumulateurs, VHU, emballages et plastiques à usage unique), auxquels s'ajoute la filière des huiles usagées. Le fonctionnement et la gouvernance de ces filières ne sont pas homogènes.
Pionnière de la responsabilité liée au produit en Allemagne, la filière des emballages repose sur une gouvernance à deux niveaux associant les « systèmes duaux » (dualen Systemen, équivalents des éco organismes français), et une centrale du registre des emballages (Zentrale Stelle Verpackungsregister) à laquelle participent notamment des représentants des Länder et de l'échelon communal.
1. Le cadre juridique général
En droit allemand, la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE est principalement transposée par la loi relative à la promotion de l'économie circulaire et la garantie d'une gestion des déchets respectueuse de l'environnement129(*) de 2012, modifiée en 2020130(*). L'article 4 de la loi allemande transpose la hiérarchie des déchets établie par la directive-cadre européenne (prévention, préparation en vue de réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment énergétique et, en dernier recours, élimination du déchet) et l'article 23 définit la responsabilité liée au produit (Produktverantwortung). Outre la fabrication de produits économes en ressources et réutilisables, cette responsabilité comprend notamment :
- la reprise des produits et des déchets générés après utilisation des produits ainsi que leur recyclage ou leur élimination ultérieurs dans le respect de l'environnement ;
- la prise en charge de la responsabilité financière ou de la responsabilité financière et organisationnelle pour la gestion des déchets produits après l'utilisation des produits ;
- l'information et le conseil du public sur les possibilités de prévention, de valorisation et d'élimination des déchets, en particulier sur les exigences en matière de collecte sélective ;
- la participation aux coûts supportés par les organismes publics d'élimination des déchets et autres personnes morales de droit public pour le nettoyage de l'environnement et la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets résultant de l'utilisation des produits mis sur le marché par un fabricant ou un distributeur ;
- ainsi que, depuis 2020, une obligation de vigilance (Obhutspflicht) concernant les produits commercialisés, en vertu de laquelle le producteur doit veiller, lors de la distribution, de la reprise ou de la restitution, à ce que les produits demeurent réutilisables et ne deviennent pas des déchets. Cette obligation a notamment pour objectif d'empêcher la destruction de produits invendus en état de marche131(*).
Ainsi, la loi allemande ne se réfère pas exactement à la notion de « responsabilité élargie du producteur » (erweiterte Herstellerverantwortung) mais la responsabilité liée au produit comprend des mesures semblables à la REP, telle que définie à l'article 8 de la directive-cadre sur les déchets.
En droit interne, l'obligation liée au produit est complétée par divers textes transposant les directives ou règlements européens prévoyant un régime de REP pour certains produits, à savoir :
- l'ordonnance sur les véhicules hors d'usage132(*) de 1997, modifiée pour la dernière fois en 2020 pour la rendre conforme aux évolutions du droit de l'Union, transpose la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage (VHU) en établissant une obligation de reprise et de recyclage des producteurs133(*) ;
- la loi sur les batteries134(*) de 2009 crée une filière à responsabilité élargie du producteur pour les batteries portables (article 7) et les batteries de véhicules (article 8). La loi de transposition du règlement (UE) 2023/1542 relative aux batteries et aux déchets de batteries135(*) (abrogeant une directive de 2006) est actuellement en cours d'examen au Bundestag136(*) ;
- la loi sur les appareils électriques et électroniques137(*) de 2015 qui, en application de la directive-cadre 2008/98/CE et de la directive 2012/19/UE138(*) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévoit, en son article 7a, l'obligation pour tout producteur de mettre en place un système de reprise et d'élimination des équipements usagés (Rücknahmekonzept) ;
- la loi sur les emballages de 2017139(*) transpose notamment le règlement (UE) 2025/40140(*) relatif aux emballages et aux déchets d'emballages et concrétise les exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages (cf. infra) ;
- la loi sur les plastiques à usage unique de 2023141(*) a transposé les obligations de la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement142(*). En vertu de son article 8, les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés en annexe de la directive.
En outre, l'ordonnance sur les huiles usagées de 2002143(*) prévoit un régime de REP pour ce type de produit. Les huiles de moteur et de boîte de vitesses ne peuvent être vendues que s'il existe sur place ou à proximité immédiate un point de collecte pour les huiles usagées.
2. Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
Il existe actuellement six régimes de REP en Allemagne144(*), correspondant aux cinq régimes obligatoires en vertu du droit de l'UE, auxquels s'ajoute la filière des huiles usagées.
Malgré ce faible nombre, le fonctionnement et la gouvernance des filières ne sont pas homogènes. Trois régimes (DEEE, piles et accumulateurs, et VHU) reposent sur un « organisme commun des producteurs » (gemeinsame Stelle der Hersteller) chargé par l'Office fédéral de l'environnement de l'enregistrement des producteurs et de l'agrément des entreprises de traitement des produits usagés, conformément au droit de l'UE145(*). Les deux organismes communs de producteurs existants pour les DEEE et les piles accumulateurs d'une part, et pour les VHU d'autre part, ont le statut de fondation de droit privé.
La filière des emballages, pionnière de la responsabilité liée au produit en Allemagne, repose quant à elle sur une gouvernance à deux niveaux associant les « systèmes duaux » (dualen Systemen, équivalents des éco-organismes français), qui adhèrent à un organisme commun de producteurs prévu par la loi, et une centrale du registre des emballages (Zentrale Stelle Verpackungsregister) permettant de contrôler l'atteinte des objectifs au niveau fédéral et d'associer les acteurs publics, dont des représentants des Länder et de l'échelon communal, aux décisions.
La filière des huiles usagées ne dispose quant à elle pas de centre commun, ni d'équivalent d'un éco-organisme spécifique.
|
Régime |
Bases juridiques |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Organismes communes de producteurs |
Financement |
|
S'inscrire au registre national DEEE ( Stiftung EAR) Mettre en place un système de collecte. |
Collecter au moins 65 % du poids moyen des DEEE mis sur le marché au cours des trois dernières années. |
La fondation EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte-Register) est chargée par l'office fédéral de l'environnement d'enregistrer les producteurs et d'agréer les entreprises de traitement et de recyclage. |
Écocontribution payée par le producteur variable selon le type d'appareil ou, en l'absence d'un éco-organisme, paiement d'une garantie à l'organisme central (fondation EAR) qui prend en charge les frais de gestion des déchets de façon subsidiaire. |
||
|
Verpackungs-gesetz (2017) |
Mettre en place un système de collecte et de recyclage, notamment via un « système dual » Déclarer le type et la masse d'emballages confiés à l'éco-organisme et le nom de ce dernier auprès de la centrale d'enregistrement d'emballages (CEE). Consigne obligatoire pour les bouteilles métalliques, en plastique ou en carton pour les boissons146(*) de 0,1 à 3,0 litres (minimum 0,25 euro). |
Depuis 2022, l'objectif minimal légal de recyclage est de 90 % des emballages et contenants en verre, carton, papier et métalliques. |
10 « systèmes duaux » : (BellandVision GmbH, Der Grüne Punkt, Eko-Punkt GmbH, Interzero Recycling Alliance Gmbh, Landbell AG, Noventiz Dual Gmbh, PreZero Dul GmbH, Reclay systees GmbH, Recycling Dual GmbH, Zentek GmbH & Co KG) Au niveau fédéral, Centrale du registre des emballages (Zentrale Stelle Verpackungsregister) |
Les éco-organismes sont financés par des écocontributions versées par les producteurs. Le montant de la contribution varie en fonction de la part du marché dont les systèmes ont la charge. |
|
|
Altölverordnung (1987) |
Indiquer sur l'emballage du bidon d'huile que celle-ci doit être rapportée après usage dans un centre de collecte des huiles usagées. Mettre en place un système de collecte sur le lieu de l'achat (magasin de bricolage, station à essence). La collecte de l'huile usagée est gratuite si l'acheteur présente une preuve d'achat. |
Pas d'objectif minimal. La collecte séparée et le recyclage des huiles usagées sont systématiquement obligatoires, eu égard à leur caractère particulièrement polluant. |
Pas d'éco-organisme mais des entreprises rémunérées directement par les producteurs. |
Rémunération versée par les producteurs aux entreprises de gestion des huiles usagées (Altölentsorgung Firmen). |
|
|
Batteriegesetz (2009) |
Mettre en place un système de collecte, de traitement et de valorisation. Rendre compte annuellement des quantités de piles et accumulateurs neufs mis sur le marché et des taux effectifs de collecte et de revalorisation. |
Taux minimal de collecte de 50 %. Taux minimaux de recyclage : 65 % des batteries au plomb-acide ; 75 % des batteries au nickel-calcium et 50 % des autres batteries. |
La fondation EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte-Register) est chargée par l'Office fédéral de l'environnement d'enregistrer les producteurs et d'agréer les systèmes de reprise (10 actuellement)147(*). |
Écocontribution payée par le producteur dont le montant varie en fonction de la composition, la durée de vie, la possibilité de réutilisation et la recyclabilité de la batterie. L'objectif est d'inciter le producteur à réduire l'utilisation de substances dangereuses. |
|
|
Einwegkunst-stofffondsgesetz (2023) |
S'enregistrer auprès de l'Office fédéral pour l'environnement en tant que producteur de produits en plastique à usage unique. Notifier le type et la masse de produits mis sur le marché annuellement. |
Objectifs identiques à ceux de la filière emballage sauf pour certains produits (lingettes humides, ballons de baudruche et filtres de tabac)qui n'ont pas d'objectif minimal. |
Pour les produits autres que les emballages (lingettes humides, ballons de baudruche et produit de tabac avec filtres), il n'existe pas d'éco-organisme. |
L'Office fédéral pour l'environnement administre un fonds pour le plastique à usage unique (Einwegkunststofffonds) alimenté par les redevances des producteurs. Leur montant est fixé en fonction de la masse de déchets qu'ils génèrent. Sur demande, les organismes publics de gestion des déchets peuvent obtenir du fonds le remboursement des coûts liés à la gestion de ce type de déchets. |
|
|
Altfahrzeug-Verordnung (1997) |
Mettre en place des points de collecte ou de désassemblage agréés accessibles à une distance raisonnable. À l'étape de la construction, réduire voire éviter l'utilisation de substances dangereuses et privilégier le recours à des matériaux recyclables. Publier les données relatives aux taux de recyclage et aux composants des voitures et les rendre facilement accessibles aux acheteurs. |
Taux minimal de réutilisation et de valorisation de 95 % du poids des véhicules. Taux minimal de réutilisation et de recyclage de 85 % du poids des véhicules. |
La centrale pour les VHU ( Gemeinsame Stelle Altfahrzeuge, GESA) est chargée d'agréer les centres de réception et les entreprises de recyclage des VHU. |
Non disponible. |
3. La filière des déchets d'emballages
· Contexte
En Allemagne, la filière des emballages fait figure de précurseur dans la mise en oeuvre du principe de responsabilité liée au produit. Son organisation repose sur des opérateurs privés, ayant généralement le statut de sociétés à responsabilité limitée, appelés « duale Systeme »148(*). Équivalents des éco-organismes français, ces systèmes sont chargés de la collecte, du tri et de la valorisation des emballages. Le nom de système dual s'explique par le fait qu'il s'agit d'un système de collecte supplémentaire organisé par le secteur privé, en plus du système public de collecte des déchets dont sont responsables les communes ou les arrondissements (Landkreise).
D'un point de vue historique, les systèmes duaux ont été créés par le décret sur les emballages entré en vigueur en 1991 qui obligeait les producteurs à récupérer et recycler leurs emballages. Le premier système dual à avoir été créé, en 1990, est « Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung mbH ». Fondé à l'origine en tant qu'organisme à but non lucratif, Der Grüne Punkt était financé par toutes les entreprises mettant des emballages sur le marché. En 2003, le monopole de Der Grüne Punkt a été supprimé et de nouveaux systèmes duaux ont été créés.
Depuis 2009 et l'entrée en vigueur de la directive-cadre 2008/98/CE sur les déchets créant la REP, la participation des producteurs d'emballages au financement d'un système dual est obligatoire. En 2019, le décret sur les déchets a été abrogé et remplacé par la nouvelle loi sur les déchets149(*). L'obligation incombant aux producteurs de participer au financement des systèmes duaux via des redevances (Beteiligungsentgelte ou plus communément appelés Lizenzentgelte) est consacrée à l'article 7 alinéa 1 de cette loi.
La redevance est souvent comprise dans le prix de vente du produit et ainsi supportée par le consommateur final. Son montant est calculé en fonction du poids et du matériau composant le produit.
Les systèmes duaux, au nombre de dix, ont l'obligation de participer à un « organisme commun des systèmes duaux » (gemeinsame Stelle, appelé Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH), en vertu de l'article 19 de la loi sur les emballages. Cet organisme commun est notamment chargé de répartir les coûts d'élimination des déchets sur la base des parts de marché des systèmes et de coordonner les appels d'offres (cf. infra).
· La répartition des compétences de collecte entre les systèmes duaux et les communes
La collecte effectuée par les systèmes duaux doit être coordonnée avec celle des structures de collecte des organismes publics de gestion des déchets sur les territoires concernés. Cette collaboration entre les acteurs publics et les systèmes duaux se matérialise par un accord de collaboration (Abstimmungsvereinbarung) écrit ayant valeur réglementaire, au sein duquel les intérêts de l'organisme public de gestion des déchets doivent être privilégiés150(*). Cet acte administratif définit notamment le type de collecte effectuée par le système dual (point de collecte dit « Bringsystem » - conteneurs, centres de recyclage ou décharges - ou système de ramassage dit « Holsystem » - collectes de rue à intervalles réguliers), le type et la taille des conteneurs de collecte ainsi que la fréquence et la période de vidage des conteneurs. Dans la mesure où la collaboration entre ces acteurs publics et privés s'effectue à l'aide des infrastructures mises en place par les communes ou arrondissements, les organismes publics de gestion des déchets peuvent réclamer le paiement d'une redevance auprès des systèmes duaux, dont le montant est calculé en fonction d'une loi fédérale sur les redevances de 2013151(*) et ce, de façon proportionnelle au volume de déchets dont les systèmes ont la charge par rapport à la quantité totale de déchets sur le territoire concerné.
Si, sur un territoire donné, un organisme public de gestion des déchets collabore avec plusieurs systèmes duaux, alors ceux-ci doivent s'organiser afin de nommer un seul représentant qui mènera les négociations avec l'organisme public aboutissant à l'accord de collaboration. La conclusion et, le cas échéant, toute modification de l'accord de coordination, requièrent l'accord de l'organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets ainsi que d'au moins deux tiers des systèmes participant à l'accord de coordination152(*).
Les systèmes duaux attribuent les prestations de collecte dans le cadre de procédures de mise en concurrence153(*) ; les appels d'offres sont publiés sur une plateforme en ligne154(*) par les systèmes duaux. Le processus de sélection est transparent et non discriminatoire. Il s'effectue en vertu du code allemand des marchés publics155(*) qui contient, en ses paragraphes 122 à 125, des dispositions relatives aux critères que doivent remplir les entreprises candidates et les éventuels cas d'exclusion de celles-ci de la procédure de passation.
· Contrôle et surveillance
Afin d'être reconnu comme tel et de pouvoir entrer en service, un système dual doit obtenir une autorisation délivrée par des autorités compétentes du Land d'activité156(*). Cette autorisation peut être retirée en cas de non-respect de ses obligations par l'entreprise agréée en tant que système dual157(*).
Au niveau national, la Centrale du registre des emballages (CEE - Zentrale Stelle Verpackungsregister) a pour principale mission de contrôler le respect des objectifs de recyclage fixés par ses organes158(*). Pour ce faire, elle contrôle l'activité des systèmes duaux, c'est-à-dire qu'elle vérifie que les quantités d'emballages à traiter déclarées sont réelles, que les rapports réguliers établis par les systèmes sont complets et plus généralement que les données déclarées en amont et en aval de leur activité sont correctes. En effet, l'article 20 de la loi sur les emballages soumet les systèmes participants à une obligation de déclaration (« Meldepflicht ») : les systèmes doivent régulièrement communiquer à la CEE des informations, notamment confirmer la masse d'emballages effectivement recyclée chaque trimestre et annoncer la masse d'emballage qu'il est prévu de recycler pour le trimestre suivant.
La CEE est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public créée par les producteurs et les distributeurs d'emballages, en application de l'article 24 de la loi sur les emballages. Les litiges nés de son activité relèvent de la compétence du juge administratif159(*). Le montant de la contribution varie en fonction de la part du marché dont chaque système dual a la charge160(*).
· Gouvernance de la Centrale du registre des emballages
La CEE est composée de quatre organes : un Kuratorium, une présidence, un conseil d'administration et un comité consultatif pour la collecte, le tri et la revalorisation161(*).
Le Kuratorium est le conseil de surveillance de la CEE ; il fixe les lignes directrices de son activité et prend des décisions via des votes à la majorité. Il nomme et démet la présidence via un vote à la majorité des deux tiers. Il est composé de treize personnes au total, dont huit représentants de producteurs, deux représentants des Länder, un représentant des associations représentatives communales (kommunale Spitzenverbände162(*)), un représentant du ministère fédéral de l'économie et un représentant du ministère fédéral de l'environnement.
La présidence, composée d'une à deux personnes maximum, dirige la CEE et assume sa responsabilité juridique et extrajudiciaire.
Le conseil d'administration (Verwaltungsrat) assiste le comité exécutif et la présidence dans leurs missions respectives. Il est composé de vingt-et-un membres, dont :
- dix représentants issus des groupes de producteurs ou de distributeurs d'emballages ;
- un représentant du ministère fédéral de l'économie ;
- un représentant du ministère fédéral de l'environnement ;
- un représentant de l'Office fédéral de l'environnement ;
- deux représentants des Länder ;
- un représentant des associations représentatives communales ;
- un représentant des acteurs privés de gestion des déchets ;
- un représentant des systèmes duaux ;
- et deux représentants des associations en faveur de l'environnement et des droits des consommateurs.
Le comité consultatif pour la collecte, le tri et la revalorisation produit et publie des recommandations ayant trait à l'amélioration de la collecte, du tri et de la revalorisation des déchets contenant des matières recyclables et conseille les communes et les systèmes duaux sur les méthodes de collaboration. Il se compose de trois représentants des associations représentatives communales, un représentant des acteurs publics de gestion des déchets à l'échelle communale, deux représentants des systèmes duaux et de deux représentants des acteurs privés de gestion des déchets.
D. ESPAGNE
La responsabilité élargie du producteur (responsabilidad ampliada del productor del producto) est régie par la loi n° 7/2022 du 8 avril 2022 relative aux déchets, qui transpose les exigences de la directive-cadre sur les déchets. Elle définit les obligations générales des producteurs et les obligations minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie.
En 2025, le ministère de la transition écologique espagnol recense douze régimes de REP opérationnels (dont sept pour les différentes catégories d'emballages). Trois filières sont en cours de développement (plastiques à usage unique, textiles, meubles et déchets d'ameublement).
La filière des déchets d'emballages a la particularité de comporter sept sous-filières distinctes correspondant aux différentes catégories d'emballages, avec pour chacune d'elle un système collectif de responsabilité élargie du producteur (SCRAP) spécifique.
1. Le cadre juridique général
La loi n° 7/2022 du 8 avril 2022 relative aux déchets et aux terrains contaminés pour une économie circulaire163(*) établit le cadre juridique de la gestion des déchets en Espagne (en remplacement d'une loi de 2011). Elle vise à mettre en conformité la réglementation nationale avec les directives européennes en matière d'économie circulaire, tout en intégrant des mesures visant à réduire l'impact environnemental des déchets et à renforcer la protection des sols contaminés. Elle vise particulièrement la prévention des déchets, l'amélioration des systèmes de gestion et l'introduction d'instruments fiscaux pour favoriser des pratiques durables.
L'article 2 (ac) de la loi de 2022 définit un producteur (de produit) comme « toute personne physique ou morale qui développe, fabrique, transforme, traite, remplit, vend ou importe des produits à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée pour leur mise sur le marché national. Ce concept inclut à la fois les personnes établies sur le territoire national qui introduisent des produits sur le marché national et celles qui se trouvent dans un autre État membre ou un pays tiers et vendent directement à des ménages ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés par le biais de contrats à distance, c'est-à-dire des contrats conclus dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée des parties au contrat, et dans lequel ont été utilisées exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, telles que le courrier postal, l'internet, le téléphone ou le fax, jusqu'au moment de la conclusion du contrat et lors de la conclusion même de celui-ci »164(*).
La responsabilité élargie du producteur (responsabilidad ampliada del productor del producto) représente un élément central du dispositif de gestion des déchets. Le titre IV de la loi transpose les exigences de la directive (UE) 2018/851165(*) en imposant aux producteurs une prise en charge accrue des déchets générés par leurs produits.
La loi aborde, d'une part, les obligations générales des producteurs (articles 37 à 40) et, d'autre part, établit les exigences minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie (articles 41 à 54).
· Les obligations générales des producteurs
Selon l'article 37, le producteur peut être tenu de prendre en charge tout ou partie de la gestion des déchets générés par ses produits, y compris leur prévention, leur collecte et leur traitement. L'objectif est de promouvoir la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets. Le producteur peut satisfaire à ces obligations soit individuellement, soit collectivement via des systèmes agréés (article 38). Les systèmes collectifs de responsabilité élargie du producteur (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor - SCRAP) ont succédé en 2011 aux systèmes intégrés de gestion (SIG) et sont des organismes à but non lucratif (ayant généralement le statut de fondation ou d'association)166(*) financés par les producteurs pour mettre en oeuvre ces obligations.
Il est aussi prévu que certains producteurs puissent assumer volontairement des responsabilités élargies même si la loi ne les y oblige pas, sous réserve de respecter les exigences réglementaires (article 39). Enfin, pour les producteurs établis à l'étranger mais commercialisant leurs produits en Espagne, la loi impose la désignation d'un représentant autorisé chargé de veiller au respect des obligations applicables (article 40).
· Les exigences minimales pour les régimes de responsabilité élargie
L'article 41 prévoit l'obligation de fixer des responsabilités claires entre les différents acteurs (producteurs, distributeurs, autorités publiques, gestionnaires de déchets). Les articles 42 à 48 précisent les obligations des systèmes de responsabilité élargie en matière d'organisation et de financement, en assurant que les producteurs contribuent proportionnellement aux coûts de gestion des déchets issus de leurs produits. Elle prévoit aussi des exigences en matière de transparence et de confidentialité des informations échangées.
La loi de 2022 encadre également la création des systèmes de responsabilité élargie (articles 49 à 52), qu'ils soient individuels ou collectifs. Elle définit les conditions d'autorisation et les garanties financières requises pour assurer leur bon fonctionnement. En cas de manquement, des sanctions sont prévues (voir infra). Enfin, les articles 53 et 54 portent sur la supervision et le contrôle des obligations du producteur, lesquels sont confiés aux autorités régionales compétentes (voir infra).
La responsabilité élargie du producteur préexistait à la loi de 2022. La loi n° 22/2011 du 28 juillet 2011 relative aux les déchets et aux sols contaminés167(*) avait introduit un cadre juridique structuré fondé sur le principe du pollueur-payeur, obligeant les producteurs à assumer la gestion des déchets générés par leurs produits, dès leur conception jusqu'à leur fin de vie.
2. Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
En 2025, le ministère de la transition écologique espagnol recense douze régimes de REP opérationnels168(*), dont sept pour les différentes catégories d'emballages et quatre autres concernant les DEEE, les piles et accumulateurs, les huiles industrielles usagées et les pneus hors d'usage.
À ces douze filières s'ajoutent trois filières actuellement en cours de développement (plastiques à usage unique, textiles, meubles et déchets d'ameublement), ainsi que la collecte et le traitement des véhicules hors d'usage (VHU), obligatoires en vertu du droit européen et du droit espagnol169(*) mais qui ne sont pas présentés comme constituant une filière REP. À terme, l'Espagne devrait donc compter trois régimes de REP, voire 16 en comptabilisant les VHU.
|
Régime |
Bases juridiques |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Éco-organismes (SCRAP) |
Mode de financement |
|
Emballages ménagers hors verre (légers, plastique, papier-carton, etc.) |
Écoconception, collecte séparée, financement de la gestion, sensibilisation |
Recyclage : 65 % (2025), 70 % (2030). Objectifs spécifiques : 50 % plastique, 75 % papier-carton, 70 % ferreux (2025) |
Écocontribution basée sur le poids et le type de matériau |
||
|
Emballages ménagers en verre |
Loi n° 11/1997172(*) et décret n° 1055/2022 |
Collecte séparée, valorisation, information aux consommateurs |
Point vert sur chaque emballage mis sur le marché, basé sur le poids |
||
|
Emballages de produits agricoles |
Décret n° 1055/2022 |
Reprise, collecte séparée, traitement approprié |
Contribution basée sur la typologie et la quantité d'emballages |
||
|
Emballages de produits phytosanitaires et fertilisants |
Décret n° 1416/2001173(*) et décret n° 1055/2022 |
Système spécifique de collecte, décontamination |
Taux de collecte = 75 %, valorisation de 100 % des déchets collectés |
Tarifs spécifiques selon la dangerosité et le type d'emballage |
|
|
Emballages ménagers de médicaments et médicaments périmés |
Décret n° 1345/2007174(*) et décret n° 1055/2022 |
Collecte spécifique en pharmacies, traitement sécurisé |
Contribution des laboratoires pharmaceutiques par unité de vente |
||
|
Emballages ménagers, commerciaux et industriels à usage unique |
Décret n° 1055/2022 |
Réduction, collecte séparée, écoconception |
Collecte séparée : 77 % des bouteilles en plastique (2025), 90 % (2029) |
Écocontribution selon type et quantité |
|
|
Emballages commerciaux et industriels à usage unique et réutilisables |
Décret n° 1055/2022 |
Suivi et traçabilité, promotion de la réutilisation |
Contribution basée sur la quantité et la « réutilisabilité » |
||
|
Débris d'emballages autorisés provisoirement |
Décret n° 1055/2022 |
Variable selon autorisation |
AMBIENVASES, CARTÓN CIRCULAR, ECOEMBES COMERCIALES, ECOLEC, ECOTIC, GENCI, IMPLICA, PUNTO GRETA, RECYCLIA ENVASES, SUN REPACK et UBICA |
Selon autorisation provisoire |
|
|
Piles et accumulateurs |
Collecte séparée, traitement, recyclage, marquage |
AMBIPILAS, ERP, FUNDACIÓN ECOLEC, FUNDACIÓN ECOPILAS, Sun Re-Battery, UNIBAT |
Contribution selon type et poids |
||
|
Pneus hors d'usage |
Collecte, hiérarchie de gestion (réutilisation, recyclage, valorisation) |
Valorisation de 100 % des déchets collectés, min. 50 % recyclage matière |
Écocontribution par pneu selon type et taille |
||
|
Huiles industrielles usagées |
Collecte séparée, traitement adéquat, valorisation |
Contribution basée sur la quantité mise sur le marché |
|||
|
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
Décret n ° 110/2015181(*) et loi n° 7/2022 |
Reprise 1 :1, collecte, traitement, information |
Collecte : 65 % du poids moyen mis sur marché ou 85 % des DEEE générés |
AMBILAMP, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECO-RAEE'S, ECOTIC, ERP, REINICIA, SUNREUSE, ECOECHE, FUNDACIÓN, ECOTIC CLIMA |
Contribution selon type d'équipement et poids |
|
Textiles |
Introduit par la loi n° 7/2022 |
Collecte séparée, préparation pour réutilisation |
Développement de la filière en cours (collecte séparée obligatoire depuis 2025). |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
|
Meubles et déchets d'ameublement |
Introduit par la loi n° 7/2022 |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
|
Produits en plastique à usage unique et produits du tabac |
Décret n° 293/2018182(*) , loi n° 7/2022 et décret n° 1093/2024183(*) |
Réduction, financement du nettoyage, sensibilisation Financement du nettoyage des mégots, sensibilisation |
Variable selon les produits |
En développement pour certains produits |
Contribution basée sur produits mis sur marché Contribution des fabricants de tabac pour le nettoyage |
3. La filière des déchets d'emballages
La responsabilité élargie du producteur pour les emballages en Espagne est encadrée par le décret royal n° 1055/2022 du 27 décembre 2022 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages qui impose aux producteurs l'obligation de gérer les déchets issus des emballages qu'ils mettent sur le marché. Ce décret transpose les directives européennes relatives à l'économie circulaire et vise à renforcer l'implication des entreprises dans la réduction de l'impact environnemental de leurs produits.
Le décret royal n° 1055/2022 du 27 décembre 2022 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages
Ce décret constitue le cadre réglementaire de référence pour la gestion des emballages et de leurs déchets, en conformité avec les obligations européennes. Son objectif principal est de renforcer la REP en imposant des obligations accrues aux fabricants, importateurs et distributeurs d'emballages. Le décret royal introduit des mécanismes de financement intégral des coûts de gestion des déchets d'emballages, de contrôle renforcé et d'adaptation aux exigences de l'économie circulaire.
S'agissant de la responsabilité élargie du producteur, il définit précisément les obligations des producteurs et la structure des régimes de REP. L'article 17 impose aux producteurs de mettre sur le marché des emballages respectant des critères de conception favorisant leur recyclabilité et leur réutilisation. Il leur incombe d'assurer la prise en charge financière et organisationnelle de la collecte et du traitement des déchets issus de leurs produits. À cette fin, ils doivent intégrer des systèmes de responsabilité élargie, qu'ils soient individuels (article 19) ou collectifs (article 20), en respectant des règles strictes de transparence et de financement.
L'article 23 énonce de façon détaillée l'obligation de la contribution financière des producteurs aux systèmes REP. Ceux-ci doivent assumer la totalité des coûts liés à la collecte séparée des déchets d'emballages, leur transport et leur traitement, mais aussi les dépenses relatives à la sensibilisation des consommateurs et au nettoyage des déchets sauvages. La modulation de cette contribution est introduite pour la première fois, tenant compte du type de matériau utilisé, de son potentiel de recyclabilité et de la présence éventuelle de substances dangereuses. L'annexe VIII fixe des critères détaillés pour ajuster ces contributions en fonction de l'impact environnemental des emballages.
Le texte distingue trois grandes catégories d'emballages, chacune soumise à des obligations spécifiques dans le cadre de la REP :
- les emballages domestiques (articles 28 à 34) sont ceux destinés aux consommateurs finaux. Les producteurs doivent financer et organiser leur collecte, leur tri et leur recyclage en partenariat avec les collectivités locales. L'article 34 impose à ces systèmes de verser une compensation aux communes en fonction des quantités d'emballages récupérées et des coûts effectifs de gestion des déchets ;
- les emballages commerciaux (articles 35 à 40) relèvent des activités économiques et sont pris en charge directement par les entreprises concernées ou par des filières REP spécialisées. L'article 40 précise que ces producteurs doivent garantir la prise en charge de 100 % des coûts de gestion ;
- et les emballages industriels (articles 41 à 45) sont ceux utilisés dans les circuits professionnels et doivent être gérés directement par les entreprises, sous le contrôle des filières REP.
Le décret prévoit l'établissement obligatoire de systèmes de dépôt, restitution et retour (SDDR) pour certains types d'emballages. L'article 46 impose ce système pour les emballages réutilisables, garantissant leur récupération et leur remise en circulation. L'article 47 l'étend à certains emballages plastiques à usage unique, notamment les bouteilles de boissons, avec des objectifs de collecte séparée progressive allant jusqu'à 90 % en 2029. L'article 48 permet aux producteurs d'établir un SDDR volontaire pour d'autres types d'emballages afin d'améliorer leur récupération.
Le décret met également en place un registre des producteurs (articles 14 et 15), auquel toute entreprise mettant des emballages sur le marché doit s'inscrire. Ce registre vise à améliorer la transparence des flux d'emballages et à garantir la traçabilité des obligations des producteurs. L'article 16 précise que les producteurs doivent transmettre annuellement des données sur la quantité et la nature des emballages mis sur le marché et collectés en fin de vie.
Un dispositif de contrôle et de sanction est détaillé dans le titre IV. L'article 52 prévoit des inspections effectuées par les autorités compétentes (cf. infra) pour vérifier le respect des obligations des producteurs et des filières REP. L'article 54 établit un régime de sanctions avec des amendes proportionnelles à la gravité des infractions. Le non-respect des obligations de financement, la non-inscription au registre des producteurs ou l'absence de mise en place d'un système REP peuvent entraîner la suspension de l'activité ou des sanctions financières significatives.
La gestion de la REP repose sur deux types de structures, les SCRAP (voir supra) et les systèmes individuels de responsabilité élargie du producteur (Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor - SIRAP), où l'entreprise s'occupe elle-même du traitement de ses emballages en fin de vie. La majorité des producteurs optent pour l'adhésion à un SCRAP, qui leur permet de mutualiser les coûts et les obligations.
Les producteurs sont tenus de s'inscrire et d'adhérer à un SCRAP ou à un SIRAP avant le 31 décembre 2024, de contribuer financièrement, par le versement d'une éco-contribution proportionnelle aux quantités d'emballages mis sur le marché. Cette contribution sert à financer l'ensemble des coûts liés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets d'emballages et de soumettre un rapport annuel détaillant les volumes d'emballages commercialisés et les taux de recyclage obtenus.
Les producteurs étrangers qui commercialisent des produits emballés en Espagne sont également soumis à cette obligation. Ceux qui ne disposent pas d'un établissement dans le pays doivent désigner un représentant autorisé afin d'assurer leur mise en conformité avec la réglementation. En l'absence de cette désignation, la responsabilité incombe au premier distributeur ou commerçant qui met ces produits en vente sur le marché espagnol. Cette exigence vise à garantir que tous les emballages mis en circulation soient couverts par un mécanisme de financement et de gestion des déchets, sans exception184(*).
Au total, il existe sept SCRAP compétents au sein de la filière des emballages, chacun spécialisé dans un type de matériau (cf. tableau supra).
4. Réflexions sur le développement et la gouvernance des régimes REP
Conformément à la loi de 2022 sur les déchets, les SCRAP doivent être constitués sous la forme d'entités juridiques à but non lucratif, au sens de la loi organique n° 1/2002 du 22 mars 2002 relative au droit d'association, ou sous toute autre forme juridique sans but lucratif respectant la réglementation applicable (article 50.1).
L'adhésion des producteurs à un SCRAP doit être ouverte et fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires (article 50.1.a). Les producteurs doivent pouvoir changer de système chaque année, soit en rejoignant un autre SCRAP, soit en mettant en place un système individuel (article 50.1.b).
La gouvernance des SCRAP repose sur la prise de décision par les producteurs membres, sur la base de critères objectifs. Des organes exécutifs peuvent être constitués, mais ceux-ci doivent être élus par l'ensemble des membres et respecter les décisions collectives prises par les producteurs (article 50.1.c).
Les SCRAP doivent assurer la transparence de leur fonctionnement en rendant publiques des informations sur leur structure juridique, les règles d'adhésion et de sortie des producteurs, les contributions financières, ainsi que les critères de sélection des prestataires de gestion des déchets (article 47).
Chaque SCRAP doit mettre en place des mécanismes d'autocontrôle, notamment via des audits indépendants, portant sur la gestion financière et la véracité des données transmises aux autorités (article 46).
Enfin, les SCRAP sont soumis à un suivi régulier et doivent transmettre aux autorités compétentes des rapports détaillés sur leurs activités, leur impact environnemental et le niveau d'atteinte des objectifs fixés en matière de gestion des déchets (article 46). En cas de non-respect des obligations légales, des sanctions peuvent être appliquées, incluant des pénalités financières, ainsi que la suspension ou la révocation de l'autorisation du SCRAP (article 46).
Les recherches n'ont pas permis d'identifier des éléments dans le débat public espagnol sur la gouvernance des SCRAP ou bien sur la transparence de ces filières.
5. La surveillance des régimes REP
Les SCRAP sont soumis à une surveillance et un contrôle assurés par plusieurs autorités compétentes. La loi de 2022 précise que ces systèmes doivent faire l'objet d'inspections périodiques et de mesures de suivi pour garantir leur conformité aux obligations légales.
Le ministère pour la transition écologique et le défi démographique joue un rôle de supervision générale. Ses services sont chargés de compiler et transmettre les informations pertinentes à la Commission européenne (article 66). Toutefois, ce sont les communautés autonomes qui exercent les fonctions d'autorisation, de surveillance, d'inspection et de sanction des activités des SCRAP sur leur territoire (article 106.4).
Les SCRAP sont soumis à des inspections régulières effectuées par les autorités compétentes (article 106.1). Ces inspections peuvent être déclenchées à tout moment afin de vérifier la conformité des autorisations et des activités déclarées. En cas de non-respect des obligations, la loi prévoit la suspension ou la révocation de l'autorisation du SCRAP et, si nécessaire, l'arrêt temporaire ou définitif de ses activités (article 106.2).
Afin de garantir une surveillance efficace, les autorités compétentes doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires, y compris des laboratoires de référence pour l'analyse et la caractérisation des déchets (article 106.2). Elles peuvent également s'appuyer sur des entités collaboratrices reconnues, la responsabilité finale incombant toujours à l'administration publique (article 106.3).
La prise d'échantillons et les analyses des déchets sont réglementées par des procédures détaillées à l'annexe XVI, qui impose notamment des conditions strictes pour la conservation et l'étiquetage des échantillons, ainsi que pour la documentation des résultats.
En cas d'infractions, des sanctions administratives peuvent être appliquées aux SCRAP, conformément au régime de sanctions prévu par la loi. Les infractions sont classées en différentes catégories (graves ou très graves) et peuvent entraîner des amendes, voire la publication des sanctions dans les médias si l'intérêt public le justifie (article 118).
Enfin, un système électronique d'information sur les déchets185(*) (e-SIR) a été mis en place par le ministère pour la transition écologique. Ce système regroupe les registres et bases de données nécessaires pour assurer le suivi et le contrôle de la gestion des déchets et des sols contaminés en Espagne (article 66).
E. ITALIE
Le décret législatif 152 du 3 avril 2006 portant « normes en matière environnementale », tel que modifié en 2020, définit les régimes de responsabilité élargie du producteur (regimi di responsabilità estesa del produttore) comme un ensemble de mesures visant à garantir que les fabricants assument la responsabilité financière, voire organisationnelle, de la gestion du cycle de vie de leurs produits.
Le système italien comprend huit régimes REP opérationnels, dont quatre correspondant à des obligations du droit de l'UE et quatre autres à des obligations légales nationales (huiles minérales, huiles et graisses végétales et animales, produits en polyéthylène et pneus). Deux autres filières sont en cours de développement (plastiques à usage unique et textile).
Créé en 2014, le régime de REP des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) repose sur 15 consortiums privés (systèmes collectifs rassemblant les producteurs - équivalents des éco-organismes français) qui participent à un centre de coordination chargé de certifier les installations de traitement. La collecte est principalement assurée par les communes et les revendeurs d'EEE. Un accord de programme est conclu tous les trois ans entre les producteurs, les entreprises de collecte, l'association nationale des communes italiennes et le centre de coordination pour définir les modalités de collecte.
1. Le cadre juridique général
L'Italie a commencé à développer les régimes de responsabilité élargie du producteur (regimi di responsabilità estesa del produttore, REP) dans les années 1990, en commençant par les emballages avec la création du consortium CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)186(*). Celui-ci a été créé par le décret législatif du 5 février 1997 dit « décret Ronchi »187(*) qui a transposé la directive européenne 94/62/CE sur les emballages.
En 2020, le pays a réformé le régime juridique des REP afin d'en améliorer l'efficacité et de transposer le paquet « économie circulaire », notamment la directive 2018/851/UE. En particulier, le décret législatif 116/2020188(*) est venu modifier le décret législatif 152 du 3 avril 2006 portant « normes en matière environnementale »189(*) afin d'introduire une nouvelle définition de la REP ainsi que des exigences minimales en la matière. Un régime de REP est ainsi défini comme un ensemble de « mesures visant à garantir que les fabricants de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase du cycle de vie au cours de laquelle le produit devient un déchet » (article 183, 1, g bis DL 152/2006)190(*).
Plus précisément, le décret législatif 152/2006 modifié prévoit :
- la possibilité de créer des régimes de REP par décret du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'économie191(*) afin de renforcer la réutilisation, la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets. Ces décrets doivent définir les exigences propres à chaque régime et les mesures prévues (article 178 bis, paragraphe 1) ;
- que les régimes de REP établis par décret « prévoient des mesures appropriées pour encourager la conception de produits et de composants visant à réduire leurs incidences sur l'environnement et la production de déchets [...] et à garantir que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets s'effectuent conformément aux critères de priorité énoncés à l'article 179 [hiérarchie des modes de traitement des déchets]. Ces mesures encouragent, entre autres, le développement, la production et la commercialisation de produits et de composants qui se prêtent à un usage multiple, contiennent des matériaux recyclés, sont techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, sont aptes à être préparés en vue du réemploi et recyclés, afin de promouvoir la mise en oeuvre correcte de la hiérarchie des déchets. Les mesures tiennent compte de l'impact de l'ensemble du cycle de vie des produits, de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, du potentiel de recyclage multiple » (article 178 bis, paragraphe 3) ;
- que les décrets instituant les REP « tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique ainsi que des incidences globales sur la santé, l'environnement et la société, en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ; réglementent les modalités possibles de réutilisation des produits ainsi que la gestion des déchets qui en résultent et prévoient l'obligation de mettre à la disposition du public des informations sur les modalités de réutilisation et de recyclage et incluent des obligations spécifiques pour les adhérents au système » (article 178 bis, paragraphe 4) ;
Selon l'article 178 ter du décret législatif 152/2006, les régimes de REP doivent a minima respecter les conditions suivantes :
- définir les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés intervenant dans les différentes chaînes d'approvisionnement, y compris les producteurs, les organisations de producteurs mettant en oeuvre la REP, les gestionnaires publics ou privés de déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les opérateurs de réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
- définir les objectifs de gestion des déchets visant à atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents prévus par le droit européen ;
- adopter un système de communication d'informations sur les produits mis sur le marché et de transmission de données sur la collecte et le traitement des déchets résultant de ces produits ;
- veiller à ce que les fabricants de produits s'assurent que les utilisateurs et les détenteurs de déchets couverts par des régimes de REP sont correctement informés des mesures de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte et des éventuelles mesures incitatives.
Aux termes de ce même article, ils doivent également garantir une couverture géographique suffisante du réseau de collecte (sans la limiter aux zones les plus rentables), des moyens financiers et organisationnels appropriés pour satisfaire aux obligations découlant de la REP, des mécanismes d'autocontrôle adéquats, étayés par des audits indépendants réguliers afin d'évaluer leur gestion financière et la qualité des données collectées et, dans les cas où la REP est exercée par des structures collectives (consortiums, équivalents des éco-organismes français), la publication d'informations sur la propriété et l'adhésion au consortium, les contributions financières versées par les producteurs et la procédure de sélection des gestionnaires de déchets.
Au titre de la REP, les producteurs doivent verser une contribution financière permettant de couvrir les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport ultérieur, du tri et du traitement nécessaires pour atteindre les objectifs européens ou nationaux (en tenant compte des recettes provenant de la réutilisation ou de la vente de déchets et des matières premières secondaires) et d'information des consommateurs. Si possible, en cas d'exécution collective des obligations du régime REP, la contribution financière est modulée pour tenir compte de la durabilité des produits, de leur recyclabilité et de la présence de substances dangereuses. La contribution financière ne doit toutefois pas excéder « les coûts nécessaires pour fournir des services de gestion des déchets d'une manière rentable » (article 178 ter, paragraphe 3). Lorsqu'il est nécessaire d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique d'une filière REP, il peut être dérogé au principe de couverture financière intégrale du coût des mesures par les producteurs, après autorisation du ministre compétent et sous certaines conditions (par exemple, dans le cas des régimes de REP mis en place par des directives européennes, les producteurs doivent supporter au moins 80 % du coût des mesures nécessaires). Par ailleurs, aucune dérogation n'est possible pour les filières REP européennes créées avant 2018 (article 178 ter, paragraphe 4).
De plus, l'article 178 ter du décret législatif 152/2006 confie au ministère de l'environnement des missions de surveillance et de contrôle du respect des obligations des régimes REP (cf. infra).
Les règles et obligations propres à chaque régime de REP sont prévues par des textes législatifs et/ou réglementaires spécifiques (cf. tableau infra).
2. Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
Aujourd'hui, le système italien comprend huit régimes REP opérationnels, dont quatre correspondant à des obligations du droit de l'UE (emballages, DEEE, piles et accumulateurs et véhicules hors d'usage) et quatre autres à des obligations légales nationales (huiles minérales, huiles et graisses végétales et animales et produits en polyéthylène).
La stratégie nationale pour l'économie circulaire192(*), adoptée en 2022, cite en outre le développement de nouvelles formes de REP prioritairement dans les deux filières suivantes :
- le plastique : il s'agit principalement de mettre en oeuvre les obligations de la directive 904/2019/UE sur les plastiques à usage unique afin de couvrir les coûts d'enlèvement de ces déchets et de limiter la présence de déchets sauvages de ce type dans l'environnement. Selon l'article 8 du décret législatif du 8 novembre 2021193(*), au plus tard le 31 décembre 2024, les déchets de produits en plastique à usage unique doivent être pris en charge dans le cadre du régime REP des emballages ou d'un ou plusieurs régimes spécifiques à mettre en place. Les producteurs devront mettre en oeuvre leurs obligations en adhérant à un système collectif de gestion et de traitement ;
- et le textile : l'article 3 du décret législatif 116/2020 a introduit l'obligation de collecte séparée des déchets textiles par les communes depuis le 1er janvier 2022. En préparation de la future filière REP, le plan national de relance et de résilience a prévu 150 millions d'euros d'investissements dans des « hubs textiles » innovants afin d'améliorer les systèmes de recyclage194(*).
Le modèle italien de REP repose principalement sur des systèmes collectifs (sistemi collettivi, équivalents des éco-organismes) chargés de mettre en oeuvre les obligations liées à la REP pour le compte des producteurs. Ils ont généralement le statut de « consortium » au sens des articles 2602 et suivants du code civil italien195(*), une personnalité juridique autonome de droit privé, sont sans but lucratif et fonctionnent sous la tutelle du ministère de l'environnement qui approuve leur statut. Il existe également dans certaines filières des systèmes autonomes dans le cadre desquels des producteurs organisent eux-mêmes la gestion de leurs déchets. Dans certaines filières (DEEE, piles et accumulateurs notamment), des centres de coordination sont chargés d'optimiser la collecte et de s'assurer de l'homogénéité du fonctionnement des différents systèmes collectifs et/ou individuels.
Malgré des disparités régionales importantes entre le Nord et le Sud du pays en termes d'infrastructures, l'Italie présente des résultats globalement satisfaisants, particulièrement dans le secteur des emballages où les statistiques officielles de taux de recyclage dépassent les objectifs européens (cf. tableau de synthèse supra). Néanmoins, ces chiffres sont contestés par certains acteurs associatifs ou sectoriels qui mettent en cause la méthodologie de comptabilisation du recyclage (prise en compte de déchets qui ne sont pas véritablement transformés en nouvelles matières premières mais envoyés dans des cimenteries ou des usines de valorisation énergétique) et exigent une certification indépendante des données196(*).
|
Régime |
Base juridique |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Eco-organisme(s) |
Financement |
|
DEEE |
À travers des systèmes collectifs ou individuels, mettre en place un système de collecte et de traitement. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre DEEE. |
Selon les catégories de DEEE, taux de collecte de 75 % à 80 % et taux de préparation pour la réutilisation et le recyclage entre 55 % et 70 %. |
15 systèmes collectifs participant au « Centro di coordinamento RAEE » |
Écocontribution payée par le consommateur lors de l'achat du produit, variable selon la catégorie de DEEE. |
|
|
Piles et accumulateurs |
Mettre en place un système de collecte séparée et des systèmes de traitement et de recyclage des déchets de piles et accumulateurs. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre piles et accumulateurs. |
Taux minimal de collecte de 45 % de la quantité mise sur le marché. |
14 systèmes collectifs et 2 systèmes autonomes participant au Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori. |
Écocontribution payée par les producteurs, variable selon le type de produit et le poids. |
|
|
Emballages |
Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (articles 217 et suivants) |
Adopter un système de consigne, de réutilisation et de recyclage des emballages. |
Recyclage d'au moins 65 % du poids de tous les déchets d'emballages d'ici fin 2025 et 70 % d'ici fin 2030 (avec une déclinaison par types de matériaux). |
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) rassemblant des systèmes collectifs pour chaque type de flux d'emballage et 4 systèmes autonomes. |
Écocontribution payée par les producteurs aux systèmes, modulée pour les plastiques depuis 2018. |
|
Gérer chaque année un poids de pneus usagés égal au poids de pneus mis sur le marché. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre pneus. |
Cibles de collecte annuelles. |
Une vingtaine de systèmes dont une majorité de systèmes individuels. |
Écocontribution payée in fine par le consommateur. |
||
|
Véhicules hors d'usage |
Mettre en place des centres de collecte et de traitement des véhicules selon le principe de la responsabilité « partagée » impliquant producteurs et concessionnaires. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre VHU (depuis 2024). |
Pas d'objectif chiffré cité dans le décret législatif 209/2003. |
Divers systèmes individuels et collectifs. |
? |
|
|
Décret législatif 27 janvier 1992, n. 95 Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 236) |
Assurer et encourager la collecte des huiles usagées en les reprenant auprès des détenteurs et des entreprises agréées. Trier les huiles usagées collectées en vue de leur élimination appropriée par régénération, combustion ou élimination |
- |
Adhésion obligatoire au Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati |
Écocontribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
|
|
Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 233) |
Assurer la collecte, le transport, le stockage, le traitement, la valorisation, le recyclage ou l'élimination des huiles et graisses végétales et animales usagées. Assurer l'élimination des huiles et graisses végétales et animales usagées collectées pour lesquelles la régénération n'est pas possible ou pratique, conformément à la réglementation en vigueur en matière de pollution. |
- |
Adhésion obligatoire au Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti |
Écocontribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
|
|
Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 234) |
Encourager la reprise des biens à base de polyéthylène à la fin de leur vie utile afin de les envoyer au recyclage et à la valorisation. Assurer l'élimination des déchets de polyéthylène dans les cas où le recyclage n'est pas possible ou économiquement viable. |
Objectifs chiffrés fixés tous les deux ans par le ministre de l'environnement. |
Adhésion obligatoire au Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene |
Écocontribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
|
|
Régime en cours de développement |
- |
- |
- |
La gouvernance du Consortium national des emballages (CONAI)
Opérateur historique en matière de REP, le CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) joue un rôle important en matière d'organisation et de coordination de la filière des déchets d'emballages et a une gouvernance spécifique par rapport aux consortiums et centres de coordination des autres filières.
En vertu de son statut et de son règlement, le CONAI dispose d'une assemblée des membres, d'un conseil d'administration, d'un président et de deux vice-présidents, ainsi que d'un collège des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est composé de dix-neuf membres dont neuf appartenant à la catégorie des producteurs, neuf à celle des utilisateurs (commerçants et distributeurs) et un membre nommé par les ministres de l'environnement et du développement économique chargé de représenter les consommateurs197(*).
3. La filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Le régime de responsabilité élargie du producteur des DEEE a été introduit en 2014 par le décret législatif 49/2014198(*). Il repose sur un modèle « multi-consortium » - c'est-à-dire qu'il existe différents systèmes collectifs -et implique différents types d'acteurs. Les DEEE, domestiques ou professionnels, sont répartis en cinq grandes catégories, selon leurs technologies. Chaque type de DEEE est recyclé et éliminé selon des modalités spécifiques.
Les consommateurs doivent trier séparément les équipements électriques et électroniques (EEE) qui ne fonctionnent plus ou dont ils souhaitent se débarrasser en les remettant gratuitement au centre de collecte de leur commune ou en les rapportant à un revendeur d'EEE199(*). L'article 11 du décret législatif 49/2014 prévoit deux modes de collecte :
- la reprise « 1 contre 1 » consiste à remettre ses DEEE au revendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Il concerne également les achats en ligne ;
- la reprise « 1 pour 0 » consiste en la remise de ses DEEE de moins de 25 cm dans les points de vente ayant des surfaces dédiées à la vente d'EEE supérieures à 400 m2. Le service est facultatif pour les points de vente dont la surface est plus petite.
Les revendeurs peuvent traiter les DEEE rapportés par les consommateurs soit en les apportant aux points de collecte municipaux, soit en mettant en place leurs propres sites de collecte. Outre les revendeurs d'EEE, deux autres types d'acteurs peuvent mettre en place des sites de collecte : les installateurs d'EEE et les « grands utilisateurs » d'EEE (par exemple, les aéroports, les hôpitaux ou les casernes) pour ce qui concerne leurs appareils d'éclairage200(*).
Les systèmes collectifs s'occupent du ramassage des DEEE récupérés dans les points de collecte et de leur transport vers des installations de traitement spécialisées certifiées par le centre de coordination des DEEE (Centro du coordinamento créé par l'article 33 du DL 49/2014). Les systèmes collectifs peuvent aussi mettre en place leurs propres points de collecte, appelés points de collecte privés201(*). Il existe actuellement 15 systèmes collectifs (14 pour les DEEE domestiques et 1 pour les DEEE professionnels)202(*). Le centre de coordination a comme les systèmes collectifs, le statut de consortium et est donc une entité de droit privé. Il est composé de tous les systèmes collectifs de gestion des DEEE provenant des ménages, et de deux membres désignés respectivement par le ministère de l'environnement et le ministère du développement économique.
En application de l'article 12 du décret législatif 49/2014, les communes doivent veiller à l'accessibilité, à la fonctionnalité et à l'adéquation des centres de collecte avec la densité de population. Les points de collecte municipaux peuvent être gérés directement par les communes ou bien leur gestion est déléguée à des entreprises203(*).
Tous les trois ans, les associations professionnelles représentant les producteurs, celles représentant les entreprises de collecte, l'Association nationale des communes italiennes (ANCI) et le Centre de coordination concluent un accord de programme204(*) régissant les modalités et le calendrier de collecte des DEEE ainsi que les exigences minimales que doivent remplir les points de collecte (article 15 DL 49/2015).
Le financement de la collecte, du transport, du traitement, de la valorisation et de l'élimination des DEEE domestiques est supporté par les producteurs présents sur le marché, proportionnellement à leur part de marché respective, calculée sur la base du poids des EEE mis sur le marché au cours de l'année civile (article 23 DL 49/2016).
Les points de collecte municipaux bénéficient des ressources économiques mises à disposition par les producteurs d'EEE dans le cadre de programmes de mise en conformité. Ces contributions, appelées primes d'efficacité, sont attribuées aux points de collecte qui respectent les exigences minimales définies dans l'accord de programme. Les producteurs d'EEE ont également constitué des fonds pour augmenter la qualité du système de collecte des déchets, qui sont attribués par des appels d'offres spécifiques (« fonds pour les tonnes attribuées » destiné aux infrastructures, au développement et à l'adaptation des points de collecte ; fonds de communication locale destiné à la réalisation de projets de communication locale pour stimuler la collecte des DEEE et fonds de micro-collecte des DEEE)205(*).
4. La surveillance des régimes REP
L'article 178 ter, paragraphe 6, du décret législatif 152/2006 confie au ministère de l'environnement des missions de surveillance et de contrôle des régimes REP. Le ministère est notamment responsable de la tenue du registre national des producteurs206(*) auquel tous les producteurs soumis à un régime de REP sont tenus de s'inscrire. Il doit également analyser les rapports financiers des systèmes collectifs, les modalités de détermination des écocontributions et la réalisation des objectifs fixés dans les conventions conclues par les systèmes collectifs ou autonomes.
Le registre national des producteurs, opérationnel depuis 2024, vise à donner au ministère les capacités de traitement et d'analyse des données nécessaires pour contrôler les objectifs quantitatifs des différents secteurs, à fiabiliser la qualité des informations recueillies et à permettre des contrôles plus efficaces207(*).
En outre, s'agissant de la filière emballages, un conseil de surveillance spécifique a été mis en place en 2024 afin de mieux contrôler le fonctionnement des systèmes collectifs et autonomes de gestion des déchets dans cette filière208(*). Le conseil de surveillance des consortiums et systèmes autonomes de gestion des déchets, des emballages et des déchets d'emballage vise notamment à garantir l'utilisation correcte de l'éco-contribution pour la gestion des déchets sur l'ensemble du territoire et prévenir les situations de marché discriminatoires et les distorsions de concurrence, améliorer l'efficacité et l'efficience des consortiums et des systèmes autonomes grâce à la réalisation d'examens périodiques des chaînes de production et à la formulation de propositions techniques et réglementaires aux ministères compétents, soutenir le ministère de l'environnement dans son activité de surveillance et assurer la conformité des statuts des systèmes collectifs ou autonomes aux exigences de la REP définies par le décret législatif 152/2006.
Ce conseil de surveillance est composé de deux représentants du ministère de l'environnement (dont l'un exerce la fonction de président), deux représentants du ministère du développement économique, d'un représentant de l'autorité de la concurrence, d'un représentant de l'autorité de régulation des réseaux énergétiques et de l'environnement et d'un représentant de l'association nationale des communes italiennes (ANCI).
F. PAYS-BAS
La loi sur la gestion de l'environnement définit un régime de responsabilité élargie des producteurs (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, UPV) comme un ensemble de règles garantissant que la personne qui met des produits sur le marché assume tout ou partie de la responsabilité financière ou organisationnelle de la gestion des déchets résiduels de ces produits et autorise le gouvernement à créer par voie réglementaire des filières REP. Un régime de REP peut également être créé de façon volontaire par des producteurs puis rendu obligatoire par une « déclaration universellement contraignante » (algemeen verbindend verklaring, AVV) du ministre compétent, à la demande d'une majorité significative de producteurs.
Les Pays-Bas comptent dix régimes de REP, dont sept issus du droit de l'UE ou du droit national (piles et accumulateurs, VHU, pneus, DEEE, emballages, et, depuis 2023, plastiques à usage unique et textile) et trois autres (papier et carton, verre à vitre et matelas) issus d'un accord volontaire entre producteurs, rendu universellement applicable (AVV).
La filière des déchets de papier et de carton (hors emballages) repose sur les communes, qui assurent la collecte séparée à la source, l'organisation de producteurs Papier Recycling Nederland et le Fonds d'élimination des déchets, organe indépendant chargé de compenser les éventuels déficits des communes grâce à un prix d'achat garanti.
À la suite de diverses critiques concernant les régimes de REP (manque de clarté dans la répartition des responsabilités entre communes et organisations de producteurs, pouvoir de marché trop important des organisations de producteurs), des consultations ont été engagées par le gouvernement néerlandais en 2022-2023 mais celles-ci ne se sont, à ce jour, pas concrétisées.
1. Le cadre juridique général
En 2023, le gouvernement néerlandais a adopté un programme national pour l'économie circulaire couvrant la période 2023-2030209(*). Celui-ci fixe l'objectif de mettre en place une économie circulaire aux Pays-Bas d'ici 2050 et de réduire de 50 % d'ici 2030 l'utilisation de certaines matières premières (métaux, minéraux et ressources fossiles).
Au niveau législatif, la mise en oeuvre de ce programme repose principalement sur le chapitre 10 de la loi sur la gestion de l'environnement210(*) relatif aux déchets. L'article 10.3 de cette loi prévoit l'adoption d'un plan national de gestion des déchets tous les six ans. Fin 2025, le plan pour les matériaux circulaires (Circulaire Materialenplan, CMP)211(*) entrera en vigueur et succédera au troisième plan national de gestion des déchets (LAP3). Au lieu de se concentrer uniquement sur les déchets, ce plan est davantage axé sur l'ensemble de la chaîne de vie des matériaux, de la conception à la transformation et à la réutilisation. Il met en place des plans de chaîne de vie des matériaux (keten- en afvalplannen) concernant 60 matériaux spécifiques et une obligation d'information des autorités compétentes (selon les cas, les conseils municipaux, conseils provinciaux ou l'agence de l'État responsable des infrastructures (Rijkswaterstaat)) au ministère de l'infrastructure et de l'environnement si elles s'éloignent des prescriptions du CMP. Le CMP définit également des normes minimales de traitement (minimumstandaards) qui encouragent les autorités compétentes à délivrer des autorisations privilégiant des techniques de traitement de haute qualité et à orienter vers le recyclage à haute valeur ajoutée212(*).
L'article 1.1 de la loi sur la gestion de l'environnement définit un régime de responsabilité élargie des producteurs (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, UPV) comme un ensemble de règles ou décisions garantissant que la personne qui met des substances, des mélanges ou des produits sur le marché assume tout ou partie de la responsabilité financière ou organisationnelle de la gestion des déchets résiduels de ces substances, mélanges ou produits et l'article 9.5.2. autorise le gouvernement à créer par voie réglementaire des filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Outre les filières REP imposées par le droit de l'UE ou la réglementation nationale, une filière REP peut également être créée par une « déclaration universellement contraignante » (algemeen verbindend verklaring, AVV). À la demande d'une majorité significative de producteurs, un accord privé concernant la mise en place d'une filière REP peut être déclaré universellement contraignant pour l'ensemble des producteurs par le ministre des infrastructures et de l'environnement213(*).
Le décret relatif à la responsabilité élargie du producteur214(*), adopté en 2020, transpose l'article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 en droit néerlandais. Il définit les obligations générales des producteurs, en présence d'un régime REP légal. Ces obligations comprennent, par exemple, la mise en place d'un système de collecte « approprié » disponible tout au long de l'année, la présentation d'un rapport annuel ou encore le fait de disposer des ressources financières et/ou organisationnelles nécessaires215(*).
Les règles et obligations propres à chaque filière REP sont définies plus précisément par des décrets sur les produits (productbesluiten) et des règlements ministériels (ministeriële regelingen). Les décrets sur les produits contiennent des obligations REP qui s'ajoutent à la réglementation européenne ou au décret sur la responsabilité élargie des producteurs et fixent des objectifs minimaux pour les producteurs. Les règlements ministériels viennent préciser ces obligations216(*).
2. Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
Il existe actuellement dix filières REP aux Pays-Bas217(*), sept d'entre elles sont des filières dites « légales » prévues par le droit de l'UE et/ou le droit national et trois autres (papier et carton, verre à vitre et matelas) sont issues d'un accord volontaire entre producteurs, rendu universellement applicable (AVV).
La première filière REP a été créée en 1995, pour les piles et accumulateurs. Les deux dernières à être entrées en vigueur, en 2023, concernent certains déchets plastiques à usage unique (emballages, ballons de baudruche, lingettes humides, filtres de cigarettes et, depuis le 31 décembre 2024, les articles de pêche contenant du plastique) et les textiles d'habillement et de maison.
La définition du producteur varie d'une filière à l'autre mais, en règle générale, le producteur est celui qui met le produit sur le marché pour la première fois. Il peut donc s'agir des importateurs basés aux Pays-Bas, des fabricants établis aux Pays-Bas ou encore des fournisseurs étrangers en ligne qui proposent eux-mêmes un produit aux utilisateurs finaux aux Pays-Bas, sans l'intervention d'un importateur218(*). Un régime de REP peut également imposer des obligations à d'autres acteurs de la chaîne de production comme par exemple les détaillants, les collecteurs, les entreprises de traitements des déchets ou les plateformes en ligne219(*).
Les producteurs peuvent remplir leurs obligations en adhérant à une organisation de producteurs (producentenorganisatie - équivalent des éco-organismes français) ou en en créant une eux-mêmes, chargée de mettre en oeuvre les obligations prévues en contrepartie du versement d'une écocontribution220(*). Les organisations de producteurs ont généralement le statut de fondation (stichting) qui correspond en droit néerlandais à des entités de droit privé à but non lucratif221(*).
Pour certaines filières, l'adhésion à une organisation de producteurs unique est obligatoire (en vertu d'un accord AVV). C'est le cas notamment pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les emballages ainsi que le papier et le carton.
|
Filière |
Base juridique et année de création |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Eco-organismes |
Financement |
|||
|
Filières REP « légales » |
||||||||
|
Piles et accumulateurs222(*) |
Regeling beheer batterijen en accu's (2008) Année de création : 1995 |
Mettre en place une structure de collecte et de traitement. Déclarer chaque année le nombre de piles et accumulateurs neufs mis sur le marché et le nombre de ceux collectés et recyclés. |
Taux de collecte minimal de 45 % d'ici fin 2023, 63 % fin 2027 et 73 % fin 2030 (règlement UE 2023/1542) |
Stichting Open (batteries portables) Stichting EPAC (batteries de vélos) ARN (batteries de voiture) |
Écocontribution payée par le producteur à l'éco-organisme dont le montant varie en fonction du type et du poids de la batterie. |
|||
|
Véhicules hors d'usage (VHU)223(*) |
Besluit beheer autowrakken (2024) AVV auto's (en vigueur jusque fin 2025) Année de création : 2002 |
Notifier le type et le nombre de voitures. Pour les fabricants basés aux PB : mesures de prévention concernant l'utilisation de substances dangereuses, matériaux recyclés. Mettre en place un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Au moins 95 % du poids des voitures mises sur le marché préparées en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage. Au moins 85 % du poids des voitures mises sur le marché recyclées. |
Stichting Auto & Recycling (appartient à ARN, Auto Recycling Nederland). |
Écocontribution payée par le producteur à l'éco-organisme fixée à 25 euros par véhicule depuis 2022. |
|||
|
Pneus de voiture224(*) |
Besluit beheer autobanden (2024) AVV autobanden (en vigueur jusque fin 2027) Date de création : 2004 |
Notifier le type et le nombre de pneus mis sur le marché. Mettre en place un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Collecte : au moins une quantité de pneus égale à la part moyenne du producteur en pourcentage du marché néerlandais des pneus de voiture neufs au cours des trois années civiles précédentes. Réutilisation et recyclage : pour le producteur, au moins 20 % du poids des pneus mis sur le marché recyclés et pour l'éco-organisme, 90 % des pneus réutilisés et 60 % recyclés. |
RecyBEM |
Écocontribution de 1,70 euro par pneu vendu payée par le producteur à l'éco-organisme (2025). |
|||
|
DEEE225(*) |
Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur AVV elektrische en elektronische apparaten (en vigueur jusque fin 2025) Date de création : 2014 |
S'enregistrer (via l'éco-organisme) au registre national DEEE. Garantir la disponibilité d'un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Au moins 65 % du poids moyen des DEEE mis sur le marché néerlandais au cours des trois dernières années collectés et traités pour le compte de chaque producteur ou importateur. Au moins 85 % du poids des DEEE produits par une entreprise aux Pays-Bas au cours de l'année concernée collectés et traités en son nom. |
Stichting Open |
Écocontribution payée par le producteur à l'éco-organisme dont le montant varie en fonction du type d'appareil et du poids. |
|||
|
Emballages (de vente, collectifs et d'expédition)226(*) |
Besluit beheer verpakkingen 2014
AVV
verpakkingen Date de création : 1997 |
Notifier le type et le nombre de colis mis sur le marché (exemption en deçà de 50 000 kg d'emballages). Mettre en place un système de collecte et de dépôt « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. Consigne obligatoire pour les bouteilles
métalliques et en plastique pour l'eau ou les boissons non
alcoolisées de 3 litres maximum |
Objectif global : 74 % du poids de tous les emballages mis sur le marché recyclés ou réutilisés en 2025. De plus, objectifs annuels variables selon la matière de l'emballage. |
Verpact. |
Écocontribution payée par le producteur à l'éco-organisme dont le montant varie en fonction de la facilité de recyclage du matériau d'emballage |
|||
|
Plastiques à usage unique (emballages plastiques jetables + ballons, filtres cigarettes, lingettes, matériel de pêche)227(*) |
Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik228(*) Regeling uitgebreide producentverantwoordelijkheid vistuig Date de création : 2023 |
Notifier le type et le nombre de produits mis sur le marché. Payer une contribution (montant fixe pour chaque produit commercialisé) afin de compenser les coûts supportés pour les gestionnaires de déchets (premier paiement en 2024). Élaborer tous les trois ans un plan de sensibilisation des consommateurs. Pour le matériel de pêche : mise en place d'un système de collecte « approprié » et financement du transport et du traitement des déchets. |
Pas d'objectif minimal sauf pour les articles de pêche à partir de 2025 : 32 % du matériel de pêche mis sur le marché collectés, avec une hausse de 3 % chaque année. |
Verpact (emballages). Actuellement aucun éco-organisme pour les ballons de baudruche, lingettes humides, produits du tabac avec filtre et articles de pêche. |
Filière REP dite « financière » : éco-contribution payée par les producteurs aux pouvoirs publics. |
|||
|
Textile229(*) |
Ministeriële regeling UPV textiel Date de création : 2023 |
Notifier le type et la quantité de textiles mis sur le marché au cours des douze derniers mois. Mettre en place un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Collecte et préparation en vue de la réutilisation ou du recyclage : d'ici 2025, au moins 50 % du poids de textiles mis sur le marché l'année précédente. Hausse des objectifs chaque année jusqu'à 75 % en 2030. Objectif spécifique pour la réutilisation aux Pays-Bas : 10 % d'ici 2025 et de 15 % d'ici 2030. Objectif spécifique pour le recyclage fibre à fibre : 25 % d'ici 2025 et 33 % d'ici 2030. |
Stichting UPV Textiel European Recycling Platform Netherlands B.V. Collective Circular Textiles. |
Écocontribution payée par le producteur à l'éco-organisme selon des tarifs différents selon l'éco-organisme (en moyenne entre 0,12 et 0,20 euro par kg en 2025). |
|||
|
Filières REP « volontaires » (rendues obligatoires par un accord AVV) |
||||||||
|
Papier et carton230(*) |
AVV papier en karton (en vigueur jusque fin 2027). Date de création : 1997. |
Encourager les utilisateurs finaux et les municipalités à trier les déchets de papier et de carton à la source. Garantir la continuité de la collecte et du recyclage des vieux papiers et cartons au moyen de garanties financières et matérielles. |
Au moins 75 % de la quantité totale de papier ou de carton commercialisée aux Pays-Bas recyclée chaque année. |
Papier Recycling Nederland (PRN) |
Écocontribution payée par le producteur et reversée aux communes (3 euros pour 1 000 kg de papier ou carton neuf mis sur le marché en 2025). |
|||
|
Matelas231(*) |
AVV consumentenmatrassen (en vigueur jusque fin octobre 2026) Date de création : 2022 |
Notifier le type et la quantité de matelas mis sur le marché. Mettre en place un système de collecte. |
Au moins 1,2 million de matelas collectés d'ici 2028. Au moins 75 % des matelas mis sur le marché recyclés d'ici 2028. |
Stichting Matras Recycling Nederland (MRN). |
Écocontribution payée par le producteur à l'éco-organisme (7,5 euros pour un matelas double en 2025 ; exemption pour les producteurs produisant moins de 200 matelas par an). |
|||
|
Verre à vitre232(*) |
AVV vlakglas (en vigueur jusque fin 2027) Date de création : 2020 |
S'enregistrer auprès de l'éco-organisme. Mettre en place un réseau national de collecte séparé. |
Au moins 90 % des déchets de verre à vitre plat produits aux Pays-Bas collectés. Au moins 98 % du verre à vitre collecté par l'éco-organisme recyclé. |
Vlakglas Recycling Nederland (VRN) |
Écocontribution payée par le producteur à l'éco-organisme (0,40 euro par mètre carré). |
|||
3. La filière des déchets de papier et carton
La filière REP pour le papier et le carton a vu le jour en 1997 à l'initiative de producteurs, sous la forme d'un accord volontaire rendu ensuite universellement contraignant par le ministre en charge de l'environnement233(*).
L'accord sur la taxe de gestion des déchets pour le papier et le carton autres que les emballages234(*) (AVV) applicable pour la période 2023-2027 est le principal texte juridique régissant la filière. Il est complété par une convention entre l'organisation de producteurs Papier Recycling Nederland (PRN) et l'association des communes néerlandaises235(*).
La gestion de la filière repose sur deux organismes :
- l'organisation de producteurs PRN qui représente les producteurs et les importateurs de papier et de carton non destinés à l'emballage, les entreprises de papier de rebut, les papeteries et les transformateurs. Le conseil d'administration de PRN est formé de 19 représentants de ces parties et assisté par un bureau exécutif236(*) ;
- et le Fonds d'élimination des déchets (Stichting Verwijderingsfonds, SVF), organe indépendant de PRN, créé dans le but de gérer un fonds destiné à compenser les éventuels déficits des communes grâce à la redevance versée par les producteurs. Son conseil d'administration est composé de représentants des producteurs, importateurs, papeteries et autres et présidé par une personnalité indépendante237(*).
Selon l'accord AVV en vigueur, la filière REP papier et carton fonctionne de la façon suivante238(*) :
- les communes assurent la collecte séparée à la source des papiers et cartons auprès des ménages. Les associations, les organisations caritatives, les écoles et les églises jouent également un rôle important dans la collecte. Après la collecte, la commune ou un autre organisme de collecte transfère les déchets de papier et de carton à une entreprise de papier recyclé agréée. À partir de cette étape, le papier et le carton collectés relèvent de la responsabilité de l'organisation de producteurs PRN ;
- l'entreprise de recyclage paie à la commune un prix qui est convenu individuellement par contrat. Ce prix dépend des prix sur le marché international pour le papier et le carton usagés, des coûts encourus par l'entreprise de recyclage et du degré de contamination du papier et du carton usagés proposés. L'entreprise de traitement des déchets reçoit, pèse et nettoie les déchets de papier et de carton. Elle les trie en différentes qualités et les met en balles, puis les transforme en nouveaux papiers et cartons ;
- PRN garantit aux conseils municipaux des communes ayant adhéré volontairement à PRN que les déchets de papier et de carton collectés (hors emballages) seront achetés à toutes les conditions du marché. À cette fin, des accords ont été conclus avec l'industrie papetière garantissant qu'en période de prix durablement bas sur le marché international, elle achèterait les vieux papiers et cartons collectés. Cette garantie d'achat assure la poursuite du cycle de vie du papier239(*) ;
- cette garantie d'achat est complétée par un prix garanti. En cas de « déficit de la chaîne » (ketendeficit) - c'est-à-dire si le prix de marché du papier usagé est trop bas et ne couvre pas les coûts de la collecte et/ou de traitement - la différence entre le prix du marché et le prix garanti est payée par un fonds alimenté par les entreprises qui mettent sur le marché des produits en papier et en carton (autres que des emballages). Les communes peuvent compter sur un prix garanti pouvant aller jusqu'à 25 euros par tonne pour les déchets de papier et de carton (autres que des emballages). Le SVF est chargé de déterminer s'il existe un déficit de la chaîne et de gérer le fonds alimenté par la redevance.
En 2025, la redevance payée par les producteurs de papier et de carton est fixée à 3 euros par tonne, avec une réduction ponctuelle de 50 centimes d'euros en raison du résultat d'exploitation positif constaté par le SVF pour l'exercice 2023240(*).
Si un producteur ne respecte pas les obligations de déclaration et d'information concernant la quantité de papier et de carton mise sur le marché et/ou ne s'acquitte pas du paiement de la redevance, le SVF peut lui infliger une amende. Son montant est déterminé sur la base de la quantité estimée de papier et de carton qui aurait dû être déclarée241(*).
Selon PRN, le taux de recyclage de papier et de carton mis sur le marché, hors emballage, a atteint 82 % en 2023 aux Pays-Bas, soit un niveau supérieur à l'objectif de 75 % prévu dans l'accord242(*). La même année, PRN estime que plus de 87 % des nouveaux papiers et cartons fabriqués aux Pays-Bas avaient été fabriqués à partir de déchets de papier243(*).
En réaction à la consultation ouverte sur le projet de Plan pour les matériaux circulaires (CMP), l'éco-organisme PRN a défendu le maintien du tri à la source du papier et du carton et de la responsabilité des communes en matière de collecte. Le projet de CMP mentionne en effet le tri ex post, après la collecte, comme une solution pour renforcer l'économie circulaire244(*).
4. Réflexions sur le développement et la gouvernance des régimes REP
Les filières REP occupent une place croissante dans le système de traitement des déchets aux Pays-Bas, avec la création de quatre nouvelles filières depuis 2020 (verre à vitre, matelas, textile et plastiques à usage unique). Mais ces filières demeurent assez hétérogènes, à la fois en termes d'objectifs, de modes de collecte, d'acteurs impliqués et de financement.
À la demande de la chambre basse du Parlement néerlandais (Tweede Kamer), le ministère des infrastructures et de la gestion de l'eau a mené des consultations auprès des organisations de producteurs (éco-organismes), opérateurs de traitement des déchets, communes et organisations non gouvernementales en 2022 et 2023 sur deux sujets : d'une part, le rôle des communes dans les filières REP et, d'autre part, la possibilité de mettre en place des incitations plus fortes en faveur de l'économie circulaire dans les filières REP. Dans une lettre au Parlement en date du 16 octobre 2023245(*), le ministre des infrastructures et de la gestion de l'eau en fonction tirait les conclusions suivantes :
- s'agissant du rôle des communes dans les filières REP : en vertu de la loi sur la gestion de l'environnement, les communes sont responsables de la collecte des déchets ménagers et doivent collecter séparément certains flux de déchets, tels que le métal, le plastique, le verre, le papier et, depuis le 1er janvier 2025, le textile et les déchets dangereux. Les producteurs entrant dans le champ d'une filière REP sont donc souvent amenés à conclure des accords avec les communes pour utiliser leurs systèmes de collecte, puis leur verser une compensation financière (comme par exemple dans la filière papier et carton présentée supra). En pratique, il existe un certain flou dans la définition des responsabilités respectives des communes et des producteurs ainsi que des désaccords récurrents sur la qualité des déchets collectés ou les redevances - en particulier concernant les emballages en plastique, métal et les cartons pour boissons (PMD). Le ministre s'est ainsi engagé à clarifier la répartition juridique des responsabilités entre les producteurs et les communes et à faciliter le recours à la médiation ou à l'arbitrage en cas de litige ;
- s'agissant des organisations de producteurs, la mise en oeuvre de la REP par leur intermédiaire garantit une organisation efficace mais le corollaire est une concentration importante du pouvoir de marché et de l'influence en un seul point de la chaîne. Le ministère propose donc d'étudier l'introduction de nouvelles exigences vis-à-vis des organisations de producteurs notamment concernant la transparence sur les accords conclus entre les producteurs et les communes (par exemple, la publication obligatoire des études de coûts par les éco-organismes), l'introduction de contrôles externes sur les pourcentages de collecte et de recyclage déclarés, l'application du principe de différenciation tarifaire, un renforcement de la coopération entre les différents acteurs (par exemple, en obligeant les éco-organismes à organiser une consultation de l'ensemble des parties impliquées dans la filière REP au moins une fois par an), des exigences renforcées en matière de concurrence et, s'agissant des filières issues d'accords volontaires, une amélioration de leur gouvernance avec la participation de la puissance publique à la définition des objectifs ;
- s'agissant des mesures en faveur de l'économie circulaire, les pistes d'amélioration mentionnées sont l'introduction d'objectifs en matière de réutilisation, réparation, prévention et d'utilisation des matériaux recyclés dans les filières REP « légales » et la poursuite de la différenciation tarifaire des écocontributions.
Les recherches n'ont pas identifié de suite législative ou réglementaire donnée à ces propositions à ce jour246(*).
5. La surveillance des régimes REP
Les producteurs ou importateurs couverts par une filière REP légale doivent informer chaque année l'agence de l'État en charge des infrastructures publiques (Rijkswaterstaat) de la quantité de produits vendus et de la quantité de déchets collectés. Si les producteurs appartiennent à une organisation de producteurs, cette obligation de notification est effectuée par celle-ci. Le Rijkswaterstaat examine le rapport, demande parfois des informations supplémentaires et informe le ministre responsable des résultats de la filière REP247(*).
Certaines organisations de producteurs peuvent elles-mêmes procéder à des contrôles et audits auprès des producteurs, voire prononcer une amende envers les producteurs qui ne respectent pas leurs obligations de déclaration et de paiement de l'éco-contribution (voir supra, l'exemple de la filière papier et carton).
De plus, l'inspection de l'environnement et des transports (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) est chargée de la surveillance et du contrôle des filières REP au niveau national248(*). L'ILT peut prendre des mesures à l'encontre des producteurs qui, à tort, ne participent pas à la filière REP ou n'ont pas adhéré à l'organisation de producteurs obligatoire. L'ILT peut également prendre des mesures si les producteurs ou leurs organisations ne fournissent pas suffisamment d'informations ou ne respectent pas correctement les règles propres à chaque filière. L'ILT examine également la fiabilité des rapports annuels des éco-organismes. L'ILT « choisit les mesures à prendre en fonction des risques et de ce qui n'a pas fonctionné »249(*).
Par exemple, en 2024, l'ILT a enquêté sur la manière dont RecyBEM, l'organisation de producteurs responsable de la filière pneus automobiles, a mis en oeuvre ses obligations statutaires250(*). Le rapport d'inspection relève notamment des problèmes méthodologiques dans la comptabilisation des objectifs de réutilisation et de recyclage (absence de déduction du textile contenu dans les pneus) et l'absence de plan pour atteindre l'objectif de réutilisation de 100 % des matériaux d'ici 2030. Il recommande également la révision du décret de 2004 sur la gestion des pneus de voiture, ce dernier étant considéré comme dépassé au regard des nouveaux objectifs en matière d'économie circulaire.
* 1 Représentants de la Commission européenne et de la Représentation permanente de la France auprès de l'UE.
* 2 L'écocontribution est une somme versée par les producteurs, importateurs ou distributeurs de produits aux éco-organismes chargés d'organiser la gestion des déchets liés à ces produits, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP).
* 3 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 4 Un éco-organisme est une structure agréée par les pouvoirs publics, généralement à but non lucratif, chargée de mettre en oeuvre la responsabilité élargie du producteur (REP) dans une filière donnée. Il organise la collecte, le tri, le recyclage ou le traitement des produits en fin de vie, en mutualisant les obligations des producteurs qui financent ces actions via des écocontributions.
* 5 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
* 6 Discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale du 12 juin 2019.
* 7 Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets.
* 8 Rapport du groupe de travail n° 7 « Évaluation » du Cnec de 2023, par Dominique Mignon et Matthieu Glachant.
* 9 La valorisation matière désigne le processus par lequel les déchets sont transformés pour être réintroduits dans un cycle de production sous forme de matières premières secondaires. Cela implique principalement le recyclage, c'est-à-dire la transformation de déchets (plastiques, métaux, papiers, etc.) en matériaux réutilisables.
* 10 Source : réponse de la DGPR au questionnaire.
* 11 Source : Ademe.
* 12 Source : réponse de Valobat au questionnaire des rapporteurs.
* 13 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 14 Les producteurs peuvent, de manière dérogatoire, mettre en place un système individuel de collecte et de traitement agréé, lorsque leurs produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, lorsqu'ils assurent une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'ils disposent d'une garantie financière en cas de défaillance (I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement).
* 15 L'autorité administrative d'instruction des demandes d'agréments est constituée par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie, auprès desquels le dossier de demande d'agrément doit être déposé. La commission interfilières REP, instance de gouvernance des filières, rend un avis sur les projets de cahiers des charges qui fixent le cadre et les objectifs de chacune des filières et sur l'agrément des éco-organismes.
* 16 Les équipements électriques et électroniques (DEEE) (au 5°) ; les piles et accumulateurs (au 6°) ; les véhicules hors d'usage (VHU) (au 15°) ; les emballages ménagers (au 1°) ; les papiers imprimés et les papiers graphiques (au 3°) ; les éléments d'ameublement (DEA) (au 10°) ; les produits textiles, linges de maison et chaussures (au 11°) ; les produits chimiques ménagers (DDS) (au 7°) ; les pneumatiques (au 16°) ; les bateaux de plaisance ou de sport (au 18°) ; les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement (DASRI) (au 9°) et les médicaments à usage humain (au 8°).
* 17 Les emballages professionnels (2025), y compris les emballages utilisés par les professionnels de la restauration (2023) (au 2°) ; les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (2022) (au 4°) ; les jouets (2022) (au 12°) ; les articles de sport et de loisirs (2022) (au 13°) ; les articles de bricolage et de jardin (2022) (au 14°) ; les huiles minérales ou synthétiques (2022) (au 17°) ; les produits du tabac (2021) (au même 19°) ; les gommes à mâcher (les chewing-gums) (2024) (au 20°) ; les textiles sanitaires à usage unique (2024) (au 21°) et les engins de pêche contenant du plastique (2025) (au 22°).
* 18 Source : réponse du Cnec au questionnaire des rapporteurs.
* 19 Source : réponse de Valobat au questionnaire des rapporteurs.
* 20 Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
* 21 Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.
* 22 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
* 23 Le taux de circularité mesure la part des matières premières secondaires (recyclées ou réutilisées) dans l'ensemble des matières utilisées dans une économie, reflétant ainsi son niveau de circularité.
* 24 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.
* 25 Source : réponse de l'éco-organisme Ecologic au questionnaire des rapporteurs.
* 26 Source : contribution écrite de l'Ocab.
* 27 Source : réponse de Coedis au questionnaire des rapporteurs.
* 28 Source : audition de la Fevad.
* 29 Proposition de loi n° 242 (2024-2025) visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois ( dossier législatif).
* 30 Source : DGPR.
* 31 Source : éco-organisme Refashion.
* 32 Source : réponse de Cyclevia au questionnaire des rapporteurs.
* 33 Source : réponse d'Écominero au questionnaire des rapporteurs.
* 34 Source : réponse de Valdelia au questionnaire des rapporteurs.
* 35 Source : réponse de Citeo au questionnaire des rapporteurs.
* 36 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.
* 37 Source : réponse de l'Ocab au questionnaire des rapporteurs.
* 38 Source : réponse d'Alcome au questionnaire des rapporteurs.
* 39 Source : réponse du Collectif des éco-organismes au questionnaire des rapporteurs.
* 40 Source : réponse de la DGCCRF au questionnaire des rapporteurs.
* 41 Source : réponse d'Amorce au questionnaire des rapporteurs.
* 42 Source : réponse de la CiFREP au questionnaire des rapporteurs.
* 43 Source : réponse de la FMB au questionnaire des rapporteurs.
* 44 Source : réponse d'Aliapur au questionnaire des rapporteurs.
* 45 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.
* 46 Texte de compromis du 15 février 2025 sur la directive modifiant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 47 Proposition de loi n° 431 (2023-2024) visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile ( dossier législatif).
* 48 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 49 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 50 Précision méthodologique : les propositions ne sont pas numérotées en fonction de l'ordre d'apparition dans le rapport, mais selon l'ordre donné par les rapporteurs.
* 51 Source : réponse de Valobat au questionnaire des rapporteurs.
* 52 Source : réponse de la FNADE au questionnaire des rapporteurs.
* 53 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.
* 54 Décret n° 2022-990 du 7 juillet 2022 relatif au secrétariat général à la planification écologique.
* 55 Source : réponse de la Fnade au questionnaire des rapporteurs.
* 56 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 57 Article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
* 58 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 59 Source : réponse de l'Ademe au questionnaire des rapporteurs.
* 60 Source : réponse de l'AMF au questionnaire des rapporteurs.
* 61 Source : réponse d'Amorce au questionnaire des rapporteurs.
* 62 Source : réponse de la Fnade au questionnaire des rapporteurs.
* 63 Source : réponse de la Federrec au questionnaire des rapporteurs.
* 64 Source : réponse de l'Association des recycleurs indépendants au questionnaire des rapporteurs.
* 65 Source : réponse Valobat au questionnaire des rapporteurs.
* 66 Rapport IGF-Igedd-CGE, 2024, « Performance et gouvernance des filières REP ».
* 67 Source : réponse du Medef au questionnaire écrit des rapporteurs.
* 68 Source : réponse de l'AMF au questionnaire écrit des rapporteurs.
* 69 Article D. 541-6-1 du code de l'environnement.
* 70 Article L. 541-10 du code de l'environnement.
* 71 Source : réponse de la FIEEC au questionnaire des rapporteurs.
* 72 Source : réponse de Valdelia au questionnaire des rapporteurs.
* 73 Source : réponse de l'AMF au questionnaire des rapporteurs.
* 74 Source : réponse de la Fnade au questionnaire des rapporteurs.
* 75 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.
* 76 Source : réponse de Léko au questionnaire des rapporteurs.
* 77 Source : réponse de l'Ademe au questionnaire des rapporteurs.
* 78 Source : réponse de la CGF au questionnaire des rapporteurs.
* 79 Source : réponse de l'Ademe au questionnaire des rapporteurs.
* 80 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 81 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 82 Source : réponse de l'Ademe au questionnaire des rapporteurs.
* 83 Source : réponse de l'AMF au questionnaire des rapporteurs.
* 84 Source : réponse de la Fnade au questionnaire des rapporteurs.
* 85 Source : réponse de L'Ameublement français au questionnaire des rapporteurs.
* 86 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 87 Les énergies fossiles et l'achat des voitures particulières neuves dites « SUV ».
* 88 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 89 Le gisement de déchets couverts par la filière REP, qui recouvre l'ensemble des déchets pouvant être éventuellement pris en charge par la filière REP, est différent du tonnage effectivement traité par la filière REP.
* 90 Il s'agit de la filière REP Emballages industriels et commerciaux (EIC) en cours de déploiement et de la filière REP Gommes à mâcher.
* 91 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
* 92 Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE.
* 93 Cour des Comptes, septembre 2022, Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser.
* 94 Rapport d'information n° 850 (2022-2023) de Mme Marta de Cidrac fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable relatif à la consigne pour réemploi et recyclage sur les emballages, du 5 juillet 2023.
* 95 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 96 Source : réponse de France Biodéchets au questionnaire des rapporteurs.
* 97 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 98 Source : réponse d'Intercommunalités de France au questionnaire des rapporteurs.
* 99 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 100 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.
* 101 Article R. 541-46 du code de l'environnement.
* 102 Source : réponse d'Ecologic au questionnaire des rapporteurs.
* 103 Source : Ademe, Bilan annuel de la filière des jouets -- Données 2023.
* 104 Rapport IGF-Igedd-CGE, 2024, « Performance et gouvernance des filières REP ».
* 105 Source : réponse de Halte à l'obsolescence programmée au questionnaire des rapporteurs.
* 106 HOP, Janvier 2024, Bonus réparation, Retour d'expérience de consommateurs et réparateurs sur le fonds réparation des équipements électriques et électroniques (EEE).
* 107 Les autres filières REP se voient tout de même fixer des objectifs de réemploi dans leur cahier de charges, les éco-organismes doivent donc mobiliser des moyens financiers adéquats destinés à atteindre ces objectifs.
* 108 Source : Ademe.
* 109 Source : réponse de Citeo au questionnaire des rapporteurs.
* 110 Source : réponse d'Elipso au questionnaire des rapporteurs.
* 111 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.
* 112 Source : réponse de l'Union pour un Réemploi Solidaire au questionnaire des rapporteurs.
* 113 Rapport IGF-Igedd-CGE, 2024, « Performance et gouvernance des filières REP ».
* 114 Source : réponse de la DGCCRF au questionnaire des rapporteurs.
* 115 Source : contribution écrite de la Banque des territoires.
* 116 Ministère de la transition écologique, 2025, « Réduire nos usages du plastique : la France s'engage ».
* 117 Source : réponse de la Fnade au questionnaire écrit des rapporteurs.
* 118 Source : réponse de l'association Orée au questionnaire écrit des rapporteurs.
* 119 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cadre-general-filieres-responsabilite-elargie-producteurs.
* 120 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 121 Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32000L0053.
* 122 Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj?locale=fr.
* 123 Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=oj:JOL_2012_197_R_0038_01.
* 124 La notion d'emballage est définie à l'article 3 de la directive comme suit : « un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l'acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d'emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception. ».
* 125 Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages.
* 126 Principalement les filtres de cigarettes (deuxième article en plastique à usage unique le plus fréquemment retrouvé sur les plages de l'UE), les lingettes humides et les ballons de baudruche.
* 127 Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
* 128 Révision de la directive-cadre 2008/98/CE sur les déchets - introduction de nouvelles dispositions sur le textile et le gaspillage alimentaire : https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-eu-waste-framework (consulté le 12/03/2025).
* 129 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen ( Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG).
* 130 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw38-de-abfallrahmenrichtlinie-791764 (consulté le 24 mars 2025).
* 131 https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallpolitik/uebersicht-kreislaufwirtschaftsgesetz/die-obhutspflicht-im-kreislaufwirtschaftsgesetz (consulté le 25 mars 2025).
* 132 Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen ( Altfahrzeug-Verordnung - AltfahrzeugV).
* 133 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0053.
* 134 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren ( Batteriegesetz - BattG).
* 135 Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj?locale=fr.
* 136 Batterie-Recht-Durchführungsgesetz ( BattDG).
* 137 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten ( Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG).
* 138 Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
* 139 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen ( Verpackungsgesetz - VerpackG).
* 140 Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages
* 141 Gesetz über den Einwegkunststofffonds ( Einwegkunststofffondsgesetz - EWKFondsG).
* 142 Directive (UE) 2019/904 du parlement européen et du conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
* 143 Altölverordnung.
* 144 www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallpolitik/produktverantwortung (consulté le 23 mars 2025).
* 145 En France, pour la filière des DEEE, l'obligation d'enregistrement des producteurs est assurée par l'ADEME.
* 146 Toutes les boissons sont concernées, y compris les produits laitiers, les jus de fruits et certaines boissons alcoolisées de moins de 15 % (notamment bière, crémant et vin). Liste détaillée à retrouver - en allemand - sur le site internet d'information des consommateurs suivant :
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/abfall/fragen-und-antworten-zum-einwegpfand-dosenpfand-11505 (consulté le 21 mars 2025).
* 147 DS Entsorgungs GmbH, GRS Consumer, GRS eMobility, GRS Healthcare, GRS Powertools, ÖcoReCell, PreZero Return2Value, REBAT, REBAT+ et Rücknahmesystem der Stiftung GRS Batterien. Voir : https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battgruecknahmesysteme#no-back (consulté le 23 mars 2025).
* 148 https://www.muelltrennung-wirkt.de/de/ueber-uns/ueber-die-dualen-systeme/ (consulté le 25 mars 2025).
* 149 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen ( Verpackungsgesetz - VerpackG).
* 150 Verpackungsgesetz, § 22.
* 151 Gesetz über Gebühren und Auslagen des Bundes ( Bundesgebührengesetz - BGebG), §9.
* 152 Verpackungsgesetz, § 22.
* 153 Verpackungsgesetz, § 23.
* 154 En règle générale, les contrats sont conclus pour une durée de trois ans. Ils sont renouvelés annuellement par tiers. La mise en concurrence est faite à l'échelle fédérale. Les appels d'offres sont publiés pendant deux mois sur la plateforme en ligne suivante :
https://www.ausschreibung-erfassung.de/web/gap/ (consulté le 18/03/2025).
* 155 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), §§122 ff .
* 156 Verpackungsgesetz, § 18.
* 157 Verpackungsgesetz, § 14.
* 158 Verpackungsgesetz, § 26.
* 159 Dans un jugement de 2023, le Tribunal administratif fédéral de Leipzig confirme le statut d'autorité publique de la CEE et, partant, de l'administrativité de ses contentieux : https://www.bverwg.de/de/090123B10AV1.23.0.
* 160 Verpackungsgesetz, § 25.
* 161 Verpackungsgesetz, § 28.
* 162 En Allemagne, ces associations sont le Deutscher Städtetag (représentant les villes), le Deutscher Landkreistag (représentant les arrondissements) et le Deutscher Städte-und Gemeindebund (représentant les communes et certaines villes).
* 163 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
* 164 Site internet de la Chambre de commerce franco-espagnole, page sur les emballages et les déchets d'emballage.
* 165 Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
* 166 https://ecolec.es/informacion-y-recursos/responsabilidad-ampliada-del-productor/ (consulté le 31 mars 2025).
* 167 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
* 168 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada.html (consulté le 20 mars 2025).
* 169 Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
* 170 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
* 171 Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
* 172 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
* 173 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.
* 174 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
* 175 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
* 176 Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
* 177 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
* 178 Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
* 179 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
* 180 Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario.
* 181 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
* 182 Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.
* 183 Real Decreto 1093/2024, de 22 de octubre, por el que se regula la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros y de los filtros comercializados para utilizarse con productos del tabaco que contengan plástico y que sean de un solo uso.
* 184 Secartys, page « Nuevas obligaciones en materia de ENVASES para empresas en 2024 - CICAT » (consulté le 17 mars 2025).
* 185 Plataforma electrónica de gestión de residuos.
* 186 https://www.conai.org/chi-siamo/cose-conai/ (consulté le 26 mars 2025).
* 187 Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
* 188 Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
* 189 Decreto legislative 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.
* 190 La Commission européenne a ouvert en juillet 2024 une procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie pour mauvaise transposition des dispositions relatives à la REP de la directive 2018/851/UE (procédure INFR(2024)2097). Les recherches n'ont toutefois pas permis de connaître le détail des faits reprochés.
* 191 Le ministre en charge de l'agriculture doit également cosigner le décret dans ses domaines de compétence.
* 192 Ministero della transizione ecologica, Strategia nazionale per l'economia circolare, 2022, pp. 51 et suivantes.
* 193 Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
* 194 https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-d (consulté le 27 mars 2025).
* 195 Selon l'article 2602 du code civil, « Par le contrat de consortium, plusieurs entrepreneurs mettent en place une organisation commune pour la régulation ou l'exécution de certaines étapes de leurs entreprises respectives ».
* 196 https://www.polieco.it/NewseMedia/ComunicatiStampa/TabId/2299/ArtMID/3093/ArticleID/2619/POLIECO-%E2%80%9CITALIA-VERA-ECCELLENZA-DEL-RICICLO-NARRAZIONE-FALSATA%E2%80%9D (consulté le 28 mars 2025).
* 197 https://www.conai.org/chi-siamo/governance/ (consulté le 28 mars 2025).
* 198 Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
* 199 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/funzionamento-del-sistema-raee/ (consulté le 28 mars 2025).
* 200 Ibid.
* 201 Ibid.
* 202 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/sistemi-collettivi/ (consulté le 28 mars 2025).
* 203 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/comuni/ (consulté le 28 mars 2025).
* 204 Voir l'accord de programme 2025-2027 : https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/03/Accordo-di-Programma-2025-2027_1.0.pdf (consulté le 28 mars 2025).
* 205 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/comuni/ (consulté le 28 mars 2025).
* 206 Ce registre électronique regroupe les registres par filières préexistants.
* 207 Ministero della transizione ecologica, Strategia nazionale per l'economia circolare, p. 52.
* 208 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Decreto 15 dicembre 2023, Obiettivi specifici e modalita' di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Créé par l'article 206 bis du décret législatif 152/2006, le conseil de surveillance n'est opérationnel que depuis 2024.
* 209 Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030.
* 210 Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer.
* 211 https://circulairmaterialenplan.nl/ (consulté le 12 mars 2025).
* 212 https://circulairmaterialenplan.nl/cmp/ (consulté le 12 mars 2025).
* 213 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/algemeen-verbindend-verklaring/ (consulté le 13 mars 2025).
* 214 Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
* 215 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/upv/ (consulté le 13 mars 2025).
* 216 Ibid.
* 217 Au 1er mars 2025. Voir la liste complète sur : https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/ (consulté le 13 mars 2025).
* 218 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/upv/ (consulté le 13 mars 2025).
* 219 Ibid.
* 220 Ibid.
* 221 Burgerlijk Wetboek Boek 2, article 285.
*
222 Centraal Planbureau (CPB),
Uitgebreide
producenten-verantwoordelijkheid: casestudies over batterijen, autowrakken en
medicijnen in Nederland, 2021, pp. 8-20
et
https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/batterijen-accu/
(consulté le 18 mars 2025).
* 223 Ibid.
* 224 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-autobanden/.
et https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/upv-autobanden (consulté le 18 mars 2025).
* 225 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-elektr-on-ische-apparaten/.
et https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 18 mars 2025).
*
226
https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-verpakkingen/
et
https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/upv-verpakkingen
(consulté le 18 mars 2025).
* 227 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-wegwerpplastic/ (consulté le 18 mars 2025).
* 228 Ce texte prévoit également l'interdiction de mise sur le marché aux Pays-Bas d'un certain nombre d'articles en plastique à usage unique : cotons-tiges, couverts, assiettes, pailles, agitateurs pour boissons et tiges fixées à des ballons.
*
229
https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-textiel/
et
https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/upv-textiel
(consulté le 18 mars 2025).
* 230 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-papier-karton/ (consulté le 18 mars 2025).
* 231 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-matrassen/ (consulté le 18 mars 2025).
*
232
https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-vlakglas/
et
https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/vrijwillige-upv-consumentenmatrassen
(consulté le 18 mars 2025).
* 233 www.afvalcirculair.nl/publish/pages/236101/pbaav19001_prn.pdf&ved=2ahUKEwiRqKztvJiMAxVscKQEHdKWLPoQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw3OQijDP4uwlQ7XQbSQUHYp (consulté le 20 mars 2025).
* 234 Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton, niet zijnde verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lors du dernier renouvellement, les 613 producteurs signataires représentaient 75,12 % du volume de papier et carton commercialisé mais seulement 34 % des producteurs, ce qui ne correspondait pas à la définition d'une « majorité significative ». Néanmoins, au nom d'une gestion efficace des déchets, le ministre de l'environnement a écarté cette définition et déclaré l'accord contraignant pour l'ensemble des producteurs.
* 235 Papiervezelconvenant VII.
* 236 https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/prn/ (consulté le 20 mars 2025).
* 237 https://prn.nl/stichting-verwijderingsfonds/ (consulté le 20 mars 2025).
* 238 Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton, niet zijnde verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, p. 8.
* 239 https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/prn-systeem/ (consulté le 20 mars 2025).
* 240 https://prn.nl/nieuws/heffing-recyclingbeheerbijdrage-systeemkosten/ (consulté le 20 mars 2025).
* 241 Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton, niet zijnde verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Annexe 1.
* 242 https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/feiten-en-cijfers/ (consulté le 20 mars 2025).
* 243 Ibid.
* 244 https://prn.nl/nieuws/circulair-materialenplan-cmp-een-gemiste-kans-voor-de-kringloop-van-papier-en-karton/.
* 245 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kamerbrief over doorontwikkeling UPV, octobre 2023.
* 246 Pour mémoire, des élections législatives ont eu lieu aux Pays-Bas en novembre 2023 et, après de longues négociations pour la formation d'une coalition gouvernementale, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions en juillet 2024.
* 247 https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 20 mars 2025).
* 248 https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 18 mars 2025).
* 249 https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 18 mars 2025).
* 250 Inspectie Leefomgeving en Transport, Uitvoering en verslaglegging UPV autobanden, 2024.